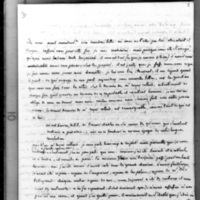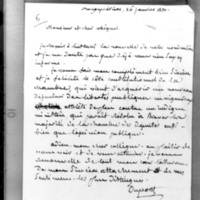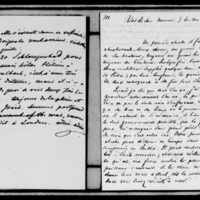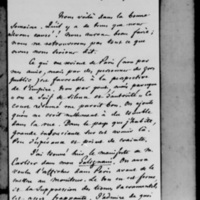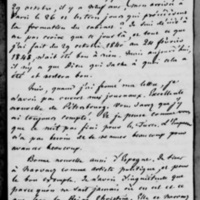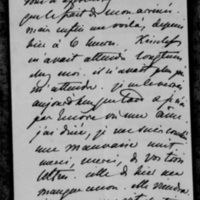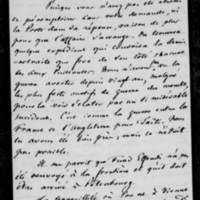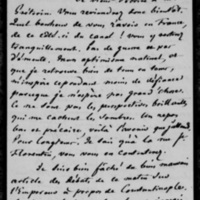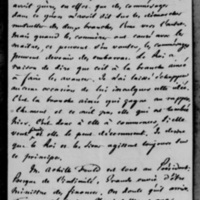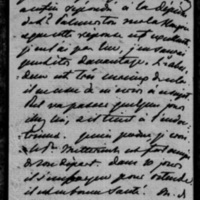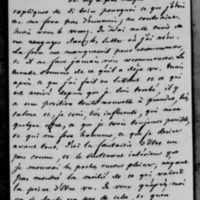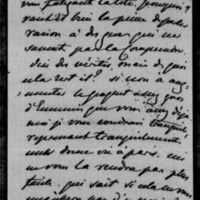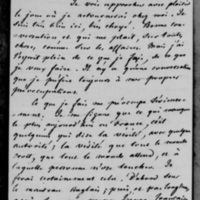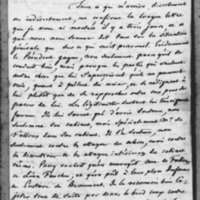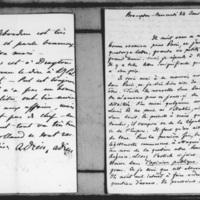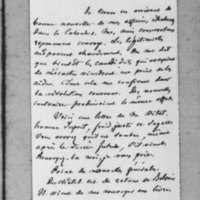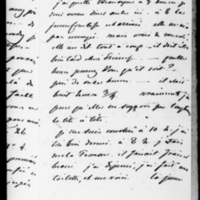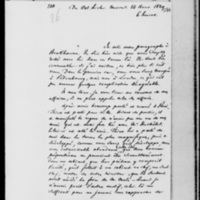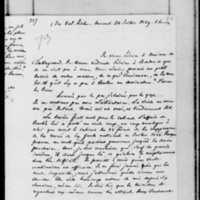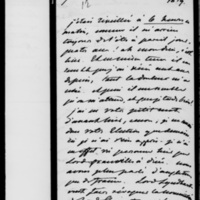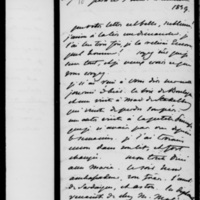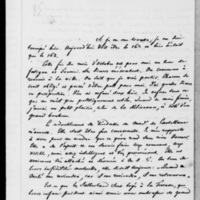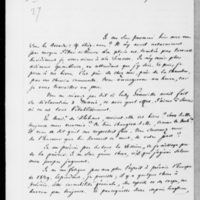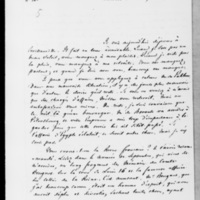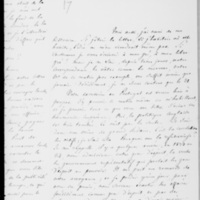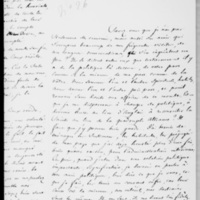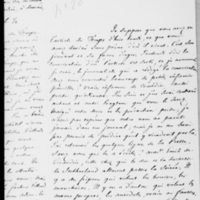Votre recherche dans le corpus : 83 résultats dans 3296 notices du site.
Trier par :
Clermont, le 21 mars 1816, Le comte de Montlosier à François Guizot
Auteur : Montlosier, François Dominique de Reynaud de (1755-1838)
Laffitte, le 21 octobre 1838, Eloi Mallac à François Guizot
Auteur : Mallac, Eloi (1809-1876)
Rouge-Perriers, le 26 janvier 1830, Dupont de l'Eure à François Guizot
Auteurs : Dupont de l'Eure, Jacques-Charles (1767-1855)
Paris, le 6 avril 1849, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Auteur : Dumon, Pierre-Sylvain (1797-1870)
111. Val Richer, Mercredi 5 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1854 (1er janvier-21 décembre) : Dorothée, une princesse russe, persona non grata à Paris
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
111 Val Richer, Mercredi 5 Juillet 1854
Au pouvoir absolu, il faut absolument deux choses, un grand homme et du bonheur, toujours un grand homme et toujours du bonheur. Quelquefois, l’une de les deux conditions supplée quelque temps au défaut de l'autre ; pas bien longtemps. Et quand toutes les deux manquent à la fois tout s'en va. Quand je dis que tout s'en va, j’ai tort ; la grandeur certainement s'en va, la puissance au loin et par la seule voie d'influence. Mais il y a des temps et des lieux où le pouvoir absolu est si naturel et si nécessaire, si bien peut-être le seul gouvernement possible, que la grandeur peut lui manquer sans grand péril intérieur. Je crois que c’est votre cas. Votre pouvoir absolu peut déchoir en Europe, sans être compromis en Russie. Il peut rentrer chez lui triste ressource ; ressource réelle pourtant et qui est une force contre les plus puissants ennemis. Si les choses continuent dans leur cours actuel c'est la ressource dont vous serez réduite à user.
Vous n'aurez seulement pas très bonne grace à en user parce que vous avez beaucoup fait blanc de votre épée au dehors. L'Empereur Alexandre pouvait se retirer glorieusement, héroïquement devant l'Empereur Napoléon ; il avait toujours été modeste, en n'était point allé chercher, avec fracas, la guerre qu’on venait lui faire.
Vous ne pouvez faire maintenant aucune concession qui détache l’Autriche de l'alliance ; elle est tiré pour son propre compte ; il lui faut, comme aux deux autres des satisfactions sérieuses, non des palliatifs. A moins que vous ne battiez les armées Autrichiennes, mieux, beaucoup mieux, que vous n’avez battu les armées turques. Ceci serait un gros événement. Qui sait ? Depuis 1848, je ne prédis plus et je ne crois plus qu'à long terme, en prenant du temps, beaucoup de temps ; je ne vois clair que de loin ; de près, je vis dans les ténèbres ; du jour au lendemain, je suis très modeste. Je donne mes conjectures, mais sans y compter. Tout est possible. Vous repasserez peut-être bientôt le Danube. Mais la situation générale n'en serait pas changée. Sans grand homme, l’Angleterre persistera et fera persister les autres. Elle a un grand gouvernement. Je vois avec plaisir que le général Luders n'est pas mort. Je ne le connais pas du tout ; mais la mort prématuré d’un homme distingué me déplait toujours.
La nouvelle insurrection Espagnole ne paraît pas avoir plus de succès que les autres. Quand Mérimée est revenu de Madrid l'hiver dernier, il disait à qui voulait l’entendre que la Reine n'en avait pas six mois et que tout le monde n'en voulait plus qu’à elle. Voilà deux insurrections, depuis, toutes deux sans succès, et toutes deux criant : " Vive la Reine. "
J’attends le texte de votre réponse à la sommation Autrichienne ; je ne puis croire que vous ayez dit : " jusqu'à notre dernier homme et notre dernier rouble. " On ne dit pas cela, même quand on le fait. C’est un lieu commun populaire qui ne vous va pas.
Midi
Rien que des nouvelles d’Espagne, et l'attente de quelque coup dans la Baltique. Adieu, Adieu. G.
Au pouvoir absolu, il faut absolument deux choses, un grand homme et du bonheur, toujours un grand homme et toujours du bonheur. Quelquefois, l’une de les deux conditions supplée quelque temps au défaut de l'autre ; pas bien longtemps. Et quand toutes les deux manquent à la fois tout s'en va. Quand je dis que tout s'en va, j’ai tort ; la grandeur certainement s'en va, la puissance au loin et par la seule voie d'influence. Mais il y a des temps et des lieux où le pouvoir absolu est si naturel et si nécessaire, si bien peut-être le seul gouvernement possible, que la grandeur peut lui manquer sans grand péril intérieur. Je crois que c’est votre cas. Votre pouvoir absolu peut déchoir en Europe, sans être compromis en Russie. Il peut rentrer chez lui triste ressource ; ressource réelle pourtant et qui est une force contre les plus puissants ennemis. Si les choses continuent dans leur cours actuel c'est la ressource dont vous serez réduite à user.
Vous n'aurez seulement pas très bonne grace à en user parce que vous avez beaucoup fait blanc de votre épée au dehors. L'Empereur Alexandre pouvait se retirer glorieusement, héroïquement devant l'Empereur Napoléon ; il avait toujours été modeste, en n'était point allé chercher, avec fracas, la guerre qu’on venait lui faire.
Vous ne pouvez faire maintenant aucune concession qui détache l’Autriche de l'alliance ; elle est tiré pour son propre compte ; il lui faut, comme aux deux autres des satisfactions sérieuses, non des palliatifs. A moins que vous ne battiez les armées Autrichiennes, mieux, beaucoup mieux, que vous n’avez battu les armées turques. Ceci serait un gros événement. Qui sait ? Depuis 1848, je ne prédis plus et je ne crois plus qu'à long terme, en prenant du temps, beaucoup de temps ; je ne vois clair que de loin ; de près, je vis dans les ténèbres ; du jour au lendemain, je suis très modeste. Je donne mes conjectures, mais sans y compter. Tout est possible. Vous repasserez peut-être bientôt le Danube. Mais la situation générale n'en serait pas changée. Sans grand homme, l’Angleterre persistera et fera persister les autres. Elle a un grand gouvernement. Je vois avec plaisir que le général Luders n'est pas mort. Je ne le connais pas du tout ; mais la mort prématuré d’un homme distingué me déplait toujours.
La nouvelle insurrection Espagnole ne paraît pas avoir plus de succès que les autres. Quand Mérimée est revenu de Madrid l'hiver dernier, il disait à qui voulait l’entendre que la Reine n'en avait pas six mois et que tout le monde n'en voulait plus qu’à elle. Voilà deux insurrections, depuis, toutes deux sans succès, et toutes deux criant : " Vive la Reine. "
J’attends le texte de votre réponse à la sommation Autrichienne ; je ne puis croire que vous ayez dit : " jusqu'à notre dernier homme et notre dernier rouble. " On ne dit pas cela, même quand on le fait. C’est un lieu commun populaire qui ne vous va pas.
Midi
Rien que des nouvelles d’Espagne, et l'attente de quelque coup dans la Baltique. Adieu, Adieu. G.
56. Val Richer, Lundi 5 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
56 Val Richer. Lundi 5 Sept 1853
Il y a aujourd’hui trente sept ans que M. de Cazes, Pozzo, le chancelier et moi nous étions ravis du succès de plusieurs notes que nous avions rédigées pour Louis XVIII, et qui l’avaient décidé à dissoudre la Chambre introuvable de 1815. La France à peu près entière était aussi ravie que nous. Qui pense aujourd’hui à la chambre introuvable et à l'ordonnance du 5 septembre ? Il y a pour les événements, un mauvais moment ; c’est celui, où ils ne sont plus du présent, et pas encore du passé ; il faut vivre dans la politique ou dans l’histoire. Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que racontent les journaux sur la rencontre de l'Empereur d’Autriche et de la princesse Bavaroise à Ischl, et sur la soudaineté de ce mariage ? Tous les hommes, les Allemands plus que d’autres ont envie d’un peu de roman partout. C'est un signe de folie chez un peuple que d'en vouloir trop ; c’est un signe de décadence morale de n'en plus vouloir du tout.
Parle-t-on du remplacement de ce pauvre Garibaldi, et par qui ? Si les gens de Mazzini tentent encore, comme il paraît des conspirations à Rome, cela servirait-il, ou non, auprès du Pape, les désirs de l'Empereur Napoléon ? Le temps qui s'écoule ôte de la chance à ces désirs comme de la valeur à leur objet. Il y aurait quelque chose d'étrange et presque de ridicule à être sacré Empereur longtemps après l'être devenu. Il faut que le ciel et la terre concourent, en même temps aux grandes choses ; Dieu ne peut pas y venir quand on n’y pense plus, et comme un ornement de surérogation. Au lieu de questions de loin nous causerons la semaine prochaine, je compte, sauf obstacle imprévu, partir d’ici, samedi soir 10, et être à Paris, Dimanche matin. J'espère vous trouver reposée, Sauf les diplomates, vous n'avez, ce me semble, ni causeur, ni informateur en ce moment. Fould et Morny sont absents. Il vous faut quelqu’un de ce côté-là. Adieu, adieu. Voici ma réponse à Marion.
Onze heures
Ni moi, non plus comme de raison, je n’ai rien de nouveau à vous dire. On me dit qu’en effet les Anglais en général sont assez noirs. Adieu.
Il y a aujourd’hui trente sept ans que M. de Cazes, Pozzo, le chancelier et moi nous étions ravis du succès de plusieurs notes que nous avions rédigées pour Louis XVIII, et qui l’avaient décidé à dissoudre la Chambre introuvable de 1815. La France à peu près entière était aussi ravie que nous. Qui pense aujourd’hui à la chambre introuvable et à l'ordonnance du 5 septembre ? Il y a pour les événements, un mauvais moment ; c’est celui, où ils ne sont plus du présent, et pas encore du passé ; il faut vivre dans la politique ou dans l’histoire. Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que racontent les journaux sur la rencontre de l'Empereur d’Autriche et de la princesse Bavaroise à Ischl, et sur la soudaineté de ce mariage ? Tous les hommes, les Allemands plus que d’autres ont envie d’un peu de roman partout. C'est un signe de folie chez un peuple que d'en vouloir trop ; c’est un signe de décadence morale de n'en plus vouloir du tout.
Parle-t-on du remplacement de ce pauvre Garibaldi, et par qui ? Si les gens de Mazzini tentent encore, comme il paraît des conspirations à Rome, cela servirait-il, ou non, auprès du Pape, les désirs de l'Empereur Napoléon ? Le temps qui s'écoule ôte de la chance à ces désirs comme de la valeur à leur objet. Il y aurait quelque chose d'étrange et presque de ridicule à être sacré Empereur longtemps après l'être devenu. Il faut que le ciel et la terre concourent, en même temps aux grandes choses ; Dieu ne peut pas y venir quand on n’y pense plus, et comme un ornement de surérogation. Au lieu de questions de loin nous causerons la semaine prochaine, je compte, sauf obstacle imprévu, partir d’ici, samedi soir 10, et être à Paris, Dimanche matin. J'espère vous trouver reposée, Sauf les diplomates, vous n'avez, ce me semble, ni causeur, ni informateur en ce moment. Fould et Morny sont absents. Il vous faut quelqu’un de ce côté-là. Adieu, adieu. Voici ma réponse à Marion.
Onze heures
Ni moi, non plus comme de raison, je n’ai rien de nouveau à vous dire. On me dit qu’en effet les Anglais en général sont assez noirs. Adieu.
N°39. Val-Richer, Lundi 12 juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
39 Val Richer, 12 Juillet 1852
C'est curieux à quel point on peut vivre dans le passé. Je m'occupe des nouvelles d'aujourd’hui, je lis mes journaux par routine, par convenance ; au fond, ce n’est pas à cela que je pense spontanément et avec intérêt l’histoire de Cromwell, et ma propre histoire de 1830 à 1848 voilà ce qui m'interesse, ce qui remplit, et anime mon esprit. C'est dommage que vous n'ayiez pas la même disposition ; je serais bien plus intéressant pour vous. Mais vous m'aimez que le présent vous êtes la contemporaine par excellence.
Que va-t-il arriver en Angleterre ? Vous devriez bien me le dire, car cela, j'en suis curieux aussi, selon ma conjecture, rien de décisifs, quand ils n’ont point de grande entreprise sur les bras et point de grand homme à leur tête, ils savent vivre, modestement au jour le jour faisant petitement leurs petites affaires, et se contentant de ne point faire de grosses sottises. Si le Président a la même sagesse il durera tant qu’il voudra.
Je suis bien aise que les radicaux des corps francs laissent Thiers tranquille à Verrey. Quand les justices providentielles arrivent, mon premier mouvement est la satisfaction. Mais je pense très vite aux personnes à leurs souffrances, à leurs chagrins, et je n’ai plus du tout soif de justice. D'ailleurs, après ses amis ce qu’on aime le mieux ce sont ses ennemis. Je m'intéresse à Thiers. Je ne le voudrais pas puissant mais point malheureux. Je ne vois pas pourquoi on met M. Drouyn de Lhuys aux affaires étrangères à la place de M. Turgot ; il a un peu plus d'encolure diplomatique au fond. Il ne fera ni plus, ni mieux. Passe pour ôter M. Duruffé des travaux public ; on peut avoir là un homme capable ; il y sera utile sans y être embarrassant. Est-ce que M. Magne, qui y était du temps de M. Fould ne serait pas disposé à y revenir ? C'est un homme vraiment capable. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. J’ai vu hier quelqu'un qui venait de Dieppe. Il dit qu’il y a beaucoup de monde, et très bonne compagnie, et qu’on trouve très bien à s'y loger. Mais je ne me fie pas à ce rapport, c’est un homme du pays, moins difficile que vous en fait de logement. Il vous faut la plage, ou près de la plage et un bon appartement dans la meilleure auberge.
Je vous quitte pour attendre plus patiemment le facteur en faisant ma toilette. Malgré la chaleur j'irai faire aujourd'hui une visite à trois lieues, dans un assez joli château. J’ai là un voisin savant, antiquaire infatigable qui ne vit qu’avec Guillaume le conquérant et Bossuet.
11 heures
Je suis bien aise que votre temps soit si plein, et vous savez que je ne me fâche jamais. à demain la conversation sur mon peu de curiosité en ce moment. Si j’avais pu aller à Paris, j’y serais allé pour vous voir plus que pour vous entendre. Je vous écrirai donc demain à Dieppe. Adieu, adieu. G.
C'est curieux à quel point on peut vivre dans le passé. Je m'occupe des nouvelles d'aujourd’hui, je lis mes journaux par routine, par convenance ; au fond, ce n’est pas à cela que je pense spontanément et avec intérêt l’histoire de Cromwell, et ma propre histoire de 1830 à 1848 voilà ce qui m'interesse, ce qui remplit, et anime mon esprit. C'est dommage que vous n'ayiez pas la même disposition ; je serais bien plus intéressant pour vous. Mais vous m'aimez que le présent vous êtes la contemporaine par excellence.
Que va-t-il arriver en Angleterre ? Vous devriez bien me le dire, car cela, j'en suis curieux aussi, selon ma conjecture, rien de décisifs, quand ils n’ont point de grande entreprise sur les bras et point de grand homme à leur tête, ils savent vivre, modestement au jour le jour faisant petitement leurs petites affaires, et se contentant de ne point faire de grosses sottises. Si le Président a la même sagesse il durera tant qu’il voudra.
Je suis bien aise que les radicaux des corps francs laissent Thiers tranquille à Verrey. Quand les justices providentielles arrivent, mon premier mouvement est la satisfaction. Mais je pense très vite aux personnes à leurs souffrances, à leurs chagrins, et je n’ai plus du tout soif de justice. D'ailleurs, après ses amis ce qu’on aime le mieux ce sont ses ennemis. Je m'intéresse à Thiers. Je ne le voudrais pas puissant mais point malheureux. Je ne vois pas pourquoi on met M. Drouyn de Lhuys aux affaires étrangères à la place de M. Turgot ; il a un peu plus d'encolure diplomatique au fond. Il ne fera ni plus, ni mieux. Passe pour ôter M. Duruffé des travaux public ; on peut avoir là un homme capable ; il y sera utile sans y être embarrassant. Est-ce que M. Magne, qui y était du temps de M. Fould ne serait pas disposé à y revenir ? C'est un homme vraiment capable. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. J’ai vu hier quelqu'un qui venait de Dieppe. Il dit qu’il y a beaucoup de monde, et très bonne compagnie, et qu’on trouve très bien à s'y loger. Mais je ne me fie pas à ce rapport, c’est un homme du pays, moins difficile que vous en fait de logement. Il vous faut la plage, ou près de la plage et un bon appartement dans la meilleure auberge.
Je vous quitte pour attendre plus patiemment le facteur en faisant ma toilette. Malgré la chaleur j'irai faire aujourd'hui une visite à trois lieues, dans un assez joli château. J’ai là un voisin savant, antiquaire infatigable qui ne vit qu’avec Guillaume le conquérant et Bossuet.
11 heures
Je suis bien aise que votre temps soit si plein, et vous savez que je ne me fâche jamais. à demain la conversation sur mon peu de curiosité en ce moment. Si j’avais pu aller à Paris, j’y serais allé pour vous voir plus que pour vous entendre. Je vous écrirai donc demain à Dieppe. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Lundi 12 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 12 Nov. 1849
8 heures
Nous voilà dans la bonne semaine. Qu'il y a de temps que nous n'avons causé. Nous aurons beau faire. nous ne retrouverons pas tout ce que nous nous serions dit. Ce qui me revient de Paris (non par mes amis, mais par des personnes du gros public) est favorable à la perspective de l'Empire. Non par goût, mais parce que " on a soif de silence et d'autorité. " Ce court résumé me paraît bon. On ajoute qu’on ne croit nullement à du trouble dans la rue. Dans le pays que j'habite, grande insouciance sur cet avenir-là. Peu d’espérance, et point de crainte. J’ai trouvé hier le manifeste de M. Carlier dans mon Galignani. On aura voulu l'afficher dans Paris avant de le mettre au Moniteur. Le ton en est ferme et la suppression des termes sacramentels est assez frappante. J'admire de quoi on est réduit à être frappé. Si l'Empire fait, ou si, pour faire l'Empire, on fait la loi sur les gardes nationales dont le Prince Paul vous a parlé, cela seul vaut la peine de courir l'aventure. Mais je doute qu'on ose cela du moins aujourd’hui. Je suis assez curieux du Ministre des Affaires étrangères. Tenez pour certain que si c’est le Prince de la Moskowa, c'est très dangereux. Tout autre est préférable. Je serai charmé d'entendre le discours du Duc de Noailles. Seul d’abord, et puis à l'Académie. J’ai quelque peine à me figurer l'académie et tous les passetemps, littéraires ou autres de Paris. J’ai pris depuis si longtemps l'habitude de ne voir, dans Paris que l’une de ces deux choses, gouvernement ou révolution, qu'il me faut un effort pour y voir autre chose. Je ne me propose pas du reste de prendre grande part à ce qui s’y voit. Il me convient de porter le deuil et j'en profiterai. Mon penchant, et pas de voiture, et l’hiver, ce sont de bonnes raisons pour courir très peu. On m’écrit que ma petite maison est bien arrangée, et sera agréable à habiter. Vous devez bien jouir de votre appartement par ce charmant temps que nous avons depuis huit jours.
Onze heures et demie
Rien à ajouter. Et probablement pas grand'chose à dire d’ici à trois jours. Adieu, adieu. Adieu. Et encore. G.
8 heures
Nous voilà dans la bonne semaine. Qu'il y a de temps que nous n'avons causé. Nous aurons beau faire. nous ne retrouverons pas tout ce que nous nous serions dit. Ce qui me revient de Paris (non par mes amis, mais par des personnes du gros public) est favorable à la perspective de l'Empire. Non par goût, mais parce que " on a soif de silence et d'autorité. " Ce court résumé me paraît bon. On ajoute qu’on ne croit nullement à du trouble dans la rue. Dans le pays que j'habite, grande insouciance sur cet avenir-là. Peu d’espérance, et point de crainte. J’ai trouvé hier le manifeste de M. Carlier dans mon Galignani. On aura voulu l'afficher dans Paris avant de le mettre au Moniteur. Le ton en est ferme et la suppression des termes sacramentels est assez frappante. J'admire de quoi on est réduit à être frappé. Si l'Empire fait, ou si, pour faire l'Empire, on fait la loi sur les gardes nationales dont le Prince Paul vous a parlé, cela seul vaut la peine de courir l'aventure. Mais je doute qu'on ose cela du moins aujourd’hui. Je suis assez curieux du Ministre des Affaires étrangères. Tenez pour certain que si c’est le Prince de la Moskowa, c'est très dangereux. Tout autre est préférable. Je serai charmé d'entendre le discours du Duc de Noailles. Seul d’abord, et puis à l'Académie. J’ai quelque peine à me figurer l'académie et tous les passetemps, littéraires ou autres de Paris. J’ai pris depuis si longtemps l'habitude de ne voir, dans Paris que l’une de ces deux choses, gouvernement ou révolution, qu'il me faut un effort pour y voir autre chose. Je ne me propose pas du reste de prendre grande part à ce qui s’y voit. Il me convient de porter le deuil et j'en profiterai. Mon penchant, et pas de voiture, et l’hiver, ce sont de bonnes raisons pour courir très peu. On m’écrit que ma petite maison est bien arrangée, et sera agréable à habiter. Vous devez bien jouir de votre appartement par ce charmant temps que nous avons depuis huit jours.
Onze heures et demie
Rien à ajouter. Et probablement pas grand'chose à dire d’ici à trois jours. Adieu, adieu. Adieu. Et encore. G.
Val-Richer, Dimanche 11 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 11 Nov. 1849
8 heures
Je suis de l’avis de Lord John sur la boutade du Président. Le rapport de Thiers sur les affaires de Rome en a été, sinon la cause, du moins l'occasion déterminante. C’était bien insultant de ne pas dire un mot du président et de sa lettre, comme s’ils n'eussent pas existé. Et c'était bien léger d'insulter ainsi l'homme qu'on a élevé et qu’on ne peut renverser. Cette faute a fait éclore la disposition du Président, disposition préexistante, mais jusque là contenue, et qui probablement fût restée encore à l'état latent, comme dirait le Ministre actuel du commerce. M Dumas, grand chimiste. Je vois d'après ce qui me revient que les hommes intelligents de la majorité ont le sentiment de cette faute, et la regrettent. Mais c’est fait. Et la boutade du président aussi, Tout cela suivra son cours. Puisque Flahaut n'en veut pas être, il a bien fait de s'en aller. Je crois que la faute du Rapport était facile à éviter. Il était facile de faire sur la lettre un paragraphe convenable qui dégageât complètement, l'assemblée de la politique du président en donnant au président lui-même satisfaction pour sa dignité et avertissement pour son gouvernement personnel.
Je suis charmé que Lord John prenne ainsi goût, non seulement à avoir des lettres de vous, mais à vous écrire. Il n'aurait pas vos lettres sans cela, et il a raison d'en vouloir. Vous excellez à rendre la vérité agréable.
Je dis comme vous pour ce qui touche ma situation personnelle en reparaissant. Nous verrons. Nous devons avoir ce qu’il faudra d'habileté et de bon sens. Le silence qui vous choque ne m’étonne pas. C'est de l’embarras et de la platitude, faute d’esprit et faute de cœur. Deux choses, si je ne me trompe, mettront à l'aise, autant qu’ils peuvent être à l'aise, les poltrons et les sots ; d'abord ma manière, et bientôt ma situation même.
Je ne vous écrierai pas de longues lettres ces jours-ci. J’ai beaucoup à faire ; dans mon Cabinet pour conduire mon travail au point où je veux qu’il soit en partant ; et hors de mon Cabinet pour les petites affaires du Val Richer. Il faut aux petites affaires autant d’attention de paroles, et de temps qu'aux grandes. Je suis seul avec mes filles. Mlle Chabaud est partie, pour aller passer quelques jours près de Rouen, chez une de ses amies.
Onze heures
Je ne vois absolument aucune raison d'hésiter, et je suis décidé. Il n’y a que deux espèces de personnes qui me conseillent de ne pas revenir ; celles qui s'en iraient volontiers elles-mêmes, et celles qui ont envie que je ne revienne pas du tout. Adieu, adieu, adieu. G.
8 heures
Je suis de l’avis de Lord John sur la boutade du Président. Le rapport de Thiers sur les affaires de Rome en a été, sinon la cause, du moins l'occasion déterminante. C’était bien insultant de ne pas dire un mot du président et de sa lettre, comme s’ils n'eussent pas existé. Et c'était bien léger d'insulter ainsi l'homme qu'on a élevé et qu’on ne peut renverser. Cette faute a fait éclore la disposition du Président, disposition préexistante, mais jusque là contenue, et qui probablement fût restée encore à l'état latent, comme dirait le Ministre actuel du commerce. M Dumas, grand chimiste. Je vois d'après ce qui me revient que les hommes intelligents de la majorité ont le sentiment de cette faute, et la regrettent. Mais c’est fait. Et la boutade du président aussi, Tout cela suivra son cours. Puisque Flahaut n'en veut pas être, il a bien fait de s'en aller. Je crois que la faute du Rapport était facile à éviter. Il était facile de faire sur la lettre un paragraphe convenable qui dégageât complètement, l'assemblée de la politique du président en donnant au président lui-même satisfaction pour sa dignité et avertissement pour son gouvernement personnel.
Je suis charmé que Lord John prenne ainsi goût, non seulement à avoir des lettres de vous, mais à vous écrire. Il n'aurait pas vos lettres sans cela, et il a raison d'en vouloir. Vous excellez à rendre la vérité agréable.
Je dis comme vous pour ce qui touche ma situation personnelle en reparaissant. Nous verrons. Nous devons avoir ce qu’il faudra d'habileté et de bon sens. Le silence qui vous choque ne m’étonne pas. C'est de l’embarras et de la platitude, faute d’esprit et faute de cœur. Deux choses, si je ne me trompe, mettront à l'aise, autant qu’ils peuvent être à l'aise, les poltrons et les sots ; d'abord ma manière, et bientôt ma situation même.
Je ne vous écrierai pas de longues lettres ces jours-ci. J’ai beaucoup à faire ; dans mon Cabinet pour conduire mon travail au point où je veux qu’il soit en partant ; et hors de mon Cabinet pour les petites affaires du Val Richer. Il faut aux petites affaires autant d’attention de paroles, et de temps qu'aux grandes. Je suis seul avec mes filles. Mlle Chabaud est partie, pour aller passer quelques jours près de Rouen, chez une de ses amies.
Onze heures
Je ne vois absolument aucune raison d'hésiter, et je suis décidé. Il n’y a que deux espèces de personnes qui me conseillent de ne pas revenir ; celles qui s'en iraient volontiers elles-mêmes, et celles qui ont envie que je ne revienne pas du tout. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 8 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 8 nov. 1849
8 heures
Je fais dire au Duc de Broglie, ce que pense Flahault. Je ne vous réponds pas qu’il le fasse. Il est dans une disposition à la fois, très amère et très réservée, de plus en plus dégouté de se mêler de ce qui se passe, en quelque façon que ce soit soit pour nuire, soit pour servir. Je suppose que Lord Lansdowne ne compte pas rester longtemps à Paris. Il serait bien bon en effet qu’il vît les choses telles qu’elles sont réellement. Je ne sais pourquoi je dis cela, car je ne pense pas qu’il résulte grand chose à Londres de son opinion sur Paris, quelle qu’elle soit. Il est de ceux dont le bon sens ne sert à rien quand il faut qu’ils fassent un effort pour que leur bon sens serve à quelque chose. Je suppose aussi que de Pétersbourg, on ne fait pas grand effort pour empêcher, en Hongrie, les exécutions qu'on déplore. C'est le rôle des sauveurs de déplorer et de ne pas empêcher, de nos jours, la Restauration a fait cela en Espagne, la République à Rome ; et vous en Hongrie. Cette affaire des réfugiés hongrois finit bien pour vous. Il était bon à l'Empereur d'avoir à se plaindre de l'action anglaise, et de le faire un peu haut. La République française, sans l'afficher ouvertement, en ayant même l'air de ne pas le vouloir, vous aidera beaucoup à faire de la Turquie votre Portugal. L'état de l'Europe vous est bien bon. L’Autriche sauvée par vous, la France annulée, vous n'êtes en face que de l’Angleterre. Si vous ne faites pas trop de boutades, vous gagnerez bien du terrain. Le refus de la présidence décennale et d’une bonne liste civile est une preuve sans réplique qu’il y a parti pris pour l'Empire. Quand ce jour-là viendra, la partie sera difficile à jouer pour tout le monde. Président, assemblée et chefs de l’assemblée, armée et chefs de l’armée, sans parler du public, pour qui rien n’est difficile, puisqu'il ne fait rien et laisse faire tout. Ce sera l'une de ces grandes eaux troubles, où les petites gens habiles font leurs propres affaires, et ceux-là seuls. Donnez-moi, je vous prie si vous pouvez quelques détails sur ce terrain que je trouverai pour mon propre compte, et qui vous indigne. Je le vois d’ici en gros ; mais il est bon de savoir avec précision, et d'avance. J'en serai plus instruit qu'indigné. J’ai une indignation générale, et préétablie qui me dispense des découvertes. Mad. Austin est à Paris. Elle a trouvé à Rouen, M. Barthélemy, Saint Hilaire qui l’a fort rassurée, et qui l’y a conduite. J'attends aujourd’hui des lettres qui me feront, je pense prendre un parti à peu près précis sur le moment où j'en ferai autant.
Onze heures
Les lettres que je reçois me disent à peu près toutes comme Sainte Aulaire, et le duc de Noailles. Je me tiens donc pour à peu près décidé pour la fin de la semaine prochaine. N'en dîtes rien. Ce sera un charmant jour. Adieu. Adieu. Adieu. G.
8 heures
Je fais dire au Duc de Broglie, ce que pense Flahault. Je ne vous réponds pas qu’il le fasse. Il est dans une disposition à la fois, très amère et très réservée, de plus en plus dégouté de se mêler de ce qui se passe, en quelque façon que ce soit soit pour nuire, soit pour servir. Je suppose que Lord Lansdowne ne compte pas rester longtemps à Paris. Il serait bien bon en effet qu’il vît les choses telles qu’elles sont réellement. Je ne sais pourquoi je dis cela, car je ne pense pas qu’il résulte grand chose à Londres de son opinion sur Paris, quelle qu’elle soit. Il est de ceux dont le bon sens ne sert à rien quand il faut qu’ils fassent un effort pour que leur bon sens serve à quelque chose. Je suppose aussi que de Pétersbourg, on ne fait pas grand effort pour empêcher, en Hongrie, les exécutions qu'on déplore. C'est le rôle des sauveurs de déplorer et de ne pas empêcher, de nos jours, la Restauration a fait cela en Espagne, la République à Rome ; et vous en Hongrie. Cette affaire des réfugiés hongrois finit bien pour vous. Il était bon à l'Empereur d'avoir à se plaindre de l'action anglaise, et de le faire un peu haut. La République française, sans l'afficher ouvertement, en ayant même l'air de ne pas le vouloir, vous aidera beaucoup à faire de la Turquie votre Portugal. L'état de l'Europe vous est bien bon. L’Autriche sauvée par vous, la France annulée, vous n'êtes en face que de l’Angleterre. Si vous ne faites pas trop de boutades, vous gagnerez bien du terrain. Le refus de la présidence décennale et d’une bonne liste civile est une preuve sans réplique qu’il y a parti pris pour l'Empire. Quand ce jour-là viendra, la partie sera difficile à jouer pour tout le monde. Président, assemblée et chefs de l’assemblée, armée et chefs de l’armée, sans parler du public, pour qui rien n’est difficile, puisqu'il ne fait rien et laisse faire tout. Ce sera l'une de ces grandes eaux troubles, où les petites gens habiles font leurs propres affaires, et ceux-là seuls. Donnez-moi, je vous prie si vous pouvez quelques détails sur ce terrain que je trouverai pour mon propre compte, et qui vous indigne. Je le vois d’ici en gros ; mais il est bon de savoir avec précision, et d'avance. J'en serai plus instruit qu'indigné. J’ai une indignation générale, et préétablie qui me dispense des découvertes. Mad. Austin est à Paris. Elle a trouvé à Rouen, M. Barthélemy, Saint Hilaire qui l’a fort rassurée, et qui l’y a conduite. J'attends aujourd’hui des lettres qui me feront, je pense prendre un parti à peu près précis sur le moment où j'en ferai autant.
Onze heures
Les lettres que je reçois me disent à peu près toutes comme Sainte Aulaire, et le duc de Noailles. Je me tiens donc pour à peu près décidé pour la fin de la semaine prochaine. N'en dîtes rien. Ce sera un charmant jour. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 29 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 29 octobre 1849
7 Heures
Vous rappelez-vous bien le 29 octobre, il y a neuf ans mon arrivée à Paris le 26 et les trois jours qui précédèrent la formation du Cabinet ? Je suis décidé à ne pas croire que ce jour-là, et tout ce que j’ai fait du 29 octobre 1840 au 24 février 1848 m'ait été bon à rien. Mais aujourd’hui il n’y a que Dieu qui sache à qui cela a été et restera bon. Hier quand j’ai fermé ma lettre, je n’avais pas ouvert mes journaux. Excellente nouvelle de Pétersbourg. Vous savez que j'y ai toujours compté. Et je pense comme vous que ce n'est pas fini pour les Turcs. L'Empereur n’a pas besoin de se remuer beaucoup pour avancer beaucoup. Bonne nouvelle aussi d’Espagne. Je tiens à Narvaez comme artiste politique, et pour le bon exemple. Je n’avais d’inquiétude que parce qu’on ne sait jamais où en est et ce que fera la Reine Christine. Elle et Narvaez se détestent et se craignent. Mais la haine et la crainte ne leur enlèvent pas leur bon sens. J’en suis charmé. Tant que ces deux personnages se soutiendront mutuellement, l’Espagne se maintiendra. Je suis assez amusé de la fausse joie qu'aura eue Lord Palmerston. Il n’a depuis longtemps que le plaisir des revers de ses adversaires, pas du tout celui de ses propres succès. Il y a bien à parier que Lord Normanby aura lu votre lettre. N’appartient-il pas plutôt à Lord John qu'à Lord Palmerston ? Malgré cela, s’il vous a lue, il se sera donné probablement le mérite d'en dire quelque chose à son chef direct. Il ne lui aura rien appris, rien sur vos sentiments et rien qui le corrige. Outre M. Moulin, j’ai eu hier un autre ancien député conservateur un brave capitaine, le vaisseau, M. Béchameil qui a été destitué après Février à cause d’une lettre de lui à moi que la Revue rétrospective à publier. Il n'en est pas moins décidé, ni moins dévoué. M. Moulin est tout-à-fait un homme de sens et d’esprit. Je le trouve très inquiet, non seulement, en Général et pour l'avenir, mais prochainement. Persuadé que le Président par détresse d'argent autant que par ambition, cherche à faire et finira par faire le coup d'Etat impérial. Faire, c’est-à-dire tenter. Et cette tentative peut amener quelque grand désordre même un triomphe momentané des rouges. Ceci, je ne vois pas comment, l'assemblée étant là, et le Président ne pouvant pas la chasser, ni se faire Empereur par la grâce des rouges qui eux chasseraient bien l’Assemblée par la violence. Mais peu importe que je voie ou que je ne voie pas comment le désordre peut éclater. Evidemment les hommes les plus sensés et les mieux informés craignent qu’il n'éclate. Ceci me préoccupe. Pour vous d’abord. Il y faut bien regarder. Montebello est très bon pour vous tenir bien au courant. N'hésitez pas, comme renseignement à faire venir aussi mon petit fidèle, et à savoir de lui ce qu’il sait. Il est toujours, bien instruit. Au fond, je ne crois pas à ces crises prochaines. Toute crise qui ne sera pas absolument indispensable, et imposée aux hommes par des nécessités actuelles, sera ajournée. Mais nous sommes tombés à ce point qu’il faut craindre même les maux auxquels on ne croit pas. Je ne suis pas très étonné de la simple carte du Duc de Broglie. Je vous dirai pourquoi. Vous n'avez pas idée de sa disposition d'esprit. On va jusqu'à dire que les affaires d'argent de Morny sont si mauvaises que, pendant son séjour à Londres, son traitement de représentant à été saisi à Paris par des créanciers. Je ne puis pas croire cela.
Midi.
Voilà votre lettre. A demain les réponses. Je n’ai jamais craint la guerre Turque, mais j'ai le cœur bien plus léger depuis que je ne peux plus la craindre. Adieu, adieu, adieu. G.
7 Heures
Vous rappelez-vous bien le 29 octobre, il y a neuf ans mon arrivée à Paris le 26 et les trois jours qui précédèrent la formation du Cabinet ? Je suis décidé à ne pas croire que ce jour-là, et tout ce que j’ai fait du 29 octobre 1840 au 24 février 1848 m'ait été bon à rien. Mais aujourd’hui il n’y a que Dieu qui sache à qui cela a été et restera bon. Hier quand j’ai fermé ma lettre, je n’avais pas ouvert mes journaux. Excellente nouvelle de Pétersbourg. Vous savez que j'y ai toujours compté. Et je pense comme vous que ce n'est pas fini pour les Turcs. L'Empereur n’a pas besoin de se remuer beaucoup pour avancer beaucoup. Bonne nouvelle aussi d’Espagne. Je tiens à Narvaez comme artiste politique, et pour le bon exemple. Je n’avais d’inquiétude que parce qu’on ne sait jamais où en est et ce que fera la Reine Christine. Elle et Narvaez se détestent et se craignent. Mais la haine et la crainte ne leur enlèvent pas leur bon sens. J’en suis charmé. Tant que ces deux personnages se soutiendront mutuellement, l’Espagne se maintiendra. Je suis assez amusé de la fausse joie qu'aura eue Lord Palmerston. Il n’a depuis longtemps que le plaisir des revers de ses adversaires, pas du tout celui de ses propres succès. Il y a bien à parier que Lord Normanby aura lu votre lettre. N’appartient-il pas plutôt à Lord John qu'à Lord Palmerston ? Malgré cela, s’il vous a lue, il se sera donné probablement le mérite d'en dire quelque chose à son chef direct. Il ne lui aura rien appris, rien sur vos sentiments et rien qui le corrige. Outre M. Moulin, j’ai eu hier un autre ancien député conservateur un brave capitaine, le vaisseau, M. Béchameil qui a été destitué après Février à cause d’une lettre de lui à moi que la Revue rétrospective à publier. Il n'en est pas moins décidé, ni moins dévoué. M. Moulin est tout-à-fait un homme de sens et d’esprit. Je le trouve très inquiet, non seulement, en Général et pour l'avenir, mais prochainement. Persuadé que le Président par détresse d'argent autant que par ambition, cherche à faire et finira par faire le coup d'Etat impérial. Faire, c’est-à-dire tenter. Et cette tentative peut amener quelque grand désordre même un triomphe momentané des rouges. Ceci, je ne vois pas comment, l'assemblée étant là, et le Président ne pouvant pas la chasser, ni se faire Empereur par la grâce des rouges qui eux chasseraient bien l’Assemblée par la violence. Mais peu importe que je voie ou que je ne voie pas comment le désordre peut éclater. Evidemment les hommes les plus sensés et les mieux informés craignent qu’il n'éclate. Ceci me préoccupe. Pour vous d’abord. Il y faut bien regarder. Montebello est très bon pour vous tenir bien au courant. N'hésitez pas, comme renseignement à faire venir aussi mon petit fidèle, et à savoir de lui ce qu’il sait. Il est toujours, bien instruit. Au fond, je ne crois pas à ces crises prochaines. Toute crise qui ne sera pas absolument indispensable, et imposée aux hommes par des nécessités actuelles, sera ajournée. Mais nous sommes tombés à ce point qu’il faut craindre même les maux auxquels on ne croit pas. Je ne suis pas très étonné de la simple carte du Duc de Broglie. Je vous dirai pourquoi. Vous n'avez pas idée de sa disposition d'esprit. On va jusqu'à dire que les affaires d'argent de Morny sont si mauvaises que, pendant son séjour à Londres, son traitement de représentant à été saisi à Paris par des créanciers. Je ne puis pas croire cela.
Midi.
Voilà votre lettre. A demain les réponses. Je n’ai jamais craint la guerre Turque, mais j'ai le cœur bien plus léger depuis que je ne peux plus la craindre. Adieu, adieu, adieu. G.
Paris, Vendredi 19 octobre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris Vendredi 19 octobre 1849
11 heures
Vous n’apprendrez absolument que le fait de mon arrivée. Mais enfin me voilà, depuis hier à 6 heures. Kisselef m’avait attendu longtemps chez moi. Il n’avait plus pu m’attendre. Je ne le verrai aujourd’hui que tard & je n'ai pas encore vu une âme. J’ai dîné, je me suis couchée. Une mauvaise nuit. Merci, merci, de vos trois lettres. Celle de hier me manque encore. Elle viendra. J'éprouve un vif sentiment d'insécurité. Pour vos affaires d’abord, & puis les affaires Turcques, l’affaire est trop engagée à ce qu’il me semble & à ce qu’il semble à Brunnow. Je verrai ce qu’en pense Kisselef. Je ne déballe rien jusqu’à plus ample informée. Vous savez bien que je ne suis en France que jour vous. Mais la République rouge où la guerre à la Russie m'en chassent, c’est clair. Et bien sous ces deux rapports, tout me paraît bien en l’air. Mes deux compagnons de voyage ont été excellents & très utiles. Tout s’est bien fait. Seulement j'apporte un rhume abominable. J’ai trouvé une lettre de Beauvale sur mon hint à Lord John à propos de Collaredo, John a écrit droit à Vienne pour supplier qu'on le nomme ambassadeur. On me prie de tenir cela secret. Bien petit intérêt à côté de tout ce qui se passe. Je vois que Thiers s’est battu hier. Je vous dis Adieu pour le cas où je sois envahie. Vous ne savez pas tout ce que j'ai à faire ! Adieu. Adieu.
2 heures. Voici votre lettre vous n'êtes pas très rassuré non plus. Il me semble que j'ai choisi un mauvais moment, si à présent je suis obligée de m'en aller, Adieu la France pour toujours, Ah quelle tristesse ! Adieu.
11 heures
Vous n’apprendrez absolument que le fait de mon arrivée. Mais enfin me voilà, depuis hier à 6 heures. Kisselef m’avait attendu longtemps chez moi. Il n’avait plus pu m’attendre. Je ne le verrai aujourd’hui que tard & je n'ai pas encore vu une âme. J’ai dîné, je me suis couchée. Une mauvaise nuit. Merci, merci, de vos trois lettres. Celle de hier me manque encore. Elle viendra. J'éprouve un vif sentiment d'insécurité. Pour vos affaires d’abord, & puis les affaires Turcques, l’affaire est trop engagée à ce qu’il me semble & à ce qu’il semble à Brunnow. Je verrai ce qu’en pense Kisselef. Je ne déballe rien jusqu’à plus ample informée. Vous savez bien que je ne suis en France que jour vous. Mais la République rouge où la guerre à la Russie m'en chassent, c’est clair. Et bien sous ces deux rapports, tout me paraît bien en l’air. Mes deux compagnons de voyage ont été excellents & très utiles. Tout s’est bien fait. Seulement j'apporte un rhume abominable. J’ai trouvé une lettre de Beauvale sur mon hint à Lord John à propos de Collaredo, John a écrit droit à Vienne pour supplier qu'on le nomme ambassadeur. On me prie de tenir cela secret. Bien petit intérêt à côté de tout ce qui se passe. Je vois que Thiers s’est battu hier. Je vous dis Adieu pour le cas où je sois envahie. Vous ne savez pas tout ce que j'ai à faire ! Adieu. Adieu.
2 heures. Voici votre lettre vous n'êtes pas très rassuré non plus. Il me semble que j'ai choisi un mauvais moment, si à présent je suis obligée de m'en aller, Adieu la France pour toujours, Ah quelle tristesse ! Adieu.
Val-Richer, Jeudi 11 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer 11 oct. 1849
8 heures
Puisque vous n'avez pas été absolus et péremptoires dans votre demande, ni la Porte dans sa réponse, raison de plus pour que l'affaire s’arrange. On trouvera quelque expédient qui couvrira la demie-retraite que fera de son côté chacune des deux puissances. Nous n'avons vu la guerre avorter depuis vingt ans malgré les plus forts motifs de guerre du monde pour la voir éclater par un si misérable incident. C'est comme la guerre entre la France et l'Angleterre pour Tahiti. Nous en avons été bien près ; mais ce n'était point possible. Il me parait que Fuad Efendi n'a pas été renvoyé à la frontière et qu’il doit être arrivé à Pétersbourg. La tranquillité où l'on est à Vienne sur cette question me parait concluante. S'il y avait la moindre raison de craindre, les esprits Autrichiens seraient renversés. Jamais l’Autriche n'aurait été à la veille d'un plus grand danger. Je vous répète qu’à Paris personne ne s’inquiète sérieusement de cette affaire. M. de Tocqueville a été, jusqu'ici, un homme d’esprit dans son Cabinet et dans ses livres. Il est possible qu’il ait de quoi être un homme d’esprit dans l'action et gouvernement. Nous verrons. Je le souhaite. C’est un honnête homme et un gentleman.
Je savais bien que ma petite lettre au Roi pour son anniversaire lui ferait, plaisir. J'ai reçu hier la plus tendre réponse. Après toutes sortes de compliments pour moi, dans le passé : « vous me donnez la plus douce consolation que je puisse recevoir, non pas à mes propres malheurs, (ce n’est pas de cela dont je m’occupe); mais à la douleur que me causent les souffrances de notre malheureuse patrie, en me disant que vous anticipez pour moi une justice à laquelle j'ai été peu accoutumé pendant ma vie. Cette justice, je l'espère et surtout je la désire pour vous comme pour moi. Mais j’ai trop peu de temps devant moi pour me flatter d'en être témoin avant que Dieu m’appelle à lui. La maladie du corps politique est bien grave. Ses médecins n’en connaissent guères la véritable nature, et je n’ai pas de confiance dans l’homéopathie qui me parait caractériser leur système de traitement. J’aurais bien envie de laisser couler ma plume mais je craindrais qu'elle n'allât top loin. Ma bonne compagne, qui se porte très bien, et qui a lu votre lettre, me charge de vous dire qu'elle en a été bien touchée.» J’ai été touché moi de cette phrase : une justice à laquelle j’ai été peu accoutumé, pendant ma vie. Il parle de lui-même comme d’un mort. Lord Beauvale a en effet bien de l’esprit, et du meilleur. Merci de m'avoir envoyé sa lettre. Je regrette bien de ne l'avoir pas vu plus souvent pendant mon séjour en Angleterre. Recevez-vous toujours la Presse ? Je ne la reçois pas, mais, M. de Girardin m'en envoie quelques numéros, ceux qu’il croit remarquables. J'en reçois un ce matin. Tout le journal, plus un supplément, remplis par un seul article le socialisme et l'impôt. Vous feriez je ne sais pas quoi plutôt que de lire cela. Je viens de le lire. Une heure de lecture. Tenez pour certain que cela fera beaucoup de mal. C'est le plan de budget, de gouvernement et de civilisation de M. de Girardin. Parfaitement fou, frivole, menteur, ignorant, pervers. Tout cela d’un ton ferme convaincu, modéré, positif, pratique. Des chimères, puériles et détestables présentées de façon à donner à tous les sots, à tous les rêveurs, à tous les badauds du monde l'illusion et le plaisir de se croire de l'esprit et du grand esprit et de l'utile esprit. Quelle perte que cet homme-là ! Il a des qualités très réelles qui ne servent qu’à ses folies et à ses vices. Personne ne lira ce numéro en Angleterre, et on aura bien raison. Et j’espère que même en France, on ne le lira pas beaucoup. C’est trop long. Mais rien ne répond mieux à l’état déréglé et chimérique des esprits. Je vous en parle bien longtemps, à vous qui n'y regarderez pas. C'est que je viens d'en être irrité.
Onze heures J’aime Clarendon Hôtel. C’est un premier pas. Je vous écrirai là demain. Vos yeux me chagrinent. Adieu, adieu. G.
8 heures
Puisque vous n'avez pas été absolus et péremptoires dans votre demande, ni la Porte dans sa réponse, raison de plus pour que l'affaire s’arrange. On trouvera quelque expédient qui couvrira la demie-retraite que fera de son côté chacune des deux puissances. Nous n'avons vu la guerre avorter depuis vingt ans malgré les plus forts motifs de guerre du monde pour la voir éclater par un si misérable incident. C'est comme la guerre entre la France et l'Angleterre pour Tahiti. Nous en avons été bien près ; mais ce n'était point possible. Il me parait que Fuad Efendi n'a pas été renvoyé à la frontière et qu’il doit être arrivé à Pétersbourg. La tranquillité où l'on est à Vienne sur cette question me parait concluante. S'il y avait la moindre raison de craindre, les esprits Autrichiens seraient renversés. Jamais l’Autriche n'aurait été à la veille d'un plus grand danger. Je vous répète qu’à Paris personne ne s’inquiète sérieusement de cette affaire. M. de Tocqueville a été, jusqu'ici, un homme d’esprit dans son Cabinet et dans ses livres. Il est possible qu’il ait de quoi être un homme d’esprit dans l'action et gouvernement. Nous verrons. Je le souhaite. C’est un honnête homme et un gentleman.
Je savais bien que ma petite lettre au Roi pour son anniversaire lui ferait, plaisir. J'ai reçu hier la plus tendre réponse. Après toutes sortes de compliments pour moi, dans le passé : « vous me donnez la plus douce consolation que je puisse recevoir, non pas à mes propres malheurs, (ce n’est pas de cela dont je m’occupe); mais à la douleur que me causent les souffrances de notre malheureuse patrie, en me disant que vous anticipez pour moi une justice à laquelle j'ai été peu accoutumé pendant ma vie. Cette justice, je l'espère et surtout je la désire pour vous comme pour moi. Mais j’ai trop peu de temps devant moi pour me flatter d'en être témoin avant que Dieu m’appelle à lui. La maladie du corps politique est bien grave. Ses médecins n’en connaissent guères la véritable nature, et je n’ai pas de confiance dans l’homéopathie qui me parait caractériser leur système de traitement. J’aurais bien envie de laisser couler ma plume mais je craindrais qu'elle n'allât top loin. Ma bonne compagne, qui se porte très bien, et qui a lu votre lettre, me charge de vous dire qu'elle en a été bien touchée.» J’ai été touché moi de cette phrase : une justice à laquelle j’ai été peu accoutumé, pendant ma vie. Il parle de lui-même comme d’un mort. Lord Beauvale a en effet bien de l’esprit, et du meilleur. Merci de m'avoir envoyé sa lettre. Je regrette bien de ne l'avoir pas vu plus souvent pendant mon séjour en Angleterre. Recevez-vous toujours la Presse ? Je ne la reçois pas, mais, M. de Girardin m'en envoie quelques numéros, ceux qu’il croit remarquables. J'en reçois un ce matin. Tout le journal, plus un supplément, remplis par un seul article le socialisme et l'impôt. Vous feriez je ne sais pas quoi plutôt que de lire cela. Je viens de le lire. Une heure de lecture. Tenez pour certain que cela fera beaucoup de mal. C'est le plan de budget, de gouvernement et de civilisation de M. de Girardin. Parfaitement fou, frivole, menteur, ignorant, pervers. Tout cela d’un ton ferme convaincu, modéré, positif, pratique. Des chimères, puériles et détestables présentées de façon à donner à tous les sots, à tous les rêveurs, à tous les badauds du monde l'illusion et le plaisir de se croire de l'esprit et du grand esprit et de l'utile esprit. Quelle perte que cet homme-là ! Il a des qualités très réelles qui ne servent qu’à ses folies et à ses vices. Personne ne lira ce numéro en Angleterre, et on aura bien raison. Et j’espère que même en France, on ne le lira pas beaucoup. C’est trop long. Mais rien ne répond mieux à l’état déréglé et chimérique des esprits. Je vous en parle bien longtemps, à vous qui n'y regarderez pas. C'est que je viens d'en être irrité.
Onze heures J’aime Clarendon Hôtel. C’est un premier pas. Je vous écrirai là demain. Vos yeux me chagrinent. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 7 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Dimanche 7 oct. 1849
Cinq heures
Je viens d'écrire à M. Gréterin. Vous reviendrez donc bientôt. Quel bonheur de vous ravoir en France, de ce côté-ci du Canal ! Vous y resterez tranquillement. Pas de guerre et pas d'émeute. Mon optimisme naturel, et que je retrouve bien de temps en temps, m'inspire cependant, moins de défiance parce que je n'espère pas grand-chose. Ce ne sont pas les perspectives brillantes qui me cachent les sombres. Un repos bas et précaire, voilà l'avenir que j’attends. Pour longtemps. Je sais qu'à la rue St Florentin vous vous en contenterez.
Je suis bien fâché du bien mauvais article des Débats de ce matin sur l'Empereur à propos de Constantinople. Les journalistes ne se refusent jamais le plaisir des moqueries, et des bravades, quel qu’en soit l’inconvénient. C’est pitoyable et déplorable. Il était si facile de parler de cela convenablement et avec des paroles encourageantes au lieu de paroles blessantes ! Où ont-ils pris celles qu'ils attribuent à l'Empereur ? Mais tout cela donne bien lieu de penser que l'affaire n’ira pas loin.
Ce que Lord John vous écrit est très sensé. A moins qu’il n’y ait l’arrière pensée dont je vous ai parlé, c'est une grosse faute. Et la faute est grosse même avec l’arrière-pensée, car elle change (je reviens à mon expression) le courant de l'opinion Européenne sans motif et sans profit suffisant. Encore un exemple du peu d'esprit des poltrons même gens d’esprit ; le douaire de Mad. la Duchesse d'Orléans. Passy et Dupin ont espéré escamoter l'affaire en la faisant très petite et la fourrant parmi d'autres. Ils se sont attiré un échec qui est un désagrément pour Mad. la Duchesse d'Orléans, et qui y fera regarder de beaucoup plus près. Il fallait présenter cela la tête haute comme l'exécution d’un traité et l'accomplissement d’un devoir honteusement retardé. C’est la vérité et c'était aussi le moyen de succès.
Qu'y a-t-il de vrai dans le remplacement du Prince de Schwartzemberg par M. de Schmerling et qu’elle en serait la valeur ? M. de Schmerling était, si je ne me trompe, le plus Autrichien des Autrichiens à Francfort. Ce ne serait pas là un signe qu'on est près de s'entendre avec la Prusse sur les Affaires Allemandes. Le renvoi de notre Ministre à Washington n'a d'autre gravité que celle d’un gros désagrément pour la République qui, après avoir eu le tort d'employer M. Poussin, a eu celui de ne pas le rappeler à temps. Je ne le connais pas ; mais j’ai entendu dire que c’était un étourneau prétentieux et grossier.
Lundi 6 oct. onze heures
Je compte bien que votre lettre me dira que vous avez reçu les miennes. Mais j'ai peur qu’elle n’arrive une demi-heure plus tard. Il pleut par torrents continus. Hier, mon pré dans la vallée était un parfait étang, se déchargeant par je ne sais combien de cascades. J’ai pris mon parti de ne plus me soucier de mes alleés pour cet automne.
J’attends la semaine prochaine Madame Austin qui vient passer trois semaines chez moi pour traduire, mon discours sur l'histoire de la révolution d’Angleterre. Il doit paraître en Anglais à Londres, le même jour qu'en Français à Paris. Voilà votre lettre. Bien troublée et bien courte. On a beau dire et vous avez beau craindre. La guerre ne sortira pas de là. Adieu. Adieu.
Cinq heures
Je viens d'écrire à M. Gréterin. Vous reviendrez donc bientôt. Quel bonheur de vous ravoir en France, de ce côté-ci du Canal ! Vous y resterez tranquillement. Pas de guerre et pas d'émeute. Mon optimisme naturel, et que je retrouve bien de temps en temps, m'inspire cependant, moins de défiance parce que je n'espère pas grand-chose. Ce ne sont pas les perspectives brillantes qui me cachent les sombres. Un repos bas et précaire, voilà l'avenir que j’attends. Pour longtemps. Je sais qu'à la rue St Florentin vous vous en contenterez.
Je suis bien fâché du bien mauvais article des Débats de ce matin sur l'Empereur à propos de Constantinople. Les journalistes ne se refusent jamais le plaisir des moqueries, et des bravades, quel qu’en soit l’inconvénient. C’est pitoyable et déplorable. Il était si facile de parler de cela convenablement et avec des paroles encourageantes au lieu de paroles blessantes ! Où ont-ils pris celles qu'ils attribuent à l'Empereur ? Mais tout cela donne bien lieu de penser que l'affaire n’ira pas loin.
Ce que Lord John vous écrit est très sensé. A moins qu’il n’y ait l’arrière pensée dont je vous ai parlé, c'est une grosse faute. Et la faute est grosse même avec l’arrière-pensée, car elle change (je reviens à mon expression) le courant de l'opinion Européenne sans motif et sans profit suffisant. Encore un exemple du peu d'esprit des poltrons même gens d’esprit ; le douaire de Mad. la Duchesse d'Orléans. Passy et Dupin ont espéré escamoter l'affaire en la faisant très petite et la fourrant parmi d'autres. Ils se sont attiré un échec qui est un désagrément pour Mad. la Duchesse d'Orléans, et qui y fera regarder de beaucoup plus près. Il fallait présenter cela la tête haute comme l'exécution d’un traité et l'accomplissement d’un devoir honteusement retardé. C’est la vérité et c'était aussi le moyen de succès.
Qu'y a-t-il de vrai dans le remplacement du Prince de Schwartzemberg par M. de Schmerling et qu’elle en serait la valeur ? M. de Schmerling était, si je ne me trompe, le plus Autrichien des Autrichiens à Francfort. Ce ne serait pas là un signe qu'on est près de s'entendre avec la Prusse sur les Affaires Allemandes. Le renvoi de notre Ministre à Washington n'a d'autre gravité que celle d’un gros désagrément pour la République qui, après avoir eu le tort d'employer M. Poussin, a eu celui de ne pas le rappeler à temps. Je ne le connais pas ; mais j’ai entendu dire que c’était un étourneau prétentieux et grossier.
Lundi 6 oct. onze heures
Je compte bien que votre lettre me dira que vous avez reçu les miennes. Mais j'ai peur qu’elle n’arrive une demi-heure plus tard. Il pleut par torrents continus. Hier, mon pré dans la vallée était un parfait étang, se déchargeant par je ne sais combien de cascades. J’ai pris mon parti de ne plus me soucier de mes alleés pour cet automne.
J’attends la semaine prochaine Madame Austin qui vient passer trois semaines chez moi pour traduire, mon discours sur l'histoire de la révolution d’Angleterre. Il doit paraître en Anglais à Londres, le même jour qu'en Français à Paris. Voilà votre lettre. Bien troublée et bien courte. On a beau dire et vous avez beau craindre. La guerre ne sortira pas de là. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Lundi 1er octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 1er octobre 1849
6 heures
J’ai acquis la certitude qu’il n’y avait guère en effet que des commérages dans ce qu'on m’avait dit sur les démarches mutuelles des deux branches, l’une vers l'autre. Mais quand les commères ont causé avec les maîtres, et peuvent s'en vanter les commérages peuvent devenir des embarras. Le Roi a raison de dire que c’est à la branche ainée à faire les avances. Je n’ai laissé échapper aucune occasion de lui inculquer cette idée. C’est la branche ainée qui gagne au rapprochement et ce n'est pas elle qui est tombée hier. C’est donc à elle à commencer si elle veut finir, et elle le peut décemment. Je désire que le Roi et les siens agissent toujours sur ce principe. M. Achille Fould est tout au Président. Presque de l’intimité. Grande envie d'être Ministre des finances. On doute qu’il arrive. Faiseur d'affaires. Plus intelligent que capable. Toujours assez bien pour moi. Plus dans l'apparence qu'au fond. Mais ce sont des gens avec qui il ne faut pas être mal.
Je vous ai dit ce matin que j'étais rentré en possession de tous les originaux. Il n'y manque rien. J’y ai retrouvé aussi les originaux, de moi, que vous m'aviez prêtés.
Mardi 2 - sept heures
Voici mon mauvais jour. J’étais mieux à Broglie qu’ici pour les heures de poste. J’avais mes lettres de grand matin, entre 7 et 8 heures et la poste ne repartait qu'à 2 heures. Ici mon facteur ne m’arrive, à présent surtout, qu'à onze heures et repart à midi. Je suis dans les terres à trois lieues du bureau de poste. Le Duc de Broglie, est à cinq minutes. Le bourg touche le château. Je sais gré à votre famille Impériale de leur chagrin sur la mort du grand Duc Michel. Ces douleurs fraternelles fidèles et vives quoique éloignées, me touchent, et me plaisent. Un peu de cœur est si rare dans les régions hautes ! Encore un exemple là du principe qui préside dans la volonté de dieu à la distribution de ses grâces et de ses rigueurs. Les unes ne vont guères, sans les autres. Au même moment où il nous comble, et il nous frappe, comme pour ne jamais nous laisser oublier notre infirmité et notre dépendance. Aussi dans les temps prospère, je me sens toujours inquiet et dans l’attente d’un malheur. Et c’est presque toujours, dans la vie privée, au sein de la famille, que Dieu place les compensations, en bien ou en mal, qui font équilibre aux incidents de la vie publique. Je ne crois pas qu’il soit possible d'avoir plus constamment que je ne l'ai le sentiment de vivre ainsi sous une main souveraine, dont il est également impossible de méconnaitre le pouvoir et de comprendre les desseins. Les impies sont de bien pauvres esprits. Il y a une sorte d’impies que je crois assez commun dans le monde surtout dans les classes élevées et cultivées, ceux qui sont impies, au fond, et ne veulent pas le paraître ; non par hypocrisie calculée mais par embarras et convenance ; les impies honteux. Ceux-là ne font pas grand mal mais ils me déplaisent beaucoup. J’aime qu’on se connaisse et qu’on se montre tel qu’on est.
Onze heures et demie
Je ferme ma lettre. Je n'ai rien de Paris. Les nouvelles de Constantinople seront plus bruyantes qu'importantes. Adieu, adieu. G.
6 heures
J’ai acquis la certitude qu’il n’y avait guère en effet que des commérages dans ce qu'on m’avait dit sur les démarches mutuelles des deux branches, l’une vers l'autre. Mais quand les commères ont causé avec les maîtres, et peuvent s'en vanter les commérages peuvent devenir des embarras. Le Roi a raison de dire que c’est à la branche ainée à faire les avances. Je n’ai laissé échapper aucune occasion de lui inculquer cette idée. C’est la branche ainée qui gagne au rapprochement et ce n'est pas elle qui est tombée hier. C’est donc à elle à commencer si elle veut finir, et elle le peut décemment. Je désire que le Roi et les siens agissent toujours sur ce principe. M. Achille Fould est tout au Président. Presque de l’intimité. Grande envie d'être Ministre des finances. On doute qu’il arrive. Faiseur d'affaires. Plus intelligent que capable. Toujours assez bien pour moi. Plus dans l'apparence qu'au fond. Mais ce sont des gens avec qui il ne faut pas être mal.
Je vous ai dit ce matin que j'étais rentré en possession de tous les originaux. Il n'y manque rien. J’y ai retrouvé aussi les originaux, de moi, que vous m'aviez prêtés.
Mardi 2 - sept heures
Voici mon mauvais jour. J’étais mieux à Broglie qu’ici pour les heures de poste. J’avais mes lettres de grand matin, entre 7 et 8 heures et la poste ne repartait qu'à 2 heures. Ici mon facteur ne m’arrive, à présent surtout, qu'à onze heures et repart à midi. Je suis dans les terres à trois lieues du bureau de poste. Le Duc de Broglie, est à cinq minutes. Le bourg touche le château. Je sais gré à votre famille Impériale de leur chagrin sur la mort du grand Duc Michel. Ces douleurs fraternelles fidèles et vives quoique éloignées, me touchent, et me plaisent. Un peu de cœur est si rare dans les régions hautes ! Encore un exemple là du principe qui préside dans la volonté de dieu à la distribution de ses grâces et de ses rigueurs. Les unes ne vont guères, sans les autres. Au même moment où il nous comble, et il nous frappe, comme pour ne jamais nous laisser oublier notre infirmité et notre dépendance. Aussi dans les temps prospère, je me sens toujours inquiet et dans l’attente d’un malheur. Et c’est presque toujours, dans la vie privée, au sein de la famille, que Dieu place les compensations, en bien ou en mal, qui font équilibre aux incidents de la vie publique. Je ne crois pas qu’il soit possible d'avoir plus constamment que je ne l'ai le sentiment de vivre ainsi sous une main souveraine, dont il est également impossible de méconnaitre le pouvoir et de comprendre les desseins. Les impies sont de bien pauvres esprits. Il y a une sorte d’impies que je crois assez commun dans le monde surtout dans les classes élevées et cultivées, ceux qui sont impies, au fond, et ne veulent pas le paraître ; non par hypocrisie calculée mais par embarras et convenance ; les impies honteux. Ceux-là ne font pas grand mal mais ils me déplaisent beaucoup. J’aime qu’on se connaisse et qu’on se montre tel qu’on est.
Onze heures et demie
Je ferme ma lettre. Je n'ai rien de Paris. Les nouvelles de Constantinople seront plus bruyantes qu'importantes. Adieu, adieu. G.
Richmond, Dimanche 30 Septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond dimanche 30 septembre 1849
Je sais le fait que Schwarzenberg a enfin répondu à la dépêche de Lord Palmerston sur la Hongrie & que cette réponse est excellente. Je ne l’ai pas lue, j'en saurai peut-être davantage. Lord Aberdeen est très curieux de cela. Il ne cesse de m'écrire à ce sujet. Peel va passer quelques jours chez lui, & il tient à l’endoctriner. Peine perdue je crois. Le Pce Metternich est fort occupé de son départ. Dans 10 jours il s'embarque pour Ostende. Il est en bonne santé. M. de Hübner est ou sera nommé ministre à Paris. C'est le président lui-même qui l’a désiré. Ce Hübner est, dit Metternich un homme très intelligent, et de la bonne école. Mais il n’est ni plus ni moins que le gendre de M. Pilat, rédacteur des Oestereihisher [?] et fils naturel d'un ami de ce même Pilat. Ce n'est pas très aristocratique. Thom passe ministre en Suisse. Je le regretterai beaucoup à Paris. Morny est très occupé d’affaires à Londres. Il ne retourne pas encore à Paris. Ces affaires c'est des affaires d’argent. Je vous ai dit que Lord John est allé à Woburn pour huit. jours. Il y a maintenant près de deux mois qu’il n’a vu lord Palmerston. J’ai lieu de croire qu’ils sont assez froidement ensemble. A propos vous saviez César & Auguste avant Lord John, car il n'en a eu connaissance qu'il y a trois jours. C’est drôle. Je vous envoie un billet de Metternich, spirituel & sévère sur le journal des Débats. Je crois qu'en vous rendant compte de la conversation de M. Achille Fould je n’ai pas assez appuyé sur ce qu'il m’a dit de vous. Personne n’approche de votre talent, & vous êtes le seul homme en France qui ayez du courage. Infailliblement vous vous retrouverez là où vous devez être. Moi je dis que je vous prêche & que je désire [ ?] l'abstention, le repos. Il dit c’est impossible. Il fait beaucoup plus de cas de Molé que de Thiers.
4 heures. Voici Morny qui est venu passer une heure avec moi. Ses nouvelles de Paris sont qu’il peut considérer M. de Falloux comme hors du cabinet. Il le regretterait du reste toujours le même dire. On ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas s’entendre sur la chose à faire. Si l'Empire On perd les légitimistes. On les perdrait peut-être même si on demandait la présidence pour 10 ans. Son opinion est qu’on restera comme on est, et que c'est là l'avis de tout le monde. Il m’a parlé très mal de Lamoricière de Drouyn de Lhuys, de tout le paquet qui tient de près ou de loin au paquet Cavaignac, Dufaure. Il croit que l’assemblée fera renvoyer & les préfets objectionnables. Il n’est pas prévu de retourner à Paris. Deux choses : il se dit charmé du Manifeste du pape. Après tout. Il a fait des concessions & il est meilleur juge que la France de la mesure des concessions. Et puis plainte de ce qu'on, nous russes par exemple, nous sommes trop polis pour la république. Nous avons par non rudesses contribué à la chute de la monarchie de juillet. Nous pourrions bien par nos bons procédés contribuer à la durée de la république. On était plus poli même pour Cavaignac que pour Louis Philippe. Morny voudrait que tout le monde se mêlât de décréditer cette forme de gouvernement.
1er octobre lundi. Voici l’étonnante nouvelle de la rupture entre la Russie & la porte ! Si cela est vrai c'est une bien grosse affaire. J’ai peine à y croire. Mais je crois certainement que Palmerston y pousse. Ah quel homme ! Je suis très préoccupée de cette grande nouvelle. Brunnow n’a pas bougé de Brighton depuis 6 semaines. Il ne cesse d'écrire et d’envoyer des courriers, mais il est là tout seul, il n’a pas vu une seule fois Lord Palmerston qu'est-ce qu'il écrit ? J’attends votre dernière lettre du Chateau de Broglie. Voici vos deux lettres, merci merci. Curieuses. Intéressantes. Je n’ai pas le temps d’y répondre il faut que ceci parte. Adieu. Adieu, adieu.
Je sais le fait que Schwarzenberg a enfin répondu à la dépêche de Lord Palmerston sur la Hongrie & que cette réponse est excellente. Je ne l’ai pas lue, j'en saurai peut-être davantage. Lord Aberdeen est très curieux de cela. Il ne cesse de m'écrire à ce sujet. Peel va passer quelques jours chez lui, & il tient à l’endoctriner. Peine perdue je crois. Le Pce Metternich est fort occupé de son départ. Dans 10 jours il s'embarque pour Ostende. Il est en bonne santé. M. de Hübner est ou sera nommé ministre à Paris. C'est le président lui-même qui l’a désiré. Ce Hübner est, dit Metternich un homme très intelligent, et de la bonne école. Mais il n’est ni plus ni moins que le gendre de M. Pilat, rédacteur des Oestereihisher [?] et fils naturel d'un ami de ce même Pilat. Ce n'est pas très aristocratique. Thom passe ministre en Suisse. Je le regretterai beaucoup à Paris. Morny est très occupé d’affaires à Londres. Il ne retourne pas encore à Paris. Ces affaires c'est des affaires d’argent. Je vous ai dit que Lord John est allé à Woburn pour huit. jours. Il y a maintenant près de deux mois qu’il n’a vu lord Palmerston. J’ai lieu de croire qu’ils sont assez froidement ensemble. A propos vous saviez César & Auguste avant Lord John, car il n'en a eu connaissance qu'il y a trois jours. C’est drôle. Je vous envoie un billet de Metternich, spirituel & sévère sur le journal des Débats. Je crois qu'en vous rendant compte de la conversation de M. Achille Fould je n’ai pas assez appuyé sur ce qu'il m’a dit de vous. Personne n’approche de votre talent, & vous êtes le seul homme en France qui ayez du courage. Infailliblement vous vous retrouverez là où vous devez être. Moi je dis que je vous prêche & que je désire [ ?] l'abstention, le repos. Il dit c’est impossible. Il fait beaucoup plus de cas de Molé que de Thiers.
4 heures. Voici Morny qui est venu passer une heure avec moi. Ses nouvelles de Paris sont qu’il peut considérer M. de Falloux comme hors du cabinet. Il le regretterait du reste toujours le même dire. On ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas s’entendre sur la chose à faire. Si l'Empire On perd les légitimistes. On les perdrait peut-être même si on demandait la présidence pour 10 ans. Son opinion est qu’on restera comme on est, et que c'est là l'avis de tout le monde. Il m’a parlé très mal de Lamoricière de Drouyn de Lhuys, de tout le paquet qui tient de près ou de loin au paquet Cavaignac, Dufaure. Il croit que l’assemblée fera renvoyer & les préfets objectionnables. Il n’est pas prévu de retourner à Paris. Deux choses : il se dit charmé du Manifeste du pape. Après tout. Il a fait des concessions & il est meilleur juge que la France de la mesure des concessions. Et puis plainte de ce qu'on, nous russes par exemple, nous sommes trop polis pour la république. Nous avons par non rudesses contribué à la chute de la monarchie de juillet. Nous pourrions bien par nos bons procédés contribuer à la durée de la république. On était plus poli même pour Cavaignac que pour Louis Philippe. Morny voudrait que tout le monde se mêlât de décréditer cette forme de gouvernement.
1er octobre lundi. Voici l’étonnante nouvelle de la rupture entre la Russie & la porte ! Si cela est vrai c'est une bien grosse affaire. J’ai peine à y croire. Mais je crois certainement que Palmerston y pousse. Ah quel homme ! Je suis très préoccupée de cette grande nouvelle. Brunnow n’a pas bougé de Brighton depuis 6 semaines. Il ne cesse d'écrire et d’envoyer des courriers, mais il est là tout seul, il n’a pas vu une seule fois Lord Palmerston qu'est-ce qu'il écrit ? J’attends votre dernière lettre du Chateau de Broglie. Voici vos deux lettres, merci merci. Curieuses. Intéressantes. Je n’ai pas le temps d’y répondre il faut que ceci parte. Adieu. Adieu, adieu.
Val-RIcher, Dimanche 30 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, dimanche 30 sept. 1849
Huit heures
Il n'y a pas moyen de vous expliquer de si loin pourquoi ce que j'écris ne me fera pas d'ennemi ; au contraire. Mais vous le verrez. Je n'ai nulle envie de me rengager dans les luttes où j'ai vécu. La force me manquerait pour recommencer, et il ne faut jamais rien recommencer. Le monde s'ennuie de ce qu’il a déjà vu. Mais après ce que j’ai fait en luttant et ce qui est arrivé depuis que je suis tombé, il y a une position toute nouvelle à prendre, très calme et, je crois très influente qui aura quelque effet, ce que je crois toujours possible, et qui me fera honneur ce que je désire avant tout. J'ai la fantaisie d'être un peu connu, et le sentiment intérieur que je mourrai les poches encore pleines, n'ayant pas montré la moitié de ce qui valait la peine d'être vu. Je veux qu'après moi on se doute un peu de cela et qu’en parlant de moi, on se dise : " C'est dommage qu’il n'ait pas fait tout ce qu’il voulait." C'est peu d'avoir été quelque chose si on ne laisse au public le sentiment qu’on pouvait être bien davantage. Le monde dédaigne et oublie bientôt ce qu’il croit avoir mesuré jusqu'au fond et épuisé. Il faut qu’il entrevoie de l’inconnu qu'il n’a pas su voir et s'approprier. Alors il estime et admire vraiment. Je suis sorti de la scène sur un échec, très immérité, je pense, mais enfin, sur un échec. Je ne veux pas, si Dieu me donne vie m’en aller tout-à-fait dans cette position là. Je veux que mon pays se doute qu’il a eu tort de me laisser tomber, et qu’il me relève lui-même, non pas dans l’arène, mais dans sa pensée. Et je suis sûr que je peux lui donner ce sentiment là sans blesser son amour propre et réveiller sa mauvaise humeur, en excitant au contraire sa curiosité son regret et son respect. Si cela peut lui servir, ensuite à quelque chose pour se réformer lui-même, tant mieux ; je n'y renonce pas pour lui, car je ne désespère pas de lui. Mais je n’entreprends plus moi-même de le réformer. Ce serait trop long et je suis trop vieux. Quand causerons-nous de tout cela, et de tout le reste ? J'en ai bien envie. Nous aussi nous pouvons bien dire ; " Que de bien perdu ! "
Voici votre lettre de Berlin. Vague et confuse, comme tout ce qui est allemand, mais spirituelle et sensée au fond. Je le crois du moins. On ne voit jamais bien clair dans l’esprit des gens qui n’ont pas vu clair eux- mêmes. Les Allemands ont beaucoup d’esprit ; mais on dirait qu'ils ne voient rien que de loin, et à travers les vapeurs du dernier horizon. Même quand ils sont sensés comme celui-ci, ils trouvent le moyen de noyer leur bon sens dans le brouillard. Il a certainement raison ; le Francfort nouveau est stupide ; le vieux Francfort est mort. Il y a en Allemagne un problème à résoudre que M. de Gagern n’a pas résolu. que M. de Metternich ne résoudrait pas et qu’il faut absolument résoudre. Celui-là seul qui le résoudra mettra les radicaux sous ses pieds, comme ils le méritent. Mais je doute que le moment de cette solution soit venu et nous pourrons bien revoir, en l’attendant, une nouvelle édition de la Diète de 1815.
J’ai reçu une lettre très amicale de Narvaez à qui j’avais recommandé Herbet, consul général à Barcelone. Point de politique comme de raison, mais un ton de confiance générale mêlé d’inquiétude sur sa propre santé. Il me parle des fortes indispositions qui l’ont empêché de voir personne, et il quittait Madrid pour retourner aux eaux de Puertollano. Adieu, adieu.
Moi aussi, je suis fâché que M. Gueneau de Mussy ne revienne pas à Paris. A cause de vous surtout. J'étais sûr qu’il vous plairait, et je crois qu’il aurait autorité sur vous pour votre santé, ce qui est bien nécessaire. Le Roi a raison de le garder. Adieu, adieu. G.
Huit heures
Il n'y a pas moyen de vous expliquer de si loin pourquoi ce que j'écris ne me fera pas d'ennemi ; au contraire. Mais vous le verrez. Je n'ai nulle envie de me rengager dans les luttes où j'ai vécu. La force me manquerait pour recommencer, et il ne faut jamais rien recommencer. Le monde s'ennuie de ce qu’il a déjà vu. Mais après ce que j’ai fait en luttant et ce qui est arrivé depuis que je suis tombé, il y a une position toute nouvelle à prendre, très calme et, je crois très influente qui aura quelque effet, ce que je crois toujours possible, et qui me fera honneur ce que je désire avant tout. J'ai la fantaisie d'être un peu connu, et le sentiment intérieur que je mourrai les poches encore pleines, n'ayant pas montré la moitié de ce qui valait la peine d'être vu. Je veux qu'après moi on se doute un peu de cela et qu’en parlant de moi, on se dise : " C'est dommage qu’il n'ait pas fait tout ce qu’il voulait." C'est peu d'avoir été quelque chose si on ne laisse au public le sentiment qu’on pouvait être bien davantage. Le monde dédaigne et oublie bientôt ce qu’il croit avoir mesuré jusqu'au fond et épuisé. Il faut qu’il entrevoie de l’inconnu qu'il n’a pas su voir et s'approprier. Alors il estime et admire vraiment. Je suis sorti de la scène sur un échec, très immérité, je pense, mais enfin, sur un échec. Je ne veux pas, si Dieu me donne vie m’en aller tout-à-fait dans cette position là. Je veux que mon pays se doute qu’il a eu tort de me laisser tomber, et qu’il me relève lui-même, non pas dans l’arène, mais dans sa pensée. Et je suis sûr que je peux lui donner ce sentiment là sans blesser son amour propre et réveiller sa mauvaise humeur, en excitant au contraire sa curiosité son regret et son respect. Si cela peut lui servir, ensuite à quelque chose pour se réformer lui-même, tant mieux ; je n'y renonce pas pour lui, car je ne désespère pas de lui. Mais je n’entreprends plus moi-même de le réformer. Ce serait trop long et je suis trop vieux. Quand causerons-nous de tout cela, et de tout le reste ? J'en ai bien envie. Nous aussi nous pouvons bien dire ; " Que de bien perdu ! "
Voici votre lettre de Berlin. Vague et confuse, comme tout ce qui est allemand, mais spirituelle et sensée au fond. Je le crois du moins. On ne voit jamais bien clair dans l’esprit des gens qui n’ont pas vu clair eux- mêmes. Les Allemands ont beaucoup d’esprit ; mais on dirait qu'ils ne voient rien que de loin, et à travers les vapeurs du dernier horizon. Même quand ils sont sensés comme celui-ci, ils trouvent le moyen de noyer leur bon sens dans le brouillard. Il a certainement raison ; le Francfort nouveau est stupide ; le vieux Francfort est mort. Il y a en Allemagne un problème à résoudre que M. de Gagern n’a pas résolu. que M. de Metternich ne résoudrait pas et qu’il faut absolument résoudre. Celui-là seul qui le résoudra mettra les radicaux sous ses pieds, comme ils le méritent. Mais je doute que le moment de cette solution soit venu et nous pourrons bien revoir, en l’attendant, une nouvelle édition de la Diète de 1815.
J’ai reçu une lettre très amicale de Narvaez à qui j’avais recommandé Herbet, consul général à Barcelone. Point de politique comme de raison, mais un ton de confiance générale mêlé d’inquiétude sur sa propre santé. Il me parle des fortes indispositions qui l’ont empêché de voir personne, et il quittait Madrid pour retourner aux eaux de Puertollano. Adieu, adieu.
Moi aussi, je suis fâché que M. Gueneau de Mussy ne revienne pas à Paris. A cause de vous surtout. J'étais sûr qu’il vous plairait, et je crois qu’il aurait autorité sur vous pour votre santé, ce qui est bien nécessaire. Le Roi a raison de le garder. Adieu, adieu. G.
Richmond, Vendredi 28 Septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond vendredi le 28 sept. 1849
M Achille Fould est venu me voir, je ne sais trop pourquoi. Sa conversation m’a intéressée. Il a de l'esprit, & il n'y a rien d’exagéré dans ses idées ni son langage. Espérant, désirant autre chose comme tout le monde. En voyant pas trop comment on pourrait s'y prendre pour y arriver. Le parti conservateur mais seulement tant qu'il a peur. Le jour où l’on n’aurait plus peur, chacun voudra tirer de son côté. Croyant aux charmes de Louis Napoléon plutôt qu’à tout autre. croyant aussi que la président pour 10 ans est une question sur la quelle tout le monde pourrait s’entendre. Mais même pour cela il faudrait un homme de courage pour le proposer. Il n’est amoureux ni de M. Dufaure, ni de M. de Falloux. Il dit de celle-ci, un doctrinaire et un jésuite. De l’autre, il travaille pour Cavaignac. Disant beaucoup de bien du prince. Approuvant toutes ses fautes, parce qu’en définitive elles lui profitent toutes. Il a passé deux heures hier avec le Roi. Pas l’idée de rapprochement entre les 2 Bourbons. Au contraire, le roi se plaignant que la branche aîné ne fait rien pour cela et répétant que l’initiative ne saurait être prise par la cadette. Les princes sont en Ecosse à la chasse. Les Nemours ne sont pas revenus d'Allemagne. M. Fould serait fâché que M. Molé entrât, il doit se réserver pour un meilleur moment. Mais il sait qu’il en a envie, quant à Thiers ce ne serait pas une acquisition. On n'a pas confiance en lui, ni aucune considération pour lui.
Il m’a parlé de vous, de ce que dans un an ou deux vous deviez nécessairement vous retrouver l’homme important, le seul. Qu’en attendant il valait bien mieux pour vous et pour cet avenir ne pas faire partie de l'assemblée. On a accusé le parti conservateur de n’avoir pas poussé à votre élection. C'était par amour pour vous. J’ai dit ici. On a repoussé. Et c'est là ce qui a étonné tout le monde. Il a équivoqué des interrogations sur ce que vous allez faire. Rien, il reste tranquille chez lui. Il écrit. Parce qu'il a besoin d'écrire. Une grande honte pour notre pays. Et puis si vous viendriez à Paris. Je ne sais pas, peut être. Il n’est pas prévu. Voilà à peu près tout.
Samedi le 29. Flahaut a été voir le roi hier. Il l'a trouvé bavard, mécontent de tout le monde. N’aimant que l'Angleterre. Et décidé à mourir ici ; même à Claremont, ce qui véritablement n’arrange pas la cour. Mais dit Flahaut "Le roi a raison de penser à lui même." Voilà donc le manifeste du Pape. Que ferez-vous ? 1 heure. Vous avez donc eu mes lettres, me voilà rassurée. Ce que vous me répondez est triste. Pauvre pays. Petits hommes ! Adieu. Adieu. Bien vite. Je suis en retard aujourd’hui, mauvaise nuit, levée tard. Adieu
M Achille Fould est venu me voir, je ne sais trop pourquoi. Sa conversation m’a intéressée. Il a de l'esprit, & il n'y a rien d’exagéré dans ses idées ni son langage. Espérant, désirant autre chose comme tout le monde. En voyant pas trop comment on pourrait s'y prendre pour y arriver. Le parti conservateur mais seulement tant qu'il a peur. Le jour où l’on n’aurait plus peur, chacun voudra tirer de son côté. Croyant aux charmes de Louis Napoléon plutôt qu’à tout autre. croyant aussi que la président pour 10 ans est une question sur la quelle tout le monde pourrait s’entendre. Mais même pour cela il faudrait un homme de courage pour le proposer. Il n’est amoureux ni de M. Dufaure, ni de M. de Falloux. Il dit de celle-ci, un doctrinaire et un jésuite. De l’autre, il travaille pour Cavaignac. Disant beaucoup de bien du prince. Approuvant toutes ses fautes, parce qu’en définitive elles lui profitent toutes. Il a passé deux heures hier avec le Roi. Pas l’idée de rapprochement entre les 2 Bourbons. Au contraire, le roi se plaignant que la branche aîné ne fait rien pour cela et répétant que l’initiative ne saurait être prise par la cadette. Les princes sont en Ecosse à la chasse. Les Nemours ne sont pas revenus d'Allemagne. M. Fould serait fâché que M. Molé entrât, il doit se réserver pour un meilleur moment. Mais il sait qu’il en a envie, quant à Thiers ce ne serait pas une acquisition. On n'a pas confiance en lui, ni aucune considération pour lui.
Il m’a parlé de vous, de ce que dans un an ou deux vous deviez nécessairement vous retrouver l’homme important, le seul. Qu’en attendant il valait bien mieux pour vous et pour cet avenir ne pas faire partie de l'assemblée. On a accusé le parti conservateur de n’avoir pas poussé à votre élection. C'était par amour pour vous. J’ai dit ici. On a repoussé. Et c'est là ce qui a étonné tout le monde. Il a équivoqué des interrogations sur ce que vous allez faire. Rien, il reste tranquille chez lui. Il écrit. Parce qu'il a besoin d'écrire. Une grande honte pour notre pays. Et puis si vous viendriez à Paris. Je ne sais pas, peut être. Il n’est pas prévu. Voilà à peu près tout.
Samedi le 29. Flahaut a été voir le roi hier. Il l'a trouvé bavard, mécontent de tout le monde. N’aimant que l'Angleterre. Et décidé à mourir ici ; même à Claremont, ce qui véritablement n’arrange pas la cour. Mais dit Flahaut "Le roi a raison de penser à lui même." Voilà donc le manifeste du Pape. Que ferez-vous ? 1 heure. Vous avez donc eu mes lettres, me voilà rassurée. Ce que vous me répondez est triste. Pauvre pays. Petits hommes ! Adieu. Adieu. Bien vite. Je suis en retard aujourd’hui, mauvaise nuit, levée tard. Adieu
Richmond, Mercredi 26 Septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond Mercredi 26 septembre 1849
Vous voilà donc écrivant toujours vous fatigant la tête. Pourquoi ? [Vain est] bien la peine de parler raison à des gens qui ne savent pas la comprendre. Dire des vérités mais de quoi cela sert il ? Si non à augmenter le paquet assez gros d’ennemi que vous avez déjà. Moi je vous voudrais tranquille, reprenant tranquillement une douce vie à Paris. Ceci ne vous la rendra pas plus facile qui sait si cela ne vous empêchera pas d'y venir ? Vous aurez fait de la belle. besogne. Dormez. Mangez, pas trop, menez une vie paisible, ne vous tracassez pas. Laissez aller le monde comme il lui plait d’aller. Vous ne le reformerez pas. Il y aurait trop de vanité à croire que vous le pouvez. Les Français sont incorrigibles, vous ne les corrigerez pas. Mais je veux que vous vous portiez bien, et que nous causions tranquillement des misères de ce monde, de ses drôleries aussi, car il est drôle. N'êtes-vous pas un peu philosophe aussi ? On le porte mieux à ce métier. ces deux pages sont le produit de votre lettre. Je parlerai [?] cela bien mieux que je ne puis vous écrire. I do my best.
Jeudi 27 septembre Voici une lettre. Assez curieuse, vous me la renverrez. Flahaut est venu jaser hier. Trois heures de séance, très bonne conversation. Beaucoup de good sense. Deux idées favorites absolues : l’Empire, et l'abolition de la liberté de la presse. Sans elle on ne sortira jamais des Révolutions. De quoi servent des lois restrictives ? On publie journellement des horreurs. Si cela continue, le monde croulera, la société s’entend pour cela je le crois. Flahaut a parlé à lord John un langage bien France sur lord Palmerston. Il est impossible de dire plus & plus fort. Il écoute, il sourit el va à Woburne pour 10 jours. Je le reverrai encore à son retour. Evidement les Metternich tout bien de quitter l'Angleterre. Elle ne se possède plus. Son langage est si violent qu'elle pourrait bien s’attirer des désagréments ici. On peut bien haïr & nuire mais avec plus de convenance M. Guenau de Mussy vient me voir quelques fois. Hélas il est prié par le roi. Il reste attaché à sa maison. 20 m. Francs par an, & les pratiques qu’il pourra se procurer à Londres. Je regrette fort qu’il ne vienne pas à Paris. J'aurais en lui pleine confiance. Imagines que lord John Russell & M. Drouyn de Lhuys ne se connaissaient pas. Ils se sont vus une fois à la chambre des communes. Voilà tout. John a porté sa carte, l’Ambassadeur l'a rendue, & c’est fini. C’est incroyable. Certainement le tort est à l’Ambassadeur. C'est à lui à rechercher le premier ministre. Adieu, car je n’espère pas votre lettre. Je vais me plaindre à lord Clauricarde. Adieu. Adieu.
Vous voilà donc écrivant toujours vous fatigant la tête. Pourquoi ? [Vain est] bien la peine de parler raison à des gens qui ne savent pas la comprendre. Dire des vérités mais de quoi cela sert il ? Si non à augmenter le paquet assez gros d’ennemi que vous avez déjà. Moi je vous voudrais tranquille, reprenant tranquillement une douce vie à Paris. Ceci ne vous la rendra pas plus facile qui sait si cela ne vous empêchera pas d'y venir ? Vous aurez fait de la belle. besogne. Dormez. Mangez, pas trop, menez une vie paisible, ne vous tracassez pas. Laissez aller le monde comme il lui plait d’aller. Vous ne le reformerez pas. Il y aurait trop de vanité à croire que vous le pouvez. Les Français sont incorrigibles, vous ne les corrigerez pas. Mais je veux que vous vous portiez bien, et que nous causions tranquillement des misères de ce monde, de ses drôleries aussi, car il est drôle. N'êtes-vous pas un peu philosophe aussi ? On le porte mieux à ce métier. ces deux pages sont le produit de votre lettre. Je parlerai [?] cela bien mieux que je ne puis vous écrire. I do my best.
Jeudi 27 septembre Voici une lettre. Assez curieuse, vous me la renverrez. Flahaut est venu jaser hier. Trois heures de séance, très bonne conversation. Beaucoup de good sense. Deux idées favorites absolues : l’Empire, et l'abolition de la liberté de la presse. Sans elle on ne sortira jamais des Révolutions. De quoi servent des lois restrictives ? On publie journellement des horreurs. Si cela continue, le monde croulera, la société s’entend pour cela je le crois. Flahaut a parlé à lord John un langage bien France sur lord Palmerston. Il est impossible de dire plus & plus fort. Il écoute, il sourit el va à Woburne pour 10 jours. Je le reverrai encore à son retour. Evidement les Metternich tout bien de quitter l'Angleterre. Elle ne se possède plus. Son langage est si violent qu'elle pourrait bien s’attirer des désagréments ici. On peut bien haïr & nuire mais avec plus de convenance M. Guenau de Mussy vient me voir quelques fois. Hélas il est prié par le roi. Il reste attaché à sa maison. 20 m. Francs par an, & les pratiques qu’il pourra se procurer à Londres. Je regrette fort qu’il ne vienne pas à Paris. J'aurais en lui pleine confiance. Imagines que lord John Russell & M. Drouyn de Lhuys ne se connaissaient pas. Ils se sont vus une fois à la chambre des communes. Voilà tout. John a porté sa carte, l’Ambassadeur l'a rendue, & c’est fini. C’est incroyable. Certainement le tort est à l’Ambassadeur. C'est à lui à rechercher le premier ministre. Adieu, car je n’espère pas votre lettre. Je vais me plaindre à lord Clauricarde. Adieu. Adieu.
Broglie, Lundi 24 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Broglie. Lundi 24 sept 1849 Sept heures
Je vois approcher avec plaisir le jour où je retournerai chez moi. Je suis très bien ici très choyé. Bonne conversation, et qui me plait sur toutes choses comme sur les affaires. Mais j’ai l’esprit plein de ce que je fais de ce que je veux faire. Il n’y a qu’une conversation que je préfère toujours à mes propres préoccupations. Ce que je fais me préoccupe sérieuse ment. Je me figure que ce qui manque le plus aujourd’hui en France, c’est quelqu'un qui dise la vérité avec quelque autorité ; la vérité que tout le monde croit, que tout le monde attend, et à laquelle personne n’ose toucher. Je ferais certainement cela. D’abord sous le manteau anglais ; puis et pas longtemps après, sous ma propre figure française, en parlant de mon temps et de moi- même. Il est clair que l'autorité ne me manque pas. Je voudrais que vous vissiez tous les gens qui viennent me voir. Je suis frappé surtout de ceux d’ici, que je ne connaissais pas auparavant, la plupart du moins. Conservateurs, il est vrai, mais conservateurs de toute sorte et de toute date. Vous seriez frappée de leur déférence. Et de leur curiosité pleine d’assentiment quand j'explique comme je l’entends, ce qui s’est passé, la conduite que j'ai tenue, et pourquoi je suis tombé quoique ma politique fût bonne, et parce qu’elle était trop bonne. N'ayez pas peur ; je ne suis point arrogant, ni blessant. Je ne fais que profiter du sentiment que je rencontre pour exprimer librement le mien. Si le temps et la force ne me manquent pas un moment viendra, où mon avis sera d'un grand poids. Mais le temps et la force pourront bien me manquer. Je vieillis. Je me fatigue vite, et de corps et d’esprit, par la promenade et par le travail. J’ai besoin de repos, de sommeil. Je dors quelques fois dans le jour. Je serais encore en état de donner un coup de collier. Mais à un effort soutenu, prolongé, sans relâche, et sans liberté, je pourrais fort bien ne pas suffire.
10 heures
Je suis bien aise que vous soyez allée à Claremont. Et sûr que votre observation est très juste. La mauvaise fortune n'a fait qu'accroitre la disposition ancienne et constante du Roi; se plaindre de tout le monde, et ne se louer de personne. Mauvaise disposition pour être bien servi. Je sais que l’intérieur n'est pas très harmonieux surtout en ce qui concerne le séjour de l'hiver prochain. L’Angleterre leur déplait à tous excepté au Roi. C’est lui qui a raison. A moins que l'hiver de Claremont ne convienne pas à la santé de la Reine, ce dont j'ai peur. Que dites-vous de Gustave de Beaumont à Vienne ? Au fond, peu importe. Mais le gros bavardage que vous avez entendu à Holland House sera encore plus déplacé à Vienne. M. de Falloux, est décidément hors de danger. Plus de nécessité de retraite, et sa convalescence servira à ajourner, les deux plus périlleuses discussions. Ce qui va beaucoup mieux aussi, c'est le choléra de Paris. Il s'en va. J’ai des nouvelles de plusieurs médecins, unanimes à se rassurer. Que faites-vous de M. Guéneau de Mussy ? Tant que vous resterez en Angleterre, je suis bien aise qu’il y reste. Adieu, adieu. Adieu encore. G.
Je vois approcher avec plaisir le jour où je retournerai chez moi. Je suis très bien ici très choyé. Bonne conversation, et qui me plait sur toutes choses comme sur les affaires. Mais j’ai l’esprit plein de ce que je fais de ce que je veux faire. Il n’y a qu’une conversation que je préfère toujours à mes propres préoccupations. Ce que je fais me préoccupe sérieuse ment. Je me figure que ce qui manque le plus aujourd’hui en France, c’est quelqu'un qui dise la vérité avec quelque autorité ; la vérité que tout le monde croit, que tout le monde attend, et à laquelle personne n’ose toucher. Je ferais certainement cela. D’abord sous le manteau anglais ; puis et pas longtemps après, sous ma propre figure française, en parlant de mon temps et de moi- même. Il est clair que l'autorité ne me manque pas. Je voudrais que vous vissiez tous les gens qui viennent me voir. Je suis frappé surtout de ceux d’ici, que je ne connaissais pas auparavant, la plupart du moins. Conservateurs, il est vrai, mais conservateurs de toute sorte et de toute date. Vous seriez frappée de leur déférence. Et de leur curiosité pleine d’assentiment quand j'explique comme je l’entends, ce qui s’est passé, la conduite que j'ai tenue, et pourquoi je suis tombé quoique ma politique fût bonne, et parce qu’elle était trop bonne. N'ayez pas peur ; je ne suis point arrogant, ni blessant. Je ne fais que profiter du sentiment que je rencontre pour exprimer librement le mien. Si le temps et la force ne me manquent pas un moment viendra, où mon avis sera d'un grand poids. Mais le temps et la force pourront bien me manquer. Je vieillis. Je me fatigue vite, et de corps et d’esprit, par la promenade et par le travail. J’ai besoin de repos, de sommeil. Je dors quelques fois dans le jour. Je serais encore en état de donner un coup de collier. Mais à un effort soutenu, prolongé, sans relâche, et sans liberté, je pourrais fort bien ne pas suffire.
10 heures
Je suis bien aise que vous soyez allée à Claremont. Et sûr que votre observation est très juste. La mauvaise fortune n'a fait qu'accroitre la disposition ancienne et constante du Roi; se plaindre de tout le monde, et ne se louer de personne. Mauvaise disposition pour être bien servi. Je sais que l’intérieur n'est pas très harmonieux surtout en ce qui concerne le séjour de l'hiver prochain. L’Angleterre leur déplait à tous excepté au Roi. C’est lui qui a raison. A moins que l'hiver de Claremont ne convienne pas à la santé de la Reine, ce dont j'ai peur. Que dites-vous de Gustave de Beaumont à Vienne ? Au fond, peu importe. Mais le gros bavardage que vous avez entendu à Holland House sera encore plus déplacé à Vienne. M. de Falloux, est décidément hors de danger. Plus de nécessité de retraite, et sa convalescence servira à ajourner, les deux plus périlleuses discussions. Ce qui va beaucoup mieux aussi, c'est le choléra de Paris. Il s'en va. J’ai des nouvelles de plusieurs médecins, unanimes à se rassurer. Que faites-vous de M. Guéneau de Mussy ? Tant que vous resterez en Angleterre, je suis bien aise qu’il y reste. Adieu, adieu. Adieu encore. G.
Brompton, Mardi 13 février 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Mardi 13 février 1849
8 heures
Tout ce qui m’arrive directement ou indirectement, me confirme la longue lettre que je vous ai montrée il y a trois jours, et ce que nous nous sommes dit, tant sur la situation générale que sur ce qui m’est personnel. Evidemment le Président gagne, non seulement parce qu’il se conduit bien, mais parce que les partis qui veulent autre chose que lui s’aperçoivent qu'ils ne peuvent. rien, quant à présent du moins et se résignent à lui plutôt que de se rapprocher entre eux pour se passer de lui. Les légitimistes surtout lui témoignent faveur. Il lui savent gré d’avoir soutenu, non seulement son Cabinet, mais spécialement M. de Falloux dans son cabinet. Il l’a soutenu, non seulement contre les attaques du dehors, mais contre les dissentions et les attaques intérieures du cabinet même. Passy voulait qu'on renvoyât MM. de Falloux, et Léon Faucher, et qu’on prit à leur place Dufaure et Gustave de Beaumont. Je le reconnais bien là ; jeter tout de suite par dessus le bord ceux contre qui on crie, pour les remplacer par les voix les moins aigres parmi ceux qui crient. Le Président n'a voulu entendre, ni à la chute, ni au démembrement de son cabinet. Les partis ajournent entre ses mains, leurs espérances et leurs querelles. Aspire-t-il à l'Empire ? A-t-il aussi ses prétentions d'avenir qu’il ajourne aussi, ne pouvant mieux faire ? C’est la question obscure, même pour ceux qui l'approchent. Il est honnête et sournois. Il ne trahit ni ses ministres, ni ses projets. Les plus habiles croient qu’il a une ambition sans bruit, comme son entêtement. On parle plus d'Empire loin de lui, qu'autour de lui. De tous les meneurs Thiers est évidemment celui qui pense le plus mal du Président. Le plus mal, c’est-à-dire le plus légèrement, qui en tient le moins de compte, et croit le moins à son avenir de président ou d'Empereur. Thiers et les Régentistes font de plus en plus bande à part, mécontents de tout le monde et mécontentant tout le monde. Plus de couverts. et plus pressés que les autres ; par étourderie naturelle, par humeur de leur désappointement en Février dernier, et envie de le réparer parce qu'à tort ou à raison, ils se croient les plus forts. Mais comme ils ont tous les autres contre ceux, Légitimistes, Impérialistes, Républicains, ils agissent au fond, tout aussi peu, et montrent plus leurs desseins qu'ils ne les avancent. L’ajournement de toutes les espérances, de toutes les prétentions, plus ou moins cachées, mais toutes impuissantes, c’est là le fait caractéristique de la situation. Soyez sure que, pour tout le monde, il n’y a qu'ajournement, personne ne renonce à ce qu'il veut et n'accepte ce qui est comme une solution. Pour ce qui me touche, curieuse comédie, très mêlée et obscure en apparence, très claire au fond et en tout cas très active. De M. Thiers à ceux de mes amis qui le voient, mêmes protestations qu’il désire mon élection, qu'il l’appuiera, qu’il veut s’entendre avec moi sur toutes choses. De la part de ses amis et de ses alliés, travail très acharné, direct et détourné, contre mon élection. Voici les deux moyens les plus neufs. On dit aux conservateurs, un peu tièdes, ou un peu badauds " Pourquoi faire arriver M. Guizot, dès le début de l’assemblée prochaine ? M. Thiers va si bien ! Il s’engage si vivement dans la cause de l'ordre, avec les amis de l’ordre ! S’il se trouve tout de suite en face de M. Guizot, l'ancienne rivalité pour recommencer ; M. Thiers peut reculer vers les idées et les hommes de la révolution. M. Guizot viendra un peu plus tard. " On ne se contente pas de Paris ; on veut agir par Claremont ; on emploie le Roi pour m’engager à l’attente, à l'ajournement, à l'abdication. C'est de bien loin, bien timidement , mais la tentative a paru dans quelques paroles du Roi à Duchâtel qui y est allé, il y a trois jours. Le général Dumas qui arrive de Paris a apporté cette consigne. Il est venu me voir. Je n’y étais pas. Il reviendra. Mon langage est très simple et très net. Je ne demande rien à personne. Je reste ici, et j’y attends les élections. Mais si mon pays m’appelle, il me trouvera prêt. Je le dis d'avance, et je ne me laisserai éconduire par personne. Toutes les jalousies sont ridicules aujourd’hui. Toutes les coteries seront impuissantes. Je n'en formerai aucune pour moi ; mais je n'en accepterai aucune contre moi. J’ai écrit hier en ce sens au duc de Broglie une lettre que je vous montrerai. Et une aussi à Piscatory, plus propre à éventer les pièges et à les déjouer. Duchâtel a les mêmes renseignements. On l'englobe, nécessairement, dans le même travail ennemi. Il prend le même parti que moi. Il reste ici jusqu'après les élections, malgré l'ennui de chercher une nouvelle maison. Il n'a la sienne que jusqu'au 1er mars. Voici une petite lettre de Barante. Il m'a envoyé sa brochure avec un exemplaire pour vous que je vous apporterai jeudi. A quelle heure arriverez-vous ? Je ne puis dire combien ces deux dîners me déplaisent. J’aimerais presque mieux que nous ne vinssiez que samedi. Dialogue entre Thiers et sa femme. Elle parlait mal du Président, de sa cour, des personnes qui y vont, de l'air et des prétentions de la maison. Ma chère amie, pas de ces propos ; tout cela ne vaut rien ; il faut être plus respectueux. - Ah, par exemple si vous croyez que je me gênerai pour le président, vous n'y pensez pas. Vous ne vous gênez pas pour mieux que lui. Souvenez-vous que vous alliez chez le duc de Nemours, en cravate noire et en bottes. Je ne m'en souviens que trop. J’avais tort, grand tort. Ah, si ce bon temps là pouvait revenir, je n'irais plus jamais aux Tuileries, qu’en cravate blanche, peut-être même, en culotte courte. Pour ceci pourtant, je ne m’engage pas. " Le Maréchal Sébastiani est à peu près en enfance. Très courtisan du Président, chez qui il va à tort et à travers. Même au bal. On en est choqué. D’Haubersaert lui disait l'autre jour, la veille du bal : " M. le Maréchal ne pourriez- vous pas avoir demain, pour ne pas aller au bal, le rhume que vous auriez du prendre sur la place Louis XV, le jour où vous avez assisté à la lecture de la Constitution ? " Voilà un volume. Ce serait bien plus long si vous étiez là. Une heure Je crains que ce ne soit ce froid, qui ravive votre rhume. Vous avez la manie de vous promener par le froid. Adieu, Adieu. Je regrette votre séance avec M. de Metternich. Je disais un jour à M. de Talleyrand : " Le premier plaisir de ce monde, c’est la conversation. " Il me dit : " Non, c'est l’action. Nous ne disions vrai ni l'un ni l'autre. Il y a un autre plaisir qui vaut mieux que ces deux là. Adieu. Adieu. Adieu. G.
8 heures
Tout ce qui m’arrive directement ou indirectement, me confirme la longue lettre que je vous ai montrée il y a trois jours, et ce que nous nous sommes dit, tant sur la situation générale que sur ce qui m’est personnel. Evidemment le Président gagne, non seulement parce qu’il se conduit bien, mais parce que les partis qui veulent autre chose que lui s’aperçoivent qu'ils ne peuvent. rien, quant à présent du moins et se résignent à lui plutôt que de se rapprocher entre eux pour se passer de lui. Les légitimistes surtout lui témoignent faveur. Il lui savent gré d’avoir soutenu, non seulement son Cabinet, mais spécialement M. de Falloux dans son cabinet. Il l’a soutenu, non seulement contre les attaques du dehors, mais contre les dissentions et les attaques intérieures du cabinet même. Passy voulait qu'on renvoyât MM. de Falloux, et Léon Faucher, et qu’on prit à leur place Dufaure et Gustave de Beaumont. Je le reconnais bien là ; jeter tout de suite par dessus le bord ceux contre qui on crie, pour les remplacer par les voix les moins aigres parmi ceux qui crient. Le Président n'a voulu entendre, ni à la chute, ni au démembrement de son cabinet. Les partis ajournent entre ses mains, leurs espérances et leurs querelles. Aspire-t-il à l'Empire ? A-t-il aussi ses prétentions d'avenir qu’il ajourne aussi, ne pouvant mieux faire ? C’est la question obscure, même pour ceux qui l'approchent. Il est honnête et sournois. Il ne trahit ni ses ministres, ni ses projets. Les plus habiles croient qu’il a une ambition sans bruit, comme son entêtement. On parle plus d'Empire loin de lui, qu'autour de lui. De tous les meneurs Thiers est évidemment celui qui pense le plus mal du Président. Le plus mal, c’est-à-dire le plus légèrement, qui en tient le moins de compte, et croit le moins à son avenir de président ou d'Empereur. Thiers et les Régentistes font de plus en plus bande à part, mécontents de tout le monde et mécontentant tout le monde. Plus de couverts. et plus pressés que les autres ; par étourderie naturelle, par humeur de leur désappointement en Février dernier, et envie de le réparer parce qu'à tort ou à raison, ils se croient les plus forts. Mais comme ils ont tous les autres contre ceux, Légitimistes, Impérialistes, Républicains, ils agissent au fond, tout aussi peu, et montrent plus leurs desseins qu'ils ne les avancent. L’ajournement de toutes les espérances, de toutes les prétentions, plus ou moins cachées, mais toutes impuissantes, c’est là le fait caractéristique de la situation. Soyez sure que, pour tout le monde, il n’y a qu'ajournement, personne ne renonce à ce qu'il veut et n'accepte ce qui est comme une solution. Pour ce qui me touche, curieuse comédie, très mêlée et obscure en apparence, très claire au fond et en tout cas très active. De M. Thiers à ceux de mes amis qui le voient, mêmes protestations qu’il désire mon élection, qu'il l’appuiera, qu’il veut s’entendre avec moi sur toutes choses. De la part de ses amis et de ses alliés, travail très acharné, direct et détourné, contre mon élection. Voici les deux moyens les plus neufs. On dit aux conservateurs, un peu tièdes, ou un peu badauds " Pourquoi faire arriver M. Guizot, dès le début de l’assemblée prochaine ? M. Thiers va si bien ! Il s’engage si vivement dans la cause de l'ordre, avec les amis de l’ordre ! S’il se trouve tout de suite en face de M. Guizot, l'ancienne rivalité pour recommencer ; M. Thiers peut reculer vers les idées et les hommes de la révolution. M. Guizot viendra un peu plus tard. " On ne se contente pas de Paris ; on veut agir par Claremont ; on emploie le Roi pour m’engager à l’attente, à l'ajournement, à l'abdication. C'est de bien loin, bien timidement , mais la tentative a paru dans quelques paroles du Roi à Duchâtel qui y est allé, il y a trois jours. Le général Dumas qui arrive de Paris a apporté cette consigne. Il est venu me voir. Je n’y étais pas. Il reviendra. Mon langage est très simple et très net. Je ne demande rien à personne. Je reste ici, et j’y attends les élections. Mais si mon pays m’appelle, il me trouvera prêt. Je le dis d'avance, et je ne me laisserai éconduire par personne. Toutes les jalousies sont ridicules aujourd’hui. Toutes les coteries seront impuissantes. Je n'en formerai aucune pour moi ; mais je n'en accepterai aucune contre moi. J’ai écrit hier en ce sens au duc de Broglie une lettre que je vous montrerai. Et une aussi à Piscatory, plus propre à éventer les pièges et à les déjouer. Duchâtel a les mêmes renseignements. On l'englobe, nécessairement, dans le même travail ennemi. Il prend le même parti que moi. Il reste ici jusqu'après les élections, malgré l'ennui de chercher une nouvelle maison. Il n'a la sienne que jusqu'au 1er mars. Voici une petite lettre de Barante. Il m'a envoyé sa brochure avec un exemplaire pour vous que je vous apporterai jeudi. A quelle heure arriverez-vous ? Je ne puis dire combien ces deux dîners me déplaisent. J’aimerais presque mieux que nous ne vinssiez que samedi. Dialogue entre Thiers et sa femme. Elle parlait mal du Président, de sa cour, des personnes qui y vont, de l'air et des prétentions de la maison. Ma chère amie, pas de ces propos ; tout cela ne vaut rien ; il faut être plus respectueux. - Ah, par exemple si vous croyez que je me gênerai pour le président, vous n'y pensez pas. Vous ne vous gênez pas pour mieux que lui. Souvenez-vous que vous alliez chez le duc de Nemours, en cravate noire et en bottes. Je ne m'en souviens que trop. J’avais tort, grand tort. Ah, si ce bon temps là pouvait revenir, je n'irais plus jamais aux Tuileries, qu’en cravate blanche, peut-être même, en culotte courte. Pour ceci pourtant, je ne m’engage pas. " Le Maréchal Sébastiani est à peu près en enfance. Très courtisan du Président, chez qui il va à tort et à travers. Même au bal. On en est choqué. D’Haubersaert lui disait l'autre jour, la veille du bal : " M. le Maréchal ne pourriez- vous pas avoir demain, pour ne pas aller au bal, le rhume que vous auriez du prendre sur la place Louis XV, le jour où vous avez assisté à la lecture de la Constitution ? " Voilà un volume. Ce serait bien plus long si vous étiez là. Une heure Je crains que ce ne soit ce froid, qui ravive votre rhume. Vous avez la manie de vous promener par le froid. Adieu, Adieu. Je regrette votre séance avec M. de Metternich. Je disais un jour à M. de Talleyrand : " Le premier plaisir de ce monde, c’est la conversation. " Il me dit : " Non, c'est l’action. Nous ne disions vrai ni l'un ni l'autre. Il y a un autre plaisir qui vaut mieux que ces deux là. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Brompton, Mercredi 24 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Mercredi 24 Janv. 1849
Il m’est venu ce matin une bonne occasion pour Paris et j'ai écrit quatorze lettres, grandes ou petites. C’est un grand ennui. Mais je réponds à tout le monde. Il y a telle lettre insignifiante qui, un jour, à son prix. Je crois aussi à de mauvais moments encore dans Paris, et je suis bien aise de n'y pas être. Toutes les nouvelles sont dans ce sens. On m'annonce pour ces jours-ci des lettres détaillées. J'en aurai quelqu'une avant samedi. Louis B. ne peut ni s'établir ni tomber sans bruit. Je persiste à croire qu’avant de tomber, il essaiera et de la République rouge et de l'Empire. Il faut qu’on ait essayé de tout. Pour la première fois, les journaux légitimistes commencent à attaquer. Thiers au nom de la question entre Henry V et la Régence. Lisez l’article ci-joint que je trouve dans l'opinion publique. C’est très grave. Et je crois que c’est absurde à eux. Ils n'ont nul intérêt à faire vider la question d'avance. Il pourraient, un jour, avoir la nécessité pour eux. Le débat préliminaire sera toujours contre eux. L’esprit de parti à tout à la fois des lumières et des aveuglements inconcevables. Je doute que cela finisse sans guerre civile. Et je ne sais pas comment la guerre civile finira. Je suis curieux de savoir si le Constitutionnel relèvera ce gant. L'expédition de Toulon, n'en sortira pas. Et le Pape a raison de rester à rade tant que les Puissances catholiques y compris l’Autriche, ne se seront pas accordées pour le ramener toutes ensemble à Civita Vecchia. Sa présence là, sous une telle escorte, ferait tomber la révolution de Rome. Je conviens que cela ne ferait pas les affaires de Lord Palmerston. Il lui vaudrait mieux que le Pape fût à Rome, impuissant et toujours menacé. Décidément Lord Palmerston est un vieillard. Il ne comprend rien à ce qui se passe et ne sait plus penser et faire que ce qu'il a pensé et fait jadis. Je suis frappé du retour de Lord Aberdeen chez Sir Robert Peel. Certainement il y a quelque chose. On commence à dire assez haut que la Reine se plaint tout haut de Lord Palmerston et s'en inquiète. Savez-vous ce que dit Barante du dîner de M. de Falloux ? " Nous avons eu le banquet du Châteaurouge ; ceci est le banquet du Châteaublanc." Et Dupin après le vote des 48 000 fr. ; pour M. Boulay de la Meurthe, vice président de la République : " 48 est donc le calibre de notre boulet. " J’ai reçu hier un billet pressant de Lady Holland, me priant, au nom de Lord Holland d’aller dîner aujourd'hui à Holland-House. J'y vais. Je serai charmé que Holland House reprît. Je vous dirai les physionomies. Adieu. Adieu. Je voudrais bien que nous fussions seuls quelques heures de Samedi à Lundi. Adieu. G.
Il m’est venu ce matin une bonne occasion pour Paris et j'ai écrit quatorze lettres, grandes ou petites. C’est un grand ennui. Mais je réponds à tout le monde. Il y a telle lettre insignifiante qui, un jour, à son prix. Je crois aussi à de mauvais moments encore dans Paris, et je suis bien aise de n'y pas être. Toutes les nouvelles sont dans ce sens. On m'annonce pour ces jours-ci des lettres détaillées. J'en aurai quelqu'une avant samedi. Louis B. ne peut ni s'établir ni tomber sans bruit. Je persiste à croire qu’avant de tomber, il essaiera et de la République rouge et de l'Empire. Il faut qu’on ait essayé de tout. Pour la première fois, les journaux légitimistes commencent à attaquer. Thiers au nom de la question entre Henry V et la Régence. Lisez l’article ci-joint que je trouve dans l'opinion publique. C’est très grave. Et je crois que c’est absurde à eux. Ils n'ont nul intérêt à faire vider la question d'avance. Il pourraient, un jour, avoir la nécessité pour eux. Le débat préliminaire sera toujours contre eux. L’esprit de parti à tout à la fois des lumières et des aveuglements inconcevables. Je doute que cela finisse sans guerre civile. Et je ne sais pas comment la guerre civile finira. Je suis curieux de savoir si le Constitutionnel relèvera ce gant. L'expédition de Toulon, n'en sortira pas. Et le Pape a raison de rester à rade tant que les Puissances catholiques y compris l’Autriche, ne se seront pas accordées pour le ramener toutes ensemble à Civita Vecchia. Sa présence là, sous une telle escorte, ferait tomber la révolution de Rome. Je conviens que cela ne ferait pas les affaires de Lord Palmerston. Il lui vaudrait mieux que le Pape fût à Rome, impuissant et toujours menacé. Décidément Lord Palmerston est un vieillard. Il ne comprend rien à ce qui se passe et ne sait plus penser et faire que ce qu'il a pensé et fait jadis. Je suis frappé du retour de Lord Aberdeen chez Sir Robert Peel. Certainement il y a quelque chose. On commence à dire assez haut que la Reine se plaint tout haut de Lord Palmerston et s'en inquiète. Savez-vous ce que dit Barante du dîner de M. de Falloux ? " Nous avons eu le banquet du Châteaurouge ; ceci est le banquet du Châteaublanc." Et Dupin après le vote des 48 000 fr. ; pour M. Boulay de la Meurthe, vice président de la République : " 48 est donc le calibre de notre boulet. " J’ai reçu hier un billet pressant de Lady Holland, me priant, au nom de Lord Holland d’aller dîner aujourd'hui à Holland-House. J'y vais. Je serai charmé que Holland House reprît. Je vous dirai les physionomies. Adieu. Adieu. Je voudrais bien que nous fussions seuls quelques heures de Samedi à Lundi. Adieu. G.
Brompton, Jeudi 18 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Jeudi 18 Janv. 1849
3 heures
Je trouve en arrivant de bonnes nouvelles de mes affaires électorales dans le Calvados. Mes amis conservateurs reprennent courage. Les légitimistes m'épousent chaudement. On me dit que bientôt les candidats qui essayaient de m'écarter viendront me prier de les aider. Tout cela me confirme dans la résolution convenue. Des nouvelles contraires produiraient le même effet. Voici une lettre de M. Vitet homme d’esprit, froid, juste et sagace. Vous verrez qu'il est sombre, même après le succès futur, s’il vient. Renvoyez-la moi, je vous prie. Point de nouvelles générales. Duchâtel est de retour de Belvain. Il vient de me renvoyer un livre. Je le verrai probablement demain. On a fait en Belgique une contrefaçon de ma Démocratie. Si petite qu'on l'envoie dans des lettres. pour 10 sous. Comment passe-ton si vite du plaisir au regret ? Une minute creuse un abyme. Adieu. Adieu. Ne vous fatiguez pas à lire.
3 heures
Je trouve en arrivant de bonnes nouvelles de mes affaires électorales dans le Calvados. Mes amis conservateurs reprennent courage. Les légitimistes m'épousent chaudement. On me dit que bientôt les candidats qui essayaient de m'écarter viendront me prier de les aider. Tout cela me confirme dans la résolution convenue. Des nouvelles contraires produiraient le même effet. Voici une lettre de M. Vitet homme d’esprit, froid, juste et sagace. Vous verrez qu'il est sombre, même après le succès futur, s’il vient. Renvoyez-la moi, je vous prie. Point de nouvelles générales. Duchâtel est de retour de Belvain. Il vient de me renvoyer un livre. Je le verrai probablement demain. On a fait en Belgique une contrefaçon de ma Démocratie. Si petite qu'on l'envoie dans des lettres. pour 10 sous. Comment passe-ton si vite du plaisir au regret ? Une minute creuse un abyme. Adieu. Adieu. Ne vous fatiguez pas à lire.
Drayton manor, Samedi 18 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Drayton-manor. Samedi 18 nov. 1848
5 heures
Nous nous sommes promenés ce matin dans le parc. Nous avons longtemps causé, Sir Robert et moi. Curieuse conversation où il y avait de quoi rire de l'un et de l'autre interlocuteur, si bien que j’en riais en parlant. Nous n'étions tous deux occupés qu’à nous démontrer que nous avions bien fait, lui de briser, à tout risque, le parti conservateur pour réformer la loi des céréales, moi d’ajourner, à tout risque, la réforme électorale pour maintenir le parti conservateur. Et je crois en vérité que nous nous sommes convaincus l’un l'autre. Mais il se fondait surtout sur ce qui est arrivé en Europe " Que serions-nous devenus, au milieu de ce bouleversement si la loi des céréales eût subsisté ? " En sorte que c’est nous qui en tombant lui avons fourni son meilleur argument.
Il me paraît avoir en ce moment une nouvelle idée fixe, c’est l’énormité partout de la « public expenditure. " Cela ne peut pas aller, on ne le supportera pas ; il faut absolument trouver un moyen de réduire, partout, les dépenses de l’armée de la marine d'avoir vraiment le budget de la paix. "Je n’ai pas manqué une si bonne occasion! " Si vous n'étiez pas tombé, si je n'étais pas tombé, cela eût peut-être été possible. La France et l'Angleterre conservatrices et amies, pouvaient se mettre sur le pied de paix, de paix solide et y mettre tout le monde. Mais aujourd’hui, sans vous, sans nous, il n'y a pas moyen. Les révolutions ne désarment pas. On ne désarme pas en présence des révolutions. " Cela lui plaisait. Il ne croit pas au bruit du fils de lord Cottenham. Il écarte la conversation sur ce sujet. Par précaution et par goût. Il n'aime pas cette perspective.
Le dean de Westminster et M. Hallam sont arrivés ce matin. Jarnac ne vient décidément pas. Il est toujours malade. Mon lit était très bon hier soir. Ma Chambre est excellente. Toute la maison est chauffée par un calorifère. Nous nous sommes promenés entre hommes. Lady Peel et Lady Mahon sont allées de leur côté.
Il y a une fille de Lady Peel qui me plaît. Jolie réservée avec intelligence de la vivacité sans mouvement. Je serais étonné qu’elle n’eût pas de l’esprit. Je ne vois pas que le soulèvement de Breslau se confirme. Il paraît que l'exécution de Blum fait beaucoup de bruit à Francfort Le droit est incontestablement du côté du Prince Windisch-Graetz. Reste la question de prudence.
Dimanche 19 nov. 4 heures
Encore une longue promenade à pied, mais pas seul, avec Sir Robert. Lord Mahon, M. Hallam et le dean de Westminster. Conversation purement amusante, mais amicale et animée. Beaucoup de jokes, latins et grecs. Sir Robert m'a mené ce matin au sermon, à Tamworth. Bien aise de me montrer. Il est impossible d'être plus courtois, sincèrement je crois, certainement avec l’intention d'être trouvé courtois, par moi-même, et par tous les témoins. Mais je comprends ceux qui disent que c’est un ermite politique, ne communiquant guères plus avec ses amis qu'avec ses ennemis.
Berlin me préoccupe beaucoup. Je crains que le Roi ne se charge de plus qu'il ne peut porter. Et s’il fait un pas en arrière, il est perdu. Voyez Francfort. Lisez les Débats. La résistance, quand elle devient efficace, effraye même ceux qui l’ont appelée. Ils y poussent et puis ils la repoussent. On ne veut, à aucun prix ; revenir au point de départ. Et on voudrait qu’en se défendant on ne fît de mal à personne. Quel est le plus grand mal, les esprits à l'envers ou les cœurs faibles ? je ne saurais décider. Les deux maux sont énormes.
Je suis bien aise que vous ayez rendu un petit service à Lady Holland. Cela vous dispense des autres. Vous avez bien raison de ne pas vous prêter à ses confidences.
Je n’ai rien de Paris. Je crois vraiment que l'acharnement de la Presse contre Cavaignac ne le serve au lieu de lui nuire. Cependant tout ce qui revient de France, continue d'être favorable à Louis Bonaparte. Parme qui est enfin arrivé hier avec sa femme, a les mêmes renseignements de son beau-frère, Jules de Larteyrie, qui est assez au courant, et qui déteste Louis Bonaparte sans vouloir de Cavaignac. Mad de Larteyrie revient ces jours-ci d'Orlombe. Jarnac la reconduira à Paris. Son mari croit à des coup de fusil, dans les rues de Paris, peu après l'élection, quelle qu’elle soit. La Princesse de Parme à Brighton m'amuse. Certainement votre visite est faite. Vous n’avez plus qu’à attendre. Adieu. Adieu.
Je pars après demain mardi, à 9 heures du matin. Adieu. G.
5 heures
Nous nous sommes promenés ce matin dans le parc. Nous avons longtemps causé, Sir Robert et moi. Curieuse conversation où il y avait de quoi rire de l'un et de l'autre interlocuteur, si bien que j’en riais en parlant. Nous n'étions tous deux occupés qu’à nous démontrer que nous avions bien fait, lui de briser, à tout risque, le parti conservateur pour réformer la loi des céréales, moi d’ajourner, à tout risque, la réforme électorale pour maintenir le parti conservateur. Et je crois en vérité que nous nous sommes convaincus l’un l'autre. Mais il se fondait surtout sur ce qui est arrivé en Europe " Que serions-nous devenus, au milieu de ce bouleversement si la loi des céréales eût subsisté ? " En sorte que c’est nous qui en tombant lui avons fourni son meilleur argument.
Il me paraît avoir en ce moment une nouvelle idée fixe, c’est l’énormité partout de la « public expenditure. " Cela ne peut pas aller, on ne le supportera pas ; il faut absolument trouver un moyen de réduire, partout, les dépenses de l’armée de la marine d'avoir vraiment le budget de la paix. "Je n’ai pas manqué une si bonne occasion! " Si vous n'étiez pas tombé, si je n'étais pas tombé, cela eût peut-être été possible. La France et l'Angleterre conservatrices et amies, pouvaient se mettre sur le pied de paix, de paix solide et y mettre tout le monde. Mais aujourd’hui, sans vous, sans nous, il n'y a pas moyen. Les révolutions ne désarment pas. On ne désarme pas en présence des révolutions. " Cela lui plaisait. Il ne croit pas au bruit du fils de lord Cottenham. Il écarte la conversation sur ce sujet. Par précaution et par goût. Il n'aime pas cette perspective.
Le dean de Westminster et M. Hallam sont arrivés ce matin. Jarnac ne vient décidément pas. Il est toujours malade. Mon lit était très bon hier soir. Ma Chambre est excellente. Toute la maison est chauffée par un calorifère. Nous nous sommes promenés entre hommes. Lady Peel et Lady Mahon sont allées de leur côté.
Il y a une fille de Lady Peel qui me plaît. Jolie réservée avec intelligence de la vivacité sans mouvement. Je serais étonné qu’elle n’eût pas de l’esprit. Je ne vois pas que le soulèvement de Breslau se confirme. Il paraît que l'exécution de Blum fait beaucoup de bruit à Francfort Le droit est incontestablement du côté du Prince Windisch-Graetz. Reste la question de prudence.
Dimanche 19 nov. 4 heures
Encore une longue promenade à pied, mais pas seul, avec Sir Robert. Lord Mahon, M. Hallam et le dean de Westminster. Conversation purement amusante, mais amicale et animée. Beaucoup de jokes, latins et grecs. Sir Robert m'a mené ce matin au sermon, à Tamworth. Bien aise de me montrer. Il est impossible d'être plus courtois, sincèrement je crois, certainement avec l’intention d'être trouvé courtois, par moi-même, et par tous les témoins. Mais je comprends ceux qui disent que c’est un ermite politique, ne communiquant guères plus avec ses amis qu'avec ses ennemis.
Berlin me préoccupe beaucoup. Je crains que le Roi ne se charge de plus qu'il ne peut porter. Et s’il fait un pas en arrière, il est perdu. Voyez Francfort. Lisez les Débats. La résistance, quand elle devient efficace, effraye même ceux qui l’ont appelée. Ils y poussent et puis ils la repoussent. On ne veut, à aucun prix ; revenir au point de départ. Et on voudrait qu’en se défendant on ne fît de mal à personne. Quel est le plus grand mal, les esprits à l'envers ou les cœurs faibles ? je ne saurais décider. Les deux maux sont énormes.
Je suis bien aise que vous ayez rendu un petit service à Lady Holland. Cela vous dispense des autres. Vous avez bien raison de ne pas vous prêter à ses confidences.
Je n’ai rien de Paris. Je crois vraiment que l'acharnement de la Presse contre Cavaignac ne le serve au lieu de lui nuire. Cependant tout ce qui revient de France, continue d'être favorable à Louis Bonaparte. Parme qui est enfin arrivé hier avec sa femme, a les mêmes renseignements de son beau-frère, Jules de Larteyrie, qui est assez au courant, et qui déteste Louis Bonaparte sans vouloir de Cavaignac. Mad de Larteyrie revient ces jours-ci d'Orlombe. Jarnac la reconduira à Paris. Son mari croit à des coup de fusil, dans les rues de Paris, peu après l'élection, quelle qu’elle soit. La Princesse de Parme à Brighton m'amuse. Certainement votre visite est faite. Vous n’avez plus qu’à attendre. Adieu. Adieu.
Je pars après demain mardi, à 9 heures du matin. Adieu. G.
Paris, Samedi 12 octobre 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris Samedi 12 octobre 1844
9 1/2
Voici vraiment ma dernière lettre portant l’adresse de l'Angleterre. Demain je vous écrirai à Eu. Quel plaisir ! Cependant voyez à quel point je vous aime plus que je ne m'aime moi-même, je regrette presque pas que Windsor ne soit pas plus long. Evidemment c’est un grand plaisir pour vous : c’est un beau un charmant moment dans votre vie, et je prends patience quand je vous sais content. Votre lettre de jeudi vient de m’arriver. Tout me plait là dedans continuez.
J’ai vu hier matin les Appony, Bacourt, Fagel, Fleichman. Ma promenade au bois de Boulogne, deux visites de Génie dans la matinée. Mon dîner solitaire la soirée chez Annette. Ceux que je vois prennent plaisir aux journaux Anglais et sont occupés et charmés de ce charmant voyage du Roi. Je cite Fagel comme le plus fervent. Il me prie aussi toujours de vous offrir son souvenir. Bien brave homme. Je suis charmée de deux articles des Débats aujourd’hui, l’un contre Thiers, l’autre contre Bruat.
Oui, votre Bruat manque à toute convenance ; il ne faut pas laisser de tels agents à ma semblable distance, & vous auriez grand tort de ne pas l’envoyer ailleurs. Faire des sottises plus innocentes. Génie m’a dit que les ministres avaient écrit au roi pour le supplier en revenant de faire la traversée de mer la plus courte. Voilà de braves ministres. Soumettez-vous je vous prie. Ils ont mille fois raison. Always chose the safest way. J’attendrai avec impatience l’itinéraire & pour le Roi, et pour vous ensuite. Marion arrive aujourd’hui, j’en suis charmée.
2 heures Vous êtes un étourdi ? Vous me dites jeudi que vous êtes sans lettre. Vous, vous impatientez, & vous n’avez pas remarqué que vous me répondiez à ma lettre de Mardi. C’est que tout simplement elle avait couru très vite et vous l'aviez reçue la veille. Adieu. Adieu. Encore du monde, encore des interruptions, mais je n’ai rien à vous dire qu'un very hearty adieu. Adieu.
9 1/2
Voici vraiment ma dernière lettre portant l’adresse de l'Angleterre. Demain je vous écrirai à Eu. Quel plaisir ! Cependant voyez à quel point je vous aime plus que je ne m'aime moi-même, je regrette presque pas que Windsor ne soit pas plus long. Evidemment c’est un grand plaisir pour vous : c’est un beau un charmant moment dans votre vie, et je prends patience quand je vous sais content. Votre lettre de jeudi vient de m’arriver. Tout me plait là dedans continuez.
J’ai vu hier matin les Appony, Bacourt, Fagel, Fleichman. Ma promenade au bois de Boulogne, deux visites de Génie dans la matinée. Mon dîner solitaire la soirée chez Annette. Ceux que je vois prennent plaisir aux journaux Anglais et sont occupés et charmés de ce charmant voyage du Roi. Je cite Fagel comme le plus fervent. Il me prie aussi toujours de vous offrir son souvenir. Bien brave homme. Je suis charmée de deux articles des Débats aujourd’hui, l’un contre Thiers, l’autre contre Bruat.
Oui, votre Bruat manque à toute convenance ; il ne faut pas laisser de tels agents à ma semblable distance, & vous auriez grand tort de ne pas l’envoyer ailleurs. Faire des sottises plus innocentes. Génie m’a dit que les ministres avaient écrit au roi pour le supplier en revenant de faire la traversée de mer la plus courte. Voilà de braves ministres. Soumettez-vous je vous prie. Ils ont mille fois raison. Always chose the safest way. J’attendrai avec impatience l’itinéraire & pour le Roi, et pour vous ensuite. Marion arrive aujourd’hui, j’en suis charmée.
2 heures Vous êtes un étourdi ? Vous me dites jeudi que vous êtes sans lettre. Vous, vous impatientez, & vous n’avez pas remarqué que vous me répondiez à ma lettre de Mardi. C’est que tout simplement elle avait couru très vite et vous l'aviez reçue la veille. Adieu. Adieu. Encore du monde, encore des interruptions, mais je n’ai rien à vous dire qu'un very hearty adieu. Adieu.
7. Château d'Eu, Lundi 4 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
7 Château d’Eu. Lundi 4 Sept. 1843,
8 heures
Je pense beaucoup à ce qui se passe ici, si je ne consultais que mon intérêt, l’intérêt de mon nom et de mon avenir, savez-vous ce que je ferais ? Je désirerais, je saisirais, s’il se présentait un prétexte pour me retirer des affaires et me tenir à l'écart. J’y suis entré, il y a trois ans, pour empêcher la guerre entre les deux premiers pays du monde. J’ai empêché la guerre. J’ai fait plus. Au bout de trois ans à travers des incidents, et des obstacles de tout genre, j’ai rétabli entre ces deux pays la bonne intelligence l'accord. La démonstration la plus brillante de mon succès est donnée en ce moment à l’Europe. Et elle est donnée au moment où je viens de réussir également sur un autre théâtre dans la question qui divisait le plus profondément la France et l'Angleterre, en Espagne. Je ne ressemble guères à Jeanne d’Arc ; mais vraiment ce jour-ci est pour moi ce que fut pour elle le sacre du Roi à Reims. Je devrais faire ce qu’elle avait envie de faire, me retirer. Je ne le ferai pas et on me brûlera quelque jour comme elle. Pas les Anglais pourtant, je pense.
Aberdeen a causé hier une heure avec le Roi. C'est-à-dire le Roi lui a parlé une heure Aberdeen a été très très frappé de lui, de son esprit, de l'abondance de ses idées, de la fermeté de son jugement de la facilité et de la vivacité de son langage. Nous sommes montés ensemble en calèche au moment où il sortait du Cabinet du Roi. Il était visiblement très préoccupé, très frappé, peut-être un peu troublé, comme un homme qui aurait été secoué et mené, très vite en tous sens, à travers champs, et qui bien que satisfait du point où il serait arrivé, aurait besoin de se remettre un peu de la route et du mouvement. The king spoke to me un very great earnestness, m’a-t-il dit. Et je le crois car, en revenant de la promenade, j’ai trouvé le Roi, très préoccupé à son tour, de l'effet qu’il avait produit sur Aberdeen. Il ma appelé en descendant de calèche pour me le demander. " Bon, Sire, lui ai-je dit ; bon, j’en suis sûr. Mais Lord Aberdeen ne m’a encore donné aucun détail. Il faut que je les attende. "
Il les attend très impatiemment. Singulier homme le plus patient de tous à la longue et dans l’ensemble des choses, le plus impatient le plus pressé, au moment et dans chaque circonstance. Il est dans une grande tendresse pour moi. Il me disait hier soir : " Vous et moi, nous sommes bien nécessaires l'un à l'autre ; sans vous, je puis empêcher du mal ; ce n’est qu’avec vous que je puis faire du bien. "
Il fait moins beau aujourd’hui. J'espère que le soleil se lèvera. Nous en avons besoin surtout aujourd’hui pour la promenade et le luncheon, dans la forêt. Le Roi a besoin de refaire la réputation de ses chemins. Il a vraiment mené hier la Reine victoria par monts et par vaux, sur les pierres, dans les ornières. Elle en riait, et s'amusait visiblement de voir six beaux chevaux gris pommelés, menés par deux charmants postillons et menant deux grands Princes dans cet étroit, tortueux et raboteux sentier. Au bout, on est arrivé à un très bel aspect du Tréport et de la mer. Aujourd’hui, il en sera autrement. Les routes de la forêt sont excellentes. Du reste il est impossible de paraître et d’être, je crois, plus contents qu'ils ne le sont les uns des autres. Tous ces anglais. s'amusent et trouvent l’hospitalité grande et bonne. J’ai causé hier soir assez longtemps, avec le Prince Albert. Aujourd’hui à midi et demie la Reine et lui me recevront privatily. Ce soir spectacle. Débat entre le Roi et la Reine (la nôtre) sur le spectacle. La salle est très petite. Jean de Paris n'irait pas. On a dit Jeannot et Colin, beaucoup d'objections. Le Roi a proposé Joconde. La Reine objecte aussi. Le Roi tient à Joconde. Il m'a appelé hier soir pour que j'eusse un avis devant la Reine. Je me suis récusé. On est resté dans l’indécision. Il faudra pourtant bien en être sorti ce soir. Adieu.
J'attends votre lettre. J'espère qu'elle me dira que vous savez l’arrivée de la Reine et que vous n'êtes plus inquiète. Je vais faire ma toilette en l’attendant. Adieu. Adieu.
Midi
Merci mille fois de m'avoir écrit une petite lettre, car la grande n’est pas encore venue et si je n'avais rien eu j'aurais été très désolé et très inquiet. A présent, j’attends la grande impatiemment. J'espère que je l’aurai ce soir. Ce qui me revient de l'état des esprits à Paris me plait beaucoup. Tout le monde m'écrit que la Reine y serait reçue à merveille. On aurait bien raison. Je regrette presque qu'elle n’y aille pas. Pourtant cela vaut mieux. Mad. de Ste Aulaire est arrivée ce matin. Voilà le soleil. Adieu Adieu. Je vais chez la Reine et de là chez Lord Aberdeen. Adieu Cent fois. J’aime mieux dire cent que mille. C'est plus vrai. Adieu. G.
8 heures
Je pense beaucoup à ce qui se passe ici, si je ne consultais que mon intérêt, l’intérêt de mon nom et de mon avenir, savez-vous ce que je ferais ? Je désirerais, je saisirais, s’il se présentait un prétexte pour me retirer des affaires et me tenir à l'écart. J’y suis entré, il y a trois ans, pour empêcher la guerre entre les deux premiers pays du monde. J’ai empêché la guerre. J’ai fait plus. Au bout de trois ans à travers des incidents, et des obstacles de tout genre, j’ai rétabli entre ces deux pays la bonne intelligence l'accord. La démonstration la plus brillante de mon succès est donnée en ce moment à l’Europe. Et elle est donnée au moment où je viens de réussir également sur un autre théâtre dans la question qui divisait le plus profondément la France et l'Angleterre, en Espagne. Je ne ressemble guères à Jeanne d’Arc ; mais vraiment ce jour-ci est pour moi ce que fut pour elle le sacre du Roi à Reims. Je devrais faire ce qu’elle avait envie de faire, me retirer. Je ne le ferai pas et on me brûlera quelque jour comme elle. Pas les Anglais pourtant, je pense.
Aberdeen a causé hier une heure avec le Roi. C'est-à-dire le Roi lui a parlé une heure Aberdeen a été très très frappé de lui, de son esprit, de l'abondance de ses idées, de la fermeté de son jugement de la facilité et de la vivacité de son langage. Nous sommes montés ensemble en calèche au moment où il sortait du Cabinet du Roi. Il était visiblement très préoccupé, très frappé, peut-être un peu troublé, comme un homme qui aurait été secoué et mené, très vite en tous sens, à travers champs, et qui bien que satisfait du point où il serait arrivé, aurait besoin de se remettre un peu de la route et du mouvement. The king spoke to me un very great earnestness, m’a-t-il dit. Et je le crois car, en revenant de la promenade, j’ai trouvé le Roi, très préoccupé à son tour, de l'effet qu’il avait produit sur Aberdeen. Il ma appelé en descendant de calèche pour me le demander. " Bon, Sire, lui ai-je dit ; bon, j’en suis sûr. Mais Lord Aberdeen ne m’a encore donné aucun détail. Il faut que je les attende. "
Il les attend très impatiemment. Singulier homme le plus patient de tous à la longue et dans l’ensemble des choses, le plus impatient le plus pressé, au moment et dans chaque circonstance. Il est dans une grande tendresse pour moi. Il me disait hier soir : " Vous et moi, nous sommes bien nécessaires l'un à l'autre ; sans vous, je puis empêcher du mal ; ce n’est qu’avec vous que je puis faire du bien. "
Il fait moins beau aujourd’hui. J'espère que le soleil se lèvera. Nous en avons besoin surtout aujourd’hui pour la promenade et le luncheon, dans la forêt. Le Roi a besoin de refaire la réputation de ses chemins. Il a vraiment mené hier la Reine victoria par monts et par vaux, sur les pierres, dans les ornières. Elle en riait, et s'amusait visiblement de voir six beaux chevaux gris pommelés, menés par deux charmants postillons et menant deux grands Princes dans cet étroit, tortueux et raboteux sentier. Au bout, on est arrivé à un très bel aspect du Tréport et de la mer. Aujourd’hui, il en sera autrement. Les routes de la forêt sont excellentes. Du reste il est impossible de paraître et d’être, je crois, plus contents qu'ils ne le sont les uns des autres. Tous ces anglais. s'amusent et trouvent l’hospitalité grande et bonne. J’ai causé hier soir assez longtemps, avec le Prince Albert. Aujourd’hui à midi et demie la Reine et lui me recevront privatily. Ce soir spectacle. Débat entre le Roi et la Reine (la nôtre) sur le spectacle. La salle est très petite. Jean de Paris n'irait pas. On a dit Jeannot et Colin, beaucoup d'objections. Le Roi a proposé Joconde. La Reine objecte aussi. Le Roi tient à Joconde. Il m'a appelé hier soir pour que j'eusse un avis devant la Reine. Je me suis récusé. On est resté dans l’indécision. Il faudra pourtant bien en être sorti ce soir. Adieu.
J'attends votre lettre. J'espère qu'elle me dira que vous savez l’arrivée de la Reine et que vous n'êtes plus inquiète. Je vais faire ma toilette en l’attendant. Adieu. Adieu.
Midi
Merci mille fois de m'avoir écrit une petite lettre, car la grande n’est pas encore venue et si je n'avais rien eu j'aurais été très désolé et très inquiet. A présent, j’attends la grande impatiemment. J'espère que je l’aurai ce soir. Ce qui me revient de l'état des esprits à Paris me plait beaucoup. Tout le monde m'écrit que la Reine y serait reçue à merveille. On aurait bien raison. Je regrette presque qu'elle n’y aille pas. Pourtant cela vaut mieux. Mad. de Ste Aulaire est arrivée ce matin. Voilà le soleil. Adieu Adieu. Je vais chez la Reine et de là chez Lord Aberdeen. Adieu Cent fois. J’aime mieux dire cent que mille. C'est plus vrai. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Discours autobiographique, Discours du for intérieur, Louis-Philippe 1er, Opinion publique, Parcours politique, Politique (Espagne), Politique (France), Portrait, Posture politique, Théâtre
8. Versailles, Mercredi 16 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1843 (12 août - 22 août) : Vacances au Val-Richer
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
8. Versailles Mercredi onze heures
Le 16 août 1843
J’ai quitté Beauséjour à 4 heures. Je suis venue dîner seule ici, à 8 la jeune contesse est arrivée. Elle ne m’a pas ennuyée. Mais voici de son côté. Elle me dit tout à coup - Il doit être bien tard chère Princesse. - Quelle heure pensez-vous qu'il soit ? Près de onze heures. Il était huit heures 3/4. Vraiment j’ai peur qu’elle ne supporte pas longtemps le tête-à-tête.
Je me suis couchée à 10 h. J'ai très bien dormi. A 8 h, j'étais sur la Terrasse. Il faisait frais et beau. J’ai déjeuné, j’ai fait une toilette et me voici. La jeune comtesse est allée se promener dans les galeries, déjeuner chez Mad. de la Tour du Pin. J’y étais conviée aussi, mais je reste. Je vous écris et j’attends votre lettre.
Bulwer parle très sérieusement. Au fond il trouve le Cadiz ce qu’il y a de mieux et de plus pratique surtout. Le fils de Don Carlos impossible. Naples peu vraisemblable comme disposition espagnole. Dieu garde dit-il que qui que ce soit mette en avant un prince étranger quel qu'il soit. Car aussitôt la France serait forcée de lui opposer un Prince d’Orléans. Il ne faut pas à tout prix que la lutte de candidats s'engage. Il ne faut se mêler de rien. Il dit cependant que l'Angleterre doit agir pour empêcher que les Cortès ne nomment le duc d’Aumale, car malgré la résolution du Roi le cas pourrait devenir embarrassant. Si l'Angleterre veut en finir, je crois bien qu’elle arriverait au résultat contraire, mais enfin ce n’est que le dire de Bulwer. Il a beaucoup répété que son gouvernement était dans les meilleures dispositions d’entente avec la France. Il a insisté sur le bon effet qu’aurait la présence de Sébastiani, fort respecté à Londres. Cependant ne sera-t-il pas un peu trop Whig pour les gouvernements actuels ?
Tout ce que vous me dites dans votre N°3 me plaît. Vous avez pris si doucement mes reproches. De la manière dont vous me répondez, je trouve bon toutes vos faiblesses. Mais voici ce que je ne pourrais jamais trouver bon c’est que je fusse renvoyée au delà du 26. Vous pouvez être faible pour votre mère, mais vous ne serez pas injuste et dur pour moi. Je reste donc ferme dans ma foi pour le 26.
Midi et demie. Voici le N°4. Je comprends fort bien la première page, car Génie m’avait confié ce qui était venu de Londres. J’espère que vous aurez consenti à rétrancher le petit mot déplaisant. Il ne faut pas que vous ayez à vous reprocher un seul fait ou geste qui empêche de s’entrendre. Mais quel dommage que vous ne soyez pas ici. Je le répète : un jour de retard dans des affaires comme celle-ci c’est beaucoup risquer et vous dites mieux que moi. Je vous copie. " tout cela a besoin d'être conduit avec un grande précision et heure par heure." Et vous êtes à 46 lieues ! Mais au moins vous reconnaissez l’inconvénient, tout le monde le pensait, et moi aussi, par dessus toutes les autres choses. Revenez, revenez. Ceci est votre grand moment vous n'avez rien eu de si grave, de si important, et de si directement posé sur vos épaules depuis 3 ans bientôt que vous êtes ministre. Et c’est là le moment que vous avez choisi pour vos vacances. Pardonnez-moi si je reviens. Mais vraiment je voudrais impress upon your mind combien cela est sérieux pour vous. Je comprends toutes vos jouissances au Val-Richer, & j’essaie même de n'être pas jalouse ; mais je suis désolée de ce que votre sommeil soit toujours troublé. Enfin votre mère en vous voyant comme cela accablé de travail, vous laisserait bien partir, car elle reconnaîtrait que la politique est sa vraie rivale Adieu. Adieu.
Je renvoie Etienne avec ceci. Je regrette que mon N°7 soit arrivé à Génie trop tard pour vous être envoyé par la poste. Je l’avais donné à [?], à 4 pour le poster de suite. Il ne s’est présenté qu’après 6. Nouveau grief. Par dessus la glace & & Adieu. Adieu. Aujourd’hui variante avant le 26. Adieu.
Le 16 août 1843
J’ai quitté Beauséjour à 4 heures. Je suis venue dîner seule ici, à 8 la jeune contesse est arrivée. Elle ne m’a pas ennuyée. Mais voici de son côté. Elle me dit tout à coup - Il doit être bien tard chère Princesse. - Quelle heure pensez-vous qu'il soit ? Près de onze heures. Il était huit heures 3/4. Vraiment j’ai peur qu’elle ne supporte pas longtemps le tête-à-tête.
Je me suis couchée à 10 h. J'ai très bien dormi. A 8 h, j'étais sur la Terrasse. Il faisait frais et beau. J’ai déjeuné, j’ai fait une toilette et me voici. La jeune comtesse est allée se promener dans les galeries, déjeuner chez Mad. de la Tour du Pin. J’y étais conviée aussi, mais je reste. Je vous écris et j’attends votre lettre.
Bulwer parle très sérieusement. Au fond il trouve le Cadiz ce qu’il y a de mieux et de plus pratique surtout. Le fils de Don Carlos impossible. Naples peu vraisemblable comme disposition espagnole. Dieu garde dit-il que qui que ce soit mette en avant un prince étranger quel qu'il soit. Car aussitôt la France serait forcée de lui opposer un Prince d’Orléans. Il ne faut pas à tout prix que la lutte de candidats s'engage. Il ne faut se mêler de rien. Il dit cependant que l'Angleterre doit agir pour empêcher que les Cortès ne nomment le duc d’Aumale, car malgré la résolution du Roi le cas pourrait devenir embarrassant. Si l'Angleterre veut en finir, je crois bien qu’elle arriverait au résultat contraire, mais enfin ce n’est que le dire de Bulwer. Il a beaucoup répété que son gouvernement était dans les meilleures dispositions d’entente avec la France. Il a insisté sur le bon effet qu’aurait la présence de Sébastiani, fort respecté à Londres. Cependant ne sera-t-il pas un peu trop Whig pour les gouvernements actuels ?
Tout ce que vous me dites dans votre N°3 me plaît. Vous avez pris si doucement mes reproches. De la manière dont vous me répondez, je trouve bon toutes vos faiblesses. Mais voici ce que je ne pourrais jamais trouver bon c’est que je fusse renvoyée au delà du 26. Vous pouvez être faible pour votre mère, mais vous ne serez pas injuste et dur pour moi. Je reste donc ferme dans ma foi pour le 26.
Midi et demie. Voici le N°4. Je comprends fort bien la première page, car Génie m’avait confié ce qui était venu de Londres. J’espère que vous aurez consenti à rétrancher le petit mot déplaisant. Il ne faut pas que vous ayez à vous reprocher un seul fait ou geste qui empêche de s’entrendre. Mais quel dommage que vous ne soyez pas ici. Je le répète : un jour de retard dans des affaires comme celle-ci c’est beaucoup risquer et vous dites mieux que moi. Je vous copie. " tout cela a besoin d'être conduit avec un grande précision et heure par heure." Et vous êtes à 46 lieues ! Mais au moins vous reconnaissez l’inconvénient, tout le monde le pensait, et moi aussi, par dessus toutes les autres choses. Revenez, revenez. Ceci est votre grand moment vous n'avez rien eu de si grave, de si important, et de si directement posé sur vos épaules depuis 3 ans bientôt que vous êtes ministre. Et c’est là le moment que vous avez choisi pour vos vacances. Pardonnez-moi si je reviens. Mais vraiment je voudrais impress upon your mind combien cela est sérieux pour vous. Je comprends toutes vos jouissances au Val-Richer, & j’essaie même de n'être pas jalouse ; mais je suis désolée de ce que votre sommeil soit toujours troublé. Enfin votre mère en vous voyant comme cela accablé de travail, vous laisserait bien partir, car elle reconnaîtrait que la politique est sa vraie rivale Adieu. Adieu.
Je renvoie Etienne avec ceci. Je regrette que mon N°7 soit arrivé à Génie trop tard pour vous être envoyé par la poste. Je l’avais donné à [?], à 4 pour le poster de suite. Il ne s’est présenté qu’après 6. Nouveau grief. Par dessus la glace & & Adieu. Adieu. Aujourd’hui variante avant le 26. Adieu.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcours politique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon
304. Val-Richer, Jeudi 31 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
304 Du Val-Richer, Jeudi 31 octobre 1839
8 heures et demie
Je voulais partir le 9. Ma mère me demande trois ou quatre jours pour des arrangements de ménage. Je partirai du 12 au 14. Je vous le dirai positivement un de ces jours. J’arriverai vers 6 heures et je vous verrai vers 8. Et pour longtemps. Quand il vous retrouve pour quelques jours, j'ai, dès le premier moment, le sentiment que je vais vous perdre. Le doux est au bord, l'amer au fond. Tout sera doux. Et puis je ne sais, mais j’ai peine à croire que l’été prochain se passe comme celui-ci. Si les situations sont les mêmes, et que je me sente à la gorge la même disposition, je pourrai bien aller prendre les eaux des Pyrénées. Elles ont parfaitement guéri, du même mal, M. de Broglie et M. Mauguin. Venez-y. C'est le plus charmant pays du monde ; et on m'assure qu’il y a deux ou trois établissements où l'on est bien. Le Duc de Noailles pourra vous le dire. Il y a passé l’été.
Les 300 lettres m'indignent comme vous. Que tout est incomplet dans la vie ! Et cet incomplet est si fragile. Rien ne sera incomplet dans quinze jours. Au moins, nous le croirons un peu, quelques fois.
Le Préfet en question méritait son sort. Mais j’en avais parlé, demandant un peu de temps pour y préparer ses amis, dont quelques uns me tiennent de fort près. Nous en étions restés là. J'apprends sa révocation par le Moniteur. Cela m'a mis dans une position désagréable, et j'ai voulu qu’on le sût. Je suis très facile avec mes amis Ministres, très facile et pour ce qui me regarde personnellement et pour les affaires. Je ne veux pourtant pas qu'on me croie trop facile et qu’on en abuse. Il faut qu’on y pense un peu. Je n'ai pas eu d’autre motif, et la chose en restera là. Vous savez bien que vous devez me tout dire. J’ai une confiance, entière en deux choses, vos premiers instincts et vos jugements définitifs. Ce qui vous vient soudainement à l’esprit, par pure impulsion de nature, et ce qui y reste quand vous y avez bien pensé, est toujours excellent. Entre deux, vous avez quelquefois des impressions excessives, des jugements pris d’un seul côté et que je dispute.
10 heures
Je suis bien aise que vous ayez encore des Affaires pour quelques jours. Je voudrais que vous en eussiez jusqu'à mon arrivée et que votre repos ne commençât qu'avec moi. Adieu. Jaubert vous plaira, à la condition que vous y mettez. Il a un mouvement inépuisable et il sera toujours très poli. Mais vous serez bientôt au bout de son esprit. Il en a beaucoup plus à la tribune qu'ailleurs. Adieu. Adieu. Le froid gagne.
8 heures et demie
Je voulais partir le 9. Ma mère me demande trois ou quatre jours pour des arrangements de ménage. Je partirai du 12 au 14. Je vous le dirai positivement un de ces jours. J’arriverai vers 6 heures et je vous verrai vers 8. Et pour longtemps. Quand il vous retrouve pour quelques jours, j'ai, dès le premier moment, le sentiment que je vais vous perdre. Le doux est au bord, l'amer au fond. Tout sera doux. Et puis je ne sais, mais j’ai peine à croire que l’été prochain se passe comme celui-ci. Si les situations sont les mêmes, et que je me sente à la gorge la même disposition, je pourrai bien aller prendre les eaux des Pyrénées. Elles ont parfaitement guéri, du même mal, M. de Broglie et M. Mauguin. Venez-y. C'est le plus charmant pays du monde ; et on m'assure qu’il y a deux ou trois établissements où l'on est bien. Le Duc de Noailles pourra vous le dire. Il y a passé l’été.
Les 300 lettres m'indignent comme vous. Que tout est incomplet dans la vie ! Et cet incomplet est si fragile. Rien ne sera incomplet dans quinze jours. Au moins, nous le croirons un peu, quelques fois.
Le Préfet en question méritait son sort. Mais j’en avais parlé, demandant un peu de temps pour y préparer ses amis, dont quelques uns me tiennent de fort près. Nous en étions restés là. J'apprends sa révocation par le Moniteur. Cela m'a mis dans une position désagréable, et j'ai voulu qu’on le sût. Je suis très facile avec mes amis Ministres, très facile et pour ce qui me regarde personnellement et pour les affaires. Je ne veux pourtant pas qu'on me croie trop facile et qu’on en abuse. Il faut qu’on y pense un peu. Je n'ai pas eu d’autre motif, et la chose en restera là. Vous savez bien que vous devez me tout dire. J’ai une confiance, entière en deux choses, vos premiers instincts et vos jugements définitifs. Ce qui vous vient soudainement à l’esprit, par pure impulsion de nature, et ce qui y reste quand vous y avez bien pensé, est toujours excellent. Entre deux, vous avez quelquefois des impressions excessives, des jugements pris d’un seul côté et que je dispute.
10 heures
Je suis bien aise que vous ayez encore des Affaires pour quelques jours. Je voudrais que vous en eussiez jusqu'à mon arrivée et que votre repos ne commençât qu'avec moi. Adieu. Jaubert vous plaira, à la condition que vous y mettez. Il a un mouvement inépuisable et il sera toujours très poli. Mais vous serez bientôt au bout de son esprit. Il en a beaucoup plus à la tribune qu'ailleurs. Adieu. Adieu. Le froid gagne.
300. Val-Richer, Dimanche 27 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
300 Du val Richer, dimanche 27 oct. 1839
9 heures
Ma mère a été souffrante hier, assez souffrante. Si cela se prolongeait ou se renouvelait d’ici à quatre jours, je presserais mon départ. Son mal, s’il s'aggravait, aurait besoin de secours prompts et décisifs. Je lui en ai dit un mot hier. Cela la contrarie. Mais je n'hésiterai pas. Pauline est parfaitement bien. Mais quelle fièvre que d’aimer des créatures, quand on a tant perdu, quand on a tant éprouvé la fragilité de la vie ! Je ne puis voir malade quelqu'un que j’aime, sans une angoisse, une prévoyance horrible. Je ne vaux plus rien pour un tel fardeau ; mes épaules plient à la moindre apparence qu’il s’appesantisse encore sur moi.
Voici une conversation de Thiers avec un de mes amis ; plus directe que la vôtre mais très analogue, je pense. Thiers : Que pensez-vous du Ministère?
- Qu’il est faible et dans une position fausse.
- Que fera-t-il ?
- Peu de chose sans doute ; ce qu'on peut faire quand on est faible et dans une position fausse.
- Et comment tout cela finira-t-il ?
- Je vous le demanderai à vous- même. "
Ici une pause assez longue. Thiers reprend, et expose ce qu’il pense du Ministère de ses embarras, des difficultés de la session ; la gauche votera contre ; M. Barrot votera contre avec quelques ménagements. Le centre gauche se divisera ; une portion appuiera le Ministère, l'autre votera contre. Et les doctrinaires, que feront-ils ?
- Comme le centre gauche.
- Et M. Guizot, que fera-t-il ? L’avez-vous vu à son dernier passage à Paris ?
- Je l'ai vu ; il agira selon les circonstances sa situation, peut être embarrassante à cause de ceux de ses amis qui sont ministres.
- Autre chose sont ses amis, autre chose est le Ministère."
Thiers revient sur la situation en général, sur l'impossibilité qu’il n’arrive pas quelque chose. On répond que quoi qu’il arrive, il est désormais impossible de parler de coalition. On lui rappelle qu'à la même place, au moment des dernières élections en causant avec lui, en prévoyait la victoire et un grand succès si la conduite était sage et mesurée ; on ajoute que rien n'a été omis de ce qui pouvait et devait tout compromettre. Ceci a paru préoccuper vivement Thiers ; le rouge lui a monté au visage. Après un peu de temps, il a repris :
- Sans se coaliser, on peut tendre au même but. On le peut et on le doit, si en effet on se propose le même but, si on a les mêmes intentions."
Nouvelle pause. Thiers reprend encore pour dire qu’il a pris son parti, qu’il travaille, qu’il veut continuer, qu'il est heureux.
- Vous faites bien. "
10 heures
Lord Brougham n’a pas prolongé assez longtemps sa fantaisie. Il ne faut pas qu’un mort revienne sitôt. Avait-il fait prévenir Lady Clauricard. Vous avez raison de ne pas montrer votre appartement. Mais moi je regrette de ne pas assister à sa création. Vous me parleriez d'autre choses. Vous me permettez cette fatuité. M. Delessert m'écrit que Calamata vient de terminer la gravure de mon portrait. On m'en donnera quelques épreuves quelques unes à Paul Dela Roche ; puis 450 pour les souscripteurs et la planche sera brisée. Voilà des amis jaloux. Adieu. Adieu. G.
9 heures
Ma mère a été souffrante hier, assez souffrante. Si cela se prolongeait ou se renouvelait d’ici à quatre jours, je presserais mon départ. Son mal, s’il s'aggravait, aurait besoin de secours prompts et décisifs. Je lui en ai dit un mot hier. Cela la contrarie. Mais je n'hésiterai pas. Pauline est parfaitement bien. Mais quelle fièvre que d’aimer des créatures, quand on a tant perdu, quand on a tant éprouvé la fragilité de la vie ! Je ne puis voir malade quelqu'un que j’aime, sans une angoisse, une prévoyance horrible. Je ne vaux plus rien pour un tel fardeau ; mes épaules plient à la moindre apparence qu’il s’appesantisse encore sur moi.
Voici une conversation de Thiers avec un de mes amis ; plus directe que la vôtre mais très analogue, je pense. Thiers : Que pensez-vous du Ministère?
- Qu’il est faible et dans une position fausse.
- Que fera-t-il ?
- Peu de chose sans doute ; ce qu'on peut faire quand on est faible et dans une position fausse.
- Et comment tout cela finira-t-il ?
- Je vous le demanderai à vous- même. "
Ici une pause assez longue. Thiers reprend, et expose ce qu’il pense du Ministère de ses embarras, des difficultés de la session ; la gauche votera contre ; M. Barrot votera contre avec quelques ménagements. Le centre gauche se divisera ; une portion appuiera le Ministère, l'autre votera contre. Et les doctrinaires, que feront-ils ?
- Comme le centre gauche.
- Et M. Guizot, que fera-t-il ? L’avez-vous vu à son dernier passage à Paris ?
- Je l'ai vu ; il agira selon les circonstances sa situation, peut être embarrassante à cause de ceux de ses amis qui sont ministres.
- Autre chose sont ses amis, autre chose est le Ministère."
Thiers revient sur la situation en général, sur l'impossibilité qu’il n’arrive pas quelque chose. On répond que quoi qu’il arrive, il est désormais impossible de parler de coalition. On lui rappelle qu'à la même place, au moment des dernières élections en causant avec lui, en prévoyait la victoire et un grand succès si la conduite était sage et mesurée ; on ajoute que rien n'a été omis de ce qui pouvait et devait tout compromettre. Ceci a paru préoccuper vivement Thiers ; le rouge lui a monté au visage. Après un peu de temps, il a repris :
- Sans se coaliser, on peut tendre au même but. On le peut et on le doit, si en effet on se propose le même but, si on a les mêmes intentions."
Nouvelle pause. Thiers reprend encore pour dire qu’il a pris son parti, qu’il travaille, qu’il veut continuer, qu'il est heureux.
- Vous faites bien. "
10 heures
Lord Brougham n’a pas prolongé assez longtemps sa fantaisie. Il ne faut pas qu’un mort revienne sitôt. Avait-il fait prévenir Lady Clauricard. Vous avez raison de ne pas montrer votre appartement. Mais moi je regrette de ne pas assister à sa création. Vous me parleriez d'autre choses. Vous me permettez cette fatuité. M. Delessert m'écrit que Calamata vient de terminer la gravure de mon portrait. On m'en donnera quelques épreuves quelques unes à Paul Dela Roche ; puis 450 pour les souscripteurs et la planche sera brisée. Voilà des amis jaloux. Adieu. Adieu. G.
274. Val-Richer, Lundi 23 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
274 Du Val Richer. Lundi 23 Sept 1839, 8 heures et demie
Je sors tard de mon lit quoique je me sois couché hier de très bonne heure. J'étais fatigué. Au rhume, qui dure encore un peu, s’était jointe la migraine. Le sommeil est ma ressource. Je ne sais si je la conserverai toujours ; mais je l'ai encore. J’ai beaucoup dormi. Je suis bien ce matin. Il fait beau. Le soleil brille. Je me sens en bonne et forte disposition. Quelles mobiles créatures nous sommes, et que les spectateurs qui nous entourent se doutent peu des agitations, des faiblesses, des innombrables vicissitudes, intérieures par lesquelles nous passons !
Si les propositions de D. Carlos sont telles qu’on le dit, elles me paraissent acceptables. Pourvu qu’il ne réserve que ses droits éventuels, en cas d’extinction de la lignée de la Reine Isabelle, masculine et féminine, et que sa renonciation à ses droits actuels, pour lui et les siens, soit bien claires, bien complète. Pourvu aussi que le gouvernement de Madrid y consente, et soit partie contractante dans l’arrangement. A ces conditions l'affaire me paraît finie, autant quelle peut l'être. Et si D. Carlos accepte tout cela, j'ai peine à voir à quel litre et par qu’elle raison on ne le laisserait pas vivre où il voudra même en Autriche, le Capharnaüm, des Prétendants. Nous sommes un grand exemple de l’état ou jettent les grands excès. Il y a cent ans, l’Europe aurait vécu au moins six mois sur un événement comme la chute de D. Carlos. Il y aurait eu là, pendant longtemps, de la pâture pour les esprits, les réflexions, les conversations, les correspondances. Figurez-vous tout ce que M. de St. Simon y aurait vu et fait voir. Aujourd’hui, nous avons tant vu, tant vu que nos yeux sont las et comme hébétés. Nous regardons à peine les plus grosses choses. Je suis sûr que, s’il ne survient point d’incident nouveau dans quinze jours, à Bourges même, D. Carlos vivra sans qu'on pense à lui.
Voilà mon ami, et le vôtre, d’Haubersaert conseiller d'’Etat. Il le désirait beaucoup et on me l’avait promis. Cette nomination de Conseillers d'Etat est une image fidèle du chaos général. On en a donné un à Thiers, un à moi, trois aux 221, trois aux 213. Et tout le monde sera content. Personne n'est difficile. Les troubles pour les grains, sans être sérieux peuvent devenir gaves et embarrassants. Décidément, les récoltes sont insuffisantes ; le pain est déjà cher et renchérira. La crise industrielle se prolonge. L’Angleterre en souffre encore plus que nous. L’hiver s’annonce mal. Si, par dessus le marché, il est froid, la détresse sera réelle.
Le parti radical, devenu parti Buonapartiste, s’agite beaucoup pour remuer le peuple. Il ne peut que cela, mais il peut cela.
9 heures 3/4
Si je commençais, je ne tarirais pas sur votre famille. Je n’ai jamais rien imaginé de pareil. Je vous renverrai demain la lettre de votre sœur. Il me faut bien la journée pour la lire. Je ne comprends pas grand chose, à la lettre de Benkhausen. Je suppose que lorsqu'il aura en main votre signature apposée aux letters of administration, vos plein pouvoirs à votre frère seront considérés comme suffisants, et que celui-ci fera alors toucher, en votre nom, par un délégué de lui, peut-être par Paul lui-même. Il vaudrait beaucoup mieux en effet ne pas faire ce tour du monde, et faire tout simplement toucher, en votre nom, par votre banquier qui remettra à vos fils leur part. Cela est bien plus simple. Vous pourriez, ce me semble, mander cela à Benkhausen. Je ne vois pas quelle objection il y pourrait faire. Vous êtes bien la maîtresse de donner vos pleins, pouvoirs à qui vous voulez, pour cette affaire spéciale ; et il est bien naturel que vous les donniez directement à votre banquier de Londres qui touchera, plutôt qu'à votre père de Pétersbourg qui sera obligé de les déléguer et de faire toucher, par un autre, vous ne savez pas qu' il est évident que vous ne sauriez prendre trop de précautions. Pourquoi, n'aurez-vous pas de vaisselle ? Dans le quart du mobilier qui vous revient de droit vous pouvez toujours prendre ce que vous voulez, au prix d'estimation. Adieu. Adieu. Vous dîtes bien, toutes ces horreurs. Adieu, dearest. G.
Je sors tard de mon lit quoique je me sois couché hier de très bonne heure. J'étais fatigué. Au rhume, qui dure encore un peu, s’était jointe la migraine. Le sommeil est ma ressource. Je ne sais si je la conserverai toujours ; mais je l'ai encore. J’ai beaucoup dormi. Je suis bien ce matin. Il fait beau. Le soleil brille. Je me sens en bonne et forte disposition. Quelles mobiles créatures nous sommes, et que les spectateurs qui nous entourent se doutent peu des agitations, des faiblesses, des innombrables vicissitudes, intérieures par lesquelles nous passons !
Si les propositions de D. Carlos sont telles qu’on le dit, elles me paraissent acceptables. Pourvu qu’il ne réserve que ses droits éventuels, en cas d’extinction de la lignée de la Reine Isabelle, masculine et féminine, et que sa renonciation à ses droits actuels, pour lui et les siens, soit bien claires, bien complète. Pourvu aussi que le gouvernement de Madrid y consente, et soit partie contractante dans l’arrangement. A ces conditions l'affaire me paraît finie, autant quelle peut l'être. Et si D. Carlos accepte tout cela, j'ai peine à voir à quel litre et par qu’elle raison on ne le laisserait pas vivre où il voudra même en Autriche, le Capharnaüm, des Prétendants. Nous sommes un grand exemple de l’état ou jettent les grands excès. Il y a cent ans, l’Europe aurait vécu au moins six mois sur un événement comme la chute de D. Carlos. Il y aurait eu là, pendant longtemps, de la pâture pour les esprits, les réflexions, les conversations, les correspondances. Figurez-vous tout ce que M. de St. Simon y aurait vu et fait voir. Aujourd’hui, nous avons tant vu, tant vu que nos yeux sont las et comme hébétés. Nous regardons à peine les plus grosses choses. Je suis sûr que, s’il ne survient point d’incident nouveau dans quinze jours, à Bourges même, D. Carlos vivra sans qu'on pense à lui.
Voilà mon ami, et le vôtre, d’Haubersaert conseiller d'’Etat. Il le désirait beaucoup et on me l’avait promis. Cette nomination de Conseillers d'Etat est une image fidèle du chaos général. On en a donné un à Thiers, un à moi, trois aux 221, trois aux 213. Et tout le monde sera content. Personne n'est difficile. Les troubles pour les grains, sans être sérieux peuvent devenir gaves et embarrassants. Décidément, les récoltes sont insuffisantes ; le pain est déjà cher et renchérira. La crise industrielle se prolonge. L’Angleterre en souffre encore plus que nous. L’hiver s’annonce mal. Si, par dessus le marché, il est froid, la détresse sera réelle.
Le parti radical, devenu parti Buonapartiste, s’agite beaucoup pour remuer le peuple. Il ne peut que cela, mais il peut cela.
9 heures 3/4
Si je commençais, je ne tarirais pas sur votre famille. Je n’ai jamais rien imaginé de pareil. Je vous renverrai demain la lettre de votre sœur. Il me faut bien la journée pour la lire. Je ne comprends pas grand chose, à la lettre de Benkhausen. Je suppose que lorsqu'il aura en main votre signature apposée aux letters of administration, vos plein pouvoirs à votre frère seront considérés comme suffisants, et que celui-ci fera alors toucher, en votre nom, par un délégué de lui, peut-être par Paul lui-même. Il vaudrait beaucoup mieux en effet ne pas faire ce tour du monde, et faire tout simplement toucher, en votre nom, par votre banquier qui remettra à vos fils leur part. Cela est bien plus simple. Vous pourriez, ce me semble, mander cela à Benkhausen. Je ne vois pas quelle objection il y pourrait faire. Vous êtes bien la maîtresse de donner vos pleins, pouvoirs à qui vous voulez, pour cette affaire spéciale ; et il est bien naturel que vous les donniez directement à votre banquier de Londres qui touchera, plutôt qu'à votre père de Pétersbourg qui sera obligé de les déléguer et de faire toucher, par un autre, vous ne savez pas qu' il est évident que vous ne sauriez prendre trop de précautions. Pourquoi, n'aurez-vous pas de vaisselle ? Dans le quart du mobilier qui vous revient de droit vous pouvez toujours prendre ce que vous voulez, au prix d'estimation. Adieu. Adieu. Vous dîtes bien, toutes ces horreurs. Adieu, dearest. G.
273. Val-Richer, Dimanche 22 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
273 Du Val-Richer, Dimanche 22 Sept 1839 7 heures
Je viens à vous en me levant. Quand j'ai du monde, je ne dispose pas de ma soirée. Elle n'est pas amusante, savez-vous à quelle condition on supporte le commun des hommes ? à condition d'avoir quelque chose à en faire. Quand on les emploie, quand on va a un but à la bonne heure ; le but anime la route, l'utilité enfante l’intérêt. Mais le vulgaire pour rien, pour s’en amuser, et pour l'amuser ! C’est bien lourd.
J’ai là sous les yeux quelque chose de bien lourd aussi ; un jeune ménage, marié depuis deux mois, une jeune femme de 19 ans, ni laide, ni jolie, ni spirituelle, ni bête, ni glacée, ni animée, parfaitement insignifiante, ordinaire, une jeune femme, rien de moins, rien de plus. Comment se marie-t-on à cela ? Le vulgaire en passant dans un salon, c’est beaucoup ; mais le vulgaire dans l’intimité, pour toujours ! Je n'ai jamais compris qu’on s'y résignât. J’aurais été à ce compte, un bien mauvais mari.
Le Roi des Pays-Bas sera-t-il un bon mari pour Melle d’Outremont ? Il me semble qu’il était, pour la première, assez dur et peu fidèle. celle-ci aura, je pense, les infidélités de moins à subir. Je crois, comme vous, que dans la disposition de tout le monde, peu ou beaucoup de vaisseaux aux Dardanelles, c'est fort la même chose. Pourquoi ne se le dit-on pas, comme nous le disons ? Mais il faut être prêt les uns contre les autres, même quand on marche ensemble. Que sait-on ? Le hasard !
Voici ce que m'écrit hier un ministre. " Le Rois, m’a parlé hier de vous, fortement avec un vif désir de votre appui, et un sentiment très profond de tout ce que vous êtes. Pour moi, mon cher ami, qui n’ai qu'une petite responsabilité & un médiocre souci de moi-même, l’honneur sauf, je n’en attends pas moins la session avec une grave anxiété. L'affaire d’Espagne est un accident heureux et un mérite. Mais la Turquie nous reste avec tous ses hasards ; et il me semble cependant qu'avec cette intention de paix qui est générale et que doit partager un souverain prudent et conséquent, tout absolu qu’il est, une ambassade habile et active serait d’un poids immense, et pourrait prévenir ce qui deviendra peut-être inévitable, sans que personne le veuille, mais parce que personne ne saurait le détourner à temps. Je suis un faible politique, mais je n'ai pas une autre pensée que celle-là dans le temps actuel. "
Vous voyez qu’on a toujours bien envie, de m'avoir et de m'éloigner. On ne fera ni l’un ni l’autre. Lisez, dans le dernier cahier de la Revue des deux mondes (15 septembre) un long article sur le Duc de Wellington, à l'occasion de ses dépêches. Il vous intéressera. C’est un assez curieux spectacle que ce vent d’impartialité qui souffle sur nous et nous fait rendre justice contre le sentiment populaire si cela s'accorde jamais avec un fort esprit national, ce sera très beau.
C’est Pascal, je crois, qui dit : " je n'estime point un homme qui possède une vertu, s’il ne possède en même temps et au même degré, la vertu contraire. " Il a raison. Mais c’est bien de l’exigence. A la vérité on n'obtient rien de bon des hommes qu'à force d’exigence.
9 heures et demie
C’est bien vrai que vos soirées et les miennes, vous chez Armin, moi avec mon jeune ménage, c’est absurde ! Et nous serions si bien ! Il n’y a point de nouvelles. Je vous dis tout ce qu’on m’écrit. On est fort occupé des émeutes du Mans de la réforme du Conseil d'Etat & Tout cela ne vous fait rien. Vous avez raison de bien finir l’affaire de l'entresol. Il n'y a point de sûreté avec ce monde là. Adieu. Adieu. Le plus long adieu possible. Il n'y a de long que ce qui est éternel. G.
Je viens à vous en me levant. Quand j'ai du monde, je ne dispose pas de ma soirée. Elle n'est pas amusante, savez-vous à quelle condition on supporte le commun des hommes ? à condition d'avoir quelque chose à en faire. Quand on les emploie, quand on va a un but à la bonne heure ; le but anime la route, l'utilité enfante l’intérêt. Mais le vulgaire pour rien, pour s’en amuser, et pour l'amuser ! C’est bien lourd.
J’ai là sous les yeux quelque chose de bien lourd aussi ; un jeune ménage, marié depuis deux mois, une jeune femme de 19 ans, ni laide, ni jolie, ni spirituelle, ni bête, ni glacée, ni animée, parfaitement insignifiante, ordinaire, une jeune femme, rien de moins, rien de plus. Comment se marie-t-on à cela ? Le vulgaire en passant dans un salon, c’est beaucoup ; mais le vulgaire dans l’intimité, pour toujours ! Je n'ai jamais compris qu’on s'y résignât. J’aurais été à ce compte, un bien mauvais mari.
Le Roi des Pays-Bas sera-t-il un bon mari pour Melle d’Outremont ? Il me semble qu’il était, pour la première, assez dur et peu fidèle. celle-ci aura, je pense, les infidélités de moins à subir. Je crois, comme vous, que dans la disposition de tout le monde, peu ou beaucoup de vaisseaux aux Dardanelles, c'est fort la même chose. Pourquoi ne se le dit-on pas, comme nous le disons ? Mais il faut être prêt les uns contre les autres, même quand on marche ensemble. Que sait-on ? Le hasard !
Voici ce que m'écrit hier un ministre. " Le Rois, m’a parlé hier de vous, fortement avec un vif désir de votre appui, et un sentiment très profond de tout ce que vous êtes. Pour moi, mon cher ami, qui n’ai qu'une petite responsabilité & un médiocre souci de moi-même, l’honneur sauf, je n’en attends pas moins la session avec une grave anxiété. L'affaire d’Espagne est un accident heureux et un mérite. Mais la Turquie nous reste avec tous ses hasards ; et il me semble cependant qu'avec cette intention de paix qui est générale et que doit partager un souverain prudent et conséquent, tout absolu qu’il est, une ambassade habile et active serait d’un poids immense, et pourrait prévenir ce qui deviendra peut-être inévitable, sans que personne le veuille, mais parce que personne ne saurait le détourner à temps. Je suis un faible politique, mais je n'ai pas une autre pensée que celle-là dans le temps actuel. "
Vous voyez qu’on a toujours bien envie, de m'avoir et de m'éloigner. On ne fera ni l’un ni l’autre. Lisez, dans le dernier cahier de la Revue des deux mondes (15 septembre) un long article sur le Duc de Wellington, à l'occasion de ses dépêches. Il vous intéressera. C’est un assez curieux spectacle que ce vent d’impartialité qui souffle sur nous et nous fait rendre justice contre le sentiment populaire si cela s'accorde jamais avec un fort esprit national, ce sera très beau.
C’est Pascal, je crois, qui dit : " je n'estime point un homme qui possède une vertu, s’il ne possède en même temps et au même degré, la vertu contraire. " Il a raison. Mais c’est bien de l’exigence. A la vérité on n'obtient rien de bon des hommes qu'à force d’exigence.
9 heures et demie
C’est bien vrai que vos soirées et les miennes, vous chez Armin, moi avec mon jeune ménage, c’est absurde ! Et nous serions si bien ! Il n’y a point de nouvelles. Je vous dis tout ce qu’on m’écrit. On est fort occupé des émeutes du Mans de la réforme du Conseil d'Etat & Tout cela ne vous fait rien. Vous avez raison de bien finir l’affaire de l'entresol. Il n'y a point de sûreté avec ce monde là. Adieu. Adieu. Le plus long adieu possible. Il n'y a de long que ce qui est éternel. G.
248. Val -Richer, Samedi 17 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
248 Du Val-Richer Samedi soir 17 août 1839 8 heures
Je ne sais pourquoi elle est venue deux heures plus tard, cette lettre où vous êtes si souffrante. Elle avait été oubliée au bureau de la poste, au moment du départ du facteur. J’aime pourtant mieux qu’elle soit venue. Que je serai heureux cet hiver, quand vous serez bien tranquillement rétablie à Paris, quand nous n'aurons plus à 120 lieues l’un de l'autre, ces odieuses angoisses ! Votre médecin ne me paraît pas un homme d’esprit. S’il craint de vous voir voyager seule comment ne vous procure-t-il pas un jeune médecin pour vous accompagner. Il y en a surement, en Allemagne comme en France, qui n’ont pas grande pratique et ne demanderaient pas mieux que de venir passer quinze jours à Paris. Ce n’est pas un grand agrément pour vous, j'en conviens ; mais c’est une sûreté et pour votre retour vous ne pouvez guère prétendre à plus. Parlez-lui en ; il me paraît impossible qu’il ne vous trouve pas quelqu'un.
Dimanche matin 7 heures
Les nouvelles d'Alexandrie ne signifient rien. Tout est en suspens à Constantinople. Nous nous disputons tous le Divan, en attendant l'Empire. Le Pacha tiendra bon. Il le peut. Il a l’excellente attitude d’un homme qui n’est point dans l’embarras et qui y met tous les autres. Il lui faut l'hérédité chez lui et la sécurité par conséquent la prépondérance à Constantinople. Nous l’appuierons, dans la première prétention par conséquent, s’il tient bon dans la seconde. C’est à lui à unir les questions. Nous ne le contraindrons pas à les séparer. Cependant on voudrait bien j’en suis sûr le trouver plus complaisant, content à meilleur marché. On a grande hâte d'en finir là aussi. Point d'affaires, c’est la grande maxime du gouvernement. Je ne crois pas que le Cabinet si petit, si faible qu’il est, y consente. Il a fait ces jours derniers, à ce propos-là, un essai de la peur que causait la seule perspective d’une crise ministérielle. Il en usera et je le lui conseille. Voilà l'immense différence de la situation, M. Molé avait assez d’esprit, de bonne apparence et de crédit pour couvrir et faire passer la politique plate. Ceux-ci ne le peuvent pas, quand même ils le voudraient. Et par là, j’ai de l'action sur eux et sur l’avenir.
M. Duchâtel se conduit très bien et pour les choses, à mon égard, dans la mesure du moins de mon exigence qui n’est pas grande. Est-il vrai que votre Impératrice soit fort malade ? On me dit de Paris que les lettres de Pétersbourg le mandent. On dit aussi que Fagel retourne à Amsterdam, & que M. Van Zuylens le remplace. Je regrette Fagel, quoiqu’il ne dise plus grand chose, sa figure me plait : bonne et loyale comme sa personne. Le Journal des Débats vient de faire un grand pas en remettant sur le tapis la question de la Chambre des Pairs. Je l'en approuve. Il faut trouver un moyen de faire vivre cette Chambre. J’ai toujours regardé l'hérédité de la Pairie comme la porte capitale de 1830. Je ne sais si on y reviendra. Le courant démocratique ne porte pas là. Pourtant ce pays-ci est très intelligent, et capable de résolution soudaine, s'il comprend un jour que l’hérédité de la Pairie modifiée je ne sais comment, lui donnerait une seconde chambre plus indépendante, plus capable, qui jouerait mieux son rôle dans la machine constitutionnelle, il pourra fort bien s'en accommoder tout-à- coup. Il faudrait lier cette question à celle de la réforme électorale et n'élargir une chambre qu'à condition de ressusciter l'autre. C’est une idée qui me vient à l’instant même, et dont il y a quelque chose à tirer.
9 h. 1/2
Mes nouvelles d'Orient sont à la guerre, à la Porte se jetant dans vos bras, préférant le Protectorat russe au protectorat égyptien. Grand trouble des trois cours. Grand conflit des malveillances et des bienveillances pour le Pacha. Je ne sais ce qui sortira de là. Ne suis-je pas bien affirmatif dans ma page 2 ? C'est moi défaut. Je ne m'en corrigerai jamais. Je fais si peu de cas des gens qui n'affirment jamais Adieu Adieu.
242 vaut un peu mieux que 241.
Je ne sais pourquoi elle est venue deux heures plus tard, cette lettre où vous êtes si souffrante. Elle avait été oubliée au bureau de la poste, au moment du départ du facteur. J’aime pourtant mieux qu’elle soit venue. Que je serai heureux cet hiver, quand vous serez bien tranquillement rétablie à Paris, quand nous n'aurons plus à 120 lieues l’un de l'autre, ces odieuses angoisses ! Votre médecin ne me paraît pas un homme d’esprit. S’il craint de vous voir voyager seule comment ne vous procure-t-il pas un jeune médecin pour vous accompagner. Il y en a surement, en Allemagne comme en France, qui n’ont pas grande pratique et ne demanderaient pas mieux que de venir passer quinze jours à Paris. Ce n’est pas un grand agrément pour vous, j'en conviens ; mais c’est une sûreté et pour votre retour vous ne pouvez guère prétendre à plus. Parlez-lui en ; il me paraît impossible qu’il ne vous trouve pas quelqu'un.
Dimanche matin 7 heures
Les nouvelles d'Alexandrie ne signifient rien. Tout est en suspens à Constantinople. Nous nous disputons tous le Divan, en attendant l'Empire. Le Pacha tiendra bon. Il le peut. Il a l’excellente attitude d’un homme qui n’est point dans l’embarras et qui y met tous les autres. Il lui faut l'hérédité chez lui et la sécurité par conséquent la prépondérance à Constantinople. Nous l’appuierons, dans la première prétention par conséquent, s’il tient bon dans la seconde. C’est à lui à unir les questions. Nous ne le contraindrons pas à les séparer. Cependant on voudrait bien j’en suis sûr le trouver plus complaisant, content à meilleur marché. On a grande hâte d'en finir là aussi. Point d'affaires, c’est la grande maxime du gouvernement. Je ne crois pas que le Cabinet si petit, si faible qu’il est, y consente. Il a fait ces jours derniers, à ce propos-là, un essai de la peur que causait la seule perspective d’une crise ministérielle. Il en usera et je le lui conseille. Voilà l'immense différence de la situation, M. Molé avait assez d’esprit, de bonne apparence et de crédit pour couvrir et faire passer la politique plate. Ceux-ci ne le peuvent pas, quand même ils le voudraient. Et par là, j’ai de l'action sur eux et sur l’avenir.
M. Duchâtel se conduit très bien et pour les choses, à mon égard, dans la mesure du moins de mon exigence qui n’est pas grande. Est-il vrai que votre Impératrice soit fort malade ? On me dit de Paris que les lettres de Pétersbourg le mandent. On dit aussi que Fagel retourne à Amsterdam, & que M. Van Zuylens le remplace. Je regrette Fagel, quoiqu’il ne dise plus grand chose, sa figure me plait : bonne et loyale comme sa personne. Le Journal des Débats vient de faire un grand pas en remettant sur le tapis la question de la Chambre des Pairs. Je l'en approuve. Il faut trouver un moyen de faire vivre cette Chambre. J’ai toujours regardé l'hérédité de la Pairie comme la porte capitale de 1830. Je ne sais si on y reviendra. Le courant démocratique ne porte pas là. Pourtant ce pays-ci est très intelligent, et capable de résolution soudaine, s'il comprend un jour que l’hérédité de la Pairie modifiée je ne sais comment, lui donnerait une seconde chambre plus indépendante, plus capable, qui jouerait mieux son rôle dans la machine constitutionnelle, il pourra fort bien s'en accommoder tout-à- coup. Il faudrait lier cette question à celle de la réforme électorale et n'élargir une chambre qu'à condition de ressusciter l'autre. C’est une idée qui me vient à l’instant même, et dont il y a quelque chose à tirer.
9 h. 1/2
Mes nouvelles d'Orient sont à la guerre, à la Porte se jetant dans vos bras, préférant le Protectorat russe au protectorat égyptien. Grand trouble des trois cours. Grand conflit des malveillances et des bienveillances pour le Pacha. Je ne sais ce qui sortira de là. Ne suis-je pas bien affirmatif dans ma page 2 ? C'est moi défaut. Je ne m'en corrigerai jamais. Je fais si peu de cas des gens qui n'affirment jamais Adieu Adieu.
242 vaut un peu mieux que 241.
244. Val-Richer, Mercredi 14 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
244 Du Val Richer, Mercredi 14 août 1839, 6 heures
Je relis votre paragraphe à Benkhausen. Je suis bien aise que vous soyez restée avec lui dans ces termes là. Ils sont très convenables si j’ai raison, et bien plus si c’est vous. Dans le premier cas, vous vous serez trompée à Pétersbourg, mais non à Londres ce qui eût pu amener quelque complication désagréable. A mon tour, je vous tiens au courant de mes affaires, si on peut appeler cela des affaires. Après avoir beaucoup parlé et remué à Paris, Thiers est parti pour Lille. Avant de partir, il a manifesté le regret de n'avoir pas vu un de mes amis qui est aussi fort lié avec M. Duchâtel. Celui-ci est allé le voir. Thiers lui a parlé de moi dans les termes les plus magnifiques, puis a développé, comme vous savez qu’il développe avec une intarissable abondance, cette idée que deux hommes prépondérants ne pouvaient être simultanément dans un cabinet, que leur présence y romprait l’unité, qu’il fallait à un Cabinet, un chef, un seul chef, maître des autres ministres, que là surtout avait résidé la force de M. Molé. Quand je n’aurais point d'autre motif, celui-là me suffirait pour ne jamais me rapprocher de M. Molé. D'ailleurs, c’est bien impossible ; nous entendons l'un et l'autre avoir les Affaires étrangères. Puis, il s'est répandu en compliments sur Duchâtel vantant beaucoup son aptitude au gouvernement de l’Intérieur. Paroles assez explicites pour autoriser son interlocuteur à lui répondre, très explicitement aussi, qu’il se trompait sur Duchâtel ; que Duchâtel n’agirait jamais envers moi comme Passy et Dufaure avaient agi envers lui-même ; que le jour où lui Thiers serait Ministre, sans moi, Duchâtel se retirerait à l'instant, et qu’il ne devait compter sur l'accession ou l'appui d'aucun de mes amis, qu'autant que je serais dans le cabinet, à la place qu’il me conviendrait d'occuper ; que c'était l'avis et le parti pris des plus grands comme des plus petits ; qu’il fallait en prendre lui-même son parti ; que s'il lui convenait de s'en rapprocher de moi, de s’en rapprocher sérieusement, la session ne s’ouvrirait qu'avec nous deux ; sinon son entrée était impossible, car il déplaisait à une grande partie de la chambre, comme au Roi. Sur ce Thiers a coupé court, se rejetant dans les ténèbres de l'avenir et racontant sa conversation avec le Roi sur les affaires d'Orient ; conversation où il a étalé les opinions, les plus pacifiques, & s'en est allé comme il était venu ; le Roi, et lui n'ont pas fait un pas l'un vers l'autre. Vous voyez que tous les rapports s'accordent. et que personne ne change. Le Roi et les bourgeois de Hanovre ne changeront pas non plus. L’Autriche et la Prusse peuvent bien donner raison au Roi, mais non le tirer d’embarras. Il les y mettra elles-mêmes, voilà tout.
Voilà M. Falck ministre à Bruxelles. Il ne s'y amusera guère. J’aimerais bien mieux qu’il vînt mettre son esprit dans le corps diplomatique de Paris. Vous m’avez dit qu'il en avait vraiment beaucoup. Il trouverait de la place vide. Je suis charmé que le Prince de Prusse en ait autant (de l’esprit) que vous lui en trouvez. Il en aura besoin, car son pays en a.Trois choses ont fait la Prusse, le Protestantisme, la science et Frédéric 2. C’est une Puissance de notre temps, un peuple et un gouvernement moderne. Sa sagesse va à toute l’Europe civilisée. Celle de l’Autriche ne va qu'à l’Autriche. Je désire la prospérité de la Prusse.
9 heures et demie
Si j’ai envie de vous voir ! Adieu, adieu. Adieu Je n’ai pas envie de vous dire autre chose. Dans la journée, nous causerons. Il m'est arrivé hier du monde. G.
Je relis votre paragraphe à Benkhausen. Je suis bien aise que vous soyez restée avec lui dans ces termes là. Ils sont très convenables si j’ai raison, et bien plus si c’est vous. Dans le premier cas, vous vous serez trompée à Pétersbourg, mais non à Londres ce qui eût pu amener quelque complication désagréable. A mon tour, je vous tiens au courant de mes affaires, si on peut appeler cela des affaires. Après avoir beaucoup parlé et remué à Paris, Thiers est parti pour Lille. Avant de partir, il a manifesté le regret de n'avoir pas vu un de mes amis qui est aussi fort lié avec M. Duchâtel. Celui-ci est allé le voir. Thiers lui a parlé de moi dans les termes les plus magnifiques, puis a développé, comme vous savez qu’il développe avec une intarissable abondance, cette idée que deux hommes prépondérants ne pouvaient être simultanément dans un cabinet, que leur présence y romprait l’unité, qu’il fallait à un Cabinet, un chef, un seul chef, maître des autres ministres, que là surtout avait résidé la force de M. Molé. Quand je n’aurais point d'autre motif, celui-là me suffirait pour ne jamais me rapprocher de M. Molé. D'ailleurs, c’est bien impossible ; nous entendons l'un et l'autre avoir les Affaires étrangères. Puis, il s'est répandu en compliments sur Duchâtel vantant beaucoup son aptitude au gouvernement de l’Intérieur. Paroles assez explicites pour autoriser son interlocuteur à lui répondre, très explicitement aussi, qu’il se trompait sur Duchâtel ; que Duchâtel n’agirait jamais envers moi comme Passy et Dufaure avaient agi envers lui-même ; que le jour où lui Thiers serait Ministre, sans moi, Duchâtel se retirerait à l'instant, et qu’il ne devait compter sur l'accession ou l'appui d'aucun de mes amis, qu'autant que je serais dans le cabinet, à la place qu’il me conviendrait d'occuper ; que c'était l'avis et le parti pris des plus grands comme des plus petits ; qu’il fallait en prendre lui-même son parti ; que s'il lui convenait de s'en rapprocher de moi, de s’en rapprocher sérieusement, la session ne s’ouvrirait qu'avec nous deux ; sinon son entrée était impossible, car il déplaisait à une grande partie de la chambre, comme au Roi. Sur ce Thiers a coupé court, se rejetant dans les ténèbres de l'avenir et racontant sa conversation avec le Roi sur les affaires d'Orient ; conversation où il a étalé les opinions, les plus pacifiques, & s'en est allé comme il était venu ; le Roi, et lui n'ont pas fait un pas l'un vers l'autre. Vous voyez que tous les rapports s'accordent. et que personne ne change. Le Roi et les bourgeois de Hanovre ne changeront pas non plus. L’Autriche et la Prusse peuvent bien donner raison au Roi, mais non le tirer d’embarras. Il les y mettra elles-mêmes, voilà tout.
Voilà M. Falck ministre à Bruxelles. Il ne s'y amusera guère. J’aimerais bien mieux qu’il vînt mettre son esprit dans le corps diplomatique de Paris. Vous m’avez dit qu'il en avait vraiment beaucoup. Il trouverait de la place vide. Je suis charmé que le Prince de Prusse en ait autant (de l’esprit) que vous lui en trouvez. Il en aura besoin, car son pays en a.Trois choses ont fait la Prusse, le Protestantisme, la science et Frédéric 2. C’est une Puissance de notre temps, un peuple et un gouvernement moderne. Sa sagesse va à toute l’Europe civilisée. Celle de l’Autriche ne va qu'à l’Autriche. Je désire la prospérité de la Prusse.
9 heures et demie
Si j’ai envie de vous voir ! Adieu, adieu. Adieu Je n’ai pas envie de vous dire autre chose. Dans la journée, nous causerons. Il m'est arrivé hier du monde. G.
Mots-clés : Diplomatie, Parcours politique, Politique (France), Politique (Prusse), Protestantisme
227. Val-Richer, Mercredi 24 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
227 Du Val-Richer, Mercredi 24 Juillet 1839, 5 heures
Je viens d’écrire à Madame de Talleyrand. Je trouve ridicule d’écrire à Baden et que ce ne soit pas à vous. Vous m'aviez promis un petit dessin de votre maison, de ce qui l'environne, de la vue. Est-ce qu’il n'y a pas à Baden un dessinateur ? J’aime les lieux honorés par les pas, éclairés par les yeux... Je ne continue pas avec La Fontaine. La suite ne vous va pas du tout. Mais ceci est vrai, et tendrement dit.
La session finit mal pour le Cabinet. L'affaire de Barbés lui a porté un rude coup, un coup analogue à celui que reçut le Cabinet du 22 février de la suppression de la revue de la garde nationale en juillet 1836. Presque personne ne croit qu'ils puissent gouverner jusqu'à la session prochaine. Moi, je suis convaincu que, sauf de grands incidents, ils iront jusques là, et qu'alors, le remplacement sera très difficile. Je persiste à croire qu'une seule combinaison est efficace. Je ne ferai jamais rien qui la rende impossible, mais j'attendrai qu'elle vienne me chercher. Elle rôde beaucoup autour de moi depuis six semaines, même ici. Je suis sûr que les ministres se regardent eux-mêmes comme très atteints. Deux seulement ont un peu gagné, M. Villemain comme orateur, M. Dufaure comme homme d’affaires et debater. Il me semble que je vous ai déjà dit tout cela. Mais vous vous plaignez que je ne vous parle pas du Cabinet. Savez-vous pourquoi on dit autour de vous que la gauche est en progrès ? Parce qu'on en a peur. Il y a longtemps que les peurs de l’Europe nous font ce mal là Je dis de votre Europe. La gauche lui semble irrésistible et elle se hâte toujours de prédire son triomphe. Ce n'est pas la gauche qui gagne du terrain, c’est la faiblesse universelle. La gauche s'affaiblit et se décolore comme le reste. Pas plus de gouvernement que d'opposition ; pas plus d’opposition que de gouvernement; voilà notre mal. S’il durait une nouvelle gauche apparaîtrait bientôt sur les ruines de l'ancienne, une vraie gauche révolutionnaire. Peut-être faut-il cela pour qu’un gouvernement reparaisse aussi. J’espère que non.
Jeudi 10 heures
Imaginez que tout à l'heure, quand le facteur m'a remis son paquet, j’y ai tout de suite cherché votre lettre. Point de lettre. Il y en avait dix au douze que j'ai jetées là avec une immense humeur. Puis j’ai cherché encore. Votre lettre s’était glissée dans un journal. Quand vous avez mal à la tête, essayez-vous d'aller vous asseoir en plein air, dans quelque coin bien tranquille, et de rester là immobile, les yeux fermés, loin de toute lumière et de tout bruit, & y dormir même ? Ce complet repos, dans un bain d’air a toujours été pour moi le seul remède aux maux de tête, dans un temps où j'en avais beaucoup.
Comment me demandez-vous pourquoi je n’ai pas été à Neuilly ? Vous n'avez donc pas vu dans les journaux, même officiels, que j’y ai été le samedi soir 20. Il est vrai que j'étais ici le vendredi matin 19. Apparemment quelqu'un y été pour moi. J’y serais allé sans l'affaire de Barbés. Je ne voulais pas m'en expliquer, et on m'en aurait certainement parlé. J'ai dit à deux personnes que je n'irais pas, et pourquoi. Elles l’ont sans doute redit et on m'a supplié. Savez-vous ce que fait le rédacteur du nouveau journal qu’on vous attribue, le Capitole ? Il fait auprès de la grille du bois de Vincennes, des discours en l’honneur d’Armand Carrel dont la statue a été inaugurée là hier matin. Il y est enseveli. Il y avait assez de monde, quoique fort paisible. Plusieurs discours ont été prononcés. On n’a remarqué que ceux de M. Arago et de M. Charles Durand, ce rédacteur.
Vendredi, 8 heures
Vous me dites que le chaud vous empêche de sortir. Nous avons froid, depuis mon retour ici. Je n’ai jamais vu si peu d’été. Il y a un grand et bel appartement à louer rue de Lille au coin de la rue de Bourgogne. La position est bonne ; mais pas de jardin. Et puis, cela ne me paraît pas gai. Plus, un joli petit hôtel nue Lascazes entre la rue Belle-Chasse et la place Belle-Chasse. Le Duc de Crussel l’occupait naguère. Un rez-de chaussée et deux étages, et un petit jardin, 5 à 6000 francs. Ceci serait mieux, quoiqu'un peu plus loin. Pour vous, la maison est gaie, la vue gaie, et vous seriez seule chez vous. Pour moi, c’est près de la Chambre. Voulez-vous que je le fasse visiter avec soin et que je vous en envoie la description détaillée ? C'est presque en face les derrières du jardin de l’hôtel Danson, où est M. de Stackelberg. Adieu. Quand nous occuperons-nous ensemble de l’arrangement de votre maison ? Adieu. Adieu. G.
Je viens d’écrire à Madame de Talleyrand. Je trouve ridicule d’écrire à Baden et que ce ne soit pas à vous. Vous m'aviez promis un petit dessin de votre maison, de ce qui l'environne, de la vue. Est-ce qu’il n'y a pas à Baden un dessinateur ? J’aime les lieux honorés par les pas, éclairés par les yeux... Je ne continue pas avec La Fontaine. La suite ne vous va pas du tout. Mais ceci est vrai, et tendrement dit.
La session finit mal pour le Cabinet. L'affaire de Barbés lui a porté un rude coup, un coup analogue à celui que reçut le Cabinet du 22 février de la suppression de la revue de la garde nationale en juillet 1836. Presque personne ne croit qu'ils puissent gouverner jusqu'à la session prochaine. Moi, je suis convaincu que, sauf de grands incidents, ils iront jusques là, et qu'alors, le remplacement sera très difficile. Je persiste à croire qu'une seule combinaison est efficace. Je ne ferai jamais rien qui la rende impossible, mais j'attendrai qu'elle vienne me chercher. Elle rôde beaucoup autour de moi depuis six semaines, même ici. Je suis sûr que les ministres se regardent eux-mêmes comme très atteints. Deux seulement ont un peu gagné, M. Villemain comme orateur, M. Dufaure comme homme d’affaires et debater. Il me semble que je vous ai déjà dit tout cela. Mais vous vous plaignez que je ne vous parle pas du Cabinet. Savez-vous pourquoi on dit autour de vous que la gauche est en progrès ? Parce qu'on en a peur. Il y a longtemps que les peurs de l’Europe nous font ce mal là Je dis de votre Europe. La gauche lui semble irrésistible et elle se hâte toujours de prédire son triomphe. Ce n'est pas la gauche qui gagne du terrain, c’est la faiblesse universelle. La gauche s'affaiblit et se décolore comme le reste. Pas plus de gouvernement que d'opposition ; pas plus d’opposition que de gouvernement; voilà notre mal. S’il durait une nouvelle gauche apparaîtrait bientôt sur les ruines de l'ancienne, une vraie gauche révolutionnaire. Peut-être faut-il cela pour qu’un gouvernement reparaisse aussi. J’espère que non.
Jeudi 10 heures
Imaginez que tout à l'heure, quand le facteur m'a remis son paquet, j’y ai tout de suite cherché votre lettre. Point de lettre. Il y en avait dix au douze que j'ai jetées là avec une immense humeur. Puis j’ai cherché encore. Votre lettre s’était glissée dans un journal. Quand vous avez mal à la tête, essayez-vous d'aller vous asseoir en plein air, dans quelque coin bien tranquille, et de rester là immobile, les yeux fermés, loin de toute lumière et de tout bruit, & y dormir même ? Ce complet repos, dans un bain d’air a toujours été pour moi le seul remède aux maux de tête, dans un temps où j'en avais beaucoup.
Comment me demandez-vous pourquoi je n’ai pas été à Neuilly ? Vous n'avez donc pas vu dans les journaux, même officiels, que j’y ai été le samedi soir 20. Il est vrai que j'étais ici le vendredi matin 19. Apparemment quelqu'un y été pour moi. J’y serais allé sans l'affaire de Barbés. Je ne voulais pas m'en expliquer, et on m'en aurait certainement parlé. J'ai dit à deux personnes que je n'irais pas, et pourquoi. Elles l’ont sans doute redit et on m'a supplié. Savez-vous ce que fait le rédacteur du nouveau journal qu’on vous attribue, le Capitole ? Il fait auprès de la grille du bois de Vincennes, des discours en l’honneur d’Armand Carrel dont la statue a été inaugurée là hier matin. Il y est enseveli. Il y avait assez de monde, quoique fort paisible. Plusieurs discours ont été prononcés. On n’a remarqué que ceux de M. Arago et de M. Charles Durand, ce rédacteur.
Vendredi, 8 heures
Vous me dites que le chaud vous empêche de sortir. Nous avons froid, depuis mon retour ici. Je n’ai jamais vu si peu d’été. Il y a un grand et bel appartement à louer rue de Lille au coin de la rue de Bourgogne. La position est bonne ; mais pas de jardin. Et puis, cela ne me paraît pas gai. Plus, un joli petit hôtel nue Lascazes entre la rue Belle-Chasse et la place Belle-Chasse. Le Duc de Crussel l’occupait naguère. Un rez-de chaussée et deux étages, et un petit jardin, 5 à 6000 francs. Ceci serait mieux, quoiqu'un peu plus loin. Pour vous, la maison est gaie, la vue gaie, et vous seriez seule chez vous. Pour moi, c’est près de la Chambre. Voulez-vous que je le fasse visiter avec soin et que je vous en envoie la description détaillée ? C'est presque en face les derrières du jardin de l’hôtel Danson, où est M. de Stackelberg. Adieu. Quand nous occuperons-nous ensemble de l’arrangement de votre maison ? Adieu. Adieu. G.
216. Baden, Dimanche 14 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
216 Baden le 14 juillet 1839, dimanche 1 heure
Que je vous dis peu en vous écrivant tous les jours, & que de choses j’aurais à vous dire ! Que de choses à répondre à votre lettre de jeudi. Et je le pourrai si j’avais un peu plus de force. Mais vous ne savez pas comme il m’en coûte d'écrire. Comme cela me fatigue ! J’ai passé une mauvaise nuit, je ne vaux rien aujourd’hui, je ne sais que vous dire. J'ai été à l'église je n’y manque jamais. Mad. de Talleyrand ne vous écrit pas probablement parce qu’elle n'a rien de bon à vous dire sur mon compte. Je la vois extrêmement peu. Elle vient tous les deux jours passer avec moi un quart d’heure, voilà tout. C'est à près pour moi comme si elle n’était pas à Baden. Le matin je vois Mad. de Nesselrode assez longtemps. Nous nous rencontrons dans l’allée et nous y restons assises pendant une heure ou plus même. Je vais quelques fois chez elle en rentrant de ma promenade le soir. Je viens quelque fois Mad. Wellesley en calèche. J’y mène aussi Mad. de la Redorte. Le reste du temps. Je me promène avec Marie et la petite Ellice. De une à 2 heures, M. de Malzaden ou quelque autre diplomate vient chez moi me conter les nouvelles. M. de Malzaden a de l'esprit.
Aujourd’hui nous épousons M. de Leuchtenberg, je ne cesse pas d’en être choquée. Vous ai-je dit que Matonchewitz est nommé pour Stockolm, dans son audience de congé l’Empereur lui a rendu ses bonnes grâces, cela me prouve qu’il n’est pas implacable. M. de la Redorte me dit que Thiers retourne à Paris avant la fin du mois. Il me dit aussi ce que vous m’aviez mandé qu'il s’était séparé du roi en très bons termes. Il ajoute que le Roi pense à remanier le ministère. Vous à l’intérieur, Thiers, les affaires étrangères. Le Maréchal la guerre. Que tout cela pourrait se faire bientôt. Y croyez-vous ?
5 heures
Voici votre lettre. Je ne veux pas que vous soyez inquiet. Je ne me porte pas bien, quelques fois je me sens bien mal, et Je vous le dis. Mais c’est une imagination. J’ai l’estomac abîmé, je ne mange pas. Je dors peu et mal, je maigris, tout cela est exact, mais cela ne me fera pas encore mourir. Je suis très impatiente du jugement des Pairs. Je vois dans un journal qu'on chante la Varsovienne dans la rue Rivoli. Cela ne me plaît pas du tout Adieu. Adieu à demain, car vous voulez tous les jours mes pauvres lettres. Dites-moi des nouvelles. Ce pauvre Pozzo, il me parait qu’il restera à Paris. Adieu dearest.
Que je vous dis peu en vous écrivant tous les jours, & que de choses j’aurais à vous dire ! Que de choses à répondre à votre lettre de jeudi. Et je le pourrai si j’avais un peu plus de force. Mais vous ne savez pas comme il m’en coûte d'écrire. Comme cela me fatigue ! J’ai passé une mauvaise nuit, je ne vaux rien aujourd’hui, je ne sais que vous dire. J'ai été à l'église je n’y manque jamais. Mad. de Talleyrand ne vous écrit pas probablement parce qu’elle n'a rien de bon à vous dire sur mon compte. Je la vois extrêmement peu. Elle vient tous les deux jours passer avec moi un quart d’heure, voilà tout. C'est à près pour moi comme si elle n’était pas à Baden. Le matin je vois Mad. de Nesselrode assez longtemps. Nous nous rencontrons dans l’allée et nous y restons assises pendant une heure ou plus même. Je vais quelques fois chez elle en rentrant de ma promenade le soir. Je viens quelque fois Mad. Wellesley en calèche. J’y mène aussi Mad. de la Redorte. Le reste du temps. Je me promène avec Marie et la petite Ellice. De une à 2 heures, M. de Malzaden ou quelque autre diplomate vient chez moi me conter les nouvelles. M. de Malzaden a de l'esprit.
Aujourd’hui nous épousons M. de Leuchtenberg, je ne cesse pas d’en être choquée. Vous ai-je dit que Matonchewitz est nommé pour Stockolm, dans son audience de congé l’Empereur lui a rendu ses bonnes grâces, cela me prouve qu’il n’est pas implacable. M. de la Redorte me dit que Thiers retourne à Paris avant la fin du mois. Il me dit aussi ce que vous m’aviez mandé qu'il s’était séparé du roi en très bons termes. Il ajoute que le Roi pense à remanier le ministère. Vous à l’intérieur, Thiers, les affaires étrangères. Le Maréchal la guerre. Que tout cela pourrait se faire bientôt. Y croyez-vous ?
5 heures
Voici votre lettre. Je ne veux pas que vous soyez inquiet. Je ne me porte pas bien, quelques fois je me sens bien mal, et Je vous le dis. Mais c’est une imagination. J’ai l’estomac abîmé, je ne mange pas. Je dors peu et mal, je maigris, tout cela est exact, mais cela ne me fera pas encore mourir. Je suis très impatiente du jugement des Pairs. Je vois dans un journal qu'on chante la Varsovienne dans la rue Rivoli. Cela ne me plaît pas du tout Adieu. Adieu à demain, car vous voulez tous les jours mes pauvres lettres. Dites-moi des nouvelles. Ce pauvre Pozzo, il me parait qu’il restera à Paris. Adieu dearest.
209. Bade, Samedi 6 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
209 Bade Samedi 6 juillet 1839 1 heure
J’ai lu et relu votre discours. Relu surtout le passage sur l’Empereur dans l’intention de bien me rendre compte de l’effet qu'il peut produire chez nous. Le personnage principal ne peut pas en méconnaître la vérité, mais elle ne lui plaira pas. Ceux qui après lui comprennent seront contents. Moi je suis très contente de tout votre discours et soyez sûr que je suis difficile. J’ai voulu commencer ma lettre par vous dire cela.
J'ai mal dormi, mes forces m’ont manqué pour la promenade du matin, j’ai pris mon bain de houblon quelle idée ! J’ai dormi depuis il me semble que je suis un peu mieux que ce matin. Vous voyez que je vous dis minutieusement tout. Le temps redevient beau mais je crains que cela ne dure pas.
5 heures
Votre lettre m’attriste, j'y répondrai demain. Je vaux mieux que je ne parais. Je vous aime plus, mille fois plus que vous le pensez. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon cœur ! Mais on ne voit jamais la dedans. Ah mon Dieu que vous aimeriez y regarder. A présent dans ce moment. Et ce moment, et sera toujours. Adieu. Je ne me sens pas bien, je ne puis pas continuer. Adieu.
J’ai lu et relu votre discours. Relu surtout le passage sur l’Empereur dans l’intention de bien me rendre compte de l’effet qu'il peut produire chez nous. Le personnage principal ne peut pas en méconnaître la vérité, mais elle ne lui plaira pas. Ceux qui après lui comprennent seront contents. Moi je suis très contente de tout votre discours et soyez sûr que je suis difficile. J’ai voulu commencer ma lettre par vous dire cela.
J'ai mal dormi, mes forces m’ont manqué pour la promenade du matin, j’ai pris mon bain de houblon quelle idée ! J’ai dormi depuis il me semble que je suis un peu mieux que ce matin. Vous voyez que je vous dis minutieusement tout. Le temps redevient beau mais je crains que cela ne dure pas.
5 heures
Votre lettre m’attriste, j'y répondrai demain. Je vaux mieux que je ne parais. Je vous aime plus, mille fois plus que vous le pensez. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon cœur ! Mais on ne voit jamais la dedans. Ah mon Dieu que vous aimeriez y regarder. A présent dans ce moment. Et ce moment, et sera toujours. Adieu. Je ne me sens pas bien, je ne puis pas continuer. Adieu.
208. Paris, Vendredi 5 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
208. Paris, Vendredi 5 Juillet 1839
Midi
Je me suis levé tard ce matin. Je dormais. Je dors assez mal, je ne sais pourquoi, car je me porte bien. Je pense beaucoup la nuit et le jour. J’ai rarement vécu aussi seul. Le monde que je vois ne rompt pas ma solitude. Le Duc de Broglie est tenu toute la journée à la Chambre des Pairs. Nous ne voyons guère qu'en dînant ensemble. Plus je suis seul, plus je vis avec vous seule. Mais je passe décidément à la présence réelle. Il n’y a que cela de vrai. Le procès ennuie tout le monde, juges et accusés. Les Pairs déclarent qu’ils n'en veulent plus de semblable. Les accusés sauf un seul ont l’attitude de gens qui ne recommenceront pas. C'est l’impression générale. Les avocats eux-mêmes sont polis. Cela finira dans huit jours. Il en reste encore près de 200 en prison. On en mettra quelques uns en liberté. Les autres attendront jusqu'au mois de novembre, au plus tard encore, pour être jugés, je ne sais pas bien par qui. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde que cette échauffourée-ci soit la dernière ; mais certainement c'est une folie, en déclin. Le Chancelier aussi est en grand Déclin out le monde en est frappé. Je n’ai pas encore été dîner à Châtenay. Cela ne me plaît pas.
Madame de Boigne va mieux. Je suis très ennuyé que vos Affaires de Pétersbourg ne marchent pas plus vite, et bien aise que votre fils Paul soit si réservé. Donc il croit sa cause mauvaise. Dans cet état des choses, il me paraît impossible que les lettres de Madame de Nesselrode. Ne vous fassent pas faire un pas. Mais il y a bien des pas à faire avant que vous soyez au terme. Vous avez beaucoup d'expérience des personnes, aucune des choses. Elles sont toutes lentes, difficiles, embrouillées. Elles ne vont que lorsqu'une volonté, active et obstinée s'en mêle. Et cette volonté pour vous. Je ne la vois pas à Pétersbourg. Il y a des Abymes de la bienveillance à la volonté. Je suis donc tourmenté, et pourtant je voudrais que vous le fussiez un peu moins. Je vous voudrais moins confiante et moins impatiente. Si vous vous laissiez complètement gouverner par moi, que vous vous en trouveriez bien !
Mon discours devient très populaire. Tout le monde s’y range. Mais tout le monde est persuadé que je veux être Ministre des Affaires étrangères, et que je n’ai parlé que pour cela. J’admire tout ce qu’on suppose et tout ce qu’on ignore en fait d’intentions. J'ai dîné hier chez le Ministre de l’instruction publique avec trente personnes que vous ne connaissez pas et M. d’Arnim qui m’a demandé de vos nouvelles. De là chez le Ministre de l’Intérieur. Peu de monde partout. Je n’ai trouvé à causer chez M. Duchâtel, qu'avec un officier de marine, homme d’esprit, autrefois aide de camp de l'amiral Rigny, le capitaine Leray. Je l’ai emmené dans un coin, et j'en ai extrait tout ce qu’il a vu de l'Orient. Nous croyons de plus en plus à la sagesse du Pacha. Mais si le Sultan lui déclare une guerre à mort, l’embarras peut commencer.
La Chambre a abrégé hier la session de huit jours. Elle a décidé qu’elle ne s’occuperait pas cette année de la loi des sucres. Votre protégé M. Dufaure, n'a pas de succès dans la discussion des chemins de fer. Plusieurs de ses projets seront rejetés et il ne les défend pas bien. Vous savez surement que Lady Granville ne va pas à Kitzingen. Elle parlait de Dieppe, du Havre. Je crois qu'elle n'ira nulle part, & que Constantinople les retiendra à Paris. Nous sommes très contents de l'Angleterre, et elle de nous. Je suis charmé que Bulwer revienne à Paris. Il a vraiment de l’esprit. On dit qu'il en a eu trop quelquefois jusqu'à la fièvre. Est-ce vrai ? Adieu. Je vais à la Chambre. Que m'importe à présent que La Terrasse soit sur mon chemin ? G.
Midi
Je me suis levé tard ce matin. Je dormais. Je dors assez mal, je ne sais pourquoi, car je me porte bien. Je pense beaucoup la nuit et le jour. J’ai rarement vécu aussi seul. Le monde que je vois ne rompt pas ma solitude. Le Duc de Broglie est tenu toute la journée à la Chambre des Pairs. Nous ne voyons guère qu'en dînant ensemble. Plus je suis seul, plus je vis avec vous seule. Mais je passe décidément à la présence réelle. Il n’y a que cela de vrai. Le procès ennuie tout le monde, juges et accusés. Les Pairs déclarent qu’ils n'en veulent plus de semblable. Les accusés sauf un seul ont l’attitude de gens qui ne recommenceront pas. C'est l’impression générale. Les avocats eux-mêmes sont polis. Cela finira dans huit jours. Il en reste encore près de 200 en prison. On en mettra quelques uns en liberté. Les autres attendront jusqu'au mois de novembre, au plus tard encore, pour être jugés, je ne sais pas bien par qui. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde que cette échauffourée-ci soit la dernière ; mais certainement c'est une folie, en déclin. Le Chancelier aussi est en grand Déclin out le monde en est frappé. Je n’ai pas encore été dîner à Châtenay. Cela ne me plaît pas.
Madame de Boigne va mieux. Je suis très ennuyé que vos Affaires de Pétersbourg ne marchent pas plus vite, et bien aise que votre fils Paul soit si réservé. Donc il croit sa cause mauvaise. Dans cet état des choses, il me paraît impossible que les lettres de Madame de Nesselrode. Ne vous fassent pas faire un pas. Mais il y a bien des pas à faire avant que vous soyez au terme. Vous avez beaucoup d'expérience des personnes, aucune des choses. Elles sont toutes lentes, difficiles, embrouillées. Elles ne vont que lorsqu'une volonté, active et obstinée s'en mêle. Et cette volonté pour vous. Je ne la vois pas à Pétersbourg. Il y a des Abymes de la bienveillance à la volonté. Je suis donc tourmenté, et pourtant je voudrais que vous le fussiez un peu moins. Je vous voudrais moins confiante et moins impatiente. Si vous vous laissiez complètement gouverner par moi, que vous vous en trouveriez bien !
Mon discours devient très populaire. Tout le monde s’y range. Mais tout le monde est persuadé que je veux être Ministre des Affaires étrangères, et que je n’ai parlé que pour cela. J’admire tout ce qu’on suppose et tout ce qu’on ignore en fait d’intentions. J'ai dîné hier chez le Ministre de l’instruction publique avec trente personnes que vous ne connaissez pas et M. d’Arnim qui m’a demandé de vos nouvelles. De là chez le Ministre de l’Intérieur. Peu de monde partout. Je n’ai trouvé à causer chez M. Duchâtel, qu'avec un officier de marine, homme d’esprit, autrefois aide de camp de l'amiral Rigny, le capitaine Leray. Je l’ai emmené dans un coin, et j'en ai extrait tout ce qu’il a vu de l'Orient. Nous croyons de plus en plus à la sagesse du Pacha. Mais si le Sultan lui déclare une guerre à mort, l’embarras peut commencer.
La Chambre a abrégé hier la session de huit jours. Elle a décidé qu’elle ne s’occuperait pas cette année de la loi des sucres. Votre protégé M. Dufaure, n'a pas de succès dans la discussion des chemins de fer. Plusieurs de ses projets seront rejetés et il ne les défend pas bien. Vous savez surement que Lady Granville ne va pas à Kitzingen. Elle parlait de Dieppe, du Havre. Je crois qu'elle n'ira nulle part, & que Constantinople les retiendra à Paris. Nous sommes très contents de l'Angleterre, et elle de nous. Je suis charmé que Bulwer revienne à Paris. Il a vraiment de l’esprit. On dit qu'il en a eu trop quelquefois jusqu'à la fièvre. Est-ce vrai ? Adieu. Je vais à la Chambre. Que m'importe à présent que La Terrasse soit sur mon chemin ? G.
189. Paris, Lundi 4 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
189 Paris Lundi le 4 mars. 1839
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
188. Paris, Dimanche 3 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
188 Paris 3 mars Dimanche 1839
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
98. Lisieux, Mardi 24 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (28 Juin- 29 Juillet)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°98 Lisieux- Mardi 24
Je persiste dans mon erreur. Je mets 98 comme si 93 avait été à sa place. Je suis encore venu dîner ici. C’est une singulière chose, qu’un pays démocratique. Tout le monde est shy avec un Ministre et shy avec humeur. Je ne suis plus ministre, mais je l’ai été et on croit que je le serai encore. Tout le monde veut être et avoir été bien pour moi, et avec moi, et croit pouvoir l’être sans embarras. Je n’ai jamais été plus entouré. Hier, à dîner, tout-à-coup, au milieu des 24 personnes qui étaient à table avec moi, comme je m’ennuyais fort l’idée m’est venu du plaisir que j’aurais si j’étais seul à table avec vous, à dîner je ne sais où. Le rouge m’a monté au visage. Ma voisine, la maîtresse de la maison l’a remarqué : " Est-ce que vous êtes souffrant ? Vous avez trop chaud. " J’ai eu beau dire que non. On a ouvert toutes les fenêtres. On m’a demandé dix fois, si j’étais encore incommodé, si j’allais mieux &, Dans huit jours, mon plaisir ne sera pas en idée. Je crois en vérité que le rouge me gagne encore en y pensant. M. Génie vient en effet passer avec moi Samedi et Dimanche. J’espère qu’il m’apportera quelque chose de vous. Je suis avide et toujours avide, en dépit du 31. Je serai très avide le 31 et tous les jours suivants. Je ne m’étonne pas que M. Villers ait mauvais ton. Il a mené à Madrid une vie fort légère, et les galanteries espagnoles n’ont bon ton, je crois, que dans les romances du Cid. Avez-vous jamais lu ces vieilles romances du Cid et de tous les héros Espagnols de son temps ? C’est très joli d’une élégance et d’une simplicité charmante. Il y a quelque chose de très agréable, de mon avis, dans une grande élégance d’esprit et de cœur une à une grande simplicité de vie matérielle. C’est souvent le mérite de l’antiquité grecque et de l’Europe du moyen-âge.
Je persiste à croire qu’Ellice est venu à Paris pour autre chose encore que pour vous et pour ne pas voter sur Lord Durham. Si vous avez quelque bon endroit où il vous plaise d’aller passer les trois journées, faites le, sauf cela, vous pouvez, ce me semble rester chez vous sans autre inconvénient que le bruit. A la vérité, il sera grand là où vous êtes. La poussière vous incommode-t-elle ? Je ne pensais pas qu’on arrose. Vous vous promenez donc toujours le soir sur la route de Neuilly.
J’y vais tous les soirs. Adieu. Je repars pour le Val-Richer, & ; je n’en sortirai plus que lundi prochain. Mon rhume n’est rien. Et je n’en aurai pas la moindre trace mardi. Adieu. G.
Je persiste dans mon erreur. Je mets 98 comme si 93 avait été à sa place. Je suis encore venu dîner ici. C’est une singulière chose, qu’un pays démocratique. Tout le monde est shy avec un Ministre et shy avec humeur. Je ne suis plus ministre, mais je l’ai été et on croit que je le serai encore. Tout le monde veut être et avoir été bien pour moi, et avec moi, et croit pouvoir l’être sans embarras. Je n’ai jamais été plus entouré. Hier, à dîner, tout-à-coup, au milieu des 24 personnes qui étaient à table avec moi, comme je m’ennuyais fort l’idée m’est venu du plaisir que j’aurais si j’étais seul à table avec vous, à dîner je ne sais où. Le rouge m’a monté au visage. Ma voisine, la maîtresse de la maison l’a remarqué : " Est-ce que vous êtes souffrant ? Vous avez trop chaud. " J’ai eu beau dire que non. On a ouvert toutes les fenêtres. On m’a demandé dix fois, si j’étais encore incommodé, si j’allais mieux &, Dans huit jours, mon plaisir ne sera pas en idée. Je crois en vérité que le rouge me gagne encore en y pensant. M. Génie vient en effet passer avec moi Samedi et Dimanche. J’espère qu’il m’apportera quelque chose de vous. Je suis avide et toujours avide, en dépit du 31. Je serai très avide le 31 et tous les jours suivants. Je ne m’étonne pas que M. Villers ait mauvais ton. Il a mené à Madrid une vie fort légère, et les galanteries espagnoles n’ont bon ton, je crois, que dans les romances du Cid. Avez-vous jamais lu ces vieilles romances du Cid et de tous les héros Espagnols de son temps ? C’est très joli d’une élégance et d’une simplicité charmante. Il y a quelque chose de très agréable, de mon avis, dans une grande élégance d’esprit et de cœur une à une grande simplicité de vie matérielle. C’est souvent le mérite de l’antiquité grecque et de l’Europe du moyen-âge.
Je persiste à croire qu’Ellice est venu à Paris pour autre chose encore que pour vous et pour ne pas voter sur Lord Durham. Si vous avez quelque bon endroit où il vous plaise d’aller passer les trois journées, faites le, sauf cela, vous pouvez, ce me semble rester chez vous sans autre inconvénient que le bruit. A la vérité, il sera grand là où vous êtes. La poussière vous incommode-t-elle ? Je ne pensais pas qu’on arrose. Vous vous promenez donc toujours le soir sur la route de Neuilly.
J’y vais tous les soirs. Adieu. Je repars pour le Val-Richer, & ; je n’en sortirai plus que lundi prochain. Mon rhume n’est rien. Et je n’en aurai pas la moindre trace mardi. Adieu. G.
175. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°175 Mardi 30 octobre. 6 h. et demie.
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
174. Val-Richer, Lundi 29 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°174 Lundi 29 Oct., 7 heures
Je suis exactement le contraire de Lord Holland, bien plus hardi dans le Gouvernement que dans l’opposition. Cela prouve qu’il n’est pas trop à sa place en ce moment, ni moi à la mienne. Je crains toujours de faire verser la voiture en querellant le cocher, même quand je n’aime pas le cocher. Et puis, l’opposition déclame beaucoup et je ne peux souffrir la déclamation. Toute parole exagérée tombe sur moi, comme un seau d’eau froide. En revanche, et pour me défendre de ma faiblesse j’ai aversion de celle d’un gouvernement. La colère me prend quand je vois le pouvoir indécis, inerte, abaissé. C’est un son faux à mon oreille, une ligne de travers à mon œil. Je puis me permettre cette colère, car je l’ai dans les affaires comme en dehors. Je n’ai jamais été content de mon propre gouvernement. Voilà les deux sentiments qui me tiennent aujourd’hui. Je navigue de l’un à l’autre.
Hier, pour la première fois depuis que je suis ici, je n’ai pas mis le pied hors de la maison. Je n’ai jamais vu un tel torrent de pluie continue. Je m’en serais consolé en travaillant, si j’avais été en train de travailler ; mais je n’étais pas en train. J’ai beaucoup causé avec Henriette. Cette bonne petite fille m’avait donné le matin, l’air fort troublé, et toute rouge, le billet au crayon que je vous envoie; et qui m’a été au cœur. Pourrez-vous le lire ? Je lui ai promis un mari qui serait charmé de vivre avec moi, et que nous ne nous séparerions jamais. Comment cette petite Duchesse de Wurtemberg s’est-elle détruite si vite ? J’espère que l’Italie la guérira si elle a auprès d’elle quelqu’un qui sache la gouverner, car je doute qu’elle se gouverne bien elle-même. Son mari n’a pas l’air gouvernant du tout.
Qu’est-ce que Fagel entend par le mauvais état des Affaires de son pays ? Croit-il que son Roi, malgré son semblant d’arrangement, s’obstinera toujours et finira par le brouiller avec ses Etats Généraux ? Si la conférence termine l’affaire Belge, je ne vois pas quel embarras il peut y avoir en Hollande. Il me semble que la duchesse de Talleyrand vous donne beaucoup à dîner. Veut-elle comme c’est l’usage de ce temps-ci, suppléer à la qualité par la quantité ? A-t-elle pris des jours ? Essaye-t-elle d’avoir une maison ? Je suis bien questionneur ce matin.
Vous souvenez-vous que vous m’écriviez de Londres, l’an dernier : " Durham a du courage, de l’audace, et surtout de l’ambition. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est Lord Durham qui le créerait. Tout cela est encore à sa naissance ; mais regardez-y bien ; le danger peut surgir tout à coup. Vous avez une sagacité bien rare, et charmante parce qu’elle est si naturelle si prompte ! En passant vous voyez au fond.
10 heures
Je me fâche de ce que vous vous fâchez ; je m’afflige de ce que vous vous affligez. Qu’est-ce que cela prouve ? que dans ma conviction, vous n’avez jamais droit de vous fâcher jamais droit de vous affliger à mon égard. Oui, j’en suis convaincu, j’en suis sûr. Entendez bien ceci, dearest, je suis infaillible envers vous. Et tant que vous ne le croirez pas vous ne me connaîtrez pas, et vous ne saurez pas combien je vous aime. Adieu, adieu toujours le même adieu quand même, et je ne veux pas qu’il y ait de quand même. G.
Je suis exactement le contraire de Lord Holland, bien plus hardi dans le Gouvernement que dans l’opposition. Cela prouve qu’il n’est pas trop à sa place en ce moment, ni moi à la mienne. Je crains toujours de faire verser la voiture en querellant le cocher, même quand je n’aime pas le cocher. Et puis, l’opposition déclame beaucoup et je ne peux souffrir la déclamation. Toute parole exagérée tombe sur moi, comme un seau d’eau froide. En revanche, et pour me défendre de ma faiblesse j’ai aversion de celle d’un gouvernement. La colère me prend quand je vois le pouvoir indécis, inerte, abaissé. C’est un son faux à mon oreille, une ligne de travers à mon œil. Je puis me permettre cette colère, car je l’ai dans les affaires comme en dehors. Je n’ai jamais été content de mon propre gouvernement. Voilà les deux sentiments qui me tiennent aujourd’hui. Je navigue de l’un à l’autre.
Hier, pour la première fois depuis que je suis ici, je n’ai pas mis le pied hors de la maison. Je n’ai jamais vu un tel torrent de pluie continue. Je m’en serais consolé en travaillant, si j’avais été en train de travailler ; mais je n’étais pas en train. J’ai beaucoup causé avec Henriette. Cette bonne petite fille m’avait donné le matin, l’air fort troublé, et toute rouge, le billet au crayon que je vous envoie; et qui m’a été au cœur. Pourrez-vous le lire ? Je lui ai promis un mari qui serait charmé de vivre avec moi, et que nous ne nous séparerions jamais. Comment cette petite Duchesse de Wurtemberg s’est-elle détruite si vite ? J’espère que l’Italie la guérira si elle a auprès d’elle quelqu’un qui sache la gouverner, car je doute qu’elle se gouverne bien elle-même. Son mari n’a pas l’air gouvernant du tout.
Qu’est-ce que Fagel entend par le mauvais état des Affaires de son pays ? Croit-il que son Roi, malgré son semblant d’arrangement, s’obstinera toujours et finira par le brouiller avec ses Etats Généraux ? Si la conférence termine l’affaire Belge, je ne vois pas quel embarras il peut y avoir en Hollande. Il me semble que la duchesse de Talleyrand vous donne beaucoup à dîner. Veut-elle comme c’est l’usage de ce temps-ci, suppléer à la qualité par la quantité ? A-t-elle pris des jours ? Essaye-t-elle d’avoir une maison ? Je suis bien questionneur ce matin.
Vous souvenez-vous que vous m’écriviez de Londres, l’an dernier : " Durham a du courage, de l’audace, et surtout de l’ambition. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est Lord Durham qui le créerait. Tout cela est encore à sa naissance ; mais regardez-y bien ; le danger peut surgir tout à coup. Vous avez une sagacité bien rare, et charmante parce qu’elle est si naturelle si prompte ! En passant vous voyez au fond.
10 heures
Je me fâche de ce que vous vous fâchez ; je m’afflige de ce que vous vous affligez. Qu’est-ce que cela prouve ? que dans ma conviction, vous n’avez jamais droit de vous fâcher jamais droit de vous affliger à mon égard. Oui, j’en suis convaincu, j’en suis sûr. Entendez bien ceci, dearest, je suis infaillible envers vous. Et tant que vous ne le croirez pas vous ne me connaîtrez pas, et vous ne saurez pas combien je vous aime. Adieu, adieu toujours le même adieu quand même, et je ne veux pas qu’il y ait de quand même. G.
163. Val-Richer, Jeudi 18 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°163 Jeudi 18 octobre. 6 h et demie
Si je ne me trompe ; je me suis trompé hier. Aujourd’hui doit être le 163 et hier n’était que le 162. Cette fin du mois d’octobre est pour moi, un temps de fatigue et d’ennui. Les dîners m’écrasent. On commence à revenir à la ville. On sait que je vais partir. Chacun se croit obligé et pressé d’être poli pour moi. J’ai quatre dîners, en perspective. J’en ai refusé deux hier. Je refuse tout ce qui ne m’est pas politiquement utile. Quand ce mois finira j’aurai un petit plaisir, celui de la délivrance à côté d’un grand bonheur. Le redoublement de tendresse de Mad. de Castellane m’amuse. Elle sait être fort caressante. Je m’en rapporte à vous pour ne rendre que ce qu’on rend sans rien donner. Elle a de l’esprit et un savoir faire trop remuant, trop visible, mais assez intelligent et très persévérant. Elle est vraiment très attachée et dévouée à M. de L.
Au temps de leurs infidélités naturelles, elle disait toujours : " Quand M. Molé me reviendra, car il me reviendra, il me retrouvera. " Est-ce que les Sutherland sont logés à la Terrasse que leurs enfants puissent ainsi venir vous embrasser de grand matin ? Ce sont d’heureux enfants. On vous fait mal en vous montrant qu’on vous aime. C’est qu’on en vous le montre pas toujours, à tout instant. Il ne faut pas avoir du bonheur à longs intervalles et par accès. Il veut la continuité. Le soleil lève devant moi froid, mais dans un ciel pur, malgré les torrents de pluie d’hier. Je vous désire de tout mon cœur, ici, près de moi ; pour moi d’abord, pour vous ensuite. Je vous ferais du bien. Ce séjour est calme et doux. Une âme fatiguée y peut trouver du repos, et vous y trouveriez aussi de la tendresse. Il n’y a point de repos tout seul. Nous parlerions, nous ne parlerions pas, comme vous voudriez. Vous pleureriez si vous vouliez. Pas trop fort, n’est-ce pas ? Pas ces sanglots où tout votre être semble près de se briser, car je vous demanderais grâce, grâce pour moi-même. J’ai le cœur bien fatigué aussi, plus fatigué que je ne le montre, même à vous. Vous me seriez bonne, vous me feriez du bien aussi. Je veux que vous m’en fassiez. J’en ai besoin et j’y compte. Vous ne viendrez pas ici, mais j’irai vous retrouver.
8 heures
Je rentre. J’ai été me promener vingt minutes dans le jardin. J’y serais resté plus longtemps. Mais les ouvriers m’ont chassé. Quand on est vu, on n’est pas seul. Vous avez raison. Rien n’aide plus à rester ministre que de ne pas vouloir s’en aller. Rois ou Parlement ne chassent guère leurs ministres quand il faut absolument les chasser. Mais les révolutions sont plus brutales, et le Duc de Frias pourrait y être pris. A la vérité, la révolution d’Espagne est une si pâle copie qu’on peut se jouer d’elle sans y risquer comme sans y gagner grand chose. On m’a assuré quand la lettre, pendant je ne sais plus quelles Cortes, on allait voir tous les matins, dans le Moniteur, ce qui s’était fait en France à pareil jour pour savoir comment on remplirait sa journée. M. de Boislecomte est-il encore à Paris ? Si vous le rencontrez, faites-le causer sur le Pacha d’Egypte. Il doit être assez curieux à entendre sur l’état d’esprit où se trouve aujourd’hui cet homme là, et ce qu’on en peut conjecturer. J’admire beaucoup la netteté avec laquelle les Orientaux, quand une situation est une fois décidée en prennent leur parti et s’y accommodent sans cesser au fond, de travailler à la changer si elle leur déplaît. Il n’y a que cela de digne, et j’ajoute d’utile. Dans notre monde, on s’use, en petits efforts contre l’impossible. C’est dommage que Méhemet Ali ne soit pas sur un plus grand théâtre et avec plus d’avenir.
10 h.
Peu m’importe que vous griffonniez pourvu que ce ne soit pas un signe de lassitude. Je suis fort aise que votre fils vous reste quelques jours de plus. Je serais fort aise aussi de le trouver encore à Paris, et de le connaitre. Adieu Adieu. G.
Si je ne me trompe ; je me suis trompé hier. Aujourd’hui doit être le 163 et hier n’était que le 162. Cette fin du mois d’octobre est pour moi, un temps de fatigue et d’ennui. Les dîners m’écrasent. On commence à revenir à la ville. On sait que je vais partir. Chacun se croit obligé et pressé d’être poli pour moi. J’ai quatre dîners, en perspective. J’en ai refusé deux hier. Je refuse tout ce qui ne m’est pas politiquement utile. Quand ce mois finira j’aurai un petit plaisir, celui de la délivrance à côté d’un grand bonheur. Le redoublement de tendresse de Mad. de Castellane m’amuse. Elle sait être fort caressante. Je m’en rapporte à vous pour ne rendre que ce qu’on rend sans rien donner. Elle a de l’esprit et un savoir faire trop remuant, trop visible, mais assez intelligent et très persévérant. Elle est vraiment très attachée et dévouée à M. de L.
Au temps de leurs infidélités naturelles, elle disait toujours : " Quand M. Molé me reviendra, car il me reviendra, il me retrouvera. " Est-ce que les Sutherland sont logés à la Terrasse que leurs enfants puissent ainsi venir vous embrasser de grand matin ? Ce sont d’heureux enfants. On vous fait mal en vous montrant qu’on vous aime. C’est qu’on en vous le montre pas toujours, à tout instant. Il ne faut pas avoir du bonheur à longs intervalles et par accès. Il veut la continuité. Le soleil lève devant moi froid, mais dans un ciel pur, malgré les torrents de pluie d’hier. Je vous désire de tout mon cœur, ici, près de moi ; pour moi d’abord, pour vous ensuite. Je vous ferais du bien. Ce séjour est calme et doux. Une âme fatiguée y peut trouver du repos, et vous y trouveriez aussi de la tendresse. Il n’y a point de repos tout seul. Nous parlerions, nous ne parlerions pas, comme vous voudriez. Vous pleureriez si vous vouliez. Pas trop fort, n’est-ce pas ? Pas ces sanglots où tout votre être semble près de se briser, car je vous demanderais grâce, grâce pour moi-même. J’ai le cœur bien fatigué aussi, plus fatigué que je ne le montre, même à vous. Vous me seriez bonne, vous me feriez du bien aussi. Je veux que vous m’en fassiez. J’en ai besoin et j’y compte. Vous ne viendrez pas ici, mais j’irai vous retrouver.
8 heures
Je rentre. J’ai été me promener vingt minutes dans le jardin. J’y serais resté plus longtemps. Mais les ouvriers m’ont chassé. Quand on est vu, on n’est pas seul. Vous avez raison. Rien n’aide plus à rester ministre que de ne pas vouloir s’en aller. Rois ou Parlement ne chassent guère leurs ministres quand il faut absolument les chasser. Mais les révolutions sont plus brutales, et le Duc de Frias pourrait y être pris. A la vérité, la révolution d’Espagne est une si pâle copie qu’on peut se jouer d’elle sans y risquer comme sans y gagner grand chose. On m’a assuré quand la lettre, pendant je ne sais plus quelles Cortes, on allait voir tous les matins, dans le Moniteur, ce qui s’était fait en France à pareil jour pour savoir comment on remplirait sa journée. M. de Boislecomte est-il encore à Paris ? Si vous le rencontrez, faites-le causer sur le Pacha d’Egypte. Il doit être assez curieux à entendre sur l’état d’esprit où se trouve aujourd’hui cet homme là, et ce qu’on en peut conjecturer. J’admire beaucoup la netteté avec laquelle les Orientaux, quand une situation est une fois décidée en prennent leur parti et s’y accommodent sans cesser au fond, de travailler à la changer si elle leur déplaît. Il n’y a que cela de digne, et j’ajoute d’utile. Dans notre monde, on s’use, en petits efforts contre l’impossible. C’est dommage que Méhemet Ali ne soit pas sur un plus grand théâtre et avec plus d’avenir.
10 h.
Peu m’importe que vous griffonniez pourvu que ce ne soit pas un signe de lassitude. Je suis fort aise que votre fils vous reste quelques jours de plus. Je serais fort aise aussi de le trouver encore à Paris, et de le connaitre. Adieu Adieu. G.
159. Val-Richer, Dimanhe 14 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°159 Dimanche 14 octobre, 7 h. et demie
Je me suis promené hier avec vous sous les Arcades. Y étiez-vous ? Il n’y avait certainement pas moyen d’être ailleurs. La pluie est-tombée par torrents. Décidément je vous aime à La Terrasse. Je m’y crois plus aisément qu’ailleurs, en attendant que j’y sois. Et puis je pense à cet hiver. C’est près de chez moi, près de la Chambre par un chemin commode. Nous arrangerons, nos heures, car je veux travailler un peu.
Vous ne m’avez pas dit si Lady Granville avait fait sa déclaration à Marie, et avec quel effet. J’aime à savoir où en est tout l’établissement. Et Mad. de Flahaut revient-elle cet hiver ? Sera t-elle toujours mon ennemie ? Ou bien changera-t-elle comme M. Molé ? Il vous a dit qu’il me respectait fort. Vous souvenez-vous de l’humeur que lui donnait ce mot, de votre part ? Je ne prévois pas du tout la session et je n’essaie pas de la prévoir. Je ne sais qu’une chose, c’est que j’agirai selon mon propre jugement.
Je ne me fatigue pas non plus l’esprit à prévoir l’Europe de 1839. Cependant, je persiste ; il y a quelque chose à prévoir. Cette immobilité générale, des esprits et des corps, ne durera pas toujours. Et parce qu’elle dure depuis longtemps, c’est une raison pour qu’elle soit plus près de son terme, non pour qu’elle dure encore. Du reste tout cela est si vague qu’il n’y a pas à en parler. Lord Holland vous plaît donc beaucoup. J’en suis bien aise Il me plaisait fort aussi. J’aime les esprits cultivés et variés, qui s’intéressent à toutes choses, et reçoivent de toutes un mouvement facile. Il y a à cela de la liberté et de l’élégance, deux qualités charmantes. Quand je suis entré dans le monde les esprits là n’étaient pas rares ; il en restait quelques uns du siècle dernier ; temps de conversation et d’amusement s’il en fut jamais, où l’on pensait à tout pour s’en entretenir et avoir de quoi se plaire les uns aux autres. Lord Holland est fort lettré, grande ressource et grand agrément pour causer. On a eu beaucoup d’esprit dans le monde. il faut en hériter et en jouir encore, et en faire jouir les autres. Je n’aime pas les gens qui ne savent parler que de ce qui se voit et se fait de leur temps et autour d’eux. Pour tout le monde, le présent est une coterie. La meilleure est petite.
Savez-vous à quoi je m’amuse quelques fois ? à chercher, parmi les gens d’esprit que j’ai connu, lesquels vous auraient plu. Je n’en trouve pas beaucoup, quelques uns pourtant, trois ou quatre. Et quand j’ai trouvé ceux-là, je cherche s’ils vous auraient plu beaucoup. Il me semble que non. J’en suis charmé.
10 heures ¼
Je ne crois pas que vous me trouviez plus de jours que de coutume, mais moi, je voudrais bien ne pas vous trouver maigrie. Je borne là mon ambition. C’est bien de la vertu à moi. Du reste je ne sais pourquoi vous vous êtes persuadée que l’embonpoint me plaisait. Cela ne m’est pas arrivée une fois en ma vie. Je suis charmé que Marie soit de bonne humeur. Vous avez raison ; il ne faut pas prodiguer les remèdes héroïques Je serai comme vous dites, la pierre de touche, Adieu, adieu. Il fait très froid aujourd’hui. Je fais rentrer mes orangers. Il faut que tout rentre. Adieu. G.
Je me suis promené hier avec vous sous les Arcades. Y étiez-vous ? Il n’y avait certainement pas moyen d’être ailleurs. La pluie est-tombée par torrents. Décidément je vous aime à La Terrasse. Je m’y crois plus aisément qu’ailleurs, en attendant que j’y sois. Et puis je pense à cet hiver. C’est près de chez moi, près de la Chambre par un chemin commode. Nous arrangerons, nos heures, car je veux travailler un peu.
Vous ne m’avez pas dit si Lady Granville avait fait sa déclaration à Marie, et avec quel effet. J’aime à savoir où en est tout l’établissement. Et Mad. de Flahaut revient-elle cet hiver ? Sera t-elle toujours mon ennemie ? Ou bien changera-t-elle comme M. Molé ? Il vous a dit qu’il me respectait fort. Vous souvenez-vous de l’humeur que lui donnait ce mot, de votre part ? Je ne prévois pas du tout la session et je n’essaie pas de la prévoir. Je ne sais qu’une chose, c’est que j’agirai selon mon propre jugement.
Je ne me fatigue pas non plus l’esprit à prévoir l’Europe de 1839. Cependant, je persiste ; il y a quelque chose à prévoir. Cette immobilité générale, des esprits et des corps, ne durera pas toujours. Et parce qu’elle dure depuis longtemps, c’est une raison pour qu’elle soit plus près de son terme, non pour qu’elle dure encore. Du reste tout cela est si vague qu’il n’y a pas à en parler. Lord Holland vous plaît donc beaucoup. J’en suis bien aise Il me plaisait fort aussi. J’aime les esprits cultivés et variés, qui s’intéressent à toutes choses, et reçoivent de toutes un mouvement facile. Il y a à cela de la liberté et de l’élégance, deux qualités charmantes. Quand je suis entré dans le monde les esprits là n’étaient pas rares ; il en restait quelques uns du siècle dernier ; temps de conversation et d’amusement s’il en fut jamais, où l’on pensait à tout pour s’en entretenir et avoir de quoi se plaire les uns aux autres. Lord Holland est fort lettré, grande ressource et grand agrément pour causer. On a eu beaucoup d’esprit dans le monde. il faut en hériter et en jouir encore, et en faire jouir les autres. Je n’aime pas les gens qui ne savent parler que de ce qui se voit et se fait de leur temps et autour d’eux. Pour tout le monde, le présent est une coterie. La meilleure est petite.
Savez-vous à quoi je m’amuse quelques fois ? à chercher, parmi les gens d’esprit que j’ai connu, lesquels vous auraient plu. Je n’en trouve pas beaucoup, quelques uns pourtant, trois ou quatre. Et quand j’ai trouvé ceux-là, je cherche s’ils vous auraient plu beaucoup. Il me semble que non. J’en suis charmé.
10 heures ¼
Je ne crois pas que vous me trouviez plus de jours que de coutume, mais moi, je voudrais bien ne pas vous trouver maigrie. Je borne là mon ambition. C’est bien de la vertu à moi. Du reste je ne sais pourquoi vous vous êtes persuadée que l’embonpoint me plaisait. Cela ne m’est pas arrivée une fois en ma vie. Je suis charmé que Marie soit de bonne humeur. Vous avez raison ; il ne faut pas prodiguer les remèdes héroïques Je serai comme vous dites, la pierre de touche, Adieu, adieu. Il fait très froid aujourd’hui. Je fais rentrer mes orangers. Il faut que tout rentre. Adieu. G.
157. Val-Richer, Vendredi 12 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°157 Vendredi 12, 7 heures
J’ai fait comme vous. Je me suis couché hier à 9 heures et demie. J’avais beaucoup travaillé dans mon Cabinet et beaucoup couru dans mes champs ; deux choses que je puis très bien faire séparément mais pas bien ensemble. J’ai toujours éprouvé cela ; de l’activité d’esprit ou de corps, tant qu’on voudra ; mais l’une ou l’autre. Dans mes moments de grande préoccupation morale une course à pied d’une demi heure me fatiguait.
Vous verrez que Mad. de Talleyrand viendra chez vous cet hiver chercher des nouvelles. Je ne lui vois que M. Royer-Collard qui puisse lui en apporter un peu. Encore est-il lui-même fort en dehors de tout. Mais il vit à la Chambre et il voit quelque fois les Ministres. Je trouve ce que vous me dîtes à propos de sa visite fort naturel. Vous réagissez, et elle non. Elle a l’air embarrassé et vous non. Cela est dans l’ordre.
L’article des Débats d’hier sur l’Angleterre, l’Inde et la Russie est curieux. Est-ce qu’il y a vraiment chez vous quelque projet semblable ? Je ne dis pas projet lointain. général, politique d’ensemble; rien de plus simple, mais projet prochain, actuel. Ce serait étrange. Du reste cela s’est vu : beaucoup de prudence, de timidité même pour ce qu’on a sous la main à sa porte ; et des intentions, des combinaisons, même des préparatifs gigantesques pour ce qui est loin, bien loin. On satisfait ainsi, à la fois son imagination et sa raison. Et l’imagination se passe d’apparences et de paroles. à la bonne heure.
Lisez vous quelques fois le petit journal de Thiers, le Nouvelliste? Il est bien vif contre le Cabinet. Thiers n’a plus tout le Constitutionnel. M. Molé s’y est glissé ; non pas de manière à l’ôter à d’autres, mais pour y avoir; un petit coin à lui. C’est sa façon de procéder. Il n’en est pas d’un journal comme d’un cœur ; on n’est pas obligé à tout ou rien. Je vous quitte pour aller voir si on plante mes arbres. Vous ne savez pas et vous ne saurez jamais ce que c’est que de surveiller des ouvriers. Mais pardonnez moi de vous trouver, quant à la température, un peu inconséquente. Vous me dites, page 1, Il fait très froid. et page 2, Comment, vous avez du feu dans votre chambre ! Cela me paraît incroyable. Quand Dieu fait très froid, moi, je fais du feu. Vous êtes à ce qu’il me semble, beaucoup plus résignée.
9 heures
Mes plantations se font bien. Je me prête, je crois, de très bonne grâce aux affaires et aux plaisirs de la Campagne. Et j’en jouirais très vivement si je les partageais. Mais je ne les partage pas. Aussi ne fais-je que m’y prêter. Voilà le facteur et une bonne lettre. N’oubliez rien, je vous prie de ce que vous avez eu une fois et un moment le projet de me dire. C’est là le mal cruel de l’absence entre tant d’autres ; on perd une infinité de choses, qui étaient bonnes, charmantes, mais qui passent avant qu’on se retrouve. Même quand je vous aurai retrouvée j’aurai beaucoup, beaucoup à regretter. N’oubliez donc pas. Je ne sais ce que feront mes amis, rien de déplacé j’espère. Pour moi, je n’irai certainement pas ailleurs que la où j’ai toujours été, depuis huit ans entr’autres. Je suis plus que jamais convaincu que c’est d’idées et de pratiques gouvernementales que la France a besoin. Et ce qui me fâche c’est qu’on l’en éloigne au lieu de l’y conduire. Si je me plains, ce sera de ce qu’on pousse ce pays-ci vers M. Odilon Barrot. Adieu. Adieu. Que c’est long ? G.
J’ai fait comme vous. Je me suis couché hier à 9 heures et demie. J’avais beaucoup travaillé dans mon Cabinet et beaucoup couru dans mes champs ; deux choses que je puis très bien faire séparément mais pas bien ensemble. J’ai toujours éprouvé cela ; de l’activité d’esprit ou de corps, tant qu’on voudra ; mais l’une ou l’autre. Dans mes moments de grande préoccupation morale une course à pied d’une demi heure me fatiguait.
Vous verrez que Mad. de Talleyrand viendra chez vous cet hiver chercher des nouvelles. Je ne lui vois que M. Royer-Collard qui puisse lui en apporter un peu. Encore est-il lui-même fort en dehors de tout. Mais il vit à la Chambre et il voit quelque fois les Ministres. Je trouve ce que vous me dîtes à propos de sa visite fort naturel. Vous réagissez, et elle non. Elle a l’air embarrassé et vous non. Cela est dans l’ordre.
L’article des Débats d’hier sur l’Angleterre, l’Inde et la Russie est curieux. Est-ce qu’il y a vraiment chez vous quelque projet semblable ? Je ne dis pas projet lointain. général, politique d’ensemble; rien de plus simple, mais projet prochain, actuel. Ce serait étrange. Du reste cela s’est vu : beaucoup de prudence, de timidité même pour ce qu’on a sous la main à sa porte ; et des intentions, des combinaisons, même des préparatifs gigantesques pour ce qui est loin, bien loin. On satisfait ainsi, à la fois son imagination et sa raison. Et l’imagination se passe d’apparences et de paroles. à la bonne heure.
Lisez vous quelques fois le petit journal de Thiers, le Nouvelliste? Il est bien vif contre le Cabinet. Thiers n’a plus tout le Constitutionnel. M. Molé s’y est glissé ; non pas de manière à l’ôter à d’autres, mais pour y avoir; un petit coin à lui. C’est sa façon de procéder. Il n’en est pas d’un journal comme d’un cœur ; on n’est pas obligé à tout ou rien. Je vous quitte pour aller voir si on plante mes arbres. Vous ne savez pas et vous ne saurez jamais ce que c’est que de surveiller des ouvriers. Mais pardonnez moi de vous trouver, quant à la température, un peu inconséquente. Vous me dites, page 1, Il fait très froid. et page 2, Comment, vous avez du feu dans votre chambre ! Cela me paraît incroyable. Quand Dieu fait très froid, moi, je fais du feu. Vous êtes à ce qu’il me semble, beaucoup plus résignée.
9 heures
Mes plantations se font bien. Je me prête, je crois, de très bonne grâce aux affaires et aux plaisirs de la Campagne. Et j’en jouirais très vivement si je les partageais. Mais je ne les partage pas. Aussi ne fais-je que m’y prêter. Voilà le facteur et une bonne lettre. N’oubliez rien, je vous prie de ce que vous avez eu une fois et un moment le projet de me dire. C’est là le mal cruel de l’absence entre tant d’autres ; on perd une infinité de choses, qui étaient bonnes, charmantes, mais qui passent avant qu’on se retrouve. Même quand je vous aurai retrouvée j’aurai beaucoup, beaucoup à regretter. N’oubliez donc pas. Je ne sais ce que feront mes amis, rien de déplacé j’espère. Pour moi, je n’irai certainement pas ailleurs que la où j’ai toujours été, depuis huit ans entr’autres. Je suis plus que jamais convaincu que c’est d’idées et de pratiques gouvernementales que la France a besoin. Et ce qui me fâche c’est qu’on l’en éloigne au lieu de l’y conduire. Si je me plains, ce sera de ce qu’on pousse ce pays-ci vers M. Odilon Barrot. Adieu. Adieu. Que c’est long ? G.
153. Val-Richer, Lundi 8 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°153 Lundi 8 Oct, 7 heures
Je me souviens qu’hier, étourdiment je vous ai encore adressé ma lettre aux Champs Elysées. Elle vous sera peut-être arrivée quelques heures plus tard.
Je suis fâché de ce que mande M. de Médem, plus fâché que surpris. Il m’a toujours paru, par ses lettres que votre frère était réellement blessé de votre peu de goût pour la Russie. C’est bien lui qui sincèrement ne conçoit pas que vous ne préfériez pas à tout, votre état de grande Dame auprès du grand Empereur dans le grand pays. M. de Lieven est encore plus soumis, pour parler convenablement mais moins russe et vous comprend mieux. Rien n’est pire que l’humeur sincère d’un honnête homme de peu d’esprit. Il se croit fondé en raison, et ce qu’il y a de plus intraitable, c’est la conviction qu’on a raison. M. de Médem aura peut-être choqué encore votre frère en lui répétant que, bien réellement, avec votre santé, vos habitudes, vos goûts, vous ne pouviez vivre ailleurs qu’à Londres ou à Paris. Les gens d’esprit vont quelque fois trop brutalement au fait. Enfin je raisonne, je cherche, je voudrais tout savoir et tout expliquer, tant cela intéresse. Je voudrais surtout que vous eussiez auprès de l’Empereur quelqu’un de bienveillant et d’intelligent, qui vous comprît, et vous fît comprendre. Je crois toujours qu’avec de l’esprit de la bonne volonté et du temps on peut beaucoup, quand on est toujours là. M. de Nesselrode et Matonchewitz, à ce qu’il me semble y seraient seuls propres. Mais l’un est trop affairé, l’autre trop petit, et ni l’un ni l’autre ne s’en soucie assez. Je suppose que vous avez répondu à votre mari.
Montrond a passé en effet son temps chez Thiers. Je suis curieux de ce qu’il y a porté et de ce qu’il en a rapporté, au moins de ce qu’il en dit. Je le verrai à mon retour. Il a vraiment de l’esprit, de l’esprit efficace. Il faut beaucoup pour qu’il rajeunisse un peu. Il était cruellement cassé.
8 h 1/2
Je viens de sortir pour aller voir mes ouvriers. Je plante des arbres. Nous avons depuis huit jours un temps admirable. Ma mère et mes enfants en profitent beaucoup dix fois dans le jour, je les envoie, au grand air, comme on envoie les chevaux à l’herbe. Nous nous promenons ensemble après déjeuner. Le matin, tout à l’heure j’assiste au premier déjeuner de mes enfants, chez ma mère. Trois fois par semaine ; ils viennent chez moi tout de suite après prendre une leçon d’arithmétique. Le soir de 9 heures et demie à 8h 1/2, je leur lis de vieilles Chroniques sur les croisades, qui les amusent extrêmement. Le reste du temps, je suis dans mon cabinet ou je me promène pour mon compte.
Quel est donc le mal de la Princesse Marie ? Quel qu’il soit, j’en suis fâché, et j’espère que ce n’est pas vraiment grave. Elle a de l’esprit. J’ai quelque fois causé avec elle tout -à-fait agréablement. Je m’intéresse à elle comme à une personne en qui on a entrevu en passant plus que le monde n’y verra, et qu’elle-même ne saura très probablement.
J’ai eu hier beaucoup de visites. On se hâte de venir me voir. J’aurai d’ici à quinze jours, quelques dîners à Lisieux private dinners, pas de banquet. Je n’en veux pas cette année Je l’ai dit à mes amis et ils l’ont fort bien compris. Je ne veux pas parler politique avant la Chambre.
10 h.
Le facteur m’arrive au milieu de ma leçon d’arithmétique. Je reçois des nouvelles de l’arrivée de Mad. d’Haussonville. Je veux écrire un mot à M. de Broglie. Adieu. Adieu, comme à la Terrasse, dans ses meilleurs jours. G.
Je me souviens qu’hier, étourdiment je vous ai encore adressé ma lettre aux Champs Elysées. Elle vous sera peut-être arrivée quelques heures plus tard.
Je suis fâché de ce que mande M. de Médem, plus fâché que surpris. Il m’a toujours paru, par ses lettres que votre frère était réellement blessé de votre peu de goût pour la Russie. C’est bien lui qui sincèrement ne conçoit pas que vous ne préfériez pas à tout, votre état de grande Dame auprès du grand Empereur dans le grand pays. M. de Lieven est encore plus soumis, pour parler convenablement mais moins russe et vous comprend mieux. Rien n’est pire que l’humeur sincère d’un honnête homme de peu d’esprit. Il se croit fondé en raison, et ce qu’il y a de plus intraitable, c’est la conviction qu’on a raison. M. de Médem aura peut-être choqué encore votre frère en lui répétant que, bien réellement, avec votre santé, vos habitudes, vos goûts, vous ne pouviez vivre ailleurs qu’à Londres ou à Paris. Les gens d’esprit vont quelque fois trop brutalement au fait. Enfin je raisonne, je cherche, je voudrais tout savoir et tout expliquer, tant cela intéresse. Je voudrais surtout que vous eussiez auprès de l’Empereur quelqu’un de bienveillant et d’intelligent, qui vous comprît, et vous fît comprendre. Je crois toujours qu’avec de l’esprit de la bonne volonté et du temps on peut beaucoup, quand on est toujours là. M. de Nesselrode et Matonchewitz, à ce qu’il me semble y seraient seuls propres. Mais l’un est trop affairé, l’autre trop petit, et ni l’un ni l’autre ne s’en soucie assez. Je suppose que vous avez répondu à votre mari.
Montrond a passé en effet son temps chez Thiers. Je suis curieux de ce qu’il y a porté et de ce qu’il en a rapporté, au moins de ce qu’il en dit. Je le verrai à mon retour. Il a vraiment de l’esprit, de l’esprit efficace. Il faut beaucoup pour qu’il rajeunisse un peu. Il était cruellement cassé.
8 h 1/2
Je viens de sortir pour aller voir mes ouvriers. Je plante des arbres. Nous avons depuis huit jours un temps admirable. Ma mère et mes enfants en profitent beaucoup dix fois dans le jour, je les envoie, au grand air, comme on envoie les chevaux à l’herbe. Nous nous promenons ensemble après déjeuner. Le matin, tout à l’heure j’assiste au premier déjeuner de mes enfants, chez ma mère. Trois fois par semaine ; ils viennent chez moi tout de suite après prendre une leçon d’arithmétique. Le soir de 9 heures et demie à 8h 1/2, je leur lis de vieilles Chroniques sur les croisades, qui les amusent extrêmement. Le reste du temps, je suis dans mon cabinet ou je me promène pour mon compte.
Quel est donc le mal de la Princesse Marie ? Quel qu’il soit, j’en suis fâché, et j’espère que ce n’est pas vraiment grave. Elle a de l’esprit. J’ai quelque fois causé avec elle tout -à-fait agréablement. Je m’intéresse à elle comme à une personne en qui on a entrevu en passant plus que le monde n’y verra, et qu’elle-même ne saura très probablement.
J’ai eu hier beaucoup de visites. On se hâte de venir me voir. J’aurai d’ici à quinze jours, quelques dîners à Lisieux private dinners, pas de banquet. Je n’en veux pas cette année Je l’ai dit à mes amis et ils l’ont fort bien compris. Je ne veux pas parler politique avant la Chambre.
10 h.
Le facteur m’arrive au milieu de ma leçon d’arithmétique. Je reçois des nouvelles de l’arrivée de Mad. d’Haussonville. Je veux écrire un mot à M. de Broglie. Adieu. Adieu, comme à la Terrasse, dans ses meilleurs jours. G.
148. Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°148 Mercredi 3 octobre 7 heures
Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.
A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.
J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.
9 heures
Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.
Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.
A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.
J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.
9 heures
Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.
59. Val-Richer, Dimanche 15 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°59. Dimanche 15. 4 heures
Moi aussi, j’ai envie de me distraire. Si j’étais la lettre, si j’habitais où elle habite, l’idée ne m’en viendrait même pas. Si seulement je vous écrivais à mon gré, à mon libre gré ! Mais je ne sais, depuis trois jours, notre correspondance, la vôtre comme la mienne votre N° de ce matin par exemple me suffit moins que jamais. Décidément, je ne serai content que le 31. Votre excursion en Portugal est venue bien à propos. J’y pensais ce matin même en m’habillant, et je pensais tout ce que vous me dites. J’aime ces harmonies imprévues. Oui, la politique Anglaise est bien tombée. Ce n’est pas la seule. Je suis dans une veine de grand dédain. C’est la consolation des oisifs ; je sais cela. Pourquoi me la refuserais-je ?
Je me rappelle il y a quelques années, en 1833 en 34 nous admirions, entre gens d’esprit, la vertu du gouvernement représentatif qui portait les gens d’esprit au pouvoir. Il me prit un remords de notre arrogance ; et je prédis qu’un jour, pour nous en punir, nous serions écartés, des Affaires précisément comme gens d’esprit, et par des adversaires dont le titre serait d’avoir moins d’esprit que nous, moins de talent que nous, moins de courage que nous, d’être des médiocrités enfin, comme dit Lord Aberdeen, la médiocrité a des droits immenses, surtout quand l’esprit démocratique prévaut. Droite précaire pourtant car l’esprit démocratique a beau être petit les affaires des peuples sont grandes, et ne se laissent pas longtemps rabaisser autant que le voudraient ceux à qui toute grandeur déplaît. Et il faut bien que tôt ou tard la taille des hommes se rajuste à la taille des affaires. Au fond Madame, je n’ai pas perdu mon arrogance. Je suis toujours sûr que le pouvoir appartient aux gens d’esprit, aux plus gens d’esprit, et qu’il ne peut manquer de leur revenir. Mais nous passons si vite, gens d’esprit ou non ! Nous avons si peu le temps d’attendre !
Je trouve ceci dans une lettre que je recevais en Octobre 1821, il y a seize ans « J’ai toujours vu tourner à ton profit, les retards même que tu n’aurais pu prévenir. Je te crois du bonheur. Cette croyance serait un enfantillage si elle ne se fondait sur ce que je le crois destiné à quelque chose en ce monde. Je sais bien cependant combien sont vains nos jugements sur les voies de la Providence. Je sais que dans sa terrible magnificence, elle peut créer et faire croître un homme supérieur pour le service d’un dessein, d’une idée destinée après d’infinies transformations à porter son fruit dans quelques milliers d’années. Je sais qu’elle peut fonder l’accomplissement de ses moindres vues sur la destruction de ses plus beaux ouvrages. Et c’est là ce qui m’épouvante sur notre petitesse, bien plus que l’immensité des cieux, le nombre et la grandeur des étoiles. Et pourtant, mon ami, j’ai sur toi, pour toi, de la confiance, beaucoup de confiance. »
Combien il faut que j’en aie en vous, moi, pour vous montrer ainsi toutes choses, tout ce qu’il y a pour moi de plus intime, non seulement dans le présent, mais dans le passé ! Mais, puisque je l’ai cette confiance, pourquoi ne vous la montrerais-je pas ? Pourquoi ne verriez-vous pas vous ce que m’écrivait sur moi-même, il y a seize ans, une âme bien noble et bien tendre ? Eh bien, cette sécurité qu’elle avait sur mon avenir, et qui la rendait patiente, même dans les plus mauvais temps, j’en ai moi-même un peu pour mon propre compte. Je me crois appelé à quelque chose qui en vaut la peine, appelé à relever quelque peu la politique de mon pays à faire rentrer dans des voies un peu régulières, et hautes les esprits et les affaires. Je ne me crois pas au bout de ce que je puis faire en ce sens. Et voulez-vous que je vous dise ? Vous avez beaucoup ajouté à ma tranquillité d’esprit. Vous m’avez donné de quoi attendre. Avant le 15 juin, ma patience était de la philosophie, de la vertu. Aujourd’hui je n’ai nul besoin de vertu, de philosophie. J’ai le fond de la vie. La broderie viendra quand elle voudra. Je la désire. J’y compte. Mais je l’attends et je l’attendrai sans le moindre effort, avec bien moins d’effort qu’il ne m’en faut pour attendre le 31 octobre. Me voilà bien distrait, n’est-ce pas ?
10 heures
Pourquoi enverriez-vous à M. de Lieven votre lettre au comte Orloff ? Pourquoi celle-là et pas les autres ? Il faut, ce me semble les lui envoyer toutes ou aucune. Et je ne vois point de bonne raison de les lui envoyer toutes. Après son procédé vous avez bien le droit de faire vous-même vos affaires sans lui en rendre compte. Si vous deviez gagner quelque chose à lui tout montrer à la bonne heure ; mais vous n’y gagneriez rien. Point de mystère et point de confiance, lui annoncer toutes vos démarches, et ne point lui en raconter les détails, qu’il sache ce que vous faites et demeure pourtant dans l’incertitude sur ce que vous dites qu’il y ait pour lui à votre égard, de la publicité et de l’inconnu, voilà, si je ne me trompe, ce qui vous convient, comme attitude, et aussi pour le succès.
J’ai bien recommandé, et je recommande de nouveau à M. Génie de vous porter lui-même mes lettres ou de vous les faire porter par quelqu’un de très sûr, qui vous les remette tout simplement ou les remporte s’il ne peut vous les remettre. Je n’ose cependant vous garantir toujours l’adresse, le tact. Donnez-moi à cet égard vos dernières instructions. Voulez-vous que j’use souvent ou rarement de ce moyen? J’ai grand peine à croire que M. de Lieven vienne à Paris, sans en avoir reçu l’autorisation formelle et je doute qu’on la lui envoie sitôt. L’affaire traînera davantage. On vous répondra. On disputera. On essaiera quelque nouveau procédé. Du reste, je ne sais ce que je dis. Vous connaissez ce monde là mieux que moi.
11 heures
’aime le N°60. J’aime beaucoup le N°60. J’aimerais encore mieux le pendant de la lettre. Ah ! Si je l’avais ! Si jamais nous nous séparons encore, il faudra que je l’aie. Mais je ne penserai plus, le 31 à aucune séparation. Adieu, Adieu. Adieu comme dans la lettre. G.
Moi aussi, j’ai envie de me distraire. Si j’étais la lettre, si j’habitais où elle habite, l’idée ne m’en viendrait même pas. Si seulement je vous écrivais à mon gré, à mon libre gré ! Mais je ne sais, depuis trois jours, notre correspondance, la vôtre comme la mienne votre N° de ce matin par exemple me suffit moins que jamais. Décidément, je ne serai content que le 31. Votre excursion en Portugal est venue bien à propos. J’y pensais ce matin même en m’habillant, et je pensais tout ce que vous me dites. J’aime ces harmonies imprévues. Oui, la politique Anglaise est bien tombée. Ce n’est pas la seule. Je suis dans une veine de grand dédain. C’est la consolation des oisifs ; je sais cela. Pourquoi me la refuserais-je ?
Je me rappelle il y a quelques années, en 1833 en 34 nous admirions, entre gens d’esprit, la vertu du gouvernement représentatif qui portait les gens d’esprit au pouvoir. Il me prit un remords de notre arrogance ; et je prédis qu’un jour, pour nous en punir, nous serions écartés, des Affaires précisément comme gens d’esprit, et par des adversaires dont le titre serait d’avoir moins d’esprit que nous, moins de talent que nous, moins de courage que nous, d’être des médiocrités enfin, comme dit Lord Aberdeen, la médiocrité a des droits immenses, surtout quand l’esprit démocratique prévaut. Droite précaire pourtant car l’esprit démocratique a beau être petit les affaires des peuples sont grandes, et ne se laissent pas longtemps rabaisser autant que le voudraient ceux à qui toute grandeur déplaît. Et il faut bien que tôt ou tard la taille des hommes se rajuste à la taille des affaires. Au fond Madame, je n’ai pas perdu mon arrogance. Je suis toujours sûr que le pouvoir appartient aux gens d’esprit, aux plus gens d’esprit, et qu’il ne peut manquer de leur revenir. Mais nous passons si vite, gens d’esprit ou non ! Nous avons si peu le temps d’attendre !
Je trouve ceci dans une lettre que je recevais en Octobre 1821, il y a seize ans « J’ai toujours vu tourner à ton profit, les retards même que tu n’aurais pu prévenir. Je te crois du bonheur. Cette croyance serait un enfantillage si elle ne se fondait sur ce que je le crois destiné à quelque chose en ce monde. Je sais bien cependant combien sont vains nos jugements sur les voies de la Providence. Je sais que dans sa terrible magnificence, elle peut créer et faire croître un homme supérieur pour le service d’un dessein, d’une idée destinée après d’infinies transformations à porter son fruit dans quelques milliers d’années. Je sais qu’elle peut fonder l’accomplissement de ses moindres vues sur la destruction de ses plus beaux ouvrages. Et c’est là ce qui m’épouvante sur notre petitesse, bien plus que l’immensité des cieux, le nombre et la grandeur des étoiles. Et pourtant, mon ami, j’ai sur toi, pour toi, de la confiance, beaucoup de confiance. »
Combien il faut que j’en aie en vous, moi, pour vous montrer ainsi toutes choses, tout ce qu’il y a pour moi de plus intime, non seulement dans le présent, mais dans le passé ! Mais, puisque je l’ai cette confiance, pourquoi ne vous la montrerais-je pas ? Pourquoi ne verriez-vous pas vous ce que m’écrivait sur moi-même, il y a seize ans, une âme bien noble et bien tendre ? Eh bien, cette sécurité qu’elle avait sur mon avenir, et qui la rendait patiente, même dans les plus mauvais temps, j’en ai moi-même un peu pour mon propre compte. Je me crois appelé à quelque chose qui en vaut la peine, appelé à relever quelque peu la politique de mon pays à faire rentrer dans des voies un peu régulières, et hautes les esprits et les affaires. Je ne me crois pas au bout de ce que je puis faire en ce sens. Et voulez-vous que je vous dise ? Vous avez beaucoup ajouté à ma tranquillité d’esprit. Vous m’avez donné de quoi attendre. Avant le 15 juin, ma patience était de la philosophie, de la vertu. Aujourd’hui je n’ai nul besoin de vertu, de philosophie. J’ai le fond de la vie. La broderie viendra quand elle voudra. Je la désire. J’y compte. Mais je l’attends et je l’attendrai sans le moindre effort, avec bien moins d’effort qu’il ne m’en faut pour attendre le 31 octobre. Me voilà bien distrait, n’est-ce pas ?
10 heures
Pourquoi enverriez-vous à M. de Lieven votre lettre au comte Orloff ? Pourquoi celle-là et pas les autres ? Il faut, ce me semble les lui envoyer toutes ou aucune. Et je ne vois point de bonne raison de les lui envoyer toutes. Après son procédé vous avez bien le droit de faire vous-même vos affaires sans lui en rendre compte. Si vous deviez gagner quelque chose à lui tout montrer à la bonne heure ; mais vous n’y gagneriez rien. Point de mystère et point de confiance, lui annoncer toutes vos démarches, et ne point lui en raconter les détails, qu’il sache ce que vous faites et demeure pourtant dans l’incertitude sur ce que vous dites qu’il y ait pour lui à votre égard, de la publicité et de l’inconnu, voilà, si je ne me trompe, ce qui vous convient, comme attitude, et aussi pour le succès.
J’ai bien recommandé, et je recommande de nouveau à M. Génie de vous porter lui-même mes lettres ou de vous les faire porter par quelqu’un de très sûr, qui vous les remette tout simplement ou les remporte s’il ne peut vous les remettre. Je n’ose cependant vous garantir toujours l’adresse, le tact. Donnez-moi à cet égard vos dernières instructions. Voulez-vous que j’use souvent ou rarement de ce moyen? J’ai grand peine à croire que M. de Lieven vienne à Paris, sans en avoir reçu l’autorisation formelle et je doute qu’on la lui envoie sitôt. L’affaire traînera davantage. On vous répondra. On disputera. On essaiera quelque nouveau procédé. Du reste, je ne sais ce que je dis. Vous connaissez ce monde là mieux que moi.
11 heures
’aime le N°60. J’aime beaucoup le N°60. J’aimerais encore mieux le pendant de la lettre. Ah ! Si je l’avais ! Si jamais nous nous séparons encore, il faudra que je l’aie. Mais je ne penserai plus, le 31 à aucune séparation. Adieu, Adieu. Adieu comme dans la lettre. G.
44. Val-Richer, Vendredi 22 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N° 44 Vendredi 5 heures
Savez-vous que je n’ai pas seulement des ennemis, mais aussi des amis qui s’occupent beaucoup de mes fréquentes visites, de nos longues conversations, et qui s’en inquiètent un peu ! Ils se disent entre eux que certainement il y a de la politique là dessous, de votre part, comme de la mienne, de ma part comme de la vôtre. Nous sommes l’un et l’autre spirituels, habiles ; nous avons l’un et l’autre pris part, et point renoncé sans doute aux affaires de ce monde. Est-ce que je me disposerais à changer de politique à devenir russe au lieu d’anglais à ressusciter la sainte au lieu de la quadruple Alliance ?
Il faut que j’y prenne bien garde. J’ai besoin de ménager les sentiments, les habitudes, les préjugés de mon pays que j’ai déjà heurtés plus d’une fois, bien qu’avec raison, pour l’administration intérieure. Et puis, quand j’entre dans une relation politique importante, significative, je devrais en parler à mes amis politiques, leur dire ce que je veux, ce que je fais, les tenir au courant enfin, car leur cause est la mienne ; nos intérêts, nos destinées sont les mêmes. Ils me sont ; ils me seront très fidèles. Ils voudraient bien être toujours instruits. Cela se dit très doucement très affectueusement. Cela me revient indirectement. J’y réponds et j’y répondrai très simplement souriant un peu, disant de vous un peu de ce que j’en pense, rassurant mes amis sur la fixité de ma politique comme sur l’étendue de ma confiance en eux et gardant bien du reste ma liberté, que je n’ai jamais livrée. J’admire toujours à quel point les hommes, même des hommes distingués, prônent le côté petit et tortueux des choses, au lieu du côté simple et grand et à force de chercher finesse, s’en vont à cent lieues de la vérité.
Samedi matin, 6 heures
Je me lève. Voilà une heure et demie que j’essaie en vain de me rendormir. On dit que la faim empêche de dormir. J’ai faim. Vous me parlez du bonheur qui me reste et m’entoure. Vous me dîtes que j’en sais jouir. Vous avez raison. Je n’ai jamais dans mes plus cruels moments, méconnu le prix de ce qui me restait. Je ne m’y suis jamais senti indifférent. Je ne me suis jamais permis de me dire à moi-même que j’y pouvais être indifférant. Je me serais cru coupable envers Dieu, plus coupable envers ces créatures qui m’aiment, m’aiment beaucoup, & qui ont droit non seulement que je les aime, mais que je me trouve heureux de ce quelles m’aiment. L’affection veut donner du bonheur, et souffre et s’offense quand elle n’en donne pas. Je sais tout cela. Bien plus, je le sens ; et naturellement, sans effort, je jouis en effet de l’affection de mes enfants, de ma mère, de mes amis ; et je leur montre que j’en jouis, et j’espère qu’ils le croient, j’en suis sûr.
Mais laissez- moi, Madame, être avec vous parfaitement sincère, c’est-à-dire vous montrer toute mon âme. C’est en cela, pour moi, que la parfaite, sincérité consiste. Aux autres, je ne mens point, mais je ne dis pas tout. Ces relations, ces affections, ces joies qui me restent, en même temps que je les ai toujours senties, je ne me suis jamais donné, je n’ai jamais pu me donner le change à moi-même sur leur importance pour moi, sur leur place en moi. Je ne voudrais pas même en vous parlant à vous seule, même avec la certitude que nul autre ne verra jamais ce que je vous dis, je ne voudrais pas dire un mot qui fût injuste qui fût offensant pour ces sentiments et ces bonheurs là. Mais il ne leur est pas donné de pénétrer jusqu’au fond de mon âme, de remplir ma vie, d’être mon âme et ma vie. Ils animent, ils embellissent la région où ils se passent, mais cette région est pour moi celle du monde extérieur et non pas la mienne propre ; c’est une région où je me promène, et non pas cette où j’habite.
Voltaire fait quelque part dans La Henriade, je crois la description du système céleste, de toutes les planètes, de tous les astres, de leur hiérarchie, de leur immensité. Il les nomme, il les compte, les compte encore ne parvint pas à les épuiser. Au dessus, au delà de ceux qu’il a nommés, qu’il a comptés.
Sont des soleils sans nombre et des mondes sans fin.
Par delà tous les lieux, le Dieu des lieux réside.
Pardonnez-moi la pompe de cette image. C’est la seule où je reconnaisse vraiment la disposition de mon âme, et ce qui s’y passe. On peut me parler d’une foule de liens, d’affections, de jouissances ; on peut en décrire la force et la douceur. Je le reconnaîtrai, je le sentirai avec ceux qui le diront. Mais par delà tous ces lieux, le Dieu des lieux réside. Et ce n’est point là pour moi, Madame une volonté un parti pris, pas plus qu’une impression de jeunesse une fantaisie d’imagination. C’est le fait, le fait pur et simple, le fait constant pour moi, en moi soit que je l’ai possédé, soit qu’il m’aie manqué un seul sentiment, un seul bonheur, a toujours été pour moi le Dieu des lieux. Je vous le disais avant le 15 Juin, et vous ne vouliez pas me croire. Je vous le redis aujourd’hui. Croyez-moi ; et ne me parlez d’aucune compensation ; et gardons ensemble nos regrets, nos regrets justes & sacrés. Et soyez bien sûre que je sens comme vous les vôtres ; bien sûre que je donnerais je ne sais pas quoi pour vous voir entourée des joies qui me restent. Mais ne mettons rien, joies ou regrets, à côté de ce qui est au delà, et au dessus de tout. Ah, que ne passons-nous notre vie ensemble ! Ce que je vous dis là, je vous le ferai voir.
4 heures Votre lettre m’arrive tard. J’ai là M. Duvergier de Hauranne, dans mon cabinet. La cloche du déjeuner sonne. J’aurais tant de choses à vous dire ! Une seule, une seule aujourd’hui. Au nom de Dieu, ne soyez pas malade. J’ai besoin de votre santé comme de... Adieu. Adieu. Un adieu sans pareil, si cela se peut. G.
Ma mère est un peu mieux ce matin.
Savez-vous que je n’ai pas seulement des ennemis, mais aussi des amis qui s’occupent beaucoup de mes fréquentes visites, de nos longues conversations, et qui s’en inquiètent un peu ! Ils se disent entre eux que certainement il y a de la politique là dessous, de votre part, comme de la mienne, de ma part comme de la vôtre. Nous sommes l’un et l’autre spirituels, habiles ; nous avons l’un et l’autre pris part, et point renoncé sans doute aux affaires de ce monde. Est-ce que je me disposerais à changer de politique à devenir russe au lieu d’anglais à ressusciter la sainte au lieu de la quadruple Alliance ?
Il faut que j’y prenne bien garde. J’ai besoin de ménager les sentiments, les habitudes, les préjugés de mon pays que j’ai déjà heurtés plus d’une fois, bien qu’avec raison, pour l’administration intérieure. Et puis, quand j’entre dans une relation politique importante, significative, je devrais en parler à mes amis politiques, leur dire ce que je veux, ce que je fais, les tenir au courant enfin, car leur cause est la mienne ; nos intérêts, nos destinées sont les mêmes. Ils me sont ; ils me seront très fidèles. Ils voudraient bien être toujours instruits. Cela se dit très doucement très affectueusement. Cela me revient indirectement. J’y réponds et j’y répondrai très simplement souriant un peu, disant de vous un peu de ce que j’en pense, rassurant mes amis sur la fixité de ma politique comme sur l’étendue de ma confiance en eux et gardant bien du reste ma liberté, que je n’ai jamais livrée. J’admire toujours à quel point les hommes, même des hommes distingués, prônent le côté petit et tortueux des choses, au lieu du côté simple et grand et à force de chercher finesse, s’en vont à cent lieues de la vérité.
Samedi matin, 6 heures
Je me lève. Voilà une heure et demie que j’essaie en vain de me rendormir. On dit que la faim empêche de dormir. J’ai faim. Vous me parlez du bonheur qui me reste et m’entoure. Vous me dîtes que j’en sais jouir. Vous avez raison. Je n’ai jamais dans mes plus cruels moments, méconnu le prix de ce qui me restait. Je ne m’y suis jamais senti indifférent. Je ne me suis jamais permis de me dire à moi-même que j’y pouvais être indifférant. Je me serais cru coupable envers Dieu, plus coupable envers ces créatures qui m’aiment, m’aiment beaucoup, & qui ont droit non seulement que je les aime, mais que je me trouve heureux de ce quelles m’aiment. L’affection veut donner du bonheur, et souffre et s’offense quand elle n’en donne pas. Je sais tout cela. Bien plus, je le sens ; et naturellement, sans effort, je jouis en effet de l’affection de mes enfants, de ma mère, de mes amis ; et je leur montre que j’en jouis, et j’espère qu’ils le croient, j’en suis sûr.
Mais laissez- moi, Madame, être avec vous parfaitement sincère, c’est-à-dire vous montrer toute mon âme. C’est en cela, pour moi, que la parfaite, sincérité consiste. Aux autres, je ne mens point, mais je ne dis pas tout. Ces relations, ces affections, ces joies qui me restent, en même temps que je les ai toujours senties, je ne me suis jamais donné, je n’ai jamais pu me donner le change à moi-même sur leur importance pour moi, sur leur place en moi. Je ne voudrais pas même en vous parlant à vous seule, même avec la certitude que nul autre ne verra jamais ce que je vous dis, je ne voudrais pas dire un mot qui fût injuste qui fût offensant pour ces sentiments et ces bonheurs là. Mais il ne leur est pas donné de pénétrer jusqu’au fond de mon âme, de remplir ma vie, d’être mon âme et ma vie. Ils animent, ils embellissent la région où ils se passent, mais cette région est pour moi celle du monde extérieur et non pas la mienne propre ; c’est une région où je me promène, et non pas cette où j’habite.
Voltaire fait quelque part dans La Henriade, je crois la description du système céleste, de toutes les planètes, de tous les astres, de leur hiérarchie, de leur immensité. Il les nomme, il les compte, les compte encore ne parvint pas à les épuiser. Au dessus, au delà de ceux qu’il a nommés, qu’il a comptés.
Sont des soleils sans nombre et des mondes sans fin.
Par delà tous les lieux, le Dieu des lieux réside.
Pardonnez-moi la pompe de cette image. C’est la seule où je reconnaisse vraiment la disposition de mon âme, et ce qui s’y passe. On peut me parler d’une foule de liens, d’affections, de jouissances ; on peut en décrire la force et la douceur. Je le reconnaîtrai, je le sentirai avec ceux qui le diront. Mais par delà tous ces lieux, le Dieu des lieux réside. Et ce n’est point là pour moi, Madame une volonté un parti pris, pas plus qu’une impression de jeunesse une fantaisie d’imagination. C’est le fait, le fait pur et simple, le fait constant pour moi, en moi soit que je l’ai possédé, soit qu’il m’aie manqué un seul sentiment, un seul bonheur, a toujours été pour moi le Dieu des lieux. Je vous le disais avant le 15 Juin, et vous ne vouliez pas me croire. Je vous le redis aujourd’hui. Croyez-moi ; et ne me parlez d’aucune compensation ; et gardons ensemble nos regrets, nos regrets justes & sacrés. Et soyez bien sûre que je sens comme vous les vôtres ; bien sûre que je donnerais je ne sais pas quoi pour vous voir entourée des joies qui me restent. Mais ne mettons rien, joies ou regrets, à côté de ce qui est au delà, et au dessus de tout. Ah, que ne passons-nous notre vie ensemble ! Ce que je vous dis là, je vous le ferai voir.
4 heures Votre lettre m’arrive tard. J’ai là M. Duvergier de Hauranne, dans mon cabinet. La cloche du déjeuner sonne. J’aurais tant de choses à vous dire ! Une seule, une seule aujourd’hui. Au nom de Dieu, ne soyez pas malade. J’ai besoin de votre santé comme de... Adieu. Adieu. Un adieu sans pareil, si cela se peut. G.
Ma mère est un peu mieux ce matin.
41. Val-Richer, Mardi 19 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°41 Mardi 10 h. du soir
Je suppose que vous avez vu l’article du Temps d’hier lundi, et que vous aurez deviné sans peine d’où il vient. C’est son journal et sa façon d’agir. J’entends d’ici la conversation d’où l’article est sorti, et je nommerais, je crois, le journaliste qui a rédigé la conversation.
Avez-vous rencontré beaucoup de petites infamies pareilles ? Vraies infamies de comédies, aussi petites qu’odieuses. J’en suis et j’en serai contrarié autant et aussi longtemps que vous le serez. Malgré votre désir et les précautions prises, je n’osais pas espérer que votre nom ne parût jamais dans un journal ; mais je ne me serait par la pas permis de prédire qu’il y viendrait par là. J’ai retrouvé les quelques lignes de la Presse. Savez-vous qui les a écrites ? Mad. Emile de Girardin, celle chez qui le Duc et la Duchesse de Sutherland allaient passer la soirée. Il y a des fripons qui volent les bourses, les mouchoirs. Il y en a d’autres qui volent les noms propres, les anecdotes vraies ou fausses. Et Chaque journal a ses coureurs de faits, de nouvelles, qui vont les recueillant et les escamotant dans tout Paris, chacun où il peut, tel dans les rues, tel dans les cafés, tel dans les salons. Et plus le non est illustre, plus le fait se paye cher. Mais ceux-ci ne sont pas des faits payés : ce sont des faits fournis gratis. Quelle honte !
Je suis préoccupé de votre contrariété. Je voudrais tant vous faire vivre dans une atmosphère parfaitement calme et douce ! Connaissez-vous en même temps rien de plus ridicule, si vous lisez ces journaux là, que tout leur ardeur à démontrer pour les matins, qu’il est impossible que M. Molé tombe, impossible que je trouve des alliés pour le renverser impossible que je revienne au pouvoir ?
Je ne pense à rien, je n’essaie rien, je ne parle ministère à personne ; les journaux qui me sont amis ne mettent aucune combinaison en avant, attaquent à peine quelques actes, quelques tendances du Cabinet. n’importe; on se démène, on crie comme des assiégés sous qui une mine va sauter, qui voient commencer un violent assaut. On semble obsédé par un fantôme. Pour les patrons de la conciliation générale, c’est bien peu de sécurité. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. L’article de ce matin, m’a donné de l’humeur et m’a fait penser à tout le reste. Habituellement je n’y pense guère. Rien ne me paraît plus plaisant que l’agitation sans relâche, les machinations continuelles, le tourment d’esprit qu’on m’attribue. J’ai de l’ambition toujours, j’en conviens ; de l’activité au besoin, je l’espère. Mais personne ne se remue moins que moi ; personne ne méprise davantage tout mouvement, petit, impatient, prématuré. Il faut, je crois, dans la vie politique, & sous notre forme de gouvernement, inventer très peu, frapper à très peu de portes, attendre tranquillement et se contenter d’être toujours prêt & à la hauteur de la marée montante, quand elle arrive. C’est mon goût, et je le suivrais n’eussé-je pas d’autre raison. Mais c’est aussi, je crois la vraie habilité. Je n’irai pourtant pas me coucher sur ces idées et ces paroles là.
Qu’est-ce donc que ces étouffements que vous avez eus à l’Eglise ? Certainement, il faut soigner votre santé. à chaque soin que vous prendrez, remerciez vous de ma part. Je vous soignerais si bien si j’étais toujours là ! Adieu, adieu. Il n’est pas onze heures. Vous avez encore du monde. Je vous assure que si j’y étais, je serais très aimable, aimable pour M. de Muhlinen. Adieu à demain.
Mercredi 10 heures ¼
Vous n’avez surement pas vu l’article du Temps. Vous ne m’en dîtes rien. Voyez-le. Il faut savoir où l’on en est. Je ne voudrai jamais que vous ignoriez rien de ce qui vous a touché, de ce qui nous touche de si près. Et pourtant que me fait le Temps, que me font tous les journaux du monde quand je reçois de vous une lettre comme le n° 42 ? Permettez-moi de ne pas vous en parler en ce moment. Vous savez qu’il y a des moments, bonheur ou malheur, où j’ai besoin de me taire, où je ne puis pas, où je ne veux pas parler. Mais vous m’avez ravi. Mais vous venez de me donner une joie incomparable. J’en ai besoin.
On me dit que le mariage de M. Duchâtel n’aura lieu que dans les premiers jours d’octobre. J’attends demain M. Duvergier de Lausanne qui vient passer ici 36 heures et qui m’apportera quelque chose de positif. Je n’ai pas répondu à votre question, je ne vous ai rien dit du tout. Je voulais ; je veux savoir. Je déteste les attentes vaines. Je les déteste pour moi pour vous. Mais, il faut que je donne ma lettre. Le facteur l’attend. Adieu. Adieu. Je ne sais qu’ajouter à mon adieu. Et pourtant, j’y voudrais tant ajouter. Adieu. G.
Je suppose que vous avez vu l’article du Temps d’hier lundi, et que vous aurez deviné sans peine d’où il vient. C’est son journal et sa façon d’agir. J’entends d’ici la conversation d’où l’article est sorti, et je nommerais, je crois, le journaliste qui a rédigé la conversation.
Avez-vous rencontré beaucoup de petites infamies pareilles ? Vraies infamies de comédies, aussi petites qu’odieuses. J’en suis et j’en serai contrarié autant et aussi longtemps que vous le serez. Malgré votre désir et les précautions prises, je n’osais pas espérer que votre nom ne parût jamais dans un journal ; mais je ne me serait par la pas permis de prédire qu’il y viendrait par là. J’ai retrouvé les quelques lignes de la Presse. Savez-vous qui les a écrites ? Mad. Emile de Girardin, celle chez qui le Duc et la Duchesse de Sutherland allaient passer la soirée. Il y a des fripons qui volent les bourses, les mouchoirs. Il y en a d’autres qui volent les noms propres, les anecdotes vraies ou fausses. Et Chaque journal a ses coureurs de faits, de nouvelles, qui vont les recueillant et les escamotant dans tout Paris, chacun où il peut, tel dans les rues, tel dans les cafés, tel dans les salons. Et plus le non est illustre, plus le fait se paye cher. Mais ceux-ci ne sont pas des faits payés : ce sont des faits fournis gratis. Quelle honte !
Je suis préoccupé de votre contrariété. Je voudrais tant vous faire vivre dans une atmosphère parfaitement calme et douce ! Connaissez-vous en même temps rien de plus ridicule, si vous lisez ces journaux là, que tout leur ardeur à démontrer pour les matins, qu’il est impossible que M. Molé tombe, impossible que je trouve des alliés pour le renverser impossible que je revienne au pouvoir ?
Je ne pense à rien, je n’essaie rien, je ne parle ministère à personne ; les journaux qui me sont amis ne mettent aucune combinaison en avant, attaquent à peine quelques actes, quelques tendances du Cabinet. n’importe; on se démène, on crie comme des assiégés sous qui une mine va sauter, qui voient commencer un violent assaut. On semble obsédé par un fantôme. Pour les patrons de la conciliation générale, c’est bien peu de sécurité. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. L’article de ce matin, m’a donné de l’humeur et m’a fait penser à tout le reste. Habituellement je n’y pense guère. Rien ne me paraît plus plaisant que l’agitation sans relâche, les machinations continuelles, le tourment d’esprit qu’on m’attribue. J’ai de l’ambition toujours, j’en conviens ; de l’activité au besoin, je l’espère. Mais personne ne se remue moins que moi ; personne ne méprise davantage tout mouvement, petit, impatient, prématuré. Il faut, je crois, dans la vie politique, & sous notre forme de gouvernement, inventer très peu, frapper à très peu de portes, attendre tranquillement et se contenter d’être toujours prêt & à la hauteur de la marée montante, quand elle arrive. C’est mon goût, et je le suivrais n’eussé-je pas d’autre raison. Mais c’est aussi, je crois la vraie habilité. Je n’irai pourtant pas me coucher sur ces idées et ces paroles là.
Qu’est-ce donc que ces étouffements que vous avez eus à l’Eglise ? Certainement, il faut soigner votre santé. à chaque soin que vous prendrez, remerciez vous de ma part. Je vous soignerais si bien si j’étais toujours là ! Adieu, adieu. Il n’est pas onze heures. Vous avez encore du monde. Je vous assure que si j’y étais, je serais très aimable, aimable pour M. de Muhlinen. Adieu à demain.
Mercredi 10 heures ¼
Vous n’avez surement pas vu l’article du Temps. Vous ne m’en dîtes rien. Voyez-le. Il faut savoir où l’on en est. Je ne voudrai jamais que vous ignoriez rien de ce qui vous a touché, de ce qui nous touche de si près. Et pourtant que me fait le Temps, que me font tous les journaux du monde quand je reçois de vous une lettre comme le n° 42 ? Permettez-moi de ne pas vous en parler en ce moment. Vous savez qu’il y a des moments, bonheur ou malheur, où j’ai besoin de me taire, où je ne puis pas, où je ne veux pas parler. Mais vous m’avez ravi. Mais vous venez de me donner une joie incomparable. J’en ai besoin.
On me dit que le mariage de M. Duchâtel n’aura lieu que dans les premiers jours d’octobre. J’attends demain M. Duvergier de Lausanne qui vient passer ici 36 heures et qui m’apportera quelque chose de positif. Je n’ai pas répondu à votre question, je ne vous ai rien dit du tout. Je voulais ; je veux savoir. Je déteste les attentes vaines. Je les déteste pour moi pour vous. Mais, il faut que je donne ma lettre. Le facteur l’attend. Adieu. Adieu. Je ne sais qu’ajouter à mon adieu. Et pourtant, j’y voudrais tant ajouter. Adieu. G.