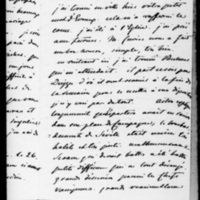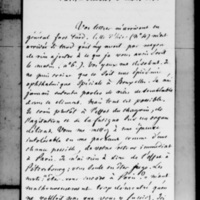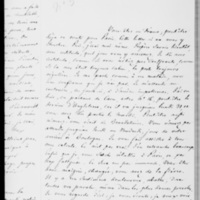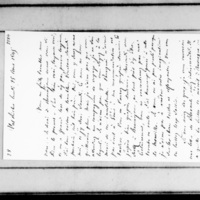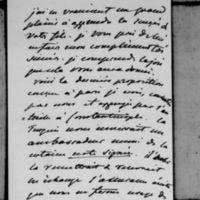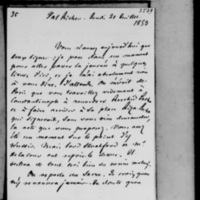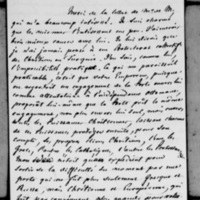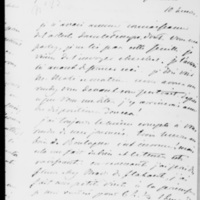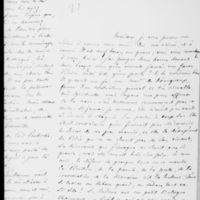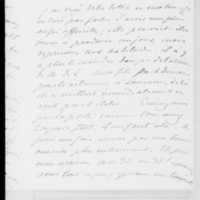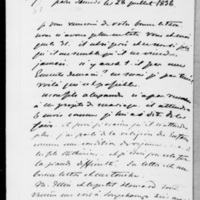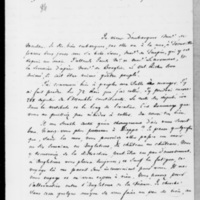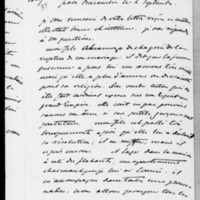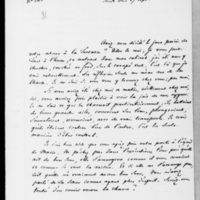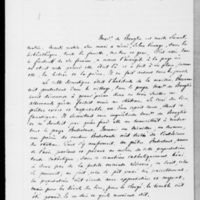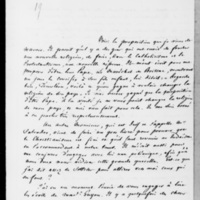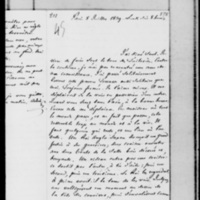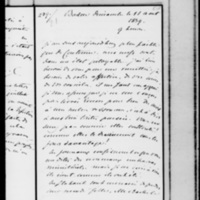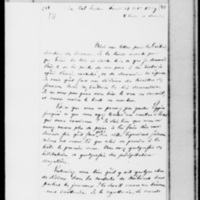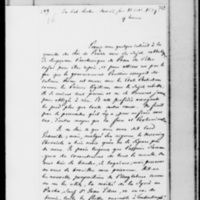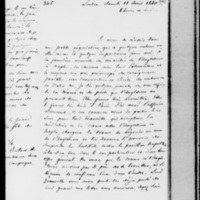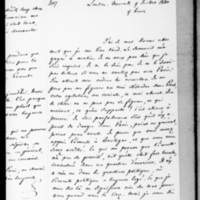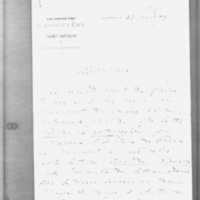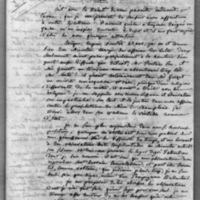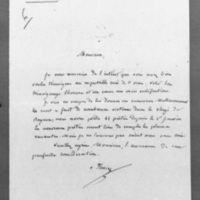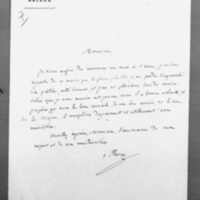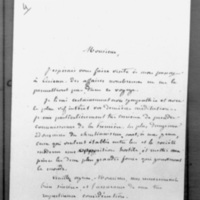Votre recherche dans le corpus : 121 résultats dans 3296 notices du site.
2.Val Richer, Dimanche 29 mai 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je me lève après neuf heures de sommeil. Je sens la fatigue s'en aller. comme la soif quand on boit. Mais il ne fait pas beau ce matin. Vous ne connaissez pas le plaisir de voir pousser vos cerises, vos fraises, vos abricots et vos pêches. Marion vous dira si c’est un plaisir. Je reviens de mon verger à mes journaux à Paris, je les regarde ; ici, je les lis.
Le Moniteur met bien du soin à répéter le Morning Post qui dit que les Cabinets de Londres et de Paris, "ont agi, agissent et agiront à Constantinople avec l'accord le plus parfait et le plus cordial." On est très pressé de rentrer dans l’ornière. Il est vrai que cette fois, vous y avez poussé. Si votre Empereur avait, dés le premier moment, dit avec précision, à tout le monde, que pour se mettre à l'abri des firmants secrets et mobiles, il demanderait pour l'Eglise grecque, ce que la France possédait depuis deux siècles pour l'Eglise latine, c’est-à-dire des capitulations formelles, et que c’était là, pour lui, la question des Lieux Saints, il n’eût pas rencontré, j'en suis convaincu, les obstacles qu’il rencontre aujourd’hui ; car bien qu'énorme en fait et très différente par là de la prétention latine, la prétention grecque est, en soi et en droit, si naturelle et si raisonnable qu’on eût eu de la peine à la combattre. Mais elle ne s’est pas expliqué tout haut, toute entière et tout de suite ; elle a apparu au dernier moment comme une nouveauté par conséquent beaucoup plus grosse qu’elle n'eût paru au premier ; et vous avez créé, à la fin, une situation grave uniquement peut-être parce que vous avez voulu vous épargner, au commencement, quelques embarras de conversation. Je n'en persiste pas moins à penser que la situation grave sa dénouera sans événements graves.
Onze heures
Je persiste toujours, quand même la tentation de conciliation des quatre puissances n'aurait pas réussi. Le feu ne prendra pas à l'Europe pour cela. Vous avez raison, il fallait parler plutôt et plus haut pour vous. Vous voyez que je suis de votre avis, encore plus que vous, car je remonte plus haut. Adieu, Adieu.
Ne soyez pas trop fatigué en partant. Je remercie Marion. G.
4. Beauséjour, Lundi 14 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le 14 août 1843
J’ai trouvé en ville hier votre petit mot d'Evreux. Cela m’a raffermi le coeur. J’ai été à l’église. J’ai prié avec ferveur. M. Cuvier nous a fait un bon sermon, simple, très bien.
En rentrant ici j’ai trouvé Bulwer qui m’attendait. Il part ce soir pour Dieppe d'où il veut revenir à la fin de la semaine pour se mettre à ma disposition. Je n’y crois pas du tout. Acton explique longuement qu'Espartero, avait eu raison dans son place de campagne, le bombardement de Séville était même très habile et très juste. Malheureusement Serano qui devait battre, a été battu. Petite différence qui a tout dérangé. Grande désunion parmi les chefs vainqueurs. Grande vraisemblance et même imminence de troubles à Madrid une réaction. Le parti français grossissant. Grande crainte que l'Espagne toute entière ne demande le duc d’Aumale. Voilà Acton, Bulwer a l’esprit préoccupé du duc d'Aumale aussi, et me demande beaucoup ce que j'en crois. Qu’est-ce que je puis croire ? Je ne crois rien, mais je m’amuse des inquiétudes anglaises, c’est ce que je lui ai dit. En ajoutant qu’ils étaient singulièrement crédules. Après, Bulwer j’ai vu Kisselef. Il n’a pas eu un mot par le dernier bateau, il ne savait donc rien et avait tout à apprendre. Grande éloge des discours du duc de Nemours vanté même par les légitimistes au Club.
A quatre heures je suis partie pour Versailles avec Pogenpohl. Jolie course, air excellent qui m’a donné des forces J'ai marché beaucoup sur la terrasse avent dîner, après dîner à huit heures je suis repartie, j’ai descendu à pied la montagne à St Cloud et j'étais rentrée à 9 1/2 et dans mon lit avant 10 heures. Voilà bien exactement hier. Aujourd’hui je vais en ville je passerai à la porte de Génie. Je dinerai chez les Cowley. Demain je compte m’établir à Versailles, mais je vais encore apprendre si la pieuse comtesse y vient décidément ; si elle ne venait pas j’irai à St Germain que je vois plus gai. Certainement je ne resterai pas ici j'y suis trop triste. Avant hier Appony, hier Bulwer ont fort exalté votre mérite. Grands, grands éloges. Voici du bien beau temps ; mais mon jardin me déplait. Je vous envoie la lettre d’Emilie. Il est clair qu’elle n’a pas grande envie de ce mariage. Je pense beaucoup à tout ce qui se prépare en Espagne, hors d’Espagne. Je crois beaucoup à une ligue européenne contre le mariage possible avec la branche d’Orléans. Je crois surtout que vous seriez mieux à Paris dans un moment pareil qu'au Val-Richer. Que de retard ; & que d'occasions où un jour de retard porte un dommage difficile à réparer. Je ne puis m’empêcher de répéter avec beaucoup d’autres que vous vous en allez tout juste au moment où vos embarras et votre action commencent, c’est singulier ! Je me sers du mot le plus poli. J’en ai de bien gros au bout des lèvres. Adieu. Adieu pourtant. Adieu. Le 26 et peut être avant. Pensez un peu si avant ne deviendrait pas nécessaire ? Adieu.
7. Paris, Vendredi 3 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos lettres m’arrivent, en général fort tard. Celle d’hier (N°4) m'est arrivée si tard qu’il n’y avait pas moyen de rien ajouter à ce que je vous avais écrit le matin (N°6).
Vos yeux me désolent. Je ne puis croire que ce soit une épidémie ophtalmique spéciale à Bruxelles. Je n’ai jamais entendu parler de rien de semblable dans le climat. Mais tout est possible. Je crois plutôt à l'effet du chagrin, de l’agitation et de la fatigue sur un organe délicat. Vous me mettez à une épreuve intolérable en me parlant, comme d’une chance possible de votre retour immédiat à Paris. Je n'ai rien à dire de l'effet à Pétersbourg, vous seule en êtes juge. Les mots : " êtes-vous encore à Paris ? " m'ont malheureusement trop démontré qu’on ne voulait pas que vous y fussiez ici. On serait certainement étonné, et comme on ne comprendrait pas, on chercherait, à ce retour, d’autres motifs que le véritable ; on ne croit guère en général aux motifs de santé, quoique ce soient les meilleurs. Trop de gens s'en servent pour me nier.
Quoiqu’on ne soit pas ici, plus en goût de la guerre qu’il y a deux mois, on y croit, et on en prend son parti, et on s'y prépare, et tout le monde règle, sur le fait, ses relations et ses plans. Je vous dis, malgré moi et tristement, mes premières idées ; je n'ai encore causé avec personne ; mais je doute que, parmi vos amis sensés et sincères, il y ait une autre impression que la mienne. Vient toujours, en première ligne votre santé, et dans ce fait là, j’ai tant de peine à voir clair, quand vous êtes ici, qu’il m’est impossible de l’apprécier de loin. Que tout cela est triste !
Demain, plus encore que tout autre jour, je voudrais être avec vous, et vous donner quelques douces distractions. Votre fidélité à de chers souvenirs m'a profondément touché dès le premier jour où je vous ai connue. C'est une vertu qui coûte cher, mais que j’aime et que j'honore infiniment. Les coeurs sont si légers, et tout passe si vite dans ces ombres chinoises de la vie !
Autre tristesse en pensant à vous. Vous avez de la religion, et elle ne vous sert pas à grand chose dans vos épreuves, vous n'y puissiez guère de consolation ni de force. En tout, le mal vous fait plus de mal que le bien ne vous fait du bien, et vous souffrez plus de vos défauts que vous ne profitez de vos qualités. Que de choses il aurait fallu pour mettre en vous l’équilibre et l'harmonie dont vous auriez besoin. Adieu, adieu.
Je ne vous dis rien du discours Impérial. Il ne faisait pas grand effet hier, ni le matin, ni le soir. Il aura le sort de presque tout ce que dit et fait son auteur ; il réussira plus dans les masses que dans les esprits difficiles. Si j'étais allemand, j'en serais mièvrement content. Adieu.
J’ai vu hier Montalembert qui m'a beaucoup parlé de vous, avec un intérêt dont je lui ai su gré.
9. Paris, Samedi 4 juin 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
On savait à Pétersbourg le départ de [Menchikoff]. La lettre qui l'annonce est venue ici 5 jours. Prodige de vitesse. Un courrier est annoncé pour demain. Nous trouvons que Menchikoff a été bien mou !
En Angleterre grande alarme et embarras pour le gouvernement quant aux détails voici la lettre d’Ellice, mais de son côté Cowley me dit que si nous entrons dans les principautés c'est la guerre entre l'Angleterre & la Russie. Je ne crois pas. Heeckeren disait hier soir sur des nouvelles de télégraphe de Vienne que nous avions occupé les principautés. Le petit Nesselrode arrive ici demain de Constantinople par Vienne. Mon salon est impayable. Tous les [diplomates] y sont, & Hubner aussi tous les soirs. Tout le monde agité.
J’ai vu hier Fould, pacifique, triste, & pas amoureux de l'Angleterre.
On repart de [S.] pour le mois de 7bre.
Midi Voilà ma lettre d’Ellice partie pour Chantilly, où L. Cowley passe la journée. Vous ne l'aurez que demain. Ce qu'il me dit de plus curieux c’est que sur une étourderie de Lord John 3 Cabinet ministers allaient quitter à propos d‘une querelle catholique protestante je ne sais quoi. Mais cela pouvait s’arranger encore.
Il dit aussi que Palmerston déblatère contre la Russie & pousse à la guerre tandis que les autres procrastinent. C'est bien là ce qui fait qu’ici on est pour Palmerston contre Aberdeen.
L'agitation diplomatique et bien grande partout. Moi je suis ici la confidente de tout le monde. Entre eux ces messieurs ne se parlent plus, ou très peu. Les Allemands sont dans les perplexités, les plus grandes. Andral ne veut pas que je parte par le mauvais temps. J’attendrai quelques jours, je ne fixe rien encore.
2 heures. Une lettre de Londres. Clarendon est au pied du mur il ne peut plus nous défendre. L’ordre sera parti pour le départ de la flotte. L’Autriche nous fait des remontrances. Si Schwarzenberg vivait il ferait marcher des troupes pour nous empêcher. Voilà ce que dit Londres. Vous voyez que tout est est bien noir. Adieu. Adieu.
11. Val Richer, Mardi 7 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les Anglais n'ont pas envie de la guerre. Vous ne prendrez pas Constantinople. L'Empire Ottoman ne tombera pas demain. Greville a raison de se dire sûr de l’Autriche et de la Prusse en tant qu’il veut dire que l’Autriche et la Prusse s'employeront à empêcher la guerre, c’est-à-dire à faire en sorte que vous ne demandez pas trop et que la Turquie vous cède assez.
Dans Phèdre, Hippolyte dit :
Un seul jour ne fait pas d’un mortel vertueux,
Un coupable assassin, un lâche incestueux.
J'en dis autant de Pétersbourg, de Londres, de Vienne, un seul jour ne fait pas, d’un gouvernement sensé, un fou. Vous resterez sensés, et les autres aussi. Et vous aurez où aller, Paris ou Londres, à votre choix. Il n’y a de question que celle des plus ou moins grands embarras qu’il faudra traverser pour arriver au but. Peut-être quelques coups de canon avant la paix. J'en doute. Pourtant cela se peut. Vous êtes en effet bien engagés ; et il vous faut quelque chose pour vous dégager. Si l'Europe a un peu d’esprit, elle vous ouvrira la porte qu’il vous fait. Cela ne me paraît pas bien difficile.
Je viens de retourner mon papier. Pardonnez moi les tâches qui sont sur la dernière page. Je n’ai pas fait attention que la première n'était pas séche.
Le rapport de M. Billault à l'Empereur sur la session au corps législatif, m'a amusé. Encore quelques injures au régime parlementaire, pour la convenance. Et puis de grands efforts pour bien établir que dans la session qui finit, on a fait beaucoup de rapports, beaucoup de lois, beaucoup discuté, beaucoup amendé, qu’on a été très parlementaire, sans que personne s’en doutât.
Les hommes ne peuvent se résoudre, à dire tout simplement la vérité, ni à mentir tout à fait. Je vois que le mariage du duc de Brabant se fera à Bruxelles et non pas à Vienne. C'est donc à Bruxelles qu’ira la Reine Marie Amélie. Point d’embarras donc pour les rencontres dans la maison de Bourbon. On en était assez préoccupé.
Je garde les lettres d’Ellice puisque vous ne me demandez pas de vous les renvoyer.
L'étourderie de Lord John Russell me paraît grosse. La commission de ces trois catholiques peut avoir des conséquences graves pour le cabinet. Qu'avait-il besoin de se laisser aller à cet accès de franchise protestante ? Est-ce pure étourderie ou bien recherche de popularité ?
Dix heures et demie.
Votre grosse nouvelle ne me fait pas changer d’avis depuis le commencement, j'admets la possibilité au canon, mais d’un canon qui n'allumera pas un grand feu, le seul qui mérite qu’on s'en inquiète. Seulement je deviens de plus en pas curieux de savoir comment Europe et Russie se tireront de cet embarras. Adieu, adieu. G.
13. Stafford House, Dimanche 23 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a longtemps que j’ai laissé là mon journal, j’ai passé huit jours à vous envoyer des soupirs & des plaintes. Vous ai-je bien manqué ? Cet ennui au reste je l’ai fait partager à tout le monde. Monsieur vous savez commander à vos chagrins. Je l’ai vu. Moi je n’ai pas cette faculté. Je l’ai moins que ne l’aurait un enfant. Je suis transparente. La joie, la peine, l’inquiétude tout se lit sur ma physionomie. Vous ne me connaissez pas encore. Je crains que vous ne me trouvez un peu primitive. En Angleterre un dîner est une affaire si grave, que lorsqu’on y manque on passe pour être très malade. J’ai tout renvoyé en journée alors on est accouru. J’ai fermé ma porte, & je n’ai vu que les plus indispensables.
J’ai dîné seule avec le duc & la duchesse. Le soir tard on me trainait en calèche. J’aimais à me trouver sous les étoiles à les regarder. y regardez vous jamais. Je ne connais pas une de vos habitudes. Je voudrais savoir comment votre journée est arrangée. Peut-être me l’avez vous dit, mais vos lettres où sont elles ? Attendu que j’en ai reçu une hier (toujours le N°7) je sortirai aujourd’hui, j’irai dîner à Holland House, je me propose même d’y être fort aimable.
2 heures. J’ai été à l’église, j’en sors à l’instant, je n’ai pas beaucoup écouté le prêtre. J’ai prié à ma façon, il me semblait que je ne priais pas seule, que tout ce que je pensais, tout ce que je demandais, un autre le pensait, le demandait avec moi. Il n’y avait rien qui ne fut digne du lieu où je me trouvais et cette image terrestre que je porte au fond de mon cœur loin de nuire à ma dévotion me semblait la redoubler, l’élever, l’épurer enfin, Dieu et vous étiez si bien confondus, dans mon âme qu’il me semble qui c’est de chez vous que je sors, mais non pas vous que je quitte. Ah jamais je ne vous quitte Monsieur je vous dis tout, parce que je vous crois bien digne de comprendre mon âme.
4 heures Je viens d’avoir un fort long entretien avec le comte Orloff, j’en suis complètement satisfaite. Tout a été réglé entre nous cela ne pouvait pas manquer car il est homme d’esprit. Entre nous, il est convenu que je ne tiendrai compte que de ses paroles, & pas de celles de mon mari, (c’est original, mais c’est ainsi.) Je retourne là où il me plait.
Cependant il faudra que je fixe un rendez-vous à mon mari. C’est Dieppe que le comte Orloff a choisi. Je n’ai pris l’intiative sur rien mais je me suis arrangée de façon à ce qu’il m’indique lui-même tout ce qui me convenait le mieux. Je ne suis jamais sortie d’une agitation aussi satisfaite.que je l’ai été de celle-là au reste comme les ratifications y manquent il faut que je prenne une mesure pour le cas où elles vinssent traverser ces projets. Dans l’esprit d’Orloff elles sont inutiles, à la bonne heure, & j’agirai en conséquence. Je serai en France avant le moment où de nouveaux ordres pourraient m’atteindre.
Lundi le 24. Lord Holland m’égaya beaucoup à dîner ; c’est un esprit aimable, toujours serein, pas le sens commun en politique mais toujours doux dans son extravagance. Il a vu la Reine pour la première fois il y a peu de jours il en est tranmporté. Il la trouve charmante & l’ensemble de la situation la plus jolie qu’on puisse imaginer. Ainsi, arrivé au palais pour son audience ou lui dit que la reine est enfermée avec Lord Melbourne et lui même on l’enferme avec une fille d’honneur de dix-huit ans aussi comme sa maîtresse, et jolie comme un ange. L’usage veut qu’au lieu d’un Chambellan, ce soit une fille d’honneur qui soit constamment dans le salon d’attente. Tout cela entretient la bonne humeur des vieilles perruques et comme je vous l’ai dit déjà la joie me semble être complètement l’ ordre du jour pour tout le monde. Savez-vous que cela donne de tristes pensées ? Cette petite princesse si innocente, si heureuse encore, combien longtemps jouïra-t-elle de cette ignorances des peines attachées à la condition ! Aujourd’hui encore elle rit, elle chante qui sait les soucis, les inquiétudes qu’elle aura dans peu de semaines & combien vite toutes les joies de son âge seront flétries !
J’ai beaucoup causé hier avec Lord Melbourne puis avec Lord Durham. Le premier me semble encore tout aussi innnocent que la reine, c’est l’effet qu’il a toujours fait sur moi. C’est un excellent homme. l’air rude & le cœur le plus mou possible. Beaucoup d’esprit & de droiture, & prodi gieusement d’indolence. Un abandon extrême quand il est sûr de quelqu’un, il lui dit tout. Toujours nous avons causé intimement ensemble. Il a des inquiétudes pour les élections. Lord Holland me parait en avoir aussi, à moins d’une accession considérable de voter à la Chambre, le gouvernement serait toujours obligé de s’appuyer sur le parti radical, je demande pourquoi ce ne serait pas sur le parti conservateur à quoi on m’objecte que dans ce parti il n’y a que le duc de Wellington & sir Robert Peel de modéré, & que leur monde ne leur permette pas de soutenir le ministère. On ne sait que faire de lord Durham et il me parait possible qu’on l’associe au gouvernement. Il y a également de l’embarras pour choisir des ambassadeurs car Pétersbourg & Vienne vout devenir vacants. Je crains même qu’il ne soit question de Paris. Mes paroles ne manquent pas pour détourner de ce projet qui me parait fort contraire aux intérêts du ministère Anglais.
Monsieur la poste est venue et mon refrain recommence. Pas de lettres ! Je ne m’agiterai plus comme j’ai fait toute la semaine dernière du moins je l’espère ; mais comment voulez-vous que je ne sois par triste ! Pas un mot d’affection depuis le N°4 qui finissait le samedi 8 juillet et nous sommes au 24. Il me parait que voici ce que je décide je quitterai Londres Samedi le 29. Je ne suis pas bien sûre si j’irai ou non passer une huitaine de jours auprès de Lady Cowper à Broadstairs. De là à Douvres et Boulogne. Je vais annoncer que ma santé m’empêche de faire les visites que j’avais projetées dans les châteaux. Trois motifs me déterminent à ceci Monsieur. D’abord je ne puis pas vivre sans lettre, je le sens, et il est inutile d’espérer que notre correspondance aille mieux, et puis dans le parti que j’ai arrêté pour mon avenir, mon incapacité de voyager doit être mise en première ligne. Troisièmement je vous l’ai dit dans cette lettre, il faut que j’aie le pied en France. Arrivée à Boulogne, j’aviserai. Veuillez aviser de votre côté c-à-d. régler notre correspondance en France. Voulez-vous que je vienne à Dieppe. Cela me rapproche de vous. Que j’aille à Paris cela fera mieux aller les lettres. Je vois bien que tout mon sort est suspendu à ces lettres. Quelle rage de lettres !
Dans tout cela et à tout hasard faites-moi trouver une lettre à Boulogne, poste restante vers le 8 août. Elle peut m’y attendre pour le cas où je tarde mais prenez vos mesures pour qu’elle y arrive, & qu’elle tombe vraiment entre mes mains. J’ai bien envie de vous dire que vous êtes maladroit. Dans tous les cas j’ai bien du guignon. Je dors un peu maintenant mais j’ai une mine épouvantable, & je serais très fâchée que vous me vissiez, quoique ce soit votre ouvrage. Eh bien il est venu le N°6. Je l’ai, je le tiens, et je l’aime ! je l’aime ! Quel pays barbare que cette France, quoi le cours de la poste n’est pas réglé ! Mais il l’est en Russie. Allons je ne querellerai plus personne et pour être bien sûre de ma résolution. Je m’arrangerai de façon à n’avoir besoin de personne. Il me reste à vous informer de ce que je vais dire ici et en France. C’est que le changement d’air d’existence, les émotions douces mais douloureuses que j’ai rencontrées ici ont tous subitement altéré ma santé, cela est vrai et visible. Que les médecins ne me permettent pas les voyages, cela est parfai tement vrai aussi ; qu’ayant rencontré ici tous mes amis réunis ayant passé trois semaines au milieu d’eux, j’ai atteint le but qui me ramenait momentanément en Angleterre. & qu’aujourd’hui qu’ils se dispersent, je vais retrouver l’air & l’existence qui ont si bien comme pendant deux ans à ma santé ! Je viens de confier tout cela à la duchesse, je ne le proclamerai que dans quelques jours. Je vais déranger déranger bien des arrangements mais je suis décidée.
Continuez cependant à m’écrire. Il vaut mieux que ses lettres me reviennent un peu vieillies que de ce que je reste sans nouvelle. C’est toujours à Londres que vos lettres seront adressées. La duchesse veut que je vous dise son souvenir. Elle a été flattée des paroles que vous lui adressez. C’est une très noble personne avec une très belle âme. La petit princesse est dans une dissipation et une coquetterie perpétuelle. Quel drôle de métier. Il me semble que j’ai été jeune, mais coquette jamais. Que de choses à vous dire quand je pourrai dire ! Monsieur vous figurez-vous nos moments de causerie ? Ce bonheur me sembe si grand, si immense, que je tremble en y pensant, car le bonheur est si rare. Adieu. Adieu, quelle lettre que votre N° 6 ! Êtes-vous content de me savoir heureuse par une lettre ? Monsieur, il me parait que vous devez être bien content de moi.
Mardi 25. Ma lettre ne part qu’aujourd’hui. J’ai reçu une énorme épitre de M. de Lieven. Il me fait part de ses plaiss. (Il venait d’arriver à Lubeck) jusqu’à la fin de septembre aux eaux, & puis il veut me voir, & me demande de lui fixer un rendez-vous. Il ne croit pas que ce puisse être en France. Ensuite il m’emmène à Rome, à Naples ; en avril il doit se retrouver à Pétersbourg. Je lui écris aujourd’hui pour lui faire comprendre que je ne puis rien faire que le rendez-vous, en France et le plus près possible de Paris. Il faudra bien que cela lui entre en tête. Il est si joyeux dans sa lettre, de sa liberté, de se retronner avec moi, de courrir avec moi que je suis un peu triste de devoir lui gâter tout cela. Que de réflexions j’ai faites ! Il y a deux mois quel accueil différent j’eusse fait à cette lettre ? Car quoique la société de mon mari ne soit pas ce qui convient à mon esprit ni peut-être à mon cœur cependant c’est une créature qui m’aime, à qui j’appartiens, qui s’occcupe de moi. C’est de l’intimité, de l’habitude, un intérieur tout ce qui est si indispensable, si doux pour une femme ! Mais une autre vie a commencé pour moi, une vie qui n’efface pas mes douleurs mais qui me fait oublier, qui me fait en plus comprendre cette vieille vie qui cependant a été si longue. Et encore, pourquoi fallait-il que tout juste à l’entrée d’une nouvelle existence pour moi. M. de Lieven qui devait se trouver naturellement en Sibérie, au bout du monde, se rapprochât de celui-ci, que son désir de me revoir devient plus vif qu’il ne l’a été pendant deux années de séparation. Tout cela Monsieur me mène bien loin, il y a du triste dans ces pensées, il y a même du remord, & je suis sûre que je n’ai pas besoin de poursuivre ce sujet pour que vous compreniez parfaitement. tout ce qui se passe en moi. Je serais peu digne de vous si je n’étais affectée par toutes nos réflexions.
Adieu vraiment, mais je recommencerai aujourd’hui une nouvelle lettre qui ira doit. J’adresse encore celle-ci à Paris. Je ne suis pas aussi sûre de partir Samedi que je l’étais hier. J’ai recommencé à manger et à dormir. Si ces bonnes habitudes se continuent, je ne vois pas pourquoi je ne me prolongerais pas encore un peu ici. Vous ne sauriez croire les efforts, les finesses, les tendresses qu’on met en oeuvre pour cela. Votre dernière lettre me rassure sur nos lettres dès lors je ne vois pas que M. Aston soit si nécessaire, vous en jugerez. Voici tout juste votre N°8. Je n’ai pas un moment à perdre. J’y répondrai dans la journée ; mais ceci doit partir. Que je vais lire, relire, jouïr ! Ah mon Dieu que la vie est une belle chose quand les lettres arrivent. J’ai copié votre N°7 & pour cause.
16. Val-Richer, Samedi 5 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.
Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.
J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.
2 heures
Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !
On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.
26. Val-Richer, Vendredi 22 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Temps charmant ce matin. Par un si beau soleil, dans un si joli pays, je ne me promène pas seul sans un vif regret. Je cherche à chaque instant ce je sais bien quoi qui me manque. Quand je dis seul, j’ai tort. Désages vient de m’arriver, et je me promenais, tout-à-l'heure avec lui. Mais ce n'est pas Désages qui me manque. Peut-on se promener à Boulogne ? Il ne m’a pas paru que le pays fût beau aux environs.
On m'écrit de Hambourg que décidément votre Impératrice, va passer l’hiver à Palerme, et que le Pince Wolkonski aux eaux de Pyrmont a reçu des instructions, pour prendre les informations, et faire les préparatifs nécessaires. J’ai peine à y croire. N'avez-vous point de nouvelles de Constantin ? Vous me l'auriez dit. Je suis impatient à cause de lui, que cette campagne finisse. Il me paraît que les difficultés sont toujours grandes. L'Empereur a fait un grand pas en acceptant. la publicité de ces bulletins. Il ne pourra plus cesser de parler. A la vérité, il n’est pas obligé de dire la vérité, personne n'étant là, pour le contredire.
Au moment où la Reine d’Angleterre est arrivée à Mayence, les Rothschild avaient été faire quelque chose de fort galant en envoyant pour elle, au débarcadère, trois superbes voitures. Le Prince Guillaume de Prusse s’est fâché, a renvoyé ces voitures de l’enceinte du port, et la Reine est montée dans la sienne. Elle a été, dit-on, beaucoup plus gaie et de meilleure humeur à Mayence qu'à Brühl. Pas d’autres détails intéressants. Je vous quitte pour faire ma toilette. Je vous reviendrai après déjeuner. De demain Samedi en huit jours, je ne vous quitterai que pour retrouver en une minute. Adieu. Adieu.
10 heures et demie
J'aurai des embarras en Gréce. Colettis et Métaxa se brouilleront. J’espère que Colettis et Mavrocordato se racommoderont. Si cela arrive, j’aurai gagné au change. Si au contraire Metaxás et Mavrocordato se coalisant Colettis seul sera-t-il assez fort et assez sage ? Je n'en sais rien. Piscatory a confiance. Et s’il ne s’agissait que d'Athènes, j'aurais bien confiance aussi. Mais Paris, Londres et Pétersbourg ! Nous verrons. En tous cas malgré ses défauts Piscatory est un très bon agent, et puissant là Que de choses moi aussi j'aurai à vous dire. Quand on est ensemble on ne sait pas tout ce qu’on se dit. En tout, nous ne sentons jamais, le bien assez vivement, assez complètement quand il est là. Qu’est allé faire Lord Cowley à Londres ? Rien que pour ses propres affaires à coup sûr. Lord Aberdeen prend-il plaisir à ses voyages ? S’il a le goût des questions religieuses, il trouvera en Allemagne de quoi le satisfaire. Ce sera sérieux d'ici à peu de temps. Adieu.
Le déjeuner sonne. J’espère que Page vous fera de bons déjeuners. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Diplomatie (Russie), Enfants (Benckendorff), Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Ministère des Affaires étrangères, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Allemagne), Politique (Grèce), Portrait, Religion, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
28. Val-Richer, Lundi 25 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous me faites trembler avec votre : " Je serai à Beauséjour avant vous si Dieu le permet. " C’est bien vrai, toujours vrai ; et on a grand tort de n’y pas penser toujours. J'ai donc raison de trembler, pourtant samedi prochain, c’est bien près. Oui, vous y serez avant moi, et j’y serai samedi. Et nous ne nous quitterons plus. Mais, je n’aime pas que vous attendiez un compagnon de voyage, je ne sais lequel. Je n’aime pas que vous soyez à la merci de ces incertitudes. Pourquoi n'avoir pas écrit à Génie ? Ma recommandation est tardive. Vous ne l'aurez qu’après demain. Et j'espère bien qu’après demain, Mercredi, vous seriez à Beauséjour, ou tout près d’y être. Certainement vous ne rencontrerez pas une trombe en route. J’ai beaucoup pensé à celle de Monville. Je vous en ai peu parlé parce que je n'aime pas à arrêter votre imagination sur les choses tristes et effrayantes. Vous vous en laissez trop saisir.
Si vous aviez des yeux, je vous enverrais une lettre de Barante, assez intéressanite. Il a quitté la Suisse et m’écrit d'Auvergne où il est allé pour son Conseil général. Il me dit : " Mon inutilité me pèse moins ici qu'à Paris." Je le comprends. Sa position est vraiment désagréable. Et il n'y a pas moyen qu’elle change.
Je suis fort sensible à la bonne intention de lord Cowley sur Tahiti. Il a raison, & j'y comptais. Je l’ai toujours trouvé excellent, plein de sens et de bon vouloir. Et je compte aussi beaucoup sur Lady Cowley, à qui j’ai toujours trouvé bien de l’esprit, et qui en a, j’en suis sûr plus qu’elle n'en montre. Elle est très franche & ne cache jamais ses sentiments ; mais elle n’en fait nul étalage. J’aime bien cette manière là.
On dit que le Roi de Prusse a dépensé, pour recevoir la Reine 400 000 thalers. C'est le compte de Berlin. L’émeute de Leipzig l’a frappé. Il est rentré à Berlin, en veine d'humeur et de répression contre la liberté religieuse. Il a fait défendre à Uhlich, Ronge et Czerski, toute promenade prosélytique. Mais personne ne le craint huit jours de suite.
Je me suis promené hier pendant quatre heures dans un pays charmant, tout autour du Val Richer, avec tout ce qui se peut d’escortes à cheval et à pied, d'arcs de triomphe de fleurs, de discours, de coups de fusil. J’ai rendu beaucoup de services à cette population. Ses affaires vont bien. Elle me trouve bon et de facile accès. Il y avait hier un sentiment de bienveillance vrai et général, et un désir vif de le manifester, et de s'amuser en le manifestant. Mes enfants étaient charmés. Cela m’a plu. Ce qui est assez remarquable, c'est l’empressement du Clergé. Jamais tant de curés ne sont venus me voir, et avec autant de témoignages de déférence et de dévouement. Evidemment ce que j’ai fait quant aux Jésuites ne m’a fait aucun tort parmi les prêtres. Au contraire. Mais on a peur des Jésuites et ces prêtres, qui sont plus constants que fâchés de les voir un peu battus, se seraient bien gardés de s'en laisser soupçonner auparavant.
Le chancelier est malade. Il devait venir passer un jour chez moi, en allant à Trouville où Mad. de Boigne a acheté une petite maison. Il est resté à Paris avec la fièvre. Duchâtel le trouve frappé et m’en paraît lui-même assez inquiet. Adieu. Vous ne me dites pas si toute bile est passée. Vous me direz ce qui vous convient en attendant Page. Adieu. Adieu. Dans six jours, un meilleur adieu. G.
29. Val Richer, Samedi 9 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Greville vous inquiétera toujours. Tout le monde a envie que vous soyez inquiets, et on a raison car l’inquiétude seule peut vous amener à une transaction. Non pas l’inquiétude de la peur, qui n’est pas de votre dictionnaire. Mais l’inquiétude du bon sens qui a été jusqu'ici votre politique ; l’inquiétude d’une guerre dont les chances et les conséquences, seraient, pour vous-mêmes comme pour l'Europe, hors de toute proportion avec ses motifs. A moins donc que votre Empereur n'ait complètement changé d’esprit et de caractère, à moins qu’il ne veuille bouleverser l'Europe pour aller, lui, à Constantinople je persiste à croire qu’il se prêtera aux efforts de la diplomatie Européenne pour l'aider à sortir du mauvais pas dans lequel il est engagé.
Pourquoi la Porte ne prendrait-elle pas non plus envers la Russie seule, mais envers les cinq grandes puissances collectivement l’engagement de respecter et de maintenir les privilèges, immunités, droits, libertés qu'à diverses époques elle a accordés, ou promis aux populations Chrétiennes de ses états ? Sans aucune distinction des diverses sortes de Chrétiens, Grecs, Catholiques, ou Protestants. Ce ne serait plus un abaissement spécial et dangereux de la Porte, une abdication de sa souveraineté au profit de l’un et du plus redou table de ses voisins ; ce serait un engagement de justice et de tolérance de l'Islamisme envers le Christianisme, contracté au profit de tous les Chrétiens et placé sous la garantie de toutes les puissances chrétiennes.
Je sais bien ce qui vous déplairait en cela ; vous ne rentreriez pas, vis-à-vis de la Porte, dans votre position tout-à-fait distincte, exception nelle, isolée et indépendante. Vous stipuleriez avec elle en commun avec toute l’Europe, et pour crier, dans l’intérêt de tous les Chrétiens Turcs, un vrai Européen. J'admets que cela vous déplaise ; mais je ne vois pas quelle raison plausible vous y pourriez opposer. Vous demandez par votre dernier manifeste que la Porte s'oblige envers vous. Elle s'obligerait envers vous, et envers d'autres aussi, il est vrai ; mais pourquoi la situation des Chrétiens de Turquie, Grecs, Catholiques, ou Protestants ne serait-ce pas réglée, en principe du moins, par toutes les grandes puissances Chrétiennes, comme l’ont été la création du Royaume de Grèce et la clôture des Détroits ? Je vais plus loin vous embarrasseriez beaucoup ceux qui se méfient de vous si vous preniez, à ce sujet ; l’initiative, si de votre propre mouvement, vous vous montriez prêts à trouver bon qu’on étende à tous les Chrétiens et à toutes les puissances, l’engagement que vous réclamez pour les Chrétiens et pour vous mêmes. Bien souvent, quand une question devient. embarrassante, le meilleur moyen de sortir d’embarras c’est de la grandir. Et ce ne serait pas la question seule qui grandirait, vous grandiriez beaucoup vous-mêmes, vous feriez acte de sympathie et de protection envers tous les Chrétiens, acte de puissance au profit de l'Eglise et de la Société Chrétienne tout entière ; vous vous porteriez les patrons du Christianisme Européen, comme vous l'avez été jusqu'ici de l'ordre Européen. A la place de votre Empereur, cela me tenterait fort. J’aurais bien à dire à ce sujet ; mais en voilà bien assez.
Onze heures Adieu, adieu. J’ai toujours cela à vous dire. Je n’ai pas encore ouvert mes journaux.
30. Ems, Dimanche 10 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu vraiment un grand plaisir à apprendre le succès de votre fils. Je vous prie de lui en faire mon compliment très sincères. Je comprends la joie que cela vous aura donnée.
Voici la dernière proposition comme à Paris je crois, comme par nous et appuyé par l'Autriche à Constantinople. La Turquie nous enverrait un ambassadeur muni de la certaine note signée. Il nous la remettrait & recevrait en échange l’assurance écrite que nous ne ferons usage de notre protectorat du culte orthodoxe que dans un but religieux, & jamais politique On me demande le secret sur ce projet. Je vous prie donc de le garder. Il doit réussir à moins que Stratford rascal ne s’y oppose.
Je suis charmée de la remise du débat au Parlement. Tout cela à l’air pacifique. à juger par tout ce qui me revient votre gouvernement a une conduite très sage. Aberdeen. est plus gêné que lui, mais au total j’espère aussi que là on ira bien.
La chaleur a été étouffante ici. Aujourd’hui c’est mieux. Ma nièce est partie hier, elle me précède à Schlangenbad, J'y vais samedi le 16. C’est donc là toujours duché de Nassau que vous m’adresserez vos lettres. Je commence à avoir un peu de société ici. D'abord les deux princes de Prusse, le futur roi, & le Prince George, les [Panin], Platen, les de l'Aigle elle est insupportable, une princesse Carolath assez animée. On vient chez moi le soir, à 9 1/2 je chasse tout le monde. Avant 10 heures je suis dans mon lit. A 7 1/2 debout et à la promenade. Je dîne à 3 1/2. Vous avez ma journée avec le bain & les courses en voiture de plus. Adieu. Adieu.
35. Val Richer, Jeudi 21 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous n'aurez aujourd’hui que deux lignes ; je pars dans un moment pour aller passer la journée à quelques lieues d’ici, et je n'ai absolument rien à vous dire. J'attends. On m’écrit de Paris que vous travaillez vivement à Constantinople à renverser Reschid Pacha et à faire arriver à sa place Riza Pacha qui signerait, sans vous rien demander, la note que vous proposez. Vous avez été un moment sur le point d'y réussir. Mais Lord Stratford et M. Delacour ont repris le dessus. Il restera de tout ceci bien du venin maturé. On reparle du sacre. Je crois qu’on n'y renoncera jamais. Je doute qu’on y arrive.
Savez-vous ce que dit le Pape de votre église ? Quelle se conserve à cause du grand froid. J’ai tort de dire votre Eglise, car vous êtes de la mienne.
Adieu, adieu. J’espère que Schlangenbad fera un peu mieux qu'Ems.
43. Val Richer, Samedi 6 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de la lettre de M. de [Meyendorff] qui m’a beaucoup intéressée. Je suis charmé que les miennes l’intéressent un peu. J’aimerais bien mieux causer avec lui. Je lui dirais que je n'ai jamais pensé à un protectorat collectif des Chrétiens en Turquie. J'en sais, comme lui, l'impossibilité pratique. Ce qui me paraissait praticable, c'était que votre Empereur, puisque on regardait un engagement de la Porte envers lui comme attentatoire à l’indépendance Ottomane, proposât lui-même que la Porte prit le même engagement, non plus envers lui seul, mais envers toutes les Puissances Chrétiennes, laissant chacune de ces Puissances protéger ensuite, pour son compte, ses propres dieux Chrétiens, l’une les Grecs, l'autre les Catholiques, l'autre les Protestants &
Mon idée n'était qu’un expédient pour sortir de la difficulté du moment par une porte qui ne fût plus seulement Grecque et Russe, mais Chrétienne et Européenne, qui fût par conséquent plus grande pour votre Empereur et unobjectionable pour les autres. Ce sont les situations prises qui décident. des affaires je voyais là une bonne situation à prendre, bonne pour la dignité et pour la solution. Voilà tout. Cela ne signifie plus rien aujourd’hui. Le sultan a beau se griser et traîner. L'affaire finira bientôt puisque tout le monde veut, qu'elle finisse. Les embarras ne sont des périls que lorsqu’il y a des puissants qui veulent en faire des périls.
Vous ne lisez probablement pas les récits de la révolution de Chine. S'ils sont vrais il y aura bientôt là, pour l'Europe, de nouveaux Chrétiens à protéger. Seront-ils Grecs, Catholiques ou Protestants ? Je crois que vous avez une mission religieuse à Pettiny. Du reste, ces Chrétiens chinois, orthodoxes ou non, me paraissent en train de se bien protéger eux-mêmes. Convaincu, comme je le suis, que le monde entier est destiné à devenir Chrétien, je serais bien aise de lui voir faire, de mon vivant, ce grand pas.
Avez-vous des nouvelles de la grande Duchesse Marie ? Le voyage de la grande Duchesse Olga en Angleterre est-il déterminé par la santé de sa sœur ? Dieu veuille épargner à votre Empereur cette affreuse épreuve ! Il m’arrive le contraire de ce qui arrive, dit-on, ordinairement ; je deviens en vieillissant, plus sympathique pour les douleurs des autres ; mes propres souvenirs me font trembler pour eux comme pour moi-même.
Je voudrais vous envoyer un peu du beau temps que nous avons depuis quelques jours ; très beau, mais pas chaud. C'est le vent du Nord avec le soleil. Nous n'aurons décidément point d'été. Vous ne me dites rien de l'effet de vos bains ; mais à en juger par l’air de votre silence, Schlangenbad vaut mieux qu'Ems.
Changarnier parle en effet trop de lui. Mais quand vous n'avez rien à faire des gens, vous ne savez pas assez les prendre par le bon côté, et mettre à profit ce qu’ils ont tout en voyant ce qui leur manque. Vous vous ennuyez trop de l'imperfection dès qu’elle ne vous est bonne à rien.
Adieu, adieu. Je ne fermerai ma lettre que quand mon facteur sera venu ; mais il ne m’apportera probablement rien à y ajouter. Adieu.
Mots-clés : Âge, Aristocratie, Autoportrait, Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Femme (santé), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Internationale), Politique (Russie), Politique (Turquie), Portrait, Portrait (Dorothée), Religion, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
45. Paris, Vendredi 22 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je n’avais aucune connaissance de l’article dans le Temps dont vous me parlez, je ne lis pas cette feuille. Je viens de l’envoyer chercher. Je l’aurais lu avant de fermer ceci. Je dois voir M. Molé ce matin. Nous avons eu rendez-vous devant son portrait. D’après ce que vous me dites j’y arriverai avec des dispositions douces !
J’ai toujours le même compte à vous rendre de mes journées, trois heures au bois de Boulogne, c’est morne, mais cela me fait du bien et le temps est ravissant. En revenant j’ai pris des fleurs chez Mad. de Flahaut, j’ai fait une petite visite à la princesse. Je suis rentrée pour 6 h 1/2, l’heure de mon dîner. Marie m’a fait lecture après ; moi couchée sur notre canapé vert. C’est là que je passe une heure après mon dîner.
Mon Ambassadeur est venu de bonne heure, il sortait d’un grand dîner chez M. Molé. Après lui Pozzo la petit princesse, Miss. de Hugel, St Simon, l’ambassadeur de Sardaigne, lord Hatturton, M. Sneyd, sir Herbert Taylor. Il n’allait jamais dans le monde à Londres, mais je l’ai beaucoup vu à la cour vous savez le rôle qu’il a joué sous trois règnes. Il n’y a rien qu’il ne sache de ce qui s’est passé de plus important et de plus intime dans le Cabinet et la cour d’Angleterre. Il sait par conséquent que j’en sais beaucoup aussi. Nous nous sommes donc retrouvés comme de très intimes connaissances. Ce qui m’a surpris c’est que Pozzo a semblé faire ici la sienne hier au soir. Il est extrêmement peu orienté en Angleterre. J’ai oublié de vous nommer M. de Mühlinen, ah quel ennuyeux ! Et aujourd’hui il est important par dessus le marché.
On est en négociation avec sa cour pour la religion des enfants à venir. Le reine voudrait au moins que les filles fussent catholiques, mais cela ne s’est jamais vu en Wurtemberg et on dispute. La noce se fera dans le courant d’octobre et ils partent de suite après pour Stuttgart d’abord, & puis le pays de Bayreuth où le prince a un pitoyable château. Ils y passeront l’hiver. On dit que votre princesse est très éprise de son futur mari. Il est parfaitement beau mais de proportions énormes.
A propos & M. Duchâtel ! Comme vous m’annoncez froidement que son mariage est remis aux premiers jours d’octobre ! J’y réponds en ne vous en parlant qu’à la quatrième page. Quoi ? Cela ferait tout une semaine de différence et puis ce sera encore pour me quitter ! Monsieur il me semble que depuis le 15 de juin nous n’avons pas fait autre chose que nous quitter. Enfin il est bien sûr que nous ne pouvons pas. vivre quinze jours ensemble. Cela me nous est au moins pas encore arrivé. C’est un étrange ménage que le nôtre !
Midi. Je viens de lire le Temps de lundi. Je suis parfaitement indignée. Monsieur que de choses je voudrais vous dire, mais vous ne pouver pas venir si ce n’est pour marié M. Duchatel. J’ai passé une bien mauvaise nuit à deux heures j’ai sonné, j’avais le frisson. Je me suis fait brosser, frotter pendant une heure. Je ne sais si c’est mes nerfs où quoi. Je me suis endormie plus tard. Ce temps est charmant, j’en proite. J’ai chaud. Je fais tout pour me bien porter, parce que cela vous fait plaisir.
Adieu Monsieur, j’ai envie de n’être pas en colère de cet article dans le Temps mais je n’y réussis pas beaucoup. Ce qui me frappe c’est que ce n’est peut-être que le commencement d’un nouveau genre de persécution que j’aurai à subir. M. Molé aurait eu envie de me chasser de France. J’ai cependant toujours été bonne pour lui.
Adieu Monsieur, adieu. Vous ne sauriez vous fâcher pour votre compte, vous êtes trop au dessus de cela ; ne vous inquiétez pas pour moi, je ne veux pas que votre affection pour moi soit l’occasion de la moindre peine pour vous. Adieu, quand pourrons-nous nous parler ? J’attends votre lettre demain avec plus d’impatience que jamais.
A propos, j’ai rencontré avant-hier M. Duvergier de Hauranne aux Tuileries. Sa vue m’a fait plaisir, je l’ai salué, il ne m’a pas reconnue, il a eu l’air le plus étonné du monde. Adieu encore. Je ne sais plus le quantième. Je vous en dis trop. Adieu. Adieu.
47. Paris, Dimanche 24 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Quel triste réveil. Votre lettre, vous savez ce qu’elle contenait cette lettre ? Point de noce. Votre mère malade. Vos occupations électorales en province, pas la plus légère espérance d’une course à Paris, et tout cela m’arrive le jour où devait tenir pour moi tant de bonheur !
En même temps, je reçois deux lettres de mon mari dont je vous transmets les passages importants dans la première du 5 Sept. il me dit : "Tu me fais de nouvelles propositions sur un voyage de circumnavigation pour te rencontrer au Havre ! S’il n’existait pas des entraves insurmontables à une telle entreprise, j’y aurais pensé à deux fois d’après les allusions qui ont été faites à ce sujet à mon passage par Carlsbad. Ce sont les conséquences nécessaires d’une fausse position trop prolongée. Il est urgent qu’elle subisse une modification d’un côté ou de l’autre."
Dans la seconde lettre du 10 Septembre " Ton N°356 m’est parvenu hier, le précédent n’est point entré encore. C’est pour cela peut-être que celui-ci ne m’est point intelligible. Tu sembles avoir reçu la lettre par laquelle je te demandai de me faire connaître ta détermination. Je suis dans l’obligation d’insister sur une réponse catégorique, car je dois moi-même rendre compte des déterminations que j’aurai à prendre en conséquence. Je t’exhorte donc à me faire connaître sans délai, si tu as intention de venir me rejoindre on non. Je dois dans un délai donné prendre une résolution quelque pénible que puisse m’être une semblable nécessité."
Que direz-vous Monsieur de tout cela ? Il est évident par la première, que des commérages ont voyagé jusqu’à Carlsbad ; & par la seconde qu’il a pris envers l’Empereur l’engagement de me forcer à tout prix à quitter Paris ? Voilà où j’en suis. Savez-vous ce qui arrivera ? L’Empereur lui permettra de venir sous la condition expresse de m’emmener et lui viendra avec empressement, incognito me surprendre. Car voilà sa jalousie éveillée, & je le connais. Il est terrible. Il est clair qu’il ne croira pas un mot des certificat du médecin. Car il me dit dans une autre partie de sa lettre " il est plaisant de remarquer que les médecins de Granville le renvoient de Paris, & que les tiens t’ordonnent d’y rester, ils sont complaisants, avant tout." Si, si ce que je crois arrive, c’est sur la mi octobre que mon mari serait ici. Qui me donnera force & courage ? Je suis bien abandonnée.
Ma journée hier a été plus triste que de coutume. Votre lettre m’avait accablée. J’ai eu de la distraction cependant, le prince Paul de Wurtemberg pendant un temps, qui m’a fait le récit de tous les embarras existants encore pour le mariage. Mon ambassadeur en suite. Ma promenade d ’habitude au bois de Boulogne, mais tout cela n’y a rien fait ; à dîner il m’a pris d’horribles souvenirs. Je n’étais qu’à eux, à eux comme aux premiers temps de mes malheurs. Tout le reste était à la surface tout, oui vous-même. Le fond de mon cœur était le désespoir, je ne trouvais que cela de réel. Je demande pardon à ces créatures chéries d’avoir
été si longtemps détournées de mon chagrin. Je demandais à Dieu comme le premier jour, de me réunir à eux dans la tombe, dans le ciel, tout de suite dans ce tombeau. Je n’entendais & ne voyais rien, Marie parlait je ne l’écoutais pas et tout à coup des sanglots affreux se sont échappés de
mon coeur. Vous ne savez pas comme je sais pleurer. Vous ne pourriez pas écouter mes sanglots, ils vous feraient trop de mal.
J’ai quitté la table, j’ai pleuré, pleuré sur l’épaule de cette pauvre Marie qui pleurait elle-même sans savoir de quoi. J’ai ouvert ma porte à 9 h 1/2. Je n’ai vu que mon ambassadeur & Pozzo.
Ma nuit a été mauvaise, & mon réveil je vous l’ai dit.
Midi
Qu’est-ce que votre mère vous donne de l’inquiétude, puisque le cas de la dissolution échéant vous pourriez être forcé de la quitter pendant quelques jours ne serait-il pas plus prudent, & plus naturel de la ramener à Paris, d’y revenir tous, de vous y établir. Cette question ne vous est-elle pas venue ? L’été est fini, la campagne n’est plus du bénéfice pour la santé.
Un courrier de Stuttgard a posté au prince de Wurtemberg défense de conclure le mariage à moins qu’il ne soit stipulé que tous les enfants seront protestants. La Reine exige qu’ils soient tous catholiques, le prince se conforme à cette volonté qui est celle de la princesse aussi, & il a écrit au roi de Würtemberg en date du 19 par courrier français qu’il passerait outre si même le Roi n’accordait pas son consentement. Dans ce dernier cas cependant il est évident que le ministre de Würtemberg n’assisterait pas à la noce & que cela ferait un petit scandale. Le prince Paul jouit de tout cela. Il abhore son frère. Hier il a dîné à St Cloud
pour la première fois depuis 7 ans.
Je cherche à me distraire en vous contant ce qui ne m’intéresse pas le moins du monde. Adieu Monsieur, dès que je suis triste, je suis malade, j’espère ne pas le dernier trop sérieusement. Je voudrais me distraire, je ne sais comment m’y prendre.
Dites-moi bien exactement des nouvelles de votre mère, & dites-moi surtout, si vous n’auriez pas plus confiance dans le médecin de Paris & les soins qu’elle trouverait ici.
Adieu. Adieu toujours adieu.
53. Val-Richer, Mardi 3 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne trouve pas que le Constitutionnel soit aussi aimable pour M. Fould que je m’y attendais à travers les félicitations et les compliments, on sent percer un peu de froideur, et quelques réserves. Est-ce que Fould serait rentré dans les affaires sans concert avec Morny et contre son gré ?
Autre remarque. La rentrée de Fould coïncide avec l’épuration du Conseil d'Etat en raison des votes dans le procès des biens d'Orléans trois des Conseillers d'Etat qui ont voté contre les décrets du 22 Janvier sont, l'un révoqué, l'autre mis à la retraite, le troisième placé autrement, et plus mal. Cela cadre peu avec l'avènement au pouvoir d’un opposant aux décrets. Il est vrai que M. Persil ancien garde des sceaux du Roi Louis-Philippe, est nommé Conseiller d'Etat en remplacement de M. Cornudet, révoqué. Est-ce que cela serait donné aux Orléanistes, à titre de dédommagement ? M. Persil est un homme capable, qui aurait mieux fait de rentrer aux affaires un autre jour et par une autre porte, puisqu’il y voulait rentrer.
Le Moniteur s’est empressé de démentir indirectement le bruit répandu que l’entrée à l’Ecole normale avait été interdite aux élevés protestants, à cause de leur religion. Il a bien fait. La liberté des cultes est un des droits auxquels, ce pays-ci tient le plus et que l'Empereur Napoléon, a le plus soigneusement respecté. Il paraît bien que M. Fortoul ministre de l’instruction publique avait fait ou dit quelque chose dans le sens dont on parlait. Il se sera ravisé. C’est un homme d’esprit, un peu léger.
Donnez-vous bien du mal pour être un grand homme ; votre statue, en bronze sera vendue aux enchères, au bout de deux siècles, à la porte de votre propre pays, pour 7.270 francs pas un quart de la valeur du bronze. C'est ce qui vient d’arriver à ce pauvre Gustave Adolphe dans l'île d'Héligoland. La statue avait fait naufrage l’un dernier, en venant de Rome à Gothenburg, et la municipalité de Gothenburg, qui l’avait commandé n'a pas voulu la racheter des mains des pauvres marins d'Héligoland qui l’avaient repêchée. Il est vrai que Gustave Adolphe n'en reste pas moins Gustave Adolphe. Sa statue a pu se noyer, mais non pas son nom. Du sein de leur séjour inconnu, les grands hommes doivent à la fois jouir de la longue trace qu’ils ont laissé ici bas, et prendre en pitié les accidents d’ingratitude et d’oubli qui leur arrivent. Je me figure que l'impression causée par le spectacle de ce monde, quand on est est hors, et complètement détaché, doit être celle d’un dédain bienveillant, et doux.
Adieu, en attendant votre lettre. Je vous quitte pour faire ma toilette. Je voudrais bien apprendre qu'avant hier Dimanche, vous avez posé le pied par terre sans trop de douleur.
// si vous écrivez à M. Fould, ce qui me paraît probable, seriez-vous assez bonne pour lui dire que du fond de ma retraite, je suis charmé de le voir rentrer sur la scène ? Il s'y conduira certainement en homme d’esprit, et de sens et tout le monde aura à y gagner. //
11 heures
Merci de votre petite page. C'est bien long ce que dit Velpeau. Je regrette de n'avoir pas été là quand il est venu. Adieu, Adieu. G.
61. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !
Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.
Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.
Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.
Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.
Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.
Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.
11 H.
J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Amour, Discours du for intérieur, histoire, Poésie, Portrait, Protestantisme, Religion
65. Bruxelles, [Mercredi 24] mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Jeudi
Brockhausen est revenu hier de Paris. Enivré de Paris, malheureux de retrouver Bruxelles. Il dit qu'on sait bien moins là qu'ici. Je suis dans mon lit aujourd’hui c’est bien ennuyeux, j’espère que ce n’est pas dangereux. Redcliffe a fait ses embarras. Il n’a pas voulu aller au dîner donné pour le prince Français, Raglan non plus, c’est drôle. Les spectateurs trouvent cela un singulier début pour l’action commune.
Il y a des gens qui prétendent qu'il y a quelques nuages entre Paris et Londres, c’est des mauvaises langues.
Quelle misère d’aller nous trouver vous en Normandie, moi en Nassau. Ce pauvre Constantin me conseillait l’autre jour de penser comme la Grande Duchesse de Weimar qui dit que le bon Dieu n’aurait pas fait autre ment que l’[Empereur] son frère, j’ai répondu que c’était bon pour un orthodoxe de le croire, mais que moi j’étais Luthérienne, et je crois au bon Dieu plus d'esprit que cela. J'ai été prise d’un accès de sommeil après une nuit blanche, et voilà qu'il est tard. Je suis obligée de fermer ma lettre. Je viens d'en recevoir une de Greville un peu bête. Evidemment l’intéressant il ne veut pas me le dire. Adieu. Adieu.
N'oubliez pas de me donner l’adresse de Génie.
67. Paris, Dimanche 22 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu votre lettre ce matin, je ne suis pas fâchée d’avoir une pièce aussi officielle ; elle pourrait être bonne à produire un jour, mais reprenons nos habitudes. Il n’y a plus le moindre danger de l’arrivée de M. de Lieven. Mon fils part demain pour le retrouver à Lausanne, delà ils se mettent immédiatement en route pour l’Italie. Ecrivez-moi par la poste comme vous avez toujours fait, il me faut cela. & puis une fois encore par une bonne occasion plus intimement. Et puis nous arrivons au 31, au 31 ! Concevez- vous tout ce que j’éprouve en traçant le chiffre ! Savez-vous que mon affaire avec mon mari est un tel dédale que nous ne nous y retrouvons plus du tout mon fils et moi, & qu’après avoir tout lu, tout examiné de part et d’autre, nous en sommes venus à la conclusion, qu’il est possible, qu’il ait inventé tout ce qu’il prête à l’Empereur ! Alors la confusion est à son comble, car mes lettres sont parties, mes confidences sont faites, & mon mari va l’apprendre. C’est vraiment trop long à vous dire.
Pahlen et moi nous avons regardé cette affaire de tous les côtés hier au soir. On peut lui intimer de me regarder comme rebelle, on peut m’ôter le portrait. Qu’est-ce que cela me fait ? Exactement rien du tout. & on ne peut pas faire plus. et faire cela cependant est hors de toute vraisemblance car tout despote qu’il est, il faut baser cela sur quelque chose. Être à Paris n’est pas suffisant & je demande une enquête. Il faut bien me l’accorder. En vérité, c’est trop bouffon & après avoir un peu gémi, je finis toujours par rire, mais je crois mon mari fou, ni plus, ni moins, & son fils le peine un peu.
Et savez vous que mon frère l’est complètement. Il vient d’embrasser la religion grecque. Allons me voilà dans une belle famille si j’y étais restée ! Mon fils part demain, j’en suis presque impatiente. Nos entretiens perpétuels sur un même sujet si désagréable me font du mal, & puis je ne dors pas la nuit, je ne vous fais plus mon journal. Depuis 9 h. jusqu’à 6 heures, il ne me quitte pas. Le bois de Boulogne nous le faisons ensemble. à 6 1/2 nous dînons encore ensemble jusqu’au moment où j’ouvre ma poste. Après demain j’écrirai avec plus de liberté d’esprit, & du temps.
J’écris des volumes à mon mari, il y a tant à expliquer ; car c’est un enfant. Je serai impatiente que vous m’annonciez la réception de ma lettre pas M. Grouchy. L’aimerez- vous un peu ? Je ne sais plus ce qu’elle contient. Je voudrais m’en rappeler, savoir s’il n’y a pas trop, s’il n’ a pas trop peu. Je flotte entre ces deux craintes. Et au bout de tout cela je suis mécontente. que ce que dans le trouble d’esprit où je vis Je vous aurai dit des bêtises, pas du tout ce que je voulais vous dire, mais je n’ai pas été maîtresse de choisir mon moment. Cela vaudra mieux que toutes les lettres. J’ai eu une excellente lettre de Valençay. Je vous en parlerai. On me dit de vous rappeler Rochecotte en nov : & moi, je vous prie de l’oublier.
Adieu. Adieu, toujours toute notre vie adieu. N’est-ce pas toute notre vit. M. Grouchy doit porter ce soir.
105. Paris, Samedi 28 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre bonne lettre nous n’avons plus en tête vous et moi que le 31. Il est si près et ce sera si joli qu’il me semble qu’il ne viendra jamais. N’y aura-t-il pas une émeute demain ? Ne serai je pas tuée ? Voilà qui est possible. Mon fils Alexandre n’a pas renoncé à ces projets de mariage. Il attendra 6 mois comme je lui ai dit de le faire, et puis je crains qu’il n’attendra plus. J’ai parlé de la religion des enfants comme une condition de rigueur, c.a.d. les fils luthériens, et je crois que cela fera la grande difficulté. Sa lettre est une bonne lettre et me touche. M. Ellice et le petit Howard sont venus un voir à Longchamp hier matin. J’ai ramené Ellice qui était venu à pied.
Le soir j’ai fait visite à Madame j ai trouvé M. de la Rovère de Steakelberg un très drôle homme. Quelle idée d’aller épouser Melle de Steakelberg. Ellice m’a lue des lettres de Londres selon lesquelles vraiment le parti libéral (Whigs libéraux) veut absolument une modification dans le ministère. Le Cabinet est fort divisé. Minto et Melbourne, à la Chambre haute, Horwich & John Russell à la Chambre basse se donnent des démentis en pleine séance. Cela a une étrange mine, et ne peut pas durer ainsi. Votre gouvernement ne veut mettre la main à la question Belge que pour la résoudre. Ainsi plus de protocole qui ne soit le dernier. Nous verrons.
116. Paris, Dimanche 26 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre d'hier m'a fait pleurer. Oui nous sommes malheureux tous les deux, bien malheureux. Mais je le suis bien plus que vous. Vous avez des enfants à élever, vous avez une patrie, vous avez des devoirs publics, une belle carrière à soutenir, vous avez un home. qu’est-ce que j'ai ? Pensez à tout ce que j’ai perdu. Pensez à ce qui me reste et ne soyez pas mécontent. Lorsque je vous montre de la tristesse, beaucoup de tristesse. J'en ai moins auprès de vous. Quelque fois même j'oublie auprès de vous mes chagrins mais lorsque je me retrouve en face de moi-même, rien que moi ! Ah c’est affreux, tous les jours je le suis parce que je ne vois davantage aucun terme à cette dure situation. Je la vois au contraire s'empirer tous les jours ; j'ennuie ou je mécontente ceux auxquels j’en parle. Vous même je vous ennuie peut être je vous mécontente peut-être. Vous trouvez que je n’apprécis pas assez la seule consolation que le ciel m’a envoyée. Vous vous trompez, mon cœur est plein de reconnaissance, d’affection. Mais encore une fois j’ai trop perdu, trop, et je rencontre de la froideur de la sûreté là où je devais attendre du soutien de la consolation. Et plus cela se prolonge plus mon cœur se révolte. Vraiment quelques fois il est prêt à la briser. Je ne me sens de courage pour rien. Il me semble que jamais je n’ai été si triste Je ne devrais pas vous dire tout cela, mais songez qu’il n’y a plus que vous à qui je le dise. Pardonnez-moi, ne vous fâchez pas. Ayez pitié de moi !
J’ai passé la matinée seule à Longchamp, et par un mauvais temps. Cela ne me vaut rien ; je me sens trop isolée. Que je serais heureuse si j'avais des gravures à côté sur du carton ; si j’étais entourée, aidée, comme vous l’êtes !
J’ai été le soir chez Mad. Appony. Elle revenait de la cour. On y est dans la plus grande joie. Vous savez que l’archevêque est tout à fait reconquis. Il sera aussi assidu qu'il a été jusqu'ici éloigné. On dit qu’il ne reproche le baptême. protestant du petit prince de Würtemberg qu’il croit que s'il y avait regardé de plus près, il en aurait fait un catholique. Qu’il veut aujourd'hui la conversion de la Duchesse d'Orléans & que par ce regret, & par cette espérance ; il est décidé à bien vivre avec la cour. Le Roi lui a pris cordialement, la main. La Reine a baisé son étole. La Duchesse d’Orléans a été fort mal une heure après ses couches. Elle va bien maintenant. L'enfant est fort grand. Et il était blanc et rose deux heures après sa naissance. Tout le monde en a été frappé.
J'ai eu hier un long entretien. Pahlen. Il était venu chez moi le matin sans me trouver. Nous nous sommes vengés le soir. Tout ce qu’il me dit m’intéresse mais il n’y a rien de nouveau à vous redire ! Tout le monde y compris le maître a été révolté du procédé de l’année à mon égard dernière et assuré ment ce n’est qu’à cela que je suis redevable du rétablissement, incomplet de l’ancien état de choses. C'est la seule chose qu'il ait eu à me rapporter sur mon compte, et je n’ai pas voulu lui faire d’interrogation. s'il avait un quelque chose d’agréable à me dire, le brave homme n’attendait pas mes questions. Quant à son affaire à lui, comme Je vous l'ai déjà dit ; il n’y a rien de changé. Le temps adoucira peut être, mais voilà tout.
Adieu, voici dimanche j’ai peur que la lettre n'arrive trop tard. J'ai mal dormi, je me suis levée tard et il est 1 heure. Adieu. Adieu.
117. Caen, Samedi 1er septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous allons rentrer dans toute la régularité de nos habitudes. Il vous aura manqué une lettre. J’attendais les vôtres sans savoir à quelle heure elles viendraient. Physiquement aussi, je suis bien aise de rentrer chez moi. Cette vie de banquets, de courses, de bavardage incessant, commence à me fatiguer. Elle ne m’a jamais plu. Pour que je m’arrange du monde, il faut que les affaires ou ses agréments vaillent la peine que je prends pour lui. Vous avez votre fils. Je regrette de ne pas le voir. Vous me direz s’il a bien du chagrin de la rupture de son mariage. Mlle de T. ne le désirait donc pas bien vivement. Vous avez, je crois, bien fait d’insister. Il faut beaucoup d’amour et une grande supériorité d’esprit pour que la différence de religion, quand l’un et l’autre y tiennent, ne devienne pas, dans le cours de la vie une vraie peine. A-t-il renoncé à tout espoir ? Il me semble aussi que dans son pays même son père à part, l’abandon de tous ses enfants au catholicisme lui ferait grand tort.
Je compte trouver une lettre au Val Richer. Elle me dira si vous êtes toujours aussi souffrante. Mandez- moi avec détail ce que dit Chemside. Je ne comprends pas votre abominable temps. Ici, il fait très beau, frais, mais point froid. Vous avez bien tort de ne pas venir en Normandie. Où avez-vous logé votre fils ? Se promène-t-il habituellement avec vous ? J’étais sûr que l’archevêque ferait ce qu’il a fait. Je trouve du reste qu’on l’a pris bien vivement. Il y avait des façons moins brutales que l’article des Débats pour lui faire sentir l’inconvenance de son discours. Inconvenance à laquelle on devait s’attendre ; comment veut-on qu’un archevêque, et surtout celui-là, ne laisse pas percer quelque humeur des nouveaux échecs que reçoit de notre temps l’unité de la foi.
M. Molé n’était pas auprès du Roi, aux Tuileries, le jour où il a reçu les députés. Ils en ont été très choqués. On m’écrit que la tête lui tourne un peu. Champlâtreux n’est pourtant pas un bien grand verre de vie. La médaille est de trop. C’est encore plus que le tableau. On ne viendra pas à bout de notre temps, de faire de grands événements avec de petits incidents. Il ne faut pas les traiter de la même façon. M. Dupin n’est pas venu aux couches parce qu’on ne l’avait pas pris pour témoin. Je ne saurais dire combien cet abandon de cette pauvre Princesse tout de suite après ses couches, m’a frappé. Voilà bien les entraînements, les oublis, les distractions des cours. Pour tous ceux qui étaient là, le monde entier avait disparu devant ce petit garçon. Et si elle était morte ! Quel tableau eût fait de cette scène M de St. Simon ! Donnez-moi quelque nouvelle de l’affaire suisse. Il me paraît que Louis Buonaparte ne s’en va pas de lui-même. Cela peut devenir embarrassant. Adieu.
Je vais déjeuner et monter en voiture. Je traverserai une très belle vallée sous un très beau soleil, par une très belle route. Vous me manquerez infiniment. Si je parlais la langue de Pétrarque, je vous dirais que dès qu’il s’élève dans mon âme une impression douce, elle me quitte et va vous chercher Si elle vous trouve elle me revient. si elle ne vous trouve pas, elle me quitte tout-à-fait. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Enfants (Benckendorff), Politique (France), Religion, Vie familiale (Dorothée)
119. Val-Richer, Lundi 3 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens d’embarquer Mad. de Meulan. Je dis bien embarquer car elle va à la mer à Trouville, passer deux jours avec sa belle-sœur Mad.de Turpin, qui y est depuis un mois. J’attends Jeudi, M. et Mad. Lenormant, & la semaine d’après Mad. de Broglie. Le Val Richer sera animé si c’est être animé qu’être peuplé. J’ai commencé hier à peupler ma salle de manger. J’y ai fait pendre les 72 Rois que j’ai collés. J’y pendrai encore 286 députés de l’Assemblée constituante. Le reste des députés ira dans le vestibule et le long de l’escalier. C’est dommage que vous ne puissiez pas m’aider à coller. On cause très bien. Il me semble aussi qu’un changement d’air vous serait bon. N’avez-vous plus personne à Dieppe ? Je pense quelquefois que, sans la mer vous pourriez aller passer un mois ou six semaines, en Angleterre, de château en château. Vous y trouveriez de la distraction, peut-être un peu d’amusement. L’Angleterre vous plaira toujours ; et sauf la fatigue ce voyage-là me paraît sans inconvénient pour vous. Il ne vous engage et ne vous expose à rien. Vous pouvez poser l’alternative entre l’Angleterre et la France.
Je cherche sans cesse quelque moyen de vous faire un peu de bien, au corps et à l’âme. Je trouve et je puis bien peu, et pourtant ! On me conteste l’abandon de Mad. la Duchesse d’Orléans au moment de ses couches, et l’imprudence qui s’en est suivie. On me dit qu’elle a tout simplement été frappée d’une fièvre puerpérale aiguë, comme la Princesse Charlotte. On me donne tous les détails imaginables sur son mal et les remèdes qu’on lui a faits. Elle est devenue froide, violette. On l’a couverte de glace. On lui a fait boire du vin de Constance, manger des citrons. Je crois au mal et aux remèdes. Mais la dénégation de l’abandon m’est suspecte. J’en voudrais savoir le vrai. Cet exemple de plus de l’enivrement factice des cours vaut la peine d’être constaté. Je suis tenté d’être de l’avis de M. Molé. Ce long séjour de votre Empereur en Allemagne, ce vagabondage imprévu, cet argent jeté par les fenêtres, tout cela, annonce un dessein. On dirait qu’il va courant portant après une influence qui lui échappe. Peut-être aussi, n’est-ce qu’une fantaisie, de despote fiévreux et ennuyé. Je ne sais comment se passera le couronnement de Milan. Mais je lis les préparatifs. N’êtes-vous pas frappée de l’extrême différence entre celui-là et celui de Londres ? à Londres, des émotions, des joies publiques, des âmes, un peuple vivant au milieu des fêtes. A Milan, je n’entrevois encore que des cérémonies et des tapisseries. Et il n’y aura certainement pas autre chose au moment même. La curiosité n’est pas la sympathie. Des spectateurs ne sont pas des acteurs. Décidément la vie est du côté de l’occident, dans les vieilles idées et les vieilles mœurs comme dans les nouvelles. Aussi, à part ceux qui y sont qui est-ce qui regarde au couronnement de Milan ? Qui s’en occupe ? Le couronnement de la Reine Victoria a intéressé le monde.
9 h. 1/2
Merci du N° 123. C’est ainsi que je les veux. Je veux être au courant de tout. Tâchez qu’Alexandre ne cède pas sur la religion des garçons, si le mariage se renoue. L’avenir de vos fils, me préoccupe. Leur père ne fera rien pour eux. Leur situation est délicate. Il ne faut pas qu’ils fournissent eux-mêmes des prétextes. Quel pays que celui où des jeunes qui bien nés et capables ne sont préoccupés à 30 ans que de l’envie de quitter le service public ! Je reviens toujours à mon occident.
A coup sûr, vous n’avez de votre vie, entendu chanter une chanson à boire. Voici le refrain d’une des plus jolies. Versez donc mes amis versez.
On n’en peut jamais assez boire.
Versez donc mes amis, versez.
On n’en peut jamais boire assez.
Adieu, adieu, adieu. Adieu. Pas assez. G.
122. Val Richer, Vendredi 21 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sacy (ou son rédacteur) a eu certainement tort ; la liberté des cultes existe en Russie ; elle a même, depuis longtemps été l’un des mérites de votre gouvernement, et l’un de ceux dont on l’a et dont il s'est avec raison, le plus vanté. Les Débats n'auraient pas eu tort s'ils avaient simplement dit qu’en sa double qualité de chef de la religion grecque et de souverain absolu, votre Empereur avait fait souvent, dans l’intérêt de l’unité de son pouvoir religieux comme politique, de la domination et de la propagande tyrannique, aux dépens des cultes non-Grecs de ses états Catholiques, Protestants, Juifs, en ont souffert et s'en sont plaints. Vous vous rappelez les religieuses persécutées, les Jésuites bannis, les Provinces Baltiques tracassées, les Juifs de Lithuanie transportés en masse. Il y a eu certainement là de quoi réclamer au nom de la liberté religieuse. Mais on ne s’inquiète jamais assez de savoir la vérité des faits et de ne parler que dans la mesure de la vérité. Je comprends qu’on se préoccupe des lenteurs de l’Autriche ; je n’y mets, pour mon compte que très peu d'importance ; je suis de l’avis de Gréville ; à cause de la Prusse, l’Autriche ne peut faire autrement. Le dénouement sera le même : ou bien vous vous déciderez à faire la paix, une paix désagréable pour vous, mais nécessaire, ou bien l’Autriche prendra décidément parti contre vous et la Prusse elle-même un peu plus tard. Au point et dans le courant où sont les choses, cela me paraît inévitable.
C'est étrange qu'Orloff ait été si insolent avec l'Empereur d’Autriche de deux choses l’une ou le comte Orloff n’a pas autant d’esprit qu’on lui en donne, ou s’il n'a fait qu’agir selon les instructions de votre Empereur, votre Empereur s'est bien trompé sur le caractère et la situation du jeune souverain auquel il avait affaire. Infatuation ! Infatuation. C'est la maladie des jolies femmes, des peuples en révolution et des souverains absolus. J’aurais certainement pris plaisir à causer avec votre jeune Prince de Nassau. Je me le rappelle, très bien. Ces deux ans passés à parcourir l’Amérique du nord, lui font honneur.
Onze heures et demie
Rien dans les journaux, ni du Danube, ni d’Espagne. Deux lettres de Paris qui ne m’apprennent pas. L'Impératrice n’est pas grosse puisqu'elle va prendre des bains de mer. Adieu, Adieu. G.
123. Paris, Dimanche 2 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre lettre reçue ce matin ; elle était bonne et intime. Je vais répondre à vos questions. Mon fils a beaucoup de chagrin de la rupture de son mariage. Il dit que la jeune personne a pour lui un amour très visible mais qu’elle a plus d’amour ou de crainte pour sa religion. Son oncle Acton qui va être fait cardinal exerce sur son esprit un grand empire. Elle croit ne pas pouvoir sauver son âme si ses petits garçons sont protestants. Mon fils est parti très brusquement après qu’elle lui a déclaré sa résolution ; il ne souffre, mais il espère encore. Il loge dans la maison à côté de Flahaut un appartement charmant que je lui ai trouvé. Il m’accompagne dans toutes mes promenades. Nous allons presque tous les jours à St Cloud. Longchamp depuis votre départ m’a paru bien ennuyeux.
Tout le monde parle de l’affaire de la Suisse sans comprendre comment elle finira. Louis Bonaparte y reste, cela est sûr. Pour le moment je pense que le rappel de l'Ambassadeur sera la seule mesure qu'on prendra, mais c’est peu de chose. Nous nous retirerons peut-être aussi tous les trois, mais les Suisses s’en consoleront. On s’étonne un peu que la Russie ait si vite et si fermement soutenue là dedans votre gouvernement. Mais c’est que, à part les caresses, vous nous trouverez peut-être meilleurs collègues que tous les autres. L’Empereur évite tout ce qui peut vous donner ombrage. Par exemple il n'a jamais reçu chez lui à Toplitz La Feronnays ou Marmont. Il ne les a vus qu'à leur promenade publique. Il a toujours beaucoup aimé M. de La Ferronays. M de Stakelberg a donné hier à dîner à mon fils qui a longtemps servi sous ses ordres. J’y ai dîné aussi & mon Ambassadeur & Médem. De là j'ai été à Auteuil. J’y ai trouvé M. Molé très entouré de la diplomatie. Il me dit qu’il est plus que jamais accablé de travail. Il a pris l’intérieur dans l'absence de M. de Montalivet. Il y avait hier plus de monde que de coutume à Auteuil. On ne sait pas où est l’Empereur de Russie dans ce moment. Il est attendu partout, et il ne parait nulle part. Le 15 Septembre lui & l’Impératrice seront. à Berlin.
Les derniers mots de votre lettre me plaisent et me font du bien. J'ai l’âme un peu moins triste depuis l'arrivée de mon fils, mais toujours ce silence inexpliqué de mon mari me donne beaucoup de chagrin. Je ne sais que penser, et l’avenir me parait abominable. Mon fils aîné me mande que si sa situation secondaire doit se prolonger il quittera le service, & pour ce cas l'idée de venir vivre auprès de moi est ce qui la donne le plus de plaisir. Adieu. Adieu. Adieu, trouvez-vous que c'est assez ? Par moi.
143. Val-Richer, Jeudi 27 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avez-vous décidé le jour précis de votre retour à la Terrasse ? Dites-le moi, je vous prie. Tout à l’heure, en rentrant dans mon cabinet, j’ai été vous y chercher, couchée au fond, sur le canapé vert. C’est là que je vais naturellement. La réflexion seule me mène rue de la Charte. Je ne sais si vous vous y trouvez chez vous ; pas moi. Si vous aviez été chez moi ce matin, réellement chez moi, ici, vous auriez pris plaisir à voir la joie de mes cygnes. Je ne sais ce qui les charmait particulièrement; ils battaient de leurs grandes ailes, couraient sur l’eau, plongeaient, s’envolaient, revenaient avec de vrais transports. Je crois qu’ils étaient contents l’un de l’autre. C’est la seule manière d’être content.
Je suis bien aise que vous ayez pris votre parti a l’égard de Marie. Ne pêchez pas dans l’exécution. Pour peu quelle ait de bon sens, elle s’arrangera comme il vous convient et comme le veut la raison. Et si elle ne s’arrange pas, c’est qu’elle n’a vraiment aucun bon sens. Vous m’avez parlé de sa sœur comme ayant plus d’esprit. Seriez-vous tenté d’en courir encore la chance ?
On fait réellement un armement sur la frontière de Suisse. Trois brigades, de six bataillons chacune, environ 15000 hommes , si c’était sérieux, ce serait trop peu. Le Roi a eu querelle avec les gens de la guerre. Il a voulu dix batteries d’artillerie. Ils n’en voulaient que quatre. On a querelle aussi avec le maréchal Vallée. Il veut plus que le budget en fait de troupes et on ne lui donne pas tout le budget. Je n’entends rien dire du procès Brossard qui va recommencer.
Vendredi 7 h. 1/2
Vous avez bien raison. Les lettres sont un pauvre moyen d’entretien. Nous nous disons plus en une heure que nous ne savons nous écrire en huit jours. Je ne connais rien de plus charmant qu’une conversation intime. Et on peut avoir tous les mérites du monde, et point ce charme-là.
Mad. de Broglie l’avait, surtout à cause du grand mouvement de son âme. Autrefois, au moindre prétexte, dès qu’elle se sentait atteinte par quelque côté, elle se mettait elle-même et toute entière dans l’enjeu de la conversation. Dans tout ce qu’elle disait quelque fois très loin, mais très clairement, on voyait la personne, une personne, très vivante, très intelligente, qui démêlait et saisissait sur le champ, partout, ce qui pouvait l’intéresser directement, intimement. On na jamais été plus femme qu’elle ne l’était par là. Depuis quelques années, elle avait réussi à s’oublier ou à à se cacher mieux elle-même, et à causer avec plus de désintéressement ou d’indifférence. Elle a laissé deux manuscrits intéressants, l’un est une espèce d’exposé de sa foi religieuse. J’ai lu celui-là. L’autre, un projet d’ouvrage sur la condition des femmes dans l’état actuel de le société. Elle m’en avait plusieurs fois parlé mais je n’en ai rien lu.. Ce n’est qu’un projet, mais long et le développé dans quelques parties. C’était une imagination prodigieusement active, et qui souffrait intérieurement de sous activité.
10 h. 1/2
Une pluie énorme a encore retardé mon facteur. Vous êtes bien triste. Hélas, je voudrais vous envoyer autre chose que de la tristesse. Quand je serai là, je tâcherai de vous apporter autre chose. De loin, aujourd’hui, je n’ai que cela, et mon affection, qui ne peut pas grand chose. Je le vois bien. Albert est arrivé à Broglie, avant-hier au soir. Ils vont à Paris aujourd’hui. La raison que vous supposez au défaut de prêtre n’a aucun fondement. C’est le temps qui a manqué. Peut-être aussi n’y a-t-on pas pensé. Pour moi, je suis arrivé le dimanche à 4 heures et les obsèques ont eu lieu le lendemain à 10 heures du matin. Il n’y avait pas moyen d’y faire penser. Aussi tendrement que tristement. Adieu. Adieu. Ma mère est assez bien.
144. Val-Richer, Vendredi 28 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir parlé de ma mère. Elle a été un peu souffrante. Elle est bien aujourd’hui, quoique très, très affligée. Mad. de Broglie était avec elle filialement. Mais je suis sûr que je vous en ai parlé. Ma mère d’ailleurs a une attitude admirable envers la douleur ; elle la supporte sans s’en défendre. Je n’ai jamais vu personne qui l’acceptât plus complètement sans s’y abandonner, qui en parût plus rempli et moins abattu. Elle y est comme dans son état naturel. Il n’y survient rien de nouveau pour elle et le plus ou le moins ne change pas grand chose à sa disposition, toujours triste mais toujours forte. Je l’ai fait beaucoup promener ces jours-ci. Je l’ai fatiguée. Et puis mes enfants ne la quittent guère. J’ai beaucoup travaillé ce matin. J’avais besoin aussi de me fatiguer. J’en suis convaincu comme vous. On ne comprend que les maux qu’on a soufferts. A ce titre, j’ai bien quelque droit à vous comprendre, pas assez peut-être. Il est vrai que je suis moins isolé. Que ne puis- je vous guérir au moins de ce mal-là ! L’autre resterait. Je l’ai vu rester. Mais ce serait celui-là de moins. Je ferai mieux de ne pas vous écrire ce soir. Je suis si triste moi-même que je ne dois rien valoir pour consoler personne, pas même vous que je voudrais tant consoler, un peu !
Samedi 7 heures
Je suis frappé du peu que nous pouvons, du peu que nous faisons pour les autres, et pour nous-mêmes. Dieu m’a traité plusieurs fois avec une grande faveur. Il m’a beaucoup ôté mais il m’avait beaucoup donné et souvent il m’a beaucoup rendu. J’ai reçu le bien, j’ai subi le mal. J’ai très peu fait moi-même dans ma propre destinée. Nous ne réglons pas les événements. Nous sommes pris dans les liens de notre situation. Nous oublions cela sans cesse. Nous nous promettons sans cesse que nous pourrons, que nous ferons. C’est notre plus grande erreur que l’orgueil de nos espérances. Voilà Louis Buonaparte éloigné. C’est une grande épine de moins dans le pied de M. Molé. La marque, en restera, mais pour le moment, il n’en sent plus la piqûre. Entendez-vous dire que la session soit toujours pour le 15 Décembre ?
Vous êtes bien bonne d’attendre mes lettres avec impatience. Qu’ai je à vous mander ? Point de nouvelles. Mon affection n’en est pas une. De près, tout est bon, la conversation donne une valeur à tout. De loin, si peu de choses valent la peine d’être envoyées !
9. 1/2
Je ne comprends, rien à cette incartade. Est-ce en effet une intrigue cosaque ou bien seulement quelque commérage subalterne qui sera monté haut, comme il arrive souvent aujourd’hui ? Je penche pour cette dernière conjecture. En tout cas, vous avez très bien fait d’aller droit à M. Molé. Il est impossible qu’il ne comprenne pas l’absurdité de tout cela et n’empêche pas toute sottise, au moins de ses propres journaux. Ne manquez pas de me dire la suite, s’il y en a une. Quelles
pauvretés !
Je suis bien aise que vous ayez un N°2. Je vous renverrai demain la lettre de Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Je reçois je ne sais combien de lettres qui me demandent des détails sur cette pauvre Mad. de Broglie. Est-il possible qu’on soit contraint de rabâcher, sur un vrai chagrin. Adieu. G.
145. Val-Richer, Dimanche 30 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens à M. de Pahlen. Ce qu’il vous à dit me paraît singulier à force d’être absurde. Que de tels propos fussent tenus en hiver, quand il m’arrive de rencontrer quelques fois chez vous Thiers le matin ; Berryer le soir, je le concevrais ; il ne faut pas aux commérages un meilleur prétexte. Mais à présent en l’absence de tout prétexte une correspondance quand vous n’avez pas écrit du tout, cela ne peut venir que de très loin, comme vous dîtes ou de très bas. Ce ne peut être qu’un retentissement des rencontres de l’hiver dernier, qui revient du bout du monde, ou un propos d’antichambre. Il est impossible que le Ministère quelque susceptible, quelque ombrageux que je le sache, quelque goût que je lui connaisse pour les rapports et les tracasseries de polices soit pour quelque chose là dedans. M. Molé vous aura, je n’en doute pas, édifiée de ce côté. Reste la supposition lointaine. Nous verrons. Il n’y a pas moyen de la vérifier sur le champ. Cependant elle me paraît bien invraisemblable. Je persiste à croire à des bavardages subalternes qui auront étouffé votre Ambassadeur. En tout cas, je lui sais gré de vous avoir avertie.
Je vous renvoie la lettre de Lord Aberdeen. Celle de Lady Clanricard est intéressante. J’en ai reçu une qui l’est assez ; de M. de Barante, d’Odessas, pleine de la Grèce et de la Turquie. Athènes et Constantinople. Deux choses surtout l’ont frappé. Colocotroni et Nicitas, les noms qui ont retenti héroïquement en Europe s’épuisant en intrigues et en humilités pour un traitement de 1500 fr. ; les Turcs qui ne sont plus Turcs ne disent plus Chiens de Chrétiens, confessent à tout propos leur infériorité et s’efforcent de nous imiter sans espérer d’y réussir. Il me dit en finissant : " Si les grandes puissances le veulent, s’il s’établissait quelque concert dans le patronage qu’elles exercent, le rajeunissement d’Eson ne serait pas impossible. La Turquie se transformerait peu à peu en un état subalterne qui prospérerait plus ou moins. Il se placerait au même rang que la Moldavie le Valachie ou la Grêce. Mais si la bonne volonté de chaque Cabinet demeure isolée et méfiante, le cadavre de l’Empire Ottoman tout en demeurant debout avancera chaque jour dans sa dissolution, et au premier incident il tombera en poudre. Le premier soin à prendre serait de faire cesser cet état provisoire et menaçant d’hostilité entre l’Egypte et Constantinople. Autrement nulle sécurité, nul progrès dans l’Orient. Je ne réponds pas qu’une telle résolution, soit possible à décider et à exécuter ; mais il m’a paru quelle était nécessaire. "
Je vous enverrais la lettre même, si elle n’était pas très longue et écrite si fin que vos pauvres yeux se perdraient à la lire. Vous avez la substance. Lord Aberdeen attache trop d’importance au Mexique et à la côte d’Afrique. C’est un reste de la vieille politique Torry, que cette disposition hargneuse à notre égard sur les petites choses, ne pouvant et ne voulant rien autre que les Whigs sur les grandes. Grandes et petites choses se tiennent. On se fait petit soi-même à retenir les secondes quand on abandonne les premières. Lord Aberdeen devrait porter dans sa politique extérieure, sa nouvelle disposition dont il vous parle pour ses relations privées. Party violence convient encore, moins aujourd’hui au dehors qu’au dedans, et national animosity doit être entirely subdued aussi bien que personal animosity. Du reste la simplicité tranquille et haute de son ton et de son caractère me plaît toujours beaucoup.
10 h.
Non je ne veux pas vous refaire ; n’on, je ne vous reproche pas votre franchise ; bien au contraire, je vous en aime. Et vous voyez bien que votre impression ne peut me déplaire puisque je l’ai eue avant vous, puisque c’est moi qui l’ai suscitée en vous. Mais vous ne connaissez pas ce pays-ci. Vous ne savez pas ce que c’est qu’un village tout catholique, et les habitudes qui en résultent dans la famille Protestante la plus pieuse. A demain les détails, car je veux vous répondre avec détail. Je ne veux pas qu’il vous reste sur le cœur autre chose, qu’un regret. Adieu Adieu. Je suis fort aise de votre conversation avec M. Molé. Cela empêchera toujours quelque chose. Adieu. Calmez-vous au moins sur les loups. Un long adieu. G.
146. Val-Richer, Lundi 1er octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mad. de Broglie est morte samedi matin. Mardi matin son mari a réuni, selon l’usage, dans la bibliothèque, toute la famille, maîtres et gens, s’est assis dans le fauteuil de sa femme, a ouvert l’évangile à la page où on était resté quand elle était là, et a fait à sa place, comme elle, la lecture et la prière. Il en fait autant tous les jours. Le culte domestique était l’habitude de le maison. Personne n’est protestant dans le village dans le pays. Mad. de Broglie, avait découvert à grand peine deux ou trois suisses ou allemands qu’elle faisait venir au château. Le curé du lieu, prêtre exact et respectable est d’un esprit court, étroit et fanatique. Il surveillait avec inquiétude Mad. de Broglie, et ne doutait pas qu’au fond, elle ne travaillât à rendre tout le pays protestant. Jamais un Ministre, un sermon, une prière de couleur protestante n’est sortie de l’intérieur du château. Tout s’y renfermait. Un prêtre protestant venu de Paris, parlant et priant au milieu de cette population toute catholique, dans ce cimetière catholiquement béni à deux pas de la petite enceinte réservée, en droit cela se pouvait; en fait cela se fût passé très paisiblement ; la population eût écouté avec approbation et respect, mais pour les dévots du lieu, pour le clergé, le trouble eût été grand. Je ne sais ce qu’ils auraient dit. On n’a pas pensé à tout cela, pas du tout. Mais on a agi sous l’influence de ces faits là. On s’est conduit selon les habitudes. La religion s’est renfermée dans la maison. On a prié, en famille, auprès du lit de mort; on a prié pour elle comme elle eût prié elle-même, comme si elle eût pu entendre. Je suis persuadée que l’idée n’est pas venue de faire autrement. Elle m’est venue à moi, et je vous l’ai dit. Mais je me suis expliqué qu’elle ne fût pas venue aux autres, et je vous l’explique comme à moi-même. Soyez sûre que c’est la vérité, et que le duc a le cœur parfaitement tranquille, qu’il croit sa femme bien et dûment reçue au sein de Dieu qu’il n’a pas cessé un instant d’être en rapport pieux avec elle. Il n’est pas léger du tout, ni d’esprit, ni de cœur.
Je ne veux pas que vous soyez blessée. Je veux que vous compreniez ce qui mérite d’être compris de vous. Mais je vous aime de votre impression, de votre colère, de votre franchise. Restez comme vous êtes et dites-moi toujours tout. Même vos intrigues politiques, quand vous en ferez. Je serais très choqué que vous en fissiez sans moi. Je vous dirai les deux ou trois petites choses qui, peut-être ont pu donner prétexte à ces ridicules commérages. A force de regarder où il n’y a rien, on finit par découvrir je ne sais qu’elle ombre qu’avec beaucoup de bonne volonté quelque passant curieux, léger, malveillant, bête, a pu transformer en un corps. Je suis persuadé qu’il n’y a rien de plus.
Je parie que le redoublement d’humeur contre l’Empereur vient de Munich. Il y est resté longtemps. Les grandes Duchesses aînées sont venues à Weymar, de là à Berlin. Le Prince Royal de Bavière y va. Il y aura là une entrevue, puis un mariage. Celui qu’on recherchait d’ici est manqué. L’Empereur aura dit et fait, à ce sujet, beaucoup de choses désagréables, offensantes. Voilà, ma conjecture. Je n’ai jamais cru que les grandes Duchesses fussent sérieusement laissées à Pétersbourg. On n’a pas voulu qu’elles vinssent, du premier saut chercher elles-mêmes des maris. On a ménagé les convenances. Mais on a cherché, les maris pour elles. Et puis elles sont venues. Et puis, et puis... Je suis fâché de deux choses ; que notre mariage soit manqué, s’il l’est et qu’il vous vienne de là quelque ennui. Mais j’espère que ce ne sera rien.
9 h. 1/2.
Ma mère est bien depuis deux jours. Elle m’appelle pour aller voir je ne sais quoi dans le jardin. Je sors avec elle autant que cela lui plait, Adieu. Adieu. Les Débats que je viens d’ouvrir ne guériront pas le chagrin de M. de Pahlen. Adieu. G.
155. Val-Richer, Mercredi 10 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici la proposition que je viens de recevoir. Il paraît qu’il y a des gens qui ont envie de fonder une nouvelle religion, de faire, dans le catholicisme et le Protestantisme, une nouvelle réforme. Ils m’ont écrit pour me proposer d’être leur Pape. Le Maréchal de Brissac, montrant un jour le crucifix à son fils enfant lui disait : " Regarde bien Timoléon, voilà ce qu’on gagne à vouloir changer la religion de son pays. Je n’ai encore gagné que la proposition d’être Pape. A la vérité je ne veux point changer la religion de mon pays, et n’ai rien fait pour cela. Je me suis borné à en parler très respectueusement. " Un autre Monsieur, qui est Juif et s’appelle M. Salvador vient de faire un gros livre pour prouver que le Christianisme est fini, et qu’il faut revenir au Judaïsme en l’accommodant à notre temps. Il m’écrit aussi pour me conjurer d’engager avec lui une polémique, afin qu’à nous deux nous vidions cette grande querelle. Est-ce que j’ai dit assez de sottises pour attirer vers moi ceux qui en font ?
J’ai eu un moment l’envie de vous engager à lire les écrits de Mad. Guyon. Il y a quelquefois des choses très touchantes, très pénétrantes, très belles, qui auraient bien été à la disposition de votre âme. Mais j’ai rouvert le livre, et je ne vous en ai pas parlé C’est trop fou. Vous avez la combinaison la plus difficile à satisfaire, beaucoup d’imagination et beaucoup de bon sens, l’âme tendre et l’esprit positif, ce qui met sur le chemin de la folie et ce qui en écarte. Et puis les livres n’ont pas grand pouvoir sur vous. Il vous faut des actions et non pas des paroles. J’ai pensé à tout cela cette nuit, ne dormant pas. C’est pourquoi je vous parle.
Je viens de me lever. Le temps est admirable. Le soleil achève de dissiper un brouillard qui roule en s’en allant, sur les bois et sur les prairies. L’air et ma vallée sont pleins de mouvement, et d’un mouvement où la bonne cause triomphe. Dans une heure tout sera charmant autour de moi. Une longue promenade ensemble sous ce soleil brillant, dans cet air frais, nous ferait plus de bien à tous deux que tous les livres du monde. On dit que Louis Buonaparte est parti de Suisse. Convenez qu’il est difficile de faire plus ridiculement sa volonté et de moins bien finir une affaire qu’on finit. Si nous vivions dans un temps où les esprits fussent un peu exigeants, un peu hauts, il y aurait là de quoi perdre un Cabinet. Mais nous sommes à une époque de bon marché, comme on dit. On veut un gouvernement bon marché. on s’en contente à bon marché. Le salon de la Terrasse est-il bien arrangé ? On n’a rien changé dans le petit cabinet, n’est-ce pas ? Verrez-vous beaucoup les Holland ? Sont-ils à l’hôtel de Bath ? Que c’est ennuyeux de vous faire des questions ! Quand je serai là, je saurai tout.
10 h.
Je suis charmé que votre monde vous soit arrivé. Nous causerons ce soir. Adieu. On m’attend en bas pour je ne sais combien de petites affaires. Adieu Adieu. Dormez donc. G.
175. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
212. Paris, Lundi 8 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'ai dîné seul. Je viens de faire seul le tour des Tuileries. Contre la coutume, je n’ai pas rencontré une âme de ma connaissance. J’ai passé solitairement devant cette pauvre Terrasse aussi solitaire que moi. Toujours fermée. Je l’aime mieux. Il me déplairait de la voir en possession d'un autre. Quand vous serez dans Paris, à la bonne heure. Encore cela me déplaira. Ces maisons où tout le monde passe et ne fait que passer cela ressemble trop au monde et à la vie. Il faut quelqu'un qui reste et un lieu où l'on reste. Un Roi anglo-saxon donnait un grand festin à ses guerriers ; deux croisées ouvertes aux deux bouts de la salle bien décorée et bruyante. Un oiseau entra par une croisée et sortit par l'autre, à tire d'aile ; puis un second, puis un troisième. Le Roi les regardait, à peine avait-il le temps de les voir. Quelques uns voltigèrent un moment au dessus de la tête des convives, puis s’envolèrent comme les autres. Un seul vint se poser sur l’épaule du Roi. Le Roi fit fermer les croisées et le garda. Le lendemain, le Roi aimait l'aisance, et l'oiseau le Roi. On rouvrit les croisées. L'oiseau ne s’en alla point.
J’ai eu ce matin une visite qui ne m'a pas donné la moindre envie de la garder. Un prêtre entre dans mon Cabinet, une figure honnête et animée. Il me raconte qu’il est Espagnol, mais depuis quelque temps employé par M. l'archevêque de Paris. Il avait été placé auprès du curé de S. Nicolas des Champs. Le Curé lui a dit du mal du Roi Louis Philippe et a voulu qu’il prêchât contre les Protestants. Cela l’a choqué. Il me demande de le tirer d'embarras. Puis tout-à-coup il se lève me saisit par les deux bouts du collet de mon habit en me disant : " Je vais vous dire la messe ; il faut que je vous dise la messe. " Prenez garde, lui ai-je dit ; ce serait une profanation ; je suis Protestant." Il a été confondu, a pris son chapeau et s’en est allé. Je crois que j’ai de l’attrait pour les fous. J'ai reçu plusieurs visites pareilles depuis quelques années.
Notre séance a été parfaitement insignifiante : des colères contre le chemin de fer de Paris à Versailles par la rive gauche ; très légitimes. Les Pairs ont fini d’entendre les plaidoiries. Ils entreront demain en délibération pour l’arrêt. Ils avaient eu quelque envie d'entrer en séance à 8 heures du matin et de n’en sortir qu'après avoir fini, tout fini. Mais ce serait trop long ; probablement 10 ou onze heures du soir. Ils y mettront deux jours. Le premier jour, ils voteront sur la culpabilité de tous les accusés ; le second, sur la pénalité.
Mardi 10 h. et demie
Je ne sais pourquoi les bains de Houblon vous choquent. Je les ai vu employer avec succès. Ne vous en découragez pas. Je suis du parti de votre médecin. Je n'ai aucune confiance en vous pour le management de votre santé. Il faut écouter avec grand soin tout ce que vous en dîtes, car vous avez des impressions très vives et probable ment très justes, qui doivent fournir des indications précieuses. Mais il ne faut pas vous croire sur ce qu’il y a à faire ou à ne pas faire, car vous n'en croyez jamais, vous que votre impression du moment, moyen très trompeur de gouvernement. Il faut consulter sans cesse le baromètre pour comprendre le temps qu’il fera. Mais Dieu ne règle pas le temps selon les variations du baromètre.
Deux choses me préoccupent sans cesse, votre santé et votre cœur. Je ne demande pas mieux que de regarder dans celui-ci tout au fond. Mais aussi, je suis difficile très difficile. Je suis charmé que vous approuviez mon discours. Vous avez mille fois raison. On ne peut pas faire sur cette question là. Personne ne veut faire, Tant mieux. Le moment n’est pas venu. Adieu. Adieu. Il faut que je vous quitte. J’ai cinq ou six lettres à écrire ce matin. Adieu. G.
221. Baden, Vendredi 19 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
239. Baden, Dimanche 11 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je me sens aujourd’hui plus faible que de coutume. Mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai bien besoin de vous pour me remettre, j’ai besoin de votre affection, de vos soins, de vos conseils, il me faut un appui. Je vous assure que je ne me conçois pas livrée encore pour bien des mois à mes seules ressources, c'est à dire à mes bien tristes pensées. Vous ne savez pas comme elles sont tristes ! Comme elles le deviennent tous les jours davantage. Les journaux confirment ce que vous me dites des nouveaux embarras ministériels. Mais je ne crois à rien. Ils iront comme ils ont été. Les Flahaut sont menacés de perdre leur seconde fille, elle crache le sang. C’est pour elle qu’ils viennent aux Eaux en Allemagne et qu’ils iront ensuite passer l'hiver en Italie.
1 heure. J’ai été à l’église. Toujours un superbe sermon. Le texte était votre lettre. Nous reverrons ceux que nous avons aimés, mais j'aime encore mieux votre lettre que ce superbe sermon. Vous avez raison. Je viens de recevoir une seconde lettre de Benkhausen qui explique tout, comme vous le dites.
J’ai l’administration et non la possession du Capital. J’écris de suite à mon frère, pour tout remettre à sa place. J'ai du regret d'avoir mal compris, pour dire la vérité c’est Mad. de Talleyrand et Bacourt qui me l’ont fait comprendre comme cela ; car vous savez bien que moi, je ne m'y entends pas. Mais il faut absolument que ce soit moi qui lève l’argent. Les droits en Angleterre emporteront 1000 £ ce qui réduit le Capital à 44800 £. Pouvez-vous me dire si dans le plein pouvoir que j’ai donné à Paris à mon frère, il est suffisamment autorisé à faire pour moi cette opération ? Je vous envoie copie de la lettre que je lui écris. Savez-vous bien que je me sens toute soulagée par cette lettre de Benkhausen ? C’est si vrai qu’étant fort malade ce matin me voilà mieux. Je suis débarrassée de ces richesses imaginaires qui m'étaient on ne peut plus désagréables.
Je viens de lire des rapports de Vienne. Vos Ambassadeurs, le vôtre, celui d'Angleterre et l’internonce sont de parfaites dupes. Le divan est entre les mains de M. de Bouteneff et c’est par lui que le divan négocie avec Méhémet Ali. Je vous dis ce qui dit la diplomatie à Vienne. Metternich est fort inquiet de ce que nous ne parlons pas. Ne vous ai-je pas toujours dit que c’était notre affaire et que nous n’entrerions pas en causerie sur cela. Adieu. Adieu mille fois, adieu. Je reçois dans ce moment une lettre de mon fils Alexandre du 31 juillet dans laquelle il me dit qu’on venait de recevoir les nouvelles de la défection du Capitan Pacha, & de la défaite de l'armée Turque, que comme cela amènera des complications graves que peuvent influer sur mes projets pour cet hiver, il se hâte de m’en donner avis !
288. Val-Richer, Lundi 14 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici une lettre pour M. Gréterin, directeur des douanes. Je la laisse ouverte pour que Génie la lise et sache bien ce que je demande. Priez-le de la porter de ma part à M. Gréterin après l'avoir cachetée, et de demander la réponse. Je crois qu’il faut une décision du Ministre des finances. Mais M. Gréterin la lui demandera. Je ne veux pas qu'on vous brise le vase en vermeil, et encore moins le buste, en marbre. Est-ce que vous ne pouvez-pas garder Pippin jusqu'à ce que vous ayez trouvé un maître d'hôtel qui vous convienne ? Je sais bien que vous en aurez encore plus de peine à lui faire dire une seconde fois qu’il faut qu'il s'en aille. Cependant j'aimerais mieux cet ennui-là que celui de prendre à la hâte le premier venu. Vous avez quelques fois des hésitations, et quelquefois des précipitations singulières. Entendez-vous dire qu’il y ait quelque chose de sérieux, dans la maladie de Méhémet dont parlent les journaux ? Ce serait encore un dénoue. ment inattendu. Je le regretterais. Le monde n'a pas de gens d’esprit à perdre.
Mardi, 7 heures et demie
Dites moi pourquoi je viens de passer une nuit très agitée, de revoir en rêve toute ma vie, ce qu'elle a eu de plus doux et de plus cruel, vingt cinq ans en quelques heures ! La même Puissance dispose donc de nous, sans nous, la nuit comme le jour, et des chimères comme des réalités. Elle devrait bien laisser la nuit au repos. Je suis brisé ce matin. Quelque confiance qu’on ait dans sa propre vie, si on avait dit au général Sébastiani que son maître d’hôtel, que je connais bien et qui le servait depuis très longtemps serait frappé d’apoplexie avant lui dans Hertford-House, on l'aurait, je crois, bien étonné. Je vous voudrais un maître d’hôtel comme celui-là de fort bonne mine, quoique trop petit, très entendu et très attaché.
Est-il vrai que l'Empereur (il ne me plaît pas de dire votre Empereur) entreprend de miner en Pologne la religion catholique, qu’il a déjà enlevé la moitié des Eglises polonaises au culte catholique pour les donner au culte grec &&. La liberté religieuse était la seule en Russie. C’était même un singulier spectacle que de voir deux états nouveaux, aux deux extrémités du monde, le plus despotique et le plus républicain que le monde ait encore vus, la Russie et les Etats-Unis commencent l'un et l'autre leur carrière, par cette tolérance, qu'au bout de six mille ans le monde civilisé a commencé à peine à entrevoir.
9 h. 1/2
J’aime bien le N°285. Il me rend compte des moindres détails de votre vie, personnes et choses. à cette condition seulement, la séparation est supportable ce qu’elle n'est jamais. Je suis charmé que vous ayez un maître d’hôtel. Mais il faut que le hasard couvre le mal de a précipitation. Cela arrive. Adieu.,Adieu. Non pas mille fois, mais mille vies. G.
J'adresse ma lettre rue Florentin, vous m'auriez averti si quelque chose était changé dans vos projets.
289. Val-Richer, Mardi 15 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Prenez-vous quelque intérêt à la querelle du Roi de Prusse avec ses sujets catholiques. Je soupçonne l’archevêque de Posen de s'être enfui pour être repris, et pour attiser un peu le feu que le Gouvernement Prussien essayait de calmer. Rome est encore avec les états protestants comme les Princes légitimes avec les sujets rebelles. Ils se croient tout permis et ne se tiennent jamais pour obligés à rien. Et cette perfidie arrogante les perd plus que toute autre cause. On finit par se persuader qu’il n'y a pour en finir avec eux, d'autre moyen que la force et l'extermination. Je ne sais ce que vous aura dit Lord Granville ; mais malgré son aigreur, le Morming Chronicle a bien envie qu’on ne se sépare pas de nous. Je parie toujours que l'affaire s'arrangera du consentement de tout le monde. On veut bien se bouder, se taquiner ; mais personne ne veut se brouiller avec personne.
Dit-on les nouvelles propositions de l'Angleterre comme on me les a dites, la moitié de la Syrie au Pacha, sauf St Jean d’Acre et en cas de besoin, toutes les flottes ensemble à Constantinople ?
Quand vous aurez le Lord Chatam, dites-moi ce que vous pensez de ce caractère-là. J’aime bien mieux votre impression que le livre, que je lirai pourtant à mon retour.
Il me vient des nouvelles de Thiers, toujours plus aigre contre MM. Passy et Dulaure, et de plus en plus embarrassé de la Réforme électorale. Si les affaires d'Orient s’arrangent, il sera en effet fort embarrassé, car il n’y aura point de champ de bataille au dehors ; il faudra en chercher un au dedans, et il n’aime pas, ceux-là.
Du reste plus militaire que jamais ; la tête lui tourne des guerres impériales ; il ne parle que de l’armée de la triste condition de l’armée du peu qu’on fait pour elle qui est pourtant le seul appui du pouvoir. A Lille, il assiste à toutes les revues, et passe sa vie avec les officiers de la garnison. Sa femme est de nouveau fort malade.
Mercredi, 8 heures
Quand vous verrez Tscham soyez assez bonne pour lui demander si M. Eynard et M. Naville de Châteauvieux sont à Genève en ce moment. Il doit le savoir. Hier, je n’ai pas mis le nez hors de la maison. Il a pli tout le jour. Ce matin il fait le plus beau soleil du monde. Beau sans chaleur, ce qui n’est jamais qu'une demi-beauté. La lumière ne suffit. pas ; il faut le feu. Il me semble que ma toux s’en va tout à fait. Mais je sens bien que l’humidité me la rendrait. Il me déplaît que vous vous soyez établie sans moi rue St Florentin. J’aurais voulu assister au début, et le partager. Vous trouvez-vous bien ? Je regarde avec plaisir ce soleil qui brille sur vous. De qui vous vient le maître d’hôtel que vous avez pris ?
9 heures et demie
J'ai besoin de relire la note de Bruxner pour la bien comprendre et vous l'expliquer. Ce n’est pas trop de notre esprit à tous deux. A demain les affaires. Adieu. Adieu. G.
292. Val-Richer, Samedi 19 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Hier au soir à 9 heures, en traversant la bibliothèque pour rentrer dans mon Cabinet, je me suis arrêté devant le plus beau clair de lune du monde. La bibliothèque en était éclairée. J’ai transporté cette lumière blanche et douce, ces bois, ces prairies, le bruit de l’eau et vous et moi, à deux cents lieues vers le midi, sous un ciel chaud et embaumé. C’était charmant. Gardez, je vous prie votre esprit comme il est fait. Je n'accepte pas en place celui du baron de Krudener. Sa mère était-elle vraiment aussi séduisante, qu’on l'a dit ? Elle a fait un roman qui s’appelle Valérie et qui a charmé ma toute première jeunesse. Mais cela ne prouve rien. Je me fais tort pourtant, tous les romans ne me charmaient pas. Aujourd'hui, je les trouve bons au dessous de ce qui se pourrait et se devrait. L’expérience de la vie, m'a appris qu'un jour une heure d'affection et de bonheur vrai est infiniment au dessus de toute l'éloquence et de toute la passion des plus beaux romans.
Je comprends vos ennuis de meubles, & j'en suis touché. Mais pas outre mesure. Ce que je crains beaucoup pour vous, ce sont les ennuis vides. Les ennuis pleins et pressés sont plus supportables. Je ne comprends pas comment vous mettrez la paix entre vos conseillés avec une tenture de soie dans le premier salon. N'a-t-il pas dû toujours y en avoir une ? N'était-ce pas là la place du meuble rouge à ramages jaunes de M. Jennison ? Puisqu'il n’y a pas réussi ; je suis bien aise qu’il ait essayé de vous duper. Il ne m’a jamais plu.
Je vois qu’en effet vous êtes sur le point de vous brouiller avec le pape. On dit que les évêques de Pologne lui ont écrit que l'Empereur avait formé, et commençait à exécuter le projet de renverser systématiquement toute la constitution religieuse et tous les rapports religieux de leur pays. Vous finirez par fournir un fait de plus à l'argument que M. Fox puisait contre la traite des nègres, dans la démence fréquente des capitaines négriers.
9 h.et demie
Quelle façon de faire les affaires d’une mère et d’une sœur ! Je suis pourtant bien aise que ce soit fini. Je ne crois guère à la possibilité de réclamer pour le mobilier de la terre de Courlande. Les plein- pouvoirs donnés à votre frère comprenait celui de transiger à ce sujet. Il en a usé et abusé, mais c’est fait. D'ailleurs, qui vous représenterait qui vous soutiendrait efficacement dans une contestation ? Vous ne pouvez pas avoir de contestation, à cette distance, dans un pays de loups, pour une affaire de vaches et de moutons. Laissez l'affaire là ; partagez le capital de Londres, et si vous dépensez rue St Florentin un peu plus d'argent que vous n'en avez, vendez quelques diamants. Ils vous donneront plus d'agrément en bons fauteuils et un jolis tapis que dans votre écrin. Adieu. Adieu. Nous trouverions bien assez de temps pour placer un Adieu. G.
340. Londres, Samedi 11 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’est pas le moins du monde question de la translation du corps de Napoléon en France. M. Molé me paraît peu au courant des Affaires étrangères. Car ici je ne vois pas pourquoi il mentirait. Du reste je ne suis pas surpris qu’il soit peu au courant. On ne l’aimait pas du tout dans le département, et parmi les gens qui y restent toujours, je n’en sais aucun qui prenne soin de l’instruire.
L’Angleterre a fait le geste pour Naples ; à l’heure qu’il est, l’amiral Stopford doit avoir saisi des bâtimens napolitains et les avoir envoyés à Malte où ils resteront en dépôt jusqu’à l’arrangement. Lord Palmerston est pourtant un peu préoccupé des conséquences possibles du coup. Nous nous emploierons à les prévenir et à amener un accommodement.
J’ai renoncé, bien contre mon goût et mon naturel, à la prétention de tout régler d’avance et pour longtemps. Mais pour ceci et dans les limites que je vous dis c’est parfaitement décidé. Il n’y a donc rien là, absolument rien qui dérange nos projets ni qui puisse nous causer aucun mécompte. Tenez pour certain que sauf les plus grandes affaires du monde ce qui ne se peut pas à Londres à cette époque.
Je serai à Paris d’octobre en Février avec ma mère et mes enfants. Il faudrait donc que je ne les fisse pas venir du tout d’ici là ce qui leur serait et à moi aussi un vif chagrin. Ils viendront donc en Juin, Notre seul dérangement portera, sur nos visites, de châteaux qui en seront, nullement supprimées mais un peu abrégées. Ces visites-là seront pour moi une convenance et presque une affaire. Ma mère le sait déjà et en est parfaitement d’accord. Je ne la laisserai pas seule à Londres. Mlle Chabaud viendra l’y voir au mois d’aout. Je ferai donc des visites, nos visites seulement un peu plus courtes. Il faut bien quelques sacrifices. Je voudrais bien sur cela, n’en faire aucun.
Que signifie cette phrase : "Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi "? Si vous parlez de mes devoirs, de mes premiers devoirs vous avez raison. Est-ce là tout ? Dites-moi. Et puis dites-moi aussi que vous vous associez à mes devoirs, et que vous m’en voudriez de ne pas les remplir parfaitement.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Famille Guizot, Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Protestantisme, Relation François-Dorothée, Religion, Réseau social et politique, Salon, Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)
345. Londres, Samedi 18 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de réussir dans une petite négociation qui a quelque valeur en elle-même et quelque importance pour moi. A la première nouvelle des vivacités de l’Angleterre à Naples, en causant avec Lord Palmerston et le voyant un peu préoccupé des conséquences possibles, une insurrection en Sicile, des embarras en Italie et, je dis quelques paroles des bons offices de la France et du parti que l’Angleterre en pourrait tirer. Elles furent bien accueillies. Elles le furent très bien à Paris. J’ai mené l’affaire vivement, et un courrier vient de partir hier soir pour Lord Granville qui acceptera la médiation de la France entre l’Angleterre, et Naples chargera la France de négocier au nom de l’Angleterre et lui donnera le pouvoir de suspendre les hostilités contre le pavillon Napolitain. Cela sera bon dans le cas particulier et d’un bon effet général. On verra que la France et l’Angleterre ne sont pas si près de se brouiller, ni si dénuées de confiance l’une dans l’autre. Lord Granville vous aura peut-être déjà parlé de ceci quand ma lettre vous arrivera. Ayez soin seulement de n’en pas parler la première. Du reste, je suppose que l’affaire une fois conclue, on n’aura rien de plus pressé que d’en parler. Je crois avoir bien saisi et bien poussé l’à propos.
3 heures
4 heures 3/4
384. Londres, Dimanche 31 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure et demie
Le voilà ce prétendu 388 qui est le 387. Où est-il allé ? Qui l’a arrêté en route? Je n’en sais rien. Je n’y comprends rien. Enfin le voilà, avec le vrai 388. J’ai passé une très mauvaise journée. J’avais l’imagination très noire. J’ai promèné mon mal partout, chez Lady Kinnout à Holland-House, chez Lady Jersey. Vous m’avez suivie partout, malade, mourante, je ne sais quoi. En rentrant, j’ai monté l’escalier quatre à quatre ; j’ai regardé sur ma table, s’il n’y avait pas une lettre quelque oubli de la poste, quelque voyageur. En ne voyant, rien, j’ai eu un mécompte comme si j’avais attendu quelque chose. Par moments, des moments bien courts, je m’en voulais de tant d’anxiète que les spectateurs, s’il y en avait eu, auraient à coup sûr, appelée tant de faiblesse. Ah, que les spectateurs sont sots ! Pour comprendre le chagrin, il faut sentir l’affection ; et l’affection, le chagrin, tout cela est personnel ; on ne le sent que pour soi-même. On passerait pour fou si on laissait entrevoir la millième partie de ces suppositions, de ces émotions innombrables, ingouvernables, qui obsèdent le cœur.
Il y avait dans la lettre du gros Monsieur, 386 une phrase dont je ne pouvais me délivrer : " Je me sens si malade ? " Je lisais cela partout, dans les yeux de mes voisins, dans les journaux du soir. Je n’y veux plus penser. Non, je ne veux pas vous faire courir la poste comme un courrier, ni vous forcer à traverser un jour de gros temps. Mais voulez-vous bien sérieusement que je ne sois pas trop impatient pour le 15 ? Voyons dites ; voulez-vous ? Convenez que j’ai un bon caractère. Rappelez- vous vos colères, vos reproches quand j’ai tardé d’un jour, quand je n’ai pas été parfaitement sûr. J’ai bien envie, pour me venger, de vous conter toutes les coquetteries que m’a faites hier Lady Kinnoul. Je voudrais bien savoir de quel droit lady Kinnoul me fait des coquetteries. Mais droit ou non, elles étaient bien coquettes.
Lord & lady Hatherton, lord et lady Manvers, lord et lady Cadogan, lord et lady Poltiemore, lord Liverpool, M. Leshington. Voilà le dîner. Personne, le soir à Holland house, Si ce n’est au bout de la bibliothèque, lady Essex, l’actrice Miss Stephens, assise au piano et chantant très agréablement pour Lord Holland et M. Allen. 3 heures J’ai été interrompu par la visite de Chekib. Effendi. Celui-là est intelligent. Il est pressant. aussi. Il a raison. Son Empire s’en va. Et si on fait naître là une guerre, quelle qu’elle soit il s’en ira encore plus vite. L’immobilité de l’Orient, l’accord général de l’Occident, à ces deux conditions la Porte peut encore durer. Si l’une ou l’autre manqur, si nous nous divisons ici et si on se bat en Asie, c’est le commencement du grand inconnu. Je dis cela beaucoup, et tout le monde est de mon avis, presque tout le monde. Mais les avis sont peu de chose ; c’est la volonté qui fait.
Ce cabinet-ci est dans une situation bien critique pour élever dans ses chambres et dans le monde, une si grande question. Et je doute que sa situation critique soit de celles dont en sort en élevant une grande question. Je ne crois pas qu’il y ait à s’abstenir définitivement, beaucoup de jugement, ni de prévoyance. Et j’attendrais sans beaucoup de crainte la démonstration des évènements. Votre conversation avecT hiers est charmante. Je suis quelque fois tené de croire qu’il est embarrassé et se déchargerait volontiers de son embarras, pour un temps, sur les épaules d’autrui. Nous verrons jusqu’à quel point la fécondité de l’esprit, la dextérité de la conduite et le talent de la parole suffisent au gouvernemen t! En attendant, il est absurde de se plaindre qu’il ne s’occupe pas des petites affaires. Je suis sûr qu’il s’en occupe plus qu’on n’a le droit de l’exiger dans sa situation. C’est précisément une de ses qualités de pouvoir penser à la fois à beaucoup de choses, grandes et petites, et porter rapidement de l’une sur l’autre son activité et son savoir faire.
Lundi 1 juin
Je trouve en m’éveillant le Roi de Prusse mort de plus grands que lui sont morts. Je le regrette. C’est toujours beaucoup qu’un Roi honnête et sensé. Je me suis intéressé à lui dans ses temps de malheur. La façon dont ils étaient traités lui, sa femme, son pays, m’indignait. Je n‘ai pas à me reprocher d’avoir pris plaisir à à Mexico et à Calcutta comme dans un écho. La place manquera à l’ambition et à la puissance des hommes. Priez Dieu qu’ils ne deviennent pas fous.
2 heures
Je reviens d’un meeting on the slave trade, où le Prince Albert a fait son début in the chair. et je trouve le 389, votre départ pour le 13. Vous ne m’avez jamais donné de si principale nouvelle. J’ai quelques doutes sur un congé à demander à Thiers pour Génie. Sans cela, rien de plus simple que de le faire venir ici pour huit jours en vous accompagnant. Il faut que j’y pense, et que je lui en écrive à lui-même. Cela se pourra peut-être sans inconvénient. Je serais charmé de vous donner ce gardien là. Mais je ne veux pas que Thiers suppose je ne sais quoi. C’est bien intime de faire ainsi passer mon intérêt avant votre agrément. Mais je suis sûr que vous le trouvez bon. Le meeting était très nombreux et intéresant. Le Prince a été fort bien reçu. O’Connell et Sir Robert Peel également bien reçus, également applaudis. Public très impartial, et prenant. plaisir à se séparer de la politique. Grand applaudissement aussi à mon nom et à ma l’arrogance brutale et déréglée que j’ai vu régner. Elle était pleine de grandeur ; mais la grandeur à son tour était pleine de grossiéreté et de folie.
Le rappel de Ste Hélène, c’est juste. Les Invalides c’est juste, St Denis aussi serait juste, quoique moins convenable. L’apothéose serait une impièté. Et aussi une demence. La Prusse elle-même m’intéresse. Il y a en Europe trois pays que j’aime après le mien : l’Angleterre, la Hollande et la Prusse. Je suis très protestant par là. C’est la Réforme qui a fait ces trois pays, qui a fait leur caractère, et en bonne partie leur grandeur. Et l’Europe leur doit une bonne partie de la sienne, sans compter l’avenir. Il n’y en a plus pour la Hollande. Les petits pays sont morts. Deux choses aujourd’hui sont trop grandes pour eux, les idées et les évènements. Ni l’esprit, ni l’activité des hommes ne peut plus se contenir dans un étroit espace sur notre terre, le plus grand espace sera bientôt si étroit ! De Londres à New York, douze jours ; bientôt six jours ; on construit en ce moment à Bristol une machine qui double la force de la vapeur. On se promènera autour du monde. Les paroles dites à Paris retentiront. personne, mentionnés assez éloquemment par le sir Lushington. Mais puisque, vous ne devez ignorer aucune de mes vanités, voici mon plaisir de ce matin. Je suis arrivé un peu tard à Exeter hall. Le Prince était déjà in the chair. On se pressait pour entrer. Sur l’escalier, à la porte de la salle dans la salle, la foule était immense. En abordant la foule, j’ai dit the french ambassador, pour m’aider à avancer. Le premier venu à qui je l’avais dit, a dit à ses voisins. Mr Guizot. Tout le monde, a répété mon nom, personne ma qualité, et tout le monde m’a fait place. Un fils de M. Wilberforce, archidiacre dans l’ile de Wight, a parlé supérieurement avec beaucoup d’éloquence, naturelle et spirituelle. Sir Robert Peel a bien parlé, éternellement bien. Je vous dis que vous ne connaissiez pas M. de Brünnow. Savez-vous comment il était vendredi dernier, à une heure du matin, dans le vestibule de Buckingham Palace, sortant du concert de la Reine et attendant sa voiture au milieu de la très bonne compagnie qui attendait comme lui ? Une sale casquette de voyage sur la tête pour ne pas s’enrhumer. Je suis un peu choqué que vous m’ayez dit que je lui plairais. Du reste, je crois que vous avez eu raison. Il parle très bien de moi Il me semble que l’approche de notre rencontre me rend bien bavard. Vous ne vous plaindrez pas que cette lettre soit courte. J’en ai bien plus long à vous dire. Adieu. Adieu. Quand vous serez ici, il me semble impossible que nous n’arrangions pas tout vous, moi, Londres, et la campagne. Il y a deux choses avec lesquelles on peut tout. La seconde, c’est de l’esprit. Devinez la première. Adieu. Ma mère vous priera peut-être de m’apporter le portrait d’Henriette, dans une boite. J’espère qu’il ne vous embarrassera pas trop. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Progrès, Relation François-Dorothée, Religion, Séjour à Londres (Dorothée)
407. Londres, Mercredi 9 [septembre] 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 Heures
J’ai si mal dormi cette nuit que je me lève tard. Le sommeil m’a gagné ce matin. Je ne veux pas dire que je suis inquiet. Je ne le suis pas. Je ne le serais pas du tout, si vous ne rouliez pas vers Paris. J’en attends avec ardeur les nouvelles. Je ne peux pas me figurer un vrai désordre dans Paris, votre agitation, vos craintes, et moi absent. Que de choses on ne peut pas se figurer, et qui arrivent, et qu’on supporte ! C’est odieux à penser. Je suis parlaitement sûr qu’il n’y a point de danger dans Paris, point en général, point pour vous. Je pense que vous aurez appris l’émeute à Boulogne, et que vous vous serez arrêtée. Ce qui me prouve que l’émeute n’a pas de gravité, c’est qu’elle était fort locale, concentrée dans un quartier d’ouvriers. Il n’y a rien eu dans les quartiers politiques, où l’émeute politique à toujours logé. Ce que je vous dis-là, ne signifiera rien du tout pour vous quand vous le lirez. Mais je vous dis ce que je me dis à moi-mêmes. J’essaye en vain de me parler d’autre chose.
J’ai dîné hier à Holland-House, avec Lord John, dont j’ai été content très content. Il commence à entrevoir la gravité de la situation. Il convient qu’on s’est fort trompé, qu’on est déjà au troisième ou quatrième mécompte qu’on ne referait pas ce qu’on a fait si ce n’était pas fait. Mais comment faire? Il cherche et ne trouve pas. Mais il cherche. Et je sais que Lord Melbourne cherche aussi avec plus de care qu’il ne lui appartient. Je ne vois là rien de plus qu’une bonne disposition pour un moment qui peut venir. En attendant qu’il vienne ceci est bien grave. Voilà le traité en cours d’exécution. Et il s’exécute avant d’être non seulement ratifié, mais notifié au Pacha ; on l’attaque en Syrie avant de lui avoir dit qu’on lui demande de rendre la Syrie, quand on lui donne vingt jours, pour répondre à ce qu’on lui aura dit ! C’est là le premier incident. Il en viendra en foule. Et c’est sous ce feu-là, qu’il faut rester immobile jusqu’à ce que le moment se présente , soit pour nous d’agir, soit pour les autres to retrace their Steps ! C’est bien difficile. C’est pourtant la seule bonne conduite, bonne pour maintenir la paix si la paix peut être maintenue, comme j’y crois toujours, bonne si nous sommes obligés à la guerre. Car il faut que nous y soyons bien certainement, bien évidemment obligés, que nous la fassions pour notre compte, pour le compte de notre rang, de notre influence, de notre sureté en Europe, non pour le compte du Pacha et de la Syrie.
Je pense sans cesse à cela, sans cesse en seconde ligne. J’ai tort car tout se tient, la première et la seconde ligne. J’y pense avec cette passion qui pénètre certainement au fond des choses comme on regarde de sa barque à l’horizon, le point d’où peut venir la tempète. Je ne découvre pas autre chose à prévoir, autre chose à faire. Ma conviction sur les chances de l’avenir, sur la route à suivre, est de plus en plus forte. Mais que la barque où nous vivons est fragile, et que toute notre sagesse, toute notre force est peu de chose quand la mer est si grosse et le port si loin ! Je moralise ; j’ai recours à Dieu, je le prie. Je ne puis pas, je ne veux pas m’en défendre. J’ai le cœur trop plein, il s’agit d’intérêts trop chers, pour que les pensées et les ressources humaines me suffisent. Je vais à la sagesse qui sait tout, au pouvoir qui peut tout. Je lui demande d’intervenir.
Une heure
C’est Rothschild qui est intervenu pendant que j’écrivais. Croyez-vous qu’il prie Dieu pour la surété de son argent ? Je ne pense pas que cela soit jamais arrivé à personne. Grande lumière sur la valeur des choses.
Je n’espérais pas de lettre aujourd’hui. Merci mille fois. Vous êtes bien aimable. C’est presque une vertu d’être aimable. Cela me plaît que vous ayez passé par Calais. Je passe toujours par là. Rien de Paris sinon les journaux qui me prouvent que l’émeute n’a pas été grand chose. Le langage du Constitutionnel, sur la dépêche de Lord Palmerston et sur la situation en général est bon. Mais j’aurais dû avoir un courrier. Adieu. Serez-vous ce soir à Paris, ou demain seulement ? Adieu partout. Adieu toujours.
Angoulême, le 24 août 1869, Joseph Frédéric Saivet à François Guizot
Mots-clés : France (1852-1870, Second Empire), histoire, Réception (Guizot), Religion
Annecy, le 27 janvier 1849, Louis Rendu à François Guizot
Arras, le 1er mars 1845, Hugues, cardinal de la Tour d'Auvergne à François Guizot
Bayeux, le 1er février 1873, Flavien Hugonin, évêque de Bayeux à François Guizot
Bayeux, le 17 avril 1871, Flavien Hugonin, évêque de Bayeux à François Guizot
Mots-clés : Calvados (France), Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Religion
Bayeux, le 18 décembre 1871, Flavien Hugonin, évêque de Bayeux à François Guizot
Mots-clés : Calvados (France), Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Religion
Bayeux, le 18 septembre 1861, Charles Didiot, évêque de Bayeux à François Guizot
Mots-clés : Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Publication, Réception (Guizot), Religion
Bayeux, le 25 juin 1868, Flavien Hugonin, évêque de Bayeux à François Guizot
Mots-clés : Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Publication, Réception (Guizot), Religion