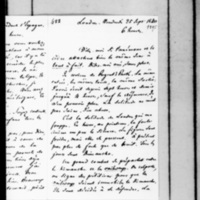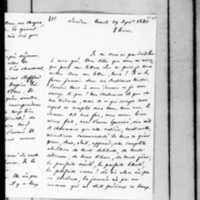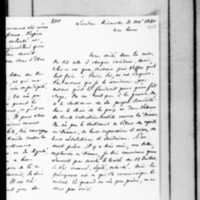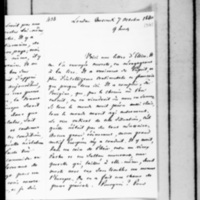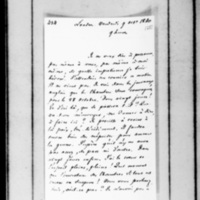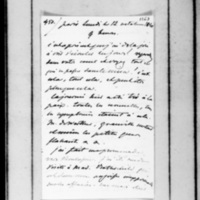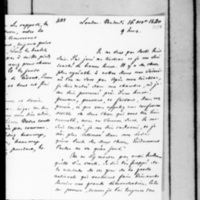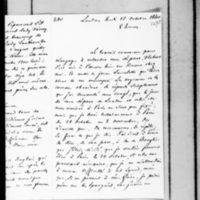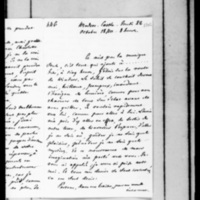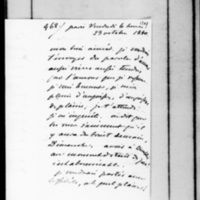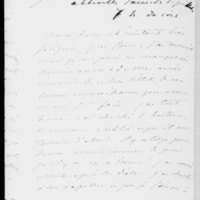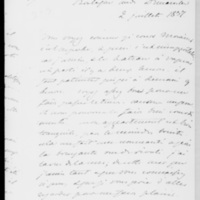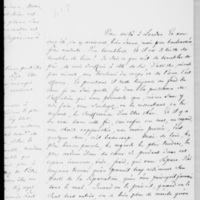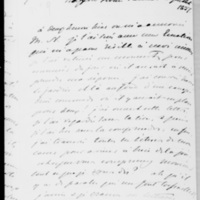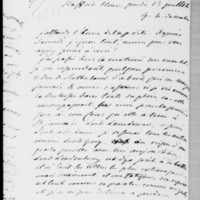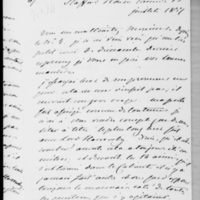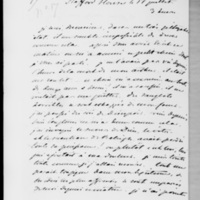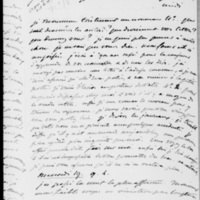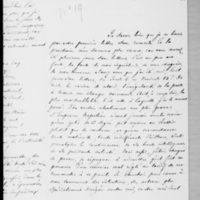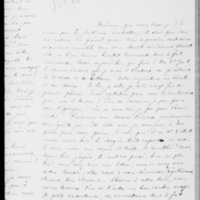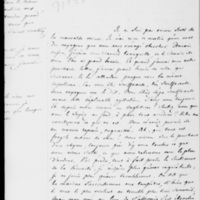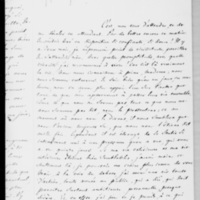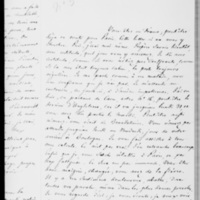Votre recherche dans le corpus : 450 résultats dans 3296 notices du site.
419. Londres, Mercredi 23 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Pardon d’avoir commencé par cette demi- feuille déchirée. Toujours la tempête. Je suis à écrire, dans mon lit depuis quatre heures du matin. J’écris quelques fois pour me rendre de ce que je pense, un compte bien complet, bien rigoureux. On pense si légèrement ! On fait tant de sottises pour avoir légèrement pensé ! Je trouve les esprits encore plus légers que les cœurs. C’est beaucoup. Mais que m’importe que les cœurs et les esprits soient légers ? Le seul cœur, le seul esprit dont j’aie besoin ne l’est pas. Il est loin de moi ; voilà son seul défaut. Je suis bien vivement ce défaut là. Je voudrais bien causer avec vous. Mon instinct m’a dit que l’affaire est dans sa crise ; crise au dedans, crise au dehors. Moi aussi, je suis condamné à la politique de l’isolement. Elle me déplaît fort. Me voilà tranquille sur la tempête. La malle a passé. Un courrier vient de m’arriver. Il ne m’apporte rien du tout qu’une lettre de cet honnête ministre des finances qui m’écrit : " Je suis bien aise de voir que les circonstances ne détournent pas lady Durham et beaucoup d’autres de venir jouir de notre beau climat, et j’espère que cette confiance ne sera pas trompée. " Je vais faire ma toilette en attendant d’autres lettres.
4 heures
J’ai encore écrit énormément depuis ce matin. Je voulais finir ce que j’avais commencé cette nuit. Vous aussi votre lettre est charmante. Laissez-moi juge de ce que vous méritez. C’est moi que cela regarde. Je vous ai dit bien des vérités, franches. Je peux bien vous dire à mon gré des vérités tendres. Ne dirait-on pas que mes vérités tendres ne seront pas franches ? Je vous aime chez moi. N’y ayez pas de sentiments mêlés. Tout est à vous, tout est à moi ; tout ce dont nous avons pu disposer, l’un et l’autre. Jamais don n’a été plus complet. Moi aussi, j’ai eu mes sentiments mêlés. A présent je ne les ai plus ; je ne les aurai plus jamais. Il me semble. Comment avez-vous trouvé mon portrait ? Votre dîner n’est donc pas autre que celui de Stafford house ? Est-ce faute d’appétit, ou de peur de fatiguer votre estomac? Je suis en général porté à croire qu’on mange trop. Le gâteau de semoule de Valentin vaut-il celui de Guillet ?
Voilà la princesse Augusta morte. Il faudra que j’aille passer sans prétexte devant Stafford house. Vous ne savez pas combien ces plaisirs-là s’usent peu pour moi. Je pourrais me donner le même tous les jours pendant des années. Mes plaisirs sont peu nombreux mais immenses, inépuisables. La transaction est sur le tapis. Elle aurait de bien meilleures chances, si le bruit ne s’était pas répandu ici que le Pacha allait céder tout-à-fait, et que c’est M. Valeski qui l’a empêché. Les adversaires de la transaction exploitent beaucoup cela. Cependant je travaille. On travaille. Il y aura un conseil de cabinet lundi. Certainement la transaction y est en grand majorité. Mais la majorité ne suffit pas. Il faut quelqu’un qui ait le courage de la prendre et de s’en servir contre la minorité.
Je dîne aujourd’hui chez Lord Palmerston. Je le pousserai vivement. Lady Palmerston m’a paru en effet avoir quelque envie de plus d’abandon. Je ne demande pas mieux. Je m’abandonnerai pourvu qu’on me cède. J’aurais vraiment aimé à me trouver de l’avis de lord Palmerston et agissant avec lui. Mais il veut tout, et moi je veux ma part. On me dit que c’est l’heure de la poste. Je trouve toutes les lettres trop courtes, celles que j’écris, celles que je reçois. Tout est trop court. Est-il vrai que vous ayez passé à Londres deux ans et demi ? J’ai peine à y croire. Quel charmant temps ! Un charmé si doux et si solennel ! Y aurait-il mieux ? N’est-ce pas, il y aura mieux ? Est-ce possible ? Oui, c’est possible. Adieu. Adieu. En attendant mieux.
422. Londres, Vendredi 25 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Dites-moi si l’anémone et le cidre attachent bien le même sens à tout-à-fait. Dites-moi oui sans plus. Je reviens de Regent’s Park. La même entrée, les mêmes tours, la même sortie. J’avais écrit depuis sept heures et demie jusqu’à 4 heures, sauf le déjeuner. Je n’en pouvais plus. La solitude ne m’est pas saine. J’en abuse. C’est la solitude de Londres, qui me frappe. En hiver au printemps, la foule anime un peu le silence. Les figures sont froides, mais elles se pressent. A présent pas plus de foule que de bruit. Tous les jours sont dimanche. Un grand combat se prépare entre le Dimanche et les railways. On colporte, on signe des pétitions pour que les railways soient immobiles le Dimanche. Ils sont décidés à se défendre. La question ira au Parlement. Le Cabinet sera un peu embarrassé. Le Dimanche a des amis dans son camp. Cependant, on croit qu’il prendra parti pour les railway.
Samedi 7 heures et demie
Les diplomates me sont arrivés hier soir pleins de paix. Mais elle leur venait d’où vient ordinairement la peste, d’Odessa. Lord Alvanley écrivait de là que tout était arrangé, que le Divan avait accepté les propositions du Pacha. Puis nous avons trouvé que c’était un bruit de bourse, déjà inséré dans le Globe. Les sources, les dates, les vraisemblances morales ôtent à ce bruit, toute valeur. Aujourd’hui ou demain nous aurons des nouvelles sérieuses de Syrie et d’Alexandrie.
Alava, Moncorvo, Schleinitz, Pollon, Van de weyer, Münchhausen, Lisboa et je ne sais combien de secrétaires. Je ne me laisserai point imposer les femmes. Tout en serait changé et gêné ? Leshommes sont là fort librement. On cause, on joue au Whist, à l’écarté, aux êchecs. Tous les journaux anglais et français sur une grande table ronde. Il n’y a rien a changer. On dit qu’Espartero va renvoyer la junte de Madrid et toutes les juntes. Qu’il restera président du Conseil, sans portefeuille et fera un ministère qui ressemblera à tous les autres. Que la nullité du ministère et du Président éclatera bientôt, et que la Reine sortira du défilé en y laissant sur le carreau tous ceux qui l’y ont poussée. Cela se pourrait. Mais au milieu de tous ces gens qui tombent, je cherche quelqu’un qui s’élève. Je ne vois pas. Il ne suffit pas pour gouverner d’user les hommes qui embarrassent. Quelques fois, il est vrai, on n’a rien de mieux à faire. Alors il faut se résigner à n’avoir rien de bien !
Je persiste dans mon jugement. Des maux alternatifs dans une anarchie impuissante. Grand exemple de ce que peuvent faire d’un pays les sottises absolutistes et les absurdités révolutionnaires. Depuis Philippe 2, elles possèdent l’Espagne. Une heure Adieu. L’adieu spécial que vous voulez ; et bien spécial ne ressemblant à aucun autre. Il le faut en vérité, car il y a là un mal qui résiste aux remèdes les plus héroïques. Un seul mot encore. Je n’ai plus entendu parler d’aucune tulipe. Et comme j’évite au lieu de chercher, je n’en entendrai point parler. Vous avez raison. Je ne puis pas m’éloigner. Et juse de cette raison là.
Je ne me plains pas. Soyez contente. Et soyons toujours aussi enfants, tous les deux. Mais ne maigrissez pas ; pour Dieu ne maigrissez pas ; point a cause de la maigreur, mais a cause de la santé. Pour moi, je vous promets de ne pas engraisser. Je vous tiens déjà parole car certainement, j’ai maigri depuis quinze jours. Mon anneau à failli glisser hier. Beaucoup de souci, beaucoup de travail, point. de repos, car point de bonheur. Je ne crois pas à la guerre. Je me le redis, je vous le redis, parce qu’en effet je n’y crois pas. Mais je suis aussi inquiet que si j’y croyais. L’intérêt est si grand que ma prévoyance est sans pouvoir sur ma disposition. Mes relations personnelles avec lord Palmerston sont toujours les mêmes, réellement bonnes. Je crois qu’il aurait vraiment envie d’être d’accord avec moi. Mais qu’importe. Nous verrons ce que rendra le conseil de lundi. Quelle puérilité que tout ce fracas des journaux les plus sérieux à propos de quelques phrases en l’air d’un journal obscur ! Je n’ai pas la moindre relation, avec l’Univers. Je n’ai rien dit, rien fait qui autorise, rien de semblable. Je n’ai pas écrit depuis je ne sais combin de temps à M. Dillon ni a personne qui pût abuser de mes paroles. Je suis réservé, très réservé, aussi réservé que je serais décidé s’il y avait lieu.
Je connais bien les difficultés de ma position. J’y pense sans cesse. C’est la chose à laquelle je pense le plus. Je ne me laisserai point engager au delà de ma propre idée. Ceci est trop grave pour qu’on s’y conduise autrement que selon sa propre idée. Mais je ne me séparerai pas sans motif très grave et je ne désavouerai rien de ce que j’ai accepté jusqu’à présent. Adieu. Adieu. Ne me dites pas que mes lettres sont courtes. Ce n’est pas vrai. Comment le seraient-elles? C’est tout mon plaisir. Adieu.
433. Paris, Vendredi 25 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai vu hier Montrond et les Appony. J’ai fait ma promenade En rentrant, j’ai vu M. de Pahlen. Après mon dîner, j’ai éte un moment chez Mad. de Flahaut avant sa réception et puis chez lady Granville, que je trouve toujours au coin du feu avec son mari. Appony a eu un long entretien, hier matin avec Thiers. M. de Metternich s’emploie à arranger Thiers le trouve long et métaphysique Il voudrait que cela allât plus vite. Il a été un peu menaçant, un peu doux, et toujours un peu drôle. Appony au fond était moins inquiet hier que ces jours derniers. Tout le monde se demande " Mais comment dès qu’on va faire la guerre ! pourquoi ? " Je crois que vraiment quand le moment surprise arrivera, le ridicule pourrait bien tuer le danger. Que Dieu m’entende.
Les petits états envoient des Déclarations de Neutralité, je veux dire Sardaigne, et Suède. Les pauvres allemands n’oseront pas l’être. La Confédération en décidera autrement.
Si je vous écrivais dans mes moments de faiblesse et de tristesse, mes paroles vous feraient de la peine. De la peine et du plaisir. Le matin j’ai un peu de force, vers le milieu du jour elle m’abandonne, le soir je suis tout à fait triste, découragée. Je regarde le fauteuil vert vide, je trouve ma vie si mal arrangée ! Et puis je la crois si courte. Et ce court moment, je le passe seule ! Je ne devrais pas vous dire tout cela. Vous avez assez de votre propre tristesse et puis vendredi, un mauvais jour.
Lady Holland a bien raison de le trouver un très mauvais jour. Je suis fort bien avec Madame de Flahaut. Après la grosse explosion, elle est redevenue charmante. A propos on dit qu’elle ne parle plus dans le monde, qu’elle est d’une réserve, d’une prudence presque outrées.
Je vous envoie une lettre du duc de Noailles, car je n’ai rien à vous dire, et le dimanche vous n’avez rien à lire à Londres. Cette pauvre princesse Augusta je la regrette, car elle était la meilleure personne du monde. Elle louchait cependant , elle ne vous aurait pas plu. J’espère qu’il n’est arrivée a personne de devenir louche après cinquante ans, car après votre déclaration. tout serait donc fini ? Ma nièce plait à tout le monde. On ne peut rien voir de plus gracieux, de plus naturel et de plus élégant. Sa mère sa arriver dans quelques jours what a bore ?
1 heure
Comment se fait-il que je n’ai pas de lettres ? Je vous en prie n’envoyez qu’au gens qui attendent la poste chez eux. Adieu, adieu. Adieu à demain. Je serai bien fâchée contre vous si vous m’envoyez autre chose qu’un tendre adieu après mon explication d’hier. Je sais suffisamment me gronder moi- même et je suis trop malade pour pouvoir supporter d’être grondée. Vous verrez qu’à force de douceur je deviendrai sage tout-à-fait. Adieu. Adieu. Il y aura un Cabinet council lundi. Il sera important. C’est de Londres que je parle.
421. Londres, Vendredi 25 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Vous voyez le travail de Paris et de Londres pour nous brouiller, Thiers et moi. L’animosité personnelle devient très vive ici. On se dit convaincu que Thiers veut la guerre. Je nie, je repousse très haut, très ferme. On persiste. On couvre sous cette conviction, sa propre obstination. Cela fait une situation de plus en plus périlleuse et délicate. Je dis périlleuse quoique le fond de ma pensée ne soit pas changé. Je ne crois pas à la guerre. Je n’y crois guère plus que je ne la veux. Je la trouverais absurde, comme un effet sans cause est absurde. Jamais je ne consentirai à voir dans Beyrouth et Damas une cause suffisante a un si immense effet. Et quoi que l’absurde, ne soit pas banni de ce monde, cependant il n’y est pas puissant à ce point. Mais quand on rase de si près le bord, il est impossible, même en ne croyant pas à la chute de ne pas avoir le sentiment du péril. Et puis les passions des hommes sont à elles seules une cause ; une cause qui dans un moment donné à propos d’un incident imprévu, peut tout emporter soudainement. C’est là le vrai danger ; celui que j’ai constamment mis, que je mets constamment sous les yeux des gens qui ont créé cette situation parce qu’ils n’ont pas voulu y croire. Ils commencent à y croire ; ils commencent à entrevoir la guerre comme possible ; et ne voulant pas s’en pendre à la situation qu’ils ont faite, ils s’en prennent à quelqu’un qui la veut, disent-ils, qui travaille sous main à l’amener. Et je passe mon temps à combattre leurs conjectures sur les intentions et leur sécurité sur la situation. Il y aura toujours un conseil de cabinet lundi, pour reparler de l’affaire Mais lord Lansdowne, lord Duncannon, lord Morpeth sont en Irlande et ne viendront pas. Et aucun de ceux qui viendront n’est encore arrivé, ni lord John Russell, ni lord Melbourne. Ils arriveront dimanche ou lundi, au moment même du conseil. Ils se réuniront sans y avoir pensé, sans en savoir et sans s’en être dit plus qu’ils n’ont encore fait. Ils en parleront une heure ou deux en hésitant beaucoup à se contredire les uns les autres. Ils croiront à peu près ce qu’ils se diront, pour ou pas être forcés de se contredire. Et voilà ce qui peut se cacher de légèreté sous les formes les plus froides et les plus sérieuses. Je n’en pousse pas moins de toutes mes forces à une transaction à une modification des propositions de la Porte au Pacha. Et après bien du temps perdu, il y a bien des chances pour que cela finisse ainsi. Je regarderais ces chances comme extrêmement probables si on croyait ici à une vraie résistance du Pacha. Mais on croit toujours qu’il cèdera.
Une heure
Il n’y a pas moyen, quand on prend le chemin de l’école, d’arriver de très bonne heure, ni toujours à la même heure. Le frêne croit que le petit F. dit vrai sur son compte. Les journaux sont pleins ce matin de mes dissentiments avec Thiers. Je suis de l’avis du Courrier français. Le jour où il y aurait entre Thiers et moi, un vrai dissentiment sur le but et la marche de la politique, nous devrions nous en avertir l’un l’autre. Et nous n’y manquerions certainement pas. Je regarde beaucoup à l’Espagne, et je n’en dis rien parce que je n’en pense rien. La modération sans force, l’anarchie sans force, la folle sans passion, le chaos parodié, quel pitoyable spectacle ! Je mintéresse à la Reine. Je lui trouve de l’esprit et du courage. soit quand elle résiste, soit quand elle cède. Je ne crois pas que, par lui-même, le pauvre pays sorte de son agonie. Mais il n’en mourra pas, et il peut y vivre longtemps sans danger pour personne. A mon avis, c’est l’Europe qui est coupable envers l’Espagne. Et coupable depuis 1833. Après la mort de Ferdinand 7 au premier moment la tutelle européenne proclamée et exercée aurait tout prévenu. On ne veut guères faire, le mal aujourd’hui. On ne sait pas faire le bien. Le bien pourrait se faire, mais à la condition d’être fait grandement. Et on s’effraie de tout ce qui exige de la grandeur. Il y a cinquante ans, l’orgueil des hommes allait à la démence ; ils se croyaient appelés à refaire le monde à la place de Dieu. Aujourd’hui, leur sagesse va jusqu’à l’inertie ; ils laissent Dieu chargé de tout. Voilà du bavardage doctrinaire Vrai pourtant.
Je viens de parcourir ces cinq pages d’écriture. Pas une tendre parole ! Est-ce possible ? Mes paroles vous plaisent. Quel plaisir auriez-vous donc si vous voyez, réellement voir ce qu’elle essayent de peindre ? Vous avez raison ; depuis que le monde existe on a beaucoup dit sur cela ; chacune des mille millions et milliards de créatures, qui ont passé sous notre soleil a élevé la voix et répété la même chose, avec son plus doux accent. Quimporte la répétition ? Tout sentiment vrai est nouveau. Tout ce qui sort réellement du fond du cœur est dit pour la première fois entendu pour la première fois. Et puis vous savez mon orgueil en ceci comme en tout, l’inégalité est immense, la varièté infinie ; les sentiments naturels, universels, que toute créature a connus et racontés à d’autres créatures, ils sont ce que les fait l’âme où ils résident ; toujours beaux et doux car Dieu les a créés tels à l’usage de tous ; mais incomparablement plus beaux, plus doux dans les élus de Dieu, car Dieu a des élus. Ne dites jamais, ne laissez jamais entrevoir ceci à personne, mon amie. Oui, j’ai la prétention de vous dire des choses qu’aucune voix d’homme n’a jamais dites et ne dira jamais qu’aucune oreille de femme n’a jamais entendues et n’entendra jamais. Et que sont les choses que je vous dis auprès de celles que je sens ?
Mon cœur est infiniment plus riche que mon langage, et mes émotions, en pensant à vous infiniment plus nouvelles, plus inouïes que mes paroles. Laissez donc ce papier et entrez dans mon cœur. Lisez ce que je ne vous écris pas. Entendez ce que je ne vous ai jamais dit. Adieu.
423. Londres, Dimanche 27 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Byng est venu me dire hier qu’il partait aujourd’hui pour l’Italie et qu’il vous verrait en passant par Paris. L’envie m’a pris de vous dire par lui, un adieu plus tendre que de coutume, bien tendre. Je voudrais bien. Mais rien ne contente ma volonté. Vous savez mon mépris pour les illusions. Hier quand l’idée m’en est venue, il me semblait que je serais charmé de vous dire un peu plus, que je vous dirais tant ! Me voici. Je suis dans mon lit. Bien seul. C’est Dimanche. Je n’entends rien. Si vous étiez là ! Vous n’y êtes pas. Et je suis triste ! Et c’est tout ce que je trouve à vous dire Dimanche est un beau jour un saint jour. Je l’aime. Rien ne rafraîchit l’âme comme de se placer ensemble sous l’œil, sous la main, sous la garde de Dieu. C’est de la sécurité, c’est de l’éternité pour l’affection et pour le bonheur. Vous avez le cœur pieux. J’ai été ravi le jour où je m’ens suis aperçu. Je ne vous ai jamais dit, s’en cela, tout ce que je voudrais. Il me semble, en ce moment, que je ne vous ai jamais rien dit. J’ai le cœur si plein de vous, si plein pour vous ! Si vous étiez là, près de moi, je vous prendrais dans mes bras, je vous presserais sur mon cœur. Point de paroles, ma bien aimée. Rien que mes lèvres sur les lèvres, mon cœur sur ton coeur.
Non, il n’y aura pas de guerre. J’ai beau être inquiet ; ma raison ne cède pas devant mon inquiétude. Plus la guerre paraît s’approcher, moins je la trouve probable. Et il me semble que tout le monde est comme moi. On y croit d’autant moins qu’on la craint d’avantage. En ceci encore, que de choses que je ne puis vous dire. Il n’y a pas moyen. L’absence est devenue bien plus amère, bien plus lourde qu’elle n’avait jamais été. Adieu donc, ma bien aimée. Un adieu tendre et triste. Pourtant mille fois plus tendre que triste ! Adieu.
423. bis Londres Dimanche 27 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quelqu’un part aujourd’hui pour Calais. J’ai quelques minutes. Je vous les donne. Je vous en conjure ; ne soyez pas à ce ce point abattue, découragée. Ne désesperez pas de vous-même, de votre santé, de notre avenir. Jamais, jamais, ne me cachez votre disposition, quelle qu’elle soit ; dites-moi toujours tout, vos plus mauvais comme vos meilleurs moments. J’ai horreur des illusions. Je ne veux pas m’en repaître, même sur ce que j’ai de plus précieux au monde. Ce n’est pas du tout pour me les épargner à moi-même que je combats vos tristes, vos sinistres impressions. C’est parce que je suis sûr, sûr qu’elles sont mal fondées. Votre santé et habituellement bien délicate. Elle a été bien ébranlée par ce mouvement de bile. Mais au fond, elle est saine ; vous n’avez point d’organe malade. Vous supportez bien plus de fatigue qu’on ne le croirait possible quand on vous voit si abattue. Il y a dans votre corps quelque chose de l’élasticité, de la vitalité de votre âme. Ce qui vous rend charmante, vous fera vivre, vivre longtemps.
Dearest, si j’étais près de vous, je vous dirais, j’en suis sûr, des choses qui vous prouveraient que j’ai raison, qui vous feraient retrouver en vous la force qui y est. Car, on ne donne pas de force à qui n’en a pas la tendresse, la plus vive ne possède pas ce beau privilège. Mais vous me l’avez dit, je l’ai vu ; je puis vous animer et vous calmer en même temps ; je puis vous rendre du mouvement du repos. Je suis loin, bien loin, et je m’en désole, et j’en souffre autant que vous. Mais, laissez-moi conserver, exercer de loin un peu de mon pouvoir salutaire, rafraichissant, reconfortant. Que ces paroles, qui tombent de mon coeur sur le papier, aillent au vôtre et y raniment la confiance, l’espérance. L’absence serait aussi trop cruelle si elle nous enlevait tout, absolument tout empire, l’un sur l’autre, si elle nous mettait tout-à-fait hors d’état de nous faire, l’un à l’autre, aucun bien, de nous porter aucun secours. Cela ne se peut pas, cela ne sera pas. Vous vous laisserez soutenir encourager par moi, même absent. Et l’absence passera. Nous nous retrouverons. Je recommencerai à vous soutenir, à vous encourager, à vous animer, à vous calmer de près, bien près. Quel jour ! Quel mouvement et bonheur !
Adieu. Adieu. Mille adieux. Le bis du N° vous sera bientôt expliqué.
436.Paris, Lundi 28 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
8 heures
Je suis sur pied de bonne heure, je crois qu’en me levant si tôt je rattraperai la lettre perdue. Car vous saurez que hier je n’ai reçu eu, rien du tout. Expliquez cela. S’il y a de votre faute je ne me sens pas le courage de vous pardonner, car vous me faites trop de mal. Mais ce ne peut être vous. Et cependant où est cette lettre ? J’ai bien assez, J’ai bien trop d’un mardi pas semaine, et me voici à deux.
J’ai vu hier matin, Bulwer, Werther, Adair, Montrond, Granville. Bulwer commence à se monter la tête beaucoup. Il veut du décisif, du vigoureux. Il trouve Stopford lâche, il faut le destituer. Il faut finir l’affaire. Schleinitz mande à Werther qu’il a fort peu d’espoir d’accommodement, que l’opinion en Angleterre devient assez générale contre la France, et qu’on ne veut pas lui laisser le triomphe d’avoir fait reculer. Vous êtes tous trop vantards, cela finit par irriter, et vos menaces n’intimident personne. Je crois cela assez vrai et dans le fond il n’y a que la diplomatie à Paris qui soit encore à vous défendre. Le duc de Broglie est arrivé. Il n’avait encore vu ni le roi, ni Thiers. Lord Granville l’a vu très triste, très découragé. Il trouve que la conduite de Thiers a été bonne, mais l’affaire est bien mal engagée. Il est triste et soucieux pour le roi. Il y a bien des gens qui regardent sa situation comme bien mauvaise. Il a épousé le pays ou pour dire plus vrai les journaux. Il sera débordé par eux.
62 dit que la chambre des députés sera toute pour la paix et que par lâcheté elle votera pour la guerre. Or, la guerre, elle sera mauvaise pour toutes les puissances peut-être (sauf l’Angleterre qui n’a qu’à y gagner) mais elle sera surtout mauvaise pour la France, car elle n’y est pas préparée. Cela paraît incontestable. Je suis sûr le ton belliqueux c’est que cela devient le ton de tout le monde. On dit, on répète : " c’est insensé. " Et l’on ajoute toujours, " Mais comment se tirer de là ? "
15 croit que c’est la guerre continentale dont vous avez envie. Il est vrai qu’à l’autre Il n’y aurait que des coups à attraper, et malgré vos promesses malgré vos désires même, ce sera la Prusse qui sera la première victime, car c’est la seule abordable, et le Rhin est ce que l’on comprend le mieux en France. Vraiment nous voilà à la veille d’un beau dénouement, je n’espère pas la moindre chose du conseil de cabinet d’aujourd’hui. Il n’y a aucune vraisemblance à ce que lord Palmerston soit out voted. Thiers a dit à M. de Werther avant hier : " Si les propositions de Méhemet ali ne sont point acceptées, c’est la guerre." J’ai fait mon régime ordinaire hier. Le bois de Boulogne, dîner seule, la perdrix, et le gâteau de semouille, pas autre chose, c’est l’ordonnance. Le soir un moment chez Mad. de Flahaut et un moment chez Lady Granville, dans mon lit à 10 heures. Voici une lettre du duc de Noailles. Elle me frappe un peu. Il est clair que les événements du jour inspirent de l’espérance.
9 heures
Voici la lettre que je devais recevoir hier. Le petit copiste est venu me l’apporter il ne l’a eu hier qu’à 10 heures du soir ; il était reste jusque là à son bureau. Il dit que s’il pouvait être prévenu des jours où on lui adresse des lettres il rentrerait pour les recevoir. Je vous supplie faites quelque chose qui n’épargne la cruelle peine de rester tout un jour sans lire des paroles qui me donnent tant tant de joie ! Car quelle lettre encore que ce 421 ! Ces deux feuilles volantes comme elles vont rester dans ma mémoire dans mon Cœur. C’est un langage du Ciel, vous dites vrai, jamais, jamais oreille de femme ne l’a entendu !J’étais donc destinée à une félicité immense ; et cependant, tout ce qu’il y manque ! Midi Je suis pleine de bonheur et d’orgueil de votre lettre. Mais j’ai le cœur plus triste tous les jours sur les. affaires. Elles vont de mal en pire. Elles vont à la guerre, quelle démence ! J’attend encore votre lettre d’aujourd’hui. La voilà
1 heure
Vous ne m’avez pas entendu sur l’adieu spécial car vous me dites qu’il ne ressemble à nul autre, cela me déplaît beaucoup, les autres ont toujours été si charmants. pour être tout autre il faut qu’il soit bien laid. Je n’en veux pas. Si fait j’en veux, car au moins c’est tout près et s’il commençait mal. Je le forcerais bien à devenir bien mais voyez quelle longue histoire pour si peu de chose. Je suis tout-à-fait enragée contre moi-même. Je vous jure que je ne retomberai plus. Car vous êtes un peu fâché et vous avez raison. Ne m’en parlez plus mais s’il vous plait un adieu qui ressemble à tous les autres. Vraiment, je pense à vous je m’inquiète de vous sur cette maudite affaire d’Orient, sans cesse, sans cesse. Ne vous en tracassez pas trop cependant je vous en prie. L’aventure de votre anneau est arrivée à mon anneau, je suis obligée d’en porter un autre pour le retenir à sa place.
Venez et tout rentrera dans l’ordre. Mon Dieu, si nous étions ensemble ! Vous voulez oui sur tout-à-fait, qu’est-ce qu’était donc tout-à-fait ? J’ai envie de dire oui à tout événement car vous le diriez, et aujourd’hui je me crois obligée à vous obéir, à vous donner toute satisfaction pour vous faire oublier mon iniquité. Oubliez, oubliez, est-il possible que rien puisse m’inquiéter ? Mais c’est si beau, c’est si rare, mon bonheur ; Je ne veux pas que le moindre souffle l’atteigne. Pardonnez pardonnez. Le temps est doux, Paris est charmant. Je suis désolée de penser à toute cette tristesse. Cette solitude de Londres. Je voudrais y retourner. Voilà Mad. Durazzo. Il faut que je vous quitte. Je ne voudrais jamais jamais vous quitter. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon Cœur. Si profond, si fort, si éternel, si tendre si triste. Adieu. Adieu. Adieu. Toute ma vie toujours ! Adieu.
425. Londres, Mardi 29 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je ne vous ai pas écrit hier à mon gré. Vous dîtes que vous ne vivez que pour mes lettres. Que ne puis-je tout mettre dans mes lettres, tout ! Je ne les ferme jamais sans un sentiment triste. J’aurais tant à vous donner et je vous envoie si peu ! Non seulement si peu de ma tendresse, mais de ce qui occupe mon esprit et remplit mon temps. Nous nous le sommes dit cent fois, nous avons bien mieux fait, nous l’avons éprouvé ; rien n’est si charmant que cette entière, continuelle, minutieuse communauté de tout ce qu’on pense, sent, sait, apprend ; cette complète abolition de toute solitude, de toute réticence de tout silence, de toute gêne ; la parfaite vérité, la parfaite liberté, la parfaite union. La vie alors n’a pas un incident, la journée n’a pas un moment qui ne soit précieux et doux. Les plus petites choses ont l’importance des grandes ; les plus grandes ont le charme des petites. Une espérance agréable se mêle à tout. Tout aboutit à un plaisir. Qu’est-ce qu’une lettre pour tenir la place d’un tel bonheur ?
Je vous ferai une confidence. Ma vue, je ne veux pas dire encore s’affaiblit, mais s’alonge. Je ne vois plus aussi également bien à toutes les distances. Par instinct, pour obtenir la même netteté, je place mon livre ou mon papier un peu plus loin de mes yeux. Vous voyez bien que nous sommes du même âge.
J’ai aujourd’hui Flahaut à dîner, avec quelques diplomates. Dedel et Neumann sont encore à Tamworth, c’est-à-dire à Drayton-castle, chez Peel. Mon c’est-à dire est fort déplacé ; vous savez cela très bien. Vous ai-je dit que Neumann était mauvais dans tout ceci, sottement mauvais, commère, vulgairement moqueur, pédantesquement léger ? C’est sa faute sans doute, car je ne comprendrais pas qu’il eût pour instruction de nuire à la transaction et à la paix. Le successeur de Hummelauer, le Baron de Keller, a assez bonne mine, l’air intelligent de la tenue. Pas très instruit par exemple ; voici de sa science, un échantillon qui m’a bien surpris. Il m’a dit l’autre jour que Frédéric le grand était mort l’année d’avant la naissance de Napoléon, vingt ans avant la révolution française, en 1768. Je n’ajoute rien. Je me suis un peu récrié. Il s’est troublé un peu, mais il a persisté, et je me suis tu. Ne racontez pas trop cela. Le bruit en reviendrait à ce pauvre homme, et il m’en voudrait. Il dîne aujourd’hui chez moi
Le conseil d’hier a été tenu mais la discussion ajournée à jeudi. Lord Lansddown, lord Morpeth et lord Duncannen n’étaint pas arrivés. On veut qu’ils y soient. Il pleut toujours. Je n’ai pas mis hier le nez hors de chez moi. J’ai joué au Whist, le soir. Je ne saurais vous dire combien cet emploi de mon temps me choque, je dirais presque m’humilie. Et quand je ne m’en ennuie pas, je n’en suis que plus humilié. 4 heures J’ai été à Holland house après-déjeuner. On a bien tort de ne pas aller se promener là plus souvent. C’est charmant. Voilà donc déjà l’amiral Stopford attaqué. C’est un modéré. Napier lui- même est sur le point de l’être. Il fera, tous les coup de tête qu’on voudra. Il aime les coups. Mais sa correspondance ne plaît point. Il parle trop bien du Pacha et trop des difficultés de l’entreprise. Il faudra faire lord Ponsonby amiral, général d’armée. Il n’y a que lui pour instrument comme pour autour à tout ceci Dedel est revenu. J’ai trouvé sa carte en revenant de Holland house. Je le verrai probablement ce soir. Lady Holland va mieux. Elle n’a pas voulu que je vous le dise, il y a deux jours. Cela porte malheurs dit-elle. Ils finiront par aller passer une semaine à Brighton. Elle se persuade que cela lui sera bon, à elle contre la bile, à lord Holland contre un rhume. J’admire cette disposition à croire selon sa fantaisie du moment.
Ne prenez pas cela pour une pierre dans votre iardin. Je n’ai point de pierre pour vous, et votre jardin est le mien. Mais il est vrai que je m’étonne souvent de votre extrême promptitude à prendre sur votre santé une idée une persuasion, une résolution. Et en m’en étonnant, je la deplore. Et certainement si j’étais toujours près de vous, je la combattrais. Pour la santé comme pour toute chose, il faut de l’observation, de l’esprit de suite, un peu de méfiance de soi-même, un peu de patience. Les complaisants, les flatteurs ne valent pas mieux au corps qu’à l’âme. Je vous prêche. Pas autant que je voudrais bien s’en faut. Il y a bien des choses que je ne vous dis pas parce que, pour les dire avec fruit, il faut les dire tout le jour, toujours ce qui est plus que tout le jour. Et je ne me résigne point à ne pas vous les dire, surtout quand elles touchent votre santé.
Adieu. Adieu devant ma gravure mais sans la regarder en lui toumant le dos. Adieu. Quel adieu !
427. Londres, Jeudi 1er octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Voilà, le 1er octobre le mois nous a fait de belles promesses. Les tiendra-t-il ! Quand serai-je libre ? Vous voyez bien que je ne le suis pas. Jamais je n’ai été plus avant dans l’affaire, et l’affaire plus avant dans sa crise. Pendant qu’on fait effort ici pour une transaction, on fait effort en Orient pour une prompte exécution. D’ici à quinze jours trois semaines, l’un ou l’autre effort aura atteint un résultat. Votre vie a été comme la mienne, bien engagée dans les affaires publiques, et vous en avez le goût comme moi. Ne vous est-il pas bien souvent arrivé de porter cette chaîne avec une fatigue pleine d’impatience, et de désirer ardemment une vie toute domestique toute simple, parfaitement libre, et calme, s’il y a du calme et de la liberté en ce monde. C’est un lieu commun, bien commun ce que je dis-là, mais par moments bien exactement vrai, bien passionnément senti. Je dis par moments pour ne pas donner à ma vie passée et probablement future, un démenti ridicule, car, si je m’en croyais aujourd’hui, je croirais à la parfaite, à la constante vérité du lieu commun. Et comme vous me croirez contre toutes les apparences, je vous dirai à vous, que pour moi le bonheur domestique est le vrai, le seul bonheur, le bonheur de mon goût, la vie de mon choix, si on choisissait sa vie. Mais on appartient à sa vocation bien plus qu’a soi-même. On obéit à son caractère bien plus qu’à son goût. Je me suis porté, je me porte aux affaires publiques, comme l’eau coule, comme la flamme monte. Quand je vois, l’occasion, quand l’événement m’appelle, je ne délibère pas, je ne choisis pas, je vais à mon poste. Il y a bien de l’orgueil dans ce que je vous dis là, et en même temps, je vous assure, bien de l’humilité. Nous sommes des instruments entre les mains d’une Puissance supérieure qui nous emploie selon ou contre notre goût, à l’usage pour lequel elle nous a faits.
J’ai dîné hier à Holland house. Lord Lansdowne, lord Morpeth, lord John Russell. Les deux premiers arrivent pour le conseil d’aujourd’hui. Ils viennent de loin, et fort contre leur gré. Je suis fâché de ne pas connaitre davantage lord Morpeth. Il me plait. Il a l’air d’un cœur simple, droit et haut. J’étais en train de pénétrer dans l’intérieur de cette famille là quand la mort de Lady Burlington est venue fermer les portes. Je les ai pourtant franchies bien souvent depuis ces portes de Stafford house, et avec quel plaisir !
2 heures
437 en aussi bon que long. Merci de vos détails. Ils m’importent beaucoup. Il n’est pas vrai qu’on s’échauffe ici contre la France. C’est un langage convenu. Je crois plutôt que les idées de transaction, le désir d’une transaction sont en progrès dans le public. Petit progrès pourtant, car le public y pense peu. Il n’y a ici point d’opinion claire, forte, qui impose au gouvernement la paix ou la guerre. Il sera bien responsable de ce qu’il fera, car il fera ce qu’il voudra. La question est entre les mains des hommes qui gouvernent. Leur esprit, ou leurs passions en décideront. Quant à la France, personne n’est plus convaincu que moi, par les raisons que vous me dites et par d’autres encore, qu’elle ne doit point provoquer à la guerre, prendre l’initiative de la guerre. Une politique défensive, une position défensive, c’est ce qui nous convient. Mais défensive pour notre dignité comme pour notre sûreté.
Or il peut se passer en Orient, par suite de la situation qu’on y a faite des événements, des actes qui compromettent notre dignité, et par suite notre sûreté. Nous ne devrions pas les accepter. Nous nous préparons non pour accomplir des desseins, mais pour faire face à des chances. Voilà mon abus, et mon langage. On le croit, si je ne me trompe, sincère et sérieux. Je ne m’étonne pas de l’attitude des légitimistes. Ce qu’il y a de plus incurable dans les partis, c’est l’infatuation de l’espérance. Bien pure infatuation, Soyez en sûre. Je ne me promènerai pas aujourd’hui, pas même seul. Il fait froid et sombre. J’aime mieux rester chez moi, à écrire ou à rêver.
Adieu. Je suppose que vous saurez aujourd’hui le secret du bis. Adieu. Adieu.
430. Londres, Dimanche 4 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Nous voilà dans la crise. On dit cela à chaque incident, mais celui-ci est gros surtout par l’effet qu’il doit faire à Paris. Ici on est inquiet. Pas autant que je le voudrais ; pas autant qu’il le faudrait pour qu’on fût sage. On ne croit pas à la guerre. On a le sentiment de sa propre sincérité dans le désir de la paix et dans l’absence de toute intention hostile envers la France. On n’a pas le sentiment de l’état des esprits en France de leurs impressions si vives, de leurs résolutions si soudaines, si on avait prévu, il y a trois mois une telle explosion en France, je suis convaincu qu’on n’aurait pas conclu le traité du 15 juillet. Je l’ai annoncé, répété, rabâché. Mais la prévoyance est ce qui se communique le moins. Et quand on n’a pas prévu, on ne veut pas voir.
Ma situation ici ne me plaît pas. J’ai beaucoup à attendre et peu à faire. On est à merveille pour moi, même ceux qui ne sont pas de mon avis et ne s’y rendent point. Un moment peut venir où je profiterai de cette bonne disposition ; le moment où, ne réussissant pas, en Syrie par les premiers moyens, employés et ne se souciant pas d’aller plus loin, on sentira, la nécessité d’une transaction. J’attends et je prépare ce moment là, quand viendra-t-il ?
On parle de la convocation de nos chambres. Celle du Parlement suivrait aussitôt. Mais, pour moi comme pour le public ce ne sont là que des bruits. C’est maintenant à Paris que se font les événements. Au moins vous me donnez de bonnes nouvelles de vous. Comment s’y est-on pris pour vous écorcher l’épaule ? Il faut que votre femme de chambre ait la main bien lourde. A quoi lui sert donc d’être laide ?
Lundi 2 heures
Trouvez donc un Byng qui vienne à Londres et que je puisse aimer aussi. Je n’ai point de nouvelles ce matin. La convocation des Chambres ! Je crois bien. Politiquement, je la désire. Je sais bien les entraînements publics, la tribune ; mais je sais aussi les entraînements cachés, insensibles, les journaux, les commérages.
Après tout, depuis dix ans, j’ai toujours vu dans les grandes occasions, les chambres favorables au bon parti ; à la raison, au vrai intérêt du pays, et lui prêtant une force qu’il ne pouvait puiser ailleurs. C’est avec les chambres que nous avons lutté contre l’entrainement révolutionnaire, contre les fatuités anonymes de la presse, contre la politique de café. Nous sommes sur le point de rentrer dans la situation de 1831. Avec plus de péril peut-être, et moins d’excuse. Je sais que, pour que les Chambres se rallient à la raison, et la soutiennent, il faut la leur montrer, la tenir constamment sous leurs yeux, la vouloir fermement soi-même et leur en inspirer la confiance. J’espère que cette lumière et cette volonté ne manqueraient pas plus aujourd’hui qu’en 1831, et que si la raison devait succomber ce ne serait pas sans s’être montrée et défendue.
J’ai reçu une longue lettre du duc de Broglie, très judicieuse, et qui me fait croire qu’on ne fera rien de précipité. Vous avez bien raison ; 20 n’a pas de l’esprit tout à fait ; et quand les grands moments approchent ce qu’il en a se trouble et chancelle. Il peut alors se laisser aveugler et entraîner comme un enfant. De son côté 62, très courageux contre le danger, est très timide contre la responsabilité. Il a naturellement beaucoup indépendance et de dignité, peu de pouvoir. Le frêne a beau chercher ; il n’apprendra pas de là ce qu’il aurait, besoin de savoir. Je suis très préoccupé du frêne. Il est très décidé ; mais il ne voudrait pas se tromper sur le moment où doit se placer sa résolution. Deux choses font le succès d’une conduite, son mérite et son à propos. On ne devine pas l’à propos. Il faut le voir. Je voudrais que ma vue s’alongeât plus encore. Je prêterais mes yeux au frêne. Bien décidément j’envie le cottage, j’aime le cottage. Et parlerions-nous quelquefois de tout cela ? J’ai peur que oui. On n’abdique pas sa nature. On ne se fait pas petit, même pour être heureux. Je voudrais pourtant bien être heureux. Qu’est-ce qui vaut une heure de bonheur ? Et quel bonheur ! C’est bien là l’orgueil humain. Je préfère infiniment le bonheur à tout. Je n’aime, à vrai dire, que le bonheur. Mais pour le bonheur, dans un cottage comme dans un palais, je veux à côté de moi, à moi, un grand coeur, un grand esprit, un grand goût, l’intimité d’une grande pensée. Je ne puis pas être heureux à moins, pas cinq minutes. Mais je serais si heureux ? Adieu. Adieu.
431. Londres, Mardi 6 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
sept heures et demie
Moi aussi je suis très agité. Tout absolument, tout est engagé, pour moi dans cette question. Mes plus chers intérêts personnels. Les plus grands intérêts politiques de mon pays, et de moi dans mon pays. Et tout cela se décide sans moi, loin de moi, en Syrie par le canon de Napier, à Paris par les conseils d’un Cabinet qui n’est pas le mien.
Ma raison persiste dans sa confiance. Je ne crois pas à la guerre. Mais mon âme est pleine de trouble. Je n’ai jamais été si agité. On se promet ici un succès prompt. On se promet que ce qui s’est passé à Beyrouth se passera, non à Alexandrie, on ne le tentera pas là, mais sur toute la côte de Syrie, à Sidon, à Tripoli, à St Jean d’Acre. On se promet. que, cela fait, le Pacha cédera et qu’on s’arrangera. On est bien léger bien présomptueux bien aveugle. Mais tout le monde l’est. On agit au hasard. On parle au hasard. Vraiment les affaires des hommes sont étrangement faites. S’ils étaient capables de le voir, ils ne le souffriraient certainement pas. Quand on n’est pas content de la politique on fait de la morale.
Hier soir à Holland house. J’étais mécontent, de mauvaise humeur. Je l’ai montré. Ce pauvre lord Holland était troublé, interdit. Il n’est pas fait pour être affligé, seulement contrarié. Il voudrait tout le monde toujours doux, aimable, content. Lady Holland a l’âme plus forte. Elle était extrêmement blessée d’un article de l’Examiner, qui a mis Holland house, en scène. Elle connait l’auteur. Elle l’a bien traité. Je lui conseille, à l’auteur, de ne pas se trouver sur son chemin. Je suis fort en scène aussi dans cet article, très convenablement pour moi, Français. Je gouverne d’un côté les vieux Whigs par Holland house de l’autre les radicaux. J’agite l’intérieur du cabinet. Du reste, l’article n’est pas si mauvais qu’il en veut avoir l’air. Au fond, il conseille une transaction.
Lord et lady Shelburne, Charles Greville, Sir Hussey Vivian, un ou deux inconnus. Lady Clanricard n’est pas à Londres. Lady Shelburne attendait avec quelque impatience que je me fisse présenter à elle. Elle a dit à lady Holland : " J’ai vu bien souvent M. Guizot à Paris, mais je n’étais rien alors. Il ne me connait pas. "
Je me suis fait présenter à présent qu’elle est quelque chose. Lord Shelburne aurait mieux fait d’insister pour Emilie. Elle était là, à côté. Décidément, dit lady Holland, ils partent après-demain pour Brighton. Leurs logements y sont arrêtés. Pour huit jours. Huit jours d’air nouveau et d’eau de Marienbad.
2 heures
Ne me grondez pas, je vous en prie, ne me grondez pas de ma réserve. Elle me déplaît bien autant qu’à vous. Mais soyez sûre que j’ai raison. Dans une situation très difficile, très délicate, il ne faut pas mettre contre soi, ne fût-elle que d’un sur mille, la chance d’une lettre perdue, d’une lettre ouverte, d’un mot échappé. Vous entrevoyez, mais vous ne savez pas à quelles difficultés, à quelles personnes je suis peut-être sur le point d’avoir affaire. Je n’en frémis pas. Je mentirais si je disais que j’en frémis. Mais si cela arrive, ce sera bien grave. Il ne faudra pas faire une faute et on en ferai; pas perdre une force, et on en perdra. Vous en savez sans doute, à l’heure qu’il est bien plus que moi. Mais l’article du Constitutionnel de dimanche me paraît bien clair. C’est la guerre ou la retraite.
J’attends demain. Demain m’apportera certainement quelque chose. Je viens de me promener. Toujours Regent’s Park. Je ne m’en lasse pas. Personne du tout. Un air doux et calme. La nature parfaitement étrangère selon son usage aux agitations des hommes. J’étais plus occupé qu’agité en marchant sans bruit dans ces allées tranquilles. La paix ou la guerre quelle question toujours ! Quelle question aujourd’hui ! Que de questions, et lesquelles, dans celle-là ! J’ai un avis. Je n’ai que cela. Est-ce assez ? Je veux voir Lucia de Lammermoor avec vous. Je ne crois pas que le mois d’octobre se passe sans que nous nous voyions. Adieu. Adieu en attendant.
432. Londres, Mercredi 7 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Voici une lettre d’Ellice. Il me l’a envoyée ouverte en m’engageant à la lire. Il a vraiment de l’esprit et plus d’intelligence continentale et française que presque tous ici. Il a compris, dès l’origine, que, par le chemin où l’on entrait, on en viendrait où nous en sommes. Si tout le monde, avait prévu aussi clair, tout le monde aurait agi autrement. Le vice radical de cette situation, c’est qu’elle n’était pas du tout nécessaire. Aucun grand événement, aucun grand motif européen n’y a conduit. Il y avait, dans un coin de l’Asie, entre un vieux Pacha et un Sultan mourant, une querelle qui laissée à elle-même, serait morte avec eux sans trouble un moment l’Europe. On en a fait une chance de guerre générale. Pourquoi ? Pour satisfaire la passion de lord Ponsomby contre le Pacha et les rêves de Lord Palmerston pour la résurrection de l’Empire Ottoman.
Voilà un courrier. Il ne m’apporte rien, rien du tout. J’en conclus qu’on patauge encore. Le mot est bien à l’image du fait. Je ne veux pas me dire, à moi-même, à quel point je suis impatient. Je vais faire ma toilette, en attendant la poste. 2 heures Certainement non. Jamais trop de feuillets, jamais assez. Vos lettres, c’est mon pain, mon délicieux pain quotidien. J’ai faim avant. Quand elles sont courtes, j’ai faim après. Quand elles sont longues, je suis nourri, point rassasié. Oui nous sommes parfaitement Ninojlubtn, et je sais parfaitement ce que cela veut dire. C’est un mot charmant. Et qui serait encore plus charmant de près que de loin.
La crise de Paris me paraît vive. Je rabâche, car je suis sûr qu’elle est moins vive qu’elle ne paraît. Comme au fond du cœur, presque personne n’a envie de la guerre, pas même les trois quarts de ceux qui la demandent à si grands cris, il est impossible que le fond du cœur n’influe pas sur la réalité de la conduite. On paie les autres d’apparences, et de paroles ; on ne s’en paie pas tout-à-fait aussi aisément soi-même. Cependant un moment peut venir où l’on l’enivre de tant de paroles et si bruyantes. Je n’irai pas avec les gens ivres. La guerre peut sortir de cette situation, et c’est son immense mal. Si elle en sort inopinément, forcément il faudra bien l’accepter, et l’accepter galamment. Mais je crois qu’on peut empêcher qu’elle n’en sorte, et qu’il y faut travailler ardemment. Et toute politique qui poussera, ou se laissera pousser à la guerre ne m’aura pas pour complice.
Probablement, je vous ai déjà dit cela bien des fois. Je rabâche, car je suis très convaincu. Je suis sûr que Thiers se défend contre le vent qui souffle autour de lui si le vent l’emportait, ce ne serait pas une raison pour se laisser emporter soi-même, et pour laisser tout emporter. Il y a encore de la folie révolutionnaire de la folie militaire dans mon pays ; mais aujourd’hui dans cette folie même, il y a plus d’écume que de venin. Et on trouvera toujours, dans le bon sens honnête de pays un point d’appui pour résister. Je pense aujourd’hui, comme en 1831, que pour une guerre juste, inévitable, défensive, la France est très forte, et que l’Europe serait bientôt divisée. Il faut donc que la guerre si elle doit éclater, soit ramenée à ce caractère, et contenue dans ces limites. Et à ces conditions, je suis porté à croire qu’elle n’éclatera pas. Car, malgré la faute très grave que l’Europe a commise en laissant se former, en formant de ses mains, un tel orage pour un si misérable motif, je crois encore au bon sens de l’Europe, et je suis persuadé qu’en Europe comme en France, la bonne politique trouverait de l’appui. Du reste le très fidèle m’écrit ce matin que la bourrasque de dimanche est un peu calmée et que les choses vont moins vite.
Ici, il y a certainement un peu d’inquiétude réelle et un désir sincère de jeter de baume sur les plaies de celte situation, en même temps qu’un parti pris d’exécuter ce qu’on a entrepris, et de ne pas faire acte de faiblesse. On est plus léger avant qu’après. On ne veut pas avoir été léger en paraître intimidé. Mais on n’est pas sans sérieuse appréhension et on a grande hâte d’atteindre le terme du défilé pour se montrer au bout. un peu plus accommodant qu’à l’entrée. Les Ministres se sont dispersés de nouveau. Mais je ne crois pas que lord John Russell, s’éloigne désormais de Londres. J’espère que Berryer et les siens n’espéreront pas trop. Les étrangers, et l’Ancien Régime, la coalition et la contre-révolution, ce sont les deux spectres du pays ; leur vice le pousse à la folie. Adieu. Je ne méprise rien. Je ne me lasse de rien. Je désire tout. Je ne peux me contenter que de tout. Mais j’aime et je goûte toujours avec le même plaisir les moindres portions de ce tout ravissant. Adieu donc aussi tendrement que le jour où adieu fut inventé.
434. Londres, Vendredi 9 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je ne veux dire à personne, pas même à vous, pas même à moi. même, de quelle impatience je suis dévoré. J’attendais un courrier ce matin. Il ne vient pas. Je vois dans les journaux anglais que les Chambres sont convoquées, pour le 28 octobre. Dans vingt jours ! Et d’ici là, que se passera-t-il ? Que va-t-on m’envoyer, me donner à dire, à faire ici ? Je persiste à croire à la paix très décidément. Il faudra encore bien des méprises pour amener la guerre. J’espère qu’il n’y en aura pas assez, de part ni d’autre. Dans vingt jours enfin. J’ai le cœur et l’esprit pleins, pleins ! Quel moment que l’ouverture des Chambres si tout est encore en suspens ! Vous vous porterez bien, n’est-ce pas ? Je n’aurai pas à m’inquiêter sur vous ? Je vous quitte. Je ne puis pas parler.
3 heures
Ma disposition est toujours la même. Je veux pourtant vous parler. On est inquiet ici. Je ne veux pas dire très inquiet. On n’est jamais très inquiet. On est très brave et très en sureté. C’est heureux d’être une grande nation avec l’Océan pour enceinte continue. Mais on redoute réellement, sinon les périls du moins les maux de la guerre. Et puis, on n’a nul goût pour une rupture avec la France ; on tient vraiment à vivre en paix et en amitié avec la France. Cela est profitable et cela a bon air. Les deux grands pays civilisés ; two gentlemen-countries. Et puis encore, au fond du cœur, on aurait honte d’une guerre si peu motivée, amenée uniquement parce qu’on ne l’aurait pas prévue, parce qu’on ne l’aurait pas crue possible. Car si on l’avait crue possible, on n’aurait certainement pas fait ce qui peut l’amener. Voilà la disposition au vrai. Je ne puis pas ne pas croire qu’on peut encore en tirer parti et sortir de cet abominable défilé. Mais, dans les actes et les paroles, la nuance est délicate et indispensable à saisir. En même temps qu’on a envie d’éviter la guerre et de s’accommoder, on est fier surceptible même. Pour rien au monde, on ne voudrait avoir, l’air de céder à la menace. On est, à cet égard, d’une préoccupation presque maladive. Ma principale inquiétude de ce moment est là. De part et d’autre, on a la peau d’une sensibilité prodigieuse. Il y faut des mains de velours. Mains rares, surtout après tant de révolutions, et de guerres.
Avoir raison au fond, et raison dans la forme, c’est beaucoup exiger. Ce sont des moments bien périlleux que ceux auxquels la perfection seule suffit. Et qui sait si la perfection même suffirait ? Je passe ma journée, en alternatives d’inquiétude et d’espérance, situation fort contraire à ma nature qui est portée à conclure, non à flotter et quand elle a conclu, à marcher ferme selon sa conclusion. Par mon instinct je dirai plus par mon expérience, j’ai confiance, grande confiance dans le courage au service du bon sens. Mais l’épreuve peut être bien rude. Et encore je ne vois les obstacles que de loin.
Je désire beaucoup, en me rendant à la session, pouvoir aller prendre ma mère et mes enfans au Val-Richer et les ramener avec moi à Paris. Je respirerais deux ou trois jours l’air de la campagne. Je ferais ce que vous me conseillez et j’arriverais un peu reposé. Car j’arriverai. C’est encore une chose dont je ne peux pas parler. Je n’ai point de petite nouvelle à vous mander. Je me trompe. M. de Brünnow, vient de m’écrire pour me prier d’aller après-demain prendre du thé et jouer au Whist à Ashburnham house. Je ne suis encore entré qu’une fois dans cette maison Ià, et certes pas avec indifférence. Unir à ce point dans le présent et étrangers, dans le passé, cela ne vous semble-t-il pas impossible ? Le comte de Noé est venu me voir il y a deux jours, m’apportant la nouvelle que Mad. Sébastiani était morte, morte à Richmond, au Star and Garter. C’est Mad. Bathiany qui est morte là. Voilà l’ordonnance de convocation, des chambres dans la seconde édition du Morning Post. C’est bien pour le 28. Adieu. Adieu.
433. Londres, Jeudi 8 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Mardi est votre mauvais jour. Jeudi est mon jour médiocre. Le mardi, vous m’écrivez plus brièvement ; vous n’avez pas en m’écrivant, le sentiment d’espérance ou de satisfaction qui anime et prolonge l’entretien. Comme nous regardons à tout ! Il n’y a rien de petit pour nous et entre nous. Je dis nous ; vous avez bien raison, tout est pareil entre nous ; nous n’avons rien à nous demander. Nous nous savons. Décidément les Holland partent aujourd’hui pour Brighton. J’ai été leur faire mes adieux hier au soir. Pour huit ou dix jours. Je dis décidément parce qu’on le disait. Ils pourraient bien être encore retenus ou bientôt rappelés. Il y aura peut-être un nouveau conseil de Cabinet après-demain samedi ou lundi. La gravité de la situation se fait sentir et je la fais valoir. On cherche sérieusement un moyen de calmer la France et de se rapprocher. Les plus raides eux-mêmes le cherchent. Il faut le trouver pendant que le traité s’exécute. Il faut se rapprocher au bruit du canon qui vient frapper les cœurs en France, sinon les corps. C’est difficile. Cependant, pourvu qu’on ne fasse pas de folie à Paris, je crois toujours qu’on finira par là. Moi aussi, j’attends la convocation des Chambres. Il faut au moins vingt jours de délai. Cela porte aux premiers jours de Novembre. Du reste, officiellement je n’en sais absolument rien.
C’est le peintre qui n’a pas voulu que je le regardasse. Car, pour vous regarder vous ; il aurait fallu le regarder lui, et tout le monde, et de la même manière. Il a dit qu’il valait mieux ne regarder personne et penser à quelque chose. Moi, je dis à quelqu’un. Pour être vrai cependant, je crois que c’est à quelque chose que pense mon portrait. Grand défaut de ressemblance. Hier soir en revenant de Holland house, j’ai été passer une demi-heure chez Mad. de Björstierna, soirée invitée. Tout ce qu’il y a ici de diplomates grands ou petits, et quatre ou cinq Anglais. J’ai joué au Whist. M. de Brünnow est toujours assez malade, et vraiment très changé. Je l’ai rencontré, il y a trois jours comme je faisais à pied ; le tour de Hyde park, ce tour que nous avons fait souvent le soir en calèche. Il se promenait aussi à pied. Il s’est joint à moi, avec un grand empressement et n’a pas voulu me quitter qu’il ne m’ait reconduit jusqu’à ma porte. On m’écrit que M. de Tatischeff à Vienne, M. de Meyendorff à Berlin, et même vos plus petits agents, dans les plus petits endroits sont remarquablement polis et soigneux depuis un mois avec les agents français, beaucoup plus qu’avant. En savez-vous quelque chose ? Et qu’est-ce que cela veut dire, si cela veut dire quelque chose, ce que je ne crois pas ?
Lord Melbourne est venu hier à Londres. Mais il n’a pas que dîner à Holland house. Il est retenu chez lui par un fort lumbago.
2 heures
Je reviens de Regent’s park. Je marchais dans Portland Place, les yeux baissés. Je les lève et je vois devant moi, assez loin une femme en noir, grande mince, un chapeau blanc, un petit voile, un mantelet de velours noir. Elle a paru me voir au même moment et doubler le pas. Le cœur m’a battu, mais battu ! Comme le sang vous monte au visage. On parle de l’influence du physique sur le moral. Et du moral, sur le physique, qu’en dire ? Pendant quelques minutes, toute ma personne s’est ressentie de cette idée, cette chimère, qui m’avait traversé l’esprit un quart de seconde. Vous avez très bien fait d’écrire à Paul. Vous le pouviez très convenablement après la façon dont vous vous étiez séparés, et dès lors vous le deviez, car vous devez ne laisser jamais échapper une occasion de lui fournir un moyen de revenir de ses torts. J’avais espéré que votre dernière entrevue, amènerait quelque chose d’un peu mieux que le simple décorum extérieur. Je crains bien qu’il ne veuille que cela. S’il vient à Paris, il faudra lui donner ce qu’il veut, et toutes les fois que vous le pourrez avec dignité, lui laisser entrevoir que, s’il voulait, il pourrait avoir davantage. Une humeur très égale, une douceur un peu triste, mais calme et persévérante, finiront peut-être par réveiller dans ce cœur là quelques uns des sentiments qui devraient y être. Comment ne m’aviez-vous pas dit que vous lui aviez écrit ? Le Chêne et le cèdre sont également sages. Ils écrivent, l’un et l’autre, très rarement à 21, et toujours avec une réserve prévoyante. Ce serait une triste et curieuse histoire que celle des rapports du hêtre avec 99, et qui ferait pénétrer bien avant dans les plus fins et plus profonds replis du cœur humain. Les mêmes passions, les mêmes faiblesses qui dominent sans pudeur comme sans combat, dans les natures grossières et basses, pénètrent souvent, par de très longs détours et après, des transformations infinies, dans les natures hautes et délicates. C’est là, dit-on de quoi dégoûter des hommes. Je ne le trouve pas. J’ai rencontré bien des coeurs légers, mais aussi des cœurs fidèles. J’ai vu tomber bien des gens ; j’en ai vu qui sont restés debout. Un seul bel exemple compense et efface presque à mes yeux, des milliers d’exemples tristes. Et là même où le mal se glisse, tout le bien ne périt pas. L’âme peut accueillir de mauvais et petits sentiments, et pourtant rester noble encore.
L’expérience de la vie m’a appris à beaucoup dédaigner et à rester juste. Je suis devenu plus exigeant à part moi, et plus indulgent dans presque toutes mes relations. Je me donne bien moins et je pardonne bien davantage. Et puis pour croire à la lumière, et pour en jouir, je n’ai pas besoin qu’il y ait au ciel des millions d’étoiles ; mon soleil me suffit. J’ai vu plusieurs personnes ce matin. Il me semble que l’inquiétude est réelle ici et va croissant. Hier soir chez Mad. de Björstierna, Neumann me disait, avec quelque componction, que certainement, si l’on avait prévu tout cela, on aurait fait autrement. Easthope sort d’ici, très inquiet, et répétant qu’il faut qu’on fasse quelque chose pour calmer la France. Nous verrons. Cette situation ne peut plus se prolonger beaucoup. Adieu. Que je passerais doucement de longues heures à causer avec vous ! Et les interruptions mille fois plus douces encore que les causeries. Adieu Adieu.
448. Paris, Samedi 10 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai déjà votre lettre, c’est qu’elle me vient par le vieux et le moins élégant . Elle est assez bonne votre lettre. Vous avez l’air d’espérer quelque chose. Si l’on veut faire, il est temps de faire ! J’aime votre lettre, j’aimais bien celle d’hier. Je les aime toutes. Vous ne savez pas comme j’aime, comme je pense, comme je rêve, comme j’attends !
Hier mon ambassadeur et Bulwer, tous les Appony. Dîner aves mon fils. Le soir chez les Granville, Granville était un peu blessé d’avoir vu reproduit et perverti comme dit Bulwer, un entretien qu’il a eu avec Thiers. C’est le Courrier français qui répétait et avec des expressions ironiques pour l’Angleterre. Granville continue à être très inquiet, tout le monde le devient beaucoup. Thiers demande souvent à mon ambassadeur des nouvelles de notre flotte. Il lui répond invariablement qu’il saura par Copenhagen quand elle passera, et que lui n’en sait rien.
On parle de convention nationale polonaise qui s’organiserait à Paris. On élira un roi, et l’on ajoute que si la France à besoin de prendre la Belgique elle priera Léopold d’aller trôner à Varsovie. Je vous redis tous les commérages diplomatiques. Je vous assure que l’attitude de Pahlen est parfait, un vrai gentleman au reste ils le sont tous ici dans cette occasion. Que pense Dedel de son nouveau roi ? Moi j’en pense très petitement. De très jolies formes couvrent un très pauvre fond. L’air d’un vieux chevalier et les actions d’un chevalier d’industrie. La mine ouverte, et une grande fausseté. Enfin c’est non seulement peu de chose, mais une mauvaise chose. Voilà mon opinion. Il faut absolument que vous permettiez ou que vous ordonniez au très fidèle d’aller vous trouver à Calais ou sur la route, quand vous reviendrez. Il sera bon que vous causiez à fond avec lui avant de voir personne ici.
Certainement j’ai pris 20 en grande dé plaisance. 29 qui est son reflet parle trop légèrement du Fresnes et puis on dirait qu’il est inutile de compter avec le chêne.Tout cela est traité étrangement. J’ai de la colère intérieure, j’aimerais bien à la montrer.
La petite duchesse de Dino est accouchée bien péniblement et tristement d’un enfant mort. Elle a eu des couches affreuses. Le duc de Mortemart vient de perdre son fils unique à 24 ans, tué par un cheval. Le duc de Wellington a écrit ici une lettre que j’ai lu à me M. Raylkes bien petit personnage. Un ivrogne, et un grand Tory, dans laquelle il lui dit après avoir déplore les circonstances que pourraient mener à une rupture avec la France : " Mais si la guerre a lieu, soyez sûr que nous étonnerons le monde par les efforts gigantesques que nous ferons pour la soutenir. Ils seront tels qu’on n’en a pas vu encore de semblable. " Je vous avoue que toute cette lettre me parait du Stuff. C’est décousu et trivial à l’excès.
Le 28 est proche, le cœur me bat de joie. Vous viendrez, vous viendrez n’est-ce pas ? Si vous pouviez venir avec quelque chose, quelque grande chose ! Il y a dans mon cœur une confusion de politique est d’amour qui est tout à fait risible. La nuit, le jour, je ne pense qu’à cela ; avec passion, avec inquiétude. Ah mon Dieu !
Adieu. Adieu. Comme vous voulez. Adieu. Je vous ai demandé avant hier je crois de nouvelles de Brunow. Vous m’en donnez aujourd’hui, on dirait que nous nous parlons par télégraphe. Je n’attends pas une grande importance à ce que vous me dites des manières nouvelles de nos diplomates. Cependant, je ne sais pas.
Adieu. Adieu. Le leading article du journal des Débats ce matin est admirable. C’est vrai tout cela est bien étrangement même ! Voilà ma belle-sœur arrivée. Adieu. Adieu. Il y m’a beaucoup dans cette lettre. Jamais assez Adieu.
450. Paris, Lundi 12 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
C’est à présent que j’ai de la joie à voir s’écouler les jours ! Regardez dans votre cœur et voyez tout ce qui se passe dans le mien. C’est cela ; tout cela, et peut être plus que cela. La journée hier a été très à là paix. Toutes les nouvelles, tous les symptômes étaient à cela. M. de Werther, Granville surtout et même les petites gens, Flahaut & &. J’ai fait ma promenade vers Boulogne. J’ai été rendre visite à Mad. Rothschild qui est dans une angoisse inexprimable sur les affaires. Son mari était à Ferrières. J’ai dîné avec mon fils. Le soir j’ai été un moment chez les Granville, un autre moment chez Mad. de Flahaut et à 10h 1/2 dans mon lit.
Je suis de plus en plus mécontente de S.. Il voudrait tout arranger pour la plus grande commodité de M. Il ne s’embarrasse guère dans cet intérêt d’aplatir le bouleau. Tous les propos de F. sont dans ce sens, et si forts qu’on m’a dit que la violette hier était sur le point de se fâcher. D’un autre côté 62 fait tout au monde pour retarder l’arrivée du peuplier.
11 heures
Voici votre lettre. Je suis bien contente de vous voir bien augurer du résultat de la note. Que Dieu vous accorde le bonheur de voir tout ceci s’arranger pacifiquement. Je suis charmée de tout ce que vous me dites sur votre propre compte.
Moi, je n’ai qu’un avis, un avis grave à donner c’est celui-ci. Si vous n’êtes pas à Paris dès le 28, vous ne pouvez être ce jour-là qu’à Londres. J’avais écrit deux longues pages de développement sur cela, j’aime mieux abréger, ceci vous suffit. J’ai vu le petit ce matin, et puis je viens de me rafraîchir sur la place.
Que de choses à dire, à demander, à commenter. Que les heures de bavardage seront charmantes. Elles se présentent tellement comme cela à mon imagination que je me ravis déjà aujourd’hui que vous dire sur ce pauvre papier. Mais dites-moi bien que vous croyez à la paix, qu’elle est sûre.
Depuis hier je commence à y croire, sans oser presque me l’avouer Mardi demain, c’est affreux ; j’ai si besoin de savoir tous les jours un mot consolant.
Je n’ai pas de nouvelles, je ne sais rien, on attend des dépêches télégraphiques sur l’Orient. Elles tardent bien. Le ton des journaux ministériels est bien doux presque timide. Le journal des Débats fait des articles très habiles, c’est qu’il est libre. An fond c’est la condition de pouvoir, de ne pas l’être.
Selon moi il n’y a de Val Richer possible qu’avant le jour de la convocation, pendant ce jour-là impossible. Voilà une et deux interruptions. Pardonnez, pardonnez. Adieu. Adieu. Ecrivez moi. aimez moi (quelle bêtise !) et arrivez. Adieu.
455. Paris, Samedi 17 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
455. Paris, Samedi 11 octobre 1840,
Oui je suis d’accord avec vous sur tout ce que vous me dites. Prenez ce oui aussi largement que vous voudrez pour le moment, je vous parle de quelque chose de sérieux. Londres vaut mieux que Paris dans les derniers jours du mois, à moins comme vous dites qu’il ne vous vienne de nouvelles lumières.
J’approuve complètement votre résolution de rester étranger à toute intrigue ; et votre absence en sera la preuve la plus forte. Mais il ne me parait pas possible de ne pas être ni pour la discussion de l’adresse ? N’est- ce pas ? C’est dans l’intérêt de votre situation politique que je parle. Et puis, si vous ne venez pas alors où serait le prétexte de venir après ? Ce ne serait plus possible. Que vous devez être troublé, agité! Mon Dieu comme je le comprends ! Comme je le suis moi même ! Quelle bagarre où se trouve tout le monde, toute chose !
Thiers a confié à quelques diplomates son envie de se retirer retirer M. Urguhart qui devait être reçu par le roi ne l’a point été. Lord Granville fait ce qu’il peut pour empêcher Thiers de recevoir ; la députation de Birmingham, Attwood & &. Il a dit à Thiers que cela équivaudrait à Palmerston recevant M. de Lamenais avec une députation de républicains. Je ne sais encore ce que fera Thiers sur cela. J’ai vu chez moi hier matin les Appony. Après cela les Granville. Le soir j’ai été chez eux. Je ne suis pas d’avis comme vous de laisser M. de Brünnow tranquille j’écris à mon frère je vous enverrai ma lettre.
11 heures mille bons adieux pour votre lettre. Je l’aime bien. Je suis comme vous quand j’entends de la musique. Et une fois la semaine j’en entends de la bonne. Je choisis votre place, je jouis d’avance. Que de charmants moments. Je ne pense qu’à cela quand je ne pense pas au plus grave ; et le plus grave je n’y pense qu’en ce qu’il a des rapports à vous. C’est bien vrai. ce que je vous dis ! Et vous le croyez bien. Et moi je crois bien tout ce que vous me dites. Ce que j’appelle grave, est votre superficiel, comme vous l’appelez superficiel relativement à ce qu’il y a dans le fond de votre cœur et qui est votre vie, comme la mienne. Et bien êtes-vous content de ma foi ?
J’aime votre résolution pour votre arrivée, j’aime la manière dont vous le dites. Après cela il ne faut rien d’absolu, car les événements peuvent vous mettre dans la nécessité de modifier votre résolution. Jusqu’ici je n’en vois pas l’occasion, mais si elle venait je saurais tout comprendre. En attendant vous avez mille fois raisons de vous poser ainsi, ferme, décidé et droit.
Savez-vous que la situation de Thiers est la plus difficile, la plus critique qu’il soit possible de se figurer ?Je ne comprends pas comment tout celle se débrouillera. on croit beaucoup qu’il nous donnera un coup de théâtre avant l’ouverture des Chambres. On dit ou autre chose.
En attendant le bruit se répand qu’Ibrahim marche sur Constantinople, en ce cas là nous occupons Constantinople et ce cas là est-il pour vous la guerre ? Mon Dieu, la guerre, jugez ce qu’est pour moi, pour nous la guerre !
1 heure. Voici mon visiteur du matin qui me quitte. Je suis fort aise de tout ce qu’il m’a dit et qu’il ne vous mander. Cela se pose bien. Le 62 de Samedi ressemble bien peu au 20 de jeudi. Rien ne me ferait plus de plaisir que de voir 1 revenir à ses bons sentiments. C’est utile. Il me semble que je puis commencer à me réjouir. Et pendant, tout est si mobile ici.
J’ai vu hier des personnes qui dînaient au Club jeudi. Lorsqu’on est venu raconter le coup de carabine. Je ne suis pas contente de la manière dont cela y a été pris : de l’indifférence, la légèreté. Des jeux de mots. c’est le tirant et non le tyran qui a été blessé. Et des éclats de rire. Les journaux sont très bien, et à tout prendre je crois ceci une bonne fortune. Adieu, car j’ai peur d’être interrompue cela m’arrive si souvent. Adieu, adieu.
441. Londres, Vendredi 16 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je ne suis pas sorti hier soir. J’ai joué au tric-trac, et je me suis couché de bonne heure. Il y a des choses plus agréables à mettre dans une soirée où l’on ne sort pas. Après mon tric-trac, je suis rentré dans ma chambre, je me suis promené près d’une heure, pensant, pensant et faisant dans mes pensées, ce que vous appelez une confusion visible de deux choses qui vont très bien ensemble, nous en sommes sûrs. Je me suis couché, je me suis endormi, et je n’ai plus retrouvé dans mes rides qu’une seule des deux choses. Evidemment l’autre ne va qu’au jour. Elle ne s’y montre pas aussi hardiment qu’elle s’en vante. Je suis très frappé de la reculade de ces gens de la garde nationale qui voulaient faire dimanche dernier une grande démonstration. Cela me prouve, comme je l’ai toujours cru qu’il y a là plus de bruit que de force et même que de vraie passion. Les factions, les coteries ont aujourd’hui en France très peu de force réelle. Il suffit presque, pour les vaincre, de n’en avoir pas peur. Mais bien des gens en ont peur. Et bien des gens aussi aujourd’hui, très honnêtes, très sensés en général, sont réellement blessés, vivement blessés du procédé anglais. Il y a grande excitation du sentiment national. Elle m’arrive de toutes parts. Comment le contenir sans l’irriter encore ? C’est bien difficile.
Quelles pauvretés je vous dis là ! Ce sont pourtant là, mes pensées habituelles. Et il le faut bien. 2 heures Je suis plus que contrarié. Comment.
Mercredi, à 2 heures et demie, vous n’aviez pas même la lettre que je vous ai écrite dimanche, qui a du être mise lundi à la porte, à Calais et vous arriver mardi ! C’est souverainement déplaisant. Moi qui prends tant de plaisir à faire luire, quand je le peux un doux rayon sur le mardi ! Ne manquez pas de me dire, si cette lettre vous est parvenue, quel jour et à quelle heure. Elle a dû vous être remise par celui que vous appelez mon confident pressé. Je vais attendre votre lettre de demain avec un redoublement d’impatience. Il y a toujours quelque raison pour que mon impatience redouble. J’aurais tant à vous dire, tant à déliberer avec vous !
La grande question pour moi dans ce moment, c’est le jour de mon arrivée à Paris. Traitez la à fond avec le fidèle. Ecoutez bien tout ce qu’il vous dira. Il y a deux jours, j’étais à peu près décidé à n’arriver que le 1er novembre. Il me revient des choses qui méritent qu’on y pense. Pensez donc.
Les amis de la paix sont contents du résultat du Conseil d’hier. On annoncera l’intention de ne pas poursuivre la déchéance du Pacha en Egypte. On conseillera à le Porte d’y renoncer, et de se montrer accessible à un rapprochement avec lui. C’est un commencement qui peut amener une fin. Les rapports, les conversations, les ouvertures, entre la France et les quatre se trouveront rengrénés. En attendant, toujours point de nouvelles de Syrie. Tous les boulets du monde ne portent pas à mille pieds de la côte. Ce n’est pas assez pour chasser les égyptiens du pays. Et les jours s’écoulent. Et les vents se levent. Encore trois semaines pareilles, et tout est fini jusqu’au mois de mai.
4 heures et demie
Des visites. Flahaut. Mac Gregor & &. Je ne vous reviens que pour vous dire adieu. Il faut que j’écrive à Thiers. Votre courte lettre de ce matin ne m’a pas convenue. Je veux que vous me disiez, beaucoup beaucoup en tous genres, beaucoup des deux choses. Adieu pourtant le même, adieu.
440. Londres, Jeudi 15 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Le travail commence pour m’engager à retarder mon départ. Flahaut s’est mis à l’œuvre hier en dînant chez moi. Et aussi ce jeune Lavalette que Thiers vient de me renvoyer. Les arguments et les caresses abondent. Je réponds simplement que j’ai demandé mon congé, que le jour de mon départ de Londres et celui de mon arrivée à Paris ne sont pas fixés. Mais que je serai certainement à Paris, du 28 octobre au 2 novembre. On n’insiste pas. On recommence. Je répète Je ferai ce que je dis. J’ai écrit à Génie de dire, de ma part à M. de Broglie, que j’étais décidé, que je voulais pouvoir être à Paris, le 28 octobre si cela me paraissait nécessaire ; que je ne m’attendais à aucune difficulté à cet égard mais que, si on pensait à m’en faire, je priais qu’on me les épargnât, car j’avais un un parti pris et je serais certainement à Paris du 28 octobre au 2 novembre. Je suis persuadé que malgré la bonne envie, on ne fera aucune difficulté. Mes amis se sont souvent trompés, je devrais dire que j’ai souvent trompé mes amis à mon égard. J’ai avec eux du laisser aller trop de laisser-aller je n’aime pas les refus, les contradictions, les petites querelles. J’aime la facilité, la complaisance. J’aime à faire plaisir à mes amis. Trop j’en conviens ; ou plutôt je crains trop de les contrarier. Le moment arrivé pourtant où j’ai mon parti pris, je refuse, je refuse péremptoirement. Ils ne s’y attendent pas. Ils s’étonnent un peu de rencontrer la limite de ma facilité. C’est ma faute. Il faut être quelquefois contrariant et raide sans nécessité, pour pouvoir l’être sans exciter de surprise, ni tromper l’attente au moment de la nécessite. Les nouvelles d’Orient sont bien insignifiantes. On commence à craindre ici ce que je vous disais, la longueur du temps, l’hiver, la fièvre. C’est du humbog de dire que la Syrie est soumise. Jamais Gascon n’a dit mieux. Et si elle ne l’est pas dans le cours de ce mois, elle ne le sera pas d’ici au printemps prochain. Et d’ici là, on ne pourra, on ne fera à peu près rien pour la soumettre. La légèreté humaine, la présomption humaine l’imprévoyance humaine, l’insuffisance de l’esprit humain. Je deviendrai un vrai prédicateur. Les sermons ont raison. Lady Holland a été malade, vraiment malade l’autre jour ; une quasi cholérine. Elle s’est trouvée mal ; il a fallu quitter la table, passer la soirée dans sa chambre. Elle était hier au soir fatiguée et changée.
Lord Melbourne et lord Lansdowne. Celui-ci était venu me voir le matin. Très sensé et très impuissant. C’est un exemple frappant de ce que peut et ne peut pas donner une grande situation aristocratique. Il est très instruit, très éclairé, très considéré très riche, très bien établi dans le public et dans le gouvernement. Il n’est rien. M. de Flahaut part samedi. On dit que décidément Emilie épousera lord Ephinstone qui reviendra de l’Inde l’été prochain. On dit que lord Ossulston l’épouserait s’il voulait. On dit qu’il épouserait lady Fanny Cowper, s’il voulait. On dit beaucoup de choses de Lord Ossulston. Lady Tankerville a perdu chez Hammersley l’argent qu’elle destinait à son voyage, en France. Elle n’ira pas. Lady Palmerston a perdu 1200 louis. Lady Fanny 400. Je vous dis ce qu’on me dit. On vous l’a peut-être déjà dit. Je vous l’ai peut-être déjà dit moi-même. Nos bavardages ne porteront guère sur cela. Ils porteront surtout.
3 heures
Je viens de faire le grand tour de Hyde Park seul. Décidément j’aime mieux être seul. Décidément aussi, c’est une supériorité que j’ai sur vous. Je n’ai pas besoin des indifférents. Vous pouvez me la pardonner. Vous n’en souffrez pas. J’ai quatre chanteurs anglais qui viennent souvent, pendant ou après, le dîner, chanter dans ma cour des paroles anglaises sur de l’excellente musique allemande. Trois hommes et une femme, Ils sont venus hier. J’ai soulevé ma fenêtre. Je les ai écoutés une grande demi-heure : c’était triste, c’était gai, c’était grave, c’était tendre. J’ai passé par toutes ces impressions et toutes me portaient à vous. Elles m’y portaient doucement, légèrement, comme on doit être porté sur un nuage. Je ne voyais rien ; je ne pensais à rien ; je flottais dans l’air, bercé de sons charmants qui me parlaient de vous. C’était délicieux, mais si court, comme les beaux rêves. Même au soin des plus beaux, on sent qu’on rêve, on n’a pas de confiance. C’est là que le bonheur est vraiment une ombre. La réalité, la présence, le bonheur éveillé, celui-la seul remplit l’âme et y laisse une trace éternelle. Je suis très contrarié que mardi, à une heure, vous n’eussiez pas encore ma lettre de Dimanche. Je comptais qu’elle vous arriverait de bonne heure. On vous l’aura remise dans la journée ! Ce n’est que la moitié du plaisir que je voulais vous donner et le mien me manque.
Mon jeudi est médiocre. Il y a au moins trois ou quatre choses, que je vous ai demandées depuis huit jour, et auxquelles vous n’avez pas répondu. Rien de grave ; mais enfin des questions sans réponse. On met ma voiture de voyage en ordre. Je recherche les jours de départ des bateaux de Londres au Havre, de Southampton au Havre de Brighton à Dieppe. Adieu. Adieu. Un adieu d’espérance. Ce n’est pas encore le meilleur.
443. Londres, Lundi 19 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous recevrez ceci Mercredi 21 et le Mercredi suivant 28, dans la soirée, vous me recevrez à mon tour. Je partirai dimanche 25, pour le Havre. J’y arriverai le 26, entre 5 et 8 heures du matin. J’en répartirai sur le champ et j’irai dîner au Val Richer. Je partirai du Val-Richer, le 27, dans l’après-midi avec tous les miens, pour aller coucher à Lisieux ou à Evreux, et le 28 au soir je serai à Paris. Ainsi, le mois d’Octobre n’aura pas menti. Personne, personne pas même vous, pas même moi, ne sait combien, il sera beau. Qu’est-ce que l’attente auprès du bonheur ?
J’ai reçu hier mon congé, dans une lettre particulière de Thiers, de très bonne grâce. Je serai à la Chambre le 29. Je ne manquerai qu’à la séance royale. Je crois que je comprends bien ma situation. et que j’y satisferai pleinement en tous sens. Elle a des embarras, des convenances, des intérêts, des devoirs fort divers. Je n’en éluderai aucun. Pour ma pleine confiance il faut, à mon jugement l’adhésion du vôtre. Que de choses à nous dire ! Ce nouvel assassinat ne m’a pas surpris. Je le pressentais. C’est une rude entreprise que de rétablir de l’ordre et de la raison dans le monde. Aujourd’hui tous les scélérats sont fous et tous les fous sont prêts à devenir des scélérats. Et les honnêtes gens ont à leur tour une folie, c’est d’accepter la démence comme excuse du crime. Il y a une démence qui excuse ; mais ce n’est pas celle de Darmer et de ses pareils. On n’ose pas regarder le mal en face et on dit qu’ils sont fous pour se rassurer. Et pendant que les uns se rassurent lâchement d’autres s’épouvantent lâchement. Tout est perdu ; c’est la fin du monde. Le monde a vu, sous d’autres noms, sous d’autres traits bien des maux et des périls pareils, égaux du moins sinon passifs, pour ne pas dire plus graves. Nous avons besoin aujourd’hui d’un degré de bonheur, et de sécurité dans le bonheur dont le monde autrefois. n’avait pas seulement l’idée. Il a vécu des siècles bien autrement assailli de souffrances, de crimes, de terreurs. Il a prospéré pourtant, il a grandi dans ces siècles là. Nous oublions tout cela. Nous voudrions que tout fût fait. Non certainement tout n’est pas fait ; il y a même beaucoup à faire encore. Mais tout n’est pas perdu non plus. L’expérience, qui m’a beaucoup appris, ne m’a point effrayé ; et moi qui passe pour un juge si sévère de mon temps; moi qui crois son mal bien plus grave que je ne le lui dis, je dis qu’à côté de ce mal, le bien abonde, et qu’à aucune époque on n’a vécu, dans le plus obscur village comme dans la rue St Florentin, au milieu de plus de justice, de douceur, de bien être et de sûreté.
J’écrirai aujourd’hui au Roi. On me dit qu’il a pris ceci avec son sang-froid ordinaire, triste pourtant de voir recommencer ce qu’il croyait fini. Le Morning Chronicle parle de lui ce matin est termes fort convenables. 2 heures Rien encore. J’y compte pourtant toujours. La poste est venue tard. Et vous ne prenez pas le plus court chemin pour venir à moi ; je suis encore plus impatient le lundi qu’un autre jour. Le dimanche est si peu de chose ! Enfin, je n’ai plus qu’un dimanche.
Lord Palmerston a demandé pour moi à la Reine une audience de congé. Je l’aurai Mercredi ou Jeudi Ne dites rien du jour de mon arrivée. Sachez seulement que je viens pour le début de la session.
Adieu. Adieu. 4 heures
Voilà 455. Excellent. Ce que j’aime le mieux ; confiant, comme l’enfance; profond, comme l’expérience. Un sentiment, n’est complet qu’avec ces deux caractères. Et il n’y a de bon, il n’y a même de charmant qu’un sentiment complet. Au début de la vie on peut trouver, on trouve du charmé dans des sentiments auxquels à vrai dire, il manque beaucoup. On sait pas ce qui y manque ; on jouit de ce qui y est sans regretter, sans pressentir ce qui n’y est pas. Quand on a vécu, quand on a mesuré les choses, on veut la perfection ; on ne se contente pas à moindre prix. Et là où on ne trouve pas tout, on ne se donne pas soi-même tout entier. Je n’ai jamais été si difficile et si satisfait.
Je n’ai pas encore les détails de la métamorphose que vous m’indiquez. Ils m’arriveront, je pense dans la journée. Cela, je puis l’attendre patiemment. Je serai fort aise de la métamorphose et pas sûr, après quelques épreuves, je finis par accepter les vicissitudes de certaines relations comme celles des saisons ; en hiver, j’espère l’été ; en été je prévois l’hiver ; le ciel pur ne chasse point le brouillard de ma mémoire, ni le brouillard le ciel pur. Je me résigne à ce mélange imparfait et à ses alternatives. Triste au fond de l’âme, mais sans injustice et sans humeur. Ou plutôt ce qui s’est montré à ce point variable et imparfait ne pénètre plus jusqu’au fond de mon âme. Je le classe dans ce superficiel qui peut être grave comme vous dîtes, et influer beaucoup sur ma destinée mais qui ne décide jamais de ma vie. Adieu. Oui, adieu comme nous le voulons.
442. Londres, Samedi 17 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
M. de Brünnow passe sa vie chez moi. Il y a joué hier au whist toute la soirée. Et moi avec lui, non pas toute la soirée pourtant. Et par hasard, toujours contre lui. Rien de nouveau sinon beaucoup de chuchotements, sur ces publications si promptes. J’espère qu’à Paris on en découvrira la source. Si les chambres à Paris ou à Londres avaient demandé ces pièces-là, on les leur aurait refusées, et on aurait eu raison. Les journaux ne les demandent pas ; ils les achètent, ils les volent, ils les prennent. Je ne sais comment, mais enfin ils les ont. C’est un grand ennui. Et je crains que pour cette dernière dépêche, celle du 8, ce ne soit plus qu’un ennui. La publication produira probablement à Paris un mauvais effet. M. de Flahaut ne part que lundi. Lady Holland, toujours souffrante, l’a prié de rester deux jours de plus.
Vous n’avez pas d’idée combien j’ai été contrarié hier de ma lettre qui vous a manqué mardi, de votre lettre à vous si courte. Je suis trop tolérant ; je ne montre pas ce qui se passe en moi quand cela me déplaît à moi-même, et peut déplaire ou affliger. J’ai tort il faut se laisser aller. Je suis encore ce matin sous le poids de ma contrariété d’hier. J’y serai jusqu’à ce que j’aie reçu votre lettre d’aujourd’hui, et que j’y aie trouvé ce qui me plait.
4 heures
Encore une tentative d’assassinat ! Je n’en s’ais rien encore que par les journaux. Pour les faits comme pour les pièces, leur diplomatie est la mieux servie. Il est très vrai : le mal extérieur et le mal intérieur vont toujours ensemble. Cela fait beaucoup de mal. La moitié suffirait. Les vieux pays et les vieux gouvernements sont heureux. J’ai tort de dire cela. Pour rien au monde, je ne voudrais pas, ne pas être de mon pays et de mon temps. Oui, ce qu’on m’écrit est grave. J’en suis peu surpris. Je vois venir depuis assez longtemps cette épreuve là. Elle peut-être fort triste Jusqu’ici, je ne me sens aucune indécision. Je suis très inquiet et très convaincu. Le petit vous parlera de tout. J’attends impatiemment ses réponses. De moment en moment, la conviction m’arrive qu’il faut être là, dans le début. Je ne prendrais mon parti sur rien avant d’avoir vu, entendu, parlé. On ne sait rien de loin. On ne dit rien de loin. J’ai beaucoup à dire et beaucoup à apprendre. Je ne veux encourir aucun reproche de précipitation, ni d’inconséquence. Mais je ne veux pas non plus manquer, sur rien, l’occasion de me décider et d’agir convenablement.
Arriver trop tôt serait d’un étourdi, arriver trop tard d’un poltron. Je ne suis ni l’un, ni l’autre. Je ne suis point de ceux à qui l’on fait faire un coup de tête en les défiant. Je trouve cela puérile. Mais quand on essaie de poser beaucoup sur moi, je me raffermis, d’autant. Je n’ai pas cédé, il y a sept mois, à ceux qui voulaient me bully in une hostilité qui ne me convenait pas. Je ne céderai pas davantage aujourd’hui à ceux qui voudraient me bully in une condescendance qui ne me convient pas davantage. J’attends mon congé. Je persiste à penser qu’on me l’enverra. Il me serait tout-à-fait désagréable d’être obligé de le prendre Adieu.
Le 453 est bien joli à la fin surtout. Je suis très occupé de la lettre que vous avez préparée. Faites bien attention. C’est délicat. Quel mal d’être loin ! Public and private evil. Adieu. Adieu.
456. Paris, Dimanche 18 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Vraiment la musique ajoute bien à... ( Trouvez le mot ) et je crois moi qu’en Italie on doit savoir mieux amer qu’autre part. Hier aux Italiens j’étais comme vous à votre fenêtre, c’était si doux ; si charmant, si enchanteur, mes pensées étaient si tendres. Venez, venez dans ma loge. Serait-il possible que dans quelques jours vous y soyez ? Quel bonheur.
J’ai vu fort peu de monde. hier. Les Granville, ignorants ; Mad. de Flahaut inquiète de la situation du ministère. Disant qu’il faut qu’il se renforcé à droite pour avoir la droite, ou plus sincèrement une portion de la droite. à gauche pour s’affectionner davantage ce parti, et c’est ce qu’elle conseille, car après tout c’est les doctrinaires qui ont les bonnes places, les grandes places et les vrais amis n’ont rien ! Voilà ; et puis les Doctrinaires ne sont pas ralliés. Il pérorent dans les salons, ils frondent & &
Aux Italiens il n’y avaient personne. Toute la diplomatie était à Auteuil. les bruits de retraite de M. Thiers circulent, mais on dit assez généralement dans le monde qu’on les fait circuler, et qu’il n’y a rien de vrai. On dit aussi, c’est 18 qui me le dit que le Roi n’accorderait pas à M. Thiers de se retirer, qu’il le sait positivement ; car il y aurait dans ce fait trop de danger pour le Roi. On dit beaucoup aussi que l’ouverture des Chambres sera retardée. Je crois, que cela ferait un mauvais effet, c’est ce qui me fait en douter.
Midi, à ma toilette, je vous regarde toujours comme vous avez le droit d’attendre que je vous regarde. Voici du nouveau aujourd’hui. Je me suis surprise à rire en vous regardant. Connaissez-vous ce rire, du plaisir, le rire du bonheur ? C’était celui-là ce matin puisque je vous dis des bêtises il est clair que je n’ai rien à vous dire. Je n’ai pas de lettres encore.
Adieu, vous trouverez ceci trop court, je le trouve aussi, mais savez-vous que je suis accouchée d’une grande et d’une petite lettre ce matin à mon frère. Toutes deux le même sujet. Je vous les enverrai. J’attends ma belle sœur pour les lui lire. Adieu. Adieu, le plus charmant adieu.
444. Londres, Mardi 20 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
Je ne sais si je vous ai bien dit le motif qui m’avait décidé à être à la chambre le 29. On ne me fait pas faire les choses en me défiant. Mais quand j’ai vu qu’on voulait que je n’y fusse pas pour la présidence, puisque je n’y fusse pas pour l’adresse, puisque j’eusse à enfoncer, mon épée jusqu’à la garde, soit pour, soit contre, je me suis demandé ce que signifiaient toutes ces exigences, et pourquoi j’y céderais. Je ne sais à Paris contre personne. Je ne suis ici et ne serai là dans aucune intrigue. Je ne dirai, je ne ferai rien là qui ne soit en parfaite harmonie avec ce que j’ai dit et fait ici depuis huit mois. J’ai secondé le Cabinet sans me lier à lui Je ferai de même. Je lui ai dit, à son avènement, que je serais avec lui, loyal et libre ! Je serai loyal et libre. Je lui ai dit que je garderais mes amis sans épouser leur humeur. Je le ferai, comme je l’ai fait. J’ai fait, le premier jour, sur mes anciennes amitiés sur notre séparation le jour où notre politique différerait ; toutes les réserves que je pourrais vouloir aujourd’hui. Pourquoi me gênerais-je ? Pourquoi donnerais-je à ma conduite un air d’embarras et d’hésitation ? Je n’en veux point. Il n’y a pas de quoi ni dans le passé, ni dans l’avenir. Je veux prendre ma position simplement, ouvertement, rondement, toute entière. Je suis député avant d’être ambassadeur, et je tiens plus à ce que je suis comme député qu’à ce que je suis comme ambassadeur.
La session s’ouvre. Je demande et on me donne un congé pour l’ouverture de la session. J’y serai de même que je ne machinerai rien, de même je n’éluderai rien. J’agirai comme député selon ma raison, ma position, mon passé. Je parlerai comme ambassadeur, selon ce que j’ai pensé, fait ou accepté depuis que je le suis. Je crois que cela peut très bien se concilier. Si cela ne se peut pas, je m’en apercevrai le premier. Je serai prêt, selon le besoin à seconder ou à me démettre, loyal pendant, libre après. Je serais bien dupe de m’imposer, pour satisfaire aux méfiances ou aux embarras des autres, une contrainte qui n’a en moi-même, pas le moindre fondement. J’accepterai hautement les difficultés de ma propre position. Je n’accepterai aucune des difficultés de la position d’autrui.
Parlons d’autre chose, Je viens de voir lady Palmerston, toujours gracieuse et embarrassée. Je crois qu’elle doit avoir beaucoup plus d’esprit avec son mari qu’avec personne. L’arrangement, le calcul ôte plus d’esprit qu’il n’en donne. Quand on en a, on n’en a jamais autant que dans l’abandon. En revenant de chez lady Palmerston, j’ai fait mes adieux à Stafford house. J’ai été exprès, sur la petite place, devant la porte. Reverrai-je cette maison ? Reverrai-je Londres? L’avenir est bien obscur. Le mien notamment. Quelqu’il soit, j’aimerai Stafford house.
Dites-moi ce que vous avez écrit sur votre long petit livre de Memoranda sous la date du 30 août. La réponse de la Reine pour mon audience de congé n’est pas encore arrivée. Je suppose demain ou après demain. La Reine reçoit, vers 6 heures. On dîne et on couche à Windsor. J’ai bien des petites choses à faire d’ici à dimanche. Qu’il y a de petites choses dans la vie ! Par exemple, je vous quitte pour des comptes. J’ai beaucoup d’ordre. Adieu. J’aime bien adieu. J’aime bien mieux oui.
446. Windsor Castle, Jeudi le 22 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce n’est pas la musique seule, c’est tout qui ajoute à hier à cinq heures, j’étais sur la route de Windsor. Le soleil se couchait devant moi brillant, pompeux, inondant l’horizon de lumière, comme pour nous charmer de tout son éclat avant de nous quitter. Je roulais rapidement vers lui, comme pour aller à lui. L’envie m’a pris d’y aller en effet, de sortir de notre terre, de traverser l’espace, d’aller je ne sais où, goûter je ne sais quels plaisirs, pénétrer je ne sais quels mystères. Et ce mouvement de mon imagination, m’a porté vers vous. Je vous ai appelée ; je vous ai prise avec moi. Et tous mes désirs se sont concentrés en un seul désir : partons, dans un baiser, pour un monde inconnu.
Pendant que je vous proposais de partir le soleil s’est couché. La nuit est venue. Le froid avec la nuit. J’ai fermé, ma calèche. Je m’y suis enfoncé, au lieu de m’élancer dans l’espace. Vous étiez là aussi, encore plus près de moi. Et le fond de ma calèche est devenu plus charmant que le monde inconnu auquel j’aspirais. Et ce matin, dans ce château de Windsor en sortant de mon lit je retrouve en vous écrivant, mes impressions d’hier. Elles me charment encore. Sans vous, si vous n’y aviez pris place, elles se seraient évanouies comme les rayons du soleil, comme les ombres de la nuit. Mais vous les avez transformées en ..... Je ne les oublierai jamais.
Personne ici que lord Melbourne, Lord Palmerston, Lord et Lady Clarendon et moi. On est très aimable pour moi, un peu par estime et par goût, je m’en flatte, un peu aussi parce que je vais à Paris. On désire que j’y sois bien pour ici, que je parle bien des personnes. On me voudrait facile pour les choses. On voit bien que l’avenir, et un avenir prochain est plein de chances. On en est occupé, occupé comme on l’est de tout ce qui n’est pas l’Angleterre elle-même ; assez occupé pourtant. On a traité la France légèrement ; mais sa malveillance importune. On sait que tôt ou tard, pour les affaires son influence pèse ; pour les réputations son opinion compte. On voudrait la calmer, l’amadouer.
Si je pouvais faire comprendre à mon pays ce que je comprends, et lui faire adopter la conduite et le langage. Que je sais bien, je crois qu’il n’aurait pas à s’en repentir. Mais ce serait trop bien pour que ce soit possible. Midi Je reviens de déjeuner. Lady Littleton est la dame in waiting. Elle a assez d’esprit. J’en trouvé bien des gens le premier jour, ou la première heure, comme vous voudrez. Je crois vraiment que bien des gens en ont pour un jour, pour une heure et je m’y laisse prendre encore quelques fois.
La Reine est toute ronde, aussi grasse que grosse. Malgré la princesse Charlotte et la Reine de Portugal, je ne la crois pas inquiète de ses couches. Je ne la crois inquiète de rien. Elle me paraît prendre la vie lestement et sensément, l’esprit gai, le caractère résolu, le cœur pas très vif. Elle reviendra à Londres vers le 15 novembre. Il est décidé qu’elle n’accouchera qu’en décembre.
On chasse ce matin, lord Melbourne et lord Palmerston n’en sont pas plus que moi. Dans la matinée, j’irai causer avec eux.
Comme nous causerons nous ! Quelle profanation de parler de ces conversations. Là à propos d’aucune autre ! Oui, je suis content de votre foi, de votre rire, de vos réponses à mes questions. Mais je prends en grand mépris tous les contentements de loin. Il n’y paraît pas, car je bavarde comme si j’étais prêt comme si je ne songeais à rien de plus. Je songe à beaucoup plus. Je songe à tout. Que c’est beau tout ! Il n’y a que cela de beau. Ne trouvez-vous pas que j’ai un bon caractère ? Trop bon, je trouve. Je suis très ambitieux et très facile, insatiable et prompt à jouir de ce que j’ai malgré ce qui me manque. Il en résulte quelquefois que trop aisément on me croit content et qu’on ne s’inquiète pas assez de me contenter. Il faut qu’on s’inquiète. J’inquiéterai. Certainement pas vous, si je croyais avoir besoin de vous inquiéter, vous ne seriez pas pour moi ce que vous êtes. Je vous dirai mon secret. Avec tout le monde, ma facilité tient à l’insouciance. Avec vous, à la confiance. 2 heures J’attends M. Herbet qui doit m’apporter mes lettres. Il ne vient pas. Je fais partir ceci. Adieu. Adieu. L’heure me presse.
462. Paris, Vendredi 23 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon bien aimé, je voudrais t’envoyer des paroles d’amour aussi vives aussi tendres que l’amour que je ressens. Je suis heureuse, je suis pleine d’angoisse, d’angoisse de plaisir, je t’attends... je m’inquiète. On dit que les rues s’animent qu’il y aura du bruit demain, Dimanche. Avoir à trembler au moment de tant de joie ! C’est abominable. Je voudrais partir avec le fidèle, ah quel plaisir ! mon ami, tu viendras chez moi tout de suite ; à moins que tu n’arrives avant 10 heures du matin ou après 10 1/2 du soir il faut venir chez moi tout droit. Il faut que je te parle avant que tu n’en vois d’autres. Viendras-tu dimanche ? Je t’ai écrit a Calais que je t’attendrai tout le jour. Ton couvert sera là, ne me laisse pas dîner seule. Mon cher bien aimé, que nous serons heureux, que je t’aime, que je t’aime ! Quelle pauvre affaire que ces paroles là écrites ! Comme je le les dirai ! Viens mon bien aimé. Je ne saurais te parler de rien dans ce moment-ci, je ne veux pas sortir de mon style intime. Le fidèle t’entretiendra de tout. Moi je regarde tes yeux, je touche ta main, tes lèvres. Mon ami, mon bien aimé, ah quel adieu je t’envoie là. Mon cher bien aimé adieu. Je tremble de plaisir adieu.
Vendredi 6h 1/2
Il faut que je vous dise un mot plus grave. Je vous conjure de ne point vous presser d’accepter ; avant de laisser soupçonner votre résolution demandez à tout savoir à tout voir ; la situation est bien difficile, vous ne devez pas reculer s’il faut du courage mais vous ne devez pas non plus aller trop vite et vous donner l’air d’un homme avide d’un portefeuille. Je trouve une situation analogue à celle du duc de Broglie bonne. Du pouvoir sans responsabilité cela n’est peut être pas possible maintenant, je ne sais pas, je ne sais rien, je veux seulement que vous n’agissiez et n’acceptiez qu’avec pleine connaissance de cause. Je vous dis tout cela dans la crainte que votre arrivée ne soit à une heure indue pour moi et que vous vous trouvez envahi par les autres avant de m’avoir vue moi. Je ne sais que désirer ou que craindre, je suis très troublée.
Tout me fait peur, si je ne vous aimais pas, je trouverais ce moment bien intéressant. maintenant, je voudrais la tranquillité, la paix du cottage, votre amour, le mien, rien que cela, ah mon ami c’est là le vrai bonheur ! Et nous n’y arriverons jamais. Adieu. encore mon ami, mon bien aimé, chéri, adoré. Adieu.
Il ne faut pas que j’oublie de vous dire que déjà Appony soutient que les puissances alliées seront très disposées à s’arranger sur des bases plus larges puisque Thiers n’y est plus la diplomatie est cependant, dans un bien grand trouble mon ambassadeur envoie un courrier demain, il ne sait rien ; il ne sait que dire. Sinon que Thiers n’y est plus jamais je n’ai vu de si pauvres diplomates, nous en rirons un peu, quand vous aurez à faire à eux ! Adieu. Adieu mon bien aimé le plus aimé des mortels. Adieu.
Samedi je croyais avoir à remettre ma lettre hier au soir au lieu de cela il ne part que ce matin. Je me lève de meilleure heure pour le recevoir et pour te dire encore deux mots. encore deux mots. Brignoles est venu hier au soir il venait de dîner aux finances avec M. de Broglie, on a beaucoup parlé de vous. Broglie a dit qu’il était certain que vous n’accepteriez pas ! J’ai trouvé moyen de faire redire cela à M. de Brignoles deux fois pour en être plus sûre. Cela ne va pas du tout avec les très bons propos que Broglie a tenu hier au fidèle. Le mauvais propos est de plus fraîche date. M. Pelet de la Lozère a dit qu’il ne voyait aucune raison pour que vous n’accepteriez pas car le Cabinet ne se retirait que pour un fait qui vous est inconnu et étranger, un paragraphe du discours. Vous n’en êtes pas responsable. Tout le monde se demande et tout le monde me demande ce que vous allez faire. J’ai une seule et même réponse pour tous sans exception. Je ne sais pas. Je serais bien aise que vous adoptassiez cela aussi pour les premiers moments avant d’avoir bien reconnu votre terrain. Peut-être poussé- je trop loin la prudence dans des conseils que je vous donne, cependant je ne crois pas, regardez bien et puis décidez.
Le duc de Noailles qui est accouru hier de la campagne et pour quelques heures seulement, affirme que vous accepteriez que vous devez accepter. Le pressentiment est général qu’il y aura une émeute, que Thiers y compte. Il se tient toujours à Auteuil. Le Roi rentre aujourd’hui pour rester aux Tuileries. Le vent a soufflé bien fort cette nuit. Je me suis inquiétée pour la traversée de Douvres à Calais, je n’en ai pas dormi. Vous passez. peut-être dans ce moment. 1 heures. Cher bien aimé demain demain, que le Dimanche est un beau jour. Le 30 août était un dimanche, demain huit semaines révolues, depuis que nous nous sommes donnés bien solennellement l’un à l’autre, pour cette vie, pour l’éternité ! Adieu mon bien aimé chéri. Adieu.
Encore, encore je ne puis pas te quitter, un baisir, mon bien aimé, un baiser. Ah si tu savais ce que j’éprouve en traçant ce mot, mon aimé, mon aimé, je te sens si près de moi, si près. Viens mon bien aimé.
[Paris], Samedi 24 juin 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me dis que l’un dernier à pareille époque, vous étiez bien plus triste. Vous étiez seule. Mais j’ai beau me dire cela. Je ne m’en contente pas. Je ne me contente de rien pour vous. Peu m’importe que votre fardeau ait été allégé ; tant qu’il pèse encore sur vous, tant que je vois, en vous abordant, en vous quittant une si profonde, tristesse établie dans vos yeux, il me semble que vous n’avez rien gagné, que je n’ai rien fait, que je pourrais que je devrais faire davantage, et votre peine devient presque pour moi un remords.
Je vous l’ai dit: sur un point un seul point, mon ambition est sans limites ; rien ne lui suffit, et tant que quelque chose me manque, tant que je n’ai pas que je ne fais pas tout ce que je voudrais, je ne sais pas me résigner, je suis mécontent et agité. Je l’étais hier je le suis aujourd’hui ; je le serai toutes les fois que je ne verrai pas l’impression douce dominer dans votre âme par dessus les impressions douloureuses, les envelopper, les calmer et sinon les guérir, ce qui ne se peut pas, ce qui ne se doit pas, du moins les couvrir d’un baume rafraîchissant. Vous le savez; j’ai toutes les prétentions du manteau de Raleigh. Mais il faudrait que le manteau de Raleigh fût toujours là, sous vos pieds, sur vos épaules.
C’est trop aussi de vouloir que l’absence fasse ce que la présence continuelle pourrait à peine espérer. Je le veux pourtant et je ne puis pas m’empêcher de le vouloir. Savez-vous pourquoi? c’est que je sens en moi tout ce qu’il faut pour réussir, oui, tout. Il manque beaucoup à ce que je fais mais il n’y manquerait rien, rien si je faisais tout ce que je puis tout ce que je sens. Adieu. Adieu. Samedi 24 10 heures
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
1. Abbeville, Samedi 1er juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’arrive dans cet instant bien fatiguée. J’ai faim, j’ai sommeil mais je ne puis ni manger ni dormir avant de vous avoir remercier de ce bon billet, de ces bonnes connaissances que vous m’avez fait faire. j’ai tout dévoré. J’ai cherché l’histoire, le roman, c’est là ce qu’il me fallait d’abord. Il y a trop peu de cela, mais comme le peu qu’il y a m’a émue. J’ai couru ensuite après les dates. J’ai cherché à me rappeler ce que je faisais à pareil jour. Enfin, j’ai eu toute les émotions du monde. Elles n’ont pas toutes été douces. Ah mon Dieu, que j’ai peu d’esprit à côté de ces esprits là ! J’en ressens quelque embarras. Et puis je me dis qu’il y a autre chose qui compte, et je me rassure.
Monsieur je devais commencer par vous conter hier. Votre billet porte la date de 6 heures. Je ne l’ai vu qu’à 9. Mais à 6 heures je passais devant votre porte ; un embarras de voitures dans la rue parallèle à la vôtre ayant forcé mon cocher de prendre de votre côté pour me mener chez lady Granville. J’ai été bien contente d’elle. Elle m’a répété " you are safe." Je fus dîner chez Mad. de Flahaut, mais matériellement dîner & bien vite, & puis chez moi des affaires, des arrangements à prendre. Il se trouve que je n’avais pensé à rien, que je n’avais donné aucun ordre, quand tout était à commencer lorsque tout devait être fini. Voilà cette bonne tête, qu’on appelait comme cela jadis ! J’ai été excédée à 10 heures je me suis couchée sans pouvoir. dormir. À 6 heures j’étais en voiture & dans la rue de Luxembourg déjà j’avais ouvert le paquet je lisais et je n’ai pas fait autre chose jusqu’ici, excepté de une à trois heures où j’ai fermé les yeux, je ne sais si j’ai dormi, si j’ai rêvé, je ne puis trop expliquer cela, & je ne veux pas m’étendre sur cette partie de ma journée. Ma voiture est douce je m’y trouve bien, il me semble que je ne me trouverai bien que dans ma voiture mon courrier entre dans mes goûts il me fait avancer rapidement et cependant avancer c’est m’éloigner mais j’ai hâte de le faire. On dirait que cela me fera revenir plus tôt.
Adieu Monsieur. Je serai couchée à l’heure où je revenais de Chatenay, il y a huit jours. Je crois que je dors déjà. Pardonnez-moi, Monsieur, cette sotte lettre. Vous n’en aurez pas de plus élégantes jusqu’à ce que je sois settled en Angleterre. Je vous promets des nouvelles, mais jusque là seulement, ma plus tendre amitié.
2. Boulogne, Dimanche 2 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous voyez comme je cours Monsieur. C’est superbe, et puis c’est insupportable car j’arrive et le bateau à vapeur est parti il y a deux heures. Il faut patienter jusqu’à demain 9 heures ! Soyez assez bon pour un faire passer le temps. Causons un peu et nous pouvons le faire bien commodément. Mon appartement est bien tranquille, pas le moindre bruit. Cela me fait une nouveauté après la bruyante rue de Rivoli. J’ai la vue de la mer de cette mer que j’aime tant & que vous connaissez si peu, & que je vous prie d’aller regarder pour me faire plaisir en descendant de voiture tout à l’heure j’ai senti une main saisir la mienne. Cela m’a donné une palpitation involontaire. C’était celle de lord Pembroke. Il ne valait pas la peine de m’agiter. Comme vous n’êtes pas femme, vous ne comprenez pas les bêtises que je vous dis là.
J’avais reçu en partant de Paris une lettre de mon mari. Je l’avais oubliée. Je l’ai ouverte aujourd’hui. Il m’écrit du 15 juin. Je me sens bien triste aujourd’hui. Je ne l’ai jamais été autant. Monsieur ces paroles dites ce jour là m’ont bien frappées.
4 h. Je viens de dîner, & j’ai reçu quelques visites. J’ai fait parler lord Pembroke, il a quitté Londres hier les Torys sont découragés, toutes les faveurs de la reine sont pour les Whigs. Lord Melbourne passe tous les jours deux heures de la matinée avec elle. Toutes ses idées sont accueillies. On ne dit rien de l’esprit et des opinions de la reine. On dit seulement qu’elle sait haïr, mais c’est bien quelque chose à 18 ans ! Elle veut à toute force chasser l’amant de sa mère. Elle le fait magnifiquement. Elle donne au chevalier Conroy trois mille lires sterling de pension pour qu’il s’en aille. Lord Pembroke s’est avisé de me parler aussi de french politics, il me dit : " Nous autres Torys nous n’avons qu’un vœu, c’est de voir M. Guizot aux affaires."
Mais monsieur ce n’est pas de politique que je veux vous parler, Je cherche... C’est de musique. Vous savez comme Je l’aime cette musique ! Comme elle m’enivre, comme elle me plait. Et bien, je l’entends, je la sens. Je n’ai pas lu aujourd’hui. j’avais trop lu hier, j’en ai mal aux yeux mais j’ai pensé à ce que j’avais lu j’ai trouvé des paroles qui m’ont été répétées. " Le paradis sur la terre." Il venait donc d’elle ? Et c’est avec elle qu’il était trouvé !
8 h. Je vous demande pardon Monsieur de vous parler à tort et à travers de tout ce qui me vient dans la tête. Quel début de correspondance et cependant, vous voyez bien que je ne vous dis rien, rien de ce que je voudrais dire. Je n’aime pas la contrainte. Je n’aime pas les souliers étroits ; un ruban qui me serre, & bien je n’aime pas plus les lettres que je vous écris, comment n’ai-je pas pensé à cela en m’engageant dans cette correspondance ? Dites Monsieur ne vaudrait-il pas mieux la laisser-là ? Hier & aujourd’hui ont été bien mal. C’est à dire bien maladroite. cela va vous fâcher, & je me sens toute humiliée d’avance de cette fâcherie.
Adieu Monsieur, adieu. C’est mon dernier mot de cette terre de France dans quelques heures je trouverai des émotions terribles. Ces pensées me font frémir. Le manteau de Raleigh (je crois que c’est le nom/ sera-t-il assez puissant ? Ah Monsieur j’ai le cœur brisé. Pensez à moi, prenez pitié de moi, je suis bien malheureuse. Adieu.
2. Paris, Dimanche 2 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rentre de ma promenade solitaire. Il n’y a presque plus personne à Paris, et je ne vais pas chercher ce qui y reste. Le bonheur, les affaires ou la solitude. C’est un blasphème de placer ces trois mots l’un à côté de l’autre. Le bonheur ne doit jamais être nommé que tout seul ; rien ne lui ressemble. Mais sans bonheur, et à défaut des affaires, j’aime bien mieux la solitude que le bavardage des indifférents. Je sais qu’on ne la supporterait pas longtemps, que l’âme s’userait vite à vivre ainsi à ses propres dépens et de sa seule substance. Mais finir seul sa journée se promener deux heures sans rien regarder, sans rien dire, n’entendant que le bruit de ses pas n’écoutant que cette voix intérieure qui nous entretient de notre passé ou de notre avenir, c’est assez doux. Dans les affaires mêmes, un peu de solitude est bonne ; il faut un moment chaque jour, secouer tous les jougs ne relever que de soi-même, permettre à sa pensée cette liberté insouciante qui lui conserve seule toute son originalité et sa grandeur. Gouverner n’est pas labourer. On s’hébête à avoir toujours la main sur la charrue et l’oeil sur le sillon. C’est un grand vice de notre organisation politique en France que ce travail incessant, ce défaut absolu de loisir auquel nous nous sommes condammés. A faire un tel métier, on se sent devenir machine soi-même et on tombe bientôt au dessous de sa tâche pour n’avoir pas su ou pu, de temps en temps, la laisser là et n’y plus songer. Je vous assure Madame qu’au milieu des plus pressantes affaires, une heure de conversation avec vous n’importe sur quoi serait, tout plaisir à part, le régime le plus sain du monde. à la vérité, ce n’est pas là de la solitude.
Ces chances lointaines, inconnues, tout cela refoule dans le cœur les choses qui auraient le plus envie d’en sortir. Il y a un degré de vérité, de liberté, qui ne souffre aucune entremise. C’est déjà trop quand on est ensemble, que la nécessité de rédiger ses sentiments en phrases et de les envoyer à deux pas en entendant le bruit de sa voix. L’âme ne passe jamais tout entière dans cette manifestation extérieure, et au moment même où elle parle, elle aspire. Surtout à être devinée dans ce qu’elle retient. Je ne sais lequel de nos poètes pour peindre la conversation. intime de deux amants a dit :
Cachés, et se parlant tout bas, quoique tout seuls. Il savait ce que c’est que l’intimité.
A tout prendre cependant, je me sens un peu plus à l’aise par M. Nettement que par la poste. Je lui remets donc cette lettre. Si vous êtes encore à Londres quand il en partira, il ira vous demander vos ordres pour moi. Vous pouvez les lui donner en sûreté. J’étais sûr que les volumes vous plairaient beaucoup. Si je n’en avais été sûr, je ne vous les aurais pas envoyés. Je ne déteste rien tant que la profanation d’un souvenir. A présent, quand vous reviendrez (car vous reviendrez) je vous parlerai librement de ces deux nobles créatures qui ont tenu tant de place dans ma vie. Il n’y a jamais eu, entre elles et moi, cinq minutes de roman. Je m’éprise le roman. Il a la prétention de surpasser la réalité et il lui est bien inférieur. L’amour vrai l’admiration vraie le dévouement vrai sont très rares, c’est pourquoi les gens qui ne s’y connaissent pas les appellent romanesques. Ils ne le sont pas du tout ; ils sont au contraire, quand ils existent tout ce qu’il y a de plus simple de plus positif, de plus pratique. Seulement il ne faut pas s’y tromper et prendre pour les sentiments-là, les fantaisies qui s’en attribuent le nom. Les feux follets qui traversent l’air s’appellent aussi des étoiles ; mais ils n’en ressemblent pas d’avantage aux étoiles véritables, et celles-ci n’en sont pas moins hautes et fixes parce que des traits de flamme apparente courent et brillent un moment dans les régions inférieures de l’atmosphère. Pourquoi vous parlerais-je aujourd’hui d’autre chose? J’ai le cœur joyeux et profondément indifférent à tout ce qui n’est pas ma joie. J’attendais votre première lettre avec une inexprimable impatience. J’avais soif de rentrer par ce simulacre, en possession de nos longs et doux entretiens. Dans une charmante habitude la première interruption a quelque chose de très amer. L’âme se précipite pour ressaisir le fil qui lui a échappé un moment. Adieu, dearest Princess. Soignez-vous comme vous me l’avez promis. Je serai charmé que vous me donniez des nouvelles ; mais sachez bien que j’aime infiniment mieux autre chose.
Adieu. Adieu. Guizot Je suis obligé de rester deux ou trois jours de plus à Paris. Moi aussi, j’ai négligé mes affaires et comme il y en a qui intéressent mes enfants je veux les faire avant de partir. Remarquez mon cachet. C’est celui dont je me servirai habituellement.
3. Boulogne, Lundi 3 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Lundi 3 juillet
La marée n’arrive pas, je suis toute impatiente de placer la mer entre la France et moi. J’espère retrouver un peu de calme en Angleterre. J’en ai grand besoin. Il me semble que j’ai la fièvre. Ah monsieur, que je voudrais vous parler, vous écouter, vous mettriez mon esprit en ordre. Que d’idées s’y pressent. Tant de douleurs, tant de joie, tant d’incertitudes sur mon avenir. C’est un chaos ; mon cœur n’y suffit pas. Il est si plein, si plein. J’attends le Capitaine, dans 10 minutes je m’embarque. Je resterai sur le pont. Je regarderai, cette France tant que mes yeux pourront regarder.
Londres mardi 10 h. du matin, J’ai fait un passage superbe, deux heures et demie. J’ai pris quelque chose a Douvres, et puis je suis venu sans m’arrêter à Stafford house. J’ y étais à onze heures hier soir. Il y avait un grand dîner tous mes english friends de la couleur Whig. Lord Grey à la tête. Ils s’étaient lasser de m’attendre ; en sorte que je n’ai plus trouvé que la famille de la Duchesse, M. Ellice, mon fils. Il ne m’attendait plus. Il allait partir. Je l’ai rencontré sur ce magnifique palier avec cette belle Duchesse et un groupe de douze personnes. Tout cela m’a accablé. J’ai embrassé le Duc, croyant embrasser mon fils. Mes jambes ne me soutenaient pas. La fatigue, les battements de mon cœur en entrant à Londres, tout ce qui le remplit mon cœur ! tout cela m’avait étourdie. On m’a fait causer, on m’a même fait rire, on m’a servi à souper à minuit, on m’a mené dans mon appartement, mon fils est resté jusqu’à une heure. Il a bien de l’esprit, et il m’aime, c’est du bonheur pour moi de me retrouver avec lui.
Je me suis couchée sans pouvoir m’endormir. J’ai entendu l’horloge de St James sonner toutes les demi heures. Mon âme était si agitée ! Je viens de me lever, & je viens à vous Monsieur. Je vous ai fait un récit bien sec de ma journée d’hier. Je n’ose pas me livrer à la douceur de vous décrire mes sensations. Cela m’entraîne, cela m’égare je ne saurais où m’arrêter ; je dirais trop peu, je dirais trop. Avant de m’embarquer hier. Je me suis jetée à genoux. J’ai invoqué Dieu. Je lui ai si souvent demandé de me laisser mourir. Hier je l’ai prié de me laisser vivre ; de me conserver ce cœur que j’ai trouvé. Il y avait du trouble et cependant tant de passion dans ma prière, et de tristesse & de douceur.
Le temps a été magnifique ; la mer calme. Je vous ai dit que pour éviter le mal de mer il faut regarder la ligne de l’horizon. Je l’ai regardé tout le temps. Mon horizon c’était la France. Cette ligne blanche que mon œil apercevait encore presque au moment d’entrer dans le port de Douvres. Et puis quand on m’a dit que nous arrivions, je me suis retournée de l’autre côté et mes yeux se sont remplis de larmes. Cette île où j’ai été si longtemps heureuse d’un bonheur si pur, si doux, si calme. Je la revoyais donc toute pleine de tant de souvenirs, & rien J’ai regardé rien pour mon cœur ! tout avec calme, je crois. Quelques habitants du lieu attendant sur le bord m’ont reconnue. J’ai été accablée de soins, de prévenance, pas un embarras. Je leur ai si longtemps appartenu que toutes les difficultés s’aplanissaient devant mon nom. Il y avait du cœur dans cet accueil ; dans les auberges sur la route on m’apportait des fruits, des fleurs. Il n’y manquait que les couplets mais John Bell n’en fait pas ! J’entendais répéter mon nom ; moi même il me semblait que j’ y avais été la veille. Rien ne m’étonnait. Je rêvais, je regardais tranquillement en beaux paysages. Deux ou trois fois seulement à la vue de ces ravissants cottages, bien ornés, entourés de beaux ombrages, tapissés de fleurs, avec les beaux enfants jouant sur le gazon, j’ai senti comment on peut être heureux. Et les plus profonds soupirs sont sortis de mon triste cœur. En approchant de Londres la nuit était venue. Je la voulais. En plein jour je n’aurai pas supporté cette vue. Londres éclairée ne me rappelait rien qui peut faire faiblir mon cœur. Je n’ai donc pas pleuré mais j’étais en rêve, vous savez Monsieur tous mes rêves. Vous me l’avez dit & je vous crois. Vous me devinez, vous savez, vous comprenez tout ce que je pense. Continuez Monsieur à penser tout ce que je pense !
Quelle lettre Monsieur, c’est moi, toujours moi dont je vous parle. Je vais vous ennuyer. D’après le peu qu’on m’a dit hier au soir le règne des Whigs est parfaitement assuré. Ils disent éternel. Je saurai beaucoup aujourd’hui ce qui fait que vous saurez beaucoup demain. Dans ce moment je n’en puis plus; je suis accablée de fatigue. Adieu Monsieur. Adieu, ne m’oubliez pas.
3. [Paris], Mardi 4 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Princesse
Ni moi non plus, je n’aime pas les souliers étroits. Vous pouvez vous en apercevoir. à dire vrai, et vous me passerez le terme, ce qu’il y aurait de plus agréable, ce serait de marcher pieds nus. Mais comme cela ne se peut, comme il faut avoir des souliers, je les aime mieux étroits que de ne pas marcher du tout. Y pensez-vous de me demander s’il ne vaudrait pas mieux laisser-là notre correspondance ? Madame on ne laisse pas comme on veut ce qu’on n’a pas pris parce qu’on le voulait. J’ai bien mis quelque chose du mien dans ma propre destinée ; et pourtant ce que j’y ai mis est bien peu à côté de ce qui m’est venu d’en haut... oui d’en haut, sans que je le demandasse et quand je n’y songeais pas. J’ai joui très vivement du bonheur. Le bonheur perdu, le vide est resté tet qu’il s’était fait ; je l’ai senti tous les jours sans chercher à le combler. Quand je l’aurais voulu, je ne l’aurais pas pu. Nous sommes, vis-à-vis de notre cœur malade, comme les Danaïdes vis-à-vis de leur tonneau ; ce que nous y mettons nous-mêmes ne le remplit pas. A une main plus puissante et plus riche il appartient de fermer l’abyme et d’y verser de nouveaux dons. Irons-nous, s’il lui plait de s’étendre avec bonté sur nous, irons-nous retuser son bienfait ou disputer sur le prix ? Non, Madame, non, il faut accepter, et jouir, et payer aussi cher que celui qui donne l’exigera. Vous allez retrouver, vous aurez retrouvé, quand cette lettre vous arrivera, de déchirants souvenirs ; mais tout déchirants qu’ils sont, à coup sûr vous ne voudriez pas les arracher de votre âme, vous ne voudriez pas ne pas avoir possédé les nobles enfants que vous avez perdus.
Un homme qui honorerait, il y a bientôt 200 ans le pays où vous êtes, le Duc d’Ormond, l’ami de Charles 1er disait, à la mort de son fils le comte d’Ossory tué en duel par le Duc de Buckingham. " Jaime mieux, mon fils mort que tout autre fils vivant. " C’est ce que je dis tous les jours du mien, et vous des vôtres; et nous aimons mieux ces maux, ces joies et ces douleurs inséparablement unis et confondus, que toute autre vie qui ne serait pas nous et ceux que nous avons aimés. Et si un beau jour se lève encore sur notre horizon, si une douce musique comme vous dites, vient encore frapper notre oreille, nous l’accueillerons nous en jouirons avec transport, qu’elles que soient les lacunes et les chances que la Providence y voudra attacher. En tout cas je réponds du manteau de Raleigh. C’est à vous, Madame, de me dire si vous croyez à sa puissance. N’ayez du moins à ce sujet que des émotions douces. J’ai le droit de vous le demander. Et puis, ne pensez jamais le moindre mal du 15 juin. Et puis encore écrivez-moi toujours comme vous m’avez écrit d’Abbeville et de Boulogne, dites-moi, taisez-moi tout ce que vous voudrez. Je jouirai des paroles; j’aurai foi au silence. Je vous défie d’inventer dans votre esprit, de trouver dans votre cœur de femme, quelque chose que je ne comprenne pas, si tant est que je ne l’ai pas devancé.
Mercredi 5 Je n’ai pas de lettre aujourd’hui. Je n’en espérais pas. Demain, j’y compterai. Je passe mes matinées d’une façon utile j’espère, mais bien monotone. Tout ce monde qui part, les députés surtout, viennent me dire adieu. Et la même conversation recommence avec chacun. Que le cercle où vivent la plupart des hommes est éteint et pauvre ! J’en suis toujours frappé à la fin d’une session. Ils sont tous épuisés, exténués d’esprit et de cœur. Ils ont évidemment dépensé, et au delà tout ce qu’ils avaient d’idées, de volonté, de force. Ils se traînent, ils baillent ; ils ont hâte d’aller se coucher et dormir. De toutes les conditions de la supériorité et de la puissance, l’activité, l’activité inépuisable est peut-être la première. J’ai beaucoup vécu avec le Maréchal Soult ; nous avons été près de trois ans ministres ensemble ; et pendant ce temps, j’ai vu tomber. l’une après l’autre devant moi toutes les qualités qu’on lui attribue ; il n’a ni esprit de suite, ni jugement sûr, ni vraie finesse d’intelligence, ni capacité efficace, c’est un grossier brouillon, un bizarre mélange du Gascon et du Barbare. Mais il est inventif, actif, infatigablement actif d’esprit, de corps, de volonté ; il projette, il combine, il trame, il pousse, il remue sans relâche. Il est important, il le sera toujours. Je doute qu’il y ait désormais grand chose à tirer de lui, mais son activité encore plus que son nom, lui donne une force avec laquelle tout le monde doit compter. Rien de nouveau d’ailleurs au milieu de ce décampement général. Ce que je sais de plus divertissant à vous mander, c’est la goutte de M. de Salvandy. Il avait l’autre jour un grand dîner, de la bonne compagnie des femmes, M. et Mad. Molé, M. Pasquier, Mad. de Boigne & & La goutte l’a pris : quand on est arrivé pour dîner, il n’avait pu quitter sa chambre ; M. Molé l’a remplacé à table ; et au sortir de table en rentrant dans le salon, tout ce beau monde a trouvé M. de Salvandy étendu sur un canapé, et faisant du soin de son immobilité, les honneurs de sa maison. Les mauvaises langues vont jusqu’à dire qu’il était là, en magnifique robe de chambre, un bonnet grec sur la tête en Sultan malade. Mais je n’en crois rien.
Savez-vous ce que je fais aujourd’hui? Je vais dîner à Chatenay. Cela me plaît-il ? Cela ne me plait-il pas? Je ne sais pas bien. Je vous le dirai après. Mad. de Boigne m’a écrit avant-hier. Enfin j’y vais. Mon départ est encore retardé de trois jours, jusqu’à lundi. L’envoi de 6 ou 7000 volumes à la campagne en est la cause. Adieu, Madame Certainement, j’irai m’asseoir au bord de la mer. Vous voulez que je la regarde. Je crois que je regarderai au delà. G.
4. Londres, Mercredi 5 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je commence à trouver qu’une lettre eut pu m’arriver déjà. Je vous la demande Monsieur. Je ne sais pas si depuis vendredi vous avez pensé à moi.
Ma journée a passé hier comme un instant, je vois bien que c’est le matin, qu’il faut que je vous écrive, car dès 1 heure je suis envahie, & minuit arrive sans que j’aie eu un instant de solitude. Vous allez être ennuyé des détails, mais vous me les avez demandés. Lord Grey deux grandes heures ! Le prince Esterhazy, Pozzo, Dedel (ministre de Hollande) Lady Flarrowby, Lady Carlisle, la duchesse comtesse de Sutherland, M. Granville jusqu’à 6 heures. Je montai alors en calèche avec la duchesse de Sutherland. Nous voulions faire le tour de Hyde park, mais nous n’avions pas fait deux cents pas que je me trouvais mal. Elle me ramena.
La vue de Londres est terrible pour moi. Je puis bien y être, mais non y regarder. Mon fils vient à 6 1/2. Je ne peux le voir à mon aise que pendant ma toilette à huit h. 1/2 on dîne : c’est détestable. Nous fûmes seuls, il n’y eut que lord Harrowby, & lord Grey & lord Morpeth, grand radical, excellent homme. Mes amis Torys ignorent encore mon arrivée. J’en suis bien aise. Je me sens si fatiguée que je n’ai plus de quoi leur montrer de la joie de les revoir. Cela viendra aujourd’hui & demain.
Au milieu de tout cela avez-vous pensé à Paris madame ? Oui monsieur, j’y ai pensé, toujours pensé.
Le contraste est grand mais je vous ai dit qu’il fait sur moi l’effet des ressemblances. Ah à propos, en montant dans l’appartement où se tient la duchesse le matin, le premier objet qui frappe ma vue est la gravure de M. Guizot ! Jugez ma surprise. Je me suis arrêtée. J’ai fixé mes yeux sur vos yeux.
Je vis ici dans une atmosphère très ministérielle ce qui fait que je ne m’avise pas d’avoir une opinion quelconque sur ce qui ce passe il est dans la nature des Whigs d’être très confiant. La Reine leur montre toutes les faveurs. Il est donc naturel qu’ils soient en pleine espérance, mais j’attends d’autres notions. Lord Grey se donne un grand mouvement pour faire entrer lord Durham dans le cabinet. Lui même lord Grey est aigre, mécontent, frondeur, & furieux d’être vieux. Je n’ai jamais rencontré personne qui convienne de ce chagrin plus naïvement que lui. C’est un vrai désespoir.
La voilà cette lettre. Quel plaisir qu’une première lettre, comme je lis vite, & puis comme je lis lentement, & puis plus lentement encore. Monsieur, que je vous remercie ! Il y a de hautes et nobles pensées dans les vers que me transcrivez, mais il y a une strophe un mot que j’aime plus que tout le reste. Nous avons découvert bien des ressemblances entre nous Monsieur. Mais il y a des impressions qui sont toutes différentes. Ainsi la poésie vous calme & vous élève. Moi elle m’élève bien ; mais si haut si haut que cela ressemble bien plus à du délire qu’à autre chose. Je la fuis donc la poésie. Je saurais lire sans danger il y a peu de temps encore. Aujourd’hui je la crains parce que je me crains. Monsieur je me connais bien, je voudrais bien vous expliquer ce que je suis, mais vous êtes si pénétrant, je n’en prendrai pas la peine. Cependant un homme sait-il bien comprendre le cœur d’une femme ? Je vous ai dit que j’en doutais quand il s’agissait de mes peines, qui doute bien plus pour le sentiment du bonheur. Il me semble que mon âme ne peut jamais suffire ni à la joie, ni à la douleur, que je vais mourir ou de l’un ou de l’autre par l’impuissance de les exprimer. Aujourd’hui j’étouffe ! Mais Monsieur de quoi vais-je vous parler ? Il y a presque du remord dans ce que je vous dis. Ici où une seule pensée devait m’absorber, je ne la retrouve plus distincte. Il y a un voile entre moi et mes malheurs. Toutes les circonstances passées sont devant mes yeux. Je me retrace tout, toute l’horreur de ces affreux moments. Et bien, Monsieur, aucune des sensations que ces souvenirs faisaient naître en moi il y a encore un mois, aucune ne m’atteint dans ce moment. Je ne pleure pas. Je ne me comprends pas. Il y a quelque chose qui m’arrête, qui me protège contre moi-même. Vous l’avez espéré pour moi, vous me l’avez prédit. Monsieur, quel bien vous m’avez fait ! Je vous en remercie à genoux.
Jeudi 6 juillet
Je renonce à vous raconter ma journée d’hier. Ma porte à été ouverte et mon salon n’a pas désempli depuis 1 heures jusqu’à 7. J’ai vu tout le monde Whigs, Tories, radicaux. Je sais les aimer tous. J’ai le cœur terriblement vaste. Vous allez me mépriser. Mais non Monsieur il ne faut pas faire cela. L’amitié me touche toujours de quelque part qu’elle ne vienne. J’aime tant être aimée ! Ces Anglais sont si sincères si simples dans l’expression de leur amitié. J’ai vu quelques yeux humides.
Oh pour le coup je ne résiste pas à cela. Mais j’étouffais matériellement, moralement, j’en recevais quelques uns dans le jardin, pour reprendre des forces. Enfin cela a fait un véritable levé. Je n’ai eu de tête à tête qu’avec lord Aberdeen, lord John Russell, lord Grey & lady Jersey. Tout le reste était cohue. Un immense dîner diplomatique. On m’avait donné la France pour voisin de droite. Cela m’a fait plaisir. Mais il est bien solennel M. Sebastiani & tout arrive bien lentement.
J’aime ce qui va vite. Si l’on tarde un peu à me répondre, je ne sais plus ce que j’ai demandé et cela m’est arrivé hier deux fois avec votre ambassadeur. Je trouve la diplomatie un peu en décadence. De mon temps, elle était un peu plus fashionable.
Jugez Monsieur qu’on me trouve bonne mine. Je ne comprends pas cela. J’ai été interrompue par une visite de deux heures de Lord Durham. Il a bien de l’esprit et il le sait. Il saisit et embrasse tout très vite. Il a le droit d’aspirer à beaucoup & à très haut. J’ignore si le droit se convertira en fait !
La Reine est tout à fait entre les mains de Lord Melbourne qui me parait user de sa position avec tact & intelligence. Il est plein de respect & de paternité pour elle. Elle a l’esprit ouvert, curieux, elle veut tout faire. Il n’y aura point d’intermédiaire entre elle et ses ministres. Elle travaille avec chacun d’eux. Elle s’informe, elle écoute, elle se fatigue à cela. On dit qu’elle en est maigrie ; sa santé est mauvaise. Elle ira fermer le parlement en personne. Elle fera à cheval la revue de l’armée, elle porte la plaque & le cordon de la jarretière. Elle veut faire tout, et tout de suite. On la contemple avec étonnement et respect. C’est un curieux spectacle à 18 ans !
Vendredi 7
J’eus hier matin encore une longue visite de Sir R. Peel, du duc de Wellington, lord Mulgrave, lord Grey, Pozzo. Je vous cite les têtes à têtes. Je ne veux pas vous ennuyer du reste. Peel est venu sur béquilles. Il a été en danger de perdre une jambe, & ceci était sa première sortie. Le duc est vieilli. Lord Grey est fort, bien avec l’un et l’autre. Il m’a dérangé hier. J’eusse aimé sa visite dans un autre moment. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est lord Durham qui le créerait, mais je vous expliquerai tout cela une autre fois. Pour le moment lord Melbourne est tout puissant. Je fus dîner hier tête à tête avec lady Jersey. Il faisait encore jour lorsque je me rendis chez elle. J’ai fondu en larmes dans la voiture, mon pauvre cœur se brisait pendant un moment il n’y avait place que pour mes malheurs. Le bavardage de Lady Jersey m’a distrait, je la quittai de bonne heure pour aller voir lady Cowper qui revenait de la campagne, où elle était allé enterrer son mari. Elle se jeta dans mes bras en sanglotant. Il ne me faut pas de pareilles scènes. Aussi ne puis-je pas y tenir plus d’un quart d’heure. Je rentrai à 10 h. pour m’enfermer chez moi. Je me couchai. Mon fils vint me trouver encore, je n’avais pas pu le voir de tout le jour. Nous causâmes beaucoup ensemble de mon plus prochain avenir. Il se complique singulièrement.
J’ai reçu hier une lettre de mon mari qui me fait croire qu’au lieu de Kazan, c’est à Carlsbad qu’il va se rendre seul, pour sa santé ! Il cherchera surement à me donner un rendez-vous. Et ce que je désirais le plus vivement il y a quelques temps je le redoute aujourd’hui comme si cela devait finir ma vie. Monsieur, je me suis créé la plus grande félicité ou le plus grand malheur de mon existence. Je l’ai senti en me livrant au seul sentiment qui peut désormais la remplir. Dieu l’a mis dans mon cœur. Pourrait-il si tôt me livrer au désespoir ? C’était mon paradis à moi, je ne pouvais en avoir d’autre sur la terre. Que j’en ai joui ! Monsieur ma pauvre tête s’en va quand je pense à cet avenir qui peut être si beau ou si horrible. Puis-je vouloir du bonheur à tout prix ? C’est à vous que j’adresse cette question.
Dans ce moment on me remet une lettre & une carte de visite, laissés ici hier au soir par un voyageur. Je n’y étais pas lorsqu’il a passé. Il a promis de revenir ce matin, la matinée me paraîtra longue, éternelle jusqu’à ce que je le voie ! Quelle bonne, quelle douce surprise. Y aura-t-il beaucoup de voyageurs ? Comme je vais regarder celui ci avec tendresse.
Pendant que je vous écrivais ou m’a annoncé cette femme dont je vous ai parlé. Celle qui a vu naître & mourir les enfants, & que je n’avais plus revue depuis le lit de mort de mon Arthur ! Ah Monsieur quelle horrible souvenir ! Il dort en paix cet ange & moi je suis encore sur la terre pour pleurer. Je l’ai vue cette femme Nous avons confondu nos larmes. Le petit chien n’y était pas, il viendra un autre jour, il me fera pleurer aussi. Je n’ai pas tenu au delà de dix minutes. Je reviens à vous, dites-moi quelque douce parole Monsieur, consolez mon pauvre cœur. Adieu, quelle longue lettre !
4. [Paris], Vendredi 7 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous voilà à Londres. Et vous avez été, en y arrivant bien émue, mais pas bouleversée pas malade. J’en tremblais. Et il est si triste de trembler de loin ! Je sais ce que c’est de trembler de près, de voir souffrir à côté de soi, d’assister minute par minute aux douleurs du corps et de l’âme. C’est affreux. Et pourtant il reste toujours au fond du cœur je ne sais qu’elle foi dans la puissance de l’affection qui vous persuade que, même sans y rien faire, vous soulagez, en les ressentant, en les voyant, les souffrances d’un être chéri. Et il y a du vrai dans cette foi, car enfin, un mot, un regard. une chaise rapprochée, une main pressée, C’est quelque chose, c’est beaucoup. Mais de loin, les plus douces paroles, les regards, les plus tendres, les plus ardents élans du cœur se perdent dans ce espace immense, vide, froid, qui vous sépare. J’ai toujours trouvé qu’on prenait trop aisément son parti de la séparation, qu’on n’en prévoyait jamais tout le mal. Quand on le prévoyait, quand on le sent tout entier, on a bien plus de mérite qu’on ne croit à y consentir, car on fait bien plus de sacrifices qu’il ne paraît. Le pauvre Brutus se trompait beaucoup s’il est vrai qu’il ait dit en mourant : " Ô vertu, tu n’es qu’un vain nom ! " Il faut que la vertu soit au contraire quelque chose de bien réel, car elle impose, et on accepte, pour lui obéir, de bien lourds fardeaux.
J’aime John Bull de vous avoir si bien reçue. Mais une autre fois, ne prenez personne pour votre fils. Comme à vous, les cottages de votre route me paraissent charmants, et j’y vois tout ce que vous avez pu y voir. Cependant. croyez-moi quelque heureuse que vous y fussiez, votre pensée votre caractère, toute votre âme se trouveraient bien à l’étroit dans un cottage. Il faut que le chêne s’étende, que le palmier s’élance, que la rose s’épanouisse. Nul n’est bien que dans un habit à sa taille ; et notre taille, Madame ce n’est ni vous, ni moi qui la réglons ; nous n’y pouvons pas plus retrancher qu’ajouter une coudée. Acceptons donc, quelque lourd qu’il puisse être quelques fois. l’habit qui nous va. Mais sous tous les habits, dans toutes les situations, les sentiments simples naturels, les sentiments primitifs et puissants qui sont le fond de l’âme humaine doivent trouver leur place et garder leur empire. Je ne sais ce qui a pu arriver à d’autres ; pour moi, je n’ai jamais éprouvé que les grands désirs, les grands travaux de la vie publique étouffassent, altérassent le moins du monde en moi, le besoin d’affection bien reçue, passionnée de sympathie intime, les joies du cœur et de la famille, tout ce qui remplit et anime la vie privée des hommes. Plus au contraire mon esprit s’est élevé et ma destinée s’est étendue, plus ces sentiments se sont développés en moi: plus ils me sont devenus chers ; plus même ils ont gagné, je crois en énergie, en fécondité en délicatesse! Il me semble qu’ils ont toujours participé au progrès général de mon être, et qu’en montant un échelon de plus, je n’ai jamais laissé en arrière aucune partie de moi-même. Il est vrai aussi que je suis devenu de plus en plus difficile pour la satisfaction intérieure de ces sentiments si doux de plus en plus exigeant quant aux mérites, aux perfections de leur objet. En ceci comme ailleurs, mon ambition a toujours été croissante, et je n’ai jamais accepté ni mécompte ni décadence. Mais en ceci surtout, ma plus haute ambition est satisfaite, car il a plu à Dieu de placer sur ma route des créatures dont la rencontre est de sa part, un bienfait infiniment supérieur à tous ses autres dons.
Samedi 8. Je n’ai pas eu de lettre hier. Vous l’avez peut-être adressée au Val Richer, m’y supposant déjà. Elle m’y attendra ; mais en attendant elle me manque beaucoup. J’espère que les miennes vous arrivent exactement Je ne sais que vous dire de ma course à Châtenay. J’ai été là dans l’état intérieur le plus mêlé, le plus combattu, tantôt charmé d’y être tantôt m’y trouvant plus seul que partout ailleurs. "Cette fois vous venez pour moi.» m’a dit Mad. de Boigne. Elle m’a parlé de vous, très bien, selon le monde. Le monde vous trouve très aimable Madame mais il vous craint un peu. Il lui semble que vous le regardez d’en haut, vous mettant plus à l’aise avec lui que vous ne lui permettez de l’être avec vous. Il soupçonne qu’au fond vous êtes un peu autre que vous ne lui paraissez. N’y ayez point de regret. La familiarité du monde n’est pas bonne ; il faut toujours se montrer à lui un peu dans le lointain et lui rester un peu inconnu.
Les bruits de dissolution prennent ici depuis deux jours, assez de consistance. Je suis allé avant. hier soir à Neuilly prendre congé du Roi et de la Reine. Le Roi, n’y était pas. Je n’ai donc point eu de conversation sur laquelle je puisse former quelque conjecture. En tout cas, les élections n’auraient probablement lieu qu’au mois d’Octobre. L’indisposition de M. le Duc d’Orléans n’était rien du tout, un pur accès de fièvre éphémère. Il passe demain une revue de la garnison de Paris. Les propos qui couraient sur son désir de commander lui-même, l’expédition de Constantine étant tout à fait tombée. Adieu., Madame. Je vais recommencer à trier dans ma bibliothèque les livres que je veux envoyer à la campagne. C’est un travail presque mécanique qui me convient à merveille. Mon âme pendant ce temps pense à qui elle veut. va où il lui plaît. Adieu. G.
5. Stafford House, Samedi 8 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Å deux heures hier on m’a annoncé M. Nettement. Je l’ai reçu avec une émotion qui m’a paru risible à moi même. Je l’ai retenu un moment pour convenir du jour où il aurait à venir prendre ma réponse. J’ai couru dans le jardin, et là au fond d’un canapé bien commode où il y aurait eu place pour deux ! J’ai ouvert cette lettre. Je l’ai regardé sans la lire, et puis Je l’ai lue sans la comprendre, enfin j’ai traversé toutes les bêtises de mon cœur pour arriver à bien de la joie. Est-ce que vous comprenez Monsieur tout ce que je vous dis ? Ah qu’il y a de paroles qui me font tressaillir. J’aime, et je crains ces lectures.
Ma journée a passé comme les précédentes. Un véritable raout le matin, un grand dîner, & un raout encore le soir. Monsieur je voudrais que vous me vissiez ici j’y suis dans ma gloire. Elle ne me touche aujourd’hui que si elle pouvait être vue par vous. Il me paraît qu’on est content du plaisir que je montre à me trouver ici. Mais j’en éprouve vraiment, je suis touchée de rencontrer tant d’amitié. Mes causeries les plus intimes furent hier avec lord Stanley, lord John Russell, lord Lyndhurst, M. Falk qui se trouve ici par hasard & que j’aime bien, lord Melgrave, lady Harrowby. ce que je vous cite c’est les very confidential friends Je les fais beaucoup parler. Peel est venu hier encore un moment mais sans plus de succès, il y avait des témoins, & ce matin il est parti pour la province & son élection. Il y aura contest. Je lui ai promis d’aller passer quelques jours dans son château.
Je promets tout ce qu’on me demande, mais au fond je ne conçois pas que je puisse faire grand chose dans ce genre. Je ne veux pas me fatiguer, & déjà je le suis horriblement. Les partie me paraissent fort aigris. Les Ministériels en pleine sécurité, l’opposition fort découragée. Les Whigs sont certainement en position de demeurer longtemps les maîtres du terrain. Si cette sécurité les dispose à s’appuyer sur le parti conservateur et à réunir leurs efforts contre les radicaux cela pourra aller fort bien & fort longtemps. Mais si les Tories y apportent de la mauvaise volonté ce qui est assez probable, & que le soutien d’O’Connell continue par là à être nécessaire au gouvernement cela peut mener loin et mal, car avec l’appui évident de la Reine les Whigs seront tout ce qu’ils n’osaient pas du temps du vieux roi. Aussi sa mort est elle regardée comme une immense calamité par le parti de l’opposition. Ce parti nie beaucoup l’esprit & la sagacité qu’on attribue à la Reine à entendre les ministres elle serait surprenante pour son âge. Le pouvoir lui plait, l’amuse, la nouveauté de sa situation fait qu’elle apporte une grande ardeur aux occupations les plus graves même. Cependant ses ministres sont assez habiles pour les lui rendre légères, pour l’intéresser sans la fatiguer, pour l’amuser un peu. Enfin on ne saurait imaginer une position politique plus avantageuse que celle de former l’esprit & les opinions d’une jeune reine de 18 ans. Les Tories sentant tout cela & bien vivement et de là vient leur désespoir, de là viendront leurs efforts dans les élections prochaines car il n’y aurait plus que la chambre basse qui pourrait renverser le gouvernement.
Lord Durham inquiète un peu tout le monde. Son ambition peut le mener à tout. Je vous ai dit que lord Grey travaille à le faire entrer dans le Cabinet. Aucun des ministres ne le veut pour collègue ; mais si on lui refuse tout, il voudra conquérir ; & dans ce but il s’entoure du parti le plus radical. Il a eu une longue conférence avec O’Connell. S’il lui promet plus que ne lui promettent les ministres, il le détache d’eux & s’érige protecteur d’un immense parti en Angleterre. C’est là l’extrémité que prévoit lord Grey. Tout cela est encore à la naissance ; mais regardez y bien, le danger peut surgir tout-à-coup. En attendant rien n’est plus conservatif que les propos & les opinions de Lord Durham. La royauté, la chambre des pairs, les Communes, l’Église il veut que tout reste comme cela est, qu’aucune atteinte n’y soit portée. L’union de l’Angleterre & de l’Irlande éternelle. Mais il veut justice pleine et entière pour l’Irlande & tout de suite. Les ministres la promettent mais lente. Durham a du courage de l’audace & surtout de l’ambition !
Que me fait l’ambition, que me fait l’Angleterre ! Voici le n°3. Que je l’aime, que je l’aime ! Monsieur nous sommes convenus qu’après ce mot on ne dit plus rien. Et bien je ne dirai rien. Je me recueillerai.Je jouerai.
Dimanche le 9 juillet. 9 h. du matin
C’est à cette heure-ci que je commence toujours à vous écris, & puis si je suis interrompue je vous reprends passé une heure, c’est fini pour toute la journée. Je vous raconte cela afin que vous sachiez où me trouver. Je ne vis hier que quelques personnes de bonne heure, et puis je me suis mis en campagne pour essayer enfin de rendre les visites qu’on m’a faites. J’en expédiais 25, mais quelle fatigue Je fus tellement excédée qu’en rentrant je me couchais, je m’endormis et l’on ne me réveilla que vers les huit heures pour le moment du dîner. Nous le fîmes en petit comité avec la petite princesse. Elle s’avisa de faire force plaisanteries qui ne lui réussirent pas. Je n’aime pas la gaieté pour ce que je prends au sérieux, et elle finit par le comprendre. Il y a deux sujets sacrés pour moi mes malheurs, & ce qui remplit mon cœur aujourd’hui. Ils se lient, ils se confrontent. Il y a quelque chose, de bien grave & profond dans le bonheur que j’éprouve ; car je ne vois que la mort pour le finir, comme il y a eu la mort pour le commencer.
Je commence à trouver que les occasions de courriers sont trop rares, il y aura donc régulièrement une lettre de plus par la poste. Cela fera trois dans la semaine. Ne manquez jamais de m’accuser réception des N°.
Je me couchai hier au triste bruit du canon. On le tirait de minute en minute d’onze heures à minuit qui est le moment où l’on descendait le cercueil du Roi dans le Caveau à Windsor. Au milieu de la chapelle. une trappe descend lentement dans le caveau. On voit ainsi disparaître insensiblement ce qui occupait une si grande place sur la terre. Cette opération dure une demi-heure. On dit qu’il n’y a rien de plus solennel ni de plus saisissant que ce moment. Cela ne se pratique que pour les personnes royales. Tout le monde était hier à Windsor. Il n’était pas resté un homme de connaissance à Londres.
Savez-vous ce que nous fîmes hier au soir ? La Duchesse avait fait venir du parlement le manteau royal porté par le dernier roi, afin d’aviser à la manière dont la reine devait le porter. Car elle est chargée de ce détail comme grande maîtresse et ce fut moi qui fis la répétition. Je le subis donc pendant 10 minutes sur mes épaules. Que de réflexions philosophiques il me fit faire, tandis que les réflexions des autres avaient toute une autre direction. Je pensai à un trône ; je pensai à un cottage & vous savez ce qui dominait ces deux pensées ?
Å propos de parlement et de manteau royal. Voici ce que la Reine écrivait il y a quelques jours à la duchesse. " I have to announce to you that I intend dissolving my parliament in person." Ces simples paroles d’un enfant de 18 ans s’appliquant à à une circonstance si grande, m’ont singulièrement, frappée. Ce qui est prodigieusement frappant encore c’est cet immense respect dont on environne la Reine. On redouble par égard même pour son âge.
Å propos, cet âge oblige à quelques changements, ainsi on est bien embarrassé de certaines questions qu’elle est obligé de connaître pour les décider, & qu’il est cependant différent de lui expliquer. Vous savez que tout procès criminel du Middlesex doit lui être soumis. Le vieux roi avait une grande impatience que l’un de ces procès fut terminé de son vivant, par la difficulté qu’il y aurait à le soumettre à une jeune fille. Il me semble que ce scrupule honore extrêmement ce bon roi. Eh bien le procès est là, & on ne sait au monde qu’en faire. Lord Melbourne a pour la reine une religion, une conscience tout à fait touchantes. Il se regarde comme son père. Il veille sur elle. Il veut que rien ne flétrisse la pureté de son esprit, de son cœur. En vérité c’est une noble et grande tâche que celle dont il est investie. & je ne connais pas d’homme ici que je crois plus capable que lui de la remplir avec honneur Savez-vous qu’à ce sujet je pense beaucoup à vous. Quelle mission pour vous que celle-là !
Lundi 10 à 9 heures du matin. Vous partez aujourd’hui. Je suis impatiente de vous savoir chez vous. Le repos de la campagne me sera très profitable. Vous y penserez à moi beau coup. Je l’ai senti hier, mais bien tristement. Nous fûmes dîner à Wisthill une ville du Duc au delà de la Tamise. Après le dîner je pris son bras pour promener dans le parc dans ces ravissantes routes sous ses beaux ombrages, c’était l’heure de la promenade de Chatenay, elle était même un peu plus avancée. Le reste de la société nous suivait de loin. Comme mon âme était loin de celui qui me tenait si près, que de peines, que de désirs, que de tristesse remplissaient mon cœur ! Je parlais sans savoir ce que je disais quelques fois ma tête partait tout à fait. Ah que ces promenades sont mauvaises ! Å vous elles ne feront point de mal. Moi, je suis trop faible.
Nous rentrâmes en ville vers minuit. Je ne veux plus vous parler de nous. J’y perds tout mon courage. J’ai vu quelques personnes hier matin ; lord Durham, lord Grey, les autres vous sont inconnus. Je médite de préparer lord Grey à ne pas me voir à Howick. C’est vraiment trop loin 300 miles. Il faut que je reste sur le pied de ne pas pouvoir entreprendre de longue course, & de regarder ce que je viens déjà de faire comme un peu extravagant. Cela me servira tout tourne autour d’une même idée. Tout y revient. Je n’aurai pas de distraction sur ce chapitre. Je dis distraction parce que vous ne sauriez concevoir tout ce que j’en ai eu dans ces derniers temps. Les bêtises que j’ai faites à Paris les derniers jours, les confusions, & les petits embarras que cela me donne. Je ne me reconnais pas, car il y a toujours eu beaucoup de règle dans ma tête pour toute chose.
Pendant que j’écrivais, on me remit le N° 4. Vous avez plus d’esprit, non pas cela, vous avez l’instinct plus sûr que moi, et ce n’est pas encore tout à fait ce que je veux dire? Vous êtes plus sûr de votre fait que je ne le suis du mien. Ainsi vous m’envoyez vos lettres souvent, tous les deux jours, et vous avez raison, mille fois raison. Moi, j’hésite encore à juger de vos impressions sur les miennes et j’ai mille fois tort. Je crains de vous ennuyer. Quelle énorme bêtise n’est-ce pas ? Eh bien j’ai envie de n’avoir plus peur, vous aurez une lettre quatre fois la semaine au moins. & Je penserai que votre joie sera égale à la mienne. Êtes-vous content de ma fatuité ?
Quelles bonnes lettres, quelle douces lettres que les vôtres, comme tout ce que vous dites entre dans mon esprit et dans mon cœur. Comme je voudrais l’avoir dit, car je sais bien que je l’ai pensé. Vous me montrez, vous m’expliquez mon âme. Ah mon Dieu que de chose je voudrais vous dire qui tendraient toutes à vous prouver que je n’ai pas besoin de vous parler. Il me semble que voilà qui ressemble bien à un Irish Bull. Je ne sais pas me faire comprendre de si loin, oui je suis loin, bien loin, trop loin. Comment ai-je fait pour partir ? Je ne le conçois pas. J’ai revu hier un précepteur ; celui qu’ils aimaient le plus, un Russe très anglais. Ah quel mal tout cela me fait ! Il l’a vu car il m’a quittée en me disant qu’il prierait Dieu pour qu’il me donne de la force. Que serais-je devenue ici, si vous ne m’aviez soutenue ?
Adieu. Adieu. Toujours ce vilain mot, & pendant si longtemps encore ! Et connaissons- nous la mesure de ce longtemps ? Ah mon pauvre cœur se brise. La Reine dissout son parlement lundi le 17. Elle désire que j’y aille, et puis elle veut me voir chez elle.
God bless you.
7. Stafford House, Jeudi 13 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’attends 1 heure de la poste, depuis Samedi j’ignore tout, même que vous ayez pensé à moi ! J’ai passé hier la matinée sur mon lit. Je vis cependant quelques personnes. Le duc de Sutherland d’abord qui ne manque jamais de venir s’assurer si je vis encore. La duchesse dans toute sa gloire car elle accompagnait la reine pour la première fois à une cour qu’elle a tenu à de St James. Lord Lansdowne, et puis lord Aberdeen. Je refusai tous les autres même lord Grey, au risque d’une grosse querelle avec lui aujourd’hui. Lord Londonderry est déjà prêt à se battre. Il m’écrit les lettres les plus extravagantes mais vraiment il me fatigue, son esprit est lent comme sa parole, comme ses gestes et je n’ai pas de temps à perdre. Nous sommes un peu sortis de la politique hier Lord Aberdeen et moi. C’est un homme avec lequel il serait possible. de causer comme on cause avec vous mais cela demande un peu de travail. D’ailleurs quoique il vous ressemble en fait d’infortunes, & les siennes surpassent toutes les autres. C’est un sujet qui lui fait horreur. Il renferme tout, et son visage d’ Othello va fort bien avec ce mouvement d’épouvante sombre par lequel il repousse toute allusion à ses malheurs. je m’arrête tout court.
La poste est venue, et je n’ai pas de lettres ! Me voilà démoralisée pour le reste de la journée. Je serai mauvaise pour vous pour tout le monde. Monsieur ne me laissez pas sans lettre. Mon imagination cherche le choléra, la peste, un accident de route, la main droite foulée. Elle rencontre tout, elle ne saurait rencontrer l’oubli, mais Je suis triste jusqu’au fond de l’âme.
Faut-il reprendre ma journée d’hier. Vous intéresse-t-elle ? Monsieur vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas comment l’inquiétude peut s’emparer de mon âme & comme un rien peut faire naître cette inquiétude, et ce que je deviens alors ? La petite princesse vint me voir hier deux fois. Nous parlâmes de mon coin autour du tapis rouge. Que je le regrette ! Je dînai seule avec Lady Cowper. Elle est à peu près consolée. Elle l’est trop. Elle a été mariée 35 ans. Je crois qu’elle se mariera dans dix mois ! Je ne vis mon fils hier qu’à 10 heures du soir. Je le renvoyai à onze pour me coucher. Tout le monde était hier à un grand bal. On m’accable d’invitations à dîner surtout je ne suis pas capable. de tout cela. Je n’accepte que les plus indispensables. Je suis fatiguée, je suis triste, comment ai-je pu quitter Paris ? Me connaitre si peu ? Ah que de pensées qui m’étouffent. J’écrirais des volumes, que je n’expliquerais pas tout ce qui remplit mon cœur. Je ne me crois pas capable d’attendre la fin de septembre. Je ne comprends plus aucun obstacle. Ah Monsieur la pauvre tête que la mienne et que j’ai tort de me montrer à vous si faible, si faible ! Qu’allez-vous penser de moi ?
4 heures. Voici un mot, un seul mot de dimanche soir sans N°. Mais quel bonheur qu’un mot, & comme celui que vous me dites me prouve que nous nous entendons ! Car vous étiez inquiet. Alors comme je l’étais ce matin. Monsieur que je vous remercie d’avoir été inquiet, cela m’enchante. Vous n’en avez pas plus de raison que moi, et cette ressemblance aussi est bonne.
Vendredi 14 9 h. Lord Grey entrait lorsque je traçais hier les derniers mots. " You seem in great spirits, shall you be more gracious to me to day ?" Je ne vois pas de raison pour remplir ce voeu, mais il est vrai que j’étais in great spirits. Un rien m’abat, un rien me relève. Mais ce n’était pas rien hier. C’était bien une petite feuille de papier que je tenais. serrée entre mes doigts, & qui valait pour moi tous les trésors.
Le P. Esterhazy m’a tenu longtemps hier matin. Il a réclamé la chambre à coucher parce qu’on est à l’abri des interrupteurs. C’est un homme d’esprit, pas du tout de l’école du prince de Metternich dans la manière, mais avec beaucoup de finesse, toute le finesse de son chef & moins de vanité & de préventions que lui. Il me fit faire quelques découvertes dans un horizon lointain. Il n’y a rien de personnel dans ce que je vous dis. Après lui vint votre Ambassadeur ; celui-là n’ont pas les privautés (dit-on privautés) du bed room. Cela ne va ni à son air solennel ni notre courte connaissance. Il me fit plaisir hier cependant, car nous arrivâmes naturellement sur un sujet qui me fait bondir le cœur. Ce sujet fut traité du côté le plus grave ; j’écoutais avec curiosité & joie. Quand on est bien écouté, on parle... J’aime beaucoup M. Sébastiani. Après tout ce monde j’eus quelques autres visites & puis je fermai ma porte pour aller faire un tour en phaéton avec lady Clanricarde qui m’avait attendue dans le jardin pendant une heure. Je reçus d’étranges confidences qui me prouvent qu’il y aura bien des défections dans les rangs réputés ministériels et que les élections peuvent avoir un résultat inattendu par les ministres dans 15 jours tout sera résolu, & ce sera un moment grave.
Hier il y eut un grand dîner Tory à Stafford house. Nous reprîmes le duc de Wellington et moi, nos vieux souvenirs de la cour de George IV. Lui et moi nous sommes inépuisables sur ce chapitre et tous nos souvenirs sont communs. Il a bien baissé cependant le duc. Il me fait l’effet d’un vieux cheval arraidi (sic) par l’âge, ce qui ne l’empêche pas d’avoir encore l’air galant. Lord Aberdeen ne me quitte pas de toute la soirée. Il fut d’un profond étonnement lorsque je lui dis, ce qui était vrai, que j’avais souvent Milton le matin. Je vous l’annonce Monsieur j’y avais cherché ce que vous me citiez un jour. Je sus répéter quelques vers à Lord Aberdeen. Cela le mit dans de véritables transports. Je ne pensais pas à lui en les disant. Il ne songeait sans doute pas à moi en les écoutant. Mais je vis que j’étais pour lui une nouvelle découverte, que je lui apparaissais sous un jour si inattendu que sa surprise pouvait prendre toutes les formes. " God is thy law, then mine." Voilà sur quoi ma mémoire s’était le plus fixée. Il trouvait plus beau ceci. "He for god only, she for god in him" J’aime la seconde idée de ce vers, je ne suis pas aussi contente de la première je crois que vous serez de mon avis. Quoi ? Elle n’aurait rien en donnant tout ? Retournez à ma première citation & continuez les trois vers qui suivent, je les aime, je les comprends. A propos et pour terminer tout à fait le sujet, Milton est bien heavy, & je crois que j’ai fini avec lui, à moins que vous n’en ordonniez autrement.
J’ai eu des nouvelles de M. de Lieven. L’Empereur n’avait pas encore décidé entre Kazan & Carlsbad. Moi il me vient quelques fois à l’idée que ce pourrait bien n’être ni l’un ni l’autre, mais la Tamise.
Ah Monsieur, imaginez que mon cœur se serre à cette pensée- là. Mon Dieu pardonnez-moi. Il me semble qu’il me pardonne, car je ne trouve rien que de pur, si pur au fond de mon âme. Je la regarde bien mon âme. Je l’aime. Je la trouve meilleure qu’elle ne m’a jamais semblé. Monsieur donnez-moi du courage. Dites moi que j’ai raison. Je vous écris de la plus étrange manière du monde. On m’interrompt vingt fois, je change de résidence emportant partout ma feuille de papier avec moi & la continuant tantôt dans le salon tantôt dans le jardin où il y a un petit établissement pour écrire. Voilà ce qui fait que vous verrez une phrase écrite avec deux encres différentes. Ces interruptions sont insoutenables. & Dieu sait les sottes lettres que je vous fais en conséquence. Mais cela vous est égal n’est-ce pas ?
Hier le jardin fut illuminé. Il l’est au gaz. C’est magnifique. Rien de plus. Compte tenez que tout cet établissement. C’est royal. Le jardin me parût de trop hier au soir. J’y aurais été si c’était Chateney quand on alla s’y perdre Je rentrai dans mon appartement, mais je ne dormis pas Je rêvai éveillée, de quatre à 6 heures. Je crois que j’ai eu la fièvre, mais elle ne me fit pas de mal. Je pensai au mois de septembre il y a quelque idée d’envoyer la jarretière au roi Louis-Philippe. Mais cette idée rencontre une forte opposition de la part de quelques vieilles têtes. Je vous parle toujours du quartier ministériel. Car les autres ignorent tout. La Reine ne consulte sa mère en rien. Elle est très absolue la Reine. Cela pourra donner du souci. je fais demander aujourd’hui à la reine de me recevoir. Je me sens mieux. & il faut que je fasse ma tournée de principes.
Adieu. Monsieur Adieu. Le petit mot me suffisait pour hier, mais vous ne me laisserez pas vivre longtemps sur cela seulement. Adieu.
8. Stafford House, Samedi 15 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous me maltraitez Monsieur, depuis le N°4. Je n’ai rien rien qu’un très petit mot de dimanche dernier. Reprenez je vous en prie vos bonnes manières. J’essayai hier de me promener un peu. Cela ne me réussit pas ; il survint un gros orage. Ma porte fut assiégée comme de coutume. Je n’ai à vous rendre compte que de mes tête à têtes. Le plus long hier fut avec Lord Harrowby. Dieu, qu’il est sombre ! Au reste cela a toujours été son métier. Et durant les 18 années qu’il s’est trouvé dans le Cabinet il n’y a jamais fait autre chose que d’exposer toujours le mauvais côté de toutes les questions qui s’y agitaient. Eh bien, c’est d’une grande utilité. De cette façon les mauvaises chances ne manquaient jamais d’être prévues et écartés si faire ce pouvait. C’est un des hommes d’État de ce pays qui a le plus d’expériences des affaires. Il était ami intime de Pitt. il voit la fin du monde bientôt. Il a un mépris. profond pour les Ministres, & il exprime tout cela dans les termes les plus doux. Cela est fort peu Anglais. J’aime mieux les vérités brutales dans leurs boucles. Alors, ils sont charmants.
Lord John Russell vient souvent causer avec moi il est d’une familiarité & d’une naïveté charmantes. Nous rions un peu de tout. Le duc de Devonshire arriva hier de la campagne pour faire les arrangements avec moi. Il veut absolument septembre à Chathworth. Moi je voudrais septembre autre part, la poussière de Paris me parait charmante enfin je verrai,.Je ne veux me lier par aucun engagement. Monsieur je m’interromps vingt fois pendant que je vous écris. Me voici dans une exclamation & un soupir d’avant hier.
Point de lettres ? Comment m’expliquer cela. Comment supporter tous ces mécomptes ? Les idées les plus extravagantes s’emparent de mon esprit. Quelques unes atroces ; d’autres tellement enivrantes que j’en perds la tête. Il me semble que un tête à tête aujourd’hui ne seront pas seulement avec des Anglais. La mer est le vite franchie ! Et puis je me figure tout. Monsieur est-il bien raisonnable de se livrer à son imagination ? Vous m’avez fait du mal en me disant un jour que vous la laissiez-vous accuser quelques fois. Prenez garde Monsieur à tout ce que vous me dites. Ma foi ne vous est si grande que je ne crois jamais mal faire en vous imitant. De même que je crois que je saurais réprimer tout ce qui pourrait vous déplaire. Cette poste venue sans lettre de France m’en a portée une de Pétersbourg. Mon mari allait s’embarquer le 8 pour venir à Lubek. Il se borne à cet avis. Je me figure quelques fois qu’il ne serait pas impossible qu’il vint me voir pour quelques jours seulement. Le bateau à vapeur de Hambourg arrive après demain. S’il l’amenait ! J’ai l’imagination toute sombre comme celle de lord Harrowby. Il me semble que l’atmosphère anglais y dispose. Tout me fait peur.
Je fis hier un grand dîné chez Lady Jersey. Votre Ambassadeur fut encore mon voisin. Il me parla de tout. Nous devenons familiers. Combien je pense à l’interrogation prophétique que vous me fîtes il y a deux ans à d’ici chez Mad. de Boigne. Vous en souvenez- vous ? Je passai après le dîné c.a.d. à onze heures du soir chez lady Holland. J’entrai & je trouvai le mari tout seul, Madame était au spectacle dans ces cas là où lui laisse à lui une bougie, ses lunettes & du papier pour écrire. Pas autre chose. Il trouva ma visite fort agréable. Sa bonne humeur me plut.
J’ai vu ce matin, lord Grey, Pozzo, & lord Aberdeen chacun bien longtemps. Ellice & quelques autres par dessus le marché. Monsieur, il est arrivé quelque chose d’étrange entre Lord Aberdeen et moi. Vous le connaissez un peu par ce que je vous ai dit de lui. Moi je le connais & je l’aime beaucoup ma société lui a toujours plu, & voilà tout. Il a été bien heureux dans sa vie. Heureux comme vous l’avez été. Il a tout perdu. Deux femmes, quatre enfants chacun à l’age de 16 ans. C’est une tragédie ambulante. Mes malheurs ont pu accroître le goût qu’il a toujours trouvé dans ma société, car les malheureux se cherchent. Il aura trouvé en moi maintenant quelque chose de plus que ce qu’il y avait autre fois. Je vous l’ai dit, je vaux mieux de mille manières. Et bien Monsieur, toute cette préface est pour arriver à ce que vous devinez. J’ai reconnu dans lord Aberdeen les mêmes symptômes que j’ai surpris en moi depuis quelques mois. Mon cœur s’est révolté à l’idée de laisser un instant d’illusion à une âme bien noble, bien malheureuse. Hier je lui ai conté l’histoire de mes sensations depuis les malheurs dont le ciel m’a frappée. Il a tout compris plus que compris, hors la force de ces expériences. Et mon dieu ce n’est pas de la force, c’est de la faiblesse. C’est parce que je suis femme, parce que mon cœur a besoin de secours, que ma voix sait trouver des paroles. Je demandais à Dieu du secours ou la mort. Il m’a secouru. Je le lui ai dit. Il sait maintenant que je ne suis pas seule sur la terre, qu’un noble cœur a accepté la mission de consoler le mien. Je me suis sentie soulagée après cet aveu. Il l’a reçu en véritable Anglais quelques mots sans suite. Un serrement de main plus fort que de coutume et il m’a quittée.
Dimanche 16 Je vous écrivais encore tard hier à 6 heures. Je ne sais pas me séparer d’une feuille de papier commencée. Je vis le Duc de Sutherland à ma toilette. Je ne l’avais pas vu de tout le jour. Il avait été à Windsor chercher les diamants de la couronne dont sa femme doit avoir la garde. Il vient les étaler sur ma table. Ces diamants sont aujourd’hui l’objet d’un procès entre la couronne d’Angleterre & de Hanovre. celle ci les réclame en vertu d’un testament de la reine Charlotte. La reine d’Angleterre n’aurait rien. Au reste si le roi Ernest ne faisait que cela à la bonne heure, mais sa proclamation ? Voilà une belle affaire. Ici les Tories en sont consternés. Elle fera le plus grand tort au parti dans les prochaines élections. Savez-vous qui est son conseiller intime ? Ce fou de Londonberry. Ce fut chez lui que j’allai dîner hier à la campagne, un dîner d’ultra, beaucoup de violence de langage, beaucoup de roses. Un chien énorme établi sur le genou droit de la maîtresse de la maison & le genou gauche d’un jeune lord son amant. Une promenade au clair de Lune sur le bord de la Tamise. Voilà ce que j’ai à vous raconter de mon dîner.
A propos lord Aberdeen devait en être. Il a envoyé ses excuses. un moment avant de nous mettre à table. J’ai passé une très manvaise nuit. Aujourd’hui dimanche point de poste. Le cœur un battra demain matin bien fort. Il me semble que je ne vous parle que de moi. Mes lettres vous ennuient-elles ?
Monsieur tout autre sujet me passe de l’esprit avec vous. Cependant l’Angleterre vous intéresse je sais assez intimement tout ce qui s’y passe. Si je vous en entretenais peut être cela m’attirerait-il de plus fréquentes lettres de votre part ! Je vais essayer. Il y a eu comme je crois vous l’avoir dit déjà quelques mécomptes dans les calcule des Whigs pour les élections, les membres les plus impertants du parti sont allés feel the pulse de leurs commettants. Le Conservatisme est fort à la mode. J’ai vu cela hier au visage moins arrondi de M. Ellice. Cependant on ne peut rien préjuger. Dans trois semaines vous y verrez très clair.
La reine veut jouir de tout à la fois et prend en même temps la royauté en gaieté & au sérieux. On dit que rien n’est plus curieux que les grands jours d’audience. Ainsi les Universités sont venues lui porter leur adresse. Le duc de Wellington a lu celle d’Oxford avec une voix très sévère, un peu tremblante, enfin beaucoup d’embarras ; le Clergé a fait de mêmes, toutes ces vieilles perruques tous ces vieux costumes rangés autour de ce vieux trône occupé par une jeune fille, tout le monde en respect, en silence, quite awfull à ce que l’on m’a dit ; & la reine assise sur ce trône avec son manteau royal, un sourire d’enfant, une voix argentine des plus claires des plus douces, on dit que cette voix est charmante, lisant ses réponses lentement appuyant avec emphase. sur my, mine, élevant la voix alors & jettant ses regards sur toute la salle. Prononçant avec humilité & onction, les passages du discours qui ont rapport à la religion. Faisant tout cela avec calme, dignité, répos. En vérité lord Grey, lord Aberdeen, le duc de Wellington qui m’ont tous raconté cela en sont confondus. Au sortir d’une corvée qui a duré quatre heures, & après avoir reccueilli en allant en revenant de St James, les applaudissements les plus enthousiastes de la foule elle donne à dîner à quelques uns de ces ministres, menant la conversation à table. Après le dîner ; elle a demandé à lord Landsdowne s’il aime la musique & s’il aimait l’entendre. & la voilà chantant des airs italiens seule, des duos avec sa mère & tournant la tête de ce pauvre lord Landsdowne. Tout cela n’est-il pas curieux, bizarre. J’ai demandé quarante fois si elle a de l’esprit. On ne m’a jamais fait de réponse bien claire. Je verrai cela moi même. Je vous ai dit que la mère est en dehors de toute affaire ; même des affaires de cour, La Duchesse de Sutherland me paraît prendre beaucoup d’ascendant sur la Reine, mais elle a peur de la maitresse. C’et étrange tout le monde en a peur. Lord Melbourne un peu plus que les autres. Il aime il admire cette volonté absolue, mais il n’a pas bien démêlé encore jusqu’où elle peut aller. Il n’est pas question de mari. Les ministres n’en sont pas pressés. Elle n’a pas l’air de l’être. Cependant une fantaisie de salon pourrait tout à coup associer quelqu’un au trône. Voilà ce qui fait plisser le front de lord Melbourne.
6 heures Lord Aberdeen m’a fait prier de le recevoir seul un moment. Je l’ai reçu. Il m’a demandé de le laisser s’exprimer en Anglais parcequ il voulait être compris. Il craignait que je n’eusse pas entendu son silence hier. Dans cette séparation de 3 ans il n’a jamais cessé de penser à moi avec une affection vive. Nul n’a compris & partagé mes malheurs comme lui. Il veut que je sache le sentiment bien intime, bien profond qu’il me porte. Il est heureux de penser que mes peines sont adoucies. Il me prie de ne pas l’oublier, & puis il me déclare que sa voiture de voyage est à ma porte, qu’il part pour ses montagnes en Écosse & qu’il ne me demande qu’une chose c’est de baiser ma main pour la première fois de sa vie. Tout cela s’est dit comme je viens de vous le dire. Il a pris ma main, il l’a retenue un moment et il est sorti, & en effet le voilà en route. Je vous ai tout dit Monsieur, savez vous qu’ici encore je reconnais la singularité de notre sort, & cette providence qui a fait le 15 de juin, & décidé du sort de ma vie.
Lundi 17. Au milieu de ce monde immense qui m’environne de ces intérêts si curieux mais qui nous sont si étranters, de ces conversations tout anglaises, de ses grands dîners où rien ne me rappelle ce que j’ai quitté, mon esprit, mon cœur ne sont préoccupés que d’une seule pensée quelle puissance que cette pensée unique qui m’absorbe aujourd’hui ! Je vis hier pendant deux heures la Duchesse de Glocester, sœur du feu roi, elle me raconta tous les gossips de cour, & d’intérieur. Deux heures aussi d’entretien intime avec lord Melbourne. Il m’en est resté tout un trésor de découvertes. Vous les aurez demain jusqu’à un certain point. Je fis hier un immense dîner chez le prince Estérhazy. Ces dîner me fatiguent extrêmement. On ne se met plus à table avant 9 heures. Il faisait chaud. Je priai qu’on ouvrit la fenêtre. Ma belle lune bien ronde, bien claire me donna des distractions abominables. Monsieur pardonnez-moi, la lune. Dans une heure, le postman fera sa tournée. Une heure d’angoisse encore et puis vendra-t-elle ? Adieu Monsieur, adieu. La poste est venue. Point de lettres ! Mon Dieu que penser ? Ayez pitié de moi.
9. Stafford House, Lundi 17 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
3 heures
Je suis monsieur dans un très pitoyable état. Il me semble impossible de durer comme cela. Après vous avoir le écrit ce matin on m’a amené ce petit chien dont je vous ai parlé. Je ne l’avais pas vu depuis l’heure de la mort de mon Arthur, il était sur son lit : "ce chien m’a reconnue au bout de deux ans et demi ! Il m’a caressée, il ne voulait pas me quitter. Des sanglots horribles se sont échappés de mon cœur. J’ai poussé des cris de désespoir. Rien depuis bien longtemps ne m’a émue comme cela. J’ai invoqué le secours de Dieu, le vôtre. Ah le manteau de Raleigh avait perdu toute sa puissance ! Ou plutôt c’est lui, lui qui ajoutait à ma douleur. Je suis triste triste comme si j’allais mourir. Tout me parait tragique dans mon existence, & les idées les plus affreuses, se sont emparées de moi depuis ce matin. Je n’ai point de lettres ! De quoi voulez-vous que je vive ?
Mardi 18. La poste est venue rien, rien. J’ai demandé à Dieu à genoux une lettre. Dieu m’abandonne. Vous ne pouvez pas m’abandonner ? Cela est impossible. Monsieur vous êtes malade. Faites-moi écrire par quelqu’un. Mad. de Meulan. Je lui demande par pitié un mot.
J’envoie ceci à l’ambassade d’Angleterre à Paris avec prière de faire porter ma lettre à la premières des adresses convenues. Serait-il possible qu’on interceptât nos lettres lettres ? Il m’est revenu un propos qui prouve toute la fureur de 17 [Molé] contre moi.
Monsieur que voulez-vous que je devienne ? Je suis sans un état pitoyable. Je ne dors pas, je ne vis pas. On ne me reconnait plus. Faites-moi savoir que vous vous portez bien. Ne me laissez pas mourir.
11. Stafford House, Lundi 17 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je recommence tristement un nouveau N°. Que sont devenues les autres ? Que deviennent vos lettres ? Que devenez-vous? Je ne puis plus penser à autre chose. Je ne sais que vous dire, mon cœur est si angoissé. J’écris à " you are safe" pour la conjurer d’apprendre de vos nouvelles & de me les dire. J’ai envoyé par courrier une lettre à l’adresse convenue, & je me suis assurée qu’elle sera postée, & non remise à la petite poste. Je viens d’écrire au porteur de votre N°2 pour le prier de passer chez moi & voir s’il y a moyen de se rendre utile. Enfin je me creuse le cerveau pour y trouver des réponses. Je veux savoir que vous vivez que vous vous portez bien. Je dévore les journaux, je tremble que votre nom ne se présente avec quelque accident. Je défie qu’il y ait au monde aujourd’hui une personne plus agitée plus inquiète que moi. Vous voyez ce bon effet que cela doit faire sur moi. Aussi suis-je bien changée & il m’est impossible de vous promettre des bras. Au contraire, je puis vous assurer qu’il ne m’en restera plus.
Mercredi 19 9h. J’ai passé la nuit la plus affreuse. Monsieur mon faible corps ne résistera pas longtemps aux angoisses que j’endure. Ma raison ne me présente rien qui puisse les calmer, et cette image qui devait tout adoucir est devenu aujourd’hui la cause de toutes mes souffrances. Il me fallait donc ce malheur de plus ! Apprenez-moi, Monsieur, à me résigner aux volontés de Dieu. Hélas vous ne m’apprenez plus rien. Je suis abandonnée, et le comble des maux pour moi devait être d’avoir entrevu, senti le bonheur joui d’une jouissance inconnue, divine, & de me voir tout arraché comme une illusion. J’ai donc rêvé. Ah ma pauvre tête, je sens qu’elle n’y est plus.
Midi. Cet horrible moment de la poste s’est passé comme ils se sont tous passés depuis dix jours. Point de lettres ! Grand Dieu qu’est ce qui s’est donc passé entre nous. La mort, l’enfer, quoi ? Dois-je douter de vous ? Ah cela m’est impossible. Dites le moi vous-même Je ne croirai que comme cela.
Je fus chez la Reine hier, je la vis seule pendant une demi-heure. Lord Palmerston m’a demandé un entretien. Je l’ai reçu seul aussi. Ce fût long & intéressant. Une grande heure avec le comte Orloff. Tout cela Monsieur occuperait bien des pages. Mais je n’ai pas ma tête. Je n’ ai qu’une pensée, il n’y a plus place pour autre chose. Mon entrevue avec Orloff y a rapport cependant, & c’est elle seule qui m’a laissé quelque sommeil. J’avais raison de me promettre quelque chose d’un homme d’esprit. Il en a et de l’indépendance. Il m’a parfaitement comprise, et je ferai comme je veux. Vous savez ce que je veux. Je le veux plus que jamais. Le voulez-vous ? Quel horrible doute.
Mon mari débarque aujourd’hui en Europe, il va d’abord aux eaux en Bohème. Il veut me voir. Monsieur, cela m’est impossible.
Jeudi le 20. J’ai la respiration suspendue. Voici onze heures, l’heure de la poste, le moindre. bruit me fait tressaillir. Je joins les mains, je prie Dieu "qu’il vive, qu’il m’aime que je le revoie." Je ne trouve plus que cela à demander au Ciel. Toute autre pensée est bannie de mon sommeil. Ah non, il y en a d’autres. Il y a tous ces tombeaux Monsieur je suis prête à perdre la raison. Une lettre un mot, pourraient m’aider à la retrouver. Mais ce mot n’arrive pas, il n’arrivera jamais. Je vis hier le porteur du N°2. Je l’ai supplié d’écrire pour demander directement des nouvelles. Je me suis parfaitement compromise, & je me suis sentie parfaitement contente.
Aujourd’hui. j’écris à Mad. de Meulan pour la conjurer de me donner de vos nouvelles. Je veux savoir que vous vivez. Il me semble que pour le moment c’est tout ce qu’il me faut. Mais Monsieur moi je ne vivrai pas longtemps. Toutes les personnes qui m’entourent sont effrayées de mon changement ? Le facteur est venu. Pas de lettres. Mes larmes, mes prières, tout est inutile. Qu’ai-je fait à Dieu pour qu’il ne punisse si cruellement.
Monsieur tout est confusion dans ma tête Je vous prends, je vous laisse, j’ai une fièvre ardente. J’oublie tout, je pense à tout. L’air de Londres m’étouffe. J’entends une voix chérie, j’entends de douces de divines paroles ! Ah je devais mourir en revenant de Chateney. Je serais morte heureuse. Aujourd’hui mourir dans le désespoir ! Hier et aujourd’hui j’ai lu les livres que j’avais en voyage. Cette lecture m’exalte & me fait du mal. Ah, qu’elles valaient mieux que moi ! Que je voudrais leur ressembler.
2 heures. J’ai été m’asseoir ou plutôt me coucher ! Dans le jardin, l’air ne m’aide pas à respirer. Il est frais cependant, tout le monde me le dit. J’ai pensé, repensé, examiné toutes les possibilités. Nos lettres sont interceptées, cela me semble hors de doute. Les journaux annoncent votre arrivée à Lisieux. Le 14 vous vous portiez bien, et je me suis un peu soulagée, mais que faire pour notre correspondance ?
J’adresse ceci à M. Aston secrétaire de l’ambassade d’Angleterre. Je le prie d’envoyer ma lettre à l’adresse convenue par un de mes gens. Je demanderai à cette adresse de Vous faire passer ceci par une vois sûre, à votre tour faites porter votre réponse à l’ambassade d’Angleterre à M. Aston que je préviendrai, & il m’adressera votre lettre pas courrier, la même voie qui vous porte ceci. Les Granville quittent Paris sans cela c’est eux qui auraient été les intermédiaires pourvu que vous prenez bien vos précautions de votre côté il me parait que ce moyen est infaillible.
Si vous ne le jugez pas tel je ne vois plus d’autres réponses que de n’envoyer quelqu’un de sûr. Un courrier ad hoc lequel viendrait me trouver à Broadstairs, c’est un lieu de bain de mer située un peu au nord de Douvres, prés de Ransgate et Margate. L’homme ferait adresser à Lady Cowper qui s’y trouve. The Dawage’s countess Cowper.
Il va sans dire Monsieur que c’est moi qui aurai à lui remettre les frais de l’allée & de la venue. Trouvez seulement un homme sûr et intelligent. Je me charge de lui faire aimer les voyages. Maintenant j’ai épuisé je crois toutes les inventions.
Vendredi. Le 21. Prenez pitié de moi, Monsieur que Dieu prenne pitié de moi. Je sens prête à perdre la raison. Comment supporter longtemps l’état affreux où je me trouve ! On me regarde avec étonnement. Je suis méconnaissable mes idées sont confuses. Il me semble que je n’ai pas connu de véritables malheurs. avant celui-ci et j’ignore la nature de ce malheur. Ai-je à amuser le Ciel ou les hommes ? Êtes-vous malade ? Mais comme il faudrait que vous le fussiez pour ne pas m’écrire un mot ! & dans ce cas assurément les journaux m’en instruiraient. Comment en supposant que mes lettres sont interceptées comme les vôtres n’avez vous pas trouvé un moyen quelconque de me faire parvenir un mot ? Je me perds dans toutes ces hypothèses & je ne puis pas en aborder une troisième. Vous ne pouvez pas m’avoir abandonnée ! Je vous l’ai demandé un jour, venez-vous du Ciel ou de l’enfer. Il y a quelque chose de surnaturel dans la puissance que vous exercez sur moi, vous l’avez établie, mon âme s’est vouée à vous. Dois-je y trouver mon salut ou ma perdition ? Pour le moment il n’y a que mort ou désespoir dans mon cœur. Secourez-moi, prenez pitié de moi. Je n’ai rien à vous dire, je ne trouve rien
J’ai subi hier une fête magnifique que donnaient mes hôtes. Comprenez-vous rien de plus horrible dans l’état de mon âme. Mon cœur était gonflé de larmes, ma vue en était troublée quelquefois. & quand elle s’éclaircissait, je cherchais parmi tous ces yeux, deux yeux. Je les évoquais, il m’a semblé un moment les rencontrer c’était un moment de frénésie. C’est alors que j’ai cru que je devenais folle. J’ai saisi le bras de quelqu’un je ne sais qui, je ne voyais rien. Il m’a dit très doucement : " vous vous trouvez mal." Je ne me suis par trouver mal. On a dit autour de moi que l’odeur des oranges était trop forte.
Monsieur j’ai un souvenir horrible de cette fête, l’une des plus belles que j’aie jamais vues. Je rêvais le cottage, le bonheur, & je ne trouvais pas, même une pauvre feuille de papier ! Monsieur si cette lettre tombe entre vos mains, ne serez-vous pas effrayer de la vivacité de la violence de ma douleur. Me pardonnerez-vous de tant savoir aimer ? Je ne savais pas moi-même, Monsieur, que cela ne fut possible, & je ne le sais aujourd’hui que pour souffrir.
C’est cependant à Lady Granville que j’adresse ceci. Je lui recommande toutes les précautions. possibles pour faire tenir ma lettre à la première de nos adresses, & dans le mot que j’adresse à cette adresse, je le prie de ne vous envoyer ma lettre que par une occasion très sûre en lui annonçant que vous lui en saurez gré. Monsieur tout bien pesé il me semble que M. Aston est l’intermédiaire le plus sûr possible. Faites porter vos lettres chez lui si jamais vous m’écrivez encore. Quelle horreur que ce doute ! Lui me les fera tenir par courrier Anglais.
M. Aston premier secrétaire de l’Ambassade de d’Angleterre,
à l’hôtel de l’ambassade
39 rue du Faubourg St Honoré.
Monsieur, vous souvenez-vous de la menace que je vous ai faite un jour. Vous souvenez-vous de ce que je voulais faire si je recevais jamais une lettre aussi douce aussi enivrante que vos paroles. Y êtes-vous ? Eh bien, savez-vous que cet horrible silence peut avoir les mêmes conséquences s’il se prolonge encore. N’y comptez pas Cependant écrivez, écrivez au nom de Dieu écrivez-moi. Ah comment ma voix ne parvient-elle pas jusqu’à vous. Quelle force dans nos âmes & quelle impuissance que nous sommes grands, & que nous sommes misérables !
God bless & protect you dearest, ever dearest.
8. Val-Richer, Mercredi 19 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je savais bien que je ne lirais pas votre première lettre sans remords. Et la prochaine m’en donnera plus encore, car vous aurez été plusieurs jours sans lettres. C’est un peu ma faute, la faute de mon inquiétude, de mon chagrin, de mon humeur. Savez-vous que j’ai été, moi, huit jours sans lettres, du jeudi 6 au vendredi 14 ? De toutes les raisons de retard, l’irrégularité de la poste à travers mes champs normands était à coup sûr, la plus vraisemblable. C’est celle à laquelle j’ai le moins pensé. J’en voulais absolument une plus grave. L’Empereur Napoléon, n’avait jamais voulu croire qu’une gelée de 25 degrés pût arriver en Russie plutôt que de coutume, et qu’une circonstance, toute matérielle, toute indifférente d’ailleurs, vint, paralyser les combinaisons de sa haute intelligence, de sa puissante volonté. Moi aussi, j’étais choqué de penser, je répugnais à admettre qu’il fût au pouvoir d’un courrier mal réglé ou tardif de me tourmenter à ce point. Je cherchais pour cause à mon tourment des intentions, des actions plus spécialement dirigées contre moi, contre moi seul. On ne se rend pas, de tout ce qui se passe dans l’âme ainsi troublée, un compte bien net ; mais que d’idées, que d’émotions la traversent que de conjectures elle invente qui frapperaient d’une surprise infinie si elles paraissaient au jour ! Que la vie extérieure, la vie qui se voit est lente, et froide, et vide, à côté de la vie intérieure, de la vie secrète ! Ce n’est pas là une des moindres causes du charme de l’intimité ; elle soulève aux yeux d’un seul être, le voilà qui couvre ce théâtre si animé, si varié, mais sans spectateurs.
J’ai lu, dans quelque vieille chronique, qu’un roi Barbare, très avisé et qui avait amassé d’immenses trésors, disait à sa femme qu’il l’aimait parce qu’elle était la seule personne à qui il les montrât. On montre son âme à la personne qu’on aime ; et entre mille raisons de l’aimer. On l’aime, en effet pour celle là. On répand devant elle tous ses trésors cachés, et elle les connait, et elle en jouit ; et du moins auprès d’elle tout ce qui est paraît ; le dehors et le dedans se confondent ; la vie éclate avec vérité et liberté.
Malgré mon remords, Madame, votre lettre me charme. Moi aussi, je vous remercie de votre inquiétude, et puis de vos great spirits. et puis encore de votre poésie. Vous avez mille fois raison. Milton a grand tort de dire. "He for God only." C’en un reste d’arrogance puritaine. Et le langage universel du genre humain proteste contre cette arrogance, car de tous temps et en tous pays, hommes et femmes également se sont dit, en s’aimant, je l’adore, ne se faisant pas plus de scrupule les uns que les autres de se parler comme s’ils parlaient à Dieu. J’ai beaucoup de foi à ces instincts spontanés et généraux du langage humain. La vérité s’y révèle presque toujours.
Jeudi 20
Je viens de m’impatienter à chercher mon Milton. Je ne l’ai pas trouvé. Il est dans des caisses de livres, qui ne me sont pas encore arrivées. J’étais pressé de relire les trois vers auxquels vous me renvoyez. Je suis bien sûr que je les aimerai comme vous. Est-il rien de plus doux que cette confiance dans une prompte et complète similitude d’impressions ? Milton est en effet un peu heavy. Cependant si nous le relisions ensemble nous y rencontrerions encore bien des vers qui vous iraient au cœur. La poésie fait bien autre chose que m’élever et me calmer au besoin ; elle m’entretient, dans le plus charmant langage, de tout ce qui a pu de tout ce qui peut charmer ma vie. Elle n’a pas toujours été pour moi ce qu’elle est aujourd’hui. J’ai appris à la comprendre. J’en jouis bien plus que je ne faisais à vingt ans. J’y découvre tous les jours des intentions, des émotions qui avaient passé inaperçues devant moi, et qui maintenant me saisissent car je les reconnais ; c’est mon âme qu’on me raconte. Voici des vers de Moore qui me sont retombés avant hier sous la main. Blessed meetings after many a day
Of widowhood past far away ;
When the loved face againts seen
close, close with not a tear between ;
Confidings frank without controul,
Pour’d mutually from soul to soul ;
As free froms any fear or doubt,
As is that light from chill, or stain
The sun into the Stars Sheds out,
So be by them shed back again !
Faites comprendre tout ce qu’il y a dans ces vers à qui n’a pas goûté tout le charme de l’intimité et senti tout le poids de l’absence ! Les émotions même les plus personnelles, des émotions qu’en les éprouvant on a été tenté soi-même de regarder comme étranges, comme vouées, au plus profond secret, on les retrouve quelquefois dans les poètes et précisément telles qu’on les a éprouvées. Vous m’avez parlé un jour du besoin impérieux qui vous avait quelquefois poussée, quand vous étiez seule, à appeler à haute voix, à bien haute voix, les êtres chéris que vous aviez perdus. Je ne sais quelle réserve, quel embarras m’empêcha de vous dire alors que moi aussi j’avais parlé, et appelé et crié comme vous. Eh bien, Madame, ce que nous avons senti l’un et l’autre, ce que nous ne nous sommes dit qu’à voix basse et en hésitant, le Dante l’a mis en beaux vers dans une canzone sur la mort de sa Beatrix : « Quelquefois, dit-il, mon imagination devient si vive, et en même temps la douleur me presse tellement de toutes parts, que je tressaille, je m’enfuis avec honte loin de toute vue ; et seul, pleurant, gémissant, j’appelle Béatrix, et je lui dis.« Beatrix es-tu morte ? Et quand je l’appelle ainsi, elle me console.»
Poscia, piangendo sol nel mio lamento,
Chiame Beatrice, e dico. Or, sei tu morta ?
E mentre ch’io la chiamo, mi comforla.
Et le Dante a cru peut-être, et nous avons peut-être cru, vous et moi, qu’une telle impression, un tel cri ne pouvaient appartenir qu’à un cœur déchiré. Le Dante s’est trompé, nous nous sommes trompés. Le bonheur aussi, un bonheur profond, saisissant, a produit les mêmes effets. Le méthodiste passionné ce John Newton dont je crois vous avoir parlé, écrit à sa femme :
« It is my frequent custom to vent my dearest
thoughts aloud when I am sure that no one
is within hearing. I have had many a tender
soliloquy concerning you, and in the height
of my enthusiasm, have often repeated your
dear name, merely to hear it returned by
the echo.
N’est-ce pas un plaisir pour vous, Madame, de retrouver ainsi, dans des cœurs si inconnus de vous à des siècles de distance, vos plus chères pensées ; vos émotions les plus intimes ? Et loin d’y rien perdre ne reçoivent-elles pas en quelque sorte par là, à vos propres yeux une nouvelle et puissante sanction. Je crois en vérité Madame, que je me suis persuadé que vous étiez là, car je vous raconte tout ce qui me vient à l’esprit ou à la mémoire, absolument comme si nous causions. Mais mon rêve s’évanouit. Vous me quittez. Adieu. Je n’aurai le cœur à l’aise que lorsque, pour vous comme pour moi, notre correspondance se sera rétablie dans sa douce régularité.
12. Stafford House,Vendredi 21 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon dernier N° est à peine sorti de mes mains que j’en commence un autre. Je me regarde avec curiosité. N’y a-t-il pas de la folie dans tout ce que je fais dans tout ce que je pense ? Qu’ai- je fait de ma raison, de ma dignité, du peu d’esprit que je croyais avoir. Il semble que tout m’ait abandonné à la fois. Je me sens livré sans réserve à quelques instants de bonheur. Je me donne sans réserve aussi au désespoir. Mais ce bonheur, il était trop grand, trop inattendu. Il devait me tourner la tête. & vous l’avez vu, je n’avais pas en moi de quoi le supporter. Je vous ai fui, croyant retrouver un peu de calme; m’accoutumer à la félicité ; et en effet je voyais dans vos lettres de quoi faire face à la fois à de déchirants souvenir et soutenir une séparation qui m’a coûtée plus encore que je ne l’ai montré. Tout cela s’est trouvé vrai pendant huit jours. Huit jours pas davantage ; mais vos lettres étaient là. Je n’en ai plus. Depuis le 9 pas un mot, pas un signe de vie. Quand elles venaient tout était riant autour de moi. Jamais tout le monde, j’écoutais tout, je prenais part à tout. J’étais touchée, honorée de l’amitié qu’on me montrait. Tout est changé, je ne comprends rien, je n’aime rien, tout m’importune. Je vous voyais partout mais cette vision me donnait de la force, du bonheur, de l’esprit. Je vous vois partout encore, sans cesse, mais votre image me bouleverse, me trouble, m’anéantit. Je veux pleurer, je pleure. Je suis les battements de mon cœur. Il ne semble qu’il battra ainsi aux approches de la mort, car eût une angoisse qui me rend difficile de comprendre comment je vis encore.
Et si je mourrais au milieu de ce tourment de cœur, de ces doutes, de ces horribles craintes, quelle mort affranchie ! Que faites-vous ? Souffrez-vous aussi ? Mais dans ce cas & dans tous les cas (cas où vous n’avez pas de lettres, ou, si elles vous arrivent, vous savez toutes mes douleurs) Comment n’avez-vous pas trouvé un moyen quelconque pour faire cesser les tourments que nous endurons ? Je dis nous ai-je tort ?
Samedi 22. 9 heures du matin, Une lettre une lettre ! La voilà devant moi. J’ai passé la nuit en pleurs, en prières. Je vous voyais, malade, mourant, mort. Qui peut deviner jusqu’où la nuit, le silence, la fièvre peuvent porter une imagination malade, un cœur passionné. Vous voyez que je ne me gêne plus. J’aurais su me contenir dans le bonheur, dans la sécurité. Vos lettres eussent été cela pour moi. Vos lettres ne venant pas l’inquiétude, les alarmes, ont tout dominé en moi. Mon style s’en est ressenti. Je me rappelle avec effroi que je n’ai plus accepté la moindre contrainte. Il y aurait gaucherie à m’y soumettre maintenant. Le mal est fait si mes lettres sont lues. Le mal est fait depuis longtemps vis à vis de vous, car si mes paroles n’ont pas exprimé tout ce que ressentait mon cœur. Vous y liriez, vous saviez bien que toute parole restait au dehors de ce qui le remplissait. Il me semble Monsieur que je ne vous ai jamais tant dit que je vous ai écrit ? mais j’en viens à votre lettre. Avec quelle ardeur j’ai déchiré l’enveloppe.
C’est le N°7. 4, 5 & 6 me manquent & ce N°7 ne traite que de haute politique. Rien que de cela. J’y cherche en vain autre chose. Cette autre chose que renfermait sans doute les lettres égarées ou interceptées. C’est celles-là qu’il me fallait. Par quel étrange hasard ou quelle infernale intention, me vois-je privée de ce qui valait tout pour moi, & rien pour tout autre ! Mais je ne dispute pas vous vivez ! J’en tiens la preuve en main j’en rends grâce à Dieu, à vous.
Il me semble que je vais revivre. Mais qu’il me faudra de temps pour revenir en fait de santé là où vous m’avez laissée ! Monsieur je suis méconnaissable. Je n’ai ni mangé, ni dormi depuis dix jours. Et ne croyez pas que j’exagère vous le verriez bien à ma mine si vous me voyiez aujourd’hui. Votre lettre est admirable, mais il me semble que celles que je n’ai pas, que ces trois N° qui me manquent, devaient être bien autrement précieux. Aujourd’hui je ne saurais haïr, mais demain après, je crois que haïras celui-qui m’a volé mon bien autant que j’aime celui-qui me le donnait. Voilà un homme très parfaitement détesté. Ah, je respire ; c’est vrai ce que je vous dis. Je respire. & il me semble que je fais respirer les autres. Marie, une femme, les enfants de la maison (ils viennent chez moi le matin) tout cela a été reçu avec douceur. Tout cela me dit que j’ai bien dormi, qu’ils voient cela à ma mine. Quel mensonge que ma mine. Je n’ai pas fermé l’œil ! Mais une lettre, quelques feuilles de papier & pas un mot affectueux cependant, voilà ma mine du moment.
Ah Monsieur quel empire que celui que vous avez sur moi. Pourquoi vous le dis-je tant ? Quel mauvais calcul.... Voilà un vilain propos, le jour où je me livrerais à un calcul, je ne saurais plus aimer. Soyez tranquille Monsieur, je ne calculerai jamais.
Votre lettre me rappelle que je ne vous ai plus rien conté depuis huit jours je crois. Je ne sais ou aller retrouver mes souvenirs, je ne sais où je vous ai laissé. Lord Palmerston a fait des démarches pour me voir seule. Je l’ai reçu. Je l’ai même reçu avec amitié, & il m’a parlé comme par le passé avec confiance. Il confirme tout ce que je vous ai déjà dit de la Reine. Il est en pleine sérénité & contentement. La proclamation du roi de Hanovre ne me parait pas le contrarier beaucoup. Elle a fait du tort au parti conservateur ici ; & elle peut donner de l’embarras en Allemagne. Cela le fait rire.
Mon audience chez la Reine m’a laissé d’elle une très favorable impression. Nous avons été seules pendant une demi-heure. Il y a beaucoup de réserve & de convenance dans sa conversation un peu de timidité qu’elle sait fort bien allier avec un peu de hauteur. Un visage charmant ouvert, l’œil fort intelligent, un sourire très gracieux, le nez bien fait, la fraîcheur de 18 ans & de joues charmantes à baiser. Elle se fatigue beaucoup mais elle dort fort bien sur tout cela. Dès que ses Ministres la quittent elle chante. Elle chante toujours, à sa toilette lorsqu’on lui met le manteau royal. la royauté lui parait charmante, et puis elle aime vouloir. Elle veut de la musique après le dîner. Il n’y a pas de tente pour la placer dans son jardin. On court au galop, on trouve, on place, on place mal, mais cela lui est égal, elle veut que cela soit & cela est. Tout est à l’avenant et tout le monde est gai de sa gaieté, jeune de sa jeunesse. Il y a longtemps qu’il n’y a rien ou de jeune sur le trône d’Angleterre. Les plus vieux, les plus frondeurs souriant avec complaisance. Tout cela est joli à voir. J’ai eu un long tête à tête avec la Duchesse de Kent. Elle est mécontente. C’est dans toute l’Angleterre la seule personne désappointée. Elle le dit trop. Il est évident que dans peu de temps d’ici il ne restera plus entre la mère & la fille que des rapports de stricts convenance. Personne n’en est fâché.
Depuis le commencement de cette semaine j’ai manqué à tous les grande dîners que j’avais acceptés. J’ai offensé bien du monde, j’ai donné du chagrin à quelques personnes. Lord Grey entre autres. Il est parti hier pour sa province vraiment affligé, & lorsque j’ai vu sur ce noble visage une larme descendre vraiment de cet œil si doux, je me suis sentie du remord et j’étais prête à lui demander pardon de toutes les angoisses qui m’ont empêchée de lui montrer de l’amitié comme il avait le droit de l’attendre de moi.
Je relis pour la quatrième fois votre N°7. Vous ne me parlez pas de mes lettres mais comme vous ne portez pas de plaintes, je dois en conclure qu’elles vous parviennent. Je risque donc encore celle-ci par la voie directe, mais saurai-je jamais si elle vous est parvenue ? Faites donc faire des recherches au bureau de poste de votre ville car enfin trois lettres me manquent, et celle-ci du 17 est bien vieille. Adieu monsieur, adieu. Que j’aurais l’âme heureuse si notre correspondance allait comme elle va pour tout le monde. Verrai-je encore une lettre ? Tout ce que j’ai gagné aujourd’hui, c’est de ne plus me faire des dragons quand il n’en viendra pas. Ah les horribles images qui m’ont poursuivies ! Tout mon corps tressaillait. Il me semblait que j’allais mourir. Mon prochain N° vous apprendra à quoi je me décide en conséquence des mouvements de mon mari.
9. Val-Richer, Vendredi 21 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame que vous dirai-je ? Je n’aime pas les sentiments combattus ; ils sont peu dans ma nature. En général, quand deux impressions contraires m’arrivent ensemble, mon cœur choisit décidément choisit et l’une devient bientôt dominante, tout à fait dominante. Mais aujourd’hui que faire ? Vos N°7 et 8, le dernier surtout que je reçois à l’instant, me pénètrent de tristesse et de bonheur. Votre inquiétude me désole et me charme. Je lis, je relis, je relis vingt fois les paroles pleines d’une agitation pour vous si douloureuse, pour moi si tendre ! Que ne donnerais-je par pour vous l’épargner? Que ne vous dois-je pas pour l’avoir sentie? Pardonnez-moi dearest Princess, pardonnez-moi mon égoïste joie ; elle n’ôte rien, je vous jure à ma peine pour votre peine. Je crois que si ce n° 8 était arrivé avant-hier, le chagrin, l’eût emporté en moi. Je vous aurais vue encore si triste, si troublée ! Mais, depuis hier j’espère, le mal est passé ; hier au plus tard, vous avez reçu une lettre; vous en aurez une autre demain ; elles iront à vous désormais régulièrement, souvent, bien souvent. Chacun à notre tour, nous avons traversé l’un et l’autre un bien sombre nuage. De petites circonstances, des circonstances tout-à-fait étrangères à notre volonté, mon déplacement, des adresses inexactes, des postes mal réglées voilà la vraie cause du mal. Il ne se reproduira plus. Nous y veillerons. J’y veillerai comme les Guèbres sur la dernière étincelle du feu sacré, comme une mère sur son enfant malade. Les témoignages de votre affection me sont mille fois plus doux que je ne vous le dirai jamais. Mais je ne veux jamais les devoir à une minute de souffrance de votre cœur.
Et Lord Aberdeen ? Il est donc parti ? Et je puis en toute sûreté, le plaindre, être juste envers lui ? Que je vous remercie de m’avoir ainsi mis à l’aise avec moi-même ! Je ne connais rien de plus pénible que de nourrir en son âme un mauvais sentiment contre un galant homme malheureux. Et pourtant vous êtes une noble créature. Et moi j’ai le cœur bien fier. Je pressentais cela et depuis longtemps. Même avant votre départ, le nom de Lord Aberdeen me frappait plus sérieusement qu’aucun autre. Pauvre homme ! C’est si naturel !
Vous ne savez pas Madame, pour un homme sérieux et malheureux, quel charme il y a en vous, dans votre air, dans votre accent, dans ces entretiens où éclatent, avec tant de dignité et d’abandon, votre esprit si haut si simple, si libre, votre âme si gravement et si finement émue, si sensible aux grandes choses, si indifférente aux petites, pleine de tant de sympathie et de tant de dédain ! Je voudrais avoir quelque occasion d’être en bon rapport avec Lord Aberdeen de lui être agréable en quelque chose. Je me sens comme des devoirs envers lui. Vous me direz s’il vous écrit s’il doit revenir à Londres avant votre départ. Vous me direz tout, comme vous l’avez fait.
Samedi 22 midi. Dearest Princess, il n’y a plus de sentiment combattu. Je n’en ai plus qu’un absolument qu’un. Je suis désespéré de votre inquiétude. Je crains quelle ne vous fasse mal. Je reçois à la fois votre petit billet, sans numéro du lundi 17 qui m’est venu directement, après être encore allé me chercher à Caen et votre N°9, du Mardi 18, qui m’arrive par Paris. J’ai beau me dire qu’à présent, depuis Jeudi vous êtes tranquille, que vous savez combien vos inquiétudes étaient vaines. Je n’en suis pas moins désolé, troublé, inquiet de nouveau moi-même et de la façon la plus douloureuse. Je vous vois, vous êtes là devant mes yeux, impatiente, préoccupée quel charme agitée, triste, attendant, attendant encore. Vous me pardonnez, n’est-ce pas? Je veux que vous me pardonniez, quoique je n’ai point de tort, non certainement point de vrai tort, point de tort devant Dieu; car moi aussi j’ai attendu et bien des jours, et avec une impatience dont j’ai contenu, dont j’ai étouffé l’expression en vous la témoignant. Et si j’avais suivi ma pente, quand vos lettres ne m’arrivaient pas quand mon imagination se lassait, s’épuisait à chercher la cause du retard ou du silence, je vous aurais écrit tous les jours ; tous les jours je vous aurais demandé pourquoi je n’avais pas de lettre. J’aurais mieux fait. Je ne l’ai pas fait à cause de vous, de vous seule. J’ai craint quelque odieuse malice. J’ai voulu y voir clair.
Enfin tout est passé n’est-ce pas, bien passé? Vous ne craignez plus, vous ne souffrez pas, vous n’êtes pas malade ? Que la parole est pitoyable, & que tous mes efforts seraient vains pour vous envoyer sur ce papier, ce que j’ai en ce moment dans le cœur ? Voyez le, devinez-le. Vous le pouvez, j’en suis sûr ; je me confie à vous. C’est ma consolation dirai-je ma joie, mon inexprimable joie de savoir, d’avoir vu, de voir tout ce qu’il y a dans votre cœur de tendresse et de puissance. Ceci encore, cette joie vous me la pardonnez également. Dites-le moi, que j’aie le plaisir de l’entendre, quoique je n’en aie pas besoin. Demain enfin, après demain au plus tard j’aurai une lettre rassurée, et qui me rassurera j’espère. Mais que d’heures encore d’ici à demain ! Aujourd’hui, il me serait impossible de vous parler d’autre chose.
Adieu adieu. Mais, je vous en conjure, soignez-vous ; ne vous livrez pas à des émotions comme celle que ce petit chien a causée. L’absence est déjà assez lourde ; au moins faut-il être tranquille sur votre santé. Je ne serais pas tranquille quand vous vous porteriez toujours le mieux du monde. Comment l’être un moment si des secousses continuelles vous assiègent ? Éloignez-les ; abrégez-les. Vous pouvez avoir de l’empire sur vous? Vous m’avez dit que vous réprimeriez tout ce qui pourrait m’affliger. Pensez à moi. Je suis sûr que vous le ferez comme vous me l’avez dit. G.
13. Stafford House, Dimanche 23 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a longtemps que j’ai laissé là mon journal, j’ai passé huit jours à vous envoyer des soupirs & des plaintes. Vous ai-je bien manqué ? Cet ennui au reste je l’ai fait partager à tout le monde. Monsieur vous savez commander à vos chagrins. Je l’ai vu. Moi je n’ai pas cette faculté. Je l’ai moins que ne l’aurait un enfant. Je suis transparente. La joie, la peine, l’inquiétude tout se lit sur ma physionomie. Vous ne me connaissez pas encore. Je crains que vous ne me trouvez un peu primitive. En Angleterre un dîner est une affaire si grave, que lorsqu’on y manque on passe pour être très malade. J’ai tout renvoyé en journée alors on est accouru. J’ai fermé ma porte, & je n’ai vu que les plus indispensables.
J’ai dîné seule avec le duc & la duchesse. Le soir tard on me trainait en calèche. J’aimais à me trouver sous les étoiles à les regarder. y regardez vous jamais. Je ne connais pas une de vos habitudes. Je voudrais savoir comment votre journée est arrangée. Peut-être me l’avez vous dit, mais vos lettres où sont elles ? Attendu que j’en ai reçu une hier (toujours le N°7) je sortirai aujourd’hui, j’irai dîner à Holland House, je me propose même d’y être fort aimable.
2 heures. J’ai été à l’église, j’en sors à l’instant, je n’ai pas beaucoup écouté le prêtre. J’ai prié à ma façon, il me semblait que je ne priais pas seule, que tout ce que je pensais, tout ce que je demandais, un autre le pensait, le demandait avec moi. Il n’y avait rien qui ne fut digne du lieu où je me trouvais et cette image terrestre que je porte au fond de mon cœur loin de nuire à ma dévotion me semblait la redoubler, l’élever, l’épurer enfin, Dieu et vous étiez si bien confondus, dans mon âme qu’il me semble qui c’est de chez vous que je sors, mais non pas vous que je quitte. Ah jamais je ne vous quitte Monsieur je vous dis tout, parce que je vous crois bien digne de comprendre mon âme.
4 heures Je viens d’avoir un fort long entretien avec le comte Orloff, j’en suis complètement satisfaite. Tout a été réglé entre nous cela ne pouvait pas manquer car il est homme d’esprit. Entre nous, il est convenu que je ne tiendrai compte que de ses paroles, & pas de celles de mon mari, (c’est original, mais c’est ainsi.) Je retourne là où il me plait.
Cependant il faudra que je fixe un rendez-vous à mon mari. C’est Dieppe que le comte Orloff a choisi. Je n’ai pris l’intiative sur rien mais je me suis arrangée de façon à ce qu’il m’indique lui-même tout ce qui me convenait le mieux. Je ne suis jamais sortie d’une agitation aussi satisfaite.que je l’ai été de celle-là au reste comme les ratifications y manquent il faut que je prenne une mesure pour le cas où elles vinssent traverser ces projets. Dans l’esprit d’Orloff elles sont inutiles, à la bonne heure, & j’agirai en conséquence. Je serai en France avant le moment où de nouveaux ordres pourraient m’atteindre.
Lundi le 24. Lord Holland m’égaya beaucoup à dîner ; c’est un esprit aimable, toujours serein, pas le sens commun en politique mais toujours doux dans son extravagance. Il a vu la Reine pour la première fois il y a peu de jours il en est tranmporté. Il la trouve charmante & l’ensemble de la situation la plus jolie qu’on puisse imaginer. Ainsi, arrivé au palais pour son audience ou lui dit que la reine est enfermée avec Lord Melbourne et lui même on l’enferme avec une fille d’honneur de dix-huit ans aussi comme sa maîtresse, et jolie comme un ange. L’usage veut qu’au lieu d’un Chambellan, ce soit une fille d’honneur qui soit constamment dans le salon d’attente. Tout cela entretient la bonne humeur des vieilles perruques et comme je vous l’ai dit déjà la joie me semble être complètement l’ ordre du jour pour tout le monde. Savez-vous que cela donne de tristes pensées ? Cette petite princesse si innocente, si heureuse encore, combien longtemps jouïra-t-elle de cette ignorances des peines attachées à la condition ! Aujourd’hui encore elle rit, elle chante qui sait les soucis, les inquiétudes qu’elle aura dans peu de semaines & combien vite toutes les joies de son âge seront flétries !
J’ai beaucoup causé hier avec Lord Melbourne puis avec Lord Durham. Le premier me semble encore tout aussi innnocent que la reine, c’est l’effet qu’il a toujours fait sur moi. C’est un excellent homme. l’air rude & le cœur le plus mou possible. Beaucoup d’esprit & de droiture, & prodi gieusement d’indolence. Un abandon extrême quand il est sûr de quelqu’un, il lui dit tout. Toujours nous avons causé intimement ensemble. Il a des inquiétudes pour les élections. Lord Holland me parait en avoir aussi, à moins d’une accession considérable de voter à la Chambre, le gouvernement serait toujours obligé de s’appuyer sur le parti radical, je demande pourquoi ce ne serait pas sur le parti conservateur à quoi on m’objecte que dans ce parti il n’y a que le duc de Wellington & sir Robert Peel de modéré, & que leur monde ne leur permette pas de soutenir le ministère. On ne sait que faire de lord Durham et il me parait possible qu’on l’associe au gouvernement. Il y a également de l’embarras pour choisir des ambassadeurs car Pétersbourg & Vienne vout devenir vacants. Je crains même qu’il ne soit question de Paris. Mes paroles ne manquent pas pour détourner de ce projet qui me parait fort contraire aux intérêts du ministère Anglais.
Monsieur la poste est venue et mon refrain recommence. Pas de lettres ! Je ne m’agiterai plus comme j’ai fait toute la semaine dernière du moins je l’espère ; mais comment voulez-vous que je ne sois par triste ! Pas un mot d’affection depuis le N°4 qui finissait le samedi 8 juillet et nous sommes au 24. Il me parait que voici ce que je décide je quitterai Londres Samedi le 29. Je ne suis pas bien sûre si j’irai ou non passer une huitaine de jours auprès de Lady Cowper à Broadstairs. De là à Douvres et Boulogne. Je vais annoncer que ma santé m’empêche de faire les visites que j’avais projetées dans les châteaux. Trois motifs me déterminent à ceci Monsieur. D’abord je ne puis pas vivre sans lettre, je le sens, et il est inutile d’espérer que notre correspondance aille mieux, et puis dans le parti que j’ai arrêté pour mon avenir, mon incapacité de voyager doit être mise en première ligne. Troisièmement je vous l’ai dit dans cette lettre, il faut que j’aie le pied en France. Arrivée à Boulogne, j’aviserai. Veuillez aviser de votre côté c-à-d. régler notre correspondance en France. Voulez-vous que je vienne à Dieppe. Cela me rapproche de vous. Que j’aille à Paris cela fera mieux aller les lettres. Je vois bien que tout mon sort est suspendu à ces lettres. Quelle rage de lettres !
Dans tout cela et à tout hasard faites-moi trouver une lettre à Boulogne, poste restante vers le 8 août. Elle peut m’y attendre pour le cas où je tarde mais prenez vos mesures pour qu’elle y arrive, & qu’elle tombe vraiment entre mes mains. J’ai bien envie de vous dire que vous êtes maladroit. Dans tous les cas j’ai bien du guignon. Je dors un peu maintenant mais j’ai une mine épouvantable, & je serais très fâchée que vous me vissiez, quoique ce soit votre ouvrage. Eh bien il est venu le N°6. Je l’ai, je le tiens, et je l’aime ! je l’aime ! Quel pays barbare que cette France, quoi le cours de la poste n’est pas réglé ! Mais il l’est en Russie. Allons je ne querellerai plus personne et pour être bien sûre de ma résolution. Je m’arrangerai de façon à n’avoir besoin de personne. Il me reste à vous informer de ce que je vais dire ici et en France. C’est que le changement d’air d’existence, les émotions douces mais douloureuses que j’ai rencontrées ici ont tous subitement altéré ma santé, cela est vrai et visible. Que les médecins ne me permettent pas les voyages, cela est parfai tement vrai aussi ; qu’ayant rencontré ici tous mes amis réunis ayant passé trois semaines au milieu d’eux, j’ai atteint le but qui me ramenait momentanément en Angleterre. & qu’aujourd’hui qu’ils se dispersent, je vais retrouver l’air & l’existence qui ont si bien comme pendant deux ans à ma santé ! Je viens de confier tout cela à la duchesse, je ne le proclamerai que dans quelques jours. Je vais déranger déranger bien des arrangements mais je suis décidée.
Continuez cependant à m’écrire. Il vaut mieux que ses lettres me reviennent un peu vieillies que de ce que je reste sans nouvelle. C’est toujours à Londres que vos lettres seront adressées. La duchesse veut que je vous dise son souvenir. Elle a été flattée des paroles que vous lui adressez. C’est une très noble personne avec une très belle âme. La petit princesse est dans une dissipation et une coquetterie perpétuelle. Quel drôle de métier. Il me semble que j’ai été jeune, mais coquette jamais. Que de choses à vous dire quand je pourrai dire ! Monsieur vous figurez-vous nos moments de causerie ? Ce bonheur me sembe si grand, si immense, que je tremble en y pensant, car le bonheur est si rare. Adieu. Adieu, quelle lettre que votre N° 6 ! Êtes-vous content de me savoir heureuse par une lettre ? Monsieur, il me parait que vous devez être bien content de moi.
Mardi 25. Ma lettre ne part qu’aujourd’hui. J’ai reçu une énorme épitre de M. de Lieven. Il me fait part de ses plaiss. (Il venait d’arriver à Lubeck) jusqu’à la fin de septembre aux eaux, & puis il veut me voir, & me demande de lui fixer un rendez-vous. Il ne croit pas que ce puisse être en France. Ensuite il m’emmène à Rome, à Naples ; en avril il doit se retrouver à Pétersbourg. Je lui écris aujourd’hui pour lui faire comprendre que je ne puis rien faire que le rendez-vous, en France et le plus près possible de Paris. Il faudra bien que cela lui entre en tête. Il est si joyeux dans sa lettre, de sa liberté, de se retronner avec moi, de courrir avec moi que je suis un peu triste de devoir lui gâter tout cela. Que de réflexions j’ai faites ! Il y a deux mois quel accueil différent j’eusse fait à cette lettre ? Car quoique la société de mon mari ne soit pas ce qui convient à mon esprit ni peut-être à mon cœur cependant c’est une créature qui m’aime, à qui j’appartiens, qui s’occcupe de moi. C’est de l’intimité, de l’habitude, un intérieur tout ce qui est si indispensable, si doux pour une femme ! Mais une autre vie a commencé pour moi, une vie qui n’efface pas mes douleurs mais qui me fait oublier, qui me fait en plus comprendre cette vieille vie qui cependant a été si longue. Et encore, pourquoi fallait-il que tout juste à l’entrée d’une nouvelle existence pour moi. M. de Lieven qui devait se trouver naturellement en Sibérie, au bout du monde, se rapprochât de celui-ci, que son désir de me revoir devient plus vif qu’il ne l’a été pendant deux années de séparation. Tout cela Monsieur me mène bien loin, il y a du triste dans ces pensées, il y a même du remord, & je suis sûre que je n’ai pas besoin de poursuivre ce sujet pour que vous compreniez parfaitement. tout ce qui se passe en moi. Je serais peu digne de vous si je n’étais affectée par toutes nos réflexions.
Adieu vraiment, mais je recommencerai aujourd’hui une nouvelle lettre qui ira doit. J’adresse encore celle-ci à Paris. Je ne suis pas aussi sûre de partir Samedi que je l’étais hier. J’ai recommencé à manger et à dormir. Si ces bonnes habitudes se continuent, je ne vois pas pourquoi je ne me prolongerais pas encore un peu ici. Vous ne sauriez croire les efforts, les finesses, les tendresses qu’on met en oeuvre pour cela. Votre dernière lettre me rassure sur nos lettres dès lors je ne vois pas que M. Aston soit si nécessaire, vous en jugerez. Voici tout juste votre N°8. Je n’ai pas un moment à perdre. J’y répondrai dans la journée ; mais ceci doit partir. Que je vais lire, relire, jouïr ! Ah mon Dieu que la vie est une belle chose quand les lettres arrivent. J’ai copié votre N°7 & pour cause.
10. Val-Richer, Dimanche 23 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne suis pas encore sorti de la mauvaise veine. Je n’’ai reçu ce matin qu’un mot du voyageur que vous avez envoyé chercher. Demain enfin, j’espère vous savoir tranquille, et le savoir de vous. J’en ai grand besoin. Et quand j’aurai reçu votre prochaine lettre j’aurai grand besoin de celles qui suivront. Je les attendrai presque avec la même impatience. Car vous êtes souffrante, très souffrante. mon voyageur me le dit. Vous étiez déjà souffrante avant cette déplorable agitation. L’avez-vous toujours été depuis votre arrivée en Angleterre ? Sentez-vous que vous le soyez, au fond, à part tout accident ? Dites-moi exactement ce qui en est. Vous m’aviez promis de me revenir reposée, engraissée.
Ah, que tout est fragile autour de nous ! Nous vivons sur le penchant d’un abyme, toujours près d’y voir tomber ce que nous avons saisi, ce que nous retenons avec le plus d’ardeur. J’ai perdu, tout-à-fait perdu le sentiment de la sécurité ; je n’espère plus qu’avec inquiétude. Je ne jouis plus qu’avec tremblement. On dit que les marins s’accoutument aux tempêtes si bien que le vent le plus violent ne trouble plus leur sommeil ; Mais mon âme au lieu de s’affermir s’est ébranlée par les épreuves, dans le souffle le plus léger, j’entends un affreux orage ; dans le moindre incident, je vois le dernier malheur. Et pourtant mes joies, ces joies si menacées me sont plus chères, plus nécessaires que jamais !
5 heures
J’ai eu des visites toute la matinée, un raout de campagne. Le Dimanche, ma porte est ouverte à tout venant. Je l’ai formellement annoncé pour qu’on me ménageât dans la semaine, et j’espère qu’on me ménagera. un peu en effet. Je vis ici à l’état de bête curieuse, mais de bête curieuse dont on n’approche qu’avec quelque respect. J’ai parcouru aujourd’hui une longue échelle sociale, depuis des laboureurs jusqu’au marquis, moral de Portes, propriétaire du beau château de Fervaques, l’une des terres qu’habitait alternativement Sully, & où l’on conserve encore religieusement la chambre et le lit d’Henri 4.
Je prends, à voir l’homme à tous les étages, un plaisir sérieux et que je rechercherais à dessein, s’il ne me venait pas naturellement. Quand on vit toujours au même niveau dans la même sphère; elle devient comme une prison où l’esprit s’enferme et hors de laquelle il ne sait plus rien voir, ne comprend plus rien. Il faut aller, venir, monter, descendre. Le genre humain est un territoire très varié, très accidenté, comme on dit aujourd’hui. On n’y peut marcher d’un pas ferme, on s’y égare à chaque instant, si on ne l’a pas parcouru en tous sens et vu sous tous les aspects. Par instinct, par goût, je ne suis pas très propre à ces relations, à ces conversations de toute sorte ; mais l’expérience, m’en a démontré la nécessité, et ce que je crois nécessaire me devient bientôt presque naturel. Et puis j’ai pour la créature humaine en général sous quelques traits qu’elle m’apparaisse, un fond de sympathie. Je la considère au premier moment avec curiosité, au second avec un intérêt qui a quelque chose de l’affection. Je me préoccupe de ce qu’elle pense, de ce qu’elle sent de tout son état intellectuel et moral. Je m’inquiète de ses destinées. Il me semble toujours que, si j’essayais, si j’avais le temps, je pourrais quelque chose sur elle, pour elle ; et la communication la plus éphémère m’a quelques fois fait rêver bien des heures à la personne, très insignifiante d’ailleurs, avec qui je l’avais eue.
A la vérité, dans les rapports de ce genre ce n’est jamais à moi que je pense, ni de moi qu’il s’agit. Pour que j’entre moi-même en jeu, pour que je me sente personnellement intéressé dans une relation humaine, il faut qu’elle satisfasse aux conditions les plus élevées, qu’elle réponde à des exigences infinies. Je deviens alors aussi difficile que je suis coulant et complaisant dans le train commun de la vie. Je me prête volontiers aux hommes dans leur intérêt et sans attendre grand chose d’eux. Mais pour me donner, je veux que tous mes désirs, toutes mes ambitions soient comblées, et au delà. Vous voyez, Madame, que moi aussi, je vous parle de moi. Parlez-moi donc toujours de vous et toujours davantage. Vous ne trouverez jamais rien qui me plaise autant.
Lundi midi
Pas de lettre de vous encore ce matin. Je n’ose me plaindre ; mais je vais attendre demain comme je pourrai. Je n’aurai un moment de repos que lorsque je vous saurai calme et moins souffrante.
14. Stafford House, Mercredi 26 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Il ne m’a plus été possible hier de vous écrire et cependant que j’étais pressée de vous parler de ce N°8. Il m’a fait tant de plaisir, tant de bien ! Que vous êtes ingénieux à me dire sous toutes les formes, dans toutes les langues, ce qui peut plaire, le plus à mon cœur ! Vous voulez me faire aimer la poésie, vous vous y prenez très bien. Je pense d’elle tout ce que vous en pensez, mais ce n’est que d’aujourd’hui qu’elle me va. Jusqu’ici elle me faisait mal et je ne vais pas chercher ce qui me tourmente. Comme vous j’y ai souvent retrouvé mon âme mais je repoussais cette image abandonnée, car toute ma vie a passée seule. C’était en effet de la poésie, rien que de la poésie, elle ne me paraissait pas pouvoir jamais devenir réalité pour moi, aujourd’hui elle s’offre à moi, distincte, sensible, je l’accepte avec transport. Elle ne me fera pas aller comme il y a 15 ans attendre que la marée monte sur une petite pointe de rocher. (Vous ai-je conté cela ? Si je ne l’ai pas fait Je vous dirai cela un jour.) Elle me fera jouir mille fois jouir, du bonheur que le Ciel m’a envoyé. Mais quand ce bonheur sera présent je ne lui promets plus mon attention. Ah comme deux mots feront pâlir tous les plus beaux vers du monde ! Comme j’y pense à ces deux mots, comme je les répète !
Vous croyez que vous m’appreniez quelque chose en me transcrivant ce que faisait le méthodiste. Comme lui j’appelle, j’appelle mais tout bas, sans nom. Je profère des mots cependant, je ne sais ce que je dis. Je sais ce que je sens, & cela est bien au-dessus de toutes les expressions heureuses. Monsieur, je me crois un grand poète.
Je mens si je vous dis que j’ai noté votre N°8 vingt fois. Je l’ai lu plus souvent.
Monsieur j’ai le cœur bien joyeux, je retourne en France. Le comte Orloff est venu hier encore une heure avant son départ. Nous avons tout récapitulé, tout examiné. Je me suis fort épanchée, par lui au besoin. Il s’est compromis Moi je suis où j’en étais. Je vous raconterai beaucoup de choses. Lord Melbourne est venu dîner hier ici. La grande maîtresse de la reine était au palais. J’ai bien causé avec le premier ministre qu’il vous divertirait, que de bonnes réflexions vous ferez sur lui, sur tout le monde, sur toute chose ! Comme je pense à vous en voyant tout cela ! Vous croyez peut être que je n’y pense qu’alors ?
Maintenant que nous savons que nous ne sommes pas morts & qu’on n’enlève pas nos lettres comme toutes mes précautions me paraissent bêtes ! Il m’en revient des témoignages de Paris, dont je suis forcée de rire. Mais c’est charmant Monsieur, nous avons fait à la fois les mêmes conjectures l’une plus absurde que l’autre. La ressemblance est complète à une chose près. Vos inquiétudes & votre mauvaise humeur vous portaient à vous taire & moi à bavarder. Qu’est-ce que cela prouve ? Il me semble que mon caractère vaut mieux que le vôtre. Vous me punissiez de mes peines & moi je vous accablais de lettres.
Jeudi 27
Je passai ma journée hier à Chiswik chez le duc de Devonshire. C’est un palais italien environné du plus beau jardin du monde. Je suis restée trois heures au moins couchée sur un divan sous le plus beau cèdre connu en Europe. Vous ne sauriez concevoir le beauté de cet arbre, de ce jardin, l’élégance, la magnificence de tout cela. Le temps était admirable. Il avait invité all my friends. Nous dînâmes de bonne heure. Un concert de 60 personnes. Ce fut gai & parfaitement beau. Je ne rentrai en ville que pour me coucher. On me parla beaucoup des élections. On ne parle pas d’autre chose, à Londres tout a été ministériel, en province c’est différent, mais à tout prendre jusqu’ici il me parait que cela se balance.
J’ai eu une lettre de M. Molé hier, toute pleine d’amitié. Il m’invite bien à revenir. Je vais le faire. Comme je passe ma soirée à la cour vendredi & que cela me mènera tard je ne crois pas que je puisse partir. Samedi. Dimanche cela ne va pas en Angleterre, ainsi ce ne sera que lundi ou mardi que je me mettrai en route sans savoir encore combien de temps je m’arrête chez Lady Cowper, mais je crois positivement que je serai en France le 8 ou 10 au plus tard.
Cependant ne vous relâchez pas dans votre correspondance ; car vos lettres me reviendront si je suis partie, & si je restais au-delà de ce que je pense vous comprenez bien que je ne peux pas vivre sans lettres. Je vous écris tant Monsieur qu’il m’arrive de ne plus écrire à personne.
Je vous quitte aujourd’hui pour remplir mille devoirs infligés. Que j’envie vos bois, vos ombrages ! Hier au milieu de ce luxe de végétation & de magnificence, c’est à eux que je pensais vous le savez bien. Adieu. Adieu. 3 heures Je rouvre ma lettre. Le N°9 est venu. Il m’a trouvée au milieu d’une conférence de 2 heures avec le duc de Wellington. Je l’écoutais avec curiosité avec attention. Quand on est entré & que j’ai senti ce petit morceau de papier entre mes mains, mon attention, ma curiosité tout est parti. Cependant il est resté une heure encore. J’étouffais. Enfin j’ai ouvert, j’ai lu, j’ai baisé. J’étouffe encore, mais de bonheur, de complète félicité. Je ne saurai imaginer, laissez moi vous montrer ce que je suis.
Ah mon Dieu il y a longtemps. que vous le voyez, et il y a quelque temps aussi que la poste le sait complètement mon bonheur me parait trop grand. J’en jouis avec trop de vivacité. Il me tue. Ainsi, je n’échappe pas. Je meure de chagrin, ou je meure de joie. Je suis une bien frêle créature. Comment tant d’âme, tant de passion dans un si faible corps !
Monsieur je vous quitte pour m’occuper de vous, pour lire, relire mille fois ces paroles, si douces, si chaudes, si pénétrantes. Vous me demandez pardon des inquiétudes que vous m’avez causées ? Ah vous voyez trop bien tout ce que ces tourments me valent aujourd’hui de jouissances. J’aime mess tourments, j’aime mes joies, car tout me vient de vous.
12. Val-Richer, Mercredi 26 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Et moi aussi je respire. Quel horrible cauchemar ! et si long ! Depuis deux jours je n’y tenais plus. Dearest, every day dearer Princess, vous avez cependant trouvé le secret de mêler à une peine déchirante une joie ineffable. Ah ne regrettez pas l’abandon de vos sentiments, de vos paroles : j’en ai reçu un bonheur incompréhensible pour moi même au milieu de mon angoisse, et pourtant si réel, si puissant ! Ma raison, ma justice me le reprochaient, mais sans le détruire. Encore une fois, il faut me le pardonner. Vous le savez ; à un seul sentiment l’égoïsme est permis ; mais il lui est bien permis, car c’est le seul où le cœur, la personne, l’être tout entier se donnent vraiment et sans réserve, et avec plein droit par conséquent de tout accepter, de tout attendre. Oui, j’ai plein droit d’être égoïste avec vous. Je ne crains pas de trop recevoir. Je ne compte pas, je ne mesure pas. Donnez, donnez-moi; je m’acquitterai. Mais ce que je vous demande aujourd’hui, ce que je vous conjure de m’envoyer par tous les courriers, c’est la certitude que votre santé n’est pas trop atteinte, que le repos du corps vous revient avec celui du cœur. Là est la préoccupation, la cruelle préoccupation qui me reste.
Déjà, quand j’étais près de vous, j’ai si souvent tremblé en vous voyant, si aisément et si profondément ébranlée en voyant à la moindre émotion un peu vive, même douce, vos nobles traits, toute votre personne près de tomber dans ce frémissement qui fait mal, même quand la joie le cause et dont on ne sait même bientôt plus, quand il vous envahit, s’il vient de la joie ou de la douleur ! Vous ne savez pas quelles inquiétudes vous m’avez déjà causées, quels regards de minutieuse et infatigable inquisition j’ai cent fois porté sur votre physionomie, sur votre maintien, sur votre démarche, pour y découvrir la moindre trace de la moindre altération de la moindre souffrance. Et que faire de telles craintes dans l’absence, quand on ne peut s’assurer à chaque instant, de leur erreur, de leurs limites du moins ?
Vous me connaîtrez un jour, Madame ; vous savez un jour quelles agitations, quelles faiblesses infinies se cachent dans mon cœur, quand une affection vraie le possède, et emploient, à leur triste service dès que l’occasion s’en présente, tout ce que je puis avoir d’imagination, d’esprit d’énergie. Épargnez moi des troubles intérieurs qui atteint le bonheur le plus grand et lassant le plus ferme courage. Veillez sur vous, soignez-vous ; rapportez moi ce teint reposé, ces bras que vous m’avez promis ? Vous aurez des lettres, vous en aurez souvent, exactement. Il est impossible que la cruelle épreuve, par laquelle nous avons passé l’un et l’autre se renouvelle. Je suis enclin à croire qu’elle n’a eu que des causes matérielles, des méprises d’adresse, des ignorances de notre part quant aux arrangements de la poste ; peut-être des combinaisons trop variées et trop savantes. Certainement nous y pourvoirons. Vérifiez, je vous prie, ce que je vous ai dit ce matin sur les numéros de mes lettres. Vous avez eu le N°4. Le N°5 était le petit billet non numéroté, écrit le Dimanche 9. Et quant au retard du N°6, j’en entrevois la raison dans la route particulière qu’il a suivie, si je ne me trompe. Vote prochaine lettre me dira j’espère, qu’il vous est arrivé. Votre N°11 n’était que le n°10. Il commence le mardi 18 à midi, et votre N°9 finissait le mardi au moment de l’arrivée du postman. Votre N°12 que j’ai reçu ce matin, n’est donc que le N°11. J’entre dans ce détail pour qu’il n’y ait point d’erreur entre nous.
Jeudi 10 heure
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’en espérais pas n’importe ; je suis désappointé. Quelle insatiable avidité que celle de notre âme ! Dès qu’elle entrevoit le bonheur elle s’y précipite, elle s’y attache ; elle le vous tout entier à tout moment. A demain mon âme. Je suis charmé de votre conversation avec le comte Orloff. Vous ferez ce que vous voulez. J’attends à présent. vos projets en raison des mouvements de M. de Lieven. Toujours attendre ! Je voudrais connaitre au moins tous les gens à qui vous parlez, de qui vous me parlez. Les noms qui m’arrivent par vous qui sont importants pour vous, et qui ne me représentent ni une figure, ni une voix, ni un caractère cela me déplaît. C’est du vague, de l’obscur, de l’étranger. Je n’en puis souffrir en ce qui vous touche. Ah, notre misère! Que de choses dont nous disons. Je ne puis les souffrir et qu’il faut souffrir pourtant, et que nous souffrons en effet.
2 heures
La proclamation du rois de Hanovre, fera du mal partout. Les conservateurs sont intéressés partout à la bonne conduite du pouvoir. Ceci est vraiment un acte de folie. Je serais bien fâché que les élections anglaises s’en ressentissent profondément. Quant à nous malgré les apparences je doute toujours que nous ayons des élections. Le mieux informé de mes amis m’écrit que jusqu’ici le Roi, qui en décidera seul, y a à peine songé, qu’on se traînera probablement jusqu’au mois de Novembre avec des velléités sans résultat, et qu’alors, quand le vent des Chambres commencera à souffler, s’il secoue un peu fort le roseau ministériel, le Roi préférera un remaniement du Cabinet à une dissolution.
Je ne pense guère à tout cela; d’abord, parce que je pense à autre chose, ensuite, parce que rien ne me déplaît tant que de penser à vide, et quand il n’y a rien à faire. La bavardage vain est la maladie de notre temps et de notre forme de gouvernement. L’esprit s’y hébète et la volonté s’y énerve. Vienne le moment d’agir ; je penserai alors. Jusque là, je veux jouir de ma liberté et n’appartenir qu’à moi-même, pour me donner à mon choix. Mais quand ce choix est fait on ne s’en dédit plus. C’est ce que dit Pompée à Sertorin dans les beaux vers, de Corneille. Je suis de l’avis de Pompée. Adieu dearest Princess. Pour la première fois depuis bien des jours, je vous ai écrit la cœur un peu à l’aise. Mais cette aise a encore besoin de confirmation. G.
Je ne sais ce qu’il y a de vrai dans les bruits de journaux sur l’état grave de M de Talleyrand. Je vais écrire à la duchesse de Dino. Vous pensez bien que je n’ai par remis votre lettre à Mad. de Meulan.)
Vendredi, 10 h. Je n’ai pas de lettre ce matin. J’en attendais pourtant. Jusqu’à ce que je sois pleinement rassuré sur votre santé, je n’aurai aucun repos.
16. Stafford House, Samedi 29 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 h. du matin
Je fus à la cour hier au soir. Je n’y trouvai pas beaucoup de monde mais une musique admirable. Tous les premiers sujets de l’opéra italien à Paris. Je n’ai pas entendu de musique depuis mes malheurs. Je suis un peu inquiète de l’effet qu’elle produira sur moi. Contre mon attente cet effet fut le plus doux possible. L’accord de ces belles voix me calma singulièrement. Il me sembla que ma fièvre se dissipait que mon âme retrouvait un peu d’équilibre. Il y a longtemps que je n’éprouvai une sensation plus délicieuse. D’onze heures à une heure du matin, je restai à écouter les douces mélodies. Les paroles, ces accents d’amour. Vous ne sauriez concevoir le bien que cela me fit. Croyez-vous que je jouissais seule ? Non Monsieur, j’ai toujours auprès de moi quelqu’un qui jouit avec moi. Mon imagination ne se sépare jamais de cette douce société elle est là, elle est partout où je me trouve, elle m’appartient comme ma main appartient à mon bras. Toujours, toujours auprès de moi, en moi. Hier elle ne m’a pas quitté d’un instant.
Quelques jolis sourires de la reine ont fait ma seule distraction. Elle est jolie la Reine, elle l’est positivement. L’air le plus enfantin, la physionomie la plus spirituelle, la plus douce, la plus ouverte. Elle est trop petite mais assise elle a la taille assez élevé pour que cela ne frappe pas. Ce épaules sont charmantes. Sa taille bien marquée par ce cordon de la jarretière. Son bras orné du motto. Elle porte des robes à traine. L’ensemble est très frappant et très digne. Je l’ai souvent regardée quoique je pensasse à tout autre chose, à d’autres yeux qu’aux siens ; elle ne les a pas noirs. J’étais séparée d’elle par sa mère qui n’acceptait pas avec beaucoup de bienveillance, les jolis sourires de sa fille, je les recueillais. Que cette cour est différente de celles que j’ai vues pendant 22 ans. Malgré la musique & les yeux noirs j’ai fait quelques réflexions bien sérieuses que faisiez-vous ? Il me semble que vous dormiez dans ce moment. N’entendez vous donc pas de la musique des accords divins, ne faisiez-vous pas d’agréables rêves ?
J’ai eu deux longs tête-à-tête hier matin d’abord avec lord Durham, puis avec Pozzo qui est remis d’un fort accès de goutte, positivement lord Durham a beaucoup d’esprit. Je vois aussi lord Melbourne. Il est rêveur, & rieur tout à la fois. C’est un bizarre mélange. La tournure la plus originale. Quand il est en bien intime causerie il se met bien près, à peu près sur vous tournant un peu le dos. Il est naïf au delà de tout dans ses aveux. Un si honnête homme que je ne conçois pas comment il reste ministre. Donnant très franchement raison à ses adversaires quand il trouve qu’ils ont raison. Je lui disais hier que dans l’opinion du duc de Wellington. Il (lord Melbourne) devait être fort aise d’être débarrassé de Roebuck et de lord Dudley Stuart au parlement. " Did he say so ? damn it, he is right." Et cela avec un accent de conviction & un geste impayable. Que vous seriez diverti & content de lui !
Il me semble Monsieur que vous penseriez comme moi sur tout le monde. Mais cependant que d’observations curieuses je recueillerais de votre part car enfin, moi je suis accoutumée à toutes ces manières, vous n’en avez pas l’habitude, et je suis sûr qu’elles vous frapperaient par des côtés qui n’attirant plus mon attention. J’ai oublié de répondre à un article de votre N°9. Je ne reverrai plus lord Aberdeen en Angleterre, cela était convenu même avant que je me décidasse à y abréger mon séjour. Nous nous écrivons, vous verrez ses lettres. Il viendra à Paris en décembre, & ce qui est curieux, c’est que la veille de l’explication que j’eus avec lui, il m’avait dit : " L’homme dont je suis le plus curieux à Paris est M. Guizot. Promettez-moi de me faire faire sa connaissance."
Mon départ reste toujours fixé à mardi. Je serai vraisemblablement à Boulogne, jeudi ou vendredi au plus tard, à moins que la lettre que j’espère y trouver ne me trace un autre itinéraire j’irai droit à Paris. Mais pas aussi vite que j’en suis venue. Il me faut beaucoup de repos & de soins. Ces 10 jours d’agitation, d’inquiétude m’ont fait un mal abominable dont je serai quelques temps à me remettre Je suis maigrie, je veux démaigrir.
Les élections sont décidément défavorables aux radicaux. Les plus violents sont éliminés partout. Les Whigs & les Tories modérés sont en faveur. Tout cela est bien, mais voyons à quoi se décidera le gouvernement à la réunion du parlement. Elle est fixée pour le mois de novembre. S’appuyera-t-il sur Peel & Wellington. Ils y sont préparés, & lui donneraient, disent-ils, un appui cordial. Voilà ce dont doute Lord melbourne et ce qu’au fond je ne puis pas trop affirmer. & le Dr. Bowring entre autres.
Dimanche 30 juillet. Midi.
J’aurais pu recevoir une lettre hier. Dimanche on ne reçoit rien d’Angleterre. Il faut en toutes choses vivre de la veille. Le pain du Samedi, la lettre de Samedi. Voci donc un triste jour. Hier ma matinée se passa comme elles se passent presque toutes. Des tête-à-tête avec les personnes qui m’en demandent. Estérhazy en a eu un très long, presque trois heures, mais il me semble aussi que rien n’a été oublié. Je crois que je vous l’ai nommé comme le successeur infaillible du prince Metternich. Il manque d’aplomb & de tenue, & il manque un peu de confiance en lui-même. Du reste il a de l’esprit & le jugement excellent. Jamais je n’ai une conversation sérieuse avec quelqu’un sans que votre nom ne s’y place. Et la plupart du temps il ne me reste rien à ajouter. Cependant je suis bien habile à prolonger le sujet, je m’écoute avec plaisir. Il me semble que je parle si bien. J’aurai à vous parler de cet entretien là ainsi que de celui que j’ai eu aujourd’hui avec lord Melbourne.
Il a voulu à la veille de mon départ un confortable talk et nous l’avons eu amplement. Deux bonnes heures sans interruption chaque minute a été bien employée et utilement. Il m’en reste une fort bonne impression. Je lui ai fait faire une lecture qui l’a vivement frappée. Il donne mille fois raison à l’auteur, il pense comme lui compléte ment ; c’est que lord Melbourne à l’esprit le plus droit que je connaisse, pas la moindre passion ou prévention et une bonne foi, une candeur adorable il manque de caractère & de volonté. Voilà son défaut, & celui-là vient plutôt de son indolence. He won’t take the trouble. Tel qu’il est cependant, c’est un vrai bonheur que ce soit l’homme appelé à former l’esprit de la reine aux affaires. La confiance qu’elle a en lui n’a pas de borne. Imaginez l’occupation curieuse, intéressante que celle de pénétrer dans le cœur d’une jeune reine de 18 ans et d’être son seul confident ! Il me semble que jamais position semblable ne s’est encore rencontrée.
10 heures du matin. Lundi 31.
Voici votre N°10. Je comprends tout ce que vous me dites. Vos inquiétudes, vos alarmes, je les comprends, je les sens si bien que c’est là ce qui me ramène en France. Il me semble qu’une fois à Boulogne je saurai respirer. Ici j’étouffe nous sommes trop loin l’un de l’autre. Cette mer entre nous me parait un gouffre où s’abîme mon bonheur, mes espérances. Tout va mal. Nos lettres, quelle misérable chose ! J’en reçois de plus fraîches de Pétersbourg je suis découragée, malheureusement malade. Je crois qu’une fois en France ma santé me reviendra. Je crois ! Quelle vanité dans ce que nous croyons ! Nous ne croyons jamais juste. Je crois à vous. Voilà où je ne me trompe pas, pour tout le reste je ne veux plus croire. Je retourne sur la terre où vous habitez j’y veux être avant qu’aucune lettre de Russie ou d’Allemagne puisse m’atteindre j’ai peur de tout. Tant que mon âme était livré à la douleur. Je ne connaissais pas la crainte, j’étais au dessus de toute vicissitude. Monsieur c’est que les malheurs élèvent l’âme. Le bonheur l’amollit. J’étais seule, abandonnée j’avais du courage, cela veut dire qu’aucune peine ne pouvait m’atteindre, & la mort m’eut fait plaisir. Aujourd’hui tout est changé, je ne veux pas mourir, je veux vivre, vivre en France auprès de vous, toujours, toujours, et j’ai peur, peur de tout. Ah mon Dieu, protégez moi, laissez moi vivre. Je lui demandais tout autre chose il y a deux mois six semaines seulement. Comment il n’y a que 6 semaines ? Quelle longue vie que ces 6 semaines !
Le N°11 entre dans ce moment. Merci merci de tout. Je suis malade, je suis faible il faut que je parte. Aurai-je la force d’arriver à Boulogne. Adieu. Adieu. Priez pour moi, pour vous.
13. Val-Richer, Samedi 29 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est mon tour d’attendre et de me désoler en attendant. Pas de lettre encore ce matin. Je m’étais levé en disposition si confiante, si douce ! Il y a deux mois, je n’éprouvais point de vicissitudes, pareilles. Je n’attendais rien. Avec quelle promptitude, avec qu’elle vivacité j’ai recommencé à vivre ! Car c’est là vraiment la vie. Nous nous connaissons à peine, Madame; nous nous sommes entrevus. Je sais bien qu’en un jour en une heure, nous en avons plus appris l’un sur l’autre que tant de gens n’en apprennent à passer leur vie ensemble. Tout ce que nous ne savons pas, tout ce que nous ne nous sommes pas dit, nous le pressentons ; et au moment où nous nous le dirons, il nous semblera que nous l’avions toujours su, que nous nous l’étions dit mille fois. Cependant il est étrange de se sentir si intimement uni à une personne qu’on a vue, qui vous a vu quinze jours.
Si ma vie extérieure, et ma vie intérieure étaient bien semblables, j’aurais moins ce sentiment là ; je pourrais me croire plus connu de vous. Mais, à la voir du dehors j’ai mené une vie toute d’action, toute vouée au public, qui a dû, qui doit paraître surtout ambitieuse, personnelle, presque sévère. Et en effet j’ai pris et je prends à ce qui m’a occupé aux études, aux Affaires, aux luttes politiques un grand, très grand intérêt. Je m’y suis adonné, je m’y adonne avec grand plaisir comme à un emploi naturel et satisfaisant de moi-même. J’y désire vivement l’éclat et le succès. Et les douloureuses épreuves que Dieu ma fait subir n’ont point changé en cela ma disposition, ni mon goût. Aux jours mêmes de l’épreuve je ne me suis point senti indifférent aux incidents de ma vie publique ; et tout en en portant le poids avec le plus pénible effort, j’y ai toujours trouvé une diversion puissante et librement acceptée. Et pourtant, j’ai le droit de le dire après ce que je dis là et pourtant là n’est point du tout, là n’a jamais été ma véritable vie ; de là je n’ai jamais reçu aucune émotion, aucune satisfaction qui atteignit jusqu’au fond de mon âme ; de là ne m’est jamais venu le sentiment du bonheur. Le bonheur, Madame, le bonheur qui pénètre partout, dans l’âme, qui la remplit et l’assouvit tout entière est quelque chose de bien étranger de bien supérieur à tout ce que la vie publique peut donner. Au delà bien au delà de tous les désirs d’ambition et de gloire, de tous les plaisirs de domination, de lutte, d’amour propre et succès, il y a un désir, il y a un plaisir qui a toujours été pour moi le premier, tellement le premier que j’aurais droit de le dire le seul ; le désir, le plaisir d’une affection infinie, parfaitement égale de cette affection qui unit et confond deux créatures de cœur, d’esprit, de volonté, de goût, qui permet à l’âme de se répandre dans une autre âme comme la lumière dans l’espace, sans obstacle, sans limite, et suscite dans l’une et l’autre toutes les émotions, tous les développements dont elles sont capables, pour leur ouvrir autant de sources de sympathie, et de joie.
Vous êtes-vous jamais figurée, Madame, vous qui sentez si vivement la musique, vous êtes-vous jamais figuré quel serait le ravissement de deux harpes bien harmonieuses & jouant toujours ensemble, si elles avaient la conscience d’elles-mêmes et de leurs accords ? Voilà le bonheur, voilà le seul sentiment, le seul état auquel je donne ce nom. Eh bien madame, j’ai cru entrevoir que vous aussi, vous étiez de même nature, que pour vous aussi, les préoccupations et les intérêts extérieurs, politiques, quelle qu’eût été leur part dans votre vie, ne suffisaient point à votre âme, que vous y trouviez un bel emploi de votre esprit si actif, si élevé, si fin ; mais que vous aviez en vous bien plus de richesses que vous n’en pouviez dépenser là, et des richesses, qui ne se dépensent point à cet emploi-là. En sorte que vous m’avez apparu comme une personne qui comprendrait et accueillerait en moi ce qui se montre et ce qui se cache, ce qui est pour le monde et ce qui est pour une seule personne au monde. Voilà par où Madame vous avez eu pour moi tant d’attrait ; voilà pourquoi d’instinct comme de choix, je me suis engagé si avant et si vite dans une relation si nouvelle. Je ne me suis point trompé, je ne me trompe point n’est-ce pas ? Ni vous non plus ? Nous sommes bien réellement tels que nous nous voyons ? J’en suis sûr, très sûr ; mais à chaque nouveau gage de certitude, à chaque fait, à chaque parole qui vous révèle de nouveau à moi telle que je vous sais à chaque pas de plus que je fais dans un si beau et si doux chemin, je suis ravi comme si je découvrais de nouveau mon trésor. Que vos lettres m’arrivent donc ; il ne m’en est pas venue une seule qui n’ait ajouté à ma foi, et à ma joie. Dimanche, 1 heure. La poste n’arrive pas. D’après les arrangements que j’ai pris elle doit être ici tous les jours, à 10 heures.
Décidément les champs, les bois, les lieux solitaires, tout cela ne vaut rien ; tout cela jette dans les relations une irrégularité, une incertitude que rien ne peut compenser. A Paris tout est ponctuel, assuré. A Paris j’aurais votre lettre depuis plus de trois heures. Car j’en aurai une aujourd’hui. J’y compte. Je vais demain mener ma mère et mes enfants aux bains de mer à Trouville. J’en reviendrai le surlendemain par Caen où l’on veut me donner un banquet. Il y aura encore là des dérangements, des retards.
Quel ennui ! Madame il ne faut par se séparer. Demain, je serai au bord de cette mer qui nous sépare. Mes regards, ma pensée, s’élanceront à l’horizon, vers l’autre bord. C’est là que vous êtes, là que je vous trouverais. Je ne puis m’accoutumer à l’impuissance, humaine, à ce perpétuel et vain effort de la volonté contre des obstacles qu’après tout, si elle voulait bien presque toujours elle pourrait surmonter. Mais les impossibilités morales, les convenances, les liens, les devoirs ! Madame, il me faut une lettre.
4 heures La voilà, et je n’en ai jamais reçu une qui valut celle-là. Vous revenez plutôt, bien plutôt ! Je me tais, je me tais. Mais c’est le N°14 qui vient de m’arriver. Je n’ai pas eu le n° 13. C’est ce qui m’explique le retard. Je l’aurai probablement demain. Je n’en veux perdre aucune. Je vois que vous avez eu mon N°6 car cette lettre-ci porte l’adresse que je vous y donnais.
Adieu adieu. Que l’air est doux et léger ! G.
17. Rochester, Mardi 1er août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
7 h. du soir.
J’ai quitté Londres à 4 heures. J’ai passé ma matinée en adieux, en pleurs. Une pluie battante m’a accompagnée jusqu’ici, & je m’y arrête par pitié pour mes yeux & un peu pour moi-même. Voici du repos. Au fond je n’en ai pas eu à Londres. J’ai été la proie de mes amis et je trouve véritablement que j’en ai trop. Le ménage Sutherland et tout ce qui y tient m’a paru bien ému de mon départ. Quand un Anglais a la larme à l’œil c’est bien quelque chose. J’ai fini ma journée hier avec lord Melbourne. Notre entretien de la veille lui était bien resté dans l’esprit & ne sera pas perdu. Il est venu dîner avec nous et resté jusqu’à minuit, couché littéralement couché à côté de moi alternativement du plus grand sérieux et de la plus grande bouffonnerie. Il vous faudrait bien du temps pour vous accoutumer à lui.
Comprenez-vous le sentiment de joie avec lequel je me suis placée dans cette voiture que j’aime tant ? Concevez-vous tout ce qu’il y a de passé & tout ce qu’il y a d’avenir dans ce sentiment ? Eh bien rien de plus simple que de croire qu’elle me mène vers ce qui est devenue ma vie, mon bonheur, car enfin c’est pour cela que j’abandonne tout mon voyage l’Angleterre et cependant je tremble, il me semble que ce bonheur Je ne l’attendrai pas, tant il me parait immense. Je ne sais ce que vous allez décider. Si vous voulez que j’aille à Dieppe j’y irai plus loin non, car on le saurait mais voudrez-vous venir à Dieppe ?
Je ne vous demande rien, il me parait que je serai très patiente, qu’une fois en France avec notre correspondance réglée je saurai attendre cependant ce qui me semble essentiel c’est de vous voir avant ma rencontre avec mon mari, celle-là aura lieu à la fin de septembre. Vous aviserez.
Douvres vendredi 4 août. Il n’y a pas eu moyen de vous dire un mot ces deux derniers jours, avant hier à Brodstairs, hier voyager de Brodstairs ici avec lady Cowper. Elle ne m’a pas quittée. & la voilà encore attendant que je me décide à partir ou à rester. La mer est mauvaise. Le vent est fort. J’ai peur du mal de mer. Je ne sais si j’aurai le courage de passer. Je n’ai pas eu de lettre ce matin. Il m’en vendra peut être une demain. C’est une étrange passion que j’ai pour ces lettres ! Je n’aime de mieux qu’elles que celui qui les écrit ; & quoique je m’en rapproche en partant, il y a quelque chose qui me retient encore dans le pays où se trouve sans doute une lettre. Elle sera arrivée à mon fils hier au soir tard, il ne peut me l’envoyer que par la poste de ce soir.
Boulogne, samedi 5. On m’a persuadée de m’embarquer hier. Le temps s’annonçait beau, on me le disait au mieux, quoique je visse bien des vilains montons blancs qui me rendent si malade. Sir Robert Adair qui passait aussi est venu me décider à peine à bord j’ai été saisie du mal plus fort que je ne l’ai jamais eu ; pendant quatre heures je suis restée alternativement évanouie et souffrante de cet horrible mal, dans les bras du seul homme à bord qui ne fut pas malade.
On m’a tenue sur le pont exposé à un vent très fort et un soleil ardent ; en conséquence de quoi j’ai un coup de soleil à la tête qui est une fort vilaine chose. C’est dans cet état que je suis arrivée à Boulogne on a de suite cherché un médecin, car pendant deux heures dans l’auberge déjà je n’avais pas recouvré la force de parler. Le médecin m’a fait mettre au lit. J’y suis restée douze heures.
Je suis mieux mais très faible. Imaginez comme j’ai dû l’être. On me dit en arrivant qu’il y a des lettres à la porte et je n’ai pas pu donner l’ordre de les chercher ! Enfin, enfin, j’ai pu trouver quelques lignes pour le réclamer. Il y en avait trois de Paris ; si mes correspondants avaient pu voir la classification que j’en ai faite il y en aurait eu un au moins bien blessé.
Monsieur quoique le mot ne vous aille pas je suis forcée de vous dire que vous êtes un étourdi. Il n’y a pas de N° à votre lettre. Cela me dérange & me déroute. J’ai sauté du N° 11 duplicata à cette petite lettre sans chiffre. Le véritable N°11 n’est pas encore entre mes mains ce qui fait que je n’ai pour toute nourriture depuis huit jours que deux mots un peu froids. Non, ils ne le sont pas. Je devine, je sens tout ce que vous ne dites pas, mais j’aime mieux croire à mes sens qu’à mon imagination. Je veux entendre voir, lire, enfin Monsieur, je suis affamée. J’ai relu vingt fois la lettre de Caen.
Ne venez pas me trouver à Paris encore. J’ai besoin de me remettre, & si je vous vois ce n’est pas le moyen. Laissez-moi me reposer, il me semble qu’en réglant bien notre correspondance je pourrai me calmer. Vous adresserez vos lettres à l’hôtel Bristol place Vendôme, c’est là que j’irai descendre car la rue Rivoli n’est pas tenable en été, il y fait trop chaud. Je n’y rentrerai qu’au 1er septembre.
Monsieur, je suis donc en France votre patrie ma... Ah mon Dieu quel mot j’allais tracer. Vous me l’avez dit un jour Monsieur vous aviez alors déjà la certitude que j’adopterais tout ce qui vous appartient. Vous avez vu le fond de mon cœur avant que je n’ai su y regarder moi-même. Vous voyez tout trop vite. Il ne me reste rien à vous apprendre. Et cependant que de choses à vous dire tout, tout ce qui traverse ma pensée !
Le duc de Saxe Meinengen est venu m’interrompre, il demeure dans l’appartement à côté du mien. C’est un très bel allemand, & bien lourd d’esprit. Je le connais d’Angleterre, il est près de la reine veuve. Il me conte ses chagrins en conséquence de la proclamation du Roi de Hanovre, qu’est-ce que cela me fait ? Je passerai ici toute la journée encore, demain si je suis mieux j’irai coucher à Abbeville.
Lundi à Beauvais. Vous voyez que je me ménage. J’en ai extrêmement besoin. Je trouverai des lettres à Paris, mais encore une fois n’y venez pas. Mandez moi quand, à quelle époque ce voyage vous conviendrait le mieux. Ecrivez-moi beaucoup, beaucoup. Vous saurez à peu près tous les jours comment je suis. En attendant ne vous inquiétez pas il n’y a rien de grave. C’est des mots abominablement dérangés. Apprenez-moi à être calme, & ma santé me reviendra. Adieu. Adieu. Il me semble que je respire plus librement en vous disant ce mot de Boulogne, il est bien tard cependant Adieu Monsieur, écrivez-moi.
16. Val-Richer, Samedi 5 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.
Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.
J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.
2 heures
Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !
On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.
18. Boulogne, Dimanche 6 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous écris un mot encore avant de partir. C’est pour vous supplier d’empêcher que mon arrivée à Paris se trouve dans les journaux sur lesquels vous exercerez de l’influence. Vous m’éviterez par là du désagrément. J’ai passé une mauvaise nuit. Je ne me sens pas bien. Je voudrais être à Paris, voir mon médecin. Je voudrais pouvoir vous écrire de Paris déjà, vous mander que je suis mieux, vous dire mille choses, mille pensées que j’ai dans le cœur, sur le cœur. Ma rencontre avec mon mari ! Vous ne sauriez croire comme elle me rend l’âme inquiète. Je n’ai cessé depuis deux ans et demi de le conjurer de venir. Je l’ai fait sous toutes les formes, en l’appuyant de toutes les raisons, en lui montrant le désir le plus tendre de me voir réunie à lui. et quand je le disais je le pensais, car je ne sais jamais dire que ce que je pense et aujourd’hui quel accueil vais-je lui faire ?
Voyez Monsieur voilà des réflexions qui me tiennent. Eh bien, elles ne m’étaient pas venues encore. Je ne songeais qu’à une chose. Je voulais toucher la terre où vous vivez. Tout disparaissait devant ce premier intérêt de ma vie. J’ai tout bravé pour y parvenir. J’y suis, et aujourd’hui ma situation vis-à-vis de M. de Lieven se présente à mon esprit dans toute son horreur. Oui Monsieur c’est le mot. Vous m’avez rendue meilleure. Et voilà pourquoi je me sens plus malheureuse. Comprenez-vous tout ce je vous dis là ? Ah oui vous savez tout vous devinez tout, tout ce qui se passe dans mon cœur. C’est ma joie ; ma gloire. Ah que de pensées qui m’étouffent. Je crois que vous avez raison. Il ne faut pas parler. Et cependant mon âme interroge la vôtre toujours, à tout instant. C’est un dialogue qui ne cesse jamais.
Ah mon Dieu comment peut-on vivre dans l’état où je suis ? Je tremble de la tête aux pieds j’ai des moments affreux, et cependant c’est si doux. Adieu. Adieu. Je vous écrirai de Paris au moment où j’y arriverai mais j’irai lentement. Aujourd’hui je coucherai à Abbeville. Que faites- vous dans ce moment 8 h 1/2 ? Je voudrais regarder, j’ai la vie si bonne si longue. Je ne comprends pas votre maison, mais vos bois il me semble que j’y suis que je touche votre bras. Ah Monsieur, adieu.