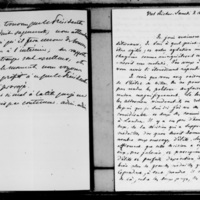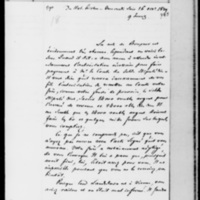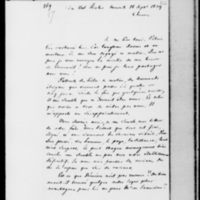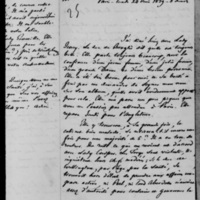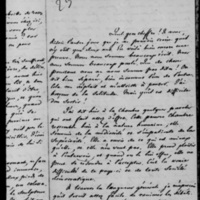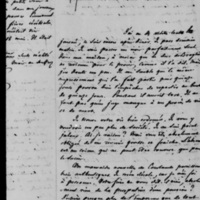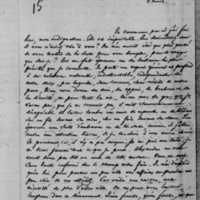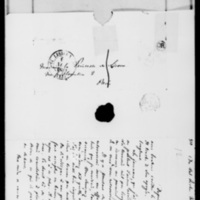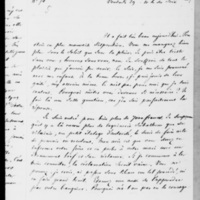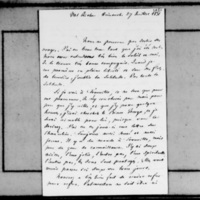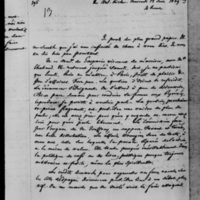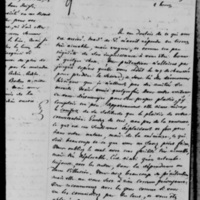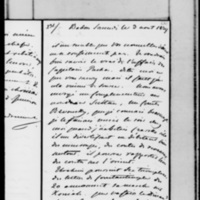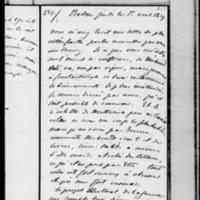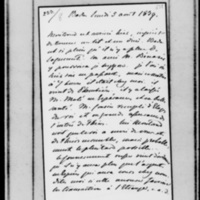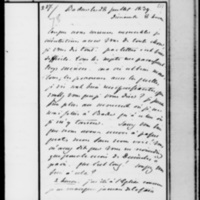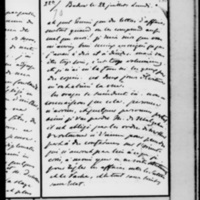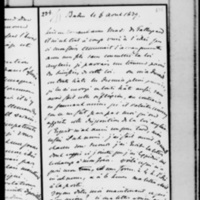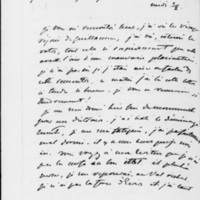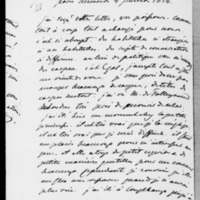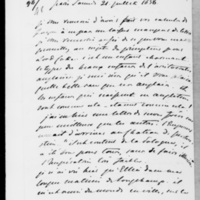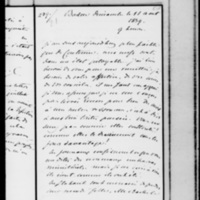Votre recherche dans le corpus : 91 résultats dans 3296 notices du site.
Trier par :
109. Val-Richer, Jeudi 23 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°109. Jeudi 23, 7 heures
Je voudrais bien voir vos instructions à Lady Clauricard. Est- ce que vous n’en gardez pas une copie ? Dites lui de vous en renvoyer une. C’est bien le moins qu’elle vous doive. Marie ne pourrait-elle pas en faire une ? Si j’étais là, je vous offrirais encore mon copiste, malgré sa bêtise. Soyez sûre qu’au besoin je vous parlerais de mes ennuis intérieurs aussi simplement que vous m’en parlez. Oui croyez hardiment que vous valez Lady Cowper pour moi. Mais malgré la tranquillité du moment je crains aussi toujours des ennuis pour vous-même. Vous m’avez fait connaitre des gens et des façons d’agir que je ne soupçonnais pas. Avec l’Empereur Nicolas et M. de Lieven, tout est possible. Aujourd’hui ne garantit point demain. Un grand géologue français, M. Elie de Beaumont vient de m’envoyer sont voyage à l’Etna. Je lisais cela hier soir. Il s’est promené je ne sais combien de temps, sur une croûte de terre assez mince, au dessous de laquelle sans rien voir, il entendait gronder et bouillonner des flammes, des eaux, des laves des pierres ; le sol pouvait à tout moment éclater sous ses pieds. Vos barbares sont ainsi faits. Il n’y a point de sûreté. Faites vos affaires vous-même. Assurez, ménagez vos moyens d’indépendance. J’y pense plus souvent que je ne vous le dis. Je suis plus tranquille sur l’Angleterre que sur vous. Non que tous les éléments d’explosion n’y soient. Entre la folie de M. Curran et celle de Lord Londonderry, il y en a plus qu’il n’en faut pour mettre le feu à un grand pays. Mais de l’un à l’autre de ces fous, la distance est longue, & remplie d’une foule de sages, très intelligents, et très résolus qui ne permettront pas aux deux petits bataillons de fous d’en venir aux mains. Voilà le résultat d’un bon et long gouvernement libre ; il n’empêche pas le mal ; il le provoque même et le développe ; mais il provoque, et crée un même temps une masse de bien, forte et compacte, qui pèse beaucoup plus dans la balance. Et puis, je vois dans tout cela bien des folies, et des colères simulées, celles de M. O’Connell et de Lord Lyndhurst par exemple. Si le péril devenait pressant, si les paroles entraînaient des actes, leur emportement radical et tory tomberait, je crois, bien vite.
Qu’est-ce que c’est donc que cette capture d’un Schooner anglais dans la mer noire ? Nous finirons par payer en Europe les frais de la rivalité anglaise et russe, en Asie. Car c’est de l’Asie au fond que la Russie, et l’Angleterre sont préoccupées. Du reste, je le veux bien. J’ai envie de voir rentrer l’Asie dans la circulation des événements. Il faut que l’Europe remue et régénère le monde entier. Ne seriez-vous pas curieuse de savoir où en seront les choses, dans 500 ans ? Je vois dans le Constitutionnel qu’il a été question d’un mariage entre le fils du Roi Ernest et une fille de l’Empereur Nicolas. Je n’y puis croire. Et puis le Constitutionnel ignore évidemment que le jeune duc de Cumberland est aveugle. Vous voyez que je lis bien mes journaux.
10 heures
Je n’ai point de nouvelles à vous envoyer. Mais en revanche, je ne vous en demande point. C’est vous que je veux, non pas vos nouvelles. Du reste dans la disette générale, vous glanez à merveille. Vous verrez Pahlen aujourd’hui. Il fournira à quelques heures. Mais vous serez obligée d’employer la méthode socratique. Il ne parle pas tout seul. Plus d’étourderie, je vous prie malgré mon prétendu contentement. J’aime mieux qu’elle soit de Pépin que de vous. Adieu. Tous ces revenants de Londres ont été bien vite usés, à ce qu’il me paraît. Vous avez raison. Pour vous, et malgré votre amour pour Londres, ils ne valent pas plus que cela. Adieu. G.
Je voudrais bien voir vos instructions à Lady Clauricard. Est- ce que vous n’en gardez pas une copie ? Dites lui de vous en renvoyer une. C’est bien le moins qu’elle vous doive. Marie ne pourrait-elle pas en faire une ? Si j’étais là, je vous offrirais encore mon copiste, malgré sa bêtise. Soyez sûre qu’au besoin je vous parlerais de mes ennuis intérieurs aussi simplement que vous m’en parlez. Oui croyez hardiment que vous valez Lady Cowper pour moi. Mais malgré la tranquillité du moment je crains aussi toujours des ennuis pour vous-même. Vous m’avez fait connaitre des gens et des façons d’agir que je ne soupçonnais pas. Avec l’Empereur Nicolas et M. de Lieven, tout est possible. Aujourd’hui ne garantit point demain. Un grand géologue français, M. Elie de Beaumont vient de m’envoyer sont voyage à l’Etna. Je lisais cela hier soir. Il s’est promené je ne sais combien de temps, sur une croûte de terre assez mince, au dessous de laquelle sans rien voir, il entendait gronder et bouillonner des flammes, des eaux, des laves des pierres ; le sol pouvait à tout moment éclater sous ses pieds. Vos barbares sont ainsi faits. Il n’y a point de sûreté. Faites vos affaires vous-même. Assurez, ménagez vos moyens d’indépendance. J’y pense plus souvent que je ne vous le dis. Je suis plus tranquille sur l’Angleterre que sur vous. Non que tous les éléments d’explosion n’y soient. Entre la folie de M. Curran et celle de Lord Londonderry, il y en a plus qu’il n’en faut pour mettre le feu à un grand pays. Mais de l’un à l’autre de ces fous, la distance est longue, & remplie d’une foule de sages, très intelligents, et très résolus qui ne permettront pas aux deux petits bataillons de fous d’en venir aux mains. Voilà le résultat d’un bon et long gouvernement libre ; il n’empêche pas le mal ; il le provoque même et le développe ; mais il provoque, et crée un même temps une masse de bien, forte et compacte, qui pèse beaucoup plus dans la balance. Et puis, je vois dans tout cela bien des folies, et des colères simulées, celles de M. O’Connell et de Lord Lyndhurst par exemple. Si le péril devenait pressant, si les paroles entraînaient des actes, leur emportement radical et tory tomberait, je crois, bien vite.
Qu’est-ce que c’est donc que cette capture d’un Schooner anglais dans la mer noire ? Nous finirons par payer en Europe les frais de la rivalité anglaise et russe, en Asie. Car c’est de l’Asie au fond que la Russie, et l’Angleterre sont préoccupées. Du reste, je le veux bien. J’ai envie de voir rentrer l’Asie dans la circulation des événements. Il faut que l’Europe remue et régénère le monde entier. Ne seriez-vous pas curieuse de savoir où en seront les choses, dans 500 ans ? Je vois dans le Constitutionnel qu’il a été question d’un mariage entre le fils du Roi Ernest et une fille de l’Empereur Nicolas. Je n’y puis croire. Et puis le Constitutionnel ignore évidemment que le jeune duc de Cumberland est aveugle. Vous voyez que je lis bien mes journaux.
10 heures
Je n’ai point de nouvelles à vous envoyer. Mais en revanche, je ne vous en demande point. C’est vous que je veux, non pas vos nouvelles. Du reste dans la disette générale, vous glanez à merveille. Vous verrez Pahlen aujourd’hui. Il fournira à quelques heures. Mais vous serez obligée d’employer la méthode socratique. Il ne parle pas tout seul. Plus d’étourderie, je vous prie malgré mon prétendu contentement. J’aime mieux qu’elle soit de Pépin que de vous. Adieu. Tous ces revenants de Londres ont été bien vite usés, à ce qu’il me paraît. Vous avez raison. Pour vous, et malgré votre amour pour Londres, ils ne valent pas plus que cela. Adieu. G.
309. Val-Richer, Mardi 5 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
309 Du Val-Richer, Mardi 5 Novembre 1839
7 heures et demie
Il y avait avant-hier du cream cheese à déjeuner, et il y a ce matin sur ma vallée un brouillard, tout-à-fait pareil. On dit que la Normandie ressemble beaucoup à l'Angleterre. Elles se tenaient évidemment avant le déluge, et il y a entre elles, depuis le déluge, des rapports continuels. Si jamais vous avez mangé à Londres de belles poires et de belles pommes elles venaient peut-être du Val-Richer. Les fermiers Normands les expédient par milliers, et il part toutes les semaines, du port de Honfleur vingt mille œufs pour l'Angleterre. J’entends shabby comme vous, et c’est parce que je l’entends que je m'en défends. Je ne vous vole jamais rien, car je vous donne tout ce dont je dispose. Voilà nos questions de Dictionnaire vidées.
Plus j’y pense, plus je me persuade que Benkhausen n’a pas d’inconvénient. Tout sera fini plus vite. Je n’espère toujours rien quant au mobilier de Courlande. Mais au moins la suppression ne passera pas inaperçue. Je suppose que vous avez envoyé à Cumming copie des questions que vous airez adressées à votre fière.
Que voulait faire. M. de Metternich de la mission de M. de Brünnow ? Terminer l'affaire d'Orient sans s'en mêler, ou nous brouiller avec l’Angleterre sans y paraître ? L’un et l'autre a échoué. Je vois, par ce qu’on m'écrit, qu'on a peu d'inquiétude, et qu’on laissera traîner dans l’idée que le temps est au profit du Pacha, qui possède. On a bien fait de renvoyer M. de Labrador, s'il s’agitait encore pour D. Carlos. Nous ne devons aux partisans de D. Carlos que la stricte légalité et à D. Carlos lui-même qu'une politique raisonnable dans sa froideur. L’Europe a envoyé un aigle qui s’appelait Napoléon et qui la troublait, mourir à Ste Hélène. Nous ferons vivre quelques mois à Bourges D. Carlos qui nous tracasse. Il y a eu tout juste proposition.
J’ai aussi mes tribulations d’intérieur. Mon concierge d'ici est malade. Je craignais hier une fluxion de poitrine. On me dit qu'il est mieux ce matin. C’est un factotum très intelligent et qui met sa fierté à être à mon service, ce qui fait que je lui passe des défauts.
10 heures
Je craignais ce qui est arrivé. La poste n’étant venue chez moi que très tard, m'en est répartie que très tard, et n'aura pas été à Lisieux à temps. Vous aurez eu deux lettres ce matin. Mauvaise compensation. Tout cela cessera dans huit jours. Les tristes chances de la vie seront les mêmes ; mais nous serons ensemble. J'espère que vous me direz bientôt que vous avez des nouvelles d'Alexandre Adieu. Adieu. J’aime mieux le Duc que Benkhausen Dix mille francs, c’est beaucoup pour une commission. Adieu. G.
7 heures et demie
Il y avait avant-hier du cream cheese à déjeuner, et il y a ce matin sur ma vallée un brouillard, tout-à-fait pareil. On dit que la Normandie ressemble beaucoup à l'Angleterre. Elles se tenaient évidemment avant le déluge, et il y a entre elles, depuis le déluge, des rapports continuels. Si jamais vous avez mangé à Londres de belles poires et de belles pommes elles venaient peut-être du Val-Richer. Les fermiers Normands les expédient par milliers, et il part toutes les semaines, du port de Honfleur vingt mille œufs pour l'Angleterre. J’entends shabby comme vous, et c’est parce que je l’entends que je m'en défends. Je ne vous vole jamais rien, car je vous donne tout ce dont je dispose. Voilà nos questions de Dictionnaire vidées.
Plus j’y pense, plus je me persuade que Benkhausen n’a pas d’inconvénient. Tout sera fini plus vite. Je n’espère toujours rien quant au mobilier de Courlande. Mais au moins la suppression ne passera pas inaperçue. Je suppose que vous avez envoyé à Cumming copie des questions que vous airez adressées à votre fière.
Que voulait faire. M. de Metternich de la mission de M. de Brünnow ? Terminer l'affaire d'Orient sans s'en mêler, ou nous brouiller avec l’Angleterre sans y paraître ? L’un et l'autre a échoué. Je vois, par ce qu’on m'écrit, qu'on a peu d'inquiétude, et qu’on laissera traîner dans l’idée que le temps est au profit du Pacha, qui possède. On a bien fait de renvoyer M. de Labrador, s'il s’agitait encore pour D. Carlos. Nous ne devons aux partisans de D. Carlos que la stricte légalité et à D. Carlos lui-même qu'une politique raisonnable dans sa froideur. L’Europe a envoyé un aigle qui s’appelait Napoléon et qui la troublait, mourir à Ste Hélène. Nous ferons vivre quelques mois à Bourges D. Carlos qui nous tracasse. Il y a eu tout juste proposition.
J’ai aussi mes tribulations d’intérieur. Mon concierge d'ici est malade. Je craignais hier une fluxion de poitrine. On me dit qu'il est mieux ce matin. C’est un factotum très intelligent et qui met sa fierté à être à mon service, ce qui fait que je lui passe des défauts.
10 heures
Je craignais ce qui est arrivé. La poste n’étant venue chez moi que très tard, m'en est répartie que très tard, et n'aura pas été à Lisieux à temps. Vous aurez eu deux lettres ce matin. Mauvaise compensation. Tout cela cessera dans huit jours. Les tristes chances de la vie seront les mêmes ; mais nous serons ensemble. J'espère que vous me direz bientôt que vous avez des nouvelles d'Alexandre Adieu. Adieu. J’aime mieux le Duc que Benkhausen Dix mille francs, c’est beaucoup pour une commission. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 2 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 2 août 1851
Je jouis vraiment de votre délivrance. Je sais à quel point vous avez dû être agitée ; et votre agitation m'inquiète et me chagrine comme m'inquiéterait et me chagrinerait une maladie. J'en veux à Couth de vous avoir si étourdiment répondu.
Je crois que vous avez raison sur les fêtes de l’hôtel de ville. On ne pouvait guère ne pas rendre les politesses anglaises et on les rendra magnifiquement. Le Lord maire et les Aldermen viendront-ils en robes et en perruques ? Depuis que je suis ici, j'ai vu des industriels considérables et deux des commissaires Français à Londres. Il y a un peu d'humeur, parmi eux, de la décision qui a supprimé, les grandes médailles d’or qu’on devait donner, en petit nombre aux ouvrages d'élite. Les Français affirment que cette décision a été prise contre eux, par jalousie, et parce qu'en fait d'ouvrages d’élite et parfaits d'exécution ils auraient eu bien plus de grandes médailles que les Anglais cependant, à tout prendre, il restera plutôt de là, entre les deux pays, des impressions bienveillantes et de bonnes relations. Je ne sais si le gouvernement Anglais a fait de la bonne politique intérieure ; mais il a certainement fait de la bonne politique étrangère. On a vu sa puissance, et on lui sait gré de cette façon de la montrer.
Mad. de Ste Aulaire m'écrit que ses visiteurs du Dimanche (à Etiolles) sont très découragés et décourageants. Le Duc de Broglie, Viel Castel & Broglie, ne m’écrit guères ; il est vrai que je ne lui ai pas écrit du tout. Mais il a chargé ma fille de me dire qu’on ne faisait et qu’on ne préparait que des bêtises. L'impression générale est triste et morne, plus que sombre et agitée. Je ne vois pas dans le pays que j'habite, grande ardeur à recommencer, le pétitionnement pour la révision. Il est vrai que déjà ce département-ci a peu pétitionné.
Voilà un fauteuil vacant à l'Académie française. Je ne vois pas à qui nous le donnerons. Il sera très vivement et très petitement disputé. Je perds, dans M. Dupaty un ami très dévoué, très actif, et assez influent dans la sphère académique comme parfaitement étranger à l'arène politique. Galant homme d'ailleurs, d'un esprit aussi sensé dans la vie que léger dans la littérature, et d’un cœur très steady. On est très ému ..., à Alexandrie, du chemin de fer que le Pacha d’Egypte vient enfin de concéder aux Anglais. Je reçois de là une lettre, non signée mais dont je reconnais l'auteur, riche négociant Français établi depuis longtemps en Egypte. " C'est le 12 de ce mois que les signatures ont été échangées. C'est donc à partir de ce moment qu'Abba-Pacha est officiellement le gouverneur du pays pour le compte de l'Angleterre. Ainsi, à moins que l’Europe ne s'y oppose, MM les Anglais vont disposer librement de 90 mille hommes, de 80 à 100 millions, des mines de charbon nouvellement découvertes, des produits inépuisables de la vallée du Nil, de l’Abyssinie & Et cela entre Malte et Aden, au point le plus stratégique du Globe commercialement et militairement parlant ; au point par conséquent le plus favorable pour prélever une dîme sur tous les produits agricoles et industriels du globe & & Et il m'invoque comme si j’y pouvais quelque chose. C'est certainement un grand pas vers la possession du Nord-Est de l'Afrique et de la clef européenne de l'Orient.
Onze heures Vous voilà parfaitement calme. Cela me plaît beaucoup. Adieu, adieu, adieu. G.
Je jouis vraiment de votre délivrance. Je sais à quel point vous avez dû être agitée ; et votre agitation m'inquiète et me chagrine comme m'inquiéterait et me chagrinerait une maladie. J'en veux à Couth de vous avoir si étourdiment répondu.
Je crois que vous avez raison sur les fêtes de l’hôtel de ville. On ne pouvait guère ne pas rendre les politesses anglaises et on les rendra magnifiquement. Le Lord maire et les Aldermen viendront-ils en robes et en perruques ? Depuis que je suis ici, j'ai vu des industriels considérables et deux des commissaires Français à Londres. Il y a un peu d'humeur, parmi eux, de la décision qui a supprimé, les grandes médailles d’or qu’on devait donner, en petit nombre aux ouvrages d'élite. Les Français affirment que cette décision a été prise contre eux, par jalousie, et parce qu'en fait d'ouvrages d’élite et parfaits d'exécution ils auraient eu bien plus de grandes médailles que les Anglais cependant, à tout prendre, il restera plutôt de là, entre les deux pays, des impressions bienveillantes et de bonnes relations. Je ne sais si le gouvernement Anglais a fait de la bonne politique intérieure ; mais il a certainement fait de la bonne politique étrangère. On a vu sa puissance, et on lui sait gré de cette façon de la montrer.
Mad. de Ste Aulaire m'écrit que ses visiteurs du Dimanche (à Etiolles) sont très découragés et décourageants. Le Duc de Broglie, Viel Castel & Broglie, ne m’écrit guères ; il est vrai que je ne lui ai pas écrit du tout. Mais il a chargé ma fille de me dire qu’on ne faisait et qu’on ne préparait que des bêtises. L'impression générale est triste et morne, plus que sombre et agitée. Je ne vois pas dans le pays que j'habite, grande ardeur à recommencer, le pétitionnement pour la révision. Il est vrai que déjà ce département-ci a peu pétitionné.
Voilà un fauteuil vacant à l'Académie française. Je ne vois pas à qui nous le donnerons. Il sera très vivement et très petitement disputé. Je perds, dans M. Dupaty un ami très dévoué, très actif, et assez influent dans la sphère académique comme parfaitement étranger à l'arène politique. Galant homme d'ailleurs, d'un esprit aussi sensé dans la vie que léger dans la littérature, et d’un cœur très steady. On est très ému ..., à Alexandrie, du chemin de fer que le Pacha d’Egypte vient enfin de concéder aux Anglais. Je reçois de là une lettre, non signée mais dont je reconnais l'auteur, riche négociant Français établi depuis longtemps en Egypte. " C'est le 12 de ce mois que les signatures ont été échangées. C'est donc à partir de ce moment qu'Abba-Pacha est officiellement le gouverneur du pays pour le compte de l'Angleterre. Ainsi, à moins que l’Europe ne s'y oppose, MM les Anglais vont disposer librement de 90 mille hommes, de 80 à 100 millions, des mines de charbon nouvellement découvertes, des produits inépuisables de la vallée du Nil, de l’Abyssinie & Et cela entre Malte et Aden, au point le plus stratégique du Globe commercialement et militairement parlant ; au point par conséquent le plus favorable pour prélever une dîme sur tous les produits agricoles et industriels du globe & & Et il m'invoque comme si j’y pouvais quelque chose. C'est certainement un grand pas vers la possession du Nord-Est de l'Afrique et de la clef européenne de l'Orient.
Onze heures Vous voilà parfaitement calme. Cela me plaît beaucoup. Adieu, adieu, adieu. G.
Paris, Samedi 5 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Voici cette note des questions à adresser et des actes à demander. Elle s'accorde s'il m’en souvient bien avec ce que vous avez demandé, à Bruxner. Adieu.
Ce n'est donc plus à la Terrasse que nous nous reverrons. Je lui ai dit hier soir en passant le seuil de la porte, un adieu bien tendre. Mais tout lieu où vous serez où nous serons aura bientôt ce droit là, sur moi. Adieu. Adieu.
G.
Paris.
Samedi 7 heures
Ce n'est donc plus à la Terrasse que nous nous reverrons. Je lui ai dit hier soir en passant le seuil de la porte, un adieu bien tendre. Mais tout lieu où vous serez où nous serons aura bientôt ce droit là, sur moi. Adieu. Adieu.
G.
Paris.
Samedi 7 heures
290. Val-Richer, Mercredi 16 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
290 Du Val-Richer, Mercredi soir 16 oct 1839 9 heures
La note de Bruxner est évidemment très obscure. Cependant en voici le sens. Quand il dit : " Nous avons à attendre incessamment l’autorisation nécessaire pour faire payement à M. le Comte du solde stipulé &. " Il veut dire qu’il recevra incessamment de vos fils, l'autorisation de remettre au comte votre frère, comme votre fondé de pouvoirs, le solde stipulé dut, savoir 14 000 roubles argent pour l’année de revenu et 24 000 roubles & &. Il me semble que ces 14 000 roubles argent doivent faire, les 60 et quelques mille francs sur lesquels vous comptiez. Ce que je ne comprends pas, c’est que vous n’ayez pas encore reçu l'acte signé qu’il vous annonce. Votre frère a certainement négligé de vous l'envoyer. Il lui a paru que puisqu'il avait fini, lui, c'était assez pour vous. Il est impossible pourtant que vous ne le receviez pas bientôt.
Puisque, lord Landsdown est à Vienne, vous aviez raison et on était mal informé. Il faudra bien que cela aussi s'éclaircisse comme vos affaires. Je ne m'inquiète pas beaucoup des vicissitudes qu’on traversera. Je crois toujours qu'elles aboutiront au même dénouement. On me mande que Thiers a dû arriver à Paris hier au soir rappelé avec tous les siens par une maladie grave de la mère de Mad. Dodne.
Jeudi 7 heures et demie
L’arrestation de Blanqui, le second ou plutôt le premier de Barbès, fait-elle quelque effet ? Ce sera un grand ennui, et un assez gros embarras pour la Chambre des Pairs. Comment jugera-t-elle autrement qu’elle n'a fait Barbés et comment jugera-t-elle de même. Je suis sûr que le Chancelier en est très préoccupé. On use bien vite les bons instruments dans ce pays-ci. Comme cour de justice, la Chambre des Pairs a fait des miracles depuis 1830. On l’en a dégoûtée. Elle n'en voudra plus faire. Le procès de Blanqui ne sera pas le seul.
Vous n’avez peut-être pas remarqué dans les journaux que Guinard l’un des principaux chefs du procès d'avril est revenu d'Angleterre et s'est constitué prisonnier pour se faire juger. Son père est mort et lui a laissé 40 ou 30 mille livres de rente. On lui a offert sa grâce. Il l'a refusée. Il veut être jugé. Tout cela ne ranimera pas les procès, ni juges, ni accusés. Mais cela fera des embarras, et des embarras ridicules. Du reste le ridicule est mort, comme tant d'autres choses. On ne se moque plus de rien, ni de personne.
9 heures et demie
Je me trompe. Le ridicule n’est pas mort. Ma bonté pour vous le ressuscite. Mais je vous le pardonne. Vous l’avez vu la première. Je rétablis les faits. On n’avait pas, autant qu’il m'en souvient, de nouvelles de Vienne. Mais on avait, de Berlin, une grande approbation, & l’opinion, positivement exprimée, qu’il en serait de même à Vienne. Du reste, vous avez raison, il y a bien du trouble dans les sources les plus pures.
Adieu. Je suis charmé de vous savoir installée, même mal. On est trop heureux quand le bien vient au bout du mal. Le contraire arrive si souvent. Adieu. Adieu. G.
La note de Bruxner est évidemment très obscure. Cependant en voici le sens. Quand il dit : " Nous avons à attendre incessamment l’autorisation nécessaire pour faire payement à M. le Comte du solde stipulé &. " Il veut dire qu’il recevra incessamment de vos fils, l'autorisation de remettre au comte votre frère, comme votre fondé de pouvoirs, le solde stipulé dut, savoir 14 000 roubles argent pour l’année de revenu et 24 000 roubles & &. Il me semble que ces 14 000 roubles argent doivent faire, les 60 et quelques mille francs sur lesquels vous comptiez. Ce que je ne comprends pas, c’est que vous n’ayez pas encore reçu l'acte signé qu’il vous annonce. Votre frère a certainement négligé de vous l'envoyer. Il lui a paru que puisqu'il avait fini, lui, c'était assez pour vous. Il est impossible pourtant que vous ne le receviez pas bientôt.
Puisque, lord Landsdown est à Vienne, vous aviez raison et on était mal informé. Il faudra bien que cela aussi s'éclaircisse comme vos affaires. Je ne m'inquiète pas beaucoup des vicissitudes qu’on traversera. Je crois toujours qu'elles aboutiront au même dénouement. On me mande que Thiers a dû arriver à Paris hier au soir rappelé avec tous les siens par une maladie grave de la mère de Mad. Dodne.
Jeudi 7 heures et demie
L’arrestation de Blanqui, le second ou plutôt le premier de Barbès, fait-elle quelque effet ? Ce sera un grand ennui, et un assez gros embarras pour la Chambre des Pairs. Comment jugera-t-elle autrement qu’elle n'a fait Barbés et comment jugera-t-elle de même. Je suis sûr que le Chancelier en est très préoccupé. On use bien vite les bons instruments dans ce pays-ci. Comme cour de justice, la Chambre des Pairs a fait des miracles depuis 1830. On l’en a dégoûtée. Elle n'en voudra plus faire. Le procès de Blanqui ne sera pas le seul.
Vous n’avez peut-être pas remarqué dans les journaux que Guinard l’un des principaux chefs du procès d'avril est revenu d'Angleterre et s'est constitué prisonnier pour se faire juger. Son père est mort et lui a laissé 40 ou 30 mille livres de rente. On lui a offert sa grâce. Il l'a refusée. Il veut être jugé. Tout cela ne ranimera pas les procès, ni juges, ni accusés. Mais cela fera des embarras, et des embarras ridicules. Du reste le ridicule est mort, comme tant d'autres choses. On ne se moque plus de rien, ni de personne.
9 heures et demie
Je me trompe. Le ridicule n’est pas mort. Ma bonté pour vous le ressuscite. Mais je vous le pardonne. Vous l’avez vu la première. Je rétablis les faits. On n’avait pas, autant qu’il m'en souvient, de nouvelles de Vienne. Mais on avait, de Berlin, une grande approbation, & l’opinion, positivement exprimée, qu’il en serait de même à Vienne. Du reste, vous avez raison, il y a bien du trouble dans les sources les plus pures.
Adieu. Je suis charmé de vous savoir installée, même mal. On est trop heureux quand le bien vient au bout du mal. Le contraire arrive si souvent. Adieu. Adieu. G.
269. Val-Richer, Mercredi 18 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
269 Du Val Richer, Mercredi 18 sept 1839 8 heures
Je me lève tard. J’étais très enrhumé hier. J'ai longtemps dormi et en moiteur. Je me sens dégagé ce matin. Que ne puis-je vous envoyer la moitié de mes heures de sommeil ! Que ne puis-je tout partager avec vous ! J’attends des hôtes ce matin des Normands éloignés qui viennent passer ici quatre ou cinq jours. Toutes les fois que quelqu'un arrive, il me semble que ce devrait être vous. Et celui qui arrive a tort de n'être pas vous. Il m’apporte un désappointement. Vous devriez avoir ce me semble une lettre de votre frère, vous disant que tout est fini, signé et vous donnant les derniers détails. J’en suis pressé. Les hommes, le pays, la distance ; tout m'est suspect. Et puis chaque arrangement bien conclu me semble un pas, vers votre établissement définitif. Je vous vois pousser des racines. On ne se repose que sur des racines. Est-ce que Démion n'est pas revenu ? Ou bien aurait-il trouvé quelque autre loyer plus avantageux pour lui ou pour M. de Jennisson ? Ou bien aurait-il pris votre lettre à Rothschild pour un refus péremptoire de donner plus de dix mille francs ?
9 h. 1/2
Je veux que vous m’écriviez dans quelque état que soient votre cœur, et vos nerfs et tout ce qu’il y a en vous. Je ne puis pas me passer un jour de vous triste ou gaie, juste ou injuste malade ou bien portante. Vous ne m'aimez pas plus que je ne vous aime, ni autrement que je ne vous aime. Vous le savez bien vous le voyez bien. Vous l’avez vu mille fois. Vous le verrez mille fois encore. Et vous ne verrez pas tout, jamais tout. Je ne vous ai jamais vue, je ne vous ai jamais quittée sans vous aimer davantage. Votre cœur, votre esprit, votre caractère, votre grandeur et vos malheurs, vos souvenirs beaux ou cruels, votre air, vos regards, votre voix, vos paroles, vous vous tout entière je vous aime, j'aime tout ; tout m'est cher et nécessaire, et me plaît et m'occupe, ici comme à la Terrasse. Ne parlez pas, ne parlez pas de votre folie. Ne parlons pas de notre folie. Mais gardez-moi la vôtre. C'est mon bonheur. Adieu adieu. Voilà mes hôtes qui m’arrivent. Adieu. G.
Je me lève tard. J’étais très enrhumé hier. J'ai longtemps dormi et en moiteur. Je me sens dégagé ce matin. Que ne puis-je vous envoyer la moitié de mes heures de sommeil ! Que ne puis-je tout partager avec vous ! J’attends des hôtes ce matin des Normands éloignés qui viennent passer ici quatre ou cinq jours. Toutes les fois que quelqu'un arrive, il me semble que ce devrait être vous. Et celui qui arrive a tort de n'être pas vous. Il m’apporte un désappointement. Vous devriez avoir ce me semble une lettre de votre frère, vous disant que tout est fini, signé et vous donnant les derniers détails. J’en suis pressé. Les hommes, le pays, la distance ; tout m'est suspect. Et puis chaque arrangement bien conclu me semble un pas, vers votre établissement définitif. Je vous vois pousser des racines. On ne se repose que sur des racines. Est-ce que Démion n'est pas revenu ? Ou bien aurait-il trouvé quelque autre loyer plus avantageux pour lui ou pour M. de Jennisson ? Ou bien aurait-il pris votre lettre à Rothschild pour un refus péremptoire de donner plus de dix mille francs ?
9 h. 1/2
Je veux que vous m’écriviez dans quelque état que soient votre cœur, et vos nerfs et tout ce qu’il y a en vous. Je ne puis pas me passer un jour de vous triste ou gaie, juste ou injuste malade ou bien portante. Vous ne m'aimez pas plus que je ne vous aime, ni autrement que je ne vous aime. Vous le savez bien vous le voyez bien. Vous l’avez vu mille fois. Vous le verrez mille fois encore. Et vous ne verrez pas tout, jamais tout. Je ne vous ai jamais vue, je ne vous ai jamais quittée sans vous aimer davantage. Votre cœur, votre esprit, votre caractère, votre grandeur et vos malheurs, vos souvenirs beaux ou cruels, votre air, vos regards, votre voix, vos paroles, vous vous tout entière je vous aime, j'aime tout ; tout m'est cher et nécessaire, et me plaît et m'occupe, ici comme à la Terrasse. Ne parlez pas, ne parlez pas de votre folie. Ne parlons pas de notre folie. Mais gardez-moi la vôtre. C'est mon bonheur. Adieu adieu. Voilà mes hôtes qui m’arrivent. Adieu. G.
293. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
293 Du Val-Richer, dimanche 20 oct. 1839
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins, tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui. Adieu. Adieu. G.
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins, tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui. Adieu. Adieu. G.
294. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
294 Du Val-Richer, dimanche soir 20 oct. 1839
9 heures
J’ai eu du monde sans relâche toute la matinée. Parce que je refuse tous les dîners, on se croit obligé de venir me voir deux fois, davantage. J’aimerais mieux discuter avec vos ouvriers. Je ne tousse plus du tout. J’y aurais regret si je n’arrangeais pas déjà mon retour à peu près pour l'époque que je vous ai dite. Il continue pourtant de faire beau.
Vous trouverai-je tout-à-fait arrangée ? Ne vous ruinez pas. Je crains vos goûts de perfection bien naturels et de bien bon goût, Limitez-vous pourtant dans votre perfection. L’appartement est déjà cher pour vous. N'aggravez pas trop le mal. Pippin, vous a-t-il quittée ? Comment Felix prend-il son petit changement de condition. Avez-vous eu le courage de l’en informer ? Je doute que vous eussiez été un bon ministre d’un gouvernement représentatif. Dire oui n’est que la moitié du talent. Non est l’autre moitié. Celle-ci vous eût manqué. Vous ne savez que plaire.
Don Carlos me paraît pressé d'avoir ses passeports. Et le Roi presse de les lui donner. Les Ministres veulent attendre l’issue de l'affaire de Cabrera. Ils ont raison. D’autant plus raison que Don Carlos a donné sous main, ordre à Cabrera de continuer la guerre. Entendez-vous dire quelque chose de Thiers ?
9 heures et demie
Vous avez tout-à-fait le droit, et vous aurez raison avant de faire la partage du capital de Londres, de demander à être informée de ce que vous aurez à toucher en argent et en effets à Pétersbourg. Je ne pense pas que vous puissiez désormais exercer aucun recours légal, ni que vous fissiez bien de le tenter, même indirectement. Mais ce qui se pourra pour embarrasser et pour arracher de la mauvaise honte quelques lumières, et quelques sommes de plus, il faut le faire. J’approuve donc tout-à-fait que vous adressiez à Londres votre question. Parlez aussi à votre frère de l'oubli de vos droits sur le mobilier de Courlande. Il ne faut pas qu’il ignore tout-à-fait sa propre légèreté, ni qu’il croie qu'elle a passé inaperçue. Je suis charmé que ce coup de pierre ne soit rien. J’ai la Reine à cœur. Après les assassins, les fous. Ceux-là aussi passeront.
Adieu. Adieu. J’ai ma petite Pauline un peu indisposée. Ce n’est rien. Adieu G.
9 heures
J’ai eu du monde sans relâche toute la matinée. Parce que je refuse tous les dîners, on se croit obligé de venir me voir deux fois, davantage. J’aimerais mieux discuter avec vos ouvriers. Je ne tousse plus du tout. J’y aurais regret si je n’arrangeais pas déjà mon retour à peu près pour l'époque que je vous ai dite. Il continue pourtant de faire beau.
Vous trouverai-je tout-à-fait arrangée ? Ne vous ruinez pas. Je crains vos goûts de perfection bien naturels et de bien bon goût, Limitez-vous pourtant dans votre perfection. L’appartement est déjà cher pour vous. N'aggravez pas trop le mal. Pippin, vous a-t-il quittée ? Comment Felix prend-il son petit changement de condition. Avez-vous eu le courage de l’en informer ? Je doute que vous eussiez été un bon ministre d’un gouvernement représentatif. Dire oui n’est que la moitié du talent. Non est l’autre moitié. Celle-ci vous eût manqué. Vous ne savez que plaire.
Don Carlos me paraît pressé d'avoir ses passeports. Et le Roi presse de les lui donner. Les Ministres veulent attendre l’issue de l'affaire de Cabrera. Ils ont raison. D’autant plus raison que Don Carlos a donné sous main, ordre à Cabrera de continuer la guerre. Entendez-vous dire quelque chose de Thiers ?
9 heures et demie
Vous avez tout-à-fait le droit, et vous aurez raison avant de faire la partage du capital de Londres, de demander à être informée de ce que vous aurez à toucher en argent et en effets à Pétersbourg. Je ne pense pas que vous puissiez désormais exercer aucun recours légal, ni que vous fissiez bien de le tenter, même indirectement. Mais ce qui se pourra pour embarrasser et pour arracher de la mauvaise honte quelques lumières, et quelques sommes de plus, il faut le faire. J’approuve donc tout-à-fait que vous adressiez à Londres votre question. Parlez aussi à votre frère de l'oubli de vos droits sur le mobilier de Courlande. Il ne faut pas qu’il ignore tout-à-fait sa propre légèreté, ni qu’il croie qu'elle a passé inaperçue. Je suis charmé que ce coup de pierre ne soit rien. J’ai la Reine à cœur. Après les assassins, les fous. Ceux-là aussi passeront.
Adieu. Adieu. J’ai ma petite Pauline un peu indisposée. Ce n’est rien. Adieu G.
201. Paris, Lundi 24 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
201 Paris lundi 24 Juin 1839 8 heures
J’ai dîné hier avec Lady Jersey. Le Duc de Broglie dit qu'elle est toujours belle. Elle parle toujours beaucoup avec la confiance d’une jeune femme, d’une jolie femme, d’une grande dame et d’une bonne personne. Elle a été très bonne pour moi et sa bonté a fini par me demander de signer mon nom sur son album, qu’elle avait évidemment apporté pour cela. Elle m’a paru un peu piquée que vous ne l’eussiez pas attendue à Paris. Elle repart jeudi pour l'Angleterre. Elle y trouvera à sa grande joie, le Cabinet, bien malade. Se retirera-t-il encore une fois pour une majorité de 5 ? Il a eu tort de rentrer. Du reste ce qui me revient est d'accord avec Lady Cowper. Les Tories sont violents, & inquiètent leurs chefs modérés ; si le duc de Wellington, par l’âge, par la santé, se trouvait hors d'état de prendre aux affaires une part active, ni Peel, ni Lord Aberdeen n'auraient assez d'autorité pour contenir et gouverner le parti. Et ses fautes rendraient bientôt le pouvoir à ses adversaires. Si vous étiez ici, vous verriez un Cabinet bien aussi chancelant en apparence, quoi qu’il le soit bien moins au fond. Vous entendriez dire tout le jour que M. Molé se rapproche de M. Thiers, et aussi de moi, et moi de M. Thiers que M. Cousin part pour Plombières avec M. Molé ; que l'autre jour, de la voix et du geste, j'ai approuvé M. de Salvandy à la tribune. Je n’ai jamais vu tant de commérages. Il n’y a rien, rien du tout, et le Cabinet tiendra jusqu'à des événements.
5 heures
Je reviens de la Chambre et j'en rapporte peut-être des évènements. Deux dépêches télégraphiques disent que les Turcs ont envahis quinze villages égyptiens qu’Ibrahim s'est mis en mouvement avec 25 000 hommes pour les reprendre ; que la flotte Turque est dans le Bosphore, occupée à embarquer 7000 hommes de débarquement ; que le Sultan est très malade &. On attend cette nuit les dépêches écrites qui donneront des détails. En tout cas, lisez attentivement le rapport que M. Jouffroy vient de lire à la Chambre. C’est un morceau remarquable par la netteté et la mesure, au fond et dans la forme. Le langage est excellent. Il a été accueilli avec grande faveur. Il est très douteux qu’il y ait un débat.
Votre N°200 vaut mieux à la fin qu'au commencement. Quand je vois, pour tout un jour, quelques lignes, écrites comme on se traine quand on ne peut plus marcher, mon cœur se serre pour vous. Du reste, j'ai la même impression que Madame de Talleyrand. Je pressens un meilleur tour de vos affaires. A la vérité il faut bien qu'à force de descendre le moment de rencontre arrive. J'emploierai mon loisir à vous chercher une maison. Et si je trouvais de l'autre côté de l'eau quelque chose qui vous convient vraiment je n'hésiterais pas ; au risque d’y perdre, et par conséquent de vous y faire perdre quelque chose. Mais n’arrêtez aucun projet donc aucune maison avant les arrangements de Pétersbourg. Il faut savoir ce que vous aurez.
Mardi 8 heures
J’ai été hier soir faire ma cour à Neuilly. J’ai trouvé le Roi en bonne humeur, et comptant que les affaires d'Orient s’arrangeront de concert entre vous nous, et tout le monde. Il m'a gardé longtemps, et m’a paru penser qu’il avait aujourd’hui du pouvoir presque ultra petita. Il me semble que cela ne va pas au delà de votre latin. De Neuilly, j’ai été chez Lady Granville. Elle part, dans une quinzaine de jours pour les eaux de Kitsingen (dis-je bien ? ) près de Würtsbourg, où elle ne trouvera personne et c’est ce qu’elle cherche. Je suis allé hier chez votre Ambassadeur. Il était parti. Adieu. Voilà des visites. Quoique vous ne me disiez rien de bon sur votre santé, j'ai à son sujet, le même pressentiment que sur vos affaires. Et je crois entrevoir que vous même l’avez un peu. Ainsi soit-il ! God bless you ! Adieu Adieu.
J’ai dîné hier avec Lady Jersey. Le Duc de Broglie dit qu'elle est toujours belle. Elle parle toujours beaucoup avec la confiance d’une jeune femme, d’une jolie femme, d’une grande dame et d’une bonne personne. Elle a été très bonne pour moi et sa bonté a fini par me demander de signer mon nom sur son album, qu’elle avait évidemment apporté pour cela. Elle m’a paru un peu piquée que vous ne l’eussiez pas attendue à Paris. Elle repart jeudi pour l'Angleterre. Elle y trouvera à sa grande joie, le Cabinet, bien malade. Se retirera-t-il encore une fois pour une majorité de 5 ? Il a eu tort de rentrer. Du reste ce qui me revient est d'accord avec Lady Cowper. Les Tories sont violents, & inquiètent leurs chefs modérés ; si le duc de Wellington, par l’âge, par la santé, se trouvait hors d'état de prendre aux affaires une part active, ni Peel, ni Lord Aberdeen n'auraient assez d'autorité pour contenir et gouverner le parti. Et ses fautes rendraient bientôt le pouvoir à ses adversaires. Si vous étiez ici, vous verriez un Cabinet bien aussi chancelant en apparence, quoi qu’il le soit bien moins au fond. Vous entendriez dire tout le jour que M. Molé se rapproche de M. Thiers, et aussi de moi, et moi de M. Thiers que M. Cousin part pour Plombières avec M. Molé ; que l'autre jour, de la voix et du geste, j'ai approuvé M. de Salvandy à la tribune. Je n’ai jamais vu tant de commérages. Il n’y a rien, rien du tout, et le Cabinet tiendra jusqu'à des événements.
5 heures
Je reviens de la Chambre et j'en rapporte peut-être des évènements. Deux dépêches télégraphiques disent que les Turcs ont envahis quinze villages égyptiens qu’Ibrahim s'est mis en mouvement avec 25 000 hommes pour les reprendre ; que la flotte Turque est dans le Bosphore, occupée à embarquer 7000 hommes de débarquement ; que le Sultan est très malade &. On attend cette nuit les dépêches écrites qui donneront des détails. En tout cas, lisez attentivement le rapport que M. Jouffroy vient de lire à la Chambre. C’est un morceau remarquable par la netteté et la mesure, au fond et dans la forme. Le langage est excellent. Il a été accueilli avec grande faveur. Il est très douteux qu’il y ait un débat.
Votre N°200 vaut mieux à la fin qu'au commencement. Quand je vois, pour tout un jour, quelques lignes, écrites comme on se traine quand on ne peut plus marcher, mon cœur se serre pour vous. Du reste, j'ai la même impression que Madame de Talleyrand. Je pressens un meilleur tour de vos affaires. A la vérité il faut bien qu'à force de descendre le moment de rencontre arrive. J'emploierai mon loisir à vous chercher une maison. Et si je trouvais de l'autre côté de l'eau quelque chose qui vous convient vraiment je n'hésiterais pas ; au risque d’y perdre, et par conséquent de vous y faire perdre quelque chose. Mais n’arrêtez aucun projet donc aucune maison avant les arrangements de Pétersbourg. Il faut savoir ce que vous aurez.
Mardi 8 heures
J’ai été hier soir faire ma cour à Neuilly. J’ai trouvé le Roi en bonne humeur, et comptant que les affaires d'Orient s’arrangeront de concert entre vous nous, et tout le monde. Il m'a gardé longtemps, et m’a paru penser qu’il avait aujourd’hui du pouvoir presque ultra petita. Il me semble que cela ne va pas au delà de votre latin. De Neuilly, j’ai été chez Lady Granville. Elle part, dans une quinzaine de jours pour les eaux de Kitsingen (dis-je bien ? ) près de Würtsbourg, où elle ne trouvera personne et c’est ce qu’elle cherche. Je suis allé hier chez votre Ambassadeur. Il était parti. Adieu. Voilà des visites. Quoique vous ne me disiez rien de bon sur votre santé, j'ai à son sujet, le même pressentiment que sur vos affaires. Et je crois entrevoir que vous même l’avez un peu. Ainsi soit-il ! God bless you ! Adieu Adieu.
298. Val-Richer, Vendredi 25 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
298. Du Val Richer Vendredi 25 octobre 1839 7 heures
J’ai remarqué que Médem, quand vous le consultiez ; était toujours de votre avis, entrait dans votre sens ; ce qui n'empêchait pas que, après le conseil, le moment de l'action venu, il ne fit rien pour vous. Lui avez-vous demandé de vous procurer sur la valeur du mobilier de la terre de Courlande, des renseignements un peu précis ? Il me semble qu’il le pourrait. Son père, si je ne me trompe, avait là, ou tout près, une partie de sa fortune. Je me méfie fort des gens qui disent toujours comme moi, et ma confiance comme mon estime, ont besoin qu'on me contrarie souvent.
Je suis charmé que Pahlen revienne ; pour vous d’abord, et aussi pour nos rapports avec vous ; bons ou mauvais, ils seront convenables et tranquilles. A présent que votre tentative sur Londres est manquée, je trouve qu'elle a été faite avec trop d’éclat. L’envoi de M. de Brünnow était une façon de monter à l'assaut ; il fallait emporter, la place. Tout cela du reste est de peu d’importance pour l’événement ; il sera le même. Ce sont de petites vicissitudes de situation et de petites agitations d'amour propre qu’on se donne comme passe-temps.
En fait de passe-temps, j’en ai un depuis deux jours qui m'amuse fort. Je lis ces mémoires de Mirabeau ou plutôt des Mirabeau, que je n’avais jamais fait que regarder. C’est une étrange famille, une fougue de passion, un besoin de suivre sa fantaisie et de faire sa volonté, une mon habitude d’énergie bizarre & d'emportement spirituel, transmis de génération en génération, comme une physionomie et un caractère de caste. Il faudra que vous lisiez cela. Mon libraire me les a envoyés avec d’autres livres, dont j’avais besoin. Je les rapporterai à Paris pour vous. Vos yeux continuent-ils de se trouver un peu mieux ?
Qu'arriverait-il si M. de Metternich refusait à Rodolphe Appony l'autorisation dont il a besoin. ? Irait-il de l'avant dans le mariage ? Mais cela n’arrivera pas.
10 heures
J’espère que la mort de Lord Brougham n’est en effet qu’une étrange mystification. Vous avez mille fois raison. Quand une gloire nationale disparaît, tout le pays s’en ressent et doit s'en affliger. Il a moins de soleil sur son horizon. donne. L'Angleterre sait bien cela. Aussi mérite-t-elle des gloires. Je ne me serais jamais douté du sentiment de Lady Clauricard ! Je ne mets pas, bien ces deux personnes là ensemble. Je suis charmé que vous ayez les letters of adm. Adieu. Adieu. G.
J’ai remarqué que Médem, quand vous le consultiez ; était toujours de votre avis, entrait dans votre sens ; ce qui n'empêchait pas que, après le conseil, le moment de l'action venu, il ne fit rien pour vous. Lui avez-vous demandé de vous procurer sur la valeur du mobilier de la terre de Courlande, des renseignements un peu précis ? Il me semble qu’il le pourrait. Son père, si je ne me trompe, avait là, ou tout près, une partie de sa fortune. Je me méfie fort des gens qui disent toujours comme moi, et ma confiance comme mon estime, ont besoin qu'on me contrarie souvent.
Je suis charmé que Pahlen revienne ; pour vous d’abord, et aussi pour nos rapports avec vous ; bons ou mauvais, ils seront convenables et tranquilles. A présent que votre tentative sur Londres est manquée, je trouve qu'elle a été faite avec trop d’éclat. L’envoi de M. de Brünnow était une façon de monter à l'assaut ; il fallait emporter, la place. Tout cela du reste est de peu d’importance pour l’événement ; il sera le même. Ce sont de petites vicissitudes de situation et de petites agitations d'amour propre qu’on se donne comme passe-temps.
En fait de passe-temps, j’en ai un depuis deux jours qui m'amuse fort. Je lis ces mémoires de Mirabeau ou plutôt des Mirabeau, que je n’avais jamais fait que regarder. C’est une étrange famille, une fougue de passion, un besoin de suivre sa fantaisie et de faire sa volonté, une mon habitude d’énergie bizarre & d'emportement spirituel, transmis de génération en génération, comme une physionomie et un caractère de caste. Il faudra que vous lisiez cela. Mon libraire me les a envoyés avec d’autres livres, dont j’avais besoin. Je les rapporterai à Paris pour vous. Vos yeux continuent-ils de se trouver un peu mieux ?
Qu'arriverait-il si M. de Metternich refusait à Rodolphe Appony l'autorisation dont il a besoin. ? Irait-il de l'avant dans le mariage ? Mais cela n’arrivera pas.
10 heures
J’espère que la mort de Lord Brougham n’est en effet qu’une étrange mystification. Vous avez mille fois raison. Quand une gloire nationale disparaît, tout le pays s’en ressent et doit s'en affliger. Il a moins de soleil sur son horizon. donne. L'Angleterre sait bien cela. Aussi mérite-t-elle des gloires. Je ne me serais jamais douté du sentiment de Lady Clauricard ! Je ne mets pas, bien ces deux personnes là ensemble. Je suis charmé que vous ayez les letters of adm. Adieu. Adieu. G.
200. Paris, Samedi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Paris, Samedi 22 Juin 1839 -7 heures
200 Quel gros chiffre ! Je vous disais l’autre jour, que je ne pouvais croire qu’il n’y eût que deux ans. En voilà bien encore une preuve. Nous nous sommes beaucoup écrit. Nous nous sommes beaucoup parlé. Que de choses pourtant nous ne nous sommes pas dîtes ! On vit bien séparés bien inconnus l’un de l'autre. Cela me déplaît et m'attriste à penser. J’ai horreur de la solitude. Mais qu’il est difficile d'en sortir !
J’ai dit hier à la Chambre quelques paroles qui ont fait assez d'effet. Cette pauvre chambre ressemble bien à la nature humaine, elle s'ennuie de la médiocrité et s’impatiente de la supériorité. Elle a envie de ce qui est mieux qu’elle et elle n'en veut pas. Elle prend plaisir à l'entrevoir; et quand on le lui offre, elle ne peut se résoudre à l'accepter. C’est la vraie difficulté de ce pays-ci et de toute société démocratique. A travers la langueur générale, je m'aperçois qu’il serait assez facile de ranimer les débats. On me promet, sur l'Orient, un discours fantastique de M. de Lamartine et un discours russe de M. de Carné.
A propos de Russe, savez-vous que l'Empereur vient de fonder ici un journal Russe, le Capitole ? C’est un M. Charles Durand, naguères journaliste à Francfort, & journaliste à votre solde, qui a transporté ici ses Pénates. Il avait épousé une fort jolie personne de mon pays de Nîmes, qu’il a fait mourir de chagrin. Cela n'empêche pas de faire un journal Russe.
M. Delessert a arrêté la nuit dernière un des quatre généraux de la République, M. Martin Bernard. C’est une capture assez grosse. Le procès en sera retardé de quelques jours. Il faut que ce nouveau venu y prenne place. Pour le moment même, cela est très bon. On s'attendait à quelque tentative nouvelle, à quelque sauvage prise d'armes de ces gens-là, pendant le procès. Il est vraisemblable que cet enlèvement d’un de leurs généraux les troublera un peu.
5 heures
Je passe d’indignation en indignation. Ces mensonges répandus à Pétersbourg, d'où viennent-ils ?
Sans nul doute, Mad. de Nesselrode est une bonne fortune. Il vous faut bien du monde pour vous défendre. Vous avez besoin d’une sentinelle à toutes les portes. Cependant je suis plus tranquille que je ne l'étais et vous devez aussi l'être plus. Il me paraît certain que vos intérêts seront protégés, et les mensonges démentis. Quand une fois cela sera fini, quand vous aurez quelque chose d'assuré, j'aurai le sentiment d'une vraie délivrance. Des Affaires pareilles, à 600 lieues, dans un tel pays avec votre santé... Moi aussi, souvent je n'en dors pas. Vous dormirez après, n’est-ce pas ? Vous me le promettez ?
Je rentre de la Chambre. Séance insignifiante. Les intimes de Thiers sont enragés mais enragés en dedans comme des officiers abandonnés de leurs soldats. Le Cabinet n’a pas gagné ce qu’ils ont perdu ; mais ils l’ont perdu. Thiers est allé prendre congé du Roi qui a causé longtemps avec lui. Ils se sont séparés en bons termes. Thiers en partant a recommandé à ses journaux de ménager le Roi. Et le Roi a dit à un ami de Thiers. Dites lui que je lui suis nécessaire et qu’il m’est agréable ; mais, qu’il faut qu’il renonce aux affaires étrangères — Vous voyez que le raccommodement n’est pas bien avancée. Thiers de loin et les siens de près sont en grande coquetterie avec moi. J’ai été chercher ce matin Lord Granville. Je ne l’ai pas trouvé. J’irai faire une visite à votre ambassadeur, s’il n’est pas parti.
Dimanche 6 heures et demie
Je suis dans une corbeille de roses. Mon petit jardin en est couvert. Si vous étiez ici, je vous les enverrais. Pourquoi n'aviez-vous plus de fleurs ? Est-ce santé ? Est-ce économie ? car j'ai vu poindre en vous cette vertu, ou pour mieux dire cette sagesse. Madame de Boigne vient d’être très souffrante, mais très souffrante, beaucoup de fièvre, du délire. Madame Récamier qui est allée dîner avant-hier avec elle, l’a trouvée encore dans son lit, et dans un grand découragement. Elle se plaint d'être fort seule, et que la société la fatigue et qu’on arrive chez elle trop tard, après 10 heures, quand elle est épuisée et ne demande plus qu’à se coucher. Elle parle de se retirer en province ou de rester à la campagne. Lord Grey n’est pas le seul qui ne puisse se résoudre à vieillir. J’irai demain voir le Chancelier, et savoir de lui si on peut aller dîner à Chatenay. J’ai dîné hier chez Mad. Lenormant, en face d’un buste de M. de Châteaubriand immense, monstrueux, quatre pieds de tête, deux pieds de cou, long, large, épais, un taureau, un colosse. Etrange façon de se grandir. C'est le sculpteur David qui met cela à la mode. Il a fait un buste de Goethe, un de Cuvier dans les mêmes proportions. Notre temps est bien enclin à croire qu'avec beaucoup, beaucoup de matière, on peut faire des âmes. C'est le système de la quantité.
On a eu hier une dépêche télégraphique d'Orient. Rien de décisif. Toujours point d'hostilités ; mais toujours à la veille. Le rapport se fait après demain à la Chambre. Nos armements maritimes se poursuivent très activement. Ils pourront bien ne pas être purement temporaires, et si la situation se prolonge, elle aboutira à nous faire tenir une grande flotte en permanence dans la méditerranée, comme vous en avez une dans la mer noire.
Adieu. Je vais faire ma toilette & recevoir du monde. Avez-vous décidément abandonné le lait d’ânesse ? Quel mal vous faisait-il ? Est-ce que vous ne le digériez pas bien. Où en est votre appétit ? Ah, on ne sait rien de loin. Adieu. Adieu.
Onze heures Les nouvelles d'Orient sont moins pacifiques que je ne vous disais. Il y a eu de petites rencontres entre des détachements isolés. On parait croire ce matin que cela deviendra sérieux.
200 Quel gros chiffre ! Je vous disais l’autre jour, que je ne pouvais croire qu’il n’y eût que deux ans. En voilà bien encore une preuve. Nous nous sommes beaucoup écrit. Nous nous sommes beaucoup parlé. Que de choses pourtant nous ne nous sommes pas dîtes ! On vit bien séparés bien inconnus l’un de l'autre. Cela me déplaît et m'attriste à penser. J’ai horreur de la solitude. Mais qu’il est difficile d'en sortir !
J’ai dit hier à la Chambre quelques paroles qui ont fait assez d'effet. Cette pauvre chambre ressemble bien à la nature humaine, elle s'ennuie de la médiocrité et s’impatiente de la supériorité. Elle a envie de ce qui est mieux qu’elle et elle n'en veut pas. Elle prend plaisir à l'entrevoir; et quand on le lui offre, elle ne peut se résoudre à l'accepter. C’est la vraie difficulté de ce pays-ci et de toute société démocratique. A travers la langueur générale, je m'aperçois qu’il serait assez facile de ranimer les débats. On me promet, sur l'Orient, un discours fantastique de M. de Lamartine et un discours russe de M. de Carné.
A propos de Russe, savez-vous que l'Empereur vient de fonder ici un journal Russe, le Capitole ? C’est un M. Charles Durand, naguères journaliste à Francfort, & journaliste à votre solde, qui a transporté ici ses Pénates. Il avait épousé une fort jolie personne de mon pays de Nîmes, qu’il a fait mourir de chagrin. Cela n'empêche pas de faire un journal Russe.
M. Delessert a arrêté la nuit dernière un des quatre généraux de la République, M. Martin Bernard. C’est une capture assez grosse. Le procès en sera retardé de quelques jours. Il faut que ce nouveau venu y prenne place. Pour le moment même, cela est très bon. On s'attendait à quelque tentative nouvelle, à quelque sauvage prise d'armes de ces gens-là, pendant le procès. Il est vraisemblable que cet enlèvement d’un de leurs généraux les troublera un peu.
5 heures
Je passe d’indignation en indignation. Ces mensonges répandus à Pétersbourg, d'où viennent-ils ?
Sans nul doute, Mad. de Nesselrode est une bonne fortune. Il vous faut bien du monde pour vous défendre. Vous avez besoin d’une sentinelle à toutes les portes. Cependant je suis plus tranquille que je ne l'étais et vous devez aussi l'être plus. Il me paraît certain que vos intérêts seront protégés, et les mensonges démentis. Quand une fois cela sera fini, quand vous aurez quelque chose d'assuré, j'aurai le sentiment d'une vraie délivrance. Des Affaires pareilles, à 600 lieues, dans un tel pays avec votre santé... Moi aussi, souvent je n'en dors pas. Vous dormirez après, n’est-ce pas ? Vous me le promettez ?
Je rentre de la Chambre. Séance insignifiante. Les intimes de Thiers sont enragés mais enragés en dedans comme des officiers abandonnés de leurs soldats. Le Cabinet n’a pas gagné ce qu’ils ont perdu ; mais ils l’ont perdu. Thiers est allé prendre congé du Roi qui a causé longtemps avec lui. Ils se sont séparés en bons termes. Thiers en partant a recommandé à ses journaux de ménager le Roi. Et le Roi a dit à un ami de Thiers. Dites lui que je lui suis nécessaire et qu’il m’est agréable ; mais, qu’il faut qu’il renonce aux affaires étrangères — Vous voyez que le raccommodement n’est pas bien avancée. Thiers de loin et les siens de près sont en grande coquetterie avec moi. J’ai été chercher ce matin Lord Granville. Je ne l’ai pas trouvé. J’irai faire une visite à votre ambassadeur, s’il n’est pas parti.
Dimanche 6 heures et demie
Je suis dans une corbeille de roses. Mon petit jardin en est couvert. Si vous étiez ici, je vous les enverrais. Pourquoi n'aviez-vous plus de fleurs ? Est-ce santé ? Est-ce économie ? car j'ai vu poindre en vous cette vertu, ou pour mieux dire cette sagesse. Madame de Boigne vient d’être très souffrante, mais très souffrante, beaucoup de fièvre, du délire. Madame Récamier qui est allée dîner avant-hier avec elle, l’a trouvée encore dans son lit, et dans un grand découragement. Elle se plaint d'être fort seule, et que la société la fatigue et qu’on arrive chez elle trop tard, après 10 heures, quand elle est épuisée et ne demande plus qu’à se coucher. Elle parle de se retirer en province ou de rester à la campagne. Lord Grey n’est pas le seul qui ne puisse se résoudre à vieillir. J’irai demain voir le Chancelier, et savoir de lui si on peut aller dîner à Chatenay. J’ai dîné hier chez Mad. Lenormant, en face d’un buste de M. de Châteaubriand immense, monstrueux, quatre pieds de tête, deux pieds de cou, long, large, épais, un taureau, un colosse. Etrange façon de se grandir. C'est le sculpteur David qui met cela à la mode. Il a fait un buste de Goethe, un de Cuvier dans les mêmes proportions. Notre temps est bien enclin à croire qu'avec beaucoup, beaucoup de matière, on peut faire des âmes. C'est le système de la quantité.
On a eu hier une dépêche télégraphique d'Orient. Rien de décisif. Toujours point d'hostilités ; mais toujours à la veille. Le rapport se fait après demain à la Chambre. Nos armements maritimes se poursuivent très activement. Ils pourront bien ne pas être purement temporaires, et si la situation se prolonge, elle aboutira à nous faire tenir une grande flotte en permanence dans la méditerranée, comme vous en avez une dans la mer noire.
Adieu. Je vais faire ma toilette & recevoir du monde. Avez-vous décidément abandonné le lait d’ânesse ? Quel mal vous faisait-il ? Est-ce que vous ne le digériez pas bien. Où en est votre appétit ? Ah, on ne sait rien de loin. Adieu. Adieu.
Onze heures Les nouvelles d'Orient sont moins pacifiques que je ne vous disais. Il y a eu de petites rencontres entre des détachements isolés. On parait croire ce matin que cela deviendra sérieux.
305. Val-Richer, Vendredi 1er novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
305 Du Val. Richer Vendredi 1er Novembre 1839
8 heures
Nous voilà dans le bon mois. En 1815, à Gand, Louis 18 sortant de son cabinet et traversant le salon, le matin même du jour où il répartit pour rentrer en France me disait : " Eh bien M. Guizot, nous voilà du bon côté de la glissoire. " J'aurai certainement, à vous retrouver, plus de plaisir que lui à reprendre la route de Paris. Que de joies différentes en ce monde, comme de douleurs ! J’en ai connu de toutes sortes ; et bien décidément c’est de l'affection que viennent les plus vives, les seules qui aillent toucher jusqu'au fond de l'âme, & l’ébranlent, et la satisfassent toute entière.
Je partirai le 13. Il n'y a pas moyen de presser davantage, ma mère. Je serai à Paris le 14 pour dîner, et je vous verrai dans la soirée. Il fait aujourd'hui un temps affreux, le vent, la pluie, le froid. Il fera beau, le 14. Je voudrais qu’il fit beau après-demain. J’ai tout mon Lisieux à déjeuner. Ce sont mes adieux. J’ai refusé absolument leurs dîners, leurs parties de campagne, leurs toasts. Ils m'auraient donné dix rhumes. Ils auront les primeurs de Ma route neuve. Elle est finie. On la livre dimanche matin à la circulation. Il ne me reste plus à faire qu’une avenue de la route à ma porte. On la fera cet hiver. L’entrepreneur me la promet pour le 15 avril prochain. Que les plus petites choses sont lentes quand il faut créer !
J’ai envie de quelque chose de M. de Bacourt. Je me crois sûr qu’il a entre les mains, je ne sais comment tous les papiers du comte de La Marck, (d’Aremberg) l’ami intime de Mirabeau et à qui Mirabeau laissa en mourant presque tous les siens, les plus confidentiels. Je voudrais bien voir, ces papiers. Je suis dans Mirabeau jusqu'au cou, par curiosité après Washington. Croyez-vous que je puisse demander à Mad. de Talleyrand de demander cela à M. de Bacourt ? Est-ce convenable ? Ou faut-il que je m'adresse directement à M. de Bacourt ?
10 heures
Votre lettre à votre frère est à merveille, très douce et très ferme, très précise. S'il a, comme j'en ai peur, oublié ou abandonné vos intérêts sur les points que vous touchez, il en ressentira quelque embarras... si quelque embarras est possible. Je n'hésite pas quant à vos fils, d'après ce que vous avez écrit à votre frère, vous devez attendre sa réponse avant de partager le capital. Vous vous le devez à vous-même. Je suis un grand partisan de la consistency. Si vous aviez renoncé à toute observation, il faudrait vider sur le champ l’affaire du capital. Mais vous avez voulu rappeler votre droit méconnu, constater du moins qu'on l’avait méconnu. Le capital est votre seul moyen d'action. Il faut le retenir jusqu'à ce qu’on ait répondu à vos observations, soit pour les accueillir quelque peu, soit pour vous dire nettement. que vous êtes liée par l’arrangement, et que vous ne devez attendre rien de plus. A votre place j’écrirais tout simplement cela à Alexandre. Mais comme ce sera Paul qui répondra par Alexandre, je comprends votre crainte de réponse inconvenante. Ne pourriez-vous pas écrire à Benkhausen, et le charger de dire à vos fils vos intentions ? Voilà mon avis à la première vue. Si quelque autre idée me venait, je vous la dirais demain.
Adieu. Adieu. A dater d'aujourd'hui les Adieux valent mieux. G.
Nous voilà dans le bon mois. En 1815, à Gand, Louis 18 sortant de son cabinet et traversant le salon, le matin même du jour où il répartit pour rentrer en France me disait : " Eh bien M. Guizot, nous voilà du bon côté de la glissoire. " J'aurai certainement, à vous retrouver, plus de plaisir que lui à reprendre la route de Paris. Que de joies différentes en ce monde, comme de douleurs ! J’en ai connu de toutes sortes ; et bien décidément c’est de l'affection que viennent les plus vives, les seules qui aillent toucher jusqu'au fond de l'âme, & l’ébranlent, et la satisfassent toute entière.
Je partirai le 13. Il n'y a pas moyen de presser davantage, ma mère. Je serai à Paris le 14 pour dîner, et je vous verrai dans la soirée. Il fait aujourd'hui un temps affreux, le vent, la pluie, le froid. Il fera beau, le 14. Je voudrais qu’il fit beau après-demain. J’ai tout mon Lisieux à déjeuner. Ce sont mes adieux. J’ai refusé absolument leurs dîners, leurs parties de campagne, leurs toasts. Ils m'auraient donné dix rhumes. Ils auront les primeurs de Ma route neuve. Elle est finie. On la livre dimanche matin à la circulation. Il ne me reste plus à faire qu’une avenue de la route à ma porte. On la fera cet hiver. L’entrepreneur me la promet pour le 15 avril prochain. Que les plus petites choses sont lentes quand il faut créer !
J’ai envie de quelque chose de M. de Bacourt. Je me crois sûr qu’il a entre les mains, je ne sais comment tous les papiers du comte de La Marck, (d’Aremberg) l’ami intime de Mirabeau et à qui Mirabeau laissa en mourant presque tous les siens, les plus confidentiels. Je voudrais bien voir, ces papiers. Je suis dans Mirabeau jusqu'au cou, par curiosité après Washington. Croyez-vous que je puisse demander à Mad. de Talleyrand de demander cela à M. de Bacourt ? Est-ce convenable ? Ou faut-il que je m'adresse directement à M. de Bacourt ?
10 heures
Votre lettre à votre frère est à merveille, très douce et très ferme, très précise. S'il a, comme j'en ai peur, oublié ou abandonné vos intérêts sur les points que vous touchez, il en ressentira quelque embarras... si quelque embarras est possible. Je n'hésite pas quant à vos fils, d'après ce que vous avez écrit à votre frère, vous devez attendre sa réponse avant de partager le capital. Vous vous le devez à vous-même. Je suis un grand partisan de la consistency. Si vous aviez renoncé à toute observation, il faudrait vider sur le champ l’affaire du capital. Mais vous avez voulu rappeler votre droit méconnu, constater du moins qu'on l’avait méconnu. Le capital est votre seul moyen d'action. Il faut le retenir jusqu'à ce qu’on ait répondu à vos observations, soit pour les accueillir quelque peu, soit pour vous dire nettement. que vous êtes liée par l’arrangement, et que vous ne devez attendre rien de plus. A votre place j’écrirais tout simplement cela à Alexandre. Mais comme ce sera Paul qui répondra par Alexandre, je comprends votre crainte de réponse inconvenante. Ne pourriez-vous pas écrire à Benkhausen, et le charger de dire à vos fils vos intentions ? Voilà mon avis à la première vue. Si quelque autre idée me venait, je vous la dirais demain.
Adieu. Adieu. A dater d'aujourd'hui les Adieux valent mieux. G.
306. Val-Richer, Samedi 2 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
306 Du Val Richer, Samedi 2 Nov à 1839
8 heures
Vous avez bien raison ; il n’y a plus de belle campagne. Encore notre maladresse : vous avez eu de la belle campagne à Baden et moi en Normandie, et nous en avons joui séparément, si c'est jouir.
Je persiste dans tous mes avis d’hier. Si votre frère y mettait un peu de bonne volonté, il ne serait peut-être pas impossible que dans l'impatience du Capital, vos fils revinssent un peu sur le mobilier de Courlande, et l’argent en portefeuille. Ils vous donneront du moins quelques explications. Je ne vois que Benkhausen ou Cumming que vous puissiez charger de les leur demander. Encore une fois, si vous en écrivez à Alexandre, ce sera Paul qui répondra et Dieu sait comment. Pourtant j'ai en idée que toujours par impatience du Capital, il se contiendra dans ce moment, et vous fera peut-être même quelques avances. N’ont-elles pas déjà un peu commencé ? N'est-ce pas là le sens caché de ce que vous a dit Bulwer ? La tendresse de la dernière lettre d'Alexandre ne lui a-t-elle pas été permise ? Vous voyez que je vous dis tout impitoyablement. Je me trompe, avec une très grande pitié. Je trouve tout cela déplorable.
Le Roi fera bien avant de dissoudre son Cabinet sur les passeports de D. Carlos de s'assurer des successeurs. Mais nous sommes bien bons d'y regarder. Cela n’est pas sérieux. J'en reviens à mon dire ; j'aime la grande et vraie comédie, non pas la petite et inutile.
9 heures et demie
Je n'accepte pas le Shabby. Vous savez que je suis maîtresse de maison ménageant, arrangeant les personnes, les choses. Dieu sait si j'étais fait pour ce métier là ! Mais c’est lui qui m’y a condamné. Ma vieille et bonne mère ne peut pas être pressée. Elle est le contraire de M. de Talleyrand. Elle a de la grandeur naturelle, et de petites habitudes. Je respecte tout en elle. Croyez donc bien, sachez donc bien une fois pour toutes que moi, je n'ai jamais rien de plus pressé que de vous revoir, et que j’y pense, comme on pense à sa première affaire et à son seul plaisir. J’ai mille choses à vous dire que je ne peux pas écrire. Adieu. Adieu.
M. Rossi, ne sera pas Pair cette fois. La loi sur les catégories pour la Pairie n'admet que les membres des quatre académies de l'Institut, & il est membre de la 5e Académie, qui n’existait pas encore du moment où cette loi a été faite. C'est moi qui l’ai créée en 1832. Objection de procureur ; mais les procureurs sont puissants partout. Il attendra. Adieu encore et toujours. G.
8 heures
Vous avez bien raison ; il n’y a plus de belle campagne. Encore notre maladresse : vous avez eu de la belle campagne à Baden et moi en Normandie, et nous en avons joui séparément, si c'est jouir.
Je persiste dans tous mes avis d’hier. Si votre frère y mettait un peu de bonne volonté, il ne serait peut-être pas impossible que dans l'impatience du Capital, vos fils revinssent un peu sur le mobilier de Courlande, et l’argent en portefeuille. Ils vous donneront du moins quelques explications. Je ne vois que Benkhausen ou Cumming que vous puissiez charger de les leur demander. Encore une fois, si vous en écrivez à Alexandre, ce sera Paul qui répondra et Dieu sait comment. Pourtant j'ai en idée que toujours par impatience du Capital, il se contiendra dans ce moment, et vous fera peut-être même quelques avances. N’ont-elles pas déjà un peu commencé ? N'est-ce pas là le sens caché de ce que vous a dit Bulwer ? La tendresse de la dernière lettre d'Alexandre ne lui a-t-elle pas été permise ? Vous voyez que je vous dis tout impitoyablement. Je me trompe, avec une très grande pitié. Je trouve tout cela déplorable.
Le Roi fera bien avant de dissoudre son Cabinet sur les passeports de D. Carlos de s'assurer des successeurs. Mais nous sommes bien bons d'y regarder. Cela n’est pas sérieux. J'en reviens à mon dire ; j'aime la grande et vraie comédie, non pas la petite et inutile.
9 heures et demie
Je n'accepte pas le Shabby. Vous savez que je suis maîtresse de maison ménageant, arrangeant les personnes, les choses. Dieu sait si j'étais fait pour ce métier là ! Mais c’est lui qui m’y a condamné. Ma vieille et bonne mère ne peut pas être pressée. Elle est le contraire de M. de Talleyrand. Elle a de la grandeur naturelle, et de petites habitudes. Je respecte tout en elle. Croyez donc bien, sachez donc bien une fois pour toutes que moi, je n'ai jamais rien de plus pressé que de vous revoir, et que j’y pense, comme on pense à sa première affaire et à son seul plaisir. J’ai mille choses à vous dire que je ne peux pas écrire. Adieu. Adieu.
M. Rossi, ne sera pas Pair cette fois. La loi sur les catégories pour la Pairie n'admet que les membres des quatre académies de l'Institut, & il est membre de la 5e Académie, qui n’existait pas encore du moment où cette loi a été faite. C'est moi qui l’ai créée en 1832. Objection de procureur ; mais les procureurs sont puissants partout. Il attendra. Adieu encore et toujours. G.
197. Val-Richer, Dimanche 16 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
197 Du Val-Richer. Dimanche 16 Juin 1839 9 heures
J’ai eu des visites toute la journée, ce soir encore après dîner. Je pars demain matin. Je vais passer un mois parfaitement seul dans ma maison ; à moins que le Duc de Broglie ne revienne pour le procès, comme il l'a dit. Mais j'en doute un peu. Il me semble que le même empressement qui l’a fait partir pour quinze jours pourra bien l'empêcher de repartir au bout de quinze jours. Pourtant il aurait tort. Il ne faut pas qu’un juge manque à un procès de vie et de mort.
Je trouve votre vie bien ordonnée. Je vous y voudrais un peu plus de société. Je ne suis point jaloux. Ai-je raison ? Mais vous êtes absolument obligée de me revenir grasse et fraîche. L'absence est un crime qui ne peut-être couvert que par le succès.
Vos mauvaises nouvelles de Courlande paraissent bien authentiques. Je m'en désole, car je n'ai foi à personne. Votre frère ne vous dit-il rien, absolu ment rien de la perspective d'une pension ? J'espère presque plus de l'Empereur que de tout autre. Je ne croirai jamais qu’il soit impossible aux trois hommes qui l’entourent de faire luire dans son cœur, s'ils le veulent, un éclair de justice et de générosité.
Lundi 9 heures
Je me lève par le plus beau soleil. Si je devais vous revoir, demain, je serais aussi gai que le soleil. Voilà la première fois depuis deux ans que je vais à Paris sans vous y retrouver. Quel ennui de partir quand on n'a pas envie d’arriver ! C’est bien deux ans, avant hier 15 Juin. Comment n’y a-t-il que deux ans ? Il me semble que c’est toute une vie.
Eternité, néant, passé, sombres abymes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez ; nous rendrez-vous les extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
C’est M. de Lamartine qui dit cela. Vous savez que j’aime la poésie. Elle entre et reste très avant dans ma mémoire. Elle agit sur moi comme un écho de l'âme. Elle me rend des sons que j'ai entendus. J’aime mieux la voix que l’écho. Pourtant l’écho est très doux. Mon fils aimait passionnément la poésie. Et sans y porter cette disposition un peu vague et romanesque de la jeunesse. C’était l’esprit le plus net et le plus simple du monde, choqué par instinct dès qu’il apercevait du brouillard ou de l'emphase ; mais d’un cœur si élevé et si délicat, d'une nature si parfaitement élégante et rare que la poésie lui allait d'elle-même et comme par une harmonie spontanée. Je n'ai vu aucune créature, qui semblât créée à ce point pour plaire ! Et c’est à moi seul qu’il a plu. J’ai connu seul le parfum charmant de cette fleur ! C'est l’un de mes plus amers regrets. Il me semble que je l’aurais moins perdu si d’autres en avaient joui comme moi.
9 h. 1/2 Le numéro 196 me désole. Je les ai tous reçus, aucun si triste. J’espérais, et je veux encore espérer mieux du lait d’ânesse, des bains de son, de tout ce régime doux et tranquille. En grâce, si votre médecin persiste à le croire bon, ne le cessez pas parce que vous vous trouvez plus souffrante un jour ou deux. Il faut bien accepter ces mauvaises alternatives. Je n’ai pas la superstition des médecins. J'y crois pourtant un peu plus qu'à notre ignorance. Je craignais bien la solitude de Baden. Vous ne supportez pas la société médiocre et vous avez raison. Il est si rare d'en rencontrer une autre !
Madame de Talleyrand travaille à se désintéresser de toutes choses, à ne penser qu'à elle-même à ses affaires, à ses conforts, à ses habitudes. Ce n’est pas une manière d'animer les autres. Moi aussi, je trouve que nous nous disons peu de chose. Adieu. Adieu.
J’ai une foule de petits soins à prendre avant de partir. Je trouve dans mes journaux de ce matin une triste nouvelle. Ce pauvre Emmanuel de Grouchy est mort à Turin d’une fièvre cérébrale. J’avais de l’amitié pour lui, et il m'était très dévoué. Il s’était marié il y a 18 mois. Il était heureux. Adieu encore. J'aime mille fois mieux une sotte réalité que mille fictions. Adieu pourtant. Mais ne souffrez pas ; ne maigrissez pas. G.
J’ai eu des visites toute la journée, ce soir encore après dîner. Je pars demain matin. Je vais passer un mois parfaitement seul dans ma maison ; à moins que le Duc de Broglie ne revienne pour le procès, comme il l'a dit. Mais j'en doute un peu. Il me semble que le même empressement qui l’a fait partir pour quinze jours pourra bien l'empêcher de repartir au bout de quinze jours. Pourtant il aurait tort. Il ne faut pas qu’un juge manque à un procès de vie et de mort.
Je trouve votre vie bien ordonnée. Je vous y voudrais un peu plus de société. Je ne suis point jaloux. Ai-je raison ? Mais vous êtes absolument obligée de me revenir grasse et fraîche. L'absence est un crime qui ne peut-être couvert que par le succès.
Vos mauvaises nouvelles de Courlande paraissent bien authentiques. Je m'en désole, car je n'ai foi à personne. Votre frère ne vous dit-il rien, absolu ment rien de la perspective d'une pension ? J'espère presque plus de l'Empereur que de tout autre. Je ne croirai jamais qu’il soit impossible aux trois hommes qui l’entourent de faire luire dans son cœur, s'ils le veulent, un éclair de justice et de générosité.
Lundi 9 heures
Je me lève par le plus beau soleil. Si je devais vous revoir, demain, je serais aussi gai que le soleil. Voilà la première fois depuis deux ans que je vais à Paris sans vous y retrouver. Quel ennui de partir quand on n'a pas envie d’arriver ! C’est bien deux ans, avant hier 15 Juin. Comment n’y a-t-il que deux ans ? Il me semble que c’est toute une vie.
Eternité, néant, passé, sombres abymes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez ; nous rendrez-vous les extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
C’est M. de Lamartine qui dit cela. Vous savez que j’aime la poésie. Elle entre et reste très avant dans ma mémoire. Elle agit sur moi comme un écho de l'âme. Elle me rend des sons que j'ai entendus. J’aime mieux la voix que l’écho. Pourtant l’écho est très doux. Mon fils aimait passionnément la poésie. Et sans y porter cette disposition un peu vague et romanesque de la jeunesse. C’était l’esprit le plus net et le plus simple du monde, choqué par instinct dès qu’il apercevait du brouillard ou de l'emphase ; mais d’un cœur si élevé et si délicat, d'une nature si parfaitement élégante et rare que la poésie lui allait d'elle-même et comme par une harmonie spontanée. Je n'ai vu aucune créature, qui semblât créée à ce point pour plaire ! Et c’est à moi seul qu’il a plu. J’ai connu seul le parfum charmant de cette fleur ! C'est l’un de mes plus amers regrets. Il me semble que je l’aurais moins perdu si d’autres en avaient joui comme moi.
9 h. 1/2 Le numéro 196 me désole. Je les ai tous reçus, aucun si triste. J’espérais, et je veux encore espérer mieux du lait d’ânesse, des bains de son, de tout ce régime doux et tranquille. En grâce, si votre médecin persiste à le croire bon, ne le cessez pas parce que vous vous trouvez plus souffrante un jour ou deux. Il faut bien accepter ces mauvaises alternatives. Je n’ai pas la superstition des médecins. J'y crois pourtant un peu plus qu'à notre ignorance. Je craignais bien la solitude de Baden. Vous ne supportez pas la société médiocre et vous avez raison. Il est si rare d'en rencontrer une autre !
Madame de Talleyrand travaille à se désintéresser de toutes choses, à ne penser qu'à elle-même à ses affaires, à ses conforts, à ses habitudes. Ce n’est pas une manière d'animer les autres. Moi aussi, je trouve que nous nous disons peu de chose. Adieu. Adieu.
J’ai une foule de petits soins à prendre avant de partir. Je trouve dans mes journaux de ce matin une triste nouvelle. Ce pauvre Emmanuel de Grouchy est mort à Turin d’une fièvre cérébrale. J’avais de l’amitié pour lui, et il m'était très dévoué. Il s’était marié il y a 18 mois. Il était heureux. Adieu encore. J'aime mille fois mieux une sotte réalité que mille fictions. Adieu pourtant. Mais ne souffrez pas ; ne maigrissez pas. G.
196. Val-Richer, Vendredi 14 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
196 Du Val-Richer. Vendredi 14 juin 1839 3 heures
Je commence par où j’ai fini hier, mon indignation. Elle est inépuisable. Que deviendriez-vous si vous n'aviez rien à vous ? On n'en aurait été que plus pressé de vous traiter de la sorte pour vous dompter, pour se venger que sais-je ? Ceci me fait éprouver un des sentiments les plus pénibles que je connaisse. Je porte un respect général et profond à ces relations naturelles, indestructibles, indépendantes de notre choix, par lesquelles, sans concours, sans mérite de notre part, dieu nous donne des amis, des appuis, du bonheur et de la sécurité ; et pour toute la vie. Même avec des gens que je n’aime pas, que je ne connais pas, il m'est souverainement désagréable de laisser tomber un mot de reproche ou de blâmer sur un fils devant sa mère, sur un frère devant sa sœur. J'en éprouve une sorte d’embarras et de tristesse comme si j'allais contre une intention divine, si je touchais à une œuvre sacrée. Et pourtant ici, il n'y a pas moyen. Je ne puis me taire ; je ne dirai jamais tout ce que je pense. Alexandre ne vous avait donc pas dit un mot de cette mesure. Vous en avez sans doute informé sur le champ votre frère. Je n'ai d'espoir qu'en lui pour pousser un peu vite vos affaires et prendre un peu soin de vos intérêts. Car voilà une raison, une nécessité de plus d’aller vite. On ne peut vous laisser longtemps dans ce dénuement. Qu’on finisse, qu’on finisse, et que vous puissiez ne plus penser qu'au lait d’ânesse et aux bains de son. Votre médecin de Baden est plein de bon sens ; il sait ce qu’il vous faut. Pour dieu, qu’on le laisse faire.
Je trouve votre réponse au Grand Duc excellente. Pour tout dire, je ne lis pas sans quelque mouvement d’impatience ces belles paroles, ces tendres épanchements de votre âme jetés à un pauvre jeune homme qui ne comprend pas, qui n'ose pas, devant qui tout cela passe comme les élans de la piété et de la prière devant une idole. Il y a un Dieu au-dessus de l’idole, dont l’idole n’est que l’image, et qui comprend l'âme qui prie. Mais ici... Décidément, je ne vaux rien pour l’idolâtrie. J’admire, j’aime le respect et le dévouement, deux vertus rares, beaucoup trop rares de mon temps et dans mon pays ; mais j'y porte, je l'avoue, un peu d'exigence superbe. Passé cette explosion de fierté libérale, je ne vois pas le moindre mot à redire dans votre lettre ; elle est triste, pénétrante, et très digne dans sa ferveur impériale. C’était le problème et vous l’avez résolu.
Samedi 9 heures
Mes hôtes viennent de partir, et moi je partirai après demain pour un mois, je présume. Si vous étiez à Paris, ce mois serait charmant. On est assez occupé du procès. Concevez-vous l'audace de ces gens-là qui font fabriquer une pièce de canon & la trainent dans les rues de Paris ? On l'a saisie. C'était une machine pitoyable ; mais enfin, au dire des ingénieurs, elle aurait pu tirer encore 40 ou 50 coups. Les sociétés secrètes viennent de modifier, leur organisation ; elles se sont constituées par armées ; à un homme par jour. Cinq armées sont organisées, formant donc à peu près 2000 hommes. Elles se sont épurées dans ce nouveau travail, comme tous les partis en déclin, mais très vivaces, qui opposent le redoublement du fanatisme au progrès de l'impuissance. La dernière insurrection n'a pas eu, dans les Provinces, le moindre retentissement. Presque toujours quand un orage éclatait à Paris, il grondait à Lyon à Strasbourg, à Marseille. Rien de semblable cette fois. L’épreuve a même été très complète car il y a eu à Lyon, un peu de tumulte parmi les ouvriers pour une question de salaires, et la politique n’y a paru en rien.
Voilà votre n°195. Merci de vos détails. J'en avais besoin. La lettre de votre frère me rassure un peu. Mais j'aspire à la fin. Du reste, après l'acceptation de vos pouvoirs par le comte de Pahlen et la surveillance déclarée de votre frère, vous pouvez certainement être plus tranquille. Il me faut la permission de l'Empereur. Ce qui vous revient de droit sera trop peu. Votre lettre à votre frère est très convenable. Adieu. Je vous dirai en arrivant à Paris, s'il faut m’écrire rue de l'Université ou rue Ville l'évêque. Adieu. Adieu. Commencez-vous à engraisser ? G.
Je commence par où j’ai fini hier, mon indignation. Elle est inépuisable. Que deviendriez-vous si vous n'aviez rien à vous ? On n'en aurait été que plus pressé de vous traiter de la sorte pour vous dompter, pour se venger que sais-je ? Ceci me fait éprouver un des sentiments les plus pénibles que je connaisse. Je porte un respect général et profond à ces relations naturelles, indestructibles, indépendantes de notre choix, par lesquelles, sans concours, sans mérite de notre part, dieu nous donne des amis, des appuis, du bonheur et de la sécurité ; et pour toute la vie. Même avec des gens que je n’aime pas, que je ne connais pas, il m'est souverainement désagréable de laisser tomber un mot de reproche ou de blâmer sur un fils devant sa mère, sur un frère devant sa sœur. J'en éprouve une sorte d’embarras et de tristesse comme si j'allais contre une intention divine, si je touchais à une œuvre sacrée. Et pourtant ici, il n'y a pas moyen. Je ne puis me taire ; je ne dirai jamais tout ce que je pense. Alexandre ne vous avait donc pas dit un mot de cette mesure. Vous en avez sans doute informé sur le champ votre frère. Je n'ai d'espoir qu'en lui pour pousser un peu vite vos affaires et prendre un peu soin de vos intérêts. Car voilà une raison, une nécessité de plus d’aller vite. On ne peut vous laisser longtemps dans ce dénuement. Qu’on finisse, qu’on finisse, et que vous puissiez ne plus penser qu'au lait d’ânesse et aux bains de son. Votre médecin de Baden est plein de bon sens ; il sait ce qu’il vous faut. Pour dieu, qu’on le laisse faire.
Je trouve votre réponse au Grand Duc excellente. Pour tout dire, je ne lis pas sans quelque mouvement d’impatience ces belles paroles, ces tendres épanchements de votre âme jetés à un pauvre jeune homme qui ne comprend pas, qui n'ose pas, devant qui tout cela passe comme les élans de la piété et de la prière devant une idole. Il y a un Dieu au-dessus de l’idole, dont l’idole n’est que l’image, et qui comprend l'âme qui prie. Mais ici... Décidément, je ne vaux rien pour l’idolâtrie. J’admire, j’aime le respect et le dévouement, deux vertus rares, beaucoup trop rares de mon temps et dans mon pays ; mais j'y porte, je l'avoue, un peu d'exigence superbe. Passé cette explosion de fierté libérale, je ne vois pas le moindre mot à redire dans votre lettre ; elle est triste, pénétrante, et très digne dans sa ferveur impériale. C’était le problème et vous l’avez résolu.
Samedi 9 heures
Mes hôtes viennent de partir, et moi je partirai après demain pour un mois, je présume. Si vous étiez à Paris, ce mois serait charmant. On est assez occupé du procès. Concevez-vous l'audace de ces gens-là qui font fabriquer une pièce de canon & la trainent dans les rues de Paris ? On l'a saisie. C'était une machine pitoyable ; mais enfin, au dire des ingénieurs, elle aurait pu tirer encore 40 ou 50 coups. Les sociétés secrètes viennent de modifier, leur organisation ; elles se sont constituées par armées ; à un homme par jour. Cinq armées sont organisées, formant donc à peu près 2000 hommes. Elles se sont épurées dans ce nouveau travail, comme tous les partis en déclin, mais très vivaces, qui opposent le redoublement du fanatisme au progrès de l'impuissance. La dernière insurrection n'a pas eu, dans les Provinces, le moindre retentissement. Presque toujours quand un orage éclatait à Paris, il grondait à Lyon à Strasbourg, à Marseille. Rien de semblable cette fois. L’épreuve a même été très complète car il y a eu à Lyon, un peu de tumulte parmi les ouvriers pour une question de salaires, et la politique n’y a paru en rien.
Voilà votre n°195. Merci de vos détails. J'en avais besoin. La lettre de votre frère me rassure un peu. Mais j'aspire à la fin. Du reste, après l'acceptation de vos pouvoirs par le comte de Pahlen et la surveillance déclarée de votre frère, vous pouvez certainement être plus tranquille. Il me faut la permission de l'Empereur. Ce qui vous revient de droit sera trop peu. Votre lettre à votre frère est très convenable. Adieu. Je vous dirai en arrivant à Paris, s'il faut m’écrire rue de l'Université ou rue Ville l'évêque. Adieu. Adieu. Commencez-vous à engraisser ? G.
308. Val-Richer, Lundi 4 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
308 Du Val-Richer. Lundi 4 Novembre 1839
7 heures
Je me lève de bonne heure Je ne sais pourquoi depuis quelque temps je passe ma nuit tout entière à rêver les rêves les plus actifs, les plus compliqués, les plus suivis du monde. La vie que je mène le jour ne m'ébranle pourtant pas les nerfs. C’est la plus égale et la plus tranquille qui se puisse. C'est peut-être cela. Je place de jour le repos et de nuit l'activité de mon esprit.
Pahlen reviendra, croyez-moi. Leurs humeurs ne sont guère plus sérieuses que leurs colères et on ne se retirera pas plus les ambassadeurs qu’on ne se tirera des coups de canon. L'immobilité et dans l'immobilité de petites parades de temps en temps pour lui donner l’air du mouvement voilà la politique. Mais parades en paroles, pas même en gestes.
J’écrirai à M. de Bacourt. Je suis curieux des lettres de Mirabeau. Cet homme là m'amuse extrêmement, beaucoup plus qu'il ne me plaît. L’incohérence et le dérèglement ne me plaisent pas, quelque grands qu’ils soient. J’aime mieux le soleil que les éclairs. Ce mouvement prodigieux et tourbillonnant des premiers temps de la révolution française, cette explosion d’idées vraies et fausses, de passions bonnes et mauvaises mêlées masquées, hors d'état de se reconnaître, cet entassement de ruines subites, de constructions avortées, d’événements étouffés, écrasés dans la foule, tout cela ressemble au chaos sans créateur, et contraint de se débrouiller lui-même. Le spectacle est très curieux ; mais je n’ai pas goût au drame. Je ne crois pas qu’il vous eût convenu plus qu'à moi. M. de Talleyrand en aimait passionnément le souvenir. Il m’a dit un jour que ce qui le consolait de tout c’était le plaisir d'avoir vécu dans ce temps-là, tant il s’était amusé.
10 heures
Vite les affaires. J’ai là un malheureux architecte qui a fait vingt lieues cette nuit pour venir me montrer et m'expliquer un projet de Pénitentiaire, une prison qui doit faire, de tous les coquins autant de petits saints. Vous ne pouvez donner vos pouvoirs au banquier, chez qui est l'argent. C’est lui qui doit le remettre. Il ne peut le recevoir en même temps. Je ne vois pas d’inconvénient à en charger Benkhausen. Il s’est bien conduit envers vous dans tout ceci. Il n'est pas dans la dépendance de vos fils. Si vous aviez à Londres quelqu'un de vos amis qui voulut en prendre la peine, si le Duc de Sutherland y était, je l’aimerais mieux. Mais faute de cela Benkhausen me paraît le meilleur. Et je pense tout-à-fait que puisque la plupart des questions sont résolues mieux vaut en finir, promptement, dès que vos fils auront manifesté leur intention sur la première. Il est clair que pour ce mobilier de Courlande, vous êtes tout-à- fait à leur merci. S'ils en tiennent compte, c’est bien. Sinon, finissez vite de tout. Adieu. Adieu. G.
7 heures
Je me lève de bonne heure Je ne sais pourquoi depuis quelque temps je passe ma nuit tout entière à rêver les rêves les plus actifs, les plus compliqués, les plus suivis du monde. La vie que je mène le jour ne m'ébranle pourtant pas les nerfs. C’est la plus égale et la plus tranquille qui se puisse. C'est peut-être cela. Je place de jour le repos et de nuit l'activité de mon esprit.
Pahlen reviendra, croyez-moi. Leurs humeurs ne sont guère plus sérieuses que leurs colères et on ne se retirera pas plus les ambassadeurs qu’on ne se tirera des coups de canon. L'immobilité et dans l'immobilité de petites parades de temps en temps pour lui donner l’air du mouvement voilà la politique. Mais parades en paroles, pas même en gestes.
J’écrirai à M. de Bacourt. Je suis curieux des lettres de Mirabeau. Cet homme là m'amuse extrêmement, beaucoup plus qu'il ne me plaît. L’incohérence et le dérèglement ne me plaisent pas, quelque grands qu’ils soient. J’aime mieux le soleil que les éclairs. Ce mouvement prodigieux et tourbillonnant des premiers temps de la révolution française, cette explosion d’idées vraies et fausses, de passions bonnes et mauvaises mêlées masquées, hors d'état de se reconnaître, cet entassement de ruines subites, de constructions avortées, d’événements étouffés, écrasés dans la foule, tout cela ressemble au chaos sans créateur, et contraint de se débrouiller lui-même. Le spectacle est très curieux ; mais je n’ai pas goût au drame. Je ne crois pas qu’il vous eût convenu plus qu'à moi. M. de Talleyrand en aimait passionnément le souvenir. Il m’a dit un jour que ce qui le consolait de tout c’était le plaisir d'avoir vécu dans ce temps-là, tant il s’était amusé.
10 heures
Vite les affaires. J’ai là un malheureux architecte qui a fait vingt lieues cette nuit pour venir me montrer et m'expliquer un projet de Pénitentiaire, une prison qui doit faire, de tous les coquins autant de petits saints. Vous ne pouvez donner vos pouvoirs au banquier, chez qui est l'argent. C’est lui qui doit le remettre. Il ne peut le recevoir en même temps. Je ne vois pas d’inconvénient à en charger Benkhausen. Il s’est bien conduit envers vous dans tout ceci. Il n'est pas dans la dépendance de vos fils. Si vous aviez à Londres quelqu'un de vos amis qui voulut en prendre la peine, si le Duc de Sutherland y était, je l’aimerais mieux. Mais faute de cela Benkhausen me paraît le meilleur. Et je pense tout-à-fait que puisque la plupart des questions sont résolues mieux vaut en finir, promptement, dès que vos fils auront manifesté leur intention sur la première. Il est clair que pour ce mobilier de Courlande, vous êtes tout-à- fait à leur merci. S'ils en tiennent compte, c’est bien. Sinon, finissez vite de tout. Adieu. Adieu. G.
299. Val-Richer, Samedi 26 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
299 Du Val Richer Samedi 26 oct. 1839 7 heures et demie
Je répète ce que nous avons dit souvent ; quand on approche du terme la route devient assommante ; quand on est près de se revoir on ne prend plus de plaisir à s’écrire. Il ne s’est rien passé depuis que nous nous sommes quittés. J’ai des milliers de choses à vous dire, et l’insuffisance des lettres me choque plus que jamais. Il fait très beau et très froid ce matin. J’ai été me promener hier sur ma nouvelle route par laquelle je m'en irai, et qui va être achevée enfin. Tout le monde dit qu’elle a été faite avec une rapidité inouïe. Il est vrai qu'on l’a commencée, l’année dernière. Pour moi, il me semble qu’on y travaille depuis un temps infini, et qu’elle s’est fait attendre outre mesure. C’est qu’on m'en a et que j'en ai beaucoup parlé. La parole allonge et use extrêmement les choses. C’est ce qui fait que, de nos jours, tant des gens sont blasés en un clin d’œil, ou même d'avance. On parle trop. Au fait, ma route sera fort jolie.
Je suis charmé que Lord Brougham ne soit pas mort. Je lui ai enfin répondu il y a huit jours. Lady Clauricard me revient beaucoup. Est-ce depuis le mariage du marquis de Dauro, ou auparavant ? Vous avez peut-être vu dans les journaux l'histoire de cette comédie de Mad. de Girardin, qui a été reçue à l'unanimité par les comédiens dont l’autorité hésite à permettre la représentation, et qui excite beaucoup de curiosité me dit-on. C’est une vengeance de femme. Elle s’appelle l’Ecole des Journalistes. C'est l'histoire du Mariage de Thiers et de toute sa vie politique et privée. M. Duchâtel paraît décidé à ne pas permettre et il a raison. Mais ces Girardins ont bec et ongles. Ils feront du bruit.
L'ouverture de la session pour le 16 ou le 20 décembre. On voudrait bien avoir quelque chose de plus à dire sur l'Orient. On espère un peu que d'orient même, il viendra quelque chose qui fera faire un pas. Au fond, je ne suis pas convaincu que le Roi soit pressé. Il aime assez à avoir sur les bras, un embarras dont il n’a pas peur.
9 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez 24 mille francs de plus. Mais j'ai peur d’une femme de chambre qui ne l'a jamais été. Comment ferez -vous cette éducation là ? Par un drôle de hasard, trois ou quatre de mes amis m’écrivent aujourd’hui même qu'ils ont vu Thiers, et leurs dires s'accordent parfaitement avec votre conversation. Je vous en parlerai demain. D'après ce qu’on me mande, l'Orient est tout à fait immobile, et on ne compte plus sûr quelque chose de nouveau avant la session. Adieu.
Si vous étiez ici, vous ne resteriez pas dans votre chambre. Il fait vraiment aujourd’hui un temps admirable pour se promener. Il y a des gens qui aiment passionnément les beaux jours d’automne, parce que ce sont les derniers. J'aime mieux les beaux jours du printemps, parce que ce sont les premiers. J’aime l'avenir, ce que j’aime encore mieux, c'est ce qui est éternel. Adieu. G.
Je répète ce que nous avons dit souvent ; quand on approche du terme la route devient assommante ; quand on est près de se revoir on ne prend plus de plaisir à s’écrire. Il ne s’est rien passé depuis que nous nous sommes quittés. J’ai des milliers de choses à vous dire, et l’insuffisance des lettres me choque plus que jamais. Il fait très beau et très froid ce matin. J’ai été me promener hier sur ma nouvelle route par laquelle je m'en irai, et qui va être achevée enfin. Tout le monde dit qu’elle a été faite avec une rapidité inouïe. Il est vrai qu'on l’a commencée, l’année dernière. Pour moi, il me semble qu’on y travaille depuis un temps infini, et qu’elle s’est fait attendre outre mesure. C’est qu’on m'en a et que j'en ai beaucoup parlé. La parole allonge et use extrêmement les choses. C’est ce qui fait que, de nos jours, tant des gens sont blasés en un clin d’œil, ou même d'avance. On parle trop. Au fait, ma route sera fort jolie.
Je suis charmé que Lord Brougham ne soit pas mort. Je lui ai enfin répondu il y a huit jours. Lady Clauricard me revient beaucoup. Est-ce depuis le mariage du marquis de Dauro, ou auparavant ? Vous avez peut-être vu dans les journaux l'histoire de cette comédie de Mad. de Girardin, qui a été reçue à l'unanimité par les comédiens dont l’autorité hésite à permettre la représentation, et qui excite beaucoup de curiosité me dit-on. C’est une vengeance de femme. Elle s’appelle l’Ecole des Journalistes. C'est l'histoire du Mariage de Thiers et de toute sa vie politique et privée. M. Duchâtel paraît décidé à ne pas permettre et il a raison. Mais ces Girardins ont bec et ongles. Ils feront du bruit.
L'ouverture de la session pour le 16 ou le 20 décembre. On voudrait bien avoir quelque chose de plus à dire sur l'Orient. On espère un peu que d'orient même, il viendra quelque chose qui fera faire un pas. Au fond, je ne suis pas convaincu que le Roi soit pressé. Il aime assez à avoir sur les bras, un embarras dont il n’a pas peur.
9 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez 24 mille francs de plus. Mais j'ai peur d’une femme de chambre qui ne l'a jamais été. Comment ferez -vous cette éducation là ? Par un drôle de hasard, trois ou quatre de mes amis m’écrivent aujourd’hui même qu'ils ont vu Thiers, et leurs dires s'accordent parfaitement avec votre conversation. Je vous en parlerai demain. D'après ce qu’on me mande, l'Orient est tout à fait immobile, et on ne compte plus sûr quelque chose de nouveau avant la session. Adieu.
Si vous étiez ici, vous ne resteriez pas dans votre chambre. Il fait vraiment aujourd’hui un temps admirable pour se promener. Il y a des gens qui aiment passionnément les beaux jours d’automne, parce que ce sont les derniers. J'aime mieux les beaux jours du printemps, parce que ce sont les premiers. J’aime l'avenir, ce que j’aime encore mieux, c'est ce qui est éternel. Adieu. G.
310. Val-Richer, Mercredi 6 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
310 Du Val-Richer, Mercredi 6 nov. 1839
7 heures et demie
Depuis quelques jours, je vois avec bonheur croître le chiffre de notre correspondance. Il touche à son apogée. Il se reposera là bien longtemps.
Les journaux que j’ai repris attentivement hier, ne parlent d’aucun accident dans la mer du Nord. La traversée n'est pas longue. Je compte que vous me donnerez au premier jour des nouvelles d'Alexandre. Je ne veux vous retrouver ni triste, ni malade. Il y a pourtant des choses qui finissent. Je vous retrouverai avec vos affaires arrangées. Pas aussi bien que je voudrais, tant s’en faut, mais enfin arrangées. Vous souvenez-vous combien de fois vous m'avez dit qu'elles ne s’arrangeraient pas ? J’ai été aussi bien inquiet. Il arrive deux choses. Tout ne tourne pas aussi mal qu’on l'imaginait. On se résigne à une grande partie du mal. Il faut accepter ces termes-moyens de la vie. Le repos est à ce prix. Il n’y faut jamais réduire son âme. Ce serait là de la décadence. Il y a une vraie consolation à planer, au dedans, bien au dessus de ce qui se passe et de ce qu’on accepte au dehors.
Ma mère a encore été souffrante hier. Je crains l’hiver. Elle a heureusement une grande force intérieure. Je ne connais personne de plus inaccessible à l’abattement. Dans sa longue vie, je l'ai vue souvent au désespoir, pas un moment abattue. C’est un puissant moyen de résistance même à la maladie. Je crois au moins autant à l'influence du moral sur le physique que du physique sur le moral.
10 heures
Les premières lignes de votre lettre me désolaient. Je n'y comprenais rien. La distribution a donc tardé à Paris. Enfin bientôt, nous ne courrons plus ni l’un ni l’autre aucune chance d'inquiétude, c’est- à-dire de cette inquiétude là. Adieu. J’ai trois lettres d'affaires à écrire par le facteur qui attend ; des lettres de départ autour de moi. Oui à huit jours. Adieu. Adieu
Je persiste sur D. Carlos. La mise en liberté immédiate eût mieux valu en effet. Mais celle-là aussi n’était pas possible. La Chambre est convoquée, pour le 23 déc. Les Pairs sont nommés. M. Rossi en est. Mais vous savez tout cela. C'est ennuyeux de ne pas savoir et faire toutes choses ensemble. Nous y touchons.
7 heures et demie
Depuis quelques jours, je vois avec bonheur croître le chiffre de notre correspondance. Il touche à son apogée. Il se reposera là bien longtemps.
Les journaux que j’ai repris attentivement hier, ne parlent d’aucun accident dans la mer du Nord. La traversée n'est pas longue. Je compte que vous me donnerez au premier jour des nouvelles d'Alexandre. Je ne veux vous retrouver ni triste, ni malade. Il y a pourtant des choses qui finissent. Je vous retrouverai avec vos affaires arrangées. Pas aussi bien que je voudrais, tant s’en faut, mais enfin arrangées. Vous souvenez-vous combien de fois vous m'avez dit qu'elles ne s’arrangeraient pas ? J’ai été aussi bien inquiet. Il arrive deux choses. Tout ne tourne pas aussi mal qu’on l'imaginait. On se résigne à une grande partie du mal. Il faut accepter ces termes-moyens de la vie. Le repos est à ce prix. Il n’y faut jamais réduire son âme. Ce serait là de la décadence. Il y a une vraie consolation à planer, au dedans, bien au dessus de ce qui se passe et de ce qu’on accepte au dehors.
Ma mère a encore été souffrante hier. Je crains l’hiver. Elle a heureusement une grande force intérieure. Je ne connais personne de plus inaccessible à l’abattement. Dans sa longue vie, je l'ai vue souvent au désespoir, pas un moment abattue. C’est un puissant moyen de résistance même à la maladie. Je crois au moins autant à l'influence du moral sur le physique que du physique sur le moral.
10 heures
Les premières lignes de votre lettre me désolaient. Je n'y comprenais rien. La distribution a donc tardé à Paris. Enfin bientôt, nous ne courrons plus ni l’un ni l’autre aucune chance d'inquiétude, c’est- à-dire de cette inquiétude là. Adieu. J’ai trois lettres d'affaires à écrire par le facteur qui attend ; des lettres de départ autour de moi. Oui à huit jours. Adieu. Adieu
Je persiste sur D. Carlos. La mise en liberté immédiate eût mieux valu en effet. Mais celle-là aussi n’était pas possible. La Chambre est convoquée, pour le 23 déc. Les Pairs sont nommés. M. Rossi en est. Mais vous savez tout cela. C'est ennuyeux de ne pas savoir et faire toutes choses ensemble. Nous y touchons.
74. Val-Richer, Vendredi 29 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (28 Juin- 29 Juillet)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°74. Vendredi 29 10 h. du soir.
Il a fait très beau aujourd’hui. J’en étais en plus mauvaise disposition. Vous me manquez bien plus sous le soleil que sous la pluie. Je puis être triste sans vous ; heureux sans vous, non. Je souffrais de tout le plaisir que j’aurais pu avoir. Ce soir, je me suis promené avec mes enfants. A la bonne heure ; je puis jouir de leur gaieté, m’y associer même. Ce n’est pas pour moi que je suis content. Pourquoi m’êtes-vous devenue si nécessaire ? Je fais là une sotte question, car j’en sais parfaitement la réponse.
Je suis outré pour bien plus de 7000 francs. Je soupçonne qu’il y a là encore plus de taquinerie subalterne que de vilenie, un petit étalage d’autorité le désir de faire acte de pouvoir en reculant. Mon avis est que vous devez en informer votre frère et en parler à votre mari avec un étonnement bref et sans réclamer. Si je commence à les bien connaître la réclamation serait vaine. Vous ne pouvez, je crois ni passer sous silence un tel procédé, ni en faire grand bruit. Étonnez-vous aussi de l’apprendre par votre banquier. Pourquoi n’a-ton pas eu le courage de le dire soi-même de vous le dire à vous ? Je vous conseille là un langage du haut en bas, le seul qui vous convienne au fond, le seul aussi, j’en ai peur qui vous donne un peu de force. Il faut qu’on sache que vous ne vous générez pas de dire à vos amis la vilenie qu’on vous fait. Un peu de crainte, vous a sauvée. Usez de ce moyen avec les formes les plus douces du monde, mais usez en toujours un peu. Qu’ils aient tous peur du qu’en dira-t-on. Votre sauvegarde est là.
Samedi 8 h.
Vous n’aurez pas de lettre aujourd’hui. Cela me déplaît. Vous a t-on porté un paquet de livres ? Je ne sais si quelque chose là vous amusera. Vous êtes très difficile à amuser. Non que vous soyez blasée, ce qui n’a jamais ni mérite, ni charme, mais parce que vous êtes très difficile et très prompte à mettre de côté ce qui ne vous plait pas du premier coup. Vous ne savez ni attendre, ni chercher. L’imperfection, l’insuffisance, l’ennui vous choquent si vivement que vous détournez sur le champ la tête avec dédain, comme si vous ne pouviez rien avoir à démêler avec tout ce qui n’est pas supérieur et accompli. C’est votre mal, & votre attrait.
Il y a dans ce paquet de livres un roman nouveau intitulé Une destinée qu’on ma apporté la veille de mon départ. Je n’en ai pas lu une ligne et je ne vous réponds pas du tout qu’il vaille le moindre chose. Mais regardez-y cinq minutes. Il est d’une jeune fille à qui je veux du bien. Il y à cinq ans, quelques semaines après le 1 mars 1838 une lettre m’arriva d’une personne inconnue. C’était une longue pièce de vers écrite à mon sujet, sur le coup qui venait de me frapper par une jeune fille de 17 ans, fille d’un pauvre aubergiste dans un pauvre village du fond du Poitou, qui n’avait jamais eu d’autres leçons que celles du maître d’école et du curé de son village, ni lu d’autres livres que quelques volumes incomplets de poésie française et quelques numéros de Journal. Ses vers sans rien de saillant, n’étaient pas dénués de sensibilité et de mouvement. Un me frappe beaucoup. Elle disait, en décrivant celle que je venais de perdre : Ses regards pleins de douceur et d’empire. C’était à croire qu’elle l’avait vue, car ce mélange là, était précisément le caractère original de sa physionomie comme de sa nature. Je fus donc très touché. On l’est toujours d’ailleurs, d’apprendre que votre nom, votre sort ont vivement ému et occupé, à 150 lieues au fond d’un village, une personne inconnue et tant soit peu distinguée. Je répondis affectueusement à cette jeune fille. Je l’encourageai. Je lui envoyai de bon livres. Un an après, je reçus une autre lettre qui m’annonçait que son père avait vendu son auberge, et qu’elle allait venir à Paris, avec son père, et sa mère, dans une charrette traînée par un cheval que son père avait gardé pour ce voyage. J’essayai de l’en détourner. Il n’y eut pas moyen. Elle sentait son génie et voulait tenter sa destinée. Elle arriva. Je devrais dire elle m’arrive, car elle venait sur la foi de ma protection, et je ne pouvais me défendre d’accepter un peu la responsabilité de son sort. Je vis une jeune fille, point jolie de manières très simples, mais convenables, et assez élégantes de l’intelligence, dans le regard de la finesse dans le sourire, point embarrassée, et parfaitement décidée à chercher, par ses vers, la fortune et la gloire. Je lui donnai quelques avis et une petite pension. Depuis elle fait des vers ; elle en a fait d’assez agréables, et qui lui ont valu quelque succès auquel j’ai un peu aidé. Elle a acquis quelques amis de plus, amis-poètes, M. de Lamartine, Mad. Testu, quelques autres que je ne connais pas mais qui ont leur monde, où ils ont leur renommée. Elle vit très modestement, honnêtement, je crois. J’ai fait avoir une petite place à son père. Elle passera sa vie à faire des vers sans jamais monter bien haut ni percer bien loin, pauvre, agitée, jamais sûre de son succès ni de son pain ; mais elle aura obéi à son instinct et coulé selon sa pente. C’est le vrai secret de bien des vies. Je vois que les vers, ne lui suffisent pas, et qu’elle commence à faire des romans. Elle m’a apporté celui-là la veille de mon départ.
10 heures
Voilà votre N°76. Oui, c’est une triste et charmante parole. Adieu. Je vous ai dit ce qu’il me semblait de la réponse à votre mari. J’y pense encore. Il est possible, ce me semble, d’exprimer une surprise très hautaine au fond et très douce dans la forme, une surprise fière et résignée, qui les fasse, non pas rougir, ce qui ne se peut pas, mais s’inquiéter un peu du jugement de cinq ou six personnes, si cela se peut. Adieu encore. G.
Il a fait très beau aujourd’hui. J’en étais en plus mauvaise disposition. Vous me manquez bien plus sous le soleil que sous la pluie. Je puis être triste sans vous ; heureux sans vous, non. Je souffrais de tout le plaisir que j’aurais pu avoir. Ce soir, je me suis promené avec mes enfants. A la bonne heure ; je puis jouir de leur gaieté, m’y associer même. Ce n’est pas pour moi que je suis content. Pourquoi m’êtes-vous devenue si nécessaire ? Je fais là une sotte question, car j’en sais parfaitement la réponse.
Je suis outré pour bien plus de 7000 francs. Je soupçonne qu’il y a là encore plus de taquinerie subalterne que de vilenie, un petit étalage d’autorité le désir de faire acte de pouvoir en reculant. Mon avis est que vous devez en informer votre frère et en parler à votre mari avec un étonnement bref et sans réclamer. Si je commence à les bien connaître la réclamation serait vaine. Vous ne pouvez, je crois ni passer sous silence un tel procédé, ni en faire grand bruit. Étonnez-vous aussi de l’apprendre par votre banquier. Pourquoi n’a-ton pas eu le courage de le dire soi-même de vous le dire à vous ? Je vous conseille là un langage du haut en bas, le seul qui vous convienne au fond, le seul aussi, j’en ai peur qui vous donne un peu de force. Il faut qu’on sache que vous ne vous générez pas de dire à vos amis la vilenie qu’on vous fait. Un peu de crainte, vous a sauvée. Usez de ce moyen avec les formes les plus douces du monde, mais usez en toujours un peu. Qu’ils aient tous peur du qu’en dira-t-on. Votre sauvegarde est là.
Samedi 8 h.
Vous n’aurez pas de lettre aujourd’hui. Cela me déplaît. Vous a t-on porté un paquet de livres ? Je ne sais si quelque chose là vous amusera. Vous êtes très difficile à amuser. Non que vous soyez blasée, ce qui n’a jamais ni mérite, ni charme, mais parce que vous êtes très difficile et très prompte à mettre de côté ce qui ne vous plait pas du premier coup. Vous ne savez ni attendre, ni chercher. L’imperfection, l’insuffisance, l’ennui vous choquent si vivement que vous détournez sur le champ la tête avec dédain, comme si vous ne pouviez rien avoir à démêler avec tout ce qui n’est pas supérieur et accompli. C’est votre mal, & votre attrait.
Il y a dans ce paquet de livres un roman nouveau intitulé Une destinée qu’on ma apporté la veille de mon départ. Je n’en ai pas lu une ligne et je ne vous réponds pas du tout qu’il vaille le moindre chose. Mais regardez-y cinq minutes. Il est d’une jeune fille à qui je veux du bien. Il y à cinq ans, quelques semaines après le 1 mars 1838 une lettre m’arriva d’une personne inconnue. C’était une longue pièce de vers écrite à mon sujet, sur le coup qui venait de me frapper par une jeune fille de 17 ans, fille d’un pauvre aubergiste dans un pauvre village du fond du Poitou, qui n’avait jamais eu d’autres leçons que celles du maître d’école et du curé de son village, ni lu d’autres livres que quelques volumes incomplets de poésie française et quelques numéros de Journal. Ses vers sans rien de saillant, n’étaient pas dénués de sensibilité et de mouvement. Un me frappe beaucoup. Elle disait, en décrivant celle que je venais de perdre : Ses regards pleins de douceur et d’empire. C’était à croire qu’elle l’avait vue, car ce mélange là, était précisément le caractère original de sa physionomie comme de sa nature. Je fus donc très touché. On l’est toujours d’ailleurs, d’apprendre que votre nom, votre sort ont vivement ému et occupé, à 150 lieues au fond d’un village, une personne inconnue et tant soit peu distinguée. Je répondis affectueusement à cette jeune fille. Je l’encourageai. Je lui envoyai de bon livres. Un an après, je reçus une autre lettre qui m’annonçait que son père avait vendu son auberge, et qu’elle allait venir à Paris, avec son père, et sa mère, dans une charrette traînée par un cheval que son père avait gardé pour ce voyage. J’essayai de l’en détourner. Il n’y eut pas moyen. Elle sentait son génie et voulait tenter sa destinée. Elle arriva. Je devrais dire elle m’arrive, car elle venait sur la foi de ma protection, et je ne pouvais me défendre d’accepter un peu la responsabilité de son sort. Je vis une jeune fille, point jolie de manières très simples, mais convenables, et assez élégantes de l’intelligence, dans le regard de la finesse dans le sourire, point embarrassée, et parfaitement décidée à chercher, par ses vers, la fortune et la gloire. Je lui donnai quelques avis et une petite pension. Depuis elle fait des vers ; elle en a fait d’assez agréables, et qui lui ont valu quelque succès auquel j’ai un peu aidé. Elle a acquis quelques amis de plus, amis-poètes, M. de Lamartine, Mad. Testu, quelques autres que je ne connais pas mais qui ont leur monde, où ils ont leur renommée. Elle vit très modestement, honnêtement, je crois. J’ai fait avoir une petite place à son père. Elle passera sa vie à faire des vers sans jamais monter bien haut ni percer bien loin, pauvre, agitée, jamais sûre de son succès ni de son pain ; mais elle aura obéi à son instinct et coulé selon sa pente. C’est le vrai secret de bien des vies. Je vois que les vers, ne lui suffisent pas, et qu’elle commence à faire des romans. Elle m’a apporté celui-là la veille de mon départ.
10 heures
Voilà votre N°76. Oui, c’est une triste et charmante parole. Adieu. Je vous ai dit ce qu’il me semblait de la réponse à votre mari. J’y pense encore. Il est possible, ce me semble, d’exprimer une surprise très hautaine au fond et très douce dans la forme, une surprise fière et résignée, qui les fasse, non pas rougir, ce qui ne se peut pas, mais s’inquiéter un peu du jugement de cinq ou six personnes, si cela se peut. Adieu encore. G.
Val-Richer, Dimanche 27 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 27 Juillet 1851
Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.
Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.
Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.
Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.
Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "
Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.
Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.
Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.
Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.
Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.
Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "
Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.
195. Val-Richer, Mercredi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
195 Du Val Richer, Mercredi 12 juin 1839 4 heures
Je prends du plus grand papier. Il me semble que j’ai une infinité de choses à vous dire. Je vous en dis bien peu pourtant. M. et Mad. de Gasparin viennent de m’arriver avec M. Chabaud. Ils resteront jusqu'à samedi. Moi, je ne partirais que lundi. Rien ne m’attire à Paris, point de plaisir et peu d'affaires. Fort peu. La question d'Orient se refroidit. Les événements s'éloignent. On s'attend à peu de discussion. Thiers part demain pour conduire sa femme aux Pyrénées. Cependant je persiste à vouloir parler. La question, prochaine et point flagrante, est peut-être une raison de plus de parler ; elle est assez près pour qu’on y regarde et encore assez loin pour qu’on parle librement. La commission fera par l'organe de M. Jouffroy, un rapport savant et terne, une belle dissertation. Les Affaires Etrangères sont de toutes, à mon avis, celles sur lesquelles la parole séparée de l'action, a le moins de valeur. Elle tombe presque inévitablement dans la politique de café, ou de livre ; politique presque toujours arbitraire et futile, même la plus spirituelle. Les crédits demandés pour augmenter nos forces navales sur les côtes d'Espagne donneront peut-être lieu à un débat plus vif. On me mande que M. Molé veut les faire attaquer. Si le cabinet, dit-il, entend continuer l'ancienne politique, l’argent qu’il demande est inutile. S’il veut adopter une politique nouvelle et s’engager plus avant dans les Affaires d’Espagne, c’est dangereux. Si en faisant comme ses prédécesseurs, il veut seulement avoir l’air de faire plus qu'eux, on ne lui doit pas des millions pour qu’il se donne ce petit plaisir. En tout le cabinet ne gagne pas de terrain. Tout le monde le trouve petit et le lui témoigne, la Chambre des Pairs et M. Bresson. Cette démission de M. Bresson a été une affaire. Le Roi, dit-on, l’en a hautement approuvé. Et pour obtenir la réintégration de M. Legrand aux forêts, il a fallu que M. Passy menaçât de sa retraite. Je vous envoie toutes les pauvretés qui m’arrivent. Pourquoi pas ? Je vous les dirais. M. de Broglie a voulu conduire lui-même sa fille à Coppet. Je ne le trouverai donc pas à Paris. Mais il y sera de retour du 20 au 25 de ce mois, pour le procès, qui durera au moins quinze jours.
On m’appelle pour la promenade. Le temps est magnifique et la verdure aussi brillante que le soleil. Je n'aime pas à faire ce qui me plaît avec quelqu'un qui n’est pas vous. Adieu au moins.
Jeudi 6 heures
La lettre de votre grand Duc est une lettre d'enfant. Je suis toujours bien aise qu'il vous l’ait écrite, et qu'Orloff ait envie d'avoir votre réponse. Je suis curieux de savoir qu’elle sera la valeur des paroles de celui-ci. Vous dites toujours qu’il a de l'esprit. Nous verrons. J’espère bien que votre pauvre Castillon aura une course de courrier. J’insisterai jusqu'à ce qu’il en ait une. On me l’a promis et je graduerai mon humeur sur l'accomplissement de la promesse. Nous avons, aussi nos barbares, nos esprits grossiers quoique rusés qui feront toutes les platitudes du monde, et manqueront de bons procédés. Mais il faut le leur faire sentir. Je ne trouverai plus personne à Paris. Mad. de Rémusat est partie pour le Languedoc. Mad. de Boigne est à Chastenay. J'irai quelque fois. Si cela peut s’appeler aller à Chastenay ! Je reviendrai vers le 15 juillet.
Mes enfants sont ici d’un bonheur charmant à voir. Je les trouve déjà engraissés. Bien des fois dans le jour, je voudrais vous envoyer la société de ma petite Henriette. Elle vous calmerait en vous amusant. Je n’ai jamais vu une créature plus sereine, et plus animée. C’est la vie et l’ordre en personne. Jamais de trouble ni de langueur. Et ayant ce qui donne et justifie l'autorité, l’instinct naturel du commandement, et la disposition au dévouement. J'en jouis avec plus de tremblement que je ne veux me le dire à moi-même. Je ne me sens plus en état de résister à de nouveaux coups. Soignez-vous bien.
9 heures Je serai très bref. Le post-scriptum de votre n°194 me met dans une indignation que je ne veux pas comprimer. Je n’ai rien vu de pareil. Qu’avez-vous donc fait ? De quoi vos fils veulent-ils vous punir ? Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir mettre dans cet adieu tout ce que je ne dis pas, et de quoi vous faire oublier tout ce qui vous arrive. J’attends bien impatiemment une lettre de votre frère. G.
Je prends du plus grand papier. Il me semble que j’ai une infinité de choses à vous dire. Je vous en dis bien peu pourtant. M. et Mad. de Gasparin viennent de m’arriver avec M. Chabaud. Ils resteront jusqu'à samedi. Moi, je ne partirais que lundi. Rien ne m’attire à Paris, point de plaisir et peu d'affaires. Fort peu. La question d'Orient se refroidit. Les événements s'éloignent. On s'attend à peu de discussion. Thiers part demain pour conduire sa femme aux Pyrénées. Cependant je persiste à vouloir parler. La question, prochaine et point flagrante, est peut-être une raison de plus de parler ; elle est assez près pour qu’on y regarde et encore assez loin pour qu’on parle librement. La commission fera par l'organe de M. Jouffroy, un rapport savant et terne, une belle dissertation. Les Affaires Etrangères sont de toutes, à mon avis, celles sur lesquelles la parole séparée de l'action, a le moins de valeur. Elle tombe presque inévitablement dans la politique de café, ou de livre ; politique presque toujours arbitraire et futile, même la plus spirituelle. Les crédits demandés pour augmenter nos forces navales sur les côtes d'Espagne donneront peut-être lieu à un débat plus vif. On me mande que M. Molé veut les faire attaquer. Si le cabinet, dit-il, entend continuer l'ancienne politique, l’argent qu’il demande est inutile. S’il veut adopter une politique nouvelle et s’engager plus avant dans les Affaires d’Espagne, c’est dangereux. Si en faisant comme ses prédécesseurs, il veut seulement avoir l’air de faire plus qu'eux, on ne lui doit pas des millions pour qu’il se donne ce petit plaisir. En tout le cabinet ne gagne pas de terrain. Tout le monde le trouve petit et le lui témoigne, la Chambre des Pairs et M. Bresson. Cette démission de M. Bresson a été une affaire. Le Roi, dit-on, l’en a hautement approuvé. Et pour obtenir la réintégration de M. Legrand aux forêts, il a fallu que M. Passy menaçât de sa retraite. Je vous envoie toutes les pauvretés qui m’arrivent. Pourquoi pas ? Je vous les dirais. M. de Broglie a voulu conduire lui-même sa fille à Coppet. Je ne le trouverai donc pas à Paris. Mais il y sera de retour du 20 au 25 de ce mois, pour le procès, qui durera au moins quinze jours.
On m’appelle pour la promenade. Le temps est magnifique et la verdure aussi brillante que le soleil. Je n'aime pas à faire ce qui me plaît avec quelqu'un qui n’est pas vous. Adieu au moins.
Jeudi 6 heures
La lettre de votre grand Duc est une lettre d'enfant. Je suis toujours bien aise qu'il vous l’ait écrite, et qu'Orloff ait envie d'avoir votre réponse. Je suis curieux de savoir qu’elle sera la valeur des paroles de celui-ci. Vous dites toujours qu’il a de l'esprit. Nous verrons. J’espère bien que votre pauvre Castillon aura une course de courrier. J’insisterai jusqu'à ce qu’il en ait une. On me l’a promis et je graduerai mon humeur sur l'accomplissement de la promesse. Nous avons, aussi nos barbares, nos esprits grossiers quoique rusés qui feront toutes les platitudes du monde, et manqueront de bons procédés. Mais il faut le leur faire sentir. Je ne trouverai plus personne à Paris. Mad. de Rémusat est partie pour le Languedoc. Mad. de Boigne est à Chastenay. J'irai quelque fois. Si cela peut s’appeler aller à Chastenay ! Je reviendrai vers le 15 juillet.
Mes enfants sont ici d’un bonheur charmant à voir. Je les trouve déjà engraissés. Bien des fois dans le jour, je voudrais vous envoyer la société de ma petite Henriette. Elle vous calmerait en vous amusant. Je n’ai jamais vu une créature plus sereine, et plus animée. C’est la vie et l’ordre en personne. Jamais de trouble ni de langueur. Et ayant ce qui donne et justifie l'autorité, l’instinct naturel du commandement, et la disposition au dévouement. J'en jouis avec plus de tremblement que je ne veux me le dire à moi-même. Je ne me sens plus en état de résister à de nouveaux coups. Soignez-vous bien.
9 heures Je serai très bref. Le post-scriptum de votre n°194 me met dans une indignation que je ne veux pas comprimer. Je n’ai rien vu de pareil. Qu’avez-vous donc fait ? De quoi vos fils veulent-ils vous punir ? Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir mettre dans cet adieu tout ce que je ne dis pas, et de quoi vous faire oublier tout ce qui vous arrive. J’attends bien impatiemment une lettre de votre frère. G.
Val-Richer, Vendredi 1er août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Vendredi 1er août 1851
Je n’ai point Gladstone, et je ne puis, comme de raison, en écrire à Lord Aberdeen sans l'avoir lu. Ce que vous me dîtes de la grossièreté et de la violence du langage m'étonne. Peut-être m’a-t-il fait envoyer sa brochure, et est-elle chez moi, à Paris où je n’ai plus personne. Je vais écrire à Henriette d'aller y regarder.
Si les faits dont Gladstone m’a parlé sont vrais, ou seulement s’il y a beaucoup de vrai, je ne m'étonne pas qu'il les ait attaqués vivement. Mettre et retenir beaucoup de gens en prison, indéfiniment, sans les faire juger, sans même leur dire pourquoi, c’est ce qu’un Anglais comprend et excuse le moins.
Je reviens à vos 10,000 liv. st. Certainement, vous avez fait il y a un an, 18 mois, 2 ans, je ne me rappelle pas bien quelque chose à ce sujet, sur la question de savoir à qui les laisser et par qui les faire toucher, il y a eu hésitation, dans votre esprit, entre Couth et Rothschild. Je ne me rappelle pas comment s'est terminée votre hésitation. Mais la coïncidence du dire de Couth avec la perte de son reçu me porte à penser que c’est chez les Rothschild à Paris ou à Londres, que vous trouverez le terme de votre inquiétude. Je serai charmé quand je vous en saurai délivrée. Je ne puis croire que la perte soit réelle. Je conviens que ce serait, pour vous, un vif ennui. Je conviens aussi que si comme je l’espère, vous retrouvez vos titres, votre mémoire, aura été bien en défaut.
Il n’y a réellement plus d'assemblée à Paris. Légitimistes, Elyséens ou Montagnards, tous ne songent plus qu’à s'en aller. S’il n’arrive point d'événement pendant leur séparation, ce qui est probable, ils se retrouveront, à leur retour, plus embarrassés qu'aujourd’hui car ils seront plus pressés, et tout aussi impuissants. C’est un spectacle plus attristant qu'inquiétant, à mon avis ; je ne crois pas à un triomphe des rouges, le pays-ci ne sait pas se sauver, et ne se laissera pas perdre. Il faudrait un bien mauvais coup de dés électoral pour amener une majorité de Montagnard. C'est très peu probable. Cependant, c’est possible ; car aujourd’hui en France les élections sont un coup de dés. L'Empereur Français il avait raison : totus mundus stultisat. Voici, au fond, ma vraie inquiétude ; quand tout le monde est fou, c’est qu'il se prépare, dans le monde, des nouveautés prodigieuses par lesquelles Dieu veut, ou le transformer ou le punir. Je ne vois pas comment nous rentrerons dans des voies déjà connues. La sagesse elle-même sera nouvelle.
Onze heures
Je respire pour vous. Il est sûr que Couth est bien léger. Je retire mes souvenirs confus. Reste votre oubli du reçu. Mais peu importe. Adieu, Adieu. Dormez et remettez vos nerfs. Adieu. G.
Je n’ai point Gladstone, et je ne puis, comme de raison, en écrire à Lord Aberdeen sans l'avoir lu. Ce que vous me dîtes de la grossièreté et de la violence du langage m'étonne. Peut-être m’a-t-il fait envoyer sa brochure, et est-elle chez moi, à Paris où je n’ai plus personne. Je vais écrire à Henriette d'aller y regarder.
Si les faits dont Gladstone m’a parlé sont vrais, ou seulement s’il y a beaucoup de vrai, je ne m'étonne pas qu'il les ait attaqués vivement. Mettre et retenir beaucoup de gens en prison, indéfiniment, sans les faire juger, sans même leur dire pourquoi, c’est ce qu’un Anglais comprend et excuse le moins.
Je reviens à vos 10,000 liv. st. Certainement, vous avez fait il y a un an, 18 mois, 2 ans, je ne me rappelle pas bien quelque chose à ce sujet, sur la question de savoir à qui les laisser et par qui les faire toucher, il y a eu hésitation, dans votre esprit, entre Couth et Rothschild. Je ne me rappelle pas comment s'est terminée votre hésitation. Mais la coïncidence du dire de Couth avec la perte de son reçu me porte à penser que c’est chez les Rothschild à Paris ou à Londres, que vous trouverez le terme de votre inquiétude. Je serai charmé quand je vous en saurai délivrée. Je ne puis croire que la perte soit réelle. Je conviens que ce serait, pour vous, un vif ennui. Je conviens aussi que si comme je l’espère, vous retrouvez vos titres, votre mémoire, aura été bien en défaut.
Il n’y a réellement plus d'assemblée à Paris. Légitimistes, Elyséens ou Montagnards, tous ne songent plus qu’à s'en aller. S’il n’arrive point d'événement pendant leur séparation, ce qui est probable, ils se retrouveront, à leur retour, plus embarrassés qu'aujourd’hui car ils seront plus pressés, et tout aussi impuissants. C’est un spectacle plus attristant qu'inquiétant, à mon avis ; je ne crois pas à un triomphe des rouges, le pays-ci ne sait pas se sauver, et ne se laissera pas perdre. Il faudrait un bien mauvais coup de dés électoral pour amener une majorité de Montagnard. C'est très peu probable. Cependant, c’est possible ; car aujourd’hui en France les élections sont un coup de dés. L'Empereur Français il avait raison : totus mundus stultisat. Voici, au fond, ma vraie inquiétude ; quand tout le monde est fou, c’est qu'il se prépare, dans le monde, des nouveautés prodigieuses par lesquelles Dieu veut, ou le transformer ou le punir. Je ne vois pas comment nous rentrerons dans des voies déjà connues. La sagesse elle-même sera nouvelle.
Onze heures
Je respire pour vous. Il est sûr que Couth est bien léger. Je retire mes souvenirs confus. Reste votre oubli du reçu. Mais peu importe. Adieu, Adieu. Dormez et remettez vos nerfs. Adieu. G.
Brompton, Samedi 9 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Je suis tout-à-fait d'avis d'accepter ce que vous propose Lutteroth. C’est raisonnable, et si vous conservez la faculté de renoncer tous les ans, l’engagement n’est pas effrayant. Je me contenterais même s’il le fallait absolument de la faculté de renoncer la première année, au 15 avril pochain. Il est bien difficile que la question, de laquelle toutes les autres dépendent, ne soit pas décidée alors.
Je n'hésiterais pas non plus à demander aux Holland de ne pas chasser sur vos terres. C’est évidemment pour eux que Tanski négocie. Ils ne peuvent vous refuser. Vous pouvez, je pense donner latitude à Luttenoth jusqu'à 9000 fr. Adieu, adieu. Je vous écrivais. Je vais reprendre.
G. Samedi 9 sept.
Voici ma phrase sur votre procés. J’aime mieux vous envoyer la minute par Jean.
Je n'hésiterais pas non plus à demander aux Holland de ne pas chasser sur vos terres. C’est évidemment pour eux que Tanski négocie. Ils ne peuvent vous refuser. Vous pouvez, je pense donner latitude à Luttenoth jusqu'à 9000 fr. Adieu, adieu. Je vous écrivais. Je vais reprendre.
G. Samedi 9 sept.
Voici ma phrase sur votre procés. J’aime mieux vous envoyer la minute par Jean.
Mots-clés : Finances (Dorothée), Procès, Réseau social et politique
Lowestoft, Dimanche 20 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Lowestoft, Dimanche 20 Août 1848
Une heure
Je quitterai Lowestoft le vendredi 1 ou le samedi 2 septembre. Je n’ai pas voulu vous le dire avant d'en être sûr. J’arriverai à Brompton vers 7 heures du soir. Si vous étiez à Londres, je vous verrai le soir même. Mais à Richmond, je ne puis vous voir que le lendemain. Ainsi à Samedi 2 ou Dimanche 3. D’aujourd’hui en quinze, au plus tard. Oui, c’est bien long. Je regrette bien que votre fils soit parti. J’avais un peu espéré qu’il trainerait jusqu’à mon retour, ou bien près. Quel plaisir de vous retrouver !
Je ne crois pas à Pierre d’Aremberg, même doublé de Lady Palmerston. Si une telle issue est jamais possible, ce ne peut-être qu’après un bien plus long et bien plus mauvais chemin. Mettez les uns au bout des autres, tous les partis, qui sont contre, et mesurez ce qu’il faut pour qu’il s'en détache successivement de quoi grossir assez le parti pour. Je ne suis pas aussi éloigné d'admettre ce qu’on vous a dit de la Duchesse d'Orléans, et je me l'applique un peu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de ce qui lui a été répondu et conseillé de Claremont. - Ne pas décourager ; n'admettre, ni ne repousser. Il se peut qu’elle ait écrit dans ce sens. Vous voyez déjà paraître ces vanités de parti qui ont déjà fait et qui feront encore tant de mal à ces combinaisons- là. Pierre d’Aremberg veut que la Duchesse d'Orléans ait pris l'initiative. Le Roi m’a dit qu'elle avait reçu des ouvertures. C'est aussi ce que m’avait à peu près dit le duc de Noailles. Je n'ose vraiment pas apprécier, ce qu’il faudrait de temps et de malheur pour forcer les vanités et les impertinences mutuelles des deux partis à se subordonner à leur bon sens. Ils se seraient sauvés vingt fois, l’un et l'autre depuis 60 ans. S'ils avaient su le faire. Mais ils ont toujours mieux aimé être battus chacun à son tour que puissants ensemble. Je serai bien heureux et bien étonné si jamais ils se guérissent de cette sottise. Nous n'avons ni vous ni moi jamais vu un tournoi, et ces grands coups de lances émoussées qui faisaient la gloire des chevaliers et le plaisir des Dames. Les tournois de paroles ont remplacé les tournois de lances. Mais plus vif, plus brillant. Lord Palmerston est plus réfléchi, plus calculé. Je ne sais si les spectateurs se sont bien amusés ; mais à coup sûr les acteurs ne se sont pas fait grand mal. Et n'admirez-vous pas la badauderie du Journal des Débats qui n’a pas assez de termes pour louer Lord Palmerston ? Ce n’est pas tout-à-fait de la badauderie. Le Journal des Débats, et avec grande raison ne veut pas de la guerre et il sait très bon gré à Lord Palmerston de la main courtoise qu'il tend à la République pour l'aider à sortir du défilé où ses vanteries l'avaient engagée.
M. Reeve m'écrit : " Je suis allé à Hertford House, voir M. de Beaumont. Son langage est identique avec la politique qu’on a pratiquée avec succès pendant bien des années dans le même hôtel. En fait, ils ne trouvent rien de mieux à faire que ce que vous avez fait ; alliance anglaise, entente cordiale, politique modeste, tout y est, moins peut-être la bonne foi. Ils se soucient fort peu de l'Italie, mais uniquement des engagements d’honneur que la France a pris dans cette affaire et ils acceptent d'avance toute espèce de transaction."
L’Autriche peut ne consulter que sa propre sagesse et réduire la transaction au strict nécessaire. Pourvu qu'il y ait un air de transaction, on en passera par ce qu’elle voudra. Ce que vous a dit Lady Palmerston de M. de Beaumont est très vrai. Point du grand monde, ni grand esprit. Gentilhomme honnête et littéraire. Pas assez d’esprit pour avoir du bon sens d'avance. Assez de droiture pour en retrouver au dernier moment. De ceux qui ouvrent la porte aux coquins et aux fous, et qui essayent de les contenir quand ils les ont fait entrer. Il n’aura ni à Londres, ni à Paris point d'influence réelle ; il ne fera et n'empêchera rien ; mais c’est un nom décent sur ce qu’on fera. Voilà les pièces communiquées. Il faudra bien donner la fin après le commencement. Je penche toujours à croire à un débat avorté, à un vote insignifiant. A moins que la passion insolente de MM. Ledru Rollin. Louis Blanc et Caussidière ne force le parti modéré à enfoncer l'épée jusqu'à la garde. Ce ne sera pas Odilon Barrot qui le fera. Je doute que Thiers s'en mêle. Si le débat n’avorte pas, il en sortira, un gros événement.
J'ai bien de la peine à avoir un avis décidé sur la rue St Florentin. Cela me plairait que vous le gardassiez. J’aime les bonnes apparences. J'y crois même un peu. Mais vous m'avez dit que vous étiez ruinée, que vous dépassiez votre revenu. Ce sera une grosse charge. Rothschild abusera de votre envie. Et qui sait pour quel temps ? S'il ne vous demandait pas de faire un bail, s’il vous laissait l’appartement de six en six mois, ce serait plus praticable. Adieu. Adieu. En tout cas, j'aime que nous débattions cette question. Adieu. Je suis charmé que nous ayons un jour fixe.
Une heure
Je quitterai Lowestoft le vendredi 1 ou le samedi 2 septembre. Je n’ai pas voulu vous le dire avant d'en être sûr. J’arriverai à Brompton vers 7 heures du soir. Si vous étiez à Londres, je vous verrai le soir même. Mais à Richmond, je ne puis vous voir que le lendemain. Ainsi à Samedi 2 ou Dimanche 3. D’aujourd’hui en quinze, au plus tard. Oui, c’est bien long. Je regrette bien que votre fils soit parti. J’avais un peu espéré qu’il trainerait jusqu’à mon retour, ou bien près. Quel plaisir de vous retrouver !
Je ne crois pas à Pierre d’Aremberg, même doublé de Lady Palmerston. Si une telle issue est jamais possible, ce ne peut-être qu’après un bien plus long et bien plus mauvais chemin. Mettez les uns au bout des autres, tous les partis, qui sont contre, et mesurez ce qu’il faut pour qu’il s'en détache successivement de quoi grossir assez le parti pour. Je ne suis pas aussi éloigné d'admettre ce qu’on vous a dit de la Duchesse d'Orléans, et je me l'applique un peu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de ce qui lui a été répondu et conseillé de Claremont. - Ne pas décourager ; n'admettre, ni ne repousser. Il se peut qu’elle ait écrit dans ce sens. Vous voyez déjà paraître ces vanités de parti qui ont déjà fait et qui feront encore tant de mal à ces combinaisons- là. Pierre d’Aremberg veut que la Duchesse d'Orléans ait pris l'initiative. Le Roi m’a dit qu'elle avait reçu des ouvertures. C'est aussi ce que m’avait à peu près dit le duc de Noailles. Je n'ose vraiment pas apprécier, ce qu’il faudrait de temps et de malheur pour forcer les vanités et les impertinences mutuelles des deux partis à se subordonner à leur bon sens. Ils se seraient sauvés vingt fois, l’un et l'autre depuis 60 ans. S'ils avaient su le faire. Mais ils ont toujours mieux aimé être battus chacun à son tour que puissants ensemble. Je serai bien heureux et bien étonné si jamais ils se guérissent de cette sottise. Nous n'avons ni vous ni moi jamais vu un tournoi, et ces grands coups de lances émoussées qui faisaient la gloire des chevaliers et le plaisir des Dames. Les tournois de paroles ont remplacé les tournois de lances. Mais plus vif, plus brillant. Lord Palmerston est plus réfléchi, plus calculé. Je ne sais si les spectateurs se sont bien amusés ; mais à coup sûr les acteurs ne se sont pas fait grand mal. Et n'admirez-vous pas la badauderie du Journal des Débats qui n’a pas assez de termes pour louer Lord Palmerston ? Ce n’est pas tout-à-fait de la badauderie. Le Journal des Débats, et avec grande raison ne veut pas de la guerre et il sait très bon gré à Lord Palmerston de la main courtoise qu'il tend à la République pour l'aider à sortir du défilé où ses vanteries l'avaient engagée.
M. Reeve m'écrit : " Je suis allé à Hertford House, voir M. de Beaumont. Son langage est identique avec la politique qu’on a pratiquée avec succès pendant bien des années dans le même hôtel. En fait, ils ne trouvent rien de mieux à faire que ce que vous avez fait ; alliance anglaise, entente cordiale, politique modeste, tout y est, moins peut-être la bonne foi. Ils se soucient fort peu de l'Italie, mais uniquement des engagements d’honneur que la France a pris dans cette affaire et ils acceptent d'avance toute espèce de transaction."
L’Autriche peut ne consulter que sa propre sagesse et réduire la transaction au strict nécessaire. Pourvu qu'il y ait un air de transaction, on en passera par ce qu’elle voudra. Ce que vous a dit Lady Palmerston de M. de Beaumont est très vrai. Point du grand monde, ni grand esprit. Gentilhomme honnête et littéraire. Pas assez d’esprit pour avoir du bon sens d'avance. Assez de droiture pour en retrouver au dernier moment. De ceux qui ouvrent la porte aux coquins et aux fous, et qui essayent de les contenir quand ils les ont fait entrer. Il n’aura ni à Londres, ni à Paris point d'influence réelle ; il ne fera et n'empêchera rien ; mais c’est un nom décent sur ce qu’on fera. Voilà les pièces communiquées. Il faudra bien donner la fin après le commencement. Je penche toujours à croire à un débat avorté, à un vote insignifiant. A moins que la passion insolente de MM. Ledru Rollin. Louis Blanc et Caussidière ne force le parti modéré à enfoncer l'épée jusqu'à la garde. Ce ne sera pas Odilon Barrot qui le fera. Je doute que Thiers s'en mêle. Si le débat n’avorte pas, il en sortira, un gros événement.
J'ai bien de la peine à avoir un avis décidé sur la rue St Florentin. Cela me plairait que vous le gardassiez. J’aime les bonnes apparences. J'y crois même un peu. Mais vous m'avez dit que vous étiez ruinée, que vous dépassiez votre revenu. Ce sera une grosse charge. Rothschild abusera de votre envie. Et qui sait pour quel temps ? S'il ne vous demandait pas de faire un bail, s’il vous laissait l’appartement de six en six mois, ce serait plus praticable. Adieu. Adieu. En tout cas, j'aime que nous débattions cette question. Adieu. Je suis charmé que nous ayons un jour fixe.
192. Val-Richer, Jeudi 6 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
192 Du Val Richer, jeudi 6 juin 1839 2 heures
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
315. Val-Richer, Lundi 11 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
315 Du Val Richer. Lundi 11 Novembre 1839
7 heures et demie
Enfin, nous voilà dans la bonne semaine. Car je suis de ceux qui regardent le Dimanche comme le dernier jour de la semaine. Après demain, je serai en route vers vous. Et vers vous définitivement établie chez vous, en France chez moi. Quelle inextinguible soif du définitif dans notre âme ! Il nous fuit toujours et nous le poursuivons toujours. Sans qu'aucun mécompte parvienne à dissiper notre illusion et à lasser notre désir. N'est-ce pas c’est définitif ? Si je n'y croyais pas un peu, je ne jouirai de rien. Si j’en étais tout-à-fait sûr, tout serait ravissant. Dites-moi que c’est sûr. Me direz-vous, quand j’entrerai que vous vous portez bien ? Vous êtes certainement mieux que vous n'étiez en arrivant de Baden. Je n’ai personne à vous donner pour vos affaires. Et puis cela ne servirait à rien. Il faudrait bien qu’on vous en parlât quelque fois, et vous vous en occuperiez, vous vous en préoccuperiez tout autant qu’à présent. Au fait, elles vont finir. Vous tenez le dernier de ces ennuis. Une fois le capital de Londres, partagé votre argent venu de Pétersbourg et placé, vous n'aurez plus de débat à soutenir ni de question à résoudre. Vous ferez vos affaires toute seule, ou plutôt, elles se feront toutes seules. Voilà un coup de soleil charmant sur la vallée jaune et verte variée de toutes les nuances de l’automne. Il n'y a de charmant que la grande route.
10 heures
Si vous aviez la moindre expérience de ces choses là, vous sauriez qu’en province, on ne s'assure pas d’une voiture, le jour où on veut. J’ai eu tort de vous dire que je parlais le 12. Dès que je m’y suis décidé. J’aurais dû attendre que la voiture me fût assurée. Une autre fois, je serai plus réservé. Mais je ne veux pas vous rendre votre gronderie. Je suis un hypocrite, car la voilà rendue. Le droit est pour vous, sans nul doute, pour la vaisselle, et je suis d’avis du fait. Demandez sans hésiter, votre part immédiates, en nature, ou en argent. Ici cela ne ferait pas un pli, à Pétersbourg, je ne sais pas. Pourtant il me paraît impossible qu’on ne vous fasse pas droit. C’est inconcevable, inconcevable. Servez-vous du capital anglais. C’est votre arme, arme bien innocente à côté de celles qu'on emploie contre vous. Mais ici, j'espère qu’elle sera efficace. Je ne serai jamais assez étonné de tels procédés. Adieu. Vous avez fort contribué à rendre toutes mes paroles exactes. Vous m'apprendrez aussi à ne rien dire d'avance. Adieu, pourtant à jeudi. Adieu. G.
7 heures et demie
Enfin, nous voilà dans la bonne semaine. Car je suis de ceux qui regardent le Dimanche comme le dernier jour de la semaine. Après demain, je serai en route vers vous. Et vers vous définitivement établie chez vous, en France chez moi. Quelle inextinguible soif du définitif dans notre âme ! Il nous fuit toujours et nous le poursuivons toujours. Sans qu'aucun mécompte parvienne à dissiper notre illusion et à lasser notre désir. N'est-ce pas c’est définitif ? Si je n'y croyais pas un peu, je ne jouirai de rien. Si j’en étais tout-à-fait sûr, tout serait ravissant. Dites-moi que c’est sûr. Me direz-vous, quand j’entrerai que vous vous portez bien ? Vous êtes certainement mieux que vous n'étiez en arrivant de Baden. Je n’ai personne à vous donner pour vos affaires. Et puis cela ne servirait à rien. Il faudrait bien qu’on vous en parlât quelque fois, et vous vous en occuperiez, vous vous en préoccuperiez tout autant qu’à présent. Au fait, elles vont finir. Vous tenez le dernier de ces ennuis. Une fois le capital de Londres, partagé votre argent venu de Pétersbourg et placé, vous n'aurez plus de débat à soutenir ni de question à résoudre. Vous ferez vos affaires toute seule, ou plutôt, elles se feront toutes seules. Voilà un coup de soleil charmant sur la vallée jaune et verte variée de toutes les nuances de l’automne. Il n'y a de charmant que la grande route.
10 heures
Si vous aviez la moindre expérience de ces choses là, vous sauriez qu’en province, on ne s'assure pas d’une voiture, le jour où on veut. J’ai eu tort de vous dire que je parlais le 12. Dès que je m’y suis décidé. J’aurais dû attendre que la voiture me fût assurée. Une autre fois, je serai plus réservé. Mais je ne veux pas vous rendre votre gronderie. Je suis un hypocrite, car la voilà rendue. Le droit est pour vous, sans nul doute, pour la vaisselle, et je suis d’avis du fait. Demandez sans hésiter, votre part immédiates, en nature, ou en argent. Ici cela ne ferait pas un pli, à Pétersbourg, je ne sais pas. Pourtant il me paraît impossible qu’on ne vous fasse pas droit. C’est inconcevable, inconcevable. Servez-vous du capital anglais. C’est votre arme, arme bien innocente à côté de celles qu'on emploie contre vous. Mais ici, j'espère qu’elle sera efficace. Je ne serai jamais assez étonné de tels procédés. Adieu. Vous avez fort contribué à rendre toutes mes paroles exactes. Vous m'apprendrez aussi à ne rien dire d'avance. Adieu, pourtant à jeudi. Adieu. G.
193. Val-Richer, Samedi 8 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
193 Du Val-Richer, Samedi 8 juin 1839 2 heures
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
314. Val-Richer, Dimanche 10 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
314 Du Val-Richer Dimanche 10 Nov. 1839
8 heures
Vous n’avez pas d’idée de l'activité qui règne dans cette maison. Je plante un bois ; je fais un chemin. Je redresse des allées. Je sème des fleurs pour l’été prochain. Et mon factotum est encore dans son lit. Ce n'est rien de grave. Mais il ne sera sur pied et bon à quelque chose que lorsque je serai parti. J'admire quel air d’importance et d'entrain on peut mettre à des choses dont on se soucie si peu. Les soins et les agréments de la vie extérieure sont charmants dans le bonheur ; mais il n’y a pas moyen d'en faire le bonheur même. Je ne l’ai jamais cru, ni tenté.
A part son chagrin, le Chancelier doit avoir bien de l'humeur autant qu’il peut en avoir. On ne lui a pas envoyé une levée de Pairs bien éclatante. On a en pourtant bien de la peine à se mettre d'accord sur ces vingt noms. Le Roi a livré une grande bataille pour M. Viermet le plus ridicule des hommes de courage. Il ne l’a emporté que la veille du Moniteur, à 10 heures du soir. Enfin il l’a emporté, tandis que le Chancelier a été battu sur M. Etienne, dont il ne voulait pas. Que disent les Granville, que dit surtout Bulwer des Affaires d'Espagne ? L'Angleterre reste-t-elle là à la tête des radicaux ? Poursuivra-t-elle sa rivalité d'influence avec nous ? Je reprends intérêt à l’Espagne. J’ai recommencé depuis que je connais Zéa. En lui, pour la première fois, j’ai entrevu un homme au delà des Pyrénées. Evidemment, il y a là, dans ce moment quelque chose à faire. Bien difficile ; mais la difficulté dans la possibilité, il n’y a que cela qui vaille la peine qu’on y mette la main. Je ne comprends pas pourquoi vos caisses arrivées au Havre, ne sont pas depuis longtemps à Paris. Ce n’est qu'un ordre d'expédition à donner. Quelque grand serment que soit Rothschild, il peut faire cela, sans déroger.
9 heures et demie
Vous serez ce matin aussi contrarié que moi du jeudi au lieu du mercredi. Pas plus, je vous en réponds. Je ne vous dirai qu’une chose. Finissez avec vos fils. Il faut absolument qu’ils vous donnent, en échange du leur part du capital anglais, l’ordre à Bruxner de vous envoyer ce qui vous appartient. Je ne comprends pas comment ils ont pu l’empêcher, comment Bruxner, s'est laissé interdire par eux ce qu’il était de son devoir de vous envoyer sur le champ. Mais tout cela est si étrange, hommes, choses, procédés, pays que je ne compte sur rien et ne m'étonne de rien. Pourquoi ne chargeriez-vous pas Cumming de cela comme du reste ? Il en sait assez pour que cela de plus ou de moins ait bien peu d'importance. Mais sans aucun doute, ordre pour ordre, argent pour argent. Je suis affligé, blessé, irrité, humilié de tout cela. Adieu. Adieu. Au moins vous n'avez plus d'inquiétude. Adieu Dearest. G.
8 heures
Vous n’avez pas d’idée de l'activité qui règne dans cette maison. Je plante un bois ; je fais un chemin. Je redresse des allées. Je sème des fleurs pour l’été prochain. Et mon factotum est encore dans son lit. Ce n'est rien de grave. Mais il ne sera sur pied et bon à quelque chose que lorsque je serai parti. J'admire quel air d’importance et d'entrain on peut mettre à des choses dont on se soucie si peu. Les soins et les agréments de la vie extérieure sont charmants dans le bonheur ; mais il n’y a pas moyen d'en faire le bonheur même. Je ne l’ai jamais cru, ni tenté.
A part son chagrin, le Chancelier doit avoir bien de l'humeur autant qu’il peut en avoir. On ne lui a pas envoyé une levée de Pairs bien éclatante. On a en pourtant bien de la peine à se mettre d'accord sur ces vingt noms. Le Roi a livré une grande bataille pour M. Viermet le plus ridicule des hommes de courage. Il ne l’a emporté que la veille du Moniteur, à 10 heures du soir. Enfin il l’a emporté, tandis que le Chancelier a été battu sur M. Etienne, dont il ne voulait pas. Que disent les Granville, que dit surtout Bulwer des Affaires d'Espagne ? L'Angleterre reste-t-elle là à la tête des radicaux ? Poursuivra-t-elle sa rivalité d'influence avec nous ? Je reprends intérêt à l’Espagne. J’ai recommencé depuis que je connais Zéa. En lui, pour la première fois, j’ai entrevu un homme au delà des Pyrénées. Evidemment, il y a là, dans ce moment quelque chose à faire. Bien difficile ; mais la difficulté dans la possibilité, il n’y a que cela qui vaille la peine qu’on y mette la main. Je ne comprends pas pourquoi vos caisses arrivées au Havre, ne sont pas depuis longtemps à Paris. Ce n’est qu'un ordre d'expédition à donner. Quelque grand serment que soit Rothschild, il peut faire cela, sans déroger.
9 heures et demie
Vous serez ce matin aussi contrarié que moi du jeudi au lieu du mercredi. Pas plus, je vous en réponds. Je ne vous dirai qu’une chose. Finissez avec vos fils. Il faut absolument qu’ils vous donnent, en échange du leur part du capital anglais, l’ordre à Bruxner de vous envoyer ce qui vous appartient. Je ne comprends pas comment ils ont pu l’empêcher, comment Bruxner, s'est laissé interdire par eux ce qu’il était de son devoir de vous envoyer sur le champ. Mais tout cela est si étrange, hommes, choses, procédés, pays que je ne compte sur rien et ne m'étonne de rien. Pourquoi ne chargeriez-vous pas Cumming de cela comme du reste ? Il en sait assez pour que cela de plus ou de moins ait bien peu d'importance. Mais sans aucun doute, ordre pour ordre, argent pour argent. Je suis affligé, blessé, irrité, humilié de tout cela. Adieu. Adieu. Au moins vous n'avez plus d'inquiétude. Adieu Dearest. G.
231. Baden, Samedi 3 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
231. Baden Samedi le 3 août 1839
Il me semble que vos nouvelles d’Orient ne se confirment pas. Je voudrais bien savoir le vrai de l’affaire du Capitaine Pacha. Dites-moi ce que vous saurez, mais il faut que cela vienne de source. Nous avons envoyé un complémentaire au nouveau Sultan, un comte Rzvonsky, que je connais beaucoup. Je le faisais venir le soir chez moi quand j'habitais Czarkoislo il me divertissait en débitant bien des mensonges, des contes de revenants surtout. Il pourra rapporter bien des contes sur l'Orient. Ibrahim poursuit ses triomphes. Des lettres de Constantinople du 20 annoncent sa marche sur Koniah, que va faire le divan ? à qui demandera-t-il secours ? Voici que la confusion commence. un courrier arrivé à Darmstadt porte le consentement de l’Empereur au mariage. On y enverra une ambassade pour la demande formelle. On continue en Allemagne à exprimer le plus grand étonnement de ce choix.
La princesse Meschersky va rester à Bade, j'en suis bien aise ; c’est une ressource lorsqu'il n’y a pas mieux.
5 heures.
Quelle lettre que ce N°230 et combien de fois je vais la relire ! Que je vous en remercie ! Je viens de recevoir une lettre de Bulner de Paris, il me dit que Khosrew Pacha le présent grand vizir est le seul homme habile et ferme en Turquie, qu’il est fort dévoué à la famille du Sultan mais qu'il pourrait bien la vendre aussi si on le payait cher. Méhémet Ali demande le renvoi du grand Vizir et l'hérédité de son gouvernement en Syrie, Egypte et ce troisième nom indéchiffrable. Bulwer croit à la nomination de l'Égyptien. Il connait bien tout cela il y a été longtemps. Le Sultan actuel is devoted to the ladies, a black dwarf and 2 monkeys. The Dwarf being the prime favorite.
Bulwer a écrit à Paul mais il n'a pas eu de réponse, et craint qu’il n’en aura pas. Vous dirai-je ce que je pense ? Si notre consul à Londres a raison, Paul en reviendra, et ce n’est que pour cela que j’aurai quelque plaisir a est accroissement inattendu de fortune. Au reste je n'y compte pas du tout et je fais tous mes calculs sur les lois russes. Il faut que je voie moi-même l'hôtel de la rue Bellechasse. Si je ne me trompe il est rebâti à neuf on n’y a pas habité encore, il y aurait du danger peut-être, je serai à Paris au commencement de septembre au plus tard et je choisirai. J’ai écrit pour l'appartement de Jennison. Je n’ai pas de réponse Adieu. Adieu, bien tendrement.
Il me semble que vos nouvelles d’Orient ne se confirment pas. Je voudrais bien savoir le vrai de l’affaire du Capitaine Pacha. Dites-moi ce que vous saurez, mais il faut que cela vienne de source. Nous avons envoyé un complémentaire au nouveau Sultan, un comte Rzvonsky, que je connais beaucoup. Je le faisais venir le soir chez moi quand j'habitais Czarkoislo il me divertissait en débitant bien des mensonges, des contes de revenants surtout. Il pourra rapporter bien des contes sur l'Orient. Ibrahim poursuit ses triomphes. Des lettres de Constantinople du 20 annoncent sa marche sur Koniah, que va faire le divan ? à qui demandera-t-il secours ? Voici que la confusion commence. un courrier arrivé à Darmstadt porte le consentement de l’Empereur au mariage. On y enverra une ambassade pour la demande formelle. On continue en Allemagne à exprimer le plus grand étonnement de ce choix.
La princesse Meschersky va rester à Bade, j'en suis bien aise ; c’est une ressource lorsqu'il n’y a pas mieux.
5 heures.
Quelle lettre que ce N°230 et combien de fois je vais la relire ! Que je vous en remercie ! Je viens de recevoir une lettre de Bulner de Paris, il me dit que Khosrew Pacha le présent grand vizir est le seul homme habile et ferme en Turquie, qu’il est fort dévoué à la famille du Sultan mais qu'il pourrait bien la vendre aussi si on le payait cher. Méhémet Ali demande le renvoi du grand Vizir et l'hérédité de son gouvernement en Syrie, Egypte et ce troisième nom indéchiffrable. Bulwer croit à la nomination de l'Égyptien. Il connait bien tout cela il y a été longtemps. Le Sultan actuel is devoted to the ladies, a black dwarf and 2 monkeys. The Dwarf being the prime favorite.
Bulwer a écrit à Paul mais il n'a pas eu de réponse, et craint qu’il n’en aura pas. Vous dirai-je ce que je pense ? Si notre consul à Londres a raison, Paul en reviendra, et ce n’est que pour cela que j’aurai quelque plaisir a est accroissement inattendu de fortune. Au reste je n'y compte pas du tout et je fais tous mes calculs sur les lois russes. Il faut que je voie moi-même l'hôtel de la rue Bellechasse. Si je ne me trompe il est rebâti à neuf on n’y a pas habité encore, il y aurait du danger peut-être, je serai à Paris au commencement de septembre au plus tard et je choisirai. J’ai écrit pour l'appartement de Jennison. Je n’ai pas de réponse Adieu. Adieu, bien tendrement.
229. Baden, Jeudi 1er août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
229 Baden jeudi le 1er août 1839
Vous m'avez écrit une lettre des plus intéressantes par les nouvelles que vous me donnez. Si ce que vous me dites sur l'Orient se confirme, si Méhémet Ali va non pas régner, mais gouverner à Constantinople ce sera certainement le dévouement le plus inattendu, le moins désiré par nous, qu'il soit possible de concevoir. Et si c’est M. de Metternich qui a tramé cela et sera son coup le plus habile. Mais je ne crois pas encore. Comment Méhémet irait-il se livrer, livrer sa tête à moins. d’être maître absolu du terrain, ce qu’il ne peut pas être. Tout cela est fort curieux à observer. Et j'en suis fort curieuse. Le projet électoral de la gauche me semble bien démocratique ! Je vous remercie beaucoup de toutes ces notions. Les premières surtout m’intéressent au plus haut degré. Continuez car aujourd’hui que j’ai perdu M. de Malzahn je suis peu informée à moins ce que vous me donnerez.
Ma nièce Meschersky est arrivée pour passer quelques jours avec moi. Il y a d’autres personnes venues aussi mais rien qui me plaise ou me convienne. En Anglais de peines de ménage bien frivoles. La petite Madame Wellesley se retire beaucoup de cela vu les journaux j'y gagne, car je le vois davantage et elle est gentille.
4 heures. Je vous envoie copie d’une partie de la lettre que j'ai reçu hier de notre consul général à Londres, auquel j'avais simplement demandé d’apprendre l’exact montant du capital. Cette réponse m'a beaucoup surprise. Je lui ai écrit de suite pour lui dire que je doutais beau coup que la loi anglaise pût s'appliquer dans ce cas ci à une étrangère et que je ne ferais aucune démarche jusqu’à ce que j'ai acquis la certitude la plus complète que je me trouve sous la régie de cette loi. Qu’en pensez-vous ? Cela me parait bien singulier ! Quelles seraient vos lois en France dans un cas pareil ? Imaginez que j'ai encore eu toute une matinée de notaires. Le premier plein pouvoir n’était pas suffisant ( celui d'avant hier) il a fallu tout recommencer. Je suis excédée de ces affaires. Que j'aime à vous entendre dire que vous êtes seul. Quel égoïsme ! mais cette affection est si égoïste. Il n'y en a qu’une qui ne le soit pas. Mes enfants ! J'étais heureuse de leur bonheur quand même il ne leur venait pas de moi. Mais vous, je veux qu’il vous manque quelque chose, et beaucoup. Adieu. Adieu.
Vous m'avez écrit une lettre des plus intéressantes par les nouvelles que vous me donnez. Si ce que vous me dites sur l'Orient se confirme, si Méhémet Ali va non pas régner, mais gouverner à Constantinople ce sera certainement le dévouement le plus inattendu, le moins désiré par nous, qu'il soit possible de concevoir. Et si c’est M. de Metternich qui a tramé cela et sera son coup le plus habile. Mais je ne crois pas encore. Comment Méhémet irait-il se livrer, livrer sa tête à moins. d’être maître absolu du terrain, ce qu’il ne peut pas être. Tout cela est fort curieux à observer. Et j'en suis fort curieuse. Le projet électoral de la gauche me semble bien démocratique ! Je vous remercie beaucoup de toutes ces notions. Les premières surtout m’intéressent au plus haut degré. Continuez car aujourd’hui que j’ai perdu M. de Malzahn je suis peu informée à moins ce que vous me donnerez.
Ma nièce Meschersky est arrivée pour passer quelques jours avec moi. Il y a d’autres personnes venues aussi mais rien qui me plaise ou me convienne. En Anglais de peines de ménage bien frivoles. La petite Madame Wellesley se retire beaucoup de cela vu les journaux j'y gagne, car je le vois davantage et elle est gentille.
4 heures. Je vous envoie copie d’une partie de la lettre que j'ai reçu hier de notre consul général à Londres, auquel j'avais simplement demandé d’apprendre l’exact montant du capital. Cette réponse m'a beaucoup surprise. Je lui ai écrit de suite pour lui dire que je doutais beau coup que la loi anglaise pût s'appliquer dans ce cas ci à une étrangère et que je ne ferais aucune démarche jusqu’à ce que j'ai acquis la certitude la plus complète que je me trouve sous la régie de cette loi. Qu’en pensez-vous ? Cela me parait bien singulier ! Quelles seraient vos lois en France dans un cas pareil ? Imaginez que j'ai encore eu toute une matinée de notaires. Le premier plein pouvoir n’était pas suffisant ( celui d'avant hier) il a fallu tout recommencer. Je suis excédée de ces affaires. Que j'aime à vous entendre dire que vous êtes seul. Quel égoïsme ! mais cette affection est si égoïste. Il n'y en a qu’une qui ne le soit pas. Mes enfants ! J'étais heureuse de leur bonheur quand même il ne leur venait pas de moi. Mais vous, je veux qu’il vous manque quelque chose, et beaucoup. Adieu. Adieu.
228. Baden, Mardi 30 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
228 Baden 11 heures. Mardi 30 juillet 1839
Imaginez que c'est devant un notaire et deux témoins que je vous écris, et que c’est le seul moment que je trouve pour le faire.
9 heures.
Voyez, je n’en puis plus de fatigue. Pour un pauvre papier de 20 lignes, j’ai été tracassé tout hier et aujourd’hui. On me demande de nouveaux plein pouvoirs pour terminer. Mon frère m'écrit sur cela très simplement et très bien. Matonchewitz pas bien du tout. Il est comme disent les Anglais, lit by Paul. Celui qui parle à toujours l’avantage sur celui qui écrit. Cela m’a tracassée, et vous savez que je n’ai pas besoin de cela de plus. Mon fils Alexandre, une lettre insignifiante comme les autres. Mon frère me mande que mes fils sont pressés de finir et de reprendre leur service. j'imagine donc qu’aussi tôt l’arrivée de mon plein pouvoir tout sera arrangé. Je le saurai dans quatre semaines.
En attendant ma santé ne va pas mieux et ma correspondance avec vous bien mal. Il y a dans tout moi un découragement, une langueur que je ne puis pas vous décrire. Baden a été pour moi très mauvais et j’y reste je ne sais pourquoi ou plutôt je le sais, c’est que je ne sais où aller pour être mieux. Tout est mal pour moi. Il y a de ma faute sans doute et je me prends en grande aversion. Votre lettre hier m'a fait plaisir. Je n'ai rien à vous dire qui puisse vous intéresser. Vous voyez comme j’ai l’esprit occupé de désagréables affaires, c’est si aride, si vous étiez là pour m'aider ; me ranimer ah mon Dieu que je serais une autre personne. Adieu. Adieu et pardonnez-moi. Je suis si fatiguée, si abîmée. Adieu.
Imaginez que c'est devant un notaire et deux témoins que je vous écris, et que c’est le seul moment que je trouve pour le faire.
9 heures.
Voyez, je n’en puis plus de fatigue. Pour un pauvre papier de 20 lignes, j’ai été tracassé tout hier et aujourd’hui. On me demande de nouveaux plein pouvoirs pour terminer. Mon frère m'écrit sur cela très simplement et très bien. Matonchewitz pas bien du tout. Il est comme disent les Anglais, lit by Paul. Celui qui parle à toujours l’avantage sur celui qui écrit. Cela m’a tracassée, et vous savez que je n’ai pas besoin de cela de plus. Mon fils Alexandre, une lettre insignifiante comme les autres. Mon frère me mande que mes fils sont pressés de finir et de reprendre leur service. j'imagine donc qu’aussi tôt l’arrivée de mon plein pouvoir tout sera arrangé. Je le saurai dans quatre semaines.
En attendant ma santé ne va pas mieux et ma correspondance avec vous bien mal. Il y a dans tout moi un découragement, une langueur que je ne puis pas vous décrire. Baden a été pour moi très mauvais et j’y reste je ne sais pourquoi ou plutôt je le sais, c’est que je ne sais où aller pour être mieux. Tout est mal pour moi. Il y a de ma faute sans doute et je me prends en grande aversion. Votre lettre hier m'a fait plaisir. Je n'ai rien à vous dire qui puisse vous intéresser. Vous voyez comme j’ai l’esprit occupé de désagréables affaires, c’est si aride, si vous étiez là pour m'aider ; me ranimer ah mon Dieu que je serais une autre personne. Adieu. Adieu et pardonnez-moi. Je suis si fatiguée, si abîmée. Adieu.
233. Baden, Lundi 5 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
233. Baden Lundi 5 août 1839
Montrond est arrivé hier, inquiet de trouver un lit et un dîner. Baden est si plein qu’il n'y a plus de logement. Son ami M. Benazet y pourvoira je suppose. Je l’ai vu hier soir en passant, mais ce matin à 7 heures il était chez moi. Il vient de Plombières. Il y a laissé M. Molé en espérances et sa belle santé. M. Cousin rempli d’éloges du roi et en grande assurance de l'entrée de Thiers. Lui Montrond croit que le Roi a envie de vous et de Thiers ensemble, mais probable ment le plus tard possible. Le gouvernement russe vient d’ordonner qu’il n’y aura plus que l’argent. En espèce qui aura cours chez nous. Dites-moi si cette mesure favorise les transactions à l’étranger, c.a.d. si c’est un bon moment pour faire passer mois argent en France ou en Angleterre. Je voudrais bien vous consulter sur divers choses mais vous êtes trop loin. On est toujours trop loin quand on n’est pas tout près.
Il faut que j’achève aujourd’hui mon roman de Félix. Après m’avoir fait la Déclaration d’hier il est allé se coucher, il n’a reparu que ce matin. Il était parfaitement ivre. Moi qui n’ai aucune connaissance de ces cas là, je croyais le pauvre homme fou. Pépin m’a éclairée. Le coupable est revenu en pénitent. J’ai dit de belles choses bien grave ment, sans rire, car ordinairement sa mine me fait rire, et tout est oublié, mais l’idée de perdre Félix avait gâté ma nuit. Et voilà comment j’ai toujours des soucis. Pardonnez-moi ma distraction des feuilles de cette lettre. Je ne suis pas ivre cependant. Il pleut ce matin ; hier il faisait superbe. J'ai eu hier une longue visite de Lady Chesterfield. Elle est un peu bête, un peu jolie, un peu ruiné. Je la connaissais fort peu en Angleterre, mais il est d'usage pour les Anglais de venir tout de suite chez moi, comme les vrais catholiques vont saluer les images dans les lieux saints
1 heures
Je viens de rencontrer un Rotschild s’en retournant à Paris que j'ai chargé d’arrêter pour moi le premier de l’hôtel Talleyrand. Si le prix n’est pas au dessus de 12 milles francs ou l’entresol pour 8 milles c.a.d. qu'il me rendra compte encore de tout cela et des arrangements à prendre. Au fond c’est la situation la plus agréable . Si le consul général de Londres a raison, le premier ne sera pas trop cher. Et s'il se trompe, j’ai de quoi fournir à l’entresol. Il me survient une affaire importante. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Demain vous serez ce que c’est.
Montrond est arrivé hier, inquiet de trouver un lit et un dîner. Baden est si plein qu’il n'y a plus de logement. Son ami M. Benazet y pourvoira je suppose. Je l’ai vu hier soir en passant, mais ce matin à 7 heures il était chez moi. Il vient de Plombières. Il y a laissé M. Molé en espérances et sa belle santé. M. Cousin rempli d’éloges du roi et en grande assurance de l'entrée de Thiers. Lui Montrond croit que le Roi a envie de vous et de Thiers ensemble, mais probable ment le plus tard possible. Le gouvernement russe vient d’ordonner qu’il n’y aura plus que l’argent. En espèce qui aura cours chez nous. Dites-moi si cette mesure favorise les transactions à l’étranger, c.a.d. si c’est un bon moment pour faire passer mois argent en France ou en Angleterre. Je voudrais bien vous consulter sur divers choses mais vous êtes trop loin. On est toujours trop loin quand on n’est pas tout près.
Il faut que j’achève aujourd’hui mon roman de Félix. Après m’avoir fait la Déclaration d’hier il est allé se coucher, il n’a reparu que ce matin. Il était parfaitement ivre. Moi qui n’ai aucune connaissance de ces cas là, je croyais le pauvre homme fou. Pépin m’a éclairée. Le coupable est revenu en pénitent. J’ai dit de belles choses bien grave ment, sans rire, car ordinairement sa mine me fait rire, et tout est oublié, mais l’idée de perdre Félix avait gâté ma nuit. Et voilà comment j’ai toujours des soucis. Pardonnez-moi ma distraction des feuilles de cette lettre. Je ne suis pas ivre cependant. Il pleut ce matin ; hier il faisait superbe. J'ai eu hier une longue visite de Lady Chesterfield. Elle est un peu bête, un peu jolie, un peu ruiné. Je la connaissais fort peu en Angleterre, mais il est d'usage pour les Anglais de venir tout de suite chez moi, comme les vrais catholiques vont saluer les images dans les lieux saints
1 heures
Je viens de rencontrer un Rotschild s’en retournant à Paris que j'ai chargé d’arrêter pour moi le premier de l’hôtel Talleyrand. Si le prix n’est pas au dessus de 12 milles francs ou l’entresol pour 8 milles c.a.d. qu'il me rendra compte encore de tout cela et des arrangements à prendre. Au fond c’est la situation la plus agréable . Si le consul général de Londres a raison, le premier ne sera pas trop cher. Et s'il se trompe, j’ai de quoi fournir à l’entresol. Il me survient une affaire importante. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Demain vous serez ce que c’est.
227. Baden, Dimanche 28 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
227 Baden le 24 juillet 1839 dimanche 8 heures
Lorsque nous sommes ensemble, je m'entretiens avec vous de toute chose, je vous dis tout. Par lettres c'est bien difficile. Tous les sujets me paraissent trop minces. Ma vie est bien monotone, les personnes avec lesquelles je vis sont bien insignifiantes ; que voulez-vous que je vous dise ? Je pense bien plus au moment où je ne serai plus à Bade qu'à celui où je m’y trouve. Savez-vous bien que nous avons encore à passer quatre mois sans nous voir ! Vous m'avez dit que vous en reviendriez que pour le mois de décembre à Paris ! Que c'est long ! Songez-vous bien à cela ?
2 heures
J’ai été à l’église comme je ne manque jamais de le faire le dimanche. Nous avons eu un superbe sermon, trop beau, car j'en suis revenue en larmes. Je viens de recevoir une lettre de F. Pahlen de Courlande. Ce n’est que là qu'il a reçu la lettre dans laquelle je lui mandais que mes fils en retenait ma pension. Il me dit qu’il est très fâché de l’avoir ignoré pendant qu'il se trouvait encore à Pétersbourg et qu'il ne doute pas que mon frère y aura une ordre. Mais mon frère n'a jamais répondu à ce que je lui en avais dit vous voyez comme tout se fait légèrement ! Pourvu que cela finisse une bonne fois. Nesselrode écrit à sa femme que mon frère lui a assuré que j’aurais 90 mille francs de rente. Ce drôle de frère Il tranche dans le grand. J’accepte volontiers ses 90 milles francs. Mais je serai curieuse de voir comment il s’y prendra pour me les faire toucher.
5 heures
Vous avez fait ce que je craignais. Je n’ai point de lettres aujourd’hui. Vous voyez bien que si je vous imitais vous n'en auriez pas non plus de moi. Mais je ne vous écris que pour vous dire que vous avez tort et que je ne vous imiterai pas. En attendant voilà un triste dimanche et une forte migraine par dessus cela. Ah que tout m’attriste et m'ennuie ! Je voudrais bien être à l’hiver. Adieu. Je n’ai vraiment pas un mot à vous dire, j’ai eu une lettre du Roi de Hanovre très insignifiante. Ses affaires vont mal à ce qu'on me dit, mais lui ne me le dit pas. Adieu.
Lorsque nous sommes ensemble, je m'entretiens avec vous de toute chose, je vous dis tout. Par lettres c'est bien difficile. Tous les sujets me paraissent trop minces. Ma vie est bien monotone, les personnes avec lesquelles je vis sont bien insignifiantes ; que voulez-vous que je vous dise ? Je pense bien plus au moment où je ne serai plus à Bade qu'à celui où je m’y trouve. Savez-vous bien que nous avons encore à passer quatre mois sans nous voir ! Vous m'avez dit que vous en reviendriez que pour le mois de décembre à Paris ! Que c'est long ! Songez-vous bien à cela ?
2 heures
J’ai été à l’église comme je ne manque jamais de le faire le dimanche. Nous avons eu un superbe sermon, trop beau, car j'en suis revenue en larmes. Je viens de recevoir une lettre de F. Pahlen de Courlande. Ce n’est que là qu'il a reçu la lettre dans laquelle je lui mandais que mes fils en retenait ma pension. Il me dit qu’il est très fâché de l’avoir ignoré pendant qu'il se trouvait encore à Pétersbourg et qu'il ne doute pas que mon frère y aura une ordre. Mais mon frère n'a jamais répondu à ce que je lui en avais dit vous voyez comme tout se fait légèrement ! Pourvu que cela finisse une bonne fois. Nesselrode écrit à sa femme que mon frère lui a assuré que j’aurais 90 mille francs de rente. Ce drôle de frère Il tranche dans le grand. J’accepte volontiers ses 90 milles francs. Mais je serai curieuse de voir comment il s’y prendra pour me les faire toucher.
5 heures
Vous avez fait ce que je craignais. Je n’ai point de lettres aujourd’hui. Vous voyez bien que si je vous imitais vous n'en auriez pas non plus de moi. Mais je ne vous écris que pour vous dire que vous avez tort et que je ne vous imiterai pas. En attendant voilà un triste dimanche et une forte migraine par dessus cela. Ah que tout m’attriste et m'ennuie ! Je voudrais bien être à l’hiver. Adieu. Je n’ai vraiment pas un mot à vous dire, j’ai eu une lettre du Roi de Hanovre très insignifiante. Ses affaires vont mal à ce qu'on me dit, mais lui ne me le dit pas. Adieu.
226. Baden, Samedi 27 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
226 Baden le 27 juillet 1839 9 heures
Je vous écris après une laide et triste promenade car il pleut ; et avant mon bain qui ne sera pas agréable non plus. Le médecin veut que je poursuive. J'obéirai encore jusqu'à ce que cela me rende malade. J’ai écrit à M. Démion et je viens d'écrire à M. de Pogenpohl au sujet de l’appartement qu'occupe le capitaine Jennisson. C'est sans contredit ce qui me conviendrait le mieux. Mais il faut savoir d’abord, s'il part ; et puis si ce n’est pas trop cher. Je ne veux pas donner au delà de 10 mille francs. Mes causeries politiques ont cessé depuis le départ de M. de Malzahn mais les journaux allemands me tiennent assez au courant de ce qui se passe, et le ministre de ce pays-ci M. de Blittersdorff vient me montrer les rapports qu'on lui fait de Vienne. Il a à Vienne un agent fort intelligent que je connais depuis bien longtemps le général Fittenborn partisan dans notre armée l’année 12 et les suivantes.
Le 10 on se flattait à Constantinople que l’armée Turque pourrait s'y rallier et empêcher les progrès d'Ibrahim. Mais on y savait la trahison patente du Capitan Pacha qui avait rallié la flotte égyptienne à Rhodes. Voilà le fait grave 5 heures. Il a plu toute la matinée et depuis mon bain j'ai eu une succession de visites.
Voici votre lettre. Vous me paraissez croire qu'Ibrahim, et le Capitan Pacha vont remuer le monde, c’est possible Mais je crois que la diplomatie fera les derniers efforts pour empêcher cela. Votre cabinet est bien faible pour une semblable crise. Ou pour agir s'il faut agir ! Nous saurons bientôt ce que va devenir l’Empire ottoman. Adieu. Adieu, vos lettres courtes ou longues me font toujours un grand plaisir, mon seul plaisir. Il y a quinze jours que je n’ai rien reçu de mon fils Alexandre. Je l’avais prié de me dire comment se porte Paul rien que cela, est-ce peut être là ce qui l’empêche de me répondre ? Adieu. Adieu mille fois.
Je vous écris après une laide et triste promenade car il pleut ; et avant mon bain qui ne sera pas agréable non plus. Le médecin veut que je poursuive. J'obéirai encore jusqu'à ce que cela me rende malade. J’ai écrit à M. Démion et je viens d'écrire à M. de Pogenpohl au sujet de l’appartement qu'occupe le capitaine Jennisson. C'est sans contredit ce qui me conviendrait le mieux. Mais il faut savoir d’abord, s'il part ; et puis si ce n’est pas trop cher. Je ne veux pas donner au delà de 10 mille francs. Mes causeries politiques ont cessé depuis le départ de M. de Malzahn mais les journaux allemands me tiennent assez au courant de ce qui se passe, et le ministre de ce pays-ci M. de Blittersdorff vient me montrer les rapports qu'on lui fait de Vienne. Il a à Vienne un agent fort intelligent que je connais depuis bien longtemps le général Fittenborn partisan dans notre armée l’année 12 et les suivantes.
Le 10 on se flattait à Constantinople que l’armée Turque pourrait s'y rallier et empêcher les progrès d'Ibrahim. Mais on y savait la trahison patente du Capitan Pacha qui avait rallié la flotte égyptienne à Rhodes. Voilà le fait grave 5 heures. Il a plu toute la matinée et depuis mon bain j'ai eu une succession de visites.
Voici votre lettre. Vous me paraissez croire qu'Ibrahim, et le Capitan Pacha vont remuer le monde, c’est possible Mais je crois que la diplomatie fera les derniers efforts pour empêcher cela. Votre cabinet est bien faible pour une semblable crise. Ou pour agir s'il faut agir ! Nous saurons bientôt ce que va devenir l’Empire ottoman. Adieu. Adieu, vos lettres courtes ou longues me font toujours un grand plaisir, mon seul plaisir. Il y a quinze jours que je n’ai rien reçu de mon fils Alexandre. Je l’avais prié de me dire comment se porte Paul rien que cela, est-ce peut être là ce qui l’empêche de me répondre ? Adieu. Adieu mille fois.
223. Baden, Lundi 22 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
223 Baden le 22 Juillet lundi
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
221. Baden, Vendredi 19 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
221 Baden, Vendredi le 19 juillet, 1839 4 heures
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
220. Baden, Jeudi 18 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
220 Baden jeudi le 18 juillet 1839, 2 heures
La poste de lundi de Paris n’est arrivé que tout à l'heure. C'est un accident arrivé à la voiture qui a causé ce retard. J'en ai été très alarmé. Mais voici votre lettre et je suis contente. Savez-vous que vos lettres sont bien prudentes. Vous me laissez beaucoup à deviner, et je ne connais au fond vos opinions sur rien. Ainsi pour parler du plus frais, trouvez-vous bon ou mauvais la commutation de la peine de Barbès ? Comment se porte le ministère ? Ces messieurs font-ils bon ménage ? Cela tiendra-t-il jusq'à la session ? Moi j’entends dire beaucoup que la gauche l'emporte, & que Thiers a des chances.
J'ai donné toute ma journée hier et ma matinée aujourd'hui à Lady Carlisle. C'est une bonne personne, un peu ennuyeuse. Elle vient de repartir. Sir John Couroy est arrivé à Bade. J’ai envie de le voir et de le faire parler, ce qui me réussit assez quand je veux. Voici ce que me dit mon frère : " Paul connait bien les lois. Il ne l’est occupé que de cela depuis son arrivée ici ; et parait très observateur des lois ! " " Voici la calcul de ce que la loi vous assigne. Cela a été discuté avec une précision scrupuleuse ! " Après avoir commenté les articles, mon frère trouvant que je suis riche, & que mes fils sont plus que riches, il poursuit : " Il serait inconvenant dans cette position de solliciter une pension du gouvernement. " Et me cite une grande dame dans ma situation qui l'a fait il y a quelques années et ajoute. " Cela a beaucoup déplu et elle a obtenu 10 000 rouble. Cette somme ne vous rendrait pas plus riche. " La question de déplaire ne me touche pas beaucoup, mais en effet je pense que je ne dirai plus un mot de cela, parce que cela m'ennuie. Ce n’est pas à moi à dire. Ces gens-là devraient faire ce qui est convenable sans que j’en parle. Il y a une chose que je regrette, c’est le plaisir de mettre dans l'embarras ou dans le tort. Voilà du mauvais cœur au fond la question n’est pas de savoir si j'ai besoin de cette pension ou non. Elle devait être donnée sans plus. Après cela savez-vous qu'il y a du plaisir à ne devoir rien à personne. J’aime mieux avoir à me venger d'une injustice. Il me semble que je vous parle un peu trop longuement de moi ; mais pour être franche j’ajouterai encore que j'ai hésité et que j'avais commencé une lettre à Orloff excessivement logique & bonne ; je l’ai laissée là. Mon frère fait des calculs très légers dans ce qu’il m'écrit et comme Pahlen part et que c'est mon frère qui va faire le reste, cela m’inquiète un peu. Ainsi il me parle de 400 mille francs da capital pour moi. Cela n'est pas possible. Ensuite il regarde comme éternels des revenus qui finissent dans 2 ans. Je serai obligée de relever tout cela, & de demander des explications, et puis on veut que je donne 355 paysans pour une rente de 9000 francs. Ils valent le double. Ensuite rien que la parole de mes fils comme garantie que la pension me serait payée. Ceci ne regarde que 21 000 fr par an, mais encore faudrait-il vérité. Enfin je prierai mon fière d’y faire attention et le style de sa lettre me prouve que cette observation ne l'étonnera pas. Mes fils auront à ce qu’ils me parait chacun 100 000 francs de rente. J'en suis bien aise. Ils n’ont pas besoin de moi, et de personne. Et cependant, s'ils avaient eu besoin de moi, j'aurais pu conserver des illusions ! Ah, tout est fini de ce côté !
Adieu, vous qui n'êtes pas une illusion, vous qui êtes ma seule vérité. Vérité que je chéris, que je désirais toute ma vie. Ecrivez-moi tous les jours. Vous allez être bien heureux au Val-Richer.
La poste de lundi de Paris n’est arrivé que tout à l'heure. C'est un accident arrivé à la voiture qui a causé ce retard. J'en ai été très alarmé. Mais voici votre lettre et je suis contente. Savez-vous que vos lettres sont bien prudentes. Vous me laissez beaucoup à deviner, et je ne connais au fond vos opinions sur rien. Ainsi pour parler du plus frais, trouvez-vous bon ou mauvais la commutation de la peine de Barbès ? Comment se porte le ministère ? Ces messieurs font-ils bon ménage ? Cela tiendra-t-il jusq'à la session ? Moi j’entends dire beaucoup que la gauche l'emporte, & que Thiers a des chances.
J'ai donné toute ma journée hier et ma matinée aujourd'hui à Lady Carlisle. C'est une bonne personne, un peu ennuyeuse. Elle vient de repartir. Sir John Couroy est arrivé à Bade. J’ai envie de le voir et de le faire parler, ce qui me réussit assez quand je veux. Voici ce que me dit mon frère : " Paul connait bien les lois. Il ne l’est occupé que de cela depuis son arrivée ici ; et parait très observateur des lois ! " " Voici la calcul de ce que la loi vous assigne. Cela a été discuté avec une précision scrupuleuse ! " Après avoir commenté les articles, mon frère trouvant que je suis riche, & que mes fils sont plus que riches, il poursuit : " Il serait inconvenant dans cette position de solliciter une pension du gouvernement. " Et me cite une grande dame dans ma situation qui l'a fait il y a quelques années et ajoute. " Cela a beaucoup déplu et elle a obtenu 10 000 rouble. Cette somme ne vous rendrait pas plus riche. " La question de déplaire ne me touche pas beaucoup, mais en effet je pense que je ne dirai plus un mot de cela, parce que cela m'ennuie. Ce n’est pas à moi à dire. Ces gens-là devraient faire ce qui est convenable sans que j’en parle. Il y a une chose que je regrette, c’est le plaisir de mettre dans l'embarras ou dans le tort. Voilà du mauvais cœur au fond la question n’est pas de savoir si j'ai besoin de cette pension ou non. Elle devait être donnée sans plus. Après cela savez-vous qu'il y a du plaisir à ne devoir rien à personne. J’aime mieux avoir à me venger d'une injustice. Il me semble que je vous parle un peu trop longuement de moi ; mais pour être franche j’ajouterai encore que j'ai hésité et que j'avais commencé une lettre à Orloff excessivement logique & bonne ; je l’ai laissée là. Mon frère fait des calculs très légers dans ce qu’il m'écrit et comme Pahlen part et que c'est mon frère qui va faire le reste, cela m’inquiète un peu. Ainsi il me parle de 400 mille francs da capital pour moi. Cela n'est pas possible. Ensuite il regarde comme éternels des revenus qui finissent dans 2 ans. Je serai obligée de relever tout cela, & de demander des explications, et puis on veut que je donne 355 paysans pour une rente de 9000 francs. Ils valent le double. Ensuite rien que la parole de mes fils comme garantie que la pension me serait payée. Ceci ne regarde que 21 000 fr par an, mais encore faudrait-il vérité. Enfin je prierai mon fière d’y faire attention et le style de sa lettre me prouve que cette observation ne l'étonnera pas. Mes fils auront à ce qu’ils me parait chacun 100 000 francs de rente. J'en suis bien aise. Ils n’ont pas besoin de moi, et de personne. Et cependant, s'ils avaient eu besoin de moi, j'aurais pu conserver des illusions ! Ah, tout est fini de ce côté !
Adieu, vous qui n'êtes pas une illusion, vous qui êtes ma seule vérité. Vérité que je chéris, que je désirais toute ma vie. Ecrivez-moi tous les jours. Vous allez être bien heureux au Val-Richer.
234. Baden, Mardi 6 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
234 Baden le 6 août 1839
Hier en causant avec Mad. de Talleyand il m’est tout à coup venu à l’idée que si mon frère terminait l’arrangement avec mes fils sans consulter la loi anglaise. Je pourrais me trouver privée des bénéfices de cette loi. On m’a demandé en toute hâte les derniers pleins pouvoirs, je lui ai envoyé en toute hâte aussi sans avoir fait cette réflexion, au contraire, en pensant même qu'il valait mieux que ce ne fût pas par moi qu’on apprit cette disposition de la loi anglaise. L’Esprit m’est venu un peu tard, mais enfin il est venu. J’ai fait venir Bacourt et avec son secours j’ai écrit la lettre dont copie ci jointe que j'ai expédié sur le champ à mon frère. Voilà ce qui m'a pris mon temps, et mes forces. à 4 h. l'idée m’est venue, & à 6 heures ma lettre était à la poste. Voyons dites-moi maintenant ce qui va en suivre ? Si ma lettre arrive après le conclusion de l'acte, est-il possible de faire valoir une droite à la loi anglaise sans une contestation des plus pénibles avec mes fils ! Vous savez que mon frère a plein pouvoir de tout régler, il aura réglé 4ème part du Capital anglais comme des autres. Une fois signé par lui comment revenir sur cet acte ? Le peut-on ? Et Paul n’a-t-il pas le doit de dire : " ce qui est fait et fait, vous deviez y regarder plus tôt. " Moi, je crois et je suis sûre qu'il connaissait la loi anglaise, et je ne puis pas m’empêcher d' en expliquer par ce fait maintenant sa persistance à vouloir mes pleins pouvoirs. Que pensez-vous de tout cela ? Ma lettre à mon frère est-elle bien ? Dites-moi votre idée sur les conséquences dans le cas de la signature de l’acte avant que mon frère ne reçoive ma lettre d’hier. Il faut convenir que j’ai été bien simple ! J’ai un peu envie de vous demander aussi pourquoi vous ne m'avez pas dit de prendre des informations à Londres. Enfin il n’y a plus rien à faire Mais cela me tracasse, et vous savez comme cela me fait du mal d'être tracassée. Est-il possible que des chiffres m'occupent tellement ! Savez-vous que j’en ai quelque honte. Je vous remercie de votre lettre hier, je voudrais en être digne c.a.d. ; avoir la force d’y répondre. Mais vous voyez que je n’ai pas de forces. Il y a de la force dans mon cœur , il y a là dedans tout ce que vous pouvez aimer à y voir soyez en bien sûr, bien sûr. Mais venez voir à quel point je suis accablée, lasse ! Encore une mauvaise nuit, vraiment cela va bien mal. Toutes mes peines de printemps, toutes ces tracasseries, tout cela se dessine fortement sur mes traits, j'ai l'air bien faible, bien faible, & je le suis.
5 heures l’Empereur a écrit au grand duc de Darmstadt, et lui annoncer que son fils va venir passer l'hiver à Darmstadt. Le mariage est parfaitement décidé. Il ne peut pas être question que la Belgique entre dans l’association des douanes d’Allemagne. Il s’agit d’un traité de commerce avec la Belgique, mais il n'y a que les puissances allemandes que puissent être des Zolleverein. Adieu. Adieu.
Je suis impatiente de votre réponse à ce que je vous écris aujourd'hui. C'est une grande question que ceci, et mon idée est que je ne m’en tirerais pas sans procès, si je voulais maintenir mes droits après l’acte signé. Mais quelles seront nos relations avec mes fils qui qu’auraient dépouillé à bon escient ! Adieu, Adieu.
Hier en causant avec Mad. de Talleyand il m’est tout à coup venu à l’idée que si mon frère terminait l’arrangement avec mes fils sans consulter la loi anglaise. Je pourrais me trouver privée des bénéfices de cette loi. On m’a demandé en toute hâte les derniers pleins pouvoirs, je lui ai envoyé en toute hâte aussi sans avoir fait cette réflexion, au contraire, en pensant même qu'il valait mieux que ce ne fût pas par moi qu’on apprit cette disposition de la loi anglaise. L’Esprit m’est venu un peu tard, mais enfin il est venu. J’ai fait venir Bacourt et avec son secours j’ai écrit la lettre dont copie ci jointe que j'ai expédié sur le champ à mon frère. Voilà ce qui m'a pris mon temps, et mes forces. à 4 h. l'idée m’est venue, & à 6 heures ma lettre était à la poste. Voyons dites-moi maintenant ce qui va en suivre ? Si ma lettre arrive après le conclusion de l'acte, est-il possible de faire valoir une droite à la loi anglaise sans une contestation des plus pénibles avec mes fils ! Vous savez que mon frère a plein pouvoir de tout régler, il aura réglé 4ème part du Capital anglais comme des autres. Une fois signé par lui comment revenir sur cet acte ? Le peut-on ? Et Paul n’a-t-il pas le doit de dire : " ce qui est fait et fait, vous deviez y regarder plus tôt. " Moi, je crois et je suis sûre qu'il connaissait la loi anglaise, et je ne puis pas m’empêcher d' en expliquer par ce fait maintenant sa persistance à vouloir mes pleins pouvoirs. Que pensez-vous de tout cela ? Ma lettre à mon frère est-elle bien ? Dites-moi votre idée sur les conséquences dans le cas de la signature de l’acte avant que mon frère ne reçoive ma lettre d’hier. Il faut convenir que j’ai été bien simple ! J’ai un peu envie de vous demander aussi pourquoi vous ne m'avez pas dit de prendre des informations à Londres. Enfin il n’y a plus rien à faire Mais cela me tracasse, et vous savez comme cela me fait du mal d'être tracassée. Est-il possible que des chiffres m'occupent tellement ! Savez-vous que j’en ai quelque honte. Je vous remercie de votre lettre hier, je voudrais en être digne c.a.d. ; avoir la force d’y répondre. Mais vous voyez que je n’ai pas de forces. Il y a de la force dans mon cœur , il y a là dedans tout ce que vous pouvez aimer à y voir soyez en bien sûr, bien sûr. Mais venez voir à quel point je suis accablée, lasse ! Encore une mauvaise nuit, vraiment cela va bien mal. Toutes mes peines de printemps, toutes ces tracasseries, tout cela se dessine fortement sur mes traits, j'ai l'air bien faible, bien faible, & je le suis.
5 heures l’Empereur a écrit au grand duc de Darmstadt, et lui annoncer que son fils va venir passer l'hiver à Darmstadt. Le mariage est parfaitement décidé. Il ne peut pas être question que la Belgique entre dans l’association des douanes d’Allemagne. Il s’agit d’un traité de commerce avec la Belgique, mais il n'y a que les puissances allemandes que puissent être des Zolleverein. Adieu. Adieu.
Je suis impatiente de votre réponse à ce que je vous écris aujourd'hui. C'est une grande question que ceci, et mon idée est que je ne m’en tirerais pas sans procès, si je voulais maintenir mes droits après l’acte signé. Mais quelles seront nos relations avec mes fils qui qu’auraient dépouillé à bon escient ! Adieu, Adieu.
219. Baden, Mercredi 17 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
219 Baden le 17 juillet 1839
Vous n'avez qu’un mot, un seul mot, Lady Carlisle vient d’arriver ; elle passe ici la journée, elle est venue pour moi ; je ne puis pas la quitter un seul instant. J’aurais tant de choses à vous dire sur votre lettre d’hier si parfaite, si touchante, si bonne, si douce. Et puis j’ai à vous parler de mes affaires, à vous envoyer copie de tout cela, à vous demander conseil, et je ne puis rien vous dire aujourd’hui. C'est bien ennuyeux. Ce qui l'est bien plus encore c’est que la malle de Paris n’est pas arrivée, qu’elle ne viendra pas. On dit un accident en route. C’est bien suspect. Je crois plutôt quelques malheurs à Paris et je tremble.
Voici vite l’extrait du projet d’arrangement rouble argent 7ème part de Kostroma 2507 roubles argent
7ème part de Courlande 2261
3ème part de Lituanie 548
5316 rb ou 21000 francs
qui me seraient payés comme rente viagère garantie par mes fils mais sans hypothèques Pahlen me le conseille. De plus
1/4 d'arende de Courlande qui court encore 20 ans 1515
1/4 arende qui finit dans 3 ans 2500 rb
4015 ou 16000 francs
Le quart du Capital anglais qui serait je crois 25000 francs. Mon année de revenus de Courlande 15830 rb argent ou 62 000 francs. Il y aurait donc 37 000 francs de revenus et un capital de 312 000 francs. Voilà l'ensemble, cela me fera avec ce que j'ai aux environs de 75 000 francs. Cela est bien. Il n’y a que le droit rigoureusement le droit, et tant mieux. Je ne dois rien à personne. Adieu je suis bien fatiguée. Je suis bien inquiète, pas de malle de Paris c'est incroyable. Mon Dieu que je voudrai votre lettre. Qu’est-il arrivé ? Adieu. Adieu.
God bless and protect you.
Vous n'avez qu’un mot, un seul mot, Lady Carlisle vient d’arriver ; elle passe ici la journée, elle est venue pour moi ; je ne puis pas la quitter un seul instant. J’aurais tant de choses à vous dire sur votre lettre d’hier si parfaite, si touchante, si bonne, si douce. Et puis j’ai à vous parler de mes affaires, à vous envoyer copie de tout cela, à vous demander conseil, et je ne puis rien vous dire aujourd’hui. C'est bien ennuyeux. Ce qui l'est bien plus encore c’est que la malle de Paris n’est pas arrivée, qu’elle ne viendra pas. On dit un accident en route. C’est bien suspect. Je crois plutôt quelques malheurs à Paris et je tremble.
Voici vite l’extrait du projet d’arrangement rouble argent 7ème part de Kostroma 2507 roubles argent
7ème part de Courlande 2261
3ème part de Lituanie 548
5316 rb ou 21000 francs
qui me seraient payés comme rente viagère garantie par mes fils mais sans hypothèques Pahlen me le conseille. De plus
1/4 d'arende de Courlande qui court encore 20 ans 1515
1/4 arende qui finit dans 3 ans 2500 rb
4015 ou 16000 francs
Le quart du Capital anglais qui serait je crois 25000 francs. Mon année de revenus de Courlande 15830 rb argent ou 62 000 francs. Il y aurait donc 37 000 francs de revenus et un capital de 312 000 francs. Voilà l'ensemble, cela me fera avec ce que j'ai aux environs de 75 000 francs. Cela est bien. Il n’y a que le droit rigoureusement le droit, et tant mieux. Je ne dois rien à personne. Adieu je suis bien fatiguée. Je suis bien inquiète, pas de malle de Paris c'est incroyable. Mon Dieu que je voudrai votre lettre. Qu’est-il arrivé ? Adieu. Adieu.
God bless and protect you.
Mots-clés : Finances (Dorothée), Santé (Dorothée)
207. Baden, Mercredi 3 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
207 Baden le 3 juillet. 2 heures 1839
Je n’ai rien à vous dire que mon impatience de vos lettres, ma mauvaise humeur du mauvais temps.
J’ai écrit aujourd’hui à Matonchewitz et à Frédéric Pahlen, je les presse tous les deux de me dire quelque chose, et je les avertis assez clairement que mes fils pourraient vouloir traîner ; que ce qui n'a aucun inconvénient pour eux, parce que leur fortune est assurée, en a de très grands pour moi qui ne sais pas le premier mot de ce que sera ma fortune, & qui suis obligé de vivre en attendant dans un provisoire très pénible. Je crois avoir fort bien expliqué tout cela. Mais il me semble que je fais toujours des merveilles, et je ne vois rien avancer ; c’est plus qu’ennuyeux.
Jeudi 4 à 8 heures
Votre n°204 m’a donné de la joie personne n’a jamais su comme vous redire toujours la même chose sous une forme toujours nouvelle. Et il y a des lignes charmantes dans votre lettre, des paroles si pénétrantes, si douces. Je vous remercie de toute la lettre, et je vous remercie de toutes les lettres que vous me promettez et que je mérite pas le plaisir qu’elles me font, et par ma reconnaissance qui sait être si vive ! Il fait toujours froid, toujours laid. J'en marche davantage, mais je n’engraisse pas. Je me baigne. J’ai quelque idée que les bains ne me conviennent pas. Mais on n'ose pas avoir d'avis avec les médecins aussi absolus que le mien. Cependant si d'ici à huit jours je ne vais pas mieux. Je crois que je romprai avec le Médecin. Qu’est-ce que veut dire un mois de régime qui n’aboutit à rien ? Je me couche à 9 heures, je me lève à 6. Je dors mieux que je ne dormais à Paris dans les dernier temps, voilà ce que j'ai gagné, mais de l’embonpoint non. Et le médecin qui ne saura pas me procurer cela sera un sot.
Le journal de Francfort renferme des commentaires sur le rapport de M. Jouffroy qui sont très bien et très vrais. Lisez cela parce que cela vient de source. Je suis même un peu surprise que nous ayons là quelqu'un d’aussi bien renseigné. Il faut qu’on ait muni à tout événement notre ministre de documents étrangers aux affaires qu'il a à traiter à la Diète. Le grand duc doit être arrivé hier à Petersbourg. Cela pourrait faire époque pour moi si je n’étais payée pour ne plus croire à rien. Ce pauvre grand Duc a éprouvé bien des pertes à Rome. Son chirurgien y est mort très peu de temps avant mon mari. Plus tard son valet de Chambre de confiance qui ne l'avait jamais quitté depuis son enfance. Et tout à l’heure son jeune camarade le comte Wulhomsky élevé avec lui et avec lequel il était entièrement lié. Tout cela mort à Rome. Ce jeune homme était tombé malade pendant que le grand Duc y était encore et n’avait plus été en état de le suivre.
5 heures.
Voici votre petit mot 205. Je ne savais pas que vous attendrez mes lettres comme moi j'attends les vôtres. Puisque vous le voulez vous les aurez tous les jours, mais quelles tristes lettres que les miennes ! Si j’allais vous ennuyer ! Car enfin je ne vous parle que de moi, Et si c'était moi florissante avec des bras, à la bonne heure. Mais moi comme vous m'avez vue ! Ah mon Dieu ! Vous me rendrez bien curieuse de la discussion sur l'Orient. Adieu. Adieu mille fois adieu, From the bottom of my heart.
Je n’ai rien à vous dire que mon impatience de vos lettres, ma mauvaise humeur du mauvais temps.
J’ai écrit aujourd’hui à Matonchewitz et à Frédéric Pahlen, je les presse tous les deux de me dire quelque chose, et je les avertis assez clairement que mes fils pourraient vouloir traîner ; que ce qui n'a aucun inconvénient pour eux, parce que leur fortune est assurée, en a de très grands pour moi qui ne sais pas le premier mot de ce que sera ma fortune, & qui suis obligé de vivre en attendant dans un provisoire très pénible. Je crois avoir fort bien expliqué tout cela. Mais il me semble que je fais toujours des merveilles, et je ne vois rien avancer ; c’est plus qu’ennuyeux.
Jeudi 4 à 8 heures
Votre n°204 m’a donné de la joie personne n’a jamais su comme vous redire toujours la même chose sous une forme toujours nouvelle. Et il y a des lignes charmantes dans votre lettre, des paroles si pénétrantes, si douces. Je vous remercie de toute la lettre, et je vous remercie de toutes les lettres que vous me promettez et que je mérite pas le plaisir qu’elles me font, et par ma reconnaissance qui sait être si vive ! Il fait toujours froid, toujours laid. J'en marche davantage, mais je n’engraisse pas. Je me baigne. J’ai quelque idée que les bains ne me conviennent pas. Mais on n'ose pas avoir d'avis avec les médecins aussi absolus que le mien. Cependant si d'ici à huit jours je ne vais pas mieux. Je crois que je romprai avec le Médecin. Qu’est-ce que veut dire un mois de régime qui n’aboutit à rien ? Je me couche à 9 heures, je me lève à 6. Je dors mieux que je ne dormais à Paris dans les dernier temps, voilà ce que j'ai gagné, mais de l’embonpoint non. Et le médecin qui ne saura pas me procurer cela sera un sot.
Le journal de Francfort renferme des commentaires sur le rapport de M. Jouffroy qui sont très bien et très vrais. Lisez cela parce que cela vient de source. Je suis même un peu surprise que nous ayons là quelqu'un d’aussi bien renseigné. Il faut qu’on ait muni à tout événement notre ministre de documents étrangers aux affaires qu'il a à traiter à la Diète. Le grand duc doit être arrivé hier à Petersbourg. Cela pourrait faire époque pour moi si je n’étais payée pour ne plus croire à rien. Ce pauvre grand Duc a éprouvé bien des pertes à Rome. Son chirurgien y est mort très peu de temps avant mon mari. Plus tard son valet de Chambre de confiance qui ne l'avait jamais quitté depuis son enfance. Et tout à l’heure son jeune camarade le comte Wulhomsky élevé avec lui et avec lequel il était entièrement lié. Tout cela mort à Rome. Ce jeune homme était tombé malade pendant que le grand Duc y était encore et n’avait plus été en état de le suivre.
5 heures.
Voici votre petit mot 205. Je ne savais pas que vous attendrez mes lettres comme moi j'attends les vôtres. Puisque vous le voulez vous les aurez tous les jours, mais quelles tristes lettres que les miennes ! Si j’allais vous ennuyer ! Car enfin je ne vous parle que de moi, Et si c'était moi florissante avec des bras, à la bonne heure. Mais moi comme vous m'avez vue ! Ah mon Dieu ! Vous me rendrez bien curieuse de la discussion sur l'Orient. Adieu. Adieu mille fois adieu, From the bottom of my heart.
215. Baden, Samedi 13 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
215 Baden Samedi 13 juillet 1839, 1 heure
Je me sens un peu mieux aujourd’hui et je crains de vous le dire,car cela me porte malheur. J'aimerais bien mieux que vous me permissiez de ne vous parler jamais de ma santé. M. de la Redorte est arrivé, il est venu me voir. Il cause c.a.d. il raconte, et au fond pas grand chose. Voici la réponse de M. de Bacourt. Ces notions lui ont été fournies par M. de Blittersdorff, le Metternich de ce pays-ci. Des lettres de Constantinople du 25 juin disent que le sultan est dans un état désespéré. Il traînera un mois tout au plus.
5 heures
Voici votre N°214 bien tendre, bien bon, je le relirai souvent. Je vous en remercie. Vous voyez que je puis à peine vous écrire, cela me fatigue, le sang me porte à la tête, je ne suis pas bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ecrivez-moi toujours et tout. Adieu. J’ai eu une lettre d'Alexandre, très insignifiante. Il me dit seulement qu’il est très occupé. Mais quand est-ce que quelqu'un prendra la peine de me dire ce qu'on fait ? Adieu. Adieu.
Je me sens un peu mieux aujourd’hui et je crains de vous le dire,car cela me porte malheur. J'aimerais bien mieux que vous me permissiez de ne vous parler jamais de ma santé. M. de la Redorte est arrivé, il est venu me voir. Il cause c.a.d. il raconte, et au fond pas grand chose. Voici la réponse de M. de Bacourt. Ces notions lui ont été fournies par M. de Blittersdorff, le Metternich de ce pays-ci. Des lettres de Constantinople du 25 juin disent que le sultan est dans un état désespéré. Il traînera un mois tout au plus.
5 heures
Voici votre N°214 bien tendre, bien bon, je le relirai souvent. Je vous en remercie. Vous voyez que je puis à peine vous écrire, cela me fatigue, le sang me porte à la tête, je ne suis pas bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ecrivez-moi toujours et tout. Adieu. J’ai eu une lettre d'Alexandre, très insignifiante. Il me dit seulement qu’il est très occupé. Mais quand est-ce que quelqu'un prendra la peine de me dire ce qu'on fait ? Adieu. Adieu.
210. Baden, Dimanche 7 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
210 Baden Dimanche le 7 juillet 1839 8 heures
Il faut convenir que vous prenez bien mal votre temps pour douter de mon cœur, pour douter que mon cœur ma vie sont à vous, pour croire que vous ne suffisez pas à mon âme. Et mon Dieu qu’est ce qui occupe mon âme ? Où trouve-t-elle du repos, de la douceur, si ce n’est en vous. Je suis bien accablée de mes malheurs passés, de mes peines présentes, je le suis plus ici que lorsque j’étais auprès de vous, et cependant avec quel bonheur je pense à vous, comme je retrouve de la joie de la sérénité dans le fond de mon âme en arrangeant le reste de ma vie pour vous, avec vous ! Vous êtes bien le reste de ma vie. Si je ne vous avais pas, je n’aurais plus rien. Dites-vous cela, dites-vous que je le pense sans cesse, sans cesse, et voyez si je ne vous aime pas plus que vous ne pouvez m'aimer ? Car vous, vous avez du bonheur sans moi. Et moi je n’ai plus rien sans vous.
Dites-moi si je dois me baigner ; si je dois rester à Baden. J'ai besoin qu'on me dirige. Je ne sais pas me décider. Je suis certainement plus malade qu’en arrivant, faut-il que j’attribue cela au temps ou aux remèdes. Jamais je n’ai été accoutumée aux bains, ils m'ont toujours affaiblie. Il n’y a que les bains de mer qui me conviennent. Dois-je faire à ma fantaisie c.a.d. ne plus rien faire. J'ai si besoin de vos conseils. Et après tout, ce que je fais ou ne fais pas, c'est pour vous. Il m'importe peu d’engraisser, de maigrir. Mais vous voulez me revoir autre que vous ne m'avez quittée, et je n'oserais pas revenir à Paris si je n’ai fait votre volonté.
J’ai été interrompue par Mad. de Nesselrode. Elle vient quelque fois causer de mes affaires. C’est de la bonté, mais il n'y a rien à dire il faut attendre. Paul va se trouver dans un grand embarras. On ne doute pas là-bas qu’il ne fasse un arrangement convenable, car le droit serait trop peu, et jamais on ne s’en est tenu au droit. Lorsqu'il s’est agi d'une mère. Voilà ce que Mad. de Nesselrode crie sur les toits en vantant à cet égard la supériorité des Russes sur tous les autres. Si elle a raison, encore une fois, le dilemme sera grand pour Paul. Que fera-t-il ? Et moi dites-moi ce que je ferai ? Puis-je accepter son au delà du droit après ce qui s’est passé ! Mon instinct me dit que non. Aidez-moi. Je vois votre réponse ; " Votre fils ne vous mettra pas dans cet embarras." Cependant répondez comme s'il m'y plaçait. Si je mettais mon acceptation au prix d’un retour de sa part, il n’aurait garde de revenir à moi. Répondez, répondez.
11 heures
Je pense beaucoup à votre discours c'est au fond le vrai discours politique dans cette discussion. Il est fort remarqué. Et en général on pense que l’Empereur doit être content de ce que vous avez dit de lui. Je le pense aussi sauf un point, le véritable, et que vous avez traité avec une grande habilité, ne lui imposant des devoirs qui pourraient ne pas rencontrer ses intérêts. Somme toute vous avez fait un beau discours et qui sera fort remarqué chez nous. On me dit que le mariage Dormstadt n'aura pas lieu. On ignorait la naissance lorsqu'on s'est embarqué si étourdiment dans cette affaire. C’est une grande étourderie d’Orloff. Mon mari en eut été incapable. Il est vrai que la bâtardise ne pouvait pas être un grand pêché aux yeux d’Orloff. A Berlin on s’est fort ému de ce choix et on a éclaté. Je ne sais au reste ceci que par des voies détournées. Voici votre lettre, je n'ai plus que le temps de vous le dire, et de vous dire adieu, et bien des adieux.
Il faut convenir que vous prenez bien mal votre temps pour douter de mon cœur, pour douter que mon cœur ma vie sont à vous, pour croire que vous ne suffisez pas à mon âme. Et mon Dieu qu’est ce qui occupe mon âme ? Où trouve-t-elle du repos, de la douceur, si ce n’est en vous. Je suis bien accablée de mes malheurs passés, de mes peines présentes, je le suis plus ici que lorsque j’étais auprès de vous, et cependant avec quel bonheur je pense à vous, comme je retrouve de la joie de la sérénité dans le fond de mon âme en arrangeant le reste de ma vie pour vous, avec vous ! Vous êtes bien le reste de ma vie. Si je ne vous avais pas, je n’aurais plus rien. Dites-vous cela, dites-vous que je le pense sans cesse, sans cesse, et voyez si je ne vous aime pas plus que vous ne pouvez m'aimer ? Car vous, vous avez du bonheur sans moi. Et moi je n’ai plus rien sans vous.
Dites-moi si je dois me baigner ; si je dois rester à Baden. J'ai besoin qu'on me dirige. Je ne sais pas me décider. Je suis certainement plus malade qu’en arrivant, faut-il que j’attribue cela au temps ou aux remèdes. Jamais je n’ai été accoutumée aux bains, ils m'ont toujours affaiblie. Il n’y a que les bains de mer qui me conviennent. Dois-je faire à ma fantaisie c.a.d. ne plus rien faire. J'ai si besoin de vos conseils. Et après tout, ce que je fais ou ne fais pas, c'est pour vous. Il m'importe peu d’engraisser, de maigrir. Mais vous voulez me revoir autre que vous ne m'avez quittée, et je n'oserais pas revenir à Paris si je n’ai fait votre volonté.
J’ai été interrompue par Mad. de Nesselrode. Elle vient quelque fois causer de mes affaires. C’est de la bonté, mais il n'y a rien à dire il faut attendre. Paul va se trouver dans un grand embarras. On ne doute pas là-bas qu’il ne fasse un arrangement convenable, car le droit serait trop peu, et jamais on ne s’en est tenu au droit. Lorsqu'il s’est agi d'une mère. Voilà ce que Mad. de Nesselrode crie sur les toits en vantant à cet égard la supériorité des Russes sur tous les autres. Si elle a raison, encore une fois, le dilemme sera grand pour Paul. Que fera-t-il ? Et moi dites-moi ce que je ferai ? Puis-je accepter son au delà du droit après ce qui s’est passé ! Mon instinct me dit que non. Aidez-moi. Je vois votre réponse ; " Votre fils ne vous mettra pas dans cet embarras." Cependant répondez comme s'il m'y plaçait. Si je mettais mon acceptation au prix d’un retour de sa part, il n’aurait garde de revenir à moi. Répondez, répondez.
11 heures
Je pense beaucoup à votre discours c'est au fond le vrai discours politique dans cette discussion. Il est fort remarqué. Et en général on pense que l’Empereur doit être content de ce que vous avez dit de lui. Je le pense aussi sauf un point, le véritable, et que vous avez traité avec une grande habilité, ne lui imposant des devoirs qui pourraient ne pas rencontrer ses intérêts. Somme toute vous avez fait un beau discours et qui sera fort remarqué chez nous. On me dit que le mariage Dormstadt n'aura pas lieu. On ignorait la naissance lorsqu'on s'est embarqué si étourdiment dans cette affaire. C’est une grande étourderie d’Orloff. Mon mari en eut été incapable. Il est vrai que la bâtardise ne pouvait pas être un grand pêché aux yeux d’Orloff. A Berlin on s’est fort ému de ce choix et on a éclaté. Je ne sais au reste ceci que par des voies détournées. Voici votre lettre, je n'ai plus que le temps de vous le dire, et de vous dire adieu, et bien des adieux.
75. Champs-Elysées, Jeudi 28 juin 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (28 Juin- 29 Juillet)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
75. Champs Elysées Jeudi 28 juin 1838 Midi 1/2
Je vous ai rencontré hier, j’ai vu le visage réjoui de Guillaume. J’ai vu, entrevu le vôtre, tout cela si rapidement que cela avait l'air d'une mauvaise plaisanterie. Je n'ai pas su si j’étais aise ou fâchée de cette rencontre ; ce matin j'ai lu cette lettre si tendre, si bonne ; je vous en remercie, si tendrement ! Je me suis donnée hier bien du mouvement pour me distraire. J'ai hâté le déménagement. Je me suis fatiguée, j’ai parfaitement mal dormi. Il y a une heure que je suis ici. Vous voyez à mon écriture que je n'ai pas les nerfs en bon état. Il pleut à verse, je me reposerai au Val-Richer. Je n'ai pas la force d'écrire, et j’ai tant tant à vous dire !
Lady Granville est à Versailles. Je ne verrai pas une âme aujourd’hui. Je me caserai. Je crois que je serai bien ici. Je viens de recevoir une lettre de Pétersbourg de mon banquier. Il me dit que mon mari a sanctionné les payements faits & ordonnés pour l’avenir 4000 fr. par mois qui m'a mis à 48 au lieu de 55, qu'il me donnait jusqu’ici. C'est une décision pitoyable. Que me conseillez vous ? Faut-il réclamer auprès de lui ou de mon frère ? Doucement ou fortement ou pas du tout ? Vous voyez que je ne suis rien sans vous.
Ah que le temps va être lourd, insoutenable, j'en suis accablée d’avance. J’ai envie de pleurer vingt fois le jour. Je suis si abandonnée. Il me semble qu'il y a un an que je ne vous ai vu. Où trouver du courage ? Adieu Je vais relire votre lettre, mais la relire, c'est pleurer. Donnez-moi de la force. Adieu. Adieu, que le ciel veille sur vous. Je suis si accablée qu'il faut que vous veniez chercher un adieu, je ne saurais me lever pour vous le donner et j’en ai besoin, bien besoin. Adieu.
Je vous ai rencontré hier, j’ai vu le visage réjoui de Guillaume. J’ai vu, entrevu le vôtre, tout cela si rapidement que cela avait l'air d'une mauvaise plaisanterie. Je n'ai pas su si j’étais aise ou fâchée de cette rencontre ; ce matin j'ai lu cette lettre si tendre, si bonne ; je vous en remercie, si tendrement ! Je me suis donnée hier bien du mouvement pour me distraire. J'ai hâté le déménagement. Je me suis fatiguée, j’ai parfaitement mal dormi. Il y a une heure que je suis ici. Vous voyez à mon écriture que je n'ai pas les nerfs en bon état. Il pleut à verse, je me reposerai au Val-Richer. Je n'ai pas la force d'écrire, et j’ai tant tant à vous dire !
Lady Granville est à Versailles. Je ne verrai pas une âme aujourd’hui. Je me caserai. Je crois que je serai bien ici. Je viens de recevoir une lettre de Pétersbourg de mon banquier. Il me dit que mon mari a sanctionné les payements faits & ordonnés pour l’avenir 4000 fr. par mois qui m'a mis à 48 au lieu de 55, qu'il me donnait jusqu’ici. C'est une décision pitoyable. Que me conseillez vous ? Faut-il réclamer auprès de lui ou de mon frère ? Doucement ou fortement ou pas du tout ? Vous voyez que je ne suis rien sans vous.
Ah que le temps va être lourd, insoutenable, j'en suis accablée d’avance. J’ai envie de pleurer vingt fois le jour. Je suis si abandonnée. Il me semble qu'il y a un an que je ne vous ai vu. Où trouver du courage ? Adieu Je vais relire votre lettre, mais la relire, c'est pleurer. Donnez-moi de la force. Adieu. Adieu, que le ciel veille sur vous. Je suis si accablée qu'il faut que vous veniez chercher un adieu, je ne saurais me lever pour vous le donner et j’en ai besoin, bien besoin. Adieu.
81. Paris, Mercredi 4 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (28 Juin- 29 Juillet)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
81. Paris Mercredi 4 juillet 1838
J’ai reçu votre lettre, vos poissons. Comme tout à coup tout a changé pour nous. C’est si abrupt. Des habitudes si étrangères à nos habitudes. Des sujets de conversation se différents. Au lieu de politique vous m’envoyez des carpes. C’est égal, j'accepte tout ce qui me vient de vous. Je vous prie de ne pas manger beaucoup de carpes, de têtes de carpes surtout. J’ai vu M. de Talleyrand à Londres, très près de mourir de cela.
J'ai été hier un moment chez la petite Princesse. Il est très vrai que je la néglige il est très vrai que je suis difficile. Il faut me plaire beaucoup pour m’intéresser un peu, et elle a trop de petit esprit & de petites manières gentilles pour me convenir beaucoup. Cependant, je conviens qu’elle me fera une ressource, quand je n’aurai plus rien. J'ai été à Longchamp jusqu'à cinq heures, & puis un moment à Auteuil. C’était une matinée de réception & il n'y avait à peu près personne. Lady Canterbery qui lorsqu’elle m’a vu venir de loin a vite quitté son siège pour se promener seule dans le jardin. Ici on la comble de politesse & une Anglaise comme moi ne la salue pas, la pauvre femme a erré longtemps et puis elle est partie sans vouloir s'approcher de la maîtresse de la maison.
Je suis rentrée pour mon dîner ; je me suis fait traîner après, & j’ai fini par Lady Granville encore. Ah, pour celle-là, elle me plait.
Les conférences pour la Belgique vont commencer à Londres. Ce ne sera ni une petite, ni une courte besogne. Je ne sais ce que fera Pozzo. Il voulait quitter le 15 pour venir passer 3 mois à Paris ! Si Matonchewitz n’avait pas été déserteur on l'enverrait à la conférence. Je ne sais si l’Empereur voudra se donner cet air de faiblesse.
La petite insurrection à Stockolm qui a misé de si près la visite de l'Empereur me parait un fait curieux. Cette visite n’aurait donc flatté que le Roi. Je ne sais rien de vos affaires ici, et il n’est pas vraisemblable que j'en apprenne rien. Je ne fais attention qu'à ce qui me vient de sources directes et celles-là ne sont pas à ma disposition. M. Molé m'a promis une visite, mais je ne fais pas le moindre cas de ses promesses.
La Reine est dit-on inquiète de la taille énorme de sa fille. Elle accouche dans quinze jours.
Je n’ai pas de lettres de mon mari. J’ai écrit aujourd’hui à mon frère.
Il fait chaud. Et le temps passe bien lentement. Il me semble même qu'il s’arrête. Ah mon Dieu qu'il y a loin jusqu’à de bons moments ! Adieu. Adieu. Est-ce que je ne vous parais pas d’un peu mauvaise humeur ? Je crains que mes lettres ne soient maussades. Je suis si transparente. Et mon chagrin prend quelques fois de si vilaines formes. Vous êtes bien mieux élevé que moi. Adieu adieu.
J’ai reçu votre lettre, vos poissons. Comme tout à coup tout a changé pour nous. C’est si abrupt. Des habitudes si étrangères à nos habitudes. Des sujets de conversation se différents. Au lieu de politique vous m’envoyez des carpes. C’est égal, j'accepte tout ce qui me vient de vous. Je vous prie de ne pas manger beaucoup de carpes, de têtes de carpes surtout. J’ai vu M. de Talleyrand à Londres, très près de mourir de cela.
J'ai été hier un moment chez la petite Princesse. Il est très vrai que je la néglige il est très vrai que je suis difficile. Il faut me plaire beaucoup pour m’intéresser un peu, et elle a trop de petit esprit & de petites manières gentilles pour me convenir beaucoup. Cependant, je conviens qu’elle me fera une ressource, quand je n’aurai plus rien. J'ai été à Longchamp jusqu'à cinq heures, & puis un moment à Auteuil. C’était une matinée de réception & il n'y avait à peu près personne. Lady Canterbery qui lorsqu’elle m’a vu venir de loin a vite quitté son siège pour se promener seule dans le jardin. Ici on la comble de politesse & une Anglaise comme moi ne la salue pas, la pauvre femme a erré longtemps et puis elle est partie sans vouloir s'approcher de la maîtresse de la maison.
Je suis rentrée pour mon dîner ; je me suis fait traîner après, & j’ai fini par Lady Granville encore. Ah, pour celle-là, elle me plait.
Les conférences pour la Belgique vont commencer à Londres. Ce ne sera ni une petite, ni une courte besogne. Je ne sais ce que fera Pozzo. Il voulait quitter le 15 pour venir passer 3 mois à Paris ! Si Matonchewitz n’avait pas été déserteur on l'enverrait à la conférence. Je ne sais si l’Empereur voudra se donner cet air de faiblesse.
La petite insurrection à Stockolm qui a misé de si près la visite de l'Empereur me parait un fait curieux. Cette visite n’aurait donc flatté que le Roi. Je ne sais rien de vos affaires ici, et il n’est pas vraisemblable que j'en apprenne rien. Je ne fais attention qu'à ce qui me vient de sources directes et celles-là ne sont pas à ma disposition. M. Molé m'a promis une visite, mais je ne fais pas le moindre cas de ses promesses.
La Reine est dit-on inquiète de la taille énorme de sa fille. Elle accouche dans quinze jours.
Je n’ai pas de lettres de mon mari. J’ai écrit aujourd’hui à mon frère.
Il fait chaud. Et le temps passe bien lentement. Il me semble même qu'il s’arrête. Ah mon Dieu qu'il y a loin jusqu’à de bons moments ! Adieu. Adieu. Est-ce que je ne vous parais pas d’un peu mauvaise humeur ? Je crains que mes lettres ne soient maussades. Je suis si transparente. Et mon chagrin prend quelques fois de si vilaines formes. Vous êtes bien mieux élevé que moi. Adieu adieu.
206. Baden, Lundi 1er juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
206 Baden lundi 1er juillet 1849, à 2 heures
Le temps est vraiment atroce. 8 degrés seulement. Le médecin ordonne à tout le monde de discontinuer les bains. Il pleut des torrents, on ne peut pas bouger ; c'est affreux ceci par un temps pareil. J’attends votre lettre tantôt. C'est la seule chose que j’attends que je désire surtout à Baden.
Vous voyez qu'on ne se presse pas de m’informer de mes affaires. Je n'ai pas d’idée comment elles vont, si elles vont. Je pense qu’il n’y aura que les lettres de Mad. de Nesselrode à son mari qui les fera aller parce qu'elle aura écrit très énergiquement qu'il faut en tirer de l’incertitude où je languis depuis si longtemps. J'ai beau m'en plaindre moi-même cela me touche pas trop ; mais le témoignage d’un turc aura du poids. Voilà comme nous sommes faits ! Un nouvel incident nous donne de l'espoir ; nous croyons si aisément ; je devrais cependant être désabusée.
Mardi 2. à 8 heures du matin Je reçois dans ce moment trois lettres de Pétersbourg. L’une de mon frère ne me parlant que de fêtes- approuvant fort ma réponse au grand duc ! me disant que Paul s’occupe de mes affaires. Voilà tout. L’autre de mon fils Alexandre qui m'annonce prochainement des voyages dans leur terre de Courlande et de Russie, ce qui fait qu’il ne viendra pas me rejoindre à Baden. La troisième de Matonchewitz. Il venait de recevoir ma grande lettre. Il en est très surpris, très peiné, et affirme que s’il n’avait pas été instruit par moi de ces tristes affaires, jamais il ne les eut soupçonnées rien dans la conduite ou le langage de Paul en laissant plus à cette idée. Dans tout cela vous voyez que mes affaires d’intérêts n'ont pas fait un pas. Et il me parait assez probable que rien ne se fera avant le voyage de mes fils, c.-a.-d. que je suis renvoyée à l'automne ou l’hiver.
Après vous avoir parlé de ce qui me tracasse, j’en viens à ce qui me plait. Votre N° 203, dont je vous remercie beaucoup. Vous me dites un peu plus de détails sur vous c’est ce que j’aime. Quand je les recevrai tous les jours je serai contente.
J’ai vu les dépêches de Constantinople du 12 juin adressées à Vienne. Elles laissent fort peu d’espoir de conserver la paix. Le manifeste contre le Pacha d’Egypte devait paraître le lendemain. Le Sultan est très malade ; il est attaqué de la poitrine, il ne peut pas durer. La Hongrie donne du souci au Cabinet de Vienne. Il aura là bien de l'embarras.
Le temps est si laid qu'au lieu de promenade on est venu chez moi hier. J’y ai eu longtemps Mad. de Nesselrode Mad. de Talleyrand et le comte Maltzan Ministre de Prusse à Vienne. Il a un peu d'esprit, une préoccupation continuelle des affaires. Et il est très bien informé de tout ce qui ce passe malgré son absence de son poste. Cela me sera une ressource.
2 heures
Je viens de recevoir des lettres de Londres. Bulner m'annonce sa nomination à Paris. Il venait d'écrire à Paul une lettre qu’il croit bonne, il me rendra compte des résultat. Ellice m'écrit aussi ; l’un et l’autre disent que battus ou battant les Ministres resteront. Il n’est pas possible de songer à un changement. La Reine est devenue Whig enragé. Les Torys c.a.d. Wellington & Peel seraient désolés d'une crise, ainsi il y n’y a aucune apparence quelconque qu’elle arrive. Lady Flora Hastings est mourante. Cela fait un très mauvais effet.
5 heures
J’ai vu ce matin chez moi, Mesdames Nesselrode, Talleyran, Albufera, la Redote. J'ai marché par un bien vilain temps. Je viens de faire mon triste dîner toute seule. Voilà un sot bulletin. Adieu, Adieu, tout ce que vous me dites m'intéresse. Je suis avide de toutes les nouvelles et avide surtout de vous. Ne trouvez-vous pas qu’il y a bien bien longtemps que nous sommes séparés, que c’est bien triste ? Ah mon Dieu que c’est triste ! Adieu.
Le temps est vraiment atroce. 8 degrés seulement. Le médecin ordonne à tout le monde de discontinuer les bains. Il pleut des torrents, on ne peut pas bouger ; c'est affreux ceci par un temps pareil. J’attends votre lettre tantôt. C'est la seule chose que j’attends que je désire surtout à Baden.
Vous voyez qu'on ne se presse pas de m’informer de mes affaires. Je n'ai pas d’idée comment elles vont, si elles vont. Je pense qu’il n’y aura que les lettres de Mad. de Nesselrode à son mari qui les fera aller parce qu'elle aura écrit très énergiquement qu'il faut en tirer de l’incertitude où je languis depuis si longtemps. J'ai beau m'en plaindre moi-même cela me touche pas trop ; mais le témoignage d’un turc aura du poids. Voilà comme nous sommes faits ! Un nouvel incident nous donne de l'espoir ; nous croyons si aisément ; je devrais cependant être désabusée.
Mardi 2. à 8 heures du matin Je reçois dans ce moment trois lettres de Pétersbourg. L’une de mon frère ne me parlant que de fêtes- approuvant fort ma réponse au grand duc ! me disant que Paul s’occupe de mes affaires. Voilà tout. L’autre de mon fils Alexandre qui m'annonce prochainement des voyages dans leur terre de Courlande et de Russie, ce qui fait qu’il ne viendra pas me rejoindre à Baden. La troisième de Matonchewitz. Il venait de recevoir ma grande lettre. Il en est très surpris, très peiné, et affirme que s’il n’avait pas été instruit par moi de ces tristes affaires, jamais il ne les eut soupçonnées rien dans la conduite ou le langage de Paul en laissant plus à cette idée. Dans tout cela vous voyez que mes affaires d’intérêts n'ont pas fait un pas. Et il me parait assez probable que rien ne se fera avant le voyage de mes fils, c.-a.-d. que je suis renvoyée à l'automne ou l’hiver.
Après vous avoir parlé de ce qui me tracasse, j’en viens à ce qui me plait. Votre N° 203, dont je vous remercie beaucoup. Vous me dites un peu plus de détails sur vous c’est ce que j’aime. Quand je les recevrai tous les jours je serai contente.
J’ai vu les dépêches de Constantinople du 12 juin adressées à Vienne. Elles laissent fort peu d’espoir de conserver la paix. Le manifeste contre le Pacha d’Egypte devait paraître le lendemain. Le Sultan est très malade ; il est attaqué de la poitrine, il ne peut pas durer. La Hongrie donne du souci au Cabinet de Vienne. Il aura là bien de l'embarras.
Le temps est si laid qu'au lieu de promenade on est venu chez moi hier. J’y ai eu longtemps Mad. de Nesselrode Mad. de Talleyrand et le comte Maltzan Ministre de Prusse à Vienne. Il a un peu d'esprit, une préoccupation continuelle des affaires. Et il est très bien informé de tout ce qui ce passe malgré son absence de son poste. Cela me sera une ressource.
2 heures
Je viens de recevoir des lettres de Londres. Bulner m'annonce sa nomination à Paris. Il venait d'écrire à Paul une lettre qu’il croit bonne, il me rendra compte des résultat. Ellice m'écrit aussi ; l’un et l’autre disent que battus ou battant les Ministres resteront. Il n’est pas possible de songer à un changement. La Reine est devenue Whig enragé. Les Torys c.a.d. Wellington & Peel seraient désolés d'une crise, ainsi il y n’y a aucune apparence quelconque qu’elle arrive. Lady Flora Hastings est mourante. Cela fait un très mauvais effet.
5 heures
J’ai vu ce matin chez moi, Mesdames Nesselrode, Talleyran, Albufera, la Redote. J'ai marché par un bien vilain temps. Je viens de faire mon triste dîner toute seule. Voilà un sot bulletin. Adieu, Adieu, tout ce que vous me dites m'intéresse. Je suis avide de toutes les nouvelles et avide surtout de vous. Ne trouvez-vous pas qu’il y a bien bien longtemps que nous sommes séparés, que c’est bien triste ? Ah mon Dieu que c’est triste ! Adieu.
98. Paris, Samedi 21 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (28 Juin- 29 Juillet)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
98. Paris Samedi 21 juillet 1838
Je vous remercie d’avoir fait vos calculs de façon à ne pas me laisser manquer de lettre. Je vous remercie aussi de ce que vous me permettez au sujet du précepteur pour Lord Coke. C’est un enfant charmant. Le type des beaux enfants de l’aristocratie anglaise. Je suis sûre qu’il vous plaira. Quelle belle race que ces Anglais ! Et les enfants qui naissent en Angleterre sont comme cela, étaient comme cela ! J’ai eu hier une lettre de mon frère un peu meilleure que les autres. L’Empereur venait d’arriver au château de Furtustein " il est content de la Pologne, il a été bon pour tous sans se faire illusion." L’Impératrice très faible. Je n’ai vu hier qu’Ellice dans ma longue matinée de Longchamp. Il m’est venu du monde en ville, sur lequel je ne regrette que M. Villers. M. Molé me mande que le grand Duc est arrivé à Lubeck très souffrant et faible. Du reste, no new whatever.
Je mène une vie très solitaire depuis que je ne reçois plus le soir et que ma matinée se passe hors de Paris. Je me couche à 10 heures après une promenade en calèche et cette promenade je la fais invariablement sur la route de Neuilly, la seule praticable puisqu’elle est arrosée ! J’ai lu dans les journaux ce matin, que la réunion de savants à Caen est fixée au 8 août & que vous devez la présider. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous m’avez juré que vous étiez du jury. Je suis extrêmement refroidie sur la partie à Versailles. Vous ne sauriez croire comme je déteste de me déplacer, comme je crains l’inconnu, un mauvais lit. Je ne suis pas difficile, mais mes conforts me sont nécessaires. Je m’engage très lestement pour ce qui est dans l’avenir, mais quand le moment de l’exécution arrive cela me devient insupportable. Je crois que cela s’appelle de la vieillesse.
Adieu, je suis enchantée de vous savoir sorti de vos dîners, il m’en revenait de pauvres lettres. Au reste depuis que j’ai le 31 devant moi, je suis devenue fort accommodante ! Adieu. Adieu. Je ne pense qu’à mardi 31.
Je vous remercie d’avoir fait vos calculs de façon à ne pas me laisser manquer de lettre. Je vous remercie aussi de ce que vous me permettez au sujet du précepteur pour Lord Coke. C’est un enfant charmant. Le type des beaux enfants de l’aristocratie anglaise. Je suis sûre qu’il vous plaira. Quelle belle race que ces Anglais ! Et les enfants qui naissent en Angleterre sont comme cela, étaient comme cela ! J’ai eu hier une lettre de mon frère un peu meilleure que les autres. L’Empereur venait d’arriver au château de Furtustein " il est content de la Pologne, il a été bon pour tous sans se faire illusion." L’Impératrice très faible. Je n’ai vu hier qu’Ellice dans ma longue matinée de Longchamp. Il m’est venu du monde en ville, sur lequel je ne regrette que M. Villers. M. Molé me mande que le grand Duc est arrivé à Lubeck très souffrant et faible. Du reste, no new whatever.
Je mène une vie très solitaire depuis que je ne reçois plus le soir et que ma matinée se passe hors de Paris. Je me couche à 10 heures après une promenade en calèche et cette promenade je la fais invariablement sur la route de Neuilly, la seule praticable puisqu’elle est arrosée ! J’ai lu dans les journaux ce matin, que la réunion de savants à Caen est fixée au 8 août & que vous devez la présider. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous m’avez juré que vous étiez du jury. Je suis extrêmement refroidie sur la partie à Versailles. Vous ne sauriez croire comme je déteste de me déplacer, comme je crains l’inconnu, un mauvais lit. Je ne suis pas difficile, mais mes conforts me sont nécessaires. Je m’engage très lestement pour ce qui est dans l’avenir, mais quand le moment de l’exécution arrive cela me devient insupportable. Je crois que cela s’appelle de la vieillesse.
Adieu, je suis enchantée de vous savoir sorti de vos dîners, il m’en revenait de pauvres lettres. Au reste depuis que j’ai le 31 devant moi, je suis devenue fort accommodante ! Adieu. Adieu. Je ne pense qu’à mardi 31.
191. Sézanne, Lundi 3 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
191 Sézanne lundi 3 juin 1839 7 heures
Vous voulez savoir de mes nouvelles. J’ai cheminé tristement, bien tristement. Mais me voici. Je vais dîner, je fais comme à Boulogne je vous prends avant mon dîné et j'ai bien faim. J'ai beaucoup de choses à vous dire ; je ne vous les dirai que de Baden, de très mauvaises nouvelles de mes affaires. C'est de mal en pire en Courlande rien rien du tout. Il me semble que lorsque on saura cela, il est difficile qu'on en fasse pas quelque chose. Comment vont se conduire mes fils ? Voulez- vous que je vous le dise ? Mon inquiétude porte sur l’opinion qu’ils vont donner d’eux ! Adieu. Adieu que ce sera long, long, triste. Je pense à vous sans cesse. Oubliez la calèche. Je reviendrai riche ou pauvre. Mon orgueil s'abaisse devant mon amour. Adieu. Je suis morte de fatigue mais adieu mille fois.
Vous voulez savoir de mes nouvelles. J’ai cheminé tristement, bien tristement. Mais me voici. Je vais dîner, je fais comme à Boulogne je vous prends avant mon dîné et j'ai bien faim. J'ai beaucoup de choses à vous dire ; je ne vous les dirai que de Baden, de très mauvaises nouvelles de mes affaires. C'est de mal en pire en Courlande rien rien du tout. Il me semble que lorsque on saura cela, il est difficile qu'on en fasse pas quelque chose. Comment vont se conduire mes fils ? Voulez- vous que je vous le dise ? Mon inquiétude porte sur l’opinion qu’ils vont donner d’eux ! Adieu. Adieu que ce sera long, long, triste. Je pense à vous sans cesse. Oubliez la calèche. Je reviendrai riche ou pauvre. Mon orgueil s'abaisse devant mon amour. Adieu. Je suis morte de fatigue mais adieu mille fois.
201. Baden, Samedi 22 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
201 Baden Samedi le 22 juin 1839 7 heures du matin
Le petit paquet m’ennuie, je donne aujourd'hui dans l’autre excès. Votre description de la place Louis XV est superbe. Celle de la chambre si elle se soutient vous dispenserait presque d'être à Paris. J’aime bien cependant vous y savoir. Vous êtes plus près, tout est plus régulier. J’ai fini ma journée hier par une promenade avec Mad. Wellesley. Elle bavarde et m’amuse un peu. Nous avons connu les mêmes personnes. Cela fait un lien. Je ne manque jamais de me coucher à 9 heures. Je ne manque rien de ce qui peut me faire me bien porter. Si je n’y réussis pas, il n’y aura pas de ma faute. Il me semble que Pozzo va vous arriver. Vous le verrez n’est-ce pas ? Faites le causer et vous me redirez s'il sait causer encore et de quoi ?
Dimanche 23. 7 heures du matin
Ma journée s’est mal passée hier. Je ne me suis pas sentie bien. Je ne le suis pas encore aujourd’hui. Je ne sais ce que c’est ; je sors cependant de mon bain, car je fais tout comme on me l’ordonne On mange très mal ici ; voilà peut- être ce qui me dérange, je n'engraisserai pas avec cela.
Onze heures. Je reviens de l'église. J’y vais tous les dimanche. Il y a un prédicateur admirable qui est le plus mauvais sujet du pays. Un homme à prendre pour toutes sortes de méfaits et le prédicateur le plus éloquent, le plus touchant que j'ai jamais entendu. Je reçois dans ce moment une lettre d’Alexandre. Lui et son frère avaient vu l’Empereur et l’Impératrice par faveur extraordinaire ils ont passé une soirée intime avec la famille impériale. Ils ont été comblés. L’Empereur attendri à leur vue. Les traitant comme des proches parents. Leur répétant vous me tenez de près et je veux que ces rapports là subsistent toujours entre nous. " Enfin c’est comme cela devait être mais comme je ne l'espérais pas. Alexandre trouve moyen par une phrase convenue de me dire qu'on continue à être très mal pour moi. Vous voyez bien qu’il ne s’agira pas de pension. Je suis toujours enchantée qu'il soit si bien pour mes enfants.
5 heures
Voici l’heure de la poste. J’attends votre lettre, et il faut que je fasse partir la mienne. J’ai vu Mad. de Nesselrode ce matin. Elle est vraiment bonne pour moi, mais je l'incommode le moins possible. Cependant je la tiendrai au courant de mes affaires. Elle a mandé à son mari d’interroger Pahlen sur mes relations avec Paul ! Tout pourra se concilier avec les intérêts de service de Paul. On a de lui bonne opinion comme capacité. Il faut le pousser. Et il pourrait être pour moi plus mal encore que cela ne doit faire aucune différence pour sa carrière. Son intérêt doit aller avant le mien, c’est comme cela que je l’entends. voilà votre lettre, intéressante bonne aimable. Je vous remercie bien de Castillon. Adieu. Je suis pressée par la poste, adieu adieu milles fois.
Le petit paquet m’ennuie, je donne aujourd'hui dans l’autre excès. Votre description de la place Louis XV est superbe. Celle de la chambre si elle se soutient vous dispenserait presque d'être à Paris. J’aime bien cependant vous y savoir. Vous êtes plus près, tout est plus régulier. J’ai fini ma journée hier par une promenade avec Mad. Wellesley. Elle bavarde et m’amuse un peu. Nous avons connu les mêmes personnes. Cela fait un lien. Je ne manque jamais de me coucher à 9 heures. Je ne manque rien de ce qui peut me faire me bien porter. Si je n’y réussis pas, il n’y aura pas de ma faute. Il me semble que Pozzo va vous arriver. Vous le verrez n’est-ce pas ? Faites le causer et vous me redirez s'il sait causer encore et de quoi ?
Dimanche 23. 7 heures du matin
Ma journée s’est mal passée hier. Je ne me suis pas sentie bien. Je ne le suis pas encore aujourd’hui. Je ne sais ce que c’est ; je sors cependant de mon bain, car je fais tout comme on me l’ordonne On mange très mal ici ; voilà peut- être ce qui me dérange, je n'engraisserai pas avec cela.
Onze heures. Je reviens de l'église. J’y vais tous les dimanche. Il y a un prédicateur admirable qui est le plus mauvais sujet du pays. Un homme à prendre pour toutes sortes de méfaits et le prédicateur le plus éloquent, le plus touchant que j'ai jamais entendu. Je reçois dans ce moment une lettre d’Alexandre. Lui et son frère avaient vu l’Empereur et l’Impératrice par faveur extraordinaire ils ont passé une soirée intime avec la famille impériale. Ils ont été comblés. L’Empereur attendri à leur vue. Les traitant comme des proches parents. Leur répétant vous me tenez de près et je veux que ces rapports là subsistent toujours entre nous. " Enfin c’est comme cela devait être mais comme je ne l'espérais pas. Alexandre trouve moyen par une phrase convenue de me dire qu'on continue à être très mal pour moi. Vous voyez bien qu’il ne s’agira pas de pension. Je suis toujours enchantée qu'il soit si bien pour mes enfants.
5 heures
Voici l’heure de la poste. J’attends votre lettre, et il faut que je fasse partir la mienne. J’ai vu Mad. de Nesselrode ce matin. Elle est vraiment bonne pour moi, mais je l'incommode le moins possible. Cependant je la tiendrai au courant de mes affaires. Elle a mandé à son mari d’interroger Pahlen sur mes relations avec Paul ! Tout pourra se concilier avec les intérêts de service de Paul. On a de lui bonne opinion comme capacité. Il faut le pousser. Et il pourrait être pour moi plus mal encore que cela ne doit faire aucune différence pour sa carrière. Son intérêt doit aller avant le mien, c’est comme cela que je l’entends. voilà votre lettre, intéressante bonne aimable. Je vous remercie bien de Castillon. Adieu. Je suis pressée par la poste, adieu adieu milles fois.
239. Baden, Dimanche 11 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
239 Baden Dimanche le 11 août 1839 9 heures
Je me sens aujourd’hui plus faible que de coutume. Mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai bien besoin de vous pour me remettre, j’ai besoin de votre affection, de vos soins, de vos conseils, il me faut un appui. Je vous assure que je ne me conçois pas livrée encore pour bien des mois à mes seules ressources, c'est à dire à mes bien tristes pensées. Vous ne savez pas comme elles sont tristes ! Comme elles le deviennent tous les jours davantage. Les journaux confirment ce que vous me dites des nouveaux embarras ministériels. Mais je ne crois à rien. Ils iront comme ils ont été. Les Flahaut sont menacés de perdre leur seconde fille, elle crache le sang. C’est pour elle qu’ils viennent aux Eaux en Allemagne et qu’ils iront ensuite passer l'hiver en Italie.
1 heure. J’ai été à l’église. Toujours un superbe sermon. Le texte était votre lettre. Nous reverrons ceux que nous avons aimés, mais j'aime encore mieux votre lettre que ce superbe sermon. Vous avez raison. Je viens de recevoir une seconde lettre de Benkhausen qui explique tout, comme vous le dites.
J’ai l’administration et non la possession du Capital. J’écris de suite à mon frère, pour tout remettre à sa place. J'ai du regret d'avoir mal compris, pour dire la vérité c’est Mad. de Talleyrand et Bacourt qui me l’ont fait comprendre comme cela ; car vous savez bien que moi, je ne m'y entends pas. Mais il faut absolument que ce soit moi qui lève l’argent. Les droits en Angleterre emporteront 1000 £ ce qui réduit le Capital à 44800 £. Pouvez-vous me dire si dans le plein pouvoir que j’ai donné à Paris à mon frère, il est suffisamment autorisé à faire pour moi cette opération ? Je vous envoie copie de la lettre que je lui écris. Savez-vous bien que je me sens toute soulagée par cette lettre de Benkhausen ? C’est si vrai qu’étant fort malade ce matin me voilà mieux. Je suis débarrassée de ces richesses imaginaires qui m'étaient on ne peut plus désagréables.
Je viens de lire des rapports de Vienne. Vos Ambassadeurs, le vôtre, celui d'Angleterre et l’internonce sont de parfaites dupes. Le divan est entre les mains de M. de Bouteneff et c’est par lui que le divan négocie avec Méhémet Ali. Je vous dis ce qui dit la diplomatie à Vienne. Metternich est fort inquiet de ce que nous ne parlons pas. Ne vous ai-je pas toujours dit que c’était notre affaire et que nous n’entrerions pas en causerie sur cela. Adieu. Adieu mille fois, adieu. Je reçois dans ce moment une lettre de mon fils Alexandre du 31 juillet dans laquelle il me dit qu’on venait de recevoir les nouvelles de la défection du Capitan Pacha, & de la défaite de l'armée Turque, que comme cela amènera des complications graves que peuvent influer sur mes projets pour cet hiver, il se hâte de m’en donner avis !
Je me sens aujourd’hui plus faible que de coutume. Mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai bien besoin de vous pour me remettre, j’ai besoin de votre affection, de vos soins, de vos conseils, il me faut un appui. Je vous assure que je ne me conçois pas livrée encore pour bien des mois à mes seules ressources, c'est à dire à mes bien tristes pensées. Vous ne savez pas comme elles sont tristes ! Comme elles le deviennent tous les jours davantage. Les journaux confirment ce que vous me dites des nouveaux embarras ministériels. Mais je ne crois à rien. Ils iront comme ils ont été. Les Flahaut sont menacés de perdre leur seconde fille, elle crache le sang. C’est pour elle qu’ils viennent aux Eaux en Allemagne et qu’ils iront ensuite passer l'hiver en Italie.
1 heure. J’ai été à l’église. Toujours un superbe sermon. Le texte était votre lettre. Nous reverrons ceux que nous avons aimés, mais j'aime encore mieux votre lettre que ce superbe sermon. Vous avez raison. Je viens de recevoir une seconde lettre de Benkhausen qui explique tout, comme vous le dites.
J’ai l’administration et non la possession du Capital. J’écris de suite à mon frère, pour tout remettre à sa place. J'ai du regret d'avoir mal compris, pour dire la vérité c’est Mad. de Talleyrand et Bacourt qui me l’ont fait comprendre comme cela ; car vous savez bien que moi, je ne m'y entends pas. Mais il faut absolument que ce soit moi qui lève l’argent. Les droits en Angleterre emporteront 1000 £ ce qui réduit le Capital à 44800 £. Pouvez-vous me dire si dans le plein pouvoir que j’ai donné à Paris à mon frère, il est suffisamment autorisé à faire pour moi cette opération ? Je vous envoie copie de la lettre que je lui écris. Savez-vous bien que je me sens toute soulagée par cette lettre de Benkhausen ? C’est si vrai qu’étant fort malade ce matin me voilà mieux. Je suis débarrassée de ces richesses imaginaires qui m'étaient on ne peut plus désagréables.
Je viens de lire des rapports de Vienne. Vos Ambassadeurs, le vôtre, celui d'Angleterre et l’internonce sont de parfaites dupes. Le divan est entre les mains de M. de Bouteneff et c’est par lui que le divan négocie avec Méhémet Ali. Je vous dis ce qui dit la diplomatie à Vienne. Metternich est fort inquiet de ce que nous ne parlons pas. Ne vous ai-je pas toujours dit que c’était notre affaire et que nous n’entrerions pas en causerie sur cela. Adieu. Adieu mille fois, adieu. Je reçois dans ce moment une lettre de mon fils Alexandre du 31 juillet dans laquelle il me dit qu’on venait de recevoir les nouvelles de la défection du Capitan Pacha, & de la défaite de l'armée Turque, que comme cela amènera des complications graves que peuvent influer sur mes projets pour cet hiver, il se hâte de m’en donner avis !
200. Baden, Jeudi 20 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
200 Baden le 20 juin 1839 jeudi 6 1/2 du matin.
Je n’ai vu personne hier, ni Mad. de Talleyrand ni Mad. de Nesselrode ma seule récréation a été une promenade le soir avec Mad. Wellesley. Vous voyez que c’est trop peu pour moi et que la journée est bien longue ! Et il y a encore au moins deux grands mois à passer de la sorte. Mon fils Alexandre me doit bien des lettres. La Dernière était du 23 mai. c’est long.
Vendredi 21 à 11 heures
Voilà tout ce que j'avais pu vous dire hier, j’étais fatiguée, triste, découragée, et dans l’angoisse d'une lettre de mon fils Alexandre venus à 5 h. et que mon médecin m'avait prié de ne pas ouvrir. afin de ne pas déranger ma nuit je l'ai donc envoyée à Mad. de Talleyrand et je ne l’ai ouverte que ce matin. Elle ne renferme rien absolument. Il est à la campagne chez ma sœur, il va tous les matins en ville pour les affaires voilà tout ce qu'il me dit. Et au fait je suis charmée qu'il ne me parle pas affaires. Ce n’est pas par lui que j'en apprendrai rien, cela doit en venir de mon frère pourvu que cela vienne bientôt ! Je suis surprise du complet silence de Matonchewitz. Je ne veux pas vous parler de ma santé jusqu'à ce que j’ai quelque chose de bon à vous en dire. Jusqu'à présent je suis comme j’étais.
3 heures 1/2
La comtesse Nesselrode est venue m’interrompre. Elle est certainement très bien disposée, elle écrit à son mari, j'ai bien insisté sur ce que je préfère la carrière de mon fils à mes propres intérêts ; ainsi je ne veux pas qu’on dise rien qui puisse lui nuire, en même temps je ne veux pas qu'on puisse me croire des torts envers lui. Tout cela est bien délicat, tout cela est difficile à ménager, c'est une mauvaise situation, et tous les jours cela m’afflige davantage Notre Ambassadeur Pahlen. m'écrit pour me dire qu'il quitte Paris aujourd'hui même. Il sera à Pétersbourg le 2 de juillet et me demande ce qu'il peut faire pour moi. Je lui écrirai pour le prier de me défendre s'il entend dire qu’on m'attaque, je ne veux pas autre chose. Mad. de Talleyrand prétend qu'aujourd’hui tout à l’air de se placer mieux pour moi et elle croit que de tout cela ressortira un bon dénouement. Moi je ne crois encore à rien de bon je suis si accoutumée au mauvais.
Lady Cowper me mande que son frère est bien fatigué, bien tracassé, que les Torys sont très violents que s'il y avait un changement elle et lord Melbourne viendraient, tout de suite de ce côté-ci. Le chevalier Courrey quitte l'Angleterre. C’est le grand événement de Londres. Peut être cela ramènera-t-il la paix entre la mère et la fille ? Lady Cowper est très désappointée de ce que je n’aille pas en Angleterre, elle m’attend en automne. Elle me reparle d’Orloff, de ses promesses. Elle me fait des messages d’amitié de Palmerston, voilà la lettre. J'aurais dû vous l’envoyer ce matin, et vous aurez dû me la rapporter à midi 1/2 ! Ah le bon temps passé !
Puisque vous allez avoir du loisir voyez un peu si vous ne pourriez pas me trouver une maison. Ne soyez pas trop exclusif pour le Fbg St. Honoré. Au fond les bonnes maisons ne sont que de l’autre côté. Vous savez qu'il me faut le soleil avant toutes choses. Non pas, pas avant vous; mais après vous. Adieu. Adieux, je suis impatiente de vos lettres de Paris que pensez-vous de la situation, éclairez- moi, racontez-moi. Adieu. Adieu.
6 h. Voici votre lettre de Paris, & il faut que la même partie. Je vous remercie tendrement, bien tendrement. Ecrivez, Ecrivez. Vous êtes dans votre maison je suppose ?
Je n’ai vu personne hier, ni Mad. de Talleyrand ni Mad. de Nesselrode ma seule récréation a été une promenade le soir avec Mad. Wellesley. Vous voyez que c’est trop peu pour moi et que la journée est bien longue ! Et il y a encore au moins deux grands mois à passer de la sorte. Mon fils Alexandre me doit bien des lettres. La Dernière était du 23 mai. c’est long.
Vendredi 21 à 11 heures
Voilà tout ce que j'avais pu vous dire hier, j’étais fatiguée, triste, découragée, et dans l’angoisse d'une lettre de mon fils Alexandre venus à 5 h. et que mon médecin m'avait prié de ne pas ouvrir. afin de ne pas déranger ma nuit je l'ai donc envoyée à Mad. de Talleyrand et je ne l’ai ouverte que ce matin. Elle ne renferme rien absolument. Il est à la campagne chez ma sœur, il va tous les matins en ville pour les affaires voilà tout ce qu'il me dit. Et au fait je suis charmée qu'il ne me parle pas affaires. Ce n’est pas par lui que j'en apprendrai rien, cela doit en venir de mon frère pourvu que cela vienne bientôt ! Je suis surprise du complet silence de Matonchewitz. Je ne veux pas vous parler de ma santé jusqu'à ce que j’ai quelque chose de bon à vous en dire. Jusqu'à présent je suis comme j’étais.
3 heures 1/2
La comtesse Nesselrode est venue m’interrompre. Elle est certainement très bien disposée, elle écrit à son mari, j'ai bien insisté sur ce que je préfère la carrière de mon fils à mes propres intérêts ; ainsi je ne veux pas qu’on dise rien qui puisse lui nuire, en même temps je ne veux pas qu'on puisse me croire des torts envers lui. Tout cela est bien délicat, tout cela est difficile à ménager, c'est une mauvaise situation, et tous les jours cela m’afflige davantage Notre Ambassadeur Pahlen. m'écrit pour me dire qu'il quitte Paris aujourd'hui même. Il sera à Pétersbourg le 2 de juillet et me demande ce qu'il peut faire pour moi. Je lui écrirai pour le prier de me défendre s'il entend dire qu’on m'attaque, je ne veux pas autre chose. Mad. de Talleyrand prétend qu'aujourd’hui tout à l’air de se placer mieux pour moi et elle croit que de tout cela ressortira un bon dénouement. Moi je ne crois encore à rien de bon je suis si accoutumée au mauvais.
Lady Cowper me mande que son frère est bien fatigué, bien tracassé, que les Torys sont très violents que s'il y avait un changement elle et lord Melbourne viendraient, tout de suite de ce côté-ci. Le chevalier Courrey quitte l'Angleterre. C’est le grand événement de Londres. Peut être cela ramènera-t-il la paix entre la mère et la fille ? Lady Cowper est très désappointée de ce que je n’aille pas en Angleterre, elle m’attend en automne. Elle me reparle d’Orloff, de ses promesses. Elle me fait des messages d’amitié de Palmerston, voilà la lettre. J'aurais dû vous l’envoyer ce matin, et vous aurez dû me la rapporter à midi 1/2 ! Ah le bon temps passé !
Puisque vous allez avoir du loisir voyez un peu si vous ne pourriez pas me trouver une maison. Ne soyez pas trop exclusif pour le Fbg St. Honoré. Au fond les bonnes maisons ne sont que de l’autre côté. Vous savez qu'il me faut le soleil avant toutes choses. Non pas, pas avant vous; mais après vous. Adieu. Adieux, je suis impatiente de vos lettres de Paris que pensez-vous de la situation, éclairez- moi, racontez-moi. Adieu. Adieu.
6 h. Voici votre lettre de Paris, & il faut que la même partie. Je vous remercie tendrement, bien tendrement. Ecrivez, Ecrivez. Vous êtes dans votre maison je suppose ?