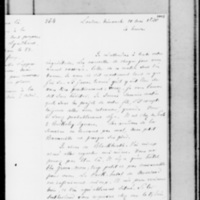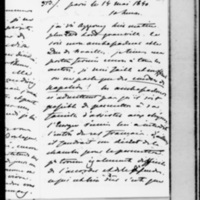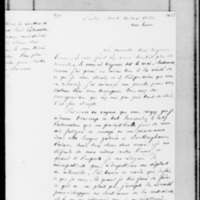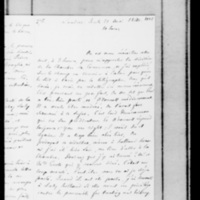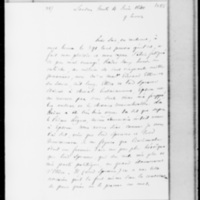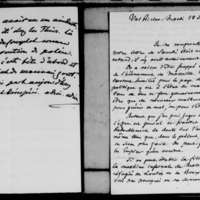Votre recherche dans le corpus : 12 résultats dans 4111 notices du site.
340. Londres, Samedi 11 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’est pas le moins du monde question de la translation du corps de Napoléon en France. M. Molé me paraît peu au courant des Affaires étrangères. Car ici je ne vois pas pourquoi il mentirait. Du reste je ne suis pas surpris qu’il soit peu au courant. On ne l’aimait pas du tout dans le département, et parmi les gens qui y restent toujours, je n’en sais aucun qui prenne soin de l’instruire.
L’Angleterre a fait le geste pour Naples ; à l’heure qu’il est, l’amiral Stopford doit avoir saisi des bâtimens napolitains et les avoir envoyés à Malte où ils resteront en dépôt jusqu’à l’arrangement. Lord Palmerston est pourtant un peu préoccupé des conséquences possibles du coup. Nous nous emploierons à les prévenir et à amener un accommodement.
J’ai renoncé, bien contre mon goût et mon naturel, à la prétention de tout régler d’avance et pour longtemps. Mais pour ceci et dans les limites que je vous dis c’est parfaitement décidé. Il n’y a donc rien là, absolument rien qui dérange nos projets ni qui puisse nous causer aucun mécompte. Tenez pour certain que sauf les plus grandes affaires du monde ce qui ne se peut pas à Londres à cette époque.
Je serai à Paris d’octobre en Février avec ma mère et mes enfants. Il faudrait donc que je ne les fisse pas venir du tout d’ici là ce qui leur serait et à moi aussi un vif chagrin. Ils viendront donc en Juin, Notre seul dérangement portera, sur nos visites, de châteaux qui en seront, nullement supprimées mais un peu abrégées. Ces visites-là seront pour moi une convenance et presque une affaire. Ma mère le sait déjà et en est parfaitement d’accord. Je ne la laisserai pas seule à Londres. Mlle Chabaud viendra l’y voir au mois d’aout. Je ferai donc des visites, nos visites seulement un peu plus courtes. Il faut bien quelques sacrifices. Je voudrais bien sur cela, n’en faire aucun.
Que signifie cette phrase : "Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi "? Si vous parlez de mes devoirs, de mes premiers devoirs vous avez raison. Est-ce là tout ? Dites-moi. Et puis dites-moi aussi que vous vous associez à mes devoirs, et que vous m’en voudriez de ne pas les remplir parfaitement.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Famille Guizot, Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Protestantisme, Relation François-Dorothée, Religion, Réseau social et politique, Salon, Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)
364. Londres, Dimanche 10 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les accidents de la semaine ne tournent pas mal. Mon petit Banneville est presque sur pied. Je viens de Blackheath. J’ai mieux aimé aller regarder moi-même. Vous ne pouvez pas être là. Il n’y a qu’un hôtel the Green-man, trop petit et pas convenable pour vous. Le Park-hotel de Norwood est infiniment mieux. Il m’a paru vraiment bien et très agréablement situé. Si les Sutherland vous reçoivent chez eux le 1er juin, vous viendrez si peu de jours auparavant que la distance de Norwvood importe assez peu. Et s’ils ne vous reçoivent pas, vous viendrez à Londres.
Je viens de conclure en trois jours une petite négociation qui fera grand bruit. J’ai redemandé les restes de Napoléon et on nous les rend. Ils seront déposés aux Invalides. Il y a plaisir à faire des Affaires avec Lord Palmerston quand il est de votre avis. Il les mène simplement et rondement. Ne parlez de ceci que quand on en parlera. Probablement on en parle déjà. Mais en tout cas, je désire que la publicité ne vienne pas de vous. On m’a promis de Paris une immense poputarité si je réussissais. Encore une fois, attendez qu’on en parle. Je ne sais pourquoi je vous répète cela.
J’ai dîné hier chez Sir Robert Peel, un dîner de Royal academy. Il y en avait un aussi chez Lord Lansdowne où j’aurais dû être aussi. Mais Peel avait eu la priorité. Je ne dînerai point chez les Philips. Je commence à supprimer quelques ennuis. Je me suis promené dans le parc de Greenwich. Je voulais retourner à Richmond. Mais je n’ai pas eu le temps.
Lundi 3 heures
Voici les renseignements les plus exacts et les plus complets. Alexandre continue d’aller bien. Chez lui, on dit et il dit lui-même, ce matin, qu’il partira dans huit jours pour Paris. J’ai envoyé Herbet, chez Brodie. Il l’a vu et à causé avec lui. Brodie trouve Alexandre bien, si bien a-t-il dit, qu’il n’ira pas le voir aujourd’hui. Mais à cette question d’Herbet: " Croyez-vous que le Prince Alexandre puisse partir dans huit jours ? " Brodie a répondu positivement; " He cannot. - Et dans quinze jours? Brodie a dit que c’était probable ; mais qu’en homme sensé, il ne voulait pas en répondre. Vous savez à présent le véritable état des choses. Il n’y a absolument aucun danger ; mais il faut du temps. Je n’ajoute rien. Décidez.
Je viens d’un grand meeting que devait présider Lord John Russel et où il a été remplacé pas Sir George Grey. Il a fallu comme de raison, y prendre la parole to second a motion. Il me semble que m’a popularité ne faiblit pas. J’ai reçu pour ce mois-ci quinze ou vingt invitations, à des meetings semblables. J’ai choisi les deux les plus considérables. Je n’irai qu’à ceux là.
J’irai peut-être dans deux heures à la Chambre des Lords où le Chancelier doit proposer un bill sur lequel parlera Lord Lyndhurst. On dit qu’on attend Lord Brougham le 23.
Votre "il ne peut pas" serait donc faux. No news. Si ce n’est que Palmella s’oppose à la demande Anglaise à Lisbonne. Mais on dit que ce pourrait bien être pour renverser le Cabinet portugais, et prendre sa place. Adieu.
J’approuve les changement à la lettre. Que j’ai de choses à vous dire ! Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Inquiétude, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Parcours politique, Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Réseau social et politique, Santé (enfant Benckendorff), Séjour à Londres (Dorothée)
373. Paris, Jeudi 14 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
J’ai vu Appony hier matin. Plus tard lord Granville. Le soir mon Ambassadeur et le duc de Noailles. Je tiens ma portie fermée encore à tous les autres ; je suis faible et souffrante. On ne parle que des cendres de Napoléon ! Les ambassadeurs n’admettent pas qu’il soit possible de permettre à sa famille d’assister aux obsèques. L’Europe réunit lui a interdit l’entrée du sol français. D’ailleurs il faudrait un décret de le chambre pour le permettre. Je trouve également difficile de l’accorder et de défendre. Ce qui est bien sûr c’est que Vous vous êtes créé là de très grands embarras pour l’avenir. Les étrangers ajoutent : " les dangers sont pour la France, qu’elle s’en tire. Granville parle comme cela aussi. Il me parait fort content de la manière dont lord Palmerston a accueilli tout ceci. En effet, il y a une une très bonne grâce. On pense généralement que la réhabilitation du Maréchal Ney sera une conséquence inévitable. Appony se prononce avec force contre cela. Le duc de Noailles dit que ce serait grave, en ce que cela casserait l’arrêt de l’un des grands corps de l’état. Je vous envoie le partage. L’affaire Rémilly est noyée pour le moment. J’ai enfin assez bien dormi cette nuit; la lettre de mon fils m’avait calmée, mais après une gande excitation le calme amène la fatigue, ce s’est qu’alors qu’on sent tout le mal qu’on s’est fait ! Il y a des gens qui disent que ces trois jours m’ont fait maigrir beaucoup, et je le crois. Vous recevez aujourd’hui la lettre dans laquelle je m’annonce et demain celle qui la détruit. Je pense à votre plaisir, et puis à votre désappointement. Je pense à tout, à tout ce qui vous passe par le cœur. Mais vous trouverez que j’ai raison, que mon inquiétude devait me faire aller ; que les nouvelles d’hier doivent me faire soumettre mes mouvements à la volonté de mon fils. Je ne veux contrarier en rien ses projets. Je sais qu’il déteste le séjour de Londres, et dès qu’il me dira ce qu’il faut faire, je me déciderai. Je reste prête à partir sur l’heure. Midi. Voici votre lettre. Elle confirme tout ce que vous me disiez hier sur mon fils, demain j’aurai de ses nouvelles plus directes et peut- être même sa décision sur mes mouvenents, car dès lundi je lui avais écrit sur ce sujet. Samedi je n’aurai rien de vous car vous m’aurez écrit à Boulogne. Je suis fatiguée, abimée, encore. un peu inquiète et l’incertitude sur ce que je vais faire dans peu de jours me tournente aussi. Voilà comme on passe sa vie ! C’est à peine vivre. Adieu, adieu. Je vois que Londres vous plait, cque vous vous y amusez. Au fond je ne vous croyais pas si susceptible d’être amusé. Mais c’est une disposition heureuse. Ah mon Dieu que je me tirais vite moi de ces bals de cour, et quand je ne pouvais pas m’en tirer, que je supportais impatiemment cette gêne ! Quelle mine désagréable je faisais au roi. Il y a bien des points sur lesquels nous ne nous ressemblons pas, mais vous avez raison. Et moi, j’ai tort. Adieu.
369. Londres, Vendredi 15 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
3 heures et demie
J’ai été chargé de l’arranger ici. Je l’ai fait. Je ne suis pas chargé des conséquences. Du reste, nous sommes, je crois, destinés à vivre sous un horizon couvert de gros nuages qui ne portent pas de tonnerre.
Je n’ai pas éte surpris de ne pas voir mon nom dans le discours de M. de Rémusat, et je le trouve assez convenable. Il ne devait y avoir dans ce discours comme il n’y a en effet, que quatre noms : le Roi, Napoléon, la France et l’Angleterre. Ce que j’admire, sans en être surpris c’est l’art avec lequel les journaux, ministeriels ou de la gauche, ont évité de parler de moi à ce propos. Cela m’arrivera souvent. Même quand on m’aura écrit : " Réussissez dans cette affaire et nous vous en laisserons tout l’honneur."
Moi aussi, je suis préoccupé de l’été qui commence et de ce qu’il peut apporter dans ma destinée. Mais ma situation est claire pour moi et ma résolution arrêtée. Je suis donc préoccupé sans agitation. Un homme d’assez d’esprit m’écrit : " On connait ici tout l’avantage de votre position, on l’admire et on l’envie. Vos amis sont peut-être ceux qui s’en arrangent le moins. Ils trouveraient assez bon que quelque cause de mécontentement vous ramenât à Paris afin que vous passiez leur dire ce qu’ils ont à faire. Il n’y a de direction nulle part. Le ministère manque complètement d’assiette. La gauche n’en sait pas encore assez long pour se conduire sagement ; et la droite paye en détail pour ses lachetés précédentes. Restez bien longtemps le plus loin possible de ces misères et gardez le moins de pitié possible pour les détresses de l’amitié.
Qu’en dites-vous ? Pourtant je me méfie de ce conseil, car c’est mon penchant. Je ne veux pas devancer d’une minute la nécessité ; mais je ne veux pas lui manquer.
5 heures
Votre fils n’est pas sorti à cause de la pluie, et aussi par prudence. Il ne sortira probablement pas avant Lundi. Mais il va de mieux en mieux. Je ne doute pas qu’il ne préfère aller à Paris, et ne vous engage à l’y attendre. Adieu. Je vous ai écrit hier à Boulogne et à Douvres, poste restante. Adieu. Adieu
Réposez-vous.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Pratique politique, Presse, Relation François-Dorothée (Dispute), Santé (enfants Benckendorff)
370. Londres, Samedi 16 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les nouvelles sont toujours bonnes. Je crois qu’il n’y aura bientôt plus de nouvelles. Je vous ai toujours dit le vrai, seulement comme j’ai pensé en même temps à la vérité de ce que je vous disais et à l’impression que vous en recevriez, j’ai ménagé mes paroles pour vous calmer sans vous tromper. Vous avez des correspondants qui n’y ont pas pris tant de soin. C’est fort, simple.
J’ai souri en voyant que vous croyez que je m’amuse beaucoup au bal. Demandez à Lady Palmerston qui me parlait l’autre jour de mon air fatigué et ennuyé en me promenant dans cette longue galerie de Buckingham-Palace. Mais deux choses sont vraies; je me défends de mon mieux contre l’ennui, et quand il l’emporte, je me résigne. Je m’impatiente peu. L’impatience me déplait et m’humilie. J’ai besoin de croire que je fais ce que je veux. Et quand je suis forcé de faire ce qui ne me plaît pas, j’accepte la nécessité pour échapper au sentiment de la contrainte. Si je ne me résignais pas, je me révolterais.
Je comprends tout ce qu’on dit sur les suites des cendres de Napoléon. Il y a beaucoup à dire. Je ne suis pas inquiet au fond. Les pays libres sont des vaisseaux à trois ponts ; ils vivent au milieu des tempêtes ; ils montent, ils descendent, et les vagues qui les agitent sont aussi celles qui les portent et les font avancer. J’aime cette vie, et ce spectacle. J’y prends part en France ; j’y assiste en Angleterre. Cela vaut la peine d’être. Si peu de choses méritent qu’on en dise cela ?
J’ai dîné hier chez Ellice, en famille. Il est vraiment très bon, et très spirituel. Et il s’amuse de si bon cœur ! Ils étaient fort contents. Le Chancellier de l’échiquier a eu un grand succès aux Communes. Son augmentation de 2 500 000 livres de taxes passera presque sans difficulté. Son statement a été trouvé excellent, simple, vrai. De plus le Cabinet est charmé de l’appui que le Duc de Wellington lui a donné l’autre jour en Chine. Jamais le Duc n’a été plus populaire parmi les whigs. Il y met un peu de coquetterie.
Il approuve fort ce qu’on a fait pour Napoléon.
Dedel est de retour. Le Roi de Hollande à parfaitement pris son parti sur Mlle d’Outremont. Il n’y pense pas plus que s’il n’y avait jamais pensé. Mais tout n’est pas fini entre lui et ses Etats-généraux. Ils auront beaucoup de peine à s’entendre sur les changements à la Constitution, car ni lui, ni les Etats ne cèderont. Mais point de guerre à mort non plus. A des entêtés qui ne se veulent pas de mal, il ne faut que du temps.
J’ai reçu un charmant petit portrait de ma fille Pauline ; d’une ressemblance excellente. Et elle a bon visage dans son portrait. On m’assure que ce n’est pas un mensonge. Ils ne partiront pour la campagne que vers la fin du mois. M. Andral a désiré qu’ils attendissent jusque là, pour prolonger un peu le lait d’ânesse.
3 heures et demie
Je viens de voir Lady Palmerston, et par elle son mari. C’est une personne de beaucoup de good sens et très pratique. Savez-vous qu’il n’est pas commode d’avoir à régler ce qui se passera à 2000 lieues, dans une affaire toute d’égards et de convenances, et de donner une pacotille de bon esprit et de mesure à des hommes qui n’en ont pas trop chez eux?
Je vous quitte pour écrire à Thiers le résultat de ma conversation, car j’ai vu aussi Lord Palmerston aujourd’hui comme hier les journaux ministériels ou quasi ministeriels, gardent le silence sur mon nom à propos de Napoléon. Je vous disais hier que je ne m’en étonnais pas. Pas plus aujourd’hui. Mais je suis bien aise qu’on sache que je le remarque, sans m’en étonner.
Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Ambition politique, Autoportrait, Diplomatie, Enfants (Guizot), Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait, Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Santé (enfants Benckendorff)
375. Londres, Jeudi 21 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
On est venu m’éveiller cette nuit à 3 heures, pour m’apporter la division de la Chambre des Communes, et j’ai expédié sur le champ un courrier à Calais pour qu’on le sût à Paris par le télégraphe. Non qu’il doive, je crois, en résulter ici aucun evènement. C’est pourtant un gros fait. On me dit que Peel a très bien parlé et O’Connell médiocrement. Il a voulu être modèré. On l’avait fort sermoné à ce sujet. C’est Lord Duncannon qui est son prédicateur. Et O’Connell répond toujours : " you are right ; I won’t do it again." Il a trop bien obéi hier. On prévoyait ce résultat, même à Holland House où j’ai été hier soir au lieu d’aller à la chambre. Devinez qui j’y ai trouvé? Mr Mrs Grote qui y avaient dîné. C’était un coup monté. Peut-être vous en ai-je déjà parlé quand ils ont été partis, j’ai demandé à lady Holland si elle avait un privilège contre les poursuites, for treating and bribery.
2 heures
Je viens de chez Lord Aberdeen. J’aime sa conversation, et je crois qu’il aime la mienne. Il y a beaucoup de shyness dans sa froideur. Et aussi de sadness. Il est préoccupé de cette affaire Napoléon. On commence à l’être ici, beaucoup plus qu’au premier moment & plus que moi. Je suis accoutumé aux apparences, et aux démonstrations bruyantes. Cependant, il est sûr que des embarras viendront de là. Ce qu’il y avait de bien est déjà recueilli ; il faudra subir le mal. Mais je ne crois pas au danger. Pourvu qu’il y ait un pouvoir qui s’en défende. En tout cas, la question est lointaine. Le retour n’est pas possible avant le mois de Novembre.
L’Orient est stationnaire. Je reste toujours sur mon terrain. On n’y vient pas. Mais on n’ose pas avancer sur le sien. Je m’applaudis du parti que j’ai pris de dire dès le premier moment, ce que je devais dire à la fin. Plus j’y pense, plus je suis convaincu que notre politique est la seule sensée. Rallumer la guerre entre les Musulmans, et courir le risque de l’allumer entre les Chrétiens pour la question de savoir si quatre ou seulement deux Pachalih de la Syrie appartiendront au vieillard qui règne à Alexandrie ou à l’enfant qui dort à Constantinople, en vérité c’est bien léger. Et je tiens pour certain qu’ici il n’y a pas trois personnes qui ne soient au fond de mon avis. De celles qui y ont pensé, s’entend. Il n’y en a pas beaucoup.
Les Affaires Etrangères occupent bien peu le public anglais. Je dis beaucoup sur cette question d’Orient ce qui est parfaitement vrai ; la politique que nous soutenons ne nous causera aucun embarras, à l’intérieur, car tout le monde, en France en est d’avis ; aucun embarras à l’extérieur, car le jour où l’on voudra agir sans nous, les embarras seront pour ceux qui entreprendront de faire, et non pour nous qui regarderons faire. L’hypothèse la plus défavorable ne nous met donc pas dans une position redoutable.
M. de Metternich a eu certainement beaucoup d’humeur pour Naples ; et dans son humeur, il s’est montré plus disposé à faire ce que voudrait Lord Palmerston en Orient. Mais sa disposition est vague, comme tout dans l’affaire. Quant au Pacha, il dit que si on le bloque dans Alexandrie, il sautera par dessus le blocus, c’est-à-dire pas dessus le Taurus. Je connais ces petites biographies, les premiers cahiers, le mien compris, qui était très bienveillant, et assez spirituel. Je connais Thiers, aussi ; mais non pas, le Duc de Broglie, ni Berryer, ni Dupin, ni Lamartine, vous serez bien aimable de m’envoyer ceux-là. L’ouvrage m'a paru écrit à bonne intention. Sait-on par qui?
Certainement, je porterai la santé de la Reine, le 25. Je suis en pension chez lady Palmerston. Elle dine samedi chez moi ; moi dimanche chez elle en petit comité, et lundi en full house. Je l’ai beaucoup vue depuis quelque temps et plus je la vois, plus je la trouve aimable. Elle dit qu’à présent je plais beaucoup à M. de Brünnow et qu’il parle de moi tendrement. Adieu.
J’ai le cœur à l’aise depuis hier à votre sujet. Je voudrais que ma grande lettre vous fût arrivée avant la petite. Je ne l’espère pas. Adieu.
Vous devriez vous arranger pour être ici le samedi 13 Juin. Au plus tard le Dimanche 14. Vous ne vous faites pas scrupule, je pense, de voyager le dimanche. Je ne trouve pas qu’on soit aussi austère ici à ce sujet, qu’on me l’avait dit. Le gros Monsieur vient passer quelques jours à Londres et vous en avertira. Ce que vous pourriez lui remettre passera de sa main dans la mienne. Que j’ai de choses à vous dire ! Et que de choses à entendre, que j’aime mille fois mieux !
Adieu, encore ; jamais pour la dernière fois.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Posture politique, Pratique politique, Salon, Séjour à Londres (Dorothée)
374. Londres, Mercredi 20 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ayez l’esprit d’être ici avant le 15 juin. J’y compte ; mais j’en parle. Je ne sais pas encore sûrement quel jour part votre fils. On m’a fait dire samedi, mais par approximation. Il n’y a du reste plus de nouvelles à vous en donner.
Je suis sorti cette nuit à 2 heures de la Chambre des Communes. Débat très médiocre et très ennuyeux. Nul homme important n’a parlé. Sauf lord Howick qui a bien parlé, mais sans faveur et dans une position délicate. J’y ai gagné un torticolli. On est mal assis et j’avais un vent coulis sur l’épaule gauche. Pourtant j’y retournerai ce soir. Je veux voir la fin. On me dit qu’O’Connell parlera ce soir. Evidemment, il n’a pas voulu répondre sur le champ à Lord Stanley. Sur son hardi et puissant visage, il y avait un peu de timidité et d’embarras.
Je ne doute pas que M. Molé ne remue ciel et terre pour nous brouiller Thiers et moi. Il n’est pas le seul. Et il est vrai que Thiers, a laissé entrevoir un défaut à la cuirasse par le puéril silence de sa presse à mon sujet à propos de Napoléon. Je m’étonne que les journaux qui ont envie de nous brouiller ne s’en soient pas déjà avisés. Cela viendra très probablement. Quant à moi, je me suis contenté d’écrire à deux ou trois personnes comme vous : " Cela ne m’étonne pas ; mais je le remarque. " Je ne me brouillerai point. Un moment viendra, peut-être où je me séparerai. Je suivrai exactement la ligne de conduite que vous savez.
Je regrette que vous n’ayiez pas vu ma petite note pour redemander Napoléon. Je crois que vous la trouveriez convenable par la simplicité et la mesure. Je suis pour les Invalides ; une sépulture militaire, religieuse et exceptionnelle. Les places publiques sont impossibles et inconvenantes. Le Panthéon est un lieu commun profane et profané. La Madeleine serait un tombeau grec. St Denis est pour les Rois de profession. Les Invalides seuls vont bien à l’homme, et à lui seul. Adieu.
Cela me déplait de vous quitter. Je voudrais vous écrire toujours. Mais j’ai des affaires. Venez et laissez moi le soin de votre place. Vous serez ma première affaire et mon seul plaisir. Adieu, Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Voyage
376. Londres, Vendredi 22 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Voilà une bonne lettre. J’aime votre bonheur autant que le mien. Je ne peux pas dire plus. Quel ennui de parler à Londres et d’être quatre jours avant de savoir que vous m’avez entendu à Paris ! Vous voyez bien qu’il faut être juste et se comprendre sans avoir besoin de se parler. C’est vraiment odieux et ridicule de se donner à soi-même des chagrins, qui sont parfaitement absurdes, et qu’on découvrira absurdes en quatre jours. Mais il y a des chagrins qui aboutissent à des joies ravissantes. Je n’ose pas le dire ; je ne devrais pas le dire. En ce moment à aucun prix, le N° 379 ne me paraît trop payé.
Non, je n’ai point été consulté sur Ste Hélène. On m’a demandé, prié, conjuré de réussir dans une négociation dont on avait fait la première ouverture, à Lord Granville. On me l’a demandé, le 2 mai. On m’a parlé de "grande reconnaissance personnelle". On a fini en me disant : " Réussissez, et nous vous en laisserons tout l’honneur." J’ai réussi le 9 mai. Je l’ai annoncé le 10. On m’a répondu : " Je vous remercie mille fois : nous vous reportons la part qui vous est due. " Le Ministre de l’intérieur m'a écrit : " Votre affaire, des restes de Napoléon a fait un effet immense." J’ai souri de tant de reconnaissance ici, de tant de silence là. Et depuis je figure bien me tenir parfaitement tranquille. Je remets ici la phrase que je viens de rayer. C’est ici qu’elle doit être.
Savez-vous ce que j’ai fait hier soir? J’ai joué au whist, au coin de mon feu avec mon monde ; et je me suis couché à 10 heures et demie. J’étais excédé des routs. des bals, des Communes. J’avais besoin de silence et de sommeil. Je joue certainement au whist, aussi bien que vous. J’étais allé le matin, passer une heure à la Chambre des Lords où l’archevèque de Dublin devait faire une motion qu’il n’a pas faite. J’ai entendu Lord Lyndhurst à propos d’une pétition. Je trouve qu’il parle très bien, très bien avec une grâce forte et tranquille qui ne va pas à l’ensemble de sa vie. Mais il est bien changé. Il est devenu vieux depuis que je suis ici.
3 heures
J’ai été interrompu par le chargé d’affaires de Naples G. Capece Galeota dei Duchi di Regina, bien noir, bien crépu, pas si long que son nom, mais assez intelligent et sensé? beaucoup plus que le Prince de Castelcicala qui fait ici une figure bien ridicule et bien vulgaire. Il veut être venu pour quelque chose ; il a essayé de parler d’affaires à Lord Palmerston qui l’a renvoyé à Paris, et à Naples. Il a imaginé, de se lier avec les Torys, les plus violents Torys, et de leur parler de ce que Lord Palmerston ne voulait pas écouter. Il promène de côté et d’autre sa tête trépanée. Tout le monde prend pour de beaux coups de sabre les cicatrices de ce trépan qu’il a subi à Naples pour une chute de cheval. Il a porté sa carte à tout le corps diplomatique, moi compris, et ne s’est fait du reste présenter à personne, moi compris. En sorte que presque personne ne lui parle. Le Roi de Naples ferait bien de rappeler ce gros Pulcinella, au crane fendu, et de ne faire parler de ses affaires que par ceux qui peuvent les faire.
Je viens de recevoir un billet de Mad. de Chastenay qui est arrivée hier avec Mad. de St Priest ; elles viennent passer quinze jours à Londres, et un mois en Angleterre. Je vais tâcher de les amuser un peu. Dites-moi ce qu’il faut faire. Elles auront peut-être envie d’être présentées à la Reine, au drawing room. Est-ce Lady Palmerston ou la comtesse de Björstyerna, la doyenne du Corps diplomatique qui se charge de cela ? C’est pour lundi. Vous n’avez pas, le temps de me répondre. J’irai le demander à Lady Palmerston. Il faut aussi que je leur donne un petit dîner, pas trop ennuyeux ; quelques hommes, Lord Elliot, Lord Mahon, lord Leveson. Dites-moi quelques noms. Pas de femmes, n’est-ce pas ? Mon Dieu, que vous êtes loin ! Alava, Bülow, M. et Mad. Dedel ?
Ma galerie de portraits va être complète. Mad. Delessert vient de faire celui de Guillaume, et va faire celui d’Henriette. Je les aurai tous les deux dans quelques jours. Guillaume avec sa toque. On dit que le portrait est charmant. Je pense que je vais engager Mad. de Chastenay et Mad. de St Priest à venir dîner demain samedi avec tous mes Whigs. C’est, pour elles, une très bonne entrée dans le monde et qui préparera le reste. Adieu.
J’espère que vous me direz que vous vous portez bien. Voilà une espérance bien pleine de fatuité, n’est-ce pas ? Mais vous me la permettez ; vous voulez que je l’aie. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Enfants (Guizot), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait, Posture politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique
387. Londres, Jeudi 4 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Hier soir en rentrant, à onze heures, le 391 tout pauvre qu’il est, a fait mon plaisir et mon repos. J’étais fatigué et pas mal ennuyé. Roder deux heures en calèche, au mileu de cent cinquante mille personnes, avec M. et Mad. Edward Ellice et ses sœurs, c’est long. Ellice et lord Spencer étaient à cheval. Certainement, Epsom ne me reverra pas. Une seule chose m’a frappé les voitures et les chevaux innombrables. La Reine a été très bien reçue. On dit que depuis le Prince Régent, aucun souverain n’était venu, à Epsom. Nous avons dîné comme je vous l’ai dit : rien que Lord spencer et Lord Duncannon. Je me figure que Cincinnatus, était un fermier d’air un peu plus héroique que lord Spencer, qui du reste m’a plu et m’a parlé politique, au grand étonnement d’Ellice. Il (lord Spencer) en a une telle aversion qu’il la fuit même dans la conversation de peur qu’on ne le prenne au mot. Aujourd’hui Eton. Et puis je ne vais plus nulle part que là où vous voudrez. Au fait je suis trop complaisant. Je pourrais montrer pourtant depuis que je suis ici une belle somme de refus.
Mon instinct sur la souscription ne m’a pas trompé. Thiers et la gauche ont fait faire là, à Napoléon mort, une pitoyable campagne. On me donne des détails assez curieux. La guerre civile dans la gauche était ardente. Partout chez les ministres, dans les couloirs, les deux factions, Bonapartistes et Anti-bonapartistes, étaient constamment aux prises. Thiers a redouté une division éclatante. Dès lors plus de parti, plus de majorité. Il a passé une nuit sans dormir. Il a fait venir Barrot. Ils ont fait venir les journalistes et ils ont tous mis leurs déroutes, ensemble pour couvrir un peu leur retraite. Tout n’est pas gloire en ce monde.
Vous avez toute raison dans votre réserve, avec M. Molé. Vous savez parfaitement quelle position je veux avoir à présent. soit en général, soit envers lui. Vous avez vu dans quels termes je l’ai prise. Je m’en rapporte aveuglément à vous sur ce que vous direz ou ne direz pas. Je sais depuis longtemps qu’avec les gens vraiment d’esprit, et qui vous aiment, il n’y a qu’une chose à faire, les mettre dans le vrai et les laisser faire. Je ne sais pourquoi je parle ici au pluriel ; le singulier me plaît davantage.
10 h et demie
Certainement je vous guérirai d’âme, j’en suis sûr ; de corps, un peu, je l’espère. Mais seulement tant que nous serons ensemble. Je n’ai pas besoin que vous me disiez quand vous êtes si poorly. Votre écriture, me le dit. Adieu Adieu. Il faut que je fasse ma toilette et que je parte. Demain, plus de course. Je vais attendre. Que la première moitié de notre mois passe vite, et la seconde jamais. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Diplomatie, Discours du for intérieur, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (France), Posture politique, Presse, Relation François-Dorothée
Val Richer, Lundi 30 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai dîné hier à Lisieux avec l'Évêque, son clergé et les gros bonnets de la ville. Le clergé toujours bienveillant, pour le président. Les laïques sans enthousiasme pour l'Empire et craignant qu’il n’amène la guerre. Tout le monde sensé dans un horizon bas et court. La conversation ne s’arrêtant pas sur la politique et cherchant, d’un sentiment général à se porter ailleurs ; tantôt sur les questions économiques, tantôt sur les questions religieuses. C’est un assez amusant spectacle que de voir ces bourgeois au fond très peu dévots quoique respectueux essayer de prendre intérêt à la querelle des auteurs chrétiens et des auteurs païens, aux citations des pères de l'Eglise, et à la tenue des synodes des prêtres du diocèse.
Avez-vous lu un article du Globe sur les affaires d'Orient, France and Turkey, bien fait et curieux ? Il me paraît que le renvoi de Rachid Pacha, s'il est sérieux ne tournera qu’à votre profit. Plus on ira, plus on sentira la faute d'avoir relevé solennellement cette question des Lieux Saints. La politique de la France en Turquie depuis vingt ans est un tissu d'inconséquences et d'étourderies.
J’étais moi-même dans cette mauvaise voie, en 1840, jusqu'à mon ambassade en Angleterre. J’ai essayé d'en sortir de 1840 à 1848 en me tenant tranquille en Orient, et en n'y traitant aucune question que de concert soit avec la Porte elle-même, soit avec toutes les grandes puissances Chrétiennes quand il fallait agir contre la Porte, c’est-à dire sur la Porte, malgré elle. Il n’y a pas autre chose à faire, tant qu’on ne sera pas décidé à fondre, avec du canon, la cloche. de ce pauvre Empire. On s'en apercevra. pour la seconde fois, lorsqu’on se sera mis, pour la seconde fois, dans quelque mauvais pas, comme il nous est arrivé en 1840 à propos de Mehemet Ali.
Le Moniteur, est un peu embarrassé à parler convenablement du déplacement du monument élevé au Duc d'Enghien dans la chappelle de Vincennes. C’est une pauvre raison à donner de ce déplacement que la nécessité de faire plaisir aux artistes " en rétablissant la symétrie des belles lignes architecturales du temple bâti par St. Louis. " Une phrase sur " le respect qu’on doit à la cendre des morts " n’est pas une compensation suffisante. Il ne fallait pas toucher du tout à la cendre de ce mort-là. Elle brûle encore et brûlera toujours quiconque y touchera.
Pourquoi M. de Persigny est-il à Londres ? Est-ce, comme, on l’a dit, pour le traité de commerce qu’on a tout récemment démenti ? J’ai peine à le croire. Il y a là des intérêts puissants, et auxquels il est aussi imprudent de toucher qu'au monument du Duc d'Enghien
11 heures
Voilà le facteur et le général Trézel qui m’arrivent à la fois. Je n'ai que le temps de vous dire Adieu, et adieu. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie (France-Angleterre), Discours autobiographique, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Opinion publique, Politique (Analyse), Politique (Normandie), Politique (Russie), Politique (Turquie), Posture politique, Presse, Réseau social et politique
Paris, Dimanche 26 septembre 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
M. Fould est venu hier me raconter la découverte de la machine infernale à Marseille. Très préoccupé de cela. On a pris tout le monde. Il croit à des ramifications à Londres. [Brignoles] il est très monté contre les [gouvernements] libres. On le fera sentir. Sentir aux uns, dire à un autre. Mais ceci peut même loin. Il faut voir l'influence que cet événement de Marseille aura sur le reste du voyage, il y a trois semaines encore. Dimanche le 16, il rentre à Paris. Entrée solennelle. Molé est venu hier très frappé de l’événement et triste, Dumon triste aussi. On croyait les fusillés oubliés. Les proportions de ceci étaient affreuses. De centaines de personnes y périssaient. Du reste Molé content de la pensée qu'on va être affranchi en même temps de la République et du suffrage universel ; Fould ne disait hier encore qu’il sera brisé après l’Empire. Celui ci est bien décidé, je ne sais si l'événement de Marseille le rapproche. (Voici votre lettre. Comment vous ne comprenez pas pourquoi la Reine ne fait pas seule. Mais ce serait son argent, elle aime mieux que ce soit celui de Parlement parenthèse) Vous voyez que c’est Hardinge qui commande l’armée. Choix très convenable. On s'occupe beaucoup à Londres de l’idée d'une descente. Le duc de [Wellington] la croyait très possible. et le Times peut la rendre vraisemblable autant que le complot de Marseille. Quoi ? Si l'on demandait à l'Angleterre l’éloignement des exilés ? It will end by war, voilà ce que répète Ellice depuis 4 ans 1/2.
J'ai montré à M. Fould ce que vous m'avez dit du discours du Prince à Lyon, cela lui a fait plaisir, mais quant à la remarque sur ce que le [gouvernement] de [Lord Palmerston] a rendu des respects à la mémoire de Napoléon, il dit qu'il courait après la popularité et que l’ayant reconnu là, la statue et les cendres ensuite ont eu cela pour à l'Angleterre l’éloignement des exilés ? It will end by war, voilà ce que répète Ellice depuis 4 ans 1/2. J'ai montré à M. Fould ce que vous m'avez dit du discours du Prince à Lyon, cela lui a fait plaisir, mais quant à la remarque sur ce que le [gouvernement] de [Lord Palmerston] a rendu des respects à la mémoire de Napoléon, il dit qu'il courait après la popularité et que l’ayant reconnu là, la statue et les cendres ensuite ont eu cela pour mobile. Il n'y a rien à répliquer c’est vrai quant à la légitimité elle n’y avait rien à faire. Pardon du petit bout de papier, je suis avare. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conversation, Empire (France), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Angleterre), Politique (France), Presse, République, Réseau social et politique, Salon, Suffrage universel
Val Richer, Mardi 28 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne comprends pas pourquoi votre lettre de samedi était restée en retard, il n’y avait certainement aucun prétexte. On a raison d'être frappé et attristé de l'événement de Marseille. Moi, j'en suis surtout humilié pour le pays. Le crime politique y est à l'état de manie. Que de temps de bon et fort gouvernement, et peut être que de nouveaux malheurs il faudra pour guérir ce mal, ou pour l'étouffer !
Autant que j'en puis juger de ma solitude, l'effet est général et partout le même. Redoublement de doute sur l'avenir, en même temps que dans le présent, le gouvernement en sera plus facile. On peut faire tous les Empires qu’on voudra. Si on peut établir la filiation outre la machine infernale de Marseille et les réfugiés de Londres, ou de Bruxelles, je ne vois pas pourquoi, on ne demanderait pas leur expulsion. Ce serait à ces gouvernements là, à se tirer comme ils pourraient de leurs embarras. Ellice aura raison un jour, mais pas de sitôt, et par sur des questions de cette nature-là.
Je ne crois pas, quoi qu’on vous dise, à l'abolition du suffrage universel. C’est un port de refuge qu’on ne se fermera jamais. Ce n’est pas la peine non plus de discuter la recherche de popularité qui a pu faire relever la statue et ramener les cendres de Napoléon. Il y avait au moins, dans cette recherche là plus de générosité que dans les décrets du 22 Janvier et moins de danger que dans la popularité demandée au suffrage universel.
Vous avez raison de vous moquer de moi à propos des obsèques du duc de Wellington. Je ne pensais pas à l'argent.
J’ai envie de dire comme l'Impératrice et de trouver que vous avez eu tort de ne pas rendre à la Duchesse de Mecklembourg et à sa fille leur visite ; je comprends que vous soyez impolie pour éviter d'être fatiguée ; mais il n’est pas plus difficile de faire rouler. cinq minutes votre voiture sur le macadam du Boulevard que sur celui des Champs Elysées ; et l'impolitesse par manie, sans motifs de temps ou de santé, par plaisir de dédain, c’est trop.
10 heures et demie
Mon facteur arrive un peu plutôt. Merci de la lettre de M. de Meyendorff. Je la lirai à mon aise dans la matinée, et je vous la renverrai demain. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Fusion monarchique, Louis-Philippe 1er, Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Opinion publique, Politique (Analyse), Politique (France), Réseau social et politique, Suffrage universel