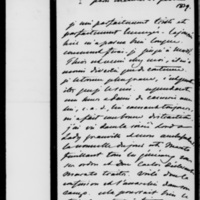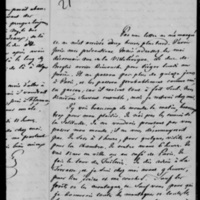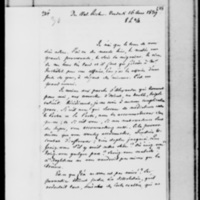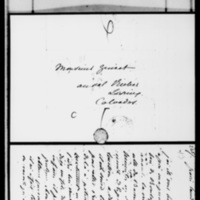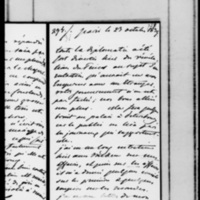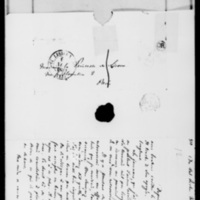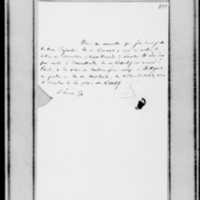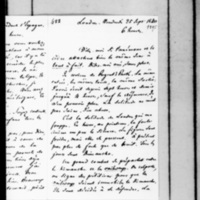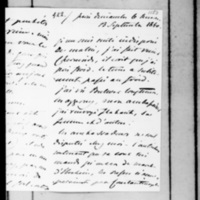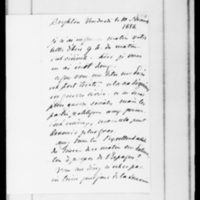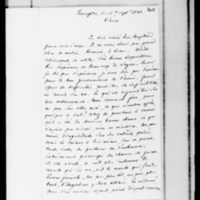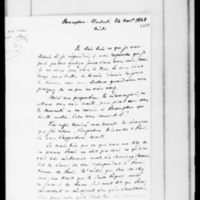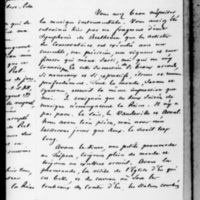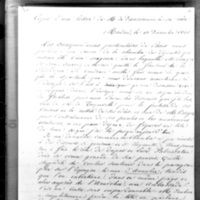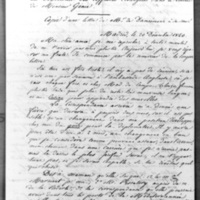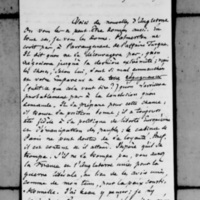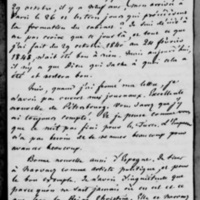Votre recherche dans le corpus : 102 résultats dans 3296 notices du site.
184. Paris, Mercredi 27 février 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis parfaitement triste et parfaitement ennuyée. La journée hier m’a paru bien longue. Comment ferai-je jusqu'à mardi. Thiers est venu chez moi ; il m’a moins divertie que de coutume. Je le trouve plus grave, c’est peut- être que je le suis. Cependant une heure et demie de causerie avec lui, c-à-d lui causant toujours, m'a fait une bonne distraction. J’ai vu dans la soirée Lord & Lady Granville et mon ambassadeur ; la nouvelle du jour est Marato fusillant tous les généraux sous ses ordres et Don Carlos déclarant Marato traître. Voilà donc la confusion et l’anarchie dans son camp. Cela pourrait bien le faire lever tout-à-fait. Granville avait l’air fort réjoui de ces nouvelles. Pahlen l’était moins. Il m’avait porté notre journal officiel renfermant un long article sur mon mari assez bien fait ! Ce qui y est le plus remarquable est ce qui n'y est pas. Ainsi pas mention de sa femme. Du reste une biographie très exacte, il est même question de ses enfants. Lady Jersey m’écrit une fort bonne lettre plus du grand dîner, mais rien de sa part qui me regarde. Il est excellent pour mon fils pour un fils, c’est tout ce qu'il me faut.
On traîne en Belgique, cela a l'air d'un parti pris ; on ne veut pas finir avant de connaître le résultat de vos élections. Voici du beau temps, j’ai été l’essayer aux Tuileries, plus tard J’irai au bois de Boulogne à 5 h. chez Lady Granville, je dîne chez Mad. de Talleyrand ; vous savez maintenant mes faits et gestes. Apprenez moi les vôtres. Adieu. Adieu. C’est bien dur de devoir se dire adieu de si loin en février. Nos beaux jours ne sont plus que les plus mauvais de l’année.
185. Paris, Jeudi 28 février 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre m’a réjoui le cœur ce matin, je vous en remercie. Vous saurez que le duc de Wellington a eu une paralysie à ma façon, un rhumatisme dans les épaules, pas autre chose. Il se porte bien. J’ai vu chez moi hier matin, mon ambassadeur, M. de Montrond, et Lady William Bentinck. La bonne femme ! Je pleurais. lorsqu'elle est entrée, car je pleure souvent. Cela l’a fort touchée. Elle m’a fait toutes les propositions imaginables. Elle voulait m’envoyer un espagnol un homme qu’elle aime beaucoup, un excellent homme à ce qu’elle dit qui viendrait chez moi tous les jours pour me distraire ! Et puis elle m’a demandé si elle pourrait m’envoyer des oiseaux, elle dit que les oiseaux distraient. Enfin elle m’a envoyé des gravures, et puis elle veut que j'aille dîner demain seule avec elle et son mari. Comprenez-vous qu’on puisse rire et s’attendrir tout à la fois ? Il y avait tant de bon cœur et tant de bêtise dans tout cela que je ne savais comment m'arranger entre mes larmes et un peu d’envie de me moquer d’elle la reconnaissance l’a emportée, et je range Lady Wlliam dans la catégorie des plus excellentes femmes, que j'aie jamais rencontrée.
Je n’ai trouvé chez Mad. de Talleyrand à dîner que M. de Montrond. Elle est inquiète de ce que le consentement de son mari au mariage de Pauline tarde tant. Palhen en est maigrie.
Le soir j'ai vu chez moi Messieurs d’Armin, de Pahlen, et de Noailles et M. Molé ; qui est fort bien touché. Il avait sa plus douce mine, et de la bonne humeur. Il attend, comme tout le monde attend. Mercredi si le temps est clair, il saura tout. Il m’a confirmé ce que je vous disais d’Espagne. Maroto est mis hors de la loi déclaré traître. Vous voyez dans les journaux à quel point on s'émeut en Angleterre pour l’affaire du pilote. Lisez la discussion à la Chambre basse. Adieu votre lettre est charmante et bonne. Mais je n’aime pas les lettres. Adieu. Adieu.
187. Paris, Samedi 2 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mercredi seulement. Que c’est long ! je m'afflige, mais je ne me plains pas. Je ne suis pas inquiète comme vous le dites. Mais cela me fait beaucoup de peine. Cela vous ne vous en plaindrez pas ? Oui le 4 ! C’est horrible, mais je ne puis ni en parler ni en écrire.
J’ai eu une lettre de Paul hier. L’Empereur a envoyé de suite à Londres le comte Strogonnoff pour remplacer mon fils pendant le voyage qu'il va faire en Russie. Il lui enjoint de venir de suite attendu qu’'il désire le voir. Paul ne veut pas aller dans ce moment, sa santé ne va pas à un voyage rapide dans la rude saison. Il ira dans quatre semaines on trouvera cela étrange, il fallait courir ventre à terre dès le lendemain ! Voilà comme on est chez nous. J’ai eu ma lettre de mon frère ce matin ; il avait reçu mes deux lettres. Celle de reproche et l’autre écrite après la mort de mon mari. La sienne contient que des hélas et des reproches sur ce que je ne veux pas vivre en Russie. Voici le lieu de lui dire une fois pour toutes pourquoi je n’y veux pas vivre et que je n’y retournerai jamais. Je vous montrerai cette lettre, je ne l’enverrai qu'après vous l’avoir lue.
J’ai vu hier matin chez moi la comtesse Appony. J’ai fait le plus agréable dîner possible chez Lady William Bentinck, elle, son mari et Lord Harry Vane, voilà tout. Très anglais, très confortable, j’ai eu presque de la gaieté. Le soir chez moi, mon ambassadeur, celui d’Autriche, Fagel, M. de Stackelberg & le Prince Waisensky. Don Carlos a retiré sa proclamation contre Maroto. Après l’avoir déclaré traître, il approuve tous ses actes, lui rend le commandement. Enfin, c’est une confusion plus grande que jamais, et mes ambassadeurs disent que ce qu'il y a de mieux à faire est d’abandonner complètement Don Carlos et le principe. Les princes gâtent le principe.
Lord Everington vient d'être nommé vice roi d’Irlande, c'est un très grand radical, un homme d’esprit, membre distingué de la chambre basse, et très grand seigneur quand son père Lord Forteseme mourra. Je vous conterai comment un jour il est resté caché pendant deux heures dans les rideaux de mon lit ! J’ajoute, puisque vous êtes si loin ; que c’est mon mari qui l'y avait caché. Vous feriez d’étranges spéculations si je ne vous disais pas cela. Et ce n’était pas cache cache.
Le petit copiste est venu. Il a commencé aujourd’hui. Cela va très bien. Les ambassadeurs avaient vu M. Molé hier. Les nouvelles sur les élections sont d’heure en heure meilleures pour les ministres. Vous avez bien fait de n'être pas allé à Rouen, mais vous faites très mal d'avoir du rhumatisme. Je vous le disais lorsque vous êtes parti, j’étais sure que vous alliez prendre froid. Faites-vous bien frotter au moins Adieu. Adieu, il faut donc encore écrire demain et lundi. What a bore ! Adieu. Adieu.
199. Paris, Jeudi 20 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pas une lettre ne m'a manqué et ne m'est arrivée deux heures plus tard. J’avais pris mes précautions. Mais adressez-les moi désormais rue de la Ville l'évêque.
Le Duc de Broglie arrive dimanche pour siéger lundi au procès. Il ne passera pas plus de quinze jours à Paris, et les passera probablement, comme moi en garçon ; car il revient tout à fait seul. Nous dinerons souvent ensemble, mais je resterai chez moi. J’y vois beaucoup de monde le matin beaucoup trop pour mon plaisir. Je n’ai pas les ennuis de la solitude. Je ne voudrais pourtant pas vous passer mon monde ; il ne vous désennuierait pas. Je sors à 1 heure, pour quelques visites et pour la chambre. Je rentre avant 6 heures. Je vais dîner en ville ou au café de Paris. Je fais le tour des Tuileries. Je dis adieu à la Terrasse; et je suis chez moi avant 9 heures pour lire, écrire et me coucher. Sauf les forêts et les montagnes, et sauf vous pour qui je donnerais toutes les montagnes et toutes les forêts du monde, cette vie ressemble un peu à la vôtre. J’en ai jusque vers la fin de juillet, du 20 au 25. La Chambre est endormie et pressée, partagée entre la précipitation et l’apathie. J’espère pourtant la réveiller et la ralentir un peu sur l'Orient. Le rapport se fait attendre. M. Jouffroy est malade. M. de Castillon sort de chez moi, bien content. Il partira pour Pétersbourg dans quinze jours. Il aurait pu partir hier et le marquis de Dalmatie me l’avait dit à la Chambre. Mais par un arrangement intérieur du département, on a mieux aimé, et il a mieux aimé lui-même ne partir que dans quinze jours. L’envoi des courriers est fréquent. Nous sommes contents des dépêches qui nous viennent de chez vous. Vous avez trouvé que nous nous étions bien pressés de demander des millions, que cela avait un peu trop ému l’Europe. Mais au fond, vous savez que nous serons raisonnables, et vous le serez vous-mêmes. L’Autriche l’est beaucoup, la Prusse beaucoup. L'Angleterre est fort contente de nous. L'hérédité du Pacha en Egypte est à peu près convenue entre quatre. Mais il lui faut l'hérédité de la Syrie, ou d'une portion de la Syrie. Sur cela, on négociera et on enverra à Constantinople des négociations conclues. Voulez-vous que j'aille à Constantinople ? J'ai lieu de croire que d'autres que vous m’y verraient avec plaisir. Passons en Occident. Ce pauvre Zéa doit être désolé. Les Cortès espagnoles dissoutes et le baron de Meer destitué du gouvernement de la Catalogne. C'est le renversement de sa politique et de toutes ses espérances. J’ai tort de dire toutes. Il retrouvera de l’espérance, car il a de la foi.
5 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez Madame de Nesselrode et qu’elle soit bonne. Quiconque a de l’esprit devrait être bon, et toujours bon. La méchanceté, pour dire le plus gros mot, même quand elle réussit ne donne que des plaisirs tristes comme sont tous les plaisirs solitaires. Ce serait une chose charmante que de se promener dans ce beau pays dont vous me parlez avec Madame de Talleyrand et vous. Puisque je n’y suis pas, parlez-lui de moi, je vous prie. J’ai cru quelques fois que pour n'être pas oublié d'elle, j’avais besoin que quelqu'un prit soin de l'en empêcher. Mauvaise condition, qu'il ne faut jamais accepter, n’est-ce pas ? Mais il me semble que son bon souvenir m'est revenu, et j'en jouis beaucoup. J'en jouirai encore mieux si vous voulez bien veiller à ce qu’il me reste.
Toute idée de voyage du Roi me parait abandonnée. Il ne faut pas aller au devant des velléités d'assassinat qui succèdent presque toujours aux tentatives d’insurrection. Mais Mgr le duc d'Orléans pourra bien aller à Bordeaux ; de la à Bayonne au devant de Mgr, le Duc de Nemours qui viendra y débarquer après avoir visite le Tage et Lisbonne ; de là le long des Pyrénées où nous avons des troupes ; de là à Alger pour voit l’armée d'Afrique. J’ai vu hier Montrond qui a envie d'aller à Baden. Je l’y ai fort encouragé. Mais il voudrait aller auparavant aux eaux d'Aix, puis à Florence, puis à Palerme. C'est beaucoup pour un été. Vendredi 11 heures.
Voilà Montrond qui sort encore de chez moi. C'est beaucoup. Adieu. Quelques uns me parlent. & d'autres m'attendent. J’aimerais bien mieux être à Baden. Adieu Adieu. G.
224. Val-Richer, Dimanche 21 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
246. Val -Richer, Vendredi 16 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai que le temps de vous dire adieu. J’ai eu du monde hier le matin une grande promenade le soir la migraine. Je viens de me lever très tard, et il faut que j'écrive à M. Duchâtel pour une affaire. Car j'ai les affaires d’une foule de gens à défaut des miennes. C’est un grand ennui.
Je reviens aux paroles d'Alexandre qui donnent pour moi, aux nouvelles d'Orient, un double, triple intérêt. Décidément, je ne crois à aucune complication grave. Si c’est nous qui servons de médiateurs entre le Pacha et la Porte nous les accommoderons sans guerre ; et si c’est vous, si nos ambassadeurs sont des dupes, vous accommoderez aussi. Cela prouve même que vous voulez accommoder. Question et combat d'influences ; rien de plus jusqu'ici.
Que feriez-vous, s’il y avait autre chose ? Où iriez-vous ? Iriez-vous quelque part ? Seriez-vous malade ? L'Angleterre ne vous vaudrait pas mieux que la France. Est-ce que Zéa ne vous est pas arrivé ? Ses pronostics étaient justes. La dissolution, qu’il redoutait tant, amène des cortes exaltées qui ne feront rien, mais qui empêcheront qu'on ne fasse s’il y a quelque chose à faire pour qui que ce soit. Du reste, ils peuvent faire en Espagne ce qui leur plaira. Nous nous en mêlerons moins que jamais. L'Orient a tué l’intervention.
9 h. 1/2
Voilà votre N°240. Je voudrais bien que vous eussiez Melle Henriette, dont je ne connais guère pourtant que sa réputation qui est bonne. Je vous dirai demain, avec détail ce que je pense de notre situation à tous en Orient. Adieu. Adieu. Je vais écrire pour l’hôtel Crillon. Adieu. G.
256. Val -Richer, Lundi 26 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voyons un peu nos affaires. Je ne saurais fixer aujourd’hui le jour où je pourrai aller vous voir. J'attends après-demain M. Devaines, son fils et une autre personne. Il faut que je les aie vus pour régler ma marche. Quel ennui que tous ces arrangements quand je n'ai d'autre envie que d'être près de vous, de vos voir, de vous entendre, de vous parler, de vous retrouver vous, changée ou non, et mon bonheur qui ne peut changer. Mais répétez-moi en attendant que le Dr Chemside ne vous trouve pas aussi changée que vous l’imaginez. Si vous allez, ou si vous pouvez aller à Dieppe, il est probable que je l'aimerai mieux que Paris. Sauf vous, je n'irais pas à Paris en ce moment. Il n’y a rien à faire, et on dira que j’y viens faire quelque chose. Mon absence, ma parfaite tranquillité sont d’un bon effet; je le sais, les gens d'esprit me le disent. Cela ne signifie rien si je ne puis vous voir qu'à Paris, et au fait cela ne signifie pas grand chose ; peu importe quelques lignes de journaux et quelques conversations de badauds. Mais toutes choses égales d'ailleurs, je crois que je préférerai Dieppe, ne fût-ce que pour ce que vous m'en dites. Dieppe ou Boulogne, cela se ressemble, n’est-ce pas ? D'ici là reposez-vous bien. Il faut être bien reposée.
Vous trouvez l'Orient en voie de pacification. Nous sommes tous d'accord, d'accord du moins de nous mettre d'accord et d’en traiter ensemble. Nous avons failli faire tout le contraire. Nous avons dit que si vous alliez à Constantinople, nous irions dans la mer de Marmara ; et que de façon ou d'autre, nous serions tous où vous seriez. Vous avez pensé que puisqu’il fallait se résigner à être tous ensemble mieux valait l'être sans embarras qu'avec embarras. Nous sommes contents. Les difficultés commencent mais nous croyons les périls passés.
J’attends des nouvelles de mon pauvre ami Baudraud. Il est malade et ne pourra probablement pas aller à Constantinople. Nous nous sommes beaucoup écrit. Mais que de choses nous aurons à nous dire !
Mardi matin 7 heures
Le plaisir de vous sentir plus près de moi ne s’use pas. Qu’on devient modeste dans ses prétentions ! J’ai appris hier que je n'aurais pas ici, dans le mois de septembre, deux personnes qui auraient pu y venir. M. & Mad. de Rémusat. Ils étaient dans leur terre, près de Toulouse, quand ils ont appris que leur fils aîné, qui a tout juste l’âge d’Henriette, était malade, très malade dans son Collège, d’une fluxion de poitrine mêlée d’accès de fièvre typhoïde. Ils sont accourus à Paris la mort dans l'âme. Ils ont trouvé leur fils hors de danger et à présent il va très bien. Quand je les ai sus à Paris, je les ai engagés à venir passer quelques jours ici avec l'enfant rétabli qui aurait sans doute besoin de la campagne. Ils font mieux que cela ; ils l’emmènent en Languedoc, où ils retournent jusqu'à la session. M. de Rémusat veut se trouver à Toulouse au passage de M. le Duc d'Orléans.
Il y a vraiment quelque tentative d'accommodement en Espagne. La situation de D. Carlos devient toujours plus mauvaise. Celle de la reine Christine pas meilleure. Marote a été assez féroce pour avoir le droit d'être un peu complaisant. Les oscaltados qui reviennent en majorité dans les Cortes témoignent quelque envie d’essayer de la faiblesse après la folie. L’Angleterre s’ennuie d’entretenir, un désordre d’où elle n’a pas même pu tiré un traité de commerce. On essaiera peut-être là aussi d’une conférence.
9 heures
Au nom de Dieu, que vos nerfs se reposent ! Je ne puis vous dire le chagrin qu'ils me font. Que sert de vous le dire ? C'est ma prétention de n'avoir plus besoin de vous dire combien je vous aime. Ai-je tort ? Plaisir oui, grand plaisir. Besoin non, plus du tout. Rouen vaudra certainement mieux que Dieppe. C'est plus près. Mais vous ne pouvez pas prendre de bains de mer à Rouen. J’apprends à l’instant même que M. de Metternich est fort malade, dangereusement me dit-on, vous le savez sans doute. Cela n'aiderait pas aux affaires d'Orient. Adieu Adieu. G.
264. Paris, Mardi 17 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je me sens un peu mieux aujourd’hui ce qui fait que j’ai le courage de vous écrire. Hier encore a été une bien mauvaise journée. Mes crampes ont recommencé, mes nerfs ont été dans un état affreux. J’ai passé la journée seule. Si je n’avais pas eu quelque heures de sommeil vous n'auriez pas de lettres ; car décidément je ne risquerai plus de vous écrire lorsque mon cœur ressemble à mes nerfs. Vous avez raison dans tout ce que vous me dites ce matin et mon Dieu, mais ce n’est pas la raison qui est mon culte ; je n’aime pas par raison. Il n’y a rien de raisonnable à aimer. Et vous avez mille fois raison de ne pas aimer à ma façon. C'est une mauvaise façon. On m'a mis ce matin dans un bain d’Eau de Cologne. Je laisse faire sans avoir confiance en rien. Cela ne durera pas longtemps. Je ne m'occupe plus de chercher quelqu'un, je ne m'occupe plus de rien de ce qui me regarde. Je vous ai dit souvent que je craignais de la folie, je la crains plus que jamais parce que je la vois venir.
J'ai une mauvaise affaire sur les bras. Malgré les promesses que j'ai faites à Bulwer de la part de madame Appony il a rencontré sa belle-sœur chez elle hier au soir. Il me le mande dans un billet ce matin, et veut pour conseil. Il regarde ceci comme une insulte personnelle. Il a raison et cependant ce n’est sans doute qu'une bêtise de Madame Appony. Mon conseil sera qu’il n’y retourne pas. Moi, j’ai droit d'être blessée aussi car la promesse m’a été donnée à moi.
1 heures
J'ai eu la visite de Génie. C'est un bon petit homme ; ce qui me prouve ma décadence et ma misère est le plaisir que me fait la visite d'un bon petit homme ! Après lui est venu Bulwer ; j’étais encore dans mon bonnet de nuit. Il n’avait pas fermé l'œil depuis hier, il voulait écrire à Lord Palmerston demander son rappel de Paris à cause de l'insulte des Appony, enfin il était dans un état violent. Au milieu de cela je reçois la réponse de Madame Appony à une petit billet d’interrogation un peu vif que je lui avais écrit, et j’éclate de rire. La belle sœur n’y avait pas été. Bulwer a eu une vision ... Il n'en revient pas. Il soutient qu'il la vue. Je l’ai assuré qu’il se trouvait obligé de croire qu’elle n'y était pas, car mensonge ou non, il est bien certain maintenant qu’elle ne s’y retrouvera plus.
Le billet de Madame Appony est long, plus de tendresses pour Bulwer, d’indignation de ce que nous soyons cru capable de manquer à ses promesses. Enfin c’est fort drôle, et c’est fini. Hier Bulwer causait avec Appony lorsqu'il a eu sa vision. Il a laissé court et est sorti brusquement de la maison.
A propos de maison, Démion est revenu. Je prends l’entresol à 12 mille francs. On dresse un inventaire des meubles. Je prendrai ce qui me conviendra.
Rothschild m’a mandé qu'il avait abdiqué ses droits entre les mains de Démion, il n'y peut donc rien. Et bien, j’ai cet entresol ! Cela ne me fait aucun plaisir, rien ne me fait plaisir. J’ai écrit hier à Benkhausen pour demander les lettres of admisnistration d’après ce que me dit mon frère lui ne le ferait pas. Si j’attends l'arrivée de Paul ce sera encore une complication une fois les lettres obtenues, l'affaire est plus courte & plus nette. Je crois que je m’épargne du temps et des embarras, & que je suis en règle. Le pensez-vous aussi ? Pourquoi attendre. Je chargerai Rothschild de lever le capital et de remettre leurs parts à mes fils voilà qui est simple.
L’affaire de Don Carlos est regardée ici comme un grand triomphe. En effet, c'est une bonne affaire. Si on est sage à Madrid cela peut devenir excellent. Palmerston, & Bulwer ont écrit à M. Lotherne pour qu'il presse le gouvernement de ratifier la convention de Maroto. Mais vu dit qu'il y a de mauvaises têtes dans les Cortes. Adieu, je suis mieux ce matin. Je ne sais comment je serai plus tard. Ne vous fâchez jamais avec moi avec toute votre raison, & laissez- moi vous aimer avec toute ma folie. Adieu
265. Paris, Mercredi 18 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vraiment ma vie est si triste, que mes nerfs ne pourront jamais se remettre. Et comme ce qui ne se remet pas s'empire, il en résulte à présent que j'ai peut être deux heures passables dans la journée sur les autres 22 où je souffre. Je n’ai encore pas dormi cette nuit je ne voulais pas vous écrire, mais vous voulez que je continue, c.a.d. que je mente, car je ne vous dirai pas tout ce que je pense, je pense trop de choses, et je suis trop malade.
Je suis étonnée de vous voir si arrière en fait de nouvelles. Bourges a été choisi dès samedi soir pour le lieu de la résidence de Don Carlos. Je le savais dimanche matin, mais je ne valais rien dimanche, ni lundi, ni depuis. La Diplomatie apostolique est fort déconcertée de ce dénouement des affaires espagnoles. La révolution triomphe partout. Cela ne peut pas plaire aux orthodoxes. Bulwer a eu un long entretien avec le roi dans lequel il me parait qu’ils ne se sont guère entendus sur les affaires de l'Orient. Elles ne vont pas, tout est en suspens, et il dépend toujours de Méhemet Ali d'embraser l’Europe. M. de Metternich doit être arrivé hier au Johannisberg. Tous les courriers lui sont adressés à lui et il désignera de là M. de Fiquelmont qui reste chargé à Vienne de remplir ses ordres.
Il fait le plus triste temps du monde. De la pluie, du vent beaucoup. Être seule vis à vis de cela, ah quelle vie ! Votre dernier paragraphe ce matin est bien tendre, il m’a fait du bien. Cela vaut mieux que les remèdes de Chermside. Voyez si votre petite lectrice voudrait de moi, je l'enverrais prendre dans ma voiture. Dites moi aussi ce qu'on donne, ce serait pour une heure dans l'avant soirée. Adieu, les crampes reviennent. J’ai peur de vous écrire. God bless you.
265. Val -Richer, Vendredi 13 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous avez bien tort de ne pas savoir dicter. C’est une habitude qu’il faudrait toujours prendre quand on est jeune. Vous pourriez sans fatigue employer une ou deux heures le soir à recueillir vos souvenirs, ce qui vous a occupée ou amusée dans votre vie. Vous vous en amuseriez encore. Je me promets bien de le faire un jour pour mon compte. A défaut de dictée ne vous conviendrait-il pas qu'une personne un peu intelligente, une femme, une jeune fille vint vous lire le soir quand vous êtes seule et que vos yeux sont fatigués ? Je vous trouverais cela, soit par moi-même d’ici, soit par Génie. Votre solitude me pèse inexprimablement. Chagrin même à part, je suis choqué comme d’une absurdité, que vous soyez seule quand il y a dans le monde, et pas au bout du monde, quelqu'un qui se plaît tant à être avec vous.
Samedi matin 6 h et demie
Je me suis couché hier de très bonne heure. La vie que je mène ici est parfaitement calme et très occupée. Je donne à mes enfants presque tout le temps que je ne passe pas dans mon Cabinet dès que je suis seul, je lis ou j'écris. Rarement il fait assez beau pour que je reprenne mes grandes promenades solitaires. Quand le soir arrive, je suis comme mon fermier qui a labouré tout le jour ; j’ai envie de dormir.
Je vois, dans mes nouvelles de l'Intérieur que la conférence sur les affaires d'Orient pourrait se tenir à Constantinople, que la Porte le demande. Je croyais cette idée tout-à-fait abandonnée. Elle avait été d'abord suggérée par vous. En entendez-vous parler de nouveau ? Que dit-on de la déconfiture de D. Carlos? S'achemine-t-on à petit bruit vers la reconnaissance de la Reine Isabelle ? Certainement, il y a là un dernier coup à donner, pas bien fort, et sans guerre aucune, qui terminerait l'affaire d’Espagne comme on a terminé celle de Belgique, et ferait rentrer toute la Péninsule dans l'ordre européen. Mais vous verrez qu'on laissera encore traîner. Les événements n’arrivent plus aujourd'hui qu’à condition d’arriver tout seuls. Les hommes ont abdiqué. Il n'y a plus que Dieu qui gouverne.
Aimez-vous la lecture des voyages ? Vous avez là, je crois, les lettres de Jacquemont sur l’Inde. Mais ce que vous n’avez certainement pas lu, c'est le Journal même de son voyage, qui se publie par livraisons, avec de grandes images et dans un très beau caractère, Ouvrage très spirituel, et plein d’intérêt. Voulez-vous le lire quoiqu'il ne soit pas fini ? On peut très bien faire, cela pour un voyage qui n’a ni commencement ni fin, et où chaque jour se suffit à soi-même. Si vous en avez envie, dites à Génie de le faire prendre chez moi dans ma chambre à coucher, parmi les livraisons non reliées. Les cahiers détachés ne sont pas bien commodes à manier ; mais du moins la lecture ne vous fatiguera pas les yeux. Je voudrais chaque matin, vous envoyer d’ici de quoi remplir votre journée.
9 heures
La lettre de votre frère est très bien. C'est le moins possible. Mais la brièveté douce et froide convient en pareille occasion. Faites la partir tout de suite et dormez. En vérité, je m'indigne de penser qu’il dépend de telles sottises de vous ôter le sommeil. Je suis charmé que M. Jennison, soit plus traitable. Adieu. Adieu. Il n'y a de bon adieu que ceux qui ne finissent pas. G.
267. Val -Richer, Lundi 16 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
J’aurais le cœur bien blessé si je ne me l’interdisais pas. Blessé à ce point que mon envie était de ne pas vous répondre du tout sur ce que vous me dites. Mais vous êtes souffrante, vous êtes seule. Dites, pensez même (ce qui est bien pis) tout ce que vous voudrez. Je ne vous répondrai jamais qu’une chose. Vous n’aurez jamais plus que moi le sentiment de ce qui manque à notre relation, de ce contraste choquant, douloureux, entre le fond du cœur et la vie extérieure, quotidienne. Si ma vie était à vous aussi bien que mon cœur, vous verriez si je sais tout subordonner à un seul sentiment à une seule affaire si je sais être toujours là et toujours le même. Mais cela n'est pas ; il y a des affections, des devoirs, des intérêts auxquels ma vie appartient, et qui ne sont pas vous. Je ne puis pas la leur ôter. Je ne puis pas me donner ce tort à leurs yeux, à mes yeux, aux yeux du monde, à vos propres yeux. Car je vous connais bien ; vous mépriseriez la faiblesse même dont vous profiteriez. Vous avez l’esprit trop droit et le cœur trop haut pour ne pas avoir besoin, sur toutes choses, d’approuver et de respecter ce que vous aimez. Je vous parle bien sérieusement n’est-ce pas ? Pas si sérieusement que je le sens. Ce qui vous touche est si sérieux pour moi ! Mais assez ; trop peut-être, quoique je vous aie dit bien peu. Comment dire ? Comment dire de loin ? Toutes les paroles me semblent froides et fausses. Voilà plus de deux ans ; et pourtant il faut encore que le temps nous apprenne, l’un sur l'autre, bien des choses.
Que me direz-vous aujourd’hui de vos crampes, et de vôtre nuit ? Je vous renvoie la lettre du Prince Metscherzky. Je voudrais bien ne plus vous parler de Paul. Il me révolte. Et puis je ne comprends pas ces mœurs-là, cette façon de repousser insolemment de faire taire un parent qui vous parle d’une mère, parce qu'il n’a pas des pleins pouvoirs, parce que ce n’est pas un procureur ! Et ce parent se laisse faire ! Il ne trouve pas un mot à répondre, un mot bien simple, bien calme, mais qui remette à sa place tout et chacun ! Le Prince Metscherzky m’a l’air d’un excellent homme, bien zélé pour vous ; mais ne le chargez pas d’affaires difficiles ; ne lui donnez pas à traiter avec un frère puissant ou un cousin arrogant. Ne placez pas non plus comme il semble vous le conseiller, toute votre fortune en Russie. Quelques mille livres de rente de plus ne valent pas beaucoup de sécurité et de facilité de moins. Du reste vous avez déjà fait le contraire pour une partie.
Vous avez bien raison ; on nomme les gens aux emplois diplomatiques, en pensant à ce qu’ils sont là d’où ils partent, point à ce qu’ils seront là où on les envoie. On pense à si peu de choses ! Que les affaires humaines se font grossièrement ! On serait bien étonné si tout à coup, par miracle, elles étaient vraiment bien faites, et par des gens vraiment d’esprit. Savez-vous pourquoi on envoie M. de Pontois à Constantinople ? Parce qu'il est terne et tranquille, ne choque personne et ne fera pas les sottises de l’amiral Roussin. Le grand abaissement de notre temps, c'est de se contenter à bon marché ; le tel quel suffit, pourvu qu'on vive.
9 h. 1/2
Vous avez un peu dormi. Il faut absolument qu’on vous trouve une lectrice. J’en vais parler à ma mère. Adieu. Adieu. J’apprends à l’instant même que D. Carlos est en France avec toute sa famille. Les bataillons navarrois acculés à la frontière ont capitulé. Elio, qui les commandait, avait envoyé d'avance un de ses aides de camp au général Harispe. On ne doute pas que les Cortes ne sanctionnent le traité. Vous savez sûrement tout cela. Adieu. Adieu. G.
268. Val -Richer, Mardi 17 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma mère me parle d’une jeune fille, agréable et bien élevée qui pourrait peut-être vous servir de lectrice. C’est la fille d’un M. Audebez, l’un des Ministres qui prêchent à la chapelle de la rue Taitbout, homme de bien, qui a une famille nombreuse, comme tous les gens qui prêchent, et a fait élever plusieurs de ses enfants en Angleterre. Mais il y aurait peut-être, pour cette jeune fille, quelque difficulté à aller seule dans les rues le soir, tard, car c’est le soir que vous en avez besoin. Il faudrait que Félix ou quelque autre l'accompagnât. Voulez- vous que je fasse demander, s’il y a là quelque chose qui vous convienne ?
Je ne vous conviendrais pas du tout en ce moment pour ce métier-là. Je suis enroué. J’ai suspendu mes lectures du soir et je prends des laits de poule. Nous avons froid, tout à fait froid. depuis deux jours. Avez-vous lu Pepy's Memoirs sur le règne et la cour de Charles 2 ? Ils vous amuseraient à parcourir. Ils sont chez moi dans le corps de bibliothèque de mon Cabinet. Faites les prendre par Génie si vous en avez envie. Le triomphe a ses embarras.
Dites-moi où nous mettrons D. Carlos. Il faut qu’il soit logé convenablement pour lui et surement pour nous. Le Duc de Valençay ne nous rendra pas Valençay. Madame ne nous prêtera pas Randan. J’ai pensé à Amboise, bon château, point prison, et assez possible à bien observer. Mais je doute fort que le Roi veuille avoir D. Carlos dans une maison à lui, une maison du domaine privé. Ce serait bien de l’intimité et de la responsabilité. Et puis notre peuple voudra des précautions plus strictes, plus apparentes. Nous aurons bien du monde à rassurer, des deux côtés des Pyrénées. Cela finira par un château fort à terme. Je ne vois pas bien lequel. Blaye et Hans sont bien petits et bien forts. La citadelle de Lille est un beau logement. Il y a de quoi admirer la bêtise humaine. On criera beaucoup, on demandera toutes sortes de précautions dans le moment-ci quand D. Carlos n’a évidemment aucune envie de recommencer; et dans un an, deux ans, que sais-je ? Quand l'envie et peut-être les moyens lui seront revenus, on n’y pensera plus, et tout sera relâché. Il faut lui faire signer une bonne renonciation et donner par l'Espagne une bonne pension qu’il ira dans quelque temps manger à Rome. Cela se peut quand vous aurez tous reconnu la reine Isabelle. Nous voilà les mains bien libres en occident. Gage de plus de l'immobilité en orient.
9 heures et demie
Pure, pure mégarde, mégarde de tristesse si ma lettre d'avant-hier ne contenait pas d'adieu. J’en suis désolé. Pardonnez-le moi. Je le mérite. Je vous dis adieu si souvent dans le jour, triste ou gai. Et puis dites-moi toujours tout, toute votre disposition, quelle qu’elle soit. Et laissez-moi en faire autant. Et que rien ne soit jamais retenu, caché entre nous. Nous nous affligerons quelquefois. C'est le droit des cœurs qui s’aiment de s'affliger réciproquement quand ils sont tristes. Mais qu'importe ? Le plus vif chagrin vaut mille fois mieux que le moindre silence. Je veux que vous me disiez tout. Je veux vous dire tout. Et adieu est toujours au bout de tout, pour tout réparer tout, charmer. Adieu. Adieu, dearest ever dearest. Adieu. G.
271. Val-Richer, Vendredi 20 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma petite lectrice a beaucoup d'accent gascon. Elle demeure à une lieue de chez vous. L'envoyer chercher, et la ramener prendrait la soirée de vos chevaux. On me propose en échange une Mademoiselle Mallet, fort recommandable de bonnes façons, assez instruite, qui a élevé une jeune fille dans une famille que je connais. Elle demeure près de chez vous rue Godot-Mauroy n°11. Elle a 45 ans. On dit qu’elle n’est pas jolie. On croit qu'en lui donnant 3 fr. par soirée de 60 à 100 fr, par mois, ce serait convenable, et qu’elle vous lirait bien ce que vous voudriez ; pendant, une heure, une heure et demie. Dites-moi si vous voulez que je vous la fasse envoyer, et à quelle heure vous la voudriez chaque soir.
Vous promenez-vous toujours après votre dîner malgré cette horrible pluie ? Ouvrez-vous votre porte, et à quelle heure ? C’est une vraie maladie que le besoin de savoir tous les détails d’une vie qu'on aime. Vous me dîtes tout bien exactement. Il me semble que j'ignore tout. J’ai raison ; on ignore tout quand on n'y est pas.
Je ne m'étonne pas que les apostoliques soient déconcertés du dénouement espagnol. C’est un gros échec pour eux ; un de ces échecs qui révèlent la faiblesse radicale d’un parti et le terrain qu'il a perdu sans retour. La chance était belle contre la révolution d’Espagne, car elle aussi, elle est faible et bien inhabile, et prêtant bien le flanc à ses ennemis. Ils échouent contre elle, bien plus par leur propre misère que par sa force. Au fond, c’est juste, c’est le parti apostolique ses maximes, ses hommes, son gouvernement qui depuis deux siècles ont laissé ou fait déchoir l’Espagne et le Portugal, déchoir comme puissance au dehors, comme prospéré et dedans, déchoir en esprit comme en richesse, en dignité comme en bien-être. Ils sont punis par où ils ont pêché ; ils se trouvent encore plus déchus eux-mêmes que le pays qu'ils ont fait déchoir. Que l’absolutisme autrichien, prussien, russe même se maintienne et batte chez lui les révolutions, je le comprends ; les peuples prospèrent et grandissent sous lui ; il a droit de durer et de vaincre. Les apostoliques, ne sont vraiment bons qu’à mourir.
9 h. 1/2
Essayez de la jeune fille de Génie. Si vous ne vous en servez pas plus de 12 ou 15 fois par mois, 60 francs me paraissent suffisants. Il faut compter entre 3 fr. et 5 fr. par soirée. Je suis toujours enrhumé. Le temps est détestable. Quand je pourrai prendre l’air à mon ordinaire, & un air un peu doux mon rhume s'en ira. Adieu. Adieu. G.
274. Val-Richer, Lundi 23 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je sors tard de mon lit quoique je me sois couché hier de très bonne heure. J'étais fatigué. Au rhume, qui dure encore un peu, s’était jointe la migraine. Le sommeil est ma ressource. Je ne sais si je la conserverai toujours ; mais je l'ai encore. J’ai beaucoup dormi. Je suis bien ce matin. Il fait beau. Le soleil brille. Je me sens en bonne et forte disposition. Quelles mobiles créatures nous sommes, et que les spectateurs qui nous entourent se doutent peu des agitations, des faiblesses, des innombrables vicissitudes, intérieures par lesquelles nous passons !
Si les propositions de D. Carlos sont telles qu’on le dit, elles me paraissent acceptables. Pourvu qu’il ne réserve que ses droits éventuels, en cas d’extinction de la lignée de la Reine Isabelle, masculine et féminine, et que sa renonciation à ses droits actuels, pour lui et les siens, soit bien claires, bien complète. Pourvu aussi que le gouvernement de Madrid y consente, et soit partie contractante dans l’arrangement. A ces conditions l'affaire me paraît finie, autant quelle peut l'être. Et si D. Carlos accepte tout cela, j'ai peine à voir à quel litre et par qu’elle raison on ne le laisserait pas vivre où il voudra même en Autriche, le Capharnaüm, des Prétendants. Nous sommes un grand exemple de l’état ou jettent les grands excès. Il y a cent ans, l’Europe aurait vécu au moins six mois sur un événement comme la chute de D. Carlos. Il y aurait eu là, pendant longtemps, de la pâture pour les esprits, les réflexions, les conversations, les correspondances. Figurez-vous tout ce que M. de St. Simon y aurait vu et fait voir. Aujourd’hui, nous avons tant vu, tant vu que nos yeux sont las et comme hébétés. Nous regardons à peine les plus grosses choses. Je suis sûr que, s’il ne survient point d’incident nouveau dans quinze jours, à Bourges même, D. Carlos vivra sans qu'on pense à lui.
Voilà mon ami, et le vôtre, d’Haubersaert conseiller d'’Etat. Il le désirait beaucoup et on me l’avait promis. Cette nomination de Conseillers d'Etat est une image fidèle du chaos général. On en a donné un à Thiers, un à moi, trois aux 221, trois aux 213. Et tout le monde sera content. Personne n'est difficile. Les troubles pour les grains, sans être sérieux peuvent devenir gaves et embarrassants. Décidément, les récoltes sont insuffisantes ; le pain est déjà cher et renchérira. La crise industrielle se prolonge. L’Angleterre en souffre encore plus que nous. L’hiver s’annonce mal. Si, par dessus le marché, il est froid, la détresse sera réelle.
Le parti radical, devenu parti Buonapartiste, s’agite beaucoup pour remuer le peuple. Il ne peut que cela, mais il peut cela.
9 heures 3/4
Si je commençais, je ne tarirais pas sur votre famille. Je n’ai jamais rien imaginé de pareil. Je vous renverrai demain la lettre de votre sœur. Il me faut bien la journée pour la lire. Je ne comprends pas grand chose, à la lettre de Benkhausen. Je suppose que lorsqu'il aura en main votre signature apposée aux letters of administration, vos plein pouvoirs à votre frère seront considérés comme suffisants, et que celui-ci fera alors toucher, en votre nom, par un délégué de lui, peut-être par Paul lui-même. Il vaudrait beaucoup mieux en effet ne pas faire ce tour du monde, et faire tout simplement toucher, en votre nom, par votre banquier qui remettra à vos fils leur part. Cela est bien plus simple. Vous pourriez, ce me semble, mander cela à Benkhausen. Je ne vois pas quelle objection il y pourrait faire. Vous êtes bien la maîtresse de donner vos pleins, pouvoirs à qui vous voulez, pour cette affaire spéciale ; et il est bien naturel que vous les donniez directement à votre banquier de Londres qui touchera, plutôt qu'à votre père de Pétersbourg qui sera obligé de les déléguer et de faire toucher, par un autre, vous ne savez pas qu' il est évident que vous ne sauriez prendre trop de précautions. Pourquoi, n'aurez-vous pas de vaisselle ? Dans le quart du mobilier qui vous revient de droit vous pouvez toujours prendre ce que vous voulez, au prix d'estimation. Adieu. Adieu. Vous dîtes bien, toutes ces horreurs. Adieu, dearest. G.
280. Paris, Mercredi 2 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Ah ! si votre médecin pouvait re connaître en médecin comme moi. J’attends son arrêt avec une espèce d’angoisse. Que j'aimerais ce médecin s'il vous faisait revenir. Dites-moi Dites-moi que vous revenez. Quelle joie ! Bulwerr m'apportera, le lien vers Lord Chatham, mais il croit que vous savez déjà son histoire mieux que tout ce que vous en diraient les le livres. Je conclurai dans la bibliothèque c'est une jolie pièce. Nos habitudes seront probablement dans ce qui était le salon de M. de Talleyrand.
Je n'ai point encore commencé avec la petite lectrice, je suis parvenue à tuer mon temps en sortant après le dîner. Dès que je serai casée ne ne sortirai plus, & c’est alors que j'aurai besoin d’elle dans l’avant soirée. Aurai-je besoin d’elle ? Répondez- moi, demandez-le à votre médecin. Il me semble que moi aussi j’ai besoin de votre médecin. Votre irriitation au gozier a passé dans le mien. J’ai toussé toute la nuit. Le temps cependant est beau.
J'ai été deux heures hier au Marais dans de grandes manifactures de bronze. J'ai choisi de jolies choses. Cela n'a pas le sens commu, car je n’ai pas encore sur quoi coucher, manger & &
Vous êtes parfaitement instruit de nos propositions. Nous verrons. C’est vraiment un moment curieux. Ah, si nous pouvions nous parler ! M. Molé est à Fontainebleau.. La Duchesse de Talleyrand répart demain, et ne reviendra à Paris qu’à la nouvelle année. Midi Génie sort de chez moi, Il avait été très inquiet de vous. Votre médecin lui a écrit un mot dès son arrivée pour le rassurer mais disant que vous avez un rhume. obstiné. Si vous venez, je vous promets de vous laisser à votre travail toute le matin. Je ne vous prendrai rien de votre temps utile. Après le soleil couché vous penseriez à moi, n'est-ce pas ? On dit que la commission de la chambre à Madrid refuse de reconnaître les fueros. Cela serait mauvais. Génie me dit qu’il vous a envoyé hier une lettre de Fontainebleau. Est-ce une invitation ? Que je le voudrais. Je ne suis plus préoccupée que de cela. De façon ou d’autre il me semble que vous devez venir. Cela est si fort entré dans ma tête que le contraire me paraîtrait une horrible injustice. J’attends votre lettre de demain avec un grande impatience. Adieu, adieu. Venez. adieu.
Mots-clés : histoire, Politique (Espagne), Santé (François), Vie domestique (Dorothée)
280. Val-Richer, Samedi 28 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
282. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’est bruit que de la nouvelle coalition, votre Empereur, Palmerston et les radicaux. Aurait-elle la majorité à Londres ? On en doute fort. Palmerston trouvant bon que vous entriez, vous dans le Bosphore et l'Asie mineure, tandis qu'il ira lui sans nous à Alexandrie, cela sera-t-il bien reçu du Parlement ? On croit que cela ne s’y présentera pas. Même avec le correctif d'un corps d’armée Autrichien pour faire le siège de St Jean d’Acre, où il n’ira pas. Tout cela a un peu l’air des mille et une nuits. Il n’y a guère, dans chaque affaire, qu’une ou deux grandes politiques. Quand on n'en veut pas, on tombe dans les politiques petites et arbitraires. De celles-là, il y en a mille.
En attendant, vous parait-il vrai, comme on me le dit, que le Cabinet anglais est plus sérieusement menacé que jamais ? On l'a dit si souvent que cela finira pas arriver sans que je le croie. Voilà Zéa décidément rentré en scène. Si les Cortes dont dissoutes comme tout l’annonce, un parti bien voisin de lui dominera dans les nouvelles. J’en suis bien aise, même politique à part. Je lui souhaite du contentement. Je ne sais pourquoi le bruit se répand dans notre Province que Don Carlos doit y venir habiter et qu’on y cherche un château pour lui. Ce qu’il y a de sûr c’est qu’on a fait visiter deux grands châteaux à peu près abandonnés, et très convenables pour un Prince abandonné.
N’allez pas vous ruiner en curiosités. Quand vous aurez vos affaires signées, vous ferez tout ce qui vous plaira. Je n’ai de ma vie été si méfiant.
Mardi, 8 heures 1/2
Avez-vous décidément adopté la bibliothèque de l'entresol pour votre chambre à coucher ? Je suis bien impatient de vous voir là. Où seront nos habitudes? Vous trouverez votre maison peuplée. Jaubert est arrivé ; fort peu préoccupé de la politique de l'Orient, à ce qu'on me dit ; il n'y a pas moyen d’en rien tirer à ce sujet. Ce n'est pas du tout un esprit de politique étrangère. Il a rapporté de Constantinople une grande préoccupation des conspirations de l’extrême gauche. Elles continuent de plus en plus basses, comme on dit les eaux sont basses. Singulière société qui ne veut ni du haut, ni du bas, ni du soleil, ni de la boue ! Comment viendra-t-elle à bout de s'organiser et de suffire à ses affaires ? Je ne pense pas à autre chose, en fait de choses, depuis deux mois que je vis en Amérique.
9 heures et demie
J’attends mon médecin aujourd'hui. Je voudrais bien qu’il fût de votre avis qu’il en fût positivement. Quoique ce qu’on appelle la raison me dise que j’ai tort de désirer cela. Je suis désolé du mariage de votre femme de chambre. Mad. de Mentzingen ne pourrait-elle vous envoyer sa pareille ? Vous avez confiance aux allemandes. Il vous faut une femme de chambre qui vous convienne beaucoup, et vous plaise un peu. La petite lectrice que Génie vous a donnée vous convient-elle, dans son état, et vous en servez-vous ? Adieu. Adieu.
285. Paris, Lundi 14 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai été voir hier la petite Princesse après ma promenade à pied au bois de Boulogne. J'avais eu avant la visite de Bulwer, & celle du Baron Krudner notre ministre en Suisse, homme d’infiniment d’esprit, de beaucoup d’instruction, et du plus aimable caractère. Il est sourd tout-à-fait. Il passe pour aller s'embarquer au Havre de là à Pétersbourg. Il s'est marié secrètement en Suisse, il y a 22 ans ! L'idée lui vint que puisqu'il a déjà un fils de 19 ans et d’autres enfants il pourrait bien faire quelque chose pour eux, et il va obtenir que son mariage soit reconnu. Il m’a fait toutes ces confidences comme on raconte qu’on vient de dîner.
Le Prince Paul de Wurtemberg m'a fait sa visite hebdomadaire il croit savoir que Don Carlos tout ne prescrivant officiellement à Cabrera & au Comte d'Espagne de cesser les hostilités leur a fait intimer l’ordre de les poursuivre. Il a envoyé des pleins pouvoirs à l'un des deux juntes qui s’est organisée en Catalogne, Je fus dîner chez M. de Brignoles. Le maréchal y vint après. Je le trouve bien maigri et changé. Les diplomates ont été faire leur tour avant-hier à St Cloud. Ils ont trouvé le Roi, très content, parfaite ment sûr de l’échec qu'aurait subit M. de Brunnow. Cela reste à être prouvé, et nous saurons cela dès l'arrivée de Lord Granville qui sera ici demain au plus tard. Je n’ai point de lettres aujourd'hui. Ce n'est qui demain que vous serez arrivé. pour moi au Val Richer. Adieu. Adieu.
A propos, j’ai trouvé un maître d’hôtel qui me parait bien par pur hasard. Voilà un souci de moins. La liste des autres est grande encore. Adieu mille fois. Je vous ai dit, n’est-ce pas, que M. de Médem ne va plus chez le Maréchal. Celui-ci a été très impoli dans la dernière entrevue.
293. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins, tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui. Adieu. Adieu. G.
294. Paris, Mercredi 23 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Toute la diplomatie a été fort divertie hier des révélations du Thiers au sujet d’un entretien qu’aurait eu mon Empereur avec un étranger. Votre gouvernement n'en est pas fâché ; nos bons alliés non plus. Cela fera quelque bruit au palais à Pétersbourg, car le public ne sera pas les journaux qui rapportent cela. J’ai eu un long entretien hier avec Médem sur mes Affaires, et puis sur les affaires. Il m’a donné quelques conseils sur les premiers & quelques soupirs sur les secondes. J’ai eu une lettre de mon Ambassadeur. Il l'annonce pour le 10 Décembre, s'il ne survient pas d'obstacle impérial. Il se réjouit fort de me trouver à l'hôtel Talleyrand. Je suis sûre qu’après vous c'est lui qui aura le plus de plaisir à m'y voir bien établie, vraiment j'y serai bien. Mon appartement. sera arrangé pour votre arrivée, mon ménage pas encore, car pour cela il faut que je sache si j’ai ou si je n’ai pas la vaisselle.
J'ai été hier au soir chez Mad. de Boigne. J’y ai vu le chancelier, il dit qu’il faut relâcher Don Carlos.
Il me semble qu’il n’y a des nouvelles de nulle part. Lord Lansdown a été voir le prince Méternich au Johanisberg. Médem parle de M. de Brunow avec beaucoup de dédain & trouve fort naturel et assez agréable qu'il ait échoué dans sa mission, car le naufrage est sûr. Paul est arrivé à Londres je ne le sais qu’indirectement. Bunkhausen ne m’a point envoyé encore les lettres of administration quoique j'aie accompli toutes les formalités requises pour les obtenir. Je n’ai pas encore répondu à mon frère. Je ne sais pas comment faire pour me plaindre un peu et ne pas le choquer. Car Médem aussi ne comprend pas qu'on ait mis ainsi un oubli mes droits en Courlande et il croit qui c’est une grosse affaire, parce que cette terre est très riche en toute chose. Le prince Metternich n'écrit rien encore au sujet du mariage de Rodolphe Appony. Ce qui fait que la chose est parfaitement en suspens ici ; tandis qu’elle est publique à Pétersbourg. Adieu. Adieu. Je suis bien contente d’apprendre que Pauline est remise, et je suis transportée de joie en vous voyant bien résolu à revenir bientôt. Adieu.
294. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
J’ai eu du monde sans relâche toute la matinée. Parce que je refuse tous les dîners, on se croit obligé de venir me voir deux fois, davantage. J’aimerais mieux discuter avec vos ouvriers. Je ne tousse plus du tout. J’y aurais regret si je n’arrangeais pas déjà mon retour à peu près pour l'époque que je vous ai dite. Il continue pourtant de faire beau.
Vous trouverai-je tout-à-fait arrangée ? Ne vous ruinez pas. Je crains vos goûts de perfection bien naturels et de bien bon goût, Limitez-vous pourtant dans votre perfection. L’appartement est déjà cher pour vous. N'aggravez pas trop le mal. Pippin, vous a-t-il quittée ? Comment Felix prend-il son petit changement de condition. Avez-vous eu le courage de l’en informer ? Je doute que vous eussiez été un bon ministre d’un gouvernement représentatif. Dire oui n’est que la moitié du talent. Non est l’autre moitié. Celle-ci vous eût manqué. Vous ne savez que plaire.
Don Carlos me paraît pressé d'avoir ses passeports. Et le Roi presse de les lui donner. Les Ministres veulent attendre l’issue de l'affaire de Cabrera. Ils ont raison. D’autant plus raison que Don Carlos a donné sous main, ordre à Cabrera de continuer la guerre. Entendez-vous dire quelque chose de Thiers ?
9 heures et demie
Vous avez tout-à-fait le droit, et vous aurez raison avant de faire la partage du capital de Londres, de demander à être informée de ce que vous aurez à toucher en argent et en effets à Pétersbourg. Je ne pense pas que vous puissiez désormais exercer aucun recours légal, ni que vous fissiez bien de le tenter, même indirectement. Mais ce qui se pourra pour embarrasser et pour arracher de la mauvaise honte quelques lumières, et quelques sommes de plus, il faut le faire. J’approuve donc tout-à-fait que vous adressiez à Londres votre question. Parlez aussi à votre frère de l'oubli de vos droits sur le mobilier de Courlande. Il ne faut pas qu’il ignore tout-à-fait sa propre légèreté, ni qu’il croie qu'elle a passé inaperçue. Je suis charmé que ce coup de pierre ne soit rien. J’ai la Reine à cœur. Après les assassins, les fous. Ceux-là aussi passeront.
Adieu. Adieu. J’ai ma petite Pauline un peu indisposée. Ce n’est rien. Adieu G.
296. Val-Richer, Mercredi 23 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Ma journée a été prise hier par M. Hèbert, qui me reste encore aujourd’hui. C’est un homme de quelque importance dans la Chambre. Il a du sens, du courage et de la parole. Il m’a toujours été très fidèle. Mais c'est une terrible chose qu’un brouillard qui rend la promenade impossible, et la conversation permanente. Je ne connais plus que vous au monde avec qui en fait de présence et de conversation, je n’arrive jamais au bout de mon plaisir. Mon hôte ne sait rien. Il vit depuis deux mois à la campagne, en vacances. Sa disposition me paraît être celle des gens sensés du centre, le mécontentement expectant, peu de confiance et peu d’ambition.
Vous verrez que D. Carlos, pour avoir ses passeports, sera obligé de prier sérieusement Cabrera et le comte d’Espagne d'en finir, & qu’ils ne lui obéiront pas. Raison de plus pour ne pas les lui donner de sitôt ; il faut qu’il ait autant d'envie que la reine Christine de voir cesser la guerre civile, et qu’il emploie ce qu’il a d'influence pour nous comme il l'a employée contre nous. Bourges doit être bien ennuyeux, pas plus pourtant qu’Elisando, je pense. Je ne suppose pas que les visiteurs Carlistes suffisent pour charmer le séjour. Quel puérile parti !
Il me paraît que Berryer poursuit sa candidature à l’Académie française car on m'en écrit de nouveau. Parlerait-il du Roi comme il convient dans son discours de réception ? Demandez-le lui tout simplement si vous le voyez. Remarquez-vous, de votre côté un léger, bien léger mouvement pour nous adoucir un peu dans notre refus de faire comme l’Angleterre.
Plus j'y pense, et plus je répète, pour la politique ce que Mirabeau disait pour la morale : " la petite tue la grande. " Et je le répète contre tout le monde.
Pour rien au monde, je ne voudrais épouser la Reine d’Angleterre. Vous n'aviez pas bonne opinion de l'avenir conjugal de la Princesse Charlotte. Je parierais bien plus contre cet avenir-ci. Je ne sais pourquoi, car au fait je n'en sais rien. Mais j’ai cette impression. Peu importe du reste au résultat. Le Prince de Cobourg ne l'en poursuivra pas moins, et ne s'en félicitera pas moins, s’il l'obtient. Puis le temps s’écoulera ; les mécomptes viendront les ennuis, les colères, les regrets peut-être. C'est le train de la vie. Bien peu y échappent, même de ceux qui le prévoient.
9 heures et demie
Je m’attendais, en effet au dénouement de Félix. Vous faites bien de le garder. Moi aussi, j’attends le beau mois de Novembre. Adieu. Adieu. Je vous quitte bien brusquement. Mon hôte entre dans mon Cabinet. Si c'était vous !
297. Paris, Samedi 26 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Imaginez-vous que Brougham à forcé M. Shafto, un de ses amis résidant avec lui à le Campagne d'écrire à Londres le récit circonstancié de sa mort, pour voir l’effet que produirait cette nouvelle. Une pure plaisanterie. Concevez-vous pareille chose. Le prince Metternich a répondu. Appony épouse, et a la promesse d’un poste indépendant en attendant il sera attaché ici. Vous ai-je dit que mon frère me parle de ce mariage aussi, et se réjouit que sa fille sera auprès de moi? Cela veut dire qu'il sera ravi que je reste à Paris. Il n’a pas de termes d'improbation assez forte pour l’affaire secrète et surtout pour le cordon donné à Espartero ! Point de nouvelles de tout.
Le Roi a été enchanté de revoir Lord Granville. J’ai été encore courir les boutiques de vieux meubles hier, le soir chez Mad. Appony et puis Lady Granville. Je ne laisse entrer chez moi personne, j’ai un peu des coquetteries pour mon appartement et je ne veux pas le montrer qu’il ne soit prêt. Je ne reçois qui Bulwer & Lord Granville, & Thiers l’autre jour dans ma chambre à coucher.
On me dit que tout sera arrangé la semaine prochaine. Le tout me coûtera 30 mille francs & j'espère pas d'avantage. vous êtes fort heureux de ne pas vous trouver auprès de moi dans ce moment, je ne vous parlerais que tapissiers et ébénistes. Peut être cependant que je vous dirais autre chose aussi ! Adieu. Adieu mille fois.
301. Val-Richer, Lundi 28 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Je ne m'étonne pas qu’on soit furieux contre Maroto. Il a bien dérangé le comte de los Valles. Mais j'admire qu'on en veuille. tant au cordon d'Espartero. On tient donc encore plus au respect des cordons qu'au respect des Rois. N'avez-vous pas eu aussi vous-même un peu d'étonnement de ce cordon ? Pour moi, je vous l'avoue, s’il a fait grand plaisir à Espartero, si les Espagnols ont trouvé que c’était là pour lui une récompense, si une aune de ruban rouge, venu de France, a au delà des Pyrénées cette valeur, je trouve qu’on très bien fait. Je fais cas des cordons ; ils plaisent à quelque chose d’indestructible et de puissant dans la nature humaine ; mais je ne les respecte pas ; pas plus que je ne respecte l'argent. Ils sont comme l'argent, très bons à donner à ceux qui les aiment, et il faut savoir, chamarrer les hommes comme les enrichir. Mais je ne connais à l'emploi des cordons, qu'une limite ; c'est de ne pas les user au point qu’on ne les désire plus. Vous voyez qu’on n'en est pas là dans la Péninsule.
Ma mère est mieux. Elle vient de me faire dire qu’elle avait passé une bonne nuit. Je l’ai fait promener hier pendant deux heures au plus petit pas possible sous un ciel sans soleil mais doux et en causant du passé, cette vie des vieillards. Elle était contente, et le contentement est ce qu’il y a de plus sain à tout âge.
J’écris ce matin à Lord Brougham pour lui dire qu’une petite affaire qu’il m’avait recommandée vient d'être faite. J’ai bien envie de lui reprocher d'être revenu trop tôt. Il fallait nous donner trois jours, son expérience est manquée. J'ai peur qu’il ne lui en reste qu’un ridicule de plus. Je suis bien aise que ce mariage Appony soit tout-à-fait arrangé, et que vous ayez votre nièce près de vous. Peut-être en ferez-vous quelque chose ?
Votre anglaise vous plait donc. Est-ce plus qu’une bonne d'enfants ?
Vous devez avoir les Pairs ce matin, au Moniteur. M. Rossi est le seul qui m'intéresse. A sa place, j’aurais mieux aimé attendre qu’une porte s'ouvrit à la Chambre des Députés. Mais qui sait attendre ? Il sera bien partout. Il est du très petit nombre des hommes qui ont assez d’esprit pour que je regrette que vous ne les connaissiez pas.
10 heures
J'ai beau faire, je ne tousse pas. Mais il fait froid. Vous n'êtes pas plus pressée que moi. Je monterai l’escalier de cet entresol avec tant de plaisir ! Je n’ai pas plus de nouvelles que vous. Je vous envoie le peu qui m’arrive. Adieu. Adieu, Adieu. Je suis bien aise que vous vous soyez reposée hier. Vous aviez l'air fatiguée. G.
302. Paris, Jeudi 31 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Prenez patience encore et lisez ce que je vous envoie. Il faut que vous me disiez maintenant ce que j'ai à faire. J'ai reçu hier une lettre d'Alexandre de Berlin. Il arrive aujourdui à Londres. Il ne veut y faire ce séjour strictement nécessaire pour régler ses intérêts là-bas ce qui veut dire recevoir sa part du capital ensuite il viendra ici. Après un petit séjour ici il va en Italie, pour revenir au printemps à Paris et puis Londres encore, et s'embarque de là avec son frère pour un second voyage en Russie. Vous voyez bien qu'il sera pressé et que moi n’ayant écrit ce que je vous envoyé que le 26 Je ne pourrai avoir de réponse que tout au plus le 20 novembre. Cela leur semblera bien long et pourra vexer ce pauvre Alexandre. Cependant puis-je après ce que j’ai écrit à mon frère, & dans mon propre intérêt, leur donner le Capital avant ses réponses ? Dois-je informer Alexandre de tout ceci ? Je crains à présent qu'il est auprès de Paul, quelques réponses impertinentes. Dois-je en charger une tierce personne & qui ? C’est au duc de Sutherland que je donnerai mes pleins pouvoirs. Mais comme il ne sera pas à Londres il les déléguera à quelqu'un, un banquier sans doute. Je ne veux répondre à la lettre d’Alexandre que quand vous m’aurez donné votre avis. Il m’écrit très tendrement et se réjouit beaucoup de me revoir. Ma lettre à mon frère est-elle bien ?
On dit dans le monde diplomatique, que le Roi est fort mécontent de tous les ministes moins le maréchal. Il s’agit de Don Carlos. On menace même de dissoudre le cabinet si ces messieurs s'obstinent à contrarier la volonté du roi sur ce point. C’est Montrond qui m’a dit cela. Lord Granville pousse à garder Don Carlos. On dit que le Roi parle très mal et très vivement sur mon Empereur. Je tremble que Pahlen ne revienne pas ce serait un vrai chagrin pour moi. Il fait un temps abominable Il n’y a plus de belle campagne possible. Adieu. Adieu, Adieu.
14/26 octobre 1839 à mon frère
J’ai reçu il y a huit jours seulement le paquet contenant votre lettre du 20 août et l’acte passé avec mes fils, et avant-hier votre lettre des 22 7bre avec le compte de Bruxner. Je commence mon cher frère par vous remercier bien tendrement de toute là peine que vous avez prise pour arranger mes affaires, et de toute l’amitié, la bonté que vous m'avez prouvées par là. Je vois que j’avais raison ne vous contestant cet été les chiffres de mon revenu que vous portiez à 9400 roubles argent et 400 milles francs de capitaux de la succession de mon mari. Mes propositions sont devenues plus modestes, selon ce que vous me mandez aujourd’hui. L’ensemble de cette succession tel que je le relus de l’acte que vous avez conclu et des autres papiers que vous m’avez envoyés forme pour moi un revenu de 36 395 roubles papiers. Mon propre avoir monte à 20 152 roubles papier. Total général 56 544. Vous en verrez le détail dans le tableau ci-joint. Vous ne trouverez peut-être plus que je suis trop riche comme vous me l'écriviez alors, car il y a loin delà à 80 mille francs de rente que vous m’annoncez. Je vais faire selon la loi russe le partage du capital anglais aussi tôt que je saurai que tout est terminé à Petersboug. Je désire pour cet effet obtenir des réponses aux observations consignés dans la note ci-jointe. En lisant avec attention l’acte et en le confrontant avec les observations que je vous avais soumises dans le temps j'ai trouvé tout parfaitement en règle et toute les questions répondues, sauf le seul point du mobilier de Courlande dont je vous avais déjà entretenu deux fois. J’appelle votre attention sur ce point. S'il a été oublié dans la discussion, c'est à vous à juger si je dois regarder la somme qui aurait dû me revenir de cet état comme perdue à tout jamais ; ou si, dans le cas que l’objet en vaille la peine, vous voudrez le porter à la connaissance de mes fils.
Note
1. La loi de Courlande dit § 194
Toute la partie mobilière de la terre, bétail, magasin, maison, effets, & & sera partagée entre la veuve & les enfants en parts égales.
Comme il m’en revient par conséquent le tiers,. que ce doit être un objet considérable, vu la qualité de la terre et que cependant je ne trouve pas cet objet spécifié dans les papiers qui m'ont été envoyés, je désire savoir quels sont les arrangements qui ont été pris à cet égard, ou l’indemnité qui m'a été assignée pour l’abandon que j’aurais fait de ce droit car on ne peut pas l'inclure dans le 15 829 roubles papier une fois payés. Cette somme formait exactement le revenu de l’année que la loi accordé à la veuve.
2°. Je ne trouve ici dans le tableau du banquier Bruxner, ni autre part mention des coupons qui se trouvaient dans le portefeuille de mon mari pour la valeur de 1350 £ sur la maison Hammersby à Londres.
3°. On aura certainement dressé un inventaire des meubles et un procès verbal de la vente qui en aura été faite à l’encan. Je désire que copie m’en soit envoyée. 4°. Je désire spécialement avoir un état de la vaisselle, & savoir si après la vente à l'encan ma part a pu être rachetée, comme je l'avais demandé. Dans le cas contraire je désire connaître le produit de cette vente.
305. Paris, Dimanche 3 novembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez mal interprété shabby. Je voulais dire et cela veut dire en Anglais, avarie, parcimonie et je l'appliquais aux quelques jours que vous me volez.
Je viens de recevoir une lettre de Bruxner qui m'annonce l’argent que m’avait déjà annoncé mon frère et me dit en même temps qu'on allait commencer sons peu la vente à l’encan, ainsi après le départ. de mes fils. Il n’y a plus à leur demander compte de cela. D'un autre côté Canning a parlé à Bulwer d’argent que Paul avait à me remettre qui doit être la part des coupons. De toutes les interrogations adressées à mon frère il ne reste donc plus à éclaircir que le premier point et il ne vaut vraiment pas la peine de suspendre pour cela. mention en sera faite pas l’entremise de Canning et mes fils feront ou ne feront pas à volonté. Ne trouvez- vous pas que cela vaut mieux ? Et puis dites-moi vite ; si pour éviter des embarras je ne ferais pas aussi bien de donner à Bulkhausen ma procuration pour lever le capital. Il est conseil général de Russie, sa probité je n'en sais rien, mais il est très employé par notre cour à toute chose. Il me parait qu'il n'y aurait pas de risque. Je donnerais avis à mes fils que je lui envoie mes pleins pouvoirs. C’est lui d’ailleurs qui a avancé 25 milles francs pour les legacy duty. Vite répondez-moi.
Il fait un brouillard de Londres épais comme du cream cheese, do you know what it is ? Il y avait hier toute l'Angleterre chez Granville. Toutes des connaissances arrivées la veille, repartant le lendemain pour l’Italie. Vous savez qu'on a renvoyé de Paris, Labrados, & Nobra deux assidus de Don Carlos. Granville approuve tout ce qui se fait dans ce genre et la détention de Don Carlos. Il espère que les ministres tiendront tête au roi et ne le relâcheront pas Du reste il n’y a aucune nouvelle. On commence à voir que la mission de Brünnow est de l’invention du Prince Metternich.
Adieu. Adieu, oui que de choses nous aurons à nous dire. Et que de choses nous aurons oubliées. C’est insupportable. Je ne me sens pas très bien aujourd’hui je crois qui je ne sortirai pas du tout. Ce brouillard est affreux. God bless you.
Autre proposition; mes pleins pouvoirs au banquier Harman chez lequel le Capital est déposé. N’est-ce pas encore plus simple ? C'est un quaker. Il est banquier de la cour de Russie depuis 50 ans.
Mots-clés : Diplomatie, Enfants (Benckendorff), Finances (Dorothée), Politique (Espagne)
306. Val-Richer, Samedi 2 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Vous avez bien raison ; il n’y a plus de belle campagne. Encore notre maladresse : vous avez eu de la belle campagne à Baden et moi en Normandie, et nous en avons joui séparément, si c'est jouir.
Je persiste dans tous mes avis d’hier. Si votre frère y mettait un peu de bonne volonté, il ne serait peut-être pas impossible que dans l'impatience du Capital, vos fils revinssent un peu sur le mobilier de Courlande, et l’argent en portefeuille. Ils vous donneront du moins quelques explications. Je ne vois que Benkhausen ou Cumming que vous puissiez charger de les leur demander. Encore une fois, si vous en écrivez à Alexandre, ce sera Paul qui répondra et Dieu sait comment. Pourtant j'ai en idée que toujours par impatience du Capital, il se contiendra dans ce moment, et vous fera peut-être même quelques avances. N’ont-elles pas déjà un peu commencé ? N'est-ce pas là le sens caché de ce que vous a dit Bulwer ? La tendresse de la dernière lettre d'Alexandre ne lui a-t-elle pas été permise ? Vous voyez que je vous dis tout impitoyablement. Je me trompe, avec une très grande pitié. Je trouve tout cela déplorable.
Le Roi fera bien avant de dissoudre son Cabinet sur les passeports de D. Carlos de s'assurer des successeurs. Mais nous sommes bien bons d'y regarder. Cela n’est pas sérieux. J'en reviens à mon dire ; j'aime la grande et vraie comédie, non pas la petite et inutile.
9 heures et demie
Je n'accepte pas le Shabby. Vous savez que je suis maîtresse de maison ménageant, arrangeant les personnes, les choses. Dieu sait si j'étais fait pour ce métier là ! Mais c’est lui qui m’y a condamné. Ma vieille et bonne mère ne peut pas être pressée. Elle est le contraire de M. de Talleyrand. Elle a de la grandeur naturelle, et de petites habitudes. Je respecte tout en elle. Croyez donc bien, sachez donc bien une fois pour toutes que moi, je n'ai jamais rien de plus pressé que de vous revoir, et que j’y pense, comme on pense à sa première affaire et à son seul plaisir. J’ai mille choses à vous dire que je ne peux pas écrire. Adieu. Adieu.
M. Rossi, ne sera pas Pair cette fois. La loi sur les catégories pour la Pairie n'admet que les membres des quatre académies de l'Institut, & il est membre de la 5e Académie, qui n’existait pas encore du moment où cette loi a été faite. C'est moi qui l’ai créée en 1832. Objection de procureur ; mais les procureurs sont puissants partout. Il attendra. Adieu encore et toujours. G.
307. Paris, Mardi 5 novembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Pas de lettres encore aujourd'hui ! Que faut-il que je pense et comment voulez-vous que je ne sois pas inquiète, très inquiète. Je voudrais m'imaginer que c’est la poste et ses négligences qui me vaut ce chagrin. Mais deux jours de suite c’est trop pour cette cause. Vous ne savez pas à quel point je m’inquiète.
M. Molé m’a fait une longue visite hier, il repart aujourd’hui pour quinze jours il va chez Madame de Castellane. Il allait hier soir aux Tuileries. Son dire est un peu méprisant pour le ministère, et sans spéculation pour l’avenir. Il voit des hommes, mais il les voit toujours isolés sans moyen aucune de faire un pluriel. Il ne comprend pas cependant que le ministère tel qu’il est puisse aller à la rencontre des hommes puissants siégeant sur leur banc. Il critique fort l’affaire de Don Carlos. Il ne fallait pas le retenir trois jours. Aujourd'hui et tous les jours il sera plus difficile de le relâcher. On vient de bannir de Bourges un ami de Don Carlos auquel on n’avait accordé que depuis huit jours la permission de résider auprès de lui.
J'ai mené hier au soir la Princesse Saltykoff chez Lady Granville. Il y avait fort peu de monde. Pahlen s'annonce pour le 10 décembre. Je persiste cependant à douter qu’il vienne. Personne n’a vu l’Empereur depuis Borodico. Il ne quitte pas sa femme. Elle allait mieux cependant. Le pauvre Bulwer a un gros chagrin. Lady Granville recevra sa belle-sœur, je n’y puis rien. Je trouve qu’elle a tort, mais elle ne m’a pas demandé mon opinion. Je calme Bulwer de mon mieux.
Midi. Dieu merci, voici deux lettres ! J’étais excessivement agitée, je ne savais à qui demander, où envoyer. J’ai parcouru avidement les journaux cherchant votre nom. Cela n’avait pas le sens commun mais le cœur n’a pas beaucoup d'esprit. Je vous remercie de n’avoir pas eu d'accident. c’est donc le 13 que je serai contente. Demain en huit. Quel plaisir ! J'ai fait comme vous me dites, j’ai écrit au Duc de Sutherland, Bulwer a écrit à Cunning pour une interrogation simple, et l’affaire va finir. Pas de nouvelle d’Alexandre Il faut bien que je m’inquiète encore de ce côté.
Adieu. Adieu. Le journal des Débats et le moniteur me paraissent assez piquants. Adieu mille fois. Dites à votre poste de ne plus me donner de frayeurs. M. Bresson est arrivé de Berlin hier. On a trouvé fort mauvais à Berlin que le roi de Hollande ait reconnu Isabelle et on le lui a dit.
309. Val-Richer, Mardi 5 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Il y avait avant-hier du cream cheese à déjeuner, et il y a ce matin sur ma vallée un brouillard, tout-à-fait pareil. On dit que la Normandie ressemble beaucoup à l'Angleterre. Elles se tenaient évidemment avant le déluge, et il y a entre elles, depuis le déluge, des rapports continuels. Si jamais vous avez mangé à Londres de belles poires et de belles pommes elles venaient peut-être du Val-Richer. Les fermiers Normands les expédient par milliers, et il part toutes les semaines, du port de Honfleur vingt mille œufs pour l'Angleterre. J’entends shabby comme vous, et c’est parce que je l’entends que je m'en défends. Je ne vous vole jamais rien, car je vous donne tout ce dont je dispose. Voilà nos questions de Dictionnaire vidées.
Plus j’y pense, plus je me persuade que Benkhausen n’a pas d’inconvénient. Tout sera fini plus vite. Je n’espère toujours rien quant au mobilier de Courlande. Mais au moins la suppression ne passera pas inaperçue. Je suppose que vous avez envoyé à Cumming copie des questions que vous airez adressées à votre fière.
Que voulait faire. M. de Metternich de la mission de M. de Brünnow ? Terminer l'affaire d'Orient sans s'en mêler, ou nous brouiller avec l’Angleterre sans y paraître ? L’un et l'autre a échoué. Je vois, par ce qu’on m'écrit, qu'on a peu d'inquiétude, et qu’on laissera traîner dans l’idée que le temps est au profit du Pacha, qui possède. On a bien fait de renvoyer M. de Labrador, s'il s’agitait encore pour D. Carlos. Nous ne devons aux partisans de D. Carlos que la stricte légalité et à D. Carlos lui-même qu'une politique raisonnable dans sa froideur. L’Europe a envoyé un aigle qui s’appelait Napoléon et qui la troublait, mourir à Ste Hélène. Nous ferons vivre quelques mois à Bourges D. Carlos qui nous tracasse. Il y a eu tout juste proposition.
J’ai aussi mes tribulations d’intérieur. Mon concierge d'ici est malade. Je craignais hier une fluxion de poitrine. On me dit qu'il est mieux ce matin. C’est un factotum très intelligent et qui met sa fierté à être à mon service, ce qui fait que je lui passe des défauts.
10 heures
Je craignais ce qui est arrivé. La poste n’étant venue chez moi que très tard, m'en est répartie que très tard, et n'aura pas été à Lisieux à temps. Vous aurez eu deux lettres ce matin. Mauvaise compensation. Tout cela cessera dans huit jours. Les tristes chances de la vie seront les mêmes ; mais nous serons ensemble. J'espère que vous me direz bientôt que vous avez des nouvelles d'Alexandre Adieu. Adieu. J’aime mieux le Duc que Benkhausen Dix mille francs, c’est beaucoup pour une commission. Adieu. G.
310. Val-Richer, Mercredi 6 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Depuis quelques jours, je vois avec bonheur croître le chiffre de notre correspondance. Il touche à son apogée. Il se reposera là bien longtemps.
Les journaux que j’ai repris attentivement hier, ne parlent d’aucun accident dans la mer du Nord. La traversée n'est pas longue. Je compte que vous me donnerez au premier jour des nouvelles d'Alexandre. Je ne veux vous retrouver ni triste, ni malade. Il y a pourtant des choses qui finissent. Je vous retrouverai avec vos affaires arrangées. Pas aussi bien que je voudrais, tant s’en faut, mais enfin arrangées. Vous souvenez-vous combien de fois vous m'avez dit qu'elles ne s’arrangeraient pas ? J’ai été aussi bien inquiet. Il arrive deux choses. Tout ne tourne pas aussi mal qu’on l'imaginait. On se résigne à une grande partie du mal. Il faut accepter ces termes-moyens de la vie. Le repos est à ce prix. Il n’y faut jamais réduire son âme. Ce serait là de la décadence. Il y a une vraie consolation à planer, au dedans, bien au dessus de ce qui se passe et de ce qu’on accepte au dehors.
Ma mère a encore été souffrante hier. Je crains l’hiver. Elle a heureusement une grande force intérieure. Je ne connais personne de plus inaccessible à l’abattement. Dans sa longue vie, je l'ai vue souvent au désespoir, pas un moment abattue. C’est un puissant moyen de résistance même à la maladie. Je crois au moins autant à l'influence du moral sur le physique que du physique sur le moral.
10 heures
Les premières lignes de votre lettre me désolaient. Je n'y comprenais rien. La distribution a donc tardé à Paris. Enfin bientôt, nous ne courrons plus ni l’un ni l’autre aucune chance d'inquiétude, c’est- à-dire de cette inquiétude là. Adieu. J’ai trois lettres d'affaires à écrire par le facteur qui attend ; des lettres de départ autour de moi. Oui à huit jours. Adieu. Adieu
Je persiste sur D. Carlos. La mise en liberté immédiate eût mieux valu en effet. Mais celle-là aussi n’était pas possible. La Chambre est convoquée, pour le 23 déc. Les Pairs sont nommés. M. Rossi en est. Mais vous savez tout cela. C'est ennuyeux de ne pas savoir et faire toutes choses ensemble. Nous y touchons.
314. Val-Richer, Dimanche 10 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Vous n’avez pas d’idée de l'activité qui règne dans cette maison. Je plante un bois ; je fais un chemin. Je redresse des allées. Je sème des fleurs pour l’été prochain. Et mon factotum est encore dans son lit. Ce n'est rien de grave. Mais il ne sera sur pied et bon à quelque chose que lorsque je serai parti. J'admire quel air d’importance et d'entrain on peut mettre à des choses dont on se soucie si peu. Les soins et les agréments de la vie extérieure sont charmants dans le bonheur ; mais il n’y a pas moyen d'en faire le bonheur même. Je ne l’ai jamais cru, ni tenté.
A part son chagrin, le Chancelier doit avoir bien de l'humeur autant qu’il peut en avoir. On ne lui a pas envoyé une levée de Pairs bien éclatante. On a en pourtant bien de la peine à se mettre d'accord sur ces vingt noms. Le Roi a livré une grande bataille pour M. Viermet le plus ridicule des hommes de courage. Il ne l’a emporté que la veille du Moniteur, à 10 heures du soir. Enfin il l’a emporté, tandis que le Chancelier a été battu sur M. Etienne, dont il ne voulait pas. Que disent les Granville, que dit surtout Bulwer des Affaires d'Espagne ? L'Angleterre reste-t-elle là à la tête des radicaux ? Poursuivra-t-elle sa rivalité d'influence avec nous ? Je reprends intérêt à l’Espagne. J’ai recommencé depuis que je connais Zéa. En lui, pour la première fois, j’ai entrevu un homme au delà des Pyrénées. Evidemment, il y a là, dans ce moment quelque chose à faire. Bien difficile ; mais la difficulté dans la possibilité, il n’y a que cela qui vaille la peine qu’on y mette la main. Je ne comprends pas pourquoi vos caisses arrivées au Havre, ne sont pas depuis longtemps à Paris. Ce n’est qu'un ordre d'expédition à donner. Quelque grand serment que soit Rothschild, il peut faire cela, sans déroger.
9 heures et demie
Vous serez ce matin aussi contrarié que moi du jeudi au lieu du mercredi. Pas plus, je vous en réponds. Je ne vous dirai qu’une chose. Finissez avec vos fils. Il faut absolument qu’ils vous donnent, en échange du leur part du capital anglais, l’ordre à Bruxner de vous envoyer ce qui vous appartient. Je ne comprends pas comment ils ont pu l’empêcher, comment Bruxner, s'est laissé interdire par eux ce qu’il était de son devoir de vous envoyer sur le champ. Mais tout cela est si étrange, hommes, choses, procédés, pays que je ne compte sur rien et ne m'étonne de rien. Pourquoi ne chargeriez-vous pas Cumming de cela comme du reste ? Il en sait assez pour que cela de plus ou de moins ait bien peu d'importance. Mais sans aucun doute, ordre pour ordre, argent pour argent. Je suis affligé, blessé, irrité, humilié de tout cela. Adieu. Adieu. Au moins vous n'avez plus d'inquiétude. Adieu Dearest. G.
328. Londres, Dimanche 22 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je ne suis pas sorti hier soir. J’ai eu à dîner MM. de Bülow, Alava, Biörnstierna, Gersdorf et Münchausen. Ils ont joué au whist. Alava ne m’a quitté qu’après onze heures. Il a failli descendre à la cuisine pour faire à Louis son compliment. Il est très heureux depuis quelque tems. Son gouvernement devient quasi-tory et s’en trouve bien. Alava parle con gusto de toutes les lois qu’on va remanier. Un peu trop à mon avis. Du reste Rumigny et Aston s’entendront à merveille à Madrid ; ils ne se mettront point à la tête des factions opposées ; ils soutiendront ensemble le gouvernement de la Reine au lieu de tirer chacun à soi. J’oublie que l’Espagne ne vous intéresse pas du tout. Vous avez tort. Il y a là quelque chose qui commence. Mais vous n’aimez pas ce qui commence. Il vous faut du plein midi. Bülow m’a paru hier moins préoccupé de sa santé, moins nervous. Il causait volontiers. Il a beaucoup de goût pour son Prince royal. Il n’y a, dit-il, à Berlin de mouvement d’esprit et de conversation que chez lui. Je vous ai envoyé sur le champ les nouvelles du corps diplomatique. Vous les ,aviez peut-être déjà. Médem ira-t-il à Stuttgart ? J’en doute. N’a-t-il pas refusé Stockholm il y a un an ? S’il part, j’en suis fâché pour lui, et même un peu pour vous. Sa conversation vous plaisait assez.
Je vous consulte et bien à l’avance, sur une grave question. Je donnerai mon premier grand dîner le 1er mai. Autrefois, c’était un dîner français. Sébastiani a changé cela et en a fait un dîner du Corps Diplomatique, plus les principaux membres du Cabinet. On me propose ou de faire comme Sébastiani, ou de donner un dîner tout anglais, sauf les deux ou trois principaux du Corps Diplomatique et composé ainsi qu’il suit :
Le Cabinet tout entier... 14 les hommes seulement
Les lords Leveson à cause de son père Uxbridge pour la Cour Albermarle Hill Pour l’armée Tankerville il y a toujours été Somerset Devonshire Pour le monde Sutherland Anglesey M Elllice Esterhazy Bülow Pour le Corps Diplomatique Alava de famille.
Il y aurait, dans ce nombre, plusieurs refus. On me propose, comme remplaçants Les Lords Carlisle, Breadalbane, Skrewsbury Dites-moi votre avis.
Le dîner tout anglais, ou à peu près, est peut-être plus utile. Mais il me semble que le dîner au Corps Diplomatique est plus convenable. Ne criera-t-on pas beaucoup si j’abandonne la tradition ? Puisque nous sommes à table, je poursuis. Voici deux autres dîners qui viendront à leur tour. Pesez-les bien. 1° Le dîner Tory
Les Cambridge…. 6 personnes, le fils, la fille, la dame d’honneur
Les lords Wellington 1 Peel 2 Lord et Lady Aberdeen 1 Lyndhurst 2 Lord et Lady Stanley 2 Lord et Lady Jersey 3 Sa fille pour la fille de la duchesse de Cambridge Witton 2 Cowley 2 Les lords Stuart de Rothsay 2 Londonderry 2 s’ils viennet tout sera fini Hertford 1 Howe 1 Et pour suppléants aux refus Les lords Douro 2 Aylesbury 2 Fitz Roy Somerset Sir Charles Bagot
3°) Le dîner de fantaisie, purement fashionable Les Sutherland 2 Palmerston 3 Clarendon 2 Tankerville 2 Aylesbury 2 Lichfield 2 Mahon 2 Anson 2 Douro 2 Leveson Douglas Foley Kisselef Cooper Et pour suppléants Chesterfield 2 Cadogan 2 Si le premier dîner était donné au Corps diplomatique, cela modifierait les deux autres. Je compte que vous serez ici avant le 3ème. Voilà de quoi méditer. Je n’ai pas fini Bourqueney m’apporte son projet pour le 1er dîner, en remplacement de celui qui précède. Il ne prend dans son cabinet que les Lords Melbourne-Landsdowne-Clarendon-Normansby-Palmerston-John Russell-Minto et Holland. Plus quinze ministres étrangers. Plus les Ducs de Somerset et Sutherland et Lord Uxbridge. Il me semble que pour le 1er mai, ceci serait plus correct. C’est bien je crois la première fois qu’on fait passer la mer à des listes d’invitation à dîner. Faut-il que je vous envoie aussi le menu ?
5 heures
Je n’ai rien ce matin. Mais au fait, je ne peux rien avoir. Quand même quelque chose serait arrivé pour moi dans Londres on ne le distribuerait que demain. J’ai passé ma matinée à écrire toutes sortes de lettres insignifiantes. Hummelauer m’a pris une heure. Je crois que ma conversation lui plait. Il a beaucoup plus d’esprit que Neumann qui ressemble à un père noble de comédie. d’Haubersaert m’a écrit comme vous : « Le résultat du vote sur les fonds secrets n’est plus douteux pour personne. « Il me dit qu’on écrit d’ici beaucoup de bien de moi à Lady Sandwich. J’ai après-demain, à l’Athénaeum, un dîner où il faudra un speech, me dit-on, mais un speech en français. Je fais, pour comprendre l’anglais, des progrès considérables. Je triomphe dans le duo. Je suffis au trio ou au quatuor, et même les morceaux d’ensemble m’effrayent peu. Mais j’ai en idée que pour parler, je ne saisirai jamais l’accent. Vous savez que je dîne aujourd’hui chez Lady Palmerston, en petit comité. Je finirai ma soirée Chez Lady Jersey. Elle a de drôle d’artifices. Elle m’a dit l’autre jour, devant plusieurs personnes, qu’elle était désolée de m’avoir manqué le matin, qu’elle ne rentrait ordinairement qu’à 5 heures. Je n’y étais pas allé. J’irai un jour à 5 heures. Lundi, 9 heures Lord et Lady Holland, Lord Normanby, Lord John Russel, M. Macaulay, M. Allen, M. et Mme Stanley, voilà le dîner. Assez languissant. Toujours la Chine. Lady Holland lit beaucoup sur la Chine. L’amirauté vient d’en publier une carte. On aura, au mois de novembre prochain des nouvelles de ce qui s’y passera d’après ce qu’on a décidé ces jours ci. Après le dîner, pour nous délasser de la Chine, j’ai expliqué l’Algérie. Il m’a paru qu’Abel-Kader était un peu moins ennuyeux que l’Empereur de Pékin. Je suis sorti à 11 heures un quart. Lady Jersey n’était pas chez elle. J’étais dans mon lit à minuit. Lord Lyndhurst est très malade, d’un inflammation de poitrine devenue presque générale. Il était mieux avant-hier, mais hier, il est retombé. Savez-vous qu’il a 70 ans ? Lady Holland m’a invité à dîner pour Mercredi. J’étais engagé. Pour dimanche. J’étais engagé. Je crois qu’il faudra attendre leur retour à Kensington. Ils iront bientôt.
Lord Holland en meurt d’envie. Il n’a point de chambre ici. Il fait sa toilette dans la salle à manger. Et pas un coin pour mettre des livres, des papiers. Il a tout son bagage dans un petit coffre qu’il transporte dans la salle à manger, dans le salon, partout avec lui. Lady Holland tient absolument à cette petite maison. Lady Cecilia Underwood va donc devenir Duchesse de Sussex. L’attaque du Morning Post est bien violente. Le Morning Chronicle, ce matin, annonce que le Cabinet est résolu d’approuver la déclaration du mariage et de demander les 6000 Livres. Je n’en ai encore entendu parler que par des ennemis. Que signifie ce procès de Lady Bulwer où le pauvre Bulwer est ramené sur la scène ? Il me semble qu’il avait raison de la craindre à Paris. Comment va-t-il ? Donnez-moi de ses nouvelles.
Une heure
Je viens d’envoyer chercher le 327. Je suis charmé que vous n’ayez plus besoin de Verity. Mais faites le toujours venir à la moindre envie. C’est un peu de repos et surtout un peu de distraction pour votre imagination. Je pense beaucoup à tout ce que vous me mandez, vous et Génie. Personne ne peut savoir ce qui peut commencer là. Mais je n’aime pas les paroles inutiles, je dis comme vous : Nous verrons. En attendant, pensez-y bien de votre côté, je vous prie. Un moment peut venir où tout notre esprit ne sera pas de trop.
2 heures
Rothschild sort de chez moi et ne m’a rien appris. Il voulait savoir quelque chose, mais je suis bien sûr que je ne lui ai rien appris non plus. Certainement j’aurais été charmé qu’il me dit que vous aviez dîné chez lui ces jours derniers. Comment ce pauvre Bulwer, avec son genou, est-il en état de se battre avec Berryer ? Le cartel m’avait échappé ce matin en lisant les journaux. C’est Bourqueney que me l’a fait remarquer. Adieu. Je vais faire des visites. Je dîne aujourd’hui au Raleigh Club. Que de dîners je donnerais pour un autre ! C’était charmant. Adieu encore. Madame la Princesse de Lieven St Florentin 2 Paris Voici des nouvelles que j’ai tout juste le temps d’ajouter. M. de Brünnow a reçu ce matin ses lettres de Ministre extraordinaire à Londres. Il n’en ira pas moins à Darmstadt. M. de Kisselef est nommé à Paris, à la place de Médem qu’on envoie à Stuttgart. Le gendre de M. de Nesselrode, M. Miloradowisch vient à Londres à la place de Kisselef. 5 heures 1/4
422. Londres, Vendredi 25 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Dites-moi si l’anémone et le cidre attachent bien le même sens à tout-à-fait. Dites-moi oui sans plus. Je reviens de Regent’s Park. La même entrée, les mêmes tours, la même sortie. J’avais écrit depuis sept heures et demie jusqu’à 4 heures, sauf le déjeuner. Je n’en pouvais plus. La solitude ne m’est pas saine. J’en abuse. C’est la solitude de Londres, qui me frappe. En hiver au printemps, la foule anime un peu le silence. Les figures sont froides, mais elles se pressent. A présent pas plus de foule que de bruit. Tous les jours sont dimanche. Un grand combat se prépare entre le Dimanche et les railways. On colporte, on signe des pétitions pour que les railways soient immobiles le Dimanche. Ils sont décidés à se défendre. La question ira au Parlement. Le Cabinet sera un peu embarrassé. Le Dimanche a des amis dans son camp. Cependant, on croit qu’il prendra parti pour les railway.
Samedi 7 heures et demie
Les diplomates me sont arrivés hier soir pleins de paix. Mais elle leur venait d’où vient ordinairement la peste, d’Odessa. Lord Alvanley écrivait de là que tout était arrangé, que le Divan avait accepté les propositions du Pacha. Puis nous avons trouvé que c’était un bruit de bourse, déjà inséré dans le Globe. Les sources, les dates, les vraisemblances morales ôtent à ce bruit, toute valeur. Aujourd’hui ou demain nous aurons des nouvelles sérieuses de Syrie et d’Alexandrie.
Alava, Moncorvo, Schleinitz, Pollon, Van de weyer, Münchhausen, Lisboa et je ne sais combien de secrétaires. Je ne me laisserai point imposer les femmes. Tout en serait changé et gêné ? Leshommes sont là fort librement. On cause, on joue au Whist, à l’écarté, aux êchecs. Tous les journaux anglais et français sur une grande table ronde. Il n’y a rien a changer. On dit qu’Espartero va renvoyer la junte de Madrid et toutes les juntes. Qu’il restera président du Conseil, sans portefeuille et fera un ministère qui ressemblera à tous les autres. Que la nullité du ministère et du Président éclatera bientôt, et que la Reine sortira du défilé en y laissant sur le carreau tous ceux qui l’y ont poussée. Cela se pourrait. Mais au milieu de tous ces gens qui tombent, je cherche quelqu’un qui s’élève. Je ne vois pas. Il ne suffit pas pour gouverner d’user les hommes qui embarrassent. Quelques fois, il est vrai, on n’a rien de mieux à faire. Alors il faut se résigner à n’avoir rien de bien !
Je persiste dans mon jugement. Des maux alternatifs dans une anarchie impuissante. Grand exemple de ce que peuvent faire d’un pays les sottises absolutistes et les absurdités révolutionnaires. Depuis Philippe 2, elles possèdent l’Espagne. Une heure Adieu. L’adieu spécial que vous voulez ; et bien spécial ne ressemblant à aucun autre. Il le faut en vérité, car il y a là un mal qui résiste aux remèdes les plus héroïques. Un seul mot encore. Je n’ai plus entendu parler d’aucune tulipe. Et comme j’évite au lieu de chercher, je n’en entendrai point parler. Vous avez raison. Je ne puis pas m’éloigner. Et juse de cette raison là.
Je ne me plains pas. Soyez contente. Et soyons toujours aussi enfants, tous les deux. Mais ne maigrissez pas ; pour Dieu ne maigrissez pas ; point a cause de la maigreur, mais a cause de la santé. Pour moi, je vous promets de ne pas engraisser. Je vous tiens déjà parole car certainement, j’ai maigri depuis quinze jours. Mon anneau à failli glisser hier. Beaucoup de souci, beaucoup de travail, point. de repos, car point de bonheur. Je ne crois pas à la guerre. Je me le redis, je vous le redis, parce qu’en effet je n’y crois pas. Mais je suis aussi inquiet que si j’y croyais. L’intérêt est si grand que ma prévoyance est sans pouvoir sur ma disposition. Mes relations personnelles avec lord Palmerston sont toujours les mêmes, réellement bonnes. Je crois qu’il aurait vraiment envie d’être d’accord avec moi. Mais qu’importe. Nous verrons ce que rendra le conseil de lundi. Quelle puérilité que tout ce fracas des journaux les plus sérieux à propos de quelques phrases en l’air d’un journal obscur ! Je n’ai pas la moindre relation, avec l’Univers. Je n’ai rien dit, rien fait qui autorise, rien de semblable. Je n’ai pas écrit depuis je ne sais combin de temps à M. Dillon ni a personne qui pût abuser de mes paroles. Je suis réservé, très réservé, aussi réservé que je serais décidé s’il y avait lieu.
Je connais bien les difficultés de ma position. J’y pense sans cesse. C’est la chose à laquelle je pense le plus. Je ne me laisserai point engager au delà de ma propre idée. Ceci est trop grave pour qu’on s’y conduise autrement que selon sa propre idée. Mais je ne me séparerai pas sans motif très grave et je ne désavouerai rien de ce que j’ai accepté jusqu’à présent. Adieu. Adieu. Ne me dites pas que mes lettres sont courtes. Ce n’est pas vrai. Comment le seraient-elles? C’est tout mon plaisir. Adieu.
422. Paris, Dimanche 13 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je me suis sentie indisposée ce matin, j’ai fait venir Chermside, il croit que j’ai pris froid. Le temps a subitement passé au froid. J’ai vu Bulwer longtemps les Appony, mon ambassadeur j’ai renvoyé Flahaut, sa femme et d’autres.
Les ambassadeurs se sont disputés chez moi. L’Autrichien soutenant que sa cour lui mande qu’en cas de marche d’Ibrahim, les Russes n’occuperaient pas Constantinople. et le Russe soutenant que nous l’occuperions. Ce discrepancy m’a un peu étonné. Le 29 actuel a vu hier au soir Z et et a obtenu l’assurance positive qu’il ne méditait point de coup de théâtre au loin. Cette idée avait été fort accréditée hier. On dit que l’Angleterre devrait bien souffler au Turc à Londres une proposition d’accommodement avec la France, c’est-à-dire que le Turc offre bénévolement de meilleures conditions au Pacha plutôt que de voir de la désunion entre des puissances qu’elle (la Turquie) regarde comme également bienveillante pour elle, et dont la rupture pourrait avoir des résultats fâcheux pour son existence. Croyez-vous qu’on inspire cela ? Ou qu’on l’ordonne, car on peut ordonner. Ce serait a loop hole.
Les nouvelles d’Espagne sont bien critiquées. Il faudra que la Reine s’humilie ou s’enfuie. Que ferez-vous dans cette affaire ? Un gouvernent qui ne serait pas soutenu par la gauche irait peut-être au secours de la Reine. Mais il est difficile que vous le fassiez. Il y a des gens qui croient que vous le ferez quand même, pour faire aujourd’hui quelque chose. Cela me semble impossible.
Lundi 14. 9 heures
Mon ambassadeur est revenu hier au soir avant de se rendre à deux routs (Appony et Flahaut) il m’a répété qu’il n’a pas eu un mot de Petersbourg, pas un mot depuis le mois de juin. Il en est fort content. Les lettres particulières de là disent qu’on n’y croit pas à la guerre, que personne n’y songe. Lui, Pahlen, la croit très possible , et même très difficile à éviter. Il me demande ce que je ferai ? Je le demande aussi que devenir ? Ah mon Dieu ! J’ai assez bien dormi. Mad. de Talleyrand est à Rochecotte. Elle m’a attendu quelques jours à Paris, à ce qu’elle prétend elle m’engage à aller chez elle ce que je ne ferai pas.
Mad. Appony est moins éprise de sa belle-fille que ne l’est son mari. Elle la trouve bien frivole, et rien que frivole ; toute la journée se passe en toilettes. Elle tremble pour l’avenir lorsque le beau trousseau sera fané ! Lui Appony n’est pas si inquiet ; il est charmé d’une jolie femme dans se maison et me parait tout aussi amoureux que son fils. Midi. J’ai revu le gros Monsieur et quelque chose de mieux que lui. Merci, merci. Demain mardi sera un mauvais jour, je voudrais qu’il fût passé ! Ah je voudrais qu’ils fussent tous passés, tous les jours de séparation ! J’ai écrit à Thiers le lendemain de mon arrivé ; il n’est pas venu, et ne m’a pas répondu. je continue à me coucher à 9 1/2, j’ai bien besoin de repos.
Adieu, adieu. Je ne prévois pas que j’apprenne rien de nouveau d’ici au moment de la poste. Adieu.
443. Paris, Lundi 5 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Hier a été une journée bien active et bien bavarde. D’heure en heure quelque rapportage, et à 5 heures à Tortoni la nouvelle que Thiers avait donné sa démission. On disait qu’il avait résolu de convoquer les chambres, d’y apporter la guerre et d’ordonner en attendant la marche de 200 000 hommes vers le Rhin et l’envoi de votre flotte à Alexandrie pour l’apposer aux alliés. On disait que le roi n’avait point voulu accorder tout cela, ni rien de cela, et que par suite Thiers donnait sa démission. nous verrons aujourd’hui. Berryer est venu chez moi à deux heures. Il ne savait rien de ces bruits, ils n’ont circulé que plus tard mais il me dit qu’une crise ministérielle était arrivée : que Thiers ne pouvait point reculer, qu’évidemment il lui fallait la guerre et que la chambre accueillerait avec transport la guerre, parce que telle était la disposition des esprits maintenant qu’il fallait commencer cependant que Thiers avait fait bien des fautes, qu’il n’avait fait que des fautes mais que pour le moment il ne s’agissait pas de les examiner, qu’il fallait satisfaction à l’amour propre national, et que comme cette satisfaction ne se présentait pas pacifiquement, il fallait la prendre de l’autre manière que ces derniers deux ans avaient fait une grande révolution dans les esprits, qu’il ne pouvait plus y avoir dévouement ou confiance, que les existences avaient été troublées, tout remis en question, et que dès lors, tout pouvait ressortir de cette situation. Que l’Angleterre avait été bien habile, que lord Palmerston était le plus grand homme qui eut paru depuis M. Pitt. Paralyser à la fois la Russie, (je n’ai pas accepté la paralysie) remettre à la tête des grandes puissances, s’emparer de la direction des affaires en Espagne, et rendre ainsi la situation de la France périlleuse de tous les côtés, c’était là un chef d’oeuvre d’habilité, enlevé galamment avec une prestesse admirable. Enfin il grossirait cela de toutes ses forces pour enfler les comparaisons. Il parlait pitoyablement des notes diplomatiques. Il demandait la réponse au factum accablant de Lord Palmerston ? Et puis il a brodé sur les crédits extraordinaires, sur les fortifications de Paris surtout, et de quel droit, sans avoir consulté la Chambre ? Et le bois de Boulogne à qui appartient-il ? Il dit après : le roi a tiré de ce ministère tout ce qu’il lui fallait pour sa propre force. Ce que Thiers préparait pour dehors, le roi se promettait bien de l’employer au dedans et le jour où arrivera la la nécessité d’une révolution extrême, le roi ayant profité habilement de tout ce que la popularité de Thiers a pu lui fournir jusqu’à sa dernière limite, le Roi se passera de lui. Placé entre deux dangers une lutte extérieure, et une lutte intérieure, le roi choisira toujours cette dernière chance. Voilà le dire de Berryer sur la situation en gros ; il n’a point nommé les personnes. Il a seulement dit en passant que vous et Thiers étiez mal ensemble, j’ai dit que ce devait être nouveau parce qu’il me semblait tout le contraire lorsque j’étais à Londres.
Après Berryer, j’ai vu tout mon monde diplomatique les quatre puissances alliées agités, mais point inquiets. Ils ne croient pas sérieusement à la guerre. Sébastiani a dit hier encore à 4 heures de l’un de ces diplomates. Tenez pour certain que le roi n’y consentira pas. Le petit ami est revenu hier une seconde fois très animé, très troublé de tout ce qu’on dit, et de tout ce qu’on lui demande. Je lui ai dit de vous tout dire dans le plus grand détail. Hier soir à 10 heures, M. de Broglie était chez Granville, qui lui a appris tout le tripotage de la journée. M. de Broglie n’en savait pas un mot, et ne voulait pas y croire. Il ne voulait pas croire que le ministère eût pu arriver à ds résolutions aussi excessives. Mais M. de Broglie, me parait être quelque fois un enfant. moi, je suis très très préoccupé de tout ceci pour vous !
Lady Palmerston m’écrit. avec amitié. Sur les affaires elle me dit : " Lord Palmerston désire plus que personne la paix, et je ne puis croire qu’avec ce désir général il y ait crainte de guerre. La conduite de M. Thiers rend toute négociation à présent fort difficile, mais il est clair que l’on serait fort aise de s’accommoder avec la France autant qu’on peut le faire sans déshonneur, et sans abandonner ses alliés. Mon mari est fort raisonnable dans cette affaire et saisirait volontiers tout moyen d’accommodement qui ne porterait point atteinte à l’honneur de son pays, ainsi ne dites pas que c’est de lui que dépend la paix ou la guerre, parce que le résultat est bien plus entre les mains de M. Thiers. Si la France se comporte comme une écervelée ce ne serait point une excuse pour nous d’être lâches ou d’abandonner nos alliés." Elle me dit encore que le duc de Wellington et Peel sont bien plus déterminés encore que son mari, et que Peel a dit : " Si l’on fait des concessions à la France, il n’y aura pas de paix dans trois mois. "
Onze heures
Je reçois votre lettre c’est charmant d’être à Lundi, c’est charmant Mercredi. Mais que faire de l’intermédiaire ? Votre gravure est devant moi dès que je quitte mon lit, tous les jours je trouve la ressemblance admirable. Mais pourquoi ne me regardez-vous pas ? Est-ce le peintre ou vous qui avez voulu cela ? Je ne suis pas sûre que vous ayez eu raison ; c’est parfait comme cela, mais votre regard fixé sur moi, c’eût été mieux encore. Je me repens d’une petite querelle que je vous ai faite hier pour abstenir des nouvelles modernes plutôt que des souvenirs anciens d’Angleterre.
Je me repends de tout ce qui n’est pas des paroles douces tendres ; de loin il ne faut jamais un moment d’impatience même sur ce qu’il y a de plus puéril. compte sur vous. Vous me connaissez un peu pétillante, vive et puis c’est des bêtises.
Mad. 79 se plaint de ce que le bouleau a trop d’intimité avec les personnes qui ne sont pas de l’avis de R. Les journaux ce matin sont bien plats à côté du commérage de la journée d’hier. Le constitutionnel est en bride. L’incertitude ne peut pas durer.
Je ne me porte pas mal, mais je ne suis pas encore assez bien pour voir du monde. Le soir cela me fatiguerait. M. Molé est revenu hier mais je n’y étais pas. Je passe le dimanche à l’ambassade d’Angleterre. Je trouve lord Granville très soucieux. Sa femme est allée avant hier à St Cloud. Elle n’y avait pas été depuis plus de 3 mois. Jamais, elle n’a vu la reine dans l’état d’accablement et de tristesse où elle l’a trouvée.
Samedi 1 heure.
Je n’ai vu personne encore, je viens de marcher sur la place, je rentre pour fermer ni avant les interruptions. Je vous écris des volumes il me semble, mais il me semble aussi que vous les voudriez encore plus gros. Je vous crois insatiable comme moi. Je vous crois comme moi en toute chose, en tout ce qui nous regarde, un peu aussi en ce qui ne nous regarde pas. Enfin je trouve que nous nous sommes tellement eingelebt (Connaissez-vous la nature de ce mot ? ) que nous n’avons plus besoin de nous rien demande,r nous nous devinons. Devinons-nous ce que deviendra ce mois-ci ? Ah pour cela, non !!
Adieu. Adieu. La crise ne peut pas se prolonger. Il faut que la convocation des chambres ressorte de ceci. Adieu. Adieu toujours adieu quoique vous commenciez un peu à le mépriser, et moi peut être aussi. Mais nous sommes trop pauvres pour ne ps accepter les plus petites aumônes. Adieu.
Brighton, Vendredi 10 novembre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai eu que ce matin votre lettre d'hier 9 h. du matin. C’est ridicule. Hier je vous en ai écrit deux. Ce que vous me dites sur Paris est fort triste. Cela va dégénérer en guerre civile. Ce ne sera plus guerre sociale, mais les partis politiques aux prises. C'est mieux mais cela peut devenir plus gros. Avez-vous lu l'excellent article du Times de ce matin sur Palmerston à propos de l'Espagne ?
Vous me direz n'est-ce pas in time quel jour de la semaine prochaine je puis vous attendre ici. Il faut que je le sache pour m'assurer de votre chambre. Hier soir toujours ma vieille princesse anglaise. Aujourd’hui toujours beau temps, beau soleil, & la promenade. Je vous quitte pour elle, et parce que je n’ai rien à vous dire je n’ai rien reçu, & vu personne qui sache. 8 heures. J’ai vu les Holland, W Lamb Alvandy. Les Holland très agréable, mais point de nouvelles. Mes journaux français me manquent. Quelle stupidité ils adressent hôtel Brighton à Bedford, et voilà. Adieu, adieu. Demain je vous écrirai de bonne heure un mot avec l'espoir qu’il vous sera porté le soir, car dimanche, rien hélas. Adieu. Adieu.
Brompton, Jeudi 7 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je suis arrivé hier trop tard pour vous écrire. Je ne vous dirai pas grand chose ce matin. Demain à dîner. Visite intéressante et utile. Très bonne disposition. Peu d’espérance et beaucoup de sagesse. Quand je dis peu d’espérance, je veux dire peu d’espérance pour le bon gouvernement de l'avenir. Grand effroi des difficultés, peut-être des impossibilités. Le monde s’en va. Ce qui est aujourd'hui s'en ira certainement. Mais comment fera, pour ne pas, s'en aller aussi ce qui viendra après, quoique ce soit assez de penchant à croire qu’il a été la dernière bonne chance, et que n'ayant pas réussi, rien ne réussira. Un peu moins d’inquiétude sur ses intérêts privés mais se créant à lui-même, sur ce point toutes sortes de questions et d'embarras. Extrêmement préoccupé des chances de guerre. Si elle éclate ce n’est plus seulement le monde qui s’en va c’est le monde qui finit. Guerre générale. Un peu plus tôt, un peu plus tard, l'Angleterre y sera attirée. En résumé, tout son ancien esprit, point d’esprit nouveau. Rien n'entre plus. Assez blessé et je le comprends de cette parfaite similitude, égalité établie, dans le discours de la Reine, entre les rapports actuels des deux pays et les rapports antérieurs. Vous aurez bien vu, en lisant le discours que je ne l’avais pas bien entendu. Encore bien plus blessé de l’article du Times d’hier. Les Princes sont allés au Parlement par égard, pour la Reine qui leur avait envoyé des billets. Cela seul aurait dû les faire traiter eux-mêmes avec plus d'égard.
Très bonnes nouvelles d'Espagne et de Séville en particulier. Attendant la nouvelle de l'accouchement. Le Duc et la Duchesse de Montpensier en très bonne position, même auprès des Progresistas qui les épouseraient, au besoin. Quelque inquiétude, non pas sur, mais pour Narvaez. Il pourrait bien être remplacé par O’Donnell, sans que le pouvoir sortît des mains des modérés. La Reine Christine pourrait bien vouloir cela, pour se raccommoder un peu avec Londres. Penchant à croire qu'elle aurait tort, mais ne s'en inquiétant pas beaucoup. L'important, c'est le pouvoir de la Reine Christine et des moderados, et celui-là n’est pas du tout compromis. Grande satisfaction de la correspondance d'Eisenach. L’attitude y est bonne et en parfaite harmonie avec celle de toute la famille. Mais on dit que la Duchesse d'Orléans a maigri. J'ai vu les trois Princes qui revenaient de la chasse. On leur a donné la chasse de l'Avemont. Grand soulagement à l'ennui.
J’ai rencontré en revenant la Reine douairière qui y allait. Et j'y rencontre toujours Lady Cowley, et Georgina. Nous sommes revenus d'Esher ensemble. Le reste à la conversation de demain.
En fait d’intérêts privés, je vous donnerai des nouvelles du procès qui vous touche. Je crois qu’il y a bien des chances d’arrangement. Je vous dirai ce que vous auriez à dire pour y aider. J’attends votre lettre à 9 heures. Mais je ferme celle-ci pour qu’elle parte tout de suite et que vous l'ayez dans la journée. Si quelque chose m’arrive, je vous écrirai ce soir. En tout cas, à demain dîner. Adieu Adieu. G.
Brompton, Vendredi 24 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai enfin terminé mon travail. M. Lemoinne que j'ai retenu, l'emportera dimanche à Paris. Je vous l'apporterai mardi.
Je crains bien que ce que vous me dites de ce pauvre Rossi ne soit pas vrai, et qu’il ne soit bien réellement mort. Le Morning Chronicle dit le savoir de son correspondant à Rome comme de Paris. M. Libri, qui sort de chez moi, me disait que le Comte Pepoli arrivé ces jours-ci de Rome, lui avait dit que Rossi réussissait et réussirait plus qu'on n'avait espéré. C'est pour cela qu’ils l’ont tué. Les révolutions de ce temps-ci sont stupides, et féroces. Elles tuent les hommes distingués, et n'en créent point. M. Libri a reçu ces jours-ci une lettre de sa mère qui lui écrit : « Il se prépare dans les états romains des choses abominables. » On s'attend à des massacres dans les Légations. Je veux encore espérer que Rossi n’est pas mort ; mais je n'y réussis pas. Sa mort m’attriste plus peut-être qu'au premier moment. Ce n'était pas vraiment un ami ; mais c'était un compagnon. Nous avons beaucoup causé dans notre vie. Il me trouvait quelquefois compromettant. Moi, je le trouvais timide. Il est mort au service de la bonne cause. Nous nous serions repris très naturellement, si nous nous étions retrouvés.
J’ai dîné hier chez Reeve, avec Lord Clarendon, que je n’avais pas encore vu. Bien vieilli sans cesser d'avoir l’air jeune. Un vieux jeune homme. Toujours aimable, et fort sensé sur la politique générale de l’Europe. Il était presque aussi content que moi du vote de l'Assemblée de Francfort contre l'Assemblée de Berlin. Il me semble que ce vote doit donner de la force au Roi de Prusse, s’il peut en prendre. Lord Clarendon, est très occupé de l'Irlande et la raconte beaucoup. Il y retourne sous peu de jours. Nous avons parlé de tout, même de l'Espagne. Il s'est presque félicité qu'elle fût restée calme et Narvaez debout. J’ai très bien parlé de Narvaez. Et même de la reine Christine. Il n'a pas trop dit non. Ils ont tous l'oreille basse du côté de l'Espagne. Clarendon est allé à Richmond et parle bien du Roi.
Je dîne Lundi chez Lady Granville. Partout Charles Greville, de plus en plus sourd. Et sans nouvelles. Voici vos deux lettres. L’une très sensée. L’autre assez amusante. Moi qui n’ai pas grande opinion de la tête de M. Molé, j’ai peine à croire à son radotage auprès de Mad. Kalorgis. Est-ce qu'elle est revenue à Paris du gré de l'Empereur, et pour le tenir au courant de grands hommes ? La séance de l'Assemblée nationale sera curieuse demain. Ils s’entretueront. Mais Cavaignac seul a quelque chose à perdre. Ce qui l'a provoqué à provoquer cette explication. La lettre de MM. Garnier-Pagès, Ducler & & est une intrigue pour remettre à flot M. de Lamartine et le porter à la Présidence à la place de Cavaignac décrié. Adieu. Adieu. Je suis bien aise que vous n’ayez plus miss Gibbons sur vos nerfs. Adieu. G.
Mots-clés : De la Démocratie (ouvrage), Diplomatie, Discours du for intérieur, Politique (Allemagne), Politique (Espagne), Politique (femme), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Italie), Portrait, Relation François-Dorothée (Dispute), Réseau social et politique, Révolution, Travail intellectuel
Château d'Eu, Mercredi 6 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Vous avez beau mépriser la musique instrumentale. Vous auriez été entrainée hier par un fragment d'une symphonie de Beethoven que les artistes du conservatoire ont exécutée, avec un ensemble, une précision, une vigueur et une finesse qui m'ont saisi, moi qui ne m’y connais pas et cette succession de si beaux accords, si nouveaux et si expressifs, étonne et remue profondément. Tout le monde, savants et ignorants, recevait la même impression que moi. Je craignais que ces deux soirées de musique n'ennuyassent la Reine. Il n’y a pas paru. Ce soir, le Vaudeville et Arnal. Nous avons trois pièces, mais nous n'en laisserons jouer que deux. Ce serait trop long. Avant le dîner, une petite promenade, au Tréport, toujours plein de monde, et toujours un excellent accueil. Avant la promenade, la visite de l’Eglise d’Eu qui est belle, et du caveau où sont les tombeaux des comtes d’Eu, les statues couchées sur le tombeau, les comtes d'un côté, leurs femmes de l'autre, et le caveau assez éclairé, par des bougies suspendues au plafond, pour qu’on vit bien tout, assez peu pour que l’aspect demeurât funèbre. Les Anglais sont très curieux de ces choses là. Ils s'arrêtaient à regarder les statues, à lire les inscriptions. Notre Reine et Mad. la Duchesse d'Orléans n'y ont pas tenu ; elles étaient là comme auprès du cercueil de Mrs. le Duc d'Orléans. Elles sont remontées précipitamment, seules, et la Protestante comme la Catholique sont tombées à genoux et en prières dans l’Eglise devant le premier Autel qu’elles ont rencontré. Nous les avons trouvées là, en remontant. Elles se sont levées, précipitamment aussi et la promenade, a continué.
J’ai eu hier encore une conversation d’une heure et demie avec Aberdeen. Excellente. Sur la Servie, sur l'Orient en Général et la Russie en Orient, sur Tahiti, sur le droit de visite, sur le traité de commerce. Nous reprendrons aujourd’hui l’Espagne pour nous bien résumer. Le droit de visite sera encore notre plus embarrassante affaire. " Il y a deux choses m’a-t-il dit, sur lesquelles notre pays n’est pas traitable, et moi pas aussi libre que je le souhaiterais, l'abolition de la traite et le Propagandisme protestant. Sur tout le reste, ne nous inquiétons, vous et moi, que de faire ce qui sera bon ; je me charge de faire approuver sur ces deux choses là, il y a de l’impossible en Angleterre, et bien des ménagements à garder. " Je lui demandais qu’elle était la force du parti des Saints dans les communes : " They are all Saints on these questions. " Je crois pourtant que nous parviendrons à nous entendre sur quelque chose. Il a aussi revu le Roi hier et ils sont tous deux très contents l’un de l'autre. La marée du matin sera demain à 10 heures. On pourra sortir du port de 10 h.
à midi.
Ce sera donc l'heure du départ, nous ramènerons la Reine à son bord comme nous avons été l’y chercher. Il fait toujours très beau. Je demande des chevaux pour demain soir, 9 heures. Je vous écrirai encore demain matin pour que vous sachiez tout jusqu’au dernier moment. Pas de santé de la Reine à dîner. Les toasts ne sont pas dans nos mœurs. Il faudrait porter aussi la santé du Roi, et celle de notre Reine, et peut-être pour compléter nos gracieusetés, celle du Prince Albert. Cela n'irait pas. Je ne me préoccupe point de ce qui se passe entre la Cité et Espartero. C'est ma nature, et ma volonté de faire peu d’attention aux incidents qui ne changeront pas le fond des choses. Lord Aberdeen, m'en a parlé le premier, pour me dire que ce n’était rien et blâmer positivement Peel d'avoir dit qu’Espartero était régent de jure. Il n’y a plus de régent de jure, m’a-t-il dit, quand il n’y a plus du tout de régent de facto. La régence n’est pas, comme la royauté, un caractère indélébile, un droit qu'on emporte partout avec soi. J’ai accepté son idée qui est juste son blâme de Peel sans le commenter, et son indifférence sur l'adresse de la Cité qui du reste est en effet bien peu de chose après la discussion et l’amendement qu’elle a subi.
Vous auriez ri de nous voir hier tous en revenant de la promenade, entrer dans le verger du Parc, le Roi et la Reine Victoria en tête, et nous arrêter devant des espaliers pour manger des pêches. On ne savait comment les peler. La Reine a mordue dedans, comme un enfant. Le Roi a tiré un couteau de sa poche : " Quand on a été, comme moi, un pauvre diable, on a un couteau dans sa poche. " Après les pêches, sont venues les poires et les noisettes. Les noisettes charmaient la Princesse de Joinville qui n’en avait jamais vu dans son pays. La Reine s'amuse parfaitement de tout cela. Lord Liverpool rit bruyamment. Lord Aberdeen sourit shyement. Et tout le monde est rentré au château de bonne humeur. Adieu. Adieu. J’oublie que j'ai des dépêches à annoter. Adieu pour ce moment.
Midi et demie
Nous venons de donner le grand cordon au Prince Albert, dans son cabinet. Le Roi. lui a fait un petit speech sur l’intimité de leurs familles, et des deux pays. Une fois le grand cordon passé : " Me voilà votre collègue, m'a-t-il dit en me prenant la main ; j’en suis charmé. " Je crois que la Jarretière ne tardera pas beaucoup. Je vous dirai pourquoi je le crois.
Le N° 7 est bien amusant. Pourquoi ne pas être un peu plus spirituel d'abord ? Cela dispenserait d'être si effronté après. Le pauvre Bresson a bon dos. Il n’a jamais voulu rien forcer, car il n’a jamais cru qu'on vînt. Je reçois à l’instant une lettre de lui. M. de Bunsen venait d’écrire à Berlin le voyage de la Reine comme certain. Bresson est ravi : " Il faut, me dit-il, avoir, comme moi, habité, respiré pendant longues années au milieu de tant d'étroites préventions de passions mesquines, et cependant ardentes, pour bien apprécier le service que vous avez rendu, et pour savoir combien vous déjouez de calculs, combien de triomphes vous changez en mécomptes. "
C'est le premier écho qui me revient. Je dirai aujourd’hui un mot de Bulwer. Soyez tranquille sur la mer. Nous ne ferons pas la moindre imprudence. Je me prévaudrais au besoin de la personne du Roi dont je réponds. Il n’y aura pas lieu. Le temps est très beau, l’air très calme. Le Prince Albert est allé nager ce matin avec nos Princes. Le Prince de Joinville reconduira la Reine jusqu'à Brighton et ne la quittera qu'après lui avoir vu mettre pied sur le sol anglais.
Voici ma plus impérieuse recommandation. Ne soyez pas souffrante. Que je vous trouve bon visage ; pas de jaune sous les yeux et aux coins de la bouche. Si vous saviez comme j'y regarde, et combien de fois en une heure ! Je n’arriverai Vendredi que bien après votre lever ; pas avant midi, si, comme je le présume, je ne pars qu'à 10 heures. Adieu. Adieu. Il faut pourtant vous quitter. Nous partons à deux heures pour une nouvelle et dernière promenade dans la forêt. Adieu. G.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Famille royale (Angleterre), Famille royale (France), Mariages espagnols, Musique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (Internationale), Portrait (Dorothée), Posture politique, Pratique politique, Réception (Guizot), Récit, Religion, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
Copie conforme d'une lettre de Monsieur de Damrémont à sa mère, Madrid, le 13 décembre 1840
Copie conforme de la lettre originale de Monsieur de Damrémont à Madame de Charnailles sa sœur, Madrid, le 19 décembre 1840
Lowestoft, Mardi 22 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Mon instinct me répète que la publication de ce Rapport de la Commission d'enquête ouvrira le tombeau de la République. Je dis la publication bien plus que le débat, dont je n’attends pas grand chose. La République n'en mourra peut-être pas beaucoup plutôt, mais, la voyant, telle qu'elle est, on la tiendra pour morte par impossibilité de vivre. Et elle mourra infailliblement de cette conviction générale. Les commencements de scènes, de démentis d’assertions aggravantes que je vois dans le Times d’hier confirment mon instinct. Je suis frappé aussi qu’on ait renoncé dans l'Assemblée à porter, comme on l’avait annoncé, M. de Lamartine à la Présidence, en envoyant M. Marrant au Ministère de l'Intérieur. En présence du rapport, on a senti que cette apothéose du Père de la République était impossible. J’attends impatiemment mes journaux français. Je serais étonné si cette semaine ne nous ferait pas faire un pas. Vous avez surement lu le spectateur de Londres de Samedi. Evidemment l’Autriche sortira de la Lombardie, et n'en sortira pas pour Charles-Albert. L’événement me donne plus complètement raison, dans la question Italienne que je ne l’avais espéré. J’ai soutenu que les peuples d'Italie, ne devaient faire que des réformes légales, de concert avec leurs gouvernements, que ni les gouvernements ni les peuples ne devaient songer à des remaniements de territoire ; que le Pape ne devait pas se brouiller avec l’Autriche ; que toute tentative, en dehors de ces limites, échouerait. C'est dommage que ce soit souvent un grand obstacle d'avoir eu raison.
Les nouvelles d’Espagne me plaisent. Les Carlistes de plus en plus nuls, et mon ministre des finances. C'est l'union rétablie dans les Moderados et leur concours assuré à Narvaez. Il n’est pas plus question à Madrid de Bulwer et de la rupture des Rapports avec l'Angleterre, que s'il n’y avait point d'Angleterre. Nous verrons comment lord Palmerston emploiera de ce côté ses vacances.
Une heure
Très intéressante lettre. Vous ne savez pas combien j’aime votre langage si naturel, si bref, si topique. Je m'inquiète peu de votre inquiétude sur ma lettre du 16. Je veux bien que vous me montriez, mais il me convient que vous me montriez tel que je suis, pensant librement et parlant comme je pense. Sans compter que, pour plaire beaucoup, il est bon de ne pas plaire toujours, et surtout de ne jamais chercher à plaire. II y a deux choses indispensables pour être pris au sérieux par les Rois, en leur agréant, beaucoup de respect et à peu près autant d'indépendance. Je vous écrirai demain ce que vous désirez. Demain seulement parce qu'il faut que, cette fois aussi, vous envoyez la lettre même. Elle vous arrivera jeudi matin. Je vous renverrai aussi demain la lettre de Paris. Je veux la relire, et je suis écrasé ce matin de correspondance. Plus une visite aux écoles de Lowestoft qu’on me fait faire à 2 heures.
Je crains beaucoup toute démonstration légitimiste. Non seulement elle échouerait ; mais elle gâterait l'avenir en compromettant, contre toute combinaison en ce sens, beaucoup de modérés. Le nom est peut-être dans ceci, ce qu’il y a de plus embarrassant. Il ne faut pas le prononcer. Que la réserve du langage soit en accord avec l'immobilité de l’attitude. N'oubliez jamais que les péchés originels du parti légitimiste sont d'être présomptueux et frivole, gouverné par les femmes et les jeunes gens. L'émigration. Voici les nouvelles que je reçois ce matin: « J'ai vu les Montesquiou qui reviennent d'Allemagne. Ce qu’ils disent est, à tout prendre, satisfaisant quant à la santé et au bonheur domestique. La résidence est très convenable et confortable, au milieu d’une jolie ville. Mais point de jardin. Seulement une terrasse au haut de la maison, où l'on prend le thé dans les belles soirées. Les environs et les promenades charmants. Beaucoup d'affection et de respect témoigné par tout le monde. Une existence paisible retirée et raisonnable. Mais les regrets de France bien vifs. Ils déjeunent à 11 heures, dinent à 4, le thé à 8, la conversation jusqu'à 10 : " Parlons de la France. " Elle se promène beaucoup et écrit beaucoup. Elle a reçu dernièrement beaucoup de visiteurs. La Maréchale de Lobau y est à présent, et les enfants de M. Reynier. Correspondance quotidienne avec Bruxelles." Ce ne sont que des détails sentimentaux. Vous voyez par votre lettre de Paris, que Pierre d’Aremberg se vantait, et qu'on est bien loin d'avoir pris là l'initiative. Je suis bien aise que vous ayez rencontré M. de Beaumont. Sa conversation avec vous est ce que j'aurais attendu. Et votre jugement de lui excellent. Je n'irai point au-devant de lui ; mais s'il vient au devant de moi, j'accepterai sa main. Il est du nombre des hommes envers qui je deviens chaque jour, au dedans plus sévère, au dehors plus tolérant. [...]
Paris, le 4 novembre 1847, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Paris, le 26 juin 1862, Hugues-Iéna Darcy à François Guizot
Paris, Samedi 10 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’y a plus personne ici, et j’ai eu du monde hier tout le jour Dalmatie Mallac, Génie, Piscatory, des insignifiants. Rien de plus que ce que nous savons ; mais un sentiment général qu’il faudra absolument du nouveau l'hiver prochain, et que tout ce qui est est usé. Le banquet de l'Elysée fait encore assez de bruit. Changarnier et les officiers supérieurs étaient partis quand les sous officiers se sont promenés dans le jardin, en criant : " Vive l'Empereur ! Aux Tuileries ! Pas tous, à beaucoup près, dit-on, mais un certain nombre. Et on dit que ces banquets se renouvelleront au retour du Président que tous les sous-officiers de l’armée de Paris y seront successivement invités. Cela déplaît beaucoup aux Généraux. Changarnier pourrait bien interdire, aux sous-officiers d’y aller. Alors le conflit entre les deux. Evidemment la Camarilla du président se remue assez et voudrait se faire un parti dans l’armée. Si son voyage réussit, s'il est bien reçu par les populations, on s’attend à quelque chose. Je ne m'attends à rien. Et au fond, Piscatory, non plus, ne croit pas qu’il se fasse rien, quoiqu’il eût bien envie de croire qu’il se fera quelque chose. On dit qu'au retour de l’assemblée, les diverses réunions, Rivoli, Richelieu, & & se disloqueront que, dans toutes, les sensés et les fous sont las de vivre ensemble et veulent se séparer, que tous les partis sont en état de désorganisation. Je crois cela ; mais je crois que l'explosion et les conséquences de cet état se feront encore attendre longtemps. Un seul fait est certain c’est que pour le moment, les légitimistes sont en perte et les orléanistes en progrès. On fait toutes sortes de raisonnements fantastiques ; voyez l’Espagne pourquoi s’est-elle sauvée ? Parce qu'il n’y avait sur le trône que des femmes et des enfants. Plus les apparences, d’un gouvernement sont faibles, moins il y a de péril ; le peuple veut un gouvernement qu'il ne craigne pas, qu'il ne respecte pas, qui ait besoin de sa protection.
Savez-vous pourquoi vous êtes tombé sans être soutenu ? Parce que vous imposiez trop, parce que vous n'avez point de préjugés populaires. Si le Roi avait suivi, en 1840, la pente populaire, s’il s’était engagé n'importe dans quoi en harmonie avec les traditions de la révolution et de l'Empire, il serait arrivé on ne sait pas quoi, mais autre chose, quelque chose qui eût duré. J’écoute, je souris, j'objecte ; je finis par parler sérieusement, et on ne sait plus que dire. Les esprits sont bien grès de retomber dans les vieilles maladies ; mais les corps sont fatigués et impuissants.
J’ai passé près de deux heures à Bruxelles avec le Prince de Metternich. Grande satisfaction de me voir ; il voulait être plus que poli. Après lui, il a fallu entrer chez Madame de Metternich ; il m'y a conduit. Aussi gracieuse que lui, là, il a fallu m'asseoir. Des compliments et des questions sur mes filles, sur leur mariage ; on cherchait mes faibles pour entrer par là. Quand je m’en suis allé il m'a reconduit jusqu'au milieu de l'escalier. Il m'a même écouté en silence deux ou trois fois. Bonne conversation. Il m’a parlé de l’Autriche et de Thiers. Plein de confiance dans l’avenir de l'Autriche : " Les hommes qui gouvernent sont de braves gens, pleins de courage " sur quoi, il me raconte toutes leurs fautes, et les embarras qui résultent de leurs fautes. Mais tout va bien. Ce qu’il m'a dit de ses conversations avec Thiers m’a intéressé. Il a fini par : " Je ne suis pas Thiériste." Et alors une longue comparaison entre sa situation à lui Metternich, et la mienne, pourquoi, il ne retourne pas en Autriche, pourquoi je fais bien de rester en dehors de tout ; en quoi nous nous ressemblons et en quoi nous différons . Pour qu’il y ait vie, il faut qu’il y ait les conditions de la vie. Ce n'est pas la même chose d'être tout-à-fait vieux, et de ne l'être pas encore tout-à-fait & &. Il m'a amusé, et il s'est amusé. Adieu.
Mon fils vient de m’arriver. On dit qu’il y a ce matin, une séance publique de l'Académie française ; prix Monthyon, l'éloge de Mad. de Staël. J'irai peut-être, pour voir quelques personnes. Adieu, Adieu. J’espère bien avoir une lettre ce matin. Adieu. G.
Pièce trouvée après la Révolution de Février 1848 au Ministère des Affaires étrangères dans le cabinet de Monsieur Génie, Copie d'une lettre de M. de Damrémont à sa sœur, Paris, le 27 avril 1848
Val-Richer, Jeudi 18 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
C'est aussi l’heure où vous vous levez, me dites-vous. Que faites-vous à cette heure-ci, aujourd’hui ? Quand vous vous le rappellerez, au moment où vous recevrez ma lettre, la vôtre ne me le dirait que dans huit jours. On aura beau inventer les chemins de fer, les ballons ; on ne supprimera pas l'absence. Je n'ai guère plus de nouveau à vous envoyer d’ici que vous d'Ems à moi.
J’ai fait hier mes visites à Lisieux, par la pluie. Je suis frappé de ce qu’il y a de tranquillité et de ce qui revient de prospérité matérielle dans le pays. Cette société est aussi habile à se défendre du mal qu’inhabile à conserver le bien. Il est vrai qu'en fait de prospérité comme de sécurité, elle se contente à bon marché. Toutes ces existences sont très petites pour la richesse comme pour l’esprit, et elles se soucient peu de devenir grandes, sous l'un ou sous l'autre rapport. Quand on a gagné assez d’argent pour vivre sans rien faire dans sa petite maison de ville ou de campagne, on se trouve assez riche. Quand on sait faire ses comptes et lire son journal, on se trouve assez spirituel. Jamais l’ambition n'a été si courte et si basse. Les proverbes ont toujours raison : on est punis par où l'on a pêché.
Voici où ce mot puni me mène tout à coup à M. de Lamartine. Bien des gens le trouvent bien puni. Je trouve qu’il ne le sera jamais assez. Vous vous rappelez l’article de Croker dans le Quarterly review sur l’évasion du Roi après Février, et la réponse qu’y a faite M. de Lamartine et dans laquelle il a raconté qu’il avait voulu, comme gouvernement provisoire, faire sortir le Roi en sûreté, qu’il était allé trouver M. de Montalivet, qu’il lui avait demandé où était le Roi, et lui avait offert, sur son honneur, de le faire conduire hors de France par quatre commissaires qu’il lui avait nommés, M. Ferdinand de Lasteyrie, M. Oscar de Lafayette, et deux de ses amis personnels, M. de Champeaux ancien officier dans la garde royale, et M. d'Argaud, attaché aux Affaires étrangères. Croker ne lâche pas prise aisément ; il est allé au fond de tous ces dire ; il a questionné le Roi, et par le Roi, M. de Montalivet. Il publie dans le nouveau n° du Quarterly review une réponse à la réponse de M. de Lamartine, et, il affirme que les quatre commissaires proposés par M. de Lamartine à M. de Montativet étaient, Lasteyrie et Lafayette, oui, mais au lieu des deux derniers nommés dans la réponse, MM. Flocon et Albert, [ouvriers] ! Peut-on concevoir un tel mensonge ? Car entre les deux assertions, je crois à celle de Montalivet. M. de Lamartine s’en tirera par l'absence. Il est à Smyrne. Le Quaterly review ne va pas là.
Voilà un petit désagrément pour Palmerston. C'est encore la Duchesse de Montpensier qui hérite du trône d’Espagne. Si la Reine d'Espagne mourait demain, il aurait de la peine, malgré ses 46 voix de majorité, à faire faire la guerre par son pays pour empêcher l'Infante de succéder. Car elle succéderait en Espagne sans difficulté ; les progressistes seraient les premiers à la reconnaître et Narvaez est toujours là.
9 heures.
Voilà votre lettre. Je n’en ai absolument aucune autre. Quand j’ai celle-là, j’attends les autres patiemment. Comment ne savez-vous pas encore que j’ai été cinq jours sans lettre ? Nous sommes bien loin. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Lundi 7 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici des nouvelles d’Angleterre. On vous les a peut-être données aussi. En tout cas, je vous les donne. Palmerston ne croit pas à l’arrangement de l'affaire Turque. Il dit qu’on ne se découragera pas, qu’on négociera jusqu'à la dernière extrémité ; mais les choses, selon lui, sont si mal emmanchées et votre Empereur a de telles répugnances (qu’est-ce que cela veut dire ?) qu’on n’arrivera probablement pas à la conclusion qu’on demande. Il se prépare pour cette chance ; il trouve sa position bonne ; il a toujours été fidèle à sa politique de liberté Européenne et d'émancipation des peuples ; le cabinet de Paris ne peut douter de sa loyauté. Bref, il est content, et il attend. J’espère qu’il se trompe. S'il ne se trompe pas, vous aurez la France et l'Angleterre unies pour la guerre libérale, au lieu de les avoir une comme de mon temps, pour la paix constitutionnelle. J’ai beau y penser ; je n'y crois pas. Pouvez-vous vérifier si ce qu’on me dit de Palmerston est vrai ?
En tout cas, les coups de canon qui le tirent en ce moment en Valachie amèneront, ou la paix prompte, ou une guerre de trente ans. On m'écrit que le marquis de Viluma quitte Paris pour aller être président du Sénat à Madrid. Si Narvaez ne devient pas bientôt président du Conseil il reviendra comme ambassadeur à Paris. La nomination du frère de M. de Viluma, du général Pezuela comme gouverneur de Cuba n'indique pas que l’Espagne soit près de s'entendre, à ce sujet, avec les Etats-Unis. C'est un militaire espagnol, très brave, très fier et très vif.
Encore une lettre d’Angleterre, de mon ami Hallam. En voici deux phrases, très sensés : - The worst that could now happen would be a decisive advantage in the fields obtained by the Turks. - There is an apparent spirit in this country very much opposed to the temporizing policy of our friend Lord Aberdeen ; but I do not believe, it lies deep, through the press is almost universally in that tone. A good deal of this swing to the refugee and revolutionary party throughout Europe, and I am most anxious for a pacific settlement, in order to defeat their objects.
Midi
Je ne suis plus curieux que des nouvelles de la bataille. Si vous ne passez pas le Danube, je suis tranquille. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 29 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 Heures
Vous rappelez-vous bien le 29 octobre, il y a neuf ans mon arrivée à Paris le 26 et les trois jours qui précédèrent la formation du Cabinet ? Je suis décidé à ne pas croire que ce jour-là, et tout ce que j’ai fait du 29 octobre 1840 au 24 février 1848 m'ait été bon à rien. Mais aujourd’hui il n’y a que Dieu qui sache à qui cela a été et restera bon. Hier quand j’ai fermé ma lettre, je n’avais pas ouvert mes journaux. Excellente nouvelle de Pétersbourg. Vous savez que j'y ai toujours compté. Et je pense comme vous que ce n'est pas fini pour les Turcs. L'Empereur n’a pas besoin de se remuer beaucoup pour avancer beaucoup. Bonne nouvelle aussi d’Espagne. Je tiens à Narvaez comme artiste politique, et pour le bon exemple. Je n’avais d’inquiétude que parce qu’on ne sait jamais où en est et ce que fera la Reine Christine. Elle et Narvaez se détestent et se craignent. Mais la haine et la crainte ne leur enlèvent pas leur bon sens. J’en suis charmé. Tant que ces deux personnages se soutiendront mutuellement, l’Espagne se maintiendra. Je suis assez amusé de la fausse joie qu'aura eue Lord Palmerston. Il n’a depuis longtemps que le plaisir des revers de ses adversaires, pas du tout celui de ses propres succès. Il y a bien à parier que Lord Normanby aura lu votre lettre. N’appartient-il pas plutôt à Lord John qu'à Lord Palmerston ? Malgré cela, s’il vous a lue, il se sera donné probablement le mérite d'en dire quelque chose à son chef direct. Il ne lui aura rien appris, rien sur vos sentiments et rien qui le corrige. Outre M. Moulin, j’ai eu hier un autre ancien député conservateur un brave capitaine, le vaisseau, M. Béchameil qui a été destitué après Février à cause d’une lettre de lui à moi que la Revue rétrospective à publier. Il n'en est pas moins décidé, ni moins dévoué. M. Moulin est tout-à-fait un homme de sens et d’esprit. Je le trouve très inquiet, non seulement, en Général et pour l'avenir, mais prochainement. Persuadé que le Président par détresse d'argent autant que par ambition, cherche à faire et finira par faire le coup d'Etat impérial. Faire, c’est-à-dire tenter. Et cette tentative peut amener quelque grand désordre même un triomphe momentané des rouges. Ceci, je ne vois pas comment, l'assemblée étant là, et le Président ne pouvant pas la chasser, ni se faire Empereur par la grâce des rouges qui eux chasseraient bien l’Assemblée par la violence. Mais peu importe que je voie ou que je ne voie pas comment le désordre peut éclater. Evidemment les hommes les plus sensés et les mieux informés craignent qu’il n'éclate. Ceci me préoccupe. Pour vous d’abord. Il y faut bien regarder. Montebello est très bon pour vous tenir bien au courant. N'hésitez pas, comme renseignement à faire venir aussi mon petit fidèle, et à savoir de lui ce qu’il sait. Il est toujours, bien instruit. Au fond, je ne crois pas à ces crises prochaines. Toute crise qui ne sera pas absolument indispensable, et imposée aux hommes par des nécessités actuelles, sera ajournée. Mais nous sommes tombés à ce point qu’il faut craindre même les maux auxquels on ne croit pas. Je ne suis pas très étonné de la simple carte du Duc de Broglie. Je vous dirai pourquoi. Vous n'avez pas idée de sa disposition d'esprit. On va jusqu'à dire que les affaires d'argent de Morny sont si mauvaises que, pendant son séjour à Londres, son traitement de représentant à été saisi à Paris par des créanciers. Je ne puis pas croire cela.
Midi.
Voilà votre lettre. A demain les réponses. Je n’ai jamais craint la guerre Turque, mais j'ai le cœur bien plus léger depuis que je ne peux plus la craindre. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Samedi 28 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
D’une heure à cinq hier ma maison n'a pas désempli. Orléanistes, quelques légitimistes quelques quasi républicains honteux. Pour moi de la bienveillance, et de la curiosité. En soi, toujours les mêmes dispositions, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Du bon sens, de l’honnêteté, même du courage ; tout cela trop petit et trop court. C'est la taille qui leur manque à tous. Ils ne sont pas au niveau de leurs affaires. Ils n'atteignent pas ou il faudrait atteindre pour faire quelque chose. Grandiront-ils assez et assez vite ? Mes arbres ont très bien poussé. Je ne suis pas aussi sûr des hommes que des arbres. Je suis content de la visite d’Armand Bertin. Le Journal restera dans une bonne ligne ; impartialement en dehors du présent, fidèle avec indépendance au passé. Et fidèle à moi avec amitié si j'étais à Paris pouvant causer deux ou trois fois par semaine, il ne s’y dirait pas un mot qui ne me convint. Spécialement sur les Affaires Etrangères. D’ici, il n’y a pas moyen d'y regarder de si près. Pourtant on marchera toujours du bon côté.
Des lettres de Barante, de Philippe de Ségur, de Glicksbierg. Barrante affectueux et triste, voyant toutes choses avec la sagacité un peu stérile d’un esprit juste et d’un cœur abattu. Un grand pays à moins qu’il ne soit réellement destiné à périr, n'est jamais si dépourvu de forces et de remèdes qu’il en a l’air. Il supporte et attend deux choses qui nous sont bien difficiles à nous passagers éphémères sur la scène, sans en avoir le projet formel, évidemment Barante finira par venir à Paris. " J’ai un bien vif regret, me dit-il, que mon lieu de retraite, soit si loin du vôtre. Sans cela, je serais allé tout de suite vous revoir. Si quelque circonstance de famille ou d'affaire m'appelle à Paris, je serai bientôt après au Val Richer On fait ce qu’on prévoit si clairement. Ségur très amical, croyant que ma maison à Paris n'est plus à ma disposition, et voulant. que, si j’y vais, j'aille occuper la sienne. Il n’y reviendra que tard, en hiver. Glücksbing est toujours à Madrid. Il m’écrit qu’il va publier quelque chose sur la réforme douanière et financière de l'Espagne, et finit par cette phrase : " M. Mon dit qu’il va vous écrire pour vous engager à venir passer quelques mois en Espagne. A part les bouffées de jalousie entre lui et le général Narvaez, dont il adviendra ce que Dieu voudra, tout marche admira blement ici. Les nouvelles d’Andalousie sont excellentes, et vous aurez remarqué l'accueil que le duc et la duchesse de Montpensier ont reçu à Gibraltar. "
En avez-vous vu quelque chose dans les journaux Anglais ? Si nous étions ensemble, je vous lirais les lettres, et elles vous amuseraient. Elles ne méritent pas d'être envoyées si loin. Je vous donne ce qu’il y a de mieux. Voulez-vous, je vous prie, faire mettre à la poste cette lettre pour Lord Aberdeen, en y ajoutant son adresse actuelle ? Je ne sais où le prendre. Onze heures Votre lettre m’arrive. Et Hébert en même temps. Pour la journée seulement. J’aime assez qu'on prenne cette habitude de venir me voir sans s’établir chez moi pour plusieurs jours. Adieu. Adieu. G.