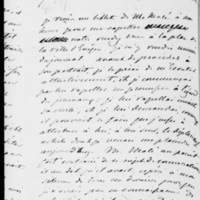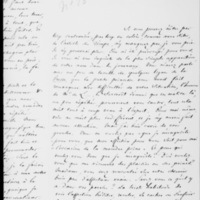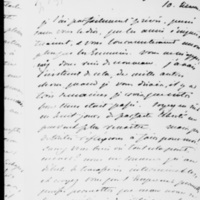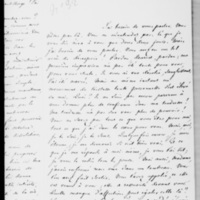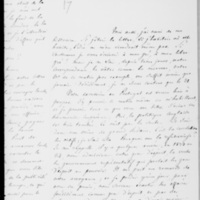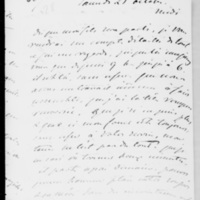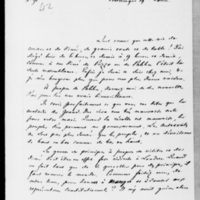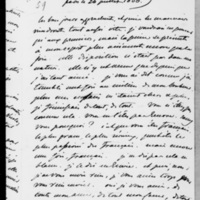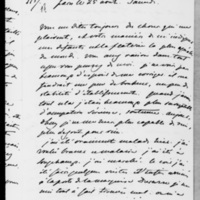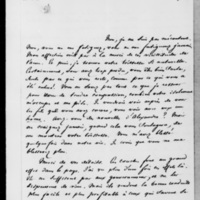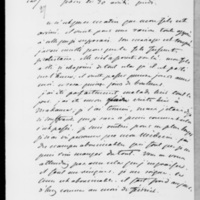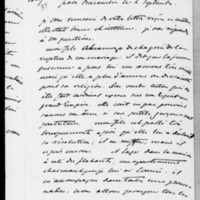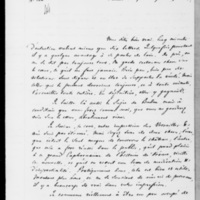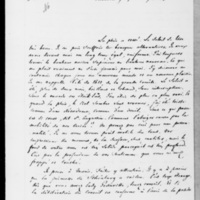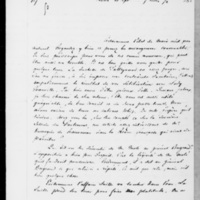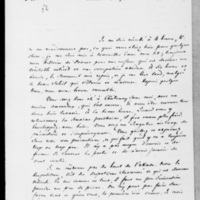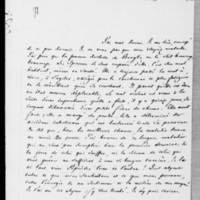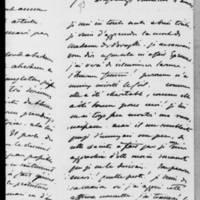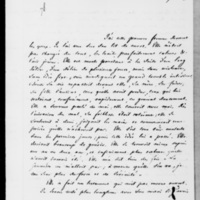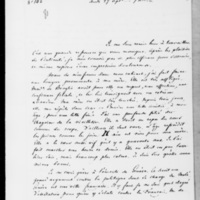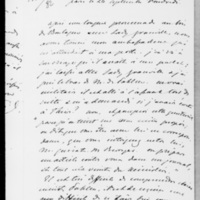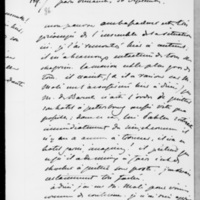Votre recherche dans le corpus : 1605 résultats dans 3296 notices du site.
46. Paris, Vendredi 22 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je reçus un billet de M. Molé à une heure pour me rappeler notre rendez-vous à la place de la ville l’Evêque. Je m’y rendis munie du journal. Avant de procéder à son portrait, je le priai de m’écouter attentivement, et je commençai par lui rappeler ses promesses à l’égard des journaux ; je lui rappelai ensuite sa visite, et je lui demandai, comment il pouvait se faire que j’eusse à attribuer à lui, à lui seul, le déplaisant article dont je venais me plaindre aujourd’hui. M. Molé me parût fort contrarié de ce sujet de conversation. Il me dit qu’il avait espéré à mon silence de tous ces derniers jours que je n’avais pas en connaissance de cet article, qu’il n’en avait pas dormi de 48 heures, qu’il comprenait mes reproches, & qu’il me donnait sa parole d’homme qu’il n’avait rien à se reprocher que d’avoir dit devant Pozzo qu’il m’avait trouvé malade & & qu’il reconnaissait bien à cette indiscrétion, qu’il avait eu parfaitement tort de le dire même à lui, mais qu’il me conjurait de croire qu’il était plus que malheureux de cet abominable article, qu’il lui était défavorable politiquement même, puisqu’il était de nature à vous blesser et de la façon la plus ungentlemanlike qui se puisse, que c’était du plus mauvais goût, de la plus maladroite intuition, enfin il ne tarit pas sur ce sujet. Je lui observai, que ce n’était pas de vous que j’étais venu lui parler ; que j’ignorais ce que vous pourriez penser de cet article, que c’était de moi qu’il s’agissait et qu’au lieu de la protection que j’étais en droit d’attendre de ce qu’il appelle son amitié pour moi, je me plaignais avec raison d’un manque pareil de respect et de convenance. Il protesta qu’il avait de suite enjoint à M. de Montalivet de faire à la presse & au temps, les admonitions. & les menaces nécessaires pour empêcher la répétition d’articles aussi scandaleux. Il me parut être très blessé de la presse surtout (je n’avais pas tenu cette feuille en main. On m’en avait lu seulement un passage.) Il recommença Pozzo, il recommença les insomnies, il me parut sérieusement peiné et fit tout ce qui était en lui pour détruire le mauvais sentiment avec le quel j’étais entrée chez lui. Je fus forcée d’admettre tout ce qu’il me dit, avec mille promesses pour l’avenir, au moins quant à ses efforts pour empêcher que cela se renouvelle. Il m’est impossible. d’entrer par lettres dans plus de détail sur ce sujet. Le Pozzo n’était pas seul, ce que j’ai su depuis, il y avait surtout le jeune homme que nous n’avons pas fort bien traité chez moi au sortir du dîner chez l’ambassadeur de Sardaigne.
Ce qui m’a beaucoup frappé dans cet entretien est la véritable inquiétude qu’il ressent & qu’il montre à votre égard. Je vous réponds que cela est. Je me suis borné à cet égard à des observations très générales. J’ai dit que je comprenais la bonne guerre entre hommes politiques, et que celle-là puisse aller aussi loin que possible, mais que ce genre d’attaque me paraissait tout à fait au dessous de ce qu’on se doit à soi- même et était de la plus mauvaise compagnie. M. Molé renchérit encore là-dessus et revint vingt fois sur ce sujet avec toutes les exclamations convenables. Voilà Monsieur ce que j’ai à vous rapporter sur mon explication de tantôt. Je trouve tout cela une bien mauvaise affaire. & plus j’y pense plus elle me vexe. jugez ce qu’on en dira au loin !
Samedi 23. Je n’ai pas pu continuer hier. Je reprends là où je vous ai laissé. Toute cette explication s’était passée sur un grand divan dans un cabinet vitré donnant sur son jardin. Il avait aussi toute la coquetterie imaginable à préparer son appartement pour me recevoir. Il est bien arrangé. Je passai quelques moments devant son portrait. Plus tard nous nous promenâmes dans le jardin toute cette visite me prit une heure. M. Molé ne me parut pas aussi gai aussi confiant que je l’avais trouvé quelques jours auparavant. Il ne se fit pas très implicitement aux bonnes dispositions que lui témoigne encore M. Thiers. Les deux premiers mois de la session prochaine lui paraissent devoir être très décisifs, & si les doctrinaires entendaient bien leurs intérêts. Ils devraient soutenir le gouvernement !
De la place de la ville de l’Evêque, je me rendis au bois de Boulogne, j’avais besoin de me remettre de cette mauvaise matinée. Je n’y réussis pas, tout ce qui m’agite me porte sur les nerfs & y reste longtemps. Je m’arrêtai chez la petite princesse, je lui parlai de ma matinée, & c’est là-dessus que j’aurais mille détails à vous donner qui ne peuvent pas trouver place dans une lettre. IL faut que je vous dise cependant que le hasard l’avait mis à même d’accepter l’exactitude de chaque chose que M. Molé m’avait dit sur ce sujet.
Ainsi c’est par le Prince Schönburg lundi à dîner chez M. de Pahlen qu’il à appris ce qui avait paru dans le Temps, et il m’a été pétrifié. Le mari l’a conté le soir même à sa femme. Comme un mouvement qui l’avait beaucoup frappé. C’est encore en présence de la petite Princesse que M. Molé avait fait le récit de sa visite chez moi, mais n’appuyant que sur que les vers de Lamartine m’ennuyaient. Pozzo et deux autres hommes étaient présents. Mon Dieu que je vous conte des détails ! J’en ai presque honte.
Je dînai mal, je fus un peu maussade après le dîner. Le soir la petite princesse, les Durazzo, tous les Pahlen & M. de. Médem vinrent chez moi. J’essayai un peu de musique, mais elle ne va pas devant le monde, je me trouble et les idées, les souvenirs ne me viennent pas. Je quittai le piano, je fus toute la soirée un peu fidgetty connaissez vous ce mot ?
J’avais le pressentiment d’un mauvais réveil. Et en effet cette lettre attendue avec tant d’impatience et à laquelle je fais toujours aveuglement un si bon, un si tendre accueil, elle me chagrine bien ! Voulez-vous que je vous le dise, dès la matinée de votre départ j’ai prévu cela. Vous n’aviez pas un air de complète vérité ne m’annonçant le 26 comme le jour de la noce ; et je n’ai pas cessé d’avoir des soupçons depuis le moment où vous m’avez quittée. Ils sont devenus une fort triste certitude. Mais expliquez-moi bien clairement si vos occupations électorales vont remplir l’intervalle entre ceci & la noce ou si elles doivent inquiéter, même sur la noce. Je vous en supplie dite moi quelque chose de fixe, nommez moi une date afin que je sache penser & me réjouir franchement. Ne craignez pas que je vous détourne de vos devoirs par la moindre plainte ; ne craignez pas une mauvaise parole, par une mauvaise pensée.
Ah mon Dieu à qui croire sur la terre si je ne croyais pas en vous. Je serai triste, triste plus constamment triste que vous, car je n’ai rien qui me distraie du seul sentiment du seul intérêt qui occupe mon âme, mais je croirai que la vôtre retourne à moi, à moi toujours dans tous les instants que vous n’êtes pas forcé de consacrer à d’autres soins et je le répète vous êtes heureux bien plus heureux que moi, car vous aviez d’autres soins ! Moi, je n’ai rien ! Vous m’avez dit qu’aussi tôt la dissolution prononcée vous êtes forcé de venir à Paris pour huit jours au moins, afin de voir votre monde, de vous concerter avec lui, votre tournée de province remplace t-elle cela ? Ne serait-elle avant, après ? Enfin je vous en prie soyez clair, bien clair dans ce que vous allez me répondre, moi je je serai bien sage, je vous le promets.
Midi. Les expressions de votre lettre me touchent, je viens de la relire. Oui, je serai tout ce que vous voulez que je sois, comptez là-dessus. Je serai tout bonnement triste, triste, pas autre chose. J’attendrai avec confiance, mais avec impatience. Vous permettez que je sois impatiente, n’est-ce pas ?
La petite princesse est partie ce matin, pour Maintenon avec son fils. C’est une partie d’enfance où elle va passer quelques jours. Ah comme j’acceptais avec transport ces parties là, comme c’étaient mes vraies fêtes ! Mon Dieu, que je suis isolée ! Lady Granville qui devait revenir aujourd’hui se remet à la semaine prochaine. Je n’ai pas de ressources de femmes. Je verrai à passer mon temps comme je pourrai. Quelle longue lettre !
Adieu, que d’adieux nous allons encore nous adresser. Il y en aura tant que je ne les aimerai plus. Ah quel blasphème ! je voulais dire que je serai lasse de les faire voyager toujours. Un peu de repos je vous en prie, du repos dans mon cabinet sur mon canapé vert. Ah mon Dieu ! Adieu.
45.Val-Richer, Samedi 23 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
47. Paris, Dimanche 24 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Quel triste réveil. Votre lettre, vous savez ce qu’elle contenait cette lettre ? Point de noce. Votre mère malade. Vos occupations électorales en province, pas la plus légère espérance d’une course à Paris, et tout cela m’arrive le jour où devait tenir pour moi tant de bonheur !
En même temps, je reçois deux lettres de mon mari dont je vous transmets les passages importants dans la première du 5 Sept. il me dit : "Tu me fais de nouvelles propositions sur un voyage de circumnavigation pour te rencontrer au Havre ! S’il n’existait pas des entraves insurmontables à une telle entreprise, j’y aurais pensé à deux fois d’après les allusions qui ont été faites à ce sujet à mon passage par Carlsbad. Ce sont les conséquences nécessaires d’une fausse position trop prolongée. Il est urgent qu’elle subisse une modification d’un côté ou de l’autre."
Dans la seconde lettre du 10 Septembre " Ton N°356 m’est parvenu hier, le précédent n’est point entré encore. C’est pour cela peut-être que celui-ci ne m’est point intelligible. Tu sembles avoir reçu la lettre par laquelle je te demandai de me faire connaître ta détermination. Je suis dans l’obligation d’insister sur une réponse catégorique, car je dois moi-même rendre compte des déterminations que j’aurai à prendre en conséquence. Je t’exhorte donc à me faire connaître sans délai, si tu as intention de venir me rejoindre on non. Je dois dans un délai donné prendre une résolution quelque pénible que puisse m’être une semblable nécessité."
Que direz-vous Monsieur de tout cela ? Il est évident par la première, que des commérages ont voyagé jusqu’à Carlsbad ; & par la seconde qu’il a pris envers l’Empereur l’engagement de me forcer à tout prix à quitter Paris ? Voilà où j’en suis. Savez-vous ce qui arrivera ? L’Empereur lui permettra de venir sous la condition expresse de m’emmener et lui viendra avec empressement, incognito me surprendre. Car voilà sa jalousie éveillée, & je le connais. Il est terrible. Il est clair qu’il ne croira pas un mot des certificat du médecin. Car il me dit dans une autre partie de sa lettre " il est plaisant de remarquer que les médecins de Granville le renvoient de Paris, & que les tiens t’ordonnent d’y rester, ils sont complaisants, avant tout." Si, si ce que je crois arrive, c’est sur la mi octobre que mon mari serait ici. Qui me donnera force & courage ? Je suis bien abandonnée.
Ma journée hier a été plus triste que de coutume. Votre lettre m’avait accablée. J’ai eu de la distraction cependant, le prince Paul de Wurtemberg pendant un temps, qui m’a fait le récit de tous les embarras existants encore pour le mariage. Mon ambassadeur en suite. Ma promenade d ’habitude au bois de Boulogne, mais tout cela n’y a rien fait ; à dîner il m’a pris d’horribles souvenirs. Je n’étais qu’à eux, à eux comme aux premiers temps de mes malheurs. Tout le reste était à la surface tout, oui vous-même. Le fond de mon cœur était le désespoir, je ne trouvais que cela de réel. Je demande pardon à ces créatures chéries d’avoir
été si longtemps détournées de mon chagrin. Je demandais à Dieu comme le premier jour, de me réunir à eux dans la tombe, dans le ciel, tout de suite dans ce tombeau. Je n’entendais & ne voyais rien, Marie parlait je ne l’écoutais pas et tout à coup des sanglots affreux se sont échappés de
mon coeur. Vous ne savez pas comme je sais pleurer. Vous ne pourriez pas écouter mes sanglots, ils vous feraient trop de mal.
J’ai quitté la table, j’ai pleuré, pleuré sur l’épaule de cette pauvre Marie qui pleurait elle-même sans savoir de quoi. J’ai ouvert ma porte à 9 h 1/2. Je n’ai vu que mon ambassadeur & Pozzo.
Ma nuit a été mauvaise, & mon réveil je vous l’ai dit.
Midi
Qu’est-ce que votre mère vous donne de l’inquiétude, puisque le cas de la dissolution échéant vous pourriez être forcé de la quitter pendant quelques jours ne serait-il pas plus prudent, & plus naturel de la ramener à Paris, d’y revenir tous, de vous y établir. Cette question ne vous est-elle pas venue ? L’été est fini, la campagne n’est plus du bénéfice pour la santé.
Un courrier de Stuttgard a posté au prince de Wurtemberg défense de conclure le mariage à moins qu’il ne soit stipulé que tous les enfants seront protestants. La Reine exige qu’ils soient tous catholiques, le prince se conforme à cette volonté qui est celle de la princesse aussi, & il a écrit au roi de Würtemberg en date du 19 par courrier français qu’il passerait outre si même le Roi n’accordait pas son consentement. Dans ce dernier cas cependant il est évident que le ministre de Würtemberg n’assisterait pas à la noce & que cela ferait un petit scandale. Le prince Paul jouit de tout cela. Il abhore son frère. Hier il a dîné à St Cloud
pour la première fois depuis 7 ans.
Je cherche à me distraire en vous contant ce qui ne m’intéresse pas le moins du monde. Adieu Monsieur, dès que je suis triste, je suis malade, j’espère ne pas le dernier trop sérieusement. Je voudrais me distraire, je ne sais comment m’y prendre.
Dites-moi bien exactement des nouvelles de votre mère, & dites-moi surtout, si vous n’auriez pas plus confiance dans le médecin de Paris & les soins qu’elle trouverait ici.
Adieu. Adieu toujours adieu.
48. Paris, Lundi 25 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je l’ai parfaitement prévu, pensé sans vous le dire, que les amis s’inquiéteraient, & vous tourmenteraient encore plus que les ennemis. Vous ne m’apprenez, donc rien de nouveau. J’avais l’instinct de cela de mille autres choses quand je vous disais, il y a trois semaines je crois que notre bon temps était passé. Soyez en sûr ces huit jours de parfaite liberté ne peuvent plus renaître. Mais que de tristes réflexions à faire pour moi ! Savez-vous bien où tout cela peut mener ? Nous ne sommes qu’au début de tracasseries interminables, et croyez-vous que l’Empereur permette, puisse permettre que mon nom se trouve mêlé à des intrigues françaises puis-je m’y exposer moi-même quel air cela a-t-il ?
Dans mon pays Monsieur je suis une très grande dame, la première dame par mon rang, par ma place au Palais et plus encore, parce que je suis la seule dame de l’Empire qui soit comptée comme vivant dans la familiarité de l’Emp. & de l’Impératrice. J’appartiens à la famille voilà ma position sociale à Pétersbourg, et voilà pourquoi la colère de l’Empereur est si grande de voir le pays de révolution honoré de ma présence. Monsieur ne riez pas quoique j’en ai grande envie, c’est du grand sérieux. Avec des idées pareilles imaginez ce qu’il va dire quand lui arriveront les commérages, les petits journaux, les grands peut-être, que sais-je, des tracasseries politiques, et vous Monsieur emmènerez-vous un auditoire pour voir, entendre, ce qui se fait, ce qui se dit dans mon cabinet vert ? Persuaderez-vous des amis méfiants, des ennemies acharnés ? Vous me faites sortir Monsieur d’une position qui était devenue bonne qui serait devenue meilleure. Je suis toujours restée au courant des affaires de l’Europe.
Je n’ai jamais connu les intrigues de partis en France que pour en rire. Je n’ai pas pris plus d’intérêt à un homme politique qu’à un autre. Voilà ce qui était bien, ce qui faisait pour moi, de ce qui se passe ici, un spectacle animé curieux mais rien qu’un spectacle dont je jouissais avec ma petite société en pleine innocence, & pleine insouciance. Déjà cette position commence à s’altérer, je le vois à la mine de la petite diplomatie de petite espèces. Elle est encore un peu ahurie, et je ne manque aucune occasion de la dérouter. Je poursuivais dans cette intention mais cela me réussira-t-il ? Je vous ai montré pour mon compte le très mauvais côté de ma position actuelle. J’ai été chercher le pire parce qu’en fait de mal, j’aime à échapper aux surprises, je veux vous dire cependant que je ne m’agite pas, je ne m’inquiète pas plus qu’il en faut. Je compte un peu sur mon savoir-faire, infiniment sur mon innocence. Nous verrons comment cela pourra aller.
Mais arrivons enfin à ce qui nous importe à nous. Quand vous reverrai- je? Je vous ai écrit une triste lettre hier, n’était-elle pas même un peu brutale Je me sais jamais ce que j’ai écrit, mais j’ai toujours souvenance de l’impression sous laquelle j’ai écrit. Cette impression était bien mauvaise. Elle n’est guère meilleure aujourd’hui. J’ai un chagrin profond. Vous ne sauriez croire tout ce que j’essaye pour me distraire. Ne vous fâchez pas je cherche à me distraire de vous car lorsque je me livre à vous dans ma pensée je me sens toujours prête à fondre en larmes. Je me puis pas vivre comme cela, je ne puis pas me bien porter, vous voulez que je me porte bien. Mais que faire, qu’imaginer ?
Je lis un peu. Je me promène plus longtemps que de coutume. Le soir je quitte ma place, je fais de la musique je dis des bêtises. Enfin je ne me ressemble pas. Hier au soir si vous étiez entré vous ne vous seriez pas reconnu chez moi. Marie occupant mon coin, ce coin encombré de gravures, et garni, par M. Caraffa, dont les yeux noirs trouvent, les yeux bleus de Marie fort beaux. M. Durazzo M. Henage je ne sais quel jeune anglais encore. Moi au piano avec toute la Sardaigne qui chantait on me rappelait des morceaux de Bellini, Adair quelques autres je ne sais plus qui. Le piano est devant une glace. J’y voyais la porte, & je me suis dit vingt fois, cent fois " S’il entrait ! " Et je voyais dans la glace que mes yeux prenaient une autre expression.
En vérité Monsieur je ne conçois pas comment je pourrai aller longtemps comme cela et je frissonne en vous disant cela. Madame de Castellane est venue chez moi hier matin, et en m’attendant nullement à l’objet de cette visite ; elle m’a fort adroitement amenée à ne pas pouvoir lui refuser d’aller dîner chez elle un jour. Cela ne me plait pas cependant. J’ai choisi jeudi. Pendant qu’elle était là je reçu un billet de M. Molé. Un billet de phrases galantes, qui ne demandait pas de réponse. Tout cela veut-il couvrir les pêchés passés, ou servir de masque à de nouveaux ? Ah, j’ai le Temps sur le cœur.
2 heures. Je viens d’écrire une bonne et forte lettre à M. de Lieven. Je crois que vous en sériez très content. Je ne comprends pas ce qu’il pourra y répondre. Mon fils qui est auprès de lui me mande qu’il est comme fou sur le chapitre de mon séjour ici, et qu’il n’y a pas moyen de placer un mot en ma faveur. C’est une vraie démence. Que de tracas de tous les côtés, que des images qui s’amoncellent ! Et les compensations en bonheur que j’ai trouvées, que le ciel a mis sur ma route quand reluira-t-il pour moi ?
M. de Broglie va revenir pour les couches de sa fille. Cela ne peut-il pas faire un petit prétexte ! Mais par dessus tout la santé de votre mère ? L’air n’est-il pas plus froid en Normandie ? Les cheminées ferment ici elle serait mieux. Pourquoi ne pas établir d’avance qu’il faut rentrer plutôt en ville. Vous n’avez pas d’habitudes sur ce chapitre, car vous n’êtes établi chez vous à la campagne que depuis cette année. Et mon dieu que me sert de vous fournir toutes ces raisons, si elles ne vous viennent pas à l’esprit, si elles ne vous viennent pas au cœur (Oh la mauvaise parole).
Je ne pense pas ce que je vous dis, mais permettez-moi d’être triste, extrêmement triste, & de le rester tant que vous ne m’aurez pas fourni une date. Le 25 aujourd’hui m’a fait mal. J’y avais tant compté. Ce salon ce cabinet que je regardais avec tant de complaisance en pensant au 25, auxquels je trouvais un air si gai, si charmant, il me font un effet désagréable aujour’’hui en y entrant j’avais envie de fermer les yeux. Demain je dîne chez Pozzo, j’avais dit d’avance que je ne serais pas chez moi le soir. Je pensais que le 26 vous en revenant de la noce & moi du dîner nous passerions notre soirée dans mon cabinet ; que vous prendriez du thé à la petite table. Je pensais à de si jolies pensées. Cela fait mal aujourd’hui. Adieu Monsieur, adieu, comme toujours plus que jamais adieu.
47. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai besoin de vous parler. Vous n’êtes pas là. Vous ne m’entendez pas. Ce que je vous dis n’ira à vous que dans deux jours. Mais j’ai besoin de vous parler. Vous avez eu un tel accès de désespoir ! Pardon dearest, pardon ; ma première impression n’a pas été toute pour vous, pour vous seule. Je vous ai vue désolée, sanglotant. J’ai été navré. Mais au même instant un mouvement de tristesse toute personnelle s’est élevé en moi. Quoi ? Je ne suis pas encore parvenu à vous donner plus de confiance dans ma tendresse ! Ma tendresse n’a pas sur vous plus de pouvoir ! Vous ne savez pas tout ce que vous êtes pour moi, tout ce que j’ai dans le cœur pour vous. Mais moi je le sais ; je le sens. Quelque fois encore, je m’en étonne ; je me demande si c’est bien vrai. Et ce que je me réponds à moi-même, je vous l’ai dit ; je vous le redis tous les jours. Moi aussi, Madame, j’avais enfermé mon âme dans un tombeau. Vous l’en avez fait sortir. Vous l’avez appelée, et elle est venue à vous ; elle a ressuscité devant vous. Quelle marque d’affection peut égaler celle-là ? Savez-vous quel bonheur j’avais possédé, j’avais perdu ? Savez-vous que si l’on m’eût dit : - Il y a sur la terre une créature, qui peut vous rendre une heure de ce bonheur - j’aurais souri, avec le plus incrédule dédain ? Et que, si l’on m’eût dit aussi : - cherchez dans le monde entier une épingle perdue, si vous la trouvez, vous retrouverez une heure de votre bonheur je serais parti, à l’instant même ; j’aurais cherché toute ma vie pour courir après cette imperceptible chance ? Voilà où j’en étais Madame, avant le 15 Juin. Voilà quel chemin j’ai eu à faire pour arriver à vous, pour vous dire ce que je vous dis aujourd’hui. Est-ce assez pour que j’aie sur vous la puissance d’écarter le désespoir, d’arrêter les sanglots ? Est-ce assez pour que vous ayez foi, en moi ? Et vous croyez que je ne supporterais pas vos sanglots !
Je supporterais tout, tout, Madame pour combattre, pour adoucir un moment votre peine. J’ai bien supporté de voir mourir, mourir lentement les créatures que j’aimais le mieux au monde ; je n’ai pas cessé un instant de les regarder, de leur parler pour que le sentiment de ma tendresse se mêlât à leur angoisse, à leur dernier souffle et qu’elles l’emportassent en me quittant. Et ce qui m’a donné, ce qui je crois me donnerait encore ce courage, c’est que j’ai, de la puissance d’une affection vraie et des souveraines douceurs qui y sont attachées, une si haute idée qu’il me semble que le plus grand bien qu’on puisse faire à une créature désolée à une créature qui souffre, c’est de lui répéter sans cesse. Je l’aime ! Je l’aime ! Pour moi, je ne connais point de douleurs que ces mots d’une bouche chérie n’aient la vertu de calmer.
Mardi 7 h. 1/2 Je ne comprends guère comment, dès le 5 sept., aucun commérage aurait pu parvenir à Carlsbad. Il faudrait qu’on sy fût pris de bien bonne heure. Du reste, je crois à beaucoup de malice et de trahison possible. Les passages que vous me transcrivez me tourmentent beaucoup. Il faut attendre l’effet du comte Orloff. C’est sur cela que vous comptez, que nous comptons une chose me déplaît extrêmement dans tout ceci, c’est de ne pouvoir me faire une idée du pays,des mœurs, de l’état social, des caractères qui le rendent possible. Je me rappelle l’indignation où nous étions de ce que l’Empereur Napoléon ne voulait pas souffrir que Mad. de Stael habitât Paris. Et pourtant quelle différence ! Il y avait pour lui un motif, un motif, sérieux.
La conversation, le salon de Madame de Stael auraient été pour lui un véritable embarras. Mais ici, quel intérêt peut-on avoir à vous faire sortir de France ? Quel inconvénient entraîne votre séjour ? Une pure fantaisie. Cela déplaît. Vous ne faites pas tout ce qui plait. Quel misérable et terrible enfantillage ! J’ai bien envie de crier : vive la Charte !
Je reviens à M. de Lieven. Que lui répondez-vous ? Vous avez, avec lui, comme avec l’Empereur, comme avec tout votre monde, une situation faite, déterminée. Vous vous y êtes bien positivement établie et dans vos entretiens de Londres avec le comte Orloff et dans les lettres à lui et à M. de Lieven que vous m’avez montrées. Vous devez, ce me semble vous y maintenir tout simplement. Les hésitations, les agitations, même purement apparentes de langage seulement rendent tout beaucoup plus difficile. Une résolution simple. claire, clairement exprimée et tranquillement maintenue, coupe court à beaucoup d’embarras, non seulement au fond, mais dans la forme. Car je ne mets pas le fond en doute ; c’est de la forme et des embarras extérieurs qu’il s’agit. C’est à cela qu’il faut pourvoir. Nous en causerons bien complètement le 6 octobre. J’attends de jour en jour l’ordonnance de dissolution.
Ma mère est beaucoup mieux. A moins de nouvel accident, je ne puis penser à lui proposer de revenir plutôt à Paris. Elle se trouve bien ici. Ma mère est à l’age où l’on a un égal besoin de distraction et de repos. La campagne lui donne l’un et l’autre. Il y a une foule de petits intérêts, de petits soins qui l’amusent; et l’égalité de la vie, le silence de l’atmosphère, la paix de tous les aspects qui l’environnent lui assurent cette espèce de quiétude morale qui dépend, pour les vieillards des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés. Si l’indisposition de ma mère reparaissait un peu sérieusement je n’hésiterais cependant pas à la ramener tout de suite à Paris. Mais comme elle en serait, fort contrariée, il y faut une vraie nécessité.
11 heures Voilà le N° 48. Qu’il est triste et si bon, si doux ! Je me console un peu en pensant que vous serez, que vous êtes déjà, un peu consolée. Vous avez une date. Nous avons une date. Il y a encore dans ce n°48, une bien mauvaise, une bien coupable parole. Je n’y reviens pas aujourd’hui. Mais j’y reviendrai. Dearest, ne me mettez rien sur le cœur. Il y a tant de choses dedans ! et toutes pour vous ! Adieu. Adieu. Adieu me plaît, mais ne me suffit pas. G.
49. Paris, Mardi 26 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon Dieu que vous avez raison lorsque vous me dites " Vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies." Que vous avez raison encore quand vous attribuez bien ma méfiance à cette triste habitude de n’avoir jamais trouvé de vrai dévouement. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup de m’expliquer si naturellement cette injustice dans mon caractère. Ce défaut n’était pas dans mon cœur, il y est venu par l’expérience mais Monsieur, cette découverte c’est vous qui me la faites faire ce matin par votre lettre. Je voudrais bien vous dire, vous prouver tout ce que je vous en porte de reconnaissance. Eh bien, je vous entends d’ici vous ne voulez une preuve une seule. Vous l’aurez. Je veux croire croire, tout ce qui me vient de vous, croire en vous, ne croire qu’en vous. Ah si vous saviez comme ces élans de mon âme sont sincères, comme cette promesse vient du fond de mon cœur vous m’aimeriez dans ce moment si vous étiez auprès de moi.
Je suis triste de penser que mes deux dernières lettres vous auront donné de l’humeur, et j’ouvrirai la vôtre demain avec un peu de crainte. J’ai peur de vous Monsieur, oui j’ai peur, quand je sens que j’ai pu vous déplaire, que je vous ai montré de l’impatience, de l’injustice. Pardonnez-moi, pardonnez moi, je vous en prie. Regardez au fond de tout cela, pardonnez-moi la forme. Vous verrez comme bientôt vous n’aurez plus rien à me pardonner & vous serez joyeux de votre ouvrage. Je relis votre lettre & j’y trouve bien quelque chose à redire. En parlant des soucis qui pèsent sur les hommes, de leurs devoirs de tous genres, vous ajoutez : " Si leur situation était un peu abaissée, leur considération tant soit peu diminuée, ils perdraient un peu, beaucoup peut être dans la pensée, dans l’imagination, & quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus." De qui parlez-vous là Monsieur, il n’est pas possible que vous ayez pensé à moi en écrivant cela. J’aime votre gloire, parce que vous l’aimez, j’aime tout ce que vous aimez, mais pour moi pour ma satisfaction ? Ah c’est votre cœur seul qu’il me faut. Vous, un cottage. Vous, toujours, sans cesse, sans autre intérêt sans autre distraction pour vous, comme pour moi. Voilà Monsieur comme aime une femme. Mais vous n’êtes pas femme, vous ne comprenez pas. Je vous demande seulement de ne pas mépriser ce que vous ne comprenez pas.Dans ce moment Monsieur je me sens plus haut que vous.
Me voila donc attendant celle dissolution avec une impatience ! Je crains d’y montrer trop d’intérêt. Hier soir j’ai demandé quand elle aurait lieu. J’ai essayé de donner à mon accent toute l’indifférence possible, je crains que cela ne m’ait pas beaucoup réussi. M. Molé était chez moi, il m’a dit : " ni tout de suite, ni très tard. Un juste milieu." cela ne m’a pas beaucoup avancé. J’ai été un moment seule avec lui, il est venu de bonne heure. Il est plein de recherches, de manières gracieuses. Il va à Compiègne demain. Il veut que je remette à lundi le dîner chez Mad. de Castellane afin qu’il puisse en être. Tout cela ne me plaît pas trop, & il m’est difficile de m’en tirer. L’article du Journal des Débats hier lui a paru être écrit tout à fait dans votre intérêt.
M. de Pahlen, Pozzo, M. de Boigne, Mad. Durazzo et le prince Schenberg passèrent la soirée chez moi. Je la finis tête-à-tête avec Pahlen, c’est toujours de mon mari que nous parlons ensemble, & quoique ce soit triste nous avons fini par rire. J’ai eu une lettre de M. Thiers ce matin de Cauterets encore. Il s’ennuie. Le 1er octobre il le quitte avec sa famille. Ils iront passer quelques jours chez M. de Cases ou chez M. de Talleyrand, et puis il va établir sa famille à Lille & lui-même veut aller en Hollande. Il passera par Paris peut-être, il n’en est pas sûr mais s’il y passe je le verrai.
On m’écrit de Valençay que la visite de M. Salvandy a eu pour objet de faire comprendre que M. de Valençay ne pouvait pas être fait pair à la prochaine nomination. Cela a donné beaucoup d’humeur. Je veux tout de suite avoir expédié toutes mes petites nouvelles. M. de Hugel est fou. Je m’en étais aperçu un peu ; vous ne sauriez croire l’instinct & que j’ai pour cela, & hier au soir M. Molé m’a dit avant que je lui en parlasse qu’il le croyait dérangé. Il vient chez lui à huit heures du matin tous les jours, les larmes aux yeux, lui découvrir une nouvelle conspiration.
Je reviens à vous. Il est dix heures & demi, vous recevez ma lettre ; encore une mauvaise lettre, je suis en grande colère contre moi-même et vous êtes si doux pour moi, si doux, si bon ! Mais, Monsieur l’absence ne vous vaut rien. Vous faites tant de mauvaises découvertes sur mon compte ! Si cela dure encore vous finirez par trouver que vous avez fait un bien mauvais marché, venez prendre tranquille possession de votre bien, & vous penserez autrement. Je suis bien aise des bonnes nouvelles de votre mère & de vos enfants ; mais vraiment établissez les ici, vous serez moins inquiet pour votre mère ; est- ce que vous ne trouvez donc pas cela vous même.
Ce n’est plus de moi que je parle. Je dîne aujourd’hui chez Pozzo. J’irai embrasser Lady Granville avant de m’y rendre. Ils arrivent ce matin, c’est un grand plaisir pour moi. 1 heure M. l’officier de la légion d’honneur est venu m’interrompre ; après lui mon énorme toilette, maintenant je vais faire ma première promenade. Ah ! si je pouvais aller vers vous au lieu de cette lettre ! Si tout à coup je me trouvais dans ce cabinet que vous fermez à clé ! Monsieur, je vais dire mille bêtises. Faites-moi taire. Vous me promettez de me nommer un jour dans la lettre que je reverrai demain ou après-demain. Mais sur cela vous seront arrivées mes mauvaises lettres, vous vous serez fâché, vous n’aurez plus en envie de me donner le moindre plaisir. Monsieur je crois que je me trompe encore, vous aurez eu pitié de moi, vous m’aurez plainte, mais vous ne m’aurez pas punie. Demain à 10 h 1/2, je me dirai que vous n’êtes plus fâché, que vous m’aimez encore, toujours, oui toujours, toujours.
Ah ! Que d’adieux, je vous adresse en répétant un mot toujours. C’est celui-ci qui est le bon aujourd’hui toujours.
49. Val-Richer, Jeudi 28 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis rentré tard hier. J’étais fatigué. Je me suis couché. Aujourd’hui, je me lève de bonne heure avant le soleil. Le 6 octobre, je ferai le contraire. J’aurai couru toute la nuit. Je me coucherai en arrivant à Paris au moment où le soleil se lèvera. Peu m’importe qu’il y ait un soleil au ciel ce jour-là. Je sais où trouver le mien. Je n’y veux pas trop penser. C’est encore si loin. De demain, vendredi, en huit jours. Y aura-t-il ce jour-là, ou le lendemain un dîner chez Pozzo, ou je ne sais quoi qui vous autorise, à fermer votre porte le soir ? Le lendemain vaudrait mieux peut-être. La dissolution sera au Moniteur le 4. Les élections commenceront le 4 novembre. Je crois mon renseignement positif.
Que de lettres j’écrirai d’ici-là ! On y tient beaucoup. Déjà, il m’arrive des plaintes de ce que je n’écris pas assez. On manque de conseils, d’informations. On veut pouvoir lire à ses amis des passages de mes lettres. J’admire infiniment le proverbe italien : lutto’l mondo e come la nostra famiglia. Il faut vos lettres à Lady Granville pour s’amuser et amuser son mari. Il faut les miennes à mes amis politiques... aussi pour s’amuser eux et leurs amis ; car c’est bien plus de l’amusement, un peu de mouvement moral qu’ils y cherchent, qu’une utilité immédiate et positive. Je leur donnerai satisfaction. Je vais écrire, écrire écrire.
Comment ? Ce pauvre M. de Hügel est fou ? Cela ne m’étonne pas. Il avait depuis quelque temps quelque chose de mystérieux et d’excessivement subtil qui m’étonnait quelques fois. Je l’attribuais à la nature de son esprit. Les Allemands ont de cela. Ils arrivent à la finesse par la subtilité et à la discrétion politique par le mystère. Qui M. de Metternich, enverra-t-il ici à sa place, en l’absence de l’Ambassadeur ? Car je ne suppose pas que les chargés d’affaires aient le privilège des Rois. Ils ne peuvent pas être fous.
Je suis charmé que les Granville soient revenus. C’est une intimité que je vous aime. Quand ils ne seront plus si effarouchés de mes rivalités politiques, j’essaierai d’y entrer un peu.
Que vous revient-il de Londres ? Je ne suppose pas qu’il se passe rien de significatif à la petite session de Novembre. Elle n’aura, je crois, que la liste civile pour objet. Les radicaux me paraissent bien modestes, bien décidés, à accepter qu’on ne leur donne rien pour éviter l’alliance des Whigs et des conservateurs. Mais la nullité et l’inaction ne sont pas, quoiqu’on en dise des éléments de durée.
De quoi je vous parle là ? Il semble que moi aussi, je veux épuiser mes petites nouvelles. J’accueille très bien les vôtres ; mais laissez-les toutes pour me dire, pour me redire toujours comment aime une femme. Le 6 octobre, dearest, dans notre cabinet, je vous dirai, et je suis sûr que vous me croirez, je vous dirai à quel point je vous comprends ? Je vous dirai quelle vie eût été pour moi aussi douce, aussi pleine que pour vous. Je ne veux pas l’écrire. Il y a des choses que je n’aime pas à écrire. Elles sont intimes à ce point qu’il me déplaît de les voir exposées au grand air, exposées à tomber je ne sais sous qu’ils yeux, à provoquer je ne sais quel sourire. Même très sûr que cela n’arrivera pas, l’idée seule de la possibilité me choque et m’arrête. Mais quand je vous aurai dit à quel point je vous comprends vous conviendrez avec moi que femme ou homme, quand on aime, on veut que ce qu’on aime se déploie dans toute sa beauté, s’élève aussi haut qu’il se peut élever. L’amour se passe de tout et prétend à tout. Il se suffit parfaitement à lui-même, et rien ne suffit à son ambition. Je suis sûr que vous pensez, que vous sentez comme moi. Mais encore une fois, je ne veux pas écrire tout ce que j’ai dans le cœur.
J’attends votre lettre de ce matin avec une douce sécurité. Elle répondra à celle où je vous donnais une date. Mais gardez-vous bien de jamais me taire aucune de vos impatiences, de vos injustices. J’ai droit à tout, et je veux tout avoir le worse comme le better. En attendant, je vais écrire à droite & à gauche. Je vous quitte pour je ne sais qui & je ne sais combien.
11 heures
Le courrier m’arrive au milieu de quatre visiteurs. Je viens pourtant de parcourir le N° 50. Que de doutes et tristes choses ! Oui, dearest, comptez sur toujours. Adieu et toujours. Il faudra bien que nous venions à bout de cette situation. Soyez tranquille. Je veillerai sur moi jusqu’au 6. Adieu, adieu. G.
59. Val-Richer, Dimanche 15 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi, j’ai envie de me distraire. Si j’étais la lettre, si j’habitais où elle habite, l’idée ne m’en viendrait même pas. Si seulement je vous écrivais à mon gré, à mon libre gré ! Mais je ne sais, depuis trois jours, notre correspondance, la vôtre comme la mienne votre N° de ce matin par exemple me suffit moins que jamais. Décidément, je ne serai content que le 31. Votre excursion en Portugal est venue bien à propos. J’y pensais ce matin même en m’habillant, et je pensais tout ce que vous me dites. J’aime ces harmonies imprévues. Oui, la politique Anglaise est bien tombée. Ce n’est pas la seule. Je suis dans une veine de grand dédain. C’est la consolation des oisifs ; je sais cela. Pourquoi me la refuserais-je ?
Je me rappelle il y a quelques années, en 1833 en 34 nous admirions, entre gens d’esprit, la vertu du gouvernement représentatif qui portait les gens d’esprit au pouvoir. Il me prit un remords de notre arrogance ; et je prédis qu’un jour, pour nous en punir, nous serions écartés, des Affaires précisément comme gens d’esprit, et par des adversaires dont le titre serait d’avoir moins d’esprit que nous, moins de talent que nous, moins de courage que nous, d’être des médiocrités enfin, comme dit Lord Aberdeen, la médiocrité a des droits immenses, surtout quand l’esprit démocratique prévaut. Droite précaire pourtant car l’esprit démocratique a beau être petit les affaires des peuples sont grandes, et ne se laissent pas longtemps rabaisser autant que le voudraient ceux à qui toute grandeur déplaît. Et il faut bien que tôt ou tard la taille des hommes se rajuste à la taille des affaires. Au fond Madame, je n’ai pas perdu mon arrogance. Je suis toujours sûr que le pouvoir appartient aux gens d’esprit, aux plus gens d’esprit, et qu’il ne peut manquer de leur revenir. Mais nous passons si vite, gens d’esprit ou non ! Nous avons si peu le temps d’attendre !
Je trouve ceci dans une lettre que je recevais en Octobre 1821, il y a seize ans « J’ai toujours vu tourner à ton profit, les retards même que tu n’aurais pu prévenir. Je te crois du bonheur. Cette croyance serait un enfantillage si elle ne se fondait sur ce que je le crois destiné à quelque chose en ce monde. Je sais bien cependant combien sont vains nos jugements sur les voies de la Providence. Je sais que dans sa terrible magnificence, elle peut créer et faire croître un homme supérieur pour le service d’un dessein, d’une idée destinée après d’infinies transformations à porter son fruit dans quelques milliers d’années. Je sais qu’elle peut fonder l’accomplissement de ses moindres vues sur la destruction de ses plus beaux ouvrages. Et c’est là ce qui m’épouvante sur notre petitesse, bien plus que l’immensité des cieux, le nombre et la grandeur des étoiles. Et pourtant, mon ami, j’ai sur toi, pour toi, de la confiance, beaucoup de confiance. »
Combien il faut que j’en aie en vous, moi, pour vous montrer ainsi toutes choses, tout ce qu’il y a pour moi de plus intime, non seulement dans le présent, mais dans le passé ! Mais, puisque je l’ai cette confiance, pourquoi ne vous la montrerais-je pas ? Pourquoi ne verriez-vous pas vous ce que m’écrivait sur moi-même, il y a seize ans, une âme bien noble et bien tendre ? Eh bien, cette sécurité qu’elle avait sur mon avenir, et qui la rendait patiente, même dans les plus mauvais temps, j’en ai moi-même un peu pour mon propre compte. Je me crois appelé à quelque chose qui en vaut la peine, appelé à relever quelque peu la politique de mon pays à faire rentrer dans des voies un peu régulières, et hautes les esprits et les affaires. Je ne me crois pas au bout de ce que je puis faire en ce sens. Et voulez-vous que je vous dise ? Vous avez beaucoup ajouté à ma tranquillité d’esprit. Vous m’avez donné de quoi attendre. Avant le 15 juin, ma patience était de la philosophie, de la vertu. Aujourd’hui je n’ai nul besoin de vertu, de philosophie. J’ai le fond de la vie. La broderie viendra quand elle voudra. Je la désire. J’y compte. Mais je l’attends et je l’attendrai sans le moindre effort, avec bien moins d’effort qu’il ne m’en faut pour attendre le 31 octobre. Me voilà bien distrait, n’est-ce pas ?
10 heures
Pourquoi enverriez-vous à M. de Lieven votre lettre au comte Orloff ? Pourquoi celle-là et pas les autres ? Il faut, ce me semble les lui envoyer toutes ou aucune. Et je ne vois point de bonne raison de les lui envoyer toutes. Après son procédé vous avez bien le droit de faire vous-même vos affaires sans lui en rendre compte. Si vous deviez gagner quelque chose à lui tout montrer à la bonne heure ; mais vous n’y gagneriez rien. Point de mystère et point de confiance, lui annoncer toutes vos démarches, et ne point lui en raconter les détails, qu’il sache ce que vous faites et demeure pourtant dans l’incertitude sur ce que vous dites qu’il y ait pour lui à votre égard, de la publicité et de l’inconnu, voilà, si je ne me trompe, ce qui vous convient, comme attitude, et aussi pour le succès.
J’ai bien recommandé, et je recommande de nouveau à M. Génie de vous porter lui-même mes lettres ou de vous les faire porter par quelqu’un de très sûr, qui vous les remette tout simplement ou les remporte s’il ne peut vous les remettre. Je n’ose cependant vous garantir toujours l’adresse, le tact. Donnez-moi à cet égard vos dernières instructions. Voulez-vous que j’use souvent ou rarement de ce moyen? J’ai grand peine à croire que M. de Lieven vienne à Paris, sans en avoir reçu l’autorisation formelle et je doute qu’on la lui envoie sitôt. L’affaire traînera davantage. On vous répondra. On disputera. On essaiera quelque nouveau procédé. Du reste, je ne sais ce que je dis. Vous connaissez ce monde là mieux que moi.
11 heures
’aime le N°60. J’aime beaucoup le N°60. J’aimerais encore mieux le pendant de la lettre. Ah ! Si je l’avais ! Si jamais nous nous séparons encore, il faudra que je l’aie. Mais je ne penserai plus, le 31 à aucune séparation. Adieu, Adieu. Adieu comme dans la lettre. G.
66. Paris, Samedi 21 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Dès que mon fils sera parti. Je vous rendrai un compte détaillé de tout ce qui me regarde, jusque là imaginez vous que depuis 9 h jusqu’à 6, il est là, sans cesse. Que nous avons un travail immense à faire ensemble, que j’ai la tête rompue, renversée, que je n’en puis plus & que si mon cœur est toujours, sans cesse à votre service, mon temps ne l’est pas du tout que je ne sais où trouver deux minutes. Il part après demain. Pauvre jeune homme placé entre son père & sa mère dans des circonstances aussi pénibles.
Je n’ai aucun espoir de ramener mon mari, il a perdu la tête. Il faut que je ramène l’Empereur & vous concevez la difficulté si j’échoue, il y aura un éclat terrible, mais rien ne m’ébranlera. Vous savez où je trouve ma force. J’ai vu M. Génie deux fois ce matin. Il m’a porté votre petit billet & demain il viendra prendre un mot de ma part pour vous l’envoyer par M. Grouchy. Vous voulez un mot, vous l’aurez, je le veux aussi, je veux vous donner de la joie. Je sais ce qu’est elle est immense pour moi.
Thiers a passé deux heures chez moi hier. Il est entré boudant, son humeur s’est éclaircie, et il est sorti enchanté. C’est vous qui faisiez sa mauvaise humeur. Il est ministériel ; si les ministres le soutiennent aux élections. Mais au fond de part ni d’autre cela ne me parait encore bien solidement établi. Il est drôle, il est bavard mais comme j’ai été frappée du peu de facilité & d’élégance avec laquelle il s’exprime ! Comme je suis gâtée il est parti ce matin pour Lille il sera ici la première semaine de Nov. Lui et Berryer se trouveront en présence à Aix & à Marseille on les oppose l’un à l’autre dans les deux villes.
Voyez avec quelle hâte je vous écris, voilà une correction plus ridicule encore que celle de l’autre jour.) Ma santé se ressent de toutes les émotions et les tracasseries qu’on me donne, je ne dors pas. Ah quand me laissera-t-on tranquille. Adieu. Adieu. Vos lettres me soutiennent. Je les aime plus que jamais & plus que jamais adieu. Dans mon n°64, j’étais moins agitée à 9h. qu’à 1 h. parce que j’avis prié mon fils de ne me dire que le matin les choses qui pouvaient m’irriter le plus. Voici les paroles de l’Empereur : " Mon honneur et ma dignité sont blessés par votre femme, elle seule a osé jamais mon autorité. Faites vous obéir par elle, si vous n’y réussissez pas, c’est moi qui la réduirez en poussière." Il nous reste à voir comment ?
65. Val-Richer, Dimanche 22 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est très doux de se réveiller quand on a le cœur content. Je ne m’étonne pas que les oiseaux chantent en se réveillant. La vie leur plait, et ils se réjouissent de la retrouver. Je ne chante qu’en dedans ; mais cela me suffit. Je m’entends moi même. Quels enfantillages je vous conte là ! Il faut bien que je vous conte mes enfantillages après mes folies. Une fois ensemble, nous parlerons sérieusement. Nous allons entrer dans la dernière semaine. Il est possible que par des arrangements de voyage j’arrive à Paris, le 31 à 7 heures du matin au lieu de 5 heures du soir. Je vous verrai ainsi quelques heures plutôt. Je vous le dirai positivement d’ici à trois jours. Le réveil du 31 vaudra encore mieux que celui d’aujourd’hui.
En attendant, et dans les moments de liberté qu’on me laisse ; je plante. Mon jardin, n’est pas commencé, mais pour ne pas perdre tout-à-fait cette année, je mets des bouquets d’arbres et d’arbustes là où je suis sûr qu’il en faudra. Il m’est venu hier 76 pins, mélèzes, sapins et arbres verts de toute espèce, déjà un peu grands; et j’ai passé presque toute ma matinée à marquer les places, à faire creuser les trous, tant au bord de la pièce d’eau, tant assez près de la maison autour d’un banc, tant à une place d’où l’en entrevoit une jolie vallée un peu lointaine. N’est-ce pas qu’il faut absolument quelque part une grande allée droite où l’on puisse se promener sans tourner sans cesse, et causer en voyant devant et derrière soi ? J’en aurai une ou plutôt deux tombant l’une sur l’autre à angle droit. La première sera d’arbres ordinaires, tilleuls, marronniers, cerisiers, je ne sais pas bien lesquels ; j’ai envie que la seconde, beaucoup plus courte, soit toute en arbres verts, deux rideaux bien hauts, bien droits, fermant bien les côtés, mais laissant voir le ciel. Qu’en dites-vous ?
Je suis curieux de votre conversation avec Thiers, ce que vous me mandez de lui ne m’étonne pas du tout. Du reste sa conduite dépendra des élections. Si elles lui sont favorables, si la gauche gagne du terrain, il fera de nouveaux pas vers elle, sera exigeant, arrogant, menaçant avec le Ministère. Si l’ancienne majorité revient la même c’est-à-dire affermie, il sera doux, modeste, se fera ministériel soutiendra, promettra. Il y a là cependant pour lui une grosse difficulté. Il ne voudra pas faire ce métier-là gratis ; et on ne pourra lui donner le prix qu’il voudra. J’ai peine à croire qu’il se mette à si bas prix que le marché. soit possible. Nous verrons. Mes nouvelles électorales sont assez bonnes. J’ai grande envie de savoir un peu aussi les projets de Berryer. Je ne crois pas que son bataillon se grossisse autant que quelques personnes l’espèrent ou le craignent. Il n’acquerra pas plus de 15 ou 20 nouveaux membres. Cependant ce sera un petit bataillon et dans une assemblée incertaine, comme le sera encore celle-ci, c’est toujours quelque chose.
On commence donc à vous soutenir un peu. Vous propagez la rébellion. Je suis bien aise que Pozzo s’en mêle. J’ai pour lui un fond de vieux goût. J’en ai toujours pour les hommes dont l’esprit a mis le mien en mouvement et avec qui j’ai causé bien en train, bien à l’aise, n’importe sur quoi. Je vous préviens que je ne vous écrirai cette semaine que des lettres misérables. J’aurai de jour en jour, moins de goût à vous écrire. J’ai une multitude de petites affaires qu’il faut absolument que je règle. On me prend tout mon temps en visites. Je vais trois fois dans la semaine dîner à Lisieux.
Mlle Chabaud, cette amie de ma mère qui était ici et avait bien voulu se charger de la leçon d’anglais de mes filles, est partie hier. Je reprends mon rôle. J’ai déjà lu hier avec Henriette une scène de Shakspeare, Hamlet and the ghost. Elle l’entend assez bien. 11 1/4 Je comprends votre agitation, votre presse. J’ai regret d’y avoir ajouté. Ne m’écrivez que quelques mots si vous êtes fatiguée. Adieu, adieu. Votre N°66 me charme. Adieu.
69. Paris, Mardi 24 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens de lire votre N° 65. Alors venez le 31 à 7 h. du matin. Cependant n’y faites pas de grand effort. parce que tout est bien dès le 31.
Mon fils m’a quittée hier au soir pour la première fois j’ai répandu des larmes sur cette triste et affreuse affaire, & c’était de voir mon fils, mon pauvre fils placé au milieu de cela, chargé par son père de venir s’assurer si ce que je lui dit est vrai, chargé de dures paroles, chargé de m’emmener fut-ce au détriment de ma santé. Car voilà les ordres. Mon fils lui déclarera qu’après ce que lui a dit le médecin, si j’avais voulu partir il ne se serait pas chargé de m’accompagner. J’ai copié pour vous la longue lettre que j’ai écrite à mon mari. Si sa réponse ne révoque pas les mesures qu’il m’a annoncées, notre correspondance cessera. Mon fils est une excellente créature, pauvre garçon comme il avait le cœur troublé de tout ceci.
Médem l’a chargé de dire à mon mari ceci. : " Si l’on attaque votre mère assurez bien qu’elle grandira beaucoup, & que l’Empereur se sera rabaissé d’autant." Je soupçonne qu’il a déjà fait connaître cette opinion en d’autres lieux. Je vous l’ai dit & je le répète.
Mon esprit est fort tranquille mais mon cœur est bien blessé, et cependant mon cœur est si heureux si joyeux ! Tout sera bien le 31. De ce jour-là je me regarde comme hors de toute atteintes. N’est-ce pas ?
Constantine me parait une bonne affaire rien que parce que le contraire eut été une détestable affaire. On dit qu’il y aura un grand embarras à trouver une honnête administration comme l’était le Gal Dancrémont.
Berryer ne s’attend pas à un grand effort, à peu près ce que vous dites une dizaine de voix peut- être. Les vrais légitimistes ne veulent pas se présenter. Je n’ai pas causé seule avec lui. Il est revenu hier, mais mon fils partait J’avais fermée ma porte.
Maintenant je veux me reposer l’esprit un peu, me livrer sans distraction à la pensée du 31. Manger, dormir, car je n’ai rien fait de tout cela depuis 6 jours. Savez-vous comment j’ai passé la première nuit de l’arrivée de mon fils ? à me promener dans le salon & à jouer du piano. ce que je vous dis Ah que j’aurais à vous conter ! Je n’ai pas encore dormi cette nuit, je suis fatiguée, bien fatiguée. Je vous dirai que je n’aime pas les allées droites. Mais c’est égal, vous en ferez pour avoir de tout. Adieu. Adieu. Jugez de ce que ce sera le 31 !
70. Val-Richer, Vendredi 27 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aimerais mieux vous voir que vous savoir faible. Je vous l’ai déjà dit une fois : je crois à la puissance de l’affection pour soulager, même physiquement. N’y eut-il que du mal à partager et ce qui est bien pis, à regarder sans le partager, j’y voudrais encore être. Il faut toujours y être. J’y serai mardi. Ce jour-là j’espère, votre mal sera passé, et pour votre mal je ne vous serai bon à rien. Ce jour là ! Tous les jours qui suivront ce jour-là ! Il y a des joies comme des peines, dont je ne sais pas, dont je ne veux pas parler. Il est impossible de ne pas mépriser la parole quand on la met à côté.
Je comprends que M. Molé soit constant. Constantine, après les deux mariages, cela fait trois bonnes fortunes. Je suis bien aise qu’il soit de bonne humeur. Je n’ai pas l’intention d’être de mauvaise humeur. Il n’y a évidemment, en ce moment, point de question ministérielle, et je ne connais rien de si ridicule que d’en vouloir faire où il n’y en a pas. Il n’y a que des positions à garder ou à prendre, et de nouvelles preuves à faire chaque jour. C’est là mon seul dessein. L’occasion, je crois, ne manquera pas. La Chambre future, si je ne me trompe, ne se donnera à personne. Il faudra la prendre. Nous causerons aussi de tout cela, mais après, bien après. Du reste, il me semble que nous aurons du temps pour tout.
Je reçois ce matin une lettre de Mad. de Dino qui me presse de nouveau pour Rochecotte. Elle y sera établie le 7 ou 8 novembre. Je n’ai pas besoin de vous dire que je n’irai pas. Je lui répondrai demain. Je n’ai du reste nul embarras à n’y pas aller. Je lui avais dit que peut-être en retournant à Paris, il me serait possible de passer de son côté. Mais les élections me rappellent. ll faut que j’aille directement ; et puis que je mette fin à mes courses de cet été. J’en ai tant fait ! Les bonnes raisons ne manquent jamais.
La Duchesse de Broglie m’écrit aussi pour se plaindre un peu que je n’aille pas, avec tous les miens, passer quinze jours à Broglie. Elle y va le 6 novembre jusqu’à l’ouverture de la session. Je la trouverai encore à Péris. J’en suis bien aise. Voilà bien des braves gens qui se sont fait tuer. J’espère que le général, Perregaux guérira. C’est un officier très distingué, un homme d’esprit et d’esprit assez haut, bien plus d’esprit que le général Danrémont qu’il aimait beaucoup. Je connais tous ceux dont je viens de lire le nom dans le bulletin. Chagrin à part, c’est une étrange impression que d’apprendre qu’un homme qu’on a beaucoup vu, qu’on n’a vu et su que plein de vie, a cessé tout à coup de vivre. On a grand peine à y croire. Je ne sais pas si l’Afrique nous servira jamais à grand chose ; mais je suis bien aise que l’esprit militaire conserve quelque part un aliment et un théâtre. Je l’honore beaucoup. Il y a des vertus qui se perdraient en ce monde si la guerre en disparaissait.
Vous voyez bien qu’il faut que je ne vous écrive plus. Je n’y ai plus le cœur. Encore un mot Dimanche et puis ! Adieu. Je repars dans deux heures pour aller dîner à Lisieux. Adieu. Adieu. Lisieux, Samedi 8 heures. Vous auriez dû avoir vendredi, à 11 heures, ma lettre par M. Génie. Vous l’aurez eue à 6 heures. Adieu. Adieu. Comment pouvez-vous imaginer que j’ai regret à quitter la campagne ? Quand j’aimerais extrêmement la campagne, je n’y penserai pas seulement une minute aujourd’hui. Adieu.
73. Paris, Samedi 28 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Tout hier s’est passé sans Génie, sans Grouchy. Et comme ce mot que je n’ai pas m’eût fait du bien ! comme je l’attendais, comme j’ai essayé de deviner ce que contient cette petite lettre ! Je me suis adressée de si douces épithètes. Couchée sur mon canapé vert, je me suis retournée sur la glace et je me suis dit des choses charmantes, et j’ai vu que l’illusion commençait à devenir très vive, à l’animation de mes yeux. Sont-ils comme cela quand je vous regarde ? Ils m’ont plu hier à moi.
Je suis toujours souffrante comme à Abbeville, plus que cela même. J’en suis très affaiblie. Je ne marche pas même dans la chambre. Je reste couchée, couchée très horizontalement. J’espère être debout mardi.
Hier matin j’ai vu les Flahaut très longtemps, et puis lady Granville qui est restée chez moi jusqu’au moment de mon dîner. Le soir il m’est venu cette petite Mad. Graham, la plus sotte femme du monde, qu’on tolère pour Pozzo. Est-il possible qu’il aille s’accrocher à cela ? La petite princesse, l’ambassadeur de Sardaigne qui m’a enfin demandé de vos nouvelles , car il ne vous a pas nommé jusqu’ici. Il a sur le cœur la visite que vous ne lui avait pas faite. M. de Simon, Pozzo que j’ai fort réjoui en lui montrant une lettre de lord Grey qui annonce positivement, un changement d’administration, ou une modification dans le ministère actuel, c’est-à-dire l’entrée de lord Durham. Moi je n’attache pas aux paroles de lord Grey qui annonce positive ment le changement d’administration, ou une modification dans le ministère actuel, c-a-d de l’entrée de lord Durham moi, je n’attache pas aux paroles de lord Grey la même valeur que Pozzo veut y mettre.
En général n’avez-vous pas trouvé qu’on rabat toujours un peu de l’opinion qu’on a des gens dès qu’on vit familièrement avec eux ? Cette règle a ses exceptions. comme toutes les règles, & je sais bien que j’en ai rencontré une ou c’est l’inverse. Il me semble que vous allez dire la même chose.
Pour en revenir à lord Grey, c’est une grande réputation, et au fond un petit homme, vous pouvez compter que ce que je vous dis là est vrai. Savez-vous bien qu’on pense à Berryer. On le trouve abattu, mécontent, ce qui est vrai, je lui ai trouvé cet air là aussi. Si on pouvait le gagner, quelle conquête. Voilà le Rubini trouvé y voyez vous la moindre vraisemblance ? Je vous assure que moi je crois qu’on y songe.
11 1/2 J’écoute, j’épie. M. Génie ne vient pas. Qu’est devenue la lettre ? Où la trouver ? Paris est bien grand. Dans votre lettre de ce matin vous me l’annonciez pour hier bien soir. J’en deviens fort inquiète, ce qui est une manière convenable de vous dire que j’en suis avide, affamée, oui affamée. Ah mardi nous n’aurons plus besoin de rien, & de personne. Mardi viendra-t-il jamais ? Adieu. Adieu.
74. Paris, Dimanche 29 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
9. heures
Ah ma dernière lettre ! Quel plaisir car tout ce que cela annonce !Je viens de recevoir la vôtre, et enfin enfin,j’ai reçu hier à 6 heures celle que M. de Grouchy m’avait apportée. Je vais la relire encore et encore elle est bonne, elle est charmante, mais elle n’efface pas la première. Je vivrais cent ans que je ne pourrais pas oublier la sensation que m’a causée la première. Et cette émotion se renouvelle chaque fois que je relis, & je le fais tous les jours. Mais après vous avoir vu. Je n’y reviendrai plus. Cela devient votre affaire vous vous chargerez de remplacer les lettres. Il vient de me prendre un remords. J’ai reçu la seconde lettre. Elle m’a fait un autre plaisir, un plaisir plus doux, plus tranquille, pas si vif, pas si animé que la première, il l’était trop. Je viendrai me calmer auprès de la seconde, et cependant il y a bien des ressemblances, avec la première, mais il y a quelque chose, je ne sais quoi, qui me fait y jouir de vos paroles avec plus de liberté d’esprit & de conscience. Je me brûle à la première, je me chauffe à l’autre. Que de bêtise je voudrais ! Je voudrais me passer le temps. Il y a encore presque 60 heures d’attente, elles me paraîtront plus longues que les trois semaines ensemble.
Hier on m’a conseillé la calèche et au pas. Je me suis donc fait traîner un peu, très peu, cela ne m’a pas fait de mal, mais il a fallu me faire porter pour remonter mon escalier.
Rubini a reparu hier à l’opéra tout le monde y était, moins mon Ambassadeur, Lady Granville & M. Sneyd qui ont passé la soirée chez moi. Elle ne m’a quittée que très tard. Avez-vous lu dans le National du 21 un portrait de M. Thiers ? Il y a des choses très spirituelles.
A propos j’allais oublier de vous remercier de Monk, que M. Génie m’a apporté hier. Je vais le lire La dernière lettre de M. O’Connel à lord Cloncerry va, je crois, décider le divorce des Ministres avec le grand agitateur. Je suis fort disposer à croire qu’on acceptera le soutien des Torries modérés. Peel va venir passer quelques jours à Paris à ce qu’on me dit
Midi. Je me sens mieux aujourd’hui décidément mieux. Mais je ne serai pas encore tout-à-fait bien mardi & vous me trouverez faible. Au fond depuis quatre mois, il ne m’est pas arrivé de passer huit jours entiers tranquilles, ou bien portante. Lorsque ma santé commence à se remettre il m’arrive une bombe qui m’abat. Entre les lettres qui m’arrivaient de l’Occident et celles quelques fois qui ne m’arrivaient pas de l’Occident, j’ai eu toujours du chagrin, de l’inquiétude, et je ne compte décidément m’arranger avec ma santé que depuis le 31 octobre. Il a l’air d’être bien près, mais qu’il me semble loin !
Adieu. Que voulez-vous que je vous dise , Je ne sais pas plus parler que vous. Je retrouverai la parole le 1er novembre peut-être. La vieille sûrement pas. Adieu. Adieu. Toute notre vie, n’est-ce pas ? Adieu !
76. Val-Richer, Lundi 2 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis très touché des détails de ce couronnement. J’aime la piété. J’aime l’antiquité. J’aime l’enthousiasme et l’affection populaire. Je voudrais savoir ce qu’il y a de vrai et de solide dans toutes ces démonstrations. Non que je ne sache que la légèreté et l’inconstance sont de tous les temps, et n’excluent point la sincérité. Mais au moins faut-il qu’au moment où ils éclatent, les sentiments soient sérieux et sincères, que ce peuple assiste avec foi à ces cérémonies religieuses, avec respect à ces anciens usages, qu’il aime vraiment sa Reine en criant. Dieu sauve la Reine ! Qu’en pensez-vous ? Je ne demande pas mieux que d’y croire. J’y crois même. Je trouve que tout cela a l’air vrai. Dites-moi que j’en puis être sûr. Vous me ferez un grand plaisir. C’est un terrible problème que de savoir si la foi, le respect et l’amour se peuvent concilier avec une discussion continuelle, & une liberté immense. C’est le problème de notre temps. Si la solution est bonne, ce sera un honneur infini pour l’humanité. Je l’espère toujours.
Comment donc le Maréchal Soult a-t-il fait pour être le second dans le cortège? Ou bien le Journal des Débats a-t-il effrontément menti ? Je l’en soupçonne un peu, quoique ce fût bien fort. Et ces acclamations, du peuple anglais pour le Maréchal, et pour lui seul, sont-elles vraies aussi ? Est-il vrai du moins que tous les journaux anglais le disent ? Levez tous mes doutes, je vous prie. Vous m’avez donné la passion de l’exactitude. Il faut satisfaire, les passions qu’on donne. Sachez bien seulement que je ne mets de prix à toutes mes questions que parce que je vous les adresse et parce que les réponses me viendront de vous. A cause de cela, vous seriez peut-être tentée de croire que je n’écris qu’à vous. Détrompez-vous. J’ai écrit ce matin à vingt-quatre personnes ; oui, 24. J’ai apporté ici tout mon paquet de lettres non répondues. Il y en a 39 de gens qui m’ont envoyé leurs ouvrages. Il faut bien répondre et répondre avec quelque intelligence, avec un certain air d’avoir lu. J’ai fait 24 fois ce mensonge là aujourd’hui.
Mardi 3 6 h. 1/2.
Je sors de mon lit. Il y avait autrefois, dans cette maison neuf moines qui n’en sortaient pas avant 10 heures. Il y a 600 ans, il y en avait je ne sais combien qui en sortaient à 4 heures du matin. Ceux-là priaient, labouraient, défrichaient, étudiaient. Ils étaient le type de la vie austère et laborieuse. Et le peuple le croyait; et il avait raison de le croire. Naguère, il y a cinquante ans, leurs successeurs étaient le type de la vie oisive, paresseuse licencieuse. Et le peuple le croyait aussi, et il avait raison, quoiqu’il le crût plus que cela n’était. Ainsi va le monde. Mais ce prodigieux contraste des choses, sous les mêmes noms, dans les mêmes lieux, et frappe l’imagination quand elle s’y arrête. Je viens de me promener un quart d’heure. Je regardais cette vallée qui est-ce qu’elle était il y a 600 ans couverte des mêmes bois, éclairée du même soleil, arrosée des mêmes eaux ; puis cette maison, la même aussi au fond, quoique plusieurs fois reconstruite. Les hommes seuls ont changé. Les moines licencieux ont succédé aux moines austères, et moi je succède aux moines licencieux. D’où vient notre plaisir à contempler ce cours des choses humaines, les vies si diverses et toutes si rapides, que le temps remporte toutes également, comme le courant de ma source emporte les feuilles de toute sorte qui y tombent. Homère a pensé et dit tout cela il y a 2700 ans, c’est lui qui compare les générations des hommes aux générations des feuilles. Et moi, je prends le même plaisir à le penser et à le dire comme lui. Mais je vous le redis. C’est là mon vrai plaisir, et celui-là Homère ne l’a pas eu.
10 h.
Voilà, la réponse à mes questions anglaises. J’y comptais presque. Nous pensons, ensemble même à 46 lieues. Que c’est loin pourtant ! Et ces lettres qui vous arrivent ou que vous écrivez sans que je les voie! Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : histoire, Politique (Angleterre), Politique (France)
78. Val-Richer, Mercredi 4 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
En effet la colère de Marguerite doit avoir été grande. Il n’y aurait certainement pas eu de bravos pour son mari. Je n’ai nul goût pour le Maréchal, mais je suis bien aise, pour l’Angleterre et pour la France qu’il ait été ainsi accueilli. Je trouve cela un vrai procédé de gentleman ; procédé d’autant meilleur que celui de Croker était plus grossier et subalterne. Les fanfaronnades du Maréchal méritaient la leçon de Croker ; mais, en pareil cas, il y a aussi peu d’honneur à se charger de la leçon qu’à la méditer. La vraie supériorité se montre bien mieux à dédaigner la rivalité et à rendre justice même libérale, à la renommée de son rival. Je voudrais être sûr qu’à pareille épreuve, mon pays se conduirait aussi noblement. Je n’oserais y compter.
Le Duc de Broglie va passer à Paris la journée du lundi 9 ; pour le jugement de la Chambre des Pairs. Il n’a pas voulu prendre part à la question de compétence ; mais la compétence admise, il prendra part au jugement. Il ne veut pas donner à M. Molé un prétexte de dire que lui aussi, il s’est retiré d’un procès. Il a raison. Je lui envie bien cette journée là. C’est du bon bien perdu. Il reviendra à Broglie, le 10, et j’irai le 11 pour y passer 24 heures. Rien ne sera dérangé dans notre correspondance.
Est-ce que Lord et Lady Granville partent décidément le 12 ? J’espère toujours quelque dérangement dans ce voyage. Je comprends qu’on soit préoccupé à Neuilly de l’Affaire d’Egypte. Mais je persiste à penser que même si elle éclate elle avortera ; c’est-à-dire que tout le monde s’entendra pour l’étouffer. Nous protégerons tous à qui mieux mieux la Porte contre cet usurpateur. Et si par hasard l’Angleterre soutenait le Pacha, ce que je ne crois pas du tout cela n’aurait d’autre effet que de resserrer encore notre intimité avec l’Autriche. Nous formerions avec elle un tiers parti qui tiendrait la balance, qui le voudrait du moins et qui y réussirait quelque temps. Il n’y a aujourd’hui que des velléités d’événements qui ne servent qu’à la conversation.
Aujourd’hui, à 3 heures, nous avons eu un assez gros orage. Il marchait rapidement sur la route de Paris. J’ai eu bien envie de le charger d’une commission, qui n’eût pas été un coup de tonnerre. Vous avez, me dîtes-vous, de notre séparation, autant d’humeur que de chagrin. Est-ce qu’on a de l’humeur sans en avoir contre quelqu’un ? Si cela se peut, j’accepte votre humeur comme votre chagrin, car moi aussi je suis horriblement égoïste. Mais si cela ne se pouvait pas contre qui votre humeur ?
10 heures 1/2
Ce ne sont pas mes carpes que je vous envoie, c’est moi-même c’est-à-dire, mon temps et ce qui d’y place comme Mad. de Sévigné envoyait ses soins à sa fille. Je suppose que vous êtes bien aise de tout savoir, petit ou grand. Si j’ai tort, dites. le moi. Adieu Mon facteur est arrivé aujourd’hui une demi-heure plus tard. Je l’ai grondé. Il a paru étonné de la vivacité de mon impatience. Adieu. Adieu.
81. Val-Richer, Dimanche 8 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les mouchoirs blancs et rouges sont tout prêts, rangés dans mon tiroir. Je viens d’en prendre un. Le pauvre roi d’Hanovre me paraît bien accusé. On peut encore exercer le pouvoir absolu là où il existe, encore en s’y prenant bien. Mais le rétablir cela ne se peut plus, surtout en en mettant enseigne. Le principe irrite plus que le fait. Les peuples sont comme les femmes, comme les hommes ; ils aiment mieux être maltraités qu’insultes. Votre Empereur a raison ; le Roi d’Hanovre gâte le métier. Si j’étais M. Molé et que j’eusse envie d’avoir le Maréchal Soult pour ministre de la guerre, son fracas à Londres me déplairait fort. Il reviendra de la plein de prétentions, & probablement ne voulant plus accepter d’autre Présidence que la sienne propre. On me mande qu’il n’y a encore rien de sérieux dans tous les bruits de remaniement de Ministère. Ce qu’on remanie, c’est l’administration d’Alger. On va changer, je crois, l’Intendant civil. M. Bresson payera son discours. Le maréchal Vallée écrit que les affaires militaires sont à peu près arrangées, qu’il lui faut à présent, pour second un administrateur actif et un peu considérable, sans quoi il ne saura que faire de tout l’argent qu’on lui vote. On a fait des propositions à un homme de mes amis. Je l’ai engagé à accepter.
Le dîner de la Reine d’Angleterre aux Ambassadeurs Constitutionnels est une affiche en bien grosses lettres. C’est comme toute la politique extérieure anglaise, un grand tapissage sur la rue. Je ne trouve pas que nos journaux en fassent le bruit convenable. Me voilà au bout de ma politique et de la vôtre. La saison est bien morte. Nous glanons. Si nous étions ensemble, nous moissonnerions toujours. La Fontaine a raison. L’absence est le plus grand des maux. Pourtant je me reproche de dire cela. Nous ne connaissons pas le plus grand des maux. Cela fait trembler. J’oublie les nouvelles de St Ouen. On bâtit le Presbytère.
9 heures
Vous dîtes que je ne vous connais pas tout-à-fait. Tant mieux ; car plus je vous ai connue, plus j’y ai gagné, et vous n’y avez pas perdu. Vous êtes pourtant d’une nature, simple, pas un peu simple, comme votre grand duc, mais très simple. La simplicité riche, c’est la perfection. Votre âme est riche, inépuisable. Je la connais mieux que je ne vous le dirai jamais. Je ne vous dis pas tout de vous surtout. Et de loin, que dit-on?
J’ai repris mer leçons avec mes filles. Je remplace leur maître d’arithmétique! Elles sont bien heureuses. C’est quelque chose de singulier qu’une vie si animée et qui laisse si peu de traces. J’ai probablement été dans mon enfance, aussi heureux, aussi animé que le sont mes filles. Je ne m’en souviens pas du tout. Vous souvenez-vous de votre enfance ? Je suis né vers seize ans. C’est de là que date ma vie, dans ma mémoire à moi. Je vous parlais de mes filles. Un de leurs bonheurs, c’est que je en leur lis le soir. Nous achevons un très joli, roman de Walter Scott, peu vanté : Richard en Palestine. Mais je ne veux pas ne leur lire que des romans même de ceux-là. C’est une lecture trop amusante, un plaisir de paresseux, un aliment qui dégoûte des autres, et ne nourrit pas, les jours derniers, j’ai pris Plutarque, la vie de Thémistocle. C’est charmant ; mais c’est un travail de lire cela à des enfants. Il faut à chaque instant sauter, retrancher, retourner, expliquer. Les faits, les livres, les esprits, le langage tout cela est bien grossier. Il n’y a pas moyen de mettre cela sous les yeux des enfants. Je ne suis pas prude ; mais avec mes filles. je deviens de la susceptibilité la plus ombrageuse. Je ne voudrais pas laisser approcher de leur pensée de leur petite figure, si fraîche et si pure un mot, une ombre, un souffle moins frais et moins pur. Pour les âmes, le mal, c’est la peste contagieuse à faire trembler, contagieuse par un mot, un regard ! J’ai fait en lisant la vie de Thémistocle, des tours de force et d’adresse admirables pour écarter le mal que je rencontrais à chaque pas. Je l’ai écarté hier ; mais demain, mais un jour, il les approchera nécessairement. N’importe, que ce soit tard, le plus tard qu’il se pourra. La longue innocence se répand, sur toute la vie.
10 h. 1/2.
Il paraît que nous parlons l’un et l’autre bien obscurément sur mes carpes. Je ne croyais pas du tout que vous les attendissiez en personne, pas plus que je n’avais pensé à vous les envoyer. Je ne voulais que justifier mon récit de leurs aventures. Mais laissons-le là. C’est plus qu’elles ne méritent. Gardez votre style, anglais ou non. Je ne vous pardonnerais pas d’en changer. Adieu. Adieu. G.
85. Broglie, Jeudi 12 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je passe ici la journée. Je retournerai demain chez moi. J’attends votre lettre de ce matin. On me l’enverra de Lisieux. Je dois l’avoir ce soir. Demain, en passant à Lisieux j’en trouverai une autre. Vous n’aurez point de dérangement non plus.
J’ai trouvé ici quelques personnes ; des députés du département qui y sont venus dîner avec moi ; tous les d’Haussenville possibles deux générations ; il me semble qu’on recommence à attendre la troisième. Le Duc de Broglie est arrivé hier matin, quelques heures avant moi. Il avait dîné la veille chez Lord Granville. Quoiqu’il soit peu bavard & moi peu questionneur, j’ai trouvé moyen d’avoir de vos nouvelles. Mais je voulais mieux. Je suis ici à sept lieues plus près de vous.
Je suis rentré dans cette maison avec émotion. J’y ai été très heureux. Il n’y a pas, dans ce parc, un coin que je n’aie visité avec quelqu’un de cher, de très cher, mon fils le dernier. Nous sommes encore là, la maison et moi rien que nous. J’ai le cœur plein, plein de choses qui vont à vous. Vous seriez bien ici, certainement bien pour quelque temps. Les maîtres sont bons simples, le cœur droit et haut. La vie est facile et assez bien arrangée Je cherche quels conforts vous manqueraient. On m’a donné l’appartement qu’on vous donnerait au rez de chaussée. Il fait un temps magnifique, trop chaud pour vous. Mais l’air est animé et les ombres du parc très épaisses. J’en ai fait le tour ce matin, à huit heures et demie. Il faut quarante minutes. Je n’aurais pas mis plus de temps avec vous. Vous marchez d’un bon pas. Mais nous nous serions arrêtés en causant. Nous nous arrêtons bien quelques fois sur le trottoir de la rue de Rivoli. Charmant trottoir !
En fait de politique, le Duc de Broglie ne m’a rien rapporté sinon le grand émoi du Cabinet, et même plus haut que le Cabinet, sur les triomphes du Maréchal Soult. C’est plus qu’on ne demandait. Et tout d’ailleurs très impérial jusqu’au vin. On n’en rit que du bout des lèvres. On croit des prétentions énormes et près de se mettre au service du parti qui leur promettra le plus. On ne songe plus du tout à lui comme simple Ministre de la guerre. On a offert ce portefeuille, là au Général de Caux qui l’a refusé. On restera comme on est.
11 heures du soir
Votre lettre n’est pas encore venue. On me dit que le courrier de Lisieux arrive le matin et que je l’aurai demain à 9 heures. J’y complais pour aujourd’hui. Il me semble que le mécompte m’est encore plus désagréable qu’il n’eut été au Val-Richer. Ce lieu, les impressions que j’y ai retrouvées tout ce qui semblerait devoir me distraire de vous m’en rapproche. Adieu. Je vous dirai bonjour demain en me levant, car cette lettre-ci partira avant que j’aie la vôtre. Probablement vous êtes déjà couchée. Vous dormez, j’espère. Adieu, Adieu.
Vendredi, 8 heures
Lady Granville part demain. Je ne puis vous dire combien je la regrette. Quel temps doivent- ils passer à Aix ? Je donnerais quelque chose de bon, comme on dit pour être un jour derrière un rideau quand vous causez avec Lady Granville. Je voudrais voir sa gaieté et la vôtre en communication. Personne, je crois n’est moins curieux que moi. Je le suis excessivement pour quelqu’un que j’aime. Il me semble que j’ai toujours, à son sujet, quelque chose de nouveau à apprendre ; et aussi que tout ce que j’en ignore tout ce qui m’en échappe est un vol qu’on me fait. C’est mon bien que je cherche à tout moment, partout. Adieu. J’aurai deux lettres aujourd’hui. Je serai au Val-Richer pour dîner. Adieu, Adieu. G. J’ai oublié de mettre de la cire noire dans mon working desk.
86. Val-Richer, Vendredi 13 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens d’arriver un peu las de la chaleur. J’étais très combattu pendant la route. Je roulais dans une charmante vallée, entre des coteaux les mieux boisés et les près les plus verts qui se puissent voir, le long de la petite rivière la plus fraîche, la plus claire. La population était dispersée dans les près, aussi gaie que la nature était riante. Elle faisait les foins. C’était un très joli spectacle. Si je vous avais eue là, à rouler avec moi, bien doucement, rien ne m’eût manqué. Mais vous auriez eu si chaud ! Et je n’aurais eu aucun moyen de vous en défendre. Je vous voyais languissante, abattue, impatientée. Cela me gâtait tout mon rêve.
J’ai mes n°88 et 89. Je suis bien aise que vous ayez pris Longchamp, en l’absence de Lady Granville. Vous êtes accoutumée à vous y plaire. Quel ouvrage y avez-vous porté ? Est-ce toujours votre tapisserie si brillante ! Si vous prenez goût à Fénelon, il y en a dans me bibliothèque rue de la Ville-l’Évêque, au rez-de-chaussée, dans l’antichambre de ma mère, une édition très complète, & d’un assez gros caractère. Faites prendre les volumes qui vous conviendront. C’est très spirituels affectueux, pénétrant, mais un peu subtil. Il faut, si je ne me trompe être dans de grandes, et très exactes habitudes, de dévotion pour se plaire toujours à ce langage où il y a bien du cant, quoique ce soit au fond raisonnable et doux. Et puis beaucoup, beaucoup de paroles, rien ne va vite.
Vous me direz comment vous vous accommodez de cette allure là. Plusieurs des journaux ministériels quittent en effet le ministère, car ils meurent ; le Journal de Paris, la Charte. D’autres l’abandonnent sans mourir, comme le Temps. Beaucoup d’autres s’émissent contre lui. Cependant il n’est pas exact de dire que les débats seuls lui restent. Il a aussi la Presse qui ne laisse pas d’avoir des abonnés. Et puis il a imaginé une méthode qui nuit, pas bien noble, mais qui lui servira quelquefois. Il achète de temps en temps un article dans les Journaux qu’il ne peut acheter tout entiers, dans des Journaux d’opposition avec 500 fr., 1000 fr., mille écus, selon impuissance du Journal et de l’occasion, il fait insérer, dans la plupart des journaux, sous une forme un peu indirecte, des réflexions ou des faits qui lui, conviennent, ou à peu près. Il vit à peu près ; mais, il n’est pas à cela près. Et vous avez raison de dire qu’il se moquera de tout le monde jusqu’à la fin de l’année. Seulement, il se moquera de bas en haut, comme Scapin se moque de Géronte. Ce n’est pas une moquerie de gouvernement. Il me paraît d’après ce que m’a dit le Duc de Broglie, que bien certainement rien n’éclaterait en Egypte si la France et l’Angleterre étaient bien décidées, et le montraient bien décidément mais qu’elles se montrent indécises, quoiqu’elles ne le soient pas. Leur langage, leur attitude sont beaucoup plus flottant que leur intention. Et alors, il peut arriver que le Pacha, tout homme d’esprit qu’il est, ne comprenne pas bien, et qu’il crois l’indécision réelle, & qu’il agisse en conséquence. Et si une fois il agit, personne n’est plus maître de rien. Je ne crois pas à cet événement parce que je ne crois pas aux événements. Cependant il y a des chances.
Oui, je suis remonté dans ma Chambre, après avoir causé de tout cela ; et en prenant mon bougeoir, et en passant au bord de l’escalier pendant que les autres le montaient (car je vous ai dit que je logeais au rez de chaussée) j’ai pensé que tout était possible. J’ai pensé, à Boulogne. J’ai bien de la peine à quitter Boulogne quand une fois j’y pense. Cependant j’ai pensé aussi au Havre. Dites-moi quelque chose d’un peu précis sur le havre. Ne soyez pas aussi indécise à son sujet que M. Molé au sujet d’Alexandrie.
Ma petite fille Henriette a été un peu souffrante en mon absence ; une indigestion sans savoir pourquoi. Il n’y paraît plus. Je l’ai trouvé à merveille. Mon rhume est à peu près fini. Je n’ai point monté à cheval. Soyez aussi docile que moi. Dormez, mangez ne perdez pas le goût du ragoût. Et sachez que j’ai trouvé à Lisieux à une exposition de tableaux qui vient de s’y faire, deux portraits charmants de Mad. Loménie. Adieu, Adieu. G.
91. Pont-l’Evêque, Jeudi 19 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quel ennui que cette vie de courses et de dîners de grande route et de table ! J’ai siégé hier de 6 heures et demie à 9 heures et demie, comme à un dîner de Pozzo ou de Pahlen. C’était la seule ressemblance. Enfin je serai ce soir chez moi, et je n’en bougerai plus que pour une plus douce raison. A propos de Pahlen, donnez-moi de ses nouvelles. J’ai pour lui une vraie bienveillance. Je crois parfaitement ce que vous me dîtes que la maladie du Grand Duc sera une très mauvaise note pour votre mari. Quand la récolte est mauvaise, les peuples s’en prennent au gouvernement. Les autocrates ne sont pas plus sensés que les peuples, et on déraisonne de haut en bas comme de bas en haut. La guerre de principes à propos de visites et de dîners doit être en effet fort ridicule à Londres. Quand on fait tant que de se quereller pour des principes, il faut remuer le monde. Comment faisiez-vous, de votre temps, pour donner à manger et à danser aux représentants constitutionnels ? Il n’y avait guère alors d’Etat constitutionnel que l’Angleterre. A moins que vous ne comptiez la Suède et les Etats-Unis. Il faut convenir que la générosité à leur égard, vous était plus facile qu’elle ne l’est aujourd’hui à M. de Strogonoff. Savez-vous quelque chose de nouveau des Affaires du Roi de Hanovre ? Il me revient, avec assez de certitude, que le rapport à la Diète sur la pétition d’Osnabrück, a été confié au ministre de Bavière, qu’il est prêt, qu’il est contraire au Roi Ernest, et que dans ce moment tout le travail de l’Autriche et de la Prusse est de l’amener à arranger l’affaire lui-même pour éviter une condamnation de Roi. On me dit en même temps qu’il est vrai que le peuple l’aime assez et le traite assez bien dans son pays. Vous verrez que dans la manie de conciliation du moment les Hanovriens concilièrent la rébellion et la loyauté.
La réception du Maréchal Soult fait un excellent effet dans ce pays-ci. J’appelle un excellent effet l’envie que cela donne aux plus vulgaires de se montrer aussi justes et généreux s’ils en avaient l’occasion. Certainement, si le Maréchal promenait le Duc de Wellington en Normandie, il le ferait applaudir partout. J’ai un grand plaisir toutes les fois que je vois une idée sensée un sentiment élevé se répandre et s’accréditer dans mon pays.
9 h. 1/2
J’ai été interrompu par des visites, et en voilà d’autres qui arrivent. Une petite ville s’ennuie tellement que le moindre événement la charme et la remue toute entière. L’ennui joue un bien grand rôle dans les affaires humaines. Je vous quitte. Il faut que je vieillisse car je commence à tenir à mes habitudes. Je ne vous écris à mon aise que de mon Cabinet du Val-Richer. Adieu. Adieu. On continue, tout le long de mon chemin, à me faire des compliments de condoléance sur mon dérangement du jury. Adieu. Je trouverais aujourd’hui à Lisieux votre N°95.
Mots-clés : Diplomatie, Mandat local, Politique, Politique (France)
97. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma corvée est finie. Ce n’est certes pas la solitude que je suis venu chercher ici. Je suis charmé de la vôtre. J’en profiterai. Je fais de charmants projets. Je fais des vœux pour que le temps se maintienne tel qu’il est aujourd’hui beau et pas chaud. Un de mes voisins de ce matin me l’a promis. " C’est, dit-il, le combat de la lune." Ce sera la lune de miel.
Je regrette que vous n’ayez pas vu M. Villers. Il aime à parler et il doit être curieux à entendre sur l’Espagne. Il a joué là un jeu bien brouillé. Quel triste sort que celui des pays faibles ! Le théâtre des intrigues rivales des grands pays quand ils ne sent pas celui de leurs guerres : jouet ou champ de bataille et toujours victime. Il ne faut pas être petit, et il faut être bon pour les petits. Je crois que c’est pour vous que M. Ellice est venu à Paris. Il me semble qu’il passe sa vie chez vous. Il a de l’esprit et il est très au courant. Comment un homme d’esprit comme lui ne s’aperçoit-il pas que tout en causant, & vous plaisant avec lui, vous ne lui portez pas grande considération ? Et s’il s’en aperçoit, comment s’en arrange-t-il ? Mais il est de ceux qui s’arrangent de tout ce qui les sert ou les amuse. Vous avez un grand talent pour traiter avec ces hommes-là. Vous les attirez sans les laisser tout à fait approcher. Vous leur plaisez et vous leur donnez le plaisir de vous plaire, mais toujours d’un peu loin. C’est votre histoire avec Thiers. En entendez-vous dire quelque chose? Ne trouvez-vous pas que le Maréchal Soult abuse de sa fortune ? Ces visites partout, ces acclamations de tous les jours, cette perpétuelle exhibition, combien de temps cela peut-il durer en Angleterre ? Chez nous, ce serait déjà fini usé. Et vous qui n’aimez pas les répétitions et les longues choses vous n’êtes donc pas Anglaise par là ? Il y a bien des côtés par où vous ne l’êtes pas. Vous avez le cœur plus anglais que l’esprit.
Du reste j’ai un de mes voisins qui arrivait d’Angleterre et qui vous charmerait à entendre, cinq minutes je veux dire car vous ne vous en accommoderiez pas plus longtemps. C’est le plus grand manufacturier du pays ; il est allé parcourir l’Angleterre pour ses affaires ; et malgré les rivalités d’argent, il en est dans un enthousiasme inépuisable ; il professe, il prêche la richesse, la propreté, l’élégance, la grandeur, l’esprit d’ordre, le bon jugement, les bonnes auberges. Je l’écoutais l’autre jour avec le plaisir de vous entendre donner raison. C’est lui qui m’a donné à dîner à Combrée avec 80 amis. Et son toast et son speech en mon honneur valaient son admiration pour l’Angleterre.
9 heures 1/2
93 méritait d’être brûlé vif. Je n’ai fait que mon devoir. Je trouve comme vous, que nous nous adressons de sottes lettres. Si elles pouvaient ressembler à nos conversations, elles seraient charmantes. Ah, nos conversations ? Nous les retrouverons de demain, en huit, pour quinze jours. Que ce sera court, & immense ! Vous y pensez, dites-vous, plus que moi. Je le veux bien, mais je le nie. J’y pense toujours. Ajoutez quelque chose à cela. Je vous en prie ; ayez des caprices ; ne vous laissez gouverner par personne en mon absence. Je ne vous le pardonnerais pas. C’est peut-être un des signes les plus assurés de l’affection que de se laisser gouverner. On ne remet sa liberté qu’à celui qu’on aime plus que soi-même, en qui on se confie plus qu’en soi-même. Redites-moi de vous gouverner.
Je n’ai pas encore de réponse pour le précepteur, vous l’aurez probablement avant moi. Vous ne savez pas combien je voudrais faire, à l’instant même ce que vous désirez. Si je pouvais le faire toujours moi-même, j’en serais sûr. Mais de loin, mais forcé de mettre un esprit au bout de mon esprit, des mains au bout de mes mains, tout est long, & je m’impatiente autant que vous. Adieu. Comment va Marie ? Dites-lui au moins une fois avant mon arrivée que je vous ai demandé de ses nouvelles. Adieu. Lundi prochain, je serai sur la route de Paris. Je vous porterai moi-même mon adieu. G.
103. Paris, Jeudi 26 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma bonne matinée de Longchamp a été raccourcie hier par les visites de M. Ellice. M. Villiers, & l’Ambassadeur d’Autriche. Chacun a eu son tête à tête. Villiers a de l’esprit et comme nous en sommes pas sortis des affaires, hier il avait bon ton. Il avait eu la veille une très longue conversation avec le Roi, il en est revenu très frappé de l’habileté, de la plausibilité, (dit-on cela ?) avec les quels le Roi défend ses opinions, car ils n’étaient pas de la même opinion sur l’affaire d’Espagne. La Belgique occupe tous les Cabinets. Le vôtre défend les intérêts de Léopold un peu trop. Celui de Londres reste encore d’accord avec nous. S’il persiste il faudra que la France aussi se range. En général nous sommes fort contents pour le moment de Lord Palmerston dans les deux questions d’Orient et de la Belgique. Je ne sais si cela se soutiendra.
J’ai fait courtement Longchamp par un temps assez froid. Mon dîner solitaire ensuite, et puis un peu de promenade encore en calèche. Marie m’a lu le soir le partage de la France pas l’empereur Nicolas. Vraiment mes Anglais sont trop niais. Comment aller gravement insérer cette bêtise dans les premiers journaux anglais ? Vous avez plus d’esprit ici. J’ai mal dormi, je me sens mal à l’aise ce matin. Je ne sais ce que c’est. En tout cas il n’y a pas de ma faute, car il est impossible de se mettre à un régime plus sain que le mien. Mes Anglais ont dîné hier chez M. Molé.je crois qu’ils dinent chez M. Decary aujourd’hui. Villiers part ce soir. Ellice ne veut partir qu’après vous avoir vu. Voilà une visite un compatriote vite adieu. Adieu.
104. Paris, Jeudi 26 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Longchamp 4 h.
108. Paris, Samedi 18 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne vous dirai pas quel devait être le N° de votre lettre de Lisieux. Mais j’ai bien envie de vous dire que j’ai plus d’ordre que vous et que je porte toujours en place ou en voyage un calendrier dans lequel je marque cela. C’est que les Français sont étourdis. Fâchez-vous bien je vous en prie. Relisez ma malencontreuse lettre. Regardez y bien. Vous verrez qu’elle n’était pas si mauvaise que vous la faisiez en calèche où vous m’avez inspiré tant de terreur. Mais brûlez la dans tous les cas, car elle vous a donné un mauvais moment et à moi ensuite aussi. J’ai si peu à vous dire de ma journée d’hier que je ferais aussi bien de n’en point parler du tout. Le Duc et la Duchesse de Palmella sont venus me trouver à Longchamp. Avant leur arrivée, j’avais marché seule dans notre allée favorite. Je me suis arrêtée où nous nous arrêtions pour regarder le Mt Calvaire. J’ai pensé à votre bras qui serrait le mien avec compassion à l’endroit où un heureux père appelait son fils d’un nom que je n’ai pas la force de tracer ! Après mon triste dîne j’ai été voir les Brignole. J’ai causé avec eux jusqu’au moment de rentrer pour me mettre au lit.
A propos avant cela, et à la lueur des lanternes, des plus pitoyables lanternes du monde, j’ai été chercher le N°24 de la rue de Sèvres. Imaginez le guignon. Le N°24 est une masure abandonnée. Pas de porte. des affiches placardées partout. Les fenêtres brisées. Enfin une ruine. Vous m’avez mystifiée. Où trouver maintenant le ventriloque ? J’aurais bien des choses à vous dire sur les journaux de ce matin, mais vous n’êtes plus là, vous ne viendrez pas et il faut que je ravale tout. La singulière manière dont le journal des Débats défend le gouvernement Français d’avoir révélé une conspiration formée contre la vie de l’Empereur Nicolas à Varsovie ? On dirait un crime d’empêcher un forfait. Que pensez- vous de cet article ? Que pensez-vous du Constitutionnel de ce matin ? Et de Chaltas, auquel on ne fera pas de procès. Et de l’article inséré dans les journaux hollandais sur cette affaire ? Et les républiques anciennes dont on a tort de trop enseigner l’histoire ? Vous voyez que je lis avec fruit, mais vous voyez aussi que j’ai besoin de vous, ... pour cela seulement ... ?
Marie est d’une gaieté qui m’offense. Elle se porte parfaitement bien. Je n’ai pas de lettres et pas de nouvelles à vous mander. J’ai écrit hier à Lady Cowper, à Mad. de Flahaut. Aujourd’hui à Lady Granville. J’ai fait hier une grande pensée, je compte en faire deux autres aujourd’hui. Maintenant vous savez tout, car je n’ai pas besoin de vous raconter que je suis triste, bien triste. Adieu. adieu.
Mots-clés : Politique (France), Presse, Réseau social et politique
104. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi m’êtes-vous devenue nécessaire ? Vous ai-je dit que mon service de poste venait de recevoir un grand perfectionnement ? Mon facteur m’arrivera une heure plutôt et retournera toujours à Lisieux avant le départ du courrier pour Paris. En sorte que vous aurez toujours ma lettre de la veille. M. Conté a arrangé cela, pour moi. Je lui en tiendrai compte quelque jour. L’allocation du Roi sur le parfait accord de sa famille, et de son ministère, est avidemment une réponse au déjeuner de M. le duc d’Orléans chez M. Foule et à mon dîner chez M. le duc d’Orléans. Je n’en reste pas moins convaincu que M. le duc d’Orléans n’a fait cela que d’accord avec le Roi. La part de la comédie est grande, en ce monde. Je trouve le discours de Lord John excellent, un vrai discours de gouvernement, acceptant la responsabilité sans dissimuler le tort, jugeant et agissant d’ensemble et non en détail. C’est le détail qui perd les hommes et les affaires. Lord John a fait de grands progrès. En tout, je trouve la conduite et la situation des Whigs, c’est à dire de Lord Melbourne et de Lord John, meilleures que je n’attendais. Lord Aberdeen se flatte. La clef de l’avenir ministériel est toujours en Irlande. Les Torys ont tort de prolonger indéfiniment les questions irlandaises. Le Gouvernement Tory de l’Irlande est impossible. Les hommes même simples spectateurs ne supportent plus ce degré d’iniquité et de violence. Je regrette la lettre de Lady Clauricard, et celle de Lady Granville, et même celle de Mad. de Flahaut. Si elle a envie de revenir cet hiver, elle reviendra. La mauvaise humeur est une puissance terrible.
9 h. 1/2
Voilà mon facteur et mon N°108. A ce soir. Je trouve ici en arrivant je ne sais combien de petites affaires à régler. Quatre ou cinq personnes sont là qui m’attendent. Nous reprendrons ce soir notre conversation. Car je veux retrouver dans nos lettres notre conversation. Je veux vous dire tout ce qui me traverse l’esprit, tout ... excepté ce qui est tout. à la vérité ceci ne me traverse pas l’esprit. Adieu. Comment voulez-vous qu’on trouve un ventriloque, un homme qui parle là où il n’est pas ? Aussi, qui a jamais cherché un ventriloque ? Je vais pourtant écrire encore pour essayer de trouver le vôtre. Adieu. G.
105. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous lisez très bien les journaux. J’ai envie de m’en fier à vous, et de n’y regarder que ce que vous me recommanderez. D’autant plus que j’avais remarqué tout ce que vous me dites et pas grand chose de plus. Je suis de votre avis sur tout entre autres sur l’article des Débats. Il était si à propos, et si aisé d’écrire sur ce bruit du Times, dix lignes de cœur haut et de bon gout, dix lignes vraiment royales, en réponse aux boutades impériales ! Pour le constitutionnel, je n’y attache aucune importance. Il serait vendu qu’il ne parlerait pas autrement. Raison de plus même. Cependant je ne le crains pas. Mais je crois que M. Molé a une voie que je crois connaitre, pour faire insérer de temps en temps, dans ce Journal, quelque article qui le serve comme il l’a fait pour la visite de Champlatreux. La plupart des journaux sont aujourd’hui des magasins où l’on achète un article. Certains acheteurs payent plus cher que d’autres, et ne peuvent entrer que rarement. Mais pourvu qu’ils en disent tant, et pas trop souvent, on les écoute. Si l’opposition savait son métier comme elle exploiterait l’abandon du procès Chaltas ! Mais elle est bête et subalterne. Elle ne sait pas, et n’ose pas. Je n’en persiste pas moins à penser qu’au dehors, on est embarrassé de cette affaire, & bien aise qu’elle ne soit pas poussée à bout. Je ne trouve pas l’article Hollandais bien fin ni bien fier. Les républiques anciennes auraient mieux répondu. Je ne suis pas républicain, ni vous non plus.
Mais avez-vous lu, vraiment lu Thucydide et Tacite, Démosthène, et Cicéron ? Ce sont les esprits qui vous vont le mieux, hauts et naturels, dignes et dégagés, sensés et élégants, et ce je ne sais quoi d’achevé que la perfection du langage donne à la pensée. Vos grandes pensées vaudront les leurs, mais pas mieux, je vous en prévient. Occupez-vous en un peu quoiqu’on dise. Voulez-vous que je fasse porter chez vous une traduction passable de Tacite. Que je voudrais vous tire tout cela moi-même ! Nous nous sommes rencontrés tard. L’eau court vite. Bien peu de place nous reste pour tout ce que j’y voudrais mettre. Le bonheur possible et point réalisé, vu et point atteint, est un des plus pénibles sentiments que je connaisse. Je vous quitte pour ce soir. Je n’ai pas encore regagné tout mon sommeil.
Lundi 20 8 heures
En rangeant, mes papiers, je viens de relire, le N°104. Je ne suis pas décidé à le bruler. Il y a du bien mauvais. Mais tout n’est pas mauvais ; et dans le mauvais même, il y a du bon, ne pouvant les séparer, j’ai envie de garder tout, pêle- mêle. Je voudrais bien n’avoir pas d’autres papiers à ranger que ces numéros là. J’ai des ennuis d’affaires, des comptes à examiner, un fermier qui ne paye pas. Vous ne savez pas ce que c’est que des affaires, et j’espère que vous ne le saurez jamais quoique je vous aie vue à la veille de le trop bien savoir. Je vais à Caen dimanche 26 de grand matin. Ainsi le samedi 25 adressez-moi votre lettre à Caen, à la Préfecture. Je passerai là cing ou six jours, entre la société des Antiquaires, les courses de chevaux et mes courses à moi dans les environs. Le pays-ci est en grand progrès de civilisation. On y prend tous les goûts élégants et civilisés, les courses, les arts, les Académies, les speeches. Tout cela est amusant, à voir naître, si petit d’abord, si informé, et pourtant si animé, si avidemment destiné à grandir. Mon Lisieux vient de fermer son exposition de tableaux, plus de 250 tableaux, dessins, n’en soit de la province soit d’ailleurs. Le public normand a été très excité et charmé. Les paysans sont venus en foule voir cela. L’expositon a fini par une loterie de tableaux. On en a acheté pas mal, de côté et d’autre. On les méprisera beaucoup un jour. Mais ils auront commencé le goût et le sentiment de l’art dans toute une population.
9 h. 1/2
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. C’est la première fois que cela m’arrive cette année. C’était hier Dimanche. On aura mis votre lettre trop tard à la poste. C’est la seule explication que j’accepte. Adieu. J’aime mieux me taire.
Mots-clés : histoire, Littérature, Politique (France), Portrait (Dorothée), Presse, Progrès
115. Paris, Samedi 25 août 1838,Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous me dites toujours des choses qui me plaisent, et votre manière de m'indiquer mes défauts est la flatterie la plus agréable du monde. Vous avez raison dans tout ce que vous pensez de moi. Je ne vois pas beaucoup d'espoir de me corriger. Il me faudrait un peu de bonheur, un peu de stabilité d’établissement. Quand j'avais tout cela j’étais beaucoup plus susceptible d'occupation sérieuse, soutenue. Aujourd’hui je ne me sens plus capable de rien, plus de gout pour rien. J’ai été vraiment malade hier. J’ai voulu braver ce malaise, j’ai été à Longchamp. J'ai marché. Le soir j’ai été faire quelques visites et enfin arrivée à la porte de la marquise Durazzo, je me suis tout-à-fait trouvée mal. On m’a porté chez elle. J’ai eu presque un évanouisse ment. Je suis revenue à l’aide de cela. Je suis un peu mieux ce matin, mais pas bien encore. J'ai beaucoup maigri ces jours derniers. Cela va et vient avec une rapidité extraordinaire. Votre mal de dent me fait beaucoup souffrir, car c’est une horreur. Je suis tourmentée d'une dent aussi, & je vais courir ce matin chez mon dentiste, je l'ai manqué hier. Prenez garde à tout ce que vous allez faire ; des courses, des banquets au milieu d'une rage de dent, c’est affreux.
J’étais à Longchamp hier & javais chez moi M. & Mme Appony lorsque Henri Greville est venue au galop m' annoncer la venue du Comte de Paris, car le canon ne nous arrive pas à Longchamp. Appony est bien vite parti et il est arrivé un peu tard pour la convocation du corps diplomatique. La maréchale Loban a montré l’enfant aux deux mondes rassemblés. On dit qu'il a l’air fort et sain. Il dormait. La Reine avait l'air comblée de bonheur, le duc d’Orléans aussi. Je vous conte ce que disait le ministre du Portugal hier au soir chez Palmella, où je fus faire visite aussi. J'ai oublié de vous dire hier que j’ai reçu une longue lettre & M. Ellice. Je l'ai envoyée à Lady Granville. Cette lettre est intéressante mais il n’y a rien de nouveau. Le ministère très affaibli par les discussions sur le Canada. Lord Durham et son conseil des écoliers en loi ; son ordonnance n'était pas soutenable. Cependant les autres actes de son administration sont excellents. S’il se fâche et il est très populaire. qu'il revienne, le ministère est infailliblement renversé. On espère qu'il restera, mais on sera fort inquiet jus qu'à ce qu'on l’apprenne. Voilà à peu près la longue lettre. Melbourne & John Russell très amis, le reste incapable.
1 heure.
J’ai fait prier M. Génie de passer chez moi ce matin. Il est venu, et il m'a promis tout ce qu'il me fallait. J’ai fait visite à mon dentiste, il est aux eaux. J'ai été chercher un français. Ah comme il est français. Rappelez moi de vous raconter notre dialogue. Vous en rirez. Il fait froid, il fait laid. Soignez-vous, écrivez-moi. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Politique (Angleterre), Politique (France), Santé (Dorothée)
114. Caen, Mardi 28 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non, je ne suis pas mécontent. Non, vous ne me fatiguez, vous ne me fatiguez jamais. Mon affection n’est pas à la merci de ces vicissitudes de l’âme. Et puis, je trouve votre tristesse si naturelle. Certainement, vous avez trop perdue vous êtes bien seule, seule par ce qui vous reste comme par ce qui vous a été enlevé. Vous ne savez pas tout, ce que je ressens pour vous de tendre compassion, combien votre isolement m’occupe et me pèse. Je voudrais voir auprès de vous les fils que vous avez encore, vous voir avec eux un home. Avez-vous des nouvelles d’Alexandre ? Mais ne craignez jamais, quand cela vous soulagera, de me montrer votre tristesse. Vous m’avez blessé quelques fois dans notre vie. Je crois que vous ne me blesserez plus. Merci de vos détails. Ces couches font un grand effet dans le pays. J’ai vu plus d’une fois ces effets là. Ils ne suffisent pas aux gouvernements, et ne les dispensent de rien. Mais ils rendent la bonne conduite plus facile et plus profitable à ceux qui savent se bien conduire. Nous avons aujourd’hui, une course spéciale, instituée hier en l’honneur du Comte de Paris.
Le soleil est magnifique. Décidément il m’accompagne. J’ai eu hier avec mes Antiquaires, une soirée brillante. 1500 personnes étaient entrées dans une salle qui en contient 1200. On a cassé des carreaux de vitre pour entendre du dehors. Ce que j’ai dit a été bien reçu. La gauche, même la plus vive, avait évidemment pris son parti d’être bien pour moi. Je connais ces alternatives là.
Je regrette que Pahlen ne vous ait rien apporté de plus. J’avais espéré d’un peu meilleures paroles. J’ai tort de dire que j’avais espéré. Mon instinct espérait, ma raison non. Quel monde que le vôtre ! Point d’âme dans les uns, point d’esprit dans les autres. Ceux qui vous ont aimée autre fois ne s’en souviennent pas plus que s’ils ne vous avaient jamais connue. Ceux qui vous aiment ne savent pas vous servir. L’occident a bien ses défauts, et je les lui ai dits souvent ; mais votre Orient ! Je plains le soleil de le trouver le premier sur son chemin. Adieu.
J’ai ma toilette à faire, des visites à recevoir la course à voir. Je vais dîner à la campagne. Je mène ici une vie très active. Je suis fâchée d’abréger mes lettres surtout quand les vôtres sont tristes. Qu’il y ait au moins dans votre cœur un coin tranquille et doux, et point solitaire. Adieu. Adieu. Mon mal de dents est à peu près parti. G.
119. Paris, Mercredi 29 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Les journaux que je viens de lire à ma toilette m’annoncent qu'il faut vous écrire de très bonne heure aujourd’hui. Je me presse donc de vous dire deux mots car voici le moment où ma lettre doit partir, midi, je vous remercie de la vôtre. Vous ne m'avez jamais donné un mauvais moment. Tout ce que vous me dites est si bon si affectueux, si tendre. Je veux le mériter, je le mérite car j’ai le cœur si reconnaissant, si plus d’affection. Mon fils n’est pas venu encore. Il m'écrivait cependant de Marseille du 24. Il ne peut par tarder. Je n’ai vu hier qu'Appony revenant de notre danse. Il m’a dit que le Roi en entrant était pâle, ému ou en colère. Il opinait pour la colère. et je vois dans le journal des Débats de ce matin que ce pouvait bien être du discours de l’archevêque. Du reste tout s’est bien passé ; mais mon Ambassadeur seul n’a pas voulu se mettre à genoux. Cela me surprend, parce qui cela ne lui ressemble pas. Je parie qu’étant fort serré en uniforme il aura craint quelque accident de toilette. Il est venu hier deux fois chez moi sans me trouver. Je me suis fait traîner en calèche, pas de Longchamp. Il m'ennuie. Tout m’ennuie, & je suis souffrante. Je ne mange pas. Je dors mal, j’étouffe de je ne sais quoi. Lady Granville m’écrit maintenant tous les deux jours, des lettres impayables. Je ne suis pas si gaie qu’elle ! Adieu. Voici une misérable lettre, mais vous sériez fâchée j’espère si elle ne venait pas ? Adieu. Adieu mille fois.
115. Caen, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars dans une heure pour aller passer la journée à 7 lieues d’ici, chez M. de Tilly. J’y coucherai .Je donnerai demain à deux de ses voisins, M. de Lacour et M. Turgot. Je ne serai de retour à Caen qu’après demain matin. Dans ce vagabondage, je crains de ne pas tomber juste demain, sur l’heure du courrier. Le service des campagnes n’est pas toujours bien exact, et ils n’y mettent pas tous le même intérêt que moi, si une lettre retardait où manquait soyez sûre que je n’ai ni le bras cassé, ni le cœur négligent. J’aurai, moi, votre lettre d’aujourd’hui ; mais celle de demain, je ne la trouverai qu’en revenant. Je ne veux pas qu’elle se perde à courir après moi. Ces courses m’ennuient fort. Enfin, j’en serai quitte samedi.
On m’a mené hier voir un magnifique établissement, créé à force de zèle pieux et d’habileté par un homme qui n’avait pas 500 louis en commençant, et qui y a dépensé près de deux millions. C’est une grande maison de fous, la meilleure œuvre, et le plus triste spectacle du monde. Un édifice immense, un ameublement bien tenu, un ordre parfait, une propreté admirable ; et au milieu de ce chef d’oeuvre de l’intelligence humaine, 5 à 600 fous ou folles errants ou accroupis, criants ou taciturnes ; gardés et soignés par 97 religieuses qu’ils maudissent et injurient sans cesse. Le bien et le mal à cet excès là et se touchant de si près mettent l’âme dans un grand malaise. Notre course en l’honneur du Comte de Paris a eu grand succès malgré l’humeur des Carlistes qui ont fait, dans le Comité des Courses ce qu’ils ont pu pour la faire échouer. Habituellement les deux partis vivent ici en grande paix se rencontrant volontiers sur les terrains neutres et traitant ensemble de bon accord des intérêts ou des plaisirs du pays. Puis survient une circonstance où ils se retrouvent absolument les mêmes. A la vérité cela aboutit à de pures taquineries qui ne dépassent même guère les paroles. Les vieilles passions se payent de bien petites satisfactions. L’archevêque prend le bon parti et ne le soutiendra pas. Celui-là aussi est un petit esprit, décidé chaque jour par de petits motifs, et incapable de résister aux fantaisies qui l’entourent.
Si vous n’avez pas encore écrit à M. Ellice, voulez- vous lui demander s’il pourrait me procurer une lettre de l’écriture de M. Pitt et une de Lord Chatam, son père ? J’en ai envie. Je ne fais pas grand cas des collections d’autographes pèle-mêle. Mais, puisque j’en ai quelques uns je veux y ajouter les noms que j’estime et qui me plaisent. Adieu. Je vis avec votre tristesse. Sans lui rien reprocher ; je la trouve si légitime ! Vous ne me dites pas, dans le N°117, comment vous êtes physiquement. Adieu. J’ai de bonnes nouvelles de mes enfants. G.
120. Paris, Jeudi 30 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ce n’est que ce matin que mon fils est arrivé. Il vient pour une raison toute opposée à celle que je supposais. Son mariage est rompu. J’avais insisté pour que les fils fussent protestants. Elle ne l’a point voulu. Mon fils a été si chagriné de tout cela qu'il est parti sur l’heure ; il vient passer quinze jours avec moi. Ce sera quinze jours de bonheur. J’ai été parfaitement malade hier tout le jour. J’ai été encore faire visite hier à Madame, je l’ai trouvée mais j’étais déjà si souffrante que je sais à peine comment cela s’est passé. Je suis rentrée pour ne plus bouger. Je n’ai vu personne que mon médecin. J'ai des crampes abominables qui font que je ne puis rien manger du tout. Vous ne vous attendrez pas avec cela que j’engraisse. Il faut me résigner. Je me soigne. Le temps est abominable. Il fait froid aujourd’hui comme au mois de février.
La Duchesse de Talleyrand arrive demain, à ce que m’a dit Madame. Elle a des affaires pressantes importantes. On dit que son mari lui dispute la tutelle de sa fille, & qu'aux termes de la loi il a raison. Vous voyez que vous jugez bien en me parlant de l’archevêque. Son discours au Roi n'était pas du tout ce qu’il devait être. Je pense qu’on est très fâchée contre lui. J'écris à mon mari et à mon frère. A l’un et à l’autre je promets d’aller en Angleterre en juin. Pardonnez-moi si je vous quitte, je vous assure que je suis tout à fait malade. Je n'ai la force de rien faire. Adieu. Adieu. Avez-vous lu le discours de Berryer à des écoliers je ne sais où ? Il leur recommande beaucoup le latin & le grec. Adieu.
Remerciez je vous en prie M. Génie, on n’a pas dit un mot de moi.
Mots-clés : Politique (France), Santé (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
117. Caen, Samedi 1er septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous allons rentrer dans toute la régularité de nos habitudes. Il vous aura manqué une lettre. J’attendais les vôtres sans savoir à quelle heure elles viendraient. Physiquement aussi, je suis bien aise de rentrer chez moi. Cette vie de banquets, de courses, de bavardage incessant, commence à me fatiguer. Elle ne m’a jamais plu. Pour que je m’arrange du monde, il faut que les affaires ou ses agréments vaillent la peine que je prends pour lui. Vous avez votre fils. Je regrette de ne pas le voir. Vous me direz s’il a bien du chagrin de la rupture de son mariage. Mlle de T. ne le désirait donc pas bien vivement. Vous avez, je crois, bien fait d’insister. Il faut beaucoup d’amour et une grande supériorité d’esprit pour que la différence de religion, quand l’un et l’autre y tiennent, ne devienne pas, dans le cours de la vie une vraie peine. A-t-il renoncé à tout espoir ? Il me semble aussi que dans son pays même son père à part, l’abandon de tous ses enfants au catholicisme lui ferait grand tort.
Je compte trouver une lettre au Val Richer. Elle me dira si vous êtes toujours aussi souffrante. Mandez- moi avec détail ce que dit Chemside. Je ne comprends pas votre abominable temps. Ici, il fait très beau, frais, mais point froid. Vous avez bien tort de ne pas venir en Normandie. Où avez-vous logé votre fils ? Se promène-t-il habituellement avec vous ? J’étais sûr que l’archevêque ferait ce qu’il a fait. Je trouve du reste qu’on l’a pris bien vivement. Il y avait des façons moins brutales que l’article des Débats pour lui faire sentir l’inconvenance de son discours. Inconvenance à laquelle on devait s’attendre ; comment veut-on qu’un archevêque, et surtout celui-là, ne laisse pas percer quelque humeur des nouveaux échecs que reçoit de notre temps l’unité de la foi.
M. Molé n’était pas auprès du Roi, aux Tuileries, le jour où il a reçu les députés. Ils en ont été très choqués. On m’écrit que la tête lui tourne un peu. Champlâtreux n’est pourtant pas un bien grand verre de vie. La médaille est de trop. C’est encore plus que le tableau. On ne viendra pas à bout de notre temps, de faire de grands événements avec de petits incidents. Il ne faut pas les traiter de la même façon. M. Dupin n’est pas venu aux couches parce qu’on ne l’avait pas pris pour témoin. Je ne saurais dire combien cet abandon de cette pauvre Princesse tout de suite après ses couches, m’a frappé. Voilà bien les entraînements, les oublis, les distractions des cours. Pour tous ceux qui étaient là, le monde entier avait disparu devant ce petit garçon. Et si elle était morte ! Quel tableau eût fait de cette scène M de St. Simon ! Donnez-moi quelque nouvelle de l’affaire suisse. Il me paraît que Louis Buonaparte ne s’en va pas de lui-même. Cela peut devenir embarrassant. Adieu.
Je vais déjeuner et monter en voiture. Je traverserai une très belle vallée sous un très beau soleil, par une très belle route. Vous me manquerez infiniment. Si je parlais la langue de Pétrarque, je vous dirais que dès qu’il s’élève dans mon âme une impression douce, elle me quitte et va vous chercher Si elle vous trouve elle me revient. si elle ne vous trouve pas, elle me quitte tout-à-fait. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Enfants (Benckendorff), Politique (France), Religion, Vie familiale (Dorothée)
123. Paris, Dimanche 2 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre lettre reçue ce matin ; elle était bonne et intime. Je vais répondre à vos questions. Mon fils a beaucoup de chagrin de la rupture de son mariage. Il dit que la jeune personne a pour lui un amour très visible mais qu’elle a plus d’amour ou de crainte pour sa religion. Son oncle Acton qui va être fait cardinal exerce sur son esprit un grand empire. Elle croit ne pas pouvoir sauver son âme si ses petits garçons sont protestants. Mon fils est parti très brusquement après qu’elle lui a déclaré sa résolution ; il ne souffre, mais il espère encore. Il loge dans la maison à côté de Flahaut un appartement charmant que je lui ai trouvé. Il m’accompagne dans toutes mes promenades. Nous allons presque tous les jours à St Cloud. Longchamp depuis votre départ m’a paru bien ennuyeux.
Tout le monde parle de l’affaire de la Suisse sans comprendre comment elle finira. Louis Bonaparte y reste, cela est sûr. Pour le moment je pense que le rappel de l'Ambassadeur sera la seule mesure qu'on prendra, mais c’est peu de chose. Nous nous retirerons peut-être aussi tous les trois, mais les Suisses s’en consoleront. On s’étonne un peu que la Russie ait si vite et si fermement soutenue là dedans votre gouvernement. Mais c’est que, à part les caresses, vous nous trouverez peut-être meilleurs collègues que tous les autres. L’Empereur évite tout ce qui peut vous donner ombrage. Par exemple il n'a jamais reçu chez lui à Toplitz La Feronnays ou Marmont. Il ne les a vus qu'à leur promenade publique. Il a toujours beaucoup aimé M. de La Ferronays. M de Stakelberg a donné hier à dîner à mon fils qui a longtemps servi sous ses ordres. J’y ai dîné aussi & mon Ambassadeur & Médem. De là j'ai été à Auteuil. J’y ai trouvé M. Molé très entouré de la diplomatie. Il me dit qu’il est plus que jamais accablé de travail. Il a pris l’intérieur dans l'absence de M. de Montalivet. Il y avait hier plus de monde que de coutume à Auteuil. On ne sait pas où est l’Empereur de Russie dans ce moment. Il est attendu partout, et il ne parait nulle part. Le 15 Septembre lui & l’Impératrice seront. à Berlin.
Les derniers mots de votre lettre me plaisent et me font du bien. J'ai l’âme un peu moins triste depuis l'arrivée de mon fils, mais toujours ce silence inexpliqué de mon mari me donne beaucoup de chagrin. Je ne sais que penser, et l’avenir me parait abominable. Mon fils aîné me mande que si sa situation secondaire doit se prolonger il quittera le service, & pour ce cas l'idée de venir vivre auprès de moi est ce qui la donne le plus de plaisir. Adieu. Adieu. Adieu, trouvez-vous que c'est assez ? Par moi.
124. Val-Richer, Samedi 8 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous dites bien vrai. Cinq minutes d’entretien valent mieux que dix lettres. Quelque fois pourtant il y a quelque avantage à se parler de loin de près, on ne se dit pas toujours tout. On garde certaines choses sur le cœur, ce qu’il ne faut jamais. Bien peu, bien peu de relations sont dignes et en état de supporter la vérité. Mais celles qui le peuvent devraient toujours, et à toute minute, l’accueillir toute entière. En définitive elles y gagnent. Je laisse la aussi, le sujet de Baden, mais à condition que vous ferez comme moi, que vous ne garderez rien, sur le cœur absolument, rien.
Je devine je crois votre impression sur Versailles et n’en suis pas étonné. Mais soyez sûre de deux choses, l’une que c’était le seul moyen de conserver le château, l’autre, que cela a fort réussi dans le public, qu’il prend plaisir à ce grand Capharnaüm de l’histoire de France, vieille et nouvelle, et qu’il en reçoit une leçon de modération et d’impartialité. Pratiquement donc cela est bien et utile. Montant plus haut, et ne se souciant de rien ni de personne, il y a beaucoup de vrai dans votre impression.
Je commence réellement à être un peu occupé de l’affaire de Suisse. Cependant je crois comme vous, qu’il n’en sortira rien que du ridicule. Rien, c’est la passion du temps. Mais si l’affaire n’est pas finie au moment de la session de manière ou d’autre, la discussion sera désagréable pour le Cabinet.
J’ai M. et Mad. Lenormant depuis deux jours. Ils partent aujourd’hui. Ils ont amené leurs trois enfants qui joints aux trois miens, font un grand bruit dans le tranquille Val-Richer. J’ai été consterné hier matin, en voyant tomber des torrents de pluie noire. La journée est longue quand on ne peut pas promener ses hôtes. Mais à midi, il ne pleuvait plus. J’ai conseillé de braver les nuages et notre courage a été récompensé. Le soleil est venu. Le terrain que j’ai choisi n’était pas trop mouillé. Nous avons fait une agréable promenade. Il n’y a rien eu ici avant- hier qui ressemble à votre orage.
On me dit que M. de Châteaubriand est revenu très frappé de l’état du midi de la décadence du Carlisme, et des progrès de l’esprit nouveau. Il vient d’écrire à Melle de Fontanes, une longue lettre très agréable, dit-on, sur le souvenir et le talent de son père. Cette lettre doit servir de Préface aux œuvres de M. de Fontanes que sa fille va publier. Je n’accepte pas votre envie. Oui, nous sommes des êtres, horriblement jaloux, mais non pour toutes choses, ni de tous. Je ne porte pas, la moindre envie aux possesseurs de parcs et de châteaux qui ne sont pas à moi. Je suis charmé qu’ils les aient et qu’ils en jouissent, et il ne m’est jamais entré, dans l’âme, à leur sujet, le plus léger sentiment d’amertume ou de tristesse. Seulement le plaisir d’y regarder s’use vite pour moi, parce que je n’y porte pas non plus cet inépuisable intérêt très naturel et très légitime, qui s’attache, pour chacun de nous à notre propre existence et à tout ce qui y tient de près ou de loin. Il y a, dans l’égoïsme, comme dans tous les sentiments naturels et universels, une part très légitime, juste en soi et nécessaire à la marche du monde. Il faut accepter hautement cette part là en lui assignant sa limite.
La Duchesse de Talleyrand revient-elle décidément ? Je suppose que le Duc de Noailles est retourné à Maintenon. Pour vous, vous y avez tout à fait renoncé, n’est-ce pas ? On me dit que Mad. Pasquier va tout à fait mourir. Je penche fort à croire que le Chancelier finira par épouser Mad. de Boigne ; et à mon avis, ils auront raison tous les deux. Ils finiront doucement leur vie ensemble sans avoir la peine d’aller se chercher deux ou trois fois, par jour. 10 h. Adieu. Adieu. Et ni Madame, ni morale. Adieu. J’avais eu la même idée sur Marie. Elle n’avait fait que me traverser l’esprit ; mais je l’avais eue, tant je trouvais cela fou. Adieu. G.
125. Val-Richer Dimanche, 9 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
La pluie a cessé. Le soleil se lève très beau. Je ne puis souffrir ces brusques alternatives. Je veux avoir devant moi un long temps égal, uniforme. J’ai toujours trouvé le bonheur ancien supérieur, au bonheur nouveau. Ce qui me plaît vraiment ne s’use jamais pour moi. J’y découvre au contraire chaque jour un nouveau mérite et un nouveau plaisir. Je me rappelle l’été de 1811 de la grande comète. Le soleil a été plus de deux mois brillant et chaud, sans interruption. Tout le monde en était las. J’en étais de plus en plus ravi. Et quand la pluie, le ciel sombre sont revenus, j’ai été triste comme d’une décadence, comme d’un deuil. Tout ce qui passe est si court, dit St Augustin. Comment l’abréger encore par la mobilité de nos désirs ?
Ne prenez pas ceci pour une personnalité. Je ne vous trouve point mobile du tout. Vos impressions du moment de la surface sont mobiles ; mais le fond de votre âme est très solide parce qu’il est très profond. C’est par la profondeur de vos sentiments que vous m’avez frappé et touché. Je pense à Marie. Faites y attention. Il y a à parier que la princesse de Schönburg a raison. C’est trop étrange. dès que vous aurez Lady Granville, tenez conseil. Et si la délibération du conseil est conforme à l’avis de la petite Princesse ayez sans doute tous les ménagements possibles ; mais ne tardez pas trop à prendre une résolution. Vous ne pouvez en conscience charger de plus votre vie d’une folle. Pauvre enfant ! J’espère encore qu’il n’en sera rien. Mais s’il y a quelque chose, ce n’est pas près de vous qu’elle se guérira. Elle y manque à la fois de sérénité et de mouvement. Elle s’agite et s’ennuie. Mauvaise condition à tout âge, encore plus dans la jeunesse.
Je suis charmé que Lady Holland, Lady Granville. et tout ce monde dont vous me parlez reviennent. Cela vous distraira l’une et l’autre, et l’une de l’autre. Que devient l’affaire du Roi de Hanovre ? Est-ce que celle-là s’en ira aussi en fumée comme les autres ? Que veut dire cette apathie, cette impuissance universelle ! Est-ce un monde fatigué qui se remet, ou un monde usé qui s’affaisse ? J’ai cru. je crois toujours à la première explication. Mais il faut de temps en temps quelque grand événement, quelque voix bien haute pour secouer cette torpeur, et interrompre la prescription de la vie. Rien ne paraît.
Je ris de moi-même en écrivant cela. Que la préoccupation de l’égoïsme est forte ! Il y a à peine huit ans que nous avons ébranlé le monde. Il n’y a pas trois ans que nous sommes sortis, nous autres Français d’une lutte intérieure terrible qui a duré cinq ans. Et nous nous plaignons de l’apathie ! Nous trouvons l’entracte bien long ? S’il m’arrive d’oublier ainsi les choses, à cause de moi, de ne pas juger mes impressions et mes désirs personnels, rappelez-moi à l’ordre, je vous prie. Je veux surtout être juste et sensé.
9. 1/2
Cela ne se peut pas. Il ne peut pas y avoir une phrase froide, ni à la fin, ni au commencement, ni nulle part. Je vous ai écrit très triste, très jaloux, mais triste, mais jaloux par une tendresse infinie, insatiable, désolée de ne pas tout pouvoir, de ne pas tout avoir. Que mes paroles sentissent l’effort ; qu’elles fussent pénibles, raides, cela se peut ; mais ce que vous dites est impossible. Je veux savoir qu’elle est cette phrase. Je suis sûr que vous vous êtes trompée. Je ne l’en efface pas moins puisqu’elle vous a affligée. Il m’arrivera peut-être encore de vous affliger. Quand il m’en viendra du chagrin de vous, je ne vous promets pas de ne pas vous en rendre. Mais jamais ce chagrin-là, jamais. N’est-ce pas que vous ne l’avez plus, que vous n’y pensez plus, que vous n’avez plus froid ? Dites-le moi ; redites. le moi. Que d’Adieux. Je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant, cette lettre. Adieu dearest, adieu. G.
Quand je dis que je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant cette lettre ce n’est pas de celle-ci, c’est de l’autre que je parle, de celle où vous dites qu’il y a une mauvaise phrase. Renvoyez-moi la phrase. Je l’ai sur le cœur, mais je n’y crois pas.
127. Val-Richer, Mardi 11 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement l’état de Marie n’est pas naturel. Regardez-y bien et prenez les arrangements, convenables. Je suis préoccupé pour vous de cet ennui nouveau, qui peut- être aussi un trouble. Il est bon qu’elle vous quitte pour quelque temps. La Duchesse de Talleyrand est assez propre, avec son air féroce, à lui imposer une contrainte sanitaire. J’attends impatiemment le résultat de vos délibérations avec Lady Granville. J’ai bien envie d’être jaloux d’elle. Quoique jaloux, je suis charmé de son retour. Elle vous est aussi utile qu’agréable, de bon conseil et de doux passe-temps. Nous avons raison de tenir au Cabinet Whig. Du reste, j’espère qu’il tiendra. Avez-vous lu sur son compte et sur la dernière session du Parlement, un article assez intéressant de M. Duvergier de Hauranne dans la Revue française qui vient de paraître ? Qui dit-on des démentis de M. Molé au général Bugrand ? L’opposition a bien peu d’esprit. C’est la légèreté de M. Molé qu’il faudrait poursuivre. Evidemment, il a dit au général Bugrand ce que celui-ci a répété. Ce n’est que cela ; mais c’est bien quelque chose. Evidemment l’affaire suisse va tomber dans l’eau. La suisse prend son temps pour faire une platitude. On a fait de tous temps des platitudes, mais autrefois, elles n’étaient pas précédées de ces éclats publics de ces fanfaronnades qui sans les empêcher aujourd’hui, les rendent parfaitement ridicules. A la vérité, il n’y a plus de ridicule ; nous en avons perdu la liberté et presque le sentiment. Depuis que le genre humain tout entier est en scène, on n’ose plus se moquer de personne.
Vous vous seriez moquée de moi hier si vous aviez eu avec quelle prolixité, quelle gravité je discutais avec les autorités de St Ouen, la question d’un bout de chemin vicinal que je veux échanger contre un autre. Vous vous sentez un peu jalouse du Val Richer. Vous avez bien tort. Je fais de mon mieux pour prendre intérêt à tout cela. J’y donne du temps, de l’attention. Je m’occupe sérieusement d’une plantation, d’un vase, d’un meuble d’une gravure. Je n’y ai point mauvaise grâce, je vous assure, et les assistants me savent, je crois, très bon gré de mon empressement et de mon plaisir.
Mais au fait tout cela est parfaitement superficiel tout cela ne m’occupe, ni ne m’amuse ; mon temps est plein mais rien que mon temps ; et quand je rentre dans mon Cabinet, je ne retrouve dans ma pensée à peu près rien de ce qui a rempli ma journée. Je ne puis me soucier vraiment et m’occuper sérieusement que de trois choses, les gens que j’aime, les affaires publiques, et les questions religieuses. Je comprends qu’on se donne tout entier à une personne, à la politique, ou à Dieu. Le reste n’en vaut pas la peine.
Je suis bien aise que vous ayez causé à fond avec Médem. Il faut qu’une fois au moins un homme d’esprit dise votre position ici et comment vous vivez. Si de l’autre côté, il y avait aussi un vrai homme d’esprit, rien de tout ce qui vous arrive, n’arriverait. Vous avez bien raison. Toutes les fois que deux hommes d’esprit se voient, ils se séparent contents l’un de l’autre. M. de Metternich et Thiers ont dû s’amuser beaucoup. Thiers fait profession d’être absorbé dans l’histoire de Florence.
10 heures
La phrase me déplaît aussi. Merci de me la pardonner. Un seul mot pourtant, pour excuser. Je ne veux, je ne puis penser à moi, à mon bonheur, à mon plaisir et y subordonner toutes choses, que si je suis pour vous tout ce que je veux être. A cette seule condition, je vous garde à tout prix. Si cela n’était pas, je ne penserais plus qu’à vous, aux intérêts et aux convenances de votre avenir, de votre avenir à vous seule. Voilà mon sentiment quand j’ai écrit cette phrase. Pardonnez-la moi encore ; mais ne dites pas qu’il y a de la glace dessous. G.
128. Val-Richer, Mercredi 12 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis réveillé à 4 heures, et ne me rendormant pas, en quoi vous étiez bien pour quelque chose, je me suis mis à travailler dans mon lit ; toujours mon histoire de France pour mes enfants qui est devenue un véritable intérêt et une occupation assidue. A six heures et demie, le sommeil m’a repris, et je me lève tard, malgré ce beau soleil qui s’étonne et m’accuse. Depuis quelque temps, nous nous levons ensemble.
Vous avez donc été à Châtenay sans moi, avec un ancien amoureux, qui l’est encore. Et vous êtes revenus tous deux bien transis. A la bonne heure. Quand vous y retournerez, la semaine prochaine, il fera encore plus froid. Enveloppez-vous bien. Vous avez un singulier mélange de précaution et d’imprévoyance. Vous quittez et reprenez sans cesse vos précautions, ce qui fait qu’il y en a toujours trop ou trop peu. Il n’y a pas moyen d’ouvrir et de fermer si souvent les portes et de n’avoir jamais de vent coulis. Je ne m’étonne pas du bruit de l’ukase. Outre le despotisme, c’est du despotisme suranné et qui est devenu ridicule. En ceci comme en tout, il faut un peu d’invention, prendre un peu de peine. On n’y peut pas faire sans façon tout ce qu’on veut, la première idée venue.
Je crois que M. de Pahlen aurait tort de démentir sans être bien sûr de son fait. Il est lui un galant homme et qui se respecte. Il ne lui serait pas indifférent de n’avoir pas dit vrai, ou de n’avoir pas su ce qui était vrai. Et puis c’est une étrange manière de gouverner que de n’informer de rien les agents, de ne pas plus compter avec eux, qu’avec ses sujets. Comment veut-on qu’ils fassent et qu’ils servent surtout dans les pays où on parle de tout, et où il faut avoir au moins l’air de tout savoir ?
Sur le procès du général Brossard, j’ai deux visages, l’un qui pleure, l’autre qui rit. Mon pauvre ami Bugeaud s’est conduit là, avec son esprit grossier et sa probité plus vraie que délicate. Je l’y reconnais bien et j’en suis fâché. Je vous ai dit hier mon impression quant à M. Molé. Je m’afflige moins de ce qui la prouve et la répand. A la légèreté j’ajoute la promptitude à abandonner ses agents. Singulier homme de gouvernement ! Incapable de suffire à la moindre difficulté sérieuse, mais très propre à pallier l’étourderie et la faiblesse ; frivole et poltron en fait, mais grave et digne en apparence. Il a son moment.
Vous voulez que je vous dise souvent que je vous aime. Je voudrais vous le lire toujours. C’est mon chagrin de ne pas le pouvoir. Je mourrai avec l’amer regret de ne vous avoir pas donné, montré toute ma tendresse, de n’avoir pas rempli toute votre âme, embaume toute votre vie de cette joie profonde et douce, solide et charmante que répand incessamment un amour vrai, le vrai amour. Je l’ai en moi pour vous. Je vous crois, je vous sais capable et d’en jouir et de le sentir. Je crois qu’il y a en vous des trésors à vous-même inconnus de bonheur et de tendresse. Je suis sûr que j’ai en moi de quoi vous plaire et vous rendre heureuse bien au delà de notre imagination à tous les deux, car la réalité, quand elle est belle, est supérieure à notre imagination de toute la supériorité de l’œuvre divine sur la pensée humaine. Je sais tout cela, et cela n’est pas, cela ne sera pas. J’aurai, pour vous des joies que je ne vous donnerai pas ; j’en attendrai de vous que je ne recevrai par. Je vous verrai des peines que je ne guérirai pas. Je tiendrai dans mes mains le manteau de Raleigh, et je ne pourrai pas l’étendre toujours devant vos pas. J’ai accepté, j’accepte de bonne grâce l’imperfection la médiocrité, la pauvreté de la vie et des relations humaines. Avec vous je ne l’accepterai jamais.
10 heures
Vous avez raison. Voilà un Numéro 132 bien shabby. J’avais envie de toute autre chose aujourd’hui. Adieu pourtant. Je vous rends votre adieu. C’est ce qu’il y a de mieux dans la lettre. Si Marie n’est pas folle, cela ne vaut pas mieux pour vous et au lien d’avoir pitié d’elle, je suis tenté d’en avoir pour vous.
130. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de votre Gazette. Je vous aime mieux vous que les nouvelles. Mais j’aime les nouvelles. Quand elles remplissent vos lettre, il me semble qu’elles ont rempli aussi votre temps. Je me trompe. Il faudrait des tas de nouvelles et des plus grandes, pour remplir le temps quand le cœur est triste ! Et encore ! Mais n’importe ; cela me semble ainsi, et ce semblant me plaît. Nous sommes si disposés à nous payer d’apparences. Ne tenez pourtant pas à votre projet de ne me parler que de nouvelles. Je veux savoir ce qui se passe ailleurs que dans le monde. Ne craignez pas les malentendus les mauvaises phrases. Entre nous, les réticences seraient bien pires. Il n’en faut point, même de loin.
A propos de nouvelles donnez-m’en du petit Lord Coke. Je m’intéresse à cet enfant. Il avait l’air si isolé avec une figure si ouverte et si gaie ! J’espère qu’il va bien. Le précepteur s’est-il animé un peu ? Si l’affaire du roi de Hanovre finit comme vous le dîtes, les Allemands diètes et peuples, baisseront beaucoup dans mon esprit. Ils n’auront que ce qu’ils méritent. Il ne faut pas vouloir, ce qu’on ne sait pas défendre. C’est sans doute l’influence de l’Autriche et de le Prusse qui a retourné la Diète, car elle était disposée à reconnaître sa compétence. Pour ce qui se fait en Espagne, Frias vaut Ofalie. Singulier temps que celui où les révolutions elles-mêmes sont apathiques, et vivent sans faire un pas. Que votre Empereur s’en aille d’Allemagne en emportant pour tout résultat, un Leuchtonberg pour gendre, peuples et Princes pourront adopter la même devise ; Much ade about nothing.
Je lève la tête en ce moment. Vous avez parfaitement raison. J’ai devant moi ce soleil froid, qui s’épuise à chasser du Ciel le brouillard, et n’a plus rien pour échauffer la terre. C’est du pur humbog. Pourtant je l’aime mieux que la pluie. J’assiste chaque jour à toute la vie du soleil. Je me couche et me lève de très bonne heure. Physiquement, je m’en trouve bien. Je voudrais vous envoyer un peu de mon sommeil.
Ce qui me fait grand plaisir à voir, c’est la santé de mes enfants. Ils sont à merveille, et d’un mouvement, d’un entrain d’esprit et de corps inimaginable. M. de Metternich n’a pas trouvé Thiers plus animé, que ne l’est ma petite Henriette. Je leur lis le soir l’histoire des croisades de Guillaume de Tyr. Nous venons de passer trois jours à assiéger, et à prendre Antioche. Au moment où nous y sommes entrés Henriette a jeté sa tapisserie, & ils se sont mis à courir et à sauter dans la Chambre avec des cris de joie, comme les Croisés eux-mêmes. Ce sera bien pis quand nous prendrons Jérusalem.
10 heures ¼
Le facteur arrive tard. Vous êtes bien triste. Il y a une chose que je ne vous pardonne pas, c’est de croire que vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez. Que de choses j’ai à vous dire ? Et je vous ai écrit hier que je n’irais pas à Paris ! Adieu. Ce soir, je vous écrirai longuement. J’ai là du monde. Prenez garde à Marie, je vous en conjure. Les folles qu’on ne croit pas folles me font trembler. Adieu. Adieu. J’ai le cœur plein !
138. Val-Richer, Dimanche 23 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai mal dormi. Je me lève ennuyé de ne pas dormir. Je ne veux pas que vous soyez malade. J’ai peur que la pauvre Duchesse de Broglie ne le soit beaucoup, beaucoup. Les spasmes se sont emparés d’elle. C’est son mal habituel même en santé. Elle a toujours passé la nuit à rêver, à s’agiter, assiégée par le cauchemar, et plus fatiguée, en se réveillant qu’en se couchant. Il parait qu’elle est dans un état nerveux déplorable. Le mal violent est venu à la suite d’une imprudence qu’elle a faite, il y a quinze jours se croyant débarrassée d’une petite fièvre de rhume. Elle avait faim ; elle a mangé du poulet. Cela a déterminé des accidents intestinaux qui ont bouleversé toute sa personne. On dit que, dans les meilleures chances la maladie durera au moins 40 jours. J’ai horreur de ces longues maladies, qui ne sont pas domptées dans la première semaine. Ni la force de celui qui souffre, ni la science de celui qui veut guérir, ne suffisent à une si longue carrière. Je les ai tant vues s’épuiser l’une et l’autre !
Quel abyme entre ce que nous souhaitons, et ce que nous pouvons entre l’énergie de nos sentiments et la misère de nos moyens. Je l’ai vu cet abyme ; j’y suis tombé. Je n’y puis croire. Il me semble impossible, absolument impossible que des affections si profondes, des vœux si ardents, toute l’âme attachée à une seule pensée à un seul effort, n’aient qu’une si pauvre puissance. Toute ma nature se refuse à cette cruelle conviction. Et quand je la sens venir, quand je me vois au terme du savoir et du pouvoir humain, je fais comme les plus simples, je me réfugie dans la prière, cette tentative d’attirer, par un désir immense et vrai, la force de Dieu au secours de notre faiblesse. Je ne sais ce que peut la prière ; je ne prétends pas entendre la réponse de Dieu à ce cri de l’homme. Mais que Dieu n’écoute pas, que le cri de l’homme se perde dans l’air comme le bruit du vent, que notre âme ne puisse, en faveur de ceux qu’elle aime infiniment, rien de plus que ce qui se voit ici bas, je ne le crois point, je ne le croirai jamais. Et je prierai toujours, dût ma prière échouer toujours. Je puis me soumettre aux plus terribles volontés de Dieu, non à la certitude de mon impuissance après de lui, et j’aime bien marcher dans les plus épaisses ténèbres que rester immobile avec désespoir, sûr qu’il n’y a aucun moyen d’arriver.
9 heures
Je vous ai quittée. J’étais trop triste. Avec vous, je me défends de ma tristesse. Je crains pour vous la contagion. Pardonnez moi quand je me laisse aller. Je vous aime beaucoup, & je le sens au moins autant quand je suis triste que dans mes meilleurs moments. Votre grand Duc va-t-il décidément mieux ? N’a-t-on plus de crainte ? Savez-vous qu’il est fort connu que c’est la brutale imprévoyance de son père qui a failli le tuer ? Les hôtes que j’ai ici me le disaient hier ; et ils ne le tenaient pas du tout de moi. Ils me quittent aujourd’hui, M. Duvergier de Hauranne ce matin. M. Rossi ce soir. Mes nouvelles sont que le Ministère est de nouveau sérieusement inquiet de la Suisse. Louis Buonaparte ne s’en ira pas. Le parti radical suisse et Français, avec lequel, il est en intelligence, lui défend de s’en aller. Et puis, il est sot au-delà de tout ce qui se peut imaginer. Il y a quelques année, à Florence, il envoya chercher en toute hâte un homme d’esprit que je connais voulant de lui un conseil. Il lui montra une lettre de Corse où on lui promettait 1500 hommes, s’il voulait aller les chercher, et débarquer avec eux en France. Son conseiller l’en détourna, l’assurant qu’il ne réussirait pas. " Mais pourquoi donc ? Mon oncle l’a bien fait avec la moitié. " L’avis de M. Hess de Zurich, qui veut qu’on demande à Louis B. de s’expliquer catégoriquement et de déclarer s’il est français ou suisse, pourrait bien offrir une issue. Il sera peut-être difficile à L. B. de dire officiellement et décidément qu’il n’est plus français. Je sais qu’on attend quelque chose de là. Probablement on a tort. En telle situation, le plus grossier mensonge ne coûte rien et ne fait pas grand chose, car il ne trompe personne.
9 h. 1/2
Elle est morte. Je viens de recevoir un mot de son mari. Je pars pour Broglie dans deux heures. Adieu. Adieu. G.
143. Longchamp, Dimanche 23 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis ici toute seule et bien triste. Je viens d’apprendre la mort de Mad. de Broglie. Je ne saurais vous dire ce que cela m’a fait éprouver. J’ai versé de silencieuses larmes. L'heureuse femme ! Personne n’a mieux mérité le ciel. Comme elle a été charitable, comme elle a été bonne pour moi. Je lui en ai trop peu montré ma reconnaissance. Mais il me semblait que je l'ennuyais un peu, & cette crainte a fait que je me suis approchée d’elle moins souvent que je ne le désirais. Son pauvre mari ! Quelle perte ! Je viens de sa maison où j’ai appris cette affreuse nouvelle. J’ai traversé le bois de Boulogne en pleurant. J'arrive ici je pleure, et je vous écris parce que j'ai besoin de pleurer auprès de vous.
Lundi
Je vous demande pardon de cette feuille de papier, je n’ai pas trouvé autre chose à Longchamp. Je continue. Votre lettre ce matin est aussi triste que moi. Je pensais bien hier en pleurant, que dans ce même moment vous pleuriez, et à Broglie. Restez y. Dites-moi comment est ce pauvre duc, dites-moi des détails. Je ne pense pas à autre chose. J'ai les yeux bien rouges ce matin. Hier j'ai été obligé de faire les honneurs d’un grand dîner chez M. de Pahlen. J’étais si triste que j'ai bien mal rempli mes devoirs. Le soir il m’a fallu aussi recevoir mon monde habituel. Mais à onze heures j'ai levé la séance, car je n'en pouvais plus. Il m’était venu beaucoup de monde. Ce que j’ai appris de plus nouveau c’est les dernières nouvelles que votre gouvernement a reçu sur Louis Bonaparte. Si la diète lui demande d’opter entre sa qualité de Français & de Suisse, il répondra qu’il est français, et il sortira immédiatement & spontanément de Suisse. Si cette question ne lui est pas posé, il ira établir son quartier général à Genèves. L’affaire Belge est dit-on rompue par le fait du Roi des Pays-Bas c-a-d qu’il ne veut aucune modification aux 24 articles. Ceci était un on-dit mais pas encore officiel. J'ai eu des lettres de Lord Aberdeen, & de M. Ellice. Lord Aberdeen ne comprend pas que l'Angleterre puisse éviter des discussions très sérieux avec la France au sujet du blocus en Amérique, and some procedings au the coast of Africa. Cela lui semble très grave.
Il parle du ministère anglais avec le dernier mépris et il ne croit pas possible qu'il résiste vu de que ce sentiment de mépris devient tout à fait général. Il dit aussi que depuis le protecteur Sommerset il n'y a jamais eu d'homme dans une situation pareille à celle de Lord Melbourne et que son pouvoir sur la Reine est absolu. Ellice n'attend les réponses de Lord Durham que le 8 du mois prochain. Il est d’opinion que Durham restera au Canada j'ai essayé hier de marcher, j'essaierai. encore aujourd’hui.
Mon fils Alexandre ne me reviendra que dans les premiers jours d'octobre. Marie le 7. Je passerai à la Terrasse probablement avant. Le grand duc est à Berlin. Je ne sais que ce fait. Je n’ai pas un mot de mon frère, ni de mon mari. Adieu. Je suis si accablée de cette mort. Je pense tant à cette angélique femme, à son pauvre mari, à votre chagrin car vous en avez beaucoup. Je vous aime, je vous aime de tout mon cœur. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Politique (Europe), Politique (France)
142. Paris, Dimanche 23 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ne vous inquiétez pas de moi. Je suis très faible, voilà tout. Je viens d'envoyer chercher Cheremside. Je voudrais qu’il me redonnât des forces. C'est singulier comme tout à coup elles m'ont abandonnée. M. Molé était fort tendre hier, et moi aussi. Il me reproche d'être prise & conquise, mais il s’y accoutume. Il soigne beaucoup Lord & Lady Holland. Il a pris goût à Sir George Villers qui est en effet un très aimable homme. Il n’y avait hier que mon Ambassacleur du corps diplomatique. Messieurs Pasquier, Decazes, Salvandy. Jeudi M. Molé reçoit chez lui les Holland. On s'occupait beaucoup hier de cette pauvre Duchesse de Broglie. On la dit ici plus mal que vous ne dites.
Je suis parfaitement ignorante de mon mari, les journaux allemands prétendent que mon frère n’est resté que deux heures à Weymar. Que l’Empereur l’a fait partir immédiatement en mission secrète. Cela parait incroyable à Pahlen & à moi. Il n’est pas des gens qu'on envoie, il est de ceux qui envoient les autres. Cependant son silence me ferait croire qu'il n’a pas résidé à Weymar. Et je reste sans nouvelles. On a fait venir les grandes Duchesses aînées pour les faire voir à leur grand père. Il n’y a pas une autre raison. On ne les avait pas prises dans le voyage en Allemagne tout juste pour ne point faire penser qu'on les promenait pour chercher des maris.
Je ferai votre message à Lady Holland. Ils restent ici jusqu'au commencement de Novembre. Vous pourrez donc encore les voir. Je n’ai point de nouvelles à vous dire et il me semble en même temps que je trouverais à causer avec vous aussi longuement que cause M. de Humbold vraiment les lettres sont un pitoyable moyen d'entretien. Mille petits symptômes peuvent être relevés en conversation, & ne sauraient l’être en s’écrivant, je trouve cela plus vrai tous les jours.
On croit assez généralement que Louis Bonaparte va quitter la Suisse. M Molé n’a pas l'air d'avoir le moindre souci. Il n'oublie pas qu’il est premier ministre depuis plus de deux ans. & il pense que ce qui a duré si long temps a par la même acquis des chances de plus de durer encore. Voilà Cheremside qui me quitte ; il me dit que ce n’est rien, que cela tient à mon état général, et qu’il ne veut y faire attention que si cela augmente. Vous voyez que je vous dis tout.
Adieu. Adieu. Je pense à vous sans cesse croyez le bien. Je dîne aujourd’hui chez M. de Pahlen avec toute l’Autriche, mais je veux prendre beaucoup de bois de Boulogne avant car le temps est beau. Adieu encore mille fois.
Mots-clés : Politique (France), Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
144. Paris Mardi 25 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m'avez écrit une bien courte lettre de Broglie, j’attendrai mieux demain. Nous nous sommes promenées Lady Granville et moi hier au bois de Boulogne. Elle est très affectée de la mort de Madame de Broglie, comme l’est sincèrement tout le monde. C’était une personne bien aimée, bien admirée. J’ai été passer une heure de la soirée chez Lady Granville. On y recevait lors que j'en suis partie. Je me sens si lasse que je suis toujours pressée d’aller trouver mon lit.
Louis Bonaparte a demandé au ministre d'Angleterre en Suisse si gouvernement anglais lui permettrait de résider en Angleterre. Cela ne peut pas se défendre. Il est décidé à y aller. Cette nouvelle a fait grande joie à M. Molé. Je crois qu’elle n’est pas connue encore. Une dépêche télégraphique annonçant hier une émeute à Genève, & cette émeute dirigée contre les Français. On avait fermé les portes de la ville; Je ne vois pas cette dépêche dans les journaux de ce matin. Quand vous m'écrivez peu il me semble que je ne sais pas vous écrire du tout. Et puis je ne me sens pas bien sans cependant que je sois malade. Aussi je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter mais pour excuser mes pauvres lettres.
Je crois que le temps est malsain, l'air ne me rafraîchit pas, & je reviens de ma promenade toujours fatiguée quoique je ne marche point. On annonce quelques anglaises ici ; l’une Lady Burghersh, est une femme d'esprit & qui a une grâce infinie. Je crois qu’elle vous plaira. Je suis bien aise quand il arrive des femmes agréables. Il en manque bien ici. Adieu, adieu.
Mots-clés : Décès, Politique (France), Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
141. Val-Richer, Mercredi 26 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai cette pauvre femme devant les yeux. Je l’ai vue sur son lit de mort. Elle n’était pas changée du tout, les traits parfaitement calmes et l’air jeune. Elle est morte pourtant à la suite d’un long délire, d’un délire de plusieurs jours, mais sans violence, sans idée fixe ; rien n’indiquait un grand trouble intérieur. Toute sa vie repassait devant elle, sa mère, ses frères, sa fille Pauline, ceux qu’elle avait perdus, ceux qui lui restaient confusément, rapidement, en général doucement. Elle a souvent parlé de moi ; elle causait avec moi. Dès l’invasion du mal, sa faiblesse était extrême ; elle se soulevait à demi, joignait les mains et commençait une prière qu’elle n’achevait pas. Elle s’est crue très malade dans les premiers jours ; puis cette idée lui a passé. Elle désirait beaucoup de guérir. Elle se trouvait mieux depuis un an ou deux ans, et infiniment plus calmes qu’elle n’avait jamais été. Elle ma dit bien des fois : " La jeunesse ne m’allait pas ; à mesure qu’elle s’en va, je me sens plus de force et de sérénité. " Elle a fait un testament qui n’est pas encore ouvert. Je serais resté plus longtemps avec son mari si j’avais dû le laisser seul. Mais sa belle sœur est arrivée et il attendait son fils hier soir ou ce matin. Il sera à Paris dans quatre on cinq jours, et n’ira pas à plus de 20 ou 30 lieues au devant de sa fille. Il est calme.
Il m’a beaucoup touché hier matin. Tous les jours, avant le déjeuner, la famille faisait la prière dans la bibliothèque. On lisait un chapitre de l’évangile, une ou deux pages de méditations pieuses et l’oraison dominicale. C’était mad. de Broglie, qui lisait. Il a fait recommencer hier et l’a remplacée. J’espère que sa fille viendra vivre avec lui. Cependant il y a des obstacles. M. d’Haussonville, a aussi son père et sa mère qui sont vieux et sourds. Albert de Broglie sera beaucoup pour son père. Il est distingué et affectueux.
Vous vouliez des détails. Je me repose ici. J’ai le cœur fatigué. Vos lettres sont bien bonnes. Mais ne vous laissez pas aller à pleurer. Vos pauvres yeux n’en ont pas besoin.
9 heures.
Je viens de passer une demi heure, avec mes enfants dans mon cabinet. Il m’aiment beaucoup. Je mentirais si je disais que votre pensée me les gâte ; non, je jouis beaucoup de leur présence, de leur affection. Mais votre pensée est toujours là, toujours. Je vous aime beaucoup. J’ai besoin de tout ce qui vous manque. Que ne puis je vous faire jouir de mon bien comme je souffre de votre mal ? Mon petit Guillaume à le meilleur cœur du monde. Quand il me voit triste, il redouble autour de moi de gaieté et de caresses. Et s’il ne réussit pas à me distraire, il s’arrête tout à coup, un peu confus, comme s’il avait fait une sottise.
Je vois que j’ai deviné juste, sur l’expédient que la suisse prendra envers Louis Buonaparte. On lui posera la question. Elle a été inventée dans le dessein. Si on ne la lui pose pas, il aura tort de transporter son quartier général à Genève. Genève n’est pas un canton radical malgré le vote de son député à la Diète. Thurgovie au Bâle campagne lui conviennent mieux. Je ne crois à aucune querelle sérieuse, pas même par lettres, pour le blocus mexicain ou la côte d’Afrique. Ni l’un ni l’autre Cabinet ne veut se quereller. Ils ont bien assez de peine à vivre. Cependant je ne crois guère non plus aux pronostics de Lord Aberdeen. L’Irlande ! L’Irlande tant que cette question-là ne sera pas vidée, les Whigs et les radicaux tiendront ensemble.
10 heures
Adieu. Le temps est mauvais en effet. Nous n’avons pas eu d’été. Pardonnez-moi la tache qui vient de se faire, je ne sais comment, sur cette lettre. Je serai bien aise de vous savoir à Le Terrasse. Adieu. Adieu. G.
142. Val-Richer, Jeudi 27 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis remis hier à travailler. C’est une grande ressource qui vous manque. Après les plaisirs de l’intimité, je n’en connais pas de plus efficace pour distraire, et même reposer d’une impression douloureuse. Avant de m’enfermer dans mon cabinet, j’ai fait faire une longue promenade à ma mère. Elle est très affligée. Mad. de Broglie avait pour elle un respect, une affection, une confiance filiale, et les lui témoignait avec un extrême abandon. Ma mère en était très touchée depuis trois jours elle me répète sans cesse : " Prendre une telle amitié à mon âge, pour une cette fin ! "
J’ai une profonde pitié des chagrins de la vieillesse. Elle a droit au repos du cœur comme du corps. D’ailleurs ils sont rares. L’âge refroidit les peines comme les joies. Il n’en est rien pour ma mère. Elle a le cœur aussi vif qu’il y a quarante ans. Je l’ai fait marcher une heure et demie. Elle en était un peu lasse hier soir, mais beaucoup plus calme. Je suis sûr qu’elle aura mieux dormi.
Je ne crois guère à l’émeute de Genève. Ce serait un grand argument contre la politique dont se charge M. Molé ; Genève est une ville française. Il y faut je ne sais quel degré d’irritation pour qu’on y éclate contre les Français. M. de Metternich doit sourire, un peu. Thiers travaille aussi. Mais au fond, d’après ce qui me revient, il est très animé et se propose de le témoigner à la prochaine session. Nous verrons bien. Il restera en Italie jusqu’au mois de novembre. Ce sera le moment du retour universel.
Je serai bien aise de retrouver les Holland à Paris autant qu’un plaisir peut être quelque chose à côté d’un bonheur. Vous devriez bien d’ici là rassembler tout ce qui vous reste de ce que vous avez écrit sur tout ce que vous avez fait ou vu. Je suis sûr qu’il y a je ne sais combien de choses, petites ou grandes, que je ne connais pas. J’ai envie de toutes. Le papier sur la mort de Lord Castlereagh est-il décidément perdu ? Faites cela en rentrant à la Terrasse. Là où je suis indifférent, je ne suis pas curieux. Mais où est mon affection, ma curiosité est insatiable. J’ai beaucoup plus envie du moindre petit papier que de Lady Burgherch. Les femmes distinguées manquent partout. L’Angleterre ne m’a encore montré que Lady Granville, et si vous voulez, Lady Clanricard. A propos, vous ne m’avez pas envoyé sa lettre.
10 h. ¼
Mon facteur arrive tard ce matin. Je n’ai pas de nouvelles de Broglie, ce qui me prouve qu’Albert n’est pas arrivé. Je suis impatient qu’il ait rejoint son père. J’avais pensé à votre prédiction. Je vous remercie de vous ménager. La fatigue ne vous vaut. rien. Soignez-vous pour le mois de novembre. Je ne comprends pas qu’on se laisse mal traiter par Lady Holland. Passe pour son mari, s’il l’aime. Car il faut aimer pour supporter. Du reste les impertinents ont raison puisqu’on les supporte. Je vous conseille d’écrire à votre mari. Toutes les fois qu’il renoue le fil, n’importe pourquoi vous devez le ressaisir. Vous l’avez dispensé d’explication. Cela vous dispense de reproche. Les confidences de Mlle Henriette ne tracassent donc plus Marie. Adieu. Tout à l’heure, en lisant votre adresse en Courlande, j’ai eu envie de vous répondre par la première phrase de mon testament. Je ne le ferai pas. Adieu. G.
147. Paris, Vendredi 28 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Après une longue promenade au bois de Boulogne avec Lady Granville, nous avons trouvé mon Ambassadeur qui m’attendait à ma porte. J’ai vu à son visage qu'il avait à me parler ; j’ai laissé aller Lady Granville et j’ai pris le bras de M. de Pahlen. Un vrai militaire il est allé à l’assaut tout de suite et m’a demandé si j’avais écrit à Thiers ? Non, et pourquoi cette question. " parce qu’on tient sur vous mille propos ; on dit que vous êtes avec lui en correspondance, que vous intriguez entre lui, M. Guizot, M. Berryer. On prépare un article contre vous dans un journal, et tout cela vient du ministère. " Il est très difficile de comprendre clairement Pahlen, il est de même un peu difficile de se faire bien comprendre de lui. D'ailleurs, il avait mille réticences, et à tout instant, " un nom de Dieu, ne parlez de ceci à personne " ; je l’ai calmé, rassuré, cela me parait très facile, car rien n’est plus inoffensif que ma conduite, mais cependant je ne saurais être indifférente à l'usage qu'on peut faire de mauvais commérages sur mon compte, et je viens d'écrire à M. Molé pour le prier de me donner un moment d'entretien.
J’ai voulu vous dire tout cela puisque je vous dis tout. Serait-ce une intrigue Cosaque pour me faire fuir Paris ? Il faut que l’invention vienne de loin puis que c’est tellement invention qu'il n'y a pas le premier mot de vrai. J’avais eu un moment l'envie de demander à Thiers de ses nouvelles, tout bêtement. Je ne l’ai pas fait, et j'en suis bien aise Il y a 6 semaines que je n’ai vu Berryer. Je suis très curieuse de savoir sur quoi on peut bâtir sur mon compte quelque chose qui sorte de la routine la plus innocente. J’ai vu beaucoup de monde hier au soir, cela devient un peu trop nombreux. Il faudra reprendre mon ancienne manière. Le duc de Noailles est venu. C’était comme il dit, le seul étranger, parce que le rôle était tout le reste de l’Europe.
J'ai reçu ce matin une lettre de mon mari de Potsdam ; je n’ai à relever dans cette lettre que les deux choses-ci. N°2 placé en haut, ce qui veut dire qu’une nouvelle ère a commencé à Weymar, & l’indication de Munich pour ma première lettre après quoi il veut me donner un nouvel avis. Le reste est des détails sur la famille impériale. Les grandes duchesses embellies. Les cantonnements à Potsdam des bêtises. Voici cette lettre de Lady Clauricarde que vous voulez absolument. Voici aussi celle de Lord Aberdeen. Brûlez la première et renvoyez moi la seconde, parce qu'il faut que j’y réponde. Adieu. Adieu, je suis un peu pressée. J’ai quelques courses à faire, & encore. à écrire. Adieu bien tendrement.
144. Val-Richer, Vendredi 28 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir parlé de ma mère. Elle a été un peu souffrante. Elle est bien aujourd’hui, quoique très, très affligée. Mad. de Broglie était avec elle filialement. Mais je suis sûr que je vous en ai parlé. Ma mère d’ailleurs a une attitude admirable envers la douleur ; elle la supporte sans s’en défendre. Je n’ai jamais vu personne qui l’acceptât plus complètement sans s’y abandonner, qui en parût plus rempli et moins abattu. Elle y est comme dans son état naturel. Il n’y survient rien de nouveau pour elle et le plus ou le moins ne change pas grand chose à sa disposition, toujours triste mais toujours forte. Je l’ai fait beaucoup promener ces jours-ci. Je l’ai fatiguée. Et puis mes enfants ne la quittent guère. J’ai beaucoup travaillé ce matin. J’avais besoin aussi de me fatiguer. J’en suis convaincu comme vous. On ne comprend que les maux qu’on a soufferts. A ce titre, j’ai bien quelque droit à vous comprendre, pas assez peut-être. Il est vrai que je suis moins isolé. Que ne puis- je vous guérir au moins de ce mal-là ! L’autre resterait. Je l’ai vu rester. Mais ce serait celui-là de moins. Je ferai mieux de ne pas vous écrire ce soir. Je suis si triste moi-même que je ne dois rien valoir pour consoler personne, pas même vous que je voudrais tant consoler, un peu !
Samedi 7 heures
Je suis frappé du peu que nous pouvons, du peu que nous faisons pour les autres, et pour nous-mêmes. Dieu m’a traité plusieurs fois avec une grande faveur. Il m’a beaucoup ôté mais il m’avait beaucoup donné et souvent il m’a beaucoup rendu. J’ai reçu le bien, j’ai subi le mal. J’ai très peu fait moi-même dans ma propre destinée. Nous ne réglons pas les événements. Nous sommes pris dans les liens de notre situation. Nous oublions cela sans cesse. Nous nous promettons sans cesse que nous pourrons, que nous ferons. C’est notre plus grande erreur que l’orgueil de nos espérances. Voilà Louis Buonaparte éloigné. C’est une grande épine de moins dans le pied de M. Molé. La marque, en restera, mais pour le moment, il n’en sent plus la piqûre. Entendez-vous dire que la session soit toujours pour le 15 Décembre ?
Vous êtes bien bonne d’attendre mes lettres avec impatience. Qu’ai je à vous mander ? Point de nouvelles. Mon affection n’en est pas une. De près, tout est bon, la conversation donne une valeur à tout. De loin, si peu de choses valent la peine d’être envoyées !
9. 1/2
Je ne comprends, rien à cette incartade. Est-ce en effet une intrigue cosaque ou bien seulement quelque commérage subalterne qui sera monté haut, comme il arrive souvent aujourd’hui ? Je penche pour cette dernière conjecture. En tout cas, vous avez très bien fait d’aller droit à M. Molé. Il est impossible qu’il ne comprenne pas l’absurdité de tout cela et n’empêche pas toute sottise, au moins de ses propres journaux. Ne manquez pas de me dire la suite, s’il y en a une. Quelles
pauvretés !
Je suis bien aise que vous ayez un N°2. Je vous renverrai demain la lettre de Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Je reçois je ne sais combien de lettres qui me demandent des détails sur cette pauvre Mad. de Broglie. Est-il possible qu’on soit contraint de rabâcher, sur un vrai chagrin. Adieu. G.
148. Paris, Samedi 29 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Comment, on n’a pas eu le temps ? ou bien, on n’y a pas pensé. Quand il s'agit d'une dernière prière sur la tombe d'un chrétien, & d’une femme qu'on aime ! Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais il n'y a que des Français capables de cela. Et vous, vous-même c’est bien légèrement que vous me donnez ces excuses. Savez-vous que cela me blesse, savez-vous que moi, moi étrangère, arrivée, là à la dernière heure j’aurais demandé à M. de Broglie à genoux d’attendre qu’un ministre de Dieu vient bénir la dépouille de sa pauvre femme. Ah dans mon froid pays, dans ce pays barbare, c’est un prêtre qui recevra tout ce qui reste de moi. Est-ce que je vous dis des choses dures ? Pardonnez moi, pardonnez ce que Lady Granville appelle vingt fois le jour, ma funeste franchise. Vous ne me referez pas. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Comment M. de Broglie pourra-t-il jamais avoir un moment de tranquillité ?
M. Molé est venu hier chez moi en sortant du Conseil. Il est convenu qu’il y avait sur mon compte mille mauvais rapportages. Berryer était sur le premier plan de la Reine ! Imaginez ! Vous qui savez ce que j’en fais. Le gros de l’affaire est que mon salon est le rendez-vous des adversaires du gouvernement. Enfin on veut me faire passer pour une archi intrigante. Vraiment c’est trop absurde. M. Molé a été parfait, il dit que lui et le Roi me défendent, mais qu’on est très exalté contre la Russie, & qu'il n’y a pas moyen de faire comprendre que moi je ne suis pas un émissaire chargé de susciter d'embarras au pouvoir existant. Voilà qui est trop fort. Je voudrais en rire, mais c’est difficile. M. Molé dit qu'il a arrêté déjà des articles qui devaient paraître contre moi qu'il y veillera encore, mais il ne répond de rien cependant. J’ai dit tout ce qui était convenable et tout ce qui était vrai. Je n'ai à m’amuser que d'une intimité ; c'est avec vous. Alors il y a eu une grande exclamation. " Oh pour celui-là. c’est tout autre chose, un homme que nous estimons & respectons tous. " Il a dit de vous mille biens et dans le meilleur langage. Mais excepté vous je voudrais bien savoir quels sont donc les Français avec lesquels je conspire ? La police du gouvernement est bien mal informée, et les fonds secrets devraient mieux servir que cela. Au total je ne comprends pas bien sur quoi repose tout ce tripotage, ni de qui j'ai à me garder, mais il me semble que M. Molé est sérieusement désireux de m’épargner tout espèce d'embarras.
Vraiment il ne me manquait plus que cela. Il me parait que l’exaspération contre l’Empereur est arrivée à un haut degré. Il y a quelque chose de nouveau à ce sujet que M. Molé n’a pas voulu me dire, et qui surpasse tout ce qui est jamais venu de mon maître. C'est fort triste. J'ai dîné hier chez Madame Graham avec les Holland, mon ambassadeur M. d’Armin, Fagel, & Villers. Celui-ci est un homme charmant. J’ai peu rencontré d’homme qui m’aient si vite plu. Je cherche à lui faire faire des conquêtes parmi mon entourage, et il faut revenir de tous, car il est en horreur à la sainte alliance.
Hier matin j’ai promené Madame Appony. Le tête à tête n’est pas aussi animé qu’avec Lady Granville. Ce matin votre lettre n'était pas sur la nappe à mon déjeuner, voilà qu’une violente agitation s’est emparée de moi. J’ai vu toutes les catastrophes imaginables et la plus naturelle s'est rencontrée dans un article de journal que j'ai pris en main et où j’ai trouvé qu'il y avait beaucoup de loups aux environs de Caen. Vous aviez été attaquée par un loup, cela ne me sortait pas de la tête, dix minutes après la lettre est venue et j’ai respiré comme si le loup venait de vous lâcher. Ah quelle pauvre tête que la mienne. Mais convenez-vous bien de cela. Un jour passé sans lettre, j'en prendrai la fièvre. Adieu, adieu. Adieu autant d’adieux que vous voudrez.
149. Paris, Dimanche 30 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon pauvre Ambassadeur est très préoccupé de l'ensemble de la situation ici. Je l’ai rencontré hier à Auteuil ; il m'a beaucoup entretenu de tous ses chagrins. La maison est le plus gros de tous. Il craint, (& il a raison car M. Molé me l’a confirmé hier à dîner) que M. de Barante n’ait l’ordre de quitter son hôtel à Pétersbourg aussi vite que possible ; dans ce cas, lui Pahlen sortirait immédiatement du sien, et comme il n'y en a aucun à trouver, il ira en hôtel garni, imaginez ! Il prétend que ce qu'il a de mieux à faire c'est de chercher à quitter son poste. J’en serai certainement très fâchée.
A dîner, j’ai eu M. Molé pour voisin comme de coutume. Je n'ai rien appris de nouveau. Il me semble que c’est pour le 20 décembre qu'est fixée l’ouverture des Chambres. Il n’a pas l'air soucieux. Il ne pense pas que la partie raisonnable de l'opposition puisse se montrer hostile, c'est vous sans doute, et en effet sur quoi le seriez-vous ? L'attitude que vous aviez l’année passée à l’époque de l'ouverture sera difficile à reprendre vu ce qui s’est dit à l'occasion des fonds secrets. Mais cependant ce qu'il y aurait de mieux à faire serait de se rapprocher de cette première position plutôt que de continuer dans la seconde. Thiers s'est assez bien tiré de la session, il a senti que la situation était mauvaise. Il s’est effacé ; après en avoir compromis d'autres. Voilà à peu près.
La dépêche télégraphique sur Genève a été démentie par une autre dépêche le lendemain. C’était un faux bruit de voyageur. Le dîner hier était pour Holland, toute l'Angleterre. Je suis restée la dernière jusqu'à 10 heures. Demain je dîne à Suresnes chez les Salomon Rotschild. Jeudi chez Lady Sandwich, vendredi chez Mad. de Castellane. & puis chez les petits Pozzo. Me voilà fort dissipée. Lady Granville est malade ; je ne l’ai pas vu depuis jeudi. Son mari a la goutte. C’est là ce qu’on rapporte des Eaux. Les Palmella me pressent fort d'aller à Versailles, les Holland y vont aussi. Mais je crains la fatigue de voyage ; car c’est une fatigue. Je vous vois triste dans vos lettres, est- ce que moi j'y ajoute ! Il me semble que oui.
Eh quand serons-nous ensemble ! J'ai eu un mot de M. de Broglie hier ; je lui avais écrit le lendemain de son malheur. Adieu. Adieu. Votre pauvre reine me fait bien de la peine ; mais elle a bien dû jouir sur cette terre cependant. Adieu, encore adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Réseau social et politique
150. Paris, Lundi 1er octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai eu une longue visite hier du C. Appony et une autre longue de mon ambassadeur. Le premier que j’avais beaucoup engagé à s’approcher de Villiers a fait comme je lui ai dit et était fort content de son entretien avec lui. Il l’a trouvé moins révolutionnaire qu’il ne pensait. De son côté Villers m’a dit qu'il trouvait Appony beaucoup moins carliste qu'on ne lui avait dit. Voilà pour commencer les Anglais me savent gré de la toute petite peine que je prends à rapprocher les gens, je ne le ferais pas si je n’avais vraiment le cœur anglais. Au surplus ceci est du bien pour tout le monde. Je suis fâchée que vous ne connaissiez pas Villiers, il vous plairait surement. M. Molé est enchanté de lui. M. de Pahlen était venu pour déverser encore son spleen. Nous avons regardé sa situation sous toutes ses faces. Nul doute qu’elle ne soit mauvaise. Nous finirons par n’avoir que des chargés d’affaires.
Après ma promenade au bois de Boulogne, j’ai été voir Lord Granville qui est couché sur son canapé en très mauvais état. Sa femme est dans son lit sans voir âme qui vive. Granville était bien content d'un petit moment de causerie avec moi. J’ai dîné seule et le soir mon salon a été rempli de monde, beaucoup trop c’est décidément ennuyeux. La France tout changera tout cela. Mais je n’y passerai que le 10, j’attendrai Marie. A propos, elle ne m écrit pas, je commence à être inquiète. Je lui écris cependant souvent.
On est fort fâché ici, & nous le sommes aussi du traité de commerce conclu entre la Porte et l'Angleterre. Cela va déterminer l'indépendance de l’Egypte et nous regardons cela comme la guerre en Orient. Nous verrons. Voici le mois d'octobre ; c’est-à-dire 6 semaines d’écoulées depuis que je ne vous ai vus. Combien ne passera-t-il encore ? Adieu, adieu. Pensez à moi beaucoup toujours, & tendrement
152. Paris, Mercredi 3 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'écris aujourd’hui à mon frère par un courrier de Pahlen. Votre gouvernement en a envoyé un à M. de Barante avant- hier, je crois entre autre pour lui prescrire de sortir de l'hôtel aussi tôt que possible. Cela sera le signal de la sortie de Pahlen, de la maison qu'il occupe, il s’en va contant à tout le monde ces douleurs, & dans un désespoir comique.
J’ai fait visite à Auteuil hier matin ; on dit qu'on ne sait pas encore le départ de Louis Bonaparte de Suisse et que cela tracasse un peu ici. Le soir, j’ai été voir les Granville malades. Il est couché, immobile. Elle va un peu mieux tous les jours.
Il arrive de normaux anglais qui passent. Je les vois, je ne vous les nomme pas, vous ne les connaissez pas du tout. Alava est venu me voir aussi, il a bonne mine. Il va à Londres dans quinze jours. Les Holland sont à Versailles, ils y ont mené aussi le poète Rogers. Vous le connaissez sans doute ?
Le soleil est superbe, je ne me lasse pas de profiter de ces derniers beaux jours. Je me promène encore le soir en voiture ouverte. Je m’enrhume, je me dé-rhume tout cela est égal, il me faut de l'air. Le petit Sneyd va partir pour l’Italie j'en suis très fâchée, car je l’ai fort à mes ordres. Ainsi quand il n'y a rien de mieux, je le prends dans ma calèche et il se laisse toujours prendre.
Marie m’a enfin écrit. Elle se dit parfaitement remise, & arrive samedi. Nous verrons. L’Empereur le prolonge un peu à Berlin. Il veut retourner chez lui par mer. Quelle idée dans cette saison et après que ses filles ont failli périr. Je suis bien aise d’apprendre que votre mère est bien. Adieu, je cherche si j’ai quelque chose à vous dire. Je ne trouve rien qu'une quantité d’adieux.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Réseau social et politique