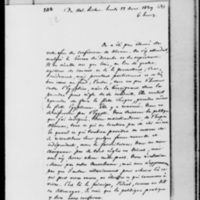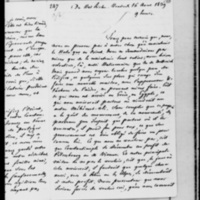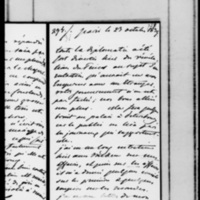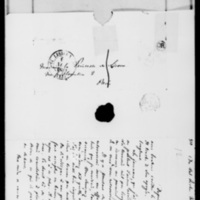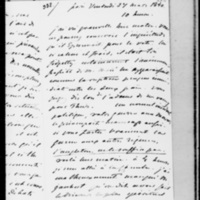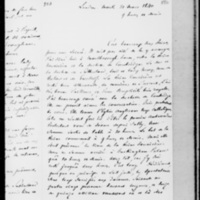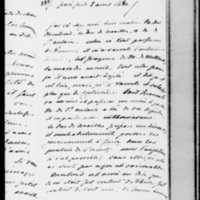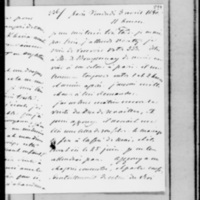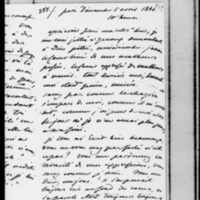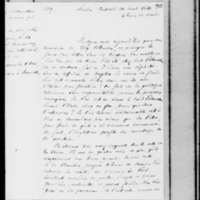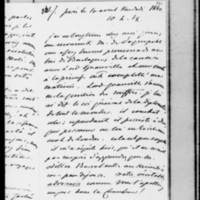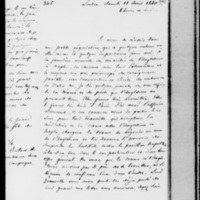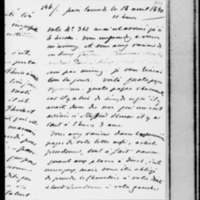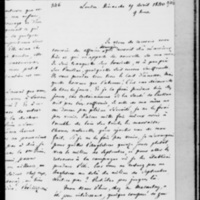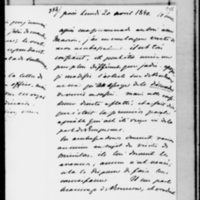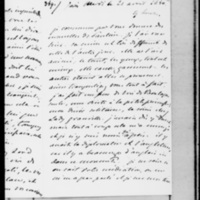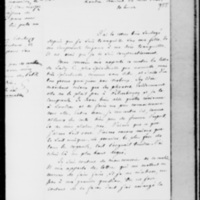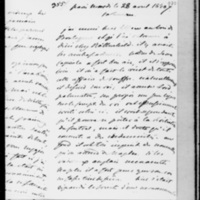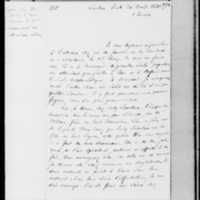Votre recherche dans le corpus : 321 résultats dans 3296 notices du site.
Trier par :
218. Baden, Mardi 16 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
218 Baden Mardi le 16 juillet 1839, 10 heures
Je vous disais hier que le temps était à l’orage. Une heure après un gros nuage noir est descendu sur Bade mais plus particulièrement sur la salle de conversation qui touche à la maison que j'habite. La foudre est tombé dessus, le paratonnerre a écarté le danger mais tout le monde qui était à table dans ce moment a senti le choc électrique, deux dames sont tombées par terre de frayeur. J'étais à la fenêtre, relisant votre lettre. Le coup a été si fort qu'il m’a fait sauter & votre lettre m’est tombée de la main. Je n'ai jamais été si près de la foudre que hier. La nuit a été orageuse aussi & nous n’avons pas fini aujourd'hui.
Voilà donc le Sultan mort, je l’ai appris hier au soir. Le courrier venu de Constantinople traversait Bade le 15 ème jour. C'est vite. Tout peut arriver un bien comme un mal. C’est un moment curieux, mais ce qui m’étonnerait le plus serait que nous prissions part à une conférence à moins qu’elle ne se bornât à établir les nouveaux rapports entre les deux chefs barbares.
5 heures
Je viens de recevoir votre lettre, je viens aussi de recevoir un gros volume de mon frère, avec tout l’arrange ment de me fortune. Je vous manderai demain le détail. Il me parait qu’il n’est pas content de mes fils. La loi rien que la loi, comme elle m’accorde à peu près ce que j’ai à présent, je ne me plains pas, mais je ne suis pas bien orientée encore je vous dirai cela plus exactement demain. Adieu. Adieu. Adieu. J'étais mieux ce matin je ne me sens pas si bien dans ce moment. God bless you.
Je vous disais hier que le temps était à l’orage. Une heure après un gros nuage noir est descendu sur Bade mais plus particulièrement sur la salle de conversation qui touche à la maison que j'habite. La foudre est tombé dessus, le paratonnerre a écarté le danger mais tout le monde qui était à table dans ce moment a senti le choc électrique, deux dames sont tombées par terre de frayeur. J'étais à la fenêtre, relisant votre lettre. Le coup a été si fort qu'il m’a fait sauter & votre lettre m’est tombée de la main. Je n'ai jamais été si près de la foudre que hier. La nuit a été orageuse aussi & nous n’avons pas fini aujourd'hui.
Voilà donc le Sultan mort, je l’ai appris hier au soir. Le courrier venu de Constantinople traversait Bade le 15 ème jour. C'est vite. Tout peut arriver un bien comme un mal. C’est un moment curieux, mais ce qui m’étonnerait le plus serait que nous prissions part à une conférence à moins qu’elle ne se bornât à établir les nouveaux rapports entre les deux chefs barbares.
5 heures
Je viens de recevoir votre lettre, je viens aussi de recevoir un gros volume de mon frère, avec tout l’arrange ment de me fortune. Je vous manderai demain le détail. Il me parait qu’il n’est pas content de mes fils. La loi rien que la loi, comme elle m’accorde à peu près ce que j’ai à présent, je ne me plains pas, mais je ne suis pas bien orientée encore je vous dirai cela plus exactement demain. Adieu. Adieu. Adieu. J'étais mieux ce matin je ne me sens pas si bien dans ce moment. God bless you.
219. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
219 Paris, mardi 16 Juillet 1839. Midi.
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
221. Paris, Mercredi 17 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
221. Paris, mercredi soir 9 heures-19 Juillet 1839
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
224. Val-Richer, Dimanche 21 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
224 Du Val-Richer, Dimanche 21 Juillet 1839 5 heures
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
226. Val-Richer, Mardi 23 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
226 Du Val-Richer, Mardi 23 Juillet 1839 5 heures
Je viens d'avoir une minute très désagréable. Henriette s'est pincé le doigt dans une porte. Elle criait : " ouvrez-moi, ouvrez-moi !"" J’ai trouvé bien long le temps d’un saut jusqu'à la porte. Ce n’est rien. Elle en sera quitte pour une compresse d’extrait de Saturne pendant quelques heures ce que Madame de Talleyrand vous a fait mettre pour pareil accident. Je lui sais très bon gré de son courage (à Henriette) ; elle n’a pas pleuré du tout.
8 heures
J’ai été interrompu par un homme qui venait de Paris me demander quelques mots de recommandation pour M. Duchâtel. Je les lui ai données. Il a dîné. Il vient de repartir. Il aura fait 90 lieues pour une lettre qui, je crois, ne lui servira pas à grand chose. Je ne m'étonne pas que la conversation de M. Humann vous plaise. Il a assez d’esprit, et ce qu’il en a est bon et net, comme vous dites. Caractère peu élevé d'ailleurs, quoique grave et dont l’honnêteté naturelle a été singulièrement altérée par l’habitude, et le goût de gagner de l’argent. Vrai allemand, susceptible sans être fier ; sentimental et personnel et fort relâché dans la pratique quoique sans corruption. Je suis bien aise que vous l’ayez à Baden ; il vous distraira quelques fois.
La destruction de l'armée Turque préoccupe beaucoup le Cabinet. Non qu’il craigne les folies du vainqueur, tout indique qu'Ibrahim selon les ordres de Méhémet, se conduira, très sagement et attendra. Mais c’est un coup bien rude pour Constantinople ; et si comme on me le mande le Capitan Pacha fait défection avec sa flotte et passe à Méhémet, que deviendra, le jeune Sultan au milieu de ce tremblement de terre ? Les personnes pourraient bien, malgré leur retenue, être encore une fois lancées malgré elles dans de grandes choses. S'il est possible qu’il y ait de grandes choses pour ceux qui n'en veulent pas. Moi aussi je suis très préoccupé de ceci.Toucherions-nous déjà au moment où l’Europe sera remise en question ? Je ne crois pas. Je ne le souhaite pas. Je ne veux, à aucun prix, d'une nouvelle grande lutte révolutionnaire. Je crois que le bonheur de l’Europe des deux Europes, et ce qui me touche bien plus, son honneur, son état moral en seraient profondément altérés, et pour longtemps. Mais s'il se pouvait que les questions fussent grandes, et point révolutionnaires, et que devenues inévitables, elles contraignissent la politique à grandir aussi, ce serait bien heureux, et j'en serais bien heureux. Nous verrons.
Mercredi 24 9 h 1/2
Je n’ai pas de lettres. Cette fois, j’en suis fâché mais non pas inquiet. J’ai peut-être tort. Nous vivons dans les ténèbres. Adieu. Adieu. Vous ne m’avez pas dit à quelle époque l’arrangement de vos affaires serait définitivement conclu et signé. Adieu.
Je viens d'avoir une minute très désagréable. Henriette s'est pincé le doigt dans une porte. Elle criait : " ouvrez-moi, ouvrez-moi !"" J’ai trouvé bien long le temps d’un saut jusqu'à la porte. Ce n’est rien. Elle en sera quitte pour une compresse d’extrait de Saturne pendant quelques heures ce que Madame de Talleyrand vous a fait mettre pour pareil accident. Je lui sais très bon gré de son courage (à Henriette) ; elle n’a pas pleuré du tout.
8 heures
J’ai été interrompu par un homme qui venait de Paris me demander quelques mots de recommandation pour M. Duchâtel. Je les lui ai données. Il a dîné. Il vient de repartir. Il aura fait 90 lieues pour une lettre qui, je crois, ne lui servira pas à grand chose. Je ne m'étonne pas que la conversation de M. Humann vous plaise. Il a assez d’esprit, et ce qu’il en a est bon et net, comme vous dites. Caractère peu élevé d'ailleurs, quoique grave et dont l’honnêteté naturelle a été singulièrement altérée par l’habitude, et le goût de gagner de l’argent. Vrai allemand, susceptible sans être fier ; sentimental et personnel et fort relâché dans la pratique quoique sans corruption. Je suis bien aise que vous l’ayez à Baden ; il vous distraira quelques fois.
La destruction de l'armée Turque préoccupe beaucoup le Cabinet. Non qu’il craigne les folies du vainqueur, tout indique qu'Ibrahim selon les ordres de Méhémet, se conduira, très sagement et attendra. Mais c’est un coup bien rude pour Constantinople ; et si comme on me le mande le Capitan Pacha fait défection avec sa flotte et passe à Méhémet, que deviendra, le jeune Sultan au milieu de ce tremblement de terre ? Les personnes pourraient bien, malgré leur retenue, être encore une fois lancées malgré elles dans de grandes choses. S'il est possible qu’il y ait de grandes choses pour ceux qui n'en veulent pas. Moi aussi je suis très préoccupé de ceci.Toucherions-nous déjà au moment où l’Europe sera remise en question ? Je ne crois pas. Je ne le souhaite pas. Je ne veux, à aucun prix, d'une nouvelle grande lutte révolutionnaire. Je crois que le bonheur de l’Europe des deux Europes, et ce qui me touche bien plus, son honneur, son état moral en seraient profondément altérés, et pour longtemps. Mais s'il se pouvait que les questions fussent grandes, et point révolutionnaires, et que devenues inévitables, elles contraignissent la politique à grandir aussi, ce serait bien heureux, et j'en serais bien heureux. Nous verrons.
Mercredi 24 9 h 1/2
Je n’ai pas de lettres. Cette fois, j’en suis fâché mais non pas inquiet. J’ai peut-être tort. Nous vivons dans les ténèbres. Adieu. Adieu. Vous ne m’avez pas dit à quelle époque l’arrangement de vos affaires serait définitivement conclu et signé. Adieu.
228. Val-Richer, Samedi 27 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
228 Du Val-Richer, Samedi 27 Juillet 1839 8 heures
Je suis seul, très seul. Non pas seul comme vous, hélas ! Je suis entouré de gens qui m’aiment, qui s'occupent de moi, qui ont besoin de moi. Mes enfants sont bien gentils bien affectueux. Ma journée est très pleine de personnes et de choses. Mais moi, je vous le répète, moi, je suis très seul. Je suis seul quand je ne me donne pas tout entier. Je suis seul quand je ne trouve pas tout ce qui me plaît, quand je rencontre, non pas des défauts ; que m'importent les défauts ? Mais des lacunes, des impossibilités. On me dit et vous même me dîtes que je suis orgueilleux. Je ne puis pas être heureux de haut en bas. Je ne puis pas aimer de haut en bas. Je veux que les yeux qui me charment soient là, devant moi, à la hauteur des miens ; et aussi les idées, les instincts, les goûts les désirs, comme les yeux. Je veux admirer et me soucier qu’on m'admire. Que personne n'entende jamais, ne sache jamais ce que je vous dis là. Pour rien au monde, je ne voudrais affliger ou blesser une affection tendre, un dévouement vrai ; ils sont si rares, & on les mérite si peu quand on ne les rend pas tout entiers ! Je vous dis qu’avant le 15 juin, j'étais seul et m’y étais résigné, qu'aujourd'hui je suis seul et ne m'y résigne pas.
3 heures
Voilà bien du nouveau en Orient. Le protectorat Européen et le Protectorat Russe se disputaient Constantinople. Elle se place sous le protectorat égyptien. A la barbe des Chrétiens divisés, les Musulmans se rallient. Je suppose que cela déplaira beaucoup chez vous. C'est évidemment un tour de M. de Metternich et du Roi Louis- Philippe. Que dira l’Angleterre ? Elle déteste l’Egypte. Serait-ce tout bonnement un coup de tête du jeune Sultan, et de ses Conseillers qui auraient voulu trancher d’un seul coup & eux-mêmes toutes les questions ? Méhémet. Ali Généralissime de l'Empire Turc ! Méhémet. Ali à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Si toute l’Europe s'en arrange, il n’y a plus d'affaires-là, pour quelque temps. Si elle ne s'en arrange pas, les grandes affaires commencent. Encore une fois, dites-moi qui a fait cela, M. de Metternich, les Turcs seuls, ou peut-être Méhêmet lui-même, par son argent et ses amis à Constantinople. Je ne voir que votre Empereur qui ne puisse pas l'avoir fait. l’acceptera-t-il ?
Il m'est arrivé ce matin bien des nouvelles. Vous savez le dehors ; voici le dedans. Des conférences ont eu lieu ces jours derniers, entre les meneurs de la gauche, députés et journalistes sur la conduite à tenir d’ici à la prochaine session notamment sur la réforme électorale. M. Barrot y présidait. Voici ce qui s’y est passé. La proposition du suffrage universel a été écartée. Il en a été de même de l’élection à deux degrés quoiqu'elle ait été vivement soutenu par quelques personnes. De même aussi de la réunion de tous les électeurs de chaque département en un seul collège siégeant au chef lieu du département, et nommant ensemble tous ses députés.
On a adopté.
1° La suppression de tout cens d'éligibilité. Le premier venu pourra être député sans payer un sou d'impôt.
2° L'admission, comme électeurs de tous les citoyens qui sont admis à être jurés.
3° Une indemnité pour les députés, à raison de 20 francs par jour pendant les sessions.
4° Aucun collège électoral ne pourra être de moins de 600 électeurs, et on admettra pour compléter ce nombre, les citoyens les plus imposés après les électeurs légaux.
5° Les délégués des colonies et les membres de la maison du Roi ne pourront être députés.
6° Les fonctionnaires accusés de corruption dans les élections pourront être poursuivis par qui voudra, et devant les tribunaux ordinaires sans aucune autorisation du Conseil d'Etat.
7° Enfin, il a été question d’interdire à tout député non-fonctionnaire d'accepter une fonction quelconque pendant la durée de la législature même en donnant sa démission. Ceci n'a été ni adopté, ni rejeté. C'est là le thème que les journaux de la gauche vont broder dans l’intervalle des sessions. La personne qui me donne ces détails, venus de source, ajoute : " Je crois cette question de la réforme très importante, en ce qu’elle décidera selon moi, la question ministérielle. Le Ministère actuel n’est assez fort ni pour accepter, ni pour rejeter une réforme électorale. Parmi les amis des Ministres centre gauche quelques uns vont disant que la crise ministérielle va commencer, et que M. Passy, Teste et Dufaure sont déterminés à ne plus souffrir le Maréchal aux Affaires étrangères, et M. Cunin- Gridame au commerce. Ce sont- là de belles paroles dont les ministres en question bercent leurs amis sans en penser un mot. "
Thiers sera à Paris dans les premiers jours d'août. Il dit beaucoup qu’il n’a d’engagement avec personne et qu’il est parfaitement libre dans ses mouvements. Le journal le Temps vient d'être acheté, dit-on, par M. de Conny, pour les Carlistes. La Presse reste entre les mains de M. Emile de Girardin et devient de plus en plus vive contre le Cabinet. Voilà un vrai Journal. Personne n'a acheté celui-là et il ne se donne qu'à vous.
Dimanche 9 heures
Je vois que les journaux ne donnent pas toutes les nouvelles d'Orient, et que vous ne comprendrez qu’à moitié ce que je vous en dis. La flotte turque est allée. Je mettre sous la protection de Méhémet. Le divan lui a écrit. Le Sultan l’a confirmé dans le gouvernement de l’Egypte et de la Syrie avec l’hérédité pour sa famille. Il l’a nommé Généralissime et soutien de l'Empire Ottoman, et l'a engagé à se rendre à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Il est probable que Méhémet ira, avec les deux flottes réunies. Voilà les faits qui du reste vous sont probablement déjà venus d'ailleurs. Ils ne sont pas officiellement connus, mais presque Certainement. Adieu. Adieu.
Je suis seul, très seul. Non pas seul comme vous, hélas ! Je suis entouré de gens qui m’aiment, qui s'occupent de moi, qui ont besoin de moi. Mes enfants sont bien gentils bien affectueux. Ma journée est très pleine de personnes et de choses. Mais moi, je vous le répète, moi, je suis très seul. Je suis seul quand je ne me donne pas tout entier. Je suis seul quand je ne trouve pas tout ce qui me plaît, quand je rencontre, non pas des défauts ; que m'importent les défauts ? Mais des lacunes, des impossibilités. On me dit et vous même me dîtes que je suis orgueilleux. Je ne puis pas être heureux de haut en bas. Je ne puis pas aimer de haut en bas. Je veux que les yeux qui me charment soient là, devant moi, à la hauteur des miens ; et aussi les idées, les instincts, les goûts les désirs, comme les yeux. Je veux admirer et me soucier qu’on m'admire. Que personne n'entende jamais, ne sache jamais ce que je vous dis là. Pour rien au monde, je ne voudrais affliger ou blesser une affection tendre, un dévouement vrai ; ils sont si rares, & on les mérite si peu quand on ne les rend pas tout entiers ! Je vous dis qu’avant le 15 juin, j'étais seul et m’y étais résigné, qu'aujourd'hui je suis seul et ne m'y résigne pas.
3 heures
Voilà bien du nouveau en Orient. Le protectorat Européen et le Protectorat Russe se disputaient Constantinople. Elle se place sous le protectorat égyptien. A la barbe des Chrétiens divisés, les Musulmans se rallient. Je suppose que cela déplaira beaucoup chez vous. C'est évidemment un tour de M. de Metternich et du Roi Louis- Philippe. Que dira l’Angleterre ? Elle déteste l’Egypte. Serait-ce tout bonnement un coup de tête du jeune Sultan, et de ses Conseillers qui auraient voulu trancher d’un seul coup & eux-mêmes toutes les questions ? Méhémet. Ali Généralissime de l'Empire Turc ! Méhémet. Ali à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Si toute l’Europe s'en arrange, il n’y a plus d'affaires-là, pour quelque temps. Si elle ne s'en arrange pas, les grandes affaires commencent. Encore une fois, dites-moi qui a fait cela, M. de Metternich, les Turcs seuls, ou peut-être Méhêmet lui-même, par son argent et ses amis à Constantinople. Je ne voir que votre Empereur qui ne puisse pas l'avoir fait. l’acceptera-t-il ?
Il m'est arrivé ce matin bien des nouvelles. Vous savez le dehors ; voici le dedans. Des conférences ont eu lieu ces jours derniers, entre les meneurs de la gauche, députés et journalistes sur la conduite à tenir d’ici à la prochaine session notamment sur la réforme électorale. M. Barrot y présidait. Voici ce qui s’y est passé. La proposition du suffrage universel a été écartée. Il en a été de même de l’élection à deux degrés quoiqu'elle ait été vivement soutenu par quelques personnes. De même aussi de la réunion de tous les électeurs de chaque département en un seul collège siégeant au chef lieu du département, et nommant ensemble tous ses députés.
On a adopté.
1° La suppression de tout cens d'éligibilité. Le premier venu pourra être député sans payer un sou d'impôt.
2° L'admission, comme électeurs de tous les citoyens qui sont admis à être jurés.
3° Une indemnité pour les députés, à raison de 20 francs par jour pendant les sessions.
4° Aucun collège électoral ne pourra être de moins de 600 électeurs, et on admettra pour compléter ce nombre, les citoyens les plus imposés après les électeurs légaux.
5° Les délégués des colonies et les membres de la maison du Roi ne pourront être députés.
6° Les fonctionnaires accusés de corruption dans les élections pourront être poursuivis par qui voudra, et devant les tribunaux ordinaires sans aucune autorisation du Conseil d'Etat.
7° Enfin, il a été question d’interdire à tout député non-fonctionnaire d'accepter une fonction quelconque pendant la durée de la législature même en donnant sa démission. Ceci n'a été ni adopté, ni rejeté. C'est là le thème que les journaux de la gauche vont broder dans l’intervalle des sessions. La personne qui me donne ces détails, venus de source, ajoute : " Je crois cette question de la réforme très importante, en ce qu’elle décidera selon moi, la question ministérielle. Le Ministère actuel n’est assez fort ni pour accepter, ni pour rejeter une réforme électorale. Parmi les amis des Ministres centre gauche quelques uns vont disant que la crise ministérielle va commencer, et que M. Passy, Teste et Dufaure sont déterminés à ne plus souffrir le Maréchal aux Affaires étrangères, et M. Cunin- Gridame au commerce. Ce sont- là de belles paroles dont les ministres en question bercent leurs amis sans en penser un mot. "
Thiers sera à Paris dans les premiers jours d'août. Il dit beaucoup qu’il n’a d’engagement avec personne et qu’il est parfaitement libre dans ses mouvements. Le journal le Temps vient d'être acheté, dit-on, par M. de Conny, pour les Carlistes. La Presse reste entre les mains de M. Emile de Girardin et devient de plus en plus vive contre le Cabinet. Voilà un vrai Journal. Personne n'a acheté celui-là et il ne se donne qu'à vous.
Dimanche 9 heures
Je vois que les journaux ne donnent pas toutes les nouvelles d'Orient, et que vous ne comprendrez qu’à moitié ce que je vous en dis. La flotte turque est allée. Je mettre sous la protection de Méhémet. Le divan lui a écrit. Le Sultan l’a confirmé dans le gouvernement de l’Egypte et de la Syrie avec l’hérédité pour sa famille. Il l’a nommé Généralissime et soutien de l'Empire Ottoman, et l'a engagé à se rendre à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Il est probable que Méhémet ira, avec les deux flottes réunies. Voilà les faits qui du reste vous sont probablement déjà venus d'ailleurs. Ils ne sont pas officiellement connus, mais presque Certainement. Adieu. Adieu.
233. Val-Richer,Vendredi 2 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
233. Du Val Richer Vendredi soir 2 Août 1839
Ni moi non plus je n’ai rien à vous dire. Je suis de mauvaise humeur. Je mène demain mes filles à Caen. Il faut que je parte de bonne heure avant l’arrivée de la poste. Je n’ai pas eu de lettre aujourd'hui ; je n'en aurai pas demain, et après-demain à 2 heures seulement à mon retour ici. Je vous répète que je suis de mauvaise humeur si vous ne m’avez pas écrit, pourquoi me disiez- vous la veille que vous ne m'imiteriez pas ? Et si vous m’avez écrit, pourquoi ce matin n’ai-je pas eu votre lettre ?
Voici mes nouvelles de ce matin. La flotte Turque est arrivée le 14 et s'est mise absolument à la disposition de Méhémet. L'amiral Stopford ne l’a pas plus arrêtée que n'avait fait l'amiral Lalande. Ainsi, on ne peut nous imputer un prétendu concert, Méhémet a déclaré qu’il ne rendrait la flotte que lorsque Khosrer Pacha ne serait plus à la tête des affaires et qu'on lui aurait accordé l’hérédité des pays qu'il gouverne. Mais en même temps l’armée égyptienne a reçu ordre de se retirer derrière, l’Euphrate. Ceci est la grande nouvelle, car ceci prouve que l'affaire se dénouera par la Diplomatie, Méhémet ne voulant donner prétexte à personne pour la dénouer autrement. C'est ce qu’on m’écrit avec une vive satisfaction. Vous le savez peut-être déjà.
Avec cette dépêche d'Alexandrie, ce que le courrier m’a apporté ce matin de plus piquant, c’est un petit livre intitulé : L'Almanach des Chasseurs, pour l’année de chasse 1839-1840 et qui débute ainsi : " Les profanes comptent quatre saisons dans l'année ; les chasseurs n'en comptent que deux : 1° Celle où l'on chasse. 2° Celle où l'on ne chasse pas. " Puis viennent toutes sortes de préceptes et de conseils, comme celui-ci : Tuez les geais, les pies, les buses, les oiseaux sont remplis de ruses. "
Rien de tout cela n’est à mon usage, car je ne chasse pas. Vous voyez bien que la poste aurait beaucoup mieux fait de m'apporter votre lettre. Adieu jusqu'à demain matin. Plût à Dieu !
Ni moi non plus je n’ai rien à vous dire. Je suis de mauvaise humeur. Je mène demain mes filles à Caen. Il faut que je parte de bonne heure avant l’arrivée de la poste. Je n’ai pas eu de lettre aujourd'hui ; je n'en aurai pas demain, et après-demain à 2 heures seulement à mon retour ici. Je vous répète que je suis de mauvaise humeur si vous ne m’avez pas écrit, pourquoi me disiez- vous la veille que vous ne m'imiteriez pas ? Et si vous m’avez écrit, pourquoi ce matin n’ai-je pas eu votre lettre ?
Voici mes nouvelles de ce matin. La flotte Turque est arrivée le 14 et s'est mise absolument à la disposition de Méhémet. L'amiral Stopford ne l’a pas plus arrêtée que n'avait fait l'amiral Lalande. Ainsi, on ne peut nous imputer un prétendu concert, Méhémet a déclaré qu’il ne rendrait la flotte que lorsque Khosrer Pacha ne serait plus à la tête des affaires et qu'on lui aurait accordé l’hérédité des pays qu'il gouverne. Mais en même temps l’armée égyptienne a reçu ordre de se retirer derrière, l’Euphrate. Ceci est la grande nouvelle, car ceci prouve que l'affaire se dénouera par la Diplomatie, Méhémet ne voulant donner prétexte à personne pour la dénouer autrement. C'est ce qu’on m’écrit avec une vive satisfaction. Vous le savez peut-être déjà.
Avec cette dépêche d'Alexandrie, ce que le courrier m’a apporté ce matin de plus piquant, c’est un petit livre intitulé : L'Almanach des Chasseurs, pour l’année de chasse 1839-1840 et qui débute ainsi : " Les profanes comptent quatre saisons dans l'année ; les chasseurs n'en comptent que deux : 1° Celle où l'on chasse. 2° Celle où l'on ne chasse pas. " Puis viennent toutes sortes de préceptes et de conseils, comme celui-ci : Tuez les geais, les pies, les buses, les oiseaux sont remplis de ruses. "
Rien de tout cela n’est à mon usage, car je ne chasse pas. Vous voyez bien que la poste aurait beaucoup mieux fait de m'apporter votre lettre. Adieu jusqu'à demain matin. Plût à Dieu !
238. Baden, Samedi 10 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
238 Baden le 10 août Samedi 1 heure
Qu'il y a longtemps que nous ne nous sommes vus ! Savez-vous bien que c'est là ce qui m’empêche de me bien porter. Il me semble que si vous étiez auprès de moi je serais bien, tout à fait bien. Que de fois je m'en suis saisie de ce besoin, ce désir d’aller où vous êtes, de causer avec vous, de vous dire tout. Ce n’est qu’avec vous que je sais parler, ce n’est que vous que j'aime à entendre. Je n'ai que tristesse, et ennui là où vous n'êtes pas. Vous me manquez bien plus que moi je ne puis vous manquer. Soyez bien sûr de cela. Les Anglais disent ici que Lady Cowper sera à Wisbade demain. Elle ne m'en a pas dit un mot. Si elle venait en effet cela changerait un peu mes plaies. Je ne retournerai pas à Paris avant de l'avoir vue. Et puis ensuite l'Angleterre ne m'irait plus du tout, car sans elle il y aurait bien de l’isolement pour moi.
5 heures Voici votre lettre. Je suis bien aise de voir que nous admirons Méhémet Ali ensemble et pour la même chose, je crois vous avoir parlé de sa note aux consuls. Aujourd’hui on dit ici que les flottes anglo-françaises ont demandé l’entrée dans les Dardanelles et que le Divan la leur a refusé. Dans tous les cas l’Orient devient une très grosse affaire et qui a un aspect imposant dans son ensemble et dans ses détails. On dirait que l’Europe a disparu ; tout est aujourd’hui à Alexandrie et Constantinople. Le temps est un peu beau aujourd'hui. Nous avons eu froid tous ces jours passés. Je me promène également par le beau et par le mauvais temps, parce que je m'ennuie. Ah, que je m’ennuie. Vous ai-je dit que je lis la Révolution par Thiers ? Je suis au 6ème volume. Et bien, cela m’enchante. Ai-je le goût mauvais ? Adieu, je n'ai pas de nouvelle à vous dire ? Je me lève toujours à 6 heures. Je reste dehors jusqu'à 8. J'y retourne de 10 à 11. J'y retourne encore de 2 à 4. (dans l’intervalle j'ai déjeuné et dormi. J'ai fait ma toilette, & &) Je dîne à 4 heures. Je ressors à 5 1/2. Et je ne rentre que pour me coucher à 9 heures. Je mène toujours quelqu'un avec moi en calèche. Marie et la petite Ellice. ma nièce. Mad Welesley. Aujourd'hui Madame de la Redorte. A 9 1/2 je suis dans mon lit. Mais je ne dors pas.
Adieu. Adieu. Avez-vous bien envie aussi de me revoir ? Adieu.
Qu'il y a longtemps que nous ne nous sommes vus ! Savez-vous bien que c'est là ce qui m’empêche de me bien porter. Il me semble que si vous étiez auprès de moi je serais bien, tout à fait bien. Que de fois je m'en suis saisie de ce besoin, ce désir d’aller où vous êtes, de causer avec vous, de vous dire tout. Ce n’est qu’avec vous que je sais parler, ce n’est que vous que j'aime à entendre. Je n'ai que tristesse, et ennui là où vous n'êtes pas. Vous me manquez bien plus que moi je ne puis vous manquer. Soyez bien sûr de cela. Les Anglais disent ici que Lady Cowper sera à Wisbade demain. Elle ne m'en a pas dit un mot. Si elle venait en effet cela changerait un peu mes plaies. Je ne retournerai pas à Paris avant de l'avoir vue. Et puis ensuite l'Angleterre ne m'irait plus du tout, car sans elle il y aurait bien de l’isolement pour moi.
5 heures Voici votre lettre. Je suis bien aise de voir que nous admirons Méhémet Ali ensemble et pour la même chose, je crois vous avoir parlé de sa note aux consuls. Aujourd’hui on dit ici que les flottes anglo-françaises ont demandé l’entrée dans les Dardanelles et que le Divan la leur a refusé. Dans tous les cas l’Orient devient une très grosse affaire et qui a un aspect imposant dans son ensemble et dans ses détails. On dirait que l’Europe a disparu ; tout est aujourd’hui à Alexandrie et Constantinople. Le temps est un peu beau aujourd'hui. Nous avons eu froid tous ces jours passés. Je me promène également par le beau et par le mauvais temps, parce que je m'ennuie. Ah, que je m’ennuie. Vous ai-je dit que je lis la Révolution par Thiers ? Je suis au 6ème volume. Et bien, cela m’enchante. Ai-je le goût mauvais ? Adieu, je n'ai pas de nouvelle à vous dire ? Je me lève toujours à 6 heures. Je reste dehors jusqu'à 8. J'y retourne de 10 à 11. J'y retourne encore de 2 à 4. (dans l’intervalle j'ai déjeuné et dormi. J'ai fait ma toilette, & &) Je dîne à 4 heures. Je ressors à 5 1/2. Et je ne rentre que pour me coucher à 9 heures. Je mène toujours quelqu'un avec moi en calèche. Marie et la petite Ellice. ma nièce. Mad Welesley. Aujourd'hui Madame de la Redorte. A 9 1/2 je suis dans mon lit. Mais je ne dors pas.
Adieu. Adieu. Avez-vous bien envie aussi de me revoir ? Adieu.
243. Val -Richer, Lundi 12 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
243 Du Val-Richer Lundi soir 12 août 1839 9 heures
Voici ce que m’écrit un homme d’esprit, vraiment d’esprit. Vous verrez bien " J'ai vu hier M. Thiers. Je ne comprends pas ceux qui disent qu’il est mobile. Quant à moi toutes les fois que je l'ai vu, je l’ai toujours trouvé exactement le même. Il était hier ce qu’il était le lendemain du ministère du 12 mai ; ironique et méprisant pour le cabinet, jaloux et défiant pour vous, irrité et rancunier pour ses amis de la gauche et du centre gauche qui l’ont quitté pour devenir Ministres. C’est toujours la même nature, et une mauvaise nature. "
" Il est parti aujourd’hui pour le public, mais il est resté pour ses intimes. Je crois même qu’il passera encore à Paris, la journée de demain. La politique n’est pas absolument étrangère à ce retard. Les signes de dissolution dans ce cabinet-ci sont devenus si manifestes depuis quelques jours qu’il a repris goût à se mêler un peu des affaires. Il a convoqué chez lui pour aujourd'hui les journalistes de la gauche. Il s’agit de combiner un plan de campagne. Du reste, il va mener sa femme aux bains de mer d'Ostende, et dit qu’il restera encore trois mon absent. "
" Quant au Ministère, les moindres affaires grossissent à vue d’ œil et menacent de devenir pour lui des embarras infranchissables. Il n'a encore aucun parti pris sur la question des sucres, & il ne serait pas étonnant que cette question amenât sa dissolution. C’est une singulière maladie que cette impossibilité où l'on est venu de s’entendre sur quoi que ce soit. On n'a pas d'obstacles devant soi et on ne peut pas se soutenir. "
" La plus grande infirmité de ce cabinet, c’est que toutes les fenêtres en sont ouvertes. La plupart des ministres posent autour de la table du conseil comme à la tribune de la Chambre. Chacun parle pour conserver sa position, comme on dit, non pour traiter les affaires. Il n'y manque plus que des sténographes. Les journaux de toutes les couleurs savent dans les moindres détails tout ce qui s’est passé et nous aurons bientôt des bulletins du Conseil des Ministres comme ceux des comités secrets de la Chambre des députés. "
Les mêmes renseignements m’arrivent de plusieurs côtés. Je vous envoie les mieux dits. Je n’en persiste pas moins. Rien avant l'approche, très proche, de la session, au plutôt.
J'attends avec impatience, votre explication sur la lettre du Consul. Je suis curieux de savoir si je me suis bêtement trompé, et pourquoi. Je suis encore plus curieux de savoir si en effet, c’est la propriété ou l'administration provisoire de ce capital que vous pouvez réclamer. Pourquoi dites-vous que nous sommes tous pleins de vanité parce que nous trouvons du mérite à la personne qui est de notre avis ? Elle a le mérite d'être de notre avis c’est-à-dire d'avoir raison, car notre avis a raison, sans quoi nous ne l'aurions pas. La vanité, c'est le besoin de faire effet sur les autres et l'extrême importance mise à cet effet, grand ou petit, mérité ou non. Ce n'est pas le plaisir de retrouver sa pensée dans les autres, et le gré fort légitime qu'on leur en sait.
Mardi 8 heures
M. le Duc d'Orléans ne va pas en Afrique seulement pour inspecter les troupes. Il y aura des coups de fusil tirés entre lui et Abdel-Kadher. Il aime les coups de fusil. Et plus en Afrique qu'ailleurs. Il y a plus d'aventures. L'histoire romaine va recommencer là, Jugurtha, Massinissa, Sophonisbe. Le désert, le soleil, les chevaux, les tentes, la chasse au lion et la guerre, tout cela a beaucoup d’attrait, tout cela excite singulièrement la passion. Je sais maintenant en Afrique, cinq ou six hommes d’un esprit rare, d’un caractère rare, qui ne quitteraient cette vie là pour rien au monde. Le traité de la Tafna mal exécuté par Abdel Kadher sera le prétexte, et la route entre Alger et Constantine le théâtre de la guerre.
10 heures
Vos interrogations à Benkhausen ne sont point compromettantes puisqu'elles ne vont pas au delà de ses propres paroles et ne décident point la question de savoir si c’est la propriété ou l'administration provisoire qui vous appartient. Mais comme votre lettre à votre frère décide cette question et parle de la propriété comme vous étant acquise par la loi anglaise vous ferez bien, je crois, de lui envoyer copie, de ce que vous avez écrit à Benkhausen pour qu’il voie que, de ce côté, vous vous êtes strictement tenue dans les termes mêmes de la lettre du Consul. Adieu, Adieu. G.
Voici ce que m’écrit un homme d’esprit, vraiment d’esprit. Vous verrez bien " J'ai vu hier M. Thiers. Je ne comprends pas ceux qui disent qu’il est mobile. Quant à moi toutes les fois que je l'ai vu, je l’ai toujours trouvé exactement le même. Il était hier ce qu’il était le lendemain du ministère du 12 mai ; ironique et méprisant pour le cabinet, jaloux et défiant pour vous, irrité et rancunier pour ses amis de la gauche et du centre gauche qui l’ont quitté pour devenir Ministres. C’est toujours la même nature, et une mauvaise nature. "
" Il est parti aujourd’hui pour le public, mais il est resté pour ses intimes. Je crois même qu’il passera encore à Paris, la journée de demain. La politique n’est pas absolument étrangère à ce retard. Les signes de dissolution dans ce cabinet-ci sont devenus si manifestes depuis quelques jours qu’il a repris goût à se mêler un peu des affaires. Il a convoqué chez lui pour aujourd'hui les journalistes de la gauche. Il s’agit de combiner un plan de campagne. Du reste, il va mener sa femme aux bains de mer d'Ostende, et dit qu’il restera encore trois mon absent. "
" Quant au Ministère, les moindres affaires grossissent à vue d’ œil et menacent de devenir pour lui des embarras infranchissables. Il n'a encore aucun parti pris sur la question des sucres, & il ne serait pas étonnant que cette question amenât sa dissolution. C’est une singulière maladie que cette impossibilité où l'on est venu de s’entendre sur quoi que ce soit. On n'a pas d'obstacles devant soi et on ne peut pas se soutenir. "
" La plus grande infirmité de ce cabinet, c’est que toutes les fenêtres en sont ouvertes. La plupart des ministres posent autour de la table du conseil comme à la tribune de la Chambre. Chacun parle pour conserver sa position, comme on dit, non pour traiter les affaires. Il n'y manque plus que des sténographes. Les journaux de toutes les couleurs savent dans les moindres détails tout ce qui s’est passé et nous aurons bientôt des bulletins du Conseil des Ministres comme ceux des comités secrets de la Chambre des députés. "
Les mêmes renseignements m’arrivent de plusieurs côtés. Je vous envoie les mieux dits. Je n’en persiste pas moins. Rien avant l'approche, très proche, de la session, au plutôt.
J'attends avec impatience, votre explication sur la lettre du Consul. Je suis curieux de savoir si je me suis bêtement trompé, et pourquoi. Je suis encore plus curieux de savoir si en effet, c’est la propriété ou l'administration provisoire de ce capital que vous pouvez réclamer. Pourquoi dites-vous que nous sommes tous pleins de vanité parce que nous trouvons du mérite à la personne qui est de notre avis ? Elle a le mérite d'être de notre avis c’est-à-dire d'avoir raison, car notre avis a raison, sans quoi nous ne l'aurions pas. La vanité, c'est le besoin de faire effet sur les autres et l'extrême importance mise à cet effet, grand ou petit, mérité ou non. Ce n'est pas le plaisir de retrouver sa pensée dans les autres, et le gré fort légitime qu'on leur en sait.
Mardi 8 heures
M. le Duc d'Orléans ne va pas en Afrique seulement pour inspecter les troupes. Il y aura des coups de fusil tirés entre lui et Abdel-Kadher. Il aime les coups de fusil. Et plus en Afrique qu'ailleurs. Il y a plus d'aventures. L'histoire romaine va recommencer là, Jugurtha, Massinissa, Sophonisbe. Le désert, le soleil, les chevaux, les tentes, la chasse au lion et la guerre, tout cela a beaucoup d’attrait, tout cela excite singulièrement la passion. Je sais maintenant en Afrique, cinq ou six hommes d’un esprit rare, d’un caractère rare, qui ne quitteraient cette vie là pour rien au monde. Le traité de la Tafna mal exécuté par Abdel Kadher sera le prétexte, et la route entre Alger et Constantine le théâtre de la guerre.
10 heures
Vos interrogations à Benkhausen ne sont point compromettantes puisqu'elles ne vont pas au delà de ses propres paroles et ne décident point la question de savoir si c’est la propriété ou l'administration provisoire qui vous appartient. Mais comme votre lettre à votre frère décide cette question et parle de la propriété comme vous étant acquise par la loi anglaise vous ferez bien, je crois, de lui envoyer copie, de ce que vous avez écrit à Benkhausen pour qu’il voie que, de ce côté, vous vous êtes strictement tenue dans les termes mêmes de la lettre du Consul. Adieu, Adieu. G.
242 . Val -Richer, Lundi 12 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
242 Du Val-Richer, lundi 12 août 1839 6 heures
On a été peu étonné de votre refus des conférences de Vienne. On s’y attendait malgré le Gascon du Danube et ses espérances. Il en résulte ceci que trois, au lieu de quatre agissent de concert, et se le promettent ; l’une, timidement, mais pourtant positivement et de très bon cœur au fond ; l'autre, avec un peu d'humeur contre l’égyptien, mais la témoignant sans la prendre pour règle de sa conduite. Elle voulait reprendre de force la flotte turque, prendre même la flotte égyptienne. Elle y a renoncé. Nous ne sacrifierons pas l’Egypte. Nous suivrons la politique que j'ai indiquée. Nous maintiendrons de l'Empire Ottoman tout ce qui ne tombera pas de soi-même. Et quand ce qui tombera paraîtra en mesure de se reconstituer sous quelque forme nouvelle et indépendante, nous le favoriserons. Nous ne nous chargerons pas de tout régler en Orient ; mais nous n’y serons absents nulle part. Nous n’interviendrons pas entre Musulmans; mais nous n'approuverons pas que d'autres interviennent pour achever là ce qui peut vivre encore, ou étouffer ce qui commence à vivre. C'est là le principe, l’idéal, comme on dit en Allemagne. Je crois que la politique pratique y sera assez conforme.
Thiers est encore à Paris tenant sur l'Orient un langage pacifique ; plus aigre que jamais contre MM. Passy et Dufaure qui le lui rendent bien. Je ne sais ce qui s’est passé récemment entre eux ; mais pendant quelque temps Thiers avait paru ménager Dufaure. Aujourd'hui il le traite fort mal, & chez lui devant tout le monde, le met au dessous de M. Martin du Nord Rien de nouveau du reste. Vous conviendrez qu'il y aurait du guignon si je me brouillais, avec le Duc de Broglie à propos de Mad. de Staël. Grace à la liberté de la presse il n’y a point de mensonge, si sot qu'il ne se trouve quelqu'un pour le dire. En attendant que nous soyons brouillés, j’ai eu hier des nouvelles du Duc de Broglie. Il va venir en Normandie pour le Conseil-général, et compte toujours passer l’automne, en Italie, avec sa fille et son fils, jusqu'à la session.
Dès que vous le pourrez, envoyez-moi la note des effets que vous voulez faire entrer en France et l’indication du bureau de douanes c’est-à-dire de la ville par où ils doivent entrer. Je l’enverrai au Directeur général des douanes en le priant de donner des ordres à ce bureau pour en autoriser l'entrée. Je crois que cela se pourra pour toutes choses puisque toutes sont des meubles anciens, et uniquement destinés à votre usage. Ne vous en embarrassez pas et laissez moi faire. Il faut seulement que je puisse désigner la nature des effets, et le point d'arrivée. Faites-vous adresser de Pétersbourg un état bien complet des caisses, de leurs numéros et de ce que chacune contient.
Je reviens aux dents des enfants français, c’est-à-dire des miens. Je ne réponds que de ceux-là. Si vous y aviez été vous auriez été content de leur petit courage, malgré le mouvement nerveux de Pauline. L'affaire a duré trois minutes, tragédie sans pathétique et sans longueur. Mais je tenais à y être moi-même. En tout, je tiens à témoigner, beaucoup de tendresse à mes enfants, et à ce qu’ils y comptent. La tendresse manque à ce lien-là, en Angleterre, et à presque toutes les relations de famille. C’est un grand mal. Toute la vie s'en ressent. Je vous disais l'autre jour qu'en fait d’éducation morale ou physique l’atmosphère, le régime et beaucoup de liberté, étaient tout à mon avis. J’ajoute beaucoup d'affection.
9 heures
Quand je suis triste pour vous, où par vous, je vous le dis. N'y voyez jamais que ce que je vous ai dit. Je veux savoir le mot qui vous a blessée. Quel qu’il soit j’ai eu tort de le dire & vous avez eu tort de vous en blesser. Je vous aime bien tendrement, et c'est mon plaisir de vous soutenir. Adieu. Adieu. J’ai beaucoup de choses à vous dire Demain.
On a été peu étonné de votre refus des conférences de Vienne. On s’y attendait malgré le Gascon du Danube et ses espérances. Il en résulte ceci que trois, au lieu de quatre agissent de concert, et se le promettent ; l’une, timidement, mais pourtant positivement et de très bon cœur au fond ; l'autre, avec un peu d'humeur contre l’égyptien, mais la témoignant sans la prendre pour règle de sa conduite. Elle voulait reprendre de force la flotte turque, prendre même la flotte égyptienne. Elle y a renoncé. Nous ne sacrifierons pas l’Egypte. Nous suivrons la politique que j'ai indiquée. Nous maintiendrons de l'Empire Ottoman tout ce qui ne tombera pas de soi-même. Et quand ce qui tombera paraîtra en mesure de se reconstituer sous quelque forme nouvelle et indépendante, nous le favoriserons. Nous ne nous chargerons pas de tout régler en Orient ; mais nous n’y serons absents nulle part. Nous n’interviendrons pas entre Musulmans; mais nous n'approuverons pas que d'autres interviennent pour achever là ce qui peut vivre encore, ou étouffer ce qui commence à vivre. C'est là le principe, l’idéal, comme on dit en Allemagne. Je crois que la politique pratique y sera assez conforme.
Thiers est encore à Paris tenant sur l'Orient un langage pacifique ; plus aigre que jamais contre MM. Passy et Dufaure qui le lui rendent bien. Je ne sais ce qui s’est passé récemment entre eux ; mais pendant quelque temps Thiers avait paru ménager Dufaure. Aujourd'hui il le traite fort mal, & chez lui devant tout le monde, le met au dessous de M. Martin du Nord Rien de nouveau du reste. Vous conviendrez qu'il y aurait du guignon si je me brouillais, avec le Duc de Broglie à propos de Mad. de Staël. Grace à la liberté de la presse il n’y a point de mensonge, si sot qu'il ne se trouve quelqu'un pour le dire. En attendant que nous soyons brouillés, j’ai eu hier des nouvelles du Duc de Broglie. Il va venir en Normandie pour le Conseil-général, et compte toujours passer l’automne, en Italie, avec sa fille et son fils, jusqu'à la session.
Dès que vous le pourrez, envoyez-moi la note des effets que vous voulez faire entrer en France et l’indication du bureau de douanes c’est-à-dire de la ville par où ils doivent entrer. Je l’enverrai au Directeur général des douanes en le priant de donner des ordres à ce bureau pour en autoriser l'entrée. Je crois que cela se pourra pour toutes choses puisque toutes sont des meubles anciens, et uniquement destinés à votre usage. Ne vous en embarrassez pas et laissez moi faire. Il faut seulement que je puisse désigner la nature des effets, et le point d'arrivée. Faites-vous adresser de Pétersbourg un état bien complet des caisses, de leurs numéros et de ce que chacune contient.
Je reviens aux dents des enfants français, c’est-à-dire des miens. Je ne réponds que de ceux-là. Si vous y aviez été vous auriez été content de leur petit courage, malgré le mouvement nerveux de Pauline. L'affaire a duré trois minutes, tragédie sans pathétique et sans longueur. Mais je tenais à y être moi-même. En tout, je tiens à témoigner, beaucoup de tendresse à mes enfants, et à ce qu’ils y comptent. La tendresse manque à ce lien-là, en Angleterre, et à presque toutes les relations de famille. C’est un grand mal. Toute la vie s'en ressent. Je vous disais l'autre jour qu'en fait d’éducation morale ou physique l’atmosphère, le régime et beaucoup de liberté, étaient tout à mon avis. J’ajoute beaucoup d'affection.
9 heures
Quand je suis triste pour vous, où par vous, je vous le dis. N'y voyez jamais que ce que je vous ai dit. Je veux savoir le mot qui vous a blessée. Quel qu’il soit j’ai eu tort de le dire & vous avez eu tort de vous en blesser. Je vous aime bien tendrement, et c'est mon plaisir de vous soutenir. Adieu. Adieu. J’ai beaucoup de choses à vous dire Demain.
247. Val -Richer, Vendredi 16 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
247 Du Val Richer Vendredi 16 août 1839 9 heures
Tenez pour certain que nous nous ne pensons pas à autre chose, qu’à maintenir le statu quo en Orient. Nous ne demanderions pas mieux que de le maintenir tout entier : nous serions volontiers, là, aussi stationnaires que M. de Metternich. Mais quand nous voyons tomber quelque part de l’édifice, et quelqu'un sur place qui essaye d’en faire une nouvelle maison, nous l'approuvons, et tâchons de l’aider, ne pouvant mieux faire. C’est ce qui nous est arrivé en Grèce, en Egypte ; ce qui nous arriverait partout où viendrait un autre Méhémet Ali. Sans compter que ce pays-ci a le goût du mouvement de la nouveauté des parvenus gens d’esprit que partout où il les rencontre, il prend feu pour eux, et que son Gouvernement est bien obligé de faire un peu comme lui. Ce que nous ne voulons pas, c’est que Constantinople se démembre au profit de Pétersbourg ou de Vienne. Et notre principale raison de ne pas le vouloir, c’est que le jour où cela arriverait, il faudrait que quelque chose aussi, vers le Rhin ou les Alpes se démembrât à notre profit. Nous pressentons que nous sérions forcés de vouloir ceci, qu'on nous casserait aux oreilles qu’il faut le vouloir, et nous n'avons nulle envie d'être mis au défi de courir cette grande aventure ou de passer pour des poltrons si nous ne la courons pas. Nous sommes pacifiques, très pacifiques, et nous ne voulons pas être poltrons.
Je dis nous, le pays. Voilà toute notre politique sur l'Orient. Et pour soutenir cette politique là, on pourrait nous faire faire beaucoup de choses. Nous regarderions comme un acte de prudence des combats sur mer, au loin, pour éviter une guerre continentale et à nos portes. Nous souhaitons, le statu quo en Orient parce qu'il nous convient en Occident. Le démembrement de l'Empire turc, c'est pour nous le remaniement de l’Europe. Le remaniement de l’Europe personne ne sait ce que c’est. Et nous sommes un pays prudent, très prudent, quoiqu'il ne soit pas impossible de nous rendre fous encore une fois, nous le sentons, et n'en voulons pas d'occasion. En tout ceci l'Angleterre pense comme nous et nous nous entendons très bien. Mais elle a une autre pensée qui n’est qu'à elle, et qui nous gêne dans notre concert. Elle ne veut. pas qu’il se forme dans la Méditerranée aucune Puissance nouvelle ; ayant des chances de force maritime et d'importance commerciale Elle ne le veut pas, et pour la Méditerranée elle-même, et pour l'Inde. De là son inimitié contre la Grèce et contre l’Egypte ; inimitié qu'elle voudrait nous faire partager, ce dont nous ne voulons pas n'ayant point d'Inde à garder, et ne craignant rien pour notre commerce dans la Méditerranée. L'Angleterre voudrait s’enchaîner, et nous enchaîner avec elle au statu quo entier, absolu, de l'Empire Ottoman. Nous ne voulons pas. parce que nous ne le croyons pas possible, parce que nous n'y avons pas un intérêt aussi grand, aussi vital que l’Angleterre ; parce que l'entreprise si nous nous en chargions ensemble pèserait bientôt sur nos épaules plus que sur les siennes et nous compromettrait, bien davantage en Europe. Voilà par où nous nous tenons et par où nous ne nous tenons pas l'Angleterre et nous. En ce moment l'Angleterre nous cède ; elle renonce à poursuivre son mauvais vouloir contre l’Egypte. Elle y renoncerait, je crois très complètement, si elle était bien convaincue que de notre côté nous tiendrons bon avec elle pour protéger contre vous soit le vieux tronc, soit les membres détachés et rajeunis de l'empire Ottoman. Elle doute ; elle nous observe. Il dépend de nous de la rassurer tout-à-fait, et en la rassurant de lui faire adopter à peu près toute notre politique.
Vous savez l’Autriche. Jamais je crois, nous n'avons été si bien avec elle. Elle est bien timide ; elle est si peu libre de ses mouvements que la perspective de la moindre collision, même dans l'Orient et pour l'Orient seul, l’épouvante presque autant que celle du remaniement de l’Europe. Cela se ressemble en effet un peu pour elle car elle tient à l'Orient et à l’Occident ; ses racines s'étendent des sources du Pô, bouches du Danube, et l’ébranlement va vite de l’une à l'autre extrémité. Cependant je crois que si elle y était forcée, si les habilités dilatoires perdaient toute leur vertu, elle agirait avec nous, et qu'elle l’a à peu près dit. Si c’est vous-même qui pacifiez l'Orient, qui présidez à la transaction entre Constantinople et Alexandrie, qui donnez un trône au Pacha pour ne pas cesser de protéger vous-même le Sultan sur le sien, il n’y a rien à dire. Vous aurez bien fait, et nous n'en serons pas très fâchés. Vous aurez gardé votre influence ; nous aurons obtenu notre résultat.
N'est-il pas très possible que tout finisse ainsi du moins en ce moment, et que sous les mensonges des journaux, sous les fanfaronnades des Gouvernements, au fond nous agissions tous à peu près dans le même sens, n'ayant pas plus d'envie les uns que les autres de rengager les grands combats ? Je suis bien tenté de le croire. Samedi 9 heures Pas de lettre ce matin. Cela me déplaît toujours beaucoup et m'inquiète un peu. Adieu. Adieu à demain. G.
Tenez pour certain que nous nous ne pensons pas à autre chose, qu’à maintenir le statu quo en Orient. Nous ne demanderions pas mieux que de le maintenir tout entier : nous serions volontiers, là, aussi stationnaires que M. de Metternich. Mais quand nous voyons tomber quelque part de l’édifice, et quelqu'un sur place qui essaye d’en faire une nouvelle maison, nous l'approuvons, et tâchons de l’aider, ne pouvant mieux faire. C’est ce qui nous est arrivé en Grèce, en Egypte ; ce qui nous arriverait partout où viendrait un autre Méhémet Ali. Sans compter que ce pays-ci a le goût du mouvement de la nouveauté des parvenus gens d’esprit que partout où il les rencontre, il prend feu pour eux, et que son Gouvernement est bien obligé de faire un peu comme lui. Ce que nous ne voulons pas, c’est que Constantinople se démembre au profit de Pétersbourg ou de Vienne. Et notre principale raison de ne pas le vouloir, c’est que le jour où cela arriverait, il faudrait que quelque chose aussi, vers le Rhin ou les Alpes se démembrât à notre profit. Nous pressentons que nous sérions forcés de vouloir ceci, qu'on nous casserait aux oreilles qu’il faut le vouloir, et nous n'avons nulle envie d'être mis au défi de courir cette grande aventure ou de passer pour des poltrons si nous ne la courons pas. Nous sommes pacifiques, très pacifiques, et nous ne voulons pas être poltrons.
Je dis nous, le pays. Voilà toute notre politique sur l'Orient. Et pour soutenir cette politique là, on pourrait nous faire faire beaucoup de choses. Nous regarderions comme un acte de prudence des combats sur mer, au loin, pour éviter une guerre continentale et à nos portes. Nous souhaitons, le statu quo en Orient parce qu'il nous convient en Occident. Le démembrement de l'Empire turc, c'est pour nous le remaniement de l’Europe. Le remaniement de l’Europe personne ne sait ce que c’est. Et nous sommes un pays prudent, très prudent, quoiqu'il ne soit pas impossible de nous rendre fous encore une fois, nous le sentons, et n'en voulons pas d'occasion. En tout ceci l'Angleterre pense comme nous et nous nous entendons très bien. Mais elle a une autre pensée qui n’est qu'à elle, et qui nous gêne dans notre concert. Elle ne veut. pas qu’il se forme dans la Méditerranée aucune Puissance nouvelle ; ayant des chances de force maritime et d'importance commerciale Elle ne le veut pas, et pour la Méditerranée elle-même, et pour l'Inde. De là son inimitié contre la Grèce et contre l’Egypte ; inimitié qu'elle voudrait nous faire partager, ce dont nous ne voulons pas n'ayant point d'Inde à garder, et ne craignant rien pour notre commerce dans la Méditerranée. L'Angleterre voudrait s’enchaîner, et nous enchaîner avec elle au statu quo entier, absolu, de l'Empire Ottoman. Nous ne voulons pas. parce que nous ne le croyons pas possible, parce que nous n'y avons pas un intérêt aussi grand, aussi vital que l’Angleterre ; parce que l'entreprise si nous nous en chargions ensemble pèserait bientôt sur nos épaules plus que sur les siennes et nous compromettrait, bien davantage en Europe. Voilà par où nous nous tenons et par où nous ne nous tenons pas l'Angleterre et nous. En ce moment l'Angleterre nous cède ; elle renonce à poursuivre son mauvais vouloir contre l’Egypte. Elle y renoncerait, je crois très complètement, si elle était bien convaincue que de notre côté nous tiendrons bon avec elle pour protéger contre vous soit le vieux tronc, soit les membres détachés et rajeunis de l'empire Ottoman. Elle doute ; elle nous observe. Il dépend de nous de la rassurer tout-à-fait, et en la rassurant de lui faire adopter à peu près toute notre politique.
Vous savez l’Autriche. Jamais je crois, nous n'avons été si bien avec elle. Elle est bien timide ; elle est si peu libre de ses mouvements que la perspective de la moindre collision, même dans l'Orient et pour l'Orient seul, l’épouvante presque autant que celle du remaniement de l’Europe. Cela se ressemble en effet un peu pour elle car elle tient à l'Orient et à l’Occident ; ses racines s'étendent des sources du Pô, bouches du Danube, et l’ébranlement va vite de l’une à l'autre extrémité. Cependant je crois que si elle y était forcée, si les habilités dilatoires perdaient toute leur vertu, elle agirait avec nous, et qu'elle l’a à peu près dit. Si c’est vous-même qui pacifiez l'Orient, qui présidez à la transaction entre Constantinople et Alexandrie, qui donnez un trône au Pacha pour ne pas cesser de protéger vous-même le Sultan sur le sien, il n’y a rien à dire. Vous aurez bien fait, et nous n'en serons pas très fâchés. Vous aurez gardé votre influence ; nous aurons obtenu notre résultat.
N'est-il pas très possible que tout finisse ainsi du moins en ce moment, et que sous les mensonges des journaux, sous les fanfaronnades des Gouvernements, au fond nous agissions tous à peu près dans le même sens, n'ayant pas plus d'envie les uns que les autres de rengager les grands combats ? Je suis bien tenté de le croire. Samedi 9 heures Pas de lettre ce matin. Cela me déplaît toujours beaucoup et m'inquiète un peu. Adieu. Adieu à demain. G.
252. Val -Richer, Jeudi 22 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
252. Du Val-Richer. Jeudi 22 août 1839 7 heures
Madame de Boigne est venue passer hier la matinée au Val-Richer. Elle va pour trois semaines chez Madame de Chastenay, près de Caen. Mad. de Chastenay m’a écrit avant-hier pour m’engager à y aller passer quelques jours avec elle. Mais je reste chez moi. Je suis las de courses et de conversations qui ne me plaisent pas beaucoup. Je n’aime ni le mouvement, ni le monde pour lui-même. Ce sont des cadres où je veux choisir et placer moi-même les figures. D'ailleurs, j’attends quelques personnes chez moi. Imaginez que Madame de Boigne est venue à pied de la grande route ici, une demi-lieue. Elle a peur des mauvais chemins en voiture, et mon chemin neuf ne sera ouvert que le 1er octobre. Elle était rendue en arrivant, sa voiture suivait fort tranquillement. Il n’y a pas l'ombre de danger dans cette traverse, quoique fort mauvaise. On va presque à travers champs. Je l’ai ramenée à la grande route, en causant. Elle ne sait rien & croit comme moi, qu’il n’y aura rien d'ici à la session.
Le Maréchal est fort content de l’Europe, le Roi est fort content du Maréchal. Desages est content aussi. Tout le monde dit que ça n’ira pas, & ça va, et ça ira jusqu'à ce qu’il faille sérieusement deux choses qui n’y sont pas de l'action et de la parole. Il n’y a plus personne à Paris Les derniers sont partis pour les Conseils-généraux.
Le Chancelier reste à soigner Mad. Pasquier qui s'est cassé l’os du fémur, et n'en guérira pas. Elle a 80 ans. Au fait, c’est de cela que Mad.de Boigne, est le plus occupée.
Quand je vous ai dit que nous n'interviendrions pas entre Musulmans, je voulais dire que nous ne ferions jamais la guerre pour les prétentions de l’un, contre celles de l'autre. Nous interviendrons pour la paix et par les négociations, tant qu’on voudra, seuls s’il le faut et bien mieux encore tout le monde, ensemble. Le Sultan et le Pacha pourraient bien rester comme la Reine Christine et Don Carlos face à face, toujours en guerre et sans rien finir. L'Orient serait mis à la fois en question et en suspens comme l'Occident. Voilà le Général Baudrand qui va féliciter Abdul-Medgid. J’en suis bien aise, pour nos affaires et pour lui. Il ne donnera là, et ici à son retour, que de bons conseils. Il allait partir pour l'Afrique avec M. le duc d'Orléans, et y faire Dieu sait quoi. Métier très fatigant pour un homme qui n’est plus jeune et qui vient d'être malade. Il se reposera à Constantinople. La Porte remettant ses affaires avec Méhémet entre les mains des cinq Puissances, c’est la conférence moins la réunion à Vienne, que nous sommes tous habiles à déguiser nos faiblesses ! Pourquoi ne pas dire tout simplement et tout haut que pas plus les uns que les autres, on ne veut se faire la guerre ? Je crois qu’on a raison, et il y aurait de la grandeur à agir ouvertement et tous ensemble en ce sens en disant pourquoi. Mais on veut garder encore quelques airs d’ambitieux, de guerrier ; on veut faire semblant de s'effrayer les uns, les autres sans se battre et on aime mieux s'abaisser en jouant une pauvre comédie que grande en disant vrai. On sera bien confus et embarrassé le jour où le bon Dieu viendra et lèvera lui-même la toile en appelant chaque acteur à jouer enfin son rôle, et à faire marcher le drame.
9 heures
Je vais causer avec ma mère de ce que vous cherchez. Je compte plus sur Melle Chabaud que sur toute autre pour le trouver. Elle a de l’esprit et connait souvent de ces personnes-là. Adieu. Adieu. Je trouve votre 246 un peu moins mal. adieu. Je vous en voudrai toujours de changer. Mais Adieu quand même. G.
Madame de Boigne est venue passer hier la matinée au Val-Richer. Elle va pour trois semaines chez Madame de Chastenay, près de Caen. Mad. de Chastenay m’a écrit avant-hier pour m’engager à y aller passer quelques jours avec elle. Mais je reste chez moi. Je suis las de courses et de conversations qui ne me plaisent pas beaucoup. Je n’aime ni le mouvement, ni le monde pour lui-même. Ce sont des cadres où je veux choisir et placer moi-même les figures. D'ailleurs, j’attends quelques personnes chez moi. Imaginez que Madame de Boigne est venue à pied de la grande route ici, une demi-lieue. Elle a peur des mauvais chemins en voiture, et mon chemin neuf ne sera ouvert que le 1er octobre. Elle était rendue en arrivant, sa voiture suivait fort tranquillement. Il n’y a pas l'ombre de danger dans cette traverse, quoique fort mauvaise. On va presque à travers champs. Je l’ai ramenée à la grande route, en causant. Elle ne sait rien & croit comme moi, qu’il n’y aura rien d'ici à la session.
Le Maréchal est fort content de l’Europe, le Roi est fort content du Maréchal. Desages est content aussi. Tout le monde dit que ça n’ira pas, & ça va, et ça ira jusqu'à ce qu’il faille sérieusement deux choses qui n’y sont pas de l'action et de la parole. Il n’y a plus personne à Paris Les derniers sont partis pour les Conseils-généraux.
Le Chancelier reste à soigner Mad. Pasquier qui s'est cassé l’os du fémur, et n'en guérira pas. Elle a 80 ans. Au fait, c’est de cela que Mad.de Boigne, est le plus occupée.
Quand je vous ai dit que nous n'interviendrions pas entre Musulmans, je voulais dire que nous ne ferions jamais la guerre pour les prétentions de l’un, contre celles de l'autre. Nous interviendrons pour la paix et par les négociations, tant qu’on voudra, seuls s’il le faut et bien mieux encore tout le monde, ensemble. Le Sultan et le Pacha pourraient bien rester comme la Reine Christine et Don Carlos face à face, toujours en guerre et sans rien finir. L'Orient serait mis à la fois en question et en suspens comme l'Occident. Voilà le Général Baudrand qui va féliciter Abdul-Medgid. J’en suis bien aise, pour nos affaires et pour lui. Il ne donnera là, et ici à son retour, que de bons conseils. Il allait partir pour l'Afrique avec M. le duc d'Orléans, et y faire Dieu sait quoi. Métier très fatigant pour un homme qui n’est plus jeune et qui vient d'être malade. Il se reposera à Constantinople. La Porte remettant ses affaires avec Méhémet entre les mains des cinq Puissances, c’est la conférence moins la réunion à Vienne, que nous sommes tous habiles à déguiser nos faiblesses ! Pourquoi ne pas dire tout simplement et tout haut que pas plus les uns que les autres, on ne veut se faire la guerre ? Je crois qu’on a raison, et il y aurait de la grandeur à agir ouvertement et tous ensemble en ce sens en disant pourquoi. Mais on veut garder encore quelques airs d’ambitieux, de guerrier ; on veut faire semblant de s'effrayer les uns, les autres sans se battre et on aime mieux s'abaisser en jouant une pauvre comédie que grande en disant vrai. On sera bien confus et embarrassé le jour où le bon Dieu viendra et lèvera lui-même la toile en appelant chaque acteur à jouer enfin son rôle, et à faire marcher le drame.
9 heures
Je vais causer avec ma mère de ce que vous cherchez. Je compte plus sur Melle Chabaud que sur toute autre pour le trouver. Elle a de l’esprit et connait souvent de ces personnes-là. Adieu. Adieu. Je trouve votre 246 un peu moins mal. adieu. Je vous en voudrai toujours de changer. Mais Adieu quand même. G.
256. Val -Richer, Lundi 26 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
256 Du Val-Richer Lundi soir 26 août 1839 9 heures
Voyons un peu nos affaires. Je ne saurais fixer aujourd’hui le jour où je pourrai aller vous voir. J'attends après-demain M. Devaines, son fils et une autre personne. Il faut que je les aie vus pour régler ma marche. Quel ennui que tous ces arrangements quand je n'ai d'autre envie que d'être près de vous, de vos voir, de vous entendre, de vous parler, de vous retrouver vous, changée ou non, et mon bonheur qui ne peut changer. Mais répétez-moi en attendant que le Dr Chemside ne vous trouve pas aussi changée que vous l’imaginez. Si vous allez, ou si vous pouvez aller à Dieppe, il est probable que je l'aimerai mieux que Paris. Sauf vous, je n'irais pas à Paris en ce moment. Il n’y a rien à faire, et on dira que j’y viens faire quelque chose. Mon absence, ma parfaite tranquillité sont d’un bon effet; je le sais, les gens d'esprit me le disent. Cela ne signifie rien si je ne puis vous voir qu'à Paris, et au fait cela ne signifie pas grand chose ; peu importe quelques lignes de journaux et quelques conversations de badauds. Mais toutes choses égales d'ailleurs, je crois que je préférerai Dieppe, ne fût-ce que pour ce que vous m'en dites. Dieppe ou Boulogne, cela se ressemble, n’est-ce pas ? D'ici là reposez-vous bien. Il faut être bien reposée.
Vous trouvez l'Orient en voie de pacification. Nous sommes tous d'accord, d'accord du moins de nous mettre d'accord et d’en traiter ensemble. Nous avons failli faire tout le contraire. Nous avons dit que si vous alliez à Constantinople, nous irions dans la mer de Marmara ; et que de façon ou d'autre, nous serions tous où vous seriez. Vous avez pensé que puisqu’il fallait se résigner à être tous ensemble mieux valait l'être sans embarras qu'avec embarras. Nous sommes contents. Les difficultés commencent mais nous croyons les périls passés.
J’attends des nouvelles de mon pauvre ami Baudraud. Il est malade et ne pourra probablement pas aller à Constantinople. Nous nous sommes beaucoup écrit. Mais que de choses nous aurons à nous dire !
Mardi matin 7 heures
Le plaisir de vous sentir plus près de moi ne s’use pas. Qu’on devient modeste dans ses prétentions ! J’ai appris hier que je n'aurais pas ici, dans le mois de septembre, deux personnes qui auraient pu y venir. M. & Mad. de Rémusat. Ils étaient dans leur terre, près de Toulouse, quand ils ont appris que leur fils aîné, qui a tout juste l’âge d’Henriette, était malade, très malade dans son Collège, d’une fluxion de poitrine mêlée d’accès de fièvre typhoïde. Ils sont accourus à Paris la mort dans l'âme. Ils ont trouvé leur fils hors de danger et à présent il va très bien. Quand je les ai sus à Paris, je les ai engagés à venir passer quelques jours ici avec l'enfant rétabli qui aurait sans doute besoin de la campagne. Ils font mieux que cela ; ils l’emmènent en Languedoc, où ils retournent jusqu'à la session. M. de Rémusat veut se trouver à Toulouse au passage de M. le Duc d'Orléans.
Il y a vraiment quelque tentative d'accommodement en Espagne. La situation de D. Carlos devient toujours plus mauvaise. Celle de la reine Christine pas meilleure. Marote a été assez féroce pour avoir le droit d'être un peu complaisant. Les oscaltados qui reviennent en majorité dans les Cortes témoignent quelque envie d’essayer de la faiblesse après la folie. L’Angleterre s’ennuie d’entretenir, un désordre d’où elle n’a pas même pu tiré un traité de commerce. On essaiera peut-être là aussi d’une conférence.
9 heures
Au nom de Dieu, que vos nerfs se reposent ! Je ne puis vous dire le chagrin qu'ils me font. Que sert de vous le dire ? C'est ma prétention de n'avoir plus besoin de vous dire combien je vous aime. Ai-je tort ? Plaisir oui, grand plaisir. Besoin non, plus du tout. Rouen vaudra certainement mieux que Dieppe. C'est plus près. Mais vous ne pouvez pas prendre de bains de mer à Rouen. J’apprends à l’instant même que M. de Metternich est fort malade, dangereusement me dit-on, vous le savez sans doute. Cela n'aiderait pas aux affaires d'Orient. Adieu Adieu. G.
Voyons un peu nos affaires. Je ne saurais fixer aujourd’hui le jour où je pourrai aller vous voir. J'attends après-demain M. Devaines, son fils et une autre personne. Il faut que je les aie vus pour régler ma marche. Quel ennui que tous ces arrangements quand je n'ai d'autre envie que d'être près de vous, de vos voir, de vous entendre, de vous parler, de vous retrouver vous, changée ou non, et mon bonheur qui ne peut changer. Mais répétez-moi en attendant que le Dr Chemside ne vous trouve pas aussi changée que vous l’imaginez. Si vous allez, ou si vous pouvez aller à Dieppe, il est probable que je l'aimerai mieux que Paris. Sauf vous, je n'irais pas à Paris en ce moment. Il n’y a rien à faire, et on dira que j’y viens faire quelque chose. Mon absence, ma parfaite tranquillité sont d’un bon effet; je le sais, les gens d'esprit me le disent. Cela ne signifie rien si je ne puis vous voir qu'à Paris, et au fait cela ne signifie pas grand chose ; peu importe quelques lignes de journaux et quelques conversations de badauds. Mais toutes choses égales d'ailleurs, je crois que je préférerai Dieppe, ne fût-ce que pour ce que vous m'en dites. Dieppe ou Boulogne, cela se ressemble, n’est-ce pas ? D'ici là reposez-vous bien. Il faut être bien reposée.
Vous trouvez l'Orient en voie de pacification. Nous sommes tous d'accord, d'accord du moins de nous mettre d'accord et d’en traiter ensemble. Nous avons failli faire tout le contraire. Nous avons dit que si vous alliez à Constantinople, nous irions dans la mer de Marmara ; et que de façon ou d'autre, nous serions tous où vous seriez. Vous avez pensé que puisqu’il fallait se résigner à être tous ensemble mieux valait l'être sans embarras qu'avec embarras. Nous sommes contents. Les difficultés commencent mais nous croyons les périls passés.
J’attends des nouvelles de mon pauvre ami Baudraud. Il est malade et ne pourra probablement pas aller à Constantinople. Nous nous sommes beaucoup écrit. Mais que de choses nous aurons à nous dire !
Mardi matin 7 heures
Le plaisir de vous sentir plus près de moi ne s’use pas. Qu’on devient modeste dans ses prétentions ! J’ai appris hier que je n'aurais pas ici, dans le mois de septembre, deux personnes qui auraient pu y venir. M. & Mad. de Rémusat. Ils étaient dans leur terre, près de Toulouse, quand ils ont appris que leur fils aîné, qui a tout juste l’âge d’Henriette, était malade, très malade dans son Collège, d’une fluxion de poitrine mêlée d’accès de fièvre typhoïde. Ils sont accourus à Paris la mort dans l'âme. Ils ont trouvé leur fils hors de danger et à présent il va très bien. Quand je les ai sus à Paris, je les ai engagés à venir passer quelques jours ici avec l'enfant rétabli qui aurait sans doute besoin de la campagne. Ils font mieux que cela ; ils l’emmènent en Languedoc, où ils retournent jusqu'à la session. M. de Rémusat veut se trouver à Toulouse au passage de M. le Duc d'Orléans.
Il y a vraiment quelque tentative d'accommodement en Espagne. La situation de D. Carlos devient toujours plus mauvaise. Celle de la reine Christine pas meilleure. Marote a été assez féroce pour avoir le droit d'être un peu complaisant. Les oscaltados qui reviennent en majorité dans les Cortes témoignent quelque envie d’essayer de la faiblesse après la folie. L’Angleterre s’ennuie d’entretenir, un désordre d’où elle n’a pas même pu tiré un traité de commerce. On essaiera peut-être là aussi d’une conférence.
9 heures
Au nom de Dieu, que vos nerfs se reposent ! Je ne puis vous dire le chagrin qu'ils me font. Que sert de vous le dire ? C'est ma prétention de n'avoir plus besoin de vous dire combien je vous aime. Ai-je tort ? Plaisir oui, grand plaisir. Besoin non, plus du tout. Rouen vaudra certainement mieux que Dieppe. C'est plus près. Mais vous ne pouvez pas prendre de bains de mer à Rouen. J’apprends à l’instant même que M. de Metternich est fort malade, dangereusement me dit-on, vous le savez sans doute. Cela n'aiderait pas aux affaires d'Orient. Adieu Adieu. G.
257. Val -Richer, Mardi 27 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
257 Mardi soir 27 août Du Val-Richer. 1839-10 heures
Je rentre dans mon Cabinet. Si j’étais à Paris, je serais chez vous. Vous m'avez gâté la solitude. Moi qui me passe si bien de tant de choses et de gens, je ne sais pas me passer de vous. J'ai bien raison. Je compte toujours que M. Devaines et son fils arriveront après demain. Nous réglerons alors notre moment. Rouen me convient à merveille. Mais vous serez là bien en l’air, dans une auberge, sans établissement. Je ne sais qui vous trouveriez à Dieppe. La saison n'est pas bonne pour les bains de mer. J'en ai tout près d’ici à Trouville, d'où l’on s'en va à cause du froid. Je ne veux pas que vous risquiez rien, rien du tout, entendez bien ceci. J’attends aussi des nouvelles du Duc de Broglie qui est à Evreux, à son Conseil Général. Il viendra me voir, et j'irai le voir en passant. Evreux est sur ma route. Il n’a vu personne du tout en passant à Paris. Les Ministres en ont été un peu étonnés.
Génie, je ne sais pourquoi ne m’a pas encore répondu sur le petit hôtel de la rue Lascazes. Il est peut-être loué (l'hôtel) Sinon voulez-vous que je fasse dire à Génie d’aller vous voir, et de vous le décrire. Mais vous aimerez mieux y aller vous- même. A quelle heure vous promenez- vous ? Je ne saurais vous dire avec quel triste dépit je pense que j’ai passé un mois à Paris sans vous, et que vous allez y passer tant de temps sans moi. Zéa y est encore. Faites-lui dire de venir vous voir. Mais pouvez-vous crier assez fort ? La dernière fois que je l'ai vu il était plus sourd que jamais et il ne voulait pas laisser dire un mot à son frère Colombe qu’il m’avait amené.
Mercredi matin, 6 heures
Dormez-vous ? Que je serais heureux si j'y pouvais voir ! La romance a beau traîner dans les rues ; elle est charmante. C’est une chose charmante de veiller auprès d’une personne, de la personne chérie. Pourvu qu’elle ne soit par malade. Quel supplice ! Je doute qu'on ait bien emmanché l'affaire d'Orient en demandent tout-à-coup, et pour le début, ou Pacha de rendre la folle. C'est une satisfaction d’amour-propre qu'on se donne, mais qui aggrave la difficulté au lieu de la résoudre. Le Pacha rendra la flotte quand on se sera arrangé avec lui ; mais céder ainsi d'avance, sur une première sommation, c’est beaucoup. Pourquoi placer la grosse question sur une si petite circonstance, et avant de l’avoir déballé, et sans donner du temps au Pacha ? Je suis obligé de penser ce que je pense en effet sans le dire. L’esprit manque. Encore une fois, que de choses j'ai à vous dire ! J’y touche ; je vous les dirai bientôt ; mais que le doux moment est loin quand on en approche ?
9 h. 1/2
Certainement, j'irai à Rouen et de là à Dieppe ; mais j'ai besoin que vous me donniez au moins un jour de plus et que vous ne partiez pour Rouen que lundi. Il me faut cette latitude pour mes hôtes. Dites- moi tout de suite quel jour vous serez à Rouen. Vous ne me dites rien de la maladie du Prince de Metternich. J'en conclus qu’elle n'est pas aussi grave qu'on me l'a dit. Politique à part, je le désire. Je ne vous veux pas une impression triste de plus, et celle là serait fort naturelle. Adieu. Adieu. Vous dites qu'il ne vous fatigue pas encore. Ce n'est pas assez. Adieu. G.
Je rentre dans mon Cabinet. Si j’étais à Paris, je serais chez vous. Vous m'avez gâté la solitude. Moi qui me passe si bien de tant de choses et de gens, je ne sais pas me passer de vous. J'ai bien raison. Je compte toujours que M. Devaines et son fils arriveront après demain. Nous réglerons alors notre moment. Rouen me convient à merveille. Mais vous serez là bien en l’air, dans une auberge, sans établissement. Je ne sais qui vous trouveriez à Dieppe. La saison n'est pas bonne pour les bains de mer. J'en ai tout près d’ici à Trouville, d'où l’on s'en va à cause du froid. Je ne veux pas que vous risquiez rien, rien du tout, entendez bien ceci. J’attends aussi des nouvelles du Duc de Broglie qui est à Evreux, à son Conseil Général. Il viendra me voir, et j'irai le voir en passant. Evreux est sur ma route. Il n’a vu personne du tout en passant à Paris. Les Ministres en ont été un peu étonnés.
Génie, je ne sais pourquoi ne m’a pas encore répondu sur le petit hôtel de la rue Lascazes. Il est peut-être loué (l'hôtel) Sinon voulez-vous que je fasse dire à Génie d’aller vous voir, et de vous le décrire. Mais vous aimerez mieux y aller vous- même. A quelle heure vous promenez- vous ? Je ne saurais vous dire avec quel triste dépit je pense que j’ai passé un mois à Paris sans vous, et que vous allez y passer tant de temps sans moi. Zéa y est encore. Faites-lui dire de venir vous voir. Mais pouvez-vous crier assez fort ? La dernière fois que je l'ai vu il était plus sourd que jamais et il ne voulait pas laisser dire un mot à son frère Colombe qu’il m’avait amené.
Mercredi matin, 6 heures
Dormez-vous ? Que je serais heureux si j'y pouvais voir ! La romance a beau traîner dans les rues ; elle est charmante. C’est une chose charmante de veiller auprès d’une personne, de la personne chérie. Pourvu qu’elle ne soit par malade. Quel supplice ! Je doute qu'on ait bien emmanché l'affaire d'Orient en demandent tout-à-coup, et pour le début, ou Pacha de rendre la folle. C'est une satisfaction d’amour-propre qu'on se donne, mais qui aggrave la difficulté au lieu de la résoudre. Le Pacha rendra la flotte quand on se sera arrangé avec lui ; mais céder ainsi d'avance, sur une première sommation, c’est beaucoup. Pourquoi placer la grosse question sur une si petite circonstance, et avant de l’avoir déballé, et sans donner du temps au Pacha ? Je suis obligé de penser ce que je pense en effet sans le dire. L’esprit manque. Encore une fois, que de choses j'ai à vous dire ! J’y touche ; je vous les dirai bientôt ; mais que le doux moment est loin quand on en approche ?
9 h. 1/2
Certainement, j'irai à Rouen et de là à Dieppe ; mais j'ai besoin que vous me donniez au moins un jour de plus et que vous ne partiez pour Rouen que lundi. Il me faut cette latitude pour mes hôtes. Dites- moi tout de suite quel jour vous serez à Rouen. Vous ne me dites rien de la maladie du Prince de Metternich. J'en conclus qu’elle n'est pas aussi grave qu'on me l'a dit. Politique à part, je le désire. Je ne vous veux pas une impression triste de plus, et celle là serait fort naturelle. Adieu. Adieu. Vous dites qu'il ne vous fatigue pas encore. Ce n'est pas assez. Adieu. G.
258. Val -Richer, Jeudi 29 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
258 Jeudi 29 août 7 heures, du Val Richer,
J'ai ri en lisant votre lettre. Est-ce que nous aurions moins d’esprit que nous ne croyons ? Vous défendez presque les gasconnades d’une politique. Est- ce que j'aurais défendu celles de l'autre ? Vous voyez bien que tout le monde veut la paix et veut avoir l'air d'être tout prêt à la guerre. Ce n’est pas là une de ces choses dont Pascal dit : " Erreur au delà des Pyrénées, vérité en deçà. " C’est vérité partout. Il n’y a que les journalistes et les badauds qui en jugent autrement.
Quand le monde sera-t-il assez sensé pour réduire un peu dans la politique, la part de la comédie ? Vous verrez que si vous tenez bon et nous aussi, on trouvera pour la conférence un moyen terme entre Vienne et Constantinople, et nous ne tiendrons bon, ni vous non plus, que dans cette confiance là. Je ne crois pas que ce soit l'Angleterre qui nous ait fait parler par note de le mer de Marmara. Nous l'avons fait pour pouvoir le dire. Nous causerons de tout cela à Dieppe. Baudrand n'est point malade. L’Angleterre n'envoie personne à Constantinople pour complimenter le Sultan. Voilà pourquoi Baudrand n’y va pas. Il me semble qu’on a tort, vous envoyez. L’Angleterre n'envoie pas. J’enverrais ! Que fait l’Autriche ? Voici ce qu’on m'écrit de Syra, après trois mois de séjour dans l'Asie mineure et à Constantinople, au milieu des scènes mêmes. " Je suis loin de croire que l'Empire Ottoman ne soit plus qu’un cadavre. Il est bien mal, mais il lui faut si peu de chose pour vivre ! C’est un peuple qui s'accommode du mal comme du bien parce qu'il n’en perçoit pas nettement la différence. Ce qui m’a le plus frappé, c'est l’insouciance, l’apathie. Point d'industrie, ni commerce, ni culture, ni quoi que ce soit qui annonce la vie. La dépopulation est effrayante, Dans certains districts, où l'on comptait, il y a quinze ans 300 000 âmes, on n'en compte plus que 13 000.
9 h. 1/2
Je reçois une lettre du Duc de Broglie, qui est à Evreux, présidant son Conseil général, et qui me demande d’aller l’y voir. J’irai dimanche ou lundi, et je serai le lendemain à Paris. C’est le plus court moyen de vous voir. Là nous causerons de vos projets ultérieurs. Ainsi, lundi ou Mardi. Ce sera charmant. Ce qui l’est déjà, c’est que vous ne soyez pas si faible. Reposez-vous en effet quelques jours, plusieurs jours. Vous en avez grand besoin.
Génie m’écrit aujourd’hui même, et me parle de plusieurs appartements d’hôtel de la rue Lascazes est loué à Mad. de Lorges. Dans les propositions, il y en a une qui ne me paraît pas sans mérite. Je vous en parlerai demain, en attendant mieux. Adieu. Adieu. G.
J'ai ri en lisant votre lettre. Est-ce que nous aurions moins d’esprit que nous ne croyons ? Vous défendez presque les gasconnades d’une politique. Est- ce que j'aurais défendu celles de l'autre ? Vous voyez bien que tout le monde veut la paix et veut avoir l'air d'être tout prêt à la guerre. Ce n’est pas là une de ces choses dont Pascal dit : " Erreur au delà des Pyrénées, vérité en deçà. " C’est vérité partout. Il n’y a que les journalistes et les badauds qui en jugent autrement.
Quand le monde sera-t-il assez sensé pour réduire un peu dans la politique, la part de la comédie ? Vous verrez que si vous tenez bon et nous aussi, on trouvera pour la conférence un moyen terme entre Vienne et Constantinople, et nous ne tiendrons bon, ni vous non plus, que dans cette confiance là. Je ne crois pas que ce soit l'Angleterre qui nous ait fait parler par note de le mer de Marmara. Nous l'avons fait pour pouvoir le dire. Nous causerons de tout cela à Dieppe. Baudrand n'est point malade. L’Angleterre n'envoie personne à Constantinople pour complimenter le Sultan. Voilà pourquoi Baudrand n’y va pas. Il me semble qu’on a tort, vous envoyez. L’Angleterre n'envoie pas. J’enverrais ! Que fait l’Autriche ? Voici ce qu’on m'écrit de Syra, après trois mois de séjour dans l'Asie mineure et à Constantinople, au milieu des scènes mêmes. " Je suis loin de croire que l'Empire Ottoman ne soit plus qu’un cadavre. Il est bien mal, mais il lui faut si peu de chose pour vivre ! C’est un peuple qui s'accommode du mal comme du bien parce qu'il n’en perçoit pas nettement la différence. Ce qui m’a le plus frappé, c'est l’insouciance, l’apathie. Point d'industrie, ni commerce, ni culture, ni quoi que ce soit qui annonce la vie. La dépopulation est effrayante, Dans certains districts, où l'on comptait, il y a quinze ans 300 000 âmes, on n'en compte plus que 13 000.
9 h. 1/2
Je reçois une lettre du Duc de Broglie, qui est à Evreux, présidant son Conseil général, et qui me demande d’aller l’y voir. J’irai dimanche ou lundi, et je serai le lendemain à Paris. C’est le plus court moyen de vous voir. Là nous causerons de vos projets ultérieurs. Ainsi, lundi ou Mardi. Ce sera charmant. Ce qui l’est déjà, c’est que vous ne soyez pas si faible. Reposez-vous en effet quelques jours, plusieurs jours. Vous en avez grand besoin.
Génie m’écrit aujourd’hui même, et me parle de plusieurs appartements d’hôtel de la rue Lascazes est loué à Mad. de Lorges. Dans les propositions, il y en a une qui ne me paraît pas sans mérite. Je vous en parlerai demain, en attendant mieux. Adieu. Adieu. G.
260. Val-Richer, Samedi 31 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
260 Du Val-Richer, Samedi 31 août 1839 6 heures
Mes nouveaux hôtes me sont arrivés hier. Je les quitterai Lundi matin pour aller dîner à Evreux. De là, je puis faire, dans la journée de mardi ce que vous préférerez, aller vous retrouver à Paris au à Rouen. Mais il faudrait que vous fussiez mardi à Rouen. Voyez ce qui vous convient décidément et dites-le moi en réponse à cette lettre. Je prendrai la vôtre Lundi matin en passant à Lisieux. Si vous préférez Rouen, dites-moi où vous descendrez, car nous pourrions passer plus d’une heure à nous chercher dans cette grande et obscure ville. Il y a sur le port un grand hôtel, fort accrédité qui s’appelle je crois hôtel de France ou de l’Europe. Vous pourriez y descendre. Nous irions de là à Dieppe. Si vous restez à Paris, je serai à La Terrasse mardi dans la journée. Je ne sais pas bien à quelle heure. Il fait très beau depuis deux jours. Paris ou Rouen, je prie pour le soleil. Vous en avez besoin et j'y prends plaisir.
J’entends bien que vous ne voudrez pas la paix à tout prix. Mais il faudrait que vous voulussiez la guerre à tout prix pour qu'elle arrivât. Vous en êtes loin. Je persiste donc, grâce à Dieu. Pourtant Dieu en sait plus que nous et s’il lui plaisait de brouiller, les choses à un certain point, toute notre bonne volonté ne les débrouillerait pas. Ce n'est ni la prévoyance, ni le désir des hommes qui réglera cet avenir-là. C’est le sort commun de l'avenir. On peut y être prêt, et c'est le comble de la sagesse humaine. On ne le fait guère.
9 h. 1/2
Vous voyez que je suis à votre disposition pour Rouen ou pour Paris. Tout à fait à votre disposition. Décidez comme vous préféreriez. Il m’est tout aussi aisé tout aussi agréable d’aller mardi d’Evreux à Rouen que d’Evreux à Paris. Pensez de plus que je n'arriverai à Paris que mardi dans la journée et qu’il m'est impossible de n’y pas rester 48 heures. Enfin, as you please. Pour moi, Rouen et Dieppe me plaisent. Adieu. Adieu.
Mes nouveaux hôtes me sont arrivés hier. Je les quitterai Lundi matin pour aller dîner à Evreux. De là, je puis faire, dans la journée de mardi ce que vous préférerez, aller vous retrouver à Paris au à Rouen. Mais il faudrait que vous fussiez mardi à Rouen. Voyez ce qui vous convient décidément et dites-le moi en réponse à cette lettre. Je prendrai la vôtre Lundi matin en passant à Lisieux. Si vous préférez Rouen, dites-moi où vous descendrez, car nous pourrions passer plus d’une heure à nous chercher dans cette grande et obscure ville. Il y a sur le port un grand hôtel, fort accrédité qui s’appelle je crois hôtel de France ou de l’Europe. Vous pourriez y descendre. Nous irions de là à Dieppe. Si vous restez à Paris, je serai à La Terrasse mardi dans la journée. Je ne sais pas bien à quelle heure. Il fait très beau depuis deux jours. Paris ou Rouen, je prie pour le soleil. Vous en avez besoin et j'y prends plaisir.
J’entends bien que vous ne voudrez pas la paix à tout prix. Mais il faudrait que vous voulussiez la guerre à tout prix pour qu'elle arrivât. Vous en êtes loin. Je persiste donc, grâce à Dieu. Pourtant Dieu en sait plus que nous et s’il lui plaisait de brouiller, les choses à un certain point, toute notre bonne volonté ne les débrouillerait pas. Ce n'est ni la prévoyance, ni le désir des hommes qui réglera cet avenir-là. C’est le sort commun de l'avenir. On peut y être prêt, et c'est le comble de la sagesse humaine. On ne le fait guère.
9 h. 1/2
Vous voyez que je suis à votre disposition pour Rouen ou pour Paris. Tout à fait à votre disposition. Décidez comme vous préféreriez. Il m’est tout aussi aisé tout aussi agréable d’aller mardi d’Evreux à Rouen que d’Evreux à Paris. Pensez de plus que je n'arriverai à Paris que mardi dans la journée et qu’il m'est impossible de n’y pas rester 48 heures. Enfin, as you please. Pour moi, Rouen et Dieppe me plaisent. Adieu. Adieu.
265. Val -Richer, Vendredi 13 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
265 Du Val Richer, Vendredi soir 13 Sept 1839 9 heures
Vous avez bien tort de ne pas savoir dicter. C’est une habitude qu’il faudrait toujours prendre quand on est jeune. Vous pourriez sans fatigue employer une ou deux heures le soir à recueillir vos souvenirs, ce qui vous a occupée ou amusée dans votre vie. Vous vous en amuseriez encore. Je me promets bien de le faire un jour pour mon compte. A défaut de dictée ne vous conviendrait-il pas qu'une personne un peu intelligente, une femme, une jeune fille vint vous lire le soir quand vous êtes seule et que vos yeux sont fatigués ? Je vous trouverais cela, soit par moi-même d’ici, soit par Génie. Votre solitude me pèse inexprimablement. Chagrin même à part, je suis choqué comme d’une absurdité, que vous soyez seule quand il y a dans le monde, et pas au bout du monde, quelqu'un qui se plaît tant à être avec vous.
Samedi matin 6 h et demie
Je me suis couché hier de très bonne heure. La vie que je mène ici est parfaitement calme et très occupée. Je donne à mes enfants presque tout le temps que je ne passe pas dans mon Cabinet dès que je suis seul, je lis ou j'écris. Rarement il fait assez beau pour que je reprenne mes grandes promenades solitaires. Quand le soir arrive, je suis comme mon fermier qui a labouré tout le jour ; j’ai envie de dormir.
Je vois, dans mes nouvelles de l'Intérieur que la conférence sur les affaires d'Orient pourrait se tenir à Constantinople, que la Porte le demande. Je croyais cette idée tout-à-fait abandonnée. Elle avait été d'abord suggérée par vous. En entendez-vous parler de nouveau ? Que dit-on de la déconfiture de D. Carlos? S'achemine-t-on à petit bruit vers la reconnaissance de la Reine Isabelle ? Certainement, il y a là un dernier coup à donner, pas bien fort, et sans guerre aucune, qui terminerait l'affaire d’Espagne comme on a terminé celle de Belgique, et ferait rentrer toute la Péninsule dans l'ordre européen. Mais vous verrez qu'on laissera encore traîner. Les événements n’arrivent plus aujourd'hui qu’à condition d’arriver tout seuls. Les hommes ont abdiqué. Il n'y a plus que Dieu qui gouverne.
Aimez-vous la lecture des voyages ? Vous avez là, je crois, les lettres de Jacquemont sur l’Inde. Mais ce que vous n’avez certainement pas lu, c'est le Journal même de son voyage, qui se publie par livraisons, avec de grandes images et dans un très beau caractère, Ouvrage très spirituel, et plein d’intérêt. Voulez-vous le lire quoiqu'il ne soit pas fini ? On peut très bien faire, cela pour un voyage qui n’a ni commencement ni fin, et où chaque jour se suffit à soi-même. Si vous en avez envie, dites à Génie de le faire prendre chez moi dans ma chambre à coucher, parmi les livraisons non reliées. Les cahiers détachés ne sont pas bien commodes à manier ; mais du moins la lecture ne vous fatiguera pas les yeux. Je voudrais chaque matin, vous envoyer d’ici de quoi remplir votre journée.
9 heures
La lettre de votre frère est très bien. C'est le moins possible. Mais la brièveté douce et froide convient en pareille occasion. Faites la partir tout de suite et dormez. En vérité, je m'indigne de penser qu’il dépend de telles sottises de vous ôter le sommeil. Je suis charmé que M. Jennison, soit plus traitable. Adieu. Adieu. Il n'y a de bon adieu que ceux qui ne finissent pas. G.
Vous avez bien tort de ne pas savoir dicter. C’est une habitude qu’il faudrait toujours prendre quand on est jeune. Vous pourriez sans fatigue employer une ou deux heures le soir à recueillir vos souvenirs, ce qui vous a occupée ou amusée dans votre vie. Vous vous en amuseriez encore. Je me promets bien de le faire un jour pour mon compte. A défaut de dictée ne vous conviendrait-il pas qu'une personne un peu intelligente, une femme, une jeune fille vint vous lire le soir quand vous êtes seule et que vos yeux sont fatigués ? Je vous trouverais cela, soit par moi-même d’ici, soit par Génie. Votre solitude me pèse inexprimablement. Chagrin même à part, je suis choqué comme d’une absurdité, que vous soyez seule quand il y a dans le monde, et pas au bout du monde, quelqu'un qui se plaît tant à être avec vous.
Samedi matin 6 h et demie
Je me suis couché hier de très bonne heure. La vie que je mène ici est parfaitement calme et très occupée. Je donne à mes enfants presque tout le temps que je ne passe pas dans mon Cabinet dès que je suis seul, je lis ou j'écris. Rarement il fait assez beau pour que je reprenne mes grandes promenades solitaires. Quand le soir arrive, je suis comme mon fermier qui a labouré tout le jour ; j’ai envie de dormir.
Je vois, dans mes nouvelles de l'Intérieur que la conférence sur les affaires d'Orient pourrait se tenir à Constantinople, que la Porte le demande. Je croyais cette idée tout-à-fait abandonnée. Elle avait été d'abord suggérée par vous. En entendez-vous parler de nouveau ? Que dit-on de la déconfiture de D. Carlos? S'achemine-t-on à petit bruit vers la reconnaissance de la Reine Isabelle ? Certainement, il y a là un dernier coup à donner, pas bien fort, et sans guerre aucune, qui terminerait l'affaire d’Espagne comme on a terminé celle de Belgique, et ferait rentrer toute la Péninsule dans l'ordre européen. Mais vous verrez qu'on laissera encore traîner. Les événements n’arrivent plus aujourd'hui qu’à condition d’arriver tout seuls. Les hommes ont abdiqué. Il n'y a plus que Dieu qui gouverne.
Aimez-vous la lecture des voyages ? Vous avez là, je crois, les lettres de Jacquemont sur l’Inde. Mais ce que vous n’avez certainement pas lu, c'est le Journal même de son voyage, qui se publie par livraisons, avec de grandes images et dans un très beau caractère, Ouvrage très spirituel, et plein d’intérêt. Voulez-vous le lire quoiqu'il ne soit pas fini ? On peut très bien faire, cela pour un voyage qui n’a ni commencement ni fin, et où chaque jour se suffit à soi-même. Si vous en avez envie, dites à Génie de le faire prendre chez moi dans ma chambre à coucher, parmi les livraisons non reliées. Les cahiers détachés ne sont pas bien commodes à manier ; mais du moins la lecture ne vous fatiguera pas les yeux. Je voudrais chaque matin, vous envoyer d’ici de quoi remplir votre journée.
9 heures
La lettre de votre frère est très bien. C'est le moins possible. Mais la brièveté douce et froide convient en pareille occasion. Faites la partir tout de suite et dormez. En vérité, je m'indigne de penser qu’il dépend de telles sottises de vous ôter le sommeil. Je suis charmé que M. Jennison, soit plus traitable. Adieu. Adieu. Il n'y a de bon adieu que ceux qui ne finissent pas. G.
280. Val-Richer, Samedi 28 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
280 Du Val Richer, samedi 28 sept 1839 5 heures
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
282. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
282 Du Val Richer, Lundi soir 30 sept. 1839 8 heures et demie
Il n’est bruit que de la nouvelle coalition, votre Empereur, Palmerston et les radicaux. Aurait-elle la majorité à Londres ? On en doute fort. Palmerston trouvant bon que vous entriez, vous dans le Bosphore et l'Asie mineure, tandis qu'il ira lui sans nous à Alexandrie, cela sera-t-il bien reçu du Parlement ? On croit que cela ne s’y présentera pas. Même avec le correctif d'un corps d’armée Autrichien pour faire le siège de St Jean d’Acre, où il n’ira pas. Tout cela a un peu l’air des mille et une nuits. Il n’y a guère, dans chaque affaire, qu’une ou deux grandes politiques. Quand on n'en veut pas, on tombe dans les politiques petites et arbitraires. De celles-là, il y en a mille.
En attendant, vous parait-il vrai, comme on me le dit, que le Cabinet anglais est plus sérieusement menacé que jamais ? On l'a dit si souvent que cela finira pas arriver sans que je le croie. Voilà Zéa décidément rentré en scène. Si les Cortes dont dissoutes comme tout l’annonce, un parti bien voisin de lui dominera dans les nouvelles. J’en suis bien aise, même politique à part. Je lui souhaite du contentement. Je ne sais pourquoi le bruit se répand dans notre Province que Don Carlos doit y venir habiter et qu’on y cherche un château pour lui. Ce qu’il y a de sûr c’est qu’on a fait visiter deux grands châteaux à peu près abandonnés, et très convenables pour un Prince abandonné.
N’allez pas vous ruiner en curiosités. Quand vous aurez vos affaires signées, vous ferez tout ce qui vous plaira. Je n’ai de ma vie été si méfiant.
Mardi, 8 heures 1/2
Avez-vous décidément adopté la bibliothèque de l'entresol pour votre chambre à coucher ? Je suis bien impatient de vous voir là. Où seront nos habitudes? Vous trouverez votre maison peuplée. Jaubert est arrivé ; fort peu préoccupé de la politique de l'Orient, à ce qu'on me dit ; il n'y a pas moyen d’en rien tirer à ce sujet. Ce n'est pas du tout un esprit de politique étrangère. Il a rapporté de Constantinople une grande préoccupation des conspirations de l’extrême gauche. Elles continuent de plus en plus basses, comme on dit les eaux sont basses. Singulière société qui ne veut ni du haut, ni du bas, ni du soleil, ni de la boue ! Comment viendra-t-elle à bout de s'organiser et de suffire à ses affaires ? Je ne pense pas à autre chose, en fait de choses, depuis deux mois que je vis en Amérique.
9 heures et demie
J’attends mon médecin aujourd'hui. Je voudrais bien qu’il fût de votre avis qu’il en fût positivement. Quoique ce qu’on appelle la raison me dise que j’ai tort de désirer cela. Je suis désolé du mariage de votre femme de chambre. Mad. de Mentzingen ne pourrait-elle vous envoyer sa pareille ? Vous avez confiance aux allemandes. Il vous faut une femme de chambre qui vous convienne beaucoup, et vous plaise un peu. La petite lectrice que Génie vous a donnée vous convient-elle, dans son état, et vous en servez-vous ? Adieu. Adieu.
Il n’est bruit que de la nouvelle coalition, votre Empereur, Palmerston et les radicaux. Aurait-elle la majorité à Londres ? On en doute fort. Palmerston trouvant bon que vous entriez, vous dans le Bosphore et l'Asie mineure, tandis qu'il ira lui sans nous à Alexandrie, cela sera-t-il bien reçu du Parlement ? On croit que cela ne s’y présentera pas. Même avec le correctif d'un corps d’armée Autrichien pour faire le siège de St Jean d’Acre, où il n’ira pas. Tout cela a un peu l’air des mille et une nuits. Il n’y a guère, dans chaque affaire, qu’une ou deux grandes politiques. Quand on n'en veut pas, on tombe dans les politiques petites et arbitraires. De celles-là, il y en a mille.
En attendant, vous parait-il vrai, comme on me le dit, que le Cabinet anglais est plus sérieusement menacé que jamais ? On l'a dit si souvent que cela finira pas arriver sans que je le croie. Voilà Zéa décidément rentré en scène. Si les Cortes dont dissoutes comme tout l’annonce, un parti bien voisin de lui dominera dans les nouvelles. J’en suis bien aise, même politique à part. Je lui souhaite du contentement. Je ne sais pourquoi le bruit se répand dans notre Province que Don Carlos doit y venir habiter et qu’on y cherche un château pour lui. Ce qu’il y a de sûr c’est qu’on a fait visiter deux grands châteaux à peu près abandonnés, et très convenables pour un Prince abandonné.
N’allez pas vous ruiner en curiosités. Quand vous aurez vos affaires signées, vous ferez tout ce qui vous plaira. Je n’ai de ma vie été si méfiant.
Mardi, 8 heures 1/2
Avez-vous décidément adopté la bibliothèque de l'entresol pour votre chambre à coucher ? Je suis bien impatient de vous voir là. Où seront nos habitudes? Vous trouverez votre maison peuplée. Jaubert est arrivé ; fort peu préoccupé de la politique de l'Orient, à ce qu'on me dit ; il n'y a pas moyen d’en rien tirer à ce sujet. Ce n'est pas du tout un esprit de politique étrangère. Il a rapporté de Constantinople une grande préoccupation des conspirations de l’extrême gauche. Elles continuent de plus en plus basses, comme on dit les eaux sont basses. Singulière société qui ne veut ni du haut, ni du bas, ni du soleil, ni de la boue ! Comment viendra-t-elle à bout de s'organiser et de suffire à ses affaires ? Je ne pense pas à autre chose, en fait de choses, depuis deux mois que je vis en Amérique.
9 heures et demie
J’attends mon médecin aujourd'hui. Je voudrais bien qu’il fût de votre avis qu’il en fût positivement. Quoique ce qu’on appelle la raison me dise que j’ai tort de désirer cela. Je suis désolé du mariage de votre femme de chambre. Mad. de Mentzingen ne pourrait-elle vous envoyer sa pareille ? Vous avez confiance aux allemandes. Il vous faut une femme de chambre qui vous convienne beaucoup, et vous plaise un peu. La petite lectrice que Génie vous a donnée vous convient-elle, dans son état, et vous en servez-vous ? Adieu. Adieu.
294. Paris, Mercredi 23 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
294. Paris, le 23 octobre 1839
Toute la diplomatie a été fort divertie hier des révélations du Thiers au sujet d’un entretien qu’aurait eu mon Empereur avec un étranger. Votre gouvernement n'en est pas fâché ; nos bons alliés non plus. Cela fera quelque bruit au palais à Pétersbourg, car le public ne sera pas les journaux qui rapportent cela. J’ai eu un long entretien hier avec Médem sur mes Affaires, et puis sur les affaires. Il m’a donné quelques conseils sur les premiers & quelques soupirs sur les secondes. J’ai eu une lettre de mon Ambassadeur. Il l'annonce pour le 10 Décembre, s'il ne survient pas d'obstacle impérial. Il se réjouit fort de me trouver à l'hôtel Talleyrand. Je suis sûre qu’après vous c'est lui qui aura le plus de plaisir à m'y voir bien établie, vraiment j'y serai bien. Mon appartement. sera arrangé pour votre arrivée, mon ménage pas encore, car pour cela il faut que je sache si j’ai ou si je n’ai pas la vaisselle.
J'ai été hier au soir chez Mad. de Boigne. J’y ai vu le chancelier, il dit qu’il faut relâcher Don Carlos.
Il me semble qu’il n’y a des nouvelles de nulle part. Lord Lansdown a été voir le prince Méternich au Johanisberg. Médem parle de M. de Brunow avec beaucoup de dédain & trouve fort naturel et assez agréable qu'il ait échoué dans sa mission, car le naufrage est sûr. Paul est arrivé à Londres je ne le sais qu’indirectement. Bunkhausen ne m’a point envoyé encore les lettres of administration quoique j'aie accompli toutes les formalités requises pour les obtenir. Je n’ai pas encore répondu à mon frère. Je ne sais pas comment faire pour me plaindre un peu et ne pas le choquer. Car Médem aussi ne comprend pas qu'on ait mis ainsi un oubli mes droits en Courlande et il croit qui c’est une grosse affaire, parce que cette terre est très riche en toute chose. Le prince Metternich n'écrit rien encore au sujet du mariage de Rodolphe Appony. Ce qui fait que la chose est parfaitement en suspens ici ; tandis qu’elle est publique à Pétersbourg. Adieu. Adieu. Je suis bien contente d’apprendre que Pauline est remise, et je suis transportée de joie en vous voyant bien résolu à revenir bientôt. Adieu.
Toute la diplomatie a été fort divertie hier des révélations du Thiers au sujet d’un entretien qu’aurait eu mon Empereur avec un étranger. Votre gouvernement n'en est pas fâché ; nos bons alliés non plus. Cela fera quelque bruit au palais à Pétersbourg, car le public ne sera pas les journaux qui rapportent cela. J’ai eu un long entretien hier avec Médem sur mes Affaires, et puis sur les affaires. Il m’a donné quelques conseils sur les premiers & quelques soupirs sur les secondes. J’ai eu une lettre de mon Ambassadeur. Il l'annonce pour le 10 Décembre, s'il ne survient pas d'obstacle impérial. Il se réjouit fort de me trouver à l'hôtel Talleyrand. Je suis sûre qu’après vous c'est lui qui aura le plus de plaisir à m'y voir bien établie, vraiment j'y serai bien. Mon appartement. sera arrangé pour votre arrivée, mon ménage pas encore, car pour cela il faut que je sache si j’ai ou si je n’ai pas la vaisselle.
J'ai été hier au soir chez Mad. de Boigne. J’y ai vu le chancelier, il dit qu’il faut relâcher Don Carlos.
Il me semble qu’il n’y a des nouvelles de nulle part. Lord Lansdown a été voir le prince Méternich au Johanisberg. Médem parle de M. de Brunow avec beaucoup de dédain & trouve fort naturel et assez agréable qu'il ait échoué dans sa mission, car le naufrage est sûr. Paul est arrivé à Londres je ne le sais qu’indirectement. Bunkhausen ne m’a point envoyé encore les lettres of administration quoique j'aie accompli toutes les formalités requises pour les obtenir. Je n’ai pas encore répondu à mon frère. Je ne sais pas comment faire pour me plaindre un peu et ne pas le choquer. Car Médem aussi ne comprend pas qu'on ait mis ainsi un oubli mes droits en Courlande et il croit qui c’est une grosse affaire, parce que cette terre est très riche en toute chose. Le prince Metternich n'écrit rien encore au sujet du mariage de Rodolphe Appony. Ce qui fait que la chose est parfaitement en suspens ici ; tandis qu’elle est publique à Pétersbourg. Adieu. Adieu. Je suis bien contente d’apprendre que Pauline est remise, et je suis transportée de joie en vous voyant bien résolu à revenir bientôt. Adieu.
307. Val-Richer, Dimanche 3 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
307 Du Val-Richer Dimanche 3 Novembre 1839
8 heures
J'espère partir, le 12 et vous voir le 13 au soir. Il me semble que dans votre appartement à vous stable, définitif, je vais prendre possession d’un bonheur stable et définitif aussi. C’est une impression très douce, ma consolation de ne plus revoir cette pauvre Terrasse. N’entrez pas dans les affaires des Appony. Je suis sûr qu’elles seront très embarrassées et pointilleuses. Ils mont toujours fait l'effet de gens qui ne sont dans les grandes affaires que pour en faire de petites, celles de leur ménage. Il n’y a pas de contraste qui me choque plus. J’y prends la mesure des gens.
On est très content de Lord Granville. Non qu’il ait rien dit de bien nouveau, ni de bien précis Mais il a dit et il répète comme très sûr de son fait : " Cela s’arrangera. " Je le crois comme lui.
Les débats de la prochaine session ne me paraissent pas tourner beaucoup aux Affaires Etrangères. L’Espagne est finie. Rien en Allemagne, si l'Orient n’est pas terminé, on en parlera peu. Je ne vois que Buenos-Aires et le gouverneur Rosas. Car les affaires du Roi Ernest aussi sont en panne. n revanche on me dit que les intrigues ministérielles se raniment, que Thiers tâte en tous sens, qu’il est en relations très suivies avec Dupin, un peu aussi avec M. Molé. Il croit tour à tour toutes les chances bonnes, et voudrait les garder toutes, Tout cela n'aboutira pas à grand chose. On se remue beaucoup plus pour se faire croire à soi-même qu'on agit que pour agir réellement. On s’attrape soi-même pour se désennuyer ou se consoler.
Les porcelaines du Roi sont arrivées hier ; bleu, blanc et or. De très belles fleurs sur les assiettes. C'est fort joli et élégant, pas très abondant.
11 heures
Il est onze heures. La poste n’est pas encore venue. et les déjeunants vont m’arriver. J’aurai à peine le temps de fermer ma lettre. J’aime à être pressé pour les affaires, mais pas du tout pour ce qui me plait. 3 heures La poste arrive à présent, pour une roue cassée. Nous sortons de table. Adieu, adieu. G.
8 heures
J'espère partir, le 12 et vous voir le 13 au soir. Il me semble que dans votre appartement à vous stable, définitif, je vais prendre possession d’un bonheur stable et définitif aussi. C’est une impression très douce, ma consolation de ne plus revoir cette pauvre Terrasse. N’entrez pas dans les affaires des Appony. Je suis sûr qu’elles seront très embarrassées et pointilleuses. Ils mont toujours fait l'effet de gens qui ne sont dans les grandes affaires que pour en faire de petites, celles de leur ménage. Il n’y a pas de contraste qui me choque plus. J’y prends la mesure des gens.
On est très content de Lord Granville. Non qu’il ait rien dit de bien nouveau, ni de bien précis Mais il a dit et il répète comme très sûr de son fait : " Cela s’arrangera. " Je le crois comme lui.
Les débats de la prochaine session ne me paraissent pas tourner beaucoup aux Affaires Etrangères. L’Espagne est finie. Rien en Allemagne, si l'Orient n’est pas terminé, on en parlera peu. Je ne vois que Buenos-Aires et le gouverneur Rosas. Car les affaires du Roi Ernest aussi sont en panne. n revanche on me dit que les intrigues ministérielles se raniment, que Thiers tâte en tous sens, qu’il est en relations très suivies avec Dupin, un peu aussi avec M. Molé. Il croit tour à tour toutes les chances bonnes, et voudrait les garder toutes, Tout cela n'aboutira pas à grand chose. On se remue beaucoup plus pour se faire croire à soi-même qu'on agit que pour agir réellement. On s’attrape soi-même pour se désennuyer ou se consoler.
Les porcelaines du Roi sont arrivées hier ; bleu, blanc et or. De très belles fleurs sur les assiettes. C'est fort joli et élégant, pas très abondant.
11 heures
Il est onze heures. La poste n’est pas encore venue. et les déjeunants vont m’arriver. J’aurai à peine le temps de fermer ma lettre. J’aime à être pressé pour les affaires, mais pas du tout pour ce qui me plait. 3 heures La poste arrive à présent, pour une roue cassée. Nous sortons de table. Adieu, adieu. G.
310. Val-Richer, Mercredi 6 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
310 Du Val-Richer, Mercredi 6 nov. 1839
7 heures et demie
Depuis quelques jours, je vois avec bonheur croître le chiffre de notre correspondance. Il touche à son apogée. Il se reposera là bien longtemps.
Les journaux que j’ai repris attentivement hier, ne parlent d’aucun accident dans la mer du Nord. La traversée n'est pas longue. Je compte que vous me donnerez au premier jour des nouvelles d'Alexandre. Je ne veux vous retrouver ni triste, ni malade. Il y a pourtant des choses qui finissent. Je vous retrouverai avec vos affaires arrangées. Pas aussi bien que je voudrais, tant s’en faut, mais enfin arrangées. Vous souvenez-vous combien de fois vous m'avez dit qu'elles ne s’arrangeraient pas ? J’ai été aussi bien inquiet. Il arrive deux choses. Tout ne tourne pas aussi mal qu’on l'imaginait. On se résigne à une grande partie du mal. Il faut accepter ces termes-moyens de la vie. Le repos est à ce prix. Il n’y faut jamais réduire son âme. Ce serait là de la décadence. Il y a une vraie consolation à planer, au dedans, bien au dessus de ce qui se passe et de ce qu’on accepte au dehors.
Ma mère a encore été souffrante hier. Je crains l’hiver. Elle a heureusement une grande force intérieure. Je ne connais personne de plus inaccessible à l’abattement. Dans sa longue vie, je l'ai vue souvent au désespoir, pas un moment abattue. C’est un puissant moyen de résistance même à la maladie. Je crois au moins autant à l'influence du moral sur le physique que du physique sur le moral.
10 heures
Les premières lignes de votre lettre me désolaient. Je n'y comprenais rien. La distribution a donc tardé à Paris. Enfin bientôt, nous ne courrons plus ni l’un ni l’autre aucune chance d'inquiétude, c’est- à-dire de cette inquiétude là. Adieu. J’ai trois lettres d'affaires à écrire par le facteur qui attend ; des lettres de départ autour de moi. Oui à huit jours. Adieu. Adieu
Je persiste sur D. Carlos. La mise en liberté immédiate eût mieux valu en effet. Mais celle-là aussi n’était pas possible. La Chambre est convoquée, pour le 23 déc. Les Pairs sont nommés. M. Rossi en est. Mais vous savez tout cela. C'est ennuyeux de ne pas savoir et faire toutes choses ensemble. Nous y touchons.
7 heures et demie
Depuis quelques jours, je vois avec bonheur croître le chiffre de notre correspondance. Il touche à son apogée. Il se reposera là bien longtemps.
Les journaux que j’ai repris attentivement hier, ne parlent d’aucun accident dans la mer du Nord. La traversée n'est pas longue. Je compte que vous me donnerez au premier jour des nouvelles d'Alexandre. Je ne veux vous retrouver ni triste, ni malade. Il y a pourtant des choses qui finissent. Je vous retrouverai avec vos affaires arrangées. Pas aussi bien que je voudrais, tant s’en faut, mais enfin arrangées. Vous souvenez-vous combien de fois vous m'avez dit qu'elles ne s’arrangeraient pas ? J’ai été aussi bien inquiet. Il arrive deux choses. Tout ne tourne pas aussi mal qu’on l'imaginait. On se résigne à une grande partie du mal. Il faut accepter ces termes-moyens de la vie. Le repos est à ce prix. Il n’y faut jamais réduire son âme. Ce serait là de la décadence. Il y a une vraie consolation à planer, au dedans, bien au dessus de ce qui se passe et de ce qu’on accepte au dehors.
Ma mère a encore été souffrante hier. Je crains l’hiver. Elle a heureusement une grande force intérieure. Je ne connais personne de plus inaccessible à l’abattement. Dans sa longue vie, je l'ai vue souvent au désespoir, pas un moment abattue. C’est un puissant moyen de résistance même à la maladie. Je crois au moins autant à l'influence du moral sur le physique que du physique sur le moral.
10 heures
Les premières lignes de votre lettre me désolaient. Je n'y comprenais rien. La distribution a donc tardé à Paris. Enfin bientôt, nous ne courrons plus ni l’un ni l’autre aucune chance d'inquiétude, c’est- à-dire de cette inquiétude là. Adieu. J’ai trois lettres d'affaires à écrire par le facteur qui attend ; des lettres de départ autour de moi. Oui à huit jours. Adieu. Adieu
Je persiste sur D. Carlos. La mise en liberté immédiate eût mieux valu en effet. Mais celle-là aussi n’était pas possible. La Chambre est convoquée, pour le 23 déc. Les Pairs sont nommés. M. Rossi en est. Mais vous savez tout cela. C'est ennuyeux de ne pas savoir et faire toutes choses ensemble. Nous y touchons.
314. Val-Richer, Dimanche 10 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
314 Du Val-Richer Dimanche 10 Nov. 1839
8 heures
Vous n’avez pas d’idée de l'activité qui règne dans cette maison. Je plante un bois ; je fais un chemin. Je redresse des allées. Je sème des fleurs pour l’été prochain. Et mon factotum est encore dans son lit. Ce n'est rien de grave. Mais il ne sera sur pied et bon à quelque chose que lorsque je serai parti. J'admire quel air d’importance et d'entrain on peut mettre à des choses dont on se soucie si peu. Les soins et les agréments de la vie extérieure sont charmants dans le bonheur ; mais il n’y a pas moyen d'en faire le bonheur même. Je ne l’ai jamais cru, ni tenté.
A part son chagrin, le Chancelier doit avoir bien de l'humeur autant qu’il peut en avoir. On ne lui a pas envoyé une levée de Pairs bien éclatante. On a en pourtant bien de la peine à se mettre d'accord sur ces vingt noms. Le Roi a livré une grande bataille pour M. Viermet le plus ridicule des hommes de courage. Il ne l’a emporté que la veille du Moniteur, à 10 heures du soir. Enfin il l’a emporté, tandis que le Chancelier a été battu sur M. Etienne, dont il ne voulait pas. Que disent les Granville, que dit surtout Bulwer des Affaires d'Espagne ? L'Angleterre reste-t-elle là à la tête des radicaux ? Poursuivra-t-elle sa rivalité d'influence avec nous ? Je reprends intérêt à l’Espagne. J’ai recommencé depuis que je connais Zéa. En lui, pour la première fois, j’ai entrevu un homme au delà des Pyrénées. Evidemment, il y a là, dans ce moment quelque chose à faire. Bien difficile ; mais la difficulté dans la possibilité, il n’y a que cela qui vaille la peine qu’on y mette la main. Je ne comprends pas pourquoi vos caisses arrivées au Havre, ne sont pas depuis longtemps à Paris. Ce n’est qu'un ordre d'expédition à donner. Quelque grand serment que soit Rothschild, il peut faire cela, sans déroger.
9 heures et demie
Vous serez ce matin aussi contrarié que moi du jeudi au lieu du mercredi. Pas plus, je vous en réponds. Je ne vous dirai qu’une chose. Finissez avec vos fils. Il faut absolument qu’ils vous donnent, en échange du leur part du capital anglais, l’ordre à Bruxner de vous envoyer ce qui vous appartient. Je ne comprends pas comment ils ont pu l’empêcher, comment Bruxner, s'est laissé interdire par eux ce qu’il était de son devoir de vous envoyer sur le champ. Mais tout cela est si étrange, hommes, choses, procédés, pays que je ne compte sur rien et ne m'étonne de rien. Pourquoi ne chargeriez-vous pas Cumming de cela comme du reste ? Il en sait assez pour que cela de plus ou de moins ait bien peu d'importance. Mais sans aucun doute, ordre pour ordre, argent pour argent. Je suis affligé, blessé, irrité, humilié de tout cela. Adieu. Adieu. Au moins vous n'avez plus d'inquiétude. Adieu Dearest. G.
8 heures
Vous n’avez pas d’idée de l'activité qui règne dans cette maison. Je plante un bois ; je fais un chemin. Je redresse des allées. Je sème des fleurs pour l’été prochain. Et mon factotum est encore dans son lit. Ce n'est rien de grave. Mais il ne sera sur pied et bon à quelque chose que lorsque je serai parti. J'admire quel air d’importance et d'entrain on peut mettre à des choses dont on se soucie si peu. Les soins et les agréments de la vie extérieure sont charmants dans le bonheur ; mais il n’y a pas moyen d'en faire le bonheur même. Je ne l’ai jamais cru, ni tenté.
A part son chagrin, le Chancelier doit avoir bien de l'humeur autant qu’il peut en avoir. On ne lui a pas envoyé une levée de Pairs bien éclatante. On a en pourtant bien de la peine à se mettre d'accord sur ces vingt noms. Le Roi a livré une grande bataille pour M. Viermet le plus ridicule des hommes de courage. Il ne l’a emporté que la veille du Moniteur, à 10 heures du soir. Enfin il l’a emporté, tandis que le Chancelier a été battu sur M. Etienne, dont il ne voulait pas. Que disent les Granville, que dit surtout Bulwer des Affaires d'Espagne ? L'Angleterre reste-t-elle là à la tête des radicaux ? Poursuivra-t-elle sa rivalité d'influence avec nous ? Je reprends intérêt à l’Espagne. J’ai recommencé depuis que je connais Zéa. En lui, pour la première fois, j’ai entrevu un homme au delà des Pyrénées. Evidemment, il y a là, dans ce moment quelque chose à faire. Bien difficile ; mais la difficulté dans la possibilité, il n’y a que cela qui vaille la peine qu’on y mette la main. Je ne comprends pas pourquoi vos caisses arrivées au Havre, ne sont pas depuis longtemps à Paris. Ce n’est qu'un ordre d'expédition à donner. Quelque grand serment que soit Rothschild, il peut faire cela, sans déroger.
9 heures et demie
Vous serez ce matin aussi contrarié que moi du jeudi au lieu du mercredi. Pas plus, je vous en réponds. Je ne vous dirai qu’une chose. Finissez avec vos fils. Il faut absolument qu’ils vous donnent, en échange du leur part du capital anglais, l’ordre à Bruxner de vous envoyer ce qui vous appartient. Je ne comprends pas comment ils ont pu l’empêcher, comment Bruxner, s'est laissé interdire par eux ce qu’il était de son devoir de vous envoyer sur le champ. Mais tout cela est si étrange, hommes, choses, procédés, pays que je ne compte sur rien et ne m'étonne de rien. Pourquoi ne chargeriez-vous pas Cumming de cela comme du reste ? Il en sait assez pour que cela de plus ou de moins ait bien peu d'importance. Mais sans aucun doute, ordre pour ordre, argent pour argent. Je suis affligé, blessé, irrité, humilié de tout cela. Adieu. Adieu. Au moins vous n'avez plus d'inquiétude. Adieu Dearest. G.
332. Paris, Vendredi 27 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
332. Paris, vendredi 27 mars 1840,
10 heures
Samedi 28. à 10 heures
10 heures
J’ai vu Granville hier matin. Vous ne pouvez concevoir l’inquiètude qu’il éprouvait pour le vote. Lui si calme et froid, Il était très fidgetty. Certainement l’animosité possible de M. Molé lui apparaissait comme la rupture presque immédiate entre les deux pays. Vous jugez dès lors de l’ardeur de ses voeux pour Thiers.
Un nouvel incident politique, votre guerre au Maroc, le préoccupait beaucoup aussi. Si vous faites vraiment la guerre aux autres régences, l’Angleterre ne le souffrira pas. Voilà hier matin. à 4 heures je suis allée à la Chambre. J’ai malheureusement manqué M. Jaubert qu’on dit avoir fait le discours le plus spirituel et le plus excellent possible pour le ministère. Je n’ai plus entendu que des ennnuyeux, et le vote à 6 heures, le vote si triomphant pour Thiers. Granville auquel j’avais promis la nouvelle, n’a pas tenu, il est venu lui même à la Chambre, Médem, toute la diplomatie. La surprise a été grande 103 voix pour Thiers. Granville a couru chez lui le prier de vous envoyer une estafette.
Ce qu’il a fait, et vous saurez ce soir la nouvelle. Voilà donc Thiers qui gouverne tout-à-fait. C’est un évènement !
J’ai eu M. de Pogenpohl à dîner, je suis allée tout de suite après aux Italiens où j’avais donné rendez-vous à Granville, Brignole et le Duc de Noailles, celui-ci fort content. Il dit, redit ce qu’il a toujours dit, que Thiers est le ministre nécessaire de l’époque, le seul qui puisse faire encore durer ceci. C’est donc logique de lui laisser le pouvoir. Il est triomphant du superbe discours de Berryer. Il rit des visages très différents des deux ambassadeurs de la loge. Granville radieux. Brignole furieux ; le discours de Thiers a mis ce côté-là en grande colère, " soutenir les révolutions chez les voisins " ! Pauvre Brignole. Vous avez ma journée. J’ai reçu ce matin une lettre d’Ellice, qui me prouve qu’il est assez mal avec Lord Palmerston, sur l’affaire d’Orient. Il a l’air de croire cependant que ce n’est pas la politique de Lord Palmerston qui prévaudra. Le mariage Sussex ne sera point reconnu. Je vous dis des nouvelles de Londres. C’est bien présomptueux.
1 heure. Maintenant je ne suis plus si pressée de vous dire ce que je pense sur votre situation. Il faudra voir comme elle s’arrangera de la direction que prendra le ministère. Il est bien puissant à l’heure qu’il est. Où ira-t-il ? That is the question. Pour le moment je suis bien aise pour vous que vous soyiez à Londres. C’est convenable. Le Journal des Débats vous a classé ce matin. J’aurais envie de causer avec vous à tout instant sur toute chose.
Le Roi passe dans ce moment pour aller se promener à Versailles, il a raison de se promener il n’a pas grand chose à faire.
Samedi 28. à 10 heures
Génie est venu hier. Nous avons beaucoup causé. C’est une créature honnête, devouée et intelligenté ; il m’a conté quelques détails qui m’ont intéressée. Après lui, Appony consterné. Il avait eu le plus grand espoir. Thiers le traite avec beaucoup de politesse, mais voilà tout ; il refuse la conversation sur les affaires publiques. Car même jeudi soir l’ayant rencontré chez Lehon et Apppony le félicitant du vote, Thiers a répondu en demandant des nouvelles de Mad. Appony. Après Appony, le Duc de Noailles est venu. Il n’y tient pas ; il a besoin de bavarder, de demander, de savoir, de s’étendre sur tout ceci. La politique étrangère le préoccupe beaucoup; il veut parler à la chambre des pairs sur la situation avec l’Angleterre. Il trouve le moment excessivement grave, on ne peut pas rester dans cette incertitude. La Princesse Soltykoff nous a interrompus. Après sa visite, j’ai été chez la petite princesse où jai trouvé Madame de Castellane, parfaitement furieuse.
C’est drôle de tant montrer. Elle a été à la grande soirée de Mad. Appony. Mercredi, elle ira à la soirée de Sardaigne, dimanche, elle ne veut pas aller chez Lady Granville. "J’ai idée que Lady et Lord Granville ne m’aiment pas. " Cela est vrai.
J’ai dîné chez Lord Granville, il m’a raconté assez. Le Duc de Broglie est dans la joie de tous les triomphes du vote. Mais il se moque de la Chambre et condamne hautement l’élan d’enthousiasme auquel elle s’est livrée pour ce comedien Berryer. Ah par exemple ! Quand un comédien joue aussi bien que cela, il est fort naturel de l’applaudir.
J’ai dîné chez Lord Granville, il m’a raconté assez. Le Duc de Broglie est dans la joie de tous les triomphes du vote. Mais il se moque de la Chambre et condamne hautement l’élan d’enthousiasme auquel elle s’est livrée pour ce comedien Berryer. Ah par exemple ! Quand un comédien joue aussi bien que cela, il est fort naturel de l’applaudir.
Voyez-vous voilà encore la passion qui l’emporte sur l’équité.
Vous auriez applaudi j’en suis sûre. L’Empereur en apprenant la Chute de Soult a fait de grands voeux pour Molé. Le Roi a exprimé à Granville beaucoup de doutes sur l’arrivé de Pahlen. Le 15 il était encore à Pétersbourg. Granville croit que la négociation pour l’Orient s’évaporera. C’est le plus mauvais cas qu’il prévoit.
Midi, voici le 330. Je n’ai encore fait que le parcourir; je vous en remercie vite. Il faut que j’écrive à mon frère ; Médem envoie un courier ce matin, et ne m’en prévient que tout à l’heure. Mais vite il faut que je vous dise quoique la circonstance me dispense d’avoir une opinion sur votre situation, que si le ministère était tombé j’aurais été d’opinion que vous ne pouviez pas rester avec M. Molé, et cette opinion je la tire de votre lettre même sur ce sujet, (lettre admirable, vrai chef d’oeuvre d’expostion d’une situation) où vous me dites. "Si je ne surmonte pas les difficultés on rejettera sur moi, la responsabilité du mauvais succès. M. Molé excelle dans cette manoeuvre." Cette dernière phrase m’avait décidée. Mais il est inutile d’en reparler dans ce moment.
Je retourne à hier. Il a fallu après le dîner aller passer une demi-heure à un concert chez une compatriote, il faut le dire très bonne musique et très grande et noble compagnie mais un froid abominable, j’ai quitté malgré que la maîtresse de la maison me traitât en Impératrice. Je suis retournée chez Lady Granville. J’y ai trouvé Thiers. Dès qu’il m’a apperçue il a fondu sur moi avec un empressement et une joie extrême. Il est content, triomphant, mais encore inquiet. Il dit " de grandes difficultés ici, de grands grands embarras au dehors. Le sort du monde entre M. Guizot, moi, et Lord Palmerston. Bizarre situation ! le 11 octobre séparé par la mer mais travaillant bien de concert. M. Guizot a un succès inouï.
Nos destinées sont bien liées ensemble. " Revenant toujours sur cela. Plein de vous, et mettant de l’intention à me le bien dire. Il m’a parlé de sa situation vis-à-vis de la diplomatie. Il voulait me parler de tout. On faisait cercle, cela devenait trop éclatant. Je lui ai demandé l’heure et je suis partie. Mais au fond j’aurais bien aimé continuer. Vous savez qu’il me plait. Il me plaisait hier encore un peu plus, et tout bonnement je suis bien aise de le voir là où il est.
Je vous remercie mille fois de la copie de certaines lettres de Londres. Cela me fait bien de la joie. A propos j’ai lu hier une lettre reçue hier de Lord Clarendon, où il dit. "M. Guizot bids fair to be the most popular Ambassador that even was in this country." N’allez pas devenir insolent, restez, restez comme vous êtes, encore une fois, grand, sérieux, cela vous va si bien. Racontez-moi toujours tout. N’est-ce pas que je vous dis tout aussi ?
A propos, le Maréchal Soult causait un jour dernier avec le duc d’Orléans qui trouvait qu’il y avait bien du danger à renverser Thiers maintenant. Le maréchal lui dit : "Il n’y a que des gens pusillanimes qui puissent trouver cela." Imaginez ! Je sais cela de source.
On est inquiet de l'expédition de Vallée. Le mauvais temps est survenu. Je vous parlerai demain de vos dîners. Décidément pas Lord Tankerville. Pourquoi y serait-il le 1er mai ? Il n’est pas votre beau-frère, et il n’a pas un titre pour cela. Ce serait même trouvé très ridicule. J’en ai causé avec Granville qui est tout-à-fait de cet avis.
Adieu. Adieu. Adieu. Que de choses je vous dis et que de choses encore j’ai à vous dire. Adieu.
333. Londres, Mardi 31 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
333. Londres, mardi 31 mars 1840
9 heures et demie
C’est beaucoup deux Reines pour une soirée. Il n’est pas aisé de les y arranger. J’ai dîné hier à Marlborough House entre la Reine douairière et la Duchesse de Cambridge. Le Duc et la Duchesse de Sutherland, Lord et Lady Jersey, Mm. de Bülow et de Gersdorf. La Reine douainière est restée bien allemande de manières et d’accent. L’air très bonne d’ailleurs et d’une simplicité bien royale. J’ai beaucoup causé avec la Duchesse de Cambridge. Elle me paraît aîmer la conversation. Bien protestante de cœur. Elle trouve l’Eglise Anglicane trop catholique. Cela me réussit fort ici d’être le premier Ambassadeur protestant venu de France depuis Sully. Nous sommes sortis de table à 10 heures. Le bal de la Reine commençait à 9 heures et demie. Mais elle était prévenue du dîner de la Reine douairière. Nous ne sommes arrivés à Buckingham-Palace qu’à 10 heures et demie. Assez tôt, car j’y suis resté jusqu’à deux heures. C’est long. Décidément quoique en principe ce soit juste, les spectateurs sont trop sacrifiés aux danseurs. Soixante ou quatre vingt personnes dansant toujours, et douze ou quinze assistants ramassant çà et là des lambeaux de conversation décousue. Lord Clarendon a été m’a principale ressource. Un peu Lady Palmerston, Lady Normanby, Lady Fitz-Harris. Je trouve la manière de Lady Palmerston avec son mari et sa fille très aimable. Elle est sans cesse occupée d’eux, et visiblement. Elle doit leur plaire beaucoup. J’ai eu hier une longue visite de M. de Kissélef, évidemment charmé d’aller à Paris, quoiqu’il y aille par Pétersbourg. Je lui ai parlé de bien des choses et bien. De deux surtout, votre conduite envers la France et notre coalition de l’an dernier. Je crois qu’il a été assez frappé. J’étais en veine de paroles très libres et point amères, comme le jour où j’ai parlé chez vous devant la Princesse Soltykoff et Nicolas Pahlen de la façon dont vous récompensiez Pozzo. Vous vous rappelez. 3 heures Il n’est bruit ici que du mauvais succès de votre expédition de Khiva. J’ai tort de dire votre et cela me déplait. Eh bien, vous savez surement que l’expédition de Khiva, n’a pas réussi. Le corps expéditionnaire est rentré dans les frontières russes après avoir perdu la moitié de ses hommes et presque tous ses moyens de transport, chameaux, charrettes etc. Je ne vois que des gens à qui cela fait plaisir. M. de Brünnow a du malheur. Invité à dîner chez la Reine, il a répondu pour dire qu’il acceptait. Du reste, depuis quelques jours il s’excuse de n’être pas venu chez moi. Il n’avait, dit-il, point de caractère bien règlé, il était si peu de chose ; il a cru qu’il devait se conduire sans prétentions. Dès qu’il aura présenté ses lettres de créance demain au lever, il viendra mettre sa carte chez moi, et il m’expliquera pourquoi il n’est pas venu plutôt. Il a tenu ce langage à plusieurs personnes entr’autre à M. de Bülow qui me l’a dit, et ne doute pas qu’il ne vienne. Je l’attends. N’en parlez à personne jusqu’à ce qu’il soit venu. Le corps Diplomatique de Londres va se renouveler beaucoup. M. de Blome retourne en Danemark. M. de Hummelauer à Vienne, quand il se sera marié à Milan ce qu’il fait par ordonnance de son médecin. Bourquenoy me quitte la sémaine prochaine. Je le regretterai. Il est de très bon conseil et d’un aimable caractére ; vraiment estimé ici. Mon ambassade vous plairait à voir. Les deux secretaires, les deux attachés et mon petit herber vivent dans la meilleure intelligence, et tous de fort bon air. L’un des attachés, M. de Vandeul est un jeune homme distingué. Je ne sais pourquoi ceci me revient à l’esprit, Lord Douro, était hier au soir au bal. Oh vraiment vraiment! J’aime mieux Lord Brougham.
Mercredi, 9 heures
J’ai causé longtemps hier après dîner avec Lady Carlisle qui m’a parlé de vous simplement; affectueusement, comme il me convient. Il y avait à dîner dix du douze personnes invitées, pour me voir. Un M. Grenville, de 84 ans frère ainé du feu lord Grenville, homme fort, lettré, dit-on et qui a l’une des plus belles, bibliothèques de l’Angleterre. Je lui ai promis d’aller la voir. Je suis d’une coquetterie infatigable. Ne croyez pas pourtant que je prodigue mes promesses. J’oublie les noms des autres. On a ici une façon de prononcer les noms propres qui les rend très difficiles à comprendre et à retenir. C’est un de mo ennuis. On me présente les gens, J’entends mal ou je n’entends pas leur nom. Et quand je les retrouve je ne m’en souviens pas. Le vieux poète Rogers est un de mes proneurs. Je le soigne. Au moment du dîner, la Duchesse de Sutherland à reçu l’avis que le lèver, qui devait avoir lieu ce matin était remis. Je viens de le recevoir aussi de Sir Robert Chester. La Reine est un peu souffrante. Elle a pourtant dansé avant-hier jusqu’à une heure et demie. On se demande toujours, si elle a raison ou tort de danser. Personne ne répond positivement. si elle a tort elle a grand tort, car elle danse beaucoup, et personne, en dansant ne saute si vivement et ne parcourt autant d’espace qu’elle J’ai fini chez Lady Minto. J’y ai découvert un parent de bien loin, un M. Boileau de Castelnau issu d’une famille de refugiés protestans Geva une branche existe encore à Rismes, et tient à la mienne. Il est beau frère de Lord Minto et a été charmé de la découverte. Précisément, par grand hazard ma mère venait de m’annoncer, le mariage d’une jeune fille de la branche Nimoise, qui a épousé à Paris un anglais un M. Grant. De là des conversations, très amicales un nouveau gage de l’alliance anglaise. J’étais rentré à minuit. C’est ma limite ordinaire.
2 heures
J’ai le 333. Au moment où je revenais à vous on est venu m’annoncer le rev. M. Sidney smith. Je l’ai reçu. Il vante fort Lord John Russell et le regarde comme l’âme du Cabinet. Il dit que Lord Melbourne est un homme de beaucoup d’esprit et un beau garçon, beaucoup plutôt qu’un politician. Mais bien moins insouciant qu’il n’en a l’air Les radicaux sont en déclin dans la Chambre deCommunes, décourages et ne comptant plus sur lEur avenir ; ils s’étaient figurés qu’ils changeraient toutes choses. Le bon sens public les paralyse. La plupart se fondront dans les Whigs. S’il y avait une de dissolution. Peel aurait, six à sept voix de majorité. Voilà notre conversation. Conversation où j’ai beaucoup plus écouté que dit ; comme je fais toujours quand je suis avec un homme qui à une reputation d’homme d’esprit un peu littéraire. Il y a des gens à qui on plaît en leur parlant ; à d’autres, en les écoutant. On distingue bien vite. Je crois tout à fait que Barante restera à Pétersbourg comme Ste Aulaire à Vienne Soyez sûre que Thiers remuera peu, le moins possible M. de Rémusat est des amis particuliers de M. de Barante et le défendra. Il y aura beaucoup de petits combats intérieurs sur les personnes Quelques nominations feront du bruit. Mais en somme, la conservation prévaudra. Je suis charmé que Pahlen revienne et vous revienne. De part et d’autre on n’est pas si méchant qu’on se fait Voilà qui est dit : le 1er juin, car bien certainement votre nièce tardera. On part toujours plus tard qu’on ne dit, excepté.... Je ne comprends pas comment Lady Palmerston a parlé d’avril, à Lady Clauricard. Juin est établi. Votre description du Duc de Br. est très vraie mais l’intérieur est très supérieur à l’extérieur. Vous trouveriez la même chose pour plusieurs de mes amis M. Piscatory et M. de Rémusat par exemple. Les défauts sont très apparens; les qualités sont essentielles et quelquefois des plus rares. Je dis cela de l’esprit comme du caractére. J’ai fort appris et j’apprends tous les jours à suspendre beaucoup mon jugement. Je crois à mon premier instinct et à ma longue réflexion. Mais cette vue superficielle, passagére qui n’est ni de l’instinet, ni de la réflexion, je m’en méfie beaucoup ; rien n’est plus trompeur. Voilà un billet de Lord Palmerston qui me dit qu’il sera au Foreign, office à 4 heures. J’ai encore deux ou trois lettres à écrire dont ma mère est une. Adieu. Je ne puis pas me plaindre de la prudence, de mes gens. Je l’ai recommandée. Adieu, adieu
9 heures et demie
C’est beaucoup deux Reines pour une soirée. Il n’est pas aisé de les y arranger. J’ai dîné hier à Marlborough House entre la Reine douairière et la Duchesse de Cambridge. Le Duc et la Duchesse de Sutherland, Lord et Lady Jersey, Mm. de Bülow et de Gersdorf. La Reine douainière est restée bien allemande de manières et d’accent. L’air très bonne d’ailleurs et d’une simplicité bien royale. J’ai beaucoup causé avec la Duchesse de Cambridge. Elle me paraît aîmer la conversation. Bien protestante de cœur. Elle trouve l’Eglise Anglicane trop catholique. Cela me réussit fort ici d’être le premier Ambassadeur protestant venu de France depuis Sully. Nous sommes sortis de table à 10 heures. Le bal de la Reine commençait à 9 heures et demie. Mais elle était prévenue du dîner de la Reine douairière. Nous ne sommes arrivés à Buckingham-Palace qu’à 10 heures et demie. Assez tôt, car j’y suis resté jusqu’à deux heures. C’est long. Décidément quoique en principe ce soit juste, les spectateurs sont trop sacrifiés aux danseurs. Soixante ou quatre vingt personnes dansant toujours, et douze ou quinze assistants ramassant çà et là des lambeaux de conversation décousue. Lord Clarendon a été m’a principale ressource. Un peu Lady Palmerston, Lady Normanby, Lady Fitz-Harris. Je trouve la manière de Lady Palmerston avec son mari et sa fille très aimable. Elle est sans cesse occupée d’eux, et visiblement. Elle doit leur plaire beaucoup. J’ai eu hier une longue visite de M. de Kissélef, évidemment charmé d’aller à Paris, quoiqu’il y aille par Pétersbourg. Je lui ai parlé de bien des choses et bien. De deux surtout, votre conduite envers la France et notre coalition de l’an dernier. Je crois qu’il a été assez frappé. J’étais en veine de paroles très libres et point amères, comme le jour où j’ai parlé chez vous devant la Princesse Soltykoff et Nicolas Pahlen de la façon dont vous récompensiez Pozzo. Vous vous rappelez. 3 heures Il n’est bruit ici que du mauvais succès de votre expédition de Khiva. J’ai tort de dire votre et cela me déplait. Eh bien, vous savez surement que l’expédition de Khiva, n’a pas réussi. Le corps expéditionnaire est rentré dans les frontières russes après avoir perdu la moitié de ses hommes et presque tous ses moyens de transport, chameaux, charrettes etc. Je ne vois que des gens à qui cela fait plaisir. M. de Brünnow a du malheur. Invité à dîner chez la Reine, il a répondu pour dire qu’il acceptait. Du reste, depuis quelques jours il s’excuse de n’être pas venu chez moi. Il n’avait, dit-il, point de caractère bien règlé, il était si peu de chose ; il a cru qu’il devait se conduire sans prétentions. Dès qu’il aura présenté ses lettres de créance demain au lever, il viendra mettre sa carte chez moi, et il m’expliquera pourquoi il n’est pas venu plutôt. Il a tenu ce langage à plusieurs personnes entr’autre à M. de Bülow qui me l’a dit, et ne doute pas qu’il ne vienne. Je l’attends. N’en parlez à personne jusqu’à ce qu’il soit venu. Le corps Diplomatique de Londres va se renouveler beaucoup. M. de Blome retourne en Danemark. M. de Hummelauer à Vienne, quand il se sera marié à Milan ce qu’il fait par ordonnance de son médecin. Bourquenoy me quitte la sémaine prochaine. Je le regretterai. Il est de très bon conseil et d’un aimable caractére ; vraiment estimé ici. Mon ambassade vous plairait à voir. Les deux secretaires, les deux attachés et mon petit herber vivent dans la meilleure intelligence, et tous de fort bon air. L’un des attachés, M. de Vandeul est un jeune homme distingué. Je ne sais pourquoi ceci me revient à l’esprit, Lord Douro, était hier au soir au bal. Oh vraiment vraiment! J’aime mieux Lord Brougham.
Mercredi, 9 heures
J’ai causé longtemps hier après dîner avec Lady Carlisle qui m’a parlé de vous simplement; affectueusement, comme il me convient. Il y avait à dîner dix du douze personnes invitées, pour me voir. Un M. Grenville, de 84 ans frère ainé du feu lord Grenville, homme fort, lettré, dit-on et qui a l’une des plus belles, bibliothèques de l’Angleterre. Je lui ai promis d’aller la voir. Je suis d’une coquetterie infatigable. Ne croyez pas pourtant que je prodigue mes promesses. J’oublie les noms des autres. On a ici une façon de prononcer les noms propres qui les rend très difficiles à comprendre et à retenir. C’est un de mo ennuis. On me présente les gens, J’entends mal ou je n’entends pas leur nom. Et quand je les retrouve je ne m’en souviens pas. Le vieux poète Rogers est un de mes proneurs. Je le soigne. Au moment du dîner, la Duchesse de Sutherland à reçu l’avis que le lèver, qui devait avoir lieu ce matin était remis. Je viens de le recevoir aussi de Sir Robert Chester. La Reine est un peu souffrante. Elle a pourtant dansé avant-hier jusqu’à une heure et demie. On se demande toujours, si elle a raison ou tort de danser. Personne ne répond positivement. si elle a tort elle a grand tort, car elle danse beaucoup, et personne, en dansant ne saute si vivement et ne parcourt autant d’espace qu’elle J’ai fini chez Lady Minto. J’y ai découvert un parent de bien loin, un M. Boileau de Castelnau issu d’une famille de refugiés protestans Geva une branche existe encore à Rismes, et tient à la mienne. Il est beau frère de Lord Minto et a été charmé de la découverte. Précisément, par grand hazard ma mère venait de m’annoncer, le mariage d’une jeune fille de la branche Nimoise, qui a épousé à Paris un anglais un M. Grant. De là des conversations, très amicales un nouveau gage de l’alliance anglaise. J’étais rentré à minuit. C’est ma limite ordinaire.
2 heures
J’ai le 333. Au moment où je revenais à vous on est venu m’annoncer le rev. M. Sidney smith. Je l’ai reçu. Il vante fort Lord John Russell et le regarde comme l’âme du Cabinet. Il dit que Lord Melbourne est un homme de beaucoup d’esprit et un beau garçon, beaucoup plutôt qu’un politician. Mais bien moins insouciant qu’il n’en a l’air Les radicaux sont en déclin dans la Chambre deCommunes, décourages et ne comptant plus sur lEur avenir ; ils s’étaient figurés qu’ils changeraient toutes choses. Le bon sens public les paralyse. La plupart se fondront dans les Whigs. S’il y avait une de dissolution. Peel aurait, six à sept voix de majorité. Voilà notre conversation. Conversation où j’ai beaucoup plus écouté que dit ; comme je fais toujours quand je suis avec un homme qui à une reputation d’homme d’esprit un peu littéraire. Il y a des gens à qui on plaît en leur parlant ; à d’autres, en les écoutant. On distingue bien vite. Je crois tout à fait que Barante restera à Pétersbourg comme Ste Aulaire à Vienne Soyez sûre que Thiers remuera peu, le moins possible M. de Rémusat est des amis particuliers de M. de Barante et le défendra. Il y aura beaucoup de petits combats intérieurs sur les personnes Quelques nominations feront du bruit. Mais en somme, la conservation prévaudra. Je suis charmé que Pahlen revienne et vous revienne. De part et d’autre on n’est pas si méchant qu’on se fait Voilà qui est dit : le 1er juin, car bien certainement votre nièce tardera. On part toujours plus tard qu’on ne dit, excepté.... Je ne comprends pas comment Lady Palmerston a parlé d’avril, à Lady Clauricard. Juin est établi. Votre description du Duc de Br. est très vraie mais l’intérieur est très supérieur à l’extérieur. Vous trouveriez la même chose pour plusieurs de mes amis M. Piscatory et M. de Rémusat par exemple. Les défauts sont très apparens; les qualités sont essentielles et quelquefois des plus rares. Je dis cela de l’esprit comme du caractére. J’ai fort appris et j’apprends tous les jours à suspendre beaucoup mon jugement. Je crois à mon premier instinct et à ma longue réflexion. Mais cette vue superficielle, passagére qui n’est ni de l’instinet, ni de la réflexion, je m’en méfie beaucoup ; rien n’est plus trompeur. Voilà un billet de Lord Palmerston qui me dit qu’il sera au Foreign, office à 4 heures. J’ai encore deux ou trois lettres à écrire dont ma mère est une. Adieu. Je ne puis pas me plaindre de la prudence, de mes gens. Je l’ai recommandée. Adieu, adieu
334. Londres, Jeudi 2 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
334. Londres, jeudi 2 avril 1840
10 heures
J’ai dîné hier chez le colonel Maberly dans la petite maison de Londres la plus magnifiquement arrangée ; un luxe prodigieux en dorures, vieux sèvres, laque & On dit que lord Lichfield est pour beaucoup dans cette magnificence là ! Mad. Maberly est une grande femme, un beau teint, des yeux très animés du mouvement d’esprit, qui a été fraiche et qui passe pour belle. Le premier jockey de l’Angleterre and an author of novels. A dîner, Sir John Shelley, un ancien ami de George 4, lady Shelley, Lord Cantalupe, l’un des rivaux de Lord Chesterfield (à propos, lundi dernier pour le bal de la Reine, Lord Chesterfield a mis sept heures à sa toilette ; il a fait son luncheon dans l’intervalle) Lord Burghersh, Sir Hussey Vivian et sa femme. Après dîner, un improvisateur Anglais M. Hook, qui avait dîné aussi, s’est mis au piano, et cherchant ça et là quelques accords, a emprovisé sur tous les sujets qu’il a plu de lui donner. Je ne sais combien de chansons en vers, rimées, quelquefois assez originales et pleines de humour. Vous n’avez pas d’idée des rires; ils sont rares ici ; on rit les dents serrées. Mais hier ils étaient tous charmés; les corn laws et Lady Kinnoul, les deux affaires de la soirée revenaient à chaque instant dans les chansons et à chaque fois les rires redoublaient. L’improvisation a fini par une chanson en mon honneur, et nous nous sommes séparés à 11 heures pour aller en effet, les uns au débat des Corn laws, les autres au bal de Lady Kinnoul. J’ai été de ceux-ci, quoiqu’infiniment plus propre au débat qu’au bal.
Office (épicerie &) 90
Gages des gens 100
Mes chevaux 20, (ils sont beaux)
3 heures
4 heures
10 heures
J’ai dîné hier chez le colonel Maberly dans la petite maison de Londres la plus magnifiquement arrangée ; un luxe prodigieux en dorures, vieux sèvres, laque & On dit que lord Lichfield est pour beaucoup dans cette magnificence là ! Mad. Maberly est une grande femme, un beau teint, des yeux très animés du mouvement d’esprit, qui a été fraiche et qui passe pour belle. Le premier jockey de l’Angleterre and an author of novels. A dîner, Sir John Shelley, un ancien ami de George 4, lady Shelley, Lord Cantalupe, l’un des rivaux de Lord Chesterfield (à propos, lundi dernier pour le bal de la Reine, Lord Chesterfield a mis sept heures à sa toilette ; il a fait son luncheon dans l’intervalle) Lord Burghersh, Sir Hussey Vivian et sa femme. Après dîner, un improvisateur Anglais M. Hook, qui avait dîné aussi, s’est mis au piano, et cherchant ça et là quelques accords, a emprovisé sur tous les sujets qu’il a plu de lui donner. Je ne sais combien de chansons en vers, rimées, quelquefois assez originales et pleines de humour. Vous n’avez pas d’idée des rires; ils sont rares ici ; on rit les dents serrées. Mais hier ils étaient tous charmés; les corn laws et Lady Kinnoul, les deux affaires de la soirée revenaient à chaque instant dans les chansons et à chaque fois les rires redoublaient. L’improvisation a fini par une chanson en mon honneur, et nous nous sommes séparés à 11 heures pour aller en effet, les uns au débat des Corn laws, les autres au bal de Lady Kinnoul. J’ai été de ceux-ci, quoiqu’infiniment plus propre au débat qu’au bal.
Maintenant que j’ai vu laissez-moi vous répéter ce que j’avais entrevu. Les femmes ici ont bien peu de délicatesse. La pruderie n’est ni mon métier, ni mon goût; mais il y a des libertés de manière et de langage, des crudités d’admiration pour la beauté et la force physique qui me causent une impression bien déplaisante. L’abandon est charmant quand il est le privilège et le secret de l’intimité, quand il est inspiré et en quelque sorte arraché par la passion ; mais l’indifférence veut de la réserve, et il n’y a point de grâce à penser et dire tout haut et à toute heure ce qu’on ne sent et ne dit que dans ces moments qui sont les éclairs de la vie. Cachés et se parlant tout bas, quoique tout seuls. Mes paroles sont exagèrées comme toutes les paroles, mais vous les reduirez à leur juste valeur et vous me comprendrez. Il y avait foule chez Lady Kinnoul ; tous les Torys. Partout le duc et la duchesse de Cambridge. Le duc a demandé il y a quelques jours à Bourqueney quand arrivait ma vaisselle. Il parait impatient du dîner que je lui donnerai. Ma vaisselle complète a dû partir hier de Paris. Je l’aurai dans dix ou douze jours. Je fais remettre à neuf ma salle à manger. Elle était bien sale. Sébastiani n’avait rien entretenu. Puisque j’ai touché au ménage, voici les grands traits de la dépense de ma maison pendant le mois de mars. Je n’ai point eu de grand dîner ; mais j’en ai eu quatre ou cinq de dix à douze personnes.
cuisine 170 livres SOffice (épicerie &) 90
Gages des gens 100
Mes chevaux 20, (ils sont beaux)
Je vous épargne les autres détails. La dépense totale du mois, y compris le loyer d’un mois de la maison mon secrétaire, le traitement du médecin de l’Ambassade, (100 livres par an) qui est à ma charge n’atteint pas 700 livres. Ce sera plus cher quand, jaurai ma mère et mes enfants. Je crois la surveillance très bonne. Mon secrétaire est un trèsor d’exactitude de devouement et de probité.
Je ne sais pourquoi la poste n’arrive pas. J’en suis moins pressé aujourd’hui ; elle ne m’apporte rien de vous.
3 heures
La poste n’est arrivée qu’à une heure. La mer avait été détestable. La malle d’Ostende n’avait pas plus passé que celle de Calais. Aujourd’hui il fait beau très beau. Le Square sous mes fénêtres commence à verdoyer. C’est un des plus
petits de Londres, mais très bien planté.
Nourri Effendi sort de chez moi. Il me demande des nouvelles et ce que nous voulons faire! Que dit l’ombre de Soliman le grand ? J’ai horreur des décadences. Dans le monde matériel les ruines sont belles ; mais dans le monde moral c’est hideux.
Je ne crois pas un mot des bruits de dissolution du Parlement. Cependant je vois plusieurs Ministres et des plus considérables, persuadés qu’ils n’auraient rien à en craindre. Ils disent qu’ils gagneraient quelque chose dans les bourgs et ne perdraient pas dans les Comtés. Ils sont revenus à leur première sécurité sur la Chine ; non qu’ils ne s’attendent à un vif débat ; mais ils comptent sur une bonne majorité. Plus j’y regarde, moins je crois à un vrai danger pour le Cabinet.
4 heures
J’ai été interrompu par M. de Pollon et Sir Alexander Johnston. Il faut absolument que je sorte pour rendre des visites que je remets depuis plusieurs jours Sir Charles Bagot, le comte de Zetland, le comte de Listowel, Lord Reag. Et puis j’ai des dépêches à préparer pour demain.
Adieu. Adieu. Voilà un mois écoulé. Je ne vous le redirai jamais assez. Rien ne peut remplir le temps où vous n’êtes pas. Adieu
M. de la Redorte est triste parceque M. de Ste Aulaire est content.
335. Paris, Jeudi 2 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
335. Paris, Jeudi 2 avril 1840,
J’ai vu chez moi hier matin M de Montrond, le Duc de Noailles, & M. de St Aulaire. Celui-ci tout parfumé de Vienne; il m’a raconté l’automne dernier, les frayeurs de M. de Metternich, sa malade ensuite, tout cela parce qu’il nous avait déplu. Il dit qu’il est bien mais qu’il raconte et rabache plus que de coutume. Lord Beauvale va arriver et passera un mois à paris ! M. de St Aulaire a lu de vos dépêches. Il en parle avec enthousiasme. Le Duc de Noailles prépare un discours, il veut absolument pousser le gouverment à faire dans la question de l’orient ; avec l’Angleterre si c’est possible; sans elle si elle ne veut pas ce qui est raisonable. Montrond est venu me dire que le roi était fort content de Thiers, fort content de tout ceci, de bonne humeur. quand il a eu fini. Je lui ai dit qu’on n’en croyait pas un mot. Il ne s’est pas fâché, et il s’est tu sur le chapitre de la satisfaction. Il a entonné vos louanges aussi. Il parait que Thiers parle beaucoup de vos dépêches. Je voudrais être Thiers pour les lire. Il m’a dit qu’on s’entretient beaucoup de Mad. de Meulan qui veut absolument aller à Londres, et que vos amis craignent qu’à force d’importunités elle y parvienne. Or, ils sentent tous que cela gâterait parfaitement votre maison. Avez-vous quelque tracasserie sur ce sujet ?
Hier, le conseil a dû décider sur M. le Duc d’Orléans. Je crois que c’est pour lui permettre de partir. Lui même n’en a pas la moindre envie, c’est une question d’honneur et de parole engagée, pas autre chose. Je me suis promenée au Bois de Boulogne par vertu, sans aucun plaisir. C’est si triste d’être seule ! Je me fatique tout de suite. J’ai eu la Princesse Wolkonsky à dîner, et puis j’ai été un quart d’heure chez Mad. Appony; grand raout insupportable, et une demi-heure chez Mad. de Castellane, M. Molé et quelques personnes y étaient, conversation générales ; rien à vous rapporter. J’étais bien lasse hier, et tout le monde m’a trouvé mauvais visage. Je suis très poorly sans savoir dire exactement ce que j’ai.
Midi
J’ai vu chez moi hier matin M de Montrond, le Duc de Noailles, & M. de St Aulaire. Celui-ci tout parfumé de Vienne; il m’a raconté l’automne dernier, les frayeurs de M. de Metternich, sa malade ensuite, tout cela parce qu’il nous avait déplu. Il dit qu’il est bien mais qu’il raconte et rabache plus que de coutume. Lord Beauvale va arriver et passera un mois à paris ! M. de St Aulaire a lu de vos dépêches. Il en parle avec enthousiasme. Le Duc de Noailles prépare un discours, il veut absolument pousser le gouverment à faire dans la question de l’orient ; avec l’Angleterre si c’est possible; sans elle si elle ne veut pas ce qui est raisonable. Montrond est venu me dire que le roi était fort content de Thiers, fort content de tout ceci, de bonne humeur. quand il a eu fini. Je lui ai dit qu’on n’en croyait pas un mot. Il ne s’est pas fâché, et il s’est tu sur le chapitre de la satisfaction. Il a entonné vos louanges aussi. Il parait que Thiers parle beaucoup de vos dépêches. Je voudrais être Thiers pour les lire. Il m’a dit qu’on s’entretient beaucoup de Mad. de Meulan qui veut absolument aller à Londres, et que vos amis craignent qu’à force d’importunités elle y parvienne. Or, ils sentent tous que cela gâterait parfaitement votre maison. Avez-vous quelque tracasserie sur ce sujet ?
Hier, le conseil a dû décider sur M. le Duc d’Orléans. Je crois que c’est pour lui permettre de partir. Lui même n’en a pas la moindre envie, c’est une question d’honneur et de parole engagée, pas autre chose. Je me suis promenée au Bois de Boulogne par vertu, sans aucun plaisir. C’est si triste d’être seule ! Je me fatique tout de suite. J’ai eu la Princesse Wolkonsky à dîner, et puis j’ai été un quart d’heure chez Mad. Appony; grand raout insupportable, et une demi-heure chez Mad. de Castellane, M. Molé et quelques personnes y étaient, conversation générales ; rien à vous rapporter. J’étais bien lasse hier, et tout le monde m’a trouvé mauvais visage. Je suis très poorly sans savoir dire exactement ce que j’ai.
Midi
Le retour de Pahlen qui me fait un grand plaiser est au fond quant à l’à propos, une drole de chose. Thiers peut s’en domner les honneurs, les dates sont pour lui. On dit que le Roi est charmé. Il me semble que votre second dîner ne devrait pas encore être pour les Torys. Le premier étant officiel pour la fête du Roi ne compte pas. Il faut que vous ayez eu chez vous lady Palmerston et la duchesse de Sutherland, lady Hansdown, Holland, && avant d’avoir lady Jersey ou autres dames Torys. Je suis sûre d’avoir raison sur ce point. Si vous êtes prêt dans votre ménage. Je vous conseillerais un petit dîner pour ces dames avant la fête encore, voici la liste. Tout cela est convenable, vous ajouterez quelques hommes, vous pourriez même le redire si vous aimez mieux.
Au fond, il faut absolument que vous ayez un dîner d’essai avant votre grand dîner du 1er de Mai, car le service ne peut pas aller tout-à-fait bien du premier coup. Et comme essai, le corps diplomatique est une très bonne chose. Prenez les tous, femmes et hommes, faites un dîner de 20 ou 24 personnes huit jours avant. Et laissez la liste que je vous envoie pour après le 1er de mai. Nous ne nous génions pas beaucoup pour le corps diplomatique, ainsi comme dépense; cela n’ allait pas aussi loin que pour les autres dîners. On ne leur donne pas a eux absolument toutes les primeurs. Dites cela à votre chef de cuisine. Vous voyez que je me mêle de tout. Mais croyez moi, essayez votre maison sur le corps diplomatique. J’ai rayé sur l’autre page parce que décidément vous ferez comme je vous conseille tout à l’heure. Et puis après le 1er de mai viendra ce que je vous ai dit plus haut, et ensuite seulement le diner Tory. Vous pourrez faire cela deux jours de suite c’est l’usage, samedi et dimanche parce que ce sont les seuls jours libres.
Voici deux heures. Il faut finir. Je n’ai rien à vous dire du tout. Je me sens si malade, je crains une grosse maladie, et je ne sais que faire. adieu
Adieu, Adieu. Au fond, il faut absolument que vous ayez un dîner d’essai avant votre grand dîner du 1er de Mai, car le service ne peut pas aller tout-à-fait bien du premier coup. Et comme essai, le corps diplomatique est une très bonne chose. Prenez les tous, femmes et hommes, faites un dîner de 20 ou 24 personnes huit jours avant. Et laissez la liste que je vous envoie pour après le 1er de mai. Nous ne nous génions pas beaucoup pour le corps diplomatique, ainsi comme dépense; cela n’ allait pas aussi loin que pour les autres dîners. On ne leur donne pas a eux absolument toutes les primeurs. Dites cela à votre chef de cuisine. Vous voyez que je me mêle de tout. Mais croyez moi, essayez votre maison sur le corps diplomatique. J’ai rayé sur l’autre page parce que décidément vous ferez comme je vous conseille tout à l’heure. Et puis après le 1er de mai viendra ce que je vous ai dit plus haut, et ensuite seulement le diner Tory. Vous pourrez faire cela deux jours de suite c’est l’usage, samedi et dimanche parce que ce sont les seuls jours libres.
Voici deux heures. Il faut finir. Je n’ai rien à vous dire du tout. Je me sens si malade, je crains une grosse maladie, et je ne sais que faire. adieu
336. Paris, Vendredi 3 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
336. Paris, vendredi 3 avril 1840
11 heuresJe me suis levée très tard. Je ne suis pas bien, j’attends Vérity. Je viens de recevoir votre 333. Dites à M. de Bourguenay de venir me voir à son retour à Paris ; il me trouvera toujours entre 1 et 2 heures et même après. J’aurai mille choses à lui demander. J’ai eu hier matin encore la visite du duc de Noailles, et puis Appony. Il venait me lire une lettre de son fils. Le mariage se fera à la fin de mai, et ils seront ici le 25 juin. Je ne les attendrai pas. Appony a un chagrin concentré, et parle confidentiellement de celui du Roi. Mais il a l’air de croire qu’il faut subir la session. J’ai pris la Calèche hier, et je me suis fait mêner à St Cloud, mais seule encore. Marion s’était envolée. J’ai marché là un peu, et j’ai dormi pendant tout le temps du retour. J’ai fait une petite visite à la petite princesse. J’ai dîné seule. Le soir j’ai eu toutes les petites gens, Bavière, Wirtemberg, Hanovre, Sardaigne, Médem, Capellen, les Durazzo et la duchesse Lobkovitz. Lady Palmerston m’a écrit une longue lettre. "L’Orient n’avance pas, mais nous esperons toujours que M. Thiers sera assez sage pour voir la nécessité d’aller de front, avec les autres puissances, c’est une question qui nous occupe beaucoup et qui serait bien facilement arrangée ; si il voulait être de bonne foi. En attendant les sôts et les badaux vont faire des voyages et s’amourachent de Mehomet Ali. Ellice bavarde aussi à tort et à travers sur ce sujet. Nous sommes tracassés de la discussion sur la Chine. Je crois Brünnow un bon et honnête homme mais il n’est guère à la hauteur de sa position " Voilà à peu pris tout. Ah encore : "le jeune Nesselrode est un sot. " Le petit Kisseleff a assez de finesse russe ; je suis bien aise que vous ayez causé avec lui. Je pensais bien que M. de Brünnow prendrait occasion de sa nomination définitive pour réparer ses gaucheries auprès de vous. Je savais déjà que Khiva avait échoué, et je suis très convaincue du plaisir que cela fait en Angleterre.
2 heures
Verity est venu. Il veut me droguer pendent huit jours. Cela ne me plaît pas du tout. Je suis bien triste tous ces jours, bien triste. à chaque minute qui s’écoule, j’ai un remords. Il me semble que j’ai manqué d’esprit ; de prévoyance ; qu’en faisant cette observation au médecin j’aurais empêché ! Ah mon dieu, mon Dieu. Cette douce voix. Cette douce créature, Ce ravissant enfant !
6 heures. J’ai été faire visite à Lady Granville. J’ai causé avec le mari, il est bien d’avis que si M. Thiers est sage il n’abandonnera pas une de ses idées sur la question de l’Orient, parce que sa chute serait inévitable. Il pense, et il sait que vous soutenez cette opinion aussi qu’il ne serait possible à aucun homme d’Etat en France d’abandonner le Pacha. Enfin il me parait être aussi bien disposé que vous pouvez le désirer, et il gémit un peu de ce que d’autres en Angleterre pensent diffèrement. Il a eu hier pour voisin à dîner chez M. Gonin, M. Odillon, Barot. Il lui a laissé l’impression d’un homme qui protège le ministère ; et de plus, d’un homme qui compte être ministre lui même. On dit que la commission de la chambre des pairs est assez animée, et que la discussion le sera certainement. M de Broglie compte parler. J’ai été au bois de Boulogne un peu. Le vent d’est était bien élevé et bien aigre. En revenant j’ai passé chez Mad. de Talleyrand, M. Sallandy y était. Il disait que M. Molé parlerait aussi. C’est probablement le 13 que commence la discussion.
samedi 4
à 9 heures
J’ai dîné seule hier, que c’est triste seule, seule! Le soir j’ai été chez Lady Granville. J’ai recausé avec Appony et je l’ai un peu pressé de questions. Il ma dit : " comment voulez-vous que le Roi ne pense pas jour et nuit aux moyens de se débarasser de Thiers." Il ajoute que le Roi a été pour le départ du duc d’orléans dans la vue de flatter l’armée et de l’avoir pour soi à tout événement. Thiers est venu à l’Ambassade et tout droit à moi sans distraction. Nous avons parlé un peu de l’affaire. Il me dit : "Si lord Palmerston est obstiné, moi aussi je suis entêté. Mais enfin nous tacherons qu’il ne ressorte de là rien de mal." Il est charmé du retour de Pahlen. J’ai passé une pauvre nuit. Je passerai une triste matiné, à 3 heures, tout cera fini. Vous
ne savez pas comme je suis déchirée jusqu’au fond des entrailles. Oui, pour une mère c’est cela. Vous dinez aujourd’hui chez Miss Stanley, j’ai la mémoire de toutes vos invitations. J’attends une lettre encore aujourd’hui. Appony me dit qu’au fond, la situation depuis votre arrivée à Londres n’a pas varié d’un demie ligne. Croyez-vous faire quelque chose ?
Midi.
Ma pauvre tête et mon pauvre cœur sont bien malades. Je dine aujourd’hui chez Appony. Ils ont voulu que ce jour-ci je ne restasse pas seule. Voici Mad. de la Redorte qui m’invite pour un jour de la semaine prochaine à dîner chez elle avec Mad. de Talleyrand et M. Thiers. Elle a prudemment attendu les fonds secrets et après deux ans de brouillerie elle se rapproche. Ah cela par exemple, c’est trop Russe ! On ferait chez nous avec plus de prudence.
1 heure
Voici votre lettre ; vous dirai-je franchement. Elle ne me plaît pas du tout. Vous vous lancez en dépit de mes avertissements dans toutes les invitations qu’on vous fait ! Qui est-ce qui a jamais songé à aller dîner chez M. Maberly ? Sa femme est tout ce qu’il y a de plus dévergondée à Londres, les convives à ce que je vois étaient à l’avenant, vraiment mon mari aurait plutôt passé la Tamise à la nage que dîner chez ces gens, et il avait bien moins que vous une réputation de gravité. Si vous acceptez comme cela de dîner chez tout le monde, le vrai monde ne tiendra plus à si grand honneur de vous avoir à dîner chez lui. Notez qu’il faut rendre, et je vous déteste de composer un dîner convenable. où serait Mad. Maberly. Les femmes n’en voudraient pas, et beaucoup d’hommes non plus. Je suis tout-à-fait fâchée de ce que vous avez fait là. On parlait l’autre jour de vos succès à Londres et quelqu’un ajoutait : "et même, il fait la cour aux femmes." "Allons, ajoutait un autre, ne désesperons pas de le voir revenir ici même mauvais sujet." En vérité en dinant chez Mad. Maberly, vous en êtes tout près. Je vous demande pardon de vous dire si vivement ce que je pense mais je ne sais pas dire autrement quand j’éprouve de la peine. Et je suis si triste, si triste ! Je ne vous répéterai plus, restez ce que vous étiez, sérieux et grand. Vous n’y pensez plus. Mon ami pardonnez moi ; vous allez déchoir et vous me causez une vive peine. Adieu. Adieu.
Paris samedi le 4 avril 1840,
3 heures
Je viens de vous écrire et je recommence. Vous ne savez pas le chagrin que vous m’avez fait, chagrin de toutes les façons. Vous êtes descendu dans mon opinion, voilà ce qui me fait mal. Je vous proteste qu’un homme de ma connaissance qui m’aurait dit à Londres, j’ai dîné chez Mad. Maberly ; cet homme-là je l’aurais tout de suite classé un élégant, parmi les élégants de mauvais genre. il faut bien que je me serve de cette expression. Si un homme sérieux ; ah là je n’ose pas dire sans vous offenser. Enfin, ce qui est bien sûr c’est que personne ne m’a jamais dit y avoir dîné. Le duc de Wellington peut être mais aussi le Duc de W. figure dans les mémoires de... le nom m’échappe, une demoiselle de Londres. Tenez pour certain que vous avez fait là quelque chose de très inconvenant, demandez la réputation de la dame, et la réputation des convives. Votre position exige un peu plus de prudence. Il est très naturel que vous ignoriez la qualité sociale ou morale des gens qui vous invitent. Il faut demander et si vous n’avez à qui, écrivez-moi, nous en étions convenus. Je suis parfaitement sûre que j’entendrai parler de ce dîner avec beaucoup d’étonnement. Ce n’est pas de cette manière là qu’il vous convient d’étonner les gens. A ce compte je conçois que vous dîniez souvent dehors. Mais vous n’avez pas la prétention de Neuman qui avait compté 60 invitations dans un hiver, il peut accepter la quantité, mais vous devez regarder à la qualité. Je crois qu’en fait d’Ambassadeur Estrhazi peut avoir dîné chez Mad. Maberly. Mais il fait pire assurément. Il ne sera venu en tête à aucun de vos devanciers d’accepter cela. Quel plaisir de pouvoir se divertir d’un philosophe ! Et moi comme j’aurais aimé à m’entendre dire que tout tout était digne de vous ! Ceci fait un petit dérangement. Croyez vous que qui [que] ce soit au monde vous dise la vérite excepté moi. Eh bien si vous aimez encore la vérité écoutez moi. Ces allures ne vous vont pas. Elles vous donneront du ridicule, j’en suis parfaitement sûre. Et le dire de bien sottes gens ici, avant votre départ encore, se trouvera vèrifier. Je ne vous ai pas dit ce que j’ai entendu alors, je n’osais pas, vous auriez pris cela pour une injure. N. Pablen disait : " Il est capable d’aller dîner chez Madame Maberly." Cela faisait suite à Mad.Durazzo : "all these pretty women will make up to him, and he will be caught." Eh bien, je ne vous l’ai pas redit. J’ai eu tort; cela eut mieux valu. Aujourd’hui, j’aurais tort de ne pas vous dire tout, tout ce que je pense. Si vous vous fâchez. Je me tairai, mais je ne me repentirais pas. Cela me prouvera seulement que Londres, vous a déjà gaté. Ah que ne restez-vous ce que vous êtes. M. de Sully serait il allé dîner là ? Un ambassadeur doit tenir plus haut sa personne. Vous ne pouvez pas accepter indistinctement les invitations de tout le monde. Sans compter les espèces conme Mad. Maberly vous ne devez aller chez de petits gens que si une grande célébrité se rettache à leur nom. Votre dîner chez Grote a paru singulier aux Granville. Mais j’ai expliqué que vous aviez dîné chez eux à Paris ; je vous cite cela pour vous montrer ce qu’on peut penser à Londres. Il arrive parfois qu’on peut être obligé de dévier : par exemple, j’ai dîné chez certains Mitchell à Londres, mais c’était le plus gros individu commerçant de nos proviences de la Baltique. Son argent avait poussé sa femme respectable et ses filles à être admises à Almacks, à Devonshire house enfin partout. Et bien alors pour m’avoir,
ces gens invitaient tous les grands noms d’Angleterre, Wellington, Suthertand. Landsdowne, Jersey dix autres de cette espèce. Et cela faisait un dîner du plus élégant, minus la famllle. Vous voyez que Mad. Maberly n’a pas eu cette ressource pour vous. Ce que vous me nommez est déplorable. J’ai trop dit, et je n’ai pas tout dit. Il me semble que je vous honore en vous disant tout. Si vous êtes ce que
vous étiez je ne puis pas vous avoir offensé. Adieu. malgré madame Maberly ! 337. Paris, Dimanche 5 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
337 Paris Dimanche 5 avril1840,
10 heures
Après avoir fermé ma lettre hier, je me suis jetée à genoux demandant à Dieu pitié, miséricorde. J’avais le cœur brisé de mes malheurs passés, le cœur oppressé des malheurs à venir, tout derrière moi, devant moi était peine, misère. Vous ne savez pas comme le chagrin s’empare de moi, comme il m’envahit. Comme j’ai peur de moi alors, le joir où je n’en aurai plus que ce sera fini. Je vous ai écrit hier beaucoup, vous ne vous serez pas fâché n’est-ce pas ? Vous me pardonnez la vivacité de mes expressions vous savez comme je suis. Vous me disiez un jour : "Si l’on pouvait toujours lire au fond du cœur, si la parole était toujours toujours la vérité." Ma parole à moi, quand c’est à vous que je parle est bien ce qu’il y a dans mon cœur! Laissez moi ce privilège. Je n’ai fait que penser au sujet de votre dernière lettre. Je vous ai peut être dit directement ce que j’en ressentais, la forme eut été autre aujourd’hui que dans le premier moment, mais le fond n’eut pas varié ; je penserai toujours sur ce sujet comme hier. Si j’étais auprés de vous je suis sûre que je vous ferais convenir que j’ai raison mais je suis loin, si loin ! Vous me dites ce que vous avez fait, pourquoi ne pas me dire ce que vous ferez, ce qu’on vous propose ? Là où il y a doute, je le resoudrai. restez donc bien fier bien haut, comme il vous convient de l’être, à vous ; comme il convient de l’être dans le poste que vous occupez. Il y a quelques fois en vous une distraction d’esprit qui vous fait ne pas juger de suite les choses ce qu’elles sont ; je dirais d’un autre français que c’est de la légèreté, chez vous il n’y a pas moyen d’appliquer ce mot, il faut en trouver un autre.
Envoyez- moi, je vous prie votre programme d’engagements pris ou à prendre. Vous aurez trois invitations par jour si vous donnez dans du Maberly ! Il est impossible qu’un étranger sache classer la société de Londres, et depuis que M. de Bourqueney vous a passé les Maberly son expérience m’est très suspecte. Excepté les toutes nouvelles gens / les radicaux/ Il n’y a personne dont je ne connaisse la position sociale à Londres. Vous pouvez être pris à des noms, à des relations, cela ne veut rien dire.
Ainsi, Sir John Shelley, ami de George 4 oui surement et je l’ai vu là, toujours, ainsi que sa femme. Mais jamais je n’ai imaginé de prier chez moi ni le mari, ni la femme. A propos de celle ci, elle racontait qu’à Vienne où elle a été pendant le congrès, M. de Metternich, très amoureux d’elle avait été un jour très pressant et qu’elle lui avait dit : "une femme qui a refusé au duc de Wellington n’accordera pas au Prince de Metternich." Wellington à qui cela fut redit s’écria : "D... m’emporte si je lui ai jamais rien demandé."
Je cois que personne ne connait mieux que moi la société à Londres, les petits embarras d’invitation dans une ville où tous les invités ont de quoi inviter à leur tour. C’est là justement ce qui fait qu’il faut regarder de si prés à ce qu’on acceppte. Ainsi les Shelley, tenant par quelques petits bouts à un peu de l’élégance des Jokeys, vous demanderont de dîner chez eux, et n’auront rien de plus pressé que d’inviter les Maberly parce que vous avez eu l’air de rire et de vous plaire dans cette société. En même temps vous verrez chez eux quelque chose de mieux que chez ceux-ci, ce mieux jugera tout de suite que vous appartenez à ce set et vous voilà classé dans leur opinion avec des gens auxquels vous n’auriez pas même du rendre de carte de visite. Je vous dis l’exacte vérité. Ensuite laissez-moi- vous dire encore, ne laissez pas envahir votre temps par des visiteurs tels que Sidney Smith le prêtre bouffon. C’est bon à rencontrer à dîner, et encore il ne m’a jamais plu je vous l’avoue et c’est plutôt un homme méprisé que le contraire, parce que le genre de son esprit va mal avec son état mais vraiment on n’imagine pas de le recevoir le matin. Un ambassadeur qui ne passe pas pour un désoeuvré ne reçoit chez lui que des gens qui lui parlent affaires. Vous n’avez rien à apprendre avec M. Smith. Croker c’est autre chose de temps en temps, il a, ou du moins, il a eu une grande expérience des affaires de son pays. Il est bon à entendre quelquefois. Je vous trouve trop poli pour commencer. Il est impossible que vous souteniez cela, il aurait mieux valu vous faire plus rare. Nous avons beaucoup causé Angleterre pendant un mois. Et tous les jours je m’aperçois davantage, que je ne vous ai rien dit. Je reviens à moi.
J’ai été au bois de Boulogne un moment. Il faisait détestable. J’ai été chez la petite Princesse, M. de Ste Aulaire y est venu. Galant, épris de la petite Princesse, lui parlant de la couleur de sa robe, lui débitant des vers sur la couleur de ses yeux. Imaginez que je suis partie d’un éclat de rire. C’était parfaitement grossier, mais je n’avais rien entendu de pareil depuis le marquis de Mascarille. Je suis partie le laissant un peu étonné de mon rire. J’ai diné chez Appony avec le duc de Noailles. Appony est bien monté aussi contre Lord Palmerston et sa russomanie. Il me semble que cela devient un morceau d’ensemble. Comment cela finira-t-il ? Le Duc de Noailles persiste à vouloir presser Thiers à la Chambre des Pairs à dire quelque chose de trancher sur l’Egypte. Berryer est reçu chez moi le soir. Il dit que l’esprit de la chambre est bien vif sur ce point, que Thiers ni personne ne pourrait faire autrement que suivre la pente égyptienne. Il y a des prétentions de places qui commencent à incommoder le ministère. Les rédacteurs sont exigeants. M. Verou veut la direction générale des beaux arts ; Walesky une Ambassade ; la gauche entrer dans le ministère. Il faudra bien que tout cela se fasse après la session.
Vous aurez cette lettre par la poste d’aujourd’hui. Il me semble que celle d’hier ne doit pas rester deux jours sans successeur. Je voudrais vous parler à tout instant. Croyez-vous que je vous aime ? Ah mon dieu ! Adieu. Adieu.
Berryer soutient que Thiers ferait bien de prendre Barrot dans le ministère parce que là il s’annulerait tout-à-fait.
10 heures
Après avoir fermé ma lettre hier, je me suis jetée à genoux demandant à Dieu pitié, miséricorde. J’avais le cœur brisé de mes malheurs passés, le cœur oppressé des malheurs à venir, tout derrière moi, devant moi était peine, misère. Vous ne savez pas comme le chagrin s’empare de moi, comme il m’envahit. Comme j’ai peur de moi alors, le joir où je n’en aurai plus que ce sera fini. Je vous ai écrit hier beaucoup, vous ne vous serez pas fâché n’est-ce pas ? Vous me pardonnez la vivacité de mes expressions vous savez comme je suis. Vous me disiez un jour : "Si l’on pouvait toujours lire au fond du cœur, si la parole était toujours toujours la vérité." Ma parole à moi, quand c’est à vous que je parle est bien ce qu’il y a dans mon cœur! Laissez moi ce privilège. Je n’ai fait que penser au sujet de votre dernière lettre. Je vous ai peut être dit directement ce que j’en ressentais, la forme eut été autre aujourd’hui que dans le premier moment, mais le fond n’eut pas varié ; je penserai toujours sur ce sujet comme hier. Si j’étais auprés de vous je suis sûre que je vous ferais convenir que j’ai raison mais je suis loin, si loin ! Vous me dites ce que vous avez fait, pourquoi ne pas me dire ce que vous ferez, ce qu’on vous propose ? Là où il y a doute, je le resoudrai. restez donc bien fier bien haut, comme il vous convient de l’être, à vous ; comme il convient de l’être dans le poste que vous occupez. Il y a quelques fois en vous une distraction d’esprit qui vous fait ne pas juger de suite les choses ce qu’elles sont ; je dirais d’un autre français que c’est de la légèreté, chez vous il n’y a pas moyen d’appliquer ce mot, il faut en trouver un autre.
Envoyez- moi, je vous prie votre programme d’engagements pris ou à prendre. Vous aurez trois invitations par jour si vous donnez dans du Maberly ! Il est impossible qu’un étranger sache classer la société de Londres, et depuis que M. de Bourqueney vous a passé les Maberly son expérience m’est très suspecte. Excepté les toutes nouvelles gens / les radicaux/ Il n’y a personne dont je ne connaisse la position sociale à Londres. Vous pouvez être pris à des noms, à des relations, cela ne veut rien dire.
Ainsi, Sir John Shelley, ami de George 4 oui surement et je l’ai vu là, toujours, ainsi que sa femme. Mais jamais je n’ai imaginé de prier chez moi ni le mari, ni la femme. A propos de celle ci, elle racontait qu’à Vienne où elle a été pendant le congrès, M. de Metternich, très amoureux d’elle avait été un jour très pressant et qu’elle lui avait dit : "une femme qui a refusé au duc de Wellington n’accordera pas au Prince de Metternich." Wellington à qui cela fut redit s’écria : "D... m’emporte si je lui ai jamais rien demandé."
Je cois que personne ne connait mieux que moi la société à Londres, les petits embarras d’invitation dans une ville où tous les invités ont de quoi inviter à leur tour. C’est là justement ce qui fait qu’il faut regarder de si prés à ce qu’on acceppte. Ainsi les Shelley, tenant par quelques petits bouts à un peu de l’élégance des Jokeys, vous demanderont de dîner chez eux, et n’auront rien de plus pressé que d’inviter les Maberly parce que vous avez eu l’air de rire et de vous plaire dans cette société. En même temps vous verrez chez eux quelque chose de mieux que chez ceux-ci, ce mieux jugera tout de suite que vous appartenez à ce set et vous voilà classé dans leur opinion avec des gens auxquels vous n’auriez pas même du rendre de carte de visite. Je vous dis l’exacte vérité. Ensuite laissez-moi- vous dire encore, ne laissez pas envahir votre temps par des visiteurs tels que Sidney Smith le prêtre bouffon. C’est bon à rencontrer à dîner, et encore il ne m’a jamais plu je vous l’avoue et c’est plutôt un homme méprisé que le contraire, parce que le genre de son esprit va mal avec son état mais vraiment on n’imagine pas de le recevoir le matin. Un ambassadeur qui ne passe pas pour un désoeuvré ne reçoit chez lui que des gens qui lui parlent affaires. Vous n’avez rien à apprendre avec M. Smith. Croker c’est autre chose de temps en temps, il a, ou du moins, il a eu une grande expérience des affaires de son pays. Il est bon à entendre quelquefois. Je vous trouve trop poli pour commencer. Il est impossible que vous souteniez cela, il aurait mieux valu vous faire plus rare. Nous avons beaucoup causé Angleterre pendant un mois. Et tous les jours je m’aperçois davantage, que je ne vous ai rien dit. Je reviens à moi.
J’ai été au bois de Boulogne un moment. Il faisait détestable. J’ai été chez la petite Princesse, M. de Ste Aulaire y est venu. Galant, épris de la petite Princesse, lui parlant de la couleur de sa robe, lui débitant des vers sur la couleur de ses yeux. Imaginez que je suis partie d’un éclat de rire. C’était parfaitement grossier, mais je n’avais rien entendu de pareil depuis le marquis de Mascarille. Je suis partie le laissant un peu étonné de mon rire. J’ai diné chez Appony avec le duc de Noailles. Appony est bien monté aussi contre Lord Palmerston et sa russomanie. Il me semble que cela devient un morceau d’ensemble. Comment cela finira-t-il ? Le Duc de Noailles persiste à vouloir presser Thiers à la Chambre des Pairs à dire quelque chose de trancher sur l’Egypte. Berryer est reçu chez moi le soir. Il dit que l’esprit de la chambre est bien vif sur ce point, que Thiers ni personne ne pourrait faire autrement que suivre la pente égyptienne. Il y a des prétentions de places qui commencent à incommoder le ministère. Les rédacteurs sont exigeants. M. Verou veut la direction générale des beaux arts ; Walesky une Ambassade ; la gauche entrer dans le ministère. Il faudra bien que tout cela se fasse après la session.
Vous aurez cette lettre par la poste d’aujourd’hui. Il me semble que celle d’hier ne doit pas rester deux jours sans successeur. Je voudrais vous parler à tout instant. Croyez-vous que je vous aime ? Ah mon dieu ! Adieu. Adieu.
Berryer soutient que Thiers ferait bien de prendre Barrot dans le ministère parce que là il s’annulerait tout-à-fait.
338. Londres, Jeudi 9 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
338. Londres Jeudi 9 avril 1840
8 heures et demie
Hier, à dîner chez Lord Clarendon, Lord et Lady Landsdowne, Lord et Lady Holland, Lord et Lady Tankerville, Lord John Russell, Ellice, deux ou trois inconnus. Nous avons eu une petite scène. Lord Clarendon a fait monter dans le salon un tableau qui lui arrivait de Madrid et dans lequel une figure de Moine ressemblait vraiment beaucoup à Lord Holland, à ce point qu’à Madrid Charles Fox s’était recrié en la voyant. Lady Holland s’est fâchée, d’abord tout haut, puis tout bas avec Lord Clarendon. "I’m angry, truly angry take away that picture so ugly, so disgusting a friar."
Midi et demie
8 heures et demie
Hier, à dîner chez Lord Clarendon, Lord et Lady Landsdowne, Lord et Lady Holland, Lord et Lady Tankerville, Lord John Russell, Ellice, deux ou trois inconnus. Nous avons eu une petite scène. Lord Clarendon a fait monter dans le salon un tableau qui lui arrivait de Madrid et dans lequel une figure de Moine ressemblait vraiment beaucoup à Lord Holland, à ce point qu’à Madrid Charles Fox s’était recrié en la voyant. Lady Holland s’est fâchée, d’abord tout haut, puis tout bas avec Lord Clarendon. "I’m angry, truly angry take away that picture so ugly, so disgusting a friar."
Il y avait quelque chose de vrai dans ce courroux conjugal. Mais la fantaisie y était plus grande que la vérité, surtout l’envie que sa volonté fût faite sur le champ, qu’on écartât d’elle ce petit déplaisir. Lord Clarendon s’est bien défendu, surpris d’abord, puis un peu fâché à son tour et obstiné. Lady Holland a insisté mais habilement mêlant la caresse à la colère et d’une voix douce quoique les regards toujours fort animés. Lord Clarendon a un peu cédé à son tour sans fuir, et la querelle a fini par une transaction de juste-milieu ; le tableau est resté dans le salon, mais retourné contre le mur. J’admire toujours la part immense de la comédie en ce monde, toujours avec une petite dose de vanité. A dix heures et demie je suis retourné à la chambre des Communes ; mais le débat était très ennuyeux. Personne d’important. Sir Robert Peel, et Lord Palmerston parleront probablement aujourd’hui pour finir. Hier soir, plusieurs ministériels m’ont paru inquiets ; ils m’ont dit: " Le champ de bataille nous restera, mais tout juste." Cela ne me fait pas cette impression là. Il est vrai que je n’y entends rien. Les dehors ici sont si froids, même quand les résolutions sont passionnées. Des charbons sous la neige. En sortant, j’ai été chez Lady Palmerston. Il y avait assez de monde. Elle était évidemment très préoccupée de la Chambre. Elle allait et venait très empressée, très polie cherchant, partout à qui parler et parlant pour se distraire, sans y réussir. J’étais chez moi à minuit. Les Holland retournent samedi s’établir à Holland house. J’ai promis d’y aller Dimanche soir et dîner le Dimanche suivant. Aujourd’hui le Drawing-room à 2 heures. Je n’aurai pas le temps de vous en dire un mot, en revenant. On dit qu’il durera au moins trois heures. La Reine n’en a point tenu depuis son mariage. retourné contre. Il y aura des présentations sans nombre.
Midi et demie
Vous dites que nous avons parlé un mois de l’Angleterre et que vous ne m’avez rien dit. Vous ne m’avez pas dit tout ce que j’avais besoin de savoir, temoin Mad. Maberly. Mais vous m’avez dit immensément et ce que vous m’avez dit m’est d’une immense utilité. Je vous rencontre, je vous reconnais à chaque pas. Vingt fois par jour, j’ai à faire usage d’une indication d’un conseil de vous. C’est charmant. Je ne connais rien, presque rien (pour dire bien vrai) de plus doux que la reconnaissance, petite ou grande, quand on aime beaucoup. Je m’y complais infiniment.
J’ai reçu hier matin beaucoup de visites de celles que vous permettez, Bülow, Hummelauer, Pollon, & M. de Bülow est très soigneux pour moi, et bien aussi, je crois, pour les choses. Le Roi de Prusse a une idée fixe, l’accord des cinq Puissances pour la surété de la paix. Nous ne demandons pas mieux ; mais nous avons aussi nos points fixes. Il paraît du reste que vous êtes de votre côté, infiniment plus doux, fort amis aussi de l’union des cinq Puissances. M. de Pahlen l’a beaucoup dit en passant à Berlin. Vous abondez beaucoup moins dans l’idée de nous pousser à l’ésolement. Mon langage quant à l’isolement est celui-ci : il nous déplaira ; il a de l’inconvenient pour nous ; c’est un embarras dans notre situation. Mais l’embarras, l’inconvénient sont surtout pour le premier moment dans le premier effet. Tandis que de l’autre côté les embarras iront croissant et finiront par devenir des périls. Quand une fois les positions seront prises, nous serons spectateurs les autres acteurs : à nous, la critique ; aux autres les affaires et la responsabilité. Or ces affaires là seront très difficiles, d’un succès très incertain, et d’un avenir très inconnu.
Voilà une Hypothése. L’autre, celle d’un accommodement entre les cinq, par des concessions réciproques du Sultan et du Pacha me paraît toujours la plus probable. Mais la solution n’est pas mûre. Le temps y conduit. J’aime donc le temps. Je ne fais rien cependant pour le gagner. Je le laisse venir. J’ai vu aussi entrer hier Charles de Mornay qui passe par Londres en retournant à Stockholm. Il est devenu bien lourd. Je le mènerai demain à Lord Palmerston. Je suis dans une grande incertitude. Il faut que je vous quitte pour faire ma toilette. Fermerai-je ma lettre et la donnerai-je à M. Herbet pour la poste avant de monter, en voiture ? Ou bien attendrai-je que je sois revenu du Drawing- room. On me parle de trois grandes heures. Je ne serais donc ici qu’à 5 heures et demie. C’est trop tard. Je ne veux pas risquer qu’une lettre attendue vous manque.
Adieu. Adieu. Vérity a-t-il vraiment commencé à vous droguer ? J’espère que non. Je déteste les drogues. On ne sait jamais ce quelles feront. Adieu.
Voilà une Hypothése. L’autre, celle d’un accommodement entre les cinq, par des concessions réciproques du Sultan et du Pacha me paraît toujours la plus probable. Mais la solution n’est pas mûre. Le temps y conduit. J’aime donc le temps. Je ne fais rien cependant pour le gagner. Je le laisse venir. J’ai vu aussi entrer hier Charles de Mornay qui passe par Londres en retournant à Stockholm. Il est devenu bien lourd. Je le mènerai demain à Lord Palmerston. Je suis dans une grande incertitude. Il faut que je vous quitte pour faire ma toilette. Fermerai-je ma lettre et la donnerai-je à M. Herbet pour la poste avant de monter, en voiture ? Ou bien attendrai-je que je sois revenu du Drawing- room. On me parle de trois grandes heures. Je ne serais donc ici qu’à 5 heures et demie. C’est trop tard. Je ne veux pas risquer qu’une lettre attendue vous manque.
Adieu. Adieu. Vérity a-t-il vraiment commencé à vous droguer ? J’espère que non. Je déteste les drogues. On ne sait jamais ce quelles feront. Adieu.
340. Paris, Jeudi 9 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
340 Paris, jeudi 9 avril 1840 10 h1/2
Appony m’a fait une longue visite hiers la dépêche télégraphique annonçant que M. Temple avait envoyé des ordres à l’amiral Stopford préocupait beaucoup l’ambassadeur. Cependant je l’ai trouvé plutôt joyeux. Il m’a fait l’éloge de M. Thiers, il le loue de sa politesse, ce qui ne l’empéchait pas de faire quelque voeux contre M. Berger. M. Molé ameutait beaucoup son monde dans ce vote. Je vois cependant que les moutons sont remis à ce berger.
Midi
Appony m’a fait une longue visite hiers la dépêche télégraphique annonçant que M. Temple avait envoyé des ordres à l’amiral Stopford préocupait beaucoup l’ambassadeur. Cependant je l’ai trouvé plutôt joyeux. Il m’a fait l’éloge de M. Thiers, il le loue de sa politesse, ce qui ne l’empéchait pas de faire quelque voeux contre M. Berger. M. Molé ameutait beaucoup son monde dans ce vote. Je vois cependant que les moutons sont remis à ce berger.
J’ai fait le tour du bois de Boulogne avec Marion en voiture, on ne me permet pas de marcher par ce temps, car il ne fait pas beau ici. j’ai fait visite à la petite princesse. elle est mieux mais il ne peut pas être question pour elle de départ
J’ai dîné seule. Le soir j’ai été en Appony dernière grande soirée. Toute la diplomatie est en grande rumeur sur l’affaire de Naples. Vous ne sauriez vous faire d’idées du soulèvement. M. Molé est venu m’en parler aussi, disant, qu’il faut s’en mêler, protester au moins. Que c’est inouï !
Granville m’en a parlé quoique affirmant qu’il n’en savait pas un mot de Londres. Il a cependant dit : "Vraiment il faut mettre à la raison ce petit roitelet." Le propos est fort, mais les Anglais ont le prévilège de l’insolence. Je ne connais pas the merit of the case, mais le procédé Anglais me parait bien soudain et violent, vraiment il me semble difficile qu’on ne s’en mèle pas. Je n’ai entendu parler que de cela hier au soir. J’étais dans mon lit avant onze heures. Comment n’avez-vous pas été encore au parlement ? Les engagements de soirée ne demandent pas un grand respect en Angleterre, on s’en tire par une carte remise le lendemain et si vous attendez une soirée libre vous arriverez au mois de juillet, c’est-à-dire lorsque le parlement finira.
J’avais le cœur plus à l’aise hier. Votre lettre m’a fait du bien tenez le dans ce bon état. J’ai fait prier Génie de venir une voir ce matin. Il y a 10 jours qu’il n’est venu. Il faut que je lui parle d’une chicane qu’on me fait pour mon loyer. Un des grands ennuis du célibat veuvage pour une femme est que tout le monde commence par la croire bête et poltrone. Je veux savoir de Génie si dans le cas présent c’est dans ce sens qu’on me traite. J’ai relu plusieurs fois votre lettre, votre portrait d’O’Connel est merveilleux. Je suis sûre que vous dites vrai. Vos dernières pages sont charmantes, c’est une beaume tout-à-fait.
Midi
J’allais assez souvent le Dimanche au Zoological garden, mais je n’y allais pas seule ! Je n’y retournerai pas. Y avez-vous été seul ou en société et avec qui ? Je vous prie de me dire toutes ces choses, tous, tous les détails. Est -ce que je vous en épargne un seul de ma journée ? On ne peut se résigner à l’absence qu’à cette condition là. Je suis bien aise que vous ayez décidé sur Madame de Meulan. Quand comptez-vous faire venir votre famille ? La ferez-vous venir cet été ? Pensez-y bien. Vous m’avez dit que vous viendrez ici à la fin de l’automne. Si vous la faites venir, vous ne me tiendrez pas votre promesse, car vous ne voudrez pas laisser votre mère, et vos enfans seuls en Angleterre. Vous ne voudrez pas leur faire passer la mer dans la mauvaise saison. Examinez bien tout cela, et dites-moi vrai, ne me trompez pas. S’ils sont auprès de vous, vous ne ferez plus avec moi vos visites de moi vos visites de châteaux. Enfin, enfin de quelque côté que je regarde cela j’y vois pour moi de grands mécomptes. Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi, mais je ne veux pas que vous me trompiez. Vous savez que quelques fois, vous l’avez essayé pour m’épargner de la peine et vous savez aussi que cela a toujours mal réussi.
Je vous envoie cette lettre parce que c’est mon jour, mais elle vous dit peu de choses.
Parlez moi de Brünnnow, n’est-il donc pas encore venu vous voir ? Quand vous le rencontrez dans le monde vous parlez vous ? La grossesse de Lady Palmerston si elle est vraie, serait étrange. Elle a mon âge.
Adieu. adieu mille fois.
339. Londres, Vendredi 10 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
339. Londres Vendredi 10 avril 1840
4 heures et demie
Quelques mots aujourd’hui pour vous remercier du 339 si tendre, et puisque les jours sans lettre sont si tristes. Par malheur j’ai très peu de temps. J’ai été chez Lord Palmerston. En en sortant, j’ai eu à écrire une dépêche sur ces affaires de Naples. Je viens de finir. Que c’est commode d’être dans une île avec l’océan pour frontière ! On fait de la politique, extérieure, sans responsabeilité comme les journaux anonymes. Je l’ai dit en riant à Lord Palmerston. Quand l’Italie sera en feu, pour qui sera l’embarras. Je l’ai trouvé raisonnable, c’est-à-dire ne demandant pas mieux que de l’être pour finir ce qu’il a si vivement commencé. Au fait, l’Angleterre profite des avantages de sa position. Ils étaient hier assez inquiets sur le vote de la Chine. Ils ont eu quatre voix de plus qu’ils n’espéraient une heure avant. Je suis resté à la Chambre jusqu’à 1 heure et demie. J’ai entendu la moitié du discours de Peel. Excellente manière de parler, simple et point familière, naturelle, et point froide ; très bien posé de sa personne ; de l’autorité, comme on en a avec ses égaux quand on leur est supérieur sans être un homme supérieur. J’ai été plus frappé de la forme que du fond. Le début à été très bien. Mais quand il est entreé en Chine, le chemin a été si long que le désespoir m’a pris et je suis sorti. Je regrette de n’avoir pas entendu Lord Palmerston. Mais il n’a pris la parole qu’à 2 heures et demie. Il a eu un vrai succès. Ce qui est excellent, c’est l’énergie et l’intelligence avec lesquelles chaque parti soutient Son chef. Les hear et les loud cheers sont pour moitié dans l’éloquence anglaise. Il n’y a rien de tel pour avancer que d’être ainsi poussé. De quoi vous parle-je là quand votre lettre m’a été si avant-dans le cœur ? Vous avez bien raison de me dire de si douces paroles. N’est-ce pas que c’est charmant ? c’est un droit divin, d’envoyer au delà des mers, dans un petit chiffon de papier du bonheur du vrai bonheur? Mais je vous en veux de votre inquiétude vague, et de votre silence. Sur votre inquiétude vague, vous n’avez droit de rien penser, de me rien dire, en pareil sujet ; mais quand vous avez le tort de penser quelque chose au moins faut-il me le dire. Et que ce soit un dîner chez Mad. Maberly qui ait transformé votre inquiétude vague en une conviction si forte en un chagrin si réel! Cela ne serait pas pardonnable si vous aviez jamais besoin de pardon, et j’en serais très offensé si je ne vous connaissais pas comme je vous aime. Vous me dites d’être fier, très fier. Je le suis mille fois plus que vous ne l’êtes pour moi, car le rouge me monte au visage en pensant à la cause de votre inquiétude. Vous ne savez pas ce qu’est pournmoi que de dire les paroles que je vous dis et à quelle hauteur je cherche et je place celle à qui je les dis.
4 heures et demie
Quelques mots aujourd’hui pour vous remercier du 339 si tendre, et puisque les jours sans lettre sont si tristes. Par malheur j’ai très peu de temps. J’ai été chez Lord Palmerston. En en sortant, j’ai eu à écrire une dépêche sur ces affaires de Naples. Je viens de finir. Que c’est commode d’être dans une île avec l’océan pour frontière ! On fait de la politique, extérieure, sans responsabeilité comme les journaux anonymes. Je l’ai dit en riant à Lord Palmerston. Quand l’Italie sera en feu, pour qui sera l’embarras. Je l’ai trouvé raisonnable, c’est-à-dire ne demandant pas mieux que de l’être pour finir ce qu’il a si vivement commencé. Au fait, l’Angleterre profite des avantages de sa position. Ils étaient hier assez inquiets sur le vote de la Chine. Ils ont eu quatre voix de plus qu’ils n’espéraient une heure avant. Je suis resté à la Chambre jusqu’à 1 heure et demie. J’ai entendu la moitié du discours de Peel. Excellente manière de parler, simple et point familière, naturelle, et point froide ; très bien posé de sa personne ; de l’autorité, comme on en a avec ses égaux quand on leur est supérieur sans être un homme supérieur. J’ai été plus frappé de la forme que du fond. Le début à été très bien. Mais quand il est entreé en Chine, le chemin a été si long que le désespoir m’a pris et je suis sorti. Je regrette de n’avoir pas entendu Lord Palmerston. Mais il n’a pris la parole qu’à 2 heures et demie. Il a eu un vrai succès. Ce qui est excellent, c’est l’énergie et l’intelligence avec lesquelles chaque parti soutient Son chef. Les hear et les loud cheers sont pour moitié dans l’éloquence anglaise. Il n’y a rien de tel pour avancer que d’être ainsi poussé. De quoi vous parle-je là quand votre lettre m’a été si avant-dans le cœur ? Vous avez bien raison de me dire de si douces paroles. N’est-ce pas que c’est charmant ? c’est un droit divin, d’envoyer au delà des mers, dans un petit chiffon de papier du bonheur du vrai bonheur? Mais je vous en veux de votre inquiétude vague, et de votre silence. Sur votre inquiétude vague, vous n’avez droit de rien penser, de me rien dire, en pareil sujet ; mais quand vous avez le tort de penser quelque chose au moins faut-il me le dire. Et que ce soit un dîner chez Mad. Maberly qui ait transformé votre inquiétude vague en une conviction si forte en un chagrin si réel! Cela ne serait pas pardonnable si vous aviez jamais besoin de pardon, et j’en serais très offensé si je ne vous connaissais pas comme je vous aime. Vous me dites d’être fier, très fier. Je le suis mille fois plus que vous ne l’êtes pour moi, car le rouge me monte au visage en pensant à la cause de votre inquiétude. Vous ne savez pas ce qu’est pournmoi que de dire les paroles que je vous dis et à quelle hauteur je cherche et je place celle à qui je les dis.
Je n’en dirai jamais, je n’en aurais jamais dit le premier mot à toute cette Angleterre que j’ai vu défiler hier au Drawing-room. Il a duré deux heures. On m’avait menacé de quatre. Les deux plus belles étaient Lady Douro et Lady Seymour. Je mets à côté la Duchesse de Roxburgh, quoique bien moins parfaite. Une foule de beautés, sans grâce, jetées dans un même moule, froides et j’ai bien regardé. Je ne me souviens de rien. La Reine était très fatiguée. Certainement elle est grosse. Elle changeait de couleur à chaque instant. Pour Lady Palmerston, elle a déjà une façon de tenir ses mains qui me persuade qu’on a raison.
Je mets Lady Ashley au nombre des plus jolies. Vous avez mon programme. Depuis, le 14 avril chez les Berry. Le 18, chez M. Macaulay. Le 4 mai chez Mad. Montefiore, une Rothschild. Je refuserai celui-ci. J’en ai essez fait là.
Je vais faire mes invitations pour le 1 mai.
Adieu. Il faut que j’écrive encore à Henriette.
Adieu. Adieu.
341. Paris, Vendredi 10 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
341 Paris le 10 avril vendredi 1840,
10 h 1/2
2 heures
Samedi le 11 avril 10 heures
10 h 1/2
J’ai eu longtemps chez moi Génie ; un moment M. de Pogenpohl une assez bonne promenade au bois de Boulogne, de la causerie. avec Lord Granville et une visite à la princesse ont complété ma matinée. Lord Granville s’anni sur la question des souffres. Je lui ai dit le cri générai de la diplomat ie, de tout le monde. Il combat cela ; cependant il persiste à dire que personne ne lui en écrit un mot de Londres. Cela est peu croyable il m’a répété hier, qu’il ne serait pas surpris d’apprendre que M. Odillon Barrat entre au ministère sous peu de jours, Votre véritable adversaire comme vous l’apelliez un jour dans la Chambre !
J’ai dîné seule ; après le diner la Princesse Wolkowsky est venue me dire adieu un moment, elle partait dans la nuit. Lord Granville, Brignole, Armin, l’internonce, les de Castellane, M. de Maussion, le Duc de Noailles, le prince d’Aremberg. Voilà ma soirée. Dès que Granville fut sorti, il n’y eut qu’un cri sur l’affaire de Naples dont on n’a pas parlé pendant qu’il y était. Brignole prétend cependant qu’une seconde note de Temple était écrite en termes plus doux, mais le fond reste le même et Stopford va agir, or la première partie de ses instructions vise à vous tout juste, parce que c’est sur des batiments Français que se trouvent chargés les souffres. Voilà une querelle engagée tout de suite. Qu’est-ce que cela va dévenir ? Vous êtes bien prudent. Vous ne me dites jamais la plus petite nouvelle politique. Brignole se plaint d’un redoublement de rigueur envers les prisonniers de Bourges, il a même fait des démarches auprès du ministre de l’intérieur, mais sans effet jusqu’ici. Il parait que Thiers a fait quelques avances à Caraffa dans l’intention que Naples demande l’intervention de la France. Mais Caraffa n’a pas relevé l’affaire. Il n’a aucun ordre à cet égard. Vos ministres étaient hier très préocuppés des nouvelles des départements où la cherté du pain cause quelques émeutes, les préfets demandent des troupes et il n’y en a pas. Le parti conservateur est content du dernier vote. Il prouve que la minorité est très serrée et décidée. On juge que la situation du Ministère est toujours très épineuse. Granville par exemple le pense.
Je ne me mèle pas de vous parler de ce que vous mande Génie mais je le sais un peu. Ce qui me frappe c’est la nécessité que vous ne laissiez aucun doute à vos amis sur votre résolution en cas de chances pour M. Molé. Vous leur devez de les éclairer sur ce point que je crois bien résolu dans votre pensée et avec raison.
A propos, hier un ministre a dit à Granville : "Ces conservateurs sont étonnants ; ils croient bien nous embarrasser par leur motion Rémilly. Et bien vogue la galère, que la reforme électorale nous vienne par là. Il faut bien qu’elle vienne un jour nous l’accepterons. Vous savez bien qu’on parle déjà de dissolution. Faut il que je fasse mon voyage en Angleterre ?
2 heures
Votre N° 337. Je vous en remercie tendrement. Vous vous êtes fâchés un peu. Un peu plus à la réflexion qu’au premier moment. Moi le premier moment a été plus vif, la réflexion a adouci. Voilà mes petites observations d’aujourd’hui. Cependant c’est presque imperceptible et je ne le vois que parce que je regarde à tout dans ce qui nous regarde avec une minutie qui surpasse encore votre bonne vue. Vous me consternez dans ce qui vous me dites de Sully, j’en restait à son austérité pour son maître, car enfin il est bien vrai qu’il condanmait sa conduite, et je croyais dès lors que c’était un Quaker. Jne crois plus à personne. Mais je croirai à vous; j’y crois. Oui, oui tout-à-fait. Il y a de si tendres paroles dans votre lettre, des paroles si pénétrantes. Votre programme me convient tout-à-fait et je suis bien aise de votre dîner le 15 à la société savante. J’en suis bien aise bourgeoisement. Ce sera une espèce de répétition avant la représentation du 1er de mai. Vous voyez que je me préocupe beaucoup de votre ménage.
Ce que vous au dites de l’impression que vous a faite la chambre des Communes me plait parfaitement, car c’est celle que j’ai reçue moi même. J’ai chargé Marion de la découverte de nouveaux pauvres. Anglais, et enfants ; c’est les deux conditions. On dit que le Roi, qui s’était mis sur le ton de la résignation a passé maintenant à l’état de plainte et de propos très amers contre son Ministère. Il se plaint aussi que son salon est désert ; on ne vient plus ! Vraiment il y a peu de dignité à ce langage.
Je vous dis à tort et à travers tout ce qui me revient, mais toujours de bonne source.
Ce que vous au dites de l’impression que vous a faite la chambre des Communes me plait parfaitement, car c’est celle que j’ai reçue moi même. J’ai chargé Marion de la découverte de nouveaux pauvres. Anglais, et enfants ; c’est les deux conditions. On dit que le Roi, qui s’était mis sur le ton de la résignation a passé maintenant à l’état de plainte et de propos très amers contre son Ministère. Il se plaint aussi que son salon est désert ; on ne vient plus ! Vraiment il y a peu de dignité à ce langage.
Je vous dis à tort et à travers tout ce qui me revient, mais toujours de bonne source.
Samedi le 11 avril 10 heures
J’ai fait hier le bois de Boulogne seule. La petite princesse. Le dîner chez La Redorte, un moment de la soirée à l’Ambassade d’Angleterre, et le reste chez Mad. de Castellane pour entendre chanter les Belgiojoso. A diner Thiers seul a parlé et moi un peu ; le passé; il répétait son Consulat et son Empire. Il a eu tort et j’ai eu raison sur un point de l’histoire. La guerre de la coalition était en 1798, et il la voulait en 99. Elle a fini en 99. Avant dîner il m’a dit un mot.L’exil du Prince de Cassaro, la mauvaie humeur de Lord Palmerston. Il voulait causer seul avec moi, mais cela n’a pas réussi, Mad. de Talleyrand était là. Avant dîner courte reconnaissance et froide. A diner pas un mot, elle n’a pas ouvert la bouche. Après le dîner un long aparté; après lequel ils sont revenus prendre place au milieu de nous. Et il l’appellait "ma chère amie" en lui serrant le bras en haut en bas. Enfin c’était drôle ! Ce qui était drôle aussi c’est le ton hautain et exigeant de Mad. de La Redorte avec Thiers. Tout comme ferait Barrot. "Vous n’êtes pas assez décidé, vous n’avez que nous, il faut donc franchement nous prendre. Il ne faut pas flatter l’ennemi & &." Thiers avait l’air de se défendre un peu, d’accepter un peu le patronage. On a parlé destitution et il a dit : "et bien le temps de cela viendra aussi." Elle était plus pressée. Mais enfin tout cela m’a donné l’idée que le mariage n’est pas aussi arrêté que je le croyais. On a parlé de M. Molé ; tout le monde Mad. de Talleyrand surtout, affirmait qu’il s’était mal défendu l’année dernière, j’ai seule soutenu le contraire parce que j’étais un peu indignée de cette injustice et cette bassesse Montrond m’a appuyée. Savez-vous que j’ai un parfait mépris pour Mad. de Talleyrand ? il y avait toujours mépris d’une certaine espèce, à présent il y a mépris de toute espèce. Vraiment, peut on ainsi se manquer de respect à soi même ? Il y avait à diner outre ce que je viens de nommer Médem, Pahlen, Brignole, Vandoeuvre, Rambuteau. A l’hotel de l’ambassade on a appris par moi les inquiétudes à Londres sur le vote de la Chambre, je l’ai su par un mot d’Ellice. Cela les a un peu consternés. Granville dit que M. Temple après une attitude très décidée et énergique. Il parle du Roi de Naples comme d’un fool. Il me semble d’après le dire de Thiers que cette affaire n’est pas en train de s’arranger. Nous nous sommes dit deux mots bien bas et bien intimes avant dîner que je n’ai peut être pas besoin de vous redire et que je ne veux pas écrire.
On m’a dit et de bonne source apparente que M. Molé aurait déclaré au Roi qu’il n’est pas en état de fournir un ministère et qu’il lui conseillait dès lors d’accepter la dissolution si elle lui est demandée. J’ai dit Le soir à M. Molé que j’avais ouï dire ce commérage. Il s’est récrié et m’a dit au contraire : "J’encourage perpétuellement le Roi à y résister, à toute outrance." Ce qui n’empêche pas qu’il ne me dit, un moment après : "Le Roi et moi nous n’avons pas seulement proféré le mot dissolution dans nos entretiens."
Je vous laisse à décider où est la vérité. Il y avait de la musique chez Mad. de Castellane, mais il y avait aussi du courant d’air. J’ai craint l’un plus que je n’ai aimé l’autre, et je suis partie de bonne heure. Appony venait de chez le roi qu’il avait trouvé de fort bonne humeur à sa grande surprise, quel terrain mouvant que ceci !
Voici votre N° 338. y a-t-il quelque nouveau réglement pour les drawing rooms ? Sous les autres règnes jamais les ambassadeurs ne restaient jusqu’à la fin à moins qu’ils en eussent envie. Mon mari, Estorhazy, M. de Talleyrand, tout cela partait quand bon leur semblait. Moi, je restais, parce que le roi et la reine venaient après le drawing room me dire un mot, mais j’ai seule. Les hommes diplomates n’ont jamais tenu jusqu’à la fin. Il n’y avait aucune nécessité de le faire.
Je suis bien aise de penser que vous allez vous trouver à Holland House. J’y ai souvent été. Souvent, surtout dans le jardin, mais pas seule.
Je n’ai pas encore écrit à la Duchesse de Sutherland, je ne sais trop que lui dire. La phrase de sa lettre qui me regarde ne parait pas aux autres aussi directe qu’elle vous semble à vous, et Lady Granville n’a pas eu de renseignement à ce sujet. S’il n’en vient pas décidément c’est que nous nous sommes trompés. Il faudra que je prenne d’autres mesures. C’est un peu ennuyeux parce qu’on est fort mal aux auberges à Londres. Je consulterai Ellice et il me trouvera peut être quelque chose hors de Londres du côté de Holland House. Mais il faut un établissement. Enfin je verrai. Vérity me drogue en effet et cela me déplait. Si le beau temps arrive jamais, je lui confierai le soin de ma santé et je laisserai les drogues.
Adieu. Adieu.
343. Paris, Mardi 14 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
343 Paris Mardi 14 avril 840
J’ai fait visite à Lady Granville hier matin, et une très longue promenade avec Marion. Je me suis même fatiguée, je suis rentreée pour me reposer. J’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Mad. de Boigne, Razonmowsky & Lobkowitz, quelques petits hommes et mon Ambassadeur nous sommes restés seuls après onze heures. Il est très difficile de tirer de Pahlen quelque chose, cependant cela est venu. Et bien il n’y a rien de nouveau. L’Empereur est ce qu’il était, toujours la même hostilité personnelle toujours la même passion. M. de Pahlen a toujours combattu sans gagner un pouce de terrain. Il n’est chargé d’aucune parole aimable, de rien du tout. Il a vu Thiers. Ils ont un peu causé. Il lui a dit que favoriser le Pacha, c’est affaiblir la porte & que puisqu’on veut l’intégrité de l’Empereur ottoman, puisqu’on le dit, il faut lui rendre la Syrie. The Old story again and again. Voilà tout. On pense mal de tout ceci. il est bien égal qui gouverne ici Thiers ou tout autre. Cela s’en va. Je crois que je vous ai donné l’essence. Pahlen a fort bonne mine ; il est content d’être ici et de n’être plus là. Il ne parle pas très bien de M. de Brünnow, un plat courtisan dont les longues et habiles dépêches sont lardées de flatteries pour l’Empereur. On le croit un grand homme. Sa nomination a fort mécontenté en Russie. Lady Clanricarde me le mande aussi. A propos, elle m’a écrit une lettre fort spirituelle. Je vous l’enverrai, par courrier Français car elle est volumineuse. Il n’y a rien de pressé, car il n’y a rien de nouveau, mais vous la lirez avec plaisir. Le temps est doux et charmant aujourd’hui. J’ai déjà marché. Et puis j’ai fait ma longue toilette et je ne viens à vous qu’à une heure. Aujourd’hui vous dînez chez les Berry. Je suis sûre qu’elles vous donneront lady William Russell et que sans jamaisvous plaire beaucoup elle vous paraîtra une bonne ressource de conversation. L’impératrice vient en Allemagne à Erns. La grande duchesse Hélène aussi.
Mercredi 15 avril 1 heure
J’ai fait visite à Lady Granville hier matin, et une très longue promenade avec Marion. Je me suis même fatiguée, je suis rentreée pour me reposer. J’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Mad. de Boigne, Razonmowsky & Lobkowitz, quelques petits hommes et mon Ambassadeur nous sommes restés seuls après onze heures. Il est très difficile de tirer de Pahlen quelque chose, cependant cela est venu. Et bien il n’y a rien de nouveau. L’Empereur est ce qu’il était, toujours la même hostilité personnelle toujours la même passion. M. de Pahlen a toujours combattu sans gagner un pouce de terrain. Il n’est chargé d’aucune parole aimable, de rien du tout. Il a vu Thiers. Ils ont un peu causé. Il lui a dit que favoriser le Pacha, c’est affaiblir la porte & que puisqu’on veut l’intégrité de l’Empereur ottoman, puisqu’on le dit, il faut lui rendre la Syrie. The Old story again and again. Voilà tout. On pense mal de tout ceci. il est bien égal qui gouverne ici Thiers ou tout autre. Cela s’en va. Je crois que je vous ai donné l’essence. Pahlen a fort bonne mine ; il est content d’être ici et de n’être plus là. Il ne parle pas très bien de M. de Brünnow, un plat courtisan dont les longues et habiles dépêches sont lardées de flatteries pour l’Empereur. On le croit un grand homme. Sa nomination a fort mécontenté en Russie. Lady Clanricarde me le mande aussi. A propos, elle m’a écrit une lettre fort spirituelle. Je vous l’enverrai, par courrier Français car elle est volumineuse. Il n’y a rien de pressé, car il n’y a rien de nouveau, mais vous la lirez avec plaisir. Le temps est doux et charmant aujourd’hui. J’ai déjà marché. Et puis j’ai fait ma longue toilette et je ne viens à vous qu’à une heure. Aujourd’hui vous dînez chez les Berry. Je suis sûre qu’elles vous donneront lady William Russell et que sans jamaisvous plaire beaucoup elle vous paraîtra une bonne ressource de conversation. L’impératrice vient en Allemagne à Erns. La grande duchesse Hélène aussi.
Mercredi 15 avril 1 heure
Je réponds au 341. Pardon de cette rature. Vous ne savez pas comme j’ai été tracassée de bêtises, toute la matinée. J’expie le péché d’avoir été lire votre lettre sur la terrasse des Tuileries, et d’y être restée avec vous et un charmant souffle du midi pendant une heure. Tout est retardé, renversé, & maintenant il faut que je vous écrive et vous aime vite, ce qui m’est on ne peut plus désagréable car il me semble que j’ai beaucoup à vous dire. Mais d’abord merci, merci de votre lettre, de Richmond de tout. Ah si vous saviez comme vous avez raison d’être ému en voyant Richmond. Toute ma vie jusqu’au 15 juin se résumait dans ce lieu Richmond. Car ce n’est que là, là que j’ai connu un vrai bonheur. Mon Dieu mon Dieu, que j’y ai été heureuse comme je le sentais, comme le disais, et comme en le quittant je me suis dit avec ferveur, ma vie est finie. Ah quel souvenir ! Je suis si occupée de l’idée que vous avez vu Richmond ; regardé ce que j’ai tant regardé, marché là où je goûtais tant de joies innocentes et pures, & vives et passionnées car je les aimais avec passion.
Je suis tellement occupée de cette idée que je ne vois que cela dans votre lettre par le premier moment des pars. Est-ce que rien ne m’avertissait que vous seriez à Richmond un jour ? Voilà que je bavarde et je veux parler.
Je suis tellement occupée de cette idée que je ne vois que cela dans votre lettre par le premier moment des pars. Est-ce que rien ne m’avertissait que vous seriez à Richmond un jour ? Voilà que je bavarde et je veux parler.
J’ai été voir votre mère hier. Pauline est souffrante sa mine m’a un peu alarmée, mais il est vrai qu’elle a toujours l’air délicat. On me dit qu’elle est mieux aujourd’hui. Elle m’intéressait hier beaucoup. D’abord elle vous ressemble beaucoup elle a vos yeux, elle a l’air triste de cette tristesse maladive, chère petite j’espère qu’elle va se remettre par cet air doux. Je n’aimais pas l’air de ces chambres hier, un air de cave tandis que dehors il faisait si doux et si calmant comment ne pas tenir un peu les fenêtres ouvertes ? J’aurais voulu arranger cela la placer du côté du midi les autres ont une mime excellente, votre mère aussi. Il y avait une dame et deux hommes ils avaient tous l’air bien shabby. Je ne sais pas au monde qui c’était. Ils parlaient de vous comme il convient d’en parler mais dans un langage un peu banal. Imaginez que je ne sais pas faire votre éloge ce qui s’appelle éloge, c’est trop vulgaire, mais mon silence me donne un air d’intimité ou d’hostilité comme on voudra le prendre. Je crains cependant qu’on ne s’en tienne à la première explication ; et cela m’embarrasse un peu, et cependant les paroles ne viennent pas. On ajoutait, c’est cependant un poste bien difficile. Alors j’ai dit, un peu avec l’accent que vous y auriez mis, " Mais c’est pour cela seulement qu’il l’a accepté."
Voilà qui a dû avoir l’air un peu trop ménage. Je ne sais qu’y faire. Je n’ai pas vu Mad. de Meulan, j’en suis bien aise. On dit qu’elle bavarde et pérore; et qu’elle va toujours à Londres. N’a-t-elle donc pas compris ? J’ai été seule au bois de Boulogne mais bien longtemps ; j’ai dîné seule. Le soir Granville, Brignole, Miraflores, Capellen, Armin, Médem, Pahlen junior. le Senior faisait des visite, lady Landwich, le Prince de Chalais. On parlait beaucoup de la séance à la Chambre des pairs. Granville y avait été. Mais j’en ai une meilleure idée après avoir parcouru ce matin les journaux. Savez-vous que M. de Broglie n’a pas lieu d’être tout-à-fait content. M. Thiers ne regarde comme exactes que les paroles qu’il dit lui même. Est ce que cela veut dir que M. de Broglie a menti ? Je serai curieuse d’appendre ce qui l’en pense. On disait généralement que M. de Villemain avait été de mauvais goût dans son attaque contre Thiers. Thiers me parait avoir parlé très habilement.
Génie est venu me trouver ce matin, il dit que les médecins ne sont pas d’opinion que votre mère puisse passer la mer. Vous le dit-on ? Je suis très préoccupée de cela maintenant. Je voudrais que vous eussiez plein contentement dans les projets que vous me dites à cet égard. Génie ne le croit guère. Je passerai à votre porte pour savoir moi-même des nouvelles de Pauline. Ai-je quelque chose à vous dire encore ? Je n’en sais rien. Je suis pressée. Mad. Appony s’annonce et je veux avoir fermé ceci. Je savais bien que Holland House vous plairait, et bien voilà ce caractère qu’ont tous les chateaux anglais, en y ajoutant une même magnificence, qui elle aussi atteste la durée. Tout y est vieux respectable respecté et puis le luxe, le soin, le confort par dessus le marché. Ces Anglais sont trop heureux ! Il n’y a pas de grandes existences à côté de celles-là. Adieu, je vais écrire à la Duchesse de Sutherland, ils m’attendent chez eux. Mais il faut qu’ils sachent que je ne puis pas monter d’escaliers, et je ne sais pas s’ils ont encore à me donner un appartement au rez de chaussée ; car coucher au second, j’aime mieux coucher dans la rue. Pardon de cet horrible griffonnage ; ma main tremble, je crois que ce changement de temps subit m’agace les nerfs.
Adieu, adieu, à demain.
345. Paris, Jeudi 16 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
345 Paris jeudi 16 avril 1840,
6 heures
J’ai été chez votre mère. J’ai vu Henriette. Elle a le visage bouffi, mais votre mère dit que c’est tout bonnement ses joues, et qu’elle est engraissée. La crainte de la rougeole se dissipe On ne croit pas qu’elle l’aie. Pauline était dans son lit. Je ne l’ai point vue. Guillaume se porte bien votre mère n’a pas l’air inquiet du tout, mais l’idée de votre inquiétude la préoccupe. Voilà exactement ce que j’ai trouvé dans votre maison et dont je vous rend un comple fidèle. J’ai vu Granville. Il a l’air d’être dans la confidence du délai de la reception de Pahlen. Le Serra Capriola attend aussi, parce que lui aussi n’était pas pressé d’arriver.
Vendredi 17, 8 heures
J’ai dîné seule. Je me suis fait trainer en calèche après le dîner. Le soir j’ai vu Appony, Armin, l’internonce. Pahlen était venu deux fois dans la matinée ; je l’ai manqué. Et le soir il court les petits spectacles pour commencer peut être aussi n’aime-t-il pas rencontrer des questioneurs avant d’avoir été au château. Je crois que la semaine se passera sans audience. Appony n’a encore rien eu de sa cour sur l’affaire de Naples, mais on dit qu’il y a grande rumeur à Vienne sur ce sujet. Vous saurez cela mieux sans doute.
10 heures
Je viens de parcourir le journaux. Ils disent que M. de Pahlen a eu son audience, par conséquent les Ambassadeurs et moi nous étions mal informés J’ai envoyé à la rue de la Ville l’Evêque. Henriette n’a pas de rougeole, et Pauline a assez bien passé la nuit. Voilà le bulletin. J’ai eu hier une très longue lettre de lady Palmerston. Elle me dit que vous allez demain à Holland House pour deux jours. J’en suis bien aise. Cela vous fera plaisir. Elle parle extremement bien de vous, décidément vous lui plaisez beaucoup. Lord Grey m’écrit avec aigreur sur toute chose et tout le monde. A propos, il me dit qu’Ellice est très peu bienveillant pour les Ministres Je vais voir cela tout à l’heure, il arrive aujourd’hui. Lord Grey me dit qu’il n’a fait que vous entrevoir, qu’il n’a pas d’occasion de causer avec vous. J’en suis fâchée. Je voudrais qu’il vous entendit. Est-ce que vous ne vous êtes point fait visite? Il serait convenable de demander à aller voir lady Grey c’est une très respectable personne. Je vous envoie cette pauvre lettre, elle vous trouvera au milieu de cette belle verdure de Holland House. Il n’y a pas d’arbre que je ne connaisse. J’y venais souvent souvent le matin, lorsque les Holland étaient absents. J’y restais des heures entières. J’écris aujourd’hui à la duchesse de Sutherland ; je parle du mois de Juin sans préciser le moment, car eux-même seront absents la première quinzaine et ne pourraient pas me recevoir alors. J’explique un peu mes jambes. Coucher au second est absolument impossible, il y a 90 marches. S’ils ont encore à me donner l’appartement du rez de chaussée, je serai fort contente d’être chez eux. J’apprends que Paul part à la fin de ce mois-ci pour la Russie. Il n’est donc pas vraisemblable que son frère le voie avant, ce qui pourrait fort bien faire qu’Alexandre ne vint pas du tout ici. Encore ce mécompte.
Je viens de parcourir le journaux. Ils disent que M. de Pahlen a eu son audience, par conséquent les Ambassadeurs et moi nous étions mal informés J’ai envoyé à la rue de la Ville l’Evêque. Henriette n’a pas de rougeole, et Pauline a assez bien passé la nuit. Voilà le bulletin. J’ai eu hier une très longue lettre de lady Palmerston. Elle me dit que vous allez demain à Holland House pour deux jours. J’en suis bien aise. Cela vous fera plaisir. Elle parle extremement bien de vous, décidément vous lui plaisez beaucoup. Lord Grey m’écrit avec aigreur sur toute chose et tout le monde. A propos, il me dit qu’Ellice est très peu bienveillant pour les Ministres Je vais voir cela tout à l’heure, il arrive aujourd’hui. Lord Grey me dit qu’il n’a fait que vous entrevoir, qu’il n’a pas d’occasion de causer avec vous. J’en suis fâchée. Je voudrais qu’il vous entendit. Est-ce que vous ne vous êtes point fait visite? Il serait convenable de demander à aller voir lady Grey c’est une très respectable personne. Je vous envoie cette pauvre lettre, elle vous trouvera au milieu de cette belle verdure de Holland House. Il n’y a pas d’arbre que je ne connaisse. J’y venais souvent souvent le matin, lorsque les Holland étaient absents. J’y restais des heures entières. J’écris aujourd’hui à la duchesse de Sutherland ; je parle du mois de Juin sans préciser le moment, car eux-même seront absents la première quinzaine et ne pourraient pas me recevoir alors. J’explique un peu mes jambes. Coucher au second est absolument impossible, il y a 90 marches. S’ils ont encore à me donner l’appartement du rez de chaussée, je serai fort contente d’être chez eux. J’apprends que Paul part à la fin de ce mois-ci pour la Russie. Il n’est donc pas vraisemblable que son frère le voie avant, ce qui pourrait fort bien faire qu’Alexandre ne vint pas du tout ici. Encore ce mécompte.
Je n’ai point de lettres de vous depuis avant-hier, et voici 1 heure. Il n’est pas vraisemblable qu’elle vienne, j’en suis fâchée. Adieu. Monsieur, adieu.
345. Londres, Samedi 18 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
345. Londres, Samedi 18 avril 1840
Je viens de réussir dans une petite négociation qui a quelque valeur en elle-même et quelque importance pour moi. A la première nouvelle des vivacités de l’Angleterre à Naples, en causant avec Lord Palmerston et le voyant un peu préoccupé des conséquences possibles, une insurrection en Sicile, des embarras en Italie et, je dis quelques paroles des bons offices de la France et du parti que l’Angleterre en pourrait tirer. Elles furent bien accueillies. Elles le furent très bien à Paris. J’ai mené l’affaire vivement, et un courrier vient de partir hier soir pour Lord Granville qui acceptera la médiation de la France entre l’Angleterre, et Naples chargera la France de négocier au nom de l’Angleterre et lui donnera le pouvoir de suspendre les hostilités contre le pavillon Napolitain. Cela sera bon dans le cas particulier et d’un bon effet général. On verra que la France et l’Angleterre ne sont pas si près de se brouiller, ni si dénuées de confiance l’une dans l’autre. Lord Granville vous aura peut-être déjà parlé de ceci quand ma lettre vous arrivera. Ayez soin seulement de n’en pas parler la première. Du reste, je suppose que l’affaire une fois conclue, on n’aura rien de plus pressé que d’en parler. Je crois avoir bien saisi et bien poussé l’à propos.
3 heures
4 heures 3/4
8 heures et demie
Je viens de réussir dans une petite négociation qui a quelque valeur en elle-même et quelque importance pour moi. A la première nouvelle des vivacités de l’Angleterre à Naples, en causant avec Lord Palmerston et le voyant un peu préoccupé des conséquences possibles, une insurrection en Sicile, des embarras en Italie et, je dis quelques paroles des bons offices de la France et du parti que l’Angleterre en pourrait tirer. Elles furent bien accueillies. Elles le furent très bien à Paris. J’ai mené l’affaire vivement, et un courrier vient de partir hier soir pour Lord Granville qui acceptera la médiation de la France entre l’Angleterre, et Naples chargera la France de négocier au nom de l’Angleterre et lui donnera le pouvoir de suspendre les hostilités contre le pavillon Napolitain. Cela sera bon dans le cas particulier et d’un bon effet général. On verra que la France et l’Angleterre ne sont pas si près de se brouiller, ni si dénuées de confiance l’une dans l’autre. Lord Granville vous aura peut-être déjà parlé de ceci quand ma lettre vous arrivera. Ayez soin seulement de n’en pas parler la première. Du reste, je suppose que l’affaire une fois conclue, on n’aura rien de plus pressé que d’en parler. Je crois avoir bien saisi et bien poussé l’à propos.
J’ai eu hier un pauvre sermon d’une insignifiance et d’une séchéresse rare, commune ici, me dit-on. Mais la foi, et la componction des assistants supplient le talent du prédicateur. J’ai été édifié du recueillement et de l’air convaincu, pénétré, de tout le monde. J’étais à St George hanover-square, la paroisse fashionable. Lady Palmerston s’est mariée là ! Je suis revenu à pied, par un beau temps, mais un vent de Nord-Est fort et froid. Je suis allé faire quelques visites, c’est-à-dire des cartes. Dans la cité pour la première fois, à la Deanery de St Paul, pour l’Evêque de Landaff. J’ai été frappé de l’aspect vraiment monumental de Temple Bar. Lord Wiltoughby, Lord Hermiker, Lord Nugent, le comte de Lovelace (qui a épousé la fille de Lord Byron, jolie et aimable) Lady Willians Pawlett et la comtesse douaierière de Charleville. Voilà, je crois, un compte-rendu bien complet, jusqu’à mes visites.
Le soir, à Holland-House où j’ai trouvé Lord Palmerston qui m’a dit que son courrier venait de partir. Lady Holland me soigne extrêmement. Elle m’a envoyé hier un ouvrage, qu’on dit curieux, sur les principaux procès criminels de l’Angleterre. Je lui envoie ce matin mon maître d’hôtel pour prendre la mesure de papiers de lampe dont elle a besoin et que je lui ferais venir. Palmerston, Hobhouse, Dedel, Neumann, Bülow, Rogers, voilà Holland House hier au soir. On cherchait un vers qui contenait un mot singulier et qui devait être, selon les uns dans Milton, selon les autres dans Shakespeare. On ne l’a pas trouvé.
3 heures
Ces menaces de rougeole me préoccupent extrêmement, et je n’en sais que ce que vous m’en dites. Je n’ai rien de ma mère ce matin, à mon vif chagrin. Elle aura envoyé sa lettre aux Affaires étrangères, pour le courrier de jeudi qui n’est pas parti, sans doute à cause du débat de la Chambre des Pairs. Je n’aurai donc rien que demain, entre midi et 2 heures. Quelle fièvre que la vie ! Je le repète sans cesse parce que je l’éprouve sans cesse. Je suis depuis deux mois dans une grande activité d’esprit, de cœur, de corps. Je n’en suis pas fatigué ; mais j’aurais besoin qu’aucune fatigue extraordinaire, aucune préoccupation extraordinaire, aucun accident, aucune épreuve ne vînt ajouter son fardeau à mon travail, son agitation à mon activité.
Je n’ai jamais senti les contrariétés, les inquiétudes plus vivement que depuis deux mois. Pendant que je lis, que j’écris, quelque idée poignante, quelque crainte horrible me vient tout à coup. Je me lève. Je fais quelques pas dans ma chambre. Je joins les mains devant Dieu ; je le prie, je le conjure deux secondes, qui me semblent des heures. Je me remets à travailler. Et je recommence dix fois. Ah, si Dieu veut encore faire quelque chose de moi, si je lui suis encore bon à quelque chose en ce monde, qu’il protège ce que jaime vous, mes enfants, ma mère. J’ai usé beaucoup de force à supporter. Il m’en reste bien peu.
Alexandre passera-t-il un peu de temps avec vous ? Vient-il prendre son frère ici pour aller en Russie ou se sont-ils donné rendez-vous quelque part ? Je n’ai entendu parler de Paul qu’une fois, Bourqueney, peu avant de partir, a dîné avec lui chez le baron de Munchausen.
On ne m’a pas encore envoyé le grand Cordon. Ce sera probablement à la fête du Roi, le 1er mai. C’est l’époque.
4 heures 3/4
J’ai été dérangé par Neumann et Bülow, de la pure conversation. La semaine prochaine sera stagnante. Tout le monde va à la campagne.
Adieu, adieu.
346. Paris, Samedi 18 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
346 Paris, samedi le 18 avril 1840,
10 heures
Votre n° 342 ne m’est arrivé qu’à 6 heures. Vous me grondez et vous m’aimez et vous avez raison de ces deux façons. J’enverrai chercher Andral d’ici à deux jours si je ne suis pas mieux. Je vous écrirai tous les jours. Voilà quatre pages répondues. Quatre pages charmantes car il y a bien de l’...., de ce qu’il avait dans des vers qui me sont arrivés à Stafford House il y a tout-à-l’heure 3 ans. Vous avez raison dans les premières pages de votre lettre aussi, article prudence, tout-à-fait raison. Quant aux places à dîner, c’est ennuyeux mais vous êtes obligé de prendre le Chancelier à votre droite et lord Lansdowne à votre gauche. Vous pririez lord Palmerston de se placer vis-à-vis de vous entre le duc de Willingtom et lord Melbourne. Voilà ce qui me semble la règle, mais laissez-moi, encore y penser. D’où vien que vous avez prié le Duc de Wellington ?
Ce devaient être des ducs whigs, Sutherland, Somerset && selon votre premier plan. Mais au fait vous n’avez pas tort ; seulement je ne sais si les ministres trouveront que vous avez raison. On me fait dire de chez vous que Pauline a passé une mauvaise nuit, et qu’Henriette est très bien. Vos enfants sont ma première pensée le matin. Pauline est si délicate qu’elle m’inquiète.
J’ai essayé hier matin de faire un tour en calèche avec le Duc de Noailles qui était venu chez moi mais il n’y a pas eu moyen de gagner Passy, et toutes les avenues étant fermées, nous sommes rentrés. Ces fêtes de Longchamps sont mon désespoir. Le duc de Noailles est content que la Chamtre des pairs aussi ait eu ses trois journées. Il a trouvé la discussion animée, élevée, très spirituelle. Et le débat tout entier contre les Ministres, en exceptant toujours Thiers qui a été comme de coutume et plus que de coutume même d’une dextérité extraordinaire.Tout le monde est d’avis de l’importance de cette discussion. Aux yeux de mon rapporteur, la gauche gagne du terrain, du moins montre-t-elle une patience et une sécurité très suspectes, parce qu’il est impossible qu’elle n’ait pas pleine certitude en se posant ainsi. La Chambre des Pairs s’est montré aussi Egyptienne que la Chambre des Députés. Thiers n’avait pas l’air content de ces trois jours. J’ai rencontré hier M. Molé chez la petite Princesse. Il est d’une amertume pour Thiers, et pour M. de Broglie surtout, qui est inconvenable comme mauvais goût. Je lui ai demandé pourquoi lui seul s’était tu. "Parce que je ne voulais parler que pour me défendre, et que personne ne m’a attaqué." Il dit que la discussion des pairs a été très supérieure comme talent à celle des députés. Montrond est venu me voir hier matin. Il est amusant mais il ne m’apprend rien de nouveau. Le Roi est content, il dit : "Thiers danse sur la corde, je veux bien lui servir de balerine. Nous sommes parfaitement d’accord sur les questions extérieures & &."
J’ai fait dîner Teham hier avec moi, pour me passer le temps. Il a des good sense and good manners, voilà tout à peu près. Le soir quelques ennuyeux, et un long tête-à-tête tard avec mon Ambassadeur. Je l’ai fait beaucoup parler, mais je n’ai appris que ce que je savais par instinct. L’Empereur ne voulait pas qu’il rétournat à Paris ? Nesselrode pressait son départ, la lutte a été vive. Une lettre que j’ai écrite le 14 février et qui a été lue pas l’Empereur a fait passablement d’effet. On a décidé son départ. Tous les entours pensent et parlent de même sur les relations avec la France. L’Empereur est seul de son opinion, et y restera. Mais vous voyez cependant qu’il n’est pas absolu quand le moment d’un éclat arrive. Il ne le risque pas sa santé un peu chanceuse. Menaces d’apoplexie. Tenez bien secret tout ce que je vous dis là.
Il courra un peu dans son empire pendant l’été ; vers l’automne, il viendra en Allemagne. Nesselrode très poltron, très effacé. Il s’abrite quelques fois derrière Orloff ; mais voilà celui-ci absent ; il accompagne le grand Duc. On ne parle pas de moi, mais ou est très mécontent de la conduite de mes fils envers moi, et Paul n’est plus au service par cette raison. Les femmes tendres pour moi, au reste vraiment faire parler Pahlen est une si rude besogne, que j’en suis fatiguée et je n’y reviendrai plus. Il a de petites idées avec de très bonnes intentions. Si on me chargeait de le gouverner je n’accepterais pas, c’est trop d’ouvrage, trop de peine à prendre pour des niaiseries. Voilà qu’il invente de ne faire la connaissance d’aucun nouveau ministre. Pourquoi ne viennent-ils pas lui faire visite ? Ils ne connait et ne connaîtra que les affaires étrangères. Je lui dis - Mais vous arrivez, il faut porter vos cartes.
- Pas du tout, ils entrent et doivent la première visite à un Ambassadeur."
Je le laisse, cela m’est égal. Il a rencontré M. de Rémusat chez sa nièce, cette folle. Ils ne se sont pas regardés. Au fond il aime passionément Molé et n’aime que cela.
Surement il faut un speech Lundi au Mansion House. Mais le ferez-vous en anglais ou en francais ? Votre accent anglais est positivement mauvais, et cependant les convives ne comprendraient guère le français. Le 2 mai à l’Académie de peinture est le dîner le plus aristocratique du monde. Vous y veriez tous les grands seigneurs de l’Angleterre. C’est très digne. Là j’avoue que je conseille le speech en Français. Vous saurez au reste que jamais mon mari n’a dit un mot. Il remerciait simplement au nom du corps diplomatique. Il y a eu de son temps une querelle d’étiquette pour ce diner qui a failli en bannir le corps diplomatique. J’accepte de grand coeur l’arrangement pour la correspondance. Vous aurez remarqué hier le monsieur pour la lettre directe vous ferez de même.
On trouvé assez généralement, et moi surtout je le trouve que M. de Broglie aurait du reprendre M. Thiers, dans ce que son discours a offert de dissemblance avec le rapport de la commission. Au reste la phrase principale : "Je n’accepte ma pensée qu’exprimée par moi même." a été retranchée au Moniteur. Sans cela, le Duc de Noailles, allait la relever. Adieu, adieu. A demain.
Le peu de mots que vous me dite sur Pauline me prouvent que vous êtes triste. Je voudrais bien y aller moi même tous les jours, j’ai peur de ce que votre grosse dame en dirait. J’y passe cependant toujours encore dans l’après-midi afin d’en savoir des nouvelles deux fois le jour. Mais je n’ose pas entrer. Adieu, adieu.
A propos, le Duc de Noailles, me prie de vous dire qu’il espère vous avoir servi et que vous le trouvez. J’oubliai Ellice. Il est venu me voir hier, bien rempli de Londres, de vous. Impatient d’aller regarder Thiers, de donner des avis. Je suis charmé qu’il soit ici pour un peu de temps.
346. Londres, Dimanche 19 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
346. Londres, Dimanche 19 avril 1840
4 heures
Je viens de recevoir mon courrier des Affaires étrangères qui aurait dû m’arriver hier et qui m’apporte des nouvelles de ma mère.
Je suis tranquille sur Henriette, et à peu près sur Pauline, quoiqu’elle soit encore souffrante. Ils vont prendre tous trois le lait d’ânesse. Mais quelle horreur que l’absence ! C’est une découverte de tous les jours. Et je la ferai pendant bien des jours, car certainement si la santé de Pauline, n’est pas très raffermie, si celle de ma mère ne me donne pas pleine sécurité, je ne les ferai pas venir. J’aime mille fois mieux avoir à trembler de loin sur toutes les mauvaises chances naturelles qu’en ajouter une de mon fait. Si je ne les fais pas venir, je m’arrangerai pour quitter l’Angleterre quinze jours plutôt vers le milieu de septembre et pour aller les retrouver à la campagne où je les établirai pendant l’été. Car vous ne resterez pas en Angleterre au-delà du milieu de septembre, n’est-ce pas ? Peut-être pas jusque là.
Mon dîner d’hier chez M. Macaulay a été peu intéressant, quoique composé de gens d’esprit, Lord Jeffrey, M. Elphinstone M. et M. Trevelyan etc, savez-vous que les Anglais ont prodigieusement de vanité et de la plus petite. Elle est moins expansive, moins complaisante, et confiante que la vanité française, mais tout aussi ardente et plus raide, plus pedante. J’en vois une foule qui sont extremement préoccupés de l’effet qu’ils font, et très fâchés quand ils n’en font pas, et très soigneux de laisser, de faire percer leurs moindres avantages. Ce qui est vrai, c’est que les hommes sérieux et simples le sont complétement, parfaitement et qu’il y en a beaucoup. Grand pays, ou la petitesse abonde à côté de la grandeur.
De chez M. Macaulay, chez les Berry, où je n’avais pu aller dîner, mardi dernier. Elles avaient un peu de musique, la fille d’un M. Hamilton qui a été ministre à Naples, fort agréable personne, qui chante assez bien, les airs italiens et les romances écossaises, avec un air de passion ossianique et malheureuse qui ne s’adresse à aucun objet particulier et semble une invitation plutôt qu’un regret.
J’étais dans mon lit à minuit, pressé de me coucher, pressé de m’endormir pour attendre avec moins d’impatience les nouvelles de mes enfants. Je me suis reveillé bien des fois. Pourtant j’ai dormi, et l’arrivée de mon courrier m’a tranquillisé. J’aurai d’autres nouvelles, entre midi et 2 heures et de vous aussi, j’espère.
4 heures
Je les ai eues mes nouvelles ; je les ai eues toutes. Mais pourquoi n’aviez-vous pas ma lettre vendredi à 1 heure ?Elle est partie mercredi bien régulièrement et bien pleine de vous car j’avais le cœur plus que plein en vous écrivant. Je me rappelle très bien cette lettre là. Vous l’aurez eue dans la journée.
Pauline continue à aller mieux. Mais je suis décidé. Je viens de recevoir une longue longue lettre de mon petit médecin qui n’est pas du tout d’avis du voyage, ni pour ma mère, ni pour Pauline, ni pour Guillaume. Il dit que pour Henriette seule, cela n’aurait aucun inconvénient. Il en a délibéré avec Andral qui est du même avis. Je n’hésite pas. Je n’en écrirai pas tout de suite à ma mère. Je veux la laisser sortir un peu de la petite sécousse qu’elle vient d’avoir et de l’effroi que lui cause sa responsabilité en mon absence. N’en parlez donc encore à personne du tout. Mais dans une quinzaine de jours, j’écrirai à ma mère ma résolution. Je les enverrai au Val-Richer vers le milieu de Mai. Je suis à peu près sûr que malgré son désir de me revoir, malgré le fardeau de la responsabilité ma mère se sentira soulagée. J’ai quelque fois entrevu que ce voyage l’inquiétait un peu, pour mes enfants, pour elle-même. Elle est d’un courage et d’un devouement sans limites. Elle risquerait ce qui lui reste de vie pour mon bonheur de quelques jours. Mais elle sait de quelle importance sont pour moi sa vie et sa santé. Elle aime ses habitudes, le Val-Richer. A tout prendre elle se consolera, et surtout elle se rassurera, ce qui m’importe beaucoup, car mon petit médecin m’écrit que son imagination est un peu ébranlée et fatiguée. Je vous aurai cet été. Je n’aurai que vous. Mais je vous aurai. Commencez-vous à savoir tout ce que vous êtes pour moi ? Et à ce propos, expliquez-moi une phrase de votre lettre. Vous parlez, dites-vous, à la duchesse de Sutherland du mois de Juin "sans préciser le moment car eux-mêmes seront absents la première quinzaine, et ne pourraient vous recevoir alors." Ce n’est pas à dire, je pense, que vous ne viendrez pas le 1er juin. Vous pourrez bien sans trop d’ennui, passer quinze jours à Miwarts Hôtel ou ailleurs, en attendant que les Sutherland soient chez eux. Et si vous retardiez, vous tomberiez, ou bien près, dans l’arrivée de votre nièce. Précisez-moi cela je vous prie.
Lundi, 8 heures et demie
Je n’ai pas pu aller passer deux jours à Holland house, comme on m’y avait engagé. J’ai chez moi, pour quelques jours, M. Lenormant que je ne veux pas abandonner si complètement. Mais j’y ai été dîner et je suis parti de bonne heure, pour avoir le temps de me promener. J’ai passé une heure seul, dans le parc. C’est ravissant. Quels beaux cèdres ! Il n’y en a pas plus sur le mont Liban, ni de plus beaux. Les arbres surtout m’ont frappé, car le paysage n’a rien de remarquable. Le diner matériellement excellent, moralement médiocre. Le personnage nouveau pour moi a été M. Duncombe, le radical à la mode. Montrond m’en avait parlé comme d’un ami particulier. Il m’a demandé si Montrond was still alive. Lord et Lady Palmerston devaient venir. Lady Palmerston est venue seule comme nous étions déjà à table. Lui est venu le soir. L’une et l’autre avaient l’air préoccupé, même triste. Je ne crois pas Lord Palmerson content de sa situation. On crie beaucoup, dans son propre parti. La Chine, l’Orient, Naples, les Etats-Unis, c’est bien des querelles et qui coûteront cher. Le déficit de la poste est grand ; il faut de nouvelles taxes. Je ne crois à aucun ébranlement réel, ni du Cabinet, ni de Lord Palmerston. Mais c’est un moment difficile et qui exige, si je ne me trompe, qu’on mette de l’eau dans son vin. Une bonne conversation après dîner, sur toutes choses. M. de Bülow a décidément plus d’esprit que toujours à faire,
tous ses collègues.
Aujourd’hui, le dîner du Lord Maire. Puis, je me réposerai. Lord et Lady Palmerston partent mardi pour Broadlands. Brünnnow et Neumann vont aujourd’hui chez le Duc de Wellington. Ils continuent à lui parler des affaires. La dispersion est générale.
Une heure
La mauvaise nuit de Pauline me tourmente. Être tourmenté et ne rien faire ne pas voir seulement ! Mon petit médecin me donne beaucoup de détails très fidèlement, j’en suis sûr. Il n’est pas inquiet. Il est bien heureux. Vous me direz si ma mère vous fait l’impression d’une personne agitée et fatiguée. Je crains toujours qu’elle n’aille jusqu’au bout de sa force. J’ai confiance dans le lait d’anesse. Il a toujours très bien réussi à mes enfants. Ils ont dû le commencer hier.
N’ayez donc pas peur de Mad. de Meulan. M. Molé a raison, c’est-à-dire qu’il a bien des raisons d’avoir de l’humeur. Il est bien bon de trouver qu’il n’a pas été attaqué. Sauf Tiers, qui s’est bien défendu, il n’y a eu d’attaqué que M. Molé qui ne s’est pas défendu et n’a été défendu par personne. Le Duc de Broglie l’a attaqué. Villemain l’a renié. Ces débats là ne lui valent rien. Je ne crois pas qu’ils vaillent grand chose non plus pour le Cabinet. Cependant on gagne toujours à faire preuve de talent et d’habilité à prouver qu’on vaut mieux que sa position. Il me semble que c’est le cas de Thiers.
M. de Noailles me sert en effet. J’ai bien lu son discours et j’en parle beaucoup et bien. Je n’ai jamais vu M. de Noailles, sans avoir envie que nous fussions du même avis. Je parlerai Anglais au Mansion house, en demandant pardon de mon mauvais langage. Cela a meilleure grace que de bien parler pour n’être pas compris. A l’académie royale, c’est autre chose ; du bon français. Je sais que c’est un dîner très aristocratique.
Le Chancelier ne vient pas diner le 1er mai à cause de la chambre, comme le speaker. Je prendrai donc à côté de moi Lord Lansdowne et Lord Melbourne. En face de moi, Lord Palmerston qui aura à côté de lui le duc de Wellington et je ne sais qui Lord Normanby, ou Lord Minto ou Lord Clarendon, ou Lord Holland ? Pensez y encore, je vous prie.
Si je mettais Lord Lansdowne en face de moi, avec Lord Palmerston et un autre ministre à ses côtés ; et moi Lord Melbourne à droite, le Duc de Wellington à gauche ?
Adieu. Je vous ferai quelque fois porter ma lettre par mon petit médecin, M. Béhier, très intelligent très sûr et parfaitement dévoué. Adieu. Adieu. Priez pour ma petite fille.
348. Paris, Lundi 20 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
348. Paris Lundi 20 avril 1840, 10 heures
Après ma promenade au bois avec Marion, j’ai eu une longue visite de mon ambassadeur. Il est très confiant, et peut être même un peu plus defférent que jadis. A propos Je modifie l’article duc de Bordeaux en ceci : qu’on essaye de le dissuader de venir en russie. Mais cette confidence directe a flatté, et a fait dire que c’était la premiere parole agréable qui ait été reçe ici de la part de l’Empereur.
Les Ambassadeurs donnent raison au mien au sujet des visites de ministres. Ils lui doivent les avances ; aucun n’est venu. Cela le dispense de faire leur connaissance. Il me parle beaucoup de Brünnow, et voudrait bien que j’ecrivisse à mon frère à son sujet, c’est-à-dire pour montrer l’inconvenance de ce choix. Je lui dit que je ne m’en mélerais pas d’ici, mais qu’une fois à Londres, je dirai peut être ce que j’en pense après avoir vu. J’ai dîné hier chez les Appony. On m’a fait entendre M. Liszt pianiste d’une grande célébrité. C’est un possédé, un enragé, faisant des merveilles, à me faire fuir. De là, un moment chez les Granville et puis chez Brignoles. Il me semble que Naples va mal. Votre médiation y fera-t-elle quelque chose ? Il y avait beaucoup de monde en Sardaigne, mais rien qui
vaille la peine de vous être redit. J’ai reçu à mon reveil une lettre d’Alexandre de Marseille. Il sera ici demain, je crois. Je m’en réjouis bien, mais j’imagine qu’il ne fera que passer pour aller trouver son frère reviendra-t-il après l’avoir vu ?Voilà ce que j’ignore.
Midi
Je viens de recevoir votre lettre. Je suis charmée de vos succès. Lord Granville m’avait dit un mot hier, mais qui ne me paraissait pas aussi catégorique. Vos inquiétudes me chagrinent extrèmement, mais vous aurez été rassuré. D’abord pas de rougeole et puis Pauline va mieux. Le lait d’ânesse, administré à tout le monde fait du bien à tous. J’ai des nouvelles tous les matins. Je crois que j’enverrai chercher M. Andral ; je ferai demander chez vous où il demeure; le vent d’est persévère, mais cependant je ne puis pas être malade seulement du vent.
Adieu ; je vous envoie la lettre de Lady Clanricarde par votre foreign office, mais je fais bien je crois de vous envoyer ceci par notre voie ordinaire.
Adieu, adieu, tranquilisez vous et soignez vous. Adieu.
349. Paris, Mardi 21 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
349. Paris, Mardi le 2l avril 1840
9 heures
Je commence par vous donner des nouvelles de Pauline. Je l’ai vue hier. Sa mine est très différente de celle de l’autre jour. elle a l’air animé. Le teint, les yeux, tout est mieux elle cause gaiement. Les autres étaient allés se promener ainsi tranquilisez vous tout-à-fait. J’ai fait un peu de bois de Boulogne seule, une visite à la petite princesse, mon diner solitaire, la soirée chez Lady Granville. J’avais dû y diner mais tout-à-coup cela m’a ennuyé et je n’y suis venu qu’après. Il y avait la diplomatie et l’Angleterre car il y a beaucoup d’Anglais ici dans ce moment. Je ne sais si on sait votre médiation on ne m’en a pas parlé, et je me suis tue. J’ai reçu hier une lettre de mon banquier à Pétersbourg. Mon frère se refuse tout-à-fait à se mêler de la vente de la vaisselle ; cela lui déplait, et il veut que Bruxner ait mes pleins pouvoirs et non pas lui. voilà qui va faire encore un très long delai, d’autant plus que la saison n’est plus favorable à des ventes. Les autres effets ont été vendus, c’est peu de chose, il m’en revient 6000 francs. Je vous dis toutes mes affaires.
10 h 1/2
Je rentre des Tuilleries. Il fait froid mais beau. Cependant ce temps sec m’est odieux, je ne respire pas à l’aise ; la pluie me ferait tant de bien. Je viens de lire les journaux, la
médiation y est.
J’ai prié Madame votre mère de m’envoyer M. Andral. Elle l’attendait hier soir. Rothschild est venu m’interrompre. Il me donne de très bonnes nouvelles sur votre compte.
Mercredi le 22 9 heures
Mon mot d’hier écrit à toutes les heures, a été interrompu par l’arrivée de mon fils. Appony l’avait précédé. Tout cela ensemble a fait qu’il était trop trod pour espérer gagner la poste. Vous n’aurez donc pas de lettres demain ; mais au fond cest juste mon mardi sera votre jeudi. Le mardi est un bien vilain jour. (interruption, mon fils)
10 heures, Voici votre lettre ; dieu merci vous êtes rassuré pour Pauline et vous avez tout lieu de l’être. Je ne trouve aucun changement dans votre mère. Elle est tout-à-fait comme je l’ai vue à mes autres visites. Et point inquiète. seulement préoccupée de votre inquiétude. Je ne suis point d’avis que vous la laissiez quinze jours, sans lui dire votre résolution. Le vague est toujours ce qui tourmente le plus, ainsi l’idée du voyage, de la traversée, d’un nouveau lieu à habiter tout cela doit lui tourmenter l’esprit. Quand vous lui aurez dit le Val Richer, je suis sûre qu’elle en sera plus tranquille du moins je serais comme cela à sa place, et puis dites lui que vous viendrez la voir en été ; trompez la un peu, ici c’est nécessaire, cela lui ferait peut être du bien.
Décidement vous aurez Lord Palmerston à dîner vis-à-vis de vous. N’étant pas à côté le vis-à-vis est la premiere place, et elle lui revient. Dans vos convives, voici la hiérarchie. Le Président du conseil. Le Pristy seal (Clarendon). Le duc de Wellington, le marquise de Normanby, Lord Minto, &. Mais Melbourne comme premier ministre doit absolument être auprès de vous. Lui et Landsdowne à vos côtés. Wellington et Clarendon auprès de
Palmerston. Soyez sûr que j’ai raison, et ce conseil est moi et Granville ensemble. J’ai dîné avec mon fils. Le soir j’ai vu Granville, mon ambassadeur, le Duc de Noailles, Ellice, Capellen, les Durazzo. Granville avait été un peu blessé des termes dans lesquels le Constitutionnel avait annoncé la médiation. Il a fait modifier dans le Moniteur parisien. Le duc de Noailles regarde cette affaire comme un grand succès pour vous et une très bonne affaire pour le ministère. Il dit c’est heureux et habile.
1 heure
Je ne puis pas être à Londres dans une auberge d’abord et puis chez les Sutherland. Il faut tout-à-fait l’un ou tout-à-fait l’autre. Autrement, cela n’aurait pas de sens, et je touve l’un beaucoup plus convenable que l’autre. Je suis sûre que je vous en ferais convenir si je vous parlais. Ils ne seront à Londres qu’après les vacances de la Pentecôte. Je pourrais bien me trouver dans les environs de Londres avant, et j’y ai pensé déjà. Je vous prie d’y penser aussi. Il me semble que Norwood est ce qu’il y a de plus près, ou bien Hamstead, si depuis mon temps il y a quelque bonne auberge établie là. Informez-vous en. J’y passerais quelques jours. Vous m’y viendriez voir, mais on ne saura que j’y suis que lorsque je le voudrai. Norwood est au midi de Londres en passant Westminster bridge. Hampstead au nord par le Regents park. Ceci vaudrait mieux peut-être, c’est plus près de chez vous. Il y a de mauvaises nouvelles de Bruxelles à ce qu’on disait hier au soir. La Reine était menacée d’une couche prématurée. Ceci pourrait faire des delais dans la noce. On parle beaucoup d’un sermon à St Roch. L’abbé Cœur a fait un discours superbe sur l’amour de l’or, la Reine s’est fâchée, et n’a plus reparu à St Roch. Je suis étonnée qu’elle ait fait cela, mais s’est parfaitement vrai et parfaitement connu. C’est dommage. Mon fils est très bien, et très bien pour moi, il me parait avoir et du regret et de l’étonnement de ce que Paul ne soit pas venu. Il ditqu’il lui a écrit sur ce sujet très fortement. Mais cela n’y fera rien. Dans ce moment il entre, pour me dire qu’il faut qu’il soit à Londres dans 6 jours. Je ne replique rien. Je n’ai plus d’opinion sur ces choses là. Je n’en parle pas et j’essaye de n’y pas penser.
Ellice passe son temps avec Thiers. Il y déjeune il y dine, il se promène avec lui même. Et il bavarde à tort et a travers. Il veut maintenant que les Etats-Unis demandent la médiation de la France dans sa querelle de frontières avec l’Angleterre. Il est très certain que votre affaire de Naples aura un grand éclat comme attestation de bonne intelligence entre Londres et Paris, et vous en avez l’honneur.
Adieu. Adieu. Je vous écris très à batons rompus ; car mon fils m’interrompt à tout instant. On me fait dire que Pauline va bien. Andral n’est pas venu. Adieu, adieu beaucoup de fois.
348. Londres, Mercredi 22 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
348. Londres, mercredi 22 avril 1840
10 heures
J’ai le cœur bien soulagé depuis que je suis tranquille sur ma fille. Je me surprends toujours à me dire tranquille. Il est vrai que je le suis comparativement. Mon courrier m’a apporté ce matin la lettre de Lady Clanricarde, plus spirituelle que nouvelle mais très spirituelle, comme vous dites et écrite d’un ton ferme quoiqu’un peu verbeux. Ses idées marchent mieux que ses phrases. Evidemment elle ne se plaît pas à Pétersbourg et je le comprends. Je serai bien aise quelle revienne à Londres et de faire un peu connaissance avec elle. Entre nous, je rencontre ici, comme ailleurs du reste bien peu de femmes d’esprit. Je ne m’en plains pas. J’aime que ce que j’aime soit rare. J’aime encore mieux que ce soit unique. Le premier, le plus fort de tous les orgueils, c’est l’orgueil tendre. J’ai celui-là au plus haut degré. Je suis content de mon courrier de ce matin. Il m’a apporté des lettres qui me mettent en mesure de faire faire, si je ne m’abuse un pas à ma grande question. On est fort content de la façon dont j’ai arrangé la médiation de Naples. J’espère que, de son côté, le Roi de Naples entendra raison. J’en serais sûr s’il n’y avait pas là une question d’argent. Son avarice sert merveilleusement sa dignité. En tout cas, les hostilités vont être suspendues ; et j’en suis fort aise. Les mécontents Italiens étaient déjà à l’œuvre. Du reste il n’y a rien à faire pour moi cette semaine. Lord Palmerston est à Broadland et n’en reviendra très probablement que Lundi.
Thiers m’annonce qu’il va m’envoyer le grand Cordon.
4 heures
Je voulais répondre avec détail au 348, faire aujourd’hui même ce que vous désirez. J’ai été pris par des visites du corps diplomatique, Hummelauer, Björnstjurna & &. Comme tout le monde est parti, je suis un peu leur ressource et je ne m’y refuse pas. Je n’ai pas le temps de vous écrire ce matin à mon aise. Ce sera pour demain.
Vous avez parfaitement raison de ne pas vous mêler de M. de Brünnow. Il ne faut pas parler de ces choses-là par complaisance pour l’humeur d’autrui et sur des ouï-dire. Quand vous serez ici, quand vous aurez vu, vous direz ce que vous aurez vu, s’il vous convient de le dire et comme il vous conviendra. Mais je vous le dis d’avance; si c’est là un homme d’esprit Russe, tant pis pour les Russes. Cela ne ressemble pas du tout à Matonchewitz. Dans le monde où je vis ici, M. de Brünnow ne sera jamais qu’un étranger subalterne et déplacé.
Votre modification sur le duc de Bordeaux est considérable, et le contentement m’étonne un peu. J’ai tort ; ce n’est pas vrai. A la place de M. le duc de Bordeaux, je ne me laisserais pas dissuader. Je mettrais dans l’embarras.
Mes nouvelles domestiques sont très bonnes. Ma mère se remet de l’agitation que lui causait sa responsabilité. Vous seriez profondément touchée de sa lettre de ce matin ; à 75 ans, une telle ardeur de cœur, tant de passion sous la gravité du caractère et de l’âge ! J’ai interdit à Pauline de m’écrire tant que cela la fatiguerait le moins du monde. Henriette la remplace.
Bülow et Alava sont venus dîner hier avec moi. Le Roi de Prusse a été assez malade. M. de Humboldt ne l’a pas vu pendant quinze jours. Il est mieux. Il a recommencé à sortir. Le Roi de Hanovre aussi a été réellement malade. Je ne savais pas à quel point il était ici odieux et décrié : non pas qu’on ne lui accorde les bonnes qualités que vous m’avez dites ; mais on lui attribue en même temps les plus mauvaises, les vrais vices. Et si peu d’esprit à côté ! Vous n’exigez pas, n’est-ce pas, que je prenne la défense de cet ami-là ? Pourtant son amitié pour vous m’a paru si sincère qu’au fond je lui porte un peu de bienveillance. Hummelauer m’annonce le Prince Esterhazy pour les premiers jours de mai. Pourtant, ils n’ont encore aucune date précise pour son départ.
Adieu. Si vous ne me donnez pas de meilleures nouvelles de vous, je compte que vous m’en donnerez d’Andral. Il demeure rue des Petits Augustins N°5 ou 7 Adieu. Adieu.
Voilà une lettre bizarrement pliée. Je n’ai pas sous ma main les enveloppes convenables.
350. Paris, Jeudi 23 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
350. Paris, Jeudi le 23 avril 1840, 9 heures
J’ai fait ma promenade seule. Pas de visites, dîner chez Lady Sandwich avec les Granville, les Brignoles et quelques autres. Thiers devait en être, il n’est pas venu. Le soir chez moi, M. Molé, Brignoles mon amb., Tcham, les d’Aremberg, Ellice, Heischman, la princesse Rasoumosky point de nouvelles. M. Molé comme de coutume, dénigrant. Les nouvelles de Bruxelles hier ont tout-à-fait rassuré le chateau et on passe à St Cloud ce matin, on raconte que votre médiation est conditionnelle. C’est-à-dire qu’elle prescrit d’alord à Naples de résilier le contrat mais se serait du nonsens et je ne le crois pas. On attend samedi ou dimanche la reponse par télégraphe. M. de Pahlen était vif hier sur la nécessité d’un arrangement quelconque en orient, il dit : si on ne fait pas. il y aura des troubles en Turquie, et alors nous y arrivons infailliblement et puis la guerre générale. L’Empereur est pour qu’on reprenne la Syrie si on le veut ; pourqu’on ne la reprenne pas si on ne veut pas. Enfin cela lui est bien égal mais il veut un arrangement, et il faut que la France et l’Angleterre s’entendent. Voilà le ton d’hier au soir. Il aura une conférence avec Thiers ce matin, et il enverra son courrier samedi. Je voudrais bien pouvoir mander quelque chose.
J’ai reçu tout à l’heure une lettre de Matonchewitz dans laquelle il me dit qu’il venait de conjurer Paul de passer par Paris. Nous verrons si cela fera effet. Je ne crois plus à rien de bon de ce côté là.
1 heure.
Voici le 347. Excellent speech, j’en suis aussi contente que l’auditoire, vec quelque chose de plus que lui. Lady Charleville donne des routs et des dîners, depuis 50 ans. Elle m’a constamment prié pendant 22 ans ; j’y ai été une fois, mon mari jamais, parce que c’est a bore. Ne vous en laissez pas incommoder. Il y a quarante vieilles femmes comme cela vous n’êtes pas accrédité auprès d’elles.
Henriette m’a écrit avant-hier de la part de sa grand-mère pour me dire que M. Andral viendrait à une certaine heure. je l’ai attendu il n’est pas venu, mais la menace de sa visite m’a fait du bien. Je suis mieux depuis deux jours. J’écris à mon frère je ne sais quoi car je n’ai rien, donnez-moi.
Adieu. Adieu, pauvre lettre, mon fils me prend mon temps ; il entre à tout instant, cela me donne des fidgets et je ne puis rien faire.
Adieu, God bless you. Je suis bien contente de vous savoir plus transquille, et de savoir ici positivement que vous avez raison de l’être.
Adieu.
349. Londres, Jeudi 23 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
349. Londres, Jeudi 23 avril 1840,
8 heures
On m’assure qu’en passant à Berlin les comtes Pahlen et Orloff ont tenu, l’un et l’autre, un langage très modéré, et qu’ils ont dit notamment qu’il fallait que les affaires d’Orient fussent reglées de concert entre les cinq cours, et sans se séparer de la France.
Si cela est, et je suis porté à le croire, vous avez là, le symptôme le plus clair de l’état actuel des affaires et des esprits de l’état au fond et non à la surface, dans la réalité et non selon l’apparence.
Selon l’apparence, la division est toujours grande. La France ne songe qu’à soutenir le Pacha d’Egypte. L’Angleterre qu’à l’abaisser. La Russie qu’à désunir la France et l’Angleterre. L’Autriche et la Prusse qu’à pressentir qu’elle sera l’issue de la lutte et à s’y adapter.
Il y a de cela en effet, aujourd’hui comme au premier jour, et c’est ce qui frappe au premier coup d’oeil. Les yeux vulgaires doivent s’arrêter là et croire qu’ils ont tout vu. Mais au delà de cette surface des affaires, au fond des cœurs, de tous les cœurs, il y a quelque chose de bien plus réel et plus puissant, le désir de l’immobilité dans l’ordre établi, la crainte de toucher à cette machine Europeenne qui se remet à peine de tant de sécousses, le pressentiment qu’en y touchant on amènerait on ne sait pas quoi mais quelque chose de grave, aussi grave qu’inconnu, impossible à prévoir, impossible à arrêter une fois commencé.
A-t-on raison d’avoir le pressentiment ? Je ne sais pas ; mais on l’a ; tout le monde l’a ; et au moment décisif, tout le monde le retrouve après l’avoir oublié. On l’oublie en effet ; et là est la cause du caractère faible, mesquin, incohérent de la politique de notre temps.
Si les gouverements Europeens se rendaient compte nettement de ce qu’ils pensent et veulent réellement, s’ils parlaient et agissaient d’après le fond de leur pensée et de leur volonté, tout serait serait entre eux simple, prompt, conséquent. Ils auraient eux-mêmes du repos et de la grandeur. Leur unanimité dans une idée et une conduite commune leur en donnerait infailliblement. Mais en même temps qu’au fond, et en définitive ils sont dirigés par une même idée et un même dessein, ils s’abandonnent, dans le cours de la vie, à des idées, à des desseins, à des intérêts secondaires, qu’il ne suivent pas hardiment et jusqu’au bout, ni de manière à rompre tout à fait avec l’idée dominante à laquelle ils rendent tous hommage, mais qui les entrainent à des déviations, des oscillations, des tatonnements, des luttes pleins dembarras et vides d’effet.
On a assez de bon sens pour que la petite politique ne tue pas la grande. On n’a pas l’esprit assez haut, ni assez ferme pour que la grande politique tue la petite. On se conduit raisonnablement, après tout sans en avoir l’honneur, ni tout le profit. Un gouvernement qui adopterait toujours et tout haut pour règle de sa conduite, avec connaissance et conséquence, cette idée simple de paix et de maintien, à laquelle, tôt ou tard, de bonne ou de mauvaise grâce, ils se rallient tous, aurait en Europe une dignité et une influence plus grande qu’on ne peut imaginer. Je vais vous dire quelque chose de bien arrogant. Ce que les gouvernements pourraient faire avec tant déclat et de fruit, j’essaye de le faire pour mon compte et dans ma sphère d’action. Je me porte en toute occasion, avec tout le monde, l’interprète de l’idée qui aujourd’hui et pour longtemps encore, domine au fond de tous les esprits. Je m’applique incessamment à les y ramener, à dissiper les petits nuages qui cachent, de temps en temps, à certains yeux l’étoile à laquelle tous se confient. Je rappelle vers la grande route ceux qui se fourvoyent dans les petits sentiers. Là est tout mon travail. Et dans ce travail j’ai pour allié le secret désir la secrete foi de tout le monde. Je les pousse tous dans le sens définitif où ils penchent, quoiqu’ils tâtent et vacillent dans des sens très différents.
Si je ne me trompe, le fond commence à prévaloir sur la surface, la réalité sur l’apparence. Tous commencent à s’apercevoir que sur la question d’Orient comme sur toutes les autres, les intérêts divers, les desseins opposés sont secondaires, qu’il serait imprudent et probablement vain de les poursuivre ; qu’il vaut mieux se conduire d’après ce qu’on a d’intérêt identique, d’intention commune, et s’y rallier de concert.
C’est cette idée qui a porté la Russie à ne pas tout risquer pour garder son traite d’Unhiar-Skelessi, qui la portera à ne pas tout risquer pour brouiller, l’Angleterre et la France. C’est cette idée qui a si puissamment combattu, dans le cabinet anglais, ses préventions et ses méfiances contre la Russie, qui combattra et atténuera aussi, je l’espère, ses préventions et ses méfiances contre l’Egypte. Le mouvement qui ramène tout le monde vers cette idée est encore faible, obscur, contrarié, tiraillé ; cependant il existe
et tout le monde en ressent l’effet ceux-là même qui persistent à s’y refuser. Je suis loin de compter sur le succès. L’expérience m’a appris que les petites idées, les petites passions peuvent l’emporter sur les grandes, pour longtemps, sinon pour toujours. Cependant et à tout prendre, je crois à l’empire de grandes idées, plutôt que des petites, et je m’y confie davantage.
Soyez sure qu’il y a ici dans le corps diplomatique, dans le pays, dans les Chambres, dans l’intérieur même du Cabinet, un secret travail, un effort point prémédité, point concerté, mais naturel et croissant pour surmonter l’entêtement de Lord Palmerston, et prévenir toute désunion, dans cette affaire, entre l’Angleterre et la France ; pas du tout pour amener, en revanche, une désunion entre l’Angleterre et la Russie, mais pour ramener au contraire tout le monde à un dessein commun et à un arrangement accepté de tous.
3 heures
Je vous en ai dit bien long ce matin, et j’en aurais bien davantage à vous dire. C’est à propos des grandes choses et des choses intimes que l’ennui de l’absence se fait surtout sentir. C’est aujourd’hui mon mauvais jour comme le mardi pour vous. J’ai eu de vos nouvelles ce matin par ma mère qui me dit qu’elle vous a vue Lundi. Ma pelite fille est à merveille, M. Andral, qui a examiné à fond sa poitrine, l’a trouvée en très bon état. Point de mal dans l’organisation, seulement beaucoup de délicatesse et un rhume accidentel.
Je viens de voir Dedel qui part après-demain pour aller passer quinze jours en Hollande. Il m’a fait venir l’eau à la bouche, pas pour la Hollande. Adieu. Adieu. Donnez-moi aussi de bonnes nouvelles de vous. Le beau temps continue, et je le vois avec quelque regret. C’est pour juin que je veux du beau temps. Vous savez que je ne sais pas jouir seul. Adieu encore
353. Paris, Dimanche 26 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
353. Paris, dimanche le 26 avril 1840,
11 heures
J’ai été bien fâchée de devoir vous expédier si courtement hier, vous me l’auriez pardonné si vous m’aviez vue. J’étais excedée d’écritures. Aujourd’hui je veux réparer si l’on me laisse, mais mon fils est toujours là. Il part demain pour Londres. D abord je veux vous dire que selon l’avis de Granville vous ferez très bien de parler Anglais aussi au dîner de l’académie samedi. Il dit que dans des occasions publiques, c’est toujours une politesse à faire aux Anglais quelqu’ils soient. Ainsi j’avais tort dans mon premier conseil. Faites votre speech anglais mais très court, c’est encore le conseil de Granville. Il a trouvé celui la Cité fort bien. Je vous dirai qu’assez généralement ici on a trouve la derniere phrase de trop je veux dire la toute dernière qui sentait un peu trop le prédicateur. Et si je dois être franche, et je dois l’être avec vous, je le trouve un peu aussi. Granville pense cependant que cela a dû avoir plutot un bon effet dit là, quoique cela eut été mieux dans la bouche d’un Evêque. Voyez je vous dit la petite critique. Ainsi à l’academie, discours anglais, bref. Chez vous vendredi point de discours, réponse à la santé du Roi par la santé de la Reine, voilà tout. Palmerston portera la santé du Roi. Il me semble que les détails de ménage sont expédiés. J’ai eu un long entretien avec Thiers Vendredi, tout le long du diner, car j’étais sa voisine. Il m’a d’abord raconté toute la séance qui avait été des plus orageuses et importantes comme vous avez vu. Il était parfaitement content, glorieux. Il avait été hardi ; à la tête de la gauche il a enfoncé, écrasé les autres. La confusion a été complète. Sa situation devient tous les jours meilleure quoique toujours difficile, mais il gagnera sans dissolution le temps naturel du renouvellement de la Chambre, le Roi est bien pour lui ; il est bien pour le Roi. Le Roi très belliqueux, lui le moderateur. L’Orient toujours Naples, toujours incertain, toujours menaçant. Cependant il n’y aura pas de guerre. Naples, une bonne affaire quoiqu’il arrive ; car c’est du renouvellement d’intimité avec l’Angleterre. Un grand contentement de vous. Même pensée, même action. Je vous ai donné Thiers, voici Mad. de Boigne hier matin chez moi. La séance de vendredi déplorable, les amis de Thiers, son monde dans le ministère consterné. C’est la gauche, la réforme, tout ce qu’on redoute. Le Roi subit une situation humiliante mais inévitable. Il est très froid pour Thiers. Thiers plus que froid pour le Roi, un peu insolent. Le Roi se tait, la Reine et Madame Adelaide parlent. La dernière surtout et avec beau d’amertume et de véhémence. On ne voit pas le terme du mal. Cette abominable coalition mène l’état où il se trouve aujourd’hui.
Toute la Cour attristée, le mariage se fera sous une impression de profonde tristesse. J’ai fini. M. Mole a fermé son salon. Le Marechal avait fermé le sien il y a déjà quinze jours. On plie bagage il n’y a rien à faire, rien à espérer. Jaubert est malade ; la jaunisse à ce qu’on dit. Il y a si longtemps que je n’ai vu Génie, que je ne sais plus rien de l’intérieur du ménage de vos amis. Mad. de Boigne parle une peu dédaigneusement de M. de Broglie. C’était jusqu’ici son héros. A propos encore, Thiers a passablement de mécontentement du langage que M. de Metthernich tient à Vienne sur son compte. Décidément ce cabinet ne lui plait pas.
Je me sens mieux sans M Andral. Il m’a écrit pour s’annoncer à une certaine heure. J’y étais, il n’est pas venu et puis il arrive hier à 6 1/2. au moment où je me mettais à table avec mon fils. Je n’ai pas pu le recevoir, il n’y a pas de ma faute. Je vais au bois de Boulogne tous les jours ; il fait plus chaud qu’au mois de juillet. Après mon dîner je me fais encore traîner en calèche. Le soir on vient chez moi, tous les soirs mon Ambassadeur. Demain je dîne avec lui chez Rothschild. Après demain chez lui, Mercredi chez Heichman jeudi, chez Mad de Boigne pour lui aussi. Il est si content de se retrouver à Paris. Vous avez bien raison sur Lady Tankerville. En général vos portraits sont toujours frappants. M. de Brünnow ne restera pas longtemps à Londres ce que j’entends dire de lui est trop unanime pour que cela ne finisse pas par le couler. Il y aura beaucoup de Russes à Londres cet été. Ils ne manqueront pas de faire de leur mieux pour lui casser le cou. N’avez-vous donc pas eu encore d’entretien d’affaires avec lui ?
Ellice vint de perdre un neuveu qu’il aimait beaucoup. Il est allé passer deux jours en retraite à Versailles. Savez-vous que votre Orient ne me plait pas ? On n’avance pas d’une ligne, par quoi cela peut-il donc finir ? Adieu. Adieu. Adieu. Mille fois adieu.
Que le temps est long !
354. Paris, Lundi 27 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
354. Paris, Lundi 27 avril 1840
9 heures
Mon fils vient de partir pour Londres. Il sera de retour au bout de huit jours J’ai fait des visites hier au soir, entre autres chez Mad. de Castellane. M. Molé a beaucoup causé avec moi, on disait hier que le blocus de Naples était établi ; il voit découler de là une guerre générale, c’est en verite très possible. Personne ne doute que les hostilités de la part de l’Angleterre en deviennent le signal d’un soulevement à Naples, où le Roi est parfaitement détesté et méprisé par tout le monde. Si le reste de l’Italie n’est mal disposé à se remuer aussi, et là se trouveraient au presence, l’Autriche reprimant et vous aidant la révolution. Tout depend de cet imbecile de Roi. Et partout et toujours tout a dépendu d’un fou ou d’un sot.
J’ai envie de me faire démocrate. La situation du parti conservateur à la Chambre parait très mauvaise aux yeux de M. Molé. Il dit : "Il n’y a pas de chef, voilà le vice radical. Il est sans remède avec les élements actuels, M. de Lamartine ne saura jamais être chef ; si un chef se retrouve tout ne serait pas perdu. "
M. Molé n’est pas absolument opposé à une réforme dans la Chambre mais il dit cependant, qu’à défaut d’aristocratie qui ne se présente pas aux élections, les fonctionnaires constituent cette aristocratie, et que les rétrancher, c’est livrer les bancs de la Chambre à des députes pris de très bas, et très pauvres qu’il faudra salarier, c’est-à-dire revenir à la Convention Nationale. Je crois avoir compris comme je vous dis là. Il trouve, naturellement avec exagération, que M. Thiers est passé à la gauche tout-à-fait depuis vendredi, que M. Odillon Barrot est le chef du Cabinet et M. Garnier Pages le chef de la gauche. Les Granville sont très affligés des nouvelles de Londres. Lady Burlington est probablement morte à l’heure qu’il est. C’est une perte immense pour toute la famille et pour le Duc de Devonshire surtout. Il vient de repartir cette nuit. Tous ces derniers jours j’ai fait ma promenade au bois de Boulogne avec mes visites, ainsi, un jour le Duc de Devonshire, un autre Mad. de Talleyrand, hier le Duc de Noailles, il a été sensible au petit mot qu’il y avait pour lui dans une de vos lettres.
Vous ne sauriez concevoir la beauté du temps, de la verdure, et de mon logement dans ce moment c’est ravissant. Ce serait trop beau si vous étiez ici. On a fait l’essai des fontaines ; elles viennent d’être dorées, la masse d’Eau est superbe. Je n’ai rien vu de plus beau à Rome. Depuis le 1er de Mai elles iront toujours. Aujourd’hui aura lieu la noce à St Cloud, M. Molé en sera.
Voici votre lettre. Je trouve votre langage sur nous très bien, et très utile.
1 heure.
Génie est enfin venu me faire visite. Il y a quinze jours que je ne l’avais vu. Il me dit que votre famille est informée que vous ne la faite pas venir à Londres, et qu’au fond votre mère est plutôt contente que contrariée. Adieu Adieu.
Je repète avec vous le deux vers, et toute la romance. Nous nous disions en même temps ces deux vers en voiture en revenant de Chatenay, le 24 juin 1837.
355. Paris, Mardi 28 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
355. Paris, mardi le 28 avril 1840
10 heures
J’ai mené hier Ellice au Bois de Boulogne, et je l’ai retrouvé à dîne chez Rottschild. Il y avait les Ambassadeurs. Le Duc de Serra Capriola a fort bon air et il s’exprime bien. Il m’a fait le recit de toute cette affaire de souffré naturellement il défend son roi. Il accuse Lord palmerston, ses propos un peu légers. sur le compte du Roi ont excessivement irrité celui-ci. Il croit cependant qu’il pourra se prêter à la résiliation du Contrat, mais il doute qu’il consente à des indemnités, au fond, il est très inquiet des nouvell qu’on attend de Naples. Si les vaissaux anglais menacent Naples il a fort peur que son roi se fasse tirer dessus. Hier s’était répandu le bruit d’un mouvement populaire, mais il n’y a encore rien d’officiel. Il y a eu musique chez Rottschild. Mais du Chant allemand qui n’est pas du tout de mon goût ; j’ai quitté à 10 1/2 pour venir me coucher et au moment d’entrer dans mon lit on m’annonce mon Ambassadeur qui me demande un moment seulement. J’ai cru qu’il y avait quelque chose d’incroyable arrivé depuis les dix minutes que je l’avais quitté. Point, il avait envie de parler, à peu près de rien ou du rabachage. Il a Brünnow dans l’esprit. Il se trouve déjà un peu en contradiction avec lui. Brünnow agit selon les paroles venant de haut. Pahlen, selon ses instructions écrites. Ceci est très différent. Cela a été mis en lumière par le dernier courrier envoyé samedi, mon opinion est que le règne de M de Bünnow à Londres ne sera pas long. Tout le monde est ligué contre lui à commencer par lui même ses bouquets, sa danse, le portrait, sa ridicule conduite avec vous, ses flatteries qui fineront par donner des nausées.
Vous souvenez-vous de mon opinion et des "Lieux où finit l’Europe et commence l’Asie" dans une dépêche.
Au fond Pahlen m’en veut un peu de ce que je n’ecris pas à son sujet. On parle toujours beaucoup de votre popularité en Angleterre. A propos j’ai vu un petit article dans le Times s’étonnant de votre dîner avec O’Connel. Je crois qu’il est parfaitement oiseux de vous recommander de ne jamais répondre à aucun article personnel dans les journaux, mais j’aime mieux faire une bêtise que négliger un bon avis.
Ellice est de la même opinion que Granville sur le discours à l’academie Anglais. Il faut qu’ils aient raison. Savez-vous que le 1er de mai est le jour de naissance du Duc de Wellington ? Si vous insinuez à Melbourne de boire à sa santé ce serait gracieux. La différences avec les autres santés c’est que les royales seraient debout, la sienne assis. Je vous suggère cela sans savoir tout-à-fait si j’ai raison. Peut être si cela était su ici y aurait-il de l’inconvénient ; non ce serait le pendant de Soult. Vous en jugerez. Si cela se faisait tout simplement en causerie entre Vous et Melbourne. Qu’en pensez-vous ? Au reste, noyez mon idée si elle vous laisse de l’hésitation. Il vaut mieux s’abstenir. Je pense beaucoup à votre dîner. Enfin je peuse à tout ce que vous faites comme je penserais à ce que j’aurais à faire moi meme, et davantage. Je voudrais qu’il n’y eut jamais en grandes comme en petites choses, rien à redire, rien à regretter. Vous avez si parfaitement commencer. Les Débats et le Constitutionnel s’occupent de vous. Au fond tout le monde pense à vous, votre situation est bonne.
2 heures
Voici Montrond. Adieu. Adieu. Je n’ai que le temps de fermer.
354. Londres, Mercredi 29 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
354. Londres, Mercredi 29 avril 1840
9 heures
Le petit comité de Holland house s’est transformé hier en 14 ou 15 personnes. Toujours au grand déplaisir de Lady Holland dit-elle ! Elle continue de me soigner comme un enfant favori. J’avais Lord Melbourne et Lord John Russell. Nous avons causé. La conversation est difficile avec Lord John ; elle est très courte. Je vois que M. de Metternich est extrêmement préoccupé de Naples de notre médiation autant que de ce qui a fait notre médiation. L’Angleterre et la France sont bien remuantes. Il n’y aura jamais de repos, en Europe tant qu’elles y seront. En sortant de Holland house, j’ai été un moment chez Lady Tankerville. Elle avait déjà vu Lady Palmerston arrivée à 5 heures. Leur intimité est grande. Elle croit au mariage de Lord Leveson et de lady Acton. En savez-vous quelque chose ?
Une heure
9 heures
Le petit comité de Holland house s’est transformé hier en 14 ou 15 personnes. Toujours au grand déplaisir de Lady Holland dit-elle ! Elle continue de me soigner comme un enfant favori. J’avais Lord Melbourne et Lord John Russell. Nous avons causé. La conversation est difficile avec Lord John ; elle est très courte. Je vois que M. de Metternich est extrêmement préoccupé de Naples de notre médiation autant que de ce qui a fait notre médiation. L’Angleterre et la France sont bien remuantes. Il n’y aura jamais de repos, en Europe tant qu’elles y seront. En sortant de Holland house, j’ai été un moment chez Lady Tankerville. Elle avait déjà vu Lady Palmerston arrivée à 5 heures. Leur intimité est grande. Elle croit au mariage de Lord Leveson et de lady Acton. En savez-vous quelque chose ?
La mort de Lady Burlington afflige bien du monde. On dit que la Duchesse de Sutherland est désolée. Voilà sa maison fermée pour quelque temps. Mais plus sa maison sera fermée, plus elle sera heureuse de vous y avoir. Dites-moi positivement ce que vous ferez, le jour. Je n’abandonne rien de ce qui est convenu. Je n’ai pu encore renvoyer à Clapham et à Norwood. Demain ou samedi, on ira. Mais répétez, répétez.
Une heure
Ce que vous a dit M. Molé me revient de bien des côtés. On me l’écrit. On me le fait écrire. Il faut laisser dire et écrire. Je suis étranger à toute rancune envers mon parti ; mais je ne me hazarderai pas légèrement. Ma position actuelle est bonne, bonne en elle-même, bonne pour tous les avenirs possibles. J’attendrai une nécessité criante, si elle doit venir. Et je tâcherai de faire, en attendant de la bonne politique, au profit du Cabinet, comme au mien.
Ne croyez pas à la guerre pour Naples, en dépit des fous ou du fou, s’il n’y en à qu’un. Je n’ai jamais vu tout le monde si loin de la guerre si effrayé d’en entendre parler. Elle n’est ni dans la nécessité des choses, ni dans le penchant des personnes. Elle ne reviendra pas encore Génie ira vous voir un de ces jours.
Tout ce que je vous dis la n’empêche que je ne trouve la séance sur la réforme des éligibles bien mauvaise. Les mesures proposées, et les paroles dites sont peu de chose. Ce qui est grave, c’est la rupture de plus en plus profonde entre le Cabinet, et le parti qui a été, est et sera toujours, au fond, le parti de gouvernement.
Il n’y a pas en France deux partis de gouvernement. On peut bien faire osciller le pendule du pouvoir mais seulement dans de certaines limites. S’il penche tout à fait vers la gauche, la machine se détraque. Je regarde et j’attends non sans inquiétude.
Ce soleil est vraiment miraculeux. Je n’en jouis pas. Je ne vous redirai jamais assez que je ne sais jouir de rien seul. Quand je pense au soleil, quand je trouve l’air doux la verdure charmante, à l’instant mon désir d’en jouir avec vous devient si vif que la jouissance se change en souffrance. Regents Parh est joli ; mais le bois de Boulogne vaut mieux.
Ma mère n’a dû recevoir qu’aujourd’hui la lettre où je renonce à son voyage. Elle pouvait s’en douter ; mais elle ne m’en a pas encore dit un mot. Je suis heureux qu’elle le prenne bien. On m’écrit et elle m’écrit elle-même qu’elle est un peu fatiguée. Elle a marché jusqu’au Tuileries, et a trouvé que c’était trop. Elle ne marche qu’au Val Richer, en passant la journée dehors. Je l’ai engagée à y aller vers le 15 mai. Mes enfants prendront le lait d’ânesse jusques là. A la rigueur, ils pourraient le prendre au Val-Richer ; mais ce serait un peu difficile à arranger, et j’aime mieux qu’il n’y ait pas d’interruption.
On fait prendre des bains à Henriette. On me dit qu’elle avait un peu d’échauffement sur une joue. L’avez vous remarqué? Adieu. J’ai un rendez-vous à 2 heures pour voir un télégraphe par l’électricité. On dit que c’est merveilleux. Une nouvelle serait le tour du monde en deux minutes ; à la lettre le tour du monde. Adieu. Adieu. Comme en revenant de Chatenay.
356. Paris, Mercredi 29 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
356. Paris le 29 avril 1840
10 heures
1 heure pas de lettre. Fagel me parle toujours beaucoup de vous. Dédel lui rend compte d’un entretien qu’il a eu avec vous avant son départ qui a été pour lui d’un grand intéret.
[Monsieur Guizot
Ambassadeur de France
Manchester Square
Angleterre.
à Londres]
10 heures
Montrond et Ellice m’ont pris du temps. J’ai fini par enlever Ellice pour ma promenade en calèche. Le dîner de mon Ambassadeur a été éternel. 2 heures & un quart à table c’est trop fort, et une chaleur et une odeur de peinture J’ai manqué chez moi, Jaubert et Berryer, car je ne suis rentrée que vers 10 heures. J’ai vu Ellice, Stratford Canning, l’internonce et mon Ambassadeur, qui se plaint beaucoup de ce que je ne le garde départ pas jusqu’à minuit. Ellice, qui avait dîné chez Thiers m’a conté la capture de 10 vaissaux napolitains. Thiers en était fort consterné.
Montrond me raconte toujours l’amour du roi pour Thiers, et la nécessite que vous et Thiers restiez bien ensemble, comme un homme qui aurait bien envie que ce fût le contraire, car quand je lui demande pourquoi tant désirer quelque chose qui est, il me répond que les rivalités, les clabaudages peuvent altérer cela ! Moi j’affirme que vous avez tout deux trop d’esprit pour vous brouiller, à moins de très grosses raisons, et que je suis convaincue que vous vous entendez à merveille. Il serait possible que cela déplût au roi. M. Molé est si aigre qu’il trouve même que la duchesse de Nemours n’est pas très jolie. On la dit cependant charmante. Mes diplomates affirment que si une révolution éclate à Naples, l’Autriche doit s’en mêler et s’en mêlera. Je trouve à Appony l’air bien préoccupé et même égarré. Brignole trouve qu’il s’est trop fait l’homme du Roi, que c’est inconvenant et fort compromettant. J’ai causé beaucoup avec lui hier, il était mon voisin à dîner. On raconte dans la diplomatie que Thiers ayant lu dans l’Allgemeine zeitung un article insolent sur lui, a fait venir M. de Luxbourg et lui a très franchement lavé la tête. Il a raison, le journal est censuré, et dès lors le gouvernement bavarois a à en répondre. Luxbourg n’a pas trouvé une parole à répliquer.
Montrond me raconte toujours l’amour du roi pour Thiers, et la nécessite que vous et Thiers restiez bien ensemble, comme un homme qui aurait bien envie que ce fût le contraire, car quand je lui demande pourquoi tant désirer quelque chose qui est, il me répond que les rivalités, les clabaudages peuvent altérer cela ! Moi j’affirme que vous avez tout deux trop d’esprit pour vous brouiller, à moins de très grosses raisons, et que je suis convaincue que vous vous entendez à merveille. Il serait possible que cela déplût au roi. M. Molé est si aigre qu’il trouve même que la duchesse de Nemours n’est pas très jolie. On la dit cependant charmante. Mes diplomates affirment que si une révolution éclate à Naples, l’Autriche doit s’en mêler et s’en mêlera. Je trouve à Appony l’air bien préoccupé et même égarré. Brignole trouve qu’il s’est trop fait l’homme du Roi, que c’est inconvenant et fort compromettant. J’ai causé beaucoup avec lui hier, il était mon voisin à dîner. On raconte dans la diplomatie que Thiers ayant lu dans l’Allgemeine zeitung un article insolent sur lui, a fait venir M. de Luxbourg et lui a très franchement lavé la tête. Il a raison, le journal est censuré, et dès lors le gouvernement bavarois a à en répondre. Luxbourg n’a pas trouvé une parole à répliquer.
Midi. Voilà cette pauvre Lady Burlington morte. Ce sera un deuil très sincère dans toute cette famille. Le Duc de Devonshire n’aimait que cela au monde. Il est possible que cela fasse un changement pour mon Stafford House. Je regretterai bien Chatsworth aussi, où je devais vous rencontrer. Pourquoi votre lettre ne m’arrive-t-elle pas ?
1 heure pas de lettre. Fagel me parle toujours beaucoup de vous. Dédel lui rend compte d’un entretien qu’il a eu avec vous avant son départ qui a été pour lui d’un grand intéret.
Dédel vous porte aux nues, il ne fait qu’une critique et il dit que sur cela tout le monde pense de même. Votre diner avec O’Connel. Vous ne deviez pas chercher cela. Je ne suis pas tout-à-fait aussi prude mais je suis plus que jamais d’opinion qu’il ne faut pas qu’il entre jamais chez vous. Ce serait une grave faute. Ecoutez ce que dit Montrond d’Ellice qu’il déteste, tous les jours davantage. Je crois à cause de son intimité avec Thiers. C’est le best inutile fellow que je connaisse. C’est drôle. Le beau temps est drôle aussi. Les canicules depuis huit jours ; je n’ai d’autre souci que de me garantir de la chaleur.
Adieu, c’est triste d’écrire deux jours de suite sans répondre. Adieu, Adieu.
[Monsieur Guizot
Ambassadeur de France
Manchester Square
Angleterre.
à Londres]
358. Paris, Jeudi 30 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
358. Paris, jeudi le 30 avril 1840
9 heures
Il y a aujourd’hui 6 ans que mon mari reçut la lettre de l’Empereur lui annonçant sa nouvelle destination lettre qui lui fit lever les mains au ciel de joie, et moi de douleur. J’ai noté ce jour comme un des plus cruels de ma vie. Il y a aujourd’hui un an que mon fils ainé me déclara qu’il ne me reverrait jamais. C’est un triste jour que ce 30 avril. J’aurai de vous une lettre n’est-ce pas ? Deux probablement, car je n’ai rien eu hier. Rien depuis lundi. C’est long. J’étais inquiette hier. Je suis allée chez votre mère pour savoir si elle aussi manquait de lettres elle avait eu la sienne, ainsi vous vous portiez bien. J’ai trouvé tout votre monde en parfaite santé et vous pouvez être bien tranquille Je me suis promenée avec Marion. J’ai dîné chez M. fFeihman. De la diplomatie. On raconte que Thiers dit à propos de l’affaire des soufres : "Si j’avais fait ce que fait Lord Palmerston, qu’aurait dit l’Europe ?" C’est vrai, entendez-vous les cris d’indignation ? Il y a bien de l’injustice dans le monde. Je n’ai vu personne hier au soir. Ces dîners me font veiller tard et je manque tout le monde. Je n’ai vu que M. de Bacourt et Ellice. Je vous enverrai par le courrier des Affaires étrangères une lettre que j’ai reçue hier de Matonchewitz, elle vous intéressera.
11 heures
Midi.
Voici deux lettres l’une par le petit médecin, l’autre par le gros monsieur. Le petit monsieur l’ayant reçu que hier à 2 heures n’a plus osé venir puisque vous lui disiez de la porter avant l heure. Je l’ai renseigné pour l’avenir. Merci de toutes les deux, et de tout. Vraiment Brünnow est trop bête. L’ Europe finira par répéter cet écho. Je vous ai dit hier un mot direct par la poste pas dessus mon autre lettre. Je répete aujourd’hui. Parlez en français à l’academie. C’était mon premier instinct vous vous en souvenez. Granville m’a déroutée, et j’ai assez de confiance dans ses avis, mais cependant je crois que le Français est plus convenable. De toutes les façons, et j’y reviens avec assurance, parce que j’entends dire qu’un ambassadeur Français doit parler sa langue là où il peut être compris et c’est vrai. C’est votre inclination aussi; c’est donc dit samedi à 8 heures je saurai que vous parlez Français. Vous ne savez pas comme je m occupe et m’inquiète de tout ce qui vous regarde. Votre dîner du 16 mai me parait trop short notice pour cette saison d’autant que tout le monde prend le samedi. Il me parait que le 23 est plus sûr. Je pense que ni les Sutherland, ni les Carlisle, ni le Duc de Devonshire, ni Lord Morpeth n’accepteront. Mais cela ne doit pas vous empêcher de donner le diner Whig, il le faut absolument avant celui-pour les Torys. J’ai écrit ce matin à M. Andral. Je ne suis pas bien de nouveau. Vraiment c’est une étrange santé que la mienne, avec mon régime, mon abstinence je ne conçois pas ce qui me dérange, je ne vois plus d’autre parti à prendre que de ne plus manger du tout. On peut s’acoutumer à cela peut être. Vous pourriez prendre M. e Mrs Slanley dans le dîner Whig si vous avez place. Adieu. Adieu.J’ai bién grondé de ce que ma lettre de samedi a été remise trop tard à la poste. Ordinairement, je les porte moi-même. Je ne suis jamais sure que de moi-même. Je viens de relire la lettre de Matonchewitz. Je vous promets qu’elle vous plaira. Vous ne l’aurez pa encore aujourd’hui. Je veux la faire lire à M. de Pahlen.
9 heures
Il y a aujourd’hui 6 ans que mon mari reçut la lettre de l’Empereur lui annonçant sa nouvelle destination lettre qui lui fit lever les mains au ciel de joie, et moi de douleur. J’ai noté ce jour comme un des plus cruels de ma vie. Il y a aujourd’hui un an que mon fils ainé me déclara qu’il ne me reverrait jamais. C’est un triste jour que ce 30 avril. J’aurai de vous une lettre n’est-ce pas ? Deux probablement, car je n’ai rien eu hier. Rien depuis lundi. C’est long. J’étais inquiette hier. Je suis allée chez votre mère pour savoir si elle aussi manquait de lettres elle avait eu la sienne, ainsi vous vous portiez bien. J’ai trouvé tout votre monde en parfaite santé et vous pouvez être bien tranquille Je me suis promenée avec Marion. J’ai dîné chez M. fFeihman. De la diplomatie. On raconte que Thiers dit à propos de l’affaire des soufres : "Si j’avais fait ce que fait Lord Palmerston, qu’aurait dit l’Europe ?" C’est vrai, entendez-vous les cris d’indignation ? Il y a bien de l’injustice dans le monde. Je n’ai vu personne hier au soir. Ces dîners me font veiller tard et je manque tout le monde. Je n’ai vu que M. de Bacourt et Ellice. Je vous enverrai par le courrier des Affaires étrangères une lettre que j’ai reçue hier de Matonchewitz, elle vous intéressera.
11 heures
Je viens de faire un tour en calèche. La chaleur empêche ma promenade plus tard. J’attends toujours votre lettre vos lettres. Hier matin, j’ai vu longtemps Appony, et longtemps Fagel. Le premier est vert de mauvaise humeur. Il y a bien de l’aigreur dans son fait. Il me raconte bien des commérages. Ces gens-là ont bien envie que vous vous brouilliez avec Thiers. Ils avalent tout ce qui peut ressembler à cela. J’ai dit à Appony ce que je vous disais hier. Il faudrait de bien grosses raisons. Votre bonne intelligence est utile, et tout-à-fait convenable ; il faut qu’elle dure. Fagel est très bon enfant et fort dans le vrai sur toute chose.
Midi.
Voici deux lettres l’une par le petit médecin, l’autre par le gros monsieur. Le petit monsieur l’ayant reçu que hier à 2 heures n’a plus osé venir puisque vous lui disiez de la porter avant l heure. Je l’ai renseigné pour l’avenir. Merci de toutes les deux, et de tout. Vraiment Brünnow est trop bête. L’ Europe finira par répéter cet écho. Je vous ai dit hier un mot direct par la poste pas dessus mon autre lettre. Je répete aujourd’hui. Parlez en français à l’academie. C’était mon premier instinct vous vous en souvenez. Granville m’a déroutée, et j’ai assez de confiance dans ses avis, mais cependant je crois que le Français est plus convenable. De toutes les façons, et j’y reviens avec assurance, parce que j’entends dire qu’un ambassadeur Français doit parler sa langue là où il peut être compris et c’est vrai. C’est votre inclination aussi; c’est donc dit samedi à 8 heures je saurai que vous parlez Français. Vous ne savez pas comme je m occupe et m’inquiète de tout ce qui vous regarde. Votre dîner du 16 mai me parait trop short notice pour cette saison d’autant que tout le monde prend le samedi. Il me parait que le 23 est plus sûr. Je pense que ni les Sutherland, ni les Carlisle, ni le Duc de Devonshire, ni Lord Morpeth n’accepteront. Mais cela ne doit pas vous empêcher de donner le diner Whig, il le faut absolument avant celui-pour les Torys. J’ai écrit ce matin à M. Andral. Je ne suis pas bien de nouveau. Vraiment c’est une étrange santé que la mienne, avec mon régime, mon abstinence je ne conçois pas ce qui me dérange, je ne vois plus d’autre parti à prendre que de ne plus manger du tout. On peut s’acoutumer à cela peut être. Vous pourriez prendre M. e Mrs Slanley dans le dîner Whig si vous avez place. Adieu. Adieu.J’ai bién grondé de ce que ma lettre de samedi a été remise trop tard à la poste. Ordinairement, je les porte moi-même. Je ne suis jamais sure que de moi-même. Je viens de relire la lettre de Matonchewitz. Je vous promets qu’elle vous plaira. Vous ne l’aurez pa encore aujourd’hui. Je veux la faire lire à M. de Pahlen.
355. Londres, Jeudi 30 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
355. Londres, Jeudi 30 avril 1840
8 heures
Je vais déjeuner aujourd’hui à Battertea chez un des favoris de la Duchesse de Sutherland, le Dr. Khay. On veut me faire voir là et à Norwood, de grandes écoles populaires en attendant que j’aille à Eton et à Oxford voir les écoles aristocratiques. A Norwood, je m’enquerrais aussi d’autre chose. Le soleil est décidé à ne pas quitter Londres. Il y fait pourtant une pauvre figure, dans son plus grand éclat. Hier, à dîner, chez Lady Lovelace, l’évêque de Norvich, bon homme un peu ridicule, un M. Villiers, frère de Lord Clarendon. Tous ses frères ont de l’esprit. Vous savez que Lady Lovelace est la fille de Lord Byron, cette petite Oda sur laquelle il a fait des vers charmants. Elle a de très jolis yeux et l’air spirituel naturel et affecté à la fois. Vous arrangerez cela, car cela est, et même, je trouve cela assez comme en Angleterre. Ils sont naturels et point à l’aise dans leur naturel ; d’où leur vient l’affectation. Je me suis ennuyé. J’ai été finir ma soirée chez Mad. Grote au milieu des radicaux. Mad. Grote, devient un personnage. Lady Palmerston l’a invitée à une soirée. J’ai entendu avant-hier Lady Holland faire un petit complot pour l’avoir à dîner la semaine prochaine à Holland, house, et bien recommander à Lord John Russell d’y venir et de plaire à Mad. Grote. Ils ne lui plairont pas, et elle ne leur plaira pas. Elle a de la hauteur et prend de la place. Ils ne lui en feront pas assez ; elle aimera mieux être reçue des radicaux chez elle qu’une étrangère poliment accueillie, à Holland house. Les complaisances aristocratiques ne peuvent plus se mettre au niveau des fiertés démocratiques. Il peut y avoir là des rapprochements sérieux et sincères, par nécessité, par bon sens, par esprit de justice. Tout ce qui est factice, superficiel, momentané ne signifie plus grand chose. On n’aura pas le vote de M. Grote comme Don Juan a eu l’argent de M. Dimanche.
J’ai été voir hier Lady Palmerston, fort contente de son petit séjour à Broadlands, pas rajeunie pourtant ; je lui trouve l’air fatigué. Elle a besoin de toilette. Le négligé du matin ne lui va plus. Elle est préoccupée des Affaires de Naples. A part l’intérêt du moment, cela lui déplaît qu’on dise que les révolutions naissent sous la main de Lord Palmerston et de le craindre elle-même un peu. Nous attendons des nouvelles. Je pense que j’aurai un courrier ce matin. Voilà mon courrier. Il m’apporte : 1° de de longues dépêches sur Naples et l’Orient avec de curieuses conversations de Méhémet Ali ; mais point de réponse encore du Roi de Naples. Cela m’impatiente. 2°des lettres et des livres des Etats-Unis d’Amérique où l’on me reproche d’avoir dit trop de bien de Jefferson. 3° l’ouvrage de M. de Tocqueville sur la démocratie en Amerique. 4° Le grand cordon de la légion d’honneur, pour que je le porte demain.
Je vis bien à découvert avec vous. Je vous montre tout, même les petits mouvements de vanité que je méprise.
Je vous quitte pour ma toilette. Je vous dirai encore un mot avant de partir pour Batterrea. J’espère bien que la poste arrivera, auparavant. Mais c’est aujourd’hui mon mauvais jour. Je n’aurai probablement rien de vous.
10 heures et demie
Je monte en voiture, et vous êtes charmante. Mon mauvais jour est excellent. Je ne veux point de mauvais jour. Il n’y en aurait point pour vous si je pouvais écrire le dimanche. J’espère bièn être rentré avant le départ de la poste. Mais à tout hazard, je ferme ma lettre et je la donne à M. Herbet. Si je reviens assez tôt, je la rouvrirai et je vous dirai encore adieu. En attendant Adieu. Adieu.