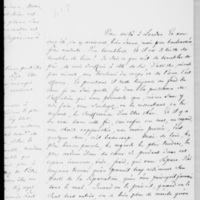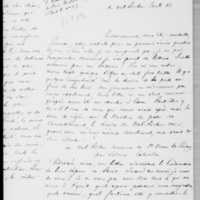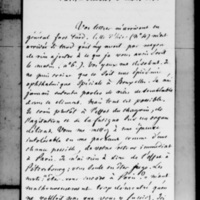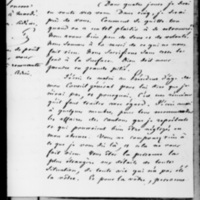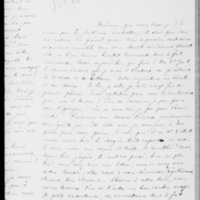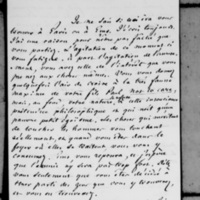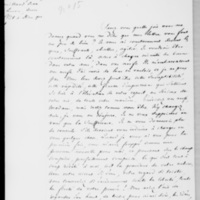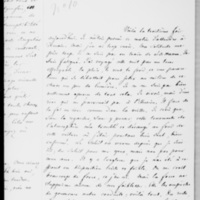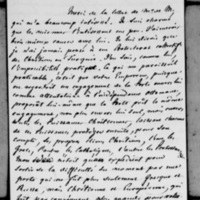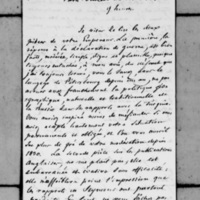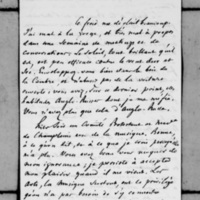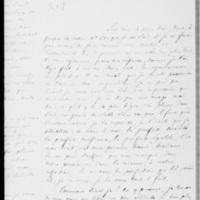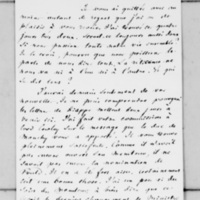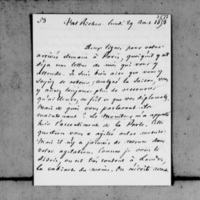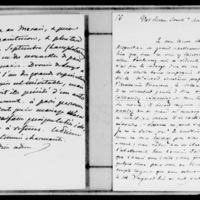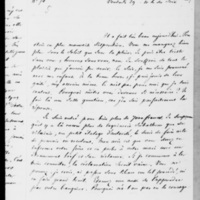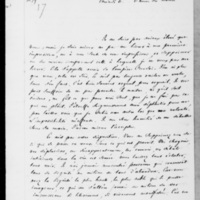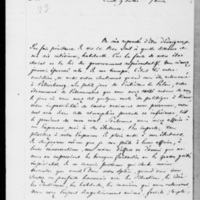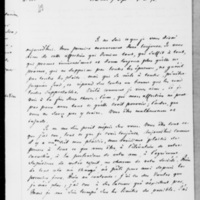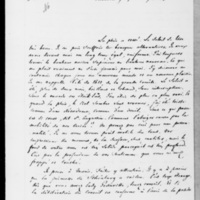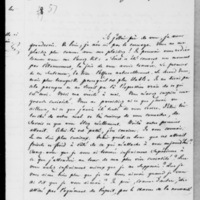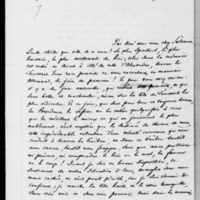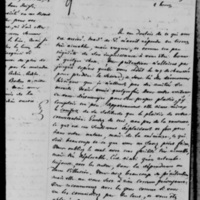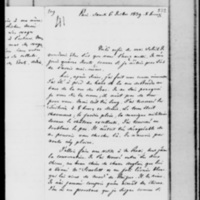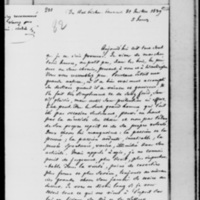Votre recherche dans le corpus : 91 résultats dans 3296 notices du site.
4. [Paris], Vendredi 7 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous voilà à Londres. Et vous avez été, en y arrivant bien émue, mais pas bouleversée pas malade. J’en tremblais. Et il est si triste de trembler de loin ! Je sais ce que c’est de trembler de près, de voir souffrir à côté de soi, d’assister minute par minute aux douleurs du corps et de l’âme. C’est affreux. Et pourtant il reste toujours au fond du cœur je ne sais qu’elle foi dans la puissance de l’affection qui vous persuade que, même sans y rien faire, vous soulagez, en les ressentant, en les voyant, les souffrances d’un être chéri. Et il y a du vrai dans cette foi, car enfin, un mot, un regard. une chaise rapprochée, une main pressée, C’est quelque chose, c’est beaucoup. Mais de loin, les plus douces paroles, les regards, les plus tendres, les plus ardents élans du cœur se perdent dans ce espace immense, vide, froid, qui vous sépare. J’ai toujours trouvé qu’on prenait trop aisément son parti de la séparation, qu’on n’en prévoyait jamais tout le mal. Quand on le prévoyait, quand on le sent tout entier, on a bien plus de mérite qu’on ne croit à y consentir, car on fait bien plus de sacrifices qu’il ne paraît. Le pauvre Brutus se trompait beaucoup s’il est vrai qu’il ait dit en mourant : " Ô vertu, tu n’es qu’un vain nom ! " Il faut que la vertu soit au contraire quelque chose de bien réel, car elle impose, et on accepte, pour lui obéir, de bien lourds fardeaux.
J’aime John Bull de vous avoir si bien reçue. Mais une autre fois, ne prenez personne pour votre fils. Comme à vous, les cottages de votre route me paraissent charmants, et j’y vois tout ce que vous avez pu y voir. Cependant. croyez-moi quelque heureuse que vous y fussiez, votre pensée votre caractère, toute votre âme se trouveraient bien à l’étroit dans un cottage. Il faut que le chêne s’étende, que le palmier s’élance, que la rose s’épanouisse. Nul n’est bien que dans un habit à sa taille ; et notre taille, Madame ce n’est ni vous, ni moi qui la réglons ; nous n’y pouvons pas plus retrancher qu’ajouter une coudée. Acceptons donc, quelque lourd qu’il puisse être quelques fois. l’habit qui nous va. Mais sous tous les habits, dans toutes les situations, les sentiments simples naturels, les sentiments primitifs et puissants qui sont le fond de l’âme humaine doivent trouver leur place et garder leur empire. Je ne sais ce qui a pu arriver à d’autres ; pour moi, je n’ai jamais éprouvé que les grands désirs, les grands travaux de la vie publique étouffassent, altérassent le moins du monde en moi, le besoin d’affection bien reçue, passionnée de sympathie intime, les joies du cœur et de la famille, tout ce qui remplit et anime la vie privée des hommes. Plus au contraire mon esprit s’est élevé et ma destinée s’est étendue, plus ces sentiments se sont développés en moi: plus ils me sont devenus chers ; plus même ils ont gagné, je crois en énergie, en fécondité en délicatesse! Il me semble qu’ils ont toujours participé au progrès général de mon être, et qu’en montant un échelon de plus, je n’ai jamais laissé en arrière aucune partie de moi-même. Il est vrai aussi que je suis devenu de plus en plus difficile pour la satisfaction intérieure de ces sentiments si doux de plus en plus exigeant quant aux mérites, aux perfections de leur objet. En ceci comme ailleurs, mon ambition a toujours été croissante, et je n’ai jamais accepté ni mécompte ni décadence. Mais en ceci surtout, ma plus haute ambition est satisfaite, car il a plu à Dieu de placer sur ma route des créatures dont la rencontre est de sa part, un bienfait infiniment supérieur à tous ses autres dons.
Samedi 8. Je n’ai pas eu de lettre hier. Vous l’avez peut-être adressée au Val Richer, m’y supposant déjà. Elle m’y attendra ; mais en attendant elle me manque beaucoup. J’espère que les miennes vous arrivent exactement Je ne sais que vous dire de ma course à Châtenay. J’ai été là dans l’état intérieur le plus mêlé, le plus combattu, tantôt charmé d’y être tantôt m’y trouvant plus seul que partout ailleurs. "Cette fois vous venez pour moi.» m’a dit Mad. de Boigne. Elle m’a parlé de vous, très bien, selon le monde. Le monde vous trouve très aimable Madame mais il vous craint un peu. Il lui semble que vous le regardez d’en haut, vous mettant plus à l’aise avec lui que vous ne lui permettez de l’être avec vous. Il soupçonne qu’au fond vous êtes un peu autre que vous ne lui paraissez. N’y ayez point de regret. La familiarité du monde n’est pas bonne ; il faut toujours se montrer à lui un peu dans le lointain et lui rester un peu inconnu.
Les bruits de dissolution prennent ici depuis deux jours, assez de consistance. Je suis allé avant. hier soir à Neuilly prendre congé du Roi et de la Reine. Le Roi, n’y était pas. Je n’ai donc point eu de conversation sur laquelle je puisse former quelque conjecture. En tout cas, les élections n’auraient probablement lieu qu’au mois d’Octobre. L’indisposition de M. le Duc d’Orléans n’était rien du tout, un pur accès de fièvre éphémère. Il passe demain une revue de la garnison de Paris. Les propos qui couraient sur son désir de commander lui-même, l’expédition de Constantine étant tout à fait tombée. Adieu., Madame. Je vais recommencer à trier dans ma bibliothèque les livres que je veux envoyer à la campagne. C’est un travail presque mécanique qui me convient à merveille. Mon âme pendant ce temps pense à qui elle veut. va où il lui plaît. Adieu. G.
4. Val-Richer, Mercredi 15 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos yeux malades me déplaisent beaucoup. Presque autant que vos yeux bien portants me plaisent. Vos yeux bien portants ont, par moment, un caractère de profondeur de regard recueilli et intérieur, admirable. Je les vois tels dans ce moment-ci. Qu'ils ne soient pas malades. Mad. Danicau vous lit-elle beaucoup ? Vous ne me dites rien d'elle. Je suis presque bien aise que vous renonciez à Dieppe. Je n’y avais pas goût. C’est bien loin pour ce que vous alliez y chercher. Et en cas de grand ennuis, il faut deux jours pour revenir à Paris. J’aime mieux St Germain ou Versailles. Je pense que vous allez samedi à Mouchy. Moi, j’irai ce jour-là établir Pauline à Trouville. Je devais y aller demain. Quelques arrangements me font retarder de deux jours. Fleischmann tient-il sa parole ? Le temps est resté un peu gâté de l'orage. Je me suis moins promené hier. Pourtant une course d’une heure dans les bois. On m’annonce pour aujourd’hui beaucoup de visites. Si je savais m’ennuyer, l’occasion serait bonne. L’état des esprits est excellent, ici et dans les environs. Je ne crains que le trop de confiance. Tous les nôtres se croient sûrs du succès trop sûrs.
Rien aujourd’hui d’aucun point. Si ce n’est de Bruxelles où l’Infant D. Enrique s’est rendu en deux jours, à charge à tout le monde, en particulier à sa sœur qui parle mal de lui et dit qu’il faut bien le veiller. Il ne s’est entouré que des émigrés progressistes. Il a dîné le 14 à la Cour, et il part aujourd’hui même pour la Hollande, d’où il ira sans nul doute à Londres. Vous avez toute raison de parler toujours de lui, comme de notre candidat N° 2. J’attends la première lettre de Jarnac pour lui écrire en détails à ce sujet. A tout prendre, je serais bien aise que Bulwer quittât Madrid pour Constantinople. C'est aussi l’avis de Bresson. Palmerston a été à Tiverton, bien réservé sur les affaires étrangères, et bien aigre sur Peel. Il me paraît impossible que l’hostilité ne recommence pas bientôt entre eux. Les Whigs feront ressortir les fautes de Peel, et il ne se laissera pas faire, je suppose. Je reçois un mot de Flahaut qui trouve sa retraite (la retraite de Peel) magnifique. Mais M. de Metternich a été très choqué de l’éloge de Cobden.
J’avais tort tout à l'heure de vous dire que je n’avais rien de nulle part. J’oubliais ce mot de Flahault qui me demande de la part de Metternich, des renseignements très détaillés sur l'organisation et le service de la Gendarmerie en France. On veut établir un service semblable en Galicie. On vient, d’Autriche, nous emprunter de la police. Pas un mot sur le discours de Montalembert et sur mon silence. Flahaut a tort. Que M de Metternich ne lui en ait rien dit, je le comprends ; mais il devrait avoir lui des informations, des conjectures, sur ce que Metternich en a pensé, et me les dire. Il fait comme bien d’autres, plus en pouvoir que lui ; dès qu’il y a quelque embarras, il s'efface. Vous ai-je dit qu’il avait écrit à Morny ? Il y a peu de temps qu’on lui disait que je n'étais pas content de lui, que j’avais envie de donner son poste à un autre, &. pour peu que cela fût vrai, disait-il, il voudrait le savoir, car pour rien au monde, il ne voudrait rester à son poste contre mon gré ou seulement contre mon goût. J’ai pleinement rassuré Morny. Adieu.
Je reviens à vos yeux. J'en attends de meilleures nouvelles. Merci de vos excellents conseils pour Henriette. J'en ai fait usage d’autant que je les avais devancés. Elle est à l’œuvre. Vous avez mille fois raison. Vous êtes vous-même, un modèle d’ordre. Adieu. Adieu. Je viens d’écrire longuement au Roi sur l’Espagne. Adieu G.
6. Val-Richer, Jeudi 13 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement vous êtes malade, Princesse, assez malade pour ne pouvoir écrire quatre lignes. Sans cela, je ne comprends pas, je ne puis comprendre comment je n’ai point de lettres. Quelle ressource pour me rassurer ! J’en ai une autre moins triste quoique l’effet en soit fort triste. Il y a quelque irrégularité dans le service de la poste au fond de mes bois. Mes journaux ne m’arrivent pas encore exactement. Deux lettres ne me sont revenues qu’après avoir été me chercher à Caen. Peut-être y en a-t-il une de vous qui court ainsi après moi. Je viens de régler avec le Directeur des postes de l’arrondissement le service du Val-Richer, voici, quand vous voudrez m’écrire directement, ma vraie et sure adresse. Au Val-Richer, Commune de St Ouen le Paing. par Lisieux. Calvados. Adressées ainsi mes lettres m’arrivent le lendemain de leur départ de Paris. Quand en aurai-je une de vous ?
Je ne veux pas vous dire tout ce qui me vient à l’esprit, quel espace parcourt mon imagination, quels ennemis, quel fantôme elle y rencontre. Je n’ai pas en général l’imagination inquiète et noire : mais quand une fois elle prend ce tour là, elle échappe tout à fait à l’empire de ma raison, tout devient possible, probable, réel. Il faut se taire alors, se taire absolument, ne pas se parler à soi-même. Je vous quitte donc Madame. Pourquoi êtes-vous devenue un si grand intérêt dans ma vie ?
Vendredi 14. Voilà une lettre, une longue, un excellente lettre. Et c’est bien celle que j’attendais. Il n’y en a point de perdue. Celle-ci est allée en effet me chercher à Caen, le service encore mal réglé de la poste a causé le retard. Un nom de village pour un autre, une négligence de commis, cinq minutes de sommeil d’un courrier qui passe, sans s’en apercevoir, devant une route de traverse, qu’il faut peu de chose pour faire beaucoup souffrir ! Enfin, la voilà. Et j’espère que les autres viendront plus régulièrement.
Vous n’êtes point malade. On vous trouve bonne mine. Ne permettez pas à tout ce monde de vous accabler de fatigue ; ils n’ont pas de quoi vous en dédommager. Ils vous aiment pourtant et ils ont raison ; et vous avez bien raison aussi d’accueillir toutes les amitiés, quels que soient leur nom et leur drapeau.
Entre nous, j’ai plus d’une fois regretter de ne pouvoir être avec mes adversaires politiques, aussi cordial aussi, bienveillant que je m’y serais senti enclin. J’en sais plus d’un en qui, politique à part, j’aurais trouvé peut-être un ami du moins une relation facile et douce. Mais le soin de la dignité personnelle, les devoirs envers la cause, les exigences et les méfiances de parti, tout cela jette entre les hommes, une froideur, une hostilité souvent sans motifs individuel et intimes. Il faut s’y résigner ; c’est la loi de cette guerre, car il y a là une guerre.
Mais vous, Madame, profitez, profitez toujours et sans hésiter de votre privilège de femme; soyez juste envers tous, bonne pour tous, amicale pour tous ceux qui le mériteront de vous. C’est quelque chose de si beau et de si rare que l’équité et l’amitié ! Je suis charmé que vous en jouissiez, et plus charmé encore que vous soyez si capable d’en jouir, que vous ayez l’esprit si libre et le cœur si affectueux. Je n’y mets qu’une condition Vous la devinez et elle est bien remplie, n’est-ce pas ? Pendant que vous retrouvez à Londres, vos douleurs, pendant que vous n’y pouvez faire un pas, regarder à rien sans avoir le cœur bouleversé au souvenir de vos fils, moi j’achève ici, dans ma maison, les arrangements que le mien y avait commencés. Je fais descendre dans ma chambre son fusil de chasse, je me promène suivi de son chien.
C’est un lien puissant entre nous, Madame, que cette triste ressemblance de nos destinées, et cette parfaite intelligence que nous avons l’un l’autre de nos peines. Il me semble que j’ai connu vos enfants ; je leur prête les traits, les qualités qui me charmaient dans le mien ; je les unis à lui dans mes regrets. Ne vous défendez pas, Madame, du sentiment qui vient émousser ce que les vôtres ont de plus poignant ; laissez-vous guérir autant que se peut guérir une vraie blessure. A mesure que nous avançons dans la vie, c’est la condition de notre âme d’éprouver et d’associer dans je ne sais qu’elle mystérieuse unité, les émotions les plus contraires, de souffrir et de jouir, de regretter, et de désirer à la fois, et avec la même vérité, la même énergie. Acceptons ces secrets de notre nature. Si vous étiez là, si nous causions en liberté, vous me parleriez de vos fils, je vous parlerais du mien. Nous nous raconterions toute leur vie, toute la nôtre, et un sentiment d’une douceur infinie et souveraine se répandrait sur notre entretien. Que mes lettres vous en apportent l’ombre ; les vôtres ont pour moi tant de charme !
Samedi 15, 9 h 1/2 du matin.
Que je dis vrai dans ces derniers mots, & bien plus vrai que je ne dis ! Voilà, le N° 5 qu’on m’apporte. Dearest Princess, je crains qu’à votre tour vous n’éprouviez quelque retard pour mes lettres, pour celle-ci du moins. Je m’en désole. Pardonnez le moi. J’aurais dû la faire partir avant-hier ; mais j’étais si impatienté de ne voir rien arriver que j’ai attendu. Je vous aurais écrit en trop mauvaise disposition. Aujourd’hui je ferais peut-être mieux d’attendre aussi. Ma disposition est trop bonne.
Tout à l’heure Madame j’irai me promener dans les bois qui m’entourent. Ils sont bien verts, bien frais, bien sombres, quoiqu’un beau soleil brille au dessus et les enveloppe de sa lumière. Ce lieu-ci est très solitaire, très sauvage. Autrefois quelques moines y venaient orner. Aujourd’hui quelques bûcherons y travaillent. J’y serai bien seul. Je n’y entendrai rien. Je n’y verrai personne. Je relirai vos lettres. Je serai charmé. Et pourtant, que le fond du jardin de la Duchesse de Sutherland me fera envie ! Et ma pensée tantôt m’y transportera, tantôt vous amènera vous-même dans les bois du Val-Richer. Et je me laisserai bercer à ces doux rêves jusqu’à ce que j’en sente le mensonge. Je rentrerai alors dans ma maison.
Je suis très préoccupé de ce que vous me dites des projets de M. de Lieven. Vous ne pouvez songer, ce me semble, à aller le rejoindre à Carlsbad. Vous voilà à peine en Angleterre. La saison des eaux serait passée avant que vous arrivassiez, en Bohème. Après les eaux, s’il y va M. de Lieven retournera sans doute auprès du grand duc. Non, Madame, il ne faut pas chercher le bonheur à tout prix ; mais il faut penser sans relâche aux moyens de lever les obstacles. Vous ne pouvez ni vous fier à Pétersbourg, ni errer sans cesse en Europe. Que ces deux points là soient bien arrêtés ; ils feront le reste.
Midi. C’est trop de bien en un jour. Je tremble pour les jours qui vont suivre. Je reçois à l’instant votre N°6. Mon pressentiment ne me trompait pas tout à fait quand je vous craignais malade. Reposez-vous, beaucoup, beaucoup. Je suis charmé que vous n’alliez pas à Howick.
Que je vous remercie d’avoir pensé à me rassurer sur votre mauvaise écriture ! Elle m’eût inquiété en effet. Je vais attendre bien impatiemment vos prochaines lettres. Je les crains pourtant un peu. Vous aurez attendu celle-ci. Vous vous serez, comme moi naguère, impatientée, tourmentée. Vous voyez que j’ai aussi ma fatuité. C’est un lieu commun que je dis là, Madame. Non, je n’ai avec vous, point de fatuité. Ce mot ne convient ni à vous, ni à moi. Mais j’ai confiance, je crois. Et vous aussi, n’est-ce pas ? Nous avons donc bien le droit de nous parler comme gens qui croient, c’est-à-dire tout simplement et en disant les choses comme elles sont, non pas comme on est convenu de les dire quand elles ne sont pas. Il faut pourtant que je finisse si je veux que ma lettre parte !
Il me semble que j’ai à peine commencé que je ne vous ai parlé de rien. Je vais au plus pressé à ce qui me touche vraiment ; et je laisse en arrière (comme je laissais le cahier rouge) la politique anglaise, la politique française, votre jeune Reine, la dissolution de son parlement, celle du nôtre, que sais-je ? Tout cela cependant m’intéresse beaucoup, et je lis très curieusement les détails que vous me donnez, et j’ai sur tout cela, des milliers de choses à vous dire. Et ma prochaine lettre, si dans celle-là encore, j’en trouve le temps. Adieu Madame.
Remerciez, je vous prie, la petite Princesse de son bon souvenir. J’y tiens beaucoup et j’en suis très touché. C’est à vous de lui demander pardon, pour moi d’un langage si familier. Je copie. Je suis bien heureux d’apprendre que Madame la Duchesse de Sutherland veut bien se rappeler mon nom. C’est du luxe en vérité d’être si bonne quand on est si belle. Mais le luxe qui vient de Dieu est charmant ; et il a comblé votre noble hôtesse de tant de dons qu’en effet elle nous doit peut-être à nous autres pauvres mortels de nous traiter avec un peu de bonté. Quelque place qu’elle me donnât à sa table, je serais ravi de m’y asseoir. G.
Mots-clés : Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Deuil, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait (Dorothée), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Séjour à Londres (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
7. Paris, Vendredi 3 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos lettres m’arrivent, en général fort tard. Celle d’hier (N°4) m'est arrivée si tard qu’il n’y avait pas moyen de rien ajouter à ce que je vous avais écrit le matin (N°6).
Vos yeux me désolent. Je ne puis croire que ce soit une épidémie ophtalmique spéciale à Bruxelles. Je n’ai jamais entendu parler de rien de semblable dans le climat. Mais tout est possible. Je crois plutôt à l'effet du chagrin, de l’agitation et de la fatigue sur un organe délicat. Vous me mettez à une épreuve intolérable en me parlant, comme d’une chance possible de votre retour immédiat à Paris. Je n'ai rien à dire de l'effet à Pétersbourg, vous seule en êtes juge. Les mots : " êtes-vous encore à Paris ? " m'ont malheureusement trop démontré qu’on ne voulait pas que vous y fussiez ici. On serait certainement étonné, et comme on ne comprendrait pas, on chercherait, à ce retour, d’autres motifs que le véritable ; on ne croit guère en général aux motifs de santé, quoique ce soient les meilleurs. Trop de gens s'en servent pour me nier.
Quoiqu’on ne soit pas ici, plus en goût de la guerre qu’il y a deux mois, on y croit, et on en prend son parti, et on s'y prépare, et tout le monde règle, sur le fait, ses relations et ses plans. Je vous dis, malgré moi et tristement, mes premières idées ; je n'ai encore causé avec personne ; mais je doute que, parmi vos amis sensés et sincères, il y ait une autre impression que la mienne. Vient toujours, en première ligne votre santé, et dans ce fait là, j’ai tant de peine à voir clair, quand vous êtes ici, qu’il m’est impossible de l’apprécier de loin. Que tout cela est triste !
Demain, plus encore que tout autre jour, je voudrais être avec vous, et vous donner quelques douces distractions. Votre fidélité à de chers souvenirs m'a profondément touché dès le premier jour où je vous ai connue. C'est une vertu qui coûte cher, mais que j’aime et que j'honore infiniment. Les coeurs sont si légers, et tout passe si vite dans ces ombres chinoises de la vie !
Autre tristesse en pensant à vous. Vous avez de la religion, et elle ne vous sert pas à grand chose dans vos épreuves, vous n'y puissiez guère de consolation ni de force. En tout, le mal vous fait plus de mal que le bien ne vous fait du bien, et vous souffrez plus de vos défauts que vous ne profitez de vos qualités. Que de choses il aurait fallu pour mettre en vous l’équilibre et l'harmonie dont vous auriez besoin. Adieu, adieu.
Je ne vous dis rien du discours Impérial. Il ne faisait pas grand effet hier, ni le matin, ni le soir. Il aura le sort de presque tout ce que dit et fait son auteur ; il réussira plus dans les masses que dans les esprits difficiles. Si j'étais allemand, j'en serais mièvrement content. Adieu.
J’ai vu hier Montalembert qui m'a beaucoup parlé de vous, avec un intérêt dont je lui ai su gré.
7. Val-Richer, Vendredi 18 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Dans quatre jours, je serai en route vers vous. Dans cinq. je serai près de vous. Comment se quitte-t-on quand on a un tel plaisir à se retrouver ? Nous avons bien peu de sens et de volonté. Nous sommes à la merci de ce qui ne nous fait rien. Nous sacrifions sans cesse le fond à la surface. Dieu doit nous prendre en grande pitié. J'écris ce matin, au Président d’âge de mon Conseil général pour lui dire que je n'irai pas, et pourquoi. C’est une réunion qu’il faut traiter avec égard. J'écris aussi à quelques membres, pour leur recommander les affaires des cantons que je représente et qui pourraient bien être négligées en mon absence.
Vous ne comprenez rien à ce que je vous dis là, et cela ne vous fait rien. Vous êtes la personne la plus étrangère aux détails de toute situation, de toute vie qui n’a pas été la vôtre. Et pour la vôtre, personne ne comprend et ne soigne mieux que vous les détails, et la pratique de tous les moments. Vous resterez comme vous êtes, et c’est ce qui me plaît. J’ai renvoyé hier à Désages ma dépêche pour Chabot avec le changement désiré. J’avais voulu que le changement fût approuvé à Eu précisement parce que la dépêche n’avait été vue qu'après avoir été envoyée. Elle sera de retour, à Londres après demain, et j'espère qu’elle y sera le point de départ d’une politique un peu nouvelle. Je mets beaucoup de prix à changer, sur l’Espagne la vieille politique de l'Angleterre par intérêt public et par orgueil personnel.
Vos conversations avec Bulwer ont été excellentes. J’ai écrit à Flahault pour qu’il se gardât un peu du Prince de Metternich à qui évidemment notre succès ne plaît guères, et qui veut trop le mariage D. Carlos et pas du tout le mariage Aguilla. J'ai peur que Flahault ne soit aussi trop bien avec lui et n'évite trop d’avoir un autre avis que le sien. Espartero est donc décidément à Bayonne. S'il ne fait comme sa femme, que traverser la France pour aller en Angleterre, peu m'importe. Mais s’il entendait rester en France, il y aurait à y bien regarder D. Carlos, Christine et Espartero ! En attendant, j’ai écrit au Ministre de l’Intérieur qu'il ne fallait à aucun prix, le laisser séjourner près des Pyrénées. Au moins aussi loin de l’Espagne que Bourges. On m'écrit de presque tous les points de l’Espagne que sa fuite précipitée, quand la dernière bombe venait à peine de tomber sur Séville fait baisser la tête de honte à tous ses partisans.
10 heures et demie M. de Beauvoir, un jeune attaché fort intelligent m’arrive à l’instant de Londres. Chabot me dit de le faire causer et qu’il est fort au courant. Sa conversation est bonne. Lord Aberdeen ne demande pas mieux que de se concerter avec nous et de nous aider en fait, à réussir dans le mariage Philippe V. Tout ce qu’il désire, c’est que nous lui épargnions le calice du principe. J’en suis d'accord et ma dépêche est partie. M. de Beauvoir croit qu’elle sera acceptée avec joie et mise en pratique. Sur ce adieu, car il faut que je renvoie le jeune homme à Paris, et j’ai encore plusieurs lettres à écrire. Adieu. A mardi. Je serai à Auteuil avant 4 heures. Adieu. G.
Voilà votre n°9. N'ayez donc pas de point de côté. Ne vous levez pas sans vous couvrir. Il ne faut pas être si remuante quand on est si délicate. Adieu. Adieu.
9. Val-Richer, Vendredi 21 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame que vous dirai-je ? Je n’aime pas les sentiments combattus ; ils sont peu dans ma nature. En général, quand deux impressions contraires m’arrivent ensemble, mon cœur choisit décidément choisit et l’une devient bientôt dominante, tout à fait dominante. Mais aujourd’hui que faire ? Vos N°7 et 8, le dernier surtout que je reçois à l’instant, me pénètrent de tristesse et de bonheur. Votre inquiétude me désole et me charme. Je lis, je relis, je relis vingt fois les paroles pleines d’une agitation pour vous si douloureuse, pour moi si tendre ! Que ne donnerais-je par pour vous l’épargner? Que ne vous dois-je pas pour l’avoir sentie? Pardonnez-moi dearest Princess, pardonnez-moi mon égoïste joie ; elle n’ôte rien, je vous jure à ma peine pour votre peine. Je crois que si ce n° 8 était arrivé avant-hier, le chagrin, l’eût emporté en moi. Je vous aurais vue encore si triste, si troublée ! Mais, depuis hier j’espère, le mal est passé ; hier au plus tard, vous avez reçu une lettre; vous en aurez une autre demain ; elles iront à vous désormais régulièrement, souvent, bien souvent. Chacun à notre tour, nous avons traversé l’un et l’autre un bien sombre nuage. De petites circonstances, des circonstances tout-à-fait étrangères à notre volonté, mon déplacement, des adresses inexactes, des postes mal réglées voilà la vraie cause du mal. Il ne se reproduira plus. Nous y veillerons. J’y veillerai comme les Guèbres sur la dernière étincelle du feu sacré, comme une mère sur son enfant malade. Les témoignages de votre affection me sont mille fois plus doux que je ne vous le dirai jamais. Mais je ne veux jamais les devoir à une minute de souffrance de votre cœur.
Et Lord Aberdeen ? Il est donc parti ? Et je puis en toute sûreté, le plaindre, être juste envers lui ? Que je vous remercie de m’avoir ainsi mis à l’aise avec moi-même ! Je ne connais rien de plus pénible que de nourrir en son âme un mauvais sentiment contre un galant homme malheureux. Et pourtant vous êtes une noble créature. Et moi j’ai le cœur bien fier. Je pressentais cela et depuis longtemps. Même avant votre départ, le nom de Lord Aberdeen me frappait plus sérieusement qu’aucun autre. Pauvre homme ! C’est si naturel !
Vous ne savez pas Madame, pour un homme sérieux et malheureux, quel charme il y a en vous, dans votre air, dans votre accent, dans ces entretiens où éclatent, avec tant de dignité et d’abandon, votre esprit si haut si simple, si libre, votre âme si gravement et si finement émue, si sensible aux grandes choses, si indifférente aux petites, pleine de tant de sympathie et de tant de dédain ! Je voudrais avoir quelque occasion d’être en bon rapport avec Lord Aberdeen de lui être agréable en quelque chose. Je me sens comme des devoirs envers lui. Vous me direz s’il vous écrit s’il doit revenir à Londres avant votre départ. Vous me direz tout, comme vous l’avez fait.
Samedi 22 midi. Dearest Princess, il n’y a plus de sentiment combattu. Je n’en ai plus qu’un absolument qu’un. Je suis désespéré de votre inquiétude. Je crains quelle ne vous fasse mal. Je reçois à la fois votre petit billet, sans numéro du lundi 17 qui m’est venu directement, après être encore allé me chercher à Caen et votre N°9, du Mardi 18, qui m’arrive par Paris. J’ai beau me dire qu’à présent, depuis Jeudi vous êtes tranquille, que vous savez combien vos inquiétudes étaient vaines. Je n’en suis pas moins désolé, troublé, inquiet de nouveau moi-même et de la façon la plus douloureuse. Je vous vois, vous êtes là devant mes yeux, impatiente, préoccupée quel charme agitée, triste, attendant, attendant encore. Vous me pardonnez, n’est-ce pas? Je veux que vous me pardonniez, quoique je n’ai point de tort, non certainement point de vrai tort, point de tort devant Dieu; car moi aussi j’ai attendu et bien des jours, et avec une impatience dont j’ai contenu, dont j’ai étouffé l’expression en vous la témoignant. Et si j’avais suivi ma pente, quand vos lettres ne m’arrivaient pas quand mon imagination se lassait, s’épuisait à chercher la cause du retard ou du silence, je vous aurais écrit tous les jours ; tous les jours je vous aurais demandé pourquoi je n’avais pas de lettre. J’aurais mieux fait. Je ne l’ai pas fait à cause de vous, de vous seule. J’ai craint quelque odieuse malice. J’ai voulu y voir clair.
Enfin tout est passé n’est-ce pas, bien passé? Vous ne craignez plus, vous ne souffrez pas, vous n’êtes pas malade ? Que la parole est pitoyable, & que tous mes efforts seraient vains pour vous envoyer sur ce papier, ce que j’ai en ce moment dans le cœur ? Voyez le, devinez-le. Vous le pouvez, j’en suis sûr ; je me confie à vous. C’est ma consolation dirai-je ma joie, mon inexprimable joie de savoir, d’avoir vu, de voir tout ce qu’il y a dans votre cœur de tendresse et de puissance. Ceci encore, cette joie vous me la pardonnez également. Dites-le moi, que j’aie le plaisir de l’entendre, quoique je n’en aie pas besoin. Demain enfin, après demain au plus tard j’aurai une lettre rassurée, et qui me rassurera j’espère. Mais que d’heures encore d’ici à demain ! Aujourd’hui, il me serait impossible de vous parler d’autre chose.
Adieu adieu. Mais, je vous en conjure, soignez-vous ; ne vous livrez pas à des émotions comme celle que ce petit chien a causée. L’absence est déjà assez lourde ; au moins faut-il être tranquille sur votre santé. Je ne serais pas tranquille quand vous vous porteriez toujours le mieux du monde. Comment l’être un moment si des secousses continuelles vous assiègent ? Éloignez-les ; abrégez-les. Vous pouvez avoir de l’empire sur vous? Vous m’avez dit que vous réprimeriez tout ce qui pourrait m’affliger. Pensez à moi. Je suis sûr que vous le ferez comme vous me l’avez dit. G.
12. Val-Richer, Mercredi 26 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Et moi aussi je respire. Quel horrible cauchemar ! et si long ! Depuis deux jours je n’y tenais plus. Dearest, every day dearer Princess, vous avez cependant trouvé le secret de mêler à une peine déchirante une joie ineffable. Ah ne regrettez pas l’abandon de vos sentiments, de vos paroles : j’en ai reçu un bonheur incompréhensible pour moi même au milieu de mon angoisse, et pourtant si réel, si puissant ! Ma raison, ma justice me le reprochaient, mais sans le détruire. Encore une fois, il faut me le pardonner. Vous le savez ; à un seul sentiment l’égoïsme est permis ; mais il lui est bien permis, car c’est le seul où le cœur, la personne, l’être tout entier se donnent vraiment et sans réserve, et avec plein droit par conséquent de tout accepter, de tout attendre. Oui, j’ai plein droit d’être égoïste avec vous. Je ne crains pas de trop recevoir. Je ne compte pas, je ne mesure pas. Donnez, donnez-moi; je m’acquitterai. Mais ce que je vous demande aujourd’hui, ce que je vous conjure de m’envoyer par tous les courriers, c’est la certitude que votre santé n’est pas trop atteinte, que le repos du corps vous revient avec celui du cœur. Là est la préoccupation, la cruelle préoccupation qui me reste.
Déjà, quand j’étais près de vous, j’ai si souvent tremblé en vous voyant, si aisément et si profondément ébranlée en voyant à la moindre émotion un peu vive, même douce, vos nobles traits, toute votre personne près de tomber dans ce frémissement qui fait mal, même quand la joie le cause et dont on ne sait même bientôt plus, quand il vous envahit, s’il vient de la joie ou de la douleur ! Vous ne savez pas quelles inquiétudes vous m’avez déjà causées, quels regards de minutieuse et infatigable inquisition j’ai cent fois porté sur votre physionomie, sur votre maintien, sur votre démarche, pour y découvrir la moindre trace de la moindre altération de la moindre souffrance. Et que faire de telles craintes dans l’absence, quand on ne peut s’assurer à chaque instant, de leur erreur, de leurs limites du moins ?
Vous me connaîtrez un jour, Madame ; vous savez un jour quelles agitations, quelles faiblesses infinies se cachent dans mon cœur, quand une affection vraie le possède, et emploient, à leur triste service dès que l’occasion s’en présente, tout ce que je puis avoir d’imagination, d’esprit d’énergie. Épargnez moi des troubles intérieurs qui atteint le bonheur le plus grand et lassant le plus ferme courage. Veillez sur vous, soignez-vous ; rapportez moi ce teint reposé, ces bras que vous m’avez promis ? Vous aurez des lettres, vous en aurez souvent, exactement. Il est impossible que la cruelle épreuve, par laquelle nous avons passé l’un et l’autre se renouvelle. Je suis enclin à croire qu’elle n’a eu que des causes matérielles, des méprises d’adresse, des ignorances de notre part quant aux arrangements de la poste ; peut-être des combinaisons trop variées et trop savantes. Certainement nous y pourvoirons. Vérifiez, je vous prie, ce que je vous ai dit ce matin sur les numéros de mes lettres. Vous avez eu le N°4. Le N°5 était le petit billet non numéroté, écrit le Dimanche 9. Et quant au retard du N°6, j’en entrevois la raison dans la route particulière qu’il a suivie, si je ne me trompe. Vote prochaine lettre me dira j’espère, qu’il vous est arrivé. Votre N°11 n’était que le n°10. Il commence le mardi 18 à midi, et votre N°9 finissait le mardi au moment de l’arrivée du postman. Votre N°12 que j’ai reçu ce matin, n’est donc que le N°11. J’entre dans ce détail pour qu’il n’y ait point d’erreur entre nous.
Jeudi 10 heure
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’en espérais pas n’importe ; je suis désappointé. Quelle insatiable avidité que celle de notre âme ! Dès qu’elle entrevoit le bonheur elle s’y précipite, elle s’y attache ; elle le vous tout entier à tout moment. A demain mon âme. Je suis charmé de votre conversation avec le comte Orloff. Vous ferez ce que vous voulez. J’attends à présent. vos projets en raison des mouvements de M. de Lieven. Toujours attendre ! Je voudrais connaitre au moins tous les gens à qui vous parlez, de qui vous me parlez. Les noms qui m’arrivent par vous qui sont importants pour vous, et qui ne me représentent ni une figure, ni une voix, ni un caractère cela me déplaît. C’est du vague, de l’obscur, de l’étranger. Je n’en puis souffrir en ce qui vous touche. Ah, notre misère! Que de choses dont nous disons. Je ne puis les souffrir et qu’il faut souffrir pourtant, et que nous souffrons en effet.
2 heures
La proclamation du rois de Hanovre, fera du mal partout. Les conservateurs sont intéressés partout à la bonne conduite du pouvoir. Ceci est vraiment un acte de folie. Je serais bien fâché que les élections anglaises s’en ressentissent profondément. Quant à nous malgré les apparences je doute toujours que nous ayons des élections. Le mieux informé de mes amis m’écrit que jusqu’ici le Roi, qui en décidera seul, y a à peine songé, qu’on se traînera probablement jusqu’au mois de Novembre avec des velléités sans résultat, et qu’alors, quand le vent des Chambres commencera à souffler, s’il secoue un peu fort le roseau ministériel, le Roi préférera un remaniement du Cabinet à une dissolution.
Je ne pense guère à tout cela; d’abord, parce que je pense à autre chose, ensuite, parce que rien ne me déplaît tant que de penser à vide, et quand il n’y a rien à faire. La bavardage vain est la maladie de notre temps et de notre forme de gouvernement. L’esprit s’y hébète et la volonté s’y énerve. Vienne le moment d’agir ; je penserai alors. Jusque là, je veux jouir de ma liberté et n’appartenir qu’à moi-même, pour me donner à mon choix. Mais quand ce choix est fait on ne s’en dédit plus. C’est ce que dit Pompée à Sertorin dans les beaux vers, de Corneille. Je suis de l’avis de Pompée. Adieu dearest Princess. Pour la première fois depuis bien des jours, je vous ai écrit la cœur un peu à l’aise. Mais cette aise a encore besoin de confirmation. G.
Je ne sais ce qu’il y a de vrai dans les bruits de journaux sur l’état grave de M de Talleyrand. Je vais écrire à la duchesse de Dino. Vous pensez bien que je n’ai par remis votre lettre à Mad. de Meulan.)
Vendredi, 10 h. Je n’ai pas de lettre ce matin. J’en attendais pourtant. Jusqu’à ce que je sois pleinement rassuré sur votre santé, je n’aurai aucun repos.
14. Val-Richer, Mardi 15 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement, mon petit ami est et sera toujours à votre disposition. Je comprends que ce ne soit qu'à la dernière extrémité. Si vous avez besoin de lui, vous arrangerez cela vous-même, car il ira, ou bien il est peut-être déjà allé vous voir dans sa promenade sur le Rhin. A part ses inconvénients, il est très intelligent, très zélé et très sûr.
Je regrette que vous ayez rebuté notre neveu Tolstoy. Il serait allé vous chercher très volontiers, il croyait avoir quelque chose à réparer. Pourquoi fermer la porte aux petits repentirs ? Dieu ne la ferme pas aux grands. Vous êtes disposée à exiger beaucoup ; quand on est exigeant, il ne faut pas être susceptible. J'étais là quand vous avez traité sévèrement ce pauvre garçon ; je vous aurais arrêtée si j’avais pu. Il n’y avait pas moyen.
L’épitaphe de M. de Meyendorff pour le Prince de Schwartzenberg est excellente je devrais dire belle, car elle résume en deux traits d’une vérité frappante et d’une précision élégante, tout ce qu’il y a eu de moralement et politiquement grand dans la vie du Prince de Schwartzenberg. C'est la perfection du genre. Qui Caesari imperium imperioque Caesarum dedit est particulièrement heureux. Je me permets de soumettre à M. de Meyendorff un petit amendement, rededit au lieu de dedit. Ce serait, je crois, d’une aussi correcte latinité, et peut-être historiquement encore plus exact.
L'Empereur avait perdu son Empire, et l'Empire, son Empereur ; Schwartzenberg les a rendus l’un à l'autre. Pardonnez-moi de vous faire ainsi truchement latin, et veuillez remercier. pour moi, M. de Meyendorff. J’aimerais encore mieux communiquer avec lui sans truchement.
En fait de raretés, je ne suis curieux que les hommes rares, mais je le suis beaucoup. Est-ce que nous ne nous rencontrerons jamais chez vous, rue St Florentin ? J’attends bien impatiemment votre lettre d'aujourd’hui.
J’espère que vous ne vous serez pas trouvée mal une seconde fois en vous habillant.
Le mot de M. de Meynard m'inquiète : ce serait manquer au respect. Il a raison ; auprès des Rois, le respect passe avant tout, même avant la santé. C’est beau mais c’est lourd, et vous êtes bien faible pour porter ce fardeau.
Toujours point de nouvelles. Ce sera quelque temps notre état. Il y a évidemment parti pris de se tenir tranquille. Tâchez de prendre quelque intérêt aux querelles des évêques. Les questions religieuses sont et seront de plus en plus à l’ordre du jour. Il faut aux hommes des questions et des passions seulement ils en changent. Pour mon compte, je ne serais pas très fâché de ce changement là ; un concile me consolerait de la chambre. Mais nous pourrions avoir un synode. Le président serait bientôt bien embarrassé de ces Parlements-là. Il ira le 10 Août prochain, inaugurer l’ouverture du chemin de fer de Paris à Strasbourg. C'est un discours à faire sur le Rhin. Il sera écouté bien attentivement des deux rives. Adieu, princesse.
Je ne fermerai ma lettre qu'après avoir vu mon facteur. Pauvre homme il arrivent bien mouillé ; il pleut toujours.
10 heures
Votre lettre est un peu moins abattue, mais toujours bien fatiguée. Adieu, adieu. J’ai une bonne lettre de Marion. G.
14. Val Richer, Vendredi 10 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne sais si ceci ira vous trouver à Paris, ou à Ems. J’écris toujours. J’ai une raison pour n'être pas fâché que vous partiez. L’agitation de ce moment-ci vous fatigue. A part l’agitation de l'amusement, vous avez celle de l’intérêt que vous prenez aux choses mêmes. Vous vous donnez quelquefois l’air de croire à la très fausse maxime de votre fils Paul : not to care : mais au fond, votre nature à cette insouciance prétendue philosophique, et qui n’est qu’un pauvre petit égoïsme. Les choses qui méritent de toucher les hommes vous touchent, réellement, et quand vous êtes dans le foyer où elles se traitent, vous vous y consumez.
Ems vous reposera, et j’espère que l'ennui n’y sera pas trop fort. Dites vous seulement que vous êtes décidé à tirer parti des gens que vous y trouverez et vous en trouverez.
Si je croyais aux apparences, et si j'avais goût aux parallélismes historiques je m'amuserais à comparer 1853 et 1840. Il y a un grand air de ressemblance. Le traité à quatre n’est pas encore fait, et ne se signera probablement pas ; mais c’est la même situation à propos de la même question. Et toujours l'Angleterre protectrice de l'Empire Ottoman, envers et contre tous ; France ou Russie. Elle doit vraiment avoir grand crédit à Constantinople. Je ne puis croire que vous engagiez la grande affaire, la conquête sur le terrain où vous êtes aujourd’hui. Quel que soit l'état de l’esprit public, en Russie, le prétexte est trop peu sérieux aux yeux de l'Europe. Tout le monde vous donnerait tort, encore plus qu'à nous en 1840 pour notre patronage de Méhémet Ali.
Duchâtel est-il encore à Paris ? Je le présume d'avoir une lettre de Mad. Lenormant. Je suppose qu’il partira pour Vichy en même temps que vous pour Ems.
Onze heures et demie
J'adresse donc encore ceci à Paris. Adieu. Adieu. G.
18. Val-Richer, Mardi 8 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous arrivez aujourd’hui à Paris. Peut-être y êtes vous déjà, car de Beauvais à Paris il n’y a que huit postes et demie. Vous y devez trouver je ne sais combien de lettres, les N°11, 12, 13 d’ici, 15 de Caen et 16 d’ici. J’ai reçu ce matin votre dernier mot de Boulogne, N°18.
Je ne vous réponds pas sur le sujet dont vous me parlez. Nous en causerons en pleine liberté. Il n’y a pas un de vos sentiments que je ne comprenne et qui ne me plaise dans le sens le plus intime et le plus sérieux de ce mot, si souvent profané. Gardez-les tous dearest ; ce sont des notes justes, l’harmonie s’y mettra. Que seulement le calme physique vous revienne. Je suis sûr que si vous vous portiez bien vous ne seriez pas en proie à ces troubles dont vous vous plaignez. Vous avez le jugement si droit l’esprit si haut et si fin que certainement, quand l’état de vos nerfs n’y fait pas obstacle vous savez voir toutes choses, choses et personnes, comme elles sont, mettre chacune à sa place, en vous-même comme au dehors, choisir décidément ce qui est vrai, juste, ce qui vous convient, et accepter, dans votre choix, les inconvénients, les difficultés, les peines même la part de mal enfin, inséparables de toute résolution. comme de toute situation humaine. Vous voulez que je vous apprenne à être calme. Je ne sais pas un si beau secret. Mais si j’ai un peu de calme, c’est que pour mes sentiments aussi bien que pour mes actions, dans ma vie intérieure comme dans ma vie extérieure, j’ai assez de prévoyance et peu d’irrésolution. Quand quelque chose commence en moi ou autour de moi, j’en vois promptement et d’un coup d’œil assez libre toutes les faces, toutes les conséquences. Si j’accepte, j’accepte sans hésitation sans retour le bien et le mal, la joie et la peine, l’avantage et l’embarras, le mérite et le tort même, s’il y en a. Et dans la suite, à mesure que les choses se développent et portent leurs fruits, bons ou mauvais, je ne suis pas plus incertain qu’au début. Je ne connais guère le regret ni le repentir. Je veux ce que j’ai voulu ; je me tiens à ce que j’ai fait. Je n’ai point la prétention que ma vie soit sans souffrances et ma conduite sans fautes. Je porte le poids des unes et la responsabilité des autres sans m’en plaindre, sans en déplacer les causes, car ces causes, je les ai en général connues et voulues. En général, dans chacun de mes sentiments, de mes actes, je pressens leur avenir et j’y consens. Et s’il m’arrive, comme il m’arrive en effet de n’avoir pas tout prévu, je ne m’en prends qu’à mon insuffisance et j’y consens encore ; car à tout prendre, en fait d’intelligence et de sagacité, je n’ai point droit de me plaindre de la part que Dieu m’a faite. En tout, je suis soumis, Madame, soumis aux imperfections de la condition humaine à mes propres imperfections aux volontés de Dieu, à mes propres volontés. Je ne me révolte point; je ne me tracasse point ; je ne délibère point à chaque minute, je ne tâtonne point à choque pas. Je veux surtout de l’unité dans mon âme et dans ma vie, et pourvu que l’ensemble me convienne, je ne marchande pas sur les détails. Quelle est, dans cette disposition la part de mon naturel et celle de ma volonté ? Je l’ignore ; mais si j’ai quelque sérénité, voilà à quoi elle tient.
Vous êtes femme, dearest, et par conséquent, un peu plus mobile, un peu plus accessible que moi à l’empire des impressions du moment. Mais vous avez beaucoup d’esprit, de raison, de courage, de dédain. Vous allez naturellement à tout ce qui est grand, simple. Soyez sûre qu’avec un peu de santé et d’habitude, il vous viendrait... laissez-moi dire il vous viendra du calme. J’ai du bien à vous faire, comme du bonheur, à vous donner. Vous me dîtes que je vous ai aidée à supporter vos peines. Je vous aiderai à vous affranchir de ces troubles intérieurs, de ces incertitudes de ces luttes répétées où l’âme se lasse et perd sa force la force dont elle a besoin, et pour résister, et pour jouir. Que je serais heureux de voir la sérénité se répandre sur votre noble physionomie, et de goûter le charme infini de votre affection. sans crainte qu’elle vous fasse mal !
Je voulais vous parler des élections anglaises qui prennent, ce me semble, un tour bien conservateur. Mais je n’y ai plus pensé. A demain les affaires. Adieu. Vous ne vous figurez pas ou plutôt vous vous figurez bien avec quelle impatiente j’attends votre première lettre de Paris. G.
Mercredi 10h.
Je reçois à présent même votre N°19 de Paris. Au nom de Dieu, calmez-vous, soignez vous. Que la fatigue du voyage, de l’absence, de la mer disparaisse. Je me charge du reste. J’attends votre réponse à ma proposition pour la semaine prochaine. Les N°12 et 18 vous ont été adressés à Londres. Le N°15 à Boulogne, porte restante- il était écrit de Caen. Le N°17 vous a été adressé à l’hôtel Bristol.
19. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Comment passerez-vous votre temps ? J’en suis préoccupé. L’ennui vous gagne aisément. Il y a bien peu de monde à Paris. En Angleterre. vous aviez trop d’amis, trop de conversations. Je crains qu’en France il ne vous en manque. Contez-moi en détail votre journée. Quoique j’espère aller bientôt y regarder moi-même, je veux savoir tout de suite ce qui en est. Vous n’avez pas contre l’ennui les ressources d’un homme, des affaires à soigner, le travail, l’étude. Je voudrais vous indiquer quelque chose d’intéressant à lire. Savez-vous lire, lire de manière à remplir quelques heures dans votre journée? J’ai peur que non. Votre vie s’est passée dans les relations de personne à personne, à voir, à causer, à écrire. Les grandes affaires, vous les avez traitées comme on traite les petites en conversation, en visite, en correspondance dans le train ordinaire de la vie. C’est de beaucoup la manière la plus amusante, et aussi la plus naturelle, et peut-être aussi la plus efficace. Vous y avez acquis, c’est-à-dire développé cette admirable intelligence des personnes, des caractères, cette disposition sympathique qui n’enlève point a votre esprit son indépendance, cette pénétration soudaine qui fait qu’avec vous rien ne se perd, que tout a un sens pour vous, que la moindre parole vous dit tout, que les éclairs les plus fugitifs de la physionomie ou de la pensée frappent vos yeux et vous illuminent comme serait le plus grand jour. Tout cela est exquis charmant et quand je suis après de vous, j’en jouis avec délice. Mais quand vous êtes seule que faites-vous de tout cela ? Vous souffrez de vos qualités de votre supériorité. Elles n’ont pas leur emploi accoutumé et il est difficile de leur en trouver un autre. Enfin dites-moi le compte de vos heures. Avez-vous jamais lu mes deux volumes sur l’histoire de la Révolution d’Angleterre jusqu’à la mort de Charles 1er ? Si vous ne les avez pas lus, je vous les ferai porter Je crois que c’est vrai, et assez vivant. J’ai recommencé ici à m’occuper de l’époque qui suit, du gouvernement de Cromwell. Les Anglais à mon avis ne comprennent pas ce temps-là, surtout les hommes, leurs idées, leurs passions, leurs intérêts, et l’amalgame étrange l’action et la réaction continuelle de ces trois causes l’une sur l’autre dans leur conduite et dans leur âme. C’est peut-être une fatuité de ma part ; mais je crois qu’il faut avoir vu & presque fait une révolution pour en comprendre une autre. 10 h. 1/2. Voilà le facteur qui m’apporte votre n° 20 et qui repart sur le champs. Il faut que je lui donne ma lettre. Vous êtes donc un peu mieux, et je vous verrai le 18. Et que votre lettre est bonne, charmante. J’y répondrai demain. Ne vous inquiétez pas de moi. Je me porte et je me porterai à merveille. Soignez- vous, soignez vous. Que je vous trouve un peu moins faible, un peu moins lasse. J’en ai tant d’envie ! Que tous les mots sont faibles ! Adieu. Adieu. Je ne comprends pas que vous n’ayez pas les N°12, 13 et 15. Les deux premiers ont été envoyés à Londres. Le troisième à Boulogne, poste restante. Il faut l’y faire redemander.
22. Val-Richer, Jeudi 24 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il m’est revenu hier, je ne sais d’où une des lettres perdues, le N°14, du 17 Juin ; il me manque encore, en retranchant le jour de lacune, deux lettres, les N°12 et 13. Que contenaient-elles de si curieux qu’on les ait gardées ? Me reviendront-elles aujourd’hui demain. Quand on garde des lettres, on devrait bien m'en prévenir pour m'ôter sinon le déplaisir, du moins, l’inquiétude. Enfin c’est passé.
Vous n'êtes pas plus souffrante. Vous me dites même que vous êtes un peu mieux, et que si vous aviez Aggy ou Marion, cela irait à peu près. Je ne désespère pas que Marion vous envoie Aggy. Je lui ai dit tout ce qui pouvait l’y décider.
Que j'ai le coeur triste, ou tranquille, je n’ai pas plus de nouvelles. Il n’y en a pas et on veut qu’il n’y en ait pas. Nous sommes assez contents dans ce pays-ci. On nous a enfin donné notre chemin de fer. Il est proposé et il sera adopté ces jours-ci. Nous ne sommes point enthousiastes, plutôt même froids et peu confiants, mais pas du tout hostiles. Nous ne pensons pas à autre chose qu'à ce qui est ; nous, le peuple. Ma situation personnelle, dans ce pays-ci, n'a peut être jamais été meilleure, on se rappelle mon temps volontiers, avec estime et regret et on me sait gré de n'avoir contre ce temps-ci, ni mauvais vouloir, ni humeur.
Le Président prépare sans bruit ses voyages. On dit toujours qu’il ira en Algérie. Je regrette bien les méprises du, ou les malentendus sur le Roi Léopold. Pourquoi de si petites raisons dérangent-elles de si grands intérêts ?
Vous vous êtes calomniée ; vous connaissez Les causeries du Lundi de M. Ste Beuve. C’est tout simplement le Recueil des articles de biographie, de littérature, d’anecdotes, qu’il fait tous les lundis dans le Constitutionnel. Quand vous aviez le Constitutionnel, vous les lisiez quelquefois, ou vous en entendiez parler. Car on en parle assez le mardi. Ce sont de petits récits, de petit portraits, spirituels bien tournés et amusants. On en a fait trois ou quatre petits volumes qui ont assez de succès. Vous n'êtes pas si peu littéraire que vous le dites seulement vous n'avez nulle envie de le paraître. Plutôt le contraire.
J’attends avec curiosité les élections anglaises. Je suis sûr qu'elles seront obscures. Il faudra encore attendre pour les comprendre. Il se fait certainement là une transformation sourde des partis et de la politique. Je persiste à n'en pas craindre beaucoup Il est impossible qu’un tempérament fort et depuis longtemps bien gouverné, ne résiste pas mieux à une maladie que les tempéraments irritables et usés par les sottises.
Avez-vous conservé du moins le Galignani ? Lisez quelquefois les articles du Spectateur. Quoique radicaux au fond, ce sont les plus impartiaux, et peut-être les plus clairvoyants.
Adieu, chère Princesse. Je ne fermerai ma lettre qu'après avoir reçu la vôtre, car j’y compte aujourd’hui, et j'ai le coeur léger, en vous disant adieu.
10 heures
Voilà votre N°16 du 19 Juin. Il me plaît comme Car on en parle assez le mardi. Ce sont de agrément pour vous, mais non comme fatigue. Je suis fort aise d'être tranquille sur votre retour. Je ne comprenais pas qu’il ne s’arrangeât pas ainsi. Adieu, Adieu. G.
22. Val-Richer, Samedi 12 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Savez-vous qu’elle joie vous me donnez quand vous me dîtes que mes lettres vous font un peu de bien ? Je vous ai constamment devant les yeux, souffrante, abattue, agitée. Je voudrais être constamment là, verser à chaque minute du baume dans votre âme, dans vos nerfs. Ils m’embarrassent vos nerfs. J’ai envie de leur en vouloir, et je ne peux pas. Vous leur devez peut-être cette susceptibilité, cette rapidité, cette finesse d’impressions qui s’allient si bien à l’élévation de votre esprit, au sérieux de votre air, de toute votre manière. Guérissez vos nerfs, Madame, mais restez comme vous êtes. N’y changez rien, je vous en conjure. Je ne veux supprimer en vous que la souffrance. Je ne vous donnerais plus de conseils, s’ils devaient vous induire à changer en vous quelque chose.
Quand je vous ai vue pour la première fois, vous m’avez frappé comme une personne nouvelle pour moi, et pourtant sur le champ comprise, parfaitement comprise. Ce qui s’est tout à coup rêvée à moi, c’est la grandeur de votre nature. Avec votre accent si ému, votre regard si triste, vous conserviez si évidemment toute la liberté, toute la fierté de votre pensée. Vous aviez l’air de regarder d’en haut, de toiser pour ainsi dire, les idées les personnes, à mesure qu’elles passaient devant vous. Il y avait dans votre physionomie, dans votre maintien dans votre langage tant de dignité, d’indépendance, et en même temps un tel besoin. D’être soulagée soutenue ! Pendant le dîner, je ne sais ce que je vous disais, vous vous êtes penchée une ou deux fois vers moi, comme entrevoyant et venant chercher dans mes paroles quelque chose qui vous était doux ; et à l’instant même, vous vous êtes relevée et détournée, comme vous repliant sur vous-même et doutant qu’il pût vous venir du dehors, d’un inconnu, quelque distraction. Je crois vous avoir déjà dit qu’il m’était resté de ce premier jour, une impression profonde. Et elle était juste ; ce que je connais en vous aujourd’hui, je l’ai entrevu ce jour là une grande âme qui ne peut vivre seule. Je ne sache rien de comparable à ce double attrait.
5. h. 1/2 Je viens de lire mes journaux. Je trouve le discours de Sir Robert Peel, un peu trop empreint, vers la fin, des habitudes d’opposition. Il reproche bien amèrement aux Ministres, l’emploi qu’ils ont fait du nom de la Reine. Faut-il appliquer le mot impudeur à des hommes dont on est si près de se rapprocher ? Peut-être les mœurs anglaises sont-elles en ce genre moins susceptibles que les nôtres. Du reste le discours est excellent et très frappant. Nous verrons à l’œuvre la Sagesse des deux côtés. Je suis charmé que vous ayez si bien fomenté, celle de Lord Melbourne. Si les conservateurs de France ont autant de persévérance et de zèle que ceux d’Angleterre, la dissolution, nous sera très bonne. Je ne crains, pour eux, que le découragement et le laisser aller. La grande infériorité dès honnêtes gens c’est qu’ils ne savent pas se lever aussi matin que les brouillons. S’ils avaient comme ceux-ci, le Diable au corps, ils gagneraient toutes les batailles.
Dans le n° 15, je crois, je vous avais dit un mot de mon meeting de Caen ; un seul mot, pour vous dire que cela ne valait pas la peine d’en écrire. J’espère que ce N° vous reviendra enfin, et aussi les N°12 et 13 qui sont partis de Lisieux pour Londres le 29 juillet et le 1er août. Vous devriez les avoir depuis longtemps. Dimanche 7 h 1/2 J’ai été interrompu hier par toutes sortes de visites, d’abord je ne sais combien de voisins qui se sont abattus chez moi comme une volée de pigeons, puis le Duc Decazes qui va à Bordeaux, et s’est détourné de 20 ou 30 lieues pour venir me dire pas grand chose.
Ce matin toute ma vallée est enveloppée d’un immense brouillard qui va, vient, monté, descend. Il essaie de se défendre contre le soleil que j’entrevois à l’horizon, en face de moi. Ce n’est encore qu’un point rougeâtre à chaque instant surmonté, voilé par le brouillard. Mais ce point, c’est la chaleur, c’est la lumière. Le brouillard sera vaincu, dispersé, chassé. Dans quelques heures mon ciel sera pur, ma vallée brillante. Plût à Dieu que ce fût toujours là l’image de la vie !
35. Lisieux, Jeudi 14 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci est pour le second jour, un morceau de pain, rien qu’un morceau de pain. Je viens de me donner une demi-heure de libre rêverie. J’appelle cela rêverie je ne sais pourquoi. Je ne rêve point ; je vois, j’entends, je sens très distinctement, très positivement. C’est aussi près de la réalité qu’il se peut quand ce n’est pas la réalité. Il est vrai qu’il y a un abyme. Mais en dépit de cet abyme, mon souvenir ne ressemble point à ce qu’on appelle de la rêverie ; il est clair, précis, animé. Il n’y a point de nuage, il n’y a que de la distance entre vous et moi. Cela me vient, je crois de vous et de ce que vous êtes, aussi bien que de moi-même vous êtes une nature, simple vraie à contours grands et nets. Il n’y a en vous rien de vague d’incertain rien qui, vu de loin, s’altère, s’efface, se confonde avec les vapeurs de l’horizon. De loin, ce n’est que votre image, mais une image lumineuse, vivante, comme vous l’êtes de près vous-même ; une image qui est à l’épreuve de l’éloignement comme de l’oubli, et à laquelle l’espace ni le temps ne peuvent rien ôter.
Dearest, je m’épuise en paroles pour vous donner quelque idée de ce que je sens aujourd’hui. Bien vainement à coup sûr. J’aime mieux m’en rapporter à vous. Parlez-vous de ma part ; et quand vous vous serez dit tout ce que vous saurez, ajoutez encore, et puis encore et puis toujours. Vous n’irez jamais au bout de ce que je vous dirais. Je vais monter en calèche pour le Val-Richer. J’y serai dans une heure et demie. C’est dans mon Cabinet seulement, auprès de ma fenêtre, que je puis reprendre avec quelque douceur nos conversations par lettres. Ici je ne sais sentir que la présence d’hier ou la séparation d’aujourd’hui. Adieu. Adieu. Adieu. G.
36. Val-Richer, Jeudi 14 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà la troisième fois aujourd’hui. Je m’étais promis ce matin d’attendre à demain. Mais j’en ai trop envie. Ma solitude me pèse trop. Je ne suis pas en train de résistance. Je suis fatiguée. J’ai voyagé cette nuit par un temps effroyable, la pluie, le vent, le froid, et une pauvre lune qui se débattait pour jeter au milieu de ce chaos un peu de lumière. Je ne me suis pas bien nettement aperçu de tout cela. Je rêvais, mais d’un rêve qui ne parvenait pas à l’illusion. Il faut de la foi en rêve comme dans la veille. Je crois que sans la regarder, sans y penser cette tourmente de l’atmosphère m’a troublé et dérangé au fond de cette voiture où j’étais pourtant bien seul, bien enfermé.
Le soleil est revenu depuis que je suis ici ; du soleil pour mes yeux, mais non pas pour mon âme. Il y a longtemps que je n’ai été à ce point en disposition triste et faible. On me croit beaucoup de force, et j’en ai. Mais la force ne supprime aucune de nos faiblesses. Elle les empêche Es, rien ne de gouverner notre conduite; voilà tout. Du reste je ne sais pourquoi j’appelle cela une faiblesse. Le vide est immense mais pas trop, pas plus que n’était le bonheur. Il est juste d’en sentir l’absence aussi vivement que la possession. Mes enfants, m’ont reçu avec transport. J’en ai été ému jusqu’à la reconnaissance. Je les aurais volontiers remerciés de leur joie. Je désire que vous les connaissiez. Mais vous ne les verrez jamais habituellement. C’est grand dommage. Ils vous aimeraient. Ils ont le cœur très prompt, très développé. Leur affection joyeuse, confiante, caressante, vous ferait du bien. Je voudrais vous voir entourée de sentiments doux, tendrement empressés. Je ne serais point jaloux de ce que vous y pourriez prendre de distraction même de plaisir.
Je vous trouve si seule de cœur ! Cela pèse sur le mien à toutes les heures du jour. Quand je ne suis pas là, vous êtes obligée de tout faire vous-même pour vous. Cependant si je devais perdre quelque chose la moindre chose à ce que vous trouveriez ailleurs aurais-je assez de vertu pour m’y résigner ? Je ne crois pas. Certainement non, je ne crois pas. Et me voudriez-vous cette vertu là ? J’espère bien que non. Imaginez qu’hier en arrivant à l’hôtel des poste pour monter en voiture, la première personne que j’aie aperçue dans la cour, c’est l’ambassadeur de Sardaigne qui venait embarquer, dans la malle poste de Turin, ce savant Prémontais qui a dîné avec nous mardi, et qu’il aime beaucoup. J’ai eu de cette rencontre, une joie d’enfant. Il me semblait qu’à côté de M. Brignole, j’entrevoyais une autre figure, seulement, il était entre elle et moi. C’était autrement mardi. J’aime mieux mardi.
Vendredi, 8 heures
J’ai beaucoup dormi. La pluie est ce matin plus épaisse que jamais. Je n’y ai pas regret. S’il faisait beau, il faudrait se promener, aller, venir être un peu en harmonie avec le soleil. Je resterai beaucoup dans mon cabinet. Mais j’y ai regret pour vous. Vous avez besoin d’air, de promenade moralement comme physiquement. Et puis soit santé, soit caractère, ces contrariétés-là vous atteignent plus que moi. En tout vous êtes sensible aux petites contrariétés. " Je suis un peu enfant gâté. " me disiez-vous l’autre jour. Il y a du vrai. Le cours de votre vie est pour beaucoup en cela. Vous avez été cruellement frappée, peu contrariée. Vos épreuves se sont passées dans la région haute. Au dessous dans celle des petits intérêts, et des petits plaisirs, vous avez eu, vous avez fait tout ce que vous avez voulu. Il en résulte quelques fois. Et vous entre la gravité si égale, si dédaigneuse de votre nature, et votre vivacité, votre susceptibilité sur des choses qui au fond ne vous font rien, et ne vous touchent qu’à la surface un contraste singulier pour qui ne vous connait pas. J’aime ce contraste. Il dit qui vous êtes, d’où vous venez, comment s’est passée votre vie. J’aime que le caractère les impressions, les habitudes, d’une personne, d’une femme surtout soient l’écho vrai, l’image vivante de sa destinée.
Il faut aux hommes plus d’indépendance de disponibilité ; il faut qu’ils soient plus prêts et moins sensibles à toutes choses. Restez comme vous êtes Madame, un peu enfant gâté dans le menu détail de la vie. Cela me plait, et je n’y perdrai rien. Vous voyez où j’aboutis toujours.
11 heures Voilà votre lettre, votre charmante lettre. Vous aimez que le dernier mot soit le plus tendre. Eh bien oui, ce sera le plus tendre, de beaucoup le plus tendre. Quelque mal que vous en disiez quelques fois, rien ne vaut adieu. Adieu, Adieu. G.
43. Val Richer, Samedi 6 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de la lettre de M. de [Meyendorff] qui m’a beaucoup intéressée. Je suis charmé que les miennes l’intéressent un peu. J’aimerais bien mieux causer avec lui. Je lui dirais que je n'ai jamais pensé à un protectorat collectif des Chrétiens en Turquie. J'en sais, comme lui, l'impossibilité pratique. Ce qui me paraissait praticable, c'était que votre Empereur, puisque on regardait un engagement de la Porte envers lui comme attentatoire à l’indépendance Ottomane, proposât lui-même que la Porte prit le même engagement, non plus envers lui seul, mais envers toutes les Puissances Chrétiennes, laissant chacune de ces Puissances protéger ensuite, pour son compte, ses propres dieux Chrétiens, l’une les Grecs, l'autre les Catholiques, l'autre les Protestants &
Mon idée n'était qu’un expédient pour sortir de la difficulté du moment par une porte qui ne fût plus seulement Grecque et Russe, mais Chrétienne et Européenne, qui fût par conséquent plus grande pour votre Empereur et unobjectionable pour les autres. Ce sont les situations prises qui décident. des affaires je voyais là une bonne situation à prendre, bonne pour la dignité et pour la solution. Voilà tout. Cela ne signifie plus rien aujourd’hui. Le sultan a beau se griser et traîner. L'affaire finira bientôt puisque tout le monde veut, qu'elle finisse. Les embarras ne sont des périls que lorsqu’il y a des puissants qui veulent en faire des périls.
Vous ne lisez probablement pas les récits de la révolution de Chine. S'ils sont vrais il y aura bientôt là, pour l'Europe, de nouveaux Chrétiens à protéger. Seront-ils Grecs, Catholiques ou Protestants ? Je crois que vous avez une mission religieuse à Pettiny. Du reste, ces Chrétiens chinois, orthodoxes ou non, me paraissent en train de se bien protéger eux-mêmes. Convaincu, comme je le suis, que le monde entier est destiné à devenir Chrétien, je serais bien aise de lui voir faire, de mon vivant, ce grand pas.
Avez-vous des nouvelles de la grande Duchesse Marie ? Le voyage de la grande Duchesse Olga en Angleterre est-il déterminé par la santé de sa sœur ? Dieu veuille épargner à votre Empereur cette affreuse épreuve ! Il m’arrive le contraire de ce qui arrive, dit-on, ordinairement ; je deviens en vieillissant, plus sympathique pour les douleurs des autres ; mes propres souvenirs me font trembler pour eux comme pour moi-même.
Je voudrais vous envoyer un peu du beau temps que nous avons depuis quelques jours ; très beau, mais pas chaud. C'est le vent du Nord avec le soleil. Nous n'aurons décidément point d'été. Vous ne me dites rien de l'effet de vos bains ; mais à en juger par l’air de votre silence, Schlangenbad vaut mieux qu'Ems.
Changarnier parle en effet trop de lui. Mais quand vous n'avez rien à faire des gens, vous ne savez pas assez les prendre par le bon côté, et mettre à profit ce qu’ils ont tout en voyant ce qui leur manque. Vous vous ennuyez trop de l'imperfection dès qu’elle ne vous est bonne à rien.
Adieu, adieu. Je ne fermerai ma lettre que quand mon facteur sera venu ; mais il ne m’apportera probablement rien à y ajouter. Adieu.
Mots-clés : Âge, Aristocratie, Autoportrait, Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Femme (santé), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Internationale), Politique (Russie), Politique (Turquie), Portrait, Portrait (Dorothée), Religion, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
46. Paris, Samedi 22 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je viens de lire les deux pièces de votre Empereur. La première la réponse à la déclaration de guerre, est bien faite, modérée, simple, digne et plausible, quoique toujours entachée, à mon avis, du défaut que j’ai toujours trouvé, vous le savez dans le langage de Pétersbourg depuis un an, ne pas avouer assez franchement la politique géographique, naturelle et traditionnelle de la Russie dans ses rapports avec la Turquie. Vous auriez inspiré moins de méfiances si vous aviez accepté hautement votre situation permanente et obligée, et l'on vous aurait su plus de gré de votre modération depuis 1830. La seconde pièce sur les publications Anglaises ne me plaît pas ; elle est embarrassée et évasive sans efficacité ; elle n'affaiblira point l'impression que les rapports de Seymour ont partout produite. En tout, ne vous fâchez pas, c’est la netteté qui manque surtout à votre diplomatie. Elle s'enveloppe de sa modération comme d’un manteau, autant pour se cacher que pour se faire valoir. Parce que vous n'êtes pas, des ambitieux agressifs, vous voulez qu'on vous croie des Saints désintéressés. Et comme vous ne voulez cependant renoncer réellement, ni à votre passé, ni à votre avenir russe, cela jette, dans votre conduite et dans votre langage, des embarras, des obscurités, des inconséquences qui vous rendent suspects, et vous affaiblissent, même quand vous n’avez aucun secret dessein.
Voilà votre N° 36. Vous voyez que mon impression sur les deux pièces. ressemble à la vôtre.
Je passe à la politique privée. La question est de savoir si vous avez plus d'envie de l'appartement de Kiss. que de fierté blessée par son mauvais procédé. Je ne trouve dans votre démarche ni dans votre lettre, rien d'inconvenant pour vous, et contrairement c'est lui qui sera dans l'embarras s’il vous cède tant mieux, s'il ne vous cède pas, vous ne serez pas plus mal avec lui que vous n'êtes, et il sera encore plus dans son tort. Ne me demandez pas ce que je ferais à votre place, vous savez que mes envies sont moins vives que les vôtres et ma susceptibilité plus raide.
Je vous quitte pour recevoir l'évêque d'Orléans qui vient me parler de sa candidature à l'Académie. Il sera élu le 18 mai, ainsi que M. de Sacy. Adieu, Adieu. G.
46. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est à peine six heures. Le Soleil n’est pas encore au dessus de l’horizon. J’ai mal dormi. Je me lève. Hier en me couchant, à 10 heures et demie, je me suis figuré dans la malle-poste au lieu de mon lit courant vers vous. A peine endormi, j’ai rêvé dans la malle-poste. A quatre heures, je me suis réveillé comme si j’arrivais. Ce devait être aujourd’hui en effet. Vous en avez douté quand je vous l’ai dit. Vous avez prévu que ce ne serait pas. Dearest, voici l’exacte vérité. Je n’en étais pas sûr. Le jour du mariage de M. Duchâtel n’était pas absolument fixé. Il m’avait parlé du 25 septembre au 2 ou 3 octobre. J’ai été faible pour moi, faible pour vous. J’ai pris la supposition favorable sans y compter, pour nous faire plaisir à tous deux, pour ne pas nous donner tout à coup, à vous un chagrin, à moi le vôtre, et le mien. J’ai eu tort. On a toujours tort, avec la personne à qui l’on dit tout, à qui l’on doit tout, de ne pas dire exactement ce qui est ce qu’on croit. Il faudrait toujours braver la peine du moment pour éviter la peine à venir. Pardonnez- moi de ne l’avoir pas fait.
Votre n°46 m’a touché, et me touche profondément ; si triste et si douce ! Si vive et si raisonnable ! Le jour où j’ai un peu causé avec la petite Princesse elle m’a dit deux ou trois fois, en me parlant de vous : « une personne si supérieure, si extraordinaire". A chaque fois ces paroles me pénétraient, me charmaient ; d’orgueil si on veut, mais de ce délicieux orgueil qui naît d’une tendresse infinie, au dessus, bien au dessus duquel cette tendresse plane, dont elle fait le pouvoir et le prix.
Oui, je suis fier, fier de vous, de votre affection pour moi de votre supériorité, de cette supériorité que je connais mille fois mieux que personne dont je jouis comme personne n’en a jamais joui. Et quand je la retrouve dans les plus petits détails de la vie, quand je vois réunies en vous les qualités, les attraits les plus contraires, tant d’abandon et tant de dignité, un cœur si tendre et un esprit si ferme, une imagination si vive et une raison si droite, un caractère si passionné et si doux, une humeur si égale avec des impressions si variées, je suis heureux, heureux, Madame, bien, bien au delà de tout ce que peuvent vous exprimer de loin mes lettres, et même mes adieux.
Maintenant, voici où j’en suis et ce qui sera. Le mariage de M. Duchâtel n’étant plus rien pour moi j’ai pris la dissolution. Elle sera certainement prononcée et publique dans les premiers jours d’Octobre au plus tard. J’ai un dîner chez moi au Val-Richer, demain 26. Après-demain 27 je vais dîner à Croissanville, à 4 lieues d’ici, avec une réunion d’électeurs. Du 27 au 2 octobre, je ferai quelques courses dans l’intérêt des élections voisines. Je recevrai beaucoup de visites. Le 3 octobre encore un dîner pour moi, et une réunion d’électeurs à Mézidon, dans ce canton que je n’ai jamais visité. Le 4 un dîner à Lisieux, point un meeting, un dîner privé, mais avec beaucoup d’électeurs. Le 5 à 1 heure et demie je monte dans la malle-poste, et le 6 à 4 heures du matin, je passe dans la rue de Rivoli, pour faire le même jour, à une heure & demie quelque chose de mieux que d’y passer.
Voilà, d’ici là ma biographie et mon itinéraire. C’est long, bien long. Je ne demande qu’une chose, dearest, une seule chose. Soyez sûre, sûre aujourd’hui comme vous le serez dans deux ans, dans trois ans, que c’est aussi long pour moi que pour vous. Ne dites donc pas que vous me contez trop de petites choses, que vous me donnez trop de détails. Jamais assez. Au milieu du grand bonheur, c’est mon petit, mais très vif plaisir de vous suivre pas à pas dans tout le cours de la journée, d’assister à toutes vos actions, d’heure en heure. Il y en a une que je regrette, qui m’a un peu désagréablement ému le cœur. Vendredi soir vous avez fait de la musique devant votre monde ; et moi, je ne vous ai pas encore entendue. Je ne veux pas, la première fois, vous entendre devant du monde ; mais je voulais avoir votre première musique, à moi seul. Vous ne savez pas à quel point la musique me plaît, m’émeut. Mais c’est pour moi une impression très intime, et qui se lie tout de suite à mes impressions les plus intimes, une de ces impressions dont je n’aime pas à parler excepté à la personne à qui je parle de tout. Je vous aurais si délicieusement écoutée !
J’attends ce matin, M. de Saint-Priest, Alexis, qui vient passer ici 24 heures. Il m’en dira long sur Lisbonne, les Chartistes, Lord Howard de Walden, Saldanha, Sä de Bandeira & & J’ai recommencé hier au soir à lire à mes enfants un romans de Walter Scott. Je vous le dis pour vous montrer que j’ai complètement repris l’usage de ma gorge. Je suis ravi que vous ayez aussi bien retrouvé celui de vos jambes, Certainement c’est une preuve de force.
11 heures Le N° 47 me désole de mille façons, toutes si douloureuses. M. de L., votre chagrin, votre manque de foi, votre santé. Mes lettres suivantes vous auront été un peu meilleures. Celle-ci vous donne une certitude, de voyage, de jour. Si vous saviez que je n’ai pas pensé, que je ne pense pas à autre chose. Croyez-vous donc que je n’ai pas pensé à emmener ma mère à Paris ? Mais elle est mieux et se trouve bien ici. Je vous répondrai demain avec détail. Adieu. Adieu. Soignez-vous, je vous en conjure. Adieu. G.
49. Paris, Mardi 25 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce froid me déplait beaucoup. J’ai mal à la gorge, et très mal à propos dans une semaine de meetings et de conversations. Le soleil tout brillant qu’il est, est peu efficace contre le vent dur et sec. Enveloppez-vous bien dans le bois de La Cambre, et n'abusez pas de la voiture ouverte ; vous avez, sur ce dernier point, des habitudes Anglo-russes dont je me méfie. Vous n’avez plus que cela d' Anglo-Russe.
Hier soir, un Comité Protestant et Mad. de Champlouis avec de la musique. Bonne à ce qu’on dit, et à ce que je crois parce qu'elle m’a plu. Vous avez beau vous moquez de mon ignorance ; je persiste à accepter. mon plaisir quand il me vient. Les arts, la musique surtout ont le privilège qu’on n'a pas besoin de s'y connaître pour en jouir. Ils trouvent toujours, dans les plus inexpérimentés, des fibres qu’ils remuent, et qui à leur tour, remuent toute l'âme.
Le traité de la Prusse et de l’Autriche fait de l'effet. On dit qu’il sera communiqué à la Diète de Francfort qui l’approuvera, et qu'alors, c’est-à-dire vers l'automne, au nom de toute l'Allemagne, on demandera aux Puissances belligérantes de mettre fin, par une transaction, à une situation interminable par la guerre. On parle même déjà des bases de la transaction ; on dirait que votre Empereur a eu tort dans les deux moyens qu’il a pris pour imposer à la Porte ses demandes, sa mission du Prince Mentchikoff et l’occupation des Principautés ; mais il avait réellement quelque chose à demander, et la Porte a eu tort de lui refuser toute satisfaction, et les Puissances occidentales ont eu tort de ne pas engager sérieusement la Porte à lui en accorder une. Tous ces torts admis, on en viendrait à l’évacuation des Principautés, et à un congrès, si mieux n’aimaient votre Empereur et la Porte en finir tout de suite par quelque chose d’analogue à la Note de Vienne un peu modifiée et sans commentaire. Voilà les prédictions. Je n’ai pas trouvé Andral hier quand j’ai passé chez lui. Je lui écrivais ce matin pour le presser, si vous ne me dites pas qu’il a répondu.
Les départs commencent. Henriette part lundi prochain pour le Val Richer, avec son mari et son enfant. Pauline et les siens resteront avec moi jusqu’au 19 Mai. Nous ferons les élections de l' Académie Française le 18, et celles de l'Académie des inscriptions le 19 et le soir même je partirai, à ma grande satisfaction. Les Broglie seront retenus un peu plus longtemps à Paris à cause des couches de la belle-fille qui va très bien. Les Ste Aulaire et les Duchâtel seront partis.
Adieu, Adieu. Avez-vous repensé à Mlle de Chériny ou à quelque autre ? Je dois dire que M. de Chériny n'a pas du tout l’air d’une grande dame Allemande à qui il faut apporter sa chaise. Adieu, G
Mots-clés : Académies, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Femme (maternité), Femme (portrait), Guerre de Crimée (1853-1856), Musique, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Allemagne), Politique (Autriche), Politique (Prusse), Portrait (Dorothée), Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Santé (François)
51. Val-Richer, Samedi 30 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai tant à vous dire, tant à propos de votre N°51, que je ne sais si je ne ferais pas mieux de faire comme vous voulez, et d’attendre le 6. Je pourrais même attendre plus loin et vous ajourner, pour ma réponse comme je l’ai déjà fait à un an, deux ans. Les ajournements me plaisent. Il me semble que je prends possession de l’avenir. Mais aujourd’hui ; je ne puis pas. Quand je vous vois une idée, une impression qui met entre nous, je ne dis pas un nuage, mais tout ce qu’il y a de plus léger, une plume dans l’air, un grain de sable. Sans vos pas, il faut qu’à l’instant même je la repousse, je l’écarte que je rétablisse, de vous à moi, la parfaite sérénité, la parfaite confiance, la parfaite égalité. C’est mon droit, c’est mon premier besoin, Madame. Je ne puis souffrir que rien manque, dans votre pensée ou dans la mienne à notre affection. Je ne veux la perfection que là ; mais là, je la veux, je la veux tout à fait.
Comment dirai-je ? En y pensant, je trouve ce que vous me dites un peu ridicule et bien plus ridicule d’y répondre. J’ai eu un moment envie d’y répondre en riant, de vous envoyer la lettre d’un homme de vingt ans, bien jeune, bien ignorant bien ignoré, très épris, ne sachant pourquoi, surpris en effet, comme vous dîtes autant que charmé. A coup sûr, vous me l’auriez renvoyée en me disant que la poste s’était trompée, que ce n’était pas moi qui avais écrit cela. Vous vous seriez chargée de ma réponse Madame. Mais quelque vraie que celle-là eût été, je n’en veux pas. J’en veux une sérieuse, très sérieuse. Je ne sais pas rire si près de votre cœur et du mien.
Nous sommes du même âge, Madame. Je conviens qu’à titre d’homme. je suis un peu plus jeune que vous ; et peut-être y a-t-il des mathématiciens, des Statisticiens qui sauraient évaluer en chiffres la différence. Mais moi madame, je ne suis pas un chiffre. Je suis une créature vivante gouverné par mes impressions, mes idées, mes goûts, parfaitement indifférent aux goûts, aux idées et aux impressions des autres, ne tenant nul compte, pour ma vie intime, ma vraie vie, de ce que pensent, font, aiment ou n’aiment pas les autres, ne songeant seulement pas aux conventions, aux habitudes, aux routines des autres, ne consultant que moi, ne croyant que moi et le plus tranquille, le mieux établi des hommes dans mes sentiments et mes plaisirs, quand ils sont tels que je les veux moi, pour moi. Et je suis très sûr que je suis à cet égard, plus exigeant, et plus ambitieux que qui que ce soit.
J’ai épousé une femme qui avait près de quatorze ans de plus que mois, et puis une femme qui en avait quinze de moins. Ni l’une ni l’autre, je vous en réponds, ne s’est aperçue une minute de la différence. C’est que je les aimais vraiment. C’’est qu’elles répondaient vraiment à tous mes goûts, à tous mes désirs. C’est quelles m’aimaient de toute leur âme. Et leur âme était haute, leur cœur tendre, leur esprit rare. Elles appartenaient l’une et l’autre et par leur nature et par leurs habitudes de toute sorte, à la région la plus élevée. Il me faut tout cela. Tant que j’ai vécu auprès d’elles, j’ai senti mon affection croître comme mon bonheur. Et quand Dieu me les a enlevées, j’ai senti que je perdais, non seulement le bonheur dont j’avais joui, mais, un bonheur inconnu, inépuisable, toujours nouveau qu’elles avaient à me donner et moi à recevoir.
Dieu me traite avec une bonté, une magnificence dont je suis à la fois fier et confondu. Il vous amène vers moi, vous venue de si loin, si étrangère à mon pays, à mon passé, si imprévue, pour moi, et pourtant si sympathique à moi, à mes goûts, à mes désirs, à tout mon être, vous d’une si grande nature, d’un esprit si élevé et si aimable, d’un cœur si vif, d’un caractère si passionné et si doux ! Vous arrivez où je suis en deuil, désolée, ne regardant à rien, ne vous souciant de personne, cherchant à votre peine un peu de soulagement à vos ennuis un peu de distraction que vous n’aviez jamais l’air de trouver, donnant à tout le monde, l’idée d’un mal incurable et d’une créature supérieure à jamais abattue, isolée. Et un jour, vous me laissez voir, vous me dîtes que je vous consolerai, que je vous relèverai, que vous m’aimerez, que vous m’aimez, que nous retrouverons vous en moi, moi en vous cette intimité, ce bonheur qui surpassent, qui dominent tout ce qu’il y a sur cette terre, toutes ses joies et toutes ses douleurs ! Voilà ce qui est Madame. Voilà ce qui nous est arrivé à vous et à moi. Et vous venez me dire que vous êtes de dix mois plus âgée que moi ! Et il vous vient de là un doute qui vous préoccupe, qui vous empêche d’avoir foi, pleine foi en moi, dans mon affection, dans votre bonheur. Et vous me demandez si, moi aussi, je ne m’apercevrai pas un jour que je suis dix mois, plus jeune que vous? Ah Madame, que voulez-vous que je vous dise ? En vérité, vous nous replacez trop l’un et l’autre dans la foule. Je ne suis pas modeste. Je veux être pour vous tout ce que vous êtes pour moi, que vous trouviez en moi tout ce que je trouve en vous. Mais on nous faisant trouver. vous à moi, moi à vous, hors de toute prévoyance, de toute attente, quand notre vie intime à l’un et à l’autre semblait finie. Dieu a fait pour nous un miracle. Il y aurait plus que de l’ingratitude, il y aurait de la folie à n’en pas sentir la merveille, à n’en pas jouir avec une reconnaissance, une confiance un ravissement sans mesure comme le bienfait.
10 heures 1/2
Je ne comprends rien, rien du tout à ce retard qui me désespère. Je vous ai écrit comme à l’ordinaire. Ma lettre a dû partir de Lisieux jeudi avant- hier. Vous en aurez eu deux ce matin. C’est impossible, autrement. Mais je n’en suis pas moins désolé. Adieu, Adieu. Vous avez bien raison. Il faut être ensemble. Adieu. G.
52. Val-Richer, Lundi 2 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai quitté avec au moins autant de regret que j’ai eu de plaisir à vous revoir. J’ai trouvé ces quatre jours très doux. Serait-ce toujours aussi doux si nous passions toute notre vie ensemble ? Je le crois, pourvu que nous prissions le parti de nous dire tout. La réticence ne nous va ni à l’un ni à l'autre. Et qui se dit tout ?
J’aurai demain seulement de vos nouvelles. Je ne puis comprendre pourquoi les lettres de Dieppe mettent deux jours à venir ici. J’ai fait votre commission à Lord Cowley sur le message que le duc de Mouchy vous a apporté. Il vous trouve pleinement satisfaite. Comme il n’avait pas encore ouvert son Moniteur, il ne savait pas encore la nomination de Fould. Il en a été fort aise. Certainement c’est une bonne chose. J’ai un peu ri du soin du Moniteur à bien dire que ce serait le dernier changement de Ministres, Crise ministérielle cela ressemble, trop à un régime parlementaire. Du reste il aura raison. Son oncle gardait ses ministres.
Vous avez satisfaction sur le prétendu traité du Morning Chronicle. Tous les journaux malveillants, ou bienveillants, le traitant de fable. L’Assemblée nationale dit : " Nous croyons que le traité du 20 Mai 1851 n'existe, pas par une raison qui en vaut bien une autre, c’est que les traités de 1815 existent." Je ne trouve du reste absolument rien dans mes journaux.
Quelles nouvelles me donnerez-vous de votre jambe ? Je suis convaincu que, si vous ne faites pas d'effort pour marcher trop tôt, ce ne sera pas long. C’est un grand déplaisir que de vous voir ou de vous savoir souffrante ; je ne veux pas sympathiser avec l'exagération de vos impressions, et j’ai l’air de ne pas me soucier de votre mal. Portez vous toujours bien, je vous en prie.
J’ai retrouvé ma maison en bon état. Je suis un peu fatigué. A Rouen, je ne me suis pas couché ; je n’ai fait que m'étendre sur un lit. Il fallait se relever à 2 heures et demie. Je suis encore très disponible ; mais je m'en ressens quelques jours.
J’ai vu Olliffe à Trouville. Je lui ai rendu compte de vous. Il ne m’a donné pour vous que les conseils que vous suivez. Il doit faire une course à Paris dans huit ou dix jours. J’aimerais mieux que ce fût dans quinze et je le lui ai dit. Il quittera Trouville à la fin du mois. M. Molé a été pris le lendemain de son arrivée, d’une névralgie d’entrailles, comme dit Olliffe, qui l’a assez inquiété. Il est reparti sur le champ.
Je n'ai vu personne d'ailleurs à Trouville. Je n'y ai passé que trois quart d'heure. Il y a un monde énorme, comme à Dieppe. Le temps est toujours magnifique. J’aurai mes Anglais Mercredi, ou Jeudi. Adieu. Adieu.
J’aimais mieux la semaine passée. Adieu. G.
P.S.: Mes vraies amitiés à Aggy. J’ai été charmé de la retrouver, et de la retrouver près de vous.
53. Val Richer, Lundi 29 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Deux lignes pour votre arrivée demain à Paris, quoi qu’il y ait déjà une lettre de moi qui vous y attend. Je suis bien aise que vous y soyez de retour malgré la saison, vous y aurez toujours plus de ressources qu'ailleurs ne fût-ce que vos diplomates. Mais de quoi vous parleront-ils maintenant ? Le Moniteur m’a apporté hier l’assentiment de la Porte. Cette question vous a agitée outre mesure. Mais il n’y a jamais de mesure dans votre agitation. Comme je vous le disais, on est très content à Londres, le Cabinet du moins. On m'écrit avant. hier : " Notre session a fini avec éclat, et le gouvernement jouit d’un repos absolu. L'opposition a disparu, et le succès de Lord Aberdeen est tout ce que ses amis pouvaient désirer. On a reproché au Cabinet une attitude un peu molle sur la question du dehors ; mais vous savez ce que valent, ces sortes d'attaques, et la position est assez forte pour nous permettre une grande modération. D'ailleurs, il est plaisant que ce soit les soi-disant amis de la Turquie qui veuillent la guerre, laquelle lui serait probablement funeste. "
Reeve va se promener à Constantinople. Faites vous lire, dans le Quaterly Review de Juin, un article sur Lord Palmerston et toute la politique anglaise à propos de l'ouvrage de M. de Ficquelmont. Il vous intéressera. Adieu, Adieu, avant quinze jours, nous aurons bien causé. G.
54. Val-Richer, Mercredi 4 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis très contrarié des quinze jours d'immobilité auxquels Velpeau vous condamne ; il a probablement raison. Mais c’est bien ennuyeux. J’aurais mieux fait de ne pas aller vous voir ; vous ne seriez pas montée dans ma chambre, et vous ne seriez pas tombée. C'est là tout ce que j'ai de mieux à vous dire.
L'insignifiance des journaux est complète. Ceux qui ne peuvent pas critiquer ne veulent pas louer. Pour surcroît le Journal des Débats, m'a manqué hier. Quand on supprime ainsi à l’esprit son aliment, on devrait supprimer aussi l'esprit lui-même. Cela se fera peu à peu.
J’ai eu hier une longue lettre de Barante qui prévoit ce résultat, car il me dit : " Lorsqu'on ne s’intéresse pas à soi-même on est indifférent à tout ; l’esprit s'éteint quand les sentiments sont glacés ! "
Il m’écrit du Mont Dore, où il est allé pour ne pas être repris l’hiver prochain de son extinction de voix.
Jeudi 5 Août
Je n’ai pas fait partir hier cette page qui n'en valait pas la peine. Vous ne m’avez pas écrit non plus. J’espère bien que ce n’est pas quelque mauvaise raison, accident ou autre. Je n'ai pas plus de nouvelles aujourd’hui qu’hier.
Mon fils, m'en apportera peut-être quelqu’une demain il est allé passer 48 heures à Paris pour un examen. Mes Anglais arrivent aussi demain.
Je vois que les élections des conseils généraux sont ce que j’attendais, ou immense majorité ministérielle c’est-à-dire présidentielle. Il me semble aussi que les pétitions impériales commencent à circuler. On m'écrit que les exilés espèrent quelque chose, du 15 Août. Ceux d’entre eux qui sont petits et modestes accepteraient volontiers l'Empire, s’il devait les faire rentrer. Que feraient les autres, Thiers, Rémusat, les généraux ? Il ne serait pas glorieux, pour eux de rentrer au milieu des Vive l'Empereur ! Ils rentreraient pourtant, s’il le leur permettait.
Avez-vous lu, dans le Galignani du 3 un article curieux du correspondant américain du Times sur Kossuth ? Il fera plaisir à Hübner.
11 heures
Voilà une lettre qui ne me plaît pas. Vous vous faites vous-même bien plus de mal que vous n'en avez. C'est singulier d'avoir l’esprit si juste, si ferme sur toutes choses, excepté sur soi-même. Je suis bien fâché de n'être plus là. Adieu, adieu. Merci de la lettre de Beauvale. Merci pour vous et pour Aggy. G.
56. Val-Richer, Samedi 7 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous trouve dans une disposition de grand abattement. Je voudrais bien que vous ne vous y laissassiez pas aller. Pardonnez-moi ce ridicule mot ; je n’ai pas le courage d’un de mes vieux amis de la vieille bonne compagnie du dernier siècle, M. Suard, secrétaire perpétuel de l'Académie Française, le Villemain d’alors ; il ne consentait jamais à dire passassiez, laissassiez, cassassier, et tous les ssassiez du monde ; il disait toujours, laissiez, passiez &&, et quand on remarquait que ce n'était pas correct, il se contentait de répondre : " Personne ne peut supposer que je ne le sache pas.
Je voudrais donc que vous ne vous laissiez pas aller à l'abattement ; vous n'êtes pas en état de supporter l'abattement dans l’ennui. J’aime mieux que l'ennui vous irrite ; vous ferez alors quelque chose pour vous en tirer. Je compte toujours que vous retournerez à Paris le 14 d'aujourd’hui, en huit, soit que vous marchiez ou non. J’espère que vous marcherez un peu.
Mes Anglais sont arrivés hier, par un assez beau temps. Ils étaient à peine, chez moi qu’un violent orage a éclaté, pluie, grêle, mes allées et mes fleurs ravagées ; vous ne connaissez pas les chagrins de propriétaire.
M. Hallam est intéressant, et inquiet. Le progrès des radicaux et la complaisance, sans limite assignable, de Lord John et de sir James Graham pour eux, l'inquiètent. Il ne sait rien de Lord Aberdeen, il ne le croit pas infecté de cette complaisance, il ne veut pas le croire. Quant à présent, Lord Derby tiendra ; il y a au moins 60 libéraux opposants, mais honnêtes, qui ne veulent pas l'attaquer ; ils le verront faire et si on l'attaque factieusement, ils le soutiendront. Lord John trop décrié pour redevenir, en ce moment chef de Cabinet, même si la place était vide.
La Reine s'adresserait à Lord Lansdowne qui malgré son âge et sa retraite ne pourrait pas refuser ; bien des gens serviraient sous lui qui ne voudraient pas servir sous Lord John. En ce cas Lord Palmerston deviendrait leader des communes comme chancelier de l'échiquier, et Lord John irait à la Chambre de Lords. Ce serait, pour lui, une grande défaite.
Hallam ne croit pas que les querelles religieuses deviennent the leading question ; il craint davantage une nouvelle motion de réforme parlementaire et le conflit de toutes sortes de propositions et de systèmes sur ce point.
Du reste immense prospérité, sécurité et confiance dans l'avenir, sans confiance dans personne. Autant, et (il l’espère) plus de progrès dans le good sense populaire que dans le radicalisme. On dit le petit Prince de Galles très intelligent et très bon.
Plus de 16 membres nouveaux dans la Chambre des Communes ; personne qui promette de devenir quelqu’un. Une très belle récolte et une admirable perspective de grouses pour le 12 Août.
Voilà les conversations d’hier soir. Ils m'ont fait coucher à près de onze heures. Adieu, en attendant, la poste. Je vais faire ma toilette.
Onze heures
Quatre pas c’est beau ! J'en suis bien content. J’espère tout-à-fait que vous marcherez bientôt et je compte qu'Aggy restera toujours. Adieu. Adieu.
Je n’ai pas deux minutes de plus. G.
74. Val-Richer, Vendredi 29 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il a fait très beau aujourd’hui. J’en étais en plus mauvaise disposition. Vous me manquez bien plus sous le soleil que sous la pluie. Je puis être triste sans vous ; heureux sans vous, non. Je souffrais de tout le plaisir que j’aurais pu avoir. Ce soir, je me suis promené avec mes enfants. A la bonne heure ; je puis jouir de leur gaieté, m’y associer même. Ce n’est pas pour moi que je suis content. Pourquoi m’êtes-vous devenue si nécessaire ? Je fais là une sotte question, car j’en sais parfaitement la réponse.
Je suis outré pour bien plus de 7000 francs. Je soupçonne qu’il y a là encore plus de taquinerie subalterne que de vilenie, un petit étalage d’autorité le désir de faire acte de pouvoir en reculant. Mon avis est que vous devez en informer votre frère et en parler à votre mari avec un étonnement bref et sans réclamer. Si je commence à les bien connaître la réclamation serait vaine. Vous ne pouvez, je crois ni passer sous silence un tel procédé, ni en faire grand bruit. Étonnez-vous aussi de l’apprendre par votre banquier. Pourquoi n’a-ton pas eu le courage de le dire soi-même de vous le dire à vous ? Je vous conseille là un langage du haut en bas, le seul qui vous convienne au fond, le seul aussi, j’en ai peur qui vous donne un peu de force. Il faut qu’on sache que vous ne vous générez pas de dire à vos amis la vilenie qu’on vous fait. Un peu de crainte, vous a sauvée. Usez de ce moyen avec les formes les plus douces du monde, mais usez en toujours un peu. Qu’ils aient tous peur du qu’en dira-t-on. Votre sauvegarde est là.
Samedi 8 h.
Vous n’aurez pas de lettre aujourd’hui. Cela me déplaît. Vous a t-on porté un paquet de livres ? Je ne sais si quelque chose là vous amusera. Vous êtes très difficile à amuser. Non que vous soyez blasée, ce qui n’a jamais ni mérite, ni charme, mais parce que vous êtes très difficile et très prompte à mettre de côté ce qui ne vous plait pas du premier coup. Vous ne savez ni attendre, ni chercher. L’imperfection, l’insuffisance, l’ennui vous choquent si vivement que vous détournez sur le champ la tête avec dédain, comme si vous ne pouviez rien avoir à démêler avec tout ce qui n’est pas supérieur et accompli. C’est votre mal, & votre attrait.
Il y a dans ce paquet de livres un roman nouveau intitulé Une destinée qu’on ma apporté la veille de mon départ. Je n’en ai pas lu une ligne et je ne vous réponds pas du tout qu’il vaille le moindre chose. Mais regardez-y cinq minutes. Il est d’une jeune fille à qui je veux du bien. Il y à cinq ans, quelques semaines après le 1 mars 1838 une lettre m’arriva d’une personne inconnue. C’était une longue pièce de vers écrite à mon sujet, sur le coup qui venait de me frapper par une jeune fille de 17 ans, fille d’un pauvre aubergiste dans un pauvre village du fond du Poitou, qui n’avait jamais eu d’autres leçons que celles du maître d’école et du curé de son village, ni lu d’autres livres que quelques volumes incomplets de poésie française et quelques numéros de Journal. Ses vers sans rien de saillant, n’étaient pas dénués de sensibilité et de mouvement. Un me frappe beaucoup. Elle disait, en décrivant celle que je venais de perdre : Ses regards pleins de douceur et d’empire. C’était à croire qu’elle l’avait vue, car ce mélange là, était précisément le caractère original de sa physionomie comme de sa nature. Je fus donc très touché. On l’est toujours d’ailleurs, d’apprendre que votre nom, votre sort ont vivement ému et occupé, à 150 lieues au fond d’un village, une personne inconnue et tant soit peu distinguée. Je répondis affectueusement à cette jeune fille. Je l’encourageai. Je lui envoyai de bon livres. Un an après, je reçus une autre lettre qui m’annonçait que son père avait vendu son auberge, et qu’elle allait venir à Paris, avec son père, et sa mère, dans une charrette traînée par un cheval que son père avait gardé pour ce voyage. J’essayai de l’en détourner. Il n’y eut pas moyen. Elle sentait son génie et voulait tenter sa destinée. Elle arriva. Je devrais dire elle m’arrive, car elle venait sur la foi de ma protection, et je ne pouvais me défendre d’accepter un peu la responsabilité de son sort. Je vis une jeune fille, point jolie de manières très simples, mais convenables, et assez élégantes de l’intelligence, dans le regard de la finesse dans le sourire, point embarrassée, et parfaitement décidée à chercher, par ses vers, la fortune et la gloire. Je lui donnai quelques avis et une petite pension. Depuis elle fait des vers ; elle en a fait d’assez agréables, et qui lui ont valu quelque succès auquel j’ai un peu aidé. Elle a acquis quelques amis de plus, amis-poètes, M. de Lamartine, Mad. Testu, quelques autres que je ne connais pas mais qui ont leur monde, où ils ont leur renommée. Elle vit très modestement, honnêtement, je crois. J’ai fait avoir une petite place à son père. Elle passera sa vie à faire des vers sans jamais monter bien haut ni percer bien loin, pauvre, agitée, jamais sûre de son succès ni de son pain ; mais elle aura obéi à son instinct et coulé selon sa pente. C’est le vrai secret de bien des vies. Je vois que les vers, ne lui suffisent pas, et qu’elle commence à faire des romans. Elle m’a apporté celui-là la veille de mon départ.
10 heures
Voilà votre N°76. Oui, c’est une triste et charmante parole. Adieu. Je vous ai dit ce qu’il me semblait de la réponse à votre mari. J’y pense encore. Il est possible, ce me semble, d’exprimer une surprise très hautaine au fond et très douce dans la forme, une surprise fière et résignée, qui les fasse, non pas rougir, ce qui ne se peut pas, mais s’inquiéter un peu du jugement de cinq ou six personnes, si cela se peut. Adieu encore. G.
79. Val-Richer, Vendredi 6 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne suis pas mieux élevé que vous ; mais je sais mieux ne pas me livrer à ma première impression, ou à une seule de mes impressions, et supprimer ou du moins imprimer celle à laquelle je ne veux pas me livrer. Cela s’appelle avoir de l’empire sur soi. J’en ai plus que vous, cela est sûr. Ce n’est pas toujours raison ou vertu, tant s’en faut. C’est bien souvent orgueil, pur orgueil. Je ne puis souffrir de ne pas paraître le maître, ni qu’il soit évident, ne fût-ce que pour moi seul, que je ne fais pas ce qui me plaît. J’étouffe soigneusement mon déplaisir pour ne pas laisser voir que je subis une autre loi que ma volonté. L’impossible m’offense. Je me sens humilié de me débattre sous sa main. J’aime mieux l’accepter. Ce n’est pas votre disposition. Vous ne supprimez rien de ce qui se passe en vous. Tout ce qui est paraît. Vos chagrins, vos déplaisirs, ces désappointements, ces ennuis, ces débats intérieurs dont la vie est semée, vous laisser tout éclater, tout voir. Je n’ai jamais rencontré personne qui conservât tant de dignité au milieu de tant d’abandon. Car vous avez la dignité la plus haute, la plus noble qui se puisse imaginer, et qui ne s’altère jamais au milieu de vos impressions si librement, si vivement manifestés. C’est un des traits les plus originaux de votre caractère, et l’un de ceux qui pour moi, de très bonne heure dans notre relation vous ont le plus mise à part de toutes les femmes. L’abandon, leur est naturel mais il les fait un peu descendre. Vous avez plus d’abandon, plus de transparence, comme vous dîtes, que personne vous restez toujours à votre hauteur. Vous me demandez si je ne vous trouve pas un peu d’humeur. Oui, Madame, quelquefois. J’ai été quelquefois tenté de m’en choquer. Excepté de ma mère, je n’ai jamais supporté l’humeur de personne. Quand la vôtre m’a apparu, je vous aimais déjà beaucoup, beaucoup. L’affection a contenu la surprise. Et puis, j’ai bientôt reconnu la source de votre humeur. Elle ne vient en vous d’aucun défaut, d’aucun désagrément de caractère, ni de susceptibilité, ni de brusquerie, ni d’exigence ni d’attachement aux petites choses. Vous êtes naturellement très douce, très égale, charmante à vivre. Votre humeur ne naît jamais que du chagrin d’un grand, d’un profond chagrin. Il vous indigne, il vous révolte, il s’empare de vous tout entière. Et alors ce qui ne répond pas pleinement à votre chagrin, ce qui n’est pas en harmonie, en parfaite harmonie avec l’état de votre âme, vous donne de l’humeur. L’humeur est pour vous l’une des formes de la douleur. Je vous aime trop, Madame, pour que cette forme là ne s’efface pas devant la profonde sympathie que votre douleur m’inspire. Vous avez cruellement souffert. Mais laissez-moi vous le dire ; je suis plus fait à la douleur que vous, à la douleur morale, comme à la douleur physique. Vos épreuves vous sont venues tard, au milieu d’une vie qui avait été constamment facile, agréable, brillante. Vous n’aviez connu ni le malheur, ni la difficulté, ni la contrariété. Vous n’aviez porté aucun fardeau. Vos émotions même malgré le sérieux de votre naturel, avaient été assez superficielles, et bien loin d’ébranler toute votre âme. Un seul sentiment, le dernier venu, était en vous très puissant et profond. Quand vous avez été frappé, vous avez éprouvé cette immense surprise, cette révolte intérieure qui accompagne, les premiers chagrins, les chagrins de la jeunesse ; et comme vous n’aviez plus, pour y échapper les ressources de la jeunesse, sa mobilité, sa facilité à se distraire, son empressement à jouir de la vie encore inconnue, vous êtes restée sous l’empire de cette impression de surprise et de révolte. La douleur vous a atteinte tard, et trouvée jeune pour souffrir. Et vous avez souffert avec l’impatience avec l’âpreté de la jeunesse. J’ai éprouvé, j’éprouve encore, en vous voyant souffrir, le sentiment d’un vieux soldat couvert de blessures, qui voit les fatigues, les langueurs, les souffrances d’un jeune homme qu’il aime et qu’il soigne...
10 heures
Je m’étais levé de bonne heure pour vous écrire bien à l’aise. J’ai été interrompu par mes enfants, par ma mère, par Mad. de Meulan, par je ne sais quel incidents insignifiants dans la maison. Voilà le facteur, et il faut qu’il reparte. J’en suis très contrarié. J’ai besoin de causer avec vous. J’ai une infinité de choses à vous dire. A demain. Ou plutôt à ce soir. Je me suis couché hier de bonne heure. Je tombais de sommeil, je ne sais pourquoi. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Discours du for intérieur, Portrait (Dorothée)
81. Val-Richer, Dimanche 8 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les mouchoirs blancs et rouges sont tout prêts, rangés dans mon tiroir. Je viens d’en prendre un. Le pauvre roi d’Hanovre me paraît bien accusé. On peut encore exercer le pouvoir absolu là où il existe, encore en s’y prenant bien. Mais le rétablir cela ne se peut plus, surtout en en mettant enseigne. Le principe irrite plus que le fait. Les peuples sont comme les femmes, comme les hommes ; ils aiment mieux être maltraités qu’insultes. Votre Empereur a raison ; le Roi d’Hanovre gâte le métier. Si j’étais M. Molé et que j’eusse envie d’avoir le Maréchal Soult pour ministre de la guerre, son fracas à Londres me déplairait fort. Il reviendra de la plein de prétentions, & probablement ne voulant plus accepter d’autre Présidence que la sienne propre. On me mande qu’il n’y a encore rien de sérieux dans tous les bruits de remaniement de Ministère. Ce qu’on remanie, c’est l’administration d’Alger. On va changer, je crois, l’Intendant civil. M. Bresson payera son discours. Le maréchal Vallée écrit que les affaires militaires sont à peu près arrangées, qu’il lui faut à présent, pour second un administrateur actif et un peu considérable, sans quoi il ne saura que faire de tout l’argent qu’on lui vote. On a fait des propositions à un homme de mes amis. Je l’ai engagé à accepter.
Le dîner de la Reine d’Angleterre aux Ambassadeurs Constitutionnels est une affiche en bien grosses lettres. C’est comme toute la politique extérieure anglaise, un grand tapissage sur la rue. Je ne trouve pas que nos journaux en fassent le bruit convenable. Me voilà au bout de ma politique et de la vôtre. La saison est bien morte. Nous glanons. Si nous étions ensemble, nous moissonnerions toujours. La Fontaine a raison. L’absence est le plus grand des maux. Pourtant je me reproche de dire cela. Nous ne connaissons pas le plus grand des maux. Cela fait trembler. J’oublie les nouvelles de St Ouen. On bâtit le Presbytère.
9 heures
Vous dîtes que je ne vous connais pas tout-à-fait. Tant mieux ; car plus je vous ai connue, plus j’y ai gagné, et vous n’y avez pas perdu. Vous êtes pourtant d’une nature, simple, pas un peu simple, comme votre grand duc, mais très simple. La simplicité riche, c’est la perfection. Votre âme est riche, inépuisable. Je la connais mieux que je ne vous le dirai jamais. Je ne vous dis pas tout de vous surtout. Et de loin, que dit-on?
J’ai repris mer leçons avec mes filles. Je remplace leur maître d’arithmétique! Elles sont bien heureuses. C’est quelque chose de singulier qu’une vie si animée et qui laisse si peu de traces. J’ai probablement été dans mon enfance, aussi heureux, aussi animé que le sont mes filles. Je ne m’en souviens pas du tout. Vous souvenez-vous de votre enfance ? Je suis né vers seize ans. C’est de là que date ma vie, dans ma mémoire à moi. Je vous parlais de mes filles. Un de leurs bonheurs, c’est que je en leur lis le soir. Nous achevons un très joli, roman de Walter Scott, peu vanté : Richard en Palestine. Mais je ne veux pas ne leur lire que des romans même de ceux-là. C’est une lecture trop amusante, un plaisir de paresseux, un aliment qui dégoûte des autres, et ne nourrit pas, les jours derniers, j’ai pris Plutarque, la vie de Thémistocle. C’est charmant ; mais c’est un travail de lire cela à des enfants. Il faut à chaque instant sauter, retrancher, retourner, expliquer. Les faits, les livres, les esprits, le langage tout cela est bien grossier. Il n’y a pas moyen de mettre cela sous les yeux des enfants. Je ne suis pas prude ; mais avec mes filles. je deviens de la susceptibilité la plus ombrageuse. Je ne voudrais pas laisser approcher de leur pensée de leur petite figure, si fraîche et si pure un mot, une ombre, un souffle moins frais et moins pur. Pour les âmes, le mal, c’est la peste contagieuse à faire trembler, contagieuse par un mot, un regard ! J’ai fait en lisant la vie de Thémistocle, des tours de force et d’adresse admirables pour écarter le mal que je rencontrais à chaque pas. Je l’ai écarté hier ; mais demain, mais un jour, il les approchera nécessairement. N’importe, que ce soit tard, le plus tard qu’il se pourra. La longue innocence se répand, sur toute la vie.
10 h. 1/2.
Il paraît que nous parlons l’un et l’autre bien obscurément sur mes carpes. Je ne croyais pas du tout que vous les attendissiez en personne, pas plus que je n’avais pensé à vous les envoyer. Je ne voulais que justifier mon récit de leurs aventures. Mais laissons-le là. C’est plus qu’elles ne méritent. Gardez votre style, anglais ou non. Je ne vous pardonnerais pas d’en changer. Adieu. Adieu. G.
82. Val-Richer, Lundi 9 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
On m’a reproché d’être dédaigneux. J’en fais pénitence. Je vis ici Dieu sait à quelle distance de ma vie intérieure, habituelle. C’est la faute de notre état social et la loi du gouvernement représentatif. Vous n’avez jamais éprouvé cela. Je me trompe. C’était là votre, condition, et aussi votre sentiment quand vous êtes retournée à Pétersbourg. Les petits jeux de l’intérieur du Palais, votre étonnement de l’étonnement que vous avez excité autour de vous le jour où vous avez dit quelques mots de politique à dîner. Votre impossibilité de causer vraiment avec personne votre mal aise dans cette atmosphère pesante et inférieure, c’est le pendant de mon mal. Seulement vous aviez affaire à un Empereur, moi à des électeurs. Peu importe. Vous plaisiez à votre Empereur. Je plais aussi à mes électeurs. Je soupçonne même que je me prête à leurs affaires, à leurs conversations, avec moins d’effort et d’ennui que ne vous en imposaient les brusques fantaisies, ou les grosses gaietés impériales. Je ne connais personne qui sache moins descendre que vous.
Dans votre sphère, quand vous vous sentez en parfaite harmonie avec les situations, les idées les sentiments, les habitudes, les manières qui vous entourent vous avez l’esprit singulièrement animé, fertile souple ; vous êtes pleine de facilité, de laisser aller. Mais vous ne pouvez pas du tout vous dépayser. Sur tout autre échelon, dans tout autre air, vous êtes comme sous la machine pneumatique, mal à l’aise, froide immobile. Vous êtes, en fait, d’élévation et de tous les genres d’élévation, ce qu’on appelle aujourd’hui une spécialité. Vos habitudes sont devenues, votre nature. Restez comme vous êtes. Ce que vous avez me charme, et je ne vous désire point ce qui vous manque.
Je suis bien aise qu’Emilie Flahaut se marie bien. Mais c’est triste d’épouser un mari qui mourra dans deux ans. Si elle l’aime ? Est-ce qu’il est menacé de la maladie de Lord Kerry ? Qu’est devenue Lady Kerry ? Est-elle morte aussi ? Elle avait bien un air à mourir. Je n’ai jamais vu de structure si frêle et de blancheur si pâle. Voilà un singulier effet d’imagination. Je vous croyais en Angleterre. Je vous écrirais à Londres. J’allais vous prier de faire mes amitiés à Lord Landsdown. C’est un souvenir de l’an dernier. Et aussi un effet de ce que depuis quelques jours, vous passez comme vous dîtes, votre vie, en Angleterre. Je la regretterai bien pour vous dans quelques jours.
J’espère que vous verrez aujourd’hui, le Duc de Broglie. Je le désire. Je le verrai après-demain. Que nous sommes enfants ! Nous avons bien raison. C’est la vie que ces enfantillages-là. Je voudrais bien voir ce qu’elle serait si on les en retranchait tous, tous absolument. Mais j’aime mieux les enfantillages de près et sans intermédiaire. Dans un poète persan qui s’appelle Saadi, un voyageur s’arrête auprès d’une fleur : " Fleurs d’un parfum si doux, es-tu la rose ? - Non, mais j’ai vécu près d’elle. "
10 heure ¼
Votre n°85 est bien triste, triste pour vous, triste pour moi. De près, votre tristesse m’est douloureuse de loin intolérable. Mais pourquoi dit-on intolérable quand on tolère ? Et puis, ne m’en veuillez pas d’être triste aussi pour moi. Il faut me pardonner mon immense exigence. Adieu Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Interculturalisme, Poésie, Portrait (Dorothée), Réseau social et politique
84. Val-Richer, Mercredi 11 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai passé hier un sotte journée à demi hébété. J’avais quelques uns de mes voisins à dîner. S’ils m’ont trouvé aimable, ils sont bien bons. Je crois qu’ils mont trouvé aimable. Je suis mieux ce matin. J’ai peu dormi, mais peu éternué. Je partirai pour Broglie, vers 1 heures, quand le facteur sera arrivé. Le facteur, c’est l’événement de ma journée. Il faut un événement à chaque journée. A Paris j’en ai deux, midi et demie et huit heure, & demie. Au Val-Richer, il n’y en a qu’un et qui ne vaut pas le moindre des deux de Paris. Il est pourtant bien impatiemment attendu même quand il apporte du chagrin et un peu d’humeur. La vivacité du chagrin me console un peu de l’injustice, de l’humeur. J’ai tort ; je me fais plus mauvais que je ne suis ; si je croyais à une humeur vraie, même injuste, je n’en serais pas si aisément consolé. Et je n’aurais point de repos que je ne l’eusse dissipée. Il y a des cœurs et des regards, entre lesquels ne doit jamais s’élever le moindre nuage.
Je vous désire tout-à-fait l’entresol de l’hôtel Talleyrand. Il vous plaît et il me semble que vous y serez bien. Vous aurez l’amusement de vous y arranger. Prenez garde seulement à ne pas vous plonger là dans un Océan de poussière et de bruit. Il se pourrait qu’après vous avoir loué l’entresol on bouleversât le reste de l’hôtel qu’on fît abattre bâtir tout près de vous sur la rue St Florentin, & alors vous seriez très mal. Avant de rien conclure assurez-vous bien des projets des acquéreurs. Vous êtes difficile, presque aussi difficile avec le monde matériel qu’avec le monde moral. Ne vous engagez pas facilement dans une situation inconnue.
Je ne sais pas les raisons de la confiance de Lord Aberdeen. Mais en tout, il me paraît un peu confiant, du moins dans ce qu’il dit. Je suis bien aise de trouver l’occasion de renvoyer ce reproche à un Anglais. Il me semble de plus en plus que les Torys n’auront de chances sérieuses que lorsque les questions d’Irlande seront à peu près vidées. D’ici là, ils ne gouverneraient pas sans guerre civile, ou à peu près en Irlande ; et l’Angleterre me parait décidée à ne plus vouloir de la guerre civile & de ses violences en Irlande. Elle le lui doit en vérité pour tout le mal qu’elle lui a fait si longtemps. Je ne connais par M. O’Connell, et ce n’ai nul goût pour son langage ; mais je m’intéresse à sa cause. Il ne me revient rien de nos affaires à nous, & je crois qu’il n’y a rien. Le Duc de Broglie me dira aujourd’hui tout ce qu’il peut y avoir. L’accident de Mad. la Duchesse d’Orléans n’est rien du tout. Est-ce que la petite Mad. Pozzo se serait dit grosse pour revenir plutôt à Paris ? On dit qu’elle s’ennuie effroyablement à Londres.
Je ne m’étonne pas de la sécurité de Kielmansegge ; mais j’ai quelque envie d’en sourire. Il est de ceux qui ne prévoient jamais les fautes et les échecs de leur maître ; ce qui n’empêche rien. Si l’affaire va à la Diète, et si la Diète condamne le roi de Hanovre, jamais condamnation de Roi n’aura fait faire à la cause Constitutionnelle, comme nous disons ; un si grand pas. Est-ce que le Roi Ernest ne s’en doutera pas d’avance ? Du reste je juge tout cela de loin, et peut-être à tort et à travers. Je suis fort revenu de la prétention de juger de loin. Il faut bien pourtant. Quoiqu’il arrive, je porterai toujours à cette bonne Reine de Hanovre, un véritable intérêt et j’espère bien qu’elle aura toujours autant de beaux manteaux dorés qu’elle voudra.
10 heures
Je pars pour Broglie avec votre n° 87. Comme on ne m’a rien fait dire je suppose que le duc y arrivera aussi ce matin. Dans tous les cas, je n’y passerai que 24 heures et je serai ici après-demain. Point de dérangement dans nos lettres. Adieu, Adieu. Oui quinze jours. G.
85. Paris, Dimanche 8 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Que je vous remercie de me raconter si bien mon caractère. Vous avez mille fois raison dans ce que vous me dites de moi, dans l’explication de mon humeur, surtout dans ce que vous me dites de ce sentiment profond de ma douleur. Voilà ma passion, intime, immense ma douleur. Dieu m’a retiré ce que j’aimais tant, parce que je l’aimais trop. Que serai- je devenue en avançant dans la vie ? Je frémissais d’avance en songeant à l’avenir de mes enfants. Quel pays, quel maître, quel dieu hélas ! Tout cela me donnait des angoisses inexprimables pour eux, pour eux, pas pour moi. Ils n’étaient déjà plus faits pour cette horrible patrie. Ils en ont trouvé une. Ah monsieur et je n’y suis pas avec eux ! Dites-moi que j’y serai, bien sûr. Je vous ai dit que le dimanche je suis toujours plus triste qu’à l’ordinaire. Votre lettre y a ajouté aujourd’hui, mais je vous en remercie, je vous en remercie beaucoup, bien tendrement.
J’ai passé une matinée hier à Longchamp. Il me semble que je puis me dispenser de vous le dire, je n’y manque jamais. Mon temps passe doucement gaiement avec Lady Granville. J’ai même ri & beaucoup. Le soir nous nous sommes retrouvés chez Mad Appony. Il y avait beaucoup de monde. J’en suis partie lorsque la musique commençait c’était un petit prodige de 9 ans qui allait jouer. Je ne peux pas supporter les prodiges, & il n’y a que mon enfant à moi que j’aimerais écouter. Le Kielmansegge y est venu. Je me suis fait conter tout le Hanovre. Il en vient. Il adore son roi qu’il trouve le Roi le plus gai, le plus franc le plus courageux & la plus bon enfant du monde. Il ne pense pas qu’il rencontre d’embarras sérieux dans son chemin. On l’aime dans les masses, et il est parfaitement sans souci. La reine fort vieillie, toute occupée d’Étiquette et de magnificence. La cour la plus somptueuse, & le revenu de l’état passant dans des habits brodés. Voilà à peu près ce qu’il m’a dit. Il a une grande vénération pour moi, par tout ce qu’il a vu que ces royautés me portent de tendresse. Outre lui j’ai causé avec M. d’Arnim. Il n’y avait que cela pour moi.
Le matin j’avais eu de longues visites de la petite princesse. Mad. Appony & la Duchesse de Montmorency. Quelle ménagère que cette grande dame française. Elle ne m’a vraiment parlé que pounds and shillings, et je sais au bout des doigts tout ce qu’elle est obligé de nourrir, éclairer et chauffer dans sa maison. Elle m’ a assurée qu’elle avait une fortune très modique. Cela m’est bien égal.
La petite Pozzo a fait une fausse couche de 6 mois. C’est hier que cet accident lui est arrivé. Jugez comme le vieux Pozzo va être désolé.
On disait hier que la Duchesse d’Orléans s’était blessée dans la chambre. Je ne sais si c’est grave.
Je recevrai ce soir ; s il y a qui recevoir. Le salon de Mad. Appony ne me guide pas, il y avait trois dames anglaises divorcées, quatre dames françaises qui auraient dû l’être si les maris français ressemblaient aux Anglais. 14 petites filles, et des hommes beaucoup mais sur lesquels je ne connaissais que trois diplomates. Je me suis retrouvée dans mon lit à 10 1/2. Je n’ai pas de bonne raison pour y entrer, car le sommeil n’y entre pas avec moi. Adieu, adieu, je voudrais bien causer avec vous mais de près.
87. Val-Richer, Samedi 14 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
De douces paroles! Je ne vous en enverrai jamais, je ne vous en ai jamais dit d’assez douces à mon gré. Vous craignez que je ne sois mécontent. Non, je ne suis pas mécontent. Je vous aime trop et je vous connais trop bien pour l’être jamais. Mais je suis triste : triste comme je ne puis pas ne pas l’être ; triste aussi peut- être comme je pourrais ne pas l’être. Je vous ai demandé un jour comment on faisait pour avoir de l’humeur sans en avoir contre quelqu’un. Je ne puis admettre qu’à cause de notre séparation vous ayez de l’humeur contre moi. L’an dernier du 15 juin à votre retour d’Angleterre, parmi mes inquiétudes, en voici une qui me préoccupait beaucoup. Si notre intimité devient complète, parfaite, comment nous accommoderons-nous de ce qu’il y a d’incomplet et d’imparfait dans notre relation ? Si nous devenons vraiment nécessaires l’un à l’autre comment supporterons-nous d’être jamais séparés ? De jour en jour, je vous découvrais plus capable d’une intimité parfaite et de tout son bonheur, et plus incapable d’accepter dans ce bonheur la moindre imperfection, la moindre lacune. Je vous en aimais chaque jour davantage et mon inquiétude croissait avec ma tendresse. Un jour, mon inquiétude a disparu. Je n’y ai plus pensé. Nous avions été sitôt et si longtemps séparés ! La séparation était notre état habituel. Je n’ai plus pensé qu’à la joie de notre réunion. J’en ai joui avec une confiance aveugle comme on jouit du bonheur ; on ne prévoit plus rien, on ne s’inquiète plus de rien ; il absorbe l’âme. Mais, vers le printemps, mon inquiétude est revenue, et revenue très vive. Mon attachement pour vous était devenu bien plus sérieux et bien plus tendre. Je vous connaissais bien mieux. Vous ne savez pas à quel point, tout l’hiver, de près, de loin, chez vous, chez moi, seuls, ensemble ou dans le monde, vous avez été constamment présente à ma pensée, l’objet constant de mon observation, de ma réflexion, de ma contemplation, de ma sympathie. Vous, la créature la plus noble, la plus fière, placée le plus haut et en même temps la plus facile à froisser, la moins propre à lutter contre le sort, la plus près de fléchir sous le fardeau ! Des sentiments si profonds, et des impressions si mobiles ! Avec tant de supériorité, pouvant si peu pour vous-même! Tant de haut dédain, et une telle impossibilité de se résigner à la souffrance, à la contrariété, à la difficulté ! Une dignité si inaltérable avec une si vive impatience contre tout ennui, tout obstacle, tout mécompte ! Je suivais tous vos mouvements; j’assistais à toute votre âme. Quel ravissant bonheur de veiller de tous côtés, à toute heure, sur cette âme si haute et si tendre, de la satisfaire pleinement, de répondre à toutes ses exigences à ses plus secrets désirs de perfection dans l’intimité ! Et en même temps de protéger constamment efficacement, cette personne si peu faite aux combats, aux épreuves. J’écarte d’elle tout mal, tout effort, de la faire vivre à l’abri d’un impénétrable bouclier, de tendresse et de soin ! Je revois tout cela avec un désir tous le jours plus vif de réaliser mon rêve. Et tous les jours, tantôt un incident indifférent en apparence, tantôt une parole de vous venait déjouer mon désir et me pénétrer de la crainte que mon rêve ne pût se réaliser. J’étais dans cette disposition pleine d’anxiété, quand le moment de notre séparation est venu.
Je ne pouvais pas hésiter. Ma mère, mes enfants attendaient impatiemment la campagne. C’est leur plaisir. C’est un grand bien pour leur santé. Ils y comptaient. Ma mince fortune, dont il faut bien que je m’occupe pour eux m"en obligeait. Je ne suis promis que dans ma vie publique, jamais, même pour mes enfants, les considérations de fortune, n’exerceraient sur moi la moindre influence. Raison de plus pour que j’en tienne quelque compte dans la vie privée. Je vous ai quittée, en essayant d’étouffer près de vous mon chagrin pour vous aider à étouffer aussi le vôtre. J’ai eu tort. Si vous aviez vu ce qu’il m’en coûtait de vous quitter, votre chagrin fût resté le même ; mais une minute d’injustice, une minute d’humeur contre moi eût été impossible. Dites-moi que vous n’êtes pas injuste, que votre humeur ne s’adresse pas à moi, pas du tout à moi, qu’elle porte uniquement sur l’imperfection, l’amère imperfection de notre relation, de notre destinée. Dites-moi cela ; pensez le toujours. Et même loin de vous-même sous ce fardeau si lourd de l’absence, je me sentirai le cœur confiant et fermé ; je reprendrai mon rêve, le rêve de vous rendre heureuse, heureuse malgré tout ce qui nous manque, malgré nos cruels souvenirs, heureuse à force d’être aimée, et bien aimée. Oui, bien aimée. C’est la plus douce parole que je sache écrire, et qu’elle est loin de la réalité ! Adieu G.
Dimanche matin 8 heures
Je porterai moi-même ce matin cette lettre à Lisieux. Je vais passer la journée à la campagne à Combrée. Que de choses je voudrais vous dire ! Rien ne me contente. Rien n’est assez tendre, assez vrai. Rien me dit tout ce que j’ai pour vous dans l’âme. Vous avez besoin que tout soit parfait autour de vous. Et je suis sûr que si j’étais toujours là, libre de tout faire & maître de tout arranger, tout serait effectivement parfait selon votre désir. Et je ne suis pas là ! Et même quand j’y suis, je ne puis pas tout ce que je pourrais ! C’est un sentiment très douloureux. Et pourtant je m’y résigne pour moi. Laissez-moi espérer que vous vous résignerez aussi comme on se résigne. Acceptons ensemble avec une commune tristesse & une commune tendresse ce qui manque non pas à notre intimité mais à notre bonheur. Supportons le ensemble, avec une confiance sans mesure l’un dans l’autre, afin de jouir ensemble de ce que nous avons. Adieu. Adieu. Je voudrais que tout mon cœur pût passer dans cet adieu. Il serait bien doux. 10 heures ¼ Je reçois votre paquet en montant en voiture, pour ma course. Merci. Merci. Je vais lire tout cela, en roulant. Il ne fait plus chaud. J’espère qu’il en va de même à Paris. Je n’aimerai bientôt plus le chaud. Adieu. Adieu.
97. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma corvée est finie. Ce n’est certes pas la solitude que je suis venu chercher ici. Je suis charmé de la vôtre. J’en profiterai. Je fais de charmants projets. Je fais des vœux pour que le temps se maintienne tel qu’il est aujourd’hui beau et pas chaud. Un de mes voisins de ce matin me l’a promis. " C’est, dit-il, le combat de la lune." Ce sera la lune de miel.
Je regrette que vous n’ayez pas vu M. Villers. Il aime à parler et il doit être curieux à entendre sur l’Espagne. Il a joué là un jeu bien brouillé. Quel triste sort que celui des pays faibles ! Le théâtre des intrigues rivales des grands pays quand ils ne sent pas celui de leurs guerres : jouet ou champ de bataille et toujours victime. Il ne faut pas être petit, et il faut être bon pour les petits. Je crois que c’est pour vous que M. Ellice est venu à Paris. Il me semble qu’il passe sa vie chez vous. Il a de l’esprit et il est très au courant. Comment un homme d’esprit comme lui ne s’aperçoit-il pas que tout en causant, & vous plaisant avec lui, vous ne lui portez pas grande considération ? Et s’il s’en aperçoit, comment s’en arrange-t-il ? Mais il est de ceux qui s’arrangent de tout ce qui les sert ou les amuse. Vous avez un grand talent pour traiter avec ces hommes-là. Vous les attirez sans les laisser tout à fait approcher. Vous leur plaisez et vous leur donnez le plaisir de vous plaire, mais toujours d’un peu loin. C’est votre histoire avec Thiers. En entendez-vous dire quelque chose? Ne trouvez-vous pas que le Maréchal Soult abuse de sa fortune ? Ces visites partout, ces acclamations de tous les jours, cette perpétuelle exhibition, combien de temps cela peut-il durer en Angleterre ? Chez nous, ce serait déjà fini usé. Et vous qui n’aimez pas les répétitions et les longues choses vous n’êtes donc pas Anglaise par là ? Il y a bien des côtés par où vous ne l’êtes pas. Vous avez le cœur plus anglais que l’esprit.
Du reste j’ai un de mes voisins qui arrivait d’Angleterre et qui vous charmerait à entendre, cinq minutes je veux dire car vous ne vous en accommoderiez pas plus longtemps. C’est le plus grand manufacturier du pays ; il est allé parcourir l’Angleterre pour ses affaires ; et malgré les rivalités d’argent, il en est dans un enthousiasme inépuisable ; il professe, il prêche la richesse, la propreté, l’élégance, la grandeur, l’esprit d’ordre, le bon jugement, les bonnes auberges. Je l’écoutais l’autre jour avec le plaisir de vous entendre donner raison. C’est lui qui m’a donné à dîner à Combrée avec 80 amis. Et son toast et son speech en mon honneur valaient son admiration pour l’Angleterre.
9 heures 1/2
93 méritait d’être brûlé vif. Je n’ai fait que mon devoir. Je trouve comme vous, que nous nous adressons de sottes lettres. Si elles pouvaient ressembler à nos conversations, elles seraient charmantes. Ah, nos conversations ? Nous les retrouverons de demain, en huit, pour quinze jours. Que ce sera court, & immense ! Vous y pensez, dites-vous, plus que moi. Je le veux bien, mais je le nie. J’y pense toujours. Ajoutez quelque chose à cela. Je vous en prie ; ayez des caprices ; ne vous laissez gouverner par personne en mon absence. Je ne vous le pardonnerais pas. C’est peut-être un des signes les plus assurés de l’affection que de se laisser gouverner. On ne remet sa liberté qu’à celui qu’on aime plus que soi-même, en qui on se confie plus qu’en soi-même. Redites-moi de vous gouverner.
Je n’ai pas encore de réponse pour le précepteur, vous l’aurez probablement avant moi. Vous ne savez pas combien je voudrais faire, à l’instant même ce que vous désirez. Si je pouvais le faire toujours moi-même, j’en serais sûr. Mais de loin, mais forcé de mettre un esprit au bout de mon esprit, des mains au bout de mes mains, tout est long, & je m’impatiente autant que vous. Adieu. Comment va Marie ? Dites-lui au moins une fois avant mon arrivée que je vous ai demandé de ses nouvelles. Adieu. Lundi prochain, je serai sur la route de Paris. Je vous porterai moi-même mon adieu. G.
101. Val Richer, Mercredi 21 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le siège de Silistrie est fatal aux généraux ; Messa Pacha tué et le général Schilder la jambe emportée. La blessure du Maréchal Paskevitch paraît moins grave. Il n’y a pas grand mal à ce que les coups portent un peu haut quelque brave qu’on soit, ces avertissements ont leur effet.
Voilà toutes mes réflexions d'aujourd’hui. Je n'en ai pas plus que de nouvelles. On a beau faire, on a beau écrire tous les jours et n'avoir rien à cacher. Il y a des abymes. entre la correspondance et la conversation. Si nous causions, j’aurais de quoi remplir ces abymes-là.
J’ai eu du regret en vous voyant quitter Bruxelles. Je n’avais pas tort. Vous aviez là du moins des habitués, et des habitués de votre robe. Vous n'aurez à Ems que des rencontres. Le Duc de Richelieu vous restera-t-il un peu longtemps ? C'est à Dieppe qu’il fait ordinairement sa saison d'eaux. Mais pour ce temps-là, les bains de mer ne sont pas encore de saison. Il n’y a encore personne à Trouville. On y attend demain le Chancelier et Mad. de Boigne. Les Broglie y viendront à la fin de Juillet. Assez de monde, dit-on. Cela me dérangera un peu. Le Val Richer est un des délassements de Trouville. Tout le monde n'a pas aussi peur que vous de trois heures de voyage. Vous souvenez-vous comme vous avez été maussade le jour où vous êtes venue ici avec Lady Alice ?
Vous êtes très bonne protestante, mais vous n'êtes ni théologienne, ni philosophe, ni historien ; je ne vous engage donc pas à lire une Défense du protestantisme contre les Ultra Catholiques que M. de Rémusat vient de publier dans la Revue des Deux Mondes. C'est pourtant un écrit très distingué, plein de bon sens et d’esprit, de vérité, et d'à propos. Si nous étions ensemble, je vous le lirais, et je vous le ferais goûter.
Midi
Point de lettre de vous, mais des nouvelles qui seraient bien grosses et bien bonnes, si elles étaient vraies ; le siège de Silistrie suspendu, le maréchal Paskevitch se retirant au delà du Pruth. Il ne manque plus que l'annonce d’un congrès. Je n'ose y croire. En attendant, adieu, Adieu. G.
105. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous lisez très bien les journaux. J’ai envie de m’en fier à vous, et de n’y regarder que ce que vous me recommanderez. D’autant plus que j’avais remarqué tout ce que vous me dites et pas grand chose de plus. Je suis de votre avis sur tout entre autres sur l’article des Débats. Il était si à propos, et si aisé d’écrire sur ce bruit du Times, dix lignes de cœur haut et de bon gout, dix lignes vraiment royales, en réponse aux boutades impériales ! Pour le constitutionnel, je n’y attache aucune importance. Il serait vendu qu’il ne parlerait pas autrement. Raison de plus même. Cependant je ne le crains pas. Mais je crois que M. Molé a une voie que je crois connaitre, pour faire insérer de temps en temps, dans ce Journal, quelque article qui le serve comme il l’a fait pour la visite de Champlatreux. La plupart des journaux sont aujourd’hui des magasins où l’on achète un article. Certains acheteurs payent plus cher que d’autres, et ne peuvent entrer que rarement. Mais pourvu qu’ils en disent tant, et pas trop souvent, on les écoute. Si l’opposition savait son métier comme elle exploiterait l’abandon du procès Chaltas ! Mais elle est bête et subalterne. Elle ne sait pas, et n’ose pas. Je n’en persiste pas moins à penser qu’au dehors, on est embarrassé de cette affaire, & bien aise qu’elle ne soit pas poussée à bout. Je ne trouve pas l’article Hollandais bien fin ni bien fier. Les républiques anciennes auraient mieux répondu. Je ne suis pas républicain, ni vous non plus.
Mais avez-vous lu, vraiment lu Thucydide et Tacite, Démosthène, et Cicéron ? Ce sont les esprits qui vous vont le mieux, hauts et naturels, dignes et dégagés, sensés et élégants, et ce je ne sais quoi d’achevé que la perfection du langage donne à la pensée. Vos grandes pensées vaudront les leurs, mais pas mieux, je vous en prévient. Occupez-vous en un peu quoiqu’on dise. Voulez-vous que je fasse porter chez vous une traduction passable de Tacite. Que je voudrais vous tire tout cela moi-même ! Nous nous sommes rencontrés tard. L’eau court vite. Bien peu de place nous reste pour tout ce que j’y voudrais mettre. Le bonheur possible et point réalisé, vu et point atteint, est un des plus pénibles sentiments que je connaisse. Je vous quitte pour ce soir. Je n’ai pas encore regagné tout mon sommeil.
Lundi 20 8 heures
En rangeant, mes papiers, je viens de relire, le N°104. Je ne suis pas décidé à le bruler. Il y a du bien mauvais. Mais tout n’est pas mauvais ; et dans le mauvais même, il y a du bon, ne pouvant les séparer, j’ai envie de garder tout, pêle- mêle. Je voudrais bien n’avoir pas d’autres papiers à ranger que ces numéros là. J’ai des ennuis d’affaires, des comptes à examiner, un fermier qui ne paye pas. Vous ne savez pas ce que c’est que des affaires, et j’espère que vous ne le saurez jamais quoique je vous aie vue à la veille de le trop bien savoir. Je vais à Caen dimanche 26 de grand matin. Ainsi le samedi 25 adressez-moi votre lettre à Caen, à la Préfecture. Je passerai là cing ou six jours, entre la société des Antiquaires, les courses de chevaux et mes courses à moi dans les environs. Le pays-ci est en grand progrès de civilisation. On y prend tous les goûts élégants et civilisés, les courses, les arts, les Académies, les speeches. Tout cela est amusant, à voir naître, si petit d’abord, si informé, et pourtant si animé, si avidemment destiné à grandir. Mon Lisieux vient de fermer son exposition de tableaux, plus de 250 tableaux, dessins, n’en soit de la province soit d’ailleurs. Le public normand a été très excité et charmé. Les paysans sont venus en foule voir cela. L’expositon a fini par une loterie de tableaux. On en a acheté pas mal, de côté et d’autre. On les méprisera beaucoup un jour. Mais ils auront commencé le goût et le sentiment de l’art dans toute une population.
9 h. 1/2
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. C’est la première fois que cela m’arrive cette année. C’était hier Dimanche. On aura mis votre lettre trop tard à la poste. C’est la seule explication que j’accepte. Adieu. J’aime mieux me taire.
Mots-clés : histoire, Littérature, Politique (France), Portrait (Dorothée), Presse, Progrès
110. Val-Richer, Vendredi 24 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il fait un temps affreux, et j’ai très mal aux dents. Voilà une mauvaise préparation pour les courses de Caen, et pour la société des Antiquaires. J’ai pourtant un peu plus de foi dans mon éloquence, malgré la douleur, que dans l’agilité des chevaux, malgré la boue. J’ai fait hier une petite répétition de la victoire de Pascal. Je souffrais vraiment beaucoup, l’impatience m’a pris, et je me suis mis à travailler comme si de rien n’était ; en moins d’une heure, l’attention l’a emporté ; je n’ai plus senti la douleur que dans le lointain, comme quelque chose qui pouvait, qui voulait même revenir, mais qui n’était pas là. Je ne l’ai retrouvée qu’à dîner. Cette nuit, j’ai dormi, grâce à un gargarisme de pavot et de fait. Vous voilà parfaitement au courant. Vous a-t-on apporté les Mémoires de Sully ? Avez-vous jété les yeux sur ces dépêches de M. de Fénélon ? Il y a bien des choses ennuyeuses, mais quelques unes vraiment curieuses et amusantes. A la vérité, il faut les chercher dans les ennuyeuses, et vous n’êtes guère propre à ce travail. Votre plus grand défaut est de ne savoir vous plaire qu’à ce qui est parfait. Défaut qui me charme et me désole. Quand je vous vois repousser avec un si fier dédain tout ce qui est médiocre, ou lent, ou froid, ou insuffisant ou mélangé, tout ce qui est entaché, en quelque manière que ce soit de l’imperfection de ce monde, je vous en aime dix fois davantage. Et puis quand je vous vois triste et ennuyée, je vous voudrais plus accommodante moins difficile. Je mens ; restez comme vous êtes, même à condition d’en souffrir. Je le préfère infiniment. Je vous voudrais seulement, pour vous-même, un peu plus de goût pour une occupation quelconque, lecture ou écriture, pour l’exercice solitaire et désintéressé de la pensée. Vous n’y perdriez rien et vous vous en trouveriez mieux. Mais vous n’aimez que les personnes ; il vous faut une âme en face de la vôtre.
Qu’à donc la petite Princesse ? Est-ce qu’elle est malade de la folie de sa femme de chambre ? Pourquoi garde-t-elle cette femme ? Si la folie persiste, il faut la mettre dans une maison de santé. Je parie que l’extrême voisinage de la petite Princesse ne lui vaudra bien auprès de vous. Elle ne supportera pas cette épreuve. Je comprends que le baptême Protestant du petit Duc de Wurtemberg déplaise à l’archevêque ; mais, il devait s’y attendre. On ne s’attend à rien ; on ne renonce à rien ; on ne se résigne point. Il y faut le poids de la nécessité la main de Dieu. Voilà pourquoi nous avons bien fait en 1830. Je pars après demain dimanche à 6 heures du matin, pour être à Caen à 11 heures. J’ai promis d’assister aux courses soleil ou pluie. Elles commencent à midi. Je rentrerai probablement chez moi à la fin de la semaine samedi ou dimanche. La Duchesse de Broglie doit venir nous voir vers cette époque, à partir de demain samedi, adressez-moi donc vos lettres à Caen, à la Préfecture. Du reste, je crois vous l’avoir déjà dit.
10 heure 1/2
Cet horrible temps a retardé mon facteur. Il arrive seulement. Je le sais que vous êtes bien seule, et je m’en désole. A votre mal, je ne sais qu’un soulagement, l’affection, et l’affection de loin, donne si peu ! Tout est bien triste. Votre lettre de ce matin me trouve en grande disposition de le dire avec vous. Adieu. Henriette sera charmée de votre lettre. Adieu. G.
Mots-clés : Littérature, Politique, Portrait (Dorothée), Santé (Dorothée), Santé (François)
113. Caen, Lundi 27 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne flatte jamais quand j’aime. Pas un nuage ne passe devant mon soleil que je ne le voie. Mais il n’a pas un rayon qui m’échappe et qui n’illumine tout à mes yeux. On ne sait pas aimer. On ne sait pas admirer. On ne sait pas jouir de ce qu’on aime et de ce qu’on admire. On en laisse perdre des trésors. Et quand on ne perd rien, quand on jouit de tout, pourquoi ne dirait-on pas tout ? Pourquoi ne renverrait-on pas tout son plaisir à sa source. On ne sait pas non plus faire plaisir à qui on aime. On en laisse échapper mille et mille moyens, mille et mille occasions. Je ne veux rien perdre, ni du plaisir que je puis prendre, ni du plaisir que je puis donner. Quel petit mot que celui-là ! J’en sais qui me conviennent bien mieux. Mais ne soyez pas malade. Je ne sais pas de mot pour mon chagrin. Pourquoi cette maigreur soudaine ? Vous êtes vraiment encore plus mobile au physique qu’au moral, pour parler comme les philosophes. N’oubliez pas de me dire ce qui sera parti de cette maigreur, si vite venue.
Je suis arrivé hier ici au milieu des coups de canon, des courses de chevaux et d’un dîner de 40 personnes. Tout cela ne m’a pas empêché de dormir. On m’a reçu à bras ouverts. J’amenais moi d’abord, puis le soleil. On nous attendait tous deux avec grande impatience. J’ai trouvé la population, vraiment la population charmée de son Prince et disant : le bonheur nous en veut. Le mot courait de bouche en bouche, et on disait bien nous. Soyez sûre que ce pays-ci regarde tout-à-fait ce gouvernement comme sien. C’est une force immense. J’écrirai ce matin, à M. le Duc d’Orléans que doit être bien content. Je suis ici jusqu’à samedi. Je passerai mon temps à déjeuner et à dîner dans les environs. Je préside ce soir la société des Antiquaires., Samedi je rentrerai chez moi. Ecrivez-moi donc Vendredi au Val-Richer.
Mon mal de dents est fort diminué. Je le sens mais je n’en souffre plus. Vous me conterez votre dentiste. Du reste, je ne m’étonne pas que le contraste vous ait frappée. Brewster à les meilleures façons du monde. Je trouve la lettre d’Ellice très sensée, car elle est d’accord avec mes conjectures. Ne vous arrive-t-il pas comme à moi, d’être sans cesse étonnée tantôt du beaucoup, tantôt du peu d’esprit que vous avez ? On devine quelques fois merveilleusement de très grandes choses et puis tout à coup on s’aperçoit qu’une petite chose qui se découvre et qu’on ignorait, modifie, immensément ce qu’on croyait très bien savoir. Avez-vous causé avec Pahlen ? Je suis impatient de savoir s’il n’aura rien vu, s’il ne vous aura rien dit qui vous éclaire un peu sur ce qui vous touche.
Adieu. Il faut que j’écrive à M. le Duc d’Orléans et à ma mère. Puis ma toilette. Puis des visites. Puis le déjeuner. Puis les courses. Puis le dîner, la séance, les speechs. Adieu.
Tout cela fait bien du bruit. Mais le moindre grain de mil Ferait bien mieux mon affaire Adieu. Je vous écris dans le même cabinet et de la même table d’où je vous ai écrit l’an dernier, à Boulogne, quand vous êtes revenue de Londres. Toujours.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Mandat local, Portrait (Dorothée)
123. Val-Richer, Vendredi 7 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne sais ce que je vous dirai aujourd’hui. Mon premier mouvement dure toujours. Je vous aime de cette affection qui domine tout, qui suffit à tout, qui promet immensément et donne toujours plus qu’elle ne promet, qui ne supprime pas toutes les épreuves ne guérit. pas toutes les plaies ; mais qui se mêle à toutes, pénètre jusqu’au fond, et répand sur toutes un baume qui les rend toutes supportables. Voilà comment je vous aime. Et je vois à la fois deux choses ; l’une, que mon affection ne peut pas pour vous tout ce quelle croit pouvoir ; l’autre que vous ne savez pas y croire. Vous êtes malheureuse et injuste. Je ne me suis point mépris sur vous. Vous êtes tout ce que j’ai cru tout ce que je crois toujours. Aujourd’hui comme il y a un an c’est mon plaisir, mon ravissant plaisir de penser à tout ce que vous êtes, à l’élévation de votre caractère, à la profondeur de votre âme, à l’agrément supérieur de votre esprit, au charme de votre société. Rien de tout cela, n’a changé n’a pâti pour moi depuis le premier jour. Bien au contraire : j’ai eu des doutes que je n’ai plus ; j’ai cru à des lacunes que n’existent pas. Mais je me suis trompé sur les limites du possible. J’ai cru que, malgré l’incomplet de notre relation, malgré la cruauté de votre mal, même sans pouvoir vous donner toute ma vie, je ranimerais, je remplirais la vôtre.
Vous m’aviez inspiré avant le 15 juin un intérêt momentané mais au moment sérieux et profond. Depuis le 15 juin, ma pensée et mon cœur ne vous ont pas quittée une minute. Vous êtes entrée et entrée avec un charme infini, dans les derniers replis de mon âme. Vous m’avez convenu, vous m’avez plu dans tout ce que j’ai en moi de plus intime, de plus exigeant, de plus insatiable. Je vous l’ai montré comme cela se peut montrer toujours bien au dessous de ce qui est, mais enfin, je vous l’ai montré. Et en vous le montrant, à vos émotions, à vos regards, à vos paroles en vous voyant renaître, et revivre, et déployer devant ma tendresse votre belle nature ranimée, je me suis flatté que je vous rendrais, et qu’à mon tour je recevrais de vous, non pas tout le bonheur, mais un bonheur encore immense, un bonheur capable de suffire à des âmes éprouvées par la vie, et qui pourtant n’ont pas succombé à ses épreuves, qui portent la marque la marque douloureuse des coups qu’elles ont reçus, et pourtant savent encore sentir et goûter avec transport les grandes, les vraies joies. Voilà ce que j’ai cru, ce que je me suis promis. Je n’ai pas de désirs médiocres. Je n’accueille que les hautes. espérances. Je sais me passer de ce qui me manque, mais non me contenter au dessous de mon ambition. Et dans notre relation, de vous à moi mon ambition a été, est infiniment plus grande que dans tous les autres intérêts où peut se répandre ma vie. Je ne saurais la réduire. Je ne regrette pas d’être ainsi. Et d’ailleurs cela est. Je puis me gouverner, non me changer.
Comment l’idée que je voudrais vous envoyer à Baden pour me débarrasser de vous, pour ne plus porter le poids de vos faiblesses et de vos peines a-t-elle pu vous entrer dans l’âme ? Je crois vous l’avoir déjà dit ; vous avez certainement passé votre vie avec des cœurs bien secs et bien légers. Vous ne pouvez parvenir à croire à une vraie affection. Vous retombez sans cesse dans vos souvenirs de la froideur et de l’égoïsme humain. C’est encore pour moi un mécompte. Je m’étais flatté qu’en dépit de votre expérience je vous rendrais une confiance, qui est dans votre nature, que je vous ferais trouver en moi ce que vous n’aviez rencontré nulle part qu’en vous-même. Je suis bien orgueilleux, n’est-ce pas ? Mon orgueil n’a rien qui puisse vous blesser. Que me dites-vous que votre esprit est bien soumis à mon esprit ? Est-ce votre soumission que je veux ? Je méprise la soumission, je méprise toute marque, tout acte d’infériorité. Je ne me plais que dans l’égalité. Je veux une nature égale comme une affection égale. Je veux vivre de niveau et en pleine liberté avec ce que j’aime. Je veux sentir à la fois son indépendance, et son union avec moi, sa dignité et son abandon. C’est à cause de vous seule, c’est en désespoir de moi sur vous et pour vous, que je vous ai conseillé d’aller à Baden ; croyant deux choses ; l’une que si je suis pour vous ce que je veux être, vous sauriez bien revenir en France, l’autre que, si je ne suis pas cela, il vous importe par dessus tout d’arranger votre vie avec ceux qui en disposent matériellement. Dites-moi que j’ai eu tort, et n’allez pas à Baden. Vous ne m’aurez jamais fait un plus immense plaisir.
9 h. 1/2
Oui, vous êtes bien douce ; mais cela ne me suffit pas. Adieu pourtant. Et adieu comme toujours. G.
125. Val-Richer Dimanche, 9 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
La pluie a cessé. Le soleil se lève très beau. Je ne puis souffrir ces brusques alternatives. Je veux avoir devant moi un long temps égal, uniforme. J’ai toujours trouvé le bonheur ancien supérieur, au bonheur nouveau. Ce qui me plaît vraiment ne s’use jamais pour moi. J’y découvre au contraire chaque jour un nouveau mérite et un nouveau plaisir. Je me rappelle l’été de 1811 de la grande comète. Le soleil a été plus de deux mois brillant et chaud, sans interruption. Tout le monde en était las. J’en étais de plus en plus ravi. Et quand la pluie, le ciel sombre sont revenus, j’ai été triste comme d’une décadence, comme d’un deuil. Tout ce qui passe est si court, dit St Augustin. Comment l’abréger encore par la mobilité de nos désirs ?
Ne prenez pas ceci pour une personnalité. Je ne vous trouve point mobile du tout. Vos impressions du moment de la surface sont mobiles ; mais le fond de votre âme est très solide parce qu’il est très profond. C’est par la profondeur de vos sentiments que vous m’avez frappé et touché. Je pense à Marie. Faites y attention. Il y a à parier que la princesse de Schönburg a raison. C’est trop étrange. dès que vous aurez Lady Granville, tenez conseil. Et si la délibération du conseil est conforme à l’avis de la petite Princesse ayez sans doute tous les ménagements possibles ; mais ne tardez pas trop à prendre une résolution. Vous ne pouvez en conscience charger de plus votre vie d’une folle. Pauvre enfant ! J’espère encore qu’il n’en sera rien. Mais s’il y a quelque chose, ce n’est pas près de vous qu’elle se guérira. Elle y manque à la fois de sérénité et de mouvement. Elle s’agite et s’ennuie. Mauvaise condition à tout âge, encore plus dans la jeunesse.
Je suis charmé que Lady Holland, Lady Granville. et tout ce monde dont vous me parlez reviennent. Cela vous distraira l’une et l’autre, et l’une de l’autre. Que devient l’affaire du Roi de Hanovre ? Est-ce que celle-là s’en ira aussi en fumée comme les autres ? Que veut dire cette apathie, cette impuissance universelle ! Est-ce un monde fatigué qui se remet, ou un monde usé qui s’affaisse ? J’ai cru. je crois toujours à la première explication. Mais il faut de temps en temps quelque grand événement, quelque voix bien haute pour secouer cette torpeur, et interrompre la prescription de la vie. Rien ne paraît.
Je ris de moi-même en écrivant cela. Que la préoccupation de l’égoïsme est forte ! Il y a à peine huit ans que nous avons ébranlé le monde. Il n’y a pas trois ans que nous sommes sortis, nous autres Français d’une lutte intérieure terrible qui a duré cinq ans. Et nous nous plaignons de l’apathie ! Nous trouvons l’entracte bien long ? S’il m’arrive d’oublier ainsi les choses, à cause de moi, de ne pas juger mes impressions et mes désirs personnels, rappelez-moi à l’ordre, je vous prie. Je veux surtout être juste et sensé.
9. 1/2
Cela ne se peut pas. Il ne peut pas y avoir une phrase froide, ni à la fin, ni au commencement, ni nulle part. Je vous ai écrit très triste, très jaloux, mais triste, mais jaloux par une tendresse infinie, insatiable, désolée de ne pas tout pouvoir, de ne pas tout avoir. Que mes paroles sentissent l’effort ; qu’elles fussent pénibles, raides, cela se peut ; mais ce que vous dites est impossible. Je veux savoir qu’elle est cette phrase. Je suis sûr que vous vous êtes trompée. Je ne l’en efface pas moins puisqu’elle vous a affligée. Il m’arrivera peut-être encore de vous affliger. Quand il m’en viendra du chagrin de vous, je ne vous promets pas de ne pas vous en rendre. Mais jamais ce chagrin-là, jamais. N’est-ce pas que vous ne l’avez plus, que vous n’y pensez plus, que vous n’avez plus froid ? Dites-le moi ; redites. le moi. Que d’Adieux. Je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant, cette lettre. Adieu dearest, adieu. G.
Quand je dis que je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant cette lettre ce n’est pas de celle-ci, c’est de l’autre que je parle, de celle où vous dites qu’il y a une mauvaise phrase. Renvoyez-moi la phrase. Je l’ai sur le cœur, mais je n’y crois pas.
126. Val-Richer, Lundi 10 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’aurai le cœur en paix que lorsque, vous aurez reçu mon démenti à votre tristesse qu’elle que soit ma phrase, et à ma phrase qui ne méritait certainement pas votre tristesse mais qui en tous cas ne valait rien puisqu’elle l’a causée Le Cardinal de Pretz dit quelque part qu’il y a des situations où l’on ne peut faire que des fautes. Il y en a aussi où l’on ne peut rien dire que de triste et d’attristant. J’avais bien ce sentiment-là en vous écrivant Vendredi. Je vous trouvais si abattue, si inquiète, et moi si impuissant pour vous guérir, que j’ai été tout à coup à la dernière extrémité de votre mal et du mien.
Quand j’aime, je prends toujours au pied de la lettre ce qu’on me dit et je crois toujours que cela durera. Je n’ai pas l’instinct de ce qui passe. La réflexion seule me l’apprend. Et puis, résignez-vous à ne me voir jamais résigné à vos mauvais moments, à ces moments qui me font douter de ce que je suis et puis pour vous. Je ne veux rien ôter à personne. Je ne veux rien envier à personne. J’aime tous vos sentiments, oui je les aime, et je vous aime vous, de les avoir tels. Vous ne savez pas pour combien l’état de votre âme, le deuil de votre âme et de votre personne est entré dans l’affection que je vous porte. S’il y a en moi quelque chose de profond, c’est mon aversion pour la légèreté de cœur, pour la promptitude de l’oubli, pour ces sentiments qui dans le vol de notre vaisseau tombent à la mer et s’y abîment avec les créatures qui en sont l’objet. Je déteste cela en moi, quand je l’y trouve, comme dans les autres. Je ne sais comment parviennent à se concilier des sentiments qui existent ensemble dans mon âme. Il y a là un mystère que je ne m’explique pas du tout qui m’a bien souvent tourmenté ; mais Dieu m’est témoin qu’ils existent ensemble, et que l’un n’abolit point l’autre, et que la mémoire de ceux que j’ai aimés est en moi, toujours présente et toujours chère. Et quand je rencontre un cœur qui n’oublie point, un cœur où les morts vivent, je me sens à l’instant pénétré pour lui de sympathie et de respect. Vous avez eu, pour moi, à ce titre seul, un attrait immense. Et il s’est toujours accru plus je vous ai connue. Dans les premiers temps, il a surmonté les doutes qui me venaient à votre sujet, soit de moi-même, soit de ce que j’entendais dire. Plus tard, il m’a fait vous pardonner ce qui m’affligeait ce qui me blessait. Il existe aujourd’hui aussi puissant, bien plus puissant que ce jour où j’ai dîné à côté de vous chez le Duc de Broglie, et où votre regard, deux ou trois fois troublé et plein de larmes au milieu d’une conversation insignifiante, m’a frappé et pénétré jusqu’au fond de l’âme. N’ayez donc jamais, dans aucun cas, pas une minute, le moindre doute sur mon inépuisable, mon infatigable sympathie pour votre mal. Quand Dieu ne m’aurait pas condamné à le ressentir pour moi-même et à le ressentir en ne vous en parlant presque jamais, à cause de vous, je trouverais en moi, dans ma disposition la plus intime de quoi vous comprendre, et m’unir à vous et vous en aimer toujours davantage. Croyez-le bien, croyez-le toujours ; et en même temps laissez-moi toute mon ambition sur vous auprès de vous. Résignez-vous à ses exigences à ses susceptibilités. Je n’y puis rien. Je n’y veux rien pouvoir. Si j’y pouvais quelque chose, vous ne seriez pas pour moi ce que vous êtes. Voulez-vous être moins?
10 heures
Le N°130 m’arrive avec trois personnes qui viennent me demander à déjeuner. Je voudrais ajouter beaucoup de choses à celui-ci. Il n’y a pas moyen. Adieu. Adieu. Votre mine m’importe beaucoup. Mais toujours, le même adieu. G.
131. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si j’étais près de vous, je vous gronderais. De loin, je n’en ai pas le courage. Vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez ! Je pourrais vous redire comme vous me l’avez dit : " Tout a été couvert un moment par l’étonnement, la joie de vous avoir trouvée. Le premier de ces sentiments, le temps l’efface naturellement. Le second dure mais plus tranquille parce qu’il est plus établi. Je ne dirai pas cela parce que ce ne serait pas là l’expression vraie de ce qui est en moi. Voici ma vérité à moi. Vous m’avez inspiré une grande curiosité. Vous ne paraissiez ni ce que j’avais vu ailleurs, ni ce que j’avais été tenté de vous croire. J’étais très touché de votre mal et très curieux de vous connaitre, de savoir ce que vous étiez réellement. Voilà votre premier attrait. Celui-là est passé, j’en conviens. Je vous connais. Je ne suis plus curieux. Mais qu’est-ce donc que cet attrait frivole et froid, à côté de ce qui m’attache à vous aujourd’hui ? Savez-vous que je vous ai trouvée infiniment supérieure à ce que j’attendais au temps de ma plus vive curiosité ? Que vous valez infiniment mieux que je ne supposais ? Que je vous aime bien plus que je ne vous aimais quand je vous ai dit que je vous aimais ? Je puis, comme d’autres, être attiré par l’agrément de l’esprit, par le charme de la nouveauté et donner à ce plaisir plus de place qu’il ne lui en est dû et me laisser aller à l’exprimer plus vivement que ne le voudrait l’exacte vérité. Tout cela, c’est de la vie superficielle, qui a son prix, que je ne dédaigne pas.
Mais ce n’est plus de cela qu’il s’agit entre nous ; ce n’est plus dans cette sphère là que nous vivons. Vous avez pénétré au fond de mon âme, dans ma vraie vie, dans ce qu’il y a en moi de plus sérieux, dans ce qui est vraiment moi. Et vous n’y avez pénétré que lentement. Je suis très accessible à la surface très peu au fond. J’ai beaucoup douté. J’entendais beaucoup parler de vous. J’ai tout écouté. Je ne vous ai pas dit le quart de tout ce que j’ai pensé, cherché, sondé, supposé. Je vous ai trouvé des défauts, des torts. Je les ai tournés et retournés en tous sens pour en découvrir l’origine, pour en mesurer la portée possible. Je vous ai traitée sans faveur. Et plus j’ai regardé à vous, plus vous avez grandi et brillé à mes yeux, plus je me suis senti pénétré et d’estime et de goût, et de tendresse pour vous, pour votre nature, votre nature primitive et essentielle telle que Dieu l’a faite. Je n’y regarde plus à présent. Peu m’importent vos défauts ; peu m’importe ce que vous pourriez avoir fait, ce que vous pourriez faire encore. Il y a en vous quelque chose qui est indépendant de tout supérieur à tout, qui domine et efface tout pour moi. Ce quelque chose, c’est le fond de votre être, c’est vous même. comme disent les dévots vous êtes pour moi, en état de grâce. Rien ne peut plus vous en faire sortir. Est-ce là me plaire assez ? Manque-t-il quelque chose à cette affection-là? Et ne croyez pas que, depuis le 15 Juin, elle n’ait pas subi plus d’une épreuve venant de vous ou d’ailleurs. Je vous dirai quelque jour toutes celles qu’elle a surmontées. Vous me direz si j’ai tort de vouloir que vous ayez foi. Mais laissez-moi vous demander une chose.
Soyez fière avec la destinée comme vous l’avez été avec votre Empereur. Ne parlez pas de la décadence qui vous entoure. Ne vous en parlez pas à vous-même. Il y a des impressions très naturelles, presque inévitables, mais qui ne méritent pas de séjourner dans l’âme. Ne leur permettez pas de faire plus que traverser la vôtre. Elle est si grande ! Rien ne lui manquerait si elle était aussi forte. Mais le sort vous a d’abord gâtée, et puis frappée immensément. Il faudrait une force immense pour suffire toujours à cette double épreuve. Je ne vous parle pas trop sérieusement, n’est-ce pas ? J’espère que non. Dites-le moi pourtant. Et chargez-moi de vous apprendre à vous aimer. Ce qui est très sérieux aussi, croyez-moi, c’est Marie. Ce que vous m’en dîtes à propos de l’enfant de la petite Princesse me trouble beaucoup. Je sais de déplorables aberrations qui ont commencé ainsi. Votre médecin est un sot. Que le mal soit déjà réel ou non, de tels symptômes méritent qu’on y regarde J’aurais bien des choses à vous dire à ce sujet. Mais je ne puis les écrire. 10 h. Je n’ai point de lettre aujourd’hui. Je laisse partir celle-ci comme elle est. Je n’y ajoute et n’en ôte rien. Adieu. Adieu. G.
149. Val-Richer, Jeudi 4 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai dîné avec vous chez Salomon. Quelle chute que celle de ce nom ? Le plus spirituel, le plus hautain, le plus aristocrate des Rois, celui dont la mémoire est restée en orient à côté de celle d’Alexandre devenu le Turcaret d’une race proscrite et vous racontant, en mauvais allemand, ses joies de parvenu ! Et puis vous avez raison : il y a des joies naturelles, qui restent aux proscrits et qui sont belles et touchantes, même sur la tête des Turcarets les plus ridicules. Et ces joies, qui sont pour tous et toujours bonnes, la Providence les refuse ou les enlève quelques fois à ceux qui les méritent le mieux et qui en jouiraient le plus noblement. Quel mystère que la destinée de chacun de nous, cette impénétrable intention d’une volonté inconnue qui nous conduit à travers les ténèbres, et dans ces ténèbres tantôt nous caresse, tantôt nous frappe, sans que nous puissions ni prévoir ni comprendre le bien ou le mal, la faveur ou le coup ! Quand je suis en bonne disposition, ce sentiment de notre situation à tous, aveugles sous une main cachée, ne m’est point pénible, car je suis soumis et confiant ; je marche la tête haute et le cœur tranquille sans rien voir et sans rien pouvoir. Mais dans les mauvais jours, dans les heures faibles, soit pour moi-même, soit pour ceux que j’aime, je succombe sous ce fardeau sans limite comme je ferme les yeux, je prends ma tête dans mes mains, comme pour me cacher et me soustraire à cette mystérieuse et irrésistible Puissance. Oui vous dites vrai, vous êtes bien seule. Vous êtes faite pour n’être pas seule ; vous avez le cœur très ouvert, très vif pour ces affections et ces joies intimes, de tous les moments, Gnimhich und Gnimhich, qui sont le vrai, le seul bonheur. Et vous êtes bien seule. J’y pense sans cesse.
Laissez-moi vous dire tout ce que je pense. Pour ce bonheur-là comme en toute chose, vous êtes délicate, difficile ; vous ne savez vous contenter de rien de médiocre. Si le médiocre, le commun pouvait vous suffire vous l’auriez, vous l’avez. Il vous reste un mari, des enfants. Vous pourriez, avec ces liens tels quels, avoir un intérieur tel quel, comme tant d’autres. Mais vous n’acceptez pas ce que d’autres acceptent ; vous ne supportez pas ce que d’autres supportent. Vous répudiez ce que d’autres gardent. Vous résistez quand d’autres cèdent. Vous ne consentez jamais à descendre, à vous abaisser à vous mutiler ni dans vos instincts, ni dans vos jugements ni dans vos désirs, ni dans vos plaisirs, ni dans vos douleurs. Ne soyez pas autrement ; n’essayez jamais d’être autrement. C’est votre nature, c’est votre supériorité, si rare et si charmante. Quand vous le voudriez, vous n’y pourriez pas renoncer. Ne le veuillez jamais. Ce serait une abdication, une profanation. Mais c’est là ce qui fait que vous êtes seule. Dites-moi que vous n’êtes pas seule quand vous êtes avec moi. Vous vous le rappelez ; c’est ce que je vous ai promis.
9 h 1/2
J’ai aussi un soleil superbe. Réunissons-nous dans ce soleil qui brille sur tous deux. Je me suis promené hier toute la matinée. J’en ferai autant aujourd’hui, mais à pied et avec mes enfants. J’ai vu Rogers une fois ; mais je ne le connais pas. J’ai vu beaucoup de gens que je ne connais pas. Vous savez que je ne suis pas curieux. Le curiosité ne me vient qu’après autre chose. Je suis curieux de savoir comment sera Marie. Je voudrais bien que vous n’eussiez pas là une tracasserie de plus. Adieu. Le temps marche et me pousse vers vous. Adieu. Adieu. Si je m’en croyais, je ne finirais pas. G.
153. Val-Richer, Lundi 8 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me souviens qu’hier, étourdiment je vous ai encore adressé ma lettre aux Champs Elysées. Elle vous sera peut-être arrivée quelques heures plus tard.
Je suis fâché de ce que mande M. de Médem, plus fâché que surpris. Il m’a toujours paru, par ses lettres que votre frère était réellement blessé de votre peu de goût pour la Russie. C’est bien lui qui sincèrement ne conçoit pas que vous ne préfériez pas à tout, votre état de grande Dame auprès du grand Empereur dans le grand pays. M. de Lieven est encore plus soumis, pour parler convenablement mais moins russe et vous comprend mieux. Rien n’est pire que l’humeur sincère d’un honnête homme de peu d’esprit. Il se croit fondé en raison, et ce qu’il y a de plus intraitable, c’est la conviction qu’on a raison. M. de Médem aura peut-être choqué encore votre frère en lui répétant que, bien réellement, avec votre santé, vos habitudes, vos goûts, vous ne pouviez vivre ailleurs qu’à Londres ou à Paris. Les gens d’esprit vont quelque fois trop brutalement au fait. Enfin je raisonne, je cherche, je voudrais tout savoir et tout expliquer, tant cela intéresse. Je voudrais surtout que vous eussiez auprès de l’Empereur quelqu’un de bienveillant et d’intelligent, qui vous comprît, et vous fît comprendre. Je crois toujours qu’avec de l’esprit de la bonne volonté et du temps on peut beaucoup, quand on est toujours là. M. de Nesselrode et Matonchewitz, à ce qu’il me semble y seraient seuls propres. Mais l’un est trop affairé, l’autre trop petit, et ni l’un ni l’autre ne s’en soucie assez. Je suppose que vous avez répondu à votre mari.
Montrond a passé en effet son temps chez Thiers. Je suis curieux de ce qu’il y a porté et de ce qu’il en a rapporté, au moins de ce qu’il en dit. Je le verrai à mon retour. Il a vraiment de l’esprit, de l’esprit efficace. Il faut beaucoup pour qu’il rajeunisse un peu. Il était cruellement cassé.
8 h 1/2
Je viens de sortir pour aller voir mes ouvriers. Je plante des arbres. Nous avons depuis huit jours un temps admirable. Ma mère et mes enfants en profitent beaucoup dix fois dans le jour, je les envoie, au grand air, comme on envoie les chevaux à l’herbe. Nous nous promenons ensemble après déjeuner. Le matin, tout à l’heure j’assiste au premier déjeuner de mes enfants, chez ma mère. Trois fois par semaine ; ils viennent chez moi tout de suite après prendre une leçon d’arithmétique. Le soir de 9 heures et demie à 8h 1/2, je leur lis de vieilles Chroniques sur les croisades, qui les amusent extrêmement. Le reste du temps, je suis dans mon cabinet ou je me promène pour mon compte.
Quel est donc le mal de la Princesse Marie ? Quel qu’il soit, j’en suis fâché, et j’espère que ce n’est pas vraiment grave. Elle a de l’esprit. J’ai quelque fois causé avec elle tout -à-fait agréablement. Je m’intéresse à elle comme à une personne en qui on a entrevu en passant plus que le monde n’y verra, et qu’elle-même ne saura très probablement.
J’ai eu hier beaucoup de visites. On se hâte de venir me voir. J’aurai d’ici à quinze jours, quelques dîners à Lisieux private dinners, pas de banquet. Je n’en veux pas cette année Je l’ai dit à mes amis et ils l’ont fort bien compris. Je ne veux pas parler politique avant la Chambre.
10 h.
Le facteur m’arrive au milieu de ma leçon d’arithmétique. Je reçois des nouvelles de l’arrivée de Mad. d’Haussonville. Je veux écrire un mot à M. de Broglie. Adieu. Adieu, comme à la Terrasse, dans ses meilleurs jours. G.
166. Val-Richer, Dimanche 21 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève au milieu d’un brouillard incomparable. Je ne vois pas les arbres qui sont devant mes fenêtres. Quand je me reporte en Languedoc, en Provence, sous ce ciel toujours si pur où les regards s’enfoncent sans que rien, les gênes et dont pourtant ils n’atteignent jamais le terme, je ne conçois pas comment je ne suis accoutumé à ces caves du Nord. Et je m’y suis accoutumé et je dis qu’elles sont vertes et fraîches. Il est vrai qu’elles le sont, qu’elles ont leur beauté, et que la sagesse de l’homme consiste à savoir jouir partout de la richesse de Dieu. Je le pense. Je le fais. Et pourtant je regrette, mon soleil. Il sera plaisant en effet que l’Empereur ait fait en Allemagne tout ce chemin et tout ce bruit pour y venir chercher, un Leuchtenberg. Du reste, je ne sais si c’est parce que je demeure loin ; mais il me semble que ce bruit ne retentit plus du tout. Je n’en entends plus rien. Tout passe bien vite de nos jours. Des intérêts, des affaires, qui jadis auraient rempli des mois, obtiennent à peine des heures. Les choses s’en vont comme les personnes en chemin de fer. Je le comprends il y a vingt cinq ans, dans le temps des batailles de Leipzig. Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas si riches, ni si pressés. Au fait, nous avons raison. Il ne faut pas regarder, longtemps, les petites choses, quand on a vécu dans les grandes.
Pour me distraire des petite choses, j’ai lu hier soir à mes enfants le Malade imaginaire. Vous n’avez pas d’idée de leurs transports de rire. Je posais mon livre pour les regarder. Je m’amuse de bon cœur avec mes enfants. Je jouis de leur gaieté. Mais je ne sais plus rire. Vous êtes et vous serez la dernière personne qui m’ait vraiment vu et fait aire. Par exemple je ne rirai pas demain. J’ai vingt personnes à déjeuner qui me prendront toute ma matinée. Je suis charmé que Pozzo vienne passer quelques mois à Paris. Je l’ai vu vous faire rire encore lui et Brougham. Comment a-t-il fait pour que sa maison ne soit pas confortable? Heureusement sa conversation le sera toujours. C’est donc à force d’esprit que Montrond se porte mieux. Il faut qu’il en ait vraiment beaucoup pour en conserver. Je causerai volontiers avec lui. J’ai besoin de causer. J’ai bien des choses à apprendre, et quelques unes à dire. Quoique vous m’ayiez admirablement tenu au courant. Vos lettres sont un miroir d’une vérité parfaite. Je n’ai jamais vu de source plus limpide que votre esprit. Rien ne le trouble et il coule toujours. Nous nous serons beaucoup écrit dans notre vie, beaucoup trop.
Avez-vous remarqué avec quel soin on a fait mettre dans les journaux que ce n’était pas la liste civile, mais l’Etat qui avait loué à M. Appony sa maison ? Il ne faut pas aller si vite au devant des propos. Est-il vrai que les Appony y soient déjà établis ? J’ai peine à le croire. Je suis curieux de voir comment on a arrangé cette maison-là. J’en aurais fait une habitation charmante. Je connais beaucoup l’hôtel Beanay que veut M. de Palhen. J’y ai vu le Président de la Chambre, M. Royer-Collard, et avant lui le directeur général des Ponts et Chaussées, Me Pasquier, je crois. C’est une assez grande maison, c’est-à-dire avec beaucoup de logement, mais rien de très grand, une cour médiocre, et si je ne me trompe une seule sortie. Deux millions me paraissent beaucoup. A la vérité il faut la meubler. Je n’y pensais pas. Ce n’est pas trop.
10 heures
Je suis désolé que vous dormiez toujours si mal. Est-ce que je ne trouverai pas, quand je serai là, des moyen d’y mettre ordre ? Adieu. Adieu. G.
193. Val-Richer, Samedi 8 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
209. Paris, Samedi 6 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mots-clés : Politique (France), Portrait (Dorothée), Récit
211. Paris, Lundi 8 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai pu lire ceci sans sourire. Je ne savais pas que vous attendiez mes lettres comme moi j’attends les vôtres. Si j’allais vous ennuyer : " Vous êtes, dirai-je incorrigible, ou incurable ? Ce n'est pas parce que vos lettres m'amusent que je les attends impatiemment ; quand elles m’attristent, je les attends plus impatiemment encore. Je vous aime. Voilà ma raison, qui dispense de toutes les autres. Il y a dans l’évangile une admirable parole : " Cherchez premièrement la sagesse ; tout le reste vous sera donné par dessous. " La tendresse a le même privilège que la sagesse ; là où elle est tout le reste vient par dessus.
Vous avez bien fait de mettre le comte Frédéric Pahlen et Matonchewitz un peu en garde. Je ne doute guère des retards factices, par humeur et vengeance. Mais puisqu'il se sent obligé à la réserve, cela ne peut aller très loin, pourvu que, de leur côté, vos fondés de pouvoir pressent au lieu de tolérer la langueur. C’est donc sur eux qu’il faut agir. M. Sampayo, qui arrive de Lisbonne dit sur l’Espagne des choses curieuses. L’anarchie y est plus grande, et le gouvernement plus impuissant que jamais. Mais à travers l’anarchie, l'activité est grande aussi dans le pays et la prospérité croissante. Il y a beaucoup plus de terres cultivées, de maisons neuves. Le commerce se répand ; des établissements de tout genre se forment ; le luxe augmente. Bref, c’est un pays qui se développe du lieu de se détruire. Et l’idée que Don Carlos ne peut rien, que le gouvernement de la Reine, bon ou mauvais, est, après tout, celui qui subsistera, cette idée devient générale. M. Sampayo ajoute que les partisans de la non-intervention ont eu raison, qu'évidemment on aurait eu tort d'intervenir, et que l’Espagne s'en tirera dans cela. Voilà qui fera bien plaisir à Zéa. M. Sampayo n’est pas content de sa campagne contre le duc de Palmella. Il s’en venge en retenant, je ne sais sous quel prétexte légal, la plus grande partie de la fortune jusqu’à ce que la marquise de Fayal ait 24 ans. Pure vengeance, car il n'en joint point ; tout s'accumule et il faudra tout rendre. Mais enfin plaisir de vengeance.
Il n'y a personne de votre connaissance à Dieppe. Vous serez partout plus seule qu’à Baden, excepté en Angleterre. Est-ce que ce sommeil que vous avez un peu retrouvé ne vous repose pas ? Comment va l'appétit ? Je fais des questions et je sais les réponses. Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir vous envoyer autre chose que des paroles. Je me suis heurté plus d’une fois en ma vie contre les limites de notre puissance, quel que soit le désir. C’est un sentiment très amer. Adieu Adieu G.
214. Paris, Mercredi 10 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Votre santé d'abord. Vous me mettez au supplice en me demandant de la gouverner. Je connais ce mal-là. Je frissonne encore en y pensant. Au bord du précipice dans les ténèbres, pousser ou retenir, on ne sait lequel, ce qu'on aime le mieux au monde ! Si vous étiez là, si j’avais là vos médecins, si je ne vous quittais pas un instant, si je voyais, si j’entendais tout mon anxiété serait affreuse. Et de loin, quand je ne sais rien, rien, quand vous me dîtes hier que vous dormez, aujourd'hui que vous ne dormez pas, tantôt que vous faites de longues promenades, tantôt que vous ne pouvez plus marcher. C'est impossible. Je vois bien que Baden ne vous fait pas le bien que vous en espériez. Ne vous en fait-il aucun ? Vous y êtes bien seule. Ou irez-vous ? à Paris quand je vais le quitter. Aux bains de mer ? Où ? En France, vous y serez plus seule que partout ailleurs. En Angleterre ? Dans cette terre de Lady Cowper dont j'ai oublié le nom, près de Douvres, Broadstairs, n'est-ce pas? Je l’aimerais mieux. Si cela se peut je l'approuverais. Cela se peut-il ? Si le cabinet reste, comme tout l’indique Lady Cowper ne viendra pas sur le continent. Tout à l'heure, je crois, elle vous a de nouveau pressée d’aller la voir.
Jusqu'au moment qui nous réunira à Paris, je ne vois que l'Angleterre qui vous convienne un peu, un peu. Et j'y crains pour vous le manque de repos, les obligations gênantes, le climat triste, les souvenirs. Je ne m’arrêterais pas si je disais tout ce qui me vient à l’esprit sur un tel intérêt, dans un tel doute. Ecoutez ; il y a des choses qu'on peut faire, des résolutions qu'on peut prendre quand la nécessité est là, la nécessitée actuelle pratique, quand l'action suivra immédiatement la résolution, quand on est là soi-même pour agir comme pour parler. Mais décider sans agir, par voie de conseil, envoyer par la poste une décision pareille. Cela ne se peut pas vous ne me le demandez pas. Madame de Talleyrand m’avait promis de me donner de vos nouvelles. Pourquoi ne le fait-elle pas ?
Jeudi 7 heures
Après votre santé, vos reproches. Je les accepte et je les repousse. Moi aussi, j’ai été gâté. Je n’ai pas prodigué mon affection ; et j'ai vu, jai toujours vu celle que j’aimais heureuse, très heureuse. Je l'ai vue heureuse à travers les épreuves, sous le poids des peines de la vie. J’ai toujours eu le pouvoir de la soulever au dessus des vagues, de rappeler le soleil devant ses yeux, le sourire sur ses lèvres, de placer pour elle, au fond de toutes choses ce bien suprême qui dissipe ou rend supportables tous les maux. De quel droit me plaindrais-je que, sur vous, le pouvoir me manque souvent ? Qu’est-ce que je fais, qu'est-ce que je puis pour vous ? Une heure, où une lettre tous les jours. C'est pitoyable. Parce que je suis avec vous ambitieux, exigeant, ne me croyez pas injuste où aveugle. Vos douleurs passées, vos ennemis présents, ce qui vous a brisée, et ce qui vous pèse, je sens tout cela ; je le sens comme, vous-même, oui comme vous- même ; et je sais le peu, le très peu de baume que je verse dans ces plaies qui auraient besoin que la main la plus tendre fût toujours là, toujours. Je sais de quoi se fait le bonheur ; je sais ce qu’il y faut, et à tout instant. Vous ne l’avez pas même par moi. Ma tendresse s’en désole ; mon orgueil s'en révolte ; mais je ne m’abuse point et ne vous reproche rien. Pourtant ne me demandez pas de changer. Je ne changerai pas. Je ne me contenterai pas pour vous, à meilleur marché que je n'ai toujours fait. Je ne prendrai pas mon parti qu’il y ait entre nous tant d'insuffisance et d’imperfection. Ce temps que je ne vous donne pas, il est plein de vous. Ce bien que je ne vous fais pas, je m’en sens le pouvoir. Ce qui manque à votre bonheur ne manque pas à ma tendresse. Ce contraste est poignant. N'importe. Je garderai avec vous mon ambition infinie, insatiable, souvent mécontente ; et je vous la montrerai, comme vous me montrez ce mal que je ne puis guérir. Voilà la vanité. Déplorons la ensemble. Pour tous deux cela vaut mieux que de s'y résigner.
Je viens à vos affaires. Ceci est plus aisé et sur ceci, j’ai un parti pris. J’ignore si votre fils fera ce qu’il doit. Mais, s’il le fait, je suis d’avis que vous mettiez de coté tout fâcheux souvenir, & que vous acceptiez de bonne grâce ce qu’il fera pour vous au delà de votre droit. Vous n’avez point cédé à sa fantaisie, à sa colère. Votre dignité est à couvert. Vous pouvez, vous devez vous montrer facile avec lui, quant à la réparation. Et s'il agit convenablement, s’il met votre droit de côté pour faire son devoir, il y a réparation de sa part. Le fait suffit pour que vous présumiez l’intention. Saisissez la et reprenez votre fils dès qu’il reprendra lui la physionomie filiale. Je n'hésite pas dans mon conseil et je souhaite beaucoup que cela finisse ainsi. Onze heures Voilà mes lettres. Point de vous. Pour le coup, ceci m'inquiète. Je ne vois point d'explication. Peut-être quelque orage. Mais la poste est arrivée. Il faut attendre à demain. Adieu. Un tendre et triste Adieu. G.
229. Val-Richer, Lundi 29 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rattraperai aisément la mesure, car l’air me plaît. Je voulais ménager votre force et vos yeux. Donnez m'en tout ce que vous voudrez. J’ai de quoi vous rendre. C'est, je crois le défenseur de l’archevêque Land qui a dit le premier qu'avec cent lapins blancs ou ne fait pas un cheval blanc. Avec cent lettres de Baden et du Val-Richer, on ne fait pas une conversation de la Terrasse. Mais j’aime mieux cent lettres que cinquante. Pourtant je ne redeviendrai quotidien qu’à partir de Jeudi 1er août.
Je mène demain mes deux filles à Caen, chez leur dentiste de province. Il faut leur ôter deux dents de lait que Brewster a voulu ajourner quand elles ont quitté Paris. Il y a un bon dentiste à Caen. J'en reviendrai après demain soir. Cette course me dérange ; mais je suis mère.
J’attends avec grande curiosité la confirmation des nouvelles d'Orient. On dit que le capitan Pacha est un homme à vous, qui avait beaucoup contribué au traité d'Unkiar-Skelessi et vous fut, aussitôt après, envoyé comme Ambassadeur. Les habiles soutiennent que tout cela n’est pas clair. Pour moi, je me suis décidément retranché les prophéties. Je veux voir.
Avez-vous entendu dire que le comte de Pahlen remplacerait Pozzo à Londres ? J’en serais fâché et pour vous et pour nous. A moins qu'on ne nous redonnât Pozzo mourant. Mais cela ne se peut guère. Votre pauvre ami de Hanovre commence à prendre peur. Il s’est chargé de plus qu’il ne peut porter. Ç'a toujours été un grand métier que celui de despote. De nos jours, il y faut Napoléon. Encore s’y est-il cassé le nez. Est-ce qu’il ne vous vient plus de lettres de là ? Du reste, il me semble qu’il vous parle toujours plus des Affaires d’autrui que des siennes. Il me semble que j'ai vu autrefois. M. de Malzahn à Paris, en 1820 et 1821. N’a-t-il pas été Ministre de Prusse à Munich, ou à Stuttgart ? Je le confonds peut-être avec un M. de Maltzen qui était aussi dans la diplomatie Prussienne ; homme d’esprit, un peu solennel.
L'humeur de la Chambre des Pairs porte ses petits fruits. On aurait voulu qu’elle fit sur le champ un second procès, pour en finir de ces gens du 12 mai, comme on en finit. Il n'y a pas du moyen. Les Pairs n’ont pas voulu en entendre parler. Leur commission d’instruction va en mettre en liberté tant qu’elle pourra, et ceux qui resteront attendront en prison que la Chambre ait un peu repris cœur aux procès. C'est encore un excellent instrument de gouvernement qu’on a bien vite usé. Les fêtes ont été on ne peut plus paisibles. Fort tièdes. Les hommes ne se réjouissent pas par commémoration. Il n'y a de solennité durable, en l’honneur d’un grand événement, que celles qui portent un caractère religieux. On ne puise un peu de durée que dans l'éternité. Notre temps a étrangement perdu l’intelligence de la durée et de ses conditions. Jamais les hommes n’ont vécu concentrés à ce point dans le présent. Petite vie, et qui fait toutes choses, à sa mesure. Et pourtant, il y a dans les idées, dans les sentiments, dans les institutions de notre temps, le germe de grandes choses très grandes. Mais pour que les grandes, choses viennent, il faut extirper les petites. On ne peut pas avoir de taillis sous les hautes futaies. Et de notre temps, les petites choses sont innombrables, petits intérêts, petits conforts, petits désirs, petit plaisirs. Il y a des facilités infinies pour dépenser sa vie et son âme en monnaie. C'est mon désespoir de voir de quoi on se contente aujourd'hui. Parmi vos raisons de me plaire, celle-ci m’a beaucoup touché, vous avez l’esprit et le cœur superbe. Cela coûte cher ; mais n’y ayez pas regret. Cela vaut encore davantage, n’est-ce pas ? Adieu pour aujourd’hui. Je vous dirai encore adieu demain avant de partir. J’oubliais de vous dire que Madane d'Haussonville est fort heureusement accouchée d’une fille. C'est ce qu'elle désirait. J’en suis charmé pour son père. Sa première couche avait été fort pénible et le tourmentait.
Mardi 9 heures 1/2
Bonjour et adieu. C'est la même chose, toujours la même et et toujours charmante. Je vous écrirai demain. Je ne vais à Caen que samedi. Encore adieu. G.
231. Val-Richer, Mercredi 31 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Aujourd'hui c’est tout seul que je me suis promené. Je viens de marcher trois heures, au petit pas, dans les bois, les près avec ou sans chemin, pensant à vous et à Washington. Vous vous ressemblez peu. Pourtant c'était une grande matière, et il a bien vraiment accompli sa destinée quand il a vaincu et gouverné. Il l’a fait très simplement et de sang froid, sans vit plaisir, mais aussi sans prétention ni effort. C’est peut-être le seul grand homme qui l'ait été par occasion seulement, poussé en haut par la nécessité des choses et non par l'élan de son propre esprit et de sa propre volonté. Deux choses lui manquaient : la passion et la pensée ; la passion ardente, insatiable ; la pensée spontanée, variée, illimitée dans son activité. Mais appelé à agir, je ne connais point de jugement, plus droit, plus imperturbable dans la vérité, point de caractère plus ferme et plus serein, toujours au niveau des grandes choses sans jamais se croire au dessus. Je vous en dirais long si je vous disais tout ce qui me vient à l'esprit sur lui en lisant sa vie et ses Lettres. J’ai pensé à vous bien plus qu'à lui. J’aime extrêmement à penser à ce que j’aime. On dit que les avares passent des heures à contempler leur trésor. Je suis un avare. Bien certainement je le suis. Je me comptais à regarder mon trésor, & je veux le garder pour moi seul.
Jeudi 6 heures
Le soleil est admirable ce matin. C’est une rareté. Je voudrais que vous vissiez ma bibliothèque au soleil levant. Il y entre à flots par neuf grandes croisées et se répand sur deux vastes jardinières pleines de fleurs et sur une série de gravures, encadrées le plus simplement du monde, en chêne et en sapin de Suède, comme la bibliothèque, mais toutes fort belles, saintes et profanes des Saintes Familles, la communion de St Jérôme, le spasimo de Raphaël, Napoléon à Eylau à Austertitz, à St Hélène, Henri 4 à Paris, Gustave Wasa à sa dernière diète & Je suis sûr que cela serait de votre goût, la bibliothèque et le soleil. Si le Cardinal Fesch qui répand son argent à tort et à travers, m'en avait laissé un peu je ferais du Val-Richer une habitation charmante. J'ai, pour cela la matière et l’esprit. Rien ne me manque que l’argent. Je comprends que l’Europe s'amuse du spectacle des Buonaparte, se disputant cet argent. Quand Fesch fut fait Cardinal, le maréchal Lefèvre ( duc de Dantzick ) homme d’esprit malicieusement grossier, lui dit avec son accent alsacien : « Sap.. Monseigneur, c'est pien heureux que je ne fous ai pas fait pendre ce chour que fous safez pien, quand fous étiez fournisseur ! " A coup sûr tous les Buonaparte trouvent aujourd'hui comme lui que c’est bien heureux. Chaque pays a ses scandales et ses hontes. L'Angleterre a vu le squelette de Cromwell de l'homme à qui elle avait obéi et qui compte au rang de ses plus grandes gloires, pendu à Tyburn et jeté dans la Tamise. Il n'en arrivera jamais autant à Caradoe. Le voilà Pair d'Angleterre. La Princesse Bagration sera-t-elle Pairesse ?
9 h. 1/2
Comment, quatre mois sans nous voir ? Est-ce que de manière ou d'autre, vous ne reviendrez pas à Paris dans le cours de septembre, soit pour y rester, soit pour y passer en allant en Angleterre ? Dans l'un et l'autre cas, j’irai vous y voir. Vous ne comptez certainement pas rester à Baden jusqu'au mois de Décembre. Dites-moi un peu vos projets. Ayez des projets si j'étais près de vous, je m'en chargerais. Je suis décidé à m'en charger désormais jusqu'à la dernière limite du possible pour moi. Mais à présent, je suis loin. Adieu. Adieu. Voilà quatre jours qui me pèseront jusqu'à ce que vous ayez recommencé à avoir des lettres tous les jours. Vous savez que je ne jouis de rien à moi seul. Adieu. Adieu. G.
255. Val-Richer, Lundi 26 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Vous voilà à Paris. Je me le dis comme si je le savais. Je veux me le dire. Je ne le saurai que demain. Demain, je serai heureux. Et quand je vous aurai vue ! Je ne puis partir tout de suite. Il m’arrive cette semaine trois personnes, entre autres M. Devaines qui viennent précisément de Paris passer quelques jours au Val-Richer. Je m’arrangerai pour y aller (à Paris) quand elles y retourneront. Il y aura plus de trois mois que nous ne nous serons vus !
Vous dîtes que vous êtes encore changée ! Ce qui m’est insupportable, c’est que sur votre santé, je ne me fie pas à vous, à vos impressions et à vos paroles. Vous avez tantôt des terreurs, tantôt des insouciances inouïes. Avec moi, cela n'a d'autre inconvénient que de m'agiter, avec d’autres, que vous appelez vos amis, il en résulte ce mal qu’ils sont incrédules à ce que vous sentez et dites de vous même de votre état intérieur. J’ai rencontré cette incrédulité et avec effroi. Vous vous reposerez à Paris.
Je suis bien fâché que les Granville n’y soient plus. Sont-ils partis pour longtemps ? Il n’y a rien de nouveau pour eux en Angleterre. Le Cabinet n’est pas en péril. Ce sera vous maintenant qui me donnerez des nouvelles. On me tient assez au courant, mais pas de votre monde. Pahlen doit être bientôt de retour. Il vous reviendra sûrement aussi fidèle. M. de Pahlen doit être toujours fidèle, quand il est près et oublier beaucoup dès qu'il est loin. Vous aurez le pauvre Pozzo. Pour celui-là, tout déchu qu’il est, je vous répondrai toujours plus de son esprit que de sa fidélité. Ramenez-vous Marie ? Je crois que non. Pourtant vous ne m’avez jamais rien dit de positif.
Vous me direz si vous voulez que je prie ma mère de vous chercher sérieusement quelqu'un.
9 h.1/2
Je respire. Vous n’êtes donc pas malade. Vous êtes venue bien vite. Je n'attendais ce matin qu'une lettre de la route. Vraiment, vous êtes à Paris, et pas malade, et votre médecin ne vous trouve pas si mal que vous l’imaginez. Mais comment avez-vous fait pour maigrir ? Ce n’est peut-être pas vrai, par autant que vous l’imaginez. Trompez vous donc, je vous prie. Et reposez-vous. Il se pourrait bien que les bains de mer vous fussent bons. Laissez-moi y penser un moment avant de choisir entre Paris et Dieppe. Aurez-vous quelqu’un à Dieppe. Et puis, il ne fait pas chaud. Il fera moins chaud tous les jours. Les bains de mer ont besoin de chaleur. Enfin, nous verrons. Vous êtes arrivée.
Adieu. Adieu. Adieu. Je n’en finirais pas. G.