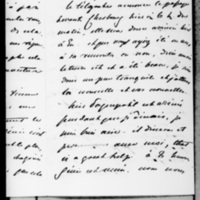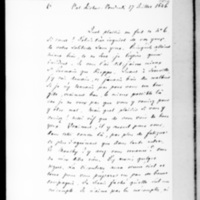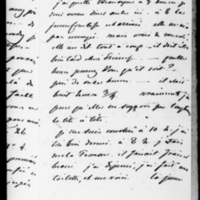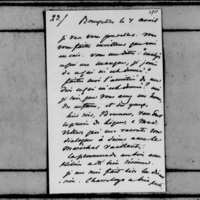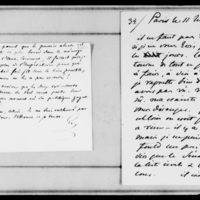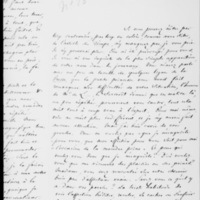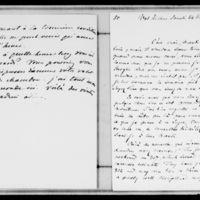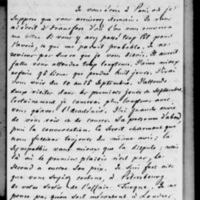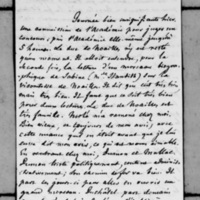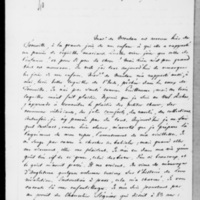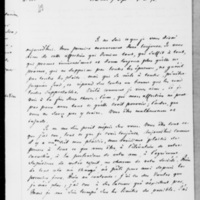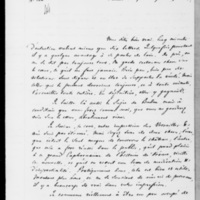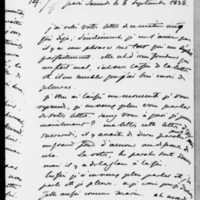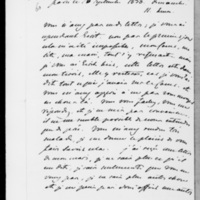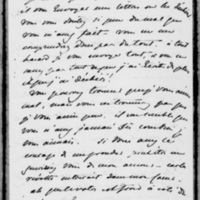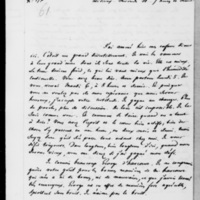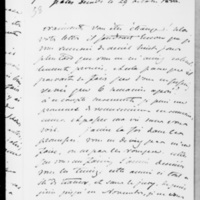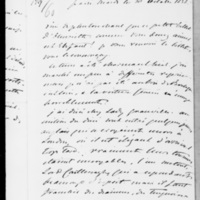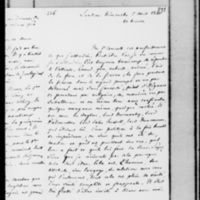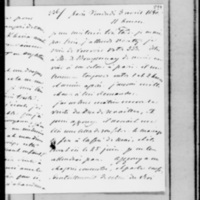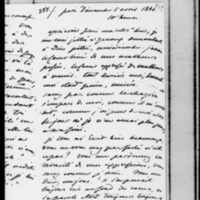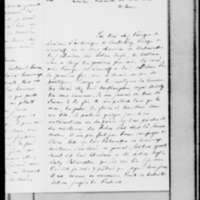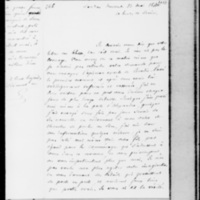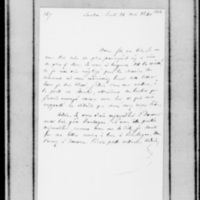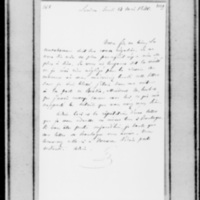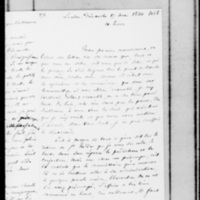Votre recherche dans le corpus : 85 résultats dans 3296 notices du site.
3. Beauséjour, Dimanche 13 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai eu hier une visite très longue de M. de Barante. Pendant une heure j’ai été pleine de vivacité. Cela allait très bien. Et puis cela a langui et puis cela n’allait plus de tout. Il faut plus que Barante pour m’intéresser et m’occuper au delà d'une heure. Il n'a rien encore d'André il attend. M. Molé lui écrit de ? tristement, mécontent de sa santé et de tout. Il sera ici sous peu de jours. Barante est convaincu que Salvandy prendra Turin avec joie quoiqu'il continue à dire qu'il ne peut accepter que Madrid. J'ai vu le prince de Dolgoronky, il ne croit pas au voyage du Gal Oudinot. Il avait vu avant hier le Gal Pajol qu'il a interrogé à propos de ce que disent les journaux. Pajol s'est mis à rire. Oudinot est allé à Ems trouver sa fille malade. De là à Vienne. Il n’y a pas un mot de vrai au voyage à Pétersbourg. Dalgorondy de son côté dit que tel qu’il connait Oudinot c'est impossible nous verrons très incessamment. Appony chez qui j’ai dîné, m’a dit que le prince Metternich avait fait beaucoup de vœux pour Espartero et que sa chute lui causerait certainement beaucoup de peine. Voilà probablement le sentiment dans les cours d’Allemagne. Et je crois que cela se traduit par le chagrin du triomphe de la France. Je vous ai assez parlé des autres. à nous maintenant. Je ne me console pas, je ne me pardonne pas de vous avoir laissé partir. Il y a plus dans ce regret qu’il n’y avait autre fois. Cela me fait frissonner. Mon cœur me remonte à la gorge, j’étouffe et je pleure. Est-ce que je vous aime plus que je ne vous aimais ; est-ce pressentiment ? Nous verrons cela le 26. Il y a treize jours jusque là ; demain il n'y en aura plus que 12. Soyez bien assuré que je ne pense qu’à cela, et que cela ne me fera pas engraisser. J'ai revu mon salon hier pendant une demi-heure avant mon coucher. Je n’ai pas pu rester en place. J’ai joué du piano tristement, beaucoup de ? J’ai assez bon dormi. Avez-vous dormi ? pas de brigands ? Avez-vous pensé à moi, au chagrin que vous me donnez. Adieu. Je porte ceci en ville. Le dimanche on ne sait rien faire parler d'ici. J'irai à l’église. Vous savez pourquoi j’y vais à 4 heures je m'embarque avec Pogenpohl pour Versailles. Trouverai-je votre lettre à Paris ? Adieu. Adieu, tous les jours une lettre n’est-ce pas. Et dans chacune après l’adieu répétez le 26. Adieu.
3. Val-Richer, Lundi 14 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val Richer. Lundi 14 Août 1843, 6 heures du matin
Que je vous remercie ! Vous êtes charmante. Je comptais sur une lettre ; et encore vous ai-je fait une sotte question. J'en ai trouvé deux. Ne craignez jamais de me fâcher. Dites-moi toujours tout. Tout me plait venant de vous. Je ne me pique point de n'avoir jamais pour ceux que j’aime, pour ma mère surtout, quelque complaisance quelque faiblesse si vous voulez. Vous y êtes vous-même pour quelque chose. J’ai tort de vous dire cela ; je touche là une triste corde. Mais moi aussi, je vous dis tout. Le spectacle d’un fils que n’est pas pour sa mère ce qu’il doit être m'a tellement blessé que cela a tourné au profit de la mienne ; et je suis devenu, pour elle, plus soigneux, plus affectueux qu'auparavant. Il est vrai qu'elle et mes enfants avaient un très vif désir de ce voyage. Il m'a plu de leur donner ce plaisir. Je n'ai pas perdu ma bonne intention. Ils sont dans le ravissement.
Je mentirais, si je ne disais pas que je prends aussi quelque plaisir à la vue de mes bois, de mon jardin, de ma bibliothèque, de ma serre, de mes orangers. Le soleil brille ce matin ; ses rayons percent avec éclat une vapeur légère et fine qui flotte encore sur les bois et les près, les plus verts du monde. C’est charmant. Mille fois moins charmant qu’un moment près de vous, une parole, un regard de vous. Croyez-moi dearest, car je vous dis tout. Ne soyez pas jalouse de mon plaisir d’ici ; il ne le mérite pas. Mais pardonnez-moi de le sentir.
Puisque le mot de jalousie est venu là, sachez que vous êtes vous dans ma maison, pour ma mère surtout un objet d'immense jalousie. Si je n'étais pas venu ici elle aurait été parfaitement convaincue que vous seule en étiez la cause. Vous la comprendrez et vous ne lui en voudrez pas. Vous avez le cœur si juste ! Gardez-moi pourtant tout ce que vous m’avez montré le jour où vous m’avez dit qu'avec moi seul vous n'aviez ni justice, ni impartialité. Je déraisonne. Je vous demande les contraires. Oui, je vous les demande, bien sûr de vous en récompenser amplement. Je ne crains jamais d'être en reste avec vous.
Le 26. Politiquement soyez tranquille. Le jour où mon absence aura un inconvénient réel je partirai sur le champ. Je suis très attentif à cet égard. Je ne vous retire point la question d’un Ambassadeur à envoyer à Madrid. Si elle vient, elle me ramène le lendemain. Dans la nuuit de samedi à dimanche, à Evreux, à une heure du matin, le directeur de la poste m'a réveillé pour m’apporter une lettre du Ministre de l’Intérieur, disait-il. J’ai cru que j'étais rappelé à Paris. Ma première, bien première impression a été de plaisir, de plaisir pour Beauséjour. Il n’y avait point de lettre de Duchâtel. C’était tout bonnement des papiers que Génie m'envoyait et qui auraient fort bien pu attendre mon réveil. Il y avait pourtant une lettre du Roi. Bonne à voir, tant elle montre son sincère éloignement pour le mariage Espagnol, son vif désir de s’entendre avec l'Angleterre, et son humeur de ce brouillard si épais de préjugé, de méfiance et de crédulité qu'il ne peut parvenir à dissiper. Je vous quitte pour lui écrire. Je vous reviendrai quand la poste sera arrivée. Adieu. Adieu. Cent fois, adieu.
10 heures
Que j’aime le N °31 ! Si Oudinot a passé à Copenhague je ne comprends pas qu’il n'aille qu'à Ems ou à Vienne et s’il n’y a pas passé, je ne comprends pas où St. Priest a pris ce qu’il m'a dit. Oudinot n'aurait-il voulu aller à Pétersbourg qu'en cachette pour porter lui-même ses regrets à l'Empereur et revenir aussitôt. Ce serait bien galant. On écrit de Madrid qu'Aston fait ses préparatifs de départ. Vous me renverrez ce que je vous envoie. Adieu. Adieu. Il faut que j'écrive au Roi, à Désages et à Génie. Adieu. Au 26.
Ni brigands, ni accidents, ni maladies.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcs et Jardins, Politique (France), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Dispute), Vie domestique (François)
4. Versailles, Dimanche 3 septembre 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le télégraphe annonce le passage devant Cherbourg hier à 6 h. du matin, elle sera donc arrivée hier à Eu. Et que vous ayez été en mer à sa rencontre ou non, Dieu merci le temps est et a été beau, je suis donc un peu tranquille et j’attends la nouvelle et vos nouvelles.
Hier Pogenpohl est arrivé, pendant que je dinais, je suis bien aise. Il dinera et promènera avec moi, that is a great help. A 8 heures Génie est venu. Nous nous sommes réciproquement communiqué au fond, c’étaient les même choses. Il ne voit pas pourquoi je me dérangerais. Si elle vient à Paris c’est autre chose, c'est-à-dire si on apprend qu’elle doit y venir. Vous voyez que tant qu’elle reste à Eu, je peux bien rester à Versailles, car ou on a rien à faire ou à décider à Paris, aucun conseil ou idée possible à donner parce qu'on n'en a pas besoin. J'ai bien envie qu’elle n’y vienne pas. Un accident, serait quelque chose d'épouvantable quand on s'engouffre dans cette idée cela fait maigrir sur place de terreur. La demeure aux Tuileries est mauvaise pour cela, car elle sort le matin de bonne heure à pied. Elle voudra sortir dans le jardin. La retenir prisonnière est si gauche. L'exposer est si terrible. Au fait l’Elysée Bourbon si elle veut Paris, c'est-ce qu’il y a de mieux. Mais j'aime mieux qu’elle ne veuille pas. Elle devrait traverser Paris incognito, voiture ordinaire, coucher à St Cloud. Voir Versailles and go home that would be the good thing. Vous allez me dire tout cela. Que vous devez être content ! Savez-vous que plus on y pense plus on trouve qu’il y a de quoi. C'est superbe et excellent. Pogenpohl me dit qu'à Paris l’effet est immense. Dans les rues partout, on ne parle que de cela. C'est une époque dans un règne. Quel joli petit paragraphe cela fera dans le discours d'ouverture des Chambres. Je voudrais bien être à Vienne, Berlin & Pétersbourg pour une demi-heure. Certainement, le soufflet est gros. Génie croit savoir qu’Armin en est le plus non pas dépité, mais chagriné par le mauvais air que cela donne à la maussaderie de son Roi il y a 1 an 1/2. Il dit savoir aussi que le langage d'Appony s'est amendé. Je verrai cela. Je suppose qu’ils viendront demain ne pouvant pas venir aujourd'hui.
Midi. Voici Génie qui me fait la gracieuseté de m’envoyer un homme exprès pour m’annoncer l'arrivée de la Reine, et m’envoyer en même temps votre lettre N° 3. Dieu merci, et merci que je suis contente, et que j'ai été bête hier avec mes terreurs. Mais vous ne vous serez par fâché. Vous ne vous fâchez pas contre moi vous savez d’où viennent mes bêtises.
Ce que vous me dites de Metternich à propos du mariage de Don Carlos m'amuse. C’est bien lui ! Qu'il va se trouver nigaud avec son idée correcte ! Mais savez-vous ce qui arrivera ? C’est qu’entre ceci dont l’Espagne ne voudra pas, Naples que l’Autriche empêchera. Les autres retrouvés par d’autres motifs, quand il ne se trouvera plus de Bourbons, que personne ne peut vouloir un de vos fils, et que vous ne pouvez pas permettre un Autrichien, on finira par trouver le Cobourg le plus inoffensif, en même temps que le lien entre l'Angleterre et la France. Prenez garde à la possibilité que l’affaire prenne cette marche-là. Arrangez-vous pour Naples avec Angleterre. C'est la bonne affaire. Pogenpohl qui a des correspondances beaucoup à Florence où il a longtemps résidé dit que le Lucques est un charmant garçon. Pourquoi pas Lucques si Naples n’allait pas ? Adieu. Adieu.
Je rabâche. Je suis in the highest spirits de savoir la Reine en France, à Eu. C'est une perfection. J'oublie de vous dire que j’ai bien dormi, que je suis mieux. à 7 1/2 j’étais sur la terrasse du palais, pas une âme que la sentinelle. Un air pur excellent. Adieu. Adieu. Que je suis impatiente de votre prochaine lettre. Adieu ever adieu. Remettez ceci à Lady Cowley.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (France-Angleterre), Inquiétude, Mariages espagnols, Politique (Espagne), Relation François-Dorothée (Diplomatie), Relation François-Dorothée (Dispute), Réseau social et politique, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
6. Val-Richer, Vendredi 17 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quel plaisir me fait ce N°6, si court ! J’étais tres inquiet de vos yeux de votre solitude sans yeux. Puisqu'ils allaient mieux hier, ce ne sera, je l’espère, qu’un incident. Je vous l’ai dit ; j’aime mieux St Germain que Dieppe. Quant à Trouville j’y vais demain, et j'aurais bien du malheur si je n’y trouvais pas pour vous un bon gite vraiment bon, le mieux possible là, car je ne veux pas que vous y veniez pour y être mal. Mais quel plaisir si vous y veniez ! Aussi vif que de vous voir de bons yeux. Vraiment, il y aurait pour vous dans cette course-là, pas plus de fatigue et plus d’agrément que dans toute autre. El Mouchy ? Y avez-vous renoncé ? Vous ne m'en dîtes rien. J’y aurais quelque regret. La vicomtesse aura remué ciel et terre pour vous préparer un peu de bonne compagnie. Je serais fâché qu'elle eût un mécompte. Je n'aime pas les mécomptes, ni donnés, ni reçus. Comme il vous conviendra du reste. Merci de la lettre de Greville. Intéressante. Je vous la renvoie avec une de Reeve que vous me renverrez. A peu près la même chose. Le parti Tory se réformera. Et un jour, il s’y formera un chef. Peel ne le redeviendra pas. A moins d’incidents bien imprévus. Et de l’autre côté les nuances se fondront dans un grand parlé libéral, qui n’en sera pas plus homogène. Et le jour qui ne sera pas très loin, ou l’esprit radical y prévaudra trop les Torys reprendront le pouvoir. Je doute que Gladstone, leur soit un chef dans les Communes. Je voudrais bien. Il est très honnête et d’un esprit doux et élevé. Nous verrons. Il y a bien à regarder là.
Le courrier d’aujourd’hui ne m'apporte rien du tout. Sinon le mouvement des élections qui s'anime un peu. Je suis charmé que Casimir Périer se porte candidat à Paris, et je désire beaucoup qu’il réussisse. Cela me convient électoralement et diplomatiquement. Adieu. Je serai court aussi aujourd’hui. J’ai un énorme paquet de signatures à donner. Je ne suis pas aussi oisif ici que l’an dernier. J’ai gardé les affaires. Je me promène pourtant beaucoup. En bien bon air. Point trop chaud. Hier il a beaucoup plu. Adieu. Adieu. Merci de vos yeux. G.
8. Versailles, Mercredi 16 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le 16 août 1843
J’ai quitté Beauséjour à 4 heures. Je suis venue dîner seule ici, à 8 la jeune contesse est arrivée. Elle ne m’a pas ennuyée. Mais voici de son côté. Elle me dit tout à coup - Il doit être bien tard chère Princesse. - Quelle heure pensez-vous qu'il soit ? Près de onze heures. Il était huit heures 3/4. Vraiment j’ai peur qu’elle ne supporte pas longtemps le tête-à-tête.
Je me suis couchée à 10 h. J'ai très bien dormi. A 8 h, j'étais sur la Terrasse. Il faisait frais et beau. J’ai déjeuné, j’ai fait une toilette et me voici. La jeune comtesse est allée se promener dans les galeries, déjeuner chez Mad. de la Tour du Pin. J’y étais conviée aussi, mais je reste. Je vous écris et j’attends votre lettre.
Bulwer parle très sérieusement. Au fond il trouve le Cadiz ce qu’il y a de mieux et de plus pratique surtout. Le fils de Don Carlos impossible. Naples peu vraisemblable comme disposition espagnole. Dieu garde dit-il que qui que ce soit mette en avant un prince étranger quel qu'il soit. Car aussitôt la France serait forcée de lui opposer un Prince d’Orléans. Il ne faut pas à tout prix que la lutte de candidats s'engage. Il ne faut se mêler de rien. Il dit cependant que l'Angleterre doit agir pour empêcher que les Cortès ne nomment le duc d’Aumale, car malgré la résolution du Roi le cas pourrait devenir embarrassant. Si l'Angleterre veut en finir, je crois bien qu’elle arriverait au résultat contraire, mais enfin ce n’est que le dire de Bulwer. Il a beaucoup répété que son gouvernement était dans les meilleures dispositions d’entente avec la France. Il a insisté sur le bon effet qu’aurait la présence de Sébastiani, fort respecté à Londres. Cependant ne sera-t-il pas un peu trop Whig pour les gouvernements actuels ?
Tout ce que vous me dites dans votre N°3 me plaît. Vous avez pris si doucement mes reproches. De la manière dont vous me répondez, je trouve bon toutes vos faiblesses. Mais voici ce que je ne pourrais jamais trouver bon c’est que je fusse renvoyée au delà du 26. Vous pouvez être faible pour votre mère, mais vous ne serez pas injuste et dur pour moi. Je reste donc ferme dans ma foi pour le 26.
Midi et demie. Voici le N°4. Je comprends fort bien la première page, car Génie m’avait confié ce qui était venu de Londres. J’espère que vous aurez consenti à rétrancher le petit mot déplaisant. Il ne faut pas que vous ayez à vous reprocher un seul fait ou geste qui empêche de s’entrendre. Mais quel dommage que vous ne soyez pas ici. Je le répète : un jour de retard dans des affaires comme celle-ci c’est beaucoup risquer et vous dites mieux que moi. Je vous copie. " tout cela a besoin d'être conduit avec un grande précision et heure par heure." Et vous êtes à 46 lieues ! Mais au moins vous reconnaissez l’inconvénient, tout le monde le pensait, et moi aussi, par dessus toutes les autres choses. Revenez, revenez. Ceci est votre grand moment vous n'avez rien eu de si grave, de si important, et de si directement posé sur vos épaules depuis 3 ans bientôt que vous êtes ministre. Et c’est là le moment que vous avez choisi pour vos vacances. Pardonnez-moi si je reviens. Mais vraiment je voudrais impress upon your mind combien cela est sérieux pour vous. Je comprends toutes vos jouissances au Val-Richer, & j’essaie même de n'être pas jalouse ; mais je suis désolée de ce que votre sommeil soit toujours troublé. Enfin votre mère en vous voyant comme cela accablé de travail, vous laisserait bien partir, car elle reconnaîtrait que la politique est sa vraie rivale Adieu. Adieu.
Je renvoie Etienne avec ceci. Je regrette que mon N°7 soit arrivé à Génie trop tard pour vous être envoyé par la poste. Je l’avais donné à [?], à 4 pour le poster de suite. Il ne s’est présenté qu’après 6. Nouveau grief. Par dessus la glace & & Adieu. Adieu. Aujourd’hui variante avant le 26. Adieu.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcours politique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon
9. Saint-Germain, Jeudi 17 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Par quatre ou cinq raisons, matelas élastique, gens d’écurie couchant au dessous de ma chambre. Victoire toussant la nuit & &, je n’ai pas dormi du tout, et pour comble d'infortune ayant été obligée de me lever pour fermer ma porte et ne m’étant pas couverte j’ai repris un point de côté comme j'en ai quelque fois en hiver, et il m’a fallu recourir à une sueur abondante pour m'en débarrasser. Je me suis donc levé tard, en mauvais état, en mauvaise humeur, & voilà l’heureux début de St Germain !
C’est parfaitement bête, car le lieu est ravissant, l’air et le temps aussi. Mais au lieu de mes conforts auxquels Je tiens beaucoup je suis dans une méchante auberge. C’est honteux pour Henri IV. J’attends encore votre lettre. Il parait que St Germain est plus loin que Versailles. Les journaux même n'y sont pas venus encore. Nous sommes arrivés ici hier à 4 heures à 6 Kisseleff et Pogenpohl sont venus dîner avec nous. Dolgorouky qui devait venir partait le même jour. Kisselef a quelque chose à vous montrer sur la Grèce , je crois que c’est de Londres qu'il l’a reçu. Il dit beaucoup que cela va bien mal en Grèce. Il dit aussi qu’on craint que Piscatory n’ait des penchants trop constitutionnel pour l’êtat du pays. Du reste il ne savait rien.
2 heure & demi. Voilà Etienne et une charmante lettre, car je vous reverrai plutôt, ma joie est grande autant que j'ai la force d’en avoir aujourd’hui. Génie m’explique que vous devez avoir reçu le courier qui vous manquait. Mais quel ennui et que je vous plains, car si votre lettre m’avait manqué je sais bien que je n’aurais plus le sens commun. Au reste comme tout vous manquait à la fois vous ne vous, serez pas inquiété pour moi. Je désire bien appendre que vous avez retranché, the objectionable word de ce que vous aviez envoyé à Londres mandez-le moi. Adieu, il faut renvoyer Etienne pour que ma lettre ne manque pas le courrier. Adieu. Adieu.
Vous me dites que vous me reverrez cinq jours plutôt après m’avoir dit que vous quitterez le Val Richer le 21 ou 22, mais vous ne pouvez donc arriver que le 23, cela ne fait que trois jours de gagne. N’ai-je pas bonne grâce de vous quereller encore ? Adieu. Adieu. Adieu. Je serai à Beauséjour Mercredi prochain en même temps que vous. Mais dites-moi encore plus exactement votre retour. Adieu. Adieu.
23. Bruxelles, Vendredi 7 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vais vous quereller. Vous vous faites meilleur que moi en cas. Vous me dites : " Malgré ce qui me manque, je jouis de ce qui m’est donné. " Faites moi l’amitié de me dire ce qui m’est donné. Mais je sais que vous avez un home, des enfants, et des yeux.
Hier soir, Brunnow, Van Praet, Le prince de Ligne & Mad. Villers qui me raconte son dialogue à dîner avec le Maréchal Vaillant. La promenade au bois avec Hélène a été bien sérieuse. Je me suis fait lire la discussion. Chasseloup a bien parlé. Montalembert a été bien imprudent. Je conçois que tout ceci ait fort animé Paris pour un jour. Je n’ai pas un mot de Constantin. Je ne conçois pas cela. Brockausen attendait encore hier au soir le courrier de Berlin qui devait passer ici le 3. Des lettres de Pétersbourg disent que l’[Empereur] a dit à la table ronde chez sa femme. " Je puis très bien m’arranger avec les Turcs s'ils imaginent les Chrétiens, mais avec les Anglais c’est autre chose." Adieu. Adieu.
Je suis plus triste aujourd’hui qu'hier cela ira comme cela. Adieu & Je vous écris par le Pce de Ligne. Dites moi si vous avez reçu ce N°.
27. Val Richer, Mardi 5 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous me donnez l’esprit des grandes choses d’une façon qui me refuse celui des petites. J’ai envie d'être choqué. La première fois que vous me consulterez sur les comptes de votre maître d'hôtel, je n'aurai pas d’avis.
J’ai les journaux du gouvernement dans les feuilles d'Havas qui me donnent des extraits du Constitutionnel et du pays, et aussi de petits articles originaux qui sont ce que le Gouvernement veut dire à ses fonctionnaires. Votre politique y est de plus en plus sévèrement jugée, mais toujours pacifiquement. Deux choses me semblent certaines, l’une qu’on vous donnera toutes les facilités possibles pour couvrir votre honneur l'autre, que si vous voulez pousser les choses très loin, vous trouverez tout le monde uni contre vous ; les uns vous feront la guerre, les autres ne vous soutiendront pas. Je parle très tranquillement de cette extrémité parce que je n'y crois point. Mais je serai charmé le jour où il ne sera même plus possible d’un parler. Je veux vous savoir tranquille aussi, et ne songeant qu'à profiter des eaux et à revenir à Paris. Je suis bien aise qu’on négocie entre Londres et Pétersbourg. Il ne se fera rien, et rien de bon à Constantinople. La transaction doit se faire là où est la puissance, je ne crois point que le Cabinet anglais ait abdiqué entre les mains de Lord Stratford. Il soutiendra son agent, mais sans se laisser mener par lui. J’espère que votre Empereur, en fera autant. La visite au général Ogareff à Portsmouth m’a fait plaisir à lire. C’est un petit symptôme des dispositions pacifiques et un beau symptôme des moeurs douces et libérales de notre temps.
J’ai eu ces jours-ci un plaisir d’une autre sorte. L’Académie Française avait mis au concours une étude historique et littéraire sur le poète Ménandre, et la comédie chez les Grecs. Elle a partagé le prix entre mon fils et un savant homme d’esprit de 40 ans Guillaume en a vingt. Son mémoire est vraiment spirituel et mérite, je crois, cette distinction.
18 heures et demie.
Voilà le Pruth passé. Quand vous serez établi dans les provinces, et que vous aurez ainsi fait acte de puissance, ferez-vous acte de modération ? Si les Turcs ou les Grecs ne font pas de folie, je l’espère. Adieu, Adieu. G.
29. Ems, Samedi 9 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Une lettre extra pour vous dire que selon mes dernières nouvelles nous allons publier une dépêche explicative de Manifeste, où il sera dit : qu’aussitôt que la porte nous aura offert des garanties acceptables et que les escadres des puissances maritimes auront quitté les eaux de la Turquie, nos troupes de leur côté évacueront la Moldavie et la Valachie. Qu'en dites-vous ?
A propos M. de [Damis] est enfoncé dans les lectures que je lui fournis quoique nous nous voyons deux fois le jour il m'écrit à tout instant. Voici sur votre lettre. Il m’en a reparlé le soir, avec des admirations sans fin sur le style de votre lettre. Vous me querellez sur la distinction que j’ai l’air de faire de votre Génie pour les grandes & petites choses. Certainement vous valez mieux pour les premières, mais je vous prie de ne pas m’abandonner dans les autres.
Je suis d'une grande curiosité du débat de hier au Parlement. On commence à dire que Palmerston reprendra les affaires parce que si dans ce poste il ne nous fait pas la guerre, les Anglais verront qu’il n’y a pas de quoi la faire. Enfin ce serait drôle, mais tout est drôle, pourvu que cela ne reste que drôle. La chaleur est étouffante. Adieu. Adieu.
J'attends ce que vous me direz du Manifeste. [Damis] prétend que de même que l'[Empereur]. excite l’enthousiasme religieux, il saura le calmer. Il est le maître très puissant chez lui.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conversation, Diplomatie (Russie), Femme (politique), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Russie), Politique (Turquie), Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique
34. Paris, Dimanche 11 juillet 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il ne faut pas vous fâcher si je ne vous écris pas tous les jours. La tête me tourne de tout ce que j’ai à faire, à dire, à écouter. Je regrette bien de ne vous avoir pas vu. Vous auriez sû. Ma crainte a été de vous déranger. Quand on est loin, on croit qu'il n'y a rien. Il y a toujours mais je ne puis pas écrire.
Fould me prie de vous dire que le Sénat a fait la liste civile & la haute cour. Il ira avec le Président à Strasbourg. Le prince a fait visite à sa femme ce qui l’a beaucoup flatté. La modification ministérielle n'aura lieu qu’à la fin du mois. Il y aura des changements en Belgique donnant satisfaction à la France. Je vous ai dit que Kisseleff est allé à Vichy.
Je pars Mardi à 8 h du matin pour Dieppe. Pas d'Aggy encore. J’espère qu’elle viendra mais ma sécurité n'y est plus, quoique Marion affirme. Jamais je n’aurais cru de sa part à tant d’affirmations déçues ! Votre portrait de L’Empereur est charmant. Je l'enverrai quand même. Adieu. Adieu.
J’étouffe et je me sens mal.
45.Val-Richer, Samedi 23 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
46. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est à peine six heures. Le Soleil n’est pas encore au dessus de l’horizon. J’ai mal dormi. Je me lève. Hier en me couchant, à 10 heures et demie, je me suis figuré dans la malle-poste au lieu de mon lit courant vers vous. A peine endormi, j’ai rêvé dans la malle-poste. A quatre heures, je me suis réveillé comme si j’arrivais. Ce devait être aujourd’hui en effet. Vous en avez douté quand je vous l’ai dit. Vous avez prévu que ce ne serait pas. Dearest, voici l’exacte vérité. Je n’en étais pas sûr. Le jour du mariage de M. Duchâtel n’était pas absolument fixé. Il m’avait parlé du 25 septembre au 2 ou 3 octobre. J’ai été faible pour moi, faible pour vous. J’ai pris la supposition favorable sans y compter, pour nous faire plaisir à tous deux, pour ne pas nous donner tout à coup, à vous un chagrin, à moi le vôtre, et le mien. J’ai eu tort. On a toujours tort, avec la personne à qui l’on dit tout, à qui l’on doit tout, de ne pas dire exactement ce qui est ce qu’on croit. Il faudrait toujours braver la peine du moment pour éviter la peine à venir. Pardonnez- moi de ne l’avoir pas fait.
Votre n°46 m’a touché, et me touche profondément ; si triste et si douce ! Si vive et si raisonnable ! Le jour où j’ai un peu causé avec la petite Princesse elle m’a dit deux ou trois fois, en me parlant de vous : « une personne si supérieure, si extraordinaire". A chaque fois ces paroles me pénétraient, me charmaient ; d’orgueil si on veut, mais de ce délicieux orgueil qui naît d’une tendresse infinie, au dessus, bien au dessus duquel cette tendresse plane, dont elle fait le pouvoir et le prix.
Oui, je suis fier, fier de vous, de votre affection pour moi de votre supériorité, de cette supériorité que je connais mille fois mieux que personne dont je jouis comme personne n’en a jamais joui. Et quand je la retrouve dans les plus petits détails de la vie, quand je vois réunies en vous les qualités, les attraits les plus contraires, tant d’abandon et tant de dignité, un cœur si tendre et un esprit si ferme, une imagination si vive et une raison si droite, un caractère si passionné et si doux, une humeur si égale avec des impressions si variées, je suis heureux, heureux, Madame, bien, bien au delà de tout ce que peuvent vous exprimer de loin mes lettres, et même mes adieux.
Maintenant, voici où j’en suis et ce qui sera. Le mariage de M. Duchâtel n’étant plus rien pour moi j’ai pris la dissolution. Elle sera certainement prononcée et publique dans les premiers jours d’Octobre au plus tard. J’ai un dîner chez moi au Val-Richer, demain 26. Après-demain 27 je vais dîner à Croissanville, à 4 lieues d’ici, avec une réunion d’électeurs. Du 27 au 2 octobre, je ferai quelques courses dans l’intérêt des élections voisines. Je recevrai beaucoup de visites. Le 3 octobre encore un dîner pour moi, et une réunion d’électeurs à Mézidon, dans ce canton que je n’ai jamais visité. Le 4 un dîner à Lisieux, point un meeting, un dîner privé, mais avec beaucoup d’électeurs. Le 5 à 1 heure et demie je monte dans la malle-poste, et le 6 à 4 heures du matin, je passe dans la rue de Rivoli, pour faire le même jour, à une heure & demie quelque chose de mieux que d’y passer.
Voilà, d’ici là ma biographie et mon itinéraire. C’est long, bien long. Je ne demande qu’une chose, dearest, une seule chose. Soyez sûre, sûre aujourd’hui comme vous le serez dans deux ans, dans trois ans, que c’est aussi long pour moi que pour vous. Ne dites donc pas que vous me contez trop de petites choses, que vous me donnez trop de détails. Jamais assez. Au milieu du grand bonheur, c’est mon petit, mais très vif plaisir de vous suivre pas à pas dans tout le cours de la journée, d’assister à toutes vos actions, d’heure en heure. Il y en a une que je regrette, qui m’a un peu désagréablement ému le cœur. Vendredi soir vous avez fait de la musique devant votre monde ; et moi, je ne vous ai pas encore entendue. Je ne veux pas, la première fois, vous entendre devant du monde ; mais je voulais avoir votre première musique, à moi seul. Vous ne savez pas à quel point la musique me plaît, m’émeut. Mais c’est pour moi une impression très intime, et qui se lie tout de suite à mes impressions les plus intimes, une de ces impressions dont je n’aime pas à parler excepté à la personne à qui je parle de tout. Je vous aurais si délicieusement écoutée !
J’attends ce matin, M. de Saint-Priest, Alexis, qui vient passer ici 24 heures. Il m’en dira long sur Lisbonne, les Chartistes, Lord Howard de Walden, Saldanha, Sä de Bandeira & & J’ai recommencé hier au soir à lire à mes enfants un romans de Walter Scott. Je vous le dis pour vous montrer que j’ai complètement repris l’usage de ma gorge. Je suis ravi que vous ayez aussi bien retrouvé celui de vos jambes, Certainement c’est une preuve de force.
11 heures Le N° 47 me désole de mille façons, toutes si douloureuses. M. de L., votre chagrin, votre manque de foi, votre santé. Mes lettres suivantes vous auront été un peu meilleures. Celle-ci vous donne une certitude, de voyage, de jour. Si vous saviez que je n’ai pas pensé, que je ne pense pas à autre chose. Croyez-vous donc que je n’ai pas pensé à emmener ma mère à Paris ? Mais elle est mieux et se trouve bien ici. Je vous répondrai demain avec détail. Adieu. Adieu. Soignez-vous, je vous en conjure. Adieu. G.
50. Val-Richer, Samedi 24 juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
C'est vrai, Mardi est bien loin ; mais il viendra dans trois jours, et quand nous aurons causé, vous serez convaincu comme moi que je ne pouvais faire autrement. Broglie n’est pas encore venu, je crois qu’il viendra ; mais ne vint-il pas, il fallait que je lui donnasse la semaine qu’il me demandait. Soyez sûre que vous serez de mon avis.
Je crois aussi que vous devez faire quelque chose sur ce sot communiqué du Moniteur. J’ai bien regretté et je regrette bien de n'être pas là, pour vous dire tout ce que je pense à ce sujet. Vous faites bien en tout cas de consulter Kisseleff. Peut-être serai-je à temps mardi.
Voilà des nouvelles qui m’arrivent de Londres, assez curieuses : « The government reckoned, on 307 which seemed tour un excessive estimate. They have got about 312 and may win two or three more. Such a party well disciplined may for a time be master of the house of common especially against a disjointed opposition without principles and without leaders. I think the main cause of Lord Derby's success has been the absence of my competitor or antagonist whom the country can tolerate and accept [?] Lord John Russell, leaned to the conservative side, he might have become such an Antagonist, and he has discovered this too late, for he is now in communication with lord Aberdeen. But by adopting the radicals, he destroyed his party and his position. The policy of the Whigs is now to avoid all hasty or premature attacks on Lord Derby, and to judge of the measures he is prepared to bring forward. But the position of the government is only the more critical, for at heads, a party prepared to demand more than it can execute... M. Lady Palmerston said to me last night triumphantly : " Observe, no one in the whole country dare, to call himself a follower of Lord John Russell ; even hastings Russell says he is a follower of sir R. Peel. " Vous connaissez mon correspondant. Adieu, Adieu.
Je voudrais bien que l’air de la mer vous fît un peu de bien. C'est vrai, je vous dois 5 fr.. Mais je ne veux pas recommencer. Je vous paierai mardi. Adieu. G.
52. Val Richer , Vendredi 26 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous écris à Paris où je suppose que vous arriverez demain. Je vous ai écrit à Francfort d’où l’on vous renverra ma lettre si vous y avez passé trop tôt pour l'avoir, ce qui me paraît probable. Je ne reviens pas sur ce que je vous disais. Il aurait fallu vous attendre trop longtemps. J’aime mieux refaire 95 lieues que perdre huit jours. J’irai vous voir du 10 au 15 septembre. J’attends deux visites dans les premiers jours de septembre. Certainement je causerai plus longtemps avec vous qu’avec l'Académie. J’ai grande envie de vous voir et de causer. La personne d'abord, puis la conversation. Ce serait charmant que nous fussions toujours du même avis ; la sympathie vaut mieux que la dispute ; mais là, où le premier plaisir n'est pas, le second à encore son prix. Je suis fort aise que vous soyiez content, à Pétersbourg de votre sortie de l'affaire Turque. Je ne pense pas qu’on soit mécontent à Londres et je crois que, s’il n’y avait point eu d'Angleterre, ou si elle ne s'en était pas mêlée, vous seriez encore plus contents. C'est elle qui vous a empêchés de faire toute votre volonté. Là est son succès, quelles qu'aient été ses fautes. La politique extérieure Anglaise fait beaucoup de fautes de détail, car elle ignore beaucoup, tant le continent lui est étranger, et elle est pleine de transformations brusques, et de soubresauts, comme il arrive dans les pays libres ; mais en gros et dans l’ensemble des choses, le bon sens et la vigueur y sont toujours et la mènent au but. Quant à l'affaire elle-même, comme je ne m'en suis jamais inquiété, j'en attends très patiemment à la dernière fin. J’ai reçu hier des nouvelles de Barante qui ne me paraît pas s'être inquiété non plus.
Le mariage de l'Empereur d’Autriche était très inattendu. En Normandie du moins. Je ne suppose pas qu’il y ait là aucun goût personnel. C’est un lien de plus avec la Bavière que l’Autriche tient toujours beaucoup à se bien assurer, comme son plus gros satellite en Allemagne. Les Belges me paraissent ravis de leur Duchesse de Brabant. L’Autriche aura toujours bien à faire avec les deux boulets rouges qu’elle traine ; mais elle se relève bien tout en les traînant. Je voudrais connaître un peu au juste son état intérieur. J’entends là dessus bien des choses contradictoires.
On m’a dit à Paris que le travail pour faire venir le Pape avait sérieusement recommencé. On vous le dira sans doute aussi. En France, dans les masses, certainement l'Impératrice est populaire ; on aime mieux la beauté, et le roman que la politique, on s'y connaît mieux. Je suis venu, samedi de Paris à Rouen par un train qui précédait d’un quart d'heure celui qui devait mener le ménage impérial à Dieppe. Toute, la population était en l’air pour les voir passer ; et ce n'était pas de la pure curiosité ; il s'y mêlait de l’intérêt.
Onze heures 1/2
Voilà mon facteur et n'en à ajouter. Adieu, adieu.G.
75. Paris, Mercredi 24 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Journée bien insignifiante hier. Une commission de l'Académie pour juger un concours ; puis l’Académie elle-même jusqu’à 5 heures. Le Duc de Noailles n’y est resté qu’un moment. Il allait entendre, pour la seconde fois, la lettre d’un morceau biographique de Sabine (M. de Standith) sur la vicomtesse de Noailles. Il dit que c’est très bien, mais très bien. Il faut que ce soit très bien pour deux lectures. Le Duc de Noailles est très famille. Molé m'a ramené chez moi. Bien vieux, et toujours de mon avis ; avec cette nuance qu’il en était avant que je lui eusse dit mon avis, ce qui est moins aimable. En rentrant chez moi, Dumon et Mallac. Dumon triste politiquement, content, administrativement ; son chemin de fer va bien. Il part, ces jours-ci pour aller en ouvrir un grand morceau. Duchâtel part demain pour le Bordelais. Molé va s’établir à Champlatreux le 1er Juin. Le Duc de Broglie à Broglie où il ne passera que six semaines. Il ira ensuite, avec son fils Paul, à Coppet, pour ne revenir à Broglie qu'à la fin d'Octobre. Vous voilà au courant les mouvements de mes amis.
J’ai vu la Princesse de Broglie avant hier, relevée de couches, étendue sur son canapé, enveloppée dans une robe de soie rose uni. Elle était charmante.
Je suis dans ma grande tristesse pour ma maison. Et mon grand ennui. Il paraît certain qu’on me chassera l'automne prochain, peut-être au mois d'Octobre. La ville a traité avec une compagnie, dont M. Pereire est le chef et qui se charge de faire le nouveau boulevard de la Madeleine, à la barrière Monceau. Je cherche des appartements. J'en ai vu deux qui sont possibles ; l’un rue du faubourg St Honoré, N°64, en face de Mad. de Pontalba ; l’autre rue du Cirque N°5. Mais je ne serai jamais la moitié aussi bien que je le suis chez moi.
Génie n’avait pas encore vu Rotschild hier. Je crois qu’il le verra demain.
Voilà le traité Austro Prussien dans le Journal des Débats. Mais non pas l'article additionnel et secret qui est le plus grave. Vous le connaissez. Les cas de guerre y sont stipulés bien formellement, et d'après ce que vous me dites de l'État des esprits à Pétersbourg, je doute fort qu’on y commente " à arrêter tout progrès ultérieurs des armées Russes sur la territoire Ottoman et à donner des garanties de la prochaine évacuation des Principautés " Vous payerez cher l’inconvénient des états despotiques, où ni le souverain, ni le peuple ne savent la vérité.
Vous pouvez vous donner le divertissement d'être jalouse de qui vous voudrez ; cela ne tire pas à conséquence. Il y a un peu de vrai, pas tout, mais un peu, dans ce qu’on vous a dit de Mad. Mollien ; quelque prétention, et trop de flatterie.
Qu'est-ce que vous avez à la poitrine ? Toussez-vous ? Je vous demande en grâce de me dire tout sur votre santé. Ma peur est toujours d'en trop rabattre de ce que vous me dites, car j’ai le malheur de ne pas me fier à vos impressions. Grand malheur, vous aimant comme je vous aime. Et de loin !
L'adresse de Génie est rue du faubourg Montmartre, 52. Adieu, Adieu.
Aujourd’hui, j’ai le Consistoire, l'Académie, et je dîne chez Broglie. Je pars toujours pour le Val Richer. Vendredi soir. Vous m'écrirez là vendredi. adieu. G.
122. Val-Richer Jeudi 6 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mad. de Meulan est revenue hier de Trouville, à la grande joie de mes enfants, à qui elle a rapporté un panier de coquilles marines. Quelles vives joies que celles de l’enfance ! Et pour si peu de chose ! Mais rien n’est peu quand tout est nouveau. Du reste j’ai tort aujourd’hui de remarquer les joies de mes enfants. Mad. de Meulan m’a rapporté aussi, à moi trois belles coquilles de l’Inde, pêchées dans les eaux de Trouville. Je n’ai pas sauté comme Guillaume ; mais ces trois coquilles m’ont fait plaisir. Depuis que je suis au Val-Richer, J’apprends à reconnaître le plaisir des petites choses, des ornements intérieurs, des jolis conforts, des raretés, des collections. Autrefois, je n’y pensais pas du tout. Aujourd’hui je ne sais quel instinct, encore bien obscur, m’avertit que je prépare là l’agrément de mon repos, l’amusement de ma vieillesse. Je ne songe pas encore à chercher ces babioles ; mais quand elles me viennent, elles me plaisent. Je n’ai eu dans ma vie qu’un goût très vif de ce genre, celui des livres. J’en ai beaucoup, et le goût m’avait passé. Il me revient. On vient de m’envoyer d’Angleterre quelques volumes curieux sur l’histoire de leur révolution. Instruction à part, cela m’a charmé. Je vous raconte là mes enfantillages. Je n’en suis pourtant pas au point du Chancelier Séguier qui disait à 83 ans : " C’est bien heureux ; bien des gens ont eu envie de me réduire & personne n’a jamais su comment. Pourtant on l’aurait pu, avec de beaux livres bien reliés. "
Vous m’avez menacé de n’avoir pas de lettre ce matin. J’attends pourtant avec grande impatience votre avis sur le voyage de Baden. Je pense sans cesse à ce qui vous touche. Je donnerai tant pour vous voir sortir de votre mauvaise position et surtout de votre abattement qui est bien pis qu’une mauvaise position. Aucune heure ne se passe certainement dans la journée sans que je me demande comment vous avez passé cette heure-là qu’est-ce qui l’a remplie pour vous, qu’elle était votre disposition intérieure. Vous m’êtes une préoccupation constante. Si j’étais près de vous, ce serait une occupation. Cela vaudrait mieux. Le Duc d’Orléans vient de me répondre d’une manière très aimable. Il est très heureux. Il me parle beaucoup de son bonheur privé, et de la bonne étoile de son père, dont il espère bien hésiter. Je vois que l’Empereur est retrouvé. Cet hiver que le grand Duc va passer en Italie prolongera le séjour de votre mari auprès de lui. Je suis bien aise que ce jeune homme soit mieux. L’intérêt que vous lui portez m’a gagné. Et puis, j’ai envie de voir un Prince doux sur ce trône barbare. Quoique l’histoire de ce monsieur, qu’il a fait brusquement enlever du milieu du parterre pour lui faire couper la barbe, donne la mesure de ce qu’est de, même la douceur dans ce monde là.
10 h.
Si je suivais mon premier mouvement, le mouvement qui me presse, je serais fâché comme je ne l’ai jamais été ; je vous gronderais comme je ne vous ai jamais grondée. Comment ? Je fais sur moi le plus amer effort, vous me demandez depuis quinze jours quelque chose à faire, quelque chose absolument pour sortir d’une situation que vous ne pouvez plus supporter. Je vous indique, malgré moi, en m’oubliant moi, la seule chose qui me semble offrir quelque chance, puisque toutes les autres sont épuisées ; et vous me dites que je veux me débarrasser de vous ! Ah, Madame! Votre pénétration vous manque. Vous ne me connaissez pas ? Et moi aussi, je ne vous dis pas la moitié, pas la centième partie de ce que je sens. Si je vous le disais en ce moment, je vous affligerais beaucoup, je vous blesserais peut-être. Je ne le ferai pas. J’ai pour vous une pitié immense. Mais je vous aime encore plus que je n’ai pitié de vous. Voilà le mal. J’essaierai de vous plaindre plus que je ne vous aime. Adieu.
Je vous écrirai plus en paix demain. Il y a pourtant au fond de mon cœur, en ce moment même, une vive joie. Non, je ne vous envoie pas à Baden. Adieu. G.
123. Val-Richer, Vendredi 7 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne sais ce que je vous dirai aujourd’hui. Mon premier mouvement dure toujours. Je vous aime de cette affection qui domine tout, qui suffit à tout, qui promet immensément et donne toujours plus qu’elle ne promet, qui ne supprime pas toutes les épreuves ne guérit. pas toutes les plaies ; mais qui se mêle à toutes, pénètre jusqu’au fond, et répand sur toutes un baume qui les rend toutes supportables. Voilà comment je vous aime. Et je vois à la fois deux choses ; l’une, que mon affection ne peut pas pour vous tout ce quelle croit pouvoir ; l’autre que vous ne savez pas y croire. Vous êtes malheureuse et injuste. Je ne me suis point mépris sur vous. Vous êtes tout ce que j’ai cru tout ce que je crois toujours. Aujourd’hui comme il y a un an c’est mon plaisir, mon ravissant plaisir de penser à tout ce que vous êtes, à l’élévation de votre caractère, à la profondeur de votre âme, à l’agrément supérieur de votre esprit, au charme de votre société. Rien de tout cela, n’a changé n’a pâti pour moi depuis le premier jour. Bien au contraire : j’ai eu des doutes que je n’ai plus ; j’ai cru à des lacunes que n’existent pas. Mais je me suis trompé sur les limites du possible. J’ai cru que, malgré l’incomplet de notre relation, malgré la cruauté de votre mal, même sans pouvoir vous donner toute ma vie, je ranimerais, je remplirais la vôtre.
Vous m’aviez inspiré avant le 15 juin un intérêt momentané mais au moment sérieux et profond. Depuis le 15 juin, ma pensée et mon cœur ne vous ont pas quittée une minute. Vous êtes entrée et entrée avec un charme infini, dans les derniers replis de mon âme. Vous m’avez convenu, vous m’avez plu dans tout ce que j’ai en moi de plus intime, de plus exigeant, de plus insatiable. Je vous l’ai montré comme cela se peut montrer toujours bien au dessous de ce qui est, mais enfin, je vous l’ai montré. Et en vous le montrant, à vos émotions, à vos regards, à vos paroles en vous voyant renaître, et revivre, et déployer devant ma tendresse votre belle nature ranimée, je me suis flatté que je vous rendrais, et qu’à mon tour je recevrais de vous, non pas tout le bonheur, mais un bonheur encore immense, un bonheur capable de suffire à des âmes éprouvées par la vie, et qui pourtant n’ont pas succombé à ses épreuves, qui portent la marque la marque douloureuse des coups qu’elles ont reçus, et pourtant savent encore sentir et goûter avec transport les grandes, les vraies joies. Voilà ce que j’ai cru, ce que je me suis promis. Je n’ai pas de désirs médiocres. Je n’accueille que les hautes. espérances. Je sais me passer de ce qui me manque, mais non me contenter au dessous de mon ambition. Et dans notre relation, de vous à moi mon ambition a été, est infiniment plus grande que dans tous les autres intérêts où peut se répandre ma vie. Je ne saurais la réduire. Je ne regrette pas d’être ainsi. Et d’ailleurs cela est. Je puis me gouverner, non me changer.
Comment l’idée que je voudrais vous envoyer à Baden pour me débarrasser de vous, pour ne plus porter le poids de vos faiblesses et de vos peines a-t-elle pu vous entrer dans l’âme ? Je crois vous l’avoir déjà dit ; vous avez certainement passé votre vie avec des cœurs bien secs et bien légers. Vous ne pouvez parvenir à croire à une vraie affection. Vous retombez sans cesse dans vos souvenirs de la froideur et de l’égoïsme humain. C’est encore pour moi un mécompte. Je m’étais flatté qu’en dépit de votre expérience je vous rendrais une confiance, qui est dans votre nature, que je vous ferais trouver en moi ce que vous n’aviez rencontré nulle part qu’en vous-même. Je suis bien orgueilleux, n’est-ce pas ? Mon orgueil n’a rien qui puisse vous blesser. Que me dites-vous que votre esprit est bien soumis à mon esprit ? Est-ce votre soumission que je veux ? Je méprise la soumission, je méprise toute marque, tout acte d’infériorité. Je ne me plais que dans l’égalité. Je veux une nature égale comme une affection égale. Je veux vivre de niveau et en pleine liberté avec ce que j’aime. Je veux sentir à la fois son indépendance, et son union avec moi, sa dignité et son abandon. C’est à cause de vous seule, c’est en désespoir de moi sur vous et pour vous, que je vous ai conseillé d’aller à Baden ; croyant deux choses ; l’une que si je suis pour vous ce que je veux être, vous sauriez bien revenir en France, l’autre que, si je ne suis pas cela, il vous importe par dessus tout d’arranger votre vie avec ceux qui en disposent matériellement. Dites-moi que j’ai eu tort, et n’allez pas à Baden. Vous ne m’aurez jamais fait un plus immense plaisir.
9 h. 1/2
Oui, vous êtes bien douce ; mais cela ne me suffit pas. Adieu pourtant. Et adieu comme toujours. G.
124. Val-Richer, Samedi 8 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous dites bien vrai. Cinq minutes d’entretien valent mieux que dix lettres. Quelque fois pourtant il y a quelque avantage à se parler de loin de près, on ne se dit pas toujours tout. On garde certaines choses sur le cœur, ce qu’il ne faut jamais. Bien peu, bien peu de relations sont dignes et en état de supporter la vérité. Mais celles qui le peuvent devraient toujours, et à toute minute, l’accueillir toute entière. En définitive elles y gagnent. Je laisse la aussi, le sujet de Baden, mais à condition que vous ferez comme moi, que vous ne garderez rien, sur le cœur absolument, rien.
Je devine je crois votre impression sur Versailles et n’en suis pas étonné. Mais soyez sûre de deux choses, l’une que c’était le seul moyen de conserver le château, l’autre, que cela a fort réussi dans le public, qu’il prend plaisir à ce grand Capharnaüm de l’histoire de France, vieille et nouvelle, et qu’il en reçoit une leçon de modération et d’impartialité. Pratiquement donc cela est bien et utile. Montant plus haut, et ne se souciant de rien ni de personne, il y a beaucoup de vrai dans votre impression.
Je commence réellement à être un peu occupé de l’affaire de Suisse. Cependant je crois comme vous, qu’il n’en sortira rien que du ridicule. Rien, c’est la passion du temps. Mais si l’affaire n’est pas finie au moment de la session de manière ou d’autre, la discussion sera désagréable pour le Cabinet.
J’ai M. et Mad. Lenormant depuis deux jours. Ils partent aujourd’hui. Ils ont amené leurs trois enfants qui joints aux trois miens, font un grand bruit dans le tranquille Val-Richer. J’ai été consterné hier matin, en voyant tomber des torrents de pluie noire. La journée est longue quand on ne peut pas promener ses hôtes. Mais à midi, il ne pleuvait plus. J’ai conseillé de braver les nuages et notre courage a été récompensé. Le soleil est venu. Le terrain que j’ai choisi n’était pas trop mouillé. Nous avons fait une agréable promenade. Il n’y a rien eu ici avant- hier qui ressemble à votre orage.
On me dit que M. de Châteaubriand est revenu très frappé de l’état du midi de la décadence du Carlisme, et des progrès de l’esprit nouveau. Il vient d’écrire à Melle de Fontanes, une longue lettre très agréable, dit-on, sur le souvenir et le talent de son père. Cette lettre doit servir de Préface aux œuvres de M. de Fontanes que sa fille va publier. Je n’accepte pas votre envie. Oui, nous sommes des êtres, horriblement jaloux, mais non pour toutes choses, ni de tous. Je ne porte pas, la moindre envie aux possesseurs de parcs et de châteaux qui ne sont pas à moi. Je suis charmé qu’ils les aient et qu’ils en jouissent, et il ne m’est jamais entré, dans l’âme, à leur sujet, le plus léger sentiment d’amertume ou de tristesse. Seulement le plaisir d’y regarder s’use vite pour moi, parce que je n’y porte pas non plus cet inépuisable intérêt très naturel et très légitime, qui s’attache, pour chacun de nous à notre propre existence et à tout ce qui y tient de près ou de loin. Il y a, dans l’égoïsme, comme dans tous les sentiments naturels et universels, une part très légitime, juste en soi et nécessaire à la marche du monde. Il faut accepter hautement cette part là en lui assignant sa limite.
La Duchesse de Talleyrand revient-elle décidément ? Je suppose que le Duc de Noailles est retourné à Maintenon. Pour vous, vous y avez tout à fait renoncé, n’est-ce pas ? On me dit que Mad. Pasquier va tout à fait mourir. Je penche fort à croire que le Chancelier finira par épouser Mad. de Boigne ; et à mon avis, ils auront raison tous les deux. Ils finiront doucement leur vie ensemble sans avoir la peine d’aller se chercher deux ou trois fois, par jour. 10 h. Adieu. Adieu. Et ni Madame, ni morale. Adieu. J’avais eu la même idée sur Marie. Elle n’avait fait que me traverser l’esprit ; mais je l’avais eue, tant je trouvais cela fou. Adieu. G.
126. Paris, Mercredi 5 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous annonçais point de lettres aujourd'hui et vous en aurez au contraire une longue. Par deux raisons. La première que je ne crois pas que le temps me permette d’aller à Versailles. La seconde : parce que je viens de recevoir de votre part. Vous m'envoyez à Baden bien lestement. Vous oubliez tout. Vous oubliez donc que je ne puis pas bouger, qu’officiellement au moins cela est établi, que je viens encore de l'écrire à mon frère, que tout le passé aurait l'air d'une comédie si je faisais ce voyage. Vous oubliez qu'une fois hors de France je n’y rentrerai pas. Vous savez cela parfaitement, vous me l'avez dit vous même cent fois. Et vous m'envoyez à Baden !
Vous êtes ennuyée de moi et vous voulez vous en débarrasser. Je le conçois un peu, je ne le conçois pas tout-à-fait. Je ne suis pas tout ce que je vous ai semblé être au commencement. Vous vous êtes mépris sur mon caractère. Vous ne pensiez pas qu’il fût si mobile, et si vous y regardiez bien cependant, est-il si mobile ! Le fond de mon cœur c'est de la douleur, une douleur éternelle. Une douleur qui a été couverte par l’étonnement, la joie de vous avoir trouvé. Le premier de ces sentiments, le temps l’efface actuellement. Le second dure, mais plus tranquille, parce qu’il est plus établi. Il y a donc dans mon cœur, ma douleur et vous. Voilà la vérité, voilà ce que je sens qui est la vérité aujourd'hui. Je ne sais ce que peut le temps. Jusqu'ici Il ne m'a été d’aucun secours. Ma situation depuis que je vous connais s’est empirée. Vous connaissez toutes les pensées toutes les tracasseries qu'on me fait éprouver. Il est impossible que mon humeur ne s’en ressente pas. J’ai l’esprit agité sans cesse. L'âme aigrie. Nulle ressource autour de moi. Un home le plus ennuyeux du monde. Tout cela ensemble fait de moi une triste société pour vous lors que nous sommes ensemble, et une plus triste encore quand je ne suis réduite qu'à vous écrire. Le fait est donc que je vous suis à charge un peu, que pour vous comme pour moi vous seriez bien aise que je sois tirée de mes peines présentes, que vous me conseillez Baden comme un moyen possible, et que s’il ne réussit pas. Eh bien, vous n'avez plus mes plaintes à recueillir, mes inégalités à supporter. Voilà tout ce que deux mots de votre lettre ont fait naître en moi de réflexions et remarquez bien, je ne vous en veux pas, je trouve que vous avez raison un peu raison, pas tout à fait.
Je vaux mieux que vous ne croyez, mieux que je ne me montre mon cœur vous est bien attaché, mon esprit est bien soumis à votre esprit. Si je vous perds, il ne me reste rien vous avez encore pour vous les joies et les gloires de cette terre. Il n’y en a plus de possibles pour moi. Et vous qui me donnez la seule félicité que je puisse goûter ici bas, la parfaite intimité de pensées, de cœur, vous voulez m’exposer à la perdre ?
Si je vous ai dit une parole un mot qui vous semble dur, pardonnez le moi, vous m'avez déjà tant pardonné. Vous savez que je dis tout ce que j'ai sur le cœur, mais vous ne savez peut-être pas que je dis peut-être pire. Il y a aussi peu de coquetterie dans mon cœur que dans ma personne. Je suis sévère pour moi. Je m’amuse. Je me montre moins bien que je ne suis. Je vous aime plus que je ne vous le dis, je vous excuse vous du fond de mon cœur. Je me rappelle avec une tendre reconnaissance votre inaltérable douceur, je reconnais avec humilité et repentir, une vivacité, les caprices de mon humeur ; je conçois que je vous ennuie quelques fois, mais je ne concevrais pas que vous puissiez cesser de m’aimer. Et vous m’envoyez à Baden.
Je suis interrompue sans cesse. Mon fils me parle ; je ne puis pas écrire, de suite, comme je voudrais. J’ai tant dans le cœur tant dans la tête. Je vous envoie ceci, sans presque savoir ce que je vous envoie. Dans les relations ordinaires de la vie, c’est mal, on a souvent tort de se laisser aller à son premier mouvement. Dans les relations qui existent entre nous c’est le premier mouvement qu'il faut suivre parce que rien ne doit rester caché. Adieu, adieu, vous verriez bien mal si vous ne voyez beaucoup beaucoup d'amour dans cette lettre. Adieu.
127. Paris, Jeudi 6 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma lettre d’hier a répondu à votre lettre d’aujourd’hui. Je laisse donc tout-à-fait ce sujet. Ah que c’est peu de chose de s’écrire comme cinq minutes d’entretien valent mieux que dix lettres ! Vous me disiez l’autre jour que vous n'aimez de jardin et de pare que le jardin ou le parc qui vous appartient, que ce qui appartient à un autre vous lasse vite. C'est très vrai, c’est ce que j'éprouve aussi, et cela s appelle de l’envie. Cette définition est peu brillante, mais elle est vraie. Soyez sûr que nous sommes des êtres horrible ment jaloux, et que la belle nature toute simple nous charme parce que nous ne sommes pas jaloux de Dieu. A propos, j’ai cependant été à Versailles hier, mais seule avec mon fils & le le petit Coke. Celui-là nous pouvions le mettre à l'abri dans ma calèche sans nous gêner, il n’en eut pas été de même de Marie, du prince Howard & de M. Acton qui devaient tous aller avec moi. A 10 heures le matin il y a eu un orage épouvantable, j'ai envoyé ma circulaire pour renoncer à la partie. A midi le temps est redevenu beau, mon fils avait une grande curiosité de Versailles, et nous y sommes allés comme je viens de vous dire.
Eh bien je dis de Versailles ce que tout le monde en dit, me réservant de penser toute autre chose. C’est de l'hérésie, c'est de l'impolitesse et voilà pourquoi je me tairai. Les ordres avaient été donnés, j’ai tout vu à mon aise ; traînée dans les petites chaises. J’ai été ensuite regarder la façade du château dans le jardin. J’ai fait un très mauvais dîner au réservoir, et je suis revenue pas l’orage le plus horrible que j'ai jamais vu nous nous sommes abrités sous une porte cochère à Sèvres. La grêle était grosse comme des prunes. Je me suis couchée à 9 heures, & à me voici. Il y a deux jours que je n’ai pas vu une âme. Je n’ai pas un mot de nouvelles à vous dire. Je suis curieuse de la Suisse. Mon fils me quitte après demain. Il reviendra le 25, pour repartir le 2 ou le 3 octobre.
Que va devenir cette affaire de la Suisse, cela commence à devenir très curieux, et cependant vous verrez que cela s'en ira en fumée. Adieu Adieu. Dites-moi toujours adieu avec le même plaisir que je le dis, je suis bien triste et bien douce aujourd'hui. Je pense bien à vous.
128. Paris, Vendredi 7 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Monsieur,
J'aurais bien envie de ne vous envoyer que cela, pour me venger du madame. J'en suis enragée. Savez-vous la réflexion que j’ai faite en recevant votre lettre ce matin, c’est que même dans une relation comme la nôtre on a tort de dire tout ce qu'on a sur le cœur, de l'écrire s’entend. Il ne faut jamais tout écrire, cela veut dire qu'il ne faut jamais être séparé. En paroles on peut tout se permettre il faut même tout dire, mais je ne vous écrirai plus rien de ce qui me passe par le cœur. Je vous manderai des nouvelles si j’en sais et pas autre chose. Vous m'avez fait du mal l’autre jour ; je vois que je vous en ai fait à mon tour. Et puis arrive votre Madame et je vous renvoie un Monsieur. Voyez où tout cela nous mène ? Mettrai-je un adieu pour terminer ? Surement c’est comme cela que cela finirait, si vous étiez là près de moi.
Je ne sais plus ce que j’ai fait hier. Je crois que je me suis promenée à pied au bois de Boulogne. C'est cela ; le temps était mauvais, je n'ai rien entrepris de lointain. Le soir j’ai vu beaucoup de monde et je n'ai pas appris grand chose. Pozzo s'annonce pour la fin de ce mois au grand contente ment des jeunes Pozzo qui devaient partir ce matin pour l'Angleterre, & qui restent. Fagel arrive demain. Les Holland mardi. Les Granville mercredi on parle beaucoup du général Bugeaud & du général Brossard. Quelle sale affaire ! De la Suisse, on ne sait qu’en dire. On croit toujours que la Suisse s'humiliera parce que tout le monde le veut ainsi. Un voyageur russe arrivé hier raconte que le grand duc est allé à Weymar. Une lettre que j’ai écrite à mon mari à Erns ne l’y aura donc pas trouvé. De Weymar mon frère m'a promis de me mander quelque chose de clair sur mes affaires, mais je ne crois plus aux promesses de personne.
Vous allez tant aimer le Val-Richer que vous serez désolé de rentrer à Paris. Regardez, voilà que la jalousie me gagne. Ah le mauvais cœur que le mien ! J'ai beaucoup causé avec la petite Princesse sur Mari. Elle a beaucoup plus d’esprit que moi et elle croit que Marie est en train de devenir folle. Serait-il possible ? Elle hait mon fils Alexandre, pas autant que vous, mais elle est en chemin. Je suis très troublée de cette idée. Je n’attends que Lady Granville pour voir ce qu’il y aurait à faire. Adieu. Adieu, si vous voulez je garnirais d’adieux, toute cette demi page. Ne me faites point de belle morale mais envoyez. moi ces petits mots là. Adieu.
129. Paris, Samedi 8 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai relu votre lettre de ce matin cinq fois déjà, décidément je ne l’aime pas. Il y a une phrase surtout qui me déplaît parfaitement. Elle est d'une froideur qui me fait mal, c’est vers la fin de la lettre et il me semble que j'ai bien envie de pleurer.
Je vous ai laissé un moment je vous reprends, je ne veux plus vous parler de votre lettre. Savez-vous à quoi je pense maintenant ? Ma lettre, cette lettre de mercredi, il y avait de dures paroles peut-être mais un grand fond d’amour au dessous de cela, la vôtre, les paroles sont douces, mais il y a de la glace à la fin. Enfin je n'en veux plus parler et j'en parle et je pleure. & je crois que je deviens folle aussi comme Marie. Ah mon Dieu que j’ai de peines, et de tout genre ! Mon fils me quitte aujourd’hui, cela me chagrine.
La Duchesse de Talleyrand est venue me voir hier matin. Elle vient plaider contre son mari, et même commencer peut-être le procès. Elle se dit très calme mais elle avait de temps en temps l’air un peu féroce. Fort belle cependant, car la férocité va bien à ses traits. Elle m’a conté mille choses curieuses sur mon empereur & sa femme. On a pour lui, à ce qu’elle dit, et pour les Russes en général, la plus grande haine en Allemagne. On se courbe devant lui, mais on le déteste. En Bavière une peur effroyable qu’il ne veuille y marier sa fille. Enfin c’est curieux, et par dessus cela des bêtises ah !! Les Appony sont venus aussi hier matin. Il parait que vraiment l'Empereur veut du Prince Leuchtemberg pour l'un de ses gendres. Si cela est, on en rira bien ici. Décidément les hôtels d’ambassade respectifs cesseront entre Paris et Pétersbourg. Pahlen va en acheter un pour le compte de l'Empereur. Il voulait acheter à la couronne celui où il est, vous ne le voulez pas. Le Roi est mécontent de cette affaire. Il croit et il a raison de le croire, que ce sera regardé & commenté comme une mesure politique. J’ai dîné comme de coutume avec mon fils et Marie, le temps était affreux je n’ai pas pu sortir le matin. Le soir, j'ai été faire une courte visite à Mad. de Talleyrand, & à Mad. de Castellane que j’ai trouvée seule. Elle paraissait croire qui Louis Bonaparte sortira de Suisse & cette affaire ne donne plus de souci selon les apparences. Thiers a vu M. de Metternich très longuement. On les dit ravis l’un de l’autre. Cela devait être. Des gens d’esprit se séparent toujours satisfaits l'un de l’autre. M. de Metternich est coquet comme une femme. Il aura emporté Thiers, & l'esprit, la vivacité, la franchise, de celui-ci auront plu à M. de Metternich, beaucoup. L'entretien a duré trois heures. Metternich a été chez Thiers. Je suis au bout de mes commérages d’hier. J'ai eu une lettre de Lady Granville, charmante, sur tout parce qu’elle s’annonce pour Mercredi. Le grand Duc est à Weymar depuis hier. Il sera à Baden le 17, pour y rester quinze jours. Adieu, je suis extrêmement triste & par vous. Ah que nous allons mal quand nous somme séparés. Si je vous montrais cette mauvaise phrase, vous auriez froid aussi. Adieu.
135. Paris, Samedi 15 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne vous ai pas écrit hier. Aujourd’hui j'essaie de le faire mais je ne crois pas que Vous me dites je vous envoie ma lettre aujourd’hui il faut tout se dire, même de loin. Cela me semble impossible si je vous disais tout, tout ce que j’ai sur le cœur. Ah que je vous blesserais. Et en ne vous le disant pas, je ne sais de quoi vous parler, car je n’ai plus qu'une idée, une seule. Vous m'avez fait bien du mal. Et vous voulez que je croie, vous voulez de la foi. Et tous les jours vous prenez soin de m’en enlever. En me quittant le 16 août vous étiez décidé à ne pas revenir. Je l’ai vu, je l’ai senti. Je me suis fait effort pour en douter. Votre proposition de Baden m'a rendu mon soupçon. Je ne vous ai pas aidé à vous débarrasser de moi, M. Duvergier de Hauranne, M. le préfet, Madame sa femme, sont venus à votre aide. Convenez que ce sont de pauvres raisons ! Les autres valent mieux ; et cependant l’année dernière elles n’étaient pas suffisantes pour vous retenir ? Vous êtes venu me voir deux fois, cela ne vous a pas semblé difficile. C’est que vous m’aimiez bien alors. Non, je ne suis pas injuste je ne suis pas défiante, je vois les choses comme elles sont. Je mérite tout ce qui m'arrive, c’est moi, toujours moi que j’accuse. Je vous l’ai dit, je ne m’aime pas, et je trouve que les autres ont raison de ne pas m’aimer. Je sens ce malheur profondément. J’ai cru que vous m'aimeriez beaucoup, beaucoup, j’avais repris confiance en moi-même, je l’ai perdue, tout à fait perdu, et je me retrouve plus isolée, plus malheureuse que je ne l'ai jamais été. Mon âme est tout à fait abîmée, flétrie. Je n'ai courage à rien. Je ne sais que vous dire. Je ne vous dis pas tout encore. Je ne vous crois plus, et le 31 octobre ! Vous reverrai-je le 31 octobre. Vous me l'avez promis, mais est-ce une raison pour que j'y crois maintenant ?
Dans ce moment il passe un convoi sous mes fenêtres. Le cercueil est tout blanc tout est recouvert de blanc. Qu’est-ce que c'est que le blanc pour les morts ? Dimanche 16 Sept. 8 h 1/2 Vous voyez bien que je ne puis pas vous envoyer ma lettre, Et j'ai besoin de vous écrire, de vous parler à tout instant. Je vous aime, je vous aime beaucoup. Pourquoi m'aimez-vous si peu ? Vos lettres sont bien écrites mais elles me semblent si froides ! Je me couvre beaucoup. Je ne parviens pas à me réchauffer.
136. Paris, Dimanche 16 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous n'avez pas eu de lettre ; cependant je vous ai écrit. Non pas le premier jour cela m’a été impossible, mon cœur, ma tête, ma main, tout s’y refusait. Mais je vous ai écrit hier, cette lettre est dans mon tiroir, elle y restera, car je vous ai dit tout ce que j’avais sur le cœur. Et vous m’avez appris à ne pas vous envoyer ces choses-là. Vous vous fâchez, vous me répondez, et je ne suis pas convaincue. Il ne me semble possible de nous entendre que de près. Vous m'avez rendue très malade, je me donne le plaisir de vous faire savoir cela. J'ai reçu une lettre de mon mari, je ne sais plus ce qu’il me dit, je sais seulement que vous ne venez pas, je ne sais plus autre chose et je ne pense pas vous offrir une autre manière de vous aimer que de perdre la tête de ce que cette année présente un tel contraste avec l’année dernière.
2 heures
Je rentre de l’église, je suis mieux. Un peu plus calme. J’y ai pensé à vous. Il m’a semblé que je devais tout vous dire, et je suis bien convaincue que je ne puis vous écrire qu'à cette condition. J'ai le cœur si plein, si plein, & vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez. pas le mal que m'a fait votre N°129. Je l'ai lue, relue, étudiée, encore une fois, toutes ces pauvres raisons. La seule, pratique est celle que vous regardez comme la plus faible. J’ai disposé du préfet & de M. Duvergier de Hauranne. Votre mère, vos enfants sûrement ils n’aiment pas à vous voir partir, mais quelques jours ! Vous l'avez bien fait l’année dernière. Et puis vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi vous venez, vous m’avez souvent répété que vous conserviez votre parfaite liberté d’actions. Je ne me range qu'à la dernière raison et celle-là m’afflige au delà de ce que je puis vous exprimer. Je ne puis donc rien. Est-ce les moyens de venir ? Le temps que cela vous prend et que vous enlèveriez à votre travail ? Mais ce temps pourrait être abrégée. Je vous aurais vu ; et vous voir, vous entendre, me faire entendre de vous, voilà ce qui m’eût comblée, voilà ce que j’attendais, et il m’est impossible de vous rendre l’impression qu'a fait sur moi l’annonce que je ne vous verrais pas. Il m’a semblé que le monde finissait pour moi. J’ai pleuré, je pleure encore, je pleurerai toujours.
Dimanche midi
Je vais à l’église demander à Dieu de remettre ma pauvre tête ! Je vous écris tous les jours, mais je ne vous enverrai ma lettre que si vous me l’ordonnez et n’ordonnez pas légèrement car mon cœur est tout entier dans cette lettre. Je vous en ai écrit trois ce matin que j'ai déchirées. Peut être ferai je le même usage de ce billet. Je n'en sais rien. Je ne sais plus rien, sinon que vous ne venez pas.
137. Paris, Lundi 17 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne sais quel parti prendre, faut il vous envoyer mes lettres ou les déchirer. Vous vous doutez si peu du mal que vous m’avez fait. Vous ne me comprendrez donc pas du tout. A tout hasard je vous envoyé tout, & vous ne savez pas tout ce que j’ai écrit de plus et que j'ai déchiré ! Vous pourrez trouver que je vous aime mal, mais vous ne trouverez pas que je vous aime peu. Il me semble que vous n'avez jamais su combien je vous aimais. Si vous avez le courage de me gronder peut-être me guérissez vous de mon amour. Car la révolte entrerait dans mon cœur. Ah que le vôtre est froid à côté du mien.
Midi
Je suis si triste, si triste. Quand me viendra la réponse à ceci, quelle sera cette réponse ? N’aurais-je pas mieux fait de dissimuler ? De faire une réponse convenable à votre 129. Une réponse aussi raisonnée aussi froide que l’était cette lettre ? Savez-vous cacher ce que vous sentez vivement. Moi, je ne le peux pas. Ainsi dans ce moment, si vous étiez ici. (ah quelle parole !) Je me jetterais à vos genoux, je vous demanderais de m’aimer, de m’aimer comme vous m’aimiez, de prendre pitié d’un pauvre cœur abattu, délaissé, malheureux, tout rempli de vous, qui n’a plus que vous, qui croyait en vous, qui voudrait y croire encore et qui ne le peut pas. Dites-moi, dites-moi si vous m’aimez. Dites le moi, vite un mot, un seul mot. Ne raisonnez pas avec moi, c'est si froid de raisonner. Cela me glace. Réchauffez mon pauvre cœur, j'y ai froid, bien froid.
1 heure. Lundi.
Encore un mot, encore. Aimez-moi, aimez moi je vous en conjure. Je pleure, je ne vois pas ce que j'écris. Dites-moi bien vite que vous m'aimez. Adieu. Adieu Adieu, toujours adieu, n’est ce pas ? Comme j’attendrai après demain matin ! si vous voyiez l'état où je suis, je vous ferai pitié.
138. Paris, Mardi 18 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Que pensez-vous de moi et qu’allez-vous me répondre ? Depuis que je vous ai écrit hier je n’ai pas cessé de tourner et retourner dans ma misérable tête votre lettre et ma réponse et plus j'y pense et plus je me repends. J'excuse tout ce que vous me dites. Je me veux du mal de tout ce que je vous ai dit. Il me reste bien ce froid. " Il fait moins pour moi cette année ci que l’année dernière", mais je n’ajoute pas " il m’aime moins " ; je ne le crois pas, et toutes ces réflexions me ramènent à vous avec moins de chagrin que je n’en éprouvais hier ; et bientôt, bientôt au bout de tous les dialogues que j’établis entre vous et moi, j'arriverai à vous demandez pardon de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que j’ai pensé surtout, car j’ai encore plus pensé que je n’ai dit et mon imagination me sert si bien que d'ici à demain matin je croirai que tout est effacé, oublié, pardonné et que je sors seulement d'un mauvais rêve. Mais encore une fois que penserez-vous de moi, qu’allez-vous me dire? Je n'ai rien reçu ce matin, je l'ai bien mérité.
Mercredi 11 heures
Ma nuit a été bien agitée. J’ai reçu cette nuit vingt lettres, elles étaient toutes mauvaises. Je me réveillais entre chaque mauvaise lettre, pour me dire, " c'est bon signe " ; " c'est mauvais signe." Et quand le matin est venu, quand je suis entrée dans le salon où je déjeune, & que je n’ai point vu de lettre auprès de mon couvert, mon cœur s’est serré. Je suis descendue dans le jardin j’ai appelé le portier, il tenait à la main une lettre. Je ne savais si je devais l’ouvrir. J’espérais plus que je ne craignais, mais je craignais un peu et le cœur me battait bien fort. Enfin je l’ai ouverte et j’ai poussé un de ces longs soupir, de ces soupirs qui vous soulagent après une grande fatigue. Vous m’avez dit tout ce qu'il me fallait ; vous me l’avez dit comme je le voulais, et il me semble que nous nous aimions mille fois mieux depuis ces terribles quatre jours. Et je crois que j'ai bien fait d’avoir perdu la tête parce que je me retrouve si bien, si bien aujourd’hui. J'aurais pour un mois de récit à vous faire sur l’histoire de ces quatre jours. Ces récits seraient interrompues pas mille adieux. Que d'émotions j’ai éprouvées ! Et cependant c'est une histoire si simple, une seule pensée. Enfin, enfin tout est fini. Mais que j'aimerais à vous le dire de près !
Dites-moi, dites-moi tout. Vous avez douté de moi, je le vois. Nous étions des personnes bien éclairées sur le compte l’un de l’autre, il faut en convenir ! Et vous vous vantez de me si bien connaître ! Moi je ne me vante de rien, je n’ai pas une prétention, mais une ambition de cœur immense. Je suis insatiable. Je veux que vous m’aimiez. Dans tous les instants, toujours. Aujourd’hui je suis si contente. Et j’ai été si malheureuse. Je ne le serai plus n'est-ce pas ? Je ne puis rien vous dire encore aujourd’hui qui sorte de mon seul et unique sujet de préoccupation. Tantôt je reviendrai à vous pour vous parler d’autre chose, car bien des choses m’ont passé, sous les yeux depuis vendredi ; je vous enverrai copie de la lettre de mon mari. Pour aujourd'hui vous n'aurez que moi, moi toute seule, avec tout ce que j’ai pour vous d'amour, d’amour éternel. Adieu.
174. Val-Richer, Lundi 29 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis exactement le contraire de Lord Holland, bien plus hardi dans le Gouvernement que dans l’opposition. Cela prouve qu’il n’est pas trop à sa place en ce moment, ni moi à la mienne. Je crains toujours de faire verser la voiture en querellant le cocher, même quand je n’aime pas le cocher. Et puis, l’opposition déclame beaucoup et je ne peux souffrir la déclamation. Toute parole exagérée tombe sur moi, comme un seau d’eau froide. En revanche, et pour me défendre de ma faiblesse j’ai aversion de celle d’un gouvernement. La colère me prend quand je vois le pouvoir indécis, inerte, abaissé. C’est un son faux à mon oreille, une ligne de travers à mon œil. Je puis me permettre cette colère, car je l’ai dans les affaires comme en dehors. Je n’ai jamais été content de mon propre gouvernement. Voilà les deux sentiments qui me tiennent aujourd’hui. Je navigue de l’un à l’autre.
Hier, pour la première fois depuis que je suis ici, je n’ai pas mis le pied hors de la maison. Je n’ai jamais vu un tel torrent de pluie continue. Je m’en serais consolé en travaillant, si j’avais été en train de travailler ; mais je n’étais pas en train. J’ai beaucoup causé avec Henriette. Cette bonne petite fille m’avait donné le matin, l’air fort troublé, et toute rouge, le billet au crayon que je vous envoie; et qui m’a été au cœur. Pourrez-vous le lire ? Je lui ai promis un mari qui serait charmé de vivre avec moi, et que nous ne nous séparerions jamais. Comment cette petite Duchesse de Wurtemberg s’est-elle détruite si vite ? J’espère que l’Italie la guérira si elle a auprès d’elle quelqu’un qui sache la gouverner, car je doute qu’elle se gouverne bien elle-même. Son mari n’a pas l’air gouvernant du tout.
Qu’est-ce que Fagel entend par le mauvais état des Affaires de son pays ? Croit-il que son Roi, malgré son semblant d’arrangement, s’obstinera toujours et finira par le brouiller avec ses Etats Généraux ? Si la conférence termine l’affaire Belge, je ne vois pas quel embarras il peut y avoir en Hollande. Il me semble que la duchesse de Talleyrand vous donne beaucoup à dîner. Veut-elle comme c’est l’usage de ce temps-ci, suppléer à la qualité par la quantité ? A-t-elle pris des jours ? Essaye-t-elle d’avoir une maison ? Je suis bien questionneur ce matin.
Vous souvenez-vous que vous m’écriviez de Londres, l’an dernier : " Durham a du courage, de l’audace, et surtout de l’ambition. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est Lord Durham qui le créerait. Tout cela est encore à sa naissance ; mais regardez-y bien ; le danger peut surgir tout à coup. Vous avez une sagacité bien rare, et charmante parce qu’elle est si naturelle si prompte ! En passant vous voyez au fond.
10 heures
Je me fâche de ce que vous vous fâchez ; je m’afflige de ce que vous vous affligez. Qu’est-ce que cela prouve ? que dans ma conviction, vous n’avez jamais droit de vous fâcher jamais droit de vous affliger à mon égard. Oui, j’en suis convaincu, j’en suis sûr. Entendez bien ceci, dearest, je suis infaillible envers vous. Et tant que vous ne le croirez pas vous ne me connaîtrez pas, et vous ne saurez pas combien je vous aime. Adieu, adieu toujours le même adieu quand même, et je ne veux pas qu’il y ait de quand même. G.
175. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
176. Lisieux, Mercredi 31 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai amené hier mes enfants dîner ici. C’était un grand divertissement. Je vais les ramener à leur grand mère dont ils sont toute la vie. Elle est mieux. Le temps devient froid, ce qui lui vaut mieux que l’humidité continuelle. Vous avez beau dire. Nous partons lundi 5. Je vous verrai mardi 6 à 6 heures et demie. Et puisque vous ne voulez pas de mon espérance que nous serons heureux, j'accepte votre certitude. Je gagne au change. Plus de paroles, plus de discussion. De loin, c’est impossible. Je le sais comme vous. Et comment se taire quand on a tant à dire ? Vous avez l’esprit, et le cœur bien actifs, bien des choses s’y passent en une heure, en deux mois et demi. Mais soyez sûre qu’il s'en passe tout autant chez moi. Je vous défie toujours. Dans longtemps, bien longtemps d'ici, quand nous serons vieux vous me direz si j'ai gagné mon défi.
Je connais beaucoup George d'Harcourt. Je ne comprenais guère votre goût pour les bonnes manières de M. Harcourt qui n'en a ni de bonnes, ni de mauvaises et que j’avais trouvé très ennuyeux. George est en effet de manières fort agréables, spirituel sans bruit. Je n’aime pas le bruit.
Non certainement il n'est pas besoin d'être anglais pour être choqué d’une soirée de mariage au Gymnase. C'est le mal de ce pays-ci qu’on veut toujours s'amuser, et qu’on s'amuse de très petits plaisirs. Comme je vois beaucoup de Puritains, je passe ma vie à défendre l'amusement ; mais je vous livre celui-là. Et comme il faut finir par une injure, je vous dirai que la passion du petit amusement possède surtout à Paris, les étrangers. Ils se figurent qu’ils y viennent pour cela. Le Gymnase fait partie du tout.
Vous trouverez bien quelque chose de moi, dans la Revue française, mais rien sur Mad. de Broglie, son mari est occupé à rassembler quelques morceaux qu’elle a publiés. Il veut y joindre des fragments de manuscrits, et il m’a demandé de mettre en tête de ce volume une notice. Je garde pour cette notice ce que je voulais dire d’elle. Ne parlez pas de ce projet de volume. J'étais fort tranquille sur votre discrétion. C’est une de vos petites et charmantes vertus. Mais je tenais à rétablir les faits. Il y avait dans votre lettre un certain où aviez-vous pris plein de doute et d'humeur. Votre doute m'offense, votre humeur me chagrine. Prenez-en votre parti. Rien de vous ne m'est indifférent, & ce qui ne m'est pas indifférent m'est important.
Voilà le N°179 et on me dit que ma voiture est prête. Adieu. Me trouvez-vous fâché ? J’étais sûr que le billet de mon Henriette vous irait au cœur. Certainement, je le garde. Adieu, Adieu. Expliquez-moi comment il se peut que je trouve le temps à la fois lent et rapide d’ici à lundi. Chaque heure qui s’en va est un gain immense. Pourtant il y en a encore beaucoup à gagner. Adieu. Adieu. G.
177. Paris, Dimanche 28 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Certainement vous avez un mauvais caractère ou une mauvaise logique dans l’esprit. Vous vous fâchez de ce que je me fâche, et c'est vous cependant qui avez commencé par m'affliger ! Cela n’a pas le sens commun. Venez et nous raisonnerons sur ce sujet, et je vous prouverai que ce n’est pas moi qui ai tort. Laissons cela maintenant. Ce qu'il y a de plus clair dans notre fait, c'est qu'à distance nous finirions par nous brouiller et que c'est impossible, à jamais impossible, lorsque nous somme ensemble, n’est-ce pas ?
Le traité entre l’Autriche & l'Angleterre ne peut pas nous être agréable, je vous dis cela de mon propre cru. Je n'en ai parlé à personne, et je n’ai personne avec qui causer de ces sujets là. Pahlen n'y entend pas un mot et Médem n’est pas ici. Je trouve en général que notre politique est fort lâchement même depuis quelques temps, aussi nous trouvons nous aujourd’hui dans un parfait isolement.
10 heures. Mon fils vient de me quitter. Je reste affligé, et bien contente de lui. C'est un excellent garçon. Me voilà seule de nouveau sans personne qui m’aime ! Je m'en vais à l'église. Je n’ai rien du tout à vous conter sur ma journée d’hier. Je l'ai passée avec mon fils, avec un peu de mélange de Lady Granville. Adieu. Adieu, & encore adieu et toujours adieu. Si cela ne vous déplaît pas.
Mots-clés : Diplomatie, Relation François-Dorothée (Dispute)
178. Paris, Lundi 29 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vraiment vous êtes étrange ! Selon votre lettre, il faudrait encore que je vous remercie de venir huit jours plus tard que vous ne m'aviez solennellement promis, et cela parce que il pouvait se faire que vous ne fussiez venu que 6 semaines après ? à ce compte surement je puis me promener de remerciements en remerciements et passer ma vie sans vous voir. J’aime la foi dans les promesses. Vous ne devez pas m'en faire, ou ne pas les rompre. Celles que vous me faisiez l’année dernière vous les teniez. Cette année ci tout a été de travers et sans le jury. Depuis juin jusqu’en novembre, je ne vous aurais pas vu une fois. et vous verrai je en novembre ? Croyez-vous que j’y crois. Il se peut que je vous dise là une chose dure, mais si vous y pensez bien vous trouverez que je n’ai pas tort. Seulement ce qui vous arrive à vous, c’est de croire que vous avez toujours raison surtout de loin ; ce qui vous arrive encore c’est de ne pas savoir combien je vous aime ! Vous voyez bien, je ne voulais pas entrer en discussion sur ce retard. Et me voilà engouffrée dans des explications sans fin et qui ne mènent à rien, car rien ne mène quand on est loin. Il faut être ensemble. Et voyez encore la différence entre vous et moi. Je vous ai dit, je vous répète. Quand nous nous serons tout dit, nous serons bien heureux. Vous modifiez cela, & vous m'écrivez aujourd'hui j'espère que nous serons heureux. C'est un bien vilain mot que vous avez tracé là Monsieur, et je suis bien aise d'avoir mis Monsieur pour vous le reprocher.
Voilà votre mère souffrante, si elle le devenait davantage n'aurez-vous pas à vous reprocher de ne pas être à Paris avec elle. Je vous prie de m'en parler tous les jours. M. Verny a fait hier un excellent discours, qui m’a fait du bien. Je mènerai Lady Granville à l’église un jour pour l'entendre. Le temps a été affreux. J’ai fait des visites entre autres à Mad. de Stackelberg. Elle avait marié sa fille la veille ; savez-vous ce qu'ils ont fait après la cérémonie ? Les mariés & toute la famille ! Ils sont allés au gymnase voir de méchantes pièces. Sans être Anglais, il me semble qu'on peut être choqué de cela.
J’ai vu beaucoup de monde hier au soir. On est resté dans la mauvaise habitude de l'été, dont je voudrais bien désaccoutumer mes amis, c’est de faire foule le dimanche & le jeudi. je n' y ai aucun plaisir, il n'y a pas de causerie possible. La princesse Schwaremberg qui était chez moi entre autres, est certainement extrêmement jolie ; elle a frappé tout le monde. Avec cela elle est animée, spirituelle. Savez-vous que la petite princesse était de mauvaise humeur ! Car même mon ambassadeur lui a été infidèle. Le George d’Harcourt dont je vous ai parlé est le vôtre. Vous devez l'avoir vu souvent chez Madame de Broglie. C’est lui que je trouve bien, et non le sot mari de Lady Elisabeth qui est le plus ennuyeux personnage du monde.
Avez-vous fait attention à l’adresse des états généraux en Hollande ? Je ne crois pas qu’elle facilite la conclusion de l’affaire belge. Jamais ils ne se sont montrés plus dévoués et plus fiers. Je serai impatiente de la revue française.
A propos, je n’ai point dit à M. de. Broglie que c’était de vous que j’avais appris qu'on l'attendait en Normandie. Jamais je ne cite. C’est mon habitude et une très bonne habitude. Ce qui fait que je n'ai jamais fait un paquet. il n'y a que vous à qui je dise tout, cela va sans dire. La cour toute entière va à Fontainebleau pour conduire jusque là la duchesse de Würtemberg. On y passera quelques jours. J’ai vu hier Mad. la Duchesse d’Orléans à l’église. Elle est selon moi, parfaitement laide.
Adieu, répétez moi, que c’est bien mardi le 6 que je vous verrai afin que j’essaie de me réjouir. J'écris aujourd’hui à Toukowsky pour lui demander l'itinéraire. C’est hopeless de l’attendre de mon mari.
Adieu, adieu, adieu. Dites-moi de bonnes, de douces paroles. Je n’aime pas du tout votre dernière lettre. Adieu.
179. Paris, Mardi 30 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Rien de plus touchant que ce petit billet d’Henriette. Comme vous devez aimer cet enfant. Je vous renvoie le billet, vous le conserverez. Le temps a été charmant hier. J'ai marché un peu à différentes reprises mais je n’ai pas été au bois de Boulogne. C'est loin, & la voiture fermée m'ennuie horriblement.
J'ai dîné chez Lady Granville. Au milieu du dîner sont entrés quelques jeunes anglais qui se croyaient encore à Londres où il est élégant d'arriver trop tard. Vraiment leur tournure étaient incroyables, l’un surtout, Lord Castleragh qui a cependant beaucoup d'esprit mais il faut franchir des diamants, des turquoises des cheveux touchant sur ses épaules, des choses étonnantes, et un peu de folie dans ses propos. L’autre, Lord Jocelyn, je ne le connaissais pas du tout, mais comme je suis anglaise. Il s'est mis tout de suite à son aise avec moi et nous avons parlé bons principes, car toute cette jeunesse, est Tory.
Il parait qu'on ne se pressera pas à Londres de donner un successeur à Lord Durham. Je crois que Lord Glendy va quitter. Il sera sans doute remplacer par Lord Morpette ou M. Baring. On espère que le soutien si unanime que les états généraux accordent à leur roi disposera Léopold à modifier ses prétentions, car il comptait que les Hollandais se montreraient mécontents. Il serait donc possible encore que les chose s’arrangent. Les cinq puissances sont d’accord entre elles & n’attendent plus que les réponses de la Haye & de Bruxelles. Léopold va à Fontainebleau & delà il retournera chez lui. On ne pense pas cependant que la cession territoriale à la Hollande s'opère sans quelque petite tentative de combat.
Que vous êtes patient de relire mes lettres vous m’apprenez que je suis sagace, je ne savais plus du tout ce que je vous avais dit dans le temps sur Lord Durham. Pour moi c’est autre chose, je relis vos lettres comme plaisir, comme étude. Elles sont admirables. Vous serez vous fâchée de celle que je vous ai écrite hier. Je n'en sais rien, mais vous auriez tort, il faut absolument parler de ces choses-là, mais jamais les écrire, je ne devais pas le faire peut-être ; mais ce n’est pas moi qui ai fourni l'occasion Enfin c’est fini ou plutôt ce sera fini le 6.
Voici un beau soleil, il ne faut pas que je le manque. Je m’en vais marcher. 2 heures Je rentre très fatiguée, je ne me sens pas bien, j’ai dormi mal d'abord, et puis ensuite lourdement. Je suis ce qui disent les Anglais out of sorts. Je n'ai jamais su d'où venait cette expression. Je lis toujours Sully avec plaisir. Adieu. Adieu, pas de lettres, pas de nouvelles. Adieu.
204. Baden, Vendredi 28 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai lu les rapports de M. Jouffroy. Il est très bien, on ne peut mieux. Mais le conseil qu’il donne impraticable. Nous ne laisserons par les puissances de l'Europe se mêler de cette affaire, soyez persuadé qu’il ne peut pas y avoir de congrès. Vous serez très content de nous, moins cela.
Vous m'écrivez de courtes lettres. Je manque d’appétit pour mon dîner mais j’en ai toujours, toujours un très grand pour vos lettres, songez à cela. Vous m'avez promis de me tout dire, mais vous ce qui arrive. Quand vous êtes à Paris vous avez beau coup à me dire et vous n'en avez pas le temps. A la campagne, beaucoup de temps et point de nouvelles vous êtes un peu dissipé à Paris. Racontez-moi mieux vos journées. Est-ce que par hasard vous feriez des visites comme l’année dernière, dont je n’entends parler que l’hiver d’ensuite ? Vous voyez que c’est une vieille querelle que je veux réchauffer. Mais trois petites pages et demi pour deux jours, cela, me parait d'une grande avarice. Comment ne trouvez-vous pas de temps pour m'écrire davantage. On trouve toujours du temps quand on veut ! Je vous prie, je vous prie écrivez-moi davantage. Vous me maltraitez, & moi je suis triste, je suis seule, je me fais des dragons. Et si dans ce moment, je continuais, je vous dirais quelques sottises. Adieu. Je vais me promener.
11 heures
Je rentre et je suis plus tranquille, mais ne dérangez pas ma tranquillité. Ecrivez-moi, écrivez- moi davantage. Eh bien, de Paris envoyez-moi une lettre tous les jours. Vous aurez honte de ne m’écrire que deux pages, il faudra bien que je vous occupe un peu plus que cela. Ce sera mieux pour vous, pour moi, pour moi surtout. A la campagne vous donnez des leçons à vos enfants, je n'en suis pas jaloux, vous donnez des ordres à les ouvriers, je n'en suis pas jalouse. Vous aidez Mad. de Meulan à caler des gravures, je n'en suis pas jalouse. Je vous laisse faire. à Paris, sans moi ; je ne vous laisse pas tant de liberté ; il faut que je vous aie à moi davantage toujours, quand vous n'avez pas des affaires. Est-ce convenu ? Je fais parler cette lettre aujourdhui lors de ma règle mais c’est pour que vous soyez plutôt informé de mes exigences. Ainsi de Paris vous m'écrirez tous les jours. Promettez-le moi je vous en supplie.
Ma nuit a été un peu meilleure. Mais le médecin a été forcé de renverser toutes ses ordonnances, au lieu de son et de lait, c'est des bains de sel et d’aromates que je vais commencer demain, & si au bout de huit jours ils ne me font pas de bien, je suis décidé à ne plus rien faire. Je suis plus faible que je ne l’étais à Paris. Il n’y a pas le sens commun à être venu ici pour être plus mal. Le prince Toufackin est venu me voir ce matin. Imaginez que j’ai eu presque du plaisir à le revoir. C’est fort. Adieu. Adieu. Il me semble que je me sens déjà. soulagé par l’arrangement que je vous propose. Adieu. Vous comprenez comment je vous dis Adieu.
210. Baden, Dimanche 7 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il faut convenir que vous prenez bien mal votre temps pour douter de mon cœur, pour douter que mon cœur ma vie sont à vous, pour croire que vous ne suffisez pas à mon âme. Et mon Dieu qu’est ce qui occupe mon âme ? Où trouve-t-elle du repos, de la douceur, si ce n’est en vous. Je suis bien accablée de mes malheurs passés, de mes peines présentes, je le suis plus ici que lorsque j’étais auprès de vous, et cependant avec quel bonheur je pense à vous, comme je retrouve de la joie de la sérénité dans le fond de mon âme en arrangeant le reste de ma vie pour vous, avec vous ! Vous êtes bien le reste de ma vie. Si je ne vous avais pas, je n’aurais plus rien. Dites-vous cela, dites-vous que je le pense sans cesse, sans cesse, et voyez si je ne vous aime pas plus que vous ne pouvez m'aimer ? Car vous, vous avez du bonheur sans moi. Et moi je n’ai plus rien sans vous.
Dites-moi si je dois me baigner ; si je dois rester à Baden. J'ai besoin qu'on me dirige. Je ne sais pas me décider. Je suis certainement plus malade qu’en arrivant, faut-il que j’attribue cela au temps ou aux remèdes. Jamais je n’ai été accoutumée aux bains, ils m'ont toujours affaiblie. Il n’y a que les bains de mer qui me conviennent. Dois-je faire à ma fantaisie c.a.d. ne plus rien faire. J'ai si besoin de vos conseils. Et après tout, ce que je fais ou ne fais pas, c'est pour vous. Il m'importe peu d’engraisser, de maigrir. Mais vous voulez me revoir autre que vous ne m'avez quittée, et je n'oserais pas revenir à Paris si je n’ai fait votre volonté.
J’ai été interrompue par Mad. de Nesselrode. Elle vient quelque fois causer de mes affaires. C’est de la bonté, mais il n'y a rien à dire il faut attendre. Paul va se trouver dans un grand embarras. On ne doute pas là-bas qu’il ne fasse un arrangement convenable, car le droit serait trop peu, et jamais on ne s’en est tenu au droit. Lorsqu'il s’est agi d'une mère. Voilà ce que Mad. de Nesselrode crie sur les toits en vantant à cet égard la supériorité des Russes sur tous les autres. Si elle a raison, encore une fois, le dilemme sera grand pour Paul. Que fera-t-il ? Et moi dites-moi ce que je ferai ? Puis-je accepter son au delà du droit après ce qui s’est passé ! Mon instinct me dit que non. Aidez-moi. Je vois votre réponse ; " Votre fils ne vous mettra pas dans cet embarras." Cependant répondez comme s'il m'y plaçait. Si je mettais mon acceptation au prix d’un retour de sa part, il n’aurait garde de revenir à moi. Répondez, répondez.
11 heures
Je pense beaucoup à votre discours c'est au fond le vrai discours politique dans cette discussion. Il est fort remarqué. Et en général on pense que l’Empereur doit être content de ce que vous avez dit de lui. Je le pense aussi sauf un point, le véritable, et que vous avez traité avec une grande habilité, ne lui imposant des devoirs qui pourraient ne pas rencontrer ses intérêts. Somme toute vous avez fait un beau discours et qui sera fort remarqué chez nous. On me dit que le mariage Dormstadt n'aura pas lieu. On ignorait la naissance lorsqu'on s'est embarqué si étourdiment dans cette affaire. C’est une grande étourderie d’Orloff. Mon mari en eut été incapable. Il est vrai que la bâtardise ne pouvait pas être un grand pêché aux yeux d’Orloff. A Berlin on s’est fort ému de ce choix et on a éclaté. Je ne sais au reste ceci que par des voies détournées. Voici votre lettre, je n'ai plus que le temps de vous le dire, et de vous dire adieu, et bien des adieux.
263. Paris, Lundi 16 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre reçue ce matin est la première depuis deux ans où je ne trouve pas le mot, adieu. J’en suis très affligé. Le dernier mot de cette lettre me prouve que j'ai eu tort dans ce que je vous ai écrit avant-hier. Comme je me sens de nouveau très malade aujourd'hui par suite d'une nuit passée tout à fait sans sommeil je crains de vous écrire. Je vous préviens que j’aurai grand soin de ne vous écrire que lorsque je serai assez bien pour ne pas craindre qu'il m'échappe des paroles qui puissent vous déplaire, parce que les répliques me font du mal. Je ne suis pas maîtresse de mon cœur, ni de ma plume, mais je suis bien maîtresse de ne point la prendre. Je ne sais par quoi je finirai, mais tous les jours je me sens plus mal. Je n’ai pas de nouvelles à vous donner. Vous ne m'avez pas dit adieu !
264. Paris, Mardi 17 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je me sens un peu mieux aujourd’hui ce qui fait que j’ai le courage de vous écrire. Hier encore a été une bien mauvaise journée. Mes crampes ont recommencé, mes nerfs ont été dans un état affreux. J’ai passé la journée seule. Si je n’avais pas eu quelque heures de sommeil vous n'auriez pas de lettres ; car décidément je ne risquerai plus de vous écrire lorsque mon cœur ressemble à mes nerfs. Vous avez raison dans tout ce que vous me dites ce matin et mon Dieu, mais ce n’est pas la raison qui est mon culte ; je n’aime pas par raison. Il n’y a rien de raisonnable à aimer. Et vous avez mille fois raison de ne pas aimer à ma façon. C'est une mauvaise façon. On m'a mis ce matin dans un bain d’Eau de Cologne. Je laisse faire sans avoir confiance en rien. Cela ne durera pas longtemps. Je ne m'occupe plus de chercher quelqu'un, je ne m'occupe plus de rien de ce qui me regarde. Je vous ai dit souvent que je craignais de la folie, je la crains plus que jamais parce que je la vois venir.
J'ai une mauvaise affaire sur les bras. Malgré les promesses que j'ai faites à Bulwer de la part de madame Appony il a rencontré sa belle-sœur chez elle hier au soir. Il me le mande dans un billet ce matin, et veut pour conseil. Il regarde ceci comme une insulte personnelle. Il a raison et cependant ce n’est sans doute qu'une bêtise de Madame Appony. Mon conseil sera qu’il n’y retourne pas. Moi, j’ai droit d'être blessée aussi car la promesse m’a été donnée à moi.
1 heures
J'ai eu la visite de Génie. C'est un bon petit homme ; ce qui me prouve ma décadence et ma misère est le plaisir que me fait la visite d'un bon petit homme ! Après lui est venu Bulwer ; j’étais encore dans mon bonnet de nuit. Il n’avait pas fermé l'œil depuis hier, il voulait écrire à Lord Palmerston demander son rappel de Paris à cause de l'insulte des Appony, enfin il était dans un état violent. Au milieu de cela je reçois la réponse de Madame Appony à une petit billet d’interrogation un peu vif que je lui avais écrit, et j’éclate de rire. La belle sœur n’y avait pas été. Bulwer a eu une vision ... Il n'en revient pas. Il soutient qu'il la vue. Je l’ai assuré qu’il se trouvait obligé de croire qu’elle n'y était pas, car mensonge ou non, il est bien certain maintenant qu’elle ne s’y retrouvera plus.
Le billet de Madame Appony est long, plus de tendresses pour Bulwer, d’indignation de ce que nous soyons cru capable de manquer à ses promesses. Enfin c’est fort drôle, et c’est fini. Hier Bulwer causait avec Appony lorsqu'il a eu sa vision. Il a laissé court et est sorti brusquement de la maison.
A propos de maison, Démion est revenu. Je prends l’entresol à 12 mille francs. On dresse un inventaire des meubles. Je prendrai ce qui me conviendra.
Rothschild m’a mandé qu'il avait abdiqué ses droits entre les mains de Démion, il n'y peut donc rien. Et bien, j’ai cet entresol ! Cela ne me fait aucun plaisir, rien ne me fait plaisir. J’ai écrit hier à Benkhausen pour demander les lettres of admisnistration d’après ce que me dit mon frère lui ne le ferait pas. Si j’attends l'arrivée de Paul ce sera encore une complication une fois les lettres obtenues, l'affaire est plus courte & plus nette. Je crois que je m’épargne du temps et des embarras, & que je suis en règle. Le pensez-vous aussi ? Pourquoi attendre. Je chargerai Rothschild de lever le capital et de remettre leurs parts à mes fils voilà qui est simple.
L’affaire de Don Carlos est regardée ici comme un grand triomphe. En effet, c'est une bonne affaire. Si on est sage à Madrid cela peut devenir excellent. Palmerston, & Bulwer ont écrit à M. Lotherne pour qu'il presse le gouvernement de ratifier la convention de Maroto. Mais vu dit qu'il y a de mauvaises têtes dans les Cortes. Adieu, je suis mieux ce matin. Je ne sais comment je serai plus tard. Ne vous fâchez jamais avec moi avec toute votre raison, & laissez- moi vous aimer avec toute ma folie. Adieu
267. Val -Richer, Lundi 16 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
J’aurais le cœur bien blessé si je ne me l’interdisais pas. Blessé à ce point que mon envie était de ne pas vous répondre du tout sur ce que vous me dites. Mais vous êtes souffrante, vous êtes seule. Dites, pensez même (ce qui est bien pis) tout ce que vous voudrez. Je ne vous répondrai jamais qu’une chose. Vous n’aurez jamais plus que moi le sentiment de ce qui manque à notre relation, de ce contraste choquant, douloureux, entre le fond du cœur et la vie extérieure, quotidienne. Si ma vie était à vous aussi bien que mon cœur, vous verriez si je sais tout subordonner à un seul sentiment à une seule affaire si je sais être toujours là et toujours le même. Mais cela n'est pas ; il y a des affections, des devoirs, des intérêts auxquels ma vie appartient, et qui ne sont pas vous. Je ne puis pas la leur ôter. Je ne puis pas me donner ce tort à leurs yeux, à mes yeux, aux yeux du monde, à vos propres yeux. Car je vous connais bien ; vous mépriseriez la faiblesse même dont vous profiteriez. Vous avez l’esprit trop droit et le cœur trop haut pour ne pas avoir besoin, sur toutes choses, d’approuver et de respecter ce que vous aimez. Je vous parle bien sérieusement n’est-ce pas ? Pas si sérieusement que je le sens. Ce qui vous touche est si sérieux pour moi ! Mais assez ; trop peut-être, quoique je vous aie dit bien peu. Comment dire ? Comment dire de loin ? Toutes les paroles me semblent froides et fausses. Voilà plus de deux ans ; et pourtant il faut encore que le temps nous apprenne, l’un sur l'autre, bien des choses.
Que me direz-vous aujourd’hui de vos crampes, et de vôtre nuit ? Je vous renvoie la lettre du Prince Metscherzky. Je voudrais bien ne plus vous parler de Paul. Il me révolte. Et puis je ne comprends pas ces mœurs-là, cette façon de repousser insolemment de faire taire un parent qui vous parle d’une mère, parce qu'il n’a pas des pleins pouvoirs, parce que ce n’est pas un procureur ! Et ce parent se laisse faire ! Il ne trouve pas un mot à répondre, un mot bien simple, bien calme, mais qui remette à sa place tout et chacun ! Le Prince Metscherzky m’a l’air d’un excellent homme, bien zélé pour vous ; mais ne le chargez pas d’affaires difficiles ; ne lui donnez pas à traiter avec un frère puissant ou un cousin arrogant. Ne placez pas non plus comme il semble vous le conseiller, toute votre fortune en Russie. Quelques mille livres de rente de plus ne valent pas beaucoup de sécurité et de facilité de moins. Du reste vous avez déjà fait le contraire pour une partie.
Vous avez bien raison ; on nomme les gens aux emplois diplomatiques, en pensant à ce qu’ils sont là d’où ils partent, point à ce qu’ils seront là où on les envoie. On pense à si peu de choses ! Que les affaires humaines se font grossièrement ! On serait bien étonné si tout à coup, par miracle, elles étaient vraiment bien faites, et par des gens vraiment d’esprit. Savez-vous pourquoi on envoie M. de Pontois à Constantinople ? Parce qu'il est terne et tranquille, ne choque personne et ne fera pas les sottises de l’amiral Roussin. Le grand abaissement de notre temps, c'est de se contenter à bon marché ; le tel quel suffit, pourvu qu'on vive.
9 h. 1/2
Vous avez un peu dormi. Il faut absolument qu’on vous trouve une lectrice. J’en vais parler à ma mère. Adieu. Adieu. J’apprends à l’instant même que D. Carlos est en France avec toute sa famille. Les bataillons navarrois acculés à la frontière ont capitulé. Elio, qui les commandait, avait envoyé d'avance un de ses aides de camp au général Harispe. On ne doute pas que les Cortes ne sanctionnent le traité. Vous savez sûrement tout cela. Adieu. Adieu. G.
336. Londres, Dimanche 5 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je lui ai dit quand on me l’a présenté : "Il y a ici, Monsieur deux choses presque également singulières, un Ambassadeur de France Protestant, un membre catholique de la Chambre des communes d’Angleterre. Nous sommes vous et moi deux grandes preuves du progrès de la justice et du bon sens." Ceci m’a gagné son cœur. Il n’y avait à dîner que Lord J. Russell, Lord Duncanmon, Edward Ellice et sa femme, M. Charles Buller et M. Austin. Mistress Stanley hésitait à inviter quelques personnes pour le soir. Elle s’est décidée et a envoyé ses petites circulaires. Sont arrivés avec empressement Lord et Lady Palmerston, Lord Normanby, Lord Clarendon, l’évêque de Norwich, Lady William Russel, etc, etc.
En sortant de table, un accès de modestie a pris à M. O’Connell ; il a voulu s’en aller.
-Oui, mais restez, restez. Nous y comptons."
-Non, je sais bien.
-Restez, je vous prie." Et il est resté avec une satisfaction visible mais sans bassesse. Lady William Russell qui ne l’avait jamais vu, m’a demandé en me le montrant. - C’est donc là M. O’Connell, et je lui ai dit "Oui"en souriant d’être venu de Paris pour le lui apprendre.
-Vous croyez peut
être, m’a-t-elle dit, que nous passions notre vie avec lui.
- Je vois bien que non."
4 heures et demie
Vous avez raison pour les dîners. Le 1er Mai ne compte pas, et le dîner Tory ne peut venir qu’après un pur dîner whig. Je rétablirai cet ordre. Mais il n’y a pas moyen de donner aucun dîner un peu nombreux avant le 1er mai. On entre dans la quinzaine de Pâques. Beaucoup de gens s’en vont. Je n’aurais pas qui je voudrais même dans le corps diplomatique. D’ailleurs, pour le 1er Mai le corps diplomatique me convient, huit ministres, et trois ou quatre grands seigneurs. J’espère que le service ira assez bien. Mon maître d’hôtel est excellent.
3 heures 1/2
J’avais vu souvent le colonel Maberly en France chez Mad. de Broglie. Il me connait ; il m’invite à dîner, je venais d’avoir quelque affaire avec lui pour les Postes des deux pays. Personne ne m’avait jamais parlé de Mad. Maberly. Vous ne m’aviez point dit la prophètie de M. Pahlen. J’ai dîné chez un anglais de ma connaissance, chez un membre du Parlement, chez le Secrétaire des postes anglaises sans me douter de l’inconvenance. Une fois là, le ton de la maîtresse de la maison ne m’a pas plu. Mais cela m’arrive quelquefois, même en très bonne compagnie. J’ai du regret de ma bèvue, mais point de remords. Je regarderai de plus près à mes acceptations ; mais je n’ose pas répondre de ma parfaite science. Venez. J’ajoute que si je ne me trompe cela a été à peine su, point ou fort peu remarqué. Rien ne m’est revenu. Soyez donc, je vous prie, moins troublée du passé. Et bien tranquille, sur l’avenir du moins quant à moi-même. Je reprends ma phrase. Je suis ce que j’étais et je resterai ce que je suis. Et je suis charmé que cela vous plaise. C’est une immense raison pour que j’y tienne. Mais en honneur comment voulez-vous que ces blunders-là ne m’arrivent jamais ?
J’ai bien envie de me plaindre à Lady Palmerston de ce qu’elle ne m’a pas empêché de dîner chez Mad. Maberly. Elle me répondra que je ne lui avais pas dit que Mad. Maberly m’avait invité. Croyez-moi, j’ai quelque fois un peu de laisser-aller ; mais il n’est pas aisé de me plaire, ni de m’attirer deux fois de suite chez soi. Et je suis plus difficile en femmes qu’en hommes. Et toutes les prophéties, que vous auriez mieux fait de me dire seront des prophèties d’Almanach. I will not be caught. Mais regardez-y toujours bien je vous prie, S’il m’arrive malheur, je m’en prends à vous. Et n’ayez jamais peur de me tout dire. Votre colère est vive, mais charmante. Je ne sais pourquoi je vous ai parlé de cela d’abord. C’est une nouvelle preuve de notre incurable égoïsme.
J’ai commencé par moi. J’aurais dû commencer par vous, par ce triste jour. Samedi en vous écrivant, je voulais vous en parler ; et le cœur m’a failli. De loin, avec vous sur ce sujet-là, celui-là seul, je crains mes paroles, je crains vos impressions. Je n’aurais confiance que si j’étais là, si je vous voyais, si je livrais ou retenais mon âme selon ce que j’apercevrais de la vôtre. Je me suis tu samedi, ne sachant pas, dans quelle disposition vous trouverait ce que j’aurais dit craignant le défaut d’accord entre vous et moi. Tout ce qui va de vous à moi m’importe, me préoccupe. Dearest, je vous ai vue bien triste près de moi. Ne le soyez pas, laissez la moi ; ne le soyez du moins que parce que je ne suis pas là. C’est là ce que je ne voudrais. Et cela ne se peut pas. Et dans ce moment, je ne vous dis pas la centième partie de ce que je voudrais dire.
336. Paris, Vendredi 3 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
2 heures
6 heures. J’ai été faire visite à Lady Granville. J’ai causé avec le mari, il est bien d’avis que si M. Thiers est sage il n’abandonnera pas une de ses idées sur la question de l’Orient, parce que sa chute serait inévitable. Il pense, et il sait que vous soutenez cette opinion aussi qu’il ne serait possible à aucun homme d’Etat en France d’abandonner le Pacha. Enfin il me parait être aussi bien disposé que vous pouvez le désirer, et il gémit un peu de ce que d’autres en Angleterre pensent diffèrement. Il a eu hier pour voisin à dîner chez M. Gonin, M. Odillon, Barot. Il lui a laissé l’impression d’un homme qui protège le ministère ; et de plus, d’un homme qui compte être ministre lui même. On dit que la commission de la chambre des pairs est assez animée, et que la discussion le sera certainement. M de Broglie compte parler. J’ai été au bois de Boulogne un peu. Le vent d’est était bien élevé et bien aigre. En revenant j’ai passé chez Mad. de Talleyrand, M. Sallandy y était. Il disait que M. Molé parlerait aussi. C’est probablement le 13 que commence la discussion.
samedi 4
à 9 heures
Midi.
1 heure
Paris samedi le 4 avril 1840,
3 heures
Je viens de vous écrire et je recommence. Vous ne savez pas le chagrin que vous m’avez fait, chagrin de toutes les façons. Vous êtes descendu dans mon opinion, voilà ce qui me fait mal. Je vous proteste qu’un homme de ma connaissance qui m’aurait dit à Londres, j’ai dîné chez Mad. Maberly ; cet homme-là je l’aurais tout de suite classé un élégant, parmi les élégants de mauvais genre. il faut bien que je me serve de cette expression. Si un homme sérieux ; ah là je n’ose pas dire sans vous offenser. Enfin, ce qui est bien sûr c’est que personne ne m’a jamais dit y avoir dîné. Le duc de Wellington peut être mais aussi le Duc de W. figure dans les mémoires de... le nom m’échappe, une demoiselle de Londres. Tenez pour certain que vous avez fait là quelque chose de très inconvenant, demandez la réputation de la dame, et la réputation des convives. Votre position exige un peu plus de prudence. Il est très naturel que vous ignoriez la qualité sociale ou morale des gens qui vous invitent. Il faut demander et si vous n’avez à qui, écrivez-moi, nous en étions convenus. Je suis parfaitement sûre que j’entendrai parler de ce dîner avec beaucoup d’étonnement. Ce n’est pas de cette manière là qu’il vous convient d’étonner les gens. A ce compte je conçois que vous dîniez souvent dehors. Mais vous n’avez pas la prétention de Neuman qui avait compté 60 invitations dans un hiver, il peut accepter la quantité, mais vous devez regarder à la qualité. Je crois qu’en fait d’Ambassadeur Estrhazi peut avoir dîné chez Mad. Maberly. Mais il fait pire assurément. Il ne sera venu en tête à aucun de vos devanciers d’accepter cela. Quel plaisir de pouvoir se divertir d’un philosophe ! Et moi comme j’aurais aimé à m’entendre dire que tout tout était digne de vous ! Ceci fait un petit dérangement. Croyez vous que qui [que] ce soit au monde vous dise la vérite excepté moi. Eh bien si vous aimez encore la vérité écoutez moi. Ces allures ne vous vont pas. Elles vous donneront du ridicule, j’en suis parfaitement sûre. Et le dire de bien sottes gens ici, avant votre départ encore, se trouvera vèrifier. Je ne vous ai pas dit ce que j’ai entendu alors, je n’osais pas, vous auriez pris cela pour une injure. N. Pablen disait : " Il est capable d’aller dîner chez Madame Maberly." Cela faisait suite à Mad.Durazzo : "all these pretty women will make up to him, and he will be caught." Eh bien, je ne vous l’ai pas redit. J’ai eu tort; cela eut mieux valu. Aujourd’hui, j’aurais tort de ne pas vous dire tout, tout ce que je pense. Si vous vous fâchez. Je me tairai, mais je ne me repentirais pas. Cela me prouvera seulement que Londres, vous a déjà gaté. Ah que ne restez-vous ce que vous êtes. M. de Sully serait il allé dîner là ? Un ambassadeur doit tenir plus haut sa personne. Vous ne pouvez pas accepter indistinctement les invitations de tout le monde. Sans compter les espèces conme Mad. Maberly vous ne devez aller chez de petits gens que si une grande célébrité se rettache à leur nom. Votre dîner chez Grote a paru singulier aux Granville. Mais j’ai expliqué que vous aviez dîné chez eux à Paris ; je vous cite cela pour vous montrer ce qu’on peut penser à Londres. Il arrive parfois qu’on peut être obligé de dévier : par exemple, j’ai dîné chez certains Mitchell à Londres, mais c’était le plus gros individu commerçant de nos proviences de la Baltique. Son argent avait poussé sa femme respectable et ses filles à être admises à Almacks, à Devonshire house enfin partout. Et bien alors pour m’avoir,
337. Londres, Mardi 7 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je reviens à votre colère. Je suis très perplexe. J’ai envie d’être content et faché, de vous remercier et de me plaindre. C’est bien tendre, mais bien injuste. Comment ? parce que dans mon ignorance fort naturelle sur trente dîners, j’en aurai accepté un à tort. Londres m’a déjà gâté, je suis descendu dans votre opinion, Dieu sait si je ne reviendrai pas à Paris un mauvais sujet ! Non. Dieu ne le sait pas et bien certainement il ne le croit pas ; il n’est pas si pressé que vous de mal penser de moi. Tenez, je me fâcherais si vous n’aviez pas mis à côté de cela des paroles excellentes, charmantes. Mais, je vous en prie gardez-moi avec la même sollicitude, sans me croire si facile à la chute. Je vous dirai nullement pour l’intérêt de la comparaison, mais pour celui de la vérité que Sully était un fort mauvais sujet, fort grossièrement mauvais sujet et que si les Miss Harriet Wilson de son temps avaient fait des mémoires, il y aurait figuré.
J’ai été hier soir chez les Berry. Ceci est convenable, j’espère. Je ne les avais pas trouvées l’autre jour et elles m’avaient écrit une lettre désolée. Il y a toujours quelques personnes. Elles partent, le 1er mai pour la campagne Richmond où elles m’ont fait promettre d’aller dîner. Je veux y aller une fois tout seul, et voir votre maison. Bourqueney est parti ce matin, par la Tamise. Il va lentement et ne sera guère à Paris que vendredi. Il ira vous voir d’1à 2. Il est très intelligent et très sûr. On l’aime ici. Je ne sais pas encore comment je le remplacerai par interim. Peut-être par Casimir Périer. Peut-être simplement par Philippe de Chabot qui est ici, bien établi dans la société et qui me plait.
4 heures et demie
Et je sais dans quel état vous êtes quand ces paroles là, viennent sur vos lèvres; je vous y ai vue. Vous me devez, oui vous me devez deux choses plus de confiance et moins de tristesse. Vous me devez qu’à côté de vos alarmes se place toujours une certaine sécurité, à côté de vos peines un certain baume doux et fortifiant. Je ne prétends pas vous faire rien oublier ; je ne prétends pas bannir toute crainte de votre âme si ébranlée. Mais je vous aime trop vous le savez trop bien, et vous devez me trop bien connaitre pour que le doute et le désespoir entrassent jamais dans votre cœur. C’est là ce qui me désole, c’est là ce qui m’offense. Que vous ayiez de bien mauvais de bien amers momens hélas, je ne puis l’empêcher et de loin bien moins encore. Mais que ma pensée, était toujours là ; appelez la comme vous m’appelleriez. Dearest je ne vous dis rien, rien en ce moment de ce que je voudrais vous dire. Mais si vous saviez comme mon cœur est plein de vous et quelle place vous tenez dans ma vie ! Voici mes engagements du moment; ils sont peu nombreux, à cause des vacances de Pâques qui suspendent tout. Je ne vois que des gens qui vont partir pour la campagne. Aujourd’hui, la Duchesse de Sutherland. Demain, Lord Clarendon. Jeudi, M. Hallam. Samedi, à déjeuner M. Senior, membre des Communes avec l’archevêque de Dublin. Dîner, chez l’évêque de Londres, Dimanche, dîner chez Ellice. Il n’y a dans tout cela, ce me semble rien que de très orthodoxe. Ellice ne part que le 15.
J’ai le mercredi 15 chez moi un dîner savant les lords Landsdowne, Aberdeen, Northampton, Mahon,MM. Macalllay, Hallam, Milman, Reeves, Sir Robert Inglis, Sir Francis Palgrave, Sir Henry Ellis, le poète Rogers, MM. Senior, Milnes. Je rends les politesses littéraires.
Soyez tranquille sur mes réceptions du matin. Très peu. J’ai reçu M. Sidney Smith, d’abord parce que je lui croyais un peu d’importance dans le monde, ensuite à cause de Lady Holland qui m’en avait beaucoup parlé. Mais mon instinct m’avait dit de lui ce que vous me dites. Rien ne me plaît moins que les prêtres bouffons. Je vais à la Chambre des Communes, pour la première fois. C’est la Chine. Adieu jusqu’à demain. Oui jusqu’à demain sans interruption.
Mercredi 9 heures
J’irai encore aujourd’hui. J’espère entendre Lord Palmerston et Sir Robert Peel. J’ai écouté bien plus attentivement que personne. On écoute bien peu. Et Lord John Russell, qui dînait à Stafford house, prétend que depuis longtemps, il n’avait pas vu la Chambre si attentive.
2 heures
337. Paris, Dimanche 5 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Après avoir fermé ma lettre hier, je me suis jetée à genoux demandant à Dieu pitié, miséricorde. J’avais le cœur brisé de mes malheurs passés, le cœur oppressé des malheurs à venir, tout derrière moi, devant moi était peine, misère. Vous ne savez pas comme le chagrin s’empare de moi, comme il m’envahit. Comme j’ai peur de moi alors, le joir où je n’en aurai plus que ce sera fini. Je vous ai écrit hier beaucoup, vous ne vous serez pas fâché n’est-ce pas ? Vous me pardonnez la vivacité de mes expressions vous savez comme je suis. Vous me disiez un jour : "Si l’on pouvait toujours lire au fond du cœur, si la parole était toujours toujours la vérité." Ma parole à moi, quand c’est à vous que je parle est bien ce qu’il y a dans mon cœur! Laissez moi ce privilège. Je n’ai fait que penser au sujet de votre dernière lettre. Je vous ai peut être dit directement ce que j’en ressentais, la forme eut été autre aujourd’hui que dans le premier moment, mais le fond n’eut pas varié ; je penserai toujours sur ce sujet comme hier. Si j’étais auprés de vous je suis sûre que je vous ferais convenir que j’ai raison mais je suis loin, si loin ! Vous me dites ce que vous avez fait, pourquoi ne pas me dire ce que vous ferez, ce qu’on vous propose ? Là où il y a doute, je le resoudrai. restez donc bien fier bien haut, comme il vous convient de l’être, à vous ; comme il convient de l’être dans le poste que vous occupez. Il y a quelques fois en vous une distraction d’esprit qui vous fait ne pas juger de suite les choses ce qu’elles sont ; je dirais d’un autre français que c’est de la légèreté, chez vous il n’y a pas moyen d’appliquer ce mot, il faut en trouver un autre.
Envoyez- moi, je vous prie votre programme d’engagements pris ou à prendre. Vous aurez trois invitations par jour si vous donnez dans du Maberly ! Il est impossible qu’un étranger sache classer la société de Londres, et depuis que M. de Bourqueney vous a passé les Maberly son expérience m’est très suspecte. Excepté les toutes nouvelles gens / les radicaux/ Il n’y a personne dont je ne connaisse la position sociale à Londres. Vous pouvez être pris à des noms, à des relations, cela ne veut rien dire.
Ainsi, Sir John Shelley, ami de George 4 oui surement et je l’ai vu là, toujours, ainsi que sa femme. Mais jamais je n’ai imaginé de prier chez moi ni le mari, ni la femme. A propos de celle ci, elle racontait qu’à Vienne où elle a été pendant le congrès, M. de Metternich, très amoureux d’elle avait été un jour très pressant et qu’elle lui avait dit : "une femme qui a refusé au duc de Wellington n’accordera pas au Prince de Metternich." Wellington à qui cela fut redit s’écria : "D... m’emporte si je lui ai jamais rien demandé."
Je cois que personne ne connait mieux que moi la société à Londres, les petits embarras d’invitation dans une ville où tous les invités ont de quoi inviter à leur tour. C’est là justement ce qui fait qu’il faut regarder de si prés à ce qu’on acceppte. Ainsi les Shelley, tenant par quelques petits bouts à un peu de l’élégance des Jokeys, vous demanderont de dîner chez eux, et n’auront rien de plus pressé que d’inviter les Maberly parce que vous avez eu l’air de rire et de vous plaire dans cette société. En même temps vous verrez chez eux quelque chose de mieux que chez ceux-ci, ce mieux jugera tout de suite que vous appartenez à ce set et vous voilà classé dans leur opinion avec des gens auxquels vous n’auriez pas même du rendre de carte de visite. Je vous dis l’exacte vérité. Ensuite laissez-moi- vous dire encore, ne laissez pas envahir votre temps par des visiteurs tels que Sidney Smith le prêtre bouffon. C’est bon à rencontrer à dîner, et encore il ne m’a jamais plu je vous l’avoue et c’est plutôt un homme méprisé que le contraire, parce que le genre de son esprit va mal avec son état mais vraiment on n’imagine pas de le recevoir le matin. Un ambassadeur qui ne passe pas pour un désoeuvré ne reçoit chez lui que des gens qui lui parlent affaires. Vous n’avez rien à apprendre avec M. Smith. Croker c’est autre chose de temps en temps, il a, ou du moins, il a eu une grande expérience des affaires de son pays. Il est bon à entendre quelquefois. Je vous trouve trop poli pour commencer. Il est impossible que vous souteniez cela, il aurait mieux valu vous faire plus rare. Nous avons beaucoup causé Angleterre pendant un mois. Et tous les jours je m’aperçois davantage, que je ne vous ai rien dit. Je reviens à moi.
J’ai été au bois de Boulogne un moment. Il faisait détestable. J’ai été chez la petite Princesse, M. de Ste Aulaire y est venu. Galant, épris de la petite Princesse, lui parlant de la couleur de sa robe, lui débitant des vers sur la couleur de ses yeux. Imaginez que je suis partie d’un éclat de rire. C’était parfaitement grossier, mais je n’avais rien entendu de pareil depuis le marquis de Mascarille. Je suis partie le laissant un peu étonné de mon rire. J’ai diné chez Appony avec le duc de Noailles. Appony est bien monté aussi contre Lord Palmerston et sa russomanie. Il me semble que cela devient un morceau d’ensemble. Comment cela finira-t-il ? Le Duc de Noailles persiste à vouloir presser Thiers à la Chambre des Pairs à dire quelque chose de trancher sur l’Egypte. Berryer est reçu chez moi le soir. Il dit que l’esprit de la chambre est bien vif sur ce point, que Thiers ni personne ne pourrait faire autrement que suivre la pente égyptienne. Il y a des prétentions de places qui commencent à incommoder le ministère. Les rédacteurs sont exigeants. M. Verou veut la direction générale des beaux arts ; Walesky une Ambassade ; la gauche entrer dans le ministère. Il faudra bien que tout cela se fasse après la session.
Vous aurez cette lettre par la poste d’aujourd’hui. Il me semble que celle d’hier ne doit pas rester deux jours sans successeur. Je voudrais vous parler à tout instant. Croyez-vous que je vous aime ? Ah mon dieu ! Adieu. Adieu.
Berryer soutient que Thiers ferait bien de prendre Barrot dans le ministère parce que là il s’annulerait tout-à-fait.
341. Londres, Dimanche 12 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Lundi, 9 heures
Une heure
Vous avez bien raison de mépriser. Soyez sûre que vous ne méprisez pas assez. Vous avez raison aussi de douter du mariage de la main gauche. Il se traitera longtemps sans se celèbrer, ni se consommer jamais. Mais il faut du temps et des incidents pour se dégager. Des embarras, des coup de bascule, de l’impuissance à droite et à gauche, c’est l’avenir et un avenir peut être assez long. Quoi au bout ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne crois pas du tout que la rivière coule du côté de M. Molé.
366. Londres, Mercredi 13 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne puis pas ne pas croire qu’en y pensant un peu plus, en ne vous livrant pas tout entière à votre première impression, vous vous épargneriez, dans les plus mauvais moments, beaucoup de tristesse pour vous beaucoup d’injustice envers moi.
Je vous répète ce que je vous ai dit, dans l’opinion bien arrêtée de Brodie ; Alexandre ne peut songer à partir avant quinze jours au plutôt. Et vous savez que les médecins prennent toujours plus de temps qu’ils n’en ont demandé d’abord. Je suppose donc que vous vous mettrez en route. Samedi peut-être. J’espère qui vous le pourrez sans trop de fatigue.
Le temps est beau. Arrivez ; vous vous trouverez très pardonnée. Je vous pardonnerais quand même. Un pardon sincère, quoique triste. Encore une chose qui me vient à l’esprit. Cumming, Brünnow. Lady Palmerston, Lady Jersey Benkhausen, tout ce monde là écrit beaucoup plus légèrement que moi, se souciant beaucoup moins de l’impression que feront sur vous leurs paroles. Moi, je pense à ce que je vous dis ; d’abord pour vous dire la vérité ; ensuite pour ne pas vous donner une impression qui aille au-delà de la vérité.
Je relis votre lettre. J’aurais mieux fait de ne pas la relire. Personne, personne qui me montre un intérêt vraiment tendre, vraiment. Ma Providence a été bien vite détrônée.
3 heures
J’ai été hier soir au bal chez le duc d’Argyll. Un bal trop grand pour une si petite maison. Une magnificence d’emprunt, qui n’était pas celle de la veille et ne sera pas celle du lendemain.
Le Duc un tout petit homme maigre, et de plus petite mine. La Duchesse, une petite grosse femme ronde, rouge, empressée. Rien de bien qu’un boy de quinze ou seize ans, le marquis de Sorn, joli quoique roux, l’air sérieux et content, poli avec un peu trop de confiance. Il m’a dit avec une fierté enfantine qu’il m’avait rencontré à la Chambre des communes, ce qui était vrai. A sa vue, à ses paroles, le souvenir de mon orgueil et de mes joies paternelles m’a traversé le cœur. Que de plaies cachées au milieu d’un bal !
Adieu. Je vous écrirai demain à tout hasard ; et vendredi matin, je saurai décidément ce que vous faites. Adieu. Adieu.
367. Londres, Jeudi 14 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
368. Londres, Jeudi 14 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
369. Londres, Vendredi 15 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
3 heures et demie
J’ai été chargé de l’arranger ici. Je l’ai fait. Je ne suis pas chargé des conséquences. Du reste, nous sommes, je crois, destinés à vivre sous un horizon couvert de gros nuages qui ne portent pas de tonnerre.
Je n’ai pas éte surpris de ne pas voir mon nom dans le discours de M. de Rémusat, et je le trouve assez convenable. Il ne devait y avoir dans ce discours comme il n’y a en effet, que quatre noms : le Roi, Napoléon, la France et l’Angleterre. Ce que j’admire, sans en être surpris c’est l’art avec lequel les journaux, ministeriels ou de la gauche, ont évité de parler de moi à ce propos. Cela m’arrivera souvent. Même quand on m’aura écrit : " Réussissez dans cette affaire et nous vous en laisserons tout l’honneur."
Moi aussi, je suis préoccupé de l’été qui commence et de ce qu’il peut apporter dans ma destinée. Mais ma situation est claire pour moi et ma résolution arrêtée. Je suis donc préoccupé sans agitation. Un homme d’assez d’esprit m’écrit : " On connait ici tout l’avantage de votre position, on l’admire et on l’envie. Vos amis sont peut-être ceux qui s’en arrangent le moins. Ils trouveraient assez bon que quelque cause de mécontentement vous ramenât à Paris afin que vous passiez leur dire ce qu’ils ont à faire. Il n’y a de direction nulle part. Le ministère manque complètement d’assiette. La gauche n’en sait pas encore assez long pour se conduire sagement ; et la droite paye en détail pour ses lachetés précédentes. Restez bien longtemps le plus loin possible de ces misères et gardez le moins de pitié possible pour les détresses de l’amitié.
Qu’en dites-vous ? Pourtant je me méfie de ce conseil, car c’est mon penchant. Je ne veux pas devancer d’une minute la nécessité ; mais je ne veux pas lui manquer.
5 heures
Votre fils n’est pas sorti à cause de la pluie, et aussi par prudence. Il ne sortira probablement pas avant Lundi. Mais il va de mieux en mieux. Je ne doute pas qu’il ne préfère aller à Paris, et ne vous engage à l’y attendre. Adieu. Je vous ai écrit hier à Boulogne et à Douvres, poste restante. Adieu. Adieu
Réposez-vous.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Pratique politique, Presse, Relation François-Dorothée (Dispute), Santé (enfants Benckendorff)
370. Paris, Lundi 11 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je suis bien inquiète malgré ce que vous me dites, malgré les autres lettres que l’on m’écrit. Bulwer m’a envoyé une lettre de Cumming dans laquelle il dit que vendredi à 2 heures mon fils n’était pas hors de danger. C’est horrible à Bulwer de m’envoyer cela mais enfinr cela c’est la vérité, car c’était écrit dans la chambre d’Alexandre. J’en suis renversée. Votre lettre ce matin me parlera de lui, mais je la recevrai sans vraie sécurité. Tous mes amis veulent ma tranquillité. Ce sot est le seul qui dise vrai. Je veux partir, on me retient, on dit que je n’en ai par la force c’est vrai peut-être, et cependant cette inquiètude n’est pas souotenable. Il ne m’a pas encore écrit une ligne. Bruwer, lady Palmerston, lady Jersez m’ont écrit hier. Cela ne me fait plus rien. Vous ne savez pas comme je souffre, comme je suis sans force, sans courage, sans espoir. Je n’en puis plus. Midi Voici votre lettre. Vous me parlez si peu de mon fils et à peu près comme quelqu’un qui n’en sait rien de direct car tandis que lady Palmerston me mandait vendredi qu’on venait de le saigner encore, Vous me dites : " Je suppose qu’il ne tardira pas à partir. " Mais il ne faut pas supposer, il faut savoir. Pardon de ce reproche, mais même vous, vous ne savez pas ce que suis, ce qu’une mère éprouve d’angoisse, et vous savez cependant que personne n’a pour moi de véritable compassion, et de véritable soucis, je les attendais de vous. Vous aurez bien vu par mes lettres que je voulais parter de suite, mais raison nablement il fallait que j’attendisse quelque chose de précis sur son état, car votre première lettre me disait " dans deux ou trois jours il n’y paraîtra plus. " Ce n’est donc rien. D’autres lettres m’alarment plus on moins. Lui ne m’écrit pas une ligne, personne ne me dit l’opinion des médecins sur la durée de sa convalescence, enfin au milieu de beaucoup d’amis, je reste cependant ignorante de tout ce que je vous voudrais savoir. Pardonnez moi encore ce réproche, mais vous aurez dû me dire davantage et ne pas vous en rapporter seulement au dire de votre domestiques. Je suis bien triste et bien découragée de l’abandon dans lequel je reste ! Personne, personne qui me montre un intérêt vraiment tendre, vraiment intelligent.
Savez- vous que la vie m’est bien à charge, je ne sais plus qu’en faire. J’étais meilleurs à voler que lord William Russell, et on m’aurait fait moins de peine qu’à lui de me tuer. Si cela ne vous donne pas trop d’embarras ayez la bonté de parler ou d’écrire à sir Benjamin Brodie et de lui demander exactement combien peut durer encore la convalescence de mon fils. Et ayez la bonté aussi de m’envoyer sa réponse. J’attendrai donc jusqu’à vendredi, car ce jour là j’aurai votre réponse.
Vos filles sont venues me voir hier. Elles se portent à merveille. Toutts les deux sont engraissées. Pauline est bien jolie. Guilllaume n’avait pas voulu quitter son sabre et son tambour. vos filles m’ont trouvée couchée et bien triste.
Il n’y avait qu’un mot de plus à la lettre à lady Palmerston pour lui dire que Nicolas Pahlen irait à Londres aussi, la lettre n’’était pas finie. J’ai déchirée ce bout de lettres parce que j’étais pressée d’avoir une allumette et je n’avais rien sous la main. Ma chute d’hier n’a pas eu de suite, mais ma santé est fort altérée de l’inquiétude que j’éprouve pour Alexandre. Je n’ai pas un mot de nouvelle à vous dire, et je suis bien fatiguée, bien malheureuse. Adieu. Adieu.
Je viens de recevoir une lettre de Burkhausen. On ne lui permet encore ni de lire ni décrire, il est très faible dans son lit, la convalescence durera bien des semaines. Je fais mes préparatifs. Si j’ai la force. Vous voyez que c’est moi qui vous donne des nouvelles de mon fils. Pardonnez-moi, encore, pardonnez moi. Je ne veux pas être inquiète mais je suis très triste.
371. Londres, Dimanche 17 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
" Since the Lord gave me the desire of my heart in my dearest Mary, the rest of the sex are no more to me than the tulips in the garden. "
Si cela ne vous plait pas, je ne vous parlerai plus jamais des tulipes que j’ai trouvées belles.
Il faut pourtant que je finisse. C’est grand dommage car je n’ai pas fini. Adieu pourtant. Adieu toujours. Je crois en effet que vous ne me connaissez pas. Adieu encore.
373. Londres, Mardi 19 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
374. Londres, Mercredi 20 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ayez l’esprit d’être ici avant le 15 juin. J’y compte ; mais j’en parle. Je ne sais pas encore sûrement quel jour part votre fils. On m’a fait dire samedi, mais par approximation. Il n’y a du reste plus de nouvelles à vous en donner.
Je suis sorti cette nuit à 2 heures de la Chambre des Communes. Débat très médiocre et très ennuyeux. Nul homme important n’a parlé. Sauf lord Howick qui a bien parlé, mais sans faveur et dans une position délicate. J’y ai gagné un torticolli. On est mal assis et j’avais un vent coulis sur l’épaule gauche. Pourtant j’y retournerai ce soir. Je veux voir la fin. On me dit qu’O’Connell parlera ce soir. Evidemment, il n’a pas voulu répondre sur le champ à Lord Stanley. Sur son hardi et puissant visage, il y avait un peu de timidité et d’embarras.
Je ne doute pas que M. Molé ne remue ciel et terre pour nous brouiller Thiers et moi. Il n’est pas le seul. Et il est vrai que Thiers, a laissé entrevoir un défaut à la cuirasse par le puéril silence de sa presse à mon sujet à propos de Napoléon. Je m’étonne que les journaux qui ont envie de nous brouiller ne s’en soient pas déjà avisés. Cela viendra très probablement. Quant à moi, je me suis contenté d’écrire à deux ou trois personnes comme vous : " Cela ne m’étonne pas ; mais je le remarque. " Je ne me brouillerai point. Un moment viendra, peut-être où je me séparerai. Je suivrai exactement la ligne de conduite que vous savez.
Je regrette que vous n’ayiez pas vu ma petite note pour redemander Napoléon. Je crois que vous la trouveriez convenable par la simplicité et la mesure. Je suis pour les Invalides ; une sépulture militaire, religieuse et exceptionnelle. Les places publiques sont impossibles et inconvenantes. Le Panthéon est un lieu commun profane et profané. La Madeleine serait un tombeau grec. St Denis est pour les Rois de profession. Les Invalides seuls vont bien à l’homme, et à lui seul. Adieu.
Cela me déplait de vous quitter. Je voudrais vous écrire toujours. Mais j’ai des affaires. Venez et laissez moi le soin de votre place. Vous serez ma première affaire et mon seul plaisir. Adieu, Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Voyage