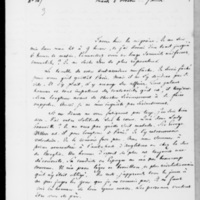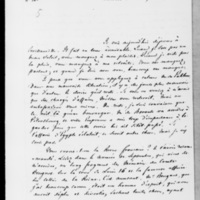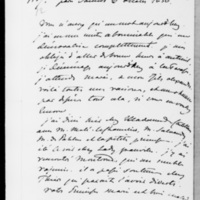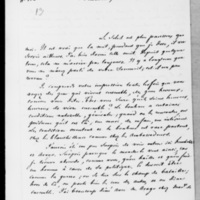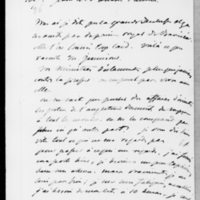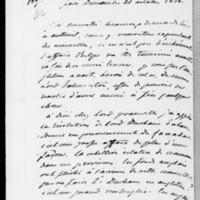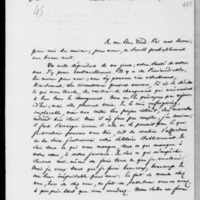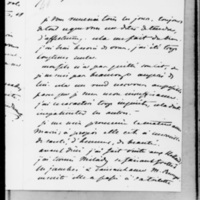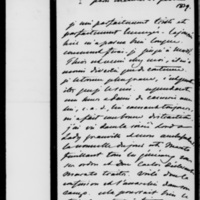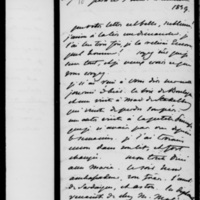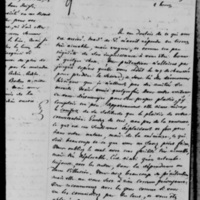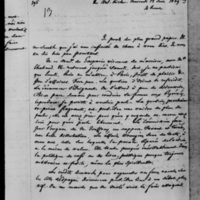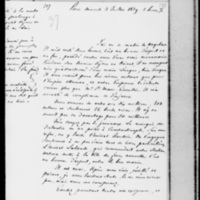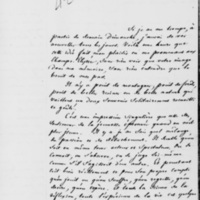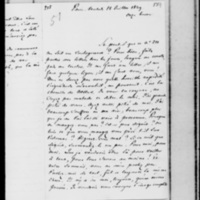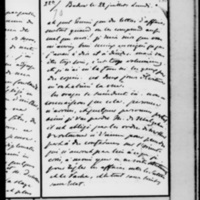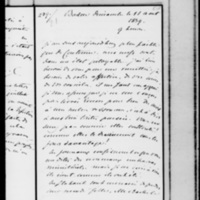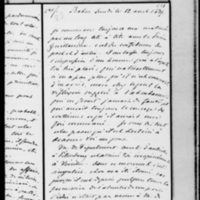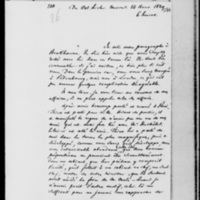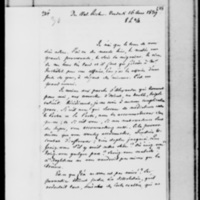Votre recherche dans le corpus : 755 résultats dans 3296 notices du site.
Trier par :
147. Val-Richer, Mardi 2 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°147 Mardi 2 octobre 7 heures
J’avais hier la migraine. Je me suis mis dans mon lit à 9 heures, et j’ai dormi d’un trait jusqu’à 6 heures ce matin. Connaissez-vous les longs sommeils uniformes immobiles ? Je ne sache rien de plus réparateur. Le trouble de votre Ambassadeur me fâche. Je serais fâché pour vous qu’il quittât Paris. Mais il ne s’y décidera pas si vite. Il s’y plait, il y arrangé ses affaires. Tout galant homme et tout impatient des contrariétés qu’il est, il tergiversera longtemps avant de chercher sérieusement à se faire rappeler. Aussi, je ne m’en inquiète pas sérieusement. Si ces dîners ne vous fatiguent pas trop j’en suis bien aise. J’ai votre solitude sur le cœur. Qu’à donc Lady Granville ! Je ne veux pas qu’elle soit malade. Sir George Villers est-il pour longtemps à Paris ? Je l’y retrouverais volontiers. Je le connais fort peu. Nous nous sommes à peine rencontrés à l’ambassade d’Angleterre ou chez le Duc de Broglie. Un homme d’esprit de plus est toujours une découverte. Sa conduite en Espagne ne m’a pas beaucoup convenu. Il m’a paru léger et brouillon et plus révolutionnaire qu’il n’y était obligé. Du reste, j’apprends tous les jours à ne pas juger les gens que je ne connais pas. Il ne faut voir les hommes de loin qu’en masse. Les personnes veulent être vues de près.
Avez-vous jamais entendu dire que Lord Holland, l’ancien, le père du grand M. Fox mettait son fils petit garçon sur une table et lui disait : " Allons, tu vas être pendu. Le peuple est là, furieux autour de toi. Parle-lui ; défends-toi, c’est à toi de sauver ta vie. " Et il écoutait les discours de l’enfant au peuple.
J’apprends aussi à mes enfants à faire des discours, mais moins tragiques. Le jeu du soir depuis trois jours est de donner un mot. Celui à qui on le donne est obligé de le placer dans un speech, un récit, et il faut que les autres, le devinent. Ce qu’il y a de plaisant, c’est que les improvisations des plus petits de Guillaume entre autres, sont les meilleures. Henriette veut faire trop bien. Cette pauvre Mad. de Broglie avait un grand talent pour amuser les enfants, le soir à des bêtises. Elle y apportait toute sorte de bonté d’invention et de grâce.
9 heures
Vous me demandez, si vous ajoutez à ma tristesse. J’ai un grand défaut. Je ne sais pas me figurer ceux que j’aime autrement que je ne les vois au moment où je les vois. Leur disposition, leur impression actuelle a pour moi tant d’importance, me préoccupe si vivement que j’oublie absolument qu’elle peut changer, quelle changera. Elle m’apparaît permanente, unique, et j’en ressens l’effet en conséquence. Vous m’avez écrit N° 146 une lettre si triste que j’en ai eu le cœur navré, abattu. Je vous ai vue toujours dans cet état et toutes choses vaines, et moi-même impuissant pour vous en tirer de là mon redoublement de tristesse. Et quand vous êtes mieux, quand vos lettres sont plus sereines, plus animées, la même chose m’arrive ; j’en jouis avec un abandon d’enfant ; je ne vous vois plus qu’avec cette physionomie si vivante, si simplement, allègrement, si profondément vivante, qui m’a si souvent charmé’en vous. Et j’oublie que le mal peut revenir, qu’il reviendra. Et quand il me revient, il m’étonne, il me consterne comme si j’en faisais la découverte. Ainsi nous avons l’un et l’autre notre façon de préoccupation imprévoyante exclusive. Tâchons de nous y accoutumer, l’un et l’autre. dans une telle intimité d’ailleurs, il faut tout accepter, se faire et même se plaire à tout, les bons et les mauvais moments, les qualités et les défauts, in health and in sickness, for better and for worse, n’est-ce pas ?
10 h. 1/2
Je suis bien aise de savoir quel jour vous retournez à la Terrasse. Adieu., Adieu. Vous avez raison de mettre bien les un avec les autres. Vous avez le génie des bons commérages. Adieu.
J’avais hier la migraine. Je me suis mis dans mon lit à 9 heures, et j’ai dormi d’un trait jusqu’à 6 heures ce matin. Connaissez-vous les longs sommeils uniformes immobiles ? Je ne sache rien de plus réparateur. Le trouble de votre Ambassadeur me fâche. Je serais fâché pour vous qu’il quittât Paris. Mais il ne s’y décidera pas si vite. Il s’y plait, il y arrangé ses affaires. Tout galant homme et tout impatient des contrariétés qu’il est, il tergiversera longtemps avant de chercher sérieusement à se faire rappeler. Aussi, je ne m’en inquiète pas sérieusement. Si ces dîners ne vous fatiguent pas trop j’en suis bien aise. J’ai votre solitude sur le cœur. Qu’à donc Lady Granville ! Je ne veux pas qu’elle soit malade. Sir George Villers est-il pour longtemps à Paris ? Je l’y retrouverais volontiers. Je le connais fort peu. Nous nous sommes à peine rencontrés à l’ambassade d’Angleterre ou chez le Duc de Broglie. Un homme d’esprit de plus est toujours une découverte. Sa conduite en Espagne ne m’a pas beaucoup convenu. Il m’a paru léger et brouillon et plus révolutionnaire qu’il n’y était obligé. Du reste, j’apprends tous les jours à ne pas juger les gens que je ne connais pas. Il ne faut voir les hommes de loin qu’en masse. Les personnes veulent être vues de près.
Avez-vous jamais entendu dire que Lord Holland, l’ancien, le père du grand M. Fox mettait son fils petit garçon sur une table et lui disait : " Allons, tu vas être pendu. Le peuple est là, furieux autour de toi. Parle-lui ; défends-toi, c’est à toi de sauver ta vie. " Et il écoutait les discours de l’enfant au peuple.
J’apprends aussi à mes enfants à faire des discours, mais moins tragiques. Le jeu du soir depuis trois jours est de donner un mot. Celui à qui on le donne est obligé de le placer dans un speech, un récit, et il faut que les autres, le devinent. Ce qu’il y a de plaisant, c’est que les improvisations des plus petits de Guillaume entre autres, sont les meilleures. Henriette veut faire trop bien. Cette pauvre Mad. de Broglie avait un grand talent pour amuser les enfants, le soir à des bêtises. Elle y apportait toute sorte de bonté d’invention et de grâce.
9 heures
Vous me demandez, si vous ajoutez à ma tristesse. J’ai un grand défaut. Je ne sais pas me figurer ceux que j’aime autrement que je ne les vois au moment où je les vois. Leur disposition, leur impression actuelle a pour moi tant d’importance, me préoccupe si vivement que j’oublie absolument qu’elle peut changer, quelle changera. Elle m’apparaît permanente, unique, et j’en ressens l’effet en conséquence. Vous m’avez écrit N° 146 une lettre si triste que j’en ai eu le cœur navré, abattu. Je vous ai vue toujours dans cet état et toutes choses vaines, et moi-même impuissant pour vous en tirer de là mon redoublement de tristesse. Et quand vous êtes mieux, quand vos lettres sont plus sereines, plus animées, la même chose m’arrive ; j’en jouis avec un abandon d’enfant ; je ne vous vois plus qu’avec cette physionomie si vivante, si simplement, allègrement, si profondément vivante, qui m’a si souvent charmé’en vous. Et j’oublie que le mal peut revenir, qu’il reviendra. Et quand il me revient, il m’étonne, il me consterne comme si j’en faisais la découverte. Ainsi nous avons l’un et l’autre notre façon de préoccupation imprévoyante exclusive. Tâchons de nous y accoutumer, l’un et l’autre. dans une telle intimité d’ailleurs, il faut tout accepter, se faire et même se plaire à tout, les bons et les mauvais moments, les qualités et les défauts, in health and in sickness, for better and for worse, n’est-ce pas ?
10 h. 1/2
Je suis bien aise de savoir quel jour vous retournez à la Terrasse. Adieu., Adieu. Vous avez raison de mettre bien les un avec les autres. Vous avez le génie des bons commérages. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Discours du for intérieur, Vie familiale (François)
148. Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°148 Mercredi 3 octobre 7 heures
Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.
A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.
J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.
9 heures
Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.
Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.
A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.
J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.
9 heures
Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.
152. Paris, Mercredi 3 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
152. Paris, le 3 octobre 1838
J'écris aujourd’hui à mon frère par un courrier de Pahlen. Votre gouvernement en a envoyé un à M. de Barante avant- hier, je crois entre autre pour lui prescrire de sortir de l'hôtel aussi tôt que possible. Cela sera le signal de la sortie de Pahlen, de la maison qu'il occupe, il s’en va contant à tout le monde ces douleurs, & dans un désespoir comique.
J’ai fait visite à Auteuil hier matin ; on dit qu'on ne sait pas encore le départ de Louis Bonaparte de Suisse et que cela tracasse un peu ici. Le soir, j’ai été voir les Granville malades. Il est couché, immobile. Elle va un peu mieux tous les jours.
Il arrive de normaux anglais qui passent. Je les vois, je ne vous les nomme pas, vous ne les connaissez pas du tout. Alava est venu me voir aussi, il a bonne mine. Il va à Londres dans quinze jours. Les Holland sont à Versailles, ils y ont mené aussi le poète Rogers. Vous le connaissez sans doute ?
Le soleil est superbe, je ne me lasse pas de profiter de ces derniers beaux jours. Je me promène encore le soir en voiture ouverte. Je m’enrhume, je me dé-rhume tout cela est égal, il me faut de l'air. Le petit Sneyd va partir pour l’Italie j'en suis très fâchée, car je l’ai fort à mes ordres. Ainsi quand il n'y a rien de mieux, je le prends dans ma calèche et il se laisse toujours prendre.
Marie m’a enfin écrit. Elle se dit parfaitement remise, & arrive samedi. Nous verrons. L’Empereur le prolonge un peu à Berlin. Il veut retourner chez lui par mer. Quelle idée dans cette saison et après que ses filles ont failli périr. Je suis bien aise d’apprendre que votre mère est bien. Adieu, je cherche si j’ai quelque chose à vous dire. Je ne trouve rien qu'une quantité d’adieux.
J'écris aujourd’hui à mon frère par un courrier de Pahlen. Votre gouvernement en a envoyé un à M. de Barante avant- hier, je crois entre autre pour lui prescrire de sortir de l'hôtel aussi tôt que possible. Cela sera le signal de la sortie de Pahlen, de la maison qu'il occupe, il s’en va contant à tout le monde ces douleurs, & dans un désespoir comique.
J’ai fait visite à Auteuil hier matin ; on dit qu'on ne sait pas encore le départ de Louis Bonaparte de Suisse et que cela tracasse un peu ici. Le soir, j’ai été voir les Granville malades. Il est couché, immobile. Elle va un peu mieux tous les jours.
Il arrive de normaux anglais qui passent. Je les vois, je ne vous les nomme pas, vous ne les connaissez pas du tout. Alava est venu me voir aussi, il a bonne mine. Il va à Londres dans quinze jours. Les Holland sont à Versailles, ils y ont mené aussi le poète Rogers. Vous le connaissez sans doute ?
Le soleil est superbe, je ne me lasse pas de profiter de ces derniers beaux jours. Je me promène encore le soir en voiture ouverte. Je m’enrhume, je me dé-rhume tout cela est égal, il me faut de l'air. Le petit Sneyd va partir pour l’Italie j'en suis très fâchée, car je l’ai fort à mes ordres. Ainsi quand il n'y a rien de mieux, je le prends dans ma calèche et il se laisse toujours prendre.
Marie m’a enfin écrit. Elle se dit parfaitement remise, & arrive samedi. Nous verrons. L’Empereur le prolonge un peu à Berlin. Il veut retourner chez lui par mer. Quelle idée dans cette saison et après que ses filles ont failli périr. Je suis bien aise d’apprendre que votre mère est bien. Adieu, je cherche si j’ai quelque chose à vous dire. Je ne trouve rien qu'une quantité d’adieux.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Réseau social et politique
150. Val-Richer, Vendredi 5 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°150 Vendredi 5 octe, 7 heures
J’ai mené hier ma mère et mes enfants faire une grande promenade. Nous avons été à St Ouen, ce fameux St Ouen le Paing, dont le nom vous fatiguait tant à écrire. Je ne comprends pas que je ne vous l’aie pas épargné plutôt. Mais notre correspondance essuyait tant d’échecs que je voulais prendre toutes les sûretés possibles. St Ouen est à un quart d’heure du Val- Richer. Mais ma mère marche si lentement que nous avons mis trois quarts d’heure. Mes enfants étaient parfaitement heureux. La joie des enfants est charmante à regarder ; d’autant qu’elle ne fait point d’envie à moi du moins. C’est un bonheur bien complet, bien exempt de regret, d’inquiétude. Mais je n’en voudrais pas, et je ne le regrette pas. Nous faisons comme vous. Nous jouissons avidement des derniers beaux jours. Hier était peut-être le dernier. Ce matin, le vent souffle, le ciel est noir, la pluie va venir. J’entends pourtant des paysans qui chantent à pleine gorge dans la vallée en récoltant leurs pommes. Encore des joies dont je ne voudrais pas.
Ce pauvre, M. de Barante sera presque aussi contrarié que M. de Pahlen. Il le racontera moins. Je comprends toutes les malveillances, toutes les hostilités, pas du tout les maussaderies. On peut se détester et se combattre mais on se salue et on se parle comme si de rien n’était. Viendra-t-il un temps où les gouvernements vivront entr’eux tout à fait en gentlemen, polis et pleins d’égards dans les choses extérieures, et indifférentes, quoiqu’il en soit du fond des choses ? J’en doute : il faudrait supprimer le caprice et l’humeur. La nature humaine ne voudra pas. Vous n’entendez surement pas parler de l’élection du Général Jacqueminot qui doit se faire demain. Ce ne sont pas les affaires de votre monde. Il me revient qu’on en est assez préoccupé. Non qu’on ne la regarde comme assurée, mais l’opposition sera forte, plus forte qu’elle n’ait jamais été. A cette occasion on m’écrit de plusieurs côtés qu’on est frappé du terrain que gagne la gauche, et qu’il se dit assez que, si le Ministère durait, il finirait par lui livrer les affaires.
Je viens de recevoir une lettre de Mad. de Rémusat qui m’a touché. Elle est désolée vraiment désolée de la mort de Mad. de Broglie, avec une vivacité, un abandon d’admiration et de chagrin qui sont rares dans le monde. Il est si froid et si sec ! Il est juste en général, mais de cette justice superficielle et indifférente qui est presque une offense pour des cœurs bien émus. C’est une des choses auxquelles j’ai eu le plus de peine à m’accoutumer. Je l’ai fait pourtant. Je ne puis souffrir de laisser aux indifférents le moindre pouvoir de m’atteindre. M. de Turpin, écrit de Venise à Mad. de Meulan que l’effet de l’armistice est vraiment très grand et que l’Empereur sera vraiment bien reçu. Du reste, Venise se relève, dit-il, non pas seulement pour un jour et par artifice, mais réellement et d’une façon durable. Le port se ranime ; les palais se réparent. Avez-vous jamais lu un peu attentivement l’histoire de Venise ? C’est un gouvernement qui a admirablement compris et exploite deux grands mobiles de ce monde, le secret et le plaisir. On n’a jamais si bien su se taire et s’amuser.
10h
Moi aussi, j’ai mes moments où je vous cherche plus encore que de coutume. Ils reviennent souvent. Vous me manquez immensément. Enfin, nous avançons. N’ayez mal aux nerfs que pour me chercher. Adieu. Adieu. G.
J’ai mené hier ma mère et mes enfants faire une grande promenade. Nous avons été à St Ouen, ce fameux St Ouen le Paing, dont le nom vous fatiguait tant à écrire. Je ne comprends pas que je ne vous l’aie pas épargné plutôt. Mais notre correspondance essuyait tant d’échecs que je voulais prendre toutes les sûretés possibles. St Ouen est à un quart d’heure du Val- Richer. Mais ma mère marche si lentement que nous avons mis trois quarts d’heure. Mes enfants étaient parfaitement heureux. La joie des enfants est charmante à regarder ; d’autant qu’elle ne fait point d’envie à moi du moins. C’est un bonheur bien complet, bien exempt de regret, d’inquiétude. Mais je n’en voudrais pas, et je ne le regrette pas. Nous faisons comme vous. Nous jouissons avidement des derniers beaux jours. Hier était peut-être le dernier. Ce matin, le vent souffle, le ciel est noir, la pluie va venir. J’entends pourtant des paysans qui chantent à pleine gorge dans la vallée en récoltant leurs pommes. Encore des joies dont je ne voudrais pas.
Ce pauvre, M. de Barante sera presque aussi contrarié que M. de Pahlen. Il le racontera moins. Je comprends toutes les malveillances, toutes les hostilités, pas du tout les maussaderies. On peut se détester et se combattre mais on se salue et on se parle comme si de rien n’était. Viendra-t-il un temps où les gouvernements vivront entr’eux tout à fait en gentlemen, polis et pleins d’égards dans les choses extérieures, et indifférentes, quoiqu’il en soit du fond des choses ? J’en doute : il faudrait supprimer le caprice et l’humeur. La nature humaine ne voudra pas. Vous n’entendez surement pas parler de l’élection du Général Jacqueminot qui doit se faire demain. Ce ne sont pas les affaires de votre monde. Il me revient qu’on en est assez préoccupé. Non qu’on ne la regarde comme assurée, mais l’opposition sera forte, plus forte qu’elle n’ait jamais été. A cette occasion on m’écrit de plusieurs côtés qu’on est frappé du terrain que gagne la gauche, et qu’il se dit assez que, si le Ministère durait, il finirait par lui livrer les affaires.
Je viens de recevoir une lettre de Mad. de Rémusat qui m’a touché. Elle est désolée vraiment désolée de la mort de Mad. de Broglie, avec une vivacité, un abandon d’admiration et de chagrin qui sont rares dans le monde. Il est si froid et si sec ! Il est juste en général, mais de cette justice superficielle et indifférente qui est presque une offense pour des cœurs bien émus. C’est une des choses auxquelles j’ai eu le plus de peine à m’accoutumer. Je l’ai fait pourtant. Je ne puis souffrir de laisser aux indifférents le moindre pouvoir de m’atteindre. M. de Turpin, écrit de Venise à Mad. de Meulan que l’effet de l’armistice est vraiment très grand et que l’Empereur sera vraiment bien reçu. Du reste, Venise se relève, dit-il, non pas seulement pour un jour et par artifice, mais réellement et d’une façon durable. Le port se ranime ; les palais se réparent. Avez-vous jamais lu un peu attentivement l’histoire de Venise ? C’est un gouvernement qui a admirablement compris et exploite deux grands mobiles de ce monde, le secret et le plaisir. On n’a jamais si bien su se taire et s’amuser.
10h
Moi aussi, j’ai mes moments où je vous cherche plus encore que de coutume. Ils reviennent souvent. Vous me manquez immensément. Enfin, nous avançons. N’ayez mal aux nerfs que pour me chercher. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Absence, Décès, Diplomatie, Enfants (Guizot), Politique (France), Vie familiale (François)
155. Paris, Samedi 6 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
155. Paris Samedi 6 octobre 1838
Vous n'aurez qu’un mot aujourd’hui. J'ai eu une nuit abominable qui me démoralise complètement. Je suis obligée d’aller de bonne heure à Auteuil, je déménage aujourd’hui à la Terrasse. J'attends Marie, & mon fils Alexandre. Voilà toutes mes raisons, et un rhume par dessus tout cela, si vous en voulez encore.
J’ai dînér hier chez Madame de Castellane avec M. Molé, le Chancelier, M. Salvandy, M. de Pahlen et la petite princesse. J'ai été le soir chez Lady Granville. J'y ai rencontré Montrond qui me semble rajeunir. Il a passé son temps chez Thiers qui parait l’avoir diverti. Votre Princesse Marie est bien malade Les médecins en sont inquiets. Il n'y aura point de Fontainebleau en conséquence.
Léopold arrive la semaine prochaine. Les affaires ne marchent pas. Palmerston ne veut rien faire, & on ne sait pas du tout ce qu’il en pense. Il est très vrai que vous m’apprenez M. Jacqueminot. La diplomatie ne s’en est pas émue. M. de Médem mande à M. de Pahlen, que mon frère est bien monté contre moi. Est-ce que par hasard l'homme d’esprit m’aurait plus mal servi que les sots ? Car à moins que Médem ait dit des choses de nature à irriter mon frère, je ne conçois pas ce qui peut être survenu.
Voyez la sotte lettre. Pardonnez moi. Je me sens fatiguée & malade. Que je vous remercie de me dire que le temps avance, c’est la plus agréable parole que je puisse entendre. Adieu. Adieu. Que je suis impatiente de l’autre espèce d’adieux !
Vous n'aurez qu’un mot aujourd’hui. J'ai eu une nuit abominable qui me démoralise complètement. Je suis obligée d’aller de bonne heure à Auteuil, je déménage aujourd’hui à la Terrasse. J'attends Marie, & mon fils Alexandre. Voilà toutes mes raisons, et un rhume par dessus tout cela, si vous en voulez encore.
J’ai dînér hier chez Madame de Castellane avec M. Molé, le Chancelier, M. Salvandy, M. de Pahlen et la petite princesse. J'ai été le soir chez Lady Granville. J'y ai rencontré Montrond qui me semble rajeunir. Il a passé son temps chez Thiers qui parait l’avoir diverti. Votre Princesse Marie est bien malade Les médecins en sont inquiets. Il n'y aura point de Fontainebleau en conséquence.
Léopold arrive la semaine prochaine. Les affaires ne marchent pas. Palmerston ne veut rien faire, & on ne sait pas du tout ce qu’il en pense. Il est très vrai que vous m’apprenez M. Jacqueminot. La diplomatie ne s’en est pas émue. M. de Médem mande à M. de Pahlen, que mon frère est bien monté contre moi. Est-ce que par hasard l'homme d’esprit m’aurait plus mal servi que les sots ? Car à moins que Médem ait dit des choses de nature à irriter mon frère, je ne conçois pas ce qui peut être survenu.
Voyez la sotte lettre. Pardonnez moi. Je me sens fatiguée & malade. Que je vous remercie de me dire que le temps avance, c’est la plus agréable parole que je puisse entendre. Adieu. Adieu. Que je suis impatiente de l’autre espèce d’adieux !
Mots-clés : Diplomatie, Vie domestique (Dorothée)
152. Val-Richer, Dimanche 7 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°152 Dimanche 7 oct. 6 heures
Le soleil est plus paresseux que moi. Il est vrai que la nuit, pendant que je dors, il va servir ailleurs. J’ai bien dormi cette nuit. Depuis quelque temps, cela ne m’arrive pas toujours. Il y a longtemps que vous ne m’avez parlé de votre sommeil ; est-il un peu revenu ?
Je comprends votre impression toutes les fois que vous voyez des gens qui vivent ensemble, des gens heureux. comme vous dîtes. Etes-vous sûre qu’ils soient heureux, heureux de vivre ensemble ? Le bonheur à certaines conditions naturelles, générales ; quand on les rencontre on présume qu’il est là ; un mari, des enfants, un intérieur. Les conditions mentent et le bonheur est rare partout, chez les blanchisseurs comme chez les Ambassadeurs. J’aurais été un peu surpris de voir entrer ici Humboldt et Arago. Surpris parce que le monde le veut ainsi, car je trouve absurde, comme vous, qu’on haïsse et qu’on fuie un homme à cause de sa politique. Ce devrait être comme la guerre ; on se tue sur le champ de bataille ; hors de là, on parle bien les uns des autres, et on dîne ensemble. J’ai beaucoup dîné avec M. Arago chez Mad de Rumford. Il a de l’esprit, un esprit actif et brutal, et le plus vaniteux des hommes. Il avait une femme aimable et sensée qui contenait ses défauts et adoucissait son humeur. Depuis qu’il l’a perdue, il a fait et dit beaucoup de sottises.
On me dit qu’on est fort occupé dans le Cabinet et au dessus, de ce que fera le Duc de Broglie. Son malheur l’éloignera-t-il des affaires ? On assure que oui qu’il ne se souciera plus de rien, que c’est une retraite morale. On le plaint beaucoup, mais on l’approuve. Vous est-il revenu quelque chose de ces prédictions-là ? Elles diffèrent beaucoup de la vôtre. Vous y êtes moins intéressée.
Prenez-vous quelque intérêt à la politique des Etats-Unis ? J’y pense beaucoup. Je lis Washington. J’ai promis de surveiller la publication de ses écrits en France. Je ferai son portrait comme Brougham, probablement un peu moins vite. A cette occasion on m’écrit et on me parle souvent de ce monde-là, qui deviendra grand quoiqu’il arrive. Vous avez bien raison, en Russie de vous soigner de ce côté. La bonne politique, s’y relève un peu. Du moins la mauvaise s’y décrie. On s’aperçoit que le suffrage universel n’est pas le remède universel. L’aristocratie revient sur l’eau. Elle aura bien de la peine à s’y tenir. Tout le monde a peine à s’y tenir aujourd’hui. C’est le mal du temps. Je serais assez aise de savoir ce que pensera de l’Amérique le ministre Autrichien, M. Marchal. C’est un homme d’esprit.
9 h. 1/2
Ma lettre aussi sera courte. Le Dimanche est mon jour de visites. On me dit qu’il y en a déjà deux qui m’attendent dans le salon. C’est de bonne heure. Adieu. Je suis bien aise de vous savoir à la Terrasse. Mais dormez-y. Adieu. Adieu en attendant. G.
Le soleil est plus paresseux que moi. Il est vrai que la nuit, pendant que je dors, il va servir ailleurs. J’ai bien dormi cette nuit. Depuis quelque temps, cela ne m’arrive pas toujours. Il y a longtemps que vous ne m’avez parlé de votre sommeil ; est-il un peu revenu ?
Je comprends votre impression toutes les fois que vous voyez des gens qui vivent ensemble, des gens heureux. comme vous dîtes. Etes-vous sûre qu’ils soient heureux, heureux de vivre ensemble ? Le bonheur à certaines conditions naturelles, générales ; quand on les rencontre on présume qu’il est là ; un mari, des enfants, un intérieur. Les conditions mentent et le bonheur est rare partout, chez les blanchisseurs comme chez les Ambassadeurs. J’aurais été un peu surpris de voir entrer ici Humboldt et Arago. Surpris parce que le monde le veut ainsi, car je trouve absurde, comme vous, qu’on haïsse et qu’on fuie un homme à cause de sa politique. Ce devrait être comme la guerre ; on se tue sur le champ de bataille ; hors de là, on parle bien les uns des autres, et on dîne ensemble. J’ai beaucoup dîné avec M. Arago chez Mad de Rumford. Il a de l’esprit, un esprit actif et brutal, et le plus vaniteux des hommes. Il avait une femme aimable et sensée qui contenait ses défauts et adoucissait son humeur. Depuis qu’il l’a perdue, il a fait et dit beaucoup de sottises.
On me dit qu’on est fort occupé dans le Cabinet et au dessus, de ce que fera le Duc de Broglie. Son malheur l’éloignera-t-il des affaires ? On assure que oui qu’il ne se souciera plus de rien, que c’est une retraite morale. On le plaint beaucoup, mais on l’approuve. Vous est-il revenu quelque chose de ces prédictions-là ? Elles diffèrent beaucoup de la vôtre. Vous y êtes moins intéressée.
Prenez-vous quelque intérêt à la politique des Etats-Unis ? J’y pense beaucoup. Je lis Washington. J’ai promis de surveiller la publication de ses écrits en France. Je ferai son portrait comme Brougham, probablement un peu moins vite. A cette occasion on m’écrit et on me parle souvent de ce monde-là, qui deviendra grand quoiqu’il arrive. Vous avez bien raison, en Russie de vous soigner de ce côté. La bonne politique, s’y relève un peu. Du moins la mauvaise s’y décrie. On s’aperçoit que le suffrage universel n’est pas le remède universel. L’aristocratie revient sur l’eau. Elle aura bien de la peine à s’y tenir. Tout le monde a peine à s’y tenir aujourd’hui. C’est le mal du temps. Je serais assez aise de savoir ce que pensera de l’Amérique le ministre Autrichien, M. Marchal. C’est un homme d’esprit.
9 h. 1/2
Ma lettre aussi sera courte. Le Dimanche est mon jour de visites. On me dit qu’il y en a déjà deux qui m’attendent dans le salon. C’est de bonne heure. Adieu. Je suis bien aise de vous savoir à la Terrasse. Mais dormez-y. Adieu. Adieu en attendant. G.
162. Paris, Samedi 13 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
162. Paris, le 13 octobre samedi
Vous ai-je dit que la grande Duchesse Olga ne veut pas du prince royal de Bavière. Elle l’a trouvée trop laid. Voilà ce que raconte M. Jennisson. Vos ministères déclament plus que jamais contre la presse. On ne peut pas croire avec elle. On ne sait que penser des affaires d’Orient. Les gestes de l'Angleterre donnent du soupçon à tout le monde. On ne les comprend pas plus ici qu’autre part. Je vous dis bien vite tout ce qui ne me regarde pas. Et pour passer à ce qui me regarde, j’ai fermé ma porte hier, je deviens un peu capricieuse dans mes allures. Mais vraiment je ne suis pas bien ; je me sens fatiguée, accablée. J'ai besoin de mon lit à 10 heures. Je ne sais comment m’arranger pour satisfaire cette fantaisie et en même temps celle de voir du monde. Au reste dans ce moment-ci encore le monde est peu amusant.
Savez-vous que le temps devient bien froid ; cela n’est pas naturel pour cette saison. Je compte sur l'été au mois de janvier. Marie est d'une douceur, d'une égalité d’humeur, & d'une bonne humeur charmante. Le speech de Lady Granville devient tout-à fait inutile. Nous l’avons ajourné à la première boutade au plus léger signe. Vous serez sans doute la pierre de touche. Elle est charmante pour mon fils. Je prétends qu’elle le soit pour vous, & tout le monde ; sans cela, bonjour.
Que je suis impatiente de voir finir ce mois ! Mais je m'en vais être horriblement envieuse. Vous allez revenir engraissé avec des joues, et moi, j'ai une très pauvre mine. Votre premier absence m'avait si bien servi. La seconde ne m'a rien valu du tout, au contraire. Palmella n'a jamais vu de sa vie Madame de Pontalba. Personne de ma connaissance ne la connait. Adieu. Adieu. Je compte les jours Adieu.
Vous ai-je dit que la grande Duchesse Olga ne veut pas du prince royal de Bavière. Elle l’a trouvée trop laid. Voilà ce que raconte M. Jennisson. Vos ministères déclament plus que jamais contre la presse. On ne peut pas croire avec elle. On ne sait que penser des affaires d’Orient. Les gestes de l'Angleterre donnent du soupçon à tout le monde. On ne les comprend pas plus ici qu’autre part. Je vous dis bien vite tout ce qui ne me regarde pas. Et pour passer à ce qui me regarde, j’ai fermé ma porte hier, je deviens un peu capricieuse dans mes allures. Mais vraiment je ne suis pas bien ; je me sens fatiguée, accablée. J'ai besoin de mon lit à 10 heures. Je ne sais comment m’arranger pour satisfaire cette fantaisie et en même temps celle de voir du monde. Au reste dans ce moment-ci encore le monde est peu amusant.
Savez-vous que le temps devient bien froid ; cela n’est pas naturel pour cette saison. Je compte sur l'été au mois de janvier. Marie est d'une douceur, d'une égalité d’humeur, & d'une bonne humeur charmante. Le speech de Lady Granville devient tout-à fait inutile. Nous l’avons ajourné à la première boutade au plus léger signe. Vous serez sans doute la pierre de touche. Elle est charmante pour mon fils. Je prétends qu’elle le soit pour vous, & tout le monde ; sans cela, bonjour.
Que je suis impatiente de voir finir ce mois ! Mais je m'en vais être horriblement envieuse. Vous allez revenir engraissé avec des joues, et moi, j'ai une très pauvre mine. Votre premier absence m'avait si bien servi. La seconde ne m'a rien valu du tout, au contraire. Palmella n'a jamais vu de sa vie Madame de Pontalba. Personne de ma connaissance ne la connait. Adieu. Adieu. Je compte les jours Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Internationale)
167. Paris, Jeudi 18 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
167. Paris, le 18 octobre 1838
C’est un bien petit mot que celui que vous m’avez écrit hier ; j'espère mieux pour demain, mais je vous remercie de tout ce que vous me dites. Matonchewitz part aujourd’hui. Je n'ai jamais tant causé avec lui de ma vie que dans ces huit jours, et suis bien contente de lui. J’aurai beau coup de choses à vous dire qui ne s’écrivent pas. Les Sutherland sont venus passer la soirée chez moi hier. Je n'ai reçu à leur donner pour les divertir ; il n’y a vraiment personne à Paris. Quel hasard que Humbold. Mon ambassadeur se calme, il croit avoir trouvé l'hotel Beauny sur la place Vendôme mais il faut deux millions et il vient de les demander à l'Empereur.
Le discours d'ouverture des états à La Haye annonce comme je crois vous l’avoir dit que la Roi a fait une démocratie conciliante au mois de mars, et que jusqu’ici il n'y a pas obtenu réponse. Il espère cependant arriver à un arrangement définitif et honorable pour la Hollande au sujet des provinces insurgées. On dit maintenant que tout sera terminée cette semaine à Londres & dans une séance de la conférence. Léopold était hier dans le salon du roi, mon ambassadeur et lui ont beaucoup parlé batailles. C’est l’anniversaire de Leipzig, gigantesque combat.
Hier il a plu tout le jour, je n’ai pas pu marcher, aujourd’hui il me faut absolument trouver le moyen de faire de l'exercice. Mes nerfs vont mal. Voilà Matonchewitz qui m’a tenue deux grande heures, & dont je viens de me séparer avec un vrai chagrin. Alava sort d'ici aussi. L'arrivée en Espagne de la Princesse de Keira, aujourd’hui reine, car elle épouse Don Carlos est un grand événement. Votre police est complaisante.
Adieu. Adieu. Je suis plus nervous que jamais, plus triste que jamais. D’après tout ce qui s’est dit entre Matonchewitz et moi, je vois que mon avenir sera affreux, & que je ne puis compter sur rien et sur personne. Quel pays, quelles gens ! Il n’y a rien de plus, rien de nouveau, seulement qu'en y regardant de bien près, nous avons trouvé que mon mari et mon frère ne sont autre chose que des courtisans, & qu’ils le resteront. Adieu. Adieu.
C’est un bien petit mot que celui que vous m’avez écrit hier ; j'espère mieux pour demain, mais je vous remercie de tout ce que vous me dites. Matonchewitz part aujourd’hui. Je n'ai jamais tant causé avec lui de ma vie que dans ces huit jours, et suis bien contente de lui. J’aurai beau coup de choses à vous dire qui ne s’écrivent pas. Les Sutherland sont venus passer la soirée chez moi hier. Je n'ai reçu à leur donner pour les divertir ; il n’y a vraiment personne à Paris. Quel hasard que Humbold. Mon ambassadeur se calme, il croit avoir trouvé l'hotel Beauny sur la place Vendôme mais il faut deux millions et il vient de les demander à l'Empereur.
Le discours d'ouverture des états à La Haye annonce comme je crois vous l’avoir dit que la Roi a fait une démocratie conciliante au mois de mars, et que jusqu’ici il n'y a pas obtenu réponse. Il espère cependant arriver à un arrangement définitif et honorable pour la Hollande au sujet des provinces insurgées. On dit maintenant que tout sera terminée cette semaine à Londres & dans une séance de la conférence. Léopold était hier dans le salon du roi, mon ambassadeur et lui ont beaucoup parlé batailles. C’est l’anniversaire de Leipzig, gigantesque combat.
Hier il a plu tout le jour, je n’ai pas pu marcher, aujourd’hui il me faut absolument trouver le moyen de faire de l'exercice. Mes nerfs vont mal. Voilà Matonchewitz qui m’a tenue deux grande heures, & dont je viens de me séparer avec un vrai chagrin. Alava sort d'ici aussi. L'arrivée en Espagne de la Princesse de Keira, aujourd’hui reine, car elle épouse Don Carlos est un grand événement. Votre police est complaisante.
Adieu. Adieu. Je suis plus nervous que jamais, plus triste que jamais. D’après tout ce qui s’est dit entre Matonchewitz et moi, je vois que mon avenir sera affreux, & que je ne puis compter sur rien et sur personne. Quel pays, quelles gens ! Il n’y a rien de plus, rien de nouveau, seulement qu'en y regardant de bien près, nous avons trouvé que mon mari et mon frère ne sont autre chose que des courtisans, & qu’ils le resteront. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Internationale)
165. Val-Richer, Samedi 20 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°165 Samedi 20 Oct. 7 heures
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
170. Paris, Dimanche 21 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
170. Paris, dimanche 21 octobre 1838
J’ai rencontré beaucoup de monde hier à Auteuil, sans y rencontrer cependant des nouvelles, si ce n’est que décidément l’affaire Belge va être terminer avant la fin de ce mois encore. Je crois que l’Angleterre avait besoin de cela, du moins Lord Palmerston, afin de pouvoir se vanter d’avoir mené à fin quelque chose. A dîner chez Lord Granville j’ai appris la résolution de Lord Ducham d'abandonner son gouvernement du Canada. C’est une grosse affaire de plus d'une façon. La rébellion éclatera de nouveau dans ces provinces. Les fonds Anglais ont fléchi à l’arrivée de cette nouvelle. Que va faire Lord Durham en Angleterre ? C'est un grand imbroglio. Les Anglais hier en étaient fort consternés.
Il y a une autre affaire à Madrid qui a aussi son importance. Frias & le chargé d’affaires d'Angleterre se sont brouillés sur une question de journaux, et au point que Lord Wiliam Hervey n’a plus voulu aller à la cour le jour de la fête de la Reine. Cela fait un grand scandale. Villers sera appelé à ajuster cela, probablement en faisant chasser Frias. Le pauvre Alava dit quand on lui demande "comment vont vos affaires ? " au diable."
Il fait chaud ; il fait beau, et je me sens très malade, c’est que je suis bien triste. Vous avez raison dans tout ce que vous me dites sur mon compte. La faveur de la cour me ramènerait mon mari, comme ma disgrâce me l’a aliéné. Est-il possible. Mais vous vous trompez la faveur ne reviendra plus. Il est unforgiving, je ne trouve pas le mot français.
On prétend que la Princesse de Beïra n’est pas en Navarre & que toute la nouvelle était une mystification. Adieu, Adieu. Mon fils me quitte demain. Adieu.
J’ai rencontré beaucoup de monde hier à Auteuil, sans y rencontrer cependant des nouvelles, si ce n’est que décidément l’affaire Belge va être terminer avant la fin de ce mois encore. Je crois que l’Angleterre avait besoin de cela, du moins Lord Palmerston, afin de pouvoir se vanter d’avoir mené à fin quelque chose. A dîner chez Lord Granville j’ai appris la résolution de Lord Ducham d'abandonner son gouvernement du Canada. C’est une grosse affaire de plus d'une façon. La rébellion éclatera de nouveau dans ces provinces. Les fonds Anglais ont fléchi à l’arrivée de cette nouvelle. Que va faire Lord Durham en Angleterre ? C'est un grand imbroglio. Les Anglais hier en étaient fort consternés.
Il y a une autre affaire à Madrid qui a aussi son importance. Frias & le chargé d’affaires d'Angleterre se sont brouillés sur une question de journaux, et au point que Lord Wiliam Hervey n’a plus voulu aller à la cour le jour de la fête de la Reine. Cela fait un grand scandale. Villers sera appelé à ajuster cela, probablement en faisant chasser Frias. Le pauvre Alava dit quand on lui demande "comment vont vos affaires ? " au diable."
Il fait chaud ; il fait beau, et je me sens très malade, c’est que je suis bien triste. Vous avez raison dans tout ce que vous me dites sur mon compte. La faveur de la cour me ramènerait mon mari, comme ma disgrâce me l’a aliéné. Est-il possible. Mais vous vous trompez la faveur ne reviendra plus. Il est unforgiving, je ne trouve pas le mot français.
On prétend que la Princesse de Beïra n’est pas en Navarre & que toute la nouvelle était une mystification. Adieu, Adieu. Mon fils me quitte demain. Adieu.
168. Val-Richer, Mardi 23 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°168 Mardi 23 Octobre, 8 heures et demie
Je me lève tard. J’ai mal dormi ; pour moi du moins ; pour vous, ce serait probablement une bonne nuit. Vos nuits dépendent de vos jours ; votre santé de votre âme. J’y pense continuellement. Il y a de l’irrémédiable. du moins pour nous ; nous n’y pouvons rien actuellement directement. Les circonstances peuvent amener, là où se décide ce qui vous touche, des raisons de changement qui amèneraient à leur tour le changement. Nous ne les prévoyons pas aujourd’hui ; mais elles peuvent venir. Je le crois unforgiving, implacable, mais non contre son propre intérêt, son moindre intérêt bien clair. Mais il n’y faut pas compter, j’en conviens ; il faut s’arranger comme si cela ne se pouvait pas. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c’est de combien d’affection et de soin j’entourerai, votre solitaire établissement. Je sais tout ce qui vous manque tout ce qui manque à votre cœur, à votre journée. Je sais ce qui m’empêche souvent moi-même de faire tout ce que je voudrais. Mais je veux tant que je ferai beaucoup beaucoup. Je me sens inépuisable pour vous. En fait de monde chez vous, hors de chez vous, en fait de passe-temps vous en aurez à peu près tant que vous voudrez. Votre salon est formé, à présent ; les habitudes sont prises ; la conversation, le petit mouvement social qui vous plaisent ne vous manqueront pas. Voilà pour la surface, au fond dearest, nous comblerons ensemble les vides, nous soignerons ensembles les plaies. Je vous aime tendrement. Le temps, l’absence, la connaissance plus complète de votre caractère, de votre esprit de vous toute entière, tout cela fait que je vous aime toujours autant, plutôt davantage. Vous savez que mes paroles n’exagèrent jamais mes sentiments. Vous savez que je suis doux à vivre. Je le serai pour vous, avec vous, plus que vous ne savez. Il y a bien du vide, bien de l’amertume dans votre situation ; j’y mettrai beaucoup de baume, beaucoup de tendresse. Vous vous souvenez de mon défi, dans nos premiers temps. Vous me direz un jour, si j’avais raison.
J’ai gardé hier mes hôtes jusqu’à cinq heures. Aujourd’hui, je vais dîner à Lisieux, demain aussi. Je mets les morceaux en quatre. Le retour de Lord Durham sera un avènement à Londres. Je ne sais qu’elle position il s’y refera ; mais je comprends que celle de Québec ne lui convienne pas. Revient-il cependant sans attendre son successeur, sans donner à son gouvernement le temps de pourvoir aux affaires du Canada ? Ce serait une boutade d’enfant gâté. Il y est sujet. Les Granville en sont-ils inquiets ? Je crois assez à leur jugement sur la situation, et les chances de leur cabinet. Ils sont éclairés, par une passion, leur désir de rester à Paris. Je la partage pour eux, quoique, non à cause d’eux.
10 heures
Je suis fâché que votre fils vous quitte avant que j’arrive. J’avais espéré qu’il vous resterait encore quelques jours ! Je suis charmé que vous en soyez contente. Ses qualités qu’il a valent mieux plus on en jouit. Je reçois une lettre de M. de Broglie qui me dit qu’en effet il ne vient pas à Broglie. Cela me met à l’aise. Je craignais toujours qu’il ne vint au moment où je veux partir. Il est bien triste, mais il reprend ses occupations intérieures. Il est très content de son fils. Adieu. Je serais en effet très bien aux Tuileries. J’y serai. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
Je me lève tard. J’ai mal dormi ; pour moi du moins ; pour vous, ce serait probablement une bonne nuit. Vos nuits dépendent de vos jours ; votre santé de votre âme. J’y pense continuellement. Il y a de l’irrémédiable. du moins pour nous ; nous n’y pouvons rien actuellement directement. Les circonstances peuvent amener, là où se décide ce qui vous touche, des raisons de changement qui amèneraient à leur tour le changement. Nous ne les prévoyons pas aujourd’hui ; mais elles peuvent venir. Je le crois unforgiving, implacable, mais non contre son propre intérêt, son moindre intérêt bien clair. Mais il n’y faut pas compter, j’en conviens ; il faut s’arranger comme si cela ne se pouvait pas. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c’est de combien d’affection et de soin j’entourerai, votre solitaire établissement. Je sais tout ce qui vous manque tout ce qui manque à votre cœur, à votre journée. Je sais ce qui m’empêche souvent moi-même de faire tout ce que je voudrais. Mais je veux tant que je ferai beaucoup beaucoup. Je me sens inépuisable pour vous. En fait de monde chez vous, hors de chez vous, en fait de passe-temps vous en aurez à peu près tant que vous voudrez. Votre salon est formé, à présent ; les habitudes sont prises ; la conversation, le petit mouvement social qui vous plaisent ne vous manqueront pas. Voilà pour la surface, au fond dearest, nous comblerons ensemble les vides, nous soignerons ensembles les plaies. Je vous aime tendrement. Le temps, l’absence, la connaissance plus complète de votre caractère, de votre esprit de vous toute entière, tout cela fait que je vous aime toujours autant, plutôt davantage. Vous savez que mes paroles n’exagèrent jamais mes sentiments. Vous savez que je suis doux à vivre. Je le serai pour vous, avec vous, plus que vous ne savez. Il y a bien du vide, bien de l’amertume dans votre situation ; j’y mettrai beaucoup de baume, beaucoup de tendresse. Vous vous souvenez de mon défi, dans nos premiers temps. Vous me direz un jour, si j’avais raison.
J’ai gardé hier mes hôtes jusqu’à cinq heures. Aujourd’hui, je vais dîner à Lisieux, demain aussi. Je mets les morceaux en quatre. Le retour de Lord Durham sera un avènement à Londres. Je ne sais qu’elle position il s’y refera ; mais je comprends que celle de Québec ne lui convienne pas. Revient-il cependant sans attendre son successeur, sans donner à son gouvernement le temps de pourvoir aux affaires du Canada ? Ce serait une boutade d’enfant gâté. Il y est sujet. Les Granville en sont-ils inquiets ? Je crois assez à leur jugement sur la situation, et les chances de leur cabinet. Ils sont éclairés, par une passion, leur désir de rester à Paris. Je la partage pour eux, quoique, non à cause d’eux.
10 heures
Je suis fâché que votre fils vous quitte avant que j’arrive. J’avais espéré qu’il vous resterait encore quelques jours ! Je suis charmé que vous en soyez contente. Ses qualités qu’il a valent mieux plus on en jouit. Je reçois une lettre de M. de Broglie qui me dit qu’en effet il ne vient pas à Broglie. Cela me met à l’aise. Je craignais toujours qu’il ne vint au moment où je veux partir. Il est bien triste, mais il reprend ses occupations intérieures. Il est très content de son fils. Adieu. Je serais en effet très bien aux Tuileries. J’y serai. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
173. Paris, Mercredi 24 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
173. Paris le 26 octobre 1838
Je vous remercie tous les jours, toujours de tout ce que vous me dites de tendre, d’affectueux. Cela me fait du bien. J'ai bien besoin de vous, j’ai été trop longtemps seule. Mon fils n’a pas quitté son lit, & je ne suis pas beaucoup auprès de lui. Cela me rend nervous au possible parce que je sens mon insuffisance. J’ai ce caractère trop inquiet, cela doit impatienter les autres.
Je me suis promenée le matin avec Marie ; à propos, elle est à merveille de santé, d'humeur, de beauté. Avant dîner, j’ai fait visite aux Holland ; j’ai trouvé Milady se faisant frotter les jambes & causant avec M. Berryer. Ensuite elle a passé à sa toilette et m’a proposé un tête à tête avec son mari. J’ai trouvé, ce que je trouverais en Angleterre c’est qu’il est l’homme le moins propre à une vraie conversation d’affaires, c’est de la politique personnelle et non pas de grands intérêts. Ce soir Marie est allée au spectacle avec les Carlisle, je suis restée avec Armin, Humbold et M. Mossion. J'ai renvoyé un peu brutalement celui-ci, pour causer avec les autres.
La fièvre jaune s’est déclarée à bord d’un bâtiment de votre flotte au Mexique. On est inquiet du prince de Joinville. Il parait hors de doute que Lord Durham reviendra sans attendre. Sa démission et peut être même sans la demander. Lord Grey m’a écrit sans connaître encore la résolution de son gendre mais il la pressent, & je ne pense pas qu'il en soit très mécontent. Il trouve qu’il a été indignement abandonné par les Ministres. Madame de Flahaut m'écrit aussi. Décidément ils ne reviennent pas. Elle se plaint amèrement de M. Molé. M. de Flahaut s'attendait à l’offre de l'ambassade à Naples, ou en Suisse ou à Turin enfin quelque chose. Je suis étonnée qu'il se soit fait de ces illusions là.
Je ne sais de quelle couleur est M. de Mossion. Il revient de Suisse où il a passé l'été. Il trouve que la France a joué un pitoyable rôle dans l’affaire de Louis Bonaparte, et la Suisse un très beau. J'ai M. Fossin et tout mon écrin à côté de moi au moment où je vous écris. Je fais faire à tout événement l’estimation de mes diamants. On ne sait pas...! Il pleut à verse. J’aurai les arcades pour ressources, et des visites ensuite. Adieu. Adieu comme vous très tendrement.
Je vous remercie tous les jours, toujours de tout ce que vous me dites de tendre, d’affectueux. Cela me fait du bien. J'ai bien besoin de vous, j’ai été trop longtemps seule. Mon fils n’a pas quitté son lit, & je ne suis pas beaucoup auprès de lui. Cela me rend nervous au possible parce que je sens mon insuffisance. J’ai ce caractère trop inquiet, cela doit impatienter les autres.
Je me suis promenée le matin avec Marie ; à propos, elle est à merveille de santé, d'humeur, de beauté. Avant dîner, j’ai fait visite aux Holland ; j’ai trouvé Milady se faisant frotter les jambes & causant avec M. Berryer. Ensuite elle a passé à sa toilette et m’a proposé un tête à tête avec son mari. J’ai trouvé, ce que je trouverais en Angleterre c’est qu’il est l’homme le moins propre à une vraie conversation d’affaires, c’est de la politique personnelle et non pas de grands intérêts. Ce soir Marie est allée au spectacle avec les Carlisle, je suis restée avec Armin, Humbold et M. Mossion. J'ai renvoyé un peu brutalement celui-ci, pour causer avec les autres.
La fièvre jaune s’est déclarée à bord d’un bâtiment de votre flotte au Mexique. On est inquiet du prince de Joinville. Il parait hors de doute que Lord Durham reviendra sans attendre. Sa démission et peut être même sans la demander. Lord Grey m’a écrit sans connaître encore la résolution de son gendre mais il la pressent, & je ne pense pas qu'il en soit très mécontent. Il trouve qu’il a été indignement abandonné par les Ministres. Madame de Flahaut m'écrit aussi. Décidément ils ne reviennent pas. Elle se plaint amèrement de M. Molé. M. de Flahaut s'attendait à l’offre de l'ambassade à Naples, ou en Suisse ou à Turin enfin quelque chose. Je suis étonnée qu'il se soit fait de ces illusions là.
Je ne sais de quelle couleur est M. de Mossion. Il revient de Suisse où il a passé l'été. Il trouve que la France a joué un pitoyable rôle dans l’affaire de Louis Bonaparte, et la Suisse un très beau. J'ai M. Fossin et tout mon écrin à côté de moi au moment où je vous écris. Je fais faire à tout événement l’estimation de mes diamants. On ne sait pas...! Il pleut à verse. J’aurai les arcades pour ressources, et des visites ensuite. Adieu. Adieu comme vous très tendrement.
177. Paris, Dimanche 28 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
177. Paris, dimanche 28 octobre 1838
Certainement vous avez un mauvais caractère ou une mauvaise logique dans l’esprit. Vous vous fâchez de ce que je me fâche, et c'est vous cependant qui avez commencé par m'affliger ! Cela n’a pas le sens commun. Venez et nous raisonnerons sur ce sujet, et je vous prouverai que ce n’est pas moi qui ai tort. Laissons cela maintenant. Ce qu'il y a de plus clair dans notre fait, c'est qu'à distance nous finirions par nous brouiller et que c'est impossible, à jamais impossible, lorsque nous somme ensemble, n’est-ce pas ?
Le traité entre l’Autriche & l'Angleterre ne peut pas nous être agréable, je vous dis cela de mon propre cru. Je n'en ai parlé à personne, et je n’ai personne avec qui causer de ces sujets là. Pahlen n'y entend pas un mot et Médem n’est pas ici. Je trouve en général que notre politique est fort lâchement même depuis quelques temps, aussi nous trouvons nous aujourd’hui dans un parfait isolement.
10 heures. Mon fils vient de me quitter. Je reste affligé, et bien contente de lui. C'est un excellent garçon. Me voilà seule de nouveau sans personne qui m’aime ! Je m'en vais à l'église. Je n’ai rien du tout à vous conter sur ma journée d’hier. Je l'ai passée avec mon fils, avec un peu de mélange de Lady Granville. Adieu. Adieu, & encore adieu et toujours adieu. Si cela ne vous déplaît pas.
Certainement vous avez un mauvais caractère ou une mauvaise logique dans l’esprit. Vous vous fâchez de ce que je me fâche, et c'est vous cependant qui avez commencé par m'affliger ! Cela n’a pas le sens commun. Venez et nous raisonnerons sur ce sujet, et je vous prouverai que ce n’est pas moi qui ai tort. Laissons cela maintenant. Ce qu'il y a de plus clair dans notre fait, c'est qu'à distance nous finirions par nous brouiller et que c'est impossible, à jamais impossible, lorsque nous somme ensemble, n’est-ce pas ?
Le traité entre l’Autriche & l'Angleterre ne peut pas nous être agréable, je vous dis cela de mon propre cru. Je n'en ai parlé à personne, et je n’ai personne avec qui causer de ces sujets là. Pahlen n'y entend pas un mot et Médem n’est pas ici. Je trouve en général que notre politique est fort lâchement même depuis quelques temps, aussi nous trouvons nous aujourd’hui dans un parfait isolement.
10 heures. Mon fils vient de me quitter. Je reste affligé, et bien contente de lui. C'est un excellent garçon. Me voilà seule de nouveau sans personne qui m’aime ! Je m'en vais à l'église. Je n’ai rien du tout à vous conter sur ma journée d’hier. Je l'ai passée avec mon fils, avec un peu de mélange de Lady Granville. Adieu. Adieu, & encore adieu et toujours adieu. Si cela ne vous déplaît pas.
Mots-clés : Diplomatie, Relation François-Dorothée (Dispute)
184. Paris, Mercredi 27 février 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
184 Paris, Mercredi 21 février 1839
Je suis parfaitement triste et parfaitement ennuyée. La journée hier m’a paru bien longue. Comment ferai-je jusqu'à mardi. Thiers est venu chez moi ; il m’a moins divertie que de coutume. Je le trouve plus grave, c’est peut- être que je le suis. Cependant une heure et demie de causerie avec lui, c-à-d lui causant toujours, m'a fait une bonne distraction. J’ai vu dans la soirée Lord & Lady Granville et mon ambassadeur ; la nouvelle du jour est Marato fusillant tous les généraux sous ses ordres et Don Carlos déclarant Marato traître. Voilà donc la confusion et l’anarchie dans son camp. Cela pourrait bien le faire lever tout-à-fait. Granville avait l’air fort réjoui de ces nouvelles. Pahlen l’était moins. Il m’avait porté notre journal officiel renfermant un long article sur mon mari assez bien fait ! Ce qui y est le plus remarquable est ce qui n'y est pas. Ainsi pas mention de sa femme. Du reste une biographie très exacte, il est même question de ses enfants. Lady Jersey m’écrit une fort bonne lettre plus du grand dîner, mais rien de sa part qui me regarde. Il est excellent pour mon fils pour un fils, c’est tout ce qu'il me faut.
On traîne en Belgique, cela a l'air d'un parti pris ; on ne veut pas finir avant de connaître le résultat de vos élections. Voici du beau temps, j’ai été l’essayer aux Tuileries, plus tard J’irai au bois de Boulogne à 5 h. chez Lady Granville, je dîne chez Mad. de Talleyrand ; vous savez maintenant mes faits et gestes. Apprenez moi les vôtres. Adieu. Adieu. C’est bien dur de devoir se dire adieu de si loin en février. Nos beaux jours ne sont plus que les plus mauvais de l’année.
Je suis parfaitement triste et parfaitement ennuyée. La journée hier m’a paru bien longue. Comment ferai-je jusqu'à mardi. Thiers est venu chez moi ; il m’a moins divertie que de coutume. Je le trouve plus grave, c’est peut- être que je le suis. Cependant une heure et demie de causerie avec lui, c-à-d lui causant toujours, m'a fait une bonne distraction. J’ai vu dans la soirée Lord & Lady Granville et mon ambassadeur ; la nouvelle du jour est Marato fusillant tous les généraux sous ses ordres et Don Carlos déclarant Marato traître. Voilà donc la confusion et l’anarchie dans son camp. Cela pourrait bien le faire lever tout-à-fait. Granville avait l’air fort réjoui de ces nouvelles. Pahlen l’était moins. Il m’avait porté notre journal officiel renfermant un long article sur mon mari assez bien fait ! Ce qui y est le plus remarquable est ce qui n'y est pas. Ainsi pas mention de sa femme. Du reste une biographie très exacte, il est même question de ses enfants. Lady Jersey m’écrit une fort bonne lettre plus du grand dîner, mais rien de sa part qui me regarde. Il est excellent pour mon fils pour un fils, c’est tout ce qu'il me faut.
On traîne en Belgique, cela a l'air d'un parti pris ; on ne veut pas finir avant de connaître le résultat de vos élections. Voici du beau temps, j’ai été l’essayer aux Tuileries, plus tard J’irai au bois de Boulogne à 5 h. chez Lady Granville, je dîne chez Mad. de Talleyrand ; vous savez maintenant mes faits et gestes. Apprenez moi les vôtres. Adieu. Adieu. C’est bien dur de devoir se dire adieu de si loin en février. Nos beaux jours ne sont plus que les plus mauvais de l’année.
187. Paris, Samedi 2 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
187 Samedi 2 mars 1839
Mercredi seulement. Que c’est long ! je m'afflige, mais je ne me plains pas. Je ne suis pas inquiète comme vous le dites. Mais cela me fait beaucoup de peine. Cela vous ne vous en plaindrez pas ? Oui le 4 ! C’est horrible, mais je ne puis ni en parler ni en écrire.
J’ai eu une lettre de Paul hier. L’Empereur a envoyé de suite à Londres le comte Strogonnoff pour remplacer mon fils pendant le voyage qu'il va faire en Russie. Il lui enjoint de venir de suite attendu qu’'il désire le voir. Paul ne veut pas aller dans ce moment, sa santé ne va pas à un voyage rapide dans la rude saison. Il ira dans quatre semaines on trouvera cela étrange, il fallait courir ventre à terre dès le lendemain ! Voilà comme on est chez nous. J’ai eu ma lettre de mon frère ce matin ; il avait reçu mes deux lettres. Celle de reproche et l’autre écrite après la mort de mon mari. La sienne contient que des hélas et des reproches sur ce que je ne veux pas vivre en Russie. Voici le lieu de lui dire une fois pour toutes pourquoi je n’y veux pas vivre et que je n’y retournerai jamais. Je vous montrerai cette lettre, je ne l’enverrai qu'après vous l’avoir lue.
J’ai vu hier matin chez moi la comtesse Appony. J’ai fait le plus agréable dîner possible chez Lady William Bentinck, elle, son mari et Lord Harry Vane, voilà tout. Très anglais, très confortable, j’ai eu presque de la gaieté. Le soir chez moi, mon ambassadeur, celui d’Autriche, Fagel, M. de Stackelberg & le Prince Waisensky. Don Carlos a retiré sa proclamation contre Maroto. Après l’avoir déclaré traître, il approuve tous ses actes, lui rend le commandement. Enfin, c’est une confusion plus grande que jamais, et mes ambassadeurs disent que ce qu'il y a de mieux à faire est d’abandonner complètement Don Carlos et le principe. Les princes gâtent le principe.
Lord Everington vient d'être nommé vice roi d’Irlande, c'est un très grand radical, un homme d’esprit, membre distingué de la chambre basse, et très grand seigneur quand son père Lord Forteseme mourra. Je vous conterai comment un jour il est resté caché pendant deux heures dans les rideaux de mon lit ! J’ajoute, puisque vous êtes si loin ; que c’est mon mari qui l'y avait caché. Vous feriez d’étranges spéculations si je ne vous disais pas cela. Et ce n’était pas cache cache.
Le petit copiste est venu. Il a commencé aujourd’hui. Cela va très bien. Les ambassadeurs avaient vu M. Molé hier. Les nouvelles sur les élections sont d’heure en heure meilleures pour les ministres. Vous avez bien fait de n'être pas allé à Rouen, mais vous faites très mal d'avoir du rhumatisme. Je vous le disais lorsque vous êtes parti, j’étais sure que vous alliez prendre froid. Faites-vous bien frotter au moins Adieu. Adieu, il faut donc encore écrire demain et lundi. What a bore ! Adieu. Adieu.
Mercredi seulement. Que c’est long ! je m'afflige, mais je ne me plains pas. Je ne suis pas inquiète comme vous le dites. Mais cela me fait beaucoup de peine. Cela vous ne vous en plaindrez pas ? Oui le 4 ! C’est horrible, mais je ne puis ni en parler ni en écrire.
J’ai eu une lettre de Paul hier. L’Empereur a envoyé de suite à Londres le comte Strogonnoff pour remplacer mon fils pendant le voyage qu'il va faire en Russie. Il lui enjoint de venir de suite attendu qu’'il désire le voir. Paul ne veut pas aller dans ce moment, sa santé ne va pas à un voyage rapide dans la rude saison. Il ira dans quatre semaines on trouvera cela étrange, il fallait courir ventre à terre dès le lendemain ! Voilà comme on est chez nous. J’ai eu ma lettre de mon frère ce matin ; il avait reçu mes deux lettres. Celle de reproche et l’autre écrite après la mort de mon mari. La sienne contient que des hélas et des reproches sur ce que je ne veux pas vivre en Russie. Voici le lieu de lui dire une fois pour toutes pourquoi je n’y veux pas vivre et que je n’y retournerai jamais. Je vous montrerai cette lettre, je ne l’enverrai qu'après vous l’avoir lue.
J’ai vu hier matin chez moi la comtesse Appony. J’ai fait le plus agréable dîner possible chez Lady William Bentinck, elle, son mari et Lord Harry Vane, voilà tout. Très anglais, très confortable, j’ai eu presque de la gaieté. Le soir chez moi, mon ambassadeur, celui d’Autriche, Fagel, M. de Stackelberg & le Prince Waisensky. Don Carlos a retiré sa proclamation contre Maroto. Après l’avoir déclaré traître, il approuve tous ses actes, lui rend le commandement. Enfin, c’est une confusion plus grande que jamais, et mes ambassadeurs disent que ce qu'il y a de mieux à faire est d’abandonner complètement Don Carlos et le principe. Les princes gâtent le principe.
Lord Everington vient d'être nommé vice roi d’Irlande, c'est un très grand radical, un homme d’esprit, membre distingué de la chambre basse, et très grand seigneur quand son père Lord Forteseme mourra. Je vous conterai comment un jour il est resté caché pendant deux heures dans les rideaux de mon lit ! J’ajoute, puisque vous êtes si loin ; que c’est mon mari qui l'y avait caché. Vous feriez d’étranges spéculations si je ne vous disais pas cela. Et ce n’était pas cache cache.
Le petit copiste est venu. Il a commencé aujourd’hui. Cela va très bien. Les ambassadeurs avaient vu M. Molé hier. Les nouvelles sur les élections sont d’heure en heure meilleures pour les ministres. Vous avez bien fait de n'être pas allé à Rouen, mais vous faites très mal d'avoir du rhumatisme. Je vous le disais lorsque vous êtes parti, j’étais sure que vous alliez prendre froid. Faites-vous bien frotter au moins Adieu. Adieu, il faut donc encore écrire demain et lundi. What a bore ! Adieu. Adieu.
188. Paris, Dimanche 3 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
188 Paris 3 mars Dimanche 1839
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
190 je crois.
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
192. Val-Richer, Jeudi 6 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
192 Du Val Richer, jeudi 6 juin 1839 2 heures
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
193. Val-Richer, Samedi 8 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
193 Du Val-Richer, Samedi 8 juin 1839 2 heures
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
195. Val-Richer, Mercredi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
195 Du Val Richer, Mercredi 12 juin 1839 4 heures
Je prends du plus grand papier. Il me semble que j’ai une infinité de choses à vous dire. Je vous en dis bien peu pourtant. M. et Mad. de Gasparin viennent de m’arriver avec M. Chabaud. Ils resteront jusqu'à samedi. Moi, je ne partirais que lundi. Rien ne m’attire à Paris, point de plaisir et peu d'affaires. Fort peu. La question d'Orient se refroidit. Les événements s'éloignent. On s'attend à peu de discussion. Thiers part demain pour conduire sa femme aux Pyrénées. Cependant je persiste à vouloir parler. La question, prochaine et point flagrante, est peut-être une raison de plus de parler ; elle est assez près pour qu’on y regarde et encore assez loin pour qu’on parle librement. La commission fera par l'organe de M. Jouffroy, un rapport savant et terne, une belle dissertation. Les Affaires Etrangères sont de toutes, à mon avis, celles sur lesquelles la parole séparée de l'action, a le moins de valeur. Elle tombe presque inévitablement dans la politique de café, ou de livre ; politique presque toujours arbitraire et futile, même la plus spirituelle. Les crédits demandés pour augmenter nos forces navales sur les côtes d'Espagne donneront peut-être lieu à un débat plus vif. On me mande que M. Molé veut les faire attaquer. Si le cabinet, dit-il, entend continuer l'ancienne politique, l’argent qu’il demande est inutile. S’il veut adopter une politique nouvelle et s’engager plus avant dans les Affaires d’Espagne, c’est dangereux. Si en faisant comme ses prédécesseurs, il veut seulement avoir l’air de faire plus qu'eux, on ne lui doit pas des millions pour qu’il se donne ce petit plaisir. En tout le cabinet ne gagne pas de terrain. Tout le monde le trouve petit et le lui témoigne, la Chambre des Pairs et M. Bresson. Cette démission de M. Bresson a été une affaire. Le Roi, dit-on, l’en a hautement approuvé. Et pour obtenir la réintégration de M. Legrand aux forêts, il a fallu que M. Passy menaçât de sa retraite. Je vous envoie toutes les pauvretés qui m’arrivent. Pourquoi pas ? Je vous les dirais. M. de Broglie a voulu conduire lui-même sa fille à Coppet. Je ne le trouverai donc pas à Paris. Mais il y sera de retour du 20 au 25 de ce mois, pour le procès, qui durera au moins quinze jours.
On m’appelle pour la promenade. Le temps est magnifique et la verdure aussi brillante que le soleil. Je n'aime pas à faire ce qui me plaît avec quelqu'un qui n’est pas vous. Adieu au moins.
Jeudi 6 heures
La lettre de votre grand Duc est une lettre d'enfant. Je suis toujours bien aise qu'il vous l’ait écrite, et qu'Orloff ait envie d'avoir votre réponse. Je suis curieux de savoir qu’elle sera la valeur des paroles de celui-ci. Vous dites toujours qu’il a de l'esprit. Nous verrons. J’espère bien que votre pauvre Castillon aura une course de courrier. J’insisterai jusqu'à ce qu’il en ait une. On me l’a promis et je graduerai mon humeur sur l'accomplissement de la promesse. Nous avons, aussi nos barbares, nos esprits grossiers quoique rusés qui feront toutes les platitudes du monde, et manqueront de bons procédés. Mais il faut le leur faire sentir. Je ne trouverai plus personne à Paris. Mad. de Rémusat est partie pour le Languedoc. Mad. de Boigne est à Chastenay. J'irai quelque fois. Si cela peut s’appeler aller à Chastenay ! Je reviendrai vers le 15 juillet.
Mes enfants sont ici d’un bonheur charmant à voir. Je les trouve déjà engraissés. Bien des fois dans le jour, je voudrais vous envoyer la société de ma petite Henriette. Elle vous calmerait en vous amusant. Je n’ai jamais vu une créature plus sereine, et plus animée. C’est la vie et l’ordre en personne. Jamais de trouble ni de langueur. Et ayant ce qui donne et justifie l'autorité, l’instinct naturel du commandement, et la disposition au dévouement. J'en jouis avec plus de tremblement que je ne veux me le dire à moi-même. Je ne me sens plus en état de résister à de nouveaux coups. Soignez-vous bien.
9 heures Je serai très bref. Le post-scriptum de votre n°194 me met dans une indignation que je ne veux pas comprimer. Je n’ai rien vu de pareil. Qu’avez-vous donc fait ? De quoi vos fils veulent-ils vous punir ? Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir mettre dans cet adieu tout ce que je ne dis pas, et de quoi vous faire oublier tout ce qui vous arrive. J’attends bien impatiemment une lettre de votre frère. G.
Je prends du plus grand papier. Il me semble que j’ai une infinité de choses à vous dire. Je vous en dis bien peu pourtant. M. et Mad. de Gasparin viennent de m’arriver avec M. Chabaud. Ils resteront jusqu'à samedi. Moi, je ne partirais que lundi. Rien ne m’attire à Paris, point de plaisir et peu d'affaires. Fort peu. La question d'Orient se refroidit. Les événements s'éloignent. On s'attend à peu de discussion. Thiers part demain pour conduire sa femme aux Pyrénées. Cependant je persiste à vouloir parler. La question, prochaine et point flagrante, est peut-être une raison de plus de parler ; elle est assez près pour qu’on y regarde et encore assez loin pour qu’on parle librement. La commission fera par l'organe de M. Jouffroy, un rapport savant et terne, une belle dissertation. Les Affaires Etrangères sont de toutes, à mon avis, celles sur lesquelles la parole séparée de l'action, a le moins de valeur. Elle tombe presque inévitablement dans la politique de café, ou de livre ; politique presque toujours arbitraire et futile, même la plus spirituelle. Les crédits demandés pour augmenter nos forces navales sur les côtes d'Espagne donneront peut-être lieu à un débat plus vif. On me mande que M. Molé veut les faire attaquer. Si le cabinet, dit-il, entend continuer l'ancienne politique, l’argent qu’il demande est inutile. S’il veut adopter une politique nouvelle et s’engager plus avant dans les Affaires d’Espagne, c’est dangereux. Si en faisant comme ses prédécesseurs, il veut seulement avoir l’air de faire plus qu'eux, on ne lui doit pas des millions pour qu’il se donne ce petit plaisir. En tout le cabinet ne gagne pas de terrain. Tout le monde le trouve petit et le lui témoigne, la Chambre des Pairs et M. Bresson. Cette démission de M. Bresson a été une affaire. Le Roi, dit-on, l’en a hautement approuvé. Et pour obtenir la réintégration de M. Legrand aux forêts, il a fallu que M. Passy menaçât de sa retraite. Je vous envoie toutes les pauvretés qui m’arrivent. Pourquoi pas ? Je vous les dirais. M. de Broglie a voulu conduire lui-même sa fille à Coppet. Je ne le trouverai donc pas à Paris. Mais il y sera de retour du 20 au 25 de ce mois, pour le procès, qui durera au moins quinze jours.
On m’appelle pour la promenade. Le temps est magnifique et la verdure aussi brillante que le soleil. Je n'aime pas à faire ce qui me plaît avec quelqu'un qui n’est pas vous. Adieu au moins.
Jeudi 6 heures
La lettre de votre grand Duc est une lettre d'enfant. Je suis toujours bien aise qu'il vous l’ait écrite, et qu'Orloff ait envie d'avoir votre réponse. Je suis curieux de savoir qu’elle sera la valeur des paroles de celui-ci. Vous dites toujours qu’il a de l'esprit. Nous verrons. J’espère bien que votre pauvre Castillon aura une course de courrier. J’insisterai jusqu'à ce qu’il en ait une. On me l’a promis et je graduerai mon humeur sur l'accomplissement de la promesse. Nous avons, aussi nos barbares, nos esprits grossiers quoique rusés qui feront toutes les platitudes du monde, et manqueront de bons procédés. Mais il faut le leur faire sentir. Je ne trouverai plus personne à Paris. Mad. de Rémusat est partie pour le Languedoc. Mad. de Boigne est à Chastenay. J'irai quelque fois. Si cela peut s’appeler aller à Chastenay ! Je reviendrai vers le 15 juillet.
Mes enfants sont ici d’un bonheur charmant à voir. Je les trouve déjà engraissés. Bien des fois dans le jour, je voudrais vous envoyer la société de ma petite Henriette. Elle vous calmerait en vous amusant. Je n’ai jamais vu une créature plus sereine, et plus animée. C’est la vie et l’ordre en personne. Jamais de trouble ni de langueur. Et ayant ce qui donne et justifie l'autorité, l’instinct naturel du commandement, et la disposition au dévouement. J'en jouis avec plus de tremblement que je ne veux me le dire à moi-même. Je ne me sens plus en état de résister à de nouveaux coups. Soignez-vous bien.
9 heures Je serai très bref. Le post-scriptum de votre n°194 me met dans une indignation que je ne veux pas comprimer. Je n’ai rien vu de pareil. Qu’avez-vous donc fait ? De quoi vos fils veulent-ils vous punir ? Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir mettre dans cet adieu tout ce que je ne dis pas, et de quoi vous faire oublier tout ce qui vous arrive. J’attends bien impatiemment une lettre de votre frère. G.
204. Paris, Dimanche 30 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
204 Dimanche 30 Juin 1839, 5 heures
Je suis excédé. Après ma corvée de visites du Dimanche, il m'a pris la fantaisie de mettre un peu d'ordre dans un horrible fouillis de livres, planches, cartes & que j’avais laissé entasser. J’y travaille depuis trois heures. La tête m'en tourne. Je ne puis me redresser. Pour moi, l'activité morale et l'activité physique s'excluent l’une l'autre. Quand je ne fais rien, quand je ne pense à rien et ne me soucie de rien, je puis marcher, courir, supporter autant de fatigue corporelle que tout autre. Mais quand j'ai l’esprit très occupé, il faut que mon corps se repose. Toute ma force va à l’un ou à l'autre emploi.
Je ne suis pas content de votre N° 203. Ce peu de succès du lait d’ânesse et des bains, cette lassitude invincible dans une vie si tranquille, cette impossibilité de reprendre un peu d’embonpoint, tout cela me désole. Je vous en conjure ; nous avons assez souffert l'un et l'autre ; ne nous soyons pas, l’un à l’autre, une cause de souffrances nouvelles. Ayons pitié l’un de l'autre. Et que Dieu ait pitié de tous deux ! Je me défends du mieux que je puis mais j’ai le cœur serré. Dites-moi que vous êtes mieux ; mais ne me mentez pas. Vous pouvez être tranquille sur Paris. Il n’y aura infailliblement point de pillage très probablement, point d'émeute, et probablement rien du tout. Le procès se passe dans un calme profond, dans la salle et autour de la salle. Les accusés ne sont pas même insolents. En cas de condamnation à mort seulement, on peut craindre quelque tentative, tentative d'assassinat, d'enlèvement, de coup fourré, qui sera déjoué, mais dont il est difficile de prévoir le mode. On croit à deux condamnations à mort. Le procès sera moins long qu’on n'imaginait. Les interrogatoires marchent vite. Pozzo a pu partir, car il est arrivé à Calais. Une dépêche télégraphique l’a annoncé ce matin. L’envie dont je vous parlais l'autre jour s'est manifestée. Le marquis de Dalmatie est allé trouver M. Duchâtel pour lui demander de la part du Maréchal, s'il croyait possible de me déterminer à aller à Constantinople. C’est décidément M. de Rumigny qui ira à Madrid et M. de Dalmatie, sera nomme à Turin. Le Duc de Montebello se désole de rester Ambassadeur à Naples in partibus. Le Roi de Naples est toujours mal et ne remplace pas M. de Ludolf. C’est Mad. la Dauphine qui a fait rompre le mariage de Mademoiselle avec le comte de Lecce, par vertu et pour ne pas sacrifier cette jeune Princesse à une espèce d’idiot.
8 heures et demie
Je viens de dîner au café de Paris, avec M. Duvergier de Hauranne, uniquement occupé des chemins de fer, qu’on discutera après l'Orient. Dans mes études, je n'ai jamais eu aucun goût pour les sciences physiques. Je reste fidèle à cette disposition. Il me faut des hommes à remuer. Les pierres m'ennuient.
Lundi 8 heures
Il fait froid. Je viens de faire faire du feu. Ce temps là vous gâte vos promenades, tout ce que vous avez de bon à Baden, n’est-ce pas ? Mes enfants m'écrivent qu’il pleut sans cesse au Val-Richer. Pour eux, ils ne s’en promènent guère moins. Ils sont très bien. Guillaume a été un peu enrhumé, mais sans la moindre conséquence. Ma mère est très bien aussi. Montrond me dit que décidément il ira à Baden. Mais il va d’abord à des eaux de malade, je ne sais lesquelles, dix en Savoie, je crois. J’ai peur qu’il ne vous arrive bien tard. Adieu. Donnez-moi de meilleures nouvelles si vous voulez que je ne sois pas triste et abattu. Ce n'est pourtant pas le moment.
La discussion sur l'Orient commence aujourd’hui. J’ai envie de parler et je doute. On dit que M. de Lamartine dira toutes sortes de choses, qu'il faut tuer, l’Empire Ottoman parce qu’il va mourir qu’il faut vous donner Constantinople pour l'ôter aux Barbares, & Adieu. Adieu.
10 heures
J’aime les plaisirs inattendus. J’aime les exigences. Je les rends. Je puis donner beaucoup, beaucoup beaucoup plus qu’on ne sait ; mais je veux reprendre tout ce que je donne. Je vous écrirai demain. Je vous écrirai deux fois par jour, si vous voulez me promettre de vous bien porter. Vous me dites que vous pensez sans cesse à moi. Je vous défie d'envoyer vers moi une pensée qui n'en rencontre une de moi vers vous. Je suis sujet à vous de fier. On dit que j'ai l’esprit actif. J’ai le cœur bien plus actif que l’esprit ; et il me passe bien plus de peines ou de joies dans l'âme que d’idées dans la tête. Mais l’esprit montre tout ce qu’il a, & l'âme en cache beaucoup. Je m'arrête, car j'irais à des subtilités de théologiens ou de Bramine. Il y a du vrai pourtant dans ce que je vous dis là. Adieu jusqu’à demain. Je vais déjeuner & puis me promener en allant à la Chambre. Je ne fais point de visites. Adieu.
Je suis excédé. Après ma corvée de visites du Dimanche, il m'a pris la fantaisie de mettre un peu d'ordre dans un horrible fouillis de livres, planches, cartes & que j’avais laissé entasser. J’y travaille depuis trois heures. La tête m'en tourne. Je ne puis me redresser. Pour moi, l'activité morale et l'activité physique s'excluent l’une l'autre. Quand je ne fais rien, quand je ne pense à rien et ne me soucie de rien, je puis marcher, courir, supporter autant de fatigue corporelle que tout autre. Mais quand j'ai l’esprit très occupé, il faut que mon corps se repose. Toute ma force va à l’un ou à l'autre emploi.
Je ne suis pas content de votre N° 203. Ce peu de succès du lait d’ânesse et des bains, cette lassitude invincible dans une vie si tranquille, cette impossibilité de reprendre un peu d’embonpoint, tout cela me désole. Je vous en conjure ; nous avons assez souffert l'un et l'autre ; ne nous soyons pas, l’un à l’autre, une cause de souffrances nouvelles. Ayons pitié l’un de l'autre. Et que Dieu ait pitié de tous deux ! Je me défends du mieux que je puis mais j’ai le cœur serré. Dites-moi que vous êtes mieux ; mais ne me mentez pas. Vous pouvez être tranquille sur Paris. Il n’y aura infailliblement point de pillage très probablement, point d'émeute, et probablement rien du tout. Le procès se passe dans un calme profond, dans la salle et autour de la salle. Les accusés ne sont pas même insolents. En cas de condamnation à mort seulement, on peut craindre quelque tentative, tentative d'assassinat, d'enlèvement, de coup fourré, qui sera déjoué, mais dont il est difficile de prévoir le mode. On croit à deux condamnations à mort. Le procès sera moins long qu’on n'imaginait. Les interrogatoires marchent vite. Pozzo a pu partir, car il est arrivé à Calais. Une dépêche télégraphique l’a annoncé ce matin. L’envie dont je vous parlais l'autre jour s'est manifestée. Le marquis de Dalmatie est allé trouver M. Duchâtel pour lui demander de la part du Maréchal, s'il croyait possible de me déterminer à aller à Constantinople. C’est décidément M. de Rumigny qui ira à Madrid et M. de Dalmatie, sera nomme à Turin. Le Duc de Montebello se désole de rester Ambassadeur à Naples in partibus. Le Roi de Naples est toujours mal et ne remplace pas M. de Ludolf. C’est Mad. la Dauphine qui a fait rompre le mariage de Mademoiselle avec le comte de Lecce, par vertu et pour ne pas sacrifier cette jeune Princesse à une espèce d’idiot.
8 heures et demie
Je viens de dîner au café de Paris, avec M. Duvergier de Hauranne, uniquement occupé des chemins de fer, qu’on discutera après l'Orient. Dans mes études, je n'ai jamais eu aucun goût pour les sciences physiques. Je reste fidèle à cette disposition. Il me faut des hommes à remuer. Les pierres m'ennuient.
Lundi 8 heures
Il fait froid. Je viens de faire faire du feu. Ce temps là vous gâte vos promenades, tout ce que vous avez de bon à Baden, n’est-ce pas ? Mes enfants m'écrivent qu’il pleut sans cesse au Val-Richer. Pour eux, ils ne s’en promènent guère moins. Ils sont très bien. Guillaume a été un peu enrhumé, mais sans la moindre conséquence. Ma mère est très bien aussi. Montrond me dit que décidément il ira à Baden. Mais il va d’abord à des eaux de malade, je ne sais lesquelles, dix en Savoie, je crois. J’ai peur qu’il ne vous arrive bien tard. Adieu. Donnez-moi de meilleures nouvelles si vous voulez que je ne sois pas triste et abattu. Ce n'est pourtant pas le moment.
La discussion sur l'Orient commence aujourd’hui. J’ai envie de parler et je doute. On dit que M. de Lamartine dira toutes sortes de choses, qu'il faut tuer, l’Empire Ottoman parce qu’il va mourir qu’il faut vous donner Constantinople pour l'ôter aux Barbares, & Adieu. Adieu.
10 heures
J’aime les plaisirs inattendus. J’aime les exigences. Je les rends. Je puis donner beaucoup, beaucoup beaucoup plus qu’on ne sait ; mais je veux reprendre tout ce que je donne. Je vous écrirai demain. Je vous écrirai deux fois par jour, si vous voulez me promettre de vous bien porter. Vous me dites que vous pensez sans cesse à moi. Je vous défie d'envoyer vers moi une pensée qui n'en rencontre une de moi vers vous. Je suis sujet à vous de fier. On dit que j'ai l’esprit actif. J’ai le cœur bien plus actif que l’esprit ; et il me passe bien plus de peines ou de joies dans l'âme que d’idées dans la tête. Mais l’esprit montre tout ce qu’il a, & l'âme en cache beaucoup. Je m'arrête, car j'irais à des subtilités de théologiens ou de Bramine. Il y a du vrai pourtant dans ce que je vous dis là. Adieu jusqu’à demain. Je vais déjeuner & puis me promener en allant à la Chambre. Je ne fais point de visites. Adieu.
205. Paris, Mardi 2 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
205 Paris, mardi 2 Juillet 1839 9 h 1/2
A mon grand regret, et contre mon dessein, je ne puis vous écrire aujourd’hui qu’en courant. La discussion d'Orient a pris hier plus détendue et d'importance qu’on ne s’y attendait. Je parlerai aujourd'hui. La politique du Cabinet du 11 octobre en 1833 a été attaquée par le duc de Valmy. Je la défendrai en passant mais je la défendrai, et il faut que j'en cause ce matin avec le Duc de Broglie qui a les dépêches. Mon temps est pris. Quatre discours ont été écoutés hier et le méritaient. M. de Valmy et très habilement mêlé et confondue le fond de la question avec la tactique Carliste. Si vous le lisez, vous me direz ce que vous pensez d’un Ambassadeur qui écrit des lettres particulières contre les instructions qu’il a reçues et exécutées. M. de Valmy n'a jamais voulu prononcer à la tribune le nom de l’amiral Roussin, quoique j'aie pu faire pour l'y obliger. Il a eu raison. Mais alors il ne fallait pas lire la lettre. M. de Carné a bien défendu le Pacha. M. de Lamartine a été très brillant. Il a du bon sens une demi-heure et il l'emploie à la critique des idées d'autrui. Cela fait, quand il parle de ses propres idées et pour son propre compte, ce sont les mille et une nuits. Mais elles vaut mieux à l'Orient qu'ailleurs, M. Villemin a été sensé vif, et quelquefois éloquent. Il a eu du succès. Vous voyez que je suis plein de mon sujet. Je suis très convaincu que vous ne viendrez pas à un congrès, quoique j’aie rencontré l’espérance contraire. Mais on est crédule à l'espérance. Sachez seulement que cette affaire là vient d’entrer dans les préoccupations publiques. C'est pour la première fois.
Rien de nouveau du Procès. Il se trame. Le Chancelier est las et mou. La Chambre n’est pas dirigée. Nous sommes fort tranquilles. Adieu. Voilà le Duc de Broglie. J’attendrai avec impatience des nouvelles de vos bains de sel et d’aromates. J'attendais presque, un mot de vous ce matin, un mot seulement, mais le début de notre nouveau régime. Vous voulez des nouvelles tous les jours, et moi je veux de vos nouvelles tous les jours. Rien de plus. Je ne veux pas vous fatiguer. Vous m'écrirez longuement quand vous pourrez. Mais de vos nouvelles. Adieu. Adieu. G
A mon grand regret, et contre mon dessein, je ne puis vous écrire aujourd’hui qu’en courant. La discussion d'Orient a pris hier plus détendue et d'importance qu’on ne s’y attendait. Je parlerai aujourd'hui. La politique du Cabinet du 11 octobre en 1833 a été attaquée par le duc de Valmy. Je la défendrai en passant mais je la défendrai, et il faut que j'en cause ce matin avec le Duc de Broglie qui a les dépêches. Mon temps est pris. Quatre discours ont été écoutés hier et le méritaient. M. de Valmy et très habilement mêlé et confondue le fond de la question avec la tactique Carliste. Si vous le lisez, vous me direz ce que vous pensez d’un Ambassadeur qui écrit des lettres particulières contre les instructions qu’il a reçues et exécutées. M. de Valmy n'a jamais voulu prononcer à la tribune le nom de l’amiral Roussin, quoique j'aie pu faire pour l'y obliger. Il a eu raison. Mais alors il ne fallait pas lire la lettre. M. de Carné a bien défendu le Pacha. M. de Lamartine a été très brillant. Il a du bon sens une demi-heure et il l'emploie à la critique des idées d'autrui. Cela fait, quand il parle de ses propres idées et pour son propre compte, ce sont les mille et une nuits. Mais elles vaut mieux à l'Orient qu'ailleurs, M. Villemin a été sensé vif, et quelquefois éloquent. Il a eu du succès. Vous voyez que je suis plein de mon sujet. Je suis très convaincu que vous ne viendrez pas à un congrès, quoique j’aie rencontré l’espérance contraire. Mais on est crédule à l'espérance. Sachez seulement que cette affaire là vient d’entrer dans les préoccupations publiques. C'est pour la première fois.
Rien de nouveau du Procès. Il se trame. Le Chancelier est las et mou. La Chambre n’est pas dirigée. Nous sommes fort tranquilles. Adieu. Voilà le Duc de Broglie. J’attendrai avec impatience des nouvelles de vos bains de sel et d’aromates. J'attendais presque, un mot de vous ce matin, un mot seulement, mais le début de notre nouveau régime. Vous voulez des nouvelles tous les jours, et moi je veux de vos nouvelles tous les jours. Rien de plus. Je ne veux pas vous fatiguer. Vous m'écrirez longuement quand vous pourrez. Mais de vos nouvelles. Adieu. Adieu. G
207. Paris, Mercredi 3 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
207 Paris, mercredi 3 Juillet 1839, 5 heures 1/2
J'ai vu ce matin, M. Urquhart. Il m'est resté deux heures. C’est un homme d’esprit et un fou, possédé contre vous d'une vrai monomanie. Pendant son dernier séjour en Orient, il ne mangeait rien qu'assaisonné d’une main Turque, bien Turque, Il vous craint pour lui-même autant que pour l'Empire Ottoman et votre Empereur le déteste encore plus que M. Marc Girardin. Il m'a accablé de compliments et d'injures. Nous venons de voter nos dix millions. 313 votants et seulement 21 boules noires. Il n’y en aurait pas eu d'avantage pour 10 millions. N'en croyez pas les journaux. Le marquis de Dalmatie ne va point à Constantinople. Sur mon refus, on y laisse l’amiral Roussin. On l’engagera seulement à ne pas écrire tant de lettres particulières. L’Amiral Lalande, qui commandait notre station, restera aussi à la tête des forces nouvelles. C’est un homme d’esprit, outre le bon marin. Il est vrai.
Après mon rêve éveillé et priant, je vous laissais seule. Je ne m'en excuse pas, mais vous me comprenez. Gardez pourtant toutes vos exigences, et repoussez toutes vos défiances. Celles ci n'auront jamais raison et les autres jamais tort. Un moment j’ai espéré suffire à votre âme à votre vie. Je n'y compte guère plus. Mais vous ne désirerez jamais rien de moi que je ne sois prêt à vous donner, et au delà. Adieu jusqu'à demain. Je vais dîner chez Madame Eynard.
Onze heures
Je rentre. Adieu encore avant de me coucher. La Grèce était là, bien contente de moi. Pauvre Grèce ! J’ai soutenu votre ouvrage. Vous auriez souri d'entendre ce matin, M. Urquhart me raconter toutes vos perfidies, quel immense et imperceptible filet vous aviez jeté sur M. Canning pour l'amener à vous, et comment il était déplorable qu’il fût mort, car il commençait à se reconnaître et à se débattre; il vous aurait échappé ; il se serait vengé ; il aurait vengé et sauvé l'Empire Ottoman. Heureusement pour vous, il est mort. Et pour la Grèce aussi, car, selon, M. Urquhart, il l’aurait défaite. Un jour aussi, vous voudrez la défaire, et c’est encore une des terreurs de M. Urquhart. Je l'ai rassuré. Je ne sais ce qui arrivera en Orient. Mais à coup sûr bien des prévisions y seront déjouées, et beaucoup de choses que nous y aurons faites, vous ou nous, pour notre compte et en passant, subsisteront et prendront une place et joueront un rôle que nous ne leur destinions pas.
Jeudi, 8 heures et demie Les amis de Thiers se désespèrent qu’il n'ait pas été ici pour cette discussion. Si vous lisez ses journaux, vous y verrez qu’'ils ont grand peur que l'envie ne me prenne d'être ministre des Affaires Etrangères. Ils m'attaquent à ce titre comme si je l'étais. A propos de Thiers, un homme de ma connaissance qui arrive de Lombardie me contait l'autre jour qu’en se promenant sur le lac de Côme le batelier qui le conduisait lui avait dit en lui montrant une villa : " C’est là que demeurait ce fameux ministre de France, avec Sa femme et sa fille. "
9 h 3/4
Je suis sans cesse interrompu. Je voudrais vous renvoyer tous les doutes, toutes les inquiétudes que suscite mon discours. Suis- je Anglais ? Suis-je Russe ? Pourquoi ai-je dit que l'Angleterre se trompait quelquefois ? Pourquoi ai-je fait tant de compliments à l'Empereur ? J'admire les badauds et les malices qu’ils voient partout.
Vous avez bien raison sur Lady Jersey. Mais ce n’est pas la persévérance de sa volonté qui fait faire ici attention à elle. Elle a été à la mode à Londres, et la mode de Londres se prolonge à Paris. Elle est partie contente de son petit séjour et un peu malade ; chargée d’emplettes. Je ne sais combien de caisses elle a emportées. Soyez tranquille sur Paris. Je n'aurai pas à faire le curieux. Le procès devient tous les jours plus petit et les précautions plus grandes. Je ne cours pas le moindre risque et la terrasse encore un peu moins que moi. Adieu. Adieu.
Nous avons froid comme, vous ; mais je fais du feu. Adieu. Pas froid. G. Ce pauvre Montrond m'écrit qu'il est malade retenu dans son lit à Versailles, par un érésipèle à la tête et des remèdes assez violents. Il me dit qu’il en a encore pour quelques jours. Si ça va bien.
J'ai vu ce matin, M. Urquhart. Il m'est resté deux heures. C’est un homme d’esprit et un fou, possédé contre vous d'une vrai monomanie. Pendant son dernier séjour en Orient, il ne mangeait rien qu'assaisonné d’une main Turque, bien Turque, Il vous craint pour lui-même autant que pour l'Empire Ottoman et votre Empereur le déteste encore plus que M. Marc Girardin. Il m'a accablé de compliments et d'injures. Nous venons de voter nos dix millions. 313 votants et seulement 21 boules noires. Il n’y en aurait pas eu d'avantage pour 10 millions. N'en croyez pas les journaux. Le marquis de Dalmatie ne va point à Constantinople. Sur mon refus, on y laisse l’amiral Roussin. On l’engagera seulement à ne pas écrire tant de lettres particulières. L’Amiral Lalande, qui commandait notre station, restera aussi à la tête des forces nouvelles. C’est un homme d’esprit, outre le bon marin. Il est vrai.
Après mon rêve éveillé et priant, je vous laissais seule. Je ne m'en excuse pas, mais vous me comprenez. Gardez pourtant toutes vos exigences, et repoussez toutes vos défiances. Celles ci n'auront jamais raison et les autres jamais tort. Un moment j’ai espéré suffire à votre âme à votre vie. Je n'y compte guère plus. Mais vous ne désirerez jamais rien de moi que je ne sois prêt à vous donner, et au delà. Adieu jusqu'à demain. Je vais dîner chez Madame Eynard.
Onze heures
Je rentre. Adieu encore avant de me coucher. La Grèce était là, bien contente de moi. Pauvre Grèce ! J’ai soutenu votre ouvrage. Vous auriez souri d'entendre ce matin, M. Urquhart me raconter toutes vos perfidies, quel immense et imperceptible filet vous aviez jeté sur M. Canning pour l'amener à vous, et comment il était déplorable qu’il fût mort, car il commençait à se reconnaître et à se débattre; il vous aurait échappé ; il se serait vengé ; il aurait vengé et sauvé l'Empire Ottoman. Heureusement pour vous, il est mort. Et pour la Grèce aussi, car, selon, M. Urquhart, il l’aurait défaite. Un jour aussi, vous voudrez la défaire, et c’est encore une des terreurs de M. Urquhart. Je l'ai rassuré. Je ne sais ce qui arrivera en Orient. Mais à coup sûr bien des prévisions y seront déjouées, et beaucoup de choses que nous y aurons faites, vous ou nous, pour notre compte et en passant, subsisteront et prendront une place et joueront un rôle que nous ne leur destinions pas.
Jeudi, 8 heures et demie Les amis de Thiers se désespèrent qu’il n'ait pas été ici pour cette discussion. Si vous lisez ses journaux, vous y verrez qu’'ils ont grand peur que l'envie ne me prenne d'être ministre des Affaires Etrangères. Ils m'attaquent à ce titre comme si je l'étais. A propos de Thiers, un homme de ma connaissance qui arrive de Lombardie me contait l'autre jour qu’en se promenant sur le lac de Côme le batelier qui le conduisait lui avait dit en lui montrant une villa : " C’est là que demeurait ce fameux ministre de France, avec Sa femme et sa fille. "
9 h 3/4
Je suis sans cesse interrompu. Je voudrais vous renvoyer tous les doutes, toutes les inquiétudes que suscite mon discours. Suis- je Anglais ? Suis-je Russe ? Pourquoi ai-je dit que l'Angleterre se trompait quelquefois ? Pourquoi ai-je fait tant de compliments à l'Empereur ? J'admire les badauds et les malices qu’ils voient partout.
Vous avez bien raison sur Lady Jersey. Mais ce n’est pas la persévérance de sa volonté qui fait faire ici attention à elle. Elle a été à la mode à Londres, et la mode de Londres se prolonge à Paris. Elle est partie contente de son petit séjour et un peu malade ; chargée d’emplettes. Je ne sais combien de caisses elle a emportées. Soyez tranquille sur Paris. Je n'aurai pas à faire le curieux. Le procès devient tous les jours plus petit et les précautions plus grandes. Je ne cours pas le moindre risque et la terrasse encore un peu moins que moi. Adieu. Adieu.
Nous avons froid comme, vous ; mais je fais du feu. Adieu. Pas froid. G. Ce pauvre Montrond m'écrit qu'il est malade retenu dans son lit à Versailles, par un érésipèle à la tête et des remèdes assez violents. Il me dit qu’il en a encore pour quelques jours. Si ça va bien.
210. Paris, Samedi 6 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
210. Paris, samedi 6 juillet 1839 9 heures du soir.
Si je ne me trompe, à partir de demain Dimanche, j’aurai de vos nouvelles tous les jours. Voilà une heure que cette idée fait mon plaisir en me promenant aux Champs-Elysées, sans rien voir que votre image dans ma mémoire, sans rien entendre que le bruit de mes pas. Il n’y a point de montagnes, point de forêts, point de belles ruines ou de belle nature qui vaillent un doux souvenir solitairement recueilli et goûté. C'est une impression singulière que celle des sentiments de la jeunesse éprouvée quand on n’est plur jeune. Il y a je ne sais quel mélange de passion et de détachement. Il semble qu’on soit en même temps acteur et spectateur. On se connait on s'observe, on se juge soi-même comme s’il s’agissait d'un autre. Et pourtant c’est bien réellement et pour son propre compte qu'on jouit ou qu’on souffre, qu’on regrette, qu’on désire, qu'on espère. Et toute la science de la réflexion, toute l'expérience de la vie, est quelque chose de bien superficiel et de bien peu puissant à côté d’une émotion vraie qui remplit le cœur et ne s’inquiète de rien.
Dimanche 8 heures
M. de Bacourt vient quelque fois vous voir à Baden, n'est-ce pas ? Seriez-vous assez bonne pour lui demander ce que c’est qu’un M. Buss membre de la seconde Chambre des Etats de Bade, qui vient de m'écrire en m'envoyant un livre de politique ? Je voudrais savoir ce que c’est avant de lui répondre. Je passerai probablement aujourd’hui toute ma matinée chez moi. Mes visites reçues, je mettrai en ordre mes papiers et ma correspondance. Je suis prodigieusement en arrière. J’aime assez à rester tout un jour sans sortir. J’irai dîner chez Madame d’Haussonville. Point de nouvelles.
En nommant M. de Rumigny à Madrid le Roi lui a dit de bien prendre garde, que s’il prenait la moindre initiative, s’il s’écartait en rien de la ligne, de conduite de son prédécesseur, il aurait affaire à lui. Rumigny appartient tout à fait air Roi. Mais le Roi se souvient qu’en suisse il était assez bien avec les radicaux. Du reste je ne sais ce qui arrive en Espagne. Personne ici n’y pense plus guère. Qu'on en fasse autant ailleurs. Je suppose que Zéa est encore à Londres. Je ne l’ai pas revu.
Onze heures
Zéa sort de chez moi, arrivé de Londres avant hier, hier soir à Neuilly, ce matin ici. Content de son voyage, des dispositions de Lord Palmerston avec qui il a fait sa paix ; encore plus de celles de Lord Melbourne ; encore plus du Duc de Wellington, et de Lord Aberdeen. Il a trouvé le Duc de Wellington, très, très changé physiquement, & moralement plus actif que jamais. L'envoi d'Aston à Madrid lui convient fort ; le départ de Lord Clarendon au moins autant. Il va passer quinze jours ici, puis il ira vous retrouver à Baden. C’est vraiment un loyal homme, et la vivacité de ses émotions me touche. On lui promet d’Espagne que la dissolution des Cortes, qu'il ne voulait pas, donnera une assemblée encore plus modérée. Je ne sais si on l’appelle optimiste ; mais à coup sûr il est bien plus sanguine in his hope que moi.
Voilà votre N°207. Ainsi, à partir de demain nous nous parlerons tous les jours. Je suis charmé que vous ayez retrouvé du sommeil. C’est bien quelque chose, en attendant les bras. C’est la préface des bras. Ne vous découragez pas; ne jetez pas votre médecin par la fenêtre. Adieu. Adieu
Si je ne me trompe, à partir de demain Dimanche, j’aurai de vos nouvelles tous les jours. Voilà une heure que cette idée fait mon plaisir en me promenant aux Champs-Elysées, sans rien voir que votre image dans ma mémoire, sans rien entendre que le bruit de mes pas. Il n’y a point de montagnes, point de forêts, point de belles ruines ou de belle nature qui vaillent un doux souvenir solitairement recueilli et goûté. C'est une impression singulière que celle des sentiments de la jeunesse éprouvée quand on n’est plur jeune. Il y a je ne sais quel mélange de passion et de détachement. Il semble qu’on soit en même temps acteur et spectateur. On se connait on s'observe, on se juge soi-même comme s’il s’agissait d'un autre. Et pourtant c’est bien réellement et pour son propre compte qu'on jouit ou qu’on souffre, qu’on regrette, qu’on désire, qu'on espère. Et toute la science de la réflexion, toute l'expérience de la vie, est quelque chose de bien superficiel et de bien peu puissant à côté d’une émotion vraie qui remplit le cœur et ne s’inquiète de rien.
Dimanche 8 heures
M. de Bacourt vient quelque fois vous voir à Baden, n'est-ce pas ? Seriez-vous assez bonne pour lui demander ce que c’est qu’un M. Buss membre de la seconde Chambre des Etats de Bade, qui vient de m'écrire en m'envoyant un livre de politique ? Je voudrais savoir ce que c’est avant de lui répondre. Je passerai probablement aujourd’hui toute ma matinée chez moi. Mes visites reçues, je mettrai en ordre mes papiers et ma correspondance. Je suis prodigieusement en arrière. J’aime assez à rester tout un jour sans sortir. J’irai dîner chez Madame d’Haussonville. Point de nouvelles.
En nommant M. de Rumigny à Madrid le Roi lui a dit de bien prendre garde, que s’il prenait la moindre initiative, s’il s’écartait en rien de la ligne, de conduite de son prédécesseur, il aurait affaire à lui. Rumigny appartient tout à fait air Roi. Mais le Roi se souvient qu’en suisse il était assez bien avec les radicaux. Du reste je ne sais ce qui arrive en Espagne. Personne ici n’y pense plus guère. Qu'on en fasse autant ailleurs. Je suppose que Zéa est encore à Londres. Je ne l’ai pas revu.
Onze heures
Zéa sort de chez moi, arrivé de Londres avant hier, hier soir à Neuilly, ce matin ici. Content de son voyage, des dispositions de Lord Palmerston avec qui il a fait sa paix ; encore plus de celles de Lord Melbourne ; encore plus du Duc de Wellington, et de Lord Aberdeen. Il a trouvé le Duc de Wellington, très, très changé physiquement, & moralement plus actif que jamais. L'envoi d'Aston à Madrid lui convient fort ; le départ de Lord Clarendon au moins autant. Il va passer quinze jours ici, puis il ira vous retrouver à Baden. C’est vraiment un loyal homme, et la vivacité de ses émotions me touche. On lui promet d’Espagne que la dissolution des Cortes, qu'il ne voulait pas, donnera une assemblée encore plus modérée. Je ne sais si on l’appelle optimiste ; mais à coup sûr il est bien plus sanguine in his hope que moi.
Voilà votre N°207. Ainsi, à partir de demain nous nous parlerons tous les jours. Je suis charmé que vous ayez retrouvé du sommeil. C’est bien quelque chose, en attendant les bras. C’est la préface des bras. Ne vous découragez pas; ne jetez pas votre médecin par la fenêtre. Adieu. Adieu
211. Paris, Lundi 8 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
211 Paris lundi 8 Juillet 1839, 8 heures
Je n'ai pu lire ceci sans sourire. Je ne savais pas que vous attendiez mes lettres comme moi j’attends les vôtres. Si j’allais vous ennuyer : " Vous êtes, dirai-je incorrigible, ou incurable ? Ce n'est pas parce que vos lettres m'amusent que je les attends impatiemment ; quand elles m’attristent, je les attends plus impatiemment encore. Je vous aime. Voilà ma raison, qui dispense de toutes les autres. Il y a dans l’évangile une admirable parole : " Cherchez premièrement la sagesse ; tout le reste vous sera donné par dessous. " La tendresse a le même privilège que la sagesse ; là où elle est tout le reste vient par dessus.
Vous avez bien fait de mettre le comte Frédéric Pahlen et Matonchewitz un peu en garde. Je ne doute guère des retards factices, par humeur et vengeance. Mais puisqu'il se sent obligé à la réserve, cela ne peut aller très loin, pourvu que, de leur côté, vos fondés de pouvoir pressent au lieu de tolérer la langueur. C’est donc sur eux qu’il faut agir. M. Sampayo, qui arrive de Lisbonne dit sur l’Espagne des choses curieuses. L’anarchie y est plus grande, et le gouvernement plus impuissant que jamais. Mais à travers l’anarchie, l'activité est grande aussi dans le pays et la prospérité croissante. Il y a beaucoup plus de terres cultivées, de maisons neuves. Le commerce se répand ; des établissements de tout genre se forment ; le luxe augmente. Bref, c’est un pays qui se développe du lieu de se détruire. Et l’idée que Don Carlos ne peut rien, que le gouvernement de la Reine, bon ou mauvais, est, après tout, celui qui subsistera, cette idée devient générale. M. Sampayo ajoute que les partisans de la non-intervention ont eu raison, qu'évidemment on aurait eu tort d'intervenir, et que l’Espagne s'en tirera dans cela. Voilà qui fera bien plaisir à Zéa. M. Sampayo n’est pas content de sa campagne contre le duc de Palmella. Il s’en venge en retenant, je ne sais sous quel prétexte légal, la plus grande partie de la fortune jusqu’à ce que la marquise de Fayal ait 24 ans. Pure vengeance, car il n'en joint point ; tout s'accumule et il faudra tout rendre. Mais enfin plaisir de vengeance.
Il n'y a personne de votre connaissance à Dieppe. Vous serez partout plus seule qu’à Baden, excepté en Angleterre. Est-ce que ce sommeil que vous avez un peu retrouvé ne vous repose pas ? Comment va l'appétit ? Je fais des questions et je sais les réponses. Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir vous envoyer autre chose que des paroles. Je me suis heurté plus d’une fois en ma vie contre les limites de notre puissance, quel que soit le désir. C’est un sentiment très amer. Adieu Adieu G.
Je n'ai pu lire ceci sans sourire. Je ne savais pas que vous attendiez mes lettres comme moi j’attends les vôtres. Si j’allais vous ennuyer : " Vous êtes, dirai-je incorrigible, ou incurable ? Ce n'est pas parce que vos lettres m'amusent que je les attends impatiemment ; quand elles m’attristent, je les attends plus impatiemment encore. Je vous aime. Voilà ma raison, qui dispense de toutes les autres. Il y a dans l’évangile une admirable parole : " Cherchez premièrement la sagesse ; tout le reste vous sera donné par dessous. " La tendresse a le même privilège que la sagesse ; là où elle est tout le reste vient par dessus.
Vous avez bien fait de mettre le comte Frédéric Pahlen et Matonchewitz un peu en garde. Je ne doute guère des retards factices, par humeur et vengeance. Mais puisqu'il se sent obligé à la réserve, cela ne peut aller très loin, pourvu que, de leur côté, vos fondés de pouvoir pressent au lieu de tolérer la langueur. C’est donc sur eux qu’il faut agir. M. Sampayo, qui arrive de Lisbonne dit sur l’Espagne des choses curieuses. L’anarchie y est plus grande, et le gouvernement plus impuissant que jamais. Mais à travers l’anarchie, l'activité est grande aussi dans le pays et la prospérité croissante. Il y a beaucoup plus de terres cultivées, de maisons neuves. Le commerce se répand ; des établissements de tout genre se forment ; le luxe augmente. Bref, c’est un pays qui se développe du lieu de se détruire. Et l’idée que Don Carlos ne peut rien, que le gouvernement de la Reine, bon ou mauvais, est, après tout, celui qui subsistera, cette idée devient générale. M. Sampayo ajoute que les partisans de la non-intervention ont eu raison, qu'évidemment on aurait eu tort d'intervenir, et que l’Espagne s'en tirera dans cela. Voilà qui fera bien plaisir à Zéa. M. Sampayo n’est pas content de sa campagne contre le duc de Palmella. Il s’en venge en retenant, je ne sais sous quel prétexte légal, la plus grande partie de la fortune jusqu’à ce que la marquise de Fayal ait 24 ans. Pure vengeance, car il n'en joint point ; tout s'accumule et il faudra tout rendre. Mais enfin plaisir de vengeance.
Il n'y a personne de votre connaissance à Dieppe. Vous serez partout plus seule qu’à Baden, excepté en Angleterre. Est-ce que ce sommeil que vous avez un peu retrouvé ne vous repose pas ? Comment va l'appétit ? Je fais des questions et je sais les réponses. Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir vous envoyer autre chose que des paroles. Je me suis heurté plus d’une fois en ma vie contre les limites de notre puissance, quel que soit le désir. C’est un sentiment très amer. Adieu Adieu G.
213. Paris, Mardi 9 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
213 Paris, mardi 9 Juillet 1839 5 heures
Je reviens de la Chambre. On a saisi cette nuit la presse clandestine du Moniteur républican, et l’un des principaux auteurs, meneurs. La police est fort active depuis quelque temps, et M. Delessert n’a pas manqué de bonheur. Il a un coup de collier à donner. L’arrêt sera rendu demain. Le parti de loin comme de près. Je remue beaucoup pour sauver Barbès M. Laffitte avait déposé ce matin une proposition contre la peine de mort. On l’a décidé à la retirer, M. Garnier-Pages a fait demander aux archives de la Chambre copie des pétitions présentées en 1830 par les blessés de Juillet pour l'abolition de la peine de mort en matière politique, dans tout cela, rien que du mouvement mais du mouvement. La session va finir. On commence demain la discussion du budget. Elle ne durera pas plus de dix ou douze jours.
Le débat sur l'Orient n'a été bon dans le Cabinet, qu'à M. Villemain. Il disait à un homme de ma connaissance « J’ai sauvé le Ministère. - Sauve qui peut." lui a-t-on répondu. Du reste le Roi est fort tranquille, sur l'Orient. Il est parfaitement d'accord avec Vienne, et d'accord avec Londres. A propos de Vienne, j'ai vu ce matin quelqu'un qui en arrive et qui dit que M. de Metternich est bien fatigué, bien cassé, que sa mémoire faiblit beaucoup sur les choses récentes, qu’il devient dévôt & &. Il est venu de lui, naguères, sur l'Orient une grande dépêche très pompeuse, très métaphysique, parfaitement doctrinaire, mais fort semblable à beaucoup d’autres que j’ai vues autrefois ; ni moins bonne au fond, ni meilleure dans la forme.
Madame de Boigne, vient demain passer la soirée à Paris, et j’irai samedi dîner à Châtenay. Voilà mes nouvelles de ce matin. Si vous en voulez de hors Paris, je vous dirai que le Val-Richer a été grêlé et que mon fermier prétend que sa récolte de blé est perdue. Mercredi, Midi. Je ne sais pourquoi le courrier est arrivé plus tard ce matin. Et comme la séance commence plutôt, je suis pressé. On veut mettre les morceaux en quatre. Notre Chambre finira avec la semaine prochaine.
J’ai dîné hier chez le Garde des sceaux avec tout ce qu’il y a ici d’ambassadeurs, c’est-à-dire tous, sauf le vôtre. Même le Turc, qui a assisté, avec toute son Ambassade, à notre débat sur l'Orient. De choquante pour nous, comme nos paroles l’étaient pour lui. Nous avions l’air de faire une autopsie devant la famille. Un de ses secrétaires n'a pu y tenir et a quitté un jour la séance, très ému et irrité. Lord Granville ne quittera pas Paris, quoique son médécin l’engage à changer d’air, s’il veut n'avoir pas de goutte l’hiver prochain. Le Duc de Devonshire vient d’arriver.
Je ne vous parle que de choses insignifiantes. Il faut que je sorte. Je garde vos affaires, votre santé et nous pour ce soir. J’ai tant à vous dire ! Et je vous dirais si peu ! Adieu. Adieu G.
Je reviens de la Chambre. On a saisi cette nuit la presse clandestine du Moniteur républican, et l’un des principaux auteurs, meneurs. La police est fort active depuis quelque temps, et M. Delessert n’a pas manqué de bonheur. Il a un coup de collier à donner. L’arrêt sera rendu demain. Le parti de loin comme de près. Je remue beaucoup pour sauver Barbès M. Laffitte avait déposé ce matin une proposition contre la peine de mort. On l’a décidé à la retirer, M. Garnier-Pages a fait demander aux archives de la Chambre copie des pétitions présentées en 1830 par les blessés de Juillet pour l'abolition de la peine de mort en matière politique, dans tout cela, rien que du mouvement mais du mouvement. La session va finir. On commence demain la discussion du budget. Elle ne durera pas plus de dix ou douze jours.
Le débat sur l'Orient n'a été bon dans le Cabinet, qu'à M. Villemain. Il disait à un homme de ma connaissance « J’ai sauvé le Ministère. - Sauve qui peut." lui a-t-on répondu. Du reste le Roi est fort tranquille, sur l'Orient. Il est parfaitement d'accord avec Vienne, et d'accord avec Londres. A propos de Vienne, j'ai vu ce matin quelqu'un qui en arrive et qui dit que M. de Metternich est bien fatigué, bien cassé, que sa mémoire faiblit beaucoup sur les choses récentes, qu’il devient dévôt & &. Il est venu de lui, naguères, sur l'Orient une grande dépêche très pompeuse, très métaphysique, parfaitement doctrinaire, mais fort semblable à beaucoup d’autres que j’ai vues autrefois ; ni moins bonne au fond, ni meilleure dans la forme.
Madame de Boigne, vient demain passer la soirée à Paris, et j’irai samedi dîner à Châtenay. Voilà mes nouvelles de ce matin. Si vous en voulez de hors Paris, je vous dirai que le Val-Richer a été grêlé et que mon fermier prétend que sa récolte de blé est perdue. Mercredi, Midi. Je ne sais pourquoi le courrier est arrivé plus tard ce matin. Et comme la séance commence plutôt, je suis pressé. On veut mettre les morceaux en quatre. Notre Chambre finira avec la semaine prochaine.
J’ai dîné hier chez le Garde des sceaux avec tout ce qu’il y a ici d’ambassadeurs, c’est-à-dire tous, sauf le vôtre. Même le Turc, qui a assisté, avec toute son Ambassade, à notre débat sur l'Orient. De choquante pour nous, comme nos paroles l’étaient pour lui. Nous avions l’air de faire une autopsie devant la famille. Un de ses secrétaires n'a pu y tenir et a quitté un jour la séance, très ému et irrité. Lord Granville ne quittera pas Paris, quoique son médécin l’engage à changer d’air, s’il veut n'avoir pas de goutte l’hiver prochain. Le Duc de Devonshire vient d’arriver.
Je ne vous parle que de choses insignifiantes. Il faut que je sorte. Je garde vos affaires, votre santé et nous pour ce soir. J’ai tant à vous dire ! Et je vous dirais si peu ! Adieu. Adieu G.
212. Baden, Mercredi 10 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
212 Baden le 10 juillet 1839 9 heures
La mort de cette pauvre Lady Flora Hastings me parait un bien mauvais événement. Si vous causez avec Pozzo demandez lui ce qu'il pense de l’impression que cela fera sur l'opinion. En général Pozzo doit être curieux à questionner et à entendre. Je regrette de ne pas le voir. Vous me faites plaisir en m’annonçant Zéa. Mais il est bien sourd et je suis bien faible.
J'entends beaucoup dire que Bade est bien mauvais pour les personnes qui souffrent des nerfs, et maintenant je me souviens que je l'ai éprouvé moi-même les deux fois que j’y suis venue. Vous m’avez dit et même écrit je crois, que j'oubliais trop facilement tout ; vous avez raison, non pas pour tout, mais pour la plupart des choses qui me touchent. Je ne profite pas de l’expérience, il faut convenir que l’affaire de Bade est une pauvre bêtise de ma part, maintenant dites-moi où il faut que j’aille ! Et voyez un peu tous les inconvénients matériels et moraux qu'il y a pour moi à un déplacement. Je vous assure que j'en suis toute consternée et surement il faut prendre un parti car tous les jours je suis plus mal, & c’est visible. M. de Bacourt va prendre des renseignements sur M. Buss et vous les aurez dans peu de jours. Tout ce qu’il en sait c’est qu’il est professeur de l’université de Fribourg.
D’après les dernières nouvelles de Vienne, l’état du Sultan est désespéré ; cela va faire une grosse complication. Je vous remercie de vous promener aux Champs Elysées en pensant à moi. Je me trouve un si pitoyable objet que j’ai peine à comprendre qu'on y pense. Mon Dieu que je suis découragée ! Voilà le médecin qui sort de chez moi, et qui me conseille d’aller chercher les bains de mer. Mon pouls l'inquiète et il veut je crois se débarrasser d'un malade compromettant. Mais avec qui aller, où aller ?
5 heures
J’ai vu une lettre de Vienne dans laquelle il est dit que le Cabinet est consterné de la nouvelle de Constantinople. Le Prince de Metternich se flatte d’établir une conférence à Vienne sur les affaires de l’Orient. J"en serais fort étonnée. Voici votre lettre. Que vous êtes bon de m’écrire si assidûment que vous me faites plaisir. Je n'ai plus que ce plaisir. Je n’attends que cela, je n’aime que cela. Adieu dans ce moment je me sens un peu mieux. Vous voyez que j'ai hâte de vous le dire. Adieu. Adieu.
La mort de cette pauvre Lady Flora Hastings me parait un bien mauvais événement. Si vous causez avec Pozzo demandez lui ce qu'il pense de l’impression que cela fera sur l'opinion. En général Pozzo doit être curieux à questionner et à entendre. Je regrette de ne pas le voir. Vous me faites plaisir en m’annonçant Zéa. Mais il est bien sourd et je suis bien faible.
J'entends beaucoup dire que Bade est bien mauvais pour les personnes qui souffrent des nerfs, et maintenant je me souviens que je l'ai éprouvé moi-même les deux fois que j’y suis venue. Vous m’avez dit et même écrit je crois, que j'oubliais trop facilement tout ; vous avez raison, non pas pour tout, mais pour la plupart des choses qui me touchent. Je ne profite pas de l’expérience, il faut convenir que l’affaire de Bade est une pauvre bêtise de ma part, maintenant dites-moi où il faut que j’aille ! Et voyez un peu tous les inconvénients matériels et moraux qu'il y a pour moi à un déplacement. Je vous assure que j'en suis toute consternée et surement il faut prendre un parti car tous les jours je suis plus mal, & c’est visible. M. de Bacourt va prendre des renseignements sur M. Buss et vous les aurez dans peu de jours. Tout ce qu’il en sait c’est qu’il est professeur de l’université de Fribourg.
D’après les dernières nouvelles de Vienne, l’état du Sultan est désespéré ; cela va faire une grosse complication. Je vous remercie de vous promener aux Champs Elysées en pensant à moi. Je me trouve un si pitoyable objet que j’ai peine à comprendre qu'on y pense. Mon Dieu que je suis découragée ! Voilà le médecin qui sort de chez moi, et qui me conseille d’aller chercher les bains de mer. Mon pouls l'inquiète et il veut je crois se débarrasser d'un malade compromettant. Mais avec qui aller, où aller ?
5 heures
J’ai vu une lettre de Vienne dans laquelle il est dit que le Cabinet est consterné de la nouvelle de Constantinople. Le Prince de Metternich se flatte d’établir une conférence à Vienne sur les affaires de l’Orient. J"en serais fort étonnée. Voici votre lettre. Que vous êtes bon de m’écrire si assidûment que vous me faites plaisir. Je n'ai plus que ce plaisir. Je n’attends que cela, je n’aime que cela. Adieu dans ce moment je me sens un peu mieux. Vous voyez que j'ai hâte de vous le dire. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
213. Baden, Jeudi 11 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
213 Baden Jeudi 11 juillet 1839 à 9 heures
J’ai passé une bien mauvaise nuit ce qui m’affaiblit encore. Je reprends tout à fait ma nouvelle sur le mariage Darmstadt. Il se fera. Le grand duc est décidément épris. Il reviendra à Darmstatd peut être même avant la fin de l’année. Mon fils aîné sera nommé conseiller d’état, quand on est cela chez nous on ira à tout. Je suis charmée ; cela le figera dans la carrière. Il parait qu’il a du succès à Pétersbourg, & que l’Empereur et tout le reste veulent conserver un Lieven pour de hauts emplois. S'il le veut il ira loin et je crois qu'il voudra.
5 heures
Je me sens bien malade, j’ai de la peine à vous écrire, et puis je m'en vais vous en causer de la peine, vraiment je ne sais que dirait le médecin me prie de quitter Bade au moins pour quelques jours. Je n'y puis pas m’y décider parce que dans cet état de souffrance il est absurde de m’en aller courir seule, toute seule ! Je ne sais où. Ah c'est d’être seule qui est affreux ! Jamais je ne l’ai autant senti qu’à présent. Pardonnez-moi mes lettres, vous voyez que je n’ai pas ma tête à moi. Et si je ne vous écris pas. Vous me croirez morte. Je vous écris donc & je vous dis tout. Je ne mange plus depuis huit jours mes forces diminuent beaucoup. Je dors encore mal, mais je dois. Mon pouls est bien faible, ma mine affreuse, ma maigreur plus grande qu’a Paris ; vous savez tout. Mais vous ne saurez pas me dire ce que je dois faire. Retourner à Paris serait absurde, enfin tout est absurde. Adieu. Adieu. Je n'ai que vos lettres pour me soutenir.
J’ai passé une bien mauvaise nuit ce qui m’affaiblit encore. Je reprends tout à fait ma nouvelle sur le mariage Darmstadt. Il se fera. Le grand duc est décidément épris. Il reviendra à Darmstatd peut être même avant la fin de l’année. Mon fils aîné sera nommé conseiller d’état, quand on est cela chez nous on ira à tout. Je suis charmée ; cela le figera dans la carrière. Il parait qu’il a du succès à Pétersbourg, & que l’Empereur et tout le reste veulent conserver un Lieven pour de hauts emplois. S'il le veut il ira loin et je crois qu'il voudra.
5 heures
Je me sens bien malade, j’ai de la peine à vous écrire, et puis je m'en vais vous en causer de la peine, vraiment je ne sais que dirait le médecin me prie de quitter Bade au moins pour quelques jours. Je n'y puis pas m’y décider parce que dans cet état de souffrance il est absurde de m’en aller courir seule, toute seule ! Je ne sais où. Ah c'est d’être seule qui est affreux ! Jamais je ne l’ai autant senti qu’à présent. Pardonnez-moi mes lettres, vous voyez que je n’ai pas ma tête à moi. Et si je ne vous écris pas. Vous me croirez morte. Je vous écris donc & je vous dis tout. Je ne mange plus depuis huit jours mes forces diminuent beaucoup. Je dors encore mal, mais je dois. Mon pouls est bien faible, ma mine affreuse, ma maigreur plus grande qu’a Paris ; vous savez tout. Mais vous ne saurez pas me dire ce que je dois faire. Retourner à Paris serait absurde, enfin tout est absurde. Adieu. Adieu. Je n'ai que vos lettres pour me soutenir.
215. Paris, Vendredi 12 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
215 Paris, Vendredi 12 Juillet 1839 Onze heures
Se peut-il que ce N° 211 me soit un soulagement ? Pour Dieu, faites partir vos lettres tous les jours, longues ou courtes gaies au tristes. Il me faut une lettre ; il me faut quelques lignes ; il me faut vous, vous ! Vous ne savez pas avec qu’elle horrible rapidité l'inquiétude m’envahit, me poursuit. C’est la chemise de Nessus. Je vous en conjure ; ne soyez pas malade et dites-le moi. J'ai grande pitié de vous. Ayez aussi pitié de moi. J’ai beaucoup souffert, en ma vie ; beaucoup plus que je ne l'ai laissé voir à personne. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Est-ce pour dégoût ? Ou bien ce que vous mangez vous pèse-t-il sur l'estomac ? Digérez-vous mal ? Si ce n’est que dégoût, surmontez-le un peu ! Pour moi, pour moi. Que je voudrais être là pour veiller à tout, pour tous savoir au moins. Et votre sommeil vous ne m'en parlez pas. Parlez-moi de tout, fût-ce toujours la même chose. Il n’y a en moi, toujours, qu’une même pensée. Je voudrais vous envoyer l'image complète de mes journées de ce qui les remplit en dedans. Vous verriez. Je devrais peut-être ne pas vous dire tout cela, ne pas ajouter mon inquiétude à votre fatigue. Si vous étiez près de moi, je me tairais mieux. Ne renoncez pas à marcher cela vous est bon. J'ai vu par vos lettres que vous dormiez quelquefois dans le jour. Ne vous en défendez pas.
Je veux parler d'autre chose. Nous sommes assez préoccupés ; agités dirait trop. La Cour rendra son arrêt aujourd’hui. Si Barbès est condamné à mort, le parti fera quelque démonstration, sans espoir, sans dessein sérieux même, par honneur, pour ne pas paraître frappé et mort du même coup. Peut-être quelque tentative sur la prison ; peut-être quelque coup de pistolet sur quelque voiture de Pair.
Paris est fort tranquille. Vous y seriez fort tranquille Je regarde votre lettre. Une chose m’en plait. Votre écriture est bonne et ferme.
J'ai vu Pozzo. Affreusement maigri, rétréci rapetissé, les yeux enfoncés dans un cercle de charbon, la parole chancelante, les épaules voûtées, les jambes ployées, les habits trop larges, l’esprit aussi chancelant que la parole. Nous causions seuls dans le premier petit salon de Mad. de Boigne, Edouard de Lagrange est entré. Il l’a pris pour le Marquis de Dalmatie, lui a parlé du Maréchal ; puis M. de Lagrange passé, il m'a dit tout bas : " C’est bien le marquis de Dalmatie, n’est-ce pas ? " en homme qui doute de lui-même. Pourtant, il m’a parlé longtemps de ses dernières affaires à Londres de ses conversations avec Lord Melbourne et Lord Palmerston de tout ce qu'il leur avait dit sur la nécessité de maintenir la paix sur leurs intérêts et les vôtres dans la paix ; tout cela très nettement, très spirituellement, comme par le passé avec verve dans l'imagination, en même temps qu'avec faiblesse et trouble dans le langage. Puis en finissant : " C'est ma campagne de vétéran. Un autre hiver à Londres me tuerait." Il ne s’est pas pris de goût pour l'Angleterre, en y vivant, Madame de Boigne va mieux, beaucoup mieux. Elle est retournée hier à Châtenay. J’irai y dîner demain.
Connaissez-vous un M. de Lücksbourg, bavarois, qui remplacera probablement ici M. de Jennisson ? Il est venu me voir avant hier. Je l’ai trouvé bien. Si M. de Jennisson s'en va, peut-être son appartement se trouvera-t-il vacant. C’est un peu cher, mais bien gai. A présent tout à côté de la maison est arrangé. Vous n'auriez pas de bruit. Adieu. Je vais à la Chambre. On commence de bonne heure. Pourquoi n’êtes-vous pas à la Terrasse ? Adieu. Adieu. J’aurai de vos nouvelles demain n’est-ce pas ? Ah que la vie est mal arrangée ! Adieu. G.
Se peut-il que ce N° 211 me soit un soulagement ? Pour Dieu, faites partir vos lettres tous les jours, longues ou courtes gaies au tristes. Il me faut une lettre ; il me faut quelques lignes ; il me faut vous, vous ! Vous ne savez pas avec qu’elle horrible rapidité l'inquiétude m’envahit, me poursuit. C’est la chemise de Nessus. Je vous en conjure ; ne soyez pas malade et dites-le moi. J'ai grande pitié de vous. Ayez aussi pitié de moi. J’ai beaucoup souffert, en ma vie ; beaucoup plus que je ne l'ai laissé voir à personne. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Est-ce pour dégoût ? Ou bien ce que vous mangez vous pèse-t-il sur l'estomac ? Digérez-vous mal ? Si ce n’est que dégoût, surmontez-le un peu ! Pour moi, pour moi. Que je voudrais être là pour veiller à tout, pour tous savoir au moins. Et votre sommeil vous ne m'en parlez pas. Parlez-moi de tout, fût-ce toujours la même chose. Il n’y a en moi, toujours, qu’une même pensée. Je voudrais vous envoyer l'image complète de mes journées de ce qui les remplit en dedans. Vous verriez. Je devrais peut-être ne pas vous dire tout cela, ne pas ajouter mon inquiétude à votre fatigue. Si vous étiez près de moi, je me tairais mieux. Ne renoncez pas à marcher cela vous est bon. J'ai vu par vos lettres que vous dormiez quelquefois dans le jour. Ne vous en défendez pas.
Je veux parler d'autre chose. Nous sommes assez préoccupés ; agités dirait trop. La Cour rendra son arrêt aujourd’hui. Si Barbès est condamné à mort, le parti fera quelque démonstration, sans espoir, sans dessein sérieux même, par honneur, pour ne pas paraître frappé et mort du même coup. Peut-être quelque tentative sur la prison ; peut-être quelque coup de pistolet sur quelque voiture de Pair.
Paris est fort tranquille. Vous y seriez fort tranquille Je regarde votre lettre. Une chose m’en plait. Votre écriture est bonne et ferme.
J'ai vu Pozzo. Affreusement maigri, rétréci rapetissé, les yeux enfoncés dans un cercle de charbon, la parole chancelante, les épaules voûtées, les jambes ployées, les habits trop larges, l’esprit aussi chancelant que la parole. Nous causions seuls dans le premier petit salon de Mad. de Boigne, Edouard de Lagrange est entré. Il l’a pris pour le Marquis de Dalmatie, lui a parlé du Maréchal ; puis M. de Lagrange passé, il m'a dit tout bas : " C’est bien le marquis de Dalmatie, n’est-ce pas ? " en homme qui doute de lui-même. Pourtant, il m’a parlé longtemps de ses dernières affaires à Londres de ses conversations avec Lord Melbourne et Lord Palmerston de tout ce qu'il leur avait dit sur la nécessité de maintenir la paix sur leurs intérêts et les vôtres dans la paix ; tout cela très nettement, très spirituellement, comme par le passé avec verve dans l'imagination, en même temps qu'avec faiblesse et trouble dans le langage. Puis en finissant : " C'est ma campagne de vétéran. Un autre hiver à Londres me tuerait." Il ne s’est pas pris de goût pour l'Angleterre, en y vivant, Madame de Boigne va mieux, beaucoup mieux. Elle est retournée hier à Châtenay. J’irai y dîner demain.
Connaissez-vous un M. de Lücksbourg, bavarois, qui remplacera probablement ici M. de Jennisson ? Il est venu me voir avant hier. Je l’ai trouvé bien. Si M. de Jennisson s'en va, peut-être son appartement se trouvera-t-il vacant. C’est un peu cher, mais bien gai. A présent tout à côté de la maison est arrangé. Vous n'auriez pas de bruit. Adieu. Je vais à la Chambre. On commence de bonne heure. Pourquoi n’êtes-vous pas à la Terrasse ? Adieu. Adieu. J’aurai de vos nouvelles demain n’est-ce pas ? Ah que la vie est mal arrangée ! Adieu. G.
215. Baden, Samedi 13 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
215 Baden Samedi 13 juillet 1839, 1 heure
Je me sens un peu mieux aujourd’hui et je crains de vous le dire,car cela me porte malheur. J'aimerais bien mieux que vous me permissiez de ne vous parler jamais de ma santé. M. de la Redorte est arrivé, il est venu me voir. Il cause c.a.d. il raconte, et au fond pas grand chose. Voici la réponse de M. de Bacourt. Ces notions lui ont été fournies par M. de Blittersdorff, le Metternich de ce pays-ci. Des lettres de Constantinople du 25 juin disent que le sultan est dans un état désespéré. Il traînera un mois tout au plus.
5 heures
Voici votre N°214 bien tendre, bien bon, je le relirai souvent. Je vous en remercie. Vous voyez que je puis à peine vous écrire, cela me fatigue, le sang me porte à la tête, je ne suis pas bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ecrivez-moi toujours et tout. Adieu. J’ai eu une lettre d'Alexandre, très insignifiante. Il me dit seulement qu’il est très occupé. Mais quand est-ce que quelqu'un prendra la peine de me dire ce qu'on fait ? Adieu. Adieu.
Je me sens un peu mieux aujourd’hui et je crains de vous le dire,car cela me porte malheur. J'aimerais bien mieux que vous me permissiez de ne vous parler jamais de ma santé. M. de la Redorte est arrivé, il est venu me voir. Il cause c.a.d. il raconte, et au fond pas grand chose. Voici la réponse de M. de Bacourt. Ces notions lui ont été fournies par M. de Blittersdorff, le Metternich de ce pays-ci. Des lettres de Constantinople du 25 juin disent que le sultan est dans un état désespéré. Il traînera un mois tout au plus.
5 heures
Voici votre N°214 bien tendre, bien bon, je le relirai souvent. Je vous en remercie. Vous voyez que je puis à peine vous écrire, cela me fatigue, le sang me porte à la tête, je ne suis pas bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ecrivez-moi toujours et tout. Adieu. J’ai eu une lettre d'Alexandre, très insignifiante. Il me dit seulement qu’il est très occupé. Mais quand est-ce que quelqu'un prendra la peine de me dire ce qu'on fait ? Adieu. Adieu.
216. Paris, Samedi 13 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
216 Paris Samedi 18 Juillet 1839, 8 heures
J'attends. Je devrais ne rien dire de plus, car d’ici à 10 heures je suis tout là. La Cour des Pairs a rendu hier au soir son arrêt, au milieu d’un calme profond. La délibération intérieure a été solennelle. Les plus difficiles sont contents de sa gravité, de sa liberté, de sa probité. La majorité sur le point capital, Barbès a été grande 133 contre 22. Le parti de l'indulgence a été soutenu par des hommes de tous les partis et surtout par ce motif qu’il fallait craindre d'exciter le fanatisme jusqu'à la rage, et de concentrer cette rage sur une seule tête. M. Cousin a soutenu cela avec beaucoup de talent. M. Molé a bien parlé, brièvement, mais nettement, pour la condamnation à mort. Je n’ai encore vu personne ce matin ; mais rien ne m'indique qu’il y ait eu le moindre bruit cette nuit. On en attendait un peu autour de la prison. En fait de forces et de précautions, il y a du luxe. On a raison. Le Duc de Broglie repart ce matin pour la Suisse. Nous nous sommes dit adieu hier au soir. Pendant son séjour, quelques uns des ministres l’ont pressé d'entrer avec eux aux Affaires étrangères. Je l’en ai pressé moi-même, me mettant, s’il entrait, à sa disposition pour le dehors. Il a positivement refusé.
10 heures
J'attends encore. Montrond sort de chez moi, guéri de son érésipèle. Il part dans deux jours pour Bourhame. Delà à Bade. Je regrette bien qu’il m’y soit pas allé plustôt. Quoique vous l'eussiez probable. ment bientôt aisé. Il est bon à retrouver souvent, mais non pas à garder longtemps. Le Maréchal se trouve fort bien aux Affaires Etrangères, et n'a aucun dessein de les céder à personne. L'Orient va très bien, grâce à lui. Tout s’y arrange, et s’y arrangera encore mieux si le Sultan meurt. Un jeune Prince, un Divan nouveau se hâteront de faire la paix avec le Pacha. La paix donc, le Sultan vivant. Encore plus la paix, le Sultan mort. D'ailleurs, il y aura une conférence, à Vienne, et vous y viendrez. M. de Metternich vous promet. ainsi sera réglée la plus grosse affaire de l’Europe. Rien n’est tel que les petits Ministères pour les grosses affaires.
Voilà le N°212. Les dernières lignes valent Je vois que le bruit d’une conférence à Vienne est Baden, comme à Paris. M. Villemain a défendu hier son budget spirituellement mais trop plaisamment. Notre Chambre n’aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments et M. Villemain en est prodigue. C'est l’usage à l'académie. Entre gens d’esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l’esprit, les uns des autres comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut, devant l'autel. Notre Chambre ne se pique pas d’esprit, et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Adieu. J’y vais à cette Chambre qui ne se pique pas d’esprit. Je verrai aujourd'hui quand nous finirons. Adieu Adieu. Encore une fois des détails.
G.
J’irai voir Pozzo aujourd'hui ou demain à votre intention.
J'attends. Je devrais ne rien dire de plus, car d’ici à 10 heures je suis tout là. La Cour des Pairs a rendu hier au soir son arrêt, au milieu d’un calme profond. La délibération intérieure a été solennelle. Les plus difficiles sont contents de sa gravité, de sa liberté, de sa probité. La majorité sur le point capital, Barbès a été grande 133 contre 22. Le parti de l'indulgence a été soutenu par des hommes de tous les partis et surtout par ce motif qu’il fallait craindre d'exciter le fanatisme jusqu'à la rage, et de concentrer cette rage sur une seule tête. M. Cousin a soutenu cela avec beaucoup de talent. M. Molé a bien parlé, brièvement, mais nettement, pour la condamnation à mort. Je n’ai encore vu personne ce matin ; mais rien ne m'indique qu’il y ait eu le moindre bruit cette nuit. On en attendait un peu autour de la prison. En fait de forces et de précautions, il y a du luxe. On a raison. Le Duc de Broglie repart ce matin pour la Suisse. Nous nous sommes dit adieu hier au soir. Pendant son séjour, quelques uns des ministres l’ont pressé d'entrer avec eux aux Affaires étrangères. Je l’en ai pressé moi-même, me mettant, s’il entrait, à sa disposition pour le dehors. Il a positivement refusé.
10 heures
J'attends encore. Montrond sort de chez moi, guéri de son érésipèle. Il part dans deux jours pour Bourhame. Delà à Bade. Je regrette bien qu’il m’y soit pas allé plustôt. Quoique vous l'eussiez probable. ment bientôt aisé. Il est bon à retrouver souvent, mais non pas à garder longtemps. Le Maréchal se trouve fort bien aux Affaires Etrangères, et n'a aucun dessein de les céder à personne. L'Orient va très bien, grâce à lui. Tout s’y arrange, et s’y arrangera encore mieux si le Sultan meurt. Un jeune Prince, un Divan nouveau se hâteront de faire la paix avec le Pacha. La paix donc, le Sultan vivant. Encore plus la paix, le Sultan mort. D'ailleurs, il y aura une conférence, à Vienne, et vous y viendrez. M. de Metternich vous promet. ainsi sera réglée la plus grosse affaire de l’Europe. Rien n’est tel que les petits Ministères pour les grosses affaires.
Voilà le N°212. Les dernières lignes valent Je vois que le bruit d’une conférence à Vienne est Baden, comme à Paris. M. Villemain a défendu hier son budget spirituellement mais trop plaisamment. Notre Chambre n’aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments et M. Villemain en est prodigue. C'est l’usage à l'académie. Entre gens d’esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l’esprit, les uns des autres comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut, devant l'autel. Notre Chambre ne se pique pas d’esprit, et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Adieu. J’y vais à cette Chambre qui ne se pique pas d’esprit. Je verrai aujourd'hui quand nous finirons. Adieu Adieu. Encore une fois des détails.
G.
J’irai voir Pozzo aujourd'hui ou demain à votre intention.
216. Baden, Dimanche 14 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
216 Baden le 14 juillet 1839, dimanche 1 heure
Que je vous dis peu en vous écrivant tous les jours, & que de choses j’aurais à vous dire ! Que de choses à répondre à votre lettre de jeudi. Et je le pourrai si j’avais un peu plus de force. Mais vous ne savez pas comme il m’en coûte d'écrire. Comme cela me fatigue ! J’ai passé une mauvaise nuit, je ne vaux rien aujourd’hui, je ne sais que vous dire. J'ai été à l'église je n’y manque jamais. Mad. de Talleyrand ne vous écrit pas probablement parce qu’elle n'a rien de bon à vous dire sur mon compte. Je la vois extrêmement peu. Elle vient tous les deux jours passer avec moi un quart d’heure, voilà tout. C'est à près pour moi comme si elle n’était pas à Baden. Le matin je vois Mad. de Nesselrode assez longtemps. Nous nous rencontrons dans l’allée et nous y restons assises pendant une heure ou plus même. Je vais quelques fois chez elle en rentrant de ma promenade le soir. Je viens quelque fois Mad. Wellesley en calèche. J’y mène aussi Mad. de la Redorte. Le reste du temps. Je me promène avec Marie et la petite Ellice. De une à 2 heures, M. de Malzaden ou quelque autre diplomate vient chez moi me conter les nouvelles. M. de Malzaden a de l'esprit.
Aujourd’hui nous épousons M. de Leuchtenberg, je ne cesse pas d’en être choquée. Vous ai-je dit que Matonchewitz est nommé pour Stockolm, dans son audience de congé l’Empereur lui a rendu ses bonnes grâces, cela me prouve qu’il n’est pas implacable. M. de la Redorte me dit que Thiers retourne à Paris avant la fin du mois. Il me dit aussi ce que vous m’aviez mandé qu'il s’était séparé du roi en très bons termes. Il ajoute que le Roi pense à remanier le ministère. Vous à l’intérieur, Thiers, les affaires étrangères. Le Maréchal la guerre. Que tout cela pourrait se faire bientôt. Y croyez-vous ?
5 heures
Voici votre lettre. Je ne veux pas que vous soyez inquiet. Je ne me porte pas bien, quelques fois je me sens bien mal, et Je vous le dis. Mais c’est une imagination. J’ai l’estomac abîmé, je ne mange pas. Je dors peu et mal, je maigris, tout cela est exact, mais cela ne me fera pas encore mourir. Je suis très impatiente du jugement des Pairs. Je vois dans un journal qu'on chante la Varsovienne dans la rue Rivoli. Cela ne me plaît pas du tout Adieu. Adieu à demain, car vous voulez tous les jours mes pauvres lettres. Dites-moi des nouvelles. Ce pauvre Pozzo, il me parait qu’il restera à Paris. Adieu dearest.
Que je vous dis peu en vous écrivant tous les jours, & que de choses j’aurais à vous dire ! Que de choses à répondre à votre lettre de jeudi. Et je le pourrai si j’avais un peu plus de force. Mais vous ne savez pas comme il m’en coûte d'écrire. Comme cela me fatigue ! J’ai passé une mauvaise nuit, je ne vaux rien aujourd’hui, je ne sais que vous dire. J'ai été à l'église je n’y manque jamais. Mad. de Talleyrand ne vous écrit pas probablement parce qu’elle n'a rien de bon à vous dire sur mon compte. Je la vois extrêmement peu. Elle vient tous les deux jours passer avec moi un quart d’heure, voilà tout. C'est à près pour moi comme si elle n’était pas à Baden. Le matin je vois Mad. de Nesselrode assez longtemps. Nous nous rencontrons dans l’allée et nous y restons assises pendant une heure ou plus même. Je vais quelques fois chez elle en rentrant de ma promenade le soir. Je viens quelque fois Mad. Wellesley en calèche. J’y mène aussi Mad. de la Redorte. Le reste du temps. Je me promène avec Marie et la petite Ellice. De une à 2 heures, M. de Malzaden ou quelque autre diplomate vient chez moi me conter les nouvelles. M. de Malzaden a de l'esprit.
Aujourd’hui nous épousons M. de Leuchtenberg, je ne cesse pas d’en être choquée. Vous ai-je dit que Matonchewitz est nommé pour Stockolm, dans son audience de congé l’Empereur lui a rendu ses bonnes grâces, cela me prouve qu’il n’est pas implacable. M. de la Redorte me dit que Thiers retourne à Paris avant la fin du mois. Il me dit aussi ce que vous m’aviez mandé qu'il s’était séparé du roi en très bons termes. Il ajoute que le Roi pense à remanier le ministère. Vous à l’intérieur, Thiers, les affaires étrangères. Le Maréchal la guerre. Que tout cela pourrait se faire bientôt. Y croyez-vous ?
5 heures
Voici votre lettre. Je ne veux pas que vous soyez inquiet. Je ne me porte pas bien, quelques fois je me sens bien mal, et Je vous le dis. Mais c’est une imagination. J’ai l’estomac abîmé, je ne mange pas. Je dors peu et mal, je maigris, tout cela est exact, mais cela ne me fera pas encore mourir. Je suis très impatiente du jugement des Pairs. Je vois dans un journal qu'on chante la Varsovienne dans la rue Rivoli. Cela ne me plaît pas du tout Adieu. Adieu à demain, car vous voulez tous les jours mes pauvres lettres. Dites-moi des nouvelles. Ce pauvre Pozzo, il me parait qu’il restera à Paris. Adieu dearest.
220. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
220 Mardi soir 10 heures-17 Juillet 1839
Je ne trouve sous ma main ce soir que ce ridicule petit papier. Il me plait pourtant. C'est comme si je vous écrivais à la Terrasse. Je viens de dîner à côté d’elle (la Terrasse) chez le Ministre des finances, avec la Sardaigne, la Prusse et la Belgique qui sont maintenant fort bien ensemble. On dit que sur la frontière, les commissaires belges et hollandais s'accablent de politesses. Le Roi Léopold (vous dites comme moi à présent) j’arrive ici vendredi. Le Duc d'Orléans part le 5 août avec sa femme pour Bordeaux, Bayonne et les Pyrénées. Elle l'accompagnera jusqu'à Port-Vendres, en il s'embarquera pour Alger, de là à Constantine et partout où nous sommes en Afrique.
Madame la Duchesse d'Orléans reviendra à Paris avec Monsieur le duc de Nemours. La cour va ces jours-ci s’établir à St Cloud. Nous sommes assez fiers de notre empire en Orient. Les deux aides de camp du Maréchal ont emporté l’un d'Alexandrie, l’autre de Constantinople, des ordres, l'un pour Ibrahimn, l'autre pour Hafiz Pacha, leur enjoignant de s'arrêter partout où ils seraient, selon le vœu de l’Europe exprimé par la France. Nos deux messagers se seront rejoints la Syrie. M. le Ministre de la guerre m'a développé cela à table en prêtant son accent Allemand à notre vanité Gasconne. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Adieu. A demain.
Mercredi, midi
Je regrette bien qu’écrire vous fatigue. Ecrire, c’est tout ce qui nous reste pour cet été. Ne voyez là que ce que j'y mets, un regret, pas du tout un reproche. Je ne crois pas bientôt, aux arrangements dont M. de la Redorte vous a parlé. Le Roi ne songe point à remanier son Cabinet. Personne ni, probablement rien ne l'y obligera d’ici à la session. Donc tout restera. Mais le décri est grand. Lady Sandwich que la Reine vient de prendre pour dame d’honneur, est-ce la nôtre ? Pozzo parle mal de Lady Normanby et d’une ou deux autres des Dames, qui entourent la Reine. Elles lui font, et lui feront, dit-il beaucoup de tort.
J’ai vu Zéa ce matin et son frère Colombie. Il passe encore quelques jours à Paris. Il est assez content de ses nouvelles d’Espagne. Pour lui personnellement, elles sont meilleures qu’avant son voyage en Angleterre. Rumigny lui convient fort. Ils ont passé quatre ans ensemble à Dresde. Je ne m'étonne pas de l’insignifiance des lettres qui vous viennent de Pétersbourg. Je ne m'en étonne pas, le genre admis ; car en soi, tout cela est plus qu'étonnant. A l’ouvrage de l'abbé de La Mennais, j'en ajouterais volontiers un autre : de l'indifférence en matière d'affection. Que j’y dirais de choses. Je mourrai gros de vérités qui seront enfouies avec moi.
Vous savez surement que M. de Castillon est à Pétersbourg à l'heure qu’il est, & probablement sur le point d'en repartir pour Paris. Notre correspondance est très active, et vous paraissez très modérés, très conciliants. On croit en général que la mort du Sultan rendra une conférence Européenne moins urgente, et plus inévitable. La paix faite avec Méhémet Ali, tous les Pachas vont en vouloir autant. Avant un an, l'Empire Ottoman sera sans dessus dessous et il faudra bien y pourvoir. Réchid-Pacha repartira probablement pour Constantinople. On dit que c'est l'homme capable. Je l’ai trouvé homme d’esprit mais d’apparence bien chétive et timide. Je vous dis là bien des pauvretés. Je vous envoie le monde comme il est. J’en aimerais mieux un autre. Il est difficile à faire. Si vous étiez là, j'oublierais celui-ci. Adieu. Je vous écrirai encore demain de Paris et samedi du Val-Richer. Adieu. Adieu. G.
Je ne trouve sous ma main ce soir que ce ridicule petit papier. Il me plait pourtant. C'est comme si je vous écrivais à la Terrasse. Je viens de dîner à côté d’elle (la Terrasse) chez le Ministre des finances, avec la Sardaigne, la Prusse et la Belgique qui sont maintenant fort bien ensemble. On dit que sur la frontière, les commissaires belges et hollandais s'accablent de politesses. Le Roi Léopold (vous dites comme moi à présent) j’arrive ici vendredi. Le Duc d'Orléans part le 5 août avec sa femme pour Bordeaux, Bayonne et les Pyrénées. Elle l'accompagnera jusqu'à Port-Vendres, en il s'embarquera pour Alger, de là à Constantine et partout où nous sommes en Afrique.
Madame la Duchesse d'Orléans reviendra à Paris avec Monsieur le duc de Nemours. La cour va ces jours-ci s’établir à St Cloud. Nous sommes assez fiers de notre empire en Orient. Les deux aides de camp du Maréchal ont emporté l’un d'Alexandrie, l’autre de Constantinople, des ordres, l'un pour Ibrahimn, l'autre pour Hafiz Pacha, leur enjoignant de s'arrêter partout où ils seraient, selon le vœu de l’Europe exprimé par la France. Nos deux messagers se seront rejoints la Syrie. M. le Ministre de la guerre m'a développé cela à table en prêtant son accent Allemand à notre vanité Gasconne. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Adieu. A demain.
Mercredi, midi
Je regrette bien qu’écrire vous fatigue. Ecrire, c’est tout ce qui nous reste pour cet été. Ne voyez là que ce que j'y mets, un regret, pas du tout un reproche. Je ne crois pas bientôt, aux arrangements dont M. de la Redorte vous a parlé. Le Roi ne songe point à remanier son Cabinet. Personne ni, probablement rien ne l'y obligera d’ici à la session. Donc tout restera. Mais le décri est grand. Lady Sandwich que la Reine vient de prendre pour dame d’honneur, est-ce la nôtre ? Pozzo parle mal de Lady Normanby et d’une ou deux autres des Dames, qui entourent la Reine. Elles lui font, et lui feront, dit-il beaucoup de tort.
J’ai vu Zéa ce matin et son frère Colombie. Il passe encore quelques jours à Paris. Il est assez content de ses nouvelles d’Espagne. Pour lui personnellement, elles sont meilleures qu’avant son voyage en Angleterre. Rumigny lui convient fort. Ils ont passé quatre ans ensemble à Dresde. Je ne m'étonne pas de l’insignifiance des lettres qui vous viennent de Pétersbourg. Je ne m'en étonne pas, le genre admis ; car en soi, tout cela est plus qu'étonnant. A l’ouvrage de l'abbé de La Mennais, j'en ajouterais volontiers un autre : de l'indifférence en matière d'affection. Que j’y dirais de choses. Je mourrai gros de vérités qui seront enfouies avec moi.
Vous savez surement que M. de Castillon est à Pétersbourg à l'heure qu’il est, & probablement sur le point d'en repartir pour Paris. Notre correspondance est très active, et vous paraissez très modérés, très conciliants. On croit en général que la mort du Sultan rendra une conférence Européenne moins urgente, et plus inévitable. La paix faite avec Méhémet Ali, tous les Pachas vont en vouloir autant. Avant un an, l'Empire Ottoman sera sans dessus dessous et il faudra bien y pourvoir. Réchid-Pacha repartira probablement pour Constantinople. On dit que c'est l'homme capable. Je l’ai trouvé homme d’esprit mais d’apparence bien chétive et timide. Je vous dis là bien des pauvretés. Je vous envoie le monde comme il est. J’en aimerais mieux un autre. Il est difficile à faire. Si vous étiez là, j'oublierais celui-ci. Adieu. Je vous écrirai encore demain de Paris et samedi du Val-Richer. Adieu. Adieu. G.
219. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
219 Paris, mardi 16 Juillet 1839. Midi.
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
221. Paris, Mercredi 17 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
221. Paris, mercredi soir 9 heures-19 Juillet 1839
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
223. Baden, Lundi 22 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
223 Baden le 22 Juillet lundi
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
229. Val-Richer, Lundi 29 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
229 Du Val-Richer, Lundi 29 Juillet 1839 - 3 heures
Je rattraperai aisément la mesure, car l’air me plaît. Je voulais ménager votre force et vos yeux. Donnez m'en tout ce que vous voudrez. J’ai de quoi vous rendre. C'est, je crois le défenseur de l’archevêque Land qui a dit le premier qu'avec cent lapins blancs ou ne fait pas un cheval blanc. Avec cent lettres de Baden et du Val-Richer, on ne fait pas une conversation de la Terrasse. Mais j’aime mieux cent lettres que cinquante. Pourtant je ne redeviendrai quotidien qu’à partir de Jeudi 1er août.
Je mène demain mes deux filles à Caen, chez leur dentiste de province. Il faut leur ôter deux dents de lait que Brewster a voulu ajourner quand elles ont quitté Paris. Il y a un bon dentiste à Caen. J'en reviendrai après demain soir. Cette course me dérange ; mais je suis mère.
J’attends avec grande curiosité la confirmation des nouvelles d'Orient. On dit que le capitan Pacha est un homme à vous, qui avait beaucoup contribué au traité d'Unkiar-Skelessi et vous fut, aussitôt après, envoyé comme Ambassadeur. Les habiles soutiennent que tout cela n’est pas clair. Pour moi, je me suis décidément retranché les prophéties. Je veux voir.
Avez-vous entendu dire que le comte de Pahlen remplacerait Pozzo à Londres ? J’en serais fâché et pour vous et pour nous. A moins qu'on ne nous redonnât Pozzo mourant. Mais cela ne se peut guère. Votre pauvre ami de Hanovre commence à prendre peur. Il s’est chargé de plus qu’il ne peut porter. Ç'a toujours été un grand métier que celui de despote. De nos jours, il y faut Napoléon. Encore s’y est-il cassé le nez. Est-ce qu’il ne vous vient plus de lettres de là ? Du reste, il me semble qu’il vous parle toujours plus des Affaires d’autrui que des siennes. Il me semble que j'ai vu autrefois. M. de Malzahn à Paris, en 1820 et 1821. N’a-t-il pas été Ministre de Prusse à Munich, ou à Stuttgart ? Je le confonds peut-être avec un M. de Maltzen qui était aussi dans la diplomatie Prussienne ; homme d’esprit, un peu solennel.
L'humeur de la Chambre des Pairs porte ses petits fruits. On aurait voulu qu’elle fit sur le champ un second procès, pour en finir de ces gens du 12 mai, comme on en finit. Il n'y a pas du moyen. Les Pairs n’ont pas voulu en entendre parler. Leur commission d’instruction va en mettre en liberté tant qu’elle pourra, et ceux qui resteront attendront en prison que la Chambre ait un peu repris cœur aux procès. C'est encore un excellent instrument de gouvernement qu’on a bien vite usé. Les fêtes ont été on ne peut plus paisibles. Fort tièdes. Les hommes ne se réjouissent pas par commémoration. Il n'y a de solennité durable, en l’honneur d’un grand événement, que celles qui portent un caractère religieux. On ne puise un peu de durée que dans l'éternité. Notre temps a étrangement perdu l’intelligence de la durée et de ses conditions. Jamais les hommes n’ont vécu concentrés à ce point dans le présent. Petite vie, et qui fait toutes choses, à sa mesure. Et pourtant, il y a dans les idées, dans les sentiments, dans les institutions de notre temps, le germe de grandes choses très grandes. Mais pour que les grandes, choses viennent, il faut extirper les petites. On ne peut pas avoir de taillis sous les hautes futaies. Et de notre temps, les petites choses sont innombrables, petits intérêts, petits conforts, petits désirs, petit plaisirs. Il y a des facilités infinies pour dépenser sa vie et son âme en monnaie. C'est mon désespoir de voir de quoi on se contente aujourd'hui. Parmi vos raisons de me plaire, celle-ci m’a beaucoup touché, vous avez l’esprit et le cœur superbe. Cela coûte cher ; mais n’y ayez pas regret. Cela vaut encore davantage, n’est-ce pas ? Adieu pour aujourd’hui. Je vous dirai encore adieu demain avant de partir. J’oubliais de vous dire que Madane d'Haussonville est fort heureusement accouchée d’une fille. C'est ce qu'elle désirait. J’en suis charmé pour son père. Sa première couche avait été fort pénible et le tourmentait.
Mardi 9 heures 1/2
Bonjour et adieu. C'est la même chose, toujours la même et et toujours charmante. Je vous écrirai demain. Je ne vais à Caen que samedi. Encore adieu. G.
Je rattraperai aisément la mesure, car l’air me plaît. Je voulais ménager votre force et vos yeux. Donnez m'en tout ce que vous voudrez. J’ai de quoi vous rendre. C'est, je crois le défenseur de l’archevêque Land qui a dit le premier qu'avec cent lapins blancs ou ne fait pas un cheval blanc. Avec cent lettres de Baden et du Val-Richer, on ne fait pas une conversation de la Terrasse. Mais j’aime mieux cent lettres que cinquante. Pourtant je ne redeviendrai quotidien qu’à partir de Jeudi 1er août.
Je mène demain mes deux filles à Caen, chez leur dentiste de province. Il faut leur ôter deux dents de lait que Brewster a voulu ajourner quand elles ont quitté Paris. Il y a un bon dentiste à Caen. J'en reviendrai après demain soir. Cette course me dérange ; mais je suis mère.
J’attends avec grande curiosité la confirmation des nouvelles d'Orient. On dit que le capitan Pacha est un homme à vous, qui avait beaucoup contribué au traité d'Unkiar-Skelessi et vous fut, aussitôt après, envoyé comme Ambassadeur. Les habiles soutiennent que tout cela n’est pas clair. Pour moi, je me suis décidément retranché les prophéties. Je veux voir.
Avez-vous entendu dire que le comte de Pahlen remplacerait Pozzo à Londres ? J’en serais fâché et pour vous et pour nous. A moins qu'on ne nous redonnât Pozzo mourant. Mais cela ne se peut guère. Votre pauvre ami de Hanovre commence à prendre peur. Il s’est chargé de plus qu’il ne peut porter. Ç'a toujours été un grand métier que celui de despote. De nos jours, il y faut Napoléon. Encore s’y est-il cassé le nez. Est-ce qu’il ne vous vient plus de lettres de là ? Du reste, il me semble qu’il vous parle toujours plus des Affaires d’autrui que des siennes. Il me semble que j'ai vu autrefois. M. de Malzahn à Paris, en 1820 et 1821. N’a-t-il pas été Ministre de Prusse à Munich, ou à Stuttgart ? Je le confonds peut-être avec un M. de Maltzen qui était aussi dans la diplomatie Prussienne ; homme d’esprit, un peu solennel.
L'humeur de la Chambre des Pairs porte ses petits fruits. On aurait voulu qu’elle fit sur le champ un second procès, pour en finir de ces gens du 12 mai, comme on en finit. Il n'y a pas du moyen. Les Pairs n’ont pas voulu en entendre parler. Leur commission d’instruction va en mettre en liberté tant qu’elle pourra, et ceux qui resteront attendront en prison que la Chambre ait un peu repris cœur aux procès. C'est encore un excellent instrument de gouvernement qu’on a bien vite usé. Les fêtes ont été on ne peut plus paisibles. Fort tièdes. Les hommes ne se réjouissent pas par commémoration. Il n'y a de solennité durable, en l’honneur d’un grand événement, que celles qui portent un caractère religieux. On ne puise un peu de durée que dans l'éternité. Notre temps a étrangement perdu l’intelligence de la durée et de ses conditions. Jamais les hommes n’ont vécu concentrés à ce point dans le présent. Petite vie, et qui fait toutes choses, à sa mesure. Et pourtant, il y a dans les idées, dans les sentiments, dans les institutions de notre temps, le germe de grandes choses très grandes. Mais pour que les grandes, choses viennent, il faut extirper les petites. On ne peut pas avoir de taillis sous les hautes futaies. Et de notre temps, les petites choses sont innombrables, petits intérêts, petits conforts, petits désirs, petit plaisirs. Il y a des facilités infinies pour dépenser sa vie et son âme en monnaie. C'est mon désespoir de voir de quoi on se contente aujourd'hui. Parmi vos raisons de me plaire, celle-ci m’a beaucoup touché, vous avez l’esprit et le cœur superbe. Cela coûte cher ; mais n’y ayez pas regret. Cela vaut encore davantage, n’est-ce pas ? Adieu pour aujourd’hui. Je vous dirai encore adieu demain avant de partir. J’oubliais de vous dire que Madane d'Haussonville est fort heureusement accouchée d’une fille. C'est ce qu'elle désirait. J’en suis charmé pour son père. Sa première couche avait été fort pénible et le tourmentait.
Mardi 9 heures 1/2
Bonjour et adieu. C'est la même chose, toujours la même et et toujours charmante. Je vous écrirai demain. Je ne vais à Caen que samedi. Encore adieu. G.
239. Baden, Dimanche 11 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
239 Baden Dimanche le 11 août 1839 9 heures
Je me sens aujourd’hui plus faible que de coutume. Mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai bien besoin de vous pour me remettre, j’ai besoin de votre affection, de vos soins, de vos conseils, il me faut un appui. Je vous assure que je ne me conçois pas livrée encore pour bien des mois à mes seules ressources, c'est à dire à mes bien tristes pensées. Vous ne savez pas comme elles sont tristes ! Comme elles le deviennent tous les jours davantage. Les journaux confirment ce que vous me dites des nouveaux embarras ministériels. Mais je ne crois à rien. Ils iront comme ils ont été. Les Flahaut sont menacés de perdre leur seconde fille, elle crache le sang. C’est pour elle qu’ils viennent aux Eaux en Allemagne et qu’ils iront ensuite passer l'hiver en Italie.
1 heure. J’ai été à l’église. Toujours un superbe sermon. Le texte était votre lettre. Nous reverrons ceux que nous avons aimés, mais j'aime encore mieux votre lettre que ce superbe sermon. Vous avez raison. Je viens de recevoir une seconde lettre de Benkhausen qui explique tout, comme vous le dites.
J’ai l’administration et non la possession du Capital. J’écris de suite à mon frère, pour tout remettre à sa place. J'ai du regret d'avoir mal compris, pour dire la vérité c’est Mad. de Talleyrand et Bacourt qui me l’ont fait comprendre comme cela ; car vous savez bien que moi, je ne m'y entends pas. Mais il faut absolument que ce soit moi qui lève l’argent. Les droits en Angleterre emporteront 1000 £ ce qui réduit le Capital à 44800 £. Pouvez-vous me dire si dans le plein pouvoir que j’ai donné à Paris à mon frère, il est suffisamment autorisé à faire pour moi cette opération ? Je vous envoie copie de la lettre que je lui écris. Savez-vous bien que je me sens toute soulagée par cette lettre de Benkhausen ? C’est si vrai qu’étant fort malade ce matin me voilà mieux. Je suis débarrassée de ces richesses imaginaires qui m'étaient on ne peut plus désagréables.
Je viens de lire des rapports de Vienne. Vos Ambassadeurs, le vôtre, celui d'Angleterre et l’internonce sont de parfaites dupes. Le divan est entre les mains de M. de Bouteneff et c’est par lui que le divan négocie avec Méhémet Ali. Je vous dis ce qui dit la diplomatie à Vienne. Metternich est fort inquiet de ce que nous ne parlons pas. Ne vous ai-je pas toujours dit que c’était notre affaire et que nous n’entrerions pas en causerie sur cela. Adieu. Adieu mille fois, adieu. Je reçois dans ce moment une lettre de mon fils Alexandre du 31 juillet dans laquelle il me dit qu’on venait de recevoir les nouvelles de la défection du Capitan Pacha, & de la défaite de l'armée Turque, que comme cela amènera des complications graves que peuvent influer sur mes projets pour cet hiver, il se hâte de m’en donner avis !
Je me sens aujourd’hui plus faible que de coutume. Mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai bien besoin de vous pour me remettre, j’ai besoin de votre affection, de vos soins, de vos conseils, il me faut un appui. Je vous assure que je ne me conçois pas livrée encore pour bien des mois à mes seules ressources, c'est à dire à mes bien tristes pensées. Vous ne savez pas comme elles sont tristes ! Comme elles le deviennent tous les jours davantage. Les journaux confirment ce que vous me dites des nouveaux embarras ministériels. Mais je ne crois à rien. Ils iront comme ils ont été. Les Flahaut sont menacés de perdre leur seconde fille, elle crache le sang. C’est pour elle qu’ils viennent aux Eaux en Allemagne et qu’ils iront ensuite passer l'hiver en Italie.
1 heure. J’ai été à l’église. Toujours un superbe sermon. Le texte était votre lettre. Nous reverrons ceux que nous avons aimés, mais j'aime encore mieux votre lettre que ce superbe sermon. Vous avez raison. Je viens de recevoir une seconde lettre de Benkhausen qui explique tout, comme vous le dites.
J’ai l’administration et non la possession du Capital. J’écris de suite à mon frère, pour tout remettre à sa place. J'ai du regret d'avoir mal compris, pour dire la vérité c’est Mad. de Talleyrand et Bacourt qui me l’ont fait comprendre comme cela ; car vous savez bien que moi, je ne m'y entends pas. Mais il faut absolument que ce soit moi qui lève l’argent. Les droits en Angleterre emporteront 1000 £ ce qui réduit le Capital à 44800 £. Pouvez-vous me dire si dans le plein pouvoir que j’ai donné à Paris à mon frère, il est suffisamment autorisé à faire pour moi cette opération ? Je vous envoie copie de la lettre que je lui écris. Savez-vous bien que je me sens toute soulagée par cette lettre de Benkhausen ? C’est si vrai qu’étant fort malade ce matin me voilà mieux. Je suis débarrassée de ces richesses imaginaires qui m'étaient on ne peut plus désagréables.
Je viens de lire des rapports de Vienne. Vos Ambassadeurs, le vôtre, celui d'Angleterre et l’internonce sont de parfaites dupes. Le divan est entre les mains de M. de Bouteneff et c’est par lui que le divan négocie avec Méhémet Ali. Je vous dis ce qui dit la diplomatie à Vienne. Metternich est fort inquiet de ce que nous ne parlons pas. Ne vous ai-je pas toujours dit que c’était notre affaire et que nous n’entrerions pas en causerie sur cela. Adieu. Adieu mille fois, adieu. Je reçois dans ce moment une lettre de mon fils Alexandre du 31 juillet dans laquelle il me dit qu’on venait de recevoir les nouvelles de la défection du Capitan Pacha, & de la défaite de l'armée Turque, que comme cela amènera des complications graves que peuvent influer sur mes projets pour cet hiver, il se hâte de m’en donner avis !
240. Baden, Dimanche 11 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
240 Baden Lundi 12 août 1839
Je commence toujours ma matinée par un long tête à tête avec le Prince Guillaume. C’est des confidences de part et d’autre. Il me laisse toujours l’impression d'un homme qui a l’esprit très bien placé ; qui naturellement n'en a pas plus qu’il n’est convenable d'en avoir mais chez lequel la réflexion supplée à l'abondance ; qui ne ferait jamais de fautes, et qui aurait toujours le courage de continuer ce qu’il aurait une fois commencé. Je vous dis tout cela parce qu’il est destiné à devenir roi un jour. M. de Figuelmont ambassadeur d'Autriche à Pétersboug est arrivé très inopinément à Vienne. Dans ce moment c’est singulier. Et on en a été étonné, car quoiqu’il eut depuis quelques temps la permission de s’absenter de son poste l’idée n'était pas venu à M. de Metternich qu'il peut en profiter dans un moment si grave a envoyé quelqu’un à Constantinople pour seconder ou gouverner l’internonce dont on est très mécontent.
Vous avez mille fois raison, il me faut quelqu’un dans mon intérieur qui me donne des soins qui me débarrasse du détail de ma maison ; j’y ai beaucoup pensé,et savez-vous sur qui j’ai jeté les yeux ! Melle Henriette, qui était auprès de Pauline Périgord. C'est une excellente personne, et par mille considérations tout juste ce qu'il me faudrait. Je viens de lui faire proposer de venir vivre auprès de moi. Je la défraierai de tout. Je lui donnerai 1500 francs par an. Mad. deTalleyrand lui a écrit, mais je ne sais si elle mettra beaucoup de cœur à cette affaire Melle Henriette sait beaucoup ! Je viens donc de lui écrire moi-même je voudrais bien qu’elle acceptât. Quel confort ce serait pour moi ! Mais encore une fois malgré ce que Mad. de Talleyrand m'a promis, elle serait fort capable de tout faire pour l'en détourner.
2 heures. Dites-moi ce que vous pensez de cet Orient. A mes yeux la conduite du Cabinet de l’Occident est parfaitement embrouillée. Que voulez-vous ? Que veut l'Angleterre avec laquelle de ces deux cours M. de Metternich s'arrange-t-il ? Il est clair que nous ne nous arrangerons d'avance avec personne. Mais enfin qu’est-ce que tout ceci et qu’est-ce qui peut m'advenir ? Qu’est-ce que cet avis de mon fils, que mon séjour pourrait être dérangé pour l’hiver prochain ? Ah, cela par exemple, je ne vous le pardonnerais pas. Parlez-moi donc de tout cela. Tout ce qu'il y a de diplomates ici vient toujours me faire visite. Je suis un vieux diplomate aussi. En vérité je me trouve bien de l’exprimer pour toutes les choses qui ne me regardent pas, car pour celles qui me touchent je suis bien primitive n'est-ce pas ?
5 heures Je viens encore à vous pour vous remercier de votre 239. Je ne sais pas ce que je ferai. Probable ment quelque jours de Bade encore, et puis je crois Paris, mais tout cela dépendra de Lady Cowper, tout le monde me dit qu’elle arrive, il faudra bien qu'elle me le dise elle même, et puis nous nous arrangerons. Adieu. Adieu, Ah que l’automne sera long ! Vous ne me dites rien des affaires à propos Rotschild vient de m'écrire. Le premier est loué à un américain, & Jenisson ne pense pas encore à partir. Ainsi point de rue St Florentin. Demandez un peu ce que devient l’hôtel Crillon.
Je commence toujours ma matinée par un long tête à tête avec le Prince Guillaume. C’est des confidences de part et d’autre. Il me laisse toujours l’impression d'un homme qui a l’esprit très bien placé ; qui naturellement n'en a pas plus qu’il n’est convenable d'en avoir mais chez lequel la réflexion supplée à l'abondance ; qui ne ferait jamais de fautes, et qui aurait toujours le courage de continuer ce qu’il aurait une fois commencé. Je vous dis tout cela parce qu’il est destiné à devenir roi un jour. M. de Figuelmont ambassadeur d'Autriche à Pétersboug est arrivé très inopinément à Vienne. Dans ce moment c’est singulier. Et on en a été étonné, car quoiqu’il eut depuis quelques temps la permission de s’absenter de son poste l’idée n'était pas venu à M. de Metternich qu'il peut en profiter dans un moment si grave a envoyé quelqu’un à Constantinople pour seconder ou gouverner l’internonce dont on est très mécontent.
Vous avez mille fois raison, il me faut quelqu’un dans mon intérieur qui me donne des soins qui me débarrasse du détail de ma maison ; j’y ai beaucoup pensé,et savez-vous sur qui j’ai jeté les yeux ! Melle Henriette, qui était auprès de Pauline Périgord. C'est une excellente personne, et par mille considérations tout juste ce qu'il me faudrait. Je viens de lui faire proposer de venir vivre auprès de moi. Je la défraierai de tout. Je lui donnerai 1500 francs par an. Mad. deTalleyrand lui a écrit, mais je ne sais si elle mettra beaucoup de cœur à cette affaire Melle Henriette sait beaucoup ! Je viens donc de lui écrire moi-même je voudrais bien qu’elle acceptât. Quel confort ce serait pour moi ! Mais encore une fois malgré ce que Mad. de Talleyrand m'a promis, elle serait fort capable de tout faire pour l'en détourner.
2 heures. Dites-moi ce que vous pensez de cet Orient. A mes yeux la conduite du Cabinet de l’Occident est parfaitement embrouillée. Que voulez-vous ? Que veut l'Angleterre avec laquelle de ces deux cours M. de Metternich s'arrange-t-il ? Il est clair que nous ne nous arrangerons d'avance avec personne. Mais enfin qu’est-ce que tout ceci et qu’est-ce qui peut m'advenir ? Qu’est-ce que cet avis de mon fils, que mon séjour pourrait être dérangé pour l’hiver prochain ? Ah, cela par exemple, je ne vous le pardonnerais pas. Parlez-moi donc de tout cela. Tout ce qu'il y a de diplomates ici vient toujours me faire visite. Je suis un vieux diplomate aussi. En vérité je me trouve bien de l’exprimer pour toutes les choses qui ne me regardent pas, car pour celles qui me touchent je suis bien primitive n'est-ce pas ?
5 heures Je viens encore à vous pour vous remercier de votre 239. Je ne sais pas ce que je ferai. Probable ment quelque jours de Bade encore, et puis je crois Paris, mais tout cela dépendra de Lady Cowper, tout le monde me dit qu’elle arrive, il faudra bien qu'elle me le dise elle même, et puis nous nous arrangerons. Adieu. Adieu, Ah que l’automne sera long ! Vous ne me dites rien des affaires à propos Rotschild vient de m'écrire. Le premier est loué à un américain, & Jenisson ne pense pas encore à partir. Ainsi point de rue St Florentin. Demandez un peu ce que devient l’hôtel Crillon.
244. Val-Richer, Mercredi 14 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
244 Du Val Richer, Mercredi 14 août 1839, 6 heures
Je relis votre paragraphe à Benkhausen. Je suis bien aise que vous soyez restée avec lui dans ces termes là. Ils sont très convenables si j’ai raison, et bien plus si c’est vous. Dans le premier cas, vous vous serez trompée à Pétersbourg, mais non à Londres ce qui eût pu amener quelque complication désagréable. A mon tour, je vous tiens au courant de mes affaires, si on peut appeler cela des affaires. Après avoir beaucoup parlé et remué à Paris, Thiers est parti pour Lille. Avant de partir, il a manifesté le regret de n'avoir pas vu un de mes amis qui est aussi fort lié avec M. Duchâtel. Celui-ci est allé le voir. Thiers lui a parlé de moi dans les termes les plus magnifiques, puis a développé, comme vous savez qu’il développe avec une intarissable abondance, cette idée que deux hommes prépondérants ne pouvaient être simultanément dans un cabinet, que leur présence y romprait l’unité, qu’il fallait à un Cabinet, un chef, un seul chef, maître des autres ministres, que là surtout avait résidé la force de M. Molé. Quand je n’aurais point d'autre motif, celui-là me suffirait pour ne jamais me rapprocher de M. Molé. D'ailleurs, c’est bien impossible ; nous entendons l'un et l'autre avoir les Affaires étrangères. Puis, il s'est répandu en compliments sur Duchâtel vantant beaucoup son aptitude au gouvernement de l’Intérieur. Paroles assez explicites pour autoriser son interlocuteur à lui répondre, très explicitement aussi, qu’il se trompait sur Duchâtel ; que Duchâtel n’agirait jamais envers moi comme Passy et Dufaure avaient agi envers lui-même ; que le jour où lui Thiers serait Ministre, sans moi, Duchâtel se retirerait à l'instant, et qu’il ne devait compter sur l'accession ou l'appui d'aucun de mes amis, qu'autant que je serais dans le cabinet, à la place qu’il me conviendrait d'occuper ; que c'était l'avis et le parti pris des plus grands comme des plus petits ; qu’il fallait en prendre lui-même son parti ; que s'il lui convenait de s'en rapprocher de moi, de s’en rapprocher sérieusement, la session ne s’ouvrirait qu'avec nous deux ; sinon son entrée était impossible, car il déplaisait à une grande partie de la chambre, comme au Roi. Sur ce Thiers a coupé court, se rejetant dans les ténèbres de l'avenir et racontant sa conversation avec le Roi sur les affaires d'Orient ; conversation où il a étalé les opinions, les plus pacifiques, & s'en est allé comme il était venu ; le Roi, et lui n'ont pas fait un pas l'un vers l'autre. Vous voyez que tous les rapports s'accordent. et que personne ne change. Le Roi et les bourgeois de Hanovre ne changeront pas non plus. L’Autriche et la Prusse peuvent bien donner raison au Roi, mais non le tirer d’embarras. Il les y mettra elles-mêmes, voilà tout.
Voilà M. Falck ministre à Bruxelles. Il ne s'y amusera guère. J’aimerais bien mieux qu’il vînt mettre son esprit dans le corps diplomatique de Paris. Vous m’avez dit qu'il en avait vraiment beaucoup. Il trouverait de la place vide. Je suis charmé que le Prince de Prusse en ait autant (de l’esprit) que vous lui en trouvez. Il en aura besoin, car son pays en a.Trois choses ont fait la Prusse, le Protestantisme, la science et Frédéric 2. C’est une Puissance de notre temps, un peuple et un gouvernement moderne. Sa sagesse va à toute l’Europe civilisée. Celle de l’Autriche ne va qu'à l’Autriche. Je désire la prospérité de la Prusse.
9 heures et demie
Si j’ai envie de vous voir ! Adieu, adieu. Adieu Je n’ai pas envie de vous dire autre chose. Dans la journée, nous causerons. Il m'est arrivé hier du monde. G.
Je relis votre paragraphe à Benkhausen. Je suis bien aise que vous soyez restée avec lui dans ces termes là. Ils sont très convenables si j’ai raison, et bien plus si c’est vous. Dans le premier cas, vous vous serez trompée à Pétersbourg, mais non à Londres ce qui eût pu amener quelque complication désagréable. A mon tour, je vous tiens au courant de mes affaires, si on peut appeler cela des affaires. Après avoir beaucoup parlé et remué à Paris, Thiers est parti pour Lille. Avant de partir, il a manifesté le regret de n'avoir pas vu un de mes amis qui est aussi fort lié avec M. Duchâtel. Celui-ci est allé le voir. Thiers lui a parlé de moi dans les termes les plus magnifiques, puis a développé, comme vous savez qu’il développe avec une intarissable abondance, cette idée que deux hommes prépondérants ne pouvaient être simultanément dans un cabinet, que leur présence y romprait l’unité, qu’il fallait à un Cabinet, un chef, un seul chef, maître des autres ministres, que là surtout avait résidé la force de M. Molé. Quand je n’aurais point d'autre motif, celui-là me suffirait pour ne jamais me rapprocher de M. Molé. D'ailleurs, c’est bien impossible ; nous entendons l'un et l'autre avoir les Affaires étrangères. Puis, il s'est répandu en compliments sur Duchâtel vantant beaucoup son aptitude au gouvernement de l’Intérieur. Paroles assez explicites pour autoriser son interlocuteur à lui répondre, très explicitement aussi, qu’il se trompait sur Duchâtel ; que Duchâtel n’agirait jamais envers moi comme Passy et Dufaure avaient agi envers lui-même ; que le jour où lui Thiers serait Ministre, sans moi, Duchâtel se retirerait à l'instant, et qu’il ne devait compter sur l'accession ou l'appui d'aucun de mes amis, qu'autant que je serais dans le cabinet, à la place qu’il me conviendrait d'occuper ; que c'était l'avis et le parti pris des plus grands comme des plus petits ; qu’il fallait en prendre lui-même son parti ; que s'il lui convenait de s'en rapprocher de moi, de s’en rapprocher sérieusement, la session ne s’ouvrirait qu'avec nous deux ; sinon son entrée était impossible, car il déplaisait à une grande partie de la chambre, comme au Roi. Sur ce Thiers a coupé court, se rejetant dans les ténèbres de l'avenir et racontant sa conversation avec le Roi sur les affaires d'Orient ; conversation où il a étalé les opinions, les plus pacifiques, & s'en est allé comme il était venu ; le Roi, et lui n'ont pas fait un pas l'un vers l'autre. Vous voyez que tous les rapports s'accordent. et que personne ne change. Le Roi et les bourgeois de Hanovre ne changeront pas non plus. L’Autriche et la Prusse peuvent bien donner raison au Roi, mais non le tirer d’embarras. Il les y mettra elles-mêmes, voilà tout.
Voilà M. Falck ministre à Bruxelles. Il ne s'y amusera guère. J’aimerais bien mieux qu’il vînt mettre son esprit dans le corps diplomatique de Paris. Vous m’avez dit qu'il en avait vraiment beaucoup. Il trouverait de la place vide. Je suis charmé que le Prince de Prusse en ait autant (de l’esprit) que vous lui en trouvez. Il en aura besoin, car son pays en a.Trois choses ont fait la Prusse, le Protestantisme, la science et Frédéric 2. C’est une Puissance de notre temps, un peuple et un gouvernement moderne. Sa sagesse va à toute l’Europe civilisée. Celle de l’Autriche ne va qu'à l’Autriche. Je désire la prospérité de la Prusse.
9 heures et demie
Si j’ai envie de vous voir ! Adieu, adieu. Adieu Je n’ai pas envie de vous dire autre chose. Dans la journée, nous causerons. Il m'est arrivé hier du monde. G.
Mots-clés : Diplomatie, Parcours politique, Politique (France), Politique (Prusse), Protestantisme
246. Val -Richer, Vendredi 16 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
246 Du Val-Richer Vendredi 16 août 1839 8 h. 3/4
Je n’ai que le temps de vous dire adieu. J’ai eu du monde hier le matin une grande promenade le soir la migraine. Je viens de me lever très tard, et il faut que j'écrive à M. Duchâtel pour une affaire. Car j'ai les affaires d’une foule de gens à défaut des miennes. C’est un grand ennui.
Je reviens aux paroles d'Alexandre qui donnent pour moi, aux nouvelles d'Orient, un double, triple intérêt. Décidément, je ne crois à aucune complication grave. Si c’est nous qui servons de médiateurs entre le Pacha et la Porte nous les accommoderons sans guerre ; et si c’est vous, si nos ambassadeurs sont des dupes, vous accommoderez aussi. Cela prouve même que vous voulez accommoder. Question et combat d'influences ; rien de plus jusqu'ici.
Que feriez-vous, s’il y avait autre chose ? Où iriez-vous ? Iriez-vous quelque part ? Seriez-vous malade ? L'Angleterre ne vous vaudrait pas mieux que la France. Est-ce que Zéa ne vous est pas arrivé ? Ses pronostics étaient justes. La dissolution, qu’il redoutait tant, amène des cortes exaltées qui ne feront rien, mais qui empêcheront qu'on ne fasse s’il y a quelque chose à faire pour qui que ce soit. Du reste, ils peuvent faire en Espagne ce qui leur plaira. Nous nous en mêlerons moins que jamais. L'Orient a tué l’intervention.
9 h. 1/2
Voilà votre N°240. Je voudrais bien que vous eussiez Melle Henriette, dont je ne connais guère pourtant que sa réputation qui est bonne. Je vous dirai demain, avec détail ce que je pense de notre situation à tous en Orient. Adieu. Adieu. Je vais écrire pour l’hôtel Crillon. Adieu. G.
Je n’ai que le temps de vous dire adieu. J’ai eu du monde hier le matin une grande promenade le soir la migraine. Je viens de me lever très tard, et il faut que j'écrive à M. Duchâtel pour une affaire. Car j'ai les affaires d’une foule de gens à défaut des miennes. C’est un grand ennui.
Je reviens aux paroles d'Alexandre qui donnent pour moi, aux nouvelles d'Orient, un double, triple intérêt. Décidément, je ne crois à aucune complication grave. Si c’est nous qui servons de médiateurs entre le Pacha et la Porte nous les accommoderons sans guerre ; et si c’est vous, si nos ambassadeurs sont des dupes, vous accommoderez aussi. Cela prouve même que vous voulez accommoder. Question et combat d'influences ; rien de plus jusqu'ici.
Que feriez-vous, s’il y avait autre chose ? Où iriez-vous ? Iriez-vous quelque part ? Seriez-vous malade ? L'Angleterre ne vous vaudrait pas mieux que la France. Est-ce que Zéa ne vous est pas arrivé ? Ses pronostics étaient justes. La dissolution, qu’il redoutait tant, amène des cortes exaltées qui ne feront rien, mais qui empêcheront qu'on ne fasse s’il y a quelque chose à faire pour qui que ce soit. Du reste, ils peuvent faire en Espagne ce qui leur plaira. Nous nous en mêlerons moins que jamais. L'Orient a tué l’intervention.
9 h. 1/2
Voilà votre N°240. Je voudrais bien que vous eussiez Melle Henriette, dont je ne connais guère pourtant que sa réputation qui est bonne. Je vous dirai demain, avec détail ce que je pense de notre situation à tous en Orient. Adieu. Adieu. Je vais écrire pour l’hôtel Crillon. Adieu. G.
245. Baden, Samedi 17 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
245 Baden Samedi le 17 août 1839
Je ne puis que vous répéter la même chose, toujours la même chose. Mes nerfs sont dans un état abominable. On cherche, on espère trouver demain, après demain, dès que ce sera trouvé. Je pars. Je n’en puis plus. Je vais plus mal tous les jours. Ecrivez toujours à Bade jusqu’à nouvel avis. Les nouvelles de Constantinople du 1er août sont en contradiction complète avec ce que vous me mandez. Vous me dites " Nous n’interviendrons pas entre Musulmans." Et on mande de Constantinople que les 5 puissances se chargent des négociations entre le Pacha et le Sultan. Expliquez-moi cela. Tout est singulier dans cette affaire.
Je voudrais bien qu’elle m'occupât assez pour m’étourdir sur mes propres maux, mais ils sont là toujours là, et il faut que je quitte Bade si je ne veux pas mourir. Adieu. Adieu.
Je ne puis que vous répéter la même chose, toujours la même chose. Mes nerfs sont dans un état abominable. On cherche, on espère trouver demain, après demain, dès que ce sera trouvé. Je pars. Je n’en puis plus. Je vais plus mal tous les jours. Ecrivez toujours à Bade jusqu’à nouvel avis. Les nouvelles de Constantinople du 1er août sont en contradiction complète avec ce que vous me mandez. Vous me dites " Nous n’interviendrons pas entre Musulmans." Et on mande de Constantinople que les 5 puissances se chargent des négociations entre le Pacha et le Sultan. Expliquez-moi cela. Tout est singulier dans cette affaire.
Je voudrais bien qu’elle m'occupât assez pour m’étourdir sur mes propres maux, mais ils sont là toujours là, et il faut que je quitte Bade si je ne veux pas mourir. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Politique (Europe), Santé (Dorothée)
251. Val-Richer, Mardi 20 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
251 Du Val-Richer, mardi soir 20 août 1839, 9 heures
Je viens de rendre mes filles parfaitement heureuses. Nous avons fini la lecture de Villehardouin, et j’y ai fait succéder un roman de Cooper qui s’appelle Les Pionniers. C’est un village de planteurs établis sur la lisière de la terre sauvage et en lutte avec les forêts, les bêtes féroces, les Indiens. A part même les aventures, la vie agricole, ses intérêts, ses plaisirs, ont évidemment un grand charme, un charme naturel pour les hommes, enfants ou non. Je le comprends avec le bonheur domestique, avec la fixité et le long avenir de la famille. Sans cela, la campagne n'est bonne que pour se reposer dans les entr'actes, ou pour se retirer quand on a fini.
N’avez-vous point de nouvelles de Lady Clauricarde ? Je la suppose retournée à St Pétersbourg. Pour elle, ce moment-ci vaut la peine d'y être. Et je m'en rapporterais assez à son jugement. C’est, si je ne me trompe, une personne très agréable à voir la première fois, et à connaitre intimement. Il y a, entre ces deux termes, un moment où elle est moins agréable. Cela arrive assez souvent avec les personnes distinguées. Le mérite frappe d'abord puis les défauts apparaissent ; puis le mérite revient et surmonte tout. J'essaie de vous parler de toutes choses. Sachez bien que je ne pense qu’à une seule.
Mercredi 9 7 heures
J’ai un besoin inexprimable de causer avec vous. Il me semble que depuis le 1er Juin nous ne nous sommes rien dit. Toutes ces lettres écrites, reçues, tous les jours ce n’est rien, rien du tout. Il n’y en a point, et dans aucune pas une phrase qui ne soit insuffisante, incomplète, fausse. C'est comme si nous étions l'un vis à vis de l'autre, dans un état de réticence et de mensonge. Cela me déplaît horriblement. Et puis, j’ai tant d'envie de vous voir, de voir par moi-même à tout ce qui vous touche, votre santé, vos affaires. Je ne comprends pas pourquoi mon Génie ne m’a pas encore répondu sur le petit hôtel de la rue Lascazes. Je lui ai recommandé de le visiter avec le plus grand détail, s'il est encore à louer. Il doit s’informer aussi pour l’hôtel Crillon.
Le Duc et la duchesse d'Orléans réussissent vraiment très bien dans leur voyage. Il y a, de la part des Carlistes, beaucoup de curiosité pour eux, une curiosité qui combat la malveillance. Quand viendra, un nouveau règne, le parti se coupera en deux ; les uns retourneront à leurs espérances ; les autres regarderont l'usurpation comme couverte par l'hérédité et se rapprocheront. On voit déjà les deux mouvements se préparer.
Il y a un grand trouble matériel, dans les journaux de Paris. Plusieurs des plus bruyants, le Siècle par exemple et la Presse sont, dit-on, en danger de mort. Au fait plus ils durent et plus ils ont d'abonnés, plus aussi leurs actionnaires se ruinent. Jamais on n'a vu une spéculation plus évidemment fondée sur une friponnerie. Le Siècle a perdu, dit-on, beaucoup d'abonnés à cause de ses velléités de ministérialisme.
9 h. 1/2
Quand donc aurez-vous trouvé quelqu'un ? J'en suis plus agité que si je le cherchais moi-même. Adieu. Je vous quitte pour aller recevoir Mad. de Boigne. Adieu. Adieu. G.
Je viens de rendre mes filles parfaitement heureuses. Nous avons fini la lecture de Villehardouin, et j’y ai fait succéder un roman de Cooper qui s’appelle Les Pionniers. C’est un village de planteurs établis sur la lisière de la terre sauvage et en lutte avec les forêts, les bêtes féroces, les Indiens. A part même les aventures, la vie agricole, ses intérêts, ses plaisirs, ont évidemment un grand charme, un charme naturel pour les hommes, enfants ou non. Je le comprends avec le bonheur domestique, avec la fixité et le long avenir de la famille. Sans cela, la campagne n'est bonne que pour se reposer dans les entr'actes, ou pour se retirer quand on a fini.
N’avez-vous point de nouvelles de Lady Clauricarde ? Je la suppose retournée à St Pétersbourg. Pour elle, ce moment-ci vaut la peine d'y être. Et je m'en rapporterais assez à son jugement. C’est, si je ne me trompe, une personne très agréable à voir la première fois, et à connaitre intimement. Il y a, entre ces deux termes, un moment où elle est moins agréable. Cela arrive assez souvent avec les personnes distinguées. Le mérite frappe d'abord puis les défauts apparaissent ; puis le mérite revient et surmonte tout. J'essaie de vous parler de toutes choses. Sachez bien que je ne pense qu’à une seule.
Mercredi 9 7 heures
J’ai un besoin inexprimable de causer avec vous. Il me semble que depuis le 1er Juin nous ne nous sommes rien dit. Toutes ces lettres écrites, reçues, tous les jours ce n’est rien, rien du tout. Il n’y en a point, et dans aucune pas une phrase qui ne soit insuffisante, incomplète, fausse. C'est comme si nous étions l'un vis à vis de l'autre, dans un état de réticence et de mensonge. Cela me déplaît horriblement. Et puis, j’ai tant d'envie de vous voir, de voir par moi-même à tout ce qui vous touche, votre santé, vos affaires. Je ne comprends pas pourquoi mon Génie ne m’a pas encore répondu sur le petit hôtel de la rue Lascazes. Je lui ai recommandé de le visiter avec le plus grand détail, s'il est encore à louer. Il doit s’informer aussi pour l’hôtel Crillon.
Le Duc et la duchesse d'Orléans réussissent vraiment très bien dans leur voyage. Il y a, de la part des Carlistes, beaucoup de curiosité pour eux, une curiosité qui combat la malveillance. Quand viendra, un nouveau règne, le parti se coupera en deux ; les uns retourneront à leurs espérances ; les autres regarderont l'usurpation comme couverte par l'hérédité et se rapprocheront. On voit déjà les deux mouvements se préparer.
Il y a un grand trouble matériel, dans les journaux de Paris. Plusieurs des plus bruyants, le Siècle par exemple et la Presse sont, dit-on, en danger de mort. Au fait plus ils durent et plus ils ont d'abonnés, plus aussi leurs actionnaires se ruinent. Jamais on n'a vu une spéculation plus évidemment fondée sur une friponnerie. Le Siècle a perdu, dit-on, beaucoup d'abonnés à cause de ses velléités de ministérialisme.
9 h. 1/2
Quand donc aurez-vous trouvé quelqu'un ? J'en suis plus agité que si je le cherchais moi-même. Adieu. Je vous quitte pour aller recevoir Mad. de Boigne. Adieu. Adieu. G.
Du Val-Richer, le 22 août 1839, François Guizot au général Baudrand
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
252. Val -Richer, Jeudi 22 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
252. Du Val-Richer. Jeudi 22 août 1839 7 heures
Madame de Boigne est venue passer hier la matinée au Val-Richer. Elle va pour trois semaines chez Madame de Chastenay, près de Caen. Mad. de Chastenay m’a écrit avant-hier pour m’engager à y aller passer quelques jours avec elle. Mais je reste chez moi. Je suis las de courses et de conversations qui ne me plaisent pas beaucoup. Je n’aime ni le mouvement, ni le monde pour lui-même. Ce sont des cadres où je veux choisir et placer moi-même les figures. D'ailleurs, j’attends quelques personnes chez moi. Imaginez que Madame de Boigne est venue à pied de la grande route ici, une demi-lieue. Elle a peur des mauvais chemins en voiture, et mon chemin neuf ne sera ouvert que le 1er octobre. Elle était rendue en arrivant, sa voiture suivait fort tranquillement. Il n’y a pas l'ombre de danger dans cette traverse, quoique fort mauvaise. On va presque à travers champs. Je l’ai ramenée à la grande route, en causant. Elle ne sait rien & croit comme moi, qu’il n’y aura rien d'ici à la session.
Le Maréchal est fort content de l’Europe, le Roi est fort content du Maréchal. Desages est content aussi. Tout le monde dit que ça n’ira pas, & ça va, et ça ira jusqu'à ce qu’il faille sérieusement deux choses qui n’y sont pas de l'action et de la parole. Il n’y a plus personne à Paris Les derniers sont partis pour les Conseils-généraux.
Le Chancelier reste à soigner Mad. Pasquier qui s'est cassé l’os du fémur, et n'en guérira pas. Elle a 80 ans. Au fait, c’est de cela que Mad.de Boigne, est le plus occupée.
Quand je vous ai dit que nous n'interviendrions pas entre Musulmans, je voulais dire que nous ne ferions jamais la guerre pour les prétentions de l’un, contre celles de l'autre. Nous interviendrons pour la paix et par les négociations, tant qu’on voudra, seuls s’il le faut et bien mieux encore tout le monde, ensemble. Le Sultan et le Pacha pourraient bien rester comme la Reine Christine et Don Carlos face à face, toujours en guerre et sans rien finir. L'Orient serait mis à la fois en question et en suspens comme l'Occident. Voilà le Général Baudrand qui va féliciter Abdul-Medgid. J’en suis bien aise, pour nos affaires et pour lui. Il ne donnera là, et ici à son retour, que de bons conseils. Il allait partir pour l'Afrique avec M. le duc d'Orléans, et y faire Dieu sait quoi. Métier très fatigant pour un homme qui n’est plus jeune et qui vient d'être malade. Il se reposera à Constantinople. La Porte remettant ses affaires avec Méhémet entre les mains des cinq Puissances, c’est la conférence moins la réunion à Vienne, que nous sommes tous habiles à déguiser nos faiblesses ! Pourquoi ne pas dire tout simplement et tout haut que pas plus les uns que les autres, on ne veut se faire la guerre ? Je crois qu’on a raison, et il y aurait de la grandeur à agir ouvertement et tous ensemble en ce sens en disant pourquoi. Mais on veut garder encore quelques airs d’ambitieux, de guerrier ; on veut faire semblant de s'effrayer les uns, les autres sans se battre et on aime mieux s'abaisser en jouant une pauvre comédie que grande en disant vrai. On sera bien confus et embarrassé le jour où le bon Dieu viendra et lèvera lui-même la toile en appelant chaque acteur à jouer enfin son rôle, et à faire marcher le drame.
9 heures
Je vais causer avec ma mère de ce que vous cherchez. Je compte plus sur Melle Chabaud que sur toute autre pour le trouver. Elle a de l’esprit et connait souvent de ces personnes-là. Adieu. Adieu. Je trouve votre 246 un peu moins mal. adieu. Je vous en voudrai toujours de changer. Mais Adieu quand même. G.
Madame de Boigne est venue passer hier la matinée au Val-Richer. Elle va pour trois semaines chez Madame de Chastenay, près de Caen. Mad. de Chastenay m’a écrit avant-hier pour m’engager à y aller passer quelques jours avec elle. Mais je reste chez moi. Je suis las de courses et de conversations qui ne me plaisent pas beaucoup. Je n’aime ni le mouvement, ni le monde pour lui-même. Ce sont des cadres où je veux choisir et placer moi-même les figures. D'ailleurs, j’attends quelques personnes chez moi. Imaginez que Madame de Boigne est venue à pied de la grande route ici, une demi-lieue. Elle a peur des mauvais chemins en voiture, et mon chemin neuf ne sera ouvert que le 1er octobre. Elle était rendue en arrivant, sa voiture suivait fort tranquillement. Il n’y a pas l'ombre de danger dans cette traverse, quoique fort mauvaise. On va presque à travers champs. Je l’ai ramenée à la grande route, en causant. Elle ne sait rien & croit comme moi, qu’il n’y aura rien d'ici à la session.
Le Maréchal est fort content de l’Europe, le Roi est fort content du Maréchal. Desages est content aussi. Tout le monde dit que ça n’ira pas, & ça va, et ça ira jusqu'à ce qu’il faille sérieusement deux choses qui n’y sont pas de l'action et de la parole. Il n’y a plus personne à Paris Les derniers sont partis pour les Conseils-généraux.
Le Chancelier reste à soigner Mad. Pasquier qui s'est cassé l’os du fémur, et n'en guérira pas. Elle a 80 ans. Au fait, c’est de cela que Mad.de Boigne, est le plus occupée.
Quand je vous ai dit que nous n'interviendrions pas entre Musulmans, je voulais dire que nous ne ferions jamais la guerre pour les prétentions de l’un, contre celles de l'autre. Nous interviendrons pour la paix et par les négociations, tant qu’on voudra, seuls s’il le faut et bien mieux encore tout le monde, ensemble. Le Sultan et le Pacha pourraient bien rester comme la Reine Christine et Don Carlos face à face, toujours en guerre et sans rien finir. L'Orient serait mis à la fois en question et en suspens comme l'Occident. Voilà le Général Baudrand qui va féliciter Abdul-Medgid. J’en suis bien aise, pour nos affaires et pour lui. Il ne donnera là, et ici à son retour, que de bons conseils. Il allait partir pour l'Afrique avec M. le duc d'Orléans, et y faire Dieu sait quoi. Métier très fatigant pour un homme qui n’est plus jeune et qui vient d'être malade. Il se reposera à Constantinople. La Porte remettant ses affaires avec Méhémet entre les mains des cinq Puissances, c’est la conférence moins la réunion à Vienne, que nous sommes tous habiles à déguiser nos faiblesses ! Pourquoi ne pas dire tout simplement et tout haut que pas plus les uns que les autres, on ne veut se faire la guerre ? Je crois qu’on a raison, et il y aurait de la grandeur à agir ouvertement et tous ensemble en ce sens en disant pourquoi. Mais on veut garder encore quelques airs d’ambitieux, de guerrier ; on veut faire semblant de s'effrayer les uns, les autres sans se battre et on aime mieux s'abaisser en jouant une pauvre comédie que grande en disant vrai. On sera bien confus et embarrassé le jour où le bon Dieu viendra et lèvera lui-même la toile en appelant chaque acteur à jouer enfin son rôle, et à faire marcher le drame.
9 heures
Je vais causer avec ma mère de ce que vous cherchez. Je compte plus sur Melle Chabaud que sur toute autre pour le trouver. Elle a de l’esprit et connait souvent de ces personnes-là. Adieu. Adieu. Je trouve votre 246 un peu moins mal. adieu. Je vous en voudrai toujours de changer. Mais Adieu quand même. G.
253. Val -Richer, Vendredi 23 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
253 253. Du Val-Richer. Vendredi 20 août 1839, 7 heures
On dirait depuis hier que je vais être pris d’un rhumatisme à l’épaule gauche. J’y ai une douleur assez vive, et j’ai quelque peine à élever le bras. J’ai déjà ressenti quelque atteinte de cette douleur-là. Il faut se frictionner, se couvrir l’épaule de laine et attendre.
J’ai eu hier des nouvelles de St Pétersbourg. Voici en quels termes. " Ma besogne d’observation et de discernement est devenue plus curieuse depuis la crise d'Orient. Je ne lui vois aucune autre solution que de faire de l’Empire ottoman un théâtre pour le commerce européen un territoire administré tant bien que mal vous le patronage commun. Quant à l'existence politique, il n’y faut plus penser. Je n’ai pas eu un moment d’inquiétude sur le maintien de la paix. Il eût fallu, pour la mettre en péril, que Constantinople fût menacé comme en 1833. Le pays où je suis est vivement blessé dans son amour propre ; ses intérêts réels, ses projets positifs ne sont pas en péril. " C’est du 10 août.
J’ai parlé à ma mère de ce que vous désirez. Elle cherchera. Elle n'a personne sous la main Elle m'a demandé si vous étiez facile a vivre. J’ai répondu oui, très facile pour qui lui plaira ; sinon, impossible. Mad. de Telleyrand écrit qu'elle s'ennuie à Baden, que tout le monde s'y ennuie, et que plus il y vient de monde, plus il y vient d’ennui. J’ai peur que Mad. de Talleyrand ne soit destinée à s'ennuyer beaucoup dans l'avenir. Elle le supportera plus fortement que vous. Elle se fera de petites affaires et de petits passe-temps qui ne sont pas à votre usage. Mais le mal sera là.
9 heures
Je suis charmé de vous écrire à Paris, en attendant que je vous y voie, nous arrangerons le moment de ma course Ne me laissez pas sans nouvelle pendant tout votre voyage. Un mot, si deux vous fatiguent. Vous savez qu’il y en a un qui est toujours excellent. Adieu. G.
On dirait depuis hier que je vais être pris d’un rhumatisme à l’épaule gauche. J’y ai une douleur assez vive, et j’ai quelque peine à élever le bras. J’ai déjà ressenti quelque atteinte de cette douleur-là. Il faut se frictionner, se couvrir l’épaule de laine et attendre.
J’ai eu hier des nouvelles de St Pétersbourg. Voici en quels termes. " Ma besogne d’observation et de discernement est devenue plus curieuse depuis la crise d'Orient. Je ne lui vois aucune autre solution que de faire de l’Empire ottoman un théâtre pour le commerce européen un territoire administré tant bien que mal vous le patronage commun. Quant à l'existence politique, il n’y faut plus penser. Je n’ai pas eu un moment d’inquiétude sur le maintien de la paix. Il eût fallu, pour la mettre en péril, que Constantinople fût menacé comme en 1833. Le pays où je suis est vivement blessé dans son amour propre ; ses intérêts réels, ses projets positifs ne sont pas en péril. " C’est du 10 août.
J’ai parlé à ma mère de ce que vous désirez. Elle cherchera. Elle n'a personne sous la main Elle m'a demandé si vous étiez facile a vivre. J’ai répondu oui, très facile pour qui lui plaira ; sinon, impossible. Mad. de Telleyrand écrit qu'elle s'ennuie à Baden, que tout le monde s'y ennuie, et que plus il y vient de monde, plus il y vient d’ennui. J’ai peur que Mad. de Talleyrand ne soit destinée à s'ennuyer beaucoup dans l'avenir. Elle le supportera plus fortement que vous. Elle se fera de petites affaires et de petits passe-temps qui ne sont pas à votre usage. Mais le mal sera là.
9 heures
Je suis charmé de vous écrire à Paris, en attendant que je vous y voie, nous arrangerons le moment de ma course Ne me laissez pas sans nouvelle pendant tout votre voyage. Un mot, si deux vous fatiguent. Vous savez qu’il y en a un qui est toujours excellent. Adieu. G.
251. Paris, Lundi 26 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
251. Paris lundi 26 août 1839 midi
C’est tout ce que je peux faire que de vous écrire deux mots. Jamais je ne me suis sentie si faible. Je ne sais que faire. Je me repose, je me repose beaucoup au point de n’avoir voulu voir encore personne. Et bien, je me sens plus mal. Je ne dors pas. Mes jambes me manquent. Ma tête s'en va. J’attendrai, avec impatience votre réponse à ma lettre d'hier. Je veux faire ce que vous voulez. Voulez-vous que nous nous voyions à Rouen, il me semble que c’est près de chez vous. Je ne veux rien moi qu’être un peu tranquille et vous voir. Si vous saviez quelle pauvreté que mes nerfs. Le médecin croit que la mer les remettra. Mais que de conditions il faut pour cela ! Il faut trouver quelqu'un qui m’accompagne. Il faut que là je trouve quelque ressource. Car seul vous savez bien que pour moi c’est mourir.
Et l’Orient, quelle bagarre ! Et le ministère Anglais quelle pauvre. situation ! Il me semble que tout le monde est malade comme moi. Adieu. Adieu. N'ayez pas de rhumatisme et ayez toujours pour moi la même affection, la même. Adieu. Adieu.
Lord Beauvale m'écrit de Vienne. "Je suis retenu ici pour ces affaires turques où nous ne ferons pas grand bien. L’avantage d'être cinq est d'empêcher les grosses sottises, mais pour faire quelque chose de bon s’est une machine trop compliquée. Il y a toujours des roues qui tournent en sens contraire. Comment voulez-vous que cela marche ? "
C’est tout ce que je peux faire que de vous écrire deux mots. Jamais je ne me suis sentie si faible. Je ne sais que faire. Je me repose, je me repose beaucoup au point de n’avoir voulu voir encore personne. Et bien, je me sens plus mal. Je ne dors pas. Mes jambes me manquent. Ma tête s'en va. J’attendrai, avec impatience votre réponse à ma lettre d'hier. Je veux faire ce que vous voulez. Voulez-vous que nous nous voyions à Rouen, il me semble que c’est près de chez vous. Je ne veux rien moi qu’être un peu tranquille et vous voir. Si vous saviez quelle pauvreté que mes nerfs. Le médecin croit que la mer les remettra. Mais que de conditions il faut pour cela ! Il faut trouver quelqu'un qui m’accompagne. Il faut que là je trouve quelque ressource. Car seul vous savez bien que pour moi c’est mourir.
Et l’Orient, quelle bagarre ! Et le ministère Anglais quelle pauvre. situation ! Il me semble que tout le monde est malade comme moi. Adieu. Adieu. N'ayez pas de rhumatisme et ayez toujours pour moi la même affection, la même. Adieu. Adieu.
Lord Beauvale m'écrit de Vienne. "Je suis retenu ici pour ces affaires turques où nous ne ferons pas grand bien. L’avantage d'être cinq est d'empêcher les grosses sottises, mais pour faire quelque chose de bon s’est une machine trop compliquée. Il y a toujours des roues qui tournent en sens contraire. Comment voulez-vous que cela marche ? "
252. Paris, Mardi 27 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
252 Paris Mardi 27 août 1839
Le médecin veut absolument l’essai au moins des bains de mer, et il veut que je m’y rende le plus tôt possible. Quel jour pourriez-vous venir à Rouen ? Delà je vous mènerais dans ma voiture à Dieppe. Vous resteriez avec moi, chez moi, quelques jours. Tout cela me parait si facile ! Répondez-moi. Il se peut que je parte déjà samedi ou dimanche. Je vous dirai cela. Ne pourrait-on pas ignorer que vous allez à Rouen ? Car je n'aimerais pas les journaux. Je ne dors pas, je ne mange pas, ah j'ai bien certainement une pauvre mine, n'espérez pas le contraire.
J’ai vu hier Appony & Médem. Je sais à peu près tout. Le premier est glorieux, et il perce dans les récits la petites satisfaction de nous croire un peu humiliés, ce que je ne relève pas du tout des paroles de Médem. Nous ne demandons pas mieux que de voir la querelle entre les deux Barbares terminée, et nous agirons avec les autres pour cela, mais rien que cela. Nous ne voulons pas que sur ce point la conférence s’établisse à Vienne. Nous la voulons à Constantinople. Hier il paraissait que les quatre la feraient à Vienne sans nous. Voilà ce qui n’ira pas à moins de se brouiller avec nous. Nous verrons. L'Angleterre et l’Autriche n’offrent à Méhémet Ali que l’hérédité de l'Egypte, quelle bêtise ! L'Angleterre veut qu'il rende la fiotte de suite. S'il refuse, qu'on rappelle les Consuls d’Alexandrie. S’il persiste encore dans son refus, que les flottes alliées s'emparent de Caudie. Je ne vois pas que vous puissiez vouloir tout cela. Encore une fois nous verrons.
Le Roi est parti fort tranquille sur la situation. Vous avez fait je vous en demande pardon, une bêtise en déclarant par hâte que vous entrerez dans les Dardanelles si nous entrions dans le Bosphore. Il est évident que c’est l'Angleterre qui vous a mis en avant ne voulant pas le dire elle-même. Nous avons répondu que dans ce cas nous rappellerions notre Ambassadeur de Constantinople regardant cela comme une rupture de notre traité par le Divan. Et puis la guerre. Vous voyez bien que vous ne la voulez pas et que ces propos là étaient fort inutiles. Vous vous êtes montrés satisfaits et même reconnaissants de notre réponse si franche, et vous y avez reconnu une nouvelle garantie de paix. Tout cela est drôle. Adieu, adieu. Je meurs de fatigue, marcher dans la chambre me fatigue ; mais adieu ne me fatigue pas encore.
Le médecin veut absolument l’essai au moins des bains de mer, et il veut que je m’y rende le plus tôt possible. Quel jour pourriez-vous venir à Rouen ? Delà je vous mènerais dans ma voiture à Dieppe. Vous resteriez avec moi, chez moi, quelques jours. Tout cela me parait si facile ! Répondez-moi. Il se peut que je parte déjà samedi ou dimanche. Je vous dirai cela. Ne pourrait-on pas ignorer que vous allez à Rouen ? Car je n'aimerais pas les journaux. Je ne dors pas, je ne mange pas, ah j'ai bien certainement une pauvre mine, n'espérez pas le contraire.
J’ai vu hier Appony & Médem. Je sais à peu près tout. Le premier est glorieux, et il perce dans les récits la petites satisfaction de nous croire un peu humiliés, ce que je ne relève pas du tout des paroles de Médem. Nous ne demandons pas mieux que de voir la querelle entre les deux Barbares terminée, et nous agirons avec les autres pour cela, mais rien que cela. Nous ne voulons pas que sur ce point la conférence s’établisse à Vienne. Nous la voulons à Constantinople. Hier il paraissait que les quatre la feraient à Vienne sans nous. Voilà ce qui n’ira pas à moins de se brouiller avec nous. Nous verrons. L'Angleterre et l’Autriche n’offrent à Méhémet Ali que l’hérédité de l'Egypte, quelle bêtise ! L'Angleterre veut qu'il rende la fiotte de suite. S'il refuse, qu'on rappelle les Consuls d’Alexandrie. S’il persiste encore dans son refus, que les flottes alliées s'emparent de Caudie. Je ne vois pas que vous puissiez vouloir tout cela. Encore une fois nous verrons.
Le Roi est parti fort tranquille sur la situation. Vous avez fait je vous en demande pardon, une bêtise en déclarant par hâte que vous entrerez dans les Dardanelles si nous entrions dans le Bosphore. Il est évident que c’est l'Angleterre qui vous a mis en avant ne voulant pas le dire elle-même. Nous avons répondu que dans ce cas nous rappellerions notre Ambassadeur de Constantinople regardant cela comme une rupture de notre traité par le Divan. Et puis la guerre. Vous voyez bien que vous ne la voulez pas et que ces propos là étaient fort inutiles. Vous vous êtes montrés satisfaits et même reconnaissants de notre réponse si franche, et vous y avez reconnu une nouvelle garantie de paix. Tout cela est drôle. Adieu, adieu. Je meurs de fatigue, marcher dans la chambre me fatigue ; mais adieu ne me fatigue pas encore.
253. Paris, Mercredi 28 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
253 Paris, le 28 août 1839,
Je commence par vous dire que je ne suis pas tout-à-fait aussi faible aujourd'hui que je l’étais hier, que mon pouls est un peu plus régulier. Ceci me prouve qu'il faut me reposer, et que pendant quelques jours c'est là ce que je compte faire sans me préoccuper de ce que je deviendrai après. Attendez donc de mes nouvelles, ne faites pas de plan, et nous verrons dans quelques jours s'il s’agira de Dieppe ou de Paris.
Le Pacha refuse. Il est cependant, un peu soucieux de cette démarche collective, quoiqu’il ne se figure pas que nous puissions être tout-à- fait d’accord. Et il a bien raison. Il est impossible de l’être moins ; il a dit à notre consul, " prenez Constantinople, car vous finirez cependant par le prendre. "
J'ai bien besoin que votre M. de Valcourt m’aide à trouver une maison. Ecrivez- lui, ou à Génie. Personne ici ne m'aide vraiment. C’est que personne ne s’intéresse vraiment à moi, il n’y aurait que vous au monde qui seriez capable de prendre intérêt à moi. Je vous écris de courtes et pauvres lettres. Je n'ai pas la force de faire plus. Et aujourd’hui je suis obligée, d'écrire à quelques personnes à Baden. Adieu. Adieu. Je suis bien aise que Madame Rémusat soit retournée en Languedoc. Adieu mille fois.
Je commence par vous dire que je ne suis pas tout-à-fait aussi faible aujourd'hui que je l’étais hier, que mon pouls est un peu plus régulier. Ceci me prouve qu'il faut me reposer, et que pendant quelques jours c'est là ce que je compte faire sans me préoccuper de ce que je deviendrai après. Attendez donc de mes nouvelles, ne faites pas de plan, et nous verrons dans quelques jours s'il s’agira de Dieppe ou de Paris.
Le Pacha refuse. Il est cependant, un peu soucieux de cette démarche collective, quoiqu’il ne se figure pas que nous puissions être tout-à- fait d’accord. Et il a bien raison. Il est impossible de l’être moins ; il a dit à notre consul, " prenez Constantinople, car vous finirez cependant par le prendre. "
J'ai bien besoin que votre M. de Valcourt m’aide à trouver une maison. Ecrivez- lui, ou à Génie. Personne ici ne m'aide vraiment. C’est que personne ne s’intéresse vraiment à moi, il n’y aurait que vous au monde qui seriez capable de prendre intérêt à moi. Je vous écris de courtes et pauvres lettres. Je n'ai pas la force de faire plus. Et aujourd’hui je suis obligée, d'écrire à quelques personnes à Baden. Adieu. Adieu. Je suis bien aise que Madame Rémusat soit retournée en Languedoc. Adieu mille fois.
254. Paris, Jeudi 29 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
254 Paris, jeudi le 2 août 1839, 10 heures
Je ne puis rien vous dire aujourd'hui avant d'avoir vu mon médecin. Il me drogue, et décidera ensuite. Le très petite amélioration que j’éprouve me fait désirer de continuer, là où je ressens du mieux, et surtout là où je me repose. Je ne suis donc pas pressé, mais c’est la saison qui me presse. Ah ! Que de temps perdu à Bade !
Je commence à voir quelques personnes. Bulwer entre autres que j'aime beaucoup. J’ai vu aussi les Brignoles, et Pozzo, Ah mon Dieu quelle destruction ! Je vois aussi mon banquier, j’arrange un peu mes affaires quoique je ne connaisse pas encore au juste l’état de ma fortune. Et puis et avant tout, je cherche une maison. C’est presque aussi difficile pour moi que pour M. de Pahlen, et quel ennui. Mais au bout de tout cela si je la trouve ; pourrai-je l'habiter ? Resterons-nous en paix ? Savez- vous que j’ai de mauvais pressentiments. Il me semble qu'on a beaucoup gâté la situation. C'est bel et bon de dire, de répéter " nous voulons tous la paix." Nous ne la voudrons pas cependant à tout prix, et il me parait que nous nous préparons. M. de Metternich n’est pas hors d’affaires, mais on dit qu’il est hors de danger. Je vous ai dit que c'est un coup de sang qu'il a eu. Sa mort serait une vraie catastrophe dans ce moment.
Midi Le Médecin prétend toujours qu'il me faut les bains de mer, nous verrons, en tout cas je ne m'ébranlerai pas avant mardi. Vous en serez prévenu à temps. M. Démion sort de chez moi, il cherche une maison. Vous ne concevez pas la difficulté que je rencontre à cela, et je répugne tout-à-fait à prolonger mon bivouac à la Terrasse. Adieu. Adieu que nous aurons de chose à nous dire !
Je ne puis rien vous dire aujourd'hui avant d'avoir vu mon médecin. Il me drogue, et décidera ensuite. Le très petite amélioration que j’éprouve me fait désirer de continuer, là où je ressens du mieux, et surtout là où je me repose. Je ne suis donc pas pressé, mais c’est la saison qui me presse. Ah ! Que de temps perdu à Bade !
Je commence à voir quelques personnes. Bulwer entre autres que j'aime beaucoup. J’ai vu aussi les Brignoles, et Pozzo, Ah mon Dieu quelle destruction ! Je vois aussi mon banquier, j’arrange un peu mes affaires quoique je ne connaisse pas encore au juste l’état de ma fortune. Et puis et avant tout, je cherche une maison. C’est presque aussi difficile pour moi que pour M. de Pahlen, et quel ennui. Mais au bout de tout cela si je la trouve ; pourrai-je l'habiter ? Resterons-nous en paix ? Savez- vous que j’ai de mauvais pressentiments. Il me semble qu'on a beaucoup gâté la situation. C'est bel et bon de dire, de répéter " nous voulons tous la paix." Nous ne la voudrons pas cependant à tout prix, et il me parait que nous nous préparons. M. de Metternich n’est pas hors d’affaires, mais on dit qu’il est hors de danger. Je vous ai dit que c'est un coup de sang qu'il a eu. Sa mort serait une vraie catastrophe dans ce moment.
Midi Le Médecin prétend toujours qu'il me faut les bains de mer, nous verrons, en tout cas je ne m'ébranlerai pas avant mardi. Vous en serez prévenu à temps. M. Démion sort de chez moi, il cherche une maison. Vous ne concevez pas la difficulté que je rencontre à cela, et je répugne tout-à-fait à prolonger mon bivouac à la Terrasse. Adieu. Adieu que nous aurons de chose à nous dire !