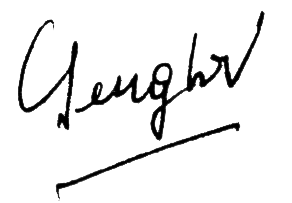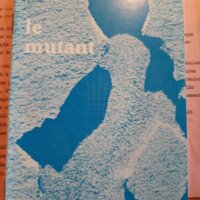Archives de l'Université des Mutants (Gorée, Sénégal)
Présentation
- Bekolo Bekolo, Pascal
- Diallo, Massaër
- Garaudy, Roger
- Senghor, Léopold Sédar
L'Université des Mutants ouvre ses portes le 6 janvier 1979 à Gorée, à l'initiative de Roger Garaudy et Léopold Sédar Senghor.
Le Guide de l'Université des Mutants en précise les objectifs :
- Aider les hommes responsables (d’entreprises, d’organismes de planification, d’administrations, d’organismes sociaux ou éducatifs) à repenser les finalités de la culture considérée non comme ornement de la vie d’une « élite », mais comme moteur de l’orientation du développement. Le culturel précéde et commande l’économie comme la réflexion sur les fins précède et commande l’organisation des moyens.
- La culture propre à jouer ce rôle ne peut être la seule « culture occidentale », importée et imposée par le colonialisme. Quels que soient les mérites indéniables de cette culture, il apparaît aujourd’hui que son caractère unilatéral, privilégiant essentiellement la domination technique de la nature, conduit, du fait de son hégémonie mondiale, à mettre en péril la planète entière par le gaspillage inconsidéré des ressources et la pollution, sans pour autant résorber la misère et les inégalités sociales et nationales. Cette culture inspire un modèle de croissance aveugle, sans finalité humaine, définie par une augmentation sans fin de la production et de la consommation. Les finalités du développement ne peuvent donc être repensées que par un dialogue des cultures interrogeant les sagesses et les techniques de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique latine, de l’Islam qui ont permis de concevoir et de vivre d’autres rapports entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme, entre l’homme et le sacré.
- Un développement authentique ne peut être qu’un développement endogène, c’est-à-dire non pas un développement artificiel et difforme orienté selon les besoins de firmes ou de puissances étrangères, mais un développement lié aux valeurs propres de chaque société, à sa culture et à ses structures, et exigeant une participation active des individus et des groupes qui en sont les sujets et les bénéficiaires. Ainsi apparaît la dimension du développement, qui exige le respect de l’identité de chaque peuple afin de préserver, par le dialogue des cultures, la totalité du patrimoine commun de l’humanité : la civilisation de l’universel.
Le programme découle des objectifs et porte sur trois thèmes :
I. les apports des grandes cultures à l’élaboration de divers modèles de développement, dans la définition des rapports :- de l’homme avec la nature
- de l’homme avec l’autre homme et la société
- de l’homme avec le divin.
Cette séquence occuperait cinq semaines de session, chacune de ces semaines étant consacrée à l’apport d’une grande culture :
- L’apport de l’Inde : du « moi » individuel au « soi » universel : l’hindouisme, naissance du bouddhisme en Inde puis son exode en Chine, dans le Sud-Est asiatique et au Japon.
- L’apport de l’Afrique : la communauté africaine traditionnelle et l’intégration de l’homme à la nature, à la famille élargie, et au sacré.
- L’apport de l’Islam : Monothésime intransigeant et organisation d’une vaste communauté (la « Umma »). La pensée des « soufis ».
- L’apport de la Chine : La Révolution culturelle comme tentative de recherche d’un modèle de développement non occidental et non soviétique. Dialectique taoïste et métamorphose du mandarinat.
- L’apport occidental. Modèle faustien : individualisme et rationalisme, scientisme et technicisme. Du mythe du « progrès » et de la croissance indéfinie à la prise de conscience de l’ « entropie » des écosystèmes et de l’histoire.
1.Les transferts technologiques :
Identité culturelle et technologies alternatives. Les énergies alternatives (ex : le soleil et le pompage à l’eau), « modernisation » sélective de l’agriculture et de l’industrie.
2.les dominations économiques :
Le sous-développement comme séquelle du colonialisme : détérioration des termes de l’échange et intégration forcée au marché mondial (division internationale du travail au profit des pays occidentaux).
Pollution aliénante de la valeur d’échange, et de l’information. Vers un nouvel ordre économique international, la percée de l’OPEP ; le programme intégré de la CNUCED et son premier échec. Les regroupements économiques comme condition d’une libération économique de l’Afrique et du Tiers Monde.
3.Les hégémonies culturelles :
Croissance (quantitative) et développement (qualitatif). Acculturation coloniale et renaissance des identités culturelles. Implication mutuelle du modèle culturel et du modèle de développement. Enseignement et formation continue dans une perspective endogène. Dimension transcendnate de la culture : la dimension divine de l’homme. Racines autochtones du socialisme aficain : la « communauté » africaine et la perspective du socialisme.
- L’inventaire des besoins, des ressources et des projets : ressources énergétiques : solaires, éoliennes, etc..., ressources hydroliques : la maîtrise de l’eau, ressources agricoles et ressources des sous-sols.
- De la communauté traditionnelle au socialisme communautaire (sans passer par l’étape bourgeoise). L’entreprise communautaire, l’institut national des entreprises communautaires, et les « universités des mutants ».
La méthode est ainsi exposée :
Il n’y aura pas de « cours ex cathedra » perpétuant le dualisme des enseignants et des enseignés, mais la présence, pendant une semaine pour chacun des dix thèmes majeurs, d’une personnalité animatrice de la réflexion apportant, bien entendu (sous forme de schémas et de questions envoyés à l’avance et communiqués à chaque stagiaire, ou sous forme d’exposés de synthèse) les matériaux de base, mais surtout stimulant la créativité, la participation et le dialogue avec l’ensemble des stagiaires.
Tout au long de la session, les stagiaires seront invités à présenter, sous forme de mémoire écrit ou de communication orale, les modifications qu’ils envisagent d’apporter dans l’exercice de leurs fonctions antérieures par suite de ce que leur a suggéré tel ou tel thème de la session (...)
Son but n’est pas de préparer des étudiants à s’intégrer dans un système existant, mais d’inciter chacun à participer à la création du futur, d’un futur inédit.
Sa méthode ne saurait donc être autoritaire, bureaucratique, semblable à celle des universités de type traditionnel dans le monde entier, mais libre, « autogérée », appelant à surmonter tout dogmatisme, pour appeler chacun à la création.
(Guide de l'Université des Mutants)
- Historique de l'université.
- Plaquettes (Guide de l'Université des Mutants, Le Mutant) et brochure de présentation.
- Revue Le Mutant d'Afrique n°2.
- Photos et inventaire partiel des livres conservés dans la bibliothèque.
- Coupures de presse de l'époque.
Cette enquête a été menée avec le soutien inconditionnel d'Erika Nimis. Qu'elle en soit ici remerciée.
Informations
Localisation
Les documents de la collection
13 notices dans cette collection
En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.Les 10 premiers documents de la collection :
Citation de la page
Archives de l'Université des Mutants (Gorée, Sénégal)1979-1985.
Groupe international de recherche Léopold Sédar Senghor ; EMAN, Thalim (CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Site Archives Léopold Sédar Senghor
Consulté le 26/01/2026 sur la plate-forme EMAN : https://eman-archives.org/Senghor/collections/show/45
Ligne de temps
Vous pouvez naviguer dans la ligne de temps avec la molette de votre souris ou en utilisant les boutons du menu.