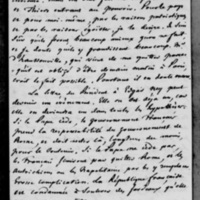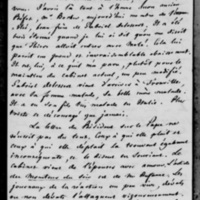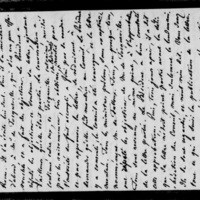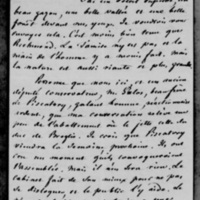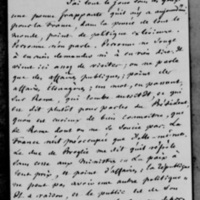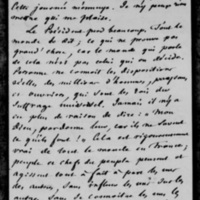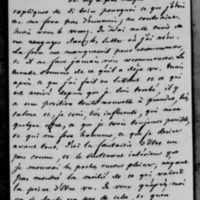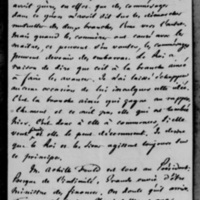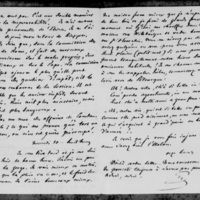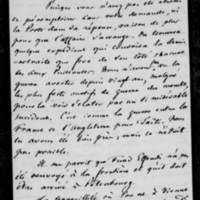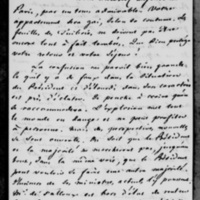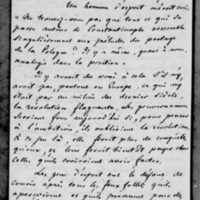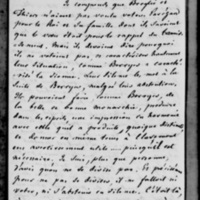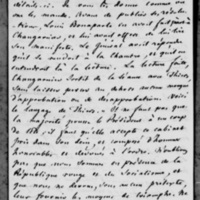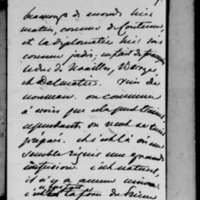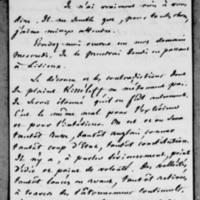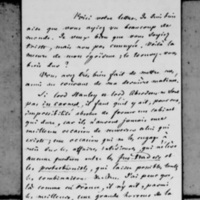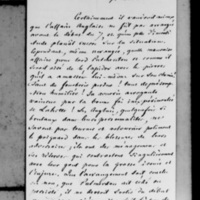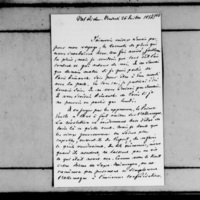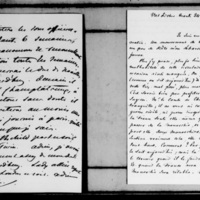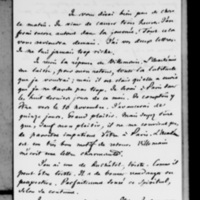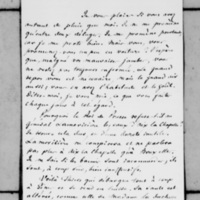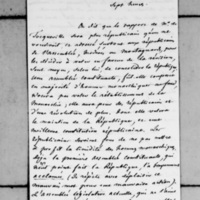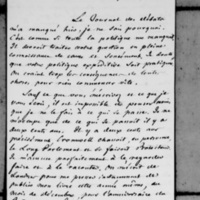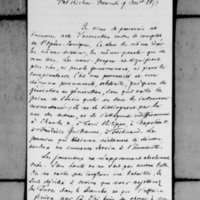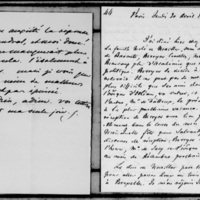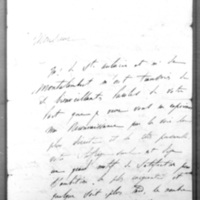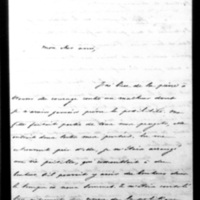Votre recherche dans le corpus : 150 résultats dans 3515 notices du site.
Val-Richer, Samedi 8 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
La conversation de Morny est curieuse. Mais un seul fait est important : Molé et Thiers entrant au pouvoir. Pour le pays et pour moi-même, par les raisons patriotiques et par les raisons égoïstes, je le désire. Je suis sûr qu’ils feront beaucoup mieux qu’on ne fait et je doute qu’ils y grandissent beaucoup. M. d'Haussonville, qui vient de me quitter parce qu’il est obligé d'être demain matin, à Paris, croit le fait possible. Pourtant il en doute encore. La lettre du Président à Edgar Ney peut devenir un événement. Elle en est déjà un, car elle ne deviendra un dans toutes les hypothèses. Si le Pape cède, le Gouvernement français prend la responsabilité du gouvernement de Rome et doit rester là, longtemps du moins pour le soutenir, si le Pape ne cède pas, les Français finiront par quitter Rome, et les Autrichiens ou les Napolitains par les y remplacer. Grosse complication. La République française est condamnée à soulever des fardeaux qu’elle ne peut pas porter. Je penche à croire qu’au premier moment le Pape cèdera. Que dit le Prince de Metternich de ceci. J’en suis plus curieux que de sa feuille volante. sa petite lettre est spirituelle, et il a raison au fond. Si l’union devait rester dans les limbes là, elle ne serait que ridicule. Je serais bien trompé, si elle n’en sortait pas et ne devenait pas plus précise. Je reçois ce matin même des nouvelles de Piscatory ? " Rien ne se passe ici. Le Président a été vivement reçu dans son dernier voyage. Je ne crois pas cependant qu’il pense, ni qu’on pense pour lui à autre chose que ce qui est. Le pays refait un peu ses affaires; le pays de promène et chasse. Il ne faut pas qu’on le trouble dans cette illusion, et les Conseils généraux eussent été très mal venus à parler révision de la Constitution. Ils parlent impôts. C'est à peu près aussi grave, et peut-être plus dangereux. L[?] fait tout ce qu’il peut dans le Midi de la question des boissons. Il en peut sortir des orages. Vous allez à Broglie. Dites-moi quand. Je voudrais pouvoir m'échapper pour vous y joindre. J’ai beaucoup à vous dire, et bien plus encore à entendre. Il serait même possible que j'eusse un sérieux conseil à vous demander. " Les derniers mots sentent bien le cabinet. Je suis assez porté à croire que Morny a raison sur toutes les personnes. Je ne sais rien de Claremont. Je ne crois pas à l'Italie. Le Roi tiendra toujours à l'Angleterre. Rome n’est pas possible. On serait bien embarrassant à Naples. Il serait plaisant que Palerme fût le lieu de repos. La maison offerte ( je dis trop, n’est-ce pas ?) à l'Impératrice. La joie de la Reine d'Angleterre me plait. J’ai objection pourtant à ce ravisse ment du sans-gêne de la vie privée. C’est aujourd’hui la manie des Rois. Preuve qu’ils ne prennent pas leur métier assez au sérieux, ou qu’ils le trouvent trop lourd. à propos une hut, s'écrit une hutte.
Dimanche 9 - 7 heures
Quand vous reverrez Morny, si mes questions vous arrivent à temps faites-vous dire par lui je vous prie, 1° la statistique de l’Assemblée combien pour chaque parti à son avis ; 2° Quelle est, dans l’intérieur du parti légitimistes la force relative des [ ?] Berryer en tête et des pointus, MM. Nettement et du Fougerais en tête. Je suis curieux de contrôler, par Morny les renseignements qu'on me donne. J’irai à Broglie jeudi prochain 12. Ecrivez moi donc là, après-demain mardi, en réponse à cette lettre ci. Vos lettres m’arriveront le surlendemain comme ici. Au château de Broglie, par Broglie. Eure. Je serai de retour ici au plus tard, le 28 septembre. Adieu, adieu, en attendant la poste. Onze heures Merci de votre longue et intéressante lettre mais ménagez vos yeux. J'en reçois une de Montebello qui est à la campagne. Il vous a déjà dit; je suppose, ce qu’il me dit. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 9 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les visites s'en vont et je viens à vous. J’avais là tout à l'heure, mon ancien préfet, M. Bocher, aujourd’hui membre de l'Assemblée , beau frère de Gabriel Delessert. Il a été bien étonné quand je lui ai dit qu'on me disait que Thiers allait entrer avec Molé. Cela lui parait un grand et invraisemblable abaissement. Il est, lui, à ce qu’il m’a paru, plutôt pour le maintien du Cabinet actuel, un peu modifié. Gabriel Delessert vient d'arriver à Trouville avec sa femme malade, sa belle-mère malade. Il a eu son fils trés malade en Italie. Plus triste et découragé que jamais. La lettre du président sur le Pape ne réussit pas du tout. Ceux à qui elle plaît et ceux à qui elle déplait la trouvent également inconséquente, et le disent en souriant. Le Cabinet vient de l’épouser avec amour. L’article du Moniteur du soir est de M. Dufaure. Les journaux de la réaction un peu vive, dévots ou non dévots l’attaquent vigoureusement. L’Univers avec colère. L'Assemblée nationale. dit : " Nous ne voyons pas pourquoi demain le Conseil d'Etat ne réhabiliterait pas M. de Lesseps. C'est sa potitique qu’on adopte ; c'est sa diplomatie qu’on veut faire triompher aujourd’hui à Rome. " Cela deviendra une grosse affaire, très grosse dans l’Assemblée et en Europe.
Il est vrai que le Code Napoléon et le gouvernement libéral sont bien enfantins. C'est là mon impression de tous les moments ; ce sont des enfants, sans prévoyance et sans consistance. Si M. de Falloux n’est pas un enfant, il sera embarrassé. Comment n’a-t-il pas su ? Et, s'il a su, comment n'a-t-il pas empêché ? On ne peut agir sensément et efficacement à Rome qu'en agissant de concert avec l'Autriche. L’Autriche peut être raisonnable. Je me suis conduit d'après cette idée là. Et je suppose qu’elle est encore juste aujourd’hui. Regardez un peu attentivement, je vous prie, à tout ce qui va se développer dans cette affaire. Elle mérite votre curiosité. Je ne vous cite de la lettre de Montebello que cette phrase-ci : " J’ai lu dans quelques journaux que j’avais été au devant du Président jusqu'à Château Thierry. Je vous prie de croire qu’il n'en est rien, et que je n’ai pas commis cet excès de zèle. J’ai été, avec la plupart de mes collègues, le recevoir à Epernay où nous étions convoqués. "
Lundi 10. six heures Je plains l'Empereur. Perdre un ami est toujours affreux. Bien plus pour un Roi. Même pour un Roi égoïste. L’égoïsme ne sauve pas des tristesses de l'isolement. Vous m'avez toujours dit que l'Empereur était capable d'affection. Sauf son chagrin, il doit être content. Il a très bien réussi dans une très bonne politique. Il a fait preuve de sagesse dans la force et de force dans la sagesse. C'est le problème que Dieu donne à résoudre à tous les grands souverains et que bien peu résolvent. J'espère pour lui et pour l'Europe, qu’il persistera dans la même conduite et toujours avec le même succès. Je suis bien préoccupé de la réorganisation de l’Autriche ; aussi nécessaire à l’Europe qu'à elle-même. Belle occasion pour ce jeune Empereur d'être un grand homme. Le mot de votre Empereur à Lamoricière est excellent. Et Lamoricière n'aura pas compris que l'Empereur le louait trop. Ce qui fait qu'il n’aura point été embarrassé de l'éloge.
Onze heures
Les Adieu du lundi ne me consolent point du mardi je n'ai rien de Paris. Adieu adieu. G.
Val-Richer, Mardi 11 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous ne sortons pas ici des orages. Mais soyez tranquille ; je ne me laisserai plus mouiller. Je n’avais vraiment pas eu grand tort d’oublier mon parapluie ; il faisait très beau depuis plusieurs jours, et pas la moindre apparence d’un changement de temps. Je ne me croyais plus à Londres. Je vais à Broglie après-demain 10. Je serai de retour au Val Richer le 22. J’ai promis de passer là quinze jours. Je ne veux pas me déplacer, ce qui est toujours un peu cher, même pour aller si près pour trois jours seulement. J'y vais avec mes enfants. Melle Chabaud qui est ici, est également invitée. Si vous venez à Paris à la fin de septembre, j'irai vous y voir dans les premiers jours d'Octobre, après mon retour au Val-Richer. Vous voir, quel bonheur ! Mais ne vous voir que pour vous quitter si tôt! Je devrais être fait aux sentiments combattus. Ma vie en a été et en est pleine. Je ne m’y accoutume pas du tout. Je suis vieux ; mais je jouirais encore, si vivement du bonheur complet et simple !
Duchâtel a quitté Paris, assez ennuyé et toujours perplexe. Il voudrait bien n'avoir ni doutes d’esprit, ni embarras de décision, voir toujours clair et être toujours sûr du succès. La prétention du Sybaritisme dans la vie commune est déjà beaucoup ; mais dans la vie publique, c’est trop. Du reste, je sais qu’il se promet beaucoup d’agréments de votre salon à Paris cet hiver " un salon neutre, dit-il, où nous verrons tout le monde et où nous pourrons dire notre avis à et sur tout le monde, sans nous gêner. " Les légitimistes se disent, et ont été, je crois vraiment très fâchés, que Madame la Duchesse d'Orléans et M. le Duc de Bordeaux, aient passé si près l’un de l'autre pour rien : " Mais c’est donc un parti pris, disent ils, de ne pas se rencontrer. Si nous l'avions su M. le comte de Chambord aurait attendu. C'est sûr." M. Véron parle bien de M. le comte de Chambord : " Intelligent et sympathique" ce sont les expressions.
Onze heures Voilà, mon triste courrier du Mardi. Il ne m’apporte rien de Paris. Mais j’aurai des visites ce matin. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 11 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Voici l’histoire de la lettre du Président sur Rome. Il l’a écrite lui seul. Puis il l’a montrée d'abord à M. de Tocqueville, qui s’est un peu effarouché, et a fait des objections. Le Président a réfuté les objections et soutenu sa lettre ajoutant d'ailleurs, qu’elle était partie. La conversation a continué entre eux et Tocqueville entrainé, moitié par les raisonnements, très obstinés (du président) moitié par l'autorité du fait accompli, a fini par se rendre et par approuver la lettre se réduisant à demander qu’elle fût montrée au Conseil. Le président y a consenti ; le conseil a été convoqué et la lettre montrée. Tous les ministres présents, sans exception ; nommément M. de Falloux. Tous, ou presque tous, ont répété les objections de M. de Tocqueville. Tous sont revenus au même point, à l’approbation de la lettre partie. Le Président a bien constaté cette approbation. Puis, trois jours après, il a dit que sa lettre n'était point partie avant la délibération du Consul mais seulement le lendemain. Ils se sont regardés, et n’ont rien dit. Vous savez tout ce qui a suivi la publication de la lettre. On dit qu'elle a été écrite par l'inspiration de Dufaure. C'est vraisemblable, et tout le monde le croit. Le parti légitimiste a fait dire au Président, par un intermédiaire fort accrédité auprès de lui, qu'ils étaient bien fâchés mois qu'il leur serait impossible de voter pour lui, sur cette question, dans l'assemblée, qu’ils ne pourraient se dispenser de voter avec le petit parti catholique (30 ou 40 membres) qu’il s’était aliéné par sa lettre. Que la majorité courait donc grand risque d'être disloquée. Le général Changarnier blâme ouvertement la lettre et paraît, en tout, moins intime avec le Président. Les conséquences de ceci à l’intérieur, peuvent donc être grosses. Quant aux conséquences à l'extérieure, il faut attendre ce que diront le Pape et l’Autriche. Je doute qu'ils fassent comme les ministres du Président et qu'ils avalent la lettre parce qu'elle est écrite et publiée. Le rédacteur du journal légitimiste de Caen vient de m’arriver en hâte pour me dire que la réconciliation des deux familles était faite, que M. le Duc d’Escars le lui écrivait positivement, et que son journal l’annoncerait demain. Ils sont évidemment en grand travail pour faire faire, et surtout pour faire croire. On dit que M. de Montalivet, agit fort dans ce sens. Vous en revient-il quelque chose ?
Autre bruit de Dieppe. Thiers a fait une longue promenade en mer, dans un bon canot, avec trois hommes sûrs. Il a rencontré au large M. le Prince de Joinville, et ils ont passé deux heures ensemble. L’attaque contre Dufaure, pour sa répugnance à écarter les fonctionnaires rouges au quasi-rouges, sera très vive. Chacun a des faits choquants à citer. La coïncidence de deux attaques vives sur la politique du dedans, et celle du dehors, fera plus que doubler l'effet. Le cabinet peut sortir de la mort, et le Président blessé. Je ne rencontre personne qui croie au dire de Morny sur Thiers et Molé prenant le pouvoir. Le choléra devient plus rare à Paris. Toujours grave quand il vient, mais plus rare. On dirait aujourd’hui qu’Odilon Barrot, en était atteint. Ce qui est sûr, c’est qu’il a été assez souffrant pour demander instamment qu’on le laissât. tranquille pendant huit jours, sans lui parler de rien, dans sa maison de campagne de Bougival. Il y était en effet quand la publication de la lettre du Président est venue l’en tirer. M. de Villèle est fort malade, dans sa terre près de Toulouse. Plus malade encore d'esprit que de corps. La tête très affaiblie, presque en enfance. Il n'a que 75 ans. M. Ravez sera remplacé à l'Assemblée par son fils. Il me semble que j'ai vidé mon sac. J’ai eu du monde toute la matinée de Paris, Trouville et Caen.
Lady Anna Maria Domkin est partie ce matin. Encore un orage tout à l'heure. Mercredi 12, huit heures Toujours la pluie, et assez froid. J’ai eu hier un assez bon échantillon de la disposition des fonctionnaires qui servent ce gouvernement-ci. Le Préfet du département est venu me voir. Il n’était pas encore venu, moitié par lâcheté, moitié à cause de la session du Conseil général. C’est un homme sensé, intelligent, honnête tout cela dans la région moyenne, et préfet sous la monarchie. Il a l’esprit très libre, et la langue assez libre sur toutes choses, y compris toutes les personnes. Il m’a raconté le séjour du Président au Havre où il était la session de son Conseil Général, les circulaires des Ministres, les discours en promenade de M. Léon Faucher, en spectateur qui ne prend pas grand intérêt au spectacle et n'admire pas beaucoup les acteurs. Les hommes de ce temps-ci ont l'art d'avoir de l’impartialité sans indépendance et de la liberté d’esprit sans dignité. Au fait, ce n’est rien de plus que la nature humaine, déshabillée et courbée par des coups de vent trop forts pour elle.
Onze heures
Ménagez vos yeux. C'est beau à moi de vous dire cela en présence d'une lettre un peu courte. N'importe ; ménagez vos yeux, et adieu sans fin. G.
Broglie, Vendredi 14 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous revenons d’une longue promenade, tous ensemble sauf Melle Chabaud qui ne peut marcher ni vite, ni longtemps. Nous causons beaucoup. Je crois que ma visite leur est très agréable. C’est du mouvement porté chez les gens qui l’aiment et qui ne savent pas s’en donner. Nous connaissons, vous et moi, ce genre de succès.
Samedi 15, 7 heures
J’ai été interrompu hier par des visites qui m'ont retenu jusqu'à l’heure du dîner. Je m’aperçois ce matin que c’est samedi et que j'ai mis hier ma lettre à la poste comme si vous pouviez l'avoir demain. Peu importe du reste. Le Duc de Broglie ne désespère pas au fond, autant qu’il le dit et qu’il le croit. Une idée le préoccupe constamment, et c’est une idée d'avenir. Comment faudrait-il reconstituer le Gouvernement si on avait à le reconstituer, mettant de côté la question du nom propre de ce gouvernement. Faire un bon lit, n'importe qui doive y coucher. Son avis est qu'on obtiendra beaucoup plus avant qu’on ne ferait après, en fait de garanties d’ordre, et de pouvoir. Parce que tant qu’il ne sera pas question de nom propre, tout le parti conservateur sera uni. Parce que, sous le manteau de la République on ira plus loin que sous aucun autre en fait de conservation. Parce qu'il faut que le gouvernement qui devra durer, trouve, quand il viendra, ses affaires essentielles toutes faites, faites par la France elle-même, sous sa responsabilité nationale, et ne soit pas obligé de les faire lui-même, et de répondre de la solution des questions. Le Duc de Broglie cherche donc la solution de toutes les questions constitutionnelles, la meilleure solution possible. Il ne croit pas qu'on révise la Constitution bientôt, ni par des coups d'Etat ; mais il ne croit pas non plus qu’on s’expose à une nouvelle épreuve de la constitution actuelle à la réélection d’une assemblée et d'un président par le suffrage universel, tel qu’il est établi aujourd’hui. Aux approches de cette épreuve-là, on prendra son parti de sauter le fossé plutôt que d’y tomber. 10 heures Je ne m'étonne pas que la malle ne soit pas arrivée en Angleterre. Nous avons vécu quatre jours au milieu des orages. Cela se calme.
Si les Holland sont en Angleterre, pourriez vous éclairer ceci ? Le Duc de Broglie était très lié avec eux et allait sans cesse à Holland House pendant son dernier séjour à Londres. Dés qu’il les a sus à Paris, il est allé les chercher et ne les a pas trouvés. Ils ont mis simplement une carte chez lui et il n’en a plus entendu parler du tout. Il ne comprend pas. Ils ne vivent, dit-il, que sur la frontière la plus rapprochée des rouges, et avec Jérôme Bonaparte. Il suppose que la froideur vient de là. La rigueur envers Gilberti est en effet un peu drôle. Pendant qu’Albert de Broglie, était encore à Rome, Gilberti y est venu. Le Pape l’a reçu, complimenté, embrassé, comblé. Et son livre avait paru. Les gouvernements oublient trop qu'aujourd’hui on n'oublie rien sur leur compte du moins. Ils sont condamnés à plus de prévoyance, et de conséquence que n’en comporte peut-être la faiblesse humaine.
A cela près du contraste trop choquant, je trouve fort simple que le Pape mette à l’Index, les livres, qu’il trouve mauvais et dangereux. C’est de sa part une simple déclaration de son jugement qui ne coûte pas un cheveu aux auteurs, et un avertisse ment à la conscience des Catholiques qu'il a charge de diriger. Quand on interdit au Pape l'index, et qu'on lui commande un gouvernement libéral, on lui interdit tout simplement d'être le Pape. Adieu. Adieu. Je suis préoccupé du Choléra de Londres. Celui de Paris est stationnaire. Adieu. G. Je n’ai pas su lire le nom de Lord .... avec qui vous avez dîné chez Lady Alice. Je trouve pourtant votre écriture meilleure que vos yeux ne se comportent.
Broglie, Dimanche 16 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai un soleil superbe, un beau gazon, une belle vallée, et une belle forêt devant mes yeux. Je voudrais vous envoyer cela. C'est moins bien tenu que Richmnond. La Tamise n’y est pas et la main de l'homme y a moins fait. Mais la nature est aussi riante, et plus grande. Personne que nous ici, et un ancien député conservateur, M. Galos, beau-frère de Piscatory, galant homme, réactionnaire ardent, que ma conversation relève un peu de l'abattement où le jette celle du Duc de Broglie. Je crois que Piscatory viendra la semaine prochaine. Ils ont cru un moment qu'ils convoqueraient l’assemblée. Mais il n’en sera rien. Le Cabinet fait de son mieux pour ne pas se disloquer et le public l’y aide. Le plus probable paraît toujours une modification partielle ; MM. Benoît. Piscatory et Daru entrant aux finances à la Marine et aux travaux publics à la place de MM. Passy, Tracy et Lacrosse. Ne prenez pas cela pour ma propre opinion. Je n'en sais rien. C'est ce qu’on me dit.
Voilà votre lettre. Je ne vois et n’entends rien, absolument rien, qui confirme ce que Lord Normanby attribue au Gal Changarnier, sur une nouvelle bataille dans les rues. Tout le monde dit toujours que tout est possible. Mais personne ne croit à cela. C'est le procès des Ledru Rollin, Felix Pyat &&, annoncé à Versailles pour le 10 octobre, qui fait dire ou supposer ce que mande Lord Normanby. Et en effet, il se pourrait bien que les rouges, à cette occasion, fissent un peu de train. Mais les forces sont énormes à Versailles comme à Paris, et je ne puis découvrir aucune inquiétude, tant soit peu sérieuse de ce côté. Sachez bien que la position de Lord Normanby est plus ridicule qu’elle nait jamais été. Sauf ce qu’il dit de la part de l’Angleterre, personne ne le prend une minute au sérieux lui-même, ni ce qu’il dit ; ni ce qu’on lui dit. Le Marquis Italien est son nom populaire. Et les Italiens n’ont pas grandi depuis dix-huit mois. Ni les marquis. Les intrigues intérieures, du Cabinet à propos de l'affaire de Rome, les lettres, réponses, répliques, contre lettres de tout le monde, et la santé de M. de Falloux, voilà les seules choses qui préoccupent le public qui s’occupe d'autre chose que de ses affaires privées. Le Duc de Broglie persiste à croire que de tout cela, il ne sortira pas même une vraie crise ministérielle. Et je vois qu’il n’est pas seul de son avis car je lis dans une lettre d’un correspondant assez spirituel au journal Belge l’Emancipation : " La question romaine est déjà bien loin. Ce n'est plus de la guerre que l’on s'effraye ; c’est d’une crise à l’intérieur. Allons, vite, qu’on s'embrasse ; voilà ce que c’est que de trop parler. On a failli se brouiller pour avoir dit que l'on était d'accord. Dans les temps où nous vivons, il est bien permis de s'injurier de se diffamer de se calomnier, de se renier, de se trahir. Mais ce n’est pas une raison pour se brouiller. Au contraire." Du reste, je regarderai avec soin du côté où l'on vous montre un point noir.
Adieu. Adieu. Demain est encore un bon jour. Mais après-demain mardi, rien. Adieu. Adieu G.
Broglie, Lundi 17 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes devenue d’une grande intimité avec Lord John. Vous le voyez tous les jours. C’est très bien fait malgré son attachement à Kossuth. Lady John mérite que vous causiez avec elle. Elle a assez d’esprit pour se plaire avec ceux qui en ont plus qu'elle. Et son mari is very uxorious. Je me figure que si j’avais été là Madame de Metternich n'aurait pas. retenu cette expression de sa colère contre Lord Palmerston qu’elle vous a soustraite. Vous voyez ce que j'en pense. Je regrette que son mari devienne si ennuyeux. Les décadences me déplaisent toujours. Soyez tranquille ; je ne redeviendrai pas doctrinaire. Fatuité à part, je ne voudrais pas redevenir rien de ce que j’ai été. Je crois que ce serait déchoir. Redevenir jeune en restant ce que je suis à la bonne heure. Et si je ne me trompe, vous en diriez autant. J’ai écrit hier une longue lettre à Lord Aberdeen. Et aussi à Claremont.
M. Dufaure fait en ce moment une chose qui fera plaisir au Roi. Il a demandé au duc de Broglie de présider une commission chargée d'examiner et de trier tous les papiers enlevés aux Tuileries après Février et déposés aux archives générales. " Il est temps, dit-il de trier ces papiers, et de rendre à la famille royale, ce qui lui appartient. Le Duc de Broglie a accepté, comme de raison. Les journaux légitimistes qui m’arrivent ce matin me frappent assez. Ils détournent leur parti de l'attaque contre le Cabinet au retour de l'Assemblée. C'est M. de Falloux qui fait cela. Il n’espère pas refaire à son gré le Cabinet nouveau, et il aime mieux maintenir celui-ci, où il est plus gros qu’il ne serait avec Molé et Thiers. En tout les légitimistes travaillent plus encore que tout autre parti, à ajourner les grosses questions. Il ne se sentent pas en état de profiter des solutions. Ils veulent pénétrer plus avant dans le pouvoir sous le manteau de la République. Sans compter qu'ils sont comme des affamés qui depuis longtemps n'approchaient pas de la table, et qui ne veulent pas risquer la part qu’ils sont en train de reprendre du gâteau. J'ai lieu de croire qu'il y a eu entre les deux branches de la famille royale quelques paroles même quelque démarche réelle de réconciliation, pour arriver du moins aux apparences de la réconciliation. Les légitimistes se vantent de quelque chose parti de Claremont. Pouvez- vous sonder un peu ce qui en est ? Par la Duchesse de Glocester, ou la Duchesse de Cambridge, ou les aboutissants légitimistes ?
Est-il vrai que vous laissez en Hongrie 40 ou 50 000 hommes ? Je ne puis pas mettre la moindre importance à Céphalonie. J’en suis fâché pour ces pauvres grecs, qui certainement seront rudement punis. Les Anglais sont d'admirables égaux et de terribles maîtres. Avez-vous remarqué deux grands articles des Débats, l’un sur l’Autriche l’autre sur la Prusse ? Je serais assez curieux de savoir ce qu'en pense M. de Metternich s'il pouvait ne pas vous le dire si longuement.
Adieu, Adieu. Je ne sais rien de précis. Mais je suis sûr que le Cabinet est plus content de ses nouvelles de Rome. Adieu. Je ramasse toutes les petites choses que j'ai à vous dire ; mais je ne vous dis pas les grandes, c’est-à-dire la grande. Adieu. Adieu. G.
Broglie, Jeudi 20 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai tout le jour sous les yeux une preuve frappante qu’il n’y a aujourd’hui pour la France, dans la pensée de tout le monde, point de politique extérieure. Personne n'en parle. Personne ne songe à en rien demander ni à en rien dire. Il vient ici assez de visites ; on ne parle que des affaires publiques ; point des Affaires étrangères ; un mot, en passant, sur Rome, qui tombe aussitôt et qui est dit plutôt pour parler du Président. qu'on est curieux de bien connaître, que de Rome dont on ne se soucie pas. La France n’est préoccupée que d'elle-même. Le Duc de Broglie me dit qu’il répète sans cesse aux Ministres : " La paix à tout prix, et point d'affaires ; la République ne peut pas avoir une autre politique. " Il a raison, et le public, est de son avis. Les journaux seuls sont en dehors de cette disposition du public, et raisonnent à perte de vue sur l'Europe. Et leurs lecteurs se plaisent assez à cela. Mais comment on se plaît à un moment de badauderie et d'oisiveté. Personne ne prend les journaux au sérieux. Ce qui n'empêche pas qu'à la longue ils n'agissent. Un jour viendra où le pays sortira de cette insouciance forcée sur sa politique et sa position au dehors, et s’en vengera sur le gouvernement qui lui en fait une nécessité. Etrange chaos que l'état des esprits et ce qu'ils ont à la fois d'activité et d’apathie de passion et d’indifférence de bon sens et d’inintelligence. Plus j'y regarde, plus je me persuade que c’est bien un état de transition, non une chute définitive. C'est ma seule consolation, et je crois que c’est la vérité.
Transition à quoi. Je n’en sais pas plus que je n’en savais quand nous avions le bonheur de causer ensemble de tout cela. Pourtant je suis plutôt confirmé qu’ébranlé dans l’idée à laquelle j'aboutissais en définitive quand nous voulions absolument voir à ceci une issue.
Onze heures
Je vous reviens après être allé entendre une homélie de l'évêque d'Evreux dans l’Eglise de Broglie. Hélas oui, il y a deux grands mois que nous nous sommes quittés ! Je n'essaie pas de vous dire combien vous me manquez. Vous me manquez non seulement pour les choses que je ne dis qu'à vous et que je n’entends que de vous, là où le vide est complet quand vous n’y êtes pas. Vous me manquez même dans les moments où il n’y a pas de vide, ou ce que j’entends et dis me plait et m'intéresse. Je suis toujours sur le point de me retourner pour voir si vous êtes là et pour vous mettre de part dans tout. Que de choses je ne dis pas que je vous dirais, et que de choses je vous dirais que je ne vous ai jamais dîtes ! Et la vie s’écoule dans cette impatience d’une affection qui ne donne et ne reçoit pas, tout ce qu'elle pourrait recevoir et donner dans le sentiment d’un grand bonheur possible et manqué.
Paris sera tranquille. Et si les rouges essayaient de le troubler la tranquillité serait pleinement rétablie en quelques heures comme au 13 Juin. La force et la volonté de faire cela y sont également. Certainement le choléra diminue. Pourtant il y en a encore, et presque toujours grave. Ne vous ai-je pas déjà dit hier qu'à cause du Choléra, on retardait de quinze jours la rentrée des écoliers aux collèges ?
La lettre de Marion est charmante et très originale, si cette aimable fille était heureuse, elle aurait tout le bon sens hors duquel elle se jette quelquefois pour répandre et animer son âme. Elle a naturellement beaucoup de bon sens. Mais il faut aux femmes même aux plus distinguées, du bonheur personnel, et de cœur, pour être dans cet équilibre intérieur qui met en état de voir les choses du dehors comme elles sont réellement, parce qu'on n'a rien à leur demander. Je parlais un jour à la Duchesse de Broglie d’une jeune femme de sa connaissance, et de la mienne qui avant son mariage avait un amour propre assez agité et exigeant, et qui depuis son mariage, était devenue parfaitement calme et modeste : " Je le crois bien, me dit-elle, elle a ce qui apaise et satisfait le plus grand amour propre possible d’une femme : elle est aimée et heureuse. " J'ai bien souvent reconnu la vérité de cela. J’ai peur que notre bonne Marion reste toujours républicaine, tantôt pour Cavaignac, tantôt pour Manin, faute d'avoir son roi à elle, un mari qu'elle adore, et qui l'adore. Adieu. Adieu.
Je ne vois rien dans mes journaux de ce matin. Je pars toujours le 28 pour retourner au Val Richer le Duc de Broglie, le 29 pour Paris. Il veut être au premier jour de l’assemblée aussi à la réunion du Conseil d'Etat qui aura probablement, lieu la veille. Adieu, Adieu, Adieu. G.
Broglie, Vendredi 21 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vois ici bien du monde. Presque autant qu’au Val Richer. En gens du pays du moins. Tous les conservateurs des environs, anciens ou nouveaux viennent me voir. Je suis frappé de ce qu’il y a en même temps, de résolution et de timidité dans leur langage. Ils sont très réactionnaires ; ils demandent de l'ordre du pouvoir, tant qu’on voudra tant qu'on pourra leur en donner mais sous le régime actuel avec les noms actuels. Ils n'abordent pas l'idée, d'un changement au fond. La république peut devenir conservatrice, despotique, aristocratique même ; ou lui en saura gré. Mais la République, je ne vois presque personne qui pense, qui veuille dire du moins qu’il pense à autre chose. Les plus hardis disent que la République pourrait bien n'être qu'une expérience, et une expérience qui ne réussira pas. Mais ils admettent tous l'expérience, et ne la regardent que comme déjà faite. Ils attendent et blâmeraient ceux qui ne voudraient pas attendre. Pour trouver des gens qui maudissent tout haut la République, qui n’en attendent rien et qui demandent pourquoi on attend ; il faut descendre beaucoup plus bas que les gens qui viennent me voir. Il faut aller parmi le peuple chez les paysans. La point de gêne, point de retenue. Et très généralement. L'Empire serait très bien reçu. Le comte de Paris serait très bien reçu. Henri V, c’est plus douteux. La Monarchie est populaire, la légitimité non. Mais pas plus pour le comte de Paris ou pour l'Empereur que pour Henri V, aucun de ceux qui maudissent la République ne remuerait le doigt. Les paysans qui demandent pourquoi on attend attendant aussi tranquillement que les bourgeois. A dire vrai depuis que les rouges ont été bien battus et qu’on croit qu'ils le seraient encore, s'ils remuaient, l’ordre règne partout, l'administration marche, les affaires se font, les intérêts privés s'arrangent, à peu près comme en temps ordinaire. Il est facile ici de renverser les gouvernement très difficile de bouleverser la société ; elle reprend très vite, son aplomb. A très courte échéance, il est vrai ; personne ne fait ni projets, ni longues affaires ; personne ne bâtit une grande maison ; personne ne prête son argent pour plus de deux ans jusqu'aux approches de la prochaine élection du Président et de l'Assemblée. Combien de temps un grand pays peut-il se passer absolument d’avenir ? Pas toujours j’en suis sûr. Mais ce pays-ci assez longtemps, j'en ai peur. S'il est grand, les hommes qui l'habitent sont si petits qu’ils ont bien moins besoin d'avenir. Ce qui est petit se résigne bien plus aisément à être court. Il est vrai qu'on en devient plus Petit, et qu’on souffre de ce rapetissement forcé de toutes les Affaires, de toutes les transactions, de toutes les entreprises, de toutes les existences. Je crois même que cette souffrance ira croissant, et finira par devenir insupportable Mais, pour le moment elle est encore assez limité ; et on la supporte assez bien. Singulier état ! Très triste à voir, mais très nouveau et très curieux à observer. Jamais certainement pays si malade au fond n'a eu si peu l’air, d'être malade, pour quelqu'un qui me ferait que le voir en passant. M de Falloux, dit très malade. Sa mort serait presque un évènement. Les légitimistes comptent sur lui, non seulement pour l'avenir, Mais pour prendre une part chaque jour un peu plu grosse en attendant. Il n'ont personne pour le remplacer.
Samedi 22- sept heures
Pouvez-vous me dire que les portraits de Mad. de Caraman sont d’une ressemblance frappante, et que vous ne voulez pas poser parce que cela vous ennuie trop ? Vous ne savez pas quel plaisir me ferait un portrait de vous vraiment ressemblant, ou bien vous n’avez pas le courage de vous donner cet ennui pour me donner ce plaisir. Si j'étais là, je vous gronderais beaucoup. De loin, il faut être court. Depuis que vous n’avez plus d’yeux, je ne sais plus que m'affliger de votre ennui. Je ne peux plus vous dire : lisez, écrivez. Vous devriez trouver une lectrice qui pût vous lire du français. Cela doit se trouver, même à Richmond. Elle vous lirait une heure ou deux dans la journée, la Revue des deux mondes, Mad. de Krudener. Quoiqu'on ne publie plus grand chose de bon à Paris, il y aurait cependant de quoi vous désennuyer un peu. Vous n'aurez plus besoin de cela à Paris. Il y aura assez de conversation pour remplir votre temps. Barante, Ste Aulaire, Duchâtel y passeront l’hiver. Tout ce qui me revient me persuade de plus en plus qu’il n’y aura point de gros événement ; rien dans les rues. Il n’y aurait que la dislocation de la majorité dans l’Assemblée qui pût amener quelque chose de gros. Mais elle me paraît bien décidée à ne pas le disloquer. Il y a, dans la masse honnête des légitimistes, beaucoup d'humeur contre leurs journaux qui les poussent, et les compromettent.
9 heures
Merci de votre longue lettre, et de cette de Lord Beauvale. Très intéressantes. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. J'ai là des épreuves de mon livre qu’il faut que je corrige et que je renvoie sur le champ à Paris. Je n'ai rien de là ce matin. Adieu, adieu, adieu. G.
Broglie, Mercredi 26 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Puisque vous êtes dans de tels épanchements, avec Lord John ne trouverez- vous pas quelque occasion, bien naturelle de lui parler de la lettre particulière que je lui écrivais sur les mariages espagnols, et qui amena une complication si vive. Je serais curieux de ce qu’il vous dirait. sur cet incident. Je regrette que vous ayez oublié, à Claremont de parler des légitimistes. Tout me confirme qu’il y a eu de part et d'autre quelque nouvelle démarche faite ; pas très sérieuse au fond, mais qui indique que de part et d'autre, on s'ennuie d'entendre tant parler de fusion et de n'y rien faire soi-même. On m'écrit de Paris que Thiers, et ses amis particuliers se montrent toujours préoccupés de mon retour, et de l'influence que je pourrais reprendre, et travaillent toujours très activement contre moi. Il y a certainement un peu de vrai et certainement aussi moins de vrai qu'on ne me le dit dans ces rapports. Ils me viennent soit d’amis très chauds, crédules à force de méfiance, soit des légitimistes qui détestent Thiers et désirent me tenir, avec lui, en état de brouillerie et de soupçon. Peu m'importe du reste ; ce qu’il y a de plus immortel ici bas ce sont les petites passions jalouses, je sais cela; et je sais aussi que lorsqu'on arrive dans la région des grands évènements et des grandes nécessités les petites passions, quelque peine qu'elles se donnent sont de bien peu d'effet. Comme je suis fort décidé à ne plus toucher à rien que pour quelque grand résultat, et par quelque grande nécessité, je me préoccupe très peu des petites passions.
Neuf heures
Ceci est trop fort : Mercredi et ma lettre me manque. Mon plaisir attendu deux jours me manque. C’est très désagréable. Je ne serai point dédommagé par le plaisir d'avoir deux lettres demain. Je n'ai rien à vous dire, et pas envie de vous parler d’autre chose. Je vois que le choléra s’en va de Londres comme de Paris. Adieu. Adieu. Je suis très sûr que ce n’est pas votre faute ; mais c'est une petite consolation. J'espère bien que ce n’est la faute que de la poste ; mais c’est une pitoyable sécurité.
Adieu, Adieu. G.
J’ai oublié de vous dire de m'adresser vos lettres au Val Richer, où je retourne après-demain 28. Mais vous y aurez pensé.
Broglie, Mercredi 26 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous écris sans plaisir. Cette journée m'ennuie. Je n'y peux rien mettre qui me plaise. Le Président perd beaucoup. Tout le monde le dit ; ce qui ne prouve pas grand chose, car le monde qui parle de cela n'est pas celui qui en décide. Personne ne connait les dispositions réelles des millions d'hommes, paysans et ouvriers, qui sont les rois du suffrage universel. Jamais il n’y a eu plus de raison de dire : " Mon Dieu, pardonne leur, car ils ne savent ce qu’ils font ! " Cela est rigoureusement vrai de tout le monde en France ; peuple et chefs du peuple pensent et agissent tout-à-fait à part les uns des autres, sans influer les uns sur les autres, sans se connaître les uns les autres. Il y a une chose merveilleuse ; c’est qu’ils ne fassent pas cent fois plus mal qu'ils ne font.
N'entendez-vous rien dire de Berlin ? Le Cabinet Braudenburg durera-t-il ? Quel est l’Arnim dont on parle pour lui succéder ? Est-ce notre ancien ami ? J'ai grand peur des fautes futures de Berlin et de Vienne. Dieu sait ce qui en sortirait. Est-ce que nous n'aurions que l’alternative des sottises ? Albert de Broglie, qui connait bien Rome ne comprend pas que la Légation de France ne s’entende pas avec le cardinal Antonelli, homme d’esprit dit-il, modéré, sensé, et avec qui M. Rossi était au mieux. Que faites. vous de M. de Bouténeff ? Est-il à Gaëte ou à Rome ? Je vous quitte pour aller faire le tour du Parc. Il y a de très beaux hêtres. Pas si beaux cependant que le grand chêne du Parc de Richmond.
Jeudi 27 sept. 9 heures
Voilà mes deux lettres. Excellentes. Mais je les aurais mieux aimées l’une après l’autre. Ils m'ont gâté ma journée d'hier. Je ne sais qui est ils. En tout cas, je lui donne ma malédiction. Ils pourraient bien avoir lu la lettre de dimanche, et lundi. Elle en valait la peine. Peu importe. S’ils sont capables de comprendre, Ils auront trouvé à apprendre. J’ai lu et relu la lettre de Lord Melbourne. Et je la ferai lire et relire. Il a cent fois raison. Mais voici cet autre problème que je le prie de résoudre : faire jouer une pièce sans acteurs. Il y a un public en France. Même un grand public, qui siffle ou applaudit. avec beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas d'acteurs. Le public ne souffre pas que personne sorte de ses rangs, monte sûr la scène et fasse son état des grands rôles. Il veut que tout le monde reste public. Notre mal est là. Certainement, il faut faire ce qui est nécessaire, et le faire sans s’embarrasser du testament des morts qui ont prétendu que les vivants devaient s’enterrer avec eux. Mais pour réussir en faisant ce qui est nécessaire, il faut deux choses : ne pas se tromper sur la nécessité, et que le public croyant aussi à la nécessité accepte ce qui a été fait en son nom. Le public français ne veut pas croire à la nécessité ! Elle le gêne. Il aime mieux ses fantaisies. Les Anglais sont un peuple politique ; ils agissent. Les Français sont un peuple critique ; ils frondent. J'en sais bien à peu près les raisons. Elles sont trop longues. Pour le moment, il n’y a plus en France qu’une idée, ou plutôt un sentiment qui ait autorité sur les masses et auquel elles soient disposées à obéir. C'est le sentiment de la légalité. Et la légalité, c’est le droit de la majorité à l'obéissance de la minorité. Là où sont la moitié plus un des mâles Français au dessus de vingt et un ans là est le droit ; le droit devant lequel tout le monde, à peu près, s’incline. hors de là, il y a que des prétentions, auxquelles chacun oppose les siennes propres. Voilà ce que disent les gens d’esprit qui se croyent obligés de dire cent subtilités et de prendre de longs détours pour arriver à peu près au même point où le bon sens résolument pratiqué, les conduirait beaucoup plus vite et plus sûrement. M. de Perigny n'est pas dégouté. Les Césars ! Qu'on m’en trouve. Par malheur, il ne suffit pas d'avoir un peu lu l’histoire pour la refaire, et de prononcer les noms pour ressembler aux hommes.
Je retourne demain au Val Richer. J'espère bien y avoir samedi ma lettre. Je l’espère parce que j’ai confiance en vous, car j'ai oublié de vous avertir à temps. Adieu, Adieu. Je vous écrirai le vendredi comme les autres jours. Adieu. G.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Elections (France), France (1848-1852, 2e République), histoire, Interculturalisme, Politique, Politique (France), Réseau social et politique, Suffrage universel
Val-RIcher, Samedi 29 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis rétabli chez moi. Avec plaisir, quoique les quinze jours que je viens de passer à Broglie aient été vrai ment agréables. Bonne et intime conversation. Je l’ai laissé un peu moins abattu que je ne l’avais trouvé. Non pas moins triste, car il y a, dans sa tristesse, une cause à laquelle personne ne peut rien. Sa situation personnelle lui déplait ; il se trouve en mauvaise compagnie ; pour lui même, il aimerait infiniment mieux n'avoir pas touché du bout du doigt à tout ceci. Non qu'il regrette d'avoir fait ce qu’il a fait ; il l’a fait par devoir, dans l’intérêt du pays, pour concourir à la résistance universelle et nécessaire des honnêtes gens contre les coquins, des hommes de sens contre les fous. Et vraiment, quand on voit de près ce qui arriverait dans ce pays-ci, si on laissait faire, on comprend que personne ne se soit cru permis d'en courir la chance, et de ne pas faire soi-même tout son possible pour empêcher. C’était une nécessité de défense personnelle et un devoir strict, urgent envers sa famille, ses amis, ses voisins, tout son pays. Mais la position qui en résulte n'en est pas moins pénible et lourde. Ce sont les conséquences d’une intervention forcé pour cause de sureté intérieure, mais qui coute cher et pèse beaucoup. Hier une heure avant de partir, j'ai encore causé de la tranquillité de Paris. Toujours la même conviction développée, en raisons convaincantes. Quoique finissant par la précaution que tout le monde prend toujours ici : " On ne peut répondre de rien. "
Albert est très bien très sensé, en train et courageux, sa femme très agréable, douce, intelligente, modeste, simplement élégante d’esprit et de cœur, prenant intérêt à la conversation souriant de plaisir parce qu'elle comprend et rougissant quand on la regarde au moment où elle comprend. Broglie et Albert partent demain pour Paris ; la petite Princesse mardi pour aller passer six semaines en Périgord, chez son père, où son mari ira la rejoindre. Ils seront tous réunis à Paris, dans la dernière quinzaine de Novembre. Albert se croit quelques chances d'être élu à l'assemblée par le département du Haut-Rhin, quand le procès de Versailles aura fait des vacances. S’il fait toutes celles auxquelles on croit, il y en aura trois dans ce département-là, et une trentaine en tout. Les réélections seront importantes. Elles révèleront, l'état actuel de ce monde, inconnu qu'on appelle le suffrage universel. On en est assez préoccupé d'avance.
Vous voilà au courant de Broglie comme si vous y aviez passé ces quinze jours. Fait important que j'oubliais. C’est bien certainement Thiers qui est le conseiller sérieux, et efficace de Louis Napoléon. Quand il y a quelque circonstance difficile, douteuse, c’est Thiers qu’il fait appeler. Il dine tête-à-tête. avec lui. Quelquefois Persigny en tiers. Puis on s’arrange pour faire donner par Molé le conseil auquel on s’est arrêté. Et pourvu que Molé ne s’en doute pas, il le donne. Et il ne demande pas mieux que de ne pas s'en douter.
Onze heures
Merci, merci de votre longue lettre. Soyez tranquille ; je n’ai pas le temps aujourd’hui de vous dire comment ; mais je vous promets que je ne me ferai pas des ennemis. Bien au contraire. Et nous passerons l’hiver ensemble à Paris, aussi doucement que le permettra l'état. général de l’atmosphère. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 30 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Huit heures
Il n'y a pas moyen de vous expliquer de si loin pourquoi ce que j'écris ne me fera pas d'ennemi ; au contraire. Mais vous le verrez. Je n'ai nulle envie de me rengager dans les luttes où j'ai vécu. La force me manquerait pour recommencer, et il ne faut jamais rien recommencer. Le monde s'ennuie de ce qu’il a déjà vu. Mais après ce que j’ai fait en luttant et ce qui est arrivé depuis que je suis tombé, il y a une position toute nouvelle à prendre, très calme et, je crois très influente qui aura quelque effet, ce que je crois toujours possible, et qui me fera honneur ce que je désire avant tout. J'ai la fantaisie d'être un peu connu, et le sentiment intérieur que je mourrai les poches encore pleines, n'ayant pas montré la moitié de ce qui valait la peine d'être vu. Je veux qu'après moi on se doute un peu de cela et qu’en parlant de moi, on se dise : " C'est dommage qu’il n'ait pas fait tout ce qu’il voulait." C'est peu d'avoir été quelque chose si on ne laisse au public le sentiment qu’on pouvait être bien davantage. Le monde dédaigne et oublie bientôt ce qu’il croit avoir mesuré jusqu'au fond et épuisé. Il faut qu’il entrevoie de l’inconnu qu'il n’a pas su voir et s'approprier. Alors il estime et admire vraiment. Je suis sorti de la scène sur un échec, très immérité, je pense, mais enfin, sur un échec. Je ne veux pas, si Dieu me donne vie m’en aller tout-à-fait dans cette position là. Je veux que mon pays se doute qu’il a eu tort de me laisser tomber, et qu’il me relève lui-même, non pas dans l’arène, mais dans sa pensée. Et je suis sûr que je peux lui donner ce sentiment là sans blesser son amour propre et réveiller sa mauvaise humeur, en excitant au contraire sa curiosité son regret et son respect. Si cela peut lui servir, ensuite à quelque chose pour se réformer lui-même, tant mieux ; je n'y renonce pas pour lui, car je ne désespère pas de lui. Mais je n’entreprends plus moi-même de le réformer. Ce serait trop long et je suis trop vieux. Quand causerons-nous de tout cela, et de tout le reste ? J'en ai bien envie. Nous aussi nous pouvons bien dire ; " Que de bien perdu ! "
Voici votre lettre de Berlin. Vague et confuse, comme tout ce qui est allemand, mais spirituelle et sensée au fond. Je le crois du moins. On ne voit jamais bien clair dans l’esprit des gens qui n’ont pas vu clair eux- mêmes. Les Allemands ont beaucoup d’esprit ; mais on dirait qu'ils ne voient rien que de loin, et à travers les vapeurs du dernier horizon. Même quand ils sont sensés comme celui-ci, ils trouvent le moyen de noyer leur bon sens dans le brouillard. Il a certainement raison ; le Francfort nouveau est stupide ; le vieux Francfort est mort. Il y a en Allemagne un problème à résoudre que M. de Gagern n’a pas résolu. que M. de Metternich ne résoudrait pas et qu’il faut absolument résoudre. Celui-là seul qui le résoudra mettra les radicaux sous ses pieds, comme ils le méritent. Mais je doute que le moment de cette solution soit venu et nous pourrons bien revoir, en l’attendant, une nouvelle édition de la Diète de 1815.
J’ai reçu une lettre très amicale de Narvaez à qui j’avais recommandé Herbet, consul général à Barcelone. Point de politique comme de raison, mais un ton de confiance générale mêlé d’inquiétude sur sa propre santé. Il me parle des fortes indispositions qui l’ont empêché de voir personne, et il quittait Madrid pour retourner aux eaux de Puertollano. Adieu, adieu.
Moi aussi, je suis fâché que M. Gueneau de Mussy ne revienne pas à Paris. A cause de vous surtout. J'étais sûr qu’il vous plairait, et je crois qu’il aurait autorité sur vous pour votre santé, ce qui est bien nécessaire. Le Roi a raison de le garder. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Lundi 1er octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
J’ai acquis la certitude qu’il n’y avait guère en effet que des commérages dans ce qu'on m’avait dit sur les démarches mutuelles des deux branches, l’une vers l'autre. Mais quand les commères ont causé avec les maîtres, et peuvent s'en vanter les commérages peuvent devenir des embarras. Le Roi a raison de dire que c’est à la branche ainée à faire les avances. Je n’ai laissé échapper aucune occasion de lui inculquer cette idée. C’est la branche ainée qui gagne au rapprochement et ce n'est pas elle qui est tombée hier. C’est donc à elle à commencer si elle veut finir, et elle le peut décemment. Je désire que le Roi et les siens agissent toujours sur ce principe. M. Achille Fould est tout au Président. Presque de l’intimité. Grande envie d'être Ministre des finances. On doute qu’il arrive. Faiseur d'affaires. Plus intelligent que capable. Toujours assez bien pour moi. Plus dans l'apparence qu'au fond. Mais ce sont des gens avec qui il ne faut pas être mal.
Je vous ai dit ce matin que j'étais rentré en possession de tous les originaux. Il n'y manque rien. J’y ai retrouvé aussi les originaux, de moi, que vous m'aviez prêtés.
Mardi 2 - sept heures
Voici mon mauvais jour. J’étais mieux à Broglie qu’ici pour les heures de poste. J’avais mes lettres de grand matin, entre 7 et 8 heures et la poste ne repartait qu'à 2 heures. Ici mon facteur ne m’arrive, à présent surtout, qu'à onze heures et repart à midi. Je suis dans les terres à trois lieues du bureau de poste. Le Duc de Broglie, est à cinq minutes. Le bourg touche le château. Je sais gré à votre famille Impériale de leur chagrin sur la mort du grand Duc Michel. Ces douleurs fraternelles fidèles et vives quoique éloignées, me touchent, et me plaisent. Un peu de cœur est si rare dans les régions hautes ! Encore un exemple là du principe qui préside dans la volonté de dieu à la distribution de ses grâces et de ses rigueurs. Les unes ne vont guères, sans les autres. Au même moment où il nous comble, et il nous frappe, comme pour ne jamais nous laisser oublier notre infirmité et notre dépendance. Aussi dans les temps prospère, je me sens toujours inquiet et dans l’attente d’un malheur. Et c’est presque toujours, dans la vie privée, au sein de la famille, que Dieu place les compensations, en bien ou en mal, qui font équilibre aux incidents de la vie publique. Je ne crois pas qu’il soit possible d'avoir plus constamment que je ne l'ai le sentiment de vivre ainsi sous une main souveraine, dont il est également impossible de méconnaitre le pouvoir et de comprendre les desseins. Les impies sont de bien pauvres esprits. Il y a une sorte d’impies que je crois assez commun dans le monde surtout dans les classes élevées et cultivées, ceux qui sont impies, au fond, et ne veulent pas le paraître ; non par hypocrisie calculée mais par embarras et convenance ; les impies honteux. Ceux-là ne font pas grand mal mais ils me déplaisent beaucoup. J’aime qu’on se connaisse et qu’on se montre tel qu’on est.
Onze heures et demie
Je ferme ma lettre. Je n'ai rien de Paris. Les nouvelles de Constantinople seront plus bruyantes qu'importantes. Adieu, adieu. G.
Val-RIcher, Mardi 9 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pas un mot des affaires de Constantinople ; ce qui me prouve qu’à tort ou à raison, on n'en est guère préoccupé. Mercredi 10, Huit heures Je me lève tard et je me suis couché hier de bonne heure. J'avais un peu mal à la gorge. Je vais mieux ce matin. J’espère que la pluie va cesser et le froid sec commencer. Je l’aime beaucoup mieux. Ma maison ferme mieux que je n'espérais. J’ai de bon bois et je ferai de grands feux, presqu'au moment où j'irai me chauffer dans ma petite maison rue Ville-l'Evêque et votre bonne chambre rue Florentin. Vous ne m’avez pas dit si vous aviez quelqu'un en vue pour vous accompagner. Quel plaisir (petit mot) si nous pouvions passer tranquillement notre hiver dans nos anciennes habitudes ! Je me charme moi-même à me les rappeler. Hélas connaissez-vous ces trois vers de Pétrarque : Ah ! Nostra vita, ch'e si bella in vista, Com' perde agevolmente, in un matino, Quel che'n molti anni a gran pena s'acquista ! « Ah, notre vue, qui est si belle en perspective, comme elle perd aisément, en une matinée ce qui s’acquiert à grand peine, ou beaucoup d’année ! " Je crois que je vous fais injure et que vous savez bien l'Italien. Onze heures Voilà votre lettre. Nous causerons demain. Je persiste toujours à n'avoir pas peur. Adieu Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Guerre, Inquiétude, Politique, Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Italie), Politique (Russie), Politique (Turquie), Politique (Vatican), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Révolution, Vie domestique (François), Vie quotidienne (François)
Val-Richer, Jeudi 11 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Puisque vous n'avez pas été absolus et péremptoires dans votre demande, ni la Porte dans sa réponse, raison de plus pour que l'affaire s’arrange. On trouvera quelque expédient qui couvrira la demie-retraite que fera de son côté chacune des deux puissances. Nous n'avons vu la guerre avorter depuis vingt ans malgré les plus forts motifs de guerre du monde pour la voir éclater par un si misérable incident. C'est comme la guerre entre la France et l'Angleterre pour Tahiti. Nous en avons été bien près ; mais ce n'était point possible. Il me parait que Fuad Efendi n'a pas été renvoyé à la frontière et qu’il doit être arrivé à Pétersbourg. La tranquillité où l'on est à Vienne sur cette question me parait concluante. S'il y avait la moindre raison de craindre, les esprits Autrichiens seraient renversés. Jamais l’Autriche n'aurait été à la veille d'un plus grand danger. Je vous répète qu’à Paris personne ne s’inquiète sérieusement de cette affaire. M. de Tocqueville a été, jusqu'ici, un homme d’esprit dans son Cabinet et dans ses livres. Il est possible qu’il ait de quoi être un homme d’esprit dans l'action et gouvernement. Nous verrons. Je le souhaite. C’est un honnête homme et un gentleman.
Je savais bien que ma petite lettre au Roi pour son anniversaire lui ferait, plaisir. J'ai reçu hier la plus tendre réponse. Après toutes sortes de compliments pour moi, dans le passé : « vous me donnez la plus douce consolation que je puisse recevoir, non pas à mes propres malheurs, (ce n’est pas de cela dont je m’occupe); mais à la douleur que me causent les souffrances de notre malheureuse patrie, en me disant que vous anticipez pour moi une justice à laquelle j'ai été peu accoutumé pendant ma vie. Cette justice, je l'espère et surtout je la désire pour vous comme pour moi. Mais j’ai trop peu de temps devant moi pour me flatter d'en être témoin avant que Dieu m’appelle à lui. La maladie du corps politique est bien grave. Ses médecins n’en connaissent guères la véritable nature, et je n’ai pas de confiance dans l’homéopathie qui me parait caractériser leur système de traitement. J’aurais bien envie de laisser couler ma plume mais je craindrais qu'elle n'allât top loin. Ma bonne compagne, qui se porte très bien, et qui a lu votre lettre, me charge de vous dire qu'elle en a été bien touchée.» J’ai été touché moi de cette phrase : une justice à laquelle j’ai été peu accoutumé, pendant ma vie. Il parle de lui-même comme d’un mort. Lord Beauvale a en effet bien de l’esprit, et du meilleur. Merci de m'avoir envoyé sa lettre. Je regrette bien de ne l'avoir pas vu plus souvent pendant mon séjour en Angleterre. Recevez-vous toujours la Presse ? Je ne la reçois pas, mais, M. de Girardin m'en envoie quelques numéros, ceux qu’il croit remarquables. J'en reçois un ce matin. Tout le journal, plus un supplément, remplis par un seul article le socialisme et l'impôt. Vous feriez je ne sais pas quoi plutôt que de lire cela. Je viens de le lire. Une heure de lecture. Tenez pour certain que cela fera beaucoup de mal. C'est le plan de budget, de gouvernement et de civilisation de M. de Girardin. Parfaitement fou, frivole, menteur, ignorant, pervers. Tout cela d’un ton ferme convaincu, modéré, positif, pratique. Des chimères, puériles et détestables présentées de façon à donner à tous les sots, à tous les rêveurs, à tous les badauds du monde l'illusion et le plaisir de se croire de l'esprit et du grand esprit et de l'utile esprit. Quelle perte que cet homme-là ! Il a des qualités très réelles qui ne servent qu’à ses folies et à ses vices. Personne ne lira ce numéro en Angleterre, et on aura bien raison. Et j’espère que même en France, on ne le lira pas beaucoup. C’est trop long. Mais rien ne répond mieux à l’état déréglé et chimérique des esprits. Je vous en parle bien longtemps, à vous qui n'y regarderez pas. C'est que je viens d'en être irrité.
Onze heures J’aime Clarendon Hôtel. C’est un premier pas. Je vous écrirai là demain. Vos yeux me chagrinent. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 12 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
huit heures
Ceci va donc vous chercher à Clarendon. Je suis allé vous y chercher il y a dix huit-mois, et neuf jours dans la voiture de Lady Allice ; deux heures après mon arrivée à Londres. Quel long espace dans notre courte vie ? Je comprends que Metternich et Wellington, ne se soient pas dit adieu sans émotion. Ils n’y sont pas fort sujets ni l’un ni l’autre, mais il n’y a point de cœur si froid qui résiste à toutes les scènes de la tragédie humaine. C’est sur eux-mêmes d'ailleurs qu’ils se sont attendris. C'est ce qui finit par arriver à ceux qui ne s'attendrissent sur personne. Il y a tant de quoi avoir pitié dans la vie ! On connait tôt ou tard ce sentiment, pour soi-même, si ce n’est pour les autres. Je suis charmé que vous soyez plus tranquille sur Constantinople. Il n’y a vraiment pas moyen de croire à cette guerre. C'est dommage que l'Empereur ait fait une telle boutade. A moins qu’il ne la retire en en tirant parti. Je suppose qu’il finira par là. Avez-vous lu la lettre de M. de Tocqueville à M. Rush à propos du Poussin de la République aux Etats-Unis ? Je l'aurais mieux aimée autre. Il y a un peu de petit épilogage pour couvrir un peu de faiblesse. Il y avait plus de dignité à convenir franchement et brièvement la grossière bêtise de l’agent qu’on venait de rappeler. Je regrette de voir un homme d’esprit et un galant homme engagé dans un mauvais service, et portant la peine. Boislecomte m’a écrit pour me demander à venir me voir. Il viendra passer ici lundi et mardi. Nous causerons. Il a précisément un esprit de conversation prompt et fécond ; des aperçus à l'infini, et en tous sens. Il ne sait pas toujours bien choisir, ni voir bien clair dans toutes les routes qu'il ouvre, son attitude est très bonne. Certainement après Février, mon régiment s’est fait et m'a fait honneur. Repassez les noms et les conduites. Broglie, père et fils, Flahaut, Dalmatie, Rossi, Bussierre, Bacourt. La Rochefoucauld Piscatory, Glücksbierg, Jarnac. Il n'y a que Rayneval qui ait faibli bien vite. J’espère que Marion viendra vous voir à Londres avant que vous n'en partiez. Est-ce qu’il n’y a vraiment pas moyen de les attirer à Paris ? Vous devriez mettre Bär Ellice dans ce complot. Mais vous ne l’avez pas sous la main. Adieu jusqu'à la poste. Je vais faire ma toilette. Adieu, adieu.
Onze heures
Vous partez donc mardi. Malgré toutes les incertitudes de l'avenir, j'en jouis et j'en jouirai comme si je comptais sur l'éternité. Adieu. Adieu. Voici le billet que je reçois de Guéterin. Il n'y a pas de mal que vous l’ayez. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 18 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Vous arriverez aujourd’hui à Paris, par un temps admirable. Votre appartement sera gai, selon sa coutume. Les feuilles des Tuileries ne doivent pas être encore tout-à-fait tombées. Que Dieu protège votre retour et votre séjour ! La confusion me paraît bien grande : ce qu’il y a de faux dans la situation du Président et d’étourdi dans son caractère est près d'éclater. Je penche à croire qu'on se raccommodera. L'explosion met tout le monde en danger et ne peut profiter à personne. Mais des perspectives nouvelles se sont ouvertes. On sait que le président. et la majorité ne marcheront pas jusqu’au bout, dans la même voie, que le président peut vouloir se faire une autre majorité. Plusieurs de ses ministres actuels l'y poussent. M. de Falloux est hors d'état de rentrer dans les affaires et va en sortir définitive ment, si ce n’est déjà fait. Nous ne tarderons pas à voir du nouveau. Le séjour de Morny à Londres est bien singulier dans ce moment. Vous verrez qu'il vous informait mal sur les dispositions du Président dans l’affaire de Constantinople. Affaire qui du reste ne deviendra pas grosse, comme je l’ai pensé dès le premier jour. La démission de Collaredo me frappe. Il est difficile qu’on n'en dise pas tout haut le motif; et certainement cela ne vaut rien pour Palmerston. Mais rien n'y fera rien. Les questions du Cabinet anglais ne se décident pas par la politique étrangère. Nous nous le sommes dit cent fois, et nous l’oublions toujours. Vous serez fâchée d’apprendre en arrivant. que Brignole va à Vienne comme Ministre. Je le regrette. C’était presque le dernier débri de notre corps diplomatique. On me dit que M. de Hübner est homme d’esprit.
Midi
Mon facteur arrive, très tard. Je n'ai que le temps de vous dire, adieu et adieu. Je suis charmé que vous trouviez mes raisons bonnes et je trouve les vôtres bonnes aussi. Donc à la mi-novembre. On m'écrit que la paix est faite entre le Président et la majorité. Le Président a cédé. Il fait bien adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Vous avez toute raison ; arrangez votre vie ; faites y entrer comme il vous convient, les personnes qui sont à la fois indifférentes et importantes. Que chacun vienne et prenne place. Cela se fera plus aisément et plus surement moi n’y étant pas. Je viendrai quand ce sera fait et nous en jouirons ensemble. On ne sait pas combien on peut lever de difficultés et concilier d'avantages avec un peu d'esprit, et de bon sens, en se laissant mutuellement l’espace et le liberté nécessaires pour agir, et pour réussir. Chacun pour soi, et pour soi seul, c'est l’égoïsme, la solitude dans la glace ; chacun par soi-même et selon sa propre situation, c’est la dignité et le succès ce qui ne nuit en rien à l'affection. Je reviens à mon désir du moment. Je suis bien curieux de votre impression sur Paris et sur la situation actuelle. Si j'en crois ce qu’on m’écrit, il se prépare bien du nouveau quoique du nouveau très naturel. J’aime assez le nouveau ; mais le nouveau qui mène à l’inconnu, celui-là est sérieux. Vous ai-je dit, ou savez-vous que, lord Normanby est très assidu chez Madame Howard ; et que c’est surtout par elle qu’il agit sur le Président ? En Angleterre comme ailleurs et en haut comme en bas, il y a des gens pour tous les métiers. Je vois que Bulwer vient de faire nommer son neveu attaché à Washington. Il se dispose probablement à partir. Au fait, il n'y a pas grand mal, malgré votre intérêt pour lui, à ce que justice soit un peu faite de Bulwer. Un peu d'ennui est un châtiment convenable pour tant d’intrigue. Le mal, c’est que justice ne soit pas faite aussi du patron qui l'a jeté à l'eau. Viendra-t-elle un jour ? J'imaginais que, puisqu'elle vous invitait si tendrement à Brocket-hall, Lady Palmerston serait venue vous voir à Londres avant votre départ. Il paraît que la tendresse n'a pas été jusque là. Je compte bien apprendre tout-à-l'heure que vous avez passé. Vous m'aurez écrit quelques lignes de Boulogne. Il a fait si beau ! J’ai joui du soleil sur terre et sur mer.
Onze heures
Vous voilà en France. La mauvaise traversée me déplait beaucoup. Mais enfin c’est fait, et vous n’êtes pas malade, vous êtes arrivée hier à Paris. J’aurai demain de vos nouvelles de là. Adieu, adieu, adieu. Adieu. C'est de bien loin. G.
Val-Richer, Dimanche 21 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je suis d’avis de ces deux points ; la République rouge, ou la guerre à la Russie vous chassent de France ; c'est clair. Je nie celui-ci : pour toujours. Il n'y a point de toujours aujourd’hui. Vous ne retournerez pas vivre, c’est-à-dire mourir en Russie. Vous irez attendre quelque part en Europe. Attendre je ne sais pas quoi, mais certainement quelque chose qui mettra fin à votre toujours. Je suis corrigé de croire un malheur quelconque impossible ; mais je ne crois pas à la longue durée d’un état violent, et anarchiquement violent. Rien ne le prouve mieux que la triste épreuve que nous faisons depuis Février. Nous sommes certes bien loin de l’ordre, mais le désordre avorte partout. Tout le monde est un peu fou ; personne n’est plus, ou n’est longtemps fou furieux. Je repousse absolument votre sinistre parole. Il peut venir bien assez de mal sans ce dernier des maux. Mon instinct est toujours que nous n'irons pas même à ces maux déjà extrêmes que j’admets comme possibles. Je crois à du mauvais, très mauvais gouvernement, changeant sans se corriger ; je ne crois pas aux extrêmes. Je conviens que ce moment-ci est bien chargé et obscur. Thiers ne pouvait guère faire autrement qu’il n’a fait. Je suis curieux de savoir s’il ira vous voir. Je le crois, s’il n’y va pas, c’est qu’il a moins d’esprit que je ne lui en crois. La Rozière a fait vraiment un discours très distingué plein de vues, d’esprit politique et de courage. Peu importent les défauts. Ce sont des défauts qui passent. Il y a là les qualités qui ne s'acquerront point quand il n’a pas plu à Dieu de les donner. C’est un succès qui me fait plaisir. La Rozière s'est bien conduit. Il mérite de réussir. De plus, je le crois ambitieux. Grand titre à l'estime aujourd’hui. Notre temps est plein d'envieux et de paresseux. Il n’y a plus d’ambitieux. Le beau temps s’en va d’ici. Je désire bien que vous le gardiez à Paris. Ayez au moins le soleil du ciel. Pour votre rhume et pour votre sérénité. Je travaille et je me promène. Il me revient tous les jours quelque retentissement du mouvement légitimiste. Les gens de Bordeaux viennent d'avoir une bonne leçon électorale, s'il y a de bonnes leçons. Ce sont les conservateurs qui ont eu tort. Il paraît du reste que même unis, ils auraient été battus. Exemple assez frappant. Les élections qu’il y aura à faire après le procès de Versailles auront de l'importance. Tout démontrera de plus en plus que le suffrage universel, qui peut empêcher la société de mourir, ne peut. pas la faire vivre. Adieu.
Je vais faire ma toilette. J’ai un mélange de joie, et de tristesse à vous savoir en France, et si près de moi. Onze heures Cette situation me pèse et m'attriste, pour vous et pour moi. Je ne crois pas à la guerre. Mais tant d’incertitude et d’insécurité est un grand ennui, pour ne pas dire pis. N'oubliez pas pourtant qu'aujourd’hui, et en France personne ne veut mourir que de vieillesse. Les solutions violentes avortent. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Lundi 22 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
sept heures
J’ai eu hier ici Réné de Guitaut. Je l’ai tourné et retourné en tous sens. Il y a quelquefois beaucoup à apprendre des petits hommes de peu d’esprit. Ils reproduisent, sans y rien ajouter, la disposition du gros public. Je n'ai pu découvrir aucune inquiétude prochaine et sérieuse. Il affirme que le public ne croit pas du tout au triomphe des rouges, ni à la guerre, les deux seules choses qu’il craignît s'il y croyait. Je ne comprendrais pas comment le parti modéré se laisserait battre, ayant la majorité dans l’assemblée qui est la force morale, et le général Changarnier, qui est la force matérielle. Le mérite de cette position, c’est qu'elle donne au parti modéré la légalité, et rejette ses adversaires, Président ou autres, dans la nécessité des coups d’Etat, impériaux ou révolutionnaires. L'Empire et la Montagne ne peuvent plus arriver autrement. Je ne puis croire qu’ils tentent sérieusement d'arriver, quelque étourdi que soit l'Empire et quelque folle que soit la montagne. Il crieront ; ils se débattront, ils menaceront ; ils ne feront rien. Le pouvoir restera à l’assemblée, c'est-à-dire aux modérés, car il me semble impossible qu'ils perdent la majorité dans l’assemblée. Cela ne résout point les questions d'avenir. Mais cela prolonge sans secousse la situation actuelle. Je cherche incessamment dans tout cela, ce qui vous touche.
Je ne vois, quant à présent, que la guerre qui puisse réellement vous toucher. Et je ne crois pas plus à la guerre qu’il y a trois semaines. Regardez bien à tout, mais ne vous tourmentez pas plus qu’il n’y a sujet. Je peux bien vous dire cela, car je suis parfaitement sûr, moi, que je me tourmente autant qu’il y a sujet. Je n'aurai jamais un plus cher intérêt, en jeu. On me dit que M. Bixio disait le soir même de son duel avec Thiers : « J’ai eu tort. J’avais entendu dire cela à M. Thiers dans son cabinet, où il n’y avait que deux autres personnes. Je n’aurais jamais dû en parler. Je me suis laissé aller. J’ai eu tort. » Je trouve Montalembert excellent, presque toujours vrai au fond, et toujours saisissant, entrainant dans la forme. Un jeune cœur uni à un esprit qui prend de l’expérience. La dernière partie du discours est charmante, vive, tendre, pénétrée, abandonnée. C’est vraiment le pendant de son discours à la Chambre des Pairs sur les affaires de Suisse. Je saurai le vote ce matin, car je pense qu’on aura voté avent hier. Nous verrons ce qui en résultera pour le Cabinet. Pouvez-vous savoir ce que c’est qu’un M. Edouard de Lackenbacher, Autrichien à Paris, qui se dit envoyé par Le Prince de Schwarzemberg pour causer avec les gens d’esprit et expliquer la politique de son Cabinet ? Il ne parle que des affaires intérieures de l’Autriche, et il en parle dans un bon sens. Je serais bien aise de savoir d’où il vient réellement et ce qu’il vaut.
Onze heures et demie
Je ferme ma lettre avant d’ouvrir un journal. N’allez pas être malade, Tout le reste est passager ou supportable. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 25 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 Heures
Un homme d’esprit m'écrit ceci : « Ne trouvez-vous pas que tout ce qui se passe autour de Constantinople ressemble singulièrement aux préludes du partage de la Pologne ? Il y a même, quant à nous, analogie dans la position. » Il y aurait du vrai à cela, s’il n’y avait pas, partout en Europe, ce qui n’y était pas au milieu du dernier siècle, la révolution flagrante. Les gouvernements seraient fous aujourd’hui si, pour penser à l’ambition, ils oubliaient la révolution. A ce jeu-là, elle ferait plus de conquêtes qu'eux et leur ferait bientôt payer cher celles qu’ils croiraient avoir faites. Les gens d’esprit ont le défaut de courir après tous les feux follets qu’ils aperçoivent, et qu’ils prennent pour des lumières. Cela les empêche de voir le grand soleil qui est en haut, et qui leur montre le vrai chemin. Je ne m'étonne pas de vos terreurs ; je m’en désole ; et à cause de ce que je leur trouve de fondé, et à cause de ce que je leur trouve d’exagéré. De la sécurité, le sentiment de la sécurité à Paris, vous n’avez pas pu y compter ; je n’ai pas à me reprocher de vous avoir rien dit qui pût vous tromper à cet égard. Aujourd’hui en France, il faut se résigner au fait et au sentiment de l’insécurité. Mais rien n’annonce des désordres prochains matériels et il y a tout lieu de croire que même survint-il quelques désordres de ce genre, il n’y aurait point de dangers pour les personnes, surtout pour les personnes étrangères, surtout point de dangers si prompts qu’ils fussent imprévoyables et indétournables. Il ne faut donc ni s'endormir ni perdre le sommeil. Quel ennui d'être loin et de ne pas avoir avec vous, sur ce point là encore plus que sur tout autre, ces conversations infinies où à force de se tout dire, on finit par atteindre ensemble à la vérité et pas s'y reposer! Enfin dans trois semaines nous en serons là. J’attends assez impatiemment ce qui a dû se passer hier à l'assemblée à propos de Napoléon Bonaparte qui a dû se plaindre qu'on mît de côté sa proposition sur le rappel des bannis pour ne s'occuper que de celle de M. Creton. C'est le second défilé du moment à passer. Si on le passe à l'aide de ces quelques paroles du rapport sur la proposition de M. Creton : ne pas prendre, en considération, quant à présent, et avec regret, on s’en sera tiré à bon marché. Avec qui et avec quoi le Président. ferait-il son coup d’état impérial avant la fin de l'année ? Je comprends qu’il ait besoin d’argent ; mais pour se procurer de l'argent, il faut, ou une assemblée qui vous le donne de gré, ou des soldats qui le prennent, pour vous, de force. Je ne vois à sa disposition ni l’un ni l’autre moyen. Il est vrai qu’à Strasbourg et à Boulogne, il ne les avait pas non plus ni l'un ni l’autre, à cela, je n'ai point de réponse, sinon qu'à Strasbourg et à Boulogne, il n'a pas réussi. Il s’appelait pourtant Louis Napoléon comme aujourd’hui. C'est beaucoup un nom ; ce n'est pas toujours assez.
Onze heures
Votre lettre d’aujourd'hui me plaît, politiquement et personnellement. Ne vous fatiguez pas. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Samedi 27 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je comprends que Broglie et Thiers n'aient pas voulu voter. Par égard pour le Roi et sa famille dont ils savaient que le vœu était pour le rappel du bannissement. Mais ils devaient dire pourquoi ils ne votaient pas, et caractériser hautement leur situation, comme Berryer a caractérisé la sienne. Leur silence les met à la suite de Berryer, malgré leur abstention. Ils pouvaient faire, comme Berryer de la belle et bonne monarchie, produire dans les esprits une impression, en harmonie avec celle qu’il a produite, quoique distincte et donner en même temps à Claremont un avertissement utile... puisqu'il est nécessaire. Je suis, plus que personne, d'avis qu’on ne se divise pas. Et précisément pour ne pas se diviser, il ne fallait ni voter, ni s'abstenir en silence. C’était là, à mon avis, une de ces occasions, où quels que soient le péril et la difficulté, les Chefs de parti doivent se montrer et prendre leur place. J'ai reçu hier une lettre de Duchâtel. Désespéré, et désespérant. Il me dit: « Plus je regarde de près le malade, et plus son état me semble grave. Vous avez vu comment l'élection a été perdue à Bordeaux. On a commis à plaisir, toutes les fautes qui, sous la monarchie ont produit tant de malheurs. On s'est cru fort, et aussitôt on s'est divisé. Quand un candidat rouge est nommé, dans la Gironde cela indique quel fond on peut faire sur les Provinces. L’Etat actuel me semble bien dangereux. On a l'illusion d’un gouvernement tolérable. Cela suffit pour endormir les modérés, et provoquer les opposants, sans donner, au fond, aucune garantie d'avenir. L’esprit est partout, abaissé à un degré que je n'aurais pas pu me figurer. La prévoyance politique des hommes les plus éclairés ne va pas au delà des questions du personnel administratif. On veut avoir de bons sous Préfets et des percepteurs passables. Voilà l’horizon, le plus étendu qu'embrasse la pensée de tous les conservateurs de Province. En somme, on aura perdu au triomphe apparent des opinions modérés. Quand le gouvernement était plus franchement républicain, l'opinion était beaucoup meilleure. Les mauvais fonctionnaires ne faisaient pas grand mal et irritaient l'opinion qui arrivait au bon sens par l'opposition. Aujourd'hui les bons fonctionnaires ne font pas de bien, et l’esprit d'opposition gagne comme de notre temps, sans être efficacement combattu. La révolution me fait l'effet d’une fièvre qui a été coupée trop tôt, et mal ; elle devient presque incurable.» Je copie au lieu de vous envoyer la lettre. Vous ne pourriez pas lire. Il reviendra avec l'hiver. J’aurais trop à dire sur la lettre de Beauvale à propos de Manin. Ce n’est pas la peine. Et je ne sais pas assez bien les faits. Je vous la rendrai. Il a toujours bien de l’esprit. Si Narvaez est définitivement sorti le 23, comme vous dites, j'en suis bien fâché. Les noms mis en avant sont plutôt très monarchiques, mais sans force. Si la reine Christine est pour quelque chose là-dedans, elle a tort. J’attends bien impatiemment les nouvelles de Pétersbourg. Tout en pensant qu'elles ne seront pas définitives, et que l'affaire trainera. Si l'Empereur Nicolas était l'Empereur Napoléon, je craindrais tout. Tout serait déjà sans dessus dessous. J'espère qu'il n'en est rien. L’exemple, après tout, n'est pas bien tentant.
Onze heures Merci de votre lettre. La conversation de Mad. Démidoff est très curieuse. Adieu, adieu. Un bon dîner et un bon matelas, c'est bien mais ce n’est pas assez. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 3 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous savez probablement ces détails-ci. Je vous les donne comme on me les mande, avant de publier ses résolutions Louis Bonaparte en avait fait part à Changarnier, et lui avait offert de lui lire son manifeste. Le général avait répondu qu'il se rendait à la Chambre, et qu’il en entendrait là, la lecture. La lecture faite, Changarnier sortit de la séance, avec Thiers sans laisser percer au dehors aucune marque d'approbation ou de désapprobation. Voici le langage de Thiers. « Il ne faut pas que la majorité pousse le président à un coup de tête ; il faut qu'elle accepte ce Cabinet pris dans son sein et composé d'hommes honorables et dévoués à l’ordre. N'oublions pas que nous sommes en présence de la République rouge et du socialisme, et que nous ne devons, sous aucun prétexte, leur fournir les moyens de triomphe. Ne faisons pas encore un 24 Février.» D'autres sont plus susceptibles, et disent que jamais assemblée n'a été plus indignement souffletée. Ils avouent néanmoins qu'elle ne peut guères se venger sans donner des armes à la Montagne et sans préparer son triomphe. Est-ce là ce qui vous revient ? Avez-vous entendu dire que sur le Boulevard, autour d’un café où se réunissent beaucoup d’officiers quelques uns, après avoir lu le manifeste, avaient crié : Vive Henri V et qu'ils avaient été sur le champ arrêtés ? Je ne fais pas de doute que la majorité ne doive accepter le cabinet pris dans son sein, et le contenir, et l’attirer à elle en le soutenant. Je crois même qu'elle pourrait tenir cette conduite avec beaucoup de dignité pour elle-même, et de profit pour son autorité sur le Pays et l'avenir. Mais je crains qu’on ne donne à une conduite qui pourrait prouver, et produire de la force, les apparences et par conséquent, les effets de la faiblesse. Je crains que mon pauvre pays ne soit défendu, contre les étourderies des enfants, que par les tâtonnements des vieillards. Gardez-moi le secret de ma crainte. Je pense à cela, et à vous. Je pense peut-être à des choses déjà surannées. Qui sait si le nouveau cabinet n’est pas mort ? Il n’avait pas encore été baptisé au Moniteur. Mes journaux me manqueront ce matin à cause de l'Assomption. Pas tous, j'espère. D'ailleurs j'aurai des lettres. C'est, je vous assure, une singulière impression que de vivre en même temps au milieu de tout cela, et au milieu du long Parlement, de Cromwell, de Richard Cromwell des Républicains, des Stuart & & & C'est une perpétuelle confusion de ressemblances et de différences, et de curiosités et de conjectures, qui tombent pêle-mêle sur la France et sur l’Angleterre, sur le passé et sur l'avenir. Je ne dirai pas cependant que je m’y perde. Mon impression est plutôt qu’il rejaillit bien de la lumière d'un pays et d’un temps sur l'autre. Mais soyez tranquille ; j'ai assez de bon sens pour ne pas me fier à mon impression et pour savoir que je n’y vois pas aussi clair que par moments, je le crois.
Midi
Merci, merci. Cela ne me paraît pas, à tout prendre, inquiétant pour le moment. Mes tendres amitiés à Ste. Aulaire quand vous le reverrez. Je crois plus que personne qu’il n’y a que les sots d'infaillibles, mais je suis très décidé à ne pas me laisser affubler du moindre tort prétendu pour épargner à d'autres la honte de leurs gros péchés. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 4 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
D'après ce que vous me dites, mon jugement d’ici est d'accord avec celui des hommes sensés, sur place. Il serait puéril et dangereux, à l'assemblée, d'entrer en lutte avec le Président. Il est dans son droit constitutionnel. Qu'elle use du sien. Si le Ministère sert mal la majorité, mais qu’elle le soutienne tant qu’il la servira sans se soucier du plus ou moins de courtoisie de son avènement. Le jour des luttes sérieuse et inévitables viendra assez tôt. C’est là évidemment la bonne conduite ; mais vous verrez qu’elle pèchera par l’exécution. Beaucoup de gens savent voir ce qu’il y a à faire. C'est l'art et le courage de le faire qui manquent. Ce qui me paraît clair, c’est que ceci n’amènera, prochainement aucun désordre matériel. C'est l'essentiel. Pourvu qu’on ne croie pas que parce que le désordre ne vient pas demain, il ne viendra jamais. Lord John m'amuse plus qu'il ne m'étonne. Les Anglais jouent très hardiment les parties qu'ils ne jouent pas. Personne à coup sûr, n’a pratiqué et ne pratique dans ses rapports avec le Parlement, une politique plus réservée, plus prudente, plus terre à terre que Lord John. Mais il conseille au président les grandes aventures. Pour moi, je ne conseille à personne, en France les grandes aventures. Elles viendront assez d'elles-mêmes, et à tout le monde. Et il n'y a aujourd’hui personne qui soit assez fort pour les étouffer en allant au devant. M. de Parieu est comme M. Rouher, un homme du même département que Morny. C’est drôle. Je ne crois cependant pas le premier lié avec Morny. Il vient originairement du parti légitimiste, et il est resté du parti catholique. Modéré en tout. C’est un homme d'assez d’esprit. Je doute que Rayneval accepte. Je ne crois pas que ses amis lui conseillent d'accepter. Vous a-t-on dit la jolie réponse de Casimir Périer, au Président qui le pressait ? " Je ne suis pas assez sûr de ma capacité pour ne pas craindre de compromettre le nom glorieux que je porte. " Ici, dans les provinces deux nous frappent ; Ferdinand Barrot à l'intérieur et Achille Fould aux finances. On les regarde comme la personnification du président. Les bruits de dettes de mauvaise vie privée se répandent beaucoup. La gloire même, a peine, de nos jours à couvrir, cela. Je reviens à ce que Ste Aulaire vous a dit à mon sujet. Je n'en suis point surpris. C'est la couleur que les amis qui ont été faibles, et les rivaux qui ne cessent jamais d'être ennemis doivent travailler à me donner. Que disaient-ils s'ils ne disaient cela ? Et comment ne profiteraient-ils pas des apparences ? Mais je ne suis pas plus inquiet que surpris. La vérité est grosse comme une montagne, et moi, je ne suis pas encore mort. Il faudra bien qu’on y voie clair qu’on le veuille ou non. Et comme l’ingratitude ne me donnera point d'humeur, je prendrais mon temps et les bons moyens. Je suis bien aise que Thiers soit venu vous voir.
Midi
Aspect bien sombre, et qui me préoccupe bien fort. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je pense. Et cela sert si peu ! Adieu. Adieu G.
Paris, Jeudi 8 novembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Beaucoup de monde hier matin comme de coutume, et la diplomatie hier soir comme jadis ; en fait de français. Le duc de Noailles, Berryer et Dalmatie. Rien de nouveau. On commence à croire que cela peut trainer cependant on veut se tenir préparé, et c'est là où me semble régner une grande confusion. C’est naturel, il n'y a aucune union. C'est ce qui fait la force du Prince. Il est plus puissant que l'assemblée. Hubuer s’accoutume à venir. Il a beaucoup d'esprit. Je trouve la situation de Kisselef très grandie ici. Cela provient ainsi de la que toutes les petites gens sont devenus quelque chose. La Sardaigne nous envoie une ambassade spéciale pour demander la reprise des relations. Elle chasse de son service tous les Polonais qui s’y trouvaient. C'est notre condition sine qua non. Quel dommage que Léopold ne puisse pas en faire autant. Nous sommes pour lui très bien, moins cela. Je vous envoie un petit Appendix à une lettre de Beauvale. Clever comme tout ce qui vient de lui. Je suis bien de son avis aussi. Je copie au lieu de l'original que je veux garder. Je vous ai dit de Richmond N'est-ce pas ce que me disait John Russell ? " il ne peut ressortir de ce bouleversement si profond que deux choses. Ou l'anarchie ou l'absolutisme, partout, hors l'Angleterre." Pardon de l'horreur de copie. On dit aujourd’hui que le président veut attendre l’année 52 et qu'il a des moyens d’attendre. C'est des mauvaises langues qui disent cela. Flahaut doit être parti. Il a aidé dans l’affaire du rappel de la flotte. J’ignore toujours si l'Angleterre en ait. Je n’ai pas vu Montebello depuis deux jours. Que pensez-vous de Germain ? Je lui aurai peut-être une bonne place. Mais je voudrais savoir ses mérites & ses inconvénients. Le gros de la lettre de Beauvale est toute à l’Empire." Donnez-moi de bonnes nouvelles de lui je vous en supplie. Régime militaire en Prusse, en Autriche, en France, en Piémont et le monde est sauvé. Mais qu’on fasse vite." Voilà textuel. Adieu. Adieu. Adieu.
Hier on parlait de la Grèce, d’Eyragues de la Rosière comme destinés au portefeuille si Rayneval n’accepte pas. Voici Flahaut qui est venu me voir tout botté pour le chemin de fer. Il emmène Morny qui a des affaires en Belgique. Lui va à Londres. Le coup d’état n’est pas encore probable au moins pour cette semaine.
Val-Richer, Mardi 13 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je n'ai vraiment rien à vous dire. Il me semble que, pour toutes choses, j’aime mieux attendre. Ecrivez-moi encore un mot demain mercredi. Je le prendrai Jeudi en passant à Lisieux. Le décousu et les contradictions dont se plaint Kisseleff, ne m'étonnent pas. Je serais étonné qu’il en fût autrement. C'est le même mal pour l'extérieur et pour l’intérieur. On est et on sera tantôt Russe, tantôt anglais, comme tantôt coup d’Etat, tantôt constitution. Il n'y a, à parler sérieusement, point d’idée et point de volonté, Des velléités, tantôt lancés en avant, tantôt retirées à travers des tâtonnements continuels. Et on ne sort des tâtonnements que par des essais de coup de tête qui avortent. Avorteront-ils toujours ? Je ne sais. En tous cas, il n'y a pour les hommes sensés, qu’une conduite à tenir soutenir le pouvoir, quels que soient son nom et sa forme, tant qu’il voudra faire de l’ordre et du pouvoir. Toutes les susceptibilités, exigences, oppositions, dissidences, me paraissent aujourd'hui des puérilités. Je me crois sûr que la commission auprès de lord Lansdowne, sera faite, et bien faite. Est-ce que vous n’avez pas vu Salvandy ? Mad. Lenormant m’écrit qu’elle l’a rencontré chez Mad de Boignes, et qu’il s'est laissé croître une crinière qui lui donne l’air d’un bison. Il est toujours au courant et raconte tout. Je retrouverai à Paris tous les anciens ministres, à l’exception de Duchâtel qui ne reviendra qu’en Décembre. Je dois avoir conservé, ma bonne mine d’Angleterre, car je me porte bien J’ai eu pendant quelques jours des commencements désagréables de crampes d'estomac qui revenaient à la même heure. Cela est passé. Je vous quitte pour mettre des livres en ordre. Je laisserai ici ma maison bien rangée. J'aurai absolument besoin à Paris de me réserver les premières heures de la matinée. Je tiens à finir et à finir bientôt ce que j'ai commencé. Onze heures J’ai certainement un vif plaisir à faire mes arrangements. Malgré un beau soleil qui persiste. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 2 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Voici votre lettre. Je suis bien aise que vous ayez vu beaucoup de monde. Je veux bien que vous soyez triste, mais non pas ennuyée, voilà la mesure de mon égoïsme ; le trouvez-vous bien dur ? Vous avez très bien fait de mettre mes amis au courant de ma dernière matinée. Si Lord Stanley et Lord Aberdeen ne sont pas in earnest, il faut qu’il y ait, pour eux, impossibilité absolue de former un cabinet qui dure car ils n'auront jamais une meilleure occasion de renverser celui qui existe ; une occasion qui ne les engage à rien sur les affaires intérieures, qui n'élève aucune question entre les free-traders et les protectionnistes, qui laisse possibles toutes les combinaisons & &.
J'ai peur que, là comme en France, il n’y ait, parmi les meilleurs, une grande horreur de la responsabilité et un goût immense du repos. Le monde périra par la mollesse des honnêtes gens. Je crois au motif qu'on vous a dit du retard de Mad la Duchesse d'Orléans à rejoindre le Roi à St Léonard. Il y a encore plus d'illusion que de toute autre chose dans son esprit. Je crois aussi à l’inimitié de votre nouveau visiteur pour le général Changarnier. Pensez-y quelque fois en causant. Au fond, le n°31 du faubourg St Honoré est bien avec et pour l'Elysée malgré les airs de salon et les apparences de langage quelques fois contraires. Le voyage de Fontainebleau m'a assez frappé. Que d’embarras toutes ces inimitiés frivoles jettent dans les affaires !
Midi.
Je vous reviens après déjeuner. Je me hâte. Je vais être assiégé de visites, le beau temps, le Dimanche et de nouveaux mariés à voir. Ils sont très contents l’un de l'autre, et je crois qu’ils ont raison. Voilà donc la loi électorale volée. Certainement elle a produit partout, un effet d'intimidation pour les rouges, d'encouragement pour les modérés. Je vois cet effet autour de moi. Il passera vite s’il n’est pas nourri ; mais il est réel. Bien moins grand pourtant ici qu’à Paris. Je trouve, à tout prendre, la situation peu changée. Il est vrai que je n’ai encore vu presque personne. Mais l’air qu’on respire est le même.
Que votre Empereur se garde bien des assassins. La perte serait immense. Il commence son grand rôle en Europe.
Je ne puis pas croire à un coup de main de Lord Palmerston sur Naples ; et s’il tentent j’espère que le Roi de Naples résistera. Pour le coup, ce serait le coup de grâce pour Palmerston, malgré tous les partis pris de l’opposition anglaise. Adieu, adieu. Mes journaux sont venus ce matin. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 3 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Certainement il vaudrait mieux que l'affaire Anglaise ne fût pas arrangée avant le débat du 7 et qu'un peu d’incertitude planât encore sur la situation. Cependant, même arrangée, quelle mauvaise affaire pour Lord Palmerston et comme il serait aisé de le lapider avec les pierres qu’il a amassées lui-même sur son chemin. Tant de fourberie perdue ! Tant de présomption humiliée ! Sa rouerie arrogante vaincue par la bonne foi inexpérimentée de Lahitte !
Les Anglais, quelquefois si brutaux dans leurs personnalités, ne savent pas tourner et retourner poliment le poignard dans les blessures de leurs adversaires ; ils ont des ménagements et des réserves qui contrastent singulièrement avec leur goût pour la grosse ironie et l’injure. Que l’arrangement soit conclu ou non, que Palmerston ait cédé, ou persisté, il ne devrait sortir du débat que mis en pièces ; il a fait là une de les choses dans lesquelles il faut absolument réussir pour pouvoir en parler.
Si vous étiez ici, si nous nous promenions ensemble, le beau soleil la fraîche verdure, le calme gai de ma vallée nous feraient oublier Palmerston et les débats de Londres. Mais vous n’y êtes pas, et j'oublie ma vallée, la verdure et le soleil pour vous parler de Palmerston.
10 heures
Vos dernières lignes me désolent sans m'étonner. Je suis parti craignant cette explosion. Ce sera bien mauvais. Se rejeter dans tous les hasards pour de si pitoyables motifs ! Nous sommes dans des mains d'enfants. Je veux croire encore qu’on s’arrangera. Et je le crois presque. Il y a un point de déraison qui me semble toujours impossible. Je m’y suis trompé souvent. Avais-je tort dans ce que je vous disais hier en vous parlant de La Redorte Je reçois de Londres une lettre curieuse. On me dit que la question grecque est à peu près morte " Tant qu'elle a été ouverte, personne n'a osé y toucher ; depuis qu’elle est fermée, l’intérêt n’y est plus. Il faudrait encore plus de talent que n'en a Lord Stanley pour la faire revivre. Il y a huit jours, on parlait avec conviction d’un vote hostile dans la chambre des Lords ; aujourd’hui, on n'y a pas renoncé, mais il en est moins question. On le disait aussi, parmi les whigs, que ce serait la dernière fois qu’on s’exposerait à subir de pareilles ignominies, et les vives remontrances de la Cour, ont été un peu mieux écoutées qu’auparavant. Mais [wows] made in pain. Il ne s’agit pas le moins du monde de mettre Lord Clarendon au foreign office ; mais il ne serait pas de toute impossibilité que Lord John s’en chargeât provisoirement lui-même. Faible lueur d’une faible intention.
On est d'accord ici pour soumettre la question des conventions rivales au Roi Othon lui-même. Palmerston s'est borné à exposer à ses collègues les deux voies qu’il y avait à suivre ; ils se sont décidés aux concessions.» Je vous envoie ce qui me vient. Paris me préoccupe bien plus que Londres. Que dites-vous du langage du Prince de Prusse ? Il a voulu se lier avant de partir et annuler d'avance l'influence de l'Empereur. Adieu, Adieu.
Trouville, Lundi 24 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars tout à l'heure ; mais je crains de trouver le facteur parti quand j’arriverai au Val-Richer. Deux lignes donc d’ici. Pour ne vous rien dire du tout, car je n’ai pas entendu depuis deux jours une parole à redire ; quoique j'aie vu deux fois hier Mad. de Boigne. Bien fusionniste, pourvu que la fusion ne soit pas une cause de secousses, car le repos avant tout. Je trouve dans le journal l'Opinion publique que mon gendre reçoit une lettre de Claremont. empruntée à l'Univers, qui est assez piquante sur Thiers. Faites vous lire cela. C'est curieux comme la vérité perce vite, confusément, mêlée de mensonge ; mais elle perce. Ce temps-ci est fait pour le malheur des finesses et des situations doubles. La finesse n'est plus possible qu'aux esprits assez grands pour savoir s’en passer. Adieu, Adieu. Je rentrerai aujourd’hui en possession de notre correspon dance. Quel dommage que vous n’ayez pas été à Trouville hier et aujourd’hui ! Ciel et temps et mer sont charmants. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 26 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
J’ai oublié de vous demander quoique j'en sois curieux, si vous étiez allée dimanche à Passy si vous y aviez fait votre rencontre et si vous lui aviez parlé de ce qu'on m'a dit à St Léonard. Je suppose qu'il n'est pas très pressé de vous rencontrer. Il est plus hardi à tendre ses pièges qu'à se trouver en face de ceux qu’il y voudrait prendre.
Le facteur va m’apporter les premières nouvelles de Londres. Je crains bien que la conclusion de l'affaire si petite pour Paris n'ait nui au débat. Le bataillon radical et fanatique qui entoune Palmerston et lui apporte solennellement son portrait, fait peur à bien des gens ; ils saisirent ce prétexte de donner satisfaction à leur peur. Si l'Angleterre, ce qui j’espère bien, n’arrivera pas, devait être emportée aussi par le démon révolutionnaire Palmerston serait le Judas qui le livrerait. Tâchez de savoir de Hübner si l’Autriche est en effet disposée, comme nous l'a dit le comte Creptowitch, à abandonner sa prétention d'entrer dans la confédération germanique avec tous ses états allemands où non allemands. Plus j’y pense, plus je trouve comme le Roi, qu'elle aurait tort d'y persister. La politique simple et attachée uniquement à l’intérêt principal est la seule qui convienne aujourd’hui : aux temps faciles et calmes il appartient de tenir grand compte des intérêts secondaires & de poursuivre simultanément des buts divers. L’Europe n'en est pas là.
10 heures
Certainement, la journée d'avant-hier est grande. Le petit billet qu’il vous a écrit me plait. Il y a de quoi penser à son petit château du Loiret. Décidément, la prudence, l'extrême prudence prévaut partout. Il faut donc que l’initiative vienne des intéressés pour qu’il y ait de bons conseils. Je n’ai jamais douté que dans le cas les conseils seraient bons. Mais je crois aussi que les plus intéressés ne sont pas les seuls intéressés, et qu’il y a bien des manières de prendre soi-même l’initiative sans inconvenance ni imprudence, quand on veut arriver au but. Je viens de lire le commencement de la séance des Communes et du discours de Rocbuck. Voilà donc la question posée entre la politique de l'Angleterre pendant trente ans et sa politique actuelle, entre M. Pitt et Lord Palmerston. Rocbuck condamne, dans le passé la lutte contre la révolution, et promet, pour l'avenir, l'appui de l’Angleterre à la Révolution. Et on appelle cela la cause de la civilisation et de la liberté ! Il est possible que Sir Robert se taise, qu'il laisse injurier ainsi tout ce passé auquel il a pris part, et pousser l'avenir dans ce détestable mensonge qui confond la révolution avec la liberté. Mais je suis décidé à ne pas comprendre son silence. L'occasion est belle pour rendre à son pays un immense service, et avoir, dans son Parlement, un immense succès. Dieu veuille qu’il le fasse ! S’il ne le fait pas, si personne ne le fait, je commencerai à être inquiet pour l'Angleterre. Adieu. Adieu.
Je jouirais bien de ce magnifique temps, si je ne craignais qu’il ne soit trop chaud pour vous. Adieu, adieu. Je ne comprends pas pourquoi ma lettre d'avant-hier a été en retard. Adieu.
Ems, Mercredi 17 juillet 1850, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah me voilà contente puisque vous l’êtes. Hier enfin j’ai eu ce qu'on appelle une lettre, je la méritais. Cette Assemblée me faisait d'ici le même effet qu’à vous. Je ne suis pas fâché de voir les assemblées devenir ridicules. Vous ne pensez pas comme moi à cet égard, et cependant vous devriez être guéri de votre passion.
J'ai eu une longue lettre de Marion. L'Angleterre est encore toute abandonnée à ses regrets et à son admiration pour Peel, les quelques paroles de Dupin, ont flatté, touché, charmé. La petite malice n’a pas été perdue non plus. Sir Robert a laissé à son fils aîné 22 000 L. de rentes of entailed property. 70 000 £ à chacun de ses autres fils, & 25 000 à chacune de ses filles. J’ignore le douaire de sa femme. Sûrement considérable. Le fils aîné se conduit à merveille. Marion fait une foule de réflexions spirituelles & sensées sur cette mort, et elle finit en me disant, qu'on ne sait pas bien encore si elle est, ou n’est pas un grand malheur. pour le pays.
La princesse régnante vient me voir à peu près tous les jours. Elle est dans une véritable angoisse, elle a peur de s'ennuyer, elle a raison. Hier elle me parlait de votre beau discours à l'assemblée l’autre jour. La Princesse de Prusse quitte Coblence pour aller résider à Bade où son mari commande l’armée. Je ne verrai donc rien de tout cela. Je vous réponds que je vous reviendrai aussi peu instruite sur l’Allemagne que j’étais partie. La politique des petits princes ne s'éclairera pas.
Marion me demande si vous avez lu " Sophisms on free trade by a Barrister " (Serjeent Byles) et comment vous le trouvez. On en est à la 8ème édition. On espère toujours renverser le ministère. Bêtise. J’ai commencé Albert de Broglie sur M. de Châteaubriand. Excellents sentiments, beaucoup d’esprit, la manière un peu lourde & quelque fois confuse. Je crois qu'il écrira mieux. En attendant ceci m’intéresse beaucoup. 2 heures. Le duc de Saxe Meiningen qui avait toujours été interrompu quand il commencent à me parler intimement des affaires allemandes m’a enfin trouvée seule aujourd'hui. Il est Prussien, il est pour un parlement allemand. Il dit que si on veut revenir à l’ancienne confédération il y aura une explosion générale. Il désire que l’Autriche reconnaisse cette vérité, & la Russie aussi. La paix avec le Danemark amènera indubitablement & tout de suite la guerre entre le Danemark & les Duchés. C'est une inextricable difficulté. Je vous ai dit tout Saxe Meiningen. J'ajoute que c'est un homme très sensé & parfaitement gentleman surtout. Je continue à me baigner & à boire. Je n'ai rien à dire de l’effet, cela me fatigue, voilà tout. Je suis toujours dans mon lit à 9 heures ce soir, & debout à 61/2 du matin. Adieu, Adieu.
J’espère que tous mes adieux vous arrivent. Je reprends une petite critique sur Albert de Broglie. Je viens d'achever. C’est charmant. Cherchez la 109ème page, et dites-moi, qui est l'homme aux Mémoires du 17ème siècle. Ce ne peut être St Simon qui écrivait encore sur la régence. Qui est-ce ? Je suis bête sans doute, mais je ne trouve pas.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Lecture, Politique, Politique (Allemagne), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (France), Politique (Russie), Portrait, Régime politique, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), VIe quotidienne (Dorothée)
Ems, Mardi 23 juillet 1850, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre ne me donne rien à répondre. Je n’ai pas de lettre d’ailleurs, les journaux sont stupides, & je le deviens. L'année va je crois finir paisiblement. certainement il y a progrès vers le bien partout. Et les rouges sont matés il faudrait bien des fautes pour qu’ils reprissent courage. Il y a beaucoup de nouveaux arrivés ici hier du Lobkowitz, des Windiesch-Graetz ; mais je ne les ai pas vus Je vous ai dit que je ne vais pas là où l'on se réunit, Maintenant voici la rage des parties. Cela ne me va pas non plus. J’aime ma routine.
La Princesse de Prusse cherche à attirer le monde. Aujourd’hui même elle vient tout près d'ici et on recrute pour elle des rencontres. Constantin a refusé net. Il ne veut pas la voir. Elle est trop ridicule et trop anti-russe. Si je pouvais la voir commodément cela m'amuserait assez mais Constantin me dit qu'à Pétersbourg on me saura plus de gré de ne pas la voir que de la rechercher. Ma nièce me plait davantage. D'abord elle est grande, ses yeux sont beaux, elle plait à tout le monde. Les petites princesses de Beauvais, qui sont toutes deux ses cousines en raffolent. Elle sait causer un peu de tout. Elle a de l'aplomb et de la modestie, de beaux cheveux, une jolie main, un teint magnifique. Elle tiendrait très bien ma table de thé. La Princesse [Crasalcovy] est ici avec deux perroquets. Elle a rencontré tout à l'heure chez moi le Prince Windischgraetz, celui qui a été blessé le jour même où on a tué sa mère. Joli jeune homme, mieux que les Viennois ordinairement. Thiers veut aller à Bruxelles chercher quelques renseignements historiques auprès du Prince Metternich. Voilà le temps chaud rêvé. Je me barricade.
Vous voyez que je ne vous dis que des bêtises. Un mot sur les Princes de l’union, le frère du Prince Albert à la tête. Quand la révolution a éclaté partout, ils ont renoncé volontairement à leurs douaires & les ont cédés à l’état contre une liste civile quelle conque. Mais le Saxe entre autre avait stipulé une clause, c’est que s'il venait à renoncer à la souveraineté les biens lui seraient rendus. Et bien aujourd’hui ils veulent tous être médiatisés, incorporés à la Prusse pour recouvrir leur argent. Voilà où en sont les princes de la Thuringe & ce qui les fait persister dans l’union. Vous voyez que je deviens savante peu à peu. Adieu. Adieu. Envoyez-moi mieux que je ne vous donne.
Val-Richer, Vendredi 26 Juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aimerais mieux n'avoir pas pour mon voyage, les torrents de pluie qui nous inondaient hier. Une fois arrivé, j'oublierai la pluie ; mais je voudrais que tout eût l’air content et gai autour de moi. Je ne saurai que demain matin, si je suis partir de Paris dimanche soir pour être à Ems mardi avec la poste. En tous cas, je partirai d’ici demain soir. Je ne vous écrirai pas demain. Je vous écrirais dimanche de Paris si je ne pouvais en partir que lundi.
A en juger par les apparences, le Prince Emile a tout-à-fait raison sur l'Allemagne. La révolution est évidemment hors d'état de faire là ce qu’elle veut. Mais je doute que les vieux gouvernements en soient plus capables, eussent-ils de l’esprit de refaire ce qu'ils voudraient. De tels événements même quand ils avortent, ne laissent pas en vie ce qui était avant eux. Comme vous le disait votre Prince de Saxe-Meiningen, on ne ramènera pas purement et simplement l'Allemagne, à l'ancienne confédération. A la suite de tout ceci, il se fera, au-delà du Rhin, plus ou moins d'unité et de constitution, mais il s'en fera. Vous me dîtes que le Prince de Prusse est devenu plus libéral que son frère, qu’il n’y aura en Autriche que des États locaux à qui on dira un mot du budget. Des Etats locaux partout en Autriche, un mot du budget à tous ces états, et le Prince de Prusse libéral ; mais ce sont là des changements énormes. Et l’Empereur d’Autriche sur son trône et le Prince de Metternich dans sa retraite, et votre Empereur dans sa grandeur intacte et inaccessible, regarderont pourtant cela comme des victoires et ils auront raison. Le monde change ; il faut s'y résigner et changer soi-même autant qu'il le faut pour être en harmonie avec la grande métamorphose, au lieu d’y mourir.
On se sépare bien mal à Paris. Le Constitutionnel, le Pouvoir, tous les amis de l'Elysée prennent la nomination de la Commission permanente avec beaucoup d’amertume. Les Burgraves, si triomphants après le vote de la loi électorale n'ont pas que, ou n’ont pas voulu s'y faire nommer eux ou leurs amis déclarés. M. Molé figure là comme un portrait d'ancêtre. Piscatory s'est mis de côté soit pour échapper comme il me l'a dit, aux embarras de la situation dans l’intervalle, soit crainte de ne pas réussir. La majorité est en dissolution. L'Elysée ne peut rien. Je ne crois à aucun grand acte de personne. Mais il arrivera quelque évènement. Quand les hommes ne peuvent décidément plus rien, ni avancer, ni rester, Dieu s’en mêle.
9 heures
Voilà votre lettre. Je ne vous en dis pas d'avantage. La coalition n’a pas pu réussir à faire passer M. Grévy pour la Commission permanente. Adieu, adieu. Je suis charmé que vous partiez d’Ems le 8, puisque je n'y pourrais rester davantage. Adieu. G.
Paris, Samedi 10 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’y a plus personne ici, et j’ai eu du monde hier tout le jour Dalmatie Mallac, Génie, Piscatory, des insignifiants. Rien de plus que ce que nous savons ; mais un sentiment général qu’il faudra absolument du nouveau l'hiver prochain, et que tout ce qui est est usé. Le banquet de l'Elysée fait encore assez de bruit. Changarnier et les officiers supérieurs étaient partis quand les sous officiers se sont promenés dans le jardin, en criant : " Vive l'Empereur ! Aux Tuileries ! Pas tous, à beaucoup près, dit-on, mais un certain nombre. Et on dit que ces banquets se renouvelleront au retour du Président que tous les sous-officiers de l’armée de Paris y seront successivement invités. Cela déplaît beaucoup aux Généraux. Changarnier pourrait bien interdire, aux sous-officiers d’y aller. Alors le conflit entre les deux. Evidemment la Camarilla du président se remue assez et voudrait se faire un parti dans l’armée. Si son voyage réussit, s'il est bien reçu par les populations, on s’attend à quelque chose. Je ne m'attends à rien. Et au fond, Piscatory, non plus, ne croit pas qu’il se fasse rien, quoiqu’il eût bien envie de croire qu’il se fera quelque chose. On dit qu'au retour de l’assemblée, les diverses réunions, Rivoli, Richelieu, & & se disloqueront que, dans toutes, les sensés et les fous sont las de vivre ensemble et veulent se séparer, que tous les partis sont en état de désorganisation. Je crois cela ; mais je crois que l'explosion et les conséquences de cet état se feront encore attendre longtemps. Un seul fait est certain c’est que pour le moment, les légitimistes sont en perte et les orléanistes en progrès. On fait toutes sortes de raisonnements fantastiques ; voyez l’Espagne pourquoi s’est-elle sauvée ? Parce qu'il n’y avait sur le trône que des femmes et des enfants. Plus les apparences, d’un gouvernement sont faibles, moins il y a de péril ; le peuple veut un gouvernement qu'il ne craigne pas, qu'il ne respecte pas, qui ait besoin de sa protection.
Savez-vous pourquoi vous êtes tombé sans être soutenu ? Parce que vous imposiez trop, parce que vous n'avez point de préjugés populaires. Si le Roi avait suivi, en 1840, la pente populaire, s’il s’était engagé n'importe dans quoi en harmonie avec les traditions de la révolution et de l'Empire, il serait arrivé on ne sait pas quoi, mais autre chose, quelque chose qui eût duré. J’écoute, je souris, j'objecte ; je finis par parler sérieusement, et on ne sait plus que dire. Les esprits sont bien grès de retomber dans les vieilles maladies ; mais les corps sont fatigués et impuissants.
J’ai passé près de deux heures à Bruxelles avec le Prince de Metternich. Grande satisfaction de me voir ; il voulait être plus que poli. Après lui, il a fallu entrer chez Madame de Metternich ; il m'y a conduit. Aussi gracieuse que lui, là, il a fallu m'asseoir. Des compliments et des questions sur mes filles, sur leur mariage ; on cherchait mes faibles pour entrer par là. Quand je m’en suis allé il m'a reconduit jusqu'au milieu de l'escalier. Il m'a même écouté en silence deux ou trois fois. Bonne conversation. Il m’a parlé de l’Autriche et de Thiers. Plein de confiance dans l’avenir de l'Autriche : " Les hommes qui gouvernent sont de braves gens, pleins de courage " sur quoi, il me raconte toutes leurs fautes, et les embarras qui résultent de leurs fautes. Mais tout va bien. Ce qu’il m'a dit de ses conversations avec Thiers m’a intéressé. Il a fini par : " Je ne suis pas Thiériste." Et alors une longue comparaison entre sa situation à lui Metternich, et la mienne, pourquoi, il ne retourne pas en Autriche, pourquoi je fais bien de rester en dehors de tout ; en quoi nous nous ressemblons et en quoi nous différons . Pour qu’il y ait vie, il faut qu’il y ait les conditions de la vie. Ce n'est pas la même chose d'être tout-à-fait vieux, et de ne l'être pas encore tout-à-fait & &. Il m'a amusé, et il s'est amusé. Adieu.
Mon fils vient de m’arriver. On dit qu’il y a ce matin, une séance publique de l'Académie française ; prix Monthyon, l'éloge de Mad. de Staël. J'irai peut-être, pour voir quelques personnes. Adieu, Adieu. J’espère bien avoir une lettre ce matin. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 21 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous avez cent fois raison, il vaut mieux, pour un pays avoir des Liverpool pour ministres que des Canning. Et les Liverpool ont une vraie supériorité, car ils ont un meilleur jugement ; ils voient mieux les choses comme elles sont en effet, et ils se conduisent selon l’intérêt du pays, non selon la fantaisie de leur esprit ou le besoin de leur vanité. C'est pourquoi l’instinct public les regarde, et avec raison comme des hommes plus sérieux. Reste en même temps cet autre instinct qui n'accorde les honneurs de l'admiration publique et historique qu'aux hommes en qui éclate quelque supériorité du premier ordre qui les met, par quelque grand côté de la nature humaine tout-à-fait hors de pair. Les deux instincts sont également fondés et également indestructibles ; ils répondent à deux faits tout différents. Votre sentiment politique n'est donc point bourgeois du tout ; il n’y a rien de plus noble que le bon sens ; mais il n'exclut pas mon observation. Quant à honorer plus au moins les Liverpool ou les Canning, c'est une autre affaire. Question d'estime individuelle, non plus d’intérêt public. Si les Liverpool, avec leur esprit moins haut et moins rare, sont exempts de cet égoïsme vaniteux qui est le tort ordinaire des Canning ils sont infiniment plus honorables. Mais cela n’arrive pas toujours ; j'ai connu des Liverpool tout aussi égoïstes, et tout aussi vains que les Canning. La médiocrité ne met pas toujours à l'abri de la vanité, et la supériorité peut s'élever jusqu'au désintéressement modeste.
Puis, laissez-moi vous dire une autre chose, que je ne dirais pas à d'autres, de peur de passer pour un mystique, ce que je ne suis guère. Je ne sais pas du tout quels sont les desseins de Dieu sur le genre humain, mais certainement il en a car il ne nous laisse jamais tranquilles. Notre bonne et heureuse condition ici bas ne suffit point à ce qu’il veut faire de nous ou par nous. Il ne permet pas que nous nous y établissions. Il jette un levain caché, il frappe un coup imprévu pour nous tenir en fermentation continuelle. Il faut que nous marchions, que nous nous transformions. Quelquefois, nous nous précipitons nous-mêmes à tort et à travers, et Dieu punit notre fougue aveugle. Puis, nous voudrions nous arrêter vivre en repos, jouir de nos biens. Dieu n'y consent pas. Pour son œuvre à lui, le Gouvernement des Liverpool ne suffit pas ; il place à côté d’eux des esprits plus exigeants, plus remuants qui veulent du nouveau, font du bruit, poussent et entraînent les hommes. Vers quel but ? Selon quel plan ? Dieu seul le sait. Mais je crois en Dieu ; j’entrevois quelque chose de ses desseins, et du rôle qu’y jouent les Liverpool et les Canning, les Villèle et les Châteaubriand ; et cela m’aide à me soumettre à ce que j’ignore profondément. Vous avez touché une corde sensible. Aussi vous voyez comme elle résonne.
Onze heures
Je crois que vous pouvez vous dispenser de vous r'abonner au National et à la Presse. Ils ont assez d'abonnés pour oublier de se venger de votre abandon. Girardin est pourtant capable d’être piqué. Je m'étonne que votre ennui l'ait emporté sur votre poltronnerie. Les articles de l'Indépendance belge ne m'étonnent pas. Il y a et il y aura à Claremont une lutte intérieure qui se manifestera par des hésitations, des contradictions et des intermittences. Du reste l'Indépendance belge peut fort bien faire de tels articles, sans Claremont. Le Ministère actuel, dont ce journal est l'organe, est très hostile à la fusion et à tout ce qui de près ou de loin, sent la légitimité. Ce sont les Odilon Barrot de la Belgique. Adieu, Adieu. Ma fille doit arriver à Paris ce matin. Guillaume ira vous demander vos commissions.
Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 24 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis un peu fatigué ce matin. Un mouvement de bile. Mon repos et un peu de diète m'en débarrasseront en deux jours. Plus j’y pense, plus je suis frappé de l'énorme malhabileté de cette circulaire et de l’excellente occasion ainsi manquée. On pouvait se poser (comme on dit aujourd’hui) à merveille, et on reste très mal posé, plus mal qu’auparavant. C'est savoir bien peu profiter de sa propre sagesse. M. le comte de Chambord se tient tranquille ; il ne veut ni conspiration, ni guerre civile, ni guerre Européenne. Il attend que la France sente elle-même qu’elle ne peut se passer de la Monarchie, et qu’il n’y a pas pour elle deux Monarchies. Quand la France sentira vraiment cela, elle le reconnaitra, tout haut. Comment ? Par qui ? Personne ne le sait aujourd’hui ; mais la France saura bien le trouver quand il le faudra absolument. Et quand la France aura reconnu cela, la monarchie sera rétablie. Voilà ce que dit la conduite qu'on tient. Il n’y avait rien de si aisé que de l’écrire; rien de si aisé que de repousser ainsi l’appel au peuple de M. de La Rochejaquelein, et de maintenir le droit monarchique sans offenser le droit national, bien mieux en le respectant et en agréant au sentiment public. On pouvait faire cela, et on fait ce que vous voyez ! J’ai peur que cette maladresse particulière ne soit le symptôme de la maladresse générale de cette intelligence politique de cette ignorance de l'état et de l’esprit du pays qui depuis si longtemps caractérisent et perdent le parti. C'est fort triste. Tout ce qu'on peut espérer c’est que cette sottise se perde dans la foule avec tant d'autres. Il en vient tant de tous les côtés.
Vous voyez que je ne me gêne guère ; je vous écris tout ce que je pense. Et ce que je vous écris, je le dis aux gens que je vois et à qui il peut être de quelque utilité que je le dise. Pourquoi me gênerais-je? J’ai un avis très décidé sur la situation; je crois qu'il y a un moyen, et qu’il n’y a qu’un moyen de sauver mon pays. Et en même je suis tout-à-fait hors de la mêlée simple spectateur et juge des coups. Je dis tout haut mon jugement C'est là aujourd’hui ma seule action. Je n'en cherche point d'autre. J’ai bien acquis le droit. d'exercer celle-là.
Midi
Je vois, par mes journaux, qu'on est aussi occupé à Paris, de la circulaire que je le suis moi-même dans mon nid. Plutôt on l'oubliera mieux ce sera. Les Débats sont en effet bien vifs contre la République. Ils prennent leurs avantages. Je veux m’arranger pour lire l'Union. Je ne vois pas d'ailleurs la moindre nouvelle qui mérite qu'on en parle. On annonce que la cour de Vienne a pris le deuil pour douze jours, pour le Roi Louis-Philippe. On y sera sensible à Claremont. Il n’y avait point eu de notification là, quand je suis parti. Adieu. Adieu.
Je ne me promènerai pas aujourd'hui. Je resterai tranquille dans mon Cabinet. Adieu. G.
Si vous revoyez Madame de Ste Aulaire, ou lui, faites leur, je vous prie, mes plus tendres amitiés.
Val-Richer, Mercredi 2 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous dirai bien peu de chose ce matin. Je viens de causer trois heures. J'en ferai encore autant dans la journée. Tout cela vous reviendra demain. J’ai vos deux lettres. Je ne suis jamais trop riche.
Je reçois la réponse de Villemain. L’Académie me laisse, pour mon retour, toute la latitude que je voudrai ; mais il est clair qu'elle a envie que je ne tarde pas trop. Je serai à Paris dans les huit derniers jours de ce mois. Je comptais y être vers le 10 novembre. J'avancerai de quinze jours. Grand plaisir. Mais soyez sûre que sauf mon plaisir, il ne me convient pas de paraître impatient d'être à Paris. L'Académie est un très bon motif de retour.
Villemain m'écrit une lettre charmante. J'en ai une de Duchâtel triste. Comme il peut être triste. Il a de bonnes vendanges en perspective. Parfaitement sensé et spirituel, selon sa coutume.
Je ne comprends rien aux Ellice. Je commence à croire qu’il y a, dans l’intérieur de cette famille, sur l’amitié de Marion pour vous, quelque chose de plus sérieux que nous ne savons, quelque grand orage domestique. Je ne m'explique pas Marion autrement. Il faut de la tragédie pour que ce ne soit pas très ridicule.
Nous verrons Radowitz à l'œuvre. Il me paraît de ceux à qui l’œuvre ne va guère, l'œuvre en chef et responsable. Les esprits actifs confus et faux, se sauvent à la faveur de la critique et des promesses. C’est quand il faut entrer dans la lumière, et l'action que leur vice éclate. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 18 octobre octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Morny s'est évidemment beaucoup servi de mon billet. Tout ce petit bruit des journaux vient de là. Je vous prie toutes les fois que vous en trouverez l'occasion de mettre la vérité à la place du bruit. Je ne cache rien de ce que je pense ; mais je n'accepte que ce que j'ai dit. Le jour où la bonne solution sera possible, je serai contre toute prolongation de pouvoir de qui que ce soit. Jusques là, je suis pour le maintien des seuls pouvoirs possibles, le Président et l'Assemblée. Et quand ils seront au pied du mur, Orléanistes et Légitimistes ensemble où chacun à son tour, seront forcément de cet avis, Bien maintenir ce qui est dans l’état provisoire, provisoire à courte échéance et le maintenir comme provisoire, il n'y a que cela de sensé.
J'envoie à Génie quatre pages de Préface pour le Washington sur la République, qui valent, je crois les dix pages que vous avez lues de la préface à Monk sur la Monarchie. Adieu, adieu, adieu, et encore.
G.
Val Richer 18 0ct. 1850
3 heures
Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de lire, dans Peel and his times, toute l'histoire du Reform- bill. Certainement il eût été possible de faire un Reform-bill plus conservateur, et qui n’entrainât pas dans le pays un si grand déplacement des influences, dans le Parlement un si complet changement des partis et des hommes en pouvoir. Il a manqué à Peel dans cette occasion, le courage qu’il a eu, envers son propre parti, dans l'affaire des Corn-laws il a manqué à Lord Grey le courage de s'entendre avec Peel au lieu de se livrer à l'emportement de la réforme. J’ai tort de dire de s'y livrer ; on a excité cet emportement ; on a porté de l’eau, non pas à la rivière, mais au torrent ; il y a eu visiblement, dans le mouvement populaire de cette époque, quelque chose de factice ne croyez-vous pas ? Et croyez-vous qu’il eût été possible à Lord Grey de se concerter avec Peel pour une réforme plus modérée ? Vous me répondrez probablement. Pas plus qu'il ne m'eût été possible à moi, avant Février de m'entendre avec Tiers sur la question de réforme. Les antécédents des hommes, des chefs sont des chaînes qu'ils ne brisent plus. Il n’y a que les soldats qui puissent changer de drapeau. Peel n'en a réellement pas changé en 1846. Il a fait alors ce qu’il avait fait toute sa vie. La consistency dans l’inconsistency, c'était son caractère et son système. Il ne savait résister invinciblement qu’au parti de qui il ne craignait rien. Vous voyez bien que je n'ai rien à vous dire du présent.
Onze heures
Je pardonne volontiers au Constitutionnel sa morale au général Changarnier. Il faut bien se donner une petite satisfaction quand on fait un sacrifice, et Changarnier a plus d’esprit qu’il n'en faut pour accepter sans humeur le sermon, d'ailleurs sensé, et poli que lui adresse M. Véron. Vous savez que j'ai toujours crue à cette fin. Mais je suis bien aise de la voir officiellement annoncée. Je compte avoir également raison en Allemagne. Et j'incline à croire que ce sera Ladowitz lui-même qui me donnera raison.
Je reçois une lettre de Van Praet à qui j’avais envoyé ma lettre au Roi Léopold. Il m’annonce une réponse du Roi et s'étend beaucoup sur la sympathie de la Belgique pour une Reine venue de France. Il me paraît clair qu'on recueille avec soin dans le Palais, toutes les raisons de se rassurer, et tous les points d’appui. Adieu.
Je vous écrirai un mot demain avant de partir pour Broglie. Je pars d'assez bonne heure parce que je m’arrête pour déjeuner à Lisieux. Il est bien convenu que lundi, mardi et mercredi, vous m'écrirez à Broglie. Adieu. Adieu. G.
18. Val-Richer, Samedi 19 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous plains, si vous avez autant de pluie que moi. Je ne me promène qu’entre deux déluges. Je me promène pourtant, car je me porte bien. Mais vous vous promenez-vous un peu en voiture ? J'espère que malgré vos mauvaises jambes, vous ne restez pas toujours enfermée. Le grand repos vous est nécessaire, mais le grand air aussi ; vous en avez l'habitude, et le goût. Dites-moi, je vous prie, ce que vous faites chaque jour à cet égard.
Pourquoi le Roi de Prusse refuse-t-il au général Lamoricière les eaux d'Aix la Chapelle ? Je trouve cela dur et d’une dureté inutile. Lamoricière ne conspirera et ne parlera pas plus à Aix la Chapelle qu'à Bruxelles. Je ne sais si les bannis sont incommodes ; ils sont, à coup sûr, bien inoffensifs.
Voilà Thiers qui débarque tout à coup à Gênes, et se rend en Suisse. Sa santé est altérée, comme celle de Madame la Duchesse d'Orléans. Cela me frappe assez. Puisque vous n’avez plus le Journal des Débats vous n'aurez pas lu un article assez intéressant sur Kossuth. Purement de l’histoire, mais de l’histoire dont Kossuth ne sera pas content. C'est à propos des Mémoires de Georgey.
Je voudrais savoir un peu réellement ces affaires de Hongrie. Je n’y vois pas clair. Je sais seulement que Kossuth est un révolutionnaire, et un charlatan, les deux espèces d'hommes qui me déplaisent le plus. C’est peut-être le mérite principal des Anglais de n'être point charlatans. Rien ne l'est moins à coup sûr, que le discours du Duc de Wellington sur la milice. Frappant mélange d’un esprit qui reste ferme et d’un vieux corps impuissant, et chancelant que l’esprit, par un dernier et pénible effort de volonté, fait encore servir à son image.
Le matin de je ne sais plus quelle bataille, M. de Turenne avait un accès de fièvre, et le frisson : on l’entendit qui marmottait entre ses dents : " Tu trembles, carcasse, si tu savais où je te mènerai tantôt ! " Je ne connais pas de parole qui prouve mieux l'immatérialité et l'immortalité de l’âme.
On dit, et ce sont les feuilles du Ministère qui le disent qu’il n’y aura pas de prolongation de la session du Corps législatif. Ils me paraissent, les uns et les autres pressés de se séparer. Je vois que M. et Mad. de Persigny sont rentrés dans le monde, ou plutôt que le monde est rentré chez eux. Le journal qui l’annonce dit que le même jour, M. de Maupas a donné un grand dîner. " Ainsi le faubourg St Germain était en fête. " Voilà M. de Persigny et M. de Maupas représentants du faubourg St Germain. Qu'on dise que le système représentatif est en décadence. Madame de Persigny voilà probablement un nouvel hôte de votre dimanche. Tout le monde la trouve jolie et agréable.
Qu'y a-t-il de vrai dans le travail et les espérances de rapprochement commercial entre l’Autriche et la Prusse ? Les journaux font bruit de la mission de M. Le Bismarck Schoenhausen à Vienne. Je voudrais bien qu'elle aboutît à l'accord. L'accord, l'accord, toute la politique est là. Adieu, en attendant votre lettre. Je ne viens pas à bout de comprendre pourquoi il y a plus loin de Schlangenbad à Paris que de Paris à Schlangenbad. 10 heures Pas de lettre aujourd’hui. C'est bien pis que d’arriver tard. Tant que vous ne vous porterez pas très bien, je ne pardonnerai pas l’inexactitude des courriers.
Paris, Vendredi 4 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
On dit que le rapport de M. de Tocqueville sera plus républicain qu’on ne voudrait, et adressé surtout aux républicains de l'assemblée, modérés ou Montagnards, pour les décider à voter en faveur de la révision, seul moyen, selon lui de consolider la république. Une assemblée constituante, fût-elle composée en majorité d'hommes monarchiques au fond, n’osera pas voter le rétablissement de la Monarchie ; elle aura peur des républicains et d'une révolution de plus. Donc elle votera le maintien de la République, et une meilleure constitution républicaine. Les républicains seraient fous de ne pas mettre à profit la timidité des hommes monarchiques. Déjà la première assemblée constituante, qui n’eût point fait la République, l'a bruyamment acclamée (Je répète avec déplaisir ce mauvais mot pour une mauvaise action). L'assemblée législative actuelle, qui ne l'aime pas du tout, l’a reconnue. Une nouvelle Assemblée constituante la confirmera, et l'améliorera en la détestant. Je ne sais si l'argument sera présente dans toute sa crudité ; mais on m’assure qu’il fera le fond du Rapport et que M. de Tocqueville se flatte même qu'à la seconde épreuve, en novembre prochain, les Montagnards, devenus intelligents, voteront en masse la révision qui aura ainsi, les trois quarts des voix à la grande humeur comme à la grande honte des monarchiques pris dans leur propre piège. Le revirement serait bizarre. Je n’y crois pas, et le duc de Broglie doute que le Rapport soit si nettement républicain. Mais rien n'est impossible aujourd’hui.
Voilà votre billet de Bruxelles. Merci. Ce n'est pas le Roi de Wurtemberg qui me fera regretter Ems, quoique je prisse plaisir à l'y rencontrer. Mais je ne puis vraiment pas me donner mon plaisir cette année. Je suis resté à Paris plus longtemps que de coutume. Il me faut un séjour de campagne. J’ai plusieurs choses à faire que je veux avoir faites, et prêtes, pour l'hiver prochain, avant la crise de 1852. Je ne travaille de suite, et vite, qu’au Val Richer. Je serai dérangé par ma course obligée à Claremont. Un autre dérangement dérangerait tout. J’avais du remords quand je n'étais pas sûr que vous seriez bien entourée à Ems. Aujourd’hui je n'ai plus que du regret. C'est bien assez. Malgré ma superbe, si le Roi de Würtemberg vient à Ems, soyez assez bonne pour lui dire qu'à coup sûr je regretterai bien vivement de n’y être pas venu cette année. J’irais plus loin qu’Ems pour causer avec un Roi homme d’esprit.
2 heures
Je reviens de chez Molé. Rien de nouveau. Plusieurs personnes manquaient. Tout le monde part. Molé va demain au Marais jusqu'à Jeudi prochain. Pas la plus petite nouvelle de Montebello à Londres. C'est singulier. La seconde course du duc de Nemours à Vienne est singulière aussi. Ils seront tous réunis à Claremont le 20 août.
Plus on va, plus on apprend que l'accueil fait au Président a été partout froid, et sur plusieurs points hostile. Son discours à Châtellerault a été un acte de défense. Il est revenu triste du voyage, quoique content du succès de son discours. Adieu.
Je vais à l'Académie. Je n'aurai que Dimanche votre billet de Cologne. Adieu, Adieu. G.
Paris, Lundi 6 septembre 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai manqué Fould hier, ce que je regrette. Je ne le verrai que demain, il est à sa cam pagne, certainement le Moniteur est à lui. J’avais oublié de vous dire. Il n’y a de communiqué que ce qui passe par lui. J'ai vu longuement Cowley hier. Voici ce que je relève de plus frappant de son opinion personelle " jamais un Bourbon ne pourra tenir en France. " Il regarderait donc une restauration comme devant ramener une révolution. Il est très décidé dans cette opinion. Il paraît qu’avant la conclusion de l’arrangement avec la Belgique. Les propos ici ont été très vifs jusqu'à menacer d'une invasion, aujourd’hui on se dit très content des deux côtés.
C’est Londonderry qui a eu la jarretière. Il a menacé de retirer trois voix au ministère dans la Chambre basse. On a cédé. Cela aura fort déplu à la Reine. Je doute que cela plaise au Président. Le dîner à St Cloud a commencé par un mistake. On était prié pour 5 1/2. Le Prince n’y était pas. Il se promenait à Bagatelle, il n’est rentré qu'à 6 1/2. Banischi avait fait le mépris. Le Prince s’est confondu en excuses. Il n’y avait personne Granville que Hubner, les Drouin de Luys, et une dame Rouger un peu leste. On a joué après mais pour de l’argent. Le Prince toujours très aimable puisque Hubner y était pour la princesse, Cowley aurait pu y être, ou Granville. Il n’y était pas. Hubner a dîné 3 fois depuis 3 semaines, pas un autre diplomate n’y dine.
J’ai eu hier une lettre toute d’amour de l’Impératrice elle-même. Elle m’écrit malgré ses yeux, & si tendrement ! Je ne sais rien de mon fils. Madame Kalerdgi était ici hier soir, maigrie, bien empressée pour moi, plein d’un nouveau roman allemand. Elle va en Russie dans 15 jours. Elle lève le camp à Paris, & n’y viendra plus qu'en passant. Molé avait l'air triste. J’avais assez de femmes. Il y a une grande disette d’hommes. On me conte qu'à Bade la suite du Prince s’y est rendue. Odieuse par sa jactance. Là on ne croit pas au mariage la [grande duchesse] Stéphanie serait contre ; elle veut du plus assuré pour sa petite fille. Il est question de Luitpold de Bavière qui doit être roi de Grèce. C'est Mad. Kalerdgi qui me rapporte cela, elle en vient. Voilà je crois toutes mes nouvelles.
Kolb part demain pour Bade avec les Delmas. Oliff est toujours à Trouville. Aggy s'en va après demain pour 10 jours chez les Hainguerlot. Vous voyez qu'on me délaisse. Je ne puis pas m'opposer. Adieu. Adieu.
Persigny n'a fait aucune affaire à Londres, et n’y a vu personne. Il a fait une visite de politesse à Malmesbury voilà tout. Il y était allé simplement pour amuser sa femme. Il est très amoureux d’elle. Voici quelques extraits de la lettre de l’Impératrice. Vos lettres me sont encore plus chères qu’autre fois, puisque nous nous connaissons et nous aimons encore mieux. Se revoir nous a réchauffé le cœur l'une pour l’autre. Je sais que sous la [Princesse] Lieven politique il y en a une autre qui est à moi, et à Dieu. Midi. Aggy remet son voyage à Tours jusqu'à la semaine prochaine
Mots-clés : Circulation épistolaire, Diplomatie, Femme (politique), Littérature, Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Politique, Politique (Angleterre), Politique (France), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Restauration (France), Révolution, Salon, Santé (Dorothée)
Paris, Mardi 5 octobre 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
Sainte-Aulaire est venu me voir hier soir. Il me dit que Montalembert était venu à Paris pour soigner l'impression d'un ouvrage qui va paraître sur le gouvernement représentatif & sur l’église. Le fond sera que la religion ne peut fleurir qu’avec la liberté, qu'il n’y a pas de liberté en France & que les prêtres ne sont plus que des courtisans, il veut un [gouvernement] représentatif. Vous voyez comme cela va faire fortune ici ! Je doute que son ouvrage paraisse. Il est indigné de la servilité du clergé. On le dit très amer. comme je ne l'ai jamais vu seul, je n’en sais rien.
Hecken est aussi venu hier soir entre le sérieux & le comique c'était assez drôle et assez menaçant. Après l’empire on prendra la Savoie en conseillant au roi de Sardaigne de se dédommager par la Lombardie, & puis on effacera la Belgique. Et puis, si la Russie et l’Autriche se fâchent, on leur lancera la révolution. Tout cela accompagné d'éclats de rire, vous en ferez ce que vous voudrez. Non pas ceci à la lettre s’il vous plaît car même en plaisanteries je n'aime pas que rien ressorte de chez moi. On trouvera une princesse. Cela ne peut pas manquer. Le Moniteur annoncera les fiançailles un beau jour lorsqu'on s’en doutera le moins. Jérôme est inquiet et mécon tent. L’Empire héréditaire et l’adoption cela ne lui convient pas du tout, & il dit : " Le frère de l’Empereur est plus fort que le neveu. " Vous fais-je assez de commérages ? On voulait savoir hier qu'il était venu une note Anglaise sur le lac français. Je veux bien croire à une dépêche peut être, à une note non. Au reste, je ne sais rien de direct depuis ce que je vous ai dit sur ce sujet. Il y a des tempêtes affreuses la nuit. Kisseleff part dimanche. Adieu. Adieu.
6. Val Richer, Jeudi 2 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Le journal des Débats m’a manqué hier, je ne sais pourquoi. C'est comme si toute la politique me manquait. Il devrait traiter votre question en pleine connaissance de cause et sensément. Je doute que votre politique expéditive soit pratiquée. On craint trop les conséquences de toutes choses pour rien commencer vite. Sauf ce que vous m'écrivez, et ce que je vous écris, il est impossible de penser moins que je ne le fais à ce qui se passe.
Je ne m'occupe que de ce qui se passait il y a deux cent ans. Il y a deux cent ans précisément, Cromwell chassait, en personne le Long Parlement et se faisait Protecteur. Je m'amuse parfaitement à le regarder faire et à le raconter. On m'écrit de Londres pour me presser instamment de publier, mon livre cette année même, au mois de décembre, pour l’anniversaire du protectorat. Partout on se plaît aux coïncidences de dates. Je crois que je leur donnerai cette satisfaction.
Vous ne vous souciez guère de la Chine. Cependant le Galignani me dit que les agents anglais et Français ont promis le secours de leurs vaisseaux pour empêcher cet Empire là de tomber. Soutenir deux Empires à la fois en Orient, c’est beaucoup. La coïncidence est singulière. Je suppose qu’elle ne vous plait pas davantage dans l'Orient asiatique que dans l'Orient européen. Mais vous n'êtes pas engagés à protéger les Chinois contre les Tartares comme les Grecs contre les Musulmans. Bizarre spectacle que celui du monde aujourd’hui ! Ce sont des hérétiques, et des schismatiques qui s'en partagent ou s'en disputent la domination. Le Pape ferait plus sagement de voir en eux des Chrétiens que de s'obstiner à les anathématiser, comme au temps où les catholiques dominaient partout. Je suis encore plus frappé de la décadence d’esprit de la cour de Rome que de celle de sa force. C'est dommage.
Onze heures
Le rappel de Brünnow serait drôle. J’ai point à y croire. Les Débats sont curieux en effet. Ils ont raison. Adieu, adieu. Vous avez raison de ne prendre personne à la place de votre Allemand. Marion vaut un homme et une femme. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 24 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quand Xérès fit dire à Léonidas " rends-moi tes armes " c’est, je pense, qu’il était un peu embarrassé de passer les Thermopyles ; et Léonidas fit acte de bon sens comme d’héroïsme en lui répondant " Viens les prendre."Il me paraît qu’Omer Pacha, est dans le même embarras que Paris, et qu’il somme le Prince Gortschakoff de passer le Danube et de venir l'attaquer, le menaçant de le passer lui-même et d'aller l’attaquer, en cas de refus. Je ne sais si c’est sérieusement qu’on écrit cela de Bucarest ; il n’y a pas eu beaucoup de situations plus ridicules que celle de ces deux armées qui vont passer l'hiver à se montrer le poing d’un bord du Danube à l'autre. Entendez-vous parler de l’Asie et la guerre peut-elle vraiment commencer là, à défaut de l'Europe ?
Je n'ai pas eu hier de nouvelles de la Reine Marie Amélie. Quand même elle continuerait d'aller mieux, elle serait hors d'état de faire son voyage d’Espagne. Les Princes ont écrit à leur frère Montpensier de venir sur le champ à Genève. On préparait, à Lisbonne, une très belle et très affectueuse réception pour la Reine. La Reine de Portugal mettait du prix à la traiter avec éclat. Le Duc de Nemours est accouru en hâte, laissant sa femme à Vienne où il retournera probablement. Je dis comme vous, je n'ai rien à dire. Je vous quitte pour aller profiter, dans mon jardin d’un temps admirable. Nous avons eu hier le plus beau jour de l’année, chaud et clair. comme dans un bel été. Aujourd’hui sera aussi beau.
Un journal dit que sir Edmund Lyons reprend du service comme marin, et va rejoindre comme contre amiral, la flotte de l’amiral Dundas. Lord Palmerston ne peut pas renvoyer en Orient un agent plus dévoué, plus remuant, plus impérieux, et plus anti-russe.
Midi
Je ne m'étonne pas de toutes ces mollesses. Il n’y a vraiment pas un motif sérieux de guerre, à moins qu’on ne s'échauffe par taquinerie, et ce n'est pas la peine. Adieu. Adieu. Ma fille vous remercie de vos bons souhaits. Elle part ce soir, en assez bonne disposition. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 9 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de parcourir, cet immense acte d'accusation contre le complot, de l'opéra comique. Ce sont les mêmes idées, les mêmes desseins, les mêmes paroles que de mon temps. Les noms propres ne signifient plus rien, ni pour le gouvernement, ni pour les conspirateurs. C'est une perversité et une démence permanente, abstraite, qui passe de génération en génération, sans qu’il vaille, la peine de savoir qu’ils en sont les instruments momentanés ; ils ne se distinguent pas les uns des autres, et ils s'attaquent indifféremment à Charles et à Louis-Philippe, à Napoléon III, à Frédéric Guillaume à Ferdinand. Le premier qui trainera réellement ce démon rendra un immense service à l'humanité.
Les journaux ne m’apprennent absolument rien. Sans doute on ne s’est pas encore battu. On ne cache pas longtemps une bataille. Je suis décidé à croire que vous rejetterez les Turcs dans le Danube, et que l'affaire finira par là. J’ai bien des choses à vous dire, mais nous sommes trop près de nous revoir. Nous causerons la semaine prochaine. Je pars décidément. Mercredi soir 16.
J’ai des nouvelles de Broglie, de Piscatory et de Barante qui m’en disent encore moins que les journaux. Barante est frappé de l'apathie universelle, sauf une seule espèce d'homme, la démagogie révolutionnaire : " C'est la seule opinion qui conserve quelque vivacité. De jour en jour, elle manifeste plus de démence et de rage. Elle espère et menace. Les chefs qu’on a ménagés, les envolés des sociétés secrètes qu’on a rappelés du bannissement sont les plus animés. Leur action sur les classes marchandes et sur les gens de la campagne est tout-à-fait nulle ; mais la cherté du pain et surtout du vin, leur donne assez de prise sur les ouvriers de nos villes. " Piscatory ne pense qu’à l'hiver prochain et à la disette.
Onze heures
Adieu, Adieu, à nos prochaines conversations.
Orosmane dit à Zaïre : Mais la mollesse est douce et sa suite est cruelle ; je mets la faiblesse à la place de la mollesse et un politique à la place d'Oromance ; si on n’avait pas été, en commençant, faible avec Lord Stratford, faible avec les Turcs & &, on ne serait pas si embarrassé.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conversation, Economie, Guerre de Crimée (1853-1856), Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Pensée politique et sociale, Politique, Politique (Analyse), Politique (France), Politique (Russie), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique
44. Paris, Jeudi 20 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai dîné hier chez M. Molé. La famille Molé et Noailles, MM. de Falloux, de Barante Berryer, Corrales, Mallac. Beaucoup plus d'Académie que de politique. Berryer se décide à se faire recevoir. Il ne peut pas se montrer plus difficile que ses amis dont l’un, l'évêque d'Orléans, va entrer, et dont l’autre, M. de Falloux, se présentera à la plus prochaine vacance. La réception de Berryer aura lieu probablement dans le cours du moi de Mai. Quelle fête pour Salvandy ! Trois discours de réception ; Berryer, tout à l’heure, M. de Sacy et l'évêque d'Orléans un mois de Décembre prochain. Le Duc de Noailles part lundi pour aller passer deux un trois jours à Bruxelles. Je m'en réjouis vraiment pour vous.
Montebello est parti pour conduire lui même son fils à Brest, où il va s’embarquer pour aller rejoindre l'amiral Parseval. Quoiqu’un peu rétabli, ce jeune homme est encore faible et tousse toujours à la suite d’une pleurésie. Mais à aucun prix, il n’a voulu manquer son embarquement. L'inquiétude du père m'a touché. Je ne crois pas que vous puissiez compter le voir à Bruxelles, ses enfants et ses affaires l'en empêcheront.
C'est l'Empereur Napoléon, dit-on, qui a insisté pour que le Duc de Cambridge passât par Vienne et fît un nouvel effort pour décider l’Autriche à entrer dans l'alliance.
J’ai vu hier Ellice, très appliqué à dire et à prouver que les deux gouvernements sont très contents l’un de l’autre, et que le gouvernement français fait tout ce qu’il doit et peut faire pour agir en Orient aussi efficacement et aussi promptement que le gouvernement anglais peut et doit le lui demander.
Sir H. Seymour persiste à dire, vous le voyez qu’il a perdu ses bagages. C’est incroyable, et cela fait ici plus de bruit que vous ne pouvez croire. On répète partout : " Barbares, barbares ! " et le mot de M. de Rulhières. " Entrouvez la veste. Vous verrez le poil encore tout rude." Les comédies, les opéras, les vaudevilles anti-russes se multiplient sur les théâtres.
Après le dîner chez Molé, la soirée chez Mad. d’Haussonville. Peu de monde, les Rémusat, les d'harcourt, Langsdorff, de Sahune. Le Duc de Broglie n’y était pas. Mad. de Staël est arrivée avant hier de Genève. On annonce une rentrée éclatante de Melle. Rachel dans une nouvelle tragédie de Médée, dont j’ai entendu la lecture il y a un an. Assez de talent. L’auteur, M. Legonel, sera l'un des concurrents de M. de Falloux aux prochaines vacances de l'Académie. Voilà votre N°34. Je me suis trompé de N°. Mardi, j'aurais dû mettre, 42 et non pas 43. Adieu. Adieu. G.
[?], Le 19 octobre 1854, Frédéric-Alfred de Falloux à François Guizot
Le 5 mars 1849, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Mots-clés : Bonheur, Décès, Deuil, Discours du for intérieur, France (1848-1852, 2e République), Politique