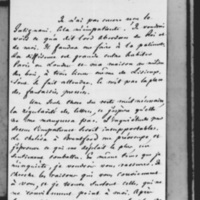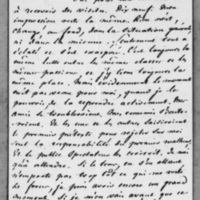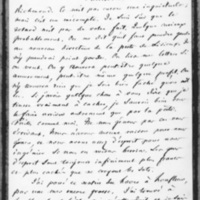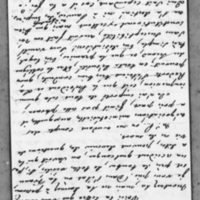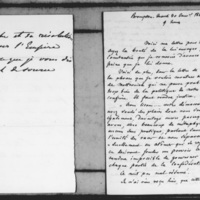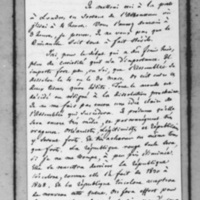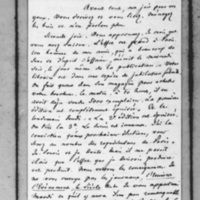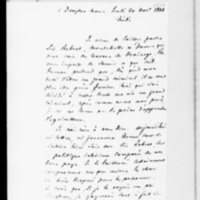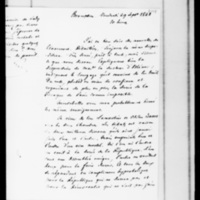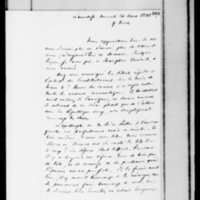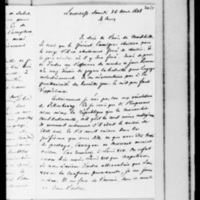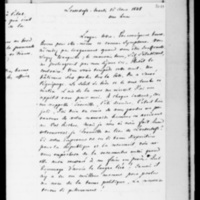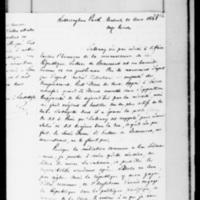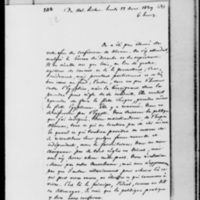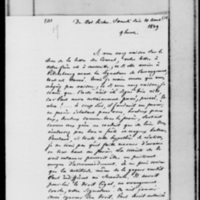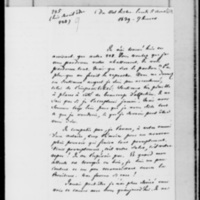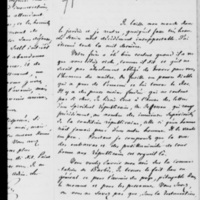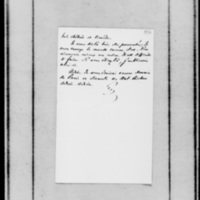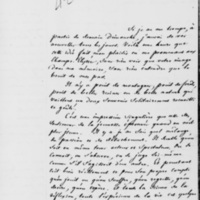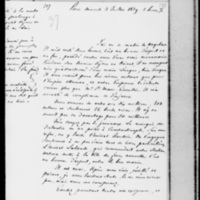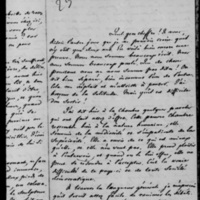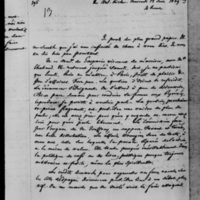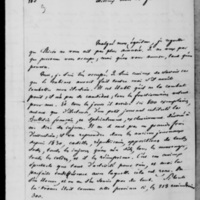Votre recherche dans le corpus : 150 résultats dans 3515 notices du site.
Val-Richer, Jeudi 2 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
J’ai été bien heureux hier tout le jour. Je crois que mes hôtes m'ont trouvé bien gai. Comme notre âme tombe tout entière sous le joug de son impression du moment. Vous savoir un peu tranquille et être moi-même un peu tranquille, sur votre compte, me suffisait. J'étais presque content comme si vous aviez été là. Ce n’est pas vrai.
J’ai sous les yeux une image de l’extrême éparpillement et dispersion des esprits en France. Mes deux hôtes au fond, pensent et veulent tous deux la même chose; ce sont deux hommes du même parti, et deux hommes d’esprits. L’un croit au retour de la Monarchie pure, l'autre croit au succès définitif tant bien que mal de la République. L'avenir est si obscur et si incertain que des yeux qui y cherchent, et y souhaitent la même chose y voient. des choses contraires. Cela fait peur pour notre destinée et pitié pour l’esprit humain. Tous deux sont fort tristes et inquiets, à cause de la bêtise et de la platitude universelles. Un garde national de Paris disait le 25 février 1848, en criant contre les ouvriers, la populace et l’anarchie : " Puisqu'on leur livre tout, qu’ils nous laissent tranquilles. " Le pays livre soit tout volontiers, l’avenir comme le passé, pourvu qu’on le laissât tranquille. Heureusement que le bon Dieu ne se contente pas à si bon marché que les hommes ; et me permet pas qu’ils soient tranquilles à tout prix. Le Cabinet actuel moins près de tomber qu'on ne le croit. Dufaure et Tocqueville, ses vrais chefs, charmés du régime actuel, comme des acteurs d'une ville de province appelés à jouer sur le théâtre de Paris, et décidés à s'y maintenir. Sincèrement attachés à la République et à la Constitution, et se flattant qu'ils y contiendront le Président. Plus ennemis de Thiers que jamais. Tocqueville a dit à M. de Lavergne : " Il faut que M. Guizot entre dans l'Assemblée ; il n’y a que lui qui puisse nous délivrer de M. Thiers. " M. Molé renonce à l'Empire comme il a renoncé à la fusion. Il renonce même à la Présidence à vie ou décennale. Il faut rester dans la Constitution. Mais quand on en viendra à l'élection d'un président, dans trois ans, il faut que le peuple réélise Louis Napoléon malgré la Constitution qui le défend. Le peuple seul est au-dessus de la Constitution, et peut la violer s'il veut. Tout le monde se soumettra alors. C’est avec cette perspective que M. Molé tâche de calmer un peu les amis impatients du président ; et de gagner du temps, sa seule politique au milieu de toutes les impossibilités d’aujourd’hui.
J'ai vu un Belge intelligent, et fort au courant de son pays et de sa cour. Le Roi Léopold assuré et tranquille mais supportant avec humeur, quoique patiemment, le joug de son cabinet actuel, les Barrot et les Dufaure de Bruxelles, qui ne lui épargnent pas les impertinences et les désagréments. Onze heures Votre lettre confirme celle d’hier. Vous n'êtes pas mal, et vous verrez de temps en temps M. Guéneau de Mussy. Adieu Dearest, à demain la conversation. La cloche du déjeuner sonne. Adieu. Adieu. G. Vous vous trompez sur le sentiment qui fait dire au Duc de Broglie ce qu'il vous dit. Peu importe du reste. Adieu encore et toujours.
Val-Richer, Mercredi 1er août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève d'impatience. J’attends la poste. Elle n’arrivera qu'à 10 heures et demie. Que m'apportera- t-elle ? J'ai reçu hier une lettre de Mad. Austin qui me dit que son mari, qui est à Brighton lui écrit que tout le monde s'y porte bien. Je désire beaucoup que vous ayez vu MM. Guéneau de Mussy. Mais que sert tout ce que je puis vous dire de loin ?
Avez-vous remarqué, dans le Times de samedi dernier 28, un excellent article sur l'état de la France que je retrouve dans le Galignani d'avant- hier 30 ? Vraiment excellent. Jamais la conduite de l’ancienne opposition dynastique, et de Thiers en particulier, n’a été mieux peinte et mieux appréciée. Beaucoup de gens en France voient et disent tout cela ; mais ils n'en font ni plus ni moins. Le bon sens porte ses fruits en Angleterre. Là où, il se rencontre en France, c'est une fleur sans fruits. Rien ne se ressemble moins chez les peuples du midi, que la conversation et la conduite ; ce qu’ils pensent et disent ne décide pas du tout de ce qu’ils font. Pleins d’intelligence et de jugement comme spectateurs, quand ils deviennent acteurs il n’y paraît plus. Bresson et Bulwer m’ont souvent dit cela, des Espagnols. Bien pis encore qu'ici, me disaient-ils. Nous n'avons plus le droit d’être sévères pour les Espagnols. Les Hongrois se défendent énergiquement. Je ne sais pas bien cette affaire-là. Je crains que le Cabinet de Vienne par routine ne se soit engagé dans des prétentions et des déclarations excessives non part contre le parti révolutionnaire de Hongrie, mais contre les anciens droits et l’esprit constitutionnel de la nation. On ne saurait séparer avec trop de soin ce qui est national de ce qui est révolutionnaire, ce qui a un fondement en droit et dans les mœurs du pays de ce qui n’est que rêverie et insolence de l’esprit d'anarchie. Le Prince de Schwartzemberg, est-il en état et en disposition de faire ce partage ? Je parle d'autre chose pour me distraire d’une seule chose. Je n'y réussis guères. Adieu. Adieu jusqu'à la poste.
10 heures trois quarts
M. de Lavergne et M. Mallac m’arrivent de Paris, et la poste n'est pas encore là. Parce que j’en suis plus pressé que jamais. Je n'ai pas encore causé du tout avec ces messieurs. Ils sont dans leurs chambres. Je ne pourrai causer avec personne que lorsque j'aurai ma lettre et pourvu qu’elle soit bonne. Voilà ma lettre. Excellente. J’ai le cœur à l'aise. J’étais sûr que M. Gueneau de Mussy vous plairait. Croyez-le et obéissez-lui autant que vous le pourrez faire pour un médecin. Il m’est très dévoué. Il vous soignera bien. Adieu. Adieu. Je vais rejoindre-mes hôtes. Adieu dearest. J’espère que le bien se soutiendra. G.
Val-Richer, Mardi 31 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Qu'aurez-vous fait ? Où êtes- vous ? Comment êtes-vous ? Je ne puis pas penser à autre chose. J'espère que vous serez allée à Brighton. J'en ai eu hier des nouvelles. Sir John Boileau y est. Il parle du bon état de l’endroit, de la bonne disposition de ceux qui y sont, sans doute le choléra n’y est pas. Et la peur que vous avez du choléra m'inquiète autant que le choléra même. Quand je l’ai eu en 1832. Mes médecins, Andral et Lerminier, ont dit que, si j'en avais eu peur il aurait été bien plus grave. Je n'en avais point peur. Que je voudrais vous envoyer ma disposition ! Et aujourd’hui mardi, je n'aurai même pas de nouvelles de ces nouvelles déjà vieilles de 48 heures. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il me paraît bon pour donner un bon conseil et de l’appui, aussi bien que des soins. Je serais étonné s’il ne s’était pas mis complètement à votre disposition. Demain, demain enfin, je saurai quelque chose. Quoi ?
Dearest, je veux parler d’autre chose. Voilà l'Assemblée prorogée. Avec une bien forte minorité contre la prorogation. Je doute que ce soit une bonne mesure. Dumon, qui va venir me voir, m'écrit : " Vous êtes arrivé au milieu d’une crise avortée. Le Président ne fera pas son 18 Brumaire dans une inauguration de chemin de fer et l’Assemblée n'a d’énergie que pour aller en vacances. Le parti modéré n'a ce me semble, que les inconvénients de sa victoire. A quoi lui serviront les lois qu’il fait si péniblement ! Est-ce le mode pénal qui nous manque ? Mais déjà les dissentiments percent, dans la majorité. Elle se divise comme si elle n’avait plus d'ennemis. Je crains bien que le parti légitimiste ne soit avant longtemps, un obstacle à la formation, si nécessaire du grand parti qui comprendrait les libéraux désabusés, les conservateurs courageux, et les légitimistes raisonnables. Il a bien bonne envie d'exploiter à son seul profit, cet accès de sincérité qui fait faire depuis huit jours tant de confessions publiques, et il semble disposé à marchander l'absolution à tout le monde, sans vouloir l'accepter de personne. Tout ce que je vois, tout ce que j’entends dire me donne une triste idée de la situation du pays. Avec l'économie sociale d’une nation civilisée nous avons l’état politique d’une nation à demi barbare. L'industrie et le crédit ne peuvent s’accommoder de l’instabilité du pouvoir ; la douceur de nos mœurs est incompatible avec sa faiblesse. Nous ne pouvons rester tels que nous sommes ; il faut remonter ou descendre encore. Notre faiblesse s'effraie de remonter ; notre sybaritisme s'effraie de descendre. Il faut bien pourtant ou travailler pour le mieux, ou se résigner au pis : tout avenir me semble possible excepté la durée du présent. Je ne crois pas que la prolongation (je ne dirai pas la durée) du présent soit si impossible. Le pays me paraît précisément avoir assez de bon sens et de courage pour ne pas tomber plus bas, pas assez pour remonter. On compte beaucoup, pour le contraindre à remonter sur l’absolue nécessité où il va être de retrouver un peu de prospérité et de crédit qui ne reviendront qu’avec un meilleur ordre politique. Je compte aussi, sur cette nécessité ; mais je ne la crois pas si urgente qu’on le dit. Nous oublions toujours le mot de Fénelon : " Dieu est patient parce qu'il est éternel. " Nous croyons que tout ira vite parce qu’il nous le faut, à nous qui ne sommes par éternels. Je suis tombé dans cette erreur-là, comme tout le monde. Je veille sans cesse pour m’en défendre. Je conviens qu’il est triste d'y réussir ; on y gagne de ne pas désespérer pour le genre humain ; mais on y perd d’espérer pour soi-même.
Dîtes-moi qu’il n’y a plus de choléra autour de vous et que vous n'en avez plus peur, je serai content, comme si j’espérais beaucoup, et pour demain.
Onze heures Je n'attendais rien de la poste et pourtant. il me semble que c’est un mécompte. Adieu, adieu, adieu, dearest. God bless and preserve you, for me ! Adieu.
Val-Richer, Samedi 28 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
D’une heure à cinq hier ma maison n'a pas désempli. Orléanistes, quelques légitimistes quelques quasi républicains honteux. Pour moi de la bienveillance, et de la curiosité. En soi, toujours les mêmes dispositions, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Du bon sens, de l’honnêteté, même du courage ; tout cela trop petit et trop court. C'est la taille qui leur manque à tous. Ils ne sont pas au niveau de leurs affaires. Ils n'atteignent pas ou il faudrait atteindre pour faire quelque chose. Grandiront-ils assez et assez vite ? Mes arbres ont très bien poussé. Je ne suis pas aussi sûr des hommes que des arbres. Je suis content de la visite d’Armand Bertin. Le Journal restera dans une bonne ligne ; impartialement en dehors du présent, fidèle avec indépendance au passé. Et fidèle à moi avec amitié si j'étais à Paris pouvant causer deux ou trois fois par semaine, il ne s’y dirait pas un mot qui ne me convint. Spécialement sur les Affaires Etrangères. D’ici, il n’y a pas moyen d'y regarder de si près. Pourtant on marchera toujours du bon côté.
Des lettres de Barante, de Philippe de Ségur, de Glicksbierg. Barrante affectueux et triste, voyant toutes choses avec la sagacité un peu stérile d’un esprit juste et d’un cœur abattu. Un grand pays à moins qu’il ne soit réellement destiné à périr, n'est jamais si dépourvu de forces et de remèdes qu’il en a l’air. Il supporte et attend deux choses qui nous sont bien difficiles à nous passagers éphémères sur la scène, sans en avoir le projet formel, évidemment Barante finira par venir à Paris. " J’ai un bien vif regret, me dit-il, que mon lieu de retraite, soit si loin du vôtre. Sans cela, je serais allé tout de suite vous revoir. Si quelque circonstance de famille ou d'affaire m'appelle à Paris, je serai bientôt après au Val Richer On fait ce qu’on prévoit si clairement. Ségur très amical, croyant que ma maison à Paris n'est plus à ma disposition, et voulant. que, si j’y vais, j'aille occuper la sienne. Il n’y reviendra que tard, en hiver. Glücksbing est toujours à Madrid. Il m’écrit qu’il va publier quelque chose sur la réforme douanière et financière de l'Espagne, et finit par cette phrase : " M. Mon dit qu’il va vous écrire pour vous engager à venir passer quelques mois en Espagne. A part les bouffées de jalousie entre lui et le général Narvaez, dont il adviendra ce que Dieu voudra, tout marche admira blement ici. Les nouvelles d’Andalousie sont excellentes, et vous aurez remarqué l'accueil que le duc et la duchesse de Montpensier ont reçu à Gibraltar. "
En avez-vous vu quelque chose dans les journaux Anglais ? Si nous étions ensemble, je vous lirais les lettres, et elles vous amuseraient. Elles ne méritent pas d'être envoyées si loin. Je vous donne ce qu’il y a de mieux. Voulez-vous, je vous prie, faire mettre à la poste cette lettre pour Lord Aberdeen, en y ajoutant son adresse actuelle ? Je ne sais où le prendre. Onze heures Votre lettre m’arrive. Et Hébert en même temps. Pour la journée seulement. J’aime assez qu'on prenne cette habitude de venir me voir sans s’établir chez moi pour plusieurs jours. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 27 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma journée d'hier a été une conversation continue. D’abord avec Salvandy, arrivé à 9 heures et demie, parti à une heure. Puis, avec Bertin et Génie, partis après dîner à 8 heures et demie. Presque toujours dans la maison, à cause de la pluie, vent, orage, grêle. Pourtant quelques intervalles lucides pour se promener en causant. Mon sol est promptement sec.
Salvandy très vieilli. Sa loupe presque doublée. Ses cheveux très longs, pour la couvrir, et très éclaircis, ce qui fait qu’ils la couvrent mal. Toujours en train, mais d’un entrain aussi un peu vieux. Il m'a dit qu’il réimprimait une ancienne brochure de lui, de 1831. Il fait de ses conversations comme de ses brochures. Il est à Paris depuis trois semaines, et y retourne aujourd’hui pour y rester jusqu'aux premiers jours d’août. Après quoi, il revient dans sa terre, à Graveron à 18 lieues de chez moi. Il viendra me voir souvent. A Paris il a vu et il voit tout le monde, excepté Thiers qui ne l'a pas cherché et qu’il n'a pas rencontré. Il raconte Molé, Berryer, Changarnier, le pauvre Bugeaud.
Molé plus animé, plus actif, écrivant plus de billets, faisant plus de visites donnant plus d’aparté que jamais. Président universel et perpétuel, de la réunion du Conseil d'état, de la société pour la propagande, anti-socialiste, de son bureau à l'Assemblée de je ne sais combien de commissions, de tout, excepté de la République. On a fait de lui une caricature très ressemblante, mais où on l'a vieilli de dix ans, avec cette devise : Espoir de notre jeune République.
Il était vendredi dernier à un dîner du Président, faisant les honneurs du salon à MM. S Marc Girardin, Véron, Jules Janin, Janvier & & C'est le dîner où Bertin a refusé d'aller. Le Président, en habit noir cravate blanche, bas de soie, tenue très correcte. M Molé en habit marron, cravate noire, et pantalon gris. Le plus heureux des hommes d’aujourd’hui fort sensé, fort écouté, fort compté, satisfait dans ses prétentions pour lui-même, espérant peu, se contentant de peu, et peu puissant pour le fond des choses. Laissant tomber l'idée de la fusion et s’attachant de plus en plus à la combinaison actuelle n'importe quelle forme nouvelle elle prenne tôt ou tard, car tout le monde croit à une forme nouvelle.
Les voyages du Président préoccupent beaucoup, en espérance ou en crainte. Il est très bien reçu. Il est très vrai qu'on lui crie : Vive l'Empereur et pas de bêtises ! M. Dufaure était un peu troublé à Amiens, et disait : "Je ne croyais pas ce pays-ci tant de goût pour l'autorité. " On se demande ce qui arrivera à Tours, à Angers, à Saumur, à Nantes, surtout à Strasbourg, où il ira ensuite, et qui paraît le principal foyer des espérances impériales. Je suis porté à croire qu’il n’arrivera rien. Tout le monde me paraît s'attendre à un changement et attendre que le voisin prenne l'initiative du mouvement. Point de désir vif, grande défiance du résultat, grande crainte de la responsabilité. Ni fois, ni ambition, ni amour, ni haine. On se trouve mal ; mais on pourrait être plus mal et il faudrait un effort pour être mieux. Et quel mieux ? Un mieux obscur, peut-être pas sûr, qui durerait combien ? Voilà le vrai état des esprits. Le Président ne pousse lui-même à rien. Ceux qui le connaissent le plus le croient ambitieux. Mais personne ne le connait. Il n’a un peu d'abandon. que pour faire sa confession de son passé. Le sang hollandais domine en lui. Il fera comme tout le monde ; il attendra. En attendant ses voyages et ses dîners le ruinent. Il ne peut pas aller. On va redemander de l'argent pour lui. Douze cent mille francs de plus. L'assemblée les donnera. Tristement, car l'état des finances est fort triste. M. Passy tarde à présenter son budget parce qu’il se sent forcé d'avouer, pour 1849, un déficit de 250 millions, & d’en prévoir un de 320 millions pour 1850. On espère ressaisir 90 à 100 millions de l'impôt sur les boissons. Mais comment faire un emprunt pour le reste ? Les habiles sont très perplexes.
La Hongrie n'est pas si populaire à Paris qu'à Londres. Toute l’Europe est impopulaire à Paris les révolutions et les gouvernements. On craint Kessuth et votre Empereur. On croit que c’est l’Autriche qui ne veut pas en finir avec le Piémont afin de tenir en occident une question ouverte qui puisse motiver l’intervention en Italie quand on en aura fini avec la Hongrie.
Il y a eu un temps, déjà ancien de 1789 à 1814, qui était le temps des confiances aveugles. C’est aujourd’hui le temps des méfiances aveugles, suite naturelle de tant de déceptions et de revers. Et la suite naturelle de la méfiance, c'est l'inertie. La France ne demande qu’à se tenir tranquille en Europe. Elle ne se mêlera des affaires de l'Europe qu'à la dernière extrémité, par force et toujours plutôt dans le bon sens, à travers toutes les indécisions et toutes les hypocrisies, comme à Rome. Le gouvernement de Juillet, qui n’a pas su se fonder lui-même, a fondé bien des choses, et on commence à s'en apercevoir. Sa politique extérieure surtout est un fait acquis que tout le monde veut maintenir. Et non seulement on la maintient, mais on en convient et bientôt en s'en vanterai. On m'assure, et je vois bien que comme Ministre des Affaires Etrangères, je suis déjà plus que réhabilité, même auprès des sots. Je vous quitte pour répondre autour Préfet du Havre qui m’a écrit la lettre la plus respectueuse et la plus heureuse que j'aie approuvé sa conduite. Il me dit : " En conformité du désir que vous en avez exprimé, j'ai l’honneur de vous apprendre que les individus qui avaient été arrêtés vendredi dernier ont déjà été relâchés à l'exception de deux que la justice revendique comme habitués de la police correctionnelle, et comme étant d'ailleurs coupables d'avoir joint à leurs cris stupides une tentative d’escroquerie chez un boucher de la rue de Paris. Votre approbation m’a été précieuse et m’a prouvé que j’avais eu raison de ne pas donner à cette ridicule gaminerie les proportions d’une émeute en l’honorant de la présence des baïonnettes citoyennes ou militaires. "
Je reçois beaucoup de lettres, des connus et des inconnus, des fidèles, et des revenants Bourqueney, de qui je n’avais pas entendu parler depuis le 21 février m’écrit avec une tendresse de Marivaux embarrassé : « Dites-vous bien, en recevant cette tardive expression de mon dévouement, que les cœurs les moins pleins ne sont pas ceux dont il n’était encore rien sorti. " Il a voulu dire : " que les cœurs dont il n'était encore rien sorti ne sont pas les moins pleins " Mettez cela à côté de ce billet que m’écrit Aberdeen : " It has been a great satisfaction to me, to see the universal respect and esteem with which you have been regarded in this country. At the same time, it has been to me a cause of sincere regret that I have been so little able to afford you any proofs of m’y cordial friendship during your stay among us. " Je ne le reverrais jamais, je l’aimerai toujours de tout mon cœur.
Merci de m'avoir envoyé le Morning Chronicle J’oublie mon sous Préfet du Havre. Je cause comme si j'étais dans mon fauteuil du Royal Hotel. Pauvre illusion ! Adieu. Adieu. Je vous redirai adieu après la poste. Que de choses j’aurais encore à vous dire.
Onze heures
Voilà votre lettre. Mais mon papier et mon temps sont pleins. Adieu, adieu. à demain. Que l’ancien demain était charmant. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 24 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai pas encore reçu le Galignani. Cela m'impatiente. Je voudrais voir ce qu'a dit Lord Aberdeen du Roi, et de moi. Il faudra me faire à la patience. La différence est grande entre habiter Paris ou Londres et ma maison au milieu des bois, à trois lieues même de Lisieux. Tout se fait attendre. Ce n’est pas la place des fantaisies pressées. Une seule chose du reste m'est nécessaire, la régularité des lettres, et j'espère qu’elle ne me manquera pas. L'inquiétude par dessus l’impatience serait insupportable. Le choléra à Brentford me préoccupe et j’éprouve ce qui me déplait le plus, un sentiment combattu. En même temps que je m'inquiète, je voudrais vous rassurer. Je cherche les raisons qui vous conviennent à vous, et je trouve surtout celles qui ne me conviennent point à moi. Après tout voici ce qui me rassure le plus. Ne vous en inquiétez pas. Il y a eu et il y a encore dans ce pays-ci quelques cas de choléra, épars et rares. Quand l'épidémie n’est pas plus intense, elle n'attaque presque jamais que ceux qui commettent vraiment des excès ou des imprudences. J'ai vu depuis trois jours trois médecins, un de Paris, et deux d'ici, qui me l'ont tous affirmé et prouvé par les exemples. Il en est très probablement de même en Angleterre, et à Richmond comme à Lisieux. Je vous répèterai sans cesse ; point d'imprudence et votre promesse.
Le discours de M. de Montalembert vous aura plu, beaucoup d'esprit, de l’esprit de bonne compagnie, et un cœur chaud et sincère. Jules Favre, un sophiste habile, qui excelle à dire des généralités à peu près vraies et à en faire des applications parfaitement fausses. C'est le grand art des révolutionnaires ; moralistes sur la scène coquins dans la coulisse et glissant très adroitement de l’une dans l'autre. Odilon Barrot a été bien ridicule avec ses prétentions, à la fois pompeuses et embarrassées, à la consistance et à la libéralité imperturbable. C’est toujours le même homme. Le repentir même ne le change pas.
Onze heures
Point de lettre. J’ai envie de dire comme vous ; c’est parce que j'ai parlé de la régularité de notre correspondance ! Toute vanterie porte malheur. J'espère que le dimanche est pour quelque chose dans ce retard. J'attendrai demain avec une double, triple impatience. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 23 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai passé ma matinée hier à recevoir des visites. Dix-neuf. Mon impression reste la même. Rien n’est changé au fond, dans la situation générale, ni dans la mienne. Seulement tout a éclaté et s'est exaspéré. C’est toujours la même lutte entre les mêmes classes et les mêmes passions, et j'y tiens toujours la même place. Mais évidemment le moment n'est pas venu pour moi, quand je le pourrais de la reprendre activement. Mes amis se troubleraient. Mes ennemis s’irriteraient. Et les uns et les autres saisiraient le premier prétexte pour rejeter sur moi seul la responsabilité du premier malheur. Et le public spectateur les croirait. Je n’ai qu'à attendre, si le temps, en s'en allant, n'emporte pas trop tôt ce qui me reste de forces, je puis avoir encore un grand moment. Si je m'en vais avant que ce moment n’arrive, j'ai lieu d'espérer aujourd’hui que justice sera faite à mon nom. Fait général. Les honnêtes gens ont moins peur des coquins que je ne m’y attendais. Ils prévoient de nouvelles luttes, sont très décidés à les soutenir, et comptent sur la victoire. Ceci je le vois. Les coquins que je ne vois pas, sont à ce qu'on me dit, assez découragés et sans confiance dans l'avenir. Ce qui ne les empêchera pas de recommencer. L’esprit manque aux uns et aux autres. Ils sont tous de très petite taille et de vue très courte. C’est une guerre entre des nains aveugles. Il y a dans les deux camps, plus de force et de courage qu’il n'en faut pour se livrer de bien autres combats que ceux qu’ils se livrent des combats au bout desquels viendrait nécessairement la grande défaite ou la grande victoire. Mais ils ont, les uns et les autres, si peu d'intelligence et de portée d'esprit, ils sont tellement au-dessous des questions et des événements qu’ils remuent, qu’il pourra fort bien leur arriver de s’agiter longtemps et misérablement sans rien finir. Il ne serait pas, je crois, bien difficile de faire agir efficacement les honnêtes gens si on pouvait leur faire réellement voir ce dont il s’agit. Ils ne voient pas. Je vous envoie mes réflexions, n'ayant point de faits. La prorogation de l'assemblée sera probablement plus courte qu’on ne l’avait dit. Le sentiment général, dans le parti de l'ordre, est contre. On craint de laisser tout seul un pouvoir si faible et un cabinet si douteux. Ce n'est plus la république seule, c’est la Montagne elle-même qui est l’objet des moqueries populaires. Autrefois, dit-on, la montagne accouchait ; aujourd’hui elle découche.
Onze heures et demie
Je regrette que Brougham et Aberdeen aient perdu leur bataille à 12 voix. Je vais les lire. Je me suis abonné, au Galignani pour rester au courant de l’Angleterre. C'est pourtant le lieu où vous êtes ! Vous ne me dites rien de votre santé. J’en conclus que ce n'est pas mal. Je vous le redemande en grâce ; n'oubliez pas ce que vous m'aurez promis. Adieu, Adieu. Le facteur et le déjeuner m'attendent. G.
Val-Richer, Dimanche 22 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'aurai le cœur un peu à l'aise que lorsque nous nous serons mutuellement répondu à notre première lettre. Il me semble qu'alors la séparation sera un peu moindre. Vous avez raison ; je suis plus heureux que vous ; j'ai des ressources et des plaisirs qui vous manquent. Aussi je n'en jouis qu'avec un certain sentiment de remords. Mes plaisirs me rappellent à vous comme mes privations. Je viens de me lever. Il fait un temps admirable, l’air est doux et vif, le bleu du ciel aussi pur et aussi brillant que le vert de mes bois. Le climat est réellement bien différent. Je voudrais vous envoyer mon soleil à Richmond. Bien mieux, vous amener, vous, sous mon soleil. Vous y viendrez, soignez-vous bien d’ici là, c'est ma préoccupation de tous les moments.
Les visites commencent bien vite. J’en ai déjà eu quatre hier. De braves gens du pays de ceux qui m’ont été fidèles, et qui restent indignes contre ceux qui ne l'ont pas été. Je leur dis qu’ils ont raison d'être indignes, et je suis plus indulgent qu'eux. Je traiterai mal un très petit nombre d'infidèles, deux ou trois, les plus scandaleux. Amnistie pleine et entière pour tous les autres. La bonne politique est partout la même. Ne trouvez-vous pas que j'ai l’air d’un souverain restauré ? C’est un peu prompt. J'en suis fort loin ; personne n'en est plus convaincu que moi. Mais je suis décidé à prendre mes avantages c'est-a-dire l'attitude d’un homme envers qui on a eu tort, et qui n'a eu tort envers personne. C’est la visite et je crois qu’elle me réussira.
9 heures
Béhier vient de m’arriver. Vous avez lu ses lettres. Il connait bien Paris et comprend bien ma situation. Rien de nouveau dans ce qu’il me dit. Tout confirme ce que nous pensons. Du temps et de l’immobilité, à ces deux conditions, la rivière coule de mon côté. A Paris, impossibilité pour le commerce, et le crédit de se relever. Détresse croissante, après la victoire. On a commencé par s'en étonner. On commence à se l’expliquer. Mais le président est fort loin d'être épuisé comme espérance. On tournera et retournera, en tous sens cette combinaison pour essayer d'en faire sortir un gouvernement. Presque plus de choléra. Moins aujourd’hui qu'à Londres. Il a été affreux pendant cinq jours. La forte chaleur semblait un ennemi acharné à la poursuite de tout le monde. Adieu. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Merci des détails de votre lettre de jeudi. Je sais très bien comment s’est passée votre journée.
Onze heures
Voilà votre lettre de Vendredi. Votre préoccupation du choléra me désole. Non que je vous veuille insouciante à cet égard. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. Béhier me disait tout à l’heure que bien peu de personnes avaient été attaquées sans quelque imprudence positive et constatée. C’est un mal qui atteint rarement, très rarement ceux qui le repoussent d'avance par un régime bon et soutenu et constant. A cela la peur est utile. Gardez donc la vôtre dans cette mesure. Et puis n’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Si le mal s’aggravait à Londres, ou si votre peur devenait un vrai mal, n’hésitez pas, partez. Il n’y a réellement plus rien à Paris. Dans l’hôpital où est Béhier, pas un seul cas depuis plusieurs jours. Je ferme une lettre avant d'avoir ouvert mes journaux. Il m'en est arrivé un paquet. L’article des Débats sur le grand duché de Bade était très bon en effet. Je ne crois pas que la Prusse ose. Adieu. Adieu.
Pas une des minutes que nous avons passées ensemble dans ces derniers jours ne me sort de la mémoire. Toutes charmantes. Adieu. Adieu, demain sera un mauvais jour. Vous aurez été un jour sans lettre de moi. Je n’ai pas pu l’éviter. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 20 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.
J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.
Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.
Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.
J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.
Samedi 21, 9 heures
J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.
Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.
L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.
Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.
Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.
Brompton, Jeudi 7 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Voici la lettre que vous désirez. Montrez la mais ne la donnez à personne je vous prie dans l'état ou la France est près de tomber de telles vérités, si, par un accident quelconque, on savait qui les a dites, peuvent devenir des questions de vie ou de mort. M. P., en me rendant compte des négociations ministérielles auxquelles il a pris part, finit par cette phrase : " Je n’ai emporté de tout cela qu’une impression, c’est que le Président et La Redorte s'étaient très bien conduits, qu'on pouvait en toute sécurité, être le collègue du second et que le premier très loyal, très simple, très désintéressé sans vanité, sans susceptibilité aurait fait un roi constitutionnel excellent, mais que Dieu ne l'a destiné ni à sauver, ni à fonder des Empires. Qui sait cependant, car il a la foi ? " Hier une heure après votre départ, j'ai reçu de M. Mallac une lettre écrite avant-hier au soir, qui contient ceci : « J'ai vu le Maréchal ce matin. Il se tient à l'écart et en réserve. L'état de l’armée l’inquiète. Les lettres qu’il reçoit des commandants des corps qui forment l’armée des Alpes, ne sont pas rassurantes. L'esprit des troupes se gâte ; les folles idées qui sont répandues dans le peuple, fermentent dans la tête des soldats. Les règles de la discipline sont observés mais il faut les appliquer sans cesse. L'obéissance est devenue grondeuse et lente. Tout annoncé enfin que le mal fait des progrès, et que nous sommes en dérive. L'armée nous échappera comme tout le reste avant peu, s’il n’arrive pas un grand événement qui nous fasse sortir de l'impasse où nous sommes. Faire de l’ordre avec le désordre moral et du gouvernement avec l'absence de tout gouvernement, c'est un problème insoluble ; il faut que cette situation éclate, et qu’il en sorte le despotisme de Louis Nap. ou celui de la rue. Le dernier me paraît le plus probable. J’attache bien peu d'importance à ce que fera le nouveau Cabinet, s'il apporte des lois répressives, il pourra avancer l'heure de la lutte et c’est là notre meilleure chance, s’il se borne à vivre au jour le jour, il fera durer la situation quelques mois encore pendant lesquels tous les moyens de résistance auront péri. Alors le triomphe de la rue me parait certain. Toute la politique se réduit aujourd’hui à comparer les forces de l’insurrection et celles de la résistance et à savoir quand et comment la bataille s’engagera. " Vous voyez que tout le monde est unanimement noir. J’ai vu hier soir, chez la marquise de Westminster, beaucoup de monde rose et blanc qui ne pensait pas à autre chose, qu’à se montrer et à se regarder. Je n’y ai rien appris. J'ai trouvé Kielmansegge assez inquiet de la Constitution de Berlin et de la République des bords du Rhin. Il craint les amours propres d'auteurs et les ambitions populaires. Ici, l'attaque de lord John avant hier soir contre MM. Bright et Cobden, fait assez d'effet. Le mot narrow-minded a beaucoup blessé les radicaux. Les Torys ont beaucoup applaudi. Je le veux bien, pourvu qu'ils n'oublient pas qu’il y a peu de sureté à vaincre par la main de ses adversaires ; on finit toujours par payer les frais de la victoire. Adieu. Je sors à midi, pour aller passer une partie de ma journée en pleine Eglise anglicane, à St Paul dans le banc de l'Evêque de Londres d'où j’entendrai l'Evêque d'Oxford. Puis, j’irai la finir chez les Quakers, au milieu de la tribu des Gurney. On me dit qu'il y en aura cinquante avec qui je dinerai sous une tente. Braves gens, amis, au fond de l’autorité qu’ils tutoient. Et leurs femmes sous leur petite coiffe blanche, ne sont mi moins jolies que d'autres, ni moins charmées qu'on les trouve jolies. Ce que j’ai écrit il y a quelques mois, en parlant de la démocratie a fait son chemin. Lord Chelsea me disait hier à dîner : " Comment peut-on dire que c'est la forme de gouvernement qui fait la sureté ? Il y a aujourd’hui trois gouvernements forts et tranquilles l’Angleterre, monarchie constitutionnelle ; la Russie, despotisme, les Etats-Unis, république. Reste toujours l'embarras de choisir. " Adieu. Adieu. Je vous prie de prier qu’il ne pleuve pas puisque je dois dîner sous la tente. Je n'y resterai certainement pas s’il pleut. J'ai le cerveau encore pris un peu moins. pourtant. Adieu. A demain. G.
Brompton, Mardi 30 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Voici ma lettre pour Humboldt Ayez la bonté de la lui envoyer par Constantin que je remercie d'avance de la peine que je lui donne. Voici de plus, dans la lettre de Humboldt, la phrase que je voulais montrer au Prince de Metternich qui ne pense probablement trop bien de la politique de notre savant confrère. Il faut rendre justice. « Nous lisons... votre démocratie. Vous avez sondé des plaies dont nous souffrons également davantage encore, parce que nous avons, avec beaucoup de métaphysique, aucun sens pratique, parlant sans cesse de l’unité des races et nous séparant individuellement en atomes qui se repoussent, et désirent fonder un pouvoir central qui rendra impossible de gouverner dans chaque partie de la confédération. " Ce n’est pas mal résumé. Je n'ai rien reçu hier que cette lettre de l'élection d’une Assemblée nouvelle qui fera Louis B. Empereur. Cavaignac disait ces jours-ci : " Ne croyez pas, messieurs, que vous nous ferez avaler la Monarchie comme nous vous avons fait avaler la République. - Général, vous en serez dispensé ; vous serez tué. " Le Prince de Joinville et le duc d’Aumale sortent de chez moi. Me racontant tout ce qu'ils ont appris. En train pour eux-mêmes, empressés pour moi. Se répandant en compliments sur ma bonne fortune dans le sort d'Odilon Barrot. Quelques retours sur le passé. " La bataille morale avait été perdue le Mercredi 23 quand le Cabinet est tombé. Elle ne pouvait pas être regagné le jeudi 24 février, par [?] général." C’est ce que dit M. le Prince de Joinville. La Reine toujours très faible Pas plus mal, mais pas mieux. Le Ld Chomel est venu avant-hier et repart ce soir. Il n’a pas d’inquiétude imminente. La Reine est très découragée.
3 heures 1/2
J’ai été interrompu par Charles Greville. Bien boiteux. Rien de nouveau ici. Plein de Paris. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Brompton, Dimanche 14 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je mettrai ceci à la poste à Londres en sortant de l’Athenaeum où j'irai à 4 heures. Vous l'aurez demain à 3 heures, je pense. Je ne veux pas que le Dimanche soit tout à fait stérile. J'ai pour le débat qui a dû finir hier plus de curiosité qu’il n’a d’importance. Il importe fort peu, en soi, que l'assemblée se dissolve le 4 ou le 30 mars. Or c'est entre ces deux temps qu’on hésite. Tout le monde est décidé ou résigné à la dissolution prochaine. Je ne me fais pas encore une idée claire de l'assemblée qui succédera. Je présume qu’elle sera encore très mêlée, et par conséquent, très orageuse. Orléanistes, légitimistes et républicains y seront forts. Et très acharnés en même temps que forts. La république rouge seule sera si je ne me trompe à peu près éliminée. Elle se remettra derrière la République tricolore, comme elle l’a fait de 1830 à 1848. Et la République tricolore acceptera de nouveau cette queue. On fera effort pour sortir du chaos. On n'en sortira pas d'un coup. Je vous assure qu’il y a bien à examiner s'il me convient de redescendre déjà dans la mêlée; car entrer dans l’Assemblée, c’est redescendre dans la mêlée. Peut-être vaudrait-il mieux, pour moi-même, et pour le moment décisif quand il viendra me tenir encore quelque temps à l'écart, sur la hauteur, disant mon avis aux combattants et sur les combattants. Nous en causerons. Je n'ai aucune lettre importante de Paris. Rien que des détails sur le succès de ma brochure. Je regarde la réconciliation et l’intimité active de Girardin et de Lamartine, comme un fait assez grave. Ce sont peut-être les deux hommes les plus mischievous parce que ce sont eux qui savent faire le plus de dupes parmi les honnêtes gens et les gens d'esprit badauds. J’ai une longue lettre de Brougham. En grands compliments sur ma brochure. Quelques observations, peu fondées, je crois. Evidemment décidé à être bien avec moi. Il compte quitter Cannes du 18 au 20. Il ne me dit pas s'il s’arrêtera à Paris en revenant. La tentative de conciliation du Roi Léopold entre l'Angleterre et l’Espagne a décidément échoué. Palmerston veut toujours un retour de Bulwer à Madrid. Narvaez ne veut pas. Et on ne veut pas à Madrid, renverser Narvaez. J’ai pourtant trouvé le Roi l’autre jour, peu en bienveillance et en confiance pour la Reine Christine. J’ai entrevu qu’elle insistait comme la Reine sa fille, pour que la Duchesse de Montpensier vint à Madrid, et qu'elle aussi ne serait peut-être pas fâchée que la Duchesse suivit les bons exemples. On est très susceptible à cet endroit. Vous n'avez pas d’idée du sentiment d'aversion et de dégoût que la corruption des cours de Madrid et de Naples a laissé dans le ménage qui y a assisté sans y prendre part. Adieu. Je ne vous écrirai pas demain. Mardi, à 2 heures J’espère qu’il fera aussi doux qu'aujourd’hui, et que je pourrai rester aussi frais qu’il vous conviendra. Adieu. Adieu G. Vous ne saurez qu’elles sont les quatre pages qui plaisent tant au Prince de Metternich. Si j'apprends quelque chose à l'Athenoeum je l’ajouterai à ma lettre.
Brompton, Samedi 13 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avant tout, ma joie pour vos yeux vous écrivez et vous lisez. Ménagez les bien et n'en parlons plus. Seconde joie. Vous approuvez. Je crois que vous avez raison. L'effet est grand à Paris. Un homme de mes amis, qui a beaucoup de sens et d’esprit d'affaires m'écrit le Mercredi soir, le jour même de la publication : " Votre libraire est dans une espèce de jubilation fébrile. On fait queue dans son magasin pour acheter votre brochure. Ce matin, à 10 heures, il en avait déjà vendu 5000 exemplaires. La première édition est complètement épuisée. Et le lendemain jeudi : " La 2° édition est épuisée. On tire la 3°. Le succès est immense. J’ai la conviction qu'aux prochaines élections, vous serez au nombre, des représentants de Paris. " Je souris et je doute. Mais il me paraît clair que l’effet que je désirais produire est produit. Nous verrons les conséquences. Je ne vous envoie pas les journaux, l'Univers, l’Evènement, le Siècle, & . Je vous apporterai mardi, ce qu’il y aura d’un peu remarquable. Je n'ai encore rien vu dans le National. Ce que vous m’envoyez contre Thiers est en effet bien vifs. La lutte sera rude, surtout après la victoire. De tout ceci le public sortira éclairé, et les partis ardents. Durer, là sera le problème. Pour le vainqueur, quelconque. Peel m'a écrit. Le Roi aussi. Tous deux très approbateurs, et assez réservés. Comme me souhaitant beaucoup de succès et ne se souciant guère de s’engager dans mon combat. Bien des gens, pas plus démocrates que moi s'étonnent de me voir attaquer si franchement la démocratie, le géant du jour, comme m'écrit Jarnac. Je me souviens d’un temps où l'on me trouvait démocrate. C’est une des grandes difficultés de notre temps que d'avoir à changer de position en changeant de dangers & d’ennemis. Je causerai à fond avec Montebello avant son départ. Je pense de lui autant de bien que vous. Je suis curieux du débat qui a commencé hier. Il me conviendrait que l'Assemblée constituante ne se séparât qu'à la fin de mars. Je doute qu'elle puisse vivre jusques là. Les Anglais ont bien de la peine à comprendre ces revirements d'opinion si soudains et si emportés. Je comprends qu'ils ne comprennent pas. Il faut être Français pour croire qu’on peut vivre en tournant si vite.
Je n'ai vu personne hier. J'aurai certaine ment d’ici à mardi des nouvelles de Génie. Il ne m'a pas écrit ces jours-ci. Il était trop occupé de mes affaires. Mardi sera charmant. Adieu. Adieu. Je ne puis vous dire le plaisir que me fait votre écriture. Je crois que je relis vos lettres plus souvent. Mes tendres amitiés à Marion. Adieu. G.
Brompton, Samedi 6 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Je viens de passer ma matinée, avec Mrs Austin, et Mr. Murray à corriger des épreuves, à régler des détails de publication & Tout est long et difficile quand on veut que ce soit bien fait, et bien fait dans deux pays à la fois. Enfin, c’est fini. La brochure paraîtra décidement mardi prochain, à Londres et à Paris. Le Times a beaucoup insisté pour en avoir les prémices, et il en donnera un extrait lundi ou mardi. M. Murray s'en promet beaucoup de succès en Angleterre. Je n'ai vraiment rien de Paris. Pas le moindre fait et à peine quelques réflexions de Philippe de Ségur qui me promet sa voix pour le duc de Noailles à l'Académie. Génie ne me parle que de ma brochure. Il est évident que la crise ministérielle a un peu troublé tout le monde, ceux qui l’ont faite et ceux qui l’ont subie, et que personne, ne s’est soucié de pousser, quant à présent, la lutte plus loin. Il me semble même qu'on blâme Thiers de l'avoir commencée sitôt. J'ai vu ce matin un ancien député conservateur, M. de Marcillac, bon homme, sensé, et tranquille, qui n'a nulle envie que Louis Nap. dure mais qui trouve qu’on se presse trop de le faire tomber. Il m'a dit de plus, et ceci me chagrine que le maréchal Bugeaud avait été réellement fort malade et ne se remettait qu'à moitié. Il a un poumon en mauvais état. M. de Marcillac croit que les prochaines élections se feront fin de mars ou au commencement d’Avril, que beaucoup de conservateurs rentreront dans l’Assemblée et qu’elle sera beaucoup meilleure que celle-ci, mais que le parti républicain y sera encore fort, trop fort. Le parti n’est plus au pouvoir, et ne tardera pas à reprendre quelque faveur dans le bas de la société. Non comme république, mais comme opposition. Ségur est fort sombre. Sa lettre ne vaut pas la peine de vous être envoyée. Il y a plus de dissertation et d'Académie qu’il ne vous en faut. L’amiral Cécilla est un choix honnête. Il a du bon sens et du savoir-faire. Très étranger à la politique générale, il ne s'appliquera qu'à bien vivre avec Paris et avec Londres, et à les faire bien vivre ensemble. Il n’aura point d’idées et ne fera point d'affaires. On le regarde comme un excellent marin. Pourquoi vos yeux vous faisaient-ils mal hier soir, après une bonne nuit ? C'est l’approche de la neige. J’ai eu de l'humeur ce matin en la voyant. Je crois que Mardi de la semaine prochaine sera le jour qui me conviendra pour venir à Brighton. J’aimerais mieux lundi. Mais je ne suis pas sûr. Je vous l’écrirai positivement dans deux jours. Adieu. Adieu. Quel ennui de vous avoir quittée ! Mes amitiés à Marion. Voici un complet de M. Etienne Arago sur le nouveau ministère. L'assemblée est fort satisfaite Du ministère qu'on lui fait ; Elle n'avait qu'une buvette ; Elle a maintenant un Buffet.
Brompton, Lundi 2 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
J'espère bien que cette indisposition ne sera rien. Vous avez raison de vous tenir tranquille et de manger très peu. Le repos et la diète. Moi aussi, j’ai été un peu incommodé cette nuit. Mais ce n’est rien du tout. Je viens de me promener une heure par un joli temps. Le voilà qui se gâte. Quel déplaisir que la distance !
Je suis allé hier voir Dumon. Il y a dans ce quartier bien des maisons à louer. Même deux ou trois. Grosvenor Place qui me paraît un très bon emplacement. Dumon restera seul lundi prochain. Sa femme et sa fille retournent à Paris. Il quittera sa maison de Wilton-Street, et se rapprochera de l'Athenaeum, sa ressource contre la solitude. Mais il sera toujours fort à portée de ce quartier-là. Duchâtel revient à la fin d’octobre, et passera l’hiver à Londres. Si on ne peut pas le passer en France. Presque toutes les lettres de France croient à une crise prochaine qui nous y fera rentrer. Personne ne dit bien pourquoi ni comment. Mais tout le monde le dit, les simples comme les gens d’esprit, à mon profond regret, ce n’est pas mon impression. Voici la nouvelle qu’on m’apporte ce matin, tout bien examiné, tous calculs faits, Cavaignac et ses amis en sont venus à penser que si on tentait de le faire nommer Président maintenant il ne serait pas nommé, et que tout croulerait. Ils se sont rejetés alors dans l’expédient contraire qui serait d’ajourner la nomination du président de la République jusqu'au moment de la dissolution de l'Assemblée elle-même, c’est-à-dire après les lois organiques. Jusque-là, on resterait et exactement comme on est, sans toucher à cette machine qu'on ne peut pas toucher, sans la briser. On m'assure que c’est là ce qui sera proposé ces jours-ci. La réunion de la rue de Poitiers s'y opposera. Mais on croit qu’elle sera battue, toutes les autres portions de l'Assemblée, y compris les Montagnards, désirant éviter une crise dont elles ne se promettent rien de bon pour elles-mêmes. C’est un gouvernement de plus en plus convaincu qu'il ne peut pas vivre, et décidé à ne pas remuer pour ne pas mourir. En définitive, il n'en mourra pas moins. Mais cela peut durer encore quelque temps.
Les Italiens affluent ici, en colère croissante contre la France et la République. Cavaignac ne sait pas la valeur des moindres paroles en Affaires étrangères. Il a, lui-même tout récemment encore, donné aux gens de Milan, aux gens de Venise, aux gens de Sicile, des espérances qui sont tombées le lendemain après une séance du Conseil. On les renvoie à Londres, en disant : " Nous ferons comme Londres. " Et Londres ne dit rien du tout. Le Roi de Naples n'attaquera, pas Palerme. Il prendra, ou se conciliera successivement toutes les autres villes, laissant Palerme vivre comme elle pourra dans son anarchie. Le temps est pour lui. A Rome on augure très mal du Cabinet Rossi. On dit que le Pape l’usera et le laissera tomber comme les autres. Et s’il veut résister plus réellement que les autres, les Républicains demain le feront tomber. Les fantaisies républicaines sont en progrès dans tous les coins. L'avocat Guerazzi reste le maître à Livourne et se promet de devenir le président de la République Toscane. Le cabinet du grand Duc va se dissoudre. Son président, le marquis Capponi, capable et honnête, aveugle et impotent, déclare qu’il ne peut plus continuer, par impotence et par honnêteté. La fermentation républicaine gagne Gênes de plus en plus ; à ce point que l’idée y circule de s'annexer à la Lombardie autrichienne. Si l’Autriche doit consentir à accepter Gênes comme ville libre et port franc. L'Empereur d’Autriche protecteur du Hambourg de la Méditerranée. Vous voyez que tout n’est pas près de finir là. Adieu. Adieu.
J’ai trouvé l'adresse de Salvo. Il part cette semaine pour aller passer quinze jours à Paris. Adieu, j'espère que demain matin, je vous saurai bien. G.
Brompton, Mardi 21 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
J’arrive et je trouve vos deux lettres. J’aime toutes vos lettres, humeur ou non. Soyez tranquille ; il y a dans celle d’hier autant d'humeur que vous en avez voulu. Je ne voudrais pas qu’il y en eût davantage. Je reconnais ma faute. J’ai écrit lundi au lieu de mardi. Car je n’ai pensé qu'à mardi. Je n'aurais pu partir plutôt sans blesser Sir Robert qui avait évidemment envie de me garder. Et j'aurais eu à regretter si j'étais parti lundi, car j’ai eu hier lundi avec Sir Robert, deux excellentes conversations, le matin à la promenade, le soir dans la bibliothèque, près de deux heures chacune, sur nos affaires futures en France et sur les affaires générales de l’Europe. Y compris Lord Palmerston. Ceci soit dit pour dissiper votre humeur. Vraiment excellentes conversations, par le fond des choses et par le ton d’amitié. Point démocrate pour la France. Encore moins pour l'Allemagne. Très inquiet de la démocratie allemande. Très favorable à nos vues pour l'avenir de la France. Plus enclin à croire à la Régence et au comte de Paris. Très mécontent de la politique extérieure anglaise. Je doute fort qu'il l’attaque lui-même ; mais il trouvera bon que ses amis l’attaquent. En résultat, je suis bien aise d’avoir fait cette visite. Elle peut devenir le commencement, non pas d’une intimité, il n'y a pas d’intimité là, mais de relations vraiment amicales et confiantes.
Je ne trouve rien de Paris. Je viens de voir un homme qui en arrive. L’élection de Louis Bonaparte est toujours la plus probable de beaucoup. Mais dans tous les cas, et quelque soit l’élu, on se battra après l'élection. Je mets assez d'importance à ce qu’écrit Tanski. Thiers vice-président &. Cela commencerait fort à m'expliquer les Débats. S’ils ne croient pas au désintéressement bonapartiste de Thiers, leur attitude est concevable. J’aurai certainement des détails bientôt. Je les ai formellement demandés à Génie par une lettre qu’il a eue avant-hier. Son silence me fait croire qu’il a des choses assez délicates à me dire et qu’il attend une occasion sure. Je vais écrire à Richmond ce que vous me dîtes de Lord Holland. Je pense comme vous qu’ils devraient accepter. Tout le monde va beaucoup mieux à Richmond. Adieu. Adieu.
Je ne vous dis rien aujourd’hui de ma prochaine visite. Je n'en sais pas encore le jour. Cela me plaît d'être revenu plus près. Jamais assez près. Depuis bien longtemps. Adieu G.
Drayton manor, Lundi 20 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Je viens de laisser partir Sir Robert, Montebello et Dumon qui vont voir des travaux de drainage. Peu vous importe de savoir ce que c’est. Dumon prétend que, dès qu’il aura cessé d'être un grand criminel, il ne veut plus être qu’un fermier. Moi qui suis décidé à rester toute ma vie un grand criminel, après comme avant mon procès, je ne me donne pas la peine d'apprendre l'agriculture. Je n’ai rien à vous dire.
Aujourd’hui ni lettres, ni journaux. Bonne conversation hier, soir avec Sir Robert, sur la politique intérieure comparée de nos deux pays. Je le laisserai certainement comprenant un peu mieux les choses et bien disposé pour les personnes. Je crois que, si je le voyais un peu longtemps, je gagnerais tout-à-fait son cœur. Nature honnête, réservée, shy, susceptible, très famille, et vie intérieure, esprit et corps toujours actifs. Lady Peel dit qu'il ne dort point, et qu’elle ne l’a jamais vu fatigué, de corps, ni d’esprit, assez sourd, ce qui contribue à sa disposition solitaire. Très heureux, et blessé de ce qui dérange son bonheur. Ne demandant à la politique extérieure que de ne pas déranger celui de l’Angleterre.
Je serai à Brompton demain à 3 heures. On voulait que je ne partisse d'ici que par le train d'une heure. Les Mahon, Dumon et Montebello s’en vont par ce train-là. Mais j’ai promis de dîner demain chez le baron Parke, chief justice. Il faut que j’arrive à temps. Je vous écrirai deux lignes en arrivant. Et puis je vous dirai à quand ma prochaine visite. J’aurai bien à faire d’ici à six semaines. Je vous dirai pourquoi. Je crois vous l’avoir déjà dit. Une nouvelle édition de deux premiers volumes de mon histoire de la révolution d'Angleterre. Une nouvelle préface. 20 000 fr. qui me viendront fort à propos. Sans compter ce que je viens d'écrire et où je veux retoucher. Je placerai pourtant bien Brighton dans tout cela. Adieu. Adieu. G.
Drayton manor, Samedi 18 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
5 heures
Nous nous sommes promenés ce matin dans le parc. Nous avons longtemps causé, Sir Robert et moi. Curieuse conversation où il y avait de quoi rire de l'un et de l'autre interlocuteur, si bien que j’en riais en parlant. Nous n'étions tous deux occupés qu’à nous démontrer que nous avions bien fait, lui de briser, à tout risque, le parti conservateur pour réformer la loi des céréales, moi d’ajourner, à tout risque, la réforme électorale pour maintenir le parti conservateur. Et je crois en vérité que nous nous sommes convaincus l’un l'autre. Mais il se fondait surtout sur ce qui est arrivé en Europe " Que serions-nous devenus, au milieu de ce bouleversement si la loi des céréales eût subsisté ? " En sorte que c’est nous qui en tombant lui avons fourni son meilleur argument.
Il me paraît avoir en ce moment une nouvelle idée fixe, c’est l’énormité partout de la « public expenditure. " Cela ne peut pas aller, on ne le supportera pas ; il faut absolument trouver un moyen de réduire, partout, les dépenses de l’armée de la marine d'avoir vraiment le budget de la paix. "Je n’ai pas manqué une si bonne occasion! " Si vous n'étiez pas tombé, si je n'étais pas tombé, cela eût peut-être été possible. La France et l'Angleterre conservatrices et amies, pouvaient se mettre sur le pied de paix, de paix solide et y mettre tout le monde. Mais aujourd’hui, sans vous, sans nous, il n'y a pas moyen. Les révolutions ne désarment pas. On ne désarme pas en présence des révolutions. " Cela lui plaisait. Il ne croit pas au bruit du fils de lord Cottenham. Il écarte la conversation sur ce sujet. Par précaution et par goût. Il n'aime pas cette perspective.
Le dean de Westminster et M. Hallam sont arrivés ce matin. Jarnac ne vient décidément pas. Il est toujours malade. Mon lit était très bon hier soir. Ma Chambre est excellente. Toute la maison est chauffée par un calorifère. Nous nous sommes promenés entre hommes. Lady Peel et Lady Mahon sont allées de leur côté.
Il y a une fille de Lady Peel qui me plaît. Jolie réservée avec intelligence de la vivacité sans mouvement. Je serais étonné qu’elle n’eût pas de l’esprit. Je ne vois pas que le soulèvement de Breslau se confirme. Il paraît que l'exécution de Blum fait beaucoup de bruit à Francfort Le droit est incontestablement du côté du Prince Windisch-Graetz. Reste la question de prudence.
Dimanche 19 nov. 4 heures
Encore une longue promenade à pied, mais pas seul, avec Sir Robert. Lord Mahon, M. Hallam et le dean de Westminster. Conversation purement amusante, mais amicale et animée. Beaucoup de jokes, latins et grecs. Sir Robert m'a mené ce matin au sermon, à Tamworth. Bien aise de me montrer. Il est impossible d'être plus courtois, sincèrement je crois, certainement avec l’intention d'être trouvé courtois, par moi-même, et par tous les témoins. Mais je comprends ceux qui disent que c’est un ermite politique, ne communiquant guères plus avec ses amis qu'avec ses ennemis.
Berlin me préoccupe beaucoup. Je crains que le Roi ne se charge de plus qu'il ne peut porter. Et s’il fait un pas en arrière, il est perdu. Voyez Francfort. Lisez les Débats. La résistance, quand elle devient efficace, effraye même ceux qui l’ont appelée. Ils y poussent et puis ils la repoussent. On ne veut, à aucun prix ; revenir au point de départ. Et on voudrait qu’en se défendant on ne fît de mal à personne. Quel est le plus grand mal, les esprits à l'envers ou les cœurs faibles ? je ne saurais décider. Les deux maux sont énormes.
Je suis bien aise que vous ayez rendu un petit service à Lady Holland. Cela vous dispense des autres. Vous avez bien raison de ne pas vous prêter à ses confidences.
Je n’ai rien de Paris. Je crois vraiment que l'acharnement de la Presse contre Cavaignac ne le serve au lieu de lui nuire. Cependant tout ce qui revient de France, continue d'être favorable à Louis Bonaparte. Parme qui est enfin arrivé hier avec sa femme, a les mêmes renseignements de son beau-frère, Jules de Larteyrie, qui est assez au courant, et qui déteste Louis Bonaparte sans vouloir de Cavaignac. Mad de Larteyrie revient ces jours-ci d'Orlombe. Jarnac la reconduira à Paris. Son mari croit à des coup de fusil, dans les rues de Paris, peu après l'élection, quelle qu’elle soit. La Princesse de Parme à Brighton m'amuse. Certainement votre visite est faite. Vous n’avez plus qu’à attendre. Adieu. Adieu.
Je pars après demain mardi, à 9 heures du matin. Adieu. G.
Brompton, Lundi 30 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je pars aujourd’hui pour Cambridge à 2 heures. Cela ne me plaît guères. Nous serons plus loin. Je crains le retard des lettres. J’étais en train de travail. Quand vous n’y êtes pas, c'est mon amusement. Je fais de la très bonne politique. Trop bonne. Toujours la même faute. Je puis vous le dire à vous. Je puis être avec vous aussi orgueilleux qu’il me plaît. Vous savez que je suis modeste en même temps qu'orgueilleux.
Point de nouvelles hier. Je suis allé voir Duchâtel qui n’en avait pas plus que moi. Nous verrons le courrier d’aujourd’hui. Il ne nous apportera pas grand chose. Nous vivrons dans le statu quo jusqu'au 10 Décembre. Mais nous comprendrons mieux une situation vraiment obscure pour moi. Duchâtel soutient que notre procès finira aussi tôt après l'élection du président. Par une ordonnance de non lieu. Si Louis Bonaparte est nommé et Thiers son ministre, il est impossible que notre procès ne finisse pas tout de suite malgré le peu d'envie.
Lisez je vous prie, attentivement le Constitutionnel. Cherchez y Thiers envers Louis Bonaparte. Là est la clef de l'avenir. D'un avenir qui dans aucun cas ne sera bien long, j’espère, mais qui pourrait être très court si Louis Bonaparte n’épousait pas Thiers. Vous devriez engager Marion à écrire à Madame de La Redorte et à la questionner un peu. Peu importe que les réponses soient des mensonges. Vous voyez clair dans le mensonge comme dans la vérité.
Les histoires des Gardes nationaux de Paris ne finissent pas. Le Duc de Somerset a demandé à Panton Hôtel, Panton Street, qu’on en priât quatre à dîner chez lui, n'importe lesquels. On lui en a envoyé quatre dont il a fait une exhibition. Entre autres un Capitaine Gonet qui est un beau parleur, et qui s’est fait l’intermédiaire entre tous ses camarades et la légation de la République à Londres. M. de Beaumont est assez embarrassé de la visite de quelques-uns à Claremont. Il a fait un rapport à ce sujet, fort modéré, atténuant au lieu de grossir. Cependant on croit qu’il y aura quelque mesure prise à Paris, qu’on défendra ces visites en uniforme hors des frontières. Il me paraît qu'à tout prendre l’excursion nationale n’a pas beaucoup plu à Paris. Entre les promeneurs eux-mêmes, il y a un peu de mauvaise humeur. Ceux qui ne sont pas allés à Claremont se sont plaints d'être compromis par ceux qui y sont allés. Ceux-ci se sont fâchés. On dit qu'au retour à Calais, il y aura quelques duels. Ici, évidemment, le peuple les a pris en très bonne part. Adieu.
Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Savez-vous ce qu'a fait Guillaume avant-hier dans un metting où les jeunes gens de King's college se réunissent les samedi pour s'exercer à parler ? Il a fait un speech en Anglais pour M. de Metternich qu’un autre attaquait comme l'auteur, par son obstination, des malheurs de l’Autriche. Guillaume a fait l’apologie de la consistency politique. Assez bien pour être fort cheered et pour faire voter à une voix de majorité, que la consistency était une vertu, non pas un tort. Il m’a redit son speech qui n’était pas mal. Il a pour la politique une passion au moins aussi effrénée que celle de mon garde national d’avant Hier. Midi Je suis désolé que ma lettre vous ait manqué, Elle a été mise à la poste avant 5 heures Peut-être est-ce trop tard pour Brighton. Celle-ci sera mise avant l’heure, par Guillaume que j'envoie exprès. C'est votre seul chagrin de Brighton que je regrette beaucoup. Je prends mon parti des autres. J’ai eu tort de ne pas insister davantage pour vous y conduire moi-même. Je n’aime pas que vous ayez peur et froid toute seule. Adieu Adieu.
Je n'ai qu’une longue lettre de Bruxelles, d’Hébert. Adieu. G. Mes amitiés à Marion, je vous prie.
Brompton, Vendredi 29 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
J’ai eu hier soir des nouvelles de Claremont. Détaillées. Toujours la même disposition. Très sensé, prêt à tout ; mais disant ce que nous disons. Expliquant bien la disposition de Mad. la Duchesse d'Orléans ; indiquant le langage qu’il convient de lui tenir. Du reste, plutôt en veine de confiance et regardant de plus en plus la durée de la baraque de Paris comme impossible. Montebello vous aura probablement donné les mêmes renseignements. Je viens de lire Lamartine et Odilon Barrot sur les deux Chambres. Les Débats ont raison. Les deux meilleurs discours qu’ils aient jamais faits l’un et l'autre. Mais empreints l'un et l'autre d’un vice mortel. Ni l'un ni l'autre ne croit à la durée de la République. L’un veut une assemblée unique, l'autre en voudrait deux pour la faire durer. Et tous les deux se répandent en compliments hyperboliques pour la République qui ne durera pas, et pour la démocratie qui ne sait pas faire ce qu’il faut pour la faire durer. Moins de fois que jamais et plus de flatterie que jamais pour la République et pour la Démocratie. Esprits très superficiels parlant du ton le plus sérieux, et une incurable faiblesse sous les apparences du courage. Toujours le même spectacle ; des médecins atteints de la maladie qu’ils veulent guérir, et ne la voyant pas, ou n’osant pas l'appeler par son nom parce qu'alors ils seraient obligés de la voir est eux-mêmes et de se traiter eux-mêmes comme malades. Encore une fois les évènements seront les seuls médecins de la France.
Brougham va pourtant tenter la cure. Je reçois ce matin de lui une lettre où il me dit : « Je commence [à] faire imprimer. Si mon ouvrage est différé, ceux qui, par amour pour la France, ont élu l'homme le plus stupide que je connaisse et qui ne fait jamais parler de lui que pour se faire moquer de lui Louis Napoléon, sont capables de renverser la République tricolore par la République rouge, et je ne ferais alors que l’éloge funèbre de leur République ! » Il ne s'attendrit pas aussi aisément que vous sur Louis Napoléon.
Une heure
La République badoise n’a pas fait longue vie. J'attends impatiemment des nouvelles de Berlin. Je commence à désespérer un peu moins de l'Allemagne. Il semble qu’un parti de résistance s'y prépare. Je doute que Paris et Londres acceptent le congrès, n'importe où, sur les Affaires d'Italie. Je le voudrais pour réhabiliter les congrès dans le monde républicain. Si le congrès à des questions territoriales à vider, Pétersbourg à Berlin y seront certainement, s’il ne s’occupe que de gouvernement intérieur de l'Italie, Londres et Paris suffisent. Dîtes, je vous prie à Montebello qu’il y a dans mon quartier, Pelham Crescent, Brompton Crescent, Onslow square, Thurloe square, plusieurs maisons à louer. Peut-être quelqu'une lui conviendrait. Je viendrai demain, samedi, dîner avec vous. J'aime mieux cela. C'est plus sûr et plus long. Mon rhume s'en va tout-à-fait. Adieu. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu’après 4 heures.
4 heures un quart
Je ne sais rien de nouveau sinon le billet qui m’arrive de Lady Holland. « Mon cher M. G., ne venez pas dîner dimanche et croyez au chagrin que j'éprouve de devoir vous faire cette prière. Je suis malade et Lord Holland est obligé d'aller visiter quelques parents. » Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous avez sans doute reçu quelque chose de pareil. Adieu. Adieu. A demain. G.
Brompton, Samedi 23 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Je trouve l'état de Paris très grave. Si Cavaignac recrute son ministère à gauche, les communistes entrainent avec eux le gouvernement. S’il le recrute à droite, les Communistes attaqueront très vite le Gouverne ment. Et Louis Bonaparte à travers tout cela, principe de désorganisation dans la droite et dans la gauche. La crise, au mieux les crises, vont se précipiter. Beaucoup de légitimistes et de conservateurs ont voté pour Louis Bonaparte, par désir de brouiller, et d'en finir. Tout le monde est plein d'humeur, d’aigreur. Avant l'élection Benj. Delessert était allé voir Thiers pour se remettre bien avec lui, et lui demander son appui. Thiers l’a très mal vécu : " Que venez-vous me demander ? Vous êtes un ancien conservateur. Ce sont les anciens conservateurs qui ont tout perdu par leur entêtement. Ils n'ont pas voulu me laisser arriver. Je n’ai rien à faire pour eux. " Vraie colère d'enfant désappointé.
Si Delessert est sorti furieux. Les conservateurs à qui il le raconte sont furieux contre Thiers. Les amis de Bugeaud spécialement furieux. Ils disent que Thiers n'a jamais rien fait et ne fera jamais rien pour lui, sinon de l’appeler indéfiniment l'illustre Maréchal. Ledru Rollin se croit déjà président. Lamartine se rapproche de nouveau de Ledru Rollin pour lui disputer la Présidence. Raspail veut qu’on fasse sortir Barbès et Blanqui de Vincennes avec lui.
Tout le monde, négocie avec tout le monde. Tout le monde se brouille, avec tout le monde. Chaos d'aveugles ivres qui ne savent plus même se servir de leur bâton pour se conduire, et s’en frappent les uns les autres à tort et à travers. Je ne sais d'où viendra la lumière qui y mettra fin, mais le chaos ne peut pas durer.
Le décret sur les biens du Roi, et des Princes est prêt. On dit qu'on le présentera la semaine prochaine. La propriété est reconnue. L’Etat garde l'administration, et alloue aux propriétaires peut-être un tiers, peut-être la moitié du revers, les dettes. payées. Si le Ministère tombe à droite le décret sera présenté en effet, et adopté. S'il tombe à gauche, on fera tout autre, chose, ou l'on ne fera, rien du tout. C'est plus commode et moins compromettant. Avant-hier, après mon départ, il y a eu une longue conversation entre le Roi et le Prince de Joinville. Grand remord, grand attendrissement de celui-ci. Il a beaucoup pleuré. L’intérieur était un peu remis.
La répression de Francfort fera de l’effet partout. C'est le 23 juin allemand. Le Prince Lichnowski et l’archevêque de Paris de ce 23 juin là. Adieu. Je voulais aller ce matin à l'Atheneum. Il pleut à Seaux. Je dîne chez M. Luckhart, Regents Park avec Croker qui est venu passer deux jours à Londres. De quoi donc est mort Lord George Bentinck ? Cela ne rendra-t-il pas plus facile à Peel de rallier le Conservative Party et de s'y rallier. Je ne crois pas du reste que Peel, y soit bien empressé. Adieu. Adieu. A demain, Holland House. J’y serai avant 5 h. G.
Brompton, Mercredi 20 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
une heure
J’ai écrit hier au Roi que s’il ne faisait pas dire le contraire j’irais à Claremont demain, jeudi de midi à 3 heures. Si vous persistez dans votre projet de venir me prendre, soyez, entre 3 h. et 3 h. et demie, à Esher, aux environs de l’ours. Nous retournerons ensemble à Richmond. Nous aurons ainsi la promenade et le dîner. Cinq bonnes heures. Je vous rapporterai la lettre de Paris. Intéressante. Je ne m'étonne pas qu’il n'eût pas encore reçu l'autre de vous. Mon révérend à qui je l'ai remise, m’avait prévenu qu’il passerait quelques jours à Boulogne où était sa famille. Il ne devait aller à Paris que du 16 au 18, et la lettre que vous venez de recevoir est du 17.
Je regrette que vous n'ayez pas trouvé la Princesse de Parme. J’ai confiance dans votre observation. Ce que dit la lettre de Paris n'explique rien. Comment ne sait-elle pas l'état des Affaires et la conduite de son parti ? Comment va-t-elle à Londres sans le savoir ? Ou sans que son parti sache qu'elle va à Londres et la mette au courant ? Tout cela ne s'explique que par la légèreté mutuelle qui explique tout, et ne rassure sur rien.
Me voilà bien pédant. Il faut bien l'être en pareille affaire. Je trouve en effet que c’est un grand symptôme de fusion, de la part des légitimistes que de porter le Maréchal Bugeaud. Ils ont bien raison et je voudrais bien qu’il passât. Pas la moindre nouvelle électorale dans mes journaux de ce matin. Je ne me rends pas bien compte de l'effet de l'élection de Louis Bonaparte, s'il est élu. En tous cas, et pour tout le monde ce sera une grosse complication. Il tombera inévitablement entre les mains des républicains rouges conspirateurs de profession, et les seuls qui puissent vouloir de lui comme Empereur. Cela peut amener un rapprochement, plus ou moins long, plus ou moins sincère, entre les républicains modérés, et l'ancienne gauche. Par conséquent entraver et retarder la fusion des monarchiques. Je vous ai déjà dit que les Débats m'étonnaient un peu. Nous en saurons davantage dans quelques jours. Evidemment nous touchons à une crise.
Qu’il fait beau ! J'en jouis pour vous à Richmond. Je reviens de Kensington Gardens. Il me faut une demi-heure pour y aller. Je m'y promène une demi-heure. C’est une heure et demie de marche en bon air. J’ai eu hier Lady Cowley. Voulant être spécialement caressante, et étant généralement grognon. Cela fait un drôle d’assemblage. Elle va passer quelques jours chez la Duchesse de Glocester. Comme de raison, elle ne savait rien. Où êtes-vous à présent ? Probablement à votre luncheon. Il va être 2 heures. Adieu. Adieu.
Je ne pense pas que le Roi me fasse être qu’il ne sera pas à Claremont, demain. Cependant, s’il me le faisait dire, je n'irais pas. Et comme je n'aurais sa lettre que demain matin, je n'aurais pas le temps de vous l'écrire. Si vous ne me voyez pas paraître à Esher, à 4 heures, retournez à Richmond. Vous aurez fait votre promenade du côté d'Esher et moi j’irai toujours dîner avec vous. Mais je compte bien aller à Claremont. Adieu. G.
P.S. Le rapport de l’Amiral Baudin, inséré dans les Débats d’aujourd’hui, prouve que la défense de Messine n'a pas été aussi désespérée qu'on le disait.
Lowestoft, Mercredi 30 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Nous approchons bien. Je ne vous écrirai plus et n'aurais plus de lettres de vous qu’aujourd’hui et demain. Quelques lignes, je vous prie à Brompton vendredi, à mon arrivée.
Avez-vous remarqué les Débats répétant l'article du Constitutionnel sur les bruits de Henri V ? Beuve du concert à ce sujet entre toutes les nuances monarchiques. Si Montalivet avait raison, si Cavaignac, au dernier moment, se retirait de la scène plutôt que de s'allier avec la République rouge, cela simplifierait beaucoup les choses. L’apostrophe de M. Ledru Rollin à l’ancienne gauche est parfaitement vraie et méritée. Et bien modérée, comme vous dîtes. Mais comment Thiers et Barrot ont-ils couché la tête sous le coup ? La défense était difficile. Pourtant il y a toujours une défense. Gens de bien peu de tête, et de courage, et de puissance quand l’épreuve est un peu forte, si la fusion avait lieu, il y aurait beaucoup à les ménager car ils pourraient faire beaucoup de mal. Mais ils seraient bien humiliés en restant dangereux. Que de partis et de personnes de qui je ne dirai jamais le quart de ce que je pense ! Ce qu’on apprend le plus en avançant dans la vie, c’est à se taire. Et rien n'isole plus que le silence. C'est ce qui rend l’intimité où l’on ne se tait sur rien, si précieuse et si douce, à samedi.
Une heure
Merci de vos détails. Très bons. Ce n'est pas seulement la meilleure solution, c’est la seule bonne, car c’est la seule qui remette les choses dans l’ordre, dans l’ordre vrai. Tout ce qu’il faut, c’est qu’elle soit possible. Et quand on la croira possible, elle le sera. Je n'ai rien d'ailleurs. Je voudrais bien qu’il dit samedi le temps d’aujourd'hui ; que le jour fût beau de toutes façons ! Adieu. Adieu. Adieu. Je ne sais plus vous dire que cela Adieu. G.
Lowestoft, Samedi 26 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Je suis de l'avis de Montebello. Je crois que le gouvernement Cavaignac choisira pour le rouge s'il est absolument forcé de choisir. Et le jour viendra où il y sera forcé. Mais de part et d’autre on s'efforcera de reculer ce jour. Personne n'a assez d'envie de gagner la bataille pour l’engager volontairement. Je ne m'accoutume pas à la pusillanimité des honnêtes gens. Ce n’est pas faute d'expérience. Certainement je n'ai pas cru aux révolutions de Pétersbourg. Et je crois que si l'Empereur aime mieux la république que la Monarchie constitutionnelle, c’est qu’il la croit moins contagieuse. Il penserait autrement s’il était le voisin des Etats-Unis. Et s’il avait raison dans la préférence que vous dites, et que vous êtes tentée de partager Cavaignac et Marrast auraient raison. Car renoncez à Louis XIV. On refait encore bien moins Louis XIV que Napoléon. Si nous n'avions d'autre alternative que Louis XIV ou la confusion permanente, je me ferais moine. Il me faut de l'avenir, dans ce monde et dans l'autre.
Dimanche 27
8 heures
J’ai eu hier au soir quelques mots de Paris qui me prouvent qu’on y est de nouveau et sérieusement inquiet. Inquiet d’une nouvelle bataille dans les rues. La république rouge ne veut pas accepter sans mot dire la politique qui accepte la déroute Italienne, ni l'ordre du jour motivé, quel qu’il soit, qui terminera le débat de l’enquête. Elle veut protester et sa protestation, c'est l’insurrection. Cavaignac la battra, nul doute et la victoire l'affermira pour aujourd’hui, mais l’usera pour demain. Le voilà engagé dans le défilé où la Monarchie de Juillet a péri, entre deux feux et deux feux bien plus étendus, bien plus ardents qu’ils n'étaient contre elle. Et il n’a pas comme elle, de qui se défendre longtemps. La Monarchie de Juillet s’est défendu avec deux armes ; par la prospérité du pays, par l'opinion, généralement accréditée, qu’elle était réellement la fin des révolutions. La république n’a ni l’une ni l'autre. Je persiste dans mon avis. Ce sera plus long que ne croient les badauds et moins long que les gens d’esprit, comme vous et moi, ne sont quelques fois tentés de craindre. Je vous envoie les impressions qui m’arrivent de Paris et mes raisonnements sur les impressions en attendant samedi.
Tempête hier, mauvais temps aujourd’hui. Je vais faire ma toilette pour aller au sermon. Je suis correct ici. Je vais au sermon tous les dimanches. Une heure Je suis désolé que vous ayez eu deux mauvaises heures. Ce n'est pas ma faute. Il est impossible d'être, en fait d’exactitude, plus minutieusement soigneux que je ne suis. Comment ne le serais-je pas ? J'ai tant besoin de votre exactitude à vous ? Elle est parfaite aussi. Je trouve que nous ne nous remercions pas assez de nos vertus mutuelles. Nous souffririons tant de nos défauts ! Enfin samedi prochain, nous n'aurons, ni à nous remercier, ni à nous plaindre.
C'est le lundi qui est mon blank day à moi. On distribue ici les lettres le dimanche. La lettre de Sabine est drôle et aimable. Je commence à être assez frappé de ces rumeurs sur Henri V. Non pas que je croie à aucun résultat prochain. Si l'explosion est prochaine. Henri V y périra, comme Louis Bonaparte a péri. Le produire aujourd’hui, c’est le détruire. Mais si on continue à parler de lui sans le lancer dans l’arène, s’il apparait de plus en plus, mais dans le lointain, il prendra du corps et grandira. Et la fusion, aujourd’hui chimérique pourrait bien devenir possible. Elle sera possible le jour où tout ce qu’il y a de monarchique en France verra là, la seule chance de salut. Ce jour-là, tout le monde se réunira pour imposer la fusion à qui de droit et de bonne ou de mauvaise humeur, on l'acceptera sans grande résistance. On y verra aussi son salut.
Avez-vous écrit dernièrement au voyageur pour la fusion ? Je pense très bien de Montebello et je suis bien aise que vous en pensiez très bien, le connaissant comme vous le connaissez à présent. Faites-lui je vous prie, mes amitiés savez-vous pourquoi Morny est revenu à Londres ? Savez-vous aussi, ou pourriez-vous savoir, si Lord Palmerston connait un M. Rothery, dont vous m’avez peut-être entendu parler, et avec qui M. Dumon est très lié ? C’est un proctor que le foreign office a quelques fois employé, du temps de Lord Aberdeen. Il vient de m’écrire qu’il partait subitement pour Madrid, m’offrant de se charger de mes commissions pour Paris. Il me dit : you will doubtless be surprised et my suddon determination to start for so turbulous a country as Spain, et ne me dit pas du tout pourquoi. Je serais curieux de savoir si c’est Lord Palmerston qui l'envoie. Il fait faire assez souvent sa diplomatie incorrecte par des voyageurs, et celui-ci est intelligent. Vous avez vu que M. d’Haussonville m’avait demandé un programme de ce qu’il devait dire, voulant écrire sur notre politique extérieure. Voici ce que je lui ai répondu. Gardez-moi cette copie que j'ai gardée pour moi. Je crois qu'il est maintenant possible et utile de dire en France ces choses-là. Ne faites usage de ceci que pour vous, à cause de M. d’Haussonville. Adieu. Adieu.
Je suis bien aise que vous n’ayez pas eu besoin de m'envoyer votre homme pour savoir si j'étais vivant. Mais s’il était venu, je l’aurais embrassé. Adieu. G.
Lowestoft, Jeudi 17 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Le temps est superbe. Je viens de me promener au bord de la mer. Mais vous manquez au soleil et à la mer bien plus que la mer et le soleil ne me manqueraient si vous étiez là. D’Hausonville m’écrit très triste quoique point découragé : " A l'heure qu’il est, me dit-il, le pouvoir nouveau est, vis-à-vis de la portion saine de l'Assemblée nationale à peu près dans les mêmes dispositions que l’ancienne commission exécutive. Autant que M. de Lamartine, M. Cavaignac redoute l’ancienne gauche, et comme lui il est prêt à s'allier avec les Montagnards, pour ne pas tomber dans les mains de ce qu'il appelle les Royalistes. Ce dictateur improvisé paie de mine plus que de toute autre chose, et a plus le goût que l’aptitude du pouvoir. Vienne une crise financière trop probable ou la guerre moins impossible depuis les revers des Italiens, et la république rouge n’aura pas perdu toutes ses chances. " Il veut écrire sur la politique étrangère passée. Il me dit que c’est à son excitation que son beau frère a écrit dans la revue des Deux Mondes, sur la diplomatie du gouvernement provisoire, l’article dont vous m’avez parlé. " Les documents diplomatiques insérés, dans la Revue rétrospective me serviront dit-il de point de départ pour venger, pièces en mains, cette diplomatie du gouvernement de Juillet, si étrangement défigurée. Je voudrais finir par indiquer quelle doit être dans cette crise terrible, l’attitude de ceux qui ont pensé ce que nous avons pensé, et fait ce que nous avons fait, si vous croyez utile de m'esquisser ce plan, je recevrai vos conseils avec reconnaissance et j’en ferai profiter notre pauvre parti resté, sans chef et sans boussole dans ce temps, si gros et si obscur." Ceci m'explique un peu Barante.
Évidemment l’envie de rentrer en scène vient à mes amis. J'ai aussi des nouvelles de Duchâtel, d’Écosse où il se promène charmé du pays. Je vous supprime l’Écosse. Voici ce qu’il me dit de la France : " Il me semble que, dans le peu qu’elle fait de bon, la République copie platement et gauchement la politique des premières années de la révolution de 1830." Quel spectacle donne la France.
On m’écrit de chez moi que les élections municipales ont été excellentes. Les résultats sont beaucoup meilleurs que de notre temps. Le député actuel de mon arrondissement, qui faisait toujours partie du conseil municipal n'a pas pu être élu cette fois.
Une heure
Votre lettre est venue au moment où j’allais déjeuner. J'espère que celle de demain me dira que votre frisson n’a pas continué. La phrase du National ne me paraît indiquer rien de particulier pour moi. Il insiste seulement sur le danger pour la République d’un débat qui mettra en scène le dernier ministre de la Monarchie qui n’a fait, après tout, que combattre ces mêmes auteurs de la révolution qu'on demande aujourd’hui à la république de condamner. Je comprends que ce débat, leur pèse. S'il y a un peu d’énergie dans le parti modéré, il faudra bien que le National et ses amis le subissent. Mais je doute de l’énergie. Tout le mal vient en France de la pusillanimité des honnêtes gens. S'ils osaient, deux jours seulement, parler et agir comme ils pensent, ils se délivreraient du cauchemar qui les oppresse. Mais ce cauchemar les paralyse, comme dans les mauvais rêves.
La lettre de Hügel est bien sombre, et je crois bien vraie. Je vous la rapporterai avec celle de Bulwer à moins que vous ne le vouliez plutôt. Je vois que Koenigsberg le parti unitaire a pris le dessus. Parti incapable de réussir, mais très capable d'empêcher que la réaction ne réussisse. La folie ne peut rien pour elle-même ; mais elle peut beaucoup contre le bon sens. Pour longtemps du moins. Que dites-vous du Général Cavaignac parcourant les Palais de Paris le Luxembourg, l’Élysée & pour voir comment on en peut faire des casernes et des postes militaires. On voulait nous prendre pour les forts détachés, dont le canon n'atteint pas Paris. Aujourd’hui, on met les forts détachés dans les rues. Ce qui me frappe, c’est que Cavaignac et les siens ont l’air de régler cela comme un régime permanent. C'est de l'avenir qu’ils s’occupent. Ils sont convaincus que, si on ôte au malade sa camisole de force, il jettera son médecin par la fenêtre. Et le gouvernement ne consiste plus pour eux qu’à prendre des mesures pour n'être pas jetés par la fenêtre. Adieu.
J’attendrai la lettre de demain un peu plus impatiemment. Je travaille. Que de choses je voudrais faire ! Adieu. Adieu. G.
J’avais donc bien raison hier de croire que la chance du Roi de Naples en Sicile pourrait bien valoir mieux que celle du Duc de Gènes.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Diplomatie, Elections (France), Eloignement, Manque, Politique, Politique (Autriche), Politique (France), Politique (Italie), Politique (Normandie), Politique (Œuvre), Presse, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée, République, Révolution, Travail intellectuel
Lowestoft, Mardi 15 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Longue lettre. Par conséquent bonne. Bonne pour elle-même, et comme symptôme. Vous n'écrivez pas longuement quand vous êtes souffrante. Soyez tranquille ; le mauvais temps, s’il s’établissait ne prolongerait pas mon séjour ici. Plutôt le contraire. Une vraie tempête cette nuit. Un bâtiment s’est perdu sur la côte. On a sauvé l'équipage. Le soleil se lève et le vent tombe ce matin. L’air de la mer me réussit. J’ai un appétit rare pour moi. A chaque instant, ceci me rappelle Trouville, l’été dernier. C’était bien joli. J'ai bien eu envie de vous garder un peu rancune de votre mauvaise humeur en arrivant au Val Richer. Mais je n'en ai rien fait. Quand retrouverai-je Trouville au lieu de Lowestoft ?
Si votre Empereur est en si bonne disposition pour la République et la reconnaît, rien ne vous empêchera de la reconnaître aussi quand elle aura renoncé à me faire un procès. Quel dommage d'avoir la langue liée ! Jamais il n’y a eu un meilleur moment pour parler au nom de la bonne politique. La mauvaise tourne si piteusement. Je commence à ne plus comprendre pourquoi ni comment on donnerait la Lombardie à Charles-Albert. Après ce qui s’est passé à Milan, ce ne serait pas même un mariage de raison. Le divorce viendrait bientôt. Deux Toscanes, comme dit le Roi, ou la Toscane doublée, comme vous dites aujourd’hui. Quoiqu'on fasse, il y aura au bout de tout ceci, un mort, l’unité italienne et un bien malade, le Roi Charles-Albert. Et un autre qui aura bien de la peine à ressusciter quoique vainqueur, l’Autriche. Pour que l’ordre se rétablisse réellement en Italie, il faut qu’il se rétablisse en France, en Allemagne, partout. A chaque nouvelle crise la question devient de plus en plus générale et unique, et toute l’Europe solidaire. Je suis de votre avis sur l’unité allemande. C’est la plus chimérique, et la plus folle de toutes. Elle ne s’établira pas. Mais la fermentation allemande durera longtemps, plus longtemps que les autres. (On veut faire à Francfort une nation et on ne veut détrôner pas un de tant de souverains.) On prétend à l'unité, et on ne veut sacrifier aucune indépendance. Il y a dans ce double dessein une inépuisable anarchie. Mais l’Allemagne ne se lassera pas tout de suite de cette anarchie. Elle y est moins pesante. et moins ruineuse qu'ailleurs précisément à cause de tous ces petits états qui après tout, au milieu de ce chaos, se gouvernent à peu près comme auparavant.
Je lirai ce soir le Prince de Linange. Je suis un peu curieux de ce qu'en dira le spectateur de Londres. Il a d’illustres souscripteurs qu’il voudra peut-être ménager. Ce dont je suis bien plus curieux, c’est de la bataille dans l’Assemblée nationale à propos du rapport de la Commission d’enquête. Si ce débat a lieu, et je ne comprends guère aujourd’hui comment il n'aurait pas lieu, ce sera à coup sûr un événement, le début d’une situation nouvelle. A moins que la mollesse des hommes n’annule les résultats naturels de la situation. Nous voyons cela, souvent.
J’aime mieux que vous restiez à Richmond. Et je crois qu’à l’épreuve vous l’aimerez mieux aussi. Vous vous feriez difficilement à Tunbridge des commencements d'habitudes. Je ne comprends pas ce que Barante peut écrire, ni qu’il écrive. Je n’ai pas de ses nouvelles depuis longtemps. A la vérité je lui dois une réponse. Je doute qu’il écrive rien qui fasse beaucoup d'effet. Son esprit ne va guère à l'état actuel des esprits. Je vais demander ce qu’a écrit Albert de Broglie sur la diplomatie de la République. Adieu. Adieu.
Je vais me promener au bord de la mer. Seul. J’ai toujours aimé la promenade solitaire, faute de mieux. Je n’ai rien de France. Adieu. Adieu. G. J’oubliais de vous dire que je trouve très bonne la dépêche de M. de Nesselrode sur les Affaires de Valachie. Conduite et langage.
Ketteringham Park, Vendredi 11 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Onze heures
Tallenay n'a pas réussi à se faire laisser l’honneur de la reconnaissance de la République. Gustave de Beaumont est un honnête homme et un gentleman. Plus de mouvement d’esprit que d’esprit, modéré d’intentions et emporté de tempérament. Point Thiers du tout. Opposé à Thiers, autrefois, quand ils étaient ensemble dans l'opposition. Rapproché de lui aujourd’hui par la nécessité, mais au fond méfiant et hostile. Un des plus actifs de la tribu Lafayette dont il a épousé la petite-fille.
On dit à Paris que Tallenay est rappelé pour m’avoir salué et dit bonjour dans la rue, ce qu'il n'a pas fait. Je serais étonné si Gustave de Beaumont, me rencontrant, ne le faisait pas. Puisque la médiation commune a lieu sérieusement, je penche à croire qu’elle réussira, au début du moins. Les embarras et peut-être les impossibilités viendront après. L'Italie ne sera pas réglée. Mais la République y aura gagné d'être reconnue, et l'Angleterre d'avoir engagé la République dans la politique pacifique au moment de la crise.
Je reviens à ce que je vous disais hier, je crois ; le Président Cavaignac sera une seconde édition du Roi Louis-Philippe. Résistance et paix. Avec bien moins de moyens, de se maintenir longtemps sur cette brèche, où il sera bientôt encore plus violemment attaqué. Ce qui est possible, ce qu'au fond de mon cœur je crois très probable, c’est que les trois grosses révolutions de 1848, France, Italie et Allemagne n'aboutissent qu'à trois immenses failures. Pour la France et l'Italie, c’est bien avancé. L'Allemagne trainera plus longtemps, mais pour finir de même. Grande leçon si cela tourne ainsi. Mais le monde n’en sera pas plus facile à gouverner. Excepté chez vous, l'absolutisme est partout aussi usé et aussi impuissant que la révolution. Et il n’y a encore que la société anglaise qui se soit montrée capable d’un juste milieu qui dure. Je suis dans une disposition singulière et pas bien agréable ; chaque jour plus convaincu que la politique que j’ai faite est la seule bonne, la seule qui puisse réussir et doutant chaque jour d'avantage qu’elle puisse réussir. La lettre que je vous renvoie est très sensée. Je vous prie de la garder. Je vous la redemanderai peut-être plus tard. Si c’est là une chimère, c’est une de celles qu'on peut poursuivre sans crainte car en les poursuivant on avance dans le bon chemin.
Savez-vous notre mal à tous ? C’est que nous sommes trop difficiles en fait de destinée. Nous voulons faire, et être trop bien. Nous nous décourageons et nous renonçons dès que tout n’est pas aussi bien que nous le voulons. J’ai relu depuis que je suis ici, la transition de la Reine Anne à la maison d’Hanovre, et le ministère de Walpole. En fait de justice, et de sagesse, et de bonheur, et de succès, les Anglais se sont contentés à bien meilleur marché que nous. Ils ont été moins exigeants, et plus persistants. Nous échouerons tant que nous ne ferons pas comme eux. Je vous envoie avec votre lettre un papier anonyme qui m’arrive ce matin de Paris, par la poste. Les Polonais sont aussi mécontents de la République que le seront demain les Italiens. Je suppose que l’un d’entre eux a voulu me donner le plaisir de voir que je n'étais pas le seul à qui ils disent des injures. La grosse affaire à Paris, c’est évidemment le rapport de la Commission d'enquête. De là naitra, entre les partis, la séparation profonde qui doit engager la lutte définitive qui doit tuer la République. Dumon m'écrit : « Si je trouve Londres trop triste, j'aurais assez envie d'aller attendre à Brighton le jour où nous pourrons rentrer en France, le jour me semble encore assez éloigné. C’est déjà bien assez pour Cavaignac d'avoir à mettre en jugement les fondateurs de la République sans qu’il se donne l’embarras de mettre en même temps hors de cause les ministres de la monarchie. » Tous les procès à vrai dire, n'en font qu’un et il n’est pas commode à juger. On l’ajournera, tant qu’on pourra. Adieu.
J’aurai demain votre lettre à Lowestoft. Je pars à 4 heure. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Histoire (Angleterre), Politique, Politique (Allemagne), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Italie), Politique (Œuvre), Portrait, Posture politique, Presse, Réception (Guizot), République, Révolution
Ketteringham Park, Mardi 8 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Onze heures
J’ai cinq minutes. Je vais rejoindre à Norwich le train du chemin de fer qui va à Yarmouth. C’est à Yarmouth que mes enfants prendront quelques bains de mer. Le médecin sort d’ici. Il trouve Pauline pas mal, c’est-à-dire point de vrai mal, mais encore assez ébranlée. Il veut encore deux ou trois jours de repos. Puis quelques bains à Yarmouth, près d’ici, à peine un voyage. Les habitants de Ketteringham viendront nous y voir. A part la raison de santé, je vous dirai mes raisons pour aller à Yarmouth, près d’ici. Vous les trouverez bonnes. Je vous quitte. L’heure du train me presse. Merci de votre longue et bonne lettre qui vient de m’arriver. Je vous écrirai demain à mon aise. Adieu. Adieu. G.
Une heure On m’a fait observer que tout bien calculé, je n’arriverai probablement pas à Norwich à temps pour le train d’Yarmouth. Je n’irai donc que demain matin. Je vais là choisir un logement. Je reviendrai ici, et nous irons à Portsmouth à la fin de la semaine. Toujours pour trop longtemps mais pas pour longtemps. Le médecin n'a point d’inquiétude pour Pauline, mais elle a été [shaked] in her whole frame. Je ne lui ai pas refusé une promenade à cheval par ce qu’il y a beaucoup monté. Soyez tranquille ; je n’y monterai point. Guillaume monte très bien.
Je ne crois plus à l’intervention en Italie. On n'en veut évidemment pas plus à Paris qu'à Londres. L’Autriche cédera sur la Lombardie. On forcera les Italiens de céder sur la Vénétie. Et le Roi Charles Albert battu aura son royaume comme, s'il l’avait conquis. Quoique peu en train de rire, je ne puis m'empêcher de rire de la république ; elle copie, timidement ce qui s’est passé après 1830. La Lombardie sera la contrepartie de la Belgique. On règlera cette question là, comme l'autre, de concert entre Paris et Londres. Mais sans mettre le pied au delà des Alpes. Il faut dire de la République ce qu’on a dit de je ne sais plus qui : " ce qu’elle fait de nouveau n’est pas bon, ce qu’elle fait de bon n'est pas nouveau. "
Je compatis fort au chagrin de l'Empereur sur sa fille Olga. Mais elle a raison. Quelle honte au Roi de Wurtemberg ! Pis que le Roi de Bavière. Je suis humilié de la conduite des Rois comme si j’étais un Roi. J’ai mon Journal des Débats. On est fort en trais de refaire un autre parti conservateur. Et celui-là enterrera un jour la République. Chaque crise révolutionnaire en France fait monter au gouvernement une nouvelle couche de la société, prise plus bas. Et celle-là est à son tour forcée de devenir conservatrice, tant bien que mal. Je ne vois pas comment on s'y prendrait pour descendre plus bas que le suffrage universel. J’ai écrit à Lord Aberdeen. J’aurai demain ou après-demain tout ce qui m'a été envoyé à St Andrews. Ecrivez-moi encore ici, Adieu, Adieu. Quel plaisir quand nous nous retrouverons. Mais que de choses nous nous serions dites que nous ne retrouverons pas ! Adieu. Adieu. G.
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849
Sept heures.
On dit que Titus disait, quand il n'avait pas fait au moins un heureux, « J'ai perdu ma journée. » Moi, je crois qu'il disait cela quand il n'avait pas vu Bérénice. Quand votre lettre me manque, ma journée est perdue. J'ai beau faire ; je ne parviens pas à la remplir. J'ai beaucoup travaillé hier ; j'ai lu ; j'ai écrit de mon histoire ; j'ai écrit des lettres. Ma journée est restée vide. Peut-être votre lettre, que j'aurais dû avoir hier, contenait la feuille volante de Metternich, et les curieux auront eu envie de la lire. Je saurai cela ce matin. Ils auraient dû être un peu plus prompts à la lire que lui à l'écrire.
Je pense beaucoup à l'Allemagne, et soit que je veuille arranger l'avenir, ou seulement le prévoir, je ne me satisfais pas. Il y a là des éléments inconciliables entre eux et indestructibles les uns pour les autres, à moins d'un bouleversement général. Des petits États évidemment incapables, soit de contenter, soit de contenir leurs peuples, un grand État qui voudrait dompter les révolutionnaires chez lui, en restant populaire parmi les révolutionnaires du dehors, dont il a besoin pour absorber les petits États, et au moment même où il envoie des troupes pour empêcher ces révolutionnaires là de triompher chez eux. Des peuples qui, petits ou grands, révolutionnaires ou non, veulent jouir de la vie politique dont ils ont commencé à goûter, et se croient humiliés s'ils ne font pas, ou n'entendent pas autant de bruit qu'on en entend et qu'on en fait à Paris et à Londres. Des gouvernements qui ont encore toutes les habitudes du pouvoir absolu, et qui, en quelques mois, ont touché, et vont encore, aux dernières limites du radicalisme, car ils ont accepté le suffrage universel, ou à peu près. Ce sont là des confusions, des ambitions, des contradictions, des nécessités et des impossibilités dont je ne me tire pas. Certainement on ne sortira pas comme on est ; mais je ne crois pas qu'on redevienne purement et simplement comme on était, et je ne vois pas ce qu'on pourra être, ni même ce qu'on voudra essayer d'être.
Attendons. J'attends l'Allemagne et votre lettre. Si j'avais la lettre, je crois que j'arrangerais mieux l'Allemagne.
Onze heures
Voilà mes deux lettres. Et moi bien content. Vous recevrez aujourd'hui celle où je vous parle du choléra. C'est ma préoccupation habituelle pour vous à Paris. On me parle aujourd'hui de nouveaux cas. Je crois décidément qu'il faut attendre un peu.
Je ne comprends rien à ce que vous dit Montebello. Je n'ai pas reçu un mot, un seul mot de lui depuis que je suis ici. Je m'en suis étonné, et je crois vous l'avoir dit. Je vais lui écrire ce matin même.
Adieu, adieu, my dearest. Soignez-vous bien. L'orage ne m'a fait aucun mal. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Politique, Politique (Allemagne), Révolution
22. Val-Richer, Mercredi 5 août août 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous somme à 28 voix de gain sur 385 élections connues hier à midi. Nous avons 230 élections contre 135. En supposant que, dans les 74 élections à connaître, toutes les chances douteuses tournent contre nous, nous aurons toujours de 80 à 90 voix de majorité. Très probablement nous en aurons 100. C’est très assez. Mais je dis comme vous, mieux vaut cet embarras que l'autre. Grand résultat. Rossi m'écrit : " Rome est aussi impatiente que moi de connaitre le résultat de vos élections. Elle sait parfaitement tout ce qu'elle a à perdre ou à gagner à votre jeu. Et Montebello : " Voilà à Rome un grand acte d’amnistie. Ici on est je crois, disposé à adopter une mesure semblable. Le Roi a un peu de dépit de s’être laissé devancé. Tout tient à la façon dont nous sommes gouvernés. Sans sortir de mon petit coin d'Italie, il n'y a plus, dans cette Péninsule, de parti Autrichien. Je ne dis pas parmi les peuples, mais parmi les gouvernements que nos affaires changent de direction et tout cela, changera bientôt. Au contraire, qu'une bonne Chambre assure à votre Ministère aux yeux de l’Europe encore cinq ans de durée, et les conséquences, de cet état de choses se développeront, au grand honneur de notre pays. " Je continue à vous montrer mes satisfactions orgueilleuses. Autre nouvelle de Montebello. " Le Prince de Schwartzenberg vient d'avoir ici une bonne fortune qui a fini par un éclat, et une séparation de la Dame et de son mari. Le Roi n’entend pas raison sur cet article-là, et je doute que Schwartzemberg puisse rester ici. On dit qu’il va prendre un congé et qu’il ne reviendra plus. On dit aussi qu’il sera remplacé par Neumann. " Lisez cette lettre de Stuttgart et renvoyez-la moi sur le champ, je vous prie. J’y vois la persistance du grand souverain et l'impuissance du petit. Lisez aussi cette note sur le Caucase. Venue de bonne source. Et renvoyez-la moi. Quoique la guère, ne vous touche guère, ceci vous intéressera un peu. Le Roi ouvrira la session en personne, le 17. Un pur compliment renvoyant le discours politique et par conséquent l'adresse politique, au mois de de Janvier. Puis la vérification des pouvoirs. Puis la constitution du bureau de la Chambre. Puis, un compliment de la Chambre au Roi avec le même ajournement de la politique. Voilà le plan qui, même sans dérangement, prendra bien trois semaines. J’aurais Jarnac ici après-demain. Et dans les 24 heures, je l’enverrai au château d’Eu. Il a, me dit-il, bien des choses à me dire qu’il aime mieux ne pas m'écrire. 2 heures J’ai été assailli de visites. Je les recevrai avant par utilité. Je les reçois après par convenance. L’heure me presse. Adieu. Adieu.
J'espère partir mardi prochain 12, le soir pour être à Paris, le 13 au matin. Vous n’avez pas d’idée de l'effet que font ces élections dans le pays. Ce sont les premières élections vraiment gouvernementales qu’on ait vues depuis 1814. C'est le propos universel. Adieu. Adieu dearest.
3. Val-Richer, Mardi 14 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pas d'estafette cette nuit. A sa place un gros orage. Le tonnerre a roulé pendant une heure et demie. Il faut de l’espace au tonnerre. Les rues de Paris lui déplaisent ; on ne l'y entend pas. La mer et les bois, c’est là qu’il triomphe. J’avais envie de dormir, et pourtant. j'écoutais avec plaisir comme un bruit champêtre. J’ai très bien dormi après et ne me suis levé qu'à 7 heures après m'être couché avant 10. Je me soigne avec une obéissance exemplaire. Hier soir, à 8 heures, je suis rentré pour éviter le serein. J’ai cette éternelle disposition, à l'éternument qui n’est rien qu'un ennui, mais bien, un ennui.
Je viens d'écrire à Sir J. Easthope. Bien, je crois ; indiquant que la confiance peut se gagner, que je désire sincèrement qu’on la gagne, mais qu’il faut la gagner. C'est le commentaire d’une phrase d’une lettre de vous à Lady Palmerston. J’écris aussi à Brougham. Brièvement. Il abuse des lettres. Il est saisi d’une haine aveugle contre les Whigs, et sera contre eux au Parlement et dans le monde, d’une activité tout aussi aveugle. Je ne veux ni me l'aliéner, ni me livrer à lui. Les relations de ce genre sont l’ennui du métier. Amis ou ennemis, de la confiance ou de la guerre, à la bonne heure, mais se méfier et ménager, c'est l’ennui. L’Espagne, me préoccupe beaucoup. Si l'Angleterre épouse D. Enrique, nous retomberons dans la vieille ornière, la lutte des partis Espagnols modérés et progressistes, & le patronage français et anglais au service de cette lutte. Situation très incommode, car ce qu’on abandonne le plus difficilement, c’est un ancien patronage. Question d'influence politique et d’amour propre personnel. Je crois bien que dans cette lettre, j'aurai le bon bout. Si les Progressistes espagnols avaient le pouvoir à Madrid, et que de concert avec Londres, ils m'offrissent D. Enrique, je serais fort embarrassé à le refuser. Mais ce sont les modérés qui dominent en Espagne ; ils ne voudront pas de D. Enrique, et si je les décide à vouloir du Duc de Cadix, l’embarras du refus sera pour l’Angleterre, qui ne refusera pas, je crois. Au fait, je ne crains pas beaucoup cette alternative, et la question ainsi placée, n'a pour nous, plus de bien mauvaise issue. Notre principe et notre honneur sont saufs, en tout cas. Je cause avec vous, en attendant votre lettre qui n’arrive pas. L’orage aura retardé la malle.
6 heures et demie Voilà votre lettre. Nous nous rencontrons parfaitement sur D. Enrique. Comme toujours. Quoique cette situation soit difficile, je l’aime pourtant bien mieux que la chance du Cobourg. Ce que vous dit Könneritz de la Constitution en Prusse me parait probable. Il y aura encore plus d’une oscillation de ce genre. Ce qui n'empêche pas qu’on ne marche vers la constitution. La dépêche de Pétersbourg est bonne en effet, bonne avec complaisance. On a pris plaisir à l’écrire. On fera tout ce qu'on pourra pour être bien avec nous, comme gouvernement, sans changer d’attitude personnelle. Je puis, après ce qui s’est passé depuis cinq ans et ma raideur de 1843, m'accommoder assez de cette situation. Elle ne manque pas de dignité, et peut avoir de l'utilité. Voici une lettre intéressante de Londres. Renvoyez-la moi, je vous prie, dès que vous l'aurez lue. Soyez sûre que le Cabinet Whig a quand on regarde à ses adversaires, une meilleure position, et plus de chances de durée qu’on ne le dit. C’est dans son propre sein que sont les germes d’une dissolution, peut-être assez prompte. Lord John, lord Palmerston et Lord Grey n'iront. pas longtemps ensemble. Il faut que je vous quitte pour répondre aux lettres d’affaires. Celle-ci est bien froide, bien d’affaires. J’ai tout autre chose dans le cœur. Je ne m'accoutume pas en me promenant que vous ne soyez pas avec moi. Je m'arrête pour vous attendre. Je me retourne pour vous chercher. C’est surtout quand quelque chose me plaît que vous me manquez Adieu. Adieu. Vous partez donc demain pour Dieppe. Allez ensuite chez la vicomtesse. Il ne faut pas s'annoncer pour ne pas aller. On s’attire de la malveillance. Même de la part de ceux qui auraient autant aimé qu’on ne leur eût rien annoncé. Adieu. Adieu, dearest. J’enverrai toujours mes lettres à Génie. G.
Ibrahim Pacha dit que la nation anglaise l’a reçu comme il a été reçu par le Roi des Français.
223. Val-Richer, Samedi 20 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai trouvé mes enfants très bien. Cependant Guillaume tousse un peu depuis quinze jours. Il mange et dort parfaitement. Il est très gai. Mon médecin dit que ce n’est rien du tout et que quelques pastilles d’ipécacuanha l’en débarrasseront.
Le Duc de Wellington s’est bien fâché contre Lord Melbourne. J'en ai été un peu surpris. Non qu’il n’eût parfaitement raison ; mais au dire de Pozzo, il y a entre eux la meilleure, intelligence ; et Lord Melbourne ne fait à peu près rien sans s'en être de près ou de loin, entendu avec le duc. Du reste il arrive à Birmingham ce qui arrive dans les grandes villes des Etats Unis d'Amérique, ce qui arrivera partout où la contagion de l'esprit démocratique aura atteint le gouvernement lui-même. On élit des magistrats mais il n’y en a plus. Il n’y a que des adorateurs et des serviteurs de la multitude. Elle est pour eux ce qu’était le Pape au Moyen-Âge pour l’Europe chrétienne. Leur premier mouvement est de la croire infaillible, et ils ne se décident à la réprimer un peu qu’en cas de nécessité absolue et après les derniers excès. Lord John s'est mieux défendu aux Communes que Lord Melbourne chez les Lords. Lord Melbourne a toujours l’air d’un homme qu'on réveille en souriant, et qui dit : " Laissez-moi tranquille. Pourquoi me tracassez-vous ? Croyez-vous que je sois là pour mon plaisir ? J’y suis pour vous empêcher d'être dévorés par cette bête. féroce. " Le Parlement ne sera prorogé que dans la seconde quinzaine d'août.
8 heures
Je rentre de bonne heure quoiqu’il fasse beau. Les soirées normandes sont trop humides pour moi. Je retomberais dans ces éternuements insensés qui m'hébètent et me fatiguent. Décidément, l’atmosphère du midi est la seule agréable la seule ou la chaleur ne soit pas celle d’une étuve et la fraîcheur celle d'une cave. C'est bien dommage que le proverbe ait raison : " Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. " J’aimerais bien à choisir mon herbe. A tout prendre, je me suis assez réglé, dominé, gouverné selon la raison, et je passe pour cela. Mais il me prend quelquefois de furieux accès de fantaisie, un désir passionné de n'en croire que mon goût mon plaisir. Personne ne saura jamais ce qu'il ma fallu d'effort la semaine dernière pour ne pas partir pour Baden dans la journée, et y aller voir moi-même.
Dimanche 6 h. 1/2
Je me lève de bonne heure ici, comme vous à Baden. Le calme du matin est charmant. La nature est animée et il n'y a point de bruit. Je crois que je travaillerai beaucoup, et avec plaisir. Pourvu qu’on ne vienne pas trop me voir. J’attends la semaine prochaine M. et Mad. Lenormant ; puis M. Devaines et son fils, puis M. Rossi. Mad. de Boigne qui ira passer un mois chez Mad. de Chastenay, près Caen, me fera une visite en passant. Ma route n'est pas tout à fait achevée. Cela éloignera quelques personnes.
Ne mettez pas grande importance, à ce que vous lisez dans les journaux sur les dissensions intérieures du Cabinet, sur le travail de M. Dufaure au profit, de la gauche, &. On essaie d’amener cela en le disant ; mais cela n'est point. Il n’y a dans le Cabinet point de dissensions, point de travail de personne au profit de personne. Ils sont tous contents d'être où ils sont, chacun tâche à se maintenir bien avec ses anciens amis pour en tirer quelque appui, M. Dufaure avec la gauche, M. Duchâtel avec le centre ; mais tout cela, sans conséquence. Au fait, ils s'accordent sans peine ; et quand ils différent, chacun dit son avis, le Roi décide, et ils n’y pensent plus.
9 heures
Je suis désolé que le courrier vous ait manqué. J’aime mieux que cela soit tombé sur le jour où vous avez eu Lady Carlisle. Lady Granville m’avait dit qu’elle irait passer une journée avec vous. Merci de ce premier aperçu sur vos arrangements. Ils me conviennent, à présent, il me faut les détails. Adieu. Adieu. Vous aurez été bien rassurés sur Paris. Adieu dearest. G.
306. Val-Richer, Samedi 2 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Vous avez bien raison ; il n’y a plus de belle campagne. Encore notre maladresse : vous avez eu de la belle campagne à Baden et moi en Normandie, et nous en avons joui séparément, si c'est jouir.
Je persiste dans tous mes avis d’hier. Si votre frère y mettait un peu de bonne volonté, il ne serait peut-être pas impossible que dans l'impatience du Capital, vos fils revinssent un peu sur le mobilier de Courlande, et l’argent en portefeuille. Ils vous donneront du moins quelques explications. Je ne vois que Benkhausen ou Cumming que vous puissiez charger de les leur demander. Encore une fois, si vous en écrivez à Alexandre, ce sera Paul qui répondra et Dieu sait comment. Pourtant j'ai en idée que toujours par impatience du Capital, il se contiendra dans ce moment, et vous fera peut-être même quelques avances. N’ont-elles pas déjà un peu commencé ? N'est-ce pas là le sens caché de ce que vous a dit Bulwer ? La tendresse de la dernière lettre d'Alexandre ne lui a-t-elle pas été permise ? Vous voyez que je vous dis tout impitoyablement. Je me trompe, avec une très grande pitié. Je trouve tout cela déplorable.
Le Roi fera bien avant de dissoudre son Cabinet sur les passeports de D. Carlos de s'assurer des successeurs. Mais nous sommes bien bons d'y regarder. Cela n’est pas sérieux. J'en reviens à mon dire ; j'aime la grande et vraie comédie, non pas la petite et inutile.
9 heures et demie
Je n'accepte pas le Shabby. Vous savez que je suis maîtresse de maison ménageant, arrangeant les personnes, les choses. Dieu sait si j'étais fait pour ce métier là ! Mais c’est lui qui m’y a condamné. Ma vieille et bonne mère ne peut pas être pressée. Elle est le contraire de M. de Talleyrand. Elle a de la grandeur naturelle, et de petites habitudes. Je respecte tout en elle. Croyez donc bien, sachez donc bien une fois pour toutes que moi, je n'ai jamais rien de plus pressé que de vous revoir, et que j’y pense, comme on pense à sa première affaire et à son seul plaisir. J’ai mille choses à vous dire que je ne peux pas écrire. Adieu. Adieu.
M. Rossi, ne sera pas Pair cette fois. La loi sur les catégories pour la Pairie n'admet que les membres des quatre académies de l'Institut, & il est membre de la 5e Académie, qui n’existait pas encore du moment où cette loi a été faite. C'est moi qui l’ai créée en 1832. Objection de procureur ; mais les procureurs sont puissants partout. Il attendra. Adieu encore et toujours. G.
304. Val-Richer, Jeudi 31 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je voulais partir le 9. Ma mère me demande trois ou quatre jours pour des arrangements de ménage. Je partirai du 12 au 14. Je vous le dirai positivement un de ces jours. J’arriverai vers 6 heures et je vous verrai vers 8. Et pour longtemps. Quand il vous retrouve pour quelques jours, j'ai, dès le premier moment, le sentiment que je vais vous perdre. Le doux est au bord, l'amer au fond. Tout sera doux. Et puis je ne sais, mais j’ai peine à croire que l’été prochain se passe comme celui-ci. Si les situations sont les mêmes, et que je me sente à la gorge la même disposition, je pourrai bien aller prendre les eaux des Pyrénées. Elles ont parfaitement guéri, du même mal, M. de Broglie et M. Mauguin. Venez-y. C'est le plus charmant pays du monde ; et on m'assure qu’il y a deux ou trois établissements où l'on est bien. Le Duc de Noailles pourra vous le dire. Il y a passé l’été.
Les 300 lettres m'indignent comme vous. Que tout est incomplet dans la vie ! Et cet incomplet est si fragile. Rien ne sera incomplet dans quinze jours. Au moins, nous le croirons un peu, quelques fois.
Le Préfet en question méritait son sort. Mais j’en avais parlé, demandant un peu de temps pour y préparer ses amis, dont quelques uns me tiennent de fort près. Nous en étions restés là. J'apprends sa révocation par le Moniteur. Cela m'a mis dans une position désagréable, et j'ai voulu qu’on le sût. Je suis très facile avec mes amis Ministres, très facile et pour ce qui me regarde personnellement et pour les affaires. Je ne veux pourtant pas qu'on me croie trop facile et qu’on en abuse. Il faut qu’on y pense un peu. Je n'ai pas eu d’autre motif, et la chose en restera là. Vous savez bien que vous devez me tout dire. J’ai une confiance, entière en deux choses, vos premiers instincts et vos jugements définitifs. Ce qui vous vient soudainement à l’esprit, par pure impulsion de nature, et ce qui y reste quand vous y avez bien pensé, est toujours excellent. Entre deux, vous avez quelquefois des impressions excessives, des jugements pris d’un seul côté et que je dispute.
10 heures
Je suis bien aise que vous ayez encore des Affaires pour quelques jours. Je voudrais que vous en eussiez jusqu'à mon arrivée et que votre repos ne commençât qu'avec moi. Adieu. Jaubert vous plaira, à la condition que vous y mettez. Il a un mouvement inépuisable et il sera toujours très poli. Mais vous serez bientôt au bout de son esprit. Il en a beaucoup plus à la tribune qu'ailleurs. Adieu. Adieu. Le froid gagne.
296. Val-Richer, Mercredi 23 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Ma journée a été prise hier par M. Hèbert, qui me reste encore aujourd’hui. C’est un homme de quelque importance dans la Chambre. Il a du sens, du courage et de la parole. Il m’a toujours été très fidèle. Mais c'est une terrible chose qu’un brouillard qui rend la promenade impossible, et la conversation permanente. Je ne connais plus que vous au monde avec qui en fait de présence et de conversation, je n’arrive jamais au bout de mon plaisir. Mon hôte ne sait rien. Il vit depuis deux mois à la campagne, en vacances. Sa disposition me paraît être celle des gens sensés du centre, le mécontentement expectant, peu de confiance et peu d’ambition.
Vous verrez que D. Carlos, pour avoir ses passeports, sera obligé de prier sérieusement Cabrera et le comte d’Espagne d'en finir, & qu’ils ne lui obéiront pas. Raison de plus pour ne pas les lui donner de sitôt ; il faut qu’il ait autant d'envie que la reine Christine de voir cesser la guerre civile, et qu’il emploie ce qu’il a d'influence pour nous comme il l'a employée contre nous. Bourges doit être bien ennuyeux, pas plus pourtant qu’Elisando, je pense. Je ne suppose pas que les visiteurs Carlistes suffisent pour charmer le séjour. Quel puérile parti !
Il me paraît que Berryer poursuit sa candidature à l’Académie française car on m'en écrit de nouveau. Parlerait-il du Roi comme il convient dans son discours de réception ? Demandez-le lui tout simplement si vous le voyez. Remarquez-vous, de votre côté un léger, bien léger mouvement pour nous adoucir un peu dans notre refus de faire comme l’Angleterre.
Plus j'y pense, et plus je répète, pour la politique ce que Mirabeau disait pour la morale : " la petite tue la grande. " Et je le répète contre tout le monde.
Pour rien au monde, je ne voudrais épouser la Reine d’Angleterre. Vous n'aviez pas bonne opinion de l'avenir conjugal de la Princesse Charlotte. Je parierais bien plus contre cet avenir-ci. Je ne sais pourquoi, car au fait je n'en sais rien. Mais j’ai cette impression. Peu importe du reste au résultat. Le Prince de Cobourg ne l'en poursuivra pas moins, et ne s'en félicitera pas moins, s’il l'obtient. Puis le temps s’écoulera ; les mécomptes viendront les ennuis, les colères, les regrets peut-être. C'est le train de la vie. Bien peu y échappent, même de ceux qui le prévoient.
9 heures et demie
Je m’attendais, en effet au dénouement de Félix. Vous faites bien de le garder. Moi aussi, j’attends le beau mois de Novembre. Adieu. Adieu. Je vous quitte bien brusquement. Mon hôte entre dans mon Cabinet. Si c'était vous !
281. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me sens beaucoup mieux ce matin. C’est une singulière chose que la rapidité avec laquelle ce mal de gorge m’envahit s’établit, semble près de devenir une maladie et s'en va. Je suis persuadé qu’en y prenant un peu garde, dans trois ou quatre jours, il n’en sera plus question. Mais c’est bien décidément mon mal.
Je sais peut-être moins de détails que vous sur l'Orient. Quand les affaires ne vont pas à leur satisfaction, ils m'en instruisent plus laconiquement surtout quand l’événement confirme mes avis. J’ai reçu cependant ces jours-ci deux lettres qui sont d'accord avec ce que vous me dites. Mais vous aussi vous êtes trop loin. Deux heures de conversation toutes les semaines nous seraient bien nécessaires. A vous dire vrai, je ne me préoccupe pas beaucoup de cette affaire là quant à présent. Deux choses seules m'importent ; la paix pour le moment, le fond de la question pour l'avenir ; la paix ne sera pas troublée, ni la question au fond résolue. Je tiens l’un et l’autre pour certain. Il ne sortira de tout ceci qu’un ajournement pacifique. Que l’ajournement soit plus ou moins digne, plus ou moins habile, qu’il en résulte plus ou moins de gloire pour les manipulateurs, il m'importe assez peu. Je ne m'étonne pas que Mad. de Castellane vous choque. Elle n'a point de mesure dans la flatterie. Là est la limite de son esprit et le côté subalterne de sa nature. Du reste, rien n'est plus rare aujourd'hui parmi nous que le tact des limites. En toutes choses, nous sommes toujours en deçà ou au delà. C’est le défaut des sociétés renouvelées par les révolutions ; il reste longtemps dans leurs mœurs quelque chose d’informe et de gros, je ne veux pas dire grossier. Il n'y a de fini et d'achevé que ce qui a duré ; ou ce que Dieu lui-même a pris la peine de faire parfait. Mais il ne prend jamais cette peine là pour les peuples.
Voilà votre N°277 et en même temps des détails sur l’orient qui m’arrivent très circonstanciés trop pour la distance où nous sommes.
Vous menez bien votre barque. Vous travaillez à vendre le plus cher possible l'abandon, c’est-à-dire le non renouvellement du traite d'Unkiar-Skelessy. Vous avez tout un plan, dans lequel tout le monde, a son poste assigné contre Méhémet Je ne crois pas à l’exécution. C’est trop artistement arrangé. Je ne suis point invité à Fontainebleau. Je ne sais pas si je le serai. Je suis bien loin. On le sait officiellement. Pour peu qu’on trouve d'embarras à m'inviter moi, et non pas, tel autre, on a prétexte pour s’en dispenser. Adieu. Adieu. Moi aussi, j’attends l'hiver. Je vous en réponds. A propos, je ne sais de quoi, je ferai comme vous avez fait quand j’ai oublié votre commission auprès de Berryer. J’attendrai que je voie Bulwer pour lui demander moi-même des renseignements sur Lord Chatam.
Adieu, quand-même. G.
250. Val -Richer, Mardi 20 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quand nous sommes ensemble je veux bien vous parler de vous-même, vous reprocher vos défauts, vous quereller. De loin, non. tout est si sec de loin, si absolu ! Il ne faut se dire de loin que de bonnes et douces paroles. Il n'y a pas moyen de donner aux autres leur vrai sens et qui sait à quel moment elles arrivent ? Toutes les fois que je me suis laissé aller à vous gronder de loin, j’y ai eu regret. Quand vous voudrez que je vous gâte, allez vous en. Je ne serai tranquille à présent que lorsque je vous saurai quelqu'un pour vous ramener. J’aimerais mieux Mlle Henriette que tout autre. Quel âge a-t-elle ? Est-elle d’une bonne santé ? Je demande tout cela pour chercher à me persuader qu'elle ira vous rejoindre.
Je suis quant à l'Orient, dans une disposition désagréable. Je suis convaincu que si la question ne s’arrange pas, c’est-à-dire ne s’ajourne pas, c'est bêtise, inaction, défaut de savoir dire et faire. Mettez quatre hommes d’esprit en Europe, à Pétersbourg, à Vienne, à Paris et à Londres, avec celui qui est à Alexandrie Faites que ces quatre hommes d’esprit voient l'affaire comme elle est réellement et se voient eux-mêmes comme ils sont réellement, il est impossible qu’ils ne prennent pas le parti, gardant chacun sa position, réservant chacun son avenir, d'agir au fond de concert. Nous avons tous un intérêt dominant, le même, et auquel longtemps encore tous les autres doivent être subordonnés. Vous Europe orientale, qui n’avez point fait de révolutions votre intérêt dominant est qu'elles ne commencent pas. Nous, Europe occidentale, qui en avons fait notre intérêt dominant est qu'elle ne recommencent pas. Nous avons tous à nous reposer, et à nous affermir, vous dans votre ancienne situation, nous dans notre nouvelle. Et territorialement, le fait est le même.
Vous avez gagné en 1815 ; nous ne demandons rien. Nous avons accepté et maintenu en 1830, à la sueur de notre front le statu quo que vous aviez acheté, contre nous en 1815, de tant de votre sang. Le moment est-il venu de le remettre en question ? Et si l'affaire d'Orient ne s’ajourne pas, il sera remis en question, et bien autre chose avec. De quoi s’agit-il au fait ? D'imposer à la Porte l’indépendance réelle du Pacha, au Pacha la paix stable avec la Porte et d'attendre. Si on se met d'accord sur ce but, on y arrivera infailliblement à quelles conditions ? Qui en aura l'honneur? Qui restera à Constantinople avec le plus d'influence ? Qui en aura à Alexandrie ? Questions secondaires, très secondaires, quelque grandes qu'elles soient.
Il faut avoir une idée simple et la placer bien haut au dessus de toutes les autres. On ne se dirige que vers un fanal très élevé et on ne marche réellement que quand on se dirige, vers un but. La révolution française à eu une idée simple ; elle a voulu se faire. La Ste alliance a eu une idée simple ; elle n’a pas voulu de révolution. L’une et l'autre a réussi : réussi quinze ans, vingt ans, comme on réussit en ce monde ; réussi pour son compte et dans ses limites, le seul succès qu’on puisse sensément prétendre. La folie de la révolution française était de vouloir se faire partout. La folie de la Ste Alliance était de vouloir empêcher la révolution française de s'accomplir. L’une et l’autre a échoué dans sa folie et réussi dans sa propre et vraie cause. La leçon est claire car elle est complète, aujourd'hui encore, pour je ne sais combien de temps, l’idée simple de l’Europe doit être la paix. Et si la paix est troublée à cause de l'Orient, ce ne sera pas à causé de l'Orient, mais à cause de la bêtise de l’occident et de l'orient chrétien. Il y a une chose dont je ne me corrigerai jamais, c’est de croire que, quand on a raison on peut réussir.
Mon honnête Washington, qui avait plus d’esprit que bien des coquins, ne se faisait aucune illusion sur les sottises de ses concitoyens ; mais je trouve à chaque pas dans ses lettres cette phrase. I cannot but hope and believe that the good sense of the people will ultimately get the better of their prejudices. Aux mots the people j'ajoute les mots and the governments, et je dis comme Washington. Je me donne pourtant deux sottises à surmonter au lieu d’une.
9 h. 1/2
J’attends chaque matin votre lettre avec bien plus que de l’impatience. Quand n'en attendrai-je plus ? Quand serons-nous réunis ? Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Conditions matérielles de la correspondance, Discours du for intérieur, Histoire (Etats-Unis), Histoire (France), Politique, Politique (Europe), Politique (France), Politique (Prusse), Politique (Russie), Relation François-Dorothée, Révolution française, Santé (Dorothée)
242 . Val -Richer, Lundi 12 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
On a été peu étonné de votre refus des conférences de Vienne. On s’y attendait malgré le Gascon du Danube et ses espérances. Il en résulte ceci que trois, au lieu de quatre agissent de concert, et se le promettent ; l’une, timidement, mais pourtant positivement et de très bon cœur au fond ; l'autre, avec un peu d'humeur contre l’égyptien, mais la témoignant sans la prendre pour règle de sa conduite. Elle voulait reprendre de force la flotte turque, prendre même la flotte égyptienne. Elle y a renoncé. Nous ne sacrifierons pas l’Egypte. Nous suivrons la politique que j'ai indiquée. Nous maintiendrons de l'Empire Ottoman tout ce qui ne tombera pas de soi-même. Et quand ce qui tombera paraîtra en mesure de se reconstituer sous quelque forme nouvelle et indépendante, nous le favoriserons. Nous ne nous chargerons pas de tout régler en Orient ; mais nous n’y serons absents nulle part. Nous n’interviendrons pas entre Musulmans; mais nous n'approuverons pas que d'autres interviennent pour achever là ce qui peut vivre encore, ou étouffer ce qui commence à vivre. C'est là le principe, l’idéal, comme on dit en Allemagne. Je crois que la politique pratique y sera assez conforme.
Thiers est encore à Paris tenant sur l'Orient un langage pacifique ; plus aigre que jamais contre MM. Passy et Dufaure qui le lui rendent bien. Je ne sais ce qui s’est passé récemment entre eux ; mais pendant quelque temps Thiers avait paru ménager Dufaure. Aujourd'hui il le traite fort mal, & chez lui devant tout le monde, le met au dessous de M. Martin du Nord Rien de nouveau du reste. Vous conviendrez qu'il y aurait du guignon si je me brouillais, avec le Duc de Broglie à propos de Mad. de Staël. Grace à la liberté de la presse il n’y a point de mensonge, si sot qu'il ne se trouve quelqu'un pour le dire. En attendant que nous soyons brouillés, j’ai eu hier des nouvelles du Duc de Broglie. Il va venir en Normandie pour le Conseil-général, et compte toujours passer l’automne, en Italie, avec sa fille et son fils, jusqu'à la session.
Dès que vous le pourrez, envoyez-moi la note des effets que vous voulez faire entrer en France et l’indication du bureau de douanes c’est-à-dire de la ville par où ils doivent entrer. Je l’enverrai au Directeur général des douanes en le priant de donner des ordres à ce bureau pour en autoriser l'entrée. Je crois que cela se pourra pour toutes choses puisque toutes sont des meubles anciens, et uniquement destinés à votre usage. Ne vous en embarrassez pas et laissez moi faire. Il faut seulement que je puisse désigner la nature des effets, et le point d'arrivée. Faites-vous adresser de Pétersbourg un état bien complet des caisses, de leurs numéros et de ce que chacune contient.
Je reviens aux dents des enfants français, c’est-à-dire des miens. Je ne réponds que de ceux-là. Si vous y aviez été vous auriez été content de leur petit courage, malgré le mouvement nerveux de Pauline. L'affaire a duré trois minutes, tragédie sans pathétique et sans longueur. Mais je tenais à y être moi-même. En tout, je tiens à témoigner, beaucoup de tendresse à mes enfants, et à ce qu’ils y comptent. La tendresse manque à ce lien-là, en Angleterre, et à presque toutes les relations de famille. C’est un grand mal. Toute la vie s'en ressent. Je vous disais l'autre jour qu'en fait d’éducation morale ou physique l’atmosphère, le régime et beaucoup de liberté, étaient tout à mon avis. J’ajoute beaucoup d'affection.
9 heures
Quand je suis triste pour vous, où par vous, je vous le dis. N'y voyez jamais que ce que je vous ai dit. Je veux savoir le mot qui vous a blessée. Quel qu’il soit j’ai eu tort de le dire & vous avez eu tort de vous en blesser. Je vous aime bien tendrement, et c'est mon plaisir de vous soutenir. Adieu. Adieu. J’ai beaucoup de choses à vous dire Demain.
241. Val -Richer, Samedi 10 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous avez raison sur le sens de la lettre du Consul, votre lettre à votre frère est à merveille ; et si elle arrive à Pétersbourg avant la signature de l’arrangement tout est sauvé. Mais je crains encore que vous n'ayez pas raison ; et si vous avez raison, je crains que l’acte n'ait été signé bien vite, car Paul aura certainement pressé, pressé. Et alors ? A coup sûr il faudrait un procès, un procès éclatant pour vous, honteux pour eux, douteux comme tous les procès, surtout comme ceux qu’on ne conduit que de loin. Vous n'entrerez pas dans ce frêle et orageux bateau. Pourtant, si toute cette hypothèse se réalise, je ne crois pas qu’il faille renoncer d'avance et tout haut au procès. La crainte de le voir entamer pourrait être un puissant moyen d'accommodement. Je ne puis croire que la certitude même de le gagner rendit Paul indifférent au scandale. Il aurait pour lui, le droit légal, un arrangement conclu, votre signature. On n’est jamais sensé ignorer son droit. Paul serait autorisé à vous dire : Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Londres des letters ef administration ? Tout cela est vrai devant les juges. Mais devant le monde, cette vérité là ne suffit pas, et Paul est du monde. Il voudrait donc probablement éviter le procès, et vous pourriez transiger. Voilà, ce me semble le plus probable et le plus raisonnable dans l’hypothèse qu’en effet la propriété de ce capital vous revient. Et si cette hypothèse est fondée, quelle odieuse réticence. qu’elle déplorable complication ! J’en suis depuis deux jours constamment préoccupé. Je ne veux pas écrire tout ce que je vous dirais à ce sujet. Et qui sait si je vous le dirais ? En tout cas soyez sûre que votre lettre à votre frère est très bien. Le rappel que vous y faites des intentions de votre mari à votre égard est frappant. C'est même la circonstance qui me porte le plus à vous donner raison, contre ma raison, dans votre interprétation de la note du Consul ; car c’est celle qui explique le mieux le défaut de testament. Je pense que vous avez écrit sur le champ à Londres pour demander des renseignements plus clairs et plus complets. A la vérité, il ne me parait pas que le sens que moi, j’attribue à la note du consul, vous soit seulement venu à l'esprit.
Dimanche, 8 heures
Vous aviez raison, et M. de Metternich, se flattait ou se vantait. L'Empereur se refuse aux conférences de Vienne. Mais en revanche, l'article qu’il a fait mettre dans la gazette d’Augsbourg est bien fanfaron ; les fanfaronnades, ces gasconnades ces espérances affichées quand on ne les a pas, tout cela, est-il bien nécessaire au Gouvernement du monde ? Ne sont-ce pas plutôt des satisfactions un peu puériles que se donnent les gouvernants eux-mêmes en s'abandonnant à toutes leurs boutades de vanité ou de fantaisie ? C’est bien peu digne et il ne vient point de pouvoir de là. Avez-vous jamais lu les historiens romains Salluste, Tacite, César ? Ce qui m'en plaît surtout, c’est la simplicité, l'absence de charlatanerie et de vanterie. C’est le grand côté du caractère romain. Les Anglais en ont quelque chose. Mais le gouvernement représentatif est très charlatan, très fanfaron à sa manière.
9 h 1/2
Le n° 235 vaut très fort la peine d'être envoyé Vous savez que j'aime tout ce qui vous passe par l'esprit. Vous avez raison sur les dents. Mais ne croyez pas que je fasse de la douleur physique une grande affaire pour mes enfants. Henriette y est assez forte. Sa sœur moins parce qu'elle a les nerfs très irritables. Je crois les douleurs très inégales selon les personnes. Adieu. Adieu. Comme le vôtre souligné ! G.
235 . Val -Richer, Lundi 5 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai trouvé hier en arrivant que votre 228. Vous voulez que je vous pardonne votre abattement. Je vous pardonne tout. Mais que sert le pardon ? Pas plus que ne ferait le reproche. Vous me donnez un sentiment auquel je suis peu accoutumé, celui de l’impossibilité, sentiment très pénible à placer à côté de beaucoup d'affection. Je ne sais pas si je l’accepterai jamais. Mais nous sommes trop loin pour que je vous dise tout ce que je voudrais ce que je devrais peut être vous dire. Je compatis peu, je l'avoue à votre ennui d’un notaire, deux témoins pour un nouveau plein pouvoir qui finira tout promptement. Finir promptement, c'est votre salut, c'est votre repos ! Je ne l'espérais pas. Et quand mon attente est trompée en bien, je suis un peu content et un peu reconnaissant envers la providence. Une faveur si rare? Jamais peut-être je n'ai plus désiré vous voir et causer avec vous qu'aujourd'hui. Je ne sais si tout ce que je vous dirais vous paraîtrait doux ; mais je suis sûr que ce serait sain pour vous. Car encore une fois, je vous aime trop pour accepter, l'impossibilité.
Parlons d’autre chose. Est-il vrai, comme on me l'écrit, qu'il est question d’un voyage de l'Empereur à Odessa avec le grand duc et M. de Nesselrode ? Personne ne peut prévoir aujourd'hui ce qui arrivera de ce côté. Un enfant Roi, une vieille Sultane-mère, deux jeunes négresses-maitresses, un vieux vizir haineux, un vieux Pacha vainqueur, toutes les habiletés de l’Europe diplomatique ne gouverneront pas cela. Nous sommes au hasard. La discorde est grande dans la gauche. Les projets de réforme électorale déplaisent à la plupart de ceux qui les acceptent, & ne sont pas acceptés de ceux à qui ils voudraient plaire. Ce sera, pour la prochaine session, un grand et bon champ de bataille. Je voudrais que ces deux questions, la réforme électorale et l'Orient restassent un peu longtemps sur le tapis. Nous avons besoin, pour nous former, de questions graves, pressantes, mais suspendues sur nos têtes, qui menacent de devenir, et ne deviennent pas tout à coup de grands événements. J’aurai probablement cette satisfaction.
Ma mère est mieux, et mes filles très bien. C’est demain, 6 août, le jour de naissance d'Henriette. Il y a dix ans. J’étais bien heureux !
9 heures
Voilà le n° 229. Je répondrai demain avec détail sur votre affaire du capital anglais. Je veux revoir le texte des lois. Mais en principe, il ne nous importe pas qu’on soit ou non étranger. Les biens de toute espèce, meubles ou immeubles qui se trouvent sur notre territoire sont régis par nos lois quelle que soit la nationalité du possesseur. Il me manque en effet beaucoup. Vous avez pleine satisfaction. Adieu. Adieu. G.
228. Val-Richer, Samedi 27 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis seul, très seul. Non pas seul comme vous, hélas ! Je suis entouré de gens qui m’aiment, qui s'occupent de moi, qui ont besoin de moi. Mes enfants sont bien gentils bien affectueux. Ma journée est très pleine de personnes et de choses. Mais moi, je vous le répète, moi, je suis très seul. Je suis seul quand je ne me donne pas tout entier. Je suis seul quand je ne trouve pas tout ce qui me plaît, quand je rencontre, non pas des défauts ; que m'importent les défauts ? Mais des lacunes, des impossibilités. On me dit et vous même me dîtes que je suis orgueilleux. Je ne puis pas être heureux de haut en bas. Je ne puis pas aimer de haut en bas. Je veux que les yeux qui me charment soient là, devant moi, à la hauteur des miens ; et aussi les idées, les instincts, les goûts les désirs, comme les yeux. Je veux admirer et me soucier qu’on m'admire. Que personne n'entende jamais, ne sache jamais ce que je vous dis là. Pour rien au monde, je ne voudrais affliger ou blesser une affection tendre, un dévouement vrai ; ils sont si rares, & on les mérite si peu quand on ne les rend pas tout entiers ! Je vous dis qu’avant le 15 juin, j'étais seul et m’y étais résigné, qu'aujourd'hui je suis seul et ne m'y résigne pas.
3 heures
Voilà bien du nouveau en Orient. Le protectorat Européen et le Protectorat Russe se disputaient Constantinople. Elle se place sous le protectorat égyptien. A la barbe des Chrétiens divisés, les Musulmans se rallient. Je suppose que cela déplaira beaucoup chez vous. C'est évidemment un tour de M. de Metternich et du Roi Louis- Philippe. Que dira l’Angleterre ? Elle déteste l’Egypte. Serait-ce tout bonnement un coup de tête du jeune Sultan, et de ses Conseillers qui auraient voulu trancher d’un seul coup & eux-mêmes toutes les questions ? Méhémet. Ali Généralissime de l'Empire Turc ! Méhémet. Ali à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Si toute l’Europe s'en arrange, il n’y a plus d'affaires-là, pour quelque temps. Si elle ne s'en arrange pas, les grandes affaires commencent. Encore une fois, dites-moi qui a fait cela, M. de Metternich, les Turcs seuls, ou peut-être Méhêmet lui-même, par son argent et ses amis à Constantinople. Je ne voir que votre Empereur qui ne puisse pas l'avoir fait. l’acceptera-t-il ?
Il m'est arrivé ce matin bien des nouvelles. Vous savez le dehors ; voici le dedans. Des conférences ont eu lieu ces jours derniers, entre les meneurs de la gauche, députés et journalistes sur la conduite à tenir d’ici à la prochaine session notamment sur la réforme électorale. M. Barrot y présidait. Voici ce qui s’y est passé. La proposition du suffrage universel a été écartée. Il en a été de même de l’élection à deux degrés quoiqu'elle ait été vivement soutenu par quelques personnes. De même aussi de la réunion de tous les électeurs de chaque département en un seul collège siégeant au chef lieu du département, et nommant ensemble tous ses députés.
On a adopté.
1° La suppression de tout cens d'éligibilité. Le premier venu pourra être député sans payer un sou d'impôt.
2° L'admission, comme électeurs de tous les citoyens qui sont admis à être jurés.
3° Une indemnité pour les députés, à raison de 20 francs par jour pendant les sessions.
4° Aucun collège électoral ne pourra être de moins de 600 électeurs, et on admettra pour compléter ce nombre, les citoyens les plus imposés après les électeurs légaux.
5° Les délégués des colonies et les membres de la maison du Roi ne pourront être députés.
6° Les fonctionnaires accusés de corruption dans les élections pourront être poursuivis par qui voudra, et devant les tribunaux ordinaires sans aucune autorisation du Conseil d'Etat.
7° Enfin, il a été question d’interdire à tout député non-fonctionnaire d'accepter une fonction quelconque pendant la durée de la législature même en donnant sa démission. Ceci n'a été ni adopté, ni rejeté. C'est là le thème que les journaux de la gauche vont broder dans l’intervalle des sessions. La personne qui me donne ces détails, venus de source, ajoute : " Je crois cette question de la réforme très importante, en ce qu’elle décidera selon moi, la question ministérielle. Le Ministère actuel n’est assez fort ni pour accepter, ni pour rejeter une réforme électorale. Parmi les amis des Ministres centre gauche quelques uns vont disant que la crise ministérielle va commencer, et que M. Passy, Teste et Dufaure sont déterminés à ne plus souffrir le Maréchal aux Affaires étrangères, et M. Cunin- Gridame au commerce. Ce sont- là de belles paroles dont les ministres en question bercent leurs amis sans en penser un mot. "
Thiers sera à Paris dans les premiers jours d'août. Il dit beaucoup qu’il n’a d’engagement avec personne et qu’il est parfaitement libre dans ses mouvements. Le journal le Temps vient d'être acheté, dit-on, par M. de Conny, pour les Carlistes. La Presse reste entre les mains de M. Emile de Girardin et devient de plus en plus vive contre le Cabinet. Voilà un vrai Journal. Personne n'a acheté celui-là et il ne se donne qu'à vous.
Dimanche 9 heures
Je vois que les journaux ne donnent pas toutes les nouvelles d'Orient, et que vous ne comprendrez qu’à moitié ce que je vous en dis. La flotte turque est allée. Je mettre sous la protection de Méhémet. Le divan lui a écrit. Le Sultan l’a confirmé dans le gouvernement de l’Egypte et de la Syrie avec l’hérédité pour sa famille. Il l’a nommé Généralissime et soutien de l'Empire Ottoman, et l'a engagé à se rendre à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Il est probable que Méhémet ira, avec les deux flottes réunies. Voilà les faits qui du reste vous sont probablement déjà venus d'ailleurs. Ils ne sont pas officiellement connus, mais presque Certainement. Adieu. Adieu.
225. Val-Richer, Lundi 22 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je laisse mon monde dans le jardin et je rentre, quoiqu'il fasse très beau. Le serein m’est décidément insupportable. J’ai éternué toute la nuit dernière.
Votre frère a été bien content quand il a vu que vous étiez riche comme il dit, et qu’il ne serait pas absolument obligé de braver pour vous l'humeur du maître. On fusille un pauvre diable qui a peur de l'ennemi, et lui tourne le dos. Il y a des peurs moins fondées qui ne coûtent pas si cher.
Je lisais tout à l'heure des lettres d’un spirituel républicain, M. Jefferson, qui range précisément, au nombre des immenses supériorités de la condition républicaine, celle-ci qu’un homme n'ait jamais peur d’un autre homme. Il se vante un peu ! Pourtant je comprends que la vue des embarras et des pusillanimités de cour donne aux républicains cet orgueil là. Vous voulez savoir mon avis sur la commutation de Barbés. Je trouve le fait bon en général et pour l'avenir du pays, pitoyable dans le moment et pour les personnes.
Vous savez ou vous ne savez pas que, sous la Restauration du milieu des conspirations et des condamnations, j’ai écrit contre l'emploi de la peine de mort en matière politique. Ce petit volume fort modéré et où il y a de belles pages, fit assez de bruit dans le temps et est resté populaire. Lorsque MM. de Lamartine, de Tracy, Arago, Dupont de l'Eure, George de Lafayette & sont allés faire une démarche, auprès du Garde des sceaux pour l'engager à empêcher l'exécution de Barbes, ils m'ont envoyé M. Dupont de l’Eure pour m'inviter à me joindre à eux. Je m'y suis refusé comme de raison, et j’ai prié M. Dupont de l’Eure de relire ce que j’avais écrit en 1821 : " Je viens de le relire moi-même, lui ai-je dit, et loin d'en rien désavouer, j'ai quelque fierté d'avoir écrit cela, il y a 18 ans, car je le pense encore aujourd'hui." Encore aujourd’hui, je désire l'abolition de la peine de mort dans les délits purement politiques. Je la voulais en 1835 quand j’ai fait poser en principe dans les lois de septembre, que les crimes politiques pourraient être punis de la détention dans un lieu de déportation, loin du territoire continental du Royaume. C’était là évidemment la peine qui devait remplacer, et par conséquent abolir la peine de mort. Le côté gauche n’en a pas voulu. Il a fait échouer cette loi là, savez-vous pourquoi ? Parce que ces messieurs, qui ne veulent pas de la peine de mort contre les crimes politiques ne veulent pas non plus d'aucune autre répression vraie, efficace. Point de répression, au fond voilà, leur désir. Et le gouvernement se trouve ainsi place entre la peine de mort et point de répression. Que voulez-vous qu’il fasse ? Pour moi, je désire l'abolition de la peine de mort pour ce genre de délits ; mais je veux à la place une peine réelle, efficace, qui intimide et réprime vraiment. Instituons-la ; je serai des vôtres. " M. Dupont de l’Eure, qui est au fond un homme honnête et sincère n’a su que me répondre, et nous nous sommes séparés bons amis. En voilà bien long ; mais vous voyez où j'en suis. Au fait, et je m'en félicite sans m'en vanter ceci est un pas immense vers l'abolition de la peine de mort en matière politique. Je ne sais comment on trouverait désormais pour l'appliquer, quelqu'un qui en eût fait plus que Barbés. Et quand on ne pourra plus l'appliquer, il faudra bien qu'on en vienne à instituer, une peine moins irréparable et pourtant efficace, car la société, à coup sûr ne consentira pas à rester sans défense contre les faiseurs de conspirations et d’insurrections, fanatiques, ou bandits. Mais en attendant, elle est réellement sans défense ; et les honnêtes gens s'en inquiètent ; et ils accusent de lâcheté le pouvoir qui les laisse sans défense ; et ils disent que c’est dans le seul intérêt de sa sûreté personnelle qu’il abandonne l’intérêt et la sûreté publique. Et de tout cela résulte un affaiblissement, un abaissement dont je ne m'alarme guère parce que j’ai confiance dans l'avenir, mais qui ont grand besoin que l'avenir arrive.
Mardi, 9 heures
Voilà l’armée Turque battue et dispersée. Si j'étais à Paris vous l'apprendriez par moi ; mais les journaux de ce matin vous en auront donné la nouvelle avant que j’arrive. Vous avez raison. Nous sommes plus loin, donc plus séparés. Je vous répète ce que je vous ai dit. Point de joie complète sans vous ; point avec vous. Je ne vous en aime pas moins. Adieu. Adieu. Les bains froids me préoccupent. G.
Mots-clés : Politique, Politique (France), Vie domestique (Dorothée)
220. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne trouve sous ma main ce soir que ce ridicule petit papier. Il me plait pourtant. C'est comme si je vous écrivais à la Terrasse. Je viens de dîner à côté d’elle (la Terrasse) chez le Ministre des finances, avec la Sardaigne, la Prusse et la Belgique qui sont maintenant fort bien ensemble. On dit que sur la frontière, les commissaires belges et hollandais s'accablent de politesses. Le Roi Léopold (vous dites comme moi à présent) j’arrive ici vendredi. Le Duc d'Orléans part le 5 août avec sa femme pour Bordeaux, Bayonne et les Pyrénées. Elle l'accompagnera jusqu'à Port-Vendres, en il s'embarquera pour Alger, de là à Constantine et partout où nous sommes en Afrique.
Madame la Duchesse d'Orléans reviendra à Paris avec Monsieur le duc de Nemours. La cour va ces jours-ci s’établir à St Cloud. Nous sommes assez fiers de notre empire en Orient. Les deux aides de camp du Maréchal ont emporté l’un d'Alexandrie, l’autre de Constantinople, des ordres, l'un pour Ibrahimn, l'autre pour Hafiz Pacha, leur enjoignant de s'arrêter partout où ils seraient, selon le vœu de l’Europe exprimé par la France. Nos deux messagers se seront rejoints la Syrie. M. le Ministre de la guerre m'a développé cela à table en prêtant son accent Allemand à notre vanité Gasconne. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Adieu. A demain.
Mercredi, midi
Je regrette bien qu’écrire vous fatigue. Ecrire, c’est tout ce qui nous reste pour cet été. Ne voyez là que ce que j'y mets, un regret, pas du tout un reproche. Je ne crois pas bientôt, aux arrangements dont M. de la Redorte vous a parlé. Le Roi ne songe point à remanier son Cabinet. Personne ni, probablement rien ne l'y obligera d’ici à la session. Donc tout restera. Mais le décri est grand. Lady Sandwich que la Reine vient de prendre pour dame d’honneur, est-ce la nôtre ? Pozzo parle mal de Lady Normanby et d’une ou deux autres des Dames, qui entourent la Reine. Elles lui font, et lui feront, dit-il beaucoup de tort.
J’ai vu Zéa ce matin et son frère Colombie. Il passe encore quelques jours à Paris. Il est assez content de ses nouvelles d’Espagne. Pour lui personnellement, elles sont meilleures qu’avant son voyage en Angleterre. Rumigny lui convient fort. Ils ont passé quatre ans ensemble à Dresde. Je ne m'étonne pas de l’insignifiance des lettres qui vous viennent de Pétersbourg. Je ne m'en étonne pas, le genre admis ; car en soi, tout cela est plus qu'étonnant. A l’ouvrage de l'abbé de La Mennais, j'en ajouterais volontiers un autre : de l'indifférence en matière d'affection. Que j’y dirais de choses. Je mourrai gros de vérités qui seront enfouies avec moi.
Vous savez surement que M. de Castillon est à Pétersbourg à l'heure qu’il est, & probablement sur le point d'en repartir pour Paris. Notre correspondance est très active, et vous paraissez très modérés, très conciliants. On croit en général que la mort du Sultan rendra une conférence Européenne moins urgente, et plus inévitable. La paix faite avec Méhémet Ali, tous les Pachas vont en vouloir autant. Avant un an, l'Empire Ottoman sera sans dessus dessous et il faudra bien y pourvoir. Réchid-Pacha repartira probablement pour Constantinople. On dit que c'est l'homme capable. Je l’ai trouvé homme d’esprit mais d’apparence bien chétive et timide. Je vous dis là bien des pauvretés. Je vous envoie le monde comme il est. J’en aimerais mieux un autre. Il est difficile à faire. Si vous étiez là, j'oublierais celui-ci. Adieu. Je vous écrirai encore demain de Paris et samedi du Val-Richer. Adieu. Adieu. G.
210. Paris, Samedi 6 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si je ne me trompe, à partir de demain Dimanche, j’aurai de vos nouvelles tous les jours. Voilà une heure que cette idée fait mon plaisir en me promenant aux Champs-Elysées, sans rien voir que votre image dans ma mémoire, sans rien entendre que le bruit de mes pas. Il n’y a point de montagnes, point de forêts, point de belles ruines ou de belle nature qui vaillent un doux souvenir solitairement recueilli et goûté. C'est une impression singulière que celle des sentiments de la jeunesse éprouvée quand on n’est plur jeune. Il y a je ne sais quel mélange de passion et de détachement. Il semble qu’on soit en même temps acteur et spectateur. On se connait on s'observe, on se juge soi-même comme s’il s’agissait d'un autre. Et pourtant c’est bien réellement et pour son propre compte qu'on jouit ou qu’on souffre, qu’on regrette, qu’on désire, qu'on espère. Et toute la science de la réflexion, toute l'expérience de la vie, est quelque chose de bien superficiel et de bien peu puissant à côté d’une émotion vraie qui remplit le cœur et ne s’inquiète de rien.
Dimanche 8 heures
M. de Bacourt vient quelque fois vous voir à Baden, n'est-ce pas ? Seriez-vous assez bonne pour lui demander ce que c’est qu’un M. Buss membre de la seconde Chambre des Etats de Bade, qui vient de m'écrire en m'envoyant un livre de politique ? Je voudrais savoir ce que c’est avant de lui répondre. Je passerai probablement aujourd’hui toute ma matinée chez moi. Mes visites reçues, je mettrai en ordre mes papiers et ma correspondance. Je suis prodigieusement en arrière. J’aime assez à rester tout un jour sans sortir. J’irai dîner chez Madame d’Haussonville. Point de nouvelles.
En nommant M. de Rumigny à Madrid le Roi lui a dit de bien prendre garde, que s’il prenait la moindre initiative, s’il s’écartait en rien de la ligne, de conduite de son prédécesseur, il aurait affaire à lui. Rumigny appartient tout à fait air Roi. Mais le Roi se souvient qu’en suisse il était assez bien avec les radicaux. Du reste je ne sais ce qui arrive en Espagne. Personne ici n’y pense plus guère. Qu'on en fasse autant ailleurs. Je suppose que Zéa est encore à Londres. Je ne l’ai pas revu.
Onze heures
Zéa sort de chez moi, arrivé de Londres avant hier, hier soir à Neuilly, ce matin ici. Content de son voyage, des dispositions de Lord Palmerston avec qui il a fait sa paix ; encore plus de celles de Lord Melbourne ; encore plus du Duc de Wellington, et de Lord Aberdeen. Il a trouvé le Duc de Wellington, très, très changé physiquement, & moralement plus actif que jamais. L'envoi d'Aston à Madrid lui convient fort ; le départ de Lord Clarendon au moins autant. Il va passer quinze jours ici, puis il ira vous retrouver à Baden. C’est vraiment un loyal homme, et la vivacité de ses émotions me touche. On lui promet d’Espagne que la dissolution des Cortes, qu'il ne voulait pas, donnera une assemblée encore plus modérée. Je ne sais si on l’appelle optimiste ; mais à coup sûr il est bien plus sanguine in his hope que moi.
Voilà votre N°207. Ainsi, à partir de demain nous nous parlerons tous les jours. Je suis charmé que vous ayez retrouvé du sommeil. C’est bien quelque chose, en attendant les bras. C’est la préface des bras. Ne vous découragez pas; ne jetez pas votre médecin par la fenêtre. Adieu. Adieu
207. Paris, Mercredi 3 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'ai vu ce matin, M. Urquhart. Il m'est resté deux heures. C’est un homme d’esprit et un fou, possédé contre vous d'une vrai monomanie. Pendant son dernier séjour en Orient, il ne mangeait rien qu'assaisonné d’une main Turque, bien Turque, Il vous craint pour lui-même autant que pour l'Empire Ottoman et votre Empereur le déteste encore plus que M. Marc Girardin. Il m'a accablé de compliments et d'injures. Nous venons de voter nos dix millions. 313 votants et seulement 21 boules noires. Il n’y en aurait pas eu d'avantage pour 10 millions. N'en croyez pas les journaux. Le marquis de Dalmatie ne va point à Constantinople. Sur mon refus, on y laisse l’amiral Roussin. On l’engagera seulement à ne pas écrire tant de lettres particulières. L’Amiral Lalande, qui commandait notre station, restera aussi à la tête des forces nouvelles. C’est un homme d’esprit, outre le bon marin. Il est vrai.
Après mon rêve éveillé et priant, je vous laissais seule. Je ne m'en excuse pas, mais vous me comprenez. Gardez pourtant toutes vos exigences, et repoussez toutes vos défiances. Celles ci n'auront jamais raison et les autres jamais tort. Un moment j’ai espéré suffire à votre âme à votre vie. Je n'y compte guère plus. Mais vous ne désirerez jamais rien de moi que je ne sois prêt à vous donner, et au delà. Adieu jusqu'à demain. Je vais dîner chez Madame Eynard.
Onze heures
Je rentre. Adieu encore avant de me coucher. La Grèce était là, bien contente de moi. Pauvre Grèce ! J’ai soutenu votre ouvrage. Vous auriez souri d'entendre ce matin, M. Urquhart me raconter toutes vos perfidies, quel immense et imperceptible filet vous aviez jeté sur M. Canning pour l'amener à vous, et comment il était déplorable qu’il fût mort, car il commençait à se reconnaître et à se débattre; il vous aurait échappé ; il se serait vengé ; il aurait vengé et sauvé l'Empire Ottoman. Heureusement pour vous, il est mort. Et pour la Grèce aussi, car, selon, M. Urquhart, il l’aurait défaite. Un jour aussi, vous voudrez la défaire, et c’est encore une des terreurs de M. Urquhart. Je l'ai rassuré. Je ne sais ce qui arrivera en Orient. Mais à coup sûr bien des prévisions y seront déjouées, et beaucoup de choses que nous y aurons faites, vous ou nous, pour notre compte et en passant, subsisteront et prendront une place et joueront un rôle que nous ne leur destinions pas.
Jeudi, 8 heures et demie Les amis de Thiers se désespèrent qu’il n'ait pas été ici pour cette discussion. Si vous lisez ses journaux, vous y verrez qu’'ils ont grand peur que l'envie ne me prenne d'être ministre des Affaires Etrangères. Ils m'attaquent à ce titre comme si je l'étais. A propos de Thiers, un homme de ma connaissance qui arrive de Lombardie me contait l'autre jour qu’en se promenant sur le lac de Côme le batelier qui le conduisait lui avait dit en lui montrant une villa : " C’est là que demeurait ce fameux ministre de France, avec Sa femme et sa fille. "
9 h 3/4
Je suis sans cesse interrompu. Je voudrais vous renvoyer tous les doutes, toutes les inquiétudes que suscite mon discours. Suis- je Anglais ? Suis-je Russe ? Pourquoi ai-je dit que l'Angleterre se trompait quelquefois ? Pourquoi ai-je fait tant de compliments à l'Empereur ? J'admire les badauds et les malices qu’ils voient partout.
Vous avez bien raison sur Lady Jersey. Mais ce n’est pas la persévérance de sa volonté qui fait faire ici attention à elle. Elle a été à la mode à Londres, et la mode de Londres se prolonge à Paris. Elle est partie contente de son petit séjour et un peu malade ; chargée d’emplettes. Je ne sais combien de caisses elle a emportées. Soyez tranquille sur Paris. Je n'aurai pas à faire le curieux. Le procès devient tous les jours plus petit et les précautions plus grandes. Je ne cours pas le moindre risque et la terrasse encore un peu moins que moi. Adieu. Adieu.
Nous avons froid comme, vous ; mais je fais du feu. Adieu. Pas froid. G. Ce pauvre Montrond m'écrit qu'il est malade retenu dans son lit à Versailles, par un érésipèle à la tête et des remèdes assez violents. Il me dit qu’il en a encore pour quelques jours. Si ça va bien.
200. Paris, Samedi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
200 Quel gros chiffre ! Je vous disais l’autre jour, que je ne pouvais croire qu’il n’y eût que deux ans. En voilà bien encore une preuve. Nous nous sommes beaucoup écrit. Nous nous sommes beaucoup parlé. Que de choses pourtant nous ne nous sommes pas dîtes ! On vit bien séparés bien inconnus l’un de l'autre. Cela me déplaît et m'attriste à penser. J’ai horreur de la solitude. Mais qu’il est difficile d'en sortir !
J’ai dit hier à la Chambre quelques paroles qui ont fait assez d'effet. Cette pauvre chambre ressemble bien à la nature humaine, elle s'ennuie de la médiocrité et s’impatiente de la supériorité. Elle a envie de ce qui est mieux qu’elle et elle n'en veut pas. Elle prend plaisir à l'entrevoir; et quand on le lui offre, elle ne peut se résoudre à l'accepter. C’est la vraie difficulté de ce pays-ci et de toute société démocratique. A travers la langueur générale, je m'aperçois qu’il serait assez facile de ranimer les débats. On me promet, sur l'Orient, un discours fantastique de M. de Lamartine et un discours russe de M. de Carné.
A propos de Russe, savez-vous que l'Empereur vient de fonder ici un journal Russe, le Capitole ? C’est un M. Charles Durand, naguères journaliste à Francfort, & journaliste à votre solde, qui a transporté ici ses Pénates. Il avait épousé une fort jolie personne de mon pays de Nîmes, qu’il a fait mourir de chagrin. Cela n'empêche pas de faire un journal Russe.
M. Delessert a arrêté la nuit dernière un des quatre généraux de la République, M. Martin Bernard. C’est une capture assez grosse. Le procès en sera retardé de quelques jours. Il faut que ce nouveau venu y prenne place. Pour le moment même, cela est très bon. On s'attendait à quelque tentative nouvelle, à quelque sauvage prise d'armes de ces gens-là, pendant le procès. Il est vraisemblable que cet enlèvement d’un de leurs généraux les troublera un peu.
5 heures
Je passe d’indignation en indignation. Ces mensonges répandus à Pétersbourg, d'où viennent-ils ?
Sans nul doute, Mad. de Nesselrode est une bonne fortune. Il vous faut bien du monde pour vous défendre. Vous avez besoin d’une sentinelle à toutes les portes. Cependant je suis plus tranquille que je ne l'étais et vous devez aussi l'être plus. Il me paraît certain que vos intérêts seront protégés, et les mensonges démentis. Quand une fois cela sera fini, quand vous aurez quelque chose d'assuré, j'aurai le sentiment d'une vraie délivrance. Des Affaires pareilles, à 600 lieues, dans un tel pays avec votre santé... Moi aussi, souvent je n'en dors pas. Vous dormirez après, n’est-ce pas ? Vous me le promettez ?
Je rentre de la Chambre. Séance insignifiante. Les intimes de Thiers sont enragés mais enragés en dedans comme des officiers abandonnés de leurs soldats. Le Cabinet n’a pas gagné ce qu’ils ont perdu ; mais ils l’ont perdu. Thiers est allé prendre congé du Roi qui a causé longtemps avec lui. Ils se sont séparés en bons termes. Thiers en partant a recommandé à ses journaux de ménager le Roi. Et le Roi a dit à un ami de Thiers. Dites lui que je lui suis nécessaire et qu’il m’est agréable ; mais, qu’il faut qu’il renonce aux affaires étrangères — Vous voyez que le raccommodement n’est pas bien avancée. Thiers de loin et les siens de près sont en grande coquetterie avec moi. J’ai été chercher ce matin Lord Granville. Je ne l’ai pas trouvé. J’irai faire une visite à votre ambassadeur, s’il n’est pas parti.
Dimanche 6 heures et demie
Je suis dans une corbeille de roses. Mon petit jardin en est couvert. Si vous étiez ici, je vous les enverrais. Pourquoi n'aviez-vous plus de fleurs ? Est-ce santé ? Est-ce économie ? car j'ai vu poindre en vous cette vertu, ou pour mieux dire cette sagesse. Madame de Boigne vient d’être très souffrante, mais très souffrante, beaucoup de fièvre, du délire. Madame Récamier qui est allée dîner avant-hier avec elle, l’a trouvée encore dans son lit, et dans un grand découragement. Elle se plaint d'être fort seule, et que la société la fatigue et qu’on arrive chez elle trop tard, après 10 heures, quand elle est épuisée et ne demande plus qu’à se coucher. Elle parle de se retirer en province ou de rester à la campagne. Lord Grey n’est pas le seul qui ne puisse se résoudre à vieillir. J’irai demain voir le Chancelier, et savoir de lui si on peut aller dîner à Chatenay. J’ai dîné hier chez Mad. Lenormant, en face d’un buste de M. de Châteaubriand immense, monstrueux, quatre pieds de tête, deux pieds de cou, long, large, épais, un taureau, un colosse. Etrange façon de se grandir. C'est le sculpteur David qui met cela à la mode. Il a fait un buste de Goethe, un de Cuvier dans les mêmes proportions. Notre temps est bien enclin à croire qu'avec beaucoup, beaucoup de matière, on peut faire des âmes. C'est le système de la quantité.
On a eu hier une dépêche télégraphique d'Orient. Rien de décisif. Toujours point d'hostilités ; mais toujours à la veille. Le rapport se fait après demain à la Chambre. Nos armements maritimes se poursuivent très activement. Ils pourront bien ne pas être purement temporaires, et si la situation se prolonge, elle aboutira à nous faire tenir une grande flotte en permanence dans la méditerranée, comme vous en avez une dans la mer noire.
Adieu. Je vais faire ma toilette & recevoir du monde. Avez-vous décidément abandonné le lait d’ânesse ? Quel mal vous faisait-il ? Est-ce que vous ne le digériez pas bien. Où en est votre appétit ? Ah, on ne sait rien de loin. Adieu. Adieu.
Onze heures Les nouvelles d'Orient sont moins pacifiques que je ne vous disais. Il y a eu de petites rencontres entre des détachements isolés. On parait croire ce matin que cela deviendra sérieux.
195. Val-Richer, Mercredi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je prends du plus grand papier. Il me semble que j’ai une infinité de choses à vous dire. Je vous en dis bien peu pourtant. M. et Mad. de Gasparin viennent de m’arriver avec M. Chabaud. Ils resteront jusqu'à samedi. Moi, je ne partirais que lundi. Rien ne m’attire à Paris, point de plaisir et peu d'affaires. Fort peu. La question d'Orient se refroidit. Les événements s'éloignent. On s'attend à peu de discussion. Thiers part demain pour conduire sa femme aux Pyrénées. Cependant je persiste à vouloir parler. La question, prochaine et point flagrante, est peut-être une raison de plus de parler ; elle est assez près pour qu’on y regarde et encore assez loin pour qu’on parle librement. La commission fera par l'organe de M. Jouffroy, un rapport savant et terne, une belle dissertation. Les Affaires Etrangères sont de toutes, à mon avis, celles sur lesquelles la parole séparée de l'action, a le moins de valeur. Elle tombe presque inévitablement dans la politique de café, ou de livre ; politique presque toujours arbitraire et futile, même la plus spirituelle. Les crédits demandés pour augmenter nos forces navales sur les côtes d'Espagne donneront peut-être lieu à un débat plus vif. On me mande que M. Molé veut les faire attaquer. Si le cabinet, dit-il, entend continuer l'ancienne politique, l’argent qu’il demande est inutile. S’il veut adopter une politique nouvelle et s’engager plus avant dans les Affaires d’Espagne, c’est dangereux. Si en faisant comme ses prédécesseurs, il veut seulement avoir l’air de faire plus qu'eux, on ne lui doit pas des millions pour qu’il se donne ce petit plaisir. En tout le cabinet ne gagne pas de terrain. Tout le monde le trouve petit et le lui témoigne, la Chambre des Pairs et M. Bresson. Cette démission de M. Bresson a été une affaire. Le Roi, dit-on, l’en a hautement approuvé. Et pour obtenir la réintégration de M. Legrand aux forêts, il a fallu que M. Passy menaçât de sa retraite. Je vous envoie toutes les pauvretés qui m’arrivent. Pourquoi pas ? Je vous les dirais. M. de Broglie a voulu conduire lui-même sa fille à Coppet. Je ne le trouverai donc pas à Paris. Mais il y sera de retour du 20 au 25 de ce mois, pour le procès, qui durera au moins quinze jours.
On m’appelle pour la promenade. Le temps est magnifique et la verdure aussi brillante que le soleil. Je n'aime pas à faire ce qui me plaît avec quelqu'un qui n’est pas vous. Adieu au moins.
Jeudi 6 heures
La lettre de votre grand Duc est une lettre d'enfant. Je suis toujours bien aise qu'il vous l’ait écrite, et qu'Orloff ait envie d'avoir votre réponse. Je suis curieux de savoir qu’elle sera la valeur des paroles de celui-ci. Vous dites toujours qu’il a de l'esprit. Nous verrons. J’espère bien que votre pauvre Castillon aura une course de courrier. J’insisterai jusqu'à ce qu’il en ait une. On me l’a promis et je graduerai mon humeur sur l'accomplissement de la promesse. Nous avons, aussi nos barbares, nos esprits grossiers quoique rusés qui feront toutes les platitudes du monde, et manqueront de bons procédés. Mais il faut le leur faire sentir. Je ne trouverai plus personne à Paris. Mad. de Rémusat est partie pour le Languedoc. Mad. de Boigne est à Chastenay. J'irai quelque fois. Si cela peut s’appeler aller à Chastenay ! Je reviendrai vers le 15 juillet.
Mes enfants sont ici d’un bonheur charmant à voir. Je les trouve déjà engraissés. Bien des fois dans le jour, je voudrais vous envoyer la société de ma petite Henriette. Elle vous calmerait en vous amusant. Je n’ai jamais vu une créature plus sereine, et plus animée. C’est la vie et l’ordre en personne. Jamais de trouble ni de langueur. Et ayant ce qui donne et justifie l'autorité, l’instinct naturel du commandement, et la disposition au dévouement. J'en jouis avec plus de tremblement que je ne veux me le dire à moi-même. Je ne me sens plus en état de résister à de nouveaux coups. Soignez-vous bien.
9 heures Je serai très bref. Le post-scriptum de votre n°194 me met dans une indignation que je ne veux pas comprimer. Je n’ai rien vu de pareil. Qu’avez-vous donc fait ? De quoi vos fils veulent-ils vous punir ? Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir mettre dans cet adieu tout ce que je ne dis pas, et de quoi vous faire oublier tout ce qui vous arrive. J’attends bien impatiemment une lettre de votre frère. G.
192. Val-Richer, Jeudi 6 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
183. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Malgré mon égoïsme, je regrette que Thiers ne vous ait pas plus amusée. Je ne veux pas que personne vous occupe ; mais qu’on vous amuse, tant qu’on pourra. Moi, je suis très occupé. Je suis curieux de savoir ce que le cabinet aurait fait contre moi s’il avait combattu mon élection. Il est établi qu’il ne la combat point ; il n’a pas de candida t; tous les fonctionnaires votent pour moi. Et tous les jours il arrive ici 800 exemplaires autant que d’électeurs, d’un petit journal intitulé le Bulletin français, et spécialement, exclusivement dévoué à me dire des injures. Il ne se met pas en grands frais d'invention ; il va reprendre dans les anciens journaux depuis 1830, carlistes, républicains, oppositions de toutes sortes, toutes les injures qu’on m'a dites, tous les mensonges, toutes les colères, et il les réimprime. C’est un curieux spectacle que tant d'activité pour rien, et aussi la parfaite indifférence avec laquelle cela est reçu. On s’en étonne et on ne s’en soucie pas du tout. Si toute la France était comme cette province-ci, les 213 reviendraient 300.
Je vais ce matin au Val-Richer. J’y aurai le plaisir d’être seul quelques heures. Après vous, ce que je désire la plus en ce moment, c’est un peu de votre solitude. Depuis quelque temps, ma disposition est assez combattue. Je ne suis point las de la vie active et des affaires ; elles me plaisent toujours ; il me semble même que ce que j'y voudrais faire est à peine commencé. J’ai la tête de la volonté encore très pleines. Pourtant je suis un peu las des hommes ; j'en ai assez de leur conversation de leur figure. Je suis au milieu d'eux comme dans une foule qu’on est pressé de traverser pour rentrer chez soi. Rentrerais-je jamais chez moi ?
Maroto ne me rejoint ni ne m'afflige comme Granville ou Pahlen. Il me prouve que j'ai raison de ne rien attendre de personne en Espagne. On y fera ce qu’on y fait ; on y restera comme on est. Il n’y a là point de vainqueur. C’est parce que nous sommes des Européens que nous nous en étonnons. Il y a un pays dix fois grand comme l’Europe, où les choses se passent et demeurent ainsi depuis des siècles. Ce pays s’appelle l'Asie. Là par exemple, on a bien raison d'être las des hommes. Quoique vous ne sachiez pas le Latin, vous savez que Tacite a dit en parlant des statues de Brutus et de Cassius : « Elles brillaient d’autant plus qu’elles n’y étaient pas." C’est votre condition dans toutes ces conversations, ces correspondances, ces articles de journaux à propos de Prince de Lieven. Laissez- moi vous répéter ce que je vous ai dit. Vous êtes trop fière pour être faible. Et vous n'êtes pas plus fière qu’il ne convient.
On a tort en Belgique d'attendre l'issue de nos élections. Elles n'enverront pas cinq hommes et un caporal dans le Limbourg. Si j’avais eu besoin d'apprendre que ce pays-ci veut la paix, je l'apprendrais au milieu de toutes les oppositions, n'importe laquelle. Il a raison. La guerre pour de grandes raisons, à la bonne heure ; mais la guerre pour des querelles de journalistes ou pour des fantaisies, de gens d’esprit, c'est absurde. Adieu. De loin, je cause avec vous de ce qui ne me fait rien, ou pas grand chose. Voyez à quels scrupules d'exactitude vous m'avez accoutumé. Au fait, vous ne savez pas, personne ne saura jamais combien tout ce qui ne me tient pas au fond du cœur est peu pour moi, et quel abyme il y a en moi entre une chose et toutes les autres. Adieu. Vous ne me donnez pas des nouvelles de votre rhumatisme. A la vérité, il était passé quand je suis parti. Mais il me semble que de ce qui vous touche, rien ne passe. Adieu, Adieu.