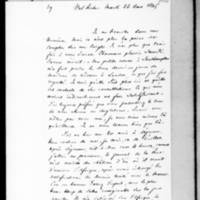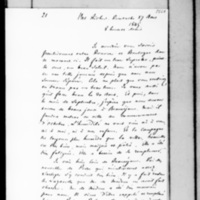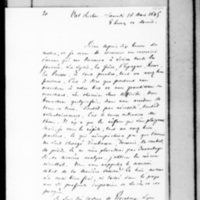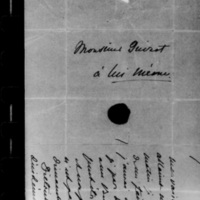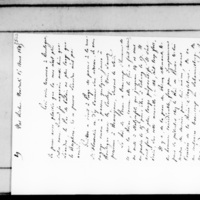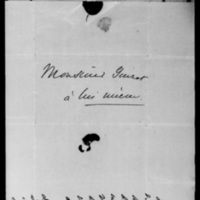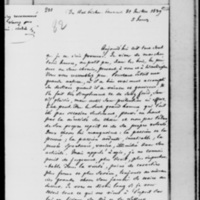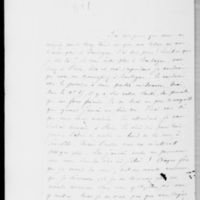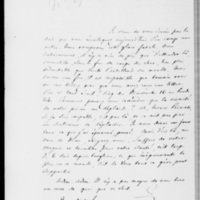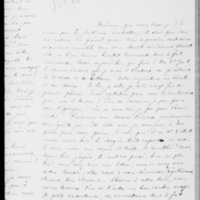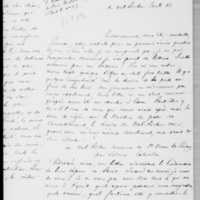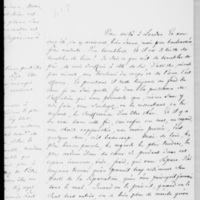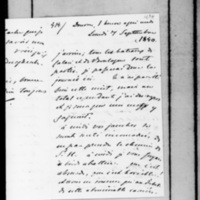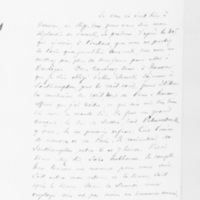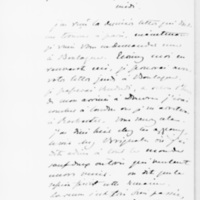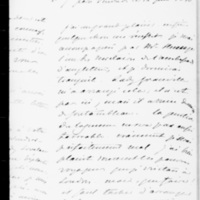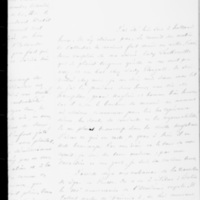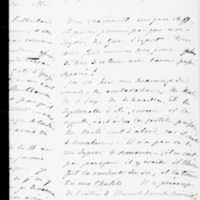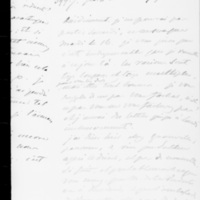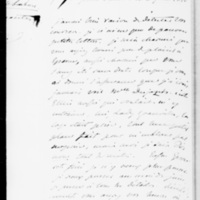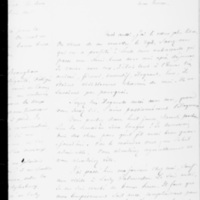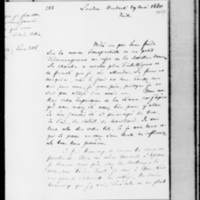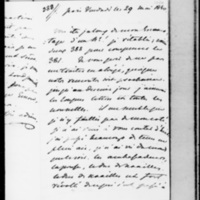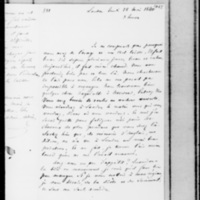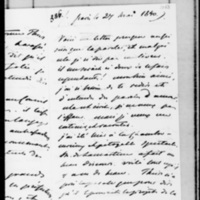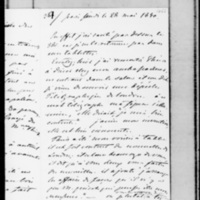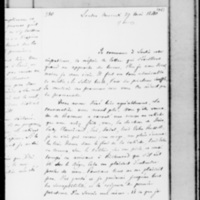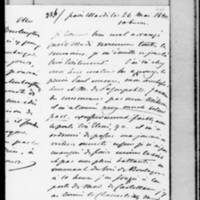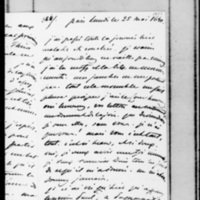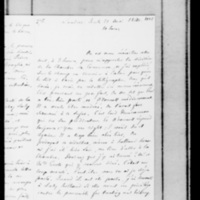Votre recherche dans le corpus : 65 résultats dans 3296 notices du site.
29. Val-Richer, Mardi 26 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me brouille dans mes Numéros. Mais ce n'est plus la peine de compter sur mes doigts. Je n’ai plus que trois fois à vous écrire. Charmant plaisir samedi. Jarnac m'écrit : " Ma petite course à Southampton m’a fait perdre les deux derniers jours de Madame de Lieven à Londres ce que j’ai fort regretté. Je crois qu’elle s’est plu ici, et qu’elle est contente de ses consultations. Ce qui m'en revient indirectement est fort satisfaisant. " J'ai toujours préféré que vous passassiez le temps de mon absence, en Angleterre. Quand vous n'êtes pas avec moi, je vous aime mieux là qu'ailleurs. Je ne vous trouve bien que là.
J’ai eu hier mes 20 amis à déjeuner, bien contents de moi, je crois, et de Guillet. Après déjeuner, c’est-à-dire vers 4 heures comme j’allais me promener, le général de la Rue m'est arrivée du château d’Eu où il venait d'arriver d'Afrique après avoir échangé les tarifications du dernier traité avec le Maroc. C’est un homme d'assez d’esprit avec le plus beau coup de sabre imaginable sur la joue gauche. Il m’a intéressé sur l’Afrique, le maréchal Bugeaud, l’Empereur de Maroc, Sir Robert Wilson, Sidi Bousalam &. Sir Robert malgré la verte réprimande de Lord Stanley, continue toujours à se mêler beaucoup du Maroc et à y faire ce qu’il peut contre notre influence. Il agit par le consul Marocain à Gibraltar et par le Pacha de Sétuan, jeune grand seigneur marocain avec qui il est lié et qu’il va voir souvent. Notre campagne de l’année dernière contre le Maroc a fait là un effet immense et qui subsiste, à ce qu’il parait.
Le pauvre Consul Général d'Angleterre, M. Drummond Hay excellent et très loyal homme, est mort de chagrin de n'avoir pas réussi à prévenir l’évènement et d’avoir vu la prépondérance, à peu près exclusive de son pays périr là, entre ses mains. Le nom du Prince de Joinville reste là fort grand. Il a laissé chez les Marocains une vive impression de courage, de savoir-faire, de sagesse, et de politesse. Le Général de la Rue m'a quitté à 9 heures. Le Maréchal Bugeaud vient passer trois mois en France, chez lui, et va faire, en arrivant une visite de quelques jours au Maréchal Soult à Soultberg-(Le Maréchal ne dit et n'écrit jamais autrement. Par tendresse pour la Maréchale Allemande.) La conversation entre les deux Maréchaux sera fort tendue, fort diplomatique, & par moments fort orageuse. Je vais faire ma toilette. J’attends tout-à-l ’heure Salvandy et Broglie.
9 heures
Voici un courrier qui m’apporte de grosses nouvelles, la destitution de Riga Pacha à Constantinople la retraite de Métaxa à Athènes. Je m’attendais à celle-ci et elle me déplaît quoique tout ce qui me revient de Grèce me porte à croire que Colettis n’en sera pas ébranlé. Mais rien absolument n’annonçait la première, et elle a été imprévue pour tout le corps diplomatique européen. Bourqueney ne se l’explique pas bien encore. Cependant, au premier aspect, il la considère comme une victoire du parti réformateur en Turquie.
Je vais lire tout cela, attentivement. Raisonnablement, le moment vient de retourner à Paris. C’est bien heureux que la raison me fasse tant de plaisir. Je reçois une lettre du Duc de Noailles. Il a eu son fils malade, mais le rétablissement est complet. Il me demande beaucoup de vos nouvelles. et finit en me disant : " Madame de Lieven aurait bien mérité, par son aimable intérêt, d'être invitée à la cérémonie qui aura lieu ici. Dimanche prochain, la pose de la première pierre du viaduc à Maintenon du chemin de fer de Chartres. " Adieu. Adieu. G.
22. Boulogne, Mardi 19 août 1845, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passée une mauvaise nuit, mon attaque de bile provenant d’un mauvais dîner. A Londres mon dîner & ma santé étaient parfaits. J’ai vu les Cowley à peu près toute la journée hier. C’est une grande ressource. Il est vrai de dire que s'ils n y étaient pas, je ne serais pas à Boulogne.
Londres m’a fait au fond un grand plaisir. Ce sont d'aimables et bonnes gens. C’est de la grande société. Je me trouve dans mon élément, et je n'en ai jamais autant joui. Mes yeux ont été un grand chagrin pour moi seulement parce que je n'ai pas pu vous écrire, car du reste ils ont servi beaucoup à l'agrément de mon séjour. Je vous expliquerai cela c’est trop long pour l’écrire.
L’impression générale que je remporte est, une excellente situation pour Peel, de la résignation du côté de la partie sensée de l'apposition (John Russel) bonne envie de tous de rester bien avec la France. Peu d'espoir que cela dure par plusieurs raisons que je réserve aussi pour la causerie. Très bonne entente avec la Russie et grande confiance de la solidité de cette amitié là. Pas beaucoup de vénération pour le Metternich d’aujourd’hui et complète pitié pour le Roi de Prusse, un extravagant, un fou.
Je suis bien aise que la reine des Belges se soit trouvé à Brüchl. Jeudi pas de lettre aujourd'hui. Qu’est ce que cela ?... la voilà qui arrive. Merci, merci. Surtout de me nommer le 30 août. Quel plaisir nous nous reverrons ce jour-là ; ce sera un Samedi. Samedi en huit. C'est charmant jusque là je me traînerais un peu ici, un peu à Mouchy peut-être. Je ne sais pas bien encore. En attendant adieu, & bien des adieux.
21. Val-Richer, Dimanche 17 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je voudrais vous savoir positivement entre Douvres et Boulogne dans ce moment-ci. Il fait un temps superbe, point de vent, un beau soleil. Nous n'avons pas eu une telle journée depuis que nous nous sommes séparés. Cela me plaît que vous rentriez en France par un beau temps. Je veux aussi qu’il fasse beau le 30 août. Et puis dans le mois de septembre, j’espère que nous aurons encore de beaux jours, à Beauséjour. Mais il faudra rentrer en ville, au commencement d’octobre. L’humidité ne vaut rien ni à vous ni à moi, ni à mes enfants. Et la campagne est toujours plus humide que la ville.
Henriette est très bien, mais maigrie et pâle. Elle a été très fatiguée. Elle a besoin de se remplumer.
Je vais bien loin de Beauséjour. J'ai des nouvelles de Perse qui m’intéressent assez. Sartiger s'y conduit très bien. Il y a fait rentrer les Lazaristes que M. de Médem en avait fait chasser. M. de Médem a été très mauvais pour nous. Il vient d’être rappelé et remplacé par un Prince Dolgorouki qui était à votre Ambassade à Constantinople. On dit qu’il sera plus modéré que Médem. On m'en parle bien. Un petit incident à Constantinople dont je suis bien aise. Le duc de Montpensier doit y être arrivé ces jours-ci. Bourqueney a communiqué d'avance à Chekib Effendi la liste des officiers qui l'accompagnaient, & devaient être présentés au Sultan. Dans le nombre, se trouvait un Abd el-At, Algérien, Arabe, Musulman, sous lieuteuant de Spahir à notre service. Vive émotion parmi les Turcs ; Comment présenter un tel homme au Sultan ? Insinuations, supplications à Bourqueney d’épargner ce calice. Il a très bien senti la gravité du cas et répondu très convenablement mais très vertement. On s'est confondu en protestations ; Abd el-Al sera reçu comme les autres officiers du Prince. Tout le régiment des Spahir serait reçu s’il accompagnait le Prince. Et de bonnes paroles sur notre possession d’Alger qu’on sait bien irrévocable, ceci fera faire un pas à la reconnaissance par la Porte. Adieu. Adieu.
J’ai des hôtes ce matin. Puis, dans la semaine où nous entrons & les premiers jours de la suivante, trois grands déjeuners de 25 personnes chacun. Mes politesses électorales à la campagne, le déjeuner est plus commode que le dîner.
Je regrette Bulwer pour votre route. Comme agrément, car comme utilité, si vous aviez besoin de quelque chose, je doute qu’il fût bon à grand chose. Quand vous reviendrez de Boulogne vous savez que Génie a, si vous voulez, quelqu'un à votre disposition. Adieu. Adieu.
Je me porte très bien. J’ai le sentiment que marcher beaucoup me fait beaucoup de bien. Seulement il n’y a pas moyen de réunir les deux choses, le mouvement physique et l'activité intellectuelle. Il faut choisir. Adieu. Adieu. G.
20. Val-Richer, Samedi 16 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
J’écris depuis six heures du matin, et je viens de recevoir, un courrier énorme qui me donnera à écrire toute la journée. La Syrie, la Grèce, l’Espagne, Rome la Prusse. A tout prendre tout va assez bien partout ! C’est à dire que partout, nous marchons à notre but, et nous grandissons en marchant. Les chemins sont difficiles. Nous bronchons quelques fois. Nous nous arrêtons de temps en temps, tantôt par nécessité, tantôt volontairement. C'est le cours ordinaire des choses. Il n’y a que les enfants qui s'en plaignent. Mais, je vous le répète tout va assez bien partout. Ce qui n'empêchera pas que l'avenir ne soit chargé d’embarras, d'ennemis, de combats, de périls. Je ne m'en plaindrai pas davantage, si, en dernière analyse, j’obtiens les mêmes résultats. Vous vous rappelez le mauvais début de la dernière session. Et bien aucune n’a aussi bien fini, ni laissé dans le pays une si profonde impression de succès et de progrès.
Je suis très content de Piscatory. Lyons travaille avec passion à faire ce qu’il lui reproche d'avoir fait, à allier M. Mavrocordato et M. Metaxa pour renverser. M. Colettis. L'alliance Anglo-Russe à la place de l'alliance Franco-Russe maintenant debout. Lyons a échoué. Et dans l'alliance Franco-Russe, Colettis a gagné beaucoup de terrain. Piscatory a vraiment beaucoup de savoir faire. Et je ne vois pas qu’il se soit écarté de l'épaisseur d'un cheveu, de la ligne que je lui ai tracée à Constantinople, on s'occupe sérieusement des affaires de Syrie. Le Ministre des Affaires étrangères, Chékib Etfendi, y est envoyé en mission pacificatrice, avec de grands pouvoirs. Nous verrons s'il en sortira quelque chose. Le public est exigeant. Il ne se contente pas d'être bien gouverné lui-même. Il veut que tous les gouvernements soient bons, même le Turc.
En Espagne, le duc de Séville a réellement, gagné un peu de terrain. Même ce me semble dans l’esprit de la Reine Christine. Vous savez que nous n'avons ni extérieurement ni au fond du cœur, pas la moindre objection à cette combinaison. J’ai averti à Naples qu’elle était en progrès. Le langage de M. le Duc de Nemours à Pampelune sera très bon. Il a été un peu indisposé à Bordeaux. Pure fatigue du voyage, qui est fatigant en effet, mais utile.
Thiers aussi va voyager en Espagne. Pour voir les champs de bataille. Et aussi en Portugal. Il y emploiera, le mois de septembre. Il va en compagnie. peut-être MM. de Rémusat, Mérimée (votre bon député), &... Bülow de plus en plus mal. D'après le langage, de ses amis mêmes, on croit sa situation désespérée. Les émeutes religieuses se multiplient en Prusse. Halberstadt a eu la sienne pour Ronge comme Posen pour Cgerski. Je ne crois pas au succès des nouvelles religions. Mais elles feront du mal aux anciennes, et j’en suis fâché. Adieu.
C'est mardi seulement que je vous saurai arrivée à Boulogne, car je compte que vous n'aurez quitté Londres qu'aujourd'hui. Ce que vous me dîtes de vos yeux me charme. Adieu. Adieu
19. Londres, Vendredi 15 août 1845, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mauvaise journée hier. Mes yeux allaient mal. J’ai eu bien peur le matin je suis mieux. Je serai curieuse de me faire lire votre discours du dîner. J’aurai cela à Douvres sans doute. Je pars demain matin à 9 heures avec Bulwer. J’irai à Folkston peut être, mais toujours par terre et non par fer. Si le temps n’est pas mauvais je passerai dimanche. Dietrichstein est revenu hier. Décidément il me fait sa cour pour arriver à Paris ! Pas d’autres news. Londres est [?] on avait bien envie de m’entraîner à la campagne. Le genre de vie et la lumière ne me vont pas.
Que de choses à vous raconter ! Tâchez que ce soit bientôt. Adieu. Adieu. J'ai mes paquets à faire & les bills à payer. Adieu beaucoup de fois adieu. Je viens de lire votre discours. Excellent. Parfait. Adieu. excellent.
19. Val-Richer, Vendredi 15 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci vous trouvera à Boulogne. Je pense avec plaisir que la mer n’est plus entre nous. Quand je nagerais aussi bien que Léandre, le Pas de Calais est plus large que le Bosphore. Et ce pauvre Léandre n'est pas arrivé.
Guillet a écrit à Page de passer à la rue St Florentin et d’y donner son adresse. Je vous engage encore à passer quelques jours à Boulogne avec les Cowley. Vous n'aurez personne à Beauséjour, surtout le soir. Le Roi de Prusse a beaucoup d'humeur de ce que la Reine comme elle le lui a fait savoir ne reste à Stolzenfels que jusqu’au 14 et veut en partir le 15 pour être à Cobourg le 17. Il avait fait de plus longs préparatifs. Il s’est écrié, sur cette nouvelle : " Ah, c’est trop fort. Il y a de la part des Princes allemands et des hommes considérables, fort peu d'empressement pour se présenter chez le Roi de Prusse & lui rendre des devoirs pour lui-même, avant l’arrivée de la Reine d'Angleterre. On va au contraire beaucoup au Johannisberg. On peut évidemment se montrer froid pour le Roi de Prusse et confiant dans M. de Metternich. Le Roi en est choqué. Et comme il est surtout homme d'impressions et d'amour propre, cette petite manœuvre n’aura probablement pas l'effet qu’on s’en promet.
La Reine d’Espagne et même la Reine Christine ont été très bien reçues à St Sébastien et dans les Provinces basques, en général ; mieux qu’on ne s’y attendait. Voilà encore des conspirations qui échouent. Ce ne sont pas les conspirations que le général Narvaez a à craindre ; c'est l'opposition dans son propre parti. Les prochaines cortes seront orageuses. Le grand Duc de Modène a décidément et pour la seconde fois refusé sa fille à M. le Duc de Bordeaux. On a donné un bal à Schönbrunn dans cette vue. Il a déclaré que si le Duc de Bordeaux y allait, ses filles n'iraient pas. Le Duc de Bordeaux a été indisposé. Le parti est très chagrin, très déconfit de cet échec. Ils disent qu’ils n’ont plus d’espoir que dans la seconde fille du Prince Jean de Saxe, 15 ans, bien laide & pauvre ; et que si cela aussi échoue, il faudra que le Duc de Bordeaux épouse une française de bonne maison, car il faut absolument qu’il se marie. La Dauphine a fort essayé de causer politique et France avec l’Electrice douairière de Bavière qui s’y est refusée. Elle (la Dauphine) s'est montrée parfaitement découragée et résignée. On lui a demandé si elle passerait l’hiver à Vienne ou à Frohsdorf : " Je n'en sais rien et cela ne me fait rien, avec le peu de jours qui me restent à vivre, et ce que j’ai à en faire, qu'importe ? " Voilà mon bulletin. Le calme est profond.
Le Roi et tout le château d’Eu ont été charmés de mon discours à St Pierre. Il m'écrit avec effusion. Henriette est décidément très bien. Mais le temps redevient mauvais, froid. Quel été ! J’ai écrit à Charles Greville. Adieu. Adieu.
Vous avez déjà passé où vous passerez après-demain. Il n'y a pas de vent aujourd’hui. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Famille royale (France), Femme (mariage), Femme (portrait), Louis-Philippe 1er, Mariage, Politique (Espagne), Politique (France), Réception (Guizot), Réseau social et politique, Santé (enfants Guizot), Séjour à Londres (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
18. Londres, Jeudi 14 août 1845, Dorothée de Lieven à François Guizot
Décidément je me suis encore trompée de N° & celui-ci est le 18ème. Votre dîner hors de chez vous, dimanche dernier me dérange. Je crains une indigestion ; & puis un assassinat, ou bien, une voiture versée. Vous savez comme je suis, parfaitement déraisonnable. Je suis tranquille quand je vous ai à Beauséjour, chez moi, ou bien dans votre cabinet que je regarde.
Hier longue promenade & causerie avec Dédel qui a tout plus de good sense & d'esprit & de connaissance de ce qui se passe ici. Beaucoup de monde chez moi le matin car tout ce qui est resté vient. Bulwer je crains me fera faux bon. Il voudrait que je retarde, & moi, je suis décidée à partir après demain. Flahaut part Lundi mais tout le monde va par le rail way. Il n'y a plus que moi dans le monde qui me serve de très mauvais chevaux de poste. Je ne sais vraiment qui partira avec moi, & je ne veut pas partir seule. Lady Cowley m’attend avec impatience et curiosité à Boulogne. J’y serai sans doute dimanche à moins de mauvais temps.
Je vous ramène des yeux assez ressemblants à ceux que j'avais en vous quittant, mais il est bien avéré que ce n’est que de l’ennui, des soins, des précautions, des privations, mais point de véritable danger. Il n’y a que Verity qui sache me traiter. Il sera à Paris au commencement de septembre. Londres est parfaitement dull, plus un seul homme public, et pas une nouvelle. Adieu, adieu, j'ai des yeux très capricieux et j'y ai mal dans ce moment, il faut que je vous quitte. Adieu.
231. Val-Richer, Mercredi 31 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Aujourd'hui c’est tout seul que je me suis promené. Je viens de marcher trois heures, au petit pas, dans les bois, les près avec ou sans chemin, pensant à vous et à Washington. Vous vous ressemblez peu. Pourtant c'était une grande matière, et il a bien vraiment accompli sa destinée quand il a vaincu et gouverné. Il l’a fait très simplement et de sang froid, sans vit plaisir, mais aussi sans prétention ni effort. C’est peut-être le seul grand homme qui l'ait été par occasion seulement, poussé en haut par la nécessité des choses et non par l'élan de son propre esprit et de sa propre volonté. Deux choses lui manquaient : la passion et la pensée ; la passion ardente, insatiable ; la pensée spontanée, variée, illimitée dans son activité. Mais appelé à agir, je ne connais point de jugement, plus droit, plus imperturbable dans la vérité, point de caractère plus ferme et plus serein, toujours au niveau des grandes choses sans jamais se croire au dessus. Je vous en dirais long si je vous disais tout ce qui me vient à l'esprit sur lui en lisant sa vie et ses Lettres. J’ai pensé à vous bien plus qu'à lui. J’aime extrêmement à penser à ce que j’aime. On dit que les avares passent des heures à contempler leur trésor. Je suis un avare. Bien certainement je le suis. Je me comptais à regarder mon trésor, & je veux le garder pour moi seul.
Jeudi 6 heures
Le soleil est admirable ce matin. C’est une rareté. Je voudrais que vous vissiez ma bibliothèque au soleil levant. Il y entre à flots par neuf grandes croisées et se répand sur deux vastes jardinières pleines de fleurs et sur une série de gravures, encadrées le plus simplement du monde, en chêne et en sapin de Suède, comme la bibliothèque, mais toutes fort belles, saintes et profanes des Saintes Familles, la communion de St Jérôme, le spasimo de Raphaël, Napoléon à Eylau à Austertitz, à St Hélène, Henri 4 à Paris, Gustave Wasa à sa dernière diète & Je suis sûr que cela serait de votre goût, la bibliothèque et le soleil. Si le Cardinal Fesch qui répand son argent à tort et à travers, m'en avait laissé un peu je ferais du Val-Richer une habitation charmante. J'ai, pour cela la matière et l’esprit. Rien ne me manque que l’argent. Je comprends que l’Europe s'amuse du spectacle des Buonaparte, se disputant cet argent. Quand Fesch fut fait Cardinal, le maréchal Lefèvre ( duc de Dantzick ) homme d’esprit malicieusement grossier, lui dit avec son accent alsacien : « Sap.. Monseigneur, c'est pien heureux que je ne fous ai pas fait pendre ce chour que fous safez pien, quand fous étiez fournisseur ! " A coup sûr tous les Buonaparte trouvent aujourd'hui comme lui que c’est bien heureux. Chaque pays a ses scandales et ses hontes. L'Angleterre a vu le squelette de Cromwell de l'homme à qui elle avait obéi et qui compte au rang de ses plus grandes gloires, pendu à Tyburn et jeté dans la Tamise. Il n'en arrivera jamais autant à Caradoe. Le voilà Pair d'Angleterre. La Princesse Bagration sera-t-elle Pairesse ?
9 h. 1/2
Comment, quatre mois sans nous voir ? Est-ce que de manière ou d'autre, vous ne reviendrez pas à Paris dans le cours de septembre, soit pour y rester, soit pour y passer en allant en Angleterre ? Dans l'un et l'autre cas, j’irai vous y voir. Vous ne comptez certainement pas rester à Baden jusqu'au mois de Décembre. Dites-moi un peu vos projets. Ayez des projets si j'étais près de vous, je m'en chargerais. Je suis décidé à m'en charger désormais jusqu'à la dernière limite du possible pour moi. Mais à présent, je suis loin. Adieu. Adieu. Voilà quatre jours qui me pèseront jusqu'à ce que vous ayez recommencé à avoir des lettres tous les jours. Vous savez que je ne jouis de rien à moi seul. Adieu. Adieu. G.
15. Caen, Mardi 1er août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai bien peur que vous ne m’ayez averti trop tard et que ma lettre ne vous trouve plus à Boulogne. J’ai bien peur ! Qu’est- ce que je dis là ? Si vous n’êtes plus à Boulogne, vous serez à Paris. Cela est vrai ; cependant je voudrais que vous me trouvassiez à Boulogne. Je voudrais être le premier à vous parler, en France. Mais dans le n°15, il y a sur votre santé, des paroles qui me font frémir. Je ne serai un peu tranquille que quand j’aurai vu, bien vu. J’irai voir dès que vous serez arrivée. En attendant, je vous écrirai demain à Paris. Je suis ici pour trois jours. J’étais ce matin au bord de la mer à Trouville. Mais l’autre, rive ne m’attirait presque plus. Que j’aurais voulu me promener avec vous sur la rive où j’étais ! Chaque fois que je revois la mer, c’est un monde nouveau que je découvre ; et je ne découvre plus un monde nouveau sans vous y chercher, ou vous y mettre. Mais je ne veux pas que vous soyez malade.
11 h 1/2 du soir J’ai été interrompu par je ne sais combien de visites, et je sors un moment du salon, qui en est encore plein, pour vous dire adieu et donner ma lettre qui partira de grand matin.
Adieu donc. Adieu sur la terre de France. Je vous l’ai déjà dit; il y a des moments en bien comme en mal, où il faut se taire, se taire absolument. L’insuffisance de la parole est trop évidente. G.
11. Duplicata Val-Richer, Mardi 25 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de vous écrire par la voie que vous m’indiquez aujourd’hui. J’en essaie une autre. Nous romprons cette glace fatale. Non certainement, il n’y a rien de pis que d’attendre là, immobile, sous le feu des coup du sort bien plus redoutable que toute l’artillerie du monde. Mais encore une fois, il est impossible que demain vous ne me disiez pas que vous avez reçu une lettre. J’en ai tant écrit ! Cinq du Dimanche 16 au lundi 24. Comment pouvez-vous craindre que la vivacité de votre peine me déplaise ? Ah, dearest Princess, si je suis coupable, c’est par là, et ce n’est pas par un sentiment de déplaisir. Je vous dirai un jour, tout ce que j’ai éprouvé, pensé. Mais d’ici là, au nom de Dieu, soignez-vous. Souffrir de votre chagrin et trembler pour votre santé, c’est trop. Je le sais depuis longtemps, ce qui m’épouvante le plus en ce monde, c’est de voir tout ce qu’on peut supporter.
Adieu. Adieu. Il n’y a pas moyen de vous dire un mot de quoi que ce soit. G.
Mercredi 10 h Enfin, enfin, vous avez une lettre. Votre N°12 me l’annonce. Quelle délivrance, pour moi comme pour vous, oui pour moi comme pour vous. Vous vous trompez sur mes N°. Vous aviez reçu le N°4 et vous me l’aviez dit. Le n° 5 était ce petit billet de Dimanche 9 que j’avais oublie de numéroter. Il ne vous manque que le N° 6 qui vous arrivera certainement. Il était allé par une autre voie qui aura retardé. Adieu, Adieu, dearest. Vous allez être accablée de lettres, accablée. G.
9. Val-Richer, Vendredi 21 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame que vous dirai-je ? Je n’aime pas les sentiments combattus ; ils sont peu dans ma nature. En général, quand deux impressions contraires m’arrivent ensemble, mon cœur choisit décidément choisit et l’une devient bientôt dominante, tout à fait dominante. Mais aujourd’hui que faire ? Vos N°7 et 8, le dernier surtout que je reçois à l’instant, me pénètrent de tristesse et de bonheur. Votre inquiétude me désole et me charme. Je lis, je relis, je relis vingt fois les paroles pleines d’une agitation pour vous si douloureuse, pour moi si tendre ! Que ne donnerais-je par pour vous l’épargner? Que ne vous dois-je pas pour l’avoir sentie? Pardonnez-moi dearest Princess, pardonnez-moi mon égoïste joie ; elle n’ôte rien, je vous jure à ma peine pour votre peine. Je crois que si ce n° 8 était arrivé avant-hier, le chagrin, l’eût emporté en moi. Je vous aurais vue encore si triste, si troublée ! Mais, depuis hier j’espère, le mal est passé ; hier au plus tard, vous avez reçu une lettre; vous en aurez une autre demain ; elles iront à vous désormais régulièrement, souvent, bien souvent. Chacun à notre tour, nous avons traversé l’un et l’autre un bien sombre nuage. De petites circonstances, des circonstances tout-à-fait étrangères à notre volonté, mon déplacement, des adresses inexactes, des postes mal réglées voilà la vraie cause du mal. Il ne se reproduira plus. Nous y veillerons. J’y veillerai comme les Guèbres sur la dernière étincelle du feu sacré, comme une mère sur son enfant malade. Les témoignages de votre affection me sont mille fois plus doux que je ne vous le dirai jamais. Mais je ne veux jamais les devoir à une minute de souffrance de votre cœur.
Et Lord Aberdeen ? Il est donc parti ? Et je puis en toute sûreté, le plaindre, être juste envers lui ? Que je vous remercie de m’avoir ainsi mis à l’aise avec moi-même ! Je ne connais rien de plus pénible que de nourrir en son âme un mauvais sentiment contre un galant homme malheureux. Et pourtant vous êtes une noble créature. Et moi j’ai le cœur bien fier. Je pressentais cela et depuis longtemps. Même avant votre départ, le nom de Lord Aberdeen me frappait plus sérieusement qu’aucun autre. Pauvre homme ! C’est si naturel !
Vous ne savez pas Madame, pour un homme sérieux et malheureux, quel charme il y a en vous, dans votre air, dans votre accent, dans ces entretiens où éclatent, avec tant de dignité et d’abandon, votre esprit si haut si simple, si libre, votre âme si gravement et si finement émue, si sensible aux grandes choses, si indifférente aux petites, pleine de tant de sympathie et de tant de dédain ! Je voudrais avoir quelque occasion d’être en bon rapport avec Lord Aberdeen de lui être agréable en quelque chose. Je me sens comme des devoirs envers lui. Vous me direz s’il vous écrit s’il doit revenir à Londres avant votre départ. Vous me direz tout, comme vous l’avez fait.
Samedi 22 midi. Dearest Princess, il n’y a plus de sentiment combattu. Je n’en ai plus qu’un absolument qu’un. Je suis désespéré de votre inquiétude. Je crains quelle ne vous fasse mal. Je reçois à la fois votre petit billet, sans numéro du lundi 17 qui m’est venu directement, après être encore allé me chercher à Caen et votre N°9, du Mardi 18, qui m’arrive par Paris. J’ai beau me dire qu’à présent, depuis Jeudi vous êtes tranquille, que vous savez combien vos inquiétudes étaient vaines. Je n’en suis pas moins désolé, troublé, inquiet de nouveau moi-même et de la façon la plus douloureuse. Je vous vois, vous êtes là devant mes yeux, impatiente, préoccupée quel charme agitée, triste, attendant, attendant encore. Vous me pardonnez, n’est-ce pas? Je veux que vous me pardonniez, quoique je n’ai point de tort, non certainement point de vrai tort, point de tort devant Dieu; car moi aussi j’ai attendu et bien des jours, et avec une impatience dont j’ai contenu, dont j’ai étouffé l’expression en vous la témoignant. Et si j’avais suivi ma pente, quand vos lettres ne m’arrivaient pas quand mon imagination se lassait, s’épuisait à chercher la cause du retard ou du silence, je vous aurais écrit tous les jours ; tous les jours je vous aurais demandé pourquoi je n’avais pas de lettre. J’aurais mieux fait. Je ne l’ai pas fait à cause de vous, de vous seule. J’ai craint quelque odieuse malice. J’ai voulu y voir clair.
Enfin tout est passé n’est-ce pas, bien passé? Vous ne craignez plus, vous ne souffrez pas, vous n’êtes pas malade ? Que la parole est pitoyable, & que tous mes efforts seraient vains pour vous envoyer sur ce papier, ce que j’ai en ce moment dans le cœur ? Voyez le, devinez-le. Vous le pouvez, j’en suis sûr ; je me confie à vous. C’est ma consolation dirai-je ma joie, mon inexprimable joie de savoir, d’avoir vu, de voir tout ce qu’il y a dans votre cœur de tendresse et de puissance. Ceci encore, cette joie vous me la pardonnez également. Dites-le moi, que j’aie le plaisir de l’entendre, quoique je n’en aie pas besoin. Demain enfin, après demain au plus tard j’aurai une lettre rassurée, et qui me rassurera j’espère. Mais que d’heures encore d’ici à demain ! Aujourd’hui, il me serait impossible de vous parler d’autre chose.
Adieu adieu. Mais, je vous en conjure, soignez-vous ; ne vous livrez pas à des émotions comme celle que ce petit chien a causée. L’absence est déjà assez lourde ; au moins faut-il être tranquille sur votre santé. Je ne serais pas tranquille quand vous vous porteriez toujours le mieux du monde. Comment l’être un moment si des secousses continuelles vous assiègent ? Éloignez-les ; abrégez-les. Vous pouvez avoir de l’empire sur vous? Vous m’avez dit que vous réprimeriez tout ce qui pourrait m’affliger. Pensez à moi. Je suis sûr que vous le ferez comme vous me l’avez dit. G.
6. Val-Richer, Jeudi 13 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement vous êtes malade, Princesse, assez malade pour ne pouvoir écrire quatre lignes. Sans cela, je ne comprends pas, je ne puis comprendre comment je n’ai point de lettres. Quelle ressource pour me rassurer ! J’en ai une autre moins triste quoique l’effet en soit fort triste. Il y a quelque irrégularité dans le service de la poste au fond de mes bois. Mes journaux ne m’arrivent pas encore exactement. Deux lettres ne me sont revenues qu’après avoir été me chercher à Caen. Peut-être y en a-t-il une de vous qui court ainsi après moi. Je viens de régler avec le Directeur des postes de l’arrondissement le service du Val-Richer, voici, quand vous voudrez m’écrire directement, ma vraie et sure adresse. Au Val-Richer, Commune de St Ouen le Paing. par Lisieux. Calvados. Adressées ainsi mes lettres m’arrivent le lendemain de leur départ de Paris. Quand en aurai-je une de vous ?
Je ne veux pas vous dire tout ce qui me vient à l’esprit, quel espace parcourt mon imagination, quels ennemis, quel fantôme elle y rencontre. Je n’ai pas en général l’imagination inquiète et noire : mais quand une fois elle prend ce tour là, elle échappe tout à fait à l’empire de ma raison, tout devient possible, probable, réel. Il faut se taire alors, se taire absolument, ne pas se parler à soi-même. Je vous quitte donc Madame. Pourquoi êtes-vous devenue un si grand intérêt dans ma vie ?
Vendredi 14. Voilà une lettre, une longue, un excellente lettre. Et c’est bien celle que j’attendais. Il n’y en a point de perdue. Celle-ci est allée en effet me chercher à Caen, le service encore mal réglé de la poste a causé le retard. Un nom de village pour un autre, une négligence de commis, cinq minutes de sommeil d’un courrier qui passe, sans s’en apercevoir, devant une route de traverse, qu’il faut peu de chose pour faire beaucoup souffrir ! Enfin, la voilà. Et j’espère que les autres viendront plus régulièrement.
Vous n’êtes point malade. On vous trouve bonne mine. Ne permettez pas à tout ce monde de vous accabler de fatigue ; ils n’ont pas de quoi vous en dédommager. Ils vous aiment pourtant et ils ont raison ; et vous avez bien raison aussi d’accueillir toutes les amitiés, quels que soient leur nom et leur drapeau.
Entre nous, j’ai plus d’une fois regretter de ne pouvoir être avec mes adversaires politiques, aussi cordial aussi, bienveillant que je m’y serais senti enclin. J’en sais plus d’un en qui, politique à part, j’aurais trouvé peut-être un ami du moins une relation facile et douce. Mais le soin de la dignité personnelle, les devoirs envers la cause, les exigences et les méfiances de parti, tout cela jette entre les hommes, une froideur, une hostilité souvent sans motifs individuel et intimes. Il faut s’y résigner ; c’est la loi de cette guerre, car il y a là une guerre.
Mais vous, Madame, profitez, profitez toujours et sans hésiter de votre privilège de femme; soyez juste envers tous, bonne pour tous, amicale pour tous ceux qui le mériteront de vous. C’est quelque chose de si beau et de si rare que l’équité et l’amitié ! Je suis charmé que vous en jouissiez, et plus charmé encore que vous soyez si capable d’en jouir, que vous ayez l’esprit si libre et le cœur si affectueux. Je n’y mets qu’une condition Vous la devinez et elle est bien remplie, n’est-ce pas ? Pendant que vous retrouvez à Londres, vos douleurs, pendant que vous n’y pouvez faire un pas, regarder à rien sans avoir le cœur bouleversé au souvenir de vos fils, moi j’achève ici, dans ma maison, les arrangements que le mien y avait commencés. Je fais descendre dans ma chambre son fusil de chasse, je me promène suivi de son chien.
C’est un lien puissant entre nous, Madame, que cette triste ressemblance de nos destinées, et cette parfaite intelligence que nous avons l’un l’autre de nos peines. Il me semble que j’ai connu vos enfants ; je leur prête les traits, les qualités qui me charmaient dans le mien ; je les unis à lui dans mes regrets. Ne vous défendez pas, Madame, du sentiment qui vient émousser ce que les vôtres ont de plus poignant ; laissez-vous guérir autant que se peut guérir une vraie blessure. A mesure que nous avançons dans la vie, c’est la condition de notre âme d’éprouver et d’associer dans je ne sais qu’elle mystérieuse unité, les émotions les plus contraires, de souffrir et de jouir, de regretter, et de désirer à la fois, et avec la même vérité, la même énergie. Acceptons ces secrets de notre nature. Si vous étiez là, si nous causions en liberté, vous me parleriez de vos fils, je vous parlerais du mien. Nous nous raconterions toute leur vie, toute la nôtre, et un sentiment d’une douceur infinie et souveraine se répandrait sur notre entretien. Que mes lettres vous en apportent l’ombre ; les vôtres ont pour moi tant de charme !
Samedi 15, 9 h 1/2 du matin.
Que je dis vrai dans ces derniers mots, & bien plus vrai que je ne dis ! Voilà, le N° 5 qu’on m’apporte. Dearest Princess, je crains qu’à votre tour vous n’éprouviez quelque retard pour mes lettres, pour celle-ci du moins. Je m’en désole. Pardonnez le moi. J’aurais dû la faire partir avant-hier ; mais j’étais si impatienté de ne voir rien arriver que j’ai attendu. Je vous aurais écrit en trop mauvaise disposition. Aujourd’hui je ferais peut-être mieux d’attendre aussi. Ma disposition est trop bonne.
Tout à l’heure Madame j’irai me promener dans les bois qui m’entourent. Ils sont bien verts, bien frais, bien sombres, quoiqu’un beau soleil brille au dessus et les enveloppe de sa lumière. Ce lieu-ci est très solitaire, très sauvage. Autrefois quelques moines y venaient orner. Aujourd’hui quelques bûcherons y travaillent. J’y serai bien seul. Je n’y entendrai rien. Je n’y verrai personne. Je relirai vos lettres. Je serai charmé. Et pourtant, que le fond du jardin de la Duchesse de Sutherland me fera envie ! Et ma pensée tantôt m’y transportera, tantôt vous amènera vous-même dans les bois du Val-Richer. Et je me laisserai bercer à ces doux rêves jusqu’à ce que j’en sente le mensonge. Je rentrerai alors dans ma maison.
Je suis très préoccupé de ce que vous me dites des projets de M. de Lieven. Vous ne pouvez songer, ce me semble, à aller le rejoindre à Carlsbad. Vous voilà à peine en Angleterre. La saison des eaux serait passée avant que vous arrivassiez, en Bohème. Après les eaux, s’il y va M. de Lieven retournera sans doute auprès du grand duc. Non, Madame, il ne faut pas chercher le bonheur à tout prix ; mais il faut penser sans relâche aux moyens de lever les obstacles. Vous ne pouvez ni vous fier à Pétersbourg, ni errer sans cesse en Europe. Que ces deux points là soient bien arrêtés ; ils feront le reste.
Midi. C’est trop de bien en un jour. Je tremble pour les jours qui vont suivre. Je reçois à l’instant votre N°6. Mon pressentiment ne me trompait pas tout à fait quand je vous craignais malade. Reposez-vous, beaucoup, beaucoup. Je suis charmé que vous n’alliez pas à Howick.
Que je vous remercie d’avoir pensé à me rassurer sur votre mauvaise écriture ! Elle m’eût inquiété en effet. Je vais attendre bien impatiemment vos prochaines lettres. Je les crains pourtant un peu. Vous aurez attendu celle-ci. Vous vous serez, comme moi naguère, impatientée, tourmentée. Vous voyez que j’ai aussi ma fatuité. C’est un lieu commun que je dis là, Madame. Non, je n’ai avec vous, point de fatuité. Ce mot ne convient ni à vous, ni à moi. Mais j’ai confiance, je crois. Et vous aussi, n’est-ce pas ? Nous avons donc bien le droit de nous parler comme gens qui croient, c’est-à-dire tout simplement et en disant les choses comme elles sont, non pas comme on est convenu de les dire quand elles ne sont pas. Il faut pourtant que je finisse si je veux que ma lettre parte !
Il me semble que j’ai à peine commencé que je ne vous ai parlé de rien. Je vais au plus pressé à ce qui me touche vraiment ; et je laisse en arrière (comme je laissais le cahier rouge) la politique anglaise, la politique française, votre jeune Reine, la dissolution de son parlement, celle du nôtre, que sais-je ? Tout cela cependant m’intéresse beaucoup, et je lis très curieusement les détails que vous me donnez, et j’ai sur tout cela, des milliers de choses à vous dire. Et ma prochaine lettre, si dans celle-là encore, j’en trouve le temps. Adieu Madame.
Remerciez, je vous prie, la petite Princesse de son bon souvenir. J’y tiens beaucoup et j’en suis très touché. C’est à vous de lui demander pardon, pour moi d’un langage si familier. Je copie. Je suis bien heureux d’apprendre que Madame la Duchesse de Sutherland veut bien se rappeler mon nom. C’est du luxe en vérité d’être si bonne quand on est si belle. Mais le luxe qui vient de Dieu est charmant ; et il a comblé votre noble hôtesse de tant de dons qu’en effet elle nous doit peut-être à nous autres pauvres mortels de nous traiter avec un peu de bonté. Quelque place qu’elle me donnât à sa table, je serais ravi de m’y asseoir. G.
Mots-clés : Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Deuil, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait (Dorothée), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Séjour à Londres (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
4. [Paris], Vendredi 7 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous voilà à Londres. Et vous avez été, en y arrivant bien émue, mais pas bouleversée pas malade. J’en tremblais. Et il est si triste de trembler de loin ! Je sais ce que c’est de trembler de près, de voir souffrir à côté de soi, d’assister minute par minute aux douleurs du corps et de l’âme. C’est affreux. Et pourtant il reste toujours au fond du cœur je ne sais qu’elle foi dans la puissance de l’affection qui vous persuade que, même sans y rien faire, vous soulagez, en les ressentant, en les voyant, les souffrances d’un être chéri. Et il y a du vrai dans cette foi, car enfin, un mot, un regard. une chaise rapprochée, une main pressée, C’est quelque chose, c’est beaucoup. Mais de loin, les plus douces paroles, les regards, les plus tendres, les plus ardents élans du cœur se perdent dans ce espace immense, vide, froid, qui vous sépare. J’ai toujours trouvé qu’on prenait trop aisément son parti de la séparation, qu’on n’en prévoyait jamais tout le mal. Quand on le prévoyait, quand on le sent tout entier, on a bien plus de mérite qu’on ne croit à y consentir, car on fait bien plus de sacrifices qu’il ne paraît. Le pauvre Brutus se trompait beaucoup s’il est vrai qu’il ait dit en mourant : " Ô vertu, tu n’es qu’un vain nom ! " Il faut que la vertu soit au contraire quelque chose de bien réel, car elle impose, et on accepte, pour lui obéir, de bien lourds fardeaux.
J’aime John Bull de vous avoir si bien reçue. Mais une autre fois, ne prenez personne pour votre fils. Comme à vous, les cottages de votre route me paraissent charmants, et j’y vois tout ce que vous avez pu y voir. Cependant. croyez-moi quelque heureuse que vous y fussiez, votre pensée votre caractère, toute votre âme se trouveraient bien à l’étroit dans un cottage. Il faut que le chêne s’étende, que le palmier s’élance, que la rose s’épanouisse. Nul n’est bien que dans un habit à sa taille ; et notre taille, Madame ce n’est ni vous, ni moi qui la réglons ; nous n’y pouvons pas plus retrancher qu’ajouter une coudée. Acceptons donc, quelque lourd qu’il puisse être quelques fois. l’habit qui nous va. Mais sous tous les habits, dans toutes les situations, les sentiments simples naturels, les sentiments primitifs et puissants qui sont le fond de l’âme humaine doivent trouver leur place et garder leur empire. Je ne sais ce qui a pu arriver à d’autres ; pour moi, je n’ai jamais éprouvé que les grands désirs, les grands travaux de la vie publique étouffassent, altérassent le moins du monde en moi, le besoin d’affection bien reçue, passionnée de sympathie intime, les joies du cœur et de la famille, tout ce qui remplit et anime la vie privée des hommes. Plus au contraire mon esprit s’est élevé et ma destinée s’est étendue, plus ces sentiments se sont développés en moi: plus ils me sont devenus chers ; plus même ils ont gagné, je crois en énergie, en fécondité en délicatesse! Il me semble qu’ils ont toujours participé au progrès général de mon être, et qu’en montant un échelon de plus, je n’ai jamais laissé en arrière aucune partie de moi-même. Il est vrai aussi que je suis devenu de plus en plus difficile pour la satisfaction intérieure de ces sentiments si doux de plus en plus exigeant quant aux mérites, aux perfections de leur objet. En ceci comme ailleurs, mon ambition a toujours été croissante, et je n’ai jamais accepté ni mécompte ni décadence. Mais en ceci surtout, ma plus haute ambition est satisfaite, car il a plu à Dieu de placer sur ma route des créatures dont la rencontre est de sa part, un bienfait infiniment supérieur à tous ses autres dons.
Samedi 8. Je n’ai pas eu de lettre hier. Vous l’avez peut-être adressée au Val Richer, m’y supposant déjà. Elle m’y attendra ; mais en attendant elle me manque beaucoup. J’espère que les miennes vous arrivent exactement Je ne sais que vous dire de ma course à Châtenay. J’ai été là dans l’état intérieur le plus mêlé, le plus combattu, tantôt charmé d’y être tantôt m’y trouvant plus seul que partout ailleurs. "Cette fois vous venez pour moi.» m’a dit Mad. de Boigne. Elle m’a parlé de vous, très bien, selon le monde. Le monde vous trouve très aimable Madame mais il vous craint un peu. Il lui semble que vous le regardez d’en haut, vous mettant plus à l’aise avec lui que vous ne lui permettez de l’être avec vous. Il soupçonne qu’au fond vous êtes un peu autre que vous ne lui paraissez. N’y ayez point de regret. La familiarité du monde n’est pas bonne ; il faut toujours se montrer à lui un peu dans le lointain et lui rester un peu inconnu.
Les bruits de dissolution prennent ici depuis deux jours, assez de consistance. Je suis allé avant. hier soir à Neuilly prendre congé du Roi et de la Reine. Le Roi, n’y était pas. Je n’ai donc point eu de conversation sur laquelle je puisse former quelque conjecture. En tout cas, les élections n’auraient probablement lieu qu’au mois d’Octobre. L’indisposition de M. le Duc d’Orléans n’était rien du tout, un pur accès de fièvre éphémère. Il passe demain une revue de la garnison de Paris. Les propos qui couraient sur son désir de commander lui-même, l’expédition de Constantine étant tout à fait tombée. Adieu., Madame. Je vais recommencer à trier dans ma bibliothèque les livres que je veux envoyer à la campagne. C’est un travail presque mécanique qui me convient à merveille. Mon âme pendant ce temps pense à qui elle veut. va où il lui plaît. Adieu. G.
414. Douvres, Lundi 7 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Lundi 7 Septembre 1840
J’arrive, tous les bateaux de Calais et de Boulogne sont partis. Je passerai donc la journée ici. Je n’ai pas été bien cette nuit, mais au total cependant j’ai du repos et je sens que mes nerfs y gagnent. à midi vos jambes se seront senties incommodées de ne pas prendre le chemin de Stafford house. à midi je vous fuyais à bride abattue. Que c’est absurde, que c’est horrible ! Et nous ne sommes qu’au début de cette abominable carrière.
4 heures
J’ai mangé, je me suis reposée. J’ai donné des ordres pour demain, c’est à 6 h. du matin que je m’embarque pour Calais si le temps. n’est tout-à-fait beau, pour Boulogne s’il y a sûreté d’un bon passage. Je manquerai donc votre lettre, car la distribution ne se fait qu’à 8 heures. Et la marée n’attend pas. Je suis triste de cela, je ne verrai cette lettre qu’à Paris ! Ma fleur était morte hier soir. La vôtre n’aura pas duré plus longtemps. J’avais mal choisi. Je vous envoie ce qui convient mieux, ce qui me ressemble. Envoyez-moi par la première occasion la feuille correspondante une feuille de chêne, allez la prendre vous même. Le lierre, et le chêne c’est bien. C’est venu sur terre anglaise dans cette Angleterre que nous aimerons toujours, n’est-a pas ? Traitez bien ce lierre il vous porte un adieu bien tendre.
6 heures
J’ai écrit au duc de Wellington. Il était sorti pour la chasse. A son retour il m’a écrit, il était très fatigué, il ne peut pas venir et il se fâche que je ne lui aie pas fait savoir mon arrivée plus tôt. Voici qu’il m’envoie lord Burghersh qui me dérange. 8 heures bonsoir, bonne nuit, adieu. Adieu toujours, toute ma vie.
411. Wrest Park, Jeudi 13 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai quitté Londres hier sans lettre je n’ai eu de vous qu’un mot de Calais, et un mot d’Eu de Samedi matin. Depuis rien du tout. Cela m’inquiète et m’afflige. Je suis venue ici malade. On me drogue ici ; je suis vraiment, souffrante. Des vertiges abominables. Je m’ennuie parfaitement : c’est bien long d’y rester encore aujourd’hui et demain !
Si j’avais une lettre je partirais peut être demain. Dans tous les cas je serai à Stafford house.
Samedi 3 heures. Je vous préviens que j’ai accepté dîner à Holland house dimanche. Lady Palmerston est ici ; elle va à Windsor demain, son mari y est et y reste jusqu’à Mercredi. J’ai eu à me plaindre de la cour et de mes amis ministériels ces derniers jours. J’ai eu une lettre de Mad. de Flahaut. Une lettre de mon frère. La première ne n’envoie pas de copie. L’autre ne me répond pas encore. Il n’avait par reçu Adieu, adieu. Je suis très mécontente de n’avoir pas eu de lettres. Adieu.
409. Londres [Stafford house], Vendredi 7 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
midi
J’ai reçu plusieurs lettres ce matin, d’abord une du duc de Poix que je vous envoie. Une de la petite Princesse au moment de quitter le Havre pour retourner en Allemagne. une de mon banquier de Pétersbourg m’envoyant un compte de pensions, de dettes, & & pour lesquelles je suis taxée au quart, tandis que mes droits de succession l’ont été à la 7ème partie : si c’est la loi je n’ai rien à dire, mais je m’informerai ; si c’est contre la loi, je ne vois pas pourquoi je dois subir cette disposition arbitraire de mon fils aîné. L’affaire de la vaisselle n’est pas terminée et ne le sera que dans 6 mois. Je fais venir Benckausen pour lui parler.
Vous êtes en France. Qu’aurez-vous trouvé là ? Les récits du matin dans les journaux ne sont pas assez clairs. Je ne vois pas assez que cette sotte affaire soit terminée. Où est Louis Bonaparte ? Serait-il possible que lord Palmerston lui eût fait visite ces jours-ci comme le disaient les journaux ? Si vous prenez ce fou, j’espère bien que vous saurez mieux faire que la première fois. N’avez-vous donc pas de conseil de guerre pour un cas pareil ? Et justice immédiate. Cela va bien ajouter encore au clabaudage entre les deux pays ! Je dînerai aujourd’hui chez Lady Clauricarde. Adieu. Adieu, mille fois. J’attendrai vos lettres avec une extrême impatience. Adieu.
409. Douvres, Dimanche 21 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
6 heures du soir
Je débarque dans ce moment après une traversée assez bonne. Je suis restée quatre heures comme une morte ; mais me voici, me voici et demain à Londres ! J’espère que j’y serai entre quatre et cinq heures. Je demeure à Dover street 36. C’est ici que je l’apprends. La seule rue de Londres que je fuis à cause de mes souvenirs, c’est là où l’on m’arrête un logement ! Vous ne savez pas ce que cela me fait éprouver. Je changerai mais il faut commcer par y descendre parce qu’il me faut bien un gîte. Ah ! L’Angleterre est triste pour moi, par ce côté-la ! Mais je veux penser à ce qui réjuit mon cœur et non à ce qui l’attriste. Envoyez à 4 heures, un de vos gens savoir si je suis arrivée ; car je n’aurai personne à vous envoyer. Je ne sais cce qu’est cette maison, et moi Je n’ai qu’un courrier. Adieu. Adieu. Il faut que je mange et que je me repose. Adieu pour la dernière fois de cette pauvre façon. Adieu !
397. Londres, Mercredi 17 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai écrit hier à Douvres au Ship Inn, pour vous dire mon déplaisir de samedi. Je présume d’après le 405 qui m’arrive à l’instant que vous ne partez de Paris qu’aujourd’hui mercredi, car vous ne mettrez pas plus de deux jours pour aller à Boulogne. Vous trouverez donc à Douvres que je suis obligé d’aller samedi déjeuner à Southampton, par le rail-road, pour célébrer la conclusion du rail-road de Paris à Rouen ; affaire que j’ai traitée et qui m’a mis très bien ici avec ce monde là. Ils font un grand banque t; le Duc de Sussex, Lord Palmerston & y vont. Je ne pouvais refuser. C’est l’union de Londres et de Paris. Je reviendrai de Southampton entre 6 et 7 heures. J’irai dîner chez le Sir John Hobhouse. Je compte bien trouver un moment pour vous voir, soit entre mon retour, et le dîner, soit après le dîner. Mais le samedi, ainsi employé n’en est pas, moins un immense ennui. Si donc vous arrivez à Londres le Vendredi, je vous verrai en arrivant de Windsor, et tout le soir. Si vous n’arrivez que le Samedi, je ne vous verrai que tard ce jour là et bien peu. Faites pour le mieux, sans vous harasser de fatigue.
En tout cas, faites-moi dire tout de suite à Hertford House que vous êtes arrivée et où vous êtes. Car je n’en sais rien. Je regarde sans cesse au temps. Il y a eu du vent cette nuit ; il est tombé ce matin. Le saleil est beau.
Adieu. Adieu. Moi aussi, je serai bien content. J’ai souri en lisant: " Que Windsor va vous plaire ! " Croyez-vous que la Reine Victoria sera aussi bonne pour moi que l’était pour vous George IV ? Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Séjour à Londres (Dorothée)
396. Londres, Mardi 16 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Vous êtes partie ce matin. Vous marchez en ce moment vers moi. Vous arriverez à Douvres peu après cette lettre. C’est ridicule d’y envoyer un morceau de papier au lieu d’y aller moi-même. Je désire bien vivement que vous arriviez à Londres vendredi, pas tard. Voici pourquoi. Je suis obligé d’aller samedi, par le railroad, déjeuner à Southampton, à un grand banquet donné pour célébrer le chemin de fer de Paris à Rouen. Dire à quel point ceci me déplait c’est impossible. J’avais tant pensé à ce samedi ! Mais il n’y a pas eu moyen de s’y refuser. J’ai négocié ce chemin de fer. Je l’ai fait réussir. C’est la jonction de Londres et de Paris. Le Duc de Sussex y va. Lord Palmerston y va. On tient essentiellement à m’avoir. Je reviendrai le jour même dîner à Londres, chez Sir John Hobhouse et je trouverai bien un moment pour vous voir, entre mon retour et le dîner, ou après le dîner. Mais samedi n’en sera par moins un pauvre jour. Qu’au moins je vous voie bien le vendredi. Je reviendrai de Windsor après le déjeuner. Et puis Dimanche commencera une serie de jours...
Je ne veux pas les qualifier. N’arrivez par trop fatiguée. Le temps est beau. J’épie le soleil. J’épie le vent. Je les interroge. Jusqu’ici, je suis content. Où arrivez-vous ? Vous devriez bien me le dire demain. Car enfin, vous le savez. Vous m’écrirez de Boulogne ou de Douvres.
Adieu. Je ne peux pas, je ne veux pas vous parler d’autre chose, Adieu J’adresse ceci au Ship Inn. Il me semble que vous ne pouvez manquer de l’y recevoir.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Séjour à Londres (Dorothée)
406. Boulogne, Jeudi 18 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens d’arriver. Le vent est si fort qui s’il continue à souffler demain avec cette violence. Je n’aurai pas le courage de passer. Cette lettre passerait donc au lieu de moi. Je veux que vous me sachiez partie et près d’arriver, et heureuse de me sentir si près ! Je suis fatiguée, mon dernier jour à Paris a été abominable. Prise par tout le monde, et par mille choses.
Thiers est venu et a causé beaucoup. Rien de nouveau, Je vous conterai. On entre, et on me remet dans ce moment votre lettre de hier. Je vois que Samedi sera mauvais et comme je ne pourrais dans aucun cas arriver à Londres demain il faudra bien attendre dimanche. Le bateau ne part demain qu’à midi, je ne serai à Douvres qu’à 5 heures. J’irai donc coucher en route. Voilà bien du retard.
Dès mon arrivée à Londres j’enverrai chez vous. Je vous verrai peut-être entre le rail road et le dîner voilà tout ce que je puis esperer. Je suis très faliguée mon petit compagnon de voyage est très utile, lui et mon courrier m’enlève tout souci mais ils n’empêchent pas que je trouve l’hôtel Talleyrand plus commode que la voiture et les auberges.
Vendredi 7 heures du matin.
Je n’ai pas décidé encore si je pars ou si j’attends demain. Le vent souffle, on dit le duc de Wellington (paquebot) mauvais. Tout cela avec votre promenade à Southampton fait que je ne vais pas risquer. Je verrai. Je ne suis pas décidée, encore. J’ai dormi presque sans réveil, ce qui est rare. En m’éveillant j’ai pensé avec joie que j’étais bien près. Adieu, adieu. Adieu.
407. Boulogne, Vendredi 19 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma lettre ce matin n’est point partie par l’occasion régulière. J’ai donc quelque crainte qu’elle ne vous parvienne pas, ce qui fait que je recommence à vous conter mes doléances. La mer est affreuse je n’ai pas eu le courage de m’embarquer. J’attends du calme demain. S’il ne venait pas il faudrait le prendre, mais j’aime presque cela mieux que le mal de mer. Vos n’avez pas d’idée de l’ennui de ceci. Il fait très froid, très gris. Il pleut à verse ; si je n’avais mon compagnon de voyage deux heures dans la journée ce serait horrible, je lis les journaux de Paris et de Londres, je vous cherche. Ne devrais-je pas vous chercher à Boulogne aussi ? Vous aviez une fois le projet d’y être ? J’attendrais plus patiemment que la tempête se calme.
Je vous écrirai aussi longtemps que durera ma quarantaine. Je regarde les girouettes et les nuages, ils me sont bien hostiles. Adieu monsieur adieu. J’avais bien espéré, ne plus vous dire. Adieu aujourd’hui je comptais vous voir ce soir ! Quel guignon ! Un temps superbe jusqu’au jour où j’ai quitté Paris, et depuis toujours tempête. Adieu. Adieu.
408. Boulogne, Samedi 20 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
La mer est toujours abominable quoique le veut commence à diminuer un peu, la traversée serait encore horrible, il faut attendre à demain. Le ciel n’est plus si chargé, le bateau de demain passe pour avoir le mouvement plus doux, c’est donc demain que je passerai j’espère.
Je veux vous dire ce petit mot par dessus mes deux lettres d’hier. Quel ennui ! Il faut que ma terreur du mal de mer soit bien forte pour me faire me résigner à Boulogne pendant 4 jours. Je marche, je lis, je fais des patiences. Mon compaqnon de voyage va me chercher des nouvelles. Nous mangeons lentement, enfin nous traînons une pitoyable journée. J’ai dejà pris Boulogne en horreur, Boulogne que nous trouvions si charmant en imagination. Il me semble que vous recevrez cette lettre et celle d’hier au soir en même temps demain matin. J’aurais tant aimé passer le dimanche à Londres. C’est un jour tranquille, je l’aurais bien employé. Adieu. Mon impatience est bien grande. Je n’ai jamais été contrariée par les éléments. Ils se mêlent de cela aussi. Mais cela revient à ce que Louis quatorze disait au Maréchal de Villeroi. Adieu. Adieu, Monsieur, adieu.
404. Paris, Dimanche le 14 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’écris de bonne heure et j’enverrai ma lettre de bonne heure à la poste ! Car voici une grande revue et tout Paris sur pied, car on attend l’Empereur Nicolas ! Imaginez que les Parisiens le croient. J’ai vu hier Montrond, Molé les Appony et Granville le soir. On parle beaucoup de l’Angleterre. Montrond et Molé enchantés que ce soient des sociétés secrètes. Ce sera d’un bon effet ici. Molé dit c’est notre belle révolution qui porte ses fruits. " Je suppose que vous ne prendriez pas la chose ainsi. En attendant c’est vraiment un spectacle fort alarmant.
J’ai vu mon compagnon de voyage; je l’ai bien examiné. Il est tout juste de taille à ne pas encombrer ma voiture. Il a l’air doux et tranquille, et gai, et il est comblé d’être mené aussi commodément.
J’ai eu une longue lettre de William Russell avec des détails intéressants. Nous sommes détestés à Berlin, on a tout fait pour empêcher l’empereur d’arriver. Le Roi de Hanôvre venait aussi. Ces deux ensemble paraissent de mauvais conseiller pour un nouveau roi. On ne sait comment il marchera, on ne connait pas ses idées politiques. On dit maintenant ici que la Redorte pourrait aller à Berlin, ce qui est sûr c’est que sa nomination n’est pas encore au Moniteur.
Je suis bien fatiguée d’hier. Des paquets, des arrangements, des visites, et au matin on va m’envahir pour voir de chez moi la revue. Mon ambassadeur est bien grognon de mon départ. Mad. de Flahaut m’écrit pour s’annoncer pour le 25. Elle a toujours quelque petite tirade contre les doctrinaires. Adieu. Adieu. Encore demain Adieu, et puis, quel plaisir !
On fait à M. de Lamericière des réceptions superbes au château. Molé critique cela et critique tout. Il est de l’opposition la plus violente.
395. Londres, Samedi 13 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici la dernière. Dans sept jours, nous serons ensemble et vous n’aurez plus de tracas. Il est vrai que vous n’y êtes pas propre du tout. Vous ne me dîtes pas si vous avez décidément pris votre compagnon de voyage. C’est un personnage bien mystérieux. Dois-je être inquiet aussi ? Je fais réparation à votre sagacité. Vous avez deviné juste sur Miss Troller ; si juste que l’insinuation m’a été faite, sur la place même. Je voudrais bien savoir ce qui vous inquiète. Vous me le direz, n’est-ce pas, si vous ne l’avez pas oublié, cinq minutes après m’avoir vu.
Je rabâche. Je ne comprends pas les Sutherland. Mais je trouve aussi que puisqu’ils l’ont écrit à Lady Granville, vous auriez pu, et vous pourriez peut-être encore sans atteinte à votre dignité, prier Lady Granville de leur demander, de votre part, si en effet, ils peuvent vous recevoir dans Stafford-House, en leur absence. Savez-vous qui manque dans les relations de cette sociélé-ci, dans les plus amicales ? La simplicité, la facilité, la rondeur. Tous les mouvements sont lents et raides. Les meilleures gens, les meilleurs amis ne savent pas se donner l’agrément de leur bonté et de leur amitié.
Je n’ai pas envie de vous donner des nouvelles. Il n’y en a pas, et je n’en ai pas envie. Je vous en donnerai quand vous serez ici. On ne parle que de l’attentat. Pour dire vrai, d’Oxford plus que de l’attentat. La badanderie est aristocratique aussi bien que démocratique. On est curieux des moindres détails sur ce malheureux. Est-il beau ? A-t-il de l’esprit ? De quelle couleur sont ses yeux ? C’est précisément là ce que veulent ces imaginations perverties, un théatre, un public, grandir et paraître au soleil, eux petits et obscurs. Il faudrait avoir assez de sens et de gravité pour ne pas leur donner ce qu’ils cherchent. Les personnes qui suivent l’affaire disent qu’il n’y a que deux choses sûres, c’est qu’il n’est pas fou, et qu’il n’est pas seul.
On me dit ici, sur le nouveau Roi de Prusse, exactement ce que vous m’avez écrit. Tout le monde, se promet beaucoup de lui ultras et libéraux. Tout le monde, sera déçu. ce qui me paraît clair, c’est qu’il est faiseur et n’aura pas la politique négative, et expectante de son père. Il faut que jeunesse se passe, celle des rois comme toute autre. Adieu. Adieu encore une fois. Je n’ai rien à vous dire. Je dirais trop ou trop peu. Adieu. Enfin.
405. Paris, Lundi 15 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
midi
J’ai reçu la dernière lettre qui doit me trouver à Paris, maintenant je viens vous en demander une à Boulogne. Ecrivez-moi en recevant ceci, je pourrai avoir votre lettre jeudi à Boulogne. Je passerai vendredi, et selon l’heure de mon arrivée à Douvres j’irai coucher à Londres ou je m’arrêterai à Rochester. Vous saurez cela. J’ai dîné hier chez les Appony, le soir chez Brignoles où j’ai dit adieu à tout le monde sauf deux ou trois qui veulent encore venir. On dit que la session finit cette semaine. La revue s’est très bien passée sauf quelques cris de réforme. L’affaire de Londres occupe beaucoup mais je n’ai pas le temps de vous parler de ces choses-là. Je pense à mon voyage, à ce que je vais trouver, je serai bien contente vendredi ! Si le temps est à l’orage j’ai peur de passer, car je suis faible et je n’échappe jamais au mal de mer. Regardez les nuages. Pensez à moi à Windsor. Il n’y a pas un coin de ce château et de ce parc où je ne me sois arrêté. Si vous avez l’appartement où il y a un salon en haute-lisse faisant face au long walk, c’est le mien. le canapé vert à la gauche de la cheminée dans le salon de la reine est celui où j’ai passé tant de soirées à côté de George IV et de Guillaume IV. Que Windsor va vous plaire ! Mais je ne vous envie pas Ascot, cela me faisait mourir d’ennui.
Adieu. Adieu. Je fais comme si j’étais déjà en Angleterre. J’y suis beaucoup, beaucoup, toujours. Adieu.
402. Paris, Vendredi 12 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai un grand plaisir. Enfin quelque chose me réussit. Je serai accompagnée, par M.Heneage l’un des secrétaires de l’ambassade d’Angleterre, et je dormirai tranquille. Lady Granville m’a arrangé cela. Il n’est pas ici, mais il arrive demain de Fontainebleau. La question du logement ne sera pas aussi favorable. Vraiment je serai parfaitement mal. J’ai bien plaint souvent les pauvre voyageurs que je visitais à Londres. Mais que faire ! Il faut tacher d’arranger en campagne au plutôt ; pour cela faites finir le parlement.
J’ai vu hier au soir Berryer il y avait bien deux mois qu’il n’était venu. Il a causé avec esprit mais son humeur est grogneuse. Il avait espère quelque éclat, ceci prend une mine trop solide, qui le deroute. Il me dit : " Thiers pouvait le taire plus fort, il a préféré faire la chambre plus faible. Il doute de l’entrée de Barrot dans le Cabinet ; et il ne compte plus du tout sur la dissolution. La gauche est divisée. Et les conservateurs ne sont pas gouvernés. Voilà à peu près l’essence de ce qu’il m’a dit. Montrond est venu hier soir aussi. Ils ont causé. Mon ambassadeur, les Durazzo d’autres.
J’avais chaud. J’aurais préféré le bois de Boulogne d’où je n’étais revenue qu’à 9 heures. Il y faisait charmant. Je jouis de cet air bien pur ; d’un air qu’on n’a jamais en Angleterre. Je reviens un moment à Berryer. Il est frappé du despotisme complet de Thiers et m’a cité à ce sujet des traits assez curieux. Jaubert est un des plus soumis
A propos mon ambassadeur est maintenant en bonne connaissance avec tous les Ministres. Cela est venu à la suite d’un commérage de ma part. Vous savez mon estime pour les commérages. Adieu Monsieur, je n’aurai plus de réponse à cette lettre Adieu.
2 heures
Je réponds encore à votre lettre. Je suis charmée de Windsor. Votre dîner des 15 chez Lady Lovelace en est dérangé, cela ne me déplait pas trop, elle a un trop joli nom. Je vous dis de loin des bétises. Je suis sûre de n’en point dire de près. Mon départ reste fixé au 16 à moins que Heneage ne me prie de le retarder. Ce ne serait que d’un jour il me ferait arriver le 19. Comme vous le dites. Adieu.
394. Londres, Vendredi 12 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
J’ai été hier soir à Holland. house. Ils n’y étaient pas. Le conseil du matin et l’attentat les avaient fait venir en ville. J’avais deux emplois de ma soirée Lady Tankerville qui se plaint toujours qu’elle ne me voit pas assez et un bal chez Lady Glengall. Je suis rentré chez moi ; je me suis mis dans mon lit et j’ai lu pendant deux heures une vie de Hampden, grand Anglais, et homme bien hereux car il a eu le bonheur de mourir au moment où allaient commencer pour lui les espérances déçues, les doutes de conduite et la responsabilité. Je me plaît beaucoup dans la vieille Angleterre. J’aime ce qui en reste, et grace à Dieu, il en reste beaucoup. Par mes idées, et le tour de mon esprit, je suis du temps moderne ; par mon caractère et mes goûts, je suis des anciens temps.
J’assiste déjà aux embarras de la transition de règne, en Prusse. On a eu à célébrer à Berlin, le 100e anniversaise de l’Académie royale. Il fallait parler de Frédérie II, du Roi mourant et plaire au Roi qui s’approche. On a chargé M. de Humbolt de cet embarras. Il s’en est tiré, en homme d’esprit, et m’a envoyé son petit discours, car les hommes d’esprit pensent toujours un peu les uns aux autres.
A propos des hommes d’esprit, vous ai-je jamais dit comment m’avait abordé à St Cloud, en se fairant présenter à moi. Reschid. Pacha, qui essaye aujourd’hui de faire de la Turquie quelque chose qui ne soit pas turc? « Moi ausi, dans mon pays, je passe pour un homme d’esprit.» Il vient, dit-on, d’en donner une preuve en se débarrassant de son rival Khosrer-Pacha qu’il a fait remplacer par Ahmed Féthi Pacha, homme insignifiant, sa créature, et ancien ambassadeur à Paris. On dit que cela vous déplaira.
Je rentre à Berlin. Il me paraît que Humboldt, Bülow et toute cette couleur là sont au mieux avec le Prince Royal. Bresson aussi est bien avec lui depuis quelque tour. Bresson est prévoyant et habile. Il n’y a pas de doute sur la retraite de Wittgenstein. On le pressera de rester, sachant qu’il ne restera pas.
2 heures
Je vous ai quittée pour trouver dans le Times, la mort du Rois de Prusse et je n’ai pu vous revenir jusqu’à présent. Lord Palmerston n’a pas pu me rejoindre hier au Foreign office. Il a été retenu à l’home office par le Conseil privé qui interrogeait les témoins sur l’attentat. Il m’a remis à aujourd’hui, et j’attends un mot de lui pour l’aller chercher. Les deux Chambres présentent leur adresse ce matin. Je suppose que la Reine recevra le corps diplomatique demain si le Cabinet trouve bon qu’elle le reçoive. Elle l’a reçu, et ses félicitations en corps, lors de son mariage. Ils sont tous fort contens de la demarche faite, qui acquitte pleinement les convenances. Je les et tous vus ce matin. Dedel est mon meilleur conseiller. Quoique rien n’ait encore transpiré on croit en général que l’assassin est chartiste. Plusieurs propos, recueillis, maintenant indiquent dans ce parti-là, un projet pareil. Ce jeune homme s’exerçait depuis trois semaines à tirer au pistolet.
Le Cabinet a eu encore hier soir un échec aux Communes, toujours sur la même question. Il y a, si je ne me trompe, dans la Chambre un parti pris, pris à une bien petite majorité, mais pris, de mettre en Irlande un temps d’arrêt à l’influence d’Oconnell. Sur les 105 membres Irlandais, il est déjà, dit-on, maître de plus de 60. Avec le systême étectoral actuel, il deviendrait bientôt maître des 40 autres. Et alors on verrait tout autre chose que l’Angleterre obligée de bien gouverner l’Irlande ; on verrait l’Irlande gouverner l’Angleterre. Voilà le gros fait qui frappe, ce me semble, les esprits et décide bien des modérés même.
Vous avez raison d’avoir beaucoup de regret et un peu de remords Windsor est venu bien à propos pour vous. Voici une vérité. Vous êtes si sensible aux petites contrariètés qu’elles peuvent balancer, pour quelque temps, les plus grandes affections. La petite vie, en vous, fait tort à la grande. Cela vient de deux causes. Vous avez été longtemps l’enfant gâté du sort faisant toujours ce qui vous plaisait. Vos déplaisirs sont démesurés, et démesurement puissants sur vous. De plus, il n’y pas en vous une force proportionnée à l’élévation, et à la vivacité de votre âme, vous êtes comme des beaux peupliers, si hauts et si minces, que le moindre vent balance, et fait plier. Vous pliez trop et trop sous les petits fardeaux, comme sous les grands. Je le trouve souvent. Je m’en impatiente quelquefois. Et puis je finis toujours pas me dire que vous connaissant comme je vous connais et vous aimant comme je vous aime, c’est à moi de vous aider à porter tous les fardeaux, petits ou grands. Puisque j’ai plus de force que vous et plus d’indifférence aux choses vraiment indifférentes, il faut bien que vous en profitiez.
Adieu. Je vous écrirai encore demain et je vous verrai vendredi, d’aujourd’hui en huit. Je ne comprends pas que vous n’ayez rien reçu des Sutherland. Charles Gréville ma dit ce que je vous ai mandé, comme une chose arrêtée, convenue. Mais il faut qu’ils vous l’écrivent eux-mênes. Adieu. Adieu.
Je corrige une phrase à ma lettre. Ce que j’avais mis ne rendait pas ma pensée. On dit qu’on a trouvé dans les poches de cet Edward Oxford, un papier qui ferait allusion à quelque relation avec Hanovre. Cela n’est pas croyable.
401. Paris, Jeudi le 11 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Simon est charmant, il vient toujours de bonne heure. C’est un si doux réveil ! La mort du Roi de Prusse fait beaucoup de sensation. Lady Granville a été hier soir à Neuilly, elle dit qu’on est accablé. On dit : " C’était le seul souverain benveillant pour nous. " Et cela est vrai, j’ai éte chez elle en revenant de Boulogne où j’ai fait ma visite de députion. Il y avait tout le dîner de l’autre jour moins Thiers. (Rothschild est furieux contre Thiers pour cette affaire des juifs de Damas.) Les ambassadeurs en masse. A propos M. Molé et moi nous les trouvons bien bêtes tous. Vous verrez que le nouveau règne en Prusse sera en effet bien du nouveau et cela seul est un mal, car tout était bien sous me vieux roi. Pauvre esprit mais droit et juste. Celui-ci beaucoup d’esprit, l’esprit charmant, mais sans règle.
Je suis sûre que les Berry ont envie de vous faire épouser Miss Trotter, mais cela ne m’enquiète pas du tout. J’irai regarder ce qui m’inquiète, ou plutôt je n’y penserai pas du tout, n’est-ce pas ? Comment faire pour arriver sans partir ? J’ai horreur d’un départ, et quand cela est accompagné de mille tracas et désagréments qui sont pour moi seule je suis sûre, il y a de quoi se fâcher beaucoup contre... Voyons ? Contre celui-qui me fait partir, croyez-vous ? La Stafford house me fâche. Il est très vrai qu’ils ont écrit il y a trois semaines à Lady Granville qu’aussi tôt partis ils mettaient Stafford house à Westhill, leur villa à ma disposition. Mais il fallait me le dire à moi, ce qu’ils n’ont pas fait, et ce qui fait que cela ne veut rien dire du tout. En attendant on me dit que je suis très mal campée, il y a beaucoup d’étrangers arrivés ou arrivant cela me sera odieux. Et à Londres je trouverai cela très inconvenant pour moi.
Voilà pourquoi la fin du season m’eut bien mieux convenu à la veille des campagnes. Il me semble que je suis un peu cross, c’est vrai mais c’est par moment ; le fond est de la joie bien grande, bien intime, bien profonde ; de la joie comme la vôtre tout au moins. Le temps est charmant, j’espère qu’il se soutiendra. On continue à parler beaucoup des mutations prochaines dans la diplomatie. Bresson, Pontois, Latour Maubourg, Rumigny tout cela doit faire la seconde edition des préfets. Adieu. Adieu. Il y en aura encore quatre de Paris? Adieu.
Lady Palmerston m’annonce qu’Esterhazy arrive incessamment à Londres, et lors Beauvale. aussi et qu’on va faire les affaires à Londres. Adieu.
400. Paris, Mercredi 10 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici vraiment, un gros chiffre, et qui ne prouve pas que nous soyons des gens d’esprit. Trois ans font environ 1100 jours. Plus du tiers de ce temps nous l’avons passé séparés !
J’ai vu hier soir beaucoup de monde ; les ambassadeurs, M. Molé, M. de Poix, M. de Noailles et les diplomates d’été comme il les appelle, c’est-à-dire les petites puissances. M. Molé seul d’abord car il vient de bonne heure. Il n’a pas vu le Roi depuis 6 semaines ; il ne voit pas pourquoi il y irait. Il blâme fort la conduite du Roi, il la trouve très malhabile. Il se préoccupe de l’entrée de Barrot dans le ministère il croit qu’on le nomme à la justice. M. Vivien au commerce, et M. Gouin dehors. Si l’entrée de Barrot faisait sortir les doctrinaires, ah, cela serait un gros événement. Alors le ministère ne peut pas tenir, les conservateurs se retrouvent compactes, forts. Cela lui plait beaucoup. Le maréchal Valée aura pour successeur au commandement de l’armée, le général Bugeaud. Dufaure serait nommé gouverneur civil de l’Algérie. Voilà le dire de M. Molé.
Les ambassadeurs étaient occupés de Berlin. Le Roi était à l’agonie. Ils commencent à trouver que ce sera une immense perte. Les derniers 6 mois de l’année 40 peuvent développer beaucoup de mauvais germes. Il y a longtemps qu’on se sent menacé de tous côtés, ne croyez vous pas que le moment est prochain où l’orage doit éclaté ? On dit que Don Carlos est dans la misère. Les légitimistes se cotisent pour le faire vivre.
2 heures
Votre n°390 me laisse un grand remord de ne pas partir Samedi. J’ai tort de dire remord, c’est regret qu’il faut dire, parce qu’il n’y a pas de ma faute à ce retard. Ma seule faute c’est d’avoir du malheur dans les petites choses comme dans les grandes. Je n’en connais qu’une grande qui ne soit pas entachée de cela. Elle couvre tout.
Vous m’apprenez que les Sutherland me donnent Stafford house, et vous concevez que ce n’est pas comme cela que je dois l’apprendre. Assurément ce serait un grand tracas et un bien mauvais gîte d’épargné. Mais encore une fois, ils ne me l’ont pas dit. J’écrirai à Benckhausen. La veille de mon départ pour qu’il me trouve un appartement convenable. dans l’une des auberges de Londres. Je ne partirai pas sans avoir vu Génie. Je serai à Londres jeudi le 18 au soir ou vendredi dans la journée. Cela dépendra du passage. Je vous écrirai de Douvres si je m’y arrête ; si non, comme je devancerai la poste, vous saurez mon arrivée quand je serai arrivée.
N’ayez pas peur que je perde une minute jusqu’à mon départ vous aurez tous les jours une lettre, et une de la route, pour que vous me sachiez vraiment en route. Adieu. Adieu. Je ne pense qu’au bonheur qui m’attend. Adieu.
392. Londres, Mercredi 10 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Ceci doit être ma dernière lettre. Savez vous mon sentiment ? c’est que je ne vous ai rien dit depuis le 25 Février. Je ne vous ai pas plus parlé que je ne vous ai vue. J’ai sur le cœur tout ce que j’ai pensé et senti pendant ce temps là. Quel débordement, comme vous dites ? Le beau temps dure, et par trop étouffant. J’ai été me promener hier au soir dans Regent’s Park jusqu’à 9 heures et demie. L’air était doux, frais, le ciel pur, les eaux pures aussi. Je vous attendais là. Je crois que je suis sorti le dernier. Il me paraît qu’on se bat toujeurs autour du corps de M. de Rumigny. Je suis essez curieux de l’issue. Le Roi en voudra beaucoup à Thiers.
Avez-vous vu Zéa ? Je serais curieux aussi de savoir ce qu’il pense des affaires du moment dans son pays. Il me paraît que les modérés sont dans une grande colère et méfiance, du voyage de la Reine. Ils croyent qu’elle veut les livrer aux exaltés. Je ne comprends pas On dit que Rumigny ne sera pas le seul. Dalmatie et Latour Maubourg sont ménacés. Il faut payer ses dettes. Ste Aulaire et Barrante n’ont rien à craindre. M. de Metternich, et l’Empereur Nicolas, les défendent. Du reste si la diplomatie est traitée comme l’administration, il y aura plus de bruit que d’effet. Que de préfets remués pour en changer un seul ! Je n’aime pas le humbug, même quand il sert à empêcher le mal. Mais il faut bien s’y résigner.
Une heure
Je ne vous dirai pas encore de gros mots. Je ferai plus. Je mettrai votre conscience à l’aise. Je viens de recevoir une invitation de la Reine pour Windsor, dîner le 17, passer la journée du 18, déjeuner le 19. Il n’y a pas moyen de n’y pas aller. Si vous arrivez ici le 15, nous aurons à nous la journée du 16 mais si vous n’arrivez que le 16 au soir ou le 17 matin, nous aurons à peine, le temps de nous entrevoir avant mon départ pour Windsor. Ne vous pressez donc pas de manière à vous troubler ou vous fatiguer. C’est une ennuyeuse parole que je vous dis là. Je suis très pressé. chaque jour plus pressé. Mais puisque ma course de Windsor coïncide avec votre tracas de ménage, faites ce qui vous convient. Je vous donne, pour arriver à Londres latitude jusqu’au 19. Si vous arrivez le 15 ou le 16, je serai parfaitement heureux. En tout cas, je vous écrirai encore à moins que votre lettre de demain ne me dise le contraire. Je vois que l’affaire des ambassadeurs tournera comme celle des prefets. Lord Palmerston ne revient qu’aujourd’hui de Broadlands. Il doit y avoir un conseil de Cabinet ce matin, probablement sur les affaires de l’Orient. Si on voulait m’admettre dans ce conseil, je crois en vérité que je serais tranquille. Cette parole est bien arrogante ; mais j’ai vu tant d’affaires mal conduites uniquement parce qu’on ne savait pas, parce qu’on n’avait pas pensé. Ici surtout on ne pense pas à assez de choses! Et chacun pense à son affaire, et ne sait rien de celles des autres. Evidemment si, dès le premier jour, toutes les faces de cette question d’Orient avaient été présentées à Lord Polmerston, lui-même ne se serait pas engagé comme il l’a fait. Cela perce à chaque instant dans sa conversation.
3 heures et demie
Je viens de faire quelques visites Je ne voulais voir que lady William Russell. Je ne l’ai pas trouvée. Elle m’inspire une estime mêlée de quelque curiosité. On dit que son mari, après avoir débuté par la Juive, fait à présent des sottises avec tout le monde. Est-ce qu’il en est en Angleterre des hommes comme des femmes ? J’entends dire qu’ici c’est à 40 ans quand leurs enfants sont élevés, que les femmes s’émancipent. Et on me cite des exemples. Nous avons ici de très mauvaises nouvelles du Rois de Prusse. Je suppose que vous les avez aussi. Adieu. J’ai été dérangé deux ou trois fois depuis que je suis rentré. Je dine chez Sir Robert Inglis. J’irai de là chez lord Grey. Lady Grey m’a écrit hier pour m’y engager. Je suis très bien avec eux. Adieu Adieu
399. Paris, Mardi le 9 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Décidément,je ne pourrai pas partir samedi, ce ne sera que mardi le 16. Je vous jure que c’est indispensable que je remette à ce jour-là. Les raisons sont longues et trop multiples pour vous les dire mais elles sont bonnes. Je vous supplie de ne pas vous fâcher, n’est -ce pas vous ne vous fâcherez pas et j’aurai des lettres jusqu’à lundi inclusivement.
J’ai dîné hier chez Granville ; personne, et rien que Pahlen après le dîner, et pas de nouvelles. Si fait, et probablement ce que vous savez, que M. de la Redorte va à Madrid, et que l’ambassade est pour M. de Rumigny. Cet arrangement a coûté à Thiers beaucoup d’efforts auprès du Roi. Mais enfin cela s’est fait selon la volonté du ministre; Il est très vraisemblable que M. Barrot entre dans le cabinet sous très peu de temps. Il veut l’intérieur, il est clair que les doctrinaires sortiront dans ce cas. Tout ceci est exactement ce que m’a dit Lord Granville, et je crois qu’il ne dit pas les choses légèrement. Et bien, si cela arrive, qu’arrivera-t-il à Londres ? That is the question !
J’ai été au bois de Boulogne après dix heures du soir, et comme j’avais, peur j’ai pris Fullarton, qui était ravi de la lune, et de l’invention d’une promenade à cette heure-là.
Midi. Un peu de promenade et ma toilette, maintenant les great and little bores d’un départ ; vous ne sauriez croire comme je suis helpless ! Pogenpohl m’aide beaucoup, et puis un homme que m’a donné Génie. Je cherche toujours un compagnon de voyage. Je suis sur la trace. Il faut que je réussisse. Je ne me vanterai que quand il sera vraiment pris. Je vais et viens, je vais à mes paquets, je reviens à vous.
Je suis curieuse de vous revoir. Ne trouvez-vous pas l’expression ridicule ? Mais c’est cela, il me parait que je trouverai du nouveau ; et si même ce nouveau était mieux, voyons.... Si je vous trouvais 25 ans au lien de 50 ! Et bien cela me déplairait beaucoup. Je veux retrouvez ce que j’ai perdu le 25 février, le retrouver tel qu’il était ce jour-là. Je l’aimais tant comme cela !
Adieu. Je vous en dirai encore quelques uns, et puis nous n’aurons plus à les dire. C’est charmant, adieu.
391. Londres, Mardi 9 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
A mon tour, j’ai une lettre bien courte ce matin. Mais je ne m’en plains pas. Je ne me plaindrai de rien cette semaine, ni la semaine prochaine, à moins que je ne me plaigne de vous ce qui ne sera pas. Je voudrais bien vous trouver quelqu’un pour vous accompagner. Pour calmer votre imagination sur du danger, il n’y en a point ; et la fatigue, un compagnon ne vous l’épargnerait pas. J’espère qu’elle ne sera pas grande. Le temps est beau. Quel dommage que je ne puisse pas aller vous prendre à Boulogne ? Ce serait si facile, si ce n’était pas impossible ? J’ai peine à voir d’où viennent vos pronostics de guerre. Je ne m’attends pas à ce qu’on fasse grand chose ici sur l’Orient. Et quand même on ferait quelque chose, je ne crois pas que la guerre en sortît. Je vous attends pour causer de cela, comme de tout. Quand nous pourrons causer que nous mépriserons ce qui s’écrit. Pendant qu’on hésite en Occident, Méhêmet Ali s’affermit et s’anime en Orient. Il agit partout où il y a des Musulmans ; il les rallie, il les échauffe. Il gagne chaque jour plus de crédit à Constantinople. Si on le pousse à bout nous aurons quelque étrange spectacle. C’est là du moins ce que promettent les apparences. Mais j’ai appris à me méfier des apparences et des promesses. Que la part de la charlatanerie est immense en ce monde ! Il y en a moins ici qu’ailleurs, et pourtant le humbug est grand ici !
Le Prince Esterhazy n’arrive pas. On dit qu’il ne se soucie pas de venir tant que l’affaire d’Orient durera. Et M. de Metternich non plus n’est pas pressé qu’il vienne. Il trouve que Neumann convient mieux à l’insignifiance, et à la tergiversation. Je n’ai point de nouvelles. On est encore aujourd’hui en vacances. Lord Palmerston ne revient que demain de Broadlands.
Le bruit court de nouveau que lady Palmerston est grosse ; bruit très général. On en parlait hier chez les Berry comme d’une chose que tout le monde savait. Il y avait hier chez les Berry, cette grande Miss Trotter qui a failli épouser M. de la Rochéfoucauld et qui ne l’a pas épousé parce qu’il n’a pas voulu lui permettre une femme de chambre protestante. Vrai type anglais grande, blonde, riche, belle avec de grands et gros traits, teint éclatant et sans finesse ; avide d’esprit, prompte à l’enthousiasme ; quelque chose de très sincère, et de très factice, l’air noble sans rien de distingué. En revenant de chez les Berry, j’ai passé un quart d’heure chez lady Jersey qui avait un petit rout. J’y ai vu vingt Miss Troller.
Dites-moi donc ce qui en est de Stafford house, et si on le met réellement à votre disposition. Je le voudrais bien pour que vous n’eussiez, point d’embarras. J’aime bien vos idées d’arrangement. Out pour tout le monde à des heures déterminées. Ne trouvez vous pas que, dans la jeunesse on aime l’imprévu et, quand on n’est plus jeune, le réglé ? Il y aura bien aussi de l’imprévu, et qui sera charmant. Mais le réglé fera le fond. de la vie. Je reçois ce matin une invitation du marquis de Hertford pour dîner à sa villa de Regent’s Park, qui paraît très jolie. Connaissez-vous beaucoup le marquis de Hertford ? Vous devriez dîner là. Adieu.
Je vous quitte pour écrire des dépêches. J’envoie un courrier ce soir. Il me semble que cette manie de voyage de la Reine d’Espagne fait assez de bruit. Le mouvement des journaux est vif pour envoyer M. de la Redorte à Madrid ! Ils montent à l’assaut. On me dit qu’il est bien trist’ le pauvre M. de la Redorte. Il ne se trouve pas tout le crèdit qu’il se croyait. Adieu. Adieu.
396. Paris, Samedi le 6 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’avais bien raison de détester vos courses. Je n’ai eu que de pauvres petites lettres. Je suis charmée que vous ayez trouvé peu de plaisir à Epsom, aussi charmée que vous l’ayez été sans doute lorsque je vous ai donné l’assurance que je n’irais jamais voir Melle Dejazet. C’est Ellice aussi qui voulait m’y entraîner, lui Lady Granville, la loge était prise, tout leur petit plan fait pour m’enlever par surprise, mais moi, je sais dire non tout de suite. Enfin Epsom c’est fini je n’y veux plus penser.
Je veux penser au mois de juin. Je pense à tous les détails. Décidément vous aurez vos heures où je serai out pour tous les autres. Nous déciderons cela tout de suite, et nos heures seront réglées selon vos convenances. Mais que Londres va me paraître étouffé, étouffant. Certainement, je ne tiendrai pas longtemps à Londres même quand j’y pense bien, assurément, si ce n’était vous je ne ferais pas ce voyage. J’y vois un peu plus de tracas que de plaisir.
J’ai dîné hier chez les Granville Ils étaient seuls. Le soir, j’ai vu chez moi M. Molé, les ambassadeurs, Armin,& & Les nouvelles de Berlin, sont meilleures vous le savez sans doute/ Ainsi mon programme est faux. M. Molé me dit que la gauche est furieuse contre Barrot. 40 des siens le quittent. Il n’apporte dans le camp ministériel tout au plus que 20 adhérents. Il faudra que Thiers le poste à la présidence et les Conservateurs joints aux extrémités le refuseront. Il nie qu’il puisse y avoir de meilleures relations entre Thiers et Le Roi. On me dit qu’il n’est pas vrai que M. de la Redorte aille à Madrid ; cela s’était établi dans le monde. Je ne sais ce qu’on pense ici du discours de Lord Palmerston. Mais la croyance générale est qu’on est assez près de la guerre. M. Molé a été frappé des paroles dites par Thiers à la chambre des Pairs sur la question de la banque. Il a fait entrevoir la guerre comme probable.
Je suis fatiguée, mais je ne suis pas si malade que je l’étais après que vous m’aviez annoncé Epsom. Adieu. Je ne songe plus qu’à Londres, j’écarte les idées de tracas, je m’attends au bonheur. Oui, un grand bonheur. Ah, que de causeries charmantes, quel débordement, Adieu. Adieu, mille fois.
390. Londres, Dimanche 7 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je vous écris avec une pensée charmante, dans le cœur. Plus que trois fois. demain, mardi et mercredi. Car sans doute vous partirez samedi matin. Vous me direz. Ma course à Epsom ne m’a pas paru si drôle qu’à lord Granville. J’ai peu ri. Ce qui me fait sourire, c’est l’importance qu’on attache quelquefois, dans le monde, à certaines choses, et tout ce qu’on y voit. J’ai été à Epsom. Epsoms est frivole. Tous les gens frivoles y vont. Donc, je deviens frivole, donc, je ferai ce que font, les gens frivoles. Donc, donc, .... Il y a bien du factice et bien de la servilité en cela d’agir plus simplement et plus librement. On me dit qu’Epsom est un spectacle curieux. Ellice me propose d’aller dîner à la campagne, tout près, avec sa famille et lord Spencer, et d’aller de là, voir ce spectacle. Je vais dîner avec Ellice et lord Spencer. Je vais avec eux me promener à Epsom. Je trouve que c’est long, et je reviens me coucher à onze heures. Si le monde voit dans ma promenade quelque chose de plus, et s’en promet, sur moi quelque empire de plus, le monde se trompe et le verra bien. Epsom m’a laissé comme il m’a pris, sans embarras d’y aller et sans envie d’y retourner.
Je vous en prie ; ne soyez pas un peu malade, dans vos lettres ni ailleurs, pour ces misères. Ayez foi. Vraiment ceci ne vaut pas la peine de douter. Et dites moi toujours tout à chaque occasion, petite ou grande, je vous en aime davantage. Même quand ce que vous me dîtes, me fait sourire.
J’ai beaucoup causé hier avec la Reine, à dîner surtout, causé de je ne sais quoi mais assez agréablement. Soyez sure qu’elle a de l’esprit, et pas mal de sérieux et de fermeté dans son jeune esprit. Elle est bien jeune. Elle rit toujours. Et on voit qu’elle a envie de rire encore plus qu’elle ne rit. Peu de monde, lord Melbourne et lord Palmerston, le Maréchal Saldanha, le comte de Hartig, M. et Mad. Van de Weyer qui sont revenus de Bruxelles, la maison. J’avais à ma droite lady Mary Howard, fille du comte de Surrey, enfoncée dans sa shyness et ses beaux cheveux blonds. Après le dîner, quelques uns ont joué au Whist, d’autres aux échecs. Nous nous sommes assis, autour d’une table. Conversation froide et languissante. La Reine va à Windsor, dans deux ou trois jours, je crois. La Duchesse de Sutherland est partie ; mais Charles Greville m’a dit qu’elle vous donnait Stafford-House, et que vous seriez là, en son absence. Cela me paraît très bien. Vous ne le saviez donc pas encore. Vous me l’auriez dit.
6 heures
Je viens de faire le tour complet de Regent’s park. J’ai marché une heure et demie, seul, lentement, pensant à vous. Quand vous serez ici, je ne ferai plus guère ces grandes promenades solitaires. Je vous donnerai mon loisir. Le beau temps dure. Je le regarde. Je lui demande, s’il durera dans huit jours. Alava a été assez malade. Il est bien bon enfant et pas mal au courant ; mais personne ne compte avec lui. Est-il vrai que M. Van de Weyer est un peu remuant et commère ? Que de choses j’ai encore à vous demander, quoique je commence à être établi ! N’est-ce pas, vous aurez la bonté avant de partir, de faire demander à Génie s’il n’a rien à m’envoyer. Décidément, il y aurait, à ce qu’il vint dans ce moment, assez d’inconvénients.
Lundi une heure
Je suis charmé que nous ne veniez à Londres qu’à cause de moi, et je veux que vous y trouviez infiniment plus de plaisir que de tracas. Je n’aime pas du tout le tracas. J’ose dire qu’il n’y a personne à la nature de qui il soit plus antipathique qu’à la mienne. Mais quand au bout du tracas, il y a un plaisir, un vrai plaisir, le tracas disparaît, je l’oublie absolument, je le traverse indifféremment. C’est si beau d’être heureux ! Si charmant ! Peu importe le prix du bonheur. Vous n’êtes pas si bien douce que moi. Vous avez le bonheur, très vif, mais la contrariété très-vive aussi, et au moment ou vous payez le bonheur, vous pensez à ce qu’il coûte. Moi, je ne pense jamais qu’à ce qu’il vaut. On m’a apporté hier le petit portrait d’Henriette, très ressemblant et très joli. Je viens de recevoir des nouvelles de leur arrivée à Lisieux. Les voilà établis à la campagne. J’espère qu’ils y seront bien. Vers le 15 suillet. ils iront aux bains de mer, à Trouville sur cette côté où je me suis promené en m’efforçant de traverser des yeux l’Océan pour alles vous chercher en Angleterre où vous étiez alors. C’est moi qui suis en Angleterre, et c’est vous qui venez m’y chercher. Mais pas des yeux seulement.
Adieu. Cet adieu est très à sa place.
Je ne crois pas à la guerre. Vous savez qu’en général je n’y crois pas. Mais pas en particulier non plus. Thiers s’amuse à en parler. cela lui plaît ; et cela lui sert aussi. Un peu de fièvre dans le présent, en perspective d’un peu de bruit dans l’avenir ; sa position s’arrange de cela. Il le croit du moins. Je ne connais personne ici qui accepte la pensée de la guerre. On est déjà assez préoccupé de celle de Chine qui sera probablement plus sérieuse qu’on n’a prévu. Je n’ai pas grande estime pour le nombre ; pourtant c’est quelque chose et en Chine ce quelque chose est immense. Adieu décidément. Plus que deux lettres. Adieu. Adieu. En attendant.
389. Londres, Samedi 6 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Moi aussi, j’ai le cœur plus libre. On vient de me remettre le 394. Savez-vous qui en a profité ? Toute mon ambassade qui passé une demi-heure avec moi après déjeuner. Je cause avec eux. J’étais tout à l’heure très animé, fécond, inventif, éloquent. Eux ils étaient visiblement charmés de moi. Ils ne savaient pas pourquoi. Soyez très éloquente aussi avec moi, quand vous serez ici. J’aime passionnément l’éloquence. Vous partez dans huit jours, samedi prochain. Que la semaine sera longue ! Je donnerais bien des choses pour qu’il fit aussi beau qu’au jourd’hui. Pas le moindre vent ; un soleil admirable. Vous viendriez agréablement et vous viendriez vite. J’ai passé hier ma journée chez moi, sauf ma visite à lady Palmerston. Le soir aussi Je me suis couché de bonne heure. Il faut que mon tempérament soit aussi complaisant pour moi que mon caractère l’est pour les autres. ai grand besoin de sommeil. Je n’en ai pas toujours autant que je voudrais. Pourtant cela s’arrange. Quand je peux avoir une longue nuit je la prends, et elle me vaut pour une semaine. Je suis bien aise qu’on écrive d’ici que mon établissement est bon. Je vous attends avec impatience pour les petites choses après les grandes. Je suis sûr, parfaitement sûr que tout n’est pouve pas bien, qu’il y a des manques, que je me trompe quelquefois. Personne ne me reproche rien. Depuis que je suis ici, ni sur ma conduite, ni sur ma maison, je n’ai pas entendu une critique. C’est impossible. C’est absurde. Venez, venez. Apportez-moi de la vérité avec du bonheur.
Voici jusqu’à présent mes dîners du mois. Je ne vous dis pas ceux que j’ai refusés aujourd’hui la Reine. Le 6, les Berry, à Richmond. Le 10, Sir Robert Inglis. Le 14, lady Williams, à Putney-heath. Le 14, lady Lovelace. Le 20, Sir John Hobhouse. Le 22. Rothschild à Gunnersbury. Le 24, lord Abinger. Le 27, lord Monteagle. Il me semble qu’il n’y a rien là que de convenable. A propos de convenable, Mad. Maberly ma envoyé son roman, Emily. Il faut bien que j’écrive un billet poli, n’est-ce pas ? Je n’ai pas lu le roman. On dit qu’il est parfaitement innocent et parfaitement ennuieux. Vous avez cent fois raison, et je suis de votre avis depuis longtemps. Il y a longtemps que je pense et dis que le sénat Romain et le parlement d’ Angleterre sont les deux plus grands gouvernement que le monde ait connus. J’appelle grands gouvernemens ceux qui font de grandes choses par de grands hommes. J’ai peine à croire que la mort du Roi de Prusse soit la révolution. D’après tout ce qui me revient, le successeur sera bien timide. Il a l’esprit plus actif que la volonté. Beaucoup de pojets et de paroles de grandes ardeurs de pensée et de conversation, puis les goûts d’une vie régulière et molle ; voilà notre temps surtout dans le haut de la société. Les gouvernemens sont aujourd’hui des cadres où les Rois viennent se placer et s’emprisonner successivement, comme des images. On a pris avant-hier mes chevaux; on les a mis chacun dans une boite ; sur cette boite on a jeté un filet. La machine a grondé ; le train est parti, et mes chevaux sont arrivés à Eton, sans avoir bougé, malgré qu’ils en eussent. Ce sera le sort de bien des Rois, et de bien des ministres. Voici quatre jours d’immobilité pour les affaires. On va à la campagne. On croit en général que la session finira de bonne heure. Je le voudrais pour nos campagnes.
3 heures
J’ai été interrompu par Lord Brougham changé, triste, fatigue, abattu, dégoûté. Fatigué matériellement ; il a imaginé de venir de Cannes à Calais dans ce que nous appelons, une voiture, un carosse de louage toujours avec les deux mêmes chevaux. Vingt-six jours pour traverser la France. Il a fait la route à pied. Je l’ai revu avec plaisir. J’aime sa conversation c’est-à-dire son monologue. Il est ici un homme très important sans influence, et très considérable sans considération. C’est curieux. Adieu. Je pense au 26 avec un plaisir infini. A ma gauche, n’est-ce pas ? Il me semble que c’est de droit. Il n’y a de femmes outre la duchesse de Cambridge, que lady Aylesbury, lady Jersey, lady Etizabeth Stuart et lady Peel. Adieu. Adieu.
398. Paris, Lundi le 8 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu une bonne lettre ce matin, nous nous renvoyons notre plaisir. C’est une charmante marchandise. Il fait beau, j’ai le cœur léger. J’ai fait beaucoup de bois de Boulogne hier, j’ai dîné seule. Seule ! Cela m’a paru de nouveau bien triste !
Le soir j’ai été un moment voir Lady Granville, et puis Mad. de Castellane. M. Molé, M. Salvaudy voilà ce que j’y ai trouvé. Dans la commission de la chambre des Pairs, M. Molé a été tout-à-fait contre les Invalides, il voulait absolument St. Denis. Il me l’a répété lui-même. Je m’étais laissé dire auparavant que le Roi a été très piqué de cela, et qu’il la regardé comme personnel. Tout le monde s’accorde à regarder la session comme fini. M. de la Redorte sera nommé ambassadeur à Bruxelles. On fait de cela une ambassade de famille. aves Mad. Lehon ambassadrice. Cela vient je crois de ce que le Roi n’a pas voulu qu’on touchât aux autres, et que Thiers avait promis à la Redorte. Rien pour M. de Flahaut ! Ils arrivent dans le courant du mois.
Mad. de Talleyrand écrit de Berlin qu’elle est comblée. Toute la famille royale est pleine de politesse pour elle. On fait là comme si le Roi n’était pas malade, il le veut ainsi, les dîners et les réceptions vont donc comme de coutume. Elle parait charmée de mon grand Duc. A moi, elle n’a pas écrit encore. C’est de Mad. de Castellane que je sais tout ceci.
2 heures je suis sortie ; j’ai vu des gens d’affaires, j’ai fait beaucoup de petites affaires, tout cela chez moi au reste, mais on me mange mon temps, mandez-moi encore des nouvelles. J’ai le temps de les recevoir. Je reste fixé à samedi mais j’ai un tracas intérieur qui pourrait cependant me faire remettre mon départ de 2 jours. Imaginez : changer femme de chambre, me livrer à une inconnue, faire sa connaissance.en route, c’est bien désagréable. Je crois que j’en ai le courage, mais je ne suis pas sûre. Tout ceci vous venge bien des querelles que je vous ai faites jadis, aussi ne manquez-vous jamais de me le rappeler. Mais ne me dites pas encore de gros mots, car Samedi est toujours dans ma tête. Ce qu’il y a dans mon cœur je n’ai pas besoin de vous le dire ! Comme le cœur galope quand on approche du moment ! Adieu. Adieu. Les diplomates ici affirment qu’on ne fait et ne fera rien sur l’Orient. J’ai reçu une lettre charmante de Matonchewitz vous l’aurez, car vous les aimez. God bless you. Adieu, adieu.
384. Londres, Dimanche 31 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure et demie
Le voilà ce prétendu 388 qui est le 387. Où est-il allé ? Qui l’a arrêté en route? Je n’en sais rien. Je n’y comprends rien. Enfin le voilà, avec le vrai 388. J’ai passé une très mauvaise journée. J’avais l’imagination très noire. J’ai promèné mon mal partout, chez Lady Kinnout à Holland-House, chez Lady Jersey. Vous m’avez suivie partout, malade, mourante, je ne sais quoi. En rentrant, j’ai monté l’escalier quatre à quatre ; j’ai regardé sur ma table, s’il n’y avait pas une lettre quelque oubli de la poste, quelque voyageur. En ne voyant, rien, j’ai eu un mécompte comme si j’avais attendu quelque chose. Par moments, des moments bien courts, je m’en voulais de tant d’anxiète que les spectateurs, s’il y en avait eu, auraient à coup sûr, appelée tant de faiblesse. Ah, que les spectateurs sont sots ! Pour comprendre le chagrin, il faut sentir l’affection ; et l’affection, le chagrin, tout cela est personnel ; on ne le sent que pour soi-même. On passerait pour fou si on laissait entrevoir la millième partie de ces suppositions, de ces émotions innombrables, ingouvernables, qui obsèdent le cœur.
Il y avait dans la lettre du gros Monsieur, 386 une phrase dont je ne pouvais me délivrer : " Je me sens si malade ? " Je lisais cela partout, dans les yeux de mes voisins, dans les journaux du soir. Je n’y veux plus penser. Non, je ne veux pas vous faire courir la poste comme un courrier, ni vous forcer à traverser un jour de gros temps. Mais voulez-vous bien sérieusement que je ne sois pas trop impatient pour le 15 ? Voyons dites ; voulez-vous ? Convenez que j’ai un bon caractère. Rappelez- vous vos colères, vos reproches quand j’ai tardé d’un jour, quand je n’ai pas été parfaitement sûr. J’ai bien envie, pour me venger, de vous conter toutes les coquetteries que m’a faites hier Lady Kinnoul. Je voudrais bien savoir de quel droit lady Kinnoul me fait des coquetteries. Mais droit ou non, elles étaient bien coquettes.
Lord & lady Hatherton, lord et lady Manvers, lord et lady Cadogan, lord et lady Poltiemore, lord Liverpool, M. Leshington. Voilà le dîner. Personne, le soir à Holland house, Si ce n’est au bout de la bibliothèque, lady Essex, l’actrice Miss Stephens, assise au piano et chantant très agréablement pour Lord Holland et M. Allen. 3 heures J’ai été interrompu par la visite de Chekib. Effendi. Celui-là est intelligent. Il est pressant. aussi. Il a raison. Son Empire s’en va. Et si on fait naître là une guerre, quelle qu’elle soit il s’en ira encore plus vite. L’immobilité de l’Orient, l’accord général de l’Occident, à ces deux conditions la Porte peut encore durer. Si l’une ou l’autre manqur, si nous nous divisons ici et si on se bat en Asie, c’est le commencement du grand inconnu. Je dis cela beaucoup, et tout le monde est de mon avis, presque tout le monde. Mais les avis sont peu de chose ; c’est la volonté qui fait.
Ce cabinet-ci est dans une situation bien critique pour élever dans ses chambres et dans le monde, une si grande question. Et je doute que sa situation critique soit de celles dont en sort en élevant une grande question. Je ne crois pas qu’il y ait à s’abstenir définitivement, beaucoup de jugement, ni de prévoyance. Et j’attendrais sans beaucoup de crainte la démonstration des évènements. Votre conversation avecT hiers est charmante. Je suis quelque fois tené de croire qu’il est embarrassé et se déchargerait volontiers de son embarras, pour un temps, sur les épaules d’autrui. Nous verrons jusqu’à quel point la fécondité de l’esprit, la dextérité de la conduite et le talent de la parole suffisent au gouvernemen t! En attendant, il est absurde de se plaindre qu’il ne s’occupe pas des petites affaires. Je suis sûr qu’il s’en occupe plus qu’on n’a le droit de l’exiger dans sa situation. C’est précisément une de ses qualités de pouvoir penser à la fois à beaucoup de choses, grandes et petites, et porter rapidement de l’une sur l’autre son activité et son savoir faire.
Lundi 1 juin
Je trouve en m’éveillant le Roi de Prusse mort de plus grands que lui sont morts. Je le regrette. C’est toujours beaucoup qu’un Roi honnête et sensé. Je me suis intéressé à lui dans ses temps de malheur. La façon dont ils étaient traités lui, sa femme, son pays, m’indignait. Je n‘ai pas à me reprocher d’avoir pris plaisir à à Mexico et à Calcutta comme dans un écho. La place manquera à l’ambition et à la puissance des hommes. Priez Dieu qu’ils ne deviennent pas fous.
2 heures
Je reviens d’un meeting on the slave trade, où le Prince Albert a fait son début in the chair. et je trouve le 389, votre départ pour le 13. Vous ne m’avez jamais donné de si principale nouvelle. J’ai quelques doutes sur un congé à demander à Thiers pour Génie. Sans cela, rien de plus simple que de le faire venir ici pour huit jours en vous accompagnant. Il faut que j’y pense, et que je lui en écrive à lui-même. Cela se pourra peut-être sans inconvénient. Je serais charmé de vous donner ce gardien là. Mais je ne veux pas que Thiers suppose je ne sais quoi. C’est bien intime de faire ainsi passer mon intérêt avant votre agrément. Mais je suis sûr que vous le trouvez bon. Le meeting était très nombreux et intéresant. Le Prince a été fort bien reçu. O’Connell et Sir Robert Peel également bien reçus, également applaudis. Public très impartial, et prenant. plaisir à se séparer de la politique. Grand applaudissement aussi à mon nom et à ma l’arrogance brutale et déréglée que j’ai vu régner. Elle était pleine de grandeur ; mais la grandeur à son tour était pleine de grossiéreté et de folie.
Le rappel de Ste Hélène, c’est juste. Les Invalides c’est juste, St Denis aussi serait juste, quoique moins convenable. L’apothéose serait une impièté. Et aussi une demence. La Prusse elle-même m’intéresse. Il y a en Europe trois pays que j’aime après le mien : l’Angleterre, la Hollande et la Prusse. Je suis très protestant par là. C’est la Réforme qui a fait ces trois pays, qui a fait leur caractère, et en bonne partie leur grandeur. Et l’Europe leur doit une bonne partie de la sienne, sans compter l’avenir. Il n’y en a plus pour la Hollande. Les petits pays sont morts. Deux choses aujourd’hui sont trop grandes pour eux, les idées et les évènements. Ni l’esprit, ni l’activité des hommes ne peut plus se contenir dans un étroit espace sur notre terre, le plus grand espace sera bientôt si étroit ! De Londres à New York, douze jours ; bientôt six jours ; on construit en ce moment à Bristol une machine qui double la force de la vapeur. On se promènera autour du monde. Les paroles dites à Paris retentiront. personne, mentionnés assez éloquemment par le sir Lushington. Mais puisque, vous ne devez ignorer aucune de mes vanités, voici mon plaisir de ce matin. Je suis arrivé un peu tard à Exeter hall. Le Prince était déjà in the chair. On se pressait pour entrer. Sur l’escalier, à la porte de la salle dans la salle, la foule était immense. En abordant la foule, j’ai dit the french ambassador, pour m’aider à avancer. Le premier venu à qui je l’avais dit, a dit à ses voisins. Mr Guizot. Tout le monde, a répété mon nom, personne ma qualité, et tout le monde m’a fait place. Un fils de M. Wilberforce, archidiacre dans l’ile de Wight, a parlé supérieurement avec beaucoup d’éloquence, naturelle et spirituelle. Sir Robert Peel a bien parlé, éternellement bien. Je vous dis que vous ne connaissiez pas M. de Brünnow. Savez-vous comment il était vendredi dernier, à une heure du matin, dans le vestibule de Buckingham Palace, sortant du concert de la Reine et attendant sa voiture au milieu de la très bonne compagnie qui attendait comme lui ? Une sale casquette de voyage sur la tête pour ne pas s’enrhumer. Je suis un peu choqué que vous m’ayez dit que je lui plairais. Du reste, je crois que vous avez eu raison. Il parle très bien de moi Il me semble que l’approche de notre rencontre me rend bien bavard. Vous ne vous plaindrez pas que cette lettre soit courte. J’en ai bien plus long à vous dire. Adieu. Adieu. Quand vous serez ici, il me semble impossible que nous n’arrangions pas tout vous, moi, Londres, et la campagne. Il y a deux choses avec lesquelles on peut tout. La seconde, c’est de l’esprit. Devinez la première. Adieu. Ma mère vous priera peut-être de m’apporter le portrait d’Henriette, dans une boite. J’espère qu’il ne vous embarrassera pas trop. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Progrès, Relation François-Dorothée, Religion, Séjour à Londres (Dorothée)
389. Paris, Samedi le 30 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon fils est arrivé hier, pâle, faible, mais bien portant. Sourd d’une oreille complètement. Le bras gauche en écharpe. Il reste ici une quinzaine de jours, et c’est toujours le 13 que je compte partir. Voilà ma principale nouvelle pour aujourd’hui.
Le duc de Noailles est rencore revenu me voir hier au soir. L’affaire de la souscription préoccupe et échauffe toutes les têtes. C’est une grosse aventure. Comment sera le dénouement ? Que vous denvz ête étonné de ce qui se passe ! On dit que le Roi est très content. Je voudrais bien savoir de quoi ? Génie est venu me voir ce matin, nous avons parlé de mon voyage, d’un compagnon de voyage. Il voudrait que vous lui demandiez de l’être, et dans ce cas que vous obtinssiez pour lui un congès par Thiers. Est-ce possible ? Je n’ose pas vous dire que je le désire beaucoup, parce que alors vous seriez capable de le faire, même, en y voyant quelques petits inconvénients ; et je ne veux jamais que le moindre embarras de cette espèce vous vienne de moi. Je vais me mettre en train de me reposer avant mon départ. Je ne veux plus recevoir le soir. J’aime mieux une promenade avant de me mettre au lit et vraiment les Ambassadeurs ne m’amusent pas assez. Hier j’avais outre eux le Maréchal Paulini, gouverveur de Gènes, une vieille connaissance intime de 30 ans en arrière, plein d’esprit et d’animation italienne. Il a été 25 ans au service de Russie. Il me dit que moi à l’âge 18 aus je lui ai rendu une fois un emminent service auprès de mon mari. Voilà de vieux souvenirs !
M. de Brünnow m’a fait faire les message les plus plats et les plus insolents à la fois. C’est vraiment un sot. Cela ne vaut pas la peine de vous être redit. Les grands inconvénients qu’il avait d’abord vu à mon arrivée en Angleterre étaient ; l’embarras où il allait ce trouver vis-avis de la cour en me recevant bien, et l’embarras vis-à-vis de l’Angleterre en me recevant mal ! Mais vraiment je n’ai pas besoin qu’il me reçoive du tout, qu’ai-je besoin de M. de Brünnow ? Il est pour moi parfaitement imperceptible. Il l’a éte jusqu’ici, et plus que jamais cette espèce le demeure à mes yeux ; car je n’ai plus besoin de personne. Vraiment il y a de quoi rire de toutes les bétises qu’il a dites à ce pauvre Alexandre. Il me fait recommander d’être bien pour lui dans mon intérêt. L’Angleterre aura les yeux sur nous deux pour examiner chaque geste, chaque parole ! Non, c’est trop bête. Ce qui ne le sera pas c’est nos causeries à nous. Imaginez tout ce que nous aurons à nous dire ! Adieu. God bless you. Votre lettre ne m’est point parvenue encore. Il est 1 heure. C’est bien long! Adieu, Adieu.
382. Londres, Vendredi 29 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Voilà un peu d’eau froide sur la mousse Bonapartiste et un petit dédommagement au réjet de la dotation Nemours. La chambre a montré plus d’intelligence et de fermeté que je n’en attendais. La forme est mesquine, mais le fond est bon. Gardez mon avis pour vous, je vous prie, puisque je ne suis pas obligé d’en avoir un. Vous me direz votre impression de la séance car j’espère que vous aurez été assez bien pour y aller.
Je n’ai jamais été si préoccupé du temps, de l’air, du soleil, du brouillard. Je vois tout cela sur votre tête. Et je vois tout ce qui se passe en vous sous toutes ces influences. Le beau temps persevère. Je fais beaucoup de courses la semaine prochaine. Ellice me mène Mercredi à Epsom ; je dînerai tout près, chez M. Motteux. Je reviendrai tard. Jeudi, je vais à Eton. C’est une grande solennité du Collège. On désire beaucoup que j’y sois. Tout cela ne me plaît pas beaucoup ; mais je me prête assez facilement à ce qui ne me plaît pas beaucoup, surtout quand je n’ai rien qui me plaise beaucoup. L’indifférence me rend très complaisant. Je ne le serai pas tant quand vous serez ici. Je deviendrai avare de mes chevaux. Et de mon temps.
J’attends mon gros Monsieur. Je sais qu’il vient d’arriver, et qu’il va venir chez moi. Je sais aussi qu’il vous a laissée mieux et meilleur visage que trois jours avant son départ. Il m’a apporté un très joli petit portrait de Guillaume par Mad. Delessert ; rien, une ébauche à moitié ébauchée, mais parfaitement ressemblant, et gracieux. Ressemblant au modèle et au peintre. C’est ce qui arrive souvent. On met du sien partout. Qu’est-ce qu’un comte Woronzoff qui vient d’arriver et que M. de Brünnow m’a présenté ? Il m’a parlé du comte Michel, comme de son frère ou de son cousin ; je n’ai pas bien entendu. Il y avait hier soir un concert chez la duchesse d’Argyll, un bal chez la duchesse de Montrose. Je n’y ai pas été. Je me retire de la frivolité, comme vous dites. Je ne veux pas qu’on dise que je ne m’en retire qu’à cause de vous. Je vais ce soir au concert de la Cour après le dîner de Lord Haddington.
4 heures
Mon bonheur s’est fait attendre longtemps. Enfin il est venu. Il ne faut pas beaucoup de lettres pour faire beaucoup de bonheur. Vous avez déjà mon impression sur la séance où vous étiez. De loin, j’ai été frappé surtout du fond. Vous de près, surtout de la forme. C’est dans l’ordre. Je persiste dans mon impression. C’est un acte de bon sens et de fermeté contre le brouhaha populaire. Je ne crois à aucun évènement prochain où je puisse être intéressé. Vous savez sur quel terrain je me suis placé, et vous m’y approuvez. La proposition Rémilly pourrait seule murir rapidement la situation. On m’écrit de tous côtés qu’elle sera rapportée peut-être, ce qui ne signifie rien, mais point discutée ce qui serait grave, decisif peut-être. En tout cas, j’y regarde beaucoup ; et si j’y voyais quelque chose, je vous le dirais sur le champ. Certainement, un chassé croisé serait déplorable, ridiculement déplorable. J’ai tant attendu qu’il faut que je finisse. Dans trois semaines, nous ne finirons jamais n’est-ce pas ? Je suis assez d’avis que vous arriviez d’abord près de Londres. Adieu, Adieu. En attendant. Cette fois, l’erreur était double. Pour 386, vous avez mis 287. Adieu.
388. Paris, Vendredi 29 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous êtes jaloux de mon escamotage d’un n° ! Je rétablis ; voici deux 388 pour componser le 381. Je vous prie de ne pas me traiter en abrégé, quoique notre rencontre soit prochaine. Jusqu’au dernier jour j’aimerai les longues lettres et toutes les nouvelles. Il me semble que je n’y faiblis pas de mon côté. Je n’ai rien à vous conter d’hier. J’ai passé beaucoup de temps en plein air, je n’ai vu du monde que le soir. Les Ambassadeurs, la Prusse, le Duc de Noailles. le Duc de Noailles est fort révolté de ce qui s’est passe à la Chambre des députés. Révolté pour Napoléon, honteux pour le pays. Cela, et tout ce qui peut s’en suivre encore. Ces querelles sur le lieu de la sépulture. Cette manière de marchander les frais, les désordes qui peuvent survenir à l’occasion de la Cérémonie, tout cela est à ses yeux des insultes à un grand honme. Il ne méritait pas cela. Il méritait bien tant d’honneur, mais il ne méritait pas autant d’indignité. Il ne fallait pas remuer sa cendre. Il y avait bien plus de grandeur à rester à Ste Hélène. Cette souscription ouverte va être un grand scandale. Scandale si elle réussit. Honte complète si elle avorte. Tout cela est pitoyable. J’ai entendu quelques plaintes hier sur ce que M. Thiers n’a pas le temps de s’occuper d’affaires. Mais il faut que j’ajoute que les affaires qu’on me citait à l’appui des plaintes étaint tout ce qu’il y a de plus infimes. Au fond Thiers ne peut pas s’occuper de détails, c’est trop exiger. Je m’étonne qu’il ne succombe pas sous les affaires en gros. J’attends mon fils aujourd’hui. J’en suis bien impatiente. Ne soyez pas trop impatient pour le 15. Ne me forcez pas à traverser un jour de gros temps. Ne me faites pas courir la poste comme un courier. Je partirai le 13 si mon fils n’y fait pas obstacle. C’est ma volonté et surtout mon désir. Mais je ne puis pas être absolument sûre. Ne vous lassez pas d’écrire. Je vous en prie. Je n’ai pas vu Lord Granville depuis trois jours, je n’ai donc pas pu lui faire votre message encore, mais je ne l’oublierai pas. Adieu. Adieu, mille fois, adieu.
381. Londres, Jeudi 28 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je ne comprends pas pourquoi vous avez de l’orage et un ciel triste. Il fait beau ici depuis plusieurs jours, beau et calme. Aujourd’hui, il fait même chaud. Vous vous porteriez bien par ce temps là. Nous chercherons de l’air pour vous. Cela ne me paraît pas impossible à arranger. Nous trouverons bien quelque chose d’agréable à Norwood. Putney & Vous avez besoin de rouler en voiture ouverte. Vous viendrez à Londres, le matin voir qui vous voudrez, dîner où vous voudrez. Et moi j’en serai quitte pour fatiguer une paire de chevaux de plus pendant que vous serez là. Sachez bien que de mémoire d’anglais, me dit-on, on n’a vu à Londres un aussi beau printemps. Et au fait, je trouve l’air moins lourd qu’on ne me l’avait annoncé. Avez-vous un peu d’appétit ? Quand on a la bile en mouvement, je crois qu’il faut bien peu manger. Si je vous mettais à mon régime, je vous dirais, de la diéte et du sommeil. Ce sont mes seuls remèdes. J’ai vu hier on me promenant, deux ou trois jolies maisons à louer, garnies, à l’extrémité de Regent’s Park du côté de Primerose. Je vous assure que là l’air est agréable. Et vraiment la portion fermée de Regent’s park, le jardin, est charmante. Depuis que Lord Duncannon m’a donné, des clefs, j’y vais quelques fois, m’asseoir seul. C’est bien frais bien tenu, assez grand pour y marcher, pas d’isolement et pas beaucoup de monde. Il me semble que vous seriez bien près de là. Savez-vous décidément dans quel hôtel vous descendrez ?
Le duc de Cambridge, qui ne pouvait venir dîner chez moi le samedi 13, m’a offert le Vendredi, 12 ou le lundi 15. J’ai pris le 12. Je garderai le 15 bien libre. Je viens de déjeuner chez M. Milnes, conservateur modéré de la Chambre des Communes avec quelques radicaux modèrés Charles Buller & et Sir Stratfort. Canning. Conversation assez animée et variée. Il y avait là un homme d’esprit un Rev. M. Thirlwall le premier scholar, dit-on, de l’Angleterre. et prédicateur très éloquent. On voudrait le faire evêque. Mais, lord Melbourne s’y oppose, ne le trouvant pas assez orthodoxe.
Je me suis laissé imposer hier par lord Burghersh une seconde séance de l’ancient concert. C’était la dernière et cela lui faisait tant de plaisir! Au fait, j’aimais autant finir ma soirée là qu’ailleurs. La musique était bonne, très bonne même une ou deux fois. J’ai causé avec lady Burghersh. J’ai trouvé son esprit dont vous m’avez parlé. Bien artiste, fin et sensé. Quand je dis sensé, je ne sais pas, mais clairvoyant.
J’ai arrangé mon petit dîner pour mes Françaises. Elles partent le 3 Juin et je les ai le 2 avec lord Elliot, lord Leveson, lord et lady Lovelace et Sir Robert Cherter que j’ai mis là parce qu’il faut qu’une fois je le mette quelque part. Les invitations me pleuvent. Voilà lord Haddington, le duc de Bucclaugh, le duc d’Argyll. Il faudra rendre tout cela. Il me faudra plus de grands dîners que je ne comptais. Vous me règlerez Point de nouvelles. Chekib. Effendi vient d’arriver.
L’affaire d’Orient remuera de nouveau probablement sans avancer. Entre nous, je crois pouvoir dire que tout le monde ici, corps diplomatique ou Anglais, Whigs ou Torys, est de mon avis dans cette question, comme on est de l’avis d’un autre. On trouve que j’ai raison. On serait bien aise que quelque circonstance rendit ma raison nécessaire. Mais il faut lutter, refuser, dire non. C’est bien difficile. Aussi je ne réponds de rien. Je ne me décourage pas non plus. J’établis chaque jour, un peu plus fortement et dans quelques esprits de plus, que j’ai raison. Je pense des hommes dans les affaires comme des enfants dans l’éducation, il faut faire leur atmosphère et les laisser respirer. Adieu. J’attends la lettre de demain avec une double, une triple impatience. Mais je vous veux point agitée, point abattue. Les vrais adieux veulent la santé. Adieu. Adieu.
386. Paris, Mercredi 27 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici une lettre presque aussi sûre que la parole et malgré cela je n’ose pas me livrer. Il me serait si doux de le faire cependant ! Mon bien aimé, J’ai si besoin de te redire et d’entendre des paroles d’amour. Cela est écrit, je ne veux pas l’effacer. Mais je veux me contenir et raconter.
J’ai été hier à la Chambre - curieux et pitoyable spectacle. M. de Lamartine a fait un beau discours voilà tout ce qu’il y a eu de beau. Thiers n’a pris la parole que pour dire qu’il épousait le projet de la commission, et la commission et Thiers ont été battus, ou leur a rogué un million. Votre président de la chambre s’est conduit comme un enfant, un enfant sot et fâché. La chambre a fait un tapage épouvantable ; comme des écoliers. C’était vraiment misérable. On n’est pas Bonapartiste, et hier on n’était pas Thieriste. On dit qu’il est resté accablé de cette triste séance, et qu’à sa soirée il était d’une humeur très hargneuse. Il accusais beaucoup M. Sauzet. je crois en effet que la première confusion était dû au Président. Mais pourquoi Thiers n’a-t-il pas parlé ? Cela me reste incompréhensible. La foule était grande dans la Chambre, dans les tribunes comme aux fonds secrets. Sébastiani est sorti sans voter, il m’a dit : "pauvre séance."
Le soir les ambassadeurs sont venus chez moi, beaucoup d’autres personnes tout cela assez amusé. Je crois que le Roi a pu l’être aussi. Il me semble que le grand effet théâtral commence bêtement. Au fond c’est honteux. Tout le monde trouve Thiers bien changé, vieilli, harassé. La faction Boigne dit qu’il donne des signes de folie. Je n’ai cependant entendu cela que là. On dit aussi qu’au Conseil le Roi ne parle plus. Il laisse faire. Au reste son langage sur Thiers avec les ambassadeurs n’a plus rien d’inconvenant. Ils sont assez contents de lui. Il est poli. On va faire les grands changements dans les préfectures quelques révocations, et beaucoup de mutations. Je crois savoir cela de bonne source.
Le roi de Prusse est très mal. Il n’en reviendra pas. Bresson mandait hier de fort mauvaises nouvelles, ce sera un gros événement. Le Roi de Prusse futur a beaucoup d’esprit, mais pas de tête. Il y a quelques années il détestait ceci encore plus que ne le déteste l’Empereur Nicolas, et il le disait beaucoup plus haut que lui. Il peut s’être amendé. En tout cas, on n’aura pas pour lui le respect qu’on a pour son père. Les libéraux espéreront tout de lui beaucoup. Les ultras aussi. Cela a l’air de non sens, et c’est comme cela cependant. Je m’imagine que mon Empereur va courir à Berlin pour voir encore. son beau père. Ce pauvre mourant sera très incommodé de cette visite.
J’ai été hier voir votre mère, elle est parfaitement bien, les enfants aussi, ils étaient au jardin, je suis allée les y trouver. Votre mère veut se mêler de moi, elle veut que je prenne de la camomille. ne crois et n’écoute aucun médecin. Je me sens si malade. Je vois, qu’au fond, je n’ai politiquement rien de bien intime à vous dire. C’est vous qui pourriez m’apprendre bien des choses, si vous aviez un gros Monsieur. Vos opinions sur l’Angleterre et les Anglais, je les devine. Mais sur ce qui se passe ici ; sur la politique européenne vous savez beaucoup, vous savez tout ce que j’ignore ! Je suis curieuse un peu de tout.
Quelques fois je m’imagine qu’un changement ici peut être très prochain, et alors je me dis qu’il pourrait bien arriver tout juste pour mon voyage d’Angleterre, c’est-à-dire aussi gauchement que possible. L’effet de la séance d’hier peut être quelque chose. Le pays sera un peu étonné, et les partisans de la dissolution en feront un argument assez puissant Qu’en pensez-vous ? Eh mon Dieu, je voudrais vous faire cette question sur toute chose ! Vous verrez que l’affaire de Ste Hélène sera une bien grosse. affaire. Elle a tant de faces vraiment c’est de la déraison ou de la trahison de l’avoir commencée. Et le Roi qui se vante d’en être l’inventeur !
Je vous écris tous les jours, et je m’étonne de ne pas vous écrire aujourd’hui un volume. Je suis honteuse de profiter si peu de cette bonne occasion. Je voulais remplir ma lettre d’Adieux sous toutes les formes. Imaginez-vous cela, prenez tout cela comme dans nos meilleurs temps. Dans les temps qui reviendront n’est-ce pas ?
Il me semble toujours que je commencerai pas arrivé auprès de Londres, quand ce ne serait que pour choisir de là l’Auberge où je veux aller à Londres. Mais je n’ai rien arrêté encore. Je crois que Brünnow en désespoir de cause aura écrit en cour pour empêcher ma venue. Ce sera peine perdue, on n’osera pas en dire un mot, et si on le disait je partirai seulement un peu plutôt. Non, je partirai comme j’ai dit. Je ne me fâcherai, ni ne me dérangerai pour personne Il n’y a plus que vous qui ait le droit de me fâcher ou de me déranger, n’est-ce pas ?
Adieu. Adieu, cher bien aimé. Que de choses à nous dire ! Que de doux et longs regards. Ah si nous en étions là ! Avertissez- moi bien au moins des chances politiques possibles. Un chassé croisé serait trop bête. Adieu. Adieu. Adieu, toujours toute ma vie, mon bien aimé.
387. Paris, Jeudi le 28 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
En effet, j’ai sauté par dessus le 381 car je ne le retrouve pas dans mes tablettes. Ecoutez ; hier j’ai rencontré Thiers à dîner chez mon ambassadeur en entrant dans le Salon il me dit : " Je viens de recevoir mes dépêches télégraphiques de Londres ". A ce mot télégraphe ma figure s’illumina, elle disait : " Je suis bien contente." J’aime mon invention, elle est bien innocente.
Thiers a été mon voisin à table. Il est fort content des nouvelles de Londres. Il se loue beaucoup de vous, il dit qu’à vous deux vous faites des merveilles. Il ajoute :
" J’arrange les affaires de façon qu’il n’y a que M. Guizot qui puisse être mon successeur.
- Ou plutôt vous les arranger de façon à les garder toujours pour vous ?
- Oh Je vous en réponds ; mais tenez, je suis jeune, je sais bien qu’une fois je les garderai toujours, je ne sais si cette fois là est à présent ; c’est possible, cela n’est pas sûr ; nous verrons, mais si M. Guizot s’ennuyait à Londres, je l’arrangerais ici.
- Il me semble que M. Guizot s’amuse fort bien à Londres et qu’il aimera à y rester.
- Oui , mais allez-y car sans cela bientôt, il vous fera des infidélités ! " Voilà vous.
Après cela il m’a parlé du vote d’avant-hier. Il me dit : " j’ai fait une faute, je devais parler. J’ai eu grand tort de ne pas le faire. Je n’avais pas idée que le Chambre. voterait comme elle a fait. J’étais ennuyé de parler, et puis j’aurais dit des paroles peut être trop excitantes. Enfin, j’ai mal décidé et une fois le vote, je me suis mis dans un grande colère. J’ai dit des choses très dures au président. Je lui ai dit : " Monsieur, vous ne connaissez pas votre devoir, vous ne savez pas présider, ce que vous venez de faire est absurde, je répète absurde. " Je lui ai dit tout cela là à sa chaise. J’ai dit des paroles dures, à Dupin, j’en ai dit au secrétaire de la justice, à tout le monde. J’étais en grande colère." Il a causé de tout, et m’a beaucoup divertie. Il dit des choses très piquantes. A propos de la responsabilité ministérielle, il dit : " C’est l’hypocrisie du despotisme." Au fait hier il était en train ; il n’a fait que causer avec moi. Nous avions commencé par Sauzet, nous avons fini à César. Il dispute tout au duc de Wellington, et plus que jamais il glorifie Napoléon. C’était hier un dîner de 30 personnes. Mad. de Boigne a essayé des agaceries à M. Thiers, à Mad. Thiers. Rien n’a réussi. Ils viennent de louer à Auteuil cette grande maison qu’avaient les Appony. Au sortir du dîner, j’ai été en calèche me rafraîchir au bois de Boulogne. Cela m’a fait dormir.
Je vous préviens que hier je n’ai eu votre lettre que vers cinq heures. Le joli garçon sort de chez lui avant l’heure de la poste. Il y rentre quand il peut, et moi je suis longtemps à attendre. Voici midi. Je n’ai rien encore. J’aime beaucoup Simon, et je regretterai beaucoup le gros Monsieur.
Je suis un peu mieux depuis hier. Ce matin mon fils m’écrit du 26 qu’il partait ce jour là et qu’il serait ici le 29 ou le 30. Brünnow l’a chargé de m’assurer de sa joie de me revoir, et qu’il se mettrait entièrement à mon service. Cela ne ressemble pas au premier message. Je vous remercie tendrement de tous vos enquiries au N°2 Berkley square. Je suis bien heureuse que vous n’ayez plus à y envoyer.
J’ai envie de vous redire les petits mots entrecoupés entre Thiers et moi. " Vous êtes très fine, pas plus que moi, mais je crois presque autant."
(moi) " Vous avez beaucoup d’esprit mais je pense quelques fois que vous en avez trop.
- Cela voudrait dire, pas assez ? non mais vous abusez." (Thiers) " Il n’y a de véritable ami qu’une femme. Dans les amitiés d’hommes il y a toujours un peu de jalousie."
" J’ai peu à faire avec les étrangers nous n’avons rien à nous dire ! Je suis poli, je pense qu’ils n’ont pas à se plaindre mais voilà tout. "
1 heure
Je viens de recevoir votre lettre des mains du joli garçon. Hier ce n’était par lui, c’était je ne sais qui, car on avait laissé la lettre ici et je l’avais trouvé à mon retour de ma promenade. Tout cela n’est pas en règle, et je m’en vais aller aux enquêtes par Génie. Lord Palmerston n’a pas bu la santé des souverains parce que vous n’avez pas fait à votre dîner du 1er mai ce que je vous avais dit. Je vous avez dit de répondre à la santé du roi par la santé de la Reine. Vous avez voulu faire mieux, vous avez ajouté les souverains. Cela n’est pas correct Granville l’autre jour a répondu à la santé de la reine, par la santé du roi. Barante à Pétersbourg répond par la sante de l’Empereur. Partout cela se fait comme cela, et la raison en est claire. Lord Palmerston c-est-à-dire l’Angleterre porte la santé du roi. Le représentant du roi répond par la santé de la Reine d’Angleterre, les autres souverains n’ont rien à faire la dedans. En revanche vous à la fête de la reine vous portez sa santé non parce que vous êtes la France mais parce que vous êtes doyen du corps diplomatique, c’est donc l’Europe qui parle, et alors il répond à l’Europe en portant en masse la santé des Souverains. Il ne l’a pas fait, il a voulu se venger de votre petit mistake. Voyez- vous, une autre fois lisez mes lettres et croyez. Je vous ai répété la Reine, la Reine. Je vous l’ai dit deux fois, vous deviez bien penser que j’aurais ajouté les autres s’il pouvait s’agir d’eux ; et j’ai été fâchée quand vous m’avez mandé les santés supplémentaires. Rappelez- vous de tout ceci l’année prochaine. Si. J’ai bien envie que vous n’ayez pas à vous en rappeler.
Dès que mon fils sera arrivé, je fixerai l’époque de mon départ pensez de votre côté que je ne puis pas résider longtemps à Londres. Qu’on y étouffe, qu’on y mène une vie abominable, que ce qu’il y aurait de bien, ce serait une quinzaine de jours là, et puis les campagnes. Mais pour cela il faut l’époque où l’on y va. Or cela dépend pour vous et pour les autres du parlement. Ces deuils anglais me déroutent un peu, et pour Londres et pour les châteaux. Chatsworth eût été charmant je devais y passer tout le mois d’août, vous deviez y venir. Il n’y a plus de Chatsworth. Il n’y a plus de Treutham. Je ne sais trois ce qu’il y aura en commun. Middleton chez les Jersey. Broadlands chez les Palmerston. Je cherche, je ne vois pas trop. Bowood est pour vous seul, je ne suis pal assez liée avec eux. Howick, est je le crains trop loin pour vous ; et puis vous ne faites guères connaissance avec Grey. Les Londonbery vous ne es voyez pas du tout. Il faut abandonner au hasard à nous arranger peut-être. J’aimerais bien quelque chose près de Londres. Mais il n’y a plus personne de ma connaissance intime près de Londres. Hatfield, Woburn, Stoke, Pamzhänger, tout cela est mort. Allons à Tumbridge voilà qui est charmant. Je dirais Richmond ! Mais il n’y a plus de Richmond possible pour moi ! Mad. de Boigne va s’établir à Chatenay aujourd’hui, Votre dîner Tory est très bien.
Adieu. Adieu. Le temps est redevenu charmant. Adieu.
380. Londres, Mercredi 27 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je commence à sentir cette impatience, ce mépris des lettres qui s’éveillent quand on approche du terme. Plus je vous dirais, moins je vous écris. Il fait un temps admirable ce matin; le soleil brille, l’air du printemps souffle. Je voudrais me promener avec vous. On n’écrit pas la promenade. Nous avons dîné hier agréablement. La conversation, vous aurait plu. Vous y êtes venue. M. de Bacourt a raconté une course en calêche que vous aviez faite, vous, la duchesse de Dino Lady Clauricard, lui, Dedel, lord John Russell, je ne sais qui encore ; un orage, une pluie énorme. Les trois dames dans le fond de la calèche, lord John en travers, sous le tablier, sur vos pieds, et aussi trempé en arrivant à Richmond que s’il eût été sur le siège. Cela me plaisait d’entendre parler de vous. Pourtant tout ne me plaisait pas. J’ai gardé et je garderai jusqu’au bout les susceptibilités et les exigences du premier printemps. J’en souris moi-même. Et ce que je dis là est presque un mensonge, car je n’en souris pas vraiment, franchement. Ce qui est vrai, ce qui est franc, ce qui s’éveille, en moi naturellement et tout-à-coup, sans réflexion, ni volonté ce sont les impressions de la jeunesse. Elles ne me gouvernent plus, mais il faut que je les gouverne, car elles sont encore là. La vie est infiniment trop courte. Notre âme a à peine le temps de se montrer. Les choses lui échappent bien avant le goût et la force d’en jouir. Il faut que vos vers de l’autre jour aient raison.
Tout commence en ce monde et tout s’achève ailleurs.
Une heure
Je vous promets du calme ici. J’espère que vous arrangerez votre vie de manière à éviter la fatigue matérielle. Vous ne pouvez pas vous coucher tard. J’en ai repris l’habitude avec une singulière facilité. Non, certainement, je ne traite pas de bétises vos impressions sur votre santé. Je crois, je suis sûr qu’elles sont souvent très exagérées. Vous avez bien plus de vie, bien plus de force que vous ne croyez dans vos mauvais moments. Mais vos mauvais momens m’occupent beaucoup, me tourmentent. Ils seront rares ici. J’y compte. Ainsi, le 13 ; c’est bien convenu. Et vous serez ici le 15. Mais il faudra que vous partiez le 13 de bonne heure. Arriverez-vous à Boulogne, de manière à passer le dimanche 14 ? Ou bien ne passerez-vous que le lundi 15 ? Répondez moi sur tout cela. Je prétends que je suis plus exact que vous en fait de réponses. Ma mère et mes enfants partent pour la campagne, le 4 juin.
Notre affaire de médiation marche. Jai obtenu hier de Lord Palmerston la restitution des bâtiments napolitains détinus encore à Malle. Le Roi de Naples de son côté concède l’abolition du monopole et le principe de l’indemnité. Il ne reste plus que des détails d’exécution sur lesquels on s’entendra. Je suis fort occupé ce matin d’une affaire qui vous touche fort peu, le chemin de fer de Paris à Rouen. On ira alors de Londres à Paris, par Southampton en 20 ou 22 heures. Je serais bien aise que cela se fit sous mon règne. C’est en train. Et les Anglais en sont fort en train. Ils y mettent 20 millions. Croyez-vous comme on me l’écrit, que la session française finira du 20 au 25 juin ? Qu’en dit-on, autour de vous ? Il est vrai que Thiers déploye beaucoup d’activité et de dextérité. Il est fort content, me fait tous les compliments et toutes les tendresses du monde, me promet qu’il n’y aura point de dissolution, qu’il ne s’y laissera point pousser et finit par me dire : " J’espère que notre nouveau 11 octobre, à cheval sur la Manche réussira aussi bien que le premier. " Lord Brougham est arrivé avant-hier. Vous ne l’avez donc pas vu à son passage à Paris, ou bien il n’y a pas passé. Je ne l’ai pas encore vu. Lady Jersey, ma dit qu’il était horriblement triste. Pauvre homme ! Il ne trouvera pas dans le mouvement qu’il se donne de remède à son mal. Il faut que le remède s’adresse là où est le mal au cœur même. Le mouvement extérieur distrait tant qu’il dure, mais ne guérit point. Voilà la grossesse de la Reine déclarée. C’est une grande question de savoir si on proposera dans cette session, le bill de régence. Le Cabinet, voudrait bien y échapper et il l’espère. Si le bill était proposé, la session finirait je ne sais quand. Adieu. J’étais bien tenté de croire que, d’ici au 15 juin, tout me serait insipide. Je me trompais. Le 385 (384) venu ce matin, m’a été au cœur. Adieu. Adieu.
385. Paris, Mardi 26 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je trouve bien mal arrangé que le mardi revienne toutes les semaines. Je m’éveille ce jour-là bien tristement. J’ai vu chez moi hier matin les Appony, le prince Paul encore, mon ambassadeur et M. de Pogenpohl. J’avais dû commencer par mon médecin. Il m’a trouvée very much below. parr, excessivement faible avec le pouls très élevé 90. Il m’a ordonné de passer ma journée en voiture ouverte ce que je n’ai manqué de faire même le soir et par une pluie battante. En revenant du bois de Boulogne, à 10 heures j’ai frappé à la porte de Mad. de Castellane ; j’y ai trouvé le chancelier, Mad. de Boigne, mon Ambassadeur, M. Molé, quelques autres. Point de causerie le matin j’avais peu recueilli aussi.
La médiation de Naples. ira bien difficilement. On ne regarde pas comme impossible que le sultan et le Pacha s’arrangent entre eux. Ce dernier devient bien puissant dans le divan et dans les provinces Turques. Un accommodement serait tout à son avantage et nous y verrions la ruine prochaine de l’empire Ottoman. Vous soutenez l’acheminement à ce résultat. Au fait puisque l’Europe ne parvient pas à arranger ces Messieurs il faut bien qu’ils finissent par s’arranger eux-même any how. J’ai eu une lettre de mon frère ce matin, qui me croit déjà à Londres. Il allait partir pour Varsovie avec l’Empereur, de là ils retournent à Pétersbourg.
Midi. Mes vertiges reprennent, et alors je vois à peine ce que j’écris. Le temps est à l’orage, le ciel bien triste s’il est comme cela ici, j’imagine ce qu’il doit être à Londres. Au fond l’air de Londres ils abominable ; ce n’est pas de l’air, et je suis sûre que vous vous sentez suffoqué, quelquefois. C’est la campagne en Angleterre qui est ravissante. C’est là où je voudrais être avec vous.
J’ai eu une longue lettre de la duchesse de Sutherland pleine de larmes et d’amitié. Elle attend encore Lord Burlington à Stafford house, je n’y peux pas être. J’irai à l’auberge. Cela ira pour quinze jours, mais au vrai je ne pourrai pas soutenir Londres plus longtemps. Il me faudra absolument de l’air. Je ne me fais une idée claire de la combinaison de l’air et de vous, mais il faudra cependant trouver moyen. Je vous écris demain par le gros Monsieur. Adieu, à demain, Adieu toujours.
384. Paris, Lundi 25 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé toute la journée hier, malade et couchée. Je crains qu’aujourd’hui ne vaille pas mieux. J’ai les nerfs et la bile en mouvements. Mes jambes ne me portent pas. Tout cela ensemble me fait pleurer quoique j’aie le coeur heureux. Oui heureux, vos lettres me soutiennent, me donnent de la joie, que deviendrais- je sans elle, sans vous. Je n’ai que vous. Mais vous c’est tout, tout, c’est si beau, et si doux. Oui, je veux avoir une foi immense, je veux remercier Dieu tous les jours de ce qu’il m’a donné, ne m’abondonnez jamais.
Je n’ai vu hier qu’Appony le prince Paul, et Pogenpohl. J’ai employé celui-ci dans les derniers temps à mettre en ordre mes papiers ; il a beaucoup d’intelligence pour cela. C’est Matonchewitz qui lui donne le plus de travail, pas de dates c’est horrible. Alors, il faut lui rappeler l’histoire, et c’est laborieux. Je l’emploie aussi à mes affaires, il faut de nouveau pleins pouvoirs, des tracasseries de détail. Cela ne finira jamais. Je ne vous en ai pas parlé, c’est trop ennuyeux.
Appony me portait la relation de la noce. L’Impératrice a habillé ma nièce. L’Empereur l’a conduite à l’autel. Toute la famille impériale était à la chapelle. De là, dans les appartements de l’Impératrice, les accolades et les santés. Et puis l’Empereur les a menés à l’église Catholique. Il les a ensuite reçus dans l’autichabre de leur appartement ment, avec toutes les, j’allais dire boufforneries des usages russes. L’Empereur avait mis ce jour là l’uniforme autrichien et l’ordre d’Autriche, enfin il n’aurait pu mieux faire pour un archiduc. Il a fait cadeau ma nièce d’une superbe parure en diamants. Les voilà comblés, et j’espère heureux.
Politiquement Appony avait peu à me dire. Il se loue beaucoup des manières polies de Thiers. Le prince Paul n’avait point de nouvelles. Il me dit seulement qu’il s’agit de quelqu’affaire semblable à celle de Fabricius qu’il croit qui se rattache aux prisonniers de Bourges, car prisoniers est le mot aujourd’hui. Thiers les a nommés comme cela en causant avec le prince. Je n’en ai plus entendu parler de longtemps. Mais je vois Brignoles d’assez mauvaise humeur en général. Mad. de Castellane est très malade, M. Molé en est même inquiet.
Mon fils sera ici jeudi j’espère. Il ne fera pas de retard pour moi, je compte toujours partir Samedi le 13. Le cœur me bat quand j’y pense. Ah qu’il me bat souvent. Je trouve le ciel gris. J’ai dans l’âme du bonheur et de l’angoisse. Ma santé est si misérable ! Il me semble quelque fois que je vais finir. J’ai tort de vous dire cela, mais vous traitez cela de bétises. Si je restais calme, tranquille, heureuse, pendant quelques jours, cela me ferait du bien. Mais je n’ai jamais ce calme. Quinze jours ne s’écoulent jamais sans une secousse. Et chaque secousse me trouve plus faible. Ah, il n’y a que vous pour me soutenir ! Votre puissante voix, votre regard, quand retrouverai-je cela ?
J’aime les Américains. Je vous remercie de ce que vous me redites. Le Roi de Hanôvre me mande vos succès à Londres, Il me dit que c’est un suffrage général. Vous ne savez pas comme cela me donne de l’orgueil ! Je crois que vous pouvez accepter Lady Kerrison, c’est la mère de Lady Mahon, du moins je le crois, demandez. Elle est soeur d’Ellice. Je me suis levée très tard, ayant très mal dormi. Il est midi, je n’ai pas encore songé à ma toilette.
Adieu. Adieu. Quel plaisir quand nous ne l’écrirons plus. Adieu.
L’auteur des biographies est un nommé Loménie, très jeune et qui ne connait l’original d’aucun des portraits qu’il trace. Adieu, adieu.
378. Londres, Dimanche 24 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je crois qu’on s’est amusé hier chez moi, et qu’on a trouvé le dîner bon. Mais Lady Holland a eu un moment affreux. Elle avait dîné la veille à 5 heures, pour aller au spectacte. Pas déjeuné le matin. Elle mourait de faim. Lord Palmerston nous a fait attendre jusqu’à 8 heures un quart. Lady Holland a commencé, par l’humeur. Puis le désespoir. Enfin, l’inanition. au moment de passer dans la salle à manger elle a appété Lord Duncannon et s’est recommandée à lui, car elle n’était pas sûre de pouvoir aller jusque là sans se trouver mal. Le dîner a dissipé, l’inanition. Mais je ne suis pas sûr qu’un peu de rancune ne lui ait pas survécu de ce que j’avais attendu Lord et Lady Palmerston. Pour le 13 juin mon dîner Tory. Voici ma liste. Le duc et la duchesse de Cambridge, le Prince George, la Princesse Angusta, Une dame un aide de camp, le duc de Wellington, lord et lady Aylesbury, lord et lady Jersey, lady Sarah Villiers, lord et lady Stuart de Rothsay, lord Abordeen, lord Hertford, lord Howe, lord Stanley, Sir Robert et lady Peel, lord Lyndhurst,lord Ellenborough.
Connaissez-vous Sir Edward Disbrowe, le ministre d’Angleterre à La Haye ? Il a de l’esprit et des manières agréables. Il vit dans une grande intimité avec M. de Boislecomte qui me l’a fort recommandé. Si les deux pays avaient partout, des agents pareils, il pourrait y avoir entre eux des affaires, jamais d’embarras.
Savez-vous que je commence à compter les jours ? C’est charmant et très impatientant. Vous n’êtes pas seule à prendre de grandes résolutions depuis la mort de ce pauvre lord William. Lady Fanny Cowper ne couche plus qu’avec un grand poignard. Elle l’a essayé l’autre jour contre son oreiller et elle a trouvé qu’il coupait très bien. Lord Leveson n’est qu’arrivé qu’après lord Palmerston. Pour lui, je ne l’avais pas attendu. Nous étions à table depuis un quart d’heure. Je cherche s’il y a encore quelque évènement que je ne vous aie pas dit. A propos de lord Leveson, tirez-moi, je vous prie, de peine avec Lord Granville. Je viens de retrouver perdu dans un tas de papiers un petit billet qu’il m’a écrit il y a déjà bien longtemps pour me recommander un M. Rey ingénieur français venu à Londres. J’ai vu ce M. Rey et je l’ai bien reçu. Mais je ne me rappelle pas si j’ai répondu à Lord Granville et son billet enfui et retrouvé, m’en fait douter. Sachez-moi cela, je vous prie, et si je n’ai pas répondu, excusez-moi par la vérité, en attendant, que je mexcuse moi-même.
4 heures
Je comprends que vous ayez oublié le vendredi. Mais je ne comprends pas pourquoi le n° que je reçois aujourd’hui s’appelle 383. Celui d’hier était 380. J’en place bien entre ces deux-là, un qui viendra demain et qui sera 381. Mais je ne puis trouver le 382. Je viens de faire quelques visites, le Maréchal Saldanha, lord Combermere &. Il y en a beaucoup ici, mais on va vite. Quand vous serez arrivée comment réglerons-nous nos heures ? Pensez-y d’abord parce qu’il faut le régler, ensuite parce qu’il est agréable d’y penser. Vous savez ma maxime que le temps ne manque jamais là où est le désir. Le temps ne me manquera donc pas ; mais je veux du fixe, sans renoncer au variable. En voiture, un quart d’heure pour aller à Stafford-House ; à pied, par les rues une demi-heure, par les pars, trois quarts d’heure. Vous ne m’avez pas dit, si la Duchesse de Sutherland vous avait répondu. Point de nouvelles, ou bien petites. La querelle avec le Portugal s’arrangera ; le maréchal Saldanha a tous les pouvoirs nécessaires. Le Roi de Naples est parti pour la Sicile fort irrité contre ceux de ses conseillers qui l’ont embarqué dans cette mauvaise affaire, entr’autre contre le prince de Satriano. On les a payées et il aura, lui, à payer. Là est la plaie. On croit ici comme vous, le Roi de Prusse fort malade. Nous en sommes fâchés, sincèrement fâchés, quoique sans rien craindre du successeur. Que je vous dise un bon procédé de M. de Brünnow. C’est demain le jour de naissance de la Reine. Jusqu’ici, d’après la tradition on n’illuminait pas à l’Ambassade. Un scrupule m’a pris. Je n’ai pas voulu prendre des airs d’empressement exclusif en illuminant tout seul, ni courir le risque de ne pas illuminer si d’autres, si un autre quelconque, illuminaient. J’ai tout simplement fait demander à Ashburnham-House ce qu’on faisait. On m’a fait dire qu’on n’illuminait pas. Trois heures après, M. de Brünnow m’a envoyé un valet de chambre pour me dire qu’il illuminait. J’illumine donc, et je le remercierai de ne m’avoir pas laissé dans l’erreur. J’ai un peu ri de la fluctuation. M. de Poix avait grande raison de compter que votre intervention serait heureure. Mais pour être heureuse, il faut qu’une intervention intervienne. Si l’affaire est faite avant que l’intervention ait paru, ce n’est pas la faute de l’intervention mais de ceux qui l’ont réclamé trop tard. Il y a trois mois que je suis ici, et cinq mois que cette place d’attaché- payé à Londres est en perspective.
Lundi 25, 8 heures
Un très petit dîner chez lord Palmerston, lord et lady Holland, lord et lady Normansby, lord John Russell, lord Leveson et moi. Décidément, on veut me mettre là dans l’intimité. Lady Holland se charge de mon éducation. Il m’est arrivé hier de citer un proverbe Anglais : Hell’s way is paved with good intentions. Elle m’a demandé bien bas bien pardon de son impertinence et m’a averti que jamais ici on ne prononçait le mot de Hell, à moins qu’on ne citât des vers de Milton. La haute poésie est la seule excusée. L’autre jour, elle m’avait repris parce que je disais always pour still. Je l’ai beaucoup remerciée. Je vois que l’inanition n’a pas laissé de rancune. A onze heures chez lady Jersey. Lord Stuart, lord Heytesbury, Sir Robert Wilson, et une femme d’esprit, point tulipe dont j’ai oublié de demander le nom quand elle est partie. Lord Heytesbury me convient : bonne conversation, pleine, sensée, tranquille, un peu triste. Il dit. "J’ai fini." Et on voit que ceux qui n’ont pas fini lui inspirent un peu d’envie sans malveillance. La beauté de mon surtout fait du bruit. Il en était question hier au soir chez Lady Jersey. 4 heures Je reviens du Drawing-room. Immense. La Reine en aura, certainement jusqu’à 7 heures. J’espère qu’on la décidera à s’asseoir. C’est fort cohue, tant on est pressé pour arriver, pressé quand on y est, et pressé en sortant. Le palais est beaucoup trop petit. Pas de place pour les queues ; pas de place pour le spectateurs. Il y a une infinie quantité de beaute perdue, choses et personnes. Adieu. Votre fils part demain. Il ira lentement de Calais à Paris. Je suis bien heureux de le voir partir. Adieu. Adieu. Par le Télégraphe.
375. Londres, Jeudi 21 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
On est venu m’éveiller cette nuit à 3 heures, pour m’apporter la division de la Chambre des Communes, et j’ai expédié sur le champ un courrier à Calais pour qu’on le sût à Paris par le télégraphe. Non qu’il doive, je crois, en résulter ici aucun evènement. C’est pourtant un gros fait. On me dit que Peel a très bien parlé et O’Connell médiocrement. Il a voulu être modèré. On l’avait fort sermoné à ce sujet. C’est Lord Duncannon qui est son prédicateur. Et O’Connell répond toujours : " you are right ; I won’t do it again." Il a trop bien obéi hier. On prévoyait ce résultat, même à Holland House où j’ai été hier soir au lieu d’aller à la chambre. Devinez qui j’y ai trouvé? Mr Mrs Grote qui y avaient dîné. C’était un coup monté. Peut-être vous en ai-je déjà parlé quand ils ont été partis, j’ai demandé à lady Holland si elle avait un privilège contre les poursuites, for treating and bribery.
2 heures
Je viens de chez Lord Aberdeen. J’aime sa conversation, et je crois qu’il aime la mienne. Il y a beaucoup de shyness dans sa froideur. Et aussi de sadness. Il est préoccupé de cette affaire Napoléon. On commence à l’être ici, beaucoup plus qu’au premier moment & plus que moi. Je suis accoutumé aux apparences, et aux démonstrations bruyantes. Cependant, il est sûr que des embarras viendront de là. Ce qu’il y avait de bien est déjà recueilli ; il faudra subir le mal. Mais je ne crois pas au danger. Pourvu qu’il y ait un pouvoir qui s’en défende. En tout cas, la question est lointaine. Le retour n’est pas possible avant le mois de Novembre.
L’Orient est stationnaire. Je reste toujours sur mon terrain. On n’y vient pas. Mais on n’ose pas avancer sur le sien. Je m’applaudis du parti que j’ai pris de dire dès le premier moment, ce que je devais dire à la fin. Plus j’y pense, plus je suis convaincu que notre politique est la seule sensée. Rallumer la guerre entre les Musulmans, et courir le risque de l’allumer entre les Chrétiens pour la question de savoir si quatre ou seulement deux Pachalih de la Syrie appartiendront au vieillard qui règne à Alexandrie ou à l’enfant qui dort à Constantinople, en vérité c’est bien léger. Et je tiens pour certain qu’ici il n’y a pas trois personnes qui ne soient au fond de mon avis. De celles qui y ont pensé, s’entend. Il n’y en a pas beaucoup.
Les Affaires Etrangères occupent bien peu le public anglais. Je dis beaucoup sur cette question d’Orient ce qui est parfaitement vrai ; la politique que nous soutenons ne nous causera aucun embarras, à l’intérieur, car tout le monde, en France en est d’avis ; aucun embarras à l’extérieur, car le jour où l’on voudra agir sans nous, les embarras seront pour ceux qui entreprendront de faire, et non pour nous qui regarderons faire. L’hypothèse la plus défavorable ne nous met donc pas dans une position redoutable.
M. de Metternich a eu certainement beaucoup d’humeur pour Naples ; et dans son humeur, il s’est montré plus disposé à faire ce que voudrait Lord Palmerston en Orient. Mais sa disposition est vague, comme tout dans l’affaire. Quant au Pacha, il dit que si on le bloque dans Alexandrie, il sautera par dessus le blocus, c’est-à-dire pas dessus le Taurus. Je connais ces petites biographies, les premiers cahiers, le mien compris, qui était très bienveillant, et assez spirituel. Je connais Thiers, aussi ; mais non pas, le Duc de Broglie, ni Berryer, ni Dupin, ni Lamartine, vous serez bien aimable de m’envoyer ceux-là. L’ouvrage m'a paru écrit à bonne intention. Sait-on par qui?
Certainement, je porterai la santé de la Reine, le 25. Je suis en pension chez lady Palmerston. Elle dine samedi chez moi ; moi dimanche chez elle en petit comité, et lundi en full house. Je l’ai beaucoup vue depuis quelque temps et plus je la vois, plus je la trouve aimable. Elle dit qu’à présent je plais beaucoup à M. de Brünnow et qu’il parle de moi tendrement. Adieu.
J’ai le cœur à l’aise depuis hier à votre sujet. Je voudrais que ma grande lettre vous fût arrivée avant la petite. Je ne l’espère pas. Adieu.
Vous devriez vous arranger pour être ici le samedi 13 Juin. Au plus tard le Dimanche 14. Vous ne vous faites pas scrupule, je pense, de voyager le dimanche. Je ne trouve pas qu’on soit aussi austère ici à ce sujet, qu’on me l’avait dit. Le gros Monsieur vient passer quelques jours à Londres et vous en avertira. Ce que vous pourriez lui remettre passera de sa main dans la mienne. Que j’ai de choses à vous dire ! Et que de choses à entendre, que j’aime mille fois mieux !
Adieu, encore ; jamais pour la dernière fois.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Posture politique, Pratique politique, Salon, Séjour à Londres (Dorothée)
378. Paris, Lundi 18 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
6 heures
J’ai oublié ce matin de vous dire que j’ai reçu une lettre de Lady Palmerston, où elle me dit ceci. " j’ai reçu votre bonne lettre du 7 et je m’en remets, à vos fortes raisons. Il est bien clair d’après ce que vous me dites qu’un délai dans votre arrivée est hors de question et puis raisonnable. En tout cas ce sera un grand plaisir pour moi de vous revoir et j’aurais été personellement bien fâchée que par raison de prudence ou autres vous eussiez trouvé sage de déférer ce que je désire depuis si longtemps." Il est clair qu’un retard ou remise ferait toujours encore un grand plaisir mais je ne veux pas le comprendre ainsi. Une longue lettre avec mille nouvelles, et puis la fin." Je vous embrasse tendrement, et nous ferons tout notre possible pour vous rendre votre séjour ici agréable."
Ellice me mande qu’il a entendu traiter le sujet de mon arrivée à la table de Lady Holland par les diplomates très alarmés, et qu’il en a beaucoup ri sous cappe. Mais qu’est-ce que ces gens s’imaginent ?
On a répandu le bruit que le roi avait la rougeole, et cela a fait subitement tomber les fonds. Il n’y a pas un mot de vrai. Mais il est vrai qu’il n’a pas eu la rougeole et qu’on prend des précautions autour de lui.
Mardi 9 heures
J’ai dîné seule, le soir les trois ambassadeurs, les d’Aremberg, Mad. Appony, la Princesse Razonmowsky, M. de la Rochefoucault. Appony très silencieux et triste. M. de Pahlen fort causant. M. de Brignoles venait du château. Le Roi lui a dit l’alarme du matin à la bourse, il se porte très bien On dit que c’est lui le Roi qui se vante d’avoir eu la premiere idée pour les restes de Napoléon où est le vrai ? On parle très mal de l’Afrique. M. Piscatory a seul raison, c’est-à-dire qu’il a seul le courage de dire ce que pense beaucoup de monde. On dit que Sébastiani l’autre jour a perdu la parole à la troisième phrase de son court discours, & que c’est les journalistes qui l’ont achevé.
Je ne sais comment je passerai ce mauvais jour. Je ne sais ce que m’apportera demain que me dira votre lettre. Le cœur me bat. Si vous pouviez me voir, voir dans mon cœur ! Il n’y m’a jamais eu de plus accupé de vous. Je vous redis toujours la même chose. Depuis quatre jours c’est moi qui parle sans cesse, j’ai la fièvre. Je vous tourmente. Vous n’aimez pas cela. Vous voulez un bonheur tranquille. Eh moi, même je le veux comme je le désire. Mais de loin, je ne me gouverne pas. Vous voyez comme ce mot montre bien que c’est vous qui me gouvernez. Ordonnez, ordonnez-moi ... de me taire. voilà ce qu’il y a de plus sûr. Trouverais-je un seul mot d’affection dant la lettre de demain ? S’il n’y était pas !
Adieu je devrais finir ; je ne peux par finir. Je voudrais courir au devant de votre lettre, et quand elle sera là je n’aurai pas le courage de l’ouvrir. Voyez-vous mon angoisse ? Ah, comme tout cela empêche d’engraisser. Je suis bien tranquile pour mon fils maintenant, mais je suis peu tranquille pour ma tête Dites-moi des nouvelles aussi. Je ne sais absolument rien. Comment est-ce que l’affaire d’Orient n’aurait pas fait un pas en avant ou en arrière ? Que fait M. de Metternich ? Je songe quelque fois à ces chose-là pour me distraire, mais j’y songe " en creusant dans le vide" comme dit M. de Metternich, car je ne sais rien. Je viens de lire le portrait de M. de Broglie dans un des cahiers. de cette biographie dont je vous ai déjà parlé, je vous l’enverrai jeudi car le commencement me parait excellent. Avez-vous lu les autres, le vôtre, Berryer, Thiers ? Vous ne m’avez pas répondu. N’oubliez pas que vous portez la santé de la Reine au dîner chez Lord Palmerston le 25. Adieu que m’avez-vous écrit hier, que m’écrirez-vous aujourd’hui ? Je ne rêve qu’à cela. Adieu. Adieu.
372. Paris, Mercredi 13 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai revu l’écriture de mon fils, j’en ai remercié Dieu du fond de mon âme. Je respire ; je me mets maintenant à sa disposition, je lui ai écrit aujourd’hui. Dans mon inquiétude je faisais ma volonté, et demain je partais. Dans sa convalescence je veux faire sa volonté à lui, afin de ne point contrarier le projet qu’il aurait de venir passer quelques temps encore à Paris. Il me dira donc, si sa convalescence devait durer, il veut se rendre de suite après à Baden, alors je me rends de suite à Londres. Si au contraire il veut et peut venir à Paris passer quelques semaines, Je l’attends. Vous saurez donc mon mouvement par d’autres que, par moi. Car cela va se décider entre Brodie et mon fils. Benkhausen sera instruit de cela aussi ; je lui avais écrit hier comme à vous que je partais demain. Je vous avoue que ce répit me soulage. Mon angoisse, mes tracasseries m’avaient donné la fièvre, je déraisonnais, tant j’étais agitée, il me semble que deux jours de vrai repos seulement me feront grand bien. Je vous conjure de m’écrire tous les jours, de ne pas vous fâcher des reproches que je vous ai faits. Songez un peu à tout ce qui traverse la tête quand on a le cœur vraiment inquiet. Voyez les contradictions entre vos lettres et celles des autres. Vous ne voyant pas mon fils, les autres le voyant. Enfin pardonnez-moi, et écrivez-moi je vous en supplie, sachez me dire tous les jours un mot de lui, mais un mot vrai. N’est-ce pas vous le ferez ? Si je partais demain, je vous verrais dans peu de jours ! Cette pensée un fait tressaillir. Mais enfin ce que je décide, ou plutôt ce que j’abandonne à la décision de mon fils me paraît raisonnable. N’est-ce pas ?
Le coup de théâtre a été frappant hier à la Chambre, mais j’ai cherché votre nom dans le discours de M. de Rémusat sans le rencontrer cela m’étonne ! Le fait a beaucoup d’éclat, en a-t-on bien pesé la portée ? Défendez-vous à la famille Bonaparte d’assister aux obsèques ? Ce serait une inique injustice. En le permettant, cela n’est pas sans danger. Cette cérémonie touchant peut-être dans le moment de nouvelles élections (car vous les aurez) n’est-elle pas un coup monté par la Gauche ? Enfin, enfin, tout est étrange.
Je viens de voir Génie. ce que j’ai lu est parfait mais ce qu’il m’a dit de la séance d’hier de la commission est bien mauvais. L’été ne se passera pas sans quelque événement qui doit influer sur votre destinée. C’est là ce qui me préoccupe beaucoup. Je n’ai vu personne ces deux derniers jours quoique tout le monde. soit annoncé. Je n’ai reçu que lady Granville tous les jours à 6 heures, et mon ambassadeur le soir à 10. Personne ne m’a vue du reste. J’étais dans un état abominable. Le petit mot de mon fils m’a fait un bien immense. Il me semble que je sois d’une grande maladie. J’étais en démence. A propos M. Molé était donc mieux enformé que vous quand il me disait il y a cinq semaines qu’on redemandait les restes de Napoléon ! Vous le niiez alors.
Adieu. Je suis pressée, parce que devant partir demain je me suis mis sur le corps une quantité d’embarras dont je ne puis pas sortir tout de suite. Adieu. Adieu. Adieu. Encore Adieu. N’essayez par de voir mon fils cela le troublerait mais faites encore parler Brodie, c’est infiniment plus sûr. Adieu.