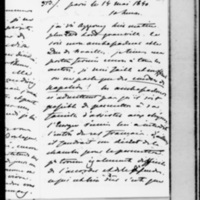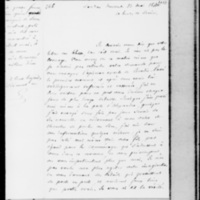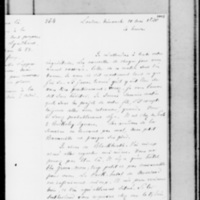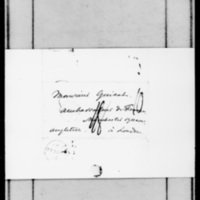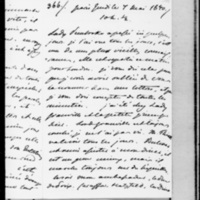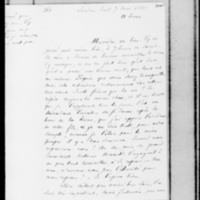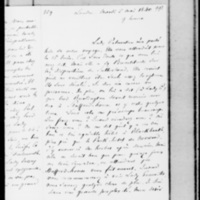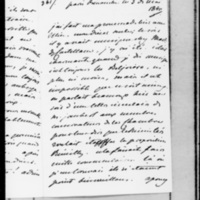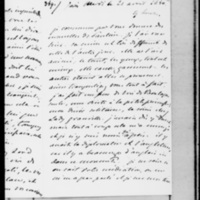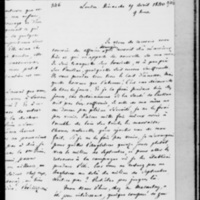Votre recherche dans le corpus : 65 résultats dans 3424 notices du site.
Trier par :
373. Paris, Jeudi 14 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
373. Paris, le 17 mai 1840,
10 heures
J’ai vu Appony hier matin. Plus tard lord Granville. Le soir mon Ambassadeur et le duc de Noailles. Je tiens ma portie fermée encore à tous les autres ; je suis faible et souffrante. On ne parle que des cendres de Napoléon ! Les ambassadeurs n’admettent pas qu’il soit possible de permettre à sa famille d’assister aux obsèques. L’Europe réunit lui a interdit l’entrée du sol français. D’ailleurs il faudrait un décret de le chambre pour le permettre. Je trouve également difficile de l’accorder et de défendre. Ce qui est bien sûr c’est que Vous vous êtes créé là de très grands embarras pour l’avenir. Les étrangers ajoutent : " les dangers sont pour la France, qu’elle s’en tire. Granville parle comme cela aussi. Il me parait fort content de la manière dont lord Palmerston a accueilli tout ceci. En effet, il y a une une très bonne grâce. On pense généralement que la réhabilitation du Maréchal Ney sera une conséquence inévitable. Appony se prononce avec force contre cela. Le duc de Noailles dit que ce serait grave, en ce que cela casserait l’arrêt de l’un des grands corps de l’état. Je vous envoie le partage. L’affaire Rémilly est noyée pour le moment. J’ai enfin assez bien dormi cette nuit; la lettre de mon fils m’avait calmée, mais après une gande excitation le calme amène la fatigue, ce s’est qu’alors qu’on sent tout le mal qu’on s’est fait ! Il y a des gens qui disent que ces trois jours m’ont fait maigrir beaucoup, et je le crois. Vous recevez aujourd’hui la lettre dans laquelle je m’annonce et demain celle qui la détruit. Je pense à votre plaisir, et puis à votre désappointement. Je pense à tout, à tout ce qui vous passe par le cœur. Mais vous trouverez que j’ai raison, que mon inquiétude devait me faire aller ; que les nouvelles d’hier doivent me faire soumettre mes mouvements à la volonté de mon fils. Je ne veux contrarier en rien ses projets. Je sais qu’il déteste le séjour de Londres, et dès qu’il me dira ce qu’il faut faire, je me déciderai. Je reste prête à partir sur l’heure. Midi. Voici votre lettre. Elle confirme tout ce que vous me disiez hier sur mon fils, demain j’aurai de ses nouvelles plus directes et peut- être même sa décision sur mes mouvenents, car dès lundi je lui avais écrit sur ce sujet. Samedi je n’aurai rien de vous car vous m’aurez écrit à Boulogne. Je suis fatiguée, abimée, encore. un peu inquiète et l’incertitude sur ce que je vais faire dans peu de jours me tournente aussi. Voilà comme on passe sa vie ! C’est à peine vivre. Adieu, adieu. Je vois que Londres vous plait, cque vous vous y amusez. Au fond je ne vous croyais pas si susceptible d’être amusé. Mais c’est une disposition heureuse. Ah mon Dieu que je me tirais vite moi de ces bals de cour, et quand je ne pouvais pas m’en tirer, que je supportais impatiemment cette gêne ! Quelle mine désagréable je faisais au roi. Il y a bien des points sur lesquels nous ne nous ressemblons pas, mais vous avez raison. Et moi, j’ai tort. Adieu.
10 heures
J’ai vu Appony hier matin. Plus tard lord Granville. Le soir mon Ambassadeur et le duc de Noailles. Je tiens ma portie fermée encore à tous les autres ; je suis faible et souffrante. On ne parle que des cendres de Napoléon ! Les ambassadeurs n’admettent pas qu’il soit possible de permettre à sa famille d’assister aux obsèques. L’Europe réunit lui a interdit l’entrée du sol français. D’ailleurs il faudrait un décret de le chambre pour le permettre. Je trouve également difficile de l’accorder et de défendre. Ce qui est bien sûr c’est que Vous vous êtes créé là de très grands embarras pour l’avenir. Les étrangers ajoutent : " les dangers sont pour la France, qu’elle s’en tire. Granville parle comme cela aussi. Il me parait fort content de la manière dont lord Palmerston a accueilli tout ceci. En effet, il y a une une très bonne grâce. On pense généralement que la réhabilitation du Maréchal Ney sera une conséquence inévitable. Appony se prononce avec force contre cela. Le duc de Noailles dit que ce serait grave, en ce que cela casserait l’arrêt de l’un des grands corps de l’état. Je vous envoie le partage. L’affaire Rémilly est noyée pour le moment. J’ai enfin assez bien dormi cette nuit; la lettre de mon fils m’avait calmée, mais après une gande excitation le calme amène la fatigue, ce s’est qu’alors qu’on sent tout le mal qu’on s’est fait ! Il y a des gens qui disent que ces trois jours m’ont fait maigrir beaucoup, et je le crois. Vous recevez aujourd’hui la lettre dans laquelle je m’annonce et demain celle qui la détruit. Je pense à votre plaisir, et puis à votre désappointement. Je pense à tout, à tout ce qui vous passe par le cœur. Mais vous trouverez que j’ai raison, que mon inquiétude devait me faire aller ; que les nouvelles d’hier doivent me faire soumettre mes mouvements à la volonté de mon fils. Je ne veux contrarier en rien ses projets. Je sais qu’il déteste le séjour de Londres, et dès qu’il me dira ce qu’il faut faire, je me déciderai. Je reste prête à partir sur l’heure. Midi. Voici votre lettre. Elle confirme tout ce que vous me disiez hier sur mon fils, demain j’aurai de ses nouvelles plus directes et peut- être même sa décision sur mes mouvenents, car dès lundi je lui avais écrit sur ce sujet. Samedi je n’aurai rien de vous car vous m’aurez écrit à Boulogne. Je suis fatiguée, abimée, encore. un peu inquiète et l’incertitude sur ce que je vais faire dans peu de jours me tournente aussi. Voilà comme on passe sa vie ! C’est à peine vivre. Adieu, adieu. Je vois que Londres vous plait, cque vous vous y amusez. Au fond je ne vous croyais pas si susceptible d’être amusé. Mais c’est une disposition heureuse. Ah mon Dieu que je me tirais vite moi de ces bals de cour, et quand je ne pouvais pas m’en tirer, que je supportais impatiemment cette gêne ! Quelle mine désagréable je faisais au roi. Il y a bien des points sur lesquels nous ne nous ressemblons pas, mais vous avez raison. Et moi, j’ai tort. Adieu.
366. Londres, Mercredi 13 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
366. Londres, Mercredi 13 mai 1840,
10 heures et demie
Je devrais vous dire que votre lettre me blesse car c’est vrai. Je n’en ai pas le courage. Vous aurez vu ce matin même que je n’avais pas attendu votre demande pour vous envoyer l’opinion exacte de Brodie. Passé le premier moment et après vous avoir très véridiquement informée et rassurée, j’ai eu deux raisons pour ne par vous donner chaque jour de plus long détails. Quoique j’aie passé moi-même à la porte d’Alexandre, quoique j’ai envoyé deux fois, par jour, savoir de ses nouvelles en ordonnant à mon valet de chambre de parler au sien, j’ai mis dans mes informations quelque réserve ; je ne suis pas allé moi-même voir votre fils, par égard pour les commérages qui s’adressent à vous dans ce moment et vous préoccupent ou vous impatientent plus que moi. Je n’ai pas voulu non plus agiter votre imagination en vous donnant des détails qui grossissent de poste en poste et arrivent faux bien que partis vrais. Je vous ai dit la vérité. Je vous l’ai dite tous les matins. Je me suis enquis avec autant de sollicitude pour mon propre enfant. Je vous ai écrit comme je demande qu’on m’écrive. Il me semble que cela n’était pas difficile à voir dans mes lettres. Et en l’y voyant, vous ne m’auriez pas écrit un jour : quelle providence que votre affection ! Et le lendemain: si cela ne vous donne pas trop d’embarras, ayez la bonté d’écrire ou de parler à Sir Benjamin Brodie. Au moment même où vous m’écriviez cela, Lundi à midi je menais moi-même, dans ma voiture, M. Herbot à la porte de Brodie, et j’attendais sa réponse.
Je ne puis pas ne pas croire qu’en y pensant un peu plus, en ne vous livrant pas tout entière à votre première impression, vous vous épargneriez, dans les plus mauvais moments, beaucoup de tristesse pour vous beaucoup d’injustice envers moi.
Je vous répète ce que je vous ai dit, dans l’opinion bien arrêtée de Brodie ; Alexandre ne peut songer à partir avant quinze jours au plutôt. Et vous savez que les médecins prennent toujours plus de temps qu’ils n’en ont demandé d’abord. Je suppose donc que vous vous mettrez en route. Samedi peut-être. J’espère qui vous le pourrez sans trop de fatigue.
Le temps est beau. Arrivez ; vous vous trouverez très pardonnée. Je vous pardonnerais quand même. Un pardon sincère, quoique triste. Encore une chose qui me vient à l’esprit. Cumming, Brünnow. Lady Palmerston, Lady Jersey Benkhausen, tout ce monde là écrit beaucoup plus légèrement que moi, se souciant beaucoup moins de l’impression que feront sur vous leurs paroles. Moi, je pense à ce que je vous dis ; d’abord pour vous dire la vérité ; ensuite pour ne pas vous donner une impression qui aille au-delà de la vérité.
Je relis votre lettre. J’aurais mieux fait de ne pas la relire. Personne, personne qui me montre un intérêt vraiment tendre, vraiment. Ma Providence a été bien vite détrônée.
3 heures
J’ai été hier soir au bal chez le duc d’Argyll. Un bal trop grand pour une si petite maison. Une magnificence d’emprunt, qui n’était pas celle de la veille et ne sera pas celle du lendemain.
Le Duc un tout petit homme maigre, et de plus petite mine. La Duchesse, une petite grosse femme ronde, rouge, empressée. Rien de bien qu’un boy de quinze ou seize ans, le marquis de Sorn, joli quoique roux, l’air sérieux et content, poli avec un peu trop de confiance. Il m’a dit avec une fierté enfantine qu’il m’avait rencontré à la Chambre des communes, ce qui était vrai. A sa vue, à ses paroles, le souvenir de mon orgueil et de mes joies paternelles m’a traversé le cœur. Que de plaies cachées au milieu d’un bal !
Adieu. Je vous écrirai demain à tout hasard ; et vendredi matin, je saurai décidément ce que vous faites. Adieu. Adieu.
Je ne puis pas ne pas croire qu’en y pensant un peu plus, en ne vous livrant pas tout entière à votre première impression, vous vous épargneriez, dans les plus mauvais moments, beaucoup de tristesse pour vous beaucoup d’injustice envers moi.
Je vous répète ce que je vous ai dit, dans l’opinion bien arrêtée de Brodie ; Alexandre ne peut songer à partir avant quinze jours au plutôt. Et vous savez que les médecins prennent toujours plus de temps qu’ils n’en ont demandé d’abord. Je suppose donc que vous vous mettrez en route. Samedi peut-être. J’espère qui vous le pourrez sans trop de fatigue.
Le temps est beau. Arrivez ; vous vous trouverez très pardonnée. Je vous pardonnerais quand même. Un pardon sincère, quoique triste. Encore une chose qui me vient à l’esprit. Cumming, Brünnow. Lady Palmerston, Lady Jersey Benkhausen, tout ce monde là écrit beaucoup plus légèrement que moi, se souciant beaucoup moins de l’impression que feront sur vous leurs paroles. Moi, je pense à ce que je vous dis ; d’abord pour vous dire la vérité ; ensuite pour ne pas vous donner une impression qui aille au-delà de la vérité.
Je relis votre lettre. J’aurais mieux fait de ne pas la relire. Personne, personne qui me montre un intérêt vraiment tendre, vraiment. Ma Providence a été bien vite détrônée.
3 heures
J’ai été hier soir au bal chez le duc d’Argyll. Un bal trop grand pour une si petite maison. Une magnificence d’emprunt, qui n’était pas celle de la veille et ne sera pas celle du lendemain.
Le Duc un tout petit homme maigre, et de plus petite mine. La Duchesse, une petite grosse femme ronde, rouge, empressée. Rien de bien qu’un boy de quinze ou seize ans, le marquis de Sorn, joli quoique roux, l’air sérieux et content, poli avec un peu trop de confiance. Il m’a dit avec une fierté enfantine qu’il m’avait rencontré à la Chambre des communes, ce qui était vrai. A sa vue, à ses paroles, le souvenir de mon orgueil et de mes joies paternelles m’a traversé le cœur. Que de plaies cachées au milieu d’un bal !
Adieu. Je vous écrirai demain à tout hasard ; et vendredi matin, je saurai décidément ce que vous faites. Adieu. Adieu.
364. Londres, Dimanche 10 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
364. Londres, Dimanche 10 mai 1840
4 heures
Je m’attendais à toute votre inquiétude. Les nouvelles de chaque jour vous auront rassurée. Celles de ce matin sont très bonnes. Je vous ai dit exactement tout ce que j’ai su. Si j’avais trouvé qu’il y ait lieu de vous dire positivement : Venez, je vous l’aurais dit sans hésiter. Je saurai demain matin, quels sont les projets de votre fils, s’il compte toujours aller vous retrouver, quand. Vous le savez probablement déjà. Il est chez M. Gale, 2 Berkeley Square.
Les accidents de la semaine ne tournent pas mal. Mon petit Banneville est presque sur pied. Je viens de Blackheath. J’ai mieux aimé aller regarder moi-même. Vous ne pouvez pas être là. Il n’y a qu’un hôtel the Green-man, trop petit et pas convenable pour vous. Le Park-hotel de Norwood est infiniment mieux. Il m’a paru vraiment bien et très agréablement situé. Si les Sutherland vous reçoivent chez eux le 1er juin, vous viendrez si peu de jours auparavant que la distance de Norwvood importe assez peu. Et s’ils ne vous reçoivent pas, vous viendrez à Londres.
Je viens de conclure en trois jours une petite négociation qui fera grand bruit. J’ai redemandé les restes de Napoléon et on nous les rend. Ils seront déposés aux Invalides. Il y a plaisir à faire des Affaires avec Lord Palmerston quand il est de votre avis. Il les mène simplement et rondement. Ne parlez de ceci que quand on en parlera. Probablement on en parle déjà. Mais en tout cas, je désire que la publicité ne vienne pas de vous. On m’a promis de Paris une immense poputarité si je réussissais. Encore une fois, attendez qu’on en parle. Je ne sais pourquoi je vous répète cela.
J’ai dîné hier chez Sir Robert Peel, un dîner de Royal academy. Il y en avait un aussi chez Lord Lansdowne où j’aurais dû être aussi. Mais Peel avait eu la priorité. Je ne dînerai point chez les Philips. Je commence à supprimer quelques ennuis. Je me suis promené dans le parc de Greenwich. Je voulais retourner à Richmond. Mais je n’ai pas eu le temps.
Lundi 3 heures
Voici les renseignements les plus exacts et les plus complets. Alexandre continue d’aller bien. Chez lui, on dit et il dit lui-même, ce matin, qu’il partira dans huit jours pour Paris. J’ai envoyé Herbet, chez Brodie. Il l’a vu et à causé avec lui. Brodie trouve Alexandre bien, si bien a-t-il dit, qu’il n’ira pas le voir aujourd’hui. Mais à cette question d’Herbet: " Croyez-vous que le Prince Alexandre puisse partir dans huit jours ? " Brodie a répondu positivement; " He cannot. - Et dans quinze jours? Brodie a dit que c’était probable ; mais qu’en homme sensé, il ne voulait pas en répondre. Vous savez à présent le véritable état des choses. Il n’y a absolument aucun danger ; mais il faut du temps. Je n’ajoute rien. Décidez.
Je viens d’un grand meeting que devait présider Lord John Russel et où il a été remplacé pas Sir George Grey. Il a fallu comme de raison, y prendre la parole to second a motion. Il me semble que m’a popularité ne faiblit pas. J’ai reçu pour ce mois-ci quinze ou vingt invitations, à des meetings semblables. J’ai choisi les deux les plus considérables. Je n’irai qu’à ceux là.
J’irai peut-être dans deux heures à la Chambre des Lords où le Chancelier doit proposer un bill sur lequel parlera Lord Lyndhurst. On dit qu’on attend Lord Brougham le 23.
Votre "il ne peut pas" serait donc faux. No news. Si ce n’est que Palmella s’oppose à la demande Anglaise à Lisbonne. Mais on dit que ce pourrait bien être pour renverser le Cabinet portugais, et prendre sa place. Adieu.
J’approuve les changement à la lettre. Que j’ai de choses à vous dire ! Adieu. Adieu.
Les accidents de la semaine ne tournent pas mal. Mon petit Banneville est presque sur pied. Je viens de Blackheath. J’ai mieux aimé aller regarder moi-même. Vous ne pouvez pas être là. Il n’y a qu’un hôtel the Green-man, trop petit et pas convenable pour vous. Le Park-hotel de Norwood est infiniment mieux. Il m’a paru vraiment bien et très agréablement situé. Si les Sutherland vous reçoivent chez eux le 1er juin, vous viendrez si peu de jours auparavant que la distance de Norwvood importe assez peu. Et s’ils ne vous reçoivent pas, vous viendrez à Londres.
Je viens de conclure en trois jours une petite négociation qui fera grand bruit. J’ai redemandé les restes de Napoléon et on nous les rend. Ils seront déposés aux Invalides. Il y a plaisir à faire des Affaires avec Lord Palmerston quand il est de votre avis. Il les mène simplement et rondement. Ne parlez de ceci que quand on en parlera. Probablement on en parle déjà. Mais en tout cas, je désire que la publicité ne vienne pas de vous. On m’a promis de Paris une immense poputarité si je réussissais. Encore une fois, attendez qu’on en parle. Je ne sais pourquoi je vous répète cela.
J’ai dîné hier chez Sir Robert Peel, un dîner de Royal academy. Il y en avait un aussi chez Lord Lansdowne où j’aurais dû être aussi. Mais Peel avait eu la priorité. Je ne dînerai point chez les Philips. Je commence à supprimer quelques ennuis. Je me suis promené dans le parc de Greenwich. Je voulais retourner à Richmond. Mais je n’ai pas eu le temps.
Lundi 3 heures
Voici les renseignements les plus exacts et les plus complets. Alexandre continue d’aller bien. Chez lui, on dit et il dit lui-même, ce matin, qu’il partira dans huit jours pour Paris. J’ai envoyé Herbet, chez Brodie. Il l’a vu et à causé avec lui. Brodie trouve Alexandre bien, si bien a-t-il dit, qu’il n’ira pas le voir aujourd’hui. Mais à cette question d’Herbet: " Croyez-vous que le Prince Alexandre puisse partir dans huit jours ? " Brodie a répondu positivement; " He cannot. - Et dans quinze jours? Brodie a dit que c’était probable ; mais qu’en homme sensé, il ne voulait pas en répondre. Vous savez à présent le véritable état des choses. Il n’y a absolument aucun danger ; mais il faut du temps. Je n’ajoute rien. Décidez.
Je viens d’un grand meeting que devait présider Lord John Russel et où il a été remplacé pas Sir George Grey. Il a fallu comme de raison, y prendre la parole to second a motion. Il me semble que m’a popularité ne faiblit pas. J’ai reçu pour ce mois-ci quinze ou vingt invitations, à des meetings semblables. J’ai choisi les deux les plus considérables. Je n’irai qu’à ceux là.
J’irai peut-être dans deux heures à la Chambre des Lords où le Chancelier doit proposer un bill sur lequel parlera Lord Lyndhurst. On dit qu’on attend Lord Brougham le 23.
Votre "il ne peut pas" serait donc faux. No news. Si ce n’est que Palmella s’oppose à la demande Anglaise à Lisbonne. Mais on dit que ce pourrait bien être pour renverser le Cabinet portugais, et prendre sa place. Adieu.
J’approuve les changement à la lettre. Que j’ai de choses à vous dire ! Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Inquiétude, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Parcours politique, Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Réseau social et politique, Santé (enfant Benckendorff), Séjour à Londres (Dorothée)
371. Paris, Mardi 12 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
371. Paris, Mardi 12 mai 1840
Je pars après demain ; ayez la bonté de m’écrire un mot à Boulogne et en autre mot lendeman à Douvres. Dites-moi seulement comment est mon fils, mais dites le moi, non sur le dire d’un domestique ; mais du médecin. Je n’ai pas un instant de repos. Je suis malade moi même, je ne sais avec qui je pars. Je suis très malheureuse. Adieu.
Je pars après demain ; ayez la bonté de m’écrire un mot à Boulogne et en autre mot lendeman à Douvres. Dites-moi seulement comment est mon fils, mais dites le moi, non sur le dire d’un domestique ; mais du médecin. Je n’ai pas un instant de repos. Je suis malade moi même, je ne sais avec qui je pars. Je suis très malheureuse. Adieu.
[Monsieur Guizot Ambassadeur de France Manchester square Angleterre à Londres]
368. Paris, le 9 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
368. Paris, le 9 mai 1840,
10 heures
Je suis dans la plus gande impatience de l’arrivée de la poste. Vous étiez comme cela il y a quelque semaines vous savez ce que c’est d’attendre quand on a le cœur inquiet J’ai eu deux lettres dans le courant de la journée, d’un comte Esterhazy, camarade de mon fils, et de Beakhauser. Toutes les deux confirment le mieux dans son état. Mais l’accident a été bien bien grave, et je ne pense qu’à cela. Cette lettre de Brünnow hier matin m’a tellement saisi que j’en suis vraiment malade mes jambes m’ont manqué hier tout le jour, et cette nuit a été bien mauvaise. Il ne me faut pas de secousse, je n’ai plus de quoi les supporter. Je n’ai vu personne hier que Mad. Appony, Brignole, le prince Labanoff, et Pogenpohl. Celui-ci est le correspondant de Beakhausen. A propos mon fils demeure à Berkeley square, 2. Je ne puis vous parler que de lui. Il ne me sort pas de la tête.
J’ai envoyé hier ma lettre à lady Palmerston mais changée. Voyez tout ce qui vient après la première citation et sautez à " Il ne vaudrait pas la peine d’avoir de l’esprit ? " jusqu’à : " Et je passerai." Ensuite voici : " Mon importance politique est finie, je jouis des bénéfices de ma nullité, tant pis pour ceux qui ne veulent pas les reconnaître elle est cependant bien légitime. De grands malheurs et de grandes injustices ont établi mon indépendance." Après cela : " Je vais en Angleterre" & & Et j’ai inséré là : " Je ne retarderai pas mon arrivée pour les petites inquiétudes des petits diplomates." Il n’y a rien là qui puisse blesser lady Palmerston quoique sa lettre m’ait blessée.
J’ai écrit à la duchesse de Sutherland une lettre qui la met à son aise tout en lui prouvant que pour ma part je me serais crue bonne à faire partie de sa famille, tout juste dans un moment d’affliction.
2 heure
Dieu merci votre lettre me rassure, quelle providence que votre affection. Personne n’a songé à me dire un mot, le lendemain du jour où l’on m’allarme. Il faut absolement que je sache si la convalescence de mon fils sera longue. Car décidement si elle traînait, j’irais en Angleterre de suite. Vous me direz cela. J’ai répondu hier à M. de Brünnow en lui envoyant un petit mot pour mon fils. 5 heures. Le duc de Noailles est venu m’interrompre. J’ai à peine le temps de fermer ceci. Adieu. Adieu.
10 heures
Je suis dans la plus gande impatience de l’arrivée de la poste. Vous étiez comme cela il y a quelque semaines vous savez ce que c’est d’attendre quand on a le cœur inquiet J’ai eu deux lettres dans le courant de la journée, d’un comte Esterhazy, camarade de mon fils, et de Beakhauser. Toutes les deux confirment le mieux dans son état. Mais l’accident a été bien bien grave, et je ne pense qu’à cela. Cette lettre de Brünnow hier matin m’a tellement saisi que j’en suis vraiment malade mes jambes m’ont manqué hier tout le jour, et cette nuit a été bien mauvaise. Il ne me faut pas de secousse, je n’ai plus de quoi les supporter. Je n’ai vu personne hier que Mad. Appony, Brignole, le prince Labanoff, et Pogenpohl. Celui-ci est le correspondant de Beakhausen. A propos mon fils demeure à Berkeley square, 2. Je ne puis vous parler que de lui. Il ne me sort pas de la tête.
J’ai envoyé hier ma lettre à lady Palmerston mais changée. Voyez tout ce qui vient après la première citation et sautez à " Il ne vaudrait pas la peine d’avoir de l’esprit ? " jusqu’à : " Et je passerai." Ensuite voici : " Mon importance politique est finie, je jouis des bénéfices de ma nullité, tant pis pour ceux qui ne veulent pas les reconnaître elle est cependant bien légitime. De grands malheurs et de grandes injustices ont établi mon indépendance." Après cela : " Je vais en Angleterre" & & Et j’ai inséré là : " Je ne retarderai pas mon arrivée pour les petites inquiétudes des petits diplomates." Il n’y a rien là qui puisse blesser lady Palmerston quoique sa lettre m’ait blessée.
J’ai écrit à la duchesse de Sutherland une lettre qui la met à son aise tout en lui prouvant que pour ma part je me serais crue bonne à faire partie de sa famille, tout juste dans un moment d’affliction.
2 heure
Dieu merci votre lettre me rassure, quelle providence que votre affection. Personne n’a songé à me dire un mot, le lendemain du jour où l’on m’allarme. Il faut absolement que je sache si la convalescence de mon fils sera longue. Car décidement si elle traînait, j’irais en Angleterre de suite. Vous me direz cela. J’ai répondu hier à M. de Brünnow en lui envoyant un petit mot pour mon fils. 5 heures. Le duc de Noailles est venu m’interrompre. J’ai à peine le temps de fermer ceci. Adieu. Adieu.
366. Paris, Jeudi 7 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
366. Paris, Jeudi le 7 de mai 1840
10h 1/2
Lady Pembroke a passé ici quelque jours. Je l’ai vue tous les jours, c’est une de mes plus veilles connaissances. Elle est répartie ce matin, pour Londres. Je vous dis cela parce que je crois avoir oublie de vous la nommer dans mes lettres et Je vous dois compte de toutes les minuties.
J’ai été chez Lady Granville et la petite princesse hier. Lord Granville est toujours couché, je ne l’ai pas vu. M. Thiers va le voir tous les jours. Bulwer, est venu assister à mon dîner, il est un peu mieux, mais il marche toujours sur des béquilles. Le soir mon ambassadeur, le duc de Poix, Caraffa, Hatzfeld, les ducs Kielmansegge. Le Roi de Hanôvre m’écrit, et me demande des lettres.
M. de Pahlen revenait de la cour. Il avait trouvé le roi tout seul, qui l’a retenu pendant plus d’une heure. Point de nouvelles.
Midi.
Voici votre lettre à l’heure où je vous écris, vous avez reçu ce que je vous ai envoyé par Ellice et vous avez l’explication de la sollicitude de Lady Palmerston, et de l’incertitude titude sur Stafford house. Rien ne me serait plus déplaisant (à part vous) que de ne point aller en Angleterre après ce qu’on vient de m’écrire. Faire la volonté, la fantaisie de ces petite diplomate ! Voyez-vous cette idée m’irrite, et me ferait partir demain, comme je crois vous l’avoir déjà dit. Ainsi qu’on trâme pour que les Sutherland ne me reçoivent pas, cela m’est parfaitement indifférent. j’irai à l’auberge à Londres, hors de Londres. C’est égal. Je ne vois qu’une seule raison qui puisse me faire renoncer à y aller, une suule c’est si vous me priez de ne pas venir, si vous y voyez de l’inconvénient pour vous. Répondez- moi à cela. Je m’indigne quand je pense qu’une pitoyable intrigue, de pitoyables gens puissent contrarier une seule des fantaisies de deux êtres comme vous et moi et ici ce n’et pas une fantaisie c’est du bonheur, un immense bonheur ! Répondez-vite, il me semble que je ne puis pas douter de votre réponse. Envoyez regarder à Blackheath, c’est assez bien comme distance. Il ne reste aucun doute dans mon esprit sur l’auteur de toute cette intrigue pour m’empêcher de venir, relisez bien les paroles, que m’écrit alexandre, et voyez les dates. Sa lettre et celle de Lady Palmerston sont du même jour, le 1 mai. Je me trompe celle d’Alexandre est du 2. Son entretien avec Brünnow dont il me rend compte a eu lieu le 29. C’est Brünnow que mon arrivée dérange. C’est Brünnow qui remue tout pour l’empêcher. Ne vous trouveriez vous pas bien sot de faire la volonté de Brünnow.
Je cherche à comprendre, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Ce que je comprends bien moins est comment Lady Palmerston se laisse entraîner. Mais enfin n’y songeons plus. Je suis très résolue et j’irai à moins que vous me disiez non. Je vous prie de ne pas me dire non. Adieu. Adieu.
Il pleut, tout le monde en est réjoui. S’il pleut aussi longtemps qu’il a fait beau. Il y aura de quoi se pendre. Adieu. Adieu. Je suis impatient de votre réponse, Adieu. Kielmansegge disait hier avec autorité : "Il y aura la dissolution" d’un ton sans appel. Adieu.
Je viens de recopier ma lettre à Lady Palmerston afin de pouvoir vous envoyer la minute. Je l’ai écrite telle que vous voyez les corrections. Elle partira demain, elle ne la recevra donc que dimanche ou lundi matin. Vous l’aurez Samedi. Dites-moi si c’est bien. J’ai vouliu dire aussi la vérité sur Ellice, car je trouve qu’on est bien dur pour lui. Granville ne pense pas très bien.
Adieu encore car c’est par ce mot qu’il faut toujours finir. Adieu. Je n’ai pas voulu attendre votre réponse qui ne peut venir que samedi car au fond ce que je dis là, je l’aurais dit dans tous les cas. Adieu.
10h 1/2
Lady Pembroke a passé ici quelque jours. Je l’ai vue tous les jours, c’est une de mes plus veilles connaissances. Elle est répartie ce matin, pour Londres. Je vous dis cela parce que je crois avoir oublie de vous la nommer dans mes lettres et Je vous dois compte de toutes les minuties.
J’ai été chez Lady Granville et la petite princesse hier. Lord Granville est toujours couché, je ne l’ai pas vu. M. Thiers va le voir tous les jours. Bulwer, est venu assister à mon dîner, il est un peu mieux, mais il marche toujours sur des béquilles. Le soir mon ambassadeur, le duc de Poix, Caraffa, Hatzfeld, les ducs Kielmansegge. Le Roi de Hanôvre m’écrit, et me demande des lettres.
M. de Pahlen revenait de la cour. Il avait trouvé le roi tout seul, qui l’a retenu pendant plus d’une heure. Point de nouvelles.
Midi.
Voici votre lettre à l’heure où je vous écris, vous avez reçu ce que je vous ai envoyé par Ellice et vous avez l’explication de la sollicitude de Lady Palmerston, et de l’incertitude titude sur Stafford house. Rien ne me serait plus déplaisant (à part vous) que de ne point aller en Angleterre après ce qu’on vient de m’écrire. Faire la volonté, la fantaisie de ces petite diplomate ! Voyez-vous cette idée m’irrite, et me ferait partir demain, comme je crois vous l’avoir déjà dit. Ainsi qu’on trâme pour que les Sutherland ne me reçoivent pas, cela m’est parfaitement indifférent. j’irai à l’auberge à Londres, hors de Londres. C’est égal. Je ne vois qu’une seule raison qui puisse me faire renoncer à y aller, une suule c’est si vous me priez de ne pas venir, si vous y voyez de l’inconvénient pour vous. Répondez- moi à cela. Je m’indigne quand je pense qu’une pitoyable intrigue, de pitoyables gens puissent contrarier une seule des fantaisies de deux êtres comme vous et moi et ici ce n’et pas une fantaisie c’est du bonheur, un immense bonheur ! Répondez-vite, il me semble que je ne puis pas douter de votre réponse. Envoyez regarder à Blackheath, c’est assez bien comme distance. Il ne reste aucun doute dans mon esprit sur l’auteur de toute cette intrigue pour m’empêcher de venir, relisez bien les paroles, que m’écrit alexandre, et voyez les dates. Sa lettre et celle de Lady Palmerston sont du même jour, le 1 mai. Je me trompe celle d’Alexandre est du 2. Son entretien avec Brünnow dont il me rend compte a eu lieu le 29. C’est Brünnow que mon arrivée dérange. C’est Brünnow qui remue tout pour l’empêcher. Ne vous trouveriez vous pas bien sot de faire la volonté de Brünnow.
Je cherche à comprendre, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Ce que je comprends bien moins est comment Lady Palmerston se laisse entraîner. Mais enfin n’y songeons plus. Je suis très résolue et j’irai à moins que vous me disiez non. Je vous prie de ne pas me dire non. Adieu. Adieu.
Il pleut, tout le monde en est réjoui. S’il pleut aussi longtemps qu’il a fait beau. Il y aura de quoi se pendre. Adieu. Adieu. Je suis impatient de votre réponse, Adieu. Kielmansegge disait hier avec autorité : "Il y aura la dissolution" d’un ton sans appel. Adieu.
Je viens de recopier ma lettre à Lady Palmerston afin de pouvoir vous envoyer la minute. Je l’ai écrite telle que vous voyez les corrections. Elle partira demain, elle ne la recevra donc que dimanche ou lundi matin. Vous l’aurez Samedi. Dites-moi si c’est bien. J’ai vouliu dire aussi la vérité sur Ellice, car je trouve qu’on est bien dur pour lui. Granville ne pense pas très bien.
Adieu encore car c’est par ce mot qu’il faut toujours finir. Adieu. Je n’ai pas voulu attendre votre réponse qui ne peut venir que samedi car au fond ce que je dis là, je l’aurais dit dans tous les cas. Adieu.
361. Londres, Jeudi 7 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
361. Londres, Jeudi 7 mai 1840
11 heures
Alexandre va bien. J’y ai passé moi-même hier, à 7 heures et demie. On m’en a donné de bonnes nouvelles. Je viens d’y envoyer, et on me fait dire qu’il dort, qu’il a passé une bonne nuit, que tout est au mieux. J’espère que vous serez tranquille. Mais cela retardera certainement son retour vers vous. Quelle fièvre que la vie! Je répète toujours la même chose et il me semble que je l’apprends tous les jours. C’est en descendant l’escalier de S. James, après le lever de la Reine, que j’ai appris l’accident de votre fils, et je me suis senti, pour votre compte, comme je l’étais pour le mien propre, il y a trois semaines. Quand nous reposerons-nous ? Un des amis du grand Janséniste Antoine Arnauld l’engageait à ne pas tant travailler, à se reposer : « Non. Non, n’aurons-nous pas l’étermité pour nous reposer ? " Je l’espère bien. Ellice n’était pas arrivé hier soir. J’en suis très impatient. Mais j’entrevois, par une convenable, pote phrase du 363 ce dont il s’agit. Cela se rapporte à quelques insinuations que m’a faites, l’autre jour Lady Palmerston. Ils ont donc bien peur de vous voir ici. Cela me parait pitoyable. Faites comme vous dîtes.
Je vous quitte pour aller déjeuner chez un chanoine de Westminster Abbey, avec Lord Mahon, Lord Littleton et M. Macaulay. Ils prennent plaisir à me montrer les tombeaux de leurs grands hommes et à m’en parler.
3 heures
Ellice sort d’ici, arrivé tout à l’heure. J’avais deviné juste. Il paraît qu’un grand Empire et trois royaumes ont peur que nous n’ayons, à nous deux, plus d’esprit qu’il ne leur faut. Je ne peux pas imaginer une autre raison.
Vous deviez venir ici bien avant qu’il fût question que j’y vinsse. Vous aviez amorcé votre voyage pour les premiers jours de juin. Vous ne l’avez pas avancé parce que je suis venu ; au contraire, vous le retardez plutôt de quelques jours. Je suis ici depuis trois mois. Ma position est prise avec tout le monde. Elle est aujourd’hui avec M. de Brünnow, ce qu’elle restera, parfaitement convenable, polie, régulière. Quelle différence y aura-t-il entre le mois de Juin et le mois de Juillet ? C’est puérile, si ce n’est pas fin. Et si c’est fin, ce n’est pas assez fin. Je dis donc comme vous, et j’espère que vous ferez comme vous dites. En vérité, les grandes entraves de la vie sont déja bien lourdes ; si on se charge encore des petites, il n’y a pas moyen.
Je viens de causer un moment avec Ellice ; bien court. Bülow est entré. Nous ous reprendrons. Certainement, il est très bon homme et très spirituel ; un peu affairé, un peu important, un peu remuant, comme les oisifs actifs. Mais on n’a qu’à ne pas se laisser faire par lui. J’admire toujours les gens qui ne veulent pas qu’on sente les mérites, et qu’on en profite, et qu’on en jouisse, parce qu’il y a quelques inconvénients dont il faut prendre la peine de se garder.
4 heures 1/4
Encore une interruption de M. Murray pour la cuisine de la Reine. On me porte une grande confiance, en ce genre. J’ai encore deux lettres à écrire. Adieu. Comme dans le 363 ; toute la page. Je suis charmé que vous approuviez ce que vous avez vu. J’y comptais. Mais j’ai bien peur que ma situation ne devienne pressante. Et je n’ai pas envie d’être pressé. Adieu. La page n’est pas pleine.
Je vous quitte pour aller déjeuner chez un chanoine de Westminster Abbey, avec Lord Mahon, Lord Littleton et M. Macaulay. Ils prennent plaisir à me montrer les tombeaux de leurs grands hommes et à m’en parler.
3 heures
Ellice sort d’ici, arrivé tout à l’heure. J’avais deviné juste. Il paraît qu’un grand Empire et trois royaumes ont peur que nous n’ayons, à nous deux, plus d’esprit qu’il ne leur faut. Je ne peux pas imaginer une autre raison.
Vous deviez venir ici bien avant qu’il fût question que j’y vinsse. Vous aviez amorcé votre voyage pour les premiers jours de juin. Vous ne l’avez pas avancé parce que je suis venu ; au contraire, vous le retardez plutôt de quelques jours. Je suis ici depuis trois mois. Ma position est prise avec tout le monde. Elle est aujourd’hui avec M. de Brünnow, ce qu’elle restera, parfaitement convenable, polie, régulière. Quelle différence y aura-t-il entre le mois de Juin et le mois de Juillet ? C’est puérile, si ce n’est pas fin. Et si c’est fin, ce n’est pas assez fin. Je dis donc comme vous, et j’espère que vous ferez comme vous dites. En vérité, les grandes entraves de la vie sont déja bien lourdes ; si on se charge encore des petites, il n’y a pas moyen.
Je viens de causer un moment avec Ellice ; bien court. Bülow est entré. Nous ous reprendrons. Certainement, il est très bon homme et très spirituel ; un peu affairé, un peu important, un peu remuant, comme les oisifs actifs. Mais on n’a qu’à ne pas se laisser faire par lui. J’admire toujours les gens qui ne veulent pas qu’on sente les mérites, et qu’on en profite, et qu’on en jouisse, parce qu’il y a quelques inconvénients dont il faut prendre la peine de se garder.
4 heures 1/4
Encore une interruption de M. Murray pour la cuisine de la Reine. On me porte une grande confiance, en ce genre. J’ai encore deux lettres à écrire. Adieu. Comme dans le 363 ; toute la page. Je suis charmé que vous approuviez ce que vous avez vu. J’y comptais. Mais j’ai bien peur que ma situation ne devienne pressante. Et je n’ai pas envie d’être pressé. Adieu. La page n’est pas pleine.
364. Paris, Mardi 5 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
364. Paris, mardi 5 mai 1840
10 heures
Je vous prie de me répondre sur le sujet des copies que je vous ai envoyées par Ellice. Je trouve cela parfaitement maladoit dans la forme et pitoyable pour le fond. Encore. une fois, soyez bien sûr que cela ne me dérangera pas, je serais même tentée d’ajouter au contraire, et s’il n’y avait du ridicule, je partirais plutot demain que dans un mois. Mais je vous prie de me parler de cela, je voudrais quelques bonnes petites phrases pour y répondre. J’ai encore vu Ellice hier longuement. J’ai fait ma promenade, mon dîner seule. Le soir les deux Pahlen, Arnim, les Durazzo, les Valambrozo, quelques autres. Mais savez-vous que tout ce monde m’occupe, vous ne savez pas comme le soir m’ennuie depuis le 24 février ! Mon fils me revient à la fin de la semaine et restera avec moi à peu près. jusqu’à mon départ.
1 heure
J’ai fait ma promenade et j’ai vu Chermside. Je suis mieux depuis qu’il m’a reprise. J’ai lu ce matin des vers charmants de Victor Hugo dans le feuilleton du journal des Débats, lisez cela. Il y a une strophe qui m’a beaucoup frappée surtout. Le dernier vers est je crois ceci.
Tout commence ici bas; et tout finit ailleurs.
Je ne vous ai pas assez dit combien je suis contente de ce que m’a montré Génie hier. Je suis contente du présent et contente de l’avenir. Vous avez mille fois raison. Que de choses à nous dire.
J’ai été dire adieu à mad. Talleyrand hier, elle part demain. Elle va droit à Berlin. se plonger dans les royautés Je crois qu’elle y trouvera l’Empératrice aussi. Le Roi de Hanovre m’a mandé que le roi de Prusse est faible et ne veut pas. bouger de Postdam. Toute la Prusse est convaincue qu’il doit mourir cette année. Il me semble que l’affaire Naples va bien, j’en suis charmée. Le temps est convert aujourd’hui. Je voudrais de la pluie, je me sens les poumons desséchés de cette chaleur. Adieu, j’ai écrit une longue lettre à Matonchewitz ce matin. il faut encore expédier le Hanôvre.
On dit que Brougham ne retournera pas en Angleterre, et qu’il ne peut pas y retourner. Adieu. Adieu. As much as you like.
10 heures
Je vous prie de me répondre sur le sujet des copies que je vous ai envoyées par Ellice. Je trouve cela parfaitement maladoit dans la forme et pitoyable pour le fond. Encore. une fois, soyez bien sûr que cela ne me dérangera pas, je serais même tentée d’ajouter au contraire, et s’il n’y avait du ridicule, je partirais plutot demain que dans un mois. Mais je vous prie de me parler de cela, je voudrais quelques bonnes petites phrases pour y répondre. J’ai encore vu Ellice hier longuement. J’ai fait ma promenade, mon dîner seule. Le soir les deux Pahlen, Arnim, les Durazzo, les Valambrozo, quelques autres. Mais savez-vous que tout ce monde m’occupe, vous ne savez pas comme le soir m’ennuie depuis le 24 février ! Mon fils me revient à la fin de la semaine et restera avec moi à peu près. jusqu’à mon départ.
1 heure
J’ai fait ma promenade et j’ai vu Chermside. Je suis mieux depuis qu’il m’a reprise. J’ai lu ce matin des vers charmants de Victor Hugo dans le feuilleton du journal des Débats, lisez cela. Il y a une strophe qui m’a beaucoup frappée surtout. Le dernier vers est je crois ceci.
Tout commence ici bas; et tout finit ailleurs.
Je ne vous ai pas assez dit combien je suis contente de ce que m’a montré Génie hier. Je suis contente du présent et contente de l’avenir. Vous avez mille fois raison. Que de choses à nous dire.
J’ai été dire adieu à mad. Talleyrand hier, elle part demain. Elle va droit à Berlin. se plonger dans les royautés Je crois qu’elle y trouvera l’Empératrice aussi. Le Roi de Hanovre m’a mandé que le roi de Prusse est faible et ne veut pas. bouger de Postdam. Toute la Prusse est convaincue qu’il doit mourir cette année. Il me semble que l’affaire Naples va bien, j’en suis charmée. Le temps est convert aujourd’hui. Je voudrais de la pluie, je me sens les poumons desséchés de cette chaleur. Adieu, j’ai écrit une longue lettre à Matonchewitz ce matin. il faut encore expédier le Hanôvre.
On dit que Brougham ne retournera pas en Angleterre, et qu’il ne peut pas y retourner. Adieu. Adieu. As much as you like.
359. Londres, Mardi 5 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
359. Londres, Mardi 5 mai 1840
9 heures
Lady Palmerston m’a parlé hier de votre voyage. Elle vous attendait pour le 15 juin. C’est sans doute ce que vous lui avez dit. Mais elle a de l’incertitude sur les dispositions des Sutherland. Elle craint qu’ils ne veuillent être seuls assez longtemps. Ils sont désolés. Le Duc n’a encore vu personne. De plus on lui a dit (à Lady Palmerston) que Lord Burlington devait revenir avec eux à Stafford house et y rester quelque temps. Tout cela me préoccupe beaucoup. Que ferez vous ! Quand viendrez-vous ? Où serez vous? On me dit qu’il y a un très bon et très agréable hôtel, à Blackheath, plus près que le Park-hôtel de Norwood. J’y enverrai M. Herbet, après-demain. Mais cela ne serait bon que pour quinze jours ou trois semaines, en attendant que Stafford-House, vous fût ouvert. Quand vous recommencerez à voir Lady Granville, vous saurez quelque chose de plus. Je suis dans une grande perplexité. Mon désir de vous voir, de vous avoir ici, est extrême, bien plus profond, bien plus de tous les instants que je ne saurais le dire. Et ma crainte que, venue ici, vous n’y soyez pas bien, pas assez commodément, pas assez agréablement, est grande aussi. Mon affection pour vous est pleine de sollicitude, et de complaisance. Je voudrais rendre l’air constamment doux sur votre tête, la terre parfaitement unie sous vos pieds. Je me sens près de m’attendrir en pensant à vous, comme à ma petite fille malade.
Je suis seul, très seul, et au fond très triste d’être seul ; personne ne sait à quel point ce que je supporte me pèse. Mais je pense comme Orosmane, et je ne veux pas que, pour venir ici, ou quand vous serez ici : Il en coûte un souper qui ne soit pas pour moi.
En attendant pensez bien, regardez bien, je vous prie, à l’état des affaires. Il m’inquiète et chaque jour davantage. Les éléments de la situation ont été mis sous vos yeux. En
apparence et en elles-mêmes, toutes les questions sur le tapis sont misérables. Mais elles couvrent la dissolution, à laquelle si rien ne change la pente on peut être fatalement poussé. Or la dissolution au milieu de ce qui se passe, sous l’influence de la gauche prépondérante. C’est un mal et un
danger que personne ne saurait mesurer. Rappelez-vous sous quels auspices le cabinet s’est formé dans ses rapports avec moi : "Point de réforme, point de dissolution." Ce sont les paroles qu’ils m’ont écrites et dont j’ai pris acte. On m’écrit beaucoup, dans des sens fort contraires. Mais ce qu’on m’écrit m’importe assez peu, ce sont les faits qui me frappent. On ne me précipitera pas dans la réforme et la dissolution, je le sais très bien. Je ne veux pas qu’on my fasse glisser. Je ne veux pas me tromper sur le moment de reprendre le gouvernement de mon parti. Je ne veux pas non plus le laisser échapper. Mon honneur y est engagé comme le bien de mon pays. Encore une fois regardez bien à tout. Faites venir Génie. Causez à fond avec lui. Il est fort au courant et plein de sens. Pour les choses même pour moi, pour tout, ce qui vaut le mieux ce que je désire c’est que mon séjour ici se prolonge, se développe. J’y grandis pendant que mon avenir se prépare ailleurs. Je tiendrai donc ici jusqu’à la dernière extrémité. Mais il ne faut pas dépasser la dernière extremité.
4 heures
Vous êtes aussi dans l’incertitude. Vous me promettez positivement le 15 juin, et probablement plutôt. J’attendrai désormais toutes les lettres avec un redoublement d’impatience. J’ai été hier chez Lord Grey, pour lui et pour Lady Grey. Je sais déjà qu’il en a été charmé. Il le désirait beaucoup. Il passe chez lui presque toutes les matinées à compter les gens qui viennent et ceux qui ne viennent pas. Je ne l’ai pourtant pas rencontré. Il est venu chez moi ce matin. J’étais sorti un moment pour mener M. Lenormant voir les tableaux de Sir Robert Peel. Je dîne Jeudi à Holland house, samedi chez Peel, le 16 chez Sir Gore Ouseley, le 17 chez lord Minto. Qu’est-ce que Sir George et Lady Philips qui m’invitent à dîner pour le 14 ?
J’ai bien envie de refuser. Hier soir un bon concert chez Mad. Montofiore, les Juifs. Ce soir, un bal chez la Comtesse de Falmouth. Lady Jersey me presse d’y aller. Lady Jersey
m’accaparerait volontiers. Elle est exigeante. Elle me fait la mine quand je ne vais pas chez elle assez souvent. Mais j’ai un grand courage contre les indifferents.
Adieu. J’ai une dépêche à écrire. Si je ne me trompe le médiation marchera à travers ses embarras. Les affaires qui commencent ne peuvent pas être finies. Les hommes sont paresseux et pressés. Ils veulent être arrivés et ne pas prendre la peine de marcher. Adieu. Adieu. Promenez-vous beaucoup. Je crois que le temps va changer ici. Je suis à Londres depuis plus de deux mois. Je n’ai encore vu pleuvoir que deux fois tout le monde dit que c’est inouï. Adieu.
363. Paris, Lundi 4 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
363. Paris, Lundi 4 mai 1840,
10 heures
Je viens de vous écrire par Ellice. Vous avez cette lettre là quelques heures après la présente. Les Appony m’ont fait une longue visite hier et puis le prince Paul, et puis Ellice que j’ai mené au bois de Boulogne pour causer. Malgré les assurances d’Appony que Naples restera tranquille on commence à craindre des soulèvements. Quelle énorme complication, si cela arrivait. On dit que vous venez de découvrir un complot trâmé à Bourges. pour empoisonner la petite reine d’Espagne et sa soeur. Quelle horreur ! Le prince Paul croit fermement que la proposition Rémilly sera discutée dans cette session même. L’autre jour chez Mad. de la Redorte où je faisais visite, M. de la Redorte disait non, et M. Piscatory soutenait oui. Vous le saurez mieux. J’ai dîné seule ; après le dîner pluis allée faire ma cour aux Tuileries pour la fête du Roi, mais tout le monde était à Versailles. J’ai été chez Lady Granville que j’ai revue pour la première fois depuis la mort de lady Burlington. Granville est couché, il a la goutte, Ensuite je suis allée courir après les rossignols chez Mad. Locke. Vraiment ces Belgioioso, c’est charmant, et je vais partout où je puis les entendre. Au fond la passion de la musique me revient.
A propos la petite de Contades est fort éprise de l’un de ces rossignols, le plus gros. Elle est une petite personne un peu étrange. à onze heures j’étais dans mon lit, mais la chaleur m’ote le sommeil depuis quelques jours.
2 heures
Vraiment je suis bien fatiguée. Je vous écris, j’éris à mon fils, j’ai eu une longue séance avec votre petit ami. J’ai répondu à Alexandre ceci. " M. de Brünnow ne m’empichèra pas de faire ce qui me plait. Je ne reconnais ce droit à personne." Ma lettre adressée à Ashbrurnham house. Je vois que ceci figurerait mieux dans une lettre que vous porte Ellice. Mais elle est déjà fermée. Je viens de recevoir 357. Cela me servira jusqu’après demain. Si vous saviez l’horreur que j’ai du mardi ! J’ai envie de remplir toute cette page d’adieux. Vous seriez bien content de moi si vous saviez tout ce qui se passe en moi. Adieu. Adieu. Je viens de vous envoyer la lettre de Metternich par votre bureau. Adieu.
10 heures
Je viens de vous écrire par Ellice. Vous avez cette lettre là quelques heures après la présente. Les Appony m’ont fait une longue visite hier et puis le prince Paul, et puis Ellice que j’ai mené au bois de Boulogne pour causer. Malgré les assurances d’Appony que Naples restera tranquille on commence à craindre des soulèvements. Quelle énorme complication, si cela arrivait. On dit que vous venez de découvrir un complot trâmé à Bourges. pour empoisonner la petite reine d’Espagne et sa soeur. Quelle horreur ! Le prince Paul croit fermement que la proposition Rémilly sera discutée dans cette session même. L’autre jour chez Mad. de la Redorte où je faisais visite, M. de la Redorte disait non, et M. Piscatory soutenait oui. Vous le saurez mieux. J’ai dîné seule ; après le dîner pluis allée faire ma cour aux Tuileries pour la fête du Roi, mais tout le monde était à Versailles. J’ai été chez Lady Granville que j’ai revue pour la première fois depuis la mort de lady Burlington. Granville est couché, il a la goutte, Ensuite je suis allée courir après les rossignols chez Mad. Locke. Vraiment ces Belgioioso, c’est charmant, et je vais partout où je puis les entendre. Au fond la passion de la musique me revient.
A propos la petite de Contades est fort éprise de l’un de ces rossignols, le plus gros. Elle est une petite personne un peu étrange. à onze heures j’étais dans mon lit, mais la chaleur m’ote le sommeil depuis quelques jours.
2 heures
Vraiment je suis bien fatiguée. Je vous écris, j’éris à mon fils, j’ai eu une longue séance avec votre petit ami. J’ai répondu à Alexandre ceci. " M. de Brünnow ne m’empichèra pas de faire ce qui me plait. Je ne reconnais ce droit à personne." Ma lettre adressée à Ashbrurnham house. Je vois que ceci figurerait mieux dans une lettre que vous porte Ellice. Mais elle est déjà fermée. Je viens de recevoir 357. Cela me servira jusqu’après demain. Si vous saviez l’horreur que j’ai du mardi ! J’ai envie de remplir toute cette page d’adieux. Vous seriez bien content de moi si vous saviez tout ce qui se passe en moi. Adieu. Adieu. Je viens de vous envoyer la lettre de Metternich par votre bureau. Adieu.
361. Paris, Dimanche 3 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
361. Paris, dimanche le 8 de mai 1840
J’ai fait ma promenade hier avec Ellice, mon dîner seule. Le soir il y avait musique chez Mad. de Castellane ; j’y ai été. C’était charmant. Quand je dis musique c’est toujours les Belgioioso, ni plus, ni moins, mais il est impossible que ce soit mieux. On parlait beaucoup hier au soir d’une lettre circulaire de M. Jaubert aux membres conservateurs de la Chambre pour leur dire que le ministère voulait étouffer la proposition, Rémilly. Cela faisait faire mille commentaires. Là où je me trouvais ils n’’étaient point bienveillant. Appony est toujours d’une humeur de dogue. Mon ambassadeur est silencieux comme de coutume. Appony dit que l’irritation du roi de Naples contre Lord Palmerston est toujours bien vive, et qu’elle rendra l’effet de la médiation bien difficile et bien lent. Mad. la duchesse d’Orléans a la rougeole, mais bénine. On la dit en général cependant dans un triste état. Il y a bien des mois. qu’elle ne prend presque plus d’aliment. Elle dépérit. Le chancelier hier était bien important et Mad.de Boigne très jolie, vraiment jolie, c’est drôle !
10 h. Voici votre lettre. je suis bien aise de vous voir enfin dans de bons rapports avec Brünnow. Je suis sure que vous lui direz des choses utiles, mais je suis tout aussi sure qu’il ne rapportera que ce qui peut flatter. Vous êtes donc entré dans est Ashburnham house, dont le nom seul me cause une émotion de joie et de douleur que je ne saurais décrire. Je crois. que je mourrais en passant le seuil de cette porte. Je pense bien à mon voyage. Mais je suis très peu fixé encore sur la manière dont je serai Londres. Il est convenu que je logerai chez les Sutherland ; s’il y avait un changement il me semble qu’il doit venir de leur part, car je ne saurais leur montrer moins de désir d’être avec eux aujourd’hui qu’ils sont dans l’affliction, au contraire cependant il est très possible. que de leur côté ils préfèrent ne voir personne. Je ne sais vraiment comment arranger cela dans ma tête. J’attendrai un peu, je verrai au bout du compte, où trouver toujours deux chambres dans une auberge. Cela me sera désagréable, mais il n’y aurait pas de choix. Soyez sur que nous serons ensemble Le 15 de juin, mais probablement avant.
midi. Je rentre de ma première promenade. J’en fais trois quand je le peux, à dix heures. Après 4 heures et après mon dîner. Que j’aime vos lettres. Adieu Adieu. Adieu.
J’ai fait ma promenade hier avec Ellice, mon dîner seule. Le soir il y avait musique chez Mad. de Castellane ; j’y ai été. C’était charmant. Quand je dis musique c’est toujours les Belgioioso, ni plus, ni moins, mais il est impossible que ce soit mieux. On parlait beaucoup hier au soir d’une lettre circulaire de M. Jaubert aux membres conservateurs de la Chambre pour leur dire que le ministère voulait étouffer la proposition, Rémilly. Cela faisait faire mille commentaires. Là où je me trouvais ils n’’étaient point bienveillant. Appony est toujours d’une humeur de dogue. Mon ambassadeur est silencieux comme de coutume. Appony dit que l’irritation du roi de Naples contre Lord Palmerston est toujours bien vive, et qu’elle rendra l’effet de la médiation bien difficile et bien lent. Mad. la duchesse d’Orléans a la rougeole, mais bénine. On la dit en général cependant dans un triste état. Il y a bien des mois. qu’elle ne prend presque plus d’aliment. Elle dépérit. Le chancelier hier était bien important et Mad.de Boigne très jolie, vraiment jolie, c’est drôle !
10 h. Voici votre lettre. je suis bien aise de vous voir enfin dans de bons rapports avec Brünnow. Je suis sure que vous lui direz des choses utiles, mais je suis tout aussi sure qu’il ne rapportera que ce qui peut flatter. Vous êtes donc entré dans est Ashburnham house, dont le nom seul me cause une émotion de joie et de douleur que je ne saurais décrire. Je crois. que je mourrais en passant le seuil de cette porte. Je pense bien à mon voyage. Mais je suis très peu fixé encore sur la manière dont je serai Londres. Il est convenu que je logerai chez les Sutherland ; s’il y avait un changement il me semble qu’il doit venir de leur part, car je ne saurais leur montrer moins de désir d’être avec eux aujourd’hui qu’ils sont dans l’affliction, au contraire cependant il est très possible. que de leur côté ils préfèrent ne voir personne. Je ne sais vraiment comment arranger cela dans ma tête. J’attendrai un peu, je verrai au bout du compte, où trouver toujours deux chambres dans une auberge. Cela me sera désagréable, mais il n’y aurait pas de choix. Soyez sur que nous serons ensemble Le 15 de juin, mais probablement avant.
midi. Je rentre de ma première promenade. J’en fais trois quand je le peux, à dix heures. Après 4 heures et après mon dîner. Que j’aime vos lettres. Adieu Adieu. Adieu.
352. Londres, Dimanche 26 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
352. Londres, Dimanche 26 avril 1840 966
Une heure
J’espère que ma lettre vous sera arrivée hier d’assez bonne heure pour vous en servir. Il m’avait été absolument impossible de vous écrire la veille. Les Ministres ne sont pas venus au diner de la Cité parce qu’ils y avaient été très mal reçus la dernière fois, sifflés à la lettre. Lord Melbourne, s’en était très bien tiré, très dignement. Mais ils ne se sont pas souciés de recommencer. Lord Palmerston à qui le matin même, j’avais dit en passant que j’irais, me répondit qu’ils n’iraient pas, et pourquoi. Un motif accidentel de plus. Les Shériffs que la Chambre avait mis en prison, et qui venaient d’être mis en liberté devaient être au dîner, et y étaient en effet. Le Lord Maire a porté leur santé et protesté contre leur emprisonnement. Tout cela faisait bien des petits embarras. Du reste, la santé des ministres a été portée et acceptée avec une froideur décente. Leur absence a été remarquée, mais sans étonnement. Les représentants de la cité au Parlement radicaux n’y étaient pas non plus et n’auraient pas été mieux reçus. La Cité est partagée en Torys en haut, radicaux en bas.
Les Ministres prendront leur revanche, le 2 Mai, at the Royal academy. Encore un speech. J’y ai quelque regret. Pas pour moi ; peu m’importe un speech de plus au de moins. Mais cela fait bien des speech et bien rapproches. Il y a quelque inconvénient à occuper si fréquemment de soi, sous la même forme. Ceci n’est pas ma faute, et il n’y a pas moyen de l’éviter. Je vais aujourd’hui au sermon à St Paul. L’évêque de Landaff m’attend at the deanery. C’est un excellent homme d’une modestie touchante. Je suis très frappé de la vanité anglaise ; je le suis autant de la modestie anglaise. On la rencontre souvent et si simple si douce ! C’est un très agréable spectacle. Je me prends sur le champ d’amitié pour ces vertus qui s’ignorent et s’étonnent qu’on ne les ignore pas. Cette lettre-ci vous sera portée par mon petit médécin, M. Béhier. Il me servira quelquefois de commissionnaire. Recevez le avec bonté. Il vous demandera quel jour vous voulez voir, M. Andral, et se chargera d’arranger le rendez-vous de façon à ce qu’il ne manque pas. J’écris à ma mère sur le voyage. Je lui dis toutes mes raisons. Je lui donne l’espérance, dune course de huit jours au Val-Richer, par le Havre et Honfleur, dans le cours de l’été. J’espère qu’elle ne se troublera pas trop de la perspective d’une responsabilité solitaire, ainsi prolongée. Je sais qu’elle se troublait un peu de la perspective du voyage. Mais un trouble n’en exclut pas un autre.
Lundi, 9 heures
Pitoyable sermon de mon ami l’évêque de Landaff. Mais j’ai trouvé le grand office Anglican très beau, quoiqu’un peu bâtard, entre Rome et Genève. Beaucoup de musique et assez bonne. On avait quelque envie de me faire une réception officielle solennelle en hommage au premier successeur de Sully. L’évêque me l’avait insinué. Je m’y suis refusé. Je n’aime pas l’étalage des grandeurs Humaines dans ce lieu-là. Et puis il m’a semblé de meilleur goût d’entrer tout simplement avec l’Evêque et d’aller m’asseoir à côté de lui. Ma modestie n’a eu d’autre effet que de se faire remarquer elle même. A peine entrés, on nous a aperçus, reconnus ; la foule s’est rangée, et nous avons traversé l’Eglise entre deux haies de fideles curieux et respectueux. Convenez que je vous raconte tout.
Le soir à Holland house. Brünnow y est venu. Il était assis à côté de Lord Holland, moi à côté de Lady Holland, trois ou quatre personnes autour Bülow, Rogers M. Suttrel. Il s’adresse à moi : « J’ai une grande joie ; je suis bien bien heureux ; j’apprends que le Grand Duc a demandé lui-même en mariage la princesse de Hesse.
Lady Holland se penche vers moi : " Il y a trois mois que cela est dans les gazettes. " Sur quoi, Brünnnow nous explique comment l’Empereur a voulu que le mariage ne se fit que quand il serait un mariage d’inclination. Et il était aussi joyeux que s’il eût épousé lui-même. Vient le nom de M. de Pahlen dont tout le monde parle à merveille. Après son nom, sa maison. Lady Holland parle de celle des Champs- Elysées, du regret qu’il a dû avoir de la quitter : " M. le Baron, permettez moi de le dire, c’est une manie de l’Empereur qui la lui a fait quitter. Je ne sais pas quelle manie ; je ne devine pas ; mais une manie enfin." Grande explication de Brünnow, un peu décontenancé. Il y avait de grandes, d’immenses réparations, à faire à l’hôtel qu’occupait à Pétersbourg M. de Barante. L’Empereur a fait faire un devis. C’était fort cher. C’eut été fort long. Un an et demi de travaux. Que fût devenu M. de Barante dans est intervalle ? L’Empereur l’aime extrêmement. L’Empereur n’a pas voulu qu’il fût dans la rue pendant qu’on raccommoderait sa maison. Et puis, quoi donc ? L’ambassadeur de Russie aurait été logé à Paris un an et demi de suite, par la France, pendant que l’Ambassadeur de France à Pétersbourg se serait trouvé sans logement russe ! L’Emperereur ne pouvait souffrir cela. L’Empereur a deux manies; la manie de M. de Barante, et la manie de la probité. Tenez que ce sont les propres paroles.
Ceci n’est pas un bon commérage. Qu’il ne me revienne pas ici, je vous prie.
Lord Palmerston ne revient que demain. Ils paraissent charmés d’être à la campagne. Ils y sont seuls. Lady Palmerston écrit que son mari, la fait monter tous les jours à cheval sur un old hunter. Cela contredit ma nouvelle.
Une heure
Je n’ai pas de lettre aujourd’hui. Pourquoi donc ? Je n’y comprends rien. Elle peut arriver encore par mon banquier ; mais je n’y compte pas. J’en suis vivement contrarié, pour ne pas dire plus.
Il n’y a point de bonne auberge à Hampstead. De petites maisons à louer, furnished, des cottages propres mais très simples. On dit qu’il y a mieux à Clapham, près de Hampstead. Je le saurai ces jours-ci. Je ferai voir aussi à Norwood où on m’assure qu’il y a de bonnes auberges. C’est mon petit herbet seul que je charge de cela, et qui est le plus discret des hommes. Adieu, quand même.
P.S. Je ferme ma lettre à 4 heures et demie. Rien n’est venu par aucune voie.
349. Paris, Mardi 21 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
349. Paris, Mardi le 2l avril 1840
9 heures
Je commence par vous donner des nouvelles de Pauline. Je l’ai vue hier. Sa mine est très différente de celle de l’autre jour. elle a l’air animé. Le teint, les yeux, tout est mieux elle cause gaiement. Les autres étaient allés se promener ainsi tranquilisez vous tout-à-fait. J’ai fait un peu de bois de Boulogne seule, une visite à la petite princesse, mon diner solitaire, la soirée chez Lady Granville. J’avais dû y diner mais tout-à-coup cela m’a ennuyé et je n’y suis venu qu’après. Il y avait la diplomatie et l’Angleterre car il y a beaucoup d’Anglais ici dans ce moment. Je ne sais si on sait votre médiation on ne m’en a pas parlé, et je me suis tue. J’ai reçu hier une lettre de mon banquier à Pétersbourg. Mon frère se refuse tout-à-fait à se mêler de la vente de la vaisselle ; cela lui déplait, et il veut que Bruxner ait mes pleins pouvoirs et non pas lui. voilà qui va faire encore un très long delai, d’autant plus que la saison n’est plus favorable à des ventes. Les autres effets ont été vendus, c’est peu de chose, il m’en revient 6000 francs. Je vous dis toutes mes affaires.
10 h 1/2
Je rentre des Tuilleries. Il fait froid mais beau. Cependant ce temps sec m’est odieux, je ne respire pas à l’aise ; la pluie me ferait tant de bien. Je viens de lire les journaux, la
médiation y est.
J’ai prié Madame votre mère de m’envoyer M. Andral. Elle l’attendait hier soir. Rothschild est venu m’interrompre. Il me donne de très bonnes nouvelles sur votre compte.
Mercredi le 22 9 heures
Mon mot d’hier écrit à toutes les heures, a été interrompu par l’arrivée de mon fils. Appony l’avait précédé. Tout cela ensemble a fait qu’il était trop trod pour espérer gagner la poste. Vous n’aurez donc pas de lettres demain ; mais au fond cest juste mon mardi sera votre jeudi. Le mardi est un bien vilain jour. (interruption, mon fils)
10 heures, Voici votre lettre ; dieu merci vous êtes rassuré pour Pauline et vous avez tout lieu de l’être. Je ne trouve aucun changement dans votre mère. Elle est tout-à-fait comme je l’ai vue à mes autres visites. Et point inquiète. seulement préoccupée de votre inquiétude. Je ne suis point d’avis que vous la laissiez quinze jours, sans lui dire votre résolution. Le vague est toujours ce qui tourmente le plus, ainsi l’idée du voyage, de la traversée, d’un nouveau lieu à habiter tout cela doit lui tourmenter l’esprit. Quand vous lui aurez dit le Val Richer, je suis sûre qu’elle en sera plus tranquille du moins je serais comme cela à sa place, et puis dites lui que vous viendrez la voir en été ; trompez la un peu, ici c’est nécessaire, cela lui ferait peut être du bien.
Décidement vous aurez Lord Palmerston à dîner vis-à-vis de vous. N’étant pas à côté le vis-à-vis est la premiere place, et elle lui revient. Dans vos convives, voici la hiérarchie. Le Président du conseil. Le Pristy seal (Clarendon). Le duc de Wellington, le marquise de Normanby, Lord Minto, &. Mais Melbourne comme premier ministre doit absolument être auprès de vous. Lui et Landsdowne à vos côtés. Wellington et Clarendon auprès de
Palmerston. Soyez sûr que j’ai raison, et ce conseil est moi et Granville ensemble. J’ai dîné avec mon fils. Le soir j’ai vu Granville, mon ambassadeur, le Duc de Noailles, Ellice, Capellen, les Durazzo. Granville avait été un peu blessé des termes dans lesquels le Constitutionnel avait annoncé la médiation. Il a fait modifier dans le Moniteur parisien. Le duc de Noailles regarde cette affaire comme un grand succès pour vous et une très bonne affaire pour le ministère. Il dit c’est heureux et habile.
1 heure
Je ne puis pas être à Londres dans une auberge d’abord et puis chez les Sutherland. Il faut tout-à-fait l’un ou tout-à-fait l’autre. Autrement, cela n’aurait pas de sens, et je touve l’un beaucoup plus convenable que l’autre. Je suis sûre que je vous en ferais convenir si je vous parlais. Ils ne seront à Londres qu’après les vacances de la Pentecôte. Je pourrais bien me trouver dans les environs de Londres avant, et j’y ai pensé déjà. Je vous prie d’y penser aussi. Il me semble que Norwood est ce qu’il y a de plus près, ou bien Hamstead, si depuis mon temps il y a quelque bonne auberge établie là. Informez-vous en. J’y passerais quelques jours. Vous m’y viendriez voir, mais on ne saura que j’y suis que lorsque je le voudrai. Norwood est au midi de Londres en passant Westminster bridge. Hampstead au nord par le Regents park. Ceci vaudrait mieux peut-être, c’est plus près de chez vous. Il y a de mauvaises nouvelles de Bruxelles à ce qu’on disait hier au soir. La Reine était menacée d’une couche prématurée. Ceci pourrait faire des delais dans la noce. On parle beaucoup d’un sermon à St Roch. L’abbé Cœur a fait un discours superbe sur l’amour de l’or, la Reine s’est fâchée, et n’a plus reparu à St Roch. Je suis étonnée qu’elle ait fait cela, mais s’est parfaitement vrai et parfaitement connu. C’est dommage. Mon fils est très bien, et très bien pour moi, il me parait avoir et du regret et de l’étonnement de ce que Paul ne soit pas venu. Il ditqu’il lui a écrit sur ce sujet très fortement. Mais cela n’y fera rien. Dans ce moment il entre, pour me dire qu’il faut qu’il soit à Londres dans 6 jours. Je ne replique rien. Je n’ai plus d’opinion sur ces choses là. Je n’en parle pas et j’essaye de n’y pas penser.
Ellice passe son temps avec Thiers. Il y déjeune il y dine, il se promène avec lui même. Et il bavarde à tort et a travers. Il veut maintenant que les Etats-Unis demandent la médiation de la France dans sa querelle de frontières avec l’Angleterre. Il est très certain que votre affaire de Naples aura un grand éclat comme attestation de bonne intelligence entre Londres et Paris, et vous en avez l’honneur.
Adieu. Adieu. Je vous écris très à batons rompus ; car mon fils m’interrompt à tout instant. On me fait dire que Pauline va bien. Andral n’est pas venu. Adieu, adieu beaucoup de fois.
346. Londres, Dimanche 19 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
346. Londres, Dimanche 19 avril 1840
4 heures
Je viens de recevoir mon courrier des Affaires étrangères qui aurait dû m’arriver hier et qui m’apporte des nouvelles de ma mère.
Je suis tranquille sur Henriette, et à peu près sur Pauline, quoiqu’elle soit encore souffrante. Ils vont prendre tous trois le lait d’ânesse. Mais quelle horreur que l’absence ! C’est une découverte de tous les jours. Et je la ferai pendant bien des jours, car certainement si la santé de Pauline, n’est pas très raffermie, si celle de ma mère ne me donne pas pleine sécurité, je ne les ferai pas venir. J’aime mille fois mieux avoir à trembler de loin sur toutes les mauvaises chances naturelles qu’en ajouter une de mon fait. Si je ne les fais pas venir, je m’arrangerai pour quitter l’Angleterre quinze jours plutôt vers le milieu de septembre et pour aller les retrouver à la campagne où je les établirai pendant l’été. Car vous ne resterez pas en Angleterre au-delà du milieu de septembre, n’est-ce pas ? Peut-être pas jusque là.
Mon dîner d’hier chez M. Macaulay a été peu intéressant, quoique composé de gens d’esprit, Lord Jeffrey, M. Elphinstone M. et M. Trevelyan etc, savez-vous que les Anglais ont prodigieusement de vanité et de la plus petite. Elle est moins expansive, moins complaisante, et confiante que la vanité française, mais tout aussi ardente et plus raide, plus pedante. J’en vois une foule qui sont extremement préoccupés de l’effet qu’ils font, et très fâchés quand ils n’en font pas, et très soigneux de laisser, de faire percer leurs moindres avantages. Ce qui est vrai, c’est que les hommes sérieux et simples le sont complétement, parfaitement et qu’il y en a beaucoup. Grand pays, ou la petitesse abonde à côté de la grandeur.
De chez M. Macaulay, chez les Berry, où je n’avais pu aller dîner, mardi dernier. Elles avaient un peu de musique, la fille d’un M. Hamilton qui a été ministre à Naples, fort agréable personne, qui chante assez bien, les airs italiens et les romances écossaises, avec un air de passion ossianique et malheureuse qui ne s’adresse à aucun objet particulier et semble une invitation plutôt qu’un regret.
J’étais dans mon lit à minuit, pressé de me coucher, pressé de m’endormir pour attendre avec moins d’impatience les nouvelles de mes enfants. Je me suis reveillé bien des fois. Pourtant j’ai dormi, et l’arrivée de mon courrier m’a tranquillisé. J’aurai d’autres nouvelles, entre midi et 2 heures et de vous aussi, j’espère.
4 heures
Je les ai eues mes nouvelles ; je les ai eues toutes. Mais pourquoi n’aviez-vous pas ma lettre vendredi à 1 heure ?Elle est partie mercredi bien régulièrement et bien pleine de vous car j’avais le cœur plus que plein en vous écrivant. Je me rappelle très bien cette lettre là. Vous l’aurez eue dans la journée.
Pauline continue à aller mieux. Mais je suis décidé. Je viens de recevoir une longue longue lettre de mon petit médecin qui n’est pas du tout d’avis du voyage, ni pour ma mère, ni pour Pauline, ni pour Guillaume. Il dit que pour Henriette seule, cela n’aurait aucun inconvénient. Il en a délibéré avec Andral qui est du même avis. Je n’hésite pas. Je n’en écrirai pas tout de suite à ma mère. Je veux la laisser sortir un peu de la petite sécousse qu’elle vient d’avoir et de l’effroi que lui cause sa responsabilité en mon absence. N’en parlez donc encore à personne du tout. Mais dans une quinzaine de jours, j’écrirai à ma mère ma résolution. Je les enverrai au Val-Richer vers le milieu de Mai. Je suis à peu près sûr que malgré son désir de me revoir, malgré le fardeau de la responsabilité ma mère se sentira soulagée. J’ai quelque fois entrevu que ce voyage l’inquiétait un peu, pour mes enfants, pour elle-même. Elle est d’un courage et d’un devouement sans limites. Elle risquerait ce qui lui reste de vie pour mon bonheur de quelques jours. Mais elle sait de quelle importance sont pour moi sa vie et sa santé. Elle aime ses habitudes, le Val-Richer. A tout prendre elle se consolera, et surtout elle se rassurera, ce qui m’importe beaucoup, car mon petit médecin m’écrit que son imagination est un peu ébranlée et fatiguée. Je vous aurai cet été. Je n’aurai que vous. Mais je vous aurai. Commencez-vous à savoir tout ce que vous êtes pour moi ? Et à ce propos, expliquez-moi une phrase de votre lettre. Vous parlez, dites-vous, à la duchesse de Sutherland du mois de Juin "sans préciser le moment car eux-mêmes seront absents la première quinzaine, et ne pourraient vous recevoir alors." Ce n’est pas à dire, je pense, que vous ne viendrez pas le 1er juin. Vous pourrez bien sans trop d’ennui, passer quinze jours à Miwarts Hôtel ou ailleurs, en attendant que les Sutherland soient chez eux. Et si vous retardiez, vous tomberiez, ou bien près, dans l’arrivée de votre nièce. Précisez-moi cela je vous prie.
Lundi, 8 heures et demie
Je n’ai pas pu aller passer deux jours à Holland house, comme on m’y avait engagé. J’ai chez moi, pour quelques jours, M. Lenormant que je ne veux pas abandonner si complètement. Mais j’y ai été dîner et je suis parti de bonne heure, pour avoir le temps de me promener. J’ai passé une heure seul, dans le parc. C’est ravissant. Quels beaux cèdres ! Il n’y en a pas plus sur le mont Liban, ni de plus beaux. Les arbres surtout m’ont frappé, car le paysage n’a rien de remarquable. Le diner matériellement excellent, moralement médiocre. Le personnage nouveau pour moi a été M. Duncombe, le radical à la mode. Montrond m’en avait parlé comme d’un ami particulier. Il m’a demandé si Montrond was still alive. Lord et Lady Palmerston devaient venir. Lady Palmerston est venue seule comme nous étions déjà à table. Lui est venu le soir. L’une et l’autre avaient l’air préoccupé, même triste. Je ne crois pas Lord Palmerson content de sa situation. On crie beaucoup, dans son propre parti. La Chine, l’Orient, Naples, les Etats-Unis, c’est bien des querelles et qui coûteront cher. Le déficit de la poste est grand ; il faut de nouvelles taxes. Je ne crois à aucun ébranlement réel, ni du Cabinet, ni de Lord Palmerston. Mais c’est un moment difficile et qui exige, si je ne me trompe, qu’on mette de l’eau dans son vin. Une bonne conversation après dîner, sur toutes choses. M. de Bülow a décidément plus d’esprit que toujours à faire,
tous ses collègues.
Aujourd’hui, le dîner du Lord Maire. Puis, je me réposerai. Lord et Lady Palmerston partent mardi pour Broadlands. Brünnnow et Neumann vont aujourd’hui chez le Duc de Wellington. Ils continuent à lui parler des affaires. La dispersion est générale.
Une heure
La mauvaise nuit de Pauline me tourmente. Être tourmenté et ne rien faire ne pas voir seulement ! Mon petit médecin me donne beaucoup de détails très fidèlement, j’en suis sûr. Il n’est pas inquiet. Il est bien heureux. Vous me direz si ma mère vous fait l’impression d’une personne agitée et fatiguée. Je crains toujours qu’elle n’aille jusqu’au bout de sa force. J’ai confiance dans le lait d’anesse. Il a toujours très bien réussi à mes enfants. Ils ont dû le commencer hier.
N’ayez donc pas peur de Mad. de Meulan. M. Molé a raison, c’est-à-dire qu’il a bien des raisons d’avoir de l’humeur. Il est bien bon de trouver qu’il n’a pas été attaqué. Sauf Tiers, qui s’est bien défendu, il n’y a eu d’attaqué que M. Molé qui ne s’est pas défendu et n’a été défendu par personne. Le Duc de Broglie l’a attaqué. Villemain l’a renié. Ces débats là ne lui valent rien. Je ne crois pas qu’ils vaillent grand chose non plus pour le Cabinet. Cependant on gagne toujours à faire preuve de talent et d’habilité à prouver qu’on vaut mieux que sa position. Il me semble que c’est le cas de Thiers.
M. de Noailles me sert en effet. J’ai bien lu son discours et j’en parle beaucoup et bien. Je n’ai jamais vu M. de Noailles, sans avoir envie que nous fussions du même avis. Je parlerai Anglais au Mansion house, en demandant pardon de mon mauvais langage. Cela a meilleure grace que de bien parler pour n’être pas compris. A l’académie royale, c’est autre chose ; du bon français. Je sais que c’est un dîner très aristocratique.
Le Chancelier ne vient pas diner le 1er mai à cause de la chambre, comme le speaker. Je prendrai donc à côté de moi Lord Lansdowne et Lord Melbourne. En face de moi, Lord Palmerston qui aura à côté de lui le duc de Wellington et je ne sais qui Lord Normanby, ou Lord Minto ou Lord Clarendon, ou Lord Holland ? Pensez y encore, je vous prie.
Si je mettais Lord Lansdowne en face de moi, avec Lord Palmerston et un autre ministre à ses côtés ; et moi Lord Melbourne à droite, le Duc de Wellington à gauche ?
Adieu. Je vous ferai quelque fois porter ma lettre par mon petit médecin, M. Béhier, très intelligent très sûr et parfaitement dévoué. Adieu. Adieu. Priez pour ma petite fille.
344. Londres, Vendredi 17 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
344.Londres, Vendredi 17 avril 1840
Je ne vous ai rien dit en me levant. J’étais dans une disposition horriblement triste. Inquiet de ma petite Pauline, me reprochant d’avoir quitté mes enfants, en demandant pardon à leur mère à la mienne. J’ai passé la nuit avec ce cauchemar me reveillant sans cesse, ne me rendormant que pour retrouver mes enfants, ma mère, vous, vos enfants à vous, tout ce que j’aime ce que j’ai perdu, ce qui me reste tous malades, inquiet pour tous. Je suis sorti de mon lit fatigué, agité. Je n’ai rien fait. Je me suis mis tout de suite à ma toilette. Je l’ai fait traîner jusqu’à l’arrivée de la poste. Enfin, elle est mieux ; elle a bien dormi ; elle n’a pas eu de petit retour de fièvre. Ma mère est tranquille. Mon petit médecin veut que je le sois. Je le suis. Je suis plus content que tranquille. On a toujours tort d’être tranquille. Je vous le disais hier. Je le répèterais toujours. Quelle fièvre que la vie ! Je ne suis point d’un naturel agité. J’ai de la sérénité et de la force. Et pourtant
que d’agitations intérieures. Que d’inconséquences et de faiblesse ! Que de résolutions prises, pour être cent fois regrettées, déplorées, et qu’on reprendrait également en pareille circonstance, malgré l’épreuve des regrets passés et la prévoyance des regrets futurs ! Trop heureux encore quand l’épreuve se borne à des craintes à des tourments, quand les regrets ne vont pas jusqu’à l’irréparable. Ah nous sommes de bien lègères créatures ! nos sentimens même les plus profonds, les plus puissants cèdent bien souvent à des considérations, à des intérets bien secondaires. Et puis nous nous étonnons, nous nous indignons des inquiétudes et des peines qui nous arrivent, comme si nous n’avions pas dû les prévoir, si nous n’avions pas pu les éviter! Enfin Dieu soit loué ; ma petite fille est mieux et je puis vous parler d’autre chose. Je ne l’aurais pas pu ce matin. Et je ne voulais pas vous parler de mon mal. Cette petite fille est vraiment bien délicate. Elle est née délicate. Elle a été malade, en naissant ; elle a eu dans les six premières semaines, une maladie qu’on appelle le muguet, des aphtes dans la bouche et la gorge. Elle avait les jambes très faibles, près de tourner. Elle a porté deux ou trois ans des petites bottines avec une mécanique. Les bains de mer, en 1835 lui ont merveilleusement fortifié les jambes et les reins. J’espère qu’on qu’on trouvera quelque régime qui fortifiera aussi le fond de sa santé. Certainement, je ne ferai pas venir ici mes enfants et ma mère contre l’avis des médécins. Je vais bien penser à cela écrire, m’informer. Si on ne me donne pas pleine sécurité, au lieu de les faire venir, je les enverrai au Val Richer où ils passeront l’été en bon air, en plein repos, dans leurs habitudes, et j’irai, les y retrouver vers la fin de septembre. Ne parlez de cela à personne. Mais, pour rien au monde, je n’ajouterai un risque de plus à tous ces horribles risques, de la vie humaine. Il n’y a point de privation que je ne préfère. Je suis charmé que décidément les Sutherland vous attendent chez eux. Cela vous épargne tout embarras. Je ne doute pas qu’ils n’aient moyen de vous mettre au rez-de-chaussée. La maison est si grande ! Quel degré de liberté aurons-nous là ? Comment arrangerons-nous nos heures ? Pensez-y d’avance pour que nous ne perdions pas un jour à le chercher.
Je trouve Thiers fort bon à la Chambre des Pairs, convenable et habile pour ici ; son langage ne me génera en rien et me servira. Pour l’Intérieur, il a été plus faible, plus vague, toujours dans sa position d’équilibriste. Il y est condanmé. Il y restera jusqu’à ce que quelque évênement, quelque crise le force à se brouiller avec la gauche ou le pousse à s’y plonger Quel sera son choix le jour de cette épreuve ? Je ne le prevois pas du tout. Il a en lui de quoi prendre le bon et le mauvais parti. Bien entouré, sontenu encouragé, gardé, il prendrait le bon. Livré à lui-même, il y a beaucoup de chance qu’il prenne le mauvais. Ce qu’il y a de bon autour de lui suffira-t-il à le garder, à le soutenir ? Je ne sais pas. C’est comme votre Empereur. Il faut quelque évènement, quelque grande necessité pour le faire
changer dans un bon sens. Il n’a pas en lui-même assez de force, et d’esprit pour se décider, pour s’éclairer seulement. Il se livre à son humeur, car ce n’est pas de la politique. Il n’a point de politique puisqu’il est modéré en fait et violent en paroles. Il ne changera que quand il plaira à Dieu. La conversation de M. de Pahlen n’y suffit pas. Je suis curieux de la lettre que vous me promettez. Elle a vraiment de l’esprit ; ne tardez pas à me l’envoyer, je vous prie. Les dépêches de M. de Brünnow doivent être longues. Il a l’esprit long. Je ne m’étonne pas que l’Empereur s’y plaise. Il (M. de Brünnow disait l’autre jour, à quelqu’un qu’il écrivait en ayant toujours devant lui le portrait de l’Empereur. Il écrit beaucoup, beaucoup ; assez pour que le Time parlât avant-hier de la singulière activité de la chancellerie Russe. M. Dedel va partir pour passer quelque temps en Hollande. J’en suis fâché. C’est celui qui me convient le mieux dans le corps diplomatique. Monde bien médiocre en soi et ici bien obscur. On compte sur le Prince Esterhazy pour les premiers jours de mai. Adieu. Je vous quitte pour aller au sermon Trinity Chapel, une petite église Anglicane où prêche, dit-on, un homme de talent. Après j’irai me promener un peu, seul. J’ai besoin de prendre l’air. Je ne suis pas sorti du tout hier soir. Je suis remonté dans ma chambre à 9 heures et demie, et j’étais dans mon lit à 4 heures. Mauvais lit.
Adieu. Adieu. A Stafford house le 3 juin !