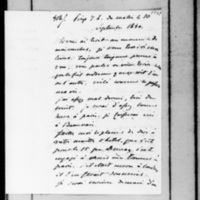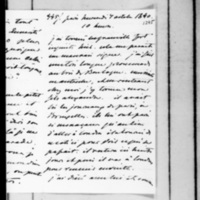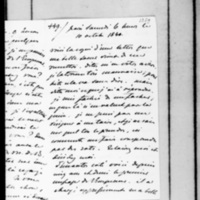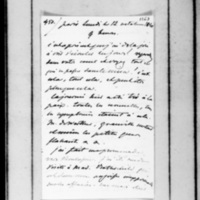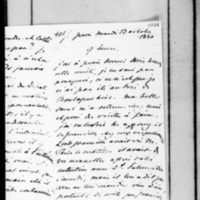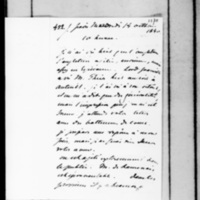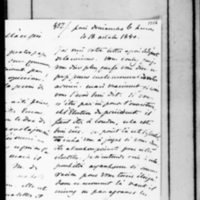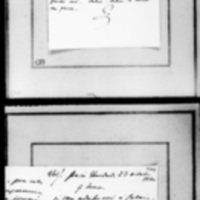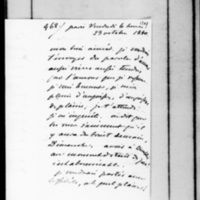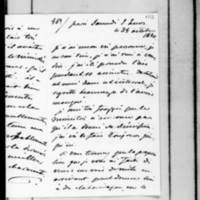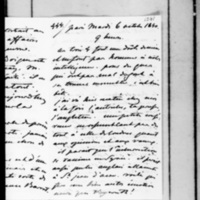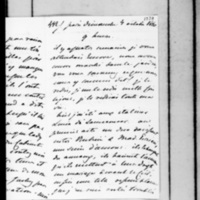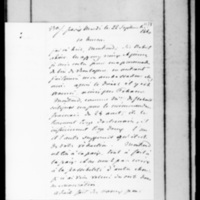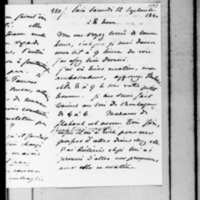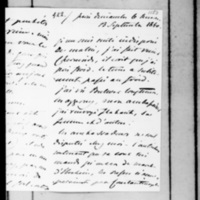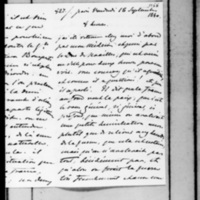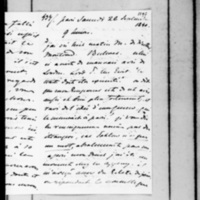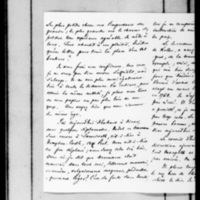Votre recherche dans le corpus : 295 résultats dans 3296 notices du site.Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres (La correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Lieven : 1836-1856)
416. Boulogne, Mardi 8 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
à 6 heures après-midi.
Je suis arrivée ici morte de fatigue. Je puis à peine tenir la plume. Mais il vous faut un mot. Je vais me coucher. On me dit des nouvelles, très effrayantes de Paris ! On débite ici qu’on se bat, qu’il y a des barricades, que Thiers a donné sa démission, que le roi ne l’a pas acceptée. Que les fonds ont fléchi de 6 %. Enfin, c’est à perte de vu. Je n’ai pas fort peur. Je crois que je partirai demain mais vous saurez ce que je fais ou ne fais pas. Pour le moment Je n’en sais rien moi même. Je suis ivre de fatigue. Rien que cela, à ce que me dit mon médecin. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique (France)
418. Poix, Jeudi 10 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous ai écrit au moment de mon coucher, je vous écris à mon lever. Toujours toujours penser à vous ; vous parler on vous écrire selon que le ciel ordonne que ce soit l’un ou l’autre. Voilà comme se passera ma vie. J’ai assez mal dormi bien du bruit. Je serai d’assez bonne heure à Paris, je laisserai ceci à Beauvais Faites-moi le plaisir de dire à votre maître d’hôtel, que c’est pour le 15 que Denay s’est engagé à venir me trouver à Paris. S’il était encore à Londres il l’en ferait souvenir.
Je serai curieuse demain d’en tendre du bavardage. Je lis les journaux en route en attendant et je trouve qu’il y a bien de la confusion. C’est probablement là le régime auquel sera livré le monde pour longtemps.
Beauvais midi. N’est-ce pas que vous avez eu une lettre de moi tous les jours ? Je suis à la 6 ème depuis Londres. Je m’arrête ici pour manger et boire de votre vin. Je viens de parcourir le Constitutionnel de hier 9. C’est assez bien répondu aux Débats. Au reste vous n’attendez pas des commentaires politiques de Beauvais ?
Adieu. Adieu. Voilà le couvert mis, c’est important pour un voyageur et j’ai faim. Adieu. Adieu mille fois. God bless you que dit-on à Londres de Napier. Adieu
370. Paris, Lundi 11 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je suis bien inquiète malgré ce que vous me dites, malgré les autres lettres que l’on m’écrit. Bulwer m’a envoyé une lettre de Cumming dans laquelle il dit que vendredi à 2 heures mon fils n’était pas hors de danger. C’est horrible à Bulwer de m’envoyer cela mais enfinr cela c’est la vérité, car c’était écrit dans la chambre d’Alexandre. J’en suis renversée. Votre lettre ce matin me parlera de lui, mais je la recevrai sans vraie sécurité. Tous mes amis veulent ma tranquillité. Ce sot est le seul qui dise vrai. Je veux partir, on me retient, on dit que je n’en ai par la force c’est vrai peut-être, et cependant cette inquiètude n’est pas souotenable. Il ne m’a pas encore écrit une ligne. Bruwer, lady Palmerston, lady Jersez m’ont écrit hier. Cela ne me fait plus rien. Vous ne savez pas comme je souffre, comme je suis sans force, sans courage, sans espoir. Je n’en puis plus. Midi Voici votre lettre. Vous me parlez si peu de mon fils et à peu près comme quelqu’un qui n’en sait rien de direct car tandis que lady Palmerston me mandait vendredi qu’on venait de le saigner encore, Vous me dites : " Je suppose qu’il ne tardira pas à partir. " Mais il ne faut pas supposer, il faut savoir. Pardon de ce reproche, mais même vous, vous ne savez pas ce que suis, ce qu’une mère éprouve d’angoisse, et vous savez cependant que personne n’a pour moi de véritable compassion, et de véritable soucis, je les attendais de vous. Vous aurez bien vu par mes lettres que je voulais parter de suite, mais raison nablement il fallait que j’attendisse quelque chose de précis sur son état, car votre première lettre me disait " dans deux ou trois jours il n’y paraîtra plus. " Ce n’est donc rien. D’autres lettres m’alarment plus on moins. Lui ne m’écrit pas une ligne, personne ne me dit l’opinion des médecins sur la durée de sa convalescence, enfin au milieu de beaucoup d’amis, je reste cependant ignorante de tout ce que je vous voudrais savoir. Pardonnez moi encore ce réproche, mais vous aurez dû me dire davantage et ne pas vous en rapporter seulement au dire de votre domestiques. Je suis bien triste et bien découragée de l’abandon dans lequel je reste ! Personne, personne qui me montre un intérêt vraiment tendre, vraiment intelligent.
Savez- vous que la vie m’est bien à charge, je ne sais plus qu’en faire. J’étais meilleurs à voler que lord William Russell, et on m’aurait fait moins de peine qu’à lui de me tuer. Si cela ne vous donne pas trop d’embarras ayez la bonté de parler ou d’écrire à sir Benjamin Brodie et de lui demander exactement combien peut durer encore la convalescence de mon fils. Et ayez la bonté aussi de m’envoyer sa réponse. J’attendrai donc jusqu’à vendredi, car ce jour là j’aurai votre réponse.
Vos filles sont venues me voir hier. Elles se portent à merveille. Toutts les deux sont engraissées. Pauline est bien jolie. Guilllaume n’avait pas voulu quitter son sabre et son tambour. vos filles m’ont trouvée couchée et bien triste.
Il n’y avait qu’un mot de plus à la lettre à lady Palmerston pour lui dire que Nicolas Pahlen irait à Londres aussi, la lettre n’’était pas finie. J’ai déchirée ce bout de lettres parce que j’étais pressée d’avoir une allumette et je n’avais rien sous la main. Ma chute d’hier n’a pas eu de suite, mais ma santé est fort altérée de l’inquiétude que j’éprouve pour Alexandre. Je n’ai pas un mot de nouvelle à vous dire, et je suis bien fatiguée, bien malheureuse. Adieu. Adieu.
Je viens de recevoir une lettre de Burkhausen. On ne lui permet encore ni de lire ni décrire, il est très faible dans son lit, la convalescence durera bien des semaines. Je fais mes préparatifs. Si j’ai la force. Vous voyez que c’est moi qui vous donne des nouvelles de mon fils. Pardonnez-moi, encore, pardonnez moi. Je ne veux pas être inquiète mais je suis très triste.
454. Paris, Vendredi 16 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le temps hier était charmant. Je suis même restée assise au bois de Boulogne. J’avais vu le matin Bulwer, toujours inquiet comme tout le monde. J’ai vu plus tard Granville qui avait trouvé M. Thiers assez soucieux et de mauvaise humeur. J’ai été porter mes félicitations à Mad. Appony dont c’était la fête. A 6 heures j’étais couchée sur un canapé me reposant de ma promenade lorsque j’ai entendu une grosse explosion. J’ai cru le canon et que la duchesse d’Orléans accouchait quinze jours trop tôt. Comme le coup n’avait pas de camarade, je n’y ai plus pensé et le soir j’apprends qu’on a encore tiré sur le roi. Mon ambassadeur, M. de Bignole et l’internonce sont venus me voir. J’avais enfin ouvert ma porte, mais comme je n’en avais prévenu personne. Je n’ai eu que cela. Nous sommes curieux du parti. que le gouvernement va tirer de ce nouvel attentat.
Midi
Les journaux s’expriment très bien, et si le gouvernement a du courage cet événement peut tourner à bien.
1 1/2
J’ai été interrompue par le petit. J’espère qu’il vous écrit beaucoup, beaucoup. 3 heures. Voici seulement à présent votre lettre. J’en suis très très contente ainsi que d’une autre que j’ai lu aussi. Je n’ai que le temps de vous dire ceci. A demain et comme toujours toujours adieu.
445. Paris, Mercredi 7 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
J’ai trouvé les Granville fort inquiets hier. Cela me parait un mauvais signe. J’ai fait une très longue promenade au bois de Boulogne, une visite en Autriche, et en rentrant chez moi j’y trouve mon fils Alexandre. Il avait lu les journaux de Paris, à Bruxelles. Ils lui ont paru si menaçants qu’au lieu d’aller à Londres il a tourné de ce côté-ci pour voir ce qui se passait. Il restera ici huit jours et puis il va à Londres pour revenir ensuite. J’ai dîné avec lui et comme mon ambassadeur allait à St Cloud et que je n’attends ce soir de visite que la sienne j’ai été passer ma soirée chez Lady Granville.
Je l’ai trouvée seule avec lord et lady Seaford, mariés depuis 6 jours à Londres. Un vieil amour, entre de veilles gens, réchauffé par un mariage fort raisonnable mais pas intéressant lord Seaford était l’une des amies de M. Canning. Il les choisissait tous un peu bêtes. On disait que le conseil hier à St Cloud devait être très important. La bourse s’est encore agitée énormément et les fonds ont éprouvés une hausse de 4 %. On annonçait pour ce matin une espèce de protestation dans le ministère au sujet de la déchéance du pacha.
Appony a couru hier soir à St Cloud pour dire au roi qu’il savait de source certaine sans être encore directe, qui sa cour blâmait hautement la Porte (et infiniment plus haut encore son internonce pour la part ostensible qu’il y a prise) au sujet de cet acte de déchéance. On espère que ce blâme arrêtera votre cour ! Mais tout arrive si tard. En vérité, je crains beaucoup plus que je n’espère, quoique mon refrain, comme celui de tout le monde, soit toujours. " Mais ce serait fou. "
1 heure
Je n’ai vu encore que le petit ami. Son intelligence et la mienne vous sont bien dévoués. J’allais dire son cœur &. Mais là je ne veux pas de cocarde. Et bien nous trouvons, je trouve surtout et mon Dieu je ne sais que dire, on peut si peu dire par lettre. j’espère que si les chambres sont convoquées, vous vous arrangiez de façon à aller avant passer quelques jours dans votre famille, faites y venir le petit ami, ce sera bien utile. Au fond votre situation est bonne. Vous êtes en dehors de toute intrigue. Vous remplissez avec dévouement, fermeté, habileté vos devoirs là où vous êtes, le jour ou il faudra en rendre compte vous saurez le faire à votre plus grande gloire. Jusque là vous êtes tranquille. Si vous écrivez au frêne recommandez lui bien de ne pas dire un mot, pas écrire une ligne qui l’engage à quoi que ce soit Sa couleur on la connait ; il ne peut pas en avoir, on ne doit pas, on ne peut pas lui en prêter un autre. Je reçois votre lettre dans cet instant, que je voudrais être occupée de vous, pour vous.
2 heures
J’ai été interrompue par tant de monde que je n’ai plus qu’un instant. La crise est plus fort que jamais dans ce moment un conseil chez le Roi, très important. On décide la convocation et la protestation. On dit presque l’existence ministérielle. Montrond sort d’ici. Il croit que la chambre sera convoquée pour le 7. Le maréchal Gérard va faire paraître un ordre du jour défendant toute manifestation publique d’origine politique de la garde nationale. Granville a une audience du Roi ce matin. Je suis très très pressée. Vous aurez des lettres aujourd’hui.
Adieu. Adieu mille fois eh tendrement adieu. Quel moment ! Adieu le roi très pacifique.
446. Paris, Jeudi le 8 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai vu hier Montrond, mon ambassadeur, et le reste de la diplomatie le soir chez Appony. La journée toute guerrière, Appony avait été frappé cependant de trouver Thiers la veille plus découragé que vaillant ; l’esprit très préoccupé. Un homme fatigué, abattu. Vraiment on ne sait pas comment tout ceci peut tourner. Le parti de la paix se renforce cependant, mais le parti contraire est bien bruyant, bien pressé. Le roi est toujours très vif avec Appony, infiniment plus doux avec mon ambassadeur.
Il a fait l’éloge de M. Titoff qui s’est refusé à prendre part à Constantinople, à la dépossession du Pacha. J’ai reçu le petit ami dans la journée. Je suis très frappée de voir que dans le récit de ses longs entretiens avec 1, il soit si peu ou point du tout question du chêne.
Décidément S. n’est pas un ami sincère. Il y a quelque ancienne rancune qui perce. Dites au frênes de ne pas s’y fier tout-à-fait.
Les ambassadeurs sont fort disposés à désirer la convocation des chambres, moi aussi. On dirait cependant que hier rien n’était décidé. J’ai eu hier une lettre de M. de Capellan dans laquelle Il me rend compte des événements de La Haye, et où il me dit qu’il part demain pour Londres pour annoncer à la reine l’avènement de son nouveau roi. Je suis désolées que nous perdions Fagel, son successeur Zeeylen est un désagréable homme. Dites toujours je vous prie mes tendresses à Dedel que j’aime beaucoup, est-il confirmé à Londres ? Pourquoi n’est-ce pas lui qu’on nomme à Paris ?
L’arrivée de ma belle-sœur m’ennuie beaucoup. Sa fille me plait davantage tous les jours. Mais elle a peu d’esprit et elle n’a que deux préoccupation sa toilette, et son mari. Et comme cela, dans cet ordre-là.
11 heures
Je suis enchantée voilà la convocation, et plus prochaine que je ne croyais. Moins de trois semaines. Dites- moi bien, répétez-moi bien que vous viendrez. Ah quel beau jour ! Vous ne sauriez imaginer comme mon cœur est joyeux. Si fait vous le savez, et vous répondez à ce transport. Mon fils va lundi à Londres pour revenir la veille de l’ouverture des chambres. Je ne lui ai pas nommé son frère. On a parlé à Baden de M. de Brünnow et moi ; les Russes en ont parlé, car la petit Hesselrode venu de Londres savait tout. Il n’y a eu qu’une opinion, on l’a blâmée de la vilenie, et encore un peu plus de la bêtise. Cependant, cependant, vous voyez qu’on ne me répond pas. Que c’est bête encore !
Vous ne voyez donc pas du tout M. de Brünnow ? Voici ce que je réponds à lady Palmerston. " Il est assez naturel que M. Guizot aime à parler de préférence avec les gens qui sont de son avis ; mais je le crois assez bien orienté en Angleterre pour savoir qu’il n’y a pas d’autre bénéfice pour lui à cela que le plaisir de la conversation. Il sait fort bien que les gens qui parlent la plus ne sont pas ceux qui mènent."
2 heures
Le petit avec ami me quitte ; nous bavardons, nous bavardons ! Voilà donc que M. Barrot sera porté à la présidence. Vous ne jugerez pas possible sans doute de rester neutre ! Je vous fais la question. J’ai donné au petit les noms français Voilà du monde il n’y a pas moyen de continuer. Je n’ai pas eu de lettres encore aujourd’hui. Adieu. Adieu.
447. Paris, Vendredi 9 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu hier matin mon ambassadeur. Le soir les Granville, où j’ai trouvé Mad. de Flahaut. J’avais fait ma promenade d’habitude dans feu le bois de Boulogne; mon dîner seule, car mon fils dînait dehors.
Je trouve qu’on est généralement rassurer par la convocation des Chambres. C’est quelques semaines de répit. Peut-être pour arriver à pire ! Mais il y a aussi la chance du contraire. Ne faudra-t-il pas la tribune nglaise comme contrepoids ? M. de Broglie est fort consulté et fort occupé. Il s’occcupe toujours avec prédilection d’un ministère qui est son ouvrage, et trouve que la candidature de M. Odilon Barrot pour la présidence est un dévoir de la part du ministère. On dit cependant que M. de Broglie est très inquiet, inquiet de tout, du dehors, du dedans. Il a raison de l’être car tout ceci est bien sérieux. les propos dans le public deviennent atroces. On retourne aux temps où ce n’est pas de l’eau qui coulait sur cette belle place. Vraiment, ma peur vient de bien des côtés maintenant. Je n’ai reçu votre lettre hier qu’à 6 heures.
11. J’ai depuis quelques jours une lecture qui m’amuse beaucoup, c’est mes lettres à mon mari depuis le jour de mon arrivée à Paris. La nouveauté des impressions le jugement quelques fois. correct, d’autre fois un peu léger sur les personnes. Le crescendo, quelques fois le décrescendo de mon goût pour elles, tout cela me divertit à relire. J’essaie de ranger mes papiers, je crois que je n’y réussirai jamais.
Midi
Voici votre lettre qui me plait bien, je suis fâchée de ce mauvais jour qui m’empêche de vous le dire comme je le voudrais. M. de Pahlen a eu un courrier au bout de quatre mois, mais un courrier qui traite de généralités à ce qu’il dit. Il est toujours excellent, sensé, mais bien inquiet. Il pense qu’on va commencer à l’être aussi. Adieu, car je ne vois rien à vous dire ! Comment êtes vous content, ou mécontent de Flahaut ? Adieu très intimement.
448. Paris, Samedi 10 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai déjà votre lettre, c’est qu’elle me vient par le vieux et le moins élégant . Elle est assez bonne votre lettre. Vous avez l’air d’espérer quelque chose. Si l’on veut faire, il est temps de faire ! J’aime votre lettre, j’aimais bien celle d’hier. Je les aime toutes. Vous ne savez pas comme j’aime, comme je pense, comme je rêve, comme j’attends !
Hier mon ambassadeur et Bulwer, tous les Appony. Dîner aves mon fils. Le soir chez les Granville, Granville était un peu blessé d’avoir vu reproduit et perverti comme dit Bulwer, un entretien qu’il a eu avec Thiers. C’est le Courrier français qui répétait et avec des expressions ironiques pour l’Angleterre. Granville continue à être très inquiet, tout le monde le devient beaucoup. Thiers demande souvent à mon ambassadeur des nouvelles de notre flotte. Il lui répond invariablement qu’il saura par Copenhagen quand elle passera, et que lui n’en sait rien.
On parle de convention nationale polonaise qui s’organiserait à Paris. On élira un roi, et l’on ajoute que si la France à besoin de prendre la Belgique elle priera Léopold d’aller trôner à Varsovie. Je vous redis tous les commérages diplomatiques. Je vous assure que l’attitude de Pahlen est parfait, un vrai gentleman au reste ils le sont tous ici dans cette occasion. Que pense Dedel de son nouveau roi ? Moi j’en pense très petitement. De très jolies formes couvrent un très pauvre fond. L’air d’un vieux chevalier et les actions d’un chevalier d’industrie. La mine ouverte, et une grande fausseté. Enfin c’est non seulement peu de chose, mais une mauvaise chose. Voilà mon opinion. Il faut absolument que vous permettiez ou que vous ordonniez au très fidèle d’aller vous trouver à Calais ou sur la route, quand vous reviendrez. Il sera bon que vous causiez à fond avec lui avant de voir personne ici.
Certainement j’ai pris 20 en grande dé plaisance. 29 qui est son reflet parle trop légèrement du Fresnes et puis on dirait qu’il est inutile de compter avec le chêne.Tout cela est traité étrangement. J’ai de la colère intérieure, j’aimerais bien à la montrer.
La petite duchesse de Dino est accouchée bien péniblement et tristement d’un enfant mort. Elle a eu des couches affreuses. Le duc de Mortemart vient de perdre son fils unique à 24 ans, tué par un cheval. Le duc de Wellington a écrit ici une lettre que j’ai lu à me M. Raylkes bien petit personnage. Un ivrogne, et un grand Tory, dans laquelle il lui dit après avoir déplore les circonstances que pourraient mener à une rupture avec la France : " Mais si la guerre a lieu, soyez sûr que nous étonnerons le monde par les efforts gigantesques que nous ferons pour la soutenir. Ils seront tels qu’on n’en a pas vu encore de semblable. " Je vous avoue que toute cette lettre me parait du Stuff. C’est décousu et trivial à l’excès.
Le 28 est proche, le cœur me bat de joie. Vous viendrez, vous viendrez n’est-ce pas ? Si vous pouviez venir avec quelque chose, quelque grande chose ! Il y a dans mon cœur une confusion de politique est d’amour qui est tout à fait risible. La nuit, le jour, je ne pense qu’à cela ; avec passion, avec inquiétude. Ah mon Dieu !
Adieu. Adieu. Comme vous voulez. Adieu. Je vous ai demandé avant hier je crois de nouvelles de Brunow. Vous m’en donnez aujourd’hui, on dirait que nous nous parlons par télégraphe. Je n’attends pas une grande importance à ce que vous me dites des manières nouvelles de nos diplomates. Cependant, je ne sais pas.
Adieu. Adieu. Le leading article du journal des Débats ce matin est admirable. C’est vrai tout cela est bien étrangement même ! Voilà ma belle-sœur arrivée. Adieu. Adieu. Il y m’a beaucoup dans cette lettre. Jamais assez Adieu.
449. Paris, Samedi 10 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici la copie d’une lettre que ma belle sœur vient de me remettre. Dites-m’en votre avis, je la trouve très mauvaise ; pour bête cela va sans dire, mais dites-moi ce que j’ai à répondre. Je suis fâchée de me fâcher ; ces gens-là n’en valent pas la peine. Je ne puis pas me résigner à me taire, et je ne sais sur quel ton le prendre, ni comment me faire comprendre par des sots. Éclairez-moi et décidez-moi.
D’un autre côté voici depuis cinq ans et demi le premier message de l’Empereur. Il a chargé expressément ma belle sœur de me dire " qu’il espère que je ne l’oublie pas lui non plus ancien ami. " Arrangez cela.
Ma belle-sœur est arrivée de Pétersbourg avec M. Mauguin, recommandée par mon frère aux soins de M. Mauguin depuis le Havre, elle a voyagé dans le coupé de la malle-poste avec M. Mauguin. M. Mauguin d’un signe à écarté les embarras de la douane, « il a fait comprendre qu’il fallait. des égards à Mad. de Benckendorff. M. Mauguin a promis sa protection à ma belle-sœur en car d’émeute ou de révolution, et M. Mauguin a assuré ma belle-sœur qu’il s’opposerait de toutes ses forces à la guerre et qu’il n’y aurait pas de guerre. Mon frère a eu de longs entretiens avec M. Mauguin, et lui a fait comprendre toute la politique de l’Empereur dont M. Mauguin est émerveillé et M. Mauguin est converti !
Je viens de vous raconter une demi-heure de ma matinée, après cela le bois de Boulogne, et puis lord Granville chez moi. Appony avant le promenade rien de nouveau une partie du Cabinet très disposée à la guerre. Je vous écris aux bougies c’est mauvais pour mes yeux, je vous quitte.
Dimanche 11 octobre. 9 heures
Je me suis levée avec quelques nouvelles idées. Si je ne prenais acte que du message de l’Empereur et que je traitasse mon frère de sot, qu’en pensez-vous ? Ce qui est bien certain, c’est que l’à propos de ce message n’est pas insignifiant. Dans ma réponse à mon frère je l’exalterai fort, et je rapetisserai, le valet de tout ce que je grandirai le maître. Approuvez-vous. ? Dans tous les cas mon frère aura le détail des vilainies de M. de Brünnow. Mais dois-je insister sur une satisfaction ? Voilà ce que je vous demande.
Je vous demande une autre chose ; dois-je écrire comme ci-devant Savez-vous que je le ferais avec infiniment de plaisir si j’écrivais droit à l’Empereur. C’est mon frère contre qui j’ai de la rancune. Enfin dites-moi, ce que j’ai à faire. Rien du tout, n’est pas possible.
J’ai dîné seule et puis j’ai été aux Italiens. J’avais dans ma loge Mad. de Flahaut, les Pahlen et Hennage. M. de Werther y est venu. Tout le monde hier était à l’espérance tout le monde croyait que dans les deux pays, on désire et on travaille sincèrement à un arrangement. Voilà le vent d’hier ne sera-t-il demain, aujourd’hui ? Certainement la situation de Thiers est pleine de difficultés, moins de périls ; on le pousse, pourra-t-il résister ?
Onze heures.
Voici votre lettre. Vous venez d’apprendre la convocation. Cela vous a écris comme moi. Que des choses réunies dans cette convocation ! Quel moment pour nous ! Vous avez raison, on ne peut pas parler. Il y a trop trop dans ce fait. Il est immense pour nous. Serez-vous content de ce que vous a porté M. de Lavalette ? le public ici est bien curieux de le connaître. Le petit fidèle croit savoir que c’est une platitude. vous prêteriez-vous a une platitude ? Je suis dans une grande anxiété.
Midi.
Je viens de voir le petit. Je l’engage à vous écrire sans cesse la nuit et le jour, il fait que vous soyez informé de tout car tout à de l’importance.
Adieu. Adieu, bientôt quel adieu !
Les diplomates disaient hier que la France veut quelque chose. de plus que le traité, quelque chose de plus grand comme la tête d’une épingle. Mais enfin quelque chose. Cela va peu avec ce que dit le petit mais on vit ici dans un cercle de confusion et de contradictions. Adieu. Adieu.
450. Paris, Lundi 12 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
C’est à présent que j’ai de la joie à voir s’écouler les jours ! Regardez dans votre cœur et voyez tout ce qui se passe dans le mien. C’est cela ; tout cela, et peut être plus que cela. La journée hier a été très à là paix. Toutes les nouvelles, tous les symptômes étaient à cela. M. de Werther, Granville surtout et même les petites gens, Flahaut & &. J’ai fait ma promenade vers Boulogne. J’ai été rendre visite à Mad. Rothschild qui est dans une angoisse inexprimable sur les affaires. Son mari était à Ferrières. J’ai dîné avec mon fils. Le soir j’ai été un moment chez les Granville, un autre moment chez Mad. de Flahaut et à 10h 1/2 dans mon lit.
Je suis de plus en plus mécontente de S.. Il voudrait tout arranger pour la plus grande commodité de M. Il ne s’embarrasse guère dans cet intérêt d’aplatir le bouleau. Tous les propos de F. sont dans ce sens, et si forts qu’on m’a dit que la violette hier était sur le point de se fâcher. D’un autre côté 62 fait tout au monde pour retarder l’arrivée du peuplier.
11 heures
Voici votre lettre. Je suis bien contente de vous voir bien augurer du résultat de la note. Que Dieu vous accorde le bonheur de voir tout ceci s’arranger pacifiquement. Je suis charmée de tout ce que vous me dites sur votre propre compte.
Moi, je n’ai qu’un avis, un avis grave à donner c’est celui-ci. Si vous n’êtes pas à Paris dès le 28, vous ne pouvez être ce jour-là qu’à Londres. J’avais écrit deux longues pages de développement sur cela, j’aime mieux abréger, ceci vous suffit. J’ai vu le petit ce matin, et puis je viens de me rafraîchir sur la place.
Que de choses à dire, à demander, à commenter. Que les heures de bavardage seront charmantes. Elles se présentent tellement comme cela à mon imagination que je me ravis déjà aujourd’hui que vous dire sur ce pauvre papier. Mais dites-moi bien que vous croyez à la paix, qu’elle est sûre.
Depuis hier je commence à y croire, sans oser presque me l’avouer Mardi demain, c’est affreux ; j’ai si besoin de savoir tous les jours un mot consolant.
Je n’ai pas de nouvelles, je ne sais rien, on attend des dépêches télégraphiques sur l’Orient. Elles tardent bien. Le ton des journaux ministériels est bien doux presque timide. Le journal des Débats fait des articles très habiles, c’est qu’il est libre. An fond c’est la condition de pouvoir, de ne pas l’être.
Selon moi il n’y a de Val Richer possible qu’avant le jour de la convocation, pendant ce jour-là impossible. Voilà une et deux interruptions. Pardonnez, pardonnez. Adieu. Adieu. Ecrivez moi. aimez moi (quelle bêtise !) et arrivez. Adieu.
451. Paris, Mardi 13 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai à peine dormi trois heures cette nuit, je ne sais pas pourquoi, si ce n’est que je n’ai pas été au bois de Boulogne hier. Ma belle sœur m’a retenue chez moi et puis des visites à faire. J’ai vu le soir les Appony et les Granville, chez eux respectivement lord Granville avait vu M. Thiers le matin, il avait de ses nouvelles après votre entretien avec lord Palmerston samedi, mais il lui a dit que vous ne lui mandez rien d’ici pourtant ; de sorte que Granville n’osait rien. Les fonds ont monté beaucoup hier, il faut que ce soit sur des nouvelles. de Londres, mais la diplomatie les ignore tout-à-fait. Le roi a reçu Brignoles dimanche au soir et lui a fait subir le même accueil qu’à Fleishmann c’est-à-dire des tirades violentes contre le traité, violentes de paroles et violentent de gestes de façon à épouvanter l’Italien comme l’avait été l’Allemand.
J’ai vu Brignoles hier qui n’en revenait pas. Le roi lui avait semblé très belliqueux, très irrité, très inquiet et il relevait de son discours que c’était une guerre agressive qu’il se voyait à la veille. d’entreprendre. Montrond est venu chez moi le matin, un peu le contraire, ton à la paix, disant que le roi la croyait sûre. Qu’il était très contente de Thiers. Thiers est très peu accessible depuis une huitaine de jours toujours à Auteuil, il cherche à s’effacer pour le moment.
Mes ambassadeurs n’y ont pas été et par conséquent ils l’ont point vu depuis plus de huit jours. Montrond me disait : " Voilà M. Guizot collé à Londres et collé à Thiers n’est-ce pas ? Je n’ai pas répondu à n’est-ce pas, je ne réponds jamais que de moi-même.
1 heure.
Le journal des Débats est très inquiétant ce matin, et le National très épouvantable. Tout le monde dit : s’il y a guerre, il y a par dessus le marché trouble à l’intérieur. S’il n’y a pas guerre, il y a surement trouble à l’intérieur. Quand ce serait vrai, il vaut mieux le mal simple par le mal double. Mais est-il possible qu’on soit condamné à voir cela ? Je suis mal disposée ce matin, j’ai peur, c’est sans doute parce que Mardi je n’ai rien pour me soutenir. J’attends demain avec grande impatience une grande curiosité. Mon fils est parti pour Londres, ce matin, je ne lui ai pas nommé son frère.
Adieu. Adieu que verrons-nous arriver dans le monde ? Je vois bien noir. On laisse trop aller le mal, pourra-t-on le maîtriser ?
Adieu, toujours le même adieu, à travers la guerre les émeutes. Ah mon Dieu ! Marion est animée, elle est venu me voir ce matin, bien gentille et bonne comme de coutume. Mon fils la trouve charmante mais voilà tout. Adieu. Adieu.
452. Paris, Mercredi 14 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je n’ai vu hier que l’Angleterre. L’Angleterre agitée, curieuse, mais assez en espérance. Lord Granville à vu M. Thiers hier au soir à Auteuil. Je l’ai vu à son retour, il ne m’a dit que des généralités, mais l’impression que j’en ai est bonne. J’attends votre lettre avec des battements de cœur. Je préparé une réponse à mon frère, mais je ne ferai rien sans votre avis. On est agité extrêmement dans le public. M. de Lamenais est épouvantable dans les provinces il y a beaucoup d’exaltation. Le gouvernement aura une rude besogne, car j’espère bien qu’il s’appliquera à apaiser. Je suis inquiète. Les Anglais désertent, ils ont parfaitement peur.
Midi
Point de lettres ? C’est toujours le Mercredi qu’elles m’arrivent le plus tard et c’est précisément. Le jour où elles sont le plus ardemment désirées. Il faudra attendre la soirée. C’est bien long ! 2 heures. Le petit est venu aussi impatient, aussi pauvre que moi. Que faire ? Et par dessus le marché je n’ai rien à vous dire. je m’en vais un mettre à lire ce long memorandum. Je n’ai pas vu mon ambassadeur depuis deux jours, il écrit je crois.
2 1/2
Tous les alliés chez moi grand bavardage dont je n’ai plus le temps de vous dire un mot. Adieu. Adieu. On dit seulement que jamais on ne s’est trouvé plus près du dénouement absolu. Paix ou guerre. Adieu.
453. Paris, Jeudi 15 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu hier après 3 heures les deux lettres de dimanche et lundi votre bonne intention de dimanche n’a été remplie que tard comme vous voyez. Mais mon cœur la compte, je vous en remercie beaucoup beaucoup. Eh bien je vois qu’on a été content de la note, et je vois cependant que cela va encore traîner. Toujours traîner. Ah mon Dieu ! Il est évident qu’on attend vos réponses.
J’ai beaucoup causé avec ma belle sœur, elle est bien peu de chose, mais enfin elle sait et elle se souvient elle se souvient donc qu’il n’y a pas quelque jours aujourd’hui, on ne rêvait pas à la guerre on ne la voulait pas ; elle est très surprise de tout ce qu’elle entend ici. Le mémorandum de Thiers est fait avec un grand talent. Cela se lit et se comprend parfaitement, et je conçois qu’ici il fasse un excellent effet pour le gouvernement et qu’au delà de la manche il a porte également la conviction dans beaucoup d’esprits. Mais nous autres ses visiteurs d’hier matin nous n’en sommes pas contents. Appony dit que tout ce qu’il dit de l’Autriche est faux. M. de Pahlen dit qu’on est bien près de se battre quand on parle ainsi de la Russie. Et il s’attend a quelque contre coup fâcheux de chez nous. En effet voilà des aveux difficiles. Il y a une forte différence entre penser les choses, et les dire ! Nous savons bien que tout le monde pense cela de nous mais aucun gouvernement n’a encore proclamé cette pensée. La France le fait.
Pensez un peu à cela, ne trouvez-vous pas que M. de Pahlen a raison. J’ai eu un long entretien hier avec ma belle sœur. Elle est d’avis d’une forte démarche de ma part contre M. de Brünnow. Elle est d’avis que je raconte tout en détail ma lettre est faite, j’attends votre conseil. J’insisterai sur une réparation. Elle m’a dit de drôles de chose.
L’empereur a toujours de la colère quand il est obligé de reconnaître que j’ai un peu d’esprit. Cela le dépite. J’ai été à une soirée chez Mad. Appony hier. La diplomatie est triste et inquiète. A propos Appony n’a plus été chez M. Thiers depuis 10 jours, et ne compte y aller que lorsqu’il aura eu un Courrier de Vienne. Mon ambassadeur n’y a pas été non plus depuis tout ce temps. Si bientôt les choses ne prennent pas une bonne tournure, elles ne prendront une bien mauvaise. Appony trouve que la question a fait un progrès sensible en ce qu’elle est très simplifiée mais aussi c’est bien plus grave, et la guerre ou la paix est à la porte, il n’y a plus de faux fuyants possibles. il y a des gens qui disent que s’il faut la guerre au bout de tout cela, il vaut mieux l’accepter tout de suite. Quand la France sera bien en mesure de la faire les alliés pourraient bien n’être plus aussi unis. Aujourd’hui ils tiennent ensemble et la France n’est pas suffisamment préparée.
Cependant il me parait clair aussi que nous (alliés) nous ne la commencerons pas, et que ni d’une part, ni de l’autre il n’y a de véritable bonne raison pour la commencer. Quelle mauvaise bagarre que tout ceci ! Que le ciel nous en tire, car les hommes ne paraissent pas devoir nous en tirer. Quand viendrez-vous quand me pourrez-vous venir ? On dit que tous vos amis sont d’opinion que vos devoirs à Londres sont un prétexte et même une raison suffisante pour vous dispenser de vous trouver ici à l’élection du président.
J’attends avec impatience ce que vous déciderez. Je n’ai point d’opinion là dessus. Je désire que rien n’aggrave l’embarras de la situation que rien ne gâte la vôtre. Je fais des vœux pour l’ensemble, je fais de bons vœux pour vous. Voilà où j’en suis. bien incertaine sur les moyens de concilier tout.
1 heure
Le petit sort d’ici ; tout ce qu’il me dit est bien grand pour le Cèdre. Le cœur me bat bien fort. Qu’est-ce qui ressortira de tout ceci ? L’heure de la décision à prendre va sonner. Ah mon Dieu. Adieu. Adieu. Mon cœur est aussi inquiet qu’il est tendre, qu’il est fidèle, qu’il est passionné. Adieu.
455. Paris, Samedi 17 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
455. Paris, Samedi 11 octobre 1840,
Oui je suis d’accord avec vous sur tout ce que vous me dites. Prenez ce oui aussi largement que vous voudrez pour le moment, je vous parle de quelque chose de sérieux. Londres vaut mieux que Paris dans les derniers jours du mois, à moins comme vous dites qu’il ne vous vienne de nouvelles lumières.
J’approuve complètement votre résolution de rester étranger à toute intrigue ; et votre absence en sera la preuve la plus forte. Mais il ne me parait pas possible de ne pas être ni pour la discussion de l’adresse ? N’est- ce pas ? C’est dans l’intérêt de votre situation politique que je parle. Et puis, si vous ne venez pas alors où serait le prétexte de venir après ? Ce ne serait plus possible. Que vous devez être troublé, agité! Mon Dieu comme je le comprends ! Comme je le suis moi même ! Quelle bagarre où se trouve tout le monde, toute chose !
Thiers a confié à quelques diplomates son envie de se retirer retirer M. Urguhart qui devait être reçu par le roi ne l’a point été. Lord Granville fait ce qu’il peut pour empêcher Thiers de recevoir ; la députation de Birmingham, Attwood & &. Il a dit à Thiers que cela équivaudrait à Palmerston recevant M. de Lamenais avec une députation de républicains. Je ne sais encore ce que fera Thiers sur cela. J’ai vu chez moi hier matin les Appony. Après cela les Granville. Le soir j’ai été chez eux. Je ne suis pas d’avis comme vous de laisser M. de Brünnow tranquille j’écris à mon frère je vous enverrai ma lettre.
11 heures mille bons adieux pour votre lettre. Je l’aime bien. Je suis comme vous quand j’entends de la musique. Et une fois la semaine j’en entends de la bonne. Je choisis votre place, je jouis d’avance. Que de charmants moments. Je ne pense qu’à cela quand je ne pense pas au plus grave ; et le plus grave je n’y pense qu’en ce qu’il a des rapports à vous. C’est bien vrai. ce que je vous dis ! Et vous le croyez bien. Et moi je crois bien tout ce que vous me dites. Ce que j’appelle grave, est votre superficiel, comme vous l’appelez superficiel relativement à ce qu’il y a dans le fond de votre cœur et qui est votre vie, comme la mienne. Et bien êtes-vous content de ma foi ?
J’aime votre résolution pour votre arrivée, j’aime la manière dont vous le dites. Après cela il ne faut rien d’absolu, car les événements peuvent vous mettre dans la nécessité de modifier votre résolution. Jusqu’ici je n’en vois pas l’occasion, mais si elle venait je saurais tout comprendre. En attendant vous avez mille fois raisons de vous poser ainsi, ferme, décidé et droit.
Savez-vous que la situation de Thiers est la plus difficile, la plus critique qu’il soit possible de se figurer ?Je ne comprends pas comment tout celle se débrouillera. on croit beaucoup qu’il nous donnera un coup de théâtre avant l’ouverture des Chambres. On dit ou autre chose.
En attendant le bruit se répand qu’Ibrahim marche sur Constantinople, en ce cas là nous occupons Constantinople et ce cas là est-il pour vous la guerre ? Mon Dieu, la guerre, jugez ce qu’est pour moi, pour nous la guerre !
1 heure. Voici mon visiteur du matin qui me quitte. Je suis fort aise de tout ce qu’il m’a dit et qu’il ne vous mander. Cela se pose bien. Le 62 de Samedi ressemble bien peu au 20 de jeudi. Rien ne me ferait plus de plaisir que de voir 1 revenir à ses bons sentiments. C’est utile. Il me semble que je puis commencer à me réjouir. Et pendant, tout est si mobile ici.
J’ai vu hier des personnes qui dînaient au Club jeudi. Lorsqu’on est venu raconter le coup de carabine. Je ne suis pas contente de la manière dont cela y a été pris : de l’indifférence, la légèreté. Des jeux de mots. c’est le tirant et non le tyran qui a été blessé. Et des éclats de rire. Les journaux sont très bien, et à tout prendre je crois ceci une bonne fortune. Adieu, car j’ai peur d’être interrompue cela m’arrive si souvent. Adieu, adieu.
443. Paris, Lundi 5 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Hier a été une journée bien active et bien bavarde. D’heure en heure quelque rapportage, et à 5 heures à Tortoni la nouvelle que Thiers avait donné sa démission. On disait qu’il avait résolu de convoquer les chambres, d’y apporter la guerre et d’ordonner en attendant la marche de 200 000 hommes vers le Rhin et l’envoi de votre flotte à Alexandrie pour l’apposer aux alliés. On disait que le roi n’avait point voulu accorder tout cela, ni rien de cela, et que par suite Thiers donnait sa démission. nous verrons aujourd’hui. Berryer est venu chez moi à deux heures. Il ne savait rien de ces bruits, ils n’ont circulé que plus tard mais il me dit qu’une crise ministérielle était arrivée : que Thiers ne pouvait point reculer, qu’évidemment il lui fallait la guerre et que la chambre accueillerait avec transport la guerre, parce que telle était la disposition des esprits maintenant qu’il fallait commencer cependant que Thiers avait fait bien des fautes, qu’il n’avait fait que des fautes mais que pour le moment il ne s’agissait pas de les examiner, qu’il fallait satisfaction à l’amour propre national, et que comme cette satisfaction ne se présentait pas pacifiquement, il fallait la prendre de l’autre manière que ces derniers deux ans avaient fait une grande révolution dans les esprits, qu’il ne pouvait plus y avoir dévouement ou confiance, que les existences avaient été troublées, tout remis en question, et que dès lors, tout pouvait ressortir de cette situation. Que l’Angleterre avait été bien habile, que lord Palmerston était le plus grand homme qui eut paru depuis M. Pitt. Paralyser à la fois la Russie, (je n’ai pas accepté la paralysie) remettre à la tête des grandes puissances, s’emparer de la direction des affaires en Espagne, et rendre ainsi la situation de la France périlleuse de tous les côtés, c’était là un chef d’oeuvre d’habilité, enlevé galamment avec une prestesse admirable. Enfin il grossirait cela de toutes ses forces pour enfler les comparaisons. Il parlait pitoyablement des notes diplomatiques. Il demandait la réponse au factum accablant de Lord Palmerston ? Et puis il a brodé sur les crédits extraordinaires, sur les fortifications de Paris surtout, et de quel droit, sans avoir consulté la Chambre ? Et le bois de Boulogne à qui appartient-il ? Il dit après : le roi a tiré de ce ministère tout ce qu’il lui fallait pour sa propre force. Ce que Thiers préparait pour dehors, le roi se promettait bien de l’employer au dedans et le jour où arrivera la la nécessité d’une révolution extrême, le roi ayant profité habilement de tout ce que la popularité de Thiers a pu lui fournir jusqu’à sa dernière limite, le Roi se passera de lui. Placé entre deux dangers une lutte extérieure, et une lutte intérieure, le roi choisira toujours cette dernière chance. Voilà le dire de Berryer sur la situation en gros ; il n’a point nommé les personnes. Il a seulement dit en passant que vous et Thiers étiez mal ensemble, j’ai dit que ce devait être nouveau parce qu’il me semblait tout le contraire lorsque j’étais à Londres.
Après Berryer, j’ai vu tout mon monde diplomatique les quatre puissances alliées agités, mais point inquiets. Ils ne croient pas sérieusement à la guerre. Sébastiani a dit hier encore à 4 heures de l’un de ces diplomates. Tenez pour certain que le roi n’y consentira pas. Le petit ami est revenu hier une seconde fois très animé, très troublé de tout ce qu’on dit, et de tout ce qu’on lui demande. Je lui ai dit de vous tout dire dans le plus grand détail. Hier soir à 10 heures, M. de Broglie était chez Granville, qui lui a appris tout le tripotage de la journée. M. de Broglie n’en savait pas un mot, et ne voulait pas y croire. Il ne voulait pas croire que le ministère eût pu arriver à ds résolutions aussi excessives. Mais M. de Broglie, me parait être quelque fois un enfant. moi, je suis très très préoccupé de tout ceci pour vous !
Lady Palmerston m’écrit. avec amitié. Sur les affaires elle me dit : " Lord Palmerston désire plus que personne la paix, et je ne puis croire qu’avec ce désir général il y ait crainte de guerre. La conduite de M. Thiers rend toute négociation à présent fort difficile, mais il est clair que l’on serait fort aise de s’accommoder avec la France autant qu’on peut le faire sans déshonneur, et sans abandonner ses alliés. Mon mari est fort raisonnable dans cette affaire et saisirait volontiers tout moyen d’accommodement qui ne porterait point atteinte à l’honneur de son pays, ainsi ne dites pas que c’est de lui que dépend la paix ou la guerre, parce que le résultat est bien plus entre les mains de M. Thiers. Si la France se comporte comme une écervelée ce ne serait point une excuse pour nous d’être lâches ou d’abandonner nos alliés." Elle me dit encore que le duc de Wellington et Peel sont bien plus déterminés encore que son mari, et que Peel a dit : " Si l’on fait des concessions à la France, il n’y aura pas de paix dans trois mois. "
Onze heures
Je reçois votre lettre c’est charmant d’être à Lundi, c’est charmant Mercredi. Mais que faire de l’intermédiaire ? Votre gravure est devant moi dès que je quitte mon lit, tous les jours je trouve la ressemblance admirable. Mais pourquoi ne me regardez-vous pas ? Est-ce le peintre ou vous qui avez voulu cela ? Je ne suis pas sûre que vous ayez eu raison ; c’est parfait comme cela, mais votre regard fixé sur moi, c’eût été mieux encore. Je me repens d’une petite querelle que je vous ai faite hier pour abstenir des nouvelles modernes plutôt que des souvenirs anciens d’Angleterre.
Je me repends de tout ce qui n’est pas des paroles douces tendres ; de loin il ne faut jamais un moment d’impatience même sur ce qu’il y a de plus puéril. compte sur vous. Vous me connaissez un peu pétillante, vive et puis c’est des bêtises.
Mad. 79 se plaint de ce que le bouleau a trop d’intimité avec les personnes qui ne sont pas de l’avis de R. Les journaux ce matin sont bien plats à côté du commérage de la journée d’hier. Le constitutionnel est en bride. L’incertitude ne peut pas durer.
Je ne me porte pas mal, mais je ne suis pas encore assez bien pour voir du monde. Le soir cela me fatiguerait. M. Molé est revenu hier mais je n’y étais pas. Je passe le dimanche à l’ambassade d’Angleterre. Je trouve lord Granville très soucieux. Sa femme est allée avant hier à St Cloud. Elle n’y avait pas été depuis plus de 3 mois. Jamais, elle n’a vu la reine dans l’état d’accablement et de tristesse où elle l’a trouvée.
Samedi 1 heure.
Je n’ai vu personne encore, je viens de marcher sur la place, je rentre pour fermer ni avant les interruptions. Je vous écris des volumes il me semble, mais il me semble aussi que vous les voudriez encore plus gros. Je vous crois insatiable comme moi. Je vous crois comme moi en toute chose, en tout ce qui nous regarde, un peu aussi en ce qui ne nous regarde pas. Enfin je trouve que nous nous sommes tellement eingelebt (Connaissez-vous la nature de ce mot ? ) que nous n’avons plus besoin de nous rien demande,r nous nous devinons. Devinons-nous ce que deviendra ce mois-ci ? Ah pour cela, non !!
Adieu. Adieu. La crise ne peut pas se prolonger. Il faut que la convocation des chambres ressorte de ceci. Adieu. Adieu toujours adieu quoique vous commenciez un peu à le mépriser, et moi peut être aussi. Mais nous sommes trop pauvres pour ne ps accepter les plus petites aumônes. Adieu.
456. Paris, Dimanche 18 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Vraiment la musique ajoute bien à... ( Trouvez le mot ) et je crois moi qu’en Italie on doit savoir mieux amer qu’autre part. Hier aux Italiens j’étais comme vous à votre fenêtre, c’était si doux ; si charmant, si enchanteur, mes pensées étaient si tendres. Venez, venez dans ma loge. Serait-il possible que dans quelques jours vous y soyez ? Quel bonheur.
J’ai vu fort peu de monde. hier. Les Granville, ignorants ; Mad. de Flahaut inquiète de la situation du ministère. Disant qu’il faut qu’il se renforcé à droite pour avoir la droite, ou plus sincèrement une portion de la droite. à gauche pour s’affectionner davantage ce parti, et c’est ce qu’elle conseille, car après tout c’est les doctrinaires qui ont les bonnes places, les grandes places et les vrais amis n’ont rien ! Voilà ; et puis les Doctrinaires ne sont pas ralliés. Il pérorent dans les salons, ils frondent & &
Aux Italiens il n’y avaient personne. Toute la diplomatie était à Auteuil. les bruits de retraite de M. Thiers circulent, mais on dit assez généralement dans le monde qu’on les fait circuler, et qu’il n’y a rien de vrai. On dit aussi, c’est 18 qui me le dit que le Roi n’accorderait pas à M. Thiers de se retirer, qu’il le sait positivement ; car il y aurait dans ce fait trop de danger pour le Roi. On dit beaucoup aussi que l’ouverture des Chambres sera retardée. Je crois, que cela ferait un mauvais effet, c’est ce qui me fait en douter.
Midi, à ma toilette, je vous regarde toujours comme vous avez le droit d’attendre que je vous regarde. Voici du nouveau aujourd’hui. Je me suis surprise à rire en vous regardant. Connaissez-vous ce rire, du plaisir, le rire du bonheur ? C’était celui-là ce matin puisque je vous dis des bêtises il est clair que je n’ai rien à vous dire. Je n’ai pas de lettres encore.
Adieu, vous trouverez ceci trop court, je le trouve aussi, mais savez-vous que je suis accouchée d’une grande et d’une petite lettre ce matin à mon frère. Toutes deux le même sujet. Je vous les enverrai. J’attends ma belle sœur pour les lui lire. Adieu. Adieu, le plus charmant adieu.
457. Paris, Dimanche 18 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu votre lettre après le départ de la mienne. Vous voulez que je vous dise plus, que je vous dise ce que je pense sur le moment de votre arrivée. Mais vraiment je crois vous l’avoir bien dit. Si vous n’êtes pas ici pour l’ouverture, et l’élection du président. Il faut être à Londres, cela est bien sûr. Ce point-là est l’essentiel, mais c’est à vous à juger si vous devez être absent ou présent pour cette élection. Je n’entends rien à cela peut-être ayant une si bonne raison pour vous tenir éloigné dans ce moment là vaut-il mieux ne pas aggraver les embarras ; votre absence remplit ce but ; mais il n’y a que vous qui puissiez juger s’il vous convient de faire à vos rapports avec le ministère le sacrifice des exigences de vos amis. Je retourne souvent cela dans ma tête et je pense toujours sauf meilleur avis que vous pouvez vous dispenser de prendre part. à l’élection. Quant à la discussion de l’adresse vous devez y être, c’est clair à moins de l’impossible, c’est-à-dire que dans ce moment-là vous concluiez vraiment quelque chose de bon, d’avantageux à Londres. Il n’y a que cela pour excuser votre absence. Mais aussi cette excuse serait un triomphe.
Vous êtes tenu autant que possible au courant de tout, voilà ce que m’assure la très fidèle, d’après cela vous pensez conclure. Je fais tous les vœux du monde pour que Dieu vous inspire et vous mène bien. Je sens toute l’importance, toute la difficulté du moment. Il ne faut pas faire de faute. Il ne faut pas vous mettre dans votre tort. Et après avoir dit cela, je sais bien cependant que vous y serez toujours aux yeux des uns ou des autres. C’est inévitable et c’est là ce qui me désole. Voyez-vous voilà quatre pages qui n’ont pas le sens commun, et qui ne vous éclairent pas même sur mon opinion ! Cela valait bien la peine de commencer. Toute ma journée a été prise, et le reste va l’être encore. J’ai eu deux-heures le Duc de Noailles, venu pour la journée, seulement. Je l’ai mené au Bois de Boulogne ce qui ne l’a pas trop diverti mais il voulait causer. M. de Werther longtemps. Ma belle sœur très longtemps. Elle est fort contente de ma lettre et elle l’appuiera. Plus tard mon Ambassadeur content de moi aussi, et est parfaitement d’avis de la lettre M. Molé m’a écrit pour demander à me voire, je lui ai fait dire de venir ce soir je l’attends car voici 8 h 1/2.
Le fidèle sort d’ici, il m’a dit tout ce qu’il vous a mandé ce matin. Je n’ai pas de réplique, et dès que vous avez confiance dans l’avis de M. Bertin de Vaux il faut le suivre. D’ailleurs il m’a rapporté des paroles frappantes, des antécédents que j’avais oubliés, et qui vous obligent de faire aujourd’hui ce que vous avez fait après la coalition, c’est évident : d’ailleurs si, comme le pense M. de Vaux, votre opposition à la présidence de M. Barrot doit au moins se manifester par lettre à vos amis, autant vaut, & mieux vaut venir vous-même. Vous voyez bien que dans tout ce que je vous dis je m’efface tout à fait. Je cherche ce qui est bien, ce qui est honorable pour vous, mon plaisir vient après.
Lundi 8 heures. Ma soirée n’a pas été comme je le pensais. Nous ne nous sommes pas dit un mot M. Molé et moi, nous n’avons pas été seuls un moment. M. de Werther mon ambassadeur, Lord Granville, Brignoles, Tschann, le duc de Noaillles. le Duc de Noailles, Lord Granville n’avait pas l’air aussi content que je l’espérais et que me le faisait croire les lettres de Lady Palmerston reçues hier. M. Molé est encore maigri, il est comme moi maintenant il est très triste et très aigre. Il a vu le roi pendant deux heures samedi. A propos il a dit à 55 qu’on vous avait envoyé votre congé, que vous allez venir. Et que Thiers a dit qu’il serait très bien pour vous si vous êtes d’accord dans le langage à tenir ; mais que s’il y avait la plus petite nuance, il avait dans sa poche de quoi vous accabler. Qu’est-ce que cela veut dire ? L’abdication de Christine racontée hier au soir n’a étonné personne, et puis rien ne fait de l’effet que le Canon en Syrie, et celui là retentit rarement. On est étonné de ne rien apprendre. Lady Palmerston me parait bien couronnée de la publication de la dépêche de M. Thiers immédiatement après la communication que vous en avez faits à son mari. Elle dit que vous vous en défendez, que vous défendez Thiers mais elle accuse nécessairement un Français. Du reste sa lettre est dans un ton très pacifique quoiqu’il y perce de la rancune contre Thiers. Quelle déplorable chose que ces personnalités !
1 heure. Je n’ai encore ni lettre, ni fidèle. Savez-vous qu’on me dit que le muguet est un peu inquiet pour son compte de la menace de 6 ? 2 heures. Voilà votre lettre, et voilà le petit qui m’a tout lu. C’est admirable, admirable, je ne trouve que ce mot, et que ce moment. Je sais que 62 n’adopte pas votre point de vue et vous écrit aujourd’hui comme cela. Je crois l’avis des autres amis plus sincères, comme je le trouve au fond plus logique, il me parait. Mon Dieu je ne sais pas ce qu’il me parait. Choisissez. Je suis une femme. Je ne suis pas brave. Vous le serez. Adieu. Adieu. Adieu.
458. Paris, Mardi 20 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
458. Paris mardi 20 octobre 1840,
9 heures
Puisque vous êtes inquiet de ma lettre à mon frère, je vous en envoie copie, et je vous préviens qu’elle ne part que samedi ou dimanche, par conséquent votre réponse à ceci m’arriverez avant. Lisez, je la trouve bien, la trouve absolument nécessaire. Ma belle-sœur m’appuie, l’occasion est bonne, Dites-moi votre avis. J’ai dîné hier chez mon Ambassadeur. Je n’ai pas pu le lui refuser c’était un dîner de famille Appony, & Benckendorff. J’y ai revu Zuglen, il repart et revient bientôt pour résider ici en place de Fagel. C’était très différent de Fagel ! De chez M. de Pahlen, j’ai été chez Lady Granville. M. de Broglie en sortait, il avait dit à Granville que vous serez ici le 26, qu’il regrettait que vous n’eussiez pas remis cela de quelques jours, qu’il aurait mieux valu attendre que l’élection du président fut passée ! J’ai vu le matin Mad. de Flahaut. Elle trouve que le ministère de Thiers est bien orageux, que tous les guignons sont venus l’accabler, elle dit beaucoup cela. Et puis elle s’inquiéte, elle dit que la gauche est impatiente il n’y a pour elle aucune faveur, elle sont toutes aux doctrinaires. Elle parle plutôt avec tristesse qu’avec passion.
Mais elle est venue sur l’Angleterre c’est-à-dire sur la portion du ministère qui a amené la rupture avec la France. J’ai donc lu la note du 8 octobre. Je suis ravie de la trouver si pacifique, mais je ne puis pas ajouter que je la trouve brillante. ni pour la forme, ni pour le fond Je ne le des pas mais je le pense.
Je suis trop heureuse de tout ce qui ajoute aux chances de paix. et généralement ceci est regardé comme rendant la guerre impossible. J’irai peut-être jusqu’à trouver ou jusqu’à dire que la note est très belle ! Savez-vous que je crois que je rêve quand je pense que je suis à si peu de jours de tant de bonheur ! Je ris de plaisir et puis je joins les mains, je remercie Dieu, et je le prie. Vous faites comme moi, j’en suis sûre. M. le conte de Paris est très mal on ne croit pas qu’il en revienne. Je ne vous dirai jamais assez combien j’ai trouvé votre lettre à 62 admirable donnez m’en une copie je vous en prie. Je n’ose pas la demander au fidèle sans votre permission. Permettez-lui. Il y en a deux autres aussi belles, si elles ne le sont pas plus encore, à ce qu’il me dit, que je n’ai point lues. Permettez. La Diplomatie dit beaucoup qu’il y a danger imminent, terrible, si Thiers sort du Ministère. Ils sont effrayés à mort ces pauvres gens. Thiers rentre en ville aujourd’hui. Le Roi pas avant le 26, à ce qu’on dit.
2 heures. Voici le petit auquel je donne ma lettre. Je n’ai rien à ajouter. Certainement la crise y est. Dans la semaine il peut y avoir quelque chose. Etes-vous bien décidé ? Quel jour ? Quel que soit ce jour, il sera beau, il sera ravissant. Adieu. Adieu. Mille fois adieu.
458_1. Paris, Le 16 octobre 1840, Dorothée de Lieven à M. de Benckendorff
Paris 16 octobre 1840,
J’ai eu votre lettre du 13 sept. mon cher frère. Je vous remercie sincèrement de la première page. Elle me soulage. L’Empereur est étranger aux procédés de M. de Brünnow. Le reste de votre lettre exige réponse et explication. Lorsque je me suis rendue à Londres, je vous ai promis, & je me promettais à moi-même que de là mes lettres auraient de l’intérêt pour vous. Mes relations à droite et à gauche, me mettaient à même de vous tenir parole. Je l’ai fait et j’ai coutume jusqu’au jour où Lady Palmerston d’un côté, Lady Clauricarde de l’autre, toutes deux mes amies intimes m’ont rapporté ces étonnantes paroles dites par M. de Brünnow à leurs maris respectifs :
" Prenez garde à M de Lieven. Mad. de Lieven ce n’est pas une ruse. Mad. de Lieven est un émissaire de la France. Le moindre mot dit à elle s’en va à l’ambassade de France." Voilà mon cher frère ma réponse à votre question : " Êtes-vous donc bien sûre que M. de Brünnow a tenu sur votre compte des propos favorables ? " Vous voyez que j’en suis bien sûre, et comme pour disculper M. de Brünnow à mes dépends vous ajoutez que mes relations avec M. Guizot sont connues. Je le crois bien ! Je n’ai rien à cacher.
M. Guizot est un homme que son esprit, sa situation, son caractère, sa probité place très haut dans le monde. J’ai du respect pour son caractère et beaucoup de goût pour sa société Je n’imagine pas que vous veuillez insinuer autre chose ? Si je le pensais, je ne vous répondrais pas plus que je n’ai répondu aux journaux. Je reviens à mon texte. J’avais remarqué à mon arrivée à Londres que le corps diplomatique était en grande réserve avec moi, malgré que tous furent mes anciens collègues. Cette circonstance m’avait d’autant plus étonnée qu’à Paris mes relations sont aussi intimes et confiantes que possibles avec tous les représentants des grandes puissances qui sont le fond de ma société. Comme en Angleterre je vis avec les Anglais cela m’importait peu, mais Lady Palmerston le jour même où elle me dénonça les propos de M. de Brünnow à son mari me dit que toute cette diplomatie était ameutée contre moi quelques temps avant mon arrivée et huit jours après cet entretien elle reçut une lettre de son frère Lord Beauvale qui lui mandait de Vienne tout ce que vous me dites, le Prince de Metternich lui avait parlé de ces bruits venus de Londres, et Lord Beauvale ajoute : " Qu’est-ce que veut dire ce bavardage ? " J’ai vu cette lettre.
Devant une intrigue aussi infâme, ourdie avec tant de soin, devant des paroles dites aussi officiellement par le ministre de l’Empereur, à des personnes aussi officielles que lord Palmerston et lord Clauricarde, je n’ai pas pu, je n’ai pas dû me taire. Quelqu’un, quelque chose était cause de la situation bien nouvelle qu’on s’efforçait de me faire à Londres. Comment attribuer à M. de Brünnow la maladresse de faire de moi son ennemi, au lieu de m’avoir pour lui, sur un terrain où tout le bénéfice de bons rapports entre nous, était de son côté ? Comment lui supposer la vilenie, il faut bien me servir de ce terme, et l’audace de venir sans grave raison flétrir par une aussi odieuse calomnie, la veuve de l’homme qu’il appelle son bienfaiteur, une femme de mon rang, placée comme je le suis dans l’opinion et l’affection des personnes les plus élevées et les plus importantes en Angleterre ? Voilà ce que me disaient mes amis en ajoutant que M. de Brünnow connu pour être un grand courtisan s’appuyait peut-être sur ma défaveur auprès de l’Empereur. Or, on la connait à Londres.
Elle a eu là de l’éclat, du retentissement par deux choses surtout ! L’oubli total où l’Empereur m’a laissée à la mort de mon mari ; la quasi défense de venir à Londres lorsque le grand Duc s’y est trouvé. Personne n’avait pu comprendre les motifs d’une d’une semblable rigueur. M. de Brünnow venait de les révéler, ils peuvent même en avoir reçu l’ordre ! Voilà ce que Lady Palmerston me rapportait comme l’opinion des autres et je pouvais même raisonnablement craindre qu’elle même se trouvât dans le doute, car mon expérience du monde m’a assez appris la vérité de cette parole de Beaumarchais : " Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose."
Je vous ai écrit le 5/17 juillet dans la chaleur de la juste indignation que j’ai ressentie ; je vous envoie copie de cet lettre pour mémoire. Je vous ai écrit le 12/24 juillet que, jusqu’à une réponse de vous sur ce point, vous ne deviez pas vous étonner que je suspendisse ma correspondance intime avec vous, et par une autre lettre du 9/21 août j’ai motivé cette résolution. En effet après tant d’années, tant de preuves de dévouement, voir mon dévouement reconnue de cette façon ; voir le ministre de l’Empereur me dénoncer à un gouvernement étranger comme un traître.
Voir cette calomnie faire son chemin auprès de deux autres cabinets étrangers, la voir ébranler la foi de mes plus intimes amis ! C’était trop, et avant que les causes de cette injures fussent éclaircies j’ai dû m’arrêter tout court c’était bien le moins que je pusse faire. Je vous en ai prévenu et vous faites de cela un chef d’accusation contre moi ! Par mon silence, je confirme les soupçons ! Est-ce me juger avec équité, est-ce seulement me juger avec logique. J’en reviens à la confidence qui m’a été faite des propos, de M. de Brünnow. Savez-vous ce que j’ai dit quand lady Palmerston et lady Clauricarde me les ont dénoncés ? J’ai dit, et j’ai dit bien fort. " L’Empereur ne le croit pas, l’Empereur ne le croira jamais car l’Empereur me connait. Mais il ne sera pas loisible à son ministre de m’injurier impunément." Voilà l’écho que je devais trouver à Pétersbourg.
Vous m’accusez au lieu de me défendre. L’Empereur fait mieux que vous. Pour la première fois depuis tant d’années, l’Empereur me fait dire des paroles d’amitié, d’ancienne amitié, par votre femme. L’Empereur sait que je suis un sujet fidèle et c’est le moment où d’autres veulent en douter ; c’est ce moment que l’Empereur choisit pour me faire parvenir un souvenir bienveillant. Dites à l’Empereur que les plus grandes faveurs sont doublées par l’à propos. Mon cœur le remercie de la faveur, mon esprit de l’à propos. Mais si mon cœur est satisfait, mon honneur ne l’est pas, car il n’en reste pas moins constant que M. de Brünnow a jeté une tache sur le noble nom que je porte ; que c’est me déshonorer que de douter que je suis le loyal sujet de l’Empereur, me déshonorer que de le dire ; et que la dame d’honneur de l’Impératrice ne peut pas rester sous le coup d’une semblable calomnie. C’est à ce titre, si ce n’est au mien propre que je demande que M. de Brünnow rétracte ce qu’il a dit là où il l’a dit, parce qu’encore une fois, il me faut cela ou autre chose qui atteste aux yeux des autres que je n’ai jamais mérité de si odieux soupçons. Je vous prie de mettre cette lettre sous les yeux de l’Empereur.
459. Paris, Le 21 octobre mercredi 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Il faut que je commence par vous parler de votre arrivée. j’ignore à quoi vous vous serez décidé pour le jour, mais quel que soit celui-que vous choisir, il me parait impossible que vous ne veniez pas droit à Paris. Votre absence de votre poste dans ce moment pour 24 h. seulement doit avoir un motif impérieux. Ce motif c’est la Chambre. Lors donc que vous quitterez Londres ce doit être pour vous rendre à Paris en droiture. Soyez sûr que j’ai raison la dedans.
Prévenez le fidèle et ordonnez lui d’aller vous trouver à Calais ou plus près sur la route. Donnez lui un rendez-vous précis. Il lui faut quelques heures de conversation avec vous avant que vous tombiez dans cette Babylone. C’est absolument nécessaire. Vous viendrez dîner chez moi le jour de votre arrivée n’est-ce pas ? Concevez-vous le plaisir que j’ai à tracer ces simples mots !
On dit que Thiers a accueilli comme ci, comme ça le communication que Lord Granville lui a faite hier de la réponse anglaise à la note du 8. Il a dit : " On reste toujours dans le même. cercle de difficultés puisque l’Angleterre met pour condition la soumission immédiate du Pacha." Le dire de Thiers aux ambassadeurs est que si la négociation traîne en longueur, on aura la guerre au printemps ; voilà cependant une modification car auparavant on l’avait tout de suite. Il s’était d’abord fâché beaucoup de la défense prussienne pour la sortir des chevaux ; hier il a été plus doux sur cela, et a dit : " Ce n’est pas poli, ce n’est pas amical, mais nous en trouverons ailleurs. "
J’ai vu hier les Granville le matin, Werther ; le soir Appony & mon ambassadeur. Je me couche toujours à 10 heures, je vais prendre de meilleures habitudes. Mad. de Castellane est venue hier s’établir à Paris. On arrive, et vous trouverez Paris plus gai que Londres. Envoyez je vous prie cette lettre. Midi. La vôtre ne vient pas encore. Toujours si tard le mercredi ! Je suis charmée des articles de journaux anglais sur le coup de Carabine, il n’y a pas eu un journal français qui ait parlé avec autant de vérité et de convenance. Ici on ne s’entretient plus du tout de cet événement. Le lendemain on n’en parlait plus.
La saisie d’écrits de M. de Lamenais me fait grand plaisir. Je pense que cela étonnera en bien. C’est un bien grave événement pour vous que l’abdication de Christine. Est-il vrai que votre ambassadeur n’ait été accrédité qu’auprès d’elle ?
2 heures. Pas de lettre et personne, pas même le fidèle. Qu’est-ce que cela veut dire. Et il faut fermer ceci, je suis bien impatiente ; au reste je ne suis plus impatiente que d’émotion ; le jour, le four où je vous reverrai ! Si c’est avant, vous serez surement ici mercredi, si après, ce ne sera qu’en novembre. Je vous ai déjà dit que je trouverai bien choisi ce que vous choisirez. Ce n’est pas moi qui vous appelle un jour plutôt. Il ne faut pas penser à moi du tout. Il faut faire ce qui est bien, ce qui est convenable. Il y a peut-être bien de l’habileté aujourd’hui, et bien de la difficulté à rester dans ces conditions là. Encore une fois je ne sais pas décider, ou si j’y pense c’est presque pour opiner pour le retard. Qu’est-ce qui fait donc que je retombe plus naturelle ment sur ce qui me contrarie la plus ? Serait-ce là le vrai. Je ne sais pas, je suis très combattu. Sans doute vous êtes déjà décidé. Ah que je me résignerai avec transport à avoir tort.
Adieu. Adieu. Je n’aime jamais vous envoyer deux opinions si incohérentes. Aussi n’est-ce pas une opinion. Seulement je bavarde, je bavarde, sur ce qui est toujours dans ma tête. Le fidèle serait bien mécontent de moi s’il savait ce que je vous écris. Il est très brave le fidèle, et il a vraiment beaucoup d’esprit. En définitive pour ces choses là je suis convaincue que son avis vaut mieux que le mien. Adieu. Adieu L’aiguille avance, rien n’arrive. Il faut finir mais par un adieu charmant.
460. Paris, Jeudi le 22 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Le brave homme que Simon ! J’ai votre lettre déjà. Ce que j’ai écrit le 30 août ? J’ai vite ouvert mon livre et j’y trouve ces deux mots rien que cela grand jour (souligné) quelques jours auparavant. Il y avait une autre note (la 25) ; venez la lire, deux mots aussi Je ne veux pas les répéter.
Votre lettre hier m’est arrivée tard. Voilà donc les jours figés. Votre lettre d’hier, celle aujourdhui. Une charmante aujourd’hui si fière, si haute, si décidée. Je vous remercie d’être fier, d’être haut, d’être décidé. Je vous remercie de tout, savez -vous de quoi je ne vous remercie pas ? C’est de vous embarquer à Londres pour le Havre, à la fin d’octobre. Vous n’avez donc jamais eu quelqu’un que vous aimez sur mer ? Vous n’avez jamais su ce que c’est que l’angoisse qu’on éprouve de loin, au moindre souffle. Et bien vous me trouverez malade j’en suis sûre car pendant vingt heures je tremblerai au moindre nuage, et si le vent s’élève mon dieu dans quel état je serai! Ne pourriez-vous pas m’épargner cette angoisse. Pourquoi faut-il ce détour. Et s’il le faut absolument pourquoi ne pas prendre par la terre, aller débarquer à Calais à Boulogne, je n’aurai pas peur, mais 20 heures de mer dans cette mauvaise mer ! Mon Dieu, si vous pouviez me faire ce sacrifice, si je pouvais croire que mes paroles seront entendues ! J’ai vu l’alerte de hier matin, j’ai été bien animée, bien furieuse, le soir le petit est revenu plus rassuré et je l’ai été aussi.
J’ai été chez les Appony c’est leur jour. Lord Granville revenait de St. Cloud ; les ministres y étaient, on allait tenir un conseil important sur le discours de la Couronne, il décidera sans doute. La situation du Cabinet Tout le monde a l’air d’attendre une crise ministérielle. J’ai vu M. Molé aussi hier au soir, le visage allongé, inquiet, préoccupé ; reprenant au moindre petit mot qui pouvait avoir un air d’encouragement Je me suis très certainement divertie à ses dépends, il ne s’en est pas douté. Je lui ai fait quelques questions banales, il n’avait pas encore vu M. de Lamartine. On me dit que le Maréchal Soult était revenu radieux d’un premier entretien avec le Roi.
Je ne sais plus ce que je vous dis tant je suis heureuse, heureuse ! Et inquiète de cette longue navigation. Hier après mon dîner je suis restée trois quatre d’heures. couchée rêvant le bonheur qui m’attend, mais le rêvant si vivement, si vivement ! Non, la réalité ne peut pas être si charmante. Et plus j’y pense, plus je tremble ; je tremble de tout ce qui peut se placer encore entre ici et mercredi. Mercredi est la soirée des Appony, Je ne reçois pas, je serai donc chez moi seule. A quelle heure viendrez-vous ? Ah quelle parole ! J’en frémis de plaisir.
Je viens de recevoir une lettre du Roi de Hanôvre par Kielmansegge il craint la guerre, il donne raison à lord Palmerston, il me recommande un monsieur Stockhausen qu’il nomme son représentant ici. Les Ambassadeurs sont un peu agités et un peu curieux de ce qui va arrivé ici. Aucun d’eux cependant ne croit la retraite de Thiers possible Le Siècle l’annonce aujourd’hui comme imminente. Je vous prie de donner rendez- vous au fidèle quelque part. C’est très nécessaire. ¨Pourquoi ne venez-vous pas droit ? Comme cela eût mieux valu. Mais enfin en venant autrement ne pourriez- vous pas aller débarquer à Calais ? Ah mon Dieu que je serais plus tranquille. J’attends pour fermer ceci quelque nouvelle de la matinée. il est 1 h 1/2.
2 heures. Personne ne vient. Comment il faut finir sans plus et voici ma dernière lettre à Londres ! Quel bonheur, cependant comme le cœur me manque quand je songe à cette longue traversée. Pourquoi me donnez-vous ce chagrin ? Quelle angoisse dimanche, quelle angoisse toute la nuit et lundi encore, et quand saurai-je où vous êtes? Ecrivez-moi un mot par la poste directement à mon adresse en débarquant, je l’aurai mardi à mon réveil, mais d’ici là c’est-à-dire de dimanche à mardi quelles heures d’angoisse. Adieu. Adieu.
Je suis sûre que vous ne souffririez pas que je m’embarque pour le Havre. Pourquoi voulez- vous que je le souffre ? Et votre courage ou le mien ne peuvent rien contre la mer. Ah si j’étais là je me jetterais à vos genoux, pour vous supplier de ne pas vous livrer à cette longue navigation et vous m’écouteriez, et bien écoutez-moi prenez par Calais, de là allez au Val-Richer si vous voulez. Aimez moi même un peu moins si cela vous est possible, Mais ne vous exposez pas, ne me rendez pas malade de terreur. Ah si en réponse à ceci Lundi vous me diriez Je vais par Calais, que je vous aimerais mille fois davantage. Adieu, adieu, adieu. Quel adieu que le premier adieu à Paris !
P. S. Voilà le fidèle. Je sais tout, vous n’irez pas au Havre vous viendrez par Calais, Dieu merci, Dieu merci. Arrivez vite. Pour plus de sûreté Voici les nouvelles. Le ministère a donné sa démission on vous a envoyé chercher par télégraphe, ne perdez pas de temps. Venez, venez. Le fidèle ira demain soir à Beauvais pour vous attendre. Quel bon adieu. Je vous écrirai à Calais à l’hôtel Dessein.
461. Paris, Vendredi 23 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Je vous adresse ceci à Calais. Quel plaisir ! à Calais ! Je vous écris encore ce soir par le fidèle qui ira vous attendre à Beauvais. Et puis plus d’adieu de si loin. Est-il possible que je sois à la veille de tant de bonheur ! Tous ce que j’ai vu hier est profondément troublé de la démission de Thiers. Toute la diplomatie était chez moi hier au soir. C’est unanime ; ils voient ressortir de ce fait la révolution et la ;guerre ; ils ne conçoivent pas que le Roi n’ait pas patienté, fléchi même jusqu’à l’ouverture de la Chambre. La démission donnée après l’ouverture avait une bien autre importance ; elle ne présentait par les même dangers. Aujourd’hui ils sont consternés. D’un autre côté les amis de Thiers, Mad. de Flahaut le prince Paul jettent feu et flamme contre le Roi. Des invectives, des cris ; en vérité c’est furibond. Montrond est venu chez moi, il avait vu le Roi, qui lui a dit que c’était irrévocable, que les Ministres étaient sortis, récemment sortis ; à la mention. de Molé le Roi lui a montré par signe si ce n’est par parole, qu’il n’en pouvait pas être question. Voilà le dire de Montrond. Je calcule quand la dépêche télégraphique a pu vous arriver. Ce que vous allez faire. Il me semble que vous aurez eu la nouvelle cette nuit, qu’à l’heure qu’il est vous demandez à Lord Palmerston une dernière entrevue, que cela et vos autres arrangements vous prendront la journée et que vous partez ce soir.
Demain vous passez de bonne heure, et vous trouverez ma lettre à 10 heures à Calais. Vous pouvez être ici dimanche dans la matinée. Dimanche vous dînerez chez moi c’est convenu, mais voici de quoi je veux convenir par dessus le marché, c’est que vous ne verrez personne avant de m’avoir vu quand ce ne serait que dix minutes ceci n’est pas. pour le plaisir de vous voir une minute plutôt, c’est plus sérieux. Je ne veux pas que vous preniez un parti ou que vous le laissiez seule ment soupçonner avant que je n’aie causé avec vous. Je resterai chez moi tout dimanche ; si je sors ce sera pour marcher au jardin un quart d’heure pour prendre l’air. Vous ne pouvez donc pas me manquer. Quittez votre voiture dans quelque rue et venez-vous en ici en fiacre. Voilà mon prospectus. Je vous supplie de faire comme cela.
1 heure
Votre lettre m’apprend que la dépêche télégraphique vous aura trouvé à Windsor. Comme je pense que lord Palmerston s’y trouve, cela ne peut pas faire une grande différence pour vos mouvements. cependant, il ne vous sera guère possible de partir ce soir. Je n’en serais pas fâchée/ Je n’aime pas ce qu’on entreprend un vendredi. Je suis superstitieuse à l’excès dès que mon cœur s’en mêle. Ainsi vous me ferez bien plaisir en m’apprenant que vous êtes parti après minuit.
3 heures
Voilà le petit qui m’a pris mon temps, mais il a été bien employé. Il s’obstine à partir ce soir, il a tort, il attendra plus de 24 heures. Je vous écrirai encore à Beauvais à l’adresse du fidèle. Adieu. Adieu cent mille fois ou une seule.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique (France)
462. Paris, Vendredi 23 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon bien aimé, je voudrais t’envoyer des paroles d’amour aussi vives aussi tendres que l’amour que je ressens. Je suis heureuse, je suis pleine d’angoisse, d’angoisse de plaisir, je t’attends... je m’inquiète. On dit que les rues s’animent qu’il y aura du bruit demain, Dimanche. Avoir à trembler au moment de tant de joie ! C’est abominable. Je voudrais partir avec le fidèle, ah quel plaisir ! mon ami, tu viendras chez moi tout de suite ; à moins que tu n’arrives avant 10 heures du matin ou après 10 1/2 du soir il faut venir chez moi tout droit. Il faut que je te parle avant que tu n’en vois d’autres. Viendras-tu dimanche ? Je t’ai écrit a Calais que je t’attendrai tout le jour. Ton couvert sera là, ne me laisse pas dîner seule. Mon cher bien aimé, que nous serons heureux, que je t’aime, que je t’aime ! Quelle pauvre affaire que ces paroles là écrites ! Comme je le les dirai ! Viens mon bien aimé. Je ne saurais te parler de rien dans ce moment-ci, je ne veux pas sortir de mon style intime. Le fidèle t’entretiendra de tout. Moi je regarde tes yeux, je touche ta main, tes lèvres. Mon ami, mon bien aimé, ah quel adieu je t’envoie là. Mon cher bien aimé adieu. Je tremble de plaisir adieu.
Vendredi 6h 1/2
Il faut que je vous dise un mot plus grave. Je vous conjure de ne point vous presser d’accepter ; avant de laisser soupçonner votre résolution demandez à tout savoir à tout voir ; la situation est bien difficile, vous ne devez pas reculer s’il faut du courage mais vous ne devez pas non plus aller trop vite et vous donner l’air d’un homme avide d’un portefeuille. Je trouve une situation analogue à celle du duc de Broglie bonne. Du pouvoir sans responsabilité cela n’est peut être pas possible maintenant, je ne sais pas, je ne sais rien, je veux seulement que vous n’agissiez et n’acceptiez qu’avec pleine connaissance de cause. Je vous dis tout cela dans la crainte que votre arrivée ne soit à une heure indue pour moi et que vous vous trouvez envahi par les autres avant de m’avoir vue moi. Je ne sais que désirer ou que craindre, je suis très troublée.
Tout me fait peur, si je ne vous aimais pas, je trouverais ce moment bien intéressant. maintenant, je voudrais la tranquillité, la paix du cottage, votre amour, le mien, rien que cela, ah mon ami c’est là le vrai bonheur ! Et nous n’y arriverons jamais. Adieu. encore mon ami, mon bien aimé, chéri, adoré. Adieu.
Il ne faut pas que j’oublie de vous dire que déjà Appony soutient que les puissances alliées seront très disposées à s’arranger sur des bases plus larges puisque Thiers n’y est plus la diplomatie est cependant, dans un bien grand trouble mon ambassadeur envoie un courrier demain, il ne sait rien ; il ne sait que dire. Sinon que Thiers n’y est plus jamais je n’ai vu de si pauvres diplomates, nous en rirons un peu, quand vous aurez à faire à eux ! Adieu. Adieu mon bien aimé le plus aimé des mortels. Adieu.
Samedi je croyais avoir à remettre ma lettre hier au soir au lieu de cela il ne part que ce matin. Je me lève de meilleure heure pour le recevoir et pour te dire encore deux mots. encore deux mots. Brignoles est venu hier au soir il venait de dîner aux finances avec M. de Broglie, on a beaucoup parlé de vous. Broglie a dit qu’il était certain que vous n’accepteriez pas ! J’ai trouvé moyen de faire redire cela à M. de Brignoles deux fois pour en être plus sûre. Cela ne va pas du tout avec les très bons propos que Broglie a tenu hier au fidèle. Le mauvais propos est de plus fraîche date. M. Pelet de la Lozère a dit qu’il ne voyait aucune raison pour que vous n’accepteriez pas car le Cabinet ne se retirait que pour un fait qui vous est inconnu et étranger, un paragraphe du discours. Vous n’en êtes pas responsable. Tout le monde se demande et tout le monde me demande ce que vous allez faire. J’ai une seule et même réponse pour tous sans exception. Je ne sais pas. Je serais bien aise que vous adoptassiez cela aussi pour les premiers moments avant d’avoir bien reconnu votre terrain. Peut-être poussé- je trop loin la prudence dans des conseils que je vous donne, cependant je ne crois pas, regardez bien et puis décidez.
Le duc de Noailles qui est accouru hier de la campagne et pour quelques heures seulement, affirme que vous accepteriez que vous devez accepter. Le pressentiment est général qu’il y aura une émeute, que Thiers y compte. Il se tient toujours à Auteuil. Le Roi rentre aujourd’hui pour rester aux Tuileries. Le vent a soufflé bien fort cette nuit. Je me suis inquiétée pour la traversée de Douvres à Calais, je n’en ai pas dormi. Vous passez. peut-être dans ce moment. 1 heures. Cher bien aimé demain demain, que le Dimanche est un beau jour. Le 30 août était un dimanche, demain huit semaines révolues, depuis que nous nous sommes donnés bien solennellement l’un à l’autre, pour cette vie, pour l’éternité ! Adieu mon bien aimé chéri. Adieu.
Encore, encore je ne puis pas te quitter, un baisir, mon bien aimé, un baiser. Ah si tu savais ce que j’éprouve en traçant ce mot, mon aimé, mon aimé, je te sens si près de moi, si près. Viens mon bien aimé.
463. Paris, Samedi 24 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai encore vu personne, je ne sais rien, je n’ai rien à vous dire. J’ai été prendre l’air pendant 10 minutes. Montrond est venu dans cet intervalle, je regrette beaucoup de l’avoir manqué. Je suis très frappée que le ministère n’annonce pas qu’il a donné sa démission J’ai vu le faire toujours jusqu’ici. Si vous trouvez que la proposition que je vous ai faite de venir me voir de suite en arrivant peut donner lieu à des clabaudages, ne le faites pas. Au fond, le motif pour lequel je vous le demande vous sera suffisamment expliqué de vive voix et par ma lettre, et ce n’est vraiment que cela qui me fait désirer la priorité.
Je vous conjure donc de faire autrement pour que que vous voyez de l’inconvénient à ce que je vous demande. Il ne faut rien risquer, rien gâter ; car vous êtes bien en scène et le moment est bien grave ainsi ne faites que ce qui est bien, et prudent, et le plus prudent je crois est de ne pas faire ce que je vous vous me trouvez ai dit. Vous me trouverez bien raisonnable sur toute chose, et bien pénétrée que c’est un grand moment pour vous. J’ai eu votre lettre de vendredi assez prophétique, sentant que l’air était chargé. 20 heures après l’avoir écrite vous aurez, reçu le télégraphe.
2 heures. Werther sort d’ici, il me rapporte que M. de Broglie a dit à plusieurs personnes que vous n’accepteriez pas. Les journaux répètent de lui le même propos. Le Roi a dit hier soir à un diplomate qu’il était très sûr de son fait, qu’il avait toute confiance que le ministère Soult allait se former, qu’il aurait la majorité. Il a ajouté qu’il y aurait bien quelques petites émeutes peut être, mais que cela n’inquiétait nullement. Adieu. Adieu. Le temps me presse. Adieu probablement et j’y compte pour la dernière fois jusqu’à un meilleur adieu, un adieu charmant.
464. Paris, Dimanche 25 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous écris à tout hasard ; je ne voulais plus le faire, mais votre lettre de vendredi 4 heures où vous ignoriez tout me fait croire qu’il est impossible que vous arriviez aujourd’hui peut-être passerez-vous à Beauvais demain, après l’entrée de la poste. Je n’ai cependant rien du tout à vous dire sinon que les journaux sont les échos fidèles des paroles que prodigue M. de Broglie, et selon lesquelles il est persuadé que vous n’accepterez pas ! Tout le monde me rapporte cela. On vous attend et on ne fait pas autre chose. J’ai pleuré vraiment pleuré en apprenant la mort de lord Holland je vois d’après votre lettre que j’ai fait plus que la plupart de ses intimes. C’est vrai les Anglais sont froids.
J’ai été hier aux Italiens. La Somnambula ravissante musique. Encore une scène d’amour, mais un scène abominable J’ai détourné la tête. Ce matin, il me semblait que vous pouviez arriver à tout instant. J’ai tout hâté, me voilà, mais " le bien aimé ne viendra pas."
2 heures. Montrond sort d’ici. Il dit que Thiers dit beaucoup et Mignet aussi pour lui qu’il vous soutiendra cordialement. Le Roi le croit, pour quelques jours. Le Roi n’est pas inquiet Thiers est gai. Le dire de Montrond est qu’il n’y a encore rien de fait - il m’a même dit que le Maréchal avait envie des Affaires étrangères. Adieu vraiment je n’ai rien à vous dire de plus et puis je ne sais pourquoi votre dernière lettre ne m’inspire pas. Il y a quelque chose de froid, je cherche, j’ai trouvé, et c’est tout bonnement que vous n’avez pas compris quelque chose. Je suis sûre que j’ai raison. Adieu cependant. Adieu, comme si vous m’avez dit adieu bien tendrement.
444. Paris, Mardi 6 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Les trois 4 font une drôle de mine et ne font pas honneur à notre intelligence, pour des gens qui ont pas mal de goût à se trouver ensemble. C’est bien bête. J’ai vu hier matin chez moi à la fois l’Autriche, la Prusse, l’Angleterre. Une petite conférence en ressemblant pas du tout à celle de Londres quant aux opinions et aux vœux. Il parait que l’insurrection se ranime en Syrie. Il paraît aussi que les Anglais allaient à St Jean d’Acre. Voilà qui fera une bien autre émotion encore qui Beyrouth !
On dit donc qu’on travaille ici à une sorte de protestation dans laquelle on établirait le casus belli. Mais tout cela n’est-il pas un peu tard ? On est très révolté ici de voir que l’internonce a assisté à la dépossession du Pacha à Constantinople.
Quant à nous je n’ai rien vu de plus modeste, même de plus effacé. C’est très drôle. Tous les acteurs en scène, le premier amoureux seul, dans les coulisses. Je ne crois pas qu’il perd rien à attendre. Mais la comédie est complète. Le soir je voulais aller chez Lady Granville lorsque est venu encore M. Molé et puis mon ambassadeur et Bulwer. Nous sommes restés à quatre jasant toujours de la même chose, et riant même un peu. C’est toujours encore dans ma chambre à coucher que je reste ; et ma porte fermée à tout ce qui ne m’amuse pas tout-à-fait. M. Molé et très curieux de tout, mais au fond il me parait être au courant de tout.
Il disait et Bulwer disait aussi que M. Barrot entrerait au ministère, si les affaires tournent à la guerre. Mad. de Boigne est toujours à Chatenay. M. Molé me l’a répété. Il ne l’a point vu du tout. Molé repart aujourd’hui ou demain pour la campagne. Personne ne parle du procès de Louis Bonaparte. Jamais il n’y eut quelque chose de plus plat. Le petit Bulwer est d’une activité extraordinaire et une relation avec toute sorte de monde, très lié avec Barrot. Il faut que je vous dise que 10 jours après mon arrivée ici j’ai écrit à Paul une lettre assez indifférente lui parlant de ma santé, un peu des nouvelles du jour, rien du tout. J’ai fait cela pour renouer la correspondance sur le même pied qu’a été notre rencontre. Il ne m’a pas répondu. C’est bien fort je ne crois pas que j’aie à me repentir de cette avancée, c’était un procédé naturel mais son silence me semble prouver qu’il ne veut avec moi que les relations de plus strict décorum rien que ce qu’il faut pour pouvoir décemment habiter la même ville que sa mère. Qu’en pensez-vous ? Est-ce comme cela ? Il écrit à Pogenpohl qu’il viendra passer l’hiver ici, cela ne me promet pas le moindre. agrément. Je le recevrai un peu plus froidement qu’à Londres. Son frère est auprès de lui dans ce moment, je l’attends sous peu de jours. 1 heure. Le petit ami est venu me voir, il est presque convenu que ce sera quotidien. Nous devrions beaucoup sur un même sujet une seule personne. Quelle situation difficile et grave, en tout, en tout.
Le chêne n’écrit-il pas trop à 21 ? Il faut qu’il sache bien que ce 21 est plus l’ami des autres que le sien, et qu’au besoin il livrerait telle phrase imprudente on intime de ses lettres. On parle de la présidence de M. Barrot, s’il n’entre pas dans le ministère. Que pensez-vous de cela ? Dans mon opinion qui sera celle de tout le monde, au premier instant les personnalités doivent s’effacer devant une grande circonstance. En y pensant davantage je ne sais que dire. Je suis très perplexe ; et c’est cela qui me fait dire, que tout, tout sera difficile. Cependant les événements viendront au secours des embarras peut-être. Je finis par crainte d’interruptions.
Adieu. Adieu mille fois adieu, que je voudrais vous parler. Ah mon Dieu que je le voudrais ! Ce ne serait ni de l’Orient, ni de la Chambre, ni du ministère. Adieu, adieu.
442. Paris, Dimanche 4 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Il y a quatre semaines, je vous attendais encore, nous avons encore marché dans le jardin, vous vous souvenez ce que nous nous y sommes dit ! Je le redis, je me le redis mille fois le jour, je le redirai toute ma vie. Hier j’ai été aux Italiens, Lucia de Lamermoor au premier acte un duo ravissant entre Rubini et Mad. Persiani, une succès d’amour. Ils échangent des anneaux, ils baisent l’anneau qu’ils mettent à leur doigt, un mariage devant le ciel, enfin une telle ressemblance que j’en suis restée troublée toute la soirée.
J’avais dans ma loge Mad. Appony et sa fille. Mon ambassadeur y est venu. J’ai dit un mot à Berryer, il viendra me voir aujourd’hui. Dans la matinée je n’avais vu Appony et manqué beaucoup d’autres : Il ne croit toujours pas à la guerre. Mais il croyait savoir que le roi avait de l’humeur contre ses ministres, ils ont eu trois conseils dans 24 heures sans informer le maître du motif. Ils le contrarient pour se bâton de maréchal à Sébastiani. Le roi très pacifique. On pense que les ministres débattent tant la question de la convocation des Chambres. Il y a toujours bien de l’agitation dans les esprits. On aimerait bien à croire à la nouvelle qu’Ibrahim a forcé les alliés à rentrer dans leurs vaisseaux, mais cette donnée est vague.
Midi.
Votre lettre de vendredi ne me dit rien. Est-ce que les conseil de jeudi n’a donc rien produit du tout ? Mais c’est incroyable. Dites moi donc quelque chose. J’ai besoin d’autres correspondances que vous ! Car par vous je n’apprends rien. Je ne vous donne pas raison pour Chiswick. C’est une très exacte copie des villas près de Padoue, il n’y manque que le soleil. Ce que les hommes ont pu ils l’ont fait ; au lieu de me conter ce que Lady Holland a dit à M. Canning, et ce qu’il lui a répondu et que je sais par cœur, dites-moi ce que lady Holland pense du Cabinet Conseil. Contez-moi l’Angleterre de votre temps et non pas l’Angleterre de mon temps. Il ne vous fâchez pas de cette petite observation, moi Je me députe quand je vous voir employer mal votre papier et votre temps. Je veux de douces paroles d’abord et puis la guerre ou la paix ensuite, je veux aussi tout l’emploi de vos journées. Moi, je vous dis tout.
Hier bois de Boulogne comme de coutume, dîner seule comme de coutume, mon lit à dix heures comme de coutume. J’ai quitté les Italiens à 9 1/2. Je n’ai pas causé avec votre petit Médecin parce que vraiment cela n’aurait pas de sens à moins de me mettre entre les main. Je suis très contente de Chermside. Il me tire vite des petites indispositions qui m’arrivent. Quand vous serez ici, vous ordonnerez et j’obéirai, jusque là à moins de catastrophes j’irai mon train ordinaire. Chermise est prudent, il me traite avec beaucoup de douceur. Ma blessure est presque guérie. Les journaux deviennent incommodes pour M. Thiers. Il n’y a guère qui le journal des Débats que le soutiennes Aujourd’hui, c’est-à-dire il n’y a que le journal des Débats que soit raisonnable car la question de Beyrouth. Le duc de Noailles, m’écrit encore. Il dit qu’il n’y a qu’un gouvernement aristocratique ou un gouvernement populaire qui puisse faire la guerre. Ce gouvernement-ci non mais où est la cause de guerre ? Voilà toujours le puzzle.
1 heure.
Je viens de marcher. Je ne sais pas de nouvelle, je n’aurai vu personne avant de fermer cette lettre. Je pense à la convocation des Chambres. Il me semble qu’il n’y a de salut pour moi que là. Car vous me préparez à un grand désappointement pour octobre. Je n’ai jamais cru sincèrement à octobre, vous n’y avez pas cru non plus. Tout cela était pour acculer deux enfants. Qu’est-ce que c’est que des projets, des volontés. Qu’est- ce que sont les plus ardents désirs ? Eh mon Dieu ; ils ne font pas gagner un jour une heure. Il me semble que je suis de mauvaise humeur aujourd’hui, et je ne vois pas pourquoi. Il n’y a rien de nouveau.
Adieu. Adieu, j’ai ressenti un vrai plaisir hier en prenant possession de ma loge. Est-ce que je me tromperais ? Il me paraissait que je devais y passé de si doux moments croyez-vous que j’aurai de doux moments ?
Adieu. Adieu. Mille fois adieu. dans ce moment une petite visite qui me dit qu’on se plaint de ce que vous n’aviez pas. Cette petite visite visite me dit aussi que 62 dit qu’on a passé toute la journée d’hier à patauger sans rien décider et qu’on attendra encore quelque jours.
419. Paris, Vendredi 11 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le 11 septembre 1840
Je ne suis arrivée qu’à 8 heures, Génie était dans la cour, il avait vu venir le postillon qui me devançait il m’attendait. Il est entré avec moi, il m’a remis. La première impression à Paris a donc été du bonheur. Je vous écris pour être lue un dimanche, j’aimerais mieux un autre jour. Je me suis couchée hier à 9. heures. Je verrai Pogenpolh à midi. Mon ambassadeur plus tard. Je voudrais bien rester ignorée de tous les autres. Mad. de Flahaut, avait déjà passé deux fois ici. M. Thiers y est venu dès mardi, me croyant arrivée.
Il faut que je me repose. Mon appartement me plait. J’espère qu’il me plaira, encore davantage. Paris me plait aussi. N’est-ce pas il me plait davantage ? Je pense à tout ! à tout !
Voici votre 407. C’est presque Londres. Vous, moi, pas autre chose. Je n’ai pas encore. eu une impression, une nouvelle pas un visage étranger. Je suis seule avec deux lettres. C’est une bonne compagnie et douce et tranquille. C’est cela qu’il me faut surtout.
3 heures.
Longtemps Pogenpolh. longtemps mon ambassadeur qui me quitte à l’instant. Bon, excellent homme. Toujours le même : " Madame, je ne sais rien, on ne m’écrit rien de Pétersbourg ! On ne me parle pas ici, je n’ai rien à leur dire ; ich lebe aufoncinem eigenen funde, recht ruhig und recht glücklich. " Et il a l’air de cela. Demain je vous écrirai longuement j’espère.
Adieu. Adieu. Il faut que ma lettre parte si cela peut s’appeler une lettre. Adieu.
430. Paris Mardi 22 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
J’ai eu hier Montrond, Sir Robert Adair. Les Appony, vieux et jeunes. Je suis sortie pour ma promenade du bois de Boulogne, en rentrant j’ai trouvé mon ambassadeur chez moi. Après le dîner il y ait revenue ainsi que Teham. Montrond comme Mad. de Flahaut critique un peu le mémorandum français du 24 août ; ils le trouvent trop doctrinaire, et infiniment trop doux, l’un et l’autre supposent qu’il est de votre rédaction.
Montrond est très à la paix, tout-à-fait à la paix et ne veut pas croire à la possibilité d’autre chose. Je n’ai rien relevé du reste dans la conversation. Adair fait des vœux pour qu’on s’arrange sur les propositions du Pacha, mais il entend qu’on prenne des sûretés contre les tendances où les armements énormes de la France pourraient la mener. Il les trouve très menaçants. Appony n’avait rien de mal à dire hier. Mon ambassadeur non plus. Seulement lorsque je lui redis l’observation que m’avait faite Granville, que lord Palmerston quand même il pourrait désirer accepter les propositions du Pacha en serait empêché peut être par l’Empereur. Il se récria en répétant mais l’Empereur ne veut pas la guerre, il ne la veut pas. J’ai répondu à lady Palmerston, J’ai pris copie de ce que je lui ai écrit. Le voici. Je suis interrompue par Bulwer & & 22. Impossible de vous dire plus. Adieu Adieu.
J’attends votre lettre avec impatience. Le langage de 6 à 29 hier était très menaçant. Heureusement, l’usage en sera modifié. Adieu.
420. Paris, Samedi 12 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous me voyez temps de bonne heure, c’est que je suis dans mon lit à 9 heures du soir j’ai assez bien dormi. J’ai vu hier matin mon ambassadeur, Appony, Bulwer et de 8 à 9 le soir votre petit homme. Je me suis fait traîner au bois de Boulogne de 4 à 6. Mad. de Flahaut est venu trois fois, j’avais fermé ma porte. Enfin elle m’a écrit pour me presser d’aller dîner chez elle. J’ai décliné et je lui ai promis d’aller me promener avec elle ce matin. Je verrai ma nièce aussi ce matin.
On ne parle plus d’émeutes du tout Dieu merci. Paris est joli, animé, quelle différence de Londres !
Je trouve ici dans le monde que je vois moins de crainte de la guerre que je ne croyais. Ils la croient possible, tout au plus probable non ; ils croient encore qu’à la dernière heure le Pacha cédera, en se mettant sous la protection de la France et que la France qui promettra ses bons offices obtiendra facilement des alliés St Jean d’Acre qui doit satisfaire le Pacha, et satisfaire la France, car ce serait une concession attendu que par son premier refus le Pacha a perdu ses droits à St Jean d’Acre. Si la guerre éclate, ils n’ont pas la moindre idée que ce puisse être autre chose qu’une guerre maritime. Et voilà pourquoi l’Angleterre y est si indifférents. Elle peut parler légèrement de la guerre, elle y gagne. Ses flottes battront et prendront, et ensuite une guerre continentale ne lui fait aucun mal. Il n’en est pas de même des autres puissances. Non, elles ne veulent pas la guerre. Elles ne comprennent pas pourquoi et comment elle se ferait, car elles ne feront rien pour cela de leur côté. Elles ne rencontreront la France nulle part ? La France regarde comme cas de guerre, l’entrée des Russes en Syrie ou à Constantinople mais ils n’y iront pas. Si Ibrahim franchit le Taurus, les flottes anglaises, russes, autrichiennes entreront dans la rue de mer de Marmara pour couvrir Constantinople. Cela ne constitue pas un cas de guerre ? Pahlen m’assure qu’il faudrait que l’Empereur fut bien changé depuis 6 mois pour en avoir envie. Il n’en veut pas. En recherchant les causes de tout ce mauvais imbroglio on trouve d’abord, une disposition hargneuse à Londres. Ensuite des illusions là comme ici. Là, ignorance volontaire ou réelle de la disposition de la France. Ici, incrédulité sur le vouloir ou le pouvoir de lord Palmerston. Après cela on dit aussi que la France a voulu jouer au plus fin. Qu’elle voulait et croyait escamoter l’arrangement en le faisant conclure d’une manière cachée et abrupte entre les deux parties. Que c’est de Pétersboug qu’on a donné l’éveil à Londres. Que cela y est revenu par d’autres voies ensuite. Que cela a excité non seulement à faire, mais à se cacher aussi pour faire le traité. Voyez ; cela me parait assez bien déduit. Au total, mes ambassadeurs ne croient pas à la guerre. Ils sont très modérés, très calmes, une fort bonne attitude. Ils se louent toujours du Roi. Ils ne se plaignent pas de Thiers, mais Appony dit seulement qu’il a des vivacités étonnantes, et que si on ferait comme lui, on se battrait déjà. Cependant il ne lui attribue pas non plus l’envie de la guerre.
Enfin le langage est concevable. Bulwer a peur, véritablement car je crois qu’il essaie de fréquentes bourrasques. Il cherche à expliquer et justifier Napier. Mes ambassadeurs sont plus francs. Ils disent tout bonnement que c’est une action honteuse.
Ah par exemple ils détestent 46 ! Le petit homme hier au soir m’a fort questionnée ; et cross examined. Cher petit, je l’aime beaucoup ; il a un amour si inquiet ! Je l’ai fort bien renseigné sur les dispositions et les résolutions et il a fini par les trouver bonnes, quoiqu’il penche un peu pour autre chose. Il est dans la plus énorme méfiance de 21. Il parle très mal de lui et de sa femme à l’égard du chêne.
1 heure.
Merci du 408. Je bénis l’invention de la poste puisque je n’ai plus qu’elle ! J’ai été faire visite à ma nièce. Elle est charmante, jolie, une beauté fière, distinguée de la race, blanche, fragile et les yeux à peu près droits, vraiment elle me plaît, elle vous plaira. Appony croit savoir aujoudhui que vous méditez quelque coup de théâtre. Caudie par exemple. Ah cela serait mauvais, car comment éviter alors que la guerre ne s’engage. Mais je pense que vous ne commencez pas. Si personne ne commence elle ne viendra jamais. Cependant comment débrouiller ce brouillamini.
Je suis fatiguée, tout me fatigue, je me soigne bien cependant, je fais ce que je peux, il me faut du temps, des ménagements. Je refuse toute sortie, les Appony, les Flahaut me veulent encore a dîner, je dis non à tout le monde. Je verrai Mad. de Flahaut ce matin. Adieu, Bulwer va venir pour causer. Je vais dîner. Et puis le bois de Boulogne. Adieu, adieu comme toujours comme dans les meilleurs moments. Mille, mille fois adieu.
P.S. les Ambassadeurs ne connaissent pas le traité du 15 juillet. On le leur promet après l’échange de ratification.
421. Paris, Dimanche 13 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Voici trois dimanches bien différents entre eux. Dimanche 30 août, dimanche 6 où je vous voyais pour la dernière fois, et celui-ci que je passe si loin, si loin de vous mais il me semble que je suis chez nous. Et cette pensée est si douce, venez la compléter.
J’ai vu hier matin Bulwer, Montrond, mon ambassadeur. Le premier bien agité, bien inquiet. Il y avait quelque chose ; il venait me le dire, l’arrivée de Montrond nous a dérangés. Montrond inquiet aussi croyant à la guerre, me faisant des questions sur vous, surtout les détails de votre attitude, vos allures, votre maison. J’ai pleinement satisfait à toutes ces questions. Je l’ai trouvé ni bien, ni mal, disant seulement que Flahaut disait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Le roi belliqueux, mais croyait à le paix. Au total pas grand chose. Mon ambassadeur inquiet aussi, la journée semblait mauvaise. Il y avait quelque chose de menaçant dans l’air. Je lui ai conté hier M. de Brünnow, il est parfaitement indiqué et parfaitement sûr que l’Empereur n’y est pour rien, mais il ne devine pas et ne comprend surtout par la bêtise. Je lui ai conté M. de Nesselrode aussi, cela le confond, mais il n’a pas pour lui une grande estime. Il me dit que j’ai très bien fait mais que je les mettrai dans un grand embarras. C’est leur affaire de s’en tirer. M. de Pahlen dit un peu autrement qu’Appony. Il est convaincu qui si Ibrahim passe le Taurus nous irons à Constantinople. Au reste, il n’a pas eu un seul courrier depuis mon départ pour l’Angleterre pas un. Il n’a pas eu un mot même par la poste depuis ce traité, c’est-à-dire qu’on ne lui dit pas un mot du traité. C’est drôle ! L’Empereur sera de retour à Pétersbourg cette semaine.
J’ai fait ma promenade avec Mad. de Flahaut. Je suis avec elle comme avec lady Palmerston bien, et pas comme avant. Elle a recommencé des explications sur la lettre. Je lui ai dit que je n’y pensais plus, elle voulait dire, et elle a dit pendant une demi-heure, trente mille même mensonges je les ai écoutés probablement comme on écoute des mensonges car elle m’a dit : " Je vois que vous ne croyez pas un mot de ce que je vous dis." J’ai souri, et je l’ai assurée que sa réponse écrite m’avait parfaitement suffi. Et voilà qui est fini. Elle a bavardé, bavardé sur les affaires, bien dans le sens raisonnable. Après. cela elle a dit qu’il y avait une question curieuse à éclaircir, que le ministère disait que vous n’aviez pas su un mot du traité et ne lui en avez rien mandé jusqu’après sa conclusion ; que vos amis, c’est-à-dire une petite partie de vos anciens amis disaient que vous avez toujours éte d’opinion qu’il se conclurait que vous en aviez averti et souvent. et elle m’a interrogée. J’ai répondu froidement, que Londres on disait et croyait que vous le saviez et que vous l’aviez dit. Flahaut que je n’ai pas vu part demain pour Londres ou autre part afin de n’être pas ici pendant le procès.
J’ai dîné seule, ou plutôt pas dîné. Après, j’ai été en calèche encore, à droite, à gauche, passer mon temps. J’ai manqué Fagel ce que je regrette. Je me suis couchée à 9 1/2.
Voici votre lettre. Comment êtes-vous resté un jour sans rien de moi ! Vous aurez vu au moins qu’il n’y avait pas de ma faute. Il y a deux pages charmantes dans votre lettre, il y a dans chaque lettre des pensées si douces, si tendres. Ah que j’y réponde doucement, tendrement !
Midi. J’ai fait un tour de promenade au jardin à pied je suis lasse, le plus petit exertion me fatigue. Je ne me plains plus que de cela ; très fatiguée, très faible, très maigre. Il faut que je me relève de ces calamités. Adieu. Adieu extrêmement.
422. Paris, Dimanche 13 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je me suis sentie indisposée ce matin, j’ai fait venir Chermside, il croit que j’ai pris froid. Le temps a subitement passé au froid. J’ai vu Bulwer longtemps les Appony, mon ambassadeur j’ai renvoyé Flahaut, sa femme et d’autres.
Les ambassadeurs se sont disputés chez moi. L’Autrichien soutenant que sa cour lui mande qu’en cas de marche d’Ibrahim, les Russes n’occuperaient pas Constantinople. et le Russe soutenant que nous l’occuperions. Ce discrepancy m’a un peu étonné. Le 29 actuel a vu hier au soir Z et et a obtenu l’assurance positive qu’il ne méditait point de coup de théâtre au loin. Cette idée avait été fort accréditée hier. On dit que l’Angleterre devrait bien souffler au Turc à Londres une proposition d’accommodement avec la France, c’est-à-dire que le Turc offre bénévolement de meilleures conditions au Pacha plutôt que de voir de la désunion entre des puissances qu’elle (la Turquie) regarde comme également bienveillante pour elle, et dont la rupture pourrait avoir des résultats fâcheux pour son existence. Croyez-vous qu’on inspire cela ? Ou qu’on l’ordonne, car on peut ordonner. Ce serait a loop hole.
Les nouvelles d’Espagne sont bien critiquées. Il faudra que la Reine s’humilie ou s’enfuie. Que ferez-vous dans cette affaire ? Un gouvernent qui ne serait pas soutenu par la gauche irait peut-être au secours de la Reine. Mais il est difficile que vous le fassiez. Il y a des gens qui croient que vous le ferez quand même, pour faire aujourd’hui quelque chose. Cela me semble impossible.
Lundi 14. 9 heures
Mon ambassadeur est revenu hier au soir avant de se rendre à deux routs (Appony et Flahaut) il m’a répété qu’il n’a pas eu un mot de Petersbourg, pas un mot depuis le mois de juin. Il en est fort content. Les lettres particulières de là disent qu’on n’y croit pas à la guerre, que personne n’y songe. Lui, Pahlen, la croit très possible , et même très difficile à éviter. Il me demande ce que je ferai ? Je le demande aussi que devenir ? Ah mon Dieu ! J’ai assez bien dormi. Mad. de Talleyrand est à Rochecotte. Elle m’a attendu quelques jours à Paris, à ce qu’elle prétend elle m’engage à aller chez elle ce que je ne ferai pas.
Mad. Appony est moins éprise de sa belle-fille que ne l’est son mari. Elle la trouve bien frivole, et rien que frivole ; toute la journée se passe en toilettes. Elle tremble pour l’avenir lorsque le beau trousseau sera fané ! Lui Appony n’est pas si inquiet ; il est charmé d’une jolie femme dans se maison et me parait tout aussi amoureux que son fils. Midi. J’ai revu le gros Monsieur et quelque chose de mieux que lui. Merci, merci. Demain mardi sera un mauvais jour, je voudrais qu’il fût passé ! Ah je voudrais qu’ils fussent tous passés, tous les jours de séparation ! J’ai écrit à Thiers le lendemain de mon arrivé ; il n’est pas venu, et ne m’a pas répondu. je continue à me coucher à 9 1/2, j’ai bien besoin de repos.
Adieu, adieu. Je ne prévois pas que j’apprenne rien de nouveau d’ici au moment de la poste. Adieu.
423. Paris, Mardi 15 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
8 heures
J’ai vu hier matin, M. de Werther et Bulwer. Point de nouvelles tout le monde très pacifique. J’ai fait ma promenade au bois avec Emilie. Je n’ai pas vu sa mère, Dieu merci.
Après mon dîner qui n’est pas un dîner, les deux Pahlen sont venus chez moi, du parlage, du rabâchage, car il n’y a rien. M. d’e Pahlen qui connait cependant fort bien l’Orient et parfaitement les Turcs, affirme qu’il est impossible que le traité stipule l’entrée des Russes dans l’Asie mineure, ou que si ce traité le dit c’est une complète absurdité. Car jamais nos troupes en surmonteraient les obstacles matériels et moraux de cette entreprise. Aucune troupe européenne ne le pourrait et nous moins que tout autre, parce que le Russe est détesté par tout musulman ainsi dans son opinion, point de Syrie possible par terre, par mer c’est l’affaire de lord Palmerston voyons s’il en viendra à bout.
Le temps est à la pluie, n’importe Paris est joli. Les fontaines font leur devoir ; les arbres sont un peu gris, C’est vrai ; mais c’est égal. Je n’ai pas vu une âme française depuis mon arrivée ; excepté Montrond. Charles Pozzo vient de se casser une côte. Le vieux est tout-à-fait imbécile, il n’y a plus d’éclaircie. La fille de Jérôme Bonaparte épouse M. Demidoff. J’en suis indignée. Le prince Paul de Wurtemberg est de retour, je pense que je vais bientôt le voir. Il doit être drôle maintenant.
Mon ambassadeur est fort impatient de ce que je n’ouvre. pas encore ma porte. Je l’ai renvoyé avant dix heures. Midi, j’ai vu le petit ami, et il m’a vue dans mon bonnet de nuit. Il est venu trop tôt, ou bien moi, je suis restée trop tard en tenue de nuit.
Il n’y a rien rien. A blank day again. Mais il est impossible qu’il ne survienne pas des événements, les matières remuantes ne manquent pas. Il faut que vous vous contentiez aujourd’hui de ce pauvre chiffon de lettre. Il ne vous en porte pas moins, tout court, qu’il est un bien long, adieu.
424. Paris, Mercredi 16 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai vraiment des moments de grand mépris pour moi, et pour vous. Je trouve si intolérablement absurde que nous soyons séparés. Vous seul à Londres ; moi seul à Paris, chacun au milieu de millions d’habitants, seuls, bien seuls ! Eh bien voyez-vous cet abominable égoïsme qui fait que je vous aime mieux à Londres qu’au Val-Richer. Je vous veux, comme moi, sans compensation, sans distraction, sans plaisir ; pensant à juin, juillet, août rêvant à octobre. Un doux passé, un charmant avenir, n’est-ce pas ? Mais il faut qu’il vienne cet avenir. Il faut que nous allions à lui bien décider à le conquérir.
J’ai vu hier Bulwer et Adair. J’ai été shopping pour un cadeau à ma nièce. Et j’ai passé chez les Appony que j’avais manqués chez moi décidément on était à la paix hier. Appony avait vu Thiers longtemps ; il avait l’air un peu mystérieux (Appony), mais fort rassuré. Après mon dîner j’ai été chez les Flahaut, il y avait M. de Sercey et M. d’Haubersaert. On a beaucoup, beaucoup parlé politique, je n’ai pas ouvert la bouche. C’est exact ce que je vous dis là, pas ouvert la bouche. On disait beaucoup que le Pacha se modérait. On faisait des paris qu’il n’y aurait aucune tentation sur la côte de Syrie qui puisse réussir. Enfin comme de raison, on était très français. J’étais dans mon lit à 10 heures, avec un gros rhume.
Le temps est abominable. J’aurai une lettre aujourd’hui. Ce pauvre M. de Stackelberg a encore perdu une fille. Mad. de la Rovère. Trois enfants dans dix mois. Je devrais dire cette pauvre Mad. de Stockelberg ! Car c’est elle, elle qui le sent !
1 heure
Comment pas de lettres ! Mais c’est impossible, n’est-ce pas c’est impossible que vous ne m ’ayez pas écrit ?
2 heures
Je vais sortir, comment il faudra fermer ma lettre sans un adieu de vous ? Faut-il que je m’inquiète ? Adieu tristement. Adieu tendrement. Adieu bien longuement.
425. Paris, Jeudi 17 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Avant toute chose, la question de la correspondance. Ce n’est qu’à huit heures hier au soir que j’ai eu votre lettre de lundi, encore j’ai été la chercher. C’est-à-dire que mourant d’ inquiétude de n’avoir pas eu de lettres j’ai pris le parti d’aller chez Génie pour savoir s’il avait quelque nouvelle, si vous étiez malade. Enfin j’étais moi dans une véritable agonie, et je vous préviens que j’y serai chaque fois qu’il n’arrivera pareille aventure. Mettez y bon ordre, car ces choses me rendent malade et vous savez que je n’ai pas besoin d’agitation ! La preuve que ceci m’avait fait du mal et que j’ai été obligée de faire chercher mon médecin le soir, toute inquiétude se porte sur les entrailles. Et j’avais repris des douleurs. Ensuite on peut me voir toujours de 9 à 10. Et puis, j’écrirai Mercredi et Lundi au N°1. Mardi et Samedi au N°2. Jeudi et Dimanche au 3.
J’ai été à Kenwood bien souvent quand je vous proposai une promenade à Hamstead, c’était là que je voulais vous mener. Pourquoi n’y avons-nous pas été ensemble ? J’ai vu hier matin chez moi Appony, Mad. Durazzo, et Mad. de Flahaut hélas ! Appony venait de prendre lecture rapide du traité dans le journal anglais. Il pensait qu’il n’y avait rien là qui dût irriter la France ou l’inquiéter. Il trouve que la lettre de Königsberg insérée dans le Constitutionnel a un grand fond de vérité ! Mad. Durazzo bonne, douce et pas bête. Brignoles revient dans un mois je crois.
Mad. de Flahaut est venu me faire une scène, une scène. M. de Flahaut et elle sont très offensés de ce que je ne veux pas parler politique en leur présence. Il est évident que je me méfie d’eux, que je ne crois pas un mot de leurs explications sur la lettre. Cela n’est pas tolérable. Et sur ce point là, je ne puis plus être qu’une connaissance et non plus une amie. Voilà littéralement la déclaration. Vraiment c’est trop drôle. J’ai répété que je ne voulais plus entendre parler de la lettre, et qu’assurément je ne parlerais pas politique qu’ils s’arrangent. La colère est grande, il y a eu des insinuations et des paroles, fort étranges, je ne les ai pas relancés. Je veux simplifier les querelles. Vraiment j’ai bien à faire avec mes amies !
C’était bien autre chose encore que lady Palmerston on dirait qu’on s’est donné le mot. Revenez au milieu de la scène, Mad. de Flahaut pleure, moi je n’ai pas eu l’air tendre. Le temps hier était épouvantable. Un vrai hurricane. Le chaos. J’ai eu peur. Plus tard, j’ai été pour une demi-heure au bois de Boulogne.
Après mon dîner, comme je l’ai dit plus haut, chez Génie avec des battements de cœur si forts si forts, il est venu à la portière me remettre la lettre reçue disait-il après 5 heures Mon ambassadeur est venu de 8 1/2 à 9 1/2 et puis mon médecin. Il reviendra ce matin. Et bien le traité ! Vous ne m’en parliez pas Lundi. Il était dans les journaux anglais cependant. Est-ce que par hasard il ne vous aurait pas été communiqué ? Je l’ai lu, je ne trouve pas que nous y jouions un grand rôle. Après cela je ne le trouve en vérité pas incommode pour la France. Et puis l’acte de Napier reste toujours incroyable car l’article qui prescrit les mesures avant la ratification dit nommément que c’est parce que l’insurrection était en train. Or elle se trouvait étouffée.
Le 14, et le 14 était toujours deux jours avant le 1. Effacez vendredi au N°1 car ce jour là j’écris tout droit. Je l’avais oublié et donnez au n°1 Lundi en place de Vendredi. Et ôtez alors le lundi au n°2. Je viens de faire cela à la seconde page. C’est compris maintenant ? 1 heure Pas de lettres, mais la tempête d’hier explique cela, je ne veux donc pas m’inquiéter. Les journaux ministériels ne font pas d’observation sur le traité. J’attends les vôtres. Je me trompais peut-être sur Napier, alors cet article du Protocole réservé est bien étrange. Dites-moi donc ce que vous en pensez.
Voici le 412. Grey a bien du bon sens. J’aime les Holland parce qu’ils vous aiment et parce qu’ils sont aimables. Je ne pourrai rien dire pour la vaisselle de Lady Durham ; vous voyez bien que je ne vois pas Thiers pourquoi ? Je ne le comprends pas et bien vous ne me dites pas un mot du traité. Why ? Chermside sort d’ici, il trouve qu’on m’a fait prendre du quinine trop tôt. J’ai des vertiges, et l’estomac bien affaibli.
2 heures
Il me semble que je vous écris de pauvres lettres, si j’allais dans le monde elles vaudraient mieux mais je n’ai pas la force et vous voulez n’est-ce pas que je me repose. Je pense que Molé ne vient pas parce que je ne lui ai pas envoyé dire que je suis ici. Il est parmi les susceptibles. Mais je vous avoue que je trouve très bon qu’on n’aie pas à citer mes paroles, et le plus sûr alors est de ne pas voir les gens, ou quand on les voit (Flahaut par exemple) de mériter des scènes pour mon silence. C’est une prudence d’enfant, mais je vis au milieu de menteurs.
Adieu. Adieu, beaucoup de fois ou une seule bonne according to your texte. Adieu. Vous avez raison, il faut obtenir la vaisselle pour lady Durham. Lord Grey plus que qui que ce soit arrange ses opinions politiques sur ces petites choses. Et ce qu’il vous mande a de l’importance et beaucoup, il faut l’entretenir dans cette disposition. Je ne puis pas finir sur cela il faut encore adieu. Dites aux Holland mille bons souvenirs de moi, adieu.
426. Paris, Vendredi 18 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je suis un peu malade aujourd’hui, je me fâche contre le médecin, contre moi. Je ne pense qu’à me soigner, me bien porter et rien ne va, rien ne réussit. Vous savez comme le découragement me gagne vite. Hier j’ai fait une longue promenade au bois de Boulogne, le temps était charmant ; en revenant j’ai ramassé Fagel et nous avons recommencé. Fagel est de la bonne espèce droit, franc, sensé. Il a de veilles habitudes de confiance avec moi. En rentrant on m’apprend que ma nièce est malade Je suis allée chez elle ce n’est pas grand chose.
Appony m’a dit les nouvelles d’Egypte. Le Pacha proposant de se contenter de l’Egypte héréditaire et de la Syrie viagère, et ... Le soir j’ai laissé entrer chez moi les Durazzo, et les deux Pahlen. Tout le monde est à la paix ici depuis quatre ou cinq jours. J’espère que tout le monde a raison. Avant mon dîner Mad. de Flahaut est revenue. J’avais bonne envie de la refuser, et puis la curiosité l’a emporté, paix ou guerre, je ne savais pas. Je me croyais en guerre. elle est entrée, douce, caressante, la nuit avait porte conseil et elle s’est résignée à rester comme par le passé, avec soustraction de la politique. Je pense que vous allez voir le père et la fille à Holland. house. La fille est gentille, c’est-ce qu’il y a de mieux dans la famille. Le père est ce qu’il y a de pire.
Mon ambassadeur est vraiment un cher homme il me parait qu’il redouble encore pour moi depuis qu’il sait M. de Brünnow. Il fronde un peu mon cabinet et trouve étrange qu’on le laisse depuis quatre mois sans une ligne d’écriture. Rien Ces gens là ne savent plus écrire, car moi aussi je n’ai rien. Midi. Voici le joli médecin m’apportant un charmant remède. Merci, merci. Denay est arrivé et en fonctions depuis quelques jours. La nouvelle femme de chambre est plus bonne que belle. Eugénie part, et je ne sais comment m’en séparer, mais je le lui avais dit ; je ne puis pas me retarder. Personne ne m’a écrit d’Angleterre depuis mon départ. Il faut que j’écrive aujourd’hui à lady Palmerston pour lui envoyer une lettre de la reine d’Hanôvre qui demande explication. Mon Ambassadeur est excessivement occupé de Mad. Lafarge ; et comme je ne lis pas ce procès, il a le plaisir de me raconter tous les jours ce drame là, cela l’enchante.
Adieu, je comprends la sottise, et même je la partage c’est effroyable ce que je vous dis là. Adieu.
427. Paris, Vendredi 18 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
4 heures
J’ai été retenue chez moi d’abord par mon médecin et puis par le duc de Noailles, qui est venu en ville pour deux heures pour me voir. Vous concevez qu’il a questionné et comme il a questionné. Et puis il a parlé. Il dit que la France au fond veut la paix, que c’est le vœu général, si général, si profond, que même on avalerait une petite humiliation encore plutôt que de se livrer aux hasards de la guerre, que cela est certain ; mais qu’on n’avalerait pas tout. Décidément pas et qu’alors on ferait la guerre très franchement et avec une grande unanimité. C’est aussi l’opinion et le dire de Berryer que le duc de Noailles venait de voir. Berryer croit savoir que Thiers est moins pacifique qu’on ne semble le croire. Il veut bien se montrer pacifique encore parce qu’il n’est pas prêt. Mais le jour où il sera prêt il voudra employer ses moyens, et le moment dangereux sera celui-là. Le duc de Noailles se creuse la tête pour trouver ce que les alliés peuvent vouloir tenter ou plutôt ce qu’ils sont convenus de faire pour le cas où l’insurrection de Syrie ne couronnerait pas leurs espérances. Il croit que les Anglais prendraient Caudie par cette position ils tiendraient les Russes aussi en échec, car ils n’en sortiraient que le jour où les Russes sortiraient de Constantinople ; ce serait européennement parlant une bonne affaire, et une bonne affaire pour les anglais dans tous les cas.
Moi - Mais la France avalerait- elle cela ?
Le duc - Je le crois, presque. Voilà à peu près l’Orient expédié ! Venons à Louis Bonaparte. Il paye très cher à Berryer pour le défendre. Et Berryer accepte parce qu’il est bien payé, et puis parce que cette défense tourne pour lui un moyen d’attaque contre le gouvernement ainsi il justifiera Bonaparte sur ce que la France n’est plus qu’un pays de désordres. Un pays où l’on proclame des légitimités à la demi-douzaine. La branche d’Orléans légitime, Bonaparte légitime, le ministère le dit. On ne sait plus auquel entendre. Voyez la confusion, de là une tentative toute naturelle. Il brodera sur cela. Il brodera sur la situation que le gouvernement a faite à la France, répudiée, isolée; ses deux grandes bases d’alliance détruites l’Espagne, l’Angleterre. Belle situation en Europe ! Enfin, enfin Louis Bonaparte a profité de tout cela, il en avait le droit.
Vienne ensuite la Chambre. Oh à la Chambre ! Qu’un orateur habile se lève et toute pacifique que soit cette chambre, cet orateur peut lui faire voter la guerre dans une demi-heure. Si la situation n’est pas. éclaircie d’ici aux chambres. Il sera très difficile d’éviter un éclat. Le duc de Noailles ne sait pas s’il viendra on ne viendra pas au procès. Je l’ai fort engagé à venir. Il m’a dit que Berryer déciderait un peu cela.
Samedi 19 septembre. 9 heures
J’ai été vraiment malade hier très affaibli, très misérable. Je n’ai pas bougé de ma chaise longue. J’ai vu Appony avant dîner, mon ambassadeur le soir. Appony avait vu Thiers. On est comme de raison très très préoccupé de savoir ce que va devenir la proposition de Méhémet Ali. Nécessairement le sultan la référera à la conférence. Voulut-il même l’accepter, Ponsomby aura soin de l’en empêcher, d’abord ce seront des délais de deux mois au moins ; pendant ce temps l’exécution du traité ira toujours. Appony trouve que le conseil donné à Méhémet ali a été bon, très adroit de la part de la France ; il croit que la conférence pourrait accepter, mais si elle n’accepte pas, si on veut à toute outrance le traite ; alors la situation devient bien plus grave qu’avant cette proposition de l’Egypte, parce que la France est compromise, et qu’elle ne peut pas laisser passer cela. Il me semble que pourvu qu’on entre en voie de négociation cela doit s’arranger. Mais les amours propres anglais se soumettront-ils à cela ? Vous me le direz.
Sur le traité, Thiers a dit à Appony : " Vraiment il est pitoyable votre traité ; il est risible, je suis sûr que le prince Metternich doit en rire aussi. " Appony lui a promis de venir l’informer de suite que le prince Metternich en rit, s’il le lui mande. au reste Appony est très frondeur, excessivement frondeur. Il trouve l’oeuvre insensée ; il fait comme moi. Il cherche le prince Métternich. Savez-vous ce que disait Pozzo au mois de juin de l’année dernière, lorsqu’il était encore vivant, et avant la bataille de Nézib ? Il disait " La Russie doit changer sa politique en Orient, c’est avec Méhémet ali qu’elle doit s’allier. " Pozzo vivant, et Metternich pas mort, et tout aurait été autrement. Il n’y a pas un homme aujourd’hui qui sache juger et conduire une affaire. Aussi. voyez le décousu, l’incroyable confusion !
M. de Pahlen était assez noir hier aussi. Il ne fronde pas aussi haut qu’Appony. Mais il n’est pas content. Il ne comprend pas, et tout qu’on ne l’informe pas, il est décidé à ne pas comprendre. Il était inquiet hier de l’information qu’il a eu que votre gouvernement permet à Levewel de revenir à Paris. Il en parlera ce soir à Thier . Si cela était, il craint un gros orage à Pétersbourg Moi je ne crois pas trop à l’orage cependant, je ne sais pas.
Midi. Voici votre lettre. Je suis touchée de ce que vous me demandez 24 heures. Faites ce qui est convenable, mais pouvez-vous vous absenter ? Encore, une fois je suis touchée, et puis je sais bien aujourd’hui que toutes les plus belles tulipes ne valent pas pour vous la plus modeste fleur des champs. Je suis triste, je suis malade Je maigris encore. On ne sait jamais tout ce qu’on a à perdre je m’étonne tous les jours. Adieu. Adieu. Pourquoi suis-je si triste ?
428. Paris, Dimanche 20 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
J’ai un peu dormi cette nuit. Je vais lire dans cette bible où nous vivions ensemble. J’ai le cœur triste et serré. J’ai eu hier une très longue visite de Bulwer, une très longue visite de Paul de Wurtemberg un peu de causerie avec Appony. Et ce soir j’ai revu les Granville qui viennent d’arrivés du Havre. Ceci a été un vrai plaisir pour moi. Eh bien, tout le monde est d’accord pour regarder la proposition égyptienne comme une nouvelle phase de la question, et comme une circonstance qui laisse aux bonnes volontés toute facilité de s’arranger avec convenance. Les Allemands sont d’opinion qu’il faut accepter tout le monde dit que la Turquie laissée à elle même accepterait des deux mains. Nous pensons. même que la Russie accepterait. Reste lord Palmerston ! Vous nous apprendrez s’il veut se servir de ce moyen pour faire sortir l’Europe des dangers qui la menacent où s’il veut à outrance braver ces dangers. Tout est là.
Les ministres anglais sont encore une fois appelés à examiner une grande question. Mais aujourd’hui ils l’examinent avec l’expérience de ce que leur a valu le 15 juillet. Il y a eu pour eux bien des surprises. En veulent-ils encore. 15 est hautement frondeur. Il n’a plus eu une ligne de 79 depuis deux mois. Le petit 29 écrit à 12 de fort bonnes choses, fort sensées. Il dit : " Il est temps encore aujourd’hui , mais ceci est le dernier moment, demain il sera trop tard. Jamais on ne répond à ces exhortations là. " Le Prince Paul a des dires fort étranges, et une vie toute particulière de la situation. Il a beaucoup couru, beaucoup vu ; et même fait. Il affirme que le mépris pour la France est le sentiment dominant partout, dans tous les cabinets. Que les platitudes passées doivent parfaite confiance dans les platitudes futures, et qu’on a beau faire on ne peut persuader à personne que la France fasse la guerre. Aucun cabinet ne veut le croire. Dirait-il vrai ?
On dit que le roi est très convaincu que tout ceci s’arrangera. Arrangez donc, et dites le moi. J’ai essayé de sortir hier mais il faisait laid, j’étais triste et faible. Je suis sortie pour voir lady Granville ; elle est grasse et rose, le mari ditto. Quand est-ce que je serai grasse et rose ?
2 heure. Point de lettres ? D’où vient ? Adieu. Adieu.
429. Paris, Dimanche 20 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
3 heures
Ma lettre est partie, et la vôtre est venue. Quelle charmante page, il y a dans cette lettre. Il n’y a pas un sujet sur lequel on a plus dit depuis que le monde existe que le sujet que traite votre lettre. On n’a jamais dit comme cela, senti comme cela. C’est si beau, si parfait, si charmant que je me demande si je mérite tout cela ? comment il se fait que j’aie mérité tout cela. Je suis fière, je suis humble. Je suis ravie, je suis heureuse, et je suis triste! Je ne devrais pas être loin !
J’ai lu dans la bible, j’ai essayé d’entendre votre voix. J’ai été aux Tuileries, la pluie m’a ramenée plus vite que je ne voulais.
Voici Bulwer. Bulmer bien mélancolique et desponding hier presque joyeux aujourd’hui. Un mot dans le Globe de vendredi que lui semble de bon augure. Mais assez piqué que ce ne soit que jeudi que Thiers lui a parlé de la proposition du Pacha tandis que cette proposition se trouvait livrée à des journalistes anglais depuis la veille. Cela m’est bien égal. Je me sens en train de croire que tout va aller bien, est-ce que je ne crois pas trop vite ? Mais votre lettre m’y encourage un peu.
Lundi 8 heure
J’ai vu un moment mon ambassadeur hier matin ; avant de me rendre au bois de Boulogne j’ai passé chez vous ; je suis entrée sous prétexte de chercher des livres. Je ne les cherchais pas, je n’en ai point pris, j’ai regardé votre portrait, d’autres portraits. Votre fauteuil, votre bureau. Vous ne ne vous doutiez pas que j’étais chez vous. J’y étais avec des sentiments bien mêlés. Le bois de Boulogne un peu, une visite à Mad. Durazzo. Mon dîner qui ne ressemble pas à un dîner, une perdrix. et un gâteau de semouille, je ne sais pas manger encore et puis lady Granville jusqu’à 10 h 1/2.
Le protocole de jeudi est-il ce qui vous faisait me dire vendredi que vous croyiez à la paix ! Il me faudrait plus que cela. Il faut que lord Palmerston dise " Examinons la proposition de M. Ali. " Dès ce moment là je croirai à la paix, avant non. J’ai eu une lettre de lady Palmerston de vendredi, ce même jour je lui écrivais au sujet de la reine de Hanôvre. Une lettre insignifiante pas un mot de politique. elle me provoque à en parler, je verrai si je le ferai. Je vous envoie copie des passages importants de sa lettre.
Midi
Voici votre lettre, courte, et demain je n’aurai rien ! Dites-moi s’il y a espoir que les propositions du Pacha devienne quelque chose. Je suis très flottante. Hier j’espérais, aujourd’hui j’espère peu. Vous m’auriez dit quelque chose, si quelquechose pouvait ressortir du nouvel incident. Cependant vous êtes en pourparler avec lord Palmerston cela laisse du jour. Quand je pense à quel point ma vie, mon bonheur dépendent des paroles qui se disent aujourd’hui à Londres ; je n’ai pas assez de vœux et de soupirs pour tout ce qui agite et remue mon âme. Voici du Soleil ; ce beau soleil de Paris, si brillant, si gai, cet air si pur. Allons nous promener ensemble aux Tuileries. Ensemble ! Ah que ce serait charmant !
Adieu. Adieu bien des fois, et encore. mille fois adieu. Lord Granville verra Thiers ce matin.
A propos Thiers a dit à M. de Pahlen qu’il ignorait qu’on eut permis à Lelevel de revenir. Qu’il allait s’en enquérir auprès de M. de Rémusat. nous verrons. Pahlen redoute tout, s’il revenait prenez garde, Appony ce que je vous dis. Adieu. Lady Palmerston me dit : " Les affaires de ce moment sont trop importantes pour pouvoir espérer de les mener à la distante même de quelques heures. Ainsi, j’ai pris mon parti, et je reste. "
430_1. Londres, Le 21 septembre 1840, Dorothée de Lieven à Lady Palmerston
Je ne voulais plus causer politique, mais vous m’en parlez je réponds, et je réponds pour faire votre écho. " Comme je voudrais voir arranger bien et vite cette affaire d’Orient ! " Vous ne le désirez sûrement pas plus que moi, Voilà notre ressemblance. Mais vous y pouvez quelque chose et moi je n’y peux rien ; voilà notre dissemblance. Eh bien ma chère, faites. Inspirez le désir ; saisissez les moyens. Les moyens y sont dit-on. Le traité a eu pour résultat excellent de faire énoncer des concessions auxquelles ni la France, ni le Pacha ne voulaient se prêter avant. C’est un triomphe très patent. Le jour où lord Palmerston dira : Examinons les propositions du Pacha. " Ce jour là, la paix est sûre. S’il dit : " Le traité doit être accompli." La guerre en ressortira. je dis ici que je n’ai vu ni Thiers, ni Molé pas un français excepté un moment le duc de Noailles, et je rapporte tout ce que je vous ai dit de l’opinion du duc. " Tenez pour certain que la France veut la paix, désire la paix. Mais tenez pour certain aussi qu’elle n’acceptera plus d’humiliation, et qu’elle fera la guerre très résolument, très unanimement, et que nous en serons tous. "
( Je fais un peu le portrait du duc de Noailles après cela je continue.)
Ma chère, vous êtes bien grands à vous tous seuls. Vous êtes immensément grands à quatre ! Les plus forts ne dérogent jamais dans quoi qu’ils fassent. Vous avez fait fléchir une inflexible volonté. Votre traité a beaucoup obtenu déjà. Et bien qu’il pacifie aujourd’hui, tout de suite ; ce sera une belle et bonne veuve. La joie sera partout dans la proposition qu’ont été et qui sont encore les alarmes.
441. Paris, Vendredi 2 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
2 heures
Au moment de faire partir mon dernier N° ce matin, il est survenu un accident qui fait qu’il n’ira que demain. J’ai des distractions abominables. J’ai à vous accuser réception d’une lettre venue hier soir tard elle est datée de Dimanche. J’ai reçu celle de Mercredi il y a deux heures. J’apprends dans ce moment la prise de Beyrouth. Je ne sais encore l’effet que cela va produire ici. On attend avec impatience le résultat du conseil de Cabinet d’hier à Londres.
Au fond je ne vous écris ce petit mot que pour vous dire qu’à l’exception d’une écorchure à l’épaule occasionnée par une friction maladroite je me porte assez bien, quoiqu’encore avec quelque souvenir de crampes à la poitrine. Mais je sors pour me promener. J’aurai bien besoin d’une garde malade ou d’une bonne d’enfant qui sût me traiter et me manier avec douceur. Je vous remercie beaucoup beaucoup de votre lettre de dimanche.
J’ai reçu Byng avec un grand plaisir. Je n’ai aucune nouvelle à vous donner. Une grande curiosité, une grande anxiété, un seul et même vœu, la paix. Tout le monde la souhaite ardemment. Mais pourra-t-elle être maintenue ? Adieu mille fois. Un adieu très long par compensation de la courte lettre. Adieu.
431. Paris, Mercredi 23 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai vu hier matin, Bulwer, Appony, Granville chez moi. J’ai fait une courte visite à Lady Granville, une plus courte promenade encore en voiture. Il pleuvait à verse après mon dîner j’ai vu les deux Pahlen jusqu’à 10 heures.
Il y avait une soirée chez Lady Granville. Granville a vu longtemps Thiers à Auteuil lundi matin. Ils sont venus ensemble en ville. Granville est retourné dîner à Auteuil. Le soir il a été à St Cloud. Partout reçu et traité avec amitié et un grand empressement. Je crois. que Thiers a perdu tout le goût, qu’il avait pour Bulwer. Thiers est monté sur son cheval de bataille. Il aura neuf cent mille combattants ; il ne craint pas l’Europe réunie. Le protocole de jeudi est à ses yeux une mystification. Le Roi est soucieux depuis deux ou trois jours. Il se loue beaucoup de M. de Pahlen, (c’est de sa personne qu’il s’agit).
Je relève une erreur dans une de vos lettres. Ce n’est pas la grande duchesse Marie seule qui se trouve être maintenant cousine de M. Demidoff. La mère de Mad. Demidoff était sœurs du Roi de Wurtemberg, cousine germaine de l’Empereur Nicolas, par conséquent M. Demidoff devient neveu de l’Empereur à la mode de Bretagne. Voilà mon indiquation. Après cela, savez-vous qui était le le père de M. Demidoff celui que vous avez vu à Paris riche et perclus ? Il était sorti de je ne sais quel gentilhomme russe et potier, C’était son métier. Il a fait cette fortune par son industrie. Vous voilà bien résigné sur mon indication. Il y a beaucoup de symptômes ici qui indiquent que les préparatifs de guerre s’ils ne sont pas employés bientôt le seront plus tard. La France ne voudra pas avoir tant fait, pour ne faire rien ; et M. Thiers surtout voudra faire beaucoup ou au moins quelque chose.
Voilà ce qu’on se dit, et ce qui a beaucoup de vraisemblance. Alors il y a des personnes qui disent qu’il vaudrait mieux lui. adresser dès aujourd’hui, tout de suite, des questions sur ses armements sont-ils défensifs ? Mais personne ne songe à l’attaquer. Sont-ils offensifs, ou enfin destinés à soutenir les prétentions du Pacha ? On dit que plus douce aujourd’hui qu’elle ne le serait peut-être dans quelques mois. Et qu’en tout état de cause on ne peut pas rester longtemps dans cet état actuel de crise et d’incertitude. Je vous dis le bavardage. Les Anglais en déclament beaucoup contre la reine Christine, probablement aussi contre votre influence sur elle. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’elle est dans une pauvre situation.
Le petit F. m’a dit tenir de bonne source que 48 parle fort mal du Frêne, à ses confidents il ajoute qu’il ne fait plus de confidences véritables au peuplier. En savez-vous quelque chose ? On dit qu’au fond Thiers est mécontent de ce que Walesky est allé à Constantinople. Je crois moi que le choix de ce négociateur sera particulièrement désagréable à la Russie et ajoutera par là à l’aigreur à Constantinople.
Il faut que j’aie une lettre aujourd’hui, il m’en faut une et bonne et longue absolument. mon fils m’écrit de Bade qu’il va encore en Angleterre. Il ne sera donc ici que dans le mois d’octobre. Vous faites bien d’avoir vos soirées. Mais je vois d’ici que lady Palmerston sous forcera à recevoir des dames. J’ai trouvé le speech du roi de Prusse de son balcon à Konisberg passablement ridicule, bien Schärmevitch. La dernière phrase inintelligible.
2 heures
Pas de lettre ! C’est abominable après deux jours d’abstinence. Il faudra fermer ceci sans vous rendre un adieu, mais je le donne comme vous pouvez le désirer tout-à-fait ? Adieu. Avez-vous lu le National de ce matin ?
432. Paris, Jeudi 24 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
433. Paris, Vendredi 25 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai vu hier Montrond et les Appony. J’ai fait ma promenade En rentrant, j’ai vu M. de Pahlen. Après mon dîner, j’ai éte un moment chez Mad. de Flahaut avant sa réception et puis chez lady Granville, que je trouve toujours au coin du feu avec son mari. Appony a eu un long entretien, hier matin avec Thiers. M. de Metternich s’emploie à arranger Thiers le trouve long et métaphysique Il voudrait que cela allât plus vite. Il a été un peu menaçant, un peu doux, et toujours un peu drôle. Appony au fond était moins inquiet hier que ces jours derniers. Tout le monde se demande " Mais comment dès qu’on va faire la guerre ! pourquoi ? " Je crois que vraiment quand le moment surprise arrivera, le ridicule pourrait bien tuer le danger. Que Dieu m’entende.
Les petits états envoient des Déclarations de Neutralité, je veux dire Sardaigne, et Suède. Les pauvres allemands n’oseront pas l’être. La Confédération en décidera autrement.
Si je vous écrivais dans mes moments de faiblesse et de tristesse, mes paroles vous feraient de la peine. De la peine et du plaisir. Le matin j’ai un peu de force, vers le milieu du jour elle m’abandonne, le soir je suis tout à fait triste, découragée. Je regarde le fauteuil vert vide, je trouve ma vie si mal arrangée ! Et puis je la crois si courte. Et ce court moment, je le passe seule ! Je ne devrais pas vous dire tout cela. Vous avez assez de votre propre tristesse et puis vendredi, un mauvais jour.
Lady Holland a bien raison de le trouver un très mauvais jour. Je suis fort bien avec Madame de Flahaut. Après la grosse explosion, elle est redevenue charmante. A propos on dit qu’elle ne parle plus dans le monde, qu’elle est d’une réserve, d’une prudence presque outrées.
Je vous envoie une lettre du duc de Noailles, car je n’ai rien à vous dire, et le dimanche vous n’avez rien à lire à Londres. Cette pauvre princesse Augusta je la regrette, car elle était la meilleure personne du monde. Elle louchait cependant , elle ne vous aurait pas plu. J’espère qu’il n’est arrivée a personne de devenir louche après cinquante ans, car après votre déclaration. tout serait donc fini ? Ma nièce plait à tout le monde. On ne peut rien voir de plus gracieux, de plus naturel et de plus élégant. Sa mère sa arriver dans quelques jours what a bore ?
1 heure
Comment se fait-il que je n’ai pas de lettres ? Je vous en prie n’envoyez qu’au gens qui attendent la poste chez eux. Adieu, adieu. Adieu à demain. Je serai bien fâchée contre vous si vous m’envoyez autre chose qu’un tendre adieu après mon explication d’hier. Je sais suffisamment me gronder moi- même et je suis trop malade pour pouvoir supporter d’être grondée. Vous verrez qu’à force de douceur je deviendrai sage tout-à-fait. Adieu. Adieu. Il y aura un Cabinet council lundi. Il sera important. C’est de Londres que je parle.
434. Paris, Samedi 26 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai vu hier matin M. de Werther, Montrond, Bulwer. Celui-ci avait de mauvais avis de Londres. Lord Palmerston écrit : " Le traité doit être exécuté. " On dit que mon Empereur est de cet avis aussi et bien plus fortement ; et ravi de l’idée d’une guerre, qui le mènerait à Paris ! Je vous dis les renseignements venus par des étrangers, car Pahlen n’a pas un mot, absolument pas un. Après mon dîner, j’ai été un moment chez les Appony. Il m’a reçue avec des éclats de joie. On répandait le nouvelle que le pacha avait tout accepté. Est-ce vrai ? Nous verrons dans la journée. Ce serait un effet une bien grande nouvelle. Pas beaucoup de gloire pour le gouvernement français. Grand triomphe pour lord Palmerston, mais enfin, la paix, la paix, à moins que vous ne veuillez la guerre pour rien du tout, et pour le seul plaisir de la faire. Je raisonne et déraisonne, car encore une fois il faut confirmation.
Montrond croit que Flahaut va faire du barbouillage à Londres, que certainement il en ressortira des commérages entre vous et Thiers. Il est fâchée de ce départ. Du reste Montrond est bien à la pais. Il dit qu’il voit Thiers rarement et que quand il le voit il le trouve tellement entouré de journalistes qu’il n’y a pas moyen de causer avec lui. Savez-vous que Bulow a en effet mécontenté sa cour ? Il avait le double ordre de faire comme ses collègues d’Autriche et de Russie, et de ne pas laisser la France en dehors. Il n’y avait pas moyen de concilier cela. Il a fallu choisir, et il a choisi ce qu’il croyait qui flattait le plus les opinions de son nouveau maître. Il s’est trompé, on lui en veut. Cette donnée que je regarde comme très exacte, vous expliquez bien des choses. Lord Palmerston en veut un peu à Bulwer pour avoir tenu un langage trop mou ici. Mon ambassadeur est venu chez moi de 9 à 10 heures. Je lui ai donné la nouvelle d’Appony. Nous avons devisé sur cela. Il doute et écrit tour à tour. Nous verrons votre lettre hier ne m’a été remise qu’à 3 heures, par le petit copiste. C’est vraiement trop tard. Et puis, c’était un pur hasard qu’il m’ait trouvée chez moi.
2 heures
Voici votre lettre tard encore ; les jolis garçons. car Dieu merci j’en ai vu trois maintenant, ne me plaisent pas autant que les vieux et les veilles femmes. Je prie qu’on vienne avant midi mais cela ne fait pas beaucoup d’effet. M. Molé sera ici pourl e procès. Il n’y est pas maintenant ; je suppose qu’il viendra me voir. J’irai demander aujourd’hui où se trouve D. Je ne vous ai pas parlé de votre portrait, je l’ai bien regardé cependant. Il est excellent mais j’aime tant ma gravure, je la regarde tant dans mon cabinet de toilette, j’y suis si habituée, que dans ma préocupation de la gravure et de l’original, je n’ai pas apprécié le portrait autant qu’il le mérite. C’est un intermédiaire dont je n’ai pas besoin les deux autres ont leur place. Je bavarde et je radote. Je rêve de bons temps, bons temps passés, bons temps à venir. Venez. La nouvelle d’Appony est- elle vraie est-elle fausse ? Si elle est fausse, le conseil de Lundi sera-t-il bon, sera-t-il mauvais ? voilà où tournent mes idées. Adieu. Adieu autant de fois et comme il vous plait. Adieu.
435. Paris, Dimanche 27 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu hier Appony, Bulwer, les Granville le soir. Le temps était beau, j’ai fait assez de chemin dans le bois de Boulogne. Mon allée favorite est détruite. Elle deviendra une fortification !
Les nouvelles d’avant-hier étaient de l’invention des Rothschild. Le conseil anglais a quitté Alexandrie. La guerre est engagée. Ferez-vous la paix demain à Londres ? Le Roi était vendredi soir de très mauvaise humeur à St Cloud. Très aigre et mécontent vis-avis des puissances. Infiniment plus monté et plus belliqueux que Thiers, et j’ai entendu dire à ma diplomatie qu’il ne valait plus la peine d’aller faire sa cour si on était exposé à entendre tout ce langage. C’est le plus favorisé des diplomates qui disait cela. Eh bien qu’arrivera-t-il donc ? Peut-il arriver autre chose que la guerre, tout insensée qu’elle paraisse ?
Mad. de Boigne est à la Campagne, elle n’a pas été en ville depuis quinze jours. Elle n’y est attendu que dans 15 jours. Je suis restée chez lady Granville hier jusqu’à 10 heures, l’heure de mon coucher. Nous avons bien bavardé et un peu ri à entendre toutes les nouvelles contradictions, à voir toutes ces fluctuations dans cette affaire si grave, on est toujours dans l’embarras de savoir de qui on aura à se moquer le lendemain ! Si le Pacha cède on se moquera de vous. S’il résiste avec succès c’est de nous qu’on rira. Je ris encore, parce que je suis à Paris. Le jour où je n’y serai plus, il en sera autrement.
Midi
On ne m’apporte pas de lettres ; je vais faire un tour aux Tuileries. Vous aimeriez n’est-ce pas à y venir avec moi ? à rentrer avec moi ? à aller regarder votre gravure. Vous ne la regarderiez pas, ni moi non plus. Adieu, c’est le moment de vous le dire. Adieu. Adieu.
436.Paris, Lundi 28 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
8 heures
Je suis sur pied de bonne heure, je crois qu’en me levant si tôt je rattraperai la lettre perdue. Car vous saurez que hier je n’ai reçu eu, rien du tout. Expliquez cela. S’il y a de votre faute je ne me sens pas le courage de vous pardonner, car vous me faites trop de mal. Mais ce ne peut être vous. Et cependant où est cette lettre ? J’ai bien assez, J’ai bien trop d’un mardi pas semaine, et me voici à deux.
J’ai vu hier matin, Bulwer, Werther, Adair, Montrond, Granville. Bulwer commence à se monter la tête beaucoup. Il veut du décisif, du vigoureux. Il trouve Stopford lâche, il faut le destituer. Il faut finir l’affaire. Schleinitz mande à Werther qu’il a fort peu d’espoir d’accommodement, que l’opinion en Angleterre devient assez générale contre la France, et qu’on ne veut pas lui laisser le triomphe d’avoir fait reculer. Vous êtes tous trop vantards, cela finit par irriter, et vos menaces n’intimident personne. Je crois cela assez vrai et dans le fond il n’y a que la diplomatie à Paris qui soit encore à vous défendre. Le duc de Broglie est arrivé. Il n’avait encore vu ni le roi, ni Thiers. Lord Granville l’a vu très triste, très découragé. Il trouve que la conduite de Thiers a été bonne, mais l’affaire est bien mal engagée. Il est triste et soucieux pour le roi. Il y a bien des gens qui regardent sa situation comme bien mauvaise. Il a épousé le pays ou pour dire plus vrai les journaux. Il sera débordé par eux.
62 dit que la chambre des députés sera toute pour la paix et que par lâcheté elle votera pour la guerre. Or, la guerre, elle sera mauvaise pour toutes les puissances peut-être (sauf l’Angleterre qui n’a qu’à y gagner) mais elle sera surtout mauvaise pour la France, car elle n’y est pas préparée. Cela paraît incontestable. Je suis sûr le ton belliqueux c’est que cela devient le ton de tout le monde. On dit, on répète : " c’est insensé. " Et l’on ajoute toujours, " Mais comment se tirer de là ? "
15 croit que c’est la guerre continentale dont vous avez envie. Il est vrai qu’à l’autre Il n’y aurait que des coups à attraper, et malgré vos promesses malgré vos désires même, ce sera la Prusse qui sera la première victime, car c’est la seule abordable, et le Rhin est ce que l’on comprend le mieux en France. Vraiment nous voilà à la veille d’un beau dénouement, je n’espère pas la moindre chose du conseil de cabinet d’aujourd’hui. Il n’y a aucune vraisemblance à ce que lord Palmerston soit out voted. Thiers a dit à M. de Werther avant hier : " Si les propositions de Méhemet ali ne sont point acceptées, c’est la guerre." J’ai fait mon régime ordinaire hier. Le bois de Boulogne, dîner seule, la perdrix, et le gâteau de semouille, pas autre chose, c’est l’ordonnance. Le soir un moment chez Mad. de Flahaut et un moment chez Lady Granville, dans mon lit à 10 heures. Voici une lettre du duc de Noailles. Elle me frappe un peu. Il est clair que les événements du jour inspirent de l’espérance.
9 heures
Voici la lettre que je devais recevoir hier. Le petit copiste est venu me l’apporter il ne l’a eu hier qu’à 10 heures du soir ; il était reste jusque là à son bureau. Il dit que s’il pouvait être prévenu des jours où on lui adresse des lettres il rentrerait pour les recevoir. Je vous supplie faites quelque chose qui n’épargne la cruelle peine de rester tout un jour sans lire des paroles qui me donnent tant tant de joie ! Car quelle lettre encore que ce 421 ! Ces deux feuilles volantes comme elles vont rester dans ma mémoire dans mon Cœur. C’est un langage du Ciel, vous dites vrai, jamais, jamais oreille de femme ne l’a entendu !J’étais donc destinée à une félicité immense ; et cependant, tout ce qu’il y manque ! Midi Je suis pleine de bonheur et d’orgueil de votre lettre. Mais j’ai le cœur plus triste tous les jours sur les. affaires. Elles vont de mal en pire. Elles vont à la guerre, quelle démence ! J’attend encore votre lettre d’aujourd’hui. La voilà
1 heure
Vous ne m’avez pas entendu sur l’adieu spécial car vous me dites qu’il ne ressemble à nul autre, cela me déplaît beaucoup, les autres ont toujours été si charmants. pour être tout autre il faut qu’il soit bien laid. Je n’en veux pas. Si fait j’en veux, car au moins c’est tout près et s’il commençait mal. Je le forcerais bien à devenir bien mais voyez quelle longue histoire pour si peu de chose. Je suis tout-à-fait enragée contre moi-même. Je vous jure que je ne retomberai plus. Car vous êtes un peu fâché et vous avez raison. Ne m’en parlez plus mais s’il vous plait un adieu qui ressemble à tous les autres. Vraiment, je pense à vous je m’inquiète de vous sur cette maudite affaire d’Orient, sans cesse, sans cesse. Ne vous en tracassez pas trop cependant je vous en prie. L’aventure de votre anneau est arrivée à mon anneau, je suis obligée d’en porter un autre pour le retenir à sa place.
Venez et tout rentrera dans l’ordre. Mon Dieu, si nous étions ensemble ! Vous voulez oui sur tout-à-fait, qu’est-ce qu’était donc tout-à-fait ? J’ai envie de dire oui à tout événement car vous le diriez, et aujourd’hui je me crois obligée à vous obéir, à vous donner toute satisfaction pour vous faire oublier mon iniquité. Oubliez, oubliez, est-il possible que rien puisse m’inquiéter ? Mais c’est si beau, c’est si rare, mon bonheur ; Je ne veux pas que le moindre souffle l’atteigne. Pardonnez pardonnez. Le temps est doux, Paris est charmant. Je suis désolée de penser à toute cette tristesse. Cette solitude de Londres. Je voudrais y retourner. Voilà Mad. Durazzo. Il faut que je vous quitte. Je ne voudrais jamais jamais vous quitter. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon Cœur. Si profond, si fort, si éternel, si tendre si triste. Adieu. Adieu. Adieu. Toute ma vie toujours ! Adieu.
437. Paris, Mardi 29 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Cet abominable mardi ; il revient tous les jours ! Pourvu que demain j’aie ma lettre de bonne heure. Je ne vis plus que pour vos lettres. J’ai fait hier ma promenade avec Mad. Durrazo. Vous ne savez pas qu’elle a de l’esprit, beaucoup de finesse, de drôlerie, et qu’elle est le meilleur mime possible. Avant de rentrer, j’ai passé chez Mad. Appony. Hemmelauer qui a passé ici raconte que l’opinion en Angleterre est très vive contre la France et qu’il y a bien peu de vraisemblance à ce que l’affaire puisse s’arranger. Nos pauvres diplomates sont fort tristes et fort tourmentés. Ce sont de très braves gens et qui animent beaucoup Paris !
En traversant la place Louis XV pour rentrer je rencontre Thiers en voiture, qui fait arrêter la voiture et la mienne tout simplement et qui d’un bond s’est trouvé dans ma calèche. Nous sommes restés dix minutes exposés au public. Il m’a dit courtement : " Si le traité s’exécute vous avez la guerre c’est certain." Je lui ai dit que personne de nous en songeait à la lui faire, et que je ne voyais pas comment elle pourrait commencer. " Ah cela, c’est mon affaire. Vous verrez. " Et puis il m’a dit que le roi était furieux, la reine extrêmement, toute la famille. Qu’il était occupé du matin au soir, que tous les jours il veut venir me voir, qu’il viendra, et des tendresses ; personne n’a été nommé. Il m’a demandé ce qu’on me mandait d’Angleterre. Je lui ai dit que les esprits étaient très montés contre la France depuis peu de jours. Il me dit que les rapports sur ce sujet étaient contradictoires. Et nous verrons. Voilà la conversation.
J’ai dîné comme de coutume. Il me semble que je mange ma perdrix mais à me regarder, je croirais plutôt que c’est elle qui me mange. Après le dîner la calèche encore. Je me fais traîner le long du boulevard. C’est si animé, si gai. Je pense à Londres. Je me fâche de regarder quelque chose de gai lorsque vous n’avez que du morne et du triste. Vraiment, je ne conçois pas qu’un français puisse habiter Londres et puis pour tout étranger j’ai toujours pensé qu’on ne peut vivre à Londres que lorsqu’on a un intérieur, des enfants, du bonheur autour de soi, dans sa maison ; alors, et une grande situation pas dessus le marché cela va, surtout. Quand on n’a pas habité Paris. Mais vous, vous ! Vous ne sauriez vous figurer. A quel point je vous plains et je m’en veux de vous avoir quitté. Ah si j’avais pu rester ! Il faut bien que je me répète que c’était impossible. Votre promenade au Regent’s park seul. Cela me fend le cœur, et cet air de Londres si lourd, si gris !
N’est-ce pas que vous comprenez qu’un pauvre diable aille se pendre au mois de novembre ? Mon ambassadeur est venu à 10 heures, il me quitte parce que c’est toujours encore l’heure où je me couche, ma porte est encore fermée à tout le monde. Nous ne parlons que d’une seule et même chose nous ne parlons fort tristement tous les deux. Il admet aujourd’hui la guerre sans la comprendre. Mais enfin la voilà, partant de là il la veut bien forte et bien courte. Encore une fois toute l’Europe, et quelque chose de pire que l’année 15 ? En vérité, c’est très possible. Il y aura bien quelques mauvaises têtes, mais elles sont bien plus rares aujourd’hui qu’elles n’étaient il y a 10 ans
L’exemple de la France n’est par dangereux. Quel degré de plus de liberté y a-t-il que sous les anciens Bourbons. Qu’est-ce que les pays gagnent à se mettre en révolution? Et l’Espagne ! On regarde tout cela, on a réfléchi à tout cela, et vous trouvez peu de sympathies révolutionnaires. C’est sur cela cependant que vous devez compter. Si ce moyen vous manque, et il vous manquera, qui peut douter que l’Europe résolue comme elle l’était alors, ne fasse, comme alors succomber la France ? vraiment la carrière est plus aventureuse pour la France peu pour les autres. S’il y a des gens légers, présomptueux. Autre part, il y en a bien ici aussi. Pensez à tout cela avec votre immense raison et votre impartialité très rare. Est-on engagé assez loin pour ne pas pouvoir trouver des moyens d’éviter un grand fléau ? La situation est mauvaise. Vous faites bien de prendre des mesures à tout événement. Vous avez bien quelque motif de ressentiment quant aux procédés, aux manières, mais de là à faire la guerre, à la provoquer ! Il y a trop loin. Personne ne vous attaquera, tenez cela pour certain ; on vous laissera. à vous tout le tort de la provocation, et il soulèvera contre vous, sincèrement, toute l’Europe. Je pense et repense sans cesse à tout cela.
10 h 1/2
Quelle surprise charmante ! Cher Simon ! J’ai failli l’embrasser. Vos douces paroles me font du bien en effet beaucoup de bien. Je me soigne ; je me soignerai. Je veux que vous me retrouviez mieux. Je suis joyeuse de votre lettre. J’attends avec une vive impatience l’explication du bis, c’est de l’émotion, un intérêt constant pour toute la journée, car vous n’avez pas un confident aussi pressé que Simon. Tout ce qui s’appelle légitimiste s’est abstenu de paraître hier à la Chambre des pairs. C’est une mesure générale convenue avec Berryer. Ceux des légitimistes qui étaient revenus aux idées et au langage le plus raisonnable ont un peu changé de ton depuis les dernières six semaines. Ils prévoient de la confusion, et par conséquent de l’Espérance.
On dit que Molé dit du roi que son esprit a beaucoup baissé. Le roi a été très vif il y a deux jours dans un entretien avec Appony. Après tout ce que j’ai fait, personne n’a pour moi la moindre considération ! Le mot n’est pas heureux. Il a frappé du poing sur le genou d’Appony de façon que le pied d’Appony a rebondi. Je vous raconte tout le bavardage.
Après le beau temps d’hier ; voici la pluie, ma promenade gâtée. Et il me faut de la promenade pour reprendre des forces. Votre lettre toute seule ne m’en donnera pas. Cependant, elle y fait quelque chose. Une de nos plus grandes dames de Russie, la fameuse comteuse Orloff si riche et dernière de son nom (car Orloff est batard) va épouser un jeune officier de 26 ans sans nom et sans renom. Cela fait un immense scandale. Elle est demoiselle et elle a 54 ans. Elle vivait depuis 20 ans dans un couvent avec des moines dont elle balayait la chambre. Elle venait à la cour pendant la semaine, chaque année et y paraissait toujours couverte de diamants, et dans la plus grande pompe. Elle fait maigre toute l’année depuis 20 ans elle n’a mangé que du poisson à la cour comme au couvent. Elle est grande, grasse, un port de reine et des yeux superbes. La colonie russe ici ne parle que de ce mariage. On en est bien plus préoccupé à Pétersbourg que des affaires d’Orient.
Pahlen nie toujours que nous envoyons notre flotte, mais toujours, toujours il est sans la moindre nouvelle.
2h 1/2
Fleischmann revenu depuis 3 jours de Stuttgard a été faire sa cour hier à St Cloud. Il sort de chez moi, le roi l’a étonné, un peu effrayé, des mouvements d’une vivacité inconcevable. Un langage très exagéré. Il se frappait la poitrine. Il poussait Fleischmann contre la muraille. Il le prenait au collet, le secouait. Enfin c’est drôle. Le duc d’Orléans plus calme de gestes, mais aussi vif de paroles à demain car je suis pressée. Adieu. adieu. Mille milles fois adieu.
438. Paris, Le 30 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Midi
Je vais vous dire toute la vérité à la condition que vous ne vous inquiéterez point. J’ai été saisie cette nuit de crampes au cœur et à la poitrine assez vives pour m’obliger à faire venir mon médecin il est venu à cinq heures. Il m’a fait faire des frictions, prendre des potions pour me faire transpirer. Cela a réussi, mais le mal est encore là. Je ne puis ni parler, en respirer librement. Je suis levée depuis un quart d’heure, on refait mon lit. Le médecin dit que c’est un cold pas autre chose. Je n’ai pas de fièvre. Eh bien vous savez tout et vous attendrez demain sans la moindre inquiétude. Mais je ne puis pas écrire longtemps.
Et j’avais tant à dire aujourd’hui 30 ! Au milieu de mes douleurs cette nuit, cette date m’est revenue à l’esprit et bien le croiriez-vous ? Je ne sais plus me rappeler ce qui s’est dit, ce qui s’est passé. Pas un détail mais le mot, l’idée, si vifs si profonds dans mon cœur. Je répète les 30 avec tant de passion. J’attends encore l’explication du bis, et j’attends encore la lettre qui doit être venue aujourd’hui. Dimanche il y avait quatre semaines depuis le 30. Dimanche prochain, il y aura quatre semaines de mon départ, je crois qu’il y a quatre ans Dans d’autres moments je crois que c’était hier. nous ne savons rien régler en nous. Nos imperfections sont si de diverses.
Adieu, il faut que je finisse. Je n’ai rien à vous dire. On attend ici avec anxiété. M. de Flahaut a écrit qu’il avait bon espoir à la suite d’un long entretien avec lord Palrmerston. J’espère qu’il n’ajoutera pas à la confusion. Je ne sais si je dois rien espérer du conseil. La seule chose sûre c’est que cet état d’incertitude ne saurait le prolonger, tout est trop tendre.
Fleischmann m’a bien confirmé ce que je vous disais hier je crois. L’Allemagne est très heureuse très peu remuer révolutionnairement parlant Elle sera fort unie pour le défense. Dieu garde que vous l’y forciez. Une longue visite hier du prince Paul de Wurtemberg ; bon a entendre, raisonnant juste, et voyant noir comme tout le monde. comme tout le monde. M. de Broglie repart pour la Suisse tout de suite presque, car le procès va être fini. On dit que c’est pitoyable ce procès.
Adieu, envoyez-moi, la paix, je vous enverrai demain ma convalescence j’espère adieu. Adieu comme le 30 aussi sérieux, aussi éternel.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Procès, Relation François-Dorothée, Santé (Dorothée)
439. Paris, Jeudi 1er octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Vous m’avez promis que le mois serait beau. J’y compte. J’ai bien dormi, les douleurs sont presque passées. Enfin n’y pensez plus, mais comptez. que je suis docile que je me soigne. Votre lettre est venue hier au moment où la mienne partait, elle ne m’a guère éclairée sur la situation, vous ne dites pas un mot qui me guide.
J’ai appris hier soir que le conseil devait être remis à Jeudi, aujourd’hui. Je meurs d’impatience et d’inquiétude. j’ai vu hier mon ambassadeur celui d’Angleterre, trois fois Bulwer, quatre fois M de Pogenpohl. Ces deux là étaient inquiets de moi. Le soir M. Molé. J’étais levé c-à-d couchée sur ma chaise longue. Les ambassadeurs anxieux.
M. Molé est fort maigri. Vous jugez ce qu’a été son langage. S’il était aux affaires, s’il y était resté, tout était autrement? Jamais l’alliance anglaise ne se fût brisé entre ses mains ; on n’a fait que des fautes ; mais il faut que je convienne qu’il attaque le maréchal Soult un peu plus encore que M. Thiers quant à la conduite. Mais de l’affaire d’Orient, il est plus préoccupé de l’intérieur encore que du dehors. La situation des partis, le manque de chef au parti conservateur, l’éparpillement des doctrinaires. L’infatuation du roi pour M. Thiers. Car le roi coule des jours tranquilles, plus d’attentats, plus d’attaque dans les journaux. Son ministre le couvre, le garantit de tout cela. Mais voici l’étrangeté du roi, après avoir passé des années à montrer Thiers aux puissances étrangères comme un révolutionnaire, ennemi de sa personne, ennemi de son trône, de tous les trônes, il s’étonne que les puissances étrangères ne veulent pas. accepter M. Thiers comme un excellent ministre. Il se fâche, il s’importe.
Molé dit comme beaucoup de monde, " Mais si on ne s’arrange pas comment fera-t-on pour avoir la guerre ? Il n’y a ni sens, ni raison à la faire pour la Syrie. Par quel bout commencer ? où, quoi ? Tout ceci est insensé, absurde. Il n’y a plus un homme en Europe. ( Il y a quelques temps déjà que je me permets cette réflexion. ) De vous il dit qu’on a beaucoup répandu que vous avez été pris au dépourvu, mais qu’il n’en croyait rien, et que d’ailleurs, il y avait des preuves.
Je sais par 29 que 62 est très content de 6. 14 parle très bien du cèdre, de ses principes, il les croit inébranlables très dédaigneusement de beaucoup de petits arbrisseaux surtout de 77. Mais il en reste de bons. Il espère beaucoup que le hêtre sera ici quand la compagnie ce ressemble, et regarde même cela comme indispensable La violette a été très réservée malgré beaucoup de tentations, car on revenait toujours sur ce qui la préoccupe le plus. Midi. Voici la lettre de mardi encore pas un mot qui me fasse jusqu’ici vous avez la moindre espérance de transaction. Vous me traitez trop mal, et il y a vraiment trop d’exagération dans votre prudence.
Votre vue s’allonge parce que vous écrivez trop, pas à moi, à d’autres. M. Molé m’a dit que Berryer avait été pitoyable, très au dessus de lui-même. Je viens de lire son discours et je trouve des passages magnifiques, sublimes. Je suis sûr que vous le trouvez aussi, et aux mêmes endroits. Et je comprends un peu que Molé ne les loue pas. M. Molé pour me homme d’esprit dit quelques fois des pauvretés, et compte trop qu’il parle des sots. Hier encore cette réflexion m’a frappée. Il est désintéressé dans son jugement. Il serait très malheureux d’être appelé aux affaires. Il ne sait pas ce qui se passe, il ne cause avec personne." J’avais envie de lui dire : " mais employons donc mieux notre temps car je ne crois pas un mot de ce que vous me dites.
La partie du discours de Berryer que j’admire parfaitement est ce qui commence à : " Le pouvoir en France est aujourd’hui confié, à un ministère dont l’origine est récente" & & & et qui finit à " et quiconque devant dieu devant le pays me dira : "S’il eût réussi je l’aurais nié ce droit. " Celui-là, je l’accepte pour juge. " J’ai été fort contente du leading article des Débats hier. C’est Le langage d’un cabinet bien plutôt que d’un journaliste. Vous savez que j’attends toujours l’explication du bis. On dit dans le monde que vous allez faire partir l’amiral Duperré avec mission d’empêcher la jonction de la flotte russe avec la flotte anglaise. Mais vient elle cette flotte russe ? On dit aussi que vous embarquez des troupes sur vos vaisseaux.
2 heures
Je ne reviens à vous que pour vous dire adieu. Adieu mille fois adieu. Le meilleur, le plus tendre. Voici les Appony. Adieu.
3 h. Sébastiani aura le bâton de Maréchal. Il y a eu quelqu’embarras mais que le roi a surmonté. Montrond sort d’ici.