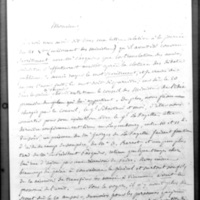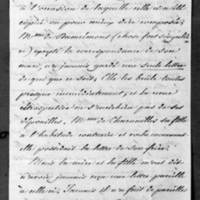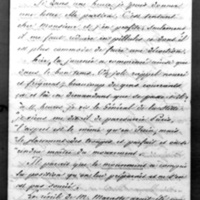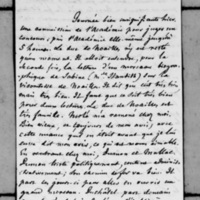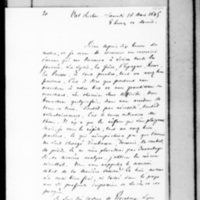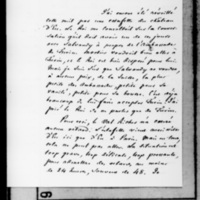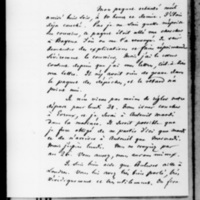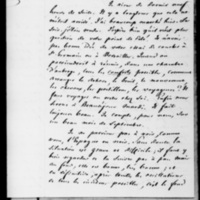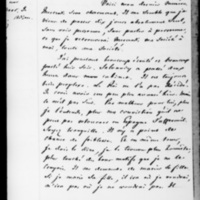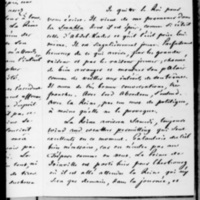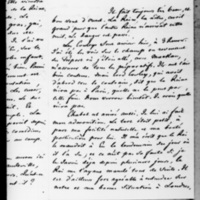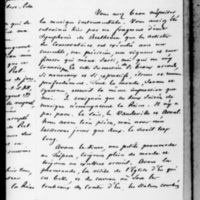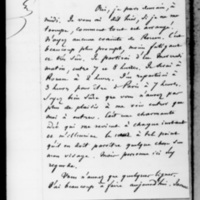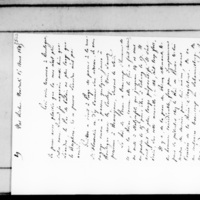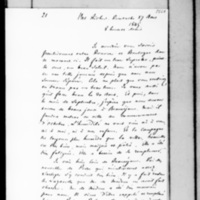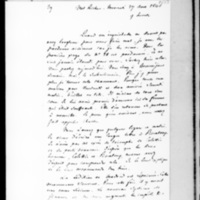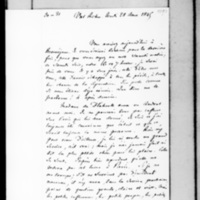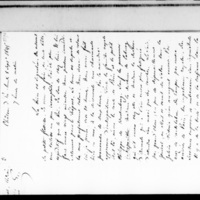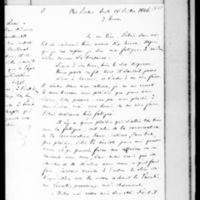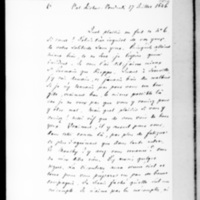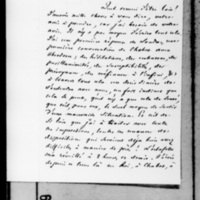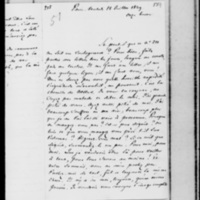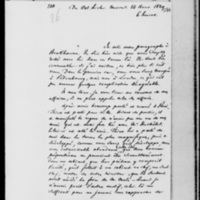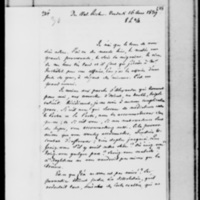Votre recherche dans le corpus : 755 résultats dans 3296 notices du site.
Paris, le 25 juin 1858, le comte de Montalivet à François Guizot
[Paris], [1848], Madame de Mirbel à François Guizot
Mais la mère et la fille m'ont dit n'avoir jamis reçu une lettre pareille à celle-ci. Jamais il n'a fait de pareilles tartines politiques. Ce style n'est pas le sien. A cette époque M. Damrémont avait moins de 20 ans. Ce n'est pas la correspondance d'un homme de cet âge. Moi qui souvent entends lire ses lettres aucunes ne ressemeblent à celle-là et aujourd'hui ou les opinions d'opposition qui y sont exprimées pourraient lui être favorables, Mme de Damrémont la renie comme ayant été pensée par son fils. Il est évident que le mauvais vouloir qui se manifeste dans l'autre lettre où sa probité est attaquée l'aura poursuivie dans celle-ci ne lui prêtent un esprit d'opposition dont la connaissance devait entraver sa carrière.
M. de Damrémont va quitter le Brésil.
Paris, le 31 Janvier 1849, Madame de Mirbel à François Guizot
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, De la Démocratie (ouvrage), Diplomatie, Famille royale (France), Femme (politique), Femme (portrait), France (1848-1852, 2e République), Fusion monarchique, Politique (France), Portrait, Réception (Guizot), Réseau social et politique, Salon
75. Paris, Mercredi 24 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Journée bien insignifiante hier. Une commission de l'Académie pour juger un concours ; puis l’Académie elle-même jusqu’à 5 heures. Le Duc de Noailles n’y est resté qu’un moment. Il allait entendre, pour la seconde fois, la lettre d’un morceau biographique de Sabine (M. de Standith) sur la vicomtesse de Noailles. Il dit que c’est très bien, mais très bien. Il faut que ce soit très bien pour deux lectures. Le Duc de Noailles est très famille. Molé m'a ramené chez moi. Bien vieux, et toujours de mon avis ; avec cette nuance qu’il en était avant que je lui eusse dit mon avis, ce qui est moins aimable. En rentrant chez moi, Dumon et Mallac. Dumon triste politiquement, content, administrativement ; son chemin de fer va bien. Il part, ces jours-ci pour aller en ouvrir un grand morceau. Duchâtel part demain pour le Bordelais. Molé va s’établir à Champlatreux le 1er Juin. Le Duc de Broglie à Broglie où il ne passera que six semaines. Il ira ensuite, avec son fils Paul, à Coppet, pour ne revenir à Broglie qu'à la fin d'Octobre. Vous voilà au courant les mouvements de mes amis.
J’ai vu la Princesse de Broglie avant hier, relevée de couches, étendue sur son canapé, enveloppée dans une robe de soie rose uni. Elle était charmante.
Je suis dans ma grande tristesse pour ma maison. Et mon grand ennui. Il paraît certain qu’on me chassera l'automne prochain, peut-être au mois d'Octobre. La ville a traité avec une compagnie, dont M. Pereire est le chef et qui se charge de faire le nouveau boulevard de la Madeleine, à la barrière Monceau. Je cherche des appartements. J'en ai vu deux qui sont possibles ; l’un rue du faubourg St Honoré, N°64, en face de Mad. de Pontalba ; l’autre rue du Cirque N°5. Mais je ne serai jamais la moitié aussi bien que je le suis chez moi.
Génie n’avait pas encore vu Rotschild hier. Je crois qu’il le verra demain.
Voilà le traité Austro Prussien dans le Journal des Débats. Mais non pas l'article additionnel et secret qui est le plus grave. Vous le connaissez. Les cas de guerre y sont stipulés bien formellement, et d'après ce que vous me dites de l'État des esprits à Pétersbourg, je doute fort qu’on y commente " à arrêter tout progrès ultérieurs des armées Russes sur la territoire Ottoman et à donner des garanties de la prochaine évacuation des Principautés " Vous payerez cher l’inconvénient des états despotiques, où ni le souverain, ni le peuple ne savent la vérité.
Vous pouvez vous donner le divertissement d'être jalouse de qui vous voudrez ; cela ne tire pas à conséquence. Il y a un peu de vrai, pas tout, mais un peu, dans ce qu’on vous a dit de Mad. Mollien ; quelque prétention, et trop de flatterie.
Qu'est-ce que vous avez à la poitrine ? Toussez-vous ? Je vous demande en grâce de me dire tout sur votre santé. Ma peur est toujours d'en trop rabattre de ce que vous me dites, car j’ai le malheur de ne pas me fier à vos impressions. Grand malheur, vous aimant comme je vous aime. Et de loin !
L'adresse de Génie est rue du faubourg Montmartre, 52. Adieu, Adieu.
Aujourd’hui, j’ai le Consistoire, l'Académie, et je dîne chez Broglie. Je pars toujours pour le Val Richer. Vendredi soir. Vous m'écrirez là vendredi. adieu. G.
20. Val-Richer, Samedi 16 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
J’écris depuis six heures du matin, et je viens de recevoir, un courrier énorme qui me donnera à écrire toute la journée. La Syrie, la Grèce, l’Espagne, Rome la Prusse. A tout prendre tout va assez bien partout ! C’est à dire que partout, nous marchons à notre but, et nous grandissons en marchant. Les chemins sont difficiles. Nous bronchons quelques fois. Nous nous arrêtons de temps en temps, tantôt par nécessité, tantôt volontairement. C'est le cours ordinaire des choses. Il n’y a que les enfants qui s'en plaignent. Mais, je vous le répète tout va assez bien partout. Ce qui n'empêchera pas que l'avenir ne soit chargé d’embarras, d'ennemis, de combats, de périls. Je ne m'en plaindrai pas davantage, si, en dernière analyse, j’obtiens les mêmes résultats. Vous vous rappelez le mauvais début de la dernière session. Et bien aucune n’a aussi bien fini, ni laissé dans le pays une si profonde impression de succès et de progrès.
Je suis très content de Piscatory. Lyons travaille avec passion à faire ce qu’il lui reproche d'avoir fait, à allier M. Mavrocordato et M. Metaxa pour renverser. M. Colettis. L'alliance Anglo-Russe à la place de l'alliance Franco-Russe maintenant debout. Lyons a échoué. Et dans l'alliance Franco-Russe, Colettis a gagné beaucoup de terrain. Piscatory a vraiment beaucoup de savoir faire. Et je ne vois pas qu’il se soit écarté de l'épaisseur d'un cheveu, de la ligne que je lui ai tracée à Constantinople, on s'occupe sérieusement des affaires de Syrie. Le Ministre des Affaires étrangères, Chékib Etfendi, y est envoyé en mission pacificatrice, avec de grands pouvoirs. Nous verrons s'il en sortira quelque chose. Le public est exigeant. Il ne se contente pas d'être bien gouverné lui-même. Il veut que tous les gouvernements soient bons, même le Turc.
En Espagne, le duc de Séville a réellement, gagné un peu de terrain. Même ce me semble dans l’esprit de la Reine Christine. Vous savez que nous n'avons ni extérieurement ni au fond du cœur, pas la moindre objection à cette combinaison. J’ai averti à Naples qu’elle était en progrès. Le langage de M. le Duc de Nemours à Pampelune sera très bon. Il a été un peu indisposé à Bordeaux. Pure fatigue du voyage, qui est fatigant en effet, mais utile.
Thiers aussi va voyager en Espagne. Pour voir les champs de bataille. Et aussi en Portugal. Il y emploiera, le mois de septembre. Il va en compagnie. peut-être MM. de Rémusat, Mérimée (votre bon député), &... Bülow de plus en plus mal. D'après le langage, de ses amis mêmes, on croit sa situation désespérée. Les émeutes religieuses se multiplient en Prusse. Halberstadt a eu la sienne pour Ronge comme Posen pour Cgerski. Je ne crois pas au succès des nouvelles religions. Mais elles feront du mal aux anciennes, et j’en suis fâché. Adieu.
C'est mardi seulement que je vous saurai arrivée à Boulogne, car je compte que vous n'aurez quitté Londres qu'aujourd'hui. Ce que vous me dîtes de vos yeux me charme. Adieu. Adieu
5. Val-Richer, Mercredi 16 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
J’ai encore été réveillé cette nuit par une estafette du château d’Eu. Le Roi me consultait sur la conversation qu’il doit avoir un de ces jours avec Salvandy à propos de l’Ambassade de Turin. Mortier voudrait bien aller à Turin et le Roi est bien disposé pour lui. Mais je suis sûr que Salvandy ne voudra à aucun prix de la Suisse, la plus petite des Ambassades, petite pour sa vanité ; petite pour sa bourse. C’est déjà beaucoup de lui faire accepter Turin. J’ai prié le Roi de ne parler que de Turin. Pour ceci, le Val Richer n'a causé aucun retard. L’estafette vient aussi vite d'Eu ici que d’Eu à Paris. Mais en tout, cela ne peut pas aller. La situation est trop grave, trop délicate, trop pressante pour admettre des retards au moins de 24 heures souvent de 48. Je Je m’arrange pour partir d’ici lundi ou mardi, le 21 ou le 22.
Mon Conseil général, les électeurs qui voulaient me donner un banquet en auront de l'humeur. J’en suis fâché, car ils sont très bien, et je tiens à ce qu’ils soient très bien pour moi. Mais il n'y a pas moyen. J'ai vu beaucoup de monde hier et je les ai préparés tous à ce désappointement. Dearest, de quel mot je me sers là! Admirez l'empire des situations. C’est au désappointement de mes électeurs que je pense quand je dois vous revoir cinq jours plutôt. Vous me le pardonnez n’est-ce pas ? Croyez-moi ; vous pouvez me tout pardonner, chaque nouvelle séparation, chaque jour de séparation me fait mieux sentir tout ce que vous êtes pour moi. Que de choses à nous dire ce jour charmant où nous nous reverrons et tous les charmants jours suivants Je vous crois parfaitement quand vous me dîtes que ce n’est pas à vous que vous pensez quand vous me parlez de la nécessité de mon retour. Vous ne m’avez pas envoyé la lettre d'Emilie. Je la plains de se marier sans goût. L’intimité de la vie quand celle du cœur n’y est pas me paraît odieuse à 55 ans comme à 20. Emilie s’y accoutumera comme presque tout le monde s’y accoutume. Mais il en résulte une certaine décadence intérieure qui me déplait infiniment. Il pleut ce matin. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai dans une heure Adieu jusque là.
10 heures Voilà bien une autre raison de revenir plutôt. Mon courrier de Paris me manque ce matin, tout entier, journaux comme dépêches, et vous par dessus tout. Je n'y comprends rien. Mais quelle que soit la cause, l'effet me déplait horriblement. Quelque négligence, un quart d’heure de retard du commis expéditeur au Ministère. C'est odieux. Je vais me plaindre amèrement à Génie. Adieu. Adieu. Ma journée sera bien longue. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Femme (mariage), Femme (politique), Femme (statut social), Louis-Philippe 1er, Mandat local, Mariage, Politique (France), Pratique politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique)
6. Val-Richer, Jeudi 17 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Mon paquet retardé m’est arrivé hier soir, à 10 heures et demie. J'étais déjà couché. Par je ne sais qu’elle méprise du courrier, ce paquet était allé me chercher à Bayeux d'où on me l’a renvoyé. Je vais demander des explications et faire reprimander sévèrement le courrier. Mais j’ai le cœur content depuis que j’ai mes lettres, c’est-à-dire ma lettre. Il n’y avait rien de grave dans le paquet des dépêches, et le retard n’a point nui. Je n'en viens pas moins de régler notre départ pour lundi 21. Nous irons coucher, à Evreux ; et je serai à Auteuil mardi dans la matinée. Il serait possible que je fusse obligé de ne partir d’ici que mardi et de n’arriver à Auteuil que Mercredi. Mais j’espère lundi.
Vous ne croyez pas au 26. Vous aurez, nous aurons mieux. Je suis bien aise que Bulwer aille à Londres. Vous lui avez très bien parlé très véridiquement et très utilement. On fera une faute énorme si on fait du bruit contre le mariage Aumale. Au fond, si nous voulions ce mariage, si les raisons françaises et Espagnoles étaient en sa faveur, je n'aurais pas grand peur de ce bruit Européen. Je le crains parce qu'il est inutile et deviendrait fort dangereux s’il faisait de ceci, pour la France et pour l'Espagne, une question d’indépendance et de dignité nationale. Du reste, je ne sais pourquoi je vous répète là ce que vous avez dit à Bulwer. M. de Metternich, sous des apparences réservées et douces, me paraît bien préoccupé du comte d'Aquila, préoccupé surtout de la crainte que le Roi de Naples ne reconnaisse, avant l’Autriche, la Reine Isabelle, et ne s'échappe ainsi du bercail, comme fit, il y a quatre ans le Roi Guillaume. Il y aurait là, en Italie un acte et un germe d'indépendance qui lui déplairait fort. C’est évidemment une affaire qu’il faut conduire sans en parler beaucoup, et sans admettre une discussion préalable. En tout, je ne m’engagerai dans aucune discussion de noms propres. Je resterai établi dans mon principe, les descendants de Philippe V. C'est à l'Espagne à prononcer et à débattre les noms propres. Votre Empereur a déclaré aux Arméniens Schismatiques, dont le Patriarche est mort dermièrement qu’il ne consentirait à une élection nouvelle qu'autant que la nation entière reconnaitrait la suprématie spirituelle du Synode de Pétersbourg. La nation a refusé. L'Empereur a interdit toute élection et confisqué en attendant les biens du Patriarche, qui sont considérables, dit-on. Cela fait du bruit à Rome. Le Pape protégera les Schismatiques contre l'Empereur.
La lettre d'Emilie est bien triste. Et celle de Brougham bien vaniteuse.
10 heures
Voilà les numéros 7 et 8. Vous avez très bien fait. Je crois comme vous, à la vertu de la vue de ce qui a été écrit sans intention. Je ne réponds plus sur le 20. Il est devenu le 22. Je vous quitte. J’ai à écrire à Génie et à Désages. Je ne crois pas à Espartero sur un bateau à vapeur entre à Bayonne. Ce serait trop drôle. Adieu. Adieu. Je suis charmé que l’air de Versailles vous plaise. G.
8. Val-Richer, Samedi 19 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je viens de dormir neuf heures de suite. Il y a longtemps que cela ne m'était arrivé. J’ai beaucoup marché hier. Le soir, j'étais rendu. J'espère bien qu'il n’est plus question de votre point de côté.
Je n’avais pas bonne idée de votre essai de coucher à St Germain ou à Versailles. Quand on parviendrait à réunir, dans une chambre d’auberge, tous les conforts possibles, comment arranger le dehors, le bruit, le mouvement, les chevaux, les postillons, les voyageurs ? Il faut voyager ou rester chez soi. Enfin nous serons à Beauséjour, mardi. Il fait toujours beau. Je compte, pour nous, sur un beau mois de septembre.
Je ne parviens pas à voir comme vous l’Espagne en noir. Sans doute la situation est grave et difficile ; il faut y bien regarder, et la suivre pas à pas. Mais au fond, elle est bonne, très bonne ; et en définitive, après toutes les oscillations et tous les incidents possibles, c’est le fond des choses qui décide. La conduite sera bonne aussi. J’ai de plus maintenant l'autorité car j'ai réussi. Je m’en servirai au dedans et au dehors. Au dedans, je crois à ma force dans la discussion. Au dehors, je crois au bon sens anglais. Voilà ma confiance. Voici mes craintes, car j’en ai plus d'une. Je crois que les Espagnols les vrais meneurs ne veuillent absolument un grand mari, et que ne pouvant avoir Aumale, ils ne reviennent au Cobourg. Je crains que malgré le bon sens de Londres, les vieilles routines Anglaises et Palmerstoniennes ne persistent dans les agents secondaires et éloignés, que l’esprit d’hostilité contre la France ne les porte à fomenter toujours en Espagne, les intrigues Espartéristes et radicales. Je crains que la bouffée de raison et de modération qui souffle en ce moment en Espagne, ne soit courte, et qu’on n’y retombe bientôt dans l’anarchie des passions et des idées révolutionnaires. Trois grosses craintes, n'est-ce pas ? Je m'y résigne. Il y a, dans le fond des choses de quoi lutter contre ces périls-là. Je sens tout le poids du fardeau que je porte. Mais je suis convaincu que les hommes qui ont gouverné leur pays, dans les grands temps n’en portaient pas un plus léger. Il faut accepter sa condition.
10 heures Voilà le 10. Je suis charmé que le point de côté soit passé. Vous avez toute raison de ne pas choquer la jeune comtesse. Je ne partirai d’ici que mardi, et ne serai à Auteuil que mercredi. Je reçois à l’instant même une lettre du Roi, qui m'avertit que Salvandy est parti d'Eu hier soir et viendra demain au Val-Richer. Tout n'est pas arrangé, bien s'en faut d'après ce que me mande le Roi. Pourtant il y a du progrès. Il faudra que j'aille faire une course à Eu dans les premiers jours de septembre ! Je l’ai promis au Roi et il me le rappelle encore aujourd'hui. Ce sera deux nuits en voiture et 36 heures de séjour. Je vais lire le discours de Palmerston sur la Servie. On m'écrit de Londres qu'il a fait de l'effet, et la réponse de Peel pas beaucoup. Adieu. Adieu. Je n’aime pas ces 24 heures de séparation de plus, mais il le faut.
Adieu. Cent fois G.
9. Val-Richer, Dimanche 20 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je serai bien court aujourd’hui. C’est un jour d'audience universelle. J’avais déjà trois visites ce matin, à 8 heures. On sait mon départ mardi. Tout le monde viendra. Et j’attends Salvandy dans la journée. Mes nouvelles d’Espagne sont bonnes. L’union des coalisés persiste et s'affermit au lieu de s’ébranler. Prim est chargé de pacifier Barcelone. Nous verrons bientôt une autre coalition, la Carlo-républicaine. Déjà on m'avertit que les Coalisés se remuent beaucoup. Coalition contre coalition. Olozaga viendra à Paris comme Ambassadeur vers la fin de septembre. On nous demandera d'en envoyer un à Madrid après le serment de la Reine aux Cortes. Jusqu'ici ce sont des affaires conduites sensément, sans presse et sans peur.
Espartero, en arrivant à Lisbonne a fait demander les honneurs de Régent. Le Ministre d’Espagne lui a fait dire qu’il avait reconnu, il y a deux jours, le gouvernement de Madrid, et le Cabinet Portugais qu’il allait le reconnaître. Espartero a déjà les illusions d'un émigré. Comme le monde va vite !
Ecrivez-moi encore demain. J’aurai votre lettre mardi matin, avant de partir. Le Roi de Prusse s’est personnellement. rejoui de la chute d’Espartero. Et Bülow aussi. Mais le travail anti-français est toujours bien actif en Allemagne. Il n’y aura pas de divorce légal entre le Prince et la Princesse Albert ; mais séparation de fait. Quand nous sommes ensemble à défaut de grandes nouvelles, il y a nous. Mais de loin, rien que des petites nouvelles, c’est pitoyable. Que Mercredi sera bon !
Piscatory fait très bien en Grèce. La conférence de Londres a adopté toutes ses vues. Adieu. Adieu. J’ai mon paquet à fermer et des gens qui attendent. Adieu, encore. G.
10, Val-Richer, Lundi 21 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon dernier numéro. Mercredi sera charmant. Il me semble que je viens de passer dix jours absolument seul sans voir personne, sans parler à personne et que je retrouverai Mercredi, ma société à moi, toute ma société.
J’ai pourtant beaucoup écouté et beaucoup parlé hier soir. Salvandy a passé deux heures dans mon cabinet. Il est toujours bien perplexe. Le Roi ne l’a pas décidé. Je crois avoir un peu plus avancé hier. Mais ce n'est pas sûr. Par malheur pour lui, plus je l’entends, plus ma conviction qu'il ne peut pas retourner en Espagne s'affermit. Soyez tranquille. Il n’y a point de chance de faiblesse. Et en même temps je dois le dire, je le trouve plus honnête, plus touché des bons motifs que je ne le croyais. Il me demande de marier sa fille. Si je marie sa fille, il ira où je voudrai, n’ira pas où je ne voudrai pas. Il sera parfaitement content. Elle a vingt ans, de l’esprit, pas jolie, fort peu d’argent, quelques espérances et elle lui dit : " Mon père, prenez garde ; se brouiller avec le Cabinet, c’est se brouiller avec le Roi, et le parti conservateur." Je crois qu’en définitive. il prendra Turin. Il me revient de Madrid qu'Aston laisse voir quelque envie d'y rester. Il a fait donner par le Chargé d'affaires du Danemark, M. d'Alborgo, un dîner au Duc de Baylen. Tout le corps diplomatique y était. Aston a été fort poli, et presque caressant avec tout le monde. En même temps pourtant il parle mal du nouveau gouvernement. A propos du départ de Prim comme gouverneur de Barcelone il disait : " Il va se faire fusiller, ou bien il bombardera Barcelone, ou bien il se mettra à la tête d’une nouvelle insurrection. " Prim répond bien qu’il ne fera rien de tout cela. Il est tout-à-fait dans la main du Général Serrano qui me parait de plus en plus, l'homme de tête et de cœur de l’évènement. Narvaez se conduit plus sagement et avec moins de prétentions que dans les premiers jours.
Il a plu hier au soir par torrents. Ce matin le soleil reparait. En tout ces dix jours ont été très beaux. J'en ai joui à St Germain autant qu’au Val-Richer. Avez-vous fini par vous arranger avec les gens d'écurie comme avec les coqs de Beauséjour ? Je sais bon gré à la jeune Comtesse de ses soins pour vous. Je chercherai quelque manière de lui faire plaisir.
Je commence à croire tout-à-fait que le général Oudinot n’a pas été à Pétersbourg. Il y serait depuis longtemps et d'André me l’aurait écrit. Nous aurons fait de la sévérité en l’air. Il n’y a pas de mal. Il en saura quelque chose, l'Empereur aussi, et l'effet en sera bon. J’espère que d'André aura eu l’esprit de ne pas tenir absolument caché ce qu’il était chargé de faire en cas. Je vous quitte, selon ma coutume, pour ma toilette.
Je vous reprendrai tout à l'heure. Adieu. Adieu.
10 heures Je ne vous reprends que pour deux minutes. Il m’arrive une foule de dépêches que je veux lire avant de les renvoyer. Elles me conviennent en général. Celles de St. Domingue sont très bonnes. Je ne vous ai jamais parlé de cette affaire-là. J'y mets de l’importance. Le Prince de Joinville et le Duc d’Aumale vont en se promenant en mer, faire une visite à Woolwich, et de là à Windsor. Je suis toujours bien aise qu’on les voie. Adieu Adieu. A après-demain.
1. Château d'Eu, Jeudi 31 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je quitte le Roi pour vous écrire. Il vient de me promener dans la Smahla dont il est épris comme si c'était celle d'Abdel-Kader et qu'il l'eut prise lui- même. Il est singulièrement jeune. Parfaitement heureux de ce qui arrive, par les grandes raisons, et par les raisons jeunes ; charmé de bien arranger et montrer son palais comme de veiller aux intérêts de son trône. Il aura de très bonnes conversations, très franches. Avec Lord Aberdeen s’entend. Avec la Reine, pas un mot de politique, à moins qu'elle ne le provoque. La Reine arrivera samedi, toujours wind and weather pemitting, qui sont excellents en ce moment. Galanterie du ciel bien nécessaire, car on n'entre pas au Tréport comme on veut. Le Prince de Joinville est parti hier pour Cherbourg, où il est allé attendre la Reine qui n’y sera que demain dans la journée, et seulement pour voir le port prendre un pilote. On est convaincu ici qu’elle n'ira pas à Paris. Rien de ce qui est venu d'elle ne donne lieu de le supposer. On s’attend à trois jours de séjour. Un grand déjeuner dans la forêt pour un jour. Magnifique promenade. Un spectacle pour un autre jour. Il y a eu bien des incertitudes, quant au spectacle. Duchâtel s’est plaint qu'on eût choisi le Gymnase, d’abord parce que c’est le seul théâtre qui n'ait pas voulu fermer aussi longtemps que les autres, à la mort de M. le Duc d'Orléans ; ensuite parce qu'il est devenu ennuyeux. Le Roi à trouvé qu’il avait raison et le Gymnase est congédié, à sa place l'Opera comique et le vaudeville votre ami Arnal. La grande calèche dans laquelle le Roi ramènera la Reine du Tréport est vraiment belle et de bon goût. Place pour les deux familles royales, au complet. La Reine sera au rez-de-chaussée dans l’appartement des Belges, convenable et tout plein de curieux portraits. On met dans sa Chambre un très grand lit, un lit anglais. Les tapis sont ôtés. Le Roi me demande, si je suis d'avis de les remettre. Je dis que non. Il fait chaud et les parquets sont très beaux, beaucoup plus beaux qu'aucun parquet anglais. La Smahla est vraiment un village de tentes en bois, qui seraient somptueuses en Afrique. Le Duc d’Aumale et le duc de Montpensier, qui arrive demain y logent. Le Duc de Nemours ne revient pas. On a pensé qu’il ne devait pas quitter son camp, laisser là dix mille soldats oisifs et dans l’attente, et toute la population, en mécompte. Je crois qu’on a raison.
C’est Lady Canning et miss Leeds qui accompagnent la Reine. Lord Aberdeen a mon appartement ordinaire. J'en ai un bien plus petit et plus simple, mais très suffisant, près du sien. La ville est pleine, archipleine, surtout d'anglais qui viennent de Dieppe, du Havre, de Boulogne, même de Southampton et de Brighton.
Un petit cabinet, place pour un lit et une chaise, se loue 25 fr. pour une soirée. Le Roi a été obligé de louer 40 chambres dans la ville. Je vous conte tout, pêle-mêle comme tout est et se fait sous mes yeux. Pourtant tout est à peu près prêt, et si la Reine arrivait demain, elle serait reçue convenablement.
Je suis arrivé à 9 heures, après une nuit très belle et très douce. J’ai assez dormi, dormi et pensé à vous tour à tour. Un peu à la Reine d'Angleterre. La Reine des Belges m'a dit à déjeuner qu’un des plaisirs qu’elle se promettait de son voyage était de me revoir. Je m'attends un peu à un siège en règle, dans l’intérêt Cobourg. Je ne trouve ici pas plus d'indécision que je n’y en apporte. La Reine est encore ébranlée de l'accident du pont. La chance était vraiment affreuse et sans la vigueur et la présence d’esprit du second postillon, on ne conçoit pas ce qui ait pu les sauver. La Reine se méfiait de ce pont, et ne se souciait pas d’y passer. " Je dirai mon mea culpa toute ma vie de ne l'avoir pas fait descendre.» m'a dit le Roi. Le petit Paris n’a pas eu peur du tout, ni du coup de canon qu’il venait de tirer. Cela a plu au Roi. Mad. la Duchesse d'Orléans y était , et aussi le duc de chartres, le Prince et la Princesse de Joinville, le duc et la duchesse de Cobourg, le duc d’Aumale, tous, excepté Madame de Nemours a bien failli être Roi m'a dit la Reine à déjeuner. Dieu se plaît à entrouvrir et à fermer l'abyme. Adieu.
Le Roi est allé se promener. Je lui ai demandé la permission de venir écrire. La poste part à 2 heures. Il me reprendra à son retour. Adieu. Adieu. Quel beau temps. J’ai voyagé jusqu'à 5 heures et demie dans un brouillard énorme. Le soleil a lui sur Eu au moment où j'approchais. En dix minutes, le brouillard a été balayé. Voilà la Musique qui annonce le départ du Roi pour la promenade. On a fait venir de Londres le God save the Queen et la musique du régiment l’apprend. On a aussi la marche saxonne du Prince Albert. Adieu, adieu. Adieu. J’espère qu’il fait aussi beau à Versailles. Je ne sais ; mais je ne trouve pas dans cette lettre assez de vous et pour vous. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Description, Diplomatie, Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Récit
3. Château d'Eu, Samedi 2 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie du matin.
Il fait toujours très beau, et bon vent d'ouest. La Reine, la nôtre, avait grand peur que l'autre Reine n’arrivait cette nuit. Le danger est passé. Les Cowley sont arrivés hier à 3 heures. J'ai été les voir sur le champ en revenant du Tréport où j'étais allé avec Mackan m’assurer de tous les préparatifs. Ils ont l'air bien contents. Mais Lord Cowley, qui avait d'abord cru le contraire, dit que la Reine n’ira pas à Paris, qu'elle ne le peut pas cette fois. Nous verrons bientôt. Je crois quelle n'ira pas.
Chabot est arrivé aussi. Je lui ai fait mon admonition. Le tort était petit, à part ma facilité naturelle et ma bonté particulière pour lui. Il m’a écrit que le Roi le mandait à Eu le lendemain du jour où il l’a su ; et ce n'est pas sa faute si je le savais déjà depuis plusieurs jours, le Roi me l'ayant mandé tout de suite. Il est d'ailleurs fort agréable à entendre sur notre et ma bonne situation à Londres. Il y a évidemment un parti pris de s’entendre avec nous sur toutes choses et de reprendre en même temps le fond et les dehors de l’intimité.
Lord Aberdeen a assez mal reçu Neumann sur les propositions de M. de Metternich en faveur du fils de D. Carlos. Il les aimerait assez en principe, mais il ne croit pas au succès et ne veut pas s'en mêler du tout. Neumann à écrit qu’il n’y avait rien à faire du foreign office sur cette question là. M. de Metternich avait écrit partout, à Berlin entr'autres, qu’il était sûr de l'Angleterre et n'attendait plus que la France. La vanterie n’est pas un défaut des seuls Français. Le gouvernement représentatif en corrige beaucoup. Le ridicule ne peut pas s’y cacher.
Le corps diplomatique de Londres ne voulait pas croire au voyage. Là aussi on pariait, Brünnow comme Kisseleff. Lord Aberdeen y a été très favorable quoi qu’il souffre beaucoup en mer. Je crois toujours que l’espoir Cobourg y est pour quelque chose. Le Prince Albert et le Roi Léopold ont évidemment beaucoup contribué à la résolution. Votre recommandation est donc bien placée, mais point nécessaire ; soyez sûre.
L’appartement de la Reine est bien arrangé. Un bon salon avec un meuble de beau Beauvais, fond rose et des fleurs d'un travail admirable. Un bon Cabinet pour le Prince Albert en velours cramoisi. La Chambre à coucher, (j'oublie la couleur) grande et très pleine de meubles. Un lit immense. (jaune, je me souviens) en face de la cheminée. Au fond du lit un grand portrait de la grande mademoiselle à plus de 50 ans, grosse, forte, le nez en l’air, quoique long, l’air hautain et étourdi, bien comme elle était. Des portraits dans toutes pièces, et dans tous les coins de toutes les pièces. En face du lit de la Reine à droite de la cheminée, le père de l'Empereur Napoléon, Napoléon et M. de Lafayette. A gauche, trois Princes de la maison de Bourbon anciens, je ne sais plus lesquels. Après la Chambre de la Reine, son cabinet, pas grand, fort joli. Beaucoup de petits comforts inspectés par le Roi avec un soin incroyable. Il était bien en colère hier parce que les serrures n'avaient pas bonne mine. Elles auront bonne mine.
J'ai vu hier Madame la Duchesse d'Orléans. bien triste. Je la trouve un peu engraissée, mais fatiguée et le teint échauffé. Bon et beau naturel. Soyez en sûre Elle viendra un peu le soir, dans le salon de la Reine. Ce sera sa rentrée dans le monde. Le Comte de Paris est à merveille, gras, gai, l'œil ferme et tranquille. Le duc de Chartres bien grêle et bien vif. Je l'ai vu hier au Tréport. Le comte d’Eu sur les bras de sa nourrice, un superbe enfant.
Le camp de Plélan va très bien. Parmi les légitimistes bretons, l'ébranlement est général ; et la masse de la population accourt au camp avec avidité. Les curés très puissants là, se rallient tous. Le Duc leur convient. La Duchesse plait. Et les soldats aussi plaisent au peuple. La Bretagne n'avait rien vu de pareil depuis on ne sait combien d'années. Les comédiens de Vannes sont venus s'établir au camp. On s'amuse utilement. A propos de comédiens nous aurons ici lundi, l'Opéra comique et le vaudeville. Jean de Paris et les deux voleurs ? Qu’est-ce que les deux voleurs ? Arnal y est-il ? Il faut pourtant que j'écrive à d'autres. Nous serons probablement convoqués, tout à coup, après le déjeuner, pour nous rendre au Tréport. Dès que la flottille de la Reine sera en vue, trois coup de canon l’annonceront. Nous endosserons notre uniforme, nous monterons dans les calèches; et Dieu sait quand nous reviendrons; à quelle heure je veux dire. Les approches, la marée, le débarquement, les cérémonies, rien ne finit. Cette lettre-ci partira donc sans que j’y puisse rien ajouter, par le courrier de 2 heures. Mais je vous écrirai ce soir par l'estafette. Il n’y avait rien à faire du télégraphe. On n'aurait pu aller le rejoindre qu'à Boulogne 28 lieues d’ici. Mad. Angelet (vous savez qui c’est, elle a élevé la Princesse Clémentine) m'a fait les plus agréables rapports sur ce qu’on disait de moi, à Windsor, la Reine et tout le monde autour de la Reine. Je me suis trompé, c’est miss Lisdle et non pas miss Leeds ; une sœur de Lady Normanby. Adieu. Adieu. Je vous dirai encore adieu après le déjeuner, avant de monter en voiture.
9 heures. Voilà du canon. Le Roi me fait demander. Je pars. Adieu. Adieu. G.
Onze heures Je reviens. Ce n’était pas la Reine, mais un petit steamer anglais envoyé devant pour annoncer qu'elle arrivera vers 2 heures. The Ariet, Captain Smith. Il a quitté la Reine à Portsmouth. Elle a dû partir de Falmouth hier au soir à 6 heures, pour passer dans la nuit devant Cherbourg. Le Prince de Joinville, averti aussi, a dû quitter hier soir la rade de Cherbourg pour aller rencontrer la Reine en mer. Tout cela est arrangé, calculé avec une précision admirable. Nous venons de déjeuner et nous rentrons chez nous jusqu'à l'heure.
Que le n° 2 est amusant ! Je répète avec vous : " C’est trop bête. " Ne trouvez-vous pas que quand on n'a pas naturellement beaucoup d'esprit il ne sert à rien, dès que la passion arrive, d'être bien élevé et de bonne condition ; on tombe au plus bas, on devient grossier et subalterne, comme si on avait passé sa vie dans l’antichambre.
Vous avez mis Andral pour Arnal. J'en ai ri. Mon pauvre Andral a failli perdre tout à l'heure sa femme d’une fluxion de poitrine, la fille de M. Royer-Collard. Elle est un peu mieux. Je déjeunais à côté de Lady Cowley. J’ai fait avec elle ce que vous auriez fait avec son mari. Je lui ai soufflé l'humeur d’Appony. Je ne savais pas que Georgina eût le cœur si français. Au point, me disait sa mère, qu’elle trouve à tous les Anglais en France, l’air vulgaire. C’était à propos du Capitaine Smith ; et pour lui, il y a du vrai. Mais pas du tout en général. Adieu. Adieu. Je dis comme tout-à-l'heure. Il faut pourtant que j'écrive à d'autres. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Description, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Famille royale (Angleterre), Famille royale (France), Femme (portrait), Louis-Philippe 1er, Portrait, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Réseau social et politique, Théâtre, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
7. Château d'Eu, Lundi 4 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je pense beaucoup à ce qui se passe ici, si je ne consultais que mon intérêt, l’intérêt de mon nom et de mon avenir, savez-vous ce que je ferais ? Je désirerais, je saisirais, s’il se présentait un prétexte pour me retirer des affaires et me tenir à l'écart. J’y suis entré, il y a trois ans, pour empêcher la guerre entre les deux premiers pays du monde. J’ai empêché la guerre. J’ai fait plus. Au bout de trois ans à travers des incidents, et des obstacles de tout genre, j’ai rétabli entre ces deux pays la bonne intelligence l'accord. La démonstration la plus brillante de mon succès est donnée en ce moment à l’Europe. Et elle est donnée au moment où je viens de réussir également sur un autre théâtre dans la question qui divisait le plus profondément la France et l'Angleterre, en Espagne. Je ne ressemble guères à Jeanne d’Arc ; mais vraiment ce jour-ci est pour moi ce que fut pour elle le sacre du Roi à Reims. Je devrais faire ce qu’elle avait envie de faire, me retirer. Je ne le ferai pas et on me brûlera quelque jour comme elle. Pas les Anglais pourtant, je pense.
Aberdeen a causé hier une heure avec le Roi. C'est-à-dire le Roi lui a parlé une heure Aberdeen a été très très frappé de lui, de son esprit, de l'abondance de ses idées, de la fermeté de son jugement de la facilité et de la vivacité de son langage. Nous sommes montés ensemble en calèche au moment où il sortait du Cabinet du Roi. Il était visiblement très préoccupé, très frappé, peut-être un peu troublé, comme un homme qui aurait été secoué et mené, très vite en tous sens, à travers champs, et qui bien que satisfait du point où il serait arrivé, aurait besoin de se remettre un peu de la route et du mouvement. The king spoke to me un very great earnestness, m’a-t-il dit. Et je le crois car, en revenant de la promenade, j’ai trouvé le Roi, très préoccupé à son tour, de l'effet qu’il avait produit sur Aberdeen. Il ma appelé en descendant de calèche pour me le demander. " Bon, Sire, lui ai-je dit ; bon, j’en suis sûr. Mais Lord Aberdeen ne m’a encore donné aucun détail. Il faut que je les attende. "
Il les attend très impatiemment. Singulier homme le plus patient de tous à la longue et dans l’ensemble des choses, le plus impatient le plus pressé, au moment et dans chaque circonstance. Il est dans une grande tendresse pour moi. Il me disait hier soir : " Vous et moi, nous sommes bien nécessaires l'un à l'autre ; sans vous, je puis empêcher du mal ; ce n’est qu’avec vous que je puis faire du bien. "
Il fait moins beau aujourd’hui. J'espère que le soleil se lèvera. Nous en avons besoin surtout aujourd’hui pour la promenade et le luncheon, dans la forêt. Le Roi a besoin de refaire la réputation de ses chemins. Il a vraiment mené hier la Reine victoria par monts et par vaux, sur les pierres, dans les ornières. Elle en riait, et s'amusait visiblement de voir six beaux chevaux gris pommelés, menés par deux charmants postillons et menant deux grands Princes dans cet étroit, tortueux et raboteux sentier. Au bout, on est arrivé à un très bel aspect du Tréport et de la mer. Aujourd’hui, il en sera autrement. Les routes de la forêt sont excellentes. Du reste il est impossible de paraître et d’être, je crois, plus contents qu'ils ne le sont les uns des autres. Tous ces anglais. s'amusent et trouvent l’hospitalité grande et bonne. J’ai causé hier soir assez longtemps, avec le Prince Albert. Aujourd’hui à midi et demie la Reine et lui me recevront privatily. Ce soir spectacle. Débat entre le Roi et la Reine (la nôtre) sur le spectacle. La salle est très petite. Jean de Paris n'irait pas. On a dit Jeannot et Colin, beaucoup d'objections. Le Roi a proposé Joconde. La Reine objecte aussi. Le Roi tient à Joconde. Il m'a appelé hier soir pour que j'eusse un avis devant la Reine. Je me suis récusé. On est resté dans l’indécision. Il faudra pourtant bien en être sorti ce soir. Adieu.
J'attends votre lettre. J'espère qu'elle me dira que vous savez l’arrivée de la Reine et que vous n'êtes plus inquiète. Je vais faire ma toilette en l’attendant. Adieu. Adieu.
Midi
Merci mille fois de m'avoir écrit une petite lettre, car la grande n’est pas encore venue et si je n'avais rien eu j'aurais été très désolé et très inquiet. A présent, j’attends la grande impatiemment. J'espère que je l’aurai ce soir. Ce qui me revient de l'état des esprits à Paris me plait beaucoup. Tout le monde m'écrit que la Reine y serait reçue à merveille. On aurait bien raison. Je regrette presque qu'elle n’y aille pas. Pourtant cela vaut mieux. Mad. de Ste Aulaire est arrivée ce matin. Voilà le soleil. Adieu Adieu. Je vais chez la Reine et de là chez Lord Aberdeen. Adieu Cent fois. J’aime mieux dire cent que mille. C'est plus vrai. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Discours autobiographique, Discours du for intérieur, Louis-Philippe 1er, Opinion publique, Parcours politique, Politique (Espagne), Politique (France), Portrait, Posture politique, Théâtre
Château d'Eu, Mercredi 6 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Vous avez beau mépriser la musique instrumentale. Vous auriez été entrainée hier par un fragment d'une symphonie de Beethoven que les artistes du conservatoire ont exécutée, avec un ensemble, une précision, une vigueur et une finesse qui m'ont saisi, moi qui ne m’y connais pas et cette succession de si beaux accords, si nouveaux et si expressifs, étonne et remue profondément. Tout le monde, savants et ignorants, recevait la même impression que moi. Je craignais que ces deux soirées de musique n'ennuyassent la Reine. Il n’y a pas paru. Ce soir, le Vaudeville et Arnal. Nous avons trois pièces, mais nous n'en laisserons jouer que deux. Ce serait trop long. Avant le dîner, une petite promenade, au Tréport, toujours plein de monde, et toujours un excellent accueil. Avant la promenade, la visite de l’Eglise d’Eu qui est belle, et du caveau où sont les tombeaux des comtes d’Eu, les statues couchées sur le tombeau, les comtes d'un côté, leurs femmes de l'autre, et le caveau assez éclairé, par des bougies suspendues au plafond, pour qu’on vit bien tout, assez peu pour que l’aspect demeurât funèbre. Les Anglais sont très curieux de ces choses là. Ils s'arrêtaient à regarder les statues, à lire les inscriptions. Notre Reine et Mad. la Duchesse d'Orléans n'y ont pas tenu ; elles étaient là comme auprès du cercueil de Mrs. le Duc d'Orléans. Elles sont remontées précipitamment, seules, et la Protestante comme la Catholique sont tombées à genoux et en prières dans l’Eglise devant le premier Autel qu’elles ont rencontré. Nous les avons trouvées là, en remontant. Elles se sont levées, précipitamment aussi et la promenade, a continué.
J’ai eu hier encore une conversation d’une heure et demie avec Aberdeen. Excellente. Sur la Servie, sur l'Orient en Général et la Russie en Orient, sur Tahiti, sur le droit de visite, sur le traité de commerce. Nous reprendrons aujourd’hui l’Espagne pour nous bien résumer. Le droit de visite sera encore notre plus embarrassante affaire. " Il y a deux choses m’a-t-il dit, sur lesquelles notre pays n’est pas traitable, et moi pas aussi libre que je le souhaiterais, l'abolition de la traite et le Propagandisme protestant. Sur tout le reste, ne nous inquiétons, vous et moi, que de faire ce qui sera bon ; je me charge de faire approuver sur ces deux choses là, il y a de l’impossible en Angleterre, et bien des ménagements à garder. " Je lui demandais qu’elle était la force du parti des Saints dans les communes : " They are all Saints on these questions. " Je crois pourtant que nous parviendrons à nous entendre sur quelque chose. Il a aussi revu le Roi hier et ils sont tous deux très contents l’un de l'autre. La marée du matin sera demain à 10 heures. On pourra sortir du port de 10 h.
à midi.
Ce sera donc l'heure du départ, nous ramènerons la Reine à son bord comme nous avons été l’y chercher. Il fait toujours très beau. Je demande des chevaux pour demain soir, 9 heures. Je vous écrirai encore demain matin pour que vous sachiez tout jusqu’au dernier moment. Pas de santé de la Reine à dîner. Les toasts ne sont pas dans nos mœurs. Il faudrait porter aussi la santé du Roi, et celle de notre Reine, et peut-être pour compléter nos gracieusetés, celle du Prince Albert. Cela n'irait pas. Je ne me préoccupe point de ce qui se passe entre la Cité et Espartero. C'est ma nature, et ma volonté de faire peu d’attention aux incidents qui ne changeront pas le fond des choses. Lord Aberdeen, m'en a parlé le premier, pour me dire que ce n’était rien et blâmer positivement Peel d'avoir dit qu’Espartero était régent de jure. Il n’y a plus de régent de jure, m’a-t-il dit, quand il n’y a plus du tout de régent de facto. La régence n’est pas, comme la royauté, un caractère indélébile, un droit qu'on emporte partout avec soi. J’ai accepté son idée qui est juste son blâme de Peel sans le commenter, et son indifférence sur l'adresse de la Cité qui du reste est en effet bien peu de chose après la discussion et l’amendement qu’elle a subi.
Vous auriez ri de nous voir hier tous en revenant de la promenade, entrer dans le verger du Parc, le Roi et la Reine Victoria en tête, et nous arrêter devant des espaliers pour manger des pêches. On ne savait comment les peler. La Reine a mordue dedans, comme un enfant. Le Roi a tiré un couteau de sa poche : " Quand on a été, comme moi, un pauvre diable, on a un couteau dans sa poche. " Après les pêches, sont venues les poires et les noisettes. Les noisettes charmaient la Princesse de Joinville qui n’en avait jamais vu dans son pays. La Reine s'amuse parfaitement de tout cela. Lord Liverpool rit bruyamment. Lord Aberdeen sourit shyement. Et tout le monde est rentré au château de bonne humeur. Adieu. Adieu. J’oublie que j'ai des dépêches à annoter. Adieu pour ce moment.
Midi et demie
Nous venons de donner le grand cordon au Prince Albert, dans son cabinet. Le Roi. lui a fait un petit speech sur l’intimité de leurs familles, et des deux pays. Une fois le grand cordon passé : " Me voilà votre collègue, m'a-t-il dit en me prenant la main ; j’en suis charmé. " Je crois que la Jarretière ne tardera pas beaucoup. Je vous dirai pourquoi je le crois.
Le N° 7 est bien amusant. Pourquoi ne pas être un peu plus spirituel d'abord ? Cela dispenserait d'être si effronté après. Le pauvre Bresson a bon dos. Il n’a jamais voulu rien forcer, car il n’a jamais cru qu'on vînt. Je reçois à l’instant une lettre de lui. M. de Bunsen venait d’écrire à Berlin le voyage de la Reine comme certain. Bresson est ravi : " Il faut, me dit-il, avoir, comme moi, habité, respiré pendant longues années au milieu de tant d'étroites préventions de passions mesquines, et cependant ardentes, pour bien apprécier le service que vous avez rendu, et pour savoir combien vous déjouez de calculs, combien de triomphes vous changez en mécomptes. "
C'est le premier écho qui me revient. Je dirai aujourd’hui un mot de Bulwer. Soyez tranquille sur la mer. Nous ne ferons pas la moindre imprudence. Je me prévaudrais au besoin de la personne du Roi dont je réponds. Il n’y aura pas lieu. Le temps est très beau, l’air très calme. Le Prince Albert est allé nager ce matin avec nos Princes. Le Prince de Joinville reconduira la Reine jusqu'à Brighton et ne la quittera qu'après lui avoir vu mettre pied sur le sol anglais.
Voici ma plus impérieuse recommandation. Ne soyez pas souffrante. Que je vous trouve bon visage ; pas de jaune sous les yeux et aux coins de la bouche. Si vous saviez comme j'y regarde, et combien de fois en une heure ! Je n’arriverai Vendredi que bien après votre lever ; pas avant midi, si, comme je le présume, je ne pars qu'à 10 heures. Adieu. Adieu. Il faut pourtant vous quitter. Nous partons à deux heures pour une nouvelle et dernière promenade dans la forêt. Adieu. G.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Famille royale (Angleterre), Famille royale (France), Mariages espagnols, Musique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (Internationale), Portrait (Dorothée), Posture politique, Pratique politique, Réception (Guizot), Récit, Religion, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
9. Château de Windsor, Dimanche 13 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Oui, je pars demain à midi. Je vous ai dit hier si je ne me trompe comment tout est arrangé. N'ayez aucune crainte de Rouen. C’est beaucoup plus prompt moins fatigant et très sûr. Je partirai d'Eu Mercredi matin, entre 7 et 8 heures. Je serai à Rouen à 2 heures. J’en repartirai à 3 heures pour être à Paris à 9 heures.
Soyez bien sûre que vous n'aurez pas plus de plaisir à me voir entrer que moi à entrer. C’est une charmante idée qui me revient à chaque instant et m'illumine le cœur à tel point qu’il en doit paraître quelque chose sur mon visage. Mais personne ici n'y regarde. Vous n'aurez que quelques lignes. J'ai beaucoup à faire aujourd’hui. Jarnac vient de passer deux heures dans mon Cabinet. J’aurai une dernière conversation avec Aberdeen et avec Peel. Je dois voir aussi le Prince Albert. Puis une foule de petites affaires à régler avec le Roi.
Par une faveur que Lord Aberdeen a arrangée, Lord John Russell est invité à dîner pour aujourd’hui. Aberdeen m’a engagé à causer avec lui, assez à cœur ouvert ; et des rapports des deux pays et du droit de visite. Il lui croit bonne intention, et est lui-même avec lui, en termes très bienveillants.
Merci de la lettre de Bulwer. Je vous la renvoie. Il écrit ici sur le même ton parfaitement content de Bresson et de Glücksbierg. Je ne compte pas laisser M. de Nion à Tanger. Lui-même demande à aller ailleurs. J’ai dîné hier à côté de la Duchesse de Gloucester qui me demande de vos nouvelles et m’a parlé de vous avec un souvenir affectueux. Elle m'a dit que la société anglaise avait perdu sa vie en vous perdant. Après dîner de la conversation avec Aberdeen, un peu avec Peel. Un vrai plaisir à revoir les Granville qui étaient là. Lord Granville est réellement mieux ; toujours faible et chancelant, mais se tenant assez longtemps debout et parlant. Le Roi a été très aimable pour eux. Mad. de Flahaut aussi était là. Tout juste polie. Je l’ai été un peu plus, et voilà tout. Du reste d’une humeur visible et naturelle. Personne ne lui parlait, ne faisait attention à elle.
Votre discours final à Aberdeen est excellent, et je le tiendrai. Il faut que je vous quitte adieu, adieu, dearest. Je tâcherai de vous écrire un mot demain, je ne sais comment, et puis d'Eu, Mardi, en y arrivant. Et puis, ce sera fini. Je vais très bien. Vous me trouverez, moins maigre qu'à mon départ. Adieu. Adieu G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Louis-Philippe 1er, Ministère des Affaires étrangères, Portrait, Pratique politique, Récit, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Réseau social et politique, Santé (François), Voyage
19. Val-Richer, Vendredi 15 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci vous trouvera à Boulogne. Je pense avec plaisir que la mer n’est plus entre nous. Quand je nagerais aussi bien que Léandre, le Pas de Calais est plus large que le Bosphore. Et ce pauvre Léandre n'est pas arrivé.
Guillet a écrit à Page de passer à la rue St Florentin et d’y donner son adresse. Je vous engage encore à passer quelques jours à Boulogne avec les Cowley. Vous n'aurez personne à Beauséjour, surtout le soir. Le Roi de Prusse a beaucoup d'humeur de ce que la Reine comme elle le lui a fait savoir ne reste à Stolzenfels que jusqu’au 14 et veut en partir le 15 pour être à Cobourg le 17. Il avait fait de plus longs préparatifs. Il s’est écrié, sur cette nouvelle : " Ah, c’est trop fort. Il y a de la part des Princes allemands et des hommes considérables, fort peu d'empressement pour se présenter chez le Roi de Prusse & lui rendre des devoirs pour lui-même, avant l’arrivée de la Reine d'Angleterre. On va au contraire beaucoup au Johannisberg. On peut évidemment se montrer froid pour le Roi de Prusse et confiant dans M. de Metternich. Le Roi en est choqué. Et comme il est surtout homme d'impressions et d'amour propre, cette petite manœuvre n’aura probablement pas l'effet qu’on s’en promet.
La Reine d’Espagne et même la Reine Christine ont été très bien reçues à St Sébastien et dans les Provinces basques, en général ; mieux qu’on ne s’y attendait. Voilà encore des conspirations qui échouent. Ce ne sont pas les conspirations que le général Narvaez a à craindre ; c'est l'opposition dans son propre parti. Les prochaines cortes seront orageuses. Le grand Duc de Modène a décidément et pour la seconde fois refusé sa fille à M. le Duc de Bordeaux. On a donné un bal à Schönbrunn dans cette vue. Il a déclaré que si le Duc de Bordeaux y allait, ses filles n'iraient pas. Le Duc de Bordeaux a été indisposé. Le parti est très chagrin, très déconfit de cet échec. Ils disent qu’ils n’ont plus d’espoir que dans la seconde fille du Prince Jean de Saxe, 15 ans, bien laide & pauvre ; et que si cela aussi échoue, il faudra que le Duc de Bordeaux épouse une française de bonne maison, car il faut absolument qu’il se marie. La Dauphine a fort essayé de causer politique et France avec l’Electrice douairière de Bavière qui s’y est refusée. Elle (la Dauphine) s'est montrée parfaitement découragée et résignée. On lui a demandé si elle passerait l’hiver à Vienne ou à Frohsdorf : " Je n'en sais rien et cela ne me fait rien, avec le peu de jours qui me restent à vivre, et ce que j’ai à en faire, qu'importe ? " Voilà mon bulletin. Le calme est profond.
Le Roi et tout le château d’Eu ont été charmés de mon discours à St Pierre. Il m'écrit avec effusion. Henriette est décidément très bien. Mais le temps redevient mauvais, froid. Quel été ! J’ai écrit à Charles Greville. Adieu. Adieu.
Vous avez déjà passé où vous passerez après-demain. Il n'y a pas de vent aujourd’hui. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Famille royale (France), Femme (mariage), Femme (portrait), Louis-Philippe 1er, Mariage, Politique (Espagne), Politique (France), Réception (Guizot), Réseau social et politique, Santé (enfants Guizot), Séjour à Londres (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
27. Val-Richer, Samedi 23 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il me survient ce matin une nécessité absolue d'écrire une longue lettre au maréchal Bugeaud. Des difficultés, des tracasseries, des étourderies, sans intérêt pour vous, mais dont il faut que je m'occupe et qui me prennent le temps que je vous destinais. A Beauséjour, le mal n'est pas grand. Si quelque incident nous ôte un quart d’heure, nous le retrouvons bientôt. De loin, on ne répare rien. Je suis bien impatient du 30. Je voudrais qu’il fit aussi beau qu’aujourd’hui. Mais les soirées commencent à devenir longues, fraîches et longues. On ne peut plus guère sortir le soir. Comment vous arrangez-vous des lumières ? En tous cas, nous resterons, dans l’obscurité.
Je serai bien aise de causer avec Bulwer. J’en serais encore plus aise, si j’avais confiance. Mais enfin il a de l’esprit et point de mauvais vouloir. J'ai commencé à parcourir la Correspondance de Sir Stratford Canning sur les affaires de Syrie. Je la trouve bonne, sensée, nette, ferme. Je traiterais volontiers avec cet homme-là malgré son difficile caractère. Deux in folio de Parliamentary Papers sur la Syrie. Et j'ai beau chercher : je ne vois aucun moyen efficace d’arranger vraiment ces affaires-là. Il y faudrait la très bonne foi et le très actif concours de la Porte. Et la Porte est apathique, & nous trompe. Mes nouvelles d'Allemagne sont de plus en plus graves. Les populations très animées ; les gouvernements très inquiets et abattus. Le Roi de Prusse, toujours gai et confiant. M. de Metternich espérait un peu après Stolzenfel. Une visite de lui au Johannisberg. Le Roi retourne sans s'arrêter à Berlin. Le pauvre Roi de saxe est désolé. Il a dit, les larmes aux yeux, à la députation de Leipzig que c’était le jour le plus triste de sa vie. " Et comment les choses là m’arrivent-elles à moi qui n’ai jamais souhaité que le plus grand bonheur de mes sujets ? "
C'est singulier que dans les temps difficiles, il y ait toujours à côté des Rois, un frère compromettant. Adieu. Adieu.
Je vois qu’il n’y aura point de Mouchy. Si vous parlez demain Dimanche, vous serez donc à Beauséjour, après-demain lundi. Vous ai-je dit que Génie qui y est allé, l’a trouvé charmant plus fleuri que jamais ? Moi, j’ai du monde à déjeuner lundi. Salvandy mardi. Du monde à déjeuner Mercredi. Une visite à Lisieux Jeudi. Mes paquets vendredi. Samedi, à 5 heures du matin je serai en voiture. Je crois que vous me trouverez tres bonne mine. Adieu. Adieu. G.
Je pense en ce moment que cette lettre-ci n’ira plus vous chercher à Boulogne et vous sera portée Lundi à Beauséjour. Heureuse lettre !
21. Val-Richer, Dimanche 17 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je voudrais vous savoir positivement entre Douvres et Boulogne dans ce moment-ci. Il fait un temps superbe, point de vent, un beau soleil. Nous n'avons pas eu une telle journée depuis que nous nous sommes séparés. Cela me plaît que vous rentriez en France par un beau temps. Je veux aussi qu’il fasse beau le 30 août. Et puis dans le mois de septembre, j’espère que nous aurons encore de beaux jours, à Beauséjour. Mais il faudra rentrer en ville, au commencement d’octobre. L’humidité ne vaut rien ni à vous ni à moi, ni à mes enfants. Et la campagne est toujours plus humide que la ville.
Henriette est très bien, mais maigrie et pâle. Elle a été très fatiguée. Elle a besoin de se remplumer.
Je vais bien loin de Beauséjour. J'ai des nouvelles de Perse qui m’intéressent assez. Sartiger s'y conduit très bien. Il y a fait rentrer les Lazaristes que M. de Médem en avait fait chasser. M. de Médem a été très mauvais pour nous. Il vient d’être rappelé et remplacé par un Prince Dolgorouki qui était à votre Ambassade à Constantinople. On dit qu’il sera plus modéré que Médem. On m'en parle bien. Un petit incident à Constantinople dont je suis bien aise. Le duc de Montpensier doit y être arrivé ces jours-ci. Bourqueney a communiqué d'avance à Chekib Effendi la liste des officiers qui l'accompagnaient, & devaient être présentés au Sultan. Dans le nombre, se trouvait un Abd el-At, Algérien, Arabe, Musulman, sous lieuteuant de Spahir à notre service. Vive émotion parmi les Turcs ; Comment présenter un tel homme au Sultan ? Insinuations, supplications à Bourqueney d’épargner ce calice. Il a très bien senti la gravité du cas et répondu très convenablement mais très vertement. On s'est confondu en protestations ; Abd el-Al sera reçu comme les autres officiers du Prince. Tout le régiment des Spahir serait reçu s’il accompagnait le Prince. Et de bonnes paroles sur notre possession d’Alger qu’on sait bien irrévocable, ceci fera faire un pas à la reconnaissance par la Porte. Adieu. Adieu.
J’ai des hôtes ce matin. Puis, dans la semaine où nous entrons & les premiers jours de la suivante, trois grands déjeuners de 25 personnes chacun. Mes politesses électorales à la campagne, le déjeuner est plus commode que le dîner.
Je regrette Bulwer pour votre route. Comme agrément, car comme utilité, si vous aviez besoin de quelque chose, je doute qu’il fût bon à grand chose. Quand vous reviendrez de Boulogne vous savez que Génie a, si vous voulez, quelqu'un à votre disposition. Adieu. Adieu.
Je me porte très bien. J’ai le sentiment que marcher beaucoup me fait beaucoup de bien. Seulement il n’y a pas moyen de réunir les deux choses, le mouvement physique et l'activité intellectuelle. Il faut choisir. Adieu. Adieu. G.
26. Val-Richer, Vendredi 22 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Temps charmant ce matin. Par un si beau soleil, dans un si joli pays, je ne me promène pas seul sans un vif regret. Je cherche à chaque instant ce je sais bien quoi qui me manque. Quand je dis seul, j’ai tort. Désages vient de m’arriver, et je me promenais, tout-à-l'heure avec lui. Mais ce n'est pas Désages qui me manque. Peut-on se promener à Boulogne ? Il ne m’a pas paru que le pays fût beau aux environs.
On m'écrit de Hambourg que décidément votre Impératrice, va passer l’hiver à Palerme, et que le Pince Wolkonski aux eaux de Pyrmont a reçu des instructions, pour prendre les informations, et faire les préparatifs nécessaires. J’ai peine à y croire. N'avez-vous point de nouvelles de Constantin ? Vous me l'auriez dit. Je suis impatient à cause de lui, que cette campagne finisse. Il me paraît que les difficultés sont toujours grandes. L'Empereur a fait un grand pas en acceptant. la publicité de ces bulletins. Il ne pourra plus cesser de parler. A la vérité, il n’est pas obligé de dire la vérité, personne n'étant là, pour le contredire.
Au moment où la Reine d’Angleterre est arrivée à Mayence, les Rothschild avaient été faire quelque chose de fort galant en envoyant pour elle, au débarcadère, trois superbes voitures. Le Prince Guillaume de Prusse s’est fâché, a renvoyé ces voitures de l’enceinte du port, et la Reine est montée dans la sienne. Elle a été, dit-on, beaucoup plus gaie et de meilleure humeur à Mayence qu'à Brühl. Pas d’autres détails intéressants. Je vous quitte pour faire ma toilette. Je vous reviendrai après déjeuner. De demain Samedi en huit jours, je ne vous quitterai que pour retrouver en une minute. Adieu. Adieu.
10 heures et demie
J'aurai des embarras en Gréce. Colettis et Métaxa se brouilleront. J’espère que Colettis et Mavrocordato se racommoderont. Si cela arrive, j’aurai gagné au change. Si au contraire Metaxás et Mavrocordato se coalisant Colettis seul sera-t-il assez fort et assez sage ? Je n'en sais rien. Piscatory a confiance. Et s’il ne s’agissait que d'Athènes, j'aurais bien confiance aussi. Mais Paris, Londres et Pétersbourg ! Nous verrons. En tous cas malgré ses défauts Piscatory est un très bon agent, et puissant là Que de choses moi aussi j'aurai à vous dire. Quand on est ensemble on ne sait pas tout ce qu’on se dit. En tout, nous ne sentons jamais, le bien assez vivement, assez complètement quand il est là. Qu’est allé faire Lord Cowley à Londres ? Rien que pour ses propres affaires à coup sûr. Lord Aberdeen prend-il plaisir à ses voyages ? S’il a le goût des questions religieuses, il trouvera en Allemagne de quoi le satisfaire. Ce sera sérieux d'ici à peu de temps. Adieu.
Le déjeuner sonne. J’espère que Page vous fera de bons déjeuners. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Diplomatie (Russie), Enfants (Benckendorff), Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Ministère des Affaires étrangères, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Allemagne), Politique (Grèce), Portrait, Religion, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
3. Val-Richer, Lundi 14 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val Richer. Lundi 14 Août 1843, 6 heures du matin
Que je vous remercie ! Vous êtes charmante. Je comptais sur une lettre ; et encore vous ai-je fait une sotte question. J'en ai trouvé deux. Ne craignez jamais de me fâcher. Dites-moi toujours tout. Tout me plait venant de vous. Je ne me pique point de n'avoir jamais pour ceux que j’aime, pour ma mère surtout, quelque complaisance quelque faiblesse si vous voulez. Vous y êtes vous-même pour quelque chose. J’ai tort de vous dire cela ; je touche là une triste corde. Mais moi aussi, je vous dis tout. Le spectacle d’un fils que n’est pas pour sa mère ce qu’il doit être m'a tellement blessé que cela a tourné au profit de la mienne ; et je suis devenu, pour elle, plus soigneux, plus affectueux qu'auparavant. Il est vrai qu'elle et mes enfants avaient un très vif désir de ce voyage. Il m'a plu de leur donner ce plaisir. Je n'ai pas perdu ma bonne intention. Ils sont dans le ravissement.
Je mentirais, si je ne disais pas que je prends aussi quelque plaisir à la vue de mes bois, de mon jardin, de ma bibliothèque, de ma serre, de mes orangers. Le soleil brille ce matin ; ses rayons percent avec éclat une vapeur légère et fine qui flotte encore sur les bois et les près, les plus verts du monde. C’est charmant. Mille fois moins charmant qu’un moment près de vous, une parole, un regard de vous. Croyez-moi dearest, car je vous dis tout. Ne soyez pas jalouse de mon plaisir d’ici ; il ne le mérite pas. Mais pardonnez-moi de le sentir.
Puisque le mot de jalousie est venu là, sachez que vous êtes vous dans ma maison, pour ma mère surtout un objet d'immense jalousie. Si je n'étais pas venu ici elle aurait été parfaitement convaincue que vous seule en étiez la cause. Vous la comprendrez et vous ne lui en voudrez pas. Vous avez le cœur si juste ! Gardez-moi pourtant tout ce que vous m’avez montré le jour où vous m’avez dit qu'avec moi seul vous n'aviez ni justice, ni impartialité. Je déraisonne. Je vous demande les contraires. Oui, je vous les demande, bien sûr de vous en récompenser amplement. Je ne crains jamais d'être en reste avec vous.
Le 26. Politiquement soyez tranquille. Le jour où mon absence aura un inconvénient réel je partirai sur le champ. Je suis très attentif à cet égard. Je ne vous retire point la question d’un Ambassadeur à envoyer à Madrid. Si elle vient, elle me ramène le lendemain. Dans la nuuit de samedi à dimanche, à Evreux, à une heure du matin, le directeur de la poste m'a réveillé pour m’apporter une lettre du Ministre de l’Intérieur, disait-il. J’ai cru que j'étais rappelé à Paris. Ma première, bien première impression a été de plaisir, de plaisir pour Beauséjour. Il n’y avait point de lettre de Duchâtel. C’était tout bonnement des papiers que Génie m'envoyait et qui auraient fort bien pu attendre mon réveil. Il y avait pourtant une lettre du Roi. Bonne à voir, tant elle montre son sincère éloignement pour le mariage Espagnol, son vif désir de s’entendre avec l'Angleterre, et son humeur de ce brouillard si épais de préjugé, de méfiance et de crédulité qu'il ne peut parvenir à dissiper. Je vous quitte pour lui écrire. Je vous reviendrai quand la poste sera arrivée. Adieu. Adieu. Cent fois, adieu.
10 heures
Que j’aime le N °31 ! Si Oudinot a passé à Copenhague je ne comprends pas qu’il n'aille qu'à Ems ou à Vienne et s’il n’y a pas passé, je ne comprends pas où St. Priest a pris ce qu’il m'a dit. Oudinot n'aurait-il voulu aller à Pétersbourg qu'en cachette pour porter lui-même ses regrets à l'Empereur et revenir aussitôt. Ce serait bien galant. On écrit de Madrid qu'Aston fait ses préparatifs de départ. Vous me renverrez ce que je vous envoie. Adieu. Adieu. Il faut que j'écrive au Roi, à Désages et à Génie. Adieu. Au 26.
Ni brigands, ni accidents, ni maladies.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcs et Jardins, Politique (France), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Dispute), Vie domestique (François)
30. Val-Richer, Mercredi 27 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Quand vos inquiétudes ne durent pas assez longtemps pour vous faire mal, je vous les pardonne aisément car je les aime. Donc la première page du N°28 est pardonnée. Je ne suis jamais étourdi pour vous, sachez bien cela. Vous partez aujourd’hui. Vous serez à Beauséjour demain. Moi le surlendemain. Plus j’y pense plus je trouve cela charmant.
Presque toute ma maison part vendredi, et sera arrivée samedi matin. Guillet en tête. Il m’aime de tout son cœur. Je lui avais permis d'amener ici sa femme qui était souffrante. Elle s’en retourne se portant à merveille. Je pense qu'en arrivant vous avez fait appeler Charles.
Vous n'aurez que quelques lignes ce matin. Je viens d’écrire une longue lettre à Piscatory. Je n’aime pas cet excès de triomphe de Colettis et du parti français. J’espère que les deux hommes. Colettis et Piscatory, auront assez d’esprit pour comprendre cela. Je le leur explique et le leur recommande très bien. La sédition de Madrid est réprimée. Cela recommence souvent. Pour cette fois, il y avait une cause sérieuse. Le nouveau système de finances de M. Mon augmente les impôts & fait user les abus. Les fripons et les contribuables se défendent. J’espère qu’ils seront battus. Le gouvernement Espagnol a besoin d’argent. Il en prend à ceux qui en ont et ne souffre plus qu’on le vole. M. Mon est un honnête homme et un homme de courage. Je viens de lui faire donner le grand cordon. Il faut soutenir les amis. Quoique tout soit bien précaire dans le pays, j'ai assez bon espoir. Bresson est à Bayonne, attendant M. le duc de Nemours qu’il accompagnera à Pampelune. Adieu. Adieu.
J’ai plusieurs ordres à donner à Génie, ma toilette à faire, 25 personnes à déjeuner. C'est le dernier. D'après vos lettres, je suis content de vos yeux. L’écriture est ferme. Et puis vous n'en parlez pas. Adieu. Adieu. G.
31. Val-Richer, Jeudi 28 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous arrivez aujourd’hui à Beauséjour. Je vous écrirai demain pour la dernière fois, pour que vous ayez un mot, samedi matin ; et samedi soir entre 6 et 7 heures, je serai près de vous. Il y a deux joies, celle d'être avec vous, celle d'avoir échappé à tous les périls à toutes les chances de la séparation. J'en parle comme si nous étions déjà réunis. Que dieu me le pardonne ! A après-demain.
Madame de Flahaut aura vu Andral avant moi. Je ne pourrai donc pas influer, sur l’avis qui lui sera donné. Je suis et j’ai toujours été convaincu que c'était et que ce serait toujours la même personne. Rien n'y peut rien. D'ailleurs, je lui ai rendu un grand service, c’est vrai. Mais je n'ai jamais fait ni dit la plus petite chose pour lui plaire. Cela se sent. J'espère bien cependant qu’elle ne restera pas cet hiver à Paris. Si je ne me trompe ; s'il ne survient pas d’incident nouveau, il n’y aura, dans la session prochaine, point de question grande, claire et vive. Mais les petites influences, les petits propos, les petites intrigues, n'en ont que plus d'importance.
Je vois, en relisant votre lettre que vous arriverez aujourd’hui à Paris, et que vous y resterez demain. Vous avez raison. Je ne pense qu’à Beauséjour parce que c’est là que j’arriverai. Mais vous ferez bien mieux de vous faire nourrir demain à Paris.
On m’écrit qu'Albert Esterhazy est bien près de sa fin. C'est décidément. M. de Canitz qui a l’intérim des Affaires étrangères à Berlin. Le Roi conserve à Bülow son titre avec un congé indéfini. Je préfère M. de Canitz à l'Armin de Bruxelles qui était aussi sur les rangs. Adieu. Adieu.
Je ne vous écrirai plus qu’un mot. J’ai une foule de petites affaires les deux jours-ci, et j'aurai encore plus de visites que d’affaires. Adieu. G.
3. Château d'Eu, Lundi 8 septembre 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures du matin
La Reine est signalée. On entrevoit sa petite flottille. Je viens de faire, en toute hâte, une toilette un peu incomplète. J’ai été plus expéditif que le Roi. Je sors de chez lui. Il lui faut encore vingt-minutes. Nous partons immédiatement pour le Tréport. Le temps est superbe et la mer parfaitement calme. Nous serons de retour, ici, je pense vers 10 heures. Nous avons fait hier en mer, à la découverte, une charmante promenade de deux heures. Pas la moindre apparence d'indisposition.
Toute la famille royale était là, même le comte de Paris et le petit Philippe de Wurtemberg. Sauf les personnes indisponibles. Madame la Duchesse de Cobourg, qui vit encore chez elle et Madame la duchesse d’Aumale qui a l’air encore plus fatiguée d'attendre son mari que ses couches. Le soir pas grand chose ; un peu de dépenaillement général ; on allait et venait du salon, dans la galerie Victoria qu'on arrangeait, encore. Pas assez de candélabres. Les lampes pas encore arrivées de Paris. Des impatiences Royales. Des serviteurs empressés et embarrassés sans inquiétude. Il y a de la bonté et de la confiance dans la bonté. Je suis rentré chez moi, et me suis couché à 10 heures. J’ai très bien dormi. Je sors avec ma grosse redingote et mon cache-nez blanc. Il fait frais. Mon rhume va bien. C’est-à-dire moi non pas lui.
Une heure
Je cause avec Lord Aberdeen depuis onze heures un quart. Je suis content. Je crois qu'il l’est aussi. La principale question, l’Espagnole coulée à fond, à sa complète satisfaction. Le Roi l’a abordée sur le champ avec lui, à bord du Victoria-Albert. Plus l’ombre d’un nuage sur ce point. Tahiti et ce qu'on appelle les armements, restent nos deux embarras. Embarras des deux côtés, embarras très ennuyeux. Rien de plus. Il supporte moins bien les embarras que moi. J'ai établi très nettement ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas. Je vous répète que je suis content. Amical au dernier point. Et le Prince Albert beaucoup.
Charmante arrivée. Le temps encore plus beau qu’il y a deux ans. Arrivée au Tréport marée basse. Il a fallu monter dans de petites voitures, pour atteindre le canot royal à travers les sables et les galets. Une demi-heure en canot pour atteindre, le Victoria-Albert. Autant à bord, pour approcher du rivage. Nous sommes descendus dans le canot du Roi, le Roi, la Reine, le Prince Albert, le Prince de Joinville, le Prince de Cobourg et moi. Puis les petites voitures pour atteindre la terre ferme. La Reine gaie comme un entant. Excellent accueil de la population, moins nombreuse qu’il y a deux ans. Presque point de préparatifs : a friendly call between neighbours. Arrivée au château par le grand parc nouveau défilé des troupes dans la Cour. La Reine comme chez elle, reconnaissant les lieux, approuvant les changements. Grand, grand succès de la Galerie Victoria. Les tableaux de quatre jours sauvés par l’intention. On s’est promis qu’ils seraient beaux quand ils seraient faits.
A déjeuner le Prince Albert donnant le bras à la Reine. le Prince de Salerne de l'autre côté. La Princesse de Salerne à la gauche du Roi. Moi à côté de la Duchesse d’Aumale.
J’ai fait vos compliments à Lady Canning, pour elle et pour son mari. Après le déjeuner, établissement dans la galerie Victoria. On s’est écouté successivement. Nous sommes restés seuls, Lord Aberdeen et moi causant toujours. Je viens de l’installer chez lui. A 2 heures, promenade. Tout le monde y va. Ce soir, à 8 heures spectacle. La petite pièce est Le nouveau seigneur. On commence par là. Demain, grande promenade et luncheon dans la forêt, à la Ste Adelaïde. La Reine part entre 4 et 5 heures. Adieu. Adieu.
Il n’y a pas moyen de continuer. L’estafette part. Adieu. G. P.S. Soyez assez bonne pour donner à Génie quelque chose de ces détails.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Famille royale (France), Femme (mariage), Femme (maternité), Femme (portrait), Ministère des Affaires étrangères, Récit, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Santé (François), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
4. Château d'Eu, Lundi 8 septembre 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
5 heures et demie
Au lieu du char à bancs royal et de la forêt, deux heures et demie de promenade à pied, dans le parc, tête-à-tête avec Lord Aberdeen. Très, très bonne promenade, affectueuse, confiante et sensée. Toute utilité à part, j’y ai pris un vrai plaisir. Lui aussi j’en suis sûr. La politique ainsi faite est grande et douce. Il y a plus ; elle semble facile. Ce n'est pas vrai. Les difficultés des choses se replacent bien vite, entre les bons sentiments des hommes. Et les hommes se séparent bientôt. N'importe ; il est impossible que de telles conversations, il ne reste pas beaucoup. Il y a des paroles qui tombent au fond des cœurs, s’y endorment, et se réveillent infailliblement quand le moment arrive où elles sont bonnes à entendre une seconde fois. Nous avons parlé de tout. Nous recommencerons un peu demain ; mais pas avec la liberté et le loisir d’aujourd’hui.
Les arrangements de demain sont un peu changés. A dix heures le déjeuné. A onze heures et demie promenade dans la forêt. pas très loin, et pas de luncheon. On revient à 3 heures dîner à 4, à 5 et demie départ pour le Tréport où la Reine s'embarquera pour être à l’île de Wight Mercredi matin. Et moi je m'embarquerai jeudi avant 7 heures pour être à Beauséjour avant 7 heures du soir. Adieu. Adieu. Je vais m'habiller pour le dîner.
Mardi, 9 sept. 8 heures et demie. Dîner encore à côté de la Duchesse d’Aumale ; Lady Canning à ma droite. Elle a du good sense, de la dignité et de la bonne grâce, mais peu de mouvement et de fécondité dans l’esprit. Lord Aberdeen, à la gauche de la Reine. On le traite très bien et on a très raison. Le spectacle commence trop tard et fini trop tard. Très jolie salle ; sous une immense tente, fort bien ornée et point froide ; au milieu du parc. Le nouveau seigneur a fait rire la Reine. Richard l’a fait pleurer. Nous n'avons ri ni pleuré. Aberdeen, et moi. Nous aurions mieux aimé causer encore.
Je lui demandais hier comment il avait trouvé le Prince des Metternich. Il m’a répété ce qu’il vous a dit, en ajoutant : " Mais vous vous n’avez pas le droit dire que le Prince de Metternich est baissé, car en nous séparant au dernier moment, comme je lui ai dit que j'allais probablement vous voir, il m'a répondu : " Je voudrais bien en faire autant ; il y a bien longtemps qu'on n'a vu en France un tel ministre. "
Je n'étais dans mon lit qu’à une heure moins un quart. Rien n’est changé, pour aujourd’hui aux dispositions d’hier. Voilà votre N°3. Je suis charmé que Verity soit de retour, et qu’il vous trouve mieux qu'à Londres. Nous prendrons les soins qu’il faudra prendre. Je ne fermerai ma lettre qu'entre 3 et 4 heures, en revenant de la promenade, car je crois qu’aujourd’hui il convient d’y aller. Adieu. Adieu jusqu'à 3 heures. Onze heures Je sors de déjeuner. J'envoie une estafette à Génie. Vous aurez ma lettre ce soir. Adieu. Adieu. G.
Pas ce soir. C’est presque impossible. Vous vous couchez de trop bonne heure. Mais demain matin.
3. Val-Richer, Mardi 14 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pas d'estafette cette nuit. A sa place un gros orage. Le tonnerre a roulé pendant une heure et demie. Il faut de l’espace au tonnerre. Les rues de Paris lui déplaisent ; on ne l'y entend pas. La mer et les bois, c’est là qu’il triomphe. J’avais envie de dormir, et pourtant. j'écoutais avec plaisir comme un bruit champêtre. J’ai très bien dormi après et ne me suis levé qu'à 7 heures après m'être couché avant 10. Je me soigne avec une obéissance exemplaire. Hier soir, à 8 heures, je suis rentré pour éviter le serein. J’ai cette éternelle disposition, à l'éternument qui n’est rien qu'un ennui, mais bien, un ennui.
Je viens d'écrire à Sir J. Easthope. Bien, je crois ; indiquant que la confiance peut se gagner, que je désire sincèrement qu’on la gagne, mais qu’il faut la gagner. C'est le commentaire d’une phrase d’une lettre de vous à Lady Palmerston. J’écris aussi à Brougham. Brièvement. Il abuse des lettres. Il est saisi d’une haine aveugle contre les Whigs, et sera contre eux au Parlement et dans le monde, d’une activité tout aussi aveugle. Je ne veux ni me l'aliéner, ni me livrer à lui. Les relations de ce genre sont l’ennui du métier. Amis ou ennemis, de la confiance ou de la guerre, à la bonne heure, mais se méfier et ménager, c'est l’ennui. L’Espagne, me préoccupe beaucoup. Si l'Angleterre épouse D. Enrique, nous retomberons dans la vieille ornière, la lutte des partis Espagnols modérés et progressistes, & le patronage français et anglais au service de cette lutte. Situation très incommode, car ce qu’on abandonne le plus difficilement, c’est un ancien patronage. Question d'influence politique et d’amour propre personnel. Je crois bien que dans cette lettre, j'aurai le bon bout. Si les Progressistes espagnols avaient le pouvoir à Madrid, et que de concert avec Londres, ils m'offrissent D. Enrique, je serais fort embarrassé à le refuser. Mais ce sont les modérés qui dominent en Espagne ; ils ne voudront pas de D. Enrique, et si je les décide à vouloir du Duc de Cadix, l’embarras du refus sera pour l’Angleterre, qui ne refusera pas, je crois. Au fait, je ne crains pas beaucoup cette alternative, et la question ainsi placée, n'a pour nous, plus de bien mauvaise issue. Notre principe et notre honneur sont saufs, en tout cas. Je cause avec vous, en attendant votre lettre qui n’arrive pas. L’orage aura retardé la malle.
6 heures et demie Voilà votre lettre. Nous nous rencontrons parfaitement sur D. Enrique. Comme toujours. Quoique cette situation soit difficile, je l’aime pourtant bien mieux que la chance du Cobourg. Ce que vous dit Könneritz de la Constitution en Prusse me parait probable. Il y aura encore plus d’une oscillation de ce genre. Ce qui n'empêche pas qu’on ne marche vers la constitution. La dépêche de Pétersbourg est bonne en effet, bonne avec complaisance. On a pris plaisir à l’écrire. On fera tout ce qu'on pourra pour être bien avec nous, comme gouvernement, sans changer d’attitude personnelle. Je puis, après ce qui s’est passé depuis cinq ans et ma raideur de 1843, m'accommoder assez de cette situation. Elle ne manque pas de dignité, et peut avoir de l'utilité. Voici une lettre intéressante de Londres. Renvoyez-la moi, je vous prie, dès que vous l'aurez lue. Soyez sûre que le Cabinet Whig a quand on regarde à ses adversaires, une meilleure position, et plus de chances de durée qu’on ne le dit. C’est dans son propre sein que sont les germes d’une dissolution, peut-être assez prompte. Lord John, lord Palmerston et Lord Grey n'iront. pas longtemps ensemble. Il faut que je vous quitte pour répondre aux lettres d’affaires. Celle-ci est bien froide, bien d’affaires. J’ai tout autre chose dans le cœur. Je ne m'accoutume pas en me promenant que vous ne soyez pas avec moi. Je m'arrête pour vous attendre. Je me retourne pour vous chercher. C’est surtout quand quelque chose me plaît que vous me manquez Adieu. Adieu. Vous partez donc demain pour Dieppe. Allez ensuite chez la vicomtesse. Il ne faut pas s'annoncer pour ne pas aller. On s’attire de la malveillance. Même de la part de ceux qui auraient autant aimé qu’on ne leur eût rien annoncé. Adieu. Adieu, dearest. J’enverrai toujours mes lettres à Génie. G.
Ibrahim Pacha dit que la nation anglaise l’a reçu comme il a été reçu par le Roi des Français.
4. Val-Richer, Mercredi 15 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos yeux malades me déplaisent beaucoup. Presque autant que vos yeux bien portants me plaisent. Vos yeux bien portants ont, par moment, un caractère de profondeur de regard recueilli et intérieur, admirable. Je les vois tels dans ce moment-ci. Qu'ils ne soient pas malades. Mad. Danicau vous lit-elle beaucoup ? Vous ne me dites rien d'elle. Je suis presque bien aise que vous renonciez à Dieppe. Je n’y avais pas goût. C’est bien loin pour ce que vous alliez y chercher. Et en cas de grand ennuis, il faut deux jours pour revenir à Paris. J’aime mieux St Germain ou Versailles. Je pense que vous allez samedi à Mouchy. Moi, j’irai ce jour-là établir Pauline à Trouville. Je devais y aller demain. Quelques arrangements me font retarder de deux jours. Fleischmann tient-il sa parole ? Le temps est resté un peu gâté de l'orage. Je me suis moins promené hier. Pourtant une course d’une heure dans les bois. On m’annonce pour aujourd’hui beaucoup de visites. Si je savais m’ennuyer, l’occasion serait bonne. L’état des esprits est excellent, ici et dans les environs. Je ne crains que le trop de confiance. Tous les nôtres se croient sûrs du succès trop sûrs.
Rien aujourd’hui d’aucun point. Si ce n’est de Bruxelles où l’Infant D. Enrique s’est rendu en deux jours, à charge à tout le monde, en particulier à sa sœur qui parle mal de lui et dit qu’il faut bien le veiller. Il ne s’est entouré que des émigrés progressistes. Il a dîné le 14 à la Cour, et il part aujourd’hui même pour la Hollande, d’où il ira sans nul doute à Londres. Vous avez toute raison de parler toujours de lui, comme de notre candidat N° 2. J’attends la première lettre de Jarnac pour lui écrire en détails à ce sujet. A tout prendre, je serais bien aise que Bulwer quittât Madrid pour Constantinople. C'est aussi l’avis de Bresson. Palmerston a été à Tiverton, bien réservé sur les affaires étrangères, et bien aigre sur Peel. Il me paraît impossible que l’hostilité ne recommence pas bientôt entre eux. Les Whigs feront ressortir les fautes de Peel, et il ne se laissera pas faire, je suppose. Je reçois un mot de Flahaut qui trouve sa retraite (la retraite de Peel) magnifique. Mais M. de Metternich a été très choqué de l’éloge de Cobden.
J’avais tort tout à l'heure de vous dire que je n’avais rien de nulle part. J’oubliais ce mot de Flahault qui me demande de la part de Metternich, des renseignements très détaillés sur l'organisation et le service de la Gendarmerie en France. On veut établir un service semblable en Galicie. On vient, d’Autriche, nous emprunter de la police. Pas un mot sur le discours de Montalembert et sur mon silence. Flahaut a tort. Que M de Metternich ne lui en ait rien dit, je le comprends ; mais il devrait avoir lui des informations, des conjectures, sur ce que Metternich en a pensé, et me les dire. Il fait comme bien d’autres, plus en pouvoir que lui ; dès qu’il y a quelque embarras, il s'efface. Vous ai-je dit qu’il avait écrit à Morny ? Il y a peu de temps qu’on lui disait que je n'étais pas content de lui, que j’avais envie de donner son poste à un autre, &. pour peu que cela fût vrai, disait-il, il voudrait le savoir, car pour rien au monde, il ne voudrait rester à son poste contre mon gré ou seulement contre mon goût. J’ai pleinement rassuré Morny. Adieu.
Je reviens à vos yeux. J'en attends de meilleures nouvelles. Merci de vos excellents conseils pour Henriette. J'en ai fait usage d’autant que je les avais devancés. Elle est à l’œuvre. Vous avez mille fois raison. Vous êtes vous-même, un modèle d’ordre. Adieu. Adieu. Je viens d’écrire longuement au Roi sur l’Espagne. Adieu G.
5. Val-Richer, Jeudi 16 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Je me lève. J’étais dans mon lit et endormis hier avant dix heures. Depuis que je me repose je sens ma fatigue. Je voudrais vivre comme La Fontaine : Quant à son temps, bien le sut dispenser ; Deux parts, en fit, dont il voulait passer L’une à dormir, et l’autre à ne rien faire. Je n'entre dans mon Cabinet, je ne me remets à mon bureau avec plaisir que pour vous écrire. Cela passera ; non pas, mon plaisir à vous écrire, mais mon besoin de ne rien faire. J'étais vraiment bien fatigué. Il n’y a qu’un plaisir qui s’allie très bien avec la fatigue, c’est celui de la conversation, de la conversation douce, intime, sans but, pur plaisir. Celui-là n'existe pour moi qu'avec vous. Si je pouvais faire mes affaires en en causant avec vous, sans autre souci que de chercher et de décider avec vous ce qu’il faut faire, laissant ensuite à d’autres le soin de l'exécution avec les autres, ce serait le Paradis, un Paradis paresseux, mais charmant.
Dites-moi votre avis sur ceci. Faut-il attendre que Palmerston ait parlé à Jarnac des affaires d'Espagne et lui ait indiqué sa disposition ou bien faut-il que Jarnac, prenant l’initiative, aille droit à Palmerston et lui dise : « L'Infant D. Enrique va arriver à Londres ; le parti progressiste veut en faire son instrument et votre candidat. Ce sera le retour de l’ancienne situation qui a été si nuisible au repos de l’Espagne, et à la bonne intelligence entre nous ; la France et les Modérés, l'Angleterre et les Progressistes, deux mariages, deux gouvernements ; une lutte continuelle, dans laquelle nous aurons l’air d'être les patrons, et nous ne serons que les instruments des partis Espagnols. Voulez-vous que nous coupions court à tout cela, et que nous travaillions, ensemble, sincèrement activement, à marier promptement la Reine d'Espagne à l’un des fils de D. François de Paule à celui qu’elle et son gouvernement préfèreront ? Nous sommes prêts ? C’est là, je crois ce qu’il y aurait de mieux. J’ai posé hier la question au Roi. J’attends sa réponse et la vôtre qui est déjà dans votre lettre d’hier. 9 heures Voilà une lettre qui me désole. Moi, Marion, Verity absents, c’est trop. Je vais attendre bien impatiemment la lettre de demain, j’espère que vos yeux ne s'obstineront pas à mal aller. Vous avez déjà eu souvent ces oscillations. Je me dis ce que j'ai besoin de croire. Si vous revenez à votre gold anointment (est-ce le nom ?), faites le vous-même plutôt que de le faire faire par Chermside.
Comment réussit Mad. Daucan ? Au moins, elle sera bonne pour vous lire. Tant que vous serez inquiète de vos yeux, vous serez mieux à Paris qu’à St Germain. La solitude est le pire. Je suis vraiment bien fâché pour cette pauvre Marina. Elle vous convenait. Le mal est-il si avancé qu’il n’y ait rien à faire ? Sinon, elle ferait bien d’aller consulter, M. Velpeau, ou M. Jaubert, ou M. Cloquet. Ce sont les habiles en ce genre. Avez- vous quelque femme de chambre en vue ? Qu’est devenue votre ancienne Marie ? Je vous questionne à tort et à travers. Si j'étais là, je saurais tout et je ferais quelque chose. Il me paraît difficile que vous ne donniez pas une petite indemnité au courrier qui vous a attendue, et ne s’est pas engagé à d'autres. Je n’ai pas d’idée du chiffres. Entre 60 et 100 fr. Ce me semble. Je dis cela au hasard. J’ai trouvé en effet, au fond de la grande enveloppe, une lettre particulière de Rayneval. Absolument rien qu’un compliment sur la mort de Mad. de Meulan.
Bonnes nouvelles de Rome. Rossi a présenté ses lettres d’Ambassadeur. Bon discours au Pape. Bonne réponse du Pape. Excellente position. Les Autrichiens se disent très contents de l’élection du Pape. Au fait si le cardinal Autrichien Gaysruck était arrivé à temps, il se serait opposé au choix de Martaï. Cela paraît certain. Il n’est plus guère douteux que le Pape ne fasse bientôt l’amnistie et des améliorations considérables dans les états romains. Gizzi Secrétaire d’état à peu près sûr. Amal, à l'intérieur ; moins sûr, mais probable. Tous deux très bons. Adieu. Adieu. Je recommande à Génie de vous montrer une dépêche de Naples qui vous amusera. Adieu. Que Dieu garde vos yeux ! Et vous toute entière ! Adieu.
6. Val-Richer, Vendredi 17 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quel plaisir me fait ce N°6, si court ! J’étais tres inquiet de vos yeux de votre solitude sans yeux. Puisqu'ils allaient mieux hier, ce ne sera, je l’espère, qu’un incident. Je vous l’ai dit ; j’aime mieux St Germain que Dieppe. Quant à Trouville j’y vais demain, et j'aurais bien du malheur si je n’y trouvais pas pour vous un bon gite vraiment bon, le mieux possible là, car je ne veux pas que vous y veniez pour y être mal. Mais quel plaisir si vous y veniez ! Aussi vif que de vous voir de bons yeux. Vraiment, il y aurait pour vous dans cette course-là, pas plus de fatigue et plus d’agrément que dans toute autre. El Mouchy ? Y avez-vous renoncé ? Vous ne m'en dîtes rien. J’y aurais quelque regret. La vicomtesse aura remué ciel et terre pour vous préparer un peu de bonne compagnie. Je serais fâché qu'elle eût un mécompte. Je n'aime pas les mécomptes, ni donnés, ni reçus. Comme il vous conviendra du reste. Merci de la lettre de Greville. Intéressante. Je vous la renvoie avec une de Reeve que vous me renverrez. A peu près la même chose. Le parti Tory se réformera. Et un jour, il s’y formera un chef. Peel ne le redeviendra pas. A moins d’incidents bien imprévus. Et de l’autre côté les nuances se fondront dans un grand parlé libéral, qui n’en sera pas plus homogène. Et le jour qui ne sera pas très loin, ou l’esprit radical y prévaudra trop les Torys reprendront le pouvoir. Je doute que Gladstone, leur soit un chef dans les Communes. Je voudrais bien. Il est très honnête et d’un esprit doux et élevé. Nous verrons. Il y a bien à regarder là.
Le courrier d’aujourd’hui ne m'apporte rien du tout. Sinon le mouvement des élections qui s'anime un peu. Je suis charmé que Casimir Périer se porte candidat à Paris, et je désire beaucoup qu’il réussisse. Cela me convient électoralement et diplomatiquement. Adieu. Je serai court aussi aujourd’hui. J’ai un énorme paquet de signatures à donner. Je ne suis pas aussi oisif ici que l’an dernier. J’ai gardé les affaires. Je me promène pourtant beaucoup. En bien bon air. Point trop chaud. Hier il a beaucoup plu. Adieu. Adieu. Merci de vos yeux. G.
7. Val-Richer, Samedi 18 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Où êtes-vous à St Germain ? Je suppose au Pavillon de Henri 4. Vous ne me l’avez pas dit. J'espère que vous y avez plus beau temps qu’il ne fait ici ce matin. Ma vallée est sous un voile de pluie. C'est ennuyeux pour aller à Trouville. J’y vais pourtant. Je pars à onze heures. Le soleil percera peut-être d’ici-là. Le temps est très variable depuis deux jours. Je vous dirai demain matin ce que j'aurai trouvé pour vous à Trouville. On dit que la maison où ma fille, et Mlle Wislez vont s’établir est la meilleure de l’endroit, la plus confortable, par la vue, et au dedans. Elles ont le projet de s’établir au second étage et de laisser le premier disponible. Je vous dirai quand j'aurai vu. L’aide de Guillet y sera. Facilité de plus.
Le Roi fait venir du château d’Eu son portrait en pied par Winterhalter, et le donnera à Lord Cowley. A propos de portrait, il a fait faire, en porcelaine, à Sèvres, d’après Winterhalter, deux très beaux portraits de la Reine Victoria et du Prince Albert, pour Windsor. Mais à la dernière cuisson, une crevasse s’est déclarée dans celui du Prince Albert, ce qui sera difficile à réparer. Peut-être faudra-t-il recommencer ? En attendant. celui de la Reine est parti. On dit que c’est un chef d’œuvre.
Le Roi a été frappé de la dépêche de M. de Nesselrode sur les croix. Voici sa phrase : " Cela est gracieux. Il y a quelque progrès ; mais je doute fort que cela aille plus loin. " L’idée de l’initiative franche avec Londres pour l’un des fils de D. François de Paule est fort approuvée. Je vais la mettre à exécution, lundi probablement. J'en écrirai en même temps à Madrid et à Naples. La Reine Christine m’a mis bien à l'aise à Naples en faisant attaquer elle-même dans ses journaux, par son secrétaire Rubio, la candidature de son frère Trapani, et en en rejetant sur nous la responsabilité. C'est bien elle qui l'abandonne et la tue. Je réserverai pour cette combinaison-là, comme pour celle de Montemolin, les chances de retour, toujours possibles avec un tel monde. Je maintiendrai notre principe tous les descendants de Philippe V si seulement, nous nous portons selon les termes, vers celui qui peut réussir, favorable à celui-là sans en abandonner aucun. Rien encore de Londres qui indique avec un peu de précision ni sur cette question-là, ni sur aucune autre, le tour que va prendre Palmerston. La réserve des Whigs est extrême. En tout, la situation donnée, je ne trouve pas leur début malhabile. Ni de mauvais air. C’est assez tranquille, et sensé. Avez-vous remarqué ces jours-ci un article du Morning Chronicle qui n'aura pas fait plaisir à Thiers ? On lui donne poliment son congé, comme War-party. N’avez-vous rien reçu de Lady Palmerston ? Avez-vous écrit à Byng ? Mad. Danicau sait-elle vous lire le Galignani ? Le Prince de Joinville et sa flotte, et sa rencontre là, avec le Duc d’Aumale, ont fait grand effet à Tunis. Nos affaires sont bonnes à l'est et à l’ouest de l'Algérie. Après son apparition devant Tripoli, il (Joinville) ira à Malte, de là à Syracuse, de là une visite au Roi de Naples, puis une au grand Duc à Florence, puis une au Pape à Rome. Tout sauvages qu’ils sont, ces Princes là se montrent volontiers quand il y a quelque effet à faire. Ils se regardent bien comme les serviteurs du pays et obligés de soigner ses intérets et sa grandeur. Le comte de Syracuse passera, dit-il, l’hiver prochain à Paris. Il va parcourir la France, en attendant. Voilà mon sac vidé. Mon cœur reste plein. Loin de vous, il se remplit de plus en plus. Nous nous croyons bien nécessaires l’un à l'autre. Nous le sommes plus que nous ne croyons.
9 heures Je vais déjeuner et partir pour Trouville. Bon petit billet de St. Germain. Je suis content de vos yeux et de Mad. Danicau. Bonnes nouvelles de Londres même sur l’Espagne. Ce demain les détails. Je suis pressé. Soyez tranquille. Rien à craindre que la pluie. Adieu. Adieu. Adieu. G.
8. Val-Richer, Dimanche 19 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Temps affreux hier pour aller à Trouville. Grande pluie, grand vent. Pourtant quelques coups de soleil et un vif plaisir à revoir la mer. Vraiment cette plage est très jolie. Peu de baigneurs encore. Personne de votre connaissance. C’est au mois d'août que doivent venir Mad. de Boigne, Mad. d’Haussonville, Mad. de Ségue & M. Molé et Mad. de Castellane devaient venir ces jours-ci. Ils avaient loué la moitié de la maison du Dr. Olliffe qui a là une assez bonne maison, confortable. Ils lui ont écrit qu'ils ne viendraient pas. Le bruit de Trouville était qu’ils ne venaient pas à cause de moi, parce qu'on leur avait écrit que je venais à Trouville, que j’y étais très populaire, qu’on devait m'y faire des fêtes &. Il est sûr que je suis là très populaire, et que j’y ai été reçu avec tous les témoignages possibles de toute la population, tous les bateaux du port pavoisés, tous les notables du bourg réunis dans ma maison. Bonne maison, la meilleure de Trouville ; très simple et très propre assez bien pourvue de meubles, linge & sur la plage, n'ayant que la mer sous vos fenêtres ; si bien qu’hier, de la salle à manger, au rez-de chaussée, pendant le dîner, à la marée haute, on ne voyait absolument que la mer sans rivages, pas plus le rivage près que le rivage loin. Vous y seriez très passablement, au 1er étage, trois chambres, avec cabinets de toilette et des chambres de domestique en haut. Pauline et Mlle Wislez seraient au second. L’aide de Guillet est là, suffisant. La maison appartient à l’un de mes amis de Lisieux qui me la prête tout entière, tant que je voudrai. Si vous en aimiez mieux une autre, il y a celle d’Olliffe, tout ou partie de ce qu’avait loué M. Molé et qui est encore vacant. Vous voyez qu’en tous cas, vous ne manqueriez pas de ressources. Pour de la société jusqu'à présent, je ne vous en vois guère là. J’irai vous y voir et vous y chercher pour vous amener au Val Richer où vous pouvez, soit coucher, soit ne passer que la journée, comme vous voudrez. On y vient de Trouville par une très jolie route en poste en moins de trois heures. Quel plaisir de vous avoir ici, malgré mes commentaires par avance ! Avec quel plaisir, nous nous y promènerions comme vous voudriez, ni plus, ni moins ! Voyez. Dites-moi. Mes descriptions sont exactes, sans omission, ni exagération. J’étais parti de Val-Richer à onze heures. J'y suis rentré à neuf heures et demie. La route est partout une allée de jardin.
Jarnac a eu une longue conversation avec Palmerston sur les affaires d’Espagne. Pure conversation, sans proposition, ni conclusion de part ni d’autre mais bonne. Notre principe des descendants de Philippe V bien maintenu. Ni admis, ni contesté comme principe ; mais approbation très explicite des fils de D. François de Paule, avec pente indiquée vers D. Enrique. Le Coburg tout-à-fait écarté avec quelque surprise que la France n'en veuille pas, car il est plus français qu'anglais. Pas un mot, sur l'Infante déclaration très expresse que les deux seuls alliés de l’Espagne doivent être là d'accord et agir de concert. Disposition annoncée, à me communiquer ses instructions à Bulwer et à continuer l’entente intime, comme Aberdeen. Tout cela assez superficiel et réservé, mais dans la bonne voie. Je vais écrire aujourd’hui à Jarnac avec détails. Lord John très bien avec Peel me dit Jarnac. Il a rencontré chez ce dernier, le Duc de Bedford, en intimité marquée. Tout le monde se concerte pour surveiller Palmerston. Pourvu qu'il n'en prenne pas de l'humeur, et ne s'amuse pas à attraper ses duègnes. J’ai peur qu’il n’y ait jamais entre lui et nous, qu'un mariage de raison. Croyez-vous que cela suffise jamais ? Deux idées, je crois à bien inculquer à W. Hervey. L’une, qu’il faut se hâter de saisir le moment où nous sommes bien disposés pour les Infants D. François de Paule, le mariage, après tout, qui convient le mieux à l'Angleterre puisque c’est un mariage purement Espagnol. L'autre, qu’il faut bien se garder de recommencer en Espagne, l’antagonisme des deux patronages, Français et Anglais, au profit des deux partis, modérés et progressistes. Ce serait la ruine du mariage François de Paule de l’ordre naissant en Espagne et de la bonne intelligence entre nous. S’il parle de l'Infante dites que le Duc de Montpensier, s'il l’épouse, est bien décidé à l'emmener en France et à vivre en France avec elle à en faire une Princesse française. Il a grand dégout et grande méfiance des Cours du midi de leurs mœurs de leurs Camarillas &. C'est le sentiment de toute la famille royale. En voilà bien long pour vos yeux, quoique bien peu pour mon plaisir. Ah, l’absence, l'absence. J’y fais tous les jours des découvertes.
9 heures Voilà le N°8. Il n’y aura de bon numéro que le dernier. Je me porte bien. Les élections aussi, comme on se poste bien au milieu d’une bataille. La lutte est très vive. Il y aura bien des morts de part et d’autre. Mais tout continue, à présager que le champ de bataille nous restera. Adieu. Adieu. Je suis accablé ce matin de signatures à donner et de lettres à écrire. Et c’est dimanche, jour de visites. Adieu. Adieu. Charmante parole dans le N°8. Vous viendrez au Val Richer. Adieu donc.
4. Val-Richer, Mardi 15 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures du matin
Quel ennui d’être loin ! J’aurais mille choses à vous dire, votre avis à prendre, car j'ai besoin de votre avis. Il n'y a pas moyen d’écrire tout cela. J’ai une première réponse de Londres, une première conversation de Chabot avec Aberdeen, des hésitations, des embarras, des pusillanimités, des susceptibilités, des prévoyances, des méfiances à l'infini, et à travers tout cela, un désir sincère de s’entendre avec nous, un fort instinct que cela se peut, qu’il n’y a que cela de sensé que c'est pour eux, le seul moyen de sortir d'une mauvaise situation. Et c'est de si loin que j’ai à traiter avec toutes ces impressions, toutes ces nuances de dispositions qui seraient déjà bien assez difficiles à manier de près !
L’estafette m'a réveillé à 2 heures et demie J’écris depuis ce temps-là au Roi, à Chabot, à Génie. Je viens de renvoyer l’estafette et je vous écris à vous, pour me rafraîchir. J'étais venu ici pour me promener, et ne rien faire. Ce n’est pas le tour que je prends. Je me suis beaucoup promené hier. J’ai arrosé mes fleurs. J'en ai beaucoup et de charmantes, des raretés. Vous les aimeriez. Ce matin, il y a un brouillard immense. Il enveloppe tout. Il fera très beau à
Midi. Vous n’avez nulle raison d'être inquiète ; mais vous avez grande raison de m’aimer plus que jamais et de me le dire. Mon plaisir à l’entendre mérite tout ce que vous voudrez. Je crois aussi que Salvandy acceptera Turin. Pourtant il n’y a jamais à compter sur les esprits mal faits, et mal faits surtout par la vanité. Ils déjouent toute prévoyance. Je vais faire ma toilette en attendant la poste. Puis j’essaierai de dormir un peu. Je m'étais couché hier avant 10 heures. Mais de 10 heures à 2 heures et demi, c’est trop peu de sommeil.
10 heures et demie. C’est charmant deux lettres. Oui, il y a, en ce moment, un inconvénient réel à être loin et très probablement je n'attendrai pas, le 26. N'en dites rien à personne. Je suis frappé d'Espartero faisant un manifeste donc n'abandonnant pas tout-à-fait la partie. On fera de lui, si on veut, un instrument d'intrigues en Espagne, et on le voudra, si nous ne nous accordons pas. Tout cela a besoin d'être conduit avec une grande précision et heure par heure. Je suis bien aise que vous ayez reçu une lettre de votre frère. Il paraît certain que l'Empereur ira à Berlin. On l’y attend. Bresson me mande que M. de Bülow est revenu en très bon état. Je vous quitte pour Génie à qui j’ai plusieurs choses à dire. Adieu. Adieu. Soyez charmante tous les jours, Adieu. G.
311. Val-Richer, Jeudi 7 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
On emballe autour de moi. Il part après demain, par le roulage des caisses de livres, d'effets, de fruits. C’est un vrai déménagement tous les ans. Mais celui-ci me plait.
Le Journal des Débats et le Moniteur sont en effet assez amusants. Et comme il arrive, ils ont tous deux raison. Ce qui me frappe aussi, c’est le Constitutionnel d'avant-hier mardi. Il est bien à la gauche. Depuis quelque temps Thiers avait paru chercher à se rapprocher du centre. Le voilà qui s'en éloigne fort. Je m’y attendais. Nous causerons de tout cela. J’ai perdu l’habitude de causer. Mais je la reprendrai avidement. Viendra-t-il beaucoup de vos Anglais, cet hiver à Paris ? Il me semble que non puisqu'ils partent pour l'Italie. A présent que vous voilà fixée à Paris, vous deviendrez une étape pour tout ce qui ira d’Angleterre sur le continent. Personne ne passera sans vous voir.
J’en suis fâché pour Bulwer. C'est peu aimable de la part de Lady Granville. Est-ce qu’ils ne l’ont pas vu, avec plaisir succéder à Aston ? Le leur a-t-on donné sans leur demander, si le choix leur convenait ?
Je comprends qu'on ait de l'humeur contre le Roi Guillaume. Mais en conscience, il ne doit rien aux trois Puissances. Elles lui ont donné de belles paroles et l’ont complètement abandonné en toute occasion. Politique à part, et ne fût-ce que par malice, il a bien fait. Il a bien fait aussi au fond. Il est rentré dans sa position naturelle. Il appartient, par toutes sortes de raisons à la politique occidentale. L'affaire de la Belgique, l’en avait seule éloigné. Et puis c’est la condition d’un peuple de négociants de rester étrangers aux querelles des trônes et des races, et de faire partout ses affaires. Du reste soyez sûre qu'avant de reconnaître il a consulté le Johannisberg.
10 heures
Mes lettres ont tort de vous arriver tard. Je ferai mieux moi-même. En attendant, je vous quitte pour donner les livres que je veux remporter. Vous avez bien raison de ne trouver aucun salon bon, ni personne aimable. Ne soyez bien que chez vous et avec moi. Adieu. Adieu dearest. G.
Evreux, Samedi 12 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'arrive. J’ai été très vite car je ne suis parti d’Auteuil qu'à 12 heures moins un quart. Vous aurez vu Génie qui vous aura dit ma visite. Rien de nouveau mais un assez vif désir de prendre les rênes de l’affaire, au nom de la légitimité qui abdiquera, et assez d'humeur contre l'Aquilo. Très bien du reste pour nous, et une nuance de raillerie sur les Anglais. Mes lettres à moi, venues par courrier français redisent exactement les mêmes choses. Flahault est un bon truchement. Voutchicth et Pit s'en vont, quand le sénat leur aura dit de s'en aller. Mais c’est une pure forme. J’aimerais bien mieux vous dire tout cela. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Je voudrais régler et remplir de loin vos journées. On ne peut rien de loin. J’ai tort. Je voudrais que vous vissiez tout ce qu’il y a en moi de loin comme de près, Vous ne diriez pas que ce n’est rien. Adieu Adieu.
On m’appelle pour dîner. Nous repartons demain à 9 heures. Il a fait bien beau malgré des nuées de poussière. J’ai trouvé ici, dans l’auberge. M. de Salvandy qui vient se faire élire membre, du Conseil général. Très amical. Il me cède son appartement, qui est le meilleur de la maison. Adieu. Adieu. J’espère que j'aurai demain, en arrivant au Val-Richer, quelques lignes de vous. Me trompé-je ? Adieu
252. Val -Richer, Jeudi 22 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame de Boigne est venue passer hier la matinée au Val-Richer. Elle va pour trois semaines chez Madame de Chastenay, près de Caen. Mad. de Chastenay m’a écrit avant-hier pour m’engager à y aller passer quelques jours avec elle. Mais je reste chez moi. Je suis las de courses et de conversations qui ne me plaisent pas beaucoup. Je n’aime ni le mouvement, ni le monde pour lui-même. Ce sont des cadres où je veux choisir et placer moi-même les figures. D'ailleurs, j’attends quelques personnes chez moi. Imaginez que Madame de Boigne est venue à pied de la grande route ici, une demi-lieue. Elle a peur des mauvais chemins en voiture, et mon chemin neuf ne sera ouvert que le 1er octobre. Elle était rendue en arrivant, sa voiture suivait fort tranquillement. Il n’y a pas l'ombre de danger dans cette traverse, quoique fort mauvaise. On va presque à travers champs. Je l’ai ramenée à la grande route, en causant. Elle ne sait rien & croit comme moi, qu’il n’y aura rien d'ici à la session.
Le Maréchal est fort content de l’Europe, le Roi est fort content du Maréchal. Desages est content aussi. Tout le monde dit que ça n’ira pas, & ça va, et ça ira jusqu'à ce qu’il faille sérieusement deux choses qui n’y sont pas de l'action et de la parole. Il n’y a plus personne à Paris Les derniers sont partis pour les Conseils-généraux.
Le Chancelier reste à soigner Mad. Pasquier qui s'est cassé l’os du fémur, et n'en guérira pas. Elle a 80 ans. Au fait, c’est de cela que Mad.de Boigne, est le plus occupée.
Quand je vous ai dit que nous n'interviendrions pas entre Musulmans, je voulais dire que nous ne ferions jamais la guerre pour les prétentions de l’un, contre celles de l'autre. Nous interviendrons pour la paix et par les négociations, tant qu’on voudra, seuls s’il le faut et bien mieux encore tout le monde, ensemble. Le Sultan et le Pacha pourraient bien rester comme la Reine Christine et Don Carlos face à face, toujours en guerre et sans rien finir. L'Orient serait mis à la fois en question et en suspens comme l'Occident. Voilà le Général Baudrand qui va féliciter Abdul-Medgid. J’en suis bien aise, pour nos affaires et pour lui. Il ne donnera là, et ici à son retour, que de bons conseils. Il allait partir pour l'Afrique avec M. le duc d'Orléans, et y faire Dieu sait quoi. Métier très fatigant pour un homme qui n’est plus jeune et qui vient d'être malade. Il se reposera à Constantinople. La Porte remettant ses affaires avec Méhémet entre les mains des cinq Puissances, c’est la conférence moins la réunion à Vienne, que nous sommes tous habiles à déguiser nos faiblesses ! Pourquoi ne pas dire tout simplement et tout haut que pas plus les uns que les autres, on ne veut se faire la guerre ? Je crois qu’on a raison, et il y aurait de la grandeur à agir ouvertement et tous ensemble en ce sens en disant pourquoi. Mais on veut garder encore quelques airs d’ambitieux, de guerrier ; on veut faire semblant de s'effrayer les uns, les autres sans se battre et on aime mieux s'abaisser en jouant une pauvre comédie que grande en disant vrai. On sera bien confus et embarrassé le jour où le bon Dieu viendra et lèvera lui-même la toile en appelant chaque acteur à jouer enfin son rôle, et à faire marcher le drame.
9 heures
Je vais causer avec ma mère de ce que vous cherchez. Je compte plus sur Melle Chabaud que sur toute autre pour le trouver. Elle a de l’esprit et connait souvent de ces personnes-là. Adieu. Adieu. Je trouve votre 246 un peu moins mal. adieu. Je vous en voudrai toujours de changer. Mais Adieu quand même. G.
211. Paris, Lundi 8 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai pu lire ceci sans sourire. Je ne savais pas que vous attendiez mes lettres comme moi j’attends les vôtres. Si j’allais vous ennuyer : " Vous êtes, dirai-je incorrigible, ou incurable ? Ce n'est pas parce que vos lettres m'amusent que je les attends impatiemment ; quand elles m’attristent, je les attends plus impatiemment encore. Je vous aime. Voilà ma raison, qui dispense de toutes les autres. Il y a dans l’évangile une admirable parole : " Cherchez premièrement la sagesse ; tout le reste vous sera donné par dessous. " La tendresse a le même privilège que la sagesse ; là où elle est tout le reste vient par dessus.
Vous avez bien fait de mettre le comte Frédéric Pahlen et Matonchewitz un peu en garde. Je ne doute guère des retards factices, par humeur et vengeance. Mais puisqu'il se sent obligé à la réserve, cela ne peut aller très loin, pourvu que, de leur côté, vos fondés de pouvoir pressent au lieu de tolérer la langueur. C’est donc sur eux qu’il faut agir. M. Sampayo, qui arrive de Lisbonne dit sur l’Espagne des choses curieuses. L’anarchie y est plus grande, et le gouvernement plus impuissant que jamais. Mais à travers l’anarchie, l'activité est grande aussi dans le pays et la prospérité croissante. Il y a beaucoup plus de terres cultivées, de maisons neuves. Le commerce se répand ; des établissements de tout genre se forment ; le luxe augmente. Bref, c’est un pays qui se développe du lieu de se détruire. Et l’idée que Don Carlos ne peut rien, que le gouvernement de la Reine, bon ou mauvais, est, après tout, celui qui subsistera, cette idée devient générale. M. Sampayo ajoute que les partisans de la non-intervention ont eu raison, qu'évidemment on aurait eu tort d'intervenir, et que l’Espagne s'en tirera dans cela. Voilà qui fera bien plaisir à Zéa. M. Sampayo n’est pas content de sa campagne contre le duc de Palmella. Il s’en venge en retenant, je ne sais sous quel prétexte légal, la plus grande partie de la fortune jusqu’à ce que la marquise de Fayal ait 24 ans. Pure vengeance, car il n'en joint point ; tout s'accumule et il faudra tout rendre. Mais enfin plaisir de vengeance.
Il n'y a personne de votre connaissance à Dieppe. Vous serez partout plus seule qu’à Baden, excepté en Angleterre. Est-ce que ce sommeil que vous avez un peu retrouvé ne vous repose pas ? Comment va l'appétit ? Je fais des questions et je sais les réponses. Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir vous envoyer autre chose que des paroles. Je me suis heurté plus d’une fois en ma vie contre les limites de notre puissance, quel que soit le désir. C’est un sentiment très amer. Adieu Adieu G.
213. Paris, Mardi 9 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens de la Chambre. On a saisi cette nuit la presse clandestine du Moniteur républican, et l’un des principaux auteurs, meneurs. La police est fort active depuis quelque temps, et M. Delessert n’a pas manqué de bonheur. Il a un coup de collier à donner. L’arrêt sera rendu demain. Le parti de loin comme de près. Je remue beaucoup pour sauver Barbès M. Laffitte avait déposé ce matin une proposition contre la peine de mort. On l’a décidé à la retirer, M. Garnier-Pages a fait demander aux archives de la Chambre copie des pétitions présentées en 1830 par les blessés de Juillet pour l'abolition de la peine de mort en matière politique, dans tout cela, rien que du mouvement mais du mouvement. La session va finir. On commence demain la discussion du budget. Elle ne durera pas plus de dix ou douze jours.
Le débat sur l'Orient n'a été bon dans le Cabinet, qu'à M. Villemain. Il disait à un homme de ma connaissance « J’ai sauvé le Ministère. - Sauve qui peut." lui a-t-on répondu. Du reste le Roi est fort tranquille, sur l'Orient. Il est parfaitement d'accord avec Vienne, et d'accord avec Londres. A propos de Vienne, j'ai vu ce matin quelqu'un qui en arrive et qui dit que M. de Metternich est bien fatigué, bien cassé, que sa mémoire faiblit beaucoup sur les choses récentes, qu’il devient dévôt & &. Il est venu de lui, naguères, sur l'Orient une grande dépêche très pompeuse, très métaphysique, parfaitement doctrinaire, mais fort semblable à beaucoup d’autres que j’ai vues autrefois ; ni moins bonne au fond, ni meilleure dans la forme.
Madame de Boigne, vient demain passer la soirée à Paris, et j’irai samedi dîner à Châtenay. Voilà mes nouvelles de ce matin. Si vous en voulez de hors Paris, je vous dirai que le Val-Richer a été grêlé et que mon fermier prétend que sa récolte de blé est perdue. Mercredi, Midi. Je ne sais pourquoi le courrier est arrivé plus tard ce matin. Et comme la séance commence plutôt, je suis pressé. On veut mettre les morceaux en quatre. Notre Chambre finira avec la semaine prochaine.
J’ai dîné hier chez le Garde des sceaux avec tout ce qu’il y a ici d’ambassadeurs, c’est-à-dire tous, sauf le vôtre. Même le Turc, qui a assisté, avec toute son Ambassade, à notre débat sur l'Orient. De choquante pour nous, comme nos paroles l’étaient pour lui. Nous avions l’air de faire une autopsie devant la famille. Un de ses secrétaires n'a pu y tenir et a quitté un jour la séance, très ému et irrité. Lord Granville ne quittera pas Paris, quoique son médécin l’engage à changer d’air, s’il veut n'avoir pas de goutte l’hiver prochain. Le Duc de Devonshire vient d’arriver.
Je ne vous parle que de choses insignifiantes. Il faut que je sorte. Je garde vos affaires, votre santé et nous pour ce soir. J’ai tant à vous dire ! Et je vous dirais si peu ! Adieu. Adieu G.
215. Paris, Vendredi 12 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Se peut-il que ce N° 211 me soit un soulagement ? Pour Dieu, faites partir vos lettres tous les jours, longues ou courtes gaies au tristes. Il me faut une lettre ; il me faut quelques lignes ; il me faut vous, vous ! Vous ne savez pas avec qu’elle horrible rapidité l'inquiétude m’envahit, me poursuit. C’est la chemise de Nessus. Je vous en conjure ; ne soyez pas malade et dites-le moi. J'ai grande pitié de vous. Ayez aussi pitié de moi. J’ai beaucoup souffert, en ma vie ; beaucoup plus que je ne l'ai laissé voir à personne. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Est-ce pour dégoût ? Ou bien ce que vous mangez vous pèse-t-il sur l'estomac ? Digérez-vous mal ? Si ce n’est que dégoût, surmontez-le un peu ! Pour moi, pour moi. Que je voudrais être là pour veiller à tout, pour tous savoir au moins. Et votre sommeil vous ne m'en parlez pas. Parlez-moi de tout, fût-ce toujours la même chose. Il n’y a en moi, toujours, qu’une même pensée. Je voudrais vous envoyer l'image complète de mes journées de ce qui les remplit en dedans. Vous verriez. Je devrais peut-être ne pas vous dire tout cela, ne pas ajouter mon inquiétude à votre fatigue. Si vous étiez près de moi, je me tairais mieux. Ne renoncez pas à marcher cela vous est bon. J'ai vu par vos lettres que vous dormiez quelquefois dans le jour. Ne vous en défendez pas.
Je veux parler d'autre chose. Nous sommes assez préoccupés ; agités dirait trop. La Cour rendra son arrêt aujourd’hui. Si Barbès est condamné à mort, le parti fera quelque démonstration, sans espoir, sans dessein sérieux même, par honneur, pour ne pas paraître frappé et mort du même coup. Peut-être quelque tentative sur la prison ; peut-être quelque coup de pistolet sur quelque voiture de Pair.
Paris est fort tranquille. Vous y seriez fort tranquille Je regarde votre lettre. Une chose m’en plait. Votre écriture est bonne et ferme.
J'ai vu Pozzo. Affreusement maigri, rétréci rapetissé, les yeux enfoncés dans un cercle de charbon, la parole chancelante, les épaules voûtées, les jambes ployées, les habits trop larges, l’esprit aussi chancelant que la parole. Nous causions seuls dans le premier petit salon de Mad. de Boigne, Edouard de Lagrange est entré. Il l’a pris pour le Marquis de Dalmatie, lui a parlé du Maréchal ; puis M. de Lagrange passé, il m'a dit tout bas : " C’est bien le marquis de Dalmatie, n’est-ce pas ? " en homme qui doute de lui-même. Pourtant, il m’a parlé longtemps de ses dernières affaires à Londres de ses conversations avec Lord Melbourne et Lord Palmerston de tout ce qu'il leur avait dit sur la nécessité de maintenir la paix sur leurs intérêts et les vôtres dans la paix ; tout cela très nettement, très spirituellement, comme par le passé avec verve dans l'imagination, en même temps qu'avec faiblesse et trouble dans le langage. Puis en finissant : " C'est ma campagne de vétéran. Un autre hiver à Londres me tuerait." Il ne s’est pas pris de goût pour l'Angleterre, en y vivant, Madame de Boigne va mieux, beaucoup mieux. Elle est retournée hier à Châtenay. J’irai y dîner demain.
Connaissez-vous un M. de Lücksbourg, bavarois, qui remplacera probablement ici M. de Jennisson ? Il est venu me voir avant hier. Je l’ai trouvé bien. Si M. de Jennisson s'en va, peut-être son appartement se trouvera-t-il vacant. C’est un peu cher, mais bien gai. A présent tout à côté de la maison est arrangé. Vous n'auriez pas de bruit. Adieu. Je vais à la Chambre. On commence de bonne heure. Pourquoi n’êtes-vous pas à la Terrasse ? Adieu. Adieu. J’aurai de vos nouvelles demain n’est-ce pas ? Ah que la vie est mal arrangée ! Adieu. G.
216. Paris, Samedi 13 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'attends. Je devrais ne rien dire de plus, car d’ici à 10 heures je suis tout là. La Cour des Pairs a rendu hier au soir son arrêt, au milieu d’un calme profond. La délibération intérieure a été solennelle. Les plus difficiles sont contents de sa gravité, de sa liberté, de sa probité. La majorité sur le point capital, Barbès a été grande 133 contre 22. Le parti de l'indulgence a été soutenu par des hommes de tous les partis et surtout par ce motif qu’il fallait craindre d'exciter le fanatisme jusqu'à la rage, et de concentrer cette rage sur une seule tête. M. Cousin a soutenu cela avec beaucoup de talent. M. Molé a bien parlé, brièvement, mais nettement, pour la condamnation à mort. Je n’ai encore vu personne ce matin ; mais rien ne m'indique qu’il y ait eu le moindre bruit cette nuit. On en attendait un peu autour de la prison. En fait de forces et de précautions, il y a du luxe. On a raison. Le Duc de Broglie repart ce matin pour la Suisse. Nous nous sommes dit adieu hier au soir. Pendant son séjour, quelques uns des ministres l’ont pressé d'entrer avec eux aux Affaires étrangères. Je l’en ai pressé moi-même, me mettant, s’il entrait, à sa disposition pour le dehors. Il a positivement refusé.
10 heures
J'attends encore. Montrond sort de chez moi, guéri de son érésipèle. Il part dans deux jours pour Bourhame. Delà à Bade. Je regrette bien qu’il m’y soit pas allé plustôt. Quoique vous l'eussiez probable. ment bientôt aisé. Il est bon à retrouver souvent, mais non pas à garder longtemps. Le Maréchal se trouve fort bien aux Affaires Etrangères, et n'a aucun dessein de les céder à personne. L'Orient va très bien, grâce à lui. Tout s’y arrange, et s’y arrangera encore mieux si le Sultan meurt. Un jeune Prince, un Divan nouveau se hâteront de faire la paix avec le Pacha. La paix donc, le Sultan vivant. Encore plus la paix, le Sultan mort. D'ailleurs, il y aura une conférence, à Vienne, et vous y viendrez. M. de Metternich vous promet. ainsi sera réglée la plus grosse affaire de l’Europe. Rien n’est tel que les petits Ministères pour les grosses affaires.
Voilà le N°212. Les dernières lignes valent Je vois que le bruit d’une conférence à Vienne est Baden, comme à Paris. M. Villemain a défendu hier son budget spirituellement mais trop plaisamment. Notre Chambre n’aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments et M. Villemain en est prodigue. C'est l’usage à l'académie. Entre gens d’esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l’esprit, les uns des autres comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut, devant l'autel. Notre Chambre ne se pique pas d’esprit, et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Adieu. J’y vais à cette Chambre qui ne se pique pas d’esprit. Je verrai aujourd'hui quand nous finirons. Adieu Adieu. Encore une fois des détails.
G.
J’irai voir Pozzo aujourd'hui ou demain à votre intention.
219. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
220. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne trouve sous ma main ce soir que ce ridicule petit papier. Il me plait pourtant. C'est comme si je vous écrivais à la Terrasse. Je viens de dîner à côté d’elle (la Terrasse) chez le Ministre des finances, avec la Sardaigne, la Prusse et la Belgique qui sont maintenant fort bien ensemble. On dit que sur la frontière, les commissaires belges et hollandais s'accablent de politesses. Le Roi Léopold (vous dites comme moi à présent) j’arrive ici vendredi. Le Duc d'Orléans part le 5 août avec sa femme pour Bordeaux, Bayonne et les Pyrénées. Elle l'accompagnera jusqu'à Port-Vendres, en il s'embarquera pour Alger, de là à Constantine et partout où nous sommes en Afrique.
Madame la Duchesse d'Orléans reviendra à Paris avec Monsieur le duc de Nemours. La cour va ces jours-ci s’établir à St Cloud. Nous sommes assez fiers de notre empire en Orient. Les deux aides de camp du Maréchal ont emporté l’un d'Alexandrie, l’autre de Constantinople, des ordres, l'un pour Ibrahimn, l'autre pour Hafiz Pacha, leur enjoignant de s'arrêter partout où ils seraient, selon le vœu de l’Europe exprimé par la France. Nos deux messagers se seront rejoints la Syrie. M. le Ministre de la guerre m'a développé cela à table en prêtant son accent Allemand à notre vanité Gasconne. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Adieu. A demain.
Mercredi, midi
Je regrette bien qu’écrire vous fatigue. Ecrire, c’est tout ce qui nous reste pour cet été. Ne voyez là que ce que j'y mets, un regret, pas du tout un reproche. Je ne crois pas bientôt, aux arrangements dont M. de la Redorte vous a parlé. Le Roi ne songe point à remanier son Cabinet. Personne ni, probablement rien ne l'y obligera d’ici à la session. Donc tout restera. Mais le décri est grand. Lady Sandwich que la Reine vient de prendre pour dame d’honneur, est-ce la nôtre ? Pozzo parle mal de Lady Normanby et d’une ou deux autres des Dames, qui entourent la Reine. Elles lui font, et lui feront, dit-il beaucoup de tort.
J’ai vu Zéa ce matin et son frère Colombie. Il passe encore quelques jours à Paris. Il est assez content de ses nouvelles d’Espagne. Pour lui personnellement, elles sont meilleures qu’avant son voyage en Angleterre. Rumigny lui convient fort. Ils ont passé quatre ans ensemble à Dresde. Je ne m'étonne pas de l’insignifiance des lettres qui vous viennent de Pétersbourg. Je ne m'en étonne pas, le genre admis ; car en soi, tout cela est plus qu'étonnant. A l’ouvrage de l'abbé de La Mennais, j'en ajouterais volontiers un autre : de l'indifférence en matière d'affection. Que j’y dirais de choses. Je mourrai gros de vérités qui seront enfouies avec moi.
Vous savez surement que M. de Castillon est à Pétersbourg à l'heure qu’il est, & probablement sur le point d'en repartir pour Paris. Notre correspondance est très active, et vous paraissez très modérés, très conciliants. On croit en général que la mort du Sultan rendra une conférence Européenne moins urgente, et plus inévitable. La paix faite avec Méhémet Ali, tous les Pachas vont en vouloir autant. Avant un an, l'Empire Ottoman sera sans dessus dessous et il faudra bien y pourvoir. Réchid-Pacha repartira probablement pour Constantinople. On dit que c'est l'homme capable. Je l’ai trouvé homme d’esprit mais d’apparence bien chétive et timide. Je vous dis là bien des pauvretés. Je vous envoie le monde comme il est. J’en aimerais mieux un autre. Il est difficile à faire. Si vous étiez là, j'oublierais celui-ci. Adieu. Je vous écrirai encore demain de Paris et samedi du Val-Richer. Adieu. Adieu. G.
221. Paris, Mercredi 17 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
229. Val-Richer, Lundi 29 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rattraperai aisément la mesure, car l’air me plaît. Je voulais ménager votre force et vos yeux. Donnez m'en tout ce que vous voudrez. J’ai de quoi vous rendre. C'est, je crois le défenseur de l’archevêque Land qui a dit le premier qu'avec cent lapins blancs ou ne fait pas un cheval blanc. Avec cent lettres de Baden et du Val-Richer, on ne fait pas une conversation de la Terrasse. Mais j’aime mieux cent lettres que cinquante. Pourtant je ne redeviendrai quotidien qu’à partir de Jeudi 1er août.
Je mène demain mes deux filles à Caen, chez leur dentiste de province. Il faut leur ôter deux dents de lait que Brewster a voulu ajourner quand elles ont quitté Paris. Il y a un bon dentiste à Caen. J'en reviendrai après demain soir. Cette course me dérange ; mais je suis mère.
J’attends avec grande curiosité la confirmation des nouvelles d'Orient. On dit que le capitan Pacha est un homme à vous, qui avait beaucoup contribué au traité d'Unkiar-Skelessi et vous fut, aussitôt après, envoyé comme Ambassadeur. Les habiles soutiennent que tout cela n’est pas clair. Pour moi, je me suis décidément retranché les prophéties. Je veux voir.
Avez-vous entendu dire que le comte de Pahlen remplacerait Pozzo à Londres ? J’en serais fâché et pour vous et pour nous. A moins qu'on ne nous redonnât Pozzo mourant. Mais cela ne se peut guère. Votre pauvre ami de Hanovre commence à prendre peur. Il s’est chargé de plus qu’il ne peut porter. Ç'a toujours été un grand métier que celui de despote. De nos jours, il y faut Napoléon. Encore s’y est-il cassé le nez. Est-ce qu’il ne vous vient plus de lettres de là ? Du reste, il me semble qu’il vous parle toujours plus des Affaires d’autrui que des siennes. Il me semble que j'ai vu autrefois. M. de Malzahn à Paris, en 1820 et 1821. N’a-t-il pas été Ministre de Prusse à Munich, ou à Stuttgart ? Je le confonds peut-être avec un M. de Maltzen qui était aussi dans la diplomatie Prussienne ; homme d’esprit, un peu solennel.
L'humeur de la Chambre des Pairs porte ses petits fruits. On aurait voulu qu’elle fit sur le champ un second procès, pour en finir de ces gens du 12 mai, comme on en finit. Il n'y a pas du moyen. Les Pairs n’ont pas voulu en entendre parler. Leur commission d’instruction va en mettre en liberté tant qu’elle pourra, et ceux qui resteront attendront en prison que la Chambre ait un peu repris cœur aux procès. C'est encore un excellent instrument de gouvernement qu’on a bien vite usé. Les fêtes ont été on ne peut plus paisibles. Fort tièdes. Les hommes ne se réjouissent pas par commémoration. Il n'y a de solennité durable, en l’honneur d’un grand événement, que celles qui portent un caractère religieux. On ne puise un peu de durée que dans l'éternité. Notre temps a étrangement perdu l’intelligence de la durée et de ses conditions. Jamais les hommes n’ont vécu concentrés à ce point dans le présent. Petite vie, et qui fait toutes choses, à sa mesure. Et pourtant, il y a dans les idées, dans les sentiments, dans les institutions de notre temps, le germe de grandes choses très grandes. Mais pour que les grandes, choses viennent, il faut extirper les petites. On ne peut pas avoir de taillis sous les hautes futaies. Et de notre temps, les petites choses sont innombrables, petits intérêts, petits conforts, petits désirs, petit plaisirs. Il y a des facilités infinies pour dépenser sa vie et son âme en monnaie. C'est mon désespoir de voir de quoi on se contente aujourd'hui. Parmi vos raisons de me plaire, celle-ci m’a beaucoup touché, vous avez l’esprit et le cœur superbe. Cela coûte cher ; mais n’y ayez pas regret. Cela vaut encore davantage, n’est-ce pas ? Adieu pour aujourd’hui. Je vous dirai encore adieu demain avant de partir. J’oubliais de vous dire que Madane d'Haussonville est fort heureusement accouchée d’une fille. C'est ce qu'elle désirait. J’en suis charmé pour son père. Sa première couche avait été fort pénible et le tourmentait.
Mardi 9 heures 1/2
Bonjour et adieu. C'est la même chose, toujours la même et et toujours charmante. Je vous écrirai demain. Je ne vais à Caen que samedi. Encore adieu. G.
244. Val-Richer, Mercredi 14 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je relis votre paragraphe à Benkhausen. Je suis bien aise que vous soyez restée avec lui dans ces termes là. Ils sont très convenables si j’ai raison, et bien plus si c’est vous. Dans le premier cas, vous vous serez trompée à Pétersbourg, mais non à Londres ce qui eût pu amener quelque complication désagréable. A mon tour, je vous tiens au courant de mes affaires, si on peut appeler cela des affaires. Après avoir beaucoup parlé et remué à Paris, Thiers est parti pour Lille. Avant de partir, il a manifesté le regret de n'avoir pas vu un de mes amis qui est aussi fort lié avec M. Duchâtel. Celui-ci est allé le voir. Thiers lui a parlé de moi dans les termes les plus magnifiques, puis a développé, comme vous savez qu’il développe avec une intarissable abondance, cette idée que deux hommes prépondérants ne pouvaient être simultanément dans un cabinet, que leur présence y romprait l’unité, qu’il fallait à un Cabinet, un chef, un seul chef, maître des autres ministres, que là surtout avait résidé la force de M. Molé. Quand je n’aurais point d'autre motif, celui-là me suffirait pour ne jamais me rapprocher de M. Molé. D'ailleurs, c’est bien impossible ; nous entendons l'un et l'autre avoir les Affaires étrangères. Puis, il s'est répandu en compliments sur Duchâtel vantant beaucoup son aptitude au gouvernement de l’Intérieur. Paroles assez explicites pour autoriser son interlocuteur à lui répondre, très explicitement aussi, qu’il se trompait sur Duchâtel ; que Duchâtel n’agirait jamais envers moi comme Passy et Dufaure avaient agi envers lui-même ; que le jour où lui Thiers serait Ministre, sans moi, Duchâtel se retirerait à l'instant, et qu’il ne devait compter sur l'accession ou l'appui d'aucun de mes amis, qu'autant que je serais dans le cabinet, à la place qu’il me conviendrait d'occuper ; que c'était l'avis et le parti pris des plus grands comme des plus petits ; qu’il fallait en prendre lui-même son parti ; que s'il lui convenait de s'en rapprocher de moi, de s’en rapprocher sérieusement, la session ne s’ouvrirait qu'avec nous deux ; sinon son entrée était impossible, car il déplaisait à une grande partie de la chambre, comme au Roi. Sur ce Thiers a coupé court, se rejetant dans les ténèbres de l'avenir et racontant sa conversation avec le Roi sur les affaires d'Orient ; conversation où il a étalé les opinions, les plus pacifiques, & s'en est allé comme il était venu ; le Roi, et lui n'ont pas fait un pas l'un vers l'autre. Vous voyez que tous les rapports s'accordent. et que personne ne change. Le Roi et les bourgeois de Hanovre ne changeront pas non plus. L’Autriche et la Prusse peuvent bien donner raison au Roi, mais non le tirer d’embarras. Il les y mettra elles-mêmes, voilà tout.
Voilà M. Falck ministre à Bruxelles. Il ne s'y amusera guère. J’aimerais bien mieux qu’il vînt mettre son esprit dans le corps diplomatique de Paris. Vous m’avez dit qu'il en avait vraiment beaucoup. Il trouverait de la place vide. Je suis charmé que le Prince de Prusse en ait autant (de l’esprit) que vous lui en trouvez. Il en aura besoin, car son pays en a.Trois choses ont fait la Prusse, le Protestantisme, la science et Frédéric 2. C’est une Puissance de notre temps, un peuple et un gouvernement moderne. Sa sagesse va à toute l’Europe civilisée. Celle de l’Autriche ne va qu'à l’Autriche. Je désire la prospérité de la Prusse.
9 heures et demie
Si j’ai envie de vous voir ! Adieu, adieu. Adieu Je n’ai pas envie de vous dire autre chose. Dans la journée, nous causerons. Il m'est arrivé hier du monde. G.
Mots-clés : Diplomatie, Parcours politique, Politique (France), Politique (Prusse), Protestantisme
246. Val -Richer, Vendredi 16 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai que le temps de vous dire adieu. J’ai eu du monde hier le matin une grande promenade le soir la migraine. Je viens de me lever très tard, et il faut que j'écrive à M. Duchâtel pour une affaire. Car j'ai les affaires d’une foule de gens à défaut des miennes. C’est un grand ennui.
Je reviens aux paroles d'Alexandre qui donnent pour moi, aux nouvelles d'Orient, un double, triple intérêt. Décidément, je ne crois à aucune complication grave. Si c’est nous qui servons de médiateurs entre le Pacha et la Porte nous les accommoderons sans guerre ; et si c’est vous, si nos ambassadeurs sont des dupes, vous accommoderez aussi. Cela prouve même que vous voulez accommoder. Question et combat d'influences ; rien de plus jusqu'ici.
Que feriez-vous, s’il y avait autre chose ? Où iriez-vous ? Iriez-vous quelque part ? Seriez-vous malade ? L'Angleterre ne vous vaudrait pas mieux que la France. Est-ce que Zéa ne vous est pas arrivé ? Ses pronostics étaient justes. La dissolution, qu’il redoutait tant, amène des cortes exaltées qui ne feront rien, mais qui empêcheront qu'on ne fasse s’il y a quelque chose à faire pour qui que ce soit. Du reste, ils peuvent faire en Espagne ce qui leur plaira. Nous nous en mêlerons moins que jamais. L'Orient a tué l’intervention.
9 h. 1/2
Voilà votre N°240. Je voudrais bien que vous eussiez Melle Henriette, dont je ne connais guère pourtant que sa réputation qui est bonne. Je vous dirai demain, avec détail ce que je pense de notre situation à tous en Orient. Adieu. Adieu. Je vais écrire pour l’hôtel Crillon. Adieu. G.
251. Val-Richer, Mardi 20 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de rendre mes filles parfaitement heureuses. Nous avons fini la lecture de Villehardouin, et j’y ai fait succéder un roman de Cooper qui s’appelle Les Pionniers. C’est un village de planteurs établis sur la lisière de la terre sauvage et en lutte avec les forêts, les bêtes féroces, les Indiens. A part même les aventures, la vie agricole, ses intérêts, ses plaisirs, ont évidemment un grand charme, un charme naturel pour les hommes, enfants ou non. Je le comprends avec le bonheur domestique, avec la fixité et le long avenir de la famille. Sans cela, la campagne n'est bonne que pour se reposer dans les entr'actes, ou pour se retirer quand on a fini.
N’avez-vous point de nouvelles de Lady Clauricarde ? Je la suppose retournée à St Pétersbourg. Pour elle, ce moment-ci vaut la peine d'y être. Et je m'en rapporterais assez à son jugement. C’est, si je ne me trompe, une personne très agréable à voir la première fois, et à connaitre intimement. Il y a, entre ces deux termes, un moment où elle est moins agréable. Cela arrive assez souvent avec les personnes distinguées. Le mérite frappe d'abord puis les défauts apparaissent ; puis le mérite revient et surmonte tout. J'essaie de vous parler de toutes choses. Sachez bien que je ne pense qu’à une seule.
Mercredi 9 7 heures
J’ai un besoin inexprimable de causer avec vous. Il me semble que depuis le 1er Juin nous ne nous sommes rien dit. Toutes ces lettres écrites, reçues, tous les jours ce n’est rien, rien du tout. Il n’y en a point, et dans aucune pas une phrase qui ne soit insuffisante, incomplète, fausse. C'est comme si nous étions l'un vis à vis de l'autre, dans un état de réticence et de mensonge. Cela me déplaît horriblement. Et puis, j’ai tant d'envie de vous voir, de voir par moi-même à tout ce qui vous touche, votre santé, vos affaires. Je ne comprends pas pourquoi mon Génie ne m’a pas encore répondu sur le petit hôtel de la rue Lascazes. Je lui ai recommandé de le visiter avec le plus grand détail, s'il est encore à louer. Il doit s’informer aussi pour l’hôtel Crillon.
Le Duc et la duchesse d'Orléans réussissent vraiment très bien dans leur voyage. Il y a, de la part des Carlistes, beaucoup de curiosité pour eux, une curiosité qui combat la malveillance. Quand viendra, un nouveau règne, le parti se coupera en deux ; les uns retourneront à leurs espérances ; les autres regarderont l'usurpation comme couverte par l'hérédité et se rapprocheront. On voit déjà les deux mouvements se préparer.
Il y a un grand trouble matériel, dans les journaux de Paris. Plusieurs des plus bruyants, le Siècle par exemple et la Presse sont, dit-on, en danger de mort. Au fait plus ils durent et plus ils ont d'abonnés, plus aussi leurs actionnaires se ruinent. Jamais on n'a vu une spéculation plus évidemment fondée sur une friponnerie. Le Siècle a perdu, dit-on, beaucoup d'abonnés à cause de ses velléités de ministérialisme.
9 h. 1/2
Quand donc aurez-vous trouvé quelqu'un ? J'en suis plus agité que si je le cherchais moi-même. Adieu. Je vous quitte pour aller recevoir Mad. de Boigne. Adieu. Adieu. G.
253. Val -Richer, Vendredi 23 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
On dirait depuis hier que je vais être pris d’un rhumatisme à l’épaule gauche. J’y ai une douleur assez vive, et j’ai quelque peine à élever le bras. J’ai déjà ressenti quelque atteinte de cette douleur-là. Il faut se frictionner, se couvrir l’épaule de laine et attendre.
J’ai eu hier des nouvelles de St Pétersbourg. Voici en quels termes. " Ma besogne d’observation et de discernement est devenue plus curieuse depuis la crise d'Orient. Je ne lui vois aucune autre solution que de faire de l’Empire ottoman un théâtre pour le commerce européen un territoire administré tant bien que mal vous le patronage commun. Quant à l'existence politique, il n’y faut plus penser. Je n’ai pas eu un moment d’inquiétude sur le maintien de la paix. Il eût fallu, pour la mettre en péril, que Constantinople fût menacé comme en 1833. Le pays où je suis est vivement blessé dans son amour propre ; ses intérêts réels, ses projets positifs ne sont pas en péril. " C’est du 10 août.
J’ai parlé à ma mère de ce que vous désirez. Elle cherchera. Elle n'a personne sous la main Elle m'a demandé si vous étiez facile a vivre. J’ai répondu oui, très facile pour qui lui plaira ; sinon, impossible. Mad. de Telleyrand écrit qu'elle s'ennuie à Baden, que tout le monde s'y ennuie, et que plus il y vient de monde, plus il y vient d’ennui. J’ai peur que Mad. de Talleyrand ne soit destinée à s'ennuyer beaucoup dans l'avenir. Elle le supportera plus fortement que vous. Elle se fera de petites affaires et de petits passe-temps qui ne sont pas à votre usage. Mais le mal sera là.
9 heures
Je suis charmé de vous écrire à Paris, en attendant que je vous y voie, nous arrangerons le moment de ma course Ne me laissez pas sans nouvelle pendant tout votre voyage. Un mot, si deux vous fatiguent. Vous savez qu’il y en a un qui est toujours excellent. Adieu. G.
14. Val-Richer, Samedi 25 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà une bonne lettre. Vous vous portez bien, vous me grondez et elle est longue. Mon éternuement est parti, et ma pauvre Henriette n’y est pour rien du tout. Ce n’est pas pour la mener promener, c'est pour mener promener M. Austin que je suis sorti le soir, et ma mère et Henriette s’en sont plaintes tout haut pour qu'il ne me fût pas possible de recommencer. Acquittez donc Henriette, dans votre esprit, et portez-vous bien. Je vous promets que je ne sortirai jamais le soleil couché. Lui et moi, nous ne serons jamais qu'ensemble sur l’horizon. Votre menace m’a fait trembler. Vous êtes charmante de vous mieux porter, charmante d'avoir si peur pour moi, mais bien... (je ne trouve pas de mot qui me convienne) de craindre le Val Richer et son influence. Je n'y apprends qu'à mieux sentir tout ce que vous êtes pour moi et le besoin que j’ai de vous. C’est un sentiment qui monte de jour en jour en moi comme la marée. Et jamais de reflux. Quelle comparaison ! Un reste de ma course de samedi dernier à Trouville. La vue de la mer me laisse toujours une impression profonde. Je ne connais rien de plus frappant que ce mouvement perpétuel dans cette monotone immensité.
Courrier très chargé ce matin deux dépêches et quatre lettres particulières de Flahault, M. de Metternich très blessé, très chagrin de Montalembert et Villemain. Ne se plaignant point de mon silence, disant qu’il le comprend et que j'ai bien fait. Je n’ai pas dû donner dans un piège qu'on me tendait la veille des élections. Metternich désavoue quelques uns des faits avancés par Montalembert. Henri Bogusez n’est pas mort. Il se porte bien a Cracovie. Quant aux faits indésavouables (sic) le gouvernement autrichien persiste à en repousser la responsabilité. Mais sinon la connivence, du moins l’apathie, la faiblesse l’imprévoyance, l'impuissance sont de plus en plus évidentes. Le Général Collin a évacué Cracovie parce qu’il n’avait, pour ses troupes, que 15 cartouches par homme et qu’il n’avait aucun moyen de s'en procurer dans toute l'étendue à son commandement. Aujourd’hui le corps d’armée qu’il faut entretenir dans la Galicie coûte un surcroit de dépense de 800 000 florins (plus de deux millions de francs) par mois. L’Autriche sera obligée de faire un gros emprunt. En outre grande fermentation dans toutes les parties de la Monarchie, même dans les états héréditaires. Les Etats de la Basse Autriche, réunis à Vienne, viennent de demander de prendre part à la confection des lois, l’abolition de la corvée & &. En Bohême, la noblesse prend l’initiative des réformes. Dans le gouvernement même dans les Affaires étrangères, beaucoup de choses arrivent dont M. de Metternich décline la responsabilité en disant qu’il ne les a pas sues qu’il n’en a pas entendu parler. Déclin palpable de l'état et de l'homme. Je n’aime pas les déclins, dussé- je en profiter. Je ne laisserai pas échapper le profit, s’il y en a mais le spectacle n’est pas de mon goût. Quant à Rome mes nouvelles sont d'accord avec les vôtres. Vienne s'en inquiète, combat l'armistice et fait, sur les réformes, du galimatias, sensé, mais si vague que ce n’est pas la peine de l'écrire. Il n’y a pas le plus petit conseil pratique à en tirer. Flahault va à Königswart, de là à Marienbad. Puis, il me demande un petit congé pour aller, soit à Venise, soit à Milan, voir sa femme et ses filles, y compris Lady Shelburne qui va aussi passer l’hiver à Rome. Vous le savez probablement déjà. Une lettre de Bulwer à moi tout-à-fait semblable à la vôtre. Aigre, inquiète déroutée souhaitant du mischief, comme vous dîtes, pour sortir d'embarras. Il n’en sortira pas. Ni personne. Bien mauvaise affaire que cette Reine à marier. Je ne vous en parlerai pas aujourd’hui. J’ai trop à y penser. Aujourd’hui je ne veux penser qu’à mon discours de demain. 600 personnes à table, et 10 000, non pas sous la table mais en dessous de la plateforme où est la table, se promenant là pour nous voir dîner et m’entendre parler, ce qu'elles n’entendront pas. Qu’il y a de choses, en ce monde qui seraient très ridicules si elles n'étaient pas très sérieuses ! Adieu. Adieu. Je vous remercie encore de tout. Adieu. G.
266. Val -Richer, Samedi 14 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Vous avez bien raison ; un bon confident général épargnerait à tout le monde bien des sottises. Que de fois je l’ai pensé sur l’heure même au milieu des affaires ! Que de fois j'ai désiré que quelqu'un fût là, qui vit les choses comme elles étaient, la vérité, et l'allât redire, à ceux qui auraient été charmés de l'apprendre et ne savaient pas la deviner ! Mais il faudrait que le confident eût bien de l’esprit et bien de l’honneur. Ce serait un rôle charmant, autant qu'utile, et qui vous croit à merveille. Que signifie notre mission en Perse ? Allons-nous là pour nous interposer entre St Pétersbourg et Londres ? Je le croirais au choix de M. de Sercey. Je ne sais qui nous allons envoyer aux Etats-Unis à la place de Pontois. Comment M. de Metternich se fait-il accompagner au Johannisberg par M. de Hügel ? Personne ne me paraît moins propre à égayer un malade. Puisque M. de Jennison s'en va décidément. Sachez-moi, je vous prie, si c'est M. de Lücksbourg qui le remplace. Il m’a paru homme d'esprit. Mais bien des gens paraissent gens d'esprit à la première conversation. Je dis de l’esprit comme Solon de la destinée des hommes. " Il n'en faut jamais juger avant la mort. "
Dimanche 7 heures
Quel temps noir et froid. De tous mes souvenirs d’enfance le plus vif est celui du soleil du midi. Je le cherche toujours au delà de ces brouillards. Un ciel sans soleil, c’est un corps sans âme. Vous m’avez bien manqué hier. J’écrivais, sur Washington une page qui m’a amené à un rapprochement entre lui et Cromwell. Le rapprochement est très piquant ; mais je ne suis pas sûr qu’il vienne à propos. Je ne suis pas très sujet au doute ; que la chose soit petite ou grande, je me décide en général, moi même et promptement. Mais quand il m’arrive d’hésiter, mon embarras est extrême, car je suis horriblement difficile, en fait de conseils. Je crois aux vôtres. Vous avez le jugement très sûr et le goût très exigeant. Et cela d’instinct sans longue méditation. Vous me direz votre avis sur la convenance de mon rapprochement.
J’espérais Lady Granville un peu plutôt, tout vient toujours trop tard. Je regrette qu'elle n'ait pas réussi dans sa négociation. En avez-vous quelque autre en vue ? Vraiment il vous faut quelqu'un. Voulez-vous que je fasse chercher ? J’y serai très difficile, aussi difficile que vous. Puis vous verrez. Votre isolement, dans votre home, pour les soin matériel de la vie, m'est insupportable.
9 heures
Je suis désolé, désolé de toute façon. Mais je ne dirai rien aujourd'hui, je ne pourrais pas. Je vous renverrai demain la lettre du Prince Mestchersky. Je veux la relire. Au nom de Dieu ne soyez pas malade. Soyez injuste tant que vous voudrez, mais non pas malade. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Discours autobiographique, Portrait (Dorothée)
267. Val -Richer, Lundi 16 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
J’aurais le cœur bien blessé si je ne me l’interdisais pas. Blessé à ce point que mon envie était de ne pas vous répondre du tout sur ce que vous me dites. Mais vous êtes souffrante, vous êtes seule. Dites, pensez même (ce qui est bien pis) tout ce que vous voudrez. Je ne vous répondrai jamais qu’une chose. Vous n’aurez jamais plus que moi le sentiment de ce qui manque à notre relation, de ce contraste choquant, douloureux, entre le fond du cœur et la vie extérieure, quotidienne. Si ma vie était à vous aussi bien que mon cœur, vous verriez si je sais tout subordonner à un seul sentiment à une seule affaire si je sais être toujours là et toujours le même. Mais cela n'est pas ; il y a des affections, des devoirs, des intérêts auxquels ma vie appartient, et qui ne sont pas vous. Je ne puis pas la leur ôter. Je ne puis pas me donner ce tort à leurs yeux, à mes yeux, aux yeux du monde, à vos propres yeux. Car je vous connais bien ; vous mépriseriez la faiblesse même dont vous profiteriez. Vous avez l’esprit trop droit et le cœur trop haut pour ne pas avoir besoin, sur toutes choses, d’approuver et de respecter ce que vous aimez. Je vous parle bien sérieusement n’est-ce pas ? Pas si sérieusement que je le sens. Ce qui vous touche est si sérieux pour moi ! Mais assez ; trop peut-être, quoique je vous aie dit bien peu. Comment dire ? Comment dire de loin ? Toutes les paroles me semblent froides et fausses. Voilà plus de deux ans ; et pourtant il faut encore que le temps nous apprenne, l’un sur l'autre, bien des choses.
Que me direz-vous aujourd’hui de vos crampes, et de vôtre nuit ? Je vous renvoie la lettre du Prince Metscherzky. Je voudrais bien ne plus vous parler de Paul. Il me révolte. Et puis je ne comprends pas ces mœurs-là, cette façon de repousser insolemment de faire taire un parent qui vous parle d’une mère, parce qu'il n’a pas des pleins pouvoirs, parce que ce n’est pas un procureur ! Et ce parent se laisse faire ! Il ne trouve pas un mot à répondre, un mot bien simple, bien calme, mais qui remette à sa place tout et chacun ! Le Prince Metscherzky m’a l’air d’un excellent homme, bien zélé pour vous ; mais ne le chargez pas d’affaires difficiles ; ne lui donnez pas à traiter avec un frère puissant ou un cousin arrogant. Ne placez pas non plus comme il semble vous le conseiller, toute votre fortune en Russie. Quelques mille livres de rente de plus ne valent pas beaucoup de sécurité et de facilité de moins. Du reste vous avez déjà fait le contraire pour une partie.
Vous avez bien raison ; on nomme les gens aux emplois diplomatiques, en pensant à ce qu’ils sont là d’où ils partent, point à ce qu’ils seront là où on les envoie. On pense à si peu de choses ! Que les affaires humaines se font grossièrement ! On serait bien étonné si tout à coup, par miracle, elles étaient vraiment bien faites, et par des gens vraiment d’esprit. Savez-vous pourquoi on envoie M. de Pontois à Constantinople ? Parce qu'il est terne et tranquille, ne choque personne et ne fera pas les sottises de l’amiral Roussin. Le grand abaissement de notre temps, c'est de se contenter à bon marché ; le tel quel suffit, pourvu qu'on vive.
9 h. 1/2
Vous avez un peu dormi. Il faut absolument qu’on vous trouve une lectrice. J’en vais parler à ma mère. Adieu. Adieu. J’apprends à l’instant même que D. Carlos est en France avec toute sa famille. Les bataillons navarrois acculés à la frontière ont capitulé. Elio, qui les commandait, avait envoyé d'avance un de ses aides de camp au général Harispe. On ne doute pas que les Cortes ne sanctionnent le traité. Vous savez sûrement tout cela. Adieu. Adieu. G.
278. Val-Richer, Vendredi 27 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous écris de mon lit. Non que je sois plus souffrant ; mais hier je me suis trouvé bien d'y être resté quelques heures, et on a voulu que j'en fisse autant aujourd'hui. Je tousse moins et je n’ai presque plus d'oppression. Quand je suis fatigué, mal à l’aise, enfoncé dans mon fauteuil, que vous me seriez douce ! Que votre voix me rafraîchirait la poitrine. Pourtant j’aimerais encore mieux être auprès de vous quand c’est vous qui souffrez.
Génie me mande qu’il vous trouve mieux que les premiers jours où il vous a vue. Il dit que Mad. de Talleyrand vous instruit fort bien sur l'imposition personnelle et mobilière, et qu’il vous a envoyé M. de Valcour dont vous êtes contente. Servez-vous de lui pour que votre tapissier ne vous vole pas trop. Je vous garantis deux choses sur mon monde, leur honnêteté et leur dévouement. J’ai la passion des honnêtes gens et de l'affection, dans tous les états et pour tous les emplois.
Je ne vous parle pas de la pauvre dépêche de Sébastiani. Vous la savez. Le Roi me fait demander où je désire qu’il m'envoie un service de porcelaine qu’il me destine, à Paris ou à la campagne. Je réponds à la campagne. C'est le premier présent que je lui aie vu faire excepté le tableau de Champlâtreux. N'en parlez pas jusqu'à ce qu’il soit arrivé.
Soupçonnez-vous quelque chose du motif de l'Empereur, en rayant votre fils ? Ce ne peut-être à cause de vous. Il l’avait si bien reçu d'abord ! Et puis Paul n’est pas vous aujourd'hui. Il faut qu’il y ait quelque chose de personnel à Paul, quelque propos.
Nous offrons, pour Méhémet, la restitution immédiate du district d'Adana à la Porte et celle de Candie après la mort de Méhémet. Mais nous tenons à la Syrie, et Méhénet me paraît y tenir encore mieux que nous. Il a raison. C’est toujours lui qui a droit de paix et de guerre sur l’Europe.
Vous vous êtes trompé sur le n° de votre lettre de Mercredi. C’est 272 et non 273. Je vais me lever.
10 h. Vos renseignements sur notre pacification d'Orient ne sont pas tout-à-fait d'accord avec les miens. Vous pourriez bien avoir raison. On est sur cette pente là. Rien n'empêche adieu. J’ai le soleil aussi ce matin. Adieu. Adieu.