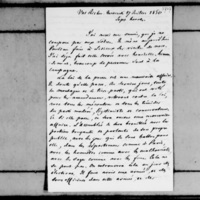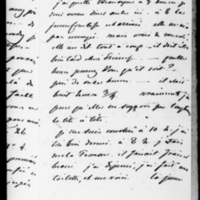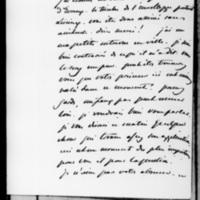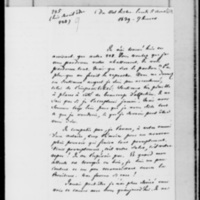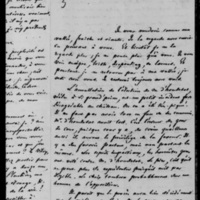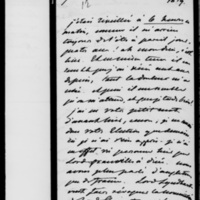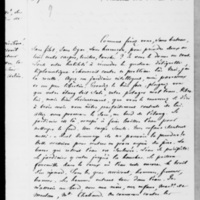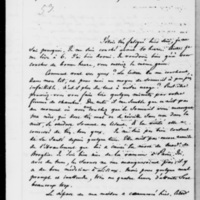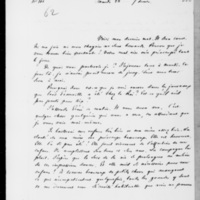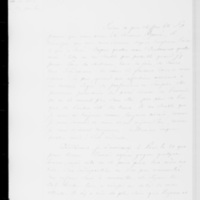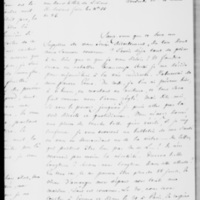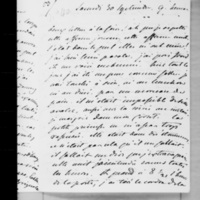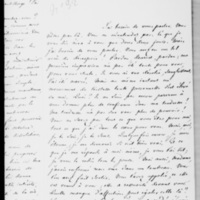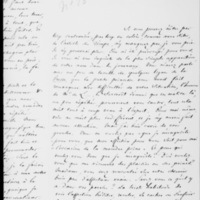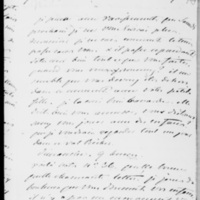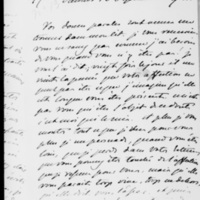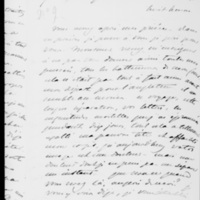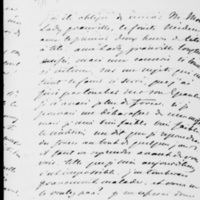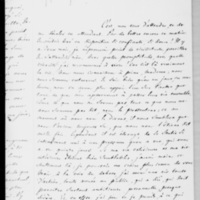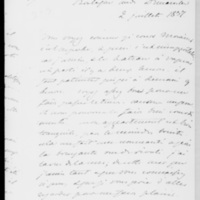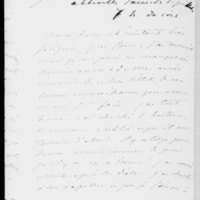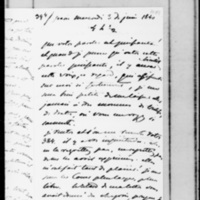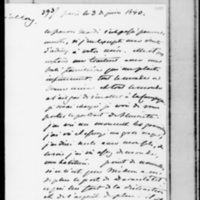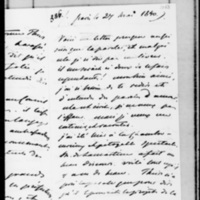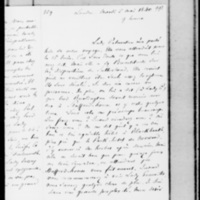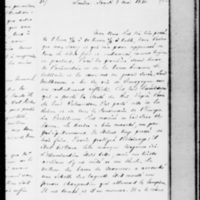Votre recherche dans le corpus : 122 résultats dans 3398 notices du site.
Val-Richer, Mercredi 17 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
J’ai aussi mes ennuis, que je ne compare pas aux vôtres. Je mène aujourd hui Pauline faire à Lisieux ses visites de noce. J'ai déjà fait cette corvée avec Henriette, heureusement, beaucoup de personnes sont à la campagne.
La loi de la presse est une mauvaise affaire. Je doute qu'elle passe. Au dernier jour, toute la montagne et le tiers parti, qui ont voté pour les amendements, voteront contre la loi, avec tous les mécontents et tous les timides du parti modéré, légitimiste et conservateur. Et si elle passe ce sera encore une mauvaise affaire. L’assemblée se sera brouillée avec la portion bruyante, et parlante de son propre public, avec les gens qui se sont battus pour elle, dans les départements comme à Paris, avec les honnêtes comme avec les malhonnêtes avec les sages comme avec les fous. Cela ne se peut pas. On retrouvera cela au jour des élections. Il faut avoir une armée, et des sous-officiers dans cette armée, et des braves, quelques fois embarrassants et compromettants, parmi ces sous-officiers. Je crains que nos amis les Burgraves n'aient fait là une mauvaise opération, et que cette loi ne coûte beaucoup plus qu’elle ne vaut. A moins qu'elle ne vaille à l'un d'eux les bonnes grâces de Mad. Kalergi. Mais je ne suppose pas ; n’est-elle pas toujours radicale ?
Je trouve que c’est beaucoup d'appeler la mort du Duc de Cambridge une catastrophe. A cela près que celle-là est connue de tout le monde, il n’y a guère de mort plus insignifiante. Comme sa vie. Du reste j'ai été bien aise de voir les témoignages de respect officiel pour son nom et sa veuve, les discours, les adresses du Parlement et du public. Tout respect est bon et devient presque d’autant plus frappant que la personne n’y entre à peu près pour rien.
Peu ou beaucoup, je suis bien aise que vous ayez Constantin et sa femme. Ce sont des soins, si ce n’est pas de la conversation. On me dit, quoiqu’il me dise lui-même le contraire, que Duchâtel n’ira pas en Allemagne. C'est assez pour lui de prendre les eaux de Carlsbad à Paris et il est plus préoccupé de sa propre santé, qui est bonne, que de celle de sa femme qui me paraît, à moi, très inquiétante. J'ai peur qu’il n'aime vraiment que lui-même. Avec sa disposition à s'ennuyer, c'est bien lourd. La préoccupation de soi-même ajoute à l'ennui, bien loin d'en distraire. Savez-vous ce qu’il faut faire pour se désennuyer ? Relire les Mémoires de St Léonard. Moi qui ne m'ennuie pas, je fais cela le soir, et je ne m'en lasse pas. Je conviens qu’il faut avoir des yeux. Comment vont les vôtres ? S'ils vont assez bien, ne me le dites pas par ménagement. Je comprendrai votre silence.
Comment fait-on l'hiver à Ems, dans des maisons sans poêle ni cheminée ? Est-ce que personne ne vit là en hiver ?
Voici une note qui m'est fort recommandée par des gens que je serais bien aise d'obliger. Excusez le constitutionnalisme des deux premiers paragraphes. Je connais le Général Rybinski, brave homme, ce qu’il y a de plus honnête et de plus tranquille dans l'émigration polonaise. Il me semble que l'Empereur, n'est pas mal disposé pour lui et les siens. Il s'agit uniquement d'aider de pauvres jeunes filles à ne pas mourir de faim. Pouvez-vous, quand vous verrez Constantin lui en dire un mot, et pourra-t-il en dire ou en écrire un mot au Maréchal Paskéwitch ?
9 heures
Votre visite au Prince et à la Princesse de Lippe Schaumbourg Bückebourg met le comble à ma compassion. Adieu, adieu, adieu. G.
Trouville, Dimanche 23 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Je passe la journée ici. Je retourne au Val Richer demain matin. Le temps est admirable. Je viens de me promener, une heure au bord de la mer. Vous trouveriez Trouville embelli, et plusieurs bonnes maisons de plus. Mad. de Boigne est arrivée ; elle est venue hier voir mes filles. J’irai la voir tout à l'heure. Le chancelier arrive mardi. Peu de monde encore du reste. On dit qu’il y en aura beaucoup. Votre dernière lettre à St Léonard (du 18 ) est venue me rejoindre ici ce matin. Je compte en trouver une demain en arrivant au Val Richer. Je n’ai rien à vous dire aujourd’hui sinon que je suis venu de Paris au Havre sans ouvrir la bouche. A qui et pourquoi aurais-je parlé ? Je serai très impatient des nouvelles de demain lundi ; plus de celles de Londres que de celles de Paris. Pourtant si les trois millions étaient rejetés, ce serait un plus gros événement, et qui aurait des conséquences plus graves que la prolongation de la vie maladive de Lord Palmerston. Je ne crois pas à ce rejet. Et je suis très curieux de savoir ce que fera Peel dans le Débat des Communes. Adieu, adieu.
Jeudi et vendredi ont été deux jours charmants. Adieu. G.
Brompton, Samedi 14 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
Je reviens de Kensal-Green où je suis allé dire adieu au tombeau de ma mère. Je ne regrette pas de la laisser ici, car elle-même n’a pas regretté d'y rester. Cette terre protestante, et protectrice pour moi lui plaisait comme dernière demeure. Elle me l'a positivement témoigné. Ma mère avait deux choses bien belles, et qui sont toutes deux devenues rares, de la foi et de la passion. J’ai fait mettre sur cette place une pierre, entourée d’une grille, et qui porte simplement son nom, son âge, et cette phrase de St Jean qu'elle répétait souvent : " Heureux sont dés à présent, ceux qui meurent au Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. "
Le Duc de Broglie m'écrit pour me demander de lui indiquer précisément quel jour, et à quelle heure j’arriverai au Havre. Il veut s’y trouver, avec Piscatory. " On a si peu de temps, dit-il, dans la maudite vie que nous menons, que peut-être ne pourrions-nous nous voir de quelque temps. " Un autre de mes amis, M. Plichon, m'écrit aussi qu’il part pour Paris afin de venir m'attendre au Havre. Je désire qu’il n’y en ait pas davantage. Je viens de voir un ancien député conservateur, M. Calmon, que je trouve excellent sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Très sensé et très fidèle. Tenant la chute de tout ceci pour certaine, mais croyant à une assez longue durée. On tombera ; on sait qu'on tombera mais comme on craint de se faire mal on chancellera longtemps. Cela me paraît dans le vrai. M. de Falloux m'écrit un billet très courtois pour me dire qu’il a fait ce que je désirais pour ma retraite de l'université. " Ce n’était pas à moi dit-il, qu’il appartenait de décerner à M. Guizot une distinction honorifique. Je dois le remercier d'avoir bien voulu ne pas tenir compte de cette méprise des circonstances." Je lui réponds : " Je vous remercie de votre courtoisie. Elle vous sied bien, et j'y comptais. Je ne sais encore à quel moment je pourrai avoir le plaisir de vous en remercier moi-même. Je compte rentrer, sous peu de jours dans mon nid du Val-Richer. Mais ce sera pour y rester avec mes enfants et mes livres. Je jouirai de l’air frais qu’on y respire et mes vœux vous suivront dans la fournaise où vous vivez. Il me semble que c’est convenable. L’air frais que je regretterai tous les jours, c’est l’air frais de la Tamise. Adieu. Adieu.
Il fait bien chaud aujourd’hui. J'espère que nous ne serez pas sortie à ces heures-ci. Rien de nouveau de Paris, vous voyez qu’Oudinot a envoyé au Pape les clés de Rome. Adieu. A demain cinq heures. Adieu. G.
20. Val-Richer, Lundi 3 août août 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est fini ici. S’il en était ainsi partout, il n’y aurait certainement pas assez d’opposition. Il en faut plus que cela. Mais je suis tranquille ! D'après ce qui me revient, la lutte est extrêmement vive dans les environs. On s'est presque battu à Bernay et un peu battu à Cherbourg. Aucun résultat n'était encore connu hier à 9 heures, quand j'ai quitté Lisieux. Je me suis levé ce matin de très bonne heure pour dicter encore quelques paroles de remerciement que j’ai dites hier, quand l'élection a été proclamée et qu'on a voulu absolument recueillir. Elles ont bien réussi. Je retourne à Lisieux ce matin à 10 heures, pour entendre, lire et signer le procès verbal du Collège électoral. Puis, j’irai à Trouville, avec ma mère et Henriette, pour y chercher Pauline et la ramener demain au Val Richer que je ne quitterai plus que pour aller vous retrouver, vous mon seul vrai plaisir, mon plus charmant repos. Oui, nous retrouverons ensemble des soirées comme les deux dernières : nous irons les chercher. Leur parfum ne s'est pas encore évanoui.
Je suis un peu fatigué. J’ai eu hier & avant-hier deux déjeuners, et deux dîners assommants. Je n’ai certes pas plus mangé ni bu qu'à mon ordinaire, mais l'estomac se fatigue de ce qu’il voit comme de ce qu’il prend. Et l’assiduité, tant d’heures durant à une conversation si insipide, & qui ne doit pas un moment en avoir l’air ! J'y réussis très bien. Je ne fais pas les choses à demi. J’attends bien impatiemment l’estafette qui m’apportera les premiers résultats. Elle ne sera pas encore arrivée à Lisieux quand j’y passerai tout à l'heure. On me l’enverra à Trouville. Vous aurez tout cela avant moi. Castellane m’écrit de ses montagnes : " Je crois moi, au grand succès dans les élections ; ce qui est très juste, car l'opposition est enviable et ce qui donnera de grands devoirs au parti conservateur. J’irai à la petite session, à moins qu’elle ne soit tout-à-fait une forme. Je m’attends en effet, en cas de grand succès aux exigences du parti conservateur. Il se sentira à son aise et voudra avoir quelques plaisirs de popularité. Nous verrons. Je vous quitte pour écrire au Roi. J’ai à lui envoyer une lettre de Bresson qui ne m'apprend pas grand chose. Plus j’y pense, plus je me persuade qu’à Londres on n’a pas en effet dessein d'entrer en lutte avec nous. Mais je crains leur faiblesse, faiblesse pour la Reine, faiblesse pour Espartero faiblesse pour les préjugés des journaux. Ils ont besoin de tout le monde, et l’âme pas bien haute. Je n’ai pas autre chose à faire que ce que je fais. Adieu. Adieu. En attendant votre lettre.
8 heures. La voici. Charmante. J'y comptais. Quand j’ai lu et relu, je passe aux affaires. Il y en a beaucoup aujourd’hui mais rien d'important. Deux lettres du Roi qui se porte mieux que jamais. " Toutes nos santés sont bonnes, me dit-il, la forte secousse que la Reine et ma sœur ont éprouvée est bien passée. Quant à moi, je suis à merveille, et je fais faire un peu d'exercice au Ministre de la guerre, dans mes promenades dont je jouis beaucoup. ". Et dans la seconde : " Je vais me promener dans mon char à bancs. Hélas ! avec escorte ! " La formation des bureaux, que m’apportent les Débats, est de bon augure. Adieu. Adieu. Je vous écrirai demain de Trouville. Je n'en reviendrai que le soir. Soyez tranquille. Ni assassin, ni rhume. Adieu. G.
Paris, Mercredi 25 septembre 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mercredi 10 h 1/2
8. Versailles, Mercredi 16 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le 16 août 1843
J’ai quitté Beauséjour à 4 heures. Je suis venue dîner seule ici, à 8 la jeune contesse est arrivée. Elle ne m’a pas ennuyée. Mais voici de son côté. Elle me dit tout à coup - Il doit être bien tard chère Princesse. - Quelle heure pensez-vous qu'il soit ? Près de onze heures. Il était huit heures 3/4. Vraiment j’ai peur qu’elle ne supporte pas longtemps le tête-à-tête.
Je me suis couchée à 10 h. J'ai très bien dormi. A 8 h, j'étais sur la Terrasse. Il faisait frais et beau. J’ai déjeuné, j’ai fait une toilette et me voici. La jeune comtesse est allée se promener dans les galeries, déjeuner chez Mad. de la Tour du Pin. J’y étais conviée aussi, mais je reste. Je vous écris et j’attends votre lettre.
Bulwer parle très sérieusement. Au fond il trouve le Cadiz ce qu’il y a de mieux et de plus pratique surtout. Le fils de Don Carlos impossible. Naples peu vraisemblable comme disposition espagnole. Dieu garde dit-il que qui que ce soit mette en avant un prince étranger quel qu'il soit. Car aussitôt la France serait forcée de lui opposer un Prince d’Orléans. Il ne faut pas à tout prix que la lutte de candidats s'engage. Il ne faut se mêler de rien. Il dit cependant que l'Angleterre doit agir pour empêcher que les Cortès ne nomment le duc d’Aumale, car malgré la résolution du Roi le cas pourrait devenir embarrassant. Si l'Angleterre veut en finir, je crois bien qu’elle arriverait au résultat contraire, mais enfin ce n’est que le dire de Bulwer. Il a beaucoup répété que son gouvernement était dans les meilleures dispositions d’entente avec la France. Il a insisté sur le bon effet qu’aurait la présence de Sébastiani, fort respecté à Londres. Cependant ne sera-t-il pas un peu trop Whig pour les gouvernements actuels ?
Tout ce que vous me dites dans votre N°3 me plaît. Vous avez pris si doucement mes reproches. De la manière dont vous me répondez, je trouve bon toutes vos faiblesses. Mais voici ce que je ne pourrais jamais trouver bon c’est que je fusse renvoyée au delà du 26. Vous pouvez être faible pour votre mère, mais vous ne serez pas injuste et dur pour moi. Je reste donc ferme dans ma foi pour le 26.
Midi et demie. Voici le N°4. Je comprends fort bien la première page, car Génie m’avait confié ce qui était venu de Londres. J’espère que vous aurez consenti à rétrancher le petit mot déplaisant. Il ne faut pas que vous ayez à vous reprocher un seul fait ou geste qui empêche de s’entrendre. Mais quel dommage que vous ne soyez pas ici. Je le répète : un jour de retard dans des affaires comme celle-ci c’est beaucoup risquer et vous dites mieux que moi. Je vous copie. " tout cela a besoin d'être conduit avec un grande précision et heure par heure." Et vous êtes à 46 lieues ! Mais au moins vous reconnaissez l’inconvénient, tout le monde le pensait, et moi aussi, par dessus toutes les autres choses. Revenez, revenez. Ceci est votre grand moment vous n'avez rien eu de si grave, de si important, et de si directement posé sur vos épaules depuis 3 ans bientôt que vous êtes ministre. Et c’est là le moment que vous avez choisi pour vos vacances. Pardonnez-moi si je reviens. Mais vraiment je voudrais impress upon your mind combien cela est sérieux pour vous. Je comprends toutes vos jouissances au Val-Richer, & j’essaie même de n'être pas jalouse ; mais je suis désolée de ce que votre sommeil soit toujours troublé. Enfin votre mère en vous voyant comme cela accablé de travail, vous laisserait bien partir, car elle reconnaîtrait que la politique est sa vraie rivale Adieu. Adieu.
Je renvoie Etienne avec ceci. Je regrette que mon N°7 soit arrivé à Génie trop tard pour vous être envoyé par la poste. Je l’avais donné à [?], à 4 pour le poster de suite. Il ne s’est présenté qu’après 6. Nouveau grief. Par dessus la glace & & Adieu. Adieu. Aujourd’hui variante avant le 26. Adieu.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcours politique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon
5. Beauséjour, Lundi 14 août 1843,Dorothée de Lieven à François Guizot
le 14 août 1843
J'ai trouvé en ville votre petit mot d'Evreux. Le timbre de l'enveloppe portait Lisieux. Vous êtes donc arrivé sans accident. Dieu merci ! J’ai eu ma petite entrevue en ville. Je suis bien contrariée de ce qu'il m’a dit. Vous le serez un peu. Peut-être trouverez-vous que votre présence ici eut mieux valu dans ce moment. Prenez garde, un faux pas peut mener loin. Je voudrais bien vous parler. Je vous disais ce matin quelque chose qui trouve assez son application. Ceci est un moment des plus importants pour vous et pour la question. Je n’aime pas votre absence. Ce n’est pas à moi du tout que je pense en vous disant cela. C’est vrai ce que je vous dis là. Voici une lettre de mon frère que vous me renverrez.
Adieu. Adieu. J’ai voulu encore ajouter ce petit mot. Les numéros sont utiles pour cela. Adieu, le 26, j'ai bien envie de ne plus y croire mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il est indispensable que vous reveniez avant. Adieu.
3. Val-Richer, Lundi 14 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val Richer. Lundi 14 Août 1843, 6 heures du matin
Que je vous remercie ! Vous êtes charmante. Je comptais sur une lettre ; et encore vous ai-je fait une sotte question. J'en ai trouvé deux. Ne craignez jamais de me fâcher. Dites-moi toujours tout. Tout me plait venant de vous. Je ne me pique point de n'avoir jamais pour ceux que j’aime, pour ma mère surtout, quelque complaisance quelque faiblesse si vous voulez. Vous y êtes vous-même pour quelque chose. J’ai tort de vous dire cela ; je touche là une triste corde. Mais moi aussi, je vous dis tout. Le spectacle d’un fils que n’est pas pour sa mère ce qu’il doit être m'a tellement blessé que cela a tourné au profit de la mienne ; et je suis devenu, pour elle, plus soigneux, plus affectueux qu'auparavant. Il est vrai qu'elle et mes enfants avaient un très vif désir de ce voyage. Il m'a plu de leur donner ce plaisir. Je n'ai pas perdu ma bonne intention. Ils sont dans le ravissement.
Je mentirais, si je ne disais pas que je prends aussi quelque plaisir à la vue de mes bois, de mon jardin, de ma bibliothèque, de ma serre, de mes orangers. Le soleil brille ce matin ; ses rayons percent avec éclat une vapeur légère et fine qui flotte encore sur les bois et les près, les plus verts du monde. C’est charmant. Mille fois moins charmant qu’un moment près de vous, une parole, un regard de vous. Croyez-moi dearest, car je vous dis tout. Ne soyez pas jalouse de mon plaisir d’ici ; il ne le mérite pas. Mais pardonnez-moi de le sentir.
Puisque le mot de jalousie est venu là, sachez que vous êtes vous dans ma maison, pour ma mère surtout un objet d'immense jalousie. Si je n'étais pas venu ici elle aurait été parfaitement convaincue que vous seule en étiez la cause. Vous la comprendrez et vous ne lui en voudrez pas. Vous avez le cœur si juste ! Gardez-moi pourtant tout ce que vous m’avez montré le jour où vous m’avez dit qu'avec moi seul vous n'aviez ni justice, ni impartialité. Je déraisonne. Je vous demande les contraires. Oui, je vous les demande, bien sûr de vous en récompenser amplement. Je ne crains jamais d'être en reste avec vous.
Le 26. Politiquement soyez tranquille. Le jour où mon absence aura un inconvénient réel je partirai sur le champ. Je suis très attentif à cet égard. Je ne vous retire point la question d’un Ambassadeur à envoyer à Madrid. Si elle vient, elle me ramène le lendemain. Dans la nuuit de samedi à dimanche, à Evreux, à une heure du matin, le directeur de la poste m'a réveillé pour m’apporter une lettre du Ministre de l’Intérieur, disait-il. J’ai cru que j'étais rappelé à Paris. Ma première, bien première impression a été de plaisir, de plaisir pour Beauséjour. Il n’y avait point de lettre de Duchâtel. C’était tout bonnement des papiers que Génie m'envoyait et qui auraient fort bien pu attendre mon réveil. Il y avait pourtant une lettre du Roi. Bonne à voir, tant elle montre son sincère éloignement pour le mariage Espagnol, son vif désir de s’entendre avec l'Angleterre, et son humeur de ce brouillard si épais de préjugé, de méfiance et de crédulité qu'il ne peut parvenir à dissiper. Je vous quitte pour lui écrire. Je vous reviendrai quand la poste sera arrivée. Adieu. Adieu. Cent fois, adieu.
10 heures
Que j’aime le N °31 ! Si Oudinot a passé à Copenhague je ne comprends pas qu’il n'aille qu'à Ems ou à Vienne et s’il n’y a pas passé, je ne comprends pas où St. Priest a pris ce qu’il m'a dit. Oudinot n'aurait-il voulu aller à Pétersbourg qu'en cachette pour porter lui-même ses regrets à l'Empereur et revenir aussitôt. Ce serait bien galant. On écrit de Madrid qu'Aston fait ses préparatifs de départ. Vous me renverrez ce que je vous envoie. Adieu. Adieu. Il faut que j'écrive au Roi, à Désages et à Génie. Adieu. Au 26.
Ni brigands, ni accidents, ni maladies.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcs et Jardins, Politique (France), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Dispute), Vie domestique (François)
Evreux, Samedi 12 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'arrive. J’ai été très vite car je ne suis parti d’Auteuil qu'à 12 heures moins un quart. Vous aurez vu Génie qui vous aura dit ma visite. Rien de nouveau mais un assez vif désir de prendre les rênes de l’affaire, au nom de la légitimité qui abdiquera, et assez d'humeur contre l'Aquilo. Très bien du reste pour nous, et une nuance de raillerie sur les Anglais. Mes lettres à moi, venues par courrier français redisent exactement les mêmes choses. Flahault est un bon truchement. Voutchicth et Pit s'en vont, quand le sénat leur aura dit de s'en aller. Mais c’est une pure forme. J’aimerais bien mieux vous dire tout cela. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Je voudrais régler et remplir de loin vos journées. On ne peut rien de loin. J’ai tort. Je voudrais que vous vissiez tout ce qu’il y a en moi de loin comme de près, Vous ne diriez pas que ce n’est rien. Adieu Adieu.
On m’appelle pour dîner. Nous repartons demain à 9 heures. Il a fait bien beau malgré des nuées de poussière. J’ai trouvé ici, dans l’auberge. M. de Salvandy qui vient se faire élire membre, du Conseil général. Très amical. Il me cède son appartement, qui est le meilleur de la maison. Adieu. Adieu. J’espère que j'aurai demain, en arrivant au Val-Richer, quelques lignes de vous. Me trompé-je ? Adieu
Beauséjour, Samedi 12 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous êtes encore à Auteuil peut être et déjà il me semble que le monde entier est placé entre vous et moi, que l’éternité commence. Je me trouve bien lâche de vous avoir laissé partir. Dites-moi, répétez-moi, jurez moi que je vous reverrai bien portant le 26 ? Je n’aurai pas un instant de tranquillité jusque là. J’attends et j’espère Génie. J'ai oublié de vous dire que Lord Howden est arrivé hier matin de Londres, & qu’il est réparti hier au soir pour l'Espagne. On disait Barcelone, et un simple voyage de curiosité. Mais il ne fera autre chose.
Midi. Voilà Génie venu et reparti. Nous avons causé de tout. Et surtout de votre voyage car je l'ai sur le cœur bien lourdement. Votre mère lui a dit ce matin, qu'elle resterait 15 jours plus au Val Richer. et puis 3 jours à Tréport et puis Auteuil vers le 1er Septembre. J’ai affirmé que c’était impossible. Génie me trouve innocente. Tout ce voyage comme affaire est parfaitement inutile. Les bois cela pouvait être fait par tout autre. Raisonnablement comment et pourquoi aller à 80 ans se trimbaler, s'exposer à être malade. Vos enfants toujours malades en voiture. Vous aurez mille tracas. C’était une pure fantaisie de votre mère à laquelle vous n'avez pas su résister. Ici, comme affaires tout le monde s’étonne et trouve le moment singulièrement choisi. Vous même il y a quinze jours. encore vous n'y croyiez pas, parce que vraiment cela n’est pas sensé. Enfin Génie a été très abondant et éloquent sur cette matière, et encore une fois il est surpris de ce que je sois encore à apprendre que pour peu que votre mère ait une fantaisie, vous ne trouvez d’autre ressource que de vous y soumettre. Et bien tout cela m’attriste beaucoup, beaucoup. Je me figure mille choses de plus maintenant. Pourquoi avez-vous été si faible ? S’il lui arrive quelque chose, sera-ce une grande consolation pour vous de savoir que vous avez fait sa volonté quand cette volonté n’est pas raisonnable. Et Génie persiste à dire que de toutes les façons cela n’est pas raisonnable. Mon Dieu, mon dieu, revenez. Mais vous ne reviendrez pas, maintenant je vois bien que vous ne jugerez aucune question assez importante pour revenir. Mais le 26 vous me l'avez juré. Adieu. Adieu. Je ne vous écrirai que de tristes lettres. Je suis très très triste beaucoup plus triste encore qu’il y a une heure. Adieu. Adieu. Ne trouvez- vous pas que je suis quelque chose, aussi ? Adieu.
Mots-clés : Famille Guizot, Relation François-Dorothée (Dispute)
305. Val-Richer, Vendredi 1er novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous voilà dans le bon mois. En 1815, à Gand, Louis 18 sortant de son cabinet et traversant le salon, le matin même du jour où il répartit pour rentrer en France me disait : " Eh bien M. Guizot, nous voilà du bon côté de la glissoire. " J'aurai certainement, à vous retrouver, plus de plaisir que lui à reprendre la route de Paris. Que de joies différentes en ce monde, comme de douleurs ! J’en ai connu de toutes sortes ; et bien décidément c’est de l'affection que viennent les plus vives, les seules qui aillent toucher jusqu'au fond de l'âme, & l’ébranlent, et la satisfassent toute entière.
Je partirai le 13. Il n'y a pas moyen de presser davantage, ma mère. Je serai à Paris le 14 pour dîner, et je vous verrai dans la soirée. Il fait aujourd'hui un temps affreux, le vent, la pluie, le froid. Il fera beau, le 14. Je voudrais qu’il fit beau après-demain. J’ai tout mon Lisieux à déjeuner. Ce sont mes adieux. J’ai refusé absolument leurs dîners, leurs parties de campagne, leurs toasts. Ils m'auraient donné dix rhumes. Ils auront les primeurs de Ma route neuve. Elle est finie. On la livre dimanche matin à la circulation. Il ne me reste plus à faire qu’une avenue de la route à ma porte. On la fera cet hiver. L’entrepreneur me la promet pour le 15 avril prochain. Que les plus petites choses sont lentes quand il faut créer !
J’ai envie de quelque chose de M. de Bacourt. Je me crois sûr qu’il a entre les mains, je ne sais comment tous les papiers du comte de La Marck, (d’Aremberg) l’ami intime de Mirabeau et à qui Mirabeau laissa en mourant presque tous les siens, les plus confidentiels. Je voudrais bien voir, ces papiers. Je suis dans Mirabeau jusqu'au cou, par curiosité après Washington. Croyez-vous que je puisse demander à Mad. de Talleyrand de demander cela à M. de Bacourt ? Est-ce convenable ? Ou faut-il que je m'adresse directement à M. de Bacourt ?
10 heures
Votre lettre à votre frère est à merveille, très douce et très ferme, très précise. S'il a, comme j'en ai peur, oublié ou abandonné vos intérêts sur les points que vous touchez, il en ressentira quelque embarras... si quelque embarras est possible. Je n'hésite pas quant à vos fils, d'après ce que vous avez écrit à votre frère, vous devez attendre sa réponse avant de partager le capital. Vous vous le devez à vous-même. Je suis un grand partisan de la consistency. Si vous aviez renoncé à toute observation, il faudrait vider sur le champ l’affaire du capital. Mais vous avez voulu rappeler votre droit méconnu, constater du moins qu'on l’avait méconnu. Le capital est votre seul moyen d'action. Il faut le retenir jusqu'à ce qu’on ait répondu à vos observations, soit pour les accueillir quelque peu, soit pour vous dire nettement. que vous êtes liée par l’arrangement, et que vous ne devez attendre rien de plus. A votre place j’écrirais tout simplement cela à Alexandre. Mais comme ce sera Paul qui répondra par Alexandre, je comprends votre crainte de réponse inconvenante. Ne pourriez-vous pas écrire à Benkhausen, et le charger de dire à vos fils vos intentions ? Voilà mon avis à la première vue. Si quelque autre idée me venait, je vous la dirais demain.
Adieu. Adieu. A dater d'aujourd'hui les Adieux valent mieux. G.
306. Val-Richer, Samedi 2 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Vous avez bien raison ; il n’y a plus de belle campagne. Encore notre maladresse : vous avez eu de la belle campagne à Baden et moi en Normandie, et nous en avons joui séparément, si c'est jouir.
Je persiste dans tous mes avis d’hier. Si votre frère y mettait un peu de bonne volonté, il ne serait peut-être pas impossible que dans l'impatience du Capital, vos fils revinssent un peu sur le mobilier de Courlande, et l’argent en portefeuille. Ils vous donneront du moins quelques explications. Je ne vois que Benkhausen ou Cumming que vous puissiez charger de les leur demander. Encore une fois, si vous en écrivez à Alexandre, ce sera Paul qui répondra et Dieu sait comment. Pourtant j'ai en idée que toujours par impatience du Capital, il se contiendra dans ce moment, et vous fera peut-être même quelques avances. N’ont-elles pas déjà un peu commencé ? N'est-ce pas là le sens caché de ce que vous a dit Bulwer ? La tendresse de la dernière lettre d'Alexandre ne lui a-t-elle pas été permise ? Vous voyez que je vous dis tout impitoyablement. Je me trompe, avec une très grande pitié. Je trouve tout cela déplorable.
Le Roi fera bien avant de dissoudre son Cabinet sur les passeports de D. Carlos de s'assurer des successeurs. Mais nous sommes bien bons d'y regarder. Cela n’est pas sérieux. J'en reviens à mon dire ; j'aime la grande et vraie comédie, non pas la petite et inutile.
9 heures et demie
Je n'accepte pas le Shabby. Vous savez que je suis maîtresse de maison ménageant, arrangeant les personnes, les choses. Dieu sait si j'étais fait pour ce métier là ! Mais c’est lui qui m’y a condamné. Ma vieille et bonne mère ne peut pas être pressée. Elle est le contraire de M. de Talleyrand. Elle a de la grandeur naturelle, et de petites habitudes. Je respecte tout en elle. Croyez donc bien, sachez donc bien une fois pour toutes que moi, je n'ai jamais rien de plus pressé que de vous revoir, et que j’y pense, comme on pense à sa première affaire et à son seul plaisir. J’ai mille choses à vous dire que je ne peux pas écrire. Adieu. Adieu.
M. Rossi, ne sera pas Pair cette fois. La loi sur les catégories pour la Pairie n'admet que les membres des quatre académies de l'Institut, & il est membre de la 5e Académie, qui n’existait pas encore du moment où cette loi a été faite. C'est moi qui l’ai créée en 1832. Objection de procureur ; mais les procureurs sont puissants partout. Il attendra. Adieu encore et toujours. G.
301. Val-Richer, Lundi 28 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Je ne m'étonne pas qu’on soit furieux contre Maroto. Il a bien dérangé le comte de los Valles. Mais j'admire qu'on en veuille. tant au cordon d'Espartero. On tient donc encore plus au respect des cordons qu'au respect des Rois. N'avez-vous pas eu aussi vous-même un peu d'étonnement de ce cordon ? Pour moi, je vous l'avoue, s’il a fait grand plaisir à Espartero, si les Espagnols ont trouvé que c’était là pour lui une récompense, si une aune de ruban rouge, venu de France, a au delà des Pyrénées cette valeur, je trouve qu’on très bien fait. Je fais cas des cordons ; ils plaisent à quelque chose d’indestructible et de puissant dans la nature humaine ; mais je ne les respecte pas ; pas plus que je ne respecte l'argent. Ils sont comme l'argent, très bons à donner à ceux qui les aiment, et il faut savoir, chamarrer les hommes comme les enrichir. Mais je ne connais à l'emploi des cordons, qu'une limite ; c'est de ne pas les user au point qu’on ne les désire plus. Vous voyez qu’on n'en est pas là dans la Péninsule.
Ma mère est mieux. Elle vient de me faire dire qu’elle avait passé une bonne nuit. Je l’ai fait promener hier pendant deux heures au plus petit pas possible sous un ciel sans soleil mais doux et en causant du passé, cette vie des vieillards. Elle était contente, et le contentement est ce qu’il y a de plus sain à tout âge.
J’écris ce matin à Lord Brougham pour lui dire qu’une petite affaire qu’il m’avait recommandée vient d'être faite. J’ai bien envie de lui reprocher d'être revenu trop tôt. Il fallait nous donner trois jours, son expérience est manquée. J'ai peur qu’il ne lui en reste qu’un ridicule de plus. Je suis bien aise que ce mariage Appony soit tout-à-fait arrangé, et que vous ayez votre nièce près de vous. Peut-être en ferez-vous quelque chose ?
Votre anglaise vous plait donc. Est-ce plus qu’une bonne d'enfants ?
Vous devez avoir les Pairs ce matin, au Moniteur. M. Rossi est le seul qui m'intéresse. A sa place, j’aurais mieux aimé attendre qu’une porte s'ouvrit à la Chambre des Députés. Mais qui sait attendre ? Il sera bien partout. Il est du très petit nombre des hommes qui ont assez d’esprit pour que je regrette que vous ne les connaissiez pas.
10 heures
J'ai beau faire, je ne tousse pas. Mais il fait froid. Vous n'êtes pas plus pressée que moi. Je monterai l’escalier de cet entresol avec tant de plaisir ! Je n’ai pas plus de nouvelles que vous. Je vous envoie le peu qui m’arrive. Adieu. Adieu, Adieu. Je suis bien aise que vous vous soyez reposée hier. Vous aviez l'air fatiguée. G.
302. Val-Richer,Mardi 29 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je me lève tard. Décidément le froid s’établit. Je fais des feux énormes, qui ne me réchauffent pas autant que le plus petit feu au coin de votre cheminée. Votre appartement sera très chaud. Sous le règne de M. de Talleyrand c'était une étuve. Mais vous êtes une Reine du Nord. Vous ouvrez les fenêtres.
Est-ce le frère de Bulwer qui vient à Paris à titre de commissaire pour les négociations commerciales ? Il me semble que toute la famille le pousse. Je n’ai pas lu un seul des romans qu’ils ont faits car ils en ont fait tous deux, si je ne me trompe. Les connaissez-vous ? L'Empereur devrait bien ne pas perdre son argent aux sottises du Capitole. Si peu qu’il en donne, elles ne le valent pas. Il y a une région où les souverains font très bien de semer l'argent ; il y fructifie. Mais trop bas, il ne sert absolument à rien. Que de pauvretés je vous dis là ! J’ai pourtant beaucoup mieux à vous dire.
10 heures
Comment ? Votre aigreur pour votre appartement avait été jusqu'à Lady Granville. Je suis ravi qu’elle soit ravie. Je veux que vous soyez très bien. Je me plais à penser que vous resterez là toujours, que je vous y soignerai toujours, que vous y mènerez une vie douce, agréable. J’arrange l’agrément de cette vie. Je cherche ce qui pourra s’y ajouter. Vous n’avez pas d’idée de l'activité de mon imagination sur les gens que j'aime. J’ai tort de dire sur les gens. Il n'y a pas de pluriel en ceci.
Les mêmes nouvelles que vous avez sur l'Impératrice, me viennent par notre gouvernement. On s'attend à une fin, très prochaine. J’ai une immense pitié pour un tel malheur, n'importe sur quelle tête.
Ma mère est décidément beaucoup mieux. C’est une affaire que de lui faire quitter la campagne où elle se plaît beaucoup, et où elle se persuade qu'elle est mieux pour sa santé parce qu'elle marche et se promène. Cependant il est déjà convenu que nous serons à Paris pour le milieu de Novembre. A présent, je prépare la fixation et l'avancement du jour. Ce que je dis là n’est guère français. Mais peu importe. Vous parlez des tracas de votre intérieur. Ce n’est rien du tout que les tracas de meubles. J’aimerai mieux avoir à arranger trente salons que trois personnes. Henriette m’aide déjà en cela. Elle est pleine de tact sur ce qui peut plaire ou déplaire, embarrasser ou faciliter. Elle a l’instinct de la conciliation.
Adieu. Adieu. Je suis au coin du feu, j’ai les doigt gelés. Mais seulement les doigts. G.
276. Val-Richer, Mercredi 25 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mes hôtes me quittent ce matin. J’en suis bien aise. J’aime mieux la solitude que l'ennui des hommes. D'ailleurs, je parle de solitude, bien à mon aise au milieu d’une famille nombreuse, et animée, et qui m’aime. C’est curieux à quel point on se laisse aller à se servir des mots complaisamment pour soi-même et sans prendre la peine de regarder, s’ils sont vraiment vrais.
Je me séparerai aussi cette semaine de Washington. Je vais finir. A regret. C’est une grande âme, et qui a fait bien simplement de grandes choses par de grands motifs. J’ai pris plaisir à vivre en intimité avec lui.
Voici ce que m'écrit de Londres un jeune Dillon, homme d’esprit établi en France par mes soins et qui est allé y passer quinze jours. Il connait bien du monde.
I have been several influential Whigs who are unonimous in regarding their cause as in the atmost peril. The Tories must get into office within a very short space of time. They have been gaining ground slowly but surely within the last twelve monthes. Tthe blunders of L. Palm and the excesses of the Chartists have frightened many among the moderate Whigs into the arms of the Tories. The great and indeed, the only support of the Ministry are the Irish party and the court ; but both are, as you know, far from popular en England. The affair of Lady Flora Hastings, has decidebly brought the Queen into great national disreporter. It is almost needless to speak of the detestation in which O'Connell, the priests and the entire Irish party are held by the great bulk of the English and scotch people. It is a sort of phrenzy, the like of which has not bien witnessed since the days of the League or the Paritans. Really, were it not for a few scattered rays of the philosophy of the 18th century that occasionnally illumine the intellectual gloom ot the British Empire we should witness today scenes that have not been surpassed even by the Inquisition. The fanaticism of the Tories is not one bit greater, than that of their antagonists, tre Papists. Both would burn, main and crucify, il they could, as in the old orthodox times of Bonner or of King Edward. The Tories have great advantage, on their side. They have wealth, talent and political organization. They are, if we forget for a moment, the crudity of some of their political tonets an admirable model as a political party. Still, although, they seem destined to enjoy a passing triumph soon, they will, I feel convinced, be ultimately discomfited. O'Connell is a knotty block. He yields to none of the Tories, in energy, and he has proved himself latterly te be an able statesman. As he is hardened against defeats, 80 he is not likely to be intimidated by that with which he is now menaced. His cause is a good one, and he has behind him seven or eight millions of miserable but resolute zenlots in whose hands the British Constitution has latterly placed a formidable and destructive weapon. O'Connell backed by these will always be able to elog and retard the working of the British constitution. The English people who are not disposed to drive Ireland into open insurrection, will at length grow tired with these and similar embarrassments. They will seek again to remove them by destroying their cause, and a tardy justice will at length be rendered to Ireland.
En voilà bien long. J’ai fini parce que j’avais commencé. Mais pour un jeune Irlandais, ce n'est pas mal de pénétration, et de sens. 9 h. 1/2 Je suis charmé que vous ayez enfin ce bail. Et si Jennison ne veut rien vendre, ce ne sera que mieux. Vous vous meublerez tout-à-fait à votre gré. Plus le Cabinet deviendra radical, plus les Torys acquerront de chances. Adieu. Adieu. Je n’ai pas de soleil aujourd'hui. Mais l'adieu est le même. G.
275. Val -Richer, Mardi 24 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais avoir le talent de tout lire. Vous me coûtez la perte de cette illusion. En retour vous me faites connaitre un singulier monde. Sous Louis 14 même sous Louis 15 beaucoup de femmes, de très bonne compagnie, ne savaient pas l'Orthographe ; ma belle-mère Mad. de Meulan était encore de ce nombre ; mais elles étaient spirituelles, élégantes ; à travers l’irrégularité de leurs phrases elles avaient le cour d’esprit fois, délicat ; la grande civilisation était partout, excepté dans leur grammaire.
Cuisinière au fond et dans la forme, c’est drôle pour votre sœur ; passez moi la brutalité de l’expression. Du reste, à force d’étude, j’ai tout lu, excepté les mots que j’ai soulignés. Ayez la bonté de m'en envoyer l’interprétation pour que la peine que j’y ai prise ne soit pas tout-à- fait perdue.
Je suis curieux de savoir comment on s'y prendra pour vous empêcher d'avoir l’argenterie qui vous convient, quand vous ne la demandez qu'en en payant la valeur, au taux de l'estimation. Est-ce que Paul veut aussi l'avoir et l'emporter en Angleterre ? Je vois qu’on trouve tout simple, votre frère même, qu’il ait donné sa démission. Je suppose que c’est la nomination de M. de Brünnow qui l'a déterminé et lui sert d'excuse auprès des moins rebelles. Plus j’y pense, plus il me semble que puisque vous avez demandé les letters of adm., ce que vous avez de mieux à faire, c’est de donner vos pleins pouvoirs à Rothschild, et de faire toucher, par lui, le capital, quand vos fils seront arrivés, à Londres, de telle sorte que jusqu'à leur retour l’argent reste où il est, et que vous et eux, vous touchiez chacun votre part au même moment, mais par votre fondé de pouvoirs direct. Il n'y a là, si je ne me trompe, rien à dire pour personne. Et c’est plus sûr.
9h 1/2
Il me paraît impossible que Démion soit menteur à ce point. Il n’a point d’intérêt commun avec M. de Jénnison. Son intérêt à lui, c’est que vous ayez l’appartement. Vous êtes un bon locataire. Vous me direz cela demain. Certainement, si j'étais là, vous auriez l’appartement. Vous auriez tout ce qui vous plairait. Dîtes-le moi toujours. Je suis charmé de le croire.
Adieu. Adieu. J’ai deux lettres d'affaire à répondre sur le champ. Adieu. G.
235 . Val -Richer, Lundi 5 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai trouvé hier en arrivant que votre 228. Vous voulez que je vous pardonne votre abattement. Je vous pardonne tout. Mais que sert le pardon ? Pas plus que ne ferait le reproche. Vous me donnez un sentiment auquel je suis peu accoutumé, celui de l’impossibilité, sentiment très pénible à placer à côté de beaucoup d'affection. Je ne sais pas si je l’accepterai jamais. Mais nous sommes trop loin pour que je vous dise tout ce que je voudrais ce que je devrais peut être vous dire. Je compatis peu, je l'avoue à votre ennui d’un notaire, deux témoins pour un nouveau plein pouvoir qui finira tout promptement. Finir promptement, c'est votre salut, c'est votre repos ! Je ne l'espérais pas. Et quand mon attente est trompée en bien, je suis un peu content et un peu reconnaissant envers la providence. Une faveur si rare? Jamais peut-être je n'ai plus désiré vous voir et causer avec vous qu'aujourd'hui. Je ne sais si tout ce que je vous dirais vous paraîtrait doux ; mais je suis sûr que ce serait sain pour vous. Car encore une fois, je vous aime trop pour accepter, l'impossibilité.
Parlons d’autre chose. Est-il vrai, comme on me l'écrit, qu'il est question d’un voyage de l'Empereur à Odessa avec le grand duc et M. de Nesselrode ? Personne ne peut prévoir aujourd'hui ce qui arrivera de ce côté. Un enfant Roi, une vieille Sultane-mère, deux jeunes négresses-maitresses, un vieux vizir haineux, un vieux Pacha vainqueur, toutes les habiletés de l’Europe diplomatique ne gouverneront pas cela. Nous sommes au hasard. La discorde est grande dans la gauche. Les projets de réforme électorale déplaisent à la plupart de ceux qui les acceptent, & ne sont pas acceptés de ceux à qui ils voudraient plaire. Ce sera, pour la prochaine session, un grand et bon champ de bataille. Je voudrais que ces deux questions, la réforme électorale et l'Orient restassent un peu longtemps sur le tapis. Nous avons besoin, pour nous former, de questions graves, pressantes, mais suspendues sur nos têtes, qui menacent de devenir, et ne deviennent pas tout à coup de grands événements. J’aurai probablement cette satisfaction.
Ma mère est mieux, et mes filles très bien. C’est demain, 6 août, le jour de naissance d'Henriette. Il y a dix ans. J’étais bien heureux !
9 heures
Voilà le n° 229. Je répondrai demain avec détail sur votre affaire du capital anglais. Je veux revoir le texte des lois. Mais en principe, il ne nous importe pas qu’on soit ou non étranger. Les biens de toute espèce, meubles ou immeubles qui se trouvent sur notre territoire sont régis par nos lois quelle que soit la nationalité du possesseur. Il me manque en effet beaucoup. Vous avez pleine satisfaction. Adieu. Adieu. G.
191. Val-Richer, Mardi 4 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous voudrais comme ma vallée, fraiche et riante. Je la regarde avec envie en pensant à vous. Et bientôt je ne la regarde plus ; je ne pense plus qu'à vous. Je vous vois maigre, triste, desponding, en larmes. Et pourtant je ne retourne pas à ma vallée ; je reste avec vous. Je resterai toujours avec vous.
L’annulation de l'élection de M. d’Houdetot, réélu à si grand'peine, est un petit incident fort désagréable au château. On en a été très piqué. Il ne faut pas avoir tort en face de ses ennemis Mr d’Houdetot avait tort. C’est l'erreur des gens de cour, puisque cour y a, de croire qu'ailleurs aussi, ils auront le privilège de la faveur. Il y a des favoris partout, mais non partout les mêmes. Les esprits impartiaux, les honnêtes gens ont voté contre M. d’Houderot. Le pire, c’est qu’il ne peut plus se représenter puisqu’il n’est pas éligible. Le choix tombera probablement sur un homme de l'opposition.
Il paraît que le procès aura lieu décidément vers le milieu de Juin. On le presse ; on ne veut pas que, s’il doit y avoir des exécutions, elles soient trop voisines des fêtes de Juillet ; et très probablement il y en aura. L'assassinat est prouvé, dit-on, contre deux des accusés, et des principaux. L’un, le nommé Barbès a tué de sa main l'officier qui commandait le poste du Palais de justice, l'autre Milon, Miron, je ne sais pas bien, a fait fusiller trois soldats, après avoir enlevé un corps de garde. Plusieurs témoins les reconnaissent.
Après les fêtes de Juillet, le Roi veut aller à Bordeaux. Il a formé plusieurs fois ce projet. Je doute qu'il l'exécute encore. Cependant il le promet. Bordeaux le demande beaucoup, et comme une réparation. Ils disent que jamais Roi ou Empereur ne les a laissés neuf ans sans aller les voir. Le Maréchal Vallée avait demandé plusieurs fois à être rappelé. On s'est montré disposé à le lui accorder. On lui aurait donné le Général Cubieres pour successeur. Il ne s'en est plus soucié, et il reste. J’en suis bien aise. A travers toutes les manies d’un esprit systématique et d’un caractère insociable, c’est un homme honnête, capable et prudent. Qualités dont notre établissement d'Afrique à grand besoin. Je m'intéresse à cet établissement. Je m’en suis beaucoup mêlé.
Mon sac est vidé, madame. Bien petit sac cette fois, et probablement souvent jusqu'à ce que je retourne à Paris. On ne m'écrit guères les petites choses, et il n’y en a pas de grandes. Vous n’avez probablement jamais ouvert un livre intitulé : Historiettes de Tallemant des Réaux. C'était un abbé du 17e siècle qui écrivait tous les soirs tout ce qu’il avait entendu dire sur toutes les personnes dont tout le monde parlait. Il a écrit ainsi six gros volumes curieux et amusants, quoique pleins d'énormes sottises. Quelqu'un de votre connaissance, mon Génie, se donne le même plaisir sur notre temps. Il laissera des volumes beaucoup plus convenables, j’en suis sûr que ceux de l'abbé Tallemant, et peut-être assez piquants. On oublie beaucoup trop en ce monde. En attendant de vraies nouvelles d'Orient, j’ai apporté ici et je lisais tout à l'heure l'ouvrage de M. Urquhart de la Turquie et de ses ressources. Savez-vous au juste quel cas on fait à Londres de l'auteur ? Le livre me semble bien vide, avec de grandes prétentions.
Adieu pour aujourd'hui. Je vous quitte pour aller assister à des plantations de fleurs ; je devrais dire coopérer. Je transporte le jardin du Roi au Val-Richer. Je mentirais si je disais que cela ne m'amuse pas du tout ; et je mentirais bien davantage si je disais que cela m'intéresse vraiment. On peut vivre superficiellement ; mais il n'y a pas moyen de s’y tromper. Pour moi, je n'y prétends pas.
Mercredi 7 heures Depuis que je ne vous vois plus, ma perplexité est extrême. Je suis bien plus inquiet ; j'ai besoin que vous me rassuriez, et j'hésite à vous le demander, à vous occuper de votre santé. Convenons d'une chose ; c’est que vous me direz tout, absolument tout ; je n'ignorerai aucun détail, ni aucune de vos inquiétudes. Ce sera comme si je vous voyais, sauf le plaisir de vous voir. A cette condition, je ne vous agiterai pas, de mon tourment. J’attends presque avec humeur le moment où j’attendrai vos lettres à jour fixe. En aurai-je ? N'en aurai-je pas ? Cette ignorance m'est insupportable. J’en ai encore pour huit jours avant que vous vous soyiez posée, que je le sache du moins et que jen éprouve l'effet. Où êtes-vous en ce moment ? à Vitry, je pense. Vous vous levez. Vous allez partir pour Nancy. J’ai fait cette route-là, il y a douze ans, le cœur bien déchiré. Je conduisais à Plombières ma femme mourante.
Que notre âme est étrange, & tout ce qui s’y passe dans le cours de la vie ! Quels contrastes, quels désaccords, impossibles à concevoir ensemble, et qui coexistent pourtant & s'effacent et disparaissent dans cette mer du temps qui couvre de son uniformité tout ce qu'elle engloutit Adieu. Adieu.
9 heures. Voilà le facteur, et deux lettres de Paris qui ne m’apportent rien à vous envoyer. Adieu encore.
190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
189. Paris, Lundi 4 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
96. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon rhume de cerveau s’en va. Je ne vous éternuerai pas au nez en arrivant. Le serein, dans ce pays-ci est une véritable pluie. Je le dédaignais trop. Depuis deux jours, j’y ai pris garde, je suis rentré de bonne heure et je m’en trouve très bien. Mes enfants y ont gagné une plus longue lecture, des Tales of the Crusaders de Walter Scott. C’est leur grand plaisir du soir. Plaisir d’une vivacité singulière. Les impressions vives, des hommes causent toujours un peu d’inquiétude. Elles auront des conséquences. Celles des enfants n’en ont point. Le plaisir passé, tout est fini. Aussi le spectacle en est très agréable. Hier soit le charme du sujet, soit vraiment le mérite du lecteur, ma petite Pauline s’est écriée tout à coup avec ravissement : " Mon père, que tu lis bien." Et je l’ai embrassée de tout mon cœur. C’est charmant d’être loué par ses enfants.
Je suis bien aise que M. Ellice reste à Paris jusqu’à mon arrivée. J’aurai peut-être aujourd’hui ou demain une réponse sur sa commission. Vous ai-je dit que j’avais dit à M. Lorain, proviseur du Collège St Louis et mon délégué pour cette affaire de passer chez vous, dès qu’il aurait trouvé quelqu’un pour vous donner l’adresse du précepteur et quelques renseignements à son sujet ? Savez-vous les détails de la conclusion ou à peu près du différend entre Berlin et Rome ? La Cour de Rome s’est conduite avec une Sagesse et une habileté consommée. Après avoir publiquement donné sur les doigts au Roi de Prusse, qu’elle prenait en flagrant délit de mensonge et de violence, elle a, sans la moindre humeur, engagé M. de Buntzen à aller un peu se promener un peu loin. Puis elle a vertement tancé l’archevêque de Posen, lui a demandé de quoi il le mêlait de vouloir imiter l’archevêque de Cologne, & lui a ordonné de se tenir tranquille et d’obéir au Roi, comme par le passé. Puis elle a reconnu l’administration provisoire du Diocèse de Cologne nécessaire à défaut de l’archevêque absent en voyage, n’importe où. Puis enfin, elle a dit au Roi qu’elle avait pourvu à tout, qu’il pouvait garder l’archevêque en prison tant qu’il voudrait, qu’elle n’en parlerait plus, que le jour où il ne se soucierait plus de garder l’archevêque, elle l’en débarrasserait en le faisant Cardinal. Voilà le bruit fini, la contagion arrêté, & le Roi de Prusse obligé d’être content, quoique déjoué dans ses petits arrangements secrets avec quelques uns de ses Évêques et fort embarrassé de son prisonnier. Rome n’eût pas mieux fait, il y a cinq cents ans. A la vérité, elle ne se se serait probablement pas contentée à si bon marché.
10 h. ¼
Le N°98 m’arrive entre une visite qui s’en va et une visite qui vient. Vous savez que le Dimanche est mon jour de corvée. J’aurai beaucoup de monde aujourd’hui, à cause de mon prochain départ. Car je pars le 30 et je serai rue de la Charte, le 31. Je devais en effet prendre le 5 août la société des Antiquaires, mais sa séance est remise à le fin d’août, toujours à cause de mon départ. Il a dérangé beaucoup de choses et de gens. Mais ce qu’il arrange, choses et gens, vaut mieux que ce qu’il dérange. Je vois à ma visite. Adieu. Here’s the place exactly. G.
87. Val-Richer, Samedi 14 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
De douces paroles! Je ne vous en enverrai jamais, je ne vous en ai jamais dit d’assez douces à mon gré. Vous craignez que je ne sois mécontent. Non, je ne suis pas mécontent. Je vous aime trop et je vous connais trop bien pour l’être jamais. Mais je suis triste : triste comme je ne puis pas ne pas l’être ; triste aussi peut- être comme je pourrais ne pas l’être. Je vous ai demandé un jour comment on faisait pour avoir de l’humeur sans en avoir contre quelqu’un. Je ne puis admettre qu’à cause de notre séparation vous ayez de l’humeur contre moi. L’an dernier du 15 juin à votre retour d’Angleterre, parmi mes inquiétudes, en voici une qui me préoccupait beaucoup. Si notre intimité devient complète, parfaite, comment nous accommoderons-nous de ce qu’il y a d’incomplet et d’imparfait dans notre relation ? Si nous devenons vraiment nécessaires l’un à l’autre comment supporterons-nous d’être jamais séparés ? De jour en jour, je vous découvrais plus capable d’une intimité parfaite et de tout son bonheur, et plus incapable d’accepter dans ce bonheur la moindre imperfection, la moindre lacune. Je vous en aimais chaque jour davantage et mon inquiétude croissait avec ma tendresse. Un jour, mon inquiétude a disparu. Je n’y ai plus pensé. Nous avions été sitôt et si longtemps séparés ! La séparation était notre état habituel. Je n’ai plus pensé qu’à la joie de notre réunion. J’en ai joui avec une confiance aveugle comme on jouit du bonheur ; on ne prévoit plus rien, on ne s’inquiète plus de rien ; il absorbe l’âme. Mais, vers le printemps, mon inquiétude est revenue, et revenue très vive. Mon attachement pour vous était devenu bien plus sérieux et bien plus tendre. Je vous connaissais bien mieux. Vous ne savez pas à quel point, tout l’hiver, de près, de loin, chez vous, chez moi, seuls, ensemble ou dans le monde, vous avez été constamment présente à ma pensée, l’objet constant de mon observation, de ma réflexion, de ma contemplation, de ma sympathie. Vous, la créature la plus noble, la plus fière, placée le plus haut et en même temps la plus facile à froisser, la moins propre à lutter contre le sort, la plus près de fléchir sous le fardeau ! Des sentiments si profonds, et des impressions si mobiles ! Avec tant de supériorité, pouvant si peu pour vous-même! Tant de haut dédain, et une telle impossibilité de se résigner à la souffrance, à la contrariété, à la difficulté ! Une dignité si inaltérable avec une si vive impatience contre tout ennui, tout obstacle, tout mécompte ! Je suivais tous vos mouvements; j’assistais à toute votre âme. Quel ravissant bonheur de veiller de tous côtés, à toute heure, sur cette âme si haute et si tendre, de la satisfaire pleinement, de répondre à toutes ses exigences à ses plus secrets désirs de perfection dans l’intimité ! Et en même temps de protéger constamment efficacement, cette personne si peu faite aux combats, aux épreuves. J’écarte d’elle tout mal, tout effort, de la faire vivre à l’abri d’un impénétrable bouclier, de tendresse et de soin ! Je revois tout cela avec un désir tous le jours plus vif de réaliser mon rêve. Et tous les jours, tantôt un incident indifférent en apparence, tantôt une parole de vous venait déjouer mon désir et me pénétrer de la crainte que mon rêve ne pût se réaliser. J’étais dans cette disposition pleine d’anxiété, quand le moment de notre séparation est venu.
Je ne pouvais pas hésiter. Ma mère, mes enfants attendaient impatiemment la campagne. C’est leur plaisir. C’est un grand bien pour leur santé. Ils y comptaient. Ma mince fortune, dont il faut bien que je m’occupe pour eux m"en obligeait. Je ne suis promis que dans ma vie publique, jamais, même pour mes enfants, les considérations de fortune, n’exerceraient sur moi la moindre influence. Raison de plus pour que j’en tienne quelque compte dans la vie privée. Je vous ai quittée, en essayant d’étouffer près de vous mon chagrin pour vous aider à étouffer aussi le vôtre. J’ai eu tort. Si vous aviez vu ce qu’il m’en coûtait de vous quitter, votre chagrin fût resté le même ; mais une minute d’injustice, une minute d’humeur contre moi eût été impossible. Dites-moi que vous n’êtes pas injuste, que votre humeur ne s’adresse pas à moi, pas du tout à moi, qu’elle porte uniquement sur l’imperfection, l’amère imperfection de notre relation, de notre destinée. Dites-moi cela ; pensez le toujours. Et même loin de vous-même sous ce fardeau si lourd de l’absence, je me sentirai le cœur confiant et fermé ; je reprendrai mon rêve, le rêve de vous rendre heureuse, heureuse malgré tout ce qui nous manque, malgré nos cruels souvenirs, heureuse à force d’être aimée, et bien aimée. Oui, bien aimée. C’est la plus douce parole que je sache écrire, et qu’elle est loin de la réalité ! Adieu G.
Dimanche matin 8 heures
Je porterai moi-même ce matin cette lettre à Lisieux. Je vais passer la journée à la campagne à Combrée. Que de choses je voudrais vous dire ! Rien ne me contente. Rien n’est assez tendre, assez vrai. Rien me dit tout ce que j’ai pour vous dans l’âme. Vous avez besoin que tout soit parfait autour de vous. Et je suis sûr que si j’étais toujours là, libre de tout faire & maître de tout arranger, tout serait effectivement parfait selon votre désir. Et je ne suis pas là ! Et même quand j’y suis, je ne puis pas tout ce que je pourrais ! C’est un sentiment très douloureux. Et pourtant je m’y résigne pour moi. Laissez-moi espérer que vous vous résignerez aussi comme on se résigne. Acceptons ensemble avec une commune tristesse & une commune tendresse ce qui manque non pas à notre intimité mais à notre bonheur. Supportons le ensemble, avec une confiance sans mesure l’un dans l’autre, afin de jouir ensemble de ce que nous avons. Adieu. Adieu. Je voudrais que tout mon cœur pût passer dans cet adieu. Il serait bien doux. 10 heures ¼ Je reçois votre paquet en montant en voiture, pour ma course. Merci. Merci. Je vais lire tout cela, en roulant. Il ne fait plus chaud. J’espère qu’il en va de même à Paris. Je n’aimerai bientôt plus le chaud. Adieu. Adieu.
75_1. Val-Richer, Dimanche 1er juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Comment feriez-vous, sans bateau, sans filet, sans ligne, sans hameçon, pour prendre deux ou trois cents carpes, truites, tanches ? Je vous le donne en tout. Toute votre habileté à résoudre les questions d’étiquette diplomatique échouerait contre ce problème là. Moi, j’ai la recette. Ayez un jardinier intelligent, mais paresseux et un peu libertin. Grondez le bien fort ; plaignez vous que votre étang soit sale, votre potager mal tenu. Dites lui, mais bien sérieusement que vous le renverrez si d’ici à trois mois, vous n’êtes parfaitement contente de lui. Allez-vous promener le soir, au bord de l’étang. Le jardinier est là, occupé à faire baisser l’eau pour nettoyer le fond. Une carpe saute. Mes enfants sautent aussi : " Quel dommage de ne pouvoir la prendre ! ". Belle occasion pour rentrer en grâce auprès du père. La barre qui retient l’eau est soulevée. L’eau se précipite. Le jardinier y entre jusqu’à la hanche. Le poisson fourmille dans le creux où l’eau reste encore. Le bruit s’en répand. Tous les gens arrivent hommes, femmes, bonnes. Les hommes entrent tous dans l’eau. Je m’assois au bord avec ma mère, mes enfants, Mad. de Meulan, Melle Chabaud. On commence contre les poissons une vraie chasse à courre. On les poursuit ; on les saisit. Les gros se débattent ; les petits glissent entre les doigts; les plus avisés se tapissent dans la vase. Les chasseurs s’animent au jeu ; on se presse, on se pousse ; l’eau rejaillit sons les pieds, sous les mains. La joie de mes enfants, est au comble. Ils bondissent autour de l’étang. Ma mère rit de bon cœur. Je ris aussi. L’espoir revient au cœur du jardinier. Il redouble d’efforts d’adresse. Tous les gens le secondent ; et en moins d’une heure, les deux ou trois cents carpes, truites sont entassés dans des seaux, des arrosoirs et transportés dans un petit vivier où elles resteront jusqu’à ce que l’étang soit bien nettoyé, l’eau bien revenue ; et elles ne sauront jamais que cinq minutes de ma mauvaise humeur et un quart d’heure de gaieté de mes enfants, leur ont seules valu cette aventure. Vous me demandez ce que je fais au Val Richer. Le voilà. Cela vaut bien les mille et 14 visites de Mad. de Strogonoff. Le singulier peuple ! Si sérieux et si frivole ! Si indépendant et si esclave de la mode, d’un jour de mode ! Je ne l’en estime et ne l’en aime pas moins.
J’aime qu’on soit capable des impressions les plus variées, raisonnable trois cents jours au moins, fou les 60 autres. Pourtant 60 c’est trop, n’est-ce pas ? Les Anglais n’en donnent pas tant à la folie. Je soupçonne qu’il y a beaucoup d’ennui dans la leur. C’est la plus mauvaise des raisons de folie. Du reste, on dit que la folie anglaise est grave, symétrique, taciturne. Est-ce vrai ? En ce cas, elle ne ressemble guère à cette de mes enfants et de mes gens ce soir. On ne s’est jamais amusé plus bruyamment. Il est vrai qu’ils ne s’ennuyaient pas du tout auparavant et qu’ils ne s ennuieront pas du tout demain. La gaieté est leur état habituel.
Lundi 8 heures
Pourquoi n’avez-vous pas encore été voir la petite Princesse ? Il me semble qu’elle est sur son déclin. Ne la négligez pas tout-à-fait. C’est votre voisine. Elle vous est plus commode, et à tout prendre, plus agréable que bien d’autres. Ne me dites pas que vous avez le dégoût de toute chose et de tout le monde. C’est une parole corruptrice pour moi si douce à entendre que j’en oublie tout remords. Et pourtant, je veux que, lorsque vous n’avez plus que tout le monde, vous ne soyez pas trop seule, ni trop triste. Oui, je le veux, par vertu, par tendresse, et aussi, et surtout parce que j’ai la confiance que tout le monde ne peut rien me faire perdre, même quand il vous amuse. Pour la première fois depuis que je suis ici, le ciel est parfaitement pur. Le soleil brille. Toute la vallée s’épanouit. Toute sa population, hommes, bêtes, oiseaux, va, vient, vole, travaille, ou broute, ou chante, librement, gaiement. Moi, je regarde. Ma gaieté à moi n’est pas là, ne me vient pas de là. Il y a plus de joie pour moi dans le petit cabinet étouffé, sur la petite chaise basse de la rue de Rivoli qu’au milieu de tout cet éclat, de tout ce sourire de la nature.
10 heures
Voilà le n°78. Je trouve comme vous la poste très peu civilisée. On me fait espérer une amélioration. Le courrier ne partirait plus de Lisieux que vers le soir après le retour du facteur du Val-Richer en sorte que vous auriez toujours mes lettres le lendemain, mais je proteste contre les cuvettes. Je me suis toujours lavé les mains jusqu’au dessus du poignet. Adieu. Mais dormez donc. G.
172. Val-Richer, Samedi 27 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’étais très fatigué hier soir je ne sais pourquoi. Je me suis couché avant 10 heures. Aussi je me lève à 6. J’ai bien dormi. Je voudrais bien qu’à vous coucher de bonne heure, vous eussiez le même gain. Comment vont vos nerfs ? La lecture en me couchant dans mon lit est pour moi, un moyen de sommeil à peu près infaillible. N’est-il plus du tout à votre usage ? Peut-être pourriez-vous vous faire lire quelques minutes par votre femme de chambre. Du reste, il me semble que ce n’est pas au moment où vous vous couchez que le sommeil vous manque. Ma mère, qui dort très mal et se réveille sans cesse dans la nuit, se rendort souvent en lisant. A la vérité elle a conservé de très bons yeux. Je ne suis pas bien content de sa santé depuis quelque temps. Elle n’est pas encore remise de l’ébranlement que lui a causé la mort de Mad. de Broglie. Je suis bien aise de la ramener à Paris. Ici. avec du temps, les sœurs ne me manqueraient pas ; il y a de bons médecins à Lisieux. Mais pour quelque mal prompt et inattendu, trois ou quatre heures d’attente sont beaucoup trop. Le départ de ma maison a commencé hier. Cette amie de ma mère dont je vous ai quelquefois parlé Melle Chabaud nous a quittés. Elle a été pour mes enfants, pendant tout son séjour d’une bonté aussi utile qu’affectueuse. Je ne puis la remplacer pour le piano d’Henriette, mais je me suis chargé de la leçon d’Anglais d’ici au 5 novembre. Nous lisons ce qui se peut lire de Shakespeare. Je ne voudrais pourtant pas nourrir mes enfants de cette lecture-là, même de ce qu’il y a de bon. C’est trop fort et trop brut. Il y a trop d’émotion et pas assez de perfection. Il faut, à de jeunes esprits quelque chose de plus serein et de plus achevé.
Mad. Graham reprend ses raouts de bien bonne heure. Il y a donc déjà beaucoup d’Anglais à Paris. Vous les aimez toujours beaucoup, c’est sûr ; mais si je ne me trompe, ils sont bien vite usés pour vous. Excepté, Lady Granville, s’entend. J’ai peur que Paris ne soit pour vous comme la cour, selon La Bruyère, " pays où l’on n’est pas toujours bien, mais qui empêche qu’on ne se trouve bien ailleurs. " Les journaux démentent la retraite du comte Woronzoff. ont-ils raison ? Il me semble que l’Orient s’apaise. Pourtant la question a fait un pas. L’Angleterre a jeté un grappin de plus & vous êtes mécontents. Qu’y a-t-il de sérieux dans son traité de commerce avec l’Autriche et dans ces bouches du Danube ? Mettez-vous à cela beaucoup d’importance ? Lord Grey a raison de trouver que son gendre a été indignement abandonné. Mais ni Lord Melbourne, ni Lord John ne pourraient faire autrement. C’est leur situation comme celle de notre cabinet, de faire, ce que d’autres ne voudraient pas faire, de supporter ce que d’autres ne voudraient pas supporter. Vous savez le mot du Prince de Talmont aux soldats qui allaient le fusiller : " J’ai fait mon devoir ; faites votre métier. " Il y a des Cabinets qui font leur devoir, d’autres leur métier.
10 heures
Je vous dirai adieu comme à l’ordinaire, à moins que vous ne vouliez pas. Mais aujourd’hui, en ce moment je ne vous dirai pas autre chose. Moi aussi, je vous blesserais, et je ne veux pas. Adieu. Je ne sais pourquoi il convient à M. de Broglie de dire qu’il n’a jamais songé à bouger de Paris. Non seulement il m’en avait parlé, mais il l’a écrit à ma mère.
101. Val Richer, Samedi 28 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon dernier mot. Il sera court. Ni ma joie, ni mon chagrin ne sont bavards. Pourvu que je vous trouve bien portante ! Votre mal aise m’a préoccupé tout le jour. De quoi vous parlerais-je ? J’ajourne tout à mardi. Ce jour là, je n’aurai point encore de jury. Tout mon temps sera à moi. Pourquoi donc, est-ce que je vois encore dans les journaux que Lord Granville a été chez le Roi ? Est-ce qu’il n’est pas parti pour Aix ? J’attends Génie ce matin. Il vous aura vue. C’est quelque chose quelqu’un qui vous a vue, en attendant que je vous voie moi-même. Je laisserai mes enfants très bien et ma mère assez bien. La santé de ma mère, me préoccupe beaucoup. Elle est heureuse. Elle l’a si peu été ! Elle jouit vivement de l’affection de mes enfants. Ils remplissent son temps et son âme. La campagne lui plaît. J’espère que le soir de sa vie se prolongera au milieu de ces impressions douces. Et elle m’est si nécessaire pour mes enfants ! A travers beaucoup de petites choses qui manquent et qui m’impatientent quelquefois, toutes les grandes y sont et me donnent une sécurité habituelle que rien ne pourra remplacer. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu’après l’arrivée du facteur. Mais il sera ici probablement avant M. Génie. Adieu donc. à mardi, midi et demie
9 h. 1/2
Le facteur ne m’apporte pas de lettre. Je suppose que M. Génie me l’apportera dans une heure. Je veux bien de cet échange. Mais sans cela, je serais inquiet. En attendant, adieu, le dernier. G.
101_2. Broglie, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je tombe de sommeil. J’ai fort peu dormi cette nuit. Ce matin au moment d’arriver, je dormais profondément. Certainement, je dormirais si je ne vous écrivais pas. Mais je ne puis me résoudre à passer toute cette matinée sans vous. A midi et demie en sortant de déjeuner, il m’a pris un vrai mal aise physique. Que le bonheur devient promptement une habitude ! Une heure après vous avoir retrouvée, il me semblait que je ne vous avais jamais quittée ; et pendant bien des jours, à midi et demie, je m’étonnerai tristement de ne pas sortir pour aller vous voir.
Samedi 7 h.1/2
J’ai été interrompu hier par M. de Broglie. Quand on arrive de Paris, il semble toujours qu’on apporte des nouvelles. Il n’y en a point. Je le dis. La conversation languit un moment. Et puis, à défaut de grandes nouvelles, les petites arrivent, abondent, et la conversation se ranime et devient intarissable. J’ai passé hier ma journée à raconter ce que je ne sais plus aujourd’hui ce que je me rappellerais bientôt si j’allais causer ailleurs. Mad. de Broglie vient de partir ce matin avec sa fille. Elle passera deux jours à Paris pour assister au grand concours de l’université où son fils a des prix, et le ramènera, sur le champ ici. Mad d’Haussonville partira du 28 au 30 pour Milan, Rome, Naples et l’hiver en Italie. Mad. de Broglie voulait absolument que nous passassions encore quinze jours ici. J’y serais revenu reprendre ma mère, et mes enfants, à mon retour de Caen. Mais je veux rentrer chez moi. Il faut une raison pour que je me plaise à en sortir longtemps. J’ai trouvé ma mère bien et mes enfants, à merveille. Guillaume est engraissé. Votre petit nécessaire a eu un grand succès. Henriette veut vous écrire. Et Pauline, qui ne sait pas écrire veut vous écrire aussi pour vous remercier avec sa sœur et pour sa sœur. Mes deux filles, sont très unies. Il faut qu’elles fassent toujours la même chose. Tout est commun entre elles. C’est un appui, et un repos dans la vie qu’une vraie intimité fraternelle. Et puis ce spectacle me plaît. Mes filles sont, dans leur famille, la troisième génération qui me le donne. Et toujours l’aînée supérieure à la cadette, et la plus dévouée, la plus prompte, aux sacrifices matériels pour sa sœur.
351. Paris, Jeudi 23 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
3 heures
Il fait trop chaud pour sortir encore. J’attends plus tard. Je suis bien aise que vous alliez passer votre journée à Holland House. J’ai eu la visite de Mme Appony ; de là, jamais rien d’intéressant. Mon ambassadeur est en travail de son courrrer et de deux ou trois dîners qu’il donne la semaine prochaine : d’abord à Molé, j’en suis et puis à Thiers, je n’en suis pas. Il n’y aura que des hommes. Je suis fâchée qu’il commence par Molé. Vous ne sauriez croire comme Ellice est occupé ici. Il travaille avec ardeur à ranimer l’amour anglais. Il y a bien bonne votonte réciproque vraiment votre succès à la Cité me me fait un grand plaisir.
Vendredi, 10 heures
68. Val-Richer, Mardi 24 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime ce gros chiffre 68. S’il prouve que nous avons été souvent séparés, il témoigne que nous nous écrivons depuis longtemps j’aime ce qui a duré. Depuis quatre mois ! Seulement quatre mois ! Cela ne me semble pas possible quand j’y pense. Tant de sentiments, tant de joies, de désirs, tant d’événement du cœur se pressent dans ce court espace. Et puis, quand nos affections arrivent à un certain degré de profondeur et s’imposent, elles prennent possession du passé comme de l’avenir, on ne se conçoit plus sans elles, pas plus que de l’un que de l’autre côté du temps. Il me semble que je vous ai toujours connue, toujours aimée, comme je vous connais et vous aime aujourd’hui, comme je vous aimerai toujours. Seulement depuis quatre mois ! C’est ridicule.
Décidément, je n’arriverai à Paris le 31 que pour dîner. J’avais espéré gagner quelques heures, mais cela ne se peut pas. Ma mère est bien. Son indisposition ne s’est pas renouvelée. Mes enfants vont à merveille. Le séjour au Val-Richer leur a réussi au delà de mon attente. Il n’y a rien de plus sain que l’espace et la liberté !
Je vous fais aussi, mon journal. J’ai continué hier mes plantations, mais sans hallucination aucune. Puis, j’ai eu dix-huit personnes, à dîner. C’est mon dernier dîner, à donner je veux dire ; j’en ai encore trois à recevoir. Par grande mésaventure, il faisait hier un temps affreux, et mes convives s’en sont allés à 9 heures et demie par la nuit la plus noire et la plus mouillée qui se puisse. Ils n’en étaient pas moins de fort bonne humeur. Je suis sûr qu’ils m’ont trouvé très aimable. Ne vous est-il pas souvent arrivé d’être aimable, de de très bien faire les choses, sans vous y plaire même, en vous en ennuyant ? Tout intérêt & volonté à part quand je suis une fois dans une situation, j’y veux être bien, je fais ce que je fais, ou plutôt cela se fait de soi-même par un certain mouvement intérieur que provoque la nécessité. On cause, on s’anime, on est aimable machinalement.
Voilà donc Constantine pris. Je regrette ce pauvre général Damremont. C’était un homme de sens et un galant homme. J’avais contribué plus que personne à lui faire donner le gouvernement d’Afrique. Il était bien avec M. le Duc d’Orléans et m’apportait plus de force que tout autre pour m’aider à chasser de là le Maréchal Clauzel. Du reste, il le désirait beaucoup lui-même, et n’y avait été envoyé que de son plein gré.
Je suis bien aise que M. de Médem soit bien pour vous. Je lui ai toujours trouvé de l’esprit. Vous serez bien longtemps avant d’avoir aucune réponse à vos grandes lettres. L’Empereur fait décidément son voyage du Caucase, et aucun de vos correspondants ne prendra sur lui de vous répondre avant son retour. Qu’est-ce que cette conciliation de l’Empereur avec le général Yermoloff ? Je croyais que c’était là un des hommes les plus plus indépendants et les plus récalcitrants de la Russie. Est-ce lui ou l’Empereur qui a fait les frais de la réconciliation ? De quoi vous parlé-je là ? Je fais comme si nous en étions ensemble depuis six mois, et que toute conversation nous fût bonne. Du reste, je prends souvent plaisir avec vous à parler des choses les plus indifférentes, les plus insignifiantes, précisément pour jouir du charme qui s’y attache près de vous. C’est un charme doux et qui repose. On a l’air de se distraire, mais il n’en est rien. On ne se distrait pas du bonheur.
11 h. 1/4
Il faut que vous mangiez que vous dormiez. Je suis décidé à vous trouvez bien et à vous bien gouverner pour votre santé. Adieu. M. de Grouchy part ce soir. Vous aurez après-demain matin de mes nouvelles par lui. Adieu. Adieu
57. Val-Richer, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vendredi 13. 4 heures
Savez-vous que ce sera un supplice de vous écrire directement, du ton dont nous sommes convenus ? J’avais déjà tant de peine à me dire que ce que je vous disais ! Il faudra encore en rabattre, beaucoup. Aussi, je me décide pour aujourd’hui à la voie indirecte. J’abuserai de mon pauvre Génie. Du reste, je l’en ai prévenu hier à 6 heures en montant en voiture, et tout sera fait comme nous l’avons réglé. Mais dites-moi si vous le pouvez jusqu’où je puis aller par la voie directe et quotidienne. Vous m’avez donné une pierre de touche telle qu’en vérité, si je m’y conforme, je vous enverrai un bulletin de ma santé en vous en demandant un de la vôtre Des lettres qui puissent être lues par M. de Lieven ! Je n’en reconnais pas moins la nécessité. Durera-t-elle longtemps ? Serons-nous longtemps dans cette attente ? En tous cas, ce ne pourra être plus de 18 jours.
Je viens d’arranger mon départ avec toute ma maison. Tout est convenu. Le 30 nous irons coucher à Evreux et dîner le 31 à Paris. Je respire en vous disant cela, et j’en ai besoin, car depuis hier j’étouffe. J’ai étouffé cette nuit ce matin, jusqu’à ce moment. Je suis épouvanté de mon bonheur. Je ne sais plus m’en passer. Quel abyme insatiable que notre cœur! un abyme, comme celui d’un mélodrame que j’ai vu jouer autrefois, qui s’appelait le Précipice, et où l’on précipitait en effet l’innocent dans un abyme de 600 pieds sans fond. Oui, un abyme de 600 pieds sans fond. Voilà ce qu’est devenu pour vous mon cœur. Avant le 15 juin, si l’on m’avait fait entrevoir une correspondance un peu amicale, un peu régulière avec une personne comme vous une personne d’esprit, bien au courant du monde, j’aurais trouvé cela charmant ; je me serais promis au moins un jour très agréable par semaine. Pendant que vous étiez en Angleterre, si l’on m’avait dit que vous reviendriez bientôt en France, et que je ne passerais jamais un mois sans en passer cinq ou six jours avec vous, je me serais cru heureux. Et bien Madame; je ne le suis pas; je ne le suis pas malgré hier, malgré avant-hier, malgré la certitude que dans 18 jours, je retrouverai hier au moins hier, n’est-ce pas ? Je suis devenu insatiable, je resterai insatiable. Vous, vous dont la simple vue fait épanouir tout mon être dont la moindre parole me charme et qui avez pour moi des paroles dont le souvenir, le seul souvenir me plonge dans l’extase, vous ne pouvez pas me rassasier. il n’est pas en votre pouvoir d’apaiser, de combler mon âme. De vous, tout la ravit et rien ne lui suffit. Vous êtes pour moi une source de délices infinies, et moi, j’ai une puissance infinie pour les désirer, pour en jouir; et quelque heureux que je sois par vous, près de vous, je sens que je puis, que je dois l’être encore davantage; et j’aspire avec une ardeur infatigable à ce bonheur inépuisable qui me vient de vous et qui chaque fois qu’il me vient me promet plus encore qu’il ne me donne et m’inspire encore plus de désirs qu’il n’en satisfait, savez-vous ce qui sépuise ce qui se lasse en moi ? La parole. J’arrive d’un coup à ses limites, et là je m’indigne et mon cœur s’élance bien loin au delà. Mais vous n’êtes pas là pour l’entendre sans qu’il parle ; et en même temps que la parole lui manque, le silence lui pèse horriblement.
Samedi 9 heures
J’ai dormi longtemps, en me réveillant souvent. Chaque fois que je me réveillais, je me disais: à une heure et demie. Et il me fallait un réveil complet et une réflexion pour me détromper. On a bien de la peine à apprendre que les choses ne sont pas dans la vie comme dans le cœur. Le premier mouvement est toujours de croire à l’harmonie de ces deux mondes, tant celui du dedans est le monde vrai, le monde souverain. L’autre nuit en roulant dans cette voiture, le ciel était pur, la lune se répandait partout, vous deviez être là comme moi, jouir avec moi de cette lumière si douce et si pénétrante ; vous deviez sortir de ces longues ombres des arbres qui semblaient cacher quelque objet et s’avancer vers moi à mesure que je marchais. Ce matin, je ne marche pas, je suis dans mon cabinet à ma table, près de mon feu. Mais le soleil brille, la vallée où les feuilles commencent à tomber, laisse entrevoir des percées profondes où la lumière entre et se perd ; tout est beau et invitant devant moi, sous mes fenêtres, partout où se porte ma vue. Je vous vois partout, je vous mets partout, partout où quelque chose me plaît et m’attire. Ce matin, comme cette nuit, comme l’autre nuit, la réflexion seule m’apprend que vous n’êtes pas là. Il faut que je le découvre ! D’instinct, je vous crois avec moi, toujours avec moi.
J’ai trouvé tous les miens en bon état. Ma mère est mieux que je ne l’avais laissée ; mes enfants sont à merveille. Savez-vous que je ne jouis de leur présence, de leur joie, qu’avec un peu d’hésitation et de mélange ? Je voudrais vous en envoyer la moitié. Une impression à moi seul un plaisir à moi seul m’étonne presque comme un contresens. N’ayez jamais d’impression, de plaisir à vous seule ! J’en serais plus qu’étonné. Vous pouvez me pardonner cette exigence toutes les exigences. Je les aurai toutes. Mais j’en ai le droit, oui, le plein droit.
11 heures
Voilà votre n° 56. Oui éternellement adieu. C’est là que tous les sentiments s’unissent et se satisfont. Adieu. Adieu.
53. Paris, Samedi 30 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Deux lettres à la fois ! Ah que je regrette cette affreuse journée, cette affreuse nuit l’état dans lequel elles m’ont mise ! J’ai bien tenu parole, j’ai pris froid et me voici enrhumée. Hier tout le jour j’ai été un peu comme folle. Je n’ai touché à rien, ni au lunchon. ni au dîner. Pas un morceau de pain. Il m’était impossible de rien avaler, aussi vers la soirée me sentais-je maigrie dans mon corset. La petite princesse ne m’as pas trop rassurée, elle était dans des étonnements ce n’était pas cela qu’il me fallait. Il fallait me dire que j’extravaguais.
Cette nuit j’ai entendu sonner toutes les heures, et quand à 8 1/2, l’heure de la poste, j’ai tiré la corde de la sonnette, il m’a pris une angoisse horrible. J’ai saisi ma tête dans mes deux mains, j’ai invoqué Dieu, je vous ai appelé vous, la respiration m’a manqué. Ma femme de chambre est entrée, on a ouvert les rideaux les volets, c’est le premier acte, le second est d’aller voir s’il y a des lettres, tout cela ne dure pas une minute 1/2 je n’ai pas fait une question. J’ai attendu le moment de la lettre, avec un frémissement intérieur horrible, & quand enfin la petite porte du couloir s’est ouverte & que j’ai vu ma femme de chambre faire le tour de mon lit pour s’approcher de moi, quand ce mouvement m’a indiqué qu’elle avait quelque chose à me remettre, ah Monsieur avant de saisir les lettres mes mains se sont jointes pour invoquer Dieu, pour le remercier. Et avec quelle ferveur !
Après avoir lu, relu, je me suis sentie mieux sur le champs, mais tellement épuisée que je n’ai pas pu me lever avant d’avoir avalé un bouillon. Voilà Monsieur tout ce que m’a valu la négligence de vos gens, car je vois au contenu de ce N°48 qui devait m’arriver hier que vous étiez parti pour Croissanville avant l’arrivée du facteur, on ne lui aura pas remis votre lettre. J’en ai bien de la colère, je vous assure, car elle m’a fait bien du mal, et n’allez pas croire. que cette expérience me prépare mieux à un autre accident ; pas du tout, je vous croirai mort tout de site. Je suis pour vous comme j’étais pour ces créatures chéries, lorsqu’elles étaient hors de ma vue, je perdais la raison.
Voilà Monsieur le pauvre être que vous avez recueilli, auquel votre cœur promet sincérité & bonheur. Voyez comme il est difficile de me les donner ? Je vous ai tout dit, j’ai voulu tout vous dire vous me pardonnez ces détails si inutiles.
Je viens d’examiner les deux enveloppes, elles portent toutes deux le timbre de Lisieux 29 septembre. Grondez un peu autour de vous, car vous allez être en courses, & vous voulez cependant me retrouver vivante. Je n’en ai pas trop l’air aujourd’hui. Vous ne sauriez croire comme ma soirée m’a pesée hier. Il y avait Pozzo, Pahlen, les Schonberg, les Durazzo, les Brignoles M. de St Simon, je ne sais qui encore. Je ne savais de quoi on me parlait. Je ne comprenais rien. J’ai fait signe à mon ambassadeur, il est parti pour donner le signal aux autres. Ce n’est qu’à onze heures & demi qu’on m’a quittée. M. de Hugel est fort malade. C’est une ossification du cœur. Et toutes les idées sont tournées vers la mort. Il ne parle que de cela. Il ne sort plus le soir. Vous ne sauriez croire comme je le plains. Comme je plains toute créature isolée. Ah Je sais tant ce qu’il y a d’horrible a être seule.
Voyez un peu Monsieur tout ce que j’ai eu de mauvais moments depuis ce vilain 13 septembre où vous m’avez quittée. Les journaux, M. Duchâtel, les lettres de mon mari, maintenant la poste. Je n’ai pas eu deux jours de tranquillité, et vous voulez que je me remette. Monsieur cela na sera possible que lorsque vous serez près de moi tout à fait. Vous m’avez dit que vous rentrerez en ville avec toute votre famille dans la dernière quinzaine d’octobre. Vous m’avez toujours donné cette époque. J’espère que là encore vous ne me trompiez pas ? Cependant depuis la noce de M. Duchâtel, j’ai un peu moins de foi dans vos paroles. Vous ne vous fâchez pas n’est-ce pas ? Et bien Monsieur je vous verrai le 6. Vous resterez surement huit jours à Paris n’est-ce pas ? & puis vous irez au Val Richer chercher votre mère et vos enfants et du 20 au 25 vous serez établi ici, ici près de moi. Toujours près de moi. Promettez le moi, je vous en conjure. Dites moi que vous me le promettez. Je serai si douce si bonne ; si égale ; si heureuse. Vous aurez du plaisir à me voir heureuse ? Je me remettrai alors, j’engraisserai.
Midi. J’ai fait venir mon médecin, il m’a trouvée very low, il me donnera des fortifiants. Je lui ai dit cependant que cela venait d’agitation & de chagrin mais cependant il veut que je prenne ses drogues. Hier de 7 à 8 h du soir on a été à me frotter pour me réchauffer et Marie étouffait dans la chambre.
Le mariage va mal. Il se fera mais le roi de Würtemberg est aussi naughty qu’il est possible, je crois, que le pauvre Mühlinen aura l’ordre de faire un tour un province. Quelles mauvaises manières que tout cela. M. Ellice m’a écrit une lettre énorme et indéchiffrable. Je vous attends pour la comprendre. La petite princesse ne s’est pas amusée à Maintenon. La duchesse de Noailles est fort bête, & son mari un peu pompeux. Le lien est beau. Je suis fort aise de n’y avoir pas été. M. Thiers sera à Valençay le 5.
Vous ne sauriez croire comme je me trouve dans le paradis aujourd’hui en comparaison de ma journée d’hier ! C’était affreux hier ayez soin que cela ne m’arrive plus je vous en conjure.
Adieu, je vais relire vos lettres, & me tenir beaucoup à l’air aujourd’hui. J’ai besoin de me remonter. J’ai une mine bien malade. Adieu. Adieu. & vendredi que ce sera beau ! Adieu. Je crois qu’il me sera plus facile de fermer ma porte vendredi soir que samedi, mais je ferai comme vous voudrez. Ordonnez.
47. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai besoin de vous parler. Vous n’êtes pas là. Vous ne m’entendez pas. Ce que je vous dis n’ira à vous que dans deux jours. Mais j’ai besoin de vous parler. Vous avez eu un tel accès de désespoir ! Pardon dearest, pardon ; ma première impression n’a pas été toute pour vous, pour vous seule. Je vous ai vue désolée, sanglotant. J’ai été navré. Mais au même instant un mouvement de tristesse toute personnelle s’est élevé en moi. Quoi ? Je ne suis pas encore parvenu à vous donner plus de confiance dans ma tendresse ! Ma tendresse n’a pas sur vous plus de pouvoir ! Vous ne savez pas tout ce que vous êtes pour moi, tout ce que j’ai dans le cœur pour vous. Mais moi je le sais ; je le sens. Quelque fois encore, je m’en étonne ; je me demande si c’est bien vrai. Et ce que je me réponds à moi-même, je vous l’ai dit ; je vous le redis tous les jours. Moi aussi, Madame, j’avais enfermé mon âme dans un tombeau. Vous l’en avez fait sortir. Vous l’avez appelée, et elle est venue à vous ; elle a ressuscité devant vous. Quelle marque d’affection peut égaler celle-là ? Savez-vous quel bonheur j’avais possédé, j’avais perdu ? Savez-vous que si l’on m’eût dit : - Il y a sur la terre une créature, qui peut vous rendre une heure de ce bonheur - j’aurais souri, avec le plus incrédule dédain ? Et que, si l’on m’eût dit aussi : - cherchez dans le monde entier une épingle perdue, si vous la trouvez, vous retrouverez une heure de votre bonheur je serais parti, à l’instant même ; j’aurais cherché toute ma vie pour courir après cette imperceptible chance ? Voilà où j’en étais Madame, avant le 15 Juin. Voilà quel chemin j’ai eu à faire pour arriver à vous, pour vous dire ce que je vous dis aujourd’hui. Est-ce assez pour que j’aie sur vous la puissance d’écarter le désespoir, d’arrêter les sanglots ? Est-ce assez pour que vous ayez foi, en moi ? Et vous croyez que je ne supporterais pas vos sanglots !
Je supporterais tout, tout, Madame pour combattre, pour adoucir un moment votre peine. J’ai bien supporté de voir mourir, mourir lentement les créatures que j’aimais le mieux au monde ; je n’ai pas cessé un instant de les regarder, de leur parler pour que le sentiment de ma tendresse se mêlât à leur angoisse, à leur dernier souffle et qu’elles l’emportassent en me quittant. Et ce qui m’a donné, ce qui je crois me donnerait encore ce courage, c’est que j’ai, de la puissance d’une affection vraie et des souveraines douceurs qui y sont attachées, une si haute idée qu’il me semble que le plus grand bien qu’on puisse faire à une créature désolée à une créature qui souffre, c’est de lui répéter sans cesse. Je l’aime ! Je l’aime ! Pour moi, je ne connais point de douleurs que ces mots d’une bouche chérie n’aient la vertu de calmer.
Mardi 7 h. 1/2 Je ne comprends guère comment, dès le 5 sept., aucun commérage aurait pu parvenir à Carlsbad. Il faudrait qu’on sy fût pris de bien bonne heure. Du reste, je crois à beaucoup de malice et de trahison possible. Les passages que vous me transcrivez me tourmentent beaucoup. Il faut attendre l’effet du comte Orloff. C’est sur cela que vous comptez, que nous comptons une chose me déplaît extrêmement dans tout ceci, c’est de ne pouvoir me faire une idée du pays,des mœurs, de l’état social, des caractères qui le rendent possible. Je me rappelle l’indignation où nous étions de ce que l’Empereur Napoléon ne voulait pas souffrir que Mad. de Stael habitât Paris. Et pourtant quelle différence ! Il y avait pour lui un motif, un motif, sérieux.
La conversation, le salon de Madame de Stael auraient été pour lui un véritable embarras. Mais ici, quel intérêt peut-on avoir à vous faire sortir de France ? Quel inconvénient entraîne votre séjour ? Une pure fantaisie. Cela déplaît. Vous ne faites pas tout ce qui plait. Quel misérable et terrible enfantillage ! J’ai bien envie de crier : vive la Charte !
Je reviens à M. de Lieven. Que lui répondez-vous ? Vous avez, avec lui, comme avec l’Empereur, comme avec tout votre monde, une situation faite, déterminée. Vous vous y êtes bien positivement établie et dans vos entretiens de Londres avec le comte Orloff et dans les lettres à lui et à M. de Lieven que vous m’avez montrées. Vous devez, ce me semble vous y maintenir tout simplement. Les hésitations, les agitations, même purement apparentes de langage seulement rendent tout beaucoup plus difficile. Une résolution simple. claire, clairement exprimée et tranquillement maintenue, coupe court à beaucoup d’embarras, non seulement au fond, mais dans la forme. Car je ne mets pas le fond en doute ; c’est de la forme et des embarras extérieurs qu’il s’agit. C’est à cela qu’il faut pourvoir. Nous en causerons bien complètement le 6 octobre. J’attends de jour en jour l’ordonnance de dissolution.
Ma mère est beaucoup mieux. A moins de nouvel accident, je ne puis penser à lui proposer de revenir plutôt à Paris. Elle se trouve bien ici. Ma mère est à l’age où l’on a un égal besoin de distraction et de repos. La campagne lui donne l’un et l’autre. Il y a une foule de petits intérêts, de petits soins qui l’amusent; et l’égalité de la vie, le silence de l’atmosphère, la paix de tous les aspects qui l’environnent lui assurent cette espèce de quiétude morale qui dépend, pour les vieillards des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés. Si l’indisposition de ma mère reparaissait un peu sérieusement je n’hésiterais cependant pas à la ramener tout de suite à Paris. Mais comme elle en serait, fort contrariée, il y faut une vraie nécessité.
11 heures Voilà le N° 48. Qu’il est triste et si bon, si doux ! Je me console un peu en pensant que vous serez, que vous êtes déjà, un peu consolée. Vous avez une date. Nous avons une date. Il y a encore dans ce n°48, une bien mauvaise, une bien coupable parole. Je n’y reviens pas aujourd’hui. Mais j’y reviendrai. Dearest, ne me mettez rien sur le cœur. Il y a tant de choses dedans ! et toutes pour vous ! Adieu. Adieu. Adieu me plaît, mais ne me suffit pas. G.
45.Val-Richer, Samedi 23 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
39. Val-Richer, Dimanche 17 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous étiez entrée tout à l’heure dans ma cour, vous auriez été un peu surprise. Vingt trois chevaux de selle, deux cabriolets, une calèche. Les principaux électeurs d’un canton voisin sont venus en masse me faire une visite. J’étais à me promener dans les bois avec mes enfants. J’ai entendu la cloche du Val Richer, signe d’un événement. Je ne savais trop lequel. Nous avons doublé le pas, et j’ai trouvé tout ce monde là qui m’attendait. Je viens de causer une heure et demie avec eux de leurs récoltes, de leurs impositions, de leurs chemins, de leurs églises, de leurs écoles. Je sais causer de cela. J’ai beaucoup d’estime et presque de respect pour les intérêts de la vie privée, de la famille, les intérêts sans prétention, sans ambition, qui ne demandent qu’ordre et justice et se chargent de faire eux-mêmes leurs affaires pourvu qu’on ne vienne pas les y troubler. C’est le fond de la société. Ce n’est pas le sel de la terre, comme dit l’Évangile mais c’est la terre même.
Ces hommes que je viens de voir sont des hommes sensés, honnêtes de bonnes mœurs domestiques, qui pensent juste et agissent bien dans une petite sphère et ont en moi, dans une sphère haute assez de confiance pour ne me parler presque jamais de ce que j’y fais et de ce qui s’y passe. Mes racines ici sont profondes dans la population des campagnes, dans l’agricultural interest. J’ai pour moi de plus, dans les villes, tout ce qu’il y a de riche, de considéré, d’un peu élevé. Mes adversaires sont dans la bourgeoisie subalterne & parmi les oisifs de café. Les carlistes sont presque comme des étrangers, vivant chez eux, entre eux et sans rapport avec la population. La plupart d’entre eux ne sont pas violents, et viendraient voter pour moi, si j’avais besoin de leurs suffrages. Du reste, je ne crois pas que mon élection soit contestée. Aucun concurrent ne s’annonce. Ce n’est pas de mon élection que je m’occupe mais de celles qui m’environnent. Je voudrais agir sur quelques arrondissements où la lutte sera assez vive. Je verrai pas mal de monde dans ce dessein. Si la France, toute entière ressemblait à la Normandie, il y aurait entre la Chambre mourante et la Chambre future bien peu de différence ; et j’y gagnerais plutôt que d’y perdre. Mais je ne suis pas encore en mesure de former un pronostic général. Vous voilà au courant de ma préoccupation politique du jour. Je veux que vous soyez au courant de tout.
Lundi 7 h. du matin
Je suis rentré hier chez moi vers 10 heures à notre heure à celle qui me plait le plus pour vous parler de nous. J’ai trouvé mon cabinet et ma chambre pleine d’une horrible fumée. Mes cheminées ne sont pas encore à l’épreuve. Il a fallu je ne sais quel temps pour la dissiper. Je me suis couché après. Aussi je me lève de bonne heure. Laissez-moi vous remercier encore du N°39, si charmant, si charmant ! Qu’il est doux de remplir un si tendre, un si noble cœur! Cette nuit trois ou quatre fois en me réveillant, vos paroles me revenaient tout à coup, presque avant que je me susse reveillé. Je les voyais écrites devant moi. Je les relisais. Adieu n’est pas le seul mot qui ait des droits sur moi.
Je ne vous avais pas parlé de ce petit tableau. J’y avais pensé pourtant, et j’aurais fini par vous en parler. Vous n’en savez pas le sujet. Il est plus lointain, plus indirect que vous ne pensez. En 1833, 34, 35. 36, j’ai relu et relu tous les poètes où je pouvais trouver quelque chose qui me répondit ; qui me fît ... dirai-je peine ou plaisir? Pétrarque surtout m’a été familier. C’est peut-être, en fait d’amour le langage le plus tendre, le plus pieux qui ait été parlé. J’entends parler dans les livres que je méprise infiniment en ce genre, poètes ou autres. Un sonnet me frappa, écrit après la mort de Laure et pour raconter un des rêves de Pétrarque. Je vous le traduis
Ma petite fille aussi est plus jolie que son portrait, des traits plus délicats, une physionomie plus fine. Vous la verrez elle. Je voudrais que vous pussiez la voir souvent, habituellement. Elle est si animée, si vive, toujours si prête à s’intéresser à tout gaiement ou sérieusement ! Elle vous regarderait avec tant d’intelligence. Elle vous écouterait avec tant de curiosité ! Laissons cela. Quand nous aurons trouvé ce que je cherche en Normandie, nous pourrons ne pas le laisser.
Lundi 10 heures 1/2
Voilà le N°40. Je n’ai pas vu cet article de la Presse dont vous me parlez. Je vais le chercher. Je renouvellerai mes recommandations indirectes comme bien vous pensez là du moins mais positives. Ce n’est pas aisé. Mettez sur Adieu tout ce que vous voudrez. Je me charge d’enchérir. Adieu. Adieu. G.
40. Paris, Samedi 16 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je pense avec ravissement que samedi prochain je ne vous écrirai plus. Monsieur je ne sais comment le temps passe sans vous. & il passe cependant ! Dites-moi bien tout ce que vous faites, quand vous vous promenez ! Il me semble que vous devriez être dehors dans ce moment avec votre petite fille. Je la crois bien bavarde. Elle doit bien vous amuser vous distraire, savez-vous jouer avec des enfants ? Que je voudrais regarder tout un jour dans ce Val-Richer.
Dimanche, 9 heures. Voilà votre N°36. Quelle bonne, quelle charmante lettre ! Je jouis du bonheur que vous donnent vos enfants. Il n’y a pas un mouvement d’envie dans ce sentiment là. Ce bonheur est fini pour moi, mais je suis heureuse de vous voir le goûter. Parlez moi de vos enfants beaucoup toujours. Vous êtes peinée de ma solitude ! Imaginez donc ce qu’elle était avant le 15 juin ! Avec tant d’amour, tant d’ardeur, tant de capacité d’aimer ! Et bien j’aimais ces tristes souvenirs, j’adorais ces images chéries, je ne m’occupais que d’elles. Je désirais le ciel, c’est là que je vivais, et j’acceptais l’existence que je m’étais faite à Paris, comme la chose du monde la plus passagère ; l’idée même de n’y être pas fixée flattait ma pensée dominante. Une mauvaise auberge en attendant une bonne demeure. Tout en moi était d’accord avec cette pensée là. Je cherchais à me distraire mais c’était pour passer le temps. Il me paraissait devoir marcher plus vite ici qu’ailleurs, c’est pourquoi j’avais choisie Paris, et la rue Rivoli pour bien regarder ce ciel ! Monsieur le vue du ciel est une grande douceur. Vous y avez bien regardé n’est-ce pas ? Monsieur, c’est affreux, c’est horrible d’être restée sur cette terre !
10 heures Je continue je n’ai pas pu continuer tantôt. Eh bien Monsieur le 15 juin est venu. Ne me plaignez plus aujourd’hui de ma solitude. Mais ne m’y laissez plus retomber. Tuez-moi plutôt. Vous savez bien que je vous dis vrai. Ce serait un bien fait. Comme vous me connaissez ! Comme tout ce que vous me dites sur mon compte me frappe de vérité. Vous me faites faire ma connaissance. Vous voyez que je suis sur le chapitre, des petites contrariétés, & de l’effet qu’elles font sur moi. Vous m’expliquez moi admirablement. Vous devez m’avoir bien regardée. Vous avez mis jusqu’ici beaucoup de bienveillance à cet examen, montrez moi mes défauts. Je vous en pris corrigez-moi, reprenez-moi. Vous verrez comme je serai docile. Monsieur j’ai si envie de vous plaire, de vous convenir en tout, en tout !
J’ai passé hier deux grandes heures au bois de Boulogne. Je me suis assise sur ce que Marie appelle votre banc. Je ne suis pas sortie de cette allée. J’y marchais avec vous. J’ai passé chez la petite princesse un moment avant le dîner. Elle n’est pas venue le soir. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai vu que Pozzo, M. Aston, une autre Anglaise & une grande dame Russe, Mad. de Razonmofsky. Ah mon Dieu quelle espèce ! 70 ans ; des roses sur la tête, une toilette à l’avenant. Et puis l’Empereur m’a dit cela, j’ai envoyé des robes à l’Impératrice ; & des petites manières, et enfin tout ce qu’il faut pour me faire frémir à la seule pensée de vivre dans un pays où l’on porte des roses à 70 ans. Ah ma patrie, comment êtes-vous ma patrie ?
La petite princesse m’a montré hier dans la presse un article sur moi & vous. ll n’y a rien dont j’ai à me plaindre, mais vous savez combien j’aimerais mieux que mon nom ne parut jamais jamais.
Pozzo resta fort tard hier. Il m’amusa un peu. Il y a dans ses récits quelque longs qu’ils soient et un peu rebattus pour moi, toujours des drôleries nouvelles, de la farce italienne, une manière originale qui en fait toujours un petit spectacle. A dire vrai hier même sans cette bouffonnerie il m’aurait endormie, car c’était incohérent. Tout 12, 13 & 14 dans une demi-heure. Mais quand il m’est venu aux conférences de Prague, et qu’après une nuit passée inutilement à émouvoir cette grave & raide Autriche personnifiée dans M. de Metternich, Pozzo s’était endormi de guerre lasse, & que je ne sais plus qui vient le secouer à 9 heures du matin pour lui dire " Réveillez vous belle endormie, l’Autriche entre dans la coalition, & l’Europe va à Paris." On ne résiste pas à la belle endormie, elle vous réveille tout de suite.
Je viens de recevoir une lettre de M. de Noailles qui me donne bien des remords. Je vois que je lui ai fait bien de la peine. Il me le dit sur un ton qui me plait. Il ne veut plus de personne & me charge de le dire aux Schönberg & Pozzo & Pahlen. Ceux là seront un peu désappointés et ne trouveront pas du tout comme lui que je vaille la peine de rompre une partie qui leur faisait grand plaisir. Mais plus j’y pense & plus je trouve que je fais bien de n’y pas aller. Il me faut toute ma longue toilette ; il me faut un tour aux Tuileries avant l’église, & comme c’est dimanche il faut que ma lettre soit mise à la poste avant que j’en revienne. Je vous dis donc adieu. Adieu Monsieur je compte bien sur un bon accueil à ce vilain mot, et je fais pour cela des avances très tendres. Adieu.
39. Paris, Samedi 16 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos douces paroles sont venues me trouver dans mon lit. Je vous remercie. Vous ne savez pas comme j’ai besoin de vous quand vous n’y êtes pas. Je vous l’ai dit vingt fois le jour il me vient la pensée que votre affection ne peut pas être ce que j’imagine qu’elle est lorsque vous êtes présent. Ce n’est pas vous qui êtes l’objet de ce doute c’est moi qui le suis. Et plus je vous montre tout ce que je suis pour vous plus je me persuade, quand vous êtes loin, que je perds dans votre estime ; que vous pouvez être touché de l’affection que je ressens pour vous, mais qu’elle vous parait trop vive, trop en dehors qu’elle doit vous lasser. Et puis quand je suis dans ce train de réflexions je vais vite à l’extrême, et j’étais triste hier, bien triste.
Le soir à ma table ronde je n’écoutais personne. Je regardais à la montre. Je voyais bien l’heure où vous remontez dans votre chambre, où vous me dites que vous vous enfermez avec moi. Eh bien, j’en ai été saisie comme d’un mauvais moment. Un moment où vous retraçant tant d’heures passées ensemble vous pourriez peut être en regretter l’emploi. Je vous vois Monsieur, je vois le mouvement d’indignation avec le quel vous repoussez en méchantes paroles, vous n’avez pas besoin de me répondre mais laissez moi vous dire tout ce qui traverse ma tête. Et trouvez-y autre chose, s’il est possible qu’une preuve de plus, que ma vie entière est attachée au bonheur dont je jouis aujourd’hui, & que je suis éperdue à la seule pensée qu’il puisse éprouver la moindre diminution. Encore une fois Monsieur je le trouve trop grand, je ne m’en trouve pas digne, & quand de flatteuses paroles, telles que vous me les écrivez aujourd’hui viennent me rehausser à mes propres yeux. Je suis heureuse, je vous crois, je porte la tête plus haut et le cœur plus rempli que jamais de ma félicité !
Mais savez-vous donc Monsieur ce que j’ai fait hier ? J’étais pressée de vous le dire et voilà que je m’égare En revenant du bois de Boulogne j’ai été reporter deux livres. J’ai demandé à entrer la portière est venu ouvrir les volets, j’ai tout vu tout regardé, touché. Les portraits comme je les ai regardés ! Ah Monsieur que suis je devenue quand j’ai aperçu le petit tableau contre la porte. Cette tête, cette tête chérie couchée sur ce canapé ; cette figure blanche auprès, anxieuse, caressante. Ah quel mouvement de jalousie, d’horrible jalousie s’est emparée de moi. Il ne faisait pas assez clair pour que je puisse lire les vers écrits dessus. Je n’en avais pas besoin, je ne le voulais pas. Je suis restée devant ce petit tableau. Son souvenir ne me quitte pas. Vous ne m’aviez pas parlé de ce tableau. Vous pensiez peut être qu’il me ferait de la peine ! La portière voyant comme ce tableau m’occupait me dit : " Monsieur était sujet à des migraines." Marie, car elle était avec moi, se mit à rire. Le rire de Marie, le dire de la portière tout cela augmenta mon horrible tristesse. Je fus prête à fondre en larmes.
Monsieur je ne puis pas supporter ces images, & vous ne me direz jamais jamais rien qui rappelle qui ressemble à ces scènes d’intimité. Ma visite se borna à ces quatre chambres. Je ne puis pas demander à voir l’étage supérieur, Marie était avec je redescendis triste, & cependant heureuse. Il me semblait que j’avais pris possession de ces quatre chambres. Mais ce petit tableau, Monsieur, ce petit tableau me serre le cœur.
La petite fille est jolie, elle me parait charmante. D’après ce qu’on m’a dit de votre fils je crois qu’il était mieux que le portrait. L’un des fils de lord Grey doit lui ressembler excessivement et il est bien beau. Je quitte votre maison. En rentrant je trouvai un billet dans lequel il y a ceci : "Depuis deux jours seulement il est parti. J’ai suivi sa marche. Et je comptais aller contribuer pour ma petite part à combler le vide que son absence doit vous laisser. Vous. voyez que je me rends justice et que Je ne m’en fais pas à croire." J’ai pensé que ceci vous divertirait.
Ma société se composa hier au soir de la petite princesse, son mari, Mad. Durazzo, l’ambassadeur de Sardaigne, sir Robert Adair, le comte Médem, Pahlen, M. Sueyd, & Mëchlinen. Celui-ci nous le chassâmes, ou à peu près vous avez fait comme de raison la conquête d’Adair, il trouve que vous connaissez l’Angleterre mieux que lui.
1 heure. J’ai beaucoup marché, presque jusqu’à me fatiguer. L’air est lourd, chaud & triste. Le soleil ne vient pas, je n’en ai pas besoin. J’ai pensé, rêvé tout le temps. Je pense, je rêve bien plus encore que je ne faisais à votre premier retour au Val-Richer tout ce qu’il y avait alors en moi est doublé. Ah que je suis heureuse & triste !
Votre buste ressemble, mais je ne l’aime pas. Il est si raide. J’ai vu le dessin de la campagne, enfin j’ai tout vu. Marie a regardé cela comme une visite classique. Elle était si curieuse de votre habitation ! Quand y reviendrez- vous pour y rester ? Ah, il n’y aura que cela de bon. Un bonheur bien réglé, bien établi. Adieu. Adieu, & comme je vous dis cet adieu ! Tâchez de bien le comprendre.
20. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.
Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?
Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.
Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.
Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.
Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.
Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.
21. Paris, Jeudi 10 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
huit heures
Vous venez après mes prières. Dans mes prières je pense à vous je prie pour vous. Monsieur venez m’enseigner à ne pas vous donner ainsi toutes mes pensées tous les battements de mon cœur. Cela n’était pas tout à fait ainsi avant mon départ pour l’Angleterre. Il me semble au moins ce voyage, cette longue séparation, vos lettres, les inquiétudes mortelles que j’ai éprouvées pendant dix jours tout cela a tellement exalté ma pauvre tête et affaibli mon corps, qu’aujourd’hui votre image est une douleur. Mais une douleur dont je ne puis pas me séparer un instant. Que sera ce quand vous serez là auprès de moi ? Je vous y vois déjà, je vous établis Je suis fâchée que ce ne soit pas dans la Chambre où nous avions pris de si douces habitudes. Je l’aurais même aimé, mais on y travaille, cela m’impatiente. J’irai voir aujourd’hui s’il n’y aurait pas moyen de presser les ouvriers. Je suis sortie hier, mais il y a un peu d’embarras à satisfaire mon médecin. Il veut de l’air et il ne veut pas d’exercice. Je me suis fait traîner doucement en calèche avant dîner, & j’ai recommencé le soir. Il faisait doux mais triste. Quand vous serez ici nous irons. un soir en calèche. Je laisserai Marion à la maison. J’ai pensé à cela tout le long de la promenade. Que j’aime rêver ainsi alors, je n’entends plus rien & j’y serais encore ; s’il n’était survenu des éclairs très forts.
Je suis rentrée à 10 h. Je me suis couchée. J’avais vu dans la journée quelques personnes. Lady Granville. Le duc de Palmilla, le duc de Hamilton, & M. de Hugel. J’ai une confidence à vous faire sur Lady Granville. Elle a toujours exercé sur moi un grand empire. Elle a de l’esprit prodigieusement et l’amour le plus fanatique pour son mari. C’est la personne qui me connaît le mieux, & qui connait le plus vite toute créature qu’elle a intérêt à pénétrer. Elle m’aime & je crois tout simplement parce qu’elle me connait. Elle sait donc tout. Hier elle m’a trouvé relisant une lettre. Eh bien Monsieur je la lui ai donnée Cette lettre c’est le N°6. Vous y traitez le sujet le plus élevé. Savez-vous ce qu’a fait Lady Granville ? Elle a pleuré, pleuré. Elle y a retrouvé tout ce qu’elle pense. Elle voudrait Monsieur se prosterner à genoux devant vous. Quand je l’ai vu ainsi , émue, exaltée. Je me suis rassurée sur mon propre compte. Il n’y a donc pas de la folie dans mon fait. Voilà ce que je me suis dit d’abord. Savez-vous ce qu’elle m’a dit ensuite ? Monsieur c’est ce que je me suis dit plusieurs fois déjà mais sans avoir où vous le répéter. "
Je mourrai Monsieur comme sont mortes ces deux femmes que vous avez tant aimées !! Elles n’ont pas plus supporté leur bonheur que moi je ne puis supporter le mien. Dieu n’aime pas que les joies du Ciel soient révéler aux mortels. Il leur retire la force de les soutenir. Savez vous Monsieur pourquoi vous venez ? C’est que vous ne sentez pas au moins de près ce qu’elles ont senti, ce que je sens. Dieu vous a placé sur la terre pour un autre but. Moi j’avais accompli ma destiné et vous aimez ma mémoire comme vous chérissez la leur. Encore une fois Monsieur défendez moi de vous écrire, cela me fait mal.
11 heures
J’ai fait ma toilette, j’ai essayé de déjeuner. Je ne puis pas manger. Le facteur est venu il ne ma pas apporté de lettres, pas de lettres ! Pourquoi ne m’avez-vous pas écrit ! Monsieur ne me donnez pas ce chagrin là. Un mot, un mot tous les jours je vous en supplie. Ne me faites pas repasser par toutes les horribles émotions de Londres. Vous le voyez je suis faible, je le deviens même plus tous les jours. Cette nuit a été mauvaise. La chaleur m’accable et cependant je suis froide comme glace. C’est un vilain état de nerfs.
J’ai des nouvelles de M. de Lieven de Marienbad en Bohême. Il allait le lendemain chez M. de Metternich à un château qu’il a près de la. Ils ne se sont pas vus depuis le temps où ils ne s’aimaient guère. Le prince de Metternich fera sur cela quelques bonnes réflexions philosophiques que je suis bien aise de n’être pas condamnée à lire car elles seraient longues. Savez- vous qu’il m’a souvent, bien souvent fait bailler, il disserte lourdement. Vous aurez lu de ses pièces diplomatiques Il y a toujours beaucoup d’esprit, beaucoup d’habileté, mais la forme en est bien allemande. Et bien il vous racontera comment on fait le macaroni avec le même intérêt, la même pesanteur. M. de Metternich traite tous les sujets de même, et se croit fort universel. Jamais il ne lui est arrivé de dire : "Je ne sais pas." Il sait tout, et surtout il a tout prévu, tout deviné. Lady Granville lisait souvent ses lettres, et ne manquait jamais d’en rire. A dire vrai elle m’entraînait quelques fois à rire aussi. Elle servait à souhait M. Canning. Je ne sais comment je suis arrivée à vous parler de tout cela, mais je suis bien aise d’une distraction.
Madame de Dino me supplie de donner rendez-vous à mon mari à Valençay. C’est beaucoup trop loin. Si je vais à Valençay il voudra m’entraîner plus loin. Mais que je suis impatiente de sa réponse à la nouvelle que je suis revenue en France ! Car lui &mon frère aussi, qui m’écrit enfin une lettre très tendre, (tendre parce que je n’étais plus à Paris) ; n’ont pas le moindre soupçon que je puisse penser de nouveau à fouler cette terre défendue. Monsieur, je bavarde, je bavarde et vous ne me dites rien. Rappelez-moi de vous conter, quand je vous verrai un moment de singulières explosions de la part de 17 dans le dernier entretien que j’ai eu avec lui. Par exemple lady Granville rit bien de lui.
Adieu Monsieur, c’est triste de vous dire adieu Sans vous avoir dit merci. Cela ne sera pas ainsi demain n’est-ce pas ?
20. Paris, Mardi 8 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai été obligée de recevoir M. Molé, lady Granville, le comte Médem avec le premier deux heures de tête-à- tête, avec lady Granville longtemps. aussi, mais une causerie si bonne, si intime sur un sujet qui me tient le cœur si serré, que j’ai fini par tomber sur son épaule. Je n’avais plus de force. Si je pouvais me débarrasser de mes nerfs mais je suis bien faible, bien faible. Le médecin me dit que je reprendrai des forces au bout de quelques jours. Il faut en reprendre avant de vous voir. Telle que je suis aujourd’hui c’est impossible. J’en tomberais gravement malade, et vous ne le voulez pas ? Je ne cesserai donc de vous le répéter, attendez je vous en conjure. Laissez-moi me remettre un peu ; je vous promets que je ne m’occuperai que de cela. Si je pouvais vous promettre de ne pas m’occuper de vous, je serais bien plus sûre de remplir le premier engagement. M. Molé m’a trouvé bien changée.
Mercredi 9 à 8 h du matin Je suis mieux, il me semble que c’est là ce que vous êtes pressé de savoir. J’ai dormi cinq heures cette nuit, je vous ai oublié un peu, Dieu merci. Et en me levant j’ai vraiment senti que mes jambes me porteraient mieux. Voyez Monsieur, voilà du progrès. Tous les jours j’espère vous en annoncer et puis, & puis. Vous viendrez quand je vous le dirai vous viendrez n’est-ce pas ? Cela me paraît simple, cela me parait sûr, & quand je pense au moment où je vous reverrai, il me semble que j’en mourrai.
Est-il possible qu’en si peu de temps vous soyez devenu pour moi ce que ma peine cherchait dans le ciel, que cette vision qui m’avait un moment enivré de délices sont devenus une réalité ? Je vous ai dit ce que j’ai éprouvé alors, je me rappelle distinctement. Cette sensation mais jamais je ne saurais la décrire, elle surpassait ce que la parole peut exprimer. Et bien de même aujourd’hui ce que j’éprouve est au-dessus de toutes les expressions humaines. Monsieur est-ce que je rêve. Y a t-il de la folie dans ce que je vous dis ? Je ne suis plus sûre de moi. Monsieur défendez-moi de vous parler.
Je lis vos lettres, je les relis. Savez-vous bien ce que sont vos lettres ? Ah quel danger pour ma pauvre raison ! onze heures On m’apporte dans ce moment votre N° 17. Voilà qui est réglée, j’accepte le 18. Je l’accepte avec transport. Pensez donc au 18, pensez y beaucoup, et faites des vœux pour que je n’y pense pas. Car ma pauvre tête pourrait aller. Votre dîner chez le curé me rappelle qu’il y a quelques temps déjà je voulais vous demander une faveur. J’ai lu dans en livre que vous m’avez donné, ces livres dont j’approche avec respect avec mille sentiments contraires que je ne peux, que je ne veux pas vous exprimer. J’y ai lu entre autres choses que celle que vous aimiez surement le mieux s’occupait des pauvres. Est-ce à St Ouen qu’elle avait des pauvres des écoles, enfin des objets de ses charités. Je voudrais bien de cette manière au moins chercher à lui ressembler. Il est une manière où je la surpasse, oui, Monsieur je la surpasse, ne me disputez pas cela j’en suis sûre, sûre.
J’en reviens à mon sujet. Monsieur ayez la bonté d’arranger ce que je vais vous dire. Je destine mille francs à votre comme. Vous distribuerez cela comme vous l’entendez, mais je voudrais bien entre autre ; que ce cottage où vous avez dîné soit mieux tenu, et que l’année prochaine vous me racontiez que cela avait l’air propre et bien rangé. Dites-moi à quelle adresse mon banquier aurait à faire passer cette somme. Adieu. Adieu. Je veux une lettre tous les jours. Je vous en supplie, je vous en conjure, tous les jours un mot jusqu’au jour qui me semble qui n’arrivera jamais !
Mon médecin sort d’ici il me trouve mieux ce matin, mais très faible. Il veut de l’air, de l’air. Une pieds sont froids comme glace, & je n’ai pas la force de marcher. Il veut me faire prendre du quinine. N’allez pas tomber malade, soignez- vous bien. Imaginez que je vais maintenant m’inquiéter de votre santé. Mais elle est bonne n’est-ce pas ? Tous vos N° entre 11 et 16 me manquent encore. Excepté la lettre de Caen sans N°.
13. Val-Richer, Samedi 29 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est mon tour d’attendre et de me désoler en attendant. Pas de lettre encore ce matin. Je m’étais levé en disposition si confiante, si douce ! Il y a deux mois, je n’éprouvais point de vicissitudes, pareilles. Je n’attendais rien. Avec quelle promptitude, avec qu’elle vivacité j’ai recommencé à vivre ! Car c’est là vraiment la vie. Nous nous connaissons à peine, Madame; nous nous sommes entrevus. Je sais bien qu’en un jour en une heure, nous en avons plus appris l’un sur l’autre que tant de gens n’en apprennent à passer leur vie ensemble. Tout ce que nous ne savons pas, tout ce que nous ne nous sommes pas dit, nous le pressentons ; et au moment où nous nous le dirons, il nous semblera que nous l’avions toujours su, que nous nous l’étions dit mille fois. Cependant il est étrange de se sentir si intimement uni à une personne qu’on a vue, qui vous a vu quinze jours.
Si ma vie extérieure, et ma vie intérieure étaient bien semblables, j’aurais moins ce sentiment là ; je pourrais me croire plus connu de vous. Mais, à la voir du dehors j’ai mené une vie toute d’action, toute vouée au public, qui a dû, qui doit paraître surtout ambitieuse, personnelle, presque sévère. Et en effet j’ai pris et je prends à ce qui m’a occupé aux études, aux Affaires, aux luttes politiques un grand, très grand intérêt. Je m’y suis adonné, je m’y adonne avec grand plaisir comme à un emploi naturel et satisfaisant de moi-même. J’y désire vivement l’éclat et le succès. Et les douloureuses épreuves que Dieu ma fait subir n’ont point changé en cela ma disposition, ni mon goût. Aux jours mêmes de l’épreuve je ne me suis point senti indifférent aux incidents de ma vie publique ; et tout en en portant le poids avec le plus pénible effort, j’y ai toujours trouvé une diversion puissante et librement acceptée. Et pourtant, j’ai le droit de le dire après ce que je dis là et pourtant là n’est point du tout, là n’a jamais été ma véritable vie ; de là je n’ai jamais reçu aucune émotion, aucune satisfaction qui atteignit jusqu’au fond de mon âme ; de là ne m’est jamais venu le sentiment du bonheur. Le bonheur, Madame, le bonheur qui pénètre partout, dans l’âme, qui la remplit et l’assouvit tout entière est quelque chose de bien étranger de bien supérieur à tout ce que la vie publique peut donner. Au delà bien au delà de tous les désirs d’ambition et de gloire, de tous les plaisirs de domination, de lutte, d’amour propre et succès, il y a un désir, il y a un plaisir qui a toujours été pour moi le premier, tellement le premier que j’aurais droit de le dire le seul ; le désir, le plaisir d’une affection infinie, parfaitement égale de cette affection qui unit et confond deux créatures de cœur, d’esprit, de volonté, de goût, qui permet à l’âme de se répandre dans une autre âme comme la lumière dans l’espace, sans obstacle, sans limite, et suscite dans l’une et l’autre toutes les émotions, tous les développements dont elles sont capables, pour leur ouvrir autant de sources de sympathie, et de joie.
Vous êtes-vous jamais figurée, Madame, vous qui sentez si vivement la musique, vous êtes-vous jamais figuré quel serait le ravissement de deux harpes bien harmonieuses & jouant toujours ensemble, si elles avaient la conscience d’elles-mêmes et de leurs accords ? Voilà le bonheur, voilà le seul sentiment, le seul état auquel je donne ce nom. Eh bien madame, j’ai cru entrevoir que vous aussi, vous étiez de même nature, que pour vous aussi, les préoccupations et les intérêts extérieurs, politiques, quelle qu’eût été leur part dans votre vie, ne suffisaient point à votre âme, que vous y trouviez un bel emploi de votre esprit si actif, si élevé, si fin ; mais que vous aviez en vous bien plus de richesses que vous n’en pouviez dépenser là, et des richesses, qui ne se dépensent point à cet emploi-là. En sorte que vous m’avez apparu comme une personne qui comprendrait et accueillerait en moi ce qui se montre et ce qui se cache, ce qui est pour le monde et ce qui est pour une seule personne au monde. Voilà par où Madame vous avez eu pour moi tant d’attrait ; voilà pourquoi d’instinct comme de choix, je me suis engagé si avant et si vite dans une relation si nouvelle. Je ne me suis point trompé, je ne me trompe point n’est-ce pas ? Ni vous non plus ? Nous sommes bien réellement tels que nous nous voyons ? J’en suis sûr, très sûr ; mais à chaque nouveau gage de certitude, à chaque fait, à chaque parole qui vous révèle de nouveau à moi telle que je vous sais à chaque pas de plus que je fais dans un si beau et si doux chemin, je suis ravi comme si je découvrais de nouveau mon trésor. Que vos lettres m’arrivent donc ; il ne m’en est pas venue une seule qui n’ait ajouté à ma foi, et à ma joie. Dimanche, 1 heure. La poste n’arrive pas. D’après les arrangements que j’ai pris elle doit être ici tous les jours, à 10 heures.
Décidément les champs, les bois, les lieux solitaires, tout cela ne vaut rien ; tout cela jette dans les relations une irrégularité, une incertitude que rien ne peut compenser. A Paris tout est ponctuel, assuré. A Paris j’aurais votre lettre depuis plus de trois heures. Car j’en aurai une aujourd’hui. J’y compte. Je vais demain mener ma mère et mes enfants aux bains de mer à Trouville. J’en reviendrai le surlendemain par Caen où l’on veut me donner un banquet. Il y aura encore là des dérangements, des retards.
Quel ennui ! Madame il ne faut par se séparer. Demain, je serai au bord de cette mer qui nous sépare. Mes regards, ma pensée, s’élanceront à l’horizon, vers l’autre bord. C’est là que vous êtes, là que je vous trouverais. Je ne puis m’accoutumer à l’impuissance, humaine, à ce perpétuel et vain effort de la volonté contre des obstacles qu’après tout, si elle voulait bien presque toujours elle pourrait surmonter. Mais les impossibilités morales, les convenances, les liens, les devoirs ! Madame, il me faut une lettre.
4 heures La voilà, et je n’en ai jamais reçu une qui valut celle-là. Vous revenez plutôt, bien plutôt ! Je me tais, je me tais. Mais c’est le N°14 qui vient de m’arriver. Je n’ai pas eu le n° 13. C’est ce qui m’explique le retard. Je l’aurai probablement demain. Je n’en veux perdre aucune. Je vois que vous avez eu mon N°6 car cette lettre-ci porte l’adresse que je vous y donnais.
Adieu adieu. Que l’air est doux et léger ! G.
2. Boulogne, Dimanche 2 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous voyez comme je cours Monsieur. C’est superbe, et puis c’est insupportable car j’arrive et le bateau à vapeur est parti il y a deux heures. Il faut patienter jusqu’à demain 9 heures ! Soyez assez bon pour un faire passer le temps. Causons un peu et nous pouvons le faire bien commodément. Mon appartement est bien tranquille, pas le moindre bruit. Cela me fait une nouveauté après la bruyante rue de Rivoli. J’ai la vue de la mer de cette mer que j’aime tant & que vous connaissez si peu, & que je vous prie d’aller regarder pour me faire plaisir en descendant de voiture tout à l’heure j’ai senti une main saisir la mienne. Cela m’a donné une palpitation involontaire. C’était celle de lord Pembroke. Il ne valait pas la peine de m’agiter. Comme vous n’êtes pas femme, vous ne comprenez pas les bêtises que je vous dis là.
J’avais reçu en partant de Paris une lettre de mon mari. Je l’avais oubliée. Je l’ai ouverte aujourd’hui. Il m’écrit du 15 juin. Je me sens bien triste aujourd’hui. Je ne l’ai jamais été autant. Monsieur ces paroles dites ce jour là m’ont bien frappées.
4 h. Je viens de dîner, & j’ai reçu quelques visites. J’ai fait parler lord Pembroke, il a quitté Londres hier les Torys sont découragés, toutes les faveurs de la reine sont pour les Whigs. Lord Melbourne passe tous les jours deux heures de la matinée avec elle. Toutes ses idées sont accueillies. On ne dit rien de l’esprit et des opinions de la reine. On dit seulement qu’elle sait haïr, mais c’est bien quelque chose à 18 ans ! Elle veut à toute force chasser l’amant de sa mère. Elle le fait magnifiquement. Elle donne au chevalier Conroy trois mille lires sterling de pension pour qu’il s’en aille. Lord Pembroke s’est avisé de me parler aussi de french politics, il me dit : " Nous autres Torys nous n’avons qu’un vœu, c’est de voir M. Guizot aux affaires."
Mais monsieur ce n’est pas de politique que je veux vous parler, Je cherche... C’est de musique. Vous savez comme Je l’aime cette musique ! Comme elle m’enivre, comme elle me plait. Et bien, je l’entends, je la sens. Je n’ai pas lu aujourd’hui. j’avais trop lu hier, j’en ai mal aux yeux mais j’ai pensé à ce que j’avais lu j’ai trouvé des paroles qui m’ont été répétées. " Le paradis sur la terre." Il venait donc d’elle ? Et c’est avec elle qu’il était trouvé !
8 h. Je vous demande pardon Monsieur de vous parler à tort et à travers de tout ce qui me vient dans la tête. Quel début de correspondance et cependant, vous voyez bien que je ne vous dis rien, rien de ce que je voudrais dire. Je n’aime pas la contrainte. Je n’aime pas les souliers étroits ; un ruban qui me serre, & bien je n’aime pas plus les lettres que je vous écris, comment n’ai-je pas pensé à cela en m’engageant dans cette correspondance ? Dites Monsieur ne vaudrait-il pas mieux la laisser-là ? Hier & aujourd’hui ont été bien mal. C’est à dire bien maladroite. cela va vous fâcher, & je me sens toute humiliée d’avance de cette fâcherie.
Adieu Monsieur, adieu. C’est mon dernier mot de cette terre de France dans quelques heures je trouverai des émotions terribles. Ces pensées me font frémir. Le manteau de Raleigh (je crois que c’est le nom/ sera-t-il assez puissant ? Ah Monsieur j’ai le cœur brisé. Pensez à moi, prenez pitié de moi, je suis bien malheureuse. Adieu.
1. Abbeville, Samedi 1er juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’arrive dans cet instant bien fatiguée. J’ai faim, j’ai sommeil mais je ne puis ni manger ni dormir avant de vous avoir remercier de ce bon billet, de ces bonnes connaissances que vous m’avez fait faire. j’ai tout dévoré. J’ai cherché l’histoire, le roman, c’est là ce qu’il me fallait d’abord. Il y a trop peu de cela, mais comme le peu qu’il y a m’a émue. J’ai couru ensuite après les dates. J’ai cherché à me rappeler ce que je faisais à pareil jour. Enfin, j’ai eu toute les émotions du monde. Elles n’ont pas toutes été douces. Ah mon Dieu, que j’ai peu d’esprit à côté de ces esprits là ! J’en ressens quelque embarras. Et puis je me dis qu’il y a autre chose qui compte, et je me rassure.
Monsieur je devais commencer par vous conter hier. Votre billet porte la date de 6 heures. Je ne l’ai vu qu’à 9. Mais à 6 heures je passais devant votre porte ; un embarras de voitures dans la rue parallèle à la vôtre ayant forcé mon cocher de prendre de votre côté pour me mener chez lady Granville. J’ai été bien contente d’elle. Elle m’a répété " you are safe." Je fus dîner chez Mad. de Flahaut, mais matériellement dîner & bien vite, & puis chez moi des affaires, des arrangements à prendre. Il se trouve que je n’avais pensé à rien, que je n’avais donné aucun ordre, quand tout était à commencer lorsque tout devait être fini. Voilà cette bonne tête, qu’on appelait comme cela jadis ! J’ai été excédée à 10 heures je me suis couchée sans pouvoir. dormir. À 6 heures j’étais en voiture & dans la rue de Luxembourg déjà j’avais ouvert le paquet je lisais et je n’ai pas fait autre chose jusqu’ici, excepté de une à trois heures où j’ai fermé les yeux, je ne sais si j’ai dormi, si j’ai rêvé, je ne puis trop expliquer cela, & je ne veux pas m’étendre sur cette partie de ma journée. Ma voiture est douce je m’y trouve bien, il me semble que je ne me trouverai bien que dans ma voiture mon courrier entre dans mes goûts il me fait avancer rapidement et cependant avancer c’est m’éloigner mais j’ai hâte de le faire. On dirait que cela me fera revenir plus tôt.
Adieu Monsieur. Je serai couchée à l’heure où je revenais de Chatenay, il y a huit jours. Je crois que je dors déjà. Pardonnez-moi, Monsieur, cette sotte lettre. Vous n’en aurez pas de plus élégantes jusqu’à ce que je sois settled en Angleterre. Je vous promets des nouvelles, mais jusque là seulement, ma plus tendre amitié.
443. Londres, Lundi 19 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous recevrez ceci Mercredi 21 et le Mercredi suivant 28, dans la soirée, vous me recevrez à mon tour. Je partirai dimanche 25, pour le Havre. J’y arriverai le 26, entre 5 et 8 heures du matin. J’en répartirai sur le champ et j’irai dîner au Val Richer. Je partirai du Val-Richer, le 27, dans l’après-midi avec tous les miens, pour aller coucher à Lisieux ou à Evreux, et le 28 au soir je serai à Paris. Ainsi, le mois d’Octobre n’aura pas menti. Personne, personne pas même vous, pas même moi, ne sait combien, il sera beau. Qu’est-ce que l’attente auprès du bonheur ?
J’ai reçu hier mon congé, dans une lettre particulière de Thiers, de très bonne grâce. Je serai à la Chambre le 29. Je ne manquerai qu’à la séance royale. Je crois que je comprends bien ma situation. et que j’y satisferai pleinement en tous sens. Elle a des embarras, des convenances, des intérêts, des devoirs fort divers. Je n’en éluderai aucun. Pour ma pleine confiance il faut, à mon jugement l’adhésion du vôtre. Que de choses à nous dire ! Ce nouvel assassinat ne m’a pas surpris. Je le pressentais. C’est une rude entreprise que de rétablir de l’ordre et de la raison dans le monde. Aujourd’hui tous les scélérats sont fous et tous les fous sont prêts à devenir des scélérats. Et les honnêtes gens ont à leur tour une folie, c’est d’accepter la démence comme excuse du crime. Il y a une démence qui excuse ; mais ce n’est pas celle de Darmer et de ses pareils. On n’ose pas regarder le mal en face et on dit qu’ils sont fous pour se rassurer. Et pendant que les uns se rassurent lâchement d’autres s’épouvantent lâchement. Tout est perdu ; c’est la fin du monde. Le monde a vu, sous d’autres noms, sous d’autres traits bien des maux et des périls pareils, égaux du moins sinon passifs, pour ne pas dire plus graves. Nous avons besoin aujourd’hui d’un degré de bonheur, et de sécurité dans le bonheur dont le monde autrefois. n’avait pas seulement l’idée. Il a vécu des siècles bien autrement assailli de souffrances, de crimes, de terreurs. Il a prospéré pourtant, il a grandi dans ces siècles là. Nous oublions tout cela. Nous voudrions que tout fût fait. Non certainement tout n’est pas fait ; il y a même beaucoup à faire encore. Mais tout n’est pas perdu non plus. L’expérience, qui m’a beaucoup appris, ne m’a point effrayé ; et moi qui passe pour un juge si sévère de mon temps; moi qui crois son mal bien plus grave que je ne le lui dis, je dis qu’à côté de ce mal, le bien abonde, et qu’à aucune époque on n’a vécu, dans le plus obscur village comme dans la rue St Florentin, au milieu de plus de justice, de douceur, de bien être et de sûreté.
J’écrirai aujourd’hui au Roi. On me dit qu’il a pris ceci avec son sang-froid ordinaire, triste pourtant de voir recommencer ce qu’il croyait fini. Le Morning Chronicle parle de lui ce matin est termes fort convenables. 2 heures Rien encore. J’y compte pourtant toujours. La poste est venue tard. Et vous ne prenez pas le plus court chemin pour venir à moi ; je suis encore plus impatient le lundi qu’un autre jour. Le dimanche est si peu de chose ! Enfin, je n’ai plus qu’un dimanche.
Lord Palmerston a demandé pour moi à la Reine une audience de congé. Je l’aurai Mercredi ou Jeudi Ne dites rien du jour de mon arrivée. Sachez seulement que je viens pour le début de la session.
Adieu. Adieu. 4 heures
Voilà 455. Excellent. Ce que j’aime le mieux ; confiant, comme l’enfance; profond, comme l’expérience. Un sentiment, n’est complet qu’avec ces deux caractères. Et il n’y a de bon, il n’y a même de charmant qu’un sentiment complet. Au début de la vie on peut trouver, on trouve du charmé dans des sentiments auxquels à vrai dire, il manque beaucoup. On sait pas ce qui y manque ; on jouit de ce qui y est sans regretter, sans pressentir ce qui n’y est pas. Quand on a vécu, quand on a mesuré les choses, on veut la perfection ; on ne se contente pas à moindre prix. Et là où on ne trouve pas tout, on ne se donne pas soi-même tout entier. Je n’ai jamais été si difficile et si satisfait.
Je n’ai pas encore les détails de la métamorphose que vous m’indiquez. Ils m’arriveront, je pense dans la journée. Cela, je puis l’attendre patiemment. Je serai fort aise de la métamorphose et pas sûr, après quelques épreuves, je finis par accepter les vicissitudes de certaines relations comme celles des saisons ; en hiver, j’espère l’été ; en été je prévois l’hiver ; le ciel pur ne chasse point le brouillard de ma mémoire, ni le brouillard le ciel pur. Je me résigne à ce mélange imparfait et à ses alternatives. Triste au fond de l’âme, mais sans injustice et sans humeur. Ou plutôt ce qui s’est montré à ce point variable et imparfait ne pénètre plus jusqu’au fond de mon âme. Je le classe dans ce superficiel qui peut être grave comme vous dîtes, et influer beaucoup sur ma destinée mais qui ne décide jamais de ma vie. Adieu. Oui, adieu comme nous le voulons.
400. Trouville, Dimanche 9 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Ce qui est vrai, c’est qu’à tout prendre je suis content de ce que j’ai vu à Eu, des deux partis. J’ai vu, d’une part de la révolution, de l’autre, de la modération. Les penchants, les désirs au fond ne sont pas, les mêmes ; mais les conduites pourront fort bien s’accorder. On travaillera sincèrement à maintenir la paix ; on fera hardiment la guerre si l’occasion l’exige. Et on prévoit des occasions qui pourraient l’exiger. On ne provoquera point ; on ne commencera point. Mais on n’éludera point. Le pays est dans la même disposition ; nulle envie de la guerre, tant s’en faut ; mais un grand parti pris de ne pas accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyiez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs. J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs.
J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous serez déjà à la campagne. Je vous écrirai encore 400 demain, à tout hasard. Samedi, en revenant de West, vous trouverez une lettre et moi. Adieu. J’aspire à demain. Trois jours sans un signe de vie ! Cela m’est-il jamais arrivé ? Adieu Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Famille Guizot, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Portrait
394. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
4h 1/2
Que votre parole est puissante ! Et quand je pense qu’outre cette parole puissante, Il y aura bientôt cette voix, ce regard, qui agissent sur moi si fortement, je me sens bien petite de me laisser aller jamais à des moments de tristesse, de doute, où vous me voyez si souvent. Je rentre et l’on me remet votre 384. Il y a vos inquiétudes. Ah ne les regrettez pas, ne regrettez pas de me les avoir exprimées. Elles m’ont fait tant de plaisir. Je me sens le cœur plus large, plus libre. Le retard de ma lettre vous avait donnée du chagrin, presque l’angoisse. Je suis si contente ! Voyez cet atroce égoïsme. Haïssez-moi bien, car je jouis vivement de vos peines quand c’est à moi qu’elles s’adressent. Nous nous sommes souvent dit que nous ne savions pas rendre tout ce qu’il y a dans notre âme. Jamais je n’ai tant senti l’insuffisance de mes paroles. Mais vous verrez quand vous m’entendrez ! De près, il me semble que je serai bien éloquente Jeudi le 4 de juin.
Voici le 385, et des volumes que j’aurais à répondre, que de choses à vous dire, bien tendres, des reproches, de la reconnaissance. Vous deviez me dire un mot sur le gros Monsieur tout de suite. vous me les dites à présent. Mon cœur allait au devant des paroles de 385. si je les avais trouvées plutôt vous m’auriez épargné quelques jours de peine. Vous avez raison. Il y a bien de la susceptibilité dans l’absence. On remarque tout, cela veut bien dire que nous nous aimons, mais pour cela même il faut que nous nous épargnions mutuellement tous les petites images, car il n’y a rien de petit quand on ne peut que se dire adieu tout de suite après. N’est-ce pas ? Ne faites rien pour Génie si vous y voyiez le moindre inconvénient. Gardez-moi une place à dîner le 26. Cela vous plait, et à moi aussi.
Mes matinées sont très coupées par mon fils et mille bêtises. J’ai à peine le temps d’écrire trois lignes de suite. J’ai dîné hier chez Rothschild à Boulogne. Nous avons beaucoup causé Thiers et moi. Il m’a dit beaucoup de choses qui méritent que je m’en souvienne. Il est très sage, très contenu. La guerre à la toute dernière extrémité, il la reculera plus que ne la reculerait tout autre ! Mais si un jour elle éclate s’il la faut absolument oh alors, par tous les moyens et ravoir ce que la nature indique. Il y a deux forts arguments. L’un pour l’autre contre la guerre. Contre, parce que personne ne la veut. Pour, parce qu’il y a 25 ans qu’on ne l’a faite. Sur l’Orient, sait-on bien, sait-on assez en Europe, que la France sur ce point est in-fle-xible ? Prononçant comme cela et répétant. En Angleterre, il n’y a que Lord Palmerston qui soit de l’avis contraire à tout le monde. La session finit, dans 10 jours tout sera terminé. Odillon Barrot s’est conduit parfaitement. Sa lettre est excellente. On s’est tiré habilement du mauvais pas de la souscription. Les funérailles, qui sait ! Il est vrai que l’épreuve sera forte, car l’émotion sera dans tous les cœurs. Le million de Joseph ? Il na pas voulu me répondre du tout sur cela, il m’a dit simplement : " C’est un vieux fou. C’était une veille créance." Cela confirme sans expliquer ce qu’il veut faire. Je suppose que cela l’embarrasse.
La Prusse. La mort du Roi c’est là révolution. Je suis parfaitement de son avis et vous verrez. Au bout d’une bien longue conversation il me dit que si je ne vais pas en Angleterre, il me jure qu’il viendra deux fois par semaine causer avec moi.
There is a bribe ! I go to England.
Je vois que l’affaire Rémilly est noyée par conséquent rien de grave ou d’immédiat. Il me semble que les rapports de Thiers avec le roi doivent être meilleurs, presque vous. Cela perce dans le paroles respectives. Il me semble que je vous ai tout rapporté. Ah encore, tous les deux lui et moi nous sommes pour une République aristocratique, franchement de tout notre cœur. Je vous assure que nous avons fort bien parlé sur cela, et je crois que vous aurez fait le troisième. Nous nous sommes bien promis de nous garder le secret. Ainsi gardez-le.
Je fais mes préparatifs, et j’ai mille embarras petits et grands, parce que vous savez que je n’ai personne pour me les épargner. Simon m’a dit ce matin qu’il a vu partir toute votre famille en très bonne santé. Il se plaint que la poste lui apporte maintenant les lettres plus tard que de coutume. Je vous en préviens, moi je me plains bien plus que lui. Je suis charmée de ce que vous me dites sur meeting du Slave trade. Vous faites bien de me dire toutes les petites vanités. Cela cela devient bien grand pour moi. de tous côtés j’entends parler de vous, parfaitement J’irez voir. Adieu Adieu, et jamais assez.
393. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le pauvre mardi s’est passé pauvrement, si j’en excepte une visite d’adieux à votre mère. Elle et vos enfant un traitent, avec une bonté familière qui me plait infiniment, tout le monde a bonne mine et tout le monde a l’air gai de s’en aller à la campagne. Je serai chargée je crois de vous porter le portrait de Henriette.
J’ai vu un moment les Granville. J’ai vu et essuyé un gros orage ; J’ai diné seule avec mon file et le soir j’ai vu assez de monde. Mes habitués. Point de nouvelles, si ce n’est que Médem a eu de plus le poste de Darmstadt, ce qui lui fait de la distraction et de l’argent de plus. Il est fort content. le Duc de Noailles dit qu’on va s’ennuyer, il n’y a plus ni affaire, ni scandale. Les ambassades attendent le mort du Roi de Prusse. La duchesse de Mouchey est accouchée d’un garçon mort. C’est un grand désespoir. Je vais dîner à Boulogne aujourd’hui chez Rothschild, demain chez Brignoles, après demain chez les Granville. Vous avez là mes disssipations. J’attends votre lettre qui me dira j’espère que mon 388 ne s’est pas égaré. Je suis aujourd’hui un peu mieux qu’hier, mais pas assez bien pour aller à Epson. Qui était de votre partie, et à dîner chez Motteux ? Où allez-vous pour le ..... ? Irez-vous à Salhill, avec qui ? Je fais une quantité de questions, toutes petites, et peut-être toutes grandes. Je suis bien loin de vous, je suis bien triste d’être si loin. Serai-je bien heueuse quand je serai près ? Lord Grey m’écrit pour me presser d’arriver ; il part avant la fin du mois. Leveson mande à son père que vous êtes établi parfaitement bien. 1 heure. Pas de lettre encore. Cela est devenu bien singulier depuis le départ du gros Monsieur. 2 1/2 il faut fermer ceci. Fermer sans avoir à répondre. Je ne sais plus de vos nouvelles depuis samedi. Le cinquième jour ! Que c’est long. Adieu, Adieu.
386. Paris, Mercredi 27 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici une lettre presque aussi sûre que la parole et malgré cela je n’ose pas me livrer. Il me serait si doux de le faire cependant ! Mon bien aimé, J’ai si besoin de te redire et d’entendre des paroles d’amour. Cela est écrit, je ne veux pas l’effacer. Mais je veux me contenir et raconter.
J’ai été hier à la Chambre - curieux et pitoyable spectacle. M. de Lamartine a fait un beau discours voilà tout ce qu’il y a eu de beau. Thiers n’a pris la parole que pour dire qu’il épousait le projet de la commission, et la commission et Thiers ont été battus, ou leur a rogué un million. Votre président de la chambre s’est conduit comme un enfant, un enfant sot et fâché. La chambre a fait un tapage épouvantable ; comme des écoliers. C’était vraiment misérable. On n’est pas Bonapartiste, et hier on n’était pas Thieriste. On dit qu’il est resté accablé de cette triste séance, et qu’à sa soirée il était d’une humeur très hargneuse. Il accusais beaucoup M. Sauzet. je crois en effet que la première confusion était dû au Président. Mais pourquoi Thiers n’a-t-il pas parlé ? Cela me reste incompréhensible. La foule était grande dans la Chambre, dans les tribunes comme aux fonds secrets. Sébastiani est sorti sans voter, il m’a dit : "pauvre séance."
Le soir les ambassadeurs sont venus chez moi, beaucoup d’autres personnes tout cela assez amusé. Je crois que le Roi a pu l’être aussi. Il me semble que le grand effet théâtral commence bêtement. Au fond c’est honteux. Tout le monde trouve Thiers bien changé, vieilli, harassé. La faction Boigne dit qu’il donne des signes de folie. Je n’ai cependant entendu cela que là. On dit aussi qu’au Conseil le Roi ne parle plus. Il laisse faire. Au reste son langage sur Thiers avec les ambassadeurs n’a plus rien d’inconvenant. Ils sont assez contents de lui. Il est poli. On va faire les grands changements dans les préfectures quelques révocations, et beaucoup de mutations. Je crois savoir cela de bonne source.
Le roi de Prusse est très mal. Il n’en reviendra pas. Bresson mandait hier de fort mauvaises nouvelles, ce sera un gros événement. Le Roi de Prusse futur a beaucoup d’esprit, mais pas de tête. Il y a quelques années il détestait ceci encore plus que ne le déteste l’Empereur Nicolas, et il le disait beaucoup plus haut que lui. Il peut s’être amendé. En tout cas, on n’aura pas pour lui le respect qu’on a pour son père. Les libéraux espéreront tout de lui beaucoup. Les ultras aussi. Cela a l’air de non sens, et c’est comme cela cependant. Je m’imagine que mon Empereur va courir à Berlin pour voir encore. son beau père. Ce pauvre mourant sera très incommodé de cette visite.
J’ai été hier voir votre mère, elle est parfaitement bien, les enfants aussi, ils étaient au jardin, je suis allée les y trouver. Votre mère veut se mêler de moi, elle veut que je prenne de la camomille. ne crois et n’écoute aucun médecin. Je me sens si malade. Je vois, qu’au fond, je n’ai politiquement rien de bien intime à vous dire. C’est vous qui pourriez m’apprendre bien des choses, si vous aviez un gros Monsieur. Vos opinions sur l’Angleterre et les Anglais, je les devine. Mais sur ce qui se passe ici ; sur la politique européenne vous savez beaucoup, vous savez tout ce que j’ignore ! Je suis curieuse un peu de tout.
Quelques fois je m’imagine qu’un changement ici peut être très prochain, et alors je me dis qu’il pourrait bien arriver tout juste pour mon voyage d’Angleterre, c’est-à-dire aussi gauchement que possible. L’effet de la séance d’hier peut être quelque chose. Le pays sera un peu étonné, et les partisans de la dissolution en feront un argument assez puissant Qu’en pensez-vous ? Eh mon Dieu, je voudrais vous faire cette question sur toute chose ! Vous verrez que l’affaire de Ste Hélène sera une bien grosse. affaire. Elle a tant de faces vraiment c’est de la déraison ou de la trahison de l’avoir commencée. Et le Roi qui se vante d’en être l’inventeur !
Je vous écris tous les jours, et je m’étonne de ne pas vous écrire aujourd’hui un volume. Je suis honteuse de profiter si peu de cette bonne occasion. Je voulais remplir ma lettre d’Adieux sous toutes les formes. Imaginez-vous cela, prenez tout cela comme dans nos meilleurs temps. Dans les temps qui reviendront n’est-ce pas ?
Il me semble toujours que je commencerai pas arrivé auprès de Londres, quand ce ne serait que pour choisir de là l’Auberge où je veux aller à Londres. Mais je n’ai rien arrêté encore. Je crois que Brünnow en désespoir de cause aura écrit en cour pour empêcher ma venue. Ce sera peine perdue, on n’osera pas en dire un mot, et si on le disait je partirai seulement un peu plutôt. Non, je partirai comme j’ai dit. Je ne me fâcherai, ni ne me dérangerai pour personne Il n’y a plus que vous qui ait le droit de me fâcher ou de me déranger, n’est-ce pas ?
Adieu. Adieu, cher bien aimé. Que de choses à nous dire ! Que de doux et longs regards. Ah si nous en étions là ! Avertissez- moi bien au moins des chances politiques possibles. Un chassé croisé serait trop bête. Adieu. Adieu. Adieu, toujours toute ma vie, mon bien aimé.
374. Paris, Vendredi 15 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous me l’avez dit une fois, mon chagrin tourne toujours en injustice. C’est possible, mais voyez la différence entre nous. Je suis pressée d’être injuste et vous, vous êtes injuste à la réflexion. Vous me grondez beaucoup, vous avez vraiment tort. Voici sur quoi ma vivacité à éclater. Votre lettre vendredi : Alexandre va très bien. Je suppose qu’il ne tardera pas à partir.
Cuming Vendredi : Poor Alexandre is still very very ill. The Surgean won’t prononce him out of danger.
J’ai copié exactement. Mettez-vous à ma place. Et puis le lendemain Beackhausen confirme la lettre de Cumming en ce sens, que ce n’est que Samedi qu’en effet le chirurgien a déclaré que le danger était passé, mais qu’il fallait beaucoup de soin. Vous m’entretenez dans une pleine sincérité, et quand la vérité est venue, elle m’a terrassée. J’étais dans un état près de la folie. je m’étais pleinement fiée à vous et assurément en vous adressant plutôt à Brodie ne sachant en dire dès le commencement "ce sera long", au lieu de me dire dès Mercredi le 6, " dans deux ou trois jours il n’y paraîtra plus". Il en serait résulté deux choses ; c’est que je serais partie sur le champs et que je n’aurais pas eu ce terrible contre coup qui m’a abîmée. Et puis et surtout, je ne vous aurais pas écrit une lettre qui vous fait de la peine, vous aviez bien vu (car vous me citez ma phrase) à quel point ce n’était que vous que je voulais croire. En y regardant bien vous ne me gronderiez pas autant, je ne mérite pas cela, mais beaucoup de pitié. Vous voyez bien que j’ai senti que j’étais vive, que j’étais peut-être inquiète, je vous en ai demandé pardon, je vous le demande encore. N’ajoutez pas à tout ce que je ressens de peine de tous les genres.
En voulez-vous de l’injustice encore ? Voulez- vous de la franchise. Eh bien, j’avais bien envie hier de vous écrire une page remplie de M. Antonin de Noailles, de M. de Flamarens, je cherche encore. qui sont les beaux jeunes gens de Paris ! Pour faire pendant à une page remplie d’observation sur les charmes de 6 ou 7 belles femmes du bal de la Reine. Je fais des découvertes sur vous depuis que vous êtes à Londres. Allez-vous vous fâcher ? Me punissez-vous d’être franche ? Faut-il que je déchire cette feuille ? Je suis très combattue. Vous avez exigé que je vous dise tout. Vous voulez avant tout lire tout-à-fait dans mon cœur, et cependant, vous me ferez peut-être me repentir de ma franchise. Savez-vous ce que je crois ? C’est qu’on m’en doit avec cette rigueur que de près ; de près, lorsqu’on peut si vite effacer, expliquer. Ah de près, je sais bien que vous ne vous fâcheriez pas ! Vous feriez le contraire ! Vous verriez ce qu’il y a de profond, de tendre derrière mes paroles. J’ai beaucoup, beaucoup à dire encore, je dis trop, je dis trop peu, J’ai le cœur gros. Je lis les journaux. J’ai cherché pour voir s’il n’y avait vraiment au bal que des jeunes femmes. J’ai trouvé lord Grey, le duc de Wellington. Est-ce que vous ne causez pas avec ces personnes-là pendant 6 heures de suite que vous restez à un bal ? Vous ne me les nommez pas. Certainement et vous le dites-vous même, vos lettres sont frivoles. Vous êtes dans le tourbillon de Londres, vous le suivez en conscience, j’avoue que je n’en trouve par la raison, car je sais fort bien que c’est inutile quand on n’en a pas le goût. Je connais la mesure du temps de résidence à toute ces gaietés là. Je le sais, mais vraiment je ne vous connaissais pas. Vous êtes jeune. Je vous le disais hier sous une autre forme, vous avez sans doute raison, en tout cas vous en êtes plus heureux. Moi, je n’ai rien de jeune ou de gai à vous dire, je vous raconte du grave.
J’ai vu hier matin M. de Bourqueney, il m’a assez intéressé ; il sait plus que n’en savent la plus part des personnes qui me parlent. Après lui Montrond et le duc de Poix. Montrond étonné de ce qu’ils vont se dire le roi et lui, en se souvenant de tout ce qu’ils se disaient sur Napoléon quand ils étaient ensemble en Sicile.
Je retourne à Bourqueney qui me dit : " On est bien content de M. Guizot ici et des succès qu’a eu sa négociation pour les reste de Napoléon, vous devriez Madame lui dire cela en lui écrivant.
- Moi Monsieur ? Mais je l’ignore ; je n’ai pas entendu nommer M. Guizot dans tout cela.
- Comment Madame ? Mais M. Thiers le disait encore hier au roi.
- A l’oreille peut-être, Monsieur." Voilà exactement notre dialogue.
M. Molé est venu hier au soir tout rempli du sujet. Il est ému de la chose, mais il trouve que c’est trop tôt, qu’on remue trop les esprits, que cela est fait avec légèreté sans en avoir examiné les conséquences. La famille, la légion d’honneur, le tapage dans les rues. Il a tout passé en revue. Il dit que s’il avait cru le temps. venu de redemander les cendres de Napoléon; c’est lui Molé qui l’aurait fait, mais qu’alors il aurait autrement qualifié cet acte que ne l’a fait M. de Rémusat, que le discours de M. de Rémusat c’est la révolution, elle toute seule qu’on honore, que lui aurait montré Bonaparte comme la restauration de la religion, de l’ordre, des lois, de l’autorité, et fait tourner tout cela au profit de la monarchie tandis que M. de Rémusat n’a remué que les passions révolutionnaires et il dit que magnanime et légitime voilà les deux grands mots du discours. L’un et l’autre parfaitement, absurdement, appliqués. Ceci est assez vrai. Il critique les Invalides, il veut St Denis, le caveau que Napoléon lui même avait fait arranger pour sa race. Les Invalides, c’est encore l’enfant de la Révolution, et non le monarque. Il ajoute : " Je suis sûr que M. Guizot a trouvé que c’était trop tôt, ou bien qu’il aurait tiré de cet événement le parti que j’ai indiqué, et non les phrases qu’a débitées M. de Rémusat." Il m’a dit hier que c’était Villemain qui lui avait annoncé cela il y a 6 semaines lorsque je vous l’ai redit.
Samedi le 16, à 11heures. J’ai reçu ce matin une lettre de mon fils. Ce pauvre garçon est demeuré sourd d’une oreille, et a perdu l’usage du bras gauche. Il me mande qu’il part de Londres après demain, qu’il restera auprès de moi juqu’à mon départ. et qu’il ira ensuite à Bade. J’ai écrit avant-hier à Boulogne, pour qu’on m’envoie votre lettre. La journée sera triste je ne recevrai rien !
J’ai été voir votre mère hier. Elle est parfaitement bien, et elle a été fort compatissante pour moi. Vos filles faisaient de la musique. Guillaume jouait avec son fusil. C’est le seul que j’ai vu ; il a fort bonne mine. J’ai été voir la petite princesse. J’ai fait dîner Pogenpohl avec moi. Nous avions à règler des comptes, et il s’était occupé de tous mes préparatifs de départ. Le soir, j’ai vu les trois Ambassadeurs, et Médem, Tcham, Armin, & & M. de. Pahlen venait de chez le roi.
Le départ du M. le Prince de Joinville. est retardé à cause de sa rougeole. Il me parait que tout le monde est triste, et qu’on trouve que Thiers est trop ivre. Je ne sais guère ce qui se passe. Appony est d’une mauvaise humeur contenue J’ai fait visite hier à Mad. de. la Redorte. Elle est glorieuse. Elle affirme qu’on ne permettra pas à la famille Bonaparte de venir. C’est bien là la résolution mais assurément ce sera la première fois dans le monde que, les seuls exclus de funérailles soient les parents du défunt. On demande l’effigie de Napoléon sur la légion d’honneur, institué par le souverain légitime de la France. Ah, le discours de M. de Rémusat ! En le relisant Il est bien étrange. Au premier coup d’oeil cela a bon air, c’est ronflant, mais à l’analyse ! Je suis curieuse de votre opinion mais elle m’arrive à travers de l’eau salée !
J’ai dormi encore cette nuit, je m’en vante comme du fait le plus intéressant des 24 heures.
Adieu. Voulez- vous que je déchire cette lettre ! Voulez-vous, voudrez vous toujours que je vous dise tout avec ma funeste franchise, comme l’appelle lady Granville ? Je prends un juste milieu je déchire et j’envoie. Adieu, adieu, si vous saviez combien je pense à vous, comment j’y peuse ! Ah ! vous seriez content si cela vous fait encore plaisir. Comme autre fois, adieu,adieu, adieu.
359. Londres, Mardi 5 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
357. Londres, Samedi 2 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon dîner s’est très bien passé. De 8 heures 1/4 à 10 heures à table dans l’ordre que vous savez et qui m’a paru approuvé de tous. Le debut froid et embarrassé comme toujours et partout. Passé la première demi-heure de l’animation et de la bonne humeur. Le cuisinier et la cave ont eu grand succès. Lord Melbourne a bu du vin de Bourgogne avec un contentement réfléchi. C’est Lord Lansdowne qui a porté la santé du Roi, d’après l’avis de Lord Palmerston. J’ai porté celle de la Reine et de tous les souverains de l’Europe. La Parisienne s’est mariée au God save the Queen. Le service a bien marché un peu précipitamment. Ils étaient trop pressés de bien faire. J’avais prodigué l’éclairage ; il était brillant. Cela manque toujours ici. L’illumination était belle, mais un triste accident s’y est mêlé et me désole. La voiture du baron de Moncorvo a accroché une échelle sur laquelle était monté un pauvre charpentier qui allumait les lampions. Il est tombé et il en mourra. Il a le crâne fracassé à la base. Il n’était pas marié, mais il allait se marier. Je lui ai fait donner tous les secours possibles. Mon médecin, qui est allé le voir ce matin à Middlesex-Hospital où je l’ai fait transporter me dit qu’il n’y a pointl’avait fait de chance de guérison. J’avais pris toutes sortes de précautions contre les accidents. Comment prévenir la maladresse d’un cocher? J’ai beaucoup causé avec le duc de Wellington qui y prenait plaisir, quoique la conversation doive lui donner assez de peine. Il cherche ses idées et ses mots comme un aveugle son chemin. Il m’a raconté Charles X, et comment il avait lui toujours prèvu sa fin. Bien aise de me tenir le même langage que Lord Aberdeen qui m’a déjà dit deux fois : " Je me glorifie d’avoir été en Europe le premier ministre qui ait reconnu le Roi Louis-Philippe."
Une heure
358. Paris, Jeudi 30 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Il y a aujourd’hui 6 ans que mon mari reçut la lettre de l’Empereur lui annonçant sa nouvelle destination lettre qui lui fit lever les mains au ciel de joie, et moi de douleur. J’ai noté ce jour comme un des plus cruels de ma vie. Il y a aujourd’hui un an que mon fils ainé me déclara qu’il ne me reverrait jamais. C’est un triste jour que ce 30 avril. J’aurai de vous une lettre n’est-ce pas ? Deux probablement, car je n’ai rien eu hier. Rien depuis lundi. C’est long. J’étais inquiette hier. Je suis allée chez votre mère pour savoir si elle aussi manquait de lettres elle avait eu la sienne, ainsi vous vous portiez bien. J’ai trouvé tout votre monde en parfaite santé et vous pouvez être bien tranquille Je me suis promenée avec Marion. J’ai dîné chez M. fFeihman. De la diplomatie. On raconte que Thiers dit à propos de l’affaire des soufres : "Si j’avais fait ce que fait Lord Palmerston, qu’aurait dit l’Europe ?" C’est vrai, entendez-vous les cris d’indignation ? Il y a bien de l’injustice dans le monde. Je n’ai vu personne hier au soir. Ces dîners me font veiller tard et je manque tout le monde. Je n’ai vu que M. de Bacourt et Ellice. Je vous enverrai par le courrier des Affaires étrangères une lettre que j’ai reçue hier de Matonchewitz, elle vous intéressera.
11 heures
Midi.
Voici deux lettres l’une par le petit médecin, l’autre par le gros monsieur. Le petit monsieur l’ayant reçu que hier à 2 heures n’a plus osé venir puisque vous lui disiez de la porter avant l heure. Je l’ai renseigné pour l’avenir. Merci de toutes les deux, et de tout. Vraiment Brünnow est trop bête. L’ Europe finira par répéter cet écho. Je vous ai dit hier un mot direct par la poste pas dessus mon autre lettre. Je répete aujourd’hui. Parlez en français à l’academie. C’était mon premier instinct vous vous en souvenez. Granville m’a déroutée, et j’ai assez de confiance dans ses avis, mais cependant je crois que le Français est plus convenable. De toutes les façons, et j’y reviens avec assurance, parce que j’entends dire qu’un ambassadeur Français doit parler sa langue là où il peut être compris et c’est vrai. C’est votre inclination aussi; c’est donc dit samedi à 8 heures je saurai que vous parlez Français. Vous ne savez pas comme je m occupe et m’inquiète de tout ce qui vous regarde. Votre dîner du 16 mai me parait trop short notice pour cette saison d’autant que tout le monde prend le samedi. Il me parait que le 23 est plus sûr. Je pense que ni les Sutherland, ni les Carlisle, ni le Duc de Devonshire, ni Lord Morpeth n’accepteront. Mais cela ne doit pas vous empêcher de donner le diner Whig, il le faut absolument avant celui-pour les Torys. J’ai écrit ce matin à M. Andral. Je ne suis pas bien de nouveau. Vraiment c’est une étrange santé que la mienne, avec mon régime, mon abstinence je ne conçois pas ce qui me dérange, je ne vois plus d’autre parti à prendre que de ne plus manger du tout. On peut s’acoutumer à cela peut être. Vous pourriez prendre M. e Mrs Slanley dans le dîner Whig si vous avez place. Adieu. Adieu.J’ai bién grondé de ce que ma lettre de samedi a été remise trop tard à la poste. Ordinairement, je les porte moi-même. Je ne suis jamais sure que de moi-même. Je viens de relire la lettre de Matonchewitz. Je vous promets qu’elle vous plaira. Vous ne l’aurez pa encore aujourd’hui. Je veux la faire lire à M. de Pahlen.