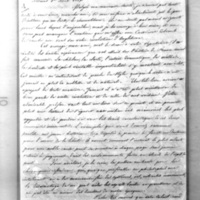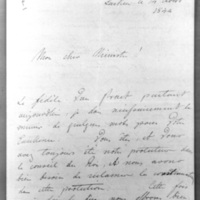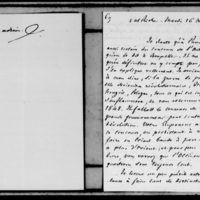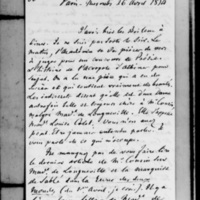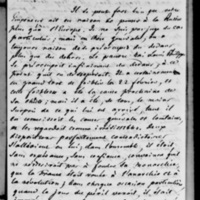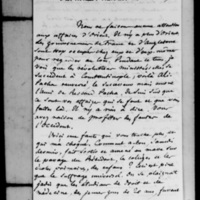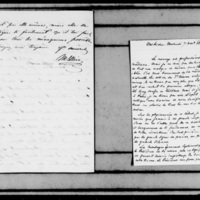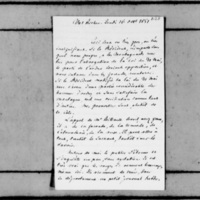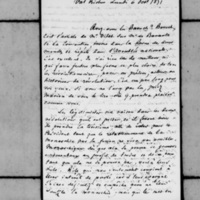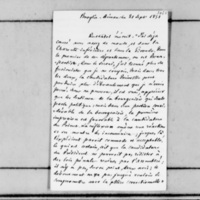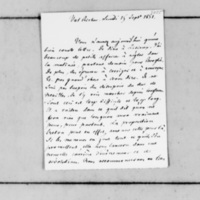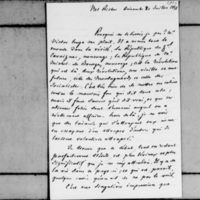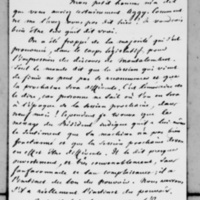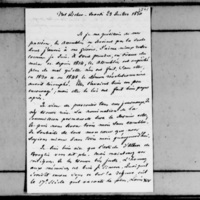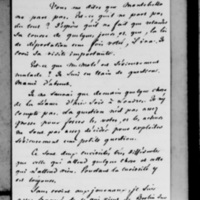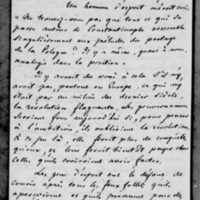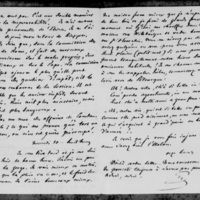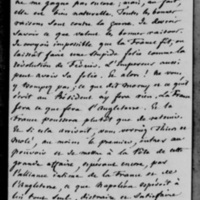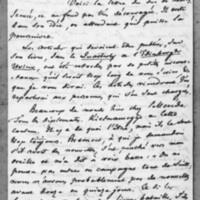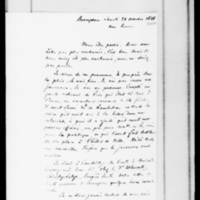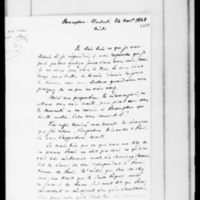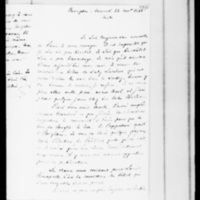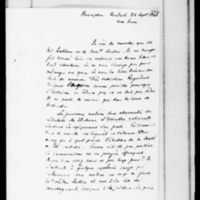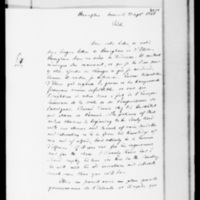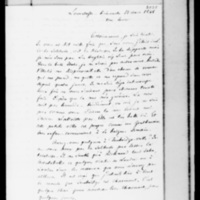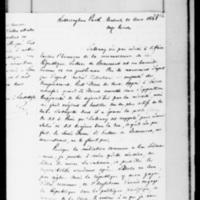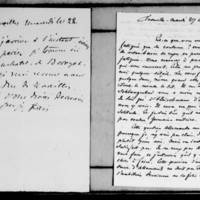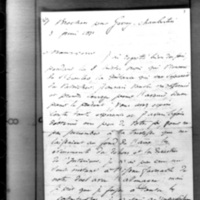Votre recherche dans le corpus : 68 résultats dans 3515 notices du site.
Clermont, le 15 octobre 1832, Le comte de Montlosier à François Guizot
Paris, le 14 février 1849, Madame de Mirbel à François Guizot
Nîmes, le 1er août 1826, Joseph Madier de Montjau à François Guizot
Lacken, le 14 août 1844, Léopold 1er à François Guizot
112. Val Richer, Jeudi 6 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je trouve le Constitutionnel d’hier curieux et grave ; son leading article sur l’Autriche et le Prince de Metternich la nouvelle escadre Anglaise dans la Manche, la proscription de votre emprunt sur toutes les grandes places de l'Europe, l'adhésion pure et simple des confédérés de Bamberg au traité de Berlin, tout cela porte un caractère d'entente et de résolution européenne qui présage une guerre de vingt ans. Quel revirement de toutes les situations ! Quel renversement de toutes les prévisions ! Ceci est aussi inattendu pour les relations extérieures des états que les Révolutions de 1848 l'ont été pour leur intérieur. Tout ce mouvement militaire et diplomatique avortera-t-il, comme le mouvement libéral de 1848 a avorté ? J’en doute. Les gouvernements engagés dans cette affaire-ci ont plus d’esprit de suite et plus de force que n'en avaient les auteurs des insurrections. Duchâtel qui revient de Vichy, m'écrit qu’il y a trouvé deux récents ambassadeurs à Constantinople, Baraguey d’Hilliers et Lavalette, et qu’il y avait peu à tirer de l’un et de l'autre. Je suis sûr que vous en auriez tiré plus qu’il n’a fait.
" On craignait beaucoup ici, me dit-il, que l'Empereur Nicolas n'opposât pas un refus décidé aux ouvertures de l’Autriche. Il n'est jamais trop tard pour être raisonnable ; j’avoue cependant que, pour l'Empereur Nicolas, se soumettre maintenant au bon sens, ce serait ou trop tôt, ou trop tard. Les résultats militaires ont été trop déplorables pour les Russes pour qu’ils puissent. en rester sur une aussi, fâcheuse impression. Rien n'égale l'incapacité qui a présidé, à l'occupation de la Debrutscha et au siège de Silistrie. On assure que, dans la Dobrudscha plus de 50 000 hommes sont morts de maladie. Cela permet de juger de l'état physique et moral des troupes qui restent. Quant à Silistrie, lever un siège devant les Turcs après avoir fait mettre hors de combat presque tous ses généraux, c’est peu honorable pour le pouvoir absolu qui, jusqu’à présent. avait en au moins le mérite des succès. militaires."
Vous voyez que tout le monde a la même impression. Duchâtel passe le mois de Juillet à Paris ou en excursion aux environs et s'en va à Bordeaux au moins d'août.
Midi
Votre N°91 ne m’apporte que votre tristesse et je n'ai à vous envoyer que la mienne. Adieu, Adieu. G.
73. Paris, Lundi 22 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je commence aussi par l'affaire. Je vous renvoie la copie de votre lettre à [Rothschild] Je suis d’avis que Génie la remette et vide cette petite question. Je viens d'en causer avec lui, il sait très bien ce qu’il faut dire, et il la dira comme il faut le dire. Vous devez garder votre appartement, sans obligation ni charge de réparations, sauf celles que vous jugerez vous-même à propos de faire, et que vous paierez vous-même.
Je ne m'étonne pas que votre Empereur rappelle Brunnow et Kisseleff de Bruxelles. Il était difficile de comprendre pourquoi, ils y restaient. Brunnow n'en fera pas plus à Vienne que M. de Meyendorff. La question n'est plus aujourd’hui dans le savoir-faire des agents de l'Empereur, mais dans la disposition réelle, personnelle et intime de l'Empereur lui-même. S’il veut sérieusement la paix, la paix est encore possible, les intermédiaires et les agents ne manqueront pas. S'il ne la désire pas sincèrement et sérieusement, personne ne viendra pas à bout de la faire. Il arrivera alors de deux chose l’une, ou bien toutes les puissances européennes seront successivement amenées à s’engager contre vous, grandes et petites, ou bien l'Europe entière tombera, dans le chaos révolutionnaire. La première chance est bien mauvaise pour vous ; la seconde est mauvaise pour tout le monde, vous compris.
Comment pouvez-vous vous dire si sûrs de la Prusse après son traité d'alliance et de garantie mutuelle, avec l’Autriche ? Il se peut que les intentions et les paroles soient toujours de votre côté ; mais les engagements et les actions sont évidemment de l'autre. Et comme ici on pèsera de plus en plus sûr l’Autriche, les mêmes causes qui l’ont amenée et la Prusse avec elle, où elle est aujourd’hui, les mèneront toutes deux plus loin. Les puissances Allemandes peuvent vous être très utiles pour arriver à la paix ; mais si la paix ne se fait pas l’hiver prochain, ce n'est pas vers vous que le courant les pousse ; et vous ne réussirez pas plus à les désunir que vous n'avez réussi à désunir la France et l'Angleterre.
J’ai passé hier la journée à la campagne, chez Mad. Mollien. Je ne suis rentré chez moi qu'à minuit. C’était un peu long.
La reine a dû partir avant hier de Séville, par Cadix et l'océan. Cependant, au dernier moment encore, elle a pu se décider à revenir par la Méditerranée. Elle était mieux, mais toujours très faible. Il me revient de Claremont que le Duc de Nemours partait pour aller au devant d'elle jusqu'à Cadix et la ramener en Angleterre où le Prince de Joinville ne revenait pas encore. Adieu.
Je ferai aujourd’hui votre commission à Duchâtel. J’ai vu Montebello qui veut toujours aller vous voir, mais qui ne sait pas bien encore quel jour. Je repartirai Vendredi soir pour le Val Richer. C'est là qu’a partir de vendredi, je vous prie de m'écrire. Adieu, Adieu. G.
69. Val-Richer, Mardi 16 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je doute qu’à Paris, on soit aussi certain du concours de l’Autriche qu'on le dit à Bruxelles. Il me revient qu'en définitive on y compte peu, et qu’on s'en explique vertement. Je reviens toujours à mon dire ; si la guerre se prolonge, elle deviendra révolutionnaire ; Italie, Hongrie, Pologne, tout ce qui est inflammable s'enflammera, et nous recommencerons 1848. Il fallait le concours de tous les grands gouvernements pour contenir la révolution. Votre Empereur a rompu le concours, en persistant à vouloir, faire en Orient bande à part. Il n’y a plus d'Orient ; et pour peu que ceci dure vous verrez que l'Occident et ses questions sont toujours tout.
Je trouve un peu puérile votre persistance à faire tant de distinction entre la France et l'Angleterre ; distinction toujours repoussée. Cela n'a pas beaucoup de dignité, et pas beaucoup plus d'habileté, surtout après la publicité de ces conversations où vous teniez si peu de compte de la France. Dans les pays où le silence règne, on se trompe toujours sur l'effet des actes et des paroles dans les pays où l'on dit tout.
Je suis bien aise que vous ayiez Montebello. Le garderez-vous quelques jours ? Andral a-t-il donné une nouvelle réponse sur Ems ou Spa ? Pure curiosité puisque la bonne résolution était prise. Il est bon que la princesse Kotschoubey soit encore quelques mois avec vous pendant que Mlle de Cerini s'y établira. Elle lui donnera le bon avis. Vous m’avez fait envie avec le bois de la Cambre et le beau soleil. Ici, je ne me promène guère que dans mon jardin. Je ne m’y promènerai pas d'ici au 27. Je pars ce soir pour Paris, par un très vilain temps ; il pleut et il fait froid. Ma fille Pauline va bien. Adieu, Adieu. Je vais faire ma toilette en attendant le facteur.
Midi
Adieu. Votre lettre est curieuse. Je vous écrirai après-demain de Paris. G.
50. Paris, Mercredi 26 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’avais hier les Boileau à dîner. Je ne suis pas sorti le soir. Le matin, l'Académie et des pièces de vers à juger pour un concours de poésie. L’histoire de l'Acropole d'Athènes pour sujet. On a lu une pièce qui a eu du succès et qui contient vraiment des beautés. Les indiscrets disent qu’elle est d’une dame autrefois belle et toujours chère à M. Cousin, malgré Mad. de Longueville. Elle s’appelle Mad. Louise Colet. Vous n'en avez peut être jamais entendu parler. Je vous parle de ce qui m'occupe. Ne manquez pas de vous faire lire le dernier article de M. Cousin sur Mad. de Longueville et la marquise de Sablé dans la Revue des deux mondes, (du 1er avril, je crois). Il y a là quelques lettres de Mad. de Longueville à son frère, au sujet de ses fils, qui sont d’un grand et bon coeur, princières, Chrétiennes et Maternelles, au fond de son couvent et sincérement détachée dn monde, elle s'inquiétait des intérêts et du salut de ses fils avec une tendresse, vertueuse et une justice fière qui m'ont touché. Evidemment, la piété l'élevait au dessus de ce frère qu’elle avait tant aimé la religieuse n’avait plus peur du grand Condé et le grand Condé avait peur d'elle.
On ne se demande même plus des nouvelles ; on les attend, en silence et avec un air de fatigue ennuyée, comme si l'on avait déjà fait de grands efforts. Tous les Anglais qui sont ici sont frappés du peu de goût, et du peu d'activité de ce pays-ci pour la guerre. Ils cherchent comment on pourra en sortir l'hiver prochain. Jusqu'ici, ils ne le trouvent pas ; et alors ils tombent dans les crises révolutionnaires, l'Italie et la Hongrie soulevées, l'Europe remanié, les nationalités en lutte déclarée, comme moyen de se tirer d'embarras. Plus je vais, plus je me confirme dans ma vieille conviction ; il n’y a pas de milieu entre la politique conservatrice et pacifique et la politique révolutionnaire ; on ne sort pas de l’une sans tomber dans l'autre. Nous sommes encore trop près des grands bouleversements sociaux pour qu’on puisse toucher au monde sans l'ébranler. Soit dessein, soit légèreté, on a oublié cela depuis un an ; on l'a oublié partout, à Londres, à Paris, à Pétersbourg. On en est déjà puni par l'impuissance. Si on n'a pas le bon sens de reconnaître la faute, et de s'arrêter, on en sera puni par la révolution.
On m’apporte les journaux. Le Moniteur prend bien des précautions pour ne pas trop froisser les relations commerciales de la France avec la Russie. On n’a jamais plus doucement préparé, et atténué d'avance la guerre.
Le Moniteur me traite moins bien que les négociants Russes. Il ordonne décidément la prolongation du boulevard Malesherbes et la démolition des maisons situées sur sa route. C'est mon cas. Grand dérangement et vif déplaisir.
Adieu, Adieu. J’espère que Vendredi ou samedi, le Duc de Noailles m’apportera de vos nouvelles, un peu détaillées. Adieu. G.
45. Val Richer, Mardi 9 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Il se peut fort bien que votre Empereur ait eu raison de penser à la Russie plus qu’à l'Europe. Je ne suis pas juge du cas particulier ; mais en thèse générale, on a toujours raison de se préoccuper du dedans plus que du dehors. Le pauvre roi Louis-Philippe se préoccupait infiniment du dedans ; à ce point qu’il en désespérait. Il a certainement en grand tort de faiblir le 22 février, et cette faiblesse a été la cause prochaine de sa chute ; mais il a été de tous, le moins surpris de ce qui lui est arrivé, tant, il en connaissait les causes générales et lointaines, et les regardait comme irrésistibles. Deux dispositions parfaitement contradictoires s'alliaient en lui ; dans l’ensemble, il était sans espérance, sans confiance, convaincu qu’il ne réussirait pas à fonder sa monarchie, que la France était vouée à l’anarchie et à la révolution dans chaque occasion particulière, quand le jour du péril venait, il était imprévoyant et sanguin, convaincu qu’avec un peu d'adresse, de souplesse et de patience. Il reviendrait sur l'eau et se relèverait après avoir plié, les deux dispositions ont également contribué à le perdre ; il a vu à la fois trop en noir et trop en beau ; il a trop désespèré du présent et trop espéré de l'avenir. On pouvait très bien résister en Février 1848, il ne l’a pas cru. Il a cru qu’il reviendrait du renvoi de son cabinet et même de son abdication ; et cela ne se pouvait pas. Il avait cela, et seulement cela, de commun avec Louis XI qu'il faisait beaucoup de fautes, et qu’il excellait. à s'en tirer, et qu’il espérait toujours avoir le temps de s’en tirer. Le temps lui a manqué pour se tirer de la dernière. Le chagrin a été pour plus de moitié dans sa mort. Le désespoir de votre N°43 est mal tombé, ce matin, après les quatre lignes du Moniteur d'hier. Vous aurez certainement eu directement l’avis de l'adhésion de votre Empereur à la proposition combinée à Vienne ? Je tiens pour impossible que le sultan n’y adhère pas aussi. Je suis donc de l’avis du Moniteur, et de la Bourse Je regarde l'affaire comme finie. Vous vous serez beaucoup tourmentée en pure perte. A part l’intérêt Européen, je suis charmé que vous voyez un terme de vos inquiétudes.
Mercredi 10 9 heures
Il me revient que Kisseleff est très content, et qu'on est très content de lui à Paris. Son attitude. et son langage, pendant toute cette crise, ont été très fermes et très tranquilles. C'est Morny qui a renversé M. de Maupas, et fait supprimer le ministre de la police. Il s'est allié pour cela avec Persigny. L'Empereur Napoléon est content de Drouyn de Lhuys et du mélange de pacifique et de guerrier qu’il a mis dans ses conversations et dans ses pièces. Bon pour tous les en cas. M. d’Hautpoul a obtenu la permission de recommencer à se promener, en mer avec son yacht de Trouville.
Mad. la Duchesse d'Orléans confie M. le comte de Paris à Paul de Ségur pour aller faire un tour en Irlande. Adieu, adieu. J'espère que demain le facteur m’apportera votre tranquillité au lieu de votre désespoir.
Par grand hasard, j’ai reçu hier une lettre de Massi ; on me dit : " La paix jusqu'ici n’est pas troublée par l'occupation ; les troupes russes observent la plus exacte discipline et payent tout ce qu'elles consomment.” Adieu. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Diplomatie (Russie), Empire (France), Famille royale (France), Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Analyse), Politique (France), Politique (Russie), Politique (Turquie), Portrait, Relation François-Dorothée (Politique), Révolution
Val Richer, Mercredi 20 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous ne faisons aucune attention aux affaires d'Orient. Il n’y a plus d'Orient. Les gouvernements de France et d’Angleterre sont trop occupés chez eux et d’eux-mêmes pour regarder au loin. Pendant ce temps, je vois que les révolutions ministérielles se succèdent à Constantinople ; voilà Ali Pacha renversé, le successeur, mais encore l’ami de Reschid Pacha. Je suis sûr que ce sont vos affaires qui se font et que vous faites là. Il n’y a rien à dire. Vous avez raison de profiter des fautes de l'Occident.
Voici une faute qui vous touche peu, et qui m’a choqué. Comment a-t-on, samedi dernier, fait sortir et amené en masse sur le passage du Président, les collèges, et les écoles primaires, des enfants ? Ceci est pire que le suffrage universel. On se plaignait jadis que les étudiants de droit et de médecine, les jeunes gens de 20 ans fussent mis en scène une politique, et on y met aujourd’hui des marmots. Ce n'est ni sensé, ni honnête.
Je ne comprends pas ce que fait Lord Malmesbury pour être mal avec l'Autriche. Je ne leur vois point de sujet de querelle ; à moins que la mauvaise humeur des voyageurs Anglais en Italie, à propos de leurs passeports, ne devienne une question de gouvernement. Ce serait bien absurde. Peut-être aussi le Piémont. qui donne sans doute de l'humeur à l’Autriche. Du reste, les puissances du continent auraient grand tort de se mettre mal avec l'Angleterre ; si jamais l’incendie révolutionnaire se rallumait ce qui n’est pas du tout impossible, c'est encore là qu'elles trouveraient, pour résister, le point d’appui le plus fixe et le plus fort.
Vous avez bien raison de trouver bon que Paris perde l'habitude de faire et de défaire les gouvernements. En soi, l'acte de puissance que font depuis quelque temps les populations des campagnes est excellent ; elles sont hors d'état de gouverner ; mais il ne faut pas qu’on puisse gouverner ou détruire les gouvernements sans elles et contre elles, et la leçon donnée en ceci aux prétentions et aux traditions de Paris est très salutaire.
Onze heures
Je n’ai pas de lettre. Adieu donc. Il fait bien beau temps. J’espère que vous avez le même soleil à Paris et que vous en profitez pour prendre l’air. Adieu, Adieu.
J'ouvre mes journaux. Vous avez perdu votre pari avec M. Molé. Nous aurons l'Empire en Novembre.
Val-Richer, Vendredi 7 novembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le message est profondément médiocre. Mais je ne crois pas du tout que ce soit un manque de dédain pour l'Assemblée. C’est tout bonnement de la médiocrité naturelle. Les articles du Dr Véron valaient mieux. Je ne trouve pas non plus que Berryer ait bien conduit sa première attaque. Il a été long, confus et hésitant. Mais si j'étais à Paris, je ne dirais pas cela. L’esprit de critique nous domine, et nous sacrifions tout au plaisir de tirer les uns sur les autres. Sur la physionomie de ce début, je crois moins que jamais à de grands coups, de l’une ou de l'autre part. On ne disserte pas si longuement et si froidement, au moment de telles révolutions. Elles sont précédées, ou par de grands signes de passion ou par de grands silences. La montagne épousant systématiquement le Président et sa mesure, cela est significatif et pourrait devenir important. Je doute que cela tienne. Le Président n'en fera pas assez pour eux et ils ne seront jamais pour lui ce qu’il veut, sa réélection. Chacun finira par rentrer dans son ornière.
J’ai mal dormi cette nuit, pas tout-à-fait par les mêmes raisons que vous. Je cherchais deux paragraphes de ma réponse à M. de Montalembert. Ils m'ont réveillé à 2 heures ; je les ai trouvés, je me suis levé, je les ai écrits, et je me suis recouché, pour mal dormir, mais pour dormir pourtant.
Le froid commence. Il gèle fort la nuit. Je vois fumer en ce moment le tuyau de ma serre. Il n’y a plus de fleurs que là. Il est bien temps d'aller retrouver ma petite maison chaude. Je ne vous écrirai plus que trois fois. Je voulais porter d’ici à Marion une belle rose en signe de ma reconnaissance. La gelée me les a flétries. Elle a bien raison d’ajouter à votre lettre des détails sur votre santé. C’est un arrangement excellent, et dont je la remercie encore.
J’ai fait ces jours-ci quelque chose d'extraordinaire dans mes moments de repos, et pour me délasser de mon travail. J’ai lu deux romans, David Copperfield de Dickens et Grantley Manor, de Lady Georgina Fullerton. Le premier est remarquablement spirituel, vrai varié et pathétique ; plein, seulement de trop d'observations et de moralités microscopiques. Le commun des hommes ne vaut pas qu'on en fasse de si minutieux portraits. Pour mon goût, j’aime bien mieux le roman de Lady Georgina, la société et la nature humaine élevée, élégante et un peu héroïque ; mais elle a l’esprit bien moins riche et bien moins vrai que Dickens. Qu'est-ce que cela vous fait à vous qui n’avez lu et ne lirez ni l'un, ni l’autre.
Onze heures et demie
Décidément mon facteur vient plus tard ; mais peu m'importe à présent. Adieu, Adieu. Je voudrais bien que vous ne violassiez pas trop les règles de Chomel. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 16 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci sera ou très gros, ou très insignifiant. Si le Président, n'importe sous quel nom propre, a les Montagnards avec lui pour l'abrogation de la loi du 31 mai, le parti de l’ordre devient opposition, et nous entrons dans les grandes aventures. Si le Président modifie la loi du 31 mai avec l'aveu d’une partie considérable des hommes d’ordre et sans satisfaire la Montagne, c’est une oscillation comme tant d'autres. Mes pronostics sont plutôt de ce côté.
L’appel de M. Billault serait assez grave ; il a de la faconde, de la témérité, de l'étourderie, de la ruse. Il peut aller à tout, tantôt le sachant, tantôt sans le savoir. Autour de moi le public s'étonne et s’inquiète un peu, sans agitation. Il est très vrai que les rouges se remuent beaucoup, même ici. Ils viennent de créer, dans le département, un petit journal hebdomadaire. Ce suffrage universel, qu’ils font colporter et répandre par paquets, même au fond des campagnes. Cela n'est pas sans action sur la multitude, même honnête, qui prend plaisir à se voir rechercher et à se croire importante.
Le parti de l'ordre prend beaucoup moins de peine, et se croit peut-être trop sûr de son fait. Certainement, les partis conservateurs de l’Assemblée se sont misérablement conduits n’osant jamais faire ni seulement dire ce qu'ils croyaient non seulement bon, mais nécessaire, et ayant peur de toucher, au seul instrument dont ils pussent se servir, le Président. Ils se sont annulés eux-mêmes pour ne pas le grandir. Par défaut de résolution ; surtout par complaisance pour leur propre fantaisie et leur humeur. Personne en a voulu se contrarier soi-même, ni contrarier ses amis. Aujourd'hui ma crainte est double ; et le parti de l’ordre et le président courent grand risque au jeu qui se joue. Les joueurs enragés peuvent espérer quelque coup heureux ; mais les anarchistes seuls ont de quoi être vraiment contents.
Je vais aujourd'hui à Lisieux pour un grand déjeuner. Je verrai là l'effet de tout ceci sur le gros public. Mon petit journal jaune me dit qu'on dit que Cartier reste. Si cela arrive, vous vous souviendrez que j'y avais pensé. Je ne sais pas si ce serait bon pour M. Carlier lui-même ; ce serait certainement bon pour nous. Il ne nous livrera pas à la Montagne. C’est un homme intelligent et résolu. Il peut avoir envie de tenter, à tout risque, une grande fortune politique, à la fois au service du suffrage universel et contre la Montagne. Dans des temps comme celui-ci, ce sont ces hommes-là qui font avancer quelque fois dénouent les situations.
M. Véron m'étonne un peu. Il était très prudent. Se mettre dans la barque d'Emile Girardin et de M. de Lamartine ! Il ne peut pas se flatter que ce sera lui qui la conduira. Quand la prudence, et la vanité sont aux prises, on ne sait jamais. Je vais faire ma toilette en attendant la poste.
Onze heures
Quel ennui que votre bile ! Je voudrais être à demain pour vous savoir mieux. Adieu, Adieu. Je pars pour Lisieux. G.
Val-Richer, Lundi 6 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avez-vous lu Baruch ? Baruch c'est l'article de M. Vitet sur M. de Barante et la Convention, inséré dans la Revue des deux mondes et répété dans l'Assemblée nationale. C'est excellent. Je n’ai rien lu de meilleur ni qui fasse justice plus ferme et plus claire de tous les révolutionnaires, passés ou présents, acteurs ou historiens de révolutions. C'est un peu long pour vos yeux. si vous ne l’avez pas lu, priez Marion de vous le lire ; elle y prendra plaisir comme vous.
Les légitimistes ont raison dans les deux résolutions qu'ils ont prises et ils feront bien de prendre la troisième, celle de voter pour le président tant que le rétablissement de la monarchie par la fusion ne sera pas possible. Monarchiques dès que cela se pourra, et gouvernementaux au profit de l’ordre, et de la paix tant que cela ne se pourra pas, voilà leur rôle. Rôle qui non seulement convient à leur intérêt de parti, car il leur épargne l’échec définitif et empêche qu'on ne leur souffle la Monarchie ; mais qui les met en sympathie et en bons termes avec la masse de la population, ce dont ils ont grand besoin. La France est monarchique au fond, et gouvernementale en attendant ; que les légitimistes soient comme elle, c'est, pour eux, le meilleur; moyen d'amener la France à être un peu comme eux ; ce qu’il faut absolument pour que la fusion et la Monarchie deviennent possibles. Que dit-on de la reculade de Thiers dans l'ordre ? Ce n'est pas lui qui a eu la pensée de la candidature du Prince de Joinville ; il ne l'a pas conseillée ; il n'en accepte pas la responsabilité. Je le reconnais bien là ; étourdi et irrésolu, téméraire et timide, ne poursuivant jamais, dans les mauvais pas les lièvres qu’il a levés. Reste à savoir si cette reculade est une manœuvre calculée ou un mouvement de retraite par embarras.
Henriette me quitte aujourd'hui et partira le 16 de Paris pour Rome. Seriez- vous assez bonne pour demander, de ma part, à M. de Hatzfeldt, s'il pourrait donner à M. de Witt quelques mots de recommandation pour M. d'Usedom qui est toujours, je crois Ministre de Prusse à Rome, et qu’on dit homme d’esprit. Ma fille, très bonne Protestante comme vous savez, désire avoir à Rome quelques connaissances protestantes surtout dans la légation de Prusse qui a à Rome une chapelle. Je donnerai à M. de Witt une lettre pour Garibaldi qu’il ira lui porter lui-même pour en avoir quelque appui auprès de la douane de Civita Vecchia, qui est, dit-on, assez difficile. Ils comptent vivre à Rome très retirés ; mais encore faut-il faire entrer ses malles et y pratiquer sa religion sans embarras. Vous serait-il possible de savoir où sont à présent, le Duc et la Duchesse de Mignano ? S'ils étaient à Rome, la Duchesse serait pour ma fille une ressource. Mais j’en doute. Onze heures Je n’ai rien de plus à vous dire qu'adieu, en attendant mieux. Adieu, adieu. G.
Broglie, Dimanche 21 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Duchâtel m'écrit : " J'ai déjà causé, avec assez de monde et dans la Charente inférieure et dans la Gironde. Dans le premier de ces départements, on est Bona partiste, dans le second, j'ai trouvé plus de fusionnistes que je ne croyais. Mais dans tous les deux, la candidature Joinville peut produire plus d’ébranlement que je n’avais pensé. Nous ne pouvons, il est vrai, apprécier que les sentiments de la bourgeoisie qui seule parle politique ; mais dans une portion considérable de la bourgeoisie, la première impression est favorable à la candidature du Prince. La réflexion amène une réaction et en montre les inconvénients ; jusque là, l'expédient paraît commode et acceptable. Ce qui est certain c’est que la candidature du Président ne pourrait pas résister à des lois pénales rendues par l'assemblée ; il n’y a pas sur ce point, deux avis ; le dévouement ne va pas jusqu'à vouloir se compromettre avec la police correctionnelle. "
" On m’a beaucoup parlé et ici, et en Saintonge, de candidature pour les prochaines élections. J'ai ajourné toute réponse définitive ; le parti à prendre dépendra des circonstances. Il se formera dans la Gironde un comité fusionniste qui servira de négociateur autre les conservateurs et les légitimistes. Chacun veut réussir et chacun sent que le succès dépend de l’union. Ce sera ici le levier des élections. La position électorale de M. Molé est très compromise dans la Gironde, pour ne pas dire perdue. Cela ne tient pas à la politique, mais au peu de soin qu'on lui reproche d'avoir pris de ses commettants. Les gens de ce pays sont pleins d'amour propre ; ils ont adopté M. Molé sous la Constituante ; ils auraient voulu au moins une visite en retour. " C'est là tout.
La lettre d’Ellice m’a attristé et point surpris. Si l'Angleterre reste entre les mains de ses amis, ils la placeront décidément sur la pente qui mène où nous sommes. Un ancien radical, qui ne l’est plus du tout, M. Austin me disait il y a trois semaines, à Weybridge : " S'il nous arrive une Chambre des Communes radicale, elle bouleversera de grand sang froid, mais de fond en comble, la société anglaise. " Et Lord John, si on le laisse faire, amènera une Chambre des communes radicale. Qui empêchera Lord John ? Je ne vois pas. Si je n’avais pas confiance dans le vieux bon sens, la vieille discipline et la vieille vertu de toute l'Angleterre, je serais très inquiet. Je le suis, malgré, ma confiance.
Quant à nos affaires à nous, Ellice répète Thiers, purement et simplement. Il est plus Thiers qu’Anglais, et il abandonne le Président. Thiers est un révolutionnaire encore en verve qui amuse un révolutionnaire blasé. Au fond de ces deux esprits-là, il y a toujours une grande aversion de toutes les supériorités et de tous les freins. Dès qu’il s’agit de rétablir vraiment l’ordre, ils rentrent dans le camp de la révolution et ils fomentent toutes les passions révolutionnaires, à tout risque. Leur situation est mauvaise car ils ne peuvent pas, quand ils ont fait une révolution rester longtemps les maîtres du gouvernement qu'elle a fait ; et ils sont obligés de recommencer. Mais notre situation à nous n'en est pas meilleure.
Je ne suis pas en disposition gaie. Je ne crains pourtant pas de grands bruits pour cet hiver. Je vous renverrai demain la lettre d'Ellice. Je suis bien aise que Marion vous revienne. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 15 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.
Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.
Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.
L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.
11 heures
Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 4 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes incomparable pour faire succéder, presque sans intervalle, la plus complète impartialité à la plus vive passion. Vous ne savez que dire à l'article des Débats sur la candidature du Prince de Joinville. Je vous assure qu’il ne détruit rien de ce que vous avez jusqu'ici pensé et dit contre cette candidature. Les Débats ne se sont pas le moins du monde inquiétés de la discuter, d'examiner si elle était bonne ou mauvaise ; ils ont saisi une occasion de faire un hymne, en l’honneur du Prince de Joinville pour couvrir leur embarras sur la question même. Ils repoussent une injure pour se dispenser d'avoir un avis. Que l'effet de leur article puisse être mauvais, je ne le conteste pas, et j’aimerais infiniment mieux qu’ils n'eussent rien dit ; mais je l'ai relu attentivement j’y avais à peine regardé hier matin, en fermant ma lettre ; c'est de la politique purement personnelle dans une situation équivoque, et pour se réserver la faculté de dire plus tard oui ou non selon le besoin de cette situation. Il y a des attaques contre les patrons de la candidature du président et des insinuations contre les patrons de celle du Prince de Joinville. On prépare et on élude. Et on finit par donner au Prince de Joinville des conseils pour son bonheur. Je ne sais ce que fera le Journal plus tard ; mais ceci n’est pas sérieux. Je n'ai encore vu que bien peu de personnes de ce pays-ci ; mais personne ne s'attend à un coup d'Etat ; et s’il arrive sans quelque fait nouveau qui le motive. On n'y comprendra rien.
La disposition des esprits est vraiment singulière et leur fait bien peu d’honneur comme esprit ; on n'a pas du tout le sentiment du danger de la situation ; on est sans confiance, mais aussi presque sans inquiétude. On semble se dire : " Nous nous en tirerons toujours ; après tout, cela ira toujours bien aussi bien que cela va à présent, et cela nous suffit. " Il n'y a point de milieu entre le désespoir de Jérémie et ce stupide aveuglement. Je suis fort triste et encore plus humilié.
Montebello m'écrit, fort triste aussi, mais je vais entrevoir de plus, dans sa tristesse un peu de perplexité. Je n'ai point de perplexité du tout ; nous avons bien plus raison que nous ne croyons. Et il faut nous établir chaque jour plus nettement dans notre avis. Je répondrai bientôt à Montebello. Je voudrais bien qu’il fût tranquille sur sa femme.
Je regarde, et je regarderai attentivement à ce qui se passe en Autriche. Ce sera curieux. Il n’arrivera, à la révolution et aux révolutionnaires, rien qu’ils n'aient mérité ; mais je voudrais bien que la réaction fût conduite habilement, et qu’il en résultât une vraie réorganisation. Je suis un peu pour les gouvernements, comme vous pour les diplomates ; je m’y intéresse, quelque soit leur nom comme à mon métier, et il me semble toujours que je suis pour quelque chose dans leurs revers ou dans ceurs succès.
10 heures
Votre lettre confirme, un peu mes conjectures instinctives. Je croirai au coup d'Etat quand je l’aurai vu. Mais ce qui me plaît le plus de votre lettre, c’est que vous vous sentez mieux. Paris vous reposera et le bon effet des eaux viendra peut-être. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 20 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi ne le dirais-je pas ? M. Victor Hugo me plaît. Il a remis tout le monde dans la vérité. La République du Gal Cavaignac, mensonge ; la République de M. Michel de Bourge, mensonge ; c’est la révolution qui est là, deux révolutions, une vieille et une future, celle des Montagnards et celle des Socialistes. C'est très bien de se mettre en colère contre le mauvais fou qui dit tout cela ; mais il faut savoir qu’il dit vrai, et que ces odieuses folies sont l'ennemi auquel on a réellement affaire. Hors de là, je ne vois que des badauds qui s’attrapent eux-mêmes en essayant d'en attraper d'autres qui se laissent volontiers attraper. Je trouve que ce débat, tout en restant parfaitement stérile est plus sérieux et plus significatif que je ne m’y attendais. Il y a de la vie dans ce pays-ci ; ce qui est, paraît, quelque envie qu'on ait de ne pas le voir. C'est une singulière impression que de recevoir l’écho de ce bruit dans le silence de ma solitude.
Mon gendre Conrad m’arrive demain pour passer ici quatre jours. Ils ne veulent pas me laisser plus longtemps seul. Pauline qui est à merveille ainsi que son enfant, vient s'établir avec son mari samedi prochain 26. Henriette est obligée de rester encore trois ou quatre semaines à Paris ; sa fille va mieux et on espère qu’elle ira décidément bien ; mais il n'y a pas moyen de la séparer en ce moment de son médecin. Le Val Richer aura revu un moine pendant huit jours. Vous savez que moine veut dire solitaire.
Je suis bien aise de ce que vous dit Lady Allice sur le ballot. Je ne me fie pourtant pas beaucoup à ces indifférences superbes des Ministres. Je compte plus sûr le bon sens anglais que sur la fermeté de Lord John. Croker, dans sa dernière lettre caractérise le genre et le degré d'habileté des Whigs, et le mal qu'ils laissent faire grâce à celui qu'ils ont l’air d'empêcher, avec beaucoup de vérité et de finesse. Je suis frappé de ce que vous me dites que la réaction va trop vite à Berlin. C'est mon impression aussi, sans bien savoir. Et j'ai peur que cette réaction, qui va si vite, ne soit, au fond, pas plus courageuse qu'habile. Avez-vous remarqué ces jours-ci un article Alexandre Thomas dans les Débats à ce sujet ? Il était plus précis et plus topique que ne l'est ordinairement cette signature.
Je trouve le Constitutionnel bien faible depuis quelque temps. Rabâcheur, sans confiance en lui-même. Est-ce que le Président serait déjà un vieux gouvernement ? Le plus grand des défauts dans ce pays-ci.
Onze heures
Le facteur ne m’apporte pas grand'chose. Petit effet de Dufaure. Pas plus grand de Barrot, M. Moulin m'écrit pendant que Barrot parle. Le discours de Berryer reste entier, et jusqu'ici seul, du bon côté du moins. Mon gendre Cornélis m’écrit : " Ce discours a fait dans Paris une grande sensation, plus grande qu'on ne pouvait l'espérer. Tout le monde en parle, et ce qui est singulier, tout le monde l'a lu. Les journaux anti légitimistes y ont beaucoup contribué ; ils ont cherché à entourer la fusion sous les couronnes décernées à M. Berryer, et pour éviter d'apprecier l'acte politique, ils ont adressé à l'orateur des louanges excessives, en affectant de ne voir là qu’un beau discours. Mais le public n'est pas de leur avis " Adieu. Adieu. Je suis charmé qu’il vous arrive du renfort. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 18 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Je suis curieux du discours de Berryer qui commençait si bien. Il aura voulu répondre sur le champ à Michel de Bourges, et mettre sa Monarchie en face de cette République. Aura-t-il poussé à fond son attaque et nié à Michel de Bourges, la République pour ne lui laisser que la Révolution ? C'est là le coup à porter aux Montagnards. Il ne faut pas leur permettre de se dire des républicains. Ils ne sont que des révolutionnaires, qui tueraient la république, s'ils y dominaient, tout aussi bien que la monarchie. Plaisante République que celle qui ne vit qu'à condition que le pouvoir soit aux mains des hommes monarchiques et que les hommes monarchiques gouvernent par la force armée et l'état de siège ! Et qui périrait demain s'il en était autrement ! C'est une stupidité, et une lâcheté de laisser les coquins et les fous se cacher sous de beaux mots ; il faut les appeler de leurs vrais noms et leur dire les choses telles qu'elles sont. Certainement on ment beaucoup parmi nous, et c’est un grand défaut ; mais nous en sommes bien punis car on nous paye de tout avec des mensonges. Et nous nous laissons faire. Sauf le ménage d’un bout à l'autre, il y a de l’esprit et du talent dans le discours de Michel de Bourges, et il mérite une bonne réponse. Jusqu’ici ce débat n'est ni violent, ni commun. Il n’est que vain.
J’oublie que je suis seul, et je cause comme si nous étions ensemble. Du reste, je supporte bien ma solitude. C'est une épreuve que je n’avais jamais faite. J’ai eu hier deux longues visites dont j’ai désiré la fin comme si j'étais constamment très entouré. L’air du pays est au profond repos. Point d’idée, point d'affection, point d’ambition, point de politique, rien, absolument rien que la préoccupation des intérêts privés, qui ne vont pas assez bien pour qu'on croie à ce qui est comme à un régime durable, ni assez mal pour qu'on désire, avec un peu de risque un changement. " Manger pour vivre et non pas vivre pour manger " était la devise d’Harpagon. " Vivre pour manger " est aujourd’hui celle de la France. Les vauriens ne désirent pas et les honnêtes gens n'espèrent pas autre chose.
Voilà mes nouvelles. Il faut que vous vous en contentiez. Je me rappelle le comte Beroldingen. Je doute qu’il soit pour vous une grande ressource.
Onze heures
Vous paraissez un peu moins ennuyée. Moi je suis charmé du succès de Berryer. M. Mollin, m'écrit : “ il a tué la discussion. Il a tenu à peu que la clôture ait été prononcée. On dit que Montalembert et Barrot vont renoncer à la parole. Victor Hugo est à la tribune et débite en comédien sa prose boursouflée. Ou le débat reprendra une vigueur nouvelle, ou nous finirons demain ! Ainsi, les républicains et les légitimistes auraient seuls parlé. Adieu. Adieu.
Ma petite fille va mieux. Pauline et son mari viendront me rejoindre dans huit jours. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 16 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Je me lève. Voilà une vie tranquille et saine. J’écrirai, des lettres ou autre chose jusqu'à 10 heures. La poste arrive. C'est mon événement. Je lis mes lettres. Je descends dans le jardin. Je remonte et je fais ma toilette. A 11 heures, je déjeune. Je me promène. Je remonte dans mon Cabinet, et je lis mes journaux. D'une heure à 7, je travaille et je me promène. A 7 heures je dîne. Après mon dîner, j'arrose mes fleurs une demi-heure. Je rentre et je lis jusqu'à 10 heures. Pas une âme, pas une voix, autre que mon valet de chambre et mon jardinier. On va commencer à savoir dans le pays que je suis arrivé, et on viendra un peu me voir. Nous parlerons de l'assemblée et du Président. Mais je resterai encore en grand repos.
Ma petite fille continue à aller mieux ; mais comme elle continue aussi à être fort délicate, je doute que le médecin d'Henriette lui permette de quitter Paris avant quinze jours. Je mettrai ce temps là à profit pour mon travail et pour mon repos.
Voilà donc la révolution Portugaise qui avorte comme les autres. Etrange temps où les révolutions sont si aisées à faire et si impossibles à poursuivre ! On ne les empêche jamais d’arriver ; mais dès qu'elles sont là, on les arrête. Je voudrais que le comte de Thomas vint à Paris l'hiver prochain. Je serais bien aise de le connaître. Que dites-vous de l'aplomb de Palmerston sur Pacifico ? et du bon sens anglais qui laisse tomber cette sottise sans mot dire, étant décidé à n'en pas renverser l’auteur ? Le vice originel du gouvernement représentatif, ce sont les paroles exagérées, et les paroles vaines tous les pays qui en essayent donnent à plein collier dans ce vice-là. L'Angleterre seule s’en défend ; elle sait parler bas, et même se taire.
10 heures
Je viens de lire mes lettres d'abord ; puis un coup d'œil sur les journaux. M. de Falloux me plaît, et le général Cavaignac m'amuse. Je lirai attentivement. J'en ai le temps. La campagne double la longueur de la vie. Vous allez mieux puisque vous ne m'en parlez pas. Vous ne me dites rien de Marion. Il me semble qu’elle doit être une grande ressource de conversation habituelle. A-t-elle autant d’esprit que de mouvement ? Ce n’est pas tout de remuer ; il faut avancer. Point de nouvelle de Paris. C’est vues qu’il faut dire. A qui se rapporte ce mot vu ? De qui parlez-vous ? De vous et de Marion. Vous êtes femmes, donc le mot qui vous regarde doit être au féminin. Vous êtes deux femmes. Donc il doit être au pluriel. Est-ce clair ?
Adieu. Adieu.
Je vais faire ma toilette. Je la fais pour moi seul comme si je devais passer ma journée à voir du monde. Adieu. G.
N°29. Val-Richer, Jeudi 1er juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon petit homme m’a dit que vous auriez certainement Aggy . Comment ne me l’avez vous pas dit hier ? Je voudrais bien être sûr qu’il dit vrai.
On a été frappé de la majorité qui s’est prononcé, dans le corps législatif, pour l'impression du discours de Montalembert. Tout le monde dit que la session qui vient de finir ne peut pas se recommencer et que la prochaine sera différente. C’est téméraire de le dire car personne ne sait où l'on en sera à l'époque de la session prochaine, dans neuf mois ! Cependant je trouve que le message du Président, indique qu’il a lui-même le sentiment que sa machine n’a pas bien fonctionné et que la session prochaine devra en effet être différente. Il l'a dit presque ouvertement, et très convenablement, sans fanfaronnade, et sans complaisance ; il a l’instinct du ton du pouvoir. Nous verrons s’il a réellement l’instinct du pouvoir. Ce serait bien le moment.
L’Europe est évidemment dans l’une de ces époques critiques où l'habileté des gouvernants peut décider, pour un assez long temps, de l'avenir. L’esprit révolutionnaire a beau être encore très fort ; il est bien malade, car il est décrié ; il a été naguères le maître, et il n’a rien su faire, rien de bon, ce qui est fort simple mais rien non plus de hardi et de grand, même mauvais ce qui lui arrive quelquefois. Evidemment la balle revient à l’esprit de gouvernement ; saura-t-il la saisir et la manier ? Démêlera-t-il bien ce qui se peut et ce qui ne se peut pas, ce qui suffit et ce qui ne suffit pas ? C'est là l'art et le secret.
J’ai des nouvelles d'Aberdeen décidément la question religieuse dominera dans les Élections anglaises. Popery or not Popery ! Voilà le résultat de ce qu’a fait la cour de Rome en Angleterre et du coup de tête du cardinal Wiseman. Je suis et je reste protestant ; mais je ne veux point de mal à l’Eglise catholique, tout au contraire. Je suis convaincu qu’elle peut seule reprendre l'influence religieuse et relever moralement la société dans les pays qui sont restés catholiques, et qui ne se feront certainement pas protestants. Mais je crains un peu que l’Eglise catholique, n'ait perdu les qualités qui l’ont jadis distinguée et qui ont tant fait pour la force, la connaissance, des temps et la mesure. Je trouve qu’elle n’a pas l’air de comprendre du tout ce temps ci. Elle se remue beaucoup partout ; elle tracasse ici les gouvernements, là les peuples, mais ce sont de vieilles tracasseries, toujours les mêmes, et qui indiquent, dans les chefs catholiques, une grande ignorance, non seulement du temps actuel et de l’esprit des nations, mais du temps passé et de leur propre histoire. Ils se souviennent de ce qu’ils ont été ; ils ne savent plus par quelles voies ni à quel prix ils étaient devenus ce qu’ils ont été. Je serais bien fâché que l’Eglise catholique fût déchue à ce point ; le monde à besoin d'elle car elle y tient encore une place qu'aucune autre église Chrétienne ne peut prendre. Et il faut que le monde reste, ou devienne, ou redevienne chrétien.
Soyez sûre que si ces affaires là ne vous intéressent pas, vous avez tort ; ce seront certainement de grandes, et peut être les plus grandes affaires des temps qui s'approchent.
10 heures et demie
Je reçois le N°23, et les extraits qu’il contient et qui sont intéressants. Adieu, adieu. Je ne sais où vous recevrez ceci. G.
N°11 Paris, Vendredi 11 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
On nous inquiète ici sur l'état intérieur de l’Autriche ; on dit que l’esprit révolution naire y est toujours très fort, et que le gouvernement reste moralement faible depuis la mort du Prince de Schwartzenberg et disposé à se conduire comme les gouvernements faibles, des concessions et des ajournements partout. Que faut-il croire de cela ?
Je suis frappé de l'échec du Cabinet Anglais à propos de la motion de M. Horsman. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué. C’est un symptôme positif de l'accès de ferveur protestante qui va présider aux élections. Il en résultera une nouvelle décomposition des anciens partis anglais. Les Torys étaient les Protestants par de excellence ; l’esprit protestant était dans le peuple leur point d’appui contre l’esprit révolutionnaire ; ils ne peuvent plus, ou ils ne savent plus, ou ils n'osent plus s'adosser fortement à ce point d’appui-là. Ils seront sans force, dans les masses, contre les radicaux politiques. Je crois qu’il y avait moyen, pour eux, de rester énergiquement Protestants sans persécuter les catholiques. M. Pitt trouverait, ce moyen là. Mais M. Pitt est mort, décidément mort. Toutes mes craintes anglaises viennent de là.
Votre N°5 qui m’arrive à l’instant m'inquiète un peu malgré vos résolutions d'impolitesse, vous serez plus polie que vous n'êtes forte, et vous vous fatiguerez. Vous aimez les Princes, Dieu s'amuse à vous en donner plus que vous n'en pouvez porter.
J’ai rendu à M. Fould sa visite, sans le trouver aussi. Il venait de partir pour Fontainebleau, avec le président, je suppose. Ils sont toujours très bien ensemble. On parle de quelques changements ministériels, partiels et politiquement insignifiants. Le ministre de l’instruction publique, M. Fortoul serait remplacé par l’un de ses prédécesseurs. M. de Parieu. On prononce le nom de M. Nisard, homme d’esprit et de mes amis, vous savez. Il est, je crois, en bons rapports avec M. de Maupas. Je ne sais rien de plus, et je ne crois pas qu’il y ait rien de plus à s'avoir.
Nous entrons décidément dans la saison morte. Tout le monde s'en va et se tait. Il n’y a plus que les évêques qui parlent, et qui se disputent. Voilà M. l'archevêque de Rheims et M. l’évêque d'Orléans aux prises sur le Christianime ou le Paganisme des livres classiques. Et l'Univers, chassé des séminaires du diocèse d'Orléans, régnera dans ceux du diocèse de Rheims. Est-ce que nous aussi, nous échangerons les querelles politiques contre les querelles religieuses ? Adieu. Je crains bien quelque trouble dans nos lettres à l'occasion de mon départ pour le Val Richer. Mais vous y aurez pensé. j’espère. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 24 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Partant dans quatre jours pour aller vous voir, il me semble déjà que ce n'est plus la peine de vous écrire. D’aujourd’hui en huit, nous causerons, s'il plaît à Dieu comme disent toujours mes amis anglais, qui ont raison. Certainement, nous avons beaucoup à nous dire ; il n’y a point de temps si stérile en événements qui le soit, entre nous, pour la conversation. Et puis, on appelle aujourd’hui stérile toute semaine qui n'amène pas quelque grosse chose. Je me défends de cette disposition qui est, au fond, celle qui fait faire, de nos jours, tant de sottises. Je tâche de ne pas m'ennuyer de ce qui dure et de contenter ma curiosité à meilleur marché que des révolutions.
J’ai des nouvelles de Rome. Le Gouvernement du Pape ne s’y rétablit guère ; mais l'ébranlement s’apaise. On oublie le passé et l'avenir. On vit au jour le jour, en rentrant dans les anciennes habitudes. C’est un repos qui reste à la merci d'une poignée de conspirateurs et d’une occasion. Le Pape est dans Rome, mais Mazzini n’est pas vaincu. Il faudra que l’armée française reste là longtemps. Et quand elle quittera Rome elle restera encore longtemps à Civita Vecchia. Personne n’y pense et ne s'en soucie. Lord Palmerston aurait bouleversé, l’Europe pour me chasser de là. Peu lui importe que la République y soit. Il a raison. La République, pour garder Rome, n'en est pas plus puissante en Italie ; pas plus que la sentinelle qui garde la Banque n'en possède les trésors. Quand les révolutions sont à la porte, les gouvernements ne sont plus que des sentinelles. La question italienne est insoluble. Autrefois, on se résignait aux questions insolubles ; on cessait d’y penser. Aujourd'hui, on ne se résigne à rien : on pense toujours à tout. Aussi la force matérielle doit être toujours partout. L’Etat de siège devient l'ordre Européen.
10 heures
La Commission permanente est nommée bien péniblement, et bien mêlée. L'opposition légitimiste et montagnarde a fait passer plusieurs des siens. Le gâchis augmente. La nouvelle querelle de Changarnier avec le Ministre de la guerre est encore replâtrée, mais cela ne peut guère aller loin. Le Président, ne pourra pas soutenir toujours d’Hautpoul.
Ce que vous me dites d'Angleterre me préoccupe. Si la Chambre des communes se met aussi à démolir son propre gouvernement, cela finira par mal tourner. Adieu, adieu. J’ai plusieurs petites lettres à écrire et mon facteur ne peut pas attendre longtemps aujourd’hui. Adieu G.
Val-Richer, Mardi 23 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si je me guérissait de mes passions, les Assemblées, ne seraient pas la seule dont j’aurais à me guérir. J’aime mieux rester comme je suis. A tout prendre en France du moins, et depuis 1814, les Assemblées ont empêché plus de mal qu'elles n’en ont fait. Sans elles en 1830, et en 1848, le démon révolutionnaire aurait triomphé. Elles l'avaient bien un peu encouragé ; mais elles le lui ont fait bien payer après. Je viens de parcourir tous mes journaux. Je n’y trouve rien. La nomination de la commission permanente sera le dernier acte. Et puis nous serons trois mois sans assemblée. Je souhaite de tout mon cœur que nous soyons mieux dans trois mois qu'aujourd’hui. Je suis bien aise que l'article d’Albert de Broglie vous ait plu. Mais maintenez vos critiques. Je les trouve très justes.
L'homme aux mémoires est bien Saint-Simon. Quoiqu'il écrivit encore sous et sur la Régence, c’est le 17ème siècle qu’il raconte le plus. Louis XIV et sa cour. J'en lis tous les soirs 30 ou 40 pages, là et là à mes enfants. Cela les amuse parfaitement. Je n’ai pas lu les Sophismes en frustrade dont vous parle Marion. Si cela en valait la peine, je les ferais demander. J’ai demandé s'il y avait déjà quelque chose d'un peu complet sur Peel. On me répond qu'il y a un livre, publié, il y a deux ou trois ans par un Dr. Cooke Taylor " Sir Robert Peel and his Times." Vous n'avez surement par entendu parler de cela.
J’ai des nouvelles de Ste Aulaire. Il me dit qu’Horace Vernet, raconte que votre Empereur est toujours charmé de la République en France et surtout partisan zélé du général Cavaignac. C'est sa plus grande nouvelle. Vous voyez que je suis à peu près aussi stérile qu'Ems. Adieu. Adieu. Voilà enfin le soleil revenu. La pluie nous a accablés pendant quelques jours. Adieu. G.
Midi
Je rouvre ma lettre. Je viens d'avoir une visite qui me rend ma liberté pour le 6 août. J'irai donc vous voir à présent. Je partirai d’ici samedi prochain 27. Je serai dimanche matin, à Paris. J’en partirai le soir ou lundi matin pour Bruxelles et je serai à Ems mardi soir 30 ou mercredi Il. J’y passerai huit jours avec vous. Il faut que je sois à Paris, dans la journée du 11. Si Aberdeen vient à Ems, tant mieux. Sinon encore tant mieux. Grand plaisir que cette petite course. Adieu, adieu.
Soyez assez bonne pour m’assurer à Ems un petit logement. J’aurai avec moi un domestique, Adieu encore. G.
Val-Richer, Samedi 8 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Vous me dites que Montebello ne part pas. Est-ce qu’il ne part pas du tout ? J'espère qu’il ne fait que retarder sa course de quelques jours, et que, la loi de déportation une fois votée, il ira. Je crois sa visite importante. Est-ce que M. Molé est sérieusement malade ? Je suis en train de questions. Manie d'absent. Je ne saurai que demain quelque chose de la séance d’hier soir à Londres. Je n'y compte pas. La question n'est pas assez grosse pour forcer les votes, et les acteurs ne sont pas assez décidés pour exploiter sérieusement une petite question. Ce sont deux curiosités très différentes que celle qui attend quelque chose et celle qui n'attend rien. Pourtant la curiosité y est toujours. Sans croire aux journaux, je suis assez frappé de ce qui vient de Berlin sur la visite du Prince de Prusse à Varsovie. Evidemment, cette visite a changé quelque choses aux dispositions de l'Empereur. Il a bien raison du reste de ne pas se jeter à l'aventure dans ce chaos allemand. Décidé et réservé, c'est son attitude depuis Février, elle lui a réussi. Il n'en doit sortir, s'il en sort, que pour quelque chose de très grand et d’indispensable.
10 heures
Les journaux répètent, et vous confirmez le départ de l'Empereur d’Autriche pour Varsovie. Il y a ou concert entre les trois souverains, ou lutte de deux devant un. Je crois plutôt au dernier fait. La querelle de l’Autriche et de la Prusse n'ira pas à la guerre ; ils ne le veulent pas eux-mêmes et au besoin vous l'empêcherez. Mais c'est une querelle, très sérieuse, querelle de prépondérance et d’ambition, qui recommencera toutes les fois que la question révolutionnaire sommeillera. Les jours de repos sont finis pour l’Europe ; l'être paisible qui était la réaction de l’ère belliqueuse de l'Empire est accomplie. Nous entrons dans la réaction contraire. Je ne crois pas aux grandes et longues guerres ; mais des menaces des commencements des échantillons de guerre, des révolutions, des quasi-révolutions, de contre-révolutions une instabilité générale, rien qui dure et rien qui finisse, c'est là ce qui nous attend pour longtemps.
Ce que Thiers vous a dit de son projet de visite à St Léonard me frappe assez et je crois à votre application de son départ ou de son retard. Je suis ennuyé de cette antithèse ; elle est trop longue et trop monotone.
Voilà Londres fini ; car évidemment le retard, c’est la fin. Quand le cabinet viendra amener qu’il est raccommodé avec la France, la Chambre des Lords ne votera pas une censure ; ou si elle la vote, le cabinet n’en tiendra compte. Ce sera de l'opposition platonique. Les individus s'en peuvent accommoder, mais les corps ne se résignent pas à étaler ce mélange de mauvais vouloir et d'impuissance. Ajournée au 17, la motion de Lord Stanley tombera dans l’eau ou sera rejetée.
Est-il vrai que Mercredi dernier, à l'assemblée générale de l'Institut, au milieu d’un grand discours de Salvandy, un pigeon blanc, qui s'était introduit dans la salle est venu se poser sur sa tête et s'est si bien empêtré dans son toupet qu’on a eu quelque peine à l'en dépêtrer ? On me mande cette bouffonnerie. Je n’y puis pas croire. Ce serait trop drôle. Adieu, et merci de votre longue lettre. Avez-vous encore vos deux fils ? Adieu Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 25 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 Heures
Un homme d’esprit m'écrit ceci : « Ne trouvez-vous pas que tout ce qui se passe autour de Constantinople ressemble singulièrement aux préludes du partage de la Pologne ? Il y a même, quant à nous, analogie dans la position. » Il y aurait du vrai à cela, s’il n’y avait pas, partout en Europe, ce qui n’y était pas au milieu du dernier siècle, la révolution flagrante. Les gouvernements seraient fous aujourd’hui si, pour penser à l’ambition, ils oubliaient la révolution. A ce jeu-là, elle ferait plus de conquêtes qu'eux et leur ferait bientôt payer cher celles qu’ils croiraient avoir faites. Les gens d’esprit ont le défaut de courir après tous les feux follets qu’ils aperçoivent, et qu’ils prennent pour des lumières. Cela les empêche de voir le grand soleil qui est en haut, et qui leur montre le vrai chemin. Je ne m'étonne pas de vos terreurs ; je m’en désole ; et à cause de ce que je leur trouve de fondé, et à cause de ce que je leur trouve d’exagéré. De la sécurité, le sentiment de la sécurité à Paris, vous n’avez pas pu y compter ; je n’ai pas à me reprocher de vous avoir rien dit qui pût vous tromper à cet égard. Aujourd’hui en France, il faut se résigner au fait et au sentiment de l’insécurité. Mais rien n’annonce des désordres prochains matériels et il y a tout lieu de croire que même survint-il quelques désordres de ce genre, il n’y aurait point de dangers pour les personnes, surtout pour les personnes étrangères, surtout point de dangers si prompts qu’ils fussent imprévoyables et indétournables. Il ne faut donc ni s'endormir ni perdre le sommeil. Quel ennui d'être loin et de ne pas avoir avec vous, sur ce point là encore plus que sur tout autre, ces conversations infinies où à force de se tout dire, on finit par atteindre ensemble à la vérité et pas s'y reposer! Enfin dans trois semaines nous en serons là. J’attends assez impatiemment ce qui a dû se passer hier à l'assemblée à propos de Napoléon Bonaparte qui a dû se plaindre qu'on mît de côté sa proposition sur le rappel des bannis pour ne s'occuper que de celle de M. Creton. C'est le second défilé du moment à passer. Si on le passe à l'aide de ces quelques paroles du rapport sur la proposition de M. Creton : ne pas prendre, en considération, quant à présent, et avec regret, on s’en sera tiré à bon marché. Avec qui et avec quoi le Président. ferait-il son coup d’état impérial avant la fin de l'année ? Je comprends qu’il ait besoin d’argent ; mais pour se procurer de l'argent, il faut, ou une assemblée qui vous le donne de gré, ou des soldats qui le prennent, pour vous, de force. Je ne vois à sa disposition ni l’un ni l’autre moyen. Il est vrai qu’à Strasbourg et à Boulogne, il ne les avait pas non plus ni l'un ni l’autre, à cela, je n'ai point de réponse, sinon qu'à Strasbourg et à Boulogne, il n'a pas réussi. Il s’appelait pourtant Louis Napoléon comme aujourd’hui. C'est beaucoup un nom ; ce n'est pas toujours assez.
Onze heures
Votre lettre d’aujourd'hui me plaît, politiquement et personnellement. Ne vous fatiguez pas. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Lundi 22 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
sept heures
J’ai eu hier ici Réné de Guitaut. Je l’ai tourné et retourné en tous sens. Il y a quelquefois beaucoup à apprendre des petits hommes de peu d’esprit. Ils reproduisent, sans y rien ajouter, la disposition du gros public. Je n'ai pu découvrir aucune inquiétude prochaine et sérieuse. Il affirme que le public ne croit pas du tout au triomphe des rouges, ni à la guerre, les deux seules choses qu’il craignît s'il y croyait. Je ne comprendrais pas comment le parti modéré se laisserait battre, ayant la majorité dans l’assemblée qui est la force morale, et le général Changarnier, qui est la force matérielle. Le mérite de cette position, c’est qu'elle donne au parti modéré la légalité, et rejette ses adversaires, Président ou autres, dans la nécessité des coups d’Etat, impériaux ou révolutionnaires. L'Empire et la Montagne ne peuvent plus arriver autrement. Je ne puis croire qu’ils tentent sérieusement d'arriver, quelque étourdi que soit l'Empire et quelque folle que soit la montagne. Il crieront ; ils se débattront, ils menaceront ; ils ne feront rien. Le pouvoir restera à l’assemblée, c'est-à-dire aux modérés, car il me semble impossible qu'ils perdent la majorité dans l’assemblée. Cela ne résout point les questions d'avenir. Mais cela prolonge sans secousse la situation actuelle. Je cherche incessamment dans tout cela, ce qui vous touche.
Je ne vois, quant à présent, que la guerre qui puisse réellement vous toucher. Et je ne crois pas plus à la guerre qu’il y a trois semaines. Regardez bien à tout, mais ne vous tourmentez pas plus qu’il n’y a sujet. Je peux bien vous dire cela, car je suis parfaitement sûr, moi, que je me tourmente autant qu’il y a sujet. Je n'aurai jamais un plus cher intérêt, en jeu. On me dit que M. Bixio disait le soir même de son duel avec Thiers : « J’ai eu tort. J’avais entendu dire cela à M. Thiers dans son cabinet, où il n’y avait que deux autres personnes. Je n’aurais jamais dû en parler. Je me suis laissé aller. J’ai eu tort. » Je trouve Montalembert excellent, presque toujours vrai au fond, et toujours saisissant, entrainant dans la forme. Un jeune cœur uni à un esprit qui prend de l’expérience. La dernière partie du discours est charmante, vive, tendre, pénétrée, abandonnée. C’est vraiment le pendant de son discours à la Chambre des Pairs sur les affaires de Suisse. Je saurai le vote ce matin, car je pense qu’on aura voté avent hier. Nous verrons ce qui en résultera pour le Cabinet. Pouvez-vous savoir ce que c’est qu’un M. Edouard de Lackenbacher, Autrichien à Paris, qui se dit envoyé par Le Prince de Schwarzemberg pour causer avec les gens d’esprit et expliquer la politique de son Cabinet ? Il ne parle que des affaires intérieures de l’Autriche, et il en parle dans un bon sens. Je serais bien aise de savoir d’où il vient réellement et ce qu’il vaut.
Onze heures et demie
Je ferme ma lettre avant d’ouvrir un journal. N’allez pas être malade, Tout le reste est passager ou supportable. Adieu, Adieu. G.
Val-RIcher, Mardi 9 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pas un mot des affaires de Constantinople ; ce qui me prouve qu’à tort ou à raison, on n'en est guère préoccupé. Mercredi 10, Huit heures Je me lève tard et je me suis couché hier de bonne heure. J'avais un peu mal à la gorge. Je vais mieux ce matin. J’espère que la pluie va cesser et le froid sec commencer. Je l’aime beaucoup mieux. Ma maison ferme mieux que je n'espérais. J’ai de bon bois et je ferai de grands feux, presqu'au moment où j'irai me chauffer dans ma petite maison rue Ville-l'Evêque et votre bonne chambre rue Florentin. Vous ne m’avez pas dit si vous aviez quelqu'un en vue pour vous accompagner. Quel plaisir (petit mot) si nous pouvions passer tranquillement notre hiver dans nos anciennes habitudes ! Je me charme moi-même à me les rappeler. Hélas connaissez-vous ces trois vers de Pétrarque : Ah ! Nostra vita, ch'e si bella in vista, Com' perde agevolmente, in un matino, Quel che'n molti anni a gran pena s'acquista ! « Ah, notre vue, qui est si belle en perspective, comme elle perd aisément, en une matinée ce qui s’acquiert à grand peine, ou beaucoup d’année ! " Je crois que je vous fais injure et que vous savez bien l'Italien. Onze heures Voilà votre lettre. Nous causerons demain. Je persiste toujours à n'avoir pas peur. Adieu Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Guerre, Inquiétude, Politique, Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Italie), Politique (Russie), Politique (Turquie), Politique (Vatican), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Révolution, Vie domestique (François), Vie quotidienne (François)
Val-RIcher, Mardi 9 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures du matin.
Votre perplexité me désole. Elle ne me gagne pas encore ; mais au fait elle est bien naturelle. Toutes les bonnes raisons sont contre la guerre. Je devrais savoir ce que valent les bonnes raisons. Je croyais impossible que la France fit, ou laissât faire une stupide folie comme la révolution de Février. L'Empereur aussi peut avoir sa folie. Et alors ! Ne vous y trompez pas ; ce que dit Morny et ce qu’il écrit au Président n’y fera rien. La France fera ce que fera l’Angleterre. Et la France poussera plutôt que de retenir. Et si cela arrivait, vous verriez Thiers et Molé, au moins le premier, entrer au pouvoir, et se mettre à la tête de cette grande affaire, espérant encore, par l'alliance intime de la France et de l'Angleterre ce que Napoléon espérait à lui tout seul, distraire et satisfaire l’esprit de révolution par la guerre, en le contenant. Chimère, mille fois chimère dans laquelle ils échoueraient bien plus vite et bien plus honteusement que n'a échoué Napoléon, mais chimère qui les tenterait (je les connais bien) et qui bouleverserait le monde. Car vous dîtes vrai; ce serait la guerre partout, et la révolution partout. Cela n’arrivera pas ; cela ne se peut pas. Il ne se peut pas que l'Empereur soit aussi fou et aussi aveugle que la garde nationale de Paris en Février. Personne ne peut prévoir, personne ne peut imaginer quels seraient, en définitive, les résultats d’un si épouvantable bouleversement, mais à coup sûr, ils ne seraient bons pour aucun des grands et réguliers gouvernements aujourd’hui debout. La fin du monde profiterait peut-être un jour à quelqu'un certainement pas à ceux qui y auraient mis le feu. Même conclusion de ma part et avec la même conviction. Mais je répète que votre perplexité me désole car enfin la chance existe, et quel serait notre sort, à nous deux, dans cette chance ! J'y pense sans relâche comme si j’y pouvais faire quelque chose. Cela ne sera pas.
Neuf heures
Je n’ai rien à espérer aujourd’hui. Je vous renvoie votre lettre allemande. Intéressante. C’est un homme d’esprit. Assez ressemblant à Klindworth. Je voudrais bien que l’Autriche et la Prusse parvinssent à s'entendre, pour quelque temps au moins, et à rétablir un peu d'ordre, en Allemagne. Si l'Empereur veut bien ou la guerre, il aura la guerre et pas Bem, et Bem bouleversera de nouveau l'Allemagne pour lui faire la guerre. Je ne fermerai ma lettre qu'après l’arrivée de la poste, pour voir si j’ai à vous dire quelque chose de Paris. Midi Le facteur arrive très tard. Je n’ai que le temps de fermer ma lettre. Adieu, Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je comprends que l’Autriche et la Russie insistent pour se faire rendre les fugitifs hongrois et polonais. Je comprends que la Turquie, refuse de les rendre. Certainement aucun des grands gouvernements Européens ne les rendrait. Être la seule nation en Europe capable de cela, c’est beaucoup. Les Turcs ne sont plus assez barbares. Sont-ils assez faibles ? Si j’avais à parier, je parierais que les fugitifs s’évaderont et iront en Angleterre. Vous ne ferez pas la guerre à la Turquie pour les reprendre. La France et l’Angleterre ne vous feront pas la guerre, avec la Turquie pour l'aider à ne pas vous les rendre. Tout le monde sera dans une impasse dont tout le monde voudra sortir. Ils s’évaderont. On criera d’un côté, on se taira de l'autre. Et bientôt on n’en parlera plus. Resteront dans le monde Kossuth, Bem, et Mazzini, trois hommes qui se seront fait un nom dans les événements de 48 et 49. La seule chose qui en reste. En apparence du moins et pour quelque temps car si les évènements ont été impuissants et ridicules, leurs causes subsistent, toujours redoutables, à ces trois hommes correspondent trois questions dont deux, l’Italienne et la Polonaise sont insolubles mais très vivaces et dont la troisième la Hongroise ne peut être résolue que par un bon gouvernement Autrichien, ce qui n’est par sûr. Et le vent de folie révolutionnaire, et socialiste soufflant toujours sur ces trois places de l’Europe, il y a à parier que l’accès de fièvre chaude qu'elles viennent de lui donner n’est pas le dernier. Si vous lisiez les journaux légitimistes, vous verriez que le parti catholique lui-même, les politiques du moins, M. de Falloux en tête ne songent qu’à profiter du Motu proprio du Pape pour sortir de Rome sauf à négocier encore après pour obtenir de lui quelque chose de plus, un peu plus d’amnistie ou un peu plus de constitution. On n'insistera pas sur le dernier point. Qui gardera le Pape et Rome après cela ? Peu importe. On aimera mieux les Espagnols que les Autrichiens. On se résignerait aux Autrichiens. L’armée française aura rétabli le Pape dans Rome, et protégé la politique modéré. C’est assez pour s'en aller. Que la politique modérée, et le Pape deviennent ensuite ce qu’ils voudront. La République française ne songe qu'à se laver les mains des révolutions et des restaurations qu'elle a faites. Ni pour les unes, ni pour les autres, elle ne se charge du succès.
Je suis frappé de la rentrée en scène, à Paris de Proudhon et de Louis Blanc par leurs nouveaux journaux la Voix du Peuple et le Nouveau monde. Le parti modéré a beau vouloir dormir ; ces gens-là, ne le lui permettront pas. Ou des batailles au moins annuelles dans les rues, ou un gouvernement assez fortement constitué pour que ceux-là, même qui ont envie de la bataille la croient impossible ; il n’y a pas moyen d'échapper à cette alternative. Il faut que la société mette le socialisme sous ses pieds, ou qu’elle meure de sa main. Et pour mettre le socialisme sous ses pieds, il faut ou cent mille hommes et le général Changarnier en permanence dans Paris, ou un vrai gouvernement. Combien de temps maintiendra-t-on le premier moyen pour s’épargner la peine de prendre le second ? C’est la question.
Onze heures
Nous ne pouvons nous répondre que le lendemain. Je vois que vous craignez plus que moi que la rupture entre la Russie et la Porte ne devienne sérieuse. Si elle devenait sérieuse, vous auriez le dernier. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 1er août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève d'impatience. J’attends la poste. Elle n’arrivera qu'à 10 heures et demie. Que m'apportera- t-elle ? J'ai reçu hier une lettre de Mad. Austin qui me dit que son mari, qui est à Brighton lui écrit que tout le monde s'y porte bien. Je désire beaucoup que vous ayez vu MM. Guéneau de Mussy. Mais que sert tout ce que je puis vous dire de loin ?
Avez-vous remarqué, dans le Times de samedi dernier 28, un excellent article sur l'état de la France que je retrouve dans le Galignani d'avant- hier 30 ? Vraiment excellent. Jamais la conduite de l’ancienne opposition dynastique, et de Thiers en particulier, n’a été mieux peinte et mieux appréciée. Beaucoup de gens en France voient et disent tout cela ; mais ils n'en font ni plus ni moins. Le bon sens porte ses fruits en Angleterre. Là où, il se rencontre en France, c'est une fleur sans fruits. Rien ne se ressemble moins chez les peuples du midi, que la conversation et la conduite ; ce qu’ils pensent et disent ne décide pas du tout de ce qu’ils font. Pleins d’intelligence et de jugement comme spectateurs, quand ils deviennent acteurs il n’y paraît plus. Bresson et Bulwer m’ont souvent dit cela, des Espagnols. Bien pis encore qu'ici, me disaient-ils. Nous n'avons plus le droit d’être sévères pour les Espagnols. Les Hongrois se défendent énergiquement. Je ne sais pas bien cette affaire-là. Je crains que le Cabinet de Vienne par routine ne se soit engagé dans des prétentions et des déclarations excessives non part contre le parti révolutionnaire de Hongrie, mais contre les anciens droits et l’esprit constitutionnel de la nation. On ne saurait séparer avec trop de soin ce qui est national de ce qui est révolutionnaire, ce qui a un fondement en droit et dans les mœurs du pays de ce qui n’est que rêverie et insolence de l’esprit d'anarchie. Le Prince de Schwartzemberg, est-il en état et en disposition de faire ce partage ? Je parle d'autre chose pour me distraire d’une seule chose. Je n'y réussis guères. Adieu. Adieu jusqu'à la poste.
10 heures trois quarts
M. de Lavergne et M. Mallac m’arrivent de Paris, et la poste n'est pas encore là. Parce que j’en suis plus pressé que jamais. Je n'ai pas encore causé du tout avec ces messieurs. Ils sont dans leurs chambres. Je ne pourrai causer avec personne que lorsque j'aurai ma lettre et pourvu qu’elle soit bonne. Voilà ma lettre. Excellente. J’ai le cœur à l'aise. J’étais sûr que M. Gueneau de Mussy vous plairait. Croyez-le et obéissez-lui autant que vous le pourrez faire pour un médecin. Il m’est très dévoué. Il vous soignera bien. Adieu. Adieu. Je vais rejoindre-mes hôtes. Adieu dearest. J’espère que le bien se soutiendra. G.
Brompton, Mercredi 27 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
Voici la lettre du Duc de Noailles Sensée et au fond pas très découragée. Il reste dans son idée, en attendant qu’il puisse la poursuivre. Les articles qui devaient être publiés, sur son livre, dans le Quarterly et l'Edinburgh review, ont été retardés par de petites circonstances qu’il serait trop long de vous écrire, et que je vous dirai. Ces articles viendront. J’en reparlerai aux personnes qui s’en sont chargées. Beaucoup de monde hier chez Collaredo. Tous les diplomates. Kielmansegge et Lettp contents. Il y a de quoi l'être, mais ils le sont trop toujours. Brunow, à qui je demandais s'il avait des nouvelles, s’est penché vers mon oreille et m'a dit à voix basse : « On ne pourra pas entrer en campagne, tout de suite ; nous n'aurons probablement pas de nouvelles avant douze, ou quinze jours. Et si les Hongrois ne veulent pas livrer babaille, s’ils se retirent dans le pays, il faudra bien les y suivre, et ce sera long. " Je vous répète textuellement. Je vous répète aussi que Bunsen me fait toujours fort la cour, et veut décidément me rendre prussien. Il ne m’a parlé que des affaires de France. Je me trompe. Quelques mots de vive satisfaction sur la défaite de Microlawski à qui le Roi de Prusse avait déjà pardonné deux fois, et serait, pour cette fois, dispensé de pardonner, car, on a proclamé la loi martiale et il n’y aura qu'à laisser faire. En sortant, dans le cloak-room, j’ai rencontré Lady Palmerston. Moins de coquetterie avec moi que de coutume. Evidemment une nuance d'humeur. Le discours de Lord Aberdeen sur l'Espagne. Voici les frivolités du bal. La Princesse Augusta de Mecklembourg dansant avec passion, et venant s'asseoir ensuite dans l'embrasure d’une fenêtre pour me parler avec passion de la lâcheté des Princes. Elle me traite comme une ancienne connaissance qui lui a plu autrefois, et comme un compagnon de tristesse et de colère. Lady Alice Peel et Lady Aylesbury dansant, l’une près de l'antre, au même quadrille, et allant se reposer, l’une à côte de l'autre sur le même banc. Lady Jersey me disant très haut : " Venez donc causer. " En m'emmenant dans un petit salon où se tenaient trente ou quarante personnes uniquement occupées à regarder, celles qui causaient et à essayer de les entendre. Madame Duchâtel, moins jeune que Lady Alice et ne dansant pas, quoiqu’elle eût dansé la veille, à ce que m'a dit Guillaume, chez Mrs Jeniors. Une seule contredanse. Je le dis à l'honneur du bon sens français. Duchâtel n’était pas là. Il a été repris de sa fièvre tierce. Il en a eu trois accès. Dumon viendra de Dieppe, voir la Duchesse d'Orléans à St Leonard. Hébert aussi. Et d’Haussonville. Et Albert de Broglie. J’irai vers le milieu de la semaine prochaine. Je viens d'avoir une longue conversation avec Disraeli. Il fait lundi une grande attaque contre toute la politique intérieure et extérieure du ministère, une revue générale de l’état des affaires anglaises, au dedans, et au dehors. Où en était l'Angleterre, chez elle et en Europe, au printemps de 1846 ? Où en est-elle aujourd’hui ? Depuis trois ans vous êtes le gouvernement, un gouvernement sans opposition, qu'avez-vous fait du pays? Décadence de prospérité et décadence d'influence. Détresse et déconsidération. Vous dites que votre politique est libérale. Non ; révolutionnaire. Vous encouragez les révolutions avant qu'elles éclatent ; et quand elles ont éclaté vous ne savez ni leur inspirer la sagesse, ni leur prêter la force. Sans prévoyance avant, sans influence après. Que votre politique est pacifique. Non ; vous brouillez partout les cartes ; la paix ne sont pas des cartes brouillées. Qu'elle est vraiment nationale, Anglaise. Non ; elle est toute personnelle. La nationalité de l'Angleterre n'a que faire de servir d’instrument à la personnalité de Lord Palmerston & & Il dit que ce débat durera deux ou trois jours. Il ne pense qu'à planter son drapeau et à former, son armée pour la campagne prochaine. Adieu. Adieu.
J’aimais mieux ma matinée d'hier. J’ai été déjeuner cher Sir John Boileau, excellente famille, dont l'amitié me touche. Je resterai à lire et à écrire jusqu'à l’heure du dîner, chez Lady Galway. Je rentrerai de bonne heure et je me coucherai. Adieu. Adieu Je n'ai rien de Paris aujourd'hui. G.
Brompton, Samedi 28 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Vous êtes partie. Donc vous n’êtes pas plus enrhumée. C’est bon. Mais si vous aviez été plus enrhumée, vous ne seriez pas partie. Je viens de me promener. A peu près sans la pluie. Je vais bien. Je n’ai pas encore mes journaux. Je n’ai vu personne. Excepté un garde national de Paris qui était là tout à l'heure, me racontant comment, le 24 février, il avait sauvé M. de Rambuteau et toute la peine qu’il avait eue à le hisser dans un cabriolet. A quoi il a ajouté qu’il avait une passion effrénée, non pas pour Mad. de R. mais pour la politique ce qui l’avait fait destituer de sa place à l’hôtel de Ville. Voilà toutes mes nouvelles.
J’espère que les journaux vont arriver. Je serai à Cambridge de lundi à Vendredi, Ecrivez-moi donc là, chez le Dr Whewell, Trinity lodge. Jusqu'à jeudi. Votre lettre de Jeudi arrivera à Brompton quelques heures avant moi. Je ne serai jamais content de vous voir à Brighton. Mais je serai moins mécontent quand je vous y aurai vraiment vue. Je ne puis souffrir de ne pas connaître votre maison, votre appartement. C’est bien assez de l'absence, sans y ajouter l'ignorance.
Vous aurez peut-être à Brighton des nouvelles du spectateur de Londres. M. de Matternich est très fâché qu’il ne paraisse plus. Il a fait venir Melle K. pour lui dire de continuer. Une bonne somme était venue de St Pétersbourg. Mlle K. ne peut pas. Elle ne sait pas où est son père, et dit qu’il l'a abandonnée, elle et le journal.
On vient de m’apporter la Revue des deux mondes. Le second article de M. d’Haussonville sur notre politique étrangère n’y est pas encore. Il y a en revanche, un assez curieux article de M. de Langsdorff sur Kossuth et Gellachion, des détails qu’on n'a pas vus ailleurs. Vous devriez vous faire lire cela. La Revue des deux mondes se trouve probablement à Brighton. C'est le n° du 15 octobre.
2 heures
Le Journal des Débats seul m'est arrivé. Je viens de lire la séance. Je ne comprends pas bien. Mon instinct est que la prompte élection est donc l’intérêt de Louis Bonaparte. Mais alors pourquoi Cavaignac l’a-t-il voulue ? Pourquoi l'Assemblée l’a-t-elle votée ? Je parierais presque que l’arrangement est fait entre Louis Bonaparte et Thiers. Odilon Barrot a parlé comme un compère. C'est une mêlée bien confuse. L’Assemblée se montre inquiète de sa propre responsabilité, et pressée de s’en décharger en partie sur un Président définitif. Nous y verrons plus clair dans quelques jours. Je n'ai rien de Paris. Ce qui me frappe c’est à quel point toutes les opinions, tous les partis se divisent, se subdivisent, se fractionnent en petites coteries qui cachent leur jeu. Grand symptôme de pauvreté d’esprit et de personnalité mesquinement ambitieuse. Je suis triste de l'aspect de mon pays. Plus triste qu'inquiet. La décadence me déplait plus que le malheur. Le discours de M. Molé est bien petit. Adieu. Adieu.
Je compte bien avoir lundi matin de vos nouvelles. Je ne pars pour Cambridge qu'à une heure. Adieu, puisqu’il faut recommencer Adieu.
Brompton, Mardi 3 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je reviens d'Albany où j'étais allé voir Macaulay. " Vous êtes, m’a-t-il dit la première personne que j’aie vue à Londres depuis huit jours." Il vit dans une complète solitude, imprimant son histoire de la Révolution de 1688 qu’il publiera en décembre. Il ne savait absolument rien.
La Rosière est venu ce matin. Amusant sur le passé, car il a quitté Paris il y a plus de six semaines. Des détails sur les premiers temps de la Révolution, Lamartine, Rémusat, Thiers. Croyant à Thiers une assez bonne position dans la Garde nationale de Paris. Attendant la fin prochaine, sans en savoir plus que nous. Il quitte Mad. la Duchesse d'Orléans dont il parle très bien. Situation matérielle déplorable, portée avec une parfaite simplicité et dignité. Plus disposée qu’on me dit à accueillir les combinaisons qui rendraient l'avenir de ses fils plus sûr. M. le comte de Paris avait le visage un peu meurtri d’une chute sans gravité. Très bien du reste, et le duc de Chartre très aimable. Décidé à rester en Allemagne, et à se conduire comme si elle était à Claremont. Point d’intelligence directe ni séparée avec Paris. La Rosière convaincu que la République rouge est plus forte en Allemagne qu'en France, et que, si elle prévalait un moment en France, l'explosion en Allemagne serait très forte. Je n'ai point d’autre nouvelle.
Vous me direz demain où je dois aller vous voir demain soir à quel numéro de Mivart, car il y en a quatre ou cinq. Passerez-vous là quelques jours ? Les jours passent si vite ! Adieu. Adieu.
Il fait bien beau. Le parc de Richmond est encore bon. Où vous promènerez-vous à Brighton ? Adieu. J’espère que vous ne vous êtes plus ressentie de votre estomac. G.
Brompton, Vendredi 24 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai enfin terminé mon travail. M. Lemoinne que j'ai retenu, l'emportera dimanche à Paris. Je vous l'apporterai mardi.
Je crains bien que ce que vous me dites de ce pauvre Rossi ne soit pas vrai, et qu’il ne soit bien réellement mort. Le Morning Chronicle dit le savoir de son correspondant à Rome comme de Paris. M. Libri, qui sort de chez moi, me disait que le Comte Pepoli arrivé ces jours-ci de Rome, lui avait dit que Rossi réussissait et réussirait plus qu'on n'avait espéré. C'est pour cela qu’ils l’ont tué. Les révolutions de ce temps-ci sont stupides, et féroces. Elles tuent les hommes distingués, et n'en créent point. M. Libri a reçu ces jours-ci une lettre de sa mère qui lui écrit : « Il se prépare dans les états romains des choses abominables. » On s'attend à des massacres dans les Légations. Je veux encore espérer que Rossi n’est pas mort ; mais je n'y réussis pas. Sa mort m’attriste plus peut-être qu'au premier moment. Ce n'était pas vraiment un ami ; mais c'était un compagnon. Nous avons beaucoup causé dans notre vie. Il me trouvait quelquefois compromettant. Moi, je le trouvais timide. Il est mort au service de la bonne cause. Nous nous serions repris très naturellement, si nous nous étions retrouvés.
J’ai dîné hier chez Reeve, avec Lord Clarendon, que je n’avais pas encore vu. Bien vieilli sans cesser d'avoir l’air jeune. Un vieux jeune homme. Toujours aimable, et fort sensé sur la politique générale de l’Europe. Il était presque aussi content que moi du vote de l'Assemblée de Francfort contre l'Assemblée de Berlin. Il me semble que ce vote doit donner de la force au Roi de Prusse, s’il peut en prendre. Lord Clarendon, est très occupé de l'Irlande et la raconte beaucoup. Il y retourne sous peu de jours. Nous avons parlé de tout, même de l'Espagne. Il s'est presque félicité qu'elle fût restée calme et Narvaez debout. J’ai très bien parlé de Narvaez. Et même de la reine Christine. Il n'a pas trop dit non. Ils ont tous l'oreille basse du côté de l'Espagne. Clarendon est allé à Richmond et parle bien du Roi.
Je dîne Lundi chez Lady Granville. Partout Charles Greville, de plus en plus sourd. Et sans nouvelles. Voici vos deux lettres. L’une très sensée. L’autre assez amusante. Moi qui n’ai pas grande opinion de la tête de M. Molé, j’ai peine à croire à son radotage auprès de Mad. Kalorgis. Est-ce qu'elle est revenue à Paris du gré de l'Empereur, et pour le tenir au courant de grands hommes ? La séance de l'Assemblée nationale sera curieuse demain. Ils s’entretueront. Mais Cavaignac seul a quelque chose à perdre. Ce qui l'a provoqué à provoquer cette explication. La lettre de MM. Garnier-Pagès, Ducler & & est une intrigue pour remettre à flot M. de Lamartine et le porter à la Présidence à la place de Cavaignac décrié. Adieu. Adieu. Je suis bien aise que vous n’ayez plus miss Gibbons sur vos nerfs. Adieu. G.
Mots-clés : De la Démocratie (ouvrage), Diplomatie, Discours du for intérieur, Politique (Allemagne), Politique (Espagne), Politique (femme), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Italie), Portrait, Relation François-Dorothée (Dispute), Réseau social et politique, Révolution, Travail intellectuel
Brompton, Mercredi 22 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Je suis toujours sans nouvelles de Paris à vous envoyer. Il est impossible que je n’en aie pas bientôt. Je sais que Duchâtel n'en a pas davantage. Je crois qu’il viendra dîner aujourd'hui avec moi. Je viens de recevoir un billet de Lady Lovelace qui me presse d’aller les voir dans le Surrey. Dumon y va. Comme de raison, je refuse. Je ne veux plus aller nulle part avant Noël, où j'irai passer quelques jours chez Sir John Boileau.
J’irai vous voir Mardi. J'aurai complétement terminé ce que j'écris. M. Lemoinne emportera, le manuscrit à Paris pour que le Duc de Broglie, le lise. Je l’apporterai mardi à Brighton. Je vous en lirai quelques fragments après l'élection du Président, quelle qu’elle soit, et à moins qu'on n'en vienne immédiatement aux mains, il y aura un moment opportun pour la publication. Les chances vont croissant pour Louis Bonaparte. C'est la conviction des Débats qui sont croyables sur ce point.
Je suis de plus en plus inquiet de Berlin mais pas étonné que de Francfort, on abandonne le Roi de Prusse après l'avoir poussé. C’est exactement ce qui arrivait en 1790 et 91 avec le pauvre Louis XVI. Du dedans et du dehors, on l'excitait, on le compromettait ; puis on ne le soutenait pas. Berlin ressemble extrêmement à notre première révolution. La Cour et la nation. Les idées et les façons d'agir. Et je crains que le Roi de Prusse, qui a plus d’esprit, n'ait encore moins de courage, et n'inspire encore moins de confiance que Louis XVI. Moralement, à coup sûr, il ne le vaut pas. Ni politiquement peut-être. Il y a là de plus l'ambition de la Prusse qui veut prendre l'Allemagne C’est vraiment là l’incendie. Le rétablissement même de l’ordre en France ne l'éteindrait pas. Mais il donnerait bien de la force pour le combattre.
Je suis vraiment triste du bruit qui est venu de Rome sur M. Rossi. Je cherche et ne trouve nulle part des détails. On dit que l'ordre n’a pas été troublé. Mais Rossi lui-même qu'est-il devenu sous ce coup de poignard pauvre homme? Quelle surprise pour lui et pour moi si, quand je l’ai envoyé à Rome, tout cet avenir s’était dévoilé devant nous ! J'espère que l’assassin a manqué son coup. Ce n'est peut-être pas vrai du tout. Il manque bien les choses à M. Rossi. Le cœur n'est ni tendre, ni grand. Mais l’esprit est supérieur ; si juste, si fin, si actif dans son indolence apparente, si prompt, si étendu ! Des vues générales et un savoir faire infini. Très inférieur à Colettis par le caractère et l’empire. J’ai pleuré Colettis. Il m’aimait et je l’aimais. Je regretterai M. Rossi, si le fait est vrai, comme un allié utile et un homme très distingué. L’un et l’autre est rare. Il ne m’a pas donné signe de vie depuis Février. On me disait, il y a quelque temps, qu’il disait qu'il ne retournerait jamais en France. S'il a été assassiné, c’est que le parti révolutionnaire de Rome, le considérait comme un obstacle, sérieux. Ce serait un honneur pour son nom.
J’ai vu hier Charles Greville à dîner, chez le Baron Parke. Il ne savait rien. Parlant toujours très mal des affaires de Sicile. Le Roi de Naples me paraît décidé à laisser trainer cette médiation anglo-française, comme on fait à Milan. On se rejoint ici de la nomination à peu près certaine, du Général Taylor comme président aux Etats-Unis. Cass est très anti- anglais.
Puisque vous prenez votre dame assez à cœur pour en être malade, vous ferez bien de vous en débarrasser, à Brighton, tel que Brighton est à présent, vous pouvez vous en passer. Il y aura tel lieu et tel moment où même cette maussade personne vous manquera. Mais après tout, vous en trouverez une autre. Nous aurons le temps de chercher. Marion vous a-t-elle reparlé ? Adieu. Adieu.
Mardi est bien loin. Je ne puis vraiment pas plutôt. Je suis très pressé. Par toutes sortes de motifs. Adieu. G.
Mots-clés : De la Démocratie (ouvrage), Diplomatie (France-Angleterre), Elections (France), Politique (Allemagne), Politique (France), Politique (Grèce), Politique (Italie), Portrait, Posture politique, Réseau social et politique, Révolution, Révolution française, Travail intellectuel, Vie domestique (Dorothée)
Brompton, Mercredi 8 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Voici une lettre très curieuse. Lisez-la, je vous prie, vous-même, malgré vos mauvais yeux et renvoyez-la moi tout de suite. G[énie] me fait dire qu'il importe infiniment que ses lettres restent entre lui et moi, et qu'il n'en revienne rien à Paris. Vous verrez combien tout cela confirme ma résolution. Je devrais dire notre résolution de me tenir parfaitement tranquille et en dehors de toutes les menées.
Le Roi me fait écrire hier par d'Houdetot " Le Roi me charge de vous dire que les accidents de santé de ses chers malades, sans être plus graves, ayant continué, les médecins avaient conseillé un changement d’air immédiat ; ce qui l’avait décidé à aller passer quelques jours à Richmond, à l’hôtel du Star and Garter. Nous partons aujourd’hui même à une heure. Le Roi désire que vous sachiez bien le pourquoi de ce mouvement afin de vous mettre en garde contre les bruits publics." D’Houdetot aurait dû me donner quelques détails sur la Reine. Mais enfin elle a pu évidemment être transportée, sans inconvénient. Je voudrais savoir qui occupera votre petit appartement. J'irai les y voir. Pourvu que mon travail m'en laisse le temps, car je veux absolument le finir sans retard et l'envoyer à Paris. Le moment de le publier peut se rencontrer tout à coup. Et dans l'état des affaires au milieu de tout ce mouvement d'intrigues croisées, je ne serais pas fâché de donner une marque publique de ma tranquillité et liberté d’esprit en parlant à mon pays sans lui dire un mot de tout cela. Cette course à Drayton va me faire perdre encore du temps. Je réponds aujourd’hui à Sir Robert Peel, mais je n’y resterai que jusqu'au mardi 21 et non jusqu'au jeudi 23 comme il me le demande. Ce serait charmant, s'il vous invitait aussi.
Je reçois à l’instant même un billet de Duchâtel qui était allé hier a Claremont au moment où le roi et toute la famille partaient pour Richmond. Il a trouvé le Duc de Nemours et le Prince de Joinville, très souffrant. Ils ont eu une rechute, c’est ce qui a déterminé la résolution, soudaine.
La dernière scène de Vienne est tragique. Le parti révolutionnaire, étudiants et autres est plus acharné que je ne le supposais. On m’apporte de Paris de bien sombres pronostics sur l'Allemagne. On s’attend que l'Assemblée de Francfort se transportera à Berlin, et finira par y proclamer la République. La Monarchie, et l’unité allemande paraissent de plus en plus incompatibles. Le rêve en progrès est celui d’une république allemande, laissant subsister dans son sein, par tolérance et jusqu’à nouvel ordre des monarchies locales. En France les esprits sont malades sans passions. En Allemagne, il y a la maladie, et la passion. Adieu, adieu. Merci de votre accueil, digne réponse à votre merci de ma visite. Adieu vaut mieux. M. Vitet arrive aujourd’hui de Paris. G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, De la Démocratie (ouvrage), Elections (France), Empire (France), Politique (Allemagne), Politique (Autriche), Politique (France), Posture politique, Réception (Guizot), Régime politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique), République, Réseau social et politique, Révolution, Santé (Dorothée), Travail intellectuel
Brompton, Mardi 26 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Je suis hors d'état de sortir. Je tousse pas mal, c’est-à-dire très mal. Il me faut un peu de confinement. J'ai bien dormi mais en me réveillant pour tousser. Je me coucherai ce soir de bonne heure. Et de tout le jour, je ne quitterai mon cabinet. Que je voudrais qu’il fit beau demain. J’espère que je pourrai aller vous voir. Peut-être le matin, à 1 heure, si je me suis encore trop pris pour me mettre en route le soir. Ceci est un grand ennui. Et j’ai bien peur que cela ne nous arrive plus d’une fois cet automne. Je me porte très bien au fond ; mais je m'enrhume aisément, et je suis aisément fatigué. Je me résignerais, très bien à n'être plus jeune si je n’avais jamais à sortir de chez moi. Ce qui vaut et ce qui sied le mieux quand on n’est plus jeune, c’est la tranquillité.
J'ai les mêmes nouvelles que vous de Paris. Si Louis Bonaparte se conduit passablement, et s’il n’est pas forcé d'attendre longtemps, il pourra bien avoir son moment. Agité et court car il ne peut pas plus supporter la liberté de la presse que Cavaignac, et il n'aura pas, comme lui, pris la dictature au bout de son épée. Son nom, qui le sert de loin, l’écrasera de près. Mais il vaudrait infiniment mieux éviter cette parenthèse de plus. Je crois encore qu’on l'évitera, que Louis Bonaparte se compromettra avant d'arriver au pouvoir et que l’armée comme l'Assemblée. soutiendront Cavaignac contre lui. Que la République et l'Impérialisme s’usent bien contre l’autre ; c'est notre meilleure chance, et à mon avis la plus probable.
Je ne comprends pas ce que votre correspondant demande à votre oncle. Il le sait prêt à la transaction. Ce n’est pas à lui à aller la chercher. Ce n’est pas à lui qu'on peut s'adresser pour qu'elle marche et se conclue. On désire quelque fait extérieur qui prouve qu'elle peut se conclure, qu'elle se conclura, le jour venu. Qu'on aille donc au-devant de ce fait ; qu'on lui fournisse l’occasion de paraître. L’occasion semblait trouvée ; on semblait même l’avoir cherchée. Tout le monde devait le croire. Non seulement on ne l'a pas saisie ; mais on s'est montré disposé à la fuir. Quand on est pressé, il faut se presser. Je n'ai jamais pensé que votre oncle pût ni dût prendre aucune initiative ; mais je suis encore bien plus de cet avis depuis le dernier incident. Je répète que lorsque la transaction ira à lui, elle le trouvera prêt ; mais il n’a rien à faire qu'à l'attendre dans l’intérêt du succès comme dans la convenance de son honneur. Il disait encore avant-hier à l’un de mes amis qu’il n’avait reçu de sa partie adverse, aucune avance, aucune insinuation qu’il pût sensément regarder comme un pas vers lui.
De Rome et de Florence, mauvaises nouvelles. Les républicains sont furieux de la petite réaction romaine et du peu de succès de l’insurrection de Livourne. La population ne veut pas les suivre, mais comme le gouvernement ne sait pas les chasser, ils sont toujours là, et et commencent, et recommenceront toujours. On dit que Charles Albert meurt de peur d'être assassiné par eux. Il mourait de peur autrefois d'être empoisonné par les Jésuites. Il ne sera probablement pas plus assassiné qu'empoisonné. Mais son succès n’ira pas plus loin. Adieu. Adieu.
Pour Dieu, ne soyez pas malade. Je veux bien être enrhumé, mais pas inquiet. Je vous renvoie votre lettre. Adieu. Adieu. G.
Brompton, Vendredi 22 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Je n'ai de nouvelles que de M. Hallam et de Mad. Austin. Je me trompe ; j'ai trouvé hier en rentrant une bonne lettre de Lord Aberdeen. Je ne vous l'envoie pas pour ménager vos yeux. Je vous la lirai dimanche. Rien de nouveau. Très autrichien. Regardant toujours l'Angleterre comme possible parce que l’Autriche ne cédera pas et ne doit pas céder. Il ne parle de revenir que dans le cours de Novembre. Les journaux modérés sont abasourdis du résultat des élections. L'Assemblée nationale soutient énergiquement son parti. Evidemment tout le monde est inquiet et tâtonne. Vous aurez vu à quel point l'élection de M. Molé a été contestée. Encore n’est-elle pas positive ? Le Communisme est en progrès effrayant. Aura-t-on assez peur et pas trop peur ? Je m’attends à quelque explosion rouge qui donnera aux modérés, un coup de fouet. M. Ledru Rollin se met à la tête des Montagnards croyant à leur victoire. Je parie que, dans son esprit, il dispute déjà à Cavaignac la présidence de la République. Nous sommes tellement hors de ce qui est sensé que tout est possible.
Lisez attentivement le récit de la prise de Messine qui est dans les Débats. Curieux exemple de l'absurde manie révolutionnaire qui est dans les esprits. Il est clair que les Messinois sont insensés, et ont été les plus féroces. On assiste à leurs atrocités. On tient leur défaite pour certaine. On rend justice à la modération du général Napolitain. N'importe c’est pour les Messinois [?] la sympathie. Uniquement parce que c’est une insurrection et une dislocation. Et le Roi de Naples, qui a offert aux Siciliens dix fois plus qu’ils n'espéraient d'abord est un despote abominable parce qu'il ne cède pas tout à des fous qui sont hors d'état de résister. La raison humaine est encore plus malade que la société humaine. Adieu.
Je vais me remettre à travailler. C’est bien dommage que je ne puisse pas dire tout ce que je voudrais. Je supprimerai de grandes vérités, et peut-être de belles choses. Adieu. Adieu. A demain.
Mots-clés : Circulation épistolaire, De la Démocratie (ouvrage), Diplomatie (Angleterre), Discours du for intérieur, Politique (Autriche), Politique (Internationale), Politique (Italie), Presse, Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Révolution, Santé (Dorothée), Travail intellectuel, Vie domestique (François), VIe quotidienne (Dorothée)
Brompton, Vendredi 15 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Je rentre de ma promenade. Je la placerai tous les jours à cette heure-là, et je serai toujours chez moi à 2 heures. Brouillard général, mais léger et pas froid. Il faisait bon marcher.
Je viens de lire le discours de Thiers, en conscience. Comme toujours spirituel, naturel, utile, long et pas grand. L'appréciation des Débats est juste sans bienveillance. Ce qui me paraît d’une bien petite conduite, c'est de parler solennellement sur toutes ces spéculations insensées, et de se taire absolument dans tout débat qui serait un combat. C’est un évènement que la flotte sarde s'en allant de Venise, et laissant à la flotte autrichienne toute liberté de la bloquer. Venise tombera comme Milan, Toutes les révolutions ont eu fair play l'Italienne comme la française, comme l'allemande. Aucune ne gagnera la partie. Vous avez raison, quel spectacle à décrire pour un grand esprit qui saurait tout voir, et pourrait tout dire. Jamais Dieu n'a donné aux hommes une telle leçon de sagesse en laissant le champ libre à leurs folies.
Un homme que je ne connais pas vient de m’envoyer de Paris un volume de 1184 pages, intitulé. Recueil complet des actes du Gouvernement provisoire (Février, mars, avril et mai 1848). Complet en effet ; les petites comme les grandes sottises. Monument élevé à une Orgie. Ce volume vaut la peine d’être regardé, et gardé. Toutes ces sottises passent comme des ombres, et on les oublie. On ne sait ni s’en délivrer, ni s’en souvenir. Précisément ce qui arrive d’un cauchemar, dans un mauvais rêve.
On travaille à monter un coup pour que le Président de la République soit nommé par l'Assemblée nationale et pour que l'Assemblée nationale actuelle vive quatre ans comme le président qu’elle aura nommé. Si cela est tenté et échoué, l’échec sera décisif. Si la tentative réussit, elle amènera une explosion. On n'acceptera pas ce bail. Voilà, un ancien député conservateur M. Teisserenc qui vient me voir, et part le soir pour Paris. Je vais écrire pour affaires. Adieu. Adieu.
J’espère que vous n'aurez pas oublié d’écrire à M. Reboul. Vous n'oubliez guère, Adieu. G.
Brompton, Mercredi 13 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Avec votre lettre ce matin, deux longues lettres de Brougham et d'Ellice. Brougham dans un accès de tendresse. Il voudrait m'envoyer son manuscrit, et que je le lusse pour y ôter, ajouter ou changer ce que je voudrais. Comme de raison, je ne refuserai. Enorme dissertation d’Ellice qui regarde la guerre et la banqueroute française comme infaillibles, et veut que l'Angleterre se retire tout-à-fait de l’Europe. Convaincu de la vertu et de l’impuissance de Cavaignac. Charmé d'avoir chez lui Duchâtel qui chasse et s’ennuie. " The patience of that ardent chasseur is beginning, to be sorely tired with our storms and torrents of rain. Amiable and interesting as he is from his knowledge of men and of affairs, how entirely he is homme d'affaires! If it was not for his engouement now for the chasse. I dearely know how I should employ his time for him in the Country. He will miss his old avocations and interests. much more than you will do."
Ellice me paraît avoir un plan pour le gouvernement de l'Irlande, et il espère que Lord John l'adoptera pendant sa visite à Dublin. J’ai ce matin quelques nouvelles d'Italie. Les chances en Sicile sont pour le Roi de Naples. Non pas pour soumettre l’intérieur de l'île, mais pour reprendre possession des villes et des points importants de la côte. Le Prince Gramatelli, qui est ici de la part des insurgés, est très abattu furieux, comme toute l'Italie contre l'Angleterre qui a laissé tout espérer, et ne tiendra rien. Dans l’intérieur de l'Italie dans les Apennins, de petits démembrements se font, de petites républiques indépendantes se proclament. Déjà crois ou quatre en Toscane et dans les légations. Anarchie complète impuissance, complète des gouvernants. Le Pape travaillant à temps, sans bruit, son épingle du jeu. De concert avec les cardinaux qui se concertent avec Vienne. Gènes à peu près perdu pour Charles-Albert. Conviction générale que l’Autriche ne veut que gagner du temps. Elle fait la police sous main en Italie comme elle la faisait ouvertement jadis. Le parti républicain, Mazzini et tous ses petits éclateront un de ces jours, et ce sera le coup de grâce de l'Italie. L’Autriche, se croira, en droit de tout faire contre eux et l'Angleterre de tout laisser faire. Et la République française dira qu’on a dérangé sa médiation qui allait réussir, et elle n'empêchera rien. Voilà les pronostics des Italiens gens d'esprit.
Je fais du feu. Il faisait froid hier chez Lady Cowley que j’ai trouvée. Elle cherche une maison. Georgine m’a paru de très bonne humeur. Il paraît que cette pauvre Aggy est mourante. Adieu. Adieu. Oui, jeudi n’est que demain. Hébert et Dumon viennent dîner avec moi aujourd’hui. Je serai demain au railway comme à l’ordinaire, avant 5 heures trois quarts. Adieu. Adieu. G.
Lowestoft, Mardi 22 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Mon instinct me répète que la publication de ce Rapport de la Commission d'enquête ouvrira le tombeau de la République. Je dis la publication bien plus que le débat, dont je n’attends pas grand chose. La République n'en mourra peut-être pas beaucoup plutôt, mais, la voyant, telle qu'elle est, on la tiendra pour morte par impossibilité de vivre. Et elle mourra infailliblement de cette conviction générale. Les commencements de scènes, de démentis d’assertions aggravantes que je vois dans le Times d’hier confirment mon instinct. Je suis frappé aussi qu’on ait renoncé dans l'Assemblée à porter, comme on l’avait annoncé, M. de Lamartine à la Présidence, en envoyant M. Marrant au Ministère de l'Intérieur. En présence du rapport, on a senti que cette apothéose du Père de la République était impossible. J’attends impatiemment mes journaux français. Je serais étonné si cette semaine ne nous ferait pas faire un pas. Vous avez surement lu le spectateur de Londres de Samedi. Evidemment l’Autriche sortira de la Lombardie, et n'en sortira pas pour Charles-Albert. L’événement me donne plus complètement raison, dans la question Italienne que je ne l’avais espéré. J’ai soutenu que les peuples d'Italie, ne devaient faire que des réformes légales, de concert avec leurs gouvernements, que ni les gouvernements ni les peuples ne devaient songer à des remaniements de territoire ; que le Pape ne devait pas se brouiller avec l’Autriche ; que toute tentative, en dehors de ces limites, échouerait. C'est dommage que ce soit souvent un grand obstacle d'avoir eu raison.
Les nouvelles d’Espagne me plaisent. Les Carlistes de plus en plus nuls, et mon ministre des finances. C'est l'union rétablie dans les Moderados et leur concours assuré à Narvaez. Il n’est pas plus question à Madrid de Bulwer et de la rupture des Rapports avec l'Angleterre, que s'il n’y avait point d'Angleterre. Nous verrons comment lord Palmerston emploiera de ce côté ses vacances.
Une heure
Très intéressante lettre. Vous ne savez pas combien j’aime votre langage si naturel, si bref, si topique. Je m'inquiète peu de votre inquiétude sur ma lettre du 16. Je veux bien que vous me montriez, mais il me convient que vous me montriez tel que je suis, pensant librement et parlant comme je pense. Sans compter que, pour plaire beaucoup, il est bon de ne pas plaire toujours, et surtout de ne jamais chercher à plaire. II y a deux choses indispensables pour être pris au sérieux par les Rois, en leur agréant, beaucoup de respect et à peu près autant d'indépendance. Je vous écrirai demain ce que vous désirez. Demain seulement parce qu'il faut que, cette fois aussi, vous envoyez la lettre même. Elle vous arrivera jeudi matin. Je vous renverrai aussi demain la lettre de Paris. Je veux la relire, et je suis écrasé ce matin de correspondance. Plus une visite aux écoles de Lowestoft qu’on me fait faire à 2 heures.
Je crains beaucoup toute démonstration légitimiste. Non seulement elle échouerait ; mais elle gâterait l'avenir en compromettant, contre toute combinaison en ce sens, beaucoup de modérés. Le nom est peut-être dans ceci, ce qu’il y a de plus embarrassant. Il ne faut pas le prononcer. Que la réserve du langage soit en accord avec l'immobilité de l’attitude. N'oubliez jamais que les péchés originels du parti légitimiste sont d'être présomptueux et frivole, gouverné par les femmes et les jeunes gens. L'émigration. Voici les nouvelles que je reçois ce matin: « J'ai vu les Montesquiou qui reviennent d'Allemagne. Ce qu’ils disent est, à tout prendre, satisfaisant quant à la santé et au bonheur domestique. La résidence est très convenable et confortable, au milieu d’une jolie ville. Mais point de jardin. Seulement une terrasse au haut de la maison, où l'on prend le thé dans les belles soirées. Les environs et les promenades charmants. Beaucoup d'affection et de respect témoigné par tout le monde. Une existence paisible retirée et raisonnable. Mais les regrets de France bien vifs. Ils déjeunent à 11 heures, dinent à 4, le thé à 8, la conversation jusqu'à 10 : " Parlons de la France. " Elle se promène beaucoup et écrit beaucoup. Elle a reçu dernièrement beaucoup de visiteurs. La Maréchale de Lobau y est à présent, et les enfants de M. Reynier. Correspondance quotidienne avec Bruxelles." Ce ne sont que des détails sentimentaux. Vous voyez par votre lettre de Paris, que Pierre d’Aremberg se vantait, et qu'on est bien loin d'avoir pris là l'initiative. Je suis bien aise que vous ayez rencontré M. de Beaumont. Sa conversation avec vous est ce que j'aurais attendu. Et votre jugement de lui excellent. Je n'irai point au-devant de lui ; mais s'il vient au devant de moi, j'accepterai sa main. Il est du nombre des hommes envers qui je deviens chaque jour, au dedans plus sévère, au dehors plus tolérant. [...]
Lowestoft, Jeudi 17 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Le temps est superbe. Je viens de me promener au bord de la mer. Mais vous manquez au soleil et à la mer bien plus que la mer et le soleil ne me manqueraient si vous étiez là. D’Hausonville m’écrit très triste quoique point découragé : " A l'heure qu’il est, me dit-il, le pouvoir nouveau est, vis-à-vis de la portion saine de l'Assemblée nationale à peu près dans les mêmes dispositions que l’ancienne commission exécutive. Autant que M. de Lamartine, M. Cavaignac redoute l’ancienne gauche, et comme lui il est prêt à s'allier avec les Montagnards, pour ne pas tomber dans les mains de ce qu'il appelle les Royalistes. Ce dictateur improvisé paie de mine plus que de toute autre chose, et a plus le goût que l’aptitude du pouvoir. Vienne une crise financière trop probable ou la guerre moins impossible depuis les revers des Italiens, et la république rouge n’aura pas perdu toutes ses chances. " Il veut écrire sur la politique étrangère passée. Il me dit que c’est à son excitation que son beau frère a écrit dans la revue des Deux Mondes, sur la diplomatie du gouvernement provisoire, l’article dont vous m’avez parlé. " Les documents diplomatiques insérés, dans la Revue rétrospective me serviront dit-il de point de départ pour venger, pièces en mains, cette diplomatie du gouvernement de Juillet, si étrangement défigurée. Je voudrais finir par indiquer quelle doit être dans cette crise terrible, l’attitude de ceux qui ont pensé ce que nous avons pensé, et fait ce que nous avons fait, si vous croyez utile de m'esquisser ce plan, je recevrai vos conseils avec reconnaissance et j’en ferai profiter notre pauvre parti resté, sans chef et sans boussole dans ce temps, si gros et si obscur." Ceci m'explique un peu Barante.
Évidemment l’envie de rentrer en scène vient à mes amis. J'ai aussi des nouvelles de Duchâtel, d’Écosse où il se promène charmé du pays. Je vous supprime l’Écosse. Voici ce qu’il me dit de la France : " Il me semble que, dans le peu qu’elle fait de bon, la République copie platement et gauchement la politique des premières années de la révolution de 1830." Quel spectacle donne la France.
On m’écrit de chez moi que les élections municipales ont été excellentes. Les résultats sont beaucoup meilleurs que de notre temps. Le député actuel de mon arrondissement, qui faisait toujours partie du conseil municipal n'a pas pu être élu cette fois.
Une heure
Votre lettre est venue au moment où j’allais déjeuner. J'espère que celle de demain me dira que votre frisson n’a pas continué. La phrase du National ne me paraît indiquer rien de particulier pour moi. Il insiste seulement sur le danger pour la République d’un débat qui mettra en scène le dernier ministre de la Monarchie qui n’a fait, après tout, que combattre ces mêmes auteurs de la révolution qu'on demande aujourd’hui à la république de condamner. Je comprends que ce débat, leur pèse. S'il y a un peu d’énergie dans le parti modéré, il faudra bien que le National et ses amis le subissent. Mais je doute de l’énergie. Tout le mal vient en France de la pusillanimité des honnêtes gens. S'ils osaient, deux jours seulement, parler et agir comme ils pensent, ils se délivreraient du cauchemar qui les oppresse. Mais ce cauchemar les paralyse, comme dans les mauvais rêves.
La lettre de Hügel est bien sombre, et je crois bien vraie. Je vous la rapporterai avec celle de Bulwer à moins que vous ne le vouliez plutôt. Je vois que Koenigsberg le parti unitaire a pris le dessus. Parti incapable de réussir, mais très capable d'empêcher que la réaction ne réussisse. La folie ne peut rien pour elle-même ; mais elle peut beaucoup contre le bon sens. Pour longtemps du moins. Que dites-vous du Général Cavaignac parcourant les Palais de Paris le Luxembourg, l’Élysée & pour voir comment on en peut faire des casernes et des postes militaires. On voulait nous prendre pour les forts détachés, dont le canon n'atteint pas Paris. Aujourd’hui, on met les forts détachés dans les rues. Ce qui me frappe, c’est que Cavaignac et les siens ont l’air de régler cela comme un régime permanent. C'est de l'avenir qu’ils s’occupent. Ils sont convaincus que, si on ôte au malade sa camisole de force, il jettera son médecin par la fenêtre. Et le gouvernement ne consiste plus pour eux qu’à prendre des mesures pour n'être pas jetés par la fenêtre. Adieu.
J’attendrai la lettre de demain un peu plus impatiemment. Je travaille. Que de choses je voudrais faire ! Adieu. Adieu. G.
J’avais donc bien raison hier de croire que la chance du Roi de Naples en Sicile pourrait bien valoir mieux que celle du Duc de Gènes.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Diplomatie, Elections (France), Eloignement, Manque, Politique, Politique (Autriche), Politique (France), Politique (Italie), Politique (Normandie), Politique (Œuvre), Presse, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée, République, Révolution, Travail intellectuel
Lowestoft, Dimanche 13 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Certainement, je suis triste. Je vous ai dit mille fois que, sans vous, j'étais seul. Et la solitude, c’est la tristesse. Je la supporte mais je n’en sors pas. Les Anglais n’y sont pour rien. Dans la belle Italie, je ne serais pas autrement. Peut-être l'Italie me dispenserait-elle d’un rhume de cerveau qui me prend, me quitte et me reprend sans cesse depuis quatre jours. Je me suis déjà interrompu deux fois en vous écrivant pour éternuer trente fois. J’espère que la mer, m'en guérira. La mer n’est pas humide. Décidément, en ceci, je ne suis pas comme vous. J’aime la mer devant moi. Elle ne m’attriste pas. Elle est très belle ici. Et cette petite ville est propre, comme un gentleman. Mes enfants commencent à se baigner demain. Aurez-vous quelqu’un à Tunbridge Wells ? Je ne vous veux pas la solitude, par dessus la tristesse. Il me semble qu’à Richmond lord John, Montebello et quelques visites de Londres ou à Londres sont des ressources que vous n'aurez pas ailleurs. Il est vrai que j’entends dire à tout le monde que Tunbridge est charmant. C’est quelque chose qu’un nouveau lieu charmant, pour quelques jours.
Il me revient de Paris qu'on n’y croit pas plus que vous au succès de la médiation. Ce n'est pas mon instinct. Si la situation actuelle pouvait se prolonger sans solution, je croirais volontiers que la médiation échouera. Elle vient, comme vous dîtes, plus qu'après dîner. Mais je ne me figure pas que l’Autriche se rétablisse purement et simplement en Lombardie et Charles Albert à Turin. Les Italiens conspireront, se soulèveront, la République sera proclamé quelque part. La République française sera forcée d’intervenir. C’est là surtout ce qu’on veut éviter par la médiation. Il faut donc que la médiation aboutisse à quelque chose, que la question paraisse résolue. Elle ne le sera pas. Mais à Paris et à Londres on a besoin de pouvoir dire qu'elle l’est. Pour sortir du mauvais pas où l'on s'est engagé. Tout cela tournera contre la République de Paris mais plus tard. On m'écrit que ces jours derniers le général Bedeau, dans des accès de délire criait sans cesse. "Je n’avais pas d’ordres! Je n'avais pas d’ordres." Vous vous rappelez que c’est lui qui devait protéger et qui n’a pas protégé la Chambre le 22 février.
Je suis bien aise que Pierre d'Aremberg soit allé à Claremont. Tout le travail en ce sens ne peut avoir que de vous effets soit qu'il réussisse ou ne réussisse pas. Quand on était à Paris, en avait assez d'humeur contre Pierre d’Aremberg qu'on ne voyait pas. Je suppose qu'on aura été bien aise de le voir à Claremont. A Claremont on est d’avis que la meilleure solution de la question Italienne, c'est de maintenir l’unité du royaume Lombardo-Vénitien en lui donnant pour roi indépendant un archiduc de Toscane. Idée simple et qui vient à tout le monde. Je la crois peu pratique. Un petit souverain de plus en Italie, et un petit souverain hors d’état de s'affranchir des Autrichiens, et de se défendre des Italiens. Ce serait un entracte, et non un dénouement. Je doute que personne veuille se contenter d’un entracte. Adieu. Adieu.
C’est bien vrai, les blank days sont détestables. Demain sera le mien. Votre lettre de Vendredi m'est arrivée hier, à 10 heures et demie du soir. Je venais de me coucher. Je m'endormais. On a eu l’esprit de me réveiller. Je me suis rendormi mieux. Je viens de recevoir celle d’hier samedi. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Eloignement, Politique (Autriche), Politique (Internationale), Relation François-Dorothée, République, Réseau social et politique, Révolution, Santé (François), Tristesse, VIe quotidienne (Dorothée)
Ketteringham Park, Vendredi 11 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Onze heures
Tallenay n'a pas réussi à se faire laisser l’honneur de la reconnaissance de la République. Gustave de Beaumont est un honnête homme et un gentleman. Plus de mouvement d’esprit que d’esprit, modéré d’intentions et emporté de tempérament. Point Thiers du tout. Opposé à Thiers, autrefois, quand ils étaient ensemble dans l'opposition. Rapproché de lui aujourd’hui par la nécessité, mais au fond méfiant et hostile. Un des plus actifs de la tribu Lafayette dont il a épousé la petite-fille.
On dit à Paris que Tallenay est rappelé pour m’avoir salué et dit bonjour dans la rue, ce qu'il n'a pas fait. Je serais étonné si Gustave de Beaumont, me rencontrant, ne le faisait pas. Puisque la médiation commune a lieu sérieusement, je penche à croire qu’elle réussira, au début du moins. Les embarras et peut-être les impossibilités viendront après. L'Italie ne sera pas réglée. Mais la République y aura gagné d'être reconnue, et l'Angleterre d'avoir engagé la République dans la politique pacifique au moment de la crise.
Je reviens à ce que je vous disais hier, je crois ; le Président Cavaignac sera une seconde édition du Roi Louis-Philippe. Résistance et paix. Avec bien moins de moyens, de se maintenir longtemps sur cette brèche, où il sera bientôt encore plus violemment attaqué. Ce qui est possible, ce qu'au fond de mon cœur je crois très probable, c’est que les trois grosses révolutions de 1848, France, Italie et Allemagne n'aboutissent qu'à trois immenses failures. Pour la France et l'Italie, c’est bien avancé. L'Allemagne trainera plus longtemps, mais pour finir de même. Grande leçon si cela tourne ainsi. Mais le monde n’en sera pas plus facile à gouverner. Excepté chez vous, l'absolutisme est partout aussi usé et aussi impuissant que la révolution. Et il n’y a encore que la société anglaise qui se soit montrée capable d’un juste milieu qui dure. Je suis dans une disposition singulière et pas bien agréable ; chaque jour plus convaincu que la politique que j’ai faite est la seule bonne, la seule qui puisse réussir et doutant chaque jour d'avantage qu’elle puisse réussir. La lettre que je vous renvoie est très sensée. Je vous prie de la garder. Je vous la redemanderai peut-être plus tard. Si c’est là une chimère, c’est une de celles qu'on peut poursuivre sans crainte car en les poursuivant on avance dans le bon chemin.
Savez-vous notre mal à tous ? C’est que nous sommes trop difficiles en fait de destinée. Nous voulons faire, et être trop bien. Nous nous décourageons et nous renonçons dès que tout n’est pas aussi bien que nous le voulons. J’ai relu depuis que je suis ici, la transition de la Reine Anne à la maison d’Hanovre, et le ministère de Walpole. En fait de justice, et de sagesse, et de bonheur, et de succès, les Anglais se sont contentés à bien meilleur marché que nous. Ils ont été moins exigeants, et plus persistants. Nous échouerons tant que nous ne ferons pas comme eux. Je vous envoie avec votre lettre un papier anonyme qui m’arrive ce matin de Paris, par la poste. Les Polonais sont aussi mécontents de la République que le seront demain les Italiens. Je suppose que l’un d’entre eux a voulu me donner le plaisir de voir que je n'étais pas le seul à qui ils disent des injures. La grosse affaire à Paris, c’est évidemment le rapport de la Commission d'enquête. De là naitra, entre les partis, la séparation profonde qui doit engager la lutte définitive qui doit tuer la République. Dumon m'écrit : « Si je trouve Londres trop triste, j'aurais assez envie d'aller attendre à Brighton le jour où nous pourrons rentrer en France, le jour me semble encore assez éloigné. C’est déjà bien assez pour Cavaignac d'avoir à mettre en jugement les fondateurs de la République sans qu’il se donne l’embarras de mettre en même temps hors de cause les ministres de la monarchie. » Tous les procès à vrai dire, n'en font qu’un et il n’est pas commode à juger. On l’ajournera, tant qu’on pourra. Adieu.
J’aurai demain votre lettre à Lowestoft. Je pars à 4 heure. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Histoire (Angleterre), Politique, Politique (Allemagne), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Italie), Politique (Œuvre), Portrait, Posture politique, Presse, Réception (Guizot), République, Révolution
Ketteringham Park, Mardi 8 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Onze heures
J’ai cinq minutes. Je vais rejoindre à Norwich le train du chemin de fer qui va à Yarmouth. C’est à Yarmouth que mes enfants prendront quelques bains de mer. Le médecin sort d’ici. Il trouve Pauline pas mal, c’est-à-dire point de vrai mal, mais encore assez ébranlée. Il veut encore deux ou trois jours de repos. Puis quelques bains à Yarmouth, près d’ici, à peine un voyage. Les habitants de Ketteringham viendront nous y voir. A part la raison de santé, je vous dirai mes raisons pour aller à Yarmouth, près d’ici. Vous les trouverez bonnes. Je vous quitte. L’heure du train me presse. Merci de votre longue et bonne lettre qui vient de m’arriver. Je vous écrirai demain à mon aise. Adieu. Adieu. G.
Une heure On m’a fait observer que tout bien calculé, je n’arriverai probablement pas à Norwich à temps pour le train d’Yarmouth. Je n’irai donc que demain matin. Je vais là choisir un logement. Je reviendrai ici, et nous irons à Portsmouth à la fin de la semaine. Toujours pour trop longtemps mais pas pour longtemps. Le médecin n'a point d’inquiétude pour Pauline, mais elle a été [shaked] in her whole frame. Je ne lui ai pas refusé une promenade à cheval par ce qu’il y a beaucoup monté. Soyez tranquille ; je n’y monterai point. Guillaume monte très bien.
Je ne crois plus à l’intervention en Italie. On n'en veut évidemment pas plus à Paris qu'à Londres. L’Autriche cédera sur la Lombardie. On forcera les Italiens de céder sur la Vénétie. Et le Roi Charles Albert battu aura son royaume comme, s'il l’avait conquis. Quoique peu en train de rire, je ne puis m'empêcher de rire de la république ; elle copie, timidement ce qui s’est passé après 1830. La Lombardie sera la contrepartie de la Belgique. On règlera cette question là, comme l'autre, de concert entre Paris et Londres. Mais sans mettre le pied au delà des Alpes. Il faut dire de la République ce qu’on a dit de je ne sais plus qui : " ce qu’elle fait de nouveau n’est pas bon, ce qu’elle fait de bon n'est pas nouveau. "
Je compatis fort au chagrin de l'Empereur sur sa fille Olga. Mais elle a raison. Quelle honte au Roi de Wurtemberg ! Pis que le Roi de Bavière. Je suis humilié de la conduite des Rois comme si j’étais un Roi. J’ai mon Journal des Débats. On est fort en trais de refaire un autre parti conservateur. Et celui-là enterrera un jour la République. Chaque crise révolutionnaire en France fait monter au gouvernement une nouvelle couche de la société, prise plus bas. Et celle-là est à son tour forcée de devenir conservatrice, tant bien que mal. Je ne vois pas comment on s'y prendrait pour descendre plus bas que le suffrage universel. J’ai écrit à Lord Aberdeen. J’aurai demain ou après-demain tout ce qui m'a été envoyé à St Andrews. Ecrivez-moi encore ici, Adieu, Adieu. Quel plaisir quand nous nous retrouverons. Mais que de choses nous nous serions dites que nous ne retrouverons pas ! Adieu. Adieu. G.
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849
Sept heures.
On dit que Titus disait, quand il n'avait pas fait au moins un heureux, « J'ai perdu ma journée. » Moi, je crois qu'il disait cela quand il n'avait pas vu Bérénice. Quand votre lettre me manque, ma journée est perdue. J'ai beau faire ; je ne parviens pas à la remplir. J'ai beaucoup travaillé hier ; j'ai lu ; j'ai écrit de mon histoire ; j'ai écrit des lettres. Ma journée est restée vide. Peut-être votre lettre, que j'aurais dû avoir hier, contenait la feuille volante de Metternich, et les curieux auront eu envie de la lire. Je saurai cela ce matin. Ils auraient dû être un peu plus prompts à la lire que lui à l'écrire.
Je pense beaucoup à l'Allemagne, et soit que je veuille arranger l'avenir, ou seulement le prévoir, je ne me satisfais pas. Il y a là des éléments inconciliables entre eux et indestructibles les uns pour les autres, à moins d'un bouleversement général. Des petits États évidemment incapables, soit de contenter, soit de contenir leurs peuples, un grand État qui voudrait dompter les révolutionnaires chez lui, en restant populaire parmi les révolutionnaires du dehors, dont il a besoin pour absorber les petits États, et au moment même où il envoie des troupes pour empêcher ces révolutionnaires là de triompher chez eux. Des peuples qui, petits ou grands, révolutionnaires ou non, veulent jouir de la vie politique dont ils ont commencé à goûter, et se croient humiliés s'ils ne font pas, ou n'entendent pas autant de bruit qu'on en entend et qu'on en fait à Paris et à Londres. Des gouvernements qui ont encore toutes les habitudes du pouvoir absolu, et qui, en quelques mois, ont touché, et vont encore, aux dernières limites du radicalisme, car ils ont accepté le suffrage universel, ou à peu près. Ce sont là des confusions, des ambitions, des contradictions, des nécessités et des impossibilités dont je ne me tire pas. Certainement on ne sortira pas comme on est ; mais je ne crois pas qu'on redevienne purement et simplement comme on était, et je ne vois pas ce qu'on pourra être, ni même ce qu'on voudra essayer d'être.
Attendons. J'attends l'Allemagne et votre lettre. Si j'avais la lettre, je crois que j'arrangerais mieux l'Allemagne.
Onze heures
Voilà mes deux lettres. Et moi bien content. Vous recevrez aujourd'hui celle où je vous parle du choléra. C'est ma préoccupation habituelle pour vous à Paris. On me parle aujourd'hui de nouveaux cas. Je crois décidément qu'il faut attendre un peu.
Je ne comprends rien à ce que vous dit Montebello. Je n'ai pas reçu un mot, un seul mot de lui depuis que je suis ici. Je m'en suis étonné, et je crois vous l'avoir dit. Je vais lui écrire ce matin même.
Adieu, adieu, my dearest. Soignez-vous bien. L'orage ne m'a fait aucun mal. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Politique, Politique (Allemagne), Révolution
281. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me sens beaucoup mieux ce matin. C’est une singulière chose que la rapidité avec laquelle ce mal de gorge m’envahit s’établit, semble près de devenir une maladie et s'en va. Je suis persuadé qu’en y prenant un peu garde, dans trois ou quatre jours, il n’en sera plus question. Mais c’est bien décidément mon mal.
Je sais peut-être moins de détails que vous sur l'Orient. Quand les affaires ne vont pas à leur satisfaction, ils m'en instruisent plus laconiquement surtout quand l’événement confirme mes avis. J’ai reçu cependant ces jours-ci deux lettres qui sont d'accord avec ce que vous me dites. Mais vous aussi vous êtes trop loin. Deux heures de conversation toutes les semaines nous seraient bien nécessaires. A vous dire vrai, je ne me préoccupe pas beaucoup de cette affaire là quant à présent. Deux choses seules m'importent ; la paix pour le moment, le fond de la question pour l'avenir ; la paix ne sera pas troublée, ni la question au fond résolue. Je tiens l’un et l’autre pour certain. Il ne sortira de tout ceci qu’un ajournement pacifique. Que l’ajournement soit plus ou moins digne, plus ou moins habile, qu’il en résulte plus ou moins de gloire pour les manipulateurs, il m'importe assez peu. Je ne m'étonne pas que Mad. de Castellane vous choque. Elle n'a point de mesure dans la flatterie. Là est la limite de son esprit et le côté subalterne de sa nature. Du reste, rien n'est plus rare aujourd'hui parmi nous que le tact des limites. En toutes choses, nous sommes toujours en deçà ou au delà. C’est le défaut des sociétés renouvelées par les révolutions ; il reste longtemps dans leurs mœurs quelque chose d’informe et de gros, je ne veux pas dire grossier. Il n'y a de fini et d'achevé que ce qui a duré ; ou ce que Dieu lui-même a pris la peine de faire parfait. Mais il ne prend jamais cette peine là pour les peuples.
Voilà votre N°277 et en même temps des détails sur l’orient qui m’arrivent très circonstanciés trop pour la distance où nous sommes.
Vous menez bien votre barque. Vous travaillez à vendre le plus cher possible l'abandon, c’est-à-dire le non renouvellement du traite d'Unkiar-Skelessy. Vous avez tout un plan, dans lequel tout le monde, a son poste assigné contre Méhémet Je ne crois pas à l’exécution. C’est trop artistement arrangé. Je ne suis point invité à Fontainebleau. Je ne sais pas si je le serai. Je suis bien loin. On le sait officiellement. Pour peu qu’on trouve d'embarras à m'inviter moi, et non pas, tel autre, on a prétexte pour s’en dispenser. Adieu. Adieu. Moi aussi, j’attends l'hiver. Je vous en réponds. A propos, je ne sais de quoi, je ferai comme vous avez fait quand j’ai oublié votre commission auprès de Berryer. J’attendrai que je voie Bulwer pour lui demander moi-même des renseignements sur Lord Chatam.
Adieu, quand-même. G.
190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
Trouville, Mardi 27 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Est-ce que vous vous sentez plus fatiguée que de coutume ? Vous me parlez de votre besoin de repos en personne vraiment fatiguée. Vous renoncez à passer par Baden qui vous amuserait. Cela me préoccupe. Donnez moi quelques détails. Les eaux fatiguent quelque temps, même quand elles font du bien. Tout le monde le dit. Il me semble que Schlangenbad vous a moins réussi qu’Ems. Je sais gré à Fleischmann d'être venu vous y voir. Il aura un peu rompu votre solitude. Et je suis sûr qu’il ne vous aura pas rendue germaine unitaire. Cette question Allemande me déplait parce que je n'y vois pas clair. J’ai un instinct plutôt qu'un avis. Mais un instinct ne satisfait pas. Je ne veux pas de ce qu’on veut faire, et j’entrevois qu’il y a quelque chose à faire. Cette passion d’unité qui tient tant d'Allemands ne doit pas être uniquement l’ambition Prussienne ou la folie révolutionnaire. Il y a probablement là dessous quelque chose de sérieux et de nécessaire. Comment s'y prendre pour reconstituer la confédération germanique et la diète de Francfort d'une façon qui donne satisfaction à ce qui n’est ni révolution, ni bouleversement territorial ? Ou bien serait-ce là un but chimérique ? Et l'Allemagne, en serait-elle venue à l'une de ces époques où les gens sensés comme les fous, les honnêtes gens comme les coquins, sciemment ou aveuglément, veulent absolument refondre toutes choses et se lancent au hasard dans les nouveautés, n'importe à quel prix. La France en était là en 1789. J’ai peur que l'Allemagne n’y soit à son tour, si cela est, la guerre européenne est infaillible, et nos 34 ans de bon gouvernement et de paix n'auront été qu’une oasis dans le désert, une halte dans le chaos.
Je conjecture et je spécule comme si nous causions. J'ai peur aussi que M. de Nesselrode n'ait raison, et que Wiesbaden n'ait fait plus de fracas qu’il ne convient. Le fracas rouge sur le passage du Président est une compensation. Mais tenez pour certain qu’à son retour il y aura à Paris un effort en faveur d’un ministère tiers-parti.
Je suis bien aise de retourner au Val Richer. Le temps est superbe ce matin. J'ai droit à un beau mois de septembre. Août a été affreux excepté les jours d’Ems.
Je suis très occupé de mon Monk. J’y ai pas mal changé, ajouté. Je crois que c’est amusant et à propos. Une grande comédie politique remise en scène devant des spectateurs acteurs eux-mêmes. Et on veut réimprimer en même temps mon Washington. Comment on rétablit une Monarchie et comment on fonde une République. Choisissez. Pourvu qu'on ne me réponde pas : ni l’un ni l'autre ! Hélas je suis un peu, pour la décadence de mon pays comme Mad. Geoffrin pour les revenants " Je n’y crois pas, mais je les crains. "
Onze heures
Pas de lettre ici. Je suppose que vous m'avez écrit au Val Richer, et que j’y trouverai votre lettre en arrivant. J'ai de bien mauvaises nouvelles de Claremont d'avant-hier. Dumas mécrit : " Il est douteux que l'état du Roi permette que S. M. aille s’installer à Richmond où se trouvent déjà M. la Duchesse d'Orléans et Mad la Duchesse de Saxe Cobourg. Les forces déclinent, tous les organes s'affaiblissent, à l'exception des facultés intellectuelles qui restent entières. J'ai dû faire une absence de quatre jours pour aller porter à Dreux le Corps de l’enfant morte dont est accouchée Mad la Duchesse d’Aumale. J’ai trouvé à mon retour avant hier, les progrès de l'affaiblissement très notables. Le Roi a fait appeler les docteurs Chamel et Fouquier. Mad. la Duchesse d'Orléans est aussi bien que possible. La Reine se maintient en bonne santé. Le Duc de Nemours est très souffrant d’un Anthrax. M. le Prince de Joinville qui a été en Belgigue chercher sa soeur la Duchesse de Saxe Cobourg et qui a dû séjourner deux jours à Ostende, à cause du mauvais état de la mer, y a été l'objet d’un accueil remarquable de la part du grand nombre de Français qui y résident. Cela s’est passé sous les yeux du Roi des Belges. "
Adieu, Adieu. Je voudrais vous envoyer ce soleil. Adieu. G.
Mots-clés : Conversation, Famille royale (France), France (1848-1852, 2e République), Histoire (Angleterre), Histoire (France), Mariage, Monarchie, Politique (Allemagne), Politique (Analyse), Politique (France), Régime politique, Relation François-Dorothée, République, Réseau social et politique, Révolution, Santé (Dorothée), Travail intellectuel, Washington, Washington, George (1732-1799)
Brochon, le 3 juin 1871, Hugues-Iéna Darcy à François Guizot
Mots-clés : France (1870-1940, 3e République), Politique (France), Révolution, Tristesse