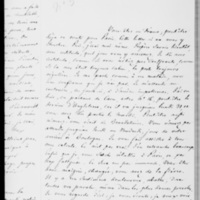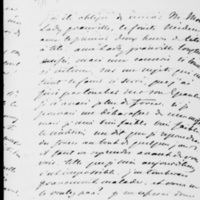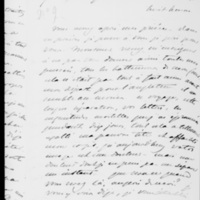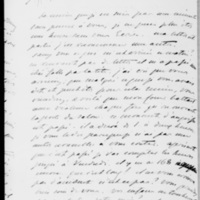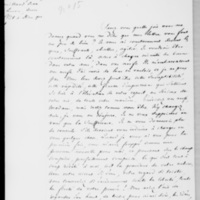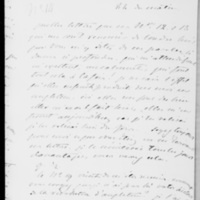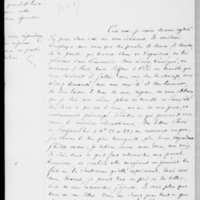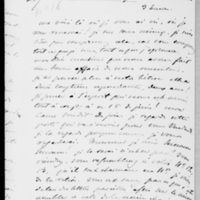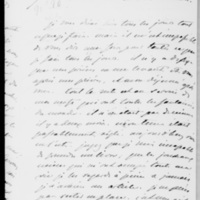Votre recherche dans le corpus : 18 résultats dans 6062 notices du site.Collection : 1837 (7 - 16 août) (1837 : Guizot en retrait du gouvernement. Dorothée se sépare de son mari)
Trier par :
16. Val-Richer, Samedi 5 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°16. Du Val-Richer, Samedi 5 août.
Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.
Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.
J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.
2 heures
Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !
On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.
Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.
Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.
J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.
2 heures
Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !
On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.
17. Val-Richer, Lundi 7 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°17 Lundi 7 août. Une heure.
Vous ne voulez pas que j’aille vous voir tout de suite. Je ne ferai que ce que vous voudrez. Mais le mécompte est grand. Je voulais partir après demain Mercredi soir, pour être à Paris, jeudi matin. J’ai un dîner obligé à Lisieux le Mercredi 16 août. Si je ne vais pas vous voir cette semaine comme je ne veux pas ne rester à Paris que 24 heures, je ne pourrai y aller que vers la fin de la semaine prochaine. Je partirais le jeudi 17 et je vous verrais le 18. Serez-vous reposée? Je trouverais, je vous assure, des conversations qui vous reposeraient mieux que votre solitude. Onze jours encore avant de savoir, de voir par moi-même comment vous êtes que c’est long ! Je sais que je suis ingrat, que c’est déjà un bien immense de vous avoir à 45 lieues, dans ma France, sans abyme ni tempête entre nous. Mais que voulez-vous?
En fait de bonheur, je n’impose point de limite à mes vœux. J’aime mieux souffrir de la privation qu’abaisser mon ambition. Réglons au moins tout de suite mon voyage. Que je puisse penser au jour précis à l’heure. Je n’ai jamais trouvé que l’attente usât la joie ; bien au contraire; le bonheur prévu mesuré, sondé d’avance à toujours surpassé mon espoir. J’entends le vrai bonheur. On parle d’imagination, d’idéal. Sans doute le train ordinaire de la vie est fort au dessous des rêves de l’âme ; mais le vrai bonheur, quand il apparaît, laisse loin, bien loin en arrière toute imagination humaine et il n’y a point de si bel idéal qui approche de la belle réalité. Que si je tarde à vous voir, au moins je vous trouve effectivement reposée. Ce que vous me dîtes pour me rassurer ne me suffit point.
Je n’ai jamais beaucoup compté sur votre séjour en Angleterre pour votre rétablissement. Je savais bien que tant de monde et de bruit vous fatiguerait. Mais ces déplorables agitations ont encore tout empiré, & vous revenez moins bien que vous n’étiez partie. Que je suis pressé d’y aller voir ! Vous ne savez pas à quel point mon imagination est malade sur la santé de ce que j’aime. C’est là le point, le seul peut-être, sur lequel m’a raison soit absolument sans pouvoir. Mon seul remède, c’est que je le sais.
4 heures J’ai fait hier jour de grande fête, et quête religieuse dans mon village un dîner bien différent de votre dîner chez le Duc de Devonshire. J’ai dîné chez mon curé avec un jeune prêtre des environs, le maire, l’adjoint un petit bourgeois, sa femme, sa fille et deux paysans. Ce dîner là était une grande affaire délibérée pendant huit jours et pour laquelle on était venu processionnellement nous inviter. Mad. de Meulan et moi, après s’être assuré de notre consentement. Nous sommes arrivés à travers. champs dans la cour, je devrais dire dans la basse-cour d’un cottage vieux, délabré où loge le curé en attendant la Construction d’un presbytère. Personne pour nous recevoir; on était encore à Vêpres. Mais en revanche, je ne sais combien de chiens, de cochons, de poules, d’oies, de camards, aboyant, grognant, criant, courant, barbotant dans deux ou trois pièces d’eau pleines de de boue ; là et là des charrettes brisées, des fagots déliés, des briques et des pierres entassées pèle-mêle, tout le bagage d’une forme mal tenue par de pauvres laboureurs. Et tout à l’entour le pays le le plus riant qui se puisse voir ; de vastes près bien frais couverts, de ces bœufs énormes, tranquilles, qui semblent le type de la force au repos ; de beaux arbres, des chênes, des hêtres, des pommiers, des pins, des mélèzes mariant leurs formes et leurs teintes si variées ; l’eau de ces marres stagnantes et sales courant à vingt pas de là, claire, pure rapide. Toutes les grâces de la nature, à côté de toutes les grossièretés de l’homme.
On est enfin revenu de Vêpres ; nous avons dîné. Tout ce monde tendu, mal à l’aise, obséquieux, tour à tour silencieux ou bavard, excepté deux, le Curé, bon prêtre sans embarras dans sa gaucherie, et le Maire ancien soldat, huit ans grenadier à cheval et sous officier dans la garde impériale, maintien grave, œil fixe et doux se taisant sans sauvagerie parlant sans vanité. Au bout d’une heure, à la fin du dîner, après quelques verres de vin de champagne car on en boit là, je suis parvenu à les mettre à l’aise et même un peu en train. Tout naturellement le dez de la conversation est tombé aux mains du vieux soldat ; et depuis la campagne de Russie jusqu’à la bataille de Waterloo, il s’est raconté lui-même sans esprit mais non sans intérêt, tour à tour bonhomme et fanatique, intelligent et crédule, enthousiaste et désabusé, ému et apathique, méprisant la paix, mais jouissant beaucoup du repos, ami de l’ordre respectueux, et disant de moi, pour témoigner l’estime qu’il me porte que les mauvais sujets de toute la France me craignent, comme il est craint, lui de ceux de St Ouen. A huit heures et demie, on nous a reconduits jusqu’au Val-Richer. Je donnerai des matériaux pour la construction du presbytère, et je suis très populaire dans St Ouen, dont je vous raconte les histoires. Je voudrais trouver ce qui peut vous divertir et vous reposer.
10 heures du soir.
Je ferme ma lettre pour la donner à un homme à moi qui va demain de grand matin, à Lisieux. Vous l’aurez ainsi un jour plutôt. Les lettres de Paris m’arrivent ici, le lendemain, de 9h. à midi. Celles qui partent du Val-Richer ne sont à Paris que le surlendemain. J’espère que vous m’aurez écrit d’Abbeville ou de Beauvais. Vous devez être à Paris demain. Adieu Adieu, sans aucun doute cet adieu là va moins loin et pèse moins sur le cœur. Il y a quelque chose de mieux pourtant, d’infiniment mieux.
Vous ne voulez pas que j’aille vous voir tout de suite. Je ne ferai que ce que vous voudrez. Mais le mécompte est grand. Je voulais partir après demain Mercredi soir, pour être à Paris, jeudi matin. J’ai un dîner obligé à Lisieux le Mercredi 16 août. Si je ne vais pas vous voir cette semaine comme je ne veux pas ne rester à Paris que 24 heures, je ne pourrai y aller que vers la fin de la semaine prochaine. Je partirais le jeudi 17 et je vous verrais le 18. Serez-vous reposée? Je trouverais, je vous assure, des conversations qui vous reposeraient mieux que votre solitude. Onze jours encore avant de savoir, de voir par moi-même comment vous êtes que c’est long ! Je sais que je suis ingrat, que c’est déjà un bien immense de vous avoir à 45 lieues, dans ma France, sans abyme ni tempête entre nous. Mais que voulez-vous?
En fait de bonheur, je n’impose point de limite à mes vœux. J’aime mieux souffrir de la privation qu’abaisser mon ambition. Réglons au moins tout de suite mon voyage. Que je puisse penser au jour précis à l’heure. Je n’ai jamais trouvé que l’attente usât la joie ; bien au contraire; le bonheur prévu mesuré, sondé d’avance à toujours surpassé mon espoir. J’entends le vrai bonheur. On parle d’imagination, d’idéal. Sans doute le train ordinaire de la vie est fort au dessous des rêves de l’âme ; mais le vrai bonheur, quand il apparaît, laisse loin, bien loin en arrière toute imagination humaine et il n’y a point de si bel idéal qui approche de la belle réalité. Que si je tarde à vous voir, au moins je vous trouve effectivement reposée. Ce que vous me dîtes pour me rassurer ne me suffit point.
Je n’ai jamais beaucoup compté sur votre séjour en Angleterre pour votre rétablissement. Je savais bien que tant de monde et de bruit vous fatiguerait. Mais ces déplorables agitations ont encore tout empiré, & vous revenez moins bien que vous n’étiez partie. Que je suis pressé d’y aller voir ! Vous ne savez pas à quel point mon imagination est malade sur la santé de ce que j’aime. C’est là le point, le seul peut-être, sur lequel m’a raison soit absolument sans pouvoir. Mon seul remède, c’est que je le sais.
4 heures J’ai fait hier jour de grande fête, et quête religieuse dans mon village un dîner bien différent de votre dîner chez le Duc de Devonshire. J’ai dîné chez mon curé avec un jeune prêtre des environs, le maire, l’adjoint un petit bourgeois, sa femme, sa fille et deux paysans. Ce dîner là était une grande affaire délibérée pendant huit jours et pour laquelle on était venu processionnellement nous inviter. Mad. de Meulan et moi, après s’être assuré de notre consentement. Nous sommes arrivés à travers. champs dans la cour, je devrais dire dans la basse-cour d’un cottage vieux, délabré où loge le curé en attendant la Construction d’un presbytère. Personne pour nous recevoir; on était encore à Vêpres. Mais en revanche, je ne sais combien de chiens, de cochons, de poules, d’oies, de camards, aboyant, grognant, criant, courant, barbotant dans deux ou trois pièces d’eau pleines de de boue ; là et là des charrettes brisées, des fagots déliés, des briques et des pierres entassées pèle-mêle, tout le bagage d’une forme mal tenue par de pauvres laboureurs. Et tout à l’entour le pays le le plus riant qui se puisse voir ; de vastes près bien frais couverts, de ces bœufs énormes, tranquilles, qui semblent le type de la force au repos ; de beaux arbres, des chênes, des hêtres, des pommiers, des pins, des mélèzes mariant leurs formes et leurs teintes si variées ; l’eau de ces marres stagnantes et sales courant à vingt pas de là, claire, pure rapide. Toutes les grâces de la nature, à côté de toutes les grossièretés de l’homme.
On est enfin revenu de Vêpres ; nous avons dîné. Tout ce monde tendu, mal à l’aise, obséquieux, tour à tour silencieux ou bavard, excepté deux, le Curé, bon prêtre sans embarras dans sa gaucherie, et le Maire ancien soldat, huit ans grenadier à cheval et sous officier dans la garde impériale, maintien grave, œil fixe et doux se taisant sans sauvagerie parlant sans vanité. Au bout d’une heure, à la fin du dîner, après quelques verres de vin de champagne car on en boit là, je suis parvenu à les mettre à l’aise et même un peu en train. Tout naturellement le dez de la conversation est tombé aux mains du vieux soldat ; et depuis la campagne de Russie jusqu’à la bataille de Waterloo, il s’est raconté lui-même sans esprit mais non sans intérêt, tour à tour bonhomme et fanatique, intelligent et crédule, enthousiaste et désabusé, ému et apathique, méprisant la paix, mais jouissant beaucoup du repos, ami de l’ordre respectueux, et disant de moi, pour témoigner l’estime qu’il me porte que les mauvais sujets de toute la France me craignent, comme il est craint, lui de ceux de St Ouen. A huit heures et demie, on nous a reconduits jusqu’au Val-Richer. Je donnerai des matériaux pour la construction du presbytère, et je suis très populaire dans St Ouen, dont je vous raconte les histoires. Je voudrais trouver ce qui peut vous divertir et vous reposer.
10 heures du soir.
Je ferme ma lettre pour la donner à un homme à moi qui va demain de grand matin, à Lisieux. Vous l’aurez ainsi un jour plutôt. Les lettres de Paris m’arrivent ici, le lendemain, de 9h. à midi. Celles qui partent du Val-Richer ne sont à Paris que le surlendemain. J’espère que vous m’aurez écrit d’Abbeville ou de Beauvais. Vous devez être à Paris demain. Adieu Adieu, sans aucun doute cet adieu là va moins loin et pèse moins sur le cœur. Il y a quelque chose de mieux pourtant, d’infiniment mieux.
18. Val-Richer, Mardi 8 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°18 Mardi 8 3 heures
Vous arrivez aujourd’hui à Paris. Peut-être y êtes vous déjà, car de Beauvais à Paris il n’y a que huit postes et demie. Vous y devez trouver je ne sais combien de lettres, les N°11, 12, 13 d’ici, 15 de Caen et 16 d’ici. J’ai reçu ce matin votre dernier mot de Boulogne, N°18.
Je ne vous réponds pas sur le sujet dont vous me parlez. Nous en causerons en pleine liberté. Il n’y a pas un de vos sentiments que je ne comprenne et qui ne me plaise dans le sens le plus intime et le plus sérieux de ce mot, si souvent profané. Gardez-les tous dearest ; ce sont des notes justes, l’harmonie s’y mettra. Que seulement le calme physique vous revienne. Je suis sûr que si vous vous portiez bien vous ne seriez pas en proie à ces troubles dont vous vous plaignez. Vous avez le jugement si droit l’esprit si haut et si fin que certainement, quand l’état de vos nerfs n’y fait pas obstacle vous savez voir toutes choses, choses et personnes, comme elles sont, mettre chacune à sa place, en vous-même comme au dehors, choisir décidément ce qui est vrai, juste, ce qui vous convient, et accepter, dans votre choix, les inconvénients, les difficultés, les peines même la part de mal enfin, inséparables de toute résolution. comme de toute situation humaine. Vous voulez que je vous apprenne à être calme. Je ne sais pas un si beau secret. Mais si j’ai un peu de calme, c’est que pour mes sentiments aussi bien que pour mes actions, dans ma vie intérieure comme dans ma vie extérieure, j’ai assez de prévoyance et peu d’irrésolution. Quand quelque chose commence en moi ou autour de moi, j’en vois promptement et d’un coup d’œil assez libre toutes les faces, toutes les conséquences. Si j’accepte, j’accepte sans hésitation sans retour le bien et le mal, la joie et la peine, l’avantage et l’embarras, le mérite et le tort même, s’il y en a. Et dans la suite, à mesure que les choses se développent et portent leurs fruits, bons ou mauvais, je ne suis pas plus incertain qu’au début. Je ne connais guère le regret ni le repentir. Je veux ce que j’ai voulu ; je me tiens à ce que j’ai fait. Je n’ai point la prétention que ma vie soit sans souffrances et ma conduite sans fautes. Je porte le poids des unes et la responsabilité des autres sans m’en plaindre, sans en déplacer les causes, car ces causes, je les ai en général connues et voulues. En général, dans chacun de mes sentiments, de mes actes, je pressens leur avenir et j’y consens. Et s’il m’arrive, comme il m’arrive en effet de n’avoir pas tout prévu, je ne m’en prends qu’à mon insuffisance et j’y consens encore ; car à tout prendre, en fait d’intelligence et de sagacité, je n’ai point droit de me plaindre de la part que Dieu m’a faite. En tout, je suis soumis, Madame, soumis aux imperfections de la condition humaine à mes propres imperfections aux volontés de Dieu, à mes propres volontés. Je ne me révolte point; je ne me tracasse point ; je ne délibère point à chaque minute, je ne tâtonne point à choque pas. Je veux surtout de l’unité dans mon âme et dans ma vie, et pourvu que l’ensemble me convienne, je ne marchande pas sur les détails. Quelle est, dans cette disposition la part de mon naturel et celle de ma volonté ? Je l’ignore ; mais si j’ai quelque sérénité, voilà à quoi elle tient.
Vous êtes femme, dearest, et par conséquent, un peu plus mobile, un peu plus accessible que moi à l’empire des impressions du moment. Mais vous avez beaucoup d’esprit, de raison, de courage, de dédain. Vous allez naturellement à tout ce qui est grand, simple. Soyez sûre qu’avec un peu de santé et d’habitude, il vous viendrait... laissez-moi dire il vous viendra du calme. J’ai du bien à vous faire, comme du bonheur, à vous donner. Vous me dîtes que je vous ai aidée à supporter vos peines. Je vous aiderai à vous affranchir de ces troubles intérieurs, de ces incertitudes de ces luttes répétées où l’âme se lasse et perd sa force la force dont elle a besoin, et pour résister, et pour jouir. Que je serais heureux de voir la sérénité se répandre sur votre noble physionomie, et de goûter le charme infini de votre affection. sans crainte qu’elle vous fasse mal !
Je voulais vous parler des élections anglaises qui prennent, ce me semble, un tour bien conservateur. Mais je n’y ai plus pensé. A demain les affaires. Adieu. Vous ne vous figurez pas ou plutôt vous vous figurez bien avec quelle impatiente j’attends votre première lettre de Paris. G.
Mercredi 10h.
Je reçois à présent même votre N°19 de Paris. Au nom de Dieu, calmez-vous, soignez vous. Que la fatigue du voyage, de l’absence, de la mer disparaisse. Je me charge du reste. J’attends votre réponse à ma proposition pour la semaine prochaine. Les N°12 et 18 vous ont été adressés à Londres. Le N°15 à Boulogne, porte restante- il était écrit de Caen. Le N°17 vous a été adressé à l’hôtel Bristol.
Vous arrivez aujourd’hui à Paris. Peut-être y êtes vous déjà, car de Beauvais à Paris il n’y a que huit postes et demie. Vous y devez trouver je ne sais combien de lettres, les N°11, 12, 13 d’ici, 15 de Caen et 16 d’ici. J’ai reçu ce matin votre dernier mot de Boulogne, N°18.
Je ne vous réponds pas sur le sujet dont vous me parlez. Nous en causerons en pleine liberté. Il n’y a pas un de vos sentiments que je ne comprenne et qui ne me plaise dans le sens le plus intime et le plus sérieux de ce mot, si souvent profané. Gardez-les tous dearest ; ce sont des notes justes, l’harmonie s’y mettra. Que seulement le calme physique vous revienne. Je suis sûr que si vous vous portiez bien vous ne seriez pas en proie à ces troubles dont vous vous plaignez. Vous avez le jugement si droit l’esprit si haut et si fin que certainement, quand l’état de vos nerfs n’y fait pas obstacle vous savez voir toutes choses, choses et personnes, comme elles sont, mettre chacune à sa place, en vous-même comme au dehors, choisir décidément ce qui est vrai, juste, ce qui vous convient, et accepter, dans votre choix, les inconvénients, les difficultés, les peines même la part de mal enfin, inséparables de toute résolution. comme de toute situation humaine. Vous voulez que je vous apprenne à être calme. Je ne sais pas un si beau secret. Mais si j’ai un peu de calme, c’est que pour mes sentiments aussi bien que pour mes actions, dans ma vie intérieure comme dans ma vie extérieure, j’ai assez de prévoyance et peu d’irrésolution. Quand quelque chose commence en moi ou autour de moi, j’en vois promptement et d’un coup d’œil assez libre toutes les faces, toutes les conséquences. Si j’accepte, j’accepte sans hésitation sans retour le bien et le mal, la joie et la peine, l’avantage et l’embarras, le mérite et le tort même, s’il y en a. Et dans la suite, à mesure que les choses se développent et portent leurs fruits, bons ou mauvais, je ne suis pas plus incertain qu’au début. Je ne connais guère le regret ni le repentir. Je veux ce que j’ai voulu ; je me tiens à ce que j’ai fait. Je n’ai point la prétention que ma vie soit sans souffrances et ma conduite sans fautes. Je porte le poids des unes et la responsabilité des autres sans m’en plaindre, sans en déplacer les causes, car ces causes, je les ai en général connues et voulues. En général, dans chacun de mes sentiments, de mes actes, je pressens leur avenir et j’y consens. Et s’il m’arrive, comme il m’arrive en effet de n’avoir pas tout prévu, je ne m’en prends qu’à mon insuffisance et j’y consens encore ; car à tout prendre, en fait d’intelligence et de sagacité, je n’ai point droit de me plaindre de la part que Dieu m’a faite. En tout, je suis soumis, Madame, soumis aux imperfections de la condition humaine à mes propres imperfections aux volontés de Dieu, à mes propres volontés. Je ne me révolte point; je ne me tracasse point ; je ne délibère point à chaque minute, je ne tâtonne point à choque pas. Je veux surtout de l’unité dans mon âme et dans ma vie, et pourvu que l’ensemble me convienne, je ne marchande pas sur les détails. Quelle est, dans cette disposition la part de mon naturel et celle de ma volonté ? Je l’ignore ; mais si j’ai quelque sérénité, voilà à quoi elle tient.
Vous êtes femme, dearest, et par conséquent, un peu plus mobile, un peu plus accessible que moi à l’empire des impressions du moment. Mais vous avez beaucoup d’esprit, de raison, de courage, de dédain. Vous allez naturellement à tout ce qui est grand, simple. Soyez sûre qu’avec un peu de santé et d’habitude, il vous viendrait... laissez-moi dire il vous viendra du calme. J’ai du bien à vous faire, comme du bonheur, à vous donner. Vous me dîtes que je vous ai aidée à supporter vos peines. Je vous aiderai à vous affranchir de ces troubles intérieurs, de ces incertitudes de ces luttes répétées où l’âme se lasse et perd sa force la force dont elle a besoin, et pour résister, et pour jouir. Que je serais heureux de voir la sérénité se répandre sur votre noble physionomie, et de goûter le charme infini de votre affection. sans crainte qu’elle vous fasse mal !
Je voulais vous parler des élections anglaises qui prennent, ce me semble, un tour bien conservateur. Mais je n’y ai plus pensé. A demain les affaires. Adieu. Vous ne vous figurez pas ou plutôt vous vous figurez bien avec quelle impatiente j’attends votre première lettre de Paris. G.
Mercredi 10h.
Je reçois à présent même votre N°19 de Paris. Au nom de Dieu, calmez-vous, soignez vous. Que la fatigue du voyage, de l’absence, de la mer disparaisse. Je me charge du reste. J’attends votre réponse à ma proposition pour la semaine prochaine. Les N°12 et 18 vous ont été adressés à Londres. Le N°15 à Boulogne, porte restante- il était écrit de Caen. Le N°17 vous a été adressé à l’hôtel Bristol.
19. Paris, Hôtel Bristol place Vendôme, Mardi 8 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
19. Paris. Hôtel de Londres place Vendôme, Mardi 8 août
10 heures du matin.
Je voudrais avoir la force de me réjouir de ce mot Paris. Monsieur vous ne concevez pas le bonheur que j’éprouve. Il me semble que je suis au près de vous avec vous. Toute cette nuit je vous ai parlé mais pas en rêve. Si j’avais rêvé j’aurais dormi, mais non je n’ai pas fermé l’œil. Je causais avec vous sans cesse, sans cesse. C’est bien la fièvre que j’ai en arrivant ici à 8 h. Je reçus votre N°11. Au moment de me coucher le 16 me fut apporté par la personne à laquelle vous l’avez adressé. Ces deux lettres ont reposé toute cette nuit sous mon oreiller dans mes mains. Mais J’ai été effrayée de mon agitation de ma faiblesse à l’aube du jour. J’ai fait venir mon médecin. Il m’assure qu’il n’y a rien de grave que la mer m’a complètement bouleversée que c’est une affaire de nerfs pas autre chose. Pour me le prouver il ne me donne à boire que de l’eau de camphre. C’est le seul remède que j’ai jamais accepté, je vous conte tout cela afin que vous n’alliez pas vous inquiéter. Quand je vous verrai je vous dirai cependant comme j’ai été mal à Abbeville.
Je vous avais écrit heureusement le bureau de la poste était fermé, on m’a rapporté ma lettre, quand je l’ai relue j’ai été effrayée pour vous, je l’ai déchirée. Je ne veux pas que vous veniez encore. Vous voyez bien que je suis trop agitée pour vous voir. Laissez-moi quelques jours de repos.
Quand je vous ai quitté il y a cinq semaines, c’était votre image qui devait effacer, adoucir au moins des images bien douloureuses. Aujourd’hui je pense tant à vous, j’y pense tant ... que je cherche un remède, et je ne sais le trouver que dans le souvenir de mes malheurs, là, il y a du calme, auprès de vous de l’agitation. Voyez Monsieur où j’en suis venue, et imaginez le déplorable état de mes nerfs ! Je vous écrirai tous les jours et le jour où je me sentirai mieux, le jour où je les serai pas si troublée en pensant à vous ; le jour où je croirai pouvoir supporter votre vue avec plus de celui, ce jour-là je vous appellerai et vous viendrez n’est-ce pas ? Est-ce donc du bonheur que j’ai trouvé auprès de vous? Je ne sais pas me répondre, mais ma vie, mon âme sont à vous, vous me répondrez.
Ah mon Dieu cela me fait mal de vous écrire. Ma pauvre raison, elle m’abandonne. Adieu. Que sont devenus les intermédiaires entre 11 & 16 ?
10 heures du matin.
Je voudrais avoir la force de me réjouir de ce mot Paris. Monsieur vous ne concevez pas le bonheur que j’éprouve. Il me semble que je suis au près de vous avec vous. Toute cette nuit je vous ai parlé mais pas en rêve. Si j’avais rêvé j’aurais dormi, mais non je n’ai pas fermé l’œil. Je causais avec vous sans cesse, sans cesse. C’est bien la fièvre que j’ai en arrivant ici à 8 h. Je reçus votre N°11. Au moment de me coucher le 16 me fut apporté par la personne à laquelle vous l’avez adressé. Ces deux lettres ont reposé toute cette nuit sous mon oreiller dans mes mains. Mais J’ai été effrayée de mon agitation de ma faiblesse à l’aube du jour. J’ai fait venir mon médecin. Il m’assure qu’il n’y a rien de grave que la mer m’a complètement bouleversée que c’est une affaire de nerfs pas autre chose. Pour me le prouver il ne me donne à boire que de l’eau de camphre. C’est le seul remède que j’ai jamais accepté, je vous conte tout cela afin que vous n’alliez pas vous inquiéter. Quand je vous verrai je vous dirai cependant comme j’ai été mal à Abbeville.
Je vous avais écrit heureusement le bureau de la poste était fermé, on m’a rapporté ma lettre, quand je l’ai relue j’ai été effrayée pour vous, je l’ai déchirée. Je ne veux pas que vous veniez encore. Vous voyez bien que je suis trop agitée pour vous voir. Laissez-moi quelques jours de repos.
Quand je vous ai quitté il y a cinq semaines, c’était votre image qui devait effacer, adoucir au moins des images bien douloureuses. Aujourd’hui je pense tant à vous, j’y pense tant ... que je cherche un remède, et je ne sais le trouver que dans le souvenir de mes malheurs, là, il y a du calme, auprès de vous de l’agitation. Voyez Monsieur où j’en suis venue, et imaginez le déplorable état de mes nerfs ! Je vous écrirai tous les jours et le jour où je me sentirai mieux, le jour où je les serai pas si troublée en pensant à vous ; le jour où je croirai pouvoir supporter votre vue avec plus de celui, ce jour-là je vous appellerai et vous viendrez n’est-ce pas ? Est-ce donc du bonheur que j’ai trouvé auprès de vous? Je ne sais pas me répondre, mais ma vie, mon âme sont à vous, vous me répondrez.
Ah mon Dieu cela me fait mal de vous écrire. Ma pauvre raison, elle m’abandonne. Adieu. Que sont devenus les intermédiaires entre 11 & 16 ?
19. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°19 Jeudi matin, 9 heures.
Comment passerez-vous votre temps ? J’en suis préoccupé. L’ennui vous gagne aisément. Il y a bien peu de monde à Paris. En Angleterre. vous aviez trop d’amis, trop de conversations. Je crains qu’en France il ne vous en manque. Contez-moi en détail votre journée. Quoique j’espère aller bientôt y regarder moi-même, je veux savoir tout de suite ce qui en est. Vous n’avez pas contre l’ennui les ressources d’un homme, des affaires à soigner, le travail, l’étude. Je voudrais vous indiquer quelque chose d’intéressant à lire. Savez-vous lire, lire de manière à remplir quelques heures dans votre journée? J’ai peur que non. Votre vie s’est passée dans les relations de personne à personne, à voir, à causer, à écrire. Les grandes affaires, vous les avez traitées comme on traite les petites en conversation, en visite, en correspondance dans le train ordinaire de la vie. C’est de beaucoup la manière la plus amusante, et aussi la plus naturelle, et peut-être aussi la plus efficace. Vous y avez acquis, c’est-à-dire développé cette admirable intelligence des personnes, des caractères, cette disposition sympathique qui n’enlève point a votre esprit son indépendance, cette pénétration soudaine qui fait qu’avec vous rien ne se perd, que tout a un sens pour vous, que la moindre parole vous dit tout, que les éclairs les plus fugitifs de la physionomie ou de la pensée frappent vos yeux et vous illuminent comme serait le plus grand jour. Tout cela est exquis charmant et quand je suis après de vous, j’en jouis avec délice. Mais quand vous êtes seule que faites-vous de tout cela ? Vous souffrez de vos qualités de votre supériorité. Elles n’ont pas leur emploi accoutumé et il est difficile de leur en trouver un autre. Enfin dites-moi le compte de vos heures. Avez-vous jamais lu mes deux volumes sur l’histoire de la Révolution d’Angleterre jusqu’à la mort de Charles 1er ? Si vous ne les avez pas lus, je vous les ferai porter Je crois que c’est vrai, et assez vivant. J’ai recommencé ici à m’occuper de l’époque qui suit, du gouvernement de Cromwell. Les Anglais à mon avis ne comprennent pas ce temps-là, surtout les hommes, leurs idées, leurs passions, leurs intérêts, et l’amalgame étrange l’action et la réaction continuelle de ces trois causes l’une sur l’autre dans leur conduite et dans leur âme. C’est peut-être une fatuité de ma part ; mais je crois qu’il faut avoir vu & presque fait une révolution pour en comprendre une autre. 10 h. 1/2. Voilà le facteur qui m’apporte votre n° 20 et qui repart sur le champs. Il faut que je lui donne ma lettre. Vous êtes donc un peu mieux, et je vous verrai le 18. Et que votre lettre est bonne, charmante. J’y répondrai demain. Ne vous inquiétez pas de moi. Je me porte et je me porterai à merveille. Soignez- vous, soignez vous. Que je vous trouve un peu moins faible, un peu moins lasse. J’en ai tant d’envie ! Que tous les mots sont faibles ! Adieu. Adieu. Je ne comprends pas que vous n’ayez pas les N°12, 13 et 15. Les deux premiers ont été envoyés à Londres. Le troisième à Boulogne, poste restante. Il faut l’y faire redemander.
Comment passerez-vous votre temps ? J’en suis préoccupé. L’ennui vous gagne aisément. Il y a bien peu de monde à Paris. En Angleterre. vous aviez trop d’amis, trop de conversations. Je crains qu’en France il ne vous en manque. Contez-moi en détail votre journée. Quoique j’espère aller bientôt y regarder moi-même, je veux savoir tout de suite ce qui en est. Vous n’avez pas contre l’ennui les ressources d’un homme, des affaires à soigner, le travail, l’étude. Je voudrais vous indiquer quelque chose d’intéressant à lire. Savez-vous lire, lire de manière à remplir quelques heures dans votre journée? J’ai peur que non. Votre vie s’est passée dans les relations de personne à personne, à voir, à causer, à écrire. Les grandes affaires, vous les avez traitées comme on traite les petites en conversation, en visite, en correspondance dans le train ordinaire de la vie. C’est de beaucoup la manière la plus amusante, et aussi la plus naturelle, et peut-être aussi la plus efficace. Vous y avez acquis, c’est-à-dire développé cette admirable intelligence des personnes, des caractères, cette disposition sympathique qui n’enlève point a votre esprit son indépendance, cette pénétration soudaine qui fait qu’avec vous rien ne se perd, que tout a un sens pour vous, que la moindre parole vous dit tout, que les éclairs les plus fugitifs de la physionomie ou de la pensée frappent vos yeux et vous illuminent comme serait le plus grand jour. Tout cela est exquis charmant et quand je suis après de vous, j’en jouis avec délice. Mais quand vous êtes seule que faites-vous de tout cela ? Vous souffrez de vos qualités de votre supériorité. Elles n’ont pas leur emploi accoutumé et il est difficile de leur en trouver un autre. Enfin dites-moi le compte de vos heures. Avez-vous jamais lu mes deux volumes sur l’histoire de la Révolution d’Angleterre jusqu’à la mort de Charles 1er ? Si vous ne les avez pas lus, je vous les ferai porter Je crois que c’est vrai, et assez vivant. J’ai recommencé ici à m’occuper de l’époque qui suit, du gouvernement de Cromwell. Les Anglais à mon avis ne comprennent pas ce temps-là, surtout les hommes, leurs idées, leurs passions, leurs intérêts, et l’amalgame étrange l’action et la réaction continuelle de ces trois causes l’une sur l’autre dans leur conduite et dans leur âme. C’est peut-être une fatuité de ma part ; mais je crois qu’il faut avoir vu & presque fait une révolution pour en comprendre une autre. 10 h. 1/2. Voilà le facteur qui m’apporte votre n° 20 et qui repart sur le champs. Il faut que je lui donne ma lettre. Vous êtes donc un peu mieux, et je vous verrai le 18. Et que votre lettre est bonne, charmante. J’y répondrai demain. Ne vous inquiétez pas de moi. Je me porte et je me porterai à merveille. Soignez- vous, soignez vous. Que je vous trouve un peu moins faible, un peu moins lasse. J’en ai tant d’envie ! Que tous les mots sont faibles ! Adieu. Adieu. Je ne comprends pas que vous n’ayez pas les N°12, 13 et 15. Les deux premiers ont été envoyés à Londres. Le troisième à Boulogne, poste restante. Il faut l’y faire redemander.
20. Paris, Mardi 8 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
20. Mardi 8 août 6. h.
J’ai été obligée de recevoir M. Molé, lady Granville, le comte Médem avec le premier deux heures de tête-à- tête, avec lady Granville longtemps. aussi, mais une causerie si bonne, si intime sur un sujet qui me tient le cœur si serré, que j’ai fini par tomber sur son épaule. Je n’avais plus de force. Si je pouvais me débarrasser de mes nerfs mais je suis bien faible, bien faible. Le médecin me dit que je reprendrai des forces au bout de quelques jours. Il faut en reprendre avant de vous voir. Telle que je suis aujourd’hui c’est impossible. J’en tomberais gravement malade, et vous ne le voulez pas ? Je ne cesserai donc de vous le répéter, attendez je vous en conjure. Laissez-moi me remettre un peu ; je vous promets que je ne m’occuperai que de cela. Si je pouvais vous promettre de ne pas m’occuper de vous, je serais bien plus sûre de remplir le premier engagement. M. Molé m’a trouvé bien changée.
Mercredi 9 à 8 h du matin Je suis mieux, il me semble que c’est là ce que vous êtes pressé de savoir. J’ai dormi cinq heures cette nuit, je vous ai oublié un peu, Dieu merci. Et en me levant j’ai vraiment senti que mes jambes me porteraient mieux. Voyez Monsieur, voilà du progrès. Tous les jours j’espère vous en annoncer et puis, & puis. Vous viendrez quand je vous le dirai vous viendrez n’est-ce pas ? Cela me paraît simple, cela me parait sûr, & quand je pense au moment où je vous reverrai, il me semble que j’en mourrai.
Est-il possible qu’en si peu de temps vous soyez devenu pour moi ce que ma peine cherchait dans le ciel, que cette vision qui m’avait un moment enivré de délices sont devenus une réalité ? Je vous ai dit ce que j’ai éprouvé alors, je me rappelle distinctement. Cette sensation mais jamais je ne saurais la décrire, elle surpassait ce que la parole peut exprimer. Et bien de même aujourd’hui ce que j’éprouve est au-dessus de toutes les expressions humaines. Monsieur est-ce que je rêve. Y a t-il de la folie dans ce que je vous dis ? Je ne suis plus sûre de moi. Monsieur défendez-moi de vous parler.
Je lis vos lettres, je les relis. Savez-vous bien ce que sont vos lettres ? Ah quel danger pour ma pauvre raison ! onze heures On m’apporte dans ce moment votre N° 17. Voilà qui est réglée, j’accepte le 18. Je l’accepte avec transport. Pensez donc au 18, pensez y beaucoup, et faites des vœux pour que je n’y pense pas. Car ma pauvre tête pourrait aller. Votre dîner chez le curé me rappelle qu’il y a quelques temps déjà je voulais vous demander une faveur. J’ai lu dans en livre que vous m’avez donné, ces livres dont j’approche avec respect avec mille sentiments contraires que je ne peux, que je ne veux pas vous exprimer. J’y ai lu entre autres choses que celle que vous aimiez surement le mieux s’occupait des pauvres. Est-ce à St Ouen qu’elle avait des pauvres des écoles, enfin des objets de ses charités. Je voudrais bien de cette manière au moins chercher à lui ressembler. Il est une manière où je la surpasse, oui, Monsieur je la surpasse, ne me disputez pas cela j’en suis sûre, sûre.
J’en reviens à mon sujet. Monsieur ayez la bonté d’arranger ce que je vais vous dire. Je destine mille francs à votre comme. Vous distribuerez cela comme vous l’entendez, mais je voudrais bien entre autre ; que ce cottage où vous avez dîné soit mieux tenu, et que l’année prochaine vous me racontiez que cela avait l’air propre et bien rangé. Dites-moi à quelle adresse mon banquier aurait à faire passer cette somme. Adieu. Adieu. Je veux une lettre tous les jours. Je vous en supplie, je vous en conjure, tous les jours un mot jusqu’au jour qui me semble qui n’arrivera jamais !
Mon médecin sort d’ici il me trouve mieux ce matin, mais très faible. Il veut de l’air, de l’air. Une pieds sont froids comme glace, & je n’ai pas la force de marcher. Il veut me faire prendre du quinine. N’allez pas tomber malade, soignez- vous bien. Imaginez que je vais maintenant m’inquiéter de votre santé. Mais elle est bonne n’est-ce pas ? Tous vos N° entre 11 et 16 me manquent encore. Excepté la lettre de Caen sans N°.
J’ai été obligée de recevoir M. Molé, lady Granville, le comte Médem avec le premier deux heures de tête-à- tête, avec lady Granville longtemps. aussi, mais une causerie si bonne, si intime sur un sujet qui me tient le cœur si serré, que j’ai fini par tomber sur son épaule. Je n’avais plus de force. Si je pouvais me débarrasser de mes nerfs mais je suis bien faible, bien faible. Le médecin me dit que je reprendrai des forces au bout de quelques jours. Il faut en reprendre avant de vous voir. Telle que je suis aujourd’hui c’est impossible. J’en tomberais gravement malade, et vous ne le voulez pas ? Je ne cesserai donc de vous le répéter, attendez je vous en conjure. Laissez-moi me remettre un peu ; je vous promets que je ne m’occuperai que de cela. Si je pouvais vous promettre de ne pas m’occuper de vous, je serais bien plus sûre de remplir le premier engagement. M. Molé m’a trouvé bien changée.
Mercredi 9 à 8 h du matin Je suis mieux, il me semble que c’est là ce que vous êtes pressé de savoir. J’ai dormi cinq heures cette nuit, je vous ai oublié un peu, Dieu merci. Et en me levant j’ai vraiment senti que mes jambes me porteraient mieux. Voyez Monsieur, voilà du progrès. Tous les jours j’espère vous en annoncer et puis, & puis. Vous viendrez quand je vous le dirai vous viendrez n’est-ce pas ? Cela me paraît simple, cela me parait sûr, & quand je pense au moment où je vous reverrai, il me semble que j’en mourrai.
Est-il possible qu’en si peu de temps vous soyez devenu pour moi ce que ma peine cherchait dans le ciel, que cette vision qui m’avait un moment enivré de délices sont devenus une réalité ? Je vous ai dit ce que j’ai éprouvé alors, je me rappelle distinctement. Cette sensation mais jamais je ne saurais la décrire, elle surpassait ce que la parole peut exprimer. Et bien de même aujourd’hui ce que j’éprouve est au-dessus de toutes les expressions humaines. Monsieur est-ce que je rêve. Y a t-il de la folie dans ce que je vous dis ? Je ne suis plus sûre de moi. Monsieur défendez-moi de vous parler.
Je lis vos lettres, je les relis. Savez-vous bien ce que sont vos lettres ? Ah quel danger pour ma pauvre raison ! onze heures On m’apporte dans ce moment votre N° 17. Voilà qui est réglée, j’accepte le 18. Je l’accepte avec transport. Pensez donc au 18, pensez y beaucoup, et faites des vœux pour que je n’y pense pas. Car ma pauvre tête pourrait aller. Votre dîner chez le curé me rappelle qu’il y a quelques temps déjà je voulais vous demander une faveur. J’ai lu dans en livre que vous m’avez donné, ces livres dont j’approche avec respect avec mille sentiments contraires que je ne peux, que je ne veux pas vous exprimer. J’y ai lu entre autres choses que celle que vous aimiez surement le mieux s’occupait des pauvres. Est-ce à St Ouen qu’elle avait des pauvres des écoles, enfin des objets de ses charités. Je voudrais bien de cette manière au moins chercher à lui ressembler. Il est une manière où je la surpasse, oui, Monsieur je la surpasse, ne me disputez pas cela j’en suis sûre, sûre.
J’en reviens à mon sujet. Monsieur ayez la bonté d’arranger ce que je vais vous dire. Je destine mille francs à votre comme. Vous distribuerez cela comme vous l’entendez, mais je voudrais bien entre autre ; que ce cottage où vous avez dîné soit mieux tenu, et que l’année prochaine vous me racontiez que cela avait l’air propre et bien rangé. Dites-moi à quelle adresse mon banquier aurait à faire passer cette somme. Adieu. Adieu. Je veux une lettre tous les jours. Je vous en supplie, je vous en conjure, tous les jours un mot jusqu’au jour qui me semble qui n’arrivera jamais !
Mon médecin sort d’ici il me trouve mieux ce matin, mais très faible. Il veut de l’air, de l’air. Une pieds sont froids comme glace, & je n’ai pas la force de marcher. Il veut me faire prendre du quinine. N’allez pas tomber malade, soignez- vous bien. Imaginez que je vais maintenant m’inquiéter de votre santé. Mais elle est bonne n’est-ce pas ? Tous vos N° entre 11 et 16 me manquent encore. Excepté la lettre de Caen sans N°.
20. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°20. Jeudi 10 4 heures
Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.
Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?
Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.
Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.
Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.
Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.
Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.
Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.
Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?
Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.
Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.
Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.
Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.
Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.
21. Paris, Jeudi 10 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
21. Paris, jeudi le 10 août 1837
huit heures
Vous venez après mes prières. Dans mes prières je pense à vous je prie pour vous. Monsieur venez m’enseigner à ne pas vous donner ainsi toutes mes pensées tous les battements de mon cœur. Cela n’était pas tout à fait ainsi avant mon départ pour l’Angleterre. Il me semble au moins ce voyage, cette longue séparation, vos lettres, les inquiétudes mortelles que j’ai éprouvées pendant dix jours tout cela a tellement exalté ma pauvre tête et affaibli mon corps, qu’aujourd’hui votre image est une douleur. Mais une douleur dont je ne puis pas me séparer un instant. Que sera ce quand vous serez là auprès de moi ? Je vous y vois déjà, je vous établis Je suis fâchée que ce ne soit pas dans la Chambre où nous avions pris de si douces habitudes. Je l’aurais même aimé, mais on y travaille, cela m’impatiente. J’irai voir aujourd’hui s’il n’y aurait pas moyen de presser les ouvriers. Je suis sortie hier, mais il y a un peu d’embarras à satisfaire mon médecin. Il veut de l’air et il ne veut pas d’exercice. Je me suis fait traîner doucement en calèche avant dîner, & j’ai recommencé le soir. Il faisait doux mais triste. Quand vous serez ici nous irons. un soir en calèche. Je laisserai Marion à la maison. J’ai pensé à cela tout le long de la promenade. Que j’aime rêver ainsi alors, je n’entends plus rien & j’y serais encore ; s’il n’était survenu des éclairs très forts.
Je suis rentrée à 10 h. Je me suis couchée. J’avais vu dans la journée quelques personnes. Lady Granville. Le duc de Palmilla, le duc de Hamilton, & M. de Hugel. J’ai une confidence à vous faire sur Lady Granville. Elle a toujours exercé sur moi un grand empire. Elle a de l’esprit prodigieusement et l’amour le plus fanatique pour son mari. C’est la personne qui me connaît le mieux, & qui connait le plus vite toute créature qu’elle a intérêt à pénétrer. Elle m’aime & je crois tout simplement parce qu’elle me connait. Elle sait donc tout. Hier elle m’a trouvé relisant une lettre. Eh bien Monsieur je la lui ai donnée Cette lettre c’est le N°6. Vous y traitez le sujet le plus élevé. Savez-vous ce qu’a fait Lady Granville ? Elle a pleuré, pleuré. Elle y a retrouvé tout ce qu’elle pense. Elle voudrait Monsieur se prosterner à genoux devant vous. Quand je l’ai vu ainsi , émue, exaltée. Je me suis rassurée sur mon propre compte. Il n’y a donc pas de la folie dans mon fait. Voilà ce que je me suis dit d’abord. Savez-vous ce qu’elle m’a dit ensuite ? Monsieur c’est ce que je me suis dit plusieurs fois déjà mais sans avoir où vous le répéter. "
Je mourrai Monsieur comme sont mortes ces deux femmes que vous avez tant aimées !! Elles n’ont pas plus supporté leur bonheur que moi je ne puis supporter le mien. Dieu n’aime pas que les joies du Ciel soient révéler aux mortels. Il leur retire la force de les soutenir. Savez vous Monsieur pourquoi vous venez ? C’est que vous ne sentez pas au moins de près ce qu’elles ont senti, ce que je sens. Dieu vous a placé sur la terre pour un autre but. Moi j’avais accompli ma destiné et vous aimez ma mémoire comme vous chérissez la leur. Encore une fois Monsieur défendez moi de vous écrire, cela me fait mal.
11 heures
J’ai fait ma toilette, j’ai essayé de déjeuner. Je ne puis pas manger. Le facteur est venu il ne ma pas apporté de lettres, pas de lettres ! Pourquoi ne m’avez-vous pas écrit ! Monsieur ne me donnez pas ce chagrin là. Un mot, un mot tous les jours je vous en supplie. Ne me faites pas repasser par toutes les horribles émotions de Londres. Vous le voyez je suis faible, je le deviens même plus tous les jours. Cette nuit a été mauvaise. La chaleur m’accable et cependant je suis froide comme glace. C’est un vilain état de nerfs.
J’ai des nouvelles de M. de Lieven de Marienbad en Bohême. Il allait le lendemain chez M. de Metternich à un château qu’il a près de la. Ils ne se sont pas vus depuis le temps où ils ne s’aimaient guère. Le prince de Metternich fera sur cela quelques bonnes réflexions philosophiques que je suis bien aise de n’être pas condamnée à lire car elles seraient longues. Savez- vous qu’il m’a souvent, bien souvent fait bailler, il disserte lourdement. Vous aurez lu de ses pièces diplomatiques Il y a toujours beaucoup d’esprit, beaucoup d’habileté, mais la forme en est bien allemande. Et bien il vous racontera comment on fait le macaroni avec le même intérêt, la même pesanteur. M. de Metternich traite tous les sujets de même, et se croit fort universel. Jamais il ne lui est arrivé de dire : "Je ne sais pas." Il sait tout, et surtout il a tout prévu, tout deviné. Lady Granville lisait souvent ses lettres, et ne manquait jamais d’en rire. A dire vrai elle m’entraînait quelques fois à rire aussi. Elle servait à souhait M. Canning. Je ne sais comment je suis arrivée à vous parler de tout cela, mais je suis bien aise d’une distraction.
Madame de Dino me supplie de donner rendez-vous à mon mari à Valençay. C’est beaucoup trop loin. Si je vais à Valençay il voudra m’entraîner plus loin. Mais que je suis impatiente de sa réponse à la nouvelle que je suis revenue en France ! Car lui &mon frère aussi, qui m’écrit enfin une lettre très tendre, (tendre parce que je n’étais plus à Paris) ; n’ont pas le moindre soupçon que je puisse penser de nouveau à fouler cette terre défendue. Monsieur, je bavarde, je bavarde et vous ne me dites rien. Rappelez-moi de vous conter, quand je vous verrai un moment de singulières explosions de la part de 17 dans le dernier entretien que j’ai eu avec lui. Par exemple lady Granville rit bien de lui.
Adieu Monsieur, c’est triste de vous dire adieu Sans vous avoir dit merci. Cela ne sera pas ainsi demain n’est-ce pas ?
huit heures
Vous venez après mes prières. Dans mes prières je pense à vous je prie pour vous. Monsieur venez m’enseigner à ne pas vous donner ainsi toutes mes pensées tous les battements de mon cœur. Cela n’était pas tout à fait ainsi avant mon départ pour l’Angleterre. Il me semble au moins ce voyage, cette longue séparation, vos lettres, les inquiétudes mortelles que j’ai éprouvées pendant dix jours tout cela a tellement exalté ma pauvre tête et affaibli mon corps, qu’aujourd’hui votre image est une douleur. Mais une douleur dont je ne puis pas me séparer un instant. Que sera ce quand vous serez là auprès de moi ? Je vous y vois déjà, je vous établis Je suis fâchée que ce ne soit pas dans la Chambre où nous avions pris de si douces habitudes. Je l’aurais même aimé, mais on y travaille, cela m’impatiente. J’irai voir aujourd’hui s’il n’y aurait pas moyen de presser les ouvriers. Je suis sortie hier, mais il y a un peu d’embarras à satisfaire mon médecin. Il veut de l’air et il ne veut pas d’exercice. Je me suis fait traîner doucement en calèche avant dîner, & j’ai recommencé le soir. Il faisait doux mais triste. Quand vous serez ici nous irons. un soir en calèche. Je laisserai Marion à la maison. J’ai pensé à cela tout le long de la promenade. Que j’aime rêver ainsi alors, je n’entends plus rien & j’y serais encore ; s’il n’était survenu des éclairs très forts.
Je suis rentrée à 10 h. Je me suis couchée. J’avais vu dans la journée quelques personnes. Lady Granville. Le duc de Palmilla, le duc de Hamilton, & M. de Hugel. J’ai une confidence à vous faire sur Lady Granville. Elle a toujours exercé sur moi un grand empire. Elle a de l’esprit prodigieusement et l’amour le plus fanatique pour son mari. C’est la personne qui me connaît le mieux, & qui connait le plus vite toute créature qu’elle a intérêt à pénétrer. Elle m’aime & je crois tout simplement parce qu’elle me connait. Elle sait donc tout. Hier elle m’a trouvé relisant une lettre. Eh bien Monsieur je la lui ai donnée Cette lettre c’est le N°6. Vous y traitez le sujet le plus élevé. Savez-vous ce qu’a fait Lady Granville ? Elle a pleuré, pleuré. Elle y a retrouvé tout ce qu’elle pense. Elle voudrait Monsieur se prosterner à genoux devant vous. Quand je l’ai vu ainsi , émue, exaltée. Je me suis rassurée sur mon propre compte. Il n’y a donc pas de la folie dans mon fait. Voilà ce que je me suis dit d’abord. Savez-vous ce qu’elle m’a dit ensuite ? Monsieur c’est ce que je me suis dit plusieurs fois déjà mais sans avoir où vous le répéter. "
Je mourrai Monsieur comme sont mortes ces deux femmes que vous avez tant aimées !! Elles n’ont pas plus supporté leur bonheur que moi je ne puis supporter le mien. Dieu n’aime pas que les joies du Ciel soient révéler aux mortels. Il leur retire la force de les soutenir. Savez vous Monsieur pourquoi vous venez ? C’est que vous ne sentez pas au moins de près ce qu’elles ont senti, ce que je sens. Dieu vous a placé sur la terre pour un autre but. Moi j’avais accompli ma destiné et vous aimez ma mémoire comme vous chérissez la leur. Encore une fois Monsieur défendez moi de vous écrire, cela me fait mal.
11 heures
J’ai fait ma toilette, j’ai essayé de déjeuner. Je ne puis pas manger. Le facteur est venu il ne ma pas apporté de lettres, pas de lettres ! Pourquoi ne m’avez-vous pas écrit ! Monsieur ne me donnez pas ce chagrin là. Un mot, un mot tous les jours je vous en supplie. Ne me faites pas repasser par toutes les horribles émotions de Londres. Vous le voyez je suis faible, je le deviens même plus tous les jours. Cette nuit a été mauvaise. La chaleur m’accable et cependant je suis froide comme glace. C’est un vilain état de nerfs.
J’ai des nouvelles de M. de Lieven de Marienbad en Bohême. Il allait le lendemain chez M. de Metternich à un château qu’il a près de la. Ils ne se sont pas vus depuis le temps où ils ne s’aimaient guère. Le prince de Metternich fera sur cela quelques bonnes réflexions philosophiques que je suis bien aise de n’être pas condamnée à lire car elles seraient longues. Savez- vous qu’il m’a souvent, bien souvent fait bailler, il disserte lourdement. Vous aurez lu de ses pièces diplomatiques Il y a toujours beaucoup d’esprit, beaucoup d’habileté, mais la forme en est bien allemande. Et bien il vous racontera comment on fait le macaroni avec le même intérêt, la même pesanteur. M. de Metternich traite tous les sujets de même, et se croit fort universel. Jamais il ne lui est arrivé de dire : "Je ne sais pas." Il sait tout, et surtout il a tout prévu, tout deviné. Lady Granville lisait souvent ses lettres, et ne manquait jamais d’en rire. A dire vrai elle m’entraînait quelques fois à rire aussi. Elle servait à souhait M. Canning. Je ne sais comment je suis arrivée à vous parler de tout cela, mais je suis bien aise d’une distraction.
Madame de Dino me supplie de donner rendez-vous à mon mari à Valençay. C’est beaucoup trop loin. Si je vais à Valençay il voudra m’entraîner plus loin. Mais que je suis impatiente de sa réponse à la nouvelle que je suis revenue en France ! Car lui &mon frère aussi, qui m’écrit enfin une lettre très tendre, (tendre parce que je n’étais plus à Paris) ; n’ont pas le moindre soupçon que je puisse penser de nouveau à fouler cette terre défendue. Monsieur, je bavarde, je bavarde et vous ne me dites rien. Rappelez-moi de vous conter, quand je vous verrai un moment de singulières explosions de la part de 17 dans le dernier entretien que j’ai eu avec lui. Par exemple lady Granville rit bien de lui.
Adieu Monsieur, c’est triste de vous dire adieu Sans vous avoir dit merci. Cela ne sera pas ainsi demain n’est-ce pas ?
21. Val-Richer, Vendredi 11 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N° 21 Vendredi 11. 2 heures
Ne me redites pas, ne me dites jamais ce que vous me dites aujourd’hui ce que Lady Granville vous a dit, ne vous disais-je pas moi, il y a quelques jours, que j’ai l’imagination malade sur la santé de ce que j’aime ? Mon plus jeune enfant ce bon petit garçon, qui un air si doux, si gai, de si beaux yeux bleus, presque les yeux de sa mère, que de temps, il m’a fallu pour le regarder sans le plus douloureux sentiment d’indignation, de révolte contre moi-même ! Voir mourir en couches la femme qu’on aime ! Madame, c’est affreux, c’est abominable ! Comment s’en console-t-on ? Quand j’ai vu ensuite mourir mon fils, si jeune, si beau, si fort, j’ai été saisi d’horreur ; j’ai regardé avec effroi mes autres enfants tout ce que j’aimais au monde ; dix fois, vingt fois, je les ai vus mourir. Vous avez fait rentrer dans mon cœur d’autres impressions, des impressions douces, heureuses, presque confiantes. Et voilà que d’un mot vous touchez à ma plus sécrète, à ma plus cruelle blessure ! Dieu m’aurait destiné à entrevoir sans cesse ses Chefs-d’œuvre, son Paradis, pour les voir, sans cesse disparaître. Il m’aurait choisi pour ce supplice là ! Il ne me donnerait que pour m’ôter ! Cela ne se peut pas. Je n’ai pas mérité cette malédiction.
Au nom de Dieu ne me dites pas cela, ne le pensez pas surtout. Il y a des choses qu’il ne faut pas penser. Mais vous ne le pensez pas. Pourquoi le penseriez- vous ? On vous assure, vous m’assurez qu’il n’y a rien de grave. On ne vous prescrit aucun remède qui indique une vraie maladie. Il vous faut du repos, beaucoup de repos, de l’air, pas de mouvement. On peut s’assurer cela. Enfin, dans huit jours, j’irai y voir. Hélas, je sais trop qu’il ne sert à rien d’y voir ! Mais je compte sur le repos, le repos doux, prolongé de l’âme comme du corps. Il faut que vous l’ayez. Je veux que vous l’ayez. Je ferai ce qu’il faudra pour que vous l’ayez. Je m’en irai, je resterai, je parlerai, je me tairai. Je comprends que ce qui vous émeut, ce qui vous occupe un peu sérieusement ne vous vaille rien. Nous y pourvoirons de près, de loin, dans nos conversations, dans mes lettres, je ne ferai que vous distraire rien que vous distraire, amuser doucement votre imagination, votre esprit. L’ennui ne vous est pas meilleur que l’excitation. Nous les éviterons l’un et l’autre. Dearest, ayez courage, ayez confiance, pour moi comme pour vous. Pensez à l’avenir. Nous avons tant de choses à nous dire, tant de choses à faire l’un pour l’autre, l’un près de l’autre dans l’avenir !
En les attendant ces belles ces bonnes choses-là, savez-vous ce que je fais ici aujourd’hui ? Je fais nettoyer, dégager de roseaux, de plantes aquatiques, de vase, une pièce d’eau qui sera dans mon jardin et sur laquelle je vais établir deux cygnes qu’un de mes voisins à élevés pour moi. Des cygnes ce sont des oiseaux de votre pays, des pays du Nord, s’il est vrai que là soit votre pays. Dans les grands hivers, quand ces beaux oiseaux trouvent en fin leur climat trop froid, ils prennent leur vol, ils viennent chez nous. J’en ai vu arriver ainsi à tire d’aile un peu fatigués, un peu maigris, mais toujours si beaux ! Nous les accueillons nous les attirons ; nous leur arrangeons, des pièces d’eau bien calme, bien pure, sous un ciel bien doux, au milieu de gazons bien verts. Ils s’y trouvent bien ; ils ne s’en vont plus; ils ne volent même jamais bien loin. Ils ont raison; et nous aussi Madame, qui prenons, à les recevoir et à les garder, tant de plaisir. Certainement, je vous écrirai, je vous écris tous les jours.
Rappelez-vous que je vous ai demandé compte de l’emploi de votre journée, un vrai compte pour moi comme celui que je vous ai rendu de la mienne. Il y aura dans le vôtre, sinon plus de visites, du moins plus de conversations que dans le mien. Je ne cause ici avec personne, quoique je parle beaucoup et à beaucoup de gens. Vous me ferez aimer Lady Granville que je connais à peine après l’avoir tant lue. Comment se fait-il qu’on se demeure à ce point étrangers en vivant si près ; tandis qu’ailleurs un moment suffit ? J’ai tort de demander ce pourquoi-là, car je le sais.
Adieu. On vient me chercher pour voir quelque chose au travail de la pièce d’eau. Il est bien convenu que je partirai le 17 pour être à Paris le 18. Vous m’écrirez donc jusqu’au 16 inclusivement, car votre lettre du 16, je l’aurai le 17, avant de partir. G.
Ne me redites pas, ne me dites jamais ce que vous me dites aujourd’hui ce que Lady Granville vous a dit, ne vous disais-je pas moi, il y a quelques jours, que j’ai l’imagination malade sur la santé de ce que j’aime ? Mon plus jeune enfant ce bon petit garçon, qui un air si doux, si gai, de si beaux yeux bleus, presque les yeux de sa mère, que de temps, il m’a fallu pour le regarder sans le plus douloureux sentiment d’indignation, de révolte contre moi-même ! Voir mourir en couches la femme qu’on aime ! Madame, c’est affreux, c’est abominable ! Comment s’en console-t-on ? Quand j’ai vu ensuite mourir mon fils, si jeune, si beau, si fort, j’ai été saisi d’horreur ; j’ai regardé avec effroi mes autres enfants tout ce que j’aimais au monde ; dix fois, vingt fois, je les ai vus mourir. Vous avez fait rentrer dans mon cœur d’autres impressions, des impressions douces, heureuses, presque confiantes. Et voilà que d’un mot vous touchez à ma plus sécrète, à ma plus cruelle blessure ! Dieu m’aurait destiné à entrevoir sans cesse ses Chefs-d’œuvre, son Paradis, pour les voir, sans cesse disparaître. Il m’aurait choisi pour ce supplice là ! Il ne me donnerait que pour m’ôter ! Cela ne se peut pas. Je n’ai pas mérité cette malédiction.
Au nom de Dieu ne me dites pas cela, ne le pensez pas surtout. Il y a des choses qu’il ne faut pas penser. Mais vous ne le pensez pas. Pourquoi le penseriez- vous ? On vous assure, vous m’assurez qu’il n’y a rien de grave. On ne vous prescrit aucun remède qui indique une vraie maladie. Il vous faut du repos, beaucoup de repos, de l’air, pas de mouvement. On peut s’assurer cela. Enfin, dans huit jours, j’irai y voir. Hélas, je sais trop qu’il ne sert à rien d’y voir ! Mais je compte sur le repos, le repos doux, prolongé de l’âme comme du corps. Il faut que vous l’ayez. Je veux que vous l’ayez. Je ferai ce qu’il faudra pour que vous l’ayez. Je m’en irai, je resterai, je parlerai, je me tairai. Je comprends que ce qui vous émeut, ce qui vous occupe un peu sérieusement ne vous vaille rien. Nous y pourvoirons de près, de loin, dans nos conversations, dans mes lettres, je ne ferai que vous distraire rien que vous distraire, amuser doucement votre imagination, votre esprit. L’ennui ne vous est pas meilleur que l’excitation. Nous les éviterons l’un et l’autre. Dearest, ayez courage, ayez confiance, pour moi comme pour vous. Pensez à l’avenir. Nous avons tant de choses à nous dire, tant de choses à faire l’un pour l’autre, l’un près de l’autre dans l’avenir !
En les attendant ces belles ces bonnes choses-là, savez-vous ce que je fais ici aujourd’hui ? Je fais nettoyer, dégager de roseaux, de plantes aquatiques, de vase, une pièce d’eau qui sera dans mon jardin et sur laquelle je vais établir deux cygnes qu’un de mes voisins à élevés pour moi. Des cygnes ce sont des oiseaux de votre pays, des pays du Nord, s’il est vrai que là soit votre pays. Dans les grands hivers, quand ces beaux oiseaux trouvent en fin leur climat trop froid, ils prennent leur vol, ils viennent chez nous. J’en ai vu arriver ainsi à tire d’aile un peu fatigués, un peu maigris, mais toujours si beaux ! Nous les accueillons nous les attirons ; nous leur arrangeons, des pièces d’eau bien calme, bien pure, sous un ciel bien doux, au milieu de gazons bien verts. Ils s’y trouvent bien ; ils ne s’en vont plus; ils ne volent même jamais bien loin. Ils ont raison; et nous aussi Madame, qui prenons, à les recevoir et à les garder, tant de plaisir. Certainement, je vous écrirai, je vous écris tous les jours.
Rappelez-vous que je vous ai demandé compte de l’emploi de votre journée, un vrai compte pour moi comme celui que je vous ai rendu de la mienne. Il y aura dans le vôtre, sinon plus de visites, du moins plus de conversations que dans le mien. Je ne cause ici avec personne, quoique je parle beaucoup et à beaucoup de gens. Vous me ferez aimer Lady Granville que je connais à peine après l’avoir tant lue. Comment se fait-il qu’on se demeure à ce point étrangers en vivant si près ; tandis qu’ailleurs un moment suffit ? J’ai tort de demander ce pourquoi-là, car je le sais.
Adieu. On vient me chercher pour voir quelque chose au travail de la pièce d’eau. Il est bien convenu que je partirai le 17 pour être à Paris le 18. Vous m’écrirez donc jusqu’au 16 inclusivement, car votre lettre du 16, je l’aurai le 17, avant de partir. G.
22. Paris, Jeudi 10 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
22. Jeudi 10 août.
3 heures
De même que je ne suis pas un moment sans penser à vous, je ne puis plus être une heure sans vous écrire. Ma lettre est partie. J’en recommence une autre. Savez-vous ce qui m’est arrivé ce matin ? Ne recevant pas de lettres, il m’a passé une idée folle par la tête. J’ai cru que vous arriviez, que malgré ce que je vous avais dit et peut être pour cela même, vous viendriez, & voilà que mon cœur battait avec violence chaque fois qu’on ouvrait la porte du salon. Ce moment d’angoisse est passé. Il a duré de 1 à deux heures. Je vous le dis parce que je n’ai pas une autre nouvelle à vous conter. A présent que c’est passé je vais compter les heures jusqu’à vendredi. Il y en a 168 encore. Que c’est long !
Il ne vous arrivera pas d’accident n’est-ce pas ? Vous prendrez bien soin de vous. Vos enfants ne tomberont pas malades, votre mère ? Ah mon Dieu que de choses possibles qui pourraient vous empêcher de venir ! Je vous conjure encore de m’écrire tous les jours. N’en manquez pas un ; si vous ne voulez pas que je sois plus malade encore.
Vendredi 11. 8 heures
J’aurai une lettre j’espère mais en attendant que sont devenues toutes les autres ? J’ai reçu mes paquets de Londres. Rien ne m’est revenu de vous. Comme tout cela a été mal arrangé. & comme j’ai eu raison de revenir ici à moins que vous me laissiez sans m’écrire. J’ai pu dîner hier à l’Ambassade d’Angleterre. Lady Granville m’a répété par cœur chaque mot de votre lettre, elle le sait mieux que moi. Elle en a la tête remplie. Mais Monsieur, elle a raison. Je vous montrerai cette lettre. Il y a des idées sublimes et quel langage ! J’ai rencontré hier quelques personnes. qui m’ont parlé de votre discours à Caen avec une grande admiration. & moi qui ne savais pas du tout que vous en eussiez fait un. Je n’ai pas là les journaux. J’étais trop souffrante pour cela. Vous ne m’en avez pas dit un mot, où bien vous m’en aurez parlé dans l’une de ces lettres qui me manquent L’un de mes nouvellistes hier m’a dit qu’il me l’enverrait ce matin.
9 h. 1/2 Le N°18 est entre mes mains. Que vous êtes grand, que vous êtes noble. Que je suis petite à côté de vous ! Monsieur, je l’ai bien pressenti. Vous ne me trouvez pas digne de vous. Vous me dites poliment que c’est mes nerfs qui me font extravaguer. Mais si ce n’était pas mes nerfs si j’étais comme cela ? Vous me laisseriez Vous m’abandonneriez ? Pardonnez-moi Monsieur, pardonnez- moi tout. Je ferai je penserai tout ce que vous voudrez. J’essayerai tout pour vous plaire. Mais laissez moi vous parler sans cesse ; vous dire tout ce qui remplit mon cœur, ma tête. C’est vous, vous. Rien que vous. J’ai tort mille fois tort de vous le redire ainsi sans répit. J’essaye de me contraindre, je n’y réussis pas. Je quitte ma lettre, j’y reviens. Ah mon Dieu que je suis loin d’être comme vous voudriez que je fusse. Mais j’y arriverai.
Je crois que je suis mieux ce matin. Mon médecin n’est pas encore venu me le dire, mais je vous le dis. Je crois que c’est votre lettre qui m’a fait du bien. Vous voyez bien qu’il me faut une lettre tous les jours, tous les jours jusqu’à vendredi Il n’y a plus que 6 jours pleins jusque là. Je ne serai j’espère ni dans mon lit couchée. Je serais sur mes deux jambes mais vous me trouverez changé. Ne me le reprochez pas. Demandez en raison à la poste à St Ouen. Tout le mal vient des 10 jours passés sans lettres. Ah quel mal ils m’ont fait !
Je vais essayer de vous parler d’autre chose. Les élections d’Angleterre ont été à merveilles jusqu’ici. Mieux, beaucoup mieux que ne l’avaient espéré les Tories. J’espère qu’ils n’y puiseront pas trop d’assurance, j’espère que Peel et Wellington resteront dans les dispositions dans les quelles je les ai laissés. C’est à dire qu’ils offriront à lord Melbourne un appuis cordial, désintéressé pour le moment en se réservant de s’associer plus tard à son gouvernement, & que lord Melbourne acceptera ce marché à la condition de concerter avec eux les mesures principales. Il y était disposé quand je l’ai quitté. Il a quelques collègue fougueux qui ne voudront pas de cet arrangement mais il m’a presque donné le droit de croire qu’il se rappellera les conseils que j’ai osé lui donner, et qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux que je trouve aujourd’hui dans votre lettre.
Je lui ai fait son portrait tel que vous voulez bien faire le mien, & puis mes nerfs, c’étaient ses radicaux, et je le conjurai de s’en guérir. Je raisonne très bien Monsieur quand il ne s’agit ni de vous ni de moi. Aujourd’hui je suis démoralisée sur ce chapitre mais vous viendrez me remettre sur le bon chemin. Je viens de prendre l’air un moment. Il est doux & charmant comme vos bois doivent être délicieux. Comme cet air là me ferait du bien !
Adieu monsieur, adieu, n’est-ce pas je vais mieux aujourd’hui ? Midi
3 heures
De même que je ne suis pas un moment sans penser à vous, je ne puis plus être une heure sans vous écrire. Ma lettre est partie. J’en recommence une autre. Savez-vous ce qui m’est arrivé ce matin ? Ne recevant pas de lettres, il m’a passé une idée folle par la tête. J’ai cru que vous arriviez, que malgré ce que je vous avais dit et peut être pour cela même, vous viendriez, & voilà que mon cœur battait avec violence chaque fois qu’on ouvrait la porte du salon. Ce moment d’angoisse est passé. Il a duré de 1 à deux heures. Je vous le dis parce que je n’ai pas une autre nouvelle à vous conter. A présent que c’est passé je vais compter les heures jusqu’à vendredi. Il y en a 168 encore. Que c’est long !
Il ne vous arrivera pas d’accident n’est-ce pas ? Vous prendrez bien soin de vous. Vos enfants ne tomberont pas malades, votre mère ? Ah mon Dieu que de choses possibles qui pourraient vous empêcher de venir ! Je vous conjure encore de m’écrire tous les jours. N’en manquez pas un ; si vous ne voulez pas que je sois plus malade encore.
Vendredi 11. 8 heures
J’aurai une lettre j’espère mais en attendant que sont devenues toutes les autres ? J’ai reçu mes paquets de Londres. Rien ne m’est revenu de vous. Comme tout cela a été mal arrangé. & comme j’ai eu raison de revenir ici à moins que vous me laissiez sans m’écrire. J’ai pu dîner hier à l’Ambassade d’Angleterre. Lady Granville m’a répété par cœur chaque mot de votre lettre, elle le sait mieux que moi. Elle en a la tête remplie. Mais Monsieur, elle a raison. Je vous montrerai cette lettre. Il y a des idées sublimes et quel langage ! J’ai rencontré hier quelques personnes. qui m’ont parlé de votre discours à Caen avec une grande admiration. & moi qui ne savais pas du tout que vous en eussiez fait un. Je n’ai pas là les journaux. J’étais trop souffrante pour cela. Vous ne m’en avez pas dit un mot, où bien vous m’en aurez parlé dans l’une de ces lettres qui me manquent L’un de mes nouvellistes hier m’a dit qu’il me l’enverrait ce matin.
9 h. 1/2 Le N°18 est entre mes mains. Que vous êtes grand, que vous êtes noble. Que je suis petite à côté de vous ! Monsieur, je l’ai bien pressenti. Vous ne me trouvez pas digne de vous. Vous me dites poliment que c’est mes nerfs qui me font extravaguer. Mais si ce n’était pas mes nerfs si j’étais comme cela ? Vous me laisseriez Vous m’abandonneriez ? Pardonnez-moi Monsieur, pardonnez- moi tout. Je ferai je penserai tout ce que vous voudrez. J’essayerai tout pour vous plaire. Mais laissez moi vous parler sans cesse ; vous dire tout ce qui remplit mon cœur, ma tête. C’est vous, vous. Rien que vous. J’ai tort mille fois tort de vous le redire ainsi sans répit. J’essaye de me contraindre, je n’y réussis pas. Je quitte ma lettre, j’y reviens. Ah mon Dieu que je suis loin d’être comme vous voudriez que je fusse. Mais j’y arriverai.
Je crois que je suis mieux ce matin. Mon médecin n’est pas encore venu me le dire, mais je vous le dis. Je crois que c’est votre lettre qui m’a fait du bien. Vous voyez bien qu’il me faut une lettre tous les jours, tous les jours jusqu’à vendredi Il n’y a plus que 6 jours pleins jusque là. Je ne serai j’espère ni dans mon lit couchée. Je serais sur mes deux jambes mais vous me trouverez changé. Ne me le reprochez pas. Demandez en raison à la poste à St Ouen. Tout le mal vient des 10 jours passés sans lettres. Ah quel mal ils m’ont fait !
Je vais essayer de vous parler d’autre chose. Les élections d’Angleterre ont été à merveilles jusqu’ici. Mieux, beaucoup mieux que ne l’avaient espéré les Tories. J’espère qu’ils n’y puiseront pas trop d’assurance, j’espère que Peel et Wellington resteront dans les dispositions dans les quelles je les ai laissés. C’est à dire qu’ils offriront à lord Melbourne un appuis cordial, désintéressé pour le moment en se réservant de s’associer plus tard à son gouvernement, & que lord Melbourne acceptera ce marché à la condition de concerter avec eux les mesures principales. Il y était disposé quand je l’ai quitté. Il a quelques collègue fougueux qui ne voudront pas de cet arrangement mais il m’a presque donné le droit de croire qu’il se rappellera les conseils que j’ai osé lui donner, et qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux que je trouve aujourd’hui dans votre lettre.
Je lui ai fait son portrait tel que vous voulez bien faire le mien, & puis mes nerfs, c’étaient ses radicaux, et je le conjurai de s’en guérir. Je raisonne très bien Monsieur quand il ne s’agit ni de vous ni de moi. Aujourd’hui je suis démoralisée sur ce chapitre mais vous viendrez me remettre sur le bon chemin. Je viens de prendre l’air un moment. Il est doux & charmant comme vos bois doivent être délicieux. Comme cet air là me ferait du bien !
Adieu monsieur, adieu, n’est-ce pas je vais mieux aujourd’hui ? Midi
22. Val-Richer, Samedi 12 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°22 Samedi 12. 2 heures
Savez-vous qu’elle joie vous me donnez quand vous me dîtes que mes lettres vous font un peu de bien ? Je vous ai constamment devant les yeux, souffrante, abattue, agitée. Je voudrais être constamment là, verser à chaque minute du baume dans votre âme, dans vos nerfs. Ils m’embarrassent vos nerfs. J’ai envie de leur en vouloir, et je ne peux pas. Vous leur devez peut-être cette susceptibilité, cette rapidité, cette finesse d’impressions qui s’allient si bien à l’élévation de votre esprit, au sérieux de votre air, de toute votre manière. Guérissez vos nerfs, Madame, mais restez comme vous êtes. N’y changez rien, je vous en conjure. Je ne veux supprimer en vous que la souffrance. Je ne vous donnerais plus de conseils, s’ils devaient vous induire à changer en vous quelque chose.
Quand je vous ai vue pour la première fois, vous m’avez frappé comme une personne nouvelle pour moi, et pourtant sur le champ comprise, parfaitement comprise. Ce qui s’est tout à coup rêvée à moi, c’est la grandeur de votre nature. Avec votre accent si ému, votre regard si triste, vous conserviez si évidemment toute la liberté, toute la fierté de votre pensée. Vous aviez l’air de regarder d’en haut, de toiser pour ainsi dire, les idées les personnes, à mesure qu’elles passaient devant vous. Il y avait dans votre physionomie, dans votre maintien dans votre langage tant de dignité, d’indépendance, et en même temps un tel besoin. D’être soulagée soutenue ! Pendant le dîner, je ne sais ce que je vous disais, vous vous êtes penchée une ou deux fois vers moi, comme entrevoyant et venant chercher dans mes paroles quelque chose qui vous était doux ; et à l’instant même, vous vous êtes relevée et détournée, comme vous repliant sur vous-même et doutant qu’il pût vous venir du dehors, d’un inconnu, quelque distraction. Je crois vous avoir déjà dit qu’il m’était resté de ce premier jour, une impression profonde. Et elle était juste ; ce que je connais en vous aujourd’hui, je l’ai entrevu ce jour là une grande âme qui ne peut vivre seule. Je ne sache rien de comparable à ce double attrait.
5. h. 1/2 Je viens de lire mes journaux. Je trouve le discours de Sir Robert Peel, un peu trop empreint, vers la fin, des habitudes d’opposition. Il reproche bien amèrement aux Ministres, l’emploi qu’ils ont fait du nom de la Reine. Faut-il appliquer le mot impudeur à des hommes dont on est si près de se rapprocher ? Peut-être les mœurs anglaises sont-elles en ce genre moins susceptibles que les nôtres. Du reste le discours est excellent et très frappant. Nous verrons à l’œuvre la Sagesse des deux côtés. Je suis charmé que vous ayez si bien fomenté, celle de Lord Melbourne. Si les conservateurs de France ont autant de persévérance et de zèle que ceux d’Angleterre, la dissolution, nous sera très bonne. Je ne crains, pour eux, que le découragement et le laisser aller. La grande infériorité dès honnêtes gens c’est qu’ils ne savent pas se lever aussi matin que les brouillons. S’ils avaient comme ceux-ci, le Diable au corps, ils gagneraient toutes les batailles.
Dans le n° 15, je crois, je vous avais dit un mot de mon meeting de Caen ; un seul mot, pour vous dire que cela ne valait pas la peine d’en écrire. J’espère que ce N° vous reviendra enfin, et aussi les N°12 et 13 qui sont partis de Lisieux pour Londres le 29 juillet et le 1er août. Vous devriez les avoir depuis longtemps. Dimanche 7 h 1/2 J’ai été interrompu hier par toutes sortes de visites, d’abord je ne sais combien de voisins qui se sont abattus chez moi comme une volée de pigeons, puis le Duc Decazes qui va à Bordeaux, et s’est détourné de 20 ou 30 lieues pour venir me dire pas grand chose.
Ce matin toute ma vallée est enveloppée d’un immense brouillard qui va, vient, monté, descend. Il essaie de se défendre contre le soleil que j’entrevois à l’horizon, en face de moi. Ce n’est encore qu’un point rougeâtre à chaque instant surmonté, voilé par le brouillard. Mais ce point, c’est la chaleur, c’est la lumière. Le brouillard sera vaincu, dispersé, chassé. Dans quelques heures mon ciel sera pur, ma vallée brillante. Plût à Dieu que ce fût toujours là l’image de la vie !
Savez-vous qu’elle joie vous me donnez quand vous me dîtes que mes lettres vous font un peu de bien ? Je vous ai constamment devant les yeux, souffrante, abattue, agitée. Je voudrais être constamment là, verser à chaque minute du baume dans votre âme, dans vos nerfs. Ils m’embarrassent vos nerfs. J’ai envie de leur en vouloir, et je ne peux pas. Vous leur devez peut-être cette susceptibilité, cette rapidité, cette finesse d’impressions qui s’allient si bien à l’élévation de votre esprit, au sérieux de votre air, de toute votre manière. Guérissez vos nerfs, Madame, mais restez comme vous êtes. N’y changez rien, je vous en conjure. Je ne veux supprimer en vous que la souffrance. Je ne vous donnerais plus de conseils, s’ils devaient vous induire à changer en vous quelque chose.
Quand je vous ai vue pour la première fois, vous m’avez frappé comme une personne nouvelle pour moi, et pourtant sur le champ comprise, parfaitement comprise. Ce qui s’est tout à coup rêvée à moi, c’est la grandeur de votre nature. Avec votre accent si ému, votre regard si triste, vous conserviez si évidemment toute la liberté, toute la fierté de votre pensée. Vous aviez l’air de regarder d’en haut, de toiser pour ainsi dire, les idées les personnes, à mesure qu’elles passaient devant vous. Il y avait dans votre physionomie, dans votre maintien dans votre langage tant de dignité, d’indépendance, et en même temps un tel besoin. D’être soulagée soutenue ! Pendant le dîner, je ne sais ce que je vous disais, vous vous êtes penchée une ou deux fois vers moi, comme entrevoyant et venant chercher dans mes paroles quelque chose qui vous était doux ; et à l’instant même, vous vous êtes relevée et détournée, comme vous repliant sur vous-même et doutant qu’il pût vous venir du dehors, d’un inconnu, quelque distraction. Je crois vous avoir déjà dit qu’il m’était resté de ce premier jour, une impression profonde. Et elle était juste ; ce que je connais en vous aujourd’hui, je l’ai entrevu ce jour là une grande âme qui ne peut vivre seule. Je ne sache rien de comparable à ce double attrait.
5. h. 1/2 Je viens de lire mes journaux. Je trouve le discours de Sir Robert Peel, un peu trop empreint, vers la fin, des habitudes d’opposition. Il reproche bien amèrement aux Ministres, l’emploi qu’ils ont fait du nom de la Reine. Faut-il appliquer le mot impudeur à des hommes dont on est si près de se rapprocher ? Peut-être les mœurs anglaises sont-elles en ce genre moins susceptibles que les nôtres. Du reste le discours est excellent et très frappant. Nous verrons à l’œuvre la Sagesse des deux côtés. Je suis charmé que vous ayez si bien fomenté, celle de Lord Melbourne. Si les conservateurs de France ont autant de persévérance et de zèle que ceux d’Angleterre, la dissolution, nous sera très bonne. Je ne crains, pour eux, que le découragement et le laisser aller. La grande infériorité dès honnêtes gens c’est qu’ils ne savent pas se lever aussi matin que les brouillons. S’ils avaient comme ceux-ci, le Diable au corps, ils gagneraient toutes les batailles.
Dans le n° 15, je crois, je vous avais dit un mot de mon meeting de Caen ; un seul mot, pour vous dire que cela ne valait pas la peine d’en écrire. J’espère que ce N° vous reviendra enfin, et aussi les N°12 et 13 qui sont partis de Lisieux pour Londres le 29 juillet et le 1er août. Vous devriez les avoir depuis longtemps. Dimanche 7 h 1/2 J’ai été interrompu hier par toutes sortes de visites, d’abord je ne sais combien de voisins qui se sont abattus chez moi comme une volée de pigeons, puis le Duc Decazes qui va à Bordeaux, et s’est détourné de 20 ou 30 lieues pour venir me dire pas grand chose.
Ce matin toute ma vallée est enveloppée d’un immense brouillard qui va, vient, monté, descend. Il essaie de se défendre contre le soleil que j’entrevois à l’horizon, en face de moi. Ce n’est encore qu’un point rougeâtre à chaque instant surmonté, voilé par le brouillard. Mais ce point, c’est la chaleur, c’est la lumière. Le brouillard sera vaincu, dispersé, chassé. Dans quelques heures mon ciel sera pur, ma vallée brillante. Plût à Dieu que ce fût toujours là l’image de la vie !
23. Paris, Samedi 12 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
23. Paris samedi 12 août 1837,
8h. du matin.
Quelles lettres que ces lettres N°12 & 13 qui me sont revenus de Londres hier que vous m’y dites de ces paroles si douces, si profondes, qui m’attendrissent m’exaltent, me calment, qui font tout cela à la fois. Je ne sais l’effet qu’elles eussent produit sur moi en Angleterre. Ici elles me font du bien elles m’en ont fait hier. Elles m’en feront aujourd’hui car je les relirai. Je les relirai bien des fois. Soyez toujours pour moi ce que vous êtes en m’écrivant ces lettres. Je le mériterai tous les jours davantage, vous verrez cela.
9 heures 1/2
Le N°19 vient de m’être remis. Comment vous croyez que je n’ai pas lu votre Histoire de la révolution d’Angleterre. Je l’ai lue, relue. Je vous en ai parlé, mais c’était à une époque où vous ne faisiez par la moindre attention à ce que je vous disais. Cet ouvrage est regardé en Angleterre comme le meilleur qui existe et comme faisant époque. On y est fort impatient de la suite. Dans ce genre-là histoires, mémoires, j’ai beaucoup lu & il n’y a guère de proposition nouvelle à me faire. C’est le seul genre de lecture qui me plaise. Mais vous avez raison de penser qu’au fond une occupation sérieuse et qui n’a pas un but pratique immédiat ne me plaît pas trop, ce qui fait que je suis très souvent ennuyée, très ennuyée même.
Aujourd’hui non car je pense, je pense. Je trouve même que je n’ai pas assez de temps pour penser. Mais monsieur, je ne voulais plus vous dire cela du tout. Et je le veux Monsieur depuis votre lettre de ce matin. Elle me laisse bien froide, bien calme. Je l’ai méritée. La vivacité de mes expressions vous aura déplu, où vous aura effrayé. Vous voulez me remettre l’esprit en ordre. Vous faites comme mon médecin, il me tient au régime. Ne le faites pas trop, j’en serais triste. Donnez-moi quelques douces paroles qui aille chercher le fond de mon cœur. J’ai besoin de cela tous les jours. Adressez vos lettres à l’hôtel de la Terrasse. J’y rentre aujourd’hui. Je me moque du soleil & des ouvriers.
Je veux être chez nous, vous recevoir chez nous. Vous aimez cela mieux aussi ? Vous voulez savoir ce que je fais. Hier trois heures à l’air au bois de Boulogne, avec Marie et un secrétaire de l’ambassade d’Autriche que j’ai fait courir inutilement la nuit de Boulogne à Abbeville, croyant que J’allais mourir et auquel je voulais laisser le soin de ramener Marie & mes diamants à Paris. Il ne m’a plus trouvé à Abbeville. C’est le même qui a couru il y a 9 ans en Angleterre pour me remettre une lettre du Prince de Metternich que je n’ai plus voulu recevoir. Le pauvre homme est chanceux. Vous voyez bien que je lui devais une promenade au bois de Boulogne, il était honoré et embarrassé à l’excès j’ai prié Marie de lui faire quelques gentillesses.
J’ai vu lady Granville longtemps. Nous n’avons parlé que de vous. Elle me soigne, elle voudrait me voir perdre mon air abattu. Le prince Paul de Würtemberg m’a fait demander de le recevoir. Il est accouru plein de l’espoir que tout marchait à la confusion en Angleterre. Je l’ai horrible ment contrarié par tout le bien que je lui ai dit de la Reine, du premier ministre et la bonne disposition où j’ai laissé ce pays. Il espère encore que je radote car il m’a dit que j’avais fort mauvaise mine & même de la fièvre. Il m’a pris le pouls et m’a assuré que je devais me soigner. Tous les Würtemberg sont médecins & le duc Eugène était accoucheur.
A propos son courrier qui est aussi cousin germain de mon Empereur va épouser la princesse Marie. Le prince Paul prétend le savoir de M. Molé lui- même. Le Roi de Würtemberg ignore parfaitement cette négociation à laquelle il ne donnera jamais son consentement. C’est Léopold qui l’a conduit. J’ai dîné seule avec Marie hier. & de 8 à 10 heures je me suis encore fait traîner en calèche. Par une belle nuit et une belle lune. Mais c’est bien ennuyeux. J’ai mal dormi. Mes occupations sont des lettres à écrire. J’ai négligé tout les monde, il faut y revenir. Vous ai-je dit que M. de Talleyrand me presse de venir à Valençay & d’y faire venir M. de Lieven ? Cela ne sera pas. Mais au reste nous causerons de tout cela. C’est prodigieux tout ce que nous avons à nous dire. Eh bien, j’ai idée que nous ne nous dirons rien. Vous souvenez-vous nos belles promesses de nous écrire des nouvelles ? Nous ne nous en sommes pas dit une seule.
De vous rapporter des bras ? Vous n’en trouvez pas. On ne saurez remplir ses engagements plus mal que je ne l’ai fait. Mais il me fallait des lettres, elles ne venaient pas. Tout tout le mal est venu de là. Adieu, je trouve que ma lettre ressemble un peu à la vôtre, mais votre cœur ressemble au mien, cela rétablit tout.
8h. du matin.
Quelles lettres que ces lettres N°12 & 13 qui me sont revenus de Londres hier que vous m’y dites de ces paroles si douces, si profondes, qui m’attendrissent m’exaltent, me calment, qui font tout cela à la fois. Je ne sais l’effet qu’elles eussent produit sur moi en Angleterre. Ici elles me font du bien elles m’en ont fait hier. Elles m’en feront aujourd’hui car je les relirai. Je les relirai bien des fois. Soyez toujours pour moi ce que vous êtes en m’écrivant ces lettres. Je le mériterai tous les jours davantage, vous verrez cela.
9 heures 1/2
Le N°19 vient de m’être remis. Comment vous croyez que je n’ai pas lu votre Histoire de la révolution d’Angleterre. Je l’ai lue, relue. Je vous en ai parlé, mais c’était à une époque où vous ne faisiez par la moindre attention à ce que je vous disais. Cet ouvrage est regardé en Angleterre comme le meilleur qui existe et comme faisant époque. On y est fort impatient de la suite. Dans ce genre-là histoires, mémoires, j’ai beaucoup lu & il n’y a guère de proposition nouvelle à me faire. C’est le seul genre de lecture qui me plaise. Mais vous avez raison de penser qu’au fond une occupation sérieuse et qui n’a pas un but pratique immédiat ne me plaît pas trop, ce qui fait que je suis très souvent ennuyée, très ennuyée même.
Aujourd’hui non car je pense, je pense. Je trouve même que je n’ai pas assez de temps pour penser. Mais monsieur, je ne voulais plus vous dire cela du tout. Et je le veux Monsieur depuis votre lettre de ce matin. Elle me laisse bien froide, bien calme. Je l’ai méritée. La vivacité de mes expressions vous aura déplu, où vous aura effrayé. Vous voulez me remettre l’esprit en ordre. Vous faites comme mon médecin, il me tient au régime. Ne le faites pas trop, j’en serais triste. Donnez-moi quelques douces paroles qui aille chercher le fond de mon cœur. J’ai besoin de cela tous les jours. Adressez vos lettres à l’hôtel de la Terrasse. J’y rentre aujourd’hui. Je me moque du soleil & des ouvriers.
Je veux être chez nous, vous recevoir chez nous. Vous aimez cela mieux aussi ? Vous voulez savoir ce que je fais. Hier trois heures à l’air au bois de Boulogne, avec Marie et un secrétaire de l’ambassade d’Autriche que j’ai fait courir inutilement la nuit de Boulogne à Abbeville, croyant que J’allais mourir et auquel je voulais laisser le soin de ramener Marie & mes diamants à Paris. Il ne m’a plus trouvé à Abbeville. C’est le même qui a couru il y a 9 ans en Angleterre pour me remettre une lettre du Prince de Metternich que je n’ai plus voulu recevoir. Le pauvre homme est chanceux. Vous voyez bien que je lui devais une promenade au bois de Boulogne, il était honoré et embarrassé à l’excès j’ai prié Marie de lui faire quelques gentillesses.
J’ai vu lady Granville longtemps. Nous n’avons parlé que de vous. Elle me soigne, elle voudrait me voir perdre mon air abattu. Le prince Paul de Würtemberg m’a fait demander de le recevoir. Il est accouru plein de l’espoir que tout marchait à la confusion en Angleterre. Je l’ai horrible ment contrarié par tout le bien que je lui ai dit de la Reine, du premier ministre et la bonne disposition où j’ai laissé ce pays. Il espère encore que je radote car il m’a dit que j’avais fort mauvaise mine & même de la fièvre. Il m’a pris le pouls et m’a assuré que je devais me soigner. Tous les Würtemberg sont médecins & le duc Eugène était accoucheur.
A propos son courrier qui est aussi cousin germain de mon Empereur va épouser la princesse Marie. Le prince Paul prétend le savoir de M. Molé lui- même. Le Roi de Würtemberg ignore parfaitement cette négociation à laquelle il ne donnera jamais son consentement. C’est Léopold qui l’a conduit. J’ai dîné seule avec Marie hier. & de 8 à 10 heures je me suis encore fait traîner en calèche. Par une belle nuit et une belle lune. Mais c’est bien ennuyeux. J’ai mal dormi. Mes occupations sont des lettres à écrire. J’ai négligé tout les monde, il faut y revenir. Vous ai-je dit que M. de Talleyrand me presse de venir à Valençay & d’y faire venir M. de Lieven ? Cela ne sera pas. Mais au reste nous causerons de tout cela. C’est prodigieux tout ce que nous avons à nous dire. Eh bien, j’ai idée que nous ne nous dirons rien. Vous souvenez-vous nos belles promesses de nous écrire des nouvelles ? Nous ne nous en sommes pas dit une seule.
De vous rapporter des bras ? Vous n’en trouvez pas. On ne saurez remplir ses engagements plus mal que je ne l’ai fait. Mais il me fallait des lettres, elles ne venaient pas. Tout tout le mal est venu de là. Adieu, je trouve que ma lettre ressemble un peu à la vôtre, mais votre cœur ressemble au mien, cela rétablit tout.
23. Val-Richer, Dimanche 13 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°23. Dimanche 13. 2 heures
C’est vrai ; je crains de vous agiter. J’y pense sans cesse en vous écrivant. Je voudrais n’employer avec vous que des paroles, si douces, si douces, de ces paroles qui bercent l’âme et l’apaisent, en lui plaisant sans l’émouvoir. Vous m’avez témoigné, en arrivant à Paris, tant d’effroi à l’idée du trouble qui vous saisirait si j’allais vous voir sur le champ, vous m’avez demandé avec une anxiété si douloureuse, de vous laisser le temps de vous reposer, de vous calmer que je suis moi-même plein de trouble et d’anxiété sur tout ce qui va à vous même de ma part, et constamment préoccupé d’éviter ce qui pourrait vous causer le moindre ébranlement.
Vos lettres d’hier et d’aujourd’hui (N° 22 et 23) me rassurent, un peu. J’en trouve le ton plus tranquille, plus fermé. Cependant j’hésite encore ; je retiens encore mon cœur, ma voix. Je sais tout ce qu’il faut retrancher aux paroles humaines, et combien elles exagèrent en général les faits ou les sentiments qu’elles expriment. Mais avec vous, dearest, je prends tout au pied de la lettre, loin de rien retrancher, j’ajoute. Je crois plus que vous ne me dîtes. Vous ne savez pas tout ce que je vois dans une phrase de vous. J’y vois non seulement ce qu’il y a mais tout ce qu’il y avait en vous au moment où vous l’avez écrite, si votre main tremblait, si votre cœur battait, si vos regards étaient troublés ou sereins, votre contenance animée ou abattue. Et sans y songer, par instinct, je réponds moins à ce que vous me dites qu’à ce que j’ai vu dans votre écriture, dans vos paroles ; en sorte que je réponds peut-être à une impression, très fugitive à un nuage sur votre front à un frisson dans vos nerfs.
Ah l’absence. l’absence ! Madame, la moins lointaine est toujours l’absence avec tous ses vides, tous ses ennuis ! Je vous aime pourtant infiniment mieux à Paris qu’à Londres, Dussé-je ne pas aller vous y voir. Et j’irai cette semaine ; et vendredi, à une heure, je serai hôtel de la Terrasse dans le cabinet devant la fenêtre duquel je me suis tant promène le vendredi soir 30 Juin ! Que vous avez bien fait de vous y rétablir.
10 heures 1/2 du soir
Je vous ai dit que ceci était mon heure mon heure à moi. Tant que le jour dure, quoi qu’on fasse, on appartient un peu aux autres. Les autres dorment. Mes fenêtres sont ouvertes. Il n’y a pas plus de mouvement, pas plus de bruit dans la campagne que dans ma maison. Rien ne vit plus excepté la lune qui regarde tout dormir, et moi qui pense à vous. C’est une étrange impression qu’une joie qui commence et ne s’achève pas, un flot de bonheur qui monte dans l’âme et retombe sur elle ne trouvant pas où se répandre. Le ciel est si pur, l’air si doux, la lune si claire, la vallée si tranquille ! Que je jouirais de tout cela, si vous étiez là ! Mais vous n’y êtes pas. Cet autre soir quand nous sommes revenus de Châtenay, j’étais près de vous ; je vous parlais, vous me parliez. Je n’ai pas regardé le ciel, la lune, la vallée. Je ne leur ai pas demandé de compléter ma joie. Elle était complète, immense. Et tout cela, n’y entrait pour rien, et je n’avais besoin de rien, & cette boite où nous roulions ensemble était pour moi toute la nature. Ne retournerons-nous jamais à Châtenay ?
Lundi 8 heures 1/2
Vous me demandez d’être toujours pour vous ce que j’étais en vous écrivant les N°12 et 13. Dearest, j’ai éprouvé bien rarement en ma vie les sentiments que ces lettres-là vous expriment sans doute, comme toutes les autres ; mais quand ces sentiments sont nés en moi, ils n’ont jamais changé, jamais faiblis. La cause en est si rare, l’effet si puissant et si doux ! Je suis, en fait d’affection et de bonheur mille fois plus difficile que je ne le puis dire. J’y veux, j’y veux instinctivement, absolument des conditions que Dieu ne réunit guère. Et quand il lui a plu, quand il lui plaît de ne traiter avec cette faveur immense, je vivrais mille ans sans épuiser son bienfait. Ceci est la dernière lettre à laquelle vous répondrez. Elle vous arrivera Mercredi, et j’aurai votre réponse. Jeudi à Lisieux où je la prendrai avant de partir pour Paris. Quelle parole! Adieu. Adieu. G.
C’est vrai ; je crains de vous agiter. J’y pense sans cesse en vous écrivant. Je voudrais n’employer avec vous que des paroles, si douces, si douces, de ces paroles qui bercent l’âme et l’apaisent, en lui plaisant sans l’émouvoir. Vous m’avez témoigné, en arrivant à Paris, tant d’effroi à l’idée du trouble qui vous saisirait si j’allais vous voir sur le champ, vous m’avez demandé avec une anxiété si douloureuse, de vous laisser le temps de vous reposer, de vous calmer que je suis moi-même plein de trouble et d’anxiété sur tout ce qui va à vous même de ma part, et constamment préoccupé d’éviter ce qui pourrait vous causer le moindre ébranlement.
Vos lettres d’hier et d’aujourd’hui (N° 22 et 23) me rassurent, un peu. J’en trouve le ton plus tranquille, plus fermé. Cependant j’hésite encore ; je retiens encore mon cœur, ma voix. Je sais tout ce qu’il faut retrancher aux paroles humaines, et combien elles exagèrent en général les faits ou les sentiments qu’elles expriment. Mais avec vous, dearest, je prends tout au pied de la lettre, loin de rien retrancher, j’ajoute. Je crois plus que vous ne me dîtes. Vous ne savez pas tout ce que je vois dans une phrase de vous. J’y vois non seulement ce qu’il y a mais tout ce qu’il y avait en vous au moment où vous l’avez écrite, si votre main tremblait, si votre cœur battait, si vos regards étaient troublés ou sereins, votre contenance animée ou abattue. Et sans y songer, par instinct, je réponds moins à ce que vous me dites qu’à ce que j’ai vu dans votre écriture, dans vos paroles ; en sorte que je réponds peut-être à une impression, très fugitive à un nuage sur votre front à un frisson dans vos nerfs.
Ah l’absence. l’absence ! Madame, la moins lointaine est toujours l’absence avec tous ses vides, tous ses ennuis ! Je vous aime pourtant infiniment mieux à Paris qu’à Londres, Dussé-je ne pas aller vous y voir. Et j’irai cette semaine ; et vendredi, à une heure, je serai hôtel de la Terrasse dans le cabinet devant la fenêtre duquel je me suis tant promène le vendredi soir 30 Juin ! Que vous avez bien fait de vous y rétablir.
10 heures 1/2 du soir
Je vous ai dit que ceci était mon heure mon heure à moi. Tant que le jour dure, quoi qu’on fasse, on appartient un peu aux autres. Les autres dorment. Mes fenêtres sont ouvertes. Il n’y a pas plus de mouvement, pas plus de bruit dans la campagne que dans ma maison. Rien ne vit plus excepté la lune qui regarde tout dormir, et moi qui pense à vous. C’est une étrange impression qu’une joie qui commence et ne s’achève pas, un flot de bonheur qui monte dans l’âme et retombe sur elle ne trouvant pas où se répandre. Le ciel est si pur, l’air si doux, la lune si claire, la vallée si tranquille ! Que je jouirais de tout cela, si vous étiez là ! Mais vous n’y êtes pas. Cet autre soir quand nous sommes revenus de Châtenay, j’étais près de vous ; je vous parlais, vous me parliez. Je n’ai pas regardé le ciel, la lune, la vallée. Je ne leur ai pas demandé de compléter ma joie. Elle était complète, immense. Et tout cela, n’y entrait pour rien, et je n’avais besoin de rien, & cette boite où nous roulions ensemble était pour moi toute la nature. Ne retournerons-nous jamais à Châtenay ?
Lundi 8 heures 1/2
Vous me demandez d’être toujours pour vous ce que j’étais en vous écrivant les N°12 et 13. Dearest, j’ai éprouvé bien rarement en ma vie les sentiments que ces lettres-là vous expriment sans doute, comme toutes les autres ; mais quand ces sentiments sont nés en moi, ils n’ont jamais changé, jamais faiblis. La cause en est si rare, l’effet si puissant et si doux ! Je suis, en fait d’affection et de bonheur mille fois plus difficile que je ne le puis dire. J’y veux, j’y veux instinctivement, absolument des conditions que Dieu ne réunit guère. Et quand il lui a plu, quand il lui plaît de ne traiter avec cette faveur immense, je vivrais mille ans sans épuiser son bienfait. Ceci est la dernière lettre à laquelle vous répondrez. Elle vous arrivera Mercredi, et j’aurai votre réponse. Jeudi à Lisieux où je la prendrai avant de partir pour Paris. Quelle parole! Adieu. Adieu. G.
24. Paris, Samedi 12 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
24. Hôtel de la Terrasse, samedi 12 août
3 heures
Me voici là où je vous ai vu, où je vous reverrai. Je me sens mieux. Je suis sûre que vous comprenez cela, car vous comprenez tout ce que je sens tout ce que j’éprouve. Mon Dieu Monsieur que nous avons fait une bonne affaire de nous rencontrer. Je ne pense plus à notre bêtise. Elle a duré longtemps cependant, deux ans ! Je pense à l’esprit qui nous est venu tout-à-coup, à ce 15 de juin ! Mon cœur bondit de joie. Je regarde cette porte qui va s’ouvrir pour vous vendredi. Je la regarde presque comme je vous regarderai. Monsieur, je suis heureuse heureuse. Je le serai n’est-ce pas ? Vous viendrez. Vous ressemblerez à votre N°12, 13 qu’ils sont charmants ces N°. Je viens de les relire. Vous ne savez pas ce que c’est de lire des lettres pareilles assise sur le même meuble à côté de la même chaise où vous étiez placé. Dans ce moment cependant Je vous écris de mon salon. J’y étais bien triste. Ah mon Dieu le moment où vous m’avez quittée ! Vous ne savez pas... oui vous savez tout ce j’ai éprouvé. Je n’y veux pas penser. Je veux penser à vendredi. Et bien & vendredi je ne le comprends pas.
Dimanche, 8 heures. Je n’ai pas dormi et cependant je suis mieux. J’ai mille choses à vous dire, je n’en trouve pas une seule. Je suis heureuse autant que je me sentais triste. Monsieur je crois que j’ai les impressions trop mobiles, je ne sais pas gouverner mon imagination, elle m’emporte toujours. Vous me ferez du bien vous réglerez tout cela. Vous me donnerez l’habitude du bonheur aujourd’hui je n’en ai encore éprouvé que les tourments. Je suis pour vous ce que J’étais pour mes enfants, plein de passion et d’inquiétude. Vous ne me connaissez pas encore. M’aimerez-vous encore quand vous me connaîtrez mieux ? Monsieur, je le crois et puis je vous promets de devenir tout ce que vous voudrez que je sois. Ah quelle puissance vous avez déjà sur moi !
Qu’ai-je donc fait hier ? Je ne m’en souviens plus. J’ai déménagé. C’est fort ennuyeux, mais ce qui est plus ennuyeux encore c’est d’avoir trouvé des ouvriers dans mon appartement. Ils y sont encore pour trois jours. N’importe je ne me fâche pas. J’ai quitté ce bruit là pour le bois de Boulogne. J’y ai été seule, & là pas une âme. Les Granville les seules créatures humaines que j’y ai rencontrées. J’étais dans la disposition la plus douce. Je pensais à vendredi. Il me semblait aussi que vous viendriez vous promener avec moi et tout me ravissait. Il m’a paru que je n’avais jamais vu le bois de Boulogne. Enfin Monsieur J’étais calme, bonne. Je dînai chez Lady Granville. Ah voici ce que j’avais à vous dire le duc de Palmella était placé vis-à-vis de moi à dîner, il m’a beaucoup regardée vous ne sauriez concevoir comme je lui en ai été reconnaissante. Je ne suis donc pas si changée et peut-être me regarderez-vous avec plaisir. Mais Monsieur je crains que non. Palmella à cette vieille habitude ; on retrouve toujours ce qui a plu une fois. Mais vous, je n’ai jamais pu vous plaire, et aujourd’hui j’ai de plus, l’air très maigre et malade. et vous ne me sauriez aucun gré de l’être à cause de vous. Voilà mon spleen qui me reprend. Pozzo vint le soir chez Lady Granville il venait d’arriver. Il a tout une autre physionomie à Paris, il à l’air jeune et gai, à Londres il ne va pas du tout. Il y est de mauvaise humeur et on l’est envers lui. Mon séjour à Londres ne lui a pas plu.
Imaginez que votre lettre ce matin court le quartier, et que je ne parviens pas à la tenir. Il valait bien la peine de me lever si joyeuse ; d’être si contente de me trouver à la Terrasse ! Ces murs que j’ai eu tant de plaisir à revoir, ils ne me disent plus rien, & ce petit morceau de papier que de douces choses il me dirait. N’avez-vous pas remarqué combien souvent les contrariétés les plus inattendues viennent traverser les joies les plus sûres ? Quoi de plus sûr que votre lettre aujourd’hui que je suis à Paris, et bien je passe d’une rue à une autre, et voilà que tout est dérangé. Pourquoi donc étais- je si gaie ? Monsieur rien ne dérangera Vendredi n’est-ce pas ? Adieu.
Voici ce que m’écrit la duchesse de Sutherland : " Parlez moi de M. Guizot. Je pense bien souvent à ces belles effusions, d’un cœur et d’un esprit bien remplis. Je vous remercie tendrement de m’en avoir montré quelque chose. Un cœur brisé qui n’en montre que mieux comme il bat." Ne trouvez-vous pas monsieur que c’est bien dit ? Vous ne saurez croire que de têtes exaltées pour vous. Pardonnez-le moi.
Adieu. Adieu. Je crois que je m’en vais courir moi-même à tous les grands et petits bureaux de poste. Le N°20 est venu, je n’ai que le temps de vous le dire.
3 heures
Me voici là où je vous ai vu, où je vous reverrai. Je me sens mieux. Je suis sûre que vous comprenez cela, car vous comprenez tout ce que je sens tout ce que j’éprouve. Mon Dieu Monsieur que nous avons fait une bonne affaire de nous rencontrer. Je ne pense plus à notre bêtise. Elle a duré longtemps cependant, deux ans ! Je pense à l’esprit qui nous est venu tout-à-coup, à ce 15 de juin ! Mon cœur bondit de joie. Je regarde cette porte qui va s’ouvrir pour vous vendredi. Je la regarde presque comme je vous regarderai. Monsieur, je suis heureuse heureuse. Je le serai n’est-ce pas ? Vous viendrez. Vous ressemblerez à votre N°12, 13 qu’ils sont charmants ces N°. Je viens de les relire. Vous ne savez pas ce que c’est de lire des lettres pareilles assise sur le même meuble à côté de la même chaise où vous étiez placé. Dans ce moment cependant Je vous écris de mon salon. J’y étais bien triste. Ah mon Dieu le moment où vous m’avez quittée ! Vous ne savez pas... oui vous savez tout ce j’ai éprouvé. Je n’y veux pas penser. Je veux penser à vendredi. Et bien & vendredi je ne le comprends pas.
Dimanche, 8 heures. Je n’ai pas dormi et cependant je suis mieux. J’ai mille choses à vous dire, je n’en trouve pas une seule. Je suis heureuse autant que je me sentais triste. Monsieur je crois que j’ai les impressions trop mobiles, je ne sais pas gouverner mon imagination, elle m’emporte toujours. Vous me ferez du bien vous réglerez tout cela. Vous me donnerez l’habitude du bonheur aujourd’hui je n’en ai encore éprouvé que les tourments. Je suis pour vous ce que J’étais pour mes enfants, plein de passion et d’inquiétude. Vous ne me connaissez pas encore. M’aimerez-vous encore quand vous me connaîtrez mieux ? Monsieur, je le crois et puis je vous promets de devenir tout ce que vous voudrez que je sois. Ah quelle puissance vous avez déjà sur moi !
Qu’ai-je donc fait hier ? Je ne m’en souviens plus. J’ai déménagé. C’est fort ennuyeux, mais ce qui est plus ennuyeux encore c’est d’avoir trouvé des ouvriers dans mon appartement. Ils y sont encore pour trois jours. N’importe je ne me fâche pas. J’ai quitté ce bruit là pour le bois de Boulogne. J’y ai été seule, & là pas une âme. Les Granville les seules créatures humaines que j’y ai rencontrées. J’étais dans la disposition la plus douce. Je pensais à vendredi. Il me semblait aussi que vous viendriez vous promener avec moi et tout me ravissait. Il m’a paru que je n’avais jamais vu le bois de Boulogne. Enfin Monsieur J’étais calme, bonne. Je dînai chez Lady Granville. Ah voici ce que j’avais à vous dire le duc de Palmella était placé vis-à-vis de moi à dîner, il m’a beaucoup regardée vous ne sauriez concevoir comme je lui en ai été reconnaissante. Je ne suis donc pas si changée et peut-être me regarderez-vous avec plaisir. Mais Monsieur je crains que non. Palmella à cette vieille habitude ; on retrouve toujours ce qui a plu une fois. Mais vous, je n’ai jamais pu vous plaire, et aujourd’hui j’ai de plus, l’air très maigre et malade. et vous ne me sauriez aucun gré de l’être à cause de vous. Voilà mon spleen qui me reprend. Pozzo vint le soir chez Lady Granville il venait d’arriver. Il a tout une autre physionomie à Paris, il à l’air jeune et gai, à Londres il ne va pas du tout. Il y est de mauvaise humeur et on l’est envers lui. Mon séjour à Londres ne lui a pas plu.
Imaginez que votre lettre ce matin court le quartier, et que je ne parviens pas à la tenir. Il valait bien la peine de me lever si joyeuse ; d’être si contente de me trouver à la Terrasse ! Ces murs que j’ai eu tant de plaisir à revoir, ils ne me disent plus rien, & ce petit morceau de papier que de douces choses il me dirait. N’avez-vous pas remarqué combien souvent les contrariétés les plus inattendues viennent traverser les joies les plus sûres ? Quoi de plus sûr que votre lettre aujourd’hui que je suis à Paris, et bien je passe d’une rue à une autre, et voilà que tout est dérangé. Pourquoi donc étais- je si gaie ? Monsieur rien ne dérangera Vendredi n’est-ce pas ? Adieu.
Voici ce que m’écrit la duchesse de Sutherland : " Parlez moi de M. Guizot. Je pense bien souvent à ces belles effusions, d’un cœur et d’un esprit bien remplis. Je vous remercie tendrement de m’en avoir montré quelque chose. Un cœur brisé qui n’en montre que mieux comme il bat." Ne trouvez-vous pas monsieur que c’est bien dit ? Vous ne saurez croire que de têtes exaltées pour vous. Pardonnez-le moi.
Adieu. Adieu. Je crois que je m’en vais courir moi-même à tous les grands et petits bureaux de poste. Le N°20 est venu, je n’ai que le temps de vous le dire.
24. Val-Richer, Lundi 14 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°24 Lundi 14, 4 heures.
Ceci est mon dernier mot. Vous l’aurez jeudi. Vendredi, j’apporterai moi-même ma lettre. Que celle de ce matin, m'a fait plaisir ! Elle est calme, gaie. Certainement vous êtes mieux. Savez-vous ce qui me trouble avec vous, quant à votre santé ? Vous avez besoin, je crois, d’en être distraite, de porter votre imagination ailleurs. J’hésite donc à vous en parler. Et pourtant ! Et puis à part la contrainte, il y a, dans cette réticence, dans le soin de détourner vos pensées en retenant les miennes, un arrangement une petite supercherie qui me déplaît.
J’ai besoin de laisser librement, aller près de vous mon esprit, mon cœur, ma parole, ma vie. Il m’en coûterait infiniment de vous tromper tant soit peu, même pour vous servir. Je le ferais cependant si votre santé y était intéressée. Qu’elle ne le soit pas Madame; que je puisse vous parler de tout, vous tout montrer, vous tout dire ! Nous nous sommes en effet écrit très peu de nouvelles. Nous les avons peut-être réservées pour le moment où nous serons ensemble.
Y a-t-il des nouvelles aujourd’hui du reste ? Toutes choses sont si prévues qu’on n’en parle plus quand elles arrivent. Savez-vous ce que c’est que l’escompte en fait d’argent ? On escompte tous les événements. Tout se passe tout se fait d’avance. Les élections anglaises finissent à peine. Leurs résultats n’ont pas encore commencé. On n’y pense déjà plus. Les nôtres se préparent. On en a déjà tant parlé, on en parlera tant d’ici à quelques jours, qu’on y arrivera blasé, épuisé. C’est une vraie maladie que ce long bavardage préalable, et une maladie sans remède, car elle est dans nos institutions, dans nos mœurs. Que deviendraient des jeunes gens qui disserteraient, bavarderaient, rêvasseraient, écrivailleraient sur l’amour bien avant de l’éprouver avant de voir une femme ? J’aime que la pensée et l’action, le dire et le faire se suivent de plus près et se lient plus intimement. Je suis sûr que l’un et l’autre s’en trouvent mieux.
Mardi 9 heures
Je me suis levé tard ce matin, et voilà l’homme de la poste qui arrive plutôt. Il faut que je lui donne ma lettre ! J’ai moins de regret qu’elle soit courte. J’y supplierai vendredi. Je lis en courant votre n°25. N’ayez plus de chagrin de mon chagrin. Il est passé puisque vous me rassurez, puisque d’ici déjà je vous vois mieux. Vendredi! Point d’adieu. G.
Ceci est mon dernier mot. Vous l’aurez jeudi. Vendredi, j’apporterai moi-même ma lettre. Que celle de ce matin, m'a fait plaisir ! Elle est calme, gaie. Certainement vous êtes mieux. Savez-vous ce qui me trouble avec vous, quant à votre santé ? Vous avez besoin, je crois, d’en être distraite, de porter votre imagination ailleurs. J’hésite donc à vous en parler. Et pourtant ! Et puis à part la contrainte, il y a, dans cette réticence, dans le soin de détourner vos pensées en retenant les miennes, un arrangement une petite supercherie qui me déplaît.
J’ai besoin de laisser librement, aller près de vous mon esprit, mon cœur, ma parole, ma vie. Il m’en coûterait infiniment de vous tromper tant soit peu, même pour vous servir. Je le ferais cependant si votre santé y était intéressée. Qu’elle ne le soit pas Madame; que je puisse vous parler de tout, vous tout montrer, vous tout dire ! Nous nous sommes en effet écrit très peu de nouvelles. Nous les avons peut-être réservées pour le moment où nous serons ensemble.
Y a-t-il des nouvelles aujourd’hui du reste ? Toutes choses sont si prévues qu’on n’en parle plus quand elles arrivent. Savez-vous ce que c’est que l’escompte en fait d’argent ? On escompte tous les événements. Tout se passe tout se fait d’avance. Les élections anglaises finissent à peine. Leurs résultats n’ont pas encore commencé. On n’y pense déjà plus. Les nôtres se préparent. On en a déjà tant parlé, on en parlera tant d’ici à quelques jours, qu’on y arrivera blasé, épuisé. C’est une vraie maladie que ce long bavardage préalable, et une maladie sans remède, car elle est dans nos institutions, dans nos mœurs. Que deviendraient des jeunes gens qui disserteraient, bavarderaient, rêvasseraient, écrivailleraient sur l’amour bien avant de l’éprouver avant de voir une femme ? J’aime que la pensée et l’action, le dire et le faire se suivent de plus près et se lient plus intimement. Je suis sûr que l’un et l’autre s’en trouvent mieux.
Mardi 9 heures
Je me suis levé tard ce matin, et voilà l’homme de la poste qui arrive plutôt. Il faut que je lui donne ma lettre ! J’ai moins de regret qu’elle soit courte. J’y supplierai vendredi. Je lis en courant votre n°25. N’ayez plus de chagrin de mon chagrin. Il est passé puisque vous me rassurez, puisque d’ici déjà je vous vois mieux. Vendredi! Point d’adieu. G.
25. Paris, Dimanche 13 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
25. Dimanche 13 août 1 heure.
J’ai fermé ma lettre au moment où l’on m’a remis la vôtre. Je n’ai eu que le temps. de vous l’annoncer. Monsieur, il faudra que je vois vos enfants. Votre petite-fille de huit ans surtout, que je l’aime ! Elle doit être charmante. Vous m’avez dit qu’elle avait vos yeux. Vous l’aimez plus que les autres. Quand les verrai-je Quelle est l’époque où toute votre famille rentre en ville ? Vous m’avez bien dit Monsieur l’emploi de votre journée lorsqu’elle est auprès de vous. Mais maintenant êtes-vous donc seul ? Tout seul c’est impossible. C’est trop triste ! Je vous remercie de m’avoir dit mes heures. Je ne regarderai plus si bêtement la lune à 10 heures. Hier tout jute à cette heure le sir Robert Adair me la faisait admirer entre les peupliers du jardin de l’Ambassade. Il me racontait comme elle est belle à Constantinople quand elle donne sur les cyprès qui ornent les cimetières. Il dit que rien n’est si beau, si important que ce spectacle et pendant toute la description qu’il m’en faisait je me tenais sur le balcon en face de cette lune qui marchait et qui brillait dans les feuillages. Je ne pensais pas à Constantinople, j’allais un peu à l’occident de Paris, et je n’y découvrais rien. C’est avoir peu d’instinct, car je sais aujourd’hui que vous étiez à votre fenêtre. Et bien Monsieur moi tous les soirs je suis en voiture ouverte à cette heure-là, hors les jours où je suis sur le balcon de Lady Granville. Je ne reçois personne Je veux de l’air. Je ne sais pourquoi je veux garder mon indépendance jusqu’à votre arrivée. Si vous voulez que j’ouvre ma porte alors, je le ferai.
Monsieur, je suis tout à coup frappée d’une idée. Dans ce n° 20 vous ne m’annoncez pas ma lettre de la veille qui a dû vous être remise avant que vous n’ayez fermé la vôtre, et je crois me rappeler qu’elle contenait quelque chose d’horriblement triste. Cela me revient comme un mauvais rêve. Je vous aurai fait de la peine. Pardonnez-le moi je vous en conjure. Je me laisse aller à tout ce qui se présente à mon esprit, je vous écris dans tous les instants du jour. J’ai de mauvais moments Je devrais me taire alors, & c’est alors que j’éprouve le besoin impérieux de vous parler. Je ne le ferai, je ne le ferais plus, pardonnez-moi. pardonnez-moi comme on pardonne à un enfant. J’ai été mal vous le savez. Je ne sais pas gouverner mes nerfs. Je vais mieux. J’irai mieux je serai bien tout à fait quand je vous aurai auprès de moi.
Lundi 14 7 1/2
Monsieur, je fus passer hier ma journée à St Germain. Je n’y avais jamais été. Lord & lady Granville m’y reçurent. Ils habitent une petite maison à côté de la Terrasse que c’est beau & comme l’air y est vif et pur. Ils me donnèrent un dîner anglais roast meat & pudding, c’est tout ce que j’aime. Je mangeai vraiment ce qui ne n’est guère arrivé depuis deux mois. Après le dîner ; nous nous fîmes traîner sur cette belle Terrasse. Vous ne m’aviez jamais dit qu’il y eût quelque chose de si beau aussi près de Paris, et puis Monsieur quel plaisir. Je m’étais rapprochée de vous. N’est-ce pas c’est votre route ? Marie n’avait pas pu venir avec moi, je me fais accompagner par M. Aston en allant nous causerons beaucoup d’Angleterre et je lui payais ses bons offices par quelques confidences sur sa reine & son premier ministre. En revenant je crus m’être acquittée, et comme l’air était charmant, bien doux, que je n’avais pas dormi la nuit, je m’endormis profondément. Je ne me réveillai qu’à la barrière. Je lui demandai l’heure 10 heures dix minutes. J’ouvris bien vite mes yeux, je regardai à droite & je vous trouvai, je trouvai vos yeux fixés sur cette belle lune. Le pauvre Aston n’eût rien encore. Il me remercia cependant beaucoup de lui avoir permis de m’accompagner au total j’ai été bien contente de ma journée. Elle m’a reposée. J’ai fait ma course en calèche. Il faisait chaud en allant mais pour revenir c’était charmant, du moins j’ai fait de jolis rêves.
10 heures Je viens de recevoir votre lettre de vendredi. J’avais donc deviné. Je vous avais fait bien de la peine, à vous, à qui je ne voudrais donner que du bonheur. J’ai pleuré en lisant votre lettre. Je vous demande pardon à genoux, & puis je me suis relevée fière, forte, décidée, oui Monsieur bien décidée à ne plus vous causer un seul moment de peine, à me bien porter, à ne plus vous dire une parole triste, je prierai Dieu de m’aider à tenir toutes ces promesses. Et vous, Monsieur, je vous en demande une, une seule qui résume tout, que vous m’avez déjà faite dans le fond de votre cœur, que vous me répéterez tous les jours de ma vie, que vous me direz, que vous m’écrirez ce mot ce seul mot qui me fait vivre, vivre heureuse, vivre pour vous, pour vous seule. Adieu Monsieur je me crains, je ne veux pas continuer. Vendredi quel beau jour ! Et on dit que c’est un mauvais jour. & Lady Holland le croit ; qu’est-ce que cela nous fait ?
J’ai fermé ma lettre au moment où l’on m’a remis la vôtre. Je n’ai eu que le temps. de vous l’annoncer. Monsieur, il faudra que je vois vos enfants. Votre petite-fille de huit ans surtout, que je l’aime ! Elle doit être charmante. Vous m’avez dit qu’elle avait vos yeux. Vous l’aimez plus que les autres. Quand les verrai-je Quelle est l’époque où toute votre famille rentre en ville ? Vous m’avez bien dit Monsieur l’emploi de votre journée lorsqu’elle est auprès de vous. Mais maintenant êtes-vous donc seul ? Tout seul c’est impossible. C’est trop triste ! Je vous remercie de m’avoir dit mes heures. Je ne regarderai plus si bêtement la lune à 10 heures. Hier tout jute à cette heure le sir Robert Adair me la faisait admirer entre les peupliers du jardin de l’Ambassade. Il me racontait comme elle est belle à Constantinople quand elle donne sur les cyprès qui ornent les cimetières. Il dit que rien n’est si beau, si important que ce spectacle et pendant toute la description qu’il m’en faisait je me tenais sur le balcon en face de cette lune qui marchait et qui brillait dans les feuillages. Je ne pensais pas à Constantinople, j’allais un peu à l’occident de Paris, et je n’y découvrais rien. C’est avoir peu d’instinct, car je sais aujourd’hui que vous étiez à votre fenêtre. Et bien Monsieur moi tous les soirs je suis en voiture ouverte à cette heure-là, hors les jours où je suis sur le balcon de Lady Granville. Je ne reçois personne Je veux de l’air. Je ne sais pourquoi je veux garder mon indépendance jusqu’à votre arrivée. Si vous voulez que j’ouvre ma porte alors, je le ferai.
Monsieur, je suis tout à coup frappée d’une idée. Dans ce n° 20 vous ne m’annoncez pas ma lettre de la veille qui a dû vous être remise avant que vous n’ayez fermé la vôtre, et je crois me rappeler qu’elle contenait quelque chose d’horriblement triste. Cela me revient comme un mauvais rêve. Je vous aurai fait de la peine. Pardonnez-le moi je vous en conjure. Je me laisse aller à tout ce qui se présente à mon esprit, je vous écris dans tous les instants du jour. J’ai de mauvais moments Je devrais me taire alors, & c’est alors que j’éprouve le besoin impérieux de vous parler. Je ne le ferai, je ne le ferais plus, pardonnez-moi. pardonnez-moi comme on pardonne à un enfant. J’ai été mal vous le savez. Je ne sais pas gouverner mes nerfs. Je vais mieux. J’irai mieux je serai bien tout à fait quand je vous aurai auprès de moi.
Lundi 14 7 1/2
Monsieur, je fus passer hier ma journée à St Germain. Je n’y avais jamais été. Lord & lady Granville m’y reçurent. Ils habitent une petite maison à côté de la Terrasse que c’est beau & comme l’air y est vif et pur. Ils me donnèrent un dîner anglais roast meat & pudding, c’est tout ce que j’aime. Je mangeai vraiment ce qui ne n’est guère arrivé depuis deux mois. Après le dîner ; nous nous fîmes traîner sur cette belle Terrasse. Vous ne m’aviez jamais dit qu’il y eût quelque chose de si beau aussi près de Paris, et puis Monsieur quel plaisir. Je m’étais rapprochée de vous. N’est-ce pas c’est votre route ? Marie n’avait pas pu venir avec moi, je me fais accompagner par M. Aston en allant nous causerons beaucoup d’Angleterre et je lui payais ses bons offices par quelques confidences sur sa reine & son premier ministre. En revenant je crus m’être acquittée, et comme l’air était charmant, bien doux, que je n’avais pas dormi la nuit, je m’endormis profondément. Je ne me réveillai qu’à la barrière. Je lui demandai l’heure 10 heures dix minutes. J’ouvris bien vite mes yeux, je regardai à droite & je vous trouvai, je trouvai vos yeux fixés sur cette belle lune. Le pauvre Aston n’eût rien encore. Il me remercia cependant beaucoup de lui avoir permis de m’accompagner au total j’ai été bien contente de ma journée. Elle m’a reposée. J’ai fait ma course en calèche. Il faisait chaud en allant mais pour revenir c’était charmant, du moins j’ai fait de jolis rêves.
10 heures Je viens de recevoir votre lettre de vendredi. J’avais donc deviné. Je vous avais fait bien de la peine, à vous, à qui je ne voudrais donner que du bonheur. J’ai pleuré en lisant votre lettre. Je vous demande pardon à genoux, & puis je me suis relevée fière, forte, décidée, oui Monsieur bien décidée à ne plus vous causer un seul moment de peine, à me bien porter, à ne plus vous dire une parole triste, je prierai Dieu de m’aider à tenir toutes ces promesses. Et vous, Monsieur, je vous en demande une, une seule qui résume tout, que vous m’avez déjà faite dans le fond de votre cœur, que vous me répéterez tous les jours de ma vie, que vous me direz, que vous m’écrirez ce mot ce seul mot qui me fait vivre, vivre heureuse, vivre pour vous, pour vous seule. Adieu Monsieur je me crains, je ne veux pas continuer. Vendredi quel beau jour ! Et on dit que c’est un mauvais jour. & Lady Holland le croit ; qu’est-ce que cela nous fait ?
26. Paris, Mardi 15 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
26. Mardi le 15 août 8 heures
Je vous dirai bien tous les jours tout ce que je fais mais il m’est impossible de vous dire une fois pour toutes ce que je fais tous les jours. Il n’y a de fixe que mes prières en me levant et vous après mes prières, et mon déjeuner après vous. Tout le reste est au service d mes nerfs qui ont toutes les fantaisies du monde. Il n’en était pas de même il y a deux mois. Mon temps était passablement réglé. Aujourd’hui rien ne l’est. Jugez que je suis incapable de prendre un livre, que les journaux même qui m’ont occupée toute ma vie je les regarde à peine & jamais je n’achève un article. Je ne peux pas rester en place. C’est une agitation abominable, je ne suis calme qu’en calèche. Mais je vais mieux déjà je vous le répète et j’ai raison de vous le répéter. Si je pouvais dormir tout serait bien, mais je n’ai pas deux heures de nuit de sommeil, & l’ensemble de ma nuit ne m’en donne pas cinq. Voilà où j’en suis depuis ma seconde semaine de Londres. Le médecin me trouve mieux, & me dit que cela ira bien que dans quelques semaines all with be right again.
Mais voyons, il vous faut ma journée d’hier. Je fus m’asseoir aux Tuileries après ma seconde toilette qui est la longue et qui vient après mon déjeuner. Marie s’ennuie car je ne reçois personne et elle ne me dit rien. Je la prierai de me parler de me dire des bêtises, tout ce qu’elle veut pourvu qu’elle parle, pourvu qu’on ne me laisse pas penser ; car il y a des moments où il faut me tirer de mes plus doux rêves, ils me font trop de mal et tout mon corps tressaille comme lorsque je me livre à mes plus douloureux souvenirs. Voilà ce qui est mauvais pour moi, bien mauvais.
Il faut que je vois du monde, à deux heures j’allai prendre lady Granville pour une tournée de visites d’abord, et puis une promenade. Elle a prodigieusement, d’esprit. L’esprit très observateur, très bouffon. Il n’y a pas de société qui m’amuse plus que la sienne. Nos visites allèrent à merveille, nous ne trouvâmes personne. M. de Valençay m’avait écrit pour me demander de le recevoir avant son départ pour Valençay. Je le vis un moment avant dîner ; je ne vis personne que lui. Je défends encore ma porte le soir & nous allâmes à 8 h. au bois de Boulogne où je marchai avec Marie un peu dans les ténèbres, mais cela me fit du bien. A 10 h. je rentrai pour me coucher voyez la sotte journée.
J’ai beaucoup écrit hier cependant, cela me fatigue & m’ennuie. J’ai trop de friends par le monde. Savez-vous quelles sont les lettres qui me coûtent le plus maintenant ? C’est celles à M. de Lieven. Nous nous écrivons tous les jours un vrai journal. Je ne sais plus le remplir. A propos c’est dans peu de jours que je recevrai la réponse à mes propositions de rencontre en France et à ma déclaration que je n’en peux pas sortir. Vous serez auprès de moi lorsque je recevrai sa lettre et c’est ce qu’il me faut car le cœur me bat bien fort lorsque j’y pense.
Voici votre N°22. Quelle douce chose, que l’habitude, et de prévoir et d’avoir du bonheur, tous les jours à 9 h. 1/4 ! Voilà ce qui calme mes nerfs. Vos lettres me font tant de bien, je vous en remercie quel charme dans votre style, après m’avoir élevée bien haut comme vous me ramenez doucement simplement sur la terre. Vous me faites vivre alternativement dans les cieux, & auprès de vos cygnes. Que j’aimerais leur société. J’ai toujours aimé les cygnes. Ils ont l’air si nobles, si fiers. Vous m’apprenez qu’ils appartiennent au Nord. Il me semble que vous m’apprendrez bien des choses.
Monsieur quel plaisir, quel plaisir de penser à l’avenir, à notre avenir. Vous m’aiderez à l’arranger. Je n’ai pas été aussi contente que vous du discours de Sir R. Peel ! Quel mauvais goût que cette comparaison de la reine avec Marie-Antoinette. A propos une lettre ministérielle de Londres me disent que les Whigs auront cependant une majorité de 40 à la Chambre basse. Mes lettres Torys me manquent dans huit jours les chiffres seront bien exactement connus. On me fait faire une observation assez curieuse, c’est que la reforme a relevé le conservatisme, & que chaque parlement depuis le bill est devenu meilleur. Le bien est résulté du mal. et mon Dieu n’est-ce pas en toutes choses dans la vie ? Que de choses j’ai à vous dire Monsieur, j’oublierai tout quand vous serez là. Cela me fâche. Je voudrais vous dire tout, tout ce qui me traverse la tête aujourd’hui. Que de fois dans ma vie j’ai senti ce besoin de tout dire sans jamais trouver où le satisfaire ! Jamais je n’ai rencontré le bonheur que vous m’offrez. Cela vous fait plaisir Monsieur n’est-ce pas ? Comment je n’ai plus que demain à vous écrire ? Demain le 16. Voyez vous j’étouffe quand je pense au 18 et cependant je suis dans un ravisse ment, une joie. Rien ne peut arriver d’ici à vendredi n’est-ce pas ?
Adieu Monsieur, il est midi, je vais prendre l’air. Je vais vous accompagner auprès de l’étang. Savez-vous que j’ai beaucoup de goût pour l’arrangement d’un jardin, & savez-vous encore que si j’étais auprès de vous je ne penserais pas à votre jardin. Allons, je vois bien qu’il est temps que je vous quitte.
Je vous dirai bien tous les jours tout ce que je fais mais il m’est impossible de vous dire une fois pour toutes ce que je fais tous les jours. Il n’y a de fixe que mes prières en me levant et vous après mes prières, et mon déjeuner après vous. Tout le reste est au service d mes nerfs qui ont toutes les fantaisies du monde. Il n’en était pas de même il y a deux mois. Mon temps était passablement réglé. Aujourd’hui rien ne l’est. Jugez que je suis incapable de prendre un livre, que les journaux même qui m’ont occupée toute ma vie je les regarde à peine & jamais je n’achève un article. Je ne peux pas rester en place. C’est une agitation abominable, je ne suis calme qu’en calèche. Mais je vais mieux déjà je vous le répète et j’ai raison de vous le répéter. Si je pouvais dormir tout serait bien, mais je n’ai pas deux heures de nuit de sommeil, & l’ensemble de ma nuit ne m’en donne pas cinq. Voilà où j’en suis depuis ma seconde semaine de Londres. Le médecin me trouve mieux, & me dit que cela ira bien que dans quelques semaines all with be right again.
Mais voyons, il vous faut ma journée d’hier. Je fus m’asseoir aux Tuileries après ma seconde toilette qui est la longue et qui vient après mon déjeuner. Marie s’ennuie car je ne reçois personne et elle ne me dit rien. Je la prierai de me parler de me dire des bêtises, tout ce qu’elle veut pourvu qu’elle parle, pourvu qu’on ne me laisse pas penser ; car il y a des moments où il faut me tirer de mes plus doux rêves, ils me font trop de mal et tout mon corps tressaille comme lorsque je me livre à mes plus douloureux souvenirs. Voilà ce qui est mauvais pour moi, bien mauvais.
Il faut que je vois du monde, à deux heures j’allai prendre lady Granville pour une tournée de visites d’abord, et puis une promenade. Elle a prodigieusement, d’esprit. L’esprit très observateur, très bouffon. Il n’y a pas de société qui m’amuse plus que la sienne. Nos visites allèrent à merveille, nous ne trouvâmes personne. M. de Valençay m’avait écrit pour me demander de le recevoir avant son départ pour Valençay. Je le vis un moment avant dîner ; je ne vis personne que lui. Je défends encore ma porte le soir & nous allâmes à 8 h. au bois de Boulogne où je marchai avec Marie un peu dans les ténèbres, mais cela me fit du bien. A 10 h. je rentrai pour me coucher voyez la sotte journée.
J’ai beaucoup écrit hier cependant, cela me fatigue & m’ennuie. J’ai trop de friends par le monde. Savez-vous quelles sont les lettres qui me coûtent le plus maintenant ? C’est celles à M. de Lieven. Nous nous écrivons tous les jours un vrai journal. Je ne sais plus le remplir. A propos c’est dans peu de jours que je recevrai la réponse à mes propositions de rencontre en France et à ma déclaration que je n’en peux pas sortir. Vous serez auprès de moi lorsque je recevrai sa lettre et c’est ce qu’il me faut car le cœur me bat bien fort lorsque j’y pense.
Voici votre N°22. Quelle douce chose, que l’habitude, et de prévoir et d’avoir du bonheur, tous les jours à 9 h. 1/4 ! Voilà ce qui calme mes nerfs. Vos lettres me font tant de bien, je vous en remercie quel charme dans votre style, après m’avoir élevée bien haut comme vous me ramenez doucement simplement sur la terre. Vous me faites vivre alternativement dans les cieux, & auprès de vos cygnes. Que j’aimerais leur société. J’ai toujours aimé les cygnes. Ils ont l’air si nobles, si fiers. Vous m’apprenez qu’ils appartiennent au Nord. Il me semble que vous m’apprendrez bien des choses.
Monsieur quel plaisir, quel plaisir de penser à l’avenir, à notre avenir. Vous m’aiderez à l’arranger. Je n’ai pas été aussi contente que vous du discours de Sir R. Peel ! Quel mauvais goût que cette comparaison de la reine avec Marie-Antoinette. A propos une lettre ministérielle de Londres me disent que les Whigs auront cependant une majorité de 40 à la Chambre basse. Mes lettres Torys me manquent dans huit jours les chiffres seront bien exactement connus. On me fait faire une observation assez curieuse, c’est que la reforme a relevé le conservatisme, & que chaque parlement depuis le bill est devenu meilleur. Le bien est résulté du mal. et mon Dieu n’est-ce pas en toutes choses dans la vie ? Que de choses j’ai à vous dire Monsieur, j’oublierai tout quand vous serez là. Cela me fâche. Je voudrais vous dire tout, tout ce qui me traverse la tête aujourd’hui. Que de fois dans ma vie j’ai senti ce besoin de tout dire sans jamais trouver où le satisfaire ! Jamais je n’ai rencontré le bonheur que vous m’offrez. Cela vous fait plaisir Monsieur n’est-ce pas ? Comment je n’ai plus que demain à vous écrire ? Demain le 16. Voyez vous j’étouffe quand je pense au 18 et cependant je suis dans un ravisse ment, une joie. Rien ne peut arriver d’ici à vendredi n’est-ce pas ?
Adieu Monsieur, il est midi, je vais prendre l’air. Je vais vous accompagner auprès de l’étang. Savez-vous que j’ai beaucoup de goût pour l’arrangement d’un jardin, & savez-vous encore que si j’étais auprès de vous je ne penserais pas à votre jardin. Allons, je vois bien qu’il est temps que je vous quitte.
27. Paris, Mercredi 16 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (7 - 16 août)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
27. Paris, mercredi 16 août
8 heures
Il a plu hier tout le jour, ce qui a fait que j’ai bien avancé mes lettres. J’ai encore le duc de Noailles & M. Ellice sur le cœur et un peu M. Thiers, & puis j’aurai fini. Une fois dans le courant de ma dépense, cela va sans fatigue, mais les dettes, c’est là ce qui est odieux.
A propos de Thiers, le médecin qu’il avait fait venir à Florence a déclaré qu’un jour de plus tuait se femme, il la ramène donc très mal aux Pyrénées, et lui même viendra regarder Paris. Je fus au bois de Boulogne de quatre à six. Je dînai à l’ambassade d’Angleterre. Je n’y rencontrai que M. Molé. Lord Granville ne dit rien ; lady Granville, parle à peine. M. Aston se tait par respect & un peu par autre chose ; M. Molé n’avait pas l’air en train, et moi, je l’étais un peu, voilà mon dîner. Je vous épargne et vous réserve quelques propos tenus avant et après le dîner ; à 10 heures je rentrais pour un coucher.
Voici donc ma dernière lettre Monsieur, qu’est-ce que je ferai demain ! Demain, j’essaierai de me distraire beaucoup pour ne pas trop penser à après demain. 9 heures. Voici le 23 & le 24 qu’on me remet en même temps. Par quelles merveille ai-je donc aujourd’hui déjà votre lettre d’hier. Cela fait que je n’aurai rien demain. Il me sied bien de me plaindre. Je suis riche aujourd’hui. Je peux bien vivre. sur cela quarante huit heures. & puis Vendredi, vendredi ! Monsieur je crois que vous avez raison. Il n’y a pas moyen de parler, je ne trouve pas une parole. Je ne veux pas vous parler de vendredi, mais j’aurais des volumes à écrire en réponse au N° 23. Comme tout ce que vous me dites est vrai, comme vous me devinez ! Il est bien vrai que je vous dis beaucoup beaucoup, & que ce n’est pas là encore tout ce que je suis. Il y a donc un être sur la terre qui comprend mon cœur.
Quelle félicité ! Dieu m’a bien châtiée, mais comme il me console. Que sa bonté est infinie ! avec quelle ferveur je l’ai invoqué depuis mes malheurs, comme je lui demandais ardemment tous les jours sans cesse, d’adoucir me douleurs où de me rappeler à lui ! Oui Monsieur la prière est efficace. Dieu m’a écouté. Il a eu pitié de mes misères. Il me comble. Dieu est grand. Monsieur invoquons le ensemble. Il nous bénira. Moi aussi, je pleure, mais ce sont des larmes bien douces. midi Je ferme ma lettre.
Adieu. Adieu. et puis plus d’adieu. Le Roi devait revenir cette nuit à St Cloud où il va rester.
8 heures
Il a plu hier tout le jour, ce qui a fait que j’ai bien avancé mes lettres. J’ai encore le duc de Noailles & M. Ellice sur le cœur et un peu M. Thiers, & puis j’aurai fini. Une fois dans le courant de ma dépense, cela va sans fatigue, mais les dettes, c’est là ce qui est odieux.
A propos de Thiers, le médecin qu’il avait fait venir à Florence a déclaré qu’un jour de plus tuait se femme, il la ramène donc très mal aux Pyrénées, et lui même viendra regarder Paris. Je fus au bois de Boulogne de quatre à six. Je dînai à l’ambassade d’Angleterre. Je n’y rencontrai que M. Molé. Lord Granville ne dit rien ; lady Granville, parle à peine. M. Aston se tait par respect & un peu par autre chose ; M. Molé n’avait pas l’air en train, et moi, je l’étais un peu, voilà mon dîner. Je vous épargne et vous réserve quelques propos tenus avant et après le dîner ; à 10 heures je rentrais pour un coucher.
Voici donc ma dernière lettre Monsieur, qu’est-ce que je ferai demain ! Demain, j’essaierai de me distraire beaucoup pour ne pas trop penser à après demain. 9 heures. Voici le 23 & le 24 qu’on me remet en même temps. Par quelles merveille ai-je donc aujourd’hui déjà votre lettre d’hier. Cela fait que je n’aurai rien demain. Il me sied bien de me plaindre. Je suis riche aujourd’hui. Je peux bien vivre. sur cela quarante huit heures. & puis Vendredi, vendredi ! Monsieur je crois que vous avez raison. Il n’y a pas moyen de parler, je ne trouve pas une parole. Je ne veux pas vous parler de vendredi, mais j’aurais des volumes à écrire en réponse au N° 23. Comme tout ce que vous me dites est vrai, comme vous me devinez ! Il est bien vrai que je vous dis beaucoup beaucoup, & que ce n’est pas là encore tout ce que je suis. Il y a donc un être sur la terre qui comprend mon cœur.
Quelle félicité ! Dieu m’a bien châtiée, mais comme il me console. Que sa bonté est infinie ! avec quelle ferveur je l’ai invoqué depuis mes malheurs, comme je lui demandais ardemment tous les jours sans cesse, d’adoucir me douleurs où de me rappeler à lui ! Oui Monsieur la prière est efficace. Dieu m’a écouté. Il a eu pitié de mes misères. Il me comble. Dieu est grand. Monsieur invoquons le ensemble. Il nous bénira. Moi aussi, je pleure, mais ce sont des larmes bien douces. midi Je ferme ma lettre.
Adieu. Adieu. et puis plus d’adieu. Le Roi devait revenir cette nuit à St Cloud où il va rester.