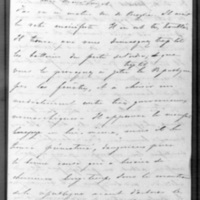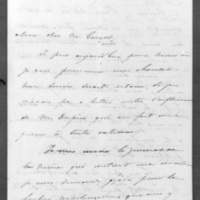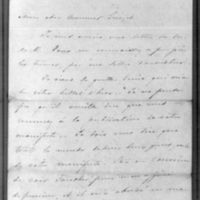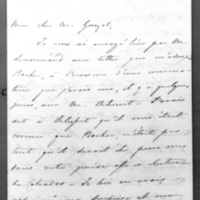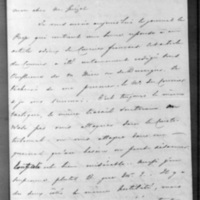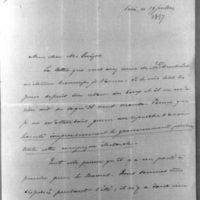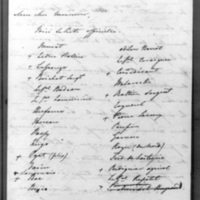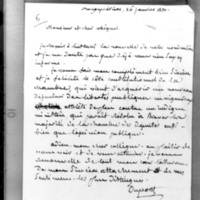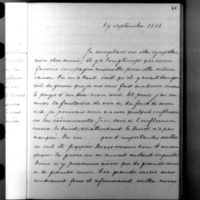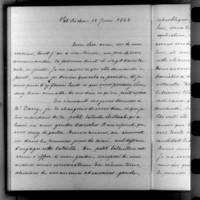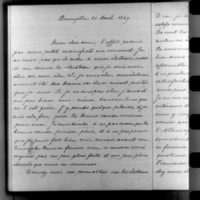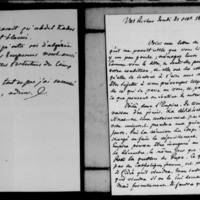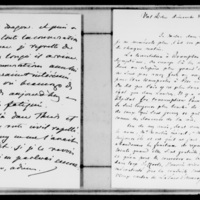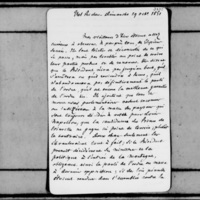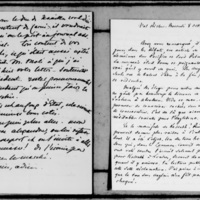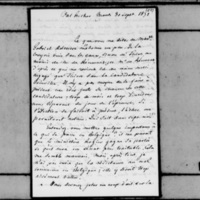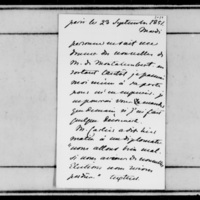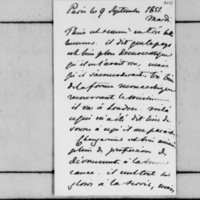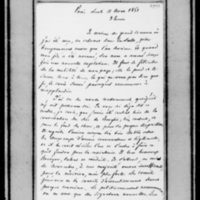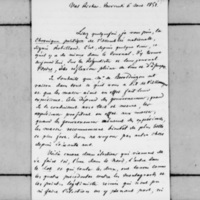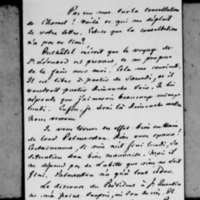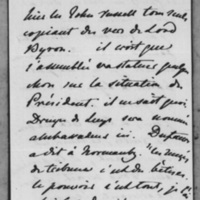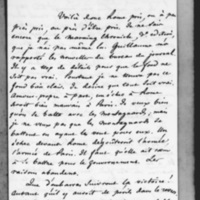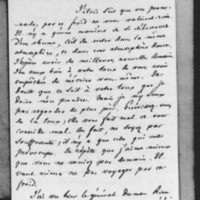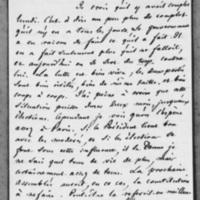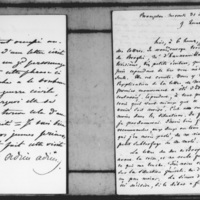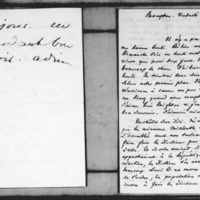Votre recherche dans le corpus : 208 résultats dans 6062 notices du site.
Trier par :
Paris, le 31 décembre 1843, le Comte de Ségur à François Guizot
Collection : 142_Correspondance de Philippe de Ségur : 1837-1870
Auteurs : Ségur, Philippe de (1780-1873)
Paris, [mai 1849], Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, 29 avril [1849], Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, Mardi [avril 1849], Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, Lundi [avril 1849], Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, le 5 juin [1849], Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, 5 mars [1849], Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, [?], Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, le 19 juillet 1857, Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, le 18 novembre 1849, Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
[Paris], le 17 mai 1849, Eloi Mallac à François Guizot
Auteurs : Mallac, Eloi (1809-1876)
Rouge-Perriers, le 26 janvier 1830, Dupont de l'Eure à François Guizot
Auteurs : Dupont de l'Eure, Jacques-Charles (1767-1855)
Rouge-Perriers, le 25 novembre 1829, Dupont de l'Eure à François Guizot
Auteurs : Dupont de l'Eure, Jacques-Charles (1767-1855)
Rouge-Perriers, le 1er septembre 1829, Dupont de l'Eure à François Guizot
Auteurs : Dupont de l'Eure, Jacques-Charles (1767-1855)
Val-Richer, le 29 septembre 1867, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val-Richer, le 12 juin 1863, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton, le 21 Avril 1849, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Paris, le 15 mai 1849, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Auteurs : Dumon, Pierre-Sylvain (1797-1870)
Paris, le 16 avril 1849, le Duc de Noailles à François Guizot
Auteurs : Noailles, Paul de (1802-1885)
Val Richer, Jeudi 21 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, jeudi 21 oct. 1852
Voici une lettre de Marion qu’il me paraît utile que vous lisiez. Prenez y un peu garde ; ménagez leurs sentiments. Comme vous le dites, ce sont des personnes de votre condition, et elles ont du cœur ; il faut qu'elles se sentent à l'aise avec vous. Vous êtes sujette à vous préoccuper trop exclusivement de ce qui se passe en vous, et pas assez de ce que pensent ou sentent les autres.
Voilà donc l'Empire. Je trouve qu’on a raison d'en finir. La délibération du mal ne sera certainement pas longue. Le vote universel prendra une quinzaine de jours. Puis la réunion du Corps législatif chargé de faire le dépouillement. Le second Empire pourra être inauguré au commencement de décembre, le même jour que le premier.
Reste la question du Pape. Ce qui me revient, par des catholiques fervents, est plutôt contraire à l’idée qu’il viendra. Mon instinct à moi est qu’il viendra si on le lui demande formellement. Mais formellement. Il faudra qu’il soit mis au pied du mur.
Onze heures
Génie m’avait écrit que le régime d’Andral vous réussissait mieux que celui de Chomel, que vous repreniez un peu d’appétit et de sommeil, qu’il vous trouvait lui-même meilleure mine. La même impression m'est revenu aussi d'ailleurs. Votre impression à vous me désole. Olliffe est si je ne me trompe, de l’avis d'Andral pour votre régime.
Les feuilles d'havas annoncent ce matin. que " la majorité qui va sortir de l’urne populaire dépassera par son chiffre, tous les résultats antérieurs, y compris le scrutin du 20 décembre. "
Je ne trouve pas qu’il y ait sujet d'être violent contre la mise en liberté d'Abdel Kader, et je suis plutôt porté à croire qu’elle n'aura pas d’inconvénient. L'Algérie doit être bien changée depuis six ans et lui-même bien dépaysé. Ce que je trouve de mauvais goût, ce sont les injures qu'à cette occasion les journaux du gouvernement nous disent à nous qui n'avons fait, dans cette occasion, que ce que le plus simple bon sens commandait alors et ce que le droit politique autorisait parfaitement. Adieu, Adieu. G.
Voici une lettre de Marion qu’il me paraît utile que vous lisiez. Prenez y un peu garde ; ménagez leurs sentiments. Comme vous le dites, ce sont des personnes de votre condition, et elles ont du cœur ; il faut qu'elles se sentent à l'aise avec vous. Vous êtes sujette à vous préoccuper trop exclusivement de ce qui se passe en vous, et pas assez de ce que pensent ou sentent les autres.
Voilà donc l'Empire. Je trouve qu’on a raison d'en finir. La délibération du mal ne sera certainement pas longue. Le vote universel prendra une quinzaine de jours. Puis la réunion du Corps législatif chargé de faire le dépouillement. Le second Empire pourra être inauguré au commencement de décembre, le même jour que le premier.
Reste la question du Pape. Ce qui me revient, par des catholiques fervents, est plutôt contraire à l’idée qu’il viendra. Mon instinct à moi est qu’il viendra si on le lui demande formellement. Mais formellement. Il faudra qu’il soit mis au pied du mur.
Onze heures
Génie m’avait écrit que le régime d’Andral vous réussissait mieux que celui de Chomel, que vous repreniez un peu d’appétit et de sommeil, qu’il vous trouvait lui-même meilleure mine. La même impression m'est revenu aussi d'ailleurs. Votre impression à vous me désole. Olliffe est si je ne me trompe, de l’avis d'Andral pour votre régime.
Les feuilles d'havas annoncent ce matin. que " la majorité qui va sortir de l’urne populaire dépassera par son chiffre, tous les résultats antérieurs, y compris le scrutin du 20 décembre. "
Je ne trouve pas qu’il y ait sujet d'être violent contre la mise en liberté d'Abdel Kader, et je suis plutôt porté à croire qu’elle n'aura pas d’inconvénient. L'Algérie doit être bien changée depuis six ans et lui-même bien dépaysé. Ce que je trouve de mauvais goût, ce sont les injures qu'à cette occasion les journaux du gouvernement nous disent à nous qui n'avons fait, dans cette occasion, que ce que le plus simple bon sens commandait alors et ce que le droit politique autorisait parfaitement. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 8 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 8 Août 1852
Je rentre dans nos habitudes ; je ne numérote plus. C’est un petit travail de chaque matin.
La translation à Brompton est un triste symptôme. On envoie là les [?] dont on n'espère plus grand chose, et qui ne sont pas assez forts ou assez riches pour être transportés à Pise où à Madère. On dit que l’air y est plus doux, et plus égal que dans Londres. Il y a un bal hôpital for consumption.
Pauvre Fanny ! Je suis toujours plus touché de la mort de ceux qui sont jeunes, et qui n’ont pas connu les douceurs de la vie.
Un de mes amis dont vous connaissez le nom, M. Moulin m'écrit : " Mon avis a toujours été et est qu’il ne faut pas abandonner les fonctions de représentation locale quand elles sont gratuites, électives et qu’on peut les conserver ou les obtenir sans trop d'effort."
J'aurais vivement mécontenté par la conduite contraire mon vieux canton de La Tour d'Auvergne que je retrouve fidèle à toutes mes fortunes aujourd’hui comme après 1848, et qui va probablement me réduire à la presque unanimité. J’ai compris d'abord les instructions de Venise comme moyen de modérer l'ardeur du parti légitimiste à se porter vers les fonctions publiques dont il a été si longtemps privé, mais je ne m'explique pas l’insistance avec laquelle, on vient de les reproduire à la veille des élections des conseils généraux. En Auvergne, elles n'ont reçu, elles ne reçoivent aucune exécution ; pas un légitimiste ne s’est retiré ; tous les légitimistes de nos conseils électifs vont y rentrer. Comme nous ne sommes pas un pays de grande propriété, le parti ne peut avoir influencé que par le patronage des intérêts locaux ; il perd toute autorité, toute importance s'il se retire sous sa tente, et sa retraite inspire plus de sarcasmes que de regrets.
Je suis bien aise que Cromwell vous amuse. Je vous en envoie sous bande un exemplaire. Cela a été inséré dans la Revue contemporaine, et ne se vend point séparément. On m'écrit que cela fait quelque bruit à Paris, et j'en juge par la fureur avec laquelle Emile Girardin l’attaque dans la Presse. Les amis du Président, ont tort de s'en fâcher. Cela n'a été écrit, ni pour lui, ni contre lui. J’ai pensé à son oncle en l'écrivant, à lui pas du tout. Il est vrai que l'allusion subsiste à la seconde génération, et que la conclusion est que Cromwell fit bien de ne pas se faire Roi. Si j'étais l’un des conseillers du Président, je lui conseillerais de faire comme Cromwell, qui mourut dans son lit, à Whitehall tranquille, et puissant. Mon conseil déplairait probablement, ce qui n'empêcherait pas qu’il ne fût bon.
Adieu. Je passe mon temps à me promener et à causer avec mes Anglais qui ont l’air de se plaire ici. Ils me quittent, le 15, et je pars le même jour pour aller près de Caen marier M. de Blagny. Je rentrerai chez moi le 13 pour n'en plus bouger. Adieu, adieu.
J’espère que la lettre de ce matin me dira que vous avez marché.
11 heures
Malgré votre lettre, j'adresse encore à Dieppe, Pour vous, je crois que vous serez mieux à Paris d’autant que les chaleurs de l'été me semblent passées. Adieu, Adieu. G.
Je rentre dans nos habitudes ; je ne numérote plus. C’est un petit travail de chaque matin.
La translation à Brompton est un triste symptôme. On envoie là les [?] dont on n'espère plus grand chose, et qui ne sont pas assez forts ou assez riches pour être transportés à Pise où à Madère. On dit que l’air y est plus doux, et plus égal que dans Londres. Il y a un bal hôpital for consumption.
Pauvre Fanny ! Je suis toujours plus touché de la mort de ceux qui sont jeunes, et qui n’ont pas connu les douceurs de la vie.
Un de mes amis dont vous connaissez le nom, M. Moulin m'écrit : " Mon avis a toujours été et est qu’il ne faut pas abandonner les fonctions de représentation locale quand elles sont gratuites, électives et qu’on peut les conserver ou les obtenir sans trop d'effort."
J'aurais vivement mécontenté par la conduite contraire mon vieux canton de La Tour d'Auvergne que je retrouve fidèle à toutes mes fortunes aujourd’hui comme après 1848, et qui va probablement me réduire à la presque unanimité. J’ai compris d'abord les instructions de Venise comme moyen de modérer l'ardeur du parti légitimiste à se porter vers les fonctions publiques dont il a été si longtemps privé, mais je ne m'explique pas l’insistance avec laquelle, on vient de les reproduire à la veille des élections des conseils généraux. En Auvergne, elles n'ont reçu, elles ne reçoivent aucune exécution ; pas un légitimiste ne s’est retiré ; tous les légitimistes de nos conseils électifs vont y rentrer. Comme nous ne sommes pas un pays de grande propriété, le parti ne peut avoir influencé que par le patronage des intérêts locaux ; il perd toute autorité, toute importance s'il se retire sous sa tente, et sa retraite inspire plus de sarcasmes que de regrets.
Je suis bien aise que Cromwell vous amuse. Je vous en envoie sous bande un exemplaire. Cela a été inséré dans la Revue contemporaine, et ne se vend point séparément. On m'écrit que cela fait quelque bruit à Paris, et j'en juge par la fureur avec laquelle Emile Girardin l’attaque dans la Presse. Les amis du Président, ont tort de s'en fâcher. Cela n'a été écrit, ni pour lui, ni contre lui. J’ai pensé à son oncle en l'écrivant, à lui pas du tout. Il est vrai que l'allusion subsiste à la seconde génération, et que la conclusion est que Cromwell fit bien de ne pas se faire Roi. Si j'étais l’un des conseillers du Président, je lui conseillerais de faire comme Cromwell, qui mourut dans son lit, à Whitehall tranquille, et puissant. Mon conseil déplairait probablement, ce qui n'empêcherait pas qu’il ne fût bon.
Adieu. Je passe mon temps à me promener et à causer avec mes Anglais qui ont l’air de se plaire ici. Ils me quittent, le 15, et je pars le même jour pour aller près de Caen marier M. de Blagny. Je rentrerai chez moi le 13 pour n'en plus bouger. Adieu, adieu.
J’espère que la lettre de ce matin me dira que vous avez marché.
11 heures
Malgré votre lettre, j'adresse encore à Dieppe, Pour vous, je crois que vous serez mieux à Paris d’autant que les chaleurs de l'été me semblent passées. Adieu, Adieu. G.
54. Val-Richer, Mercredi 4 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
54 Val-Richer, Mercredi 4 août 1852
Je suis très contrarié des quinze jours d'immobilité auxquels Velpeau vous condamne ; il a probablement raison. Mais c’est bien ennuyeux. J’aurais mieux fait de ne pas aller vous voir ; vous ne seriez pas montée dans ma chambre, et vous ne seriez pas tombée. C'est là tout ce que j'ai de mieux à vous dire.
L'insignifiance des journaux est complète. Ceux qui ne peuvent pas critiquer ne veulent pas louer. Pour surcroît le Journal des Débats, m'a manqué hier. Quand on supprime ainsi à l’esprit son aliment, on devrait supprimer aussi l'esprit lui-même. Cela se fera peu à peu.
J’ai eu hier une longue lettre de Barante qui prévoit ce résultat, car il me dit : " Lorsqu'on ne s’intéresse pas à soi-même on est indifférent à tout ; l’esprit s'éteint quand les sentiments sont glacés ! "
Il m’écrit du Mont Dore, où il est allé pour ne pas être repris l’hiver prochain de son extinction de voix.
Jeudi 5 Août
Je n’ai pas fait partir hier cette page qui n'en valait pas la peine. Vous ne m’avez pas écrit non plus. J’espère bien que ce n’est pas quelque mauvaise raison, accident ou autre. Je n'ai pas plus de nouvelles aujourd’hui qu’hier.
Mon fils, m'en apportera peut-être quelqu’une demain il est allé passer 48 heures à Paris pour un examen. Mes Anglais arrivent aussi demain.
Je vois que les élections des conseils généraux sont ce que j’attendais, ou immense majorité ministérielle c’est-à-dire présidentielle. Il me semble aussi que les pétitions impériales commencent à circuler. On m'écrit que les exilés espèrent quelque chose, du 15 Août. Ceux d’entre eux qui sont petits et modestes accepteraient volontiers l'Empire, s’il devait les faire rentrer. Que feraient les autres, Thiers, Rémusat, les généraux ? Il ne serait pas glorieux, pour eux de rentrer au milieu des Vive l'Empereur ! Ils rentreraient pourtant, s’il le leur permettait.
Avez-vous lu, dans le Galignani du 3 un article curieux du correspondant américain du Times sur Kossuth ? Il fera plaisir à Hübner.
11 heures
Voilà une lettre qui ne me plaît pas. Vous vous faites vous-même bien plus de mal que vous n'en avez. C'est singulier d'avoir l’esprit si juste, si ferme sur toutes choses, excepté sur soi-même. Je suis bien fâché de n'être plus là. Adieu, adieu. Merci de la lettre de Beauvale. Merci pour vous et pour Aggy. G.
Je suis très contrarié des quinze jours d'immobilité auxquels Velpeau vous condamne ; il a probablement raison. Mais c’est bien ennuyeux. J’aurais mieux fait de ne pas aller vous voir ; vous ne seriez pas montée dans ma chambre, et vous ne seriez pas tombée. C'est là tout ce que j'ai de mieux à vous dire.
L'insignifiance des journaux est complète. Ceux qui ne peuvent pas critiquer ne veulent pas louer. Pour surcroît le Journal des Débats, m'a manqué hier. Quand on supprime ainsi à l’esprit son aliment, on devrait supprimer aussi l'esprit lui-même. Cela se fera peu à peu.
J’ai eu hier une longue lettre de Barante qui prévoit ce résultat, car il me dit : " Lorsqu'on ne s’intéresse pas à soi-même on est indifférent à tout ; l’esprit s'éteint quand les sentiments sont glacés ! "
Il m’écrit du Mont Dore, où il est allé pour ne pas être repris l’hiver prochain de son extinction de voix.
Jeudi 5 Août
Je n’ai pas fait partir hier cette page qui n'en valait pas la peine. Vous ne m’avez pas écrit non plus. J’espère bien que ce n’est pas quelque mauvaise raison, accident ou autre. Je n'ai pas plus de nouvelles aujourd’hui qu’hier.
Mon fils, m'en apportera peut-être quelqu’une demain il est allé passer 48 heures à Paris pour un examen. Mes Anglais arrivent aussi demain.
Je vois que les élections des conseils généraux sont ce que j’attendais, ou immense majorité ministérielle c’est-à-dire présidentielle. Il me semble aussi que les pétitions impériales commencent à circuler. On m'écrit que les exilés espèrent quelque chose, du 15 Août. Ceux d’entre eux qui sont petits et modestes accepteraient volontiers l'Empire, s’il devait les faire rentrer. Que feraient les autres, Thiers, Rémusat, les généraux ? Il ne serait pas glorieux, pour eux de rentrer au milieu des Vive l'Empereur ! Ils rentreraient pourtant, s’il le leur permettait.
Avez-vous lu, dans le Galignani du 3 un article curieux du correspondant américain du Times sur Kossuth ? Il fera plaisir à Hübner.
11 heures
Voilà une lettre qui ne me plaît pas. Vous vous faites vous-même bien plus de mal que vous n'en avez. C'est singulier d'avoir l’esprit si juste, si ferme sur toutes choses, excepté sur soi-même. Je suis bien fâché de n'être plus là. Adieu, adieu. Merci de la lettre de Beauvale. Merci pour vous et pour Aggy. G.
Paris, Lundi 20 octobre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris le 20 octobre 1851
Le Président a dit avant hier que rien ne serait changé à sa politique. L’Europe peut être tranquille sur ce point. Il n'a jamais accepté pour son compte le 31 Mai. Il veut être réélu comme il a été élu. Il le sera. Il restera là où il est. Les vieux temps & les vieux hommes sont passés. Il a beaucoup réfléchi à tout cela, et il a le pays avec lui. Il est fort indifférent à ce que fera, ou ne fera pas l’Assemblée. Son entourage tient un langage très vif, les autres ont plus à perdre que nous. Ils ont des terres, des maisons des familles. Nous sommes indépendants de tous ces biens. Nous irons résolument au but et au bout. Cela sent un peu le brigand, c’est égal.
Hier soir [Hecheren] se croyait sur que Billault entrait que le général [Bourjolis] serait [Ministre] des Affaires étrangères. Saint-Arnaud à la guerre. Ducos je ne sais quoi. Il croyait aussi que Fould resterait. Cela je ne le crois pas du tout. Il faudrait pour cela que le Président se prêtât à une modification de la loi du 31 Mai.
J'ai revu hier soir le brave Lahitte, & cela m’a fait grand plaisir. Le Président rentre à l'Elysée. Samedi J’ai vu assez de monde hier point d’hommes politiques. Thiers a été si effrayé pendant 3 jours, qu’il en a été malade et ses accidents d’aphtes lui sont revenus. On dit beaucoup qui Carlier l’avait prévenu lui & Changarnier qu’ils seraient arrêtés.
Hier [Heseren] disait que le Président ne demandait pas mieux que d’être mis en accusation, alors il ira de l’avant. Je cite [Hesseren] parce qu'il voit dit-on le président tous les jours. Il a beaucoup d’esprit.
Il y aura consultation pour moi aujourd’hui. Il y a de quoi. Je suis toute jaune & tirée.
Samedi
J'avais une loge aux italiens. Je n’ai pas eu le courage ni l’envie d'y aller. Adieu. Adieu.
Vitet a été très frappé de ce que vous me dites du travail légitimiste contre vous. Je verrai le duc de Noailles aujourd’hui je lui en parlerai. Le comte Buol va arriver ici de Londres aussitôt que Kossuth y paraîtra. Hubner m'a dit qui si la princesse Grasalcovitz se permettait le moindre propos factieux, l'Empereur lui ordonnerait sur le champ de revenir en Hongrie. On est là très sévère. Le corps diplomatique blâme toujours ceci, & attend sans curiosité les nouveaux Ministres. On dit beaucoup que ce ne se sera qu’un relais, & que la troupe dorée est derrière. Montebello est revenu. Sa femme va mieux.
Le Président a dit avant hier que rien ne serait changé à sa politique. L’Europe peut être tranquille sur ce point. Il n'a jamais accepté pour son compte le 31 Mai. Il veut être réélu comme il a été élu. Il le sera. Il restera là où il est. Les vieux temps & les vieux hommes sont passés. Il a beaucoup réfléchi à tout cela, et il a le pays avec lui. Il est fort indifférent à ce que fera, ou ne fera pas l’Assemblée. Son entourage tient un langage très vif, les autres ont plus à perdre que nous. Ils ont des terres, des maisons des familles. Nous sommes indépendants de tous ces biens. Nous irons résolument au but et au bout. Cela sent un peu le brigand, c’est égal.
Hier soir [Hecheren] se croyait sur que Billault entrait que le général [Bourjolis] serait [Ministre] des Affaires étrangères. Saint-Arnaud à la guerre. Ducos je ne sais quoi. Il croyait aussi que Fould resterait. Cela je ne le crois pas du tout. Il faudrait pour cela que le Président se prêtât à une modification de la loi du 31 Mai.
J'ai revu hier soir le brave Lahitte, & cela m’a fait grand plaisir. Le Président rentre à l'Elysée. Samedi J’ai vu assez de monde hier point d’hommes politiques. Thiers a été si effrayé pendant 3 jours, qu’il en a été malade et ses accidents d’aphtes lui sont revenus. On dit beaucoup qui Carlier l’avait prévenu lui & Changarnier qu’ils seraient arrêtés.
Hier [Heseren] disait que le Président ne demandait pas mieux que d’être mis en accusation, alors il ira de l’avant. Je cite [Hesseren] parce qu'il voit dit-on le président tous les jours. Il a beaucoup d’esprit.
Il y aura consultation pour moi aujourd’hui. Il y a de quoi. Je suis toute jaune & tirée.
Samedi
J'avais une loge aux italiens. Je n’ai pas eu le courage ni l’envie d'y aller. Adieu. Adieu.
Vitet a été très frappé de ce que vous me dites du travail légitimiste contre vous. Je verrai le duc de Noailles aujourd’hui je lui en parlerai. Le comte Buol va arriver ici de Londres aussitôt que Kossuth y paraîtra. Hubner m'a dit qui si la princesse Grasalcovitz se permettait le moindre propos factieux, l'Empereur lui ordonnerait sur le champ de revenir en Hongrie. On est là très sévère. Le corps diplomatique blâme toujours ceci, & attend sans curiosité les nouveaux Ministres. On dit beaucoup que ce ne se sera qu’un relais, & que la troupe dorée est derrière. Montebello est revenu. Sa femme va mieux.
Val-Richer, Dimanche 19 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 19 Oct. 1851
Mes visiteurs d'hier étaient assez curieux à observer. A peu près tous des Elyséens sensés. Il sont tristes et déconcertés de ce qui se passe, mais pas troublés au point de croire leur partie perdue, et de renoncer. Ils disent que le Président n'ira pas jusqu'au bout, qu’il s’arrêtera ou qu’il reviendra à temps, qu'il n'abandonnera pas définitivement le parti de l’ordre, qu'il est encore la meilleure garantie de l’ordre, &. Ils ajoutent que tous des mouvements parlementaires restent inconnus ou indifférents à la masse des paysans qui sont toujours décidés à voter pour Louis Napoléon que la candidature du Prince de Joinville ne gagne ici point de terrain, plutôt le contraire, deux choses seulement les ébranleraient tout-à-fait ; si le président. prenait décidément ses ministres et la politique à l'entrée de la Montagne, obligeant ainsi le parti de l’ordre en masse à devenir opposition ; si des lois pénales étaient rendues dans l'Assemblée contre la réélection du Président. Ceci pénétrerait jusqu'aux paysans et arrêterait beaucoup de votes. Dans cette hypothèse, à laquelle ils ne croient pas, quelques uns vont au Prince de Joinville. D'autres, les plus intelligents pensent à Changamier, beaucoup disent que le Président des rouges l'emporterait et ont peur.
Sur la loi du 31 mai, à peu près tous désirent les modifications dont il était question avant la crise et blâment beaucoup le Président de ne s'en être pas contenté. Voilà mes observations. Décidément ce pays-ci est sensé. Si toute la France, lui ressemblait, il n’y aurait pas grand chose à craindre. On dit cependant que le département de La Manche se gâte un peu. Toujours, dans la masse des paysans même méfiance et même antipathie envers les légitimistes.
Je regrette que Kisseleff n'ait pas dîné à St. Cloud avec les dames Russes. Il est bon observateur. Je suis curieux de savoir jusqu'à quel point le Président est confiant ou troublé.
Pendant que nous remettons ici tout en question, l'Europe est tranquille et se reconstitue. Je suis frappé du contraste. Quand l’Assemblée sera réunie, on devrait bien faire ressortir ce fait pour faire sentir à la France sa jolie et poser sur les honnêtes gens. Si le Président. changeait réellement de politique, l’armée Française quitterait Rome, et ce serait un petit ébranlement. Mais l’Autrichienne y entrevoit tout de suite. Je ne crois pas aux Italiens. Pourtant il y a encore là des volcans et des tremblements de terre.
A propos d'Italiens, avez-vous été à leur rentrée ? Je n'ai pas regardé dans les journaux si elle avait été brillante. Cela ne vous fera-t-il pas coucher trop tard le samedi, veille du Dimanche ?
Onze heures
Mes impressions d’ici ne sont pas en désaccord avec ce que dit M. Fould de la confiance du Président. Quand l'Assemblée sera là, ce sera autre chose. On a beau en mal parler. Sa présence réelle agit et sur le public, et sur le président lui-même. Nous verrons. Adieu, adieu. G.
Mes visiteurs d'hier étaient assez curieux à observer. A peu près tous des Elyséens sensés. Il sont tristes et déconcertés de ce qui se passe, mais pas troublés au point de croire leur partie perdue, et de renoncer. Ils disent que le Président n'ira pas jusqu'au bout, qu’il s’arrêtera ou qu’il reviendra à temps, qu'il n'abandonnera pas définitivement le parti de l’ordre, qu'il est encore la meilleure garantie de l’ordre, &. Ils ajoutent que tous des mouvements parlementaires restent inconnus ou indifférents à la masse des paysans qui sont toujours décidés à voter pour Louis Napoléon que la candidature du Prince de Joinville ne gagne ici point de terrain, plutôt le contraire, deux choses seulement les ébranleraient tout-à-fait ; si le président. prenait décidément ses ministres et la politique à l'entrée de la Montagne, obligeant ainsi le parti de l’ordre en masse à devenir opposition ; si des lois pénales étaient rendues dans l'Assemblée contre la réélection du Président. Ceci pénétrerait jusqu'aux paysans et arrêterait beaucoup de votes. Dans cette hypothèse, à laquelle ils ne croient pas, quelques uns vont au Prince de Joinville. D'autres, les plus intelligents pensent à Changamier, beaucoup disent que le Président des rouges l'emporterait et ont peur.
Sur la loi du 31 mai, à peu près tous désirent les modifications dont il était question avant la crise et blâment beaucoup le Président de ne s'en être pas contenté. Voilà mes observations. Décidément ce pays-ci est sensé. Si toute la France, lui ressemblait, il n’y aurait pas grand chose à craindre. On dit cependant que le département de La Manche se gâte un peu. Toujours, dans la masse des paysans même méfiance et même antipathie envers les légitimistes.
Je regrette que Kisseleff n'ait pas dîné à St. Cloud avec les dames Russes. Il est bon observateur. Je suis curieux de savoir jusqu'à quel point le Président est confiant ou troublé.
Pendant que nous remettons ici tout en question, l'Europe est tranquille et se reconstitue. Je suis frappé du contraste. Quand l’Assemblée sera réunie, on devrait bien faire ressortir ce fait pour faire sentir à la France sa jolie et poser sur les honnêtes gens. Si le Président. changeait réellement de politique, l’armée Française quitterait Rome, et ce serait un petit ébranlement. Mais l’Autrichienne y entrevoit tout de suite. Je ne crois pas aux Italiens. Pourtant il y a encore là des volcans et des tremblements de terre.
A propos d'Italiens, avez-vous été à leur rentrée ? Je n'ai pas regardé dans les journaux si elle avait été brillante. Cela ne vous fera-t-il pas coucher trop tard le samedi, veille du Dimanche ?
Onze heures
Mes impressions d’ici ne sont pas en désaccord avec ce que dit M. Fould de la confiance du Président. Quand l'Assemblée sera là, ce sera autre chose. On a beau en mal parler. Sa présence réelle agit et sur le public, et sur le président lui-même. Nous verrons. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 8 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 8 Oct. 1851
Avez-vous remarqué, il y a deux jours dans les Débats un article de John Lemoinne sur Pacifico et Lord Palmerston ? La moquerie était bonne et poignante. Il est vrai qu’il y avait de quoi. Les Anglais seuls ont le talent d’être à la fois puissants et ridicules. Malgré ses éloges pour notre ami, je ne goûte pas beaucoup le discours, de Sir James Graham à Aberdeen. Vide et mou. Des promesses de concessions cachées sous un manteau de conservateur. C'est de là que viennent mes véritables craintes pour l'Angleterre.
Et le manifeste de Kossuth ? Rien ne pouvait donner plus raison à l’interdiction dont il a été l'objet. Un des trois hommes de sens qui, dans le Common Council de la cité, ont voté contre l’accueil solennel préparé pour Kossuth à Londres, devrait demander quand il y arrivera, la lecture publique de cette sotte déclaration. J’ai peine à croire que le bon sens Anglais n'en fût pas choqué.
Ma feuille jaune raconte tous les embarras de Changarnier à propos de son messager de l’Assemblée. Je les comprends. Le général approche du pied du mur. Plus j'y regarde, plus je me persuade que sa candidature n’a point de chances. Il aurait fallu, pour la préparer, une tout autre conduite que celle qu’il a tenue et qu’il tient encore.
Vous voyez que, moi aussi, je n’ai rien à vous dire. Je reçois beaucoup de visites locales. On vient me parler des élections. La préoccupation sérieuse commence. Elle ira vite quand les débats de l'assemblée auront recommencé. Je me tiens parfaitement tranquille. Je ne vais nulle part. Guillaume le conquérant seul aura le pouvoir de me faire faire une course dans mes environs. Je ne sais si j’aurai encore, dans ma vie, quelque chose de considérable à faire ; ce que je sais bien c’est qu’il faudra que la circonstance vienne me chercher chez moi.
10 heures
Voilà deux visiteurs qui m’arrivent de Caen, avant le facteur. Je vous dis adieu en hâte. Je ne fermerai pourtant ma lettre qu'après l’arrivée de la poste. Adieu, Adieu. G.
Avez-vous remarqué, il y a deux jours dans les Débats un article de John Lemoinne sur Pacifico et Lord Palmerston ? La moquerie était bonne et poignante. Il est vrai qu’il y avait de quoi. Les Anglais seuls ont le talent d’être à la fois puissants et ridicules. Malgré ses éloges pour notre ami, je ne goûte pas beaucoup le discours, de Sir James Graham à Aberdeen. Vide et mou. Des promesses de concessions cachées sous un manteau de conservateur. C'est de là que viennent mes véritables craintes pour l'Angleterre.
Et le manifeste de Kossuth ? Rien ne pouvait donner plus raison à l’interdiction dont il a été l'objet. Un des trois hommes de sens qui, dans le Common Council de la cité, ont voté contre l’accueil solennel préparé pour Kossuth à Londres, devrait demander quand il y arrivera, la lecture publique de cette sotte déclaration. J’ai peine à croire que le bon sens Anglais n'en fût pas choqué.
Ma feuille jaune raconte tous les embarras de Changarnier à propos de son messager de l’Assemblée. Je les comprends. Le général approche du pied du mur. Plus j'y regarde, plus je me persuade que sa candidature n’a point de chances. Il aurait fallu, pour la préparer, une tout autre conduite que celle qu’il a tenue et qu’il tient encore.
Vous voyez que, moi aussi, je n’ai rien à vous dire. Je reçois beaucoup de visites locales. On vient me parler des élections. La préoccupation sérieuse commence. Elle ira vite quand les débats de l'assemblée auront recommencé. Je me tiens parfaitement tranquille. Je ne vais nulle part. Guillaume le conquérant seul aura le pouvoir de me faire faire une course dans mes environs. Je ne sais si j’aurai encore, dans ma vie, quelque chose de considérable à faire ; ce que je sais bien c’est qu’il faudra que la circonstance vienne me chercher chez moi.
10 heures
Voilà deux visiteurs qui m’arrivent de Caen, avant le facteur. Je vous dis adieu en hâte. Je ne fermerai pourtant ma lettre qu'après l’arrivée de la poste. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 30 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 30 Sept 1851
Ce que vous me dîtes de Mad. Gabriel Delessert m'étonne un peu. Je la croyais bien dans les eaux, sinon de Thiers au moins de M. de Rémusat ; et M. de Rémusat, d'après ce qui me revient est au moins aussi engagé que Thiers dans la candidature Joinville. Il n’y a pas moyen de se faire à présent une idée juste des chances de cette candidature ; trop de mois et trop d'incidents nous séparent des jours de l’épreuve. Si l'élection se faisait à présent, l'échec me paraîtrait certain. Qui sait dans sept mois ?
Entendez-vous mettre quelque importance à ce qui se passe en Belgique ? Il me paraît que le ministère Rogier gagne sa partie et qu’il aura un sénat plus traitable. Cela me semble mauvais. Mais après tout, je n‘ai pas envie que la résistance au mal commence en Belgique ; elle y serait trop aisément battue.
Vous devriez jeter un coup d'oeil sur la brochure de M. de Késatry, dont je trouve des extraits dans les Débats. Cela n'a guère d'autre mérite que celui d’une grande franchise ; mais c’est quelque chose. Le gros public qui m’entoure pense tout ce que dit M. De Késatry.
J’ai eu hier la visite de l'inspecteur des écoles primaires de mon arrondissement. Vous ne devinerez jamais pourquoi je vous en parle. Un homme de 40 ans, d'une assez jolie figure, l'air intelligent, un peu familier, très bavard après m'avoir parlé des écoles : " Jai vécu trois ans à Berlin, Monsieur, dans la maison d’un de vos admirateurs. - Qui donc, Monsieur ? - Chez le Ministre de Russie, M. le Baron de Meyendorff. J’ai achevé l'éducation de ses fils. " - Grands détails sur M. de Meyendorff, sur son esprit, sa prodigieuse instruction, sur son intérieur, sa femme, ses fils. J’ai peine à croire que mon inspecteur ait été là, un bon et convenable précepteur. Il s'appelle M. Lambert. Du reste on m'a dit du bien de lui et il s’acquitte bien, ici, de ses fonctions.
Je continue la lecture du Mémoire napolitain décidément, il a trop longuement raison. Je regrette Montebello pour vous. J'ai bien peur qu’un grand malheur ne l'attende. Il en souffrira beaucoup. Est-ce qu’il va établir sa femme à Tours pour l'hiver ?
Onze heures
Je crois tous les jours un peu moins au coup d'Etat auquel je n'ai jamais cru. Thiers est bien bon de s'amuser à avoir peur de Vincennes. C’est du luxe de peur.
Mes lettres ne m'apprennent rien du tout. J'en reçois une de Montalembert qui s’excuse de n'avoir pas encore terminé son discours, et demande un peu de répit. Ce qu’il voudra Adieu, Adieu. G.
Ce que vous me dîtes de Mad. Gabriel Delessert m'étonne un peu. Je la croyais bien dans les eaux, sinon de Thiers au moins de M. de Rémusat ; et M. de Rémusat, d'après ce qui me revient est au moins aussi engagé que Thiers dans la candidature Joinville. Il n’y a pas moyen de se faire à présent une idée juste des chances de cette candidature ; trop de mois et trop d'incidents nous séparent des jours de l’épreuve. Si l'élection se faisait à présent, l'échec me paraîtrait certain. Qui sait dans sept mois ?
Entendez-vous mettre quelque importance à ce qui se passe en Belgique ? Il me paraît que le ministère Rogier gagne sa partie et qu’il aura un sénat plus traitable. Cela me semble mauvais. Mais après tout, je n‘ai pas envie que la résistance au mal commence en Belgique ; elle y serait trop aisément battue.
Vous devriez jeter un coup d'oeil sur la brochure de M. de Késatry, dont je trouve des extraits dans les Débats. Cela n'a guère d'autre mérite que celui d’une grande franchise ; mais c’est quelque chose. Le gros public qui m’entoure pense tout ce que dit M. De Késatry.
J’ai eu hier la visite de l'inspecteur des écoles primaires de mon arrondissement. Vous ne devinerez jamais pourquoi je vous en parle. Un homme de 40 ans, d'une assez jolie figure, l'air intelligent, un peu familier, très bavard après m'avoir parlé des écoles : " Jai vécu trois ans à Berlin, Monsieur, dans la maison d’un de vos admirateurs. - Qui donc, Monsieur ? - Chez le Ministre de Russie, M. le Baron de Meyendorff. J’ai achevé l'éducation de ses fils. " - Grands détails sur M. de Meyendorff, sur son esprit, sa prodigieuse instruction, sur son intérieur, sa femme, ses fils. J’ai peine à croire que mon inspecteur ait été là, un bon et convenable précepteur. Il s'appelle M. Lambert. Du reste on m'a dit du bien de lui et il s’acquitte bien, ici, de ses fonctions.
Je continue la lecture du Mémoire napolitain décidément, il a trop longuement raison. Je regrette Montebello pour vous. J'ai bien peur qu’un grand malheur ne l'attende. Il en souffrira beaucoup. Est-ce qu’il va établir sa femme à Tours pour l'hiver ?
Onze heures
Je crois tous les jours un peu moins au coup d'Etat auquel je n'ai jamais cru. Thiers est bien bon de s'amuser à avoir peur de Vincennes. C’est du luxe de peur.
Mes lettres ne m'apprennent rien du tout. J'en reçois une de Montalembert qui s’excuse de n'avoir pas encore terminé son discours, et demande un peu de répit. Ce qu’il voudra Adieu, Adieu. G.
Paris, Mardi 23 septembre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris le 23 septembre 1851 Mardi
Personne ne sait me donner des nouvelles de M. de Montalembert. En sortant tantôt je passerai moi-même à sa porte pour m'en enquérir. Je ne pourrai vous mandez que demain si j’ai fait quelque découverte. M. Carlier a dit hier matin à un diplomate. " Nous allons bien mal. Si nous avions de nouvelles élections nous serions perdus. " Textuel. l’inquiétude commence à devenir générale. Qu’est-ce que ce sera vers Novembre ?
Jai vu hier soir [Glucesberg] entre autre. Son père est convalescent ils ne sont plus inquiets. On me dit que Thiers est engraissé et de très bonne, humeur. Boutonné quant à la candidature Joinville. Pas d’opinion. Il a passé chez moi hier, sans en trouver. M. Pougoulat /je crois que je dis bien / votera pour la rentrée. des Princes. On dit qu’une grande partie des Légitimistes fera comme lui. Le sort de cette cette proposition est fort douteux et le temps qui coule est à l’avantage de Joinville. Peut-on courir ce risque-là ? Mais les grands hommes se proclament / il n'y a que le petit homme qui soit ici, & il ne perd pas son temps. Dumon était noir hier. Adieu. Adieu.
Personne ne sait me donner des nouvelles de M. de Montalembert. En sortant tantôt je passerai moi-même à sa porte pour m'en enquérir. Je ne pourrai vous mandez que demain si j’ai fait quelque découverte. M. Carlier a dit hier matin à un diplomate. " Nous allons bien mal. Si nous avions de nouvelles élections nous serions perdus. " Textuel. l’inquiétude commence à devenir générale. Qu’est-ce que ce sera vers Novembre ?
Jai vu hier soir [Glucesberg] entre autre. Son père est convalescent ils ne sont plus inquiets. On me dit que Thiers est engraissé et de très bonne, humeur. Boutonné quant à la candidature Joinville. Pas d’opinion. Il a passé chez moi hier, sans en trouver. M. Pougoulat /je crois que je dis bien / votera pour la rentrée. des Princes. On dit qu’une grande partie des Légitimistes fera comme lui. Le sort de cette cette proposition est fort douteux et le temps qui coule est à l’avantage de Joinville. Peut-on courir ce risque-là ? Mais les grands hommes se proclament / il n'y a que le petit homme qui soit ici, & il ne perd pas son temps. Dumon était noir hier. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Dimanche 14 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 14 sept. 1851
Ce que vous me dîtes du petit orage contre les Lettres du Times ne me surprend pas du tout. On veut le but ; mais on ne veut ni prendre la peine, ni courir le risque des moyens. Et dès qu’on découvre dans les moyens quelque imperfection un côté faible, on s'y rue et on s'enfuit par là, pour échapper à toute responsabilité. Les hommes ne sont ni plus conséquents, ni plus braves que cela ; je le sais depuis longtemps. Avant d'aller à Claremont, j'ai dit tout haut à bien des gens ce que j’y voulais dire. Quand je me suis trouvé dans le salon de la Reine, j'ai dit en grande partie, tout haut ce que j’avais dit que j’y dirais. Après en être sorti, j'ai redit tout haut, à bien des gens, ce que j'y avais dit. Quoi d'étonnant que tout cela se retrouve dans les lettres du correspondant du Times ? Je ne réponds pas des erreurs des confusions et des inconvenances qui s’y trouvent mêlées, et je ne regrette pas la publicité que reçoit ainsi ce qu’il y a de vrai, car je l'ai voulue. Pour mon propre honneur et pour le succès de la bonne cause qui a besoin qu'on fasse échouer la mauvaise. Voilà mon langage. Je n'en sortirai pas.
Je m'étonne aussi que le Duc de Noailles ne soit pas venu vous voir. On a raison de faire venir M. de Falloux. Soit dans l’intérieur du parti, soit dans ses relations extérieures, on ne peut pas se passer de lui. C’est bien dommage qu’il soit d’une si mauvaise santé.
Autre étonnement, c’est le gouvernement anglais donnant raison aux Américains à propos de Cuba. Valdegamas en est-il bien sûr ? La lettre d'Isturitz au Times m’a tout l’air au contraire d'être concertée avec Lord Palmerston. Si Valdegamas a raison, c’est certainement une grande hypocrisie et une grande platitude de Palmerston envers les Américains. Il ne veut pas contrarier là, le sentiment populaire et il n'agira en faveur de l’Espagne, que sous main. Les Etats-Unis sont une bien grande Puissance
Il faut que la garçonnade soit bien inhérente aux Français, car tous les partis en France, grands ou petits ont leur Gascon, qui même est quelquefois leur héros. M. de La Rochejaquelein est certainement le premier de tous. On me dit ici que sa réélection comme député, dans son département du Morbihan, n'est pas du tout certaine. Je serais bien surpris si, pour être président, il avait dans toute la France, 50,000 voix. Je ne sais rien d'une entrevue de Morny avec Mallac. Je n’y crois pas.
11 heures
Je suis charmé que vous ayez un peu mieux dormi. Adieu, Adieu. G.
Ce que vous me dîtes du petit orage contre les Lettres du Times ne me surprend pas du tout. On veut le but ; mais on ne veut ni prendre la peine, ni courir le risque des moyens. Et dès qu’on découvre dans les moyens quelque imperfection un côté faible, on s'y rue et on s'enfuit par là, pour échapper à toute responsabilité. Les hommes ne sont ni plus conséquents, ni plus braves que cela ; je le sais depuis longtemps. Avant d'aller à Claremont, j'ai dit tout haut à bien des gens ce que j’y voulais dire. Quand je me suis trouvé dans le salon de la Reine, j'ai dit en grande partie, tout haut ce que j’avais dit que j’y dirais. Après en être sorti, j'ai redit tout haut, à bien des gens, ce que j'y avais dit. Quoi d'étonnant que tout cela se retrouve dans les lettres du correspondant du Times ? Je ne réponds pas des erreurs des confusions et des inconvenances qui s’y trouvent mêlées, et je ne regrette pas la publicité que reçoit ainsi ce qu’il y a de vrai, car je l'ai voulue. Pour mon propre honneur et pour le succès de la bonne cause qui a besoin qu'on fasse échouer la mauvaise. Voilà mon langage. Je n'en sortirai pas.
Je m'étonne aussi que le Duc de Noailles ne soit pas venu vous voir. On a raison de faire venir M. de Falloux. Soit dans l’intérieur du parti, soit dans ses relations extérieures, on ne peut pas se passer de lui. C’est bien dommage qu’il soit d’une si mauvaise santé.
Autre étonnement, c’est le gouvernement anglais donnant raison aux Américains à propos de Cuba. Valdegamas en est-il bien sûr ? La lettre d'Isturitz au Times m’a tout l’air au contraire d'être concertée avec Lord Palmerston. Si Valdegamas a raison, c’est certainement une grande hypocrisie et une grande platitude de Palmerston envers les Américains. Il ne veut pas contrarier là, le sentiment populaire et il n'agira en faveur de l’Espagne, que sous main. Les Etats-Unis sont une bien grande Puissance
Il faut que la garçonnade soit bien inhérente aux Français, car tous les partis en France, grands ou petits ont leur Gascon, qui même est quelquefois leur héros. M. de La Rochejaquelein est certainement le premier de tous. On me dit ici que sa réélection comme député, dans son département du Morbihan, n'est pas du tout certaine. Je serais bien surpris si, pour être président, il avait dans toute la France, 50,000 voix. Je ne sais rien d'une entrevue de Morny avec Mallac. Je n’y crois pas.
11 heures
Je suis charmé que vous ayez un peu mieux dormi. Adieu, Adieu. G.
Paris, Samedi 13 septembre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris le 13 septembre 1851
Le duc de Noailles est venu hier matin. Il ressemble parfaitement au duc de Broglie. “c'en est fait de la France. Nous périssons, seulement j’aime mieux périr avec le Président qu’avec le prince de Join ville " Voilà toute sa politique. On fait venir M. de Falloux. C'est l'homme utile & convenable si l’on peut faire quelque chose. Mais rien ne pourra être fait que lorsqu'on aura vraiment peur. Peur à l’Elysée, puis dans le camps légitimiste. Ce moment sera la proposition Creton. Si elle passe, ou alors les légitimistes se déclarent. Berryer passe à l’Elysée & dira pourquoi. Mais il faut que l’Elysée prenne en retour des engagements. Si la proposition est rejetée ou écartée, on restera comme on est. Des bruits de coup d’état ont circulé dans la journée. Cela vient de quelques déplacements de régiments. Mad. Royer qui est venue voir Marion était toute pleine de cela.
Le soir Dumon, Kisseleff, Antonini, Mercier. Rien de neuf. Marion me quitte aujourd’hui pour huit jours. D'abord chez les Royer & puis à Ferrières. J'ai un peu dormi cette nuit, mais cela ne va pas encore. Adieu. Adieu. C’est drôle, Barante.
Le duc de Noailles est venu hier matin. Il ressemble parfaitement au duc de Broglie. “c'en est fait de la France. Nous périssons, seulement j’aime mieux périr avec le Président qu’avec le prince de Join ville " Voilà toute sa politique. On fait venir M. de Falloux. C'est l'homme utile & convenable si l’on peut faire quelque chose. Mais rien ne pourra être fait que lorsqu'on aura vraiment peur. Peur à l’Elysée, puis dans le camps légitimiste. Ce moment sera la proposition Creton. Si elle passe, ou alors les légitimistes se déclarent. Berryer passe à l’Elysée & dira pourquoi. Mais il faut que l’Elysée prenne en retour des engagements. Si la proposition est rejetée ou écartée, on restera comme on est. Des bruits de coup d’état ont circulé dans la journée. Cela vient de quelques déplacements de régiments. Mad. Royer qui est venue voir Marion était toute pleine de cela.
Le soir Dumon, Kisseleff, Antonini, Mercier. Rien de neuf. Marion me quitte aujourd’hui pour huit jours. D'abord chez les Royer & puis à Ferrières. J'ai un peu dormi cette nuit, mais cela ne va pas encore. Adieu. Adieu. C’est drôle, Barante.
Paris, Vendredi 12 septembre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris vendredi le 12 septembre 1851
Saint-Aulaire est venu hier & Vitet & Montebello, voilà pour la matinée. Le soir je n’ai vu qu’Antonini tout seul. J’expédie d'abord celui-ci. Valdegamas avait dîné chez lui se louant extrêmement du gouvernement français qui met la flotte des Antilles aux ordres des gouverneurs de Cuba. Tandis que le gouvernement Anglais donne raison aux américains. Morny aurait eu une entrevue avec Mallat. Est-ce vrai ?
Ce que je sais c’est que Morny est à la chasse. Vitet était bien sombre. Si on ne convient de rien avant l'Assemblée, la gauche proposera les loix pénales contre les votes illégaux & il sera bien difficile de s'opposer. Changarnier pousser à ce vote tant qu’il peut. Comment entre l'Elysée & les légitimistes n’'y a t il pas quelque rapprochement ? Si cela était, tout pourrait aller. Je suis étonnée que le duc de Noailles ne soit pas venu me voir hier. Il passait la matinée en ville. J'ai oublié de vous dire qu'on a envoyé chercher Falloux. C'est Berryer qui me l’a dit. Montebello serait bien d'avis qu'on s’arrangeât avec le président. Saint-Aulaire croit savoir que le duc de Broglie est en grave blâme des lettres dans le Times. C'est un peu l’opinion de tout le monde. Barante dit que son département est très Joinvilliste.
Vous avez là tous les commérages que je sais. Marion a dîné hier chez Salomon Rothschild en famille avec Changarnier. Mad. (James] seule manquait elle est à [Ferrières]. Changarnier folâtre et disant à Marion qu’elle avait eu tort de nous quitter avant hier. Il n'a de secret pour personne. Sa politique est la plus nette dégagée de tout image. Il est monarchien, & veut un Roi. Il n’a pas dit lequel. Le ton de la maison était hostile à l’Elysée. La Rochejaquelein disait hier à Montebello que sa candidature, qu'il avait traité lui-même de plaisanterie devenait très sérieuse, & qu'il avait déjà au-delà de 600 m. voix ! Le duc de Lévis parle très mal de tout projet de rapprochement avec l’Elysée. Marion a vu hier matin M. Royer, très animé et se moquant beaucoup de Changarnier.
Mes nuits continuent à être mauvaises. Je n'ai pas à me plaindre d’autre chose. C'est bien assez. Le Prince Metternich trouve comme moi la lettre d'Aberdeen pitoyable. Marion est convaincu que Gladstone et peut-être même notre ami n'ont pas été fâché de se réhabiliter auprès des libéraux et de reprendre un peu de la popularité que leur avait fait perdre leur vote sur le bill Catholique. Elle pourrait bien avoir raison. Ma lettre est une vraie mosaïque on m’interrompt. Joaillier & tapissier. Je suis embarquée pour ma chambre à coucher. Il faut aller. Mais j’arrête pour les autres. On m’interrompt. Adieu. Adieu.
Saint-Aulaire est venu hier & Vitet & Montebello, voilà pour la matinée. Le soir je n’ai vu qu’Antonini tout seul. J’expédie d'abord celui-ci. Valdegamas avait dîné chez lui se louant extrêmement du gouvernement français qui met la flotte des Antilles aux ordres des gouverneurs de Cuba. Tandis que le gouvernement Anglais donne raison aux américains. Morny aurait eu une entrevue avec Mallat. Est-ce vrai ?
Ce que je sais c’est que Morny est à la chasse. Vitet était bien sombre. Si on ne convient de rien avant l'Assemblée, la gauche proposera les loix pénales contre les votes illégaux & il sera bien difficile de s'opposer. Changarnier pousser à ce vote tant qu’il peut. Comment entre l'Elysée & les légitimistes n’'y a t il pas quelque rapprochement ? Si cela était, tout pourrait aller. Je suis étonnée que le duc de Noailles ne soit pas venu me voir hier. Il passait la matinée en ville. J'ai oublié de vous dire qu'on a envoyé chercher Falloux. C'est Berryer qui me l’a dit. Montebello serait bien d'avis qu'on s’arrangeât avec le président. Saint-Aulaire croit savoir que le duc de Broglie est en grave blâme des lettres dans le Times. C'est un peu l’opinion de tout le monde. Barante dit que son département est très Joinvilliste.
Vous avez là tous les commérages que je sais. Marion a dîné hier chez Salomon Rothschild en famille avec Changarnier. Mad. (James] seule manquait elle est à [Ferrières]. Changarnier folâtre et disant à Marion qu’elle avait eu tort de nous quitter avant hier. Il n'a de secret pour personne. Sa politique est la plus nette dégagée de tout image. Il est monarchien, & veut un Roi. Il n’a pas dit lequel. Le ton de la maison était hostile à l’Elysée. La Rochejaquelein disait hier à Montebello que sa candidature, qu'il avait traité lui-même de plaisanterie devenait très sérieuse, & qu'il avait déjà au-delà de 600 m. voix ! Le duc de Lévis parle très mal de tout projet de rapprochement avec l’Elysée. Marion a vu hier matin M. Royer, très animé et se moquant beaucoup de Changarnier.
Mes nuits continuent à être mauvaises. Je n'ai pas à me plaindre d’autre chose. C'est bien assez. Le Prince Metternich trouve comme moi la lettre d'Aberdeen pitoyable. Marion est convaincu que Gladstone et peut-être même notre ami n'ont pas été fâché de se réhabiliter auprès des libéraux et de reprendre un peu de la popularité que leur avait fait perdre leur vote sur le bill Catholique. Elle pourrait bien avoir raison. Ma lettre est une vraie mosaïque on m’interrompt. Joaillier & tapissier. Je suis embarquée pour ma chambre à coucher. Il faut aller. Mais j’arrête pour les autres. On m’interrompt. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Jeudi 11 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 11 Sept 1851
J'ai passé hier ma matinée à Lisieux. 26 visites ! à la vérité, je n'en ai trouvé que six. Dans les villes de province comme à Paris la société est dispersée et court les champs. Ce n'est pas la peine de vous redire mes observations sur l'état des esprits. Je n’ai rien entendu de nouveau. J'arrive toujours à la même conclusion ; s'il ne survient point d'événement qui dérange la pente des choses, on élira une assemblée plus présidentielle que celle-ci, et puis on réélira le Président, dans la confiance que l'Assemblée couvrira l’inconstitutionnalité de sa ratification. Toutes les autres combinaisons, toutes les autres. prétentions sont en dehors du sentiment national. Il est vrai que, dans mon pauvre pays le sentiment national est bien souvent bafoué et foulé aux pieds. Il se venge ; mais cela ne le sauve pas.
Je travaille beaucoup. J'écris ma politique personnelle ; ce que j’ai cherché pour mon pays ; fragment de Mémoires personnels. Je veux avoir cela tout prêt, pour le publier au moment qui me conviendra. C’est un grand amusement et ce peut être un grand intérêt pour moi. Je crois que cela vous intéressera aussi. On peut très bien trouver la garantie qu’on cherche pour Changarnier. Je suis moins sûr, qu'elle lui convienne quand on l’aura trouvée.
Si Thiers va à Londres, c'est pour faire cesser les hésitations qui existent encore là, qui ont même augmenté, je crois, dans ces derniers temps, et qui empêchent toute conduite positive et publique. Or il n’y a que les conduites positives et publiques qui réussissent. Thiers ira quand le Duc d’Aumale y sera arrivé, pour être de la délibération de famille. Je ne crois pas qu'on lui résiste. Il fera adopter le plan de campagne qu’il proposera. Quel sera ce plan. C'est ce qu’il faudra savoir le plus tôt possible. Il y en avait eu un premier qui a été fort dérangé. Nous verrons ce qui adviendra du second.
Est-ce que personne à votre connaissance, ne parle d'aller aussi voir Madame la Duchesse d'Orléans à Eisenach ? Je n’entends plus parler du tout de Piscatory. Il ne m’a pas écrit depuis que je suis ici. J'en saurai peut-être quelque chose à Broglie. En tout cas je romprais moi-même le silence. Je ne veux, ni me brouiller avec un ami, ni me laisser boucher une fenêtre sur le camp ennemi. Avez-vous quelque certitude qu’il est en correspondance avec la Duchesse de Talleyrand ? Cela vaut la peine de le savoir sûrement. Je m'étonnerais que de la part de Palmerston, cette correspondance eût recommencé sans quelque intention. Il a à la fois beaucoup de premier mouvement et beaucoup de calcul. Et il peut avoir envie de s’entrouvrir, en tous sens des portes.
11 heures
Merci de votre longue lettre. Je vous remercierai bien plus encore quand vous me direz que vous vous sentez mieux. Voilà des visiteurs de Trouville qui viennent me demander à déjeuner. Hippolyte de La Rochefoucauld et cinq ou six Mallet, Labouchère & Adieu, Adieu. G.
J'ai passé hier ma matinée à Lisieux. 26 visites ! à la vérité, je n'en ai trouvé que six. Dans les villes de province comme à Paris la société est dispersée et court les champs. Ce n'est pas la peine de vous redire mes observations sur l'état des esprits. Je n’ai rien entendu de nouveau. J'arrive toujours à la même conclusion ; s'il ne survient point d'événement qui dérange la pente des choses, on élira une assemblée plus présidentielle que celle-ci, et puis on réélira le Président, dans la confiance que l'Assemblée couvrira l’inconstitutionnalité de sa ratification. Toutes les autres combinaisons, toutes les autres. prétentions sont en dehors du sentiment national. Il est vrai que, dans mon pauvre pays le sentiment national est bien souvent bafoué et foulé aux pieds. Il se venge ; mais cela ne le sauve pas.
Je travaille beaucoup. J'écris ma politique personnelle ; ce que j’ai cherché pour mon pays ; fragment de Mémoires personnels. Je veux avoir cela tout prêt, pour le publier au moment qui me conviendra. C’est un grand amusement et ce peut être un grand intérêt pour moi. Je crois que cela vous intéressera aussi. On peut très bien trouver la garantie qu’on cherche pour Changarnier. Je suis moins sûr, qu'elle lui convienne quand on l’aura trouvée.
Si Thiers va à Londres, c'est pour faire cesser les hésitations qui existent encore là, qui ont même augmenté, je crois, dans ces derniers temps, et qui empêchent toute conduite positive et publique. Or il n’y a que les conduites positives et publiques qui réussissent. Thiers ira quand le Duc d’Aumale y sera arrivé, pour être de la délibération de famille. Je ne crois pas qu'on lui résiste. Il fera adopter le plan de campagne qu’il proposera. Quel sera ce plan. C'est ce qu’il faudra savoir le plus tôt possible. Il y en avait eu un premier qui a été fort dérangé. Nous verrons ce qui adviendra du second.
Est-ce que personne à votre connaissance, ne parle d'aller aussi voir Madame la Duchesse d'Orléans à Eisenach ? Je n’entends plus parler du tout de Piscatory. Il ne m’a pas écrit depuis que je suis ici. J'en saurai peut-être quelque chose à Broglie. En tout cas je romprais moi-même le silence. Je ne veux, ni me brouiller avec un ami, ni me laisser boucher une fenêtre sur le camp ennemi. Avez-vous quelque certitude qu’il est en correspondance avec la Duchesse de Talleyrand ? Cela vaut la peine de le savoir sûrement. Je m'étonnerais que de la part de Palmerston, cette correspondance eût recommencé sans quelque intention. Il a à la fois beaucoup de premier mouvement et beaucoup de calcul. Et il peut avoir envie de s’entrouvrir, en tous sens des portes.
11 heures
Merci de votre longue lettre. Je vous remercierai bien plus encore quand vous me direz que vous vous sentez mieux. Voilà des visiteurs de Trouville qui viennent me demander à déjeuner. Hippolyte de La Rochefoucauld et cinq ou six Mallet, Labouchère & Adieu, Adieu. G.
Paris, Mardi 9 septembre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris le 9 Septembre 1851 Mardi
Thiers est revenu en très belle humeur, il dit que le pays est bien plus démocratique qu’il ne l’avait cru, mais qu'il s'accommoderait très bien de la forme monarchique recouvrant le socialisme. Il va à Londres. Voilà ce qui m’a été dit hier de source à ce qu’il me paraît. Changarnier est bien animé. Plein de professions de dévouement à la bonne cause. Il met toute la gloire à la servir, mais il ne peut pas affecter cela sans compromettre son élection à la présidence sur laquelle il compte, à quoi il travaille, & qui servira au moins à diviser les voix. On veut lui imposer un certain engagement, obtenir quelque garantie, il est prêt à la donner, il faut inventer, chercher. L'Elysée semble disposé à se rapprocher de Molé, on dit même de Changarnier ; je vous redis ce qu'on me dit et tout cela est encore à l’état de symptômes. Je n’ai pas vu Changarnier. J’ai vu hier Mad. Decazes. Elle est convaincu que Joinville sera élu. Elle dit : " Pourquoi pas ? Ceci vaut mieux que 1830. On ne chasse personne. " On fait aujourd’hui l'opération de la peine au Duc Decazes. Il en a fort peur. Lord Granville est ici. Il est venu me voir hier. Spirituel & doux, & ne m’apprenant rien de nouveau.
Je ne me sens toujours pas bien. Pas de sommeil et très nervous. Adieu. Adieu. Adieu.
Thiers est revenu en très belle humeur, il dit que le pays est bien plus démocratique qu’il ne l’avait cru, mais qu'il s'accommoderait très bien de la forme monarchique recouvrant le socialisme. Il va à Londres. Voilà ce qui m’a été dit hier de source à ce qu’il me paraît. Changarnier est bien animé. Plein de professions de dévouement à la bonne cause. Il met toute la gloire à la servir, mais il ne peut pas affecter cela sans compromettre son élection à la présidence sur laquelle il compte, à quoi il travaille, & qui servira au moins à diviser les voix. On veut lui imposer un certain engagement, obtenir quelque garantie, il est prêt à la donner, il faut inventer, chercher. L'Elysée semble disposé à se rapprocher de Molé, on dit même de Changarnier ; je vous redis ce qu'on me dit et tout cela est encore à l’état de symptômes. Je n’ai pas vu Changarnier. J’ai vu hier Mad. Decazes. Elle est convaincu que Joinville sera élu. Elle dit : " Pourquoi pas ? Ceci vaut mieux que 1830. On ne chasse personne. " On fait aujourd’hui l'opération de la peine au Duc Decazes. Il en a fort peur. Lord Granville est ici. Il est venu me voir hier. Spirituel & doux, & ne m’apprenant rien de nouveau.
Je ne me sens toujours pas bien. Pas de sommeil et très nervous. Adieu. Adieu. Adieu.
Paris, Dimanche 7 septembre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris Dimanche le 7 Septembre 1851
Plus j’y pense, plus je suis contente de ce que vous avez fait à Claremont. Comme cela a éclairé la situation ! & puisque vos princes sont de si pauvres gens, tant mieux que cela soit proclamé. Quelle mauvaise race et comme la bonne aura toujours raison de se défier d'eux.
Carlier a dit hier à [Kisseleff] qu'on a saisi surtout des papiers importants. L’affaire n’ira pas devant le jury. Elle sera jugée plus sommairement. La grande chose à présent c’est les élections. On les veut très prochaines. A la question si cela serait encore cette année, il y a eu doute à cause de mouvement de [communes] du nouvel an, mais certainement cela sera au mois de janvier. J’ai vu hier Hatzfeld, Dumon & Kisseleff. J’avais fermé ma porte aux autres. J’étais trop fatiguée. Hatzfeld est d’opinion que les arrestations sont un prélude. Le public ne s’est pas ému le moins du monde. On peut aller de l’avant & de degrés en degrés faire un coup d'Etat qui n’a pas l’inconvénient d’un coup de tonnerre. Je crois qu’on serait fâché à l’Elysée de voir la candidature Joinville tout à fait morte, car elle sert à effrayer les légitimistes et à les rapprocher de l'Elysée. Quant à nous autres nous sommes très décidément pour le Président. Il n'y a pas mieux, il n’y a pas si bien, il n'y a même personne.
Je n'ai plus entendu parler de Morny. La Redorte est parti depuis plusieurs jours. Je n'ai pas encore fait savoir à Changarnier mon retour. Je le ferai demain. Je vous ai dit qu'il va aujourd’hui à Champlatreux avec Montebello. Molé m'écrit pour me presser beaucoup d'aller le voir. J’irai dans la semaine mais pour quelques heures seulement. Comme vous dites bien sur Lamartine ! J'ai un peu dormi cette nuit, pas beaucoup. Adieu. Adieu.
Plus j’y pense, plus je suis contente de ce que vous avez fait à Claremont. Comme cela a éclairé la situation ! & puisque vos princes sont de si pauvres gens, tant mieux que cela soit proclamé. Quelle mauvaise race et comme la bonne aura toujours raison de se défier d'eux.
Carlier a dit hier à [Kisseleff] qu'on a saisi surtout des papiers importants. L’affaire n’ira pas devant le jury. Elle sera jugée plus sommairement. La grande chose à présent c’est les élections. On les veut très prochaines. A la question si cela serait encore cette année, il y a eu doute à cause de mouvement de [communes] du nouvel an, mais certainement cela sera au mois de janvier. J’ai vu hier Hatzfeld, Dumon & Kisseleff. J’avais fermé ma porte aux autres. J’étais trop fatiguée. Hatzfeld est d’opinion que les arrestations sont un prélude. Le public ne s’est pas ému le moins du monde. On peut aller de l’avant & de degrés en degrés faire un coup d'Etat qui n’a pas l’inconvénient d’un coup de tonnerre. Je crois qu’on serait fâché à l’Elysée de voir la candidature Joinville tout à fait morte, car elle sert à effrayer les légitimistes et à les rapprocher de l'Elysée. Quant à nous autres nous sommes très décidément pour le Président. Il n'y a pas mieux, il n’y a pas si bien, il n'y a même personne.
Je n'ai plus entendu parler de Morny. La Redorte est parti depuis plusieurs jours. Je n'ai pas encore fait savoir à Changarnier mon retour. Je le ferai demain. Je vous ai dit qu'il va aujourd’hui à Champlatreux avec Montebello. Molé m'écrit pour me presser beaucoup d'aller le voir. J’irai dans la semaine mais pour quelques heures seulement. Comme vous dites bien sur Lamartine ! J'ai un peu dormi cette nuit, pas beaucoup. Adieu. Adieu.
Paris, Lundi 11 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Paris. Lundi 11 aout 1851
3 heures
Je reviens du grand concours où j’ai été reçu, en entrant dans la salle, plus bruyamment encore que l’an dernier. Et quand mon fils a été nommé, son nom a amené deux fois une nouvelle explosion. Il faut se féliciter de la mobilité de mon pays ; elle le perd et le sauve tour à tour. Ce qui ne veut pas dire que je le croie sauvé parce qu’il recommence à m’applaudir.
J’ai eu du monde constamment, quoiqu’il n’y ait personne ici. Je vous ai déjà dit ce matin, je crois, que j’avais été content hier de la conversation du Duc de Broglie, très content, et pour le fond des choses, et pour sa propre disposition. Il regarde l’union comme très bien établie entre les deux corps d’armée conservateur et légitimiste, et il les croit décidés l’un et l'autre à faire ce qu’il faudra pour la maintenir. Il loue beaucoup Berryer, talent et conduite. Il s'attend, au mois de Novembre, à une majorité, encore insuffisante, pour la révision, mais plus forte. Les conseils généraux et les consuls d’arrondissement seront presque unanimes. Le pétitionnement recommence. On ne veut que des signatures nouvelles. Que résultera-t-il de tout cela au Printemps ? On n'en sait rien. On ne s'inquiète pas de le savoir. On ne s’inquiète que de l'élection de l'Assemblée, très probablement au mois de mars. On l'espère bonne, au moins aussi bonne que celle-ci, et plus décidée. Si on y réussit, on verra après. On aura fait ce qui fera ce qui sera possible.
Le Président se conduit tranquillement, sans autre dessein ni travail que sa réélection. C’est toujours le plus probable. Jusqu'ici le mouvement n’est pas vif pour le Prince de Joinville et lui ne dit ni oui, ni non. L’Elysée parait plutôt content qu'inquiet de cet incident.
Lord Aberdeen m'écrit qu’il part pour l’Ecosse où il me presse fort d'aller. Je n'irai point. Il me dit : " We expect a new reform bill at tre opening, of the next session of Parliament. If Lord Derby at that time should be prepared to abandon his present policy of protection and dear bread, he may very probably be able to oppose Parliamentany Reforme with success. But if not Lord John may carry universal suffrage, if he should think proper. Whatever exertion or sacrifice may be necessary to secure free trade will be cheerfully made."
Nous verrons si l’aristocratie anglaise aura son vieux bon sens. Je trouve que dans ces derniers temps, son bon sens et son énergie ont également faibli. Elle a été plus entêtée que hardie.
Mardi 12
M. Molé est venu hier pendant que je vous écrivais. Il arrivait du Marais. Je le reverrai aujourd’hui avant de partir. Nous aurons notre petite réunion pour les affaires de l'Assemblée nationale. Duchâtel est arrivé aussi hier soir. Kisseleff est venu me voir après Molé. Vous manquez beaucoup à ce monde. Kisseleff dit qu’il use ses redingotes n'ayant plus une occasion de mettre un habit. Molé part samedi pour Champlâtreux, jusqu'au mois de Novembre. Il se promet que vous irez l’y voir.
Changarnier est parti tout de suite pour la Bourgogne ; triste, et commençant à s'apercevoir qu’il n’a pas bien conduit sa barque. Pas la moindre nouvelle d'ailleurs.
Autre visite hier, qui m’a intéressé et plus. Le comte de Thomar que Païva m’a amené. Encore jeune, physionomie spirituelle ; mélange de gravité espagnole et de vivacité italienne. Bien méridional. La langage plus impartial et plus calme sur ses ennemis qu’il n’appartient aux méridionaux. Il est ici pour quelques semaines. Et en automne, il compte aller reprendre sa place dans la Chambre des Pairs de Lisbonne. Rien ne l'en empêche. Adieu.
Je repars ce soir à 6 heures emmenant tout ce que j’avais laissé ici des miens. Je voudrais bien que vous me dissiez ce matin que votre tête va mieux. Adieu, Adieu.
G.
3 heures
Je reviens du grand concours où j’ai été reçu, en entrant dans la salle, plus bruyamment encore que l’an dernier. Et quand mon fils a été nommé, son nom a amené deux fois une nouvelle explosion. Il faut se féliciter de la mobilité de mon pays ; elle le perd et le sauve tour à tour. Ce qui ne veut pas dire que je le croie sauvé parce qu’il recommence à m’applaudir.
J’ai eu du monde constamment, quoiqu’il n’y ait personne ici. Je vous ai déjà dit ce matin, je crois, que j’avais été content hier de la conversation du Duc de Broglie, très content, et pour le fond des choses, et pour sa propre disposition. Il regarde l’union comme très bien établie entre les deux corps d’armée conservateur et légitimiste, et il les croit décidés l’un et l'autre à faire ce qu’il faudra pour la maintenir. Il loue beaucoup Berryer, talent et conduite. Il s'attend, au mois de Novembre, à une majorité, encore insuffisante, pour la révision, mais plus forte. Les conseils généraux et les consuls d’arrondissement seront presque unanimes. Le pétitionnement recommence. On ne veut que des signatures nouvelles. Que résultera-t-il de tout cela au Printemps ? On n'en sait rien. On ne s'inquiète pas de le savoir. On ne s’inquiète que de l'élection de l'Assemblée, très probablement au mois de mars. On l'espère bonne, au moins aussi bonne que celle-ci, et plus décidée. Si on y réussit, on verra après. On aura fait ce qui fera ce qui sera possible.
Le Président se conduit tranquillement, sans autre dessein ni travail que sa réélection. C’est toujours le plus probable. Jusqu'ici le mouvement n’est pas vif pour le Prince de Joinville et lui ne dit ni oui, ni non. L’Elysée parait plutôt content qu'inquiet de cet incident.
Lord Aberdeen m'écrit qu’il part pour l’Ecosse où il me presse fort d'aller. Je n'irai point. Il me dit : " We expect a new reform bill at tre opening, of the next session of Parliament. If Lord Derby at that time should be prepared to abandon his present policy of protection and dear bread, he may very probably be able to oppose Parliamentany Reforme with success. But if not Lord John may carry universal suffrage, if he should think proper. Whatever exertion or sacrifice may be necessary to secure free trade will be cheerfully made."
Nous verrons si l’aristocratie anglaise aura son vieux bon sens. Je trouve que dans ces derniers temps, son bon sens et son énergie ont également faibli. Elle a été plus entêtée que hardie.
Mardi 12
M. Molé est venu hier pendant que je vous écrivais. Il arrivait du Marais. Je le reverrai aujourd’hui avant de partir. Nous aurons notre petite réunion pour les affaires de l'Assemblée nationale. Duchâtel est arrivé aussi hier soir. Kisseleff est venu me voir après Molé. Vous manquez beaucoup à ce monde. Kisseleff dit qu’il use ses redingotes n'ayant plus une occasion de mettre un habit. Molé part samedi pour Champlâtreux, jusqu'au mois de Novembre. Il se promet que vous irez l’y voir.
Changarnier est parti tout de suite pour la Bourgogne ; triste, et commençant à s'apercevoir qu’il n’a pas bien conduit sa barque. Pas la moindre nouvelle d'ailleurs.
Autre visite hier, qui m’a intéressé et plus. Le comte de Thomar que Païva m’a amené. Encore jeune, physionomie spirituelle ; mélange de gravité espagnole et de vivacité italienne. Bien méridional. La langage plus impartial et plus calme sur ses ennemis qu’il n’appartient aux méridionaux. Il est ici pour quelques semaines. Et en automne, il compte aller reprendre sa place dans la Chambre des Pairs de Lisbonne. Rien ne l'en empêche. Adieu.
Je repars ce soir à 6 heures emmenant tout ce que j’avais laissé ici des miens. Je voudrais bien que vous me dissiez ce matin que votre tête va mieux. Adieu, Adieu.
G.
Val-Richer, Mercredi 6 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 6 août 1851
Lisez quelquefois, je vous prie, la Chronique politique de l'Assemblée nationale signée Robillard. C'est, depuis quelque temps ce qu’il y a de mieux dans le Journal. J’y trouve aujourd’hui sur les Régentistes et leur journal l'Ordre, des réflexions pleines de sens et d'à propos.
Je souhaite que M. de Beroldingen ait raison dans tout ce qu’il vous a dit de l'Allemagne et que les masses aient, en effet fait leur expérience. Cela dépend des gouvernements ; quand ils se conduisent avec tact et mesure, les expériences profitent en effet aux masses ; quand les gouvernements abusent des expériences, les masses recommencent bientôt de plus belle et plus fort. Nous ne voyons pas autre chose depuis soixante ans.
Voilà encore deux élections qui viennent de se faire ici, l’une dans le nord, l'autre dans le Lot, et qui toutes les deux, ont tourné comme les quatre précédentes contre les Montagnards, et les pointus légitimistes réunis qui n'ont pu ni faire l'élection en y prenant part, ni la faire manquer en s'abstenant. Cela fait bien des échecs pour eux dans l’Assemblée, et au dehors. Si le plaisir du succès peut consolider l’union des conservateurs et des légitimistes sensés, ce sera excellent, [?] le Président en profitera le premier.
J’ai eu hier des nouvelles de votre ami M. Fould, à l'occasion d’une petite affaire que je lui avais recommandée, et qu’il a faite de très bonne grâce. Il m’écrit d’un ton content. Ce que vous me dîtes de l'absence de toute nouvelle directe à Frohsdorf, le 23, sur la visite à Claremont, est étrange. C'est bien le cas de dire légèreté française. Je vous demande la permission de mettre humain à la place de française, par amendement. Que d'anglais auraient fait une démarche semblable sans en rien dire, ni avant, ni après au premier intéressé.
Je commence à m'occuper de mon discours futur en réponse à M. de Montalembert. Sans connaître du tout le sien qui n’est pas fait, et qu’il m’apportera ici, m’a-t-il dit, vers la fin de septembre. Je n’écris pas un mot, comme de raison ; mais je lis ce qu’ont écrit M. Droz et M. de Montalembert mes deux sujets. Deux sujets bien divers, venus des points opposés de l’horizon, et qui ont fini par se rencontrer dans les mêmes sentiments sur toutes les grandes choses de la vie. Il y a de quoi bien parler. Dieu sait où nous en serons quand viendra cette séance ! Peut-être au milieu de l'élection d’une assemblée constituante. Cependant je ne crois pas ; je persiste à ne croire à rien jusqu'au printemps de 1852.
Ce que j’ai peine à croire, c’est que je ne désire pas vous retrouver dimanche à Paris, et que j'y aille pour ne pas vous y retrouver. Je n'ai encore point de nouvelle de Duchâtel depuis son retour, je suppose qu’il persiste dans son projet de visite à Claremont. Je saurai Dimanche si nous faisons ce pèlerinage à plusieurs. Montebello ni Dumon non plus ne m’écrivent. Il paraît que tout le monde est las de n'avoir rien fait et ne songe qu’à s'en reposer. onze heures J'espère bien que votre mal de tête n'est que de la migraine, et par conséquent un mal très passager. J'ai deux lettres de vous à la fois, du 1er et du 2. Adieu Adieu.
J’ai peur de n'avoir rien demain. Adieu. G.
Lisez quelquefois, je vous prie, la Chronique politique de l'Assemblée nationale signée Robillard. C'est, depuis quelque temps ce qu’il y a de mieux dans le Journal. J’y trouve aujourd’hui sur les Régentistes et leur journal l'Ordre, des réflexions pleines de sens et d'à propos.
Je souhaite que M. de Beroldingen ait raison dans tout ce qu’il vous a dit de l'Allemagne et que les masses aient, en effet fait leur expérience. Cela dépend des gouvernements ; quand ils se conduisent avec tact et mesure, les expériences profitent en effet aux masses ; quand les gouvernements abusent des expériences, les masses recommencent bientôt de plus belle et plus fort. Nous ne voyons pas autre chose depuis soixante ans.
Voilà encore deux élections qui viennent de se faire ici, l’une dans le nord, l'autre dans le Lot, et qui toutes les deux, ont tourné comme les quatre précédentes contre les Montagnards, et les pointus légitimistes réunis qui n'ont pu ni faire l'élection en y prenant part, ni la faire manquer en s'abstenant. Cela fait bien des échecs pour eux dans l’Assemblée, et au dehors. Si le plaisir du succès peut consolider l’union des conservateurs et des légitimistes sensés, ce sera excellent, [?] le Président en profitera le premier.
J’ai eu hier des nouvelles de votre ami M. Fould, à l'occasion d’une petite affaire que je lui avais recommandée, et qu’il a faite de très bonne grâce. Il m’écrit d’un ton content. Ce que vous me dîtes de l'absence de toute nouvelle directe à Frohsdorf, le 23, sur la visite à Claremont, est étrange. C'est bien le cas de dire légèreté française. Je vous demande la permission de mettre humain à la place de française, par amendement. Que d'anglais auraient fait une démarche semblable sans en rien dire, ni avant, ni après au premier intéressé.
Je commence à m'occuper de mon discours futur en réponse à M. de Montalembert. Sans connaître du tout le sien qui n’est pas fait, et qu’il m’apportera ici, m’a-t-il dit, vers la fin de septembre. Je n’écris pas un mot, comme de raison ; mais je lis ce qu’ont écrit M. Droz et M. de Montalembert mes deux sujets. Deux sujets bien divers, venus des points opposés de l’horizon, et qui ont fini par se rencontrer dans les mêmes sentiments sur toutes les grandes choses de la vie. Il y a de quoi bien parler. Dieu sait où nous en serons quand viendra cette séance ! Peut-être au milieu de l'élection d’une assemblée constituante. Cependant je ne crois pas ; je persiste à ne croire à rien jusqu'au printemps de 1852.
Ce que j’ai peine à croire, c’est que je ne désire pas vous retrouver dimanche à Paris, et que j'y aille pour ne pas vous y retrouver. Je n'ai encore point de nouvelle de Duchâtel depuis son retour, je suppose qu’il persiste dans son projet de visite à Claremont. Je saurai Dimanche si nous faisons ce pèlerinage à plusieurs. Montebello ni Dumon non plus ne m’écrivent. Il paraît que tout le monde est las de n'avoir rien fait et ne songe qu’à s'en reposer. onze heures J'espère bien que votre mal de tête n'est que de la migraine, et par conséquent un mal très passager. J'ai deux lettres de vous à la fois, du 1er et du 2. Adieu Adieu.
J’ai peur de n'avoir rien demain. Adieu. G.
Paris, Dimanche 6 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Paris, Dimanche 6 Juillet 1851
M. Paget vient de m’apporter deux lettres de Lord Aberdeen, des 28 juillet et 4 juillet. M. d'Harcourt après l’avoir promis, avait négligé d’envoyer chercher la première, ou de donner son adresse. Légèreté française comme vous diriez. Longue lettre. Voici les points intéressants. Le Roi Léopold point hostile à la fusion, mais croyant que les Princes ont peu à y faire ; tenant le même langage que le feu Roi ; se plaignant de la déraison impertinente de quelques légitimistes, surtout autour du comte de Chambord. Celui-ci serait convenablement reçu à Londres, s'il y allait. Les désirs de la famille d'Orléans, surtout de la Reine et du duc de Nemours, y seraient pris en grande considération. Le Cabinet anglais, plus discrédité que ne l'a jamais été aucun gouvernement ; mais il achèvera la session. " We are threatened with a new reform bill at the commencement of the next session ; and although lord John looks to this as the means of acquiring additional strength, it may very possibly lead to his ruin. This is a matter upon which all conservatives might act cordially together. "
Changarnier s'est montré fort perplexe. Il craint une grosse majorité pour la révision. Des hommes sur qui il comptait pour voter contre, M. de Maleville et M. de Rémusat, par exemple, voteront pour dans leur intérêt électoral. Il insiste ardemment pour qu’on prenne d'avance des mesures législatives contre l'élection des trois candidats inconstitutionnels. Il regarde, en ce cas, sa propre élection comme certaine, avec toutes les meilleures conséquences. Mais il doute beaucoup que l'Assemblée le fasse. Il dit les mêmes choses que vous lui avez entendu dire, avec moins d’assurance. J’irai lui rendre sa visite avant mon départ. Quelques autres personnes ce matin, mais rien de nouveau. Décidément les affaires commerciales reprennent assez.
Le public a moins peur de 1852, sans savoir comment, il se croit sûr qu’il s’en tirera, à assez bon marché, et il ne demande rien de plus. La chute d’ambition est encore plus grande que la chute de puissance.
Lundi 7 9 heures
Votre mot de Cologne m’arrive. J'espère que demain je vous saurai arrivée et établie à Ems. Cela me plaît de connaître les lieux, maison et pays. J’irai me promener avec vous à Nassau. J'espère aussi que vous aurez pensé à m'écrire au Val Richer, à partir de Mercredi 9. Rien n’est changé dans mes projets.
Je n'ai vu personne hier soir. Je reçois ce matin une lettre de Donoso Cortes qui me croit et m'écrit au Val Richer. Voici le dernier paragraphe : " Mon Dieu ! je suis émerveillé de voir combien sont faciles les choses difficiles. Je crois, par exemple, qu’il se peut que le salut de l’Europe tienne à ce qu’un homme, qui est à Val Richer, le veuille ou ne le veuille pas. Le voudra-t-il ? " Comprenez-vous ? La lettre roule sur l’Eglise catholique qui peut seule sauver le monde, parce qu’elle en sait plus que le monde, et aime plus que le monde n'aime. Et la question est de savoir si je voudrai me faire catholique. Suis-je assez flatté pour me décider ? Qu'en pensez-vous ? Adieu, adieu.
Dites-moi, je vous prie, à quelle heure vous arrivent mes lettres et partent les vôtres. Adieu. G.
M. Paget vient de m’apporter deux lettres de Lord Aberdeen, des 28 juillet et 4 juillet. M. d'Harcourt après l’avoir promis, avait négligé d’envoyer chercher la première, ou de donner son adresse. Légèreté française comme vous diriez. Longue lettre. Voici les points intéressants. Le Roi Léopold point hostile à la fusion, mais croyant que les Princes ont peu à y faire ; tenant le même langage que le feu Roi ; se plaignant de la déraison impertinente de quelques légitimistes, surtout autour du comte de Chambord. Celui-ci serait convenablement reçu à Londres, s'il y allait. Les désirs de la famille d'Orléans, surtout de la Reine et du duc de Nemours, y seraient pris en grande considération. Le Cabinet anglais, plus discrédité que ne l'a jamais été aucun gouvernement ; mais il achèvera la session. " We are threatened with a new reform bill at the commencement of the next session ; and although lord John looks to this as the means of acquiring additional strength, it may very possibly lead to his ruin. This is a matter upon which all conservatives might act cordially together. "
Changarnier s'est montré fort perplexe. Il craint une grosse majorité pour la révision. Des hommes sur qui il comptait pour voter contre, M. de Maleville et M. de Rémusat, par exemple, voteront pour dans leur intérêt électoral. Il insiste ardemment pour qu’on prenne d'avance des mesures législatives contre l'élection des trois candidats inconstitutionnels. Il regarde, en ce cas, sa propre élection comme certaine, avec toutes les meilleures conséquences. Mais il doute beaucoup que l'Assemblée le fasse. Il dit les mêmes choses que vous lui avez entendu dire, avec moins d’assurance. J’irai lui rendre sa visite avant mon départ. Quelques autres personnes ce matin, mais rien de nouveau. Décidément les affaires commerciales reprennent assez.
Le public a moins peur de 1852, sans savoir comment, il se croit sûr qu’il s’en tirera, à assez bon marché, et il ne demande rien de plus. La chute d’ambition est encore plus grande que la chute de puissance.
Lundi 7 9 heures
Votre mot de Cologne m’arrive. J'espère que demain je vous saurai arrivée et établie à Ems. Cela me plaît de connaître les lieux, maison et pays. J’irai me promener avec vous à Nassau. J'espère aussi que vous aurez pensé à m'écrire au Val Richer, à partir de Mercredi 9. Rien n’est changé dans mes projets.
Je n'ai vu personne hier soir. Je reçois ce matin une lettre de Donoso Cortes qui me croit et m'écrit au Val Richer. Voici le dernier paragraphe : " Mon Dieu ! je suis émerveillé de voir combien sont faciles les choses difficiles. Je crois, par exemple, qu’il se peut que le salut de l’Europe tienne à ce qu’un homme, qui est à Val Richer, le veuille ou ne le veuille pas. Le voudra-t-il ? " Comprenez-vous ? La lettre roule sur l’Eglise catholique qui peut seule sauver le monde, parce qu’elle en sait plus que le monde, et aime plus que le monde n'aime. Et la question est de savoir si je voudrai me faire catholique. Suis-je assez flatté pour me décider ? Qu'en pensez-vous ? Adieu, adieu.
Dites-moi, je vous prie, à quelle heure vous arrivent mes lettres et partent les vôtres. Adieu. G.
Paris, Mercredi 2 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Paris. Mercredi 2 Juillet 185
Une heure
Je ne suis pas du tout résigné à la séparation. Mon plaisir me manquera aux heures accoutumées, et mon attente de mon plaisir tout le jour.
En vous quittant hier soir je suis retourné chez Mad. de Staël. Point d'autre visiteur que Viel-Castel uniquement préoccupé des affaires de La Plata dont le rapport se fait ces jours-ci. M. Thiers, les a toujours à coeur, plus que vous. Il ne refera pourtant pas son discours cette année, mais il en fera faire plusieurs. Pour rien, car la paix sera faite avec Rosas. 13 membres de la commission sont pour la paix contre 2. M. De Tocqueville lira Lundi 7, à la Commission, son rapport sur la révision. La Commission le discutera lundi et mardi. Il le lira à l’assemblée mercredi, ou jeudi. Le grand débat commencera, le mardi 15, grand peut-être, et long certainement.
Pour la réunion des Pyramides, sept orateurs, MM. de Broglie, Montalembert, Daru, Odilon Barrot, Beugnot, Gal Bedeau et Coquerel. Pour la République, plaine ou Montagne, MM. le Gal Cavaignac, Lamartine, Gal Lamoricière, Jules Favre, Charras, Mathieu de la Drôme Michel de Bourges. Pour le Tiers Parti, MM. Dufaure, Tocqueville et Laboulais. Pour les légitimistes, MM. Berryer, Falloux, Vatimesnil, La Rochejacquelein, Laboulie. Pour les fusionnistes MM. Molé, Montebello, Moulin. Pour le Ministère, MM. Baroche. Léon Faucher et Rouher. Voilà le programme général. Et comme il s’agit de prendre position pour les élections futures, peu de gens se retireront de la scène. Au moins dix ou douze jours de débat. Je n’ai encore vu personne qui connût le discours du Président.
La réception de Poitiers n'a pas valu celle de Tours. Peu de visites ce matin. Deux légitimistes, MM. de Neuville et de Limairac, bien pressés qu’on s'entende avec eux pour faire, à la loi du 31 mai une petite modification qui leur permette de ne pas attaquer la loi, et de voter avec la majorité, contre la Montagne. Le parti est assez découragé.
Je verrai demain le général Chabannes qui part le soir pour Claremont. Je lui dirai bien des choses à redire et il les redira. Je ne suis pas plus intéressant que cela. Adieu. La pluie me plait. Vous aurez moins chaud et point de poussière. Adieu, adieu.
Tout va bien chez moi. Adieu. G.
Une heure
Je ne suis pas du tout résigné à la séparation. Mon plaisir me manquera aux heures accoutumées, et mon attente de mon plaisir tout le jour.
En vous quittant hier soir je suis retourné chez Mad. de Staël. Point d'autre visiteur que Viel-Castel uniquement préoccupé des affaires de La Plata dont le rapport se fait ces jours-ci. M. Thiers, les a toujours à coeur, plus que vous. Il ne refera pourtant pas son discours cette année, mais il en fera faire plusieurs. Pour rien, car la paix sera faite avec Rosas. 13 membres de la commission sont pour la paix contre 2. M. De Tocqueville lira Lundi 7, à la Commission, son rapport sur la révision. La Commission le discutera lundi et mardi. Il le lira à l’assemblée mercredi, ou jeudi. Le grand débat commencera, le mardi 15, grand peut-être, et long certainement.
Pour la réunion des Pyramides, sept orateurs, MM. de Broglie, Montalembert, Daru, Odilon Barrot, Beugnot, Gal Bedeau et Coquerel. Pour la République, plaine ou Montagne, MM. le Gal Cavaignac, Lamartine, Gal Lamoricière, Jules Favre, Charras, Mathieu de la Drôme Michel de Bourges. Pour le Tiers Parti, MM. Dufaure, Tocqueville et Laboulais. Pour les légitimistes, MM. Berryer, Falloux, Vatimesnil, La Rochejacquelein, Laboulie. Pour les fusionnistes MM. Molé, Montebello, Moulin. Pour le Ministère, MM. Baroche. Léon Faucher et Rouher. Voilà le programme général. Et comme il s’agit de prendre position pour les élections futures, peu de gens se retireront de la scène. Au moins dix ou douze jours de débat. Je n’ai encore vu personne qui connût le discours du Président.
La réception de Poitiers n'a pas valu celle de Tours. Peu de visites ce matin. Deux légitimistes, MM. de Neuville et de Limairac, bien pressés qu’on s'entende avec eux pour faire, à la loi du 31 mai une petite modification qui leur permette de ne pas attaquer la loi, et de voter avec la majorité, contre la Montagne. Le parti est assez découragé.
Je verrai demain le général Chabannes qui part le soir pour Claremont. Je lui dirai bien des choses à redire et il les redira. Je ne suis pas plus intéressant que cela. Adieu. La pluie me plait. Vous aurez moins chaud et point de poussière. Adieu, adieu.
Tout va bien chez moi. Adieu. G.
Ems, Mercredi 10 juillet 1850, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Ems le 10 Juillet 1850
Votre lettre hier est intéressante sur Paris. Elle confirme tout ce que je pense, c’est que bon gré malgré tout tournera au profit du Président. Il est là pour aussi longtemps qu'il lui plaira. Eh bien qu'il fasse de bonnes choses. Deux tiers des électeurs de Paris éliminés, quelle bonne affaire. Voyons la loi sur la presse. Elle passera j’espère, malgré l'humeur des journaux. Voici enfin Ellice, & je vous engage à l’étudier, cela en vaut la peine. Quelle journée hier ! De la pluie tout le long. Personne que le Prince Paul pendant une demi-heure. C’est à pleurer. Je suis au bout de la ville. Ainsi pas même la récréation des passants, d’un peu de bruit, rien, rien du tout. De hautes montagnes couvertes de nuages. Je m'attendais à bien de l’ennui. Ceci surpasse de beaucoup mon attente, comment arriverai-je au bout des quatre semaines ? Je bois, & aujourd’hui je commence les bains. Le temps y est très peu favorable. Jusqu’ici & me voilà au quatrième jour des verres d’eau, je ne sens d’autre effet qu’une grande lassitude. Un affaiblissement général. Si c’est là ce que je suis venue chercher, il ne valait pas la peine de faire ce long voyage. J’étais bien assez faible à Paris. C’est le Médecin du coin qui règle mon régime.
Marion m’a envoyé la correspondance dont parle Ellice. C’est en effet une lettre pleine de reproches, & de flatteries de la part lady Palmerston. Reproches des critiques d’Ellice sur Palmerston. La réponse d’Ellice est très franche, il déteste la politique révolutionnaire du [f. o.] et condamne tout à fait la marche suivie par le [gouvernement] tout entier dans cette discussion. C'était le 21, lendemain du jour où Lord Russel avait fait fi de la chambre des Pairs, & des grandes puissances. Enfin, sa lettre est parfaitement dans la vérité en même temps que convenable. Peel ayant disparu, je suis bien portée à croire que le seul homme considérable en Angleterre reste lord Palmerston. Au besoin l’autre l’aurait contenu, dominé. Aujourd’hui il reste sans frein, sans contrôle. Je crois que l'Angleterre ira mal. Qu’en pensez-vous ? Adieu, adieu. Quel ennui que l'absence, quel ennui que l'ennui. Adieu. Adieu. Quel bon article sur Peel dans les Débats de dimanche, par Lemoine !
Votre lettre hier est intéressante sur Paris. Elle confirme tout ce que je pense, c’est que bon gré malgré tout tournera au profit du Président. Il est là pour aussi longtemps qu'il lui plaira. Eh bien qu'il fasse de bonnes choses. Deux tiers des électeurs de Paris éliminés, quelle bonne affaire. Voyons la loi sur la presse. Elle passera j’espère, malgré l'humeur des journaux. Voici enfin Ellice, & je vous engage à l’étudier, cela en vaut la peine. Quelle journée hier ! De la pluie tout le long. Personne que le Prince Paul pendant une demi-heure. C’est à pleurer. Je suis au bout de la ville. Ainsi pas même la récréation des passants, d’un peu de bruit, rien, rien du tout. De hautes montagnes couvertes de nuages. Je m'attendais à bien de l’ennui. Ceci surpasse de beaucoup mon attente, comment arriverai-je au bout des quatre semaines ? Je bois, & aujourd’hui je commence les bains. Le temps y est très peu favorable. Jusqu’ici & me voilà au quatrième jour des verres d’eau, je ne sens d’autre effet qu’une grande lassitude. Un affaiblissement général. Si c’est là ce que je suis venue chercher, il ne valait pas la peine de faire ce long voyage. J’étais bien assez faible à Paris. C’est le Médecin du coin qui règle mon régime.
Marion m’a envoyé la correspondance dont parle Ellice. C’est en effet une lettre pleine de reproches, & de flatteries de la part lady Palmerston. Reproches des critiques d’Ellice sur Palmerston. La réponse d’Ellice est très franche, il déteste la politique révolutionnaire du [f. o.] et condamne tout à fait la marche suivie par le [gouvernement] tout entier dans cette discussion. C'était le 21, lendemain du jour où Lord Russel avait fait fi de la chambre des Pairs, & des grandes puissances. Enfin, sa lettre est parfaitement dans la vérité en même temps que convenable. Peel ayant disparu, je suis bien portée à croire que le seul homme considérable en Angleterre reste lord Palmerston. Au besoin l’autre l’aurait contenu, dominé. Aujourd’hui il reste sans frein, sans contrôle. Je crois que l'Angleterre ira mal. Qu’en pensez-vous ? Adieu, adieu. Quel ennui que l'absence, quel ennui que l'ennui. Adieu. Adieu. Quel bon article sur Peel dans les Débats de dimanche, par Lemoine !
Val-Richer, Jeudi 13 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 13 juin 1850
Neuf heures
Pas un mot sur la consultation de Chomel ! Voilà ce qui me déplaît de votre lettre. Est-ce que la consultation n’a pas eu lieu ? Duchâtel m'écrit que le voyage de St Léonard est pressant, et me propose de le faire avec moi. Cela me convient. Il est libre à partir de samedi, et il voudrait partir dimanche soir. Je lui réponds que j'aimerais beaucoup mieux lundi. Enfin, je serai là dimanche matin. Nous verrons. Je vous trouve en effet bien en train de lord Palmerston. Dieu vous exauce ! Certainement, si rien n’est fini lundi sa situation sera bien mauvaise. Mais il ne dépend pas de Lahitte que rien ne soit fini. Palmerston n'a qu'à tout céder.
Le discours du Président à St Quentin ne m’a point surpris, ni son succès. Il ressemble à tous ses autres discours. Bonnes intentions vagues et contradictoires. Le vrai et le faux, le pour et le contre le gentleman et le philanthrope, un peu socialiste, l’ordre et la porte entrouverte au désordre. Et c'est à cause de cela que le Président réussit souvent en parlant. L’état général des esprits lui ressemble eux aussi, ils voudraient tout cela à la fois. Changarnier a raison de ne pas faire de bruit. Voilà Emile de Girardin enfin élu. Ce sera dans l’assemblée, un ennui pour le gouvernement et quelques fois un embarras. Il prêtera souvent à la Montagne de l’esprit et de l'audace. Ce n'est nullepart ni jamais un homme indifférent.
Vous ne vous intéressez surement pas à Cuba. Moi, je suis charmé que la piraterie américaine ait échoué honteusement. Je souhaite toutes sortes de bien à l’Espagne et au général Narvaez. Adieu. J’ai tant de choses à vous dire dimanche que je ne vois rien à vous dire aujourd’hui. Je vous écrirai encore demain. Je suis seul absolument seul aujourd’hui dans le Val Richer. Pauline est partie ce matin pour Trouville avec son mari. Henriette arrive ce soir ici avec le sien. Adieu, adieu. G.
Neuf heures
Pas un mot sur la consultation de Chomel ! Voilà ce qui me déplaît de votre lettre. Est-ce que la consultation n’a pas eu lieu ? Duchâtel m'écrit que le voyage de St Léonard est pressant, et me propose de le faire avec moi. Cela me convient. Il est libre à partir de samedi, et il voudrait partir dimanche soir. Je lui réponds que j'aimerais beaucoup mieux lundi. Enfin, je serai là dimanche matin. Nous verrons. Je vous trouve en effet bien en train de lord Palmerston. Dieu vous exauce ! Certainement, si rien n’est fini lundi sa situation sera bien mauvaise. Mais il ne dépend pas de Lahitte que rien ne soit fini. Palmerston n'a qu'à tout céder.
Le discours du Président à St Quentin ne m’a point surpris, ni son succès. Il ressemble à tous ses autres discours. Bonnes intentions vagues et contradictoires. Le vrai et le faux, le pour et le contre le gentleman et le philanthrope, un peu socialiste, l’ordre et la porte entrouverte au désordre. Et c'est à cause de cela que le Président réussit souvent en parlant. L’état général des esprits lui ressemble eux aussi, ils voudraient tout cela à la fois. Changarnier a raison de ne pas faire de bruit. Voilà Emile de Girardin enfin élu. Ce sera dans l’assemblée, un ennui pour le gouvernement et quelques fois un embarras. Il prêtera souvent à la Montagne de l’esprit et de l'audace. Ce n'est nullepart ni jamais un homme indifférent.
Vous ne vous intéressez surement pas à Cuba. Moi, je suis charmé que la piraterie américaine ait échoué honteusement. Je souhaite toutes sortes de bien à l’Espagne et au général Narvaez. Adieu. J’ai tant de choses à vous dire dimanche que je ne vois rien à vous dire aujourd’hui. Je vous écrirai encore demain. Je suis seul absolument seul aujourd’hui dans le Val Richer. Pauline est partie ce matin pour Trouville avec son mari. Henriette arrive ce soir ici avec le sien. Adieu, adieu. G.
Val-RIcher, Samedi 29 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 29 Sept 1849 8 heures
Je suis rétabli chez moi. Avec plaisir, quoique les quinze jours que je viens de passer à Broglie aient été vrai ment agréables. Bonne et intime conversation. Je l’ai laissé un peu moins abattu que je ne l’avais trouvé. Non pas moins triste, car il y a, dans sa tristesse, une cause à laquelle personne ne peut rien. Sa situation personnelle lui déplait ; il se trouve en mauvaise compagnie ; pour lui même, il aimerait infiniment mieux n'avoir pas touché du bout du doigt à tout ceci. Non qu'il regrette d'avoir fait ce qu’il a fait ; il l’a fait par devoir, dans l’intérêt du pays, pour concourir à la résistance universelle et nécessaire des honnêtes gens contre les coquins, des hommes de sens contre les fous. Et vraiment, quand on voit de près ce qui arriverait dans ce pays-ci, si on laissait faire, on comprend que personne ne se soit cru permis d'en courir la chance, et de ne pas faire soi-même tout son possible pour empêcher. C’était une nécessité de défense personnelle et un devoir strict, urgent envers sa famille, ses amis, ses voisins, tout son pays. Mais la position qui en résulte n'en est pas moins pénible et lourde. Ce sont les conséquences d’une intervention forcé pour cause de sureté intérieure, mais qui coute cher et pèse beaucoup. Hier une heure avant de partir, j'ai encore causé de la tranquillité de Paris. Toujours la même conviction développée, en raisons convaincantes. Quoique finissant par la précaution que tout le monde prend toujours ici : " On ne peut répondre de rien. "
Albert est très bien très sensé, en train et courageux, sa femme très agréable, douce, intelligente, modeste, simplement élégante d’esprit et de cœur, prenant intérêt à la conversation souriant de plaisir parce qu'elle comprend et rougissant quand on la regarde au moment où elle comprend. Broglie et Albert partent demain pour Paris ; la petite Princesse mardi pour aller passer six semaines en Périgord, chez son père, où son mari ira la rejoindre. Ils seront tous réunis à Paris, dans la dernière quinzaine de Novembre. Albert se croit quelques chances d'être élu à l'assemblée par le département du Haut-Rhin, quand le procès de Versailles aura fait des vacances. S’il fait toutes celles auxquelles on croit, il y en aura trois dans ce département-là, et une trentaine en tout. Les réélections seront importantes. Elles révèleront, l'état actuel de ce monde, inconnu qu'on appelle le suffrage universel. On en est assez préoccupé d'avance.
Vous voilà au courant de Broglie comme si vous y aviez passé ces quinze jours. Fait important que j'oubliais. C’est bien certainement Thiers qui est le conseiller sérieux, et efficace de Louis Napoléon. Quand il y a quelque circonstance difficile, douteuse, c’est Thiers qu’il fait appeler. Il dine tête-à-tête. avec lui. Quelquefois Persigny en tiers. Puis on s’arrange pour faire donner par Molé le conseil auquel on s’est arrêté. Et pourvu que Molé ne s’en doute pas, il le donne. Et il ne demande pas mieux que de ne pas s'en douter.
Onze heures
Merci, merci de votre longue lettre. Soyez tranquille ; je n’ai pas le temps aujourd’hui de vous dire comment ; mais je vous promets que je ne me ferai pas des ennemis. Bien au contraire. Et nous passerons l’hiver ensemble à Paris, aussi doucement que le permettra l'état. général de l’atmosphère. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Je suis rétabli chez moi. Avec plaisir, quoique les quinze jours que je viens de passer à Broglie aient été vrai ment agréables. Bonne et intime conversation. Je l’ai laissé un peu moins abattu que je ne l’avais trouvé. Non pas moins triste, car il y a, dans sa tristesse, une cause à laquelle personne ne peut rien. Sa situation personnelle lui déplait ; il se trouve en mauvaise compagnie ; pour lui même, il aimerait infiniment mieux n'avoir pas touché du bout du doigt à tout ceci. Non qu'il regrette d'avoir fait ce qu’il a fait ; il l’a fait par devoir, dans l’intérêt du pays, pour concourir à la résistance universelle et nécessaire des honnêtes gens contre les coquins, des hommes de sens contre les fous. Et vraiment, quand on voit de près ce qui arriverait dans ce pays-ci, si on laissait faire, on comprend que personne ne se soit cru permis d'en courir la chance, et de ne pas faire soi-même tout son possible pour empêcher. C’était une nécessité de défense personnelle et un devoir strict, urgent envers sa famille, ses amis, ses voisins, tout son pays. Mais la position qui en résulte n'en est pas moins pénible et lourde. Ce sont les conséquences d’une intervention forcé pour cause de sureté intérieure, mais qui coute cher et pèse beaucoup. Hier une heure avant de partir, j'ai encore causé de la tranquillité de Paris. Toujours la même conviction développée, en raisons convaincantes. Quoique finissant par la précaution que tout le monde prend toujours ici : " On ne peut répondre de rien. "
Albert est très bien très sensé, en train et courageux, sa femme très agréable, douce, intelligente, modeste, simplement élégante d’esprit et de cœur, prenant intérêt à la conversation souriant de plaisir parce qu'elle comprend et rougissant quand on la regarde au moment où elle comprend. Broglie et Albert partent demain pour Paris ; la petite Princesse mardi pour aller passer six semaines en Périgord, chez son père, où son mari ira la rejoindre. Ils seront tous réunis à Paris, dans la dernière quinzaine de Novembre. Albert se croit quelques chances d'être élu à l'assemblée par le département du Haut-Rhin, quand le procès de Versailles aura fait des vacances. S’il fait toutes celles auxquelles on croit, il y en aura trois dans ce département-là, et une trentaine en tout. Les réélections seront importantes. Elles révèleront, l'état actuel de ce monde, inconnu qu'on appelle le suffrage universel. On en est assez préoccupé d'avance.
Vous voilà au courant de Broglie comme si vous y aviez passé ces quinze jours. Fait important que j'oubliais. C’est bien certainement Thiers qui est le conseiller sérieux, et efficace de Louis Napoléon. Quand il y a quelque circonstance difficile, douteuse, c’est Thiers qu’il fait appeler. Il dine tête-à-tête. avec lui. Quelquefois Persigny en tiers. Puis on s’arrange pour faire donner par Molé le conseil auquel on s’est arrêté. Et pourvu que Molé ne s’en doute pas, il le donne. Et il ne demande pas mieux que de ne pas s'en douter.
Onze heures
Merci, merci de votre longue lettre. Soyez tranquille ; je n’ai pas le temps aujourd’hui de vous dire comment ; mais je vous promets que je ne me ferai pas des ennemis. Bien au contraire. Et nous passerons l’hiver ensemble à Paris, aussi doucement que le permettra l'état. général de l’atmosphère. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 26 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Dimanche 26 Août 1849.
Val Richer 7 heures et demie
Je n'ai point été nommé au Conseil Général. C'est le voisin que je vous ai indiqué. Malgré ce que j'ai dit on m’a encore donné 300 voix. Ma commune et deux communes voisines n’ont pas voulu aller voter du tout, plutôt que de ne pas voter pour moi. Bien des poltrons ont encore peur de moi. Bien des esprits faibles sont encore incertains. Dans les premiers temps de la révolution, les Républicains de toute nuance, et plus récemment mes anciens adversaires politiques, ont ardemment travaillé contre moi, dans tout le pays. Journaux, petits pamphlets caricatures, lettres particulières, mensonges spécieux ou effrontés, odieux ou stupides, tout a été mis en œuvre et non sans quelque succès dans quelques parties de cette masse qui n’a point d’yeux pour voir, ni de temps pour regarder. Il reste, et il restera longtemps encore des traces de ce travail. Mais évidemment le vent souffle aujourd’hui de mon côté. Le courage revient à mes amis. La faveur des indifférents me revient. On fait de tout côté, honte à ceux qui ont menti ou qui ont cru aux mensonges. Ma présence et mon immobilité plaisent. Je n'ai qu'à continuer, et je continuerai certainement. Je suis sur le flot qui monte. S’il monte assez haut pour me relever, à la bonne heure. Je ne suis point pressé et je ne me contenterai pas à bon marché.
Ce qui me contentera parfaitement dans trois heures, j’espère, c’est votre lettre vos deux lettres. Comment se fait-il que ces irrégularités aient attendu jusqu'à présent pour se produire et qu’elles se renouvèlent à si peu de jours de distance ? Si on lit nos lettres, et si ceux qui les lisent ont un peu d’esprit, ils doivent voir bien clairement deux choses, que nous ne nous gênons pas, et que nous n’avons rien à cacher. Ce n’est vraiment pas la peine de nous causer le très vif déplaisir d’un retard.
J’ai reçu hier un mot de Dalmatie qui m’a annoncé sa visite pour cette semaine. On me dit que M. de Corcelle est très malade, et qu’il pourrait bien mourir à Castellamare. Ce serait une perte pour le Pape dont il a épousé avec passion la cause. On me dit aussi qu’il y aura, un peu plutôt ou un peu plus tard nouvelle explosion en Piémont, au moment où le Roi sera obligé de dissoudre la Chambre actuelle. La Suisse redevient le foyer du volcan, et c’est sur le Piémont que la flamme se dirige. Suisse et Piémont seront envahis s’ils éclatent, et la République Française fera comme les autres, on laissera faire les autres. Si les gouvernements sensés, sont assez sensés, leur chance est bonne. Les fous sont faibles et bêtes. Je crains que la brouillerie qui a éclaté entre Narvaez et Mon ne se raccommode pas cette fois. Ce serait bien dommage. Adieu jusqu'à la poste. Adieu, adieu. Je vais faire ma toilette.
Onze heures
Voilà seulement la lettre de jeudi 23. Je devrais avoir aussi celle d'avant-hier vendredi. Est-ce que les lettres mettraient désormais trois jours à m’arriver ? Je ne puis pas le croire. Il faut qu’il y ait quelque méprise, quelque retard dans l’ajustement de Richmond à Londres, et de Londres à Paris. Vous y prenez surement grand soin, dearest. Pourtant, j'ai bien envie que nous retrouvions notre exactitude accoutumée. Jusqu'ici cela marchait si bien ! Adieu, adieu. Nous verrons si j'aurai deux lettres demain, ou seulement celle de Vendredi. Adieu. G.
Val Richer 7 heures et demie
Je n'ai point été nommé au Conseil Général. C'est le voisin que je vous ai indiqué. Malgré ce que j'ai dit on m’a encore donné 300 voix. Ma commune et deux communes voisines n’ont pas voulu aller voter du tout, plutôt que de ne pas voter pour moi. Bien des poltrons ont encore peur de moi. Bien des esprits faibles sont encore incertains. Dans les premiers temps de la révolution, les Républicains de toute nuance, et plus récemment mes anciens adversaires politiques, ont ardemment travaillé contre moi, dans tout le pays. Journaux, petits pamphlets caricatures, lettres particulières, mensonges spécieux ou effrontés, odieux ou stupides, tout a été mis en œuvre et non sans quelque succès dans quelques parties de cette masse qui n’a point d’yeux pour voir, ni de temps pour regarder. Il reste, et il restera longtemps encore des traces de ce travail. Mais évidemment le vent souffle aujourd’hui de mon côté. Le courage revient à mes amis. La faveur des indifférents me revient. On fait de tout côté, honte à ceux qui ont menti ou qui ont cru aux mensonges. Ma présence et mon immobilité plaisent. Je n'ai qu'à continuer, et je continuerai certainement. Je suis sur le flot qui monte. S’il monte assez haut pour me relever, à la bonne heure. Je ne suis point pressé et je ne me contenterai pas à bon marché.
Ce qui me contentera parfaitement dans trois heures, j’espère, c’est votre lettre vos deux lettres. Comment se fait-il que ces irrégularités aient attendu jusqu'à présent pour se produire et qu’elles se renouvèlent à si peu de jours de distance ? Si on lit nos lettres, et si ceux qui les lisent ont un peu d’esprit, ils doivent voir bien clairement deux choses, que nous ne nous gênons pas, et que nous n’avons rien à cacher. Ce n’est vraiment pas la peine de nous causer le très vif déplaisir d’un retard.
J’ai reçu hier un mot de Dalmatie qui m’a annoncé sa visite pour cette semaine. On me dit que M. de Corcelle est très malade, et qu’il pourrait bien mourir à Castellamare. Ce serait une perte pour le Pape dont il a épousé avec passion la cause. On me dit aussi qu’il y aura, un peu plutôt ou un peu plus tard nouvelle explosion en Piémont, au moment où le Roi sera obligé de dissoudre la Chambre actuelle. La Suisse redevient le foyer du volcan, et c’est sur le Piémont que la flamme se dirige. Suisse et Piémont seront envahis s’ils éclatent, et la République Française fera comme les autres, on laissera faire les autres. Si les gouvernements sensés, sont assez sensés, leur chance est bonne. Les fous sont faibles et bêtes. Je crains que la brouillerie qui a éclaté entre Narvaez et Mon ne se raccommode pas cette fois. Ce serait bien dommage. Adieu jusqu'à la poste. Adieu, adieu. Je vais faire ma toilette.
Onze heures
Voilà seulement la lettre de jeudi 23. Je devrais avoir aussi celle d'avant-hier vendredi. Est-ce que les lettres mettraient désormais trois jours à m’arriver ? Je ne puis pas le croire. Il faut qu’il y ait quelque méprise, quelque retard dans l’ajustement de Richmond à Londres, et de Londres à Paris. Vous y prenez surement grand soin, dearest. Pourtant, j'ai bien envie que nous retrouvions notre exactitude accoutumée. Jusqu'ici cela marchait si bien ! Adieu, adieu. Nous verrons si j'aurai deux lettres demain, ou seulement celle de Vendredi. Adieu. G.
Richmond, Lundi 18 juin 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond le 18 Juin
Lundi 5 heures
Hier les John Russell tous seuls copiant des vers de lord Byron. Il croit que l’assemblée va statuer quelque chose sur la situation du Président. Il ne sait quoi. Drouyn de Lhuys sera nommé ambassadeur ici. Dufaure a dit à Normanby. " Les soucis de tribune, c’est des bêtises ! Le pouvoir c’est tout, je l'ai, et je le garderai. " Mon Empereur mécontent de roi de Prusse. Voilà tout ce que j’ai relevé de la conversation hier. J’ai rencontré Duchâtel dans la rue. Delessert lui mande qu'on s’est fort battu à Lyon, on a tiré des forts. Cela a bien fini, & tout cela est bon. Je rentre, le temps est charmant, & la promenade avec vous serait plus charmante encore. Des visites. Adieu. Adieu.
Lundi 5 heures
Hier les John Russell tous seuls copiant des vers de lord Byron. Il croit que l’assemblée va statuer quelque chose sur la situation du Président. Il ne sait quoi. Drouyn de Lhuys sera nommé ambassadeur ici. Dufaure a dit à Normanby. " Les soucis de tribune, c’est des bêtises ! Le pouvoir c’est tout, je l'ai, et je le garderai. " Mon Empereur mécontent de roi de Prusse. Voilà tout ce que j’ai relevé de la conversation hier. J’ai rencontré Duchâtel dans la rue. Delessert lui mande qu'on s’est fort battu à Lyon, on a tiré des forts. Cela a bien fini, & tout cela est bon. Je rentre, le temps est charmant, & la promenade avec vous serait plus charmante encore. Des visites. Adieu. Adieu.
Brompton, Dimanche 10 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Dimanche 10 Juin 1849
2 heures
Voilà donc Rome pris, ou à peu près pris, ou près d'être pris. Je ne sais encore que le Morning Chronicle, 3e édition, que je n'ai pas même lu. Guillaume m'a rapporté les nouvelles du bureau du journal. Il y a trop de détails pour que le fond ne soit pas vrai. Pourtant je ne trouve pas ce fond bien clair. Je désire que tout soit vrai. Amour-propre à part, un échec à Rome serait bien mauvais à Paris. Je veux bien qu’on se batte avec les Montagnards ; mais je ne veux pas que les Montagnards se battent en ayant le vent pour eux. Un échec devant Rome dégoûterait l’armée, l’armée de Paris. Il faut qu’elle ait cœur à se battre pour le Gouvernement. Les raisons abandent. Que d’embarras suivront la victoire ! Autant qu’il y aurait de périls dans le revers. Le Dimanche est plus insupportable, aujourd’hui que jamais. Rome, la santé du Maréchal Bugeaud. Ledru Rollin mort ou vivant. Attendre m'impatiente aujourd’hui presque autant que vous. Je ne me suis pas ennuyé hier chez Lady Alice. A table, j'ai assez causé avec elle, de vous surtout. Elle vous aime. Je ne m'y trompe pas. Elle a un peu trop de peine à comprendre ce qu'on lui dit. Le marquis, et la marquise d’Exter, le duc de Ruttand, Lord Granby, Lord Chelsea, Lord Jermyn, Lord Forrester, Sir James Gaham, M. Goulburn, Kielmansegge, Lady Aylesbury, Lord Jocelyn. J’étais chez moi à onze heures. Duchâtel sort d’ici. Il ne savait rien.
4 heures
J’ai été interrompu par Paul Dara qui arrive de Paris en passant par St Léonard.. Il a eu le choléra. 14 personnes dans la maison de son frère avec qui il habite, ont eu le choléra. Deux sont morts, le beau père de son frère et le cuisinier. Toujours brave mais aussi triste que brave. De mon avis pourtant en ce point que, s’il est vrai que le mal à beaucoup, grandi, il est vrai aussi que les moyens de résistance ne manquent point la majorité, le Président, encore l'armée. C'est le courage qui manque, et encore plus le courage de l’espérance que celui de la défense. On se croit perdu. On se défendrait si on croit relever la tête et regarder l'ennemi. Les légitimistes sauf la petite coterie de M. de la Rochejacquelin sont sensé, dans l'Assemblée. Il est convenu contre les grands partis, qu’on n'élèvera aucune question politique aucune question de prétendant, qu’on ne pensera, d'ici à trois ans qu’à se défendre du danger commun. On cherche un successeur au Président actuel qui ne sera point réélu. On ne pense qu'au Prince de Joinville. C'est le seul roi dans l’air. La duchesse d'Orléans arrive le 25. Le Prince et la Princesse de Joinville vont la voir à Eisenach. Le duc de Nemours ira la prendre à Ostende. Je vous donne pêle-mêle ce que m'a donné Daru. Il passe ici quelques jours. Adieu. Je vais à l’Athenaeum. Il fait froid, gris. Beaucoup de vent. Les Delassort m'ont fait demander, si je serai chez moi ce voir. Ils viendront à 9 heures. On me reparle d'élection dans le Calvados à propos de la mort de M. Deslongrais. Je nous montrerai ce que je réponds. Vous approuverez. Adieu. Adieu. G.
2 heures
Voilà donc Rome pris, ou à peu près pris, ou près d'être pris. Je ne sais encore que le Morning Chronicle, 3e édition, que je n'ai pas même lu. Guillaume m'a rapporté les nouvelles du bureau du journal. Il y a trop de détails pour que le fond ne soit pas vrai. Pourtant je ne trouve pas ce fond bien clair. Je désire que tout soit vrai. Amour-propre à part, un échec à Rome serait bien mauvais à Paris. Je veux bien qu’on se batte avec les Montagnards ; mais je ne veux pas que les Montagnards se battent en ayant le vent pour eux. Un échec devant Rome dégoûterait l’armée, l’armée de Paris. Il faut qu’elle ait cœur à se battre pour le Gouvernement. Les raisons abandent. Que d’embarras suivront la victoire ! Autant qu’il y aurait de périls dans le revers. Le Dimanche est plus insupportable, aujourd’hui que jamais. Rome, la santé du Maréchal Bugeaud. Ledru Rollin mort ou vivant. Attendre m'impatiente aujourd’hui presque autant que vous. Je ne me suis pas ennuyé hier chez Lady Alice. A table, j'ai assez causé avec elle, de vous surtout. Elle vous aime. Je ne m'y trompe pas. Elle a un peu trop de peine à comprendre ce qu'on lui dit. Le marquis, et la marquise d’Exter, le duc de Ruttand, Lord Granby, Lord Chelsea, Lord Jermyn, Lord Forrester, Sir James Gaham, M. Goulburn, Kielmansegge, Lady Aylesbury, Lord Jocelyn. J’étais chez moi à onze heures. Duchâtel sort d’ici. Il ne savait rien.
4 heures
J’ai été interrompu par Paul Dara qui arrive de Paris en passant par St Léonard.. Il a eu le choléra. 14 personnes dans la maison de son frère avec qui il habite, ont eu le choléra. Deux sont morts, le beau père de son frère et le cuisinier. Toujours brave mais aussi triste que brave. De mon avis pourtant en ce point que, s’il est vrai que le mal à beaucoup, grandi, il est vrai aussi que les moyens de résistance ne manquent point la majorité, le Président, encore l'armée. C'est le courage qui manque, et encore plus le courage de l’espérance que celui de la défense. On se croit perdu. On se défendrait si on croit relever la tête et regarder l'ennemi. Les légitimistes sauf la petite coterie de M. de la Rochejacquelin sont sensé, dans l'Assemblée. Il est convenu contre les grands partis, qu’on n'élèvera aucune question politique aucune question de prétendant, qu’on ne pensera, d'ici à trois ans qu’à se défendre du danger commun. On cherche un successeur au Président actuel qui ne sera point réélu. On ne pense qu'au Prince de Joinville. C'est le seul roi dans l’air. La duchesse d'Orléans arrive le 25. Le Prince et la Princesse de Joinville vont la voir à Eisenach. Le duc de Nemours ira la prendre à Ostende. Je vous donne pêle-mêle ce que m'a donné Daru. Il passe ici quelques jours. Adieu. Je vais à l’Athenaeum. Il fait froid, gris. Beaucoup de vent. Les Delassort m'ont fait demander, si je serai chez moi ce voir. Ils viendront à 9 heures. On me reparle d'élection dans le Calvados à propos de la mort de M. Deslongrais. Je nous montrerai ce que je réponds. Vous approuverez. Adieu. Adieu. G.
Brompton, Samedi 2 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Il est quatre heures. Vous ne viendrez probablement pas aujourd'hui. Voici les nouvelles de Paris. Dupin a été nommé Président au premier tour de scrutin. Il a eu 336 voix (Dupin aîné) et 9 (Dupin seul) ; en tout 345. Ledru Rollin 182. Et Lamoricière (porté par la réunion Dufaure) 76. C'est un très bon résultat. Les rouges et le tiers parti ensemble n'ont que 258 voix. Les modérés seuls en ont 345. C'est une meilleure majorité qu’on n'attendait. On m'écrit de plus, (M. Mallac en sortant de chez le Maréchal Bugeaud), que cette majorité se montre décidée, compacte et très disposée à marcher sur le ventre de la minorité si la minorité veut l'opprimer. Quant au cabinet avant-hier, il semblait formé. Dufaure, Remusat, Vivien, Tocqueville. Ils avaient tous accepté. Bugeaud et Falloux étaient à l'écart. La séance violente de la veille a épouvanté Dufaure et relevé en même temps ses prétentions. Soit sincèrement, soit pour rompre, il a demandé l'éloignement de Changarnier. Rémusat voulait rompre aussi. Le président a refusé d'accepter seulement la discussion sur ce point. Ces messieurs se sont retirés. Le Maréchal a été rappelé. Il comptait sur Barrot, Barrot a objecté sa fatigue, et décliné absolument d'entrer sans Dufaure. On m'écrit : " Le maréchal est décide à aller jusqu'au bout. Les désertions successives ne l’intimident pas. Vous pouvez regarder la combinaison suivante comme arrêtée : - Présidence et guerre, le Maréchal - Affaires Etrangères, Gal Bedeau - Intérieur Maleville - Travaux publics, La Redorte - Finances, Benoist - Instruction publique, Falloux - Marine Piscatory - Commerce buffet. - Garde des Sceaux, M. Rouher député nouveau (ami de Morny). Ces messieurs devaient se réunir hier soir chez le président et en finir. Si on peut finir quelque chose. Ceci serait le mieux possible. Adieu. Adieu. Il fait bien beau. Vous aurez pris plaisir à vous promener. Adieu.
Brompton, Samedi 2 Juin 1849 4 heures
Brompton, Samedi 2 Juin 1849 4 heures
Mots-clés : Elections (France), Politique (France)
Brompton, Vendredi 16 février 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton. Vendredi 16 fév. 1849
Midi
Demain sera charmant. Et je serai charmé que vous me fassiez honte de mes mauvaises pensées. J’ai tort de dire mes. Je ne devrais dire que ma. J’en ai bien rarement. Votre lettre de demain matin me dira si vous voulez que j'aille dîner avec vous. La dernière tentative pour ajourner la fin de l'Assemblée à échouer. Les élections auront très probablement lieu, le 22 avril. Cela met mon retour en France aux premiers jours de mai. Je n’ai point de nouvelles ce matin. Duchâtel, qui sort de chez moi, m’a apporté les siennes. Tout à fait d'accord avec les miennes. Seulement il ne croit pas qu'au fond Molé sait bien en ce qui touche notre élection. Il se croit sûr que Molé, sous main, travaille activement contre lui à Bordeaux. Je lui ai montré ce que j’ai écrit au duc de Broglie. Il approuve complètement et écrira dans le même sens. Thiers a fait sa paix avec le Président. Il a vu que les affaires du Président allaient mieux, et il s'est rapproché de lui. C’est Morny qui l’écrit à Flahault. Flahault toujours très bien, très gentleman et tenant un très bon langage. Dites, je vous prie, au Prince de Metternich que je regrette, et que je regretterai beaucoup mes visites à Brighton. Nous avons à peine commencé à causer, et nous avons ce me semble, de quoi causer des années. J'espère que nous nous reverrons à Londres. Je me désespère même pas de Paris. Faites-moi aussi la grâce de demander pour moi, à la Princesse de Metternich, une petite place dans ses souvenirs de Brighton. Et notre bonne Marion ? Est-ce quelle ne m’écrira pas quelques fois pour son compte ? Est-ce qu’elle ne viendra pas vous voir ? Il y a bien peu de personnes qui gagnent plus on les voit. C'est le sort de Marion. Je la charge de mes amitiés pour ses sœurs. Adieu. Adieu. Il fait plus froid ce matin. Prenez bien vos précautions demain. Adieu. Adieu. G.
Midi
Demain sera charmant. Et je serai charmé que vous me fassiez honte de mes mauvaises pensées. J’ai tort de dire mes. Je ne devrais dire que ma. J’en ai bien rarement. Votre lettre de demain matin me dira si vous voulez que j'aille dîner avec vous. La dernière tentative pour ajourner la fin de l'Assemblée à échouer. Les élections auront très probablement lieu, le 22 avril. Cela met mon retour en France aux premiers jours de mai. Je n’ai point de nouvelles ce matin. Duchâtel, qui sort de chez moi, m’a apporté les siennes. Tout à fait d'accord avec les miennes. Seulement il ne croit pas qu'au fond Molé sait bien en ce qui touche notre élection. Il se croit sûr que Molé, sous main, travaille activement contre lui à Bordeaux. Je lui ai montré ce que j’ai écrit au duc de Broglie. Il approuve complètement et écrira dans le même sens. Thiers a fait sa paix avec le Président. Il a vu que les affaires du Président allaient mieux, et il s'est rapproché de lui. C’est Morny qui l’écrit à Flahault. Flahault toujours très bien, très gentleman et tenant un très bon langage. Dites, je vous prie, au Prince de Metternich que je regrette, et que je regretterai beaucoup mes visites à Brighton. Nous avons à peine commencé à causer, et nous avons ce me semble, de quoi causer des années. J'espère que nous nous reverrons à Londres. Je me désespère même pas de Paris. Faites-moi aussi la grâce de demander pour moi, à la Princesse de Metternich, une petite place dans ses souvenirs de Brighton. Et notre bonne Marion ? Est-ce quelle ne m’écrira pas quelques fois pour son compte ? Est-ce qu’elle ne viendra pas vous voir ? Il y a bien peu de personnes qui gagnent plus on les voit. C'est le sort de Marion. Je la charge de mes amitiés pour ses sœurs. Adieu. Adieu. Il fait plus froid ce matin. Prenez bien vos précautions demain. Adieu. Adieu. G.
Brompton, Mercredi 14 février 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton. Mercredi 14 février 1849
J’étais sûr que vos promenades par ce froid ne vous valaient rien. Il n’y a qu’une manière de se débarrasser d'un rhume, c’est de rester dans la même atmosphère, et dans une atmosphère douce. J'espère avoir de meilleures nouvelles demain. J'en veux bien à votre toux de vous avoir empêchée de m’écrire vous-même. Je doute que ce soit à votre toux que je doive m'en prendre. Mais je n’y veux pas regarder de plus près. Guérissez-vous de la toux ; elle vous fait mal et vous conseille mal. Au fait ne soyez pas souffrante ; il n’y a que cela qui me préoccupe. Je répète que j’aime mieux que vous ne veniez pas demain. Il vaut mieux ne pas voyager par ce froid. J’ai vu hier le général Dumas. Rien de plus que ce que je vous ai mandé hier, mais bien ce que je vous ai mandé. Très timidement, très indirectement. J’ai très nettement, été toute espérance que je laissasse faire, de moi, un bouc émissaire. Voilà la phrase dans laquelle se résume ma lettre au duc de Broglie : " Je ne demande rien à personne. Rien à mes anciens amis. Rien à plus forte raison, à mes anciens adversaires. Je ne recherche point la réparation qui m’est due. Mais lorsqu'elle vient spontanément à moi, j'ai droit d'attendre qu'on ne se mette pas en travers pour l'empêcher de m’arriver. Et je ne le souffrirai pas. " Ma conversation avec Dumas a été le commentaire de cette phrase. La Reine est dans le même état. Abattu, ne voulant, ni manger, ni marcher, quoique ses médecins l'exigent. Le duc d’Aumale vient de louer, un pied à terre à Londres, entre Charing-cross et la rivière. Il y passe ses journées à arranger une petite bibliothèque. Les nouvelles du général Changarnier excellentes. L'espoir est là. Je viens de voir Montebello. Il part demain pour aller passer quinze jours à Paris, voir sa mère, et aviser un peu à ses affaires électorales dans le dép. du Gers en celui de la Marne. Il y tient et il a quitté la France depuis si longtemps qu'on l'y connaît peu. Il a besoin d’exhorter ses amis. Je l'ai mis bien au courant de la situation. Il est absolument de mon avis. Son attitude et son langage seront très bons. Il regrette fort de n'avoir pas le temps d'aller vous voir. Barante est spirituel, sensé, ingénieux et judicieux, un peu terne, et pas très frappant. ni pour les hommes de beaucoup d’esprit ni pour le gros du public. De plus, un peu confus et incohérent ; les idées se suivent plus qu'elles ne se tiennent. Adieu. Adieu. Il me semble que je vous entends tousser. Cela me poursuit. Adieu. Je remercie la bonne Marion. Adieu. G.
J’étais sûr que vos promenades par ce froid ne vous valaient rien. Il n’y a qu’une manière de se débarrasser d'un rhume, c’est de rester dans la même atmosphère, et dans une atmosphère douce. J'espère avoir de meilleures nouvelles demain. J'en veux bien à votre toux de vous avoir empêchée de m’écrire vous-même. Je doute que ce soit à votre toux que je doive m'en prendre. Mais je n’y veux pas regarder de plus près. Guérissez-vous de la toux ; elle vous fait mal et vous conseille mal. Au fait ne soyez pas souffrante ; il n’y a que cela qui me préoccupe. Je répète que j’aime mieux que vous ne veniez pas demain. Il vaut mieux ne pas voyager par ce froid. J’ai vu hier le général Dumas. Rien de plus que ce que je vous ai mandé hier, mais bien ce que je vous ai mandé. Très timidement, très indirectement. J’ai très nettement, été toute espérance que je laissasse faire, de moi, un bouc émissaire. Voilà la phrase dans laquelle se résume ma lettre au duc de Broglie : " Je ne demande rien à personne. Rien à mes anciens amis. Rien à plus forte raison, à mes anciens adversaires. Je ne recherche point la réparation qui m’est due. Mais lorsqu'elle vient spontanément à moi, j'ai droit d'attendre qu'on ne se mette pas en travers pour l'empêcher de m’arriver. Et je ne le souffrirai pas. " Ma conversation avec Dumas a été le commentaire de cette phrase. La Reine est dans le même état. Abattu, ne voulant, ni manger, ni marcher, quoique ses médecins l'exigent. Le duc d’Aumale vient de louer, un pied à terre à Londres, entre Charing-cross et la rivière. Il y passe ses journées à arranger une petite bibliothèque. Les nouvelles du général Changarnier excellentes. L'espoir est là. Je viens de voir Montebello. Il part demain pour aller passer quinze jours à Paris, voir sa mère, et aviser un peu à ses affaires électorales dans le dép. du Gers en celui de la Marne. Il y tient et il a quitté la France depuis si longtemps qu'on l'y connaît peu. Il a besoin d’exhorter ses amis. Je l'ai mis bien au courant de la situation. Il est absolument de mon avis. Son attitude et son langage seront très bons. Il regrette fort de n'avoir pas le temps d'aller vous voir. Barante est spirituel, sensé, ingénieux et judicieux, un peu terne, et pas très frappant. ni pour les hommes de beaucoup d’esprit ni pour le gros du public. De plus, un peu confus et incohérent ; les idées se suivent plus qu'elles ne se tiennent. Adieu. Adieu. Il me semble que je vous entends tousser. Cela me poursuit. Adieu. Je remercie la bonne Marion. Adieu. G.
Brompton, Dimanche 4 février 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton, Dimanche 4 fév. 1849
Je crois qu’il y avait complot lundi. C’est à dire un peu plus de complot qu’il n’y en a tous les jours. Le Gouvernement a eu raison de faire ce qu’il a fait. Il en a fait seulement plus qu’il ne fallait, et aujourd’hui on se sert du trop contre lui. La lutte est bien vive ; les deux partis sont bien irrités, bien de même taille et bien corps à corps. J’ai peine à croire que cette situation puisse durer deux mois jusqu'aux élections, cependant je vois qu’on l'espère assez à Paris. Si le Président tient bon avec les modérés, et si les élections se font sous cette influence, il se donne je ne sais quel temps de vie de plus mais certainement assez de temps. La prochaine assemblée aurait, en ce cas, la constitution à refaire. Peut-être la referait-on meilleure sous le manteau de la République que sous tout autre. Ce sera long et obscur. C'est ce que j’y vois de plus clair.
Jour sans nouvelles. J’irai à l'Athenaeum. Mais les journaux français n’y arrivent que tard. D'ailleurs nous n’y aurons que ceux d’hier matin. C'est ceux de ce matin qu’il nous faut. Je vous écrirai demain matin avant de partir pour Claremont. Et puis demain soir, de chez Croker où je n’arriverai pas avant 3 où 4 heures. Mais je ne sais pas à quelle heure la poste part de chez lui. J'écrirai toujours. Si nous étions ensemble Nous parlerions toujours. Ce serait mieux.
Voici ma réponse à votre nouvelle attaque à propos de Béhier. C'est une lettre de lui que Pauline a reçue. Jeudi, et où il explique pourquoi il n’est pas arrivé dimanche. J’ai eu un moment envie de me fâcher. Mais j’aurais eu tort, quoique vous ayez tort. Je n’ai pas toujours été exact. Vous restez méfiante trop longtemps. C’est tout simple. Molière était très jaloux de sa femme qui était très coquette. Et la querellait un jour. Il s’arrêta tout à coup en disant : " Au fait, je n’ai pas le droit de m'étonner qu'elle ne puisse pas s'empêcher d'être coquette, moi qui ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. " Je ne pourrais pas m'empêcher d'être jaloux. Mais, je peux fort bien m'empêcher d'être inexact. Et vous faites bien d’insister, même quand vous vous trompez. Vous finirez par n’y plus revenir Adieu. Adieu Votre écriture est bien bonne ce matin. Adieu. G.
Je crois qu’il y avait complot lundi. C’est à dire un peu plus de complot qu’il n’y en a tous les jours. Le Gouvernement a eu raison de faire ce qu’il a fait. Il en a fait seulement plus qu’il ne fallait, et aujourd’hui on se sert du trop contre lui. La lutte est bien vive ; les deux partis sont bien irrités, bien de même taille et bien corps à corps. J’ai peine à croire que cette situation puisse durer deux mois jusqu'aux élections, cependant je vois qu’on l'espère assez à Paris. Si le Président tient bon avec les modérés, et si les élections se font sous cette influence, il se donne je ne sais quel temps de vie de plus mais certainement assez de temps. La prochaine assemblée aurait, en ce cas, la constitution à refaire. Peut-être la referait-on meilleure sous le manteau de la République que sous tout autre. Ce sera long et obscur. C'est ce que j’y vois de plus clair.
Jour sans nouvelles. J’irai à l'Athenaeum. Mais les journaux français n’y arrivent que tard. D'ailleurs nous n’y aurons que ceux d’hier matin. C'est ceux de ce matin qu’il nous faut. Je vous écrirai demain matin avant de partir pour Claremont. Et puis demain soir, de chez Croker où je n’arriverai pas avant 3 où 4 heures. Mais je ne sais pas à quelle heure la poste part de chez lui. J'écrirai toujours. Si nous étions ensemble Nous parlerions toujours. Ce serait mieux.
Voici ma réponse à votre nouvelle attaque à propos de Béhier. C'est une lettre de lui que Pauline a reçue. Jeudi, et où il explique pourquoi il n’est pas arrivé dimanche. J’ai eu un moment envie de me fâcher. Mais j’aurais eu tort, quoique vous ayez tort. Je n’ai pas toujours été exact. Vous restez méfiante trop longtemps. C’est tout simple. Molière était très jaloux de sa femme qui était très coquette. Et la querellait un jour. Il s’arrêta tout à coup en disant : " Au fait, je n’ai pas le droit de m'étonner qu'elle ne puisse pas s'empêcher d'être coquette, moi qui ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. " Je ne pourrais pas m'empêcher d'être jaloux. Mais, je peux fort bien m'empêcher d'être inexact. Et vous faites bien d’insister, même quand vous vous trompez. Vous finirez par n’y plus revenir Adieu. Adieu Votre écriture est bien bonne ce matin. Adieu. G.
Brompton, Mercredi 31 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton, mercredi 31 Janv. 1849
9 heures
Hier à 6 heures, j’ai eu enfin des lettres. Je vous en envoie trois ; le duc de Broglie, M. d’Haussonville, et une troisième, très petite écriture, que je vous prie, cependant de lire vous-même, et vous seule. Elle est courte. Vous y trouverez l'explication de la lettre de Molé. Mon premier mouvement a été d'être fort contrarié, cependant, à tout prendre, je crois qu’il vaut mieux que ce qui est arrivé soit arrivé. C’est un embarras de moins dans les situations. Je gronderai et je pardonnerai. J’avais bien fait de recommander, aux deux ou trois personnes à qui j'en avais parlé de ne rien dire du petit subterfuge de M. Molé. La lettre du duc de Broglie est écrite avant la crise et ne roule guères que sur ce qui me touche. Très noire et desponding sur la situation générale. M. d’Haussonville un peu moins. Le séance d’hier aura été décisive si le débat a fini. Ou la reculade de l'Assemblée, ou l'expulsion de l’Assemblée, ou le reculade du Président devant l’Assemblée, il faut qu'une de ces trois choses là arrive. Je crois à la première. C'est ce que m'indique le vent de Paris. Je trouve que les grands préparatifs militaires du Cabinet ont plus l’air d’un acte d’intimidation que d’un prélude de combat. Duchâtel est venu dîner hier avec moi. Il avait des lettres aussi dans ce sens-là. Et sombres aussi. Si l'Assemblée recule, nous aurons les élections fin de mars. Si le Président expulse l’Assemblée et fait des élections, la prochaine assemblée le fera Empereur. Si le Président recule et livre son cabinet, la crise se prolongera, et la prochaine assemblée qui viendra je ne sais quand, chassera le Président et la République. Voilà le résumé de nos conversations. Mais encore une fois, je crois à la reculade de l’Assemblée. Pendant de l'abdication du 24 Février. La poste arrive et ne m'apporte rien de Paris. Ni lettres, ni journaux. Je les aurai à 3 heures. Merci de la lettre de M. Armand. Intéressante. Je vous la renvoie. Renvoyez-moi je vous prie, tout de suite mes trois lettres de Paris. Les Princes quoi qu’ils m'aient dit le contraire sont ; au fond, de l’avis de Lady Holland, et croient leur mère très malade. Cela perce dans leurs paroles. Je sais positivement de ce matin, que Chomel est parti hier au soir très inquiet. Point de lésion organique nulle part ; mais un dépérissement général, lent, progressif. Chomel dit que cela a commencé à la mort du Duc d'Orléans. Le Roi n’est pas très inquiet. Il ne ne veut pas l'être et on ne veut pas qu’il le soit. S’il l’était, il ferait un mal énorme à la Reine par son agitation ses explosions de tous les moments. Elle a surtout besoin de repos. J’irai samedi à Claremont.
Une heure
Voilà le Daily News. L’Assemblée a en effet reculé. Et sur le rapport Grevy et sur la loi des Clubs. Bien petite majorité qui ouvre la porte à toutes sortes d’amendements et de transactions. Mais enfin toute crise ajournée, et très probablement l'assemblée se dissoudra dans le cours du mois de mars, et les élections se feront en avril. Je ne rentrerai qu'après. Gabriel Delassort sort de chez moi. Arrivé avant-hier soir, il repart Samedi. Rien de plus que ce que nous savons. Ne croyant pas au succès des légitimistes. On passera par l'Empire. Ni lui, ni son fière ne veulent être élus à la prochaine assemblée. Il m'a lu deux lettres venues hier de sa femme et de son frère. Adieu. Adieu. On doit m'apporter aujourd’hui la circulaire Prussienne. God bless your eyes ! Adieu, Adieu. G.
9 heures
Hier à 6 heures, j’ai eu enfin des lettres. Je vous en envoie trois ; le duc de Broglie, M. d’Haussonville, et une troisième, très petite écriture, que je vous prie, cependant de lire vous-même, et vous seule. Elle est courte. Vous y trouverez l'explication de la lettre de Molé. Mon premier mouvement a été d'être fort contrarié, cependant, à tout prendre, je crois qu’il vaut mieux que ce qui est arrivé soit arrivé. C’est un embarras de moins dans les situations. Je gronderai et je pardonnerai. J’avais bien fait de recommander, aux deux ou trois personnes à qui j'en avais parlé de ne rien dire du petit subterfuge de M. Molé. La lettre du duc de Broglie est écrite avant la crise et ne roule guères que sur ce qui me touche. Très noire et desponding sur la situation générale. M. d’Haussonville un peu moins. Le séance d’hier aura été décisive si le débat a fini. Ou la reculade de l'Assemblée, ou l'expulsion de l’Assemblée, ou le reculade du Président devant l’Assemblée, il faut qu'une de ces trois choses là arrive. Je crois à la première. C'est ce que m'indique le vent de Paris. Je trouve que les grands préparatifs militaires du Cabinet ont plus l’air d’un acte d’intimidation que d’un prélude de combat. Duchâtel est venu dîner hier avec moi. Il avait des lettres aussi dans ce sens-là. Et sombres aussi. Si l'Assemblée recule, nous aurons les élections fin de mars. Si le Président expulse l’Assemblée et fait des élections, la prochaine assemblée le fera Empereur. Si le Président recule et livre son cabinet, la crise se prolongera, et la prochaine assemblée qui viendra je ne sais quand, chassera le Président et la République. Voilà le résumé de nos conversations. Mais encore une fois, je crois à la reculade de l’Assemblée. Pendant de l'abdication du 24 Février. La poste arrive et ne m'apporte rien de Paris. Ni lettres, ni journaux. Je les aurai à 3 heures. Merci de la lettre de M. Armand. Intéressante. Je vous la renvoie. Renvoyez-moi je vous prie, tout de suite mes trois lettres de Paris. Les Princes quoi qu’ils m'aient dit le contraire sont ; au fond, de l’avis de Lady Holland, et croient leur mère très malade. Cela perce dans leurs paroles. Je sais positivement de ce matin, que Chomel est parti hier au soir très inquiet. Point de lésion organique nulle part ; mais un dépérissement général, lent, progressif. Chomel dit que cela a commencé à la mort du Duc d'Orléans. Le Roi n’est pas très inquiet. Il ne ne veut pas l'être et on ne veut pas qu’il le soit. S’il l’était, il ferait un mal énorme à la Reine par son agitation ses explosions de tous les moments. Elle a surtout besoin de repos. J’irai samedi à Claremont.
Une heure
Voilà le Daily News. L’Assemblée a en effet reculé. Et sur le rapport Grevy et sur la loi des Clubs. Bien petite majorité qui ouvre la porte à toutes sortes d’amendements et de transactions. Mais enfin toute crise ajournée, et très probablement l'assemblée se dissoudra dans le cours du mois de mars, et les élections se feront en avril. Je ne rentrerai qu'après. Gabriel Delassort sort de chez moi. Arrivé avant-hier soir, il repart Samedi. Rien de plus que ce que nous savons. Ne croyant pas au succès des légitimistes. On passera par l'Empire. Ni lui, ni son fière ne veulent être élus à la prochaine assemblée. Il m'a lu deux lettres venues hier de sa femme et de son frère. Adieu. Adieu. On doit m'apporter aujourd’hui la circulaire Prussienne. God bless your eyes ! Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Elections (France), Politique (France)
Brompton, Vendredi 26 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton. Vendredi 26 Janv. 1849
Il n'y a pas moyen de me donner lundi. Béhier arrive de Paris. Dimanche soir ou lundi matin. Il ne vient que pour deux jours. Il m’apportera beaucoup de choses. J'ai besoin d'être ici lundi. Je viendrai donc demain à Brighton, selon notre premier plan. J'espère que nous réussirons à causer, un peu seuls. Vous me direz quand vous comptez revenir. J’aime bien Brighton et j'en garderai un bon souvenir. J’aimerai mieux Londres. Duchâtel sort d’ici. Mêmes nouvelles que les miennes. Misérable état des affaires. L'Assemblée veut non seulement durer, mais faire faire les élections par des Ministres à elle. Et si cela arrivait, si les ministres appartenaient à la République et non à la réaction, les élections, s'en ressentiraient beaucoup. Louis B. est encore le drapeau de l’ordre, la population n'en est pas encore à faire les élections en opposition à son ministère. L'Assemblée veut aussi faire elle-même, le budget de 1849 se promettant de se rendre populaire par des réductions d'impôts et de paralyser l'administration entre les mains de ses adversaires. Tout ce qu'il y a de plus personnel et de plus petit ; les personnes étant très petites. Pas une ombre d’idée ou de sentiment public. Dumon dit : " On ne fait plus de politique en France ; il n’y a plus que des intrigues de couloir. " L'Etat intérieur du Cabinet ici se révèle. On en parle partout. C'est sur le discours de la couronne que l’embarras éclate. On ne réussit pas à se mettre d'accord sur ce qu’on dira de l'Italie et de l’Espagne. Il me revient qu'hier Lord Palm. était pris d’un vif retour de goutte, suite de la vive contrariété. Je dîne aujourd’hui chez le Ld. Holland. Il est plus que vous ne croyez au courant de toutes choses. Adieu. Adieu. A demain 2 heures. J’aime bien la veille. C'est le lendemain qui est mauvais. Enfin, bientôt il n'y aura plus de lendemain. Adieu. Adieu. G.
Il n'y a pas moyen de me donner lundi. Béhier arrive de Paris. Dimanche soir ou lundi matin. Il ne vient que pour deux jours. Il m’apportera beaucoup de choses. J'ai besoin d'être ici lundi. Je viendrai donc demain à Brighton, selon notre premier plan. J'espère que nous réussirons à causer, un peu seuls. Vous me direz quand vous comptez revenir. J’aime bien Brighton et j'en garderai un bon souvenir. J’aimerai mieux Londres. Duchâtel sort d’ici. Mêmes nouvelles que les miennes. Misérable état des affaires. L'Assemblée veut non seulement durer, mais faire faire les élections par des Ministres à elle. Et si cela arrivait, si les ministres appartenaient à la République et non à la réaction, les élections, s'en ressentiraient beaucoup. Louis B. est encore le drapeau de l’ordre, la population n'en est pas encore à faire les élections en opposition à son ministère. L'Assemblée veut aussi faire elle-même, le budget de 1849 se promettant de se rendre populaire par des réductions d'impôts et de paralyser l'administration entre les mains de ses adversaires. Tout ce qu'il y a de plus personnel et de plus petit ; les personnes étant très petites. Pas une ombre d’idée ou de sentiment public. Dumon dit : " On ne fait plus de politique en France ; il n’y a plus que des intrigues de couloir. " L'Etat intérieur du Cabinet ici se révèle. On en parle partout. C'est sur le discours de la couronne que l’embarras éclate. On ne réussit pas à se mettre d'accord sur ce qu’on dira de l'Italie et de l’Espagne. Il me revient qu'hier Lord Palm. était pris d’un vif retour de goutte, suite de la vive contrariété. Je dîne aujourd’hui chez le Ld. Holland. Il est plus que vous ne croyez au courant de toutes choses. Adieu. Adieu. A demain 2 heures. J’aime bien la veille. C'est le lendemain qui est mauvais. Enfin, bientôt il n'y aura plus de lendemain. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Elections (France), Politique (France), Relation François-Dorothée
Brompton, Dimanche 21 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Dimanche 21 Janv. 1849
Je ne me suis jamais accoutumé à cette date du 21 Janvier. J’étais si enfant que je n'en ai aucun souvenir personnel. Mais l'impression m'en reste profonde. Je suis bien près de l’avis de Madame de Metternich. On peut oublier le champ de bataille d’Eylau, non pas la place Louis XV. J’aime cent fois mieux courir le risque de la non élection que courir, ou avoir l’air de courir après l'élection. Je viens d’écrire dans ce sens au duc de Broglie. Il est à Paris très sombre. Dumon aussi. Ce que Barante vous écrit est vrai. J’ai une lettre de lui où il me dit la même chose, et toutes celles qu’on m’apporte les confirment. De sombres pronostics, et des intrigues pitoyables, il n’y a que cela. Ce que fera le pays en masse sera peut-être bon; et à de bons instincts. Ce que feront les individus isolés ceux dont nous savons les noms, sera mauvais ; ils sont plus aigris qu'éclairés. On croit que décidément l'assemblée n'assignera point de terme fixe pour son départ. Elle se contentera de réduire à trois ou quatre le nombre des lois organiques, et voudra faire celles-là ainsi que le budget ; ce qui pourra bien la conduire jusqu'au mois de juillet. Il y a autant de mécontentement que d’abattement, et vice versa. Le public trouve que les légitimistes se remuent beaucoup, et commence à s’en impatienter. On dit que le grand dîner de M. de Falloux a déplu. On dit cependant, en même temps, que depuis quelques jours, Thiers tourne à la fusion. Mais on ajoute que ce pourrait bien être uniquement un trick de quelques jours. Des Ministres actuels. Léon Faucher est le meilleur, le plus laborieux, et le plus sérieux. Il a donc raison d’être glorieux. Mais on dit aussi qu’il est désagréable, maussade, dur, impoli et détesté. Je vous répète les rapports de deux ou trois personnes que je viens de voir, entr'autres de Duchâtel qui est revenu hier au soir de Belvair, frappé de la splendeur, de l'ordre, de la froideur et de l’ennui. Il dit que s’il n’avait pas eu pour causer un peu, Lady Alice et M. Stafford O’Brien, il ne sait pas ce qu’il serait devenu. Le duc de Rutland était en effet malade. Tout s’est passé sans lui. Duchâtel l’a vu dans sa chambre la veille de son départ. Duchâtel a bien envie, aussi de prolonger son séjour à Londres jusqu'après les élections à moins qu'elles ne soient retardées jusqu'au mois de Juillet. Nous n'aurions, en ce cas, aucune raison de ne pas retourner, dans le cours de mars. Notre retour n'aurait aucun air électoral. Votre lettre pour Barante part aujourd'hui. J’ai effacé baron et mis l'adresse. Il est place Vendôme n°8. Je vous rapporterai la sienne samedi. Adieu. Adieu. J’aime bien les longues lettres mais ne fatiguez pas vos yeux. Adieu G.
Je ne me suis jamais accoutumé à cette date du 21 Janvier. J’étais si enfant que je n'en ai aucun souvenir personnel. Mais l'impression m'en reste profonde. Je suis bien près de l’avis de Madame de Metternich. On peut oublier le champ de bataille d’Eylau, non pas la place Louis XV. J’aime cent fois mieux courir le risque de la non élection que courir, ou avoir l’air de courir après l'élection. Je viens d’écrire dans ce sens au duc de Broglie. Il est à Paris très sombre. Dumon aussi. Ce que Barante vous écrit est vrai. J’ai une lettre de lui où il me dit la même chose, et toutes celles qu’on m’apporte les confirment. De sombres pronostics, et des intrigues pitoyables, il n’y a que cela. Ce que fera le pays en masse sera peut-être bon; et à de bons instincts. Ce que feront les individus isolés ceux dont nous savons les noms, sera mauvais ; ils sont plus aigris qu'éclairés. On croit que décidément l'assemblée n'assignera point de terme fixe pour son départ. Elle se contentera de réduire à trois ou quatre le nombre des lois organiques, et voudra faire celles-là ainsi que le budget ; ce qui pourra bien la conduire jusqu'au mois de juillet. Il y a autant de mécontentement que d’abattement, et vice versa. Le public trouve que les légitimistes se remuent beaucoup, et commence à s’en impatienter. On dit que le grand dîner de M. de Falloux a déplu. On dit cependant, en même temps, que depuis quelques jours, Thiers tourne à la fusion. Mais on ajoute que ce pourrait bien être uniquement un trick de quelques jours. Des Ministres actuels. Léon Faucher est le meilleur, le plus laborieux, et le plus sérieux. Il a donc raison d’être glorieux. Mais on dit aussi qu’il est désagréable, maussade, dur, impoli et détesté. Je vous répète les rapports de deux ou trois personnes que je viens de voir, entr'autres de Duchâtel qui est revenu hier au soir de Belvair, frappé de la splendeur, de l'ordre, de la froideur et de l’ennui. Il dit que s’il n’avait pas eu pour causer un peu, Lady Alice et M. Stafford O’Brien, il ne sait pas ce qu’il serait devenu. Le duc de Rutland était en effet malade. Tout s’est passé sans lui. Duchâtel l’a vu dans sa chambre la veille de son départ. Duchâtel a bien envie, aussi de prolonger son séjour à Londres jusqu'après les élections à moins qu'elles ne soient retardées jusqu'au mois de Juillet. Nous n'aurions, en ce cas, aucune raison de ne pas retourner, dans le cours de mars. Notre retour n'aurait aucun air électoral. Votre lettre pour Barante part aujourd'hui. J’ai effacé baron et mis l'adresse. Il est place Vendôme n°8. Je vous rapporterai la sienne samedi. Adieu. Adieu. J’aime bien les longues lettres mais ne fatiguez pas vos yeux. Adieu G.