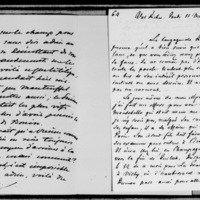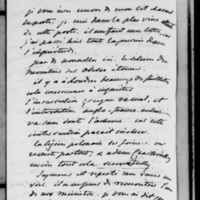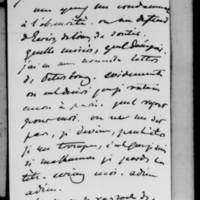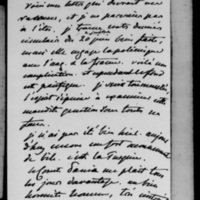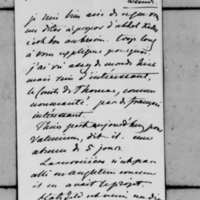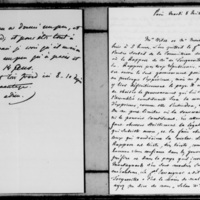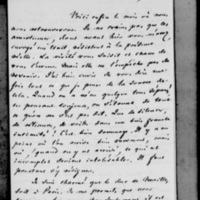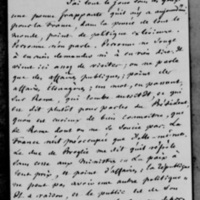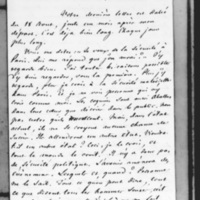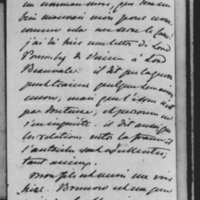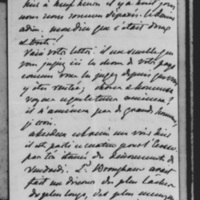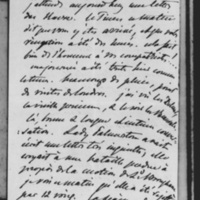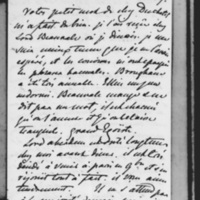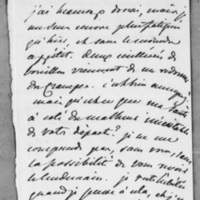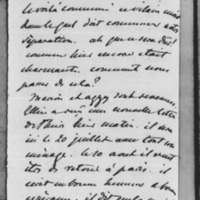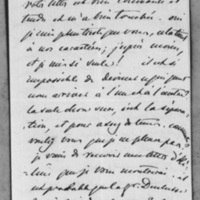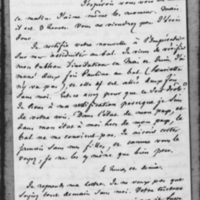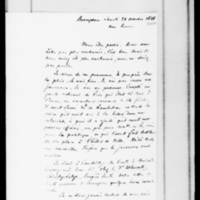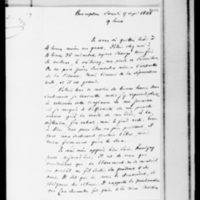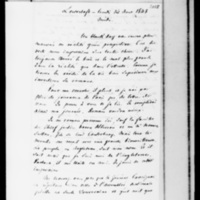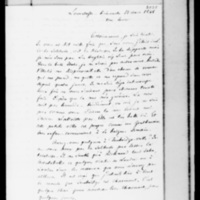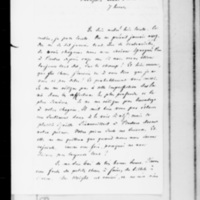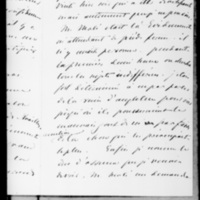Votre recherche dans le corpus : 58 résultats dans 6062 notices du site.
87. Val Richer, Mardi 6 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous voilà donc bien plus loin. Au moins j’espère que votre santé s’en trouvera bien. Ems m'a laissé un souvenir très agréable. J’aime extrêmement les bois et les montagnes. Je me suis beaucoup promené seul à Ems, en pensant que, trois ou quatre heures après, je me promènerais avec vous. Rien n’est plus doux que le mélange de la solitude et de la société qu’on aime.
Votre voisin de campagne à Bruxelles a raison. Vous êtes déjà grandement diminués. J’en suis frappé par ce que j'entends dire aux ignorants et aux simples. Les uns comptaient sur vous comme puissance conservatrice ; les autres vous redoutaient comme puissance envahissante. Vous avez perdu la confiance des uns et la peur des autres. Evidemment vous êtes capables d’une grande et longue résistance passive, mais non pas d’un grand et prompt effort actif.
Votre sécurité Russe vous reste ; votre importance Européenne baisse beaucoup. C'est un fait qui se développera de plus en plus si la guerre se prolonge ; on ne vous atteindra pas au coeur, par où vous êtes Russes ; on vous humiliera, on vous mutilera peut-être sur vos frontières, par où vous êtes européens. Je ne sais ce que cela changera à votre avenir lointain, à vos perspectives séculaires, mais votre situation actuelle et votre avenir prochain en souffriront beaucoup. Ce que l'Empereur Napoléon 1er voulait faire contre vous, en même temps qu’il luttait contre l’Angle terre, l'Angleterre, le fera avec l’aide de l'Empereur Napoléon III. Bossuet s'écrierait ; " Ô mystère des plans et des coups de Dieu. Ô vicissitudes étranges et faces imprévues des affaires humaines. " Faites bientôt la paix, c'est votre meilleur, peut-être votre seul moyen de couper court à tous les développements d’une crise que vous n'avez pas su prévoir.
Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que dit la Gazette de Cologne de la disgrâce, où est tombé chez vous M. de Meyendorff ? Il est aisé de briser les hommes d’esprit à qui l’on a commandé des fautes ; il est difficile de les remplacer.
Adieu jusqu'à l’arrivée de mon facteur. Je vous quitte pour aller profiter dans mon jardin d’un rayon de soleil. Hier, nous espérions le beau temps mais le vent du nord ouest lutte encore pour le froid et la pluie.
Onze heures
Je viens de lire les détails et l'affaire de Hango. Petite expérience d’où il paraît résulter que vos artilleurs tirent bien et que les canons Anglais portent plus loin que les vôtres. Viennent les grandes épreuves. Tout indique que l’armée Turque et un corps Anglo-Français se sont mis en mouvement pour vous faire lever le siège de Silistrie. Adieu, adieu. G.
65. Bruxelles, [Mercredi 24] mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Jeudi
Brockhausen est revenu hier de Paris. Enivré de Paris, malheureux de retrouver Bruxelles. Il dit qu'on sait bien moins là qu'ici. Je suis dans mon lit aujourd’hui c’est bien ennuyeux, j’espère que ce n’est pas dangereux. Redcliffe a fait ses embarras. Il n’a pas voulu aller au dîner donné pour le prince Français, Raglan non plus, c’est drôle. Les spectateurs trouvent cela un singulier début pour l’action commune.
Il y a des gens qui prétendent qu'il y a quelques nuages entre Paris et Londres, c’est des mauvaises langues.
Quelle misère d’aller nous trouver vous en Normandie, moi en Nassau. Ce pauvre Constantin me conseillait l’autre jour de penser comme la Grande Duchesse de Weimar qui dit que le bon Dieu n’aurait pas fait autre ment que l’[Empereur] son frère, j’ai répondu que c’était bon pour un orthodoxe de le croire, mais que moi j’étais Luthérienne, et je crois au bon Dieu plus d'esprit que cela. J'ai été prise d’un accès de sommeil après une nuit blanche, et voilà qu'il est tard. Je suis obligée de fermer ma lettre. Je viens d'en recevoir une de Greville un peu bête. Evidemment l’intéressant il ne veut pas me le dire. Adieu. Adieu.
N'oubliez pas de me donner l’adresse de Génie.
64. Bruxelles, Mardi 23 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mardi
Je vous remercie d’avoir remis mon affaire entre les mains de Génie. Il traitera fort bien avec Rothschild et cela pourra aller vite. Mais reverrai-je jamais mon appartement ? D’abord la paix, quand viendra-t-elle ? & ma santé qui s’en va au grand galop. J’ai tous les jours quelque mal nouveau. Maintenant mal à la poitrine, hier névralgie à la tête. C'est une misère. Je crois le climat de Bruxelles bien mauvais. Quelle est l’adresse de Génie ? J'ai lu des choses curieuses. Il paraît que la faction allemande est débordée à Pétersbourg. Et nos agents diplomatiques sont tous allemands. En Autriche, Prusse, Danemark, Brunnow est à Vienne. Tout cela est pour la paix et la prêche. On dit même que Paskevitch aurait dit : "Je ne sais pas pourquoi je vais faire la guerre." Et bien tout cela n'a pas cours chez nous. Je commence à croire que le petit Grand Duc Constantin gouverne.
Comme vous voyez beaucoup Mad. Mollien depuis quelques temps je suis devenue jalouse et j’ai demandé ce qu’elle était. De bonnes manières, je le sais je la connais, mais après on me dit qu’elle est très ennuyeuse, de la prétention, de l’affectation de la flatterie & des phrases. Cela ne vous va pas il me semble et je me rassure. C'est bien long toute une journée avec elle.
Le ministre Belge chez nous raconte Odessa comme nous l’avons raconté nous-même. Pas une grosse affaire, pas grand dommage à la ville même point, et celui fait à vos vaisseaux c’est les 4 canons de notre petit lieutenant d’artillerie qui l’a causé. Tout cela est donc peu de chose. Les préparatifs à Cronstadt, Sveaborg et surtout Pétersbourg formidables, & même exagérés. La Finlande très dévouée. La Suède pas de danger qu’elle tourne contre nous. Vienne l'hiver & elle aurait tout à craindre de notre part. Elle ne peut pas s'y exposer. Levorin, Courlande, Estonie, les plus affectionnées provinces de l’Empire. Enfin nous sommes en pleine confiance. Ai-je raison de dire que nous sommes très mal à l'aise, mais pas ridicules ?
Comme je suis triste de penser que vous allez être si loin. Et que moi je m'éloignerai à mon tour. Quel espace entre nous ! Adieu. Adieu.
64. Val-Richer, Jeudi 11 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le langage de Rothschild prouve qu’il a bien envie que la paix se fasse, et que vous cédiez assez pour qu’elle se fasse. Je ne connais pas d'homme dont toutes les paroles tendent plus constamment au but de son intérêt personnel, par instinct ou avec dessein. Il ne s'oublie pas un moment.
Le jour même de mon départ de Paris, j’ai fait un effort pour vous envoyer Montebello qui était venu me voir. Mais je n'y crois pas, malgré son envie. Outre ses enfants, il a des affaires qui le clouent à Paris. Son second fils doit faire, bientôt ses examens pour entrer à l'École de St Cyr. Il n’ira chez lui, en Champagne, que tard, vers la fin de Juillet. Duchâtel part le 22 de ce mois pour La Grange, et de là à Vichy, où d'Haubersart va aussi. Dumon part aussi pour aller inaugurer la moitié de son chemin de fer de Lyon à Avignon. Je trouverai encore tout notre monde à Paris jeudi prochain, mais, en en repartant, je n’y laisserai plus personne.
Moi aussi cela me déplait que vous vous éloigniez encore davantage. Ce sera pis encore quand vous serez à Schlangenbad ou à Bade. Je connais Ems ; je vous y vois. Que de sentiments puissants et doux il faut refouler dans son coeur quand on est loin ! Que de choses qu’on voudrait se dire quand on ne le peut pas, et qu’on n'aurait pas besoin de se dire si on était ensemble !
Le journal des Débats a fait un bon article sur la duchesse de Parme. Elle se fait vraiment honneur. Lord Clauricard, et M. Disraeli s’en font moins par leurs taquineries sur l'amiral Dundas et le Duc de Cambridge. Le gouvernement anglais n'a pa grandi ; mais l'opposition a bien plus baissé. Est-il vrai que lady Clauricard a perdu une de ses filles, Lady Larcelles, je crois ?
Vous voyez bien que je n’ai rien à vous dire. Je vais faire ma toilette en attendant la poste. Adieu. Midi. Voilà le N°53. Adieu, Adieu.
Je n’ai pas encore ouvert les journaux. G.
50. Bruxelles, Samedi 6 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous écris encore de mon lit et avant la poste. Je suis dans la plus vive attente de cette poste. Il me faut une lettre, car j’ai passé hier toute la journée dans l’inquiétude.
Pas de nouvelles ici. Le silence du Moniteur sur Odessa étonne. Il y a à Londres beaucoup de faillites cela commence à inquiéter l'insurrection grecque va mal, et l’intervention anglo-franco-autrichien va sans doute l'achever. Car cette intervention parait résolue.
La légion populaire se forme. On recrute partout, & Adam Czartoryski mène tout cela successfully.
Seymour est reparti sans venir me voir. Il a eu peur de rencontrer l'un de nos ministres. Je vous ai dit que son langage sur l’Empereur était trés bon. Il ne trouve pas que son gouvernement fasse assez de cas de lui, le public le comble, mais il n’y a aucun profit à ces démonstrations.
Voilà votre lettre d’hier le 59. Pas de 58. Qu’est-il devenu ? Où le réclamer ? Que concluait-il ? Vous en souvenez-vous, pourriez-vous recommencer, ou du moins vous souvenir un peu ? C’est le jeudi 4 qui me manque. Celui-ci est bien court, & vous voilà bien loin. Cet éloignement me désole. Se parler & se répondre dans 48 heures c’est encore charmant quand on n’a pas mieux.
Mlle Cerini (c’est bien cela famille Italienne de Florence) est repartie ce matin. Nos arrangements sont faits. Elle est tout ce que vous me dites d'elle reste à m’accoutumer à elle et à oublier Marion, ce qui est bien difficile. Elle viendra for good vers le 25 de ce mois. Je compte aller le 6 juin à Ems. Ce sera avec une grande tristesse. M'éloigner de vous encore davantage, c’est à pleurer ! Le Moniteur de ce matin est encore maigre sur Odessa. Il y reste au 22. Je suis curieuse de votre relation, et enfin, de la fin. Brockhausen deux fois le jour, Van Praet une, les Creptovitch, Brunnow souvent, Labensky, voilà sur quoi je roule. La petite Olga me plait bien, elle lit & m’amuse. Adieu. Adieu.
26. Bruxelles, Lundi 10 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Bual en apprenant nos propositions a dit, il est trop tard. L’Autriche ne se prononce pas encore hostilement mais elle aime à nous laisser dans l’inquiétude. Meyendorff est dans son lit de colère et de vexation. Brouillé tout-à-fait avec son beau frère. Tout a très mauvaise apparence. Ce que vous me dites de votre anglais ne présente pas une perspective passable prochaine. Ah mon Dieu que notre joie aura été courte ! A point seulement pour m'empêcher de pleurer quand je me suis séparée de vous. Mais que de soupires je pousse depuis.
Hier un arrivant russe de Vienne. Mad. Barrot, [Chrepto vitch] [Brockhausen] Van Stratten, je n’ai pas vu autre chose. J'oublie Kisseleff cinq minutes pour une commission indirecte. Même froideur de mon côté. Brunnow m’a parlé de lui, du repentir. Et bien qu'il le montre. La commission c’était Mercier lui écrivant de Dresde à propos d'une dame de compagnie, un écho de Mad. Bilinska. Grand commérage déjà. Seebach passera par ici demain se rendant à Dresde. Ah mon Dieu que les jours sont longs.
Vous ne me dites pas si vous avez reçu tous mes N° avez-vous eu le 23 ? Sans importance mais for regularity's sake.
Le Maréchal Paskevitch a des pleins pouvoirs prodigieux militaires et diplomatiques. Il commande tout depuis la Crimée jusqu’à la Baltique et prendra une résidence centrale d'où il dirigera tous les mouvements. Pétersbourg est trop loin. Nous nous replions sur nous-même abandonnant tous les postes exposés. Je crois vous avoir déjà dit cela. Je me souviens d'avoir l'année 34 proposé à l’Empereur de faire cadeau à quelqu’un des îles d'Ossil et Dago. Habitées par des sauvages, car j'en avais vu à bord du bâtiment où j’étais sur la Baltique. Nous avions pensé échoué là sur des rochers, et ces animaux étaient venus nous porter secours. Une honte d’avoir de pareils sujets si près de la capitale. Adieu. Adieu.
Que deviendrai- je sans vos lettres ! Pas un moment de soulagement pour mon esprit dans toute une longue journée. Et Paris, si beau si charmant, si vert, si animé, l'air si doux, et la causerie ! et vous deux fois le jour, quel paradis. Adieu.
13. Bruxelles, Mercredi 15 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Portez demain votre lettre chez Hatzfeld, il envoie un courrier, il recevra votre lettre jusqu'à 6 heures. J’ai vu hier le roi. Bien bonne & longue conversation. Plein de raison, & sachant se placer au point de vue de chacun. Il n’y a rien de nouveau. Si la négociation pour l'émancipation des Chrétiens réussit à Constantinople (Je vois qu'on s'était trop pressé de la regarder comme faite) tout devrait finir. Adieu. Adieu.
Priez mes amis de ne pas m'oublier. Votre rencontre avec Thiers m'amuse.
8. Bruxelles, Mardi 7 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mes yeux me condamnent à l’obscurité. On me défend d'écrire, de lire, de sortir. Quelle misère, quel désespoir. J'ai eu un homme de lettre de Pétersbourg. Evidemment on eût désiré que je restasse encore à Paris. Quel regret pour moi. On ne le dit pas, je devine, peut être je me trompe, c’est que je suis si malheureuse je perds la tête. Ecrivez-moi. Adieu. Adieu.
La Prusse se rapproche de nous.
Mots-clés : Eloignement, Guerre de Crimée (1853-1856), Santé (Dorothée)
1. Paris, Vendredi 24 février 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'avais résolu de ne pas vous dire un mot de mon chagrin et de mon vide. Cela ne se peut pas. Il y aurait trop de mensonge dans le silence. Mais je ne vous en dirais pas plus long qu'hier matin, en vous quittant. Que Dieu vous garde et vous ramène. Je reste à Paris et vous êtes à Bruxelles. Sans vous, Paris, pour moi, c’est Bruxelles pour vous.
Hier matin, l’Académie. Tout le monde y était, sauf le Duc de Noailles. Dupin m'a demandé si vous étiez partie, avec des paroles de regret et s'excusant de n'être pas allé vous voir ces derniers jours. Je le soupçonne, un peu de n'avoir pas voulu être classé parmi les complices de la Russie. Peu de conversation politique. L’Académie commence à s'occuper du jugement des prix qu’elle a à donner cette année. C'est son coup de feu. Cela la distrait des autres.
Le soir quelques personnes chez moi, entre autres, le Duc de Broglie et son fils. Broglie était venu me voir la veille, et m’avait touché. Après m'avoir parlé de toutes choses, il m'avait dit, d’un bon d’amitié aussi vraie qu’embarrassée " Vous allez vous trouver bien seul ; venez nous voir plus souvent ; nous sommes chez nous tous les jours, les dimanche et lundi chez moi, les mardi, jeudi et samedi chez Mad. d'Haussonville la mère, les mercredi et vendredi chez ma fille et chez Mad. de Stael ; vous aurez toujours là de quoi causer avec des amis. Et puis, venez dîner toutes les fois que vous voudrez, avec Guillaume." Je lui ai serré la main de bon cœur.
On ne parlait que de deux choses l’entrée de l’Autriche dans l'alliance et le soulèvement des Chrétiens de Turquie. Deux grosses choses. On ne sait précisément et certainement ni l’une ni l’autre ; mais on les accueille l’une et l’autre avec faveur, comme des espérances ou des moyens de retour à la paix qui est toujours l'idée fixe de ce pays-ci. Je me trompe ; on parlait un peu d’une deux jours. Moins nombreuses qu’on ne l’avait dit ; mais on en annonçait d'autres. On dit, aussi que quelques personnes seront engagées à aller à la campagne. " à quelle compagne ? - Oh,à leur propre campagne, chez elles, hors de Paris seulement. "
Je ne suppose elle serait bien superflue ; je n'attends que le retour de ma fille Pauline pour m'en aller au Val Richer.
A onze heures, je suis allé signer le contrat de la petite La Redorte. Une cohue immense ; 1700 personnes invitées ; l’ennui de la queue m’a pris ; il faisait sec et pas froid ; j'ai laissé là ma voiture et j’ai été à pied. En arrivant, sur l'escalier, 2 ou 300 personnes montant, 2 ou 300 descendant ; tout le monde de connaissance, étrangers et Français ; quelques rares légitimistes. J’ai vu la Maréchale et La Redorte qui donnait le bras à sa fille ; très jolie. Il m’avait rencontré dans le premier salon ; il est revenu sur ses pas avec sa fille : " Ma fille veut vous bien voir et vous remercier d'être venu."
J’ai mis dix minutes à redescendre l'escalier. Au bas, j’ai rencontré Thiers qui attendait : " N'est-ce pas, lui ai-je dit, que la patience est la plus difficile des vertus ? - Oui ; pourtant, on l’apprend avec l’âge. - Comme on apprend ce qu’on subit." J'étais dans mon lit à minuit. J'espère que vous étiez depuis longtemps dans le vôtre. J’ai joui pour vous du beau temps de la journée. Adieu, adieu. Pour combien de temps ? Adieu. G.
33. Schlangenbad, Dimanche 17 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis arrivée fatiguée. Je trouve ici la température de la Sibérie, beaucoup de monde, pas une connaissance, ma nièce qui a ici ses parents, le Roi de Wurtemberg arrivé hier aussi. Comme on ne dispose pas des rois, je ne sais trop s'il me fera une ressource. Les journaux et les lettres arrivent ici tard, je serai bien arrivée, et vous êtes plus loin que jamais. Votre dernière lettre est du 11. Au fond l'été est ma plus mauvaise saison. Je ne sais jamais l'employer. On dit qu’on va me regretter à Ems. J'y avais un vrai salon. Les princes de Prusse et [Panin] & Platen étaient le fond, cela avait fini par être agréable, après avoir bien mal commencé. Il fait très froid ici, froid comme en octobre. J’attends la porte, si elle m’apporte quelque chose, j’ajouterai, si non et en tous cas. Adieu. Adieu.
31. Ems, Mercredi 13 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici une lettre qui devrait me rassurer, et je ne parviens pas à l’être. Je trouve notre dernière circulaire de 20 juin bien faite, mais elle engage la polémique avec l'Ang & la France. Voilà une complication. Et cependant le fond est pacifique. Je suis tourmentée, l'esprit s'épuise à examiner cette maudite question sous toutes ses faces.
Je n’ai pas été bien hier. Aujourd’hui encore un fort mouvement de bile. C’est la Turquie. Le comte [Pani] me plait tous les jours d'avantage. Un bien honnête homme, très instruit, très intéressant à écouter sur la Russie, et en pleine confiance avec moi. C’est un ami de Viel Castel ils se sont rencontrés en Espagne. Nous nous parlons de bien loin c’est vrai, c’est bien ennuyeux ; et quand il y aurait tant à se dire ! C’est pourquoi mes lettres sont bêtes. Je le sens. Je ne puis penser qu'à une seule chose, & je ne puis pas dire tout ce que j’en pense. Pour changer, que veut dire le voyage de la Reine Christine ? Je trouve que nous sommes devenus bien ignorants vous et moi. Adieu. Adieu.
La lettre dont parle M. et celle où vous me disiez votre opinion sur l'Angleterre.
Paris, Lundi 6 octobre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis bien aise de ce que vous me dites à propos d'Abdel Kader c'est bon au besoin. Trop long à vous expliquer pourquoi. J’ai vu assez de monde hier mais rien d’intéressant, le comte de Thomas, comme nouveauté. Pas de Français intéressant. Thiers part aujourd’hui pour Valenciennes, dit-il. Une absence de 5 jours. Lamoricière n’est pas allé en Angleterre comme il en avait le projet. Hatzfeld est venu me dire adieu. Il part ce soir pour Berlin.
Malgré tout mon [?] de rester si longtemps sans vous voir, d'autant plus qu’à présent je suis vraiment sans ressource, je ne puis pas regretter votre absence. Il est bon que vous restiez tranquille et loin dans ce moment de bavardage stérile. L’agitation ne sert jamais et elle ôte toujours un peu de la dignité. Quelle pauvre lettre ! Mais je ne sais absolument rien. Adieu. Adieu
Val-Richer, Jeudi 17 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Le temps est splendide. J'ouvre mes fenêtres sous le plus pur ciel, et le plus brillant soleil que j’aie jamais vus en Normandie. N'étaient les vapeurs qui roulent en fuyant à l’horizon, je croirais un col et un soleil du midi. Mais je n'y crois pas. L’impression chaude et transparente de l’air du midi est restée trop vive dans ma mémoire. Je viens d'allumer mon feu.
Après la nature, l'histoire. Celle-ci est bien ancienne. Pourquoi êtes-vous si loin ? Le discours de M. de Falloux est excellent, spirituel, sensé, honnête, élevé, élégant. Je comprends que l’assemblée soit restée froide. Ni l’éloquence n'est puissante, ni la politique pratique. Rien qui satisfasse les intérêts, ni qui remue les armes. C'est, pour moitié, la faute de la situation quand il n’y a rien à faire, il n’y a rien à dire. Pourtant on pouvait certainement exciter plus fortement l’inquiétude et faire entrevoir plus distinctement l'avenir. Le Général Cavaignac m'a intéressé et ennuyé. Tout ce qu’il dit est nouveau pour lui et vieux pour moi. Il découvre des théories usées. Mais on sent un homme sous les guenilles un homme fortement convaincu et qui se battra pour la République. Plus l'avenir s'éloigne, plus il m'inquiète. La République ne peut pas vivre, et ne se laissera pas mourir. Je suis dans un état d’esprit très désagréable. Je crois fermement à un certain avenir et je ne vois pas du tout comment il sortira du présent. Comme un homme sûr d'arriver, mais qui marcherait à travers des précipices sans voir du tout son chemin. C’est la foi absolument dénuée de science. M. de Maistre serait content de celle-là.
Je n'ai point oublié les Delmas. Je suis allé chez eux et, ne les trouvant pas j'ai laissé deux cartes p.p.c., pour qu’ils sussent bien que, s'ils ne me croyaient pas, c’est que je n'étais plus à Paris. Quand j'aurais un mauvais procédé, pour vous, vous ou moi, nous irons le dire à Rome. Je vous laisserai le choix. Je n’ai pas dîné le Jeudi 10, chez les Hatzfeldt parce que j’avais un engagement antérieur chez Mad. Lenormant, engagement auquel j'ai manqué parce que j'étais encore souffrant. J’ai passé moi-même et mis des cartes, la veille de mon départ, chez Hatzfeldt, Hübner, Kisseleff et Antonini. On m'a dit que ce dernier était malade.
10 heures
Voilà des visites qui m'arrivent avec la poste. Je n'ai que le temps de fermer mes lettres. Mon bulletin de l'assemblée porte : “ Berryer est depuis quelques minutes à la tribune. Il signale le double danger de l’anarchie, et du Bonapartisme. Il devient magnifique, admirable. Il n’a jamais été plus beau, aussi beau. Mais il faut que je ferme ma lettre. La nomination du Général Magnan est très mal accueillie.” Adieu, Adieu. G.
Paris, Mardi 8 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
M. Vitet et M. Moulin sont venus hier à 5 heures. L’un quittait le Gal Changarnier ; l'autre sortait de le Commission de révision où le Rapport de M. de Tocqueville venait d'être lu. Rapport pas trop républicain. La république est encore le seul gouvernement possible ; il faut en prolonger l’expérience, mais ne pas prétendre y lier définitivement le pays. Il est le maître de choisir le gouvernement qui lui convient, et l'assemblée constituante sera la maîtresse d’exprimer comme elle l’entendra, le vœu du pays. On ne peut limiter, ni la souveraineté nationale, ni le pouvoir constituant. En attendant, il faut observer strictement la légalité, seul frein qui subsiste encore, et la faire observer, à tous ceux qui voudraient la violer.
Le ton du Rapport est triste, très triste, connu d’un homme sans confiance dans les gouvernements qu’il préfère et dans le pays qu’il invoque. Les Montagnards s’en sont montrés surpris, et mécontents. Le Gal Cavaignac a dit à M. de Tocqueville : " C'est le moins de mal que vous ayez pu dire de nous. " selon M. Charras, c’est de la métaphysique bien vague ; il faut du temps pour la comprendre. "
Ils ont demandé, l'impression immédiate du Rapport pour eux seuls et du temps. Ils le discuteront aujourd’hui et demain. On croit qu'il ne sera déposé que jeudi, et que le débat ne commencera que le jeudi suivant 17. Après la séance de la Commission les révisionnistes se sont réunis chez le duc de Broglie pour arrêter la liste des orateurs qui doivent parler et s'inscrire pour la révision. M. de Montalembert très ardent, poussant tout le monde à parler ; ce qu’il faudrait, dit-il, ce serait que les 233 membres, qui ont signé pour demander la révision, s’inscrivissent pour la soutenir. Il s'est plaint du rigorisme excessif du rapport quant à la légalité. " Il n'y a pas moyen de nous plaindre, lui a dit le duc de Broglie, ni de parler autrement ; nous pouvons subir l’illégalité ; nous ne pouvons pas l'autoriser et l'accepter d'avance. "
On a dressé la liste des Orateurs ; une douzaine environ, MM de Montalembert, Broglie, Daru, Beugnot, Goulard, O. Barrot, Berryer, Falloux, Kerdrel & &. O. Barrot prêchant avec passion, la prudence, la modération " On sera très violent contre le Président ; il faut être très doux, jeter de l’eau froide. " Il fait sur tout le monde l'effet d’une ambition impatiente et sénile, qui veut arriver, qui se croit près d’arriver, et qui meurt de peur qu’on ne la dérange, ou qu’on ne lui impose des efforts qu'elle ne pourrait pas faire. On ne sait pas encore si beaucoup de Montagnards parleront, et lesquels. On s’attend à un débat long, violent, confus et plein d’incidents.
Changarnier est triste et inquiet. Il y a évidemment recrudescence de mouvement Bonapartiste et de timidité parmi les anti bonapartistes. L’intérêt électoral gouvernera tout le monde. Dans les masses, Changarnier est un candidat inconnu. Pour lui donner quelques chances, il faudrait écarter d'avance, et absolument au nom de la légalité, les trois candidats connus Le Napoléon, le Prince de Joinville & Ledru Rollin, Est-ce faisable ? En allant à Beauvais, le Président a été harangué à Clermont-Oise, par le Président du tribunal qui lui a dit : " Vous avez été élu il y a trois ans ; vous serez réélu l'an prochain, quoiqu'on fasse, et quoi qu'on dise. " Cette boutade inconstitutionnelle de la part d'un magistrat, a fait quelque rumeur. Le Président n’a rien répondu. Thiers ne songe qu'au libre échange. Michel Chevalier voyage pour recueillir des faits contre son discours. Thiers en recueille pour le défendre. Duvergier de Hauranne revient de Claremont, et se loue de l'accueil qu’il y a reçu. Je n'ai encore point de nouvelles, des autres voyageurs. Il en viendra probablement aujourd’hui. Je pars toujours samedi. J’ai été un peu incommodé hier ; ce n'est rien. Les Hatzfeldt m’ont engagé à dîner pour Jeudi. Je n'irai pas. Je mettrai quelques cartes p.p.c. Adieu.
J’ai bien peur de ne pas avoir ce matin une lettre d'Ems. L'Allemagne ne me ressemble pas ; elle ne prend ni la ligne droite, ni le chemin le plus court. Adieu, Adieu.G.
Paris, Mercredi 2 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Je ne suis pas du tout résigné à la séparation. Mon plaisir me manquera aux heures accoutumées, et mon attente de mon plaisir tout le jour.
En vous quittant hier soir je suis retourné chez Mad. de Staël. Point d'autre visiteur que Viel-Castel uniquement préoccupé des affaires de La Plata dont le rapport se fait ces jours-ci. M. Thiers, les a toujours à coeur, plus que vous. Il ne refera pourtant pas son discours cette année, mais il en fera faire plusieurs. Pour rien, car la paix sera faite avec Rosas. 13 membres de la commission sont pour la paix contre 2. M. De Tocqueville lira Lundi 7, à la Commission, son rapport sur la révision. La Commission le discutera lundi et mardi. Il le lira à l’assemblée mercredi, ou jeudi. Le grand débat commencera, le mardi 15, grand peut-être, et long certainement.
Pour la réunion des Pyramides, sept orateurs, MM. de Broglie, Montalembert, Daru, Odilon Barrot, Beugnot, Gal Bedeau et Coquerel. Pour la République, plaine ou Montagne, MM. le Gal Cavaignac, Lamartine, Gal Lamoricière, Jules Favre, Charras, Mathieu de la Drôme Michel de Bourges. Pour le Tiers Parti, MM. Dufaure, Tocqueville et Laboulais. Pour les légitimistes, MM. Berryer, Falloux, Vatimesnil, La Rochejacquelein, Laboulie. Pour les fusionnistes MM. Molé, Montebello, Moulin. Pour le Ministère, MM. Baroche. Léon Faucher et Rouher. Voilà le programme général. Et comme il s’agit de prendre position pour les élections futures, peu de gens se retireront de la scène. Au moins dix ou douze jours de débat. Je n’ai encore vu personne qui connût le discours du Président.
La réception de Poitiers n'a pas valu celle de Tours. Peu de visites ce matin. Deux légitimistes, MM. de Neuville et de Limairac, bien pressés qu’on s'entende avec eux pour faire, à la loi du 31 mai une petite modification qui leur permette de ne pas attaquer la loi, et de voter avec la majorité, contre la Montagne. Le parti est assez découragé.
Je verrai demain le général Chabannes qui part le soir pour Claremont. Je lui dirai bien des choses à redire et il les redira. Je ne suis pas plus intéressant que cela. Adieu. La pluie me plait. Vous aurez moins chaud et point de poussière. Adieu, adieu.
Tout va bien chez moi. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 18 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
C'est aussi l’heure où vous vous levez, me dites-vous. Que faites-vous à cette heure-ci, aujourd’hui ? Quand vous vous le rappellerez, au moment où vous recevrez ma lettre, la vôtre ne me le dirait que dans huit jours. On aura beau inventer les chemins de fer, les ballons ; on ne supprimera pas l'absence. Je n'ai guère plus de nouveau à vous envoyer d’ici que vous d'Ems à moi.
J’ai fait hier mes visites à Lisieux, par la pluie. Je suis frappé de ce qu’il y a de tranquillité et de ce qui revient de prospérité matérielle dans le pays. Cette société est aussi habile à se défendre du mal qu’inhabile à conserver le bien. Il est vrai qu'en fait de prospérité comme de sécurité, elle se contente à bon marché. Toutes ces existences sont très petites pour la richesse comme pour l’esprit, et elles se soucient peu de devenir grandes, sous l'un ou sous l'autre rapport. Quand on a gagné assez d’argent pour vivre sans rien faire dans sa petite maison de ville ou de campagne, on se trouve assez riche. Quand on sait faire ses comptes et lire son journal, on se trouve assez spirituel. Jamais l’ambition n'a été si courte et si basse. Les proverbes ont toujours raison : on est punis par où l'on a pêché.
Voici où ce mot puni me mène tout à coup à M. de Lamartine. Bien des gens le trouvent bien puni. Je trouve qu’il ne le sera jamais assez. Vous vous rappelez l’article de Croker dans le Quarterly review sur l’évasion du Roi après Février, et la réponse qu’y a faite M. de Lamartine et dans laquelle il a raconté qu’il avait voulu, comme gouvernement provisoire, faire sortir le Roi en sûreté, qu’il était allé trouver M. de Montalivet, qu’il lui avait demandé où était le Roi, et lui avait offert, sur son honneur, de le faire conduire hors de France par quatre commissaires qu’il lui avait nommés, M. Ferdinand de Lasteyrie, M. Oscar de Lafayette, et deux de ses amis personnels, M. de Champeaux ancien officier dans la garde royale, et M. d'Argaud, attaché aux Affaires étrangères. Croker ne lâche pas prise aisément ; il est allé au fond de tous ces dire ; il a questionné le Roi, et par le Roi, M. de Montalivet. Il publie dans le nouveau n° du Quarterly review une réponse à la réponse de M. de Lamartine, et, il affirme que les quatre commissaires proposés par M. de Lamartine à M. de Montativet étaient, Lasteyrie et Lafayette, oui, mais au lieu des deux derniers nommés dans la réponse, MM. Flocon et Albert, [ouvriers] ! Peut-on concevoir un tel mensonge ? Car entre les deux assertions, je crois à celle de Montalivet. M. de Lamartine s’en tirera par l'absence. Il est à Smyrne. Le Quaterly review ne va pas là.
Voilà un petit désagrément pour Palmerston. C'est encore la Duchesse de Montpensier qui hérite du trône d’Espagne. Si la Reine d'Espagne mourait demain, il aurait de la peine, malgré ses 46 voix de majorité, à faire faire la guerre par son pays pour empêcher l'Infante de succéder. Car elle succéderait en Espagne sans difficulté ; les progressistes seraient les premiers à la reconnaître et Narvaez est toujours là.
9 heures.
Voilà votre lettre. Je n’en ai absolument aucune autre. Quand j’ai celle-là, j’attends les autres patiemment. Comment ne savez-vous pas encore que j’ai été cinq jours sans lettre ? Nous sommes bien loin. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 28 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Est-ce donc bien demain que vous partez ? Cela me fait l'effet d’une seconde séparation. Paris est si près ! J’espère qu’au moins les eaux d’Aix-la-Chapelle vous feront du bien. Prenez les avec précaution ; elles passent pour très fortes ; j’ai entendu dire que nous n'avions en France point d’eaux sulfureuses aussi fortes. Je ne vous crois aucun mal spécial et précis ; je vous crois au contraire un bon fond d’organisation et de tempérament. Mais vous êtes affaiblie délicate et susceptible ; il faut vous fortifier en vous ménageant ; des toniques doux et soutenus ; point de secousse. C'est dommage que je ne sois pas médecin et votre médecin. Je suis sûr que je vous traiterais à merveille. Mais vous n'êtes pas commode pour votre médecin.
J'attends Londres dans beaucoup de curiosité. Personne n'aura dit ce qu’il y à dire, et ce qui tuerait infailliblement Lord Palmerston, peut-être même dans la Chambre des Communes actuelle. Je connais bien les Anglais. et je les comprends d'instinct encore mieux que je ne les connais ; je sais qu’elles sont les cordes qu’il faut toucher pour aller jusqu'au fond de leur âme. Ils ont à la fois le respect des anciennes choses, des anciennes lois, et le goût de la liberté ; ils sont en même temps de vieux conservateurs et des libéraux sensés et honnêtes ; il faut leur montrer que Lord Palmerston ne leur ressemble et ne leur convient ni sous l’un ni sous l'autre rappor ; qu’il fait en leur nom de la politique qui n’a rien d'Anglais, point de dignité, point de moralité point d'intelligence des vrais intérêts de la liberté dans le monde comme de la considération et de l'influence de l’Angleterre. Je voudrais soulever contre lui, l’esprit libéral des Anglais, aussi bien que leur esprit conservateur, et le leur faire voir tel qu’il est réellement, comme un brouillon sans prévoyance et sans foi, qui va servant et semant partout, l'anarchie révolutionnaire, et qui revient ensuite dire dans le Parlement qu’il a soutenu l'Angleterre et la liberté tandis qu'il les a partout compromises, et rendues suspectes ou odieuses. Vous voyez ; je retombe toujours dans mon ancien métier. Je vous assure, et vous me croirez sans peine, que mon discours serait très bon.
10 heures
J’avais bien raison de vous envoyer un discours. Je viens de parcourir celui de Lord Palmerston. Le meilleur, ce me semble, qu’il ait jamais fait. Spirituel, spécieux et convenable. Je le lirai attentivement. Mais je persiste dans le mien. La réponse à Lord Palmerston pourrait être foudroyante. Puisque Sir J. Graham s'est engagé si avant, Sir Robert Peel en fera certainement autant et parlera bien. Le débat est solennel. Et certainement Palmerston en restera blessé à mort. Je crains seulement que le public, les badauds honnêtes, ne soient pas suffisamment détrompés et éclairés, sur son compte. Vous aurez moins chaud aujourd'hui. L'orage n’est pas encore fini. Il abattra la poussière sur votre route. Adieu. adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 1er novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Huit heures
Voici enfin, le mois où nous nous retrouverons. Je ne crains pas que les amertumes, dont avant-hier vous m'avez envoyé un trait résistent à la présence réelle. La vérité vous saisit et chasse de vous l’erreur. Mais elle ne l'empêche pas de revenir. J’ai bien envie de vous dire une fois tout ce que je pense de la source de cela. Quand on a vécu quelque temps séparés en pensant toujours, on s'étonne de tout ce qu’on ne s’est pas dit. Que de silences, de réticences, de voiles dans une bien grande intimité! C’est bien dommage. Il y a un point où l'on arrive bien rarement, mais où, quand on y est arrivé, ce qui est incomplet devient intolérable. Il faut pourtant s'y résigner. Je suis charmé que le Duc de Noailles soit à Paris. Je me promets que nous causerons beaucoup. Non seulement il est très sensé et très honnête, mais je me figure qu’il y a en lui quelque chose de plus qu’il ne montre. J’aime les gens dont je n‘ai pas vu le bout. J’ai eu hier ici un autre ancien député conservateur du midi. Il avait une lettre de son fils, jeune maréchal des logés dans un régiment de chasseurs à Rome. Voici les termes. « Nous nous ennuyons bien ici. Nous ne savons pas pour qui ni pourquoi nous y sommes. On nous fait changer tous les jours notre fusil d’épaule ; demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Le Pape devrait bien revenir pour que nous nous en allions. Voilà le sentiment populaire dans l'armée. Je vois venir un bien autre embarras. Le Pape dira, ou donnera clairement à entendre qu'il ne reviendra à Rome que lorsque les Français n'y seront plus. Et alors comment s'en ira-t-on. S’en aller, ce sera être chassé par le Pape. J'admire ce que la bonne politique peut devenir, entre les mains des sots. Ici aussi le coup d'état est dans l’air ; c’est-à-dire qu'on en parle car je ne trouve pas qu’on y croie. Quel qu’il soit s’il se fait sans le concours de l'assemblée et du général Changarnier, ce sera un triste coup de cloche. Le Président a beaucoup perdu dans les campagnes mêmes. Il ne me paraît plus en état d’agir seul. Comme de raison, il me vient bien des messages empressés et obscurs. C'est l’état de tous les esprits. Il m'en vient d’Emile de Girardin toujours, en ébullition. Il me paraît que la présidence du Prince de Joinville est décidément son idée du jour, et qu’il se propose de la pousser chaude ment à travers le premier nouveau gâchis. Je ne sais plus quelle importance conserve encore son journal. Je le vois toujours assez rependu pour nuire. Et l'homme a, dans ce genre, une vraie puissance.
Midi
Voilà un nouveau cabinet qui m’arrive. Ce n'est évidemment qu’une préface. Quel déplorable et ridicule gâchis ! J’ai la conviction que tout cela ne sera que ridicule. Il faudrait que les honnêtes gens fussent plus sots que les sots pour se laisser déposséder et mâter avec les forces qu’ils ont entre les mains. Je suis charmé que vous vous inquiétiez moins. Quand serons-nous réunis ? Adieu, Adieu Adieu. G.
Broglie, Jeudi 20 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai tout le jour sous les yeux une preuve frappante qu’il n’y a aujourd’hui pour la France, dans la pensée de tout le monde, point de politique extérieure. Personne n'en parle. Personne ne songe à en rien demander ni à en rien dire. Il vient ici assez de visites ; on ne parle que des affaires publiques ; point des Affaires étrangères ; un mot, en passant, sur Rome, qui tombe aussitôt et qui est dit plutôt pour parler du Président. qu'on est curieux de bien connaître, que de Rome dont on ne se soucie pas. La France n’est préoccupée que d'elle-même. Le Duc de Broglie me dit qu’il répète sans cesse aux Ministres : " La paix à tout prix, et point d'affaires ; la République ne peut pas avoir une autre politique. " Il a raison, et le public, est de son avis. Les journaux seuls sont en dehors de cette disposition du public, et raisonnent à perte de vue sur l'Europe. Et leurs lecteurs se plaisent assez à cela. Mais comment on se plaît à un moment de badauderie et d'oisiveté. Personne ne prend les journaux au sérieux. Ce qui n'empêche pas qu'à la longue ils n'agissent. Un jour viendra où le pays sortira de cette insouciance forcée sur sa politique et sa position au dehors, et s’en vengera sur le gouvernement qui lui en fait une nécessité. Etrange chaos que l'état des esprits et ce qu'ils ont à la fois d'activité et d’apathie de passion et d’indifférence de bon sens et d’inintelligence. Plus j'y regarde, plus je me persuade que c’est bien un état de transition, non une chute définitive. C'est ma seule consolation, et je crois que c’est la vérité.
Transition à quoi. Je n’en sais pas plus que je n’en savais quand nous avions le bonheur de causer ensemble de tout cela. Pourtant je suis plutôt confirmé qu’ébranlé dans l’idée à laquelle j'aboutissais en définitive quand nous voulions absolument voir à ceci une issue.
Onze heures
Je vous reviens après être allé entendre une homélie de l'évêque d'Evreux dans l’Eglise de Broglie. Hélas oui, il y a deux grands mois que nous nous sommes quittés ! Je n'essaie pas de vous dire combien vous me manquez. Vous me manquez non seulement pour les choses que je ne dis qu'à vous et que je n’entends que de vous, là où le vide est complet quand vous n’y êtes pas. Vous me manquez même dans les moments où il n’y a pas de vide, ou ce que j’entends et dis me plait et m'intéresse. Je suis toujours sur le point de me retourner pour voir si vous êtes là et pour vous mettre de part dans tout. Que de choses je ne dis pas que je vous dirais, et que de choses je vous dirais que je ne vous ai jamais dîtes ! Et la vie s’écoule dans cette impatience d’une affection qui ne donne et ne reçoit pas, tout ce qu'elle pourrait recevoir et donner dans le sentiment d’un grand bonheur possible et manqué.
Paris sera tranquille. Et si les rouges essayaient de le troubler la tranquillité serait pleinement rétablie en quelques heures comme au 13 Juin. La force et la volonté de faire cela y sont également. Certainement le choléra diminue. Pourtant il y en a encore, et presque toujours grave. Ne vous ai-je pas déjà dit hier qu'à cause du Choléra, on retardait de quinze jours la rentrée des écoliers aux collèges ?
La lettre de Marion est charmante et très originale, si cette aimable fille était heureuse, elle aurait tout le bon sens hors duquel elle se jette quelquefois pour répandre et animer son âme. Elle a naturellement beaucoup de bon sens. Mais il faut aux femmes même aux plus distinguées, du bonheur personnel, et de cœur, pour être dans cet équilibre intérieur qui met en état de voir les choses du dehors comme elles sont réellement, parce qu'on n'a rien à leur demander. Je parlais un jour à la Duchesse de Broglie d’une jeune femme de sa connaissance, et de la mienne qui avant son mariage avait un amour propre assez agité et exigeant, et qui depuis son mariage, était devenue parfaitement calme et modeste : " Je le crois bien, me dit-elle, elle a ce qui apaise et satisfait le plus grand amour propre possible d’une femme : elle est aimée et heureuse. " J'ai bien souvent reconnu la vérité de cela. J’ai peur que notre bonne Marion reste toujours républicaine, tantôt pour Cavaignac, tantôt pour Manin, faute d'avoir son roi à elle, un mari qu'elle adore, et qui l'adore. Adieu. Adieu.
Je ne vois rien dans mes journaux de ce matin. Je pars toujours le 28 pour retourner au Val Richer le Duc de Broglie, le 29 pour Paris. Il veut être au premier jour de l’assemblée aussi à la réunion du Conseil d'Etat qui aura probablement, lieu la veille. Adieu, Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 21 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Votre dernière lettre est datée du 18 Août, juste un mois après mon départ. C'est déjà bien long. Chaque jour plus long. Vous me dîtes : " Je veux de la sécurité à Paris. Qui me répond que j'en aurai ? " J'y regarde bien. J’ai toutes les raisons possibles d'y bien regarder, vous la première. Plus j’y regarde, plus je crois à la sécurité matérielle dans Paris. Et je ne vois personne qui n’y croie comme moi. Les coquins sont aussi abattus dans leur cœur que décriés dans le public. Non pas certes qu’ils renoncent. Mais dans l'état actuel, ils ne se croient aucune chance de succès. Ils attendront un autre état. Viendra- t-il un autre état ? Ceci, je le crois, et tout le monde, le croit. Il n’y a donc pas de sécurité politique. L'avenir amènera des évènements. Lesquels et quand ? Personne ne le sait. Tout ce qu'on peut dire, tout ce que disent tous les hommes sensés, c’est que dans trois ans, si d'ici là on ne fait rien, la réélection du Président et de l'assemblée fera une révolution, bonne ou mauvaise plus probablement mauvaise. Et probablement avant ce terme, aux approches de ce terme, pour éviter cette révolution inconnue, les pouvoirs aujourd’hui établis, et certainement, les plus forts, l'Assemblée, le Président, le Général Changarnier feront quelque chose. Personne ne sait quoi, ni quand. Tout le monde croit à quelque chose et croit que quelque chose sera nécessaire. Je reviens donc à mon point de départ. De la sécurité matérielle, oui. Pas de troubles dans la rue. De la sécurité politique, pas d’évènements graves. Personne ne peut vous promettre cela. La question se réduit donc à ceci : quel genre et quel degré de sécurité vous faut-il ?
M. de Metternich a raison ; l'exécution du prêtre à Bologne est stupide. C’est du bois sur un feu qui s'éteint. Les gouvernements vainqueurs ne savent pas le mal qu’ils se préparent quand ils redonnent un bon thème aux mauvaises passions vaincues. Ce que veulent surtout les révolutionnaires, c’est un fait, un acte, un nom-propre, de quoi parler. Ils excellent ensuite à commenter et à répandre.
Je ne comprends pas Brünnow à votre égard. Non seulement de la négligence, mais de la malveillance, c’est trop bête pour un homme même pour un subalterne d’esprit. Il faut que je ne sais quand, je ne sais comment, vous l’ayez blessé dans quelque secret repli de son cœur subalterne. Vous pouvez avoir le Génie de l'offense ; quelque fois le voulant bien, quelquefois sans le savoir. Peu importe du reste cette occasion-ci. M. de Brünnow n'apprendra rien à Lord Palmerston sur l’amitié que vous lui portez.
Je regrette bien Lord Beauvale pour vous. C'est évidemment la conversation qui vous plaît le plus. Pourquoi les Ellice ne veulent-ils plus venir à Paris ? Est-ce que le père et la mère ont peur ? Avez-vous des nouvelles de Bav. Ellice ? Est-il en Ecosse ? J’ai vu arriver hier un petit anglais, le second fils de Sir John Boileau. Il vient passer huit jours au Val Richer. L’aîné est aux Etats Unis. Milnes veut venir me voir ici. Bon homme et fidèle, malgré la promiscuité de son amitié.
Onze heures
J'ai beau faire ; j’attends la poste le mardi comme les autres jours. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Jeudi 9 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ce que vous mande Piscatory est triste. Comme tout le monde dit de même, ce doit être la vérité attendue. J’ai eu hier quelques visites du voisinage. (à propos la vieille princesse si touchée de ce que vous lui adressez, que vite elle a envoyé chercher des fleurs, bouquets, plantes & & pour orner mon salon) le duc de Cambridge qui part aujourd’hui pour faire visite à son frère à Hanovre. Plus tard j’ai été dîner chez la duchesse de Glocester, rien que la famille royale et moi. J’ai regretté d’avoir accepté, car malgré mes barricades, mes yeux ont souffert de la lumière rien d’intéressant naturellement. A onze heures j'ai été dans mon lit. La duchesse de Cambridge se plaint et avec raison, de la duchesse d’Orléans qui ne lui a pas fait visite quoiqu’elle en ait fait aux autres membres de la famille. Cela fait un petit commérage qui les occupe. Sa fille de Meklembourg me plait chaque fois que je la rencontre. Le vieux Dennison M.P. frère de la. Marquise de Conyngham vient de mourir. Il laisse à lord Albert Conyngham, second fils de sa sœur toute sa fortune en terre et de plus deux millions de Livres, ce qui veut dire deux millions de Francs de rente. Vous avez vu lord Albert chez moi à Paris, pas grand-chose.
Voici votre lettre de Mardi. Toujours un nouveau bonheur quand j'aperçois votre petite lettre dans la grosse main de Jean. Quand aurai-je un autre bonheur que celui-là ? Adieu. Adieu. Je ménage mes yeux aujourd’hui, et je n’ai pas une nouvelle à vous donner ici on ne parle que de la reine et de l'Irlande. Il me semble que nos affaires vont cependant bien en Hongrie, Dieu merci. Adieu dearest Adieu. Comme vous êtes loin ! Adieu.
Richmond, Mercredi 1er août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Un nouveau mois, qui sera un bien mauvais mois pour nous comme cela me serre le cœur ! J’ai lu hier une lettre de lord Ponsonby de Vienne à lord Beauvale. Il dit que la guerre peut trainer quelques semaines encore, mais que l’issue n'est pas douteuse, et personne ne s'en inquiète. Il dit aussi que les relations entre la France et l’Autriche sont excellentes ; tant mieux.
Mon fils est venu me voir hier. Brünnow est un peu noir sur la Hongrie. Je ne sais pas de nouvelles du reste. Le choléra continue et grandit. 130 morts dans la journée. C'est beaucoup, & ce n'est pas tout ; on avoue cela, mais le vrai chiffre est au-delà de 200. Je reste cependant. Je me soigne. Je me fais beaucoup trainer dans le parc, il n’y a pas de choléra là. Je passe et repasse devant le beau chêne, & vous savez à quoi je pense et repense tous les soirs chez Beauvale et un peu aussi chez Mad. Delmas.
A propos elle a été bien flattée de votre souvenir. Faites dire un mot à la vieille princesse. Le temps est passable. J’occupe dans ce moment-ci l'appartement qu’avait la Reine. Mais c’est un peu bruyant, & j’espère succéder à Mad. Steigley qui part dans peu de jours.
Je suis allée aux informations à propos de la lettre de l’Empereur au Président ; c'est la même formule que pour le Président des Etats-Unis. Mon grand et bon ami. N’importe je suis bien aise qu’il ait écrit. Je ne vois pas cependant que les journaux français le disent. C’est dans le Morning Chronicle que je l’avais trouvé.
J’ai rendu compte à Lord Aberdeen de ma petite discussion avec Lord John à son sujet. Cela l’amusera. Je n’ai pas manqué avant hier de lui faire parvenir votre lettre. Adieu. Adieu dearest, adieu.
Que c’est long déjà, & que ce sera long encore. Les correspondances de Paris dans les journaux anglais disent qu'on est inquiet. On croit à un coup d’état on le craint parce que les trois partis monarchistes sont divisés mais on ne peut pas rester comme on est. Quel puzzle. Adieu. Adieu.
Richmond, Lundi 30 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Duchâtel m’a tenu longtemps et mon essai de la poste de 4 heures ne peut pas se faire aujourd’hui. Il part le 4. Il s'embarque à Ostende, le lendemain il dîne à Spa chez sa belle-mère. Il ira ensuite à Paris pour peu de jours & de là chez lui dans le midi. Je crois qu'il préfère ne pas débarquer dans un port français. Son arrivée ne fait pas événement et il aura fait d'une pierre deux coups, la France & Paris. On lui écrit pour lui conseiller cela. Il sera à Paris encore avant la dispersion de l'Assemblée. On lui mande que Morny est un vrai personnage et que c’est lui qui pousse à l’Empire. Duchâtel n’y croit pas. Il ne voit d’où viendrait le courage. En même temps je pense, que si on le tentait cela serait accepté par tous, lui, Duchâtel le premier. Morny a écrit à Duchâtel une lettre très vive d'amitié, de vœux de le voir à Paris, à l’Assemblée, disant que des gens comme lui sont nécessaires & &
Il faut que je vous dise qu'ayant été très inquiétée par suite de ce qui s’est passé au Havre le 19. J’avais écrit au duc de Broglie pour lui demander s’il voyait du danger pour vous au Val-Richer, il me répond et me rassure pleinement, me disant que les quelques cris poussés au Havre n’avaient aucune signification aucune portée mais voici comme il finit sa lettre... " Votre bon souvenir m’est d’autant plus précieux que je n’espère point vous revoir ici. Vous avez vu les derniers beaux jours de la France, ni vous, ni nous ne les reverrons plus. " Il n’espère pas me revoir. Cela veut dire poliment que je ferai grand plaisir en ne [?] pas. C’est clair. Je [?] bien ne pas lui faire ce plaisir. Lettres de vendredi et Samedi très intéressantes. Je vois que vos journées sont bien garnies. J’en [suis] bien aise. J’aime qu’on vienne [vous] voir.
Mardi 31. Onze heures
[?] ce que m'écrit mon fils de [?] en date du 20. [Je] vous ai écrit dans le temps que les français mettaient le maintien [de] la constitution comme prix au [retour] du Pape, ils n’auraient rien [?], & que si le Pape avait la faiblesse d’accepter cette condition [?] serait recommencé. D’après tout ce que j'ai su, le [?] Pape retournerait à Rome les mains libres. Lui de sa personne ne retournera qu’après un an à Rome où il serait représenté par une commission, et toutes les commissions le [?] à une sécularisation partielle de l’administration. En attendant le Pape irait probablement résider dans quelque ville des légations. Rayneval qui c’est conduit dans toute cette affaire avec sagesse et habileté succéderait dit-on à Haverest. Si le pays est tranquille et gouvernement fort. "
Voilà un petit rapport très bien fait. Je lis avec plaisir que mon Empereur a écrit au Président pour lui annoncer, je crois la mort de sa petite-fille. Voilà les relations régulières rétablies. Cela ne fera pas à Claremont autant de plaisir qu'à moi.
Hier M. Fould s’est annoncé chez moi, je l'ai reçu. Quelle figure ! Che bruta facia ! Puisque nous sommes voisins, il a cru devoir venir. Il m’a rassurée sur le choléra de Richmond aussi bien que sur celui de Paris. Il arrivait de là. Il dit que c'est bien vide & bien triste. J'ai fait ma promenade en voiture avec lord Chelsea. Le soir j’ai [?] le piquet à Lord Beauvale. Cela ne lui a pas plu du tout. Je suis un mauvais maitre.
J’ai pris un nouveau médecin à Richmond. J'ai horreur de celui qui m’a tant effrayé l’autre jour. M. G. de Mussy reviendra me voir aussi. Adieu. Adieu. Aujourd’hui Mardi, Il y a quinze jours, je vous ai vu encore. Je ne veux pas me laisser aller à vous dire tout ce que je sens, tout ce que je souffre ! Trouvez un mari, je vous en prie. Travaillez- y. Adieu. Adieu dearest adieu.
Richmond, Vendredi 27 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hier nous avons eu le plus violent orage qu’on ait jamais eu en Angleterre. 3 heures de durée, éclairs et tonnerre incessant. L'orage s'acharnait sur le Castel & le royal hôtel. J’ai passé tout ce temps seule, la communication impossible. Le déluge. La pluie a passé le toit & j’ai reçu un vrai bain de douche dans ma chambre à coucher. Plus tard j’ai été voir Metternich il m’a prouvé très longuement que cet orage devait tuer le Choléra. Electricité & & C’était de la sienne. En politique, il est charmé de Montalembert, de Thiers. Il dit que les nouvelles de Hongrie sont excellentes. Je ne vois pas cela encore. Il m'a beaucoup demandé de vos nouvelles. Je l'ai trouvé fort maigre, mais il est bien.
Le soir j’ai vu Beauvale, et puis de la musique chez Delmas. Cela m’a un peu échauffé, & j'ai mal passé la nuit. Hier il est mort 120 personnes du Choléra à Londres, avant-hier 64. Cela augmente beaucoup. J'ai lu ou plutôt parcouru Thiers, il a dit d'excellentes choses, et le ton de ce discours m’a paru bon. Les journaux anglais disent qu'il a produit beaucoup d’effet. Ils le donnent aujourd’hui tout en entier.
Voici votre lettre. Je vais affranchir la mienne, et nous verrons. Comment il n'y a que huit jours aujourd’hui que vous êtes arrivé au Val Richer ? Dieu que cela a été long. Je ne vous parle pas de ma santé par superstition en effet. Quand je serai malade je vous le dirai. Le parlement sera prorogé le 31. Point de séance royale. La reine part d'Osborne le 1er août pour l’Irlande. Adieu. Adieu. Je n’ai pas un mot de nouvelle à vous donner l'orage a intercepté tous les arrivages. La province a vécu sur son propre fond. God bless you dearest.
Richmond, Mercredi 25 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hier à neuf heures il y a huit jours nous nous sommes séparés. Le dernier adieu. Mon Dieu que c’était doux. & triste. Voici votre lettre. Il me semble que vous jugez ici les choses de votre pays comme vous les jugez depuis que vous y êtes rentré ; choses & hommes. Voyons ce que le temps amènera ? Il n'amènera pas de grands hommes, je crois.
Aberdeen est venu me voir hier. II est parti ce matin pour l’Ecosse. Pas très étonné du dévouement de Vendredi. Lord Brougham avait fait un discours des plus lâches, des plus longs, des plus ennuyeux du monde. Le parti était révolté. Il ménageait lord Palmerston avec une tendresse paternelle. Cela a dégouté beaucoup de monde. Quelques Pairs sont sortis disant qu’ils ne voulaient pas voter pour une motion faite par lord Brougham. Je crois que ceci était un prétexte, et que la vraie raison était la crainte de renverser le Ministère. Quoiqu'il ne soit les Lords Hefford, Pembroke. Tankerville, Cantorbéry, Willougby & & & s’en sont allés. Le duc de Wellington est parti aussi, il est vrai que pour celui-là son vote eût pu être de l’autre côté. On l’accuse fort de désorganiser encore un parti qui l’est déjà beaucoup. Lord Aberdeen a eu hier un dernier entretien très long avec lord Stanly. Ils ne sont venus à reconnaître qu’il n’y avait pour le moment aucun moyen de prendre les affaires ensemble quand bien même les circonstances écarteraient les présents ministres du pouvoir. Aberdeen parle très dédaigneusement de Peel. D'abord comme d'un défunt et puis comme du destructeur du plus grand et respectable parti qu’ait jamais eu l'Angleterre. Moi aussi, mon Peelisme est fini. Lady Alice, parle comme les autres. Aberdeen craint fort les meetings radicaux qui vont se tenir partout en faveur des Hongrois. Il trouve que l’esprit démagogique grandit. Cela l’inquiète.
J’ai oublié de vous dire hier qu' Ellice a reçu une nouvelle lettre de Mad. d'Osne sur le même ton. Thiers et toute la famille sera à Dieppe le 3 août pour y passer quatre semaines. Mon fils est venu me voir hier pour quelques heures. Sa tournée dans le pays lui a profité, il se porte mieux. Brunow envoie des courriers à Varsovie. L’Empereur doit y être revenu hier. J’ai été hier au soir chez Lord Beauvale. Nous sommes une grande ressource l’un pour l’autre Bulwer m'écrit une longue lettre de Francfort, Résumé. L’Allemagne veut l’Unité. La Prusse, si elle ne fait pas de fautes, formera une [?] du Nord. Les petits princes disparaîtront certainement. L'Autriche reprendra sa situation après que la guerre de Hongrie sera terminée. Il n’y a là rien de neuf.
Adieu. Adieu. Je pense à vous tout le jour. Cela n’est pas nouveau non plus, adieu, adieu.
Val-Richer, Dimanche 22 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'aurai le cœur un peu à l'aise que lorsque nous nous serons mutuellement répondu à notre première lettre. Il me semble qu'alors la séparation sera un peu moindre. Vous avez raison ; je suis plus heureux que vous ; j'ai des ressources et des plaisirs qui vous manquent. Aussi je n'en jouis qu'avec un certain sentiment de remords. Mes plaisirs me rappellent à vous comme mes privations. Je viens de me lever. Il fait un temps admirable, l’air est doux et vif, le bleu du ciel aussi pur et aussi brillant que le vert de mes bois. Le climat est réellement bien différent. Je voudrais vous envoyer mon soleil à Richmond. Bien mieux, vous amener, vous, sous mon soleil. Vous y viendrez, soignez-vous bien d’ici là, c'est ma préoccupation de tous les moments.
Les visites commencent bien vite. J’en ai déjà eu quatre hier. De braves gens du pays de ceux qui m’ont été fidèles, et qui restent indignes contre ceux qui ne l'ont pas été. Je leur dis qu’ils ont raison d'être indignes, et je suis plus indulgent qu'eux. Je traiterai mal un très petit nombre d'infidèles, deux ou trois, les plus scandaleux. Amnistie pleine et entière pour tous les autres. La bonne politique est partout la même. Ne trouvez-vous pas que j'ai l’air d’un souverain restauré ? C’est un peu prompt. J'en suis fort loin ; personne n'en est plus convaincu que moi. Mais je suis décidé à prendre mes avantages c'est-a-dire l'attitude d’un homme envers qui on a eu tort, et qui n'a eu tort envers personne. C’est la visite et je crois qu’elle me réussira.
9 heures
Béhier vient de m’arriver. Vous avez lu ses lettres. Il connait bien Paris et comprend bien ma situation. Rien de nouveau dans ce qu’il me dit. Tout confirme ce que nous pensons. Du temps et de l’immobilité, à ces deux conditions, la rivière coule de mon côté. A Paris, impossibilité pour le commerce, et le crédit de se relever. Détresse croissante, après la victoire. On a commencé par s'en étonner. On commence à se l’expliquer. Mais le président est fort loin d'être épuisé comme espérance. On tournera et retournera, en tous sens cette combinaison pour essayer d'en faire sortir un gouvernement. Presque plus de choléra. Moins aujourd’hui qu'à Londres. Il a été affreux pendant cinq jours. La forte chaleur semblait un ennemi acharné à la poursuite de tout le monde. Adieu. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Merci des détails de votre lettre de jeudi. Je sais très bien comment s’est passée votre journée.
Onze heures
Voilà votre lettre de Vendredi. Votre préoccupation du choléra me désole. Non que je vous veuille insouciante à cet égard. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. Béhier me disait tout à l’heure que bien peu de personnes avaient été attaquées sans quelque imprudence positive et constatée. C’est un mal qui atteint rarement, très rarement ceux qui le repoussent d'avance par un régime bon et soutenu et constant. A cela la peur est utile. Gardez donc la vôtre dans cette mesure. Et puis n’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Si le mal s’aggravait à Londres, ou si votre peur devenait un vrai mal, n’hésitez pas, partez. Il n’y a réellement plus rien à Paris. Dans l’hôpital où est Béhier, pas un seul cas depuis plusieurs jours. Je ferme une lettre avant d'avoir ouvert mes journaux. Il m'en est arrivé un paquet. L’article des Débats sur le grand duché de Bade était très bon en effet. Je ne crois pas que la Prusse ose. Adieu. Adieu.
Pas une des minutes que nous avons passées ensemble dans ces derniers jours ne me sort de la mémoire. Toutes charmantes. Adieu. Adieu, demain sera un mauvais jour. Vous aurez été un jour sans lettre de moi. Je n’ai pas pu l’éviter. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Samedi 21 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Midi.
J'attends aujourd’hui une lettre du Havre. Le Times ce matin dit que vous y êtes arrivé, et que votre réception a été des huées. Cela fait bien de l'honneur à vos compatriotes ! Ma journée a été triste hier comme le temps. Beaucoup de pluie, point de visites de Londres. J’ai vu les Delmas la vieille princesse, & le soir les Beauvale. Là, bonne et longue et intime conversation.
Lady Palmerston avait écrit une lettre très inquiète, elle croyait à une bataille perdue à propos de la motion de Lord Brougham. Je vois ce matin qu’elle a été rejetée par 12 voix. La séance a duré jusqu'à 4 h. du matin. Brougham. Carlisle. Hugtesberg. Minto. Aberdeen Lansdown, Stanley. Voilà les orateurs & dans l’ordre que je dis là. On m'apporte votre lettre du Havre. Merci, mais vous ne dites pas comme le Times. J'aime mieux vous croire vous, que lui. (C’était dans les ships news, Southampton.)
Vous voilà donc établi chez vous ! que Dieu vous protège. Comme nous sommes loin ! Les discours hier sont si longs, qu’il m’est impossible de les lire. J'ai choisi celui d'Aberdeen, j’y trouve des paroles honorables & justes pour le roi, Lord Palmerston et pour vous. Je relève cela, parce que les journaux de Paris ne rendront surement pas les discours dans leur étendue. Onze heures de séance. C'est long !
Mon fils est revenu de Londres de sa tournée. J’irai peut être le voir demain, quoique je ne me soucie pas trop de l'air de Londres. Il est vrai que le choléra est bien près d’ici à Brentford vis-à-vis Ken. Peut-être à Richmond, mais on ne me le dit pas. Je n’ai pas de lettres du continent. Demain rien de nulle part, ce sera very dull. Adieu, sotte lettre. Je bavarderais bien cependant si je vous avais là dans ce fauteuil, si bien placé pour un entretien intime comme je regarde ce fauteuil avec tendresse et tristesse ! Adieu. Adieu. Adieu.
Richmond, Jeudi 19 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre petit mot de chez Duchâtel m’a fait du bien. Je l'ai reçu chez lord Beauvale où je dînais. Je me suis mieux tenue que je ne l’avais espéré, et les convives m'ont épargné les phrases banales. Brougham a été très aimable. Ellice un peu endormi. Beauvale mange & ne dit pas un mot, il est charmé qu'on l’amuse et qu’on le laisse tranquille. Grand égoïste. Lord Aberdeen est resté longtemps chez moi avant dîner. Il est très décidé à venir à Paris en 9bre et s'en réjouit tout-à-fait, il vous aime tendrement. Il ne s’attend pas à la majorité demain, mais il voudrait une minorité très respectable.
Ellenborough ne vient pas. Il est malade à la campagne, il a écrit à Lord Brougham ( qui me l’a montré) une lettre très sage très sensée sur la discussion de demain. Lord Aberdeen de son côté a fait part à Lord Brougham de votre recommandation de ne rien dire qui peut gêner les mouvements de la diplomatie française en Italie, & Brougham m’a paru très résolu à observer cette recommandation. Nous verrons car c'est une créature si mobile. Il a vivement regretté de n’avoir pas su le jour de votre départ, il aurait beaucoup désiré causer avec vous avant le débat. Lady Palmerston lui a écrit deux autres lettres, bien aigres & bien inquiètes, il raconte cela fort drôlement.
Je ne suis pas contente de moi. Le malaise continue. Il faut que ce soit dans l'air, car Dieu sait que je me ménage. Le temps est froid. Le vent a soufflé cette nuit. Vous concevez que je n’ai pas dormi, je vous voyais malade en mer.
Midi.
Vous voilà donc en France ! Que c'est loin de moi. Je suis charmée de connaître le Val Richer. Je saurai où vous chercher. Vous aurez un grand plaisir à vous retrouver là, à retrouver vos arbres, votre pelouse, Vos sentiers. Tout cela reposera votre âme. Vous avez là tout le contentement intérieur, de la famille, de la propriété. Je vous manquerai c'est vrai, et je crois que je vous manquerai beaucoup, mais vous avez mille plaisirs que je n’ai pas. Et certes dans cette séparation je suis plus à plaindre que vous. Vous le sentez. Je voudrais me mieux porter et j'y prendrai de la peine, pour vous faire plaisir.
La Reine ayant décidé qu’elle ne viendrait plus à Londres, a reçu hier l’ambassadeur de France à Osborne. Simple présentation, après quoi il est revenu à Londres avec lord Palmerston. La reine a gardé quelques ministres à dîner, elle avait tenu conseil. Elle ne prorogera pas le parlement en personne. Son départ pour l’Irlande est fixé au 2 ou 3 août. Hier encore il m’a été dit de bien bonne source qu’elle est plus que jamais mécontente de Lord Palmerston et qu’elle le lui montre. Adieu. Adieu, mille fois. J’espère une lettre du Havre Samedi. Adieu encore & toujours.
Richmond, Mercredi 18 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Onze heures
Je veux encore essayer de vous faire parvenir deux mots à Londres. Cette pensée si douce que vous êtes à une heure de distance, il y faut donc renoncer. Renoncer à tant de bonheur ! Ah mon Dieu Hier mes genoux ont fléchi quand vous avez fermé la porte. Je suis restée en prières. J’ai tant prié, et toujours une seule & même prière. Je n’ai pas pleuré. Le moment même d'un grand chagrin me trouve sans larmes. C'est de l’étonne ment. Tout est suspendu en moi. Je me suis mise à la fenêtre, presque sans pensée. Je ne sais ce que j’ai fait ensuite. Je me suis couchée. J’ai dormi un peu, pas beaucoup et je me lève, la désolation dans l'âme !
Une lettre de Constantin de Berlin. L’Empereur est parti subitement de Varsovie pour aller surprendre l'Impératrice le jour de sa fête le 13. Il ne devait passer à Pétersbourg que deux ou 3 jours. Un moment de halte dans les opérations. On veut toucher en masse sur l’armée véritable des rebelles. Tout est calculé. On ne doute de rien, et dans 15 jours ou 3 semaines l’affaire de la Hongrie sera terminée. A Berlin, grand changement dans les esprit même les plus sages. L’unité, l’unité au profit de la Prusse ; les succès dans le Palatinat & dans le grand-duché de Bade ont tourné toutes les têtes. grande haine contre l’Autriche, mille soupçons. Le roi, la reine & une partie du ministère résistent seuls à cet entrainement. Mais la bourrasque est bien forte. Prokesh et Bernstorff sont incapables de rien arranger. Il faut changer ces deux instruments. L’armistice avec le Danemark mécontente beaucoup les Allemands. Enfin beaucoup de fronde à Berlin.
Adieu. Adieu, cher bien aimé, adieu. Voici les larmes. Je m’arrête. Adieu. Dites un mot, pour que je sache que vous avez reçu cette lettre. Voilà du vent. J’ai peur pour cette nuit. Passez-vous sur un bâtiment anglais ou français ? Je ferme ma lettre à 2 1/2. Je l'adresse chez Duchâtel. C’est plus sûr. Mon messager reviendra de la directement. Adieu. Adieu, mille fois. Mon cœur se brise. Adieu.
Richmond, Lundi 16 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai beaucoup dormi mais je me sens encore plus fatiguée qu’hier et sans le moindre appétit. Deux cuillérées de bouillon viennent de me redonner des crampes. C’est bien ennuyeux mais qu’est-ce que ma santé à côté du malheur inévitable de votre départ ? Je ne me comprends pas, sans vous, sans la possibilité de vous revoir. le lendemain. Je reste hébétée quand je pense à cela, et j'y pense sans cesse !
Lady Alice Peel est venue un moment ce matin. Elle ne sait rien. La situation des Français à Rome me parait terrible. Comment cela finira-t-il ? Adieu que puis-je vous dire ? Je ne sais rien, et je ne trouve dans mon propre fond que misère, tristesse, désolation. Adieu. Adieu.
Richmond, Mercredi 4 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'aurais parié hier ma vie que vous ne viendrez pas aujourd’hui, et j’aurais gardé ma vie. Mais ne parlons pas de cela. Nos jours sont comptés. Si d'un côté cela devrait disposer à être avare de nos bons moments si courts et si rares, d’un autre côté cela m'impose de ne point quereller. Ainsi encore une fois n'en parlons plus. Voilà donc Rome soumise J'en sens bien aise. Mais encore une maladresse tout au bout. Bideau envoie lorsque Oudinot achève ! Au reste voici les embarras qui commencent.
7 heures
Lord Aberdeen est venu. J’espère que vous avez vu l’article de Thiers sur l’Espagne. Admirable Lady Allen, Peel, lady [?] Flahaut, Koller. Abondance aujourd’hui, Metternich va plus mal. Il s'affaiblit. Il ne peut plus marcher on le porte. On persiste à dire qu'il n’y a pas de danger. Cela n’est pas possible. Les Ellice sont partis. Cela me fait un vrai chagrin et un grand vide. Adieu. Je crains de manquer la poste. Adieu.
Richmond, Dimanche 1er juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le voilà commencé ce vilain mois dans lequel doit commencer notre séparation. Ah que ce sera dur comme hier encore était charmant. Comment nous passer de cela ? Marion et Aggy sont revenues. Ellice a reçu une nouvelle lettre de Thiers hier matin. Il sera ici le 20 juillet avec tout son ménage. Le 10 août il veut être de retour à Paris. Il écrit en bonne humeur & bonne espérance. Il dit que la majorité est excellente. Ferme, décidée. Plus de batailles à craindre dans les rues. J’ai été chez Metternich hier soir. Il était bien, et de bonne humeur ; l’accident & l'inquiétude étaient passés.
4 heures
Je rentre d'une longue promenade à Hampton court. J’ai voulu montrer au moins les jardins à mes petites. Le temps est charmant. Vous auriez aimé cette course. Qu’apprendrons-nous demain ? 6 heures. Voici les Duchatel. Il faut fermer ceci. Adieu. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Eloignement, Politique (France), Relation François-Dorothée
Richmond, Vendredi 29 juin 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre est bien touchante et tendre et m’a bien touchée. Oui, je suis plus triste que vous, cela tient à nos caractères, j'espère moins et je suis si seule ! Il est si impossible de deviner ce qui peut nous arriver à l’un et à l’autre ? La seule chose sûre, c'est la séparation et pour assez de temps. Comment voulez-vous que je ne pleure pas ?
Je viens de recevoir une lettre d’[?] que je vous montrerai. Il est probable que la grande Duchesse Marie viendra passer 3 semaines en Angleterre. Cela peut se croiser avec mon voyage à Paris, il faudrait y renoncer, le retarder. Albrecht veut absolument que je prenne l’entresol place Vendôme. Je ne veux pas me lier. C’est bien bas, il me semble que je dormirais mal. Je veux choisir moi-même.
Je crois que Marion & Aggy reviendront ici demain. Elles vont aujourd’hui en ville. Les parents sont doux & charmés qu'elles s'amusent. Quand je me couche elles vont chez les Metternich, là elles chantent & dansent jusqu’à minuit. Moi je me sens bien lasse et nervous. Je vais ce matin. à un déjeuner chez lady Douglas, j’y verrai du monde, et cela ne m'amuse pas. Les jours vont se presser, se passer. Et le terrible jour arrivera. Quel néant pour moi ! Alors, comme je trouverai doux d'être à Richmond, vous à Brompton, sans nous voir. Qu’est-ce que cela fait ? On se sent près l'un de l’autre, on peut se voir dans une heure. Toute la différence du possible à l’impossible. Ah que je suis triste. Adieu. Adieu, & demain adieu.
Brompton, Jeudi 28 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'espérais vous voir un moment ce matin. J’aime même les moments. Mais il est 3 heures. Vous ne viendrez pas. J’écris donc. Je rectifie votre nouvelle à l'Impératrice sur mes assiduités au bal. Je viens de vérifier mon tableau d’invitations en Mai et Juin. J’ai mené deux fois Pauline au bal ( Henriette n'y va pas) et elle y est allée deux fois sans moi. Est-ce assez pour que ce soit drôle ? Je tiens à ma rectification parce que je suis de votre avis dans l'état de mon pays et dans mon état à moi hors de mon pays, le bal ne me convient pas. Je n'irai certes jamais sans mes filles, et comme vous le voyez, je ne les y mène que bien peu. 4 heures et demie Je reprends ma lettre. Je ne veux pas que [vous] soyez tout demain sans moi. Votre tristesse me pèse douloureusement, quoi que je fusse bien fâché si vous n'étiez pas triste. Depuis bien longtemps, je ne vous vois pas, je ne pense pas à vous sans avoir devant les yeux cette amère séparation. Elle est inévitable. J’ai tardé autant que je l’ai pu décemment, à rentrer dans mon pays. Je ne puis pas ne pas y rentrer, et ne pas saisir le bon moment d’y rentrer. Et en y rentrant, je ne puis pas ne pas aller d'abord m'établir au Val-Richer. Toutes les nécessités de toute sorte, tous les avis de tous mes amis m'en font une loi. Si vous pouviez croire que j’en suis, que j’en serai aussi triste que vous ! Si vous saviez tout ce que sont pour moi votre affection, votre conversation, votre présence, notre intimité ! Vous me manquez déjà tant quand nous sommes près, quand nous nous verrons demain ! Que sera-ce quand nous serons loin, et sans savoir quand nous nous verrons ? Je suis plus enclin que vous à l'espérance, à la confiance. Vous viendrez bientôt à Paris. Vous y resterez plus longtemps que vous n'aurez dit. Nous nous y rejoindrons plus souvent que nous ne l'attendons. Je crois cela. Je le crois vraiment. Croyons le ensemble. Nous serons encore bien assez tristes. En le croyant, nous ferons bien mieux ce qu’il faudra pour que cela soit. J’aime mieux vous l'écrire que vous le dire. Je compte partir du 15 au 20 juillet. Je ne veux pas manquer le moment opportun et que tout le monde juge opportun. Tout le monde s'attend à me voir revenir bientôt. On ne comprendrait pas pourquoi je tarde plus longtemps et si je tardais longtemps, on demanderait ensuite pourquoi je reviens. De plus, le bail de ma maison finit le 18 Juillet. J'espère que d'ici là le choléra aura quitté Paris, et que vous aussi vous y retournerez vers la même époque. Quand nous serons ensemble en France, ce sera un commencement de réunion. Je ne puis pas vous parler d'autre chose, quand même j'aurais autre chose à vous dire. Je mettrai, cette lettre à la poste en allant dîner. Vous l'aurez demain, à je ne sais quelle heure. Après-demain. nous aurons quelques bonnes heures. J’espère que cela ne tient pas uniquement à mon tour d'esprit, plus optimiste que le vôtre ; mais j’ai la confiance que nous aurons encore de bonnes années. J’ai une peine immense à me figurer que je n'aurai pas ce que je désire ardemment. J'ai pourtant assez vécu pour savoir que je m’y suis souvent trompé. Adieu, adieu. Adieu. Adieu. G.
Bedford hotel Brighton, Dimanche 29 octobre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je commence Brighton bien mal. Votre lettre n’est pas venue. Pourquoi ? Vous êtes maladroit en expéditions de lettres. Sans doute trop tard à la poste, car je ne veux admettre, ni maladie, ni oubli, ni paresse. Je vous en prie, ne me faites pas de ces mauvais tours. Vous savez que tout de suite je m'inquiète. Quel temps hier, quel voyage ! Pas même Gale, personne. Avec la multitude d'amis et d’obligés, je manque toujours d’obligeants, tandis que tout le monde en trouve. J'ai eu bien peur, j’ai eu bien froid. Je trouve ici une tempête, de la tristesse, de la solitude, un joli salon mais petit comme une cage avec des courants d'air de tous côtés. Je ne sais comment je pourrai y tenir. La bonne Marion est venue deux fois me recréer la vue & me réjouir le cœur. Aggy va décidément mieux. J'irai la voir aujourd’hui, si la tempête me permet de sortir. Vous ne m'avez pas donné votre adresse pour Cambridge.
Voici Brougham amusant. Hier pas un mot de politique et je n’y ai pas pensé ; savez vous que cela repose. Et que cette continuelle agitation, excitation est très malsaine. Je ne m’agiterai tout le jour, aujourd’hui, que de votre silence, mais c’est bien pire que la politique. Je serai en rhumatisme, en choléra, cependant tout cela n’aurait pas empêché un bout de lettres, et je crois que je resterai encore un peu plus fâchée qu'inquiète.
Le Constitutionnel raconte le discours de Louis Bonaparte. Sans commentaire. La Prusse appuie cette candidature à défaut de Lamartine qu’il regarde comme impossible faute de votants. Je découpe ce qu’il dit sur Thiers ; et que je trouve très bien.
Adieu, Cambridge est loin, bien loin de Brighton. Je voudrais être à vendredi pour vous tenir plus prés. N’allez pas trop manger ou boire dans ce ménage anglais. Dites-moi votre adresse, je crains que vous ne l'ayez pas fait, de sorte que demain j'adresserai ma lettre tout bonnement à Cambridge. Envoyez la chercher à la poste. Adieu. Adieu
Brompton, Samedi 28 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Vous êtes partie. Donc vous n’êtes pas plus enrhumée. C’est bon. Mais si vous aviez été plus enrhumée, vous ne seriez pas partie. Je viens de me promener. A peu près sans la pluie. Je vais bien. Je n’ai pas encore mes journaux. Je n’ai vu personne. Excepté un garde national de Paris qui était là tout à l'heure, me racontant comment, le 24 février, il avait sauvé M. de Rambuteau et toute la peine qu’il avait eue à le hisser dans un cabriolet. A quoi il a ajouté qu’il avait une passion effrénée, non pas pour Mad. de R. mais pour la politique ce qui l’avait fait destituer de sa place à l’hôtel de Ville. Voilà toutes mes nouvelles.
J’espère que les journaux vont arriver. Je serai à Cambridge de lundi à Vendredi, Ecrivez-moi donc là, chez le Dr Whewell, Trinity lodge. Jusqu'à jeudi. Votre lettre de Jeudi arrivera à Brompton quelques heures avant moi. Je ne serai jamais content de vous voir à Brighton. Mais je serai moins mécontent quand je vous y aurai vraiment vue. Je ne puis souffrir de ne pas connaître votre maison, votre appartement. C’est bien assez de l'absence, sans y ajouter l'ignorance.
Vous aurez peut-être à Brighton des nouvelles du spectateur de Londres. M. de Matternich est très fâché qu’il ne paraisse plus. Il a fait venir Melle K. pour lui dire de continuer. Une bonne somme était venue de St Pétersbourg. Mlle K. ne peut pas. Elle ne sait pas où est son père, et dit qu’il l'a abandonnée, elle et le journal.
On vient de m’apporter la Revue des deux mondes. Le second article de M. d’Haussonville sur notre politique étrangère n’y est pas encore. Il y a en revanche, un assez curieux article de M. de Langsdorff sur Kossuth et Gellachion, des détails qu’on n'a pas vus ailleurs. Vous devriez vous faire lire cela. La Revue des deux mondes se trouve probablement à Brighton. C'est le n° du 15 octobre.
2 heures
Le Journal des Débats seul m'est arrivé. Je viens de lire la séance. Je ne comprends pas bien. Mon instinct est que la prompte élection est donc l’intérêt de Louis Bonaparte. Mais alors pourquoi Cavaignac l’a-t-il voulue ? Pourquoi l'Assemblée l’a-t-elle votée ? Je parierais presque que l’arrangement est fait entre Louis Bonaparte et Thiers. Odilon Barrot a parlé comme un compère. C'est une mêlée bien confuse. L’Assemblée se montre inquiète de sa propre responsabilité, et pressée de s’en décharger en partie sur un Président définitif. Nous y verrons plus clair dans quelques jours. Je n'ai rien de Paris. Ce qui me frappe c’est à quel point toutes les opinions, tous les partis se divisent, se subdivisent, se fractionnent en petites coteries qui cachent leur jeu. Grand symptôme de pauvreté d’esprit et de personnalité mesquinement ambitieuse. Je suis triste de l'aspect de mon pays. Plus triste qu'inquiet. La décadence me déplait plus que le malheur. Le discours de M. Molé est bien petit. Adieu. Adieu.
Je compte bien avoir lundi matin de vos nouvelles. Je ne pars pour Cambridge qu'à une heure. Adieu, puisqu’il faut recommencer Adieu.
Brighton, Jeudi 16 novembre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Le bavardage de Marion hier soir m’a fait manquer la poste de 10 minutes. J'en ai été au désespoir, mais pas de remède. Je viens me confesser, et vite je vous adresse deux mots à l'aube du jour bien en courant pour ne pas manquer la porte de ce matin. Je n'ai fait que lire votre petit mot pas encore les incluses. Je vous les renverrai par la poste de 2 h. Vous aurez cela ce soir ou au plus tard demain de bonne heure.
Je suis consternée du journal des Débats. Une querelle parmi les modérés dans ce moment, mais c’est criant. Qu’est-ce qui peut être arrivé. Cela me parait un grand malheur. Je crois que je ne rendrai jamais au journal des Débats mon estime. Kielmannsegge est ici et y reste. Audran lui a dit que Francfort a envoyé à Berlin le député Basserman pour donner appui au roi et l’encourager à chasser son Assemblée nationale. Audran va venir ici.
Je suis charmée de la fin de votre procès mais cependant j’ai quelque envie d'en avoir peur. Vous voudrez retourner, pas à présent mais vous commencez à y songer. Et moi. quoi ? M. de la Redorte écrit à Marion. Cavaignac est usé, personne n'en veut. Louis Bonaparte est inconnu, il vaut peut-être mieux, mais je ne sais pas. Je ne m'intéresse plus à rien et puis trois pages de bonheur domestique qu'elle n’a pas. les Cambridge arrivent la semaine prochaine, aussi au Bedford. Adieu. Adieu bien vite.
Hier, avant-hier charmants. Votre absence et si loin va être insupportable. Je crois encore que vous pourriez abréger et retourner Lundi. Adieu, adieu mille fois. Ayez bien soin en arrivant là de dire vous même à la house maid To warm your bed, and bring a bedpan when you go to bed. Les chambres & les lits sont toujours froids dans les châteaux. Adieu.
Cambridge, Mercredi 1er novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
C’est un des plus grands ennuis de l'absence que de conserver pendant bien des heures, bien des jours, une tristesse qui n’existe plus là d'où elle est venue. Je suis sûr que vous avez eu hier mes deux lettres. J'ai beau me le dire ; je ne puis me décharger le cœur de votre peine. Il faut que vous m'ayez dit vous-même qu'elle n'est plus. Ce soir, j’espère. Demain matin au plus tard.
Je suis frappé de l’attaque simultanée des Débats, de l’Assemblée nationale et de l'Opinion publique contre Louis Bonaparte Les conservateurs et les légitimistes prennent ouvertement leur parti contre lui. Cela le voue à une situation intenable, (nous en savons quelque chose) à la situation entre deux feux. Thiers et ses amis peuvent l’y faire durer un peu plus longtemps, pas bien longtemps. Je les connais d'ailleurs ; ils ne sont ni braves, ni tenaces ; ils se dégouteront bientôt de ce métier. Nous ne touchons pas à la fin, mais bien certainement nous y marchons.
Mad. Lenormant m’écrit : " Nous allons au Bonaparte comme on va dans ce pays-ici. C’est un torrent. " C’est sur Bugeaud ou sur Changarnier que se porteront les voix des conservateurs et des légitimistes qui ne veulent décidément pas de Louis Bonaparte. Ce ne sera probablement pas très nombreux. Seulement une protestation. Mad. Lenormant me dit : " J’ai reçu une lettre bien triste de M. de Barante. Il est aussi abattu, aussi découragé qu'en mars dernier. Il me charge de vous parler de lui et de vous dire qu’il souffre de la privation de toute correspondance avec vous ; mais je ne sais s’il oserait. " M. Parquier et Mad. de Boigne sont revenus, le 25. Le chancelier ne tenait plus hors de Paris. Il est établi rue Royale, mieux logé, dit-il, qu’il n’a jamais été ; en train de tout ; n'ayant rien perdu à la République, car son âge et ses yeux l'avertissaient de quitter son siège &. Mad. de Boigne est fort maigrie, fort pâlie ; pleine de sens et d’esprit comme toujours ; assez rassurée car elle aussi a eu bien peur. Savez-vous que Mad. d’Arbouville a un cancer du sein. On doit l’opérer, mais on dit que cette opération ne donne pas l’espérance de la guérison parce que l’humeur cancéreuse est dans le sang. Voilà les petites nouvelles des personnes.
D'autres lettres où on me demande ce qu’il faut faire pour la Présidence. J’ai quelque doute s’il me convient de donner d’ici un conseil. Pourtant on me dit que la Presse de ce matin prétend que je conseille Louis Napoléon. Je ne veux pas laisser établir cela.
Jeudi 2 Nov. 6 heures
J’ai eu hier au soir votre lettre satisfaite. Nous voilà rétablis en sincérité mutuelle. J’ai trouvé là un mot qui me plaît bien. Quand vous serez revenue de Cambridge, nous verrons. Mes journaux ne m'apprennent rien. Le Prince de Windischgratz compte évidemment sur la reddition de Vienne sans coup périr ou à peu près, s’il a raison d'y compter, il a raison d'attendre. Les agents de Louis Bonaparte font des bévues bien vulgaires. Il y en a un qui s’est présenté il y a quelques jours à Verneuil chez M. de Talleyrand (Ernest que j’avais fait entrer à la Chambre des Pairs, le dernier entré) pour lui demander, s’il voulait vendre sa terre au Prince Louis disant qu’il ne serait probablement pas facile qu'on lui en donnât 2 ou 300 mille francs de plus qu’elle ne vaut. M. de Talleyrand l’a mis à la porte. C’est son fils, Archambaud qui l’écrit à Guillaume. Le Dr Olliffe me fait écrire que vous lui avez fait espérer que vous vous intéresseriez à lui pour qu’il fût knighted, et il me fait prier de vous le rappeler. Je ne sais ce qu’il y a de vrai mais je m'acquitte de la commission. Adieu. Adieu.
J’aurai votre lettre dans la journée. Il y a trois postes par jour à Cambridge. Adieu. G.
Brompton, Lundi 30 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je pars aujourd’hui pour Cambridge à 2 heures. Cela ne me plaît guères. Nous serons plus loin. Je crains le retard des lettres. J’étais en train de travail. Quand vous n’y êtes pas, c'est mon amusement. Je fais de la très bonne politique. Trop bonne. Toujours la même faute. Je puis vous le dire à vous. Je puis être avec vous aussi orgueilleux qu’il me plaît. Vous savez que je suis modeste en même temps qu'orgueilleux.
Point de nouvelles hier. Je suis allé voir Duchâtel qui n’en avait pas plus que moi. Nous verrons le courrier d’aujourd’hui. Il ne nous apportera pas grand chose. Nous vivrons dans le statu quo jusqu'au 10 Décembre. Mais nous comprendrons mieux une situation vraiment obscure pour moi. Duchâtel soutient que notre procès finira aussi tôt après l'élection du président. Par une ordonnance de non lieu. Si Louis Bonaparte est nommé et Thiers son ministre, il est impossible que notre procès ne finisse pas tout de suite malgré le peu d'envie.
Lisez je vous prie, attentivement le Constitutionnel. Cherchez y Thiers envers Louis Bonaparte. Là est la clef de l'avenir. D'un avenir qui dans aucun cas ne sera bien long, j’espère, mais qui pourrait être très court si Louis Bonaparte n’épousait pas Thiers. Vous devriez engager Marion à écrire à Madame de La Redorte et à la questionner un peu. Peu importe que les réponses soient des mensonges. Vous voyez clair dans le mensonge comme dans la vérité.
Les histoires des Gardes nationaux de Paris ne finissent pas. Le Duc de Somerset a demandé à Panton Hôtel, Panton Street, qu’on en priât quatre à dîner chez lui, n'importe lesquels. On lui en a envoyé quatre dont il a fait une exhibition. Entre autres un Capitaine Gonet qui est un beau parleur, et qui s’est fait l’intermédiaire entre tous ses camarades et la légation de la République à Londres. M. de Beaumont est assez embarrassé de la visite de quelques-uns à Claremont. Il a fait un rapport à ce sujet, fort modéré, atténuant au lieu de grossir. Cependant on croit qu’il y aura quelque mesure prise à Paris, qu’on défendra ces visites en uniforme hors des frontières. Il me paraît qu'à tout prendre l’excursion nationale n’a pas beaucoup plu à Paris. Entre les promeneurs eux-mêmes, il y a un peu de mauvaise humeur. Ceux qui ne sont pas allés à Claremont se sont plaints d'être compromis par ceux qui y sont allés. Ceux-ci se sont fâchés. On dit qu'au retour à Calais, il y aura quelques duels. Ici, évidemment, le peuple les a pris en très bonne part. Adieu.
Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Savez-vous ce qu'a fait Guillaume avant-hier dans un metting où les jeunes gens de King's college se réunissent les samedi pour s'exercer à parler ? Il a fait un speech en Anglais pour M. de Metternich qu’un autre attaquait comme l'auteur, par son obstination, des malheurs de l’Autriche. Guillaume a fait l’apologie de la consistency politique. Assez bien pour être fort cheered et pour faire voter à une voix de majorité, que la consistency était une vertu, non pas un tort. Il m’a redit son speech qui n’était pas mal. Il a pour la politique une passion au moins aussi effrénée que celle de mon garde national d’avant Hier. Midi Je suis désolé que ma lettre vous ait manqué, Elle a été mise à la poste avant 5 heures Peut-être est-ce trop tard pour Brighton. Celle-ci sera mise avant l’heure, par Guillaume que j'envoie exprès. C'est votre seul chagrin de Brighton que je regrette beaucoup. Je prends mon parti des autres. J’ai eu tort de ne pas insister davantage pour vous y conduire moi-même. Je n’aime pas que vous ayez peur et froid toute seule. Adieu Adieu.
Je n'ai qu’une longue lettre de Bruxelles, d’Hébert. Adieu. G. Mes amitiés à Marion, je vous prie.
Brompton, Samedi 9 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je vous ai quittée hier à 4 heures moins un quart. J'étais chez moi à 4 heures 35 minutes, ayant changé trois fois de voiture, le railway, mes pieds et l’omnibus. On ne peut guères surmonter mieux l'obstacle de la distance. Mais l’ennui de la séparation reste et il est grand. J'étais levé ce matin de bonne heure. Non seulement je travaille, mais j'y reprends plaisir. Je retrouve cette confiance de ma jeunesse où je croyais à l'efficacité de mes paroles autant qu'à la vérité de mes idées. A la réflexion, j’en rabats ; mais le fond reste. Grâce à Dieu, car pour être un peu puissant, il faut, non seulement vouloir l'être mais croire fermement qu’on le sera.
Je n'ai rien appris hier soir. Rumigny part aujourd’hui. Il est de ceux qui voudraient que de Claremont, on se montrât, en parlât, on fit sentir sa présence à ses amis. Il dit que les amis le demandent, se plaignent du silence. Il rappelle la proclamation que Zea Bermudes fit faire à la reine Christine chassée en 1840, et la bonne position d'attente que ce seul fait rendit à la Reine. Il se peut que le moment vienne, pour le Roi, de dire quelque chose ; mais, à coup sûr, il n’est pas venu. Je viens de vous renvoyer Jean. Je persiste dans mes deux avis. Il faut proposer ce que vous dit Lutteroth. Il faut sommer Lady Holland de se retirer. Rothschild vous donnerait en tous cas, la préférence. Les Holland ne sont que des oiseaux de passage. Merci du gibier.
Midi
Que dites-vous des derniers mots de la Lettre de Louis Bonaparte ; on ne détruit réellement que ce qu'on remplace ? C’est une candidature bien déclarée. J’ai toutes les peines du monde à prendre cet homme-là un peu au sérieux. Pourtant il a été quelques jours un prétendant sérieux. Il pourrait le redevenir. Il faut pas se donner une démolition de plus à faire. Bon avis aux partis monarchiques pour qu’ils s’entendent. Le Journal des Débats continue. Le Gouvernement de Cavaignac est bien isolé. Le National pour tout appui ! Et le National embarrassé, triste. Il est impossible que cette situation dure longtemps.
Je regrette ce pauvre général Baudrand. Il n’avait plus rien à faire en ce monde. Mais je n’aime pas que les honnêtes gens meurent. C'était un soldat vertueux et gentleman. Très noble type. Il sera mort tristement et tranquillement. Il y a certainement quelque chose de nouveau de la part de l’Autriche. Vous l'aurez peut-être su hier soir. Je regarde attentivement aux préparatifs de Marseille. Ce ne sont pas des préparatifs de guerre. Il ne peuvent avoir pour objet qu’une démonstration. Où ? Pourquoi ? Le Pape ne parait pas menacé en ce moment. Le discours de la Reine est bien confiant dans la pacification. Croker croit à la guerre. Il m’écrit. « I am more and more convinced that this republic must end speedily, in another convulsion whether thal will produce another republic, red or rose, or a monarchy,or a regency. I cannot guess ; but as soon as ever the dictatorial sword it theather, we shall have another Struggle, in Paris ; and then also, if not before, a continental war. Je ne crois pas. Adieu. Adieu.
A demain Holland house. n'oubliez pas la lettre dont je vous ai envoyé tout à l'heure un paragraphe. Adieu. G.
J'ai donné transmis à mon avocat les renseignements que vous avez bien voulu me transmettre sur mon procès, Il en a causé de nouveau avec mon oncle qu’il a trouvé mieux disposé pour une transaction et prenant lui-même quelque peine pour y disposer les autres parties intéressées. Mais il y a pour celles-ci surtout, et pour la situation où elles se trouveraient si la transaction avait lieu, certaines garanties qui paraissent indispensables. Je n'y vois, pour mon compte aucune difficulté. Quand mon avocat trouvera les choses assez avancées pour que j'aie à répondre, je vous prierai de me dire votre avis. Encore une fois, je ne vous demande plus pardon de vous ennuyer ainsi de mes affaires. Mais certainement il y a progrès vers la conciliation.
Lowestoft, Jeudi 17 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Le temps est superbe. Je viens de me promener au bord de la mer. Mais vous manquez au soleil et à la mer bien plus que la mer et le soleil ne me manqueraient si vous étiez là. D’Hausonville m’écrit très triste quoique point découragé : " A l'heure qu’il est, me dit-il, le pouvoir nouveau est, vis-à-vis de la portion saine de l'Assemblée nationale à peu près dans les mêmes dispositions que l’ancienne commission exécutive. Autant que M. de Lamartine, M. Cavaignac redoute l’ancienne gauche, et comme lui il est prêt à s'allier avec les Montagnards, pour ne pas tomber dans les mains de ce qu'il appelle les Royalistes. Ce dictateur improvisé paie de mine plus que de toute autre chose, et a plus le goût que l’aptitude du pouvoir. Vienne une crise financière trop probable ou la guerre moins impossible depuis les revers des Italiens, et la république rouge n’aura pas perdu toutes ses chances. " Il veut écrire sur la politique étrangère passée. Il me dit que c’est à son excitation que son beau frère a écrit dans la revue des Deux Mondes, sur la diplomatie du gouvernement provisoire, l’article dont vous m’avez parlé. " Les documents diplomatiques insérés, dans la Revue rétrospective me serviront dit-il de point de départ pour venger, pièces en mains, cette diplomatie du gouvernement de Juillet, si étrangement défigurée. Je voudrais finir par indiquer quelle doit être dans cette crise terrible, l’attitude de ceux qui ont pensé ce que nous avons pensé, et fait ce que nous avons fait, si vous croyez utile de m'esquisser ce plan, je recevrai vos conseils avec reconnaissance et j’en ferai profiter notre pauvre parti resté, sans chef et sans boussole dans ce temps, si gros et si obscur." Ceci m'explique un peu Barante.
Évidemment l’envie de rentrer en scène vient à mes amis. J'ai aussi des nouvelles de Duchâtel, d’Écosse où il se promène charmé du pays. Je vous supprime l’Écosse. Voici ce qu’il me dit de la France : " Il me semble que, dans le peu qu’elle fait de bon, la République copie platement et gauchement la politique des premières années de la révolution de 1830." Quel spectacle donne la France.
On m’écrit de chez moi que les élections municipales ont été excellentes. Les résultats sont beaucoup meilleurs que de notre temps. Le député actuel de mon arrondissement, qui faisait toujours partie du conseil municipal n'a pas pu être élu cette fois.
Une heure
Votre lettre est venue au moment où j’allais déjeuner. J'espère que celle de demain me dira que votre frisson n’a pas continué. La phrase du National ne me paraît indiquer rien de particulier pour moi. Il insiste seulement sur le danger pour la République d’un débat qui mettra en scène le dernier ministre de la Monarchie qui n’a fait, après tout, que combattre ces mêmes auteurs de la révolution qu'on demande aujourd’hui à la république de condamner. Je comprends que ce débat, leur pèse. S'il y a un peu d’énergie dans le parti modéré, il faudra bien que le National et ses amis le subissent. Mais je doute de l’énergie. Tout le mal vient en France de la pusillanimité des honnêtes gens. S'ils osaient, deux jours seulement, parler et agir comme ils pensent, ils se délivreraient du cauchemar qui les oppresse. Mais ce cauchemar les paralyse, comme dans les mauvais rêves.
La lettre de Hügel est bien sombre, et je crois bien vraie. Je vous la rapporterai avec celle de Bulwer à moins que vous ne le vouliez plutôt. Je vois que Koenigsberg le parti unitaire a pris le dessus. Parti incapable de réussir, mais très capable d'empêcher que la réaction ne réussisse. La folie ne peut rien pour elle-même ; mais elle peut beaucoup contre le bon sens. Pour longtemps du moins. Que dites-vous du Général Cavaignac parcourant les Palais de Paris le Luxembourg, l’Élysée & pour voir comment on en peut faire des casernes et des postes militaires. On voulait nous prendre pour les forts détachés, dont le canon n'atteint pas Paris. Aujourd’hui, on met les forts détachés dans les rues. Ce qui me frappe, c’est que Cavaignac et les siens ont l’air de régler cela comme un régime permanent. C'est de l'avenir qu’ils s’occupent. Ils sont convaincus que, si on ôte au malade sa camisole de force, il jettera son médecin par la fenêtre. Et le gouvernement ne consiste plus pour eux qu’à prendre des mesures pour n'être pas jetés par la fenêtre. Adieu.
J’attendrai la lettre de demain un peu plus impatiemment. Je travaille. Que de choses je voudrais faire ! Adieu. Adieu. G.
J’avais donc bien raison hier de croire que la chance du Roi de Naples en Sicile pourrait bien valoir mieux que celle du Duc de Gènes.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Diplomatie, Elections (France), Eloignement, Manque, Politique, Politique (Autriche), Politique (France), Politique (Italie), Politique (Normandie), Politique (Œuvre), Presse, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée, République, Révolution, Travail intellectuel
Lowestoft, Lundi 14 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Un blank day est encore plus mauvais en réalité qu’en perspective. C’est du reste mon impression sur toutes choses. J’ai toujours trouvé le bien et le mal plus grands dans la réalité que dans l’attente. Comme je trouve les vérités de la vie bien supérieures aux inventions des romans. Pour me consoler, il pleut, et je n’ai pas plus de journaux de Paris que de lettres de vous. Je pense à vous et je lis. Je remplirai ainsi ma journée. Demain vaudra mieux.
Je ne connais personne ici, sauf la famille du Chief justice baron Alderson et un M. Manners Sulton, fils de Lord Canterbury. Mais tout le monde me reçoit avec une grande bienveillance. Le peuple en Angleterre sait mon nom. Et il sait aussi que je suis ami de l'Angleterre. Partout, il me traite en amis. Je jouis de cette impression. Ne trouvez-vous pas que le Général Cavaignac en répétant sans cesse à l’Assemblée nationale qu'elle est seule souveraine, et qu’il n’est que son humble agent, lui met bien continuellement le marché à la main ? Il le peut, mais il me semble qu’il en abuse. Je crois beaucoup au pouvoir d'un caractère droit et digne. Pourtant il y a une certaine mesure d’esprit dont cela, ne dispense pas. Vous revient-il quelque chose d’une intrigue Girardin, Lamartine et Marrast que dénonce mon journal l'Assemblée nationale? Certainement les deux premiers sont des hommes qui n’ont pas renoncé à s’approprier la République. Ils n'y réussiront pas, mais ils la manieront et remanieront assez pour ajouter leur propre discrédit au sien.
J’attends impatiemment des nouvelles d'Italie. Et en attendant, je n’ai rien de plus à vous dire. Si vous étiez là, je ne tarirais pas. Adieu. Adieu. Mon éternuement s’en va un peu. Adieu. G.
Richmond, Lundi 14 août 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
Midi
J’ai vu hier Lord Palmerston à Holland House. Il ne savait pas si l’armistice était ou non une conséquence de la médiation commune. Les courriers n’étant partis de Paris que Mardi dernier. Il me parait que ce n’est pas eux qui ont pu décider. On bavardait beaucoup là hier. La Lombardie à la Toscane. Voilà l’idée générale, dans tout cela voyons le dernier mot de l'Autriche. L’article du Moniteur est fort important. Évidemment chez vous on veut la paix, et on compte encore sur notre bon vouloir pour la république. L'Allemagne fait le plus gros, des embarras. Kielmannsegge me disait encore hier que les têtes y sont tout-à-fait renversées. Vous voyez que la France aussi se mêle d’arranger l'affaire des Duchés. L’entente entre Paris et Londres embrasse sans doute toutes les questions en litige. Le Manifeste du Prince de Linange serait bien plus critiqué s’il ne serait pas du frère de la Reine. Mais avec cela même, on en parle avec grande désapprobation. Je n’ai rien lu de plus fou & de plus bête. On dit que Strockmer la croit, c’est impossible. Il a plus d'esprit que cela.
Voilà de la pluie à verse. Quel climat, quelle tristesse. Comment iront les bains de mer avec cette pluie ? Et puis vous viendrez me dire qu'on n’a pas pu prendre les bains, qu'il faut donc prolonger. Je n’accepterai pas cela. Voilà votre lettre. Seul plaisir, seule ressource. Mais quand viendra le temps où nous ne songerons plus aux ressources ?
J'ai rencontré hier Dumon aussi à Holland house. Il songe beaucoup à s’établir à Brighton le mois prochain pour la mauvaise saison. Aggy va un peu mieux. Elle m’a écrit elle même. Je ne donne pas encore de rendez-vous à Pierre d’Aremberg car je n'ai rien décidé sur Tunbridge. J'attends toujours pour un appartement. Adieu, adieu. Comme c’est long.
Voici mes réponses de Tunbridge Wells. Pas d'appartement du tout. Tout est pris. Je reste donc ici. Cela va faire plaisir à Montebello, il est bien accoutumé à mon bavardage.
Lowestoft, Dimanche 13 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Certainement, je suis triste. Je vous ai dit mille fois que, sans vous, j'étais seul. Et la solitude, c’est la tristesse. Je la supporte mais je n’en sors pas. Les Anglais n’y sont pour rien. Dans la belle Italie, je ne serais pas autrement. Peut-être l'Italie me dispenserait-elle d’un rhume de cerveau qui me prend, me quitte et me reprend sans cesse depuis quatre jours. Je me suis déjà interrompu deux fois en vous écrivant pour éternuer trente fois. J’espère que la mer, m'en guérira. La mer n’est pas humide. Décidément, en ceci, je ne suis pas comme vous. J’aime la mer devant moi. Elle ne m’attriste pas. Elle est très belle ici. Et cette petite ville est propre, comme un gentleman. Mes enfants commencent à se baigner demain. Aurez-vous quelqu’un à Tunbridge Wells ? Je ne vous veux pas la solitude, par dessus la tristesse. Il me semble qu’à Richmond lord John, Montebello et quelques visites de Londres ou à Londres sont des ressources que vous n'aurez pas ailleurs. Il est vrai que j’entends dire à tout le monde que Tunbridge est charmant. C’est quelque chose qu’un nouveau lieu charmant, pour quelques jours.
Il me revient de Paris qu'on n’y croit pas plus que vous au succès de la médiation. Ce n'est pas mon instinct. Si la situation actuelle pouvait se prolonger sans solution, je croirais volontiers que la médiation échouera. Elle vient, comme vous dîtes, plus qu'après dîner. Mais je ne me figure pas que l’Autriche se rétablisse purement et simplement en Lombardie et Charles Albert à Turin. Les Italiens conspireront, se soulèveront, la République sera proclamé quelque part. La République française sera forcée d’intervenir. C’est là surtout ce qu’on veut éviter par la médiation. Il faut donc que la médiation aboutisse à quelque chose, que la question paraisse résolue. Elle ne le sera pas. Mais à Paris et à Londres on a besoin de pouvoir dire qu'elle l’est. Pour sortir du mauvais pas où l'on s'est engagé. Tout cela tournera contre la République de Paris mais plus tard. On m'écrit que ces jours derniers le général Bedeau, dans des accès de délire criait sans cesse. "Je n’avais pas d’ordres! Je n'avais pas d’ordres." Vous vous rappelez que c’est lui qui devait protéger et qui n’a pas protégé la Chambre le 22 février.
Je suis bien aise que Pierre d'Aremberg soit allé à Claremont. Tout le travail en ce sens ne peut avoir que de vous effets soit qu'il réussisse ou ne réussisse pas. Quand on était à Paris, en avait assez d'humeur contre Pierre d’Aremberg qu'on ne voyait pas. Je suppose qu'on aura été bien aise de le voir à Claremont. A Claremont on est d’avis que la meilleure solution de la question Italienne, c'est de maintenir l’unité du royaume Lombardo-Vénitien en lui donnant pour roi indépendant un archiduc de Toscane. Idée simple et qui vient à tout le monde. Je la crois peu pratique. Un petit souverain de plus en Italie, et un petit souverain hors d’état de s'affranchir des Autrichiens, et de se défendre des Italiens. Ce serait un entracte, et non un dénouement. Je doute que personne veuille se contenter d’un entracte. Adieu. Adieu.
C’est bien vrai, les blank days sont détestables. Demain sera le mien. Votre lettre de Vendredi m'est arrivée hier, à 10 heures et demie du soir. Je venais de me coucher. Je m'endormais. On a eu l’esprit de me réveiller. Je me suis rendormi mieux. Je viens de recevoir celle d’hier samedi. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Eloignement, Politique (Autriche), Politique (Internationale), Relation François-Dorothée, République, Réseau social et politique, Révolution, Santé (François), Tristesse, VIe quotidienne (Dorothée)
Richmond, Vendredi 11 août 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
Midi
Je viens de lire votre lettre. Voici donc une nouvelle adresse pour la mienne. Si tout ce qui me donne tant de chagrin vous donne à vous un gendre, j'en serai charmée. Les nouvelles d’Italie sont excellentes. Milan pris à ce qu'il parait. Qu’est-ce qui vient faire la médiation ? Je pense que Radetzki l’enverra promener. Il est rentré at home. Personne au monde n'a le droit de l’inviter à en sortir. Savez-vous ce que je crois. L'Autriche érigera la Lombardie en état indépendant, sous un prince autrichien. Une autre Toscane. Qui est-ce qui pourra trouver à redire à cela ? Elle gardera Venise comme de raison. Tallenay est parti avant-hier soir pour Paris, furieux ; on lui a donné congé pas trop brusquement on ne sait pas pourquoi ; moi au moins je ne le sais pas ; est-ce parce qu’il m’a rencontré à Holland house ? Beaumont est arrivé. La reine va venir le recevoir. On dit que Normanby a contribué à cette nomination. Il le voyait beaucoup qu’est-ce que vous pensez de lui ? On dit que le Roi de Hollande est très mal. La nouvelle en est venue hier. Je suis charmée que vous soyez sans inquiétude pour Pauline. Ma santé est comme vous l'avez laissée. La Prusse est très intéressante comme nouvelles. Elle est mieux renseignée qu'aucun journal de Paris. Elle dit le secret des négociations très exactement, à ce que je sais. Du reste elle est assez modérée. Opposition, mais contenue. Adieu. Adieu.
Il y a bien longtemps que nous sommes séparés. Adieu.
Richmond, Jeudi 10 août 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
midi
Lord John était très préoccupé de l’Allemagne surtout. Qu’est-ce que veut dire cette immiscion dans les affaires d’Italie ? Cette guerre au Danemark ? Ces prétentions sur le Limbourg de quoi se mêle Francfort ? Mais ni nous, ni la France, ni la Russie, ni la Prusse probablement ne peuvent le permettre. Nous espérons dans Wessemberg qu'il ait un esprit sage. Quand au Pce de Linange sa nomination nous déplait fort. La Reine est très fâchée. Nous pouvons être dans le cas de faire très mauvais ménage avec son frère. Sur l’Italie, il m’a donné à entendre que la médiation de la France & de l'Angleterre aurait pour base l'Adige. Mais d’un côté il ne sait pas si l’Autriche voudra s’en contenter après les victoires de Radzki, de l’autre il ne me semblait pas très sûr de la France qui a proclamé l’indépendance de l’Italie toute entière. Ensuite, il me dit quoique Cavaignac & Bastide. parlent dans le meilleur sens, on n’est cependant jamais très sûr du même langage deux jours de suite. Enfin il n’était pas très stons en fait de confiance, mais certainement extrêmement anxious d’éviter la guerre. On va faire venir la Reine à Londres pour un conseil où on reconnaitra la république française, et elle recevra. Talleney. Il m’a dit, " et vous aussi vous avez dit que vous reconnaîtriez." Je n’en sais rien. Le Morning Chronicle annonce ce matin que Gustave de Beaumont est nommé ministre à Londres. Ce serait du Thiers n’est-ce pas ? Voici une lettre du duc de Noailles. Renvoyez la moi après l'avoir lue. Constantin m’écrit : " Si l'armée allemande entre dans le Lettland nous intervenons et la guerre en est la conséquence. Que fera la Prusse ? Se soumettra-t-elle à Francfort ? S’exposera-t-elle à voir ses provinces envahies par notre armée ? Ou se joindra-t-elle à nous qui seule pouvons la soutenir et la rendre à son honneur national. " Les réponses de Lord Lansdown à Stanley semblent équivalentes à l’aveu que la flotte anglaise s'opposera de force à l'envoi des troupes napolitaines, contre la seule ses réponses confirment aussi de tous points ce que Lady Holland vous avait dit. Quelle conduite ! Lisez le leading article du Times ce matin, admirable. Que de topics, sur lesquels nous aurions à parler à perte d’haleine. Quel dommage, quel dommage d’être si loin. Votre petit mot ce matin est bien court. J'espère mieux demain. J'ai déjeuné hier chez la duchesse de Gloucester, bonne femme. Adieu, adieu.
Brompton, Mardi 1 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Je suis rentré hier triste. Ce matin, je pars triste. On ne prévoit jamais assez. On ne se dit jamais tout. Que de contrariétés, de vrais chagrins, nous nous serions épargnés l’un à l'autre depuis onze ans si nous nous étions toujours tout dit, sur le champ ! Et hier encore, que de choses j'aurais eu à vous dire que je ne vous ai pas dîtes ! Et probablement vous aussi. Je ne me résigne pas à cette imperfection de la vie, dans les affections les plus profondes et les plus sincères. Je ne me résigne pas davantage à votre chagrin. Il m’est bien venu par éclairs un sentiment doux à le voir, si vif. Mais ce plaisir égoïste s’évanouissait à l'instant devant votre peine. Votre peine seule me suivra. Et elle ne me quittera que quand nous nous serons rejoints. Encore une fois, pourquoi ne nous disons pas toujours tout ?
Je me suis levé de très bonne heure. J’avais une foule de petites choses à faire, de billets à écrire. M. Wright est arrivé, et ne m’a rien apporté que des choses insignifiantes. M. Génie. était à la campagne, au moment où il est parti. M. Pise n'avait pu le voir à temps. J’écris à Génie lui-même par André qui va passer en France le temps que je passerai en Ecosse, et je lui désigne à lui-même ce que je veux avoir ici, par la première occasion sure que je lui indiquerais. Vous n'êtes pas plus contrariée que moi de tous ces retards. Il est si difficile de régler de loin comme on veut de telles choses, quand on veut en même temps multiplier les précautions, et épuiser la prudence ! Adieu. Adieu. Je n’ai pas cœur à vous parler d’autre chose ce matin, quoique j'eusse beaucoup à vous dire sur les nouvelles d’hier que je trouve plus grosses plus j'y pense. Je ne crois pas que Paris se conduise aussi sensément et résolument que vous l’inventiez hier Adieu. Adieu. C'est de bien loin ! G.
27. Val-Richer, Samedi 23 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il me survient ce matin une nécessité absolue d'écrire une longue lettre au maréchal Bugeaud. Des difficultés, des tracasseries, des étourderies, sans intérêt pour vous, mais dont il faut que je m'occupe et qui me prennent le temps que je vous destinais. A Beauséjour, le mal n'est pas grand. Si quelque incident nous ôte un quart d’heure, nous le retrouvons bientôt. De loin, on ne répare rien. Je suis bien impatient du 30. Je voudrais qu’il fit aussi beau qu’aujourd’hui. Mais les soirées commencent à devenir longues, fraîches et longues. On ne peut plus guère sortir le soir. Comment vous arrangez-vous des lumières ? En tous cas, nous resterons, dans l’obscurité.
Je serai bien aise de causer avec Bulwer. J’en serais encore plus aise, si j’avais confiance. Mais enfin il a de l’esprit et point de mauvais vouloir. J'ai commencé à parcourir la Correspondance de Sir Stratford Canning sur les affaires de Syrie. Je la trouve bonne, sensée, nette, ferme. Je traiterais volontiers avec cet homme-là malgré son difficile caractère. Deux in folio de Parliamentary Papers sur la Syrie. Et j'ai beau chercher : je ne vois aucun moyen efficace d’arranger vraiment ces affaires-là. Il y faudrait la très bonne foi et le très actif concours de la Porte. Et la Porte est apathique, & nous trompe. Mes nouvelles d'Allemagne sont de plus en plus graves. Les populations très animées ; les gouvernements très inquiets et abattus. Le Roi de Prusse, toujours gai et confiant. M. de Metternich espérait un peu après Stolzenfel. Une visite de lui au Johannisberg. Le Roi retourne sans s'arrêter à Berlin. Le pauvre Roi de saxe est désolé. Il a dit, les larmes aux yeux, à la députation de Leipzig que c’était le jour le plus triste de sa vie. " Et comment les choses là m’arrivent-elles à moi qui n’ai jamais souhaité que le plus grand bonheur de mes sujets ? "
C'est singulier que dans les temps difficiles, il y ait toujours à côté des Rois, un frère compromettant. Adieu. Adieu.
Je vois qu’il n’y aura point de Mouchy. Si vous parlez demain Dimanche, vous serez donc à Beauséjour, après-demain lundi. Vous ai-je dit que Génie qui y est allé, l’a trouvé charmant plus fleuri que jamais ? Moi, j’ai du monde à déjeuner lundi. Salvandy mardi. Du monde à déjeuner Mercredi. Une visite à Lisieux Jeudi. Mes paquets vendredi. Samedi, à 5 heures du matin je serai en voiture. Je crois que vous me trouverez tres bonne mine. Adieu. Adieu. G.
Je pense en ce moment que cette lettre-ci n’ira plus vous chercher à Boulogne et vous sera portée Lundi à Beauséjour. Heureuse lettre !
7. Château de Windsor, Vendredi 11 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Votre pauvre frère est donc mort. Tristesse ou joie, toute chose m'est un motif de plus de regretter l'absence. Loin de vous ce qui vous afflige me pèse ; ce qui me plaît à moi, me pèse. Je ne puis souffrir cette rupture de notre douce et constante communauté. Je suis vraiment triste que votre frère n'ait pas eu la consolation de mourir chez lui, dans sa chambre au milieu des siens. Il semble qu’on ne meure en repos que là. Et cette pauvre Marie Tolstoy ! Je ne lui trouvais point d’esprit. Mais elle a un air noble et mélancolique qui m’intéressait. Non, vous n’êtes pas seule, car je vais revenir.
Nous partons toujours lundi 14, pour nous embarquer à Portsmouth vers 5 heures et arriver au château d'Eu mardi 15 à déjeuner. J’y passerai le reste de la journée du mardi et je serai à Paris mercredi soir. Bien profonde joie.
Le voyage est excellent et laissera ici de profondes traces. Mais cinq jours suffisent pleinement. Je sors de la cérémonie de la Jarretière. Vraiment magnifique et imposante, sauf toujours un peu de lenteur et de puérilité dans les détails, 14 chevaliers présents. Le Roi, très bonne mine, très bonne tenu ; point d'empressement et saluant bien. Lord Anglesey a failli tomber deux ou trois fois en se retirant. Je ne vous redis pas ce que vous diront les journaux.
Hier à dîner entre la Duchesse de Mecklembourg et la Duchesse de Norfolk. La première spirituelle, et gracieuse ; la seconde pompeusement complimenteuse. Après dîner, Lord Stanley. Longue et très bonne conversation. Il m'a dit en nous quittant : " Je vous promets que je me souviendrai de tout ce que vous m'avez dit. " Je crois avoir fait impression. Le Roi en croit autant pour son compte. Quel dommage de ne pas voir les hommes là tous les trois mois ! Qu'il y aurait peu d'affaires. Lord Stanley m’a fait à moi l'impression d'une grande franchise & straightforwardness. Le tort des Anglais, c'est de ne pas penser d’eux mêmes à une foule de choses, et de choses importantes. Il faut qu'on les leur montre.
Outre Stanley, un peu de conversation avec M. Goulburn. Je les ai soignés, tous. Voilà deux soirées où je vous jure que j’ai été très aimable. Hier trois heures avec Aberdeen. Parfait sur toutes choses. Nous sommes de vrais complices. Nous nous donnons des conseils mutuels. Il est bien préoccupé de Tahiti et bien embarrassé du droit de visite. Ce matin deux heures et demie avec Peel. Remarquablement amical pour moi. Les paroles de la plus haute estime, de la plus entière confiance. Il a fini par me tendre la main en me demandant mon amitié de cœur. A un point qui ma surpris. Du reste très bonne intention ; plus d'humeur. Le voyage en effacera toute trace : mais des doutes, des hésitations et des inquiétudes dans l’esprit qui est plus sain que grand. Il m'a répété deux fois, qu’il s’entendait parfaitement et sur toutes choses avec Lord Aberdeen. Se regardant comme brouillé avec une portion notable de l’aristocratie anglaise, & le regrettant peu.
L'Empereur et M. de Nesselrode ont pris plus d’une demi-heure de notre temps. Les choses sont parfaitement tirées au clair. Il a fort approuvé ma conduite de ce côté depuis trois ans. Que de choses j'aurais encore à vous dire. Mais il faut finir. Mon courrier part dans une demi-heure et j’ai à écrire à Duchâtel. Adieu. Adieu. Dearest ever dearest.
J'oublie toujours de vous dire que je vais bien. Un peu de fatigue le soir. Je suis toujours charmé de me coucher. Mais je suffis à chaque jour, et mieux chaque jour. Je mange, quoique je ne puisse pas avoir un bon poulet. Demain, la Cité de Londres envoie à Windsor son Lord Maire, ses douze Aldermen et 18 membres de son common council pour présenter au Roi une adresse excellente pour lui, excellente pour la France. N'ayant pu obtenir le banquet à Guildhall ils n'en ont pas moins voulu manifester leurs sentiments. Ici, cela fait un gros effet. J’espère que chez nous, il sera très bon. Je n'écris pas à Génie dites-lui je vous prie ceci et quelques autres détails pour sa satisfaction. Adieu adieu. G.
1. Beauséjour, Jeudi 31 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
6 heures
Je commence par le récit de ma visite hier soir qui a été divertissante mais autrement que je ne pensais. M. Molé était la évidemment m’attendant de pied ferme. Il n'y avait personne. Pendant la première demi-heure, on chercha tous les sujets indifférents. J’étais fort déterminée à ne pas parler de la Reine d'Angleterre pour voir jusqu’où ils pousseraient le mauvais goût de ne pas faire mention de la chose qui les préoccupait le plus. Enfin, je nomme le duc d'Ossena [?] que je venais de voir, M. Molé me demanda s'il m'avait parlé du voyage de la Reine. Non, ce qui était vrai. Alors, il dit : Pour mon compte je suis enchanté de ce voyage. C'est un excellent événement. Et puis mon plaisir est double par le dépit que cela cause à certaines gens. C’est même fort drôle. Comment ? Qui ? Ah, d’abord le faubourg St Germain. Ils en crèvent et puis on en crève dans toutes les langues. Ah. Ah ! "
Hier à la soirée des Appony, c’était impayable. Ces pauvres diplomates ! Quand je disais à l’un d'eux, (et je me suis donné le plaisir de le dire à chacun) eh bien la Reine d'Angleterre arrive. On me répondait par " Avez-vous lu le National ? - Non Monsieur je ne le lis jamais tout ce que j’ai pu obtenir d'eux c'était ceci. C’est un grand événement et puis ils baissaient la tête avec un air capable. Ensuite c’est trop peu déguisé, et tous étaient comme cela. Evidemment c'est une grande déroute, mais c’est trop le montrer. - Vous souvenez vous Monsieur le conte d'une petite confidences que vous m'avez faite il y a quelques années ? Vous me disiez le corps diplomatique n’a pas d'esprit. - Oh, pour cela, c’est vrai. Et bien la seule personne convenable dans le salon Appony était le Duc de Noailles. Il me dit : c’est un événement très important, un grand raffermissement pour la dynastie, et je comprends que le roi et toutes les personnes, qui lui sont attachées ne soient fières et contentes. " Je vous ai redit tout Molé sur ce sujet.
Mad. de Castellane qui avait été de la soirée Appony confirme tout et renchérissait. Pour le coup Molé n’a pas menti car je ne doute pas un instant de la mauvaise humeur mais vous voyez qu'il a pris le bon côté dans l’affaire. Ou du moins qu'il le montra. Il m’a dit encore, c’est votre Empereur surtout qui sera furieux. J'ai simplement répondu, c'est une leçon. Il a encore fort blâmé l’article de la presse, du premier jour qu'il a trouvé de très mauvais goût. Il pense que si la reine vient à Paris, elle y sera très bien reçue. Enfin il était très gai, et n’aurait pas mieux parlé s'il était votre Ambassadeur. J’ai vu longtemps les Cowley. Ils sont dans le troisième œil.
Les lettres de Londres hier de Henry Greville disaient que la Reine ne passerait à Eu qu’un jour et qu’elle viendrait décidément à Paris. Aujourd’hui il attendait son courrier avec quelque chose, comme vous les verrez demain vous saurez avant moi. Vraiment plus on pense à cet événement plus on le trouve grand, immense. Soyez en bien content, et pas trop orgueilleux. Amenez bien la reine, soignez bien le Prince vous ne saurez trop faire dans ce genre. Every Thing short of another Cobourg. Il me semble que vous feriez bien de vous arranger de façon à faire parler le télégraphe. Faites donc stationner un directeur là où il passe le plus près d’Eu. Vous gagneriez toujours huit heures au moins, et plus, et il serait bon qu'on sût ici l'arrivée de la Reine à Eu ; puis que Duchâtel sût très vite si elle vient à Paris. Je vais parler de cela à Génie. Il en donnera peut-être l’idée à Duchâtel. Les Cowley étaient en peine d’une loge à l'opéra, pour le cas où la Reine y irait. Je leur ai dit de s'adresser à vous. En général il faudrait que le corps diplomatique peut être pourvu, car malgré leur mauvaise humeur. Il faut leur supposer un peu de curiosité.
Je vais en ville un moment. peut-être passerai-je chez les Appony. Je suis jalouse du divertissement de Molé. Je vais à Versailles pour dîner et coucher. Si je trouve Pogenpohl je l’emmènerai dîner et pour le cas où il n’y aurait pas de fête pour moi, ce qui est possible, je ne ferais au moins pas le retour seule dont j ai un peu peur dans l'obscurité. Je crois que Madame de Castellane viendra passer un jour chez moi à Versailles. Mais au fond je suis si curieuse d’Eu que je ne sais si je tiendrai loin de Paris. Ecrivez-moi bien les nouvelles. Je suis encore à m'étonner et à m’inquiéter de la joie de notre séparation, à m'inquiéter parce que j’ai pleuré chaque fois, et toujours je vous ai retrouvé bien portant et bien. Aujourd’hui que je ne pleure pas qu’est-ce qui m'attend ? On sait si peu prévoir ! Tout est si incertain dans ce monde ! Vous n'avez pas besoin de mes exclamations et de mes méditations. Vous voilà dans grand [?]. Je pense avec plaisir à la joie de tout votre camp. Adieu Adieu. Adieu.