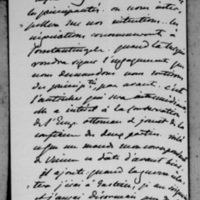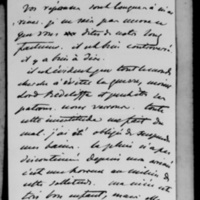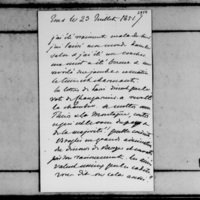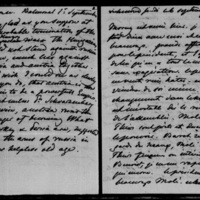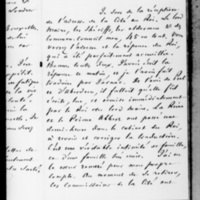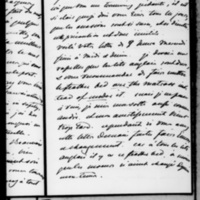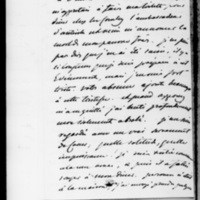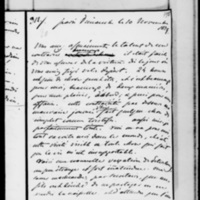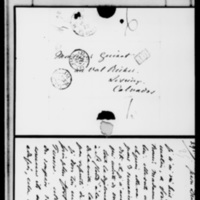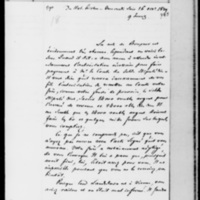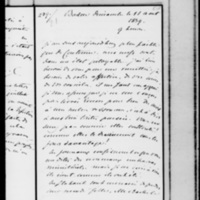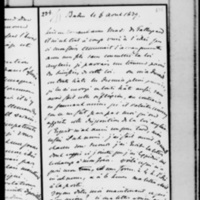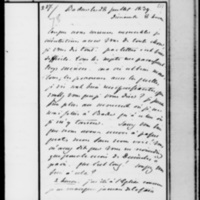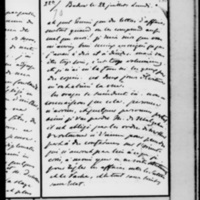Votre recherche dans le corpus : 116 résultats dans 6062 notices du site.
Trier par :
33. Schlangenbad, Dimanche 17 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
33 Schlangenbad dimanche 17 juillet 1853
Je suis arrivée fatiguée. Je trouve ici la température de la Sibérie, beaucoup de monde, pas une connaissance, ma nièce qui a ici ses parents, le Roi de Wurtemberg arrivé hier aussi. Comme on ne dispose pas des rois, je ne sais trop s'il me fera une ressource. Les journaux et les lettres arrivent ici tard, je serai bien arrivée, et vous êtes plus loin que jamais. Votre dernière lettre est du 11. Au fond l'été est ma plus mauvaise saison. Je ne sais jamais l'employer. On dit qu’on va me regretter à Ems. J'y avais un vrai salon. Les princes de Prusse et [Panin] & Platen étaient le fond, cela avait fini par être agréable, après avoir bien mal commencé. Il fait très froid ici, froid comme en octobre. J’attends la porte, si elle m’apporte quelque chose, j’ajouterai, si non et en tous cas. Adieu. Adieu.
Je suis arrivée fatiguée. Je trouve ici la température de la Sibérie, beaucoup de monde, pas une connaissance, ma nièce qui a ici ses parents, le Roi de Wurtemberg arrivé hier aussi. Comme on ne dispose pas des rois, je ne sais trop s'il me fera une ressource. Les journaux et les lettres arrivent ici tard, je serai bien arrivée, et vous êtes plus loin que jamais. Votre dernière lettre est du 11. Au fond l'été est ma plus mauvaise saison. Je ne sais jamais l'employer. On dit qu’on va me regretter à Ems. J'y avais un vrai salon. Les princes de Prusse et [Panin] & Platen étaient le fond, cela avait fini par être agréable, après avoir bien mal commencé. Il fait très froid ici, froid comme en octobre. J’attends la porte, si elle m’apporte quelque chose, j’ajouterai, si non et en tous cas. Adieu. Adieu.
25. Ems, Samedi 2 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
25 Ems samedi le 2 juillet 1853
Aujourd’hui 2 nous entrons dans les principautés. On nous interpellera sur nos intentions. Les négociations commenceront à Constantinople. Quand la Turquie voudra signer l'engagement que nous demandons nous sortirons des principautés, pas avant. C’est l'Autriche qui sera intermédiaire. Elle a intérêt à la conservation de l’[Empire] ottoman & point de la confiance des deux parties. Voilà ce que me mande mon correspondant de Vienne en date d’avant hier. Il ajoute quand la guerre éclatera j’irai à Gastine, je me soignerai et j'aurai désormais peu de foi dans la diplomatie. Si je n’étais retenu par les liens de la reconnaissance j'enverrai toute la boutique au Diable.
Vous voyez qu’il n'y a là rien pour me rassurer. Aussi suis-je bien noire.
2 h. Dans ce moment une lettre de Berlin d'un jour plus fraîche et donnant des nouvelles de Pétersbourg du 25. Beaucoup plus rassurantes, mais refusant de m’expliquer pourquoi, mais me priant de croire. Je ne demande pas mieux, mais j’ai peine à comprendre. Comme tout cela me tracasse, et la pluie par dessus le marché et une température très froide, et pas une âme. Les de Laigle sont ici c’est à peu près comme rien du tout.
Ma Nièce est gentille & bon enfant. Adieu. Adieu.
Aujourd’hui 2 nous entrons dans les principautés. On nous interpellera sur nos intentions. Les négociations commenceront à Constantinople. Quand la Turquie voudra signer l'engagement que nous demandons nous sortirons des principautés, pas avant. C’est l'Autriche qui sera intermédiaire. Elle a intérêt à la conservation de l’[Empire] ottoman & point de la confiance des deux parties. Voilà ce que me mande mon correspondant de Vienne en date d’avant hier. Il ajoute quand la guerre éclatera j’irai à Gastine, je me soignerai et j'aurai désormais peu de foi dans la diplomatie. Si je n’étais retenu par les liens de la reconnaissance j'enverrai toute la boutique au Diable.
Vous voyez qu’il n'y a là rien pour me rassurer. Aussi suis-je bien noire.
2 h. Dans ce moment une lettre de Berlin d'un jour plus fraîche et donnant des nouvelles de Pétersbourg du 25. Beaucoup plus rassurantes, mais refusant de m’expliquer pourquoi, mais me priant de croire. Je ne demande pas mieux, mais j’ai peine à comprendre. Comme tout cela me tracasse, et la pluie par dessus le marché et une température très froide, et pas une âme. Les de Laigle sont ici c’est à peu près comme rien du tout.
Ma Nièce est gentille & bon enfant. Adieu. Adieu.
23. Ems, Mardi 28 juin 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
23. Ems le 28 juin 1853
Vos réponses sont longues à m’arriver. Je ne sais pas encore ce que vous dites de notre long facteur. Il est bien controversé. Il y a bien à dire. Il est évident que tout le monde cherche à éviter la guerre, moins Lord Redcliffe et peut-être ses patrons. Nous verrons. Toute cette incertitude me fait du mal. J’ai été obligée de suspendre mes bains. La pluie n’a pas discontinué depuis mon arrivée c’est une horreur au milieu de cette solitude. Ma nièce est très bon enfant, mais elle va bien s'ennuyer aussi. Je n'ai pas un mot à vous dire. Personne ne m'écrit de Paris. Mollé seul ! Je vous laisse à juger ce que sont ses lettres ! Il parait que Morny s'est donné du mouvement, vous m'en direz quelque chose.
Un mot de Constantin m’apprend que nous entrerons le 2 juillet dans les principautés. Les Bulgares Turcs nous demandent des armes contre les Turcs, les Grecs sont dans une grande effervescence, les Turcs sont agressifs. Ils envoient des émissaires pour soulever les Circassiens. Tout cela est très mauvais. Comment cela finira-t-il ?
Adieu. Adieu.
Nous faisons une pauvre correspondance ! Menchikoff reste à bord de son vaisseau à Odessa.
Vos réponses sont longues à m’arriver. Je ne sais pas encore ce que vous dites de notre long facteur. Il est bien controversé. Il y a bien à dire. Il est évident que tout le monde cherche à éviter la guerre, moins Lord Redcliffe et peut-être ses patrons. Nous verrons. Toute cette incertitude me fait du mal. J’ai été obligée de suspendre mes bains. La pluie n’a pas discontinué depuis mon arrivée c’est une horreur au milieu de cette solitude. Ma nièce est très bon enfant, mais elle va bien s'ennuyer aussi. Je n'ai pas un mot à vous dire. Personne ne m'écrit de Paris. Mollé seul ! Je vous laisse à juger ce que sont ses lettres ! Il parait que Morny s'est donné du mouvement, vous m'en direz quelque chose.
Un mot de Constantin m’apprend que nous entrerons le 2 juillet dans les principautés. Les Bulgares Turcs nous demandent des armes contre les Turcs, les Grecs sont dans une grande effervescence, les Turcs sont agressifs. Ils envoient des émissaires pour soulever les Circassiens. Tout cela est très mauvais. Comment cela finira-t-il ?
Adieu. Adieu.
Nous faisons une pauvre correspondance ! Menchikoff reste à bord de son vaisseau à Odessa.
21. Ems, Mercredi 23 juin 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
21 Ems le 23 juin 1853
Quoique l’avis soit inutile j’espère, puisque je l'ai négligé hier. Je veux vous le dire aujourd’hui : que la copie que je vous ai envoyée hier reste bien pour vous seul ! Je n’ai rien de plus. Je suis curieuse de ce que vous me direz de notre dépêche.
Ma nièce arrive après-demain. Son mari n'ose pas quitter Berlin. Je crois & je crains alternativement : la paix, la guerre. Comment deviner ? C’est triste de ne bavarder qu’avec moi-même. Il pleut à verse. Voilà le cinquième jour, et pas une âme. Adieu. Adieu.
Quoique l’avis soit inutile j’espère, puisque je l'ai négligé hier. Je veux vous le dire aujourd’hui : que la copie que je vous ai envoyée hier reste bien pour vous seul ! Je n’ai rien de plus. Je suis curieuse de ce que vous me direz de notre dépêche.
Ma nièce arrive après-demain. Son mari n'ose pas quitter Berlin. Je crois & je crains alternativement : la paix, la guerre. Comment deviner ? C’est triste de ne bavarder qu’avec moi-même. Il pleut à verse. Voilà le cinquième jour, et pas une âme. Adieu. Adieu.
Val Richer, Mardi 17 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 17 Août 1852
Le Duc Decazes est venu hier et repart aujourd’hui. Il est à Trouville, où la foule change sans diminuer. Il est assez curieux à entendre à cause de son intimité avec le Roi Jérôme qu’il vient de voir au Havre.
Le Roi Jérôme ne croit pas au mariage du Président ; non seulement il n’en veut pas, mais il n'y croit pas ; il soutient même que le Président, au fond, ne s'en soucie pas. Il affirme que son fils, Napoléon est très bien avec son cousin. Decazes dit qu’en effet ils s'étaient bien remis, mais que dans ces derniers temps, ils ont recommencé à être mal. Rien de nouveau d'ailleurs, les dissensions intérieures des chefs du sénat, le Roi Jérôme, le vice président, M. Mesnard, le grand référendaire d’Hautpoul &. Cela ne vous fait rien, ni à moi non plus, ni à personne.
J’ai vu une lettre de Mad. [Donne] écrite de Vevey peu de jours avant le rappel des exilés. Ils ne s’y attendaient pas du tout. //
Le retour de Fould aux affaires est un sujet très général de satisfaction. On n'en attend que du bien, et on en attend du bien. La destitution des trois conseillers avait beaucoup étonné. On s’imagine que le rappel des exilés ne sera pas la seule compensation.
10 heures et demie.
Je vous plains vraiment, et tout-à-fait. Ce sont de grands ennuis pour tout le monde, et vous êtes moins faite que personne pour ces ennuis-là. Je voudrais bien vous y aider un peu ; mais de loin, je ne puis rien. Je suis surtout préoccupé du maître d'hôtel. C'est votre grosse prière et la plus difficile à trouver. Auguste vous reviendra bientôt. J’espère que Jean fait de son mieux.
Pauvre Tolstoy ! Adieu, Adieu.
Je n'ai pas encore fait ma toilette. Decazes m’a retardé. Il vient de partir. Il est un grand exemple de ce que peut le courage contre un mal incurable. Il me paraît que la fête a été superbe, sauf les illuminations, dit-on. Adieu. G.
Le Duc Decazes est venu hier et repart aujourd’hui. Il est à Trouville, où la foule change sans diminuer. Il est assez curieux à entendre à cause de son intimité avec le Roi Jérôme qu’il vient de voir au Havre.
Le Roi Jérôme ne croit pas au mariage du Président ; non seulement il n’en veut pas, mais il n'y croit pas ; il soutient même que le Président, au fond, ne s'en soucie pas. Il affirme que son fils, Napoléon est très bien avec son cousin. Decazes dit qu’en effet ils s'étaient bien remis, mais que dans ces derniers temps, ils ont recommencé à être mal. Rien de nouveau d'ailleurs, les dissensions intérieures des chefs du sénat, le Roi Jérôme, le vice président, M. Mesnard, le grand référendaire d’Hautpoul &. Cela ne vous fait rien, ni à moi non plus, ni à personne.
J’ai vu une lettre de Mad. [Donne] écrite de Vevey peu de jours avant le rappel des exilés. Ils ne s’y attendaient pas du tout. //
Le retour de Fould aux affaires est un sujet très général de satisfaction. On n'en attend que du bien, et on en attend du bien. La destitution des trois conseillers avait beaucoup étonné. On s’imagine que le rappel des exilés ne sera pas la seule compensation.
10 heures et demie.
Je vous plains vraiment, et tout-à-fait. Ce sont de grands ennuis pour tout le monde, et vous êtes moins faite que personne pour ces ennuis-là. Je voudrais bien vous y aider un peu ; mais de loin, je ne puis rien. Je suis surtout préoccupé du maître d'hôtel. C'est votre grosse prière et la plus difficile à trouver. Auguste vous reviendra bientôt. J’espère que Jean fait de son mieux.
Pauvre Tolstoy ! Adieu, Adieu.
Je n'ai pas encore fait ma toilette. Decazes m’a retardé. Il vient de partir. Il est un grand exemple de ce que peut le courage contre un mal incurable. Il me paraît que la fête a été superbe, sauf les illuminations, dit-on. Adieu. G.
Val Richer, Dimanche 15 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 15 Août 1852
Que d'éclat, de mouvement et de bruit vous aurez autour de vous aujourd’hui, autant que j'ai autour de moi de silence et de repos. Le contraste m'amuse à le figurer.
Ce que vous me dites de l'impression que vous a faite, la conversation de Fould me plaît. C’est toujours bon qu’un homme d’esprit juge sa situation grande, car c’est un gage qu’il s'y conduira grandement et sensément. Quand on a son amour propre satisfait et le sentiment d’une haute responsabilité, on est en voie de sagesse. M. Fould en aura besoin.
J’ai vu du monde dans la petite tournée que je viens de faire, des gens de parti et des gens tout-à-fait étrangers aux partis des beaux esprits et des esprits simples de gros bonnets de province et des paysans ; voici mes deux observations. Le gouvernement du Président a gagné comme avenir ; on le croit établi et on croit qu’il durera, on ne voit rien qui puisse le renverser et lui succéder. Il n’a pas gagné comme considération et renom de capacité ; il a en général pour serviteurs des hommes inférieurs et des brouillons légers ou peu estimés. Durer ne suffit pas ; il faut monter en durant.
Il y a de l’inquiétude, dans le pays pour les récoltes, et si le temps qu’il fait depuis quinze jours se prolonge encore autant l’inquiétude sera fondée. Les moissons se font mal ; la pluie perd les blés.
Avez-vous vu Morny depuis votre retour ? Est-il bien avec Fould ? Les feuilles d'Havas insistent beaucoup pour bien établir qu’il n’y aura plus de changement dans le Ministère, et je suis persuadé qu'elles ont raison. Mais si la santé de M. de Persigny devenait de plus en puis mauvaise, il faudrait bien y pourvoir. Je me figure qu’en pareil cas, M. Jayr serait l’un des hommes auxquels le Président songerait. Je ne sais pas du tout quelles sont en ce moment ses dispositions. Sa capacité est réelle.
11 heures
Puisque vous marchez mieux, vous marcherez bien. Mais ne hasardez rien. Ce que vous me dites de l'enfant de Tolstoy me fait grand plaisir. Il pleut ici à torrents. Que deviendrez vous ce soir à Paris, vous et tous vos lampions ? Adieu, adieu. G.
Que d'éclat, de mouvement et de bruit vous aurez autour de vous aujourd’hui, autant que j'ai autour de moi de silence et de repos. Le contraste m'amuse à le figurer.
Ce que vous me dites de l'impression que vous a faite, la conversation de Fould me plaît. C’est toujours bon qu’un homme d’esprit juge sa situation grande, car c’est un gage qu’il s'y conduira grandement et sensément. Quand on a son amour propre satisfait et le sentiment d’une haute responsabilité, on est en voie de sagesse. M. Fould en aura besoin.
J’ai vu du monde dans la petite tournée que je viens de faire, des gens de parti et des gens tout-à-fait étrangers aux partis des beaux esprits et des esprits simples de gros bonnets de province et des paysans ; voici mes deux observations. Le gouvernement du Président a gagné comme avenir ; on le croit établi et on croit qu’il durera, on ne voit rien qui puisse le renverser et lui succéder. Il n’a pas gagné comme considération et renom de capacité ; il a en général pour serviteurs des hommes inférieurs et des brouillons légers ou peu estimés. Durer ne suffit pas ; il faut monter en durant.
Il y a de l’inquiétude, dans le pays pour les récoltes, et si le temps qu’il fait depuis quinze jours se prolonge encore autant l’inquiétude sera fondée. Les moissons se font mal ; la pluie perd les blés.
Avez-vous vu Morny depuis votre retour ? Est-il bien avec Fould ? Les feuilles d'Havas insistent beaucoup pour bien établir qu’il n’y aura plus de changement dans le Ministère, et je suis persuadé qu'elles ont raison. Mais si la santé de M. de Persigny devenait de plus en puis mauvaise, il faudrait bien y pourvoir. Je me figure qu’en pareil cas, M. Jayr serait l’un des hommes auxquels le Président songerait. Je ne sais pas du tout quelles sont en ce moment ses dispositions. Sa capacité est réelle.
11 heures
Puisque vous marchez mieux, vous marcherez bien. Mais ne hasardez rien. Ce que vous me dites de l'enfant de Tolstoy me fait grand plaisir. Il pleut ici à torrents. Que deviendrez vous ce soir à Paris, vous et tous vos lampions ? Adieu, adieu. G.
Val Richer, Samedi 14 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, samedi 14 Août 1852
Je suis très fâché de la mort de votre pauvre maître d'hôtel. Je ne sais pas ce qu’il valait au fond ; mais d'apparence, il vous convenait à merveille, et vous le remplacerez difficilement. Les petites difficultés de la vie ne vous valent rien.
Ce pauvre Tolstoy me touche infiniment. Il est dévoué à ses enfants comme un père et comme une bonne. De quoi donc ce petit garçon est-il si malade ? C'est le second, je pense. J’ai trouvé à l’aîné bien bonne mine quand je l’ai vu à Dieppe. Faites moi la grâce de ne pas laisser ignorer à votre neveu que je suis vraiment préoccupé de lui et de son chagrin. Il y a de mauvaises veines dans la vie, dans la vie domestique comme dans la vie politique ; mais elles s’épuisent.
Vous recommencez à marcher. J'espère que la mauvaise veine est finie. Dieu vous garde ! Avez-vous vu quelque médecin ou chirurgien depuis votre retour à Paris, car Olliffe n’y doit pas être ?
Je suis revenu ici hier à 6 heures avec les entrailles assez souffrantes. Malgré ma sobriété, les dérangements de vie et de régime se font toujours sentir. Je suis mieux ce matin. J’ai dormi longtemps.
Je trouve ici des lettres, mais point de nouvelles. La plus vraie nouvelle à mon avis, c'est le livre de Proudhon, et l'autorisation de paraître que le président lui a donnée, après avoir lu son livre, et la lettre. Je trouve cela grave, sans m'en étonner. Dans un régime de liberté de la presse, ce ne serait rien qu’un mauvais livre de plus par un homme d’esprit, mais aujourd’hui, c’est quelque chose. Peut-être n’est-ce pas vrai. Je le voudrais. Le Président aurait tort, s’il s’engageait dans cette voie-là. On ne peut pas faire à la fois sa cour au Clergé et à Proudhom.
Que signifie le voyage de la Reine d'Angleterre à Anvers ? Est-ce une simple fantaisie de promenade, ou une marque d'intimité protectrice ! On me dit qu’il y a un mouvement de l'Elysée vers Londres, et qu’on verra la preuve dans un traité de commerce qui fera des concessions à l'Angleterre pour l'importation des fers et des houilles. Si ce traité a lieu, il fera du bruit.
Le retard du voyage du Président dans le midi me fait croire au mariage. Je comprends les inquiétudes de M. de Persigny et je ne les crois pas fondées. Si le Président veut réellement se marier, il se mariera que cela plaise, ou non, ailleurs. On ne fera rien de grave pour l'empêcher.
Onze heures 1/4
Mon facteur arrive très tard ; mais en revanche, il m’apporte une lettre intéressante. Pauvre Tolstoy ! Adieu, adieu. A demain les affaires, c’est-à-dire la conversation, c’est à dire l'écriture qui ne vaut pas le quart de la conversation. Adieu. G.
Je suis très fâché de la mort de votre pauvre maître d'hôtel. Je ne sais pas ce qu’il valait au fond ; mais d'apparence, il vous convenait à merveille, et vous le remplacerez difficilement. Les petites difficultés de la vie ne vous valent rien.
Ce pauvre Tolstoy me touche infiniment. Il est dévoué à ses enfants comme un père et comme une bonne. De quoi donc ce petit garçon est-il si malade ? C'est le second, je pense. J’ai trouvé à l’aîné bien bonne mine quand je l’ai vu à Dieppe. Faites moi la grâce de ne pas laisser ignorer à votre neveu que je suis vraiment préoccupé de lui et de son chagrin. Il y a de mauvaises veines dans la vie, dans la vie domestique comme dans la vie politique ; mais elles s’épuisent.
Vous recommencez à marcher. J'espère que la mauvaise veine est finie. Dieu vous garde ! Avez-vous vu quelque médecin ou chirurgien depuis votre retour à Paris, car Olliffe n’y doit pas être ?
Je suis revenu ici hier à 6 heures avec les entrailles assez souffrantes. Malgré ma sobriété, les dérangements de vie et de régime se font toujours sentir. Je suis mieux ce matin. J’ai dormi longtemps.
Je trouve ici des lettres, mais point de nouvelles. La plus vraie nouvelle à mon avis, c'est le livre de Proudhon, et l'autorisation de paraître que le président lui a donnée, après avoir lu son livre, et la lettre. Je trouve cela grave, sans m'en étonner. Dans un régime de liberté de la presse, ce ne serait rien qu’un mauvais livre de plus par un homme d’esprit, mais aujourd’hui, c’est quelque chose. Peut-être n’est-ce pas vrai. Je le voudrais. Le Président aurait tort, s’il s’engageait dans cette voie-là. On ne peut pas faire à la fois sa cour au Clergé et à Proudhom.
Que signifie le voyage de la Reine d'Angleterre à Anvers ? Est-ce une simple fantaisie de promenade, ou une marque d'intimité protectrice ! On me dit qu’il y a un mouvement de l'Elysée vers Londres, et qu’on verra la preuve dans un traité de commerce qui fera des concessions à l'Angleterre pour l'importation des fers et des houilles. Si ce traité a lieu, il fera du bruit.
Le retard du voyage du Président dans le midi me fait croire au mariage. Je comprends les inquiétudes de M. de Persigny et je ne les crois pas fondées. Si le Président veut réellement se marier, il se mariera que cela plaise, ou non, ailleurs. On ne fera rien de grave pour l'empêcher.
Onze heures 1/4
Mon facteur arrive très tard ; mais en revanche, il m’apporte une lettre intéressante. Pauvre Tolstoy ! Adieu, adieu. A demain les affaires, c’est-à-dire la conversation, c’est à dire l'écriture qui ne vaut pas le quart de la conversation. Adieu. G.
Ems, Mercredi 23 juillet 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Ems le 23 Juillet 1851
J’ai été vraiment malade hier. J'ai laissé mon monde dans le salon & j’ai été me coucher ma nuit a été bonne & me revoilà sur jambes ce matin. Le temps est charmant. Les lettres de Paris disent que le rôle de Changarnier a révolté la chambre, se mettre avec Thiers & la Montagne contre ce qui est le voeu du pays & de la majorité ! Quelle conduite. Broglie en grande admiration du discours de Berryer et converti par son raisonnement. Les aînés valent mieux que les cadets. Vous dit-on cela aussi ?
Ellice va arriver. Marion part Samedi avec Duchatel. Les Metternich l'envoient chercher à Bingen. Ils l’attendent avec impatience. J'ai ici un neveu qui est bête et sa femme qu’on dit un peu jolie. Je verrai cela. demain. Je réponds au petit cousin. Je vous envoie la partie de sa lettre qui me plait tant. Je suis sure qu’elle vous plaira aussi. Vous me la renverrez. Adieu. Il fait très chaud aujourd’hui cela me convient. Adieu
J’ai été vraiment malade hier. J'ai laissé mon monde dans le salon & j’ai été me coucher ma nuit a été bonne & me revoilà sur jambes ce matin. Le temps est charmant. Les lettres de Paris disent que le rôle de Changarnier a révolté la chambre, se mettre avec Thiers & la Montagne contre ce qui est le voeu du pays & de la majorité ! Quelle conduite. Broglie en grande admiration du discours de Berryer et converti par son raisonnement. Les aînés valent mieux que les cadets. Vous dit-on cela aussi ?
Ellice va arriver. Marion part Samedi avec Duchatel. Les Metternich l'envoient chercher à Bingen. Ils l’attendent avec impatience. J'ai ici un neveu qui est bête et sa femme qu’on dit un peu jolie. Je verrai cela. demain. Je réponds au petit cousin. Je vous envoie la partie de sa lettre qui me plait tant. Je suis sure qu’elle vous plaira aussi. Vous me la renverrez. Adieu. Il fait très chaud aujourd’hui cela me convient. Adieu
14. Val-Richer, Mardi 15 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°14 Val Richer, Mardi 15 Juin 1852
Certainement, mon petit ami est et sera toujours à votre disposition. Je comprends que ce ne soit qu'à la dernière extrémité. Si vous avez besoin de lui, vous arrangerez cela vous-même, car il ira, ou bien il est peut-être déjà allé vous voir dans sa promenade sur le Rhin. A part ses inconvénients, il est très intelligent, très zélé et très sûr.
Je regrette que vous ayez rebuté notre neveu Tolstoy. Il serait allé vous chercher très volontiers, il croyait avoir quelque chose à réparer. Pourquoi fermer la porte aux petits repentirs ? Dieu ne la ferme pas aux grands. Vous êtes disposée à exiger beaucoup ; quand on est exigeant, il ne faut pas être susceptible. J'étais là quand vous avez traité sévèrement ce pauvre garçon ; je vous aurais arrêtée si j’avais pu. Il n’y avait pas moyen.
L’épitaphe de M. de Meyendorff pour le Prince de Schwartzenberg est excellente je devrais dire belle, car elle résume en deux traits d’une vérité frappante et d’une précision élégante, tout ce qu’il y a eu de moralement et politiquement grand dans la vie du Prince de Schwartzenberg. C'est la perfection du genre. Qui Caesari imperium imperioque Caesarum dedit est particulièrement heureux. Je me permets de soumettre à M. de Meyendorff un petit amendement, rededit au lieu de dedit. Ce serait, je crois, d’une aussi correcte latinité, et peut-être historiquement encore plus exact.
L'Empereur avait perdu son Empire, et l'Empire, son Empereur ; Schwartzenberg les a rendus l’un à l'autre. Pardonnez-moi de vous faire ainsi truchement latin, et veuillez remercier. pour moi, M. de Meyendorff. J’aimerais encore mieux communiquer avec lui sans truchement.
En fait de raretés, je ne suis curieux que les hommes rares, mais je le suis beaucoup. Est-ce que nous ne nous rencontrerons jamais chez vous, rue St Florentin ? J’attends bien impatiemment votre lettre d'aujourd’hui.
J’espère que vous ne vous serez pas trouvée mal une seconde fois en vous habillant.
Le mot de M. de Meynard m'inquiète : ce serait manquer au respect. Il a raison ; auprès des Rois, le respect passe avant tout, même avant la santé. C’est beau mais c’est lourd, et vous êtes bien faible pour porter ce fardeau.
Toujours point de nouvelles. Ce sera quelque temps notre état. Il y a évidemment parti pris de se tenir tranquille. Tâchez de prendre quelque intérêt aux querelles des évêques. Les questions religieuses sont et seront de plus en plus à l’ordre du jour. Il faut aux hommes des questions et des passions seulement ils en changent. Pour mon compte, je ne serais pas très fâché de ce changement là ; un concile me consolerait de la chambre. Mais nous pourrions avoir un synode. Le président serait bientôt bien embarrassé de ces Parlements-là. Il ira le 10 Août prochain, inaugurer l’ouverture du chemin de fer de Paris à Strasbourg. C'est un discours à faire sur le Rhin. Il sera écouté bien attentivement des deux rives. Adieu, princesse.
Je ne fermerai ma lettre qu'après avoir vu mon facteur. Pauvre homme il arrivent bien mouillé ; il pleut toujours.
10 heures
Votre lettre est un peu moins abattue, mais toujours bien fatiguée. Adieu, adieu. J’ai une bonne lettre de Marion. G.
Certainement, mon petit ami est et sera toujours à votre disposition. Je comprends que ce ne soit qu'à la dernière extrémité. Si vous avez besoin de lui, vous arrangerez cela vous-même, car il ira, ou bien il est peut-être déjà allé vous voir dans sa promenade sur le Rhin. A part ses inconvénients, il est très intelligent, très zélé et très sûr.
Je regrette que vous ayez rebuté notre neveu Tolstoy. Il serait allé vous chercher très volontiers, il croyait avoir quelque chose à réparer. Pourquoi fermer la porte aux petits repentirs ? Dieu ne la ferme pas aux grands. Vous êtes disposée à exiger beaucoup ; quand on est exigeant, il ne faut pas être susceptible. J'étais là quand vous avez traité sévèrement ce pauvre garçon ; je vous aurais arrêtée si j’avais pu. Il n’y avait pas moyen.
L’épitaphe de M. de Meyendorff pour le Prince de Schwartzenberg est excellente je devrais dire belle, car elle résume en deux traits d’une vérité frappante et d’une précision élégante, tout ce qu’il y a eu de moralement et politiquement grand dans la vie du Prince de Schwartzenberg. C'est la perfection du genre. Qui Caesari imperium imperioque Caesarum dedit est particulièrement heureux. Je me permets de soumettre à M. de Meyendorff un petit amendement, rededit au lieu de dedit. Ce serait, je crois, d’une aussi correcte latinité, et peut-être historiquement encore plus exact.
L'Empereur avait perdu son Empire, et l'Empire, son Empereur ; Schwartzenberg les a rendus l’un à l'autre. Pardonnez-moi de vous faire ainsi truchement latin, et veuillez remercier. pour moi, M. de Meyendorff. J’aimerais encore mieux communiquer avec lui sans truchement.
En fait de raretés, je ne suis curieux que les hommes rares, mais je le suis beaucoup. Est-ce que nous ne nous rencontrerons jamais chez vous, rue St Florentin ? J’attends bien impatiemment votre lettre d'aujourd’hui.
J’espère que vous ne vous serez pas trouvée mal une seconde fois en vous habillant.
Le mot de M. de Meynard m'inquiète : ce serait manquer au respect. Il a raison ; auprès des Rois, le respect passe avant tout, même avant la santé. C’est beau mais c’est lourd, et vous êtes bien faible pour porter ce fardeau.
Toujours point de nouvelles. Ce sera quelque temps notre état. Il y a évidemment parti pris de se tenir tranquille. Tâchez de prendre quelque intérêt aux querelles des évêques. Les questions religieuses sont et seront de plus en plus à l’ordre du jour. Il faut aux hommes des questions et des passions seulement ils en changent. Pour mon compte, je ne serais pas très fâché de ce changement là ; un concile me consolerait de la chambre. Mais nous pourrions avoir un synode. Le président serait bientôt bien embarrassé de ces Parlements-là. Il ira le 10 Août prochain, inaugurer l’ouverture du chemin de fer de Paris à Strasbourg. C'est un discours à faire sur le Rhin. Il sera écouté bien attentivement des deux rives. Adieu, princesse.
Je ne fermerai ma lettre qu'après avoir vu mon facteur. Pauvre homme il arrivent bien mouillé ; il pleut toujours.
10 heures
Votre lettre est un peu moins abattue, mais toujours bien fatiguée. Adieu, adieu. J’ai une bonne lettre de Marion. G.
Val-Richer, Vendredi 4 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 4 oct. 1850
J’y ai bien pensé depuis hier. Je ne vois rien de mieux à faire sur cette infamie, ni aucune précaution plus efficace à prendre pour l'avenir. Et les deux personnes que je vous ai indiqués sont très propres à ménager l'exécution. Peut-être vous suggéreront-elles quelque autre chose ? Peut-être en aurez-vous déjà parlé à quelque autre personne. Je doute qu’il y ait plus ni mieux à faire. Votre frère vous a fait là un triste legs. Je voudrais bien que vous ne vous en agitassiez pas outre mesure.
Moi aussi, je trouve la lettre de M. Molé dans les Débats très bonne ; venant à propos et bonne en soi. Il faut voir de près le mal qu’a fait, dans la masse des honnêtes conservateurs, la sotte circulaire. Leur principale objection contre la fusion était cette question : " Est-elle possible ? " Depuis la circulaire, ils se répondent eux-mêmes : " Non. " Il faut du temps et des incidents nouveaux.
Vous avez bien raison ; il a fallu une immense gaucherie au Roi pour faire dire de lui ce qu’il méritait si peu. Je n’ai jamais vu un plus étrange amalgame d'adresse et de gaucherie, d’esprit profond et de légèreté de persévérance et de mobilité. Beaucoup de finesse et point de tact, une grande expérience des hommes et aucun sentiment juste de l'effet que produisaient sur eux ses actions et ses paroles. Deux idées fixes, suite ses impressions de sa jeunesse : l'iirésistibilité du torrent révolutionnaire, une fois débordé, et la détresse des proscrits sans argent. On ne sait pas combien de choses ont découlé de là. Les articles de M. de Montalivet sont intéressants, et utiles.
Dix heures
Votre trouble me désole. Je l’entrevoyais et je le comprends, mais je le crois excessif. Je vous répète que je suis prêt à venir si vous le désirez, pour vous car, pour la chose, je ne vois vraiment pas ce que ma présence y fera de plus ; sinon de donner à penser à ceux qui pourraient y regarder avec curiosité qu'elle est grosse et qu'on les craint. Si l'affaire ne pouvait pas être réglée à Paris, ou si le temps manquait, il faudrait envoyer sur le champ à Bruxelles, et l'homme que j'ai indiqué dans mon billet à mon visiteur serait très propre à cela. Soyez sûre qu’en pareille occasion, il faut faire le moins de bruit et se donner le moins de mouvement extérieur possible. L’important c’est d’avoir le manuscrit avec une déclaration comme celle dont je vous ai parlé. J’y pense et repense, et je ne vois pas autre chose à faire ; et pour faire cela, les deux personnes que je vous ai indiquées me paraissent toujours, ce qu’il y a de mieux, soit qu'on puisse régler l'affaire à Paris avec le fils de cette femme, ou qu’il faille aller à Bruxelles ou à Aix- la-Chapelle, pour un waiter soit avec le libraire, soit avec elle-même.
Enfin, je suis comme de raison à votre disposition ; mais je vous prie vous et vos conseillers d'y bien penser ; je ne crois pas qu’il soit utile que j'aille. Vous avez parfaitement fait d’en parler à Dumon. Adieu, Adieu, Adieu. Que je regrette de n'être pas là pour vous calmer un peu ! Adieu. G.
P.S. Je ne comprendrais pas que cette femme eût retrouvé à dessein l’envoi de sa lettre, pour que vous n'eussiez pas le temps de répondre dans le délai indiqué à sa proposition, car alors pourquoi vous l'aurait-elle faite ? Sa lettre est une arme contre elle, et elle ne put l'écrire qu'avec le désir que sa proposition fût accueillie.
J’y ai bien pensé depuis hier. Je ne vois rien de mieux à faire sur cette infamie, ni aucune précaution plus efficace à prendre pour l'avenir. Et les deux personnes que je vous ai indiqués sont très propres à ménager l'exécution. Peut-être vous suggéreront-elles quelque autre chose ? Peut-être en aurez-vous déjà parlé à quelque autre personne. Je doute qu’il y ait plus ni mieux à faire. Votre frère vous a fait là un triste legs. Je voudrais bien que vous ne vous en agitassiez pas outre mesure.
Moi aussi, je trouve la lettre de M. Molé dans les Débats très bonne ; venant à propos et bonne en soi. Il faut voir de près le mal qu’a fait, dans la masse des honnêtes conservateurs, la sotte circulaire. Leur principale objection contre la fusion était cette question : " Est-elle possible ? " Depuis la circulaire, ils se répondent eux-mêmes : " Non. " Il faut du temps et des incidents nouveaux.
Vous avez bien raison ; il a fallu une immense gaucherie au Roi pour faire dire de lui ce qu’il méritait si peu. Je n’ai jamais vu un plus étrange amalgame d'adresse et de gaucherie, d’esprit profond et de légèreté de persévérance et de mobilité. Beaucoup de finesse et point de tact, une grande expérience des hommes et aucun sentiment juste de l'effet que produisaient sur eux ses actions et ses paroles. Deux idées fixes, suite ses impressions de sa jeunesse : l'iirésistibilité du torrent révolutionnaire, une fois débordé, et la détresse des proscrits sans argent. On ne sait pas combien de choses ont découlé de là. Les articles de M. de Montalivet sont intéressants, et utiles.
Dix heures
Votre trouble me désole. Je l’entrevoyais et je le comprends, mais je le crois excessif. Je vous répète que je suis prêt à venir si vous le désirez, pour vous car, pour la chose, je ne vois vraiment pas ce que ma présence y fera de plus ; sinon de donner à penser à ceux qui pourraient y regarder avec curiosité qu'elle est grosse et qu'on les craint. Si l'affaire ne pouvait pas être réglée à Paris, ou si le temps manquait, il faudrait envoyer sur le champ à Bruxelles, et l'homme que j'ai indiqué dans mon billet à mon visiteur serait très propre à cela. Soyez sûre qu’en pareille occasion, il faut faire le moins de bruit et se donner le moins de mouvement extérieur possible. L’important c’est d’avoir le manuscrit avec une déclaration comme celle dont je vous ai parlé. J’y pense et repense, et je ne vois pas autre chose à faire ; et pour faire cela, les deux personnes que je vous ai indiquées me paraissent toujours, ce qu’il y a de mieux, soit qu'on puisse régler l'affaire à Paris avec le fils de cette femme, ou qu’il faille aller à Bruxelles ou à Aix- la-Chapelle, pour un waiter soit avec le libraire, soit avec elle-même.
Enfin, je suis comme de raison à votre disposition ; mais je vous prie vous et vos conseillers d'y bien penser ; je ne crois pas qu’il soit utile que j'aille. Vous avez parfaitement fait d’en parler à Dumon. Adieu, Adieu, Adieu. Que je regrette de n'être pas là pour vous calmer un peu ! Adieu. G.
P.S. Je ne comprendrais pas que cette femme eût retrouvé à dessein l’envoi de sa lettre, pour que vous n'eussiez pas le temps de répondre dans le délai indiqué à sa proposition, car alors pourquoi vous l'aurait-elle faite ? Sa lettre est une arme contre elle, et elle ne put l'écrire qu'avec le désir que sa proposition fût accueillie.
Richmond, Jeudi 6 Septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond Jeudi le 6 septembre 1849
Morny est venu hier. Je l'ai fait dîner avec moi et causer beaucoup. Grande affection pour le président, et l'opinion de lui qu'en a tout le monde, sans exagération. Le président ne veut rien hâter. Cela viendra de soi-même. Un changement dans le ministère est inévitable dés le retour de l’Assemblée. Molé & Thiers sont prêts et désirent le pouvoir. Barrot resterait garde des sceaux, Molé aff. étr., Thiers finances ou intérieur. Benoist, je ne me rappelle plus qui encore. Le président aime beaucoup Molé. Celui-ci & du courage beaucoup plus que Thiers, et au fond c’est le président qui n'était pas pressé de prendre celui-ci comme ministre. Grand discours éloge de Falloux, tout-à-fait premier personnage dans l’Intérieur & la confiance de tous. Montalembert aussi. Les légitimistes imbéciles et rendant tout difficile. Berger n’est pas de ce nombre. Broglie très compté & respecté mais pas très pratique. Piscatory faible. On avait tant dit de lui qu’il était cassant, qu'il s'est mis à joué le modéré, il fait cela gauchement avec exagération et on en rit. On rit surtout de la Redorte. L’un et l'autre ayant frisé le ministère se considèrent toujours comme candidats. Excellentes relations avec Kisselef. Grand éloge de celui-ci. Normanby une vacature qui ne quitte pas le président. Tout aussi ridicule que jamais Morny a essayé une explication de la conduite envers vous. Vous avez été mal informé. C'est par égard & amitié pour vous qu’il craignait que vous ne fussiez élu. Et certainement plus le temps coule & plus on voit que vous êtes le premier homme de votre pays. Is not the word this war the meaning.
Les Orléans parfaitement oubliés. Paris tranquille & charmant. Il va en Ecosse & retourne pour la rentrée de l'Assemblée. Je le verrai encore. J'ai eu une longue lettre de d’Impératrice, excellente, de [?], elle a voulu aller à Fall voir le tombeau de mon frère. Elle en revenait encore. Grande joie de nos victoires et elle me dit : " Palmerston va être bien affligé pour ses chers Hongrois, lui qui formait des vœux sincères pour nos défaites. " Cette lettre a été bien ouverte. J'espère que c’est en Angleterre. J'ai déjeuné hier chez la duchesse de Glocester. On serait charmé dans la famille royale que Claremont décampât et allât en Italie. On est fatigué de leur présence. La reine est de cet avis aussi. Cette reine vient de passer deux jours dans une petite chaumière isolée dans les Moors. Personne que son mari, une femme de chambre, un valet de pied & un marmiton & deux [ ?]. Le valet de pieds habillant le prince, les [?], & ramant le couple royal sur le lac. Une hutte composée de deux chambres pour le ménage un autre pour les domestiques pas d'habitation à 40 miles à la ronde. Elle écrit dans des extases de joie. C’est charmant d’être jeune. Voici mon petit billet de Metternich. Assez spirituel. Pas de grande feuille. Vous ne l'aurez jamais. Votre lettre m’arrive. Quelle idée que l’Empereur ait donné son portrait et celui de l’Impératrice à Lamoricière. C’est un conte. Mais Morny me dit qu'on le traite très bien. Adieu. Adieu. Adieu.
Morny est venu hier. Je l'ai fait dîner avec moi et causer beaucoup. Grande affection pour le président, et l'opinion de lui qu'en a tout le monde, sans exagération. Le président ne veut rien hâter. Cela viendra de soi-même. Un changement dans le ministère est inévitable dés le retour de l’Assemblée. Molé & Thiers sont prêts et désirent le pouvoir. Barrot resterait garde des sceaux, Molé aff. étr., Thiers finances ou intérieur. Benoist, je ne me rappelle plus qui encore. Le président aime beaucoup Molé. Celui-ci & du courage beaucoup plus que Thiers, et au fond c’est le président qui n'était pas pressé de prendre celui-ci comme ministre. Grand discours éloge de Falloux, tout-à-fait premier personnage dans l’Intérieur & la confiance de tous. Montalembert aussi. Les légitimistes imbéciles et rendant tout difficile. Berger n’est pas de ce nombre. Broglie très compté & respecté mais pas très pratique. Piscatory faible. On avait tant dit de lui qu’il était cassant, qu'il s'est mis à joué le modéré, il fait cela gauchement avec exagération et on en rit. On rit surtout de la Redorte. L’un et l'autre ayant frisé le ministère se considèrent toujours comme candidats. Excellentes relations avec Kisselef. Grand éloge de celui-ci. Normanby une vacature qui ne quitte pas le président. Tout aussi ridicule que jamais Morny a essayé une explication de la conduite envers vous. Vous avez été mal informé. C'est par égard & amitié pour vous qu’il craignait que vous ne fussiez élu. Et certainement plus le temps coule & plus on voit que vous êtes le premier homme de votre pays. Is not the word this war the meaning.
Les Orléans parfaitement oubliés. Paris tranquille & charmant. Il va en Ecosse & retourne pour la rentrée de l'Assemblée. Je le verrai encore. J'ai eu une longue lettre de d’Impératrice, excellente, de [?], elle a voulu aller à Fall voir le tombeau de mon frère. Elle en revenait encore. Grande joie de nos victoires et elle me dit : " Palmerston va être bien affligé pour ses chers Hongrois, lui qui formait des vœux sincères pour nos défaites. " Cette lettre a été bien ouverte. J'espère que c’est en Angleterre. J'ai déjeuné hier chez la duchesse de Glocester. On serait charmé dans la famille royale que Claremont décampât et allât en Italie. On est fatigué de leur présence. La reine est de cet avis aussi. Cette reine vient de passer deux jours dans une petite chaumière isolée dans les Moors. Personne que son mari, une femme de chambre, un valet de pied & un marmiton & deux [ ?]. Le valet de pieds habillant le prince, les [?], & ramant le couple royal sur le lac. Une hutte composée de deux chambres pour le ménage un autre pour les domestiques pas d'habitation à 40 miles à la ronde. Elle écrit dans des extases de joie. C’est charmant d’être jeune. Voici mon petit billet de Metternich. Assez spirituel. Pas de grande feuille. Vous ne l'aurez jamais. Votre lettre m’arrive. Quelle idée que l’Empereur ait donné son portrait et celui de l’Impératrice à Lamoricière. C’est un conte. Mais Morny me dit qu'on le traite très bien. Adieu. Adieu. Adieu.
Richmond, Mercredi 27 septembre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond le 27 septembre 1848
Il ne faut jamais m'écrire avant cinq heures, car les lettres ne me sont remises que le lendemain. J'espère que vous allez mieux. Je compte aller vous faire visite demain & y voir moi-même si je n’étais pas venue jusqu’à 4 heures. Ecrivez-moi, je vous en prie.
On me dit qu'il y a dans l’Assemblée nationale un article sur M. de. Beaumont et sur moi, des mensonges, mais qui pourraient lui faire du tout. L’avez vous lu & qu’est-ce que c’est ? Je vous envoyé ce que j’ai écrit aujourd’hui à mon correspondant. Albrecht m’écrit d’avant-hier 25. " Notre situation est plus grave que jamais, nous touchons à la crise il faut se prononcer pour la république ou pour autre chose. Cavaignac est fini, je crois, quand il dit que la France veut la république il sait bien qu'il ment. Les votes de confiance ne signifient rien. Nous pourrions goûter de l'Empire tellement les masses de la France tiennent du Fran[?] cela ferait planche pour arriver à autre chose." Il continue, il ne croit pas à la bataille dans la rue.
Je n’ai vu que Montebello & Jumilhac je ne sais donc rien. Lisez cet insolent & stupide article du National ! Adieu.
La semaine prochaine je quitte certainement Richmond. Les soirées y deviennent bien longues et les journée pas très gaies & l'air très humide. Votre rhume serait vite guéri auprès de la mer. Adieu, Adieu.
Savez-vous que je ne comprends pas ce que vous me dites sur le procès ? Vous savez bien que l'oncle est prêt à la transaction mais que voulez-vous donc qu'il fasse ? Personne ne vient à lui, & même la nouvelle venue qui était une occasion, le fait & le dit. Dans cette situation il n’a autre chose à faire qu'à attendre si mes affaires doivent avancer faites donc un pas. Quand on est pressé, il faut se presser ; je répète que je ne comprends pas & mon avocat pas plus que moi.
Il ne faut jamais m'écrire avant cinq heures, car les lettres ne me sont remises que le lendemain. J'espère que vous allez mieux. Je compte aller vous faire visite demain & y voir moi-même si je n’étais pas venue jusqu’à 4 heures. Ecrivez-moi, je vous en prie.
On me dit qu'il y a dans l’Assemblée nationale un article sur M. de. Beaumont et sur moi, des mensonges, mais qui pourraient lui faire du tout. L’avez vous lu & qu’est-ce que c’est ? Je vous envoyé ce que j’ai écrit aujourd’hui à mon correspondant. Albrecht m’écrit d’avant-hier 25. " Notre situation est plus grave que jamais, nous touchons à la crise il faut se prononcer pour la république ou pour autre chose. Cavaignac est fini, je crois, quand il dit que la France veut la république il sait bien qu'il ment. Les votes de confiance ne signifient rien. Nous pourrions goûter de l'Empire tellement les masses de la France tiennent du Fran[?] cela ferait planche pour arriver à autre chose." Il continue, il ne croit pas à la bataille dans la rue.
Je n’ai vu que Montebello & Jumilhac je ne sais donc rien. Lisez cet insolent & stupide article du National ! Adieu.
La semaine prochaine je quitte certainement Richmond. Les soirées y deviennent bien longues et les journée pas très gaies & l'air très humide. Votre rhume serait vite guéri auprès de la mer. Adieu, Adieu.
Savez-vous que je ne comprends pas ce que vous me dites sur le procès ? Vous savez bien que l'oncle est prêt à la transaction mais que voulez-vous donc qu'il fasse ? Personne ne vient à lui, & même la nouvelle venue qui était une occasion, le fait & le dit. Dans cette situation il n’a autre chose à faire qu'à attendre si mes affaires doivent avancer faites donc un pas. Quand on est pressé, il faut se presser ; je répète que je ne comprends pas & mon avocat pas plus que moi.
Brompton, Mardi 26 septembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Mardi 26 sept 1848
Une heure
Je suis hors d'état de sortir. Je tousse pas mal, c’est-à-dire très mal. Il me faut un peu de confinement. J'ai bien dormi mais en me réveillant pour tousser. Je me coucherai ce soir de bonne heure. Et de tout le jour, je ne quitterai mon cabinet. Que je voudrais qu’il fit beau demain. J’espère que je pourrai aller vous voir. Peut-être le matin, à 1 heure, si je me suis encore trop pris pour me mettre en route le soir. Ceci est un grand ennui. Et j’ai bien peur que cela ne nous arrive plus d’une fois cet automne. Je me porte très bien au fond ; mais je m'enrhume aisément, et je suis aisément fatigué. Je me résignerais, très bien à n'être plus jeune si je n’avais jamais à sortir de chez moi. Ce qui vaut et ce qui sied le mieux quand on n’est plus jeune, c’est la tranquillité.
J'ai les mêmes nouvelles que vous de Paris. Si Louis Bonaparte se conduit passablement, et s’il n’est pas forcé d'attendre longtemps, il pourra bien avoir son moment. Agité et court car il ne peut pas plus supporter la liberté de la presse que Cavaignac, et il n'aura pas, comme lui, pris la dictature au bout de son épée. Son nom, qui le sert de loin, l’écrasera de près. Mais il vaudrait infiniment mieux éviter cette parenthèse de plus. Je crois encore qu’on l'évitera, que Louis Bonaparte se compromettra avant d'arriver au pouvoir et que l’armée comme l'Assemblée. soutiendront Cavaignac contre lui. Que la République et l'Impérialisme s’usent bien contre l’autre ; c'est notre meilleure chance, et à mon avis la plus probable.
Je ne comprends pas ce que votre correspondant demande à votre oncle. Il le sait prêt à la transaction. Ce n’est pas à lui à aller la chercher. Ce n’est pas à lui qu'on peut s'adresser pour qu'elle marche et se conclue. On désire quelque fait extérieur qui prouve qu'elle peut se conclure, qu'elle se conclura, le jour venu. Qu'on aille donc au-devant de ce fait ; qu'on lui fournisse l’occasion de paraître. L’occasion semblait trouvée ; on semblait même l’avoir cherchée. Tout le monde devait le croire. Non seulement on ne l'a pas saisie ; mais on s'est montré disposé à la fuir. Quand on est pressé, il faut se presser. Je n'ai jamais pensé que votre oncle pût ni dût prendre aucune initiative ; mais je suis encore bien plus de cet avis depuis le dernier incident. Je répète que lorsque la transaction ira à lui, elle le trouvera prêt ; mais il n’a rien à faire qu'à l'attendre dans l’intérêt du succès comme dans la convenance de son honneur. Il disait encore avant-hier à l’un de mes amis qu’il n’avait reçu de sa partie adverse, aucune avance, aucune insinuation qu’il pût sensément regarder comme un pas vers lui.
De Rome et de Florence, mauvaises nouvelles. Les républicains sont furieux de la petite réaction romaine et du peu de succès de l’insurrection de Livourne. La population ne veut pas les suivre, mais comme le gouvernement ne sait pas les chasser, ils sont toujours là, et et commencent, et recommenceront toujours. On dit que Charles Albert meurt de peur d'être assassiné par eux. Il mourait de peur autrefois d'être empoisonné par les Jésuites. Il ne sera probablement pas plus assassiné qu'empoisonné. Mais son succès n’ira pas plus loin. Adieu. Adieu.
Pour Dieu, ne soyez pas malade. Je veux bien être enrhumé, mais pas inquiet. Je vous renvoie votre lettre. Adieu. Adieu. G.
Une heure
Je suis hors d'état de sortir. Je tousse pas mal, c’est-à-dire très mal. Il me faut un peu de confinement. J'ai bien dormi mais en me réveillant pour tousser. Je me coucherai ce soir de bonne heure. Et de tout le jour, je ne quitterai mon cabinet. Que je voudrais qu’il fit beau demain. J’espère que je pourrai aller vous voir. Peut-être le matin, à 1 heure, si je me suis encore trop pris pour me mettre en route le soir. Ceci est un grand ennui. Et j’ai bien peur que cela ne nous arrive plus d’une fois cet automne. Je me porte très bien au fond ; mais je m'enrhume aisément, et je suis aisément fatigué. Je me résignerais, très bien à n'être plus jeune si je n’avais jamais à sortir de chez moi. Ce qui vaut et ce qui sied le mieux quand on n’est plus jeune, c’est la tranquillité.
J'ai les mêmes nouvelles que vous de Paris. Si Louis Bonaparte se conduit passablement, et s’il n’est pas forcé d'attendre longtemps, il pourra bien avoir son moment. Agité et court car il ne peut pas plus supporter la liberté de la presse que Cavaignac, et il n'aura pas, comme lui, pris la dictature au bout de son épée. Son nom, qui le sert de loin, l’écrasera de près. Mais il vaudrait infiniment mieux éviter cette parenthèse de plus. Je crois encore qu’on l'évitera, que Louis Bonaparte se compromettra avant d'arriver au pouvoir et que l’armée comme l'Assemblée. soutiendront Cavaignac contre lui. Que la République et l'Impérialisme s’usent bien contre l’autre ; c'est notre meilleure chance, et à mon avis la plus probable.
Je ne comprends pas ce que votre correspondant demande à votre oncle. Il le sait prêt à la transaction. Ce n’est pas à lui à aller la chercher. Ce n’est pas à lui qu'on peut s'adresser pour qu'elle marche et se conclue. On désire quelque fait extérieur qui prouve qu'elle peut se conclure, qu'elle se conclura, le jour venu. Qu'on aille donc au-devant de ce fait ; qu'on lui fournisse l’occasion de paraître. L’occasion semblait trouvée ; on semblait même l’avoir cherchée. Tout le monde devait le croire. Non seulement on ne l'a pas saisie ; mais on s'est montré disposé à la fuir. Quand on est pressé, il faut se presser. Je n'ai jamais pensé que votre oncle pût ni dût prendre aucune initiative ; mais je suis encore bien plus de cet avis depuis le dernier incident. Je répète que lorsque la transaction ira à lui, elle le trouvera prêt ; mais il n’a rien à faire qu'à l'attendre dans l’intérêt du succès comme dans la convenance de son honneur. Il disait encore avant-hier à l’un de mes amis qu’il n’avait reçu de sa partie adverse, aucune avance, aucune insinuation qu’il pût sensément regarder comme un pas vers lui.
De Rome et de Florence, mauvaises nouvelles. Les républicains sont furieux de la petite réaction romaine et du peu de succès de l’insurrection de Livourne. La population ne veut pas les suivre, mais comme le gouvernement ne sait pas les chasser, ils sont toujours là, et et commencent, et recommenceront toujours. On dit que Charles Albert meurt de peur d'être assassiné par eux. Il mourait de peur autrefois d'être empoisonné par les Jésuites. Il ne sera probablement pas plus assassiné qu'empoisonné. Mais son succès n’ira pas plus loin. Adieu. Adieu.
Pour Dieu, ne soyez pas malade. Je veux bien être enrhumé, mais pas inquiet. Je vous renvoie votre lettre. Adieu. Adieu. G.
8. Château de Windsor, Samedi 12 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°8 Château de Windsor. Samedi 12 Oct. 1844, 4 h. et demie
Je sors de la réception de l'adresse de la Cité au Roi. Le Lord maire, les Sheriffs, les aldermen, & des common Council men, 45 en tout. Vous verrez l'adresse et la réponse du Roi, qui a été parfaitement accueillie. Bonnes toutes deux. J’avais écrit la réponse ce matin, et je l’avais fait traduire par Jarnac. De l’avis de Peel, et d'Aberdeen il fallait qu’elle fût écrite lue et remise immédiatement par le Roi au lord Maire. La Reine et le Prince Albert ont passé une demi-heure dans le cabinet du Roi à revoir et corriger la traduction. C'est une véritable intimité de famille et d’une famille très unie.
J’ai eu le cœur remué pour mon propre compte. Au moment de se retirer les commissaires de la Cité ont demandé tout bas qu’on leur montrât M. Guizot, et à peu près tous m'ont salué avec un regard respectueux et affectueux qui m’a vraiment ému. Au dire de tous ici, cette adresse, votée à l’unanimité dans le Common Council est un évènement sans exemple et très significatif. Peel répète souvent qu’il en est très frappé. Plus j’avance plus je suis sûr qu'ici le voyage est excellent, excellent dans le Gouvernement et dans le public. Le Duc de Wellington est venu ce matin passer une heure chez moi. Nous avons causé de toutes choses, même du droit de visite ; évidemment ma conversation lui plaisait, et j'espère qu’il s’en souviendra.
Vous avez raison ; il faudrait que Cowley fût Earl. Je tâcherai de faire arriver cela. J'en parlerai au Roi, qui a déjà très bien parlé des Cowley. Le Roi vient de partir pour une visite à Eton. Il est infatigable. Je suis resté pour écrire, pour vous écrire.
Ne vous enfermez pas dans votre deuil au delà de ce que veut la convenance. Je ne doute pas que la lettre de Constantin ne me touche. C’est un bon jeune homme. J'espère qu’à partir de demain Dimanche, vous aurez l’esprit de m'écrire au château d’Eu et non plus en Angleterre. Lundi encore, écrivez-moi à ici. J’aurai votre lettre mardi, et Mercredi j'irai vous chercher vous même au lieu d'attendre vos lettres.
Nous quitterons Windsor Lundi à midi. La Reine, avec le Prince Albert, reconduira le Roi à Portsmouth. Là vers 3 ou 4 heures elle montera à bord du Gomer, où le Roi lui donnera un luncheon. Après le luncheon, elle quittera le Gomer pour monter sur son yacht, le Victoria Albert et les deux bâtiments sortiront ensemble du port de Portsmouth la Reine pour aller à l’île de Wight, nous pour faire voile vers le Tréport. On ne peut pas pousser plus loin la bonne grâce, et l’amitié. On dit que tout Londres sera lundi à Portsmouth.
Bacourt peut aller à Bruxelles. Je ne crois pas avoir besoin de lui avant le 1er Déc. Et en tous cas Bruxelles est si près. Je vais vraiment très bien. J'en suis frappé surtout pour l’appétit. Il y a bien encore un fond de fatigue surmonté par l'excitation de la vie que je mène et par ma volonté. Pourtant je sens aussi revenir la force, la force vraie et naturelle. Je suis sûr qu'à mon arrivée vous serez contente de moi. Adieu. Adieu. Votre lettre de ce matin m'a bien plu. Seulement vous ne me dîtes rien de votre santé. Adieu, dearest.
Je sors de la réception de l'adresse de la Cité au Roi. Le Lord maire, les Sheriffs, les aldermen, & des common Council men, 45 en tout. Vous verrez l'adresse et la réponse du Roi, qui a été parfaitement accueillie. Bonnes toutes deux. J’avais écrit la réponse ce matin, et je l’avais fait traduire par Jarnac. De l’avis de Peel, et d'Aberdeen il fallait qu’elle fût écrite lue et remise immédiatement par le Roi au lord Maire. La Reine et le Prince Albert ont passé une demi-heure dans le cabinet du Roi à revoir et corriger la traduction. C'est une véritable intimité de famille et d’une famille très unie.
J’ai eu le cœur remué pour mon propre compte. Au moment de se retirer les commissaires de la Cité ont demandé tout bas qu’on leur montrât M. Guizot, et à peu près tous m'ont salué avec un regard respectueux et affectueux qui m’a vraiment ému. Au dire de tous ici, cette adresse, votée à l’unanimité dans le Common Council est un évènement sans exemple et très significatif. Peel répète souvent qu’il en est très frappé. Plus j’avance plus je suis sûr qu'ici le voyage est excellent, excellent dans le Gouvernement et dans le public. Le Duc de Wellington est venu ce matin passer une heure chez moi. Nous avons causé de toutes choses, même du droit de visite ; évidemment ma conversation lui plaisait, et j'espère qu’il s’en souviendra.
Vous avez raison ; il faudrait que Cowley fût Earl. Je tâcherai de faire arriver cela. J'en parlerai au Roi, qui a déjà très bien parlé des Cowley. Le Roi vient de partir pour une visite à Eton. Il est infatigable. Je suis resté pour écrire, pour vous écrire.
Ne vous enfermez pas dans votre deuil au delà de ce que veut la convenance. Je ne doute pas que la lettre de Constantin ne me touche. C’est un bon jeune homme. J'espère qu’à partir de demain Dimanche, vous aurez l’esprit de m'écrire au château d’Eu et non plus en Angleterre. Lundi encore, écrivez-moi à ici. J’aurai votre lettre mardi, et Mercredi j'irai vous chercher vous même au lieu d'attendre vos lettres.
Nous quitterons Windsor Lundi à midi. La Reine, avec le Prince Albert, reconduira le Roi à Portsmouth. Là vers 3 ou 4 heures elle montera à bord du Gomer, où le Roi lui donnera un luncheon. Après le luncheon, elle quittera le Gomer pour monter sur son yacht, le Victoria Albert et les deux bâtiments sortiront ensemble du port de Portsmouth la Reine pour aller à l’île de Wight, nous pour faire voile vers le Tréport. On ne peut pas pousser plus loin la bonne grâce, et l’amitié. On dit que tout Londres sera lundi à Portsmouth.
Bacourt peut aller à Bruxelles. Je ne crois pas avoir besoin de lui avant le 1er Déc. Et en tous cas Bruxelles est si près. Je vais vraiment très bien. J'en suis frappé surtout pour l’appétit. Il y a bien encore un fond de fatigue surmonté par l'excitation de la vie que je mène et par ma volonté. Pourtant je sens aussi revenir la force, la force vraie et naturelle. Je suis sûr qu'à mon arrivée vous serez contente de moi. Adieu. Adieu. Votre lettre de ce matin m'a bien plu. Seulement vous ne me dîtes rien de votre santé. Adieu, dearest.
Paris, Vendredi 11 octobre 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris, vendredi le 11 octobre 1844,
à 9 heures
J’ai abandonné les N° parce que j’ai cru que vous me trouveriez pédante, il est si clair que je dois vous écrire tous les jours que les occasions sont si sûres et si directes. Cette précaution est donc inutile. Voilà votre lettre de 9 heures Mercredi, finie à Midi et demi.
Je devais me rappeler que les lits Anglais sont durs, & vous recommander de faire mettre le feather bed over the mattress instead ot under it. Mais je ne pense à rien, je suis une sotte aussi comme André. Et mon avertissement vient trop tard. Cependant si vous avez cette lettre demain faites faire encore ce changement. Car à tous les lits Anglais il y a ce feather bed, à moins que les mœurs n’aient changé depuis mon temps.
Le petit Nesselrode hier était en train de me parler quand on est venu nous interrompre. Il reviendra aujourd’hui. Il postulait de l’inquiétude de son père à la seule possibilité d’une vraie querelle entre la France et l'Angleterre, de son ardent désir de la paix. Il parle du voyage de son père en Angleterre comme de la promenade d'un indépendant désœuvré. Il donne sa parole d’honneur qu’il n’est pas question du mariage Cambridge, et ajoute cependant que ce serait le plus convenable de ceux qu'ont faits les filles de l'Empereur.
Lord Cowley est fort irrité à ce que le Boüet du Sénégal the real french boute feu, he says, se trouve sur l’escadrille qui a mené le roi, par conséquent à Portsmouth. Comment a-t-on pu permettre cela ? Il n’appartient pas ces navires. C’est Cowley qui parle. Il est aussi dans l'agonie pour cette nouvelle aventure à Tahiti. Il a de suite envoyé à Lord Aberdeen le Messager qui nie l'arrivée d’aucun rapport sur ce fait mais cela n’empêchera pas qu'on ne croie à Londres, qu'il a eu lieu. Il se félicite de n'avoir pas l’explication sur ses épaules, car il pense que vous allez vider cela à Windsor. J'en doute. Et votre Bruat faisant imprimer à Tahiti les rapporte dont vous niez l’existence ici. Ah mon Dieu, quels agents vous employez. Et celui-là vous l'avez choisi vous me l'avez vanté. Quel mauvaise affaire que ce Tahiti tout ensemble.
Je me suis promenée hier au bois de Boulogne, j’avais besoin d'air, une matinée est massacrée. Tout le monde vient, et puis j’ai beaucoup à écrire en Russie. Je m’occupe d’Annette bonne fille, bien triste. Après mon dîner, je vais tous les jours chez elle. J’y reste jusqu'à 10 heures.
Dieu merci vous me répétez que vous allez bien. Comme je vous regarderai à votre retour ! Votre retour ! Quelle charmante chose que cela. Comme j'y pense mais avant tout je veux savoir à quelle heure lundi vous quitterez Windsor à quelle heure vous vous embarquerez à Portsmouth. Ah, s’il fait du vent, que je serai malheureuse ! A quelque moment que vous partiez, mettez-vous sur votre lit, c’est toujours la meilleure précaution à prendre contre le mal de mer. Ne croyez pas les gens qui vous diront qu'il faut rester sur le pont. Et puis arrivé à Eu, reposez-vous bien, ne vous pressez pas, je saurai attendre une fois que je vous saurai en safety. Et puis je ne sais pourquoi j’ai des préventions contre Rouen. Pourquoi ne pas venir par la route naturelle. Coucher à Granvilliers ou à Beauvais en faisant faire une bon fin, bien bassiner votre lit ; et ayant soin d'avoir une voiture dont les roues tournent & les glaces se lèvent. Pensez à tout et racontez-moi ce que vous ferez.
Je reçois dans ce moment une longue lettre de Bulwer, je n’ai fait que la parcourir. Grande éloge de Bresson & de Glusbery. Beaucoup de goût pour le Prince de Joinville. " H. R. H. is clever agreable & what we English like off hand. He pleased me much. " Au bout de tout cela il me rappelle une petite demande qu'il m’a faite dans le temps. Vous savez bien, & me prie if I could manage that. & &
Je me suis mise à penser ce que seraient vos dernières paroles avec Lord Aberdeen et voici mon little speech. " Maintenant nous nous connaissons bien, nous nous sommes éprouvés, notre règle de conduite politique est la même, tant que nous serons ministres nous pratiquerons la paix, la bonne entente. Le jour où une difficulté bien grave se présentait, et où nous pourrions vraiment craindre de ne pas parvenir à nous entendre par voie diplomatique ordinaire promettons-nous, avant la dernière extrémité, de nous rencontrer ; un rendez-vous sur terre française. Les Anglais pas plus que les Français ne veulent la guerre. Ils sauront gré aux deux hommes qui la leur épargneront, qui auront épuisé toutes ses ressources en tout cas nous aurons fait votre devoir. " Est-ce que je radote ?
2 heures. Génie est venu me trouver. Nous rabâchons ensemble. Mais je n'en ai jamais assez. Herbet lui dit aussi que vous allez bien. Je vous en prie prenez bien du soin de vous. Génie m'ébranle sur la question du retour mais je veux savoir absolument quelle route vous prendrez ; mandez-le moi. Je laisse ceci ouvert pour le cas où j'apprendrais quelque chose.
Quels bons leading articles dans les journaux anglais. Comme je serais fixée de mon roi dont on dirait cela, et comme j’aurais de la bonne conduite pour une nation étrangère qui me parlerait de cette façon. Mais ces français n’ont aucun sens de la vraie délicatesse, du vrai honneur, du vrai mérite. Vraiment j’ai quelque chose comme un grandissime mépris pour les Français de ce moment. Adieu. Adieu.
Je vous envoie la lettre de Bulwer après l’avoir lue. Vous verrez qu'il parle mal de Nyon, mal de Hay, qu'il se loue beaucoup du consul napolitain Martino.
à 9 heures
J’ai abandonné les N° parce que j’ai cru que vous me trouveriez pédante, il est si clair que je dois vous écrire tous les jours que les occasions sont si sûres et si directes. Cette précaution est donc inutile. Voilà votre lettre de 9 heures Mercredi, finie à Midi et demi.
Je devais me rappeler que les lits Anglais sont durs, & vous recommander de faire mettre le feather bed over the mattress instead ot under it. Mais je ne pense à rien, je suis une sotte aussi comme André. Et mon avertissement vient trop tard. Cependant si vous avez cette lettre demain faites faire encore ce changement. Car à tous les lits Anglais il y a ce feather bed, à moins que les mœurs n’aient changé depuis mon temps.
Le petit Nesselrode hier était en train de me parler quand on est venu nous interrompre. Il reviendra aujourd’hui. Il postulait de l’inquiétude de son père à la seule possibilité d’une vraie querelle entre la France et l'Angleterre, de son ardent désir de la paix. Il parle du voyage de son père en Angleterre comme de la promenade d'un indépendant désœuvré. Il donne sa parole d’honneur qu’il n’est pas question du mariage Cambridge, et ajoute cependant que ce serait le plus convenable de ceux qu'ont faits les filles de l'Empereur.
Lord Cowley est fort irrité à ce que le Boüet du Sénégal the real french boute feu, he says, se trouve sur l’escadrille qui a mené le roi, par conséquent à Portsmouth. Comment a-t-on pu permettre cela ? Il n’appartient pas ces navires. C’est Cowley qui parle. Il est aussi dans l'agonie pour cette nouvelle aventure à Tahiti. Il a de suite envoyé à Lord Aberdeen le Messager qui nie l'arrivée d’aucun rapport sur ce fait mais cela n’empêchera pas qu'on ne croie à Londres, qu'il a eu lieu. Il se félicite de n'avoir pas l’explication sur ses épaules, car il pense que vous allez vider cela à Windsor. J'en doute. Et votre Bruat faisant imprimer à Tahiti les rapporte dont vous niez l’existence ici. Ah mon Dieu, quels agents vous employez. Et celui-là vous l'avez choisi vous me l'avez vanté. Quel mauvaise affaire que ce Tahiti tout ensemble.
Je me suis promenée hier au bois de Boulogne, j’avais besoin d'air, une matinée est massacrée. Tout le monde vient, et puis j’ai beaucoup à écrire en Russie. Je m’occupe d’Annette bonne fille, bien triste. Après mon dîner, je vais tous les jours chez elle. J’y reste jusqu'à 10 heures.
Dieu merci vous me répétez que vous allez bien. Comme je vous regarderai à votre retour ! Votre retour ! Quelle charmante chose que cela. Comme j'y pense mais avant tout je veux savoir à quelle heure lundi vous quitterez Windsor à quelle heure vous vous embarquerez à Portsmouth. Ah, s’il fait du vent, que je serai malheureuse ! A quelque moment que vous partiez, mettez-vous sur votre lit, c’est toujours la meilleure précaution à prendre contre le mal de mer. Ne croyez pas les gens qui vous diront qu'il faut rester sur le pont. Et puis arrivé à Eu, reposez-vous bien, ne vous pressez pas, je saurai attendre une fois que je vous saurai en safety. Et puis je ne sais pourquoi j’ai des préventions contre Rouen. Pourquoi ne pas venir par la route naturelle. Coucher à Granvilliers ou à Beauvais en faisant faire une bon fin, bien bassiner votre lit ; et ayant soin d'avoir une voiture dont les roues tournent & les glaces se lèvent. Pensez à tout et racontez-moi ce que vous ferez.
Je reçois dans ce moment une longue lettre de Bulwer, je n’ai fait que la parcourir. Grande éloge de Bresson & de Glusbery. Beaucoup de goût pour le Prince de Joinville. " H. R. H. is clever agreable & what we English like off hand. He pleased me much. " Au bout de tout cela il me rappelle une petite demande qu'il m’a faite dans le temps. Vous savez bien, & me prie if I could manage that. & &
Je me suis mise à penser ce que seraient vos dernières paroles avec Lord Aberdeen et voici mon little speech. " Maintenant nous nous connaissons bien, nous nous sommes éprouvés, notre règle de conduite politique est la même, tant que nous serons ministres nous pratiquerons la paix, la bonne entente. Le jour où une difficulté bien grave se présentait, et où nous pourrions vraiment craindre de ne pas parvenir à nous entendre par voie diplomatique ordinaire promettons-nous, avant la dernière extrémité, de nous rencontrer ; un rendez-vous sur terre française. Les Anglais pas plus que les Français ne veulent la guerre. Ils sauront gré aux deux hommes qui la leur épargneront, qui auront épuisé toutes ses ressources en tout cas nous aurons fait votre devoir. " Est-ce que je radote ?
2 heures. Génie est venu me trouver. Nous rabâchons ensemble. Mais je n'en ai jamais assez. Herbet lui dit aussi que vous allez bien. Je vous en prie prenez bien du soin de vous. Génie m'ébranle sur la question du retour mais je veux savoir absolument quelle route vous prendrez ; mandez-le moi. Je laisse ceci ouvert pour le cas où j'apprendrais quelque chose.
Quels bons leading articles dans les journaux anglais. Comme je serais fixée de mon roi dont on dirait cela, et comme j’aurais de la bonne conduite pour une nation étrangère qui me parlerait de cette façon. Mais ces français n’ont aucun sens de la vraie délicatesse, du vrai honneur, du vrai mérite. Vraiment j’ai quelque chose comme un grandissime mépris pour les Français de ce moment. Adieu. Adieu.
Je vous envoie la lettre de Bulwer après l’avoir lue. Vous verrez qu'il parle mal de Nyon, mal de Hay, qu'il se loue beaucoup du consul napolitain Martino.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Famille Benckendorff, Famille royale (France), Politique (France), Portrait, Presse, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Réseau social et politique, Vie domestique (François), Voyage
7. Château de Windsor, Vendredi 11 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°7 Château de Windsor, Vendredi 11 Oct. 1844
4 heures
Votre pauvre frère est donc mort. Tristesse ou joie, toute chose m'est un motif de plus de regretter l'absence. Loin de vous ce qui vous afflige me pèse ; ce qui me plaît à moi, me pèse. Je ne puis souffrir cette rupture de notre douce et constante communauté. Je suis vraiment triste que votre frère n'ait pas eu la consolation de mourir chez lui, dans sa chambre au milieu des siens. Il semble qu’on ne meure en repos que là. Et cette pauvre Marie Tolstoy ! Je ne lui trouvais point d’esprit. Mais elle a un air noble et mélancolique qui m’intéressait. Non, vous n’êtes pas seule, car je vais revenir.
Nous partons toujours lundi 14, pour nous embarquer à Portsmouth vers 5 heures et arriver au château d'Eu mardi 15 à déjeuner. J’y passerai le reste de la journée du mardi et je serai à Paris mercredi soir. Bien profonde joie.
Le voyage est excellent et laissera ici de profondes traces. Mais cinq jours suffisent pleinement. Je sors de la cérémonie de la Jarretière. Vraiment magnifique et imposante, sauf toujours un peu de lenteur et de puérilité dans les détails, 14 chevaliers présents. Le Roi, très bonne mine, très bonne tenu ; point d'empressement et saluant bien. Lord Anglesey a failli tomber deux ou trois fois en se retirant. Je ne vous redis pas ce que vous diront les journaux.
Hier à dîner entre la Duchesse de Mecklembourg et la Duchesse de Norfolk. La première spirituelle, et gracieuse ; la seconde pompeusement complimenteuse. Après dîner, Lord Stanley. Longue et très bonne conversation. Il m'a dit en nous quittant : " Je vous promets que je me souviendrai de tout ce que vous m'avez dit. " Je crois avoir fait impression. Le Roi en croit autant pour son compte. Quel dommage de ne pas voir les hommes là tous les trois mois ! Qu'il y aurait peu d'affaires. Lord Stanley m’a fait à moi l'impression d'une grande franchise & straightforwardness. Le tort des Anglais, c'est de ne pas penser d’eux mêmes à une foule de choses, et de choses importantes. Il faut qu'on les leur montre.
Outre Stanley, un peu de conversation avec M. Goulburn. Je les ai soignés, tous. Voilà deux soirées où je vous jure que j’ai été très aimable. Hier trois heures avec Aberdeen. Parfait sur toutes choses. Nous sommes de vrais complices. Nous nous donnons des conseils mutuels. Il est bien préoccupé de Tahiti et bien embarrassé du droit de visite. Ce matin deux heures et demie avec Peel. Remarquablement amical pour moi. Les paroles de la plus haute estime, de la plus entière confiance. Il a fini par me tendre la main en me demandant mon amitié de cœur. A un point qui ma surpris. Du reste très bonne intention ; plus d'humeur. Le voyage en effacera toute trace : mais des doutes, des hésitations et des inquiétudes dans l’esprit qui est plus sain que grand. Il m'a répété deux fois, qu’il s’entendait parfaitement et sur toutes choses avec Lord Aberdeen. Se regardant comme brouillé avec une portion notable de l’aristocratie anglaise, & le regrettant peu.
L'Empereur et M. de Nesselrode ont pris plus d’une demi-heure de notre temps. Les choses sont parfaitement tirées au clair. Il a fort approuvé ma conduite de ce côté depuis trois ans. Que de choses j'aurais encore à vous dire. Mais il faut finir. Mon courrier part dans une demi-heure et j’ai à écrire à Duchâtel. Adieu. Adieu. Dearest ever dearest.
J'oublie toujours de vous dire que je vais bien. Un peu de fatigue le soir. Je suis toujours charmé de me coucher. Mais je suffis à chaque jour, et mieux chaque jour. Je mange, quoique je ne puisse pas avoir un bon poulet. Demain, la Cité de Londres envoie à Windsor son Lord Maire, ses douze Aldermen et 18 membres de son common council pour présenter au Roi une adresse excellente pour lui, excellente pour la France. N'ayant pu obtenir le banquet à Guildhall ils n'en ont pas moins voulu manifester leurs sentiments. Ici, cela fait un gros effet. J’espère que chez nous, il sera très bon. Je n'écris pas à Génie dites-lui je vous prie ceci et quelques autres détails pour sa satisfaction. Adieu adieu. G.
4 heures
Votre pauvre frère est donc mort. Tristesse ou joie, toute chose m'est un motif de plus de regretter l'absence. Loin de vous ce qui vous afflige me pèse ; ce qui me plaît à moi, me pèse. Je ne puis souffrir cette rupture de notre douce et constante communauté. Je suis vraiment triste que votre frère n'ait pas eu la consolation de mourir chez lui, dans sa chambre au milieu des siens. Il semble qu’on ne meure en repos que là. Et cette pauvre Marie Tolstoy ! Je ne lui trouvais point d’esprit. Mais elle a un air noble et mélancolique qui m’intéressait. Non, vous n’êtes pas seule, car je vais revenir.
Nous partons toujours lundi 14, pour nous embarquer à Portsmouth vers 5 heures et arriver au château d'Eu mardi 15 à déjeuner. J’y passerai le reste de la journée du mardi et je serai à Paris mercredi soir. Bien profonde joie.
Le voyage est excellent et laissera ici de profondes traces. Mais cinq jours suffisent pleinement. Je sors de la cérémonie de la Jarretière. Vraiment magnifique et imposante, sauf toujours un peu de lenteur et de puérilité dans les détails, 14 chevaliers présents. Le Roi, très bonne mine, très bonne tenu ; point d'empressement et saluant bien. Lord Anglesey a failli tomber deux ou trois fois en se retirant. Je ne vous redis pas ce que vous diront les journaux.
Hier à dîner entre la Duchesse de Mecklembourg et la Duchesse de Norfolk. La première spirituelle, et gracieuse ; la seconde pompeusement complimenteuse. Après dîner, Lord Stanley. Longue et très bonne conversation. Il m'a dit en nous quittant : " Je vous promets que je me souviendrai de tout ce que vous m'avez dit. " Je crois avoir fait impression. Le Roi en croit autant pour son compte. Quel dommage de ne pas voir les hommes là tous les trois mois ! Qu'il y aurait peu d'affaires. Lord Stanley m’a fait à moi l'impression d'une grande franchise & straightforwardness. Le tort des Anglais, c'est de ne pas penser d’eux mêmes à une foule de choses, et de choses importantes. Il faut qu'on les leur montre.
Outre Stanley, un peu de conversation avec M. Goulburn. Je les ai soignés, tous. Voilà deux soirées où je vous jure que j’ai été très aimable. Hier trois heures avec Aberdeen. Parfait sur toutes choses. Nous sommes de vrais complices. Nous nous donnons des conseils mutuels. Il est bien préoccupé de Tahiti et bien embarrassé du droit de visite. Ce matin deux heures et demie avec Peel. Remarquablement amical pour moi. Les paroles de la plus haute estime, de la plus entière confiance. Il a fini par me tendre la main en me demandant mon amitié de cœur. A un point qui ma surpris. Du reste très bonne intention ; plus d'humeur. Le voyage en effacera toute trace : mais des doutes, des hésitations et des inquiétudes dans l’esprit qui est plus sain que grand. Il m'a répété deux fois, qu’il s’entendait parfaitement et sur toutes choses avec Lord Aberdeen. Se regardant comme brouillé avec une portion notable de l’aristocratie anglaise, & le regrettant peu.
L'Empereur et M. de Nesselrode ont pris plus d’une demi-heure de notre temps. Les choses sont parfaitement tirées au clair. Il a fort approuvé ma conduite de ce côté depuis trois ans. Que de choses j'aurais encore à vous dire. Mais il faut finir. Mon courrier part dans une demi-heure et j’ai à écrire à Duchâtel. Adieu. Adieu. Dearest ever dearest.
J'oublie toujours de vous dire que je vais bien. Un peu de fatigue le soir. Je suis toujours charmé de me coucher. Mais je suffis à chaque jour, et mieux chaque jour. Je mange, quoique je ne puisse pas avoir un bon poulet. Demain, la Cité de Londres envoie à Windsor son Lord Maire, ses douze Aldermen et 18 membres de son common council pour présenter au Roi une adresse excellente pour lui, excellente pour la France. N'ayant pu obtenir le banquet à Guildhall ils n'en ont pas moins voulu manifester leurs sentiments. Ici, cela fait un gros effet. J’espère que chez nous, il sera très bon. Je n'écris pas à Génie dites-lui je vous prie ceci et quelques autres détails pour sa satisfaction. Adieu adieu. G.
5. Paris, Jeudi 10 octobre 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris, Jeudi le 10 octobre 1844
8 h 1/2 matin
Voilà votre bon petit mot de Portsmouth. Merci. Merci. Bien dormi, bien mangé. C'est là ce qu’il faut me dire. C'est la seule chose qui m’intéresse vraiment. Hier soir Génie est venu m’apporter la dépêche télégraphique de Windsor. J’en ai été médiocrement contente, elle ne parlait pas de vous. Sachez bien qu’il n'y a que vous pour moi dans le monde.
A propos de cette dépêche la colère de Génie était sans bornes, restée 23 1/2 heures entre Windsor & Calais ! C'est vrai que c’est fort.
Il est impossible de faire plus. La venue du Prince Albert à Portsmouth à bord du Gomer, c’est parfait. Que je serai curieuse maintenant des détails. Comme les journaux vont nous en régaler ! Je voudrais qu’ils me racontent aussi ce que vous mangez.
Hier pauvre journée de larmes. Constantin m'a écrit la plus touchante lettre du monde. Vous verrez qu’elle vous touchera. Cette lettre a enfin fait pleurer la pauvre Annette. Elle n’a pas quitté son lit depuis l’arrivée de la nouvelle.
J’ai vu hier matin Fagel deux fois, Fleishman, Kisseleff, Bacourt, l'Ambassadeur d’Autriche. J'ai fait ma promenade au bois de Boulogne après mon dîner. J'ai été chez Annette où je suis restée jusqu'à 1 heure de me coucher. Je ferai cela tous les jours. Bacourt vous demande s'il doit attendre votre arrivée. Il voulait aller lundi à Bruxelles pour en revenir le 1er Nbre. Mais si vous en disposez autrement, il fera votre volonté et vous attendra. Il ne sait rien que le fait que vous avez peut être besoin de lui. Fagel est excellent d’abord pour moi (il a le cœur très charitable) et puis excellent par les rapports avec Londres. Lord Aberdeen a lu le rapport de Fagel sur son entretien avec le roi où celui-ci-li a fait un éloge si vif & si mérité d’Aberdeen. Cela lui a fait une satisfaction visible. Il s’est beaucoup loué & d'ici, et de vos agents d'Espagne surtout de Glusbery. C'est absurde de vous adresser tout cela à Windsor. Je ne sais que vous mander. Vous comprenez bien qu'ici il n’y a pas de nouvelles, & que moi plus recluse que jamais à présent à cause de mon deuil, je ne puis rien apprendre.
Le Toulonnais donne votre traité avec le Maroc. Certainement, cela n’est pas en règle. Comment ces choses là arrivent-elles chez vous ? J'espère que Tahiti ne va pas faire un nouvel embarras. Ah que j'arriverais à jeter Tahiti au fond de la mer. Revenez je vous en prie avec le droit de visite au fond de mer aussi. Je ne sais pourquoi, je l'espère beaucoup. Mais surtout je vous en supplie portez vous bien. Dormez, mangez, prenez des forces et parlez moi de cela tous les jours.
Sans doute le Roi se louera de Cowley à Windsor. Je voudrais que cela valût à ce bon vieux homme le titre d’earl. Je n’ai pas vu Lady Cowley hier elle était malade, elle viendra aujourd’hui.
Midi et demi. Dans ce moment m’arrive votre petit mot de Windsor. Mardi 5 heures Mille fois thank you dearest que c’est charmant de lire écrit de votre main : Je suis très bien. Continuez à l’être et à me le dire.
Que la bonne réception de Portsmouth m'enchante. Au fait tous ces hourras feront du bien au roi ici. Cela le réhausse encore. Quelle honte pour les Français de si peu reconnaître ce qu’ils possèdent. Mais savez vous qu’au fond il y a un sentiment d’inquiétude de son absence, on sera content de le savoir de retour. Il manque, c’est un vide. On s’aperçoit que c’est une grande affaire que le roi. Je crois moi que tout ceci fera du bien.
9 heures
J’ai été accablée de visites. Il faut que je ferme ceci & que je le porte chez Génie. Adieu. Adieu. Vos filles sont venues elles ont été très aimables pour moi, et m'ont apporté de charmantes brioches bien chaudes très utiles. Elles ont bonne mine toutes les deux. Adieu. Adieu.
Voilà le petit Nessellrode qui reste aussi. Je vous redirai tout demain. Adieu. Adieu. God bless you dearest.
8 h 1/2 matin
Voilà votre bon petit mot de Portsmouth. Merci. Merci. Bien dormi, bien mangé. C'est là ce qu’il faut me dire. C'est la seule chose qui m’intéresse vraiment. Hier soir Génie est venu m’apporter la dépêche télégraphique de Windsor. J’en ai été médiocrement contente, elle ne parlait pas de vous. Sachez bien qu’il n'y a que vous pour moi dans le monde.
A propos de cette dépêche la colère de Génie était sans bornes, restée 23 1/2 heures entre Windsor & Calais ! C'est vrai que c’est fort.
Il est impossible de faire plus. La venue du Prince Albert à Portsmouth à bord du Gomer, c’est parfait. Que je serai curieuse maintenant des détails. Comme les journaux vont nous en régaler ! Je voudrais qu’ils me racontent aussi ce que vous mangez.
Hier pauvre journée de larmes. Constantin m'a écrit la plus touchante lettre du monde. Vous verrez qu’elle vous touchera. Cette lettre a enfin fait pleurer la pauvre Annette. Elle n’a pas quitté son lit depuis l’arrivée de la nouvelle.
J’ai vu hier matin Fagel deux fois, Fleishman, Kisseleff, Bacourt, l'Ambassadeur d’Autriche. J'ai fait ma promenade au bois de Boulogne après mon dîner. J'ai été chez Annette où je suis restée jusqu'à 1 heure de me coucher. Je ferai cela tous les jours. Bacourt vous demande s'il doit attendre votre arrivée. Il voulait aller lundi à Bruxelles pour en revenir le 1er Nbre. Mais si vous en disposez autrement, il fera votre volonté et vous attendra. Il ne sait rien que le fait que vous avez peut être besoin de lui. Fagel est excellent d’abord pour moi (il a le cœur très charitable) et puis excellent par les rapports avec Londres. Lord Aberdeen a lu le rapport de Fagel sur son entretien avec le roi où celui-ci-li a fait un éloge si vif & si mérité d’Aberdeen. Cela lui a fait une satisfaction visible. Il s’est beaucoup loué & d'ici, et de vos agents d'Espagne surtout de Glusbery. C'est absurde de vous adresser tout cela à Windsor. Je ne sais que vous mander. Vous comprenez bien qu'ici il n’y a pas de nouvelles, & que moi plus recluse que jamais à présent à cause de mon deuil, je ne puis rien apprendre.
Le Toulonnais donne votre traité avec le Maroc. Certainement, cela n’est pas en règle. Comment ces choses là arrivent-elles chez vous ? J'espère que Tahiti ne va pas faire un nouvel embarras. Ah que j'arriverais à jeter Tahiti au fond de la mer. Revenez je vous en prie avec le droit de visite au fond de mer aussi. Je ne sais pourquoi, je l'espère beaucoup. Mais surtout je vous en supplie portez vous bien. Dormez, mangez, prenez des forces et parlez moi de cela tous les jours.
Sans doute le Roi se louera de Cowley à Windsor. Je voudrais que cela valût à ce bon vieux homme le titre d’earl. Je n’ai pas vu Lady Cowley hier elle était malade, elle viendra aujourd’hui.
Midi et demi. Dans ce moment m’arrive votre petit mot de Windsor. Mardi 5 heures Mille fois thank you dearest que c’est charmant de lire écrit de votre main : Je suis très bien. Continuez à l’être et à me le dire.
Que la bonne réception de Portsmouth m'enchante. Au fait tous ces hourras feront du bien au roi ici. Cela le réhausse encore. Quelle honte pour les Français de si peu reconnaître ce qu’ils possèdent. Mais savez vous qu’au fond il y a un sentiment d’inquiétude de son absence, on sera content de le savoir de retour. Il manque, c’est un vide. On s’aperçoit que c’est une grande affaire que le roi. Je crois moi que tout ceci fera du bien.
9 heures
J’ai été accablée de visites. Il faut que je ferme ceci & que je le porte chez Génie. Adieu. Adieu. Vos filles sont venues elles ont été très aimables pour moi, et m'ont apporté de charmantes brioches bien chaudes très utiles. Elles ont bonne mine toutes les deux. Adieu. Adieu.
Voilà le petit Nessellrode qui reste aussi. Je vous redirai tout demain. Adieu. Adieu. God bless you dearest.
4. Paris, Mercredi 9 octobre 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Paris mercredi 9 octobre 1844
9 heures
A 6 heures hier au moment où je m’apprêtais à faire ma toilette pour dîner chez les Cowley, l'ambassadeur d’Autriche est venu m'annoncer la mort de mon pauvre frère. Je ne puis pas dire que j’en ai été saisie, il y a si longtemps que je suis préparée à cet évènement, mais j'en suis fort triste. Votre absence ajoute beaucoup à cette tristesse. Et quand Appony m’a eu quittée j’ai senti profondément mon isolement absolu. Je me suis regardé avec un vrai serrement de cœur, quelle solitude, quelle impuissance. Je suis restée comme cela une heure et puis il a fallu songer à mon dîner. Personne n'était à la maison, j’ai envoyé prendre quelque chose chez un restaurant, je n’ai pas que manger à huit heures je suis allé chez Annette. Pauvre fille elle sanglote sans pleurer. Elle se reproche d’avoir quitté son père. Et elle ne sait pas tout encore. On dit qu'il est mort dans la traversée, ainsi sans sa femme, sans ses enfants. Le bon Constantin tout seul auprès de lui. Toutes ces nouvelles sont venues par des correspondance russes. Personne ne nous a écrit encore ni à Annette ni à moi. Je suis restée auprès d'elle jusqu'à 10 heures. J’ai mal dormi encore. J’ai beaucoup rêvé de vous. Je me suis levée de bonne heure dans l’attente d'une lettre, d'une nouvelle. Il n'y a ni télégraphe ni lettre. Je sens qu’il n’y a pas de quoi m’inquiéter, et je m’inquiète. C’est votre santé qui me trouble l'imagination. Le temps est devenu très froid. Vous avez été fort exposé à l’air. Comment tout cela vous va-t-il ? Par pitié pour moi soignez vous extrêmement. Si vous avez dit vrai c’est d’aujourd'hui en huit que je vous reverrais. Ah que le ciel m’accorde ce bonheur. Et puis je jurerai que vous ne m'échapperez plus.
La pauvre Marie Tolstoy selon ces nouvelles russes aussi, est très près de sa fin. Ce pauvre excellent Constantin quel chagrin pour lui. Il ne lui reste plus rien. Je suis sûre qu'il se rappelle & cherche mon amitié. Il n’a plus que moi pour l’aimer. Je crains qu’il me demande à aller au Caucase cela me désolerait. Voilà encore qu'aujourd’hui ma lettre est demandée pour 11 heures vite je finis. Je vous prie je vous supplie portez-vous bien & ne me dites que cela. Adieu. Adieu.
Mille fois adieu dearest.
9 heures
A 6 heures hier au moment où je m’apprêtais à faire ma toilette pour dîner chez les Cowley, l'ambassadeur d’Autriche est venu m'annoncer la mort de mon pauvre frère. Je ne puis pas dire que j’en ai été saisie, il y a si longtemps que je suis préparée à cet évènement, mais j'en suis fort triste. Votre absence ajoute beaucoup à cette tristesse. Et quand Appony m’a eu quittée j’ai senti profondément mon isolement absolu. Je me suis regardé avec un vrai serrement de cœur, quelle solitude, quelle impuissance. Je suis restée comme cela une heure et puis il a fallu songer à mon dîner. Personne n'était à la maison, j’ai envoyé prendre quelque chose chez un restaurant, je n’ai pas que manger à huit heures je suis allé chez Annette. Pauvre fille elle sanglote sans pleurer. Elle se reproche d’avoir quitté son père. Et elle ne sait pas tout encore. On dit qu'il est mort dans la traversée, ainsi sans sa femme, sans ses enfants. Le bon Constantin tout seul auprès de lui. Toutes ces nouvelles sont venues par des correspondance russes. Personne ne nous a écrit encore ni à Annette ni à moi. Je suis restée auprès d'elle jusqu'à 10 heures. J’ai mal dormi encore. J’ai beaucoup rêvé de vous. Je me suis levée de bonne heure dans l’attente d'une lettre, d'une nouvelle. Il n'y a ni télégraphe ni lettre. Je sens qu’il n’y a pas de quoi m’inquiéter, et je m’inquiète. C’est votre santé qui me trouble l'imagination. Le temps est devenu très froid. Vous avez été fort exposé à l’air. Comment tout cela vous va-t-il ? Par pitié pour moi soignez vous extrêmement. Si vous avez dit vrai c’est d’aujourd'hui en huit que je vous reverrais. Ah que le ciel m’accorde ce bonheur. Et puis je jurerai que vous ne m'échapperez plus.
La pauvre Marie Tolstoy selon ces nouvelles russes aussi, est très près de sa fin. Ce pauvre excellent Constantin quel chagrin pour lui. Il ne lui reste plus rien. Je suis sûre qu'il se rappelle & cherche mon amitié. Il n’a plus que moi pour l’aimer. Je crains qu’il me demande à aller au Caucase cela me désolerait. Voilà encore qu'aujourd’hui ma lettre est demandée pour 11 heures vite je finis. Je vous prie je vous supplie portez-vous bien & ne me dites que cela. Adieu. Adieu.
Mille fois adieu dearest.
3. Saverne, Samedi 3 août 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
3. Saverne Samedi 3 août 1844
6 h. du matin
Je veux encore vous dire adieu sur terre de France. Je serai triste en passant le Rhin ! Hier n’a pas été si bien que les autres journées. Un accident ; le postillon sous les chevaux... La voiture presque renversée. Mon Constantin a sauté dehors avec une prestesse de cosaque. Il a tout fait, coupé les traits, relevé le postillon. Enfin nous nous sommes remis de la frayeur et de l’accident. Cela a fait un délai d'une heure. Le pauvre postillon y perdra un doigt.
Je vais donc revoir mon frère aujourd’hui. Je commence à y penser. J’aurai un peu de plaisir, et quelques conversations curieuses. A propos, si l’envie de voir Strasbourg lui venait, s’il était curieux (ce qu'il sera) d’un exercice des chasseurs d’Orléans, Hennequin serait-il homme à l’orienter pour le jour où cela pourrait se rencontrer ? Ou bien pourriez-vous lui faire tenir quelque autorisation auprès du Chef militaire pour cela ? Cela serait de la bien bonne grâce. Je vous dis ceci en l'air, mais Constantin croit que son oncle serait le plus heureux du monde de voir pareille fête.
Les visiteurs de Bade arrivent à Strasbourg sans passeports. Au reste je vous reparlerai de cela encore quand je l’aurai vu. Je vais déjeuner et partir. Je soutiens bien le voyage. Constantin est tout étonné du peu d'embarras que je lui donne, mais cela vient de ce qu’il est là et que je ne m’inquiète pas de mille détails du voyage. Ma santé va assez bien. Adieu. Adieu. Ecrivez-moi, soignez-vous. God bless you dearest.
6 h. du matin
Je veux encore vous dire adieu sur terre de France. Je serai triste en passant le Rhin ! Hier n’a pas été si bien que les autres journées. Un accident ; le postillon sous les chevaux... La voiture presque renversée. Mon Constantin a sauté dehors avec une prestesse de cosaque. Il a tout fait, coupé les traits, relevé le postillon. Enfin nous nous sommes remis de la frayeur et de l’accident. Cela a fait un délai d'une heure. Le pauvre postillon y perdra un doigt.
Je vais donc revoir mon frère aujourd’hui. Je commence à y penser. J’aurai un peu de plaisir, et quelques conversations curieuses. A propos, si l’envie de voir Strasbourg lui venait, s’il était curieux (ce qu'il sera) d’un exercice des chasseurs d’Orléans, Hennequin serait-il homme à l’orienter pour le jour où cela pourrait se rencontrer ? Ou bien pourriez-vous lui faire tenir quelque autorisation auprès du Chef militaire pour cela ? Cela serait de la bien bonne grâce. Je vous dis ceci en l'air, mais Constantin croit que son oncle serait le plus heureux du monde de voir pareille fête.
Les visiteurs de Bade arrivent à Strasbourg sans passeports. Au reste je vous reparlerai de cela encore quand je l’aurai vu. Je vais déjeuner et partir. Je soutiens bien le voyage. Constantin est tout étonné du peu d'embarras que je lui donne, mais cela vient de ce qu’il est là et que je ne m’inquiète pas de mille détails du voyage. Ma santé va assez bien. Adieu. Adieu. Ecrivez-moi, soignez-vous. God bless you dearest.
Mots-clés : Enfants (Benckendorff), Famille Benckendorff, Récit, Santé (Dorothée), Voyage
11. Saint-Germain, Vendredi 18 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1843 (12 août - 22 août) : Vacances au Val-Richer
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
11. St Germain, vendredi 3 heures.
Le 18 août 1843
J’ai répondu trop courtement tout à l'heure à votre lettre. J’étais pressée de renvoyer Etienne. Je suis très frappée de ce que vous me dites sur Metternich et Naples. Il faut lui enlever cette clientelle, ou plutôt ce client. Faire reconnaître par Naples. Je crois moi, en tout, que vous menerez bien cette affaire là. Elle est grande vous vous y ferez hommes. Mais il faut la surveiller et la suivre de très près.
Samedi Midi le 19 août. Je fus interrompue hier par l'arrivée des [Delosdeky], de Rodolple Appony. Ils sont restés jusque près de l'heure du dîner. Le mari va aujourd’hui à Dunckerque où il s'embarque, & la femme au Havre où elle reste. Elle a eu une lettre de mon frère par laquelle il est évident, qu'il voudrait que sa femme passât l'hiver à Paris pour se débarrasser d’elle, & il garderait Sophie. The better half, et nous aurons the worse. Nous avons eu à dîner le prince Kourakine et M. Balabine. Vous ne vous attendez pas que cela me fournisse quoi que ce soit à vous dire. Voici huit jours depuis votre départ. Et bien le temps a passé. il passe sur l'ennui comme sur la joie. Mais Dieu merci il n’y a plus que trois jour. Que vous aimeriez St Germain ! C’est charmant et un air si pur si bon. Une heure. Votre lettre m’arrive. Je suis enchantée que vous ayez renvoyé à Londres, avec le changement. Décidément c’est avec Londres qu'il faut s’arranger, et vous y parviendrez. Comment Espertaro serait vraiment en France ? C’est certainement original. Depuis votre lettre qui fixe Mardi pour votre retour je médite sur les moyens de m'échapper. Si je le puis convenablement vous savez bien que je le ferai, mais si cela devait offenser ou chagriner cette bonne jeune comtesse, je ne pourrais pas. Vous ne sauriez croire toutes les attentions qu’elle a pour moi. Adieu. Adieu. Il me semble donc que je ne vous lirerai plus que demain. Je mens, je vous écrirai, toujours puisque Genie saura bien où vous trouver. Adieu. Adieu.
Le 18 août 1843
J’ai répondu trop courtement tout à l'heure à votre lettre. J’étais pressée de renvoyer Etienne. Je suis très frappée de ce que vous me dites sur Metternich et Naples. Il faut lui enlever cette clientelle, ou plutôt ce client. Faire reconnaître par Naples. Je crois moi, en tout, que vous menerez bien cette affaire là. Elle est grande vous vous y ferez hommes. Mais il faut la surveiller et la suivre de très près.
Samedi Midi le 19 août. Je fus interrompue hier par l'arrivée des [Delosdeky], de Rodolple Appony. Ils sont restés jusque près de l'heure du dîner. Le mari va aujourd’hui à Dunckerque où il s'embarque, & la femme au Havre où elle reste. Elle a eu une lettre de mon frère par laquelle il est évident, qu'il voudrait que sa femme passât l'hiver à Paris pour se débarrasser d’elle, & il garderait Sophie. The better half, et nous aurons the worse. Nous avons eu à dîner le prince Kourakine et M. Balabine. Vous ne vous attendez pas que cela me fournisse quoi que ce soit à vous dire. Voici huit jours depuis votre départ. Et bien le temps a passé. il passe sur l'ennui comme sur la joie. Mais Dieu merci il n’y a plus que trois jour. Que vous aimeriez St Germain ! C’est charmant et un air si pur si bon. Une heure. Votre lettre m’arrive. Je suis enchantée que vous ayez renvoyé à Londres, avec le changement. Décidément c’est avec Londres qu'il faut s’arranger, et vous y parviendrez. Comment Espertaro serait vraiment en France ? C’est certainement original. Depuis votre lettre qui fixe Mardi pour votre retour je médite sur les moyens de m'échapper. Si je le puis convenablement vous savez bien que je le ferai, mais si cela devait offenser ou chagriner cette bonne jeune comtesse, je ne pourrais pas. Vous ne sauriez croire toutes les attentions qu’elle a pour moi. Adieu. Adieu. Il me semble donc que je ne vous lirerai plus que demain. Je mens, je vous écrirai, toujours puisque Genie saura bien où vous trouver. Adieu. Adieu.
312. Paris, Dimanche 10 novembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
312 Paris, Dimanche le 10 Novembre 1839
Vous avez assurément le talent de me contrarier beaucoup. Il était facile de vous assurer de la voiture dès le jour où vous avez fixé votre départ. 24 heures est peu de chose peut-être et c’est beaucoup pour moi, beaucoup de deux manières. Pour mon plaisir, d'abord ; & puis pour mes affaires. Cette contrariété par dessous ma mauvaise journée d'hier fait quelque chose de complet comme tristesse. Aussi suis-je parfaitement triste. Rien ne va pour moi, tout va contre moi dans le monde, et c’est cette vérité visible en toute chose qui fait que la vie m’est insupportable.
Voici une nouvelle vexation de Pétersbourg un peu étrange et fort inattendue. Ma sœur me mande, par secrétaire, que mes fils ont décidé de ne partager ni me vendre la vaisselle, et d’attendre que l’un du trois ait besoin de la totalité pour indemniser les deux autres. Vous voyez bien la portée de cela ; on me refuse l'usage et l’usufruit. Car il est bien clair que je ne prendrai pas une vaisselle de 30 couverts et que je ne payerai pas 200 milles francs. C’est sur cela qu'il faut que je vous consulte. Moi, je suis décidée à ne pas admettre un arrangement aussi absurde. Je vais insister pour avoir et tout de suite, ma part en nature, ou ma part en argent. Et je suis décidée de plus à un point partager le capital anglais que ce point ne soit arrangé. C’est cela que je voulais vous soumettre. Attendre jeudi pour vous consulter & vendredi pour écrire c’est beaucoup trop long. Veuillez me répondre par écrit. Ici le droit est pour moi tout-à-fait. Je ne comprends ni ma sœur, ni mon frère, mais il n'y a rien de gâté je pense puisqu'en tout cas ce ne pouvait être qu’un arrangement provisoire. S’il en était autrement, j'en suis fâchée pour mon frère mais je n’accepterais pas la sanction qu’il y aurait donné. Je vous prie de m’écrire encore un mot sur ceci car ma lettre ne partira que mardi. Songez aussi au fait d’absurdité, qu'à moins d’être ambassadeur, les fortunes de mes fils ne sont pas de taille à avoir jamais besoin de cette vaisselle, Paul s’est mis hors de la carrière, & Alexandre n'arrivera à ce poste jamais. Ce n’est donc je le répète qu’une résolution de me contrarier, et c’est cela qui me révolte et m'irrite à un haut degré. J’ai eu une lettre de mon frère mais qui ne me dit rien, sinon qu'il sera impatient d’apprendre la conclusion de mes affaires, et que mes file désirent vivement être bien avec moi ! Paul s’y prend bien.
Pozzo est devenu tout-à-fait imbécile. Je m’étonne qu'on le montre encore. C'est humiliant. J'ai vu hier, Brignoles et quelques autres mais je ne sais rien absolument rien de nouveau. J'ai oublié de demander des nouvelles du Duc de Bordeaux. Adieu, vous voyez que mon humeur va mal ; ma santé va mal aussi. Adieu. je m’étais tant réjouie de mercredi ! J’apprendrai à ne me réjouir de rien. je m’épargnerai des désappointements. Je ne me réjouis donc pas de jeudi qui sait ce que sera jeudi. Adieu.
Vous avez assurément le talent de me contrarier beaucoup. Il était facile de vous assurer de la voiture dès le jour où vous avez fixé votre départ. 24 heures est peu de chose peut-être et c’est beaucoup pour moi, beaucoup de deux manières. Pour mon plaisir, d'abord ; & puis pour mes affaires. Cette contrariété par dessous ma mauvaise journée d'hier fait quelque chose de complet comme tristesse. Aussi suis-je parfaitement triste. Rien ne va pour moi, tout va contre moi dans le monde, et c’est cette vérité visible en toute chose qui fait que la vie m’est insupportable.
Voici une nouvelle vexation de Pétersbourg un peu étrange et fort inattendue. Ma sœur me mande, par secrétaire, que mes fils ont décidé de ne partager ni me vendre la vaisselle, et d’attendre que l’un du trois ait besoin de la totalité pour indemniser les deux autres. Vous voyez bien la portée de cela ; on me refuse l'usage et l’usufruit. Car il est bien clair que je ne prendrai pas une vaisselle de 30 couverts et que je ne payerai pas 200 milles francs. C’est sur cela qu'il faut que je vous consulte. Moi, je suis décidée à ne pas admettre un arrangement aussi absurde. Je vais insister pour avoir et tout de suite, ma part en nature, ou ma part en argent. Et je suis décidée de plus à un point partager le capital anglais que ce point ne soit arrangé. C’est cela que je voulais vous soumettre. Attendre jeudi pour vous consulter & vendredi pour écrire c’est beaucoup trop long. Veuillez me répondre par écrit. Ici le droit est pour moi tout-à-fait. Je ne comprends ni ma sœur, ni mon frère, mais il n'y a rien de gâté je pense puisqu'en tout cas ce ne pouvait être qu’un arrangement provisoire. S’il en était autrement, j'en suis fâchée pour mon frère mais je n’accepterais pas la sanction qu’il y aurait donné. Je vous prie de m’écrire encore un mot sur ceci car ma lettre ne partira que mardi. Songez aussi au fait d’absurdité, qu'à moins d’être ambassadeur, les fortunes de mes fils ne sont pas de taille à avoir jamais besoin de cette vaisselle, Paul s’est mis hors de la carrière, & Alexandre n'arrivera à ce poste jamais. Ce n’est donc je le répète qu’une résolution de me contrarier, et c’est cela qui me révolte et m'irrite à un haut degré. J’ai eu une lettre de mon frère mais qui ne me dit rien, sinon qu'il sera impatient d’apprendre la conclusion de mes affaires, et que mes file désirent vivement être bien avec moi ! Paul s’y prend bien.
Pozzo est devenu tout-à-fait imbécile. Je m’étonne qu'on le montre encore. C'est humiliant. J'ai vu hier, Brignoles et quelques autres mais je ne sais rien absolument rien de nouveau. J'ai oublié de demander des nouvelles du Duc de Bordeaux. Adieu, vous voyez que mon humeur va mal ; ma santé va mal aussi. Adieu. je m’étais tant réjouie de mercredi ! J’apprendrai à ne me réjouir de rien. je m’épargnerai des désappointements. Je ne me réjouis donc pas de jeudi qui sait ce que sera jeudi. Adieu.
309. Val-Richer, Mardi 5 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
309 Du Val-Richer, Mardi 5 Novembre 1839
7 heures et demie
Il y avait avant-hier du cream cheese à déjeuner, et il y a ce matin sur ma vallée un brouillard, tout-à-fait pareil. On dit que la Normandie ressemble beaucoup à l'Angleterre. Elles se tenaient évidemment avant le déluge, et il y a entre elles, depuis le déluge, des rapports continuels. Si jamais vous avez mangé à Londres de belles poires et de belles pommes elles venaient peut-être du Val-Richer. Les fermiers Normands les expédient par milliers, et il part toutes les semaines, du port de Honfleur vingt mille œufs pour l'Angleterre. J’entends shabby comme vous, et c’est parce que je l’entends que je m'en défends. Je ne vous vole jamais rien, car je vous donne tout ce dont je dispose. Voilà nos questions de Dictionnaire vidées.
Plus j’y pense, plus je me persuade que Benkhausen n’a pas d’inconvénient. Tout sera fini plus vite. Je n’espère toujours rien quant au mobilier de Courlande. Mais au moins la suppression ne passera pas inaperçue. Je suppose que vous avez envoyé à Cumming copie des questions que vous airez adressées à votre fière.
Que voulait faire. M. de Metternich de la mission de M. de Brünnow ? Terminer l'affaire d'Orient sans s'en mêler, ou nous brouiller avec l’Angleterre sans y paraître ? L’un et l'autre a échoué. Je vois, par ce qu’on m'écrit, qu'on a peu d'inquiétude, et qu’on laissera traîner dans l’idée que le temps est au profit du Pacha, qui possède. On a bien fait de renvoyer M. de Labrador, s'il s’agitait encore pour D. Carlos. Nous ne devons aux partisans de D. Carlos que la stricte légalité et à D. Carlos lui-même qu'une politique raisonnable dans sa froideur. L’Europe a envoyé un aigle qui s’appelait Napoléon et qui la troublait, mourir à Ste Hélène. Nous ferons vivre quelques mois à Bourges D. Carlos qui nous tracasse. Il y a eu tout juste proposition.
J’ai aussi mes tribulations d’intérieur. Mon concierge d'ici est malade. Je craignais hier une fluxion de poitrine. On me dit qu'il est mieux ce matin. C’est un factotum très intelligent et qui met sa fierté à être à mon service, ce qui fait que je lui passe des défauts.
10 heures
Je craignais ce qui est arrivé. La poste n’étant venue chez moi que très tard, m'en est répartie que très tard, et n'aura pas été à Lisieux à temps. Vous aurez eu deux lettres ce matin. Mauvaise compensation. Tout cela cessera dans huit jours. Les tristes chances de la vie seront les mêmes ; mais nous serons ensemble. J'espère que vous me direz bientôt que vous avez des nouvelles d'Alexandre Adieu. Adieu. J’aime mieux le Duc que Benkhausen Dix mille francs, c’est beaucoup pour une commission. Adieu. G.
7 heures et demie
Il y avait avant-hier du cream cheese à déjeuner, et il y a ce matin sur ma vallée un brouillard, tout-à-fait pareil. On dit que la Normandie ressemble beaucoup à l'Angleterre. Elles se tenaient évidemment avant le déluge, et il y a entre elles, depuis le déluge, des rapports continuels. Si jamais vous avez mangé à Londres de belles poires et de belles pommes elles venaient peut-être du Val-Richer. Les fermiers Normands les expédient par milliers, et il part toutes les semaines, du port de Honfleur vingt mille œufs pour l'Angleterre. J’entends shabby comme vous, et c’est parce que je l’entends que je m'en défends. Je ne vous vole jamais rien, car je vous donne tout ce dont je dispose. Voilà nos questions de Dictionnaire vidées.
Plus j’y pense, plus je me persuade que Benkhausen n’a pas d’inconvénient. Tout sera fini plus vite. Je n’espère toujours rien quant au mobilier de Courlande. Mais au moins la suppression ne passera pas inaperçue. Je suppose que vous avez envoyé à Cumming copie des questions que vous airez adressées à votre fière.
Que voulait faire. M. de Metternich de la mission de M. de Brünnow ? Terminer l'affaire d'Orient sans s'en mêler, ou nous brouiller avec l’Angleterre sans y paraître ? L’un et l'autre a échoué. Je vois, par ce qu’on m'écrit, qu'on a peu d'inquiétude, et qu’on laissera traîner dans l’idée que le temps est au profit du Pacha, qui possède. On a bien fait de renvoyer M. de Labrador, s'il s’agitait encore pour D. Carlos. Nous ne devons aux partisans de D. Carlos que la stricte légalité et à D. Carlos lui-même qu'une politique raisonnable dans sa froideur. L’Europe a envoyé un aigle qui s’appelait Napoléon et qui la troublait, mourir à Ste Hélène. Nous ferons vivre quelques mois à Bourges D. Carlos qui nous tracasse. Il y a eu tout juste proposition.
J’ai aussi mes tribulations d’intérieur. Mon concierge d'ici est malade. Je craignais hier une fluxion de poitrine. On me dit qu'il est mieux ce matin. C’est un factotum très intelligent et qui met sa fierté à être à mon service, ce qui fait que je lui passe des défauts.
10 heures
Je craignais ce qui est arrivé. La poste n’étant venue chez moi que très tard, m'en est répartie que très tard, et n'aura pas été à Lisieux à temps. Vous aurez eu deux lettres ce matin. Mauvaise compensation. Tout cela cessera dans huit jours. Les tristes chances de la vie seront les mêmes ; mais nous serons ensemble. J'espère que vous me direz bientôt que vous avez des nouvelles d'Alexandre Adieu. Adieu. J’aime mieux le Duc que Benkhausen Dix mille francs, c’est beaucoup pour une commission. Adieu. G.
305. Val-Richer, Vendredi 1er novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
305 Du Val. Richer Vendredi 1er Novembre 1839
8 heures
Nous voilà dans le bon mois. En 1815, à Gand, Louis 18 sortant de son cabinet et traversant le salon, le matin même du jour où il répartit pour rentrer en France me disait : " Eh bien M. Guizot, nous voilà du bon côté de la glissoire. " J'aurai certainement, à vous retrouver, plus de plaisir que lui à reprendre la route de Paris. Que de joies différentes en ce monde, comme de douleurs ! J’en ai connu de toutes sortes ; et bien décidément c’est de l'affection que viennent les plus vives, les seules qui aillent toucher jusqu'au fond de l'âme, & l’ébranlent, et la satisfassent toute entière.
Je partirai le 13. Il n'y a pas moyen de presser davantage, ma mère. Je serai à Paris le 14 pour dîner, et je vous verrai dans la soirée. Il fait aujourd'hui un temps affreux, le vent, la pluie, le froid. Il fera beau, le 14. Je voudrais qu’il fit beau après-demain. J’ai tout mon Lisieux à déjeuner. Ce sont mes adieux. J’ai refusé absolument leurs dîners, leurs parties de campagne, leurs toasts. Ils m'auraient donné dix rhumes. Ils auront les primeurs de Ma route neuve. Elle est finie. On la livre dimanche matin à la circulation. Il ne me reste plus à faire qu’une avenue de la route à ma porte. On la fera cet hiver. L’entrepreneur me la promet pour le 15 avril prochain. Que les plus petites choses sont lentes quand il faut créer !
J’ai envie de quelque chose de M. de Bacourt. Je me crois sûr qu’il a entre les mains, je ne sais comment tous les papiers du comte de La Marck, (d’Aremberg) l’ami intime de Mirabeau et à qui Mirabeau laissa en mourant presque tous les siens, les plus confidentiels. Je voudrais bien voir, ces papiers. Je suis dans Mirabeau jusqu'au cou, par curiosité après Washington. Croyez-vous que je puisse demander à Mad. de Talleyrand de demander cela à M. de Bacourt ? Est-ce convenable ? Ou faut-il que je m'adresse directement à M. de Bacourt ?
10 heures
Votre lettre à votre frère est à merveille, très douce et très ferme, très précise. S'il a, comme j'en ai peur, oublié ou abandonné vos intérêts sur les points que vous touchez, il en ressentira quelque embarras... si quelque embarras est possible. Je n'hésite pas quant à vos fils, d'après ce que vous avez écrit à votre frère, vous devez attendre sa réponse avant de partager le capital. Vous vous le devez à vous-même. Je suis un grand partisan de la consistency. Si vous aviez renoncé à toute observation, il faudrait vider sur le champ l’affaire du capital. Mais vous avez voulu rappeler votre droit méconnu, constater du moins qu'on l’avait méconnu. Le capital est votre seul moyen d'action. Il faut le retenir jusqu'à ce qu’on ait répondu à vos observations, soit pour les accueillir quelque peu, soit pour vous dire nettement. que vous êtes liée par l’arrangement, et que vous ne devez attendre rien de plus. A votre place j’écrirais tout simplement cela à Alexandre. Mais comme ce sera Paul qui répondra par Alexandre, je comprends votre crainte de réponse inconvenante. Ne pourriez-vous pas écrire à Benkhausen, et le charger de dire à vos fils vos intentions ? Voilà mon avis à la première vue. Si quelque autre idée me venait, je vous la dirais demain.
Adieu. Adieu. A dater d'aujourd'hui les Adieux valent mieux. G.
Nous voilà dans le bon mois. En 1815, à Gand, Louis 18 sortant de son cabinet et traversant le salon, le matin même du jour où il répartit pour rentrer en France me disait : " Eh bien M. Guizot, nous voilà du bon côté de la glissoire. " J'aurai certainement, à vous retrouver, plus de plaisir que lui à reprendre la route de Paris. Que de joies différentes en ce monde, comme de douleurs ! J’en ai connu de toutes sortes ; et bien décidément c’est de l'affection que viennent les plus vives, les seules qui aillent toucher jusqu'au fond de l'âme, & l’ébranlent, et la satisfassent toute entière.
Je partirai le 13. Il n'y a pas moyen de presser davantage, ma mère. Je serai à Paris le 14 pour dîner, et je vous verrai dans la soirée. Il fait aujourd'hui un temps affreux, le vent, la pluie, le froid. Il fera beau, le 14. Je voudrais qu’il fit beau après-demain. J’ai tout mon Lisieux à déjeuner. Ce sont mes adieux. J’ai refusé absolument leurs dîners, leurs parties de campagne, leurs toasts. Ils m'auraient donné dix rhumes. Ils auront les primeurs de Ma route neuve. Elle est finie. On la livre dimanche matin à la circulation. Il ne me reste plus à faire qu’une avenue de la route à ma porte. On la fera cet hiver. L’entrepreneur me la promet pour le 15 avril prochain. Que les plus petites choses sont lentes quand il faut créer !
J’ai envie de quelque chose de M. de Bacourt. Je me crois sûr qu’il a entre les mains, je ne sais comment tous les papiers du comte de La Marck, (d’Aremberg) l’ami intime de Mirabeau et à qui Mirabeau laissa en mourant presque tous les siens, les plus confidentiels. Je voudrais bien voir, ces papiers. Je suis dans Mirabeau jusqu'au cou, par curiosité après Washington. Croyez-vous que je puisse demander à Mad. de Talleyrand de demander cela à M. de Bacourt ? Est-ce convenable ? Ou faut-il que je m'adresse directement à M. de Bacourt ?
10 heures
Votre lettre à votre frère est à merveille, très douce et très ferme, très précise. S'il a, comme j'en ai peur, oublié ou abandonné vos intérêts sur les points que vous touchez, il en ressentira quelque embarras... si quelque embarras est possible. Je n'hésite pas quant à vos fils, d'après ce que vous avez écrit à votre frère, vous devez attendre sa réponse avant de partager le capital. Vous vous le devez à vous-même. Je suis un grand partisan de la consistency. Si vous aviez renoncé à toute observation, il faudrait vider sur le champ l’affaire du capital. Mais vous avez voulu rappeler votre droit méconnu, constater du moins qu'on l’avait méconnu. Le capital est votre seul moyen d'action. Il faut le retenir jusqu'à ce qu’on ait répondu à vos observations, soit pour les accueillir quelque peu, soit pour vous dire nettement. que vous êtes liée par l’arrangement, et que vous ne devez attendre rien de plus. A votre place j’écrirais tout simplement cela à Alexandre. Mais comme ce sera Paul qui répondra par Alexandre, je comprends votre crainte de réponse inconvenante. Ne pourriez-vous pas écrire à Benkhausen, et le charger de dire à vos fils vos intentions ? Voilà mon avis à la première vue. Si quelque autre idée me venait, je vous la dirais demain.
Adieu. Adieu. A dater d'aujourd'hui les Adieux valent mieux. G.
303. Val-Richer, Mardi 29 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
803 Du Val-Richer, mardi soir 29 oct. 1839
J’ai écrit ce matin quelques pages qui m'ont amusé. La famille de Mad. de Rumford m’a demandé de parler d’elle dans quelque Biographie. J’ai recueilli quelques souvenirs. Les souvenirs sont un grand amusement. Mad. de Rumford avait été très bonne pour moi, il y a trente ans, quand j'étais un petit jeune homme bien inconnu. Elle a fait les deux choses qui touchent le plus en pareil cas ; elle m'a témoigné en tête-à-tête beaucoup de bienveillance dans le monde, beaucoup de considération. Je le lui ai bien rendu. Quand elle a mis à me voir souvent chez elle, plus d'importance pour elle-même que pour moi, j’y suis allé très souvent, je l’ai beaucoup soignée, et j’ai contribué à l'agrément de son vieux salon comme elle avait contribué à l'agrément de ma jeunesse. Elle en a été touchée. Elle m'a dit deux ou trois fois, en me serrant la main, avec son ton bref et rude : " Vous êtes bien aimable. "
Il y a trente ans, 25 ans, 20 ans son salon valait beaucoup ; tous les étrangers de quelque distinction y venaient. C’était une arche de Noé de bonne compagnie. Salon très peu politique, mais d’une conversation très animée, très variée. J’ai vu là les dernières lueurs de la sociabilité élégante, spirituelle, facile du dernier siècle. Il s'en fallait bien qu’elle en fût un modèle elle-même ; elle était brutale, despotique ; mais elle avait de bonnes traditions et qui attiraient tous les bons débris.
Vous me montrerez votre petite Ellice. La pauvre enfant me parait en train de déchoir. Je lui saurai toujours gré de vous avoir un peur soutenue à Baden. Savez-vous que vous m’avez vraiment inquiété pendant ce temps-là, physiquement et moralement ? Pour une personne d’un esprit aussi ferme et aussi précis que le vôtre, vous avez quelquefois, sur vous-même, la parole singulièrement exagérée ; sans le moindre dessein d’exagérer, mais parce que votre imagination et vos nerfs s’ébranlent outre mesure. De là me vient à votre sujet, un déplaisir quelque fois très pénible ; je ne sais jamais bien ce qu’il faut croire de vos impressions sur votre propre compte ; je crains de me trop rassurer en me disant que vous vous inquiétez trop. Donnez-moi un moyen de savoir exactement ce qui est ; je ne puis supporter l'idée de me tromper dans ce qui m’intéresse si vivement. Quand nous sommes ensemble, je m'en tire ; je vois. Mais de loin le doute est intolérable.
9 heures et demie
Vous avez raison sur mon préfet, et je ne pouvais pourtant pas passer le fait complètement sous silence. Je vous dirai pourquoi. Mais la chose va finir et j’espère qu’il n’en restera qu'une bonne impression. Je vous enverrai bientôt une date. Je ne veux pas vous la dire avant d'en être sûr. Je conviens de notre maladresse. Trois cents lettres en moins de deux ans et demi, c’est horrible. Adieu. Adieu. Il faut que j'écrive quelques lignes à Génie à propos de ce Préfet. Adieu. G.
J’ai écrit ce matin quelques pages qui m'ont amusé. La famille de Mad. de Rumford m’a demandé de parler d’elle dans quelque Biographie. J’ai recueilli quelques souvenirs. Les souvenirs sont un grand amusement. Mad. de Rumford avait été très bonne pour moi, il y a trente ans, quand j'étais un petit jeune homme bien inconnu. Elle a fait les deux choses qui touchent le plus en pareil cas ; elle m'a témoigné en tête-à-tête beaucoup de bienveillance dans le monde, beaucoup de considération. Je le lui ai bien rendu. Quand elle a mis à me voir souvent chez elle, plus d'importance pour elle-même que pour moi, j’y suis allé très souvent, je l’ai beaucoup soignée, et j’ai contribué à l'agrément de son vieux salon comme elle avait contribué à l'agrément de ma jeunesse. Elle en a été touchée. Elle m'a dit deux ou trois fois, en me serrant la main, avec son ton bref et rude : " Vous êtes bien aimable. "
Il y a trente ans, 25 ans, 20 ans son salon valait beaucoup ; tous les étrangers de quelque distinction y venaient. C’était une arche de Noé de bonne compagnie. Salon très peu politique, mais d’une conversation très animée, très variée. J’ai vu là les dernières lueurs de la sociabilité élégante, spirituelle, facile du dernier siècle. Il s'en fallait bien qu’elle en fût un modèle elle-même ; elle était brutale, despotique ; mais elle avait de bonnes traditions et qui attiraient tous les bons débris.
Vous me montrerez votre petite Ellice. La pauvre enfant me parait en train de déchoir. Je lui saurai toujours gré de vous avoir un peur soutenue à Baden. Savez-vous que vous m’avez vraiment inquiété pendant ce temps-là, physiquement et moralement ? Pour une personne d’un esprit aussi ferme et aussi précis que le vôtre, vous avez quelquefois, sur vous-même, la parole singulièrement exagérée ; sans le moindre dessein d’exagérer, mais parce que votre imagination et vos nerfs s’ébranlent outre mesure. De là me vient à votre sujet, un déplaisir quelque fois très pénible ; je ne sais jamais bien ce qu’il faut croire de vos impressions sur votre propre compte ; je crains de me trop rassurer en me disant que vous vous inquiétez trop. Donnez-moi un moyen de savoir exactement ce qui est ; je ne puis supporter l'idée de me tromper dans ce qui m’intéresse si vivement. Quand nous sommes ensemble, je m'en tire ; je vois. Mais de loin le doute est intolérable.
9 heures et demie
Vous avez raison sur mon préfet, et je ne pouvais pourtant pas passer le fait complètement sous silence. Je vous dirai pourquoi. Mais la chose va finir et j’espère qu’il n’en restera qu'une bonne impression. Je vous enverrai bientôt une date. Je ne veux pas vous la dire avant d'en être sûr. Je conviens de notre maladresse. Trois cents lettres en moins de deux ans et demi, c’est horrible. Adieu. Adieu. Il faut que j'écrive quelques lignes à Génie à propos de ce Préfet. Adieu. G.
302. Paris, Jeudi 31 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
302 Paris le 11 octobre 1839,
Prenez patience encore et lisez ce que je vous envoie. Il faut que vous me disiez maintenant ce que j'ai à faire. J'ai reçu hier une lettre d'Alexandre de Berlin. Il arrive aujourdui à Londres. Il ne veut y faire ce séjour strictement nécessaire pour régler ses intérêts là-bas ce qui veut dire recevoir sa part du capital ensuite il viendra ici. Après un petit séjour ici il va en Italie, pour revenir au printemps à Paris et puis Londres encore, et s'embarque de là avec son frère pour un second voyage en Russie. Vous voyez bien qu'il sera pressé et que moi n’ayant écrit ce que je vous envoyé que le 26 Je ne pourrai avoir de réponse que tout au plus le 20 novembre. Cela leur semblera bien long et pourra vexer ce pauvre Alexandre. Cependant puis-je après ce que j’ai écrit à mon frère, & dans mon propre intérêt, leur donner le Capital avant ses réponses ? Dois-je informer Alexandre de tout ceci ? Je crains à présent qu'il est auprès de Paul, quelques réponses impertinentes. Dois-je en charger une tierce personne & qui ? C’est au duc de Sutherland que je donnerai mes pleins pouvoirs. Mais comme il ne sera pas à Londres il les déléguera à quelqu'un, un banquier sans doute. Je ne veux répondre à la lettre d’Alexandre que quand vous m’aurez donné votre avis. Il m’écrit très tendrement et se réjouit beaucoup de me revoir. Ma lettre à mon frère est-elle bien ?
On dit dans le monde diplomatique, que le Roi est fort mécontent de tous les ministes moins le maréchal. Il s’agit de Don Carlos. On menace même de dissoudre le cabinet si ces messieurs s'obstinent à contrarier la volonté du roi sur ce point. C’est Montrond qui m’a dit cela. Lord Granville pousse à garder Don Carlos. On dit que le Roi parle très mal et très vivement sur mon Empereur. Je tremble que Pahlen ne revienne pas ce serait un vrai chagrin pour moi. Il fait un temps abominable Il n’y a plus de belle campagne possible. Adieu. Adieu, Adieu.
14/26 octobre 1839 à mon frère
J’ai reçu il y a huit jours seulement le paquet contenant votre lettre du 20 août et l’acte passé avec mes fils, et avant-hier votre lettre des 22 7bre avec le compte de Bruxner. Je commence mon cher frère par vous remercier bien tendrement de toute là peine que vous avez prise pour arranger mes affaires, et de toute l’amitié, la bonté que vous m'avez prouvées par là. Je vois que j’avais raison ne vous contestant cet été les chiffres de mon revenu que vous portiez à 9400 roubles argent et 400 milles francs de capitaux de la succession de mon mari. Mes propositions sont devenues plus modestes, selon ce que vous me mandez aujourd’hui. L’ensemble de cette succession tel que je le relus de l’acte que vous avez conclu et des autres papiers que vous m’avez envoyés forme pour moi un revenu de 36 395 roubles papiers. Mon propre avoir monte à 20 152 roubles papier. Total général 56 544. Vous en verrez le détail dans le tableau ci-joint. Vous ne trouverez peut-être plus que je suis trop riche comme vous me l'écriviez alors, car il y a loin delà à 80 mille francs de rente que vous m’annoncez. Je vais faire selon la loi russe le partage du capital anglais aussi tôt que je saurai que tout est terminé à Petersboug. Je désire pour cet effet obtenir des réponses aux observations consignés dans la note ci-jointe. En lisant avec attention l’acte et en le confrontant avec les observations que je vous avais soumises dans le temps j'ai trouvé tout parfaitement en règle et toute les questions répondues, sauf le seul point du mobilier de Courlande dont je vous avais déjà entretenu deux fois. J’appelle votre attention sur ce point. S'il a été oublié dans la discussion, c'est à vous à juger si je dois regarder la somme qui aurait dû me revenir de cet état comme perdue à tout jamais ; ou si, dans le cas que l’objet en vaille la peine, vous voudrez le porter à la connaissance de mes fils.
Note
1. La loi de Courlande dit § 194
Toute la partie mobilière de la terre, bétail, magasin, maison, effets, & & sera partagée entre la veuve & les enfants en parts égales.
Comme il m’en revient par conséquent le tiers,. que ce doit être un objet considérable, vu la qualité de la terre et que cependant je ne trouve pas cet objet spécifié dans les papiers qui m'ont été envoyés, je désire savoir quels sont les arrangements qui ont été pris à cet égard, ou l’indemnité qui m'a été assignée pour l’abandon que j’aurais fait de ce droit car on ne peut pas l'inclure dans le 15 829 roubles papier une fois payés. Cette somme formait exactement le revenu de l’année que la loi accordé à la veuve.
2°. Je ne trouve ici dans le tableau du banquier Bruxner, ni autre part mention des coupons qui se trouvaient dans le portefeuille de mon mari pour la valeur de 1350 £ sur la maison Hammersby à Londres.
3°. On aura certainement dressé un inventaire des meubles et un procès verbal de la vente qui en aura été faite à l’encan. Je désire que copie m’en soit envoyée. 4°. Je désire spécialement avoir un état de la vaisselle, & savoir si après la vente à l'encan ma part a pu être rachetée, comme je l'avais demandé. Dans le cas contraire je désire connaître le produit de cette vente.
Prenez patience encore et lisez ce que je vous envoie. Il faut que vous me disiez maintenant ce que j'ai à faire. J'ai reçu hier une lettre d'Alexandre de Berlin. Il arrive aujourdui à Londres. Il ne veut y faire ce séjour strictement nécessaire pour régler ses intérêts là-bas ce qui veut dire recevoir sa part du capital ensuite il viendra ici. Après un petit séjour ici il va en Italie, pour revenir au printemps à Paris et puis Londres encore, et s'embarque de là avec son frère pour un second voyage en Russie. Vous voyez bien qu'il sera pressé et que moi n’ayant écrit ce que je vous envoyé que le 26 Je ne pourrai avoir de réponse que tout au plus le 20 novembre. Cela leur semblera bien long et pourra vexer ce pauvre Alexandre. Cependant puis-je après ce que j’ai écrit à mon frère, & dans mon propre intérêt, leur donner le Capital avant ses réponses ? Dois-je informer Alexandre de tout ceci ? Je crains à présent qu'il est auprès de Paul, quelques réponses impertinentes. Dois-je en charger une tierce personne & qui ? C’est au duc de Sutherland que je donnerai mes pleins pouvoirs. Mais comme il ne sera pas à Londres il les déléguera à quelqu'un, un banquier sans doute. Je ne veux répondre à la lettre d’Alexandre que quand vous m’aurez donné votre avis. Il m’écrit très tendrement et se réjouit beaucoup de me revoir. Ma lettre à mon frère est-elle bien ?
On dit dans le monde diplomatique, que le Roi est fort mécontent de tous les ministes moins le maréchal. Il s’agit de Don Carlos. On menace même de dissoudre le cabinet si ces messieurs s'obstinent à contrarier la volonté du roi sur ce point. C’est Montrond qui m’a dit cela. Lord Granville pousse à garder Don Carlos. On dit que le Roi parle très mal et très vivement sur mon Empereur. Je tremble que Pahlen ne revienne pas ce serait un vrai chagrin pour moi. Il fait un temps abominable Il n’y a plus de belle campagne possible. Adieu. Adieu, Adieu.
14/26 octobre 1839 à mon frère
J’ai reçu il y a huit jours seulement le paquet contenant votre lettre du 20 août et l’acte passé avec mes fils, et avant-hier votre lettre des 22 7bre avec le compte de Bruxner. Je commence mon cher frère par vous remercier bien tendrement de toute là peine que vous avez prise pour arranger mes affaires, et de toute l’amitié, la bonté que vous m'avez prouvées par là. Je vois que j’avais raison ne vous contestant cet été les chiffres de mon revenu que vous portiez à 9400 roubles argent et 400 milles francs de capitaux de la succession de mon mari. Mes propositions sont devenues plus modestes, selon ce que vous me mandez aujourd’hui. L’ensemble de cette succession tel que je le relus de l’acte que vous avez conclu et des autres papiers que vous m’avez envoyés forme pour moi un revenu de 36 395 roubles papiers. Mon propre avoir monte à 20 152 roubles papier. Total général 56 544. Vous en verrez le détail dans le tableau ci-joint. Vous ne trouverez peut-être plus que je suis trop riche comme vous me l'écriviez alors, car il y a loin delà à 80 mille francs de rente que vous m’annoncez. Je vais faire selon la loi russe le partage du capital anglais aussi tôt que je saurai que tout est terminé à Petersboug. Je désire pour cet effet obtenir des réponses aux observations consignés dans la note ci-jointe. En lisant avec attention l’acte et en le confrontant avec les observations que je vous avais soumises dans le temps j'ai trouvé tout parfaitement en règle et toute les questions répondues, sauf le seul point du mobilier de Courlande dont je vous avais déjà entretenu deux fois. J’appelle votre attention sur ce point. S'il a été oublié dans la discussion, c'est à vous à juger si je dois regarder la somme qui aurait dû me revenir de cet état comme perdue à tout jamais ; ou si, dans le cas que l’objet en vaille la peine, vous voudrez le porter à la connaissance de mes fils.
Note
1. La loi de Courlande dit § 194
Toute la partie mobilière de la terre, bétail, magasin, maison, effets, & & sera partagée entre la veuve & les enfants en parts égales.
Comme il m’en revient par conséquent le tiers,. que ce doit être un objet considérable, vu la qualité de la terre et que cependant je ne trouve pas cet objet spécifié dans les papiers qui m'ont été envoyés, je désire savoir quels sont les arrangements qui ont été pris à cet égard, ou l’indemnité qui m'a été assignée pour l’abandon que j’aurais fait de ce droit car on ne peut pas l'inclure dans le 15 829 roubles papier une fois payés. Cette somme formait exactement le revenu de l’année que la loi accordé à la veuve.
2°. Je ne trouve ici dans le tableau du banquier Bruxner, ni autre part mention des coupons qui se trouvaient dans le portefeuille de mon mari pour la valeur de 1350 £ sur la maison Hammersby à Londres.
3°. On aura certainement dressé un inventaire des meubles et un procès verbal de la vente qui en aura été faite à l’encan. Je désire que copie m’en soit envoyée. 4°. Je désire spécialement avoir un état de la vaisselle, & savoir si après la vente à l'encan ma part a pu être rachetée, comme je l'avais demandé. Dans le cas contraire je désire connaître le produit de cette vente.
296. Paris, Vendredi 25 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
296. Paris, le 25 octobre 1839
Midi
J’ai passé toute la journée dans ma chambre. Je n’ai vu personne que Thiers il est venu à 2 h. et ne m’a quittée qu’après cinq heures. Beaucoup d’Orient, presque rien que cela. Beaucoup d’esprit sur ce sujet. Ce qu’il aimerait le mieux, c’est que nous nous arrangeassions cela. Au fond c'est son vieux refrain et le refrain de beaucoup de gens ici. " Donnez-nous le Rhin, & nous vous donnerons Constantinople. " Mais il y a une petits écueil là-dedans, c’est que nous pouvons prendre Constantinople, & que nous ne pourrons ni ne voudrons donner le Rhin. Je l'ai un peu plaisante sur la coalition il a fort mal pris mes plaisanteries et a soutenu fort et ferme qu’elle avait accompli ce qu’elle s'était proposé. Tuer le ministère, que c’était beaucoup, que c’était tout, & que les gens d’esprit n’avaient pas un autre devoir. Les Turcs tous les uns après les autres, de façon à y arriver après que tout le monde sera mort. Je vous assure que je vous ai dit là tout ce qu’il a tourné et retourné pendant 3 heures. Il parle fort bien de vous, mais sans affectation, il dit qu’il est à merveille avec le roi.
J’ai eu une lettre de mon frère qui m'envoie les comptes de Brünnow. J'aurai 24 milles francs de plus que les 56 mille en tout 80 mille qui me seront remise quand je voudrai, à ce que dit mon frère. Il a jouté " Vous n'aurez plus qu’à régler la question du capital anglais Paul part pour Londres à cet effet, il a un vif désir de se réconcilier, avec vous. " (écrit comme cela.) Je voudrais voir trace de ce désir ! Ce que vous me dites de M. de Talleyrand est d'une parfaite vérité, de grandes habitudes mais pas de grandeur naturelle. Adieu.
Me voici en face d’une jolie femme de chambre, qui ne l'a jamais été mais qui a l’air si doux que je veux me résigner à toutes le gaucheries. Adieu, adieu.
Midi
J’ai passé toute la journée dans ma chambre. Je n’ai vu personne que Thiers il est venu à 2 h. et ne m’a quittée qu’après cinq heures. Beaucoup d’Orient, presque rien que cela. Beaucoup d’esprit sur ce sujet. Ce qu’il aimerait le mieux, c’est que nous nous arrangeassions cela. Au fond c'est son vieux refrain et le refrain de beaucoup de gens ici. " Donnez-nous le Rhin, & nous vous donnerons Constantinople. " Mais il y a une petits écueil là-dedans, c’est que nous pouvons prendre Constantinople, & que nous ne pourrons ni ne voudrons donner le Rhin. Je l'ai un peu plaisante sur la coalition il a fort mal pris mes plaisanteries et a soutenu fort et ferme qu’elle avait accompli ce qu’elle s'était proposé. Tuer le ministère, que c’était beaucoup, que c’était tout, & que les gens d’esprit n’avaient pas un autre devoir. Les Turcs tous les uns après les autres, de façon à y arriver après que tout le monde sera mort. Je vous assure que je vous ai dit là tout ce qu’il a tourné et retourné pendant 3 heures. Il parle fort bien de vous, mais sans affectation, il dit qu’il est à merveille avec le roi.
J’ai eu une lettre de mon frère qui m'envoie les comptes de Brünnow. J'aurai 24 milles francs de plus que les 56 mille en tout 80 mille qui me seront remise quand je voudrai, à ce que dit mon frère. Il a jouté " Vous n'aurez plus qu’à régler la question du capital anglais Paul part pour Londres à cet effet, il a un vif désir de se réconcilier, avec vous. " (écrit comme cela.) Je voudrais voir trace de ce désir ! Ce que vous me dites de M. de Talleyrand est d'une parfaite vérité, de grandes habitudes mais pas de grandeur naturelle. Adieu.
Me voici en face d’une jolie femme de chambre, qui ne l'a jamais été mais qui a l’air si doux que je veux me résigner à toutes le gaucheries. Adieu, adieu.
291. Paris, Dimanche 20 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
291 Paris dimanche 20 octobre 1839
Je n'ai vu hier que Bulwer le matin, & Pozzo le soir. J’ai trouvé Mad. de Boigne chez lui. Elle reste en ville jusqu'à pied et puis elle va à Pontchartain pour 3 semaines. Il ne s’est rien dit, et je n'avais rien appris le matin qui mérite de vous être rapporté. Toute la Diplomatie hier est allée à St Cloud à la suite de l'accident de la veille, la Reine ne s’est pas ressenti de ce coup. Je dois très mal. Le bruit est bien plus fort ici qu'à la Terrasse. Cette nuit j’ai entendu des soupirs sous mes fenêtres comme ils ne me sont pas adressés cela m’incommoda beaucoup. Je vais aviser à des sourderies renforcées. J'ai reçu hier une lettre de mon fils Alexandre. Il restait encore à Pétersbourg jusqu'à la décision de ses affaires de service. Il ne mande que tout le reste est terminé et que Paul partait le 5 pour Londres. Il doit y être arrivé. Je suppose qu'il va entrer en relations indirectes avec moi pour l’affaire du Capital. Voulez-vous bien me dire avant d'en faire le partage je n’ai pas le droit de demander à être informée de ce que j'aurai à toucher en argent et en effets à Pétersbourg ? Si je vous ai déjà adressé cette question, pardonnez-moi la répétition. Je n’ai pas vu Tcham depuis votre lettre. Adieu. Il fait un bien beau soleil à Paris, presque aussi joli que votre Lune du Val Richer mais venez-vous chauffer ici. Adieu. Adieu. Adieu. Dites-moi si en répondant à mon frère je dois faire mention de l'oubli dans lequel on a laissé mes droits.
Je n'ai vu hier que Bulwer le matin, & Pozzo le soir. J’ai trouvé Mad. de Boigne chez lui. Elle reste en ville jusqu'à pied et puis elle va à Pontchartain pour 3 semaines. Il ne s’est rien dit, et je n'avais rien appris le matin qui mérite de vous être rapporté. Toute la Diplomatie hier est allée à St Cloud à la suite de l'accident de la veille, la Reine ne s’est pas ressenti de ce coup. Je dois très mal. Le bruit est bien plus fort ici qu'à la Terrasse. Cette nuit j’ai entendu des soupirs sous mes fenêtres comme ils ne me sont pas adressés cela m’incommoda beaucoup. Je vais aviser à des sourderies renforcées. J'ai reçu hier une lettre de mon fils Alexandre. Il restait encore à Pétersbourg jusqu'à la décision de ses affaires de service. Il ne mande que tout le reste est terminé et que Paul partait le 5 pour Londres. Il doit y être arrivé. Je suppose qu'il va entrer en relations indirectes avec moi pour l’affaire du Capital. Voulez-vous bien me dire avant d'en faire le partage je n’ai pas le droit de demander à être informée de ce que j'aurai à toucher en argent et en effets à Pétersbourg ? Si je vous ai déjà adressé cette question, pardonnez-moi la répétition. Je n’ai pas vu Tcham depuis votre lettre. Adieu. Il fait un bien beau soleil à Paris, presque aussi joli que votre Lune du Val Richer mais venez-vous chauffer ici. Adieu. Adieu. Adieu. Dites-moi si en répondant à mon frère je dois faire mention de l'oubli dans lequel on a laissé mes droits.
293. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
293 Du Val-Richer, dimanche 20 oct. 1839
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins, tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui. Adieu. Adieu. G.
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins, tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui. Adieu. Adieu. G.
290. Paris, Samedi 19 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
290 Paris, le 19 octobre samedi 1839
Je n’ai vraiment pas le temps ni la force de copier les papiers et les explications que m’a envoyés mon frère. J’en suis fâchée, car je voudrais vous tout montrer. J'ai fait lire tout cela hier à M. de Pogenpohl. Voici l’explication. La loi ne me donne que la 7ème part aux arendes comme aux biens fonds. Ainsi c’est en règle. Le question de la partie mobilière en Courlande a été évidemment, parfaitement oubliée. Il est d’avis que je dois la reproduire rigoureusement Paul peut refuser d'entrer en discussion, mon abandon étant complet, honorablement il ne le peut pas. Ce serait un tort de plus. Voici donc maintenant ma fortune. 2 mille francs de pension. Et le quart du Capital Anglais. Cela fera 36 milles francs en tout et pas davantage. Les 52 milles francs car ce n’est pas plus de l’année de veuve, couvriront ma dépense depuis juin et l'achat du mobilier. Je ne compte pas sur cinq sols des capitaux qui peuvent se trouver en Russie. D'abord il est clair par la lettre de mon frère que Paul ne veut pas même dire ce qu'il y a avant d’avoir touché le capital Anglais. Et quand il l’aura touché il est probable qu’il ne se trouvera rien, ou peu de chose. Les effets sont encore à partager, ma sœur est chargée de cela pour mon compte. Vous savez comme je comprendrai ses lettres. Au bout de tous mes calculs je trouve qu'en tout y compris toutes mes propres ressources, j'aurai 60 milles francs de rente & pas davantage. vous verrez que c’est exact. Mes fils auront chacun 110 mille francs de rente. Voilà assez parler d’affaires.
Le courrier de Médem venait de Londres. L'Angleterre n’a pas accepté nos propositions. Ses contre propositions ne sont pas très claires. Le question reste à peu près comme elle était mais il y a quelque rapprochement entre Londres et Pétersbourg dans l'ensemble de nos relations. J'aurai des tapis qui vous plairont. Le dîner de M. Fleichman valait mieux que son invitation. Je ne sais pas si on rappelle Ponsonby. Je le demanderai, mais j’en doute, on ne voudra pas encore fâcher Lord Grey. et les mémoires à payer à vérifier. Ah quelle bagarre, et comment vous écris je deux lignes qui aient le sens commun. Adieu. Adieu.
Je n’ai pas fait de promenade depuis 5 jours. Je ne parviens pas à bouger de chez moi. Adieu. Adieu. God bless you. Voyez comme je vous écris des lettres élégantes. Si vous me voyez entre les tapisseries, les lampistes, les marchands de bronze, et les changements de maître d'hôtel & de femme de chambre
Je n’ai vraiment pas le temps ni la force de copier les papiers et les explications que m’a envoyés mon frère. J’en suis fâchée, car je voudrais vous tout montrer. J'ai fait lire tout cela hier à M. de Pogenpohl. Voici l’explication. La loi ne me donne que la 7ème part aux arendes comme aux biens fonds. Ainsi c’est en règle. Le question de la partie mobilière en Courlande a été évidemment, parfaitement oubliée. Il est d’avis que je dois la reproduire rigoureusement Paul peut refuser d'entrer en discussion, mon abandon étant complet, honorablement il ne le peut pas. Ce serait un tort de plus. Voici donc maintenant ma fortune. 2 mille francs de pension. Et le quart du Capital Anglais. Cela fera 36 milles francs en tout et pas davantage. Les 52 milles francs car ce n’est pas plus de l’année de veuve, couvriront ma dépense depuis juin et l'achat du mobilier. Je ne compte pas sur cinq sols des capitaux qui peuvent se trouver en Russie. D'abord il est clair par la lettre de mon frère que Paul ne veut pas même dire ce qu'il y a avant d’avoir touché le capital Anglais. Et quand il l’aura touché il est probable qu’il ne se trouvera rien, ou peu de chose. Les effets sont encore à partager, ma sœur est chargée de cela pour mon compte. Vous savez comme je comprendrai ses lettres. Au bout de tous mes calculs je trouve qu'en tout y compris toutes mes propres ressources, j'aurai 60 milles francs de rente & pas davantage. vous verrez que c’est exact. Mes fils auront chacun 110 mille francs de rente. Voilà assez parler d’affaires.
Le courrier de Médem venait de Londres. L'Angleterre n’a pas accepté nos propositions. Ses contre propositions ne sont pas très claires. Le question reste à peu près comme elle était mais il y a quelque rapprochement entre Londres et Pétersbourg dans l'ensemble de nos relations. J'aurai des tapis qui vous plairont. Le dîner de M. Fleichman valait mieux que son invitation. Je ne sais pas si on rappelle Ponsonby. Je le demanderai, mais j’en doute, on ne voudra pas encore fâcher Lord Grey. et les mémoires à payer à vérifier. Ah quelle bagarre, et comment vous écris je deux lignes qui aient le sens commun. Adieu. Adieu.
Je n’ai pas fait de promenade depuis 5 jours. Je ne parviens pas à bouger de chez moi. Adieu. Adieu. God bless you. Voyez comme je vous écris des lettres élégantes. Si vous me voyez entre les tapisseries, les lampistes, les marchands de bronze, et les changements de maître d'hôtel & de femme de chambre
290. Val-Richer, Mercredi 16 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
290 Du Val-Richer, Mercredi soir 16 oct 1839 9 heures
La note de Bruxner est évidemment très obscure. Cependant en voici le sens. Quand il dit : " Nous avons à attendre incessamment l’autorisation nécessaire pour faire payement à M. le Comte du solde stipulé &. " Il veut dire qu’il recevra incessamment de vos fils, l'autorisation de remettre au comte votre frère, comme votre fondé de pouvoirs, le solde stipulé dut, savoir 14 000 roubles argent pour l’année de revenu et 24 000 roubles & &. Il me semble que ces 14 000 roubles argent doivent faire, les 60 et quelques mille francs sur lesquels vous comptiez. Ce que je ne comprends pas, c’est que vous n’ayez pas encore reçu l'acte signé qu’il vous annonce. Votre frère a certainement négligé de vous l'envoyer. Il lui a paru que puisqu'il avait fini, lui, c'était assez pour vous. Il est impossible pourtant que vous ne le receviez pas bientôt.
Puisque, lord Landsdown est à Vienne, vous aviez raison et on était mal informé. Il faudra bien que cela aussi s'éclaircisse comme vos affaires. Je ne m'inquiète pas beaucoup des vicissitudes qu’on traversera. Je crois toujours qu'elles aboutiront au même dénouement. On me mande que Thiers a dû arriver à Paris hier au soir rappelé avec tous les siens par une maladie grave de la mère de Mad. Dodne.
Jeudi 7 heures et demie
L’arrestation de Blanqui, le second ou plutôt le premier de Barbès, fait-elle quelque effet ? Ce sera un grand ennui, et un assez gros embarras pour la Chambre des Pairs. Comment jugera-t-elle autrement qu’elle n'a fait Barbés et comment jugera-t-elle de même. Je suis sûr que le Chancelier en est très préoccupé. On use bien vite les bons instruments dans ce pays-ci. Comme cour de justice, la Chambre des Pairs a fait des miracles depuis 1830. On l’en a dégoûtée. Elle n'en voudra plus faire. Le procès de Blanqui ne sera pas le seul.
Vous n’avez peut-être pas remarqué dans les journaux que Guinard l’un des principaux chefs du procès d'avril est revenu d'Angleterre et s'est constitué prisonnier pour se faire juger. Son père est mort et lui a laissé 40 ou 30 mille livres de rente. On lui a offert sa grâce. Il l'a refusée. Il veut être jugé. Tout cela ne ranimera pas les procès, ni juges, ni accusés. Mais cela fera des embarras, et des embarras ridicules. Du reste le ridicule est mort, comme tant d'autres choses. On ne se moque plus de rien, ni de personne.
9 heures et demie
Je me trompe. Le ridicule n’est pas mort. Ma bonté pour vous le ressuscite. Mais je vous le pardonne. Vous l’avez vu la première. Je rétablis les faits. On n’avait pas, autant qu’il m'en souvient, de nouvelles de Vienne. Mais on avait, de Berlin, une grande approbation, & l’opinion, positivement exprimée, qu’il en serait de même à Vienne. Du reste, vous avez raison, il y a bien du trouble dans les sources les plus pures.
Adieu. Je suis charmé de vous savoir installée, même mal. On est trop heureux quand le bien vient au bout du mal. Le contraire arrive si souvent. Adieu. Adieu. G.
La note de Bruxner est évidemment très obscure. Cependant en voici le sens. Quand il dit : " Nous avons à attendre incessamment l’autorisation nécessaire pour faire payement à M. le Comte du solde stipulé &. " Il veut dire qu’il recevra incessamment de vos fils, l'autorisation de remettre au comte votre frère, comme votre fondé de pouvoirs, le solde stipulé dut, savoir 14 000 roubles argent pour l’année de revenu et 24 000 roubles & &. Il me semble que ces 14 000 roubles argent doivent faire, les 60 et quelques mille francs sur lesquels vous comptiez. Ce que je ne comprends pas, c’est que vous n’ayez pas encore reçu l'acte signé qu’il vous annonce. Votre frère a certainement négligé de vous l'envoyer. Il lui a paru que puisqu'il avait fini, lui, c'était assez pour vous. Il est impossible pourtant que vous ne le receviez pas bientôt.
Puisque, lord Landsdown est à Vienne, vous aviez raison et on était mal informé. Il faudra bien que cela aussi s'éclaircisse comme vos affaires. Je ne m'inquiète pas beaucoup des vicissitudes qu’on traversera. Je crois toujours qu'elles aboutiront au même dénouement. On me mande que Thiers a dû arriver à Paris hier au soir rappelé avec tous les siens par une maladie grave de la mère de Mad. Dodne.
Jeudi 7 heures et demie
L’arrestation de Blanqui, le second ou plutôt le premier de Barbès, fait-elle quelque effet ? Ce sera un grand ennui, et un assez gros embarras pour la Chambre des Pairs. Comment jugera-t-elle autrement qu’elle n'a fait Barbés et comment jugera-t-elle de même. Je suis sûr que le Chancelier en est très préoccupé. On use bien vite les bons instruments dans ce pays-ci. Comme cour de justice, la Chambre des Pairs a fait des miracles depuis 1830. On l’en a dégoûtée. Elle n'en voudra plus faire. Le procès de Blanqui ne sera pas le seul.
Vous n’avez peut-être pas remarqué dans les journaux que Guinard l’un des principaux chefs du procès d'avril est revenu d'Angleterre et s'est constitué prisonnier pour se faire juger. Son père est mort et lui a laissé 40 ou 30 mille livres de rente. On lui a offert sa grâce. Il l'a refusée. Il veut être jugé. Tout cela ne ranimera pas les procès, ni juges, ni accusés. Mais cela fera des embarras, et des embarras ridicules. Du reste le ridicule est mort, comme tant d'autres choses. On ne se moque plus de rien, ni de personne.
9 heures et demie
Je me trompe. Le ridicule n’est pas mort. Ma bonté pour vous le ressuscite. Mais je vous le pardonne. Vous l’avez vu la première. Je rétablis les faits. On n’avait pas, autant qu’il m'en souvient, de nouvelles de Vienne. Mais on avait, de Berlin, une grande approbation, & l’opinion, positivement exprimée, qu’il en serait de même à Vienne. Du reste, vous avez raison, il y a bien du trouble dans les sources les plus pures.
Adieu. Je suis charmé de vous savoir installée, même mal. On est trop heureux quand le bien vient au bout du mal. Le contraire arrive si souvent. Adieu. Adieu. G.
287. Val-Richer, Lundi 14 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
287 Du Val Richer, Lundi 14 oct. 1839 8 heures
Je ne comprends pas que vous n'eussiez pas vu Génie samedi à une heure et demie. Il m'a quitté à 6 heures emportant une lettre pour vous. Il faut qu’il ait eu quelque affaire obligée. Il vous aura surement vue, dans la journée.
Je suis arrivé hier à 4 heures, point fatigué. Il fait beau, mais je tousse toujours un peu. Je trouve en arrivant quatre invitations à dîner. Je les refuse toutes en disant que mon médecin veut que je me repose pendant le reste de mon séjour à la campagne. Mes enfants sont à merveille. Ma mère pas trop. Rien de grave cependant.
Le procédé de M. Jennison est en effet choquant. Mais il n’y a que lui qui puisse en souffrir. Vous avez votre bail signé. S’il ne voulait vous rien vendre, vous auriez un peu plus d'affaires pour votre arrangement voilà tout. Mais il vous vendra ; ne lui achetez pas plus, et ne le payez pas plus cher que vous ne voulez. Le monde est juif. La dispersion de la race juive a infecté le monde
9 heures et demie
Sans nul doute, les questions à votre fière sont trop péremptoires et il vaut mieux attendre. Quoiqu'il n’y ait rien d’impossible, il me paraît impossible que vous ne receviez pas bientôt la copie textuelle de l’arrangement définitif. Nous verrons alors ce qui manquera. Je vous enverrai demain matin une lettre pour le directeur des Douanes. Vous prierez Génie de la lui porter et de suivre cette petite affaire. Il faut toujours un homme à la suite d’une affaire. Rien ne se fait tout seul. Adieu.
Je trouve ici une foule de petites affaires à régler, et de lettres insignifiantes auxquelles il faut pourtant répondre. Adieu Adieu. G.
Je ne comprends pas que vous n'eussiez pas vu Génie samedi à une heure et demie. Il m'a quitté à 6 heures emportant une lettre pour vous. Il faut qu’il ait eu quelque affaire obligée. Il vous aura surement vue, dans la journée.
Je suis arrivé hier à 4 heures, point fatigué. Il fait beau, mais je tousse toujours un peu. Je trouve en arrivant quatre invitations à dîner. Je les refuse toutes en disant que mon médecin veut que je me repose pendant le reste de mon séjour à la campagne. Mes enfants sont à merveille. Ma mère pas trop. Rien de grave cependant.
Le procédé de M. Jennison est en effet choquant. Mais il n’y a que lui qui puisse en souffrir. Vous avez votre bail signé. S’il ne voulait vous rien vendre, vous auriez un peu plus d'affaires pour votre arrangement voilà tout. Mais il vous vendra ; ne lui achetez pas plus, et ne le payez pas plus cher que vous ne voulez. Le monde est juif. La dispersion de la race juive a infecté le monde
9 heures et demie
Sans nul doute, les questions à votre fière sont trop péremptoires et il vaut mieux attendre. Quoiqu'il n’y ait rien d’impossible, il me paraît impossible que vous ne receviez pas bientôt la copie textuelle de l’arrangement définitif. Nous verrons alors ce qui manquera. Je vous enverrai demain matin une lettre pour le directeur des Douanes. Vous prierez Génie de la lui porter et de suivre cette petite affaire. Il faut toujours un homme à la suite d’une affaire. Rien ne se fait tout seul. Adieu.
Je trouve ici une foule de petites affaires à régler, et de lettres insignifiantes auxquelles il faut pourtant répondre. Adieu Adieu. G.
275. Val -Richer, Mardi 24 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
275 Du Val-Richer, mardi 24 Sept. 1839 7 heures
Je croyais avoir le talent de tout lire. Vous me coûtez la perte de cette illusion. En retour vous me faites connaitre un singulier monde. Sous Louis 14 même sous Louis 15 beaucoup de femmes, de très bonne compagnie, ne savaient pas l'Orthographe ; ma belle-mère Mad. de Meulan était encore de ce nombre ; mais elles étaient spirituelles, élégantes ; à travers l’irrégularité de leurs phrases elles avaient le cour d’esprit fois, délicat ; la grande civilisation était partout, excepté dans leur grammaire.
Cuisinière au fond et dans la forme, c’est drôle pour votre sœur ; passez moi la brutalité de l’expression. Du reste, à force d’étude, j’ai tout lu, excepté les mots que j’ai soulignés. Ayez la bonté de m'en envoyer l’interprétation pour que la peine que j’y ai prise ne soit pas tout-à- fait perdue.
Je suis curieux de savoir comment on s'y prendra pour vous empêcher d'avoir l’argenterie qui vous convient, quand vous ne la demandez qu'en en payant la valeur, au taux de l'estimation. Est-ce que Paul veut aussi l'avoir et l'emporter en Angleterre ? Je vois qu’on trouve tout simple, votre frère même, qu’il ait donné sa démission. Je suppose que c’est la nomination de M. de Brünnow qui l'a déterminé et lui sert d'excuse auprès des moins rebelles. Plus j’y pense, plus il me semble que puisque vous avez demandé les letters of adm., ce que vous avez de mieux à faire, c’est de donner vos pleins pouvoirs à Rothschild, et de faire toucher, par lui, le capital, quand vos fils seront arrivés, à Londres, de telle sorte que jusqu'à leur retour l’argent reste où il est, et que vous et eux, vous touchiez chacun votre part au même moment, mais par votre fondé de pouvoirs direct. Il n'y a là, si je ne me trompe, rien à dire pour personne. Et c’est plus sûr.
9h 1/2
Il me paraît impossible que Démion soit menteur à ce point. Il n’a point d’intérêt commun avec M. de Jénnison. Son intérêt à lui, c’est que vous ayez l’appartement. Vous êtes un bon locataire. Vous me direz cela demain. Certainement, si j'étais là, vous auriez l’appartement. Vous auriez tout ce qui vous plairait. Dîtes-le moi toujours. Je suis charmé de le croire.
Adieu. Adieu. J’ai deux lettres d'affaire à répondre sur le champ. Adieu. G.
Je croyais avoir le talent de tout lire. Vous me coûtez la perte de cette illusion. En retour vous me faites connaitre un singulier monde. Sous Louis 14 même sous Louis 15 beaucoup de femmes, de très bonne compagnie, ne savaient pas l'Orthographe ; ma belle-mère Mad. de Meulan était encore de ce nombre ; mais elles étaient spirituelles, élégantes ; à travers l’irrégularité de leurs phrases elles avaient le cour d’esprit fois, délicat ; la grande civilisation était partout, excepté dans leur grammaire.
Cuisinière au fond et dans la forme, c’est drôle pour votre sœur ; passez moi la brutalité de l’expression. Du reste, à force d’étude, j’ai tout lu, excepté les mots que j’ai soulignés. Ayez la bonté de m'en envoyer l’interprétation pour que la peine que j’y ai prise ne soit pas tout-à- fait perdue.
Je suis curieux de savoir comment on s'y prendra pour vous empêcher d'avoir l’argenterie qui vous convient, quand vous ne la demandez qu'en en payant la valeur, au taux de l'estimation. Est-ce que Paul veut aussi l'avoir et l'emporter en Angleterre ? Je vois qu’on trouve tout simple, votre frère même, qu’il ait donné sa démission. Je suppose que c’est la nomination de M. de Brünnow qui l'a déterminé et lui sert d'excuse auprès des moins rebelles. Plus j’y pense, plus il me semble que puisque vous avez demandé les letters of adm., ce que vous avez de mieux à faire, c’est de donner vos pleins pouvoirs à Rothschild, et de faire toucher, par lui, le capital, quand vos fils seront arrivés, à Londres, de telle sorte que jusqu'à leur retour l’argent reste où il est, et que vous et eux, vous touchiez chacun votre part au même moment, mais par votre fondé de pouvoirs direct. Il n'y a là, si je ne me trompe, rien à dire pour personne. Et c’est plus sûr.
9h 1/2
Il me paraît impossible que Démion soit menteur à ce point. Il n’a point d’intérêt commun avec M. de Jénnison. Son intérêt à lui, c’est que vous ayez l’appartement. Vous êtes un bon locataire. Vous me direz cela demain. Certainement, si j'étais là, vous auriez l’appartement. Vous auriez tout ce qui vous plairait. Dîtes-le moi toujours. Je suis charmé de le croire.
Adieu. Adieu. J’ai deux lettres d'affaire à répondre sur le champ. Adieu. G.
274. Val-Richer, Lundi 23 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
274 Du Val Richer. Lundi 23 Sept 1839, 8 heures et demie
Je sors tard de mon lit quoique je me sois couché hier de très bonne heure. J'étais fatigué. Au rhume, qui dure encore un peu, s’était jointe la migraine. Le sommeil est ma ressource. Je ne sais si je la conserverai toujours ; mais je l'ai encore. J’ai beaucoup dormi. Je suis bien ce matin. Il fait beau. Le soleil brille. Je me sens en bonne et forte disposition. Quelles mobiles créatures nous sommes, et que les spectateurs qui nous entourent se doutent peu des agitations, des faiblesses, des innombrables vicissitudes, intérieures par lesquelles nous passons !
Si les propositions de D. Carlos sont telles qu’on le dit, elles me paraissent acceptables. Pourvu qu’il ne réserve que ses droits éventuels, en cas d’extinction de la lignée de la Reine Isabelle, masculine et féminine, et que sa renonciation à ses droits actuels, pour lui et les siens, soit bien claires, bien complète. Pourvu aussi que le gouvernement de Madrid y consente, et soit partie contractante dans l’arrangement. A ces conditions l'affaire me paraît finie, autant quelle peut l'être. Et si D. Carlos accepte tout cela, j'ai peine à voir à quel litre et par qu’elle raison on ne le laisserait pas vivre où il voudra même en Autriche, le Capharnaüm, des Prétendants. Nous sommes un grand exemple de l’état ou jettent les grands excès. Il y a cent ans, l’Europe aurait vécu au moins six mois sur un événement comme la chute de D. Carlos. Il y aurait eu là, pendant longtemps, de la pâture pour les esprits, les réflexions, les conversations, les correspondances. Figurez-vous tout ce que M. de St. Simon y aurait vu et fait voir. Aujourd’hui, nous avons tant vu, tant vu que nos yeux sont las et comme hébétés. Nous regardons à peine les plus grosses choses. Je suis sûr que, s’il ne survient point d’incident nouveau dans quinze jours, à Bourges même, D. Carlos vivra sans qu'on pense à lui.
Voilà mon ami, et le vôtre, d’Haubersaert conseiller d'’Etat. Il le désirait beaucoup et on me l’avait promis. Cette nomination de Conseillers d'Etat est une image fidèle du chaos général. On en a donné un à Thiers, un à moi, trois aux 221, trois aux 213. Et tout le monde sera content. Personne n'est difficile. Les troubles pour les grains, sans être sérieux peuvent devenir gaves et embarrassants. Décidément, les récoltes sont insuffisantes ; le pain est déjà cher et renchérira. La crise industrielle se prolonge. L’Angleterre en souffre encore plus que nous. L’hiver s’annonce mal. Si, par dessus le marché, il est froid, la détresse sera réelle.
Le parti radical, devenu parti Buonapartiste, s’agite beaucoup pour remuer le peuple. Il ne peut que cela, mais il peut cela.
9 heures 3/4
Si je commençais, je ne tarirais pas sur votre famille. Je n’ai jamais rien imaginé de pareil. Je vous renverrai demain la lettre de votre sœur. Il me faut bien la journée pour la lire. Je ne comprends pas grand chose, à la lettre de Benkhausen. Je suppose que lorsqu'il aura en main votre signature apposée aux letters of administration, vos plein pouvoirs à votre frère seront considérés comme suffisants, et que celui-ci fera alors toucher, en votre nom, par un délégué de lui, peut-être par Paul lui-même. Il vaudrait beaucoup mieux en effet ne pas faire ce tour du monde, et faire tout simplement toucher, en votre nom, par votre banquier qui remettra à vos fils leur part. Cela est bien plus simple. Vous pourriez, ce me semble, mander cela à Benkhausen. Je ne vois pas quelle objection il y pourrait faire. Vous êtes bien la maîtresse de donner vos pleins, pouvoirs à qui vous voulez, pour cette affaire spéciale ; et il est bien naturel que vous les donniez directement à votre banquier de Londres qui touchera, plutôt qu'à votre père de Pétersbourg qui sera obligé de les déléguer et de faire toucher, par un autre, vous ne savez pas qu' il est évident que vous ne sauriez prendre trop de précautions. Pourquoi, n'aurez-vous pas de vaisselle ? Dans le quart du mobilier qui vous revient de droit vous pouvez toujours prendre ce que vous voulez, au prix d'estimation. Adieu. Adieu. Vous dîtes bien, toutes ces horreurs. Adieu, dearest. G.
Je sors tard de mon lit quoique je me sois couché hier de très bonne heure. J'étais fatigué. Au rhume, qui dure encore un peu, s’était jointe la migraine. Le sommeil est ma ressource. Je ne sais si je la conserverai toujours ; mais je l'ai encore. J’ai beaucoup dormi. Je suis bien ce matin. Il fait beau. Le soleil brille. Je me sens en bonne et forte disposition. Quelles mobiles créatures nous sommes, et que les spectateurs qui nous entourent se doutent peu des agitations, des faiblesses, des innombrables vicissitudes, intérieures par lesquelles nous passons !
Si les propositions de D. Carlos sont telles qu’on le dit, elles me paraissent acceptables. Pourvu qu’il ne réserve que ses droits éventuels, en cas d’extinction de la lignée de la Reine Isabelle, masculine et féminine, et que sa renonciation à ses droits actuels, pour lui et les siens, soit bien claires, bien complète. Pourvu aussi que le gouvernement de Madrid y consente, et soit partie contractante dans l’arrangement. A ces conditions l'affaire me paraît finie, autant quelle peut l'être. Et si D. Carlos accepte tout cela, j'ai peine à voir à quel litre et par qu’elle raison on ne le laisserait pas vivre où il voudra même en Autriche, le Capharnaüm, des Prétendants. Nous sommes un grand exemple de l’état ou jettent les grands excès. Il y a cent ans, l’Europe aurait vécu au moins six mois sur un événement comme la chute de D. Carlos. Il y aurait eu là, pendant longtemps, de la pâture pour les esprits, les réflexions, les conversations, les correspondances. Figurez-vous tout ce que M. de St. Simon y aurait vu et fait voir. Aujourd’hui, nous avons tant vu, tant vu que nos yeux sont las et comme hébétés. Nous regardons à peine les plus grosses choses. Je suis sûr que, s’il ne survient point d’incident nouveau dans quinze jours, à Bourges même, D. Carlos vivra sans qu'on pense à lui.
Voilà mon ami, et le vôtre, d’Haubersaert conseiller d'’Etat. Il le désirait beaucoup et on me l’avait promis. Cette nomination de Conseillers d'Etat est une image fidèle du chaos général. On en a donné un à Thiers, un à moi, trois aux 221, trois aux 213. Et tout le monde sera content. Personne n'est difficile. Les troubles pour les grains, sans être sérieux peuvent devenir gaves et embarrassants. Décidément, les récoltes sont insuffisantes ; le pain est déjà cher et renchérira. La crise industrielle se prolonge. L’Angleterre en souffre encore plus que nous. L’hiver s’annonce mal. Si, par dessus le marché, il est froid, la détresse sera réelle.
Le parti radical, devenu parti Buonapartiste, s’agite beaucoup pour remuer le peuple. Il ne peut que cela, mais il peut cela.
9 heures 3/4
Si je commençais, je ne tarirais pas sur votre famille. Je n’ai jamais rien imaginé de pareil. Je vous renverrai demain la lettre de votre sœur. Il me faut bien la journée pour la lire. Je ne comprends pas grand chose, à la lettre de Benkhausen. Je suppose que lorsqu'il aura en main votre signature apposée aux letters of administration, vos plein pouvoirs à votre frère seront considérés comme suffisants, et que celui-ci fera alors toucher, en votre nom, par un délégué de lui, peut-être par Paul lui-même. Il vaudrait beaucoup mieux en effet ne pas faire ce tour du monde, et faire tout simplement toucher, en votre nom, par votre banquier qui remettra à vos fils leur part. Cela est bien plus simple. Vous pourriez, ce me semble, mander cela à Benkhausen. Je ne vois pas quelle objection il y pourrait faire. Vous êtes bien la maîtresse de donner vos pleins, pouvoirs à qui vous voulez, pour cette affaire spéciale ; et il est bien naturel que vous les donniez directement à votre banquier de Londres qui touchera, plutôt qu'à votre père de Pétersbourg qui sera obligé de les déléguer et de faire toucher, par un autre, vous ne savez pas qu' il est évident que vous ne sauriez prendre trop de précautions. Pourquoi, n'aurez-vous pas de vaisselle ? Dans le quart du mobilier qui vous revient de droit vous pouvez toujours prendre ce que vous voulez, au prix d'estimation. Adieu. Adieu. Vous dîtes bien, toutes ces horreurs. Adieu, dearest. G.
269. Paris, Dimanche 22 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
269 Paris, Dimanche 22 septembre 1839
10 heures
Bulwer est venu hier pendant mon dîné me porter une lettre qu'il venait de recevoir de Cuming et une incluse de Paul à celui-ci traitant toutes deux du capital à Londres. Paul charge Cumming de prendre toutes les mesures légales pour me pour suivre au cas que je lève le capital avant son arrivée et que je retire les fonds. Cuming parait être dans la plus horrible perplexité. Il renouvelle la prière que je donne à Paul mes pleins pouvoirs ! Jugez si j’irai les donner après cette insolence. J’ai très simplement répondu à Bulwer que je viens de demander les lettres of administration pour qu’au retour de mes fils il n'y ait pas de temps de perdu et que je puisse leur faire tout de suite la remise de leurs parts et que ce sera mon banquier à Londres que je chargerai de la leur remettre. A cette occasion Bulwer m’a écrit qu'il avait eu des Affaires d’argent avec Paul et que sans douter le moins du monde de son honneur, il devait convenir qu’il n'avait jamais rencontré personne qui traitât en matière d’argent d'une si étrange façon que lui, et qu’il prendrai soin de n’en avoir jamais avec lui. Vous devinez que toute cette discussion m’a fait un effet mauvais comme santé, et que je n’ai pas dormi la nuit. Ma sœur qui a dû assister au partage du mobilier me mande dans une lettre indéchiffrable que je n’aurai pas de vaisselle !
Mon fils Alexandre m'écrit en date du 7 qu'il se rendait avec son frère chez mon frère pour une dizaine de jours. Qu'à son retour ils feraient leurs préparatifs de départ. Leurs oncles, les frères de mon mari ont procédé à l’enterrement en Courlande sans attendre ses fils & sans leur en donner avis ! Quelle famille ! Vous savez maintenant toutes les agréables nouvelles que j'ai eues hier. Je vous enverrai la lettre de ma sœur après avoir encore essayé de la lire, je ne crois pas que vous y parveniez. Savez-vous ce qui m'arrive au milieu d’un peu de colère, c’est de rire, vraiment rire de la manière dont tout se passe. Voici la lettre de ma sœur, vous rirez sans doute aussi. Je reçois dans ce moment une réponse de Berkhausen dans laquelle il me demande de lui envoyer les noms, prénoms, & titres du Prince de Lieven, date de son décès. Mes noms, prénoms & titres, et ajoute : " aussi tôt que votre altesse m’aura fourni ces renseignements je me procurerai les lettres d’administration en question que j’aurai l’honneur de lui adresser, pour qu’elle veuille bien y apposer sa signature et au moyen de ce document M. le Prince de Benckendorff qui se trouve déjà muni des pleins pouvoirs de votre altesse pourra toucher par l’entremise d’un fondé de pouvoir le montant des fonds laissés par le feu Prince de Lieven entre les mains de M. Harmann et C°."
Dites-moi ce que cela veut dire, pour quoi faudra-t-il que j'envoie cela à mon frère ? Je m'imagine que cela vient de la lettre de Paul, que Cuming mande à Bulwer qu'il avait montre à Berkhausen. Vous savez que mon frère est fort bien pour Paul et que celui-ci se croit à tout événement en meilleures mains chez mon frère que chez moi. Conseillez-moi, que faut-il que je fasse ? Ce tour du monde me parait parfaitement puéril, mon frère m’ayant dit surtout, " qu'à l’égard du capital j’aurai à m’entendre avec Paul ". Je crois que vous avez copie de cette lettre Ah, quand serai-je sortie de toutes ces horreurs ?
Madame de Talleryand est arrivée. Je la verrai ce soir. Il est parfaitement certain que nous sommes fort rapprochés de l'Angleterre. et que cela s’est opéré par suite de votre refroidissement avec elle. Nous boudons ceci, et on laisse M. de Médem, sans la moindre instruction et sans la moindre réponse nous donnons raison à l'Angleterre dans son hostilité contre l’Egypte. Les positions ont essuyé un change ment notable. Ce qui ressort le plus évidemment de tout cela c'est le maintien de la paix. Tant mieux votre lettre est bien courte, mais vous ne toussez pas, j'en suis bien aise. Encore une fois il fait bien humide au Val-Richer. Je ferai votre commission à Bulwer pour Lord Chatham. Adieu. Adieu, mille fois.
Renvoyez-moi le chef d’oeuvre de ma sœur. Nous avons appris à écrire ensemble. Son éducation a duré deux aux de plus que la mienne. C'est pourtant une très bonne femme, & qui a plus d’esprit que moi, c’est ce que j’ai toujours entendu dire.
10 heures
Bulwer est venu hier pendant mon dîné me porter une lettre qu'il venait de recevoir de Cuming et une incluse de Paul à celui-ci traitant toutes deux du capital à Londres. Paul charge Cumming de prendre toutes les mesures légales pour me pour suivre au cas que je lève le capital avant son arrivée et que je retire les fonds. Cuming parait être dans la plus horrible perplexité. Il renouvelle la prière que je donne à Paul mes pleins pouvoirs ! Jugez si j’irai les donner après cette insolence. J’ai très simplement répondu à Bulwer que je viens de demander les lettres of administration pour qu’au retour de mes fils il n'y ait pas de temps de perdu et que je puisse leur faire tout de suite la remise de leurs parts et que ce sera mon banquier à Londres que je chargerai de la leur remettre. A cette occasion Bulwer m’a écrit qu'il avait eu des Affaires d’argent avec Paul et que sans douter le moins du monde de son honneur, il devait convenir qu’il n'avait jamais rencontré personne qui traitât en matière d’argent d'une si étrange façon que lui, et qu’il prendrai soin de n’en avoir jamais avec lui. Vous devinez que toute cette discussion m’a fait un effet mauvais comme santé, et que je n’ai pas dormi la nuit. Ma sœur qui a dû assister au partage du mobilier me mande dans une lettre indéchiffrable que je n’aurai pas de vaisselle !
Mon fils Alexandre m'écrit en date du 7 qu'il se rendait avec son frère chez mon frère pour une dizaine de jours. Qu'à son retour ils feraient leurs préparatifs de départ. Leurs oncles, les frères de mon mari ont procédé à l’enterrement en Courlande sans attendre ses fils & sans leur en donner avis ! Quelle famille ! Vous savez maintenant toutes les agréables nouvelles que j'ai eues hier. Je vous enverrai la lettre de ma sœur après avoir encore essayé de la lire, je ne crois pas que vous y parveniez. Savez-vous ce qui m'arrive au milieu d’un peu de colère, c’est de rire, vraiment rire de la manière dont tout se passe. Voici la lettre de ma sœur, vous rirez sans doute aussi. Je reçois dans ce moment une réponse de Berkhausen dans laquelle il me demande de lui envoyer les noms, prénoms, & titres du Prince de Lieven, date de son décès. Mes noms, prénoms & titres, et ajoute : " aussi tôt que votre altesse m’aura fourni ces renseignements je me procurerai les lettres d’administration en question que j’aurai l’honneur de lui adresser, pour qu’elle veuille bien y apposer sa signature et au moyen de ce document M. le Prince de Benckendorff qui se trouve déjà muni des pleins pouvoirs de votre altesse pourra toucher par l’entremise d’un fondé de pouvoir le montant des fonds laissés par le feu Prince de Lieven entre les mains de M. Harmann et C°."
Dites-moi ce que cela veut dire, pour quoi faudra-t-il que j'envoie cela à mon frère ? Je m'imagine que cela vient de la lettre de Paul, que Cuming mande à Bulwer qu'il avait montre à Berkhausen. Vous savez que mon frère est fort bien pour Paul et que celui-ci se croit à tout événement en meilleures mains chez mon frère que chez moi. Conseillez-moi, que faut-il que je fasse ? Ce tour du monde me parait parfaitement puéril, mon frère m’ayant dit surtout, " qu'à l’égard du capital j’aurai à m’entendre avec Paul ". Je crois que vous avez copie de cette lettre Ah, quand serai-je sortie de toutes ces horreurs ?
Madame de Talleryand est arrivée. Je la verrai ce soir. Il est parfaitement certain que nous sommes fort rapprochés de l'Angleterre. et que cela s’est opéré par suite de votre refroidissement avec elle. Nous boudons ceci, et on laisse M. de Médem, sans la moindre instruction et sans la moindre réponse nous donnons raison à l'Angleterre dans son hostilité contre l’Egypte. Les positions ont essuyé un change ment notable. Ce qui ressort le plus évidemment de tout cela c'est le maintien de la paix. Tant mieux votre lettre est bien courte, mais vous ne toussez pas, j'en suis bien aise. Encore une fois il fait bien humide au Val-Richer. Je ferai votre commission à Bulwer pour Lord Chatham. Adieu. Adieu, mille fois.
Renvoyez-moi le chef d’oeuvre de ma sœur. Nous avons appris à écrire ensemble. Son éducation a duré deux aux de plus que la mienne. C'est pourtant une très bonne femme, & qui a plus d’esprit que moi, c’est ce que j’ai toujours entendu dire.
268. Paris, Samedi 21 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
268 Paris Samedi le 21 septembre 1839,
Je sors tous les soirs malgré la pluie que voulez-vous que je devienne ? Je tue le temps faute de pouvoir l’employer. La femme la plus sotte ne mène une existence plus bête que la mienne. Les journées deviennent bien courtes. La causerie serait si bonne, si douce quand le jour disparaît. Et vous êtes au Val-Richer et moi seule, seule, seule ici. J'ai vu Armin hier au soir chez lui. C'est un ami de désespoir qui m’a pris. Je l’ai trouvé seul bien établi et bien étonné de ma visite. L'étonnement l’a rendu bavard.
L’affaire d’Orient n’offre plus de danger. L'Angleterre s’entend avec nous. Il n’y a que la France qui soit en bravades, sans doute pour les députés. Aussi n’y fait-on pas grande attention voilà à ce qu'il me semble la situation du moment.
M. de Jennisson ne se presse pas de me faire place. Il a cependant remis son bail à Démion. Moi je suis pressée de sortir d'ici d’autant plus qu'on m'en chasse. Il y a des gens qui me disent qu'il faut me hâter. de signer et de conclure avec M. Démion sans cela, s'il trouve 60 francs au dessus de 12 mille je perds l’appartement. Je vais faire cela aujourd’hui.
Je n’ai rien de mon fils, rien de mon frère. Soyez sûr qu'on ne prendra. pas la peine de m'informer de mes affaires. Génie dit que le Val-Richer est bien humide ; cela va mal à votre rhume. Et comment rester tard dans l’année dans un lieu humide ? Songez à cela, si non pour vous, pour vos enfants, votre mère. Adieu. Adieu, continuez-vous à recevoir des lettres de M. Duchâtel ? Vous ne me dites pas une pauvre nouvelle. Il me semble que vous vivez à Kostromé. Adieu. Adieu.
Je sors tous les soirs malgré la pluie que voulez-vous que je devienne ? Je tue le temps faute de pouvoir l’employer. La femme la plus sotte ne mène une existence plus bête que la mienne. Les journées deviennent bien courtes. La causerie serait si bonne, si douce quand le jour disparaît. Et vous êtes au Val-Richer et moi seule, seule, seule ici. J'ai vu Armin hier au soir chez lui. C'est un ami de désespoir qui m’a pris. Je l’ai trouvé seul bien établi et bien étonné de ma visite. L'étonnement l’a rendu bavard.
L’affaire d’Orient n’offre plus de danger. L'Angleterre s’entend avec nous. Il n’y a que la France qui soit en bravades, sans doute pour les députés. Aussi n’y fait-on pas grande attention voilà à ce qu'il me semble la situation du moment.
M. de Jennisson ne se presse pas de me faire place. Il a cependant remis son bail à Démion. Moi je suis pressée de sortir d'ici d’autant plus qu'on m'en chasse. Il y a des gens qui me disent qu'il faut me hâter. de signer et de conclure avec M. Démion sans cela, s'il trouve 60 francs au dessus de 12 mille je perds l’appartement. Je vais faire cela aujourd’hui.
Je n’ai rien de mon fils, rien de mon frère. Soyez sûr qu'on ne prendra. pas la peine de m'informer de mes affaires. Génie dit que le Val-Richer est bien humide ; cela va mal à votre rhume. Et comment rester tard dans l’année dans un lieu humide ? Songez à cela, si non pour vous, pour vos enfants, votre mère. Adieu. Adieu, continuez-vous à recevoir des lettres de M. Duchâtel ? Vous ne me dites pas une pauvre nouvelle. Il me semble que vous vivez à Kostromé. Adieu. Adieu.
266. Paris, Jeudi 19 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
266 Paris jeudi le 19 septembre 1839
Non, je n'ai rien de mon frère, et je n’aurai probablement rien de longtemps, car il est parti pour son château avec une troupe d’élégantes dames de la cour. Il y passera trois semaines si'ce n’est plus, et je le connais assez pour savoir que là il ne me donnera pas cinq minutes de souvenir. C’est par Appony que je connais ses mouvements. En attendant il pourra bien se faire que mes file arrivent et que ce ne soit que par Alexandre que j’apprenne l’arrangement de mes affaires. C’est de drôles de manières et deux singulières familles ! Dans la mienne j’ai perdu ce qu'il y avait de mieux ce qui eût été bien rare partout, mon pauvre frère Constantin. Dans la famille Lieven. Mes deux anges.
Je vois les Appony assez souvent et Bulwer presque tous les jours. Mais je serais embarrassée de vous nommer autre chose. Midi. Génie est venu me voir il a eu la bonté de chercher et de trouver une jeune fille de famille bourgeoise, honnête qui viendrait me faire lecture pendant une ou deux heures de la soirée. Dites-moi ce qu'il faut que je donne ? Il parait qu'on aimerait un arrange ment par mois. Ce qui est sûr c’est que je ne m’en servirais pas plus de 10 fois peut-être par mois. Pensez-vous que 60 francs soient assez. Ou faut-il davantage ? Quand je ne suis pas malade je vais faire visite le soir aux Brignoles, Appony, Pozzo. Répondez-moi sur l'article des arrangements. Trouvez-vous le grand cordon de la légion d’honneur bien placé ? Moi cela m’a étonnée, et je me défie un peu de l'à propos des choses qui m'étonnent. C'est de la présomption peut-être. Je vous envoie une pauvre lettre. Je n’ai point de nouvelles à vous dire. Je trouve que les journaux ne sont pas tranquillisants sur les affaires de l’Orient.
Adieu. Adieu. Ne soyez pas enrhumé.
Non, je n'ai rien de mon frère, et je n’aurai probablement rien de longtemps, car il est parti pour son château avec une troupe d’élégantes dames de la cour. Il y passera trois semaines si'ce n’est plus, et je le connais assez pour savoir que là il ne me donnera pas cinq minutes de souvenir. C’est par Appony que je connais ses mouvements. En attendant il pourra bien se faire que mes file arrivent et que ce ne soit que par Alexandre que j’apprenne l’arrangement de mes affaires. C’est de drôles de manières et deux singulières familles ! Dans la mienne j’ai perdu ce qu'il y avait de mieux ce qui eût été bien rare partout, mon pauvre frère Constantin. Dans la famille Lieven. Mes deux anges.
Je vois les Appony assez souvent et Bulwer presque tous les jours. Mais je serais embarrassée de vous nommer autre chose. Midi. Génie est venu me voir il a eu la bonté de chercher et de trouver une jeune fille de famille bourgeoise, honnête qui viendrait me faire lecture pendant une ou deux heures de la soirée. Dites-moi ce qu'il faut que je donne ? Il parait qu'on aimerait un arrange ment par mois. Ce qui est sûr c’est que je ne m’en servirais pas plus de 10 fois peut-être par mois. Pensez-vous que 60 francs soient assez. Ou faut-il davantage ? Quand je ne suis pas malade je vais faire visite le soir aux Brignoles, Appony, Pozzo. Répondez-moi sur l'article des arrangements. Trouvez-vous le grand cordon de la légion d’honneur bien placé ? Moi cela m’a étonnée, et je me défie un peu de l'à propos des choses qui m'étonnent. C'est de la présomption peut-être. Je vous envoie une pauvre lettre. Je n’ai point de nouvelles à vous dire. Je trouve que les journaux ne sont pas tranquillisants sur les affaires de l’Orient.
Adieu. Adieu. Ne soyez pas enrhumé.
264. Paris, Mardi 17 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
264. Paris Mardi le 17 Septembre 1839, 9 heures
Je me sens un peu mieux aujourd’hui ce qui fait que j’ai le courage de vous écrire. Hier encore a été une bien mauvaise journée. Mes crampes ont recommencé, mes nerfs ont été dans un état affreux. J’ai passé la journée seule. Si je n’avais pas eu quelque heures de sommeil vous n'auriez pas de lettres ; car décidément je ne risquerai plus de vous écrire lorsque mon cœur ressemble à mes nerfs. Vous avez raison dans tout ce que vous me dites ce matin et mon Dieu, mais ce n’est pas la raison qui est mon culte ; je n’aime pas par raison. Il n’y a rien de raisonnable à aimer. Et vous avez mille fois raison de ne pas aimer à ma façon. C'est une mauvaise façon. On m'a mis ce matin dans un bain d’Eau de Cologne. Je laisse faire sans avoir confiance en rien. Cela ne durera pas longtemps. Je ne m'occupe plus de chercher quelqu'un, je ne m'occupe plus de rien de ce qui me regarde. Je vous ai dit souvent que je craignais de la folie, je la crains plus que jamais parce que je la vois venir.
J'ai une mauvaise affaire sur les bras. Malgré les promesses que j'ai faites à Bulwer de la part de madame Appony il a rencontré sa belle-sœur chez elle hier au soir. Il me le mande dans un billet ce matin, et veut pour conseil. Il regarde ceci comme une insulte personnelle. Il a raison et cependant ce n’est sans doute qu'une bêtise de Madame Appony. Mon conseil sera qu’il n’y retourne pas. Moi, j’ai droit d'être blessée aussi car la promesse m’a été donnée à moi.
1 heures
J'ai eu la visite de Génie. C'est un bon petit homme ; ce qui me prouve ma décadence et ma misère est le plaisir que me fait la visite d'un bon petit homme ! Après lui est venu Bulwer ; j’étais encore dans mon bonnet de nuit. Il n’avait pas fermé l'œil depuis hier, il voulait écrire à Lord Palmerston demander son rappel de Paris à cause de l'insulte des Appony, enfin il était dans un état violent. Au milieu de cela je reçois la réponse de Madame Appony à une petit billet d’interrogation un peu vif que je lui avais écrit, et j’éclate de rire. La belle sœur n’y avait pas été. Bulwer a eu une vision ... Il n'en revient pas. Il soutient qu'il la vue. Je l’ai assuré qu’il se trouvait obligé de croire qu’elle n'y était pas, car mensonge ou non, il est bien certain maintenant qu’elle ne s’y retrouvera plus.
Le billet de Madame Appony est long, plus de tendresses pour Bulwer, d’indignation de ce que nous soyons cru capable de manquer à ses promesses. Enfin c’est fort drôle, et c’est fini. Hier Bulwer causait avec Appony lorsqu'il a eu sa vision. Il a laissé court et est sorti brusquement de la maison.
A propos de maison, Démion est revenu. Je prends l’entresol à 12 mille francs. On dresse un inventaire des meubles. Je prendrai ce qui me conviendra.
Rothschild m’a mandé qu'il avait abdiqué ses droits entre les mains de Démion, il n'y peut donc rien. Et bien, j’ai cet entresol ! Cela ne me fait aucun plaisir, rien ne me fait plaisir. J’ai écrit hier à Benkhausen pour demander les lettres of admisnistration d’après ce que me dit mon frère lui ne le ferait pas. Si j’attends l'arrivée de Paul ce sera encore une complication une fois les lettres obtenues, l'affaire est plus courte & plus nette. Je crois que je m’épargne du temps et des embarras, & que je suis en règle. Le pensez-vous aussi ? Pourquoi attendre. Je chargerai Rothschild de lever le capital et de remettre leurs parts à mes fils voilà qui est simple.
L’affaire de Don Carlos est regardée ici comme un grand triomphe. En effet, c'est une bonne affaire. Si on est sage à Madrid cela peut devenir excellent. Palmerston, & Bulwer ont écrit à M. Lotherne pour qu'il presse le gouvernement de ratifier la convention de Maroto. Mais vu dit qu'il y a de mauvaises têtes dans les Cortes. Adieu, je suis mieux ce matin. Je ne sais comment je serai plus tard. Ne vous fâchez jamais avec moi avec toute votre raison, & laissez- moi vous aimer avec toute ma folie. Adieu
Je me sens un peu mieux aujourd’hui ce qui fait que j’ai le courage de vous écrire. Hier encore a été une bien mauvaise journée. Mes crampes ont recommencé, mes nerfs ont été dans un état affreux. J’ai passé la journée seule. Si je n’avais pas eu quelque heures de sommeil vous n'auriez pas de lettres ; car décidément je ne risquerai plus de vous écrire lorsque mon cœur ressemble à mes nerfs. Vous avez raison dans tout ce que vous me dites ce matin et mon Dieu, mais ce n’est pas la raison qui est mon culte ; je n’aime pas par raison. Il n’y a rien de raisonnable à aimer. Et vous avez mille fois raison de ne pas aimer à ma façon. C'est une mauvaise façon. On m'a mis ce matin dans un bain d’Eau de Cologne. Je laisse faire sans avoir confiance en rien. Cela ne durera pas longtemps. Je ne m'occupe plus de chercher quelqu'un, je ne m'occupe plus de rien de ce qui me regarde. Je vous ai dit souvent que je craignais de la folie, je la crains plus que jamais parce que je la vois venir.
J'ai une mauvaise affaire sur les bras. Malgré les promesses que j'ai faites à Bulwer de la part de madame Appony il a rencontré sa belle-sœur chez elle hier au soir. Il me le mande dans un billet ce matin, et veut pour conseil. Il regarde ceci comme une insulte personnelle. Il a raison et cependant ce n’est sans doute qu'une bêtise de Madame Appony. Mon conseil sera qu’il n’y retourne pas. Moi, j’ai droit d'être blessée aussi car la promesse m’a été donnée à moi.
1 heures
J'ai eu la visite de Génie. C'est un bon petit homme ; ce qui me prouve ma décadence et ma misère est le plaisir que me fait la visite d'un bon petit homme ! Après lui est venu Bulwer ; j’étais encore dans mon bonnet de nuit. Il n’avait pas fermé l'œil depuis hier, il voulait écrire à Lord Palmerston demander son rappel de Paris à cause de l'insulte des Appony, enfin il était dans un état violent. Au milieu de cela je reçois la réponse de Madame Appony à une petit billet d’interrogation un peu vif que je lui avais écrit, et j’éclate de rire. La belle sœur n’y avait pas été. Bulwer a eu une vision ... Il n'en revient pas. Il soutient qu'il la vue. Je l’ai assuré qu’il se trouvait obligé de croire qu’elle n'y était pas, car mensonge ou non, il est bien certain maintenant qu’elle ne s’y retrouvera plus.
Le billet de Madame Appony est long, plus de tendresses pour Bulwer, d’indignation de ce que nous soyons cru capable de manquer à ses promesses. Enfin c’est fort drôle, et c’est fini. Hier Bulwer causait avec Appony lorsqu'il a eu sa vision. Il a laissé court et est sorti brusquement de la maison.
A propos de maison, Démion est revenu. Je prends l’entresol à 12 mille francs. On dresse un inventaire des meubles. Je prendrai ce qui me conviendra.
Rothschild m’a mandé qu'il avait abdiqué ses droits entre les mains de Démion, il n'y peut donc rien. Et bien, j’ai cet entresol ! Cela ne me fait aucun plaisir, rien ne me fait plaisir. J’ai écrit hier à Benkhausen pour demander les lettres of admisnistration d’après ce que me dit mon frère lui ne le ferait pas. Si j’attends l'arrivée de Paul ce sera encore une complication une fois les lettres obtenues, l'affaire est plus courte & plus nette. Je crois que je m’épargne du temps et des embarras, & que je suis en règle. Le pensez-vous aussi ? Pourquoi attendre. Je chargerai Rothschild de lever le capital et de remettre leurs parts à mes fils voilà qui est simple.
L’affaire de Don Carlos est regardée ici comme un grand triomphe. En effet, c'est une bonne affaire. Si on est sage à Madrid cela peut devenir excellent. Palmerston, & Bulwer ont écrit à M. Lotherne pour qu'il presse le gouvernement de ratifier la convention de Maroto. Mais vu dit qu'il y a de mauvaises têtes dans les Cortes. Adieu, je suis mieux ce matin. Je ne sais comment je serai plus tard. Ne vous fâchez jamais avec moi avec toute votre raison, & laissez- moi vous aimer avec toute ma folie. Adieu
264. Val -Richer, Jeudi 12 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
264 Du Val Richer, jeudi 12 septembre 1839 Midi et demie
Je rentre pour être avec vous. Vous savez le peu de cas que je fais des fictions. Mais enfin... Je me promenais tout à l’heure avec ma mère et mes enfants. Je ne sais pourquoi j'ai regardé à ma montre. Midi et demie m’a donné l’envie de rentrer, le besoin d'être seul. Vous êtes seule aussi. Je vous ai promis que vous ne le seriez plus. Je ne tiens toute ma promesse qu’au dedans de mon cœur à votre cœur. Au dehors. dans notre vie, je vous laisse encore seule souvent longtemps... Ah que tout est imparfait.
La nouvelle proposition de Jénisson, me contrarie beaucoup. Vous seriez si bien là ! Je me persuade que M. Démion arrangera la chose et vous fera avoir l’appartement sans meubles. M. de Jénisson se trompe s’il espère le louer sur le champ comme il lui convient. Il ne trouvera pas de chalands avant la fin de l’automne, et perdra ainsi ce qu’il se flatte de gagner. Vous aviez bien raison de prévoir que les affaires vous afflueraient quand je serais parti. Vous aurez vu Génie ce matin. Abouchez-le avec Démion ; il traitera mieux que vous. En tout cas la rue de Lille est toujours à votre disposition. Je viens de relire votre frère. C'est bien ce que j’ai entrevu. Pour en finir, pour se débarrasser de toute contrariété en pensant à vous et de toute peine à prendre pour vous, il a besoin de partager les torts entre vous et vos fils. C'est commode, ainsi font les indifférents de peu d’esprit. Il y a bien de quoi vous blesser. Mais ne vous blessez pas, par fierté. Ne voyez là que des affaires. Je vous demande plus qu’il ne se peut, je le sais bien. J’ai peine à croire que l’augmentation de 2000 roubles de pension soit à la place des capitaux. Elle n'y correspond pas. Le capital Anglais n’y peut-être compris. A lui seul, il vaut plus de 13 000 fr de rente. Ce ne pourrait donc être que pour le capital d’une année de revenu de la terre de Courlande. Il vaut mieux que vous le receviez en masse. Votre frère, est-il autorisé par vos pleins pouvoirs à conclure un tel arrangement, sans votre consentement spécial ?
Voici ce que m'écrit Brougham ce matin : " Mon cher M. Guizot, permettez que je vous exprime mon horreur au sujet d’un bruit qui vient de me parvenir de ma belle-fille à la Haye - et qui m’attribue - je dois dire plutôt m'impute une brochure sur la politique de France, et nommément contre le Roi - Notre roi, j’ose l’appeler. Je n'en sais pas même le titre. Encore moins en ai-je lu même une ligne. Jugez de mon étonnement. C'est probablement une ruse de libraire. "
" Encore une justification. L'on m'accuse d'avoir trop parlé du duc de Wellington aux dépens de l’armée française. Au contraire, le comble de mon éloge était qu'au lieu de se battre contre vos troupes, Napoléon les avait commandées tandis que Wellington les avait combattues. Sachant qu’il y avait des respectables Français près de moi, certes j'aurais eu grand soin de ne pas préférer le moindre mot contre vous autres, quand même j'aurais eu une telle opinion, ce que certes, je n’avais point. " Rendez-lui le service de répéter un peu ses démentis. Il faut obliger les gens d’esprit, même fous. Il ne me dit pas un mot d'Angleterre.
8 heures et demie
Je viens à vous à 8 heures et demie comme à midi et demie avec le même désir et le même serrement de cœur. Vous aviez bien raison avant-hier de vous séparer de moi, avec plus de peine que jamais. Je n’ai jamais passé un peu de temps près de vous sans que le plaisir d’y être ne devint plus vif, et la peine de n'y plus être, plus amère. Et cette fois plus encore que jamais. J’ai oublié de vous dire que, si vous vouliez achever l'histoire de la Révolution de Thiers, je l’avais à votre disposition. Dites à Génie de la faire prendre dans la bibliothèque de l’antichambre du salon, au premier étage. Avez-vous lu les mémoires sur le consulat de Thibaudeau ? Ils vous intéresseraient.
Si M. de Jénisson est intraitable tâchons de voir le bon côté de la rue de Lille. Vous payerez 5000 fr de moins & vous aurez sans embarras, sans qu’il y manque rien, le plaisir d’arranger l’appartement à votre gré. Je me dis et redis cela d'avance, pour être moins contrarié pour vous, s’il faut l'être. Au fait, la rue de Lille est très convenable, parfaitement convenable, et nous mettrons dans le jardin tant de fleurs et de si belles fleurs, que nous le rendrons gai et varié. Vous savez que j'ai le département des fleurs. J’apporterai d’ici, dans ce cas de très belles graines qui me viennent du Jardin du Roi. Nous les sèmerons au printemps sur ce gazon que nous métamorphoserons en corbeille. N'a-t-il pas été convenu que décidément on vous donnerait la grande chambre dont vous avez besoin, au haut de l’escalier ?
9 h. 1/2
Si vous m'êtes nécessaire ? Vous aurez beau faire ; vous pouvez me le demander à moi, mais à vous-même, au fond, de votre cœur, je vous en défie. Je suis sûr que vous serez de plus en plus contente de mon génie, et il vous dira beaucoup de petites nouvelles. Je suis fâché que Rothschild attende Démion. C’est Démion qui règne, au gré de Rothschild. Je m’y attendais. Adieu. Adieu. G.
Je rentre pour être avec vous. Vous savez le peu de cas que je fais des fictions. Mais enfin... Je me promenais tout à l’heure avec ma mère et mes enfants. Je ne sais pourquoi j'ai regardé à ma montre. Midi et demie m’a donné l’envie de rentrer, le besoin d'être seul. Vous êtes seule aussi. Je vous ai promis que vous ne le seriez plus. Je ne tiens toute ma promesse qu’au dedans de mon cœur à votre cœur. Au dehors. dans notre vie, je vous laisse encore seule souvent longtemps... Ah que tout est imparfait.
La nouvelle proposition de Jénisson, me contrarie beaucoup. Vous seriez si bien là ! Je me persuade que M. Démion arrangera la chose et vous fera avoir l’appartement sans meubles. M. de Jénisson se trompe s’il espère le louer sur le champ comme il lui convient. Il ne trouvera pas de chalands avant la fin de l’automne, et perdra ainsi ce qu’il se flatte de gagner. Vous aviez bien raison de prévoir que les affaires vous afflueraient quand je serais parti. Vous aurez vu Génie ce matin. Abouchez-le avec Démion ; il traitera mieux que vous. En tout cas la rue de Lille est toujours à votre disposition. Je viens de relire votre frère. C'est bien ce que j’ai entrevu. Pour en finir, pour se débarrasser de toute contrariété en pensant à vous et de toute peine à prendre pour vous, il a besoin de partager les torts entre vous et vos fils. C'est commode, ainsi font les indifférents de peu d’esprit. Il y a bien de quoi vous blesser. Mais ne vous blessez pas, par fierté. Ne voyez là que des affaires. Je vous demande plus qu’il ne se peut, je le sais bien. J’ai peine à croire que l’augmentation de 2000 roubles de pension soit à la place des capitaux. Elle n'y correspond pas. Le capital Anglais n’y peut-être compris. A lui seul, il vaut plus de 13 000 fr de rente. Ce ne pourrait donc être que pour le capital d’une année de revenu de la terre de Courlande. Il vaut mieux que vous le receviez en masse. Votre frère, est-il autorisé par vos pleins pouvoirs à conclure un tel arrangement, sans votre consentement spécial ?
Voici ce que m'écrit Brougham ce matin : " Mon cher M. Guizot, permettez que je vous exprime mon horreur au sujet d’un bruit qui vient de me parvenir de ma belle-fille à la Haye - et qui m’attribue - je dois dire plutôt m'impute une brochure sur la politique de France, et nommément contre le Roi - Notre roi, j’ose l’appeler. Je n'en sais pas même le titre. Encore moins en ai-je lu même une ligne. Jugez de mon étonnement. C'est probablement une ruse de libraire. "
" Encore une justification. L'on m'accuse d'avoir trop parlé du duc de Wellington aux dépens de l’armée française. Au contraire, le comble de mon éloge était qu'au lieu de se battre contre vos troupes, Napoléon les avait commandées tandis que Wellington les avait combattues. Sachant qu’il y avait des respectables Français près de moi, certes j'aurais eu grand soin de ne pas préférer le moindre mot contre vous autres, quand même j'aurais eu une telle opinion, ce que certes, je n’avais point. " Rendez-lui le service de répéter un peu ses démentis. Il faut obliger les gens d’esprit, même fous. Il ne me dit pas un mot d'Angleterre.
8 heures et demie
Je viens à vous à 8 heures et demie comme à midi et demie avec le même désir et le même serrement de cœur. Vous aviez bien raison avant-hier de vous séparer de moi, avec plus de peine que jamais. Je n’ai jamais passé un peu de temps près de vous sans que le plaisir d’y être ne devint plus vif, et la peine de n'y plus être, plus amère. Et cette fois plus encore que jamais. J’ai oublié de vous dire que, si vous vouliez achever l'histoire de la Révolution de Thiers, je l’avais à votre disposition. Dites à Génie de la faire prendre dans la bibliothèque de l’antichambre du salon, au premier étage. Avez-vous lu les mémoires sur le consulat de Thibaudeau ? Ils vous intéresseraient.
Si M. de Jénisson est intraitable tâchons de voir le bon côté de la rue de Lille. Vous payerez 5000 fr de moins & vous aurez sans embarras, sans qu’il y manque rien, le plaisir d’arranger l’appartement à votre gré. Je me dis et redis cela d'avance, pour être moins contrarié pour vous, s’il faut l'être. Au fait, la rue de Lille est très convenable, parfaitement convenable, et nous mettrons dans le jardin tant de fleurs et de si belles fleurs, que nous le rendrons gai et varié. Vous savez que j'ai le département des fleurs. J’apporterai d’ici, dans ce cas de très belles graines qui me viennent du Jardin du Roi. Nous les sèmerons au printemps sur ce gazon que nous métamorphoserons en corbeille. N'a-t-il pas été convenu que décidément on vous donnerait la grande chambre dont vous avez besoin, au haut de l’escalier ?
9 h. 1/2
Si vous m'êtes nécessaire ? Vous aurez beau faire ; vous pouvez me le demander à moi, mais à vous-même, au fond, de votre cœur, je vous en défie. Je suis sûr que vous serez de plus en plus contente de mon génie, et il vous dira beaucoup de petites nouvelles. Je suis fâché que Rothschild attende Démion. C’est Démion qui règne, au gré de Rothschild. Je m’y attendais. Adieu. Adieu. G.
259. Paris, Jeudi 12 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
259 Paris Jeudi 12 Septembre 1839 9 heure
J’ai trouvé votre lettre à mon réveil. Je vous remercie. Vous ne me dites pas si vous avez vu encore M. Duchâtel, si vous avez appris quelque chose des rapports de M. de Barante. Je n’ai vu personne hier matin que Mad. de Castellane qui est venu gazouiller chez moi, et M. de Pogenpohl avec lequel je suis convenue de ne rien dire jusqu'au retour de M. Démion. J’ai fait seule, toujours seule, ma promenade au bois. Après, le dîner j'ai été faire visite à Mad. Appony et puis Pozzo. Je n’ai pas appris un mot de nouvelle ni chez l'un ni chez l’autre. Pozzo est dans l’enfance tout-à-fait.
J’ai très mal dormi. Je viens de recevoir une lettre de Buckhausen dans laquelle il me dit que mon frère ayant mes pleins pouvoirs peut obtenir les letters of administration. Je laisserai cela se débrouiller comme cela pourra. J’ai été interrompue par la visite de votre petit homme. J'en suis très contente. Il m’a redit tout ce que vous l’aviez chargé de me dire, et de plus beaucoup de choses qui m’ont intéressée. Nous nous reverrons Samedi. C'est une créature fort intelligente à ce qu’il me parait, et puis, ou avant tout, il a l’air de vous être si attaché !
Midi. Je viens de voir Rothschild un moment sur l’article de la maison il attend Démion comme moi. Il ne sera ici que demain soir. Sur la politique il blâme extrêmement la France dans l’affaire de l’Orient. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Adieu. Oui. Vous êtes nécessaire de deux côtés, c'est là votre grande supériorité sur moi, sans compter toutes les autres. Et moi ; moi, pauvre moi. Est-il bien vrai que je vous suis nécessaire ? Et n’est- il pas bien vrai que je suis de trop à tout le reste ? Ah, que je suis triste. Adieu. Adieu.
J’ai trouvé votre lettre à mon réveil. Je vous remercie. Vous ne me dites pas si vous avez vu encore M. Duchâtel, si vous avez appris quelque chose des rapports de M. de Barante. Je n’ai vu personne hier matin que Mad. de Castellane qui est venu gazouiller chez moi, et M. de Pogenpohl avec lequel je suis convenue de ne rien dire jusqu'au retour de M. Démion. J’ai fait seule, toujours seule, ma promenade au bois. Après, le dîner j'ai été faire visite à Mad. Appony et puis Pozzo. Je n’ai pas appris un mot de nouvelle ni chez l'un ni chez l’autre. Pozzo est dans l’enfance tout-à-fait.
J’ai très mal dormi. Je viens de recevoir une lettre de Buckhausen dans laquelle il me dit que mon frère ayant mes pleins pouvoirs peut obtenir les letters of administration. Je laisserai cela se débrouiller comme cela pourra. J’ai été interrompue par la visite de votre petit homme. J'en suis très contente. Il m’a redit tout ce que vous l’aviez chargé de me dire, et de plus beaucoup de choses qui m’ont intéressée. Nous nous reverrons Samedi. C'est une créature fort intelligente à ce qu’il me parait, et puis, ou avant tout, il a l’air de vous être si attaché !
Midi. Je viens de voir Rothschild un moment sur l’article de la maison il attend Démion comme moi. Il ne sera ici que demain soir. Sur la politique il blâme extrêmement la France dans l’affaire de l’Orient. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Adieu. Oui. Vous êtes nécessaire de deux côtés, c'est là votre grande supériorité sur moi, sans compter toutes les autres. Et moi ; moi, pauvre moi. Est-il bien vrai que je vous suis nécessaire ? Et n’est- il pas bien vrai que je suis de trop à tout le reste ? Ah, que je suis triste. Adieu. Adieu.
258. Paris, Mercredi 11 septembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
258 Paris Mercredi 11 Septembre 1839, 9 heures
Jamais je ne me suis séparée de vous avec autant de chagrin que hier. J’ai été reprendre au bois de Boulogne la route que nous avions fait la veille ! Je suis rentrée, mon dieu était sur la table. Je me suis mise sur le balcon pour attendre les voiture ; quand je vous ai aperçu, mon cœur a bondi de joie comme si je vous retrouvais pour vous garder. Ah si alors vous étiez descendu de voiture si vous étiez entré chez moi, je me serais jetée à vos genoux pour vous demander de ne plus m’abandonner ou de me laisser vous suivre. J’ai pleuré alors, beaucoup pleuré. La voiture vous emportait ! Le soir j’ai refait le triste bois de Boulogne.
M. Henry Greville est venu passer une demi-heure chez moi. Il m’a raconté l'Angleterre, il en revient. Avant de me coucher M. Pogenpoll me fit tenir un billet de M. Jennisson qui dit ceci. " les pertes que j’éprouve en mettant tout mon établissement en vente m’ont décidé à louer mon appartement tel que vous le connaissez, tout compris, non le linge et la vaisselle. Si Madame de Lieven à qui cela me parait devoir convenir pas dessus tout pour 2 1/2 ans à partir du 1er octobre prochain en voulait, nous nous entendrions. " Voyez-vous le nouvel embarras ? il voudra louer pour 16 milles francs, plus peut-être. Cela ne me convient d’aucune façon possible. Je dirai que j’attends Démion pour tout cela, mais vous verrez, je finirai par n'avoir pas l’appartement. car j’ai du guignon en tout ! J’ai passé une nuit détestable. J’ai passé une nuit détestable.
En me levant j’ai trouvé sur une table une lettre de mon frère. Je vous avais dit qu’elle m'arriverait aussi tôt que vous m’auriez quittée : la voici et mes observations. Je suis très blessée. Répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez et ce que je dois répondre, vraiment le courage me manque pour répondre à ces gens-là. Je crois moi qu’on massacre mes affaires et qu'il faudra encore dire merci. J’avais bien besoin de vous auprès de moi, pour me calmer sur cette lettre. Je suis triste, triste, triste à mourir.
Midi 1/2 !! ah comment m’accoutumer à voir arriver ce moment tous les jours sans vos deux yeux qui viennent éclairer ma vie ! Il vous est arrivé de douter quelques fois de moi, de croire que je ne vous aimais pas comme vous le vouliez comme vous l'aviez imaginé. En doutez-vous aujourd’hui ? Dites-moi cela. Adieu, car je ne sais pas écrire quand j'ai le cœur si plein, si plein. Adieu. En me levant j’ai trouvé sur une table une lettre de mon frère. Je vous avais dit qu’elle m'arriverait aussi tôt que vous m’auriez quitté : la voici et mes observations. Je suis très blessée. Répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez et ce que je dois répondre, vraiment le courage me manque pour répondre à ces gens-là. Je crois moi qu’on massacre mes affaires et qu'il faudra encore dire merci. J’avais bien besoin de vous auprès de moi, pour me calmer sur cette lettre. Je suis triste, triste, triste à mourir.
Midi 1/2 !! ah comment m’accoutumer à voir arriver ce moment tous les jours sans vos deux yeux qui viennent éclairer ma vie ! Il vous est arrivé de douter
Jamais je ne me suis séparée de vous avec autant de chagrin que hier. J’ai été reprendre au bois de Boulogne la route que nous avions fait la veille ! Je suis rentrée, mon dieu était sur la table. Je me suis mise sur le balcon pour attendre les voiture ; quand je vous ai aperçu, mon cœur a bondi de joie comme si je vous retrouvais pour vous garder. Ah si alors vous étiez descendu de voiture si vous étiez entré chez moi, je me serais jetée à vos genoux pour vous demander de ne plus m’abandonner ou de me laisser vous suivre. J’ai pleuré alors, beaucoup pleuré. La voiture vous emportait ! Le soir j’ai refait le triste bois de Boulogne.
M. Henry Greville est venu passer une demi-heure chez moi. Il m’a raconté l'Angleterre, il en revient. Avant de me coucher M. Pogenpoll me fit tenir un billet de M. Jennisson qui dit ceci. " les pertes que j’éprouve en mettant tout mon établissement en vente m’ont décidé à louer mon appartement tel que vous le connaissez, tout compris, non le linge et la vaisselle. Si Madame de Lieven à qui cela me parait devoir convenir pas dessus tout pour 2 1/2 ans à partir du 1er octobre prochain en voulait, nous nous entendrions. " Voyez-vous le nouvel embarras ? il voudra louer pour 16 milles francs, plus peut-être. Cela ne me convient d’aucune façon possible. Je dirai que j’attends Démion pour tout cela, mais vous verrez, je finirai par n'avoir pas l’appartement. car j’ai du guignon en tout ! J’ai passé une nuit détestable. J’ai passé une nuit détestable.
En me levant j’ai trouvé sur une table une lettre de mon frère. Je vous avais dit qu’elle m'arriverait aussi tôt que vous m’auriez quittée : la voici et mes observations. Je suis très blessée. Répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez et ce que je dois répondre, vraiment le courage me manque pour répondre à ces gens-là. Je crois moi qu’on massacre mes affaires et qu'il faudra encore dire merci. J’avais bien besoin de vous auprès de moi, pour me calmer sur cette lettre. Je suis triste, triste, triste à mourir.
Midi 1/2 !! ah comment m’accoutumer à voir arriver ce moment tous les jours sans vos deux yeux qui viennent éclairer ma vie ! Il vous est arrivé de douter quelques fois de moi, de croire que je ne vous aimais pas comme vous le vouliez comme vous l'aviez imaginé. En doutez-vous aujourd’hui ? Dites-moi cela. Adieu, car je ne sais pas écrire quand j'ai le cœur si plein, si plein. Adieu. En me levant j’ai trouvé sur une table une lettre de mon frère. Je vous avais dit qu’elle m'arriverait aussi tôt que vous m’auriez quitté : la voici et mes observations. Je suis très blessée. Répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez et ce que je dois répondre, vraiment le courage me manque pour répondre à ces gens-là. Je crois moi qu’on massacre mes affaires et qu'il faudra encore dire merci. J’avais bien besoin de vous auprès de moi, pour me calmer sur cette lettre. Je suis triste, triste, triste à mourir.
Midi 1/2 !! ah comment m’accoutumer à voir arriver ce moment tous les jours sans vos deux yeux qui viennent éclairer ma vie ! Il vous est arrivé de douter
239. Baden, Dimanche 11 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
239 Baden Dimanche le 11 août 1839 9 heures
Je me sens aujourd’hui plus faible que de coutume. Mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai bien besoin de vous pour me remettre, j’ai besoin de votre affection, de vos soins, de vos conseils, il me faut un appui. Je vous assure que je ne me conçois pas livrée encore pour bien des mois à mes seules ressources, c'est à dire à mes bien tristes pensées. Vous ne savez pas comme elles sont tristes ! Comme elles le deviennent tous les jours davantage. Les journaux confirment ce que vous me dites des nouveaux embarras ministériels. Mais je ne crois à rien. Ils iront comme ils ont été. Les Flahaut sont menacés de perdre leur seconde fille, elle crache le sang. C’est pour elle qu’ils viennent aux Eaux en Allemagne et qu’ils iront ensuite passer l'hiver en Italie.
1 heure. J’ai été à l’église. Toujours un superbe sermon. Le texte était votre lettre. Nous reverrons ceux que nous avons aimés, mais j'aime encore mieux votre lettre que ce superbe sermon. Vous avez raison. Je viens de recevoir une seconde lettre de Benkhausen qui explique tout, comme vous le dites.
J’ai l’administration et non la possession du Capital. J’écris de suite à mon frère, pour tout remettre à sa place. J'ai du regret d'avoir mal compris, pour dire la vérité c’est Mad. de Talleyrand et Bacourt qui me l’ont fait comprendre comme cela ; car vous savez bien que moi, je ne m'y entends pas. Mais il faut absolument que ce soit moi qui lève l’argent. Les droits en Angleterre emporteront 1000 £ ce qui réduit le Capital à 44800 £. Pouvez-vous me dire si dans le plein pouvoir que j’ai donné à Paris à mon frère, il est suffisamment autorisé à faire pour moi cette opération ? Je vous envoie copie de la lettre que je lui écris. Savez-vous bien que je me sens toute soulagée par cette lettre de Benkhausen ? C’est si vrai qu’étant fort malade ce matin me voilà mieux. Je suis débarrassée de ces richesses imaginaires qui m'étaient on ne peut plus désagréables.
Je viens de lire des rapports de Vienne. Vos Ambassadeurs, le vôtre, celui d'Angleterre et l’internonce sont de parfaites dupes. Le divan est entre les mains de M. de Bouteneff et c’est par lui que le divan négocie avec Méhémet Ali. Je vous dis ce qui dit la diplomatie à Vienne. Metternich est fort inquiet de ce que nous ne parlons pas. Ne vous ai-je pas toujours dit que c’était notre affaire et que nous n’entrerions pas en causerie sur cela. Adieu. Adieu mille fois, adieu. Je reçois dans ce moment une lettre de mon fils Alexandre du 31 juillet dans laquelle il me dit qu’on venait de recevoir les nouvelles de la défection du Capitan Pacha, & de la défaite de l'armée Turque, que comme cela amènera des complications graves que peuvent influer sur mes projets pour cet hiver, il se hâte de m’en donner avis !
Je me sens aujourd’hui plus faible que de coutume. Mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai bien besoin de vous pour me remettre, j’ai besoin de votre affection, de vos soins, de vos conseils, il me faut un appui. Je vous assure que je ne me conçois pas livrée encore pour bien des mois à mes seules ressources, c'est à dire à mes bien tristes pensées. Vous ne savez pas comme elles sont tristes ! Comme elles le deviennent tous les jours davantage. Les journaux confirment ce que vous me dites des nouveaux embarras ministériels. Mais je ne crois à rien. Ils iront comme ils ont été. Les Flahaut sont menacés de perdre leur seconde fille, elle crache le sang. C’est pour elle qu’ils viennent aux Eaux en Allemagne et qu’ils iront ensuite passer l'hiver en Italie.
1 heure. J’ai été à l’église. Toujours un superbe sermon. Le texte était votre lettre. Nous reverrons ceux que nous avons aimés, mais j'aime encore mieux votre lettre que ce superbe sermon. Vous avez raison. Je viens de recevoir une seconde lettre de Benkhausen qui explique tout, comme vous le dites.
J’ai l’administration et non la possession du Capital. J’écris de suite à mon frère, pour tout remettre à sa place. J'ai du regret d'avoir mal compris, pour dire la vérité c’est Mad. de Talleyrand et Bacourt qui me l’ont fait comprendre comme cela ; car vous savez bien que moi, je ne m'y entends pas. Mais il faut absolument que ce soit moi qui lève l’argent. Les droits en Angleterre emporteront 1000 £ ce qui réduit le Capital à 44800 £. Pouvez-vous me dire si dans le plein pouvoir que j’ai donné à Paris à mon frère, il est suffisamment autorisé à faire pour moi cette opération ? Je vous envoie copie de la lettre que je lui écris. Savez-vous bien que je me sens toute soulagée par cette lettre de Benkhausen ? C’est si vrai qu’étant fort malade ce matin me voilà mieux. Je suis débarrassée de ces richesses imaginaires qui m'étaient on ne peut plus désagréables.
Je viens de lire des rapports de Vienne. Vos Ambassadeurs, le vôtre, celui d'Angleterre et l’internonce sont de parfaites dupes. Le divan est entre les mains de M. de Bouteneff et c’est par lui que le divan négocie avec Méhémet Ali. Je vous dis ce qui dit la diplomatie à Vienne. Metternich est fort inquiet de ce que nous ne parlons pas. Ne vous ai-je pas toujours dit que c’était notre affaire et que nous n’entrerions pas en causerie sur cela. Adieu. Adieu mille fois, adieu. Je reçois dans ce moment une lettre de mon fils Alexandre du 31 juillet dans laquelle il me dit qu’on venait de recevoir les nouvelles de la défection du Capitan Pacha, & de la défaite de l'armée Turque, que comme cela amènera des complications graves que peuvent influer sur mes projets pour cet hiver, il se hâte de m’en donner avis !
234. Baden, Mardi 6 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
234 Baden le 6 août 1839
Hier en causant avec Mad. de Talleyand il m’est tout à coup venu à l’idée que si mon frère terminait l’arrangement avec mes fils sans consulter la loi anglaise. Je pourrais me trouver privée des bénéfices de cette loi. On m’a demandé en toute hâte les derniers pleins pouvoirs, je lui ai envoyé en toute hâte aussi sans avoir fait cette réflexion, au contraire, en pensant même qu'il valait mieux que ce ne fût pas par moi qu’on apprit cette disposition de la loi anglaise. L’Esprit m’est venu un peu tard, mais enfin il est venu. J’ai fait venir Bacourt et avec son secours j’ai écrit la lettre dont copie ci jointe que j'ai expédié sur le champ à mon frère. Voilà ce qui m'a pris mon temps, et mes forces. à 4 h. l'idée m’est venue, & à 6 heures ma lettre était à la poste. Voyons dites-moi maintenant ce qui va en suivre ? Si ma lettre arrive après le conclusion de l'acte, est-il possible de faire valoir une droite à la loi anglaise sans une contestation des plus pénibles avec mes fils ! Vous savez que mon frère a plein pouvoir de tout régler, il aura réglé 4ème part du Capital anglais comme des autres. Une fois signé par lui comment revenir sur cet acte ? Le peut-on ? Et Paul n’a-t-il pas le doit de dire : " ce qui est fait et fait, vous deviez y regarder plus tôt. " Moi, je crois et je suis sûre qu'il connaissait la loi anglaise, et je ne puis pas m’empêcher d' en expliquer par ce fait maintenant sa persistance à vouloir mes pleins pouvoirs. Que pensez-vous de tout cela ? Ma lettre à mon frère est-elle bien ? Dites-moi votre idée sur les conséquences dans le cas de la signature de l’acte avant que mon frère ne reçoive ma lettre d’hier. Il faut convenir que j’ai été bien simple ! J’ai un peu envie de vous demander aussi pourquoi vous ne m'avez pas dit de prendre des informations à Londres. Enfin il n’y a plus rien à faire Mais cela me tracasse, et vous savez comme cela me fait du mal d'être tracassée. Est-il possible que des chiffres m'occupent tellement ! Savez-vous que j’en ai quelque honte. Je vous remercie de votre lettre hier, je voudrais en être digne c.a.d. ; avoir la force d’y répondre. Mais vous voyez que je n’ai pas de forces. Il y a de la force dans mon cœur , il y a là dedans tout ce que vous pouvez aimer à y voir soyez en bien sûr, bien sûr. Mais venez voir à quel point je suis accablée, lasse ! Encore une mauvaise nuit, vraiment cela va bien mal. Toutes mes peines de printemps, toutes ces tracasseries, tout cela se dessine fortement sur mes traits, j'ai l'air bien faible, bien faible, & je le suis.
5 heures l’Empereur a écrit au grand duc de Darmstadt, et lui annoncer que son fils va venir passer l'hiver à Darmstadt. Le mariage est parfaitement décidé. Il ne peut pas être question que la Belgique entre dans l’association des douanes d’Allemagne. Il s’agit d’un traité de commerce avec la Belgique, mais il n'y a que les puissances allemandes que puissent être des Zolleverein. Adieu. Adieu.
Je suis impatiente de votre réponse à ce que je vous écris aujourd'hui. C'est une grande question que ceci, et mon idée est que je ne m’en tirerais pas sans procès, si je voulais maintenir mes droits après l’acte signé. Mais quelles seront nos relations avec mes fils qui qu’auraient dépouillé à bon escient ! Adieu, Adieu.
Hier en causant avec Mad. de Talleyand il m’est tout à coup venu à l’idée que si mon frère terminait l’arrangement avec mes fils sans consulter la loi anglaise. Je pourrais me trouver privée des bénéfices de cette loi. On m’a demandé en toute hâte les derniers pleins pouvoirs, je lui ai envoyé en toute hâte aussi sans avoir fait cette réflexion, au contraire, en pensant même qu'il valait mieux que ce ne fût pas par moi qu’on apprit cette disposition de la loi anglaise. L’Esprit m’est venu un peu tard, mais enfin il est venu. J’ai fait venir Bacourt et avec son secours j’ai écrit la lettre dont copie ci jointe que j'ai expédié sur le champ à mon frère. Voilà ce qui m'a pris mon temps, et mes forces. à 4 h. l'idée m’est venue, & à 6 heures ma lettre était à la poste. Voyons dites-moi maintenant ce qui va en suivre ? Si ma lettre arrive après le conclusion de l'acte, est-il possible de faire valoir une droite à la loi anglaise sans une contestation des plus pénibles avec mes fils ! Vous savez que mon frère a plein pouvoir de tout régler, il aura réglé 4ème part du Capital anglais comme des autres. Une fois signé par lui comment revenir sur cet acte ? Le peut-on ? Et Paul n’a-t-il pas le doit de dire : " ce qui est fait et fait, vous deviez y regarder plus tôt. " Moi, je crois et je suis sûre qu'il connaissait la loi anglaise, et je ne puis pas m’empêcher d' en expliquer par ce fait maintenant sa persistance à vouloir mes pleins pouvoirs. Que pensez-vous de tout cela ? Ma lettre à mon frère est-elle bien ? Dites-moi votre idée sur les conséquences dans le cas de la signature de l’acte avant que mon frère ne reçoive ma lettre d’hier. Il faut convenir que j’ai été bien simple ! J’ai un peu envie de vous demander aussi pourquoi vous ne m'avez pas dit de prendre des informations à Londres. Enfin il n’y a plus rien à faire Mais cela me tracasse, et vous savez comme cela me fait du mal d'être tracassée. Est-il possible que des chiffres m'occupent tellement ! Savez-vous que j’en ai quelque honte. Je vous remercie de votre lettre hier, je voudrais en être digne c.a.d. ; avoir la force d’y répondre. Mais vous voyez que je n’ai pas de forces. Il y a de la force dans mon cœur , il y a là dedans tout ce que vous pouvez aimer à y voir soyez en bien sûr, bien sûr. Mais venez voir à quel point je suis accablée, lasse ! Encore une mauvaise nuit, vraiment cela va bien mal. Toutes mes peines de printemps, toutes ces tracasseries, tout cela se dessine fortement sur mes traits, j'ai l'air bien faible, bien faible, & je le suis.
5 heures l’Empereur a écrit au grand duc de Darmstadt, et lui annoncer que son fils va venir passer l'hiver à Darmstadt. Le mariage est parfaitement décidé. Il ne peut pas être question que la Belgique entre dans l’association des douanes d’Allemagne. Il s’agit d’un traité de commerce avec la Belgique, mais il n'y a que les puissances allemandes que puissent être des Zolleverein. Adieu. Adieu.
Je suis impatiente de votre réponse à ce que je vous écris aujourd'hui. C'est une grande question que ceci, et mon idée est que je ne m’en tirerais pas sans procès, si je voulais maintenir mes droits après l’acte signé. Mais quelles seront nos relations avec mes fils qui qu’auraient dépouillé à bon escient ! Adieu, Adieu.
228. Baden, Mardi 30 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
228 Baden 11 heures. Mardi 30 juillet 1839
Imaginez que c'est devant un notaire et deux témoins que je vous écris, et que c’est le seul moment que je trouve pour le faire.
9 heures.
Voyez, je n’en puis plus de fatigue. Pour un pauvre papier de 20 lignes, j’ai été tracassé tout hier et aujourd’hui. On me demande de nouveaux plein pouvoirs pour terminer. Mon frère m'écrit sur cela très simplement et très bien. Matonchewitz pas bien du tout. Il est comme disent les Anglais, lit by Paul. Celui qui parle à toujours l’avantage sur celui qui écrit. Cela m’a tracassée, et vous savez que je n’ai pas besoin de cela de plus. Mon fils Alexandre, une lettre insignifiante comme les autres. Mon frère me mande que mes fils sont pressés de finir et de reprendre leur service. j'imagine donc qu’aussi tôt l’arrivée de mon plein pouvoir tout sera arrangé. Je le saurai dans quatre semaines.
En attendant ma santé ne va pas mieux et ma correspondance avec vous bien mal. Il y a dans tout moi un découragement, une langueur que je ne puis pas vous décrire. Baden a été pour moi très mauvais et j’y reste je ne sais pourquoi ou plutôt je le sais, c’est que je ne sais où aller pour être mieux. Tout est mal pour moi. Il y a de ma faute sans doute et je me prends en grande aversion. Votre lettre hier m'a fait plaisir. Je n'ai rien à vous dire qui puisse vous intéresser. Vous voyez comme j’ai l’esprit occupé de désagréables affaires, c’est si aride, si vous étiez là pour m'aider ; me ranimer ah mon Dieu que je serais une autre personne. Adieu. Adieu et pardonnez-moi. Je suis si fatiguée, si abîmée. Adieu.
Imaginez que c'est devant un notaire et deux témoins que je vous écris, et que c’est le seul moment que je trouve pour le faire.
9 heures.
Voyez, je n’en puis plus de fatigue. Pour un pauvre papier de 20 lignes, j’ai été tracassé tout hier et aujourd’hui. On me demande de nouveaux plein pouvoirs pour terminer. Mon frère m'écrit sur cela très simplement et très bien. Matonchewitz pas bien du tout. Il est comme disent les Anglais, lit by Paul. Celui qui parle à toujours l’avantage sur celui qui écrit. Cela m’a tracassée, et vous savez que je n’ai pas besoin de cela de plus. Mon fils Alexandre, une lettre insignifiante comme les autres. Mon frère me mande que mes fils sont pressés de finir et de reprendre leur service. j'imagine donc qu’aussi tôt l’arrivée de mon plein pouvoir tout sera arrangé. Je le saurai dans quatre semaines.
En attendant ma santé ne va pas mieux et ma correspondance avec vous bien mal. Il y a dans tout moi un découragement, une langueur que je ne puis pas vous décrire. Baden a été pour moi très mauvais et j’y reste je ne sais pourquoi ou plutôt je le sais, c’est que je ne sais où aller pour être mieux. Tout est mal pour moi. Il y a de ma faute sans doute et je me prends en grande aversion. Votre lettre hier m'a fait plaisir. Je n'ai rien à vous dire qui puisse vous intéresser. Vous voyez comme j’ai l’esprit occupé de désagréables affaires, c’est si aride, si vous étiez là pour m'aider ; me ranimer ah mon Dieu que je serais une autre personne. Adieu. Adieu et pardonnez-moi. Je suis si fatiguée, si abîmée. Adieu.
227. Baden, Dimanche 28 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
227 Baden le 24 juillet 1839 dimanche 8 heures
Lorsque nous sommes ensemble, je m'entretiens avec vous de toute chose, je vous dis tout. Par lettres c'est bien difficile. Tous les sujets me paraissent trop minces. Ma vie est bien monotone, les personnes avec lesquelles je vis sont bien insignifiantes ; que voulez-vous que je vous dise ? Je pense bien plus au moment où je ne serai plus à Bade qu'à celui où je m’y trouve. Savez-vous bien que nous avons encore à passer quatre mois sans nous voir ! Vous m'avez dit que vous en reviendriez que pour le mois de décembre à Paris ! Que c'est long ! Songez-vous bien à cela ?
2 heures
J’ai été à l’église comme je ne manque jamais de le faire le dimanche. Nous avons eu un superbe sermon, trop beau, car j'en suis revenue en larmes. Je viens de recevoir une lettre de F. Pahlen de Courlande. Ce n’est que là qu'il a reçu la lettre dans laquelle je lui mandais que mes fils en retenait ma pension. Il me dit qu’il est très fâché de l’avoir ignoré pendant qu'il se trouvait encore à Pétersbourg et qu'il ne doute pas que mon frère y aura une ordre. Mais mon frère n'a jamais répondu à ce que je lui en avais dit vous voyez comme tout se fait légèrement ! Pourvu que cela finisse une bonne fois. Nesselrode écrit à sa femme que mon frère lui a assuré que j’aurais 90 mille francs de rente. Ce drôle de frère Il tranche dans le grand. J’accepte volontiers ses 90 milles francs. Mais je serai curieuse de voir comment il s’y prendra pour me les faire toucher.
5 heures
Vous avez fait ce que je craignais. Je n’ai point de lettres aujourd’hui. Vous voyez bien que si je vous imitais vous n'en auriez pas non plus de moi. Mais je ne vous écris que pour vous dire que vous avez tort et que je ne vous imiterai pas. En attendant voilà un triste dimanche et une forte migraine par dessus cela. Ah que tout m’attriste et m'ennuie ! Je voudrais bien être à l’hiver. Adieu. Je n’ai vraiment pas un mot à vous dire, j’ai eu une lettre du Roi de Hanovre très insignifiante. Ses affaires vont mal à ce qu'on me dit, mais lui ne me le dit pas. Adieu.
Lorsque nous sommes ensemble, je m'entretiens avec vous de toute chose, je vous dis tout. Par lettres c'est bien difficile. Tous les sujets me paraissent trop minces. Ma vie est bien monotone, les personnes avec lesquelles je vis sont bien insignifiantes ; que voulez-vous que je vous dise ? Je pense bien plus au moment où je ne serai plus à Bade qu'à celui où je m’y trouve. Savez-vous bien que nous avons encore à passer quatre mois sans nous voir ! Vous m'avez dit que vous en reviendriez que pour le mois de décembre à Paris ! Que c'est long ! Songez-vous bien à cela ?
2 heures
J’ai été à l’église comme je ne manque jamais de le faire le dimanche. Nous avons eu un superbe sermon, trop beau, car j'en suis revenue en larmes. Je viens de recevoir une lettre de F. Pahlen de Courlande. Ce n’est que là qu'il a reçu la lettre dans laquelle je lui mandais que mes fils en retenait ma pension. Il me dit qu’il est très fâché de l’avoir ignoré pendant qu'il se trouvait encore à Pétersbourg et qu'il ne doute pas que mon frère y aura une ordre. Mais mon frère n'a jamais répondu à ce que je lui en avais dit vous voyez comme tout se fait légèrement ! Pourvu que cela finisse une bonne fois. Nesselrode écrit à sa femme que mon frère lui a assuré que j’aurais 90 mille francs de rente. Ce drôle de frère Il tranche dans le grand. J’accepte volontiers ses 90 milles francs. Mais je serai curieuse de voir comment il s’y prendra pour me les faire toucher.
5 heures
Vous avez fait ce que je craignais. Je n’ai point de lettres aujourd’hui. Vous voyez bien que si je vous imitais vous n'en auriez pas non plus de moi. Mais je ne vous écris que pour vous dire que vous avez tort et que je ne vous imiterai pas. En attendant voilà un triste dimanche et une forte migraine par dessus cela. Ah que tout m’attriste et m'ennuie ! Je voudrais bien être à l’hiver. Adieu. Je n’ai vraiment pas un mot à vous dire, j’ai eu une lettre du Roi de Hanovre très insignifiante. Ses affaires vont mal à ce qu'on me dit, mais lui ne me le dit pas. Adieu.
225. Baden, Vendredi 26 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
225. Baden Vendredi 26 juillet 1839 9 heures
J’ai eu une fort mauvaise nuit au fond je ne crois pas qu’il m'arrive de jamais bien dormir ou bien manger à Baden. Je ne sais pas pourquoi j’y reste et j ne sais comment je ferai pour en partir si ma faiblesse augmente. Ensuite l'ennui, la crainte de voyager seule. Car c’est à présent que je vais être bien seule, pas même Marie. Je n’ai aucun projet quelconque ; j’attends. Je vois couler le temps. Je n'ai jamais été si indécise, si flottante qu'aujourd'hui. La seule chose fixe est Paris plutôt ou plus tard c.a. d. Septembre ou Novembre et plutôt le premier.
J’ai trouvé un mot dans votre avant dernière lettre qui m’a fait battre le cœur. Vous avez songé à venir à Baden ! Un seul instant cette idée ou ce désir vous est venu. Et moi je me suis dit. S'il venait, s'il pouvait venir, pourquoi ne pourrait-il pas venir ? Pendant quelques jours je revenais à cela sans cesse. C’est peut être dans le même temps que vous y rêviez aussi. Rêve, rêve, rien que rêve pour tout ce qui est bonheur !
Je suis fâchée de vous avoir remis vos lettres. Il y en a que j'aimerais tant à relire. Celles où vous me parlez de votre foi en Dieu ; de votre foi à l'éternité. Celles où vous me dites que je reverrai ce que j’ai tant aimé ! Ah comme j'y pense, quelle douceur de penser à cela d’y croire. Dites-moi bien d’y croire.
Il a plu hier tout le jour. Cela ne m’a pas empêchée de faire ma promenade. M. de Malzahn est encore venu trois fois prendre congé de moi, j’ai cru que cela irait jusqu'à l’année prochaine. Enfin il est bien parti. C’est dommage, je pouvais causer avec lui.
2 heures
Le médecin a voulu absolument que je recommençasse des bains ; je m’y prête encore plutôt par ennui que par conviction des bains presque froids, ils me plaisent comme sensation, mais nous verrons s'ils me conviennent.
5 heures
Merci de votre lettre 225. Je la reçois dans cet instant. Je viens d'en recevoir une aussi de Pahlen l’ambassadeur. Mon frère lui a dit que j’aurais 90 milles francs de rente avec ce que j'ai d'abord il ne sait pas ce que j’ai et je voudrais bien voir comment il arrivera à cette somme. Savez-vous ce qu’est mon frère, un peu hâbleur. Est-ce un mot dont on ne sert ? et puis c'est un homme qui se débarrasse des questions en brodant. C’est égal. Ce n'est pas ce qu’il a dit à Pahlen mais ce sera ce que moi je vous ai dit 75 mille. Adieu. Adieu.
Je vais à ma promenade du soir. Je vous remercie de vos lettres, elles me font tant de plaisir. Vous voyez que les nouvelles de l’Orient sont plus tôt sues à Baden que chez vous. On a tiré le canon, illuminé à Alexandrie. On dit que Méhémet Ali demande la régence.
J’ai eu une fort mauvaise nuit au fond je ne crois pas qu’il m'arrive de jamais bien dormir ou bien manger à Baden. Je ne sais pas pourquoi j’y reste et j ne sais comment je ferai pour en partir si ma faiblesse augmente. Ensuite l'ennui, la crainte de voyager seule. Car c’est à présent que je vais être bien seule, pas même Marie. Je n’ai aucun projet quelconque ; j’attends. Je vois couler le temps. Je n'ai jamais été si indécise, si flottante qu'aujourd'hui. La seule chose fixe est Paris plutôt ou plus tard c.a. d. Septembre ou Novembre et plutôt le premier.
J’ai trouvé un mot dans votre avant dernière lettre qui m’a fait battre le cœur. Vous avez songé à venir à Baden ! Un seul instant cette idée ou ce désir vous est venu. Et moi je me suis dit. S'il venait, s'il pouvait venir, pourquoi ne pourrait-il pas venir ? Pendant quelques jours je revenais à cela sans cesse. C’est peut être dans le même temps que vous y rêviez aussi. Rêve, rêve, rien que rêve pour tout ce qui est bonheur !
Je suis fâchée de vous avoir remis vos lettres. Il y en a que j'aimerais tant à relire. Celles où vous me parlez de votre foi en Dieu ; de votre foi à l'éternité. Celles où vous me dites que je reverrai ce que j’ai tant aimé ! Ah comme j'y pense, quelle douceur de penser à cela d’y croire. Dites-moi bien d’y croire.
Il a plu hier tout le jour. Cela ne m’a pas empêchée de faire ma promenade. M. de Malzahn est encore venu trois fois prendre congé de moi, j’ai cru que cela irait jusqu'à l’année prochaine. Enfin il est bien parti. C’est dommage, je pouvais causer avec lui.
2 heures
Le médecin a voulu absolument que je recommençasse des bains ; je m’y prête encore plutôt par ennui que par conviction des bains presque froids, ils me plaisent comme sensation, mais nous verrons s'ils me conviennent.
5 heures
Merci de votre lettre 225. Je la reçois dans cet instant. Je viens d'en recevoir une aussi de Pahlen l’ambassadeur. Mon frère lui a dit que j’aurais 90 milles francs de rente avec ce que j'ai d'abord il ne sait pas ce que j’ai et je voudrais bien voir comment il arrivera à cette somme. Savez-vous ce qu’est mon frère, un peu hâbleur. Est-ce un mot dont on ne sert ? et puis c'est un homme qui se débarrasse des questions en brodant. C’est égal. Ce n'est pas ce qu’il a dit à Pahlen mais ce sera ce que moi je vous ai dit 75 mille. Adieu. Adieu.
Je vais à ma promenade du soir. Je vous remercie de vos lettres, elles me font tant de plaisir. Vous voyez que les nouvelles de l’Orient sont plus tôt sues à Baden que chez vous. On a tiré le canon, illuminé à Alexandrie. On dit que Méhémet Ali demande la régence.
223. Baden, Lundi 22 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
223 Baden le 22 Juillet lundi
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
222. Baden, Samedi 20 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
222 Baden Samedi 20 juillet 1839, 3 heures
Une bien mauvaise nuit. Une bien mauvaise matinée, un mal de tête nerveux abominable, voilà de beaux éléments pour une lettre ! Celle qui m’est venue de vous hier est fort intéressante, je vous en remercie. Vraiment ici à Baden on est étonné de l’affaire Barbés, elle est peut être oubliée à Paris. Mais il me semble que l’effet n'y a pas été bon non plus, car les journaux ministériels se taisent, et les autres ont des articles abominables.
Dimanche 21 5 heures
Vous voyez que j'ai été bien peu capable d'écriture. J'ai souffert de maux de tête horribles. Je suis un peu mieux dans ce moment-ci. On me dit que cela tient au temps qui est à l'orage. C'est des bêtises. J'ai mal parce que je suis malade. J’ai reçu votre dernière lettre de Paris. Dites-moi pourquoi vous n’êtes pas retourné à Neuilly avant votre départ. Je vous remercie beaucoup d’avoir procuré la course du courrier à M. de Castillon.
Je sais de Berlin que la conférence de Vienne n’est pas aussi sûre que le dit M. de Metternich. Il est bien actif dans ce moment. Moi je le suis aussi on du moins j'essaye de l'être, demain j'envoie un gros volume à mon frère. J'aurais voulu vous consulter sur tout. J'ai eu ce matin une longue visite de Sir John Courey, il m’a tout raconté. Savez-vous qui est au fond de tout cela ? Léopold. Depuis l’année 35 il a brouillé la mère et la fille afin de gouverner celle-ci. L'instrument est Letzech. Il n’a réussi qu'à brouiller, mais non à gouverner.
Voyez quel griffonnage, il m’en coûte un peu d'écrire. Et quelle pauvre lettre ! Vous la recevrez bien mal. Il me semble qu’elle n’est là que pour faire acte d'existence. Vous n'en voulez que tous les deux jours vous avez raison, mes lettres sont trop bêtes. J'en ai reçu de Lord Grey ce matin. Il est très anti ministériel et parle des Chartistes avec le plus grand dédain. Il m’invite beaucoup à venir à Hewish, s’il était plus près J’irais. Adieu. Adieu. Que de choses j’ai à vous dire, à vous demander. Ah que nous sommes loin, & que le temps est long encore. Adieu mille fois et bien tendrement.
Une bien mauvaise nuit. Une bien mauvaise matinée, un mal de tête nerveux abominable, voilà de beaux éléments pour une lettre ! Celle qui m’est venue de vous hier est fort intéressante, je vous en remercie. Vraiment ici à Baden on est étonné de l’affaire Barbés, elle est peut être oubliée à Paris. Mais il me semble que l’effet n'y a pas été bon non plus, car les journaux ministériels se taisent, et les autres ont des articles abominables.
Dimanche 21 5 heures
Vous voyez que j'ai été bien peu capable d'écriture. J'ai souffert de maux de tête horribles. Je suis un peu mieux dans ce moment-ci. On me dit que cela tient au temps qui est à l'orage. C'est des bêtises. J'ai mal parce que je suis malade. J’ai reçu votre dernière lettre de Paris. Dites-moi pourquoi vous n’êtes pas retourné à Neuilly avant votre départ. Je vous remercie beaucoup d’avoir procuré la course du courrier à M. de Castillon.
Je sais de Berlin que la conférence de Vienne n’est pas aussi sûre que le dit M. de Metternich. Il est bien actif dans ce moment. Moi je le suis aussi on du moins j'essaye de l'être, demain j'envoie un gros volume à mon frère. J'aurais voulu vous consulter sur tout. J'ai eu ce matin une longue visite de Sir John Courey, il m’a tout raconté. Savez-vous qui est au fond de tout cela ? Léopold. Depuis l’année 35 il a brouillé la mère et la fille afin de gouverner celle-ci. L'instrument est Letzech. Il n’a réussi qu'à brouiller, mais non à gouverner.
Voyez quel griffonnage, il m’en coûte un peu d'écrire. Et quelle pauvre lettre ! Vous la recevrez bien mal. Il me semble qu’elle n’est là que pour faire acte d'existence. Vous n'en voulez que tous les deux jours vous avez raison, mes lettres sont trop bêtes. J'en ai reçu de Lord Grey ce matin. Il est très anti ministériel et parle des Chartistes avec le plus grand dédain. Il m’invite beaucoup à venir à Hewish, s’il était plus près J’irais. Adieu. Adieu. Que de choses j’ai à vous dire, à vous demander. Ah que nous sommes loin, & que le temps est long encore. Adieu mille fois et bien tendrement.
221. Baden, Vendredi 19 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
221 Baden, Vendredi le 19 juillet, 1839 4 heures
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
220. Baden, Jeudi 18 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
220 Baden jeudi le 18 juillet 1839, 2 heures
La poste de lundi de Paris n’est arrivé que tout à l'heure. C'est un accident arrivé à la voiture qui a causé ce retard. J'en ai été très alarmé. Mais voici votre lettre et je suis contente. Savez-vous que vos lettres sont bien prudentes. Vous me laissez beaucoup à deviner, et je ne connais au fond vos opinions sur rien. Ainsi pour parler du plus frais, trouvez-vous bon ou mauvais la commutation de la peine de Barbès ? Comment se porte le ministère ? Ces messieurs font-ils bon ménage ? Cela tiendra-t-il jusq'à la session ? Moi j’entends dire beaucoup que la gauche l'emporte, & que Thiers a des chances.
J'ai donné toute ma journée hier et ma matinée aujourd'hui à Lady Carlisle. C'est une bonne personne, un peu ennuyeuse. Elle vient de repartir. Sir John Couroy est arrivé à Bade. J’ai envie de le voir et de le faire parler, ce qui me réussit assez quand je veux. Voici ce que me dit mon frère : " Paul connait bien les lois. Il ne l’est occupé que de cela depuis son arrivée ici ; et parait très observateur des lois ! " " Voici la calcul de ce que la loi vous assigne. Cela a été discuté avec une précision scrupuleuse ! " Après avoir commenté les articles, mon frère trouvant que je suis riche, & que mes fils sont plus que riches, il poursuit : " Il serait inconvenant dans cette position de solliciter une pension du gouvernement. " Et me cite une grande dame dans ma situation qui l'a fait il y a quelques années et ajoute. " Cela a beaucoup déplu et elle a obtenu 10 000 rouble. Cette somme ne vous rendrait pas plus riche. " La question de déplaire ne me touche pas beaucoup, mais en effet je pense que je ne dirai plus un mot de cela, parce que cela m'ennuie. Ce n’est pas à moi à dire. Ces gens-là devraient faire ce qui est convenable sans que j’en parle. Il y a une chose que je regrette, c’est le plaisir de mettre dans l'embarras ou dans le tort. Voilà du mauvais cœur au fond la question n’est pas de savoir si j'ai besoin de cette pension ou non. Elle devait être donnée sans plus. Après cela savez-vous qu'il y a du plaisir à ne devoir rien à personne. J’aime mieux avoir à me venger d'une injustice. Il me semble que je vous parle un peu trop longuement de moi ; mais pour être franche j’ajouterai encore que j'ai hésité et que j'avais commencé une lettre à Orloff excessivement logique & bonne ; je l’ai laissée là. Mon frère fait des calculs très légers dans ce qu’il m'écrit et comme Pahlen part et que c'est mon frère qui va faire le reste, cela m’inquiète un peu. Ainsi il me parle de 400 mille francs da capital pour moi. Cela n'est pas possible. Ensuite il regarde comme éternels des revenus qui finissent dans 2 ans. Je serai obligée de relever tout cela, & de demander des explications, et puis on veut que je donne 355 paysans pour une rente de 9000 francs. Ils valent le double. Ensuite rien que la parole de mes fils comme garantie que la pension me serait payée. Ceci ne regarde que 21 000 fr par an, mais encore faudrait-il vérité. Enfin je prierai mon fière d’y faire attention et le style de sa lettre me prouve que cette observation ne l'étonnera pas. Mes fils auront à ce qu’ils me parait chacun 100 000 francs de rente. J'en suis bien aise. Ils n’ont pas besoin de moi, et de personne. Et cependant, s'ils avaient eu besoin de moi, j'aurais pu conserver des illusions ! Ah, tout est fini de ce côté !
Adieu, vous qui n'êtes pas une illusion, vous qui êtes ma seule vérité. Vérité que je chéris, que je désirais toute ma vie. Ecrivez-moi tous les jours. Vous allez être bien heureux au Val-Richer.
La poste de lundi de Paris n’est arrivé que tout à l'heure. C'est un accident arrivé à la voiture qui a causé ce retard. J'en ai été très alarmé. Mais voici votre lettre et je suis contente. Savez-vous que vos lettres sont bien prudentes. Vous me laissez beaucoup à deviner, et je ne connais au fond vos opinions sur rien. Ainsi pour parler du plus frais, trouvez-vous bon ou mauvais la commutation de la peine de Barbès ? Comment se porte le ministère ? Ces messieurs font-ils bon ménage ? Cela tiendra-t-il jusq'à la session ? Moi j’entends dire beaucoup que la gauche l'emporte, & que Thiers a des chances.
J'ai donné toute ma journée hier et ma matinée aujourd'hui à Lady Carlisle. C'est une bonne personne, un peu ennuyeuse. Elle vient de repartir. Sir John Couroy est arrivé à Bade. J’ai envie de le voir et de le faire parler, ce qui me réussit assez quand je veux. Voici ce que me dit mon frère : " Paul connait bien les lois. Il ne l’est occupé que de cela depuis son arrivée ici ; et parait très observateur des lois ! " " Voici la calcul de ce que la loi vous assigne. Cela a été discuté avec une précision scrupuleuse ! " Après avoir commenté les articles, mon frère trouvant que je suis riche, & que mes fils sont plus que riches, il poursuit : " Il serait inconvenant dans cette position de solliciter une pension du gouvernement. " Et me cite une grande dame dans ma situation qui l'a fait il y a quelques années et ajoute. " Cela a beaucoup déplu et elle a obtenu 10 000 rouble. Cette somme ne vous rendrait pas plus riche. " La question de déplaire ne me touche pas beaucoup, mais en effet je pense que je ne dirai plus un mot de cela, parce que cela m'ennuie. Ce n’est pas à moi à dire. Ces gens-là devraient faire ce qui est convenable sans que j’en parle. Il y a une chose que je regrette, c’est le plaisir de mettre dans l'embarras ou dans le tort. Voilà du mauvais cœur au fond la question n’est pas de savoir si j'ai besoin de cette pension ou non. Elle devait être donnée sans plus. Après cela savez-vous qu'il y a du plaisir à ne devoir rien à personne. J’aime mieux avoir à me venger d'une injustice. Il me semble que je vous parle un peu trop longuement de moi ; mais pour être franche j’ajouterai encore que j'ai hésité et que j'avais commencé une lettre à Orloff excessivement logique & bonne ; je l’ai laissée là. Mon frère fait des calculs très légers dans ce qu’il m'écrit et comme Pahlen part et que c'est mon frère qui va faire le reste, cela m’inquiète un peu. Ainsi il me parle de 400 mille francs da capital pour moi. Cela n'est pas possible. Ensuite il regarde comme éternels des revenus qui finissent dans 2 ans. Je serai obligée de relever tout cela, & de demander des explications, et puis on veut que je donne 355 paysans pour une rente de 9000 francs. Ils valent le double. Ensuite rien que la parole de mes fils comme garantie que la pension me serait payée. Ceci ne regarde que 21 000 fr par an, mais encore faudrait-il vérité. Enfin je prierai mon fière d’y faire attention et le style de sa lettre me prouve que cette observation ne l'étonnera pas. Mes fils auront à ce qu’ils me parait chacun 100 000 francs de rente. J'en suis bien aise. Ils n’ont pas besoin de moi, et de personne. Et cependant, s'ils avaient eu besoin de moi, j'aurais pu conserver des illusions ! Ah, tout est fini de ce côté !
Adieu, vous qui n'êtes pas une illusion, vous qui êtes ma seule vérité. Vérité que je chéris, que je désirais toute ma vie. Ecrivez-moi tous les jours. Vous allez être bien heureux au Val-Richer.
218. Baden, Mardi 16 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
218 Baden Mardi le 16 juillet 1839, 10 heures
Je vous disais hier que le temps était à l’orage. Une heure après un gros nuage noir est descendu sur Bade mais plus particulièrement sur la salle de conversation qui touche à la maison que j'habite. La foudre est tombé dessus, le paratonnerre a écarté le danger mais tout le monde qui était à table dans ce moment a senti le choc électrique, deux dames sont tombées par terre de frayeur. J'étais à la fenêtre, relisant votre lettre. Le coup a été si fort qu'il m’a fait sauter & votre lettre m’est tombée de la main. Je n'ai jamais été si près de la foudre que hier. La nuit a été orageuse aussi & nous n’avons pas fini aujourd'hui.
Voilà donc le Sultan mort, je l’ai appris hier au soir. Le courrier venu de Constantinople traversait Bade le 15 ème jour. C'est vite. Tout peut arriver un bien comme un mal. C’est un moment curieux, mais ce qui m’étonnerait le plus serait que nous prissions part à une conférence à moins qu’elle ne se bornât à établir les nouveaux rapports entre les deux chefs barbares.
5 heures
Je viens de recevoir votre lettre, je viens aussi de recevoir un gros volume de mon frère, avec tout l’arrange ment de me fortune. Je vous manderai demain le détail. Il me parait qu’il n’est pas content de mes fils. La loi rien que la loi, comme elle m’accorde à peu près ce que j’ai à présent, je ne me plains pas, mais je ne suis pas bien orientée encore je vous dirai cela plus exactement demain. Adieu. Adieu. Adieu. J'étais mieux ce matin je ne me sens pas si bien dans ce moment. God bless you.
Je vous disais hier que le temps était à l’orage. Une heure après un gros nuage noir est descendu sur Bade mais plus particulièrement sur la salle de conversation qui touche à la maison que j'habite. La foudre est tombé dessus, le paratonnerre a écarté le danger mais tout le monde qui était à table dans ce moment a senti le choc électrique, deux dames sont tombées par terre de frayeur. J'étais à la fenêtre, relisant votre lettre. Le coup a été si fort qu'il m’a fait sauter & votre lettre m’est tombée de la main. Je n'ai jamais été si près de la foudre que hier. La nuit a été orageuse aussi & nous n’avons pas fini aujourd'hui.
Voilà donc le Sultan mort, je l’ai appris hier au soir. Le courrier venu de Constantinople traversait Bade le 15 ème jour. C'est vite. Tout peut arriver un bien comme un mal. C’est un moment curieux, mais ce qui m’étonnerait le plus serait que nous prissions part à une conférence à moins qu’elle ne se bornât à établir les nouveaux rapports entre les deux chefs barbares.
5 heures
Je viens de recevoir votre lettre, je viens aussi de recevoir un gros volume de mon frère, avec tout l’arrange ment de me fortune. Je vous manderai demain le détail. Il me parait qu’il n’est pas content de mes fils. La loi rien que la loi, comme elle m’accorde à peu près ce que j’ai à présent, je ne me plains pas, mais je ne suis pas bien orientée encore je vous dirai cela plus exactement demain. Adieu. Adieu. Adieu. J'étais mieux ce matin je ne me sens pas si bien dans ce moment. God bless you.