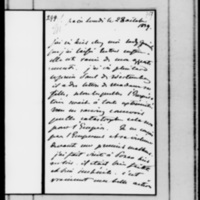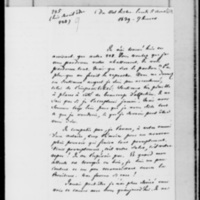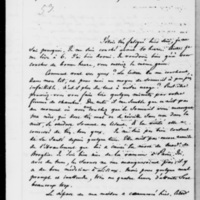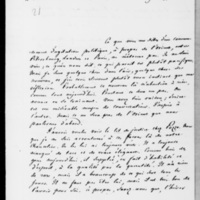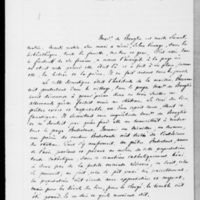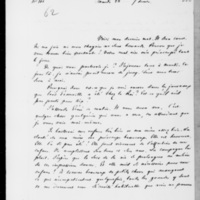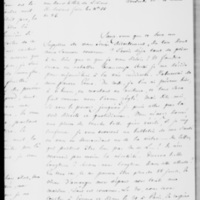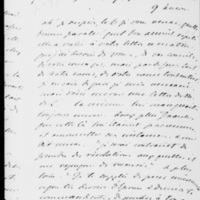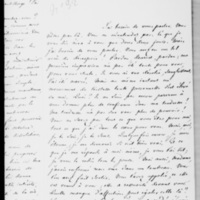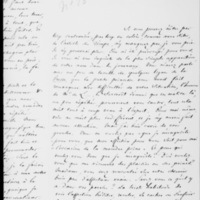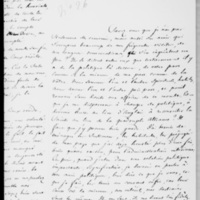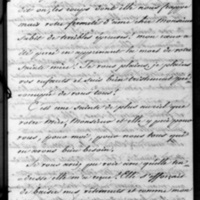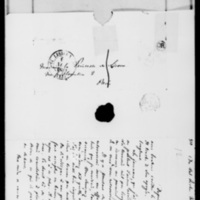Votre recherche dans le corpus : 24 résultats dans 6063 notices du site.
299. Paris, Lundi 28 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu hier chez moi Lady Granville que j’ai laissé entrer enfin. Elle est ravie de mon appartement. J’ai vu plus tard le prince Paul de Wurtemberg. Il a des lettres de Madame sa fille, selon lesquelles l'Impératrice serait à toute extrémité. Vous ne sauriez concevoir quelle catastrophe cela sera pour l’Empire. Je ne conçois pas l’'Empereur et sa violence devant un premier malheur. J'ai fait visite à Pozzo hier au soir. Il était bien faible et bien imbécile. C’est vraiment une belle action d’aller passer une heure avec lui. Je viens de recevoir une lettre d'Ellice, mais je n’ai pas le courage encore d’aller à cet affront. La petite Ellice est arrivée très gentille, mais pas tout-à-fait autant qu'à Bade. C’est qu’à Bade j’étais bien abandonnée. Adieu.
Je vous assure que je suis bien harassée de tous ces tracas d’intérieur. Je ris quelque fois à force d’avoir envie d'en pleurer. Adieu. Si votre mère n’est incommodée qu'un peu et de façon seulement à ce que votre retour ne soit qu’une mesure de prudence je ne saurais m’en chagriner. Si vous aviez de l’inquiétude soyez sûr que j’en aurais beaucoup beaucoup aussi. Adieu. Adieu.
300. Val-Richer, Dimanche 27 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Ma mère a été souffrante hier, assez souffrante. Si cela se prolongeait ou se renouvelait d’ici à quatre jours, je presserais mon départ. Son mal, s’il s'aggravait, aurait besoin de secours prompts et décisifs. Je lui en ai dit un mot hier. Cela la contrarie. Mais je n'hésiterai pas. Pauline est parfaitement bien. Mais quelle fièvre que d’aimer des créatures, quand on a tant perdu, quand on a tant éprouvé la fragilité de la vie ! Je ne puis voir malade quelqu'un que j’aime, sans une angoisse, une prévoyance horrible. Je ne vaux plus rien pour un tel fardeau ; mes épaules plient à la moindre apparence qu’il s’appesantisse encore sur moi.
Voici une conversation de Thiers avec un de mes amis ; plus directe que la vôtre mais très analogue, je pense. Thiers : Que pensez-vous du Ministère?
- Qu’il est faible et dans une position fausse.
- Que fera-t-il ?
- Peu de chose sans doute ; ce qu'on peut faire quand on est faible et dans une position fausse.
- Et comment tout cela finira-t-il ?
- Je vous le demanderai à vous- même. "
Ici une pause assez longue. Thiers reprend, et expose ce qu’il pense du Ministère de ses embarras, des difficultés de la session ; la gauche votera contre ; M. Barrot votera contre avec quelques ménagements. Le centre gauche se divisera ; une portion appuiera le Ministère, l'autre votera contre. Et les doctrinaires, que feront-ils ?
- Comme le centre gauche.
- Et M. Guizot, que fera-t-il ? L’avez-vous vu à son dernier passage à Paris ?
- Je l'ai vu ; il agira selon les circonstances sa situation, peut être embarrassante à cause de ceux de ses amis qui sont ministres.
- Autre chose sont ses amis, autre chose est le Ministère."
Thiers revient sur la situation en général, sur l'impossibilité qu’il n’arrive pas quelque chose. On répond que quoi qu’il arrive, il est désormais impossible de parler de coalition. On lui rappelle qu'à la même place, au moment des dernières élections en causant avec lui, en prévoyait la victoire et un grand succès si la conduite était sage et mesurée ; on ajoute que rien n'a été omis de ce qui pouvait et devait tout compromettre. Ceci a paru préoccuper vivement Thiers ; le rouge lui a monté au visage. Après un peu de temps, il a repris :
- Sans se coaliser, on peut tendre au même but. On le peut et on le doit, si en effet on se propose le même but, si on a les mêmes intentions."
Nouvelle pause. Thiers reprend encore pour dire qu’il a pris son parti, qu’il travaille, qu’il veut continuer, qu'il est heureux.
- Vous faites bien. "
10 heures
Lord Brougham n’a pas prolongé assez longtemps sa fantaisie. Il ne faut pas qu’un mort revienne sitôt. Avait-il fait prévenir Lady Clauricard. Vous avez raison de ne pas montrer votre appartement. Mais moi je regrette de ne pas assister à sa création. Vous me parleriez d'autre choses. Vous me permettez cette fatuité. M. Delessert m'écrit que Calamata vient de terminer la gravure de mon portrait. On m'en donnera quelques épreuves quelques unes à Paul Dela Roche ; puis 450 pour les souscripteurs et la planche sera brisée. Voilà des amis jaloux. Adieu. Adieu. G.
287. Val-Richer, Lundi 14 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne comprends pas que vous n'eussiez pas vu Génie samedi à une heure et demie. Il m'a quitté à 6 heures emportant une lettre pour vous. Il faut qu’il ait eu quelque affaire obligée. Il vous aura surement vue, dans la journée.
Je suis arrivé hier à 4 heures, point fatigué. Il fait beau, mais je tousse toujours un peu. Je trouve en arrivant quatre invitations à dîner. Je les refuse toutes en disant que mon médecin veut que je me repose pendant le reste de mon séjour à la campagne. Mes enfants sont à merveille. Ma mère pas trop. Rien de grave cependant.
Le procédé de M. Jennison est en effet choquant. Mais il n’y a que lui qui puisse en souffrir. Vous avez votre bail signé. S’il ne voulait vous rien vendre, vous auriez un peu plus d'affaires pour votre arrangement voilà tout. Mais il vous vendra ; ne lui achetez pas plus, et ne le payez pas plus cher que vous ne voulez. Le monde est juif. La dispersion de la race juive a infecté le monde
9 heures et demie
Sans nul doute, les questions à votre fière sont trop péremptoires et il vaut mieux attendre. Quoiqu'il n’y ait rien d’impossible, il me paraît impossible que vous ne receviez pas bientôt la copie textuelle de l’arrangement définitif. Nous verrons alors ce qui manquera. Je vous enverrai demain matin une lettre pour le directeur des Douanes. Vous prierez Génie de la lui porter et de suivre cette petite affaire. Il faut toujours un homme à la suite d’une affaire. Rien ne se fait tout seul. Adieu.
Je trouve ici une foule de petites affaires à régler, et de lettres insignifiantes auxquelles il faut pourtant répondre. Adieu Adieu. G.
262. Val-Richer, Mercredi 11 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous avez embaumé mon voyage. Le parfum de cette charmante minute dure encore. J’aurais voulu que Génie allât vous voir ce matin. Il ne le pouvait pas. Il avait des rapports à faire à sa cour, ce qui l'oblige à s'y rendre de bonne heure. Je vous le répète ; chargez-le de tout ce qui vous embarrassera ou vous ennuiera. Je réponds qu’il le fera bien et avec plaisir. Je suis arrivé il y a deux heures. J’ai trouvé mes enfants, à merveille, ma mère toujours un peu chancelante.
Il fait un temps admirable. Ce matin, à 5 heures, un brouillard affreux. Le brouillard et le soleil, la tristesse et la joie se touchent, se mêlent presque. Les contrastes de la vie ont bien de la peine à se concilier dans notre cœur. Je n’y prétends pas. Si vous pouviez voir au fond, cela me suffirait, et je suis sûr que cela vous ferait du bien. C’est un si grand repos qu’une sécurité parfaite, même de loin. Vous m’êtes nécessaire, nécessaire comme je le suis pour vous. Mais je suis nécessaire en deux endroits. Que j'aurais à vous dire ! Je ne vous ai rien dit. Adieu. Je n’ai pas dormi cette nuit. Je dormirai peut-être une heure dans la journée.
Adieu Adieu. Non pas farewell for ever, mais ever and ever farewell. G.
235 . Val -Richer, Lundi 5 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai trouvé hier en arrivant que votre 228. Vous voulez que je vous pardonne votre abattement. Je vous pardonne tout. Mais que sert le pardon ? Pas plus que ne ferait le reproche. Vous me donnez un sentiment auquel je suis peu accoutumé, celui de l’impossibilité, sentiment très pénible à placer à côté de beaucoup d'affection. Je ne sais pas si je l’accepterai jamais. Mais nous sommes trop loin pour que je vous dise tout ce que je voudrais ce que je devrais peut être vous dire. Je compatis peu, je l'avoue à votre ennui d’un notaire, deux témoins pour un nouveau plein pouvoir qui finira tout promptement. Finir promptement, c'est votre salut, c'est votre repos ! Je ne l'espérais pas. Et quand mon attente est trompée en bien, je suis un peu content et un peu reconnaissant envers la providence. Une faveur si rare? Jamais peut-être je n'ai plus désiré vous voir et causer avec vous qu'aujourd'hui. Je ne sais si tout ce que je vous dirais vous paraîtrait doux ; mais je suis sûr que ce serait sain pour vous. Car encore une fois, je vous aime trop pour accepter, l'impossibilité.
Parlons d’autre chose. Est-il vrai, comme on me l'écrit, qu'il est question d’un voyage de l'Empereur à Odessa avec le grand duc et M. de Nesselrode ? Personne ne peut prévoir aujourd'hui ce qui arrivera de ce côté. Un enfant Roi, une vieille Sultane-mère, deux jeunes négresses-maitresses, un vieux vizir haineux, un vieux Pacha vainqueur, toutes les habiletés de l’Europe diplomatique ne gouverneront pas cela. Nous sommes au hasard. La discorde est grande dans la gauche. Les projets de réforme électorale déplaisent à la plupart de ceux qui les acceptent, & ne sont pas acceptés de ceux à qui ils voudraient plaire. Ce sera, pour la prochaine session, un grand et bon champ de bataille. Je voudrais que ces deux questions, la réforme électorale et l'Orient restassent un peu longtemps sur le tapis. Nous avons besoin, pour nous former, de questions graves, pressantes, mais suspendues sur nos têtes, qui menacent de devenir, et ne deviennent pas tout à coup de grands événements. J’aurai probablement cette satisfaction.
Ma mère est mieux, et mes filles très bien. C’est demain, 6 août, le jour de naissance d'Henriette. Il y a dix ans. J’étais bien heureux !
9 heures
Voilà le n° 229. Je répondrai demain avec détail sur votre affaire du capital anglais. Je veux revoir le texte des lois. Mais en principe, il ne nous importe pas qu’on soit ou non étranger. Les biens de toute espèce, meubles ou immeubles qui se trouvent sur notre territoire sont régis par nos lois quelle que soit la nationalité du possesseur. Il me manque en effet beaucoup. Vous avez pleine satisfaction. Adieu. Adieu. G.
232. Val-Richer, Jeudi 1er août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous avez tort de ne pas me dire tout, absolument tout, de loin comme de près, de loin encore plus que de près. Quand je suis près quand je vous vois deux fois par jour, j'ai bien moins besoin que vous me disiez. Je devine, je sais d'avance. Et puis je vous vois ce qui vaut bien des paroles même des vôtres. Essayez de m'en dire autant qu’il en faudra pour me faire oublier un moment que je ne vous vois pas. C'est pourtant là ce que nous nous devrions l'un à l'autre quand nous sommes séparés. Entendez bien qu’il n’y a rien d'insignifiant, ni chose, ni personne, quand elle vous touche. Et puis, ce qui m'importe encore plus que le dehors de votre vue, c'est le dedans. J'aime bien à savoir les incidents de votre journée, encore plus ceux de votre âme. Dites-moi toute votre âme, ce qui l’occupe, ce qui la traverse bon ou mauvais, triste ou gai. J’ai bien envie d’être parfaitement exigeant, et de vous dire que tout ce que vous ne me dites pas, vous me le cachez, car j’ai droit de le savoir. Vous m’avez dit souvent ( quelquefois trop au commencement de notre relation, car cela m'étonnait un peu ) que vous étiez si transparente ! Soyez le de loin comme de près, et toujours, et jusqu'au fond. L’amour, c’est la transparence. L’intimité, c’est la transparence. Et la transparence, c’est que tout paraisse, que tout aille s’offrir de soi-même à des yeux charmés de tout voir. C'est ici, bien plus encore que dans tout ce qui se passe autour de vous, qu’il n’y a rien d’insignifiant pour moi. Savez-vous ce qui vous arrive ? Quand vous êtes fatiguée, ennuyée vous supposez que je le suis aussi. Vous n’avez plus confiance ni en vous, ni en moi, et vous vous laissez retomber même en m'écrivant, dans votre solitude, je veux dire dans votre isolement. Souvenez-vous que la première parole qui nous a vraiment unis a été celle-ci. Vous ne serez plus seule. Qu’elle reste entre nous, éternellement, parfaitement vraie. Ne soyez jamais seule. Je n'admets qu’une raison pour que vos lettres ne m'apportent pas, comme un miroir, toute votre vie, et toute votre âme ; c’est la fatigue physique de tout écrire.
Vendredi 9 heures
Je vois dans quelques journaux que la Belgique demande à entrer dans l’association des douanes allemandes. Je voudrais bien savoir ce qu’il y a de vrai. Je sais bien ce que la Belgique dit et fait dire sur la rive gauche du Rhin, mais je suis curieux de la rive droite. Pouvez-vous en causer avec M. de Blittersdorff, ou quelque autre bien instruit ?
La gauche a nommé un comité chargé de rédiger un projet de réforme électorale d'après les bases que je vous ai dites. Ce sont MM. Barrot, Carnot, Chambolle, Corcelles, Gauthier de Rumilly, de Golbery, Isambert, Larabit, de Sade et de Tocqueville. Il n'y a là de républicain que M. Carnot. Mais il l’est hautement, décidément et a été nommé comme tel par le 6e arrondissement de Paris. C’est à lui que les autres feront des concessions. Jamais assez pour qu'il soit content du projet, mais assez pour qu'il ne le désavoue pas. C’est l’hostilité de M. Garnier Pagès d'avoir mis M. Carnot, dans ce Comité. Il y aura ainsi beaucoup plus d’influence que s’il y était entré lui-même, ce que probablement il n'aurait pas pu.
Je ne suis pas content de la santé de ma mère depuis deux au trois jours. Elle a la tête fort lourde et un petit retour de vertiges. Je crains que le temps orageux et constamment mauvais ne lui fasse mal. Voilà un beau soleil depuis avant-hier. Je mène demain mes filles à Caen. J'en reviendrai après demain. Je m’arrangerai pour que notre quotidienneté n’en soit pas dérangée.
Vous me dîtes que bientôt vous n'aurez même plus Marie. Est-ce qu’elle se marie ? Ou bien avez-vous un parti pris de vous en séparer ? Si vous le faites cherchez quelqu'un pour la remplacer, parmi vos parent on ailleurs. Je sais combien ce choix est difficile et peut devenir ennuyeux. Pourtant il vous faut quelqu'un. Vous ne pouvez rester matériellement seule. Au moins vous faudrait-il une femme de chambre renforcée, de bonnes manières, capable de vous lire. Mais si vous rencontrez quelqu'un ou s’il vous vient quelque idée, ne vous décidez pas tout de suite, et sur votre première impulsion. Cela n’est jamais facile à défaire.
9 h. 1/2
Pourquoi n'ai-je pas de lettre ce matin ? Ceci me déplaît. Vous devez m'avoir écrit. Votre lettre d’hier me le promet. Adieu. Un triste adieu. G.
175. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
172. Val-Richer, Samedi 27 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’étais très fatigué hier soir je ne sais pourquoi. Je me suis couché avant 10 heures. Aussi je me lève à 6. J’ai bien dormi. Je voudrais bien qu’à vous coucher de bonne heure, vous eussiez le même gain. Comment vont vos nerfs ? La lecture en me couchant dans mon lit est pour moi, un moyen de sommeil à peu près infaillible. N’est-il plus du tout à votre usage ? Peut-être pourriez-vous vous faire lire quelques minutes par votre femme de chambre. Du reste, il me semble que ce n’est pas au moment où vous vous couchez que le sommeil vous manque. Ma mère, qui dort très mal et se réveille sans cesse dans la nuit, se rendort souvent en lisant. A la vérité elle a conservé de très bons yeux. Je ne suis pas bien content de sa santé depuis quelque temps. Elle n’est pas encore remise de l’ébranlement que lui a causé la mort de Mad. de Broglie. Je suis bien aise de la ramener à Paris. Ici. avec du temps, les sœurs ne me manqueraient pas ; il y a de bons médecins à Lisieux. Mais pour quelque mal prompt et inattendu, trois ou quatre heures d’attente sont beaucoup trop. Le départ de ma maison a commencé hier. Cette amie de ma mère dont je vous ai quelquefois parlé Melle Chabaud nous a quittés. Elle a été pour mes enfants, pendant tout son séjour d’une bonté aussi utile qu’affectueuse. Je ne puis la remplacer pour le piano d’Henriette, mais je me suis chargé de la leçon d’Anglais d’ici au 5 novembre. Nous lisons ce qui se peut lire de Shakespeare. Je ne voudrais pourtant pas nourrir mes enfants de cette lecture-là, même de ce qu’il y a de bon. C’est trop fort et trop brut. Il y a trop d’émotion et pas assez de perfection. Il faut, à de jeunes esprits quelque chose de plus serein et de plus achevé.
Mad. Graham reprend ses raouts de bien bonne heure. Il y a donc déjà beaucoup d’Anglais à Paris. Vous les aimez toujours beaucoup, c’est sûr ; mais si je ne me trompe, ils sont bien vite usés pour vous. Excepté, Lady Granville, s’entend. J’ai peur que Paris ne soit pour vous comme la cour, selon La Bruyère, " pays où l’on n’est pas toujours bien, mais qui empêche qu’on ne se trouve bien ailleurs. " Les journaux démentent la retraite du comte Woronzoff. ont-ils raison ? Il me semble que l’Orient s’apaise. Pourtant la question a fait un pas. L’Angleterre a jeté un grappin de plus & vous êtes mécontents. Qu’y a-t-il de sérieux dans son traité de commerce avec l’Autriche et dans ces bouches du Danube ? Mettez-vous à cela beaucoup d’importance ? Lord Grey a raison de trouver que son gendre a été indignement abandonné. Mais ni Lord Melbourne, ni Lord John ne pourraient faire autrement. C’est leur situation comme celle de notre cabinet, de faire, ce que d’autres ne voudraient pas faire, de supporter ce que d’autres ne voudraient pas supporter. Vous savez le mot du Prince de Talmont aux soldats qui allaient le fusiller : " J’ai fait mon devoir ; faites votre métier. " Il y a des Cabinets qui font leur devoir, d’autres leur métier.
10 heures
Je vous dirai adieu comme à l’ordinaire, à moins que vous ne vouliez pas. Mais aujourd’hui, en ce moment je ne vous dirai pas autre chose. Moi aussi, je vous blesserais, et je ne veux pas. Adieu. Je ne sais pourquoi il convient à M. de Broglie de dire qu’il n’a jamais songé à bouger de Paris. Non seulement il m’en avait parlé, mais il l’a écrit à ma mère.
156. Val-Richer, Mercredi 10 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce que vous me dîtes d’un commencement d’agitation politique à propos de l’Orient, entre Pétersbourg, Londres et Paris ne m’étonne pas. Je ne sais rien ; ce qu’on nous dit, ce qui paraît est plutôt pacifique. Mais je sens quelque chose dans l’air, quelque chose de nouveau et j’en crois souvent plutôt mon instinct que ma réflexion. Probablement ce nouveau-là, n’aboutira à rien comme tout aujourd’hui. Pourtant ce sera un pas. On avance en se traînant. Vous avez bien raison, écrire est un misérable moyen de conversation. J’espère à l’autre. Mais ce ne sera pas de l’Orient que nous parlerons d’abord.
J’aurais voulu voir le lit de justice chez Pozzo. Non que je ne sois accoutumé à ces façons-là de notre Chancelier. Je les lui ai toujours vues. Il a toujours manqué de tact et de vraie élégance. Comme bien des gens aujourd’hui, il supplée en fait d’habilité et d’esprit, à la qualité par la quantité. Il n’a rien de rare, mais, il a beaucoup de ce qui sert tous les jours. Il ne faut pas être lui, mais il est très bon de l’avoir pour soi. A propos, savez-vous que l’hiver dernier, il était jaloux de M. Piscatory auprès de Mad. de Boigne ? Je ne sais si cela recommencera cet hiver.
Jeudi 7 heures
Vous tenez un véritable congrès, Matonchavitz, Alexandre, des arrivants de Naples, de Londres, de Pétersbourg. Quand les fabricants de commérages sur vos grandes intrigues sauront tout cela, ils se croiront bien sûrs de leur fait. Moi, je passe mon temps à intriguer avec Marius, Sylla et César. Et nous nous amusons parfaitement mes enfants, et moi, de l’esprit et des actions de ces intrigants-là. On peut vraiment mettre les plus grandes choses et les plus grands hommes à la portée d’enfants intelligents et accoutumés à entendre parler de tout. M. de Broglie me mande qu’il sera obligé de venir à Broglie du 20 au 25 de ce mois, pour affaires, et qu’il viendra passer 29 heures ici. Il ne voit en effet personne. Mais sa lettre ne porte aucun caractère d’abattement qui est la disposition que je craindrais le plus pour lui. Il ne doit rester à Broglie que trois ou quatre jours. Que les impressions sont diverses ! Il m’a paru pressé de quitter Broglie, et effrayé d’y revenir. J’aurais voulu rester toujours aux mêmes lieux, entouré des mêmes objets, menant la même vie. C’est le changement qui me navre et me révolte après la mort.
Ma mère était un peu souffrante hier, toujours de cette même disposition au mal de tête et au vertige. Je lui ai fait faire une longue promenade dans ces bois, sous ce soleil dont je vous parlais le matin. Elle s’en est bien trouvée. Elle a une merveilleuse disposition à se distraire et à se reposer des émotions fortes par les plaisirs simples. Je fais planter des arbres ; elle regarde, elle conseille ; et cet intérêt qu’elle y prend lui fait plus de bien que toutes les tisanes du monde.
Lady Granville a t-elle fait sa déclaration à Marie. Vous savez que j’en suis curieux. Je ne doute guère de la soumission au premier moment. C’est l’exécution qu’il faut voir. Vous arrive-t-il comme à moi ? Il y a deux époques où je ne me plais guère à vous écrire, et suis en un moment au bout de ce que j’ai à vous dire; c’est quand je viens de vous quitter, et quand j’approche de vous revoir. Entre deux je me résigne, je m’établis. Mais les premiers et les derniers temps sont durs.
10 heures 1/4
Vous aimez les petits mots. J’en ai le cœur plein. Je ne peux pas, vous les envoyer tous. Je vous les apporterai. Adieu, Adieu Moi, j’aime la visite de Mad. de Talleyrand. G.
146. Val-Richer, Lundi 1er octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mad. de Broglie est morte samedi matin. Mardi matin son mari a réuni, selon l’usage, dans la bibliothèque, toute la famille, maîtres et gens, s’est assis dans le fauteuil de sa femme, a ouvert l’évangile à la page où on était resté quand elle était là, et a fait à sa place, comme elle, la lecture et la prière. Il en fait autant tous les jours. Le culte domestique était l’habitude de le maison. Personne n’est protestant dans le village dans le pays. Mad. de Broglie, avait découvert à grand peine deux ou trois suisses ou allemands qu’elle faisait venir au château. Le curé du lieu, prêtre exact et respectable est d’un esprit court, étroit et fanatique. Il surveillait avec inquiétude Mad. de Broglie, et ne doutait pas qu’au fond, elle ne travaillât à rendre tout le pays protestant. Jamais un Ministre, un sermon, une prière de couleur protestante n’est sortie de l’intérieur du château. Tout s’y renfermait. Un prêtre protestant venu de Paris, parlant et priant au milieu de cette population toute catholique, dans ce cimetière catholiquement béni à deux pas de la petite enceinte réservée, en droit cela se pouvait; en fait cela se fût passé très paisiblement ; la population eût écouté avec approbation et respect, mais pour les dévots du lieu, pour le clergé, le trouble eût été grand. Je ne sais ce qu’ils auraient dit. On n’a pas pensé à tout cela, pas du tout. Mais on a agi sous l’influence de ces faits là. On s’est conduit selon les habitudes. La religion s’est renfermée dans la maison. On a prié, en famille, auprès du lit de mort; on a prié pour elle comme elle eût prié elle-même, comme si elle eût pu entendre. Je suis persuadée que l’idée n’est pas venue de faire autrement. Elle m’est venue à moi, et je vous l’ai dit. Mais je me suis expliqué qu’elle ne fût pas venue aux autres, et je vous l’explique comme à moi-même. Soyez sûre que c’est la vérité, et que le duc a le cœur parfaitement tranquille, qu’il croit sa femme bien et dûment reçue au sein de Dieu qu’il n’a pas cessé un instant d’être en rapport pieux avec elle. Il n’est pas léger du tout, ni d’esprit, ni de cœur.
Je ne veux pas que vous soyez blessée. Je veux que vous compreniez ce qui mérite d’être compris de vous. Mais je vous aime de votre impression, de votre colère, de votre franchise. Restez comme vous êtes et dites-moi toujours tout. Même vos intrigues politiques, quand vous en ferez. Je serais très choqué que vous en fissiez sans moi. Je vous dirai les deux ou trois petites choses qui, peut-être ont pu donner prétexte à ces ridicules commérages. A force de regarder où il n’y a rien, on finit par découvrir je ne sais qu’elle ombre qu’avec beaucoup de bonne volonté quelque passant curieux, léger, malveillant, bête, a pu transformer en un corps. Je suis persuadé qu’il n’y a rien de plus.
Je parie que le redoublement d’humeur contre l’Empereur vient de Munich. Il y est resté longtemps. Les grandes Duchesses aînées sont venues à Weymar, de là à Berlin. Le Prince Royal de Bavière y va. Il y aura là une entrevue, puis un mariage. Celui qu’on recherchait d’ici est manqué. L’Empereur aura dit et fait, à ce sujet, beaucoup de choses désagréables, offensantes. Voilà, ma conjecture. Je n’ai jamais cru que les grandes Duchesses fussent sérieusement laissées à Pétersbourg. On n’a pas voulu qu’elles vinssent, du premier saut chercher elles-mêmes des maris. On a ménagé les convenances. Mais on a cherché, les maris pour elles. Et puis elles sont venues. Et puis, et puis... Je suis fâché de deux choses ; que notre mariage soit manqué, s’il l’est et qu’il vous vienne de là quelque ennui. Mais j’espère que ce ne sera rien.
9 h. 1/2.
Ma mère est bien depuis deux jours. Elle m’appelle pour aller voir je ne sais quoi dans le jardin. Je sors avec elle autant que cela lui plait, Adieu. Adieu. Les Débats que je viens d’ouvrir ne guériront pas le chagrin de M. de Pahlen. Adieu. G.
144. Val-Richer, Vendredi 28 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir parlé de ma mère. Elle a été un peu souffrante. Elle est bien aujourd’hui, quoique très, très affligée. Mad. de Broglie était avec elle filialement. Mais je suis sûr que je vous en ai parlé. Ma mère d’ailleurs a une attitude admirable envers la douleur ; elle la supporte sans s’en défendre. Je n’ai jamais vu personne qui l’acceptât plus complètement sans s’y abandonner, qui en parût plus rempli et moins abattu. Elle y est comme dans son état naturel. Il n’y survient rien de nouveau pour elle et le plus ou le moins ne change pas grand chose à sa disposition, toujours triste mais toujours forte. Je l’ai fait beaucoup promener ces jours-ci. Je l’ai fatiguée. Et puis mes enfants ne la quittent guère. J’ai beaucoup travaillé ce matin. J’avais besoin aussi de me fatiguer. J’en suis convaincu comme vous. On ne comprend que les maux qu’on a soufferts. A ce titre, j’ai bien quelque droit à vous comprendre, pas assez peut-être. Il est vrai que je suis moins isolé. Que ne puis- je vous guérir au moins de ce mal-là ! L’autre resterait. Je l’ai vu rester. Mais ce serait celui-là de moins. Je ferai mieux de ne pas vous écrire ce soir. Je suis si triste moi-même que je ne dois rien valoir pour consoler personne, pas même vous que je voudrais tant consoler, un peu !
Samedi 7 heures
Je suis frappé du peu que nous pouvons, du peu que nous faisons pour les autres, et pour nous-mêmes. Dieu m’a traité plusieurs fois avec une grande faveur. Il m’a beaucoup ôté mais il m’avait beaucoup donné et souvent il m’a beaucoup rendu. J’ai reçu le bien, j’ai subi le mal. J’ai très peu fait moi-même dans ma propre destinée. Nous ne réglons pas les événements. Nous sommes pris dans les liens de notre situation. Nous oublions cela sans cesse. Nous nous promettons sans cesse que nous pourrons, que nous ferons. C’est notre plus grande erreur que l’orgueil de nos espérances. Voilà Louis Buonaparte éloigné. C’est une grande épine de moins dans le pied de M. Molé. La marque, en restera, mais pour le moment, il n’en sent plus la piqûre. Entendez-vous dire que la session soit toujours pour le 15 Décembre ?
Vous êtes bien bonne d’attendre mes lettres avec impatience. Qu’ai je à vous mander ? Point de nouvelles. Mon affection n’en est pas une. De près, tout est bon, la conversation donne une valeur à tout. De loin, si peu de choses valent la peine d’être envoyées !
9. 1/2
Je ne comprends, rien à cette incartade. Est-ce en effet une intrigue cosaque ou bien seulement quelque commérage subalterne qui sera monté haut, comme il arrive souvent aujourd’hui ? Je penche pour cette dernière conjecture. En tout cas, vous avez très bien fait d’aller droit à M. Molé. Il est impossible qu’il ne comprenne pas l’absurdité de tout cela et n’empêche pas toute sottise, au moins de ses propres journaux. Ne manquez pas de me dire la suite, s’il y en a une. Quelles
pauvretés !
Je suis bien aise que vous ayez un N°2. Je vous renverrai demain la lettre de Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Je reçois je ne sais combien de lettres qui me demandent des détails sur cette pauvre Mad. de Broglie. Est-il possible qu’on soit contraint de rabâcher, sur un vrai chagrin. Adieu. G.
101. Val Richer, Samedi 28 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon dernier mot. Il sera court. Ni ma joie, ni mon chagrin ne sont bavards. Pourvu que je vous trouve bien portante ! Votre mal aise m’a préoccupé tout le jour. De quoi vous parlerais-je ? J’ajourne tout à mardi. Ce jour là, je n’aurai point encore de jury. Tout mon temps sera à moi. Pourquoi donc, est-ce que je vois encore dans les journaux que Lord Granville a été chez le Roi ? Est-ce qu’il n’est pas parti pour Aix ? J’attends Génie ce matin. Il vous aura vue. C’est quelque chose quelqu’un qui vous a vue, en attendant que je vous voie moi-même. Je laisserai mes enfants très bien et ma mère assez bien. La santé de ma mère, me préoccupe beaucoup. Elle est heureuse. Elle l’a si peu été ! Elle jouit vivement de l’affection de mes enfants. Ils remplissent son temps et son âme. La campagne lui plaît. J’espère que le soir de sa vie se prolongera au milieu de ces impressions douces. Et elle m’est si nécessaire pour mes enfants ! A travers beaucoup de petites choses qui manquent et qui m’impatientent quelquefois, toutes les grandes y sont et me donnent une sécurité habituelle que rien ne pourra remplacer. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu’après l’arrivée du facteur. Mais il sera ici probablement avant M. Génie. Adieu donc. à mardi, midi et demie
9 h. 1/2
Le facteur ne m’apporte pas de lettre. Je suppose que M. Génie me l’apportera dans une heure. Je veux bien de cet échange. Mais sans cela, je serais inquiet. En attendant, adieu, le dernier. G.
57. Val-Richer, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vendredi 13. 4 heures
Savez-vous que ce sera un supplice de vous écrire directement, du ton dont nous sommes convenus ? J’avais déjà tant de peine à me dire que ce que je vous disais ! Il faudra encore en rabattre, beaucoup. Aussi, je me décide pour aujourd’hui à la voie indirecte. J’abuserai de mon pauvre Génie. Du reste, je l’en ai prévenu hier à 6 heures en montant en voiture, et tout sera fait comme nous l’avons réglé. Mais dites-moi si vous le pouvez jusqu’où je puis aller par la voie directe et quotidienne. Vous m’avez donné une pierre de touche telle qu’en vérité, si je m’y conforme, je vous enverrai un bulletin de ma santé en vous en demandant un de la vôtre Des lettres qui puissent être lues par M. de Lieven ! Je n’en reconnais pas moins la nécessité. Durera-t-elle longtemps ? Serons-nous longtemps dans cette attente ? En tous cas, ce ne pourra être plus de 18 jours.
Je viens d’arranger mon départ avec toute ma maison. Tout est convenu. Le 30 nous irons coucher à Evreux et dîner le 31 à Paris. Je respire en vous disant cela, et j’en ai besoin, car depuis hier j’étouffe. J’ai étouffé cette nuit ce matin, jusqu’à ce moment. Je suis épouvanté de mon bonheur. Je ne sais plus m’en passer. Quel abyme insatiable que notre cœur! un abyme, comme celui d’un mélodrame que j’ai vu jouer autrefois, qui s’appelait le Précipice, et où l’on précipitait en effet l’innocent dans un abyme de 600 pieds sans fond. Oui, un abyme de 600 pieds sans fond. Voilà ce qu’est devenu pour vous mon cœur. Avant le 15 juin, si l’on m’avait fait entrevoir une correspondance un peu amicale, un peu régulière avec une personne comme vous une personne d’esprit, bien au courant du monde, j’aurais trouvé cela charmant ; je me serais promis au moins un jour très agréable par semaine. Pendant que vous étiez en Angleterre, si l’on m’avait dit que vous reviendriez bientôt en France, et que je ne passerais jamais un mois sans en passer cinq ou six jours avec vous, je me serais cru heureux. Et bien Madame; je ne le suis pas; je ne le suis pas malgré hier, malgré avant-hier, malgré la certitude que dans 18 jours, je retrouverai hier au moins hier, n’est-ce pas ? Je suis devenu insatiable, je resterai insatiable. Vous, vous dont la simple vue fait épanouir tout mon être dont la moindre parole me charme et qui avez pour moi des paroles dont le souvenir, le seul souvenir me plonge dans l’extase, vous ne pouvez pas me rassasier. il n’est pas en votre pouvoir d’apaiser, de combler mon âme. De vous, tout la ravit et rien ne lui suffit. Vous êtes pour moi une source de délices infinies, et moi, j’ai une puissance infinie pour les désirer, pour en jouir; et quelque heureux que je sois par vous, près de vous, je sens que je puis, que je dois l’être encore davantage; et j’aspire avec une ardeur infatigable à ce bonheur inépuisable qui me vient de vous et qui chaque fois qu’il me vient me promet plus encore qu’il ne me donne et m’inspire encore plus de désirs qu’il n’en satisfait, savez-vous ce qui sépuise ce qui se lasse en moi ? La parole. J’arrive d’un coup à ses limites, et là je m’indigne et mon cœur s’élance bien loin au delà. Mais vous n’êtes pas là pour l’entendre sans qu’il parle ; et en même temps que la parole lui manque, le silence lui pèse horriblement.
Samedi 9 heures
J’ai dormi longtemps, en me réveillant souvent. Chaque fois que je me réveillais, je me disais: à une heure et demie. Et il me fallait un réveil complet et une réflexion pour me détromper. On a bien de la peine à apprendre que les choses ne sont pas dans la vie comme dans le cœur. Le premier mouvement est toujours de croire à l’harmonie de ces deux mondes, tant celui du dedans est le monde vrai, le monde souverain. L’autre nuit en roulant dans cette voiture, le ciel était pur, la lune se répandait partout, vous deviez être là comme moi, jouir avec moi de cette lumière si douce et si pénétrante ; vous deviez sortir de ces longues ombres des arbres qui semblaient cacher quelque objet et s’avancer vers moi à mesure que je marchais. Ce matin, je ne marche pas, je suis dans mon cabinet à ma table, près de mon feu. Mais le soleil brille, la vallée où les feuilles commencent à tomber, laisse entrevoir des percées profondes où la lumière entre et se perd ; tout est beau et invitant devant moi, sous mes fenêtres, partout où se porte ma vue. Je vous vois partout, je vous mets partout, partout où quelque chose me plaît et m’attire. Ce matin, comme cette nuit, comme l’autre nuit, la réflexion seule m’apprend que vous n’êtes pas là. Il faut que je le découvre ! D’instinct, je vous crois avec moi, toujours avec moi.
J’ai trouvé tous les miens en bon état. Ma mère est mieux que je ne l’avais laissée ; mes enfants sont à merveille. Savez-vous que je ne jouis de leur présence, de leur joie, qu’avec un peu d’hésitation et de mélange ? Je voudrais vous en envoyer la moitié. Une impression à moi seul un plaisir à moi seul m’étonne presque comme un contresens. N’ayez jamais d’impression, de plaisir à vous seule ! J’en serais plus qu’étonné. Vous pouvez me pardonner cette exigence toutes les exigences. Je les aurai toutes. Mais j’en ai le droit, oui, le plein droit.
11 heures
Voilà votre n° 56. Oui éternellement adieu. C’est là que tous les sentiments s’unissent et se satisfont. Adieu. Adieu.
50. Paris, Mercredi 27septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah, je respire, le 6 je vous verrai ; quelle bonne parole ! Quel bon accueil répété elle a valu à votre lettre ce matin. Que j’ai besoin de vous, de vos conseils de votre courage, mais par dessus tout de votre cœur, de votre cœur tout entier. Je ne sais de quoi je suis menacée mais voici encore une lettre de M. de Lieven. La mienne lui manquait toujours encore, deux plus fraîches que celle-là lui étaient parvenues, il renouvelle ses instances, & me dit encore : " Je serai contraint de prendre des résolutions auxquelles il me répugne de recourir." & plus loin " Je te supplie de peser mûrement ce que tes devoirs d’épouses & de mère te commandent de penser à ton avenir comme à ton présent." Mais mon Dieu que veut-il dire ? Serait-ce une séparation qu’il demanderait : Quoi ? Parce que je reste malade à Paris ? Vraiment ma raison se refuse à croire à une pareille barbarie. & cependant que veulent dire ces mots ? Je vais les transcrire en écrivant à mon frère, & me mettre complètement sous sa protection.
Au commencement de l’année 35 à Pétersbourg avec mes deux enfants bien portants, tous les honneurs tous les biens de la terre, moins la faculté physique & morale de m’accoutumer à cet horrible pays, je répétais cent fois à mon mari si cela finira par une catastrophe." C’est moi qui croyais finir. Vous savez les malheurs qui m’ont frappé, & en effet tout a été fini pour moi. Aujourd’hui encore je répète cela finira par une catastrophe, je ne savais laquelle mais il faut un dénouement à une situation aussi menacée et je vis sous le coup de cette attente. Tous les jours je puis voir éclater l’orage. J’ai vous, votre affection pour me soutenir. Ma ferme volonté de tout supporter plutôt que de vous quitter, & cependant Monsieur voyez à quoi je puis être exposée !
C’est vendredi qu’est le 6. Ah comme je l’attendrai ! Hier ma promenade a été courte. Il m’a pris la fantaisie d’aller dans des boutiques de vieilleries après, il était trop tard pour le bois de Boulogne j’ai marché dans les Champs Elysées J’ai été chercher des fleurs chez Mad. de Flahaut. Je suis allée embrasser lady Granville au moment où elle descendait de voiture. J’ai dîné chez Pozzo avec toute l’Europe ce que nous autres orthodoxes appelons la bonne Europe. M. Molé, qui devait y être a écrit pour dire qu’il était malade. J’ai beaucoup joui de l’esprit de Pozzo à dîner. Il en a extrêmement, et la vanité la plus simple du monde. Il croit très naturellement qu’il n’y a pas d’homme qui le vaille et il le dit très naturellement aussi. Cela est si établi dans son esprit, que je me suis surprise à me demander, s’il avait peut-être raison. Il m’a dit cependant une grande sottise. "Je n’ai jamais rien emprunté chez les autres. " Il n’y a que Dieu qui n’ait pas besoin d’autres.
Les tracasseries élevées par le roi de Würtemberg donnent bien de l’humeur et de l’embarras ici. Le mariage se fera quand même. Mais il ne sera pas reconnu en Wûrtemberg, quelle ridicule affaire ! C’est tout bonnement du crû du roi, mais je ne doute pas qu’on ne nous l’attribue encore. Il était dix heures lorsque je suis sortie de chez Pozzo, & j’y laissai tout le monde. J’allai chez lady Granville d’abord un long tête-à-tête avec Mylord dans son Cabinet, & puis elle avec mille questions ; & bien des conseils d’amitié. Les journaux l’ont indiqué, je voudrais pouvoir les oublier.
Je me suis couchée hier vers minuit à 8 1/2 votre lettre était dans mes mains et mieux que cela ! Elle m’a été remise en même temps que celle de mon mari. Hier je l’avais reçu avec celle de Thiers, & du prince Talleyrand. Vous comprenez qu’il n’y en a qu’une que je lie dans mon lit. Et mon Dieu, celles de M. de Lieven je n’en suis jamais pressée ! Je voudrais que vous fussiez là, je vous les remettrais & puis vous me les liriez avec quelques commentaires qui m’adouciraient les expressions ou le sens. Enfin vous me donneriez de la force. Je pleurerais auprès de vous. Ce serait si doux !
Monsieur, je vous ai vu étonné quelques fois de la terreur que m’inspire mon mari. rappelez-vous que j’avais quatorze ans quand je l’ai épousé, qu’il en avait douze de plus que moi, et qu’il est très naturellement devenu mon maître parce que j’étais à peu près un enfant. J’ai senti depuis, & bientôt même l’avantage que j’avais sur lui mais cette première impression est restée, et je tremble, oui je tremble quand je reçois ses lettres. Tenez aujourd’hui j’ai vraiment le frisson. C’est bien mauvais pour mes nerfs. Il ne sait pas le mal qu’il me fait, & s’il le savait peut être s’en réjouirait-il ! Ah Monsieur je n’ose pas vous dire que je suis malheureuse, & cela ne sera même pas exact, parce qu’il y a au fond de mon cœur un sentiment de bonheur, de bonheur du Ciel, mais cependant J’ai un chagrin bien grand, une angoisse de tous les instants qui troublent bien ce bonheur quand vous êtes là, quand vous serez là ah c’est autre chose.
Le 6 viendra-t-il bientôt ? Je vous remercie de m’avoir donné le délai de tous vos dîners, n’allez pas avoir d’accident en allant & venant ; vos routes sont mauvaises, les nuits sombres prenez bien des précautions, je vous en prie. Quel insupportable homme que votre Alexis de St Priest. Il a de l’esprit, mais sa manière est la plus insolente la plus arrogante que j’ai jamais rencontrée. Il était si odieux, à toutes les personnes qui le rencontraient chez moi, qu’il m’a été impossible de l’encourager à y revenir. Et puis c’est une commère ! Si vous voulez que je l’aime cependant Je l’aimerai. Il commence à faire froid. Quand comptez vous établir votre famille à Paris ? Ah revenez tous, il n’y aura que cela de bon.
Adieu Monsieur adieu. il me semble impossible de rien dire qui vaille un adieu quand il est comme les miens, quand j’y appuie avec tant de tendresses. Adieu.
47. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai besoin de vous parler. Vous n’êtes pas là. Vous ne m’entendez pas. Ce que je vous dis n’ira à vous que dans deux jours. Mais j’ai besoin de vous parler. Vous avez eu un tel accès de désespoir ! Pardon dearest, pardon ; ma première impression n’a pas été toute pour vous, pour vous seule. Je vous ai vue désolée, sanglotant. J’ai été navré. Mais au même instant un mouvement de tristesse toute personnelle s’est élevé en moi. Quoi ? Je ne suis pas encore parvenu à vous donner plus de confiance dans ma tendresse ! Ma tendresse n’a pas sur vous plus de pouvoir ! Vous ne savez pas tout ce que vous êtes pour moi, tout ce que j’ai dans le cœur pour vous. Mais moi je le sais ; je le sens. Quelque fois encore, je m’en étonne ; je me demande si c’est bien vrai. Et ce que je me réponds à moi-même, je vous l’ai dit ; je vous le redis tous les jours. Moi aussi, Madame, j’avais enfermé mon âme dans un tombeau. Vous l’en avez fait sortir. Vous l’avez appelée, et elle est venue à vous ; elle a ressuscité devant vous. Quelle marque d’affection peut égaler celle-là ? Savez-vous quel bonheur j’avais possédé, j’avais perdu ? Savez-vous que si l’on m’eût dit : - Il y a sur la terre une créature, qui peut vous rendre une heure de ce bonheur - j’aurais souri, avec le plus incrédule dédain ? Et que, si l’on m’eût dit aussi : - cherchez dans le monde entier une épingle perdue, si vous la trouvez, vous retrouverez une heure de votre bonheur je serais parti, à l’instant même ; j’aurais cherché toute ma vie pour courir après cette imperceptible chance ? Voilà où j’en étais Madame, avant le 15 Juin. Voilà quel chemin j’ai eu à faire pour arriver à vous, pour vous dire ce que je vous dis aujourd’hui. Est-ce assez pour que j’aie sur vous la puissance d’écarter le désespoir, d’arrêter les sanglots ? Est-ce assez pour que vous ayez foi, en moi ? Et vous croyez que je ne supporterais pas vos sanglots !
Je supporterais tout, tout, Madame pour combattre, pour adoucir un moment votre peine. J’ai bien supporté de voir mourir, mourir lentement les créatures que j’aimais le mieux au monde ; je n’ai pas cessé un instant de les regarder, de leur parler pour que le sentiment de ma tendresse se mêlât à leur angoisse, à leur dernier souffle et qu’elles l’emportassent en me quittant. Et ce qui m’a donné, ce qui je crois me donnerait encore ce courage, c’est que j’ai, de la puissance d’une affection vraie et des souveraines douceurs qui y sont attachées, une si haute idée qu’il me semble que le plus grand bien qu’on puisse faire à une créature désolée à une créature qui souffre, c’est de lui répéter sans cesse. Je l’aime ! Je l’aime ! Pour moi, je ne connais point de douleurs que ces mots d’une bouche chérie n’aient la vertu de calmer.
Mardi 7 h. 1/2 Je ne comprends guère comment, dès le 5 sept., aucun commérage aurait pu parvenir à Carlsbad. Il faudrait qu’on sy fût pris de bien bonne heure. Du reste, je crois à beaucoup de malice et de trahison possible. Les passages que vous me transcrivez me tourmentent beaucoup. Il faut attendre l’effet du comte Orloff. C’est sur cela que vous comptez, que nous comptons une chose me déplaît extrêmement dans tout ceci, c’est de ne pouvoir me faire une idée du pays,des mœurs, de l’état social, des caractères qui le rendent possible. Je me rappelle l’indignation où nous étions de ce que l’Empereur Napoléon ne voulait pas souffrir que Mad. de Stael habitât Paris. Et pourtant quelle différence ! Il y avait pour lui un motif, un motif, sérieux.
La conversation, le salon de Madame de Stael auraient été pour lui un véritable embarras. Mais ici, quel intérêt peut-on avoir à vous faire sortir de France ? Quel inconvénient entraîne votre séjour ? Une pure fantaisie. Cela déplaît. Vous ne faites pas tout ce qui plait. Quel misérable et terrible enfantillage ! J’ai bien envie de crier : vive la Charte !
Je reviens à M. de Lieven. Que lui répondez-vous ? Vous avez, avec lui, comme avec l’Empereur, comme avec tout votre monde, une situation faite, déterminée. Vous vous y êtes bien positivement établie et dans vos entretiens de Londres avec le comte Orloff et dans les lettres à lui et à M. de Lieven que vous m’avez montrées. Vous devez, ce me semble vous y maintenir tout simplement. Les hésitations, les agitations, même purement apparentes de langage seulement rendent tout beaucoup plus difficile. Une résolution simple. claire, clairement exprimée et tranquillement maintenue, coupe court à beaucoup d’embarras, non seulement au fond, mais dans la forme. Car je ne mets pas le fond en doute ; c’est de la forme et des embarras extérieurs qu’il s’agit. C’est à cela qu’il faut pourvoir. Nous en causerons bien complètement le 6 octobre. J’attends de jour en jour l’ordonnance de dissolution.
Ma mère est beaucoup mieux. A moins de nouvel accident, je ne puis penser à lui proposer de revenir plutôt à Paris. Elle se trouve bien ici. Ma mère est à l’age où l’on a un égal besoin de distraction et de repos. La campagne lui donne l’un et l’autre. Il y a une foule de petits intérêts, de petits soins qui l’amusent; et l’égalité de la vie, le silence de l’atmosphère, la paix de tous les aspects qui l’environnent lui assurent cette espèce de quiétude morale qui dépend, pour les vieillards des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés. Si l’indisposition de ma mère reparaissait un peu sérieusement je n’hésiterais cependant pas à la ramener tout de suite à Paris. Mais comme elle en serait, fort contrariée, il y faut une vraie nécessité.
11 heures Voilà le N° 48. Qu’il est triste et si bon, si doux ! Je me console un peu en pensant que vous serez, que vous êtes déjà, un peu consolée. Vous avez une date. Nous avons une date. Il y a encore dans ce n°48, une bien mauvaise, une bien coupable parole. Je n’y reviens pas aujourd’hui. Mais j’y reviendrai. Dearest, ne me mettez rien sur le cœur. Il y a tant de choses dedans ! et toutes pour vous ! Adieu. Adieu. Adieu me plaît, mais ne me suffit pas. G.
46. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est à peine six heures. Le Soleil n’est pas encore au dessus de l’horizon. J’ai mal dormi. Je me lève. Hier en me couchant, à 10 heures et demie, je me suis figuré dans la malle-poste au lieu de mon lit courant vers vous. A peine endormi, j’ai rêvé dans la malle-poste. A quatre heures, je me suis réveillé comme si j’arrivais. Ce devait être aujourd’hui en effet. Vous en avez douté quand je vous l’ai dit. Vous avez prévu que ce ne serait pas. Dearest, voici l’exacte vérité. Je n’en étais pas sûr. Le jour du mariage de M. Duchâtel n’était pas absolument fixé. Il m’avait parlé du 25 septembre au 2 ou 3 octobre. J’ai été faible pour moi, faible pour vous. J’ai pris la supposition favorable sans y compter, pour nous faire plaisir à tous deux, pour ne pas nous donner tout à coup, à vous un chagrin, à moi le vôtre, et le mien. J’ai eu tort. On a toujours tort, avec la personne à qui l’on dit tout, à qui l’on doit tout, de ne pas dire exactement ce qui est ce qu’on croit. Il faudrait toujours braver la peine du moment pour éviter la peine à venir. Pardonnez- moi de ne l’avoir pas fait.
Votre n°46 m’a touché, et me touche profondément ; si triste et si douce ! Si vive et si raisonnable ! Le jour où j’ai un peu causé avec la petite Princesse elle m’a dit deux ou trois fois, en me parlant de vous : « une personne si supérieure, si extraordinaire". A chaque fois ces paroles me pénétraient, me charmaient ; d’orgueil si on veut, mais de ce délicieux orgueil qui naît d’une tendresse infinie, au dessus, bien au dessus duquel cette tendresse plane, dont elle fait le pouvoir et le prix.
Oui, je suis fier, fier de vous, de votre affection pour moi de votre supériorité, de cette supériorité que je connais mille fois mieux que personne dont je jouis comme personne n’en a jamais joui. Et quand je la retrouve dans les plus petits détails de la vie, quand je vois réunies en vous les qualités, les attraits les plus contraires, tant d’abandon et tant de dignité, un cœur si tendre et un esprit si ferme, une imagination si vive et une raison si droite, un caractère si passionné et si doux, une humeur si égale avec des impressions si variées, je suis heureux, heureux, Madame, bien, bien au delà de tout ce que peuvent vous exprimer de loin mes lettres, et même mes adieux.
Maintenant, voici où j’en suis et ce qui sera. Le mariage de M. Duchâtel n’étant plus rien pour moi j’ai pris la dissolution. Elle sera certainement prononcée et publique dans les premiers jours d’Octobre au plus tard. J’ai un dîner chez moi au Val-Richer, demain 26. Après-demain 27 je vais dîner à Croissanville, à 4 lieues d’ici, avec une réunion d’électeurs. Du 27 au 2 octobre, je ferai quelques courses dans l’intérêt des élections voisines. Je recevrai beaucoup de visites. Le 3 octobre encore un dîner pour moi, et une réunion d’électeurs à Mézidon, dans ce canton que je n’ai jamais visité. Le 4 un dîner à Lisieux, point un meeting, un dîner privé, mais avec beaucoup d’électeurs. Le 5 à 1 heure et demie je monte dans la malle-poste, et le 6 à 4 heures du matin, je passe dans la rue de Rivoli, pour faire le même jour, à une heure & demie quelque chose de mieux que d’y passer.
Voilà, d’ici là ma biographie et mon itinéraire. C’est long, bien long. Je ne demande qu’une chose, dearest, une seule chose. Soyez sûre, sûre aujourd’hui comme vous le serez dans deux ans, dans trois ans, que c’est aussi long pour moi que pour vous. Ne dites donc pas que vous me contez trop de petites choses, que vous me donnez trop de détails. Jamais assez. Au milieu du grand bonheur, c’est mon petit, mais très vif plaisir de vous suivre pas à pas dans tout le cours de la journée, d’assister à toutes vos actions, d’heure en heure. Il y en a une que je regrette, qui m’a un peu désagréablement ému le cœur. Vendredi soir vous avez fait de la musique devant votre monde ; et moi, je ne vous ai pas encore entendue. Je ne veux pas, la première fois, vous entendre devant du monde ; mais je voulais avoir votre première musique, à moi seul. Vous ne savez pas à quel point la musique me plaît, m’émeut. Mais c’est pour moi une impression très intime, et qui se lie tout de suite à mes impressions les plus intimes, une de ces impressions dont je n’aime pas à parler excepté à la personne à qui je parle de tout. Je vous aurais si délicieusement écoutée !
J’attends ce matin, M. de Saint-Priest, Alexis, qui vient passer ici 24 heures. Il m’en dira long sur Lisbonne, les Chartistes, Lord Howard de Walden, Saldanha, Sä de Bandeira & & J’ai recommencé hier au soir à lire à mes enfants un romans de Walter Scott. Je vous le dis pour vous montrer que j’ai complètement repris l’usage de ma gorge. Je suis ravi que vous ayez aussi bien retrouvé celui de vos jambes, Certainement c’est une preuve de force.
11 heures Le N° 47 me désole de mille façons, toutes si douloureuses. M. de L., votre chagrin, votre manque de foi, votre santé. Mes lettres suivantes vous auront été un peu meilleures. Celle-ci vous donne une certitude, de voyage, de jour. Si vous saviez que je n’ai pas pensé, que je ne pense pas à autre chose. Croyez-vous donc que je n’ai pas pensé à emmener ma mère à Paris ? Mais elle est mieux et se trouve bien ici. Je vous répondrai demain avec détail. Adieu. Adieu. Soignez-vous, je vous en conjure. Adieu. G.
47. Paris, Dimanche 24 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Quel triste réveil. Votre lettre, vous savez ce qu’elle contenait cette lettre ? Point de noce. Votre mère malade. Vos occupations électorales en province, pas la plus légère espérance d’une course à Paris, et tout cela m’arrive le jour où devait tenir pour moi tant de bonheur !
En même temps, je reçois deux lettres de mon mari dont je vous transmets les passages importants dans la première du 5 Sept. il me dit : "Tu me fais de nouvelles propositions sur un voyage de circumnavigation pour te rencontrer au Havre ! S’il n’existait pas des entraves insurmontables à une telle entreprise, j’y aurais pensé à deux fois d’après les allusions qui ont été faites à ce sujet à mon passage par Carlsbad. Ce sont les conséquences nécessaires d’une fausse position trop prolongée. Il est urgent qu’elle subisse une modification d’un côté ou de l’autre."
Dans la seconde lettre du 10 Septembre " Ton N°356 m’est parvenu hier, le précédent n’est point entré encore. C’est pour cela peut-être que celui-ci ne m’est point intelligible. Tu sembles avoir reçu la lettre par laquelle je te demandai de me faire connaître ta détermination. Je suis dans l’obligation d’insister sur une réponse catégorique, car je dois moi-même rendre compte des déterminations que j’aurai à prendre en conséquence. Je t’exhorte donc à me faire connaître sans délai, si tu as intention de venir me rejoindre on non. Je dois dans un délai donné prendre une résolution quelque pénible que puisse m’être une semblable nécessité."
Que direz-vous Monsieur de tout cela ? Il est évident par la première, que des commérages ont voyagé jusqu’à Carlsbad ; & par la seconde qu’il a pris envers l’Empereur l’engagement de me forcer à tout prix à quitter Paris ? Voilà où j’en suis. Savez-vous ce qui arrivera ? L’Empereur lui permettra de venir sous la condition expresse de m’emmener et lui viendra avec empressement, incognito me surprendre. Car voilà sa jalousie éveillée, & je le connais. Il est terrible. Il est clair qu’il ne croira pas un mot des certificat du médecin. Car il me dit dans une autre partie de sa lettre " il est plaisant de remarquer que les médecins de Granville le renvoient de Paris, & que les tiens t’ordonnent d’y rester, ils sont complaisants, avant tout." Si, si ce que je crois arrive, c’est sur la mi octobre que mon mari serait ici. Qui me donnera force & courage ? Je suis bien abandonnée.
Ma journée hier a été plus triste que de coutume. Votre lettre m’avait accablée. J’ai eu de la distraction cependant, le prince Paul de Wurtemberg pendant un temps, qui m’a fait le récit de tous les embarras existants encore pour le mariage. Mon ambassadeur en suite. Ma promenade d ’habitude au bois de Boulogne, mais tout cela n’y a rien fait ; à dîner il m’a pris d’horribles souvenirs. Je n’étais qu’à eux, à eux comme aux premiers temps de mes malheurs. Tout le reste était à la surface tout, oui vous-même. Le fond de mon cœur était le désespoir, je ne trouvais que cela de réel. Je demande pardon à ces créatures chéries d’avoir
été si longtemps détournées de mon chagrin. Je demandais à Dieu comme le premier jour, de me réunir à eux dans la tombe, dans le ciel, tout de suite dans ce tombeau. Je n’entendais & ne voyais rien, Marie parlait je ne l’écoutais pas et tout à coup des sanglots affreux se sont échappés de
mon coeur. Vous ne savez pas comme je sais pleurer. Vous ne pourriez pas écouter mes sanglots, ils vous feraient trop de mal.
J’ai quitté la table, j’ai pleuré, pleuré sur l’épaule de cette pauvre Marie qui pleurait elle-même sans savoir de quoi. J’ai ouvert ma porte à 9 h 1/2. Je n’ai vu que mon ambassadeur & Pozzo.
Ma nuit a été mauvaise, & mon réveil je vous l’ai dit.
Midi
Qu’est-ce que votre mère vous donne de l’inquiétude, puisque le cas de la dissolution échéant vous pourriez être forcé de la quitter pendant quelques jours ne serait-il pas plus prudent, & plus naturel de la ramener à Paris, d’y revenir tous, de vous y établir. Cette question ne vous est-elle pas venue ? L’été est fini, la campagne n’est plus du bénéfice pour la santé.
Un courrier de Stuttgard a posté au prince de Wurtemberg défense de conclure le mariage à moins qu’il ne soit stipulé que tous les enfants seront protestants. La Reine exige qu’ils soient tous catholiques, le prince se conforme à cette volonté qui est celle de la princesse aussi, & il a écrit au roi de Würtemberg en date du 19 par courrier français qu’il passerait outre si même le Roi n’accordait pas son consentement. Dans ce dernier cas cependant il est évident que le ministre de Würtemberg n’assisterait pas à la noce & que cela ferait un petit scandale. Le prince Paul jouit de tout cela. Il abhore son frère. Hier il a dîné à St Cloud
pour la première fois depuis 7 ans.
Je cherche à me distraire en vous contant ce qui ne m’intéresse pas le moins du monde. Adieu Monsieur, dès que je suis triste, je suis malade, j’espère ne pas le dernier trop sérieusement. Je voudrais me distraire, je ne sais comment m’y prendre.
Dites-moi bien exactement des nouvelles de votre mère, & dites-moi surtout, si vous n’auriez pas plus confiance dans le médecin de Paris & les soins qu’elle trouverait ici.
Adieu. Adieu toujours adieu.
45.Val-Richer, Samedi 23 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
44. Val-Richer, Vendredi 22 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Savez-vous que je n’ai pas seulement des ennemis, mais aussi des amis qui s’occupent beaucoup de mes fréquentes visites, de nos longues conversations, et qui s’en inquiètent un peu ! Ils se disent entre eux que certainement il y a de la politique là dessous, de votre part, comme de la mienne, de ma part comme de la vôtre. Nous sommes l’un et l’autre spirituels, habiles ; nous avons l’un et l’autre pris part, et point renoncé sans doute aux affaires de ce monde. Est-ce que je me disposerais à changer de politique à devenir russe au lieu d’anglais à ressusciter la sainte au lieu de la quadruple Alliance ?
Il faut que j’y prenne bien garde. J’ai besoin de ménager les sentiments, les habitudes, les préjugés de mon pays que j’ai déjà heurtés plus d’une fois, bien qu’avec raison, pour l’administration intérieure. Et puis, quand j’entre dans une relation politique importante, significative, je devrais en parler à mes amis politiques, leur dire ce que je veux, ce que je fais, les tenir au courant enfin, car leur cause est la mienne ; nos intérêts, nos destinées sont les mêmes. Ils me sont ; ils me seront très fidèles. Ils voudraient bien être toujours instruits. Cela se dit très doucement très affectueusement. Cela me revient indirectement. J’y réponds et j’y répondrai très simplement souriant un peu, disant de vous un peu de ce que j’en pense, rassurant mes amis sur la fixité de ma politique comme sur l’étendue de ma confiance en eux et gardant bien du reste ma liberté, que je n’ai jamais livrée. J’admire toujours à quel point les hommes, même des hommes distingués, prônent le côté petit et tortueux des choses, au lieu du côté simple et grand et à force de chercher finesse, s’en vont à cent lieues de la vérité.
Samedi matin, 6 heures
Je me lève. Voilà une heure et demie que j’essaie en vain de me rendormir. On dit que la faim empêche de dormir. J’ai faim. Vous me parlez du bonheur qui me reste et m’entoure. Vous me dîtes que j’en sais jouir. Vous avez raison. Je n’ai jamais dans mes plus cruels moments, méconnu le prix de ce qui me restait. Je ne m’y suis jamais senti indifférent. Je ne me suis jamais permis de me dire à moi-même que j’y pouvais être indifférant. Je me serais cru coupable envers Dieu, plus coupable envers ces créatures qui m’aiment, m’aiment beaucoup, & qui ont droit non seulement que je les aime, mais que je me trouve heureux de ce quelles m’aiment. L’affection veut donner du bonheur, et souffre et s’offense quand elle n’en donne pas. Je sais tout cela. Bien plus, je le sens ; et naturellement, sans effort, je jouis en effet de l’affection de mes enfants, de ma mère, de mes amis ; et je leur montre que j’en jouis, et j’espère qu’ils le croient, j’en suis sûr.
Mais laissez- moi, Madame, être avec vous parfaitement sincère, c’est-à-dire vous montrer toute mon âme. C’est en cela, pour moi, que la parfaite, sincérité consiste. Aux autres, je ne mens point, mais je ne dis pas tout. Ces relations, ces affections, ces joies qui me restent, en même temps que je les ai toujours senties, je ne me suis jamais donné, je n’ai jamais pu me donner le change à moi-même sur leur importance pour moi, sur leur place en moi. Je ne voudrais pas même en vous parlant à vous seule, même avec la certitude que nul autre ne verra jamais ce que je vous dis, je ne voudrais pas dire un mot qui fût injuste qui fût offensant pour ces sentiments et ces bonheurs là. Mais il ne leur est pas donné de pénétrer jusqu’au fond de mon âme, de remplir ma vie, d’être mon âme et ma vie. Ils animent, ils embellissent la région où ils se passent, mais cette région est pour moi celle du monde extérieur et non pas la mienne propre ; c’est une région où je me promène, et non pas cette où j’habite.
Voltaire fait quelque part dans La Henriade, je crois la description du système céleste, de toutes les planètes, de tous les astres, de leur hiérarchie, de leur immensité. Il les nomme, il les compte, les compte encore ne parvint pas à les épuiser. Au dessus, au delà de ceux qu’il a nommés, qu’il a comptés.
Sont des soleils sans nombre et des mondes sans fin.
Par delà tous les lieux, le Dieu des lieux réside.
Pardonnez-moi la pompe de cette image. C’est la seule où je reconnaisse vraiment la disposition de mon âme, et ce qui s’y passe. On peut me parler d’une foule de liens, d’affections, de jouissances ; on peut en décrire la force et la douceur. Je le reconnaîtrai, je le sentirai avec ceux qui le diront. Mais par delà tous ces lieux, le Dieu des lieux réside. Et ce n’est point là pour moi, Madame une volonté un parti pris, pas plus qu’une impression de jeunesse une fantaisie d’imagination. C’est le fait, le fait pur et simple, le fait constant pour moi, en moi soit que je l’ai possédé, soit qu’il m’aie manqué un seul sentiment, un seul bonheur, a toujours été pour moi le Dieu des lieux. Je vous le disais avant le 15 Juin, et vous ne vouliez pas me croire. Je vous le redis aujourd’hui. Croyez-moi ; et ne me parlez d’aucune compensation ; et gardons ensemble nos regrets, nos regrets justes & sacrés. Et soyez bien sûre que je sens comme vous les vôtres ; bien sûre que je donnerais je ne sais pas quoi pour vous voir entourée des joies qui me restent. Mais ne mettons rien, joies ou regrets, à côté de ce qui est au delà, et au dessus de tout. Ah, que ne passons-nous notre vie ensemble ! Ce que je vous dis là, je vous le ferai voir.
4 heures Votre lettre m’arrive tard. J’ai là M. Duvergier de Hauranne, dans mon cabinet. La cloche du déjeuner sonne. J’aurais tant de choses à vous dire ! Une seule, une seule aujourd’hui. Au nom de Dieu, ne soyez pas malade. J’ai besoin de votre santé comme de... Adieu. Adieu. Un adieu sans pareil, si cela se peut. G.
Ma mère est un peu mieux ce matin.
43. Val-Richer, Vendredi 22 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me réveille bien triste. Je l’étais hier au soir. Je le serai souvent. Hier en vous écrivant, j’étais surtout préoccupé d’une injustice possible de votre part. Aujourd’hui, je le suis bien plus du chagrin même. M. Duvergnier de Hauranne est arrivé. M. Duchâtel ne se marie que le 2 octobre et il se marie sans mariage, absolument sans personne que les parents et les témoins nécessaires. En sortant de l’église, il va passer quelques jours à Meudon, et de là, il part pour Mirembeau, en Saintonge où est sa terre.
Je n’ai donc là, ni motif, ni prétexte. J’en attends un autre. Vous recevrez cette lettre-ci dimanche. Vous attendiez mieux le jour là. Quand vous me partez de vos longues journées, de votre impatience de les voir couler, j’éprouve un sentiment analogue à celui que j’éprouve quand vous m’écriviez d’Angleterre vos inquiétudes, vos douleurs de n’avoir pas de lettre. Pardonnez-moi encore, Madame ; ma première impression est une joie profonde de cette tendresse si vive. La peine ne vient qu’après. Je jouis pour moi avant de souffrir pour vous. Quand vous étiez en Angleterre, quand vos lettres m’arrivaient exactement, et non pas les miennes à vous, je souffrais pour vous. Aujourd’hui, quand je ne pars pas, c’est pour vous et pour moi j’aime mieux dire pour nous, que je souffre.
Quand viendra, la dissolution ? J’établis autour de moi, dans la conversation, qu’elle n’obligera probablement d’aller passer trois au quatre jours à Paris. Mais nous sommes à la merci de l’événement, à la merci des nécessités électorales du pays qui m’entoure. Que de chaines nous portons. J’en ai secoué beaucoup. Il en reste encore énormément.
J’ai ma mère souffrante ce matin. Elle est sujette à des étourdissements, à des vertiges qui pourraient devenir quelque chose de plus grave. On est venu m’avertir au moment où je me levais. Je sors de chez elle. Elle vient de prendre un bain de pieds avec beaucoup de moutarde. Elle est mieux. J’espère que ce ne sera rien du tout. Je lui ai vu plusieurs fois ces petits accidents, et ils ont toujours disparu devant des remèdes, fort simples Mais elle va avoir 73 ans. J’aime beaucoup ma mère. Je lui dois beaucoup. Et personne ne la remplacerait auprès de mes enfants. Elle est avec eux d’une tendresse, d’une assiduité, d’une vigilance inquiète qui fait presque tout ce qui me reste de sécurité. Quand j’avais mon fils, ma sécurité était infiniment plus grande. Tout homme et tout jeune qu’il était, j’étais sur qu’à mon défaut il soignerait, il élèverait ses sœurs et son fière avec une affection, une attention paternelle. Et il était plein d’esprit, de sens, d’activité sérieuse, de tout ce qui fait qu’on peut être à la tête d’une famille. Aujourd’hui moi manquant ma famille, si jeune, resterait comme un faisceau sans lin, un troupeau sans berger. C’est une forte attache que de se sentir nécessaire. Mais c’est aussi un pesant fardeau.
Je vous parle de ma famille. Ne vous arrive-t-il pas quelques fois d’être dans cette disposition où l’on n’ose pas, où l’on ne veut pas ne [?] que sur un seul sujet, sur le sujet intime qui remplit l’âme, et où cependant l’on ne pourrait souffrir de parler de choses indifférentes ? On va alors à ces choses qui sont beaucoup quoiqu’elles ne soient pas tout, à ces intérêts qui tiennent vraiment au cœur quoiqu’ils n’en occupent pas le fond. Ce n’est pas l’intimité personnelle exclusive, c’est encore de l’intimité et qui a quelque douceur.
11 heures
Votre n° 44 m’arrive une demi heure plus tard que de coutume. C’est long, une demi-heure ! Mais le dédommagement est immense, charmant. Ne me gâtez pas trop. J’ai tant de plaisir à croire tout ce que vous me dîtes ! Nous avons besoin pourtant de nous gâter l’un l’autre jusqu’à ce que nous nous retrouvions. Ah, que je voudrais trouver quelque parole qui vous apportât ce que j’ai dans l’âme ! Adieu. Adieu, un adieu triste est au moins aussi tendre qu’un adieu. satisfait. Adieu. G.
354. Londres, Mercredi 29 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Le petit comité de Holland house s’est transformé hier en 14 ou 15 personnes. Toujours au grand déplaisir de Lady Holland dit-elle ! Elle continue de me soigner comme un enfant favori. J’avais Lord Melbourne et Lord John Russell. Nous avons causé. La conversation est difficile avec Lord John ; elle est très courte. Je vois que M. de Metternich est extrêmement préoccupé de Naples de notre médiation autant que de ce qui a fait notre médiation. L’Angleterre et la France sont bien remuantes. Il n’y aura jamais de repos, en Europe tant qu’elles y seront. En sortant de Holland house, j’ai été un moment chez Lady Tankerville. Elle avait déjà vu Lady Palmerston arrivée à 5 heures. Leur intimité est grande. Elle croit au mariage de Lord Leveson et de lady Acton. En savez-vous quelque chose ?
Une heure
340. Londres, Samedi 11 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’est pas le moins du monde question de la translation du corps de Napoléon en France. M. Molé me paraît peu au courant des Affaires étrangères. Car ici je ne vois pas pourquoi il mentirait. Du reste je ne suis pas surpris qu’il soit peu au courant. On ne l’aimait pas du tout dans le département, et parmi les gens qui y restent toujours, je n’en sais aucun qui prenne soin de l’instruire.
L’Angleterre a fait le geste pour Naples ; à l’heure qu’il est, l’amiral Stopford doit avoir saisi des bâtimens napolitains et les avoir envoyés à Malte où ils resteront en dépôt jusqu’à l’arrangement. Lord Palmerston est pourtant un peu préoccupé des conséquences possibles du coup. Nous nous emploierons à les prévenir et à amener un accommodement.
J’ai renoncé, bien contre mon goût et mon naturel, à la prétention de tout régler d’avance et pour longtemps. Mais pour ceci et dans les limites que je vous dis c’est parfaitement décidé. Il n’y a donc rien là, absolument rien qui dérange nos projets ni qui puisse nous causer aucun mécompte. Tenez pour certain que sauf les plus grandes affaires du monde ce qui ne se peut pas à Londres à cette époque.
Je serai à Paris d’octobre en Février avec ma mère et mes enfants. Il faudrait donc que je ne les fisse pas venir du tout d’ici là ce qui leur serait et à moi aussi un vif chagrin. Ils viendront donc en Juin, Notre seul dérangement portera, sur nos visites, de châteaux qui en seront, nullement supprimées mais un peu abrégées. Ces visites-là seront pour moi une convenance et presque une affaire. Ma mère le sait déjà et en est parfaitement d’accord. Je ne la laisserai pas seule à Londres. Mlle Chabaud viendra l’y voir au mois d’aout. Je ferai donc des visites, nos visites seulement un peu plus courtes. Il faut bien quelques sacrifices. Je voudrais bien sur cela, n’en faire aucun.
Que signifie cette phrase : "Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi "? Si vous parlez de mes devoirs, de mes premiers devoirs vous avez raison. Est-ce là tout ? Dites-moi. Et puis dites-moi aussi que vous vous associez à mes devoirs, et que vous m’en voudriez de ne pas les remplir parfaitement.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Famille Guizot, Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Protestantisme, Relation François-Dorothée, Religion, Réseau social et politique, Salon, Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)
Paris, le 4 avril 1848, Madame de Mirbel à François Guizot
Mots-clés : Amis et relations, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Enfants (Guizot), Exil, Famille Guizot, Famille royale (France), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1848 (Révolution de février)), France (1848-1852, 2e République), Mort, Politique (France), Portrait, Portrait (François), Réception (Guizot), Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel), Souvenirs
310. Val-Richer, Mercredi 6 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Depuis quelques jours, je vois avec bonheur croître le chiffre de notre correspondance. Il touche à son apogée. Il se reposera là bien longtemps.
Les journaux que j’ai repris attentivement hier, ne parlent d’aucun accident dans la mer du Nord. La traversée n'est pas longue. Je compte que vous me donnerez au premier jour des nouvelles d'Alexandre. Je ne veux vous retrouver ni triste, ni malade. Il y a pourtant des choses qui finissent. Je vous retrouverai avec vos affaires arrangées. Pas aussi bien que je voudrais, tant s’en faut, mais enfin arrangées. Vous souvenez-vous combien de fois vous m'avez dit qu'elles ne s’arrangeraient pas ? J’ai été aussi bien inquiet. Il arrive deux choses. Tout ne tourne pas aussi mal qu’on l'imaginait. On se résigne à une grande partie du mal. Il faut accepter ces termes-moyens de la vie. Le repos est à ce prix. Il n’y faut jamais réduire son âme. Ce serait là de la décadence. Il y a une vraie consolation à planer, au dedans, bien au dessus de ce qui se passe et de ce qu’on accepte au dehors.
Ma mère a encore été souffrante hier. Je crains l’hiver. Elle a heureusement une grande force intérieure. Je ne connais personne de plus inaccessible à l’abattement. Dans sa longue vie, je l'ai vue souvent au désespoir, pas un moment abattue. C’est un puissant moyen de résistance même à la maladie. Je crois au moins autant à l'influence du moral sur le physique que du physique sur le moral.
10 heures
Les premières lignes de votre lettre me désolaient. Je n'y comprenais rien. La distribution a donc tardé à Paris. Enfin bientôt, nous ne courrons plus ni l’un ni l’autre aucune chance d'inquiétude, c’est- à-dire de cette inquiétude là. Adieu. J’ai trois lettres d'affaires à écrire par le facteur qui attend ; des lettres de départ autour de moi. Oui à huit jours. Adieu. Adieu
Je persiste sur D. Carlos. La mise en liberté immédiate eût mieux valu en effet. Mais celle-là aussi n’était pas possible. La Chambre est convoquée, pour le 23 déc. Les Pairs sont nommés. M. Rossi en est. Mais vous savez tout cela. C'est ennuyeux de ne pas savoir et faire toutes choses ensemble. Nous y touchons.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Enfants (Benckendorff), Finances (Dorothée), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Politique (Espagne), Politique (France), Politique (Internationale), Portrait, Relation François-Dorothée, Rossi, Pellegrino (1787-1848), Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)