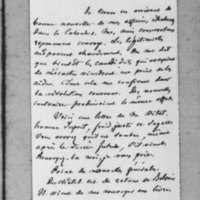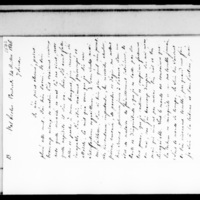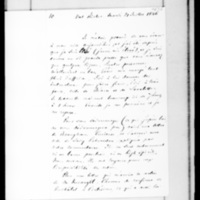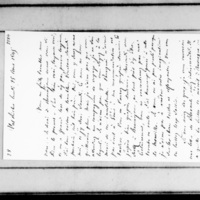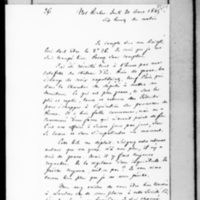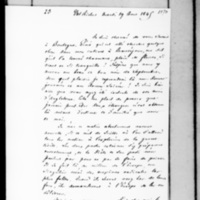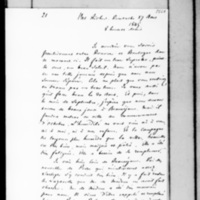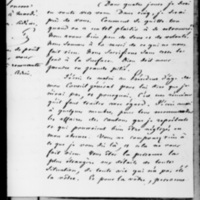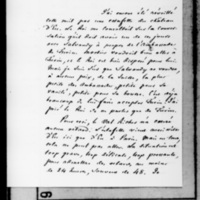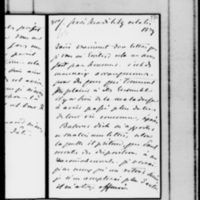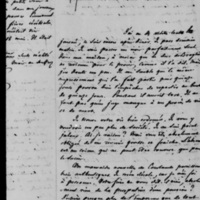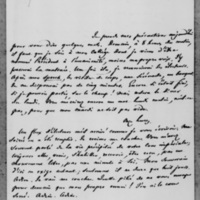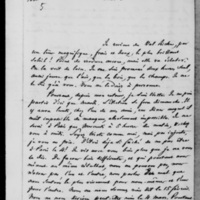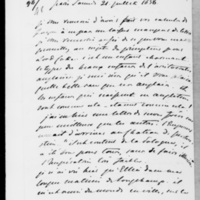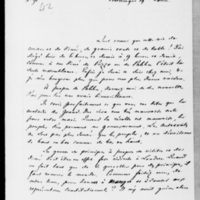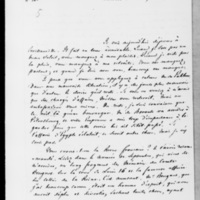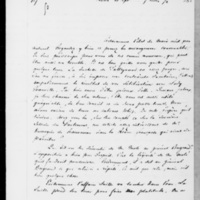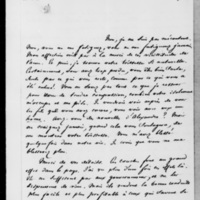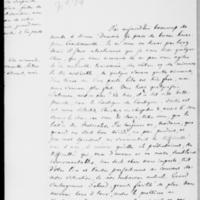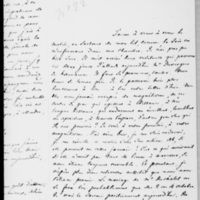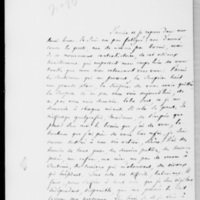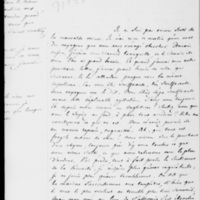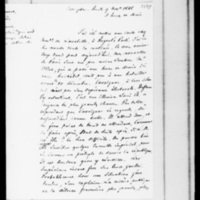Votre recherche dans le corpus : 53 résultats dans 6063 notices du site.
Brompton, Jeudi 18 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je trouve en arrivant de bonnes nouvelles de mes affaires électorales dans le Calvados. Mes amis conservateurs reprennent courage. Les légitimistes m'épousent chaudement. On me dit que bientôt les candidats qui essayaient de m'écarter viendront me prier de les aider. Tout cela me confirme dans la résolution convenue. Des nouvelles contraires produiraient le même effet. Voici une lettre de M. Vitet homme d’esprit, froid, juste et sagace. Vous verrez qu'il est sombre, même après le succès futur, s’il vient. Renvoyez-la moi, je vous prie. Point de nouvelles générales. Duchâtel est de retour de Belvain. Il vient de me renvoyer un livre. Je le verrai probablement demain. On a fait en Belgique une contrefaçon de ma Démocratie. Si petite qu'on l'envoie dans des lettres. pour 10 sous. Comment passe-ton si vite du plaisir au regret ? Une minute creuse un abyme. Adieu. Adieu. Ne vous fatiguez pas à lire.
Brighton, Dimanche 12 novembre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez été charmant hier deux lettres. J’ai reçu la première hier soir. La seconde à mon réveil ce matin, et toutes les deux très intéressantes. Je suis bien contente qu'on ne vous porte pas pour le Calvados.
Je n’ai pas lu le journal des Débats depuis le 8. Il se promène en Angleterre. J’ai écrit à Paris pour me plaindre. Rien de nouveau d'ici. Une lettre de Lord Brougham de Cannes du 6 amusante mais rien de nouveau. Le militaire à Lyon, fanatique pour la Bête impériale.
Je me réjouis extrêmement de Mardi. Je suppose que vous arriverez comme l'autre jour. S'il y avait un changement dans les heures mandez le moi demain. Nicolay est venu ici pour la journée. Je le fais dîner avec moi. On meurt assez à Pétersbourg et encore du choléra, entre autres ce Prince Dolgorouky homme d’esprit dont vous devez-vous souvenir, et que j’aimais beaucoup. Lady Holland vient me voir tous les jours. Je vous raconterai quelque chose sur elle qui vous divertira organiser l’état de siège, pourquoi pas la révolution, pourquoi pas le bombardement de Paris. Il faut tout prévoir. C'est trop de non sens. Adieu. Adieu
Brighton, Samedi 11 novembre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Je vous renvoie la lettre du Duc de Noailles. Sensée. Tout ce que vous me dites & tout ce qui revient de là prouve encore de l’incertitude sur la présidence, et Cavaignac m'apparait toujours comme un grand malheur. Mais avec l’autre aussi quelle confusion. C'est égal j'aime mieux l’autre. Votre élection dans le Calvados me trouble horriblement. J'espère encore qu’elle ne se fera pas. Prenez-y de la peine. Mais si le malheur voulait que vous fussiez élu, ne serait-il pas simple de leur écrire que ne pouvant par les servir de la prison vous les priez d’attendre, ou d'en prendre un autre. C'est bien clair que vous ne devez pas aller à Paris, à aucun prix. Dites-moi que c’est votre avis.
Peel m’invite à Drayton, mais évidemment avec peu d'espoir que j’accepte. C'est trop loin, je ne suis pas capable de ces tours de jeunesse. Je n’ai rien à vous dire ce matin. Les journaux anglais ne sont pas là encore, et mes Français vont se promener à Bedford. On prend l’hôtel pour la forme. Adieu. Adieu. et toujours Adieu.
Malgré les conduites et les citernes je trouve les accidents de Claremont un peu équivoques. Savez-vous, ce qu’ils comptent faire, car Richmond ne doit pas être tenable ? Adieu. Adieu.
Lady Holland me dit qu'on adore Cavaignac au foreign office, on est convenu avec lui de certains arrangements dans l'Orient. Contre nous sans doute. Normanby et Jérôme Bonaparte qui étaient amis intimes sont brouillés tout-à-fait depuis le mois de Mai, je vous conterai cela, rappelez le moi. Adieu. Adieu.
20. Val-Richer, Lundi 3 août août 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est fini ici. S’il en était ainsi partout, il n’y aurait certainement pas assez d’opposition. Il en faut plus que cela. Mais je suis tranquille ! D'après ce qui me revient, la lutte est extrêmement vive dans les environs. On s'est presque battu à Bernay et un peu battu à Cherbourg. Aucun résultat n'était encore connu hier à 9 heures, quand j'ai quitté Lisieux. Je me suis levé ce matin de très bonne heure pour dicter encore quelques paroles de remerciement que j’ai dites hier, quand l'élection a été proclamée et qu'on a voulu absolument recueillir. Elles ont bien réussi. Je retourne à Lisieux ce matin à 10 heures, pour entendre, lire et signer le procès verbal du Collège électoral. Puis, j’irai à Trouville, avec ma mère et Henriette, pour y chercher Pauline et la ramener demain au Val Richer que je ne quitterai plus que pour aller vous retrouver, vous mon seul vrai plaisir, mon plus charmant repos. Oui, nous retrouverons ensemble des soirées comme les deux dernières : nous irons les chercher. Leur parfum ne s'est pas encore évanoui.
Je suis un peu fatigué. J’ai eu hier & avant-hier deux déjeuners, et deux dîners assommants. Je n’ai certes pas plus mangé ni bu qu'à mon ordinaire, mais l'estomac se fatigue de ce qu’il voit comme de ce qu’il prend. Et l’assiduité, tant d’heures durant à une conversation si insipide, & qui ne doit pas un moment en avoir l’air ! J'y réussis très bien. Je ne fais pas les choses à demi. J’attends bien impatiemment l’estafette qui m’apportera les premiers résultats. Elle ne sera pas encore arrivée à Lisieux quand j’y passerai tout à l'heure. On me l’enverra à Trouville. Vous aurez tout cela avant moi. Castellane m’écrit de ses montagnes : " Je crois moi, au grand succès dans les élections ; ce qui est très juste, car l'opposition est enviable et ce qui donnera de grands devoirs au parti conservateur. J’irai à la petite session, à moins qu’elle ne soit tout-à-fait une forme. Je m’attends en effet, en cas de grand succès aux exigences du parti conservateur. Il se sentira à son aise et voudra avoir quelques plaisirs de popularité. Nous verrons. Je vous quitte pour écrire au Roi. J’ai à lui envoyer une lettre de Bresson qui ne m'apprend pas grand chose. Plus j’y pense, plus je me persuade qu’à Londres on n’a pas en effet dessein d'entrer en lutte avec nous. Mais je crains leur faiblesse, faiblesse pour la Reine, faiblesse pour Espartero faiblesse pour les préjugés des journaux. Ils ont besoin de tout le monde, et l’âme pas bien haute. Je n’ai pas autre chose à faire que ce que je fais. Adieu. Adieu. En attendant votre lettre.
8 heures. La voici. Charmante. J'y comptais. Quand j’ai lu et relu, je passe aux affaires. Il y en a beaucoup aujourd’hui mais rien d'important. Deux lettres du Roi qui se porte mieux que jamais. " Toutes nos santés sont bonnes, me dit-il, la forte secousse que la Reine et ma sœur ont éprouvée est bien passée. Quant à moi, je suis à merveille, et je fais faire un peu d'exercice au Ministre de la guerre, dans mes promenades dont je jouis beaucoup. ". Et dans la seconde : " Je vais me promener dans mon char à bancs. Hélas ! avec escorte ! " La formation des bureaux, que m’apportent les Débats, est de bon augure. Adieu. Adieu. Je vous écrirai demain de Trouville. Je n'en reviendrai que le soir. Soyez tranquille. Ni assassin, ni rhume. Adieu. G.
15. Val-Richer, Dimanche 26 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous n'aurez que deux lignes aujourd’hui, pour que vous ne soyez pas inquiète. Je pars à 11 heures et demie pour Lisieux. J’ai ma toilette à faire et ma promenade pour mon discours, car j’ai été hier assailli de visites qu’il a fallu recevoir. Je ne puis renvoyer, en ce moment des électeurs qui viennent de plusieurs lieues. Je sais ce que je veux dire à ce banquet. Mais j’ai encore besoin d’une heure de solitude. Je vais bien. Plus d’éternuement du tout. Merci de vous bien porter. Je vous renvoie Flahault et Marion. Charmante fille comme vous dites. Rien de nouveau ce matin. L’Espagne me tourmente beaucoup. Adieu. Adieu. Pardon de mon laconisme. Adieu. G. Lord Normanby sera à Paris Le 17 août. C’est ce que m’écrit La Rochefoucauld. Il est parti de Florence le 16 pour Londres.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Mandat local, Mariages espagnols
14. Val-Richer, Samedi 25 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà une bonne lettre. Vous vous portez bien, vous me grondez et elle est longue. Mon éternuement est parti, et ma pauvre Henriette n’y est pour rien du tout. Ce n’est pas pour la mener promener, c'est pour mener promener M. Austin que je suis sorti le soir, et ma mère et Henriette s’en sont plaintes tout haut pour qu'il ne me fût pas possible de recommencer. Acquittez donc Henriette, dans votre esprit, et portez-vous bien. Je vous promets que je ne sortirai jamais le soleil couché. Lui et moi, nous ne serons jamais qu'ensemble sur l’horizon. Votre menace m’a fait trembler. Vous êtes charmante de vous mieux porter, charmante d'avoir si peur pour moi, mais bien... (je ne trouve pas de mot qui me convienne) de craindre le Val Richer et son influence. Je n'y apprends qu'à mieux sentir tout ce que vous êtes pour moi et le besoin que j’ai de vous. C’est un sentiment qui monte de jour en jour en moi comme la marée. Et jamais de reflux. Quelle comparaison ! Un reste de ma course de samedi dernier à Trouville. La vue de la mer me laisse toujours une impression profonde. Je ne connais rien de plus frappant que ce mouvement perpétuel dans cette monotone immensité.
Courrier très chargé ce matin deux dépêches et quatre lettres particulières de Flahault, M. de Metternich très blessé, très chagrin de Montalembert et Villemain. Ne se plaignant point de mon silence, disant qu’il le comprend et que j'ai bien fait. Je n’ai pas dû donner dans un piège qu'on me tendait la veille des élections. Metternich désavoue quelques uns des faits avancés par Montalembert. Henri Bogusez n’est pas mort. Il se porte bien a Cracovie. Quant aux faits indésavouables (sic) le gouvernement autrichien persiste à en repousser la responsabilité. Mais sinon la connivence, du moins l’apathie, la faiblesse l’imprévoyance, l'impuissance sont de plus en plus évidentes. Le Général Collin a évacué Cracovie parce qu’il n’avait, pour ses troupes, que 15 cartouches par homme et qu’il n’avait aucun moyen de s'en procurer dans toute l'étendue à son commandement. Aujourd’hui le corps d’armée qu’il faut entretenir dans la Galicie coûte un surcroit de dépense de 800 000 florins (plus de deux millions de francs) par mois. L’Autriche sera obligée de faire un gros emprunt. En outre grande fermentation dans toutes les parties de la Monarchie, même dans les états héréditaires. Les Etats de la Basse Autriche, réunis à Vienne, viennent de demander de prendre part à la confection des lois, l’abolition de la corvée & &. En Bohême, la noblesse prend l’initiative des réformes. Dans le gouvernement même dans les Affaires étrangères, beaucoup de choses arrivent dont M. de Metternich décline la responsabilité en disant qu’il ne les a pas sues qu’il n’en a pas entendu parler. Déclin palpable de l'état et de l'homme. Je n’aime pas les déclins, dussé- je en profiter. Je ne laisserai pas échapper le profit, s’il y en a mais le spectacle n’est pas de mon goût. Quant à Rome mes nouvelles sont d'accord avec les vôtres. Vienne s'en inquiète, combat l'armistice et fait, sur les réformes, du galimatias, sensé, mais si vague que ce n’est pas la peine de l'écrire. Il n’y a pas le plus petit conseil pratique à en tirer. Flahault va à Königswart, de là à Marienbad. Puis, il me demande un petit congé pour aller, soit à Venise, soit à Milan, voir sa femme et ses filles, y compris Lady Shelburne qui va aussi passer l’hiver à Rome. Vous le savez probablement déjà. Une lettre de Bulwer à moi tout-à-fait semblable à la vôtre. Aigre, inquiète déroutée souhaitant du mischief, comme vous dîtes, pour sortir d'embarras. Il n’en sortira pas. Ni personne. Bien mauvaise affaire que cette Reine à marier. Je ne vous en parlerai pas aujourd’hui. J’ai trop à y penser. Aujourd’hui je ne veux penser qu’à mon discours de demain. 600 personnes à table, et 10 000, non pas sous la table mais en dessous de la plateforme où est la table, se promenant là pour nous voir dîner et m’entendre parler, ce qu'elles n’entendront pas. Qu’il y a de choses, en ce monde qui seraient très ridicules si elles n'étaient pas très sérieuses ! Adieu. Adieu. Je vous remercie encore de tout. Adieu. G.
13. Val-Richer, Vendredi 24 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai point éternué, point pleuré cette nuit. J’ai bien dormi. Je suis beaucoup mieux ce matin. C’est vraiment curieux avec quelle vivacité ce mal-là me vient, avec quelle rapidité il s'en va. Hier, s'il avait fallu aller et parler à mon banquet, j’en aurais été incapable. J'en étais vraiment préoccupé, et attristé. Ce n’est qu'à vous que je dis mes satisfactions orgueilleuses, à vous seule aussi mes faiblesses. J'en ai bien plus qu’il n'en paraît. Les circonstances importantes, les nécessités absolues, prévues, annoncées, de paraître et d’agir, me mettent bien souvent, plusieurs jours à l'avance dans un état de malaise, de frémissement intérieur, de doute et d’inquiétude, que je ne laisse pas du tout percer, que je contiens et comprime fortement en moi, car j’ai beaucoup d'empire, sur moi-même mais qui n'en est pas moins, très réel et très désagréable. Tout le monde est convaincu que la tribune ne m'inquiète et ne me trouble jamais. Tout le monde se trompe. Je suis très souvent et très vivement troublé, pas quand une fois je suis à la tribune et dans l’action, mais auparavant, en pensant au succès nécessaire et toujours incertain.
8 heures Décidément les bains ne vous valent pas mieux que le serein à moi. Cela m'étonne. Nerveuse comme vous l’êtes il me semble que les bains devraient vous être bons, J’espère que votre estomac se remettra bientôt en ordre. Pour les petits soins contre les petits maux, j'ai assez de confiance dans Chermside. Il vous connait bien et me parait sensé. Pourvu qu’il n'abuse pas des blue pills. Je vais attendre tout le jour la lettre de demain. Que de temps dans la vie on passe à attendre ? Palmerston me fait demander, en effet ce que nous pensons des Affaires de Rome, [?] et autres, et ce qu’il doit dire et faire pour être comme il veut, d'accord avec nous. Cela sera facile à Rome où il n’est rien, et nous n'en tirerons pas grand profit. C’est à Madrid qu’il faudrait-se mettre d'accord, et j'en doute tous les jours d'avantage. J’ai fait ma démarche. Nous verrons le résultat. En tout cas elle est bonne, et si elle ne nous met pas d’accord ; elle me mettra, moi, à l'aise. Comme on peut être à l'aise dans une si grosse et si difficile affaire. Un grand point sera au moins obtenu. Il n’y aura, rien avant mes élections. Les nouvelles en sont toujours très bonnes. De plus en plus bonnes, si je m'en rapporte à ce qui m’arrive de tous côtés. Mais j’ai aussi ma méfiance. Le Roi d’Hanôvre a été assez malade pour qu’on ait été sérieusement inquiet pendant trois jours. C’est du moins ce que M. d’Houdetot m'écrit. Il est mieux. Il aura M. de Béarn le 4 août. L’ordonnance sera signée ce jour-là comme ministre définitif.
Les bains de mer réussissent parfaitement à ma fille Pauline. On lui jette sur les reins des seaux d’eau qui j’espère seront bons à sa taille. Le temps est charmant depuis trois jours. Revenu au chaud, trop peut-être à Paris, et pour vous. Pas ici. Adieu, dearest. Plus j'avance, moins l'adieu me suffit. Je pense sans cesse à vous. Je vous suis dans tous les détails, à toutes les heures de votre journée. Il me semble que si j'étais là, tout serait mieux. Adieu. Adieu. G.
10. Val-Richer, Mardi 21 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je m'étais promis de vous écrire à mon aise aujourd’hui ; et j’ai été depuis que je suis levé (j’avais mis élevé) et je suis encore en si grande presse que vous n'aurez que quelques lignes. Quatre personnes m’attendent en bas. Génie m’a envoyé tout plein d’affaires. J’ai à lui donner des instructions, pour faire finir, d’ici à trois jours, celle de Béarn et de Lavalette. Je travaille vraiment beaucoup ici de 7 heures à 1 heure. Ensuite je me promène et je me repose.
Pour vous dédommager (ce qui j'espère bien ne vous dédommagera pas) voici une lettre de Brougham. Curieuse et d'accord avec celle de Lady Palmerston, expliquée par votre commentaire. Ils ne sont certainement ni en bonne position, ni en high spirit. Nous verrons. Ils ont toujours pour eux l’impossibilité des autres. Plus, une lettre qui m’arrive ce matin, de M. Durangel, l'homme de confiance de Duchâtel, à l’intérieur, et qui a aussi la mienne. Vraiment homme d’esprit de son honnête et véridique, plutôt enclin à voir en noir. Vous verrez que les pronostics électoraux continuent à être bons. Nous approchons bien du moment. Je mets de l'importance à ce que je dirai dimanche. Je parlerai à tout le pays. Ce banquet est ici fort à la mode. On y viendra de loin et il n’y aura pas de place pour tous les souscripteurs. Merci de vos conversations avec Hervey. J’ai écrit hier à Jarnac, aujourd’hui à Bresson dans le sens convenu. Il me reste Naples. Adieux tristes et affectueux. Tenez pour certain que le Roi ne fera rien pour Trapani aux dépends de Cadix. Il est pressé d'en finir. S’il y a en Espagne quelque revirement, ce qui est toujours possible, il sera naturel et point de notre fait. Nous irons droit devant nous, dans la voie où nous sommes. Vous ne me dîtes rien de vos yeux. Donc c’est bien. Et Trouville. J’y pense sans cesse. Adieu. Adieu. Adieu. G.
8. Val-Richer, Dimanche 19 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Temps affreux hier pour aller à Trouville. Grande pluie, grand vent. Pourtant quelques coups de soleil et un vif plaisir à revoir la mer. Vraiment cette plage est très jolie. Peu de baigneurs encore. Personne de votre connaissance. C’est au mois d'août que doivent venir Mad. de Boigne, Mad. d’Haussonville, Mad. de Ségue & M. Molé et Mad. de Castellane devaient venir ces jours-ci. Ils avaient loué la moitié de la maison du Dr. Olliffe qui a là une assez bonne maison, confortable. Ils lui ont écrit qu'ils ne viendraient pas. Le bruit de Trouville était qu’ils ne venaient pas à cause de moi, parce qu'on leur avait écrit que je venais à Trouville, que j’y étais très populaire, qu’on devait m'y faire des fêtes &. Il est sûr que je suis là très populaire, et que j’y ai été reçu avec tous les témoignages possibles de toute la population, tous les bateaux du port pavoisés, tous les notables du bourg réunis dans ma maison. Bonne maison, la meilleure de Trouville ; très simple et très propre assez bien pourvue de meubles, linge & sur la plage, n'ayant que la mer sous vos fenêtres ; si bien qu’hier, de la salle à manger, au rez-de chaussée, pendant le dîner, à la marée haute, on ne voyait absolument que la mer sans rivages, pas plus le rivage près que le rivage loin. Vous y seriez très passablement, au 1er étage, trois chambres, avec cabinets de toilette et des chambres de domestique en haut. Pauline et Mlle Wislez seraient au second. L’aide de Guillet est là, suffisant. La maison appartient à l’un de mes amis de Lisieux qui me la prête tout entière, tant que je voudrai. Si vous en aimiez mieux une autre, il y a celle d’Olliffe, tout ou partie de ce qu’avait loué M. Molé et qui est encore vacant. Vous voyez qu’en tous cas, vous ne manqueriez pas de ressources. Pour de la société jusqu'à présent, je ne vous en vois guère là. J’irai vous y voir et vous y chercher pour vous amener au Val Richer où vous pouvez, soit coucher, soit ne passer que la journée, comme vous voudrez. On y vient de Trouville par une très jolie route en poste en moins de trois heures. Quel plaisir de vous avoir ici, malgré mes commentaires par avance ! Avec quel plaisir, nous nous y promènerions comme vous voudriez, ni plus, ni moins ! Voyez. Dites-moi. Mes descriptions sont exactes, sans omission, ni exagération. J’étais parti de Val-Richer à onze heures. J'y suis rentré à neuf heures et demie. La route est partout une allée de jardin.
Jarnac a eu une longue conversation avec Palmerston sur les affaires d’Espagne. Pure conversation, sans proposition, ni conclusion de part ni d’autre mais bonne. Notre principe des descendants de Philippe V bien maintenu. Ni admis, ni contesté comme principe ; mais approbation très explicite des fils de D. François de Paule, avec pente indiquée vers D. Enrique. Le Coburg tout-à-fait écarté avec quelque surprise que la France n'en veuille pas, car il est plus français qu'anglais. Pas un mot, sur l'Infante déclaration très expresse que les deux seuls alliés de l’Espagne doivent être là d'accord et agir de concert. Disposition annoncée, à me communiquer ses instructions à Bulwer et à continuer l’entente intime, comme Aberdeen. Tout cela assez superficiel et réservé, mais dans la bonne voie. Je vais écrire aujourd’hui à Jarnac avec détails. Lord John très bien avec Peel me dit Jarnac. Il a rencontré chez ce dernier, le Duc de Bedford, en intimité marquée. Tout le monde se concerte pour surveiller Palmerston. Pourvu qu'il n'en prenne pas de l'humeur, et ne s'amuse pas à attraper ses duègnes. J’ai peur qu’il n’y ait jamais entre lui et nous, qu'un mariage de raison. Croyez-vous que cela suffise jamais ? Deux idées, je crois à bien inculquer à W. Hervey. L’une, qu’il faut se hâter de saisir le moment où nous sommes bien disposés pour les Infants D. François de Paule, le mariage, après tout, qui convient le mieux à l'Angleterre puisque c’est un mariage purement Espagnol. L'autre, qu’il faut bien se garder de recommencer en Espagne, l’antagonisme des deux patronages, Français et Anglais, au profit des deux partis, modérés et progressistes. Ce serait la ruine du mariage François de Paule de l’ordre naissant en Espagne et de la bonne intelligence entre nous. S’il parle de l'Infante dites que le Duc de Montpensier, s'il l’épouse, est bien décidé à l'emmener en France et à vivre en France avec elle à en faire une Princesse française. Il a grand dégout et grande méfiance des Cours du midi de leurs mœurs de leurs Camarillas &. C'est le sentiment de toute la famille royale. En voilà bien long pour vos yeux, quoique bien peu pour mon plaisir. Ah, l’absence, l'absence. J’y fais tous les jours des découvertes.
9 heures Voilà le N°8. Il n’y aura de bon numéro que le dernier. Je me porte bien. Les élections aussi, comme on se poste bien au milieu d’une bataille. La lutte est très vive. Il y aura bien des morts de part et d’autre. Mais tout continue, à présager que le champ de bataille nous restera. Adieu. Adieu. Je suis accablé ce matin de signatures à donner et de lettres à écrire. Et c’est dimanche, jour de visites. Adieu. Adieu. Charmante parole dans le N°8. Vous viendrez au Val Richer. Adieu donc.
28. Val-Richer, Lundi 25 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous me faites trembler avec votre : " Je serai à Beauséjour avant vous si Dieu le permet. " C’est bien vrai, toujours vrai ; et on a grand tort de n’y pas penser toujours. J'ai donc raison de trembler, pourtant samedi prochain, c’est bien près. Oui, vous y serez avant moi, et j’y serai samedi. Et nous ne nous quitterons plus. Mais, je n’aime pas que vous attendiez un compagnon de voyage, je ne sais lequel. Je n’aime pas que vous soyez à la merci de ces incertitudes. Pourquoi n'avoir pas écrit à Génie ? Ma recommandation est tardive. Vous ne l'aurez qu’après demain. Et j'espère bien qu’après demain, Mercredi, vous seriez à Beauséjour, ou tout près d’y être. Certainement vous ne rencontrerez pas une trombe en route. J’ai beaucoup pensé à celle de Monville. Je vous en ai peu parlé parce que je n'aime pas à arrêter votre imagination sur les choses tristes et effrayantes. Vous vous en laissez trop saisir.
Si vous aviez des yeux, je vous enverrais une lettre de Barante, assez intéressanite. Il a quitté la Suisse et m’écrit d'Auvergne où il est allé pour son Conseil général. Il me dit : " Mon inutilité me pèse moins ici qu'à Paris." Je le comprends. Sa position est vraiment désagréable. Et il n'y a pas moyen qu’elle change.
Je suis fort sensible à la bonne intention de lord Cowley sur Tahiti. Il a raison, & j'y comptais. Je l’ai toujours trouvé excellent, plein de sens et de bon vouloir. Et je compte aussi beaucoup sur Lady Cowley, à qui j’ai toujours trouvé bien de l’esprit, et qui en a, j’en suis sûr plus qu’elle n'en montre. Elle est très franche & ne cache jamais ses sentiments ; mais elle n’en fait nul étalage. J’aime bien cette manière là.
On dit que le Roi de Prusse a dépensé, pour recevoir la Reine 400 000 thalers. C'est le compte de Berlin. L’émeute de Leipzig l’a frappé. Il est rentré à Berlin, en veine d'humeur et de répression contre la liberté religieuse. Il a fait défendre à Uhlich, Ronge et Czerski, toute promenade prosélytique. Mais personne ne le craint huit jours de suite.
Je me suis promené hier pendant quatre heures dans un pays charmant, tout autour du Val Richer, avec tout ce qui se peut d’escortes à cheval et à pied, d'arcs de triomphe de fleurs, de discours, de coups de fusil. J’ai rendu beaucoup de services à cette population. Ses affaires vont bien. Elle me trouve bon et de facile accès. Il y avait hier un sentiment de bienveillance vrai et général, et un désir vif de le manifester, et de s'amuser en le manifestant. Mes enfants étaient charmés. Cela m’a plu. Ce qui est assez remarquable, c'est l’empressement du Clergé. Jamais tant de curés ne sont venus me voir, et avec autant de témoignages de déférence et de dévouement. Evidemment ce que j’ai fait quant aux Jésuites ne m’a fait aucun tort parmi les prêtres. Au contraire. Mais on a peur des Jésuites et ces prêtres, qui sont plus constants que fâchés de les voir un peu battus, se seraient bien gardés de s'en laisser soupçonner auparavant.
Le chancelier est malade. Il devait venir passer un jour chez moi, en allant à Trouville où Mad. de Boigne a acheté une petite maison. Il est resté à Paris avec la fièvre. Duchâtel le trouve frappé et m’en paraît lui-même assez inquiet. Adieu. Vous ne me dites pas si toute bile est passée. Vous me direz ce qui vous convient en attendant Page. Adieu. Adieu. Dans six jours, un meilleur adieu. G.
25. Val-Richer, Jeudi 21 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Six heures du matin
Je compte sur mes doigts. Ceci doit être le N°26. Je crois que je me suis trompé hier. Prenez sans compter. J’ai été réveillé tout-à-l'heure par une estafette du château d'Eu. Rien de grave. Un échange de croix napolitaines. Neuf Pairs pris dans la Chambre des députés à mettre au Moniteur. Ce qui est plus grave, ce sont les plis et replis, tours et retours des Jésuites pour échapper à l'exécution des promesses de Rome. Il a bien fallu commencer ; mais on a commencé, d’une façon qui n'aurait point de fin. C’est une affaire à suivre jour par jour, sans se lasser et sans s'impatienter un moment.
Cette bile me déplait. Soignez votre estomac autant que vos yeux. Là non plus, il n’y a rien de grave. Mais il y faut toujours regarder. De la vigilance, sans inquiétude. Je prêche, toujours, n’est-ce pas ? Je vous aime encore bien plus que je ne vous prêche. Vous avez raison de vous être bien trouvée à Londres et de vous plaire à cette société-là. Grande, sensée et honnête. Je suis charmé que vous en rapportiez une impression agréable. Que de choses vous aurez à me dire ! Vos longues lettres m’ont beaucoup, beaucoup manqué. Mais en les regrettant beaucoup, je ne me suis pas surpris une seule fois à les désirer. J’aime encore mieux vos yeux que vos lettres. C’est bien beau ce que je dis là. De près, c'est sûr ; j'aime mieux vos yeux. De loin, il y a bien de la vertu pour moi à le dire.
Dites-moi pourquoi Brignole m'écrit si tendrement. Voici ce qui m’arrive de lui ce matin. Je vais lui répondre bien poliment. J’attendais le Chancelier à déjeuner ce matin. Il m'écrit qu'il est pris de courbature et de fièvre et qu’il reste encore à Paris. J’aurai, d’aujourd’hui à Mercredi prochain 60 personnes à déjeuner en trois fois. Et samedi 30, à 5 heures du matin, je serai sur la route de Beauséjour.
On m’écrit de Mayence du 17. " S. M. Britanique avait annoncé à la chapelle Anglicane qu’elle assisterait ce matin au service divin, à 10 heures et demie. Mais au dernier moment, il y a eu subitement contre-ordre, & demande d’un second service pour 3 heures ; lequel, en troisième ordre a été porte à 4 heures. Cette instabilité se manifeste en toutes choses. " Grande disette de Princes Allemands à Mayence. Rien que le Prince et la Princesse héréditaire de Hesse d'Armstadt ; encore venus après longue hésitation et délibération. Personne de Bade, ni de Würtemberg, ni de Hesse-Cassel. " On s'attendait à voir arriver la Duchesse douairière de Nassau avec le Duc régnant. Mais le refus donné par la Reine de passer par Biberich, était si peu oublié que le Duc ne s’est pas gêné de venir hier à Mayence, comme simple particulier, & de prendre part, comme tout le monde, à ce qui se passait au débarcadère et à la parade. " Mon correspondant finit par cette drôle de phrase: " En résultat général, jusqu'à présent, il paraît y avoir eu plus de mauvais sang que de bon sang ? "
Ne me faites pas de mauvais commérages, je vous prie vous savez que vous n'en faites que de bons. Adieu. Je suppose que cette lettre vous trouvera encore à Boulogne. En tous cas vous aurez informé Génie de vos mouvements. Adieu Adieu. G.
23. Val-Richer, Mardi 19 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis charmé de vous savoir à Boulogne. Génie qui est allé chercher quelque chose dans mon cabinet à Beauséjour me dit qu’il l’a trouvé charmant, plein de fleurs, si riant et si tranquille ! J’espère que nous y aurons un beau et bon mois de septembre. Avec quel plaisir je reprendrai-là nos douces journées et nos douces soirées ! Je suis bien aise que vous ayez été contente de vos amis d'Angleterre. Cela me plait de penser que jamais peut-être deux étrangers n'ont obtenu là autant d'estime et d’amitié que vous et moi. Je n’ai ce matin absolument aucune nouvelle, si ce n'est de Suisse où l'on s'attend tous les matins à l'explosion de la guerre civile. Les deux partis extrêmes s’y préparent ouvertement, et la Diète et son parti n’en parlent pas pour ne pas se faire de peine. Il se fait là au milieu de l’Europe, un singulier essai des maximes radicales les plus folles. Quand ils seront assez las de leurs fous, ils demanderont à l’Europe de les en délivrer.
Voici mes arrangements. J’ai chez moi les 21, 25 et 27 août, trois grands déjeuners électoraux. Je partirai d’ici le 30 à 5 heures du matin. Je serai à Beauséjour à 6 heures pour dîner, et nous passerons ensemble, la soirée de notre 30. Que de choses je retrouverai en vous retrouvant.
Vous ai-je dit que j’ai écrit au duc de Noailles à propos de sa lettre à vous et de son fils ? Il est allé passer deux jours à Paris. Il a du monde chez lui ces jours-ci. D’après ce qui me revient le parti légitimiste est en plus grand désarroi et abattement que jamais. Mon succès à Rome et le refus du grand Duc de Modène les ont fort déconfits. Ils se croyaient bien établis là.
Voilà une estafette qui m’arrive du château d’Eu. Une réponse du Roi sur des demandes de croix que fait Bresson à l'occasion de l’entrevue de Pampelune. Les Espagnols font de grands, grands préparatifs ; des troupes, des meubles, des chevaux, des taureaux. Ce pays-là passera probablement encore par bien des épreuves bien des hauts et des bas. Cependant, ou je suis bien trompé, ou c’est un pays qui se relève, et qui avant cent ans d’ici aura repris un rang considérable en Europe. On a toujours tort d'oublier que la première résistance à Napoléon est venue de là. Grande preuve d’énergie et de vitalité nationale. Je vous quitte pour répondre au Roi, et pour écrire au Duc de Nemours et à Bresson. Adieu. Adieu.
Comment êtes-vous logée à Boulogne ? Je ne m’y suis jamais arrêté. Adieu. Adieu. G.
21. Val-Richer, Dimanche 17 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je voudrais vous savoir positivement entre Douvres et Boulogne dans ce moment-ci. Il fait un temps superbe, point de vent, un beau soleil. Nous n'avons pas eu une telle journée depuis que nous nous sommes séparés. Cela me plaît que vous rentriez en France par un beau temps. Je veux aussi qu’il fasse beau le 30 août. Et puis dans le mois de septembre, j’espère que nous aurons encore de beaux jours, à Beauséjour. Mais il faudra rentrer en ville, au commencement d’octobre. L’humidité ne vaut rien ni à vous ni à moi, ni à mes enfants. Et la campagne est toujours plus humide que la ville.
Henriette est très bien, mais maigrie et pâle. Elle a été très fatiguée. Elle a besoin de se remplumer.
Je vais bien loin de Beauséjour. J'ai des nouvelles de Perse qui m’intéressent assez. Sartiger s'y conduit très bien. Il y a fait rentrer les Lazaristes que M. de Médem en avait fait chasser. M. de Médem a été très mauvais pour nous. Il vient d’être rappelé et remplacé par un Prince Dolgorouki qui était à votre Ambassade à Constantinople. On dit qu’il sera plus modéré que Médem. On m'en parle bien. Un petit incident à Constantinople dont je suis bien aise. Le duc de Montpensier doit y être arrivé ces jours-ci. Bourqueney a communiqué d'avance à Chekib Effendi la liste des officiers qui l'accompagnaient, & devaient être présentés au Sultan. Dans le nombre, se trouvait un Abd el-At, Algérien, Arabe, Musulman, sous lieuteuant de Spahir à notre service. Vive émotion parmi les Turcs ; Comment présenter un tel homme au Sultan ? Insinuations, supplications à Bourqueney d’épargner ce calice. Il a très bien senti la gravité du cas et répondu très convenablement mais très vertement. On s'est confondu en protestations ; Abd el-Al sera reçu comme les autres officiers du Prince. Tout le régiment des Spahir serait reçu s’il accompagnait le Prince. Et de bonnes paroles sur notre possession d’Alger qu’on sait bien irrévocable, ceci fera faire un pas à la reconnaissance par la Porte. Adieu. Adieu.
J’ai des hôtes ce matin. Puis, dans la semaine où nous entrons & les premiers jours de la suivante, trois grands déjeuners de 25 personnes chacun. Mes politesses électorales à la campagne, le déjeuner est plus commode que le dîner.
Je regrette Bulwer pour votre route. Comme agrément, car comme utilité, si vous aviez besoin de quelque chose, je doute qu’il fût bon à grand chose. Quand vous reviendrez de Boulogne vous savez que Génie a, si vous voulez, quelqu'un à votre disposition. Adieu. Adieu.
Je me porte très bien. J’ai le sentiment que marcher beaucoup me fait beaucoup de bien. Seulement il n’y a pas moyen de réunir les deux choses, le mouvement physique et l'activité intellectuelle. Il faut choisir. Adieu. Adieu. G.
7. Val-Richer, Vendredi 18 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Dans quatre jours, je serai en route vers vous. Dans cinq. je serai près de vous. Comment se quitte-t-on quand on a un tel plaisir à se retrouver ? Nous avons bien peu de sens et de volonté. Nous sommes à la merci de ce qui ne nous fait rien. Nous sacrifions sans cesse le fond à la surface. Dieu doit nous prendre en grande pitié. J'écris ce matin, au Président d’âge de mon Conseil général pour lui dire que je n'irai pas, et pourquoi. C’est une réunion qu’il faut traiter avec égard. J'écris aussi à quelques membres, pour leur recommander les affaires des cantons que je représente et qui pourraient bien être négligées en mon absence.
Vous ne comprenez rien à ce que je vous dis là, et cela ne vous fait rien. Vous êtes la personne la plus étrangère aux détails de toute situation, de toute vie qui n’a pas été la vôtre. Et pour la vôtre, personne ne comprend et ne soigne mieux que vous les détails, et la pratique de tous les moments. Vous resterez comme vous êtes, et c’est ce qui me plaît. J’ai renvoyé hier à Désages ma dépêche pour Chabot avec le changement désiré. J’avais voulu que le changement fût approuvé à Eu précisement parce que la dépêche n’avait été vue qu'après avoir été envoyée. Elle sera de retour, à Londres après demain, et j'espère qu’elle y sera le point de départ d’une politique un peu nouvelle. Je mets beaucoup de prix à changer, sur l’Espagne la vieille politique de l'Angleterre par intérêt public et par orgueil personnel.
Vos conversations avec Bulwer ont été excellentes. J’ai écrit à Flahault pour qu’il se gardât un peu du Prince de Metternich à qui évidemment notre succès ne plaît guères, et qui veut trop le mariage D. Carlos et pas du tout le mariage Aguilla. J'ai peur que Flahault ne soit aussi trop bien avec lui et n'évite trop d’avoir un autre avis que le sien. Espartero est donc décidément à Bayonne. S'il ne fait comme sa femme, que traverser la France pour aller en Angleterre, peu m'importe. Mais s’il entendait rester en France, il y aurait à y bien regarder D. Carlos, Christine et Espartero ! En attendant, j’ai écrit au Ministre de l’Intérieur qu'il ne fallait à aucun prix, le laisser séjourner près des Pyrénées. Au moins aussi loin de l’Espagne que Bourges. On m'écrit de presque tous les points de l’Espagne que sa fuite précipitée, quand la dernière bombe venait à peine de tomber sur Séville fait baisser la tête de honte à tous ses partisans.
10 heures et demie M. de Beauvoir, un jeune attaché fort intelligent m’arrive à l’instant de Londres. Chabot me dit de le faire causer et qu’il est fort au courant. Sa conversation est bonne. Lord Aberdeen ne demande pas mieux que de se concerter avec nous et de nous aider en fait, à réussir dans le mariage Philippe V. Tout ce qu’il désire, c’est que nous lui épargnions le calice du principe. J’en suis d'accord et ma dépêche est partie. M. de Beauvoir croit qu’elle sera acceptée avec joie et mise en pratique. Sur ce adieu, car il faut que je renvoie le jeune homme à Paris, et j’ai encore plusieurs lettres à écrire. Adieu. A mardi. Je serai à Auteuil avant 4 heures. Adieu. G.
Voilà votre n°9. N'ayez donc pas de point de côté. Ne vous levez pas sans vous couvrir. Il ne faut pas être si remuante quand on est si délicate. Adieu. Adieu.
5. Val-Richer, Mercredi 16 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
J’ai encore été réveillé cette nuit par une estafette du château d’Eu. Le Roi me consultait sur la conversation qu’il doit avoir un de ces jours avec Salvandy à propos de l’Ambassade de Turin. Mortier voudrait bien aller à Turin et le Roi est bien disposé pour lui. Mais je suis sûr que Salvandy ne voudra à aucun prix de la Suisse, la plus petite des Ambassades, petite pour sa vanité ; petite pour sa bourse. C’est déjà beaucoup de lui faire accepter Turin. J’ai prié le Roi de ne parler que de Turin. Pour ceci, le Val Richer n'a causé aucun retard. L’estafette vient aussi vite d'Eu ici que d’Eu à Paris. Mais en tout, cela ne peut pas aller. La situation est trop grave, trop délicate, trop pressante pour admettre des retards au moins de 24 heures souvent de 48. Je Je m’arrange pour partir d’ici lundi ou mardi, le 21 ou le 22.
Mon Conseil général, les électeurs qui voulaient me donner un banquet en auront de l'humeur. J’en suis fâché, car ils sont très bien, et je tiens à ce qu’ils soient très bien pour moi. Mais il n'y a pas moyen. J'ai vu beaucoup de monde hier et je les ai préparés tous à ce désappointement. Dearest, de quel mot je me sers là! Admirez l'empire des situations. C’est au désappointement de mes électeurs que je pense quand je dois vous revoir cinq jours plutôt. Vous me le pardonnez n’est-ce pas ? Croyez-moi ; vous pouvez me tout pardonner, chaque nouvelle séparation, chaque jour de séparation me fait mieux sentir tout ce que vous êtes pour moi. Que de choses à nous dire ce jour charmant où nous nous reverrons et tous les charmants jours suivants Je vous crois parfaitement quand vous me dîtes que ce n’est pas à vous que vous pensez quand vous me parlez de la nécessité de mon retour. Vous ne m’avez pas envoyé la lettre d'Emilie. Je la plains de se marier sans goût. L’intimité de la vie quand celle du cœur n’y est pas me paraît odieuse à 55 ans comme à 20. Emilie s’y accoutumera comme presque tout le monde s’y accoutume. Mais il en résulte une certaine décadence intérieure qui me déplait infiniment. Il pleut ce matin. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai dans une heure Adieu jusque là.
10 heures Voilà bien une autre raison de revenir plutôt. Mon courrier de Paris me manque ce matin, tout entier, journaux comme dépêches, et vous par dessus tout. Je n'y comprends rien. Mais quelle que soit la cause, l'effet me déplait horriblement. Quelque négligence, un quart d’heure de retard du commis expéditeur au Ministère. C'est odieux. Je vais me plaindre amèrement à Génie. Adieu. Adieu. Ma journée sera bien longue. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Femme (mariage), Femme (politique), Femme (statut social), Louis-Philippe 1er, Mandat local, Mariage, Politique (France), Pratique politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique)
305. Val-Richer, Vendredi 1er novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous voilà dans le bon mois. En 1815, à Gand, Louis 18 sortant de son cabinet et traversant le salon, le matin même du jour où il répartit pour rentrer en France me disait : " Eh bien M. Guizot, nous voilà du bon côté de la glissoire. " J'aurai certainement, à vous retrouver, plus de plaisir que lui à reprendre la route de Paris. Que de joies différentes en ce monde, comme de douleurs ! J’en ai connu de toutes sortes ; et bien décidément c’est de l'affection que viennent les plus vives, les seules qui aillent toucher jusqu'au fond de l'âme, & l’ébranlent, et la satisfassent toute entière.
Je partirai le 13. Il n'y a pas moyen de presser davantage, ma mère. Je serai à Paris le 14 pour dîner, et je vous verrai dans la soirée. Il fait aujourd'hui un temps affreux, le vent, la pluie, le froid. Il fera beau, le 14. Je voudrais qu’il fit beau après-demain. J’ai tout mon Lisieux à déjeuner. Ce sont mes adieux. J’ai refusé absolument leurs dîners, leurs parties de campagne, leurs toasts. Ils m'auraient donné dix rhumes. Ils auront les primeurs de Ma route neuve. Elle est finie. On la livre dimanche matin à la circulation. Il ne me reste plus à faire qu’une avenue de la route à ma porte. On la fera cet hiver. L’entrepreneur me la promet pour le 15 avril prochain. Que les plus petites choses sont lentes quand il faut créer !
J’ai envie de quelque chose de M. de Bacourt. Je me crois sûr qu’il a entre les mains, je ne sais comment tous les papiers du comte de La Marck, (d’Aremberg) l’ami intime de Mirabeau et à qui Mirabeau laissa en mourant presque tous les siens, les plus confidentiels. Je voudrais bien voir, ces papiers. Je suis dans Mirabeau jusqu'au cou, par curiosité après Washington. Croyez-vous que je puisse demander à Mad. de Talleyrand de demander cela à M. de Bacourt ? Est-ce convenable ? Ou faut-il que je m'adresse directement à M. de Bacourt ?
10 heures
Votre lettre à votre frère est à merveille, très douce et très ferme, très précise. S'il a, comme j'en ai peur, oublié ou abandonné vos intérêts sur les points que vous touchez, il en ressentira quelque embarras... si quelque embarras est possible. Je n'hésite pas quant à vos fils, d'après ce que vous avez écrit à votre frère, vous devez attendre sa réponse avant de partager le capital. Vous vous le devez à vous-même. Je suis un grand partisan de la consistency. Si vous aviez renoncé à toute observation, il faudrait vider sur le champ l’affaire du capital. Mais vous avez voulu rappeler votre droit méconnu, constater du moins qu'on l’avait méconnu. Le capital est votre seul moyen d'action. Il faut le retenir jusqu'à ce qu’on ait répondu à vos observations, soit pour les accueillir quelque peu, soit pour vous dire nettement. que vous êtes liée par l’arrangement, et que vous ne devez attendre rien de plus. A votre place j’écrirais tout simplement cela à Alexandre. Mais comme ce sera Paul qui répondra par Alexandre, je comprends votre crainte de réponse inconvenante. Ne pourriez-vous pas écrire à Benkhausen, et le charger de dire à vos fils vos intentions ? Voilà mon avis à la première vue. Si quelque autre idée me venait, je vous la dirais demain.
Adieu. Adieu. A dater d'aujourd'hui les Adieux valent mieux. G.
300. Paris, Mardi 29 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici vraiment 300 lettres que je vous ai écrites, cela ne nous fait pas honneur. C'est de mauvais arrangements pour des gens qui trouvent du plaisir à être ensemble il y a bien de la maladresse à avoir passé plus du temps de leur vie commune, séparés. Bulwer doit m’apporter ce matin une lettre, selon laquelle il prétend que Paul montre des dispositions à un racomodément. Je verrai. Je ne veux qu’un retour sincère, Je n’en accepterai plus d’autre. Il m’a trop offensé.
Appony est allé annoncer au roi le mariage de son fils, on dirait l’héritier d'un trone ! Ces bonnes gens font une quantité de petites démarches de petits arrangements surtout, qui sont assez drôles. Le fils se met un peu sous ma protection pour empêcher des lésineries, mais cela ne me regarde pas. Je préparerai mon cadeau. Voilà tout ce que j’ai à y faire.
Midi. Vingt marchands deux querelles où j’avais raison, un froid de loup, une quantité de petits embarras qui puissent toujours pas me donner des grands plaisirs pour me moment vous voyez bien qu'il s’agit de mes meubles, voilà l'emploi de cette première partie de la matinée. Mes lettres doivent bien vous ennuyer car je n’ai rien à vous dire du tout. J'ai eu une longue lettre d’Ellice, au fond rien de nouveau. Le ministère très faible tout juste comme il y a un an et les vraisemblances qu’il fera la même campagne. Point de gloire, mais les plans for ever.
A propos, j’ai ouï dire que vous avez une espèce de discussion presque de querelle avec M. Duchâtel pour un préfet je ne sais pas son nom, & on dit vraiment que vous avez tort, que votre préfet est un sot et que vous ne devriez pas vous faire une affaire pour un pareil personnage. Je trouve cela aussi, et je serais bien aise que vous fussiez de cet avis. Soyez sûr que lorsque je m’avise de vous dire de ces choses là c’est que je crois qu’il est bien de vous le dire. Adieu. Adieu, quand m'annoncerez-vous une date? Adieu.
294. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
J’ai eu du monde sans relâche toute la matinée. Parce que je refuse tous les dîners, on se croit obligé de venir me voir deux fois, davantage. J’aimerais mieux discuter avec vos ouvriers. Je ne tousse plus du tout. J’y aurais regret si je n’arrangeais pas déjà mon retour à peu près pour l'époque que je vous ai dite. Il continue pourtant de faire beau.
Vous trouverai-je tout-à-fait arrangée ? Ne vous ruinez pas. Je crains vos goûts de perfection bien naturels et de bien bon goût, Limitez-vous pourtant dans votre perfection. L’appartement est déjà cher pour vous. N'aggravez pas trop le mal. Pippin, vous a-t-il quittée ? Comment Felix prend-il son petit changement de condition. Avez-vous eu le courage de l’en informer ? Je doute que vous eussiez été un bon ministre d’un gouvernement représentatif. Dire oui n’est que la moitié du talent. Non est l’autre moitié. Celle-ci vous eût manqué. Vous ne savez que plaire.
Don Carlos me paraît pressé d'avoir ses passeports. Et le Roi presse de les lui donner. Les Ministres veulent attendre l’issue de l'affaire de Cabrera. Ils ont raison. D’autant plus raison que Don Carlos a donné sous main, ordre à Cabrera de continuer la guerre. Entendez-vous dire quelque chose de Thiers ?
9 heures et demie
Vous avez tout-à-fait le droit, et vous aurez raison avant de faire la partage du capital de Londres, de demander à être informée de ce que vous aurez à toucher en argent et en effets à Pétersbourg. Je ne pense pas que vous puissiez désormais exercer aucun recours légal, ni que vous fissiez bien de le tenter, même indirectement. Mais ce qui se pourra pour embarrasser et pour arracher de la mauvaise honte quelques lumières, et quelques sommes de plus, il faut le faire. J’approuve donc tout-à-fait que vous adressiez à Londres votre question. Parlez aussi à votre frère de l'oubli de vos droits sur le mobilier de Courlande. Il ne faut pas qu’il ignore tout-à-fait sa propre légèreté, ni qu’il croie qu'elle a passé inaperçue. Je suis charmé que ce coup de pierre ne soit rien. J’ai la Reine à cœur. Après les assassins, les fous. Ceux-là aussi passeront.
Adieu. Adieu. J’ai ma petite Pauline un peu indisposée. Ce n’est rien. Adieu G.
279. Val-Richer, Samedi 28 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
e vous écris encore de mon lit, et dans une telle moiteur qu’il n’y a pas moyen de vous écrire plus de quatre lignes. On veut absolument que je rentre mes bras. J’ai très bien dormi. Mes nuits sont fort bonnes. Mais ce matin je tousse et je crois bien que quelques heures de lit feront finir cela plutôt.
J'ai demain une fatigue et un grand ennui ; un déjeuner de vingt leaders électoraux Ils sont invités depuis quinze jours. Il n’y à pas moyen d’y échapper. Je les laisserai se promener, sans moi dans le jardin car il pleut et il pleuvra. Mais dans ce pays-ci on se promène à pied comme vous en calèche sous la pluie. Voilà votre n° 275. Je suis bien aise que vous ayez signé, et que Génie vous ait bien défendue. Démion voulait vous avoir à sa discrétion. Décidément, je rentre mes bras. Je crois très bons les soins que vous me prescrivez pour la gorge, et j'en userai dès que je ne tousserai plus. Adieu. Adieu. G.
234 . Caen, Samedi 3 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne veux pas qu’une lettre vous manque. Mais ce sera à peine une lettre. Je quitte quarante personnes et je repars demain à 6 heures. On a arraché trois dents à mes filles, trois dents de fait destinées à mourir et qui obstruaient le passage. Cela est devenu nécessaire en deux mois, car elles avaient été chez Brewster quelques jours avant leur départ. Elles ont très bien supporté le mal. Et Pauline surtout y a eu du mérite, car elle avait bien le frisson. Ce n'est pas un enfant d’un naturel ferme ; mais elle est capable, pour quelques moments, par affection, par fierté, d’un véritable héroïsme. Si les grandes personnes avaient la moitié des vertus qu'elles demandent aux enfants, le monde serait beau à voir. Mais on fait bien de demander beaucoup aux enfants. Il faut qu’ils acquièrent de quoi perdre.
Je n'ai rien appris ici comme de raison Et je ne vous envoie pas la politique de province. Ce n'est pas la plus intelligente. mais c’est bien souvent, je vous assure, la plus sensée ; non pas plus sensée que vous et moi, mais plus sensée que la plupart des gens avec qui nous passons notre vie et comptons beaucoup. Je reviens toujours de la campagne, avec un grand fond d'estime pour les country gentlemen et les farmers. Adieu. Je compte trouver deux lettres chez moi demain. Adieu. G.
Mots-clés : Enfants (Guizot), Mandat local, Pédagogie, Santé (enfants Guizot)
197. Val-Richer, Dimanche 16 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai eu des visites toute la journée, ce soir encore après dîner. Je pars demain matin. Je vais passer un mois parfaitement seul dans ma maison ; à moins que le Duc de Broglie ne revienne pour le procès, comme il l'a dit. Mais j'en doute un peu. Il me semble que le même empressement qui l’a fait partir pour quinze jours pourra bien l'empêcher de repartir au bout de quinze jours. Pourtant il aurait tort. Il ne faut pas qu’un juge manque à un procès de vie et de mort.
Je trouve votre vie bien ordonnée. Je vous y voudrais un peu plus de société. Je ne suis point jaloux. Ai-je raison ? Mais vous êtes absolument obligée de me revenir grasse et fraîche. L'absence est un crime qui ne peut-être couvert que par le succès.
Vos mauvaises nouvelles de Courlande paraissent bien authentiques. Je m'en désole, car je n'ai foi à personne. Votre frère ne vous dit-il rien, absolu ment rien de la perspective d'une pension ? J'espère presque plus de l'Empereur que de tout autre. Je ne croirai jamais qu’il soit impossible aux trois hommes qui l’entourent de faire luire dans son cœur, s'ils le veulent, un éclair de justice et de générosité.
Lundi 9 heures
Je me lève par le plus beau soleil. Si je devais vous revoir, demain, je serais aussi gai que le soleil. Voilà la première fois depuis deux ans que je vais à Paris sans vous y retrouver. Quel ennui de partir quand on n'a pas envie d’arriver ! C’est bien deux ans, avant hier 15 Juin. Comment n’y a-t-il que deux ans ? Il me semble que c’est toute une vie.
Eternité, néant, passé, sombres abymes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez ; nous rendrez-vous les extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
C’est M. de Lamartine qui dit cela. Vous savez que j’aime la poésie. Elle entre et reste très avant dans ma mémoire. Elle agit sur moi comme un écho de l'âme. Elle me rend des sons que j'ai entendus. J’aime mieux la voix que l’écho. Pourtant l’écho est très doux. Mon fils aimait passionnément la poésie. Et sans y porter cette disposition un peu vague et romanesque de la jeunesse. C’était l’esprit le plus net et le plus simple du monde, choqué par instinct dès qu’il apercevait du brouillard ou de l'emphase ; mais d’un cœur si élevé et si délicat, d'une nature si parfaitement élégante et rare que la poésie lui allait d'elle-même et comme par une harmonie spontanée. Je n'ai vu aucune créature, qui semblât créée à ce point pour plaire ! Et c’est à moi seul qu’il a plu. J’ai connu seul le parfum charmant de cette fleur ! C'est l’un de mes plus amers regrets. Il me semble que je l’aurais moins perdu si d’autres en avaient joui comme moi.
9 h. 1/2 Le numéro 196 me désole. Je les ai tous reçus, aucun si triste. J’espérais, et je veux encore espérer mieux du lait d’ânesse, des bains de son, de tout ce régime doux et tranquille. En grâce, si votre médecin persiste à le croire bon, ne le cessez pas parce que vous vous trouvez plus souffrante un jour ou deux. Il faut bien accepter ces mauvaises alternatives. Je n’ai pas la superstition des médecins. J'y crois pourtant un peu plus qu'à notre ignorance. Je craignais bien la solitude de Baden. Vous ne supportez pas la société médiocre et vous avez raison. Il est si rare d'en rencontrer une autre !
Madame de Talleyrand travaille à se désintéresser de toutes choses, à ne penser qu'à elle-même à ses affaires, à ses conforts, à ses habitudes. Ce n’est pas une manière d'animer les autres. Moi aussi, je trouve que nous nous disons peu de chose. Adieu. Adieu.
J’ai une foule de petits soins à prendre avant de partir. Je trouve dans mes journaux de ce matin une triste nouvelle. Ce pauvre Emmanuel de Grouchy est mort à Turin d’une fièvre cérébrale. J’avais de l’amitié pour lui, et il m'était très dévoué. Il s’était marié il y a 18 mois. Il était heureux. Adieu encore. J'aime mille fois mieux une sotte réalité que mille fictions. Adieu pourtant. Mais ne souffrez pas ; ne maigrissez pas. G.
188. Lisieux, Lundi 4 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est aujourd’hui que je ne puis vous écrire qu’un mot au milieu de trente visites. Ma Chambre ne désemplit pas. J’ai eu un succès complet, comme il me convenait. Les Républicains et les Carlistes se sont abstenus. Et j’ai eu presque l'unanimité, 477 voix sur 525, c'est-à-dire 156 voix de plus qu’à ma dernière élection, et 67 voix de plus que dans l’élection où j'en avais le plus obtenu. Le pays est charmé de moi, & moi de lui. Vous verrez dans les journaux ce que je leur ai dit après l'élection. Toute la population m’a suivi dans les rues jusqu'à ma porte. On ne me dira plus que je ne suis pas populaire du moins jusqu’à ce que j’y aie mis ordre moi-même. Tout va assez bien autour de moi. Je ne connais encore que 8 élections. Le Ministère y a déjà perdu 2 voix, et nous point. J’en saurai davantage mercredi matin, car je pars demain bien décidément, & je vous verrai mercredi.
J’espère que le retard de Paul n'aura pas pour lui de suite fâcheuse. Mais à sa place je serais parti sur le champ. J'estime trop l'indépendance pour la mettre à toute sauce. Nous causerons de tout cela Mercredi. Farewell, farewell fom the deepest of my heart !
Mots-clés : Elections (France), Enfants (Benckendorff), Mandat local
187. Lisieux, Samedi 2 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je prends mes précautions aujourd’hui pour vous dire quelques mots. Demain à 8 heures du matin, il faut que je sois à mon collège dont je viens d'être nommé Président à l'unanimité, moins ma propre voix. J’y passerai la matinée. Une fois élu je remercierai les électeurs. Après mon speech, les visites de corps, une sérénade, un banquet. Je ne disposerai pas de cinq minutes. Encore si c'était fini, si je pouvais partir sur le champ ! Mais restera le dîner du lundi. Vous m'écrirez encore un mot lundi matin, n’est-ce pas, pour que mon mardi ne soit pas vide. Onze heures Un flux d’électeurs m'est arrivé comme je vous écrivais. Ma soirée en a été remplie. Je reviens me coucher. Vous m’avez souvent parlé de la vie précipitée de votre cour impériale ; toujours aller, venir, s'habiller, recevoir, être reçu, pas un mouvement libre, pas une minute à soi. Mon souverain d'ici en exige autant ; seulement il ne dure que huit jours. Adieu. Je vais me coucher. Quelle pitié de ne vous envoyer pour demain que mon propre ennui ! J'en ai le cœur serré. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Mandat local
184. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens du Val Richer, par un temps magnifique, frais et doux ; le plus brillant soleil ! Point de verdure encore, mais elle va éclater. On la voit de loin. Je me suis promené deux heures seul, aussi jeune que l’air, que les bois, que les champs. Je ne le dis qu'à vous. Vous ne le direz à personne. Pourtant depuis mon retour, je suis triste. Je ne puis partir d’ici que mardi. L’élection se fera dimanche. Il y aura lundi chez l’un de mes amis, un dîner auquel il m'est impossible de manquer absolument impossible. Je ne serai à Paris que Mercredi à 5 heures du matin, & chez vous à midi. Soyez triste comme moi, mais pas injuste, je vous en prie. J'étais déjà si fâché de ne pas être à Paris, le 4. Je vis avec vous bien plus que je ne vous le dis. De façons bien différentes et qui pourtant nous mènent au même résultat, nous ne pouvons pas, nous n'osons pas l’un et l'autre, nous parler du mal que nous sentons le plus vivement pour nous-mêmes et l'un pour l'autre. Nous ne nous sommes rien dit le 15 février. Nous ne nous dirions peut-être rien le 4 mars. Pourtant je voudrais être là ; je voudrais vous voir. En vérité, il y a des tendresses, auxquelles Dieu devrait accorder de paraître telles qu’elles sont et de donner tout ce qu’elles ont, sans démonstration extérieure, sans parole. Dearest for ever dearest !
Vendredi 7 heures et demie
J’ai été réveillé cette nuit à une heure du matin, par un singulier message. Des électeurs de Rouen m’ont envoyé l'un d'entre eux pour me conjurer, c’est bien le mot d'aller passer quelques heures à Rouen et de prendre la parole dans un grand meeting où il s’agit d'assurer le succès des candidats de l'opposition entr'autres de M. Duvergier de Hauranne qu'on veut porter à Rouen. Il leur faut un virtuose pour porter le dernier coup. Avec un virtuose ils se tiennent pour vainqueurs. Je me suis excusé, comme vous pensez bien. J’ai à faire ici. J’ai donné une belle lettre au lieu de ma personne. On la lira dans le meeting. Mais vous savez le peu qu’est une lettre. En voilà pourtant une qu’on m’apporte, et qui est beaucoup. Certainement, Lady William Bentinck est une bonne femme. Je le savais. A présent, je lui en sais gré. A-t-elle été jusqu'à vous offrir son perroquet, ce perroquet favori qui va se promener avec elle ? Je suis bien aise que le Duc de Wellington, n'ait pas notre rhumatisme. Je dis notre, car décidément j'ai les épaules un peu entreprises. Je n’ai pas même le temps de lire les journaux. J'ai laissé les miens à Paris. Il faudrait ici aller Ies chercher au Club. On me les raconte. Et je n’ai pas besoin qu’on me les raconte. Je les fais bien tout seul, amis ou ennemis. Le rabâchage règne et gouverne dans le monde. J’ai bien remarqué l'âpreté anglaise dans cette affaire du Pilote. Il y a quelque chose de plus que l'humeur de l'affaire même. C’est une humeur générale, et qui prend plaisir à se faire sentir, les plus simples en sont frappés, et frappés aussi de la chose même, de l'étourderie de ce jeune Prince, et de l’inconvénient des étourderies princières. On va de là aux faiblesses royales. Et de là on vient à moi, pour me donner raison. Le Duc d'Orléans a passé ici, cette nuit. Il va sans doute au devant du Prince de Joinville. Nous sommes sur la route de Brest.
Adieu. A mercredi. J’ai ces 24 heures là bien lourdes, sur le cœur. Il n'y a pas moyen. Adieu.
98. Paris, Samedi 21 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie d’avoir fait vos calculs de façon à ne pas me laisser manquer de lettre. Je vous remercie aussi de ce que vous me permettez au sujet du précepteur pour Lord Coke. C’est un enfant charmant. Le type des beaux enfants de l’aristocratie anglaise. Je suis sûre qu’il vous plaira. Quelle belle race que ces Anglais ! Et les enfants qui naissent en Angleterre sont comme cela, étaient comme cela ! J’ai eu hier une lettre de mon frère un peu meilleure que les autres. L’Empereur venait d’arriver au château de Furtustein " il est content de la Pologne, il a été bon pour tous sans se faire illusion." L’Impératrice très faible. Je n’ai vu hier qu’Ellice dans ma longue matinée de Longchamp. Il m’est venu du monde en ville, sur lequel je ne regrette que M. Villers. M. Molé me mande que le grand Duc est arrivé à Lubeck très souffrant et faible. Du reste, no new whatever.
Je mène une vie très solitaire depuis que je ne reçois plus le soir et que ma matinée se passe hors de Paris. Je me couche à 10 heures après une promenade en calèche et cette promenade je la fais invariablement sur la route de Neuilly, la seule praticable puisqu’elle est arrosée ! J’ai lu dans les journaux ce matin, que la réunion de savants à Caen est fixée au 8 août & que vous devez la présider. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous m’avez juré que vous étiez du jury. Je suis extrêmement refroidie sur la partie à Versailles. Vous ne sauriez croire comme je déteste de me déplacer, comme je crains l’inconnu, un mauvais lit. Je ne suis pas difficile, mais mes conforts me sont nécessaires. Je m’engage très lestement pour ce qui est dans l’avenir, mais quand le moment de l’exécution arrive cela me devient insupportable. Je crois que cela s’appelle de la vieillesse.
Adieu, je suis enchantée de vous savoir sorti de vos dîners, il m’en revenait de pauvres lettres. Au reste depuis que j’ai le 31 devant moi, je suis devenue fort accommodante ! Adieu. Adieu. Je ne pense qu’à mardi 31.
97. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma corvée est finie. Ce n’est certes pas la solitude que je suis venu chercher ici. Je suis charmé de la vôtre. J’en profiterai. Je fais de charmants projets. Je fais des vœux pour que le temps se maintienne tel qu’il est aujourd’hui beau et pas chaud. Un de mes voisins de ce matin me l’a promis. " C’est, dit-il, le combat de la lune." Ce sera la lune de miel.
Je regrette que vous n’ayez pas vu M. Villers. Il aime à parler et il doit être curieux à entendre sur l’Espagne. Il a joué là un jeu bien brouillé. Quel triste sort que celui des pays faibles ! Le théâtre des intrigues rivales des grands pays quand ils ne sent pas celui de leurs guerres : jouet ou champ de bataille et toujours victime. Il ne faut pas être petit, et il faut être bon pour les petits. Je crois que c’est pour vous que M. Ellice est venu à Paris. Il me semble qu’il passe sa vie chez vous. Il a de l’esprit et il est très au courant. Comment un homme d’esprit comme lui ne s’aperçoit-il pas que tout en causant, & vous plaisant avec lui, vous ne lui portez pas grande considération ? Et s’il s’en aperçoit, comment s’en arrange-t-il ? Mais il est de ceux qui s’arrangent de tout ce qui les sert ou les amuse. Vous avez un grand talent pour traiter avec ces hommes-là. Vous les attirez sans les laisser tout à fait approcher. Vous leur plaisez et vous leur donnez le plaisir de vous plaire, mais toujours d’un peu loin. C’est votre histoire avec Thiers. En entendez-vous dire quelque chose? Ne trouvez-vous pas que le Maréchal Soult abuse de sa fortune ? Ces visites partout, ces acclamations de tous les jours, cette perpétuelle exhibition, combien de temps cela peut-il durer en Angleterre ? Chez nous, ce serait déjà fini usé. Et vous qui n’aimez pas les répétitions et les longues choses vous n’êtes donc pas Anglaise par là ? Il y a bien des côtés par où vous ne l’êtes pas. Vous avez le cœur plus anglais que l’esprit.
Du reste j’ai un de mes voisins qui arrivait d’Angleterre et qui vous charmerait à entendre, cinq minutes je veux dire car vous ne vous en accommoderiez pas plus longtemps. C’est le plus grand manufacturier du pays ; il est allé parcourir l’Angleterre pour ses affaires ; et malgré les rivalités d’argent, il en est dans un enthousiasme inépuisable ; il professe, il prêche la richesse, la propreté, l’élégance, la grandeur, l’esprit d’ordre, le bon jugement, les bonnes auberges. Je l’écoutais l’autre jour avec le plaisir de vous entendre donner raison. C’est lui qui m’a donné à dîner à Combrée avec 80 amis. Et son toast et son speech en mon honneur valaient son admiration pour l’Angleterre.
9 heures 1/2
93 méritait d’être brûlé vif. Je n’ai fait que mon devoir. Je trouve comme vous, que nous nous adressons de sottes lettres. Si elles pouvaient ressembler à nos conversations, elles seraient charmantes. Ah, nos conversations ? Nous les retrouverons de demain, en huit, pour quinze jours. Que ce sera court, & immense ! Vous y pensez, dites-vous, plus que moi. Je le veux bien, mais je le nie. J’y pense toujours. Ajoutez quelque chose à cela. Je vous en prie ; ayez des caprices ; ne vous laissez gouverner par personne en mon absence. Je ne vous le pardonnerais pas. C’est peut-être un des signes les plus assurés de l’affection que de se laisser gouverner. On ne remet sa liberté qu’à celui qu’on aime plus que soi-même, en qui on se confie plus qu’en soi-même. Redites-moi de vous gouverner.
Je n’ai pas encore de réponse pour le précepteur, vous l’aurez probablement avant moi. Vous ne savez pas combien je voudrais faire, à l’instant même ce que vous désirez. Si je pouvais le faire toujours moi-même, j’en serais sûr. Mais de loin, mais forcé de mettre un esprit au bout de mon esprit, des mains au bout de mes mains, tout est long, & je m’impatiente autant que vous. Adieu. Comment va Marie ? Dites-lui au moins une fois avant mon arrivée que je vous ai demandé de ses nouvelles. Adieu. Lundi prochain, je serai sur la route de Paris. Je vous porterai moi-même mon adieu. G.
92. Lisieux, Jeudi 19 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je m’aperçois que si je ne vous écris que demain matin du Val-Richer et par le facteur vous serez un jour sans lettre. Et comme j’ai un domestique un peu malade, j’aurais quelque embarras à envoyer demain matin à Lisieux. Je vous écris donc d’ici, avant de partir et quelques mots. Depuis que je dois vous voir dans douze jours, j’ai le cœur très léger sur les lettres. Elles ne me plaisent pas moins ; mais j’ai un plaisir plus vif en perspective, et ma pensée se porte sans cesse sur celui-là.
Il est possible que ma mère, mes enfants, Mad. de Meulan, toute ma maison aillent passer à Broglie le temps que je passerai à Paris. Mad. de Broglie veut absolument les avoir tous dans le cours de l’été. Je vais lui proposer pour le 1er août cette visite générale qui lui conviendra, je n’en doute pas. J’en serai bien aise. J’aime autant, quand je m’en vais, les mettre, en bonne compagnie. Je vous dirai du reste comme nouvelle, car c’en est une pour moi, que la route promise pour aller au Val-Richer se fait réellement. Les travaux sont en pleine activité. J’y passerai peut-être dès cette année en quittant la campagne. Elle sera bonne et fort jolie, toute à travers des près et des bois. Vous n’avez jamais vu de près les intérêts-là. Vous ne savez pas avec qu’elle vivacité toute une population s’en occupe. Il y a plus de deux lieues de pays et trois ou quatre villages qui ont foi en moi, une foi aveugle, depuis qu’ils voient cette route s’exécuter. Ils ne croyaient pas que cela fût possible. Nous trouvons que le monde s’est terriblement remué depuis quelque temps. Je vous assure que l’apathie est encore bien plus grande que le mouvement.
5 h. 1/2
Voilà votre N° 96 qui bêtement était allé me chercher je ne sais où dans la ville depuis ce matin. La lettre qui vous sera arrivée aujourd’hui vous aura consolée, j’espère, de la brièveté de l’autre. J’écris à l’instant même pour vous trouver votre précepteur. J’ai un jeune homme en vue ; mais je ne sais s’il est à Paris. Je m’adresse à un homme, en qui j’ai pleine confiance. Il avait élevé mon fils. Je suis assiégé de visites. Adieu. Je vous écrirai mieux demain. Adieu.G.
Mots-clés : Mandat local, Vie familiale (François)
91. Pont-l’Evêque, Jeudi 19 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quel ennui que cette vie de courses et de dîners de grande route et de table ! J’ai siégé hier de 6 heures et demie à 9 heures et demie, comme à un dîner de Pozzo ou de Pahlen. C’était la seule ressemblance. Enfin je serai ce soir chez moi, et je n’en bougerai plus que pour une plus douce raison. A propos de Pahlen, donnez-moi de ses nouvelles. J’ai pour lui une vraie bienveillance. Je crois parfaitement ce que vous me dîtes que la maladie du Grand Duc sera une très mauvaise note pour votre mari. Quand la récolte est mauvaise, les peuples s’en prennent au gouvernement. Les autocrates ne sont pas plus sensés que les peuples, et on déraisonne de haut en bas comme de bas en haut. La guerre de principes à propos de visites et de dîners doit être en effet fort ridicule à Londres. Quand on fait tant que de se quereller pour des principes, il faut remuer le monde. Comment faisiez-vous, de votre temps, pour donner à manger et à danser aux représentants constitutionnels ? Il n’y avait guère alors d’Etat constitutionnel que l’Angleterre. A moins que vous ne comptiez la Suède et les Etats-Unis. Il faut convenir que la générosité à leur égard, vous était plus facile qu’elle ne l’est aujourd’hui à M. de Strogonoff. Savez-vous quelque chose de nouveau des Affaires du Roi de Hanovre ? Il me revient, avec assez de certitude, que le rapport à la Diète sur la pétition d’Osnabrück, a été confié au ministre de Bavière, qu’il est prêt, qu’il est contraire au Roi Ernest, et que dans ce moment tout le travail de l’Autriche et de la Prusse est de l’amener à arranger l’affaire lui-même pour éviter une condamnation de Roi. On me dit en même temps qu’il est vrai que le peuple l’aime assez et le traite assez bien dans son pays. Vous verrez que dans la manie de conciliation du moment les Hanovriens concilièrent la rébellion et la loyauté.
La réception du Maréchal Soult fait un excellent effet dans ce pays-ci. J’appelle un excellent effet l’envie que cela donne aux plus vulgaires de se montrer aussi justes et généreux s’ils en avaient l’occasion. Certainement, si le Maréchal promenait le Duc de Wellington en Normandie, il le ferait applaudir partout. J’ai un grand plaisir toutes les fois que je vois une idée sensée un sentiment élevé se répandre et s’accréditer dans mon pays.
9 h. 1/2
J’ai été interrompu par des visites, et en voilà d’autres qui arrivent. Une petite ville s’ennuie tellement que le moindre événement la charme et la remue toute entière. L’ennui joue un bien grand rôle dans les affaires humaines. Je vous quitte. Il faut que je vieillisse car je commence à tenir à mes habitudes. Je ne vous écris à mon aise que de mon Cabinet du Val-Richer. Adieu. Adieu. On continue, tout le long de mon chemin, à me faire des compliments de condoléance sur mon dérangement du jury. Adieu. Je trouverais aujourd’hui à Lisieux votre N°95.
Mots-clés : Diplomatie, Mandat local, Politique, Politique (France)
90. Lisieux, Mardi 17 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je serai rue de la Charte le 31 Juillet entre midi et une heure, c’est-à-dire dans quatorze jours. Je passerai à Paris la première quinzaine d’août. C’est la belle institution du jury qui me vaut cela. Je viens de recevoir ma convocation officielle. On me plaint beaucoup ; mais on me prêche la vertu ; on me dit qu’il n’y a pas moyen de s’en dispenser, qu’il faut remplir ses devoirs de citoyen. Je réponds vertueusement. Avec vous, je ne dis rien, je n’ajoute rien. Le fait sans phrase. Je n’en sais point qui exprime mon plaisir. Ceci vous consolera, je l’espère, de mes quelques lignes de ce matin. Je n’ai pas la moindre envie de vous parler d’autre chose. Je viens de voir tout ce qu’on peut voir de monde à Lisieux, des bosquets illuminés, des alliées sombres, des allées claires. Pendant qu’on se promenait, j’ai joué au trictrac dans un petit pavillon. C’est mon boulevard contre la conversation qui me poursuit ici sans relâche. Chacun veut avoir la sienne. J’en vais chercher autant demain à cinq lieues d’ici à Pont-Lévêque. Puis, je rentrerai chez moi jusqu’au 30 Juillet. Quinze jours ce n’est pas une éternité de huit mois ; mais, c’est quelque chose Nous le dirons ensemble cet adieu que vous me rendez aujourd’hui. En l’attendant, je vais me coucher. Je n’ai vraiment pas le cœur à une conversation quelconque, même avec vous. J’ai un grand déjeuner demain, avant de partir pour aller dîner. Je serai assiégé dès le matin. Je trouverai pourtant bien moyen de vous dire un autre adieu.
Mercredi 6 h. 1/2
J’ai bien dormi, en me réveillant très souvent ; mais des réveils si doux ? J’espère que vous aurez de meilleures nouvelles de votre Grand Duc. Je lui porte intérêt. Vous n’avez pas d’idée de l’effet singulier qu’ont produit sur moi vos paroles J’espère que mes enfants seront heureux sous son règne. Vous avez parfaitement raison. Mais il ne m’est jamais tombé dans l’esprit que le bonheur de mes enfants dépendit du caractère du souverain. Nous faisons un peu plus notre bonheur nous- mêmes. Nous n’y réussissons pas toujours. Mais enfin, quand nous n’y réussissons pas, c’est notre faute. C’était là ce qui m’irritait sous l’Empereur Napoléon. Je sentais mon sort et celui des miens tout-à-fait dépendant de la volonté, bonne ou mauvaise, sage ou folle, d’un autre homme. Je n’ai jamais pu m’y accoutumer. Léopold ira vous voir quand vous l’aurez reconnu. Il ne veut pas s’exposer à ce que vous ne l’appeliez pas par son nom. Je vous quitte. Je vais faire ma toilette. Il faut que je sois prêt quand on m’arrivera. Tout le monde ici se lève de bonne heure. Adieu. Quel joli adieu ! Il n’a pas encore vécu près de la rose, mais il en pressent le parfum. Vous lasserez vous de la comparaison ? G.
8 heures Voilà le N°94. On m’interrompt aussi pendant que je le lis. Mais ce n’est pas le même interrupteur. Adieu.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Empire (France), Mandat local, Politique
85. Broglie, Jeudi 12 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je passe ici la journée. Je retournerai demain chez moi. J’attends votre lettre de ce matin. On me l’enverra de Lisieux. Je dois l’avoir ce soir. Demain, en passant à Lisieux j’en trouverai une autre. Vous n’aurez point de dérangement non plus.
J’ai trouvé ici quelques personnes ; des députés du département qui y sont venus dîner avec moi ; tous les d’Haussenville possibles deux générations ; il me semble qu’on recommence à attendre la troisième. Le Duc de Broglie est arrivé hier matin, quelques heures avant moi. Il avait dîné la veille chez Lord Granville. Quoiqu’il soit peu bavard & moi peu questionneur, j’ai trouvé moyen d’avoir de vos nouvelles. Mais je voulais mieux. Je suis ici à sept lieues plus près de vous.
Je suis rentré dans cette maison avec émotion. J’y ai été très heureux. Il n’y a pas, dans ce parc, un coin que je n’aie visité avec quelqu’un de cher, de très cher, mon fils le dernier. Nous sommes encore là, la maison et moi rien que nous. J’ai le cœur plein, plein de choses qui vont à vous. Vous seriez bien ici, certainement bien pour quelque temps. Les maîtres sont bons simples, le cœur droit et haut. La vie est facile et assez bien arrangée Je cherche quels conforts vous manqueraient. On m’a donné l’appartement qu’on vous donnerait au rez de chaussée. Il fait un temps magnifique, trop chaud pour vous. Mais l’air est animé et les ombres du parc très épaisses. J’en ai fait le tour ce matin, à huit heures et demie. Il faut quarante minutes. Je n’aurais pas mis plus de temps avec vous. Vous marchez d’un bon pas. Mais nous nous serions arrêtés en causant. Nous nous arrêtons bien quelques fois sur le trottoir de la rue de Rivoli. Charmant trottoir !
En fait de politique, le Duc de Broglie ne m’a rien rapporté sinon le grand émoi du Cabinet, et même plus haut que le Cabinet, sur les triomphes du Maréchal Soult. C’est plus qu’on ne demandait. Et tout d’ailleurs très impérial jusqu’au vin. On n’en rit que du bout des lèvres. On croit des prétentions énormes et près de se mettre au service du parti qui leur promettra le plus. On ne songe plus du tout à lui comme simple Ministre de la guerre. On a offert ce portefeuille, là au Général de Caux qui l’a refusé. On restera comme on est.
11 heures du soir
Votre lettre n’est pas encore venue. On me dit que le courrier de Lisieux arrive le matin et que je l’aurai demain à 9 heures. J’y complais pour aujourd’hui. Il me semble que le mécompte m’est encore plus désagréable qu’il n’eut été au Val-Richer. Ce lieu, les impressions que j’y ai retrouvées tout ce qui semblerait devoir me distraire de vous m’en rapproche. Adieu. Je vous dirai bonjour demain en me levant, car cette lettre-ci partira avant que j’aie la vôtre. Probablement vous êtes déjà couchée. Vous dormez, j’espère. Adieu, Adieu.
Vendredi, 8 heures
Lady Granville part demain. Je ne puis vous dire combien je la regrette. Quel temps doivent- ils passer à Aix ? Je donnerais quelque chose de bon, comme on dit pour être un jour derrière un rideau quand vous causez avec Lady Granville. Je voudrais voir sa gaieté et la vôtre en communication. Personne, je crois n’est moins curieux que moi. Je le suis excessivement pour quelqu’un que j’aime. Il me semble que j’ai toujours, à son sujet, quelque chose de nouveau à apprendre ; et aussi que tout ce que j’en ignore tout ce qui m’en échappe est un vol qu’on me fait. C’est mon bien que je cherche à tout moment, partout. Adieu. J’aurai deux lettres aujourd’hui. Je serai au Val-Richer pour dîner. Adieu, Adieu. G. J’ai oublié de mettre de la cire noire dans mon working desk.
81. Val-Richer, Dimanche 8 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les mouchoirs blancs et rouges sont tout prêts, rangés dans mon tiroir. Je viens d’en prendre un. Le pauvre roi d’Hanovre me paraît bien accusé. On peut encore exercer le pouvoir absolu là où il existe, encore en s’y prenant bien. Mais le rétablir cela ne se peut plus, surtout en en mettant enseigne. Le principe irrite plus que le fait. Les peuples sont comme les femmes, comme les hommes ; ils aiment mieux être maltraités qu’insultes. Votre Empereur a raison ; le Roi d’Hanovre gâte le métier. Si j’étais M. Molé et que j’eusse envie d’avoir le Maréchal Soult pour ministre de la guerre, son fracas à Londres me déplairait fort. Il reviendra de la plein de prétentions, & probablement ne voulant plus accepter d’autre Présidence que la sienne propre. On me mande qu’il n’y a encore rien de sérieux dans tous les bruits de remaniement de Ministère. Ce qu’on remanie, c’est l’administration d’Alger. On va changer, je crois, l’Intendant civil. M. Bresson payera son discours. Le maréchal Vallée écrit que les affaires militaires sont à peu près arrangées, qu’il lui faut à présent, pour second un administrateur actif et un peu considérable, sans quoi il ne saura que faire de tout l’argent qu’on lui vote. On a fait des propositions à un homme de mes amis. Je l’ai engagé à accepter.
Le dîner de la Reine d’Angleterre aux Ambassadeurs Constitutionnels est une affiche en bien grosses lettres. C’est comme toute la politique extérieure anglaise, un grand tapissage sur la rue. Je ne trouve pas que nos journaux en fassent le bruit convenable. Me voilà au bout de ma politique et de la vôtre. La saison est bien morte. Nous glanons. Si nous étions ensemble, nous moissonnerions toujours. La Fontaine a raison. L’absence est le plus grand des maux. Pourtant je me reproche de dire cela. Nous ne connaissons pas le plus grand des maux. Cela fait trembler. J’oublie les nouvelles de St Ouen. On bâtit le Presbytère.
9 heures
Vous dîtes que je ne vous connais pas tout-à-fait. Tant mieux ; car plus je vous ai connue, plus j’y ai gagné, et vous n’y avez pas perdu. Vous êtes pourtant d’une nature, simple, pas un peu simple, comme votre grand duc, mais très simple. La simplicité riche, c’est la perfection. Votre âme est riche, inépuisable. Je la connais mieux que je ne vous le dirai jamais. Je ne vous dis pas tout de vous surtout. Et de loin, que dit-on?
J’ai repris mer leçons avec mes filles. Je remplace leur maître d’arithmétique! Elles sont bien heureuses. C’est quelque chose de singulier qu’une vie si animée et qui laisse si peu de traces. J’ai probablement été dans mon enfance, aussi heureux, aussi animé que le sont mes filles. Je ne m’en souviens pas du tout. Vous souvenez-vous de votre enfance ? Je suis né vers seize ans. C’est de là que date ma vie, dans ma mémoire à moi. Je vous parlais de mes filles. Un de leurs bonheurs, c’est que je en leur lis le soir. Nous achevons un très joli, roman de Walter Scott, peu vanté : Richard en Palestine. Mais je ne veux pas ne leur lire que des romans même de ceux-là. C’est une lecture trop amusante, un plaisir de paresseux, un aliment qui dégoûte des autres, et ne nourrit pas, les jours derniers, j’ai pris Plutarque, la vie de Thémistocle. C’est charmant ; mais c’est un travail de lire cela à des enfants. Il faut à chaque instant sauter, retrancher, retourner, expliquer. Les faits, les livres, les esprits, le langage tout cela est bien grossier. Il n’y a pas moyen de mettre cela sous les yeux des enfants. Je ne suis pas prude ; mais avec mes filles. je deviens de la susceptibilité la plus ombrageuse. Je ne voudrais pas laisser approcher de leur pensée de leur petite figure, si fraîche et si pure un mot, une ombre, un souffle moins frais et moins pur. Pour les âmes, le mal, c’est la peste contagieuse à faire trembler, contagieuse par un mot, un regard ! J’ai fait en lisant la vie de Thémistocle, des tours de force et d’adresse admirables pour écarter le mal que je rencontrais à chaque pas. Je l’ai écarté hier ; mais demain, mais un jour, il les approchera nécessairement. N’importe, que ce soit tard, le plus tard qu’il se pourra. La longue innocence se répand, sur toute la vie.
10 h. 1/2.
Il paraît que nous parlons l’un et l’autre bien obscurément sur mes carpes. Je ne croyais pas du tout que vous les attendissiez en personne, pas plus que je n’avais pensé à vous les envoyer. Je ne voulais que justifier mon récit de leurs aventures. Mais laissons-le là. C’est plus qu’elles ne méritent. Gardez votre style, anglais ou non. Je ne vous pardonnerais pas d’en changer. Adieu. Adieu. G.
169.Lisieux, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier au moment où j’allais partir, deux personnes me sont arrivées qui viennent passer deux ou trois jours au Val Richer. Il a bien fallu les y laisser pour venir dîner ici, et je les laisserai encore aujourd’hui. Aussi je retourne, sur le champ pour être poli au moins à déjeuner. Encore aujourd’hui vous n’aurez donc que quelques lignes. Cela me déplaît, je vous assure autant qu’à vous. Il me semble que je vous ai sous ma garde, et que je manque à ma consigne quand je vous quitte. Il faut que vous me plaisiez beaucoup et bien sérieusement pour qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas le goût ni l’habitude, des devoirs factices, et je n’aliène pas aisément une part de ma liberté. Vous avez vécu dans un pays libre, représentatif, électoral. Mais vous n’en avez jamais mené la vie. Vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un grand dîner d’électeurs importants, où viennent s’étaler toutes les importances, toutes les magnificences de l’endroit où il faut passer deux heures à table mangeant et causant, deux heures après la table causant et jouant au trictrac, avec 40 personnes. Voilà ma vie hier et aujourd’hui. Cela aussi, il faut que ce soit bien sérieux pour que je le fasse. Mais c’est un sérieux moins plaisant.
Je crois comme Berryer que la prochaine session sera importante et très animée si chacun consent à prendre sa position simplement, nettement, sans but immédiat et sans combinaison factice. C’est, pour mon compte, ce que je me propose de faire. Adieu. On me dit que ma calèche est prête. La poste n’est pas encore arrivée. J’espérais l’avoir avant de partir. Elle viendra me chercher au Val-Richer. Il a fait un brouillard abominable, cette nuit. Le courrier aura marché plus lentement. Adieu. Adieu. Non pas comme si nous nous promenions, aux Tuileries, mais comme dans notre cabinet. G.
153. Val-Richer, Lundi 8 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me souviens qu’hier, étourdiment je vous ai encore adressé ma lettre aux Champs Elysées. Elle vous sera peut-être arrivée quelques heures plus tard.
Je suis fâché de ce que mande M. de Médem, plus fâché que surpris. Il m’a toujours paru, par ses lettres que votre frère était réellement blessé de votre peu de goût pour la Russie. C’est bien lui qui sincèrement ne conçoit pas que vous ne préfériez pas à tout, votre état de grande Dame auprès du grand Empereur dans le grand pays. M. de Lieven est encore plus soumis, pour parler convenablement mais moins russe et vous comprend mieux. Rien n’est pire que l’humeur sincère d’un honnête homme de peu d’esprit. Il se croit fondé en raison, et ce qu’il y a de plus intraitable, c’est la conviction qu’on a raison. M. de Médem aura peut-être choqué encore votre frère en lui répétant que, bien réellement, avec votre santé, vos habitudes, vos goûts, vous ne pouviez vivre ailleurs qu’à Londres ou à Paris. Les gens d’esprit vont quelque fois trop brutalement au fait. Enfin je raisonne, je cherche, je voudrais tout savoir et tout expliquer, tant cela intéresse. Je voudrais surtout que vous eussiez auprès de l’Empereur quelqu’un de bienveillant et d’intelligent, qui vous comprît, et vous fît comprendre. Je crois toujours qu’avec de l’esprit de la bonne volonté et du temps on peut beaucoup, quand on est toujours là. M. de Nesselrode et Matonchewitz, à ce qu’il me semble y seraient seuls propres. Mais l’un est trop affairé, l’autre trop petit, et ni l’un ni l’autre ne s’en soucie assez. Je suppose que vous avez répondu à votre mari.
Montrond a passé en effet son temps chez Thiers. Je suis curieux de ce qu’il y a porté et de ce qu’il en a rapporté, au moins de ce qu’il en dit. Je le verrai à mon retour. Il a vraiment de l’esprit, de l’esprit efficace. Il faut beaucoup pour qu’il rajeunisse un peu. Il était cruellement cassé.
8 h 1/2
Je viens de sortir pour aller voir mes ouvriers. Je plante des arbres. Nous avons depuis huit jours un temps admirable. Ma mère et mes enfants en profitent beaucoup dix fois dans le jour, je les envoie, au grand air, comme on envoie les chevaux à l’herbe. Nous nous promenons ensemble après déjeuner. Le matin, tout à l’heure j’assiste au premier déjeuner de mes enfants, chez ma mère. Trois fois par semaine ; ils viennent chez moi tout de suite après prendre une leçon d’arithmétique. Le soir de 9 heures et demie à 8h 1/2, je leur lis de vieilles Chroniques sur les croisades, qui les amusent extrêmement. Le reste du temps, je suis dans mon cabinet ou je me promène pour mon compte.
Quel est donc le mal de la Princesse Marie ? Quel qu’il soit, j’en suis fâché, et j’espère que ce n’est pas vraiment grave. Elle a de l’esprit. J’ai quelque fois causé avec elle tout -à-fait agréablement. Je m’intéresse à elle comme à une personne en qui on a entrevu en passant plus que le monde n’y verra, et qu’elle-même ne saura très probablement.
J’ai eu hier beaucoup de visites. On se hâte de venir me voir. J’aurai d’ici à quinze jours, quelques dîners à Lisieux private dinners, pas de banquet. Je n’en veux pas cette année Je l’ai dit à mes amis et ils l’ont fort bien compris. Je ne veux pas parler politique avant la Chambre.
10 h.
Le facteur m’arrive au milieu de ma leçon d’arithmétique. Je reçois des nouvelles de l’arrivée de Mad. d’Haussonville. Je veux écrire un mot à M. de Broglie. Adieu. Adieu, comme à la Terrasse, dans ses meilleurs jours. G.
148. Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.
A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.
J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.
9 heures
Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.
127. Val-Richer, Mardi 11 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement l’état de Marie n’est pas naturel. Regardez-y bien et prenez les arrangements, convenables. Je suis préoccupé pour vous de cet ennui nouveau, qui peut- être aussi un trouble. Il est bon qu’elle vous quitte pour quelque temps. La Duchesse de Talleyrand est assez propre, avec son air féroce, à lui imposer une contrainte sanitaire. J’attends impatiemment le résultat de vos délibérations avec Lady Granville. J’ai bien envie d’être jaloux d’elle. Quoique jaloux, je suis charmé de son retour. Elle vous est aussi utile qu’agréable, de bon conseil et de doux passe-temps. Nous avons raison de tenir au Cabinet Whig. Du reste, j’espère qu’il tiendra. Avez-vous lu sur son compte et sur la dernière session du Parlement, un article assez intéressant de M. Duvergier de Hauranne dans la Revue française qui vient de paraître ? Qui dit-on des démentis de M. Molé au général Bugrand ? L’opposition a bien peu d’esprit. C’est la légèreté de M. Molé qu’il faudrait poursuivre. Evidemment, il a dit au général Bugrand ce que celui-ci a répété. Ce n’est que cela ; mais c’est bien quelque chose. Evidemment l’affaire suisse va tomber dans l’eau. La suisse prend son temps pour faire une platitude. On a fait de tous temps des platitudes, mais autrefois, elles n’étaient pas précédées de ces éclats publics de ces fanfaronnades qui sans les empêcher aujourd’hui, les rendent parfaitement ridicules. A la vérité, il n’y a plus de ridicule ; nous en avons perdu la liberté et presque le sentiment. Depuis que le genre humain tout entier est en scène, on n’ose plus se moquer de personne.
Vous vous seriez moquée de moi hier si vous aviez eu avec quelle prolixité, quelle gravité je discutais avec les autorités de St Ouen, la question d’un bout de chemin vicinal que je veux échanger contre un autre. Vous vous sentez un peu jalouse du Val Richer. Vous avez bien tort. Je fais de mon mieux pour prendre intérêt à tout cela. J’y donne du temps, de l’attention. Je m’occupe sérieusement d’une plantation, d’un vase, d’un meuble d’une gravure. Je n’y ai point mauvaise grâce, je vous assure, et les assistants me savent, je crois, très bon gré de mon empressement et de mon plaisir.
Mais au fait tout cela est parfaitement superficiel tout cela ne m’occupe, ni ne m’amuse ; mon temps est plein mais rien que mon temps ; et quand je rentre dans mon Cabinet, je ne retrouve dans ma pensée à peu près rien de ce qui a rempli ma journée. Je ne puis me soucier vraiment et m’occuper sérieusement que de trois choses, les gens que j’aime, les affaires publiques, et les questions religieuses. Je comprends qu’on se donne tout entier à une personne, à la politique, ou à Dieu. Le reste n’en vaut pas la peine.
Je suis bien aise que vous ayez causé à fond avec Médem. Il faut qu’une fois au moins un homme d’esprit dise votre position ici et comment vous vivez. Si de l’autre côté, il y avait aussi un vrai homme d’esprit, rien de tout ce qui vous arrive, n’arriverait. Vous avez bien raison. Toutes les fois que deux hommes d’esprit se voient, ils se séparent contents l’un de l’autre. M. de Metternich et Thiers ont dû s’amuser beaucoup. Thiers fait profession d’être absorbé dans l’histoire de Florence.
10 heures
La phrase me déplaît aussi. Merci de me la pardonner. Un seul mot pourtant, pour excuser. Je ne veux, je ne puis penser à moi, à mon bonheur, à mon plaisir et y subordonner toutes choses, que si je suis pour vous tout ce que je veux être. A cette seule condition, je vous garde à tout prix. Si cela n’était pas, je ne penserais plus qu’à vous, aux intérêts et aux convenances de votre avenir, de votre avenir à vous seule. Voilà mon sentiment quand j’ai écrit cette phrase. Pardonnez-la moi encore ; mais ne dites pas qu’il y a de la glace dessous. G.
116. Lantheuil, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Un seul mot qui, j’espère, vous arrivera à temps. Je me suis échappé du salon où je ne sais combien de personnes sont venues me voir. Je fais le métier de bête curieuse. On vient de m’apporter les N° 118 et 119. Je suis charmé qu’Alexandre vous arrive. Ce sera une douce distraction. Vous avez, je crois, toute raison de préférer l’Angleterre à Baden. Il faut qu’on vienne chez vous, et non pas, vous aller chez les autres. Vous débattrez beaucoup mieux votre avenir à Londres qu’à Baden. En tout cas, je suis bien aise qu’il y ait pour un an du moins, quelque chose de connu, de réglé.
Je serai chez moi après-demain, à ma grande satisfaction. Si ce régime-ci durait, j’aurais le sort de Vert-Vert. Aujourd’hui, je suis chez des gens qui m’aiment vraiment et qui me plaisent, chez les Turgot. Adieu. On vient me chercher. Voici une lettre bien plus misérable que la vôtre. Pardonnez la moi. Je le mérite car mon plus doux temps est celui où je vous écris. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Famille Benckendorff, Mandat local, Vie familiale (Dorothée)
114. Caen, Mardi 28 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non, je ne suis pas mécontent. Non, vous ne me fatiguez, vous ne me fatiguez jamais. Mon affection n’est pas à la merci de ces vicissitudes de l’âme. Et puis, je trouve votre tristesse si naturelle. Certainement, vous avez trop perdue vous êtes bien seule, seule par ce qui vous reste comme par ce qui vous a été enlevé. Vous ne savez pas tout, ce que je ressens pour vous de tendre compassion, combien votre isolement m’occupe et me pèse. Je voudrais voir auprès de vous les fils que vous avez encore, vous voir avec eux un home. Avez-vous des nouvelles d’Alexandre ? Mais ne craignez jamais, quand cela vous soulagera, de me montrer votre tristesse. Vous m’avez blessé quelques fois dans notre vie. Je crois que vous ne me blesserez plus. Merci de vos détails. Ces couches font un grand effet dans le pays. J’ai vu plus d’une fois ces effets là. Ils ne suffisent pas aux gouvernements, et ne les dispensent de rien. Mais ils rendent la bonne conduite plus facile et plus profitable à ceux qui savent se bien conduire. Nous avons aujourd’hui, une course spéciale, instituée hier en l’honneur du Comte de Paris.
Le soleil est magnifique. Décidément il m’accompagne. J’ai eu hier avec mes Antiquaires, une soirée brillante. 1500 personnes étaient entrées dans une salle qui en contient 1200. On a cassé des carreaux de vitre pour entendre du dehors. Ce que j’ai dit a été bien reçu. La gauche, même la plus vive, avait évidemment pris son parti d’être bien pour moi. Je connais ces alternatives là.
Je regrette que Pahlen ne vous ait rien apporté de plus. J’avais espéré d’un peu meilleures paroles. J’ai tort de dire que j’avais espéré. Mon instinct espérait, ma raison non. Quel monde que le vôtre ! Point d’âme dans les uns, point d’esprit dans les autres. Ceux qui vous ont aimée autre fois ne s’en souviennent pas plus que s’ils ne vous avaient jamais connue. Ceux qui vous aiment ne savent pas vous servir. L’occident a bien ses défauts, et je les lui ai dits souvent ; mais votre Orient ! Je plains le soleil de le trouver le premier sur son chemin. Adieu.
J’ai ma toilette à faire, des visites à recevoir la course à voir. Je vais dîner à la campagne. Je mène ici une vie très active. Je suis fâchée d’abréger mes lettres surtout quand les vôtres sont tristes. Qu’il y ait au moins dans votre cœur un coin tranquille et doux, et point solitaire. Adieu. Adieu. Mon mal de dents est à peu près parti. G.
113. Caen, Lundi 27 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne flatte jamais quand j’aime. Pas un nuage ne passe devant mon soleil que je ne le voie. Mais il n’a pas un rayon qui m’échappe et qui n’illumine tout à mes yeux. On ne sait pas aimer. On ne sait pas admirer. On ne sait pas jouir de ce qu’on aime et de ce qu’on admire. On en laisse perdre des trésors. Et quand on ne perd rien, quand on jouit de tout, pourquoi ne dirait-on pas tout ? Pourquoi ne renverrait-on pas tout son plaisir à sa source. On ne sait pas non plus faire plaisir à qui on aime. On en laisse échapper mille et mille moyens, mille et mille occasions. Je ne veux rien perdre, ni du plaisir que je puis prendre, ni du plaisir que je puis donner. Quel petit mot que celui-là ! J’en sais qui me conviennent bien mieux. Mais ne soyez pas malade. Je ne sais pas de mot pour mon chagrin. Pourquoi cette maigreur soudaine ? Vous êtes vraiment encore plus mobile au physique qu’au moral, pour parler comme les philosophes. N’oubliez pas de me dire ce qui sera parti de cette maigreur, si vite venue.
Je suis arrivé hier ici au milieu des coups de canon, des courses de chevaux et d’un dîner de 40 personnes. Tout cela ne m’a pas empêché de dormir. On m’a reçu à bras ouverts. J’amenais moi d’abord, puis le soleil. On nous attendait tous deux avec grande impatience. J’ai trouvé la population, vraiment la population charmée de son Prince et disant : le bonheur nous en veut. Le mot courait de bouche en bouche, et on disait bien nous. Soyez sûre que ce pays-ci regarde tout-à-fait ce gouvernement comme sien. C’est une force immense. J’écrirai ce matin, à M. le Duc d’Orléans que doit être bien content. Je suis ici jusqu’à samedi. Je passerai mon temps à déjeuner et à dîner dans les environs. Je préside ce soir la société des Antiquaires., Samedi je rentrerai chez moi. Ecrivez-moi donc Vendredi au Val-Richer.
Mon mal de dents est fort diminué. Je le sens mais je n’en souffre plus. Vous me conterez votre dentiste. Du reste, je ne m’étonne pas que le contraste vous ait frappée. Brewster à les meilleures façons du monde. Je trouve la lettre d’Ellice très sensée, car elle est d’accord avec mes conjectures. Ne vous arrive-t-il pas comme à moi, d’être sans cesse étonnée tantôt du beaucoup, tantôt du peu d’esprit que vous avez ? On devine quelques fois merveilleusement de très grandes choses et puis tout à coup on s’aperçoit qu’une petite chose qui se découvre et qu’on ignorait, modifie, immensément ce qu’on croyait très bien savoir. Avez-vous causé avec Pahlen ? Je suis impatient de savoir s’il n’aura rien vu, s’il ne vous aura rien dit qui vous éclaire un peu sur ce qui vous touche.
Adieu. Il faut que j’écrive à M. le Duc d’Orléans et à ma mère. Puis ma toilette. Puis des visites. Puis le déjeuner. Puis les courses. Puis le dîner, la séance, les speechs. Adieu.
Tout cela fait bien du bruit. Mais le moindre grain de mil Ferait bien mieux mon affaire Adieu. Je vous écris dans le même cabinet et de la même table d’où je vous ai écrit l’an dernier, à Boulogne, quand vous êtes revenue de Londres. Toujours.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Mandat local, Portrait (Dorothée)
69. Val-Richer, Jeudi 26 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis revenu ce matin de Lisieux où j’ai couché. J’y retourne à 4 heures Je fais planter, démeubler, enfermer, emballer. Je ne sais si je viendrai à bout, avant mon départ de faire ce que je veux avoir fait ici. Vous ne savez pas qu’il faut que je regarde à tout, que je sois maître et maîtresse de maison. C’est ennuyeux, et quelques fois plus qu’ennuyeux. Je n’aurai pas ces jours-ci une heure à moi. Notre correspondance s’en ressentira, notre correspondance mon plus vif et plus doux plaisir, ma vie et mon repos, tant que je suis loin de vous ! J’y ai moins de regret ; dans cinq jours, je serai près de vous. Vous avez raison, que de choses possibles dans cinq jours ! Mais il n’en arrivera aucune. Il ne se peut pas qu’un tel bonheur me manque, nous manque.
J’espère que votre indisposition ne se prolongera pas trop. Non, si j’étais là, je ne vous lirais pas les Hindous. Ce n’est pas ce moment. Voilà un mot qui, depuis ce matin, résonne sans cesse dans mes oreilles, et dans mon cœur. Je n’entends que cela, je ne pense qu’à Je reçois le N°71 au moment de monter en voiture pou retourner au Val-Richer. Beaucoup, beaucoup de repos ; un long repos. Êtes-vous aussi malade qu’à Abbeville ? Vous m’écrivez encore dimanche pour lundi. Et puis plus de lettre ! Adieu, adieu. C’est l’avant dernier.
65. Val-Richer, Dimanche 22 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est très doux de se réveiller quand on a le cœur content. Je ne m’étonne pas que les oiseaux chantent en se réveillant. La vie leur plait, et ils se réjouissent de la retrouver. Je ne chante qu’en dedans ; mais cela me suffit. Je m’entends moi même. Quels enfantillages je vous conte là ! Il faut bien que je vous conte mes enfantillages après mes folies. Une fois ensemble, nous parlerons sérieusement. Nous allons entrer dans la dernière semaine. Il est possible que par des arrangements de voyage j’arrive à Paris, le 31 à 7 heures du matin au lieu de 5 heures du soir. Je vous verrai ainsi quelques heures plutôt. Je vous le dirai positivement d’ici à trois jours. Le réveil du 31 vaudra encore mieux que celui d’aujourd’hui.
En attendant, et dans les moments de liberté qu’on me laisse ; je plante. Mon jardin, n’est pas commencé, mais pour ne pas perdre tout-à-fait cette année, je mets des bouquets d’arbres et d’arbustes là où je suis sûr qu’il en faudra. Il m’est venu hier 76 pins, mélèzes, sapins et arbres verts de toute espèce, déjà un peu grands; et j’ai passé presque toute ma matinée à marquer les places, à faire creuser les trous, tant au bord de la pièce d’eau, tant assez près de la maison autour d’un banc, tant à une place d’où l’en entrevoit une jolie vallée un peu lointaine. N’est-ce pas qu’il faut absolument quelque part une grande allée droite où l’on puisse se promener sans tourner sans cesse, et causer en voyant devant et derrière soi ? J’en aurai une ou plutôt deux tombant l’une sur l’autre à angle droit. La première sera d’arbres ordinaires, tilleuls, marronniers, cerisiers, je ne sais pas bien lesquels ; j’ai envie que la seconde, beaucoup plus courte, soit toute en arbres verts, deux rideaux bien hauts, bien droits, fermant bien les côtés, mais laissant voir le ciel. Qu’en dites-vous ?
Je suis curieux de votre conversation avec Thiers, ce que vous me mandez de lui ne m’étonne pas du tout. Du reste sa conduite dépendra des élections. Si elles lui sont favorables, si la gauche gagne du terrain, il fera de nouveaux pas vers elle, sera exigeant, arrogant, menaçant avec le Ministère. Si l’ancienne majorité revient la même c’est-à-dire affermie, il sera doux, modeste, se fera ministériel soutiendra, promettra. Il y a là cependant pour lui une grosse difficulté. Il ne voudra pas faire ce métier-là gratis ; et on ne pourra lui donner le prix qu’il voudra. J’ai peine à croire qu’il se mette à si bas prix que le marché. soit possible. Nous verrons. Mes nouvelles électorales sont assez bonnes. J’ai grande envie de savoir un peu aussi les projets de Berryer. Je ne crois pas que son bataillon se grossisse autant que quelques personnes l’espèrent ou le craignent. Il n’acquerra pas plus de 15 ou 20 nouveaux membres. Cependant ce sera un petit bataillon et dans une assemblée incertaine, comme le sera encore celle-ci, c’est toujours quelque chose.
On commence donc à vous soutenir un peu. Vous propagez la rébellion. Je suis bien aise que Pozzo s’en mêle. J’ai pour lui un fond de vieux goût. J’en ai toujours pour les hommes dont l’esprit a mis le mien en mouvement et avec qui j’ai causé bien en train, bien à l’aise, n’importe sur quoi. Je vous préviens que je ne vous écrirai cette semaine que des lettres misérables. J’aurai de jour en jour, moins de goût à vous écrire. J’ai une multitude de petites affaires qu’il faut absolument que je règle. On me prend tout mon temps en visites. Je vais trois fois dans la semaine dîner à Lisieux.
Mlle Chabaud, cette amie de ma mère qui était ici et avait bien voulu se charger de la leçon d’anglais de mes filles, est partie hier. Je reprends mon rôle. J’ai déjà lu hier avec Henriette une scène de Shakspeare, Hamlet and the ghost. Elle l’entend assez bien. 11 1/4 Je comprends votre agitation, votre presse. J’ai regret d’y avoir ajouté. Ne m’écrivez que quelques mots si vous êtes fatiguée. Adieu, adieu. Votre N°66 me charme. Adieu.
48. Val-Richer, Mardi 26 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai aujourd’hui beaucoup de monde à dîner. Demain, je pars de bonne heure pour Croissanville. Je ne vous en dirai pas long. Mais il faut absolument que je vous dise quelque chose, que je vous remercie de ne pas vous agiter de ces misérables tracasseries, des vôtres et des miennes. Je dis misérables de quelque source quelles viennent, d’un trône ou d’un parti. Cela est bien fort ; mais nous sommes plus forts. Vous lisez quelquefois Salomon n’est-ce pas ? Eh bien il a dit cette belle parole, dans le Cantique des cantiques. Fortis est ut mors dilectio. Cherchez au chapitre 8, verset 6. Vous verrez le sens car vous ne savez, dites-vous, que le latin, des Protocoles.
J’ai toujours vu Madame, que quand on était bien décidé, un peu prudent et pas mal spirituel, on surmontait les difficultés une à une à mesure qu’elles se présentaient, des difficultés qui, vues d’avance et en masse, semblent insurmontables. Une seule chose nous importe, c’est d’être l’un et l’autre parfaitement au courant de notre situation, de nos embarras mutuels. Grand soulagement d’abord, grande facilité de plus. Nous unirons tour à tour, contre le problème ou l’embarras du moment nos deux esprits et nos deux volontés. Nous en viendrons à bout, je vous en réponds. J’avais bien un peu prévu ceux qui m’arriveraient du côté de mes amis, mais prévu comme on prévoit, c’est-à-dire vaguement et dans un lointain auquel en regarde à peine. Je suis bien aise de les avoir vus de plus près, et charmé de vous en avoir parlé. Je ne m’en inquiète pas le moins du monde ; bien moins que vous ne devez que nous ne devons nous inquiéter des vôtres. Avec quelques soins, de bonnes conversations, la vérité et la tribune, je dissiperai aisément ces nuages d’intérieur. Ceux de votre horizon à vous, sont plus noirs et plus pesamment chargés. Il faudra que nous y regardions sans cesse que nous nous appliquions, à démêler de loin, à déjouer d’avance les méchancetés, les mensonges. Il y en aura beaucoup. Je vois d’ici comment on les invente, comment on les met en circulation. Je connais ce monde là. Mais, je vous le répète, nous les démêlerons, nous les déjouerons. Ce que je ne connais pas, et à quoi je ne puis pas grand chose, c’est ce qui vient de chez vous ! Vous en serez chargée. Cependant, je vous y aiderai, soyez en sûre. Je vous rendrai, même là, le succès plus facile. Je savais tout ce que vous me dites de votre situation là. Il faut que vous la conserviez cette situation, là et en Europe. Ce n’est pas votre situation, je n’ai pas besoin de vous le dire, qui m’a attiré vers vous, qui m’a attaché à vous. Mais il me plaît que vous l’ayez ; il me plaît qu’elle soit grande, très grande. Il n’y a rien de trop grand pour vous, rien de trop grand selon votre nature et selon mon cœur. Il faut que tout le monde vous voie haut et compte avec vous. Vous serez toujours au dessus de toutes les grandeurs.
Du temps, Madame, du temps et nous : nous arrangerons tout cela. Jamais parfaitement, jamais à notre pleine satisfaction ; jamais assez pour que les ennuis et la nécessité d’y prendre du soin ne recommencent pas sans cesse; c’est la condition de ce monde ; mais assez pour que notre intérêt à nous, notre intérêt si doux et si cher soit assuré et que personne n’ait le pouvoir de nous y déranger.
Mercredi 7 heures
Je partirai, tout à l’heure. J’espère cependant avoir votre lettre auparavant, Un de mes amis de Lisieux, qui vient avec moi à Croissanville, m’a promis de m’apporter ici mon courrier de très bonne heure. Je reviendrai ici ce soir. Oui j’aurais été très étonné de trouver votre salon arrangé comme vous me le dîtes. Peut-être un petit mouvement ... Comment dirai-je ? Je ne sais pas trop je ne me soucie pas d’appeler cela par son nom ...un petit mouvement d’autre chose, se serait mêlé à la surprise. Cependant, dearest continuez, quittez votre place, faites de la musique, cherchez et trouvez un peu de distraction, vous en avez besoin pour votre santé, pour le repos de votre esprit. Je veux que vous en ayez, seulement, quand vous êtes à votre piano, continuez aussi de regarder à la porte pour voir si j’entre.
9 h. 1/2 Je suis obligé de partir sans avoir votre lettre. Cela m’ennuie. J’espère qu’on me l’apportera directement à Croissanville. Adieu donc, cet adieu éternel. Plût à Dieu qu’il fût éternel, mais non pas de loin ! G.
46. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est à peine six heures. Le Soleil n’est pas encore au dessus de l’horizon. J’ai mal dormi. Je me lève. Hier en me couchant, à 10 heures et demie, je me suis figuré dans la malle-poste au lieu de mon lit courant vers vous. A peine endormi, j’ai rêvé dans la malle-poste. A quatre heures, je me suis réveillé comme si j’arrivais. Ce devait être aujourd’hui en effet. Vous en avez douté quand je vous l’ai dit. Vous avez prévu que ce ne serait pas. Dearest, voici l’exacte vérité. Je n’en étais pas sûr. Le jour du mariage de M. Duchâtel n’était pas absolument fixé. Il m’avait parlé du 25 septembre au 2 ou 3 octobre. J’ai été faible pour moi, faible pour vous. J’ai pris la supposition favorable sans y compter, pour nous faire plaisir à tous deux, pour ne pas nous donner tout à coup, à vous un chagrin, à moi le vôtre, et le mien. J’ai eu tort. On a toujours tort, avec la personne à qui l’on dit tout, à qui l’on doit tout, de ne pas dire exactement ce qui est ce qu’on croit. Il faudrait toujours braver la peine du moment pour éviter la peine à venir. Pardonnez- moi de ne l’avoir pas fait.
Votre n°46 m’a touché, et me touche profondément ; si triste et si douce ! Si vive et si raisonnable ! Le jour où j’ai un peu causé avec la petite Princesse elle m’a dit deux ou trois fois, en me parlant de vous : « une personne si supérieure, si extraordinaire". A chaque fois ces paroles me pénétraient, me charmaient ; d’orgueil si on veut, mais de ce délicieux orgueil qui naît d’une tendresse infinie, au dessus, bien au dessus duquel cette tendresse plane, dont elle fait le pouvoir et le prix.
Oui, je suis fier, fier de vous, de votre affection pour moi de votre supériorité, de cette supériorité que je connais mille fois mieux que personne dont je jouis comme personne n’en a jamais joui. Et quand je la retrouve dans les plus petits détails de la vie, quand je vois réunies en vous les qualités, les attraits les plus contraires, tant d’abandon et tant de dignité, un cœur si tendre et un esprit si ferme, une imagination si vive et une raison si droite, un caractère si passionné et si doux, une humeur si égale avec des impressions si variées, je suis heureux, heureux, Madame, bien, bien au delà de tout ce que peuvent vous exprimer de loin mes lettres, et même mes adieux.
Maintenant, voici où j’en suis et ce qui sera. Le mariage de M. Duchâtel n’étant plus rien pour moi j’ai pris la dissolution. Elle sera certainement prononcée et publique dans les premiers jours d’Octobre au plus tard. J’ai un dîner chez moi au Val-Richer, demain 26. Après-demain 27 je vais dîner à Croissanville, à 4 lieues d’ici, avec une réunion d’électeurs. Du 27 au 2 octobre, je ferai quelques courses dans l’intérêt des élections voisines. Je recevrai beaucoup de visites. Le 3 octobre encore un dîner pour moi, et une réunion d’électeurs à Mézidon, dans ce canton que je n’ai jamais visité. Le 4 un dîner à Lisieux, point un meeting, un dîner privé, mais avec beaucoup d’électeurs. Le 5 à 1 heure et demie je monte dans la malle-poste, et le 6 à 4 heures du matin, je passe dans la rue de Rivoli, pour faire le même jour, à une heure & demie quelque chose de mieux que d’y passer.
Voilà, d’ici là ma biographie et mon itinéraire. C’est long, bien long. Je ne demande qu’une chose, dearest, une seule chose. Soyez sûre, sûre aujourd’hui comme vous le serez dans deux ans, dans trois ans, que c’est aussi long pour moi que pour vous. Ne dites donc pas que vous me contez trop de petites choses, que vous me donnez trop de détails. Jamais assez. Au milieu du grand bonheur, c’est mon petit, mais très vif plaisir de vous suivre pas à pas dans tout le cours de la journée, d’assister à toutes vos actions, d’heure en heure. Il y en a une que je regrette, qui m’a un peu désagréablement ému le cœur. Vendredi soir vous avez fait de la musique devant votre monde ; et moi, je ne vous ai pas encore entendue. Je ne veux pas, la première fois, vous entendre devant du monde ; mais je voulais avoir votre première musique, à moi seul. Vous ne savez pas à quel point la musique me plaît, m’émeut. Mais c’est pour moi une impression très intime, et qui se lie tout de suite à mes impressions les plus intimes, une de ces impressions dont je n’aime pas à parler excepté à la personne à qui je parle de tout. Je vous aurais si délicieusement écoutée !
J’attends ce matin, M. de Saint-Priest, Alexis, qui vient passer ici 24 heures. Il m’en dira long sur Lisbonne, les Chartistes, Lord Howard de Walden, Saldanha, Sä de Bandeira & & J’ai recommencé hier au soir à lire à mes enfants un romans de Walter Scott. Je vous le dis pour vous montrer que j’ai complètement repris l’usage de ma gorge. Je suis ravi que vous ayez aussi bien retrouvé celui de vos jambes, Certainement c’est une preuve de force.
11 heures Le N° 47 me désole de mille façons, toutes si douloureuses. M. de L., votre chagrin, votre manque de foi, votre santé. Mes lettres suivantes vous auront été un peu meilleures. Celle-ci vous donne une certitude, de voyage, de jour. Si vous saviez que je n’ai pas pensé, que je ne pense pas à autre chose. Croyez-vous donc que je n’ai pas pensé à emmener ma mère à Paris ? Mais elle est mieux et se trouve bien ici. Je vous répondrai demain avec détail. Adieu. Adieu. Soignez-vous, je vous en conjure. Adieu. G.
42. Val-Richer, Jeudi 21 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime à venir à vous le matin, en sortant de mon lit comme le soir en m’enfermant dans ma chambre. Je n’ai pas pu hier soir. Il m’est arrivé deux visiteurs qui passeront ici deux jours. J’attends aujourd’hui M. Duvergier de Hauranne. Il faut se promener, causer. Mon temps se trouve pris. Je le passerais bien plus doucement à lire, à lire votre lettre d’hier. Vous êtes-vous jamais occupée de magnétisme, de ces contes de gens qui agissent à distance, à très longue distance, qui endorment ou éveillent, troublent ou apaisent à travers l’espace, d’autres gens sur qui ils ont pouvoir ? Je crois à votre pouvoir, à votre magnétisme. J’ai vécu hier, je me suis endormi, je me réveille ce matin sous son action. Ah si elle pouvait ne cesser jamais ! C’est ce qui arriverait si elle n’avait pas tant de lieues à traverser, si nous étions toujours ensemble. Et pourtant, je n’espère plus vous retrouver aussitôt que nous nous l’étions promis. Le mariage de M. Duchâtel ne se fera très probablement que du 2 au 4 octobre. Je vais le savoir positivement aujourd’hui.
De plus le mouvement électoral s’anime dans le pays. On vient, de tous les environs, m’en parler, me demander conseil, chercher une direction, une impulsion. J’agis d’ici, par la conversation, par les visites que je reçois, par quelques courses que je ferai, sur toute la Normandie, c’est à dire sur l’élection de 40 députés. C’est une grande affaire. Il faut que je la mette en bon train. La présence réelle, nous le savons trop, ne peut être remplacée. Pour moi-même, j’ai du monde à recevoir, à aller voir. Mon élection est plus sûre qu’aucune autre. Aucun concurrent ne se présente, ne s’annonce. Cependant je ne serais pas surpris, à quelques petits symptômes bien cachés, bien honteux que vers les derniers jours en ameutant les républicains, les carlistes violents, quelques indices, quelques grognons, on fit une tentative, non pour m’empêcher d’être élu on n’y pense pas, mais pour m’enlever quelques voix et rendre mon élection moins brillante en lui donnant quelque apparence de contestation. Il faut que je déjoue d’avance cette malice. Si elle doit se produire. Et pour cela, j’ai besoin précisément au moment où la fièvre électorale se prononce, où les hommes se rallient et s’engagent d’être sur les lieux de voir, de causer, d’animer tous les miens d’affermir les flottants.
Il y a un canton important, car il contient près de 100 électeurs dans lequel je n’ai jamais mis le pied. Je veux y aller un de ces jours. Je crois à peu de pouvoir réel, mais à beaucoup de mauvais vouloir soufflant contre moi d’un certain point, qui n’est pas un des points cardinaux, quoiqu’il en ait l’air. Il faut que j’agisse au grand jour, pendant qu’on travaille sous terre, que je sois aigle pendant qu’on est taupe. Est- ce là de l’orgueil ou de la prudence, dites, le moi? Tous les deux probablement.
Orgueil ou prudence, dearest, cela me coûte cher, et j’ai là, pour ce moment un cruel sacrifice à faire. Le saurez-vous, le croirez-vous tout ce qu’il est ? C’est ma plus vraie, ma plus triste préoccupation. Oui, si j’étais sûr que notre réunion retardée excite en vous les mêmes sentiments, tous les mêmes sentiments qu’en moi, et point d’autres; si j’étais sûr qu’il ne vous vient aucune de ces mauvaises pensées qui me désolent, et comme injustice et comme preuve que vous ne me connaissez pas encore ; si je pouvais vous faire voir, parfaitement voir mon âme, toute mon âme, comme je vous ai fait voir avant-hier une de mes journées, et dissiper ainsi, dissiper sans retour les doutes coupables de la vôtre, à cette condition là, je n’aurais pas moins de chagrin, mais j’aurais un meilleur chagrin, un chagrin parfaitement confiant en vous, sympathique avec vous, et je ne vous parlerais que de notre chagrin. Si vous saviez qu’elle est à ce moment même en vous écrivant, mon impatience de tout ce que je vous dis là, combien, au fond de mon cœur, je me sens étonné, blessé, pour vous et pour moi de vous le dire, de pouvoir croire que j’aie à vous le dire !
Dearest, que la confiance égale la tendresse, que toutes paroles autres que des paroles de tendresse soient inutiles et ne puissent plus nous venir à la pensée ! Il en sera ainsi un jour ; j’y compte. Vous savez que je vous ai ajournée à un an à deux ans à l’époque qui vous voudriez. Que mon ajournement soit sans objet; épargnons-nous l’épreuve du temps ; soyons, dès aujourd’hui aussi surs l’un de l’autre, aussi établis dans notre foi mutuelle, que nous le serions après l’avoir subie. La vie est si courte ! N’en employons rien à essayer, à attendre ; C’est perdre du bonheur pour rien.
10h 1/2
Voilà le N° 43, que j’aime bien quoique j’aime mieux le n° 42. Oui, nous sommes bien loin. Mais vous m’avez envoyé votre Soleil, hier et aujourd’hui, il est très beau. Le petit tableau est de 1835. Gardons notre goût pour Adieu. C’est un goût d’absent mais, dans l’absence, c’est ce qu’il y a de mieux. Adieu donc Adieu, faute de mieux. G.
39. Val-Richer, Dimanche 17 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous étiez entrée tout à l’heure dans ma cour, vous auriez été un peu surprise. Vingt trois chevaux de selle, deux cabriolets, une calèche. Les principaux électeurs d’un canton voisin sont venus en masse me faire une visite. J’étais à me promener dans les bois avec mes enfants. J’ai entendu la cloche du Val Richer, signe d’un événement. Je ne savais trop lequel. Nous avons doublé le pas, et j’ai trouvé tout ce monde là qui m’attendait. Je viens de causer une heure et demie avec eux de leurs récoltes, de leurs impositions, de leurs chemins, de leurs églises, de leurs écoles. Je sais causer de cela. J’ai beaucoup d’estime et presque de respect pour les intérêts de la vie privée, de la famille, les intérêts sans prétention, sans ambition, qui ne demandent qu’ordre et justice et se chargent de faire eux-mêmes leurs affaires pourvu qu’on ne vienne pas les y troubler. C’est le fond de la société. Ce n’est pas le sel de la terre, comme dit l’Évangile mais c’est la terre même.
Ces hommes que je viens de voir sont des hommes sensés, honnêtes de bonnes mœurs domestiques, qui pensent juste et agissent bien dans une petite sphère et ont en moi, dans une sphère haute assez de confiance pour ne me parler presque jamais de ce que j’y fais et de ce qui s’y passe. Mes racines ici sont profondes dans la population des campagnes, dans l’agricultural interest. J’ai pour moi de plus, dans les villes, tout ce qu’il y a de riche, de considéré, d’un peu élevé. Mes adversaires sont dans la bourgeoisie subalterne & parmi les oisifs de café. Les carlistes sont presque comme des étrangers, vivant chez eux, entre eux et sans rapport avec la population. La plupart d’entre eux ne sont pas violents, et viendraient voter pour moi, si j’avais besoin de leurs suffrages. Du reste, je ne crois pas que mon élection soit contestée. Aucun concurrent ne s’annonce. Ce n’est pas de mon élection que je m’occupe mais de celles qui m’environnent. Je voudrais agir sur quelques arrondissements où la lutte sera assez vive. Je verrai pas mal de monde dans ce dessein. Si la France, toute entière ressemblait à la Normandie, il y aurait entre la Chambre mourante et la Chambre future bien peu de différence ; et j’y gagnerais plutôt que d’y perdre. Mais je ne suis pas encore en mesure de former un pronostic général. Vous voilà au courant de ma préoccupation politique du jour. Je veux que vous soyez au courant de tout.
Lundi 7 h. du matin
Je suis rentré hier chez moi vers 10 heures à notre heure à celle qui me plait le plus pour vous parler de nous. J’ai trouvé mon cabinet et ma chambre pleine d’une horrible fumée. Mes cheminées ne sont pas encore à l’épreuve. Il a fallu je ne sais quel temps pour la dissiper. Je me suis couché après. Aussi je me lève de bonne heure. Laissez-moi vous remercier encore du N°39, si charmant, si charmant ! Qu’il est doux de remplir un si tendre, un si noble cœur! Cette nuit trois ou quatre fois en me réveillant, vos paroles me revenaient tout à coup, presque avant que je me susse reveillé. Je les voyais écrites devant moi. Je les relisais. Adieu n’est pas le seul mot qui ait des droits sur moi.
Je ne vous avais pas parlé de ce petit tableau. J’y avais pensé pourtant, et j’aurais fini par vous en parler. Vous n’en savez pas le sujet. Il est plus lointain, plus indirect que vous ne pensez. En 1833, 34, 35. 36, j’ai relu et relu tous les poètes où je pouvais trouver quelque chose qui me répondit ; qui me fît ... dirai-je peine ou plaisir? Pétrarque surtout m’a été familier. C’est peut-être, en fait d’amour le langage le plus tendre, le plus pieux qui ait été parlé. J’entends parler dans les livres que je méprise infiniment en ce genre, poètes ou autres. Un sonnet me frappa, écrit après la mort de Laure et pour raconter un des rêves de Pétrarque. Je vous le traduis
Ma petite fille aussi est plus jolie que son portrait, des traits plus délicats, une physionomie plus fine. Vous la verrez elle. Je voudrais que vous pussiez la voir souvent, habituellement. Elle est si animée, si vive, toujours si prête à s’intéresser à tout gaiement ou sérieusement ! Elle vous regarderait avec tant d’intelligence. Elle vous écouterait avec tant de curiosité ! Laissons cela. Quand nous aurons trouvé ce que je cherche en Normandie, nous pourrons ne pas le laisser.
Lundi 10 heures 1/2
Voilà le N°40. Je n’ai pas vu cet article de la Presse dont vous me parlez. Je vais le chercher. Je renouvellerai mes recommandations indirectes comme bien vous pensez là du moins mais positives. Ce n’est pas aisé. Mettez sur Adieu tout ce que vous voudrez. Je me charge d’enchérir. Adieu. Adieu. G.
28. Val-Richer, Dimanche 27 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai à écrire ce matin trois ou quatre lettres indispensables ; mais il m’est impossible de ne pas commencer par vous. Un quart d’heure seulement ; puis, je vous quitterai pour aller à mes devoirs. Est-ce sur que je vous quitterai ? Je passerais si doucement ma journée à vous écrire. Au moins, si je vous quitte, vous saurez ce qu’il m’en a coûté, n’est-ce pas ? L’absence qui est toujours intolérable, ne peut être tolérée qu’à une condition, la confiance, la parfaite sécurité du cœur. Le Ciel veut de la foi ; et partout où il y a de la foi, il y a quelque chose du ciel qui adoucit toutes les amertumes de la terre.
2 heures
Voilà les visites du Dimanche qui commencent. Je voudrais bien ne pas être trop interrompu aujourd’hui. Vous avez raison de faire aussi, des visites, outre la distraction vos dettes seront payées. Payez aussi vos dettes de lettres si vous en avez encore. Je vous le recommande comme si cela était nécessaire pour que vous fussiez libre, bien libre la semaine prochaine. Ne trouvez-vous pas qu’on prend plaisir à multiplier les précautions, les arrangements, à entrer, sans la moindre nécessité dans les plus petits détails ? Il y a une importance qui se répand sur toutes choses et leur prête à toute sa grandeur. Moi, j’ai déjà réglé toute ma course de Compiègne. J’irai après demain mardi chercher ma mère et mes enfants à Trouville. Je les ramènerai ici mercredi, à la rigueur, en forçant. personnes et chevaux, je pourrais revenir le mardi soir ; mais je soigne encore mon reste d’enrouement ; et Mad. de Meulan, que j’emmène a quelque envie de se promener un peu au bord de la mer. Il faut penser au plaisir de ceux avec qui l’on vit et qui vous aiment n’est-ce pas ? Je suis sûr que vous y pensez beaucoup que vous êtes très bonne, très attentive pour vos entours.
10 heures et demie
J’ai mal pris mon jour pour désirer de ne pas être interrompu. Comme j’écrivais mes lettres de devoir, deux visiteurs me sont arrivés de treize lieues, un neveu de Mad. Récamier et un de nos plus habiles paysagistes, M. Alligny. Il a pris fantaisie à celui-ci de venir dessiner une vue du Val Richer. Je les ai reçus, promenés, et je viens seulement de les envoyer coucher. Ils répartiront demain, après déjeuner. Savez-vous ce qui m’arrive à chaque, incident de la vie aux plus petits incidents? Je me dis. Cela me plairait si..... Cela m’amuserait si .... Comme le si n’y est pas, cela ne me plaît ni ne m’amuse. Cependant je me plais, je m’amuse, intérieurement à imaginer à me raconter tout bas ce qui serait, ce qui se dirait, comment toutes choses se passeraient si le si était là. C’est ce que j’ai fait depuis 4 heures, en marchant, en causant, en cherchant le plus joli point de vue, pour le paysagiste en prenant du thé ce soir. Ou je me trompe fort ou ces messieurs m’ont trouvé aimable et sont contents de mon accueil. Ils ont vraiment cru qu’en leur parlant c’était à eux que je pensais. Mais j’ai trop parlé. Je suis enroué ce soir. Ce n’était pas la peine. Je vais me coucher. Adieu. Ce n’est pas le vrai adieu. Celui-ci à demain, après avoir reçu votre lettre. Pourquoi pas deux adieu ? Il y en aura deux, Madame et je vous promets que l’on ne nuira point à l’autre.
Lundi 3 heures
Il pleut horriblement. J’attends le facteur depuis dix heures. Enfin le voilà. Comment tant de joie peut-elle en une seconde, succéder à tant d’ennui ? Que de choses je voudrais vous dire ! Mais il faut que le facteur reparte tout de suite. Adieu. Adieu Je crois que le second vaut mieux que le premier. G.
25. Lisieux, Samedi 26 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’arrive et je repars dans une demi-heure. Je suis un peu fatiguée ; non d’avoir couru la poste, non de n’avoir pas dormi, mais de ce mouvement contradictoire de cet odieux tiraillement qui emportait mon corps loin de vous tandis que mon âme retournait vers vous.
Parmi les sentiments qui me pressent, la surprise tient une grande place, la surprise de vous avoir quittée la surprise de ne pas vous voir aujourd’hui, de ne pas vous voir demain. Cela est, et je me demande à chaque minute si cela se peut. Je m’effraie quelques fois, Madame de l’empire que prend sur moi le besoin que j’ai de vous le bonheur que j’ai près de vous. Car enfin, je suis encore destiné à une vie active, sévère. J’ai des devoirs de tout genre des devoirs publics, des devoirs privés, mes enfants, ma mère un peu de renom à soutenir des curieux qui m’observent des rivaux qui m’épient. Tout cela est difficile laborieux. Il faut, pour suffire à tout cela que je suis vigilant, indépendant, disponible, que m’a poussée le soit comme ma personne. Que ferai-je si je suis à ce point envahi, absorbé, si j’arrache avec effort mon âme à une idée unique pour la lui rendre aussitôt de plus en plus exclusivement possédée ? Et pourtant désormais, il n’en peut être autrement, il n’en sera pas autrement. Je le sais, je le sens ; je ne m’en défends pas ; je repousserais avec aversion, si elle pouvait me venir, toute idée de m’en défendre ; mais elle ne me vient pas, elle ne me viendra pas. Aidez-moi Madame à mettre en harmonie tous mes sentiments, toutes mes volontés. Aidez-moi à ne rien oublier, à ne rien négliger de ce que je dois aux autres, à moi-même, à vous car c’est à vous maintenant que je dois tout, c’est à vous que revient, qu’appartient en définitive tout ce qui me touche, c’est pour vous, pour votre plaisir, pour votre orgueil, qu’il faut que jusqu’au dernier moment de ma vie, je me montre égal, supérieur à toutes les tâches dont il plaira à la providence de me charger. Je me sens si fier ! Que j’en sois toujours digne ! Je ne supporterais pas l’appréhension du moindre déclin dans ce qui m’a valu... Je ne veux pas lui donner de nom. De quoi vous parlé-je là quand mon cœur étouffe d’autre chose? Oui, c’est à dessein. Je cherche depuis que je vous ai quittée, tout ce que je puis avoir en mon âme de plus haut de plus ferme. Ce n’est que là que je puis trouver un peu de force. Je retrouverai assez tôt toute ma faiblesse. Que dis-je retrouver ? Elle est là ; je la sens et elle m’est plus chère que jamais. Here’s the place. G.
20. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.
Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?
Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.
Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.
Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.
Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.
Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.
17. Val-Richer, Lundi 7 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous ne voulez pas que j’aille vous voir tout de suite. Je ne ferai que ce que vous voudrez. Mais le mécompte est grand. Je voulais partir après demain Mercredi soir, pour être à Paris, jeudi matin. J’ai un dîner obligé à Lisieux le Mercredi 16 août. Si je ne vais pas vous voir cette semaine comme je ne veux pas ne rester à Paris que 24 heures, je ne pourrai y aller que vers la fin de la semaine prochaine. Je partirais le jeudi 17 et je vous verrais le 18. Serez-vous reposée? Je trouverais, je vous assure, des conversations qui vous reposeraient mieux que votre solitude. Onze jours encore avant de savoir, de voir par moi-même comment vous êtes que c’est long ! Je sais que je suis ingrat, que c’est déjà un bien immense de vous avoir à 45 lieues, dans ma France, sans abyme ni tempête entre nous. Mais que voulez-vous?
En fait de bonheur, je n’impose point de limite à mes vœux. J’aime mieux souffrir de la privation qu’abaisser mon ambition. Réglons au moins tout de suite mon voyage. Que je puisse penser au jour précis à l’heure. Je n’ai jamais trouvé que l’attente usât la joie ; bien au contraire; le bonheur prévu mesuré, sondé d’avance à toujours surpassé mon espoir. J’entends le vrai bonheur. On parle d’imagination, d’idéal. Sans doute le train ordinaire de la vie est fort au dessous des rêves de l’âme ; mais le vrai bonheur, quand il apparaît, laisse loin, bien loin en arrière toute imagination humaine et il n’y a point de si bel idéal qui approche de la belle réalité. Que si je tarde à vous voir, au moins je vous trouve effectivement reposée. Ce que vous me dîtes pour me rassurer ne me suffit point.
Je n’ai jamais beaucoup compté sur votre séjour en Angleterre pour votre rétablissement. Je savais bien que tant de monde et de bruit vous fatiguerait. Mais ces déplorables agitations ont encore tout empiré, & vous revenez moins bien que vous n’étiez partie. Que je suis pressé d’y aller voir ! Vous ne savez pas à quel point mon imagination est malade sur la santé de ce que j’aime. C’est là le point, le seul peut-être, sur lequel m’a raison soit absolument sans pouvoir. Mon seul remède, c’est que je le sais.
4 heures J’ai fait hier jour de grande fête, et quête religieuse dans mon village un dîner bien différent de votre dîner chez le Duc de Devonshire. J’ai dîné chez mon curé avec un jeune prêtre des environs, le maire, l’adjoint un petit bourgeois, sa femme, sa fille et deux paysans. Ce dîner là était une grande affaire délibérée pendant huit jours et pour laquelle on était venu processionnellement nous inviter. Mad. de Meulan et moi, après s’être assuré de notre consentement. Nous sommes arrivés à travers. champs dans la cour, je devrais dire dans la basse-cour d’un cottage vieux, délabré où loge le curé en attendant la Construction d’un presbytère. Personne pour nous recevoir; on était encore à Vêpres. Mais en revanche, je ne sais combien de chiens, de cochons, de poules, d’oies, de camards, aboyant, grognant, criant, courant, barbotant dans deux ou trois pièces d’eau pleines de de boue ; là et là des charrettes brisées, des fagots déliés, des briques et des pierres entassées pèle-mêle, tout le bagage d’une forme mal tenue par de pauvres laboureurs. Et tout à l’entour le pays le le plus riant qui se puisse voir ; de vastes près bien frais couverts, de ces bœufs énormes, tranquilles, qui semblent le type de la force au repos ; de beaux arbres, des chênes, des hêtres, des pommiers, des pins, des mélèzes mariant leurs formes et leurs teintes si variées ; l’eau de ces marres stagnantes et sales courant à vingt pas de là, claire, pure rapide. Toutes les grâces de la nature, à côté de toutes les grossièretés de l’homme.
On est enfin revenu de Vêpres ; nous avons dîné. Tout ce monde tendu, mal à l’aise, obséquieux, tour à tour silencieux ou bavard, excepté deux, le Curé, bon prêtre sans embarras dans sa gaucherie, et le Maire ancien soldat, huit ans grenadier à cheval et sous officier dans la garde impériale, maintien grave, œil fixe et doux se taisant sans sauvagerie parlant sans vanité. Au bout d’une heure, à la fin du dîner, après quelques verres de vin de champagne car on en boit là, je suis parvenu à les mettre à l’aise et même un peu en train. Tout naturellement le dez de la conversation est tombé aux mains du vieux soldat ; et depuis la campagne de Russie jusqu’à la bataille de Waterloo, il s’est raconté lui-même sans esprit mais non sans intérêt, tour à tour bonhomme et fanatique, intelligent et crédule, enthousiaste et désabusé, ému et apathique, méprisant la paix, mais jouissant beaucoup du repos, ami de l’ordre respectueux, et disant de moi, pour témoigner l’estime qu’il me porte que les mauvais sujets de toute la France me craignent, comme il est craint, lui de ceux de St Ouen. A huit heures et demie, on nous a reconduits jusqu’au Val-Richer. Je donnerai des matériaux pour la construction du presbytère, et je suis très populaire dans St Ouen, dont je vous raconte les histoires. Je voudrais trouver ce qui peut vous divertir et vous reposer.
10 heures du soir.
Je ferme ma lettre pour la donner à un homme à moi qui va demain de grand matin, à Lisieux. Vous l’aurez ainsi un jour plutôt. Les lettres de Paris m’arrivent ici, le lendemain, de 9h. à midi. Celles qui partent du Val-Richer ne sont à Paris que le surlendemain. J’espère que vous m’aurez écrit d’Abbeville ou de Beauvais. Vous devez être à Paris demain. Adieu Adieu, sans aucun doute cet adieu là va moins loin et pèse moins sur le cœur. Il y a quelque chose de mieux pourtant, d’infiniment mieux.
10. Val-Richer, Dimanche 23 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne suis pas encore sorti de la mauvaise veine. Je n’’ai reçu ce matin qu’un mot du voyageur que vous avez envoyé chercher. Demain enfin, j’espère vous savoir tranquille, et le savoir de vous. J’en ai grand besoin. Et quand j’aurai reçu votre prochaine lettre j’aurai grand besoin de celles qui suivront. Je les attendrai presque avec la même impatience. Car vous êtes souffrante, très souffrante. mon voyageur me le dit. Vous étiez déjà souffrante avant cette déplorable agitation. L’avez-vous toujours été depuis votre arrivée en Angleterre ? Sentez-vous que vous le soyez, au fond, à part tout accident ? Dites-moi exactement ce qui en est. Vous m’aviez promis de me revenir reposée, engraissée.
Ah, que tout est fragile autour de nous ! Nous vivons sur le penchant d’un abyme, toujours près d’y voir tomber ce que nous avons saisi, ce que nous retenons avec le plus d’ardeur. J’ai perdu, tout-à-fait perdu le sentiment de la sécurité ; je n’espère plus qu’avec inquiétude. Je ne jouis plus qu’avec tremblement. On dit que les marins s’accoutument aux tempêtes si bien que le vent le plus violent ne trouble plus leur sommeil ; Mais mon âme au lieu de s’affermir s’est ébranlée par les épreuves, dans le souffle le plus léger, j’entends un affreux orage ; dans le moindre incident, je vois le dernier malheur. Et pourtant mes joies, ces joies si menacées me sont plus chères, plus nécessaires que jamais !
5 heures
J’ai eu des visites toute la matinée, un raout de campagne. Le Dimanche, ma porte est ouverte à tout venant. Je l’ai formellement annoncé pour qu’on me ménageât dans la semaine, et j’espère qu’on me ménagera. un peu en effet. Je vis ici à l’état de bête curieuse, mais de bête curieuse dont on n’approche qu’avec quelque respect. J’ai parcouru aujourd’hui une longue échelle sociale, depuis des laboureurs jusqu’au marquis, moral de Portes, propriétaire du beau château de Fervaques, l’une des terres qu’habitait alternativement Sully, & où l’on conserve encore religieusement la chambre et le lit d’Henri 4.
Je prends, à voir l’homme à tous les étages, un plaisir sérieux et que je rechercherais à dessein, s’il ne me venait pas naturellement. Quand on vit toujours au même niveau dans la même sphère; elle devient comme une prison où l’esprit s’enferme et hors de laquelle il ne sait plus rien voir, ne comprend plus rien. Il faut aller, venir, monter, descendre. Le genre humain est un territoire très varié, très accidenté, comme on dit aujourd’hui. On n’y peut marcher d’un pas ferme, on s’y égare à chaque instant, si on ne l’a pas parcouru en tous sens et vu sous tous les aspects. Par instinct, par goût, je ne suis pas très propre à ces relations, à ces conversations de toute sorte ; mais l’expérience, m’en a démontré la nécessité, et ce que je crois nécessaire me devient bientôt presque naturel. Et puis j’ai pour la créature humaine en général sous quelques traits qu’elle m’apparaisse, un fond de sympathie. Je la considère au premier moment avec curiosité, au second avec un intérêt qui a quelque chose de l’affection. Je me préoccupe de ce qu’elle pense, de ce qu’elle sent de tout son état intellectuel et moral. Je m’inquiète de ses destinées. Il me semble toujours que, si j’essayais, si j’avais le temps, je pourrais quelque chose sur elle, pour elle ; et la communication la plus éphémère m’a quelques fois fait rêver bien des heures à la personne, très insignifiante d’ailleurs, avec qui je l’avais eue.
A la vérité, dans les rapports de ce genre ce n’est jamais à moi que je pense, ni de moi qu’il s’agit. Pour que j’entre moi-même en jeu, pour que je me sente personnellement intéressé dans une relation humaine, il faut qu’elle satisfasse aux conditions les plus élevées, qu’elle réponde à des exigences infinies. Je deviens alors aussi difficile que je suis coulant et complaisant dans le train commun de la vie. Je me prête volontiers aux hommes dans leur intérêt et sans attendre grand chose d’eux. Mais pour me donner, je veux que tous mes désirs, toutes mes ambitions soient comblées, et au delà. Vous voyez, Madame, que moi aussi, je vous parle de moi. Parlez-moi donc toujours de vous et toujours davantage. Vous ne trouverez jamais rien qui me plaise autant.
Lundi midi
Pas de lettre de vous encore ce matin. Je n’ose me plaindre ; mais je vais attendre demain comme je pourrai. Je n’aurai un moment de repos que lorsque je vous saurai calme et moins souffrante.
Brompton, Jeudi 9 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
5 heures et demie
J’ai été mettre une carte chez Mad. de Lavalette à Regent Park. J’ai eu du monde toute la matinée. Je vous arrive trop tard pour aujourd’hui. Mes nouvelles de Paris sont un peu moins sombres. M. Vitet, qui a passé une heure et demie ici avec Duchâtel croit peu à une bataille avant le 10 décembre. Cavaignac, à tort selon lui, n'est pas sans espérance électorale. Dufaure l’y entretient. C’est une illusion. Louis Bonaparte a toujours les plus grandes chances. Pas telles cependant que Cavaignac se regarde, dès aujourd’hui comme battu. Il attend donc, et ne fera point de bruit en attendant. Comment en faire après tout de suite après, si Louis Napoléon est élu ? Ce sera difficile. On pourra bien essayer de susciter quelque tumulte impérial pour se donner un prétexte de sauver la République. Il est douteux qu’on y réussisse. Les Impériaux seront fort sur leurs gardes. Probablement donc une situation fort tendue, sans explosion. La misère publique et la détresse financière plus grandes, plus croissantes, le peuple de Paris plus désespéré qu’on ne peut dire, Louis Bonaparte prudent et silencieux, dans le présent, se promettant d'être très très conservateur dans l'avenir. Il parle à ses confidents de je ne sais quel plébiscite impérial d'il y a plus de 40 ans qui lui permettra de rétablir une Chambre des Pairs héréditaire formée de tout ce qui reste de Sénateurs de l'Empire, de Pairs de la Restauration et de Pairs de Juillet. La fusion ainsi accomplie en même temps que l’hérédité rétablie. Des intentions très bonnes et très ridicules, qui peuvent être utiles après lui. Le propos des légitimistes et des conservateurs, est ceci : " Les Bourbons ne peuvent pas succéder à la République. Il faut les Bonaparte entre deux comme la première fois. "
On m’écrit de Paris : " Le bruit se répand que votre candidature fait de tels progrès dans le Calvados que votre sélection y serait faite à l'unanimité. Le candidat légitimiste qui devait être porté M. Thomine, a écrit, dit-on à M. de Falloux qu’il se retirait et que lui se retirant, votre élection croit d'elle-même. " Je doute de ceci. Cependant il faut prévoir cette chance que je sois élu malgré ce que j'ai dit et fait dire. Ce sera un grave embarras.
J’ai oublié de vous dire que de bonne source, on attribue au Général Lamoricière ce propos : " Si on nous envoie Louis Napoléon pour Président. nous le recevrons à coups de fusil ; je mettrais le feu à Paris de mes propres mains plutôt que de le subir. " C’est bien violent. Pourtant cela indique le dessein de ne rien faire avant l'élection.
Voici une lettre du duc de Noailles qui m’est arrivée avec son livre. Renvoyez-la moi, je vous prie. J'ai vu ce matin le Médecin du Roi. Il arrivait de Richmond. On y va mieux. Il n'a d’inquiétude pour personne malgré les rechutes. La Reine était très souffrante. On a de nouveau analysé l'eau la veille du départ, en présence de plusieurs chimistes anglais, extraordinairement chargée de plomb. Ce sont des réparations faites il y a près de deux ans, à des conduits, et à une citerne. Claremont avait à peine été habité depuis. Rien de singulier donc. Deux maids aussi ont été malades. Duchâtel penchait à croire à quelque empoisonnement factice, à quelque coquin envoyé de Paris et gagnant un domestique. Je n'y crois pas. Le médecin non plus. Tout s’explique naturellement. Adieu. Adieu. A demain matin.
Vendredi 10. 9 heures
Je n’ai rien ce matin. Sinon Adieu, adieu, ce qui n’est pas nouveau et n'en vaut que mieux. Adieu donc. J’ai eu hier soir, à 8 heures, votre lettre du matin.