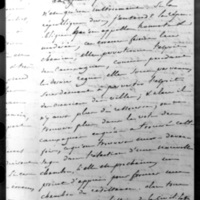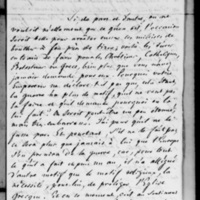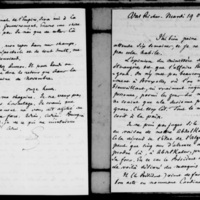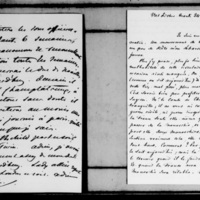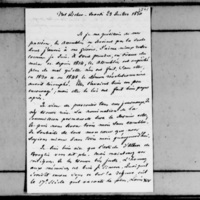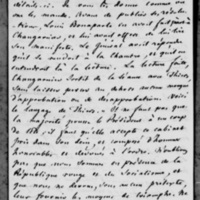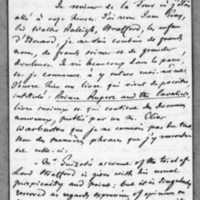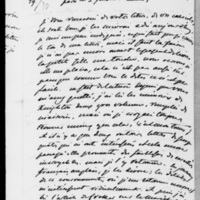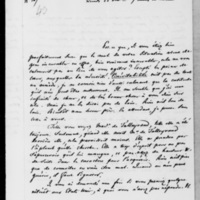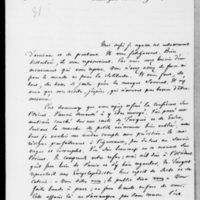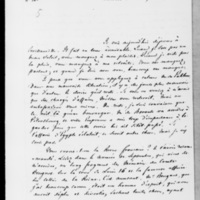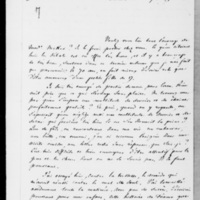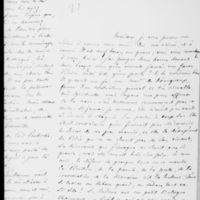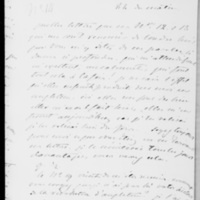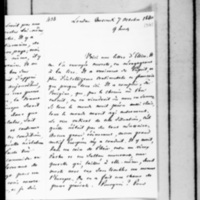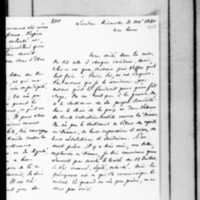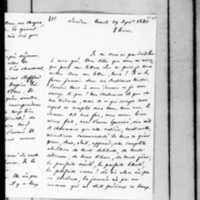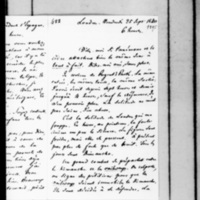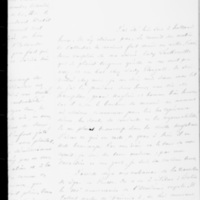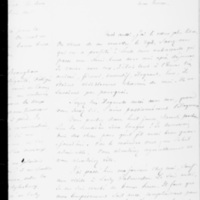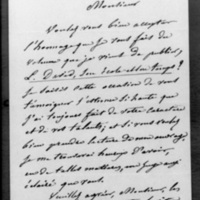Votre recherche dans le corpus : 151 résultats dans 5770 notices du site.
Paris, le 21 août 1824, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
[?], le 24 octobre 1848, le Duc de Noailles à François Guizot
19. Paris, Jeudi 16 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si de part et d'autre, on ne voulait réellement que ce qu’on dit, l'occasion serait belle pour arrêter encore, les milliers de bouches à feu près de tirer, voilà les Turcs en train de faire pour les Chrétiens, Catholiques, Protestants ou Grecs, bien plus que vous n'avez jamais demandé, pour eux. Pourquoi votre Empereur ne déclare-t-il pas que cela étant, la guerre n'a plus le motif, qu’il ne veut pas la faire et qu’il demande pourquoi, on l’a lui fait ? On serait peut-être un peu étonné, mais très embarrassé. J’ai peur qu’il ne le fasse pas. Et pourtant, s'il ne le fait pas, ce sera plus que jamais à lui que l'Europe s'en prendra de la guerre, car, pour tout ce qu’il a fait depuis un an, il n’a allégué d’autre motif que le motif religieux, la nécessité, pour lui, de protéger l'Eglise grecque. Et en ce moment, c’est au sentiment religieux de son peuple qu’il fait appel pour populariser la guerre. Voici ce qui arrivera probablement. La Russie fera la guerre, à l'Europe pour garantir aux Chrétiens grecs, de Turquie des privilèges très inférieurs à ceux que la Turquie leur accorde. L’Europe fera la guerre aux Chrétiens grecs pour les forcer à accepter ce que la Turquie leur accorde. En soi, cela est absurde, et bientôt, aux yeux des hommes religieux, cela sera odieux. Et si, comme cela encore est probable, l’Europe est elle-même bouleversée, de nouveau par cette guerre, devenue révolution, un jour ne tardera pas à venir, où il n’y aura ni assez de malédictions, ni assez de sifflets pour les auteurs d’une telle situation.
On n'aura, pour échapper aux malédictions. et aux sifflets, d’autre ressource que de dire qu’on voulait autre chose que ce qu’on disait. Triste apologie quand le jour du jugement est arrivé.
On disait hier, de bonne source, que tout était arrangé avec l’Autriche, qu’elle ne vous déclarerait et ne vous ferait point la guerre, mais qu’elle déclarerait son adhésion morale à la politique qui maintient l’intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman, et qu'elle se chargerait de maintenir l’ordre, dans la Servie, la Bosnie et le Monténégro. On paraissait espérer que la Prusse en gardant sa neutralité, donnerait, à cette quasi-neutralité de l’Autriche, une approbation explicite. " Si on était sage, disait avant hier Morny, on se contenterait de cela, on le dirait tout haut, et on resterait en intimité avec l’Autriche, à ces termes. " Il a raison ; mais il disait Si. Et si on n’est pas sage, qu’arrivera-t-il ?
Voilà votre numéro 13. Vous avez un peu troublé Molé il y a quelques jours, en lui écrivant, par la poste, que vous aviez chargé M. de Mirepoix de lui remettre une lettre. Cela n’est pas de votre prudence ordinaire, et je ne dirai pas à Hatzfeld que vous m'avez écrit, par la poste aussi, de me servir de son courrier. Je lui ferai demander ce matin si son courrier peut se charger aussi des deux volumes, de Cromwell. Je pense que oui. Sinon, je vous les enverrai par une autre voie. Adieu.
Je vous ai dit, je crois, que je vais au Val Richer lundi, pour trois jours. J'en reviendrai Vendredi matin. Mon projet. est ensuite de partir le 21 mars et d'aller passer cinq jours avec vous, jusqu’au 5 avril au soir, d’un jeudi à un jeudi. On vient assez me voir le jeudi soir, et je ne veux pas y manquer souvent. J'espère que rien ne dérangera mon projet, et qu’il vous conviendra comme à moi. Adieu, adieu. G.
P.S. On m'assure que les nouvelles de Constantinople disent que la négociation en faveur les Chrétiens est loin d’être aussi avancée qu’on le disait. Au bal qu'a donné ces jours derniers le Roi Jérôme, on affirme que son fils Napoléon n’a pas paru, déclarant à son père que dans ces fonctionnaires Impériaux, il y avait tant d'ennemis de leur droit héréditaire qu’il ne voulait pas se mêler à eux. Le Roi de Naples se prêtera à tout ce qu’on voudra de lui ; mais il a demandé à être débarrassé de M. de Maupas qui intriguait trop ouvertement pour les Murat. De là le remplacement de Maupas par de la cour.
18. Paris, Mercredi 15 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier, un dîner agréable chez Mad. de Caraman ; Broglie, et son fils, Montalembert, et sa femme, Berryer, George d'Harcourt, et Lady William Russell. Spirituelle, et étonnée de découvrir qu'elle ne savait pas bien l’histoire de la mort de César. Je lui ai appris l’existence du récit le plus détaillé, le plus contemporain et le plus politique au fait. Il est vrai que la publication en est récente. Elle prend à l'érudition beaucoup plus d’intérêt qu’à la politique.
On parlait assez du Prince de Hohenzollern, et on ne croyait pas que l’attitude de la Prusse eût été aussi bien prise ici que vous le présumez.
2 heures
J’ai été dérangé par trois visites ; mais elles ne m'ont rien apporté. L'emprunt réussit beaucoup ; il y avait hier grand concours de prêteurs. On dit que Fould n’a pas été d’avis de cette démocratie financière. Je n'ai point entendu dire que le maréchal St Arnaud passât par Vienne. Mais on disait hier qu’il allait passer huit ou dix jours à la campagne pour se reposer avant d’entrer en campagne. Je vous enverrai mon Cromwell qui paraît demain. Si vos yeux s'en accommodent, cela vous amusera. Adieu.
Il faut que je sorte pour affaires. Je vais lundi soir passer trois jours au Val Richer, pour affaires aussi. J'y mène un jardinier. J’irai m'y établir complètement du 1er au 15 mai. Ma fille Pauline sera ici, le 15 avril. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 24 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quand Xérès fit dire à Léonidas " rends-moi tes armes " c’est, je pense, qu’il était un peu embarrassé de passer les Thermopyles ; et Léonidas fit acte de bon sens comme d’héroïsme en lui répondant " Viens les prendre."Il me paraît qu’Omer Pacha, est dans le même embarras que Paris, et qu’il somme le Prince Gortschakoff de passer le Danube et de venir l'attaquer, le menaçant de le passer lui-même et d'aller l’attaquer, en cas de refus. Je ne sais si c’est sérieusement qu’on écrit cela de Bucarest ; il n’y a pas eu beaucoup de situations plus ridicules que celle de ces deux armées qui vont passer l'hiver à se montrer le poing d’un bord du Danube à l'autre. Entendez-vous parler de l’Asie et la guerre peut-elle vraiment commencer là, à défaut de l'Europe ?
Je n'ai pas eu hier de nouvelles de la Reine Marie Amélie. Quand même elle continuerait d'aller mieux, elle serait hors d'état de faire son voyage d’Espagne. Les Princes ont écrit à leur frère Montpensier de venir sur le champ à Genève. On préparait, à Lisbonne, une très belle et très affectueuse réception pour la Reine. La Reine de Portugal mettait du prix à la traiter avec éclat. Le Duc de Nemours est accouru en hâte, laissant sa femme à Vienne où il retournera probablement. Je dis comme vous, je n'ai rien à dire. Je vous quitte pour aller profiter, dans mon jardin d’un temps admirable. Nous avons eu hier le plus beau jour de l’année, chaud et clair. comme dans un bel été. Aujourd’hui sera aussi beau.
Un journal dit que sir Edmund Lyons reprend du service comme marin, et va rejoindre comme contre amiral, la flotte de l’amiral Dundas. Lord Palmerston ne peut pas renvoyer en Orient un agent plus dévoué, plus remuant, plus impérieux, et plus anti-russe.
Midi
Je ne m'étonne pas de toutes ces mollesses. Il n’y a vraiment pas un motif sérieux de guerre, à moins qu’on ne s'échauffe par taquinerie, et ce n'est pas la peine. Adieu. Adieu. Ma fille vous remercie de vos bons souhaits. Elle part ce soir, en assez bonne disposition. Adieu. G.
Val Richer, Mardi 20 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Merci de la lettre que j’ai reçue ce matin, et que je n'attendais pas. Je suis bien aise que la dépêche adressée à M. de Meyendorff vous ait satisfaite ; c’est un bon effet qui viendra à propos ; tout le monde a envie d'être satisfait. Je vois du reste que la première motion de votre refus commence à passer. Les joueurs sont prompts à la crainte et à l'espérance.
Vous avez bien raison de vous promener trois heures ; le temps est magnifique ; j’ai marché hier deux heures de suite dans les bois. J'avais travaillé sans me lever une fois de mon fauteuil, depuis cinq heures et demie du matin jusqu'à onze heures. Vous aurez besoin de me répéter plus d’une fois la terre de M. Drouyn de Lhuys pour que j'y croie.
Si vous preniez aux détails et aux intrigues politiques du passé un peu de l’intérêt que vous prenez à celles du présent, je vous engagerais à lire, dans la Revue des deux mondes, le Ministère de Lord Bolingbroke sous la Reine Anne, par M. de Rémusat ; ce sont les premières campagnes, du régime parlementaire en Angleterre. Moi, cela m'amuse. Pour vous ; ce serait trop long et trop ancien. Barante m'écrit : " Ce pauvre, M. de Rémusat, la mort du gouvernement parlementaire lui fait tant de chagrin que, pour se consoler, il le dissèque. "
J’ai une corvée lundi prochain ; il faut que j'aille dîner chez M. Hébert, à six lieues d’ici. Il vient me voir régulièrement tous les ans. Je lui ai promis d’aller une fois chez lui. Il me demande de lui tenir ma parole. Je ferai cela lundi. L’ancien précepteur de mon fils vient de m’arriver avec sa femme pour passer ici quatre ou cinq jours. Dites-moi, si vous avez dit à la Princesse Koutschoubey ce que je vous ai dit pour les commencements de son fils. Je parlerais de lui à mon professeur. qui est un homme sensé et très au courant des bons maîtres.
Mercredi 21
En vous parlant d’une mission trop secrète, je vous ai nommé je crois la Revue des deux mondes ; il me revient à l’esprit que je me suis trompé, et que c’est dans la Revue contemporaine (numéro du 15 sept) que se trouve cette petit histoire assez amusante.
Lisez, si vous ne l’avez déjà lu, dans les Débats d’hier, l'article sur les dépenses qu'impose déjà à la ville de Paris le prix actuel du pain ; vous verrez à qu’elle somme énorme cela s'éleverait si on continuait sur ce pied.
Adieu, adieu. Je vais lire l'analyse que donnent les Débats de votre nouvelle prière. G.
Val Richer, Mardi 19 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai bien peine à croire qu’on attende six semaines, et je ne trouverais pas cela habile. L'opinion du ministère des affaires étrangères est que l'affaire Belge s’arrangera. On n'y met pas beaucoup d'empressement à Bruxelles où l'on n'est ni bienveillant, ni vraiment inquiet ; mais personne, parmi les gens du métier à Paris ne craint que cela devienne politiquement grave. C’est trop tôt. Tout le monde est et croit à la paix.
Je ne puis pas juger si le Président a eu raison de mettre Abdel Kader en liberté. Cela dépend de l'état de l'Algérie. Il se peut que cinq ans d’absence, aient fait perdre là, à Abdel Kader, presque toute sa force. En ce cas, le président a bien fait.
Le voilà délivré du marquis de Londonderry. Il (le président) vient de faire un très bon acte en nommant Cardinal l’archevêque de Tours. C’est un des homme les plus sensés et les plus justement honorés du clergé.
Qu'est-ce que cet ouvrage que je vois annoncé dans le Journal des Débats, avec une certaine solennité : Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la Russie sous Pierre le grand et Catherine 1ère ? En avez-vous entendu parler ? C’est bien vieux pour vous intéresser, quoique ce soit Russe.
Voici, ma seule question sur votre santé. Vous me dites Chomel, Andral. Les avez-vous vus ensemble ? Chomel est-il revenu ? Se sont-ils mis d'accord sur votre régime ?
J’ai des nouvelles de Suisse. La Duchesse d'Orléans porte toujours et portera encore quelque temps le bras en écharpe. Mais elle va bien. Elle retourne décidément à Claremont avec la Reine.
Le Duc de Broglie est resté à Coppet. Il ne revient à Broglie que du 20 au 25. Il me paraît que la rencontre du Président et de Morny a été très affectueuse. Entendez-vous dire quelque chose de Flahaut ? Viendra-t-il à Paris dans cette circonstance ! Je me figure que Mad. de Flahaut a beaucoup d'humeur de n’y pas être.
Onze heures
Voici votre lettre. Je l’aime mieux que celle d’hier. Elle n’est pas abattue. Deux choses seulement ; tout de suite. Je serai charmé quand nous causerons ; mais ne comptez pas sur moi pour disputer beaucoup ; je ne dispute plus guères quand je disputerais trop. Et puis, quoique je sois vraiment désolé d'avoir brûlé la lettre d'Aggy, pardonnez moi d'avoir souri de votre légèreté française. Vous avez l’art de faire d’une pierre, mon pas deux coups, mais trente six millions de coups, pour rendre le coup plus lourd. Je n’ai pas la même goût ; je ne cherche pas en vous les défauts russes. Adieu, Adieu.
Vous ne m’avez point dit pourquoi lord Beauvale est contre le discours de Bordeaux.
[Paris], Vendredi 17 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai quittée vite, triste de vous quitter et de vous laisser triste, ne dites pas, ne pensez pas que nous ne nous reverrons pas. Nous nous reverrons. Nous retrouverons nos conversations intimes. Vous êtes très souffrante, mais très vivante dans votre faiblesse. Je ne vous dis pas tout ce que je pense et sens à votre sujet. Je crains de vous émouvoir. Je crains vos impressions. Au revoir dearest, ever dearest. Adieu, Adieu. Au revoir. G.
Vendredi 17 sept. 1852 6 heures
Mots-clés : Conversation, histoire, Lecture, Relation François-Dorothée, Santé (Dorothée)
Val Richer, Jeudi 9 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Dites-moi précisément quel jour Aggy part pour son petit voyage. J’irai passer avec vous trois jours pendant son absence. Je veux voir par moi-même comment vous êtes et me donner, nous donner ce rafraîchissement dans le cours d’une si longue séparation. Je puis faire cela la semaine prochaine. J’attendrai après demain vendredi votre réponse pour fixer le jour de mon départ. Ce sera un charmant plaisir.
Je m'étonne que le Président ne soigne pas Cowley autant que Hubner. Il compte sans doute davantage sur la complaisance, de l’Autriche pour sa grande affaire ; mais il a besoin aussi de celle de l'Angleterre, et je ne la crois pas inabordable.
Ce que vous me dites de Lord Cowley quant aux chances de l'avenir n’est probablement pas son sentiment à lui seul dans son gouvernement. La politique anglaise est peut-être, de toutes celle qui vit le plus dans le présent. Le Cabinet actuel d'ailleurs n'est guère en état, ni en disposition d’aller au devant d’aucune difficulté, il les éludera tant qu’il pourra et n'en créera à personne pour ne pas s'en créer à lui-même.
Le journal des Débats répond à ma question ; il annonce le rappel du ministre de France à La Haye, le petit d’André, si je ne me trompe. Je doute que cela fasse revenir les Chambres hollandaises, au traité sur la contrefaçon. Ce seront de mauvais rapports inutiles.
Mad. Kalerdgi manquera à l'Elysée et à M. Molé. Il a le goût des comédiennes Mad. de Castellane valait mieux que celle-ci. Elle était capable de dévouement. Je doute qu’il en soit de même de Mad. Kalerdgi. Passe pour le dévouement d’un jour ; mais la dévouement long exclusif, non. Mad. de Castellane, il est vrai n’avait pas commencé par ce dévouement-là ; mais elle y était venue. C'est quelque chose.
A propos de Mad. Kalerdgi, Piscatory me revient à l’esprit. J’ai eu de ses nouvelles il va mieux. Il a eu une forte esquinancie mais il a une de ses filles assez gravement malade, ce qui le tourmente beaucoup. Il a du cœur. Il se tient parfaitement tranquille entre ses enfants et les champs.
Onze heures
Je vous chercherai de vieux Mémoires. Ce pauvre Piscatory a perdu sa fille, une enfant de douze ans. Je reçois trois lignes de lui. Adieu, Adieu. G.
Paris, Mardi 7 septembre 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai lu tout Mad. d’Arbouville tout Georgia Fullarton. Vos autres recommandations ne me promettent pas grand chose. Trouvez mieux je vous prie ; du vieux historique, mémoires. Ne prenez pas la peine de me les expliquer. Dites les titres et à côté, " bien, passable, curieux. " selon qu'ils le méritent.
Molé a vu Thiers longtemps et l'a trouvé résigné pour longtemps au Président, et puis disant qu'on reviendra à la monarchie mais qu'il faut pour cela que les deux monarchies se réunissent et ensuite l'abdication ou l’adoption, ce qui veut et donc bonjour. Moi je crois que Cowley a raison, et Dieu sait ce que verra la France. Dumon est rentré en ville. Molé part ce matin pour le Marais, mais il reviendra dans 15 jours avant le départ de Kalergi.
Hubner a été étonné de lire qu'on a lancé ma nouvelle frégate portant le nom d'Austerlitz. Toujours ces souvenirs affichés, cela finira par provoquer. Qu'il laisse dormir en paix les masses et les triomphes de son oncle. Je le trouve trop modeste, il a assez fait lui-même et peut se passer désormais de ces souvenirs.
Kalerdgi m’amuse. Elle a beaucoup recueilli, et elle bavarde. Son oncle trouve les Bourbons immensément bêtes. Le général Haynau est parti fort content de son séjour ici. Adieu, adieu. Kolb a décidé les Delmas à rester, cela m’arrange.
N°39. Val-Richer, Lundi 12 juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
C'est curieux à quel point on peut vivre dans le passé. Je m'occupe des nouvelles d'aujourd’hui, je lis mes journaux par routine, par convenance ; au fond, ce n’est pas à cela que je pense spontanément et avec intérêt l’histoire de Cromwell, et ma propre histoire de 1830 à 1848 voilà ce qui m'interesse, ce qui remplit, et anime mon esprit. C'est dommage que vous n'ayiez pas la même disposition ; je serais bien plus intéressant pour vous. Mais vous m'aimez que le présent vous êtes la contemporaine par excellence.
Que va-t-il arriver en Angleterre ? Vous devriez bien me le dire, car cela, j'en suis curieux aussi, selon ma conjecture, rien de décisifs, quand ils n’ont point de grande entreprise sur les bras et point de grand homme à leur tête, ils savent vivre, modestement au jour le jour faisant petitement leurs petites affaires, et se contentant de ne point faire de grosses sottises. Si le Président a la même sagesse il durera tant qu’il voudra.
Je suis bien aise que les radicaux des corps francs laissent Thiers tranquille à Verrey. Quand les justices providentielles arrivent, mon premier mouvement est la satisfaction. Mais je pense très vite aux personnes à leurs souffrances, à leurs chagrins, et je n’ai plus du tout soif de justice. D'ailleurs, après ses amis ce qu’on aime le mieux ce sont ses ennemis. Je m'intéresse à Thiers. Je ne le voudrais pas puissant mais point malheureux. Je ne vois pas pourquoi on met M. Drouyn de Lhuys aux affaires étrangères à la place de M. Turgot ; il a un peu plus d'encolure diplomatique au fond. Il ne fera ni plus, ni mieux. Passe pour ôter M. Duruffé des travaux public ; on peut avoir là un homme capable ; il y sera utile sans y être embarrassant. Est-ce que M. Magne, qui y était du temps de M. Fould ne serait pas disposé à y revenir ? C'est un homme vraiment capable. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. J’ai vu hier quelqu'un qui venait de Dieppe. Il dit qu’il y a beaucoup de monde, et très bonne compagnie, et qu’on trouve très bien à s'y loger. Mais je ne me fie pas à ce rapport, c’est un homme du pays, moins difficile que vous en fait de logement. Il vous faut la plage, ou près de la plage et un bon appartement dans la meilleure auberge.
Je vous quitte pour attendre plus patiemment le facteur en faisant ma toilette. Malgré la chaleur j'irai faire aujourd'hui une visite à trois lieues, dans un assez joli château. J’ai là un voisin savant, antiquaire infatigable qui ne vit qu’avec Guillaume le conquérant et Bossuet.
11 heures
Je suis bien aise que votre temps soit si plein, et vous savez que je ne me fâche jamais. à demain la conversation sur mon peu de curiosité en ce moment. Si j’avais pu aller à Paris, j’y serais allé pour vous voir plus que pour vous entendre. Je vous écrirai donc demain à Dieppe. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 24 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.
J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.
J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.
Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.
Onze heures
On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.
Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 15 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici une question que je ne trouve pas, dans ma bibliothèque d’ici, les moyens de résoudre et sur laquelle mon petit visiteur ira peut-être vous consulter. mon libraire veut mettre sur le titre de Washington, les armes des Etats-Unis d’Amérique, et sur le titre de Monk, les armes d'Angleterre. Mais ce sont les armes d’Angleterre sous les Stuart qu’il faut là et non pas les armes d'Angleterre sous la maison de Hanovre. Je ne me rappelle pas bien et je ne puis indiquer d’ici les différences. On fera la vérification, à la Bibliothèque du Roi, (nationale aujourd’hui) et je pense qu’on trouvera là tout ce qu’il faut pour la faire. Mais si quelque renseignement manquait aurait-on, à l'Ambassade d'Angleterre, et votre ami Edwards pourrait-il procurer de là un modèle des armes de Charles 2 en 1660 ? J'espère qu’il ne sera pas du tout nécessaire que vous preniez cette peine, mais je veux vous prévenir qu’il est possible qu’on vienne vous en parler.
Ce que vous a dit de Cazes ne m'étonne pas. Bien des gens le pensent. C'est peut-être le plus grand danger qu’il y ait à courir. J’ai très mauvaise idée de ce que serait le résultat. Probablement encore un abaissement de plus. Mais la tentation serait forte. Je dois dire que les dernières paroles qui m’ont été dites à ce sujet ont été très bonnes et très formelles.
Avez-vous revu Morny ? Je suis assez curieux de savoir, s'il vous dira quelque chose de mes quelques lignes, et de l’usage qu’il en a fait.
La corde est en effet bien tendue en Allemagne. Pourtant il me semble que Radowitz prend déjà son tournant pour la détendre un peu. Que vaut ce que disent les journaux de son travail pour amener l'union restreinte à n'être qu'une union militaire comme il y a une union douanière ? Ce serait encore un grand pas pour la Prusse et je ne comprendrais pas que les petits États se laissassent ainsi absorber par la Prusse sans avoir au moins le voile et le profit de la grande unité germanique. Mais il y aurait là un commencement de reculade. Je persiste en tout cas à ne point croire à la guerre. Personne n'en veut, excepté la révolution qui a peu prospéré en Allemagne. L'indécision même de votre Empereur entre Berlin et Vienne est un gage de paix. Y eût-il guerre, le Président ne serait pas en état, le voulût-il de faire prendre parti pour la Prusse. On ne prendrait point de parti de Paris comme de Pétersbourg et de Londres on remuerait ciel et terre pour empêcher la guerre, qui serait de nouveau la révolution. Je ne viens pas à bout d'être inquiet de ce côté, malgré le duo de bravoure de Radowitz et de Hübner.
10 heures
Je vois beaucoup de bruit dans les journaux et rien de plus. Pas plus de coup d’Etat en France que de guerre en Allemagne. Je n'ai qu'une raison de me méfier de mon impression ; c’est qu’il ne faut pas aujourd’hui trop croire au bon sens. Notre temps a trouvé le moyen d'être à la fois faible et fou. Adieu, adieu.
Je reçois de mauvaises nouvelles du midi de la France. On m’écrit que les rouges y redeviennent très actifs. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 24 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis un peu fatigué ce matin. Un mouvement de bile. Mon repos et un peu de diète m'en débarrasseront en deux jours. Plus j’y pense, plus je suis frappé de l'énorme malhabileté de cette circulaire et de l’excellente occasion ainsi manquée. On pouvait se poser (comme on dit aujourd’hui) à merveille, et on reste très mal posé, plus mal qu’auparavant. C'est savoir bien peu profiter de sa propre sagesse. M. le comte de Chambord se tient tranquille ; il ne veut ni conspiration, ni guerre civile, ni guerre Européenne. Il attend que la France sente elle-même qu’elle ne peut se passer de la Monarchie, et qu’il n’y a pas pour elle deux Monarchies. Quand la France sentira vraiment cela, elle le reconnaitra, tout haut. Comment ? Par qui ? Personne ne le sait aujourd’hui ; mais la France saura bien le trouver quand il le faudra absolument. Et quand la France aura reconnu cela, la monarchie sera rétablie. Voilà ce que dit la conduite qu'on tient. Il n’y avait rien de si aisé que de l’écrire; rien de si aisé que de repousser ainsi l’appel au peuple de M. de La Rochejaquelein, et de maintenir le droit monarchique sans offenser le droit national, bien mieux en le respectant et en agréant au sentiment public. On pouvait faire cela, et on fait ce que vous voyez ! J’ai peur que cette maladresse particulière ne soit le symptôme de la maladresse générale de cette intelligence politique de cette ignorance de l'état et de l’esprit du pays qui depuis si longtemps caractérisent et perdent le parti. C'est fort triste. Tout ce qu'on peut espérer c’est que cette sottise se perde dans la foule avec tant d'autres. Il en vient tant de tous les côtés.
Vous voyez que je ne me gêne guère ; je vous écris tout ce que je pense. Et ce que je vous écris, je le dis aux gens que je vois et à qui il peut être de quelque utilité que je le dise. Pourquoi me gênerais-je? J’ai un avis très décidé sur la situation; je crois qu'il y a un moyen, et qu’il n’y a qu’un moyen de sauver mon pays. Et en même je suis tout-à-fait hors de la mêlée simple spectateur et juge des coups. Je dis tout haut mon jugement C'est là aujourd’hui ma seule action. Je n'en cherche point d'autre. J’ai bien acquis le droit. d'exercer celle-là.
Midi
Je vois, par mes journaux, qu'on est aussi occupé à Paris, de la circulaire que je le suis moi-même dans mon nid. Plutôt on l'oubliera mieux ce sera. Les Débats sont en effet bien vifs contre la République. Ils prennent leurs avantages. Je veux m’arranger pour lire l'Union. Je ne vois pas d'ailleurs la moindre nouvelle qui mérite qu'on en parle. On annonce que la cour de Vienne a pris le deuil pour douze jours, pour le Roi Louis-Philippe. On y sera sensible à Claremont. Il n’y avait point eu de notification là, quand je suis parti. Adieu. Adieu.
Je ne me promènerai pas aujourd'hui. Je resterai tranquille dans mon Cabinet. Adieu. G.
Si vous revoyez Madame de Ste Aulaire, ou lui, faites leur, je vous prie, mes plus tendres amitiés.
Val-Richer, Mardi 23 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si je me guérissait de mes passions, les Assemblées, ne seraient pas la seule dont j’aurais à me guérir. J’aime mieux rester comme je suis. A tout prendre en France du moins, et depuis 1814, les Assemblées ont empêché plus de mal qu'elles n’en ont fait. Sans elles en 1830, et en 1848, le démon révolutionnaire aurait triomphé. Elles l'avaient bien un peu encouragé ; mais elles le lui ont fait bien payer après. Je viens de parcourir tous mes journaux. Je n’y trouve rien. La nomination de la commission permanente sera le dernier acte. Et puis nous serons trois mois sans assemblée. Je souhaite de tout mon cœur que nous soyons mieux dans trois mois qu'aujourd’hui. Je suis bien aise que l'article d’Albert de Broglie vous ait plu. Mais maintenez vos critiques. Je les trouve très justes.
L'homme aux mémoires est bien Saint-Simon. Quoiqu'il écrivit encore sous et sur la Régence, c’est le 17ème siècle qu’il raconte le plus. Louis XIV et sa cour. J'en lis tous les soirs 30 ou 40 pages, là et là à mes enfants. Cela les amuse parfaitement. Je n’ai pas lu les Sophismes en frustrade dont vous parle Marion. Si cela en valait la peine, je les ferais demander. J’ai demandé s'il y avait déjà quelque chose d'un peu complet sur Peel. On me répond qu'il y a un livre, publié, il y a deux ou trois ans par un Dr. Cooke Taylor " Sir Robert Peel and his Times." Vous n'avez surement par entendu parler de cela.
J’ai des nouvelles de Ste Aulaire. Il me dit qu’Horace Vernet, raconte que votre Empereur est toujours charmé de la République en France et surtout partisan zélé du général Cavaignac. C'est sa plus grande nouvelle. Vous voyez que je suis à peu près aussi stérile qu'Ems. Adieu. Adieu. Voilà enfin le soleil revenu. La pluie nous a accablés pendant quelques jours. Adieu. G.
Midi
Je rouvre ma lettre. Je viens d'avoir une visite qui me rend ma liberté pour le 6 août. J'irai donc vous voir à présent. Je partirai d’ici samedi prochain 27. Je serai dimanche matin, à Paris. J’en partirai le soir ou lundi matin pour Bruxelles et je serai à Ems mardi soir 30 ou mercredi Il. J’y passerai huit jours avec vous. Il faut que je sois à Paris, dans la journée du 11. Si Aberdeen vient à Ems, tant mieux. Sinon encore tant mieux. Grand plaisir que cette petite course. Adieu, adieu.
Soyez assez bonne pour m’assurer à Ems un petit logement. J’aurai avec moi un domestique, Adieu encore. G.
Val-Richer, Samedi 3 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous savez probablement ces détails-ci. Je vous les donne comme on me les mande, avant de publier ses résolutions Louis Bonaparte en avait fait part à Changarnier, et lui avait offert de lui lire son manifeste. Le général avait répondu qu'il se rendait à la Chambre, et qu’il en entendrait là, la lecture. La lecture faite, Changarnier sortit de la séance, avec Thiers sans laisser percer au dehors aucune marque d'approbation ou de désapprobation. Voici le langage de Thiers. « Il ne faut pas que la majorité pousse le président à un coup de tête ; il faut qu'elle accepte ce Cabinet pris dans son sein et composé d'hommes honorables et dévoués à l’ordre. N'oublions pas que nous sommes en présence de la République rouge et du socialisme, et que nous ne devons, sous aucun prétexte, leur fournir les moyens de triomphe. Ne faisons pas encore un 24 Février.» D'autres sont plus susceptibles, et disent que jamais assemblée n'a été plus indignement souffletée. Ils avouent néanmoins qu'elle ne peut guères se venger sans donner des armes à la Montagne et sans préparer son triomphe. Est-ce là ce qui vous revient ? Avez-vous entendu dire que sur le Boulevard, autour d’un café où se réunissent beaucoup d’officiers quelques uns, après avoir lu le manifeste, avaient crié : Vive Henri V et qu'ils avaient été sur le champ arrêtés ? Je ne fais pas de doute que la majorité ne doive accepter le cabinet pris dans son sein, et le contenir, et l’attirer à elle en le soutenant. Je crois même qu'elle pourrait tenir cette conduite avec beaucoup de dignité pour elle-même, et de profit pour son autorité sur le Pays et l'avenir. Mais je crains qu’on ne donne à une conduite qui pourrait prouver, et produire de la force, les apparences et par conséquent, les effets de la faiblesse. Je crains que mon pauvre pays ne soit défendu, contre les étourderies des enfants, que par les tâtonnements des vieillards. Gardez-moi le secret de ma crainte. Je pense à cela, et à vous. Je pense peut-être à des choses déjà surannées. Qui sait si le nouveau cabinet n’est pas mort ? Il n’avait pas encore été baptisé au Moniteur. Mes journaux me manqueront ce matin à cause de l'Assomption. Pas tous, j'espère. D'ailleurs j'aurai des lettres. C'est, je vous assure, une singulière impression que de vivre en même temps au milieu de tout cela, et au milieu du long Parlement, de Cromwell, de Richard Cromwell des Républicains, des Stuart & & & C'est une perpétuelle confusion de ressemblances et de différences, et de curiosités et de conjectures, qui tombent pêle-mêle sur la France et sur l’Angleterre, sur le passé et sur l'avenir. Je ne dirai pas cependant que je m’y perde. Mon impression est plutôt qu’il rejaillit bien de la lumière d'un pays et d’un temps sur l'autre. Mais soyez tranquille ; j'ai assez de bon sens pour ne pas me fier à mon impression et pour savoir que je n’y vois pas aussi clair que par moments, je le crois.
Midi
Merci, merci. Cela ne me paraît pas, à tout prendre, inquiétant pour le moment. Mes tendres amitiés à Ste. Aulaire quand vous le reverrez. Je crois plus que personne qu’il n’y a que les sots d'infaillibles, mais je suis très décidé à ne pas me laisser affubler du moindre tort prétendu pour épargner à d'autres la honte de leurs gros péchés. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Brompton, Mardi 19 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je reviens de la Tour où j'étais allé à onze heures. J’ai revu Jane Grey, Sir Walter Raleigh, Strafford, les enfants d'Edouard, je ne sais combien de grands noms, de grands crimes et de grandes douleurs. Je vis beaucoup dans le passé et je commence à y entrer moi-même. J'ouvre hier un livre qui vient de paraître, intitulé : Prince Rupert and the Cavaliers, livre curieux et qui contient des documents nouveaux publié par un M. Elias Warburton que je ne connais pas du tout. Une des premières phrases que j'y rencontre est cette- ci : «M. Guizot's account of the trial of Lord Strafford is given with his usual perspicasity and point : but it is singularly reserved as regards expression of opinion on te merits of the case. The reader will easily supply a parallel between the fortunes of the great English Minister and those of a recent French one. The former, when his arm was paralysed in the north by the Kings want of nerve to carry out measures of which he had already reaped all the [?] and danger, and only required courage to grasp at the success for which he had so dearly paid ; the latter when his labours long directed towards the transmutation of the bases elements of France were ruined in the very moment of projection, the timidity of his master, and those, claments let loose to desolate the Empire. " Je ne me plains point de ce jugement. Mais ne trouvez-vous pas que c'est le ton de l'histoire sur les morts ? Je ne sais pourquoi je n’ai point de nouvelles de Paris. J'en attends de tout le monde. Les gens que j'ai vus hier soir, chez Lady Stanley de Alderley, et ce matin, chez moi, ne savaient rien. On croyait généralement que Ledru Rollin est à Londres. Je ne crois pas. On le saurait positivement. On parlait aussi d’une vive attaque d'Oudinet sur Rome, de monuments détruits, de statues brisées, de tableaux percés. Je ne connais pas de pire condition que celle de ce pauvre homme ; il faut qu’il prenne Rome et qu’il n’y gâte pas une image. M. Benoist Fould vient de venir chez moi pendant que j'étais à la Tour. Je le regrette. Personne n'est mieux informé que lui de Paris. Il se fait tout envoyer et quelquefois des courriers exprès. Il va aujourd'hui même s'établir à Richmond, Mansfield house, en face du Star and garter. Par M. de Stieghz, si vous voulez, vous saurez ses nouvelles. Je ne doute pas qu’il ne la connaisse. Tous ces banquiers sont compatriotes. Si, comme il m’a paru vous n’avez pas grande envie de venir demain à Pelham Crescent, je veux vous dire que je suis obligé de sorti à 3 heures avec M. et Lady Charlotte Denison, pour aller voir l’exposition des fleurs à Regent's Park. Mon désir est et mon plaisir sera de vous voir auparavant ; vous venez en général à 2 heures et demie. Mais je veux que vous sachiez à quelle heure je serai pris. Un quart d'heure en bien court. Pour moi, je l’aime infiniment mieux que rien du tout. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Kimbolton Castle, Mardi 20 mars 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
20 mars ! Quel jour, il y a 35 ans! Louis XVIII avait fui de Paris dans la nuit. Napoléon y entrait le soir. très tard, et en se cachant, quoique le maître. Trois trônes sont tombés à Paris depuis ce jour-là. Trois Rois ont fui de nouveau. Et qui sait ?
Merci de votre lettre. Je l’avais ce matin, à 5 heures et demie. Vous d'abord. et puis des nouvelles. Mais voici un grand déplaisir. Il m’est absolument impossible d’en finir aujourd’hui avec les papiers. Il y en a plus que je n'en attendais. Il me faut la journée de demain. Et Guillaume aura à copier sans relâche pendant ces deux jours. Je ne puis pas être venu ici pour n'en pas remporter ce que j’y ai trouvé. J’en partirai après-demain Jeudi, vers 10 heures du matin, pour être à Bedford à onze heures trois quarts, à Londres à 3, à Brompton à 4, et chez vous le soir avant 8 heures. Pouvez-vous m'envoyer votre voiture à 7 heures et demie ? Je vous écrirai encore demain. J’ai deux déplaisirs, le mien et le vôtre. Ce serait bien pis si je n'en avais qu’un. Je travaille depuis ce matin. Il n'y a pas moyen. Le manifeste de la Rue de Poitiers est ce que j'attendais. Une sonate sans défaut. L'impression universelle sera celle-là. Par conséquent complète impuissance, ce qui n'est jamais bon pour des hommes importants. Il faut parler pour tous, ou parler seul et pour soi seul. Mais parler tous ensemble et tous du même ton, c’est si impossible que cela devient ridicule, quelque irréprochable que soit le ton. Je suis toujours sans nouvelles de Paris. Ce qui fait que j’en suis chaque jour plus curieux. Ce voyage m'a fort dérangé. Si je n’avais pas quitté Brompton, ce que j'ai à écrire eût été écrit cette semaine.
Je crois à l’arrangement des affaires de Sicile. Les Siciliens se résigneront. Le monde a vu des fanatismes qui ne se résignaient pas et qui résistaient, même sans chances de succès. Mais aujourd'hui ce n’est pas au fanatisme, c’est à la folie que nous avons à faire. La folie se décourage bien plutôt. Le Roi de Naples donne aux Siciliens tout ce à quoi ils ont droit, et peut-être plus qu'ils ne pourront porter. Mais cela n'en fera pas moins pour l'Angleterre, en Sicile l'effet d’un abandon honteux après une provocation coupable. Je suis, quant à la situation du cabinet, de l'avis de Peel qui en sait plus que moi. Et c’est l'avis que je trouve ici, parmi deux ou trois hommes simples et sensés qui vivent loin des Affaires. Quand les hommes simples et les hommes d’esprit sont du même avis, ils sont probablement bien près de la vérité. Pourtant je parierais pour le maintien. Adieu. Adieu. Cela me déplait beaucoup de voir les jours s'écouler. Vous partirez dans onze jours, et je serai plus de six semaines, sans vous voir. Ecrivez-moi encore un mot demain. Je l’aurai après-demain à 8 heures et demie, et je ne partirai qu'à 10. Adieu. Adieu.
G.
Drayton manor, Samedi 18 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Brompton, Mercredi 8 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Flahaut et Lavalette sortent de chez moi. Très troublés des nouvelles de Paris d'hier. Baisse énorme à la Bourse ; plus de 40 sous sur le 3 et sur le 5 pour 100. Anxiété générale comme la veille du 28 juin. Les républicains disant tout haut " Nous ne nous laisserons pas renverser. " Les modérés : " Nous ne nous laisserons pas déporter. " La garde mobile et la ligne tout près d'en venir aux mains non plus par des duels, mais en corps. La revue de l’armée ajournée, point à cause du temps mais parce que plusieurs régiments annonçaient qu’ils crieraient : " à bas Cavaignac ! Vive, Louis Bonaparte ! " Tous les symptômes de l'approche d’une lutte, d’une crise. Morny écrit : " J’ai de l’or ; j’aurai un passeport ; si nous sommes battus, je m’en servirai. " Duchâtel a trouvé hier le Roi sérieusement inquiet du Prince de Joinville. Et même un peu de la Reine. Leur arrivée à Richmond aura été triste.
Jeudi 9 Nov. 8 heures
J'ai dîné hier chez Lady Coltman, des magistrats et Macaulay. Moins abondant que de coutume. Préoccupé de son livre (Histoire de la révolution de 1688) qui paraîtra le 4 décembre. Lord Jeffrey, qui en a lu des fragments, dit que c'est excellent au-dessus de ce qu’il attendait. Cela vous est égal. Vous aimez assez les vieilles gens, point les vieux temps. Il faut que vous-même, de votre personne, vous ayez été de quelque chose dans les choses pour vous y intéresser. Vous êtes très personnelle. Point de nouvelles là. Ni Anglaises, ni Françaises. Presque tout le monde content du résultat de Vienne. En gros, le public anglais veut du bien à l’Autriche. Le libéralisme de Macaulay se satisferait en espérant l'affranchissement des Slaves et un affaiblissement pour la Russie.
Je mettrai moi-même cette lettre-ci à la poste tout-à-l’heure avant 9 heures. Je veux voir, si elle vous arrivera ce soir. Vous me le direz. Si j’apprends dans la journée quelque chose qui en vaille la peine, je vous écrirai un mot avant 5 heures. J'attends, M. Vitet qui a dû arriver hier de Paris. A moins que le mauvais temps ne l'ait arrêté à Boulogne.
On dit qu’hier il y avait tempête. L’avez-vous eue à Brighton ? Jai rapporté de Brighton une impression très agréable. Probablement plus agréable qu'il ne mérite. Je vois par ce qui me revient de Paris que là dans Paris, la perspective de la chute de Cavaignac déplait à pas mal de gens. Par terreur de la transition. Et aussi parce que, sans aimer la République pas mal de gens se disaient qu'après tout, peut- être, en entourant Cavaignac, en le soutenant la république modérée serait possible. On les jette dans un danger et on leur retire une chance. Ils en voudront beaucoup à Thiers d'avoir poussé à Louis Bonaparte. M. de Tocqueville est fort prononcé dans ce sens. On recrute ouvertement chez lui pour Cavaignac. Les Anglais qui vont à Paris vont beaucoup là. L’armée des Alpes est, pour Cavaignac et le républicain, un grand sujet d'inquiétude. Ils craignent qu’un beau jour, tout à coup, le maréchal Bugeaud n'aille se mettre à la tête et ne marche sur Paris. Je recherche tous les bruits, tous les petits propos pour vous les envoyer. Adieu. Adieu. G.
280. Paris, Mercredi 2 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Ah ! si votre médecin pouvait re connaître en médecin comme moi. J’attends son arrêt avec une espèce d’angoisse. Que j'aimerais ce médecin s'il vous faisait revenir. Dites-moi Dites-moi que vous revenez. Quelle joie ! Bulwerr m'apportera, le lien vers Lord Chatham, mais il croit que vous savez déjà son histoire mieux que tout ce que vous en diraient les le livres. Je conclurai dans la bibliothèque c'est une jolie pièce. Nos habitudes seront probablement dans ce qui était le salon de M. de Talleyrand.
Je n'ai point encore commencé avec la petite lectrice, je suis parvenue à tuer mon temps en sortant après le dîner. Dès que je serai casée ne ne sortirai plus, & c’est alors que j'aurai besoin d’elle dans l’avant soirée. Aurai-je besoin d’elle ? Répondez- moi, demandez-le à votre médecin. Il me semble que moi aussi j’ai besoin de votre médecin. Votre irriitation au gozier a passé dans le mien. J’ai toussé toute la nuit. Le temps cependant est beau.
J'ai été deux heures hier au Marais dans de grandes manifactures de bronze. J'ai choisi de jolies choses. Cela n'a pas le sens commu, car je n’ai pas encore sur quoi coucher, manger & &
Vous êtes parfaitement instruit de nos propositions. Nous verrons. C’est vraiment un moment curieux. Ah, si nous pouvions nous parler ! M. Molé est à Fontainebleau.. La Duchesse de Talleyrand répart demain, et ne reviendra à Paris qu’à la nouvelle année. Midi Génie sort de chez moi, Il avait été très inquiet de vous. Votre médecin lui a écrit un mot dès son arrivée pour le rassurer mais disant que vous avez un rhume. obstiné. Si vous venez, je vous promets de vous laisser à votre travail toute le matin. Je ne vous prendrai rien de votre temps utile. Après le soleil couché vous penseriez à moi, n'est-ce pas ? On dit que la commission de la chambre à Madrid refuse de reconnaître les fueros. Cela serait mauvais. Génie me dit qu’il vous a envoyé hier une lettre de Fontainebleau. Est-ce une invitation ? Que je le voudrais. Je ne suis plus préoccupée que de cela. De façon ou d’autre il me semble que vous devez venir. Cela est si fort entré dans ma tête que le contraire me paraîtrait une horrible injustice. J’attends votre lettre de demain avec un grande impatience. Adieu, adieu. Venez. adieu.
Mots-clés : histoire, Politique (Espagne), Santé (François), Vie domestique (Dorothée)
264. Val -Richer, Jeudi 12 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rentre pour être avec vous. Vous savez le peu de cas que je fais des fictions. Mais enfin... Je me promenais tout à l’heure avec ma mère et mes enfants. Je ne sais pourquoi j'ai regardé à ma montre. Midi et demie m’a donné l’envie de rentrer, le besoin d'être seul. Vous êtes seule aussi. Je vous ai promis que vous ne le seriez plus. Je ne tiens toute ma promesse qu’au dedans de mon cœur à votre cœur. Au dehors. dans notre vie, je vous laisse encore seule souvent longtemps... Ah que tout est imparfait.
La nouvelle proposition de Jénisson, me contrarie beaucoup. Vous seriez si bien là ! Je me persuade que M. Démion arrangera la chose et vous fera avoir l’appartement sans meubles. M. de Jénisson se trompe s’il espère le louer sur le champ comme il lui convient. Il ne trouvera pas de chalands avant la fin de l’automne, et perdra ainsi ce qu’il se flatte de gagner. Vous aviez bien raison de prévoir que les affaires vous afflueraient quand je serais parti. Vous aurez vu Génie ce matin. Abouchez-le avec Démion ; il traitera mieux que vous. En tout cas la rue de Lille est toujours à votre disposition. Je viens de relire votre frère. C'est bien ce que j’ai entrevu. Pour en finir, pour se débarrasser de toute contrariété en pensant à vous et de toute peine à prendre pour vous, il a besoin de partager les torts entre vous et vos fils. C'est commode, ainsi font les indifférents de peu d’esprit. Il y a bien de quoi vous blesser. Mais ne vous blessez pas, par fierté. Ne voyez là que des affaires. Je vous demande plus qu’il ne se peut, je le sais bien. J’ai peine à croire que l’augmentation de 2000 roubles de pension soit à la place des capitaux. Elle n'y correspond pas. Le capital Anglais n’y peut-être compris. A lui seul, il vaut plus de 13 000 fr de rente. Ce ne pourrait donc être que pour le capital d’une année de revenu de la terre de Courlande. Il vaut mieux que vous le receviez en masse. Votre frère, est-il autorisé par vos pleins pouvoirs à conclure un tel arrangement, sans votre consentement spécial ?
Voici ce que m'écrit Brougham ce matin : " Mon cher M. Guizot, permettez que je vous exprime mon horreur au sujet d’un bruit qui vient de me parvenir de ma belle-fille à la Haye - et qui m’attribue - je dois dire plutôt m'impute une brochure sur la politique de France, et nommément contre le Roi - Notre roi, j’ose l’appeler. Je n'en sais pas même le titre. Encore moins en ai-je lu même une ligne. Jugez de mon étonnement. C'est probablement une ruse de libraire. "
" Encore une justification. L'on m'accuse d'avoir trop parlé du duc de Wellington aux dépens de l’armée française. Au contraire, le comble de mon éloge était qu'au lieu de se battre contre vos troupes, Napoléon les avait commandées tandis que Wellington les avait combattues. Sachant qu’il y avait des respectables Français près de moi, certes j'aurais eu grand soin de ne pas préférer le moindre mot contre vous autres, quand même j'aurais eu une telle opinion, ce que certes, je n’avais point. " Rendez-lui le service de répéter un peu ses démentis. Il faut obliger les gens d’esprit, même fous. Il ne me dit pas un mot d'Angleterre.
8 heures et demie
Je viens à vous à 8 heures et demie comme à midi et demie avec le même désir et le même serrement de cœur. Vous aviez bien raison avant-hier de vous séparer de moi, avec plus de peine que jamais. Je n’ai jamais passé un peu de temps près de vous sans que le plaisir d’y être ne devint plus vif, et la peine de n'y plus être, plus amère. Et cette fois plus encore que jamais. J’ai oublié de vous dire que, si vous vouliez achever l'histoire de la Révolution de Thiers, je l’avais à votre disposition. Dites à Génie de la faire prendre dans la bibliothèque de l’antichambre du salon, au premier étage. Avez-vous lu les mémoires sur le consulat de Thibaudeau ? Ils vous intéresseraient.
Si M. de Jénisson est intraitable tâchons de voir le bon côté de la rue de Lille. Vous payerez 5000 fr de moins & vous aurez sans embarras, sans qu’il y manque rien, le plaisir d’arranger l’appartement à votre gré. Je me dis et redis cela d'avance, pour être moins contrarié pour vous, s’il faut l'être. Au fait, la rue de Lille est très convenable, parfaitement convenable, et nous mettrons dans le jardin tant de fleurs et de si belles fleurs, que nous le rendrons gai et varié. Vous savez que j'ai le département des fleurs. J’apporterai d’ici, dans ce cas de très belles graines qui me viennent du Jardin du Roi. Nous les sèmerons au printemps sur ce gazon que nous métamorphoserons en corbeille. N'a-t-il pas été convenu que décidément on vous donnerait la grande chambre dont vous avez besoin, au haut de l’escalier ?
9 h. 1/2
Si vous m'êtes nécessaire ? Vous aurez beau faire ; vous pouvez me le demander à moi, mais à vous-même, au fond, de votre cœur, je vous en défie. Je suis sûr que vous serez de plus en plus contente de mon génie, et il vous dira beaucoup de petites nouvelles. Je suis fâché que Rothschild attende Démion. C’est Démion qui règne, au gré de Rothschild. Je m’y attendais. Adieu. Adieu. G.
190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
79. Paris, Lundi 2 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre lettre, de vos conseils, ils sont bons, je les suivrai & dès aujourd’hui. Je suis un peu indignée, ce qui fait que je crains le ton de ma lettre, mais il faut la faire Je n’ai pas encore ouvert le paquet de livres. La petite fille me touche, nous verrons si elle me plaira cela n’est pas aussi sûr parce que comme vous le dites ce n’est pas facile. En fait de lecture depuis que vous m'avez quittée, j'ai lu les Mémoires de Knighton deux gros volumes, remplis de niaiseries, mais où je croyais toujours trouver mieux que cela ; (c’est mon temps) et il n'y a que deux ou trois lettres de George quatre qui m’ont intéressée et cela encore parce qu'elles prouvent des faiblesses de caractère incroyables, mais je l'y retrouve. Les journaux français anglais. je les dévore, les détails de ce couronnement, où je me retrouve encore m’intéressent ridiculement, et puis j’ai lu l’article de Croker sur le Maréchal Soult Il a eu en effet singulier; celui de faire applaudir Le maréchal non seulement dans les rues, mais dans l'abbaye, oui dans l'abbaye, c’est trop, car là il n'y a pas de mots, rien que les hautes classes. Vous jugez comme il en est enflé. Les lettres que j’ai reçues, celles que j'ai lues sont remplies de détails intéressants. La Reine a été vraiment étonnante. Mon fils aussi me mande qu’il n'a rien vu de plus gracieux, de plus digne ; de plus charmant que toute sa tenue, tous ses mouvements, toutes ses inspirations pendant les cinq heures entières qu’elle est restée en scène dans l’église.
La Reine n’est pas contente du duc de Nemours. Il est entré dans sa loge à l'opéra pour lui faire visite. Elle a trouvé cela très familier, et elle a raison. Nous nous sommes communiquées nos lettre & nouvelles hier matin Lady Granville & moi. Nous étions un peu émues l’une & l’autre. Le froid Lord Granville l’était bien aussi. On dit que Melbourne a pleuré comme un enfant à l'église. Le Duc de Wellington aussi. On cite ceux-là, il y aura eu bien d’autres larmes. La reine en a versé un peu pendant le sermon. Elle a été abîmée de fatigue.
J'ai reçu hier au soir. Tout ce qui reste ici est venu. Lord Granville revenait de Neuilly. Il me dit qu'on y est inquiet de l'Egypte. L’affaire devient grave. Je vous ai quitté pour écrire à mon mari, cette lettre m’a été odieuse à écrire. Je l’ai adressée à la reine de H. pour qu’elle la lui remette. J'écrirai à mon frère par un courrier. Me voilà fatiguée, & les nerfs un peu agacés. Je vous quitte. Il me semble que je sais aussi peu vous écrire que vous parler. Je ne puis pas traiter le sujet de notre séparation. Elle m’est insoutenable. J'en ai de l'humeur autant que du chagrin. Il me faut du temps, du temps pour m’accoutumer à cette horreur. Est-ce qu’on s'habitue à cela. Adieu. Le temps est tourd, et je suis si triste !
Mots-clés : histoire, Politique (Angleterre), Vie familiale (Dorothée)
76. Val-Richer, Lundi 2 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis très touché des détails de ce couronnement. J’aime la piété. J’aime l’antiquité. J’aime l’enthousiasme et l’affection populaire. Je voudrais savoir ce qu’il y a de vrai et de solide dans toutes ces démonstrations. Non que je ne sache que la légèreté et l’inconstance sont de tous les temps, et n’excluent point la sincérité. Mais au moins faut-il qu’au moment où ils éclatent, les sentiments soient sérieux et sincères, que ce peuple assiste avec foi à ces cérémonies religieuses, avec respect à ces anciens usages, qu’il aime vraiment sa Reine en criant. Dieu sauve la Reine ! Qu’en pensez-vous ? Je ne demande pas mieux que d’y croire. J’y crois même. Je trouve que tout cela a l’air vrai. Dites-moi que j’en puis être sûr. Vous me ferez un grand plaisir. C’est un terrible problème que de savoir si la foi, le respect et l’amour se peuvent concilier avec une discussion continuelle, & une liberté immense. C’est le problème de notre temps. Si la solution est bonne, ce sera un honneur infini pour l’humanité. Je l’espère toujours.
Comment donc le Maréchal Soult a-t-il fait pour être le second dans le cortège? Ou bien le Journal des Débats a-t-il effrontément menti ? Je l’en soupçonne un peu, quoique ce fût bien fort. Et ces acclamations, du peuple anglais pour le Maréchal, et pour lui seul, sont-elles vraies aussi ? Est-il vrai du moins que tous les journaux anglais le disent ? Levez tous mes doutes, je vous prie. Vous m’avez donné la passion de l’exactitude. Il faut satisfaire, les passions qu’on donne. Sachez bien seulement que je ne mets de prix à toutes mes questions que parce que je vous les adresse et parce que les réponses me viendront de vous. A cause de cela, vous seriez peut-être tentée de croire que je n’écris qu’à vous. Détrompez-vous. J’ai écrit ce matin à vingt-quatre personnes ; oui, 24. J’ai apporté ici tout mon paquet de lettres non répondues. Il y en a 39 de gens qui m’ont envoyé leurs ouvrages. Il faut bien répondre et répondre avec quelque intelligence, avec un certain air d’avoir lu. J’ai fait 24 fois ce mensonge là aujourd’hui.
Mardi 3 6 h. 1/2.
Je sors de mon lit. Il y avait autrefois, dans cette maison neuf moines qui n’en sortaient pas avant 10 heures. Il y a 600 ans, il y en avait je ne sais combien qui en sortaient à 4 heures du matin. Ceux-là priaient, labouraient, défrichaient, étudiaient. Ils étaient le type de la vie austère et laborieuse. Et le peuple le croyait; et il avait raison de le croire. Naguère, il y a cinquante ans, leurs successeurs étaient le type de la vie oisive, paresseuse licencieuse. Et le peuple le croyait aussi, et il avait raison, quoiqu’il le crût plus que cela n’était. Ainsi va le monde. Mais ce prodigieux contraste des choses, sous les mêmes noms, dans les mêmes lieux, et frappe l’imagination quand elle s’y arrête. Je viens de me promener un quart d’heure. Je regardais cette vallée qui est-ce qu’elle était il y a 600 ans couverte des mêmes bois, éclairée du même soleil, arrosée des mêmes eaux ; puis cette maison, la même aussi au fond, quoique plusieurs fois reconstruite. Les hommes seuls ont changé. Les moines licencieux ont succédé aux moines austères, et moi je succède aux moines licencieux. D’où vient notre plaisir à contempler ce cours des choses humaines, les vies si diverses et toutes si rapides, que le temps remporte toutes également, comme le courant de ma source emporte les feuilles de toute sorte qui y tombent. Homère a pensé et dit tout cela il y a 2700 ans, c’est lui qui compare les générations des hommes aux générations des feuilles. Et moi, je prends le même plaisir à le penser et à le dire comme lui. Mais je vous le redis. C’est là mon vrai plaisir, et celui-là Homère ne l’a pas eu.
10 h.
Voilà, la réponse à mes questions anglaises. J’y comptais presque. Nous pensons, ensemble même à 46 lieues. Que c’est loin pourtant ! Et ces lettres qui vous arrivent ou que vous écrivez sans que je les voie! Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : histoire, Politique (Angleterre), Politique (France)
75. Val-Richer, Samedi 30 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis au loin de mon feu. Il a plus presque tout le jour. Je regrette que vous n’aimiez pas le feu. Je vous établirais près du mien, et nous passerions là une soirée charmante. Mais je ne veux pas faire violence, à votre goût, même en pensée.
Savez-vous que Charles 1er n’a point dit en mourant cette belle parole qu’on lui a attribuée. Dites à la Reine que je ne lui ai jamais été infidèle, même en pensée ? Pas plus que l’abbé Edguworth n’a dit à Louis 16, sur l’échafaud : " Fils de St Louis, montez au Ciel." Pas plus que Charles 10, en rentrant à Paris, en 1814, n’a dit : " Messieurs, rien n’est changé ; il n’y a qu’un Français de plus." C’est un journaliste qui le jour même de la mort de Louis 16 dînant avec quelques uns de ses amis, & tout ému de cet effroyable spectacle dit : " En vérité, au moment où il a été frappé, j’ai cru entendre son confesseur s’écrier : " Fils de St Louis, montez au ciel "." Et dès le lendemain en effet, dans je ne sais quelle feuille, ces mots furent mis sur le compte de l’abbé Edguvorth qui plus tard s’en défendait modestement disant qu’il n’avait pas été assez heureux pour les trouver. Quand au mot de Charles 10 en 1814, il est du comte Beugnot qui le lui prêta pour plaire un moment à la vieille Garde impériale. Rien n’est si commun que ces renoms usurpés de belles en spirituelles paroles. En revanche que de mots charmants sont restés inconnus ! J’en ai entendu je ne sais combien qui méritaient de faire le tour du monde et la réputation d’un homme. Et je ne parle que de ceux que j’ai vraiment entendus qui ont été réellement prononcés tout haut. Combien d’autres n’ont été que pensé, sont nés et morts d’ans l’esprit de leur auteur, charmants pour Dieu seul ! Ne croyez-vous, pas qu’on a bien plus d’esprit qu’on n’en montre? Je m’amuserai quelque jour à écrire les Mémoires d’une âme, et je n’y mettrai que ce que cette âme-là, n’a jamais dit. Encore n’y mettrai-je pas tout. Je défie qu’on dise jamais même tout bas, tout ce qu’on a senti ou pensé, qu’on se décide jamais à voir au dehors, ne fût-ce que de ses propres yeux tout ce qui s’est passé au dedans.
Si nous étions toujours ensemble, vous dirais-je vraiment tout ? Tout, c’est beaucoup dire ; à peu près tout. Et si nous passions ensemble je ne sais combien de cent ans, tout peut-être un jour. Il n’y a point d’intimité à laquelle le temps n’ajoute immensément chaque jour. Et l’intimité la plus parfaite n’arrive jamais au terme des choses qui peuvent, qui doivent entrer un jour dans son domaine. Quel dommage ! Il nous faut absolument l’éternité.
Dimanche, 8 heures
Vous me demandez de la force. J’en ai eu beaucoup dans ma vie, jamais avec le sentiment que j’en avais assez. Bien souvent au contraire, je me suis senti sur le point d’en manquer. Je ne puis vous donner que beaucoup, beaucoup d’affection. Faites en de la force, si vous pouvez. Je le voudrais bien. Près de vous, je l’espère. Mais de loin ! Il y en a pourtant à prendre à cette source, même de loin.
J’ irai peut-être à Broglie, vers la fin de la semaine, pour 24 heures seulement, et je m’arrangerai pour que notre correspondance n’en soit pas dérangée. Mon nouveau facteur est jusqu’ici admirablement exact. Il arrive entre 9 et 10 heures. Mes journaux m’ont manqué hier. Dites-moi ce qu’on vous aura dit du procès de la Chambre des Pairs.
10 h.
Merci de vos commérages anglais. De vous, tout m’amuse, même ce qui ne fait que passer par vous. Ne me dîtes pas comment vous étiez, comment vous réussissiez à Londres. Je le sais, je vous y vois moi qui n’ai jamais vu Londres. Je suis sûr que tout était joli. Adieu. Je suis charmé que Bagatelle vous ait plu. Votre n°77 me plaît. Vous y êtes moins abattue. Adieu.
Mots-clés : Discours du for intérieur, histoire, Relation François-Dorothée
167. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Est-ce que si vous étiez bien parfaitement sûre que le mal de votre situation vient de gens incurables en effet, bien vraiment incurables cela ne vous calmerait pas au lieu de vous agiter ? Excepté les peines de cœur auxquelles la nécessité, l’inévitabilité n’est pas du tout un remède, je ne connais rien d’aussi calmant que la certitude qu’il n’en peut être autrement. Il me semble que j’ai une infinité de choses, et de très bonnes choses à vous dire sur cela. Mais je ne les dirai pas de loin. Rien n’est bon de loin. Bientôt nous serons près. En attendant, je pense sans cesse à vous. Telle vous voyez Mad. de Talleyrand, telle elle a été toujours. Seulement, quand elle avait M. de Talleyrand derrière elle, cela paraissait moins. Elle ne prendra pas l’aplomb qu’elle cherche. Elle a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir qu’il lui manque, et pas assez de hauteur, de de suite dans le caractère pour l’acquérir. Rien n’est pire que de connaitre en vain son mal. Quand on n’en peut guérir, il faut l’ignorer.
Je vous ai demandé une fois, si vous preniez quelque intérêt aux Etats-Unis, à quoi vous n’avez pas répondu. Il faut bien que j’y prenne intérêt puisque je m’en occupe. Mais Washington à part, il m’est arrivé, les jours derniers de Boston une nouvelle et grande quarterly review qui ma fort étonné, tant j’y ai trouvé d’esprit, de bon et presque de grand esprit quoique un peu enthusiantic and unexperienced. C’est très supérieur à tout ce que j’avais vu de là. L’auteur est un M. Greene, jusqu’ici inconnu, pour moi du moins. Je prends un vrai plaisir à découvrir dans le monde un homme de plus. un homme, c’est un monde.
On m’écrit qu’une affaire à laquelle vous n’avez certainement jamais pensé devient pour le Cabinet un assez gros embarras, l’affaire des sucres. Vous ne savez peut-être pas qu’il y a deux sucres, deux sucres en guerre, le sucre de canne et le sucre de betterave. Ils veulent absolument. ou qu’on leur sacrifie leur rival ou qu’on les mette d’accord. Malgré, son talent de conciliation, M. Molé n’en peut venir à bout. Il y a là quelque chose de plus à faire que de donner des paroles à droite et à gauche. Les intérêts sont en présence, très positifs et très animés. Ils exigent qu’on ait un avis, une volonté. M. Duchâtel m’écrit qu’on a trouvé cette exigence par trop forte, et qu’on n’aura, ni volonté, ni avis. Je vous mande tout ce qu’on me mande. A propos de M. Duchâtel, sa femme vient d’accoucher d’un garçon. Il est bien content.
Vous ne vous doutez pas du petit plaisir que j’ai à regarder ce matin par ma fenêtre. Il fait beau, s’il n’avait pas fait beau, j’aurais eu sur les bras, pendant quatre ou cinq heures, entre les quatre murs de mon salon, les vingt hôtes que j’attends de Lisieux à déjeuner. Grace au soleil, je pourrai les mettre dehors, je veux dire les promener.
10 heures
Je ne reçois pas une ligne de vous, je ne pense pas une fois à vous sans que mon désir de me retrouver auprès de vous redouble. Enfin, j’approche. Je vous aime bien tendrement. Je ne puis pas pour vous ce que je voudrais ce que je pourrais pas la millième partie, mais enfin, de près, je puis quelque chose, je fais quelque chose. Votre tristesse me pèse bien plus quand je ne la vois pas. Je serai triste avec vous. Je serai gai pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous faire un peu de bien. Je vous aime trop pour ne pas vous faire du bien. Adieu. Adieu. G.
165. Val-Richer, Samedi 20 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
161. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
148. Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.
A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.
J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.
9 heures
Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.
130. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de votre Gazette. Je vous aime mieux vous que les nouvelles. Mais j’aime les nouvelles. Quand elles remplissent vos lettre, il me semble qu’elles ont rempli aussi votre temps. Je me trompe. Il faudrait des tas de nouvelles et des plus grandes, pour remplir le temps quand le cœur est triste ! Et encore ! Mais n’importe ; cela me semble ainsi, et ce semblant me plaît. Nous sommes si disposés à nous payer d’apparences. Ne tenez pourtant pas à votre projet de ne me parler que de nouvelles. Je veux savoir ce qui se passe ailleurs que dans le monde. Ne craignez pas les malentendus les mauvaises phrases. Entre nous, les réticences seraient bien pires. Il n’en faut point, même de loin.
A propos de nouvelles donnez-m’en du petit Lord Coke. Je m’intéresse à cet enfant. Il avait l’air si isolé avec une figure si ouverte et si gaie ! J’espère qu’il va bien. Le précepteur s’est-il animé un peu ? Si l’affaire du roi de Hanovre finit comme vous le dîtes, les Allemands diètes et peuples, baisseront beaucoup dans mon esprit. Ils n’auront que ce qu’ils méritent. Il ne faut pas vouloir, ce qu’on ne sait pas défendre. C’est sans doute l’influence de l’Autriche et de le Prusse qui a retourné la Diète, car elle était disposée à reconnaître sa compétence. Pour ce qui se fait en Espagne, Frias vaut Ofalie. Singulier temps que celui où les révolutions elles-mêmes sont apathiques, et vivent sans faire un pas. Que votre Empereur s’en aille d’Allemagne en emportant pour tout résultat, un Leuchtonberg pour gendre, peuples et Princes pourront adopter la même devise ; Much ade about nothing.
Je lève la tête en ce moment. Vous avez parfaitement raison. J’ai devant moi ce soleil froid, qui s’épuise à chasser du Ciel le brouillard, et n’a plus rien pour échauffer la terre. C’est du pur humbog. Pourtant je l’aime mieux que la pluie. J’assiste chaque jour à toute la vie du soleil. Je me couche et me lève de très bonne heure. Physiquement, je m’en trouve bien. Je voudrais vous envoyer un peu de mon sommeil.
Ce qui me fait grand plaisir à voir, c’est la santé de mes enfants. Ils sont à merveille, et d’un mouvement, d’un entrain d’esprit et de corps inimaginable. M. de Metternich n’a pas trouvé Thiers plus animé, que ne l’est ma petite Henriette. Je leur lis le soir l’histoire des croisades de Guillaume de Tyr. Nous venons de passer trois jours à assiéger, et à prendre Antioche. Au moment où nous y sommes entrés Henriette a jeté sa tapisserie, & ils se sont mis à courir et à sauter dans la Chambre avec des cris de joie, comme les Croisés eux-mêmes. Ce sera bien pis quand nous prendrons Jérusalem.
10 heures ¼
Le facteur arrive tard. Vous êtes bien triste. Il y a une chose que je ne vous pardonne pas, c’est de croire que vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez. Que de choses j’ai à vous dire ? Et je vous ai écrit hier que je n’irais pas à Paris ! Adieu. Ce soir, je vous écrirai longuement. J’ai là du monde. Prenez garde à Marie, je vous en conjure. Les folles qu’on ne croit pas folles me font trembler. Adieu. Adieu. J’ai le cœur plein !
120. Val-Richer, Mardi 4 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mots-clés : Discours du for intérieur, histoire, Vie familiale (François)
111. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voulez-vous lire tout l’ouvrage de Mad. Necker ? Je le ferai porter chez vous. Ce qu’en citaient hier les débats est en effet très beau, et il y a beaucoup de très beau, surtout dans ce denier volume que je n’ai fait que parcourir. A 70 ans, on fait mieux d’écrire cela que d’être amoureux d’une petite fille de 17. Je suis très ennuyé de partir demain pour Caen. Rien n’est pire que ce qui dérange sans plaire. Ne trouvez-vous pas qu’on s’impose une multitude de devoirs et de chaines parfaitement gratuits ? Et puis, quand on y regarde, on s’aperçoit qu’on néglige aussi une multitude de devoir et de soins qui feraient très bien si on s’en donnait la peine. Que de fois, en rencontrant dans ma vie, un embarras, une lutte, un ennemi, j’en ai reconnu l’origine dans une visite omise, une lettre restée sans réponse, que sais je ? C’est bien difficile et bien ennuyeux d’être attentif pour les gens et les choses dont on ne se soucie pas. Il le faut pourtant.
J’ai essayé hier, contre la tristesse le remède qui m’avait réussi contre le mal de dents. J’ai travaillé assidûment toute la matinée. Avec peu de succès. J’écrivais pourtant pour mes enfants, cette histoire de France que je veux leur raconter moi-même. Je le leur ai dit. Ils en ont sauté de joie autour de moi pendant un quart d’heure. Leur joie m’a encore attristé. J’avais eu cette idée il y a quinze ans ; pour mon fils. Je la reprends aujourd’hui pour ces trois petits. Que de choses qu’on reprend, qu’on renoue, qu’on recommence ! Toute ma vie m’est revenue à l’esprit. C’est bien ma vie. C’était bien moi. Et tout cela n’est plus ! Et toute cette immense part de moi-même a disparu ! Et je vais comme si j’étais tout entier ! Et j’ai encore soif de ce vase rempli et brisé tant de fois ! Ah, nous sommes de misérables créatures ? Nous ne pouvons conserver, & nous ne savons pas nous passer. Jeunes, nous nous épuisons à désirer et à espérer. Vieux, nous nous fatiguons à regretter et à désirer encore. Et les joies perdues sont pour nous comme si elles n’avaient jamais été. Et elles nous gâtent celles qui nous restent. Et celles qui nous restent ne nous empêchent pas de rechercher avec passion celles que nous n’avons plus comme si nous n’en avions pas eu notre part. Notre cœur est sans reconnaissance envers Dieu, sans équité envers les autres, insatiable dans son égoïsme. Je donnerais je ne sais quoi pour vous guérir de votre douleur. Et votre douleur me ramène à la mienne. Et la mienne me distrait de la vôtre. Je suis triste et mécontent de moi-même. C’est trop.
J’ai peine à croire que Mad. la Duchesse d’Orléans se soit trompée d’un mois. D’après ce qui me revient de l’intérieur de sa maison, on attend réellement d’un moment à l’autre. Du reste, c’est bien absurde, de moi de vous en parler d’ici. Vous entendez surement rabâcher tout le jour, sur ces pauvres petites nouvelles là Devinez à quoi je passe ma soirée depuis quatre jours. A coller avec de la gomme sur de grands cartons et dans de grands cadres que j’ai fait faire exprès, les portraits de tous les rois de France d’abord, ensuite de tous les députés à l’assemblée constituante. J’ai 72 portraits de Rois et 530 portraits de députés défaiseurs et faiseurs de Rois. Je veux garnir de cette collection, à la fois loyale et insolente, ma salle à manger et mon vestibule. Je fais cela avec l’aide de Mad. de Meulan, et un peu de mes enfants. Cela vaut bien vos grandes pensées.
10 heures
Ma lettre n’est pas propre à changer votre mauvaise disposition. Je voudrais trouver quelque chose à vous dire qui fût bon à écrire à M. de Lieven. Je ne trouve rien. Il y a de l’irrémédiable en ce monde. Quand il en aura fini avec le grand Duc, quand il sera oisif et seul peut-être alors sentira-t-il quelque besoin des autres, de vous, de ses enfants. Et intérêt seul, à ce qu’il me semble, peut agir, sur lui. Adieu. Je suis bien aise que Pahlen soit de retour. Il vous remplira quelques moments. Parlez-moi toujours de vous, toujours. Et toujours adieu. G.
105. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous lisez très bien les journaux. J’ai envie de m’en fier à vous, et de n’y regarder que ce que vous me recommanderez. D’autant plus que j’avais remarqué tout ce que vous me dites et pas grand chose de plus. Je suis de votre avis sur tout entre autres sur l’article des Débats. Il était si à propos, et si aisé d’écrire sur ce bruit du Times, dix lignes de cœur haut et de bon gout, dix lignes vraiment royales, en réponse aux boutades impériales ! Pour le constitutionnel, je n’y attache aucune importance. Il serait vendu qu’il ne parlerait pas autrement. Raison de plus même. Cependant je ne le crains pas. Mais je crois que M. Molé a une voie que je crois connaitre, pour faire insérer de temps en temps, dans ce Journal, quelque article qui le serve comme il l’a fait pour la visite de Champlatreux. La plupart des journaux sont aujourd’hui des magasins où l’on achète un article. Certains acheteurs payent plus cher que d’autres, et ne peuvent entrer que rarement. Mais pourvu qu’ils en disent tant, et pas trop souvent, on les écoute. Si l’opposition savait son métier comme elle exploiterait l’abandon du procès Chaltas ! Mais elle est bête et subalterne. Elle ne sait pas, et n’ose pas. Je n’en persiste pas moins à penser qu’au dehors, on est embarrassé de cette affaire, & bien aise qu’elle ne soit pas poussée à bout. Je ne trouve pas l’article Hollandais bien fin ni bien fier. Les républiques anciennes auraient mieux répondu. Je ne suis pas républicain, ni vous non plus.
Mais avez-vous lu, vraiment lu Thucydide et Tacite, Démosthène, et Cicéron ? Ce sont les esprits qui vous vont le mieux, hauts et naturels, dignes et dégagés, sensés et élégants, et ce je ne sais quoi d’achevé que la perfection du langage donne à la pensée. Vos grandes pensées vaudront les leurs, mais pas mieux, je vous en prévient. Occupez-vous en un peu quoiqu’on dise. Voulez-vous que je fasse porter chez vous une traduction passable de Tacite. Que je voudrais vous tire tout cela moi-même ! Nous nous sommes rencontrés tard. L’eau court vite. Bien peu de place nous reste pour tout ce que j’y voudrais mettre. Le bonheur possible et point réalisé, vu et point atteint, est un des plus pénibles sentiments que je connaisse. Je vous quitte pour ce soir. Je n’ai pas encore regagné tout mon sommeil.
Lundi 20 8 heures
En rangeant, mes papiers, je viens de relire, le N°104. Je ne suis pas décidé à le bruler. Il y a du bien mauvais. Mais tout n’est pas mauvais ; et dans le mauvais même, il y a du bon, ne pouvant les séparer, j’ai envie de garder tout, pêle- mêle. Je voudrais bien n’avoir pas d’autres papiers à ranger que ces numéros là. J’ai des ennuis d’affaires, des comptes à examiner, un fermier qui ne paye pas. Vous ne savez pas ce que c’est que des affaires, et j’espère que vous ne le saurez jamais quoique je vous aie vue à la veille de le trop bien savoir. Je vais à Caen dimanche 26 de grand matin. Ainsi le samedi 25 adressez-moi votre lettre à Caen, à la Préfecture. Je passerai là cing ou six jours, entre la société des Antiquaires, les courses de chevaux et mes courses à moi dans les environs. Le pays-ci est en grand progrès de civilisation. On y prend tous les goûts élégants et civilisés, les courses, les arts, les Académies, les speeches. Tout cela est amusant, à voir naître, si petit d’abord, si informé, et pourtant si animé, si avidemment destiné à grandir. Mon Lisieux vient de fermer son exposition de tableaux, plus de 250 tableaux, dessins, n’en soit de la province soit d’ailleurs. Le public normand a été très excité et charmé. Les paysans sont venus en foule voir cela. L’expositon a fini par une loterie de tableaux. On en a acheté pas mal, de côté et d’autre. On les méprisera beaucoup un jour. Mais ils auront commencé le goût et le sentiment de l’art dans toute une population.
9 h. 1/2
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. C’est la première fois que cela m’arrive cette année. C’était hier Dimanche. On aura mis votre lettre trop tard à la poste. C’est la seule explication que j’accepte. Adieu. J’aime mieux me taire.
Mots-clés : histoire, Littérature, Politique (France), Portrait (Dorothée), Presse, Progrès
61. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !
Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.
Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.
Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.
Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.
Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.
Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.
11 H.
J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Amour, Discours du for intérieur, histoire, Poésie, Portrait, Protestantisme, Religion
50. Val-Richer, Jeudi 28 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de recevoir trois ou quatre visites d’écrire six lettres. Il me faut du repos, c’est-à-dire du bonheur. Je ne comprends pas d’autre repos. Ce serait vraiment du bonheur, de vous écrire après avoir lu et relu ce que vous m’écrivez si tant d’inquiétude ne se mêlait pas à tant de joie. Je me creuse la tête comme vous pour deviner ce que peut faire, ce que peut méditer M. de Lieven. Je ne veux pas vous en parler. Il me déplairait de dire ce que j’en dirais. Jusqu’à ce que vous ayez des nouvelles de l’intervention du comte Orloff, j’espérerai quelque chose. Vous avez raison décrire avec détail à votre frère, avec grand détail. Il faut que tout ce monde-là, si préoccupé de lui-même et de sa position à la Cour, se sente aussi un peu responsable de votre destinée. Nous causerons de tout cela, le 6 bien bien sérieusement car j’y pense sans cesse. Newton a trouvé le système du monde en y pensant toujours. Il n’en avait pas à coup sûr, autant d’envie que j’en ai de trouver à votre situation une bonne issue. Mais les volontés d’hommes sont plus difficiles, à démêler et n’ont pas des lois aussi fixés que le cours des astres.
10 heures Me voilà enfermé chez moi, enfermé sous clef. Ah, vous auriez bien dû venir à la place de votre lettre comme vous en avez eu l’idée. Vous vous arrêtez en pareil cas, vous ne voulez par dire ce que vous appelez des bêtises. Et moi, que dirais-je ? Je m’arrêterai aussi. Pourtant si vous étiez là près de moi, quelle soirée charmante ! Quel doux entretien ! Vous êtes bien plus heureuse que moi. Vous avez notre Cabinet, Autour de vous, nous avons été, nous sommes partout ensemble. Ici je suis seul. Je parle de vous à tout ; mais rien ne me répond. Aussi je vais à vous bien plus que je ne vous amène à moi. J’aime mieux me souvenir qu’imaginer. Je reprends ma place, mes places. Je refais nos conversations. Je n’ai rien oublié, pas un mot, son lieu, sa date, votre regard, votre accent. J’ai des souvenirs, très préférés ; mais tous me sont présents. Ceux de la table à thé, que cette heure-ci me rappelle, sont au nombre des plus doux ; doux comme un bonheur depuis longtemps, goûté dont on jouit comme de son bien, comme de son droit, avec ravissement mais sans trouble, habitude et prélude d’une intimité parfaite, charmante dans le passé, charmante dans l’avenir ! Adieu, Madame.
Je n’ai pas de thé là ; et quand j’en aurais certainement je n’en prendrais pas. Mais adieu au moins, adieu. Vendredi 6 heures et demie Certainement Pozzo a beaucoup d’esprit, un esprit très étendu, droit, fécond, varié, agréable. A côté de lui à table au coin du feu, j’en jouis infiniment, comme vous. Mais il reste toujours lui au dessous de son esprit. Il n’a jamais l’air d’être tout à fait au niveau, bien établi au niveau de son esprit et de sa situation. Et puis laissez-moi vous dire une impertinence. Pozzo n’a jamais fait que de la politique extérieure de la diplomatie. Il n’a jamais gouverné un pays, traité directement, face à face, avec les idées, les intérêts, les passions de tout un peuple. Métier plus difficile, plus compliqué, plus périlleux, qui met aux prises de bien plus près, bien plus fortement avec les hommes et tout ce qu’il y a dans les hommes, et qui exige, qui provoque, dans celui qui le fait un développement bien plus complet, bien plus énergique de toutes les facultés, du caractère comme de l’intelligence, de la volonté comme de l’habilité. J’ai trouvé, dans les hommes les plus distingués qui ont suivi la même carrière que Pozzo, beaucoup d’étendue, d’élévation de liberté d’esprit, beaucoup de pénétration et de savoir faire dans les relations personnelles, quelques fois de la grandeur et de la hardiesse dans les desseins, dans les combinaisons, jamais cette profonde connaissance de la nature, et de la société humaine cette intelligence de leur vie réelle de leurs besoins ; cette fermeté de pensée et de conduite cette habitude fière de la responsabilité, qui donnent et prouvent la puissance, la grande puissance sur les hommes.
Je ne connais que deux carrières qui placent l’homme, un homme, aussi haut qu’il peut attendre, et le forcent de déployer, pour y monter et pour y rester tout ce qu’il peut être ; c’est la guerre et le gouvernement. Là sont, je crois les conditions, les plus nombreuses, les plus dures et par conséquent, le plus grand exercice de la supériorité. M. de Talleyrand et Pozzo ont beaucoup d’esprit, et ils ont beaucoup fait. Le cardinal de Richelieu et M. Pitt ont fait et prouvé bien davantage. Je ne parle pas de quelques hommes hors ligne qui ont conquis et gouverné. Frédéric 2 ; Napoléon. Pour ceux là c’est trop évident. Je n’ai pas la moindre envie que vous aimiez Alexis de St Priest. Traitez-le comme il vous plaira, quoiqu’il m’ait assez amusé lundi, dans deux heures de conversation. Il allait passer quinze jours près de Caen, chez Madame de Chastenay.
10 heures 3/4
Voilà votre N°51. Je n’en veux rien dire, absolument rien en ce moment. J’en ai le cœur trop plein. Mais j’y répondrai quoique vous ne vouliez pas. Deux mots seulement, vos deux mots. Adieu à toujours. G.
23. Paris, Samedi 12 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
8h. du matin.
Quelles lettres que ces lettres N°12 & 13 qui me sont revenus de Londres hier que vous m’y dites de ces paroles si douces, si profondes, qui m’attendrissent m’exaltent, me calment, qui font tout cela à la fois. Je ne sais l’effet qu’elles eussent produit sur moi en Angleterre. Ici elles me font du bien elles m’en ont fait hier. Elles m’en feront aujourd’hui car je les relirai. Je les relirai bien des fois. Soyez toujours pour moi ce que vous êtes en m’écrivant ces lettres. Je le mériterai tous les jours davantage, vous verrez cela.
9 heures 1/2
Le N°19 vient de m’être remis. Comment vous croyez que je n’ai pas lu votre Histoire de la révolution d’Angleterre. Je l’ai lue, relue. Je vous en ai parlé, mais c’était à une époque où vous ne faisiez par la moindre attention à ce que je vous disais. Cet ouvrage est regardé en Angleterre comme le meilleur qui existe et comme faisant époque. On y est fort impatient de la suite. Dans ce genre-là histoires, mémoires, j’ai beaucoup lu & il n’y a guère de proposition nouvelle à me faire. C’est le seul genre de lecture qui me plaise. Mais vous avez raison de penser qu’au fond une occupation sérieuse et qui n’a pas un but pratique immédiat ne me plaît pas trop, ce qui fait que je suis très souvent ennuyée, très ennuyée même.
Aujourd’hui non car je pense, je pense. Je trouve même que je n’ai pas assez de temps pour penser. Mais monsieur, je ne voulais plus vous dire cela du tout. Et je le veux Monsieur depuis votre lettre de ce matin. Elle me laisse bien froide, bien calme. Je l’ai méritée. La vivacité de mes expressions vous aura déplu, où vous aura effrayé. Vous voulez me remettre l’esprit en ordre. Vous faites comme mon médecin, il me tient au régime. Ne le faites pas trop, j’en serais triste. Donnez-moi quelques douces paroles qui aille chercher le fond de mon cœur. J’ai besoin de cela tous les jours. Adressez vos lettres à l’hôtel de la Terrasse. J’y rentre aujourd’hui. Je me moque du soleil & des ouvriers.
Je veux être chez nous, vous recevoir chez nous. Vous aimez cela mieux aussi ? Vous voulez savoir ce que je fais. Hier trois heures à l’air au bois de Boulogne, avec Marie et un secrétaire de l’ambassade d’Autriche que j’ai fait courir inutilement la nuit de Boulogne à Abbeville, croyant que J’allais mourir et auquel je voulais laisser le soin de ramener Marie & mes diamants à Paris. Il ne m’a plus trouvé à Abbeville. C’est le même qui a couru il y a 9 ans en Angleterre pour me remettre une lettre du Prince de Metternich que je n’ai plus voulu recevoir. Le pauvre homme est chanceux. Vous voyez bien que je lui devais une promenade au bois de Boulogne, il était honoré et embarrassé à l’excès j’ai prié Marie de lui faire quelques gentillesses.
J’ai vu lady Granville longtemps. Nous n’avons parlé que de vous. Elle me soigne, elle voudrait me voir perdre mon air abattu. Le prince Paul de Würtemberg m’a fait demander de le recevoir. Il est accouru plein de l’espoir que tout marchait à la confusion en Angleterre. Je l’ai horrible ment contrarié par tout le bien que je lui ai dit de la Reine, du premier ministre et la bonne disposition où j’ai laissé ce pays. Il espère encore que je radote car il m’a dit que j’avais fort mauvaise mine & même de la fièvre. Il m’a pris le pouls et m’a assuré que je devais me soigner. Tous les Würtemberg sont médecins & le duc Eugène était accoucheur.
A propos son courrier qui est aussi cousin germain de mon Empereur va épouser la princesse Marie. Le prince Paul prétend le savoir de M. Molé lui- même. Le Roi de Würtemberg ignore parfaitement cette négociation à laquelle il ne donnera jamais son consentement. C’est Léopold qui l’a conduit. J’ai dîné seule avec Marie hier. & de 8 à 10 heures je me suis encore fait traîner en calèche. Par une belle nuit et une belle lune. Mais c’est bien ennuyeux. J’ai mal dormi. Mes occupations sont des lettres à écrire. J’ai négligé tout les monde, il faut y revenir. Vous ai-je dit que M. de Talleyrand me presse de venir à Valençay & d’y faire venir M. de Lieven ? Cela ne sera pas. Mais au reste nous causerons de tout cela. C’est prodigieux tout ce que nous avons à nous dire. Eh bien, j’ai idée que nous ne nous dirons rien. Vous souvenez-vous nos belles promesses de nous écrire des nouvelles ? Nous ne nous en sommes pas dit une seule.
De vous rapporter des bras ? Vous n’en trouvez pas. On ne saurez remplir ses engagements plus mal que je ne l’ai fait. Mais il me fallait des lettres, elles ne venaient pas. Tout tout le mal est venu de là. Adieu, je trouve que ma lettre ressemble un peu à la vôtre, mais votre cœur ressemble au mien, cela rétablit tout.
443. Londres, Lundi 19 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous recevrez ceci Mercredi 21 et le Mercredi suivant 28, dans la soirée, vous me recevrez à mon tour. Je partirai dimanche 25, pour le Havre. J’y arriverai le 26, entre 5 et 8 heures du matin. J’en répartirai sur le champ et j’irai dîner au Val Richer. Je partirai du Val-Richer, le 27, dans l’après-midi avec tous les miens, pour aller coucher à Lisieux ou à Evreux, et le 28 au soir je serai à Paris. Ainsi, le mois d’Octobre n’aura pas menti. Personne, personne pas même vous, pas même moi, ne sait combien, il sera beau. Qu’est-ce que l’attente auprès du bonheur ?
J’ai reçu hier mon congé, dans une lettre particulière de Thiers, de très bonne grâce. Je serai à la Chambre le 29. Je ne manquerai qu’à la séance royale. Je crois que je comprends bien ma situation. et que j’y satisferai pleinement en tous sens. Elle a des embarras, des convenances, des intérêts, des devoirs fort divers. Je n’en éluderai aucun. Pour ma pleine confiance il faut, à mon jugement l’adhésion du vôtre. Que de choses à nous dire ! Ce nouvel assassinat ne m’a pas surpris. Je le pressentais. C’est une rude entreprise que de rétablir de l’ordre et de la raison dans le monde. Aujourd’hui tous les scélérats sont fous et tous les fous sont prêts à devenir des scélérats. Et les honnêtes gens ont à leur tour une folie, c’est d’accepter la démence comme excuse du crime. Il y a une démence qui excuse ; mais ce n’est pas celle de Darmer et de ses pareils. On n’ose pas regarder le mal en face et on dit qu’ils sont fous pour se rassurer. Et pendant que les uns se rassurent lâchement d’autres s’épouvantent lâchement. Tout est perdu ; c’est la fin du monde. Le monde a vu, sous d’autres noms, sous d’autres traits bien des maux et des périls pareils, égaux du moins sinon passifs, pour ne pas dire plus graves. Nous avons besoin aujourd’hui d’un degré de bonheur, et de sécurité dans le bonheur dont le monde autrefois. n’avait pas seulement l’idée. Il a vécu des siècles bien autrement assailli de souffrances, de crimes, de terreurs. Il a prospéré pourtant, il a grandi dans ces siècles là. Nous oublions tout cela. Nous voudrions que tout fût fait. Non certainement tout n’est pas fait ; il y a même beaucoup à faire encore. Mais tout n’est pas perdu non plus. L’expérience, qui m’a beaucoup appris, ne m’a point effrayé ; et moi qui passe pour un juge si sévère de mon temps; moi qui crois son mal bien plus grave que je ne le lui dis, je dis qu’à côté de ce mal, le bien abonde, et qu’à aucune époque on n’a vécu, dans le plus obscur village comme dans la rue St Florentin, au milieu de plus de justice, de douceur, de bien être et de sûreté.
J’écrirai aujourd’hui au Roi. On me dit qu’il a pris ceci avec son sang-froid ordinaire, triste pourtant de voir recommencer ce qu’il croyait fini. Le Morning Chronicle parle de lui ce matin est termes fort convenables. 2 heures Rien encore. J’y compte pourtant toujours. La poste est venue tard. Et vous ne prenez pas le plus court chemin pour venir à moi ; je suis encore plus impatient le lundi qu’un autre jour. Le dimanche est si peu de chose ! Enfin, je n’ai plus qu’un dimanche.
Lord Palmerston a demandé pour moi à la Reine une audience de congé. Je l’aurai Mercredi ou Jeudi Ne dites rien du jour de mon arrivée. Sachez seulement que je viens pour le début de la session.
Adieu. Adieu. 4 heures
Voilà 455. Excellent. Ce que j’aime le mieux ; confiant, comme l’enfance; profond, comme l’expérience. Un sentiment, n’est complet qu’avec ces deux caractères. Et il n’y a de bon, il n’y a même de charmant qu’un sentiment complet. Au début de la vie on peut trouver, on trouve du charmé dans des sentiments auxquels à vrai dire, il manque beaucoup. On sait pas ce qui y manque ; on jouit de ce qui y est sans regretter, sans pressentir ce qui n’y est pas. Quand on a vécu, quand on a mesuré les choses, on veut la perfection ; on ne se contente pas à moindre prix. Et là où on ne trouve pas tout, on ne se donne pas soi-même tout entier. Je n’ai jamais été si difficile et si satisfait.
Je n’ai pas encore les détails de la métamorphose que vous m’indiquez. Ils m’arriveront, je pense dans la journée. Cela, je puis l’attendre patiemment. Je serai fort aise de la métamorphose et pas sûr, après quelques épreuves, je finis par accepter les vicissitudes de certaines relations comme celles des saisons ; en hiver, j’espère l’été ; en été je prévois l’hiver ; le ciel pur ne chasse point le brouillard de ma mémoire, ni le brouillard le ciel pur. Je me résigne à ce mélange imparfait et à ses alternatives. Triste au fond de l’âme, mais sans injustice et sans humeur. Ou plutôt ce qui s’est montré à ce point variable et imparfait ne pénètre plus jusqu’au fond de mon âme. Je le classe dans ce superficiel qui peut être grave comme vous dîtes, et influer beaucoup sur ma destinée mais qui ne décide jamais de ma vie. Adieu. Oui, adieu comme nous le voulons.
432. Londres, Mercredi 7 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Voici une lettre d’Ellice. Il me l’a envoyée ouverte en m’engageant à la lire. Il a vraiment de l’esprit et plus d’intelligence continentale et française que presque tous ici. Il a compris, dès l’origine, que, par le chemin où l’on entrait, on en viendrait où nous en sommes. Si tout le monde, avait prévu aussi clair, tout le monde aurait agi autrement. Le vice radical de cette situation, c’est qu’elle n’était pas du tout nécessaire. Aucun grand événement, aucun grand motif européen n’y a conduit. Il y avait, dans un coin de l’Asie, entre un vieux Pacha et un Sultan mourant, une querelle qui laissée à elle-même, serait morte avec eux sans trouble un moment l’Europe. On en a fait une chance de guerre générale. Pourquoi ? Pour satisfaire la passion de lord Ponsomby contre le Pacha et les rêves de Lord Palmerston pour la résurrection de l’Empire Ottoman.
Voilà un courrier. Il ne m’apporte rien, rien du tout. J’en conclus qu’on patauge encore. Le mot est bien à l’image du fait. Je ne veux pas me dire, à moi-même, à quel point je suis impatient. Je vais faire ma toilette, en attendant la poste. 2 heures Certainement non. Jamais trop de feuillets, jamais assez. Vos lettres, c’est mon pain, mon délicieux pain quotidien. J’ai faim avant. Quand elles sont courtes, j’ai faim après. Quand elles sont longues, je suis nourri, point rassasié. Oui nous sommes parfaitement Ninojlubtn, et je sais parfaitement ce que cela veut dire. C’est un mot charmant. Et qui serait encore plus charmant de près que de loin.
La crise de Paris me paraît vive. Je rabâche, car je suis sûr qu’elle est moins vive qu’elle ne paraît. Comme au fond du cœur, presque personne n’a envie de la guerre, pas même les trois quarts de ceux qui la demandent à si grands cris, il est impossible que le fond du cœur n’influe pas sur la réalité de la conduite. On paie les autres d’apparences, et de paroles ; on ne s’en paie pas tout-à-fait aussi aisément soi-même. Cependant un moment peut venir où l’on l’enivre de tant de paroles et si bruyantes. Je n’irai pas avec les gens ivres. La guerre peut sortir de cette situation, et c’est son immense mal. Si elle en sort inopinément, forcément il faudra bien l’accepter, et l’accepter galamment. Mais je crois qu’on peut empêcher qu’elle n’en sorte, et qu’il y faut travailler ardemment. Et toute politique qui poussera, ou se laissera pousser à la guerre ne m’aura pas pour complice.
Probablement, je vous ai déjà dit cela bien des fois. Je rabâche, car je suis très convaincu. Je suis sûr que Thiers se défend contre le vent qui souffle autour de lui si le vent l’emportait, ce ne serait pas une raison pour se laisser emporter soi-même, et pour laisser tout emporter. Il y a encore de la folie révolutionnaire de la folie militaire dans mon pays ; mais aujourd’hui dans cette folie même, il y a plus d’écume que de venin. Et on trouvera toujours, dans le bon sens honnête de pays un point d’appui pour résister. Je pense aujourd’hui, comme en 1831, que pour une guerre juste, inévitable, défensive, la France est très forte, et que l’Europe serait bientôt divisée. Il faut donc que la guerre si elle doit éclater, soit ramenée à ce caractère, et contenue dans ces limites. Et à ces conditions, je suis porté à croire qu’elle n’éclatera pas. Car, malgré la faute très grave que l’Europe a commise en laissant se former, en formant de ses mains, un tel orage pour un si misérable motif, je crois encore au bon sens de l’Europe, et je suis persuadé qu’en Europe comme en France, la bonne politique trouverait de l’appui. Du reste le très fidèle m’écrit ce matin que la bourrasque de dimanche est un peu calmée et que les choses vont moins vite.
Ici, il y a certainement un peu d’inquiétude réelle et un désir sincère de jeter de baume sur les plaies de celte situation, en même temps qu’un parti pris d’exécuter ce qu’on a entrepris, et de ne pas faire acte de faiblesse. On est plus léger avant qu’après. On ne veut pas avoir été léger en paraître intimidé. Mais on n’est pas sans sérieuse appréhension et on a grande hâte d’atteindre le terme du défilé pour se montrer au bout. un peu plus accommodant qu’à l’entrée. Les Ministres se sont dispersés de nouveau. Mais je ne crois pas que lord John Russell, s’éloigne désormais de Londres. J’espère que Berryer et les siens n’espéreront pas trop. Les étrangers, et l’Ancien Régime, la coalition et la contre-révolution, ce sont les deux spectres du pays ; leur vice le pousse à la folie. Adieu. Je ne méprise rien. Je ne me lasse de rien. Je désire tout. Je ne peux me contenter que de tout. Mais j’aime et je goûte toujours avec le même plaisir les moindres portions de ce tout ravissant. Adieu donc aussi tendrement que le jour où adieu fut inventé.
430. Londres, Dimanche 4 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Nous voilà dans la crise. On dit cela à chaque incident, mais celui-ci est gros surtout par l’effet qu’il doit faire à Paris. Ici on est inquiet. Pas autant que je le voudrais ; pas autant qu’il le faudrait pour qu’on fût sage. On ne croit pas à la guerre. On a le sentiment de sa propre sincérité dans le désir de la paix et dans l’absence de toute intention hostile envers la France. On n’a pas le sentiment de l’état des esprits en France de leurs impressions si vives, de leurs résolutions si soudaines, si on avait prévu, il y a trois mois une telle explosion en France, je suis convaincu qu’on n’aurait pas conclu le traité du 15 juillet. Je l’ai annoncé, répété, rabâché. Mais la prévoyance est ce qui se communique le moins. Et quand on n’a pas prévu, on ne veut pas voir.
Ma situation ici ne me plaît pas. J’ai beaucoup à attendre et peu à faire. On est à merveille pour moi, même ceux qui ne sont pas de mon avis et ne s’y rendent point. Un moment peut venir où je profiterai de cette bonne disposition ; le moment où, ne réussissant pas, en Syrie par les premiers moyens, employés et ne se souciant pas d’aller plus loin, on sentira, la nécessité d’une transaction. J’attends et je prépare ce moment là, quand viendra-t-il ?
On parle de la convocation de nos chambres. Celle du Parlement suivrait aussitôt. Mais, pour moi comme pour le public ce ne sont là que des bruits. C’est maintenant à Paris que se font les événements. Au moins vous me donnez de bonnes nouvelles de vous. Comment s’y est-on pris pour vous écorcher l’épaule ? Il faut que votre femme de chambre ait la main bien lourde. A quoi lui sert donc d’être laide ?
Lundi 2 heures
Trouvez donc un Byng qui vienne à Londres et que je puisse aimer aussi. Je n’ai point de nouvelles ce matin. La convocation des Chambres ! Je crois bien. Politiquement, je la désire. Je sais bien les entraînements publics, la tribune ; mais je sais aussi les entraînements cachés, insensibles, les journaux, les commérages.
Après tout, depuis dix ans, j’ai toujours vu dans les grandes occasions, les chambres favorables au bon parti ; à la raison, au vrai intérêt du pays, et lui prêtant une force qu’il ne pouvait puiser ailleurs. C’est avec les chambres que nous avons lutté contre l’entrainement révolutionnaire, contre les fatuités anonymes de la presse, contre la politique de café. Nous sommes sur le point de rentrer dans la situation de 1831. Avec plus de péril peut-être, et moins d’excuse. Je sais que, pour que les Chambres se rallient à la raison, et la soutiennent, il faut la leur montrer, la tenir constamment sous leurs yeux, la vouloir fermement soi-même et leur en inspirer la confiance. J’espère que cette lumière et cette volonté ne manqueraient pas plus aujourd’hui qu’en 1831, et que si la raison devait succomber ce ne serait pas sans s’être montrée et défendue.
J’ai reçu une longue lettre du duc de Broglie, très judicieuse, et qui me fait croire qu’on ne fera rien de précipité. Vous avez bien raison ; 20 n’a pas de l’esprit tout à fait ; et quand les grands moments approchent ce qu’il en a se trouble et chancelle. Il peut alors se laisser aveugler et entraîner comme un enfant. De son côté 62, très courageux contre le danger, est très timide contre la responsabilité. Il a naturellement beaucoup indépendance et de dignité, peu de pouvoir. Le frêne a beau chercher ; il n’apprendra pas de là ce qu’il aurait, besoin de savoir. Je suis très préoccupé du frêne. Il est très décidé ; mais il ne voudrait pas se tromper sur le moment où doit se placer sa résolution. Deux choses font le succès d’une conduite, son mérite et son à propos. On ne devine pas l’à propos. Il faut le voir. Je voudrais que ma vue s’alongeât plus encore. Je prêterais mes yeux au frêne. Bien décidément j’envie le cottage, j’aime le cottage. Et parlerions-nous quelquefois de tout cela ? J’ai peur que oui. On n’abdique pas sa nature. On ne se fait pas petit, même pour être heureux. Je voudrais pourtant bien être heureux. Qu’est-ce qui vaut une heure de bonheur ? Et quel bonheur ! C’est bien là l’orgueil humain. Je préfère infiniment le bonheur à tout. Je n’aime, à vrai dire, que le bonheur. Mais pour le bonheur, dans un cottage comme dans un palais, je veux à côté de moi, à moi, un grand coeur, un grand esprit, un grand goût, l’intimité d’une grande pensée. Je ne puis pas être heureux à moins, pas cinq minutes. Mais je serais si heureux ? Adieu. Adieu.
425. Londres, Mardi 29 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je ne vous ai pas écrit hier à mon gré. Vous dîtes que vous ne vivez que pour mes lettres. Que ne puis-je tout mettre dans mes lettres, tout ! Je ne les ferme jamais sans un sentiment triste. J’aurais tant à vous donner et je vous envoie si peu ! Non seulement si peu de ma tendresse, mais de ce qui occupe mon esprit et remplit mon temps. Nous nous le sommes dit cent fois, nous avons bien mieux fait, nous l’avons éprouvé ; rien n’est si charmant que cette entière, continuelle, minutieuse communauté de tout ce qu’on pense, sent, sait, apprend ; cette complète abolition de toute solitude, de toute réticence de tout silence, de toute gêne ; la parfaite vérité, la parfaite liberté, la parfaite union. La vie alors n’a pas un incident, la journée n’a pas un moment qui ne soit précieux et doux. Les plus petites choses ont l’importance des grandes ; les plus grandes ont le charme des petites. Une espérance agréable se mêle à tout. Tout aboutit à un plaisir. Qu’est-ce qu’une lettre pour tenir la place d’un tel bonheur ?
Je vous ferai une confidence. Ma vue, je ne veux pas dire encore s’affaiblit, mais s’alonge. Je ne vois plus aussi également bien à toutes les distances. Par instinct, pour obtenir la même netteté, je place mon livre ou mon papier un peu plus loin de mes yeux. Vous voyez bien que nous sommes du même âge.
J’ai aujourd’hui Flahaut à dîner, avec quelques diplomates. Dedel et Neumann sont encore à Tamworth, c’est-à-dire à Drayton-castle, chez Peel. Mon c’est-à dire est fort déplacé ; vous savez cela très bien. Vous ai-je dit que Neumann était mauvais dans tout ceci, sottement mauvais, commère, vulgairement moqueur, pédantesquement léger ? C’est sa faute sans doute, car je ne comprendrais pas qu’il eût pour instruction de nuire à la transaction et à la paix. Le successeur de Hummelauer, le Baron de Keller, a assez bonne mine, l’air intelligent de la tenue. Pas très instruit par exemple ; voici de sa science, un échantillon qui m’a bien surpris. Il m’a dit l’autre jour que Frédéric le grand était mort l’année d’avant la naissance de Napoléon, vingt ans avant la révolution française, en 1768. Je n’ajoute rien. Je me suis un peu récrié. Il s’est troublé un peu, mais il a persisté, et je me suis tu. Ne racontez pas trop cela. Le bruit en reviendrait à ce pauvre homme, et il m’en voudrait. Il dîne aujourd’hui chez moi
Le conseil d’hier a été tenu mais la discussion ajournée à jeudi. Lord Lansddown, lord Morpeth et lord Duncannen n’étaint pas arrivés. On veut qu’ils y soient. Il pleut toujours. Je n’ai pas mis hier le nez hors de chez moi. J’ai joué au Whist, le soir. Je ne saurais vous dire combien cet emploi de mon temps me choque, je dirais presque m’humilie. Et quand je ne m’en ennuie pas, je n’en suis que plus humilié. 4 heures J’ai été à Holland house après-déjeuner. On a bien tort de ne pas aller se promener là plus souvent. C’est charmant. Voilà donc déjà l’amiral Stopford attaqué. C’est un modéré. Napier lui- même est sur le point de l’être. Il fera, tous les coup de tête qu’on voudra. Il aime les coups. Mais sa correspondance ne plaît point. Il parle trop bien du Pacha et trop des difficultés de l’entreprise. Il faudra faire lord Ponsonby amiral, général d’armée. Il n’y a que lui pour instrument comme pour autour à tout ceci Dedel est revenu. J’ai trouvé sa carte en revenant de Holland house. Je le verrai probablement ce soir. Lady Holland va mieux. Elle n’a pas voulu que je vous le dise, il y a deux jours. Cela porte malheurs dit-elle. Ils finiront par aller passer une semaine à Brighton. Elle se persuade que cela lui sera bon, à elle contre la bile, à lord Holland contre un rhume. J’admire cette disposition à croire selon sa fantaisie du moment.
Ne prenez pas cela pour une pierre dans votre iardin. Je n’ai point de pierre pour vous, et votre jardin est le mien. Mais il est vrai que je m’étonne souvent de votre extrême promptitude à prendre sur votre santé une idée une persuasion, une résolution. Et en m’en étonnant, je la deplore. Et certainement si j’étais toujours près de vous, je la combattrais. Pour la santé comme pour toute chose, il faut de l’observation, de l’esprit de suite, un peu de méfiance de soi-même, un peu de patience. Les complaisants, les flatteurs ne valent pas mieux au corps qu’à l’âme. Je vous prêche. Pas autant que je voudrais bien s’en faut. Il y a bien des choses que je ne vous dis pas parce que, pour les dire avec fruit, il faut les dire tout le jour, toujours ce qui est plus que tout le jour. Et je ne me résigne point à ne pas vous les dire, surtout quand elles touchent votre santé.
Adieu. Adieu devant ma gravure mais sans la regarder en lui toumant le dos. Adieu. Quel adieu !
422. Londres, Vendredi 25 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Dites-moi si l’anémone et le cidre attachent bien le même sens à tout-à-fait. Dites-moi oui sans plus. Je reviens de Regent’s Park. La même entrée, les mêmes tours, la même sortie. J’avais écrit depuis sept heures et demie jusqu’à 4 heures, sauf le déjeuner. Je n’en pouvais plus. La solitude ne m’est pas saine. J’en abuse. C’est la solitude de Londres, qui me frappe. En hiver au printemps, la foule anime un peu le silence. Les figures sont froides, mais elles se pressent. A présent pas plus de foule que de bruit. Tous les jours sont dimanche. Un grand combat se prépare entre le Dimanche et les railways. On colporte, on signe des pétitions pour que les railways soient immobiles le Dimanche. Ils sont décidés à se défendre. La question ira au Parlement. Le Cabinet sera un peu embarrassé. Le Dimanche a des amis dans son camp. Cependant, on croit qu’il prendra parti pour les railway.
Samedi 7 heures et demie
Les diplomates me sont arrivés hier soir pleins de paix. Mais elle leur venait d’où vient ordinairement la peste, d’Odessa. Lord Alvanley écrivait de là que tout était arrangé, que le Divan avait accepté les propositions du Pacha. Puis nous avons trouvé que c’était un bruit de bourse, déjà inséré dans le Globe. Les sources, les dates, les vraisemblances morales ôtent à ce bruit, toute valeur. Aujourd’hui ou demain nous aurons des nouvelles sérieuses de Syrie et d’Alexandrie.
Alava, Moncorvo, Schleinitz, Pollon, Van de weyer, Münchhausen, Lisboa et je ne sais combien de secrétaires. Je ne me laisserai point imposer les femmes. Tout en serait changé et gêné ? Leshommes sont là fort librement. On cause, on joue au Whist, à l’écarté, aux êchecs. Tous les journaux anglais et français sur une grande table ronde. Il n’y a rien a changer. On dit qu’Espartero va renvoyer la junte de Madrid et toutes les juntes. Qu’il restera président du Conseil, sans portefeuille et fera un ministère qui ressemblera à tous les autres. Que la nullité du ministère et du Président éclatera bientôt, et que la Reine sortira du défilé en y laissant sur le carreau tous ceux qui l’y ont poussée. Cela se pourrait. Mais au milieu de tous ces gens qui tombent, je cherche quelqu’un qui s’élève. Je ne vois pas. Il ne suffit pas pour gouverner d’user les hommes qui embarrassent. Quelques fois, il est vrai, on n’a rien de mieux à faire. Alors il faut se résigner à n’avoir rien de bien !
Je persiste dans mon jugement. Des maux alternatifs dans une anarchie impuissante. Grand exemple de ce que peuvent faire d’un pays les sottises absolutistes et les absurdités révolutionnaires. Depuis Philippe 2, elles possèdent l’Espagne. Une heure Adieu. L’adieu spécial que vous voulez ; et bien spécial ne ressemblant à aucun autre. Il le faut en vérité, car il y a là un mal qui résiste aux remèdes les plus héroïques. Un seul mot encore. Je n’ai plus entendu parler d’aucune tulipe. Et comme j’évite au lieu de chercher, je n’en entendrai point parler. Vous avez raison. Je ne puis pas m’éloigner. Et juse de cette raison là.
Je ne me plains pas. Soyez contente. Et soyons toujours aussi enfants, tous les deux. Mais ne maigrissez pas ; pour Dieu ne maigrissez pas ; point a cause de la maigreur, mais a cause de la santé. Pour moi, je vous promets de ne pas engraisser. Je vous tiens déjà parole car certainement, j’ai maigri depuis quinze jours. Mon anneau à failli glisser hier. Beaucoup de souci, beaucoup de travail, point. de repos, car point de bonheur. Je ne crois pas à la guerre. Je me le redis, je vous le redis, parce qu’en effet je n’y crois pas. Mais je suis aussi inquiet que si j’y croyais. L’intérêt est si grand que ma prévoyance est sans pouvoir sur ma disposition. Mes relations personnelles avec lord Palmerston sont toujours les mêmes, réellement bonnes. Je crois qu’il aurait vraiment envie d’être d’accord avec moi. Mais qu’importe. Nous verrons ce que rendra le conseil de lundi. Quelle puérilité que tout ce fracas des journaux les plus sérieux à propos de quelques phrases en l’air d’un journal obscur ! Je n’ai pas la moindre relation, avec l’Univers. Je n’ai rien dit, rien fait qui autorise, rien de semblable. Je n’ai pas écrit depuis je ne sais combin de temps à M. Dillon ni a personne qui pût abuser de mes paroles. Je suis réservé, très réservé, aussi réservé que je serais décidé s’il y avait lieu.
Je connais bien les difficultés de ma position. J’y pense sans cesse. C’est la chose à laquelle je pense le plus. Je ne me laisserai point engager au delà de ma propre idée. Ceci est trop grave pour qu’on s’y conduise autrement que selon sa propre idée. Mais je ne me séparerai pas sans motif très grave et je ne désavouerai rien de ce que j’ai accepté jusqu’à présent. Adieu. Adieu. Ne me dites pas que mes lettres sont courtes. Ce n’est pas vrai. Comment le seraient-elles? C’est tout mon plaisir. Adieu.
421. Londres, Vendredi 25 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Vous voyez le travail de Paris et de Londres pour nous brouiller, Thiers et moi. L’animosité personnelle devient très vive ici. On se dit convaincu que Thiers veut la guerre. Je nie, je repousse très haut, très ferme. On persiste. On couvre sous cette conviction, sa propre obstination. Cela fait une situation de plus en plus périlleuse et délicate. Je dis périlleuse quoique le fond de ma pensée ne soit pas changé. Je ne crois pas à la guerre. Je n’y crois guère plus que je ne la veux. Je la trouverais absurde, comme un effet sans cause est absurde. Jamais je ne consentirai à voir dans Beyrouth et Damas une cause suffisante a un si immense effet. Et quoi que l’absurde, ne soit pas banni de ce monde, cependant il n’y est pas puissant à ce point. Mais quand on rase de si près le bord, il est impossible, même en ne croyant pas à la chute de ne pas avoir le sentiment du péril. Et puis les passions des hommes sont à elles seules une cause ; une cause qui dans un moment donné à propos d’un incident imprévu, peut tout emporter soudainement. C’est là le vrai danger ; celui que j’ai constamment mis, que je mets constamment sous les yeux des gens qui ont créé cette situation parce qu’ils n’ont pas voulu y croire. Ils commencent à y croire ; ils commencent à entrevoir la guerre comme possible ; et ne voulant pas s’en pendre à la situation qu’ils ont faite, ils s’en prennent à quelqu’un qui la veut, disent-ils, qui travaille sous main à l’amener. Et je passe mon temps à combattre leurs conjectures sur les intentions et leur sécurité sur la situation. Il y aura toujours un conseil de cabinet lundi, pour reparler de l’affaire Mais lord Lansdowne, lord Duncannon, lord Morpeth sont en Irlande et ne viendront pas. Et aucun de ceux qui viendront n’est encore arrivé, ni lord John Russell, ni lord Melbourne. Ils arriveront dimanche ou lundi, au moment même du conseil. Ils se réuniront sans y avoir pensé, sans en savoir et sans s’en être dit plus qu’ils n’ont encore fait. Ils en parleront une heure ou deux en hésitant beaucoup à se contredire les uns les autres. Ils croiront à peu près ce qu’ils se diront, pour ou pas être forcés de se contredire. Et voilà ce qui peut se cacher de légèreté sous les formes les plus froides et les plus sérieuses. Je n’en pousse pas moins de toutes mes forces à une transaction à une modification des propositions de la Porte au Pacha. Et après bien du temps perdu, il y a bien des chances pour que cela finisse ainsi. Je regarderais ces chances comme extrêmement probables si on croyait ici à une vraie résistance du Pacha. Mais on croit toujours qu’il cèdera.
Une heure
Il n’y a pas moyen, quand on prend le chemin de l’école, d’arriver de très bonne heure, ni toujours à la même heure. Le frêne croit que le petit F. dit vrai sur son compte. Les journaux sont pleins ce matin de mes dissentiments avec Thiers. Je suis de l’avis du Courrier français. Le jour où il y aurait entre Thiers et moi, un vrai dissentiment sur le but et la marche de la politique, nous devrions nous en avertir l’un l’autre. Et nous n’y manquerions certainement pas. Je regarde beaucoup à l’Espagne, et je n’en dis rien parce que je n’en pense rien. La modération sans force, l’anarchie sans force, la folle sans passion, le chaos parodié, quel pitoyable spectacle ! Je mintéresse à la Reine. Je lui trouve de l’esprit et du courage. soit quand elle résiste, soit quand elle cède. Je ne crois pas que, par lui-même, le pauvre pays sorte de son agonie. Mais il n’en mourra pas, et il peut y vivre longtemps sans danger pour personne. A mon avis, c’est l’Europe qui est coupable envers l’Espagne. Et coupable depuis 1833. Après la mort de Ferdinand 7 au premier moment la tutelle européenne proclamée et exercée aurait tout prévenu. On ne veut guères faire, le mal aujourd’hui. On ne sait pas faire le bien. Le bien pourrait se faire, mais à la condition d’être fait grandement. Et on s’effraie de tout ce qui exige de la grandeur. Il y a cinquante ans, l’orgueil des hommes allait à la démence ; ils se croyaient appelés à refaire le monde à la place de Dieu. Aujourd’hui, leur sagesse va jusqu’à l’inertie ; ils laissent Dieu chargé de tout. Voilà du bavardage doctrinaire Vrai pourtant.
Je viens de parcourir ces cinq pages d’écriture. Pas une tendre parole ! Est-ce possible ? Mes paroles vous plaisent. Quel plaisir auriez-vous donc si vous voyez, réellement voir ce qu’elle essayent de peindre ? Vous avez raison ; depuis que le monde existe on a beaucoup dit sur cela ; chacune des mille millions et milliards de créatures, qui ont passé sous notre soleil a élevé la voix et répété la même chose, avec son plus doux accent. Quimporte la répétition ? Tout sentiment vrai est nouveau. Tout ce qui sort réellement du fond du cœur est dit pour la première fois entendu pour la première fois. Et puis vous savez mon orgueil en ceci comme en tout, l’inégalité est immense, la varièté infinie ; les sentiments naturels, universels, que toute créature a connus et racontés à d’autres créatures, ils sont ce que les fait l’âme où ils résident ; toujours beaux et doux car Dieu les a créés tels à l’usage de tous ; mais incomparablement plus beaux, plus doux dans les élus de Dieu, car Dieu a des élus. Ne dites jamais, ne laissez jamais entrevoir ceci à personne, mon amie. Oui, j’ai la prétention de vous dire des choses qu’aucune voix d’homme n’a jamais dites et ne dira jamais qu’aucune oreille de femme n’a jamais entendues et n’entendra jamais. Et que sont les choses que je vous dis auprès de celles que je sens ?
Mon cœur est infiniment plus riche que mon langage, et mes émotions, en pensant à vous infiniment plus nouvelles, plus inouïes que mes paroles. Laissez donc ce papier et entrez dans mon cœur. Lisez ce que je ne vous écris pas. Entendez ce que je ne vous ai jamais dit. Adieu.
394. Londres, Vendredi 12 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
J’ai été hier soir à Holland. house. Ils n’y étaient pas. Le conseil du matin et l’attentat les avaient fait venir en ville. J’avais deux emplois de ma soirée Lady Tankerville qui se plaint toujours qu’elle ne me voit pas assez et un bal chez Lady Glengall. Je suis rentré chez moi ; je me suis mis dans mon lit et j’ai lu pendant deux heures une vie de Hampden, grand Anglais, et homme bien hereux car il a eu le bonheur de mourir au moment où allaient commencer pour lui les espérances déçues, les doutes de conduite et la responsabilité. Je me plaît beaucoup dans la vieille Angleterre. J’aime ce qui en reste, et grace à Dieu, il en reste beaucoup. Par mes idées, et le tour de mon esprit, je suis du temps moderne ; par mon caractère et mes goûts, je suis des anciens temps.
J’assiste déjà aux embarras de la transition de règne, en Prusse. On a eu à célébrer à Berlin, le 100e anniversaise de l’Académie royale. Il fallait parler de Frédérie II, du Roi mourant et plaire au Roi qui s’approche. On a chargé M. de Humbolt de cet embarras. Il s’en est tiré, en homme d’esprit, et m’a envoyé son petit discours, car les hommes d’esprit pensent toujours un peu les uns aux autres.
A propos des hommes d’esprit, vous ai-je jamais dit comment m’avait abordé à St Cloud, en se fairant présenter à moi. Reschid. Pacha, qui essaye aujourd’hui de faire de la Turquie quelque chose qui ne soit pas turc? « Moi ausi, dans mon pays, je passe pour un homme d’esprit.» Il vient, dit-on, d’en donner une preuve en se débarrassant de son rival Khosrer-Pacha qu’il a fait remplacer par Ahmed Féthi Pacha, homme insignifiant, sa créature, et ancien ambassadeur à Paris. On dit que cela vous déplaira.
Je rentre à Berlin. Il me paraît que Humboldt, Bülow et toute cette couleur là sont au mieux avec le Prince Royal. Bresson aussi est bien avec lui depuis quelque tour. Bresson est prévoyant et habile. Il n’y a pas de doute sur la retraite de Wittgenstein. On le pressera de rester, sachant qu’il ne restera pas.
2 heures
Je vous ai quittée pour trouver dans le Times, la mort du Rois de Prusse et je n’ai pu vous revenir jusqu’à présent. Lord Palmerston n’a pas pu me rejoindre hier au Foreign office. Il a été retenu à l’home office par le Conseil privé qui interrogeait les témoins sur l’attentat. Il m’a remis à aujourd’hui, et j’attends un mot de lui pour l’aller chercher. Les deux Chambres présentent leur adresse ce matin. Je suppose que la Reine recevra le corps diplomatique demain si le Cabinet trouve bon qu’elle le reçoive. Elle l’a reçu, et ses félicitations en corps, lors de son mariage. Ils sont tous fort contens de la demarche faite, qui acquitte pleinement les convenances. Je les et tous vus ce matin. Dedel est mon meilleur conseiller. Quoique rien n’ait encore transpiré on croit en général que l’assassin est chartiste. Plusieurs propos, recueillis, maintenant indiquent dans ce parti-là, un projet pareil. Ce jeune homme s’exerçait depuis trois semaines à tirer au pistolet.
Le Cabinet a eu encore hier soir un échec aux Communes, toujours sur la même question. Il y a, si je ne me trompe, dans la Chambre un parti pris, pris à une bien petite majorité, mais pris, de mettre en Irlande un temps d’arrêt à l’influence d’Oconnell. Sur les 105 membres Irlandais, il est déjà, dit-on, maître de plus de 60. Avec le systême étectoral actuel, il deviendrait bientôt maître des 40 autres. Et alors on verrait tout autre chose que l’Angleterre obligée de bien gouverner l’Irlande ; on verrait l’Irlande gouverner l’Angleterre. Voilà le gros fait qui frappe, ce me semble, les esprits et décide bien des modérés même.
Vous avez raison d’avoir beaucoup de regret et un peu de remords Windsor est venu bien à propos pour vous. Voici une vérité. Vous êtes si sensible aux petites contrariètés qu’elles peuvent balancer, pour quelque temps, les plus grandes affections. La petite vie, en vous, fait tort à la grande. Cela vient de deux causes. Vous avez été longtemps l’enfant gâté du sort faisant toujours ce qui vous plaisait. Vos déplaisirs sont démesurés, et démesurement puissants sur vous. De plus, il n’y pas en vous une force proportionnée à l’élévation, et à la vivacité de votre âme, vous êtes comme des beaux peupliers, si hauts et si minces, que le moindre vent balance, et fait plier. Vous pliez trop et trop sous les petits fardeaux, comme sous les grands. Je le trouve souvent. Je m’en impatiente quelquefois. Et puis je finis toujours pas me dire que vous connaissant comme je vous connais et vous aimant comme je vous aime, c’est à moi de vous aider à porter tous les fardeaux, petits ou grands. Puisque j’ai plus de force que vous et plus d’indifférence aux choses vraiment indifférentes, il faut bien que vous en profitiez.
Adieu. Je vous écrirai encore demain et je vous verrai vendredi, d’aujourd’hui en huit. Je ne comprends pas que vous n’ayez rien reçu des Sutherland. Charles Gréville ma dit ce que je vous ai mandé, comme une chose arrêtée, convenue. Mais il faut qu’ils vous l’écrivent eux-mênes. Adieu. Adieu.
Je corrige une phrase à ma lettre. Ce que j’avais mis ne rendait pas ma pensée. On dit qu’on a trouvé dans les poches de cet Edward Oxford, un papier qui ferait allusion à quelque relation avec Hanovre. Cela n’est pas croyable.
389. Londres, Samedi 6 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Moi aussi, j’ai le cœur plus libre. On vient de me remettre le 394. Savez-vous qui en a profité ? Toute mon ambassade qui passé une demi-heure avec moi après déjeuner. Je cause avec eux. J’étais tout à l’heure très animé, fécond, inventif, éloquent. Eux ils étaient visiblement charmés de moi. Ils ne savaient pas pourquoi. Soyez très éloquente aussi avec moi, quand vous serez ici. J’aime passionnément l’éloquence. Vous partez dans huit jours, samedi prochain. Que la semaine sera longue ! Je donnerais bien des choses pour qu’il fit aussi beau qu’au jourd’hui. Pas le moindre vent ; un soleil admirable. Vous viendriez agréablement et vous viendriez vite. J’ai passé hier ma journée chez moi, sauf ma visite à lady Palmerston. Le soir aussi Je me suis couché de bonne heure. Il faut que mon tempérament soit aussi complaisant pour moi que mon caractère l’est pour les autres. ai grand besoin de sommeil. Je n’en ai pas toujours autant que je voudrais. Pourtant cela s’arrange. Quand je peux avoir une longue nuit je la prends, et elle me vaut pour une semaine. Je suis bien aise qu’on écrive d’ici que mon établissement est bon. Je vous attends avec impatience pour les petites choses après les grandes. Je suis sûr, parfaitement sûr que tout n’est pouve pas bien, qu’il y a des manques, que je me trompe quelquefois. Personne ne me reproche rien. Depuis que je suis ici, ni sur ma conduite, ni sur ma maison, je n’ai pas entendu une critique. C’est impossible. C’est absurde. Venez, venez. Apportez-moi de la vérité avec du bonheur.
Voici jusqu’à présent mes dîners du mois. Je ne vous dis pas ceux que j’ai refusés aujourd’hui la Reine. Le 6, les Berry, à Richmond. Le 10, Sir Robert Inglis. Le 14, lady Williams, à Putney-heath. Le 14, lady Lovelace. Le 20, Sir John Hobhouse. Le 22. Rothschild à Gunnersbury. Le 24, lord Abinger. Le 27, lord Monteagle. Il me semble qu’il n’y a rien là que de convenable. A propos de convenable, Mad. Maberly ma envoyé son roman, Emily. Il faut bien que j’écrive un billet poli, n’est-ce pas ? Je n’ai pas lu le roman. On dit qu’il est parfaitement innocent et parfaitement ennuieux. Vous avez cent fois raison, et je suis de votre avis depuis longtemps. Il y a longtemps que je pense et dis que le sénat Romain et le parlement d’ Angleterre sont les deux plus grands gouvernement que le monde ait connus. J’appelle grands gouvernemens ceux qui font de grandes choses par de grands hommes. J’ai peine à croire que la mort du Roi de Prusse soit la révolution. D’après tout ce qui me revient, le successeur sera bien timide. Il a l’esprit plus actif que la volonté. Beaucoup de pojets et de paroles de grandes ardeurs de pensée et de conversation, puis les goûts d’une vie régulière et molle ; voilà notre temps surtout dans le haut de la société. Les gouvernemens sont aujourd’hui des cadres où les Rois viennent se placer et s’emprisonner successivement, comme des images. On a pris avant-hier mes chevaux; on les a mis chacun dans une boite ; sur cette boite on a jeté un filet. La machine a grondé ; le train est parti, et mes chevaux sont arrivés à Eton, sans avoir bougé, malgré qu’ils en eussent. Ce sera le sort de bien des Rois, et de bien des ministres. Voici quatre jours d’immobilité pour les affaires. On va à la campagne. On croit en général que la session finira de bonne heure. Je le voudrais pour nos campagnes.
3 heures
J’ai été interrompu par Lord Brougham changé, triste, fatigue, abattu, dégoûté. Fatigué matériellement ; il a imaginé de venir de Cannes à Calais dans ce que nous appelons, une voiture, un carosse de louage toujours avec les deux mêmes chevaux. Vingt-six jours pour traverser la France. Il a fait la route à pied. Je l’ai revu avec plaisir. J’aime sa conversation c’est-à-dire son monologue. Il est ici un homme très important sans influence, et très considérable sans considération. C’est curieux. Adieu. Je pense au 26 avec un plaisir infini. A ma gauche, n’est-ce pas ? Il me semble que c’est de droit. Il n’y a de femmes outre la duchesse de Cambridge, que lady Aylesbury, lady Jersey, lady Etizabeth Stuart et lady Peel. Adieu. Adieu.
Paris, le 12 février 1855, Etienne-Jean Delécluze à François Guizot
Mots-clés : France (1852-1870, Second Empire), histoire, Publication
Paris, le 7 avril 1867, Victor Viard, chanoine d'Arras, à François Guizot
Mots-clés : France (1852-1870, Second Empire), histoire, Réception (Guizot), Religion
Paris, le 5 novembre 1861, Gaspard Deguerry à François Guizot
Mots-clés : France (1852-1870, Second Empire), histoire, Publication, Réception (Guizot), Religion
Paris, le 24 octobre 1861, G. Meignan à François Guizot
Mots-clés : France (1852-1870, Second Empire), histoire, Réception (Guizot), Religion
Lisieux, le 23 septembre 1855, Cogniard, curé de Lisieux, à François Guizot
Mots-clés : France (1852-1870, Second Empire), histoire, Réception (Guizot), Religion