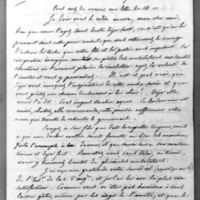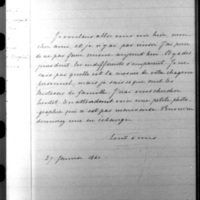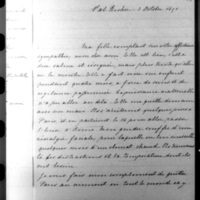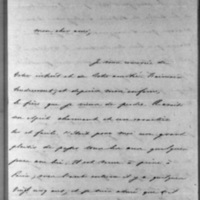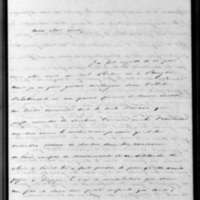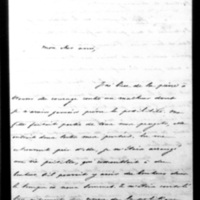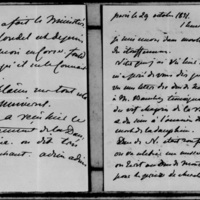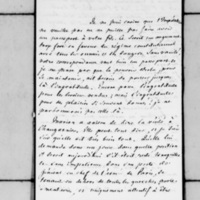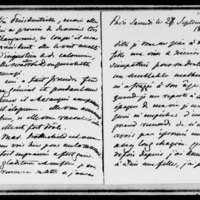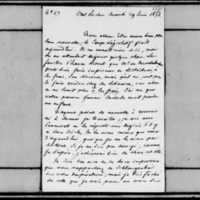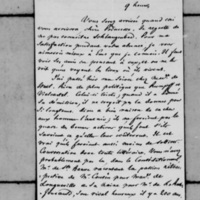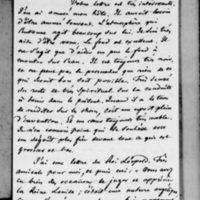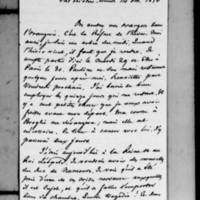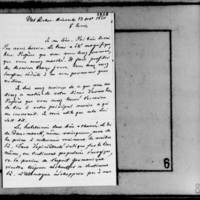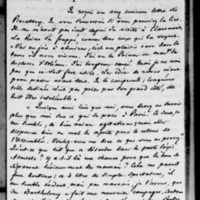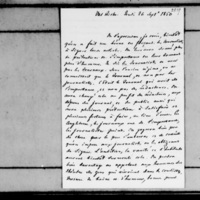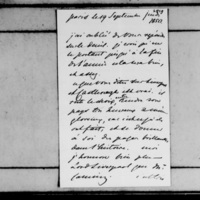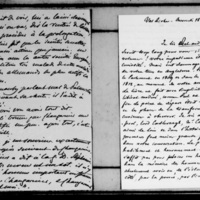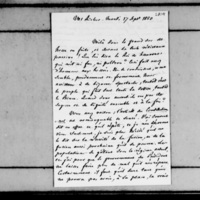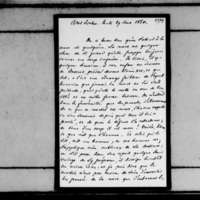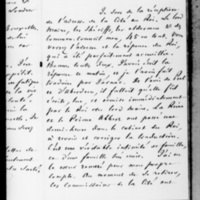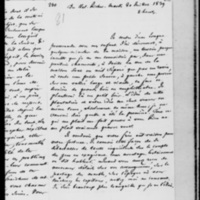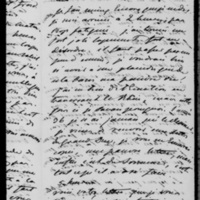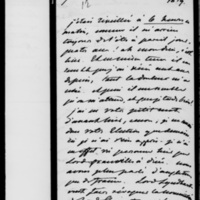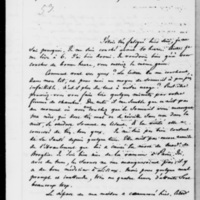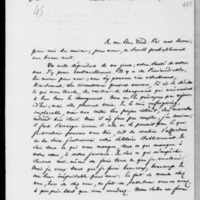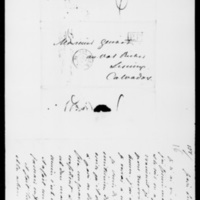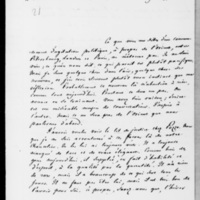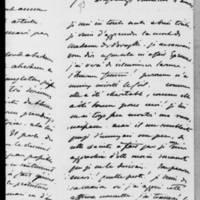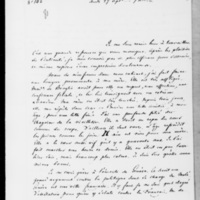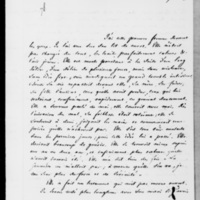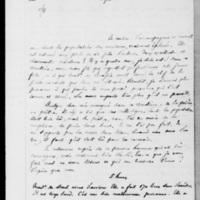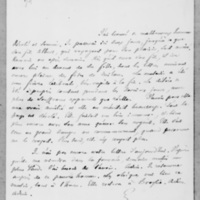Votre recherche dans le corpus : 140 résultats dans 6062 notices du site.
Nîmes, le 14 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot
Nîmes, le 23 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot
Paris, le 27 janvier 1861, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Mots-clés : Décès, Deuil, France (1852-1870, Second Empire), Tristesse
Val-Richer, le 5 octobre 1851, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Paris, le 10 juin 1854, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Mots-clés : Décès, Deuil, Diplomatie, France (1852-1870, Second Empire), Politique (France), Portrait
Paris, le 30 septembre 1851, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
1849, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Le 5 mars 1849, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Mots-clés : Bonheur, Décès, Deuil, Discours du for intérieur, France (1848-1852, 2e République), Politique
Val-Richer, Mercredi 29 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le Ministère n'est pas effrayant. Tous ceux que je connais sont, ou du moins ont toujours été des conservateurs très décidés. En particulier, les Ministres de l’intérieur et de la justice ; gens capables et honnêtes, et très compromis contre les rouges. Je ne me figure pas qu'avec ces hommes-là il puisse y avoir à craindre ni alliance avec la Montagne, ni coup d'Etat. Je persiste plus que jamais dans ma première conjecture. Rejet complet, par l'assemblée de l'abrogation de la loi du 31 mai, et acceptation par le Président, des modifications à cette même loi que l'Assemblée fera elle-même un peu plus tard, à l'occasion de la loi municipale. Les ministres, qui sortent rentreront alors, M. Fould, M. Rouher, M. Baroche, d'autres peut-être, M. Léon Faucher restera dehors. Ce sera la dupe de cette journée, avec M. De Lamartine et Emile de Girardin. Voilà mon programme.
Je ne connais pas du tout M. de Maupas le Préfet de Police, ni le Ministre de la guerre, le général St Arnauld. On parle mal du premier. Le maréchal Bugeaud regardait le second comme un militaire hardi et capable. S'ils ont comme on dit de l'esprit tous les deux, ils comprendront bien vite la situation et ils ne pousseront pas aux mesures extrêmes. Quand elles ne sont pas dans l’air, personne ne peut les y mettre. Dans le conflit, je parie toujours pour Morny.
Puisque Mad. de la Redorte et Mad. Roger, et les dames Russes sont venues chez vous en deuil et puisque vous les en avez louées, tout est correct. Qui avez-vous loué ? Des femmes, plusieurs femmes. Et avant le mot louées, je trouve dans votre phrase le mot les qui désigne ces femmes. Donc, quand vous avez écrit le mot louées, vous saviez que vous parliez de femmes, et de plusieurs femmes ; donc il fallait le féminin et le pluriel, c’est-à-dire louées et non pas loué. Est-ce clair ?
Ce que la Redorte vous a dit, quant à la situation respective du Président et de l'Assemblée devant le public est vrai de mon département comme du [sign]. Quoiqu’un peu moins absolument, parce qu'on ne change pas aussi vite d'impression et d'avis en Normandie qu’en Languedoc
Onze heures
Ces accès de faiblesse nerveuse me désolent. Que je voudrais une bonne lettre le Pétersbourg. Elle vous ferait plus de bien que toute autre chose. L'écriture de Marion sur l'adresse m’a troublé. J’ai été heureux de trouver la vôtre en dedan.s Adieu, adieu.
Je partirai d’ici le 11 nov. et je serai à Paris le 14 au matin. Adieu. G.
Paris, Mercredi 29 octobre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
1 heure
Je suis encore dans mon lit, avec des étouffements. Vitet que j'ai vu hier soir m’a prié de vous dire qu'il a vu les lettres du duc de Nemours à M. Bauchez témoignant du vif chagrin de la reine & du sien à l'occasion de la mort de la Dauphine. Le Duc de [Nemours] était son filleul. On va célébrer une messe, et on écrit au duc de [Mont?] pour le prier de chercher un complimenteur convenable pour Frohsdorf. On espère that he will take the hint. Cela serait très bien.
Longue visite hier matin de M. Dupin. Blâmant beaucoup, espérant peu de l'Assemblée à cause de ses divisions. Des regrets, des hélas de ce que chacun s'occupe de son intérêt ou de son penchant personnel. Le mieux serait que le comte de Chambord abdique ! Il pense bien de Corbin & Giraud, il rit du reste surtout de Fortoul. Il n’ira pas à St Cloud, il s'est borné à s’inscrire à l'Elysée. Le soir Pasquier m’a dit qu’il croyait que Corbin refuse. Il n’est pas ici encore.
Je voudrais bien mes nouvelles. J'en suis bien loin aujourd’hui. Rien de Pétersbourg. Adieu. Adieu.
Je trouve votre discours à Falaise extrêmement bien. Avez-vous trouvé la statue extrêmement belle ?
Val-Richer, Samedi 25 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous n'aurez aujourd’hui que quelques lignes. Je pars après déjeuner pour Falaise où l’on me donne un dîner choisi ; et demain Guillaume le conquérant. Il faut que je me promène ce matin dans mon jardin pour arranger mon discours, car à Falaise je n'aurai pas un moment de loisir. Vous avez bien mal traité la statue du Roi ; on m'a dit qu'elle est belle. Je suis décidé à la trouver.
La Dauphine me revient toujours depuis hier. Deux choses me touchent également ; la grandeur vertueuse, et malheureuse ; la vertu et le malheur dans une condition pauvre et obscure. Dit-on si elle a regretté de mourir, et si elle espérait beaucoup revoir en France son neveu, et aller elle-même à Saint Denis ? Je ne puis pas ne pas être sûr qu'on fera à Claremont tout ce qui convient. Je suppose qu’à Paris toute la société monarchique prendra le deuil, indistinctement.
Voilà l’arrêt au Conseil de Guerre de Lyon confirmé par le Conseil de révision et la double fermeté du Président mise à l’épreuve. Enverra-t-il à Noukahiva, M. Genti et ses complices ? Adieu.
Je vais me promener. Onze heures Je suis bien impatient de la réponse de Pétersbourg. J’espère qu'elle sera bonne et qu'elle calmera un peu vos nerfs. Que devient la lettre que le duc de Noailles devait m'écrire le lendemain ? Soyez tranquille sur Falaise. Adieu, Adieu.
Je vous écrirai demain de Falaise. Je reviendrai ici lundi matin, de bonne heure. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 28 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne puis croire que l'Impératrice ne veuille pas ou ne puisse pas faire avoir un passeport à votre fils. Ce serait un argument trop fort en faveur du régime constitutionnel avec tous ses ennuis et ses dangers. Sans vanité, votre correspondance vaut bien un passeport, et je ne pense pas que le pouvoir absolu, pour se maintenir, ait besoin de pousser jusque là l’ingratitude. Encore passe l’ingratitude pour les services rendus ; mais l’ingratitude pour des plaisirs si souvent donnés ! Je ne pardonnerais pas celle-là.
Marion a raison de dire la vérité à Changarnier. Elle peut tout dire, et je suis sûr qu’elle dit très bien tout. Qu'elle lui demande donc un jour dans quelle position il serait aujourd’hui, s’il était resté tranquille et sans impatience, dans son poste de Général en Chef de l’armée de Paris, se tenant en dehors de toutes les querelles parlementaires, et uniquement attentif à être toujours le représentant et le défenseur de l’ordre, soit à l'Elysée, soit à l'Assemblée. Il serait. aujourd’hui, entre Louis Napoléon et le Prince de Joinville le candidat naturel et obligé du parti de l’ordre à la présidence, la seule et assurée ressource de la majorité et du public dans leur perplexité. Pour moi je ne me console pas qu'il ne se soit pas ménagé cette chance simple infaillible, et je n'espère pas qu'en glanant de tous côtes des débris de partis, il s'en refasse une qui en approche, de bien loin. Personne n'est plus noir que moi, dans ce moment-ci.
La déclaration du Général Magnan au Président ne m'étonne pas. La peur gagnera tout le monde. Mais le lendemain du jour où tout le monde a eu peur ne vaut pas mieux que la veille, et nous ne serons pas tirés d'embarras parce que le président y sera tombé.
La Duchesse de Marmier n'a pas le moindre crédit à Claremont, et ses paroles ne signifient absolument rien. Mais elle remplacera là Mad. Mollien qui en dit quelques fois de bonnes. Pas beaucoup plus efficaces, il est vrai. Cependant, je persiste à croire que les bonnes paroles valent mieux que les mauvaises. Je regrette donc Mad. Mollien à Claremont.
Ma fille est assez bien. Elle a un peu dormi. Il iront son mari et elle, passer l'hiver à Rome. La santé de son mari a besoin du midi, et les raisons qui venaient de l'enfant ne subsistant plus. Rome vaut mieux qu' Hyères. Ils partiront vers le milieu d'octobre.
10 heures et demie
Henriette vous remercie de vos paroles qui lui ont été au cœur. Et moi aussi. Elle supportera comme il faut les épreuves et j'espère que Dieu lui enverra encore des joies. Adieu, Adieu. Je reçois ce matin beaucoup de lettres et on m'attend pour la prière. Adieu. G.
Paris, Samedi 27 septembre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Dites je vous en prie à votre fille ma vive & sincère sympathie, pour sa douleur. Un semblable malheur m’a frappé à son âge. Quand je me reporte à cette époque de ma vie je ne puis m'empêcher d'un grand remord de n'en avoir pas éprouvé un assez long chagrin. Que de fois depuis j’ai demandé à Dieu une fille, j’ai pleuré cette fille. Pauvre enfant, heureux enfant sans doute. Henriette a plus que je n’avais alors ces sentiments religieux qui font supporter avec douceur les volontés de Dieu, les peines qu'il vous envoie. Elle a plus que moi aussi la réflexion. Marion me prie de vous dire et à votre fille sa plus tendre sympathie. Elle est vraiment touchée de votre affliction.
J’ai vu hier apparaître Bulwer vraiment comme un ghost. Quelle mine ! Il passera sans doute l'hiver à Paris. Les Ministres lui ont fait mille éloges flatteurs, mais Palmerston a été froid. Il demande un autre poste. On ne le lui promet pas. Il ne veut pas retourner en Amérique, & comme je doute qu'on s'emploie en Europe, je suppose qu’il demandera sa pension de retraite. Pacha est venu aussi, on débarquait. Il est nouveau à Pétersbourg & va s’y rendre. Il a voulu tout de suite démentir le bruit qui avait couru qu’il était chargé de négocier un mariage pour le Président, il dit qu'il n'y a pas un mot de vrai. Il parle tristement de son pays. Les septembristes vont tout à l’heure être les maîtres. L'armée est complètement indisciplinée, perdue.
Fould est venu le soir, il y avait du monde nous n’avons pas pu causer. Son dire général est toujours une grande confiance dans le succès & assez de mépris pour tout autre concurrent. Montebello est revenu de Chalons disant que dans la Marne le mouvement napoléonien est irrésistible, unanime. Grande défaveur pour Joinville. Il a causé très longuement avec Léon Faucher, sur les élections d’abord, il lui a dit que le mot d’ordre du [gouvernement] devrait être de voter pour les 446 qui ont formé la majorité pour la révision, & ne pas s’inquiéter de tel ou tel parti. Ceci serait le mot de ralliement. Léon Faucher a gouté cela. On a parlé ensuite de la prorogation. & Léon Faucher a dit que le Président ne l’accepterait certainement pas des mains de l’Assemblée seule, qu’il lui fallait le suffrage du pays. Je trouve qu'il a raison.
Palmerston a fait un bon discours, et habile ; avec de la malice pour n’en pas perdre l'habitude. Comment trouvez-vous la réponse du [gouvernement] napolitain à Gladstone ? Je n’ai pas lu encore. Adieu. Adieu.
Paris, Samedi 17 mai 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hier Duchatel seul, le matin. Le soir M. Molé, Antonini, Hotzfeld. Molé est remis et en bon train & bonne humeur. Il avait eu la visite de M. Dupin, revenu très révérencieux pour la fusion. Il ne parle plus que chapeau bas de M. le comte de Chambord il dit seulement qu'il faut que tous les prétendants se fusionnent Antonini me contait les fureurs du parti Thiers contre Changarnier. M. de Rémusat crie à l'ingratitude. " C'est moi qui lui ai fait les pauvres petites phrases qu'il a encore à débiter à la tribune." !
Duchatel est bien amusé de Lady Allen pas reçue à Esher. Cela l’enchante. On dit beaucoup que Léopold passe à la fusion. J’ai eu une lettre de Constantin du 15 il parlait à l’instant même avec le Roi. La reine ayant reçu la nouvelle de la mort de la duchesse de Leuchtenberg, sa sœur n’a pas pu aller à Varsovie. Cette mort met en deuil toutes les cours de l’Europe. Prusse, Autriche, Russie, Saxe, Suède, Piémont, Elysée ! C’est sa tante. Il ferme ses portes. On espère que les 3 souverains se rencontreront, c’est très désirable. Dans tous les cas, on se concerte pour les éventualités françaises et cela deviendra visible bientôt. Montebello est repris, une troisième rougeole s’est déclarée chez lui. C'est insupportable. J'ai eu une visite ce matin qui me dit que Mazzini désavoue la pièce. D'un autre côté M. Carlier a dit hier à quelqu’un qu’elle était authentique. J’espère qu’elle l’est.
Adieu. Adieu, jusqu’à lundi. Adieu.
N°27. Val-Richer, Mardi 29 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous allons être encore bien plus sans nouvelles ; le corps législatif finit aujourd’hui. Il ne venait rien de là, mais on en attendait toujours quelque chose. Les feuilles d'havas disent que M. de Montalembert peut bien faire imprimer et distribuer, à ses frais, son discours, mais qu’il ne peut pas le faire vendre chez des libraires, car alors ce ne serait plus à ses frais. J’ai vu que votre pauvre favori Mérode avait perdu un enfant.
N'ayant point de nouvelles à recevoir ni à donner, je travaille ; je vis, avec Cromwell, et les républicains anglais, d’il y a deux siècles. Je les aime mieux que ceux d'aujourd’hui, quoique je ne les aime pas du tout. Si je ne suis pas dérangé, comme je l’espère, j'achèverai bien des choses cet été.
Je suis très aise de la douce impression que vous rapporterez de Schlangenbad sur votre impératrice ; mais je suis fâché de celle que je vois percer en vous sur ces deux pauvres petites Ellice. Vous n'êtes pas juste. Vous avez de l’amitié pour elles, mais ce n’est pas par amitié pour elles que vous les désirez près de vous ; c’est pour vous-même. Elles ont de l'amitié pour vous et elles se trouvent très bien près de vous ; mais leur soeur est plus malade que vous, et bien plus isolée que vous sans elles. Elles ont toujours vécu toutes les trois ensemble, et si elles doivent rester de vieilles filles ce sera en vivant ensemble qu'elles supporteront le mieux leur solitude, et leur vieillesse. Elles pensent probablement à tout cela, et elles sont perplexes. Comme agrément et amusement, elles sont infiniment mieux chez vous que chez elles. Pourquoi donc sont-elles perplexes ? Uniquement par sentiment des devoirs et des affections de famille, et par prévoyance de leur propre avenir. J’espère que l’une d'elles viendra vous retrouver ; vous en avez besoin, comme vous dites, et vous ne trouverez jamais aussi bien qu'elles ; mais soyez juste pour elles, et ne gâtez pas d'avance, par des amertumes de coeur que vous ne cacherez pas longtemps la douceur et le plaisir que vous trouvez dans leur société.
J’ai des nouvelles de Duchâtel, de Vitet, de Mallac, d'Arnaud Bertin, de Molé. Ils n'en savent pas plus que vous et moi. Molé est occupé de la querelle des Évêques, et de l’abbé Gaume sur les livres classiques Païens ou Chrétiens. Je viens de lui écrire quelques lignes de condoléance sur la mort de sa soeur. Je ne crois pas que ce soit pour lui un vif chagrin.
Je n'ai pas entendu parler du duc de Noailles, il est à Maintenon mettant en ordre les lettres de Mad. de Maintenon et cherchant à grand peine les dates qu’elle n’y a pas mises, car vous n'étiez pas là pour la corriger de ce défaut.
Albert de Broglie est revenu d’Angleterre, ramenant sa soeur, son père, qui était allé passer quelques jours en Alsace pour les affaires, est de retour à Broglie. Ils y vivent très paisiblement et très solitairement.
Il n’y a pas encore beaucoup de monde à Trouville ; mais on en attend beaucoup du beau monde ; toutes les maisons sont louées Mad. de Boigne et le chancelier y sont établis. Voilà les nouvelles de ma province, à défaut de Paris.
11 heures
Voilà votre N°21. Grâce à Dieu l'ordre est bien rétabli. Adieu, Adieu. G.
N°3 Paris, Jeudi 3 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Vous serez arrivée quand ceci vous arrivera, chère Princesse. Je regrette de ne pas connaître Schlangenbad. Pour ma satisfaction pendant votre absence, je vous aimerais mieux à Ems que je connais. Il faut voir ses amis en pensant à eux et on ne les voit qu’en voyant les lieux où ils vivent.
J’ai passé hier ma soirée chez Mad. de Stael. Rien de plus politique que Rumpff et Viel-Castel. Celui-ci triste quand il a donné sa démission, il ne croyait pas la donner pour si longtemps. Dieu a bien raison de cacher aux hommes l'avenir ; ils ne feraient pas la quart des bonnes actions qu’ils font s'ils savaient ce qu'elles leur coûteront. Il est vrai qu’ils feraient aussi moins de sottises. Conversation donc toute littéraire.
Vous n'avez probablement pas lu dans le Constitutionnel, M. de Ste Beuve racontant la passion rétrospective de M. Cousin pour Mad. de Longueville, et sa haine pour M. de La Rochefoucauld, son rival heureux, il y a 200 ans. M. Cousin est très irrité de cet article et en parle comme d’une publication malveillante qui lui aurait fait manquer une bonne fortune à laquelle il touchait. M. de Ste Beuve a proposé, pour son tombeau cette épitaphe : " Ci gît M. Cousin ; il voulait fonder une grande école de philosophie, et il aima Mad. de Longueville. " Vous voyez que les nouvelles manquent tout- à-fait.
On dit que le Président ira en Algérie. Ce serait hardi. J’ai vu hier deux personnes qui arrivent d’Algérie, émerveillés des progrès.
Voilà votre lettre de Bruxelles. Merci d'avoir écrit et dormi. J’espérais bien que le voyage vous reposerait.
On est très préoccupé ici de l’attitude des partis monarchiques. Je coupe pour vous, le petit leading article des feuilles d'Havas d’hier soir. Cela n’est pas écrit pour le public de Paris et la presse de Paris n'en dit rien, mais les journaux des départements le reproduisent et le répandent partout. C'est là le langage qu’on veut parler au public intérieur sur lequel on compte.
4 heures
Jules de Mornay est mort hier soir d’une congestion cérébrale. C'était une bien pauvre tête, et un assez noble coeur. Il m’a fait de l'opposition jusqu’au 24 février, mais depuis, nous étions bien ensemble. Trés fusionniste, et le disant très haut à Madame la Duchesse d'Orléans. C’est une famille bien frappée. En six mois Mad. de Mornay a perdu son père, sa mère, son mari et la fille aînée qui s’est faite religieuse malgré elle. Je vous quitte pour l'Académie. On ne remplit jamais mieux ses devoirs qu’au dernier moment. Adieu.
J’ai bien peur d'être un ou d'être un ou deux jours sans nouvelles de vous. Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Absence, Amis et relations, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Deuil, Discours du for intérieur, France (1848-1852, 2e République), Fusion monarchique, Portrait, Presse, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique), Salon, Voyage
Broglie, Mercredi 23 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Votre lettre est très intéressante. J'en ai amusé mon hôte. Il aurait besoin d'être amusé souvent. L’atmosphère qui l'entoure agit beaucoup sur lui. Je suis très aise d’être venu. Le fond est excellent. Il ne s’agit que d’aider un peu le fond à monter sur l’eau. Il est toujours très noir et ne peut pas se persuader que rien de ce qui serait bon, soit possible. Très sensé du reste, et très spirituel sur la conduite à tenir dans le présent. Quand il a le temps de méditer sur les choses, c'est un esprit plein d'invention. Et un cœur toujours très noble. Je n'en connais point qui se soulève avec un dégoût plus fier devant tout ce qui est grossier et bas.
J’ai une lettre du Roi Léopold. Très amicale pour moi, et puis ceci : " Vous avez eu bien des occasions de juger, et apprécier la Reine Louise ; c'était une nature angélique, comme l'on n'en rencontre que bien rarement sur la terre ; et elle était une amie aussi affectueuse et dévouée qu’elle était distinguée comme intelligence et comme possédant un jugement des plus remarquables. Hélas, cet être si bon, si noble, et si distingué, si utile plus, nous est ravi, et mon home se trouve cruellement détruit. J’ai eu à subir de bien cruelles épreuves dans ma vie ; j'espérais que, vers son déclin, je n'aurais pas eu à déplorer la perte d’une amie de tant d'années plus jeune que moi. C'est encore une victime de Février. Ces épreuves sont trop rudes pour des âmes d’une véritable sensibilité. " C'est plus convenable que chaud. Et son dernier mot en parlant de sa femme, si utile en plus ; et en parlant de lui-même, des âmes d’une véritable sensibilité. On a bien raison de ne pas chercher à se montrer autre qu’on n'est. Les plus habiles n'y réussissent pas.
Salvandy est amusant. Il fera bien de rendre ses courses utiles. Il faut que son Wiesbaden serve à quelque chose, car on a dans le parti conservateur bien de la peine à le lui pardonner. Et à vrai dire on ne le lui pardonne pas. Je suis frappé de ce que j’entends dire à cet égard par des gens d'ailleurs fort sensés et point hostiles à la fusion. Du reste, dans tous les partis, et dans toutes les affaires il faut quelqu'un pour faire ces choses là, quelqu'un qui ne craigne ni la fatigue, ni le ridicule. Il a certainement, après tout, de l’esprit du courage, et beaucoup de sens en gros avec point du tout de tact et de mesure en détail. J'attends la dernière nouvelle de la reculade de la Prusse. Comme du renvoi de d’Hautpoul. Je tiens les deux faits pour assurés.
Lisez-vous attentivement dans le Galignani ce qui regarde Lord Stanley et sa manœuvre du moment pour rétrécir le fossé entre les Protectionists et les Free-Traders ? Cela en vaut la peine. Il essaie de prendre envers la réforme commerciale, la même position que prit Peel, en 1832, envers la réforme parle mentaire. Je souhaite fort qu’il y réussisse aussi bien. La reconstitution, en Angleterre d'un parti conservateur intelligent me paraît ce que nous avons de plus important à souhaiter aujourd'hui ; hors de chez nous s’entend. Adieu, adieu.
Ici aussi il fait froid. Et on ne se chauffe bien qu'à Paris. J’y serai d’aujourd'hui en huit jours. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 19 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous me dîtes qu'on a signé à Bregenz l’engagement de mettre sur pied une armée de 220 000 hommes, et mes journaux me disent que la Prusse est sur le point de céder, d’ajourner l'union restreinte, et de rentrer elle-même dans la diète de Francfort. Les deux choses vont très bien ensemble. Ainsi, soit-il ! La reculade prussienne, quelque forte qu’elle soit, ne m'étonnera pas. Grande ambition et grand courage, c'était le grand Frédéric. Grande ambition et petit courage, ce sont ses successeurs.
J'ai de mauvaises nouvelles de Belgique. Même au milieu du deuil public, la colère populaire contre le Roi continue, et on craint qu'elle ne finisse par éclater. Il a été heureux que Mad. Mayer fût partie car des attroupements considérables se sont formés deux fois devant sa maison, et ne se sont dissipés qu'après avoir acquis la certitude qu'elle n’y était plus. Je trouve que la Reine Louise s'est admirablement conduite envers le Roi dans ses derniers moments. Ce qu'elle lui a dit, la tendresse modeste qu'elle lui a témoignée, en lui baisant la main, tout cela ressemble à un voile protecteur qu’elle a voulu étendre sur son mari avant de le quitter. Cela est bien de la personne qui répondait à la question de savoir si la duchesse de Praslin avait reconnu son mari : " Certainement non ; si elle l’avait reconnu, elle n'aurait pas sonné. "
Dumas m'écrit de Claremont que la Reine y sera de retour après-demain lundi ? Elle s'embarque à Ostende demain soir. Sa santé se soutient presque au même niveau que son courage. Madame la Duchesse d'Orléans est revenue à Esher lundi dernier, très fatiguée. La mort de la Reine Louise, cette douleur de tout un peuple, ces allées et venues de toute une famille royale à travers, l’Océan pour se ranger autour d'un lit de mort et d'un cercueil, tant de souffrance dans l’âme et tant d’éclat dans le deuil tout cela grandit ceux qui pleurent et frappe beaucoup ceux qui regardent. Avez-vous entendu dire quelque chose de ce que fera ou sans doute a déjà fait M. le comte de Chambord dans cette occasion ?
La querelle du Président et de la Commission ne les aura grandis ni l’un ni l'autre quand ils arriveront devant l’assemblée. Duchâtel a raison ; il n’y a que des perdants, et point de gagnants dans le jeu que jouent aujourd’hui en France des pouvoirs et les partis. Ils y sont pourtant très animés.
Puisque Lady Jersey arrive, soyez assez bonne pour lui dire que je regrette bien de n'être pas à Paris pendant les huit jours qu'elle doit y passer. Je reste avec un coeur très affectueux pour mes amis d'Angleterre et j’ai toujours grand plaisir à les revoir. Je suis fâché pour vous du départ de Dumon. Avez-vous écrit à Duchâtel, comme vous en aviez le projet ? Vous est-il revenu quelque chose de Salvandy à son passage à Paris ? car il doit y avoir passé. Je n’ai pas entendu parler de lui.
Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 14 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
On rentre mes orangers, dans l’orangerie. C’est la préface de l'hiver. Moi aussi, je suis un arbre du midi quand l'hiver vient, il faut que je rentre. Je compte partir d’ici le mardi 29 et être à Paris le 30. Pauline et son mari resteront quelques jours après moi. Henriette part vendredi prochain. J'ai besoin de bien employer les quinze jours qui me restent. Il y a cent petites choses que je veux avoir faites avant mon départ. Ma course à Broglie me dérangera ; mais elle est nécessaire. Je tiens à causer avec lui. J’y passerai deux jours.
J’écris aujourd’hui à la Reine et au Roi Léopold. Je voudrais avoir des nouvelles du duc de Nemours. Je vois qu’il a été pris d'une de ces crises nerveuses auxquelles il est sujet, et qu’il a fallu l'emporter dans sa chambre. Quelle tragédie. Et dans les tragédies royales, depuis la maison d'Oedipe jusqu'à la maison d'Orléans, c’est toujours une femme qui est la figure frappante, le type du malheur, et du dévouement. Antigone, la Dauphine, la Reine Marie-Amèlie. La femme de la tragédie des Stuart est la plus obscure, Marie-Béatrix de Modène. Elle aussi a pourtant son originalité et sa grandeur. Grandeur de couvent plus que de trône, si vous aviez des yeux, je vous engagerais à lire son histoire dans les Lives of the Queens of England de Miss Agnes Strickland, livre médiocre et écrit avec une partialité jacobite puérile, mais plein de détails anecdotiques, et de lettres originales qui ont de l'intérêt.
Je reviens à une autre tragédie non pas royale, mais populaire, celle du Holstein. Quel acharnement mutuel devant Friedrichstadt. Je suis sûr qu’il y a eu là des scènes de passion, de courage, de dévouement et de douleur égales à celles des plus célèbres luttes historiques. Les hommes ont quelquefois de l'énergie et de la vertu à prodiguer obscurément sur les plus petits théâtres ; et puis elles leur manquent quand elles auraient tant d’éclat devant le monde entier qui regarde.
J'ai lu attentivement le discours du Roi de Danemark à l’ouverture de sa diète. Remarquable par le ton confiant, sûr de son fait et amical pour son peuple. On y sent que roi et peuple sont d'accord et ne font vraiment qu’un. Il paraît que son mariage à la mode ne l'a pas encore dépopularisé. Pardonnez-moi mon calembour.
10 heures
Je reçois un des principaux journaux de Bruxelles. C'est beau et touchant, et ce sera pour la pauvre mère qui survit, une vraie consolation. Elle a le cœur assez grand pour rester sensible à ces consolations là. J’ai une lettre d'Ostende, d’un de mes amis M. Plichon, qui était là ; il m’écrit ce que disent les journaux, plus ceci : " La Reine Marie Amélie est sublime ; elle est devenue surnaturelle. c’est elle qui console les enfants, l’époux, les frères. Une heure ne s’était pas écoulée depuis le moment suprême que déjà elle était aux pieds de l’autel, environnée de toute sa famille, et donnant l'exemple de la résignation aux décrets de la Providence. Elle m’a fait la grace de me recevoir. Elle ne tient plus à la terre. Depuis Ste Thérèse, je n'ai pas vu une sublimité morale aussi grande. " La comparaison est un peu étrange ; mais mon correspondant est un admirateur passionné de Ste Thérèse comme s’il l’avait vue. Il a dit ce qu’il a trouvé de plus beau.
Votre impératrice ferait vraiment bien d’écrire Adieu, Adieu, Soignez votre estomac. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 13 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je me lève. J'ai bien dormi. J'en avais besoin. Le temps a été magnifique hier. J'espère que vous vous serez promenée, que vous aurez marché. Il faut profiter des derniers beaux jours. Vous serez assez longtemps réduite à ne vous promener qu'en voiture. Je suis assez curieux de ce que vous me direz ce matin de votre dîner d'avant-hier. J'espère que vous aurez trouvé l'occasion de dire à votre principal convive ce qui me concernait. Je crois utile que cela lui soit dit.
Les Holsteinois sont bien acharnés. Le roi de Danemark même vainqueur aura de la peine à redevenir vraiment le maître là. Tant d'opiniâtreté indique sur le lieu même, un sentiment populaire énergique et la passion de l’esprit germanique viendra toujours réchauffer ce sentiment là. L'Allemagne n'échappera pas à une grande transformation. Je ne sais laquelle ni comment ni au profit de qui ; mais l'Allemagne ne restera pas comme elle est. Je ne vois en Europe que l’Angleterre et la Russie qui aient chance de rester longtemps comme elles sont.
Midi
Pauvre Reine ! A moi, comme à vous, ce sont les seuls mots qui viennent. Avez-vous remarqué son petit dialogue avec le curé d'Ostende à l'entrée et à la sortie de l’église ? " Priez beaucoup pour mon enfant. " Je ne connais rien de plus touchant que ces simples mots.
Merci de vos détails, très intéressants sur votre dîner. Si vous trouvez quelque occasion naturelle de dire ce que je vous rappelais tout-à-l'heure, soyez assez bonne pour la saisir. Le petit article des Débats sur la séance de la commission permanente me frappe un peu. C’est certainement Dupin qui l’a dicté. Il prouve que si la commission ne veut pas pousser les choses à bout; elle veut les avoir prises au sérieux. Il faut que le Général d'Hautpoul soit congédié avant l’ouverture de l'Assemblée.
Je suis fort aise que Marion ait pris son parti. Faites lui en, je vous prie, mon compli ment en lui disant combien je regrette de ne l'avoir pas vue. Je lui aurais conseillé ce qu’elle fait. J’ajoute seulement que s'il est bien convenu qu’elle restera à Paris avec sa soeur Fanny, il faut qu’elle y reste en effet quand ses parents partiront. Si elle retourne en Angleterre avec eux, elle ne reviendra pas. Adieu, Adieu. G.
Le Duc de Broglie ira certainement à Claremont car la Reine et la famille Royale y retourneront, je pense, aussitôt après les obsèques. Je crois que j'irai à Broglie lundi 21, pour 48 heures. Adieu, encore.
Mots-clés : Deuil, Europe, Famille royale (France), Femme (maternité), Femme (politique), Femme (statut social), Politique (Allemagne), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Prusse), Politique (Russie), Posture politique, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon, Santé (François)
Val-Richer, Lundi 30 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reçois une assez curieuse lettre de Piscatory. Je vous l’enverrais si vous pouviez la lire. Il ne m’avait pas écrit depuis sa visite à Claremont. La Reine l’a frappé comme tous ceux qui la voient. “ J’ai eu joie à admirer, c'est un plaisir rare dans le temps où nous vivons. J'ai vu les Princes et Mad. la Duchesse d'Orléans. J’ai longtemps causé. Mais je ne crois pas que ce soit fort utile. Les idées de retour m'ont paru passer avant tout. Je le comprends; lorsqu'une telle destinée n'est pas prise par son grand côté, elle doit être intolérable. "
" Quoique aussi loin que moi, vous devez en savoir plus que moi sur ce qui se passe à Paris. Ce sont, ce me semble, de bien vaines agitations ; mais elles disposent bien ou mal les esprits pour le retour de l'assemblée. Voulez-vous me dire ce que vous en pensez ? Qu’est-ce que c’est que ce désordre dans le parti légitimiste ? Y a-t-il là une chance pour que les bons se séparent sérieusement des mauvais ? Cela me paraît fort douteux ; et à titre de simple spectateur, il me semble évident, mais pas mauvais, je l'avoue, que M. Barthelemy a fait une mauvaise campagne. Autour de moi, l'effet n'est bon ni dans l’un ni dans l'autre camp. Ne croyez pas cependant que je prétende voir clair dans ce que pensent mes voisins, petits et gros. Ce qui est incontestable, c’est que l'inquiétude, et le malaise sont généraux ; les uns en sont poussés, en avant ; les autres regardent avec regret la terre qu'ils ont perdue. Je ne crois pas que cela soit sérieux ; mais il est certain que le nom du Prince de Joinville se prononce très haut. Le Président ne gagne pas ; il n’y a que ceux qui ont sérieusement à perdre qui veuillent faire fie, qui dure dans ce semblant de repos. Ce n’est certes pas moi qui reprocherai à personne ses incertitudes ; j’en suis plein; et cela m'inquiéterait. Si je ne savais que quand le feu commence, je ne suis que trop disposé à prendre promptement mon parti. Mais hélas, que ferons-nous ? Pourquoi Dieu a-t-it voulu qu’on eût des enfants sur cette maudite terre ? Ce serait très curieux, et mes semblables m’ont assez désintéressé d'eux pour que je trouvasse tont cela fort amusant. Il n'y a pas moyen, on a des filles à marier du moins à faire vivre ; il ne s'agit donc pas de se passer ses fantaisies. Mais où est la raison ? Où est le bon chemin: où est le but ? Vous êtes bien habile ; et cependant vous ne me le direz pas. Dites-moi pourtant ce que vous pensez ? Quand je ne le sais pas, et plus encore quand je ne viens pas à bout de penser comme vous, je suis prêt à chanter comme les enfants qui sont seuls la nuit, et qui ont peur. "
Ne dites à personne, je vous prie, cette dernière phrase. Son amour propre pourrait être blessé s’il lui en revenait quelque chose et il ne faut pas troubler les bons sentiments en piquant l'amour propre. Mais vous voyez qu'il est incertain, inquiet, et point inabordable pour moi.
Je suis charmé que vous ayez pris le deuil et envoyé un consul général à Bruxelles, deux choses utiles pour l'avenir.
Charmé aussi de ce que Thiers a dit à Mercier sur le Général Changarnier. La double visite dont vous me parlez à Champlâtreux vaut la peine qu'on sache ce qu’ils y ont dit.
J’ai écrit à Villemain pour l'Académie. Je ferai ce qu’elle voudra. La raison veut que je reste ici jusqu'au mois de novembre. Pour mes affaires d'abord qui en ont besoin. Puis, parce que j’ai promis au Duc de Broglie d'aller passer une semaine chez lui, ce que je ferai mercredi 9 octobre. Visite utile. Un bon motif pour revenir plutôt serait charmant ; mais vraiment, il me faut un bon motif, autre que mon plaisir.
Dix heures
Ce qui me fait grand plaisir, c’est que vous soyez tranquille sur Constantin. Je vous ai dit que vous rêviez, et j'avais bien raison. Mais je n'aime pas les mauvais rêves pour vous. La Reine des Belges m'afflige profondément. Quelle prédestination aux épreuves ? La branche cadette ne le cède guère à la branche aînée, ni la Reine à la Dauphine. Adieu, adieu. G.
Paris, Samedi 28 septembre 1850, Dorothée de Lieven à François Guizot
Beaucoup de monde hier soir et au début un court tête-à-tête avec M. Achille. Fould. Je lui ai lu un passage de votre dernière lettre sur la situation. Il y a extrêmement applaudi & m’a dit que c’est comme cela en effet qu’on est décidé à se conduire. On ne fera rien. Les Ministres tâcheront de faire aller leurs affaires le mieux possible, et on attendra, on verra. On avait songé un moment à poursuivre quelques journaux légitimistes, on y renonce. Cela ne vaut pas la peine. Le parti en charge lui-même de se perdre. La circulaire est toujours regardée comme une bonne fortune. Quelques doutes sur ce que sont les vrais sentiments de M. Molé. Grand éloge de lui, & flatté de votre bonne opinion. J'ai été fâchée d'être interrompue, la conversation était intéressante et l'homme spirituel. M. Molé m'écrit ce matin que Jules de Lasteyrie est allé le voir hier, & qu'on lui annonce le général Changarnier pour ce matin. M. Roger a été envoyé à Clarmont. Voilà bien du mouvement. Le Président a reçu hier l'ambassadeur d’Espagne qui lui a apporté la toison d'or, la même que portait le roi Louis- Philippe ! Avant hier encore revue à Versailles toujours banquet aux officiers, sous officiers & soldats. Une [bouteille] de Champagne pour 2 par officiers. Mardi prochain cela recommence. Le général Lahitte y est invité. M. Persigny a été envoyé en Angleterre, on dit pour négocier de l’argent. Il n’y en a plus. Beaucoup de gens disent que l'assemblée n’en donnera plus, parce qu'on le fait boire à l’armée.
J’ai revu hier le duc de Noailles, il est reparti pour Maintenon, assez remonté ! Deux faits importants. Ma cour a pris le deuil pour 15 jours pour le roi Louis-Philippe et nous avons nommé un consul général à Bruxelles M. de Bacharach, homme très comme il faut & distinguée. C'est un premier pas vers des relations diplomatiques. Je connais l'homme. Il est resté 20 ans à Hambourg menant là nos affaires. Est-ce que l’Académie ne vous oblige pas à revenir ici en octobre ? Adieu. Adieu.
Thiers a dit à M. Menier à Bade qu’il était plein de doutes. sur la vraie pensée du général Changarnier. M. Fould me disait hier que Thiers revient le 10 octobre. Il avait eu une lettre de lui.
Val-Richer, Jeudi 26 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
On s’apercevra, je crois bientôt qu’on a fait une bévue en forçant les Journalistes, à signer leurs articles. On leur aura donné plus de prétentions et d’importance en leur donnant plus d'humeur. Je dis les journalistes, et non pas les journaux. Sous l’Ancien régime, on ne connaissait que le journal, et non pas les journalistes. C'était le journal qui avait de l'importance, et non pas ses rédacteurs. On aura changé cela au profit des rédacteurs, aux dépens du journal et du public aussi qui aura plusieurs prétentions à satisfaire et plusieurs fortunes à faire au lieu d’une. En Angleterre, les journaux ont de l'importance les journalistes point. On gagnera bien peu de chose par le peu d’embarras, et de crainte qu'on impose aux journalistes, en les obligeant de signer. L’ambition, la vanité et l'habitude auront bientôt surmonté cela. On perdra bien davantage en appelant aux honneurs du théâtre des gens qui vivaient dans les coulisses. Mesure de haine et d'humeur, bonne pour satisfaire la haine et l’humeur inintelligente et imprévoyante hors de là. C'est l’impression qui m’a frappé hier, en lisant mes journaux signés pour la première fois.
Autre raison. Quand les rédacteurs ne signent pas, l'autorité appartient au propriétaire qui a la responsabilité morale du journal. Quand les rédacteurs signent, une partie de l'autorité va à eux avec la responsabilité, c’est-à-dire que l'influence passe de l’esprit de propriété à l’esprit de vanité.
Il me revient que le président est décidé à fondre la cloche l’hiver prochain, c’est-à-dire sa cloche. Il demandera formellement à l'Assemblée la prorogation de ses pouvoirs avec la révision, de la Constitution. Si l’assemblée la lui refuse il ira seul devant le suffrage universel, vraiment universel. Il est décidé à durer, à durer tant qu’il pourra à faire tout pour durer. Je le comprends ; mais je crois qu’il se tromperait si pour durer il lançait lui-même le pays dans une secousse. Il pourrait se tromper beaucoup sur le résultat. Le pays s'en prendra de la secousse dont il ne veut pas à celui qui en aura pris l’initiative, et il la lui fera payer. La force du président est précisément de mettre le pays à l'abri d’une secousse nouvelle, et des maux et ce qui est pire des incertitudes dont l'idée seule fait trembler le pays. S'il est bien conseillé, il gardera à tout prix cette position qui lui donnera au dernier moment, quand il faudra absolument fondre la cloche, plus de chances de durée qu’il n’en trouverait dans un appel prématuré, et non indispensable, au suffrage universel.
10 heures
Votre récit de la revue de Versailles est curieux. Mistriss Howard et Lady Normanby ! Rien de plus, rien de moins. C’est un peu fort.
Vous voyez bien que j’ai raison de dire que Lady Allice me plait. Je vois qu’on a pris aussi le deuil à Berlin pour le Roi Louis Philippe. A ma connaissance, il n’y a pas eu plus de notification là qu'à Vienne. Il n’y en avait point il y a trois semaines. C’est donc spontané. Ils ont raison. Adieu, Adieu. G.
Paris, Jeudi 19 septembre 1850, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai oublié de vous répondre sur le deuil. Je crois qu'en le portant jusqu’à la fin de l’année cela sera bien, et assez. Ce que vous dites sur Liverpool et Castelrengh est vrai. Il reste le choix entre rendre son pays très heureux & même glorieux car c'est ce qu’ils ont fait, et se donner à soi des pages brillants dans l’histoire. Moi, j'honore bien plus lord Liverpool que M. Canning. C’est très bourgeois ici que je vous dis là, je le suis un peu en politique. J’ai vu hier matin, lady Douglas, très bonne personne & qui me plait. Tolstoy est revenu. Un accident dans la famille a hâté son retour. Il regrette beaucoup de n’avoir pas pu aller au Val Richer. Je suis charmée de l’avoir ici. Hier soir M. Mercier, revenant de Bade. Trés curieux sur Bade. Thiers archi orléaniste. Ennemi juré des des légitimistes, & républicains plutôt que cela. La reine de Hollande éprise de lui & lui d’elle. Tous les jours ensemble. C'est assez drôle à entendre. Il parait qu’il n’avait pas encore vu la grande duchesse Hélène. Les princesses en querelle entre elles. La princesse de Prusse en grande hostilité avec la reine de Hollande sa cousine. Thiers n’a pas bougé de Bade. La princesse Mathilde a rêvé.
Achille Fould est venu hier soir aussi. Il a certainement de l’esprit, et de la mesure dont je fais grand cas. Il est convaincu quoiqu’on dise ou qu’on fasse, qu'il en ira de la prolongation de la Présidence comme de la dotation. On la votera & tout le monde. Le pays très tranquille & à aucune époque le gouvernement n’a été plus puissant et plus obéi. J’ai donné à lire à Dumon des articles de l’Indépendance Belge, répétés dans le Galignani, évidemment venus de Clarmont qui atténuent & dénaturent même un peu les messages entre Wiesbaden & Clarmont. Salvandy y est tourné en ridicule. Je ne sais pas un mot d’aucun de ces quartiers, pas même des commérages. Montebello est ici, mais il n’est pas venu me voir encore. Mon rhume continue. C'est bien long, et mes yeux sont enrhumés aussi. Adieu. Adieu.
2 h. tout à l'heure Montebello & M. Molé venu pour la commission. Molé enchanté de ce que vous me dites à propos de l’article dans le Constitutionnel. Il signerait chacune de vos paroles.
Val-Richer, Mercredi 18 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je lis Peel and his times. Ce serait trop long pour vous, trois gros volumes ! Votre impatience étoufferait votre curiosité. Mais c'est dommage ; toute l'histoire de votre temps en Angleterre. Peel est entré dans le Parlement, en 1809 et dans les affaires en 1812, au moment de votre arrivée à Londres. Le livre est fait avec simplicité, et bon sens, libéral modéré, comme Peel est devenu à la fin. Le point de départ était bien loin de là et les phases de la transformation sont curieuses à observer. Je vis avec Lord Liverpool, Lord Castlereagh, M. Canning. Vus ainsi de loin et dans l’histoire, les deux premiers font moins grande figure que dans votre conversation. Le pouvoir, même habilement et heureusement exercé, ne suffit pas pour placer un homme bien haut dans la mémoire des hommes ; il faut absolument avoir eu de l'éclat par quelque côté, par la pensée, par l'imagination, par le caractère, par la parole, il importe peu quelle grande qualité, mais une qualité first rate, qui mette un homme à part entre ses contemporains. L'histoire ne laisse à leur rang que ceux-là. Canning a cet honneur. Peel aussi l’aura, à des titres bien différents. Lord Liverpool et Lord Castlereagh, meilleurs ministres de leur temps peut-être descendent à mesure que leur temps s'éloigne ; ils n'avaient rien de ce qui est beau et grand dans tous les temps.
Savez-vous s'il est vrai que M. le Duc de Nemours et les Princes ses frères aient écrit au général Changarnier pour le remercier de la messe des Tuileries ? Ils ont eu fort raison, s'ils l’ont fait et j’avais eu tort, moi de ne pas songer à le leur conseiller. Je serais bien aise d’être sûr qu’ils l’ont fait.
L'article que j'ai lu hier dans le Constitutionnel est certainement de M. Granier de Cassaignac. Je me rappelle qu’il est venu me voir, il y a quelques semaines, dans je ne sais plus quel de mes passages à Paris, et que je lui ai dit une grande partie des choses qui sont là. Il s'est évidemment souvenu et prévalu de cette conversation.
Je vous quitte pour ma toilette. Je vais ce matin faire une visite à dix lieues d’ici chez M. de Banneville. J’avais deux visites lointaines à faire. J’en serai quitte. Il faut que je parte à 9 heures tout de suite après l’arrivée de la poste. Nous avions depuis quinze jours un temps admirable. Ce matin, un grand brouillard, mais de ces brouillards que le soleil dissipe quand il est bien levé. Je compte sur le soleil. J'ai beaucoup perdu de mon optimisme pour les grandes choses ; il me reste encore pour les petites.
9 heures
Voilà votre lettre. Adieu. Je pars. Adieu Adieu. Je suis fort aise de l'accueil fait à Piscatory à Claremont. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Mardi 17 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc le grand duc de Hesse en fuite, et devant la seule résistance passive ! Que lui dira le Roi de Hanovre, qui n’est ni fou, ni poltron. Ceci fait assez d’honneur aux Hessois. Ils se conduisent, ce me semble, prudemment et fermement. Nous assistons à de bizarres spectacles ; tantôt c'est le peuple qui fait seul toute la sottise, tantôt le Prince. Quand donc auront-ils un peu de sagesse et de dignité ensemble et à la fois.
Vous avez raison, l'article du Constitutionnel est remarquable et sensé. J’ai souvent dit en effet ce qu’il répète, et je n'en désavoue rien. Seulement, je suis plus décidé qu’il ne le dit sur la nécessité de la fusion, et de la fusion aussi prochaine qu’il se pourra. Les populations se gâtent sous le régime actuel et j'ai peur que le gouvernement du Président ne laisse faire plus de mal qu’il n'en répare. Certainement il faut qu’il dure tant qu’on ne pourra pas avoir à sa place, la vraie solution, et il faut, pendant qu’il dure, lui donner toute la force nécessaire pour que sa durée nous fasse regagner du terrain. Mais nous payons cher aussi cette durée, et nous aurions tort de la prolonger indéfiniment, par peur ou par paresse. Et le président lui-même s'il est bien conseillé, doit désirer que la solution définitive arrive pendant qu’il est debout et puissant, et peut s'y faire lui-même sa part, et non après quelque nouveau cataclysme qui le jetterait et le laisserait. le premier sur la plage noyé et nu.
Le courrier de ce matin m’apporte bien des articles de journaux remarquables. L'Univers répète, celui du Times sur nous et Salvandy à Claremont et à Richmond ; et j’y vois que l'Union et l'Opinion publique l'ont aussi répété. Je coupe dans un journal qui m’arrive de Marseille l'article sur le service funèbre célébré là en l'honneur du Roi, et je vous l'envoie avec la lettre du rédacteur qui me l'a envoyé, et que je ne connais pas du tout. Curieux et bons symptômes. M. de Villèle, pendant, son ministère, avait mis ce motto avec ses armes sur sa voiture : " Tout vient à point qui peut attendre. " Il avait raison.
Midi
Pouvez-vous me dire combien de temps nous devons porter le deuil du Roi ? Je vois qu'à Bruxelles on l’a pris pour trois mois, et à Séville pour un an. Peu m'importe à moi qui suis toujours en deuil ; mais je veux qu'autour de moi on soit parfaitement correct, et jusqu'au bout. On dit que la Reine des Belges va un peu mieux. Dieu le veuille. Il paraît qu'en tout cas la Reine a retardé son voyage à Bruxelles. Je n'ai point cru à la retraite de M. de Meyendorff. Mais je suis bien aise d'être sûr. Adieu, Adieu.
Merci de vos soins pour ma lettre en Angleterre. Que ne vous assurez-vous d'avance rue Chauchat, une place dans une petite tribune, hors des grands courants d’air ? Je crois que cela se peut. Adieu G.
Val-Richer, Dimanche 15 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis frappé de ce que vous me dîtes de l’intimité de Changarnier et de Lamoricière. Cela coïncide avec ce qui m'est revenu d'ailleurs, ces jours-ci. Lamoricière dans des conversations intimes, s’est déclaré inconciliable, absolument inconciliable avec les rouges et l'Empire, ou toute combinaison bonapartiste analogue à l'Empire ; du reste prêt à accepter toute autre solution, l'une ou l'autre des deux branches, n'importe laquelle, ou mieux encore toutes deux ensemble ceci dans l’hypothèse où la république régulière ne pourrait pas durer, ce qu’il ne regarde point comme sûr, mais comme très possible. Je vous donne ces ouï dire pour ce qu'ils valent ; ils viennent de bon lieu. Ils peuvent être vrais aujourd’hui et point demain ; Lamoricière est si mobile ?
Les nouvelles de Bruxelles m'affligent beaucoup. La Reine, toute cette famille royale quittant le cercueil du Roi et traversant la mer pour venir s'asseoir auprès du lit de mort de leur fille, de leur sœur ! Quelle épreuve ! quel spectacle ! Les douleurs s’appellent et s'attirent. Je ne sais rien que par les journaux ; mais j’ai le cœur serré à l'idée de ce deuil sur deuil pour la Reine dont la personne, et le cœur, semblaient ne laisser plus de place à un deuil nouveau. Je voulais écrire ces jours-ci à la Reine et à M. le Duc de Nemours. Je n'ose pas. J’attends.
J'espère que vous me donnerez aujourd’hui d'un peu meilleures nouvelles de votre rhume. Décidément enrhumée ou non, et encore plus enrhumée, je vous aime mieux à Paris qu'ailleurs. Vous y avez à la fois plus de repos et plus de mouvement. Je compare ce que vous voyez là, avec votre solitude de Schlangenbad. Et pour avoir cela vous n'avez d'autre peine à prendre que de ne pas sortir de chez vous.
Je suis curieux de ce que vous me direz sur M. de Meyendorff. La nouvelle de Berlin est répétée dans tous les journaux. Je ne puis croire à cette retraite, et encore moins au motif. Mad. Swebach (est-ce bien son nom ? ) doit savoir le vrai. Midi Je regrette de n'avoir pas vu l'article du Times, sur Salvandy. Je suis frappé de la réserve des journaux de toute opinion sur ce sujet. Ils sentent tous que c’est sérieux, et ne veulent ni s’engager ni se compromettre. Je vois ce matin un article du Siècle qui pose, entre la Monarchie et la République, je ne sais combien de questions pleines d'embarras et qui admettent les réponses contraires.
Je suis bien aise d'avoir valu à Constantin les remerciements qu’il a reçus. Vous savez que je lui ai trouvé, sous sa tranquillité modeste et un peu stérile, l’esprit plus ouvert et plus sérieux que je ne supposais. Adieu, adieu. Vous aurez reçu ce matin une réponse sur Fleischmann. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 29 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
On a beau dire qu’on s'attend à la mort de quelqu'un. La mort est quelque chose de si grand qu’elle frappe toujours comme un coup imprévu.
Je lisais, il y a quelques semaines à mes enfants un sermon de Bossuet, prêché devant Louis XIV, et qui dit : " C’est une étrange faiblesse de l’esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu’elle se mette en vue de tous côtés et en mille formes diverses. On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui à parlé, et de quoi le défunt l’a entretenu ; et tout d’un coup, il est mort ! Voilà dit-on ce que c’est que l'homme. Et celui qui le dit, c’est un homme ; et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée ; ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt les noires idées ; et je puis dire que les mortels n’ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes. " Ce sont de bien belles paroles et bien vraies.
Que feront la Reine et ses enfants ? Je persiste à penser que le parti digne est de laisser le corps du Roi à Claremont, toujours le centre et le lieu de la famille royale, jusqu'à ce qu'elle puisse le ramener à Dreux, comme il y doit être ramené, sans désordre et sans indifférence. Aujourd’hui, il y aurait l'un ou l'autre spectacle. Et toujours quelques uns des Princes à Claremont pendant que les autres voyageraient à leur gré. C’est la conduite que nous avons indiquée à St Léonard le Duc de Broglie et moi. Je viens de lui écrire pour lui demander, s’il est toujours du même avis. Que de sottises seront dites d’ici à huit jours sur ce grand mort ! Sottises de haine et sottises de bêtise.
En France et aussi en Angleterre. J'espère qu’il y aura aussi des paroles convenables. Il y a droit, et il peut supporter la vérité. J’espère aussi avoir enfin des lettres de vous. Le silence dans l'absence est insupportable.
Dix heures
Voilà vos deux lettres. J'ai vraiment envie, pour vous, que vous puissiez aller à Bade. Vous y passeriez huit jours agréablement. Qu'avez-vous besoin du Duc de Noailles ? Plaisir, je comprends, mais besoin, non. Kolb suffit pour la sureté.. Les Débats sont très convenables sur le Roi. Les paroles sont justes et le sentiment vrai. Le Constitutionnel très inconvenant. Sec et petit. On dirait qu’il parle pour sa propre justification. Quand viendra le moment où la vérité pourra être dite ? Jamais peut-être de mon vivant. Adieu, adieu.
Vous ne me dites pas de ne plus vous écrire à Schlangenbad. Je continue donc. Je serai bien aise quand je vous en saurai dehors. Votre ennui me déplaît et le froid m'inquiète. Adieu, adieu.
Prendra-t-on à Wiesbaden le deuil du Roi ? Ce serait de bien bonne paroles convenables. Il y a droit, et il peut politique comme de bien bon goût.
Val-Richer, Lundi 10 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Duchâtel m'écrit comme vous que l’argent du Président passera, après bien du tirage. Il croit aussi que sa loi du tombeau Napoléon passera cette semaine, et il ira alors à St Léonard, deux ou trois jours plus tôt ou plus tard selon que les nouvelles seront plus ou moins inquiétantes. Je ne sais pourquoi je vous redis tout cela qu’il vous dit surement lui-même. Habitude de nous redire tout ; on a bien de la peine à croire à l'absence, même quand on la sent. J’ai bien de la peine aussi à admettre ce que vous dit Ellice que l'affaire grecque reste toujours sérieuse dans la Chambre des Lords, malgré l'ajournement, et que le Cabinet ne s’en tirera pas. Flatterie pour votre désir. Ce serait trop beau. Il serait vraiment très beau qu’une affaire point grave en elle-même, et complètement terminée devînt l'objet d’un débat sérieux, et que par pur respect de la bonne politique, pour le seul honneur du pays, le Cabinet fût sérieusement censuré, et tombât devant cette censure. Quelle que soit mon estime pour l'Angleterre, je n'en espère pas tant. Je vois de plus, d'après ce que vous me citez, qu’il ne s’agit pas de substituer simplement, selon le choix du roi Othon, la convention Drouyn de Lhuys à la Convention Wyse, et qu’on en fait une troisième, un amalgame des deux premières. Si on retranche de celle-ci l’article qui mettait l’Angleterre à l'abri des réclamations de la Grèce pour pertes et avaries et si la Grèce élève en effet des réclamations, ceci peut prolonger et envenimer l'affaire.
J’ai passé hier ma matinée à Lisieux. J'ai vu assez de monde. Pays étrangement tranquille. On parle sans la moindre inquiétude de l'insécurité universelle. On prévoit et on discute les révolutions futures ; et on s’établit dans cette prévoyance comme dans un mal dont on ne peut ni guérir, ni mourir. On semble assuré que quoi qu’il arrive, on ne sera pas beaucoup pire qu’on n'est, et on se résigne, assez aisément à n'avoir ni plus haute ambition, ni plus grave crainte. C’est un spectacle profondément humiliant.
Qu'est-ce que la princesse Léonida Galitzine qui va a Trouville, et dont il me semble que vous m'avez parlé ? On me dit qu'elle est soeur de Paul Tolstoy, et que c’est une bonne et aimable personne, un peu timide et sauvage, qui a perdu sa fille aînée il y a quelques années, et que le chagrin dévore. Est-ce vrai ?
9 heures
Mauvaises nouvelles du Roi, de Londres et de Paris. J’attendrai ce que Montebello m’écrira, et que Thiers soit revenu. Je ne veux pas, comme de raison, m'y trouver avec lui. Broglie ne sait pas quel jour il sera disponible. Je ne puis l'attendre indéfiniment. Je le verrai en passant par Paris, et s'il est prêt, je l'emmènerai sinon, j'irai sans lui. Car je passerai par Paris. Adieu, adieu. J’ai cinq ou six petites lettres à écrire. Adieu. G.
8. Château de Windsor, Samedi 12 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je sors de la réception de l'adresse de la Cité au Roi. Le Lord maire, les Sheriffs, les aldermen, & des common Council men, 45 en tout. Vous verrez l'adresse et la réponse du Roi, qui a été parfaitement accueillie. Bonnes toutes deux. J’avais écrit la réponse ce matin, et je l’avais fait traduire par Jarnac. De l’avis de Peel, et d'Aberdeen il fallait qu’elle fût écrite lue et remise immédiatement par le Roi au lord Maire. La Reine et le Prince Albert ont passé une demi-heure dans le cabinet du Roi à revoir et corriger la traduction. C'est une véritable intimité de famille et d’une famille très unie.
J’ai eu le cœur remué pour mon propre compte. Au moment de se retirer les commissaires de la Cité ont demandé tout bas qu’on leur montrât M. Guizot, et à peu près tous m'ont salué avec un regard respectueux et affectueux qui m’a vraiment ému. Au dire de tous ici, cette adresse, votée à l’unanimité dans le Common Council est un évènement sans exemple et très significatif. Peel répète souvent qu’il en est très frappé. Plus j’avance plus je suis sûr qu'ici le voyage est excellent, excellent dans le Gouvernement et dans le public. Le Duc de Wellington est venu ce matin passer une heure chez moi. Nous avons causé de toutes choses, même du droit de visite ; évidemment ma conversation lui plaisait, et j'espère qu’il s’en souviendra.
Vous avez raison ; il faudrait que Cowley fût Earl. Je tâcherai de faire arriver cela. J'en parlerai au Roi, qui a déjà très bien parlé des Cowley. Le Roi vient de partir pour une visite à Eton. Il est infatigable. Je suis resté pour écrire, pour vous écrire.
Ne vous enfermez pas dans votre deuil au delà de ce que veut la convenance. Je ne doute pas que la lettre de Constantin ne me touche. C’est un bon jeune homme. J'espère qu’à partir de demain Dimanche, vous aurez l’esprit de m'écrire au château d’Eu et non plus en Angleterre. Lundi encore, écrivez-moi à ici. J’aurai votre lettre mardi, et Mercredi j'irai vous chercher vous même au lieu d'attendre vos lettres.
Nous quitterons Windsor Lundi à midi. La Reine, avec le Prince Albert, reconduira le Roi à Portsmouth. Là vers 3 ou 4 heures elle montera à bord du Gomer, où le Roi lui donnera un luncheon. Après le luncheon, elle quittera le Gomer pour monter sur son yacht, le Victoria Albert et les deux bâtiments sortiront ensemble du port de Portsmouth la Reine pour aller à l’île de Wight, nous pour faire voile vers le Tréport. On ne peut pas pousser plus loin la bonne grâce, et l’amitié. On dit que tout Londres sera lundi à Portsmouth.
Bacourt peut aller à Bruxelles. Je ne crois pas avoir besoin de lui avant le 1er Déc. Et en tous cas Bruxelles est si près. Je vais vraiment très bien. J'en suis frappé surtout pour l’appétit. Il y a bien encore un fond de fatigue surmonté par l'excitation de la vie que je mène et par ma volonté. Pourtant je sens aussi revenir la force, la force vraie et naturelle. Je suis sûr qu'à mon arrivée vous serez contente de moi. Adieu. Adieu. Votre lettre de ce matin m'a bien plu. Seulement vous ne me dîtes rien de votre santé. Adieu, dearest.
230. Val-Richer, Mardi 30 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rentre d’une longue promenade avec mes enfants. J'ai découvert, à quelques minutes de la maison, un terrain presque inculte que je ne me connaissais pas dans une position charmante, à droite la vue de la maison dont on n'est séparé que par un ravin où coule une petite source, à gauche, une percée sur une vallée large et riante, en face et derrière de grandes bois en amphithéâtre. Je planterai là un petit bois. L’idée de cette plantation et votre idée me sont venues en même temps absolument en même temps ; je ne saurais dire qu’elle a été le première. Tout ce qui me plaît me fait penser à vous. Rien ne me plaît vraiment qu'avec vous.
Je voudrais que votre frère eût raison pour votre fortune. Je connais cette façon de se débarrasser de toute inquiétude sur le compte des gens en exagérant leurs avantages. Certainement on dit hableur. Quand vous aurez reçu de nouveaux détails sur vos arrangements, sur le partage des meubles sur l'époque où vous toucherez les capitaux, mettez-moi au courant. Je suis beaucoup plus tranquille que je ne l'étais. Je ne le suis pas encore assez pour mon plaisir.
Mes dernières nouvelles d'Orient restent un peu en suspens. Ce qu'on m’avait mandé me paraît plutôt commencé qu'accompli. Si Méhémet trouve moyen de donner satisfaction à l'Angleterre pour l'isthme de Suez, ses affaires seront bonnes. Mais il faut qu’il fasse cela. Je n’ai rien reçu le matin.
9 heures
Vous voulez revoir ce que vous avez aimé. Vous voulez y croire. Vous y croyez bien plus que vous ne pensez. Vous y croyez naturellement, spontanément, par instinct, c’est-à-dire par l'élan primitif et libre de votre âme. Vous croyez à bien plus qu'à la réunion dans l'avenir. Vous vous croyez en rapport avec eux encore à présent, toujours d’un monde à l'autre. Pourquoi les appelez-vous les priez-vous ? Pourquoi levez-vous les yeux, joignez-vous les mains vers eux. Feriez-vous tout cela, la moindre de ces choses-là si réellement, au fond de votre âme, vous les croyiez sourds, insensibles, tout-à-fait étrangers à vous, morts vraiment morts ? Nous portons en nous une foi obscure, mais invincible à une relation inconnue, mais réelle, avec les êtres chéris qui nous ont quittés. Ils ont des droits sur nous, nous avons des devoirs envers eux. En nous acquittant de ces devoirs, nous croyons satisfaire à quelqu'un. Si nous y manquions nous croirions avoir manqué à quelqu'un. A cette croyance se joint même le sentiment que les morts ne pouvant réclamer, ni se faire rendre eux-mêmes, ce qui leur est dû la dette n'en est pour nous que plus sacrée. Qu’est-ce à dire ? Les morts jouissent-ils ou souffrent-ils donc de ce que leur accordent ou leur refusent les vivants ? Je ne puis pas vous répondre. Je ne dois pas toutes de vous répondre. Comment l'être qui n’est plus de ce monde peut-il être encore affecté de ce qui s’y passe ? Quelle société peut l’unir encore à ceux qui y sont restés ? L'homme ne le conçoit pas, et dès qu’il le cherche, il s'égare. Cependant il y croit, et ne peut pas plus échapper à l’instinct de sa nature que dépasser les limites assignées à sa science. Et remarquez que cet instinct n'a point de prétentions scientifiques ; il se suffit à lui-même. Au moment où l'homme, obéissant à cette voix intérieure, s’acquitte envers les morts de quelque devoir pieux, aucune curiosité, aucun doute ne le préoccupe ; il n’a nul besoin de savoir quel est leur mode d'existence ou quel mode de communication est possible entre eux et lui. Il agit en vertu d’une foi irréfléchie dont il se contente, certain, sans s’inquiéter de la route ni du moyen, que son action a un objet, que ses sentiments iront à leur but. C’est seulement lorsque d’acteur l'homme devient spectateur, lors qu’il interroge sa nature au lieu de la suivre et s'examine au lieu de se croire c’est alors que s'élèvent en lui les doutes de l’esprit, les besoins de la science, et qu’il entreprend, pour devenir savant, de franchir des limites au delà desquelles ses croyances instinctives ne le portaient point. Regardez dans l'âme de cette femme, de cette fille qui vont auprès d’un tombeau, offrir à un mari, à un père, tant de marques de tendresse et de respect. Croient-elles savoir, sur son état depuis la mort, sur sa relation avec elles, ce que cherchent les philosophes ? Pas du tout. Les problèmes qu'agitent les philosophes n'existent pas pour elles ; si elles les voyaient, elles seraient, comme les philosophes, tourmentés du besoin et de l’impossibilité de les résoudre. Essayez de soulever ces problèmes dans leur pensée : demandez-leur comment elles se figurent que le parfum de ces fleurs qu'elles cultivent la fraîcheur de cet ombrage qu'elles entretiennent, vont charmer l'être à qui s'adressent leurs soins. Vous les verrez saisies de trouble ; vous n'en recevrez que des réponses timides, contradictoires. Peut-être même leurs paroles démentiront- elles leurs actes ; peut-être s'accuseront-elles de faiblesse et d’erreur avant votre intervention, elles ne croyaient pas en savoir davantage ; elles ignoraient ce qu'elles. ignorent ; mais elles ne le cherchaient point. Elles adhéraient fortement à une foi simple, naturelle ; et jouissaient de ses espérances, et agissaient selon ses inspirations, sans rien demander de plus. C'est le caractère de cette foi qu'elle n’a point de réponse aux doutes, point de solution des problèmes qu’élève la curiosité de l’esprit. Elle n’est point curieuse elle-même ; elle existe ; elle affirme les faits qu'elle entrevoit. Ne lui demandez pas de les démontrer, de les expliquer. Elle est invincible et sans aucune prétention. Ecoutez-la ; elle vous consolera ; ne l’interrogez pas, car elle ne se chargera point de vous instruire, sublime et modeste à la fois, elle révèle l'avenir et ne tente pas de le dévoiler.
Mercredi 10 h.
Ne manquez pas de me répondre sur le petit hôtel de la rue Belle-Chasse, qu’occupait M. de Crussot. Beaucoup de vos convenances m'y paraissent réunies. J’aimerais bien mieux l'entresol de la rue St Florentin. Mais je crains qu'on n'en veuille 12 mille francs. Adieu. Adieu. Pendant une semaine, vous n'aurez eu de lettre que tous les deux jours. Mais nous voilà, au même pas. Encore adieu. G.
206. Baden, Lundi 1er juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le temps est vraiment atroce. 8 degrés seulement. Le médecin ordonne à tout le monde de discontinuer les bains. Il pleut des torrents, on ne peut pas bouger ; c'est affreux ceci par un temps pareil. J’attends votre lettre tantôt. C'est la seule chose que j’attends que je désire surtout à Baden.
Vous voyez qu'on ne se presse pas de m’informer de mes affaires. Je n'ai pas d’idée comment elles vont, si elles vont. Je pense qu’il n’y aura que les lettres de Mad. de Nesselrode à son mari qui les fera aller parce qu'elle aura écrit très énergiquement qu'il faut en tirer de l’incertitude où je languis depuis si longtemps. J'ai beau m'en plaindre moi-même cela me touche pas trop ; mais le témoignage d’un turc aura du poids. Voilà comme nous sommes faits ! Un nouvel incident nous donne de l'espoir ; nous croyons si aisément ; je devrais cependant être désabusée.
Mardi 2. à 8 heures du matin Je reçois dans ce moment trois lettres de Pétersbourg. L’une de mon frère ne me parlant que de fêtes- approuvant fort ma réponse au grand duc ! me disant que Paul s’occupe de mes affaires. Voilà tout. L’autre de mon fils Alexandre qui m'annonce prochainement des voyages dans leur terre de Courlande et de Russie, ce qui fait qu’il ne viendra pas me rejoindre à Baden. La troisième de Matonchewitz. Il venait de recevoir ma grande lettre. Il en est très surpris, très peiné, et affirme que s’il n’avait pas été instruit par moi de ces tristes affaires, jamais il ne les eut soupçonnées rien dans la conduite ou le langage de Paul en laissant plus à cette idée. Dans tout cela vous voyez que mes affaires d’intérêts n'ont pas fait un pas. Et il me parait assez probable que rien ne se fera avant le voyage de mes fils, c.-a.-d. que je suis renvoyée à l'automne ou l’hiver.
Après vous avoir parlé de ce qui me tracasse, j’en viens à ce qui me plait. Votre N° 203, dont je vous remercie beaucoup. Vous me dites un peu plus de détails sur vous c’est ce que j’aime. Quand je les recevrai tous les jours je serai contente.
J’ai vu les dépêches de Constantinople du 12 juin adressées à Vienne. Elles laissent fort peu d’espoir de conserver la paix. Le manifeste contre le Pacha d’Egypte devait paraître le lendemain. Le Sultan est très malade ; il est attaqué de la poitrine, il ne peut pas durer. La Hongrie donne du souci au Cabinet de Vienne. Il aura là bien de l'embarras.
Le temps est si laid qu'au lieu de promenade on est venu chez moi hier. J’y ai eu longtemps Mad. de Nesselrode Mad. de Talleyrand et le comte Maltzan Ministre de Prusse à Vienne. Il a un peu d'esprit, une préoccupation continuelle des affaires. Et il est très bien informé de tout ce qui ce passe malgré son absence de son poste. Cela me sera une ressource.
2 heures
Je viens de recevoir des lettres de Londres. Bulner m'annonce sa nomination à Paris. Il venait d'écrire à Paul une lettre qu’il croit bonne, il me rendra compte des résultat. Ellice m'écrit aussi ; l’un et l’autre disent que battus ou battant les Ministres resteront. Il n’est pas possible de songer à un changement. La Reine est devenue Whig enragé. Les Torys c.a.d. Wellington & Peel seraient désolés d'une crise, ainsi il y n’y a aucune apparence quelconque qu’elle arrive. Lady Flora Hastings est mourante. Cela fait un très mauvais effet.
5 heures
J’ai vu ce matin chez moi, Mesdames Nesselrode, Talleyran, Albufera, la Redote. J'ai marché par un bien vilain temps. Je viens de faire mon triste dîner toute seule. Voilà un sot bulletin. Adieu, Adieu, tout ce que vous me dites m'intéresse. Je suis avide de toutes les nouvelles et avide surtout de vous. Ne trouvez-vous pas qu’il y a bien bien longtemps que nous sommes séparés, que c’est bien triste ? Ah mon Dieu que c’est triste ! Adieu.
193. Baden, Jeudi 6 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je fais mieux encore que je ne dis. Je suis arrivée à 2 heures, pas. trop fatiguée. J ai trouvé un fort joli logement fort en désordre, il faut passer par un peu d'ennui, je voudrais bien n’avoir à me plaindre que de cela dans ma pauvre vie ! J’ai eu bien de l'émotion en traversant le Rhin, mais cette fois-ci je savais pourquoi ; l'année 36 je n'ai jamais pu le deviner. Je viens de recevoir une lettre du grand Duc, je vous en écrirai copie, une pauvre lettre ; mais enfin c'est du souvenir, c'est tout ce qu'il a à se faire.
5 heures
Voici votre lettre, que je vous remercie ! Je suis triste mais j'essaierai de l'être le moins possible avez-vous eu ma lettre de Sezanne. & de Saverne ? Voyez bien à m'accuser réception de tous mes N°. Voici la lettre du grand duc orthographe & tout.
Londres 19/31 mai 1839
Madame,
Avant de quitter ce pays où vous avez passé tant d’années et où tout ceux que vous ont connu, vous aiment et vous conservent un attachement bien sincères, permettez-moi de vous adresser ce peu de mots pour vous dire, chère Princesse, la peine que j'éprouve de ce que les circonstances ne nous aient pas permis de nous rencontrer. Le séjour que j’ai fait en Angleterre et l'accueil vraiment amical que j’y ai reçu de la part de la Reine, de ses ministres, et je puis le dire avec vérité de le part de tous les partis, me laisseront un souvenir bien agréable pour toute ma vie. Soyez persuadée, Madame que je serais éternellement reconnaissant à la veuve du Prince de Lieven pour l'amitié que son défunt mari n'a jamais cessé de me témoigner et que j'ai su apprécier.
Recevez Madame les assurances des sentiments que je vous ai voués.
Alexandre
Je vais répondre, et vous en aurez copie aussi. Vous ai-je dit qu'Orloff était inquiet de n'avoir rien eu de moi depuis sa lettre. C'est Lady Cowper qui me mande. Je ne sais encore qui est à Baden. Je crois, personne. Au reste je n’ai pas regardé par la fenêtre. Il pleut et fait froid. Bonsoir mais surtout adieu.
Vendredi 7 à 7 heures du matin.
Je me suis coucher à 9 heures levée à 6. J'ai fait une longue promenade pas un beau soleil dans un pays ravissant, j’ai déjeuné et me voici à vous, à vous toujours. Il me semble que je m'arrangerai de ceci très bien pourvu qu'il ne pleuve pas. Vraiment mon logement est charmant, gai, environné de rosiers, d’orangers. Je vous enverrai le dessin, le plan. 2 heures J’ai vu du monde des Russes, que vous ne connaissez pas. M. de Bacourt qui me dit que ma lettre doit être porté de suite à la poste. Adieu donc, adieu, il fait beau, il fait chaud, si vous étiez ici ! God bless you.
189. Paris, Lundi 4 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
186. Lisieux, Samedi 2 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le soleil a beau briller la rivière, a beau couler gaiement devant ma fenêtre ; tout ce qui m'entoure a beau prendre soin de m'animer et de me plaire. Je pense tristement à vous, si triste ! Je me sens seul loin de vous, si seul !
Je vous l'ai dit bien souvent; je puis me répandre au dehors ; je puis paraître, je puis être très occupé, très actif, et que tout cela soit point un mensonge, point un effort, mais très superficiel, très indifférent pour moi, pour ce qui est vraiment moi. Moi, c’est ce qui m’aime et ce que j'aime. Moi, c’est vous, vous de loin vu de près, triste ou gaie, pleurant ou souriant, juste ou injuste même. Mais ne soyez pas injuste ; ne le soyez jamais !
J'ai bien raison d'être triste avec vous. Voilà votre pauvre lettre. C’est bien assez du mal des jours ; les mots devraient être un repos. Je regrette quelque fois que vous ne soyez pas en état et aussi en nécessité absolue de vous fatiguer physiquement. Je l’ai éprouvé ; l'extrême fatigue endort la douleur ; quand le corps s'affaisse, l’âme s’apaise. Paix stérile, paix sans joie, mais qui donne quelque relâche et rend quelque force. Et puis, quand de cruelles images vous assiègent, quand vous n'êtes entourée que de morts, faites un effort, prenez votre élan ; sortez de ces tombeaux. Ils en sont sortis ; ils sont ailleurs. Nous serons où ils sont. Je me suis longtemps épuisé à chercher où ils sont et comment ils y sont. Je ne recueillais de mon travail que ténèbres et anxiété. C’est qu’il ne nous est pas donné, il ne nous est pas permis de voir clair d’une rive à l'autre. Si nous y voyions clair, s'ils étaient là devant nos yeux, nous appelant, nous attendant, supporterions-nous de rester où nous sommes aussi longtemps que Dieu l’ordonne ? Ferions-nous jusqu'au bout notre tâche ? Nous nous refuserions à tout, nous abandonnerions tout ; nous jetterions là notre fardeau, notre devoir, et nous nous précipiterions vers cette rive où nous les verrions clairement. Dieu ne le veut pas, mon amie. Dieu veut que nous restions où il nous a mis, tant qu’il nous y laisse. C'est pourquoi, il nous refuse cette lumière certaine, vive qui nous attirerait invinciblement ailleurs ; c'est pourquoi il couvre d'obscurité ce séjour inconnu où ceux qui nous sont chers emporteraient toute notre âme. Mais l’obscurité ne détruit pas ce qu’elle cache ; mais cette autre rêve où ils nous ont devancés, n'en existe pas moins parce qu'un nuage s'étend sur le fleuve qui nous en sépare. Il faut renoncer à voir dearest, il faut renoncer à comprendre. Il faut croire en Dieu. Depuis que je me suis renfermé dans la foi en Dieu, depuis que j’ai jeté à ses pieds toutes les prétentions de mon intelligence, et même les ambitions prématurées de mon âme, j'avance en paix quoique dans la nuit, et j'ai atteint la certitude, en acceptant mon ignorance. Que je voudrais vous donner la même sécurité la même paix ! Je ne renonce pas, je ne veux pas renoncer à l’espérer.
Midi
Je vais aller voter pour la formation du bureau. Demain, je serai retenu toute la journée, car on veut me nommer Président du Collège. Je ne pourrai probablement vous écrire que quelques lignes. Je les retarderai jusqu’au dernier moment ; il est possible que le scrutin soit dépouillé avant le départ du courrier. Je vous en dirais le résultat. Moi aussi, j’attends. Je viens de recevoir une lettre de M. Jaubert qui me rassure tout à fait sur l’élection de M. Duvergier. D'autant que Jaubert est disposé à voir en noir. Je suis préoccupé de celle de M. Joseph Poirier. J'y tiens et j'en ai toujours été un peu inquiet. Nous verrons. Je ne crains pas grand chose du résultat définitif, quel qu’il soit. Si la victoire ne nous est pas donnée du premier coup, nous aurons certainement de quoi la prendre. Peut-être cela vaudrait-il mieux. En tous cas, je suis résigné et prêt. Adieu. Ne soyez pas trop souffrante, je vous en prie. Mon ambition est bien modeste. Adieu. G.
[Paris], Mercredi 18 mai 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est le sentiment qui m’a accompagné hier toute la soirée, et quand je suis entré dans mon lit et jusqu’au moment où je me suis évanoui dans le sommeil. Je pensais à vous, à ma mère, à mes enfants. Je pouvais mourir. Je n’étais pas seul. Dites-le moi comme je vous l’ai dit, comme je vous le redis. Nous avons été l’un et l’autre bien battus, bien chargés. Nous avons eu et nous aurons jusqu’au bout le cœur bien malade. Mais dans notre mal, c’est un bien immense de nous être rencontrés, et de faire ensemble, hand in hand, ce qui nous reste de chemin. Vous êtes fatiguée, très fatiguée. Appuyez-vous sur moi. Moi aussi, je suis souvent fatigué, plus souvent que je ne le dis ; et j’ai besoin de m’appuyer sur vous, besoin du moins d’être sûr que je le puis si la fatigue me presse trop. Oui, j’ai besoin de vous. Adieu. Farwell. Gots sey mit ihnen. N’y a-t-il pas encore quelque autre manière de vous dire adieu ? Je vous ai beaucoup dit depuis le 15 juin, bien peu pourtant, infiniment peu auprès de ce que j’aurais à vous dire. Chaque jour, à chaque occasion douce ou pénible triste ou gaie, je me sens le cœur plus rempli que jamais. Mais le temps manque, les paroles manquent. Tout manque, excepté le cœur même. Adieu. G.
Ma petite Pauline a fort bien dormi. Elle est mieux ce matin. Ce ne sera rien. Mercredi, 9 heures
Mots-clés : Deuil, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Relation François-Dorothée
172. Val-Richer, Samedi 27 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’étais très fatigué hier soir je ne sais pourquoi. Je me suis couché avant 10 heures. Aussi je me lève à 6. J’ai bien dormi. Je voudrais bien qu’à vous coucher de bonne heure, vous eussiez le même gain. Comment vont vos nerfs ? La lecture en me couchant dans mon lit est pour moi, un moyen de sommeil à peu près infaillible. N’est-il plus du tout à votre usage ? Peut-être pourriez-vous vous faire lire quelques minutes par votre femme de chambre. Du reste, il me semble que ce n’est pas au moment où vous vous couchez que le sommeil vous manque. Ma mère, qui dort très mal et se réveille sans cesse dans la nuit, se rendort souvent en lisant. A la vérité elle a conservé de très bons yeux. Je ne suis pas bien content de sa santé depuis quelque temps. Elle n’est pas encore remise de l’ébranlement que lui a causé la mort de Mad. de Broglie. Je suis bien aise de la ramener à Paris. Ici. avec du temps, les sœurs ne me manqueraient pas ; il y a de bons médecins à Lisieux. Mais pour quelque mal prompt et inattendu, trois ou quatre heures d’attente sont beaucoup trop. Le départ de ma maison a commencé hier. Cette amie de ma mère dont je vous ai quelquefois parlé Melle Chabaud nous a quittés. Elle a été pour mes enfants, pendant tout son séjour d’une bonté aussi utile qu’affectueuse. Je ne puis la remplacer pour le piano d’Henriette, mais je me suis chargé de la leçon d’Anglais d’ici au 5 novembre. Nous lisons ce qui se peut lire de Shakespeare. Je ne voudrais pourtant pas nourrir mes enfants de cette lecture-là, même de ce qu’il y a de bon. C’est trop fort et trop brut. Il y a trop d’émotion et pas assez de perfection. Il faut, à de jeunes esprits quelque chose de plus serein et de plus achevé.
Mad. Graham reprend ses raouts de bien bonne heure. Il y a donc déjà beaucoup d’Anglais à Paris. Vous les aimez toujours beaucoup, c’est sûr ; mais si je ne me trompe, ils sont bien vite usés pour vous. Excepté, Lady Granville, s’entend. J’ai peur que Paris ne soit pour vous comme la cour, selon La Bruyère, " pays où l’on n’est pas toujours bien, mais qui empêche qu’on ne se trouve bien ailleurs. " Les journaux démentent la retraite du comte Woronzoff. ont-ils raison ? Il me semble que l’Orient s’apaise. Pourtant la question a fait un pas. L’Angleterre a jeté un grappin de plus & vous êtes mécontents. Qu’y a-t-il de sérieux dans son traité de commerce avec l’Autriche et dans ces bouches du Danube ? Mettez-vous à cela beaucoup d’importance ? Lord Grey a raison de trouver que son gendre a été indignement abandonné. Mais ni Lord Melbourne, ni Lord John ne pourraient faire autrement. C’est leur situation comme celle de notre cabinet, de faire, ce que d’autres ne voudraient pas faire, de supporter ce que d’autres ne voudraient pas supporter. Vous savez le mot du Prince de Talmont aux soldats qui allaient le fusiller : " J’ai fait mon devoir ; faites votre métier. " Il y a des Cabinets qui font leur devoir, d’autres leur métier.
10 heures
Je vous dirai adieu comme à l’ordinaire, à moins que vous ne vouliez pas. Mais aujourd’hui, en ce moment je ne vous dirai pas autre chose. Moi aussi, je vous blesserais, et je ne veux pas. Adieu. Je ne sais pourquoi il convient à M. de Broglie de dire qu’il n’a jamais songé à bouger de Paris. Non seulement il m’en avait parlé, mais il l’a écrit à ma mère.
170. Val-Richer, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je commence à vous écrire ici. Ce soir et demain matin à Lisieux, je n’aurai pas plus de temps que ce matin. Je suis désolé de l’état de vos nerfs. J’espère que l’indisposition de votre fils ne sera rien, et n’aura d’autre effet que de vous le laisser quelques jours de plus. Je ne puis partir d’ici que le 5 novembre. J’ai fait et je fais force de voiles pour finir je ne sais combien de petites affaires, qui sont pourtant des affaires, et que je ne puis laisser en arrière. Ma mère de son côté m’a demandé jusqu’au 5 pour ses arrangements de ménage. Ces cinq jours de retard me contrarient vivement. Il n’y avait pas moyen. Nous partirons le 5 au soir. Nous arriverons le 6 pour dîner. Je vous verrai le 6, à 8 heures du soir. Nous voilà au moins à jour fixe. Aurez-vous un bon jour en me revoyant ? Je voudrais bien vous égayer vous distraire. Je ferai de mon mieux. Il y a des choses dont je suis sûr. Il y en a d’autres sur lesquelles notre disposition, n’est pas, la même. Les mêmes remèdes ne nous sont pas bons à l’un et à l’autre. Mais, quoique je n’aie plus vingt-cinq ans je persiste à croire beaucoup qu’on trouve ce qu’on cherche et qu’on peut ce qu’on veut. Je chercherai et je voudrai. Vous avez raison de vouloir de l’éclat, de la grandeur. C’est aussi mon gout, très décidé, et l’un des mérites en effet des monarchie. Cependant je ne puis souscrire absolument à votre arrêt. La République romaine a bien eu quelque éclat, et il n’y a pas beaucoup de plus grandes figures que Scipion et Annibal. Il y a république et république, comme aussi monarchie et monarchie. Il me revient que Thiers est fort triste, fort abattu et assez de l’avis que vous me mandiez de Berryer. La tristesse est en général pour Thiers une source de bonne conduite. Nous verrons. Il revient vers le milieu de novembre.
Lisieux, jeudi 9 heures
J’attends votre lettre. Je n’aime pas à attendre dans les auberges. Nulle part le sentiment de la solitude n’est plus vif. C’est ce qui fait qu’il est charmant de voyager avec quelqu’un qu’on aime. Le monde disparaît. On est vraiment seule. Il y a, dans je ne sais plus quel roman de Mad. de Stael, une page où cela est senti et dit à merveille. A propos de Mad de Stael, j’ai écrit ces jours-ci sur l’état des âmes, dans notre temps, quelques pages qui paraîtront dans la Revue française et où j’ai un peu parlé de Mad. de Broglie. On dit bien peu ce qu’on pense quand on pense vraiment quelque chose sur quelqu’un qui le mérite. Je voudrais avoir réussi cette fois. Vous me le direz.
Voilà 173. Toujours aussi nervons. Il fait pourtant beau. Je ne sais pourquoi je dis pourtant, car décidément je n’aime pas les beaux jours d’automne. Je les accepte, j’en jouis même. Mais on n’aime pas, tout ce dont on jouit. On n’aime que ce qu’on préfère. Adieu. Je remonte en voiture. Les dîners me laissent cinq jours de repos jusqu’à mardi. Je donne cette lettre à la poste avec chagrin. Ces cinq jours de retard vous déplairont, comme à moi. Adieu. Adieu. G.
168. Val-Richer, Mardi 23 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève tard. J’ai mal dormi ; pour moi du moins ; pour vous, ce serait probablement une bonne nuit. Vos nuits dépendent de vos jours ; votre santé de votre âme. J’y pense continuellement. Il y a de l’irrémédiable. du moins pour nous ; nous n’y pouvons rien actuellement directement. Les circonstances peuvent amener, là où se décide ce qui vous touche, des raisons de changement qui amèneraient à leur tour le changement. Nous ne les prévoyons pas aujourd’hui ; mais elles peuvent venir. Je le crois unforgiving, implacable, mais non contre son propre intérêt, son moindre intérêt bien clair. Mais il n’y faut pas compter, j’en conviens ; il faut s’arranger comme si cela ne se pouvait pas. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c’est de combien d’affection et de soin j’entourerai, votre solitaire établissement. Je sais tout ce qui vous manque tout ce qui manque à votre cœur, à votre journée. Je sais ce qui m’empêche souvent moi-même de faire tout ce que je voudrais. Mais je veux tant que je ferai beaucoup beaucoup. Je me sens inépuisable pour vous. En fait de monde chez vous, hors de chez vous, en fait de passe-temps vous en aurez à peu près tant que vous voudrez. Votre salon est formé, à présent ; les habitudes sont prises ; la conversation, le petit mouvement social qui vous plaisent ne vous manqueront pas. Voilà pour la surface, au fond dearest, nous comblerons ensemble les vides, nous soignerons ensembles les plaies. Je vous aime tendrement. Le temps, l’absence, la connaissance plus complète de votre caractère, de votre esprit de vous toute entière, tout cela fait que je vous aime toujours autant, plutôt davantage. Vous savez que mes paroles n’exagèrent jamais mes sentiments. Vous savez que je suis doux à vivre. Je le serai pour vous, avec vous, plus que vous ne savez. Il y a bien du vide, bien de l’amertume dans votre situation ; j’y mettrai beaucoup de baume, beaucoup de tendresse. Vous vous souvenez de mon défi, dans nos premiers temps. Vous me direz un jour, si j’avais raison.
J’ai gardé hier mes hôtes jusqu’à cinq heures. Aujourd’hui, je vais dîner à Lisieux, demain aussi. Je mets les morceaux en quatre. Le retour de Lord Durham sera un avènement à Londres. Je ne sais qu’elle position il s’y refera ; mais je comprends que celle de Québec ne lui convienne pas. Revient-il cependant sans attendre son successeur, sans donner à son gouvernement le temps de pourvoir aux affaires du Canada ? Ce serait une boutade d’enfant gâté. Il y est sujet. Les Granville en sont-ils inquiets ? Je crois assez à leur jugement sur la situation, et les chances de leur cabinet. Ils sont éclairés, par une passion, leur désir de rester à Paris. Je la partage pour eux, quoique, non à cause d’eux.
10 heures
Je suis fâché que votre fils vous quitte avant que j’arrive. J’avais espéré qu’il vous resterait encore quelques jours ! Je suis charmé que vous en soyez contente. Ses qualités qu’il a valent mieux plus on en jouit. Je reçois une lettre de M. de Broglie qui me dit qu’en effet il ne vient pas à Broglie. Cela me met à l’aise. Je craignais toujours qu’il ne vint au moment où je veux partir. Il est bien triste, mais il reprend ses occupations intérieures. Il est très content de son fils. Adieu. Je serais en effet très bien aux Tuileries. J’y serai. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
166. Paris, Mercredi 17 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez bien raison, et je suis très fatiguée, et je suis très maigrie, c’est trop pour moi, et je ne me résigne parce que cela va cesser. J’ai passé presque ma journée entière hier avec les Sutherland ; aujourd’hui encore. Après demain ils partent. Je vois même très peu mon fils, heureusement il reste quelque jours de plus. Le Roi de Hanovre me mande que l’Empereur était très triste et a battu à Postdam, on ne sait de quoi. Du reste, il est en santé parfaite.
Je ne m’accorde pas du tout avec vous sur l’Orient. Je ne vois pas à quelle bonne fin, nous perdrions l'Angleterre dans nos conseils sur cette question. Ce n’est pas avec elle qu’elle s’arrangera jamais, ce sera contre elle. Il y a d'autres puissances qui feraient meilleur ménage avec nous sur ce point & vous les connaissez. Mais en attendant que cette affaire arrive au point où il faudra la résoudre. Il est bon qu’elle reste comme elle est. Miraflores vient d'être nommé ambassadeur ici, ce qui le comble de joie. Il n'y avait rien de nouveau hier de Madrid.
Vous savez qu’on a reçu hier la nouvelle que Louis Bonaparte est parti le 14 & qu'il sera le 19 à Londres. C’est donc vraiment fini. Lord Granville a vu le Duc de Broglie hier. Il l’a trouvé extrêmement abattu & changé. Il lui a dit qu'il ne songeait pas à aller à Broglie. Il ne quittera pas Paris. J'ai dîné hier chez Lady Granville ; rien qu'Angleterre, 20 anglais. Je n’ai pas fermé l’œil cette nuit. C'est déplorable. Lady Jersey me mande qu'elle a vu mon mari à Munich, à Innsbruck, et que le grand Duc a parfaitement bonne mine. Adieu, je vous écris en me levant dans la crainte que plus tard je ne trouverai plus un moment. Voyez aussi comme je griffonne. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Politique (France), Politique (Internationale)
165. Val-Richer, Samedi 20 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
157. Paris, Lundi 8 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai vu hier que Palmella et Fagel. J'ai fermé ma porte à tous les autres & le soir on a fait comme on a pu, mais vraiment je me suis sentie trop malade pour recevoir. Je me suis couchée à 9 heures. J'ai un peu mieux dormi et je verrai à me conduire mieux. Je viens de recevoir une lettre très ministérielle de Matonchewitz, qui me laisse croire qu'il viendra me voir secrètement à Paris ou dans les environs, ce qui me fera un grand plaisir. C’est mon premier confident, et privy counciler ; à lui est due ma première révolte. Lui même s’est mal trouvé de ce système. Il a fait une reculade, j'espère ne jamais en faire.
Il fait très froid, très désagréable et les arbres du Tuileries sont de toutes les couleurs hors la vraie. On dit beaucoup que M. de Broglie est dans un désespoir qui rend toute idée d’affaire impossible. M. Decazes raconte qu’il ne quitte pas la Chambre de sa femme, qu’il y conserve le lit ou elle couchait à côté du sien. Enfin pour le moment on assure qu’il n’a pas une autre pensée. Je suis persuadée qu'avant la fin de l’année il en aura bien d’autres, et je trouve très bien et nécessaire qu’un homme se voue plus que jamais à la vie publique lorsque la vie privée à été détruite. Voilà ce que fait qu’un homme vit encore et doit vivre après avoir essuyé les plus grands malheurs et que pour une femme, c'est fort inutile.
J'ai fait des courses ce matin, je m’arrange c’est-à-dire que je me fatigue. Vous me demandez des nouvelles de mon sommeil dans le moment où j’ai un très mauvais compte à vous en rendre. Je m’endors à 10 h. Je me réveille à 3 et tout est fini. C’est trop peu.
Adieu, mon petit cabinet me plait ; je vous y retrouve, partout. Vous y pensez n’est-ce pas ? Adieu. Adieu. Je ne sais ce que j’ai fait de mon papier, je ne retrouve pas mes enveloppes et Félix a trop couru pour que je l'envoie en chercher. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
156. Val-Richer, Mercredi 10 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce que vous me dîtes d’un commencement d’agitation politique à propos de l’Orient, entre Pétersbourg, Londres et Paris ne m’étonne pas. Je ne sais rien ; ce qu’on nous dit, ce qui paraît est plutôt pacifique. Mais je sens quelque chose dans l’air, quelque chose de nouveau et j’en crois souvent plutôt mon instinct que ma réflexion. Probablement ce nouveau-là, n’aboutira à rien comme tout aujourd’hui. Pourtant ce sera un pas. On avance en se traînant. Vous avez bien raison, écrire est un misérable moyen de conversation. J’espère à l’autre. Mais ce ne sera pas de l’Orient que nous parlerons d’abord.
J’aurais voulu voir le lit de justice chez Pozzo. Non que je ne sois accoutumé à ces façons-là de notre Chancelier. Je les lui ai toujours vues. Il a toujours manqué de tact et de vraie élégance. Comme bien des gens aujourd’hui, il supplée en fait d’habilité et d’esprit, à la qualité par la quantité. Il n’a rien de rare, mais, il a beaucoup de ce qui sert tous les jours. Il ne faut pas être lui, mais il est très bon de l’avoir pour soi. A propos, savez-vous que l’hiver dernier, il était jaloux de M. Piscatory auprès de Mad. de Boigne ? Je ne sais si cela recommencera cet hiver.
Jeudi 7 heures
Vous tenez un véritable congrès, Matonchavitz, Alexandre, des arrivants de Naples, de Londres, de Pétersbourg. Quand les fabricants de commérages sur vos grandes intrigues sauront tout cela, ils se croiront bien sûrs de leur fait. Moi, je passe mon temps à intriguer avec Marius, Sylla et César. Et nous nous amusons parfaitement mes enfants, et moi, de l’esprit et des actions de ces intrigants-là. On peut vraiment mettre les plus grandes choses et les plus grands hommes à la portée d’enfants intelligents et accoutumés à entendre parler de tout. M. de Broglie me mande qu’il sera obligé de venir à Broglie du 20 au 25 de ce mois, pour affaires, et qu’il viendra passer 29 heures ici. Il ne voit en effet personne. Mais sa lettre ne porte aucun caractère d’abattement qui est la disposition que je craindrais le plus pour lui. Il ne doit rester à Broglie que trois ou quatre jours. Que les impressions sont diverses ! Il m’a paru pressé de quitter Broglie, et effrayé d’y revenir. J’aurais voulu rester toujours aux mêmes lieux, entouré des mêmes objets, menant la même vie. C’est le changement qui me navre et me révolte après la mort.
Ma mère était un peu souffrante hier, toujours de cette même disposition au mal de tête et au vertige. Je lui ai fait faire une longue promenade dans ces bois, sous ce soleil dont je vous parlais le matin. Elle s’en est bien trouvée. Elle a une merveilleuse disposition à se distraire et à se reposer des émotions fortes par les plaisirs simples. Je fais planter des arbres ; elle regarde, elle conseille ; et cet intérêt qu’elle y prend lui fait plus de bien que toutes les tisanes du monde.
Lady Granville a t-elle fait sa déclaration à Marie. Vous savez que j’en suis curieux. Je ne doute guère de la soumission au premier moment. C’est l’exécution qu’il faut voir. Vous arrive-t-il comme à moi ? Il y a deux époques où je ne me plais guère à vous écrire, et suis en un moment au bout de ce que j’ai à vous dire; c’est quand je viens de vous quitter, et quand j’approche de vous revoir. Entre deux je me résigne, je m’établis. Mais les premiers et les derniers temps sont durs.
10 heures 1/4
Vous aimez les petits mots. J’en ai le cœur plein. Je ne peux pas, vous les envoyer tous. Je vous les apporterai. Adieu, Adieu Moi, j’aime la visite de Mad. de Talleyrand. G.
144. Val-Richer, Vendredi 28 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir parlé de ma mère. Elle a été un peu souffrante. Elle est bien aujourd’hui, quoique très, très affligée. Mad. de Broglie était avec elle filialement. Mais je suis sûr que je vous en ai parlé. Ma mère d’ailleurs a une attitude admirable envers la douleur ; elle la supporte sans s’en défendre. Je n’ai jamais vu personne qui l’acceptât plus complètement sans s’y abandonner, qui en parût plus rempli et moins abattu. Elle y est comme dans son état naturel. Il n’y survient rien de nouveau pour elle et le plus ou le moins ne change pas grand chose à sa disposition, toujours triste mais toujours forte. Je l’ai fait beaucoup promener ces jours-ci. Je l’ai fatiguée. Et puis mes enfants ne la quittent guère. J’ai beaucoup travaillé ce matin. J’avais besoin aussi de me fatiguer. J’en suis convaincu comme vous. On ne comprend que les maux qu’on a soufferts. A ce titre, j’ai bien quelque droit à vous comprendre, pas assez peut-être. Il est vrai que je suis moins isolé. Que ne puis- je vous guérir au moins de ce mal-là ! L’autre resterait. Je l’ai vu rester. Mais ce serait celui-là de moins. Je ferai mieux de ne pas vous écrire ce soir. Je suis si triste moi-même que je ne dois rien valoir pour consoler personne, pas même vous que je voudrais tant consoler, un peu !
Samedi 7 heures
Je suis frappé du peu que nous pouvons, du peu que nous faisons pour les autres, et pour nous-mêmes. Dieu m’a traité plusieurs fois avec une grande faveur. Il m’a beaucoup ôté mais il m’avait beaucoup donné et souvent il m’a beaucoup rendu. J’ai reçu le bien, j’ai subi le mal. J’ai très peu fait moi-même dans ma propre destinée. Nous ne réglons pas les événements. Nous sommes pris dans les liens de notre situation. Nous oublions cela sans cesse. Nous nous promettons sans cesse que nous pourrons, que nous ferons. C’est notre plus grande erreur que l’orgueil de nos espérances. Voilà Louis Buonaparte éloigné. C’est une grande épine de moins dans le pied de M. Molé. La marque, en restera, mais pour le moment, il n’en sent plus la piqûre. Entendez-vous dire que la session soit toujours pour le 15 Décembre ?
Vous êtes bien bonne d’attendre mes lettres avec impatience. Qu’ai je à vous mander ? Point de nouvelles. Mon affection n’en est pas une. De près, tout est bon, la conversation donne une valeur à tout. De loin, si peu de choses valent la peine d’être envoyées !
9. 1/2
Je ne comprends, rien à cette incartade. Est-ce en effet une intrigue cosaque ou bien seulement quelque commérage subalterne qui sera monté haut, comme il arrive souvent aujourd’hui ? Je penche pour cette dernière conjecture. En tout cas, vous avez très bien fait d’aller droit à M. Molé. Il est impossible qu’il ne comprenne pas l’absurdité de tout cela et n’empêche pas toute sottise, au moins de ses propres journaux. Ne manquez pas de me dire la suite, s’il y en a une. Quelles
pauvretés !
Je suis bien aise que vous ayez un N°2. Je vous renverrai demain la lettre de Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Je reçois je ne sais combien de lettres qui me demandent des détails sur cette pauvre Mad. de Broglie. Est-il possible qu’on soit contraint de rabâcher, sur un vrai chagrin. Adieu. G.
143. Longchamp, Dimanche 23 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis ici toute seule et bien triste. Je viens d’apprendre la mort de Mad. de Broglie. Je ne saurais vous dire ce que cela m’a fait éprouver. J’ai versé de silencieuses larmes. L'heureuse femme ! Personne n’a mieux mérité le ciel. Comme elle a été charitable, comme elle a été bonne pour moi. Je lui en ai trop peu montré ma reconnaissance. Mais il me semblait que je l'ennuyais un peu, & cette crainte a fait que je me suis approchée d’elle moins souvent que je ne le désirais. Son pauvre mari ! Quelle perte ! Je viens de sa maison où j’ai appris cette affreuse nouvelle. J’ai traversé le bois de Boulogne en pleurant. J'arrive ici je pleure, et je vous écris parce que j'ai besoin de pleurer auprès de vous.
Lundi
Je vous demande pardon de cette feuille de papier, je n’ai pas trouvé autre chose à Longchamp. Je continue. Votre lettre ce matin est aussi triste que moi. Je pensais bien hier en pleurant, que dans ce même moment vous pleuriez, et à Broglie. Restez y. Dites-moi comment est ce pauvre duc, dites-moi des détails. Je ne pense pas à autre chose. J'ai les yeux bien rouges ce matin. Hier j'ai été obligé de faire les honneurs d’un grand dîner chez M. de Pahlen. J’étais si triste que j'ai bien mal rempli mes devoirs. Le soir il m’a fallu aussi recevoir mon monde habituel. Mais à onze heures j'ai levé la séance, car je n'en pouvais plus. Il m’était venu beaucoup de monde. Ce que j’ai appris de plus nouveau c’est les dernières nouvelles que votre gouvernement a reçu sur Louis Bonaparte. Si la diète lui demande d’opter entre sa qualité de Français & de Suisse, il répondra qu’il est français, et il sortira immédiatement & spontanément de Suisse. Si cette question ne lui est pas posé, il ira établir son quartier général à Genèves. L’affaire Belge est dit-on rompue par le fait du Roi des Pays-Bas c-a-d qu’il ne veut aucune modification aux 24 articles. Ceci était un on-dit mais pas encore officiel. J'ai eu des lettres de Lord Aberdeen, & de M. Ellice. Lord Aberdeen ne comprend pas que l'Angleterre puisse éviter des discussions très sérieux avec la France au sujet du blocus en Amérique, and some procedings au the coast of Africa. Cela lui semble très grave.
Il parle du ministère anglais avec le dernier mépris et il ne croit pas possible qu'il résiste vu de que ce sentiment de mépris devient tout à fait général. Il dit aussi que depuis le protecteur Sommerset il n'y a jamais eu d'homme dans une situation pareille à celle de Lord Melbourne et que son pouvoir sur la Reine est absolu. Ellice n'attend les réponses de Lord Durham que le 8 du mois prochain. Il est d’opinion que Durham restera au Canada j'ai essayé hier de marcher, j'essaierai. encore aujourd’hui.
Mon fils Alexandre ne me reviendra que dans les premiers jours d'octobre. Marie le 7. Je passerai à la Terrasse probablement avant. Le grand duc est à Berlin. Je ne sais que ce fait. Je n’ai pas un mot de mon frère, ni de mon mari. Adieu. Je suis si accablée de cette mort. Je pense tant à cette angélique femme, à son pauvre mari, à votre chagrin car vous en avez beaucoup. Je vous aime, je vous aime de tout mon cœur. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Politique (Europe), Politique (France)
142. Val-Richer, Jeudi 27 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis remis hier à travailler. C’est une grande ressource qui vous manque. Après les plaisirs de l’intimité, je n’en connais pas de plus efficace pour distraire, et même reposer d’une impression douloureuse. Avant de m’enfermer dans mon cabinet, j’ai fait faire une longue promenade à ma mère. Elle est très affligée. Mad. de Broglie avait pour elle un respect, une affection, une confiance filiale, et les lui témoignait avec un extrême abandon. Ma mère en était très touchée depuis trois jours elle me répète sans cesse : " Prendre une telle amitié à mon âge, pour une cette fin ! "
J’ai une profonde pitié des chagrins de la vieillesse. Elle a droit au repos du cœur comme du corps. D’ailleurs ils sont rares. L’âge refroidit les peines comme les joies. Il n’en est rien pour ma mère. Elle a le cœur aussi vif qu’il y a quarante ans. Je l’ai fait marcher une heure et demie. Elle en était un peu lasse hier soir, mais beaucoup plus calme. Je suis sûr qu’elle aura mieux dormi.
Je ne crois guère à l’émeute de Genève. Ce serait un grand argument contre la politique dont se charge M. Molé ; Genève est une ville française. Il y faut je ne sais quel degré d’irritation pour qu’on y éclate contre les Français. M. de Metternich doit sourire, un peu. Thiers travaille aussi. Mais au fond, d’après ce qui me revient, il est très animé et se propose de le témoigner à la prochaine session. Nous verrons bien. Il restera en Italie jusqu’au mois de novembre. Ce sera le moment du retour universel.
Je serai bien aise de retrouver les Holland à Paris autant qu’un plaisir peut être quelque chose à côté d’un bonheur. Vous devriez bien d’ici là rassembler tout ce qui vous reste de ce que vous avez écrit sur tout ce que vous avez fait ou vu. Je suis sûr qu’il y a je ne sais combien de choses, petites ou grandes, que je ne connais pas. J’ai envie de toutes. Le papier sur la mort de Lord Castlereagh est-il décidément perdu ? Faites cela en rentrant à la Terrasse. Là où je suis indifférent, je ne suis pas curieux. Mais où est mon affection, ma curiosité est insatiable. J’ai beaucoup plus envie du moindre petit papier que de Lady Burgherch. Les femmes distinguées manquent partout. L’Angleterre ne m’a encore montré que Lady Granville, et si vous voulez, Lady Clanricard. A propos, vous ne m’avez pas envoyé sa lettre.
10 h. ¼
Mon facteur arrive tard ce matin. Je n’ai pas de nouvelles de Broglie, ce qui me prouve qu’Albert n’est pas arrivé. Je suis impatient qu’il ait rejoint son père. J’avais pensé à votre prédiction. Je vous remercie de vous ménager. La fatigue ne vous vaut. rien. Soignez-vous pour le mois de novembre. Je ne comprends pas qu’on se laisse mal traiter par Lady Holland. Passe pour son mari, s’il l’aime. Car il faut aimer pour supporter. Du reste les impertinents ont raison puisqu’on les supporte. Je vous conseille d’écrire à votre mari. Toutes les fois qu’il renoue le fil, n’importe pourquoi vous devez le ressaisir. Vous l’avez dispensé d’explication. Cela vous dispense de reproche. Les confidences de Mlle Henriette ne tracassent donc plus Marie. Adieu. Tout à l’heure, en lisant votre adresse en Courlande, j’ai eu envie de vous répondre par la première phrase de mon testament. Je ne le ferai pas. Adieu. G.
141. Val-Richer, Mercredi 26 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai cette pauvre femme devant les yeux. Je l’ai vue sur son lit de mort. Elle n’était pas changée du tout, les traits parfaitement calmes et l’air jeune. Elle est morte pourtant à la suite d’un long délire, d’un délire de plusieurs jours, mais sans violence, sans idée fixe ; rien n’indiquait un grand trouble intérieur. Toute sa vie repassait devant elle, sa mère, ses frères, sa fille Pauline, ceux qu’elle avait perdus, ceux qui lui restaient confusément, rapidement, en général doucement. Elle a souvent parlé de moi ; elle causait avec moi. Dès l’invasion du mal, sa faiblesse était extrême ; elle se soulevait à demi, joignait les mains et commençait une prière qu’elle n’achevait pas. Elle s’est crue très malade dans les premiers jours ; puis cette idée lui a passé. Elle désirait beaucoup de guérir. Elle se trouvait mieux depuis un an ou deux ans, et infiniment plus calmes qu’elle n’avait jamais été. Elle ma dit bien des fois : " La jeunesse ne m’allait pas ; à mesure qu’elle s’en va, je me sens plus de force et de sérénité. " Elle a fait un testament qui n’est pas encore ouvert. Je serais resté plus longtemps avec son mari si j’avais dû le laisser seul. Mais sa belle sœur est arrivée et il attendait son fils hier soir ou ce matin. Il sera à Paris dans quatre on cinq jours, et n’ira pas à plus de 20 ou 30 lieues au devant de sa fille. Il est calme.
Il m’a beaucoup touché hier matin. Tous les jours, avant le déjeuner, la famille faisait la prière dans la bibliothèque. On lisait un chapitre de l’évangile, une ou deux pages de méditations pieuses et l’oraison dominicale. C’était mad. de Broglie, qui lisait. Il a fait recommencer hier et l’a remplacée. J’espère que sa fille viendra vivre avec lui. Cependant il y a des obstacles. M. d’Haussonville, a aussi son père et sa mère qui sont vieux et sourds. Albert de Broglie sera beaucoup pour son père. Il est distingué et affectueux.
Vous vouliez des détails. Je me repose ici. J’ai le cœur fatigué. Vos lettres sont bien bonnes. Mais ne vous laissez pas aller à pleurer. Vos pauvres yeux n’en ont pas besoin.
9 heures.
Je viens de passer une demi heure, avec mes enfants dans mon cabinet. Il m’aiment beaucoup. Je mentirais si je disais que votre pensée me les gâte ; non, je jouis beaucoup de leur présence, de leur affection. Mais votre pensée est toujours là, toujours. Je vous aime beaucoup. J’ai besoin de tout ce qui vous manque. Que ne puis je vous faire jouir de mon bien comme je souffre de votre mal ? Mon petit Guillaume à le meilleur cœur du monde. Quand il me voit triste, il redouble autour de moi de gaieté et de caresses. Et s’il ne réussit pas à me distraire, il s’arrête tout à coup, un peu confus, comme s’il avait fait une sottise.
Je vois que j’ai deviné juste, sur l’expédient que la suisse prendra envers Louis Buonaparte. On lui posera la question. Elle a été inventée dans le dessein. Si on ne la lui pose pas, il aura tort de transporter son quartier général à Genève. Genève n’est pas un canton radical malgré le vote de son député à la Diète. Thurgovie au Bâle campagne lui conviennent mieux. Je ne crois à aucune querelle sérieuse, pas même par lettres, pour le blocus mexicain ou la côte d’Afrique. Ni l’un ni l’autre Cabinet ne veut se quereller. Ils ont bien assez de peine à vivre. Cependant je ne crois guère non plus aux pronostics de Lord Aberdeen. L’Irlande ! L’Irlande tant que cette question-là ne sera pas vidée, les Whigs et les radicaux tiendront ensemble.
10 heures
Adieu. Le temps est mauvais en effet. Nous n’avons pas eu d’été. Pardonnez-moi la tache qui vient de se faire, je ne sais comment, sur cette lettre. Je serai bien aise de vous savoir à Le Terrasse. Adieu. Adieu. G.
140. Broglie, Lundi 24 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens d’accompagner le cercueil avec toute la population des environs vraiment éplorée. Elle est enterrée aux pieds de sa fille Pauline. Deux excellentes et charmantes créatures ! Il y a quatre ans, je suis entré dans ce cimetière, avec mon fils qui regrettait profondément cette jeune fille, et à qui Mad. de Broglie, avait donné la clef de la petite enceinte qui leur est réservée.
Bientôt, je n’aurai plus personne à qui parler de mon passé personne qui l’ait connu et aimé. La mort emporte bien plus qu’il ne paraît. Quelque chose m’a manqué dans ce cimetière, de la prière, un prêtre. Il n’y a ici que des catholiques. Toute la population était bien là, mais des prêtres, non. J’ai eu envie de les remplacer, de prier tout haut. Je ne l’ai pas fait. Je ne supporte pas la mort sans Dieu. Quand une âme s’en va, il faut qu’il soit là pour la recevoir. Je retourne auprès de ce pauvre homme qui est très courageux, mais vraiment bien désolé. Est-ce que je vous fais mal en vous disant ce qui me traverse l’âme ? J’espère que non.
5 heures
Mad. de Stael vient d’arriver. Elle a fait 170 lieues sans s’arrêter. Il est trop tard. C’est une bien malheureuse personne. Elle a tout entrevu, mari, enfants, sœur, bonheur intime, bonheur extérieure, et n’a rien entrevu que pour le perdre ! Je retourne demain chez moi. Je partirai après déjeuner. Je n’ai pas eu votre lettre aujourd’hui. Je l’aurai demain matin, et j’en trouverai une autre en passant à Lisieux. Si les accidents n’ont pas cessé, tenez-vous bien bien tranquille. Lady Granville a encore raison. L’immobilité est le vrai remède. Je lui sais gré d’être toujours aussi aimable pour moi. Elle vous le doit bien. Vous lui êtes de si bon secours pour amuser son mari !
Mardi 7 heures
Je n’ai jamais vu un tel rideau de pluie, si épais qu’il cache absolument la campagne. Peu importe du reste dans ce lieu-ci. Le soleil n’y égaierait personne. Le soleil reviendra. Ceux qui sont tristes s’en iront. Et un jour, je ne sais quand, mais pas loin, car rien n’est loin, tout passe si vite, on se plaira, on sera gai, dans ce lieu-ci comme ailleurs.. J’ai horreur de cette brièveté de toutes choses. Pas toutes n’est-ce pas ? Albert arrive aujourd’hui. Le pauvre enfant sait à peine le danger. Il aimait tendrement sa mère. Dès qu’il sera arrivé ils partiront tous pour Paris, et de là le Duc de son fils iront au devant de Mad. d’Haussonville. Je vais me retrouver seul chez moi. J’en suis bien aise. J’ai vu assez de monde. Trois ou quatre personnes doivent encore venir, mais dans huit ou dix jours seulement.
Adieu.
J’ai besoin de vos lettres. Comment former une conjecture sur ce que fera ou ne fera pas M. de Lieven ? Ses liens avec vous, sa qualité de mari, de père, de gentleman, tout cela n’entre pour rien dans sa conduite. Un autre décide de tout ; et cet autre qui peut deviner sa fantaisie, son humeur du moment. Il y a deux vices radicaux dans la nature humaine, la légèreté et l’arrogance. La situation despotique les développe l’un et l’autre au delà de que ce qui se peut imaginer. On ne vous écrira pas. Et puis on vous écrira. Il n’y a à compter sur rien. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
Mots-clés : Deuil, Discours du for intérieur, Vie familiale (Dorothée)
139. Broglie, Lundi 24 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai trouvé ce malheureux homme désolé et soumis. Je passerai ici deux jours jusqu’à ce que son fils Albert, qui voyageait pour son plaisir soit arrivé demain, ou après-demain. Dès qu’il aura son fils, il ira avec lui au devant de sa fille, dont les lettres arrivent encore pleines des fêtes de Milan. Le maladie a été une fièvre cérébrale, très rapide à la fin. Le délire a été à peu près constant pendant les derniers jours avec plus de souffrance apparente que réelle. J’avais pour elle une vrai amitié et elle en méritait beaucoup. Tout le pays est désolé. Elle faisait un bien immense, & bien plus encore avec son âme qu’avec son argent. Elle s’est crue en grand danger au commencement, quand personne ne le croyait. Plus tard ; elle n’y croyait plus. Je n’ai pas encore votre lettre d’aujourd’hui. J’espère qu’elle me viendra dans la journée, demain matin au plus tard. J’ai besoin de l’avoir. Adieu. Je retourne auprès de ce pauvre homme. Les obsèques ont lieu ce matin, tout à l’heure. Elle restera à Broglie.
Adieu Adieu.
Mots-clés : Deuil
126. Val-Richer, Lundi 10 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’aurai le cœur en paix que lorsque, vous aurez reçu mon démenti à votre tristesse qu’elle que soit ma phrase, et à ma phrase qui ne méritait certainement pas votre tristesse mais qui en tous cas ne valait rien puisqu’elle l’a causée Le Cardinal de Pretz dit quelque part qu’il y a des situations où l’on ne peut faire que des fautes. Il y en a aussi où l’on ne peut rien dire que de triste et d’attristant. J’avais bien ce sentiment-là en vous écrivant Vendredi. Je vous trouvais si abattue, si inquiète, et moi si impuissant pour vous guérir, que j’ai été tout à coup à la dernière extrémité de votre mal et du mien.
Quand j’aime, je prends toujours au pied de la lettre ce qu’on me dit et je crois toujours que cela durera. Je n’ai pas l’instinct de ce qui passe. La réflexion seule me l’apprend. Et puis, résignez-vous à ne me voir jamais résigné à vos mauvais moments, à ces moments qui me font douter de ce que je suis et puis pour vous. Je ne veux rien ôter à personne. Je ne veux rien envier à personne. J’aime tous vos sentiments, oui je les aime, et je vous aime vous, de les avoir tels. Vous ne savez pas pour combien l’état de votre âme, le deuil de votre âme et de votre personne est entré dans l’affection que je vous porte. S’il y a en moi quelque chose de profond, c’est mon aversion pour la légèreté de cœur, pour la promptitude de l’oubli, pour ces sentiments qui dans le vol de notre vaisseau tombent à la mer et s’y abîment avec les créatures qui en sont l’objet. Je déteste cela en moi, quand je l’y trouve, comme dans les autres. Je ne sais comment parviennent à se concilier des sentiments qui existent ensemble dans mon âme. Il y a là un mystère que je ne m’explique pas du tout qui m’a bien souvent tourmenté ; mais Dieu m’est témoin qu’ils existent ensemble, et que l’un n’abolit point l’autre, et que la mémoire de ceux que j’ai aimés est en moi, toujours présente et toujours chère. Et quand je rencontre un cœur qui n’oublie point, un cœur où les morts vivent, je me sens à l’instant pénétré pour lui de sympathie et de respect. Vous avez eu, pour moi, à ce titre seul, un attrait immense. Et il s’est toujours accru plus je vous ai connue. Dans les premiers temps, il a surmonté les doutes qui me venaient à votre sujet, soit de moi-même, soit de ce que j’entendais dire. Plus tard, il m’a fait vous pardonner ce qui m’affligeait ce qui me blessait. Il existe aujourd’hui aussi puissant, bien plus puissant que ce jour où j’ai dîné à côté de vous chez le Duc de Broglie, et où votre regard, deux ou trois fois troublé et plein de larmes au milieu d’une conversation insignifiante, m’a frappé et pénétré jusqu’au fond de l’âme. N’ayez donc jamais, dans aucun cas, pas une minute, le moindre doute sur mon inépuisable, mon infatigable sympathie pour votre mal. Quand Dieu ne m’aurait pas condamné à le ressentir pour moi-même et à le ressentir en ne vous en parlant presque jamais, à cause de vous, je trouverais en moi, dans ma disposition la plus intime de quoi vous comprendre, et m’unir à vous et vous en aimer toujours davantage. Croyez-le bien, croyez-le toujours ; et en même temps laissez-moi toute mon ambition sur vous auprès de vous. Résignez-vous à ses exigences à ses susceptibilités. Je n’y puis rien. Je n’y veux rien pouvoir. Si j’y pouvais quelque chose, vous ne seriez pas pour moi ce que vous êtes. Voulez-vous être moins?
10 heures
Le N°130 m’arrive avec trois personnes qui viennent me demander à déjeuner. Je voudrais ajouter beaucoup de choses à celui-ci. Il n’y a pas moyen. Adieu. Adieu. Votre mine m’importe beaucoup. Mais toujours, le même adieu. G.