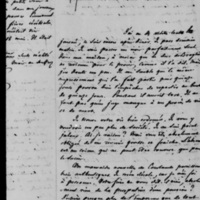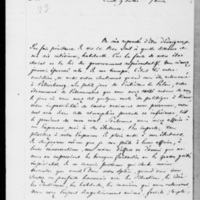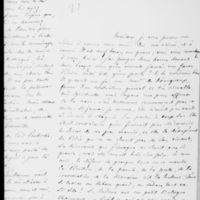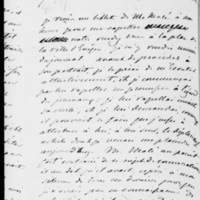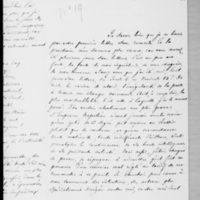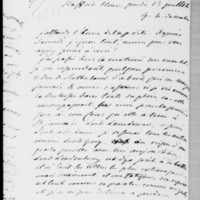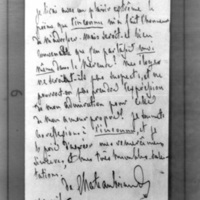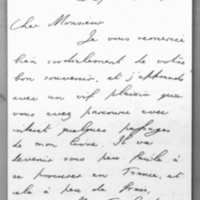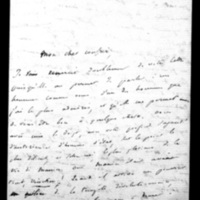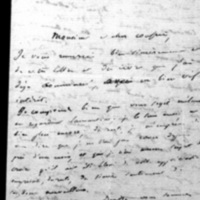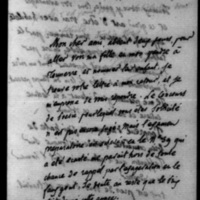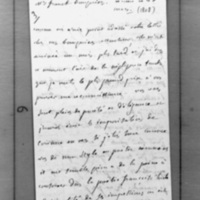Votre recherche dans le corpus : 23 résultats dans 6063 notices du site.
Trier par :
197. Val-Richer, Dimanche 16 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
197 Du Val-Richer. Dimanche 16 Juin 1839 9 heures
J’ai eu des visites toute la journée, ce soir encore après dîner. Je pars demain matin. Je vais passer un mois parfaitement seul dans ma maison ; à moins que le Duc de Broglie ne revienne pour le procès, comme il l'a dit. Mais j'en doute un peu. Il me semble que le même empressement qui l’a fait partir pour quinze jours pourra bien l'empêcher de repartir au bout de quinze jours. Pourtant il aurait tort. Il ne faut pas qu’un juge manque à un procès de vie et de mort.
Je trouve votre vie bien ordonnée. Je vous y voudrais un peu plus de société. Je ne suis point jaloux. Ai-je raison ? Mais vous êtes absolument obligée de me revenir grasse et fraîche. L'absence est un crime qui ne peut-être couvert que par le succès.
Vos mauvaises nouvelles de Courlande paraissent bien authentiques. Je m'en désole, car je n'ai foi à personne. Votre frère ne vous dit-il rien, absolu ment rien de la perspective d'une pension ? J'espère presque plus de l'Empereur que de tout autre. Je ne croirai jamais qu’il soit impossible aux trois hommes qui l’entourent de faire luire dans son cœur, s'ils le veulent, un éclair de justice et de générosité.
Lundi 9 heures
Je me lève par le plus beau soleil. Si je devais vous revoir, demain, je serais aussi gai que le soleil. Voilà la première fois depuis deux ans que je vais à Paris sans vous y retrouver. Quel ennui de partir quand on n'a pas envie d’arriver ! C’est bien deux ans, avant hier 15 Juin. Comment n’y a-t-il que deux ans ? Il me semble que c’est toute une vie.
Eternité, néant, passé, sombres abymes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez ; nous rendrez-vous les extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
C’est M. de Lamartine qui dit cela. Vous savez que j’aime la poésie. Elle entre et reste très avant dans ma mémoire. Elle agit sur moi comme un écho de l'âme. Elle me rend des sons que j'ai entendus. J’aime mieux la voix que l’écho. Pourtant l’écho est très doux. Mon fils aimait passionnément la poésie. Et sans y porter cette disposition un peu vague et romanesque de la jeunesse. C’était l’esprit le plus net et le plus simple du monde, choqué par instinct dès qu’il apercevait du brouillard ou de l'emphase ; mais d’un cœur si élevé et si délicat, d'une nature si parfaitement élégante et rare que la poésie lui allait d'elle-même et comme par une harmonie spontanée. Je n'ai vu aucune créature, qui semblât créée à ce point pour plaire ! Et c’est à moi seul qu’il a plu. J’ai connu seul le parfum charmant de cette fleur ! C'est l’un de mes plus amers regrets. Il me semble que je l’aurais moins perdu si d’autres en avaient joui comme moi.
9 h. 1/2 Le numéro 196 me désole. Je les ai tous reçus, aucun si triste. J’espérais, et je veux encore espérer mieux du lait d’ânesse, des bains de son, de tout ce régime doux et tranquille. En grâce, si votre médecin persiste à le croire bon, ne le cessez pas parce que vous vous trouvez plus souffrante un jour ou deux. Il faut bien accepter ces mauvaises alternatives. Je n’ai pas la superstition des médecins. J'y crois pourtant un peu plus qu'à notre ignorance. Je craignais bien la solitude de Baden. Vous ne supportez pas la société médiocre et vous avez raison. Il est si rare d'en rencontrer une autre !
Madame de Talleyrand travaille à se désintéresser de toutes choses, à ne penser qu'à elle-même à ses affaires, à ses conforts, à ses habitudes. Ce n’est pas une manière d'animer les autres. Moi aussi, je trouve que nous nous disons peu de chose. Adieu. Adieu.
J’ai une foule de petits soins à prendre avant de partir. Je trouve dans mes journaux de ce matin une triste nouvelle. Ce pauvre Emmanuel de Grouchy est mort à Turin d’une fièvre cérébrale. J’avais de l’amitié pour lui, et il m'était très dévoué. Il s’était marié il y a 18 mois. Il était heureux. Adieu encore. J'aime mille fois mieux une sotte réalité que mille fictions. Adieu pourtant. Mais ne souffrez pas ; ne maigrissez pas. G.
J’ai eu des visites toute la journée, ce soir encore après dîner. Je pars demain matin. Je vais passer un mois parfaitement seul dans ma maison ; à moins que le Duc de Broglie ne revienne pour le procès, comme il l'a dit. Mais j'en doute un peu. Il me semble que le même empressement qui l’a fait partir pour quinze jours pourra bien l'empêcher de repartir au bout de quinze jours. Pourtant il aurait tort. Il ne faut pas qu’un juge manque à un procès de vie et de mort.
Je trouve votre vie bien ordonnée. Je vous y voudrais un peu plus de société. Je ne suis point jaloux. Ai-je raison ? Mais vous êtes absolument obligée de me revenir grasse et fraîche. L'absence est un crime qui ne peut-être couvert que par le succès.
Vos mauvaises nouvelles de Courlande paraissent bien authentiques. Je m'en désole, car je n'ai foi à personne. Votre frère ne vous dit-il rien, absolu ment rien de la perspective d'une pension ? J'espère presque plus de l'Empereur que de tout autre. Je ne croirai jamais qu’il soit impossible aux trois hommes qui l’entourent de faire luire dans son cœur, s'ils le veulent, un éclair de justice et de générosité.
Lundi 9 heures
Je me lève par le plus beau soleil. Si je devais vous revoir, demain, je serais aussi gai que le soleil. Voilà la première fois depuis deux ans que je vais à Paris sans vous y retrouver. Quel ennui de partir quand on n'a pas envie d’arriver ! C’est bien deux ans, avant hier 15 Juin. Comment n’y a-t-il que deux ans ? Il me semble que c’est toute une vie.
Eternité, néant, passé, sombres abymes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez ; nous rendrez-vous les extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
C’est M. de Lamartine qui dit cela. Vous savez que j’aime la poésie. Elle entre et reste très avant dans ma mémoire. Elle agit sur moi comme un écho de l'âme. Elle me rend des sons que j'ai entendus. J’aime mieux la voix que l’écho. Pourtant l’écho est très doux. Mon fils aimait passionnément la poésie. Et sans y porter cette disposition un peu vague et romanesque de la jeunesse. C’était l’esprit le plus net et le plus simple du monde, choqué par instinct dès qu’il apercevait du brouillard ou de l'emphase ; mais d’un cœur si élevé et si délicat, d'une nature si parfaitement élégante et rare que la poésie lui allait d'elle-même et comme par une harmonie spontanée. Je n'ai vu aucune créature, qui semblât créée à ce point pour plaire ! Et c’est à moi seul qu’il a plu. J’ai connu seul le parfum charmant de cette fleur ! C'est l’un de mes plus amers regrets. Il me semble que je l’aurais moins perdu si d’autres en avaient joui comme moi.
9 h. 1/2 Le numéro 196 me désole. Je les ai tous reçus, aucun si triste. J’espérais, et je veux encore espérer mieux du lait d’ânesse, des bains de son, de tout ce régime doux et tranquille. En grâce, si votre médecin persiste à le croire bon, ne le cessez pas parce que vous vous trouvez plus souffrante un jour ou deux. Il faut bien accepter ces mauvaises alternatives. Je n’ai pas la superstition des médecins. J'y crois pourtant un peu plus qu'à notre ignorance. Je craignais bien la solitude de Baden. Vous ne supportez pas la société médiocre et vous avez raison. Il est si rare d'en rencontrer une autre !
Madame de Talleyrand travaille à se désintéresser de toutes choses, à ne penser qu'à elle-même à ses affaires, à ses conforts, à ses habitudes. Ce n’est pas une manière d'animer les autres. Moi aussi, je trouve que nous nous disons peu de chose. Adieu. Adieu.
J’ai une foule de petits soins à prendre avant de partir. Je trouve dans mes journaux de ce matin une triste nouvelle. Ce pauvre Emmanuel de Grouchy est mort à Turin d’une fièvre cérébrale. J’avais de l’amitié pour lui, et il m'était très dévoué. Il s’était marié il y a 18 mois. Il était heureux. Adieu encore. J'aime mille fois mieux une sotte réalité que mille fictions. Adieu pourtant. Mais ne souffrez pas ; ne maigrissez pas. G.
82. Val-Richer, Lundi 9 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (28 Juin- 29 Juillet)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°82. Lundi 9 Juillet, 7 heures
On m’a reproché d’être dédaigneux. J’en fais pénitence. Je vis ici Dieu sait à quelle distance de ma vie intérieure, habituelle. C’est la faute de notre état social et la loi du gouvernement représentatif. Vous n’avez jamais éprouvé cela. Je me trompe. C’était là votre, condition, et aussi votre sentiment quand vous êtes retournée à Pétersbourg. Les petits jeux de l’intérieur du Palais, votre étonnement de l’étonnement que vous avez excité autour de vous le jour où vous avez dit quelques mots de politique à dîner. Votre impossibilité de causer vraiment avec personne votre mal aise dans cette atmosphère pesante et inférieure, c’est le pendant de mon mal. Seulement vous aviez affaire à un Empereur, moi à des électeurs. Peu importe. Vous plaisiez à votre Empereur. Je plais aussi à mes électeurs. Je soupçonne même que je me prête à leurs affaires, à leurs conversations, avec moins d’effort et d’ennui que ne vous en imposaient les brusques fantaisies, ou les grosses gaietés impériales. Je ne connais personne qui sache moins descendre que vous.
Dans votre sphère, quand vous vous sentez en parfaite harmonie avec les situations, les idées les sentiments, les habitudes, les manières qui vous entourent vous avez l’esprit singulièrement animé, fertile souple ; vous êtes pleine de facilité, de laisser aller. Mais vous ne pouvez pas du tout vous dépayser. Sur tout autre échelon, dans tout autre air, vous êtes comme sous la machine pneumatique, mal à l’aise, froide immobile. Vous êtes, en fait, d’élévation et de tous les genres d’élévation, ce qu’on appelle aujourd’hui une spécialité. Vos habitudes sont devenues, votre nature. Restez comme vous êtes. Ce que vous avez me charme, et je ne vous désire point ce qui vous manque.
Je suis bien aise qu’Emilie Flahaut se marie bien. Mais c’est triste d’épouser un mari qui mourra dans deux ans. Si elle l’aime ? Est-ce qu’il est menacé de la maladie de Lord Kerry ? Qu’est devenue Lady Kerry ? Est-elle morte aussi ? Elle avait bien un air à mourir. Je n’ai jamais vu de structure si frêle et de blancheur si pâle. Voilà un singulier effet d’imagination. Je vous croyais en Angleterre. Je vous écrirais à Londres. J’allais vous prier de faire mes amitiés à Lord Landsdown. C’est un souvenir de l’an dernier. Et aussi un effet de ce que depuis quelques jours, vous passez comme vous dîtes, votre vie, en Angleterre. Je la regretterai bien pour vous dans quelques jours.
J’espère que vous verrez aujourd’hui, le Duc de Broglie. Je le désire. Je le verrai après-demain. Que nous sommes enfants ! Nous avons bien raison. C’est la vie que ces enfantillages-là. Je voudrais bien voir ce qu’elle serait si on les en retranchait tous, tous absolument. Mais j’aime mieux les enfantillages de près et sans intermédiaire. Dans un poète persan qui s’appelle Saadi, un voyageur s’arrête auprès d’une fleur : " Fleurs d’un parfum si doux, es-tu la rose ? - Non, mais j’ai vécu près d’elle. "
10 heure ¼
Votre n°85 est bien triste, triste pour vous, triste pour moi. De près, votre tristesse m’est douloureuse de loin intolérable. Mais pourquoi dit-on intolérable quand on tolère ? Et puis, ne m’en veuillez pas d’être triste aussi pour moi. Il faut me pardonner mon immense exigence. Adieu Adieu. G.
On m’a reproché d’être dédaigneux. J’en fais pénitence. Je vis ici Dieu sait à quelle distance de ma vie intérieure, habituelle. C’est la faute de notre état social et la loi du gouvernement représentatif. Vous n’avez jamais éprouvé cela. Je me trompe. C’était là votre, condition, et aussi votre sentiment quand vous êtes retournée à Pétersbourg. Les petits jeux de l’intérieur du Palais, votre étonnement de l’étonnement que vous avez excité autour de vous le jour où vous avez dit quelques mots de politique à dîner. Votre impossibilité de causer vraiment avec personne votre mal aise dans cette atmosphère pesante et inférieure, c’est le pendant de mon mal. Seulement vous aviez affaire à un Empereur, moi à des électeurs. Peu importe. Vous plaisiez à votre Empereur. Je plais aussi à mes électeurs. Je soupçonne même que je me prête à leurs affaires, à leurs conversations, avec moins d’effort et d’ennui que ne vous en imposaient les brusques fantaisies, ou les grosses gaietés impériales. Je ne connais personne qui sache moins descendre que vous.
Dans votre sphère, quand vous vous sentez en parfaite harmonie avec les situations, les idées les sentiments, les habitudes, les manières qui vous entourent vous avez l’esprit singulièrement animé, fertile souple ; vous êtes pleine de facilité, de laisser aller. Mais vous ne pouvez pas du tout vous dépayser. Sur tout autre échelon, dans tout autre air, vous êtes comme sous la machine pneumatique, mal à l’aise, froide immobile. Vous êtes, en fait, d’élévation et de tous les genres d’élévation, ce qu’on appelle aujourd’hui une spécialité. Vos habitudes sont devenues, votre nature. Restez comme vous êtes. Ce que vous avez me charme, et je ne vous désire point ce qui vous manque.
Je suis bien aise qu’Emilie Flahaut se marie bien. Mais c’est triste d’épouser un mari qui mourra dans deux ans. Si elle l’aime ? Est-ce qu’il est menacé de la maladie de Lord Kerry ? Qu’est devenue Lady Kerry ? Est-elle morte aussi ? Elle avait bien un air à mourir. Je n’ai jamais vu de structure si frêle et de blancheur si pâle. Voilà un singulier effet d’imagination. Je vous croyais en Angleterre. Je vous écrirais à Londres. J’allais vous prier de faire mes amitiés à Lord Landsdown. C’est un souvenir de l’an dernier. Et aussi un effet de ce que depuis quelques jours, vous passez comme vous dîtes, votre vie, en Angleterre. Je la regretterai bien pour vous dans quelques jours.
J’espère que vous verrez aujourd’hui, le Duc de Broglie. Je le désire. Je le verrai après-demain. Que nous sommes enfants ! Nous avons bien raison. C’est la vie que ces enfantillages-là. Je voudrais bien voir ce qu’elle serait si on les en retranchait tous, tous absolument. Mais j’aime mieux les enfantillages de près et sans intermédiaire. Dans un poète persan qui s’appelle Saadi, un voyageur s’arrête auprès d’une fleur : " Fleurs d’un parfum si doux, es-tu la rose ? - Non, mais j’ai vécu près d’elle. "
10 heure ¼
Votre n°85 est bien triste, triste pour vous, triste pour moi. De près, votre tristesse m’est douloureuse de loin intolérable. Mais pourquoi dit-on intolérable quand on tolère ? Et puis, ne m’en veuillez pas d’être triste aussi pour moi. Il faut me pardonner mon immense exigence. Adieu Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Interculturalisme, Poésie, Portrait (Dorothée), Réseau social et politique
61. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°61. Mardi 17 9 heures 1/4
Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !
Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.
Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.
Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.
Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.
Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.
Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.
11 H.
J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.
Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !
Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.
Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.
Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.
Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.
Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.
Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.
11 H.
J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Amour, Discours du for intérieur, histoire, Poésie, Portrait, Protestantisme, Religion
46. Paris, Vendredi 22 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
46. Vendredi 22 Septembre. 6 heures
Je reçus un billet de M. Molé à une heure pour me rappeler notre rendez-vous à la place de la ville l’Evêque. Je m’y rendis munie du journal. Avant de procéder à son portrait, je le priai de m’écouter attentivement, et je commençai par lui rappeler ses promesses à l’égard des journaux ; je lui rappelai ensuite sa visite, et je lui demandai, comment il pouvait se faire que j’eusse à attribuer à lui, à lui seul, le déplaisant article dont je venais me plaindre aujourd’hui. M. Molé me parût fort contrarié de ce sujet de conversation. Il me dit qu’il avait espéré à mon silence de tous ces derniers jours que je n’avais pas en connaissance de cet article, qu’il n’en avait pas dormi de 48 heures, qu’il comprenait mes reproches, & qu’il me donnait sa parole d’homme qu’il n’avait rien à se reprocher que d’avoir dit devant Pozzo qu’il m’avait trouvé malade & & qu’il reconnaissait bien à cette indiscrétion, qu’il avait eu parfaitement tort de le dire même à lui, mais qu’il me conjurait de croire qu’il était plus que malheureux de cet abominable article, qu’il lui était défavorable politiquement même, puisqu’il était de nature à vous blesser et de la façon la plus ungentlemanlike qui se puisse, que c’était du plus mauvais goût, de la plus maladroite intuition, enfin il ne tarit pas sur ce sujet. Je lui observai, que ce n’était pas de vous que j’étais venu lui parler ; que j’ignorais ce que vous pourriez penser de cet article, que c’était de moi qu’il s’agissait et qu’au lieu de la protection que j’étais en droit d’attendre de ce qu’il appelle son amitié pour moi, je me plaignais avec raison d’un manque pareil de respect et de convenance. Il protesta qu’il avait de suite enjoint à M. de Montalivet de faire à la presse & au temps, les admonitions. & les menaces nécessaires pour empêcher la répétition d’articles aussi scandaleux. Il me parut être très blessé de la presse surtout (je n’avais pas tenu cette feuille en main. On m’en avait lu seulement un passage.) Il recommença Pozzo, il recommença les insomnies, il me parut sérieusement peiné et fit tout ce qui était en lui pour détruire le mauvais sentiment avec le quel j’étais entrée chez lui. Je fus forcée d’admettre tout ce qu’il me dit, avec mille promesses pour l’avenir, au moins quant à ses efforts pour empêcher que cela se renouvelle. Il m’est impossible. d’entrer par lettres dans plus de détail sur ce sujet. Le Pozzo n’était pas seul, ce que j’ai su depuis, il y avait surtout le jeune homme que nous n’avons pas fort bien traité chez moi au sortir du dîner chez l’ambassadeur de Sardaigne.
Ce qui m’a beaucoup frappé dans cet entretien est la véritable inquiétude qu’il ressent & qu’il montre à votre égard. Je vous réponds que cela est. Je me suis borné à cet égard à des observations très générales. J’ai dit que je comprenais la bonne guerre entre hommes politiques, et que celle-là puisse aller aussi loin que possible, mais que ce genre d’attaque me paraissait tout à fait au dessous de ce qu’on se doit à soi- même et était de la plus mauvaise compagnie. M. Molé renchérit encore là-dessus et revint vingt fois sur ce sujet avec toutes les exclamations convenables. Voilà Monsieur ce que j’ai à vous rapporter sur mon explication de tantôt. Je trouve tout cela une bien mauvaise affaire. & plus j’y pense plus elle me vexe. jugez ce qu’on en dira au loin !
Samedi 23. Je n’ai pas pu continuer hier. Je reprends là où je vous ai laissé. Toute cette explication s’était passée sur un grand divan dans un cabinet vitré donnant sur son jardin. Il avait aussi toute la coquetterie imaginable à préparer son appartement pour me recevoir. Il est bien arrangé. Je passai quelques moments devant son portrait. Plus tard nous nous promenâmes dans le jardin toute cette visite me prit une heure. M. Molé ne me parut pas aussi gai aussi confiant que je l’avais trouvé quelques jours auparavant. Il ne se fit pas très implicitement aux bonnes dispositions que lui témoigne encore M. Thiers. Les deux premiers mois de la session prochaine lui paraissent devoir être très décisifs, & si les doctrinaires entendaient bien leurs intérêts. Ils devraient soutenir le gouvernement !
De la place de la ville de l’Evêque, je me rendis au bois de Boulogne, j’avais besoin de me remettre de cette mauvaise matinée. Je n’y réussis pas, tout ce qui m’agite me porte sur les nerfs & y reste longtemps. Je m’arrêtai chez la petite princesse, je lui parlai de ma matinée, & c’est là-dessus que j’aurais mille détails à vous donner qui ne peuvent pas trouver place dans une lettre. IL faut que je vous dise cependant que le hasard l’avait mis à même d’accepter l’exactitude de chaque chose que M. Molé m’avait dit sur ce sujet.
Ainsi c’est par le Prince Schönburg lundi à dîner chez M. de Pahlen qu’il à appris ce qui avait paru dans le Temps, et il m’a été pétrifié. Le mari l’a conté le soir même à sa femme. Comme un mouvement qui l’avait beaucoup frappé. C’est encore en présence de la petite Princesse que M. Molé avait fait le récit de sa visite chez moi, mais n’appuyant que sur que les vers de Lamartine m’ennuyaient. Pozzo et deux autres hommes étaient présents. Mon Dieu que je vous conte des détails ! J’en ai presque honte.
Je dînai mal, je fus un peu maussade après le dîner. Le soir la petite princesse, les Durazzo, tous les Pahlen & M. de. Médem vinrent chez moi. J’essayai un peu de musique, mais elle ne va pas devant le monde, je me trouble et les idées, les souvenirs ne me viennent pas. Je quittai le piano, je fus toute la soirée un peu fidgetty connaissez vous ce mot ?
J’avais le pressentiment d’un mauvais réveil. Et en effet cette lettre attendue avec tant d’impatience et à laquelle je fais toujours aveuglement un si bon, un si tendre accueil, elle me chagrine bien ! Voulez-vous que je vous le dise, dès la matinée de votre départ j’ai prévu cela. Vous n’aviez pas un air de complète vérité ne m’annonçant le 26 comme le jour de la noce ; et je n’ai pas cessé d’avoir des soupçons depuis le moment où vous m’avez quittée. Ils sont devenus une fort triste certitude. Mais expliquez-moi bien clairement si vos occupations électorales vont remplir l’intervalle entre ceci & la noce ou si elles doivent inquiéter, même sur la noce. Je vous en supplie dite moi quelque chose de fixe, nommez moi une date afin que je sache penser & me réjouir franchement. Ne craignez pas que je vous détourne de vos devoirs par la moindre plainte ; ne craignez pas une mauvaise parole, par une mauvaise pensée.
Ah mon Dieu à qui croire sur la terre si je ne croyais pas en vous. Je serai triste, triste plus constamment triste que vous, car je n’ai rien qui me distraie du seul sentiment du seul intérêt qui occupe mon âme, mais je croirai que la vôtre retourne à moi, à moi toujours dans tous les instants que vous n’êtes pas forcé de consacrer à d’autres soins et je le répète vous êtes heureux bien plus heureux que moi, car vous aviez d’autres soins ! Moi, je n’ai rien ! Vous m’avez dit qu’aussi tôt la dissolution prononcée vous êtes forcé de venir à Paris pour huit jours au moins, afin de voir votre monde, de vous concerter avec lui, votre tournée de province remplace t-elle cela ? Ne serait-elle avant, après ? Enfin je vous en prie soyez clair, bien clair dans ce que vous allez me répondre, moi je je serai bien sage, je vous le promets.
Midi. Les expressions de votre lettre me touchent, je viens de la relire. Oui, je serai tout ce que vous voulez que je sois, comptez là-dessus. Je serai tout bonnement triste, triste, pas autre chose. J’attendrai avec confiance, mais avec impatience. Vous permettez que je sois impatiente, n’est-ce pas ?
La petite princesse est partie ce matin, pour Maintenon avec son fils. C’est une partie d’enfance où elle va passer quelques jours. Ah comme j’acceptais avec transport ces parties là, comme c’étaient mes vraies fêtes ! Mon Dieu, que je suis isolée ! Lady Granville qui devait revenir aujourd’hui se remet à la semaine prochaine. Je n’ai pas de ressources de femmes. Je verrai à passer mon temps comme je pourrai. Quelle longue lettre !
Adieu, que d’adieux nous allons encore nous adresser. Il y en aura tant que je ne les aimerai plus. Ah quel blasphème ! je voulais dire que je serai lasse de les faire voyager toujours. Un peu de repos je vous en prie, du repos dans mon cabinet sur mon canapé vert. Ah mon Dieu ! Adieu.
Je reçus un billet de M. Molé à une heure pour me rappeler notre rendez-vous à la place de la ville l’Evêque. Je m’y rendis munie du journal. Avant de procéder à son portrait, je le priai de m’écouter attentivement, et je commençai par lui rappeler ses promesses à l’égard des journaux ; je lui rappelai ensuite sa visite, et je lui demandai, comment il pouvait se faire que j’eusse à attribuer à lui, à lui seul, le déplaisant article dont je venais me plaindre aujourd’hui. M. Molé me parût fort contrarié de ce sujet de conversation. Il me dit qu’il avait espéré à mon silence de tous ces derniers jours que je n’avais pas en connaissance de cet article, qu’il n’en avait pas dormi de 48 heures, qu’il comprenait mes reproches, & qu’il me donnait sa parole d’homme qu’il n’avait rien à se reprocher que d’avoir dit devant Pozzo qu’il m’avait trouvé malade & & qu’il reconnaissait bien à cette indiscrétion, qu’il avait eu parfaitement tort de le dire même à lui, mais qu’il me conjurait de croire qu’il était plus que malheureux de cet abominable article, qu’il lui était défavorable politiquement même, puisqu’il était de nature à vous blesser et de la façon la plus ungentlemanlike qui se puisse, que c’était du plus mauvais goût, de la plus maladroite intuition, enfin il ne tarit pas sur ce sujet. Je lui observai, que ce n’était pas de vous que j’étais venu lui parler ; que j’ignorais ce que vous pourriez penser de cet article, que c’était de moi qu’il s’agissait et qu’au lieu de la protection que j’étais en droit d’attendre de ce qu’il appelle son amitié pour moi, je me plaignais avec raison d’un manque pareil de respect et de convenance. Il protesta qu’il avait de suite enjoint à M. de Montalivet de faire à la presse & au temps, les admonitions. & les menaces nécessaires pour empêcher la répétition d’articles aussi scandaleux. Il me parut être très blessé de la presse surtout (je n’avais pas tenu cette feuille en main. On m’en avait lu seulement un passage.) Il recommença Pozzo, il recommença les insomnies, il me parut sérieusement peiné et fit tout ce qui était en lui pour détruire le mauvais sentiment avec le quel j’étais entrée chez lui. Je fus forcée d’admettre tout ce qu’il me dit, avec mille promesses pour l’avenir, au moins quant à ses efforts pour empêcher que cela se renouvelle. Il m’est impossible. d’entrer par lettres dans plus de détail sur ce sujet. Le Pozzo n’était pas seul, ce que j’ai su depuis, il y avait surtout le jeune homme que nous n’avons pas fort bien traité chez moi au sortir du dîner chez l’ambassadeur de Sardaigne.
Ce qui m’a beaucoup frappé dans cet entretien est la véritable inquiétude qu’il ressent & qu’il montre à votre égard. Je vous réponds que cela est. Je me suis borné à cet égard à des observations très générales. J’ai dit que je comprenais la bonne guerre entre hommes politiques, et que celle-là puisse aller aussi loin que possible, mais que ce genre d’attaque me paraissait tout à fait au dessous de ce qu’on se doit à soi- même et était de la plus mauvaise compagnie. M. Molé renchérit encore là-dessus et revint vingt fois sur ce sujet avec toutes les exclamations convenables. Voilà Monsieur ce que j’ai à vous rapporter sur mon explication de tantôt. Je trouve tout cela une bien mauvaise affaire. & plus j’y pense plus elle me vexe. jugez ce qu’on en dira au loin !
Samedi 23. Je n’ai pas pu continuer hier. Je reprends là où je vous ai laissé. Toute cette explication s’était passée sur un grand divan dans un cabinet vitré donnant sur son jardin. Il avait aussi toute la coquetterie imaginable à préparer son appartement pour me recevoir. Il est bien arrangé. Je passai quelques moments devant son portrait. Plus tard nous nous promenâmes dans le jardin toute cette visite me prit une heure. M. Molé ne me parut pas aussi gai aussi confiant que je l’avais trouvé quelques jours auparavant. Il ne se fit pas très implicitement aux bonnes dispositions que lui témoigne encore M. Thiers. Les deux premiers mois de la session prochaine lui paraissent devoir être très décisifs, & si les doctrinaires entendaient bien leurs intérêts. Ils devraient soutenir le gouvernement !
De la place de la ville de l’Evêque, je me rendis au bois de Boulogne, j’avais besoin de me remettre de cette mauvaise matinée. Je n’y réussis pas, tout ce qui m’agite me porte sur les nerfs & y reste longtemps. Je m’arrêtai chez la petite princesse, je lui parlai de ma matinée, & c’est là-dessus que j’aurais mille détails à vous donner qui ne peuvent pas trouver place dans une lettre. IL faut que je vous dise cependant que le hasard l’avait mis à même d’accepter l’exactitude de chaque chose que M. Molé m’avait dit sur ce sujet.
Ainsi c’est par le Prince Schönburg lundi à dîner chez M. de Pahlen qu’il à appris ce qui avait paru dans le Temps, et il m’a été pétrifié. Le mari l’a conté le soir même à sa femme. Comme un mouvement qui l’avait beaucoup frappé. C’est encore en présence de la petite Princesse que M. Molé avait fait le récit de sa visite chez moi, mais n’appuyant que sur que les vers de Lamartine m’ennuyaient. Pozzo et deux autres hommes étaient présents. Mon Dieu que je vous conte des détails ! J’en ai presque honte.
Je dînai mal, je fus un peu maussade après le dîner. Le soir la petite princesse, les Durazzo, tous les Pahlen & M. de. Médem vinrent chez moi. J’essayai un peu de musique, mais elle ne va pas devant le monde, je me trouble et les idées, les souvenirs ne me viennent pas. Je quittai le piano, je fus toute la soirée un peu fidgetty connaissez vous ce mot ?
J’avais le pressentiment d’un mauvais réveil. Et en effet cette lettre attendue avec tant d’impatience et à laquelle je fais toujours aveuglement un si bon, un si tendre accueil, elle me chagrine bien ! Voulez-vous que je vous le dise, dès la matinée de votre départ j’ai prévu cela. Vous n’aviez pas un air de complète vérité ne m’annonçant le 26 comme le jour de la noce ; et je n’ai pas cessé d’avoir des soupçons depuis le moment où vous m’avez quittée. Ils sont devenus une fort triste certitude. Mais expliquez-moi bien clairement si vos occupations électorales vont remplir l’intervalle entre ceci & la noce ou si elles doivent inquiéter, même sur la noce. Je vous en supplie dite moi quelque chose de fixe, nommez moi une date afin que je sache penser & me réjouir franchement. Ne craignez pas que je vous détourne de vos devoirs par la moindre plainte ; ne craignez pas une mauvaise parole, par une mauvaise pensée.
Ah mon Dieu à qui croire sur la terre si je ne croyais pas en vous. Je serai triste, triste plus constamment triste que vous, car je n’ai rien qui me distraie du seul sentiment du seul intérêt qui occupe mon âme, mais je croirai que la vôtre retourne à moi, à moi toujours dans tous les instants que vous n’êtes pas forcé de consacrer à d’autres soins et je le répète vous êtes heureux bien plus heureux que moi, car vous aviez d’autres soins ! Moi, je n’ai rien ! Vous m’avez dit qu’aussi tôt la dissolution prononcée vous êtes forcé de venir à Paris pour huit jours au moins, afin de voir votre monde, de vous concerter avec lui, votre tournée de province remplace t-elle cela ? Ne serait-elle avant, après ? Enfin je vous en prie soyez clair, bien clair dans ce que vous allez me répondre, moi je je serai bien sage, je vous le promets.
Midi. Les expressions de votre lettre me touchent, je viens de la relire. Oui, je serai tout ce que vous voulez que je sois, comptez là-dessus. Je serai tout bonnement triste, triste, pas autre chose. J’attendrai avec confiance, mais avec impatience. Vous permettez que je sois impatiente, n’est-ce pas ?
La petite princesse est partie ce matin, pour Maintenon avec son fils. C’est une partie d’enfance où elle va passer quelques jours. Ah comme j’acceptais avec transport ces parties là, comme c’étaient mes vraies fêtes ! Mon Dieu, que je suis isolée ! Lady Granville qui devait revenir aujourd’hui se remet à la semaine prochaine. Je n’ai pas de ressources de femmes. Je verrai à passer mon temps comme je pourrai. Quelle longue lettre !
Adieu, que d’adieux nous allons encore nous adresser. Il y en aura tant que je ne les aimerai plus. Ah quel blasphème ! je voulais dire que je serai lasse de les faire voyager toujours. Un peu de repos je vous en prie, du repos dans mon cabinet sur mon canapé vert. Ah mon Dieu ! Adieu.
44. Paris, Jeudi 21 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
44. Paris, le 21 Septembre jeudi 10 heures
Ce qui me frappe en vous beaucoup est tout juste la qualité qu’on vous conteste. Ainsi on m’a sans cesse répété, qu’il n’y a en vous ni naturel ni vérité, que tout est à effet ; et ce qui me charme, ce qui m’en chante est de vous voir toujours, sur toute chose si simple, si éloigné de la moindre prétention, préparation. (Pardonnez-moi la comparaison Monsieur) de vous voir en cela me ressembler si parfaitement. Ce que j’aime encore en vous beaucoup, beaucoup et je vous l’ai déjà dit, c’est ce tact, ce bon goût qui vous accompagnent toujours. Il y a tant de délicatesse dans tout ce que vous dites, tout ce que vous faites! Voyez Monsieur, vous pourriez manquer de tout cela et être encore supérieur à tous, être encore l’objet de mes respects comme dit M. Molé (et il ne sait pas tout ce qu’il exprime dans ce mot !) mais si vous saviez comme tout cela me charme ! Comme j’aime à être fière de tout en vous, à rencontrer toujours ce que je voudrais qui fût, non seulement à ne jamais heurter contre rien qui me froisse, mais à trouver mieux que je n’attends jusques dans les nuances les plus imperceptibles et il n’y a rien d’imperceptible quand on regarde comme je regarde, quand le cœur regarde de si près, si près, avec tant d’anxiété, de passion, et cependant soyez en bien sûr, sans aveuglement ; au contraire avec des yeux très difficiles.
Eh bien, Monsieur tous les jours dans chaque mot que vous me dites, chaque ligne que vous m’écrivez. Je fais une nouvelle découverte charmante. Ce bien que j’ai acquis, j’y trouve mille trésors nouveaux, toujours, tous les jours, et cela me fait des joies inexprimables. Vous m’avez fait regarder dans votre intérieur, que je vous en remercie, comme vous m’avez attendrie, enchantée que vous êtes heureux Monsieur. Oui vous êtes heureux. Vous savez si bien jouir de ce qui vous reste ! Vous ne voulez pas que je regrette d’être encore ici bas sans plus jamais jouir d’aucune des joies que vous ressentez ?
Ah Monsieur, dans le moment où je pense à tant de bonheur fini pour toujours, ce regret me vient bien naturellement. Ces moments sont courts, une image chérie se présente à ma pensée et la détourne de la vue de ces tombeaux. Mais je frissonne & je jouis parce qu’en même temps, quand vous y êtes cette première sensation est plus rare ; mais vous absent, qu’est-ce qui me reste ? Pardonnez-moi mes tristes paroles, je veux vous parler d’autre chose.
Hier malgré la chaleur, j’allai avec la petits princesse, Marie & M. Sneyd me faire traîner jusqu’à St Cloud à ce qu’on appelle la lanterne. Là nous descendîmes. C’est beau, et c’est joli, je redescendis à pied. Et puis nous nous fîmes mener au bois de Boulogne que je trouve plus joli encore parce que j’en ai l’habitude. Vous ne savez pas que j’aime beaucoup mes habitudes ainsi je marche mieux dans mon allée, que dans les autres allées. & j’y trouve l’air meilleur, qu’à St Cloud. Tout cela ensemble fit cependant quatre heures de plein air, & d’un air charmant. La petite princesse était toute fatiguée je ne l’ai pas été, ce qui me prouve que je reprends des forces. Mais encore une fois comment n’avez vous pas beau temps & bien chaud en Normandie ? Je suis indignée de vous voir faire du feu. Marie me quitta tout de suite après le dîner pour aller à l’opéra avec la petite Princesse. Je ne vis personne que M. de Brignole pendant une heure qui me fit toutes ses confidences diplomatiques, nous ne nous étions encore jamais trouvés en tête-à-tête et après lui lord Hatherton (ci-devant Littleton secrétaire d’état pour l’Irlande & qui y a fait des bêtises) avec lui ce fût de la politique anglaise fort intime parce que les Anglais ne se gênent jamais avec moi. A propos lui croit savoir, que la reine est bête, c’est possible.
J’allais me coucher avant onze heures. La chaleur me tient encore éveillée dans la nuit, & vers le matin je m’endormis très profondément, & je fis des rêves des rêves charmants, comme je n’en ai jamais fait encore. Ah Monsieur quels jolis rêves et tout en rêvant je me disais, que je faisais mal de rêver comme cela, je cherchais à m’éveiller, & cependant j’aimais tant mon rêve. Je laissai durer le combat, parce que je ne voulais pas me séparer de ce que je savais bien qui allait m’échapper au moment où ma main toucherait le cordon de la sonnette. Je l’ai pris, je ne l’ai pas tiré, j’avais tant de peine à m’y décider. Enfin il a fallu le faire, et à 9h 1/2 seulement. J’ai dit adieu à mon rêve pour dire bonjour à votre lettre que j’ai tenue quelques temps sans l’ouvrir tant je trouvais encore le rêve plus joli que la lettre. Voyez Monsieur quels aveux je vous fais !
Je le disais bien hier il y a intermittence ce qui me fait espérer que demain je serai très bien élevé, je m’en vais même vous quitter à présent pour essayer d’anticiper sur demain 2 heures Monsieur toute votre explication ou plutôt votre récit si simple sur sur les vers de Pétrarque, m’a tant touché ! Cela s’applique encore à mes observations du commencement de ma lettre. Ah j’aime tout, tout !
Adieu monsieur, je retourne au commencement de votre lettre. Laissez-moi mes regrets, mais soyez sûr, bien sûr que quand je suis avec vous ou avec vos lettres, j’aime la vie, je l’aime beaucoup je m’y sens heureuse, bien heureuse. Mais que de fois, je retouche ! Adieu, adieu. Adieu.
Ce qui me frappe en vous beaucoup est tout juste la qualité qu’on vous conteste. Ainsi on m’a sans cesse répété, qu’il n’y a en vous ni naturel ni vérité, que tout est à effet ; et ce qui me charme, ce qui m’en chante est de vous voir toujours, sur toute chose si simple, si éloigné de la moindre prétention, préparation. (Pardonnez-moi la comparaison Monsieur) de vous voir en cela me ressembler si parfaitement. Ce que j’aime encore en vous beaucoup, beaucoup et je vous l’ai déjà dit, c’est ce tact, ce bon goût qui vous accompagnent toujours. Il y a tant de délicatesse dans tout ce que vous dites, tout ce que vous faites! Voyez Monsieur, vous pourriez manquer de tout cela et être encore supérieur à tous, être encore l’objet de mes respects comme dit M. Molé (et il ne sait pas tout ce qu’il exprime dans ce mot !) mais si vous saviez comme tout cela me charme ! Comme j’aime à être fière de tout en vous, à rencontrer toujours ce que je voudrais qui fût, non seulement à ne jamais heurter contre rien qui me froisse, mais à trouver mieux que je n’attends jusques dans les nuances les plus imperceptibles et il n’y a rien d’imperceptible quand on regarde comme je regarde, quand le cœur regarde de si près, si près, avec tant d’anxiété, de passion, et cependant soyez en bien sûr, sans aveuglement ; au contraire avec des yeux très difficiles.
Eh bien, Monsieur tous les jours dans chaque mot que vous me dites, chaque ligne que vous m’écrivez. Je fais une nouvelle découverte charmante. Ce bien que j’ai acquis, j’y trouve mille trésors nouveaux, toujours, tous les jours, et cela me fait des joies inexprimables. Vous m’avez fait regarder dans votre intérieur, que je vous en remercie, comme vous m’avez attendrie, enchantée que vous êtes heureux Monsieur. Oui vous êtes heureux. Vous savez si bien jouir de ce qui vous reste ! Vous ne voulez pas que je regrette d’être encore ici bas sans plus jamais jouir d’aucune des joies que vous ressentez ?
Ah Monsieur, dans le moment où je pense à tant de bonheur fini pour toujours, ce regret me vient bien naturellement. Ces moments sont courts, une image chérie se présente à ma pensée et la détourne de la vue de ces tombeaux. Mais je frissonne & je jouis parce qu’en même temps, quand vous y êtes cette première sensation est plus rare ; mais vous absent, qu’est-ce qui me reste ? Pardonnez-moi mes tristes paroles, je veux vous parler d’autre chose.
Hier malgré la chaleur, j’allai avec la petits princesse, Marie & M. Sneyd me faire traîner jusqu’à St Cloud à ce qu’on appelle la lanterne. Là nous descendîmes. C’est beau, et c’est joli, je redescendis à pied. Et puis nous nous fîmes mener au bois de Boulogne que je trouve plus joli encore parce que j’en ai l’habitude. Vous ne savez pas que j’aime beaucoup mes habitudes ainsi je marche mieux dans mon allée, que dans les autres allées. & j’y trouve l’air meilleur, qu’à St Cloud. Tout cela ensemble fit cependant quatre heures de plein air, & d’un air charmant. La petite princesse était toute fatiguée je ne l’ai pas été, ce qui me prouve que je reprends des forces. Mais encore une fois comment n’avez vous pas beau temps & bien chaud en Normandie ? Je suis indignée de vous voir faire du feu. Marie me quitta tout de suite après le dîner pour aller à l’opéra avec la petite Princesse. Je ne vis personne que M. de Brignole pendant une heure qui me fit toutes ses confidences diplomatiques, nous ne nous étions encore jamais trouvés en tête-à-tête et après lui lord Hatherton (ci-devant Littleton secrétaire d’état pour l’Irlande & qui y a fait des bêtises) avec lui ce fût de la politique anglaise fort intime parce que les Anglais ne se gênent jamais avec moi. A propos lui croit savoir, que la reine est bête, c’est possible.
J’allais me coucher avant onze heures. La chaleur me tient encore éveillée dans la nuit, & vers le matin je m’endormis très profondément, & je fis des rêves des rêves charmants, comme je n’en ai jamais fait encore. Ah Monsieur quels jolis rêves et tout en rêvant je me disais, que je faisais mal de rêver comme cela, je cherchais à m’éveiller, & cependant j’aimais tant mon rêve. Je laissai durer le combat, parce que je ne voulais pas me séparer de ce que je savais bien qui allait m’échapper au moment où ma main toucherait le cordon de la sonnette. Je l’ai pris, je ne l’ai pas tiré, j’avais tant de peine à m’y décider. Enfin il a fallu le faire, et à 9h 1/2 seulement. J’ai dit adieu à mon rêve pour dire bonjour à votre lettre que j’ai tenue quelques temps sans l’ouvrir tant je trouvais encore le rêve plus joli que la lettre. Voyez Monsieur quels aveux je vous fais !
Je le disais bien hier il y a intermittence ce qui me fait espérer que demain je serai très bien élevé, je m’en vais même vous quitter à présent pour essayer d’anticiper sur demain 2 heures Monsieur toute votre explication ou plutôt votre récit si simple sur sur les vers de Pétrarque, m’a tant touché ! Cela s’applique encore à mes observations du commencement de ma lettre. Ah j’aime tout, tout !
Adieu monsieur, je retourne au commencement de votre lettre. Laissez-moi mes regrets, mais soyez sûr, bien sûr que quand je suis avec vous ou avec vos lettres, j’aime la vie, je l’aime beaucoup je m’y sens heureuse, bien heureuse. Mais que de fois, je retouche ! Adieu, adieu. Adieu.
39. Val-Richer, Dimanche 17 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°39 Dimanche 17. 4 heures
Si vous étiez entrée tout à l’heure dans ma cour, vous auriez été un peu surprise. Vingt trois chevaux de selle, deux cabriolets, une calèche. Les principaux électeurs d’un canton voisin sont venus en masse me faire une visite. J’étais à me promener dans les bois avec mes enfants. J’ai entendu la cloche du Val Richer, signe d’un événement. Je ne savais trop lequel. Nous avons doublé le pas, et j’ai trouvé tout ce monde là qui m’attendait. Je viens de causer une heure et demie avec eux de leurs récoltes, de leurs impositions, de leurs chemins, de leurs églises, de leurs écoles. Je sais causer de cela. J’ai beaucoup d’estime et presque de respect pour les intérêts de la vie privée, de la famille, les intérêts sans prétention, sans ambition, qui ne demandent qu’ordre et justice et se chargent de faire eux-mêmes leurs affaires pourvu qu’on ne vienne pas les y troubler. C’est le fond de la société. Ce n’est pas le sel de la terre, comme dit l’Évangile mais c’est la terre même.
Ces hommes que je viens de voir sont des hommes sensés, honnêtes de bonnes mœurs domestiques, qui pensent juste et agissent bien dans une petite sphère et ont en moi, dans une sphère haute assez de confiance pour ne me parler presque jamais de ce que j’y fais et de ce qui s’y passe. Mes racines ici sont profondes dans la population des campagnes, dans l’agricultural interest. J’ai pour moi de plus, dans les villes, tout ce qu’il y a de riche, de considéré, d’un peu élevé. Mes adversaires sont dans la bourgeoisie subalterne & parmi les oisifs de café. Les carlistes sont presque comme des étrangers, vivant chez eux, entre eux et sans rapport avec la population. La plupart d’entre eux ne sont pas violents, et viendraient voter pour moi, si j’avais besoin de leurs suffrages. Du reste, je ne crois pas que mon élection soit contestée. Aucun concurrent ne s’annonce. Ce n’est pas de mon élection que je m’occupe mais de celles qui m’environnent. Je voudrais agir sur quelques arrondissements où la lutte sera assez vive. Je verrai pas mal de monde dans ce dessein. Si la France, toute entière ressemblait à la Normandie, il y aurait entre la Chambre mourante et la Chambre future bien peu de différence ; et j’y gagnerais plutôt que d’y perdre. Mais je ne suis pas encore en mesure de former un pronostic général. Vous voilà au courant de ma préoccupation politique du jour. Je veux que vous soyez au courant de tout.
Lundi 7 h. du matin
Je suis rentré hier chez moi vers 10 heures à notre heure à celle qui me plait le plus pour vous parler de nous. J’ai trouvé mon cabinet et ma chambre pleine d’une horrible fumée. Mes cheminées ne sont pas encore à l’épreuve. Il a fallu je ne sais quel temps pour la dissiper. Je me suis couché après. Aussi je me lève de bonne heure. Laissez-moi vous remercier encore du N°39, si charmant, si charmant ! Qu’il est doux de remplir un si tendre, un si noble cœur! Cette nuit trois ou quatre fois en me réveillant, vos paroles me revenaient tout à coup, presque avant que je me susse reveillé. Je les voyais écrites devant moi. Je les relisais. Adieu n’est pas le seul mot qui ait des droits sur moi.
Je ne vous avais pas parlé de ce petit tableau. J’y avais pensé pourtant, et j’aurais fini par vous en parler. Vous n’en savez pas le sujet. Il est plus lointain, plus indirect que vous ne pensez. En 1833, 34, 35. 36, j’ai relu et relu tous les poètes où je pouvais trouver quelque chose qui me répondit ; qui me fît ... dirai-je peine ou plaisir? Pétrarque surtout m’a été familier. C’est peut-être, en fait d’amour le langage le plus tendre, le plus pieux qui ait été parlé. J’entends parler dans les livres que je méprise infiniment en ce genre, poètes ou autres. Un sonnet me frappa, écrit après la mort de Laure et pour raconter un des rêves de Pétrarque. Je vous le traduis
Si vous étiez entrée tout à l’heure dans ma cour, vous auriez été un peu surprise. Vingt trois chevaux de selle, deux cabriolets, une calèche. Les principaux électeurs d’un canton voisin sont venus en masse me faire une visite. J’étais à me promener dans les bois avec mes enfants. J’ai entendu la cloche du Val Richer, signe d’un événement. Je ne savais trop lequel. Nous avons doublé le pas, et j’ai trouvé tout ce monde là qui m’attendait. Je viens de causer une heure et demie avec eux de leurs récoltes, de leurs impositions, de leurs chemins, de leurs églises, de leurs écoles. Je sais causer de cela. J’ai beaucoup d’estime et presque de respect pour les intérêts de la vie privée, de la famille, les intérêts sans prétention, sans ambition, qui ne demandent qu’ordre et justice et se chargent de faire eux-mêmes leurs affaires pourvu qu’on ne vienne pas les y troubler. C’est le fond de la société. Ce n’est pas le sel de la terre, comme dit l’Évangile mais c’est la terre même.
Ces hommes que je viens de voir sont des hommes sensés, honnêtes de bonnes mœurs domestiques, qui pensent juste et agissent bien dans une petite sphère et ont en moi, dans une sphère haute assez de confiance pour ne me parler presque jamais de ce que j’y fais et de ce qui s’y passe. Mes racines ici sont profondes dans la population des campagnes, dans l’agricultural interest. J’ai pour moi de plus, dans les villes, tout ce qu’il y a de riche, de considéré, d’un peu élevé. Mes adversaires sont dans la bourgeoisie subalterne & parmi les oisifs de café. Les carlistes sont presque comme des étrangers, vivant chez eux, entre eux et sans rapport avec la population. La plupart d’entre eux ne sont pas violents, et viendraient voter pour moi, si j’avais besoin de leurs suffrages. Du reste, je ne crois pas que mon élection soit contestée. Aucun concurrent ne s’annonce. Ce n’est pas de mon élection que je m’occupe mais de celles qui m’environnent. Je voudrais agir sur quelques arrondissements où la lutte sera assez vive. Je verrai pas mal de monde dans ce dessein. Si la France, toute entière ressemblait à la Normandie, il y aurait entre la Chambre mourante et la Chambre future bien peu de différence ; et j’y gagnerais plutôt que d’y perdre. Mais je ne suis pas encore en mesure de former un pronostic général. Vous voilà au courant de ma préoccupation politique du jour. Je veux que vous soyez au courant de tout.
Lundi 7 h. du matin
Je suis rentré hier chez moi vers 10 heures à notre heure à celle qui me plait le plus pour vous parler de nous. J’ai trouvé mon cabinet et ma chambre pleine d’une horrible fumée. Mes cheminées ne sont pas encore à l’épreuve. Il a fallu je ne sais quel temps pour la dissiper. Je me suis couché après. Aussi je me lève de bonne heure. Laissez-moi vous remercier encore du N°39, si charmant, si charmant ! Qu’il est doux de remplir un si tendre, un si noble cœur! Cette nuit trois ou quatre fois en me réveillant, vos paroles me revenaient tout à coup, presque avant que je me susse reveillé. Je les voyais écrites devant moi. Je les relisais. Adieu n’est pas le seul mot qui ait des droits sur moi.
Je ne vous avais pas parlé de ce petit tableau. J’y avais pensé pourtant, et j’aurais fini par vous en parler. Vous n’en savez pas le sujet. Il est plus lointain, plus indirect que vous ne pensez. En 1833, 34, 35. 36, j’ai relu et relu tous les poètes où je pouvais trouver quelque chose qui me répondit ; qui me fît ... dirai-je peine ou plaisir? Pétrarque surtout m’a été familier. C’est peut-être, en fait d’amour le langage le plus tendre, le plus pieux qui ait été parlé. J’entends parler dans les livres que je méprise infiniment en ce genre, poètes ou autres. Un sonnet me frappa, écrit après la mort de Laure et pour raconter un des rêves de Pétrarque. Je vous le traduis
" Celle que, de son temps, nulle autre ne surpassait, n’égalait, n’approchait, vient auprès du lit où je languis, si belle que j’ose à peine la
regarder. Et pleine de compassion elle s’assied sur le bord ; et avec cette main, que j’ai tant désirée, elle m’essuie les yeux ; et elle m’adresse des paroles si douces que jamais mortel n’en entendit de pareilles.- Que peut, dit-elle, pour la vertu et le savoir, celui qui se laisse abattre ? Ne pleure plus. Ne m’as-tu pas assez pleurée ? Plût à Dieu qu’aujourd’hui tu fusses vraiment vivant comme il est vrai que je ne suis pas morte ! "
Voilà mon petit tableau Madame. Il m’a fait du bien. M. Scheffer a réussi à y mettre quelque chose de la ressemblance qui pouvait me plaire. Les vers inscrits au bas sont le sonnet même de Pétrarque. Oui, mon fils était mieux, bien mieux que son portrait, qui lui ressemble pourtant beaucoup. Vous avez vu, vous avez regardé avec amour d’aussi nobles, d’aussi aimables visages, pas plus nobles, pas plus aimable.
Ma petite fille aussi est plus jolie que son portrait, des traits plus délicats, une physionomie plus fine. Vous la verrez elle. Je voudrais que vous pussiez la voir souvent, habituellement. Elle est si animée, si vive, toujours si prête à s’intéresser à tout gaiement ou sérieusement ! Elle vous regarderait avec tant d’intelligence. Elle vous écouterait avec tant de curiosité ! Laissons cela. Quand nous aurons trouvé ce que je cherche en Normandie, nous pourrons ne pas le laisser.
Lundi 10 heures 1/2
Voilà le N°40. Je n’ai pas vu cet article de la Presse dont vous me parlez. Je vais le chercher. Je renouvellerai mes recommandations indirectes comme bien vous pensez là du moins mais positives. Ce n’est pas aisé. Mettez sur Adieu tout ce que vous voudrez. Je me charge d’enchérir. Adieu. Adieu. G.
Ma petite fille aussi est plus jolie que son portrait, des traits plus délicats, une physionomie plus fine. Vous la verrez elle. Je voudrais que vous pussiez la voir souvent, habituellement. Elle est si animée, si vive, toujours si prête à s’intéresser à tout gaiement ou sérieusement ! Elle vous regarderait avec tant d’intelligence. Elle vous écouterait avec tant de curiosité ! Laissons cela. Quand nous aurons trouvé ce que je cherche en Normandie, nous pourrons ne pas le laisser.
Lundi 10 heures 1/2
Voilà le N°40. Je n’ai pas vu cet article de la Presse dont vous me parlez. Je vais le chercher. Je renouvellerai mes recommandations indirectes comme bien vous pensez là du moins mais positives. Ce n’est pas aisé. Mettez sur Adieu tout ce que vous voudrez. Je me charge d’enchérir. Adieu. Adieu. G.
14. Stafford House, Mercredi 26 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (1er juillet- 6 août) : Les premières semaines de la relation et de la correspondance entre les deux amants
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
14. Stafford house le 26 juillet
9 heures
Il ne m’a plus été possible hier de vous écrire et cependant que j’étais pressée de vous parler de ce N°8. Il m’a fait tant de plaisir, tant de bien ! Que vous êtes ingénieux à me dire sous toutes les formes, dans toutes les langues, ce qui peut plaire, le plus à mon cœur ! Vous voulez me faire aimer la poésie, vous vous y prenez très bien. Je pense d’elle tout ce que vous en pensez, mais ce n’est que d’aujourd’hui qu’elle me va. Jusqu’ici elle me faisait mal et je ne vais pas chercher ce qui me tourmente. Comme vous j’y ai souvent retrouvé mon âme mais je repoussais cette image abandonnée, car toute ma vie a passée seule. C’était en effet de la poésie, rien que de la poésie, elle ne me paraissait pas pouvoir jamais devenir réalité pour moi, aujourd’hui elle s’offre à moi, distincte, sensible, je l’accepte avec transport. Elle ne me fera pas aller comme il y a 15 ans attendre que la marée monte sur une petite pointe de rocher. (Vous ai-je conté cela ? Si je ne l’ai pas fait Je vous dirai cela un jour.) Elle me fera jouir mille fois jouir, du bonheur que le Ciel m’a envoyé. Mais quand ce bonheur sera présent je ne lui promets plus mon attention. Ah comme deux mots feront pâlir tous les plus beaux vers du monde ! Comme j’y pense à ces deux mots, comme je les répète !
Vous croyez que vous m’appreniez quelque chose en me transcrivant ce que faisait le méthodiste. Comme lui j’appelle, j’appelle mais tout bas, sans nom. Je profère des mots cependant, je ne sais ce que je dis. Je sais ce que je sens, & cela est bien au-dessus de toutes les expressions heureuses. Monsieur, je me crois un grand poète.
Je mens si je vous dis que j’ai noté votre N°8 vingt fois. Je l’ai lu plus souvent.
Monsieur j’ai le cœur bien joyeux, je retourne en France. Le comte Orloff est venu hier encore une heure avant son départ. Nous avons tout récapitulé, tout examiné. Je me suis fort épanchée, par lui au besoin. Il s’est compromis Moi je suis où j’en étais. Je vous raconterai beaucoup de choses. Lord Melbourne est venu dîner hier ici. La grande maîtresse de la reine était au palais. J’ai bien causé avec le premier ministre qu’il vous divertirait, que de bonnes réflexions vous ferez sur lui, sur tout le monde, sur toute chose ! Comme je pense à vous en voyant tout cela ! Vous croyez peut être que je n’y pense qu’alors ?
Maintenant que nous savons que nous ne sommes pas morts & qu’on n’enlève pas nos lettres comme toutes mes précautions me paraissent bêtes ! Il m’en revient des témoignages de Paris, dont je suis forcée de rire. Mais c’est charmant Monsieur, nous avons fait à la fois les mêmes conjectures l’une plus absurde que l’autre. La ressemblance est complète à une chose près. Vos inquiétudes & votre mauvaise humeur vous portaient à vous taire & moi à bavarder. Qu’est-ce que cela prouve ? Il me semble que mon caractère vaut mieux que le vôtre. Vous me punissiez de mes peines & moi je vous accablais de lettres.
Jeudi 27
Je passai ma journée hier à Chiswik chez le duc de Devonshire. C’est un palais italien environné du plus beau jardin du monde. Je suis restée trois heures au moins couchée sur un divan sous le plus beau cèdre connu en Europe. Vous ne sauriez concevoir le beauté de cet arbre, de ce jardin, l’élégance, la magnificence de tout cela. Le temps était admirable. Il avait invité all my friends. Nous dînâmes de bonne heure. Un concert de 60 personnes. Ce fut gai & parfaitement beau. Je ne rentrai en ville que pour me coucher. On me parla beaucoup des élections. On ne parle pas d’autre chose, à Londres tout a été ministériel, en province c’est différent, mais à tout prendre jusqu’ici il me parait que cela se balance.
J’ai eu une lettre de M. Molé hier, toute pleine d’amitié. Il m’invite bien à revenir. Je vais le faire. Comme je passe ma soirée à la cour vendredi & que cela me mènera tard je ne crois pas que je puisse partir. Samedi. Dimanche cela ne va pas en Angleterre, ainsi ce ne sera que lundi ou mardi que je me mettrai en route sans savoir encore combien de temps je m’arrête chez Lady Cowper, mais je crois positivement que je serai en France le 8 ou 10 au plus tard.
Cependant ne vous relâchez pas dans votre correspondance ; car vos lettres me reviendront si je suis partie, & si je restais au-delà de ce que je pense vous comprenez bien que je ne peux pas vivre sans lettres. Je vous écris tant Monsieur qu’il m’arrive de ne plus écrire à personne.
Je vous quitte aujourd’hui pour remplir mille devoirs infligés. Que j’envie vos bois, vos ombrages ! Hier au milieu de ce luxe de végétation & de magnificence, c’est à eux que je pensais vous le savez bien. Adieu. Adieu. 3 heures Je rouvre ma lettre. Le N°9 est venu. Il m’a trouvée au milieu d’une conférence de 2 heures avec le duc de Wellington. Je l’écoutais avec curiosité avec attention. Quand on est entré & que j’ai senti ce petit morceau de papier entre mes mains, mon attention, ma curiosité tout est parti. Cependant il est resté une heure encore. J’étouffais. Enfin j’ai ouvert, j’ai lu, j’ai baisé. J’étouffe encore, mais de bonheur, de complète félicité. Je ne saurai imaginer, laissez moi vous montrer ce que je suis.
Ah mon Dieu il y a longtemps. que vous le voyez, et il y a quelque temps aussi que la poste le sait complètement mon bonheur me parait trop grand. J’en jouis avec trop de vivacité. Il me tue. Ainsi, je n’échappe pas. Je meure de chagrin, ou je meure de joie. Je suis une bien frêle créature. Comment tant d’âme, tant de passion dans un si faible corps !
Monsieur je vous quitte pour m’occuper de vous, pour lire, relire mille fois ces paroles, si douces, si chaudes, si pénétrantes. Vous me demandez pardon des inquiétudes que vous m’avez causées ? Ah vous voyez trop bien tout ce que ces tourments me valent aujourd’hui de jouissances. J’aime mess tourments, j’aime mes joies, car tout me vient de vous.
9 heures
Il ne m’a plus été possible hier de vous écrire et cependant que j’étais pressée de vous parler de ce N°8. Il m’a fait tant de plaisir, tant de bien ! Que vous êtes ingénieux à me dire sous toutes les formes, dans toutes les langues, ce qui peut plaire, le plus à mon cœur ! Vous voulez me faire aimer la poésie, vous vous y prenez très bien. Je pense d’elle tout ce que vous en pensez, mais ce n’est que d’aujourd’hui qu’elle me va. Jusqu’ici elle me faisait mal et je ne vais pas chercher ce qui me tourmente. Comme vous j’y ai souvent retrouvé mon âme mais je repoussais cette image abandonnée, car toute ma vie a passée seule. C’était en effet de la poésie, rien que de la poésie, elle ne me paraissait pas pouvoir jamais devenir réalité pour moi, aujourd’hui elle s’offre à moi, distincte, sensible, je l’accepte avec transport. Elle ne me fera pas aller comme il y a 15 ans attendre que la marée monte sur une petite pointe de rocher. (Vous ai-je conté cela ? Si je ne l’ai pas fait Je vous dirai cela un jour.) Elle me fera jouir mille fois jouir, du bonheur que le Ciel m’a envoyé. Mais quand ce bonheur sera présent je ne lui promets plus mon attention. Ah comme deux mots feront pâlir tous les plus beaux vers du monde ! Comme j’y pense à ces deux mots, comme je les répète !
Vous croyez que vous m’appreniez quelque chose en me transcrivant ce que faisait le méthodiste. Comme lui j’appelle, j’appelle mais tout bas, sans nom. Je profère des mots cependant, je ne sais ce que je dis. Je sais ce que je sens, & cela est bien au-dessus de toutes les expressions heureuses. Monsieur, je me crois un grand poète.
Je mens si je vous dis que j’ai noté votre N°8 vingt fois. Je l’ai lu plus souvent.
Monsieur j’ai le cœur bien joyeux, je retourne en France. Le comte Orloff est venu hier encore une heure avant son départ. Nous avons tout récapitulé, tout examiné. Je me suis fort épanchée, par lui au besoin. Il s’est compromis Moi je suis où j’en étais. Je vous raconterai beaucoup de choses. Lord Melbourne est venu dîner hier ici. La grande maîtresse de la reine était au palais. J’ai bien causé avec le premier ministre qu’il vous divertirait, que de bonnes réflexions vous ferez sur lui, sur tout le monde, sur toute chose ! Comme je pense à vous en voyant tout cela ! Vous croyez peut être que je n’y pense qu’alors ?
Maintenant que nous savons que nous ne sommes pas morts & qu’on n’enlève pas nos lettres comme toutes mes précautions me paraissent bêtes ! Il m’en revient des témoignages de Paris, dont je suis forcée de rire. Mais c’est charmant Monsieur, nous avons fait à la fois les mêmes conjectures l’une plus absurde que l’autre. La ressemblance est complète à une chose près. Vos inquiétudes & votre mauvaise humeur vous portaient à vous taire & moi à bavarder. Qu’est-ce que cela prouve ? Il me semble que mon caractère vaut mieux que le vôtre. Vous me punissiez de mes peines & moi je vous accablais de lettres.
Jeudi 27
Je passai ma journée hier à Chiswik chez le duc de Devonshire. C’est un palais italien environné du plus beau jardin du monde. Je suis restée trois heures au moins couchée sur un divan sous le plus beau cèdre connu en Europe. Vous ne sauriez concevoir le beauté de cet arbre, de ce jardin, l’élégance, la magnificence de tout cela. Le temps était admirable. Il avait invité all my friends. Nous dînâmes de bonne heure. Un concert de 60 personnes. Ce fut gai & parfaitement beau. Je ne rentrai en ville que pour me coucher. On me parla beaucoup des élections. On ne parle pas d’autre chose, à Londres tout a été ministériel, en province c’est différent, mais à tout prendre jusqu’ici il me parait que cela se balance.
J’ai eu une lettre de M. Molé hier, toute pleine d’amitié. Il m’invite bien à revenir. Je vais le faire. Comme je passe ma soirée à la cour vendredi & que cela me mènera tard je ne crois pas que je puisse partir. Samedi. Dimanche cela ne va pas en Angleterre, ainsi ce ne sera que lundi ou mardi que je me mettrai en route sans savoir encore combien de temps je m’arrête chez Lady Cowper, mais je crois positivement que je serai en France le 8 ou 10 au plus tard.
Cependant ne vous relâchez pas dans votre correspondance ; car vos lettres me reviendront si je suis partie, & si je restais au-delà de ce que je pense vous comprenez bien que je ne peux pas vivre sans lettres. Je vous écris tant Monsieur qu’il m’arrive de ne plus écrire à personne.
Je vous quitte aujourd’hui pour remplir mille devoirs infligés. Que j’envie vos bois, vos ombrages ! Hier au milieu de ce luxe de végétation & de magnificence, c’est à eux que je pensais vous le savez bien. Adieu. Adieu. 3 heures Je rouvre ma lettre. Le N°9 est venu. Il m’a trouvée au milieu d’une conférence de 2 heures avec le duc de Wellington. Je l’écoutais avec curiosité avec attention. Quand on est entré & que j’ai senti ce petit morceau de papier entre mes mains, mon attention, ma curiosité tout est parti. Cependant il est resté une heure encore. J’étouffais. Enfin j’ai ouvert, j’ai lu, j’ai baisé. J’étouffe encore, mais de bonheur, de complète félicité. Je ne saurai imaginer, laissez moi vous montrer ce que je suis.
Ah mon Dieu il y a longtemps. que vous le voyez, et il y a quelque temps aussi que la poste le sait complètement mon bonheur me parait trop grand. J’en jouis avec trop de vivacité. Il me tue. Ainsi, je n’échappe pas. Je meure de chagrin, ou je meure de joie. Je suis une bien frêle créature. Comment tant d’âme, tant de passion dans un si faible corps !
Monsieur je vous quitte pour m’occuper de vous, pour lire, relire mille fois ces paroles, si douces, si chaudes, si pénétrantes. Vous me demandez pardon des inquiétudes que vous m’avez causées ? Ah vous voyez trop bien tout ce que ces tourments me valent aujourd’hui de jouissances. J’aime mess tourments, j’aime mes joies, car tout me vient de vous.
8. Val-Richer, Mercredi 19 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (1er juillet- 6 août) : Les premières semaines de la relation et de la correspondance entre les deux amants
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°8. Mercredi 19 Midi.
Je savais bien que je ne lirais pas votre première lettre sans remords. Et la prochaine m’en donnera plus encore, car vous aurez été plusieurs jours sans lettres. C’est un peu ma faute, la faute de mon inquiétude, de mon chagrin, de mon humeur. Savez-vous que j’ai été, moi, huit jours sans lettres, du jeudi 6 au vendredi 14 ? De toutes les raisons de retard, l’irrégularité de la poste à travers mes champs normands était à coup sûr, la plus vraisemblable. C’est celle à laquelle j’ai le moins pensé. J’en voulais absolument une plus grave. L’Empereur Napoléon, n’avait jamais voulu croire qu’une gelée de 25 degrés pût arriver en Russie plutôt que de coutume, et qu’une circonstance, toute matérielle, toute indifférente d’ailleurs, vint, paralyser les combinaisons de sa haute intelligence, de sa puissante volonté. Moi aussi, j’étais choqué de penser, je répugnais à admettre qu’il fût au pouvoir d’un courrier mal réglé ou tardif de me tourmenter à ce point. Je cherchais pour cause à mon tourment des intentions, des actions plus spécialement dirigées contre moi, contre moi seul. On ne se rend pas, de tout ce qui se passe dans l’âme ainsi troublée, un compte bien net ; mais que d’idées, que d’émotions la traversent que de conjectures elle invente qui frapperaient d’une surprise infinie si elles paraissaient au jour ! Que la vie extérieure, la vie qui se voit est lente, et froide, et vide, à côté de la vie intérieure, de la vie secrète ! Ce n’est pas là une des moindres causes du charme de l’intimité ; elle soulève aux yeux d’un seul être, le voilà qui couvre ce théâtre si animé, si varié, mais sans spectateurs.
J’ai lu, dans quelque vieille chronique, qu’un roi Barbare, très avisé et qui avait amassé d’immenses trésors, disait à sa femme qu’il l’aimait parce qu’elle était la seule personne à qui il les montrât. On montre son âme à la personne qu’on aime ; et entre mille raisons de l’aimer. On l’aime, en effet pour celle là. On répand devant elle tous ses trésors cachés, et elle les connait, et elle en jouit ; et du moins auprès d’elle tout ce qui est paraît ; le dehors et le dedans se confondent ; la vie éclate avec vérité et liberté.
Malgré mon remords, Madame, votre lettre me charme. Moi aussi, je vous remercie de votre inquiétude, et puis de vos great spirits. et puis encore de votre poésie. Vous avez mille fois raison. Milton a grand tort de dire. "He for God only." C’en un reste d’arrogance puritaine. Et le langage universel du genre humain proteste contre cette arrogance, car de tous temps et en tous pays, hommes et femmes également se sont dit, en s’aimant, je l’adore, ne se faisant pas plus de scrupule les uns que les autres de se parler comme s’ils parlaient à Dieu. J’ai beaucoup de foi à ces instincts spontanés et généraux du langage humain. La vérité s’y révèle presque toujours.
Jeudi 20
Je viens de m’impatienter à chercher mon Milton. Je ne l’ai pas trouvé. Il est dans des caisses de livres, qui ne me sont pas encore arrivées. J’étais pressé de relire les trois vers auxquels vous me renvoyez. Je suis bien sûr que je les aimerai comme vous. Est-il rien de plus doux que cette confiance dans une prompte et complète similitude d’impressions ? Milton est en effet un peu heavy. Cependant si nous le relisions ensemble nous y rencontrerions encore bien des vers qui vous iraient au cœur. La poésie fait bien autre chose que m’élever et me calmer au besoin ; elle m’entretient, dans le plus charmant langage, de tout ce qui a pu de tout ce qui peut charmer ma vie. Elle n’a pas toujours été pour moi ce qu’elle est aujourd’hui. J’ai appris à la comprendre. J’en jouis bien plus que je ne faisais à vingt ans. J’y découvre tous les jours des intentions, des émotions qui avaient passé inaperçues devant moi, et qui maintenant me saisissent car je les reconnais ; c’est mon âme qu’on me raconte. Voici des vers de Moore qui me sont retombés avant hier sous la main. Blessed meetings after many a day
Of widowhood past far away ;
When the loved face againts seen
close, close with not a tear between ;
Confidings frank without controul,
Pour’d mutually from soul to soul ;
As free froms any fear or doubt,
As is that light from chill, or stain
The sun into the Stars Sheds out,
So be by them shed back again !
Faites comprendre tout ce qu’il y a dans ces vers à qui n’a pas goûté tout le charme de l’intimité et senti tout le poids de l’absence ! Les émotions même les plus personnelles, des émotions qu’en les éprouvant on a été tenté soi-même de regarder comme étranges, comme vouées, au plus profond secret, on les retrouve quelquefois dans les poètes et précisément telles qu’on les a éprouvées. Vous m’avez parlé un jour du besoin impérieux qui vous avait quelquefois poussée, quand vous étiez seule, à appeler à haute voix, à bien haute voix, les êtres chéris que vous aviez perdus. Je ne sais quelle réserve, quel embarras m’empêcha de vous dire alors que moi aussi j’avais parlé, et appelé et crié comme vous. Eh bien, Madame, ce que nous avons senti l’un et l’autre, ce que nous ne nous sommes dit qu’à voix basse et en hésitant, le Dante l’a mis en beaux vers dans une canzone sur la mort de sa Beatrix : « Quelquefois, dit-il, mon imagination devient si vive, et en même temps la douleur me presse tellement de toutes parts, que je tressaille, je m’enfuis avec honte loin de toute vue ; et seul, pleurant, gémissant, j’appelle Béatrix, et je lui dis.« Beatrix es-tu morte ? Et quand je l’appelle ainsi, elle me console.»
Poscia, piangendo sol nel mio lamento,
Chiame Beatrice, e dico. Or, sei tu morta ?
E mentre ch’io la chiamo, mi comforla.
Et le Dante a cru peut-être, et nous avons peut-être cru, vous et moi, qu’une telle impression, un tel cri ne pouvaient appartenir qu’à un cœur déchiré. Le Dante s’est trompé, nous nous sommes trompés. Le bonheur aussi, un bonheur profond, saisissant, a produit les mêmes effets. Le méthodiste passionné ce John Newton dont je crois vous avoir parlé, écrit à sa femme :
« It is my frequent custom to vent my dearest
thoughts aloud when I am sure that no one
is within hearing. I have had many a tender
soliloquy concerning you, and in the height
of my enthusiasm, have often repeated your
dear name, merely to hear it returned by
the echo.
N’est-ce pas un plaisir pour vous, Madame, de retrouver ainsi, dans des cœurs si inconnus de vous à des siècles de distance, vos plus chères pensées ; vos émotions les plus intimes ? Et loin d’y rien perdre ne reçoivent-elles pas en quelque sorte par là, à vos propres yeux une nouvelle et puissante sanction. Je crois en vérité Madame, que je me suis persuadé que vous étiez là, car je vous raconte tout ce qui me vient à l’esprit ou à la mémoire, absolument comme si nous causions. Mais mon rêve s’évanouit. Vous me quittez. Adieu. Je n’aurai le cœur à l’aise que lorsque, pour vous comme pour moi, notre correspondance se sera rétablie dans sa douce régularité.
Je savais bien que je ne lirais pas votre première lettre sans remords. Et la prochaine m’en donnera plus encore, car vous aurez été plusieurs jours sans lettres. C’est un peu ma faute, la faute de mon inquiétude, de mon chagrin, de mon humeur. Savez-vous que j’ai été, moi, huit jours sans lettres, du jeudi 6 au vendredi 14 ? De toutes les raisons de retard, l’irrégularité de la poste à travers mes champs normands était à coup sûr, la plus vraisemblable. C’est celle à laquelle j’ai le moins pensé. J’en voulais absolument une plus grave. L’Empereur Napoléon, n’avait jamais voulu croire qu’une gelée de 25 degrés pût arriver en Russie plutôt que de coutume, et qu’une circonstance, toute matérielle, toute indifférente d’ailleurs, vint, paralyser les combinaisons de sa haute intelligence, de sa puissante volonté. Moi aussi, j’étais choqué de penser, je répugnais à admettre qu’il fût au pouvoir d’un courrier mal réglé ou tardif de me tourmenter à ce point. Je cherchais pour cause à mon tourment des intentions, des actions plus spécialement dirigées contre moi, contre moi seul. On ne se rend pas, de tout ce qui se passe dans l’âme ainsi troublée, un compte bien net ; mais que d’idées, que d’émotions la traversent que de conjectures elle invente qui frapperaient d’une surprise infinie si elles paraissaient au jour ! Que la vie extérieure, la vie qui se voit est lente, et froide, et vide, à côté de la vie intérieure, de la vie secrète ! Ce n’est pas là une des moindres causes du charme de l’intimité ; elle soulève aux yeux d’un seul être, le voilà qui couvre ce théâtre si animé, si varié, mais sans spectateurs.
J’ai lu, dans quelque vieille chronique, qu’un roi Barbare, très avisé et qui avait amassé d’immenses trésors, disait à sa femme qu’il l’aimait parce qu’elle était la seule personne à qui il les montrât. On montre son âme à la personne qu’on aime ; et entre mille raisons de l’aimer. On l’aime, en effet pour celle là. On répand devant elle tous ses trésors cachés, et elle les connait, et elle en jouit ; et du moins auprès d’elle tout ce qui est paraît ; le dehors et le dedans se confondent ; la vie éclate avec vérité et liberté.
Malgré mon remords, Madame, votre lettre me charme. Moi aussi, je vous remercie de votre inquiétude, et puis de vos great spirits. et puis encore de votre poésie. Vous avez mille fois raison. Milton a grand tort de dire. "He for God only." C’en un reste d’arrogance puritaine. Et le langage universel du genre humain proteste contre cette arrogance, car de tous temps et en tous pays, hommes et femmes également se sont dit, en s’aimant, je l’adore, ne se faisant pas plus de scrupule les uns que les autres de se parler comme s’ils parlaient à Dieu. J’ai beaucoup de foi à ces instincts spontanés et généraux du langage humain. La vérité s’y révèle presque toujours.
Jeudi 20
Je viens de m’impatienter à chercher mon Milton. Je ne l’ai pas trouvé. Il est dans des caisses de livres, qui ne me sont pas encore arrivées. J’étais pressé de relire les trois vers auxquels vous me renvoyez. Je suis bien sûr que je les aimerai comme vous. Est-il rien de plus doux que cette confiance dans une prompte et complète similitude d’impressions ? Milton est en effet un peu heavy. Cependant si nous le relisions ensemble nous y rencontrerions encore bien des vers qui vous iraient au cœur. La poésie fait bien autre chose que m’élever et me calmer au besoin ; elle m’entretient, dans le plus charmant langage, de tout ce qui a pu de tout ce qui peut charmer ma vie. Elle n’a pas toujours été pour moi ce qu’elle est aujourd’hui. J’ai appris à la comprendre. J’en jouis bien plus que je ne faisais à vingt ans. J’y découvre tous les jours des intentions, des émotions qui avaient passé inaperçues devant moi, et qui maintenant me saisissent car je les reconnais ; c’est mon âme qu’on me raconte. Voici des vers de Moore qui me sont retombés avant hier sous la main. Blessed meetings after many a day
Of widowhood past far away ;
When the loved face againts seen
close, close with not a tear between ;
Confidings frank without controul,
Pour’d mutually from soul to soul ;
As free froms any fear or doubt,
As is that light from chill, or stain
The sun into the Stars Sheds out,
So be by them shed back again !
Faites comprendre tout ce qu’il y a dans ces vers à qui n’a pas goûté tout le charme de l’intimité et senti tout le poids de l’absence ! Les émotions même les plus personnelles, des émotions qu’en les éprouvant on a été tenté soi-même de regarder comme étranges, comme vouées, au plus profond secret, on les retrouve quelquefois dans les poètes et précisément telles qu’on les a éprouvées. Vous m’avez parlé un jour du besoin impérieux qui vous avait quelquefois poussée, quand vous étiez seule, à appeler à haute voix, à bien haute voix, les êtres chéris que vous aviez perdus. Je ne sais quelle réserve, quel embarras m’empêcha de vous dire alors que moi aussi j’avais parlé, et appelé et crié comme vous. Eh bien, Madame, ce que nous avons senti l’un et l’autre, ce que nous ne nous sommes dit qu’à voix basse et en hésitant, le Dante l’a mis en beaux vers dans une canzone sur la mort de sa Beatrix : « Quelquefois, dit-il, mon imagination devient si vive, et en même temps la douleur me presse tellement de toutes parts, que je tressaille, je m’enfuis avec honte loin de toute vue ; et seul, pleurant, gémissant, j’appelle Béatrix, et je lui dis.« Beatrix es-tu morte ? Et quand je l’appelle ainsi, elle me console.»
Poscia, piangendo sol nel mio lamento,
Chiame Beatrice, e dico. Or, sei tu morta ?
E mentre ch’io la chiamo, mi comforla.
Et le Dante a cru peut-être, et nous avons peut-être cru, vous et moi, qu’une telle impression, un tel cri ne pouvaient appartenir qu’à un cœur déchiré. Le Dante s’est trompé, nous nous sommes trompés. Le bonheur aussi, un bonheur profond, saisissant, a produit les mêmes effets. Le méthodiste passionné ce John Newton dont je crois vous avoir parlé, écrit à sa femme :
« It is my frequent custom to vent my dearest
thoughts aloud when I am sure that no one
is within hearing. I have had many a tender
soliloquy concerning you, and in the height
of my enthusiasm, have often repeated your
dear name, merely to hear it returned by
the echo.
N’est-ce pas un plaisir pour vous, Madame, de retrouver ainsi, dans des cœurs si inconnus de vous à des siècles de distance, vos plus chères pensées ; vos émotions les plus intimes ? Et loin d’y rien perdre ne reçoivent-elles pas en quelque sorte par là, à vos propres yeux une nouvelle et puissante sanction. Je crois en vérité Madame, que je me suis persuadé que vous étiez là, car je vous raconte tout ce qui me vient à l’esprit ou à la mémoire, absolument comme si nous causions. Mais mon rêve s’évanouit. Vous me quittez. Adieu. Je n’aurai le cœur à l’aise que lorsque, pour vous comme pour moi, notre correspondance se sera rétablie dans sa douce régularité.
7. Stafford House, Jeudi 13 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (1er juillet- 6 août) : Les premières semaines de la relation et de la correspondance entre les deux amants
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
7. Stafford house, jeudi 13 juillet 9 h. du matin,
J’attends 1 heure de la poste, depuis Samedi j’ignore tout, même que vous ayez pensé à moi ! J’ai passé hier la matinée sur mon lit. Je vis cependant quelques personnes. Le duc de Sutherland d’abord qui ne manque jamais de venir s’assurer si je vis encore. La duchesse dans toute sa gloire car elle accompagnait la reine pour la première fois à une cour qu’elle a tenu à de St James. Lord Lansdowne, et puis lord Aberdeen. Je refusai tous les autres même lord Grey, au risque d’une grosse querelle avec lui aujourd’hui. Lord Londonderry est déjà prêt à se battre. Il m’écrit les lettres les plus extravagantes mais vraiment il me fatigue, son esprit est lent comme sa parole, comme ses gestes et je n’ai pas de temps à perdre. Nous sommes un peu sortis de la politique hier Lord Aberdeen et moi. C’est un homme avec lequel il serait possible. de causer comme on cause avec vous mais cela demande un peu de travail. D’ailleurs quoique il vous ressemble en fait d’infortunes, & les siennes surpassent toutes les autres. C’est un sujet qui lui fait horreur. Il renferme tout, et son visage d’ Othello va fort bien avec ce mouvement d’épouvante sombre par lequel il repousse toute allusion à ses malheurs. je m’arrête tout court.
La poste est venue, et je n’ai pas de lettres ! Me voilà démoralisée pour le reste de la journée. Je serai mauvaise pour vous pour tout le monde. Monsieur ne me laissez pas sans lettre. Mon imagination cherche le choléra, la peste, un accident de route, la main droite foulée. Elle rencontre tout, elle ne saurait rencontrer l’oubli, mais Je suis triste jusqu’au fond de l’âme.
Faut-il reprendre ma journée d’hier. Vous intéresse-t-elle ? Monsieur vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas comment l’inquiétude peut s’emparer de mon âme & comme un rien peut faire naître cette inquiétude, et ce que je deviens alors ? La petite princesse vint me voir hier deux fois. Nous parlâmes de mon coin autour du tapis rouge. Que je le regrette ! Je dînai seule avec Lady Cowper. Elle est à peu près consolée. Elle l’est trop. Elle a été mariée 35 ans. Je crois qu’elle se mariera dans dix mois ! Je ne vis mon fils hier qu’à 10 heures du soir. Je le renvoyai à onze pour me coucher. Tout le monde était hier à un grand bal. On m’accable d’invitations à dîner surtout je ne suis pas capable. de tout cela. Je n’accepte que les plus indispensables. Je suis fatiguée, je suis triste, comment ai-je pu quitter Paris ? Me connaitre si peu ? Ah que de pensées qui m’étouffent. J’écrirais des volumes, que je n’expliquerais pas tout ce qui remplit mon cœur. Je ne me crois pas capable d’attendre la fin de septembre. Je ne comprends plus aucun obstacle. Ah Monsieur la pauvre tête que la mienne et que j’ai tort de me montrer à vous si faible, si faible ! Qu’allez-vous penser de moi ?
4 heures. Voici un mot, un seul mot de dimanche soir sans N°. Mais quel bonheur qu’un mot, & comme celui que vous me dites me prouve que nous nous entendons ! Car vous étiez inquiet. Alors comme je l’étais ce matin. Monsieur que je vous remercie d’avoir été inquiet, cela m’enchante. Vous n’en avez pas plus de raison que moi, et cette ressemblance aussi est bonne.
Vendredi 14 9 h. Lord Grey entrait lorsque je traçais hier les derniers mots. " You seem in great spirits, shall you be more gracious to me to day ?" Je ne vois pas de raison pour remplir ce voeu, mais il est vrai que j’étais in great spirits. Un rien m’abat, un rien me relève. Mais ce n’était pas rien hier. C’était bien une petite feuille de papier que je tenais. serrée entre mes doigts, & qui valait pour moi tous les trésors.
Le P. Esterhazy m’a tenu longtemps hier matin. Il a réclamé la chambre à coucher parce qu’on est à l’abri des interrupteurs. C’est un homme d’esprit, pas du tout de l’école du prince de Metternich dans la manière, mais avec beaucoup de finesse, toute le finesse de son chef & moins de vanité & de préventions que lui. Il me fit faire quelques découvertes dans un horizon lointain. Il n’y a rien de personnel dans ce que je vous dis. Après lui vint votre Ambassadeur ; celui-là n’ont pas les privautés (dit-on privautés) du bed room. Cela ne va ni à son air solennel ni notre courte connaissance. Il me fit plaisir hier cependant, car nous arrivâmes naturellement sur un sujet qui me fait bondir le cœur. Ce sujet fut traité du côté le plus grave ; j’écoutais avec curiosité & joie. Quand on est bien écouté, on parle... J’aime beaucoup M. Sébastiani. Après tout ce monde j’eus quelques autres visites & puis je fermai ma porte pour aller faire un tour en phaéton avec lady Clanricarde qui m’avait attendue dans le jardin pendant une heure. Je reçus d’étranges confidences qui me prouvent qu’il y aura bien des défections dans les rangs réputés ministériels et que les élections peuvent avoir un résultat inattendu par les ministres dans 15 jours tout sera résolu, & ce sera un moment grave.
Hier il y eut un grand dîner Tory à Stafford house. Nous reprîmes le duc de Wellington et moi, nos vieux souvenirs de la cour de George IV. Lui et moi nous sommes inépuisables sur ce chapitre et tous nos souvenirs sont communs. Il a bien baissé cependant le duc. Il me fait l’effet d’un vieux cheval arraidi (sic) par l’âge, ce qui ne l’empêche pas d’avoir encore l’air galant. Lord Aberdeen ne me quitte pas de toute la soirée. Il fut d’un profond étonnement lorsque je lui dis, ce qui était vrai, que j’avais souvent Milton le matin. Je vous l’annonce Monsieur j’y avais cherché ce que vous me citiez un jour. Je sus répéter quelques vers à Lord Aberdeen. Cela le mit dans de véritables transports. Je ne pensais pas à lui en les disant. Il ne songeait sans doute pas à moi en les écoutant. Mais je vis que j’étais pour lui une nouvelle découverte, que je lui apparaissais sous un jour si inattendu que sa surprise pouvait prendre toutes les formes. " God is thy law, then mine." Voilà sur quoi ma mémoire s’était le plus fixée. Il trouvait plus beau ceci. "He for god only, she for god in him" J’aime la seconde idée de ce vers, je ne suis pas aussi contente de la première je crois que vous serez de mon avis. Quoi ? Elle n’aurait rien en donnant tout ? Retournez à ma première citation & continuez les trois vers qui suivent, je les aime, je les comprends. A propos et pour terminer tout à fait le sujet, Milton est bien heavy, & je crois que j’ai fini avec lui, à moins que vous n’en ordonniez autrement.
J’ai eu des nouvelles de M. de Lieven. L’Empereur n’avait pas encore décidé entre Kazan & Carlsbad. Moi il me vient quelques fois à l’idée que ce pourrait bien n’être ni l’un ni l’autre, mais la Tamise.
Ah Monsieur, imaginez que mon cœur se serre à cette pensée- là. Mon Dieu pardonnez-moi. Il me semble qu’il me pardonne, car je ne trouve rien que de pur, si pur au fond de mon âme. Je la regarde bien mon âme. Je l’aime. Je la trouve meilleure qu’elle ne m’a jamais semblé. Monsieur donnez-moi du courage. Dites moi que j’ai raison. Je vous écris de la plus étrange manière du monde. On m’interrompt vingt fois, je change de résidence emportant partout ma feuille de papier avec moi & la continuant tantôt dans le salon tantôt dans le jardin où il y a un petit établissement pour écrire. Voilà ce qui fait que vous verrez une phrase écrite avec deux encres différentes. Ces interruptions sont insoutenables. & Dieu sait les sottes lettres que je vous fais en conséquence. Mais cela vous est égal n’est-ce pas ?
Hier le jardin fut illuminé. Il l’est au gaz. C’est magnifique. Rien de plus. Compte tenez que tout cet établissement. C’est royal. Le jardin me parût de trop hier au soir. J’y aurais été si c’était Chateney quand on alla s’y perdre Je rentrai dans mon appartement, mais je ne dormis pas Je rêvai éveillée, de quatre à 6 heures. Je crois que j’ai eu la fièvre, mais elle ne me fit pas de mal. Je pensai au mois de septembre il y a quelque idée d’envoyer la jarretière au roi Louis-Philippe. Mais cette idée rencontre une forte opposition de la part de quelques vieilles têtes. Je vous parle toujours du quartier ministériel. Car les autres ignorent tout. La Reine ne consulte sa mère en rien. Elle est très absolue la Reine. Cela pourra donner du souci. je fais demander aujourd’hui à la reine de me recevoir. Je me sens mieux. & il faut que je fasse ma tournée de principes.
Adieu. Monsieur Adieu. Le petit mot me suffisait pour hier, mais vous ne me laisserez pas vivre longtemps sur cela seulement. Adieu.
J’attends 1 heure de la poste, depuis Samedi j’ignore tout, même que vous ayez pensé à moi ! J’ai passé hier la matinée sur mon lit. Je vis cependant quelques personnes. Le duc de Sutherland d’abord qui ne manque jamais de venir s’assurer si je vis encore. La duchesse dans toute sa gloire car elle accompagnait la reine pour la première fois à une cour qu’elle a tenu à de St James. Lord Lansdowne, et puis lord Aberdeen. Je refusai tous les autres même lord Grey, au risque d’une grosse querelle avec lui aujourd’hui. Lord Londonderry est déjà prêt à se battre. Il m’écrit les lettres les plus extravagantes mais vraiment il me fatigue, son esprit est lent comme sa parole, comme ses gestes et je n’ai pas de temps à perdre. Nous sommes un peu sortis de la politique hier Lord Aberdeen et moi. C’est un homme avec lequel il serait possible. de causer comme on cause avec vous mais cela demande un peu de travail. D’ailleurs quoique il vous ressemble en fait d’infortunes, & les siennes surpassent toutes les autres. C’est un sujet qui lui fait horreur. Il renferme tout, et son visage d’ Othello va fort bien avec ce mouvement d’épouvante sombre par lequel il repousse toute allusion à ses malheurs. je m’arrête tout court.
La poste est venue, et je n’ai pas de lettres ! Me voilà démoralisée pour le reste de la journée. Je serai mauvaise pour vous pour tout le monde. Monsieur ne me laissez pas sans lettre. Mon imagination cherche le choléra, la peste, un accident de route, la main droite foulée. Elle rencontre tout, elle ne saurait rencontrer l’oubli, mais Je suis triste jusqu’au fond de l’âme.
Faut-il reprendre ma journée d’hier. Vous intéresse-t-elle ? Monsieur vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas comment l’inquiétude peut s’emparer de mon âme & comme un rien peut faire naître cette inquiétude, et ce que je deviens alors ? La petite princesse vint me voir hier deux fois. Nous parlâmes de mon coin autour du tapis rouge. Que je le regrette ! Je dînai seule avec Lady Cowper. Elle est à peu près consolée. Elle l’est trop. Elle a été mariée 35 ans. Je crois qu’elle se mariera dans dix mois ! Je ne vis mon fils hier qu’à 10 heures du soir. Je le renvoyai à onze pour me coucher. Tout le monde était hier à un grand bal. On m’accable d’invitations à dîner surtout je ne suis pas capable. de tout cela. Je n’accepte que les plus indispensables. Je suis fatiguée, je suis triste, comment ai-je pu quitter Paris ? Me connaitre si peu ? Ah que de pensées qui m’étouffent. J’écrirais des volumes, que je n’expliquerais pas tout ce qui remplit mon cœur. Je ne me crois pas capable d’attendre la fin de septembre. Je ne comprends plus aucun obstacle. Ah Monsieur la pauvre tête que la mienne et que j’ai tort de me montrer à vous si faible, si faible ! Qu’allez-vous penser de moi ?
4 heures. Voici un mot, un seul mot de dimanche soir sans N°. Mais quel bonheur qu’un mot, & comme celui que vous me dites me prouve que nous nous entendons ! Car vous étiez inquiet. Alors comme je l’étais ce matin. Monsieur que je vous remercie d’avoir été inquiet, cela m’enchante. Vous n’en avez pas plus de raison que moi, et cette ressemblance aussi est bonne.
Vendredi 14 9 h. Lord Grey entrait lorsque je traçais hier les derniers mots. " You seem in great spirits, shall you be more gracious to me to day ?" Je ne vois pas de raison pour remplir ce voeu, mais il est vrai que j’étais in great spirits. Un rien m’abat, un rien me relève. Mais ce n’était pas rien hier. C’était bien une petite feuille de papier que je tenais. serrée entre mes doigts, & qui valait pour moi tous les trésors.
Le P. Esterhazy m’a tenu longtemps hier matin. Il a réclamé la chambre à coucher parce qu’on est à l’abri des interrupteurs. C’est un homme d’esprit, pas du tout de l’école du prince de Metternich dans la manière, mais avec beaucoup de finesse, toute le finesse de son chef & moins de vanité & de préventions que lui. Il me fit faire quelques découvertes dans un horizon lointain. Il n’y a rien de personnel dans ce que je vous dis. Après lui vint votre Ambassadeur ; celui-là n’ont pas les privautés (dit-on privautés) du bed room. Cela ne va ni à son air solennel ni notre courte connaissance. Il me fit plaisir hier cependant, car nous arrivâmes naturellement sur un sujet qui me fait bondir le cœur. Ce sujet fut traité du côté le plus grave ; j’écoutais avec curiosité & joie. Quand on est bien écouté, on parle... J’aime beaucoup M. Sébastiani. Après tout ce monde j’eus quelques autres visites & puis je fermai ma porte pour aller faire un tour en phaéton avec lady Clanricarde qui m’avait attendue dans le jardin pendant une heure. Je reçus d’étranges confidences qui me prouvent qu’il y aura bien des défections dans les rangs réputés ministériels et que les élections peuvent avoir un résultat inattendu par les ministres dans 15 jours tout sera résolu, & ce sera un moment grave.
Hier il y eut un grand dîner Tory à Stafford house. Nous reprîmes le duc de Wellington et moi, nos vieux souvenirs de la cour de George IV. Lui et moi nous sommes inépuisables sur ce chapitre et tous nos souvenirs sont communs. Il a bien baissé cependant le duc. Il me fait l’effet d’un vieux cheval arraidi (sic) par l’âge, ce qui ne l’empêche pas d’avoir encore l’air galant. Lord Aberdeen ne me quitte pas de toute la soirée. Il fut d’un profond étonnement lorsque je lui dis, ce qui était vrai, que j’avais souvent Milton le matin. Je vous l’annonce Monsieur j’y avais cherché ce que vous me citiez un jour. Je sus répéter quelques vers à Lord Aberdeen. Cela le mit dans de véritables transports. Je ne pensais pas à lui en les disant. Il ne songeait sans doute pas à moi en les écoutant. Mais je vis que j’étais pour lui une nouvelle découverte, que je lui apparaissais sous un jour si inattendu que sa surprise pouvait prendre toutes les formes. " God is thy law, then mine." Voilà sur quoi ma mémoire s’était le plus fixée. Il trouvait plus beau ceci. "He for god only, she for god in him" J’aime la seconde idée de ce vers, je ne suis pas aussi contente de la première je crois que vous serez de mon avis. Quoi ? Elle n’aurait rien en donnant tout ? Retournez à ma première citation & continuez les trois vers qui suivent, je les aime, je les comprends. A propos et pour terminer tout à fait le sujet, Milton est bien heavy, & je crois que j’ai fini avec lui, à moins que vous n’en ordonniez autrement.
J’ai eu des nouvelles de M. de Lieven. L’Empereur n’avait pas encore décidé entre Kazan & Carlsbad. Moi il me vient quelques fois à l’idée que ce pourrait bien n’être ni l’un ni l’autre, mais la Tamise.
Ah Monsieur, imaginez que mon cœur se serre à cette pensée- là. Mon Dieu pardonnez-moi. Il me semble qu’il me pardonne, car je ne trouve rien que de pur, si pur au fond de mon âme. Je la regarde bien mon âme. Je l’aime. Je la trouve meilleure qu’elle ne m’a jamais semblé. Monsieur donnez-moi du courage. Dites moi que j’ai raison. Je vous écris de la plus étrange manière du monde. On m’interrompt vingt fois, je change de résidence emportant partout ma feuille de papier avec moi & la continuant tantôt dans le salon tantôt dans le jardin où il y a un petit établissement pour écrire. Voilà ce qui fait que vous verrez une phrase écrite avec deux encres différentes. Ces interruptions sont insoutenables. & Dieu sait les sottes lettres que je vous fais en conséquence. Mais cela vous est égal n’est-ce pas ?
Hier le jardin fut illuminé. Il l’est au gaz. C’est magnifique. Rien de plus. Compte tenez que tout cet établissement. C’est royal. Le jardin me parût de trop hier au soir. J’y aurais été si c’était Chateney quand on alla s’y perdre Je rentrai dans mon appartement, mais je ne dormis pas Je rêvai éveillée, de quatre à 6 heures. Je crois que j’ai eu la fièvre, mais elle ne me fit pas de mal. Je pensai au mois de septembre il y a quelque idée d’envoyer la jarretière au roi Louis-Philippe. Mais cette idée rencontre une forte opposition de la part de quelques vieilles têtes. Je vous parle toujours du quartier ministériel. Car les autres ignorent tout. La Reine ne consulte sa mère en rien. Elle est très absolue la Reine. Cela pourra donner du souci. je fais demander aujourd’hui à la reine de me recevoir. Je me sens mieux. & il faut que je fasse ma tournée de principes.
Adieu. Monsieur Adieu. Le petit mot me suffisait pour hier, mais vous ne me laisserez pas vivre longtemps sur cela seulement. Adieu.
4. Londres, Mercredi 5 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (1er juillet- 6 août) : Les premières semaines de la relation et de la correspondance entre les deux amants
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
3. Londres le 5 juillet 1837,
Je commence à trouver qu’une lettre eut pu m’arriver déjà. Je vous la demande Monsieur. Je ne sais pas si depuis vendredi vous avez pensé à moi.
Ma journée a passé hier comme un instant, je vois bien que c’est le matin, qu’il faut que je vous écrive, car dès 1 heure je suis envahie, & minuit arrive sans que j’aie eu un instant de solitude. Vous allez être ennuyé des détails, mais vous me les avez demandés. Lord Grey deux grandes heures ! Le prince Esterhazy, Pozzo, Dedel (ministre de Hollande) Lady Flarrowby, Lady Carlisle, la duchesse comtesse de Sutherland, M. Granville jusqu’à 6 heures. Je montai alors en calèche avec la duchesse de Sutherland. Nous voulions faire le tour de Hyde park, mais nous n’avions pas fait deux cents pas que je me trouvais mal. Elle me ramena.
La vue de Londres est terrible pour moi. Je puis bien y être, mais non y regarder. Mon fils vient à 6 1/2. Je ne peux le voir à mon aise que pendant ma toilette à huit h. 1/2 on dîne : c’est détestable. Nous fûmes seuls, il n’y eut que lord Harrowby, & lord Grey & lord Morpeth, grand radical, excellent homme. Mes amis Torys ignorent encore mon arrivée. J’en suis bien aise. Je me sens si fatiguée que je n’ai plus de quoi leur montrer de la joie de les revoir. Cela viendra aujourd’hui & demain.
Au milieu de tout cela avez-vous pensé à Paris madame ? Oui monsieur, j’y ai pensé, toujours pensé.
Le contraste est grand mais je vous ai dit qu’il fait sur moi l’effet des ressemblances. Ah à propos, en montant dans l’appartement où se tient la duchesse le matin, le premier objet qui frappe ma vue est la gravure de M. Guizot ! Jugez ma surprise. Je me suis arrêtée. J’ai fixé mes yeux sur vos yeux.
Je vis ici dans une atmosphère très ministérielle ce qui fait que je ne m’avise pas d’avoir une opinion quelconque sur ce qui ce passe il est dans la nature des Whigs d’être très confiant. La Reine leur montre toutes les faveurs. Il est donc naturel qu’ils soient en pleine espérance, mais j’attends d’autres notions. Lord Grey se donne un grand mouvement pour faire entrer lord Durham dans le cabinet. Lui même lord Grey est aigre, mécontent, frondeur, & furieux d’être vieux. Je n’ai jamais rencontré personne qui convienne de ce chagrin plus naïvement que lui. C’est un vrai désespoir.
La voilà cette lettre. Quel plaisir qu’une première lettre, comme je lis vite, & puis comme je lis lentement, & puis plus lentement encore. Monsieur, que je vous remercie ! Il y a de hautes et nobles pensées dans les vers que me transcrivez, mais il y a une strophe un mot que j’aime plus que tout le reste. Nous avons découvert bien des ressemblances entre nous Monsieur. Mais il y a des impressions qui sont toutes différentes. Ainsi la poésie vous calme & vous élève. Moi elle m’élève bien ; mais si haut si haut que cela ressemble bien plus à du délire qu’à autre chose. Je la fuis donc la poésie. Je saurais lire sans danger il y a peu de temps encore. Aujourd’hui je la crains parce que je me crains. Monsieur je me connais bien, je voudrais bien vous expliquer ce que je suis, mais vous êtes si pénétrant, je n’en prendrai pas la peine. Cependant un homme sait-il bien comprendre le cœur d’une femme ? Je vous ai dit que j’en doutais quand il s’agissait de mes peines, qui doute bien plus pour le sentiment du bonheur. Il me semble que mon âme ne peut jamais suffire ni à la joie, ni à la douleur, que je vais mourir ou de l’un ou de l’autre par l’impuissance de les exprimer. Aujourd’hui j’étouffe ! Mais Monsieur de quoi vais-je vous parler ? Il y a presque du remord dans ce que je vous dis. Ici où une seule pensée devait m’absorber, je ne la retrouve plus distincte. Il y a un voile entre moi et mes malheurs. Toutes les circonstances passées sont devant mes yeux. Je me retrace tout, toute l’horreur de ces affreux moments. Et bien, Monsieur, aucune des sensations que ces souvenirs faisaient naître en moi il y a encore un mois, aucune ne m’atteint dans ce moment. Je ne pleure pas. Je ne me comprends pas. Il y a quelque chose qui m’arrête, qui me protège contre moi-même. Vous l’avez espéré pour moi, vous me l’avez prédit. Monsieur, quel bien vous m’avez fait ! Je vous en remercie à genoux.
Jeudi 6 juillet
Je renonce à vous raconter ma journée d’hier. Ma porte à été ouverte et mon salon n’a pas désempli depuis 1 heures jusqu’à 7. J’ai vu tout le monde Whigs, Tories, radicaux. Je sais les aimer tous. J’ai le cœur terriblement vaste. Vous allez me mépriser. Mais non Monsieur il ne faut pas faire cela. L’amitié me touche toujours de quelque part qu’elle ne vienne. J’aime tant être aimée ! Ces Anglais sont si sincères si simples dans l’expression de leur amitié. J’ai vu quelques yeux humides.
Oh pour le coup je ne résiste pas à cela. Mais j’étouffais matériellement, moralement, j’en recevais quelques uns dans le jardin, pour reprendre des forces. Enfin cela a fait un véritable levé. Je n’ai eu de tête à tête qu’avec lord Aberdeen, lord John Russell, lord Grey & lady Jersey. Tout le reste était cohue. Un immense dîner diplomatique. On m’avait donné la France pour voisin de droite. Cela m’a fait plaisir. Mais il est bien solennel M. Sebastiani & tout arrive bien lentement.
J’aime ce qui va vite. Si l’on tarde un peu à me répondre, je ne sais plus ce que j’ai demandé et cela m’est arrivé hier deux fois avec votre ambassadeur. Je trouve la diplomatie un peu en décadence. De mon temps, elle était un peu plus fashionable.
Jugez Monsieur qu’on me trouve bonne mine. Je ne comprends pas cela. J’ai été interrompue par une visite de deux heures de Lord Durham. Il a bien de l’esprit et il le sait. Il saisit et embrasse tout très vite. Il a le droit d’aspirer à beaucoup & à très haut. J’ignore si le droit se convertira en fait !
La Reine est tout à fait entre les mains de Lord Melbourne qui me parait user de sa position avec tact & intelligence. Il est plein de respect & de paternité pour elle. Elle a l’esprit ouvert, curieux, elle veut tout faire. Il n’y aura point d’intermédiaire entre elle et ses ministres. Elle travaille avec chacun d’eux. Elle s’informe, elle écoute, elle se fatigue à cela. On dit qu’elle en est maigrie ; sa santé est mauvaise. Elle ira fermer le parlement en personne. Elle fera à cheval la revue de l’armée, elle porte la plaque & le cordon de la jarretière. Elle veut faire tout, et tout de suite. On la contemple avec étonnement et respect. C’est un curieux spectacle à 18 ans !
Vendredi 7
J’eus hier matin encore une longue visite de Sir R. Peel, du duc de Wellington, lord Mulgrave, lord Grey, Pozzo. Je vous cite les têtes à têtes. Je ne veux pas vous ennuyer du reste. Peel est venu sur béquilles. Il a été en danger de perdre une jambe, & ceci était sa première sortie. Le duc est vieilli. Lord Grey est fort, bien avec l’un et l’autre. Il m’a dérangé hier. J’eusse aimé sa visite dans un autre moment. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est lord Durham qui le créerait, mais je vous expliquerai tout cela une autre fois. Pour le moment lord Melbourne est tout puissant. Je fus dîner hier tête à tête avec lady Jersey. Il faisait encore jour lorsque je me rendis chez elle. J’ai fondu en larmes dans la voiture, mon pauvre cœur se brisait pendant un moment il n’y avait place que pour mes malheurs. Le bavardage de Lady Jersey m’a distrait, je la quittai de bonne heure pour aller voir lady Cowper qui revenait de la campagne, où elle était allé enterrer son mari. Elle se jeta dans mes bras en sanglotant. Il ne me faut pas de pareilles scènes. Aussi ne puis-je pas y tenir plus d’un quart d’heure. Je rentrai à 10 h. pour m’enfermer chez moi. Je me couchai. Mon fils vint me trouver encore, je n’avais pas pu le voir de tout le jour. Nous causâmes beaucoup ensemble de mon plus prochain avenir. Il se complique singulièrement.
J’ai reçu hier une lettre de mon mari qui me fait croire qu’au lieu de Kazan, c’est à Carlsbad qu’il va se rendre seul, pour sa santé ! Il cherchera surement à me donner un rendez-vous. Et ce que je désirais le plus vivement il y a quelques temps je le redoute aujourd’hui comme si cela devait finir ma vie. Monsieur, je me suis créé la plus grande félicité ou le plus grand malheur de mon existence. Je l’ai senti en me livrant au seul sentiment qui peut désormais la remplir. Dieu l’a mis dans mon cœur. Pourrait-il si tôt me livrer au désespoir ? C’était mon paradis à moi, je ne pouvais en avoir d’autre sur la terre. Que j’en ai joui ! Monsieur ma pauvre tête s’en va quand je pense à cet avenir qui peut être si beau ou si horrible. Puis-je vouloir du bonheur à tout prix ? C’est à vous que j’adresse cette question.
Dans ce moment on me remet une lettre & une carte de visite, laissés ici hier au soir par un voyageur. Je n’y étais pas lorsqu’il a passé. Il a promis de revenir ce matin, la matinée me paraîtra longue, éternelle jusqu’à ce que je le voie ! Quelle bonne, quelle douce surprise. Y aura-t-il beaucoup de voyageurs ? Comme je vais regarder celui ci avec tendresse.
Pendant que je vous écrivais ou m’a annoncé cette femme dont je vous ai parlé. Celle qui a vu naître & mourir les enfants, & que je n’avais plus revue depuis le lit de mort de mon Arthur ! Ah Monsieur quelle horrible souvenir ! Il dort en paix cet ange & moi je suis encore sur la terre pour pleurer. Je l’ai vue cette femme Nous avons confondu nos larmes. Le petit chien n’y était pas, il viendra un autre jour, il me fera pleurer aussi. Je n’ai pas tenu au delà de dix minutes. Je reviens à vous, dites-moi quelque douce parole Monsieur, consolez mon pauvre cœur. Adieu, quelle longue lettre !
Je commence à trouver qu’une lettre eut pu m’arriver déjà. Je vous la demande Monsieur. Je ne sais pas si depuis vendredi vous avez pensé à moi.
Ma journée a passé hier comme un instant, je vois bien que c’est le matin, qu’il faut que je vous écrive, car dès 1 heure je suis envahie, & minuit arrive sans que j’aie eu un instant de solitude. Vous allez être ennuyé des détails, mais vous me les avez demandés. Lord Grey deux grandes heures ! Le prince Esterhazy, Pozzo, Dedel (ministre de Hollande) Lady Flarrowby, Lady Carlisle, la duchesse comtesse de Sutherland, M. Granville jusqu’à 6 heures. Je montai alors en calèche avec la duchesse de Sutherland. Nous voulions faire le tour de Hyde park, mais nous n’avions pas fait deux cents pas que je me trouvais mal. Elle me ramena.
La vue de Londres est terrible pour moi. Je puis bien y être, mais non y regarder. Mon fils vient à 6 1/2. Je ne peux le voir à mon aise que pendant ma toilette à huit h. 1/2 on dîne : c’est détestable. Nous fûmes seuls, il n’y eut que lord Harrowby, & lord Grey & lord Morpeth, grand radical, excellent homme. Mes amis Torys ignorent encore mon arrivée. J’en suis bien aise. Je me sens si fatiguée que je n’ai plus de quoi leur montrer de la joie de les revoir. Cela viendra aujourd’hui & demain.
Au milieu de tout cela avez-vous pensé à Paris madame ? Oui monsieur, j’y ai pensé, toujours pensé.
Le contraste est grand mais je vous ai dit qu’il fait sur moi l’effet des ressemblances. Ah à propos, en montant dans l’appartement où se tient la duchesse le matin, le premier objet qui frappe ma vue est la gravure de M. Guizot ! Jugez ma surprise. Je me suis arrêtée. J’ai fixé mes yeux sur vos yeux.
Je vis ici dans une atmosphère très ministérielle ce qui fait que je ne m’avise pas d’avoir une opinion quelconque sur ce qui ce passe il est dans la nature des Whigs d’être très confiant. La Reine leur montre toutes les faveurs. Il est donc naturel qu’ils soient en pleine espérance, mais j’attends d’autres notions. Lord Grey se donne un grand mouvement pour faire entrer lord Durham dans le cabinet. Lui même lord Grey est aigre, mécontent, frondeur, & furieux d’être vieux. Je n’ai jamais rencontré personne qui convienne de ce chagrin plus naïvement que lui. C’est un vrai désespoir.
La voilà cette lettre. Quel plaisir qu’une première lettre, comme je lis vite, & puis comme je lis lentement, & puis plus lentement encore. Monsieur, que je vous remercie ! Il y a de hautes et nobles pensées dans les vers que me transcrivez, mais il y a une strophe un mot que j’aime plus que tout le reste. Nous avons découvert bien des ressemblances entre nous Monsieur. Mais il y a des impressions qui sont toutes différentes. Ainsi la poésie vous calme & vous élève. Moi elle m’élève bien ; mais si haut si haut que cela ressemble bien plus à du délire qu’à autre chose. Je la fuis donc la poésie. Je saurais lire sans danger il y a peu de temps encore. Aujourd’hui je la crains parce que je me crains. Monsieur je me connais bien, je voudrais bien vous expliquer ce que je suis, mais vous êtes si pénétrant, je n’en prendrai pas la peine. Cependant un homme sait-il bien comprendre le cœur d’une femme ? Je vous ai dit que j’en doutais quand il s’agissait de mes peines, qui doute bien plus pour le sentiment du bonheur. Il me semble que mon âme ne peut jamais suffire ni à la joie, ni à la douleur, que je vais mourir ou de l’un ou de l’autre par l’impuissance de les exprimer. Aujourd’hui j’étouffe ! Mais Monsieur de quoi vais-je vous parler ? Il y a presque du remord dans ce que je vous dis. Ici où une seule pensée devait m’absorber, je ne la retrouve plus distincte. Il y a un voile entre moi et mes malheurs. Toutes les circonstances passées sont devant mes yeux. Je me retrace tout, toute l’horreur de ces affreux moments. Et bien, Monsieur, aucune des sensations que ces souvenirs faisaient naître en moi il y a encore un mois, aucune ne m’atteint dans ce moment. Je ne pleure pas. Je ne me comprends pas. Il y a quelque chose qui m’arrête, qui me protège contre moi-même. Vous l’avez espéré pour moi, vous me l’avez prédit. Monsieur, quel bien vous m’avez fait ! Je vous en remercie à genoux.
Jeudi 6 juillet
Je renonce à vous raconter ma journée d’hier. Ma porte à été ouverte et mon salon n’a pas désempli depuis 1 heures jusqu’à 7. J’ai vu tout le monde Whigs, Tories, radicaux. Je sais les aimer tous. J’ai le cœur terriblement vaste. Vous allez me mépriser. Mais non Monsieur il ne faut pas faire cela. L’amitié me touche toujours de quelque part qu’elle ne vienne. J’aime tant être aimée ! Ces Anglais sont si sincères si simples dans l’expression de leur amitié. J’ai vu quelques yeux humides.
Oh pour le coup je ne résiste pas à cela. Mais j’étouffais matériellement, moralement, j’en recevais quelques uns dans le jardin, pour reprendre des forces. Enfin cela a fait un véritable levé. Je n’ai eu de tête à tête qu’avec lord Aberdeen, lord John Russell, lord Grey & lady Jersey. Tout le reste était cohue. Un immense dîner diplomatique. On m’avait donné la France pour voisin de droite. Cela m’a fait plaisir. Mais il est bien solennel M. Sebastiani & tout arrive bien lentement.
J’aime ce qui va vite. Si l’on tarde un peu à me répondre, je ne sais plus ce que j’ai demandé et cela m’est arrivé hier deux fois avec votre ambassadeur. Je trouve la diplomatie un peu en décadence. De mon temps, elle était un peu plus fashionable.
Jugez Monsieur qu’on me trouve bonne mine. Je ne comprends pas cela. J’ai été interrompue par une visite de deux heures de Lord Durham. Il a bien de l’esprit et il le sait. Il saisit et embrasse tout très vite. Il a le droit d’aspirer à beaucoup & à très haut. J’ignore si le droit se convertira en fait !
La Reine est tout à fait entre les mains de Lord Melbourne qui me parait user de sa position avec tact & intelligence. Il est plein de respect & de paternité pour elle. Elle a l’esprit ouvert, curieux, elle veut tout faire. Il n’y aura point d’intermédiaire entre elle et ses ministres. Elle travaille avec chacun d’eux. Elle s’informe, elle écoute, elle se fatigue à cela. On dit qu’elle en est maigrie ; sa santé est mauvaise. Elle ira fermer le parlement en personne. Elle fera à cheval la revue de l’armée, elle porte la plaque & le cordon de la jarretière. Elle veut faire tout, et tout de suite. On la contemple avec étonnement et respect. C’est un curieux spectacle à 18 ans !
Vendredi 7
J’eus hier matin encore une longue visite de Sir R. Peel, du duc de Wellington, lord Mulgrave, lord Grey, Pozzo. Je vous cite les têtes à têtes. Je ne veux pas vous ennuyer du reste. Peel est venu sur béquilles. Il a été en danger de perdre une jambe, & ceci était sa première sortie. Le duc est vieilli. Lord Grey est fort, bien avec l’un et l’autre. Il m’a dérangé hier. J’eusse aimé sa visite dans un autre moment. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est lord Durham qui le créerait, mais je vous expliquerai tout cela une autre fois. Pour le moment lord Melbourne est tout puissant. Je fus dîner hier tête à tête avec lady Jersey. Il faisait encore jour lorsque je me rendis chez elle. J’ai fondu en larmes dans la voiture, mon pauvre cœur se brisait pendant un moment il n’y avait place que pour mes malheurs. Le bavardage de Lady Jersey m’a distrait, je la quittai de bonne heure pour aller voir lady Cowper qui revenait de la campagne, où elle était allé enterrer son mari. Elle se jeta dans mes bras en sanglotant. Il ne me faut pas de pareilles scènes. Aussi ne puis-je pas y tenir plus d’un quart d’heure. Je rentrai à 10 h. pour m’enfermer chez moi. Je me couchai. Mon fils vint me trouver encore, je n’avais pas pu le voir de tout le jour. Nous causâmes beaucoup ensemble de mon plus prochain avenir. Il se complique singulièrement.
J’ai reçu hier une lettre de mon mari qui me fait croire qu’au lieu de Kazan, c’est à Carlsbad qu’il va se rendre seul, pour sa santé ! Il cherchera surement à me donner un rendez-vous. Et ce que je désirais le plus vivement il y a quelques temps je le redoute aujourd’hui comme si cela devait finir ma vie. Monsieur, je me suis créé la plus grande félicité ou le plus grand malheur de mon existence. Je l’ai senti en me livrant au seul sentiment qui peut désormais la remplir. Dieu l’a mis dans mon cœur. Pourrait-il si tôt me livrer au désespoir ? C’était mon paradis à moi, je ne pouvais en avoir d’autre sur la terre. Que j’en ai joui ! Monsieur ma pauvre tête s’en va quand je pense à cet avenir qui peut être si beau ou si horrible. Puis-je vouloir du bonheur à tout prix ? C’est à vous que j’adresse cette question.
Dans ce moment on me remet une lettre & une carte de visite, laissés ici hier au soir par un voyageur. Je n’y étais pas lorsqu’il a passé. Il a promis de revenir ce matin, la matinée me paraîtra longue, éternelle jusqu’à ce que je le voie ! Quelle bonne, quelle douce surprise. Y aura-t-il beaucoup de voyageurs ? Comme je vais regarder celui ci avec tendresse.
Pendant que je vous écrivais ou m’a annoncé cette femme dont je vous ai parlé. Celle qui a vu naître & mourir les enfants, & que je n’avais plus revue depuis le lit de mort de mon Arthur ! Ah Monsieur quelle horrible souvenir ! Il dort en paix cet ange & moi je suis encore sur la terre pour pleurer. Je l’ai vue cette femme Nous avons confondu nos larmes. Le petit chien n’y était pas, il viendra un autre jour, il me fera pleurer aussi. Je n’ai pas tenu au delà de dix minutes. Je reviens à vous, dites-moi quelque douce parole Monsieur, consolez mon pauvre cœur. Adieu, quelle longue lettre !
2. Paris, Dimanche 2 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (1er juillet- 6 août) : Les premières semaines de la relation et de la correspondance entre les deux amants
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°2 Dimanche 2 juillet 10 heures du soir
Je rentre de ma promenade solitaire. Il n’y a presque plus personne à Paris, et je ne vais pas chercher ce qui y reste. Le bonheur, les affaires ou la solitude. C’est un blasphème de placer ces trois mots l’un à côté de l’autre. Le bonheur ne doit jamais être nommé que tout seul ; rien ne lui ressemble. Mais sans bonheur, et à défaut des affaires, j’aime bien mieux la solitude que le bavardage des indifférents. Je sais qu’on ne la supporterait pas longtemps, que l’âme s’userait vite à vivre ainsi à ses propres dépens et de sa seule substance. Mais finir seul sa journée se promener deux heures sans rien regarder, sans rien dire, n’entendant que le bruit de ses pas n’écoutant que cette voix intérieure qui nous entretient de notre passé ou de notre avenir, c’est assez doux. Dans les affaires mêmes, un peu de solitude est bonne ; il faut un moment chaque jour, secouer tous les jougs ne relever que de soi-même, permettre à sa pensée cette liberté insouciante qui lui conserve seule toute son originalité et sa grandeur. Gouverner n’est pas labourer. On s’hébête à avoir toujours la main sur la charrue et l’oeil sur le sillon. C’est un grand vice de notre organisation politique en France que ce travail incessant, ce défaut absolu de loisir auquel nous nous sommes condammés. A faire un tel métier, on se sent devenir machine soi-même et on tombe bientôt au dessous de sa tâche pour n’avoir pas su ou pu, de temps en temps, la laisser là et n’y plus songer. Je vous assure Madame qu’au milieu des plus pressantes affaires, une heure de conversation avec vous n’importe sur quoi serait, tout plaisir à part, le régime le plus sain du monde. à la vérité, ce n’est pas là de la solitude.
Je rentre de ma promenade solitaire. Il n’y a presque plus personne à Paris, et je ne vais pas chercher ce qui y reste. Le bonheur, les affaires ou la solitude. C’est un blasphème de placer ces trois mots l’un à côté de l’autre. Le bonheur ne doit jamais être nommé que tout seul ; rien ne lui ressemble. Mais sans bonheur, et à défaut des affaires, j’aime bien mieux la solitude que le bavardage des indifférents. Je sais qu’on ne la supporterait pas longtemps, que l’âme s’userait vite à vivre ainsi à ses propres dépens et de sa seule substance. Mais finir seul sa journée se promener deux heures sans rien regarder, sans rien dire, n’entendant que le bruit de ses pas n’écoutant que cette voix intérieure qui nous entretient de notre passé ou de notre avenir, c’est assez doux. Dans les affaires mêmes, un peu de solitude est bonne ; il faut un moment chaque jour, secouer tous les jougs ne relever que de soi-même, permettre à sa pensée cette liberté insouciante qui lui conserve seule toute son originalité et sa grandeur. Gouverner n’est pas labourer. On s’hébête à avoir toujours la main sur la charrue et l’oeil sur le sillon. C’est un grand vice de notre organisation politique en France que ce travail incessant, ce défaut absolu de loisir auquel nous nous sommes condammés. A faire un tel métier, on se sent devenir machine soi-même et on tombe bientôt au dessous de sa tâche pour n’avoir pas su ou pu, de temps en temps, la laisser là et n’y plus songer. Je vous assure Madame qu’au milieu des plus pressantes affaires, une heure de conversation avec vous n’importe sur quoi serait, tout plaisir à part, le régime le plus sain du monde. à la vérité, ce n’est pas là de la solitude.
Lundi 3. 10 h du matin. Voilà votre lettre d’Abbeville. Je ne serai pas seul aujourd’hui. Que vous êtes aimable! Je voudrais vous le dire à mon plein gré. Mais je n’en ferai rien. Cette lettre n’ira cependant pas par la poste ; elle vous sera portée par le jeune homme dont je vous ai parlé, M. Nettement, qui va passer trois semaines en Angleterre et vient de me dire qu’il partait demain. Un moment, il m’a semblé que dans cette confiance, je vous parlerais comme nous nous parlions ici. Cela ne se peut ; j’y renonce. Ces mains étrangères, quelque sûres qu’elles soient
Ces chances lointaines, inconnues, tout cela refoule dans le cœur les choses qui auraient le plus envie d’en sortir. Il y a un degré de vérité, de liberté, qui ne souffre aucune entremise. C’est déjà trop quand on est ensemble, que la nécessité de rédiger ses sentiments en phrases et de les envoyer à deux pas en entendant le bruit de sa voix. L’âme ne passe jamais tout entière dans cette manifestation extérieure, et au moment même où elle parle, elle aspire. Surtout à être devinée dans ce qu’elle retient. Je ne sais lequel de nos poètes pour peindre la conversation. intime de deux amants a dit :
Cachés, et se parlant tout bas, quoique tout seuls. Il savait ce que c’est que l’intimité.
A tout prendre cependant, je me sens un peu plus à l’aise par M. Nettement que par la poste. Je lui remets donc cette lettre. Si vous êtes encore à Londres quand il en partira, il ira vous demander vos ordres pour moi. Vous pouvez les lui donner en sûreté. J’étais sûr que les volumes vous plairaient beaucoup. Si je n’en avais été sûr, je ne vous les aurais pas envoyés. Je ne déteste rien tant que la profanation d’un souvenir. A présent, quand vous reviendrez (car vous reviendrez) je vous parlerai librement de ces deux nobles créatures qui ont tenu tant de place dans ma vie. Il n’y a jamais eu, entre elles et moi, cinq minutes de roman. Je m’éprise le roman. Il a la prétention de surpasser la réalité et il lui est bien inférieur. L’amour vrai l’admiration vraie le dévouement vrai sont très rares, c’est pourquoi les gens qui ne s’y connaissent pas les appellent romanesques. Ils ne le sont pas du tout ; ils sont au contraire, quand ils existent tout ce qu’il y a de plus simple de plus positif, de plus pratique. Seulement il ne faut pas s’y tromper et prendre pour les sentiments-là, les fantaisies qui s’en attribuent le nom. Les feux follets qui traversent l’air s’appellent aussi des étoiles ; mais ils n’en ressemblent pas d’avantage aux étoiles véritables, et celles-ci n’en sont pas moins hautes et fixes parce que des traits de flamme apparente courent et brillent un moment dans les régions inférieures de l’atmosphère. Pourquoi vous parlerais-je aujourd’hui d’autre chose? J’ai le cœur joyeux et profondément indifférent à tout ce qui n’est pas ma joie. J’attendais votre première lettre avec une inexprimable impatience. J’avais soif de rentrer par ce simulacre, en possession de nos longs et doux entretiens. Dans une charmante habitude la première interruption a quelque chose de très amer. L’âme se précipite pour ressaisir le fil qui lui a échappé un moment. Adieu, dearest Princess. Soignez-vous comme vous me l’avez promis. Je serai charmé que vous me donniez des nouvelles ; mais sachez bien que j’aime infiniment mieux autre chose.
Adieu. Adieu. Guizot Je suis obligé de rester deux ou trois jours de plus à Paris. Moi aussi, j’ai négligé mes affaires et comme il y en a qui intéressent mes enfants je veux les faire avant de partir. Remarquez mon cachet. C’est celui dont je me servirai habituellement.
Ces chances lointaines, inconnues, tout cela refoule dans le cœur les choses qui auraient le plus envie d’en sortir. Il y a un degré de vérité, de liberté, qui ne souffre aucune entremise. C’est déjà trop quand on est ensemble, que la nécessité de rédiger ses sentiments en phrases et de les envoyer à deux pas en entendant le bruit de sa voix. L’âme ne passe jamais tout entière dans cette manifestation extérieure, et au moment même où elle parle, elle aspire. Surtout à être devinée dans ce qu’elle retient. Je ne sais lequel de nos poètes pour peindre la conversation. intime de deux amants a dit :
Cachés, et se parlant tout bas, quoique tout seuls. Il savait ce que c’est que l’intimité.
A tout prendre cependant, je me sens un peu plus à l’aise par M. Nettement que par la poste. Je lui remets donc cette lettre. Si vous êtes encore à Londres quand il en partira, il ira vous demander vos ordres pour moi. Vous pouvez les lui donner en sûreté. J’étais sûr que les volumes vous plairaient beaucoup. Si je n’en avais été sûr, je ne vous les aurais pas envoyés. Je ne déteste rien tant que la profanation d’un souvenir. A présent, quand vous reviendrez (car vous reviendrez) je vous parlerai librement de ces deux nobles créatures qui ont tenu tant de place dans ma vie. Il n’y a jamais eu, entre elles et moi, cinq minutes de roman. Je m’éprise le roman. Il a la prétention de surpasser la réalité et il lui est bien inférieur. L’amour vrai l’admiration vraie le dévouement vrai sont très rares, c’est pourquoi les gens qui ne s’y connaissent pas les appellent romanesques. Ils ne le sont pas du tout ; ils sont au contraire, quand ils existent tout ce qu’il y a de plus simple de plus positif, de plus pratique. Seulement il ne faut pas s’y tromper et prendre pour les sentiments-là, les fantaisies qui s’en attribuent le nom. Les feux follets qui traversent l’air s’appellent aussi des étoiles ; mais ils n’en ressemblent pas d’avantage aux étoiles véritables, et celles-ci n’en sont pas moins hautes et fixes parce que des traits de flamme apparente courent et brillent un moment dans les régions inférieures de l’atmosphère. Pourquoi vous parlerais-je aujourd’hui d’autre chose? J’ai le cœur joyeux et profondément indifférent à tout ce qui n’est pas ma joie. J’attendais votre première lettre avec une inexprimable impatience. J’avais soif de rentrer par ce simulacre, en possession de nos longs et doux entretiens. Dans une charmante habitude la première interruption a quelque chose de très amer. L’âme se précipite pour ressaisir le fil qui lui a échappé un moment. Adieu, dearest Princess. Soignez-vous comme vous me l’avez promis. Je serai charmé que vous me donniez des nouvelles ; mais sachez bien que j’aime infiniment mieux autre chose.
Adieu. Adieu. Guizot Je suis obligé de rester deux ou trois jours de plus à Paris. Moi aussi, j’ai négligé mes affaires et comme il y en a qui intéressent mes enfants je veux les faire avant de partir. Remarquez mon cachet. C’est celui dont je me servirai habituellement.
378. Londres, Dimanche 24 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
378. Londres, Dimanche 24 mai 1840
Je crois qu’on s’est amusé hier chez moi, et qu’on a trouvé le dîner bon. Mais Lady Holland a eu un moment affreux. Elle avait dîné la veille à 5 heures, pour aller au spectacte. Pas déjeuné le matin. Elle mourait de faim. Lord Palmerston nous a fait attendre jusqu’à 8 heures un quart. Lady Holland a commencé, par l’humeur. Puis le désespoir. Enfin, l’inanition. au moment de passer dans la salle à manger elle a appété Lord Duncannon et s’est recommandée à lui, car elle n’était pas sûre de pouvoir aller jusque là sans se trouver mal. Le dîner a dissipé, l’inanition. Mais je ne suis pas sûr qu’un peu de rancune ne lui ait pas survécu de ce que j’avais attendu Lord et Lady Palmerston. Pour le 13 juin mon dîner Tory. Voici ma liste. Le duc et la duchesse de Cambridge, le Prince George, la Princesse Angusta, Une dame un aide de camp, le duc de Wellington, lord et lady Aylesbury, lord et lady Jersey, lady Sarah Villiers, lord et lady Stuart de Rothsay, lord Abordeen, lord Hertford, lord Howe, lord Stanley, Sir Robert et lady Peel, lord Lyndhurst,lord Ellenborough.
Connaissez-vous Sir Edward Disbrowe, le ministre d’Angleterre à La Haye ? Il a de l’esprit et des manières agréables. Il vit dans une grande intimité avec M. de Boislecomte qui me l’a fort recommandé. Si les deux pays avaient partout, des agents pareils, il pourrait y avoir entre eux des affaires, jamais d’embarras.
Savez-vous que je commence à compter les jours ? C’est charmant et très impatientant. Vous n’êtes pas seule à prendre de grandes résolutions depuis la mort de ce pauvre lord William. Lady Fanny Cowper ne couche plus qu’avec un grand poignard. Elle l’a essayé l’autre jour contre son oreiller et elle a trouvé qu’il coupait très bien. Lord Leveson n’est qu’arrivé qu’après lord Palmerston. Pour lui, je ne l’avais pas attendu. Nous étions à table depuis un quart d’heure. Je cherche s’il y a encore quelque évènement que je ne vous aie pas dit. A propos de lord Leveson, tirez-moi, je vous prie, de peine avec Lord Granville. Je viens de retrouver perdu dans un tas de papiers un petit billet qu’il m’a écrit il y a déjà bien longtemps pour me recommander un M. Rey ingénieur français venu à Londres. J’ai vu ce M. Rey et je l’ai bien reçu. Mais je ne me rappelle pas si j’ai répondu à Lord Granville et son billet enfui et retrouvé, m’en fait douter. Sachez-moi cela, je vous prie, et si je n’ai pas répondu, excusez-moi par la vérité, en attendant, que je mexcuse moi-même.
4 heures
Je comprends que vous ayez oublié le vendredi. Mais je ne comprends pas pourquoi le n° que je reçois aujourd’hui s’appelle 383. Celui d’hier était 380. J’en place bien entre ces deux-là, un qui viendra demain et qui sera 381. Mais je ne puis trouver le 382. Je viens de faire quelques visites, le Maréchal Saldanha, lord Combermere &. Il y en a beaucoup ici, mais on va vite. Quand vous serez arrivée comment réglerons-nous nos heures ? Pensez-y d’abord parce qu’il faut le régler, ensuite parce qu’il est agréable d’y penser. Vous savez ma maxime que le temps ne manque jamais là où est le désir. Le temps ne me manquera donc pas ; mais je veux du fixe, sans renoncer au variable. En voiture, un quart d’heure pour aller à Stafford-House ; à pied, par les rues une demi-heure, par les pars, trois quarts d’heure. Vous ne m’avez pas dit, si la Duchesse de Sutherland vous avait répondu. Point de nouvelles, ou bien petites. La querelle avec le Portugal s’arrangera ; le maréchal Saldanha a tous les pouvoirs nécessaires. Le Roi de Naples est parti pour la Sicile fort irrité contre ceux de ses conseillers qui l’ont embarqué dans cette mauvaise affaire, entr’autre contre le prince de Satriano. On les a payées et il aura, lui, à payer. Là est la plaie. On croit ici comme vous, le Roi de Prusse fort malade. Nous en sommes fâchés, sincèrement fâchés, quoique sans rien craindre du successeur. Que je vous dise un bon procédé de M. de Brünnow. C’est demain le jour de naissance de la Reine. Jusqu’ici, d’après la tradition on n’illuminait pas à l’Ambassade. Un scrupule m’a pris. Je n’ai pas voulu prendre des airs d’empressement exclusif en illuminant tout seul, ni courir le risque de ne pas illuminer si d’autres, si un autre quelconque, illuminaient. J’ai tout simplement fait demander à Ashburnham-House ce qu’on faisait. On m’a fait dire qu’on n’illuminait pas. Trois heures après, M. de Brünnow m’a envoyé un valet de chambre pour me dire qu’il illuminait. J’illumine donc, et je le remercierai de ne m’avoir pas laissé dans l’erreur. J’ai un peu ri de la fluctuation. M. de Poix avait grande raison de compter que votre intervention serait heureure. Mais pour être heureuse, il faut qu’une intervention intervienne. Si l’affaire est faite avant que l’intervention ait paru, ce n’est pas la faute de l’intervention mais de ceux qui l’ont réclamé trop tard. Il y a trois mois que je suis ici, et cinq mois que cette place d’attaché- payé à Londres est en perspective.
Lundi 25, 8 heures
Un très petit dîner chez lord Palmerston, lord et lady Holland, lord et lady Normansby, lord John Russell, lord Leveson et moi. Décidément, on veut me mettre là dans l’intimité. Lady Holland se charge de mon éducation. Il m’est arrivé hier de citer un proverbe Anglais : Hell’s way is paved with good intentions. Elle m’a demandé bien bas bien pardon de son impertinence et m’a averti que jamais ici on ne prononçait le mot de Hell, à moins qu’on ne citât des vers de Milton. La haute poésie est la seule excusée. L’autre jour, elle m’avait repris parce que je disais always pour still. Je l’ai beaucoup remerciée. Je vois que l’inanition n’a pas laissé de rancune. A onze heures chez lady Jersey. Lord Stuart, lord Heytesbury, Sir Robert Wilson, et une femme d’esprit, point tulipe dont j’ai oublié de demander le nom quand elle est partie. Lord Heytesbury me convient : bonne conversation, pleine, sensée, tranquille, un peu triste. Il dit. "J’ai fini." Et on voit que ceux qui n’ont pas fini lui inspirent un peu d’envie sans malveillance. La beauté de mon surtout fait du bruit. Il en était question hier au soir chez Lady Jersey. 4 heures Je reviens du Drawing-room. Immense. La Reine en aura, certainement jusqu’à 7 heures. J’espère qu’on la décidera à s’asseoir. C’est fort cohue, tant on est pressé pour arriver, pressé quand on y est, et pressé en sortant. Le palais est beaucoup trop petit. Pas de place pour les queues ; pas de place pour le spectateurs. Il y a une infinie quantité de beaute perdue, choses et personnes. Adieu. Votre fils part demain. Il ira lentement de Calais à Paris. Je suis bien heureux de le voir partir. Adieu. Adieu. Par le Télégraphe.
Je crois qu’on s’est amusé hier chez moi, et qu’on a trouvé le dîner bon. Mais Lady Holland a eu un moment affreux. Elle avait dîné la veille à 5 heures, pour aller au spectacte. Pas déjeuné le matin. Elle mourait de faim. Lord Palmerston nous a fait attendre jusqu’à 8 heures un quart. Lady Holland a commencé, par l’humeur. Puis le désespoir. Enfin, l’inanition. au moment de passer dans la salle à manger elle a appété Lord Duncannon et s’est recommandée à lui, car elle n’était pas sûre de pouvoir aller jusque là sans se trouver mal. Le dîner a dissipé, l’inanition. Mais je ne suis pas sûr qu’un peu de rancune ne lui ait pas survécu de ce que j’avais attendu Lord et Lady Palmerston. Pour le 13 juin mon dîner Tory. Voici ma liste. Le duc et la duchesse de Cambridge, le Prince George, la Princesse Angusta, Une dame un aide de camp, le duc de Wellington, lord et lady Aylesbury, lord et lady Jersey, lady Sarah Villiers, lord et lady Stuart de Rothsay, lord Abordeen, lord Hertford, lord Howe, lord Stanley, Sir Robert et lady Peel, lord Lyndhurst,lord Ellenborough.
Connaissez-vous Sir Edward Disbrowe, le ministre d’Angleterre à La Haye ? Il a de l’esprit et des manières agréables. Il vit dans une grande intimité avec M. de Boislecomte qui me l’a fort recommandé. Si les deux pays avaient partout, des agents pareils, il pourrait y avoir entre eux des affaires, jamais d’embarras.
Savez-vous que je commence à compter les jours ? C’est charmant et très impatientant. Vous n’êtes pas seule à prendre de grandes résolutions depuis la mort de ce pauvre lord William. Lady Fanny Cowper ne couche plus qu’avec un grand poignard. Elle l’a essayé l’autre jour contre son oreiller et elle a trouvé qu’il coupait très bien. Lord Leveson n’est qu’arrivé qu’après lord Palmerston. Pour lui, je ne l’avais pas attendu. Nous étions à table depuis un quart d’heure. Je cherche s’il y a encore quelque évènement que je ne vous aie pas dit. A propos de lord Leveson, tirez-moi, je vous prie, de peine avec Lord Granville. Je viens de retrouver perdu dans un tas de papiers un petit billet qu’il m’a écrit il y a déjà bien longtemps pour me recommander un M. Rey ingénieur français venu à Londres. J’ai vu ce M. Rey et je l’ai bien reçu. Mais je ne me rappelle pas si j’ai répondu à Lord Granville et son billet enfui et retrouvé, m’en fait douter. Sachez-moi cela, je vous prie, et si je n’ai pas répondu, excusez-moi par la vérité, en attendant, que je mexcuse moi-même.
4 heures
Je comprends que vous ayez oublié le vendredi. Mais je ne comprends pas pourquoi le n° que je reçois aujourd’hui s’appelle 383. Celui d’hier était 380. J’en place bien entre ces deux-là, un qui viendra demain et qui sera 381. Mais je ne puis trouver le 382. Je viens de faire quelques visites, le Maréchal Saldanha, lord Combermere &. Il y en a beaucoup ici, mais on va vite. Quand vous serez arrivée comment réglerons-nous nos heures ? Pensez-y d’abord parce qu’il faut le régler, ensuite parce qu’il est agréable d’y penser. Vous savez ma maxime que le temps ne manque jamais là où est le désir. Le temps ne me manquera donc pas ; mais je veux du fixe, sans renoncer au variable. En voiture, un quart d’heure pour aller à Stafford-House ; à pied, par les rues une demi-heure, par les pars, trois quarts d’heure. Vous ne m’avez pas dit, si la Duchesse de Sutherland vous avait répondu. Point de nouvelles, ou bien petites. La querelle avec le Portugal s’arrangera ; le maréchal Saldanha a tous les pouvoirs nécessaires. Le Roi de Naples est parti pour la Sicile fort irrité contre ceux de ses conseillers qui l’ont embarqué dans cette mauvaise affaire, entr’autre contre le prince de Satriano. On les a payées et il aura, lui, à payer. Là est la plaie. On croit ici comme vous, le Roi de Prusse fort malade. Nous en sommes fâchés, sincèrement fâchés, quoique sans rien craindre du successeur. Que je vous dise un bon procédé de M. de Brünnow. C’est demain le jour de naissance de la Reine. Jusqu’ici, d’après la tradition on n’illuminait pas à l’Ambassade. Un scrupule m’a pris. Je n’ai pas voulu prendre des airs d’empressement exclusif en illuminant tout seul, ni courir le risque de ne pas illuminer si d’autres, si un autre quelconque, illuminaient. J’ai tout simplement fait demander à Ashburnham-House ce qu’on faisait. On m’a fait dire qu’on n’illuminait pas. Trois heures après, M. de Brünnow m’a envoyé un valet de chambre pour me dire qu’il illuminait. J’illumine donc, et je le remercierai de ne m’avoir pas laissé dans l’erreur. J’ai un peu ri de la fluctuation. M. de Poix avait grande raison de compter que votre intervention serait heureure. Mais pour être heureuse, il faut qu’une intervention intervienne. Si l’affaire est faite avant que l’intervention ait paru, ce n’est pas la faute de l’intervention mais de ceux qui l’ont réclamé trop tard. Il y a trois mois que je suis ici, et cinq mois que cette place d’attaché- payé à Londres est en perspective.
Lundi 25, 8 heures
Un très petit dîner chez lord Palmerston, lord et lady Holland, lord et lady Normansby, lord John Russell, lord Leveson et moi. Décidément, on veut me mettre là dans l’intimité. Lady Holland se charge de mon éducation. Il m’est arrivé hier de citer un proverbe Anglais : Hell’s way is paved with good intentions. Elle m’a demandé bien bas bien pardon de son impertinence et m’a averti que jamais ici on ne prononçait le mot de Hell, à moins qu’on ne citât des vers de Milton. La haute poésie est la seule excusée. L’autre jour, elle m’avait repris parce que je disais always pour still. Je l’ai beaucoup remerciée. Je vois que l’inanition n’a pas laissé de rancune. A onze heures chez lady Jersey. Lord Stuart, lord Heytesbury, Sir Robert Wilson, et une femme d’esprit, point tulipe dont j’ai oublié de demander le nom quand elle est partie. Lord Heytesbury me convient : bonne conversation, pleine, sensée, tranquille, un peu triste. Il dit. "J’ai fini." Et on voit que ceux qui n’ont pas fini lui inspirent un peu d’envie sans malveillance. La beauté de mon surtout fait du bruit. Il en était question hier au soir chez Lady Jersey. 4 heures Je reviens du Drawing-room. Immense. La Reine en aura, certainement jusqu’à 7 heures. J’espère qu’on la décidera à s’asseoir. C’est fort cohue, tant on est pressé pour arriver, pressé quand on y est, et pressé en sortant. Le palais est beaucoup trop petit. Pas de place pour les queues ; pas de place pour le spectateurs. Il y a une infinie quantité de beaute perdue, choses et personnes. Adieu. Votre fils part demain. Il ira lentement de Calais à Paris. Je suis bien heureux de le voir partir. Adieu. Adieu. Par le Télégraphe.
364. Paris, Mardi 5 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
364. Paris, mardi 5 mai 1840
10 heures
Je vous prie de me répondre sur le sujet des copies que je vous ai envoyées par Ellice. Je trouve cela parfaitement maladoit dans la forme et pitoyable pour le fond. Encore. une fois, soyez bien sûr que cela ne me dérangera pas, je serais même tentée d’ajouter au contraire, et s’il n’y avait du ridicule, je partirais plutot demain que dans un mois. Mais je vous prie de me parler de cela, je voudrais quelques bonnes petites phrases pour y répondre. J’ai encore vu Ellice hier longuement. J’ai fait ma promenade, mon dîner seule. Le soir les deux Pahlen, Arnim, les Durazzo, les Valambrozo, quelques autres. Mais savez-vous que tout ce monde m’occupe, vous ne savez pas comme le soir m’ennuie depuis le 24 février ! Mon fils me revient à la fin de la semaine et restera avec moi à peu près. jusqu’à mon départ.
1 heure
J’ai fait ma promenade et j’ai vu Chermside. Je suis mieux depuis qu’il m’a reprise. J’ai lu ce matin des vers charmants de Victor Hugo dans le feuilleton du journal des Débats, lisez cela. Il y a une strophe qui m’a beaucoup frappée surtout. Le dernier vers est je crois ceci.
Tout commence ici bas; et tout finit ailleurs.
Je ne vous ai pas assez dit combien je suis contente de ce que m’a montré Génie hier. Je suis contente du présent et contente de l’avenir. Vous avez mille fois raison. Que de choses à nous dire.
J’ai été dire adieu à mad. Talleyrand hier, elle part demain. Elle va droit à Berlin. se plonger dans les royautés Je crois qu’elle y trouvera l’Empératrice aussi. Le Roi de Hanovre m’a mandé que le roi de Prusse est faible et ne veut pas. bouger de Postdam. Toute la Prusse est convaincue qu’il doit mourir cette année. Il me semble que l’affaire Naples va bien, j’en suis charmée. Le temps est convert aujourd’hui. Je voudrais de la pluie, je me sens les poumons desséchés de cette chaleur. Adieu, j’ai écrit une longue lettre à Matonchewitz ce matin. il faut encore expédier le Hanôvre.
On dit que Brougham ne retournera pas en Angleterre, et qu’il ne peut pas y retourner. Adieu. Adieu. As much as you like.
10 heures
Je vous prie de me répondre sur le sujet des copies que je vous ai envoyées par Ellice. Je trouve cela parfaitement maladoit dans la forme et pitoyable pour le fond. Encore. une fois, soyez bien sûr que cela ne me dérangera pas, je serais même tentée d’ajouter au contraire, et s’il n’y avait du ridicule, je partirais plutot demain que dans un mois. Mais je vous prie de me parler de cela, je voudrais quelques bonnes petites phrases pour y répondre. J’ai encore vu Ellice hier longuement. J’ai fait ma promenade, mon dîner seule. Le soir les deux Pahlen, Arnim, les Durazzo, les Valambrozo, quelques autres. Mais savez-vous que tout ce monde m’occupe, vous ne savez pas comme le soir m’ennuie depuis le 24 février ! Mon fils me revient à la fin de la semaine et restera avec moi à peu près. jusqu’à mon départ.
1 heure
J’ai fait ma promenade et j’ai vu Chermside. Je suis mieux depuis qu’il m’a reprise. J’ai lu ce matin des vers charmants de Victor Hugo dans le feuilleton du journal des Débats, lisez cela. Il y a une strophe qui m’a beaucoup frappée surtout. Le dernier vers est je crois ceci.
Tout commence ici bas; et tout finit ailleurs.
Je ne vous ai pas assez dit combien je suis contente de ce que m’a montré Génie hier. Je suis contente du présent et contente de l’avenir. Vous avez mille fois raison. Que de choses à nous dire.
J’ai été dire adieu à mad. Talleyrand hier, elle part demain. Elle va droit à Berlin. se plonger dans les royautés Je crois qu’elle y trouvera l’Empératrice aussi. Le Roi de Hanovre m’a mandé que le roi de Prusse est faible et ne veut pas. bouger de Postdam. Toute la Prusse est convaincue qu’il doit mourir cette année. Il me semble que l’affaire Naples va bien, j’en suis charmée. Le temps est convert aujourd’hui. Je voudrais de la pluie, je me sens les poumons desséchés de cette chaleur. Adieu, j’ai écrit une longue lettre à Matonchewitz ce matin. il faut encore expédier le Hanôvre.
On dit que Brougham ne retournera pas en Angleterre, et qu’il ne peut pas y retourner. Adieu. Adieu. As much as you like.
[Paris], le 19 octobre 1834, Jules Janin à François Guizot
Collection : 151_Correspondances : 1833-1865
Auteurs : Janin, Jules (1804-1874)
Val-de Loup, le 12 mai 1809, François-René de Chateaubriand à François Guizot
Auteurs : Chateaubriand, François-René de (1768-1848)
Mots-clés : Catholicisme, France (1814-1830, Restauration), Poésie, Protestantisme, Religion
Paris, le 18 avril 1806, François-René de Chateaubriand à François Guizot
Auteurs : Chateaubriand, François-René de (1768-1848)
Mots-clés : France (1814-1830, Restauration), Poésie, Publication
Grosvener Place, le 27 avril 1870, Philip Henry Stanhope à François Guizot
Collection : 179_Lettres de Philip Henry Stanhope : 1842-1872
Auteurs : Stanhope, Philip-Henry vicomte Mahon (1805-1875)
Mots-clés : Edition, France (1852-1870, Second Empire), Poésie, Publication
Ville d'Avray, le 25 juillet 1861, Ernest Legouvé à François Guizot
Collection : 183_Correspondances : 1848-1871
Auteurs : Legouvé, Ernest (1807-1903)
[Seine port], le 26 juin 1861, Ernest Legouvé à François Guizot
Collection : 183_Correspondances : 1848-1871
Auteurs : Legouvé, Ernest (1807-1903)
Teddington, le 6 février 1870, Louis d'Orléans à François Guizot
Auteurs : Orléans, Louis Charles Philippe Raphaël d' (duc de Nemours) (1814-1896)
Le 28 juin 1861, Abel Villemain à François Guizot
Collection : 195_Lettres d'Abel Villemain à Guizot : 1827-1868
Auteurs : Villemain, Abel-François (1790-1870)
Le 21 juin 1861, Abel Villemain à François Guizot
Collection : 195_Lettres d'Abel Villemain à Guizot : 1827-1868
Auteurs : Villemain, Abel-François (1790-1870)
Vienne, le 20 mars 1808, Madame de Staël à François Guizot
Collection : 157_Correspondance avec Madame de Staël : 1807-1808
Auteurs : Necker, Anne-Louise Germaine (1766-1817)