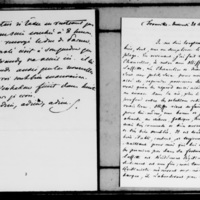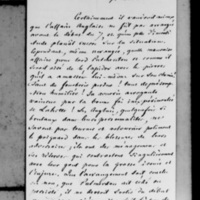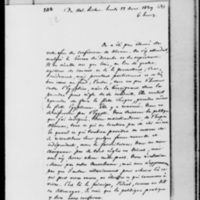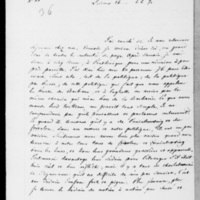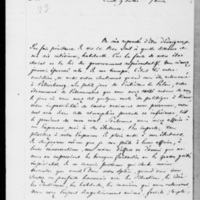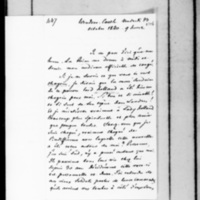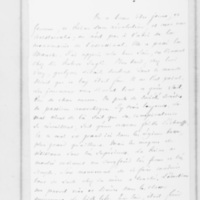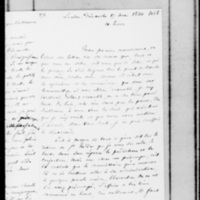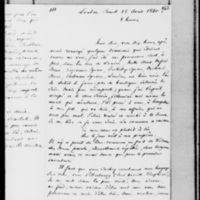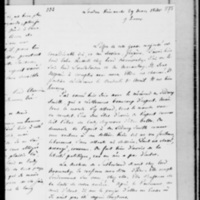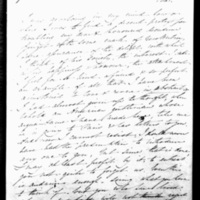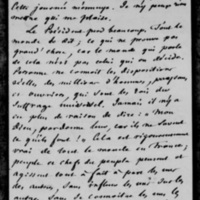Votre recherche dans le corpus : 39 résultats dans 6062 notices du site.
41. Paris, Lundi 17 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Deux jours sans lettres, ni hier, ni avant hier. Je ne comprends pas. J’ai la confiance que si vous étiez malade et hors d'Etat de m'écrire deux lignes, Hélène me donnerait de vos nouvelles. J'espère donc que vous n'êtes pas malade. Mais le déplaisir est grand.
10 heures et demie
En voilà deux 30 et 31. J’aurais dû avoir le 30 hier. Mon plaisir de ce moment me fait oublier mon ennui de deux jours.
Votre commission pour Andrial sera faite avant 2 heures. Elle est un peu délicate ; mais je m’arrangerai pour la bien faire, et j'espère qu’il pourra persister en conscience dans son propre avis. J'y mets presque autant d'importance que vous-même. La Princesse Kotschoubey auprès de vous m'est une grande sécurité. Au moins faut-il que vous l'ayez tout l'été.
Je vous ai dit mon impuissance auprès de Marion. Soyez sûre de deux choses, que j’ai dit tout ce que je pouvais, tout ce qui se pouvait dire, et qu’il n’y a pas moyen. Toute la famille a un parti pris. Et puis, au fond du cœur, sans me le dire, on vous craint.
Laissez lui prendre un pied chez vous ; elle en aura bientôt pris quatre. Vous avez abusé ; il y a un degré d’exigence qui tue la puissance. Aggy n'était pas en état de se défendre ; mais il lui est resté une grande peur de succomber. Marion sait se défendre ; mais elle n’a pas envie d'y être obligée. Elles se sont jadis très étourdiment engagées ; elles ne veulent plus s’engager du tout. Je vous ai dit, la chance que Marion m’avait laissé entrevoir ; si j’avais voulu amener cette chance à devenir une promesse, j’aurais eu un non positif. Vous connaissez la brutalité des Anglais quand ils sont décidés. Je n’ai pas encore vu Ellice. Je causerai Jeudi avec lui.
Brougham aussi est arrivé. Ils parlent beaucoup l’un et l'autre, des difficultés de la guerre ; ils ne se promettent point de succès prompts et décisifs ; mais ils se montrent et ils disent que leur pays est très résolu à continuer, tant qu’il faudra ; ils indiquent trois ans comme le minimum de la durée. C'est presque aussi ridicule que trois jours ou trois siècles. Personne ne peut rien entrevoir dans l'avenir de cet apathique chaos.
Le Duc de Cambridge s'amuse beaucoup ici. Il a retardé son départ pour un grand bal qu’on lui donne aujourd’hui aux Tuileries.
Le maréchal St Arnaud ne commandera point Lord Raglan. Il y aura concert entre les deux armées, mais non unité. Ainsi ont opéré, le Duc de Marlborough et le Prince Eugène, Wellington, et Blücher. Cela a des inconvénients, mais des inconvénients qui n'empêchent pas les victoires.
Je n’avais pas oublié, le courrier de Brock. Mais je n’avais rien à vous dire qui en valût la peine. Hier matin, Duchâtel longtemps et Molé. Hier soir Broglie et Ste Aulaire. Personne ne sait rien, et tout le monde attend sans grande curiosité. L'indifférence politique a remplacé l'indifférence religieuse, ce qui ne veut pas dire qu’il y ait beaucoup de chaleur religieuse. Adieu, Adieu.
Je vous quitte pour faire ma toilette et m'occuper ensuite d'Andral. Adieu. G.
Trouville, Mercredi 21 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis longtemps promené hier seul une ou deux lieues le long de la plage. En revenant, j’ai fait visite au Chancelier, à notre ami Olliffe et à Charles Laffitte. Le Chancelier et Mad. de Boigne, sont aux petits soins pour moi. Il est bien aisé de reprendre possession des gens. Il est vrai qu'on les reperd aussi aisément. Plus on avance dans la vie, plus le fossé devient profond entre les relations ordinaires et les vrais liens.
Ollife vient de faire bâtir ici pour lui-même une bonne et jolie maison absurde au dehors, gothique, mauresque, italienne mais très commode et bien arrangée au dedans et très bien meublée. Il est tout à fait riche, bien établi, content, et toujours très reconnaissant pour moi qui lui ai fait faire les premiers pas dans sa fortune.
Charles Laffitte est décidément légitimiste. Cela seulement est une fin ; mais tant que les légitimistes mèneront aux-mêmes leur barque, ils n'aborderont pas. Le Président leur doit une belle chandelle. Ils lui donnent les trois quarts des Orléanistes.
Voilà ce que j’ai appris dans mes visites. Aujourd'hui je vais dîner à la campagne, prés de Honfleur chez Mad. Denoix, femme de notre consul général à Milan, grande ancienne armée du chancelier. Elle habite un cottage dans un site qu’on dit le plus beau du pays.
Pauline avec son mari, et Guillaume, part samedi pour l’Angleterre, et je retourne mardi prochain au Val Richer, avec Henriette. Il fait froid à Trouville, décidément le mois d’Août a été laid. Mes huit jours d'Ems sont le seul beau temps de l'été.
Vous m'apprenez que la Princesse Crasalcovitch est méchante. Mais cela ne m'étonne pas. Cela va à son air et à ses gestes. Est-ce pour lui donner à dîner que Thiers est venu à Baden ? Le Chancelier est convaincu qu'il est venu pour Wiesbaden. Je le croirais si je n'étais pas sûr que j'ai été à Ems et que je n'ai pas vu M. le comte de Chambord. Je voudrais que le Chancelier eût raison.
Est-ce Crasalcovitch, comme je dis, ou Grassalcovitch comme vous dites ? Je soupçonne que chez ces peuples encore un peu barbares personne ne sait bien quel est vraiment son nom. Shakespeare signait trois ou quatre orthographes différentes. Adieu jusqu'à l'heure de la poste. Je vais faire ma toilette. J’ai vu hier des nouvelles de Claremont. Toujours mauvaises. Le Roi n'a plus de jambes du tout. Il ne peut se soutenir d'un fauteuil à l'autre, dans sa chambre.
Midi
Voici votre lettre. Très intéressante. Je souhaite de tout mon coeur que tout cela soit vrai. Le départ brusque de M. de La Rochejaquelein est un bon symptôme. Adieu, Adieu. Je vais lire le séjour du président à Besançon. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 3 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Certainement il vaudrait mieux que l'affaire Anglaise ne fût pas arrangée avant le débat du 7 et qu'un peu d’incertitude planât encore sur la situation. Cependant, même arrangée, quelle mauvaise affaire pour Lord Palmerston et comme il serait aisé de le lapider avec les pierres qu’il a amassées lui-même sur son chemin. Tant de fourberie perdue ! Tant de présomption humiliée ! Sa rouerie arrogante vaincue par la bonne foi inexpérimentée de Lahitte !
Les Anglais, quelquefois si brutaux dans leurs personnalités, ne savent pas tourner et retourner poliment le poignard dans les blessures de leurs adversaires ; ils ont des ménagements et des réserves qui contrastent singulièrement avec leur goût pour la grosse ironie et l’injure. Que l’arrangement soit conclu ou non, que Palmerston ait cédé, ou persisté, il ne devrait sortir du débat que mis en pièces ; il a fait là une de les choses dans lesquelles il faut absolument réussir pour pouvoir en parler.
Si vous étiez ici, si nous nous promenions ensemble, le beau soleil la fraîche verdure, le calme gai de ma vallée nous feraient oublier Palmerston et les débats de Londres. Mais vous n’y êtes pas, et j'oublie ma vallée, la verdure et le soleil pour vous parler de Palmerston.
10 heures
Vos dernières lignes me désolent sans m'étonner. Je suis parti craignant cette explosion. Ce sera bien mauvais. Se rejeter dans tous les hasards pour de si pitoyables motifs ! Nous sommes dans des mains d'enfants. Je veux croire encore qu’on s’arrangera. Et je le crois presque. Il y a un point de déraison qui me semble toujours impossible. Je m’y suis trompé souvent. Avais-je tort dans ce que je vous disais hier en vous parlant de La Redorte Je reçois de Londres une lettre curieuse. On me dit que la question grecque est à peu près morte " Tant qu'elle a été ouverte, personne n'a osé y toucher ; depuis qu’elle est fermée, l’intérêt n’y est plus. Il faudrait encore plus de talent que n'en a Lord Stanley pour la faire revivre. Il y a huit jours, on parlait avec conviction d’un vote hostile dans la chambre des Lords ; aujourd’hui, on n'y a pas renoncé, mais il en est moins question. On le disait aussi, parmi les whigs, que ce serait la dernière fois qu’on s’exposerait à subir de pareilles ignominies, et les vives remontrances de la Cour, ont été un peu mieux écoutées qu’auparavant. Mais [wows] made in pain. Il ne s’agit pas le moins du monde de mettre Lord Clarendon au foreign office ; mais il ne serait pas de toute impossibilité que Lord John s’en chargeât provisoirement lui-même. Faible lueur d’une faible intention.
On est d'accord ici pour soumettre la question des conventions rivales au Roi Othon lui-même. Palmerston s'est borné à exposer à ses collègues les deux voies qu’il y avait à suivre ; ils se sont décidés aux concessions.» Je vous envoie ce qui me vient. Paris me préoccupe bien plus que Londres. Que dites-vous du langage du Prince de Prusse ? Il a voulu se lier avant de partir et annuler d'avance l'influence de l'Empereur. Adieu, Adieu.
Richmond, Mardi 25 Septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai causé hier avec Lord John du même sujet que traite la lettre de Beauvale que je vous ai envoyée hier. Il s'est mis à rire. " Les Français sont si drôles. Ils raisonnent, ils raisonnent & n’arrivent jamais à du plain good sense. Of course leur assemblée comme notre parlement est bien maîtresse de faire ce qu'elle veut & sa dé[?] ne la gêne pas. What did we do in George 1st reign ? At that time te parliement sat for three years, that was the law. But as the country was agitated by the intrigues of the Jacobit party and as there might have been danger from it, parliament renewed sitting for 7 years. And this has been the rule ever since. So that we did not fear to do an unlawfull thing. When there was necessity for it. And certainly there is necessity in France to do away with their mons truous constitution. This assembly is just as powerfull as was the former. But they will go on talking and talking without doing anything that has common sense. Vous voyez que c’est bien là le même langage que Beauvale. Pas de nouvelles. Je crois que Flahaut & Morny arrivent d'Ecosse aujourd'hui. Lady Shelborne étant ici. Je pense qu’ils y viendront.
N’est-ce pas demain que je vous adresse pour la dernière fois ma lettre au château de Broglie. Je le regrette, J'aimais à vous savoir avec lui, & de la bonne conversation. De quoi êtes- vous convenu avec lui sur l’époque de votre retour à Paris, car enfin vous n'avez pas le projet de passer l'hiver au Val-Richer, & l'hiver commence en 9bre 1. Quel ennui ! Depuis deux jours on ne me donne les lettres & journaux de France qu'a 3 heures. A propos, écrivez-moi le vendredi une lettre séparée, Elle me sera remise le lundi, plusieurs heures avant celle de Samedi. Ainsi écrivez & envoyez tous les jours de la semaine. Achille Fould est à la campagne chez Lady Allice. Voilà qu’elle veut me l'envoyer quelle drôle de femme. Il repart Samedi pour Paris. Adieu.
Val-Richer, Mercredi 1er août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève d'impatience. J’attends la poste. Elle n’arrivera qu'à 10 heures et demie. Que m'apportera- t-elle ? J'ai reçu hier une lettre de Mad. Austin qui me dit que son mari, qui est à Brighton lui écrit que tout le monde s'y porte bien. Je désire beaucoup que vous ayez vu MM. Guéneau de Mussy. Mais que sert tout ce que je puis vous dire de loin ?
Avez-vous remarqué, dans le Times de samedi dernier 28, un excellent article sur l'état de la France que je retrouve dans le Galignani d'avant- hier 30 ? Vraiment excellent. Jamais la conduite de l’ancienne opposition dynastique, et de Thiers en particulier, n’a été mieux peinte et mieux appréciée. Beaucoup de gens en France voient et disent tout cela ; mais ils n'en font ni plus ni moins. Le bon sens porte ses fruits en Angleterre. Là où, il se rencontre en France, c'est une fleur sans fruits. Rien ne se ressemble moins chez les peuples du midi, que la conversation et la conduite ; ce qu’ils pensent et disent ne décide pas du tout de ce qu’ils font. Pleins d’intelligence et de jugement comme spectateurs, quand ils deviennent acteurs il n’y paraît plus. Bresson et Bulwer m’ont souvent dit cela, des Espagnols. Bien pis encore qu'ici, me disaient-ils. Nous n'avons plus le droit d’être sévères pour les Espagnols. Les Hongrois se défendent énergiquement. Je ne sais pas bien cette affaire-là. Je crains que le Cabinet de Vienne par routine ne se soit engagé dans des prétentions et des déclarations excessives non part contre le parti révolutionnaire de Hongrie, mais contre les anciens droits et l’esprit constitutionnel de la nation. On ne saurait séparer avec trop de soin ce qui est national de ce qui est révolutionnaire, ce qui a un fondement en droit et dans les mœurs du pays de ce qui n’est que rêverie et insolence de l’esprit d'anarchie. Le Prince de Schwartzemberg, est-il en état et en disposition de faire ce partage ? Je parle d'autre chose pour me distraire d’une seule chose. Je n'y réussis guères. Adieu. Adieu jusqu'à la poste.
10 heures trois quarts
M. de Lavergne et M. Mallac m’arrivent de Paris, et la poste n'est pas encore là. Parce que j’en suis plus pressé que jamais. Je n'ai pas encore causé du tout avec ces messieurs. Ils sont dans leurs chambres. Je ne pourrai causer avec personne que lorsque j'aurai ma lettre et pourvu qu’elle soit bonne. Voilà ma lettre. Excellente. J’ai le cœur à l'aise. J’étais sûr que M. Gueneau de Mussy vous plairait. Croyez-le et obéissez-lui autant que vous le pourrez faire pour un médecin. Il m’est très dévoué. Il vous soignera bien. Adieu. Adieu. Je vais rejoindre-mes hôtes. Adieu dearest. J’espère que le bien se soutiendra. G.
Richmond, Samedi 9 septembre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens d’écrire à Lutteroth & d'accepter tous ses avis. Savez-vous que l’affaire danoise devient bien grosse. Moi je crois que Francfort croulera de cette affaire-là. Il est impossible que la Prusse le soumette à ces insolences, voyez un peu où tout cela peut mener ?
Je n’ai pas rencontré hier le Koller, je n'ai donc rien du tout à vous dire, mais j'écris as in duty bound. Et pour quelque chose d’autre encore, mon grand plaisir. Je suis étonnée de n’avoir rien de Lady Palmerston. Ils sont allés à Broadlands.
Vos filles ont un peu choqué l’Assemblée à la prorogation avec leurs robes montantes. Clauricarde & moi nous vous avions bien recommandé la tenue comme pour un grand dîner, mais vous n'écoutez pas, ou vous ne vous faites pas écouter. Vous serez fâché de la mort de Baudrant, Adieu. Adieu à demain 5 heures à Holland house. Adieu.
9. Château d'Eu, Mercredi 16 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je vous en conjure, ne soyez pas malade ; que je ne vous trouve pas malade. Vous ne savez pas à quel point j'ai besoin d'être tranquille sur vous, avec quel sentiment, chaque fois que je vous vois, j’interroge votre physionomie. Que sera-ce quand je vais vous revoir ? Vous le voyez ; je suis prudent je suis clever. J’ai ramené le Roi par Calais. Je reste un jour ici à me reposer. C’est vous qui êtes chargée de m’en récompenser. Portez-vous bien. Je suis bien, très bien. J’ai bien dormi de 5 à 10 heures. J’ai très bien déjeuné dans ma chambre. Quand ma toilette a été faite, l’heure du déjeuner du Roi était passé. Et puis, j'ai besoin et soif de solitude. J’ai donc préféré ma chambre. Une côtelette, une aile de poulet, des asperges, du raisin, et du thé. Est-ce bien ?
Cela vaut mieux que la cuisine de Windsor. Pas de légumes mangeables, excepté les pommes de terre. Pas un bon poulet. Et toutes les peines du monde à avoir du riz ou du vermicel, pour potage, au lieu de turtle. Vous auriez ri du luncheon que nous avons mangé à Portsmouth chez un bon M. Grant, Store keeper qui l’avait préparé pour ses amis de Londres venus pour assister à l'embarquement du Roi. Plus de 10 mille personnes étaient là dans cet espoir. L’amiral Cockburn, était au désespoir de notre changement de plan. Il a lutté obstinément pour le premier projet. Il regrettait. passionnément son spectacle sur mer. Puis, quand on lui a demandé d’envoyer un canot au Gomer, qui était en rade à Spithead il y en a envoyé deux successivement qui sont revenus, tous deux sans avoir pu franchir la barre. Il aurait fallu rester à Portsmouth à attendre que le temps changeât.
En débarquant en France à Calais, à Boulogne, à Montreuil, à Abbeville, partout sur la route, j’ai trouvé l’état d’esprit des populations excellent. Vive joie de revoir, de reprendre le Roi. Vif orgueil de l’accueil qu’il venait de recevoir en Angleterre. Vive satisfaction de la consolidation de la paix. Voilà les sentiments vrais, naturels, spontanés. Je les jetterai à la tête de ceux qui essaieront de les obscurcir, de les dénaturer, de mettre à la place les stupidités routinières et les animosités factices des journaux. Vous avez mille fois raison. Je prendrai ma position et les choses sur un ton très haut. J’en ai le droit, et c’est la bonne tactique. Adien. Adieu.
Dear, dear, infinitely dear. Encore une fois, ne soyez pas malade. Si vous m’aimez, c’est tout ce que je vous demande. Adieu. Je suis charmé que Marion soit là. Adieu. à demain. Charmante parole ! G.
312. Val-Richer, Jeudi 7 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je pense que depuis plusieurs jours, je ne vous écris que de courtes lettres. Cela me déplaît. Au moment où je vous écris, la perspective de Mercredi soir m’apparaît et je m'arrête. Ma lettre m’ennuie. Quand elle est partie, sa brièveté me choque ; tout ce que j’aurais pu vous dire me revient à l’esprit. C’est une conversation qui me manque. C’est presque vous qui me manquez. Presque quasi. Vous dites que le cœur n’a pas d’esprit. Ce n’est pas vrai. Je ne connais rien qui en ait autant. Rien qui en donne autant. Quel est l'amoureux qui n’a pas d'esprit. M. de Sainte-Beuve en a, sans être amoureux ; mais du plus alambiqué, quintessencié, un peloton embrouillé qui se dévide dans un labyrinthe.
Je vous vois d'ici immobile, grave étonnée, regardant les interlocuteurs, et vous en allant. Vous avez raison. C’est un défaut Français de s'adonner tout entier à une idée, une fantaisie, une conversation, une personne et de ne plus faire attention à rien ni à qui que ce soit. Défaut aggravé de notre temps par les habitudes de coterie. Les habitués d'une coterie sont peu polis. Ils se voient tous les jours, et ne se gênent plus entre eux. Delà à ne se gêner pour personne, il n’y a pas loin. Puis, il y a un argot dans une coterie, & ceux qui le parlent oublient que tout le monde, n’est pas initié. M. le Chancelier, en sa qualité d’ancien parlementaire, se croit obligé d’être pour les Jansénistes d’aimer les Jansénistes. Il ne les connait, ni ne les aime. Rien ne ressemble moins à un Janséniste que cet esprit tout d’expédients, de billets du matin, de visites du soir, avisé, expérimenté, glissant beaucoup et ne tombant jamais. Pascal l’aurait mis dans ses Provinciales. Mais n'importe. Ses pères étaient Jansénistes. Il n'en entendra pas parler avec indifférence. Il ne cessera pas d’en parler. M. de Ste Beuve n’a pas les mêmes raisons de passion. Il a les raisons contraires, ce qui vaut tout autant. Il est, lui, un converti à l'amour du Jansénisme, un ancien libertin et incrédule qui s’est épris d’un enthousiasme littéraire pour austérité et la dévotion. Il a le zèle du novice comme M. le Chancelier, celui de l’hérédité. Vous qui n’avez ni l’un ni l'autre, vous ne vous êtes pas trouvée de la coterie. Après avoir concédé, il faut résister. Il y a des impolitesses nationales. Chaque pays a les siennes. Quand nous serons ensemble, je vous dirai celles que je trouve aux Anglais. Pour le moment, je ne parle de M. de Ste Beuve qu'à vous. Je n'en veux pas parler légèrement. Il écrit à mon sujet une espèce de brochure qui doit paraître cet hiver dans la Revue des deux mondes. On m'a dit cela.
Vendredi 7 heures et demie
Je me lève par un singulier effet de lumière. Le ciel est rouge comme au plus chaud soleil couchant du midi. Il fait froid. Le temps ne me fait plus rien. Il n'y a point et il n’y aura point de querelle sérieuse entre le Roi et son Cabinet. Ils se céderont toujours assez l’un à l'autre pour que le dissentiment n'aille jamais au delà de l'humeur. Et comme ils n’ont pas la prétention d'être amoureux l'un de l'autre entre eux l'humeur ne fait rien.
10 heures
Je ne me résigne pas à ces affaires de Péterbourg, à ces entraves de Paul, à ce renouvellement perpétuel de procédés inouïs. Il m’est venu de là depuis six mois, plus de vraie colère intérieure que d'aucune autre source depuis bien des années. Adieu. Adieu. Les jours s’écoulent. Trop lentement, mais ils s’écoulent. Adieu. G.
309. Val-Richer, Mardi 5 novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Il y avait avant-hier du cream cheese à déjeuner, et il y a ce matin sur ma vallée un brouillard, tout-à-fait pareil. On dit que la Normandie ressemble beaucoup à l'Angleterre. Elles se tenaient évidemment avant le déluge, et il y a entre elles, depuis le déluge, des rapports continuels. Si jamais vous avez mangé à Londres de belles poires et de belles pommes elles venaient peut-être du Val-Richer. Les fermiers Normands les expédient par milliers, et il part toutes les semaines, du port de Honfleur vingt mille œufs pour l'Angleterre. J’entends shabby comme vous, et c’est parce que je l’entends que je m'en défends. Je ne vous vole jamais rien, car je vous donne tout ce dont je dispose. Voilà nos questions de Dictionnaire vidées.
Plus j’y pense, plus je me persuade que Benkhausen n’a pas d’inconvénient. Tout sera fini plus vite. Je n’espère toujours rien quant au mobilier de Courlande. Mais au moins la suppression ne passera pas inaperçue. Je suppose que vous avez envoyé à Cumming copie des questions que vous airez adressées à votre fière.
Que voulait faire. M. de Metternich de la mission de M. de Brünnow ? Terminer l'affaire d'Orient sans s'en mêler, ou nous brouiller avec l’Angleterre sans y paraître ? L’un et l'autre a échoué. Je vois, par ce qu’on m'écrit, qu'on a peu d'inquiétude, et qu’on laissera traîner dans l’idée que le temps est au profit du Pacha, qui possède. On a bien fait de renvoyer M. de Labrador, s'il s’agitait encore pour D. Carlos. Nous ne devons aux partisans de D. Carlos que la stricte légalité et à D. Carlos lui-même qu'une politique raisonnable dans sa froideur. L’Europe a envoyé un aigle qui s’appelait Napoléon et qui la troublait, mourir à Ste Hélène. Nous ferons vivre quelques mois à Bourges D. Carlos qui nous tracasse. Il y a eu tout juste proposition.
J’ai aussi mes tribulations d’intérieur. Mon concierge d'ici est malade. Je craignais hier une fluxion de poitrine. On me dit qu'il est mieux ce matin. C’est un factotum très intelligent et qui met sa fierté à être à mon service, ce qui fait que je lui passe des défauts.
10 heures
Je craignais ce qui est arrivé. La poste n’étant venue chez moi que très tard, m'en est répartie que très tard, et n'aura pas été à Lisieux à temps. Vous aurez eu deux lettres ce matin. Mauvaise compensation. Tout cela cessera dans huit jours. Les tristes chances de la vie seront les mêmes ; mais nous serons ensemble. J'espère que vous me direz bientôt que vous avez des nouvelles d'Alexandre Adieu. Adieu. J’aime mieux le Duc que Benkhausen Dix mille francs, c’est beaucoup pour une commission. Adieu. G.
242 . Val -Richer, Lundi 12 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
On a été peu étonné de votre refus des conférences de Vienne. On s’y attendait malgré le Gascon du Danube et ses espérances. Il en résulte ceci que trois, au lieu de quatre agissent de concert, et se le promettent ; l’une, timidement, mais pourtant positivement et de très bon cœur au fond ; l'autre, avec un peu d'humeur contre l’égyptien, mais la témoignant sans la prendre pour règle de sa conduite. Elle voulait reprendre de force la flotte turque, prendre même la flotte égyptienne. Elle y a renoncé. Nous ne sacrifierons pas l’Egypte. Nous suivrons la politique que j'ai indiquée. Nous maintiendrons de l'Empire Ottoman tout ce qui ne tombera pas de soi-même. Et quand ce qui tombera paraîtra en mesure de se reconstituer sous quelque forme nouvelle et indépendante, nous le favoriserons. Nous ne nous chargerons pas de tout régler en Orient ; mais nous n’y serons absents nulle part. Nous n’interviendrons pas entre Musulmans; mais nous n'approuverons pas que d'autres interviennent pour achever là ce qui peut vivre encore, ou étouffer ce qui commence à vivre. C'est là le principe, l’idéal, comme on dit en Allemagne. Je crois que la politique pratique y sera assez conforme.
Thiers est encore à Paris tenant sur l'Orient un langage pacifique ; plus aigre que jamais contre MM. Passy et Dufaure qui le lui rendent bien. Je ne sais ce qui s’est passé récemment entre eux ; mais pendant quelque temps Thiers avait paru ménager Dufaure. Aujourd'hui il le traite fort mal, & chez lui devant tout le monde, le met au dessous de M. Martin du Nord Rien de nouveau du reste. Vous conviendrez qu'il y aurait du guignon si je me brouillais, avec le Duc de Broglie à propos de Mad. de Staël. Grace à la liberté de la presse il n’y a point de mensonge, si sot qu'il ne se trouve quelqu'un pour le dire. En attendant que nous soyons brouillés, j’ai eu hier des nouvelles du Duc de Broglie. Il va venir en Normandie pour le Conseil-général, et compte toujours passer l’automne, en Italie, avec sa fille et son fils, jusqu'à la session.
Dès que vous le pourrez, envoyez-moi la note des effets que vous voulez faire entrer en France et l’indication du bureau de douanes c’est-à-dire de la ville par où ils doivent entrer. Je l’enverrai au Directeur général des douanes en le priant de donner des ordres à ce bureau pour en autoriser l'entrée. Je crois que cela se pourra pour toutes choses puisque toutes sont des meubles anciens, et uniquement destinés à votre usage. Ne vous en embarrassez pas et laissez moi faire. Il faut seulement que je puisse désigner la nature des effets, et le point d'arrivée. Faites-vous adresser de Pétersbourg un état bien complet des caisses, de leurs numéros et de ce que chacune contient.
Je reviens aux dents des enfants français, c’est-à-dire des miens. Je ne réponds que de ceux-là. Si vous y aviez été vous auriez été content de leur petit courage, malgré le mouvement nerveux de Pauline. L'affaire a duré trois minutes, tragédie sans pathétique et sans longueur. Mais je tenais à y être moi-même. En tout, je tiens à témoigner, beaucoup de tendresse à mes enfants, et à ce qu’ils y comptent. La tendresse manque à ce lien-là, en Angleterre, et à presque toutes les relations de famille. C’est un grand mal. Toute la vie s'en ressent. Je vous disais l'autre jour qu'en fait d’éducation morale ou physique l’atmosphère, le régime et beaucoup de liberté, étaient tout à mon avis. J’ajoute beaucoup d'affection.
9 heures
Quand je suis triste pour vous, où par vous, je vous le dis. N'y voyez jamais que ce que je vous ai dit. Je veux savoir le mot qui vous a blessée. Quel qu’il soit j’ai eu tort de le dire & vous avez eu tort de vous en blesser. Je vous aime bien tendrement, et c'est mon plaisir de vous soutenir. Adieu. Adieu. J’ai beaucoup de choses à vous dire Demain.
235. Baden, Mercredi 7 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hier ne m’a pas apporté de lettre de vous. Sans doute c’est le dentiste de Caen qui me l'a enlevée en même temps que les dents de lait de vos filles. Nous avons eu bien froid hier. Ce n’est pas un bel été, et dans le moment je crois que nous sommes entrés en automne. Le prince Guillaume de Prusse fils du Roi, est arrivé hier. C'est le seul de ces princes qui ait de la tenue et un très bon esprit. Il vient de Darmstadt. Il est charmée de Notre future impératrice, mais il critique le choix pour tout ce qui n’est pas sa personne. Il m’a parlé avec peu de goût du mariage Leinchtemberg nous n'avons encore causé que de cela. M. de Jennison sera rappelé pour s’être mêlé de vouloir faire un mariage pour le prince royal avec la princesse Clémentine.
2 heures Le prince Guillaume est venu me faire une longue visite nous avons parlé de choses sérieuses. Il a un très bon esprit qui me plait. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Dites-moi quelles sont les mesures à prendre pour faire entrer en France mes effets. J'espère qu’ils pourront encore m'être expédiés par la présente navigation si le partage est fait. Je n’en ai pas la nouvelle mais je ne puis pas en douter. 5 heures Je reçois en même temps votre N°233 et la lettre de Caen.
Je remarque l’immense différence de l'éducation française et anglaise, à propos des dents de vos enfants. En Angleterre on ôte aux enfants quatre dents par séance, cela n'occupe ni les parents, ni les enfants Ils reviennent bien contents car on leur donne une guinée par dent c’est l'usage. Et tout se passe gaiement et sur tout facilement. Le fait est que les dentistes Anglais sont très habiles et que les vôtres font sans doute de cela une tragédie. Au reste vous devez savoir que ce n’est pas une souffrance pour les enfants. Et moi même en Angleterre. Je me souviens de m'être fait ôter mes dents à ma toilette et d’avoir paru à dîner chez le Roi une heure après sans me trouver un grand mérite à ce fait. Je crois que les sensations se mesurent sur les précédents. Nous sommes excessivement des singes. Ne pensez-vous pas cela un peu ? Quelle longue dissertation sur les dents. Est-ce que nous n’avons rien à nous dire. Voulez-vous encore une observation ? L'anglais en général est plus fort à la douleur qui tout autre nation. Vous seriez fort content d'observer les Anglais sous ce rapport à tous les âges. Leur éducation physique est admirable.
Adieu, Adieu. Voilà de ces lettres (ma lettre) qui me paraissent ne pas valoir la peine d'être envoyées, mais savez-vous pour quoi je l'envoie ? Uniquement pour ceci adieu. P.S. L'écho français dit que vous vouliez épouser Mad. de Stael parce qu’elle est riche, que vous aviez chargé M. de Broglie de votre procuration. Mais qu'il l’épouse pour son compte, & qu’en conséquence vous êtes brouillé avec lui.
Mots-clés : Interculturalisme, Pédagogie, Politique (Russie), Santé (enfants Guizot)
88. Lisieux, Lundi 16 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai couché ici. Je vais retourner déjeuner chez moi. Demain je reviens dîner ici, un grand dîner de toutes les autorités du pays. Après-demain, je vais dîner à cinq lieues, à Pont-Lévêque, pour une réunion à peu près pareille. J’ai dîné hier avec 80 personnes, 76 pour être exact. Tout cela, c’est de la politique ; de la politique peu Russe ; de cette politique qui fait que nous appelons les Russes des barbares, et à laquelle on arrive par le même chemin qui mène hors de la Barbarie. Ce que vous mande Lord Willians me paraît tout simple. Je ne comprendrais pas qu’ils pensassent et parlassent autrement. Et quand ils trouvent qu’il y a de l’uninteresting et du frivolous, dans nos mœurs et notre politique, ils ont un peu raison. Seulement nous avons bien plus raison quand nous trouvons à notre tour tant de frivolous et d’uninteresting dans les leurs et dans leur grandeur grossière et apparente. J’estimerais davantage leur dédain pour l’étranger s’il était bien réel et bien réfléchi, mais il y a tant de charlatanerie et d’ignorance qu’il est difficile de n’en pas sourire. C’est un dédain d’enfants forts et piqués. Plus j’avance, plus je trouve le dédain de nation à nation peu sensé et un peu ridicule, souvent même aussi le dédain pour les personnes. C’est une leçon que je me donne à moi-même, & qui ne changera pas ma nature, je ne lui demande pas mais qui contient et rectifie mon jugement. Toute créature humaine à quelque côté par lequel elle mérite qu’on ne la dédaigne pas. Ce sont les choses de ce monde que nous pouvons librement dédaigner.
Je suis bien philosophe aujourd’hui, n’est-ce pas ? Philosophe ou non, merci de vos lettres. A part leur contenu j’ai été charmé de les recevoir et de les lire. Je suis rentré à l’hôtel de la Terrasse. J’ai retrouvé notre cabinet, notre conversation, nos délicieux commérages. Ma philosophie est très capable d’illusion. Tout ce qui me rapproche de vous ne fût-ce qu’en pensée, n’est jamais une illusion. C’est revenir au contraire à la réalité, à ma vraie vie, à ma vie intérieure et habituelle. C’est très vrai que, même-ici, je vis habituellement avec vous. Je vous entends, je vous parle, je vous questionne, je vous raconte ; j’assiste à toutes vos impressions, je vous livre toutes les miennes. La différence est immense pourtant. De loin, tout cela m’occupe. De près, cela fait mon bonheur.
Voilà le n° 92. Je suis charmé que vous ayez dormi. Je me l’étais promis hier matin. Ai-je raison de vous dire que j’assiste, de loin et d’avance, à toutes vos impressions. Le chaud a un peu repris, cependant bien moins lourd et moins intense. J’ai beaucoup pensé à ce que vous me dîtes de Broglie. Je veux y penser encore avant d’avoir un avis. Le duc de Broglie doit venir passer deux jours au Val-Richer, vers la fin de ce mois. Je le sonderai à ce sujet. Je sais comment. Je suis aussi fier, aussi difficile pour vous que pour moi. Certainement, vous ne devez aller que là où vous êtes désirée. Il faut que mon sentiment à ce sujet soit bien fort pour que la seule idée, la moindre possibilité de vous voir en Normandie n’effraie pas toutes choses. Vous voir, me promener avec vous ! Savez-vous ce que c’est ? J’espère que vous aurez de meilleures nouvelles de votre grand Duc. La fièvre tierce est un mal mais pas un danger. Je ne sais ce que sont les médecins Russes et Danois. Henriette était à merveille hier. Je crois en effet que c’est la chaleur qui lui avait donné cette indigestion. Adieu.
Où pourriez-vous donc aller hors de Paris si la chaleur revenait ? Avez-vous quelque idée ? Je voudrais bien pouvoir vous en envoyer une. Mais je ne veux pas que vous alliez quelque part pour y être encore plus seule qu’à Paris. Adieu. Adieu. G.
82. Val-Richer, Lundi 9 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
On m’a reproché d’être dédaigneux. J’en fais pénitence. Je vis ici Dieu sait à quelle distance de ma vie intérieure, habituelle. C’est la faute de notre état social et la loi du gouvernement représentatif. Vous n’avez jamais éprouvé cela. Je me trompe. C’était là votre, condition, et aussi votre sentiment quand vous êtes retournée à Pétersbourg. Les petits jeux de l’intérieur du Palais, votre étonnement de l’étonnement que vous avez excité autour de vous le jour où vous avez dit quelques mots de politique à dîner. Votre impossibilité de causer vraiment avec personne votre mal aise dans cette atmosphère pesante et inférieure, c’est le pendant de mon mal. Seulement vous aviez affaire à un Empereur, moi à des électeurs. Peu importe. Vous plaisiez à votre Empereur. Je plais aussi à mes électeurs. Je soupçonne même que je me prête à leurs affaires, à leurs conversations, avec moins d’effort et d’ennui que ne vous en imposaient les brusques fantaisies, ou les grosses gaietés impériales. Je ne connais personne qui sache moins descendre que vous.
Dans votre sphère, quand vous vous sentez en parfaite harmonie avec les situations, les idées les sentiments, les habitudes, les manières qui vous entourent vous avez l’esprit singulièrement animé, fertile souple ; vous êtes pleine de facilité, de laisser aller. Mais vous ne pouvez pas du tout vous dépayser. Sur tout autre échelon, dans tout autre air, vous êtes comme sous la machine pneumatique, mal à l’aise, froide immobile. Vous êtes, en fait, d’élévation et de tous les genres d’élévation, ce qu’on appelle aujourd’hui une spécialité. Vos habitudes sont devenues, votre nature. Restez comme vous êtes. Ce que vous avez me charme, et je ne vous désire point ce qui vous manque.
Je suis bien aise qu’Emilie Flahaut se marie bien. Mais c’est triste d’épouser un mari qui mourra dans deux ans. Si elle l’aime ? Est-ce qu’il est menacé de la maladie de Lord Kerry ? Qu’est devenue Lady Kerry ? Est-elle morte aussi ? Elle avait bien un air à mourir. Je n’ai jamais vu de structure si frêle et de blancheur si pâle. Voilà un singulier effet d’imagination. Je vous croyais en Angleterre. Je vous écrirais à Londres. J’allais vous prier de faire mes amitiés à Lord Landsdown. C’est un souvenir de l’an dernier. Et aussi un effet de ce que depuis quelques jours, vous passez comme vous dîtes, votre vie, en Angleterre. Je la regretterai bien pour vous dans quelques jours.
J’espère que vous verrez aujourd’hui, le Duc de Broglie. Je le désire. Je le verrai après-demain. Que nous sommes enfants ! Nous avons bien raison. C’est la vie que ces enfantillages-là. Je voudrais bien voir ce qu’elle serait si on les en retranchait tous, tous absolument. Mais j’aime mieux les enfantillages de près et sans intermédiaire. Dans un poète persan qui s’appelle Saadi, un voyageur s’arrête auprès d’une fleur : " Fleurs d’un parfum si doux, es-tu la rose ? - Non, mais j’ai vécu près d’elle. "
10 heure ¼
Votre n°85 est bien triste, triste pour vous, triste pour moi. De près, votre tristesse m’est douloureuse de loin intolérable. Mais pourquoi dit-on intolérable quand on tolère ? Et puis, ne m’en veuillez pas d’être triste aussi pour moi. Il faut me pardonner mon immense exigence. Adieu Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Interculturalisme, Poésie, Portrait (Dorothée), Réseau social et politique
148. Paris, Samedi 29 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Comment, on n’a pas eu le temps ? ou bien, on n’y a pas pensé. Quand il s'agit d'une dernière prière sur la tombe d'un chrétien, & d’une femme qu'on aime ! Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais il n'y a que des Français capables de cela. Et vous, vous-même c’est bien légèrement que vous me donnez ces excuses. Savez-vous que cela me blesse, savez-vous que moi, moi étrangère, arrivée, là à la dernière heure j’aurais demandé à M. de Broglie à genoux d’attendre qu’un ministre de Dieu vient bénir la dépouille de sa pauvre femme. Ah dans mon froid pays, dans ce pays barbare, c’est un prêtre qui recevra tout ce qui reste de moi. Est-ce que je vous dis des choses dures ? Pardonnez moi, pardonnez ce que Lady Granville appelle vingt fois le jour, ma funeste franchise. Vous ne me referez pas. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Comment M. de Broglie pourra-t-il jamais avoir un moment de tranquillité ?
M. Molé est venu hier chez moi en sortant du Conseil. Il est convenu qu’il y avait sur mon compte mille mauvais rapportages. Berryer était sur le premier plan de la Reine ! Imaginez ! Vous qui savez ce que j’en fais. Le gros de l’affaire est que mon salon est le rendez-vous des adversaires du gouvernement. Enfin on veut me faire passer pour une archi intrigante. Vraiment c’est trop absurde. M. Molé a été parfait, il dit que lui et le Roi me défendent, mais qu’on est très exalté contre la Russie, & qu'il n’y a pas moyen de faire comprendre que moi je ne suis pas un émissaire chargé de susciter d'embarras au pouvoir existant. Voilà qui est trop fort. Je voudrais en rire, mais c’est difficile. M. Molé dit qu'il a arrêté déjà des articles qui devaient paraître contre moi qu'il y veillera encore, mais il ne répond de rien cependant. J’ai dit tout ce qui était convenable et tout ce qui était vrai. Je n'ai à m’amuser que d'une intimité ; c'est avec vous. Alors il y a eu une grande exclamation. " Oh pour celui-là. c’est tout autre chose, un homme que nous estimons & respectons tous. " Il a dit de vous mille biens et dans le meilleur langage. Mais excepté vous je voudrais bien savoir quels sont donc les Français avec lesquels je conspire ? La police du gouvernement est bien mal informée, et les fonds secrets devraient mieux servir que cela. Au total je ne comprends pas bien sur quoi repose tout ce tripotage, ni de qui j'ai à me garder, mais il me semble que M. Molé est sérieusement désireux de m’épargner tout espèce d'embarras.
Vraiment il ne me manquait plus que cela. Il me parait que l’exaspération contre l’Empereur est arrivée à un haut degré. Il y a quelque chose de nouveau à ce sujet que M. Molé n’a pas voulu me dire, et qui surpasse tout ce qui est jamais venu de mon maître. C'est fort triste. J'ai dîné hier chez Madame Graham avec les Holland, mon ambassadeur M. d’Armin, Fagel, & Villers. Celui-ci est un homme charmant. J’ai peu rencontré d’homme qui m’aient si vite plu. Je cherche à lui faire faire des conquêtes parmi mon entourage, et il faut revenir de tous, car il est en horreur à la sainte alliance.
Hier matin j’ai promené Madame Appony. Le tête à tête n’est pas aussi animé qu’avec Lady Granville. Ce matin votre lettre n'était pas sur la nappe à mon déjeuner, voilà qu’une violente agitation s’est emparée de moi. J’ai vu toutes les catastrophes imaginables et la plus naturelle s'est rencontrée dans un article de journal que j'ai pris en main et où j’ai trouvé qu'il y avait beaucoup de loups aux environs de Caen. Vous aviez été attaquée par un loup, cela ne me sortait pas de la tête, dix minutes après la lettre est venue et j’ai respiré comme si le loup venait de vous lâcher. Ah quelle pauvre tête que la mienne. Mais convenez-vous bien de cela. Un jour passé sans lettre, j'en prendrai la fièvre. Adieu, adieu. Adieu autant d’adieux que vous voudrez.
31. Paris, Lundi 28 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il me faut une lettre commencée, quand je ne ferais qu’y placer le numéro. C’est donc pour cela tout seul que vous me renvoyez à ma table. Mais Monsieur, je suis bien lasse. J’ai beaucoup écrit. J’ai trop de correspondances, elles m’ennuient, & je ne sais comment les secouer. J’ai marché malgré la pluie, car il pleut, mais ce temps me convient mieux que la chaleur. J’ai même eu froid cette nuit. J’ai repris mon couvre-pied. Comment êtes-vous ? Cette irritation à la gorge vous a-t-elle enfin quitté ? Je veux savoir cela. Je veux tout savoir. Je vous en donne bien l’exemple cette heure-ci et les suivantes me sont bien dures à supporter. Je ne puis fixer mon attention sur rien, pas même sur les livres que vous m’avez laissés. Je les prends, je les quitte. Je me couche sur mon canapé. Je m’y assieds, je change de place. Je me promène dans le salon. Je ne regarde plus dans les glaces. M’y voir seule, c’est si triste ! Monsieur, que les heures sont longues. Je relis deux lettres. Elles me font tant de bien. Mon âme en est si doucement caressée. Que de vœux elles m’arrachent. Que de prières j’adresse au Ciel, que de promesses, je me fais à moi-même ! Il me semble qu’à nous deux rien n’est impossible. Que nous pouvons défier les hommes. Ah ! Qu’on ne vienne par troubler mon bonheur car j’oublierais tout, plutôt que de m’en séparer. Monsieur, voilà une parole bien coupable, & cependant, je sens que le fond de mon cœur ne l’est pas. Jamais au contraire, il n’a été rempli par de plus doux, par de plus nobles sentiments, par des sentiments plus religieux. Ah, que vous m’avez fait de bien !
Mardi 9 heures. Le N°27 est là. On me l’a remis lorsque je rentrais de ma première promenade. Je l’ai portée dans mon cabinet, & là sur mon canapé je l’ai ouvert. C’est charmant des lettres, vos lettres, mais il y a quel que chose de mieux que cela ! J’ai fait hier une promenade accoutumée, mais il n’y a pas eu moyen de marcher, il a plus à verse tout le jour, il pleut fort à matin, mais j’ai perdu patience, et j’ai marché un peu dans l’eau comme s’il faisait sec. J’ai hâte de vous dire que j’ai changé de chaussures parce que vous iriez peut être vous mettre en tête que j’ai pris froid. Monsieur, c’est incroyable toutes les pauvretés que je vous dis et tout ce que je vous prête d’inquiétude pour la santé. Cela ressemble singulièrement à la table de thé. Vous le voulez bien n’est-ce pas ?
J’ai commencé ma soirée hier avec quelques ennuyeux, les Stackelberg et autres, je l’ai mieux fini, avec le duc de Noailles qui est venu passer deux jours à Paris pour moi. Nous avons eu des plaisir à nous revoir ; nous avons très vite bavardé & je l’ai renvoyé à 11 heures.
Le mérite que je lui trouve c’est d’être de très bonne compagnie ; de savoir un peu tout, & de prendre intérêt à tout ce qui a occupé ma vie extérieure, ainsi d’être curieux des personnes qu’il n’a jamais vues dès qu’elles ont de l’importance. Ce qui me frappe en général dans les Français c’est leur parfait dédain pour tout ce qui n’est pas France et Français. Ils se regardent comme seules dignes d’occuper la scène, les Piscatory sont fort nombreux. Il me parait que les français méprisent parfaitement tous les autres peuples en masse et en détails. Ils font exception pour les Anglais, & ceux-là ils les détestent parce qu’ils leur portent envie. Ils cachent cela sous une même forme de silence ou d’indifférence pour tout sujet étranger.
Dès le commencement, de mon arrivée ici vous êtes le seul qui m’ayez adressé quelques questions sur l’Angleterre. Depuis, et avant même notre mois de juin chaque fois que nous causons ensemble. Vous me meniez sur terre étrangère, vous interrogiez même la petite Princesse. Tout cela je l’ai bien remarqué. La vraie supériorité n’est pas méprisante. Monsieur j’aurais bien de belles choses à vous dire la dessus, ainsi qu’une observation toute récente que j’ai faite ici sur quelqu’un mais je vous parle là de choses qui sortent de mon sujet, de mon sujet musique. J’y ai presque du remord.
Je viens de recevoir un billet dans lequel il y a cette phrase. " Vous êtes seule je crois, c’est-à-dire que l’objet de vos respects s’est éloigné." Je n’ajoute ni ne retranche pas un trait de plume. Je n’ai pas de lettre de mon mari. Les N° précédents le dernier ne m’arrivent même pas. Au fond cela me repose. En fait de lettres je ne veux que les vôtres, je ne veux lire que cela, penser qu’à cela. Mon médecin me trouve mieux je veux bien le croire, mais il n’y paraît pas.
Adieu monsieur vous voilà au bord de la mer, ou du moins vous allez y être ? J’achève cette lettre à midi. Encore cinq jours, cinq grands jours c’est-à-dire que dimanche à cette heure-ci ; mon cœur battra déja bien fort. Adieu, adieu Dearest.
447. Windsor Castle, Vendredi 23 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je ne pars d’ici qu’à une heure. La Reine me donne à midi et demie mon audience officielle de congé. Si je ne savais ce que vaut le mot chagrin, je dirais que la mort soudaine de ce pauvre lord Holland a été hier un chagrin pour moi. Si bon et si aimable ! Et si seul de son espèce dans Londres ! Et je m’intéresse vraiment à lady Holland, beaucoup plus spirituelle, et plus amie que presque toutes. Savez-vous que je suis choqué, vraiment choqué de indifférence avec laquelle cette nouvelle a été reçue autour de moi ? Personne j’en suis sûr, n’y a pensé autant que moi. Ils passaient tous leur vie chez lui depuis 30 ans. Décidément cette race-ci est personnelle et dure. J’ai entendu de nos vieux soldats parler de leurs camarades qu’ils avaient vus tomber à côté d’eux sous le canon, c’était plus tendre.
Et puis il y a dans la froideur forte de ces gens-ci, une certaine acceptation brutale de la nécessité des coups du sort. Ils sont dans la vie comme dans la foule ; ils ne regardent seulement pas celui qui tombe. Ils passent. On dirait qu’ils mettent leur dignité à ne se montrer quoiqu’il arrive, pas plus surpris qu’affligés. Mais leur dignité ne leur coûte. rien du tout. La grande, la belle nature, humaine est plus riche, plus expansive. Elle trouve plus abondamment dans les événements et sur les personnes de quoi penser et s’émouvoir. Et quand elle gouverne ses pensées et ses émotions. On voit qu’elle y prend vraiment quelque peine. Ces gens-ci ont l’air de comprimer ce qu’ils ne sentent pas. Politiquement, je regrette beaucoup lord Holland. Il n’avait pas autant d’influence que j’aurais voulu. Mais il en avait plus qu’on n’en convenait. La désapprobation de Holland house gênait beaucoup, même quand elle n’empêchait pas.
Londres 4 heures et demie
J’arrive. La Reine ne m’a donné mon audience que tard. J’ai à peine le temps de fermer ma lettre. J’en ai plusieurs à fermer, et indispensables. Je pars toujours après-demain. Je serai toujours à Paris, le 28 au soir. Il n’est pas du tout nécessaire d’y être le matin. Je serai à la Chambre le 29. Rien ne commence que le 29. Je ne fais absolument que passer par la Normandie pour y prendre mes enfants. Je ne resterai pas 18 heures chez moi. Cela n’a aucun inconvénient. Si je partais par Douvres des Calais, j’arriverais à Paris 20 heures plutôt. C’est tout-à- fait indifférent....politiquement.
Adieu. Adieu. Il faut absolument que je vous quitte votre grande lettre est très bien. Rien à changer du tout. Adieu. Adieu. Bientôt plus d’adieu.
420. Londres, Mercredi 23 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
six heures et demie
Je vous quitte à peine et je vous reviens. Pourquoi se quitter jamais? Savez-vous que les trois quarts des chagrins qu’on a c’est qu’on le veut. bien ?
Il me semble que 22 s’accroche bien fort aux branches du Chêne. On me dit qu’il y a bien des gens qui voudraient l’y pendre. De loin, 48 a un peu l’air de s’accrocher à tout. Quoique 12 ne soit que le quart de 48, il se flatte bien d’être un chiffre plus fort, et il s’asseoirait volontiers aux pieds du chêne pour qu’il se prétât à l’usage qu’on voudrait faire de lui. Il lui ferait même probablement d’assez grandes concessions de terrain. Est-ce que la grande pensée n’a pas envoyé quelqu’une de ses feuilles à 83 qui aime tant les fleurs ? Si je ne me trompe il se fait en ce moment bien des calculs autour de 34. Le Mélèze serait curieux de savoir si on lui en veut toujours beaucoup de ne pas vouloir épouser 2 en secondes noces et si on espère que 14 refera un grand mariage. Je vous suis à peine revenu et il faut que je vous quitte pour m’habiller. Quand vous étiez ici, j’en voulais à à R. féminin. Depuis que vous n’y êtes plus, je la revois avec plaisir. Elle n’est pas la rose, mais.... Il est convenu que j’aime les redites.
Jeudi 9 heures
A dîner, Lady Clanricard, Lord Minto, M. et Mad. Van de Weyer, Alava, Pollon et Schleinitz, Lady Clanricard en grande coquetterie avec moi, coquetterie non seulement animée et spirituelle, mais presque douce et affectueuse, ce qui est moins dans sa nature. Un lieu banal de conversation, mœurs anglaises ; elle en faisait très bon marché. " Mais nous avons un seul avantage, l’intimité ; nous aimons l’intimité ; nous avons de l’intimité. " Je me suis récrié : " C’est précisément ce que vous n’avez pas. Je ne sais pas comment vous êtes dans vos ménages mais en sortant du ménage de la famille, vous tombez tout de suite dans le raout. Il faut à l’intimité un laisser-aller, un besoin de communication, de sympathie, d’épanchement, qui me semblent inconnus ici. "
Cela ne vaut pas la peine de vous être redit. Son langage était très bienveillant pour la France, pour la vie et la societé française. Point de politique du tout : " Je ne comprends pas comment fait-on Angleterre une femme de moyen-âge qui devient veuve et n’a plus de grande part au monde. Si cela m’arrive j’irai vivre ailleurs, en France peut-être. " Pas plus de politique avec Lord Palmerston qu’avec Lady Clanricard. Un peu avec Lord Minto. Triste de part et d’autre. L’idée de la guerre possible pénètre ici. Il y a huit jours, on n’y croyait pas encore du tout. Je persiste à n’y pas croire. Une transaction sortira de tous ces essais de transaction. Et j’y regarde avec une anxièté qui surmonte, je vous en réponds, ma disposition générale à l’optimisme. Lord et lady Palmerston très empressés pour moi.
Une heure
Vous avez très bien écrit à lady Palmerston Evidemment, évidemment, il est absurde, il est ridicule de faire courir à l’Europe, pour le motif qu’on allègue, les chances qu’on lui ferait courir en repoussant une transaction. " Il faut Beyrout et Damas au Sultan ! " Qui donc savait, qui pensait à savoir en Europe, il y a deux ans si Beyrout et Damas étaient au Sultan, ou au Pacha ? L’Europe, l’Europe saine grande, forte, belle, attachant ses destinées à la question de savoir si ces ruines pestiférées seront au pouvoir d’un vieillard près de mourir ou d’un enfant hors d’état de régner ? Dieu garde le monde de cette alliance : un petit esprit et un caractère fort ! Il n’y a pas de folie, pas de matheur qui n’en puisse sortir. Moi aussi, le memorandum du 24 août ne m’a pas satisfait, pour la forme du moins. Je l’aurais écrit autrement. C’est vraiment du guignon qu’il passe pour trop doctrinaire. On m’écrit ce matin que 31 a grand peur et fort peu d’envie de rentrer dans une si vive mêlée. Pourquoi n’écririez-vous pas à 2 que vous êtes de retour ? Savez vous ce que je soupçonne dans ce silence gardé envers vous par 2 et trois fois 2 ? Quelque misérable lâcheté, tenez pour certain que le langage de 90 à Paris, et celui de l’homme qui " mange avec autorité " à Londres sont très differents. Le mangeur n’est pas frondeur du tout. Adieu.
Vous ai-je dit aujourd’hui un mot autre que d’affaires ? Non, je crois. Pourtant j’ai bien autre chose dans le cœur Adieu, Selon mon cœur.
395. Londres, Samedi 13 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici la dernière. Dans sept jours, nous serons ensemble et vous n’aurez plus de tracas. Il est vrai que vous n’y êtes pas propre du tout. Vous ne me dîtes pas si vous avez décidément pris votre compagnon de voyage. C’est un personnage bien mystérieux. Dois-je être inquiet aussi ? Je fais réparation à votre sagacité. Vous avez deviné juste sur Miss Troller ; si juste que l’insinuation m’a été faite, sur la place même. Je voudrais bien savoir ce qui vous inquiète. Vous me le direz, n’est-ce pas, si vous ne l’avez pas oublié, cinq minutes après m’avoir vu.
Je rabâche. Je ne comprends pas les Sutherland. Mais je trouve aussi que puisqu’ils l’ont écrit à Lady Granville, vous auriez pu, et vous pourriez peut-être encore sans atteinte à votre dignité, prier Lady Granville de leur demander, de votre part, si en effet, ils peuvent vous recevoir dans Stafford-House, en leur absence. Savez-vous qui manque dans les relations de cette sociélé-ci, dans les plus amicales ? La simplicité, la facilité, la rondeur. Tous les mouvements sont lents et raides. Les meilleures gens, les meilleurs amis ne savent pas se donner l’agrément de leur bonté et de leur amitié.
Je n’ai pas envie de vous donner des nouvelles. Il n’y en a pas, et je n’en ai pas envie. Je vous en donnerai quand vous serez ici. On ne parle que de l’attentat. Pour dire vrai, d’Oxford plus que de l’attentat. La badanderie est aristocratique aussi bien que démocratique. On est curieux des moindres détails sur ce malheureux. Est-il beau ? A-t-il de l’esprit ? De quelle couleur sont ses yeux ? C’est précisément là ce que veulent ces imaginations perverties, un théatre, un public, grandir et paraître au soleil, eux petits et obscurs. Il faudrait avoir assez de sens et de gravité pour ne pas leur donner ce qu’ils cherchent. Les personnes qui suivent l’affaire disent qu’il n’y a que deux choses sûres, c’est qu’il n’est pas fou, et qu’il n’est pas seul.
On me dit ici, sur le nouveau Roi de Prusse, exactement ce que vous m’avez écrit. Tout le monde, se promet beaucoup de lui ultras et libéraux. Tout le monde, sera déçu. ce qui me paraît clair, c’est qu’il est faiseur et n’aura pas la politique négative, et expectante de son père. Il faut que jeunesse se passe, celle des rois comme toute autre. Adieu. Adieu encore une fois. Je n’ai rien à vous dire. Je dirais trop ou trop peu. Adieu. Enfin.
393. Londres 11 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
On a beau être jeune, et femme, et Reine sans révolution, et avec une aristocratie ; on n’est pas à l’abri de la monomanie de l’assassinat. Elle a passé la Manche. J’ai appris cela hier au soir en dinant chez le Sir Robert Inglis. Plus tard, chez lord Grey, quelques détails douteux. Tout le monde disait que ce boy était fou. Il ne l’est point. Les journaux vous diront tout ce qu’on sait. Peu de chose encore. On parle de sociétés secrètes, de passions anarchiques. J’y crois toujours. Le mal vient de là, soit que des conspirateurs se réunnissent, soit qu’un cerveau faible s’échauffe. Et ce mal est grand ici dans les régions basses plus grand qu’ailleurs. Mais les moyens de résistance sont très supérieurs. La Reine a montré vraiment un sangfroid, très ferme et très simple. Son mouvement de se faire conduire tout de suite chez sa mère a touché. L’émotion me paraît vive et sincère dans les classes moyennes. Le High life, hier au soir était froid et lèger, comme partout. On faisait de la musique chez Lord Gey. J’écoutais comme les autres. Et en écoutant, je pensais à ces quelques têtes couronnées, partout le point de mire de ces milliers de prolétaires indignés de n’être pas riches et heureux et à ces passions frénétiques qui fermentent à côté de ces plaisirs frivoles. y aura-t-il dans le monde, assez de sagesse et de courage pour dompter le fléau ? Je le crois. Et le spectacle de cette société-ci me rassure encore plus qu’il ne m’inquiète. Le bien y surpasse le mal, quoique le mal soit grand. Si japprends quelque chore dans la matinée je vous le dirai.
2 heures
Rien de nouveau. On interroge cet homme ; on cherche. Les principaux membres du corps diplo. matique sont venus chez moi. Nous avons cherché, une manière de témoigner à la Reine notre vif sentinent sur ce qui vient d’arriver. De concert avec Bülow, Hummelauer, Pallen, etc J’ai écrit à Lord Palmerston, le billet ci-joint. Il s’en est montré fort touché. Je dois le voir à 4 heures, quand il en aura parlé à ses collègues. N’en parlez pas, car il serait possible qu’il n’y ait point d’audience, point d’expression publique et collective. D’après ce qu’on m’a dit et si je me rappelle bien ce que vous m’avez dit. ceci serait un peu une innovation. Elle est naturelle, vu l’incident, et ces messieurs la désirent tous. Nous avons des usages, nous autres Français, en pareille matière. Je les emporterai peut-être à Londres.
Je m’attendais au retard de ce matin. Je vous ai dit hier pourquoi j’y consentais sans me trop facher. Je n’en dis pas davantage. Je ne veux pas vous donner plus de liberté que je n’en veux prendre pour moi-même en pareil cas. Je me réserve de me fâcher une autre fois, s’il y a lieu et il vous est maintenant interdit de vous fâcher jamais, car il n’y aura jamais lieu. Mais votre curiosité, que je ne comprend pas, sera fort décue, car vous ne trouverez rien de nouveau. De l’inconnu peut-être. que vous prendrez pour du nouveau. Je rabats quelque chose de mon opinion sur votre sagacité. Vous me connaissez bien peu Est-ce que je suis si obscur ?Je vous réponds que tout ce qui y était le 25 février y est encore, y sera toujours. Et rien qui ne soit avec ce qui était le 25 février dans la plus intime harmonie. Mon Dieu, que j’ai de choses à vous dire, et à vous apprendre ? Je ne crois pas du tout à Barrot dans le Cabinet. Et soyez sûre que j’ai raison. Mais si cela était, je n’ai pas la moindre incertitude. Vous avez trouvé cette hypothèse prévue dans ce que vous a montré Génie. Adieu. Vous aurez des lettres jusqu’à lundi inclusivement Adieu. Adieu.
392. Londres, Mercredi 10 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Ceci doit être ma dernière lettre. Savez vous mon sentiment ? c’est que je ne vous ai rien dit depuis le 25 Février. Je ne vous ai pas plus parlé que je ne vous ai vue. J’ai sur le cœur tout ce que j’ai pensé et senti pendant ce temps là. Quel débordement, comme vous dites ? Le beau temps dure, et par trop étouffant. J’ai été me promener hier au soir dans Regent’s Park jusqu’à 9 heures et demie. L’air était doux, frais, le ciel pur, les eaux pures aussi. Je vous attendais là. Je crois que je suis sorti le dernier. Il me paraît qu’on se bat toujeurs autour du corps de M. de Rumigny. Je suis essez curieux de l’issue. Le Roi en voudra beaucoup à Thiers.
Avez-vous vu Zéa ? Je serais curieux aussi de savoir ce qu’il pense des affaires du moment dans son pays. Il me paraît que les modérés sont dans une grande colère et méfiance, du voyage de la Reine. Ils croyent qu’elle veut les livrer aux exaltés. Je ne comprends pas On dit que Rumigny ne sera pas le seul. Dalmatie et Latour Maubourg sont ménacés. Il faut payer ses dettes. Ste Aulaire et Barrante n’ont rien à craindre. M. de Metternich, et l’Empereur Nicolas, les défendent. Du reste si la diplomatie est traitée comme l’administration, il y aura plus de bruit que d’effet. Que de préfets remués pour en changer un seul ! Je n’aime pas le humbug, même quand il sert à empêcher le mal. Mais il faut bien s’y résigner.
Une heure
Je ne vous dirai pas encore de gros mots. Je ferai plus. Je mettrai votre conscience à l’aise. Je viens de recevoir une invitation de la Reine pour Windsor, dîner le 17, passer la journée du 18, déjeuner le 19. Il n’y a pas moyen de n’y pas aller. Si vous arrivez ici le 15, nous aurons à nous la journée du 16 mais si vous n’arrivez que le 16 au soir ou le 17 matin, nous aurons à peine, le temps de nous entrevoir avant mon départ pour Windsor. Ne vous pressez donc pas de manière à vous troubler ou vous fatiguer. C’est une ennuyeuse parole que je vous dis là. Je suis très pressé. chaque jour plus pressé. Mais puisque ma course de Windsor coïncide avec votre tracas de ménage, faites ce qui vous convient. Je vous donne, pour arriver à Londres latitude jusqu’au 19. Si vous arrivez le 15 ou le 16, je serai parfaitement heureux. En tout cas, je vous écrirai encore à moins que votre lettre de demain ne me dise le contraire. Je vois que l’affaire des ambassadeurs tournera comme celle des prefets. Lord Palmerston ne revient qu’aujourd’hui de Broadlands. Il doit y avoir un conseil de Cabinet ce matin, probablement sur les affaires de l’Orient. Si on voulait m’admettre dans ce conseil, je crois en vérité que je serais tranquille. Cette parole est bien arrogante ; mais j’ai vu tant d’affaires mal conduites uniquement parce qu’on ne savait pas, parce qu’on n’avait pas pensé. Ici surtout on ne pense pas à assez de choses! Et chacun pense à son affaire, et ne sait rien de celles des autres. Evidemment si, dès le premier jour, toutes les faces de cette question d’Orient avaient été présentées à Lord Polmerston, lui-même ne se serait pas engagé comme il l’a fait. Cela perce à chaque instant dans sa conversation.
3 heures et demie
Je viens de faire quelques visites Je ne voulais voir que lady William Russell. Je ne l’ai pas trouvée. Elle m’inspire une estime mêlée de quelque curiosité. On dit que son mari, après avoir débuté par la Juive, fait à présent des sottises avec tout le monde. Est-ce qu’il en est en Angleterre des hommes comme des femmes ? J’entends dire qu’ici c’est à 40 ans quand leurs enfants sont élevés, que les femmes s’émancipent. Et on me cite des exemples. Nous avons ici de très mauvaises nouvelles du Rois de Prusse. Je suppose que vous les avez aussi. Adieu. J’ai été dérangé deux ou trois fois depuis que je suis rentré. Je dine chez Sir Robert Inglis. J’irai de là chez lord Grey. Lady Grey m’a écrit hier pour m’y engager. Je suis très bien avec eux. Adieu Adieu
379. Londres, Mardi 26 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Vous aviez raison. Lady Palmerston ne dînait pas hier avec nous. Elle me l’avait dit Dimanche. Grand dîner ennuyeux, pas énormement long. J’ai porté la santé de la Reine. Pourquoi Lord Palmerston n’a-t-il pas fait comme j’ai fait chez moi le 1er mai, où j’ai répondu à la santé du Roi, par celle de la Reine et de tous les souverains de l’Europe ! Est-ce l’usage Anglais? Le nôtre est plus poli. De chez Lord Palmerston chez Lord Lansdowne. Rout immense. Le Drawing room du matin transporté à Berkeley-square. Du temps et des embarras sans fin pour arriver. J’ai eu du bonheur pour sortir. Ma voiture était tout près. J’étais chez moi à minuit et demi. Lady Lansdowne me convient. J’ai beaucoup causé avec elle samedi, chez moi. Elle a l’esprit droit et le cœur haut et vraiment du cœur. Elle aspire ardemment à Bowood. La plupart des Anglais et Anglaises me paraissent avoir peu de goût pour cette vie de bals et de routs, qu’il mènent avec fureur.
Je lis à l’instant même dans le Morning Chronicle : " The duke and dutchess of Sutherland leave Stafford House shortly for Trentham, whence they purpose going to Dunrobin Castle, Sutherland shire." Est-ce vra i? Qu’en savez vous ? Et dans ce cas, quel hôtel choisissez-vous ? Nous approchons beaucoup. Donnez moi de charmants détails. Vous aurez votre fils à la fin de la semaine. Vous pourrez tout règler alors.
Je vais déjeuner ce matin à Kensington, chez M. Senior avec lord Lansdowne, l’archevêque de Dublin, M. et Mad. Grote que décidément on veut prendre. Je dîne chez moi avec Bacourt, Dedel, Sir Edouard Disbroule et Frédérie Byng. Voilà tout le menu de ma vie.
Parlons d’autre chose : Thiers a raison de riposter à Ancone par Cracovie. La réponse est sans réplique, sans propagande, sans guerre, sans évènement, il nous serait facile de susciter aux Puissances, moins amies que d’autres, bien des embarras, des ennuis, d’élever ou d’entretenir en Europe, à leur sujet, ce bourdonnement de plaintes, de griefs, de réclamations, de prétentions, qui est fort incommode pour des gouvernements peu exercés au bruit. Nous ne le faisons pas ; mon avis est qu’il ne faut pas le faire ; mais il faut, dans l’occasion, nous prévaloir de ce que nous ne le faisons pas, et indiquer que nous voyons très bien toutes ces petites plaies auxquelles nous ne voulons pas toucher.
Je vous répète ce que je crois vous avoir déjà dit. Le Cabinet ne prend pas son échec au sérieux ; ni lui, ni personne. C’est à dire qu’ils restent très décidément et que personne n’en est surpris et ne s’attendait au contraire. Mais les Torys prétendent sérieusement au pouvoir et renouvellerons souvent l’assaut. Les Whigs s’attendaient à perdre les élections de Ludlow et de Cambridge, Pourtant ils en sont tristes. Et ils craignent un peu de perdre aussi celle de Cockermouth où M. Horsman pourrait bien n’être pas réélu. Ceci serait pire. Je ne crois à rien d’imminent ; mais je crois à une situation aggravée.
4 heures
Pour Dieu, ne soyez pas malade. Je suis, en ce qui vous touche votre santé, dans une disposition intolérable et toujours près de devenir douloureuse. Je ne me fie pas à vos impressions ; je vous crois portée à l’exagération mais si je me trompais ! Ne soyez pas malade, je vous en conjure. Mes Françaises sont contentes de moi. Je leur donnerais probablement encore un petit dîné comme vous dîtes. Pas de lady Jersey ; elle est pour mon grand dîner Tory du 10 juin et c’est assez. Mesdames de Chastenay et de St Priest partent de demain en huit pour leur tournée, in the country, et puis pour Paris. Mad de St. Priest, fait bâtir une maison sur le terrain de l’hôtel d’havré. Elle veut retourner à ses ouvriers. Adieu. Corrigez le numero de vos lettres Vous êtes d’1 en avant. Adieu. Adieu. Je vais à mes dépêches. Adieu. J’ai besoin de finir par adieu.
378. Londres, Dimanche 24 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je crois qu’on s’est amusé hier chez moi, et qu’on a trouvé le dîner bon. Mais Lady Holland a eu un moment affreux. Elle avait dîné la veille à 5 heures, pour aller au spectacte. Pas déjeuné le matin. Elle mourait de faim. Lord Palmerston nous a fait attendre jusqu’à 8 heures un quart. Lady Holland a commencé, par l’humeur. Puis le désespoir. Enfin, l’inanition. au moment de passer dans la salle à manger elle a appété Lord Duncannon et s’est recommandée à lui, car elle n’était pas sûre de pouvoir aller jusque là sans se trouver mal. Le dîner a dissipé, l’inanition. Mais je ne suis pas sûr qu’un peu de rancune ne lui ait pas survécu de ce que j’avais attendu Lord et Lady Palmerston. Pour le 13 juin mon dîner Tory. Voici ma liste. Le duc et la duchesse de Cambridge, le Prince George, la Princesse Angusta, Une dame un aide de camp, le duc de Wellington, lord et lady Aylesbury, lord et lady Jersey, lady Sarah Villiers, lord et lady Stuart de Rothsay, lord Abordeen, lord Hertford, lord Howe, lord Stanley, Sir Robert et lady Peel, lord Lyndhurst,lord Ellenborough.
Connaissez-vous Sir Edward Disbrowe, le ministre d’Angleterre à La Haye ? Il a de l’esprit et des manières agréables. Il vit dans une grande intimité avec M. de Boislecomte qui me l’a fort recommandé. Si les deux pays avaient partout, des agents pareils, il pourrait y avoir entre eux des affaires, jamais d’embarras.
Savez-vous que je commence à compter les jours ? C’est charmant et très impatientant. Vous n’êtes pas seule à prendre de grandes résolutions depuis la mort de ce pauvre lord William. Lady Fanny Cowper ne couche plus qu’avec un grand poignard. Elle l’a essayé l’autre jour contre son oreiller et elle a trouvé qu’il coupait très bien. Lord Leveson n’est qu’arrivé qu’après lord Palmerston. Pour lui, je ne l’avais pas attendu. Nous étions à table depuis un quart d’heure. Je cherche s’il y a encore quelque évènement que je ne vous aie pas dit. A propos de lord Leveson, tirez-moi, je vous prie, de peine avec Lord Granville. Je viens de retrouver perdu dans un tas de papiers un petit billet qu’il m’a écrit il y a déjà bien longtemps pour me recommander un M. Rey ingénieur français venu à Londres. J’ai vu ce M. Rey et je l’ai bien reçu. Mais je ne me rappelle pas si j’ai répondu à Lord Granville et son billet enfui et retrouvé, m’en fait douter. Sachez-moi cela, je vous prie, et si je n’ai pas répondu, excusez-moi par la vérité, en attendant, que je mexcuse moi-même.
4 heures
Je comprends que vous ayez oublié le vendredi. Mais je ne comprends pas pourquoi le n° que je reçois aujourd’hui s’appelle 383. Celui d’hier était 380. J’en place bien entre ces deux-là, un qui viendra demain et qui sera 381. Mais je ne puis trouver le 382. Je viens de faire quelques visites, le Maréchal Saldanha, lord Combermere &. Il y en a beaucoup ici, mais on va vite. Quand vous serez arrivée comment réglerons-nous nos heures ? Pensez-y d’abord parce qu’il faut le régler, ensuite parce qu’il est agréable d’y penser. Vous savez ma maxime que le temps ne manque jamais là où est le désir. Le temps ne me manquera donc pas ; mais je veux du fixe, sans renoncer au variable. En voiture, un quart d’heure pour aller à Stafford-House ; à pied, par les rues une demi-heure, par les pars, trois quarts d’heure. Vous ne m’avez pas dit, si la Duchesse de Sutherland vous avait répondu. Point de nouvelles, ou bien petites. La querelle avec le Portugal s’arrangera ; le maréchal Saldanha a tous les pouvoirs nécessaires. Le Roi de Naples est parti pour la Sicile fort irrité contre ceux de ses conseillers qui l’ont embarqué dans cette mauvaise affaire, entr’autre contre le prince de Satriano. On les a payées et il aura, lui, à payer. Là est la plaie. On croit ici comme vous, le Roi de Prusse fort malade. Nous en sommes fâchés, sincèrement fâchés, quoique sans rien craindre du successeur. Que je vous dise un bon procédé de M. de Brünnow. C’est demain le jour de naissance de la Reine. Jusqu’ici, d’après la tradition on n’illuminait pas à l’Ambassade. Un scrupule m’a pris. Je n’ai pas voulu prendre des airs d’empressement exclusif en illuminant tout seul, ni courir le risque de ne pas illuminer si d’autres, si un autre quelconque, illuminaient. J’ai tout simplement fait demander à Ashburnham-House ce qu’on faisait. On m’a fait dire qu’on n’illuminait pas. Trois heures après, M. de Brünnow m’a envoyé un valet de chambre pour me dire qu’il illuminait. J’illumine donc, et je le remercierai de ne m’avoir pas laissé dans l’erreur. J’ai un peu ri de la fluctuation. M. de Poix avait grande raison de compter que votre intervention serait heureure. Mais pour être heureuse, il faut qu’une intervention intervienne. Si l’affaire est faite avant que l’intervention ait paru, ce n’est pas la faute de l’intervention mais de ceux qui l’ont réclamé trop tard. Il y a trois mois que je suis ici, et cinq mois que cette place d’attaché- payé à Londres est en perspective.
Lundi 25, 8 heures
Un très petit dîner chez lord Palmerston, lord et lady Holland, lord et lady Normansby, lord John Russell, lord Leveson et moi. Décidément, on veut me mettre là dans l’intimité. Lady Holland se charge de mon éducation. Il m’est arrivé hier de citer un proverbe Anglais : Hell’s way is paved with good intentions. Elle m’a demandé bien bas bien pardon de son impertinence et m’a averti que jamais ici on ne prononçait le mot de Hell, à moins qu’on ne citât des vers de Milton. La haute poésie est la seule excusée. L’autre jour, elle m’avait repris parce que je disais always pour still. Je l’ai beaucoup remerciée. Je vois que l’inanition n’a pas laissé de rancune. A onze heures chez lady Jersey. Lord Stuart, lord Heytesbury, Sir Robert Wilson, et une femme d’esprit, point tulipe dont j’ai oublié de demander le nom quand elle est partie. Lord Heytesbury me convient : bonne conversation, pleine, sensée, tranquille, un peu triste. Il dit. "J’ai fini." Et on voit que ceux qui n’ont pas fini lui inspirent un peu d’envie sans malveillance. La beauté de mon surtout fait du bruit. Il en était question hier au soir chez Lady Jersey. 4 heures Je reviens du Drawing-room. Immense. La Reine en aura, certainement jusqu’à 7 heures. J’espère qu’on la décidera à s’asseoir. C’est fort cohue, tant on est pressé pour arriver, pressé quand on y est, et pressé en sortant. Le palais est beaucoup trop petit. Pas de place pour les queues ; pas de place pour le spectateurs. Il y a une infinie quantité de beaute perdue, choses et personnes. Adieu. Votre fils part demain. Il ira lentement de Calais à Paris. Je suis bien heureux de le voir partir. Adieu. Adieu. Par le Télégraphe.
371. Londres, Dimanche 17 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
" Since the Lord gave me the desire of my heart in my dearest Mary, the rest of the sex are no more to me than the tulips in the garden. "
Si cela ne vous plait pas, je ne vous parlerai plus jamais des tulipes que j’ai trouvées belles.
Il faut pourtant que je finisse. C’est grand dommage car je n’ai pas fini. Adieu pourtant. Adieu toujours. Je crois en effet que vous ne me connaissez pas. Adieu encore.
365. Londres, Mardi 12 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
moins de la part des hommes, un peu d’insolence, de la part des femmes un peu d’empressement. Cela ne me plaît pas. La Reine a dansé trois contredanses avec le Prince George de Cambridge, le duc de Bucclengh. J’oublie le troisième. Quelques personnes s’en désolaient ; elle n’est donc pas grosse. Elle a dansé en femme grosse rarement et doucement. Elle qui prend d’ordinaire un espace immense, elle contenait ses pas sous sa robe. Elle est très gracieuse pour moi. Et son mari aussi. Et la Duchesse de Cambridge extrêmement. Elle s’est plainte à moi de ne pas me voir assez souvent. On a dansé ce qu’ils appellent la danse écossaise ; une vraie danse, comme des gens qui s’amusent et qui ont envie de s’amuser davantage.
Le Duc de Bucclengh et Lord Ossuloton l’ont dansé à merveille. Et aussi la petite belle fille d’Ellice, qui ressemble parfaitement à une bruyère.
Beau souper médiocre. Louis vaut mieux que Francatelli. J’ai fait mon devoir en conscience. Je ne suis sorti qu’après la Reine, à 2 heures et demie. Bülow et les autres en prennent plus à l’aise. J’ai attendu ma voiture un temps énorme. Ce service-là n’est pas bien ordonné. Je n’étais dans mon lit qu’à 3 heures et demie Je fais mon devoir aussi, ce me semble. Je vous conte toutes les frivolités de Londres, qui sont les miennes. C’est long pour un spectateur. Sir Robert Peel était là, sa femme, sa fille ; venus de bonne heure, restés tard. Quelques uns des plus vifs et sévères conservateurs. Sir Robert Inglis. Mrs. Stanley m’a dit que son mari avait passé une matinée à examiner la liste des invitations.
Point de nouvelles d’ailleurs.
Une heure
Comment vous laissez-vous tomber ? Si vous pensiez à moi toujours, comme vous le dites, vous ne feriez pas cela. J’attendrai la lettre de demain avec un redoublement d’impatience. Je déteste les incidents. Ile sont toujours mauvais.
Je vois ce soir chez le Duc d’Argyle. Un nouveau duc d’Argyle,Tory ; le premier de son nom depuis longtemps. Il connait et voit peu de monde. Voilà une invitation à dîner chez Sir Robert Inglis pour le 10 juin. C’est s’y prendre à l’avance.
358. Londres, Dimanche 3 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Lundi une heure
2heures 1/2
Mots-clés : Ambassade à Londres, Aristocratie, Autoportrait, Diplomatie, Interculturalisme, Peinture, Portrait
360. Paris, Samedi 2 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai eu votre lettre après le départ de la mienne. Je suis toujours fâchée quand je ne puis pas répondre de suite. Cela abrège la distance lorsqu’on n’a que quatre jours entre soi. Savez-vous que le télégraphe électrique sort de ma famille. Ce gros M. de Shilling que vous avez vu chez moi en 35 (je ne sais si vous vous souvenez de lui). Il était l’inventeur, il y a quelques quinze ans de cela. Mais je crois que vous vous trompez sur la célérité, il fallait cinq ou 6 secondes entre Pétersbourg et Moscou. Midi Voici votre lettre. Ce que vous dites du melange d’affectation et de naturel dans les Anglaises est très juste. En général elles manquent de grâce, cela est sûr. Et puis elles cherchent à s’en donner; ce qui ne va jamais. Je suis fort aise du grand cordon. Je ne suis pas. tout à fait au dessus de ces petites vanités là. Il y a des choses qu’il faut avoir et puis alors c’est fini des petites vanités. J’ai pensé à votre dîner hier beaucoup. Je penserai à celui d’aujourd’hui.
Le duc de Noailles est venu causer pendant longtemps hier matin, Berryer trouve la chambre très occuppée, très animée, non pas sur quelque chose de spécial, mais enfin une disposition à faire ou à voir faire quelque chose. La séance sur les éligibles a classé les partis, cela a plu, et cela a donné le goût d’arriver à quelque chose de plus clair encore. Berryer croit que la Commission fera éclore cela, et que la discussion se développera plus encore. Enfin il voit ressortir une dissolution de la Chambre par le fait de la Chambre elle-même , et non pas par le ministère ce qui mettra la cour dans l’impossibilité de la refuser. Car si même les pairs rejetaient une loi d’incompatibilité, cela ne rendrait pas de nouvelles élections moins nécessaires, les députés fonctionnaires ne pouvant pas rester sous le coup de précautions. La session ne finira donc pas sans quelque chose d’éclatant. Voilà l’opinion de Berryer. Je n’ai vu hier personne à peu près, la fête absordant tout le monde.
Le soir M. Jaubert est venu pour rencontrer Ellice, mais celui-ci a tardé et jamais ils ne feront connaissance. J’ai lu à Jaubert le passage de la lettre de Lord Aberdeen où il parle de vous. Cela a semblé lui faire un grand plaisir. Nous avons causé assez familièrement ensemble. Il me plait. Il me parait être fort content de Thiers, et de la situation en général. Pahlen est entré, je les ai introduced to each other, mais mon ambassadeur a reçu cela bien froidement, trop froidement. Ellice plus tard, rabâchant sur la Chine.
2 heures
Lady Pembroke est venu m’in terrompre avant ma toilette. me voici bien en retard. Je cherche vite si j’ai quelque chose à vous dire je ne trouve pas. Les fontaines sont admirables, Le soleil va toujours. La chaleur aussi, c’est même ennuyeux.
M. Andral m’a écrit pour me dire qu’il ne pouvait pas venir me voir, parcequ’il est trop occupé. Le Duc de Noailles prétend qu’il n’y a que moi à qui pareille avanie arrive. Sur cela j’ai envoyé cherche Chermeside. Ne pouvant avoir le meilleur, je reviens au plus mauvais médecin, mais c’est que je me souviens que de son temps j’allais mieux, peut être fera-t-il encore ce miracle. Je n’ai pas vu Lady Granville à la façon Anglaise elle ferme sa porte à tout le monde mêne moi puisqu’il y a eu un mort dans la famille. Elle peut le faire elle est entourée. Adieu, adieu. J’aurai une lettre demain, et puis lundi ; mais je ne saurai le dîner de l’Académie que mercredi ; c’est bien long. Adieu mille fois. Le Duc de Noailles trouve que votre position à Londres est superbe et qu’elle vous prépare à tout.
357. Paris, Mercredi 29 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je crois Monsieur que je me suis permis il y a quelques jours de vous dire l’opinion de quelques Anglais ici sur le discours que vous aurez à prononcer samedi au dîner de l’Academie j’y ai bien pensé depuis et je crois que leur avis cependant n’est pas bon. Un discours en français est plus convenable dans
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Interculturalisme
352. Londres, Dimanche 26 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’espère que ma lettre vous sera arrivée hier d’assez bonne heure pour vous en servir. Il m’avait été absolument impossible de vous écrire la veille. Les Ministres ne sont pas venus au diner de la Cité parce qu’ils y avaient été très mal reçus la dernière fois, sifflés à la lettre. Lord Melbourne, s’en était très bien tiré, très dignement. Mais ils ne se sont pas souciés de recommencer. Lord Palmerston à qui le matin même, j’avais dit en passant que j’irais, me répondit qu’ils n’iraient pas, et pourquoi. Un motif accidentel de plus. Les Shériffs que la Chambre avait mis en prison, et qui venaient d’être mis en liberté devaient être au dîner, et y étaient en effet. Le Lord Maire a porté leur santé et protesté contre leur emprisonnement. Tout cela faisait bien des petits embarras. Du reste, la santé des ministres a été portée et acceptée avec une froideur décente. Leur absence a été remarquée, mais sans étonnement. Les représentants de la cité au Parlement radicaux n’y étaient pas non plus et n’auraient pas été mieux reçus. La Cité est partagée en Torys en haut, radicaux en bas.
Lundi, 9 heures
Une heure
351. Londres, Samedi 25 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier soir, vers dix heures, après avoir renvoyé quelques français qui étaient venus me voir, j’ai été me promener seul à pied dans les rues de Londres. Duke street, Oxford Street, Grosvenor-square, Berkeley square, Orchard Street, Postman square. Londres est bien noir. Pas de soleil le jour ; pas de boutiques éclairées le soir. Mais peu m’importe ; quand j’ai l’esprit occupé et le cœur serein j’illumine moi-même le monde qui m’entoure. J’ai pensé à vous à Hampstead à ma fille qui va bien à mes affaires qui ne vont pas mal. J’étais rentré et couché à 11 heures.
Je me lève et je vous écris. La romance a raison.
3 heures
4 heures et demie
347. Londres, Mardi 21 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai eu un grand, grand succès at the Mansion house. J’étais seul du corps diplomatique et d’autant mieux reçu. On me dit que M. de Brünnow y serait allé si je n’y étais pas allé. Le Lord Maire ayant porté ma santé et celle des ministres étrangers, voici mon petit speech, un peu prémédité et écrit en rentrant ; vous l’aurez tout entier avec ses fautes : My lord Ladies and Gentlemet I beg yous pardon for my bad very bad English language. I am sure you will show some kindness to a foreigner who likes et better to speak very imperfectly your language than to be imperfectly understood, speaking his own. I am truly happy Gentlemen that it is in this moment my duty to express to you in the name of all the corps diplomatique as in my own name, of Europe as well as of France our warmest feelings of gratitude for your noble and kind hospitality. Your ancestors Gentlemen, I could almost say your fathers should have been very astonished if They have been told that During more than twenty five years, the Ambassadors, the Ministers, the representatives of all the States, all the nations in Europe and in America could every year sit together, with you, in this hall, enjoying the friendship of England and promising to you the friendship, of the civilised world. In times not far from us, war, a war if not general at least partial, if not incessant at least very frequent, rendered such meetings always incomplete and irregular. Peace has made to us that happiness, the consequence and the image of the happiness of the wortd. And pray, gentlemen, remark this : it is not an idle, infertile peace, as it exists sometimes between weak, somnolent and declining nations. It is the most active, the most fruitful peace that was ever seen brought in and maintained by the power of civilisation, labour, justice and liberty.
Une heure
332. Londres, Dimanche 29 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
L’effet de cette grosse majorité est considérable ici, et me servira, j’espère. J’avais hier Lord John Russel chez Lord Normanby. J’ai vu le soir lord Landsdowne et M. Macaulay. Ils sont disposés à compter avec nous. Ellice est charmé. Il partira décidément le vendredi 10 avril. Il est bien heureux. J’ai causé hier soir avec le revérend M Sidney Smith, qui a réellement beaucoup d’esprit. Mais tout le monde s’y attend, tout le monde vous en avertit. C’est son état d’avoir de l’esprit comme c’est l’état de Lady Seymour d’être belle. On demande de l’esprit à M. Sidney Smith, comme une voiture à un sellier. Rien ici ne va facilement librement, sans attente, ni dessein. Tout est classé, arrangé, convenu. On fait bien d’avoir de la liberté politique, car on n’en a pas d’autre.
3 heures
6 heures
Lundi, 9 heures et demie
2 heures
3 heures
327. Londres, Samedi 21 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
3 heures
4 heures ¾
320. Londres, Jeudi 5 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Londres, jeudi 5 mars 1840, 8 heures du matin
Je me lève. Comment aurez-vous dormi cette nuit ? Hier était un triste jour. J’ai le coeur plein de remords d’être loin de vous. Je ne vous ai jamais fait le bien que j’aurais voulu. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais tout le bien que je voudrais vous faire, mon ambition infinie, insatiable, avec vous. Je vous aime trop pour me résigner jamais à me sentir impuissant et désarmé quand je vous vois un chagrin, n’importe lequel, n’importe de quelle date. Non, je ne me résignerai jamais à ce que cela soit, jamais à le croire; je m’en prendrai toujours à l’imperfection de notre relation, à la séparation de nos vies, à l’impossibilité où je suis de vous donner tout ce que j’ai en moi pour vous, d’exercer auprès de vous, sur vous, toute cette puissance d’affection et de tendres soins, le seul vrai baume que Dieu ait mis à notre disposition pour les blessures de l’âme. Dearest, vous avez beaucoup souffert, et il vous a toujours manqué du bonheur à côté de la souffrance. Il n’y a pas moyen de supprimer la souffrance dans la vie humaine; elle en est inséparable ; mais le bonheur aussi peut s’y placer; et la destinée le plus rudement frappée, le cœur le plus déchiré peuvent contenir en même temps les joies les plus intimes et les plus douces. C’est ce mélange de bien et de mal, cette compensation de l’un par l’autre que je voudrais du moins vous donner. Près de vous, je faisais déjà si peu! Quoi donc de loin?
6 heures
Vous avez raison. Je suis faible quelquefois avec mes amis. Mais dans cette occasion, ma faiblesse était bien embarrassée, car elle avait à choisir : le Duc de Broglie, MM. de Rémusat et Jaubert d’un côté, MM. Duchâtel et Villemain de l’autre. Evidemment il fallait chercher ailleurs que dans mes amitiés le motif de décision. Je ne vous redirai pas ce que vous aurez vu dans ma lettre à Duchâtel et dans celle du Duc de Broglie. Il ne m’est resté, il ne me reste aucun doute. Je ne sais ce qui arrivera. Je penche à croire qu’au fond ce Ministère fera à peu près comme le précédent. Je suis sûr qu’il le voudra; je présume qu’il le pourra. Je ne lui vois ni des amis bien exigeants, ni des ennemis bien intraitables. S’il en était autretrement, si le pouvoir allait réellement à la gauche, je n’hésiterais pas un instant. Ils le savent. Voici ce que m’a écrit Thiers :
« Mon cher Collègue, je me hâte de vous écrire que le Ministère est constitué. Vous y verrez, parmi les membres qui le composent, deux de vos amis, Jaubert et Rémusat, cl dans tous les autres, des hommes auxquels vous vous seriez volontiers associé. Nos fréquentes communications depuis dix-huit mois nous ont prouvé, à l’un et à l’autre, que nous étions d’accord sur ce qu’il y avait à faire, soit au dedans, soit au dehors. Nous pouvons donc marcher ensemble au même but. Je serais bien heureux si en réussissant tous les deux dans notre tâche, vous à Londres, moi à Paris, nous ajoutions une page à l’histoire de nos anciennes relations. Car aujourd’hui comme au 11 octobre, nous travaillons à tirer le pays d’affreux embarras. Vous trouverez en moi la même confiance, la même amitié qu’à cette époque. Je compte en retour sur les mêmes sentiments. Je ne vous parle pas d’affaires aujourd’hui. Je ne le pourrais pas utilement. J’attends vos prochaines communications et les prochaines délibérations du nouveau Cabinet. Ce n’est qu’un mot d’affection que j’ai voulu vous adresser aujourd’hui, au début de nos relations nouvelles. » Je lui ai répondu ce matin : « Mon cher Collègue, je crois comme vous qu’il y a à tirer le pays de graves embarras. Je vous y aiderai d’ici, loyalement et de mon mieux. Nous avons fait ensemble, de 1832 à 1836, des choses qu’un jour peut-être, je l’espère, on appellera grandes. Recommençons. Nous nous connaissons et nous n’avons pas besoin de beaucoup de paroles. Vous trouverez en moi la même confiance, la même amitié que vous me promettez et que je vous remercie de désirer. Nous nous sommes assurés en effet, dans ces derniers temps, que nous pouvions’ marcher ensemble vers le même but. Rémusat m’écrit que le Ministère s’est formé sur cette idée : Point de réforme, point de dissolution. C’est le seul drapeau sous lequel je puisse agir utilement pour le Cabinet, honorablement pour moi. Si quelque circonstance survenait qui me parût devoir modifier nos relations, je vous le dirais à l’instant et très franchement. Je suis sûr que vous me comprendriez, et même que vous m’approuveriez. » Vous voilà au courant, comme on peut l’être de loin. Misérable communication ! Pendant que je vous écris, mon âme, mes regards, ma voix vous cherchent. Adieu. Je vous quitte pour aller m’habiller et dîner chez la Reine.
Vendredi 6 mars, 5 heures
J’ai diné à la droite de la Reine qui avait son mari à sa gauche. Elle a été très aimable pour moi. Soyez tranquille ; pas la plus petite allusion aux Affaires. La famille Royale, la Princesse Marie, Melle Rachel, Paris, Buckingham-Palace ont défrayé la conversation. La Reine a eu pour moi les mêmes bontés que Mme la Duchesse d’Orléans ; elle a lu mes ouvrages. Elle a un joli regard et un joli son de voix. Dans son intimité elle a supprimé la retraite des femmes avant les hommes. Hier les vieilles mœurs ont prévalu. J’avais à ma droite Lady Palmerston, puis Lord Melbourne, le Marquis de Westminster, Lady Barham etc, 28 en tout.
Après le dîner, on s’est établi autour d’une table ronde, dans un beau salon jaune qui m’a fait frémir tout le cœur en y entrant. C’est presque la même tenture que votre premier salon. Deux ou trois femmes se sont mises à travailler. Nous avons causé, sans trop de langueur, grâce à Lady Palmerston et à moi jusqu’à onze heures un quart que la Reine s’est retirée.
J’ai découvert au-dessus des trois portes de ce salon trois portraits... Je vous donne à deviner lesquels! Fénelon, le Czar Pierre et Anne Hyde, Duchesse d’York. Je me suis étonné de ce rapprochement de trois personnes si parfaitement incohérentes. On ne l’avait pas remarqué. Personne n’a pu en trouver la raison. J’en ai trouvé une. On a choisi ces portraits à la taille. Ils allaient bien aux trois places.
On disait hier matin une nouvelle. La Reine n’avait pas paru la veille à dîner, elle était souffrante ; elle est grosse. Lady Holland a apporté cela le soir chez Ellice où j’avais dîné. Mais la Reine a dîné hier et ce matin elle a tenu un lever qui a duré deux heures. C’est beaucoup si elle est grosse. Cependant on ne retire pas la nouvelle.
Ce lever, m’a ennuyé et intéressé. C’est bien long et bien monotone. Pourtant j’ai regardé avec une émotion pleine d’estime le respect profond de tout ce monde, courtiers, Lawyers, Aldermen, Officers, passant devant la Reine, la plupart mettant un genou en terre pour lui baiser la main, tous parfaitement sérieux, sincères et gauches. Il y faut cette sincérité et ce sérieux pour que tous ces vieux habits, ces perruques, ces bourses, ces costumes que personne, même en Angleterre, ne porte plus que pour venir là, ne fassent pas un effet un peu ridicule. Mais je suis peu sensible au ridicule des dehors quand le dedans ne l’est pas. J’ai vu le Duc de Wellington, triste vue, presqu’aussi triste que celle de Pozzo; rapetissé de trois ou quatre pouces, maigre, chancelant, vous regardant avec ces yeux vagues et éteints où l’âme qui va s’enfuir ne prend plus peine de se montrer, vous parlant de cette voix tremblante dont la faiblesse ressemble à l’émotion d’un dernier adieu. Il n’est point moralement dans l’état de Pozzo, l’intelligence est encore là, mais à force de volonté et avec fatigue. Il s’est excusé de n’être pas ecore venu chez moi : « J’étais à la campagne ». Je crois que je dinerai avec lui chez le Sir Robert Peel.
M. de Brünnow n’est pas encore venu chez moi. C’est le seul. Il était au lever de la Reine, très empressé, auprès des Ministres, busy-body 2 et subalterne dans ses façons.
Lady Palmerston m’a parlé de Paul. Il ne va absolument nulle part, si ce n’est à Crockford à 9 heures pour dîner. Il passe sa journée chez lui, en robe de chambre et à fumer. M. de Brünnow, dans les premiers moments, l’a vu deux ou trois fois et a essayé de le voir davantage. Paul n’a pas voulu. M. de Brünnow ne le voit plus.
Le mariage de Darmstadt n’est point certain. Le Grand Duc y retourne pour voir s’il pourra se décider. On doute qu’il se décide. Il est toujours amoureux en Russie. M. de Brünnow reviendra ensuite ici comme ministre en permanence, en attendant, fort longtemps peut être, un ambassadeur.
Samedi, 8 heures du matin
Hier, à dîner chez Lord Clarendon, M. de Brünnow s’est fait enfin présenter à moi. Il est bien remuant, papillonnant, aimable. Ce dîner m’a plu, Lord Clarendon est plus continental, plus de laisser-aller. Nous avions le Marquis de Douro et sa femme, la plus belle personne de l’Angleterre, dit-on, et vraiment très belle. Point d’esprit du tout. Comme lui. Entre nous il en est étrangement dépourvu. Plus que cela, car il parle beaucoup & se met en avant. Je vous étonnerais en vous répétant les pauvretés qu’il m’a dites. Toujours Lord Melbourne, Lord & Lady Palmerston. Après dîner, j’ai été à Devonshire House, où j’ai trouvé la Duchesse de Cambridge et un très select party, Lady Jersey, La Duchesse de Montrose, &, &. On dansait, le Duc de Devonshire autant que personne. On me parle beaucoup de vous, et je suis sûr que je réponds très bien.
10 heures
Voilà le 319. Mon remords de n’être pas auprès de vous redouble. Je me reproche l’agrément que je trouve ici, le plaisir que je prends à regarder, à être bien reçu. Je ne supporte pas la pensée d’être gai quand vous êtes triste, entouré quand vous êtes seule. Et pourtant cela est et je l’accepte en fait au moment même où mon cœur s’en indigne. Ah !Pardonnez-moi dearest, pardonnez-moi cette faiblesse de notre nature, à laquelle il n’y a peut-être pas moyen d’échapper et qui n’empêche pas que dans toutes les situations, à toutes les heures du jour, je n’aimasse mille fois mieux être auprès de vous que partout ailleurs, et partager votre tristesse plutôt que toutes les joies du monde. N’est-ce pas que vous me le pardonnez? N’est-ce pas que vous savez bien tout ce que vous êtes pour moi? La mer qui nous sépare est bien profonde, mais mon affection pour vous l’est mille fois davantage. Et j’aurais ici tous les succès imaginables que je leur préférerais mille fois le succès de vous donner un jour, une heure de bonheur.
Vous voulez que je vous parle des affaires. M. de Brünnow est évidemment en panne, attendant que les embarras, les obstacles au progrès de la négociation viennent de nous, pour se saisir tout à coup de ce fait, se faire un mérite de l’empressement, de la facilité de son maître, pousser peut-être cette facilité plus loin qu’il ne l’a fait encore, et enlever brusquement le succès. Je tâcherai de ne pas le servir dans cette tactique. Evidemment il y a ici un désir sincère, vif, de ne pas se séparer de nous ; on fera des sacrifices réels à ce désir. Il y a des dissidences marquées, à cet égard, dans le cabinet ; quelques-uns tiennent beaucoup plus à nous que d’autres. Mais tous y tiennent, et je n’entends pas le moins du monde me prévaloir des dissidences, ni chercher seulement à m’en servir. J’ai commencé à traiter et je traiterai jusqu’au bout l’affaire avec la plus entière franchise, m’appliquant uniquement à convaincre tout le monde de l’intérêt supérieur des deux pays au maintien de l’alliance, et de la nécessité d’une transaction, entre le Sultan et le Pacha, qui puisse être acceptée par le Pacha comme par le Sultan, par la France comme par l’Angleterre et qui mette fin à cette question-là en ajournant toutes les autres.
M. d’André n’a apporté de Pétersbourg que des lettres assez vagues, plutôt l’idée que l’affaire ne marchait pas, et un redoublement de colère de l’Empereur qui avait espéré, dit-on, que la dépêche, inspirée par lui, de M. de Nesselrode à Médem, amènerait une réponse qui amènerait une rupture. Je n’en crois rien. Pourtant, je n’en sais rien.
Adieu. Adieu. Continuez de me tout dire. Vos lettres me font un peu vivre à Paris, et cela m’est très utile. Soyez tranquille. Je n’oublierai pas vos recommandations. Mais répétez les moi toujours. Adieu encore.
Continuez de m’écrire les lundi et jeudi par les Affaires Etrangères, et le samedi par la Poste. Et si vous vouliez quelque chose de plus indirect, envoyez votre lettre à Génie.
318. Londres, Samedi 29 février 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
318 Londres Samedi 29 février 1840
9 heures du matin
J’éprouve ici le matin une grande impression de calme. Personne ne vient. Personne ne me parle. Je n’entends point de bruit. C’est le repos de la nuit, sauf les ténèbres. Il me semble que je sors d’un guêpier bruyant, et que je contemple une ruche d’abeilles qui travaillent toutes sans bourdonner. Vous avez raison. Avec du bonheur domestique, la vie peut être ici aussi douce que grande. Il y a en France trop de mouvement extérieur; ici, pas assez de mouvement intérieur. En tout, l’aspect de cette société me plaît; je m’y sens à l’aise et dans un air sain, bien que trop froid.
Voilà du bonheur, le 316. Décidément chaque fois, je vous dirai mille fois merci. Oui, c’est du bonheur, un bonheur charmant quoique triste. Que serait-ce s’il était gai ? Je ne comprends pas Mad. Sébastiani ; malgré tout ce que j’en savais, ceci est plus bête. Mais je comprends encore moins Génie. Je lui ai répété ma recommandation pour tous les jours, cinq minutes avant de monter en voiture. Je n’entrevois qu’un motif, les obsèques de ce pauvre M. Devaines. Elles ont dû avoir lieu avant-hier jeudi, et Génie aura eu toutes sortes de soin à prendre. C’est un travail de mourir, et ceux qui s’en vont lèguent à ceux qui restent l’embarras avec le chagrin. Il est impossible que Génie ne soit pas allé vous voir hier.
4 heures Je viens d’avoir des aventures. Je sors de chez la Reine. Imaginez que je reçois, à une heure dix minutes, un billet de Lord Palmerston qui me dit que la Reine me recevra à une heure. J’envoie sur le champ chez Lord Palmerston pour constater mon innocence. Je m’habille en toute hâte. Je demande mes chevaux. Je pars. J’arrive avant 2 heures, à Buckingham. Comme de raison, on m’attendait. Je monte et trouve Lord Palmerston qui arrivait aussi. Les ordres de la Reine lui étaient parvenus tard. On ne les lui avait pas remis tout de suite. Heureuse-ment la Reine avait d’autres audiences qu’elle avait données en atten-dant. [Point de maître des cérémonies. Sir Robert Chesler, prévenu en même temps que moi, n’avait pas été aussi preste que moi.]
Bref, la Reine m’a reçu avec beaucoup de bonne grâce; sa dignité la grandit; son regard est intelligent et animé. Je lui ai dit en entrant : « J’espère, Madame, que Votre Majesté sait mon excuse, car je serais inexcusable. » Elle m’a répondu en souriant, et j’ai vu que Lord Palmerston était excusé aussi. Mon audience a été courte. Le Roi, la famille Royale, les relations du Roi avec le Duc de Kent son père, la surprise que je ne fusse jamais venu en Angleterre etc, etc. [Je suis sorti. Lors Palmerston est resté un moment après moi. Je m’en allais ; il m’a rejoint en courant : « Vous n’avez pas fini ; je vais vous présenter sur le champs au Prince Albert et à la Duchesse de Kent ; sans cela, vous ne pourriez leur être présenté qu’au prochain lever, le 6 mars ; et il faut qu’au contraire que, ce jour-là, vous soyez de vieux amis. »]
Nous avons été chez le Prince Albert, très beau et agréable jeune homme d’une physionomie douce, ouverte, intelligente, simple et élégant de langage. Il m’a retenu un quart d’heure. Nous avons causé. Il m’a plu tout à fait...
[De là, chez la Duchesse de Kent, au rez de chaussée. Elle était un peu malade de la goutte. Au moment où je traversais le vestibule pour aller reprendre ma voiture, sir Robert Chester est entré descendant de la sienne. Je lui ai fait toutes mes excuses dont je n’avais pas besoin. Je suis rentré chez moi, j’ai quitté mon harnois. J’ai couru une heure et demie pour aller m’écrire chez les Ducs de Sussex & de Cambridge, la duchesse de Glocester, les Princesses Auguste et Sophie-Mathilde, et me voici de retour. Demain les visites du cabinet. Après demain celle du Corps diplomatique. Les cartes pleuvent chez moi ce matin. On me remet à l’instant celle de Lord Aberdeen, Lord Holland et Lord Howe. Je demanderai demain à être reçu par la Reine Douairière.
Je suis allé hier soir chez Lady Holland sans la trouver. Elle était à Covent Garden où la Reine a été fort bien reçue. Les loges en face ont été louées pour 20 £ pour la voir, et les loges à côté 10 liv., pour ne pas la voir.
Dimanche 9 heures.
J’ai été plongé hier en Angleterre ; jusqu’au fond. A dîner le duc de Sussex, le Duc de Norfolk, le Duc de Devonshire, Lord Carlisle, Lord & Lady Albermarle, Lord & Lady Minto, Lord & Lady Elisabeth Howard, Lady Seymour, &, &, tous Whigs sauf un petit Tory dont j’ai oublié le nom. Le soir un rout immense, tout ce qu’il y a de ministres, de corps diplomatique, de membres des deux chambres, Whigs, Torys, radicaux, depuis lors Aberdeen jusqu’à M. Grote ; mais les Whigs souverains, selon leur droit.
J’ai passé ma soirée à être présenté et à accueillir des présentés. On me dit que je dois être content, très content que j’ai été bien lion et bon lion. Il me semble que j’ai rencontré de la curiosité et de la bienveillance. Je suis décidé à y être difficile. Je ne fais nul cas des demi-succès et des succès de début. Il les faut, mais pour commencer, comme il faut un premier échelon à la plus haute échelle. Si je suis bon à quelque chose ici, pour mon pays & pour moi, ce ne peut être qu’en inspirant une estime & un intérêt soutenu & croissants.
Fanny Cowper est charmante ! Elle promène partout, modestement mais sans embarras, un regard si jeune et si indépendant ! Je serais surpris si elle n’avait pas des goûts très décidés, en attendant des volontés.
Lord Aberdeen est venu à moi avec un empressement marqué. Je l’ai trouvé plus vieux et l’air moins sombre que je ne m’y attendais.
Lord Melbourne m’a parlé français de très bonne grace et longtemps. Il n’y a qu’Ellice qui soit décidé à ne pas me dire un mot de français. Il a raison. Je lui ai promis d’aller diner chez lui mercredi, en famille, et vendredi, chez Lord Charendon, en petit comité. Lord Charendon a été très aimable.
Je n’ai pas vu, du Cabinet, Lord John Russel, et du corps diplomatique, le Baron de Brunnow.
Connaissez-vous une Mad. Stanley, jolie, vive, spirituelle, whig très décidée et très active, que Lord Palmerston appelle notre Chef d’Etat major ? Son mari est un whipper-in important.
J’ai trouvé là le Prince de Capoue et sa femme. Il y a plus que l’océan entre les façons anglaises et les façons napolitaines.
Le Duc de Sussex a l’air d’un très bon homme. Il m’a beaucoup parlé de ses voyages sur le continent. Il a vu commencer toutes les révolutions, en France, en Espagne, en Portugal. Il prenait grand plaisir à me raconter Mirabeau. Vous savez que M. Croker m’a dressé à ces leçons-là.
J’étais à table entre Lady Cecilia Underwood (vous savez) et Lady Albermarle qui m’a mis très bonnement, au courant de tout le monde. Lady Palmerston avait à côté d’elle le Duc de Sussex et le duc de Norfolk. C’est la règle, n’est-ce pas ?
J’ai échangé en courant quelques paroles avec Lady Palmerstonn affectueuses pour vous. Elle a l’air très contente, et répand avec beaucoup de grace son contentement tout autour d’elle. Son fils, Lord Cooper m’a paru sprituel.
Si nous étions ensemble, je vous dirais mon compliment de Lady Palmerston à mon sujet, que j’ai entendu en passant. Mais cela ne se dit que tout bas quoique tout seuls.
Vous avez raison ; elle a l’air très fine et voyant tout sans y regarder.
5 heures
J’ai eu toute à l’heure un vrai plaisir. J’ai été à Stafford house. Le Duc et la Duchesse de Sutherland m’ont accueilli presque avec amitié. J’aime Stafford-house. C’est très beau, très beau. Et ce sera encore plus beau, car le premier étage n’est pas fini. J’ai vu ce qui est fait et ce qui se fait. Le Duc m’a promené partout. L’Escalier a vraiment de la grandeur, assez pour que la richesse y soit bien placée. Le comte de Montfort m’y a succédé.
J’apprends que j’ai eu tort de ne pas me mettre à côté de Lady Palmerston. C’est Lady Albermarle qui m’a trompé. Je lui donnais le bras. Je l’ai consultée ; elle m’a dit que je devais me placer à côté de Lady Cécilia Underwood, quasi altesse royale. Je prendrais ma revanche.
J’ai fait ce matin toutes mes visites de cabinet, et Lord Charendon sort d’ici. Il a vraiment de l’esprit, et un esprit gracieux. Nous nous sommes entendus au-delà de mon attente. Je dine chez lui vendredi, samedi chez Lord Lyndhurst, Dimanche chez Lord Landsdown. Il y a aussi un dîner arrangé chez le duc de Devonshire, avec le duc et la duchesse de Cambridge. Je subis cette première bouffée , j’espère qu’elle ne soufflera pas toujours.
Je vous parle de tout, et pas un mot de ce qui se fait à Paris. Que serviraient mes paroles ? Vous en savez plus que moi. J’attends ce que me mandera le duc de Broglie. Il a mes pouvoirs, sauf ratification. Adieu pour Aujourd’hui. Il fait très froid. Mais je n’ai pas l’impression d’un changement de climat.
M. Dedel sort aussi de chez moi, très ouvert et très bienveillant. Je crois que je me trouverai bien de lui et avec lui Lundi.
Lundi 2 mars 9 heures
Je ne compte pas avoir de lettre de vous ce matin, par la poste. Vous aurez attendu le courrier des affaires étrangères. C’est horrible une poste qui arrive et qui ne m’apporte rien de vous. Le Val-Richer, Baden ne m’ont jamais coûté si cher. Je m’y accoutume tous les jours moins. C’est déjà si peu qu’une lettre ! Et pourtant c’est tout.
J’ai passé deux heures et demie hier soir chez Lady Holland, empressée, charmante. J’ai trouvé Lord Holland toujours le même, absolument le même, la seule personne qui ne m paraisse pas vieillie, d’esprit ni de corps. Lord John Russel et Ellice y avaient dîné. Lord & Lady Palmerston y sont venus le soir. J’ai un peu causé avec Lady Palmerston, et j’ai protesté contre l’erreur où m’avait attiré Lady Albermarle avant-hier. Voici mes dîners de la semaine. Mercredi Ellice. Vendredi, Lord Clarendon. Samedi, Sir Robert Peel. Dimanche, Lord Landsdown. Mardi 10, le Duc de Sutherland. Il me semble que je vous en ai dit la moitié plus haut.
10 heures ¼
J’avais tort de ne pas espérer. La poste est charmante. Que de choses à vous répondre ! En attendant vous gagnerez quelque chose à ma joie. Je ferai partir ce volume aujourd’hui. Un autre suivra promptement. Que ne donnerais-je pas en ce moment pour causer une heure avec vous ! Adieu. Adieu.
331. Londres, Vendredi 27 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je me lève de bonne heure. Je me suis couché de bonne heure hier, quoique j’aie dîné chez Lady Jersey où l’on dîne plus tard que partout ailleurs. J’en suis sorti à 10 heures trois quarts, et j’ai été passer un quart d’heure chez Lady Landsdowne. J’étais rentré à 11 heures et demie Lady Jersey a vraiment trop peu d’esprit pour tant d’activite et de paroles. Elle me lasse sans m’animer. J’ai revu hier chez elle la petite Lady Alice Peel toujours aussi vive et aussi bizarre, dans son parfait naturel. Elle était enfermée dans une petite robe de soie bariolée sans rien sur son cou, rien dans ses cheveux, pas le plus petit ornement, non absolument qu’elle et sa robe. Cela lui allait bien.
Blankenberghe, August 6, 1847, Sarah Austin à François Guizot
Dresden, Dec. 21, 1841, Sarah Austin à François Guizot
308. Paris, Mercredi 6 novembre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai dîné hier chez les Appony, plus tard j’ai été chez Madame de Boigne. Elle est maintenant fixée ici. Rien ne m’a paru plus ridicule que la demi-heure que j’y ai passé. Il y avait M. de Sainte Beuve (dis-je bien ?). Les premières deux minutes il causait à voix basse avec M. Rossi, lorsque le chancelier est entré. Madame de Boigne sans lui dire bonjour ni bonsoir lui montre M. de Sainte- Beuve, et lui dit qu'il soutient les Jansénistes, depuis cet instant je n’ai plus entendu que Pascal Arnaud, Nicole, avec un flux de phrases, de sentences d'un côté et de l’autre à tel point qu’il a été impossible de dire un mot ou d’avoir une idée. Un fond, j'avais bien envie de rire. C'était une véritable exhibition je crois que c’est comme cela que l’entendaient ces messieurs.
Broglie, Mercredi 26 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous écris sans plaisir. Cette journée m'ennuie. Je n'y peux rien mettre qui me plaise. Le Président perd beaucoup. Tout le monde le dit ; ce qui ne prouve pas grand chose, car le monde qui parle de cela n'est pas celui qui en décide. Personne ne connait les dispositions réelles des millions d'hommes, paysans et ouvriers, qui sont les rois du suffrage universel. Jamais il n’y a eu plus de raison de dire : " Mon Dieu, pardonne leur, car ils ne savent ce qu’ils font ! " Cela est rigoureusement vrai de tout le monde en France ; peuple et chefs du peuple pensent et agissent tout-à-fait à part les uns des autres, sans influer les uns sur les autres, sans se connaître les uns les autres. Il y a une chose merveilleuse ; c’est qu’ils ne fassent pas cent fois plus mal qu'ils ne font.
N'entendez-vous rien dire de Berlin ? Le Cabinet Braudenburg durera-t-il ? Quel est l’Arnim dont on parle pour lui succéder ? Est-ce notre ancien ami ? J'ai grand peur des fautes futures de Berlin et de Vienne. Dieu sait ce qui en sortirait. Est-ce que nous n'aurions que l’alternative des sottises ? Albert de Broglie, qui connait bien Rome ne comprend pas que la Légation de France ne s’entende pas avec le cardinal Antonelli, homme d’esprit dit-il, modéré, sensé, et avec qui M. Rossi était au mieux. Que faites. vous de M. de Bouténeff ? Est-il à Gaëte ou à Rome ? Je vous quitte pour aller faire le tour du Parc. Il y a de très beaux hêtres. Pas si beaux cependant que le grand chêne du Parc de Richmond.
Jeudi 27 sept. 9 heures
Voilà mes deux lettres. Excellentes. Mais je les aurais mieux aimées l’une après l’autre. Ils m'ont gâté ma journée d'hier. Je ne sais qui est ils. En tout cas, je lui donne ma malédiction. Ils pourraient bien avoir lu la lettre de dimanche, et lundi. Elle en valait la peine. Peu importe. S’ils sont capables de comprendre, Ils auront trouvé à apprendre. J’ai lu et relu la lettre de Lord Melbourne. Et je la ferai lire et relire. Il a cent fois raison. Mais voici cet autre problème que je le prie de résoudre : faire jouer une pièce sans acteurs. Il y a un public en France. Même un grand public, qui siffle ou applaudit. avec beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas d'acteurs. Le public ne souffre pas que personne sorte de ses rangs, monte sûr la scène et fasse son état des grands rôles. Il veut que tout le monde reste public. Notre mal est là. Certainement, il faut faire ce qui est nécessaire, et le faire sans s’embarrasser du testament des morts qui ont prétendu que les vivants devaient s’enterrer avec eux. Mais pour réussir en faisant ce qui est nécessaire, il faut deux choses : ne pas se tromper sur la nécessité, et que le public croyant aussi à la nécessité accepte ce qui a été fait en son nom. Le public français ne veut pas croire à la nécessité ! Elle le gêne. Il aime mieux ses fantaisies. Les Anglais sont un peuple politique ; ils agissent. Les Français sont un peuple critique ; ils frondent. J'en sais bien à peu près les raisons. Elles sont trop longues. Pour le moment, il n’y a plus en France qu’une idée, ou plutôt un sentiment qui ait autorité sur les masses et auquel elles soient disposées à obéir. C'est le sentiment de la légalité. Et la légalité, c’est le droit de la majorité à l'obéissance de la minorité. Là où sont la moitié plus un des mâles Français au dessus de vingt et un ans là est le droit ; le droit devant lequel tout le monde, à peu près, s’incline. hors de là, il y a que des prétentions, auxquelles chacun oppose les siennes propres. Voilà ce que disent les gens d’esprit qui se croyent obligés de dire cent subtilités et de prendre de longs détours pour arriver à peu près au même point où le bon sens résolument pratiqué, les conduirait beaucoup plus vite et plus sûrement. M. de Perigny n'est pas dégouté. Les Césars ! Qu'on m’en trouve. Par malheur, il ne suffit pas d'avoir un peu lu l’histoire pour la refaire, et de prononcer les noms pour ressembler aux hommes.
Je retourne demain au Val Richer. J'espère bien y avoir samedi ma lettre. Je l’espère parce que j’ai confiance en vous, car j'ai oublié de vous avertir à temps. Adieu, Adieu. Je vous écrirai le vendredi comme les autres jours. Adieu. G.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Elections (France), France (1848-1852, 2e République), histoire, Interculturalisme, Politique, Politique (France), Politique (Vatican), Réseau social et politique, Rossi, Pellegrino (1787-1848), Suffrage universel