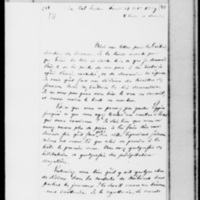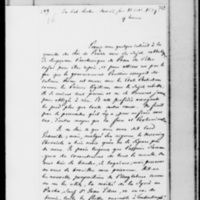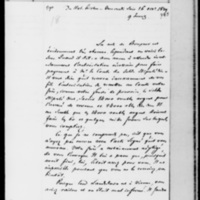Votre recherche dans le corpus : 263 résultats dans 6062 notices du site.Collection : 1839 : De la Chambre à l'Ambassade (1837-1839 : Vacances gouvernementales)
Trier par :
254. Val-Richer, Dimanche 25 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
254. Du Val Richer, Dimanche 25 août 1839
9 heures 1/2
Je n'ai que cinq minutes. Je reçois à la fois ce matin 248 et 249 de Baden et de Saverne. Rien ne m’était venu hier. Je ne vous ai pas écrit ne sachant rien. Je ne puis dire que je suis moins, inquiet. Il me faut votre arrivée à Paris. Enfin vous y serez aujourd’hui. Adieu. Adieu. Demain, je vous écrirai à l'aise, si jamais on écrit à l'aise. Adieu, comme à la Terrasse. G.
9 heures 1/2
Je n'ai que cinq minutes. Je reçois à la fois ce matin 248 et 249 de Baden et de Saverne. Rien ne m’était venu hier. Je ne vous ai pas écrit ne sachant rien. Je ne puis dire que je suis moins, inquiet. Il me faut votre arrivée à Paris. Enfin vous y serez aujourd’hui. Adieu. Adieu. Demain, je vous écrirai à l'aise, si jamais on écrit à l'aise. Adieu, comme à la Terrasse. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance
255. Val-Richer, Lundi 26 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
255. Du Val-Richer, Lundi 26 août 1839
7 heures
Vous voilà à Paris. Je me le dis comme si je le savais. Je veux me le dire. Je ne le saurai que demain. Demain, je serai heureux. Et quand je vous aurai vue ! Je ne puis partir tout de suite. Il m’arrive cette semaine trois personnes, entre autres M. Devaines qui viennent précisément de Paris passer quelques jours au Val-Richer. Je m’arrangerai pour y aller (à Paris) quand elles y retourneront. Il y aura plus de trois mois que nous ne nous serons vus !
Vous dîtes que vous êtes encore changée ! Ce qui m’est insupportable, c’est que sur votre santé, je ne me fie pas à vous, à vos impressions et à vos paroles. Vous avez tantôt des terreurs, tantôt des insouciances inouïes. Avec moi, cela n'a d'autre inconvénient que de m'agiter, avec d’autres, que vous appelez vos amis, il en résulte ce mal qu’ils sont incrédules à ce que vous sentez et dites de vous même de votre état intérieur. J’ai rencontré cette incrédulité et avec effroi. Vous vous reposerez à Paris.
Je suis bien fâché que les Granville n’y soient plus. Sont-ils partis pour longtemps ? Il n’y a rien de nouveau pour eux en Angleterre. Le Cabinet n’est pas en péril. Ce sera vous maintenant qui me donnerez des nouvelles. On me tient assez au courant, mais pas de votre monde. Pahlen doit être bientôt de retour. Il vous reviendra sûrement aussi fidèle. M. de Pahlen doit être toujours fidèle, quand il est près et oublier beaucoup dès qu'il est loin. Vous aurez le pauvre Pozzo. Pour celui-là, tout déchu qu’il est, je vous répondrai toujours plus de son esprit que de sa fidélité. Ramenez-vous Marie ? Je crois que non. Pourtant vous ne m’avez jamais rien dit de positif.
Vous me direz si vous voulez que je prie ma mère de vous chercher sérieusement quelqu'un.
9 h.1/2
Je respire. Vous n’êtes donc pas malade. Vous êtes venue bien vite. Je n'attendais ce matin qu'une lettre de la route. Vraiment, vous êtes à Paris, et pas malade, et votre médecin ne vous trouve pas si mal que vous l’imaginez. Mais comment avez-vous fait pour maigrir ? Ce n’est peut-être pas vrai, par autant que vous l’imaginez. Trompez vous donc, je vous prie. Et reposez-vous. Il se pourrait bien que les bains de mer vous fussent bons. Laissez-moi y penser un moment avant de choisir entre Paris et Dieppe. Aurez-vous quelqu’un à Dieppe. Et puis, il ne fait pas chaud. Il fera moins chaud tous les jours. Les bains de mer ont besoin de chaleur. Enfin, nous verrons. Vous êtes arrivée.
Adieu. Adieu. Adieu. Je n’en finirais pas. G.
7 heures
Vous voilà à Paris. Je me le dis comme si je le savais. Je veux me le dire. Je ne le saurai que demain. Demain, je serai heureux. Et quand je vous aurai vue ! Je ne puis partir tout de suite. Il m’arrive cette semaine trois personnes, entre autres M. Devaines qui viennent précisément de Paris passer quelques jours au Val-Richer. Je m’arrangerai pour y aller (à Paris) quand elles y retourneront. Il y aura plus de trois mois que nous ne nous serons vus !
Vous dîtes que vous êtes encore changée ! Ce qui m’est insupportable, c’est que sur votre santé, je ne me fie pas à vous, à vos impressions et à vos paroles. Vous avez tantôt des terreurs, tantôt des insouciances inouïes. Avec moi, cela n'a d'autre inconvénient que de m'agiter, avec d’autres, que vous appelez vos amis, il en résulte ce mal qu’ils sont incrédules à ce que vous sentez et dites de vous même de votre état intérieur. J’ai rencontré cette incrédulité et avec effroi. Vous vous reposerez à Paris.
Je suis bien fâché que les Granville n’y soient plus. Sont-ils partis pour longtemps ? Il n’y a rien de nouveau pour eux en Angleterre. Le Cabinet n’est pas en péril. Ce sera vous maintenant qui me donnerez des nouvelles. On me tient assez au courant, mais pas de votre monde. Pahlen doit être bientôt de retour. Il vous reviendra sûrement aussi fidèle. M. de Pahlen doit être toujours fidèle, quand il est près et oublier beaucoup dès qu'il est loin. Vous aurez le pauvre Pozzo. Pour celui-là, tout déchu qu’il est, je vous répondrai toujours plus de son esprit que de sa fidélité. Ramenez-vous Marie ? Je crois que non. Pourtant vous ne m’avez jamais rien dit de positif.
Vous me direz si vous voulez que je prie ma mère de vous chercher sérieusement quelqu'un.
9 h.1/2
Je respire. Vous n’êtes donc pas malade. Vous êtes venue bien vite. Je n'attendais ce matin qu'une lettre de la route. Vraiment, vous êtes à Paris, et pas malade, et votre médecin ne vous trouve pas si mal que vous l’imaginez. Mais comment avez-vous fait pour maigrir ? Ce n’est peut-être pas vrai, par autant que vous l’imaginez. Trompez vous donc, je vous prie. Et reposez-vous. Il se pourrait bien que les bains de mer vous fussent bons. Laissez-moi y penser un moment avant de choisir entre Paris et Dieppe. Aurez-vous quelqu’un à Dieppe. Et puis, il ne fait pas chaud. Il fera moins chaud tous les jours. Les bains de mer ont besoin de chaleur. Enfin, nous verrons. Vous êtes arrivée.
Adieu. Adieu. Adieu. Je n’en finirais pas. G.
256. Val -Richer, Lundi 26 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
256 Du Val-Richer Lundi soir 26 août 1839 9 heures
Voyons un peu nos affaires. Je ne saurais fixer aujourd’hui le jour où je pourrai aller vous voir. J'attends après-demain M. Devaines, son fils et une autre personne. Il faut que je les aie vus pour régler ma marche. Quel ennui que tous ces arrangements quand je n'ai d'autre envie que d'être près de vous, de vos voir, de vous entendre, de vous parler, de vous retrouver vous, changée ou non, et mon bonheur qui ne peut changer. Mais répétez-moi en attendant que le Dr Chemside ne vous trouve pas aussi changée que vous l’imaginez. Si vous allez, ou si vous pouvez aller à Dieppe, il est probable que je l'aimerai mieux que Paris. Sauf vous, je n'irais pas à Paris en ce moment. Il n’y a rien à faire, et on dira que j’y viens faire quelque chose. Mon absence, ma parfaite tranquillité sont d’un bon effet; je le sais, les gens d'esprit me le disent. Cela ne signifie rien si je ne puis vous voir qu'à Paris, et au fait cela ne signifie pas grand chose ; peu importe quelques lignes de journaux et quelques conversations de badauds. Mais toutes choses égales d'ailleurs, je crois que je préférerai Dieppe, ne fût-ce que pour ce que vous m'en dites. Dieppe ou Boulogne, cela se ressemble, n’est-ce pas ? D'ici là reposez-vous bien. Il faut être bien reposée.
Vous trouvez l'Orient en voie de pacification. Nous sommes tous d'accord, d'accord du moins de nous mettre d'accord et d’en traiter ensemble. Nous avons failli faire tout le contraire. Nous avons dit que si vous alliez à Constantinople, nous irions dans la mer de Marmara ; et que de façon ou d'autre, nous serions tous où vous seriez. Vous avez pensé que puisqu’il fallait se résigner à être tous ensemble mieux valait l'être sans embarras qu'avec embarras. Nous sommes contents. Les difficultés commencent mais nous croyons les périls passés.
J’attends des nouvelles de mon pauvre ami Baudraud. Il est malade et ne pourra probablement pas aller à Constantinople. Nous nous sommes beaucoup écrit. Mais que de choses nous aurons à nous dire !
Mardi matin 7 heures
Le plaisir de vous sentir plus près de moi ne s’use pas. Qu’on devient modeste dans ses prétentions ! J’ai appris hier que je n'aurais pas ici, dans le mois de septembre, deux personnes qui auraient pu y venir. M. & Mad. de Rémusat. Ils étaient dans leur terre, près de Toulouse, quand ils ont appris que leur fils aîné, qui a tout juste l’âge d’Henriette, était malade, très malade dans son Collège, d’une fluxion de poitrine mêlée d’accès de fièvre typhoïde. Ils sont accourus à Paris la mort dans l'âme. Ils ont trouvé leur fils hors de danger et à présent il va très bien. Quand je les ai sus à Paris, je les ai engagés à venir passer quelques jours ici avec l'enfant rétabli qui aurait sans doute besoin de la campagne. Ils font mieux que cela ; ils l’emmènent en Languedoc, où ils retournent jusqu'à la session. M. de Rémusat veut se trouver à Toulouse au passage de M. le Duc d'Orléans.
Il y a vraiment quelque tentative d'accommodement en Espagne. La situation de D. Carlos devient toujours plus mauvaise. Celle de la reine Christine pas meilleure. Marote a été assez féroce pour avoir le droit d'être un peu complaisant. Les oscaltados qui reviennent en majorité dans les Cortes témoignent quelque envie d’essayer de la faiblesse après la folie. L’Angleterre s’ennuie d’entretenir, un désordre d’où elle n’a pas même pu tiré un traité de commerce. On essaiera peut-être là aussi d’une conférence.
9 heures
Au nom de Dieu, que vos nerfs se reposent ! Je ne puis vous dire le chagrin qu'ils me font. Que sert de vous le dire ? C'est ma prétention de n'avoir plus besoin de vous dire combien je vous aime. Ai-je tort ? Plaisir oui, grand plaisir. Besoin non, plus du tout. Rouen vaudra certainement mieux que Dieppe. C'est plus près. Mais vous ne pouvez pas prendre de bains de mer à Rouen. J’apprends à l’instant même que M. de Metternich est fort malade, dangereusement me dit-on, vous le savez sans doute. Cela n'aiderait pas aux affaires d'Orient. Adieu Adieu. G.
Voyons un peu nos affaires. Je ne saurais fixer aujourd’hui le jour où je pourrai aller vous voir. J'attends après-demain M. Devaines, son fils et une autre personne. Il faut que je les aie vus pour régler ma marche. Quel ennui que tous ces arrangements quand je n'ai d'autre envie que d'être près de vous, de vos voir, de vous entendre, de vous parler, de vous retrouver vous, changée ou non, et mon bonheur qui ne peut changer. Mais répétez-moi en attendant que le Dr Chemside ne vous trouve pas aussi changée que vous l’imaginez. Si vous allez, ou si vous pouvez aller à Dieppe, il est probable que je l'aimerai mieux que Paris. Sauf vous, je n'irais pas à Paris en ce moment. Il n’y a rien à faire, et on dira que j’y viens faire quelque chose. Mon absence, ma parfaite tranquillité sont d’un bon effet; je le sais, les gens d'esprit me le disent. Cela ne signifie rien si je ne puis vous voir qu'à Paris, et au fait cela ne signifie pas grand chose ; peu importe quelques lignes de journaux et quelques conversations de badauds. Mais toutes choses égales d'ailleurs, je crois que je préférerai Dieppe, ne fût-ce que pour ce que vous m'en dites. Dieppe ou Boulogne, cela se ressemble, n’est-ce pas ? D'ici là reposez-vous bien. Il faut être bien reposée.
Vous trouvez l'Orient en voie de pacification. Nous sommes tous d'accord, d'accord du moins de nous mettre d'accord et d’en traiter ensemble. Nous avons failli faire tout le contraire. Nous avons dit que si vous alliez à Constantinople, nous irions dans la mer de Marmara ; et que de façon ou d'autre, nous serions tous où vous seriez. Vous avez pensé que puisqu’il fallait se résigner à être tous ensemble mieux valait l'être sans embarras qu'avec embarras. Nous sommes contents. Les difficultés commencent mais nous croyons les périls passés.
J’attends des nouvelles de mon pauvre ami Baudraud. Il est malade et ne pourra probablement pas aller à Constantinople. Nous nous sommes beaucoup écrit. Mais que de choses nous aurons à nous dire !
Mardi matin 7 heures
Le plaisir de vous sentir plus près de moi ne s’use pas. Qu’on devient modeste dans ses prétentions ! J’ai appris hier que je n'aurais pas ici, dans le mois de septembre, deux personnes qui auraient pu y venir. M. & Mad. de Rémusat. Ils étaient dans leur terre, près de Toulouse, quand ils ont appris que leur fils aîné, qui a tout juste l’âge d’Henriette, était malade, très malade dans son Collège, d’une fluxion de poitrine mêlée d’accès de fièvre typhoïde. Ils sont accourus à Paris la mort dans l'âme. Ils ont trouvé leur fils hors de danger et à présent il va très bien. Quand je les ai sus à Paris, je les ai engagés à venir passer quelques jours ici avec l'enfant rétabli qui aurait sans doute besoin de la campagne. Ils font mieux que cela ; ils l’emmènent en Languedoc, où ils retournent jusqu'à la session. M. de Rémusat veut se trouver à Toulouse au passage de M. le Duc d'Orléans.
Il y a vraiment quelque tentative d'accommodement en Espagne. La situation de D. Carlos devient toujours plus mauvaise. Celle de la reine Christine pas meilleure. Marote a été assez féroce pour avoir le droit d'être un peu complaisant. Les oscaltados qui reviennent en majorité dans les Cortes témoignent quelque envie d’essayer de la faiblesse après la folie. L’Angleterre s’ennuie d’entretenir, un désordre d’où elle n’a pas même pu tiré un traité de commerce. On essaiera peut-être là aussi d’une conférence.
9 heures
Au nom de Dieu, que vos nerfs se reposent ! Je ne puis vous dire le chagrin qu'ils me font. Que sert de vous le dire ? C'est ma prétention de n'avoir plus besoin de vous dire combien je vous aime. Ai-je tort ? Plaisir oui, grand plaisir. Besoin non, plus du tout. Rouen vaudra certainement mieux que Dieppe. C'est plus près. Mais vous ne pouvez pas prendre de bains de mer à Rouen. J’apprends à l’instant même que M. de Metternich est fort malade, dangereusement me dit-on, vous le savez sans doute. Cela n'aiderait pas aux affaires d'Orient. Adieu Adieu. G.
257. Val -Richer, Mardi 27 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
257 Mardi soir 27 août Du Val-Richer. 1839-10 heures
Je rentre dans mon Cabinet. Si j’étais à Paris, je serais chez vous. Vous m'avez gâté la solitude. Moi qui me passe si bien de tant de choses et de gens, je ne sais pas me passer de vous. J'ai bien raison. Je compte toujours que M. Devaines et son fils arriveront après demain. Nous réglerons alors notre moment. Rouen me convient à merveille. Mais vous serez là bien en l’air, dans une auberge, sans établissement. Je ne sais qui vous trouveriez à Dieppe. La saison n'est pas bonne pour les bains de mer. J'en ai tout près d’ici à Trouville, d'où l’on s'en va à cause du froid. Je ne veux pas que vous risquiez rien, rien du tout, entendez bien ceci. J’attends aussi des nouvelles du Duc de Broglie qui est à Evreux, à son Conseil Général. Il viendra me voir, et j'irai le voir en passant. Evreux est sur ma route. Il n’a vu personne du tout en passant à Paris. Les Ministres en ont été un peu étonnés.
Génie, je ne sais pourquoi ne m’a pas encore répondu sur le petit hôtel de la rue Lascazes. Il est peut-être loué (l'hôtel) Sinon voulez-vous que je fasse dire à Génie d’aller vous voir, et de vous le décrire. Mais vous aimerez mieux y aller vous- même. A quelle heure vous promenez- vous ? Je ne saurais vous dire avec quel triste dépit je pense que j’ai passé un mois à Paris sans vous, et que vous allez y passer tant de temps sans moi. Zéa y est encore. Faites-lui dire de venir vous voir. Mais pouvez-vous crier assez fort ? La dernière fois que je l'ai vu il était plus sourd que jamais et il ne voulait pas laisser dire un mot à son frère Colombe qu’il m’avait amené.
Mercredi matin, 6 heures
Dormez-vous ? Que je serais heureux si j'y pouvais voir ! La romance a beau traîner dans les rues ; elle est charmante. C’est une chose charmante de veiller auprès d’une personne, de la personne chérie. Pourvu qu’elle ne soit par malade. Quel supplice ! Je doute qu'on ait bien emmanché l'affaire d'Orient en demandent tout-à-coup, et pour le début, ou Pacha de rendre la folle. C'est une satisfaction d’amour-propre qu'on se donne, mais qui aggrave la difficulté au lieu de la résoudre. Le Pacha rendra la flotte quand on se sera arrangé avec lui ; mais céder ainsi d'avance, sur une première sommation, c’est beaucoup. Pourquoi placer la grosse question sur une si petite circonstance, et avant de l’avoir déballé, et sans donner du temps au Pacha ? Je suis obligé de penser ce que je pense en effet sans le dire. L’esprit manque. Encore une fois, que de choses j'ai à vous dire ! J’y touche ; je vous les dirai bientôt ; mais que le doux moment est loin quand on en approche ?
9 h. 1/2
Certainement, j'irai à Rouen et de là à Dieppe ; mais j'ai besoin que vous me donniez au moins un jour de plus et que vous ne partiez pour Rouen que lundi. Il me faut cette latitude pour mes hôtes. Dites- moi tout de suite quel jour vous serez à Rouen. Vous ne me dites rien de la maladie du Prince de Metternich. J'en conclus qu’elle n'est pas aussi grave qu'on me l'a dit. Politique à part, je le désire. Je ne vous veux pas une impression triste de plus, et celle là serait fort naturelle. Adieu. Adieu. Vous dites qu'il ne vous fatigue pas encore. Ce n'est pas assez. Adieu. G.
Je rentre dans mon Cabinet. Si j’étais à Paris, je serais chez vous. Vous m'avez gâté la solitude. Moi qui me passe si bien de tant de choses et de gens, je ne sais pas me passer de vous. J'ai bien raison. Je compte toujours que M. Devaines et son fils arriveront après demain. Nous réglerons alors notre moment. Rouen me convient à merveille. Mais vous serez là bien en l’air, dans une auberge, sans établissement. Je ne sais qui vous trouveriez à Dieppe. La saison n'est pas bonne pour les bains de mer. J'en ai tout près d’ici à Trouville, d'où l’on s'en va à cause du froid. Je ne veux pas que vous risquiez rien, rien du tout, entendez bien ceci. J’attends aussi des nouvelles du Duc de Broglie qui est à Evreux, à son Conseil Général. Il viendra me voir, et j'irai le voir en passant. Evreux est sur ma route. Il n’a vu personne du tout en passant à Paris. Les Ministres en ont été un peu étonnés.
Génie, je ne sais pourquoi ne m’a pas encore répondu sur le petit hôtel de la rue Lascazes. Il est peut-être loué (l'hôtel) Sinon voulez-vous que je fasse dire à Génie d’aller vous voir, et de vous le décrire. Mais vous aimerez mieux y aller vous- même. A quelle heure vous promenez- vous ? Je ne saurais vous dire avec quel triste dépit je pense que j’ai passé un mois à Paris sans vous, et que vous allez y passer tant de temps sans moi. Zéa y est encore. Faites-lui dire de venir vous voir. Mais pouvez-vous crier assez fort ? La dernière fois que je l'ai vu il était plus sourd que jamais et il ne voulait pas laisser dire un mot à son frère Colombe qu’il m’avait amené.
Mercredi matin, 6 heures
Dormez-vous ? Que je serais heureux si j'y pouvais voir ! La romance a beau traîner dans les rues ; elle est charmante. C’est une chose charmante de veiller auprès d’une personne, de la personne chérie. Pourvu qu’elle ne soit par malade. Quel supplice ! Je doute qu'on ait bien emmanché l'affaire d'Orient en demandent tout-à-coup, et pour le début, ou Pacha de rendre la folle. C'est une satisfaction d’amour-propre qu'on se donne, mais qui aggrave la difficulté au lieu de la résoudre. Le Pacha rendra la flotte quand on se sera arrangé avec lui ; mais céder ainsi d'avance, sur une première sommation, c’est beaucoup. Pourquoi placer la grosse question sur une si petite circonstance, et avant de l’avoir déballé, et sans donner du temps au Pacha ? Je suis obligé de penser ce que je pense en effet sans le dire. L’esprit manque. Encore une fois, que de choses j'ai à vous dire ! J’y touche ; je vous les dirai bientôt ; mais que le doux moment est loin quand on en approche ?
9 h. 1/2
Certainement, j'irai à Rouen et de là à Dieppe ; mais j'ai besoin que vous me donniez au moins un jour de plus et que vous ne partiez pour Rouen que lundi. Il me faut cette latitude pour mes hôtes. Dites- moi tout de suite quel jour vous serez à Rouen. Vous ne me dites rien de la maladie du Prince de Metternich. J'en conclus qu’elle n'est pas aussi grave qu'on me l'a dit. Politique à part, je le désire. Je ne vous veux pas une impression triste de plus, et celle là serait fort naturelle. Adieu. Adieu. Vous dites qu'il ne vous fatigue pas encore. Ce n'est pas assez. Adieu. G.
258. Val -Richer, Jeudi 29 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
258 Jeudi 29 août 7 heures, du Val Richer,
J'ai ri en lisant votre lettre. Est-ce que nous aurions moins d’esprit que nous ne croyons ? Vous défendez presque les gasconnades d’une politique. Est- ce que j'aurais défendu celles de l'autre ? Vous voyez bien que tout le monde veut la paix et veut avoir l'air d'être tout prêt à la guerre. Ce n’est pas là une de ces choses dont Pascal dit : " Erreur au delà des Pyrénées, vérité en deçà. " C’est vérité partout. Il n’y a que les journalistes et les badauds qui en jugent autrement.
Quand le monde sera-t-il assez sensé pour réduire un peu dans la politique, la part de la comédie ? Vous verrez que si vous tenez bon et nous aussi, on trouvera pour la conférence un moyen terme entre Vienne et Constantinople, et nous ne tiendrons bon, ni vous non plus, que dans cette confiance là. Je ne crois pas que ce soit l'Angleterre qui nous ait fait parler par note de le mer de Marmara. Nous l'avons fait pour pouvoir le dire. Nous causerons de tout cela à Dieppe. Baudrand n'est point malade. L’Angleterre n'envoie personne à Constantinople pour complimenter le Sultan. Voilà pourquoi Baudrand n’y va pas. Il me semble qu’on a tort, vous envoyez. L’Angleterre n'envoie pas. J’enverrais ! Que fait l’Autriche ? Voici ce qu’on m'écrit de Syra, après trois mois de séjour dans l'Asie mineure et à Constantinople, au milieu des scènes mêmes. " Je suis loin de croire que l'Empire Ottoman ne soit plus qu’un cadavre. Il est bien mal, mais il lui faut si peu de chose pour vivre ! C’est un peuple qui s'accommode du mal comme du bien parce qu'il n’en perçoit pas nettement la différence. Ce qui m’a le plus frappé, c'est l’insouciance, l’apathie. Point d'industrie, ni commerce, ni culture, ni quoi que ce soit qui annonce la vie. La dépopulation est effrayante, Dans certains districts, où l'on comptait, il y a quinze ans 300 000 âmes, on n'en compte plus que 13 000.
9 h. 1/2
Je reçois une lettre du Duc de Broglie, qui est à Evreux, présidant son Conseil général, et qui me demande d’aller l’y voir. J’irai dimanche ou lundi, et je serai le lendemain à Paris. C’est le plus court moyen de vous voir. Là nous causerons de vos projets ultérieurs. Ainsi, lundi ou Mardi. Ce sera charmant. Ce qui l’est déjà, c’est que vous ne soyez pas si faible. Reposez-vous en effet quelques jours, plusieurs jours. Vous en avez grand besoin.
Génie m’écrit aujourd’hui même, et me parle de plusieurs appartements d’hôtel de la rue Lascazes est loué à Mad. de Lorges. Dans les propositions, il y en a une qui ne me paraît pas sans mérite. Je vous en parlerai demain, en attendant mieux. Adieu. Adieu. G.
J'ai ri en lisant votre lettre. Est-ce que nous aurions moins d’esprit que nous ne croyons ? Vous défendez presque les gasconnades d’une politique. Est- ce que j'aurais défendu celles de l'autre ? Vous voyez bien que tout le monde veut la paix et veut avoir l'air d'être tout prêt à la guerre. Ce n’est pas là une de ces choses dont Pascal dit : " Erreur au delà des Pyrénées, vérité en deçà. " C’est vérité partout. Il n’y a que les journalistes et les badauds qui en jugent autrement.
Quand le monde sera-t-il assez sensé pour réduire un peu dans la politique, la part de la comédie ? Vous verrez que si vous tenez bon et nous aussi, on trouvera pour la conférence un moyen terme entre Vienne et Constantinople, et nous ne tiendrons bon, ni vous non plus, que dans cette confiance là. Je ne crois pas que ce soit l'Angleterre qui nous ait fait parler par note de le mer de Marmara. Nous l'avons fait pour pouvoir le dire. Nous causerons de tout cela à Dieppe. Baudrand n'est point malade. L’Angleterre n'envoie personne à Constantinople pour complimenter le Sultan. Voilà pourquoi Baudrand n’y va pas. Il me semble qu’on a tort, vous envoyez. L’Angleterre n'envoie pas. J’enverrais ! Que fait l’Autriche ? Voici ce qu’on m'écrit de Syra, après trois mois de séjour dans l'Asie mineure et à Constantinople, au milieu des scènes mêmes. " Je suis loin de croire que l'Empire Ottoman ne soit plus qu’un cadavre. Il est bien mal, mais il lui faut si peu de chose pour vivre ! C’est un peuple qui s'accommode du mal comme du bien parce qu'il n’en perçoit pas nettement la différence. Ce qui m’a le plus frappé, c'est l’insouciance, l’apathie. Point d'industrie, ni commerce, ni culture, ni quoi que ce soit qui annonce la vie. La dépopulation est effrayante, Dans certains districts, où l'on comptait, il y a quinze ans 300 000 âmes, on n'en compte plus que 13 000.
9 h. 1/2
Je reçois une lettre du Duc de Broglie, qui est à Evreux, présidant son Conseil général, et qui me demande d’aller l’y voir. J’irai dimanche ou lundi, et je serai le lendemain à Paris. C’est le plus court moyen de vous voir. Là nous causerons de vos projets ultérieurs. Ainsi, lundi ou Mardi. Ce sera charmant. Ce qui l’est déjà, c’est que vous ne soyez pas si faible. Reposez-vous en effet quelques jours, plusieurs jours. Vous en avez grand besoin.
Génie m’écrit aujourd’hui même, et me parle de plusieurs appartements d’hôtel de la rue Lascazes est loué à Mad. de Lorges. Dans les propositions, il y en a une qui ne me paraît pas sans mérite. Je vous en parlerai demain, en attendant mieux. Adieu. Adieu. G.
259. Val -Richer,Vendredi 30 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
259 Du Val-Richer, vendredi 29 août 1839, 7 heures
Raisonnablement, j’aime mieux que vous restiez à Paris. Cela est plus commode. Je regretterai pourtant la solitude de Dieppe. Il n'y a pas moyen d'accorder tous ses désirs. Mon projet est d’aller dîner lundi à Evreux avec le Duc de Broglie. J'en repartirai dans la nuit et je serai à Paris mardi matin. J'espère que cela ne contrariera pas vos arrangements. Nous chercherons ensemble une maison. Génie m'en indique trois qu’il a visitées. Deux ne me paraissent rien valoir. L’une rue de Grenelle très près de Mad. de Talleyrand en face du passage Ste Marie, dans une maison de Mad. de La Rochejacquelein au rez-de-chaussée avec un jardin, 6000 fr. La vieille Duchesse de La Force demeure au premier. L'autre, rue de Varennes, près de la rue du Bac. C’est un hôtel [?], beaucoup trop loin. 11 000 francs. La troisième me semble meilleure, rue St Dominique entre la rue Belle-Chasse et l’hôtel du Consul d'Etat, presque en face des Brignole. Elle appartient au comte de Schulenbourg. 10 000 francs. Une belle cour des communs assez bien disposée. Un rez-de-chaussée seulement. Deux salons une salle à manger, une salle de billard, quatre chambres à coucher, des dépendances suffisantes. Un petit jardin de forme irrégulière et pas gracieuse resseré entre le Jardin du Conseit d'Etat et celui de Pozzo. Voici l'objection. C’est au Nord. Mais vous devriez le voir.
Le Pacha a bien raison de refuser. Vous voyez que déjà on n'avoue pas la proposition. Si j'étais de ses amis, je lui conseillerais ce qu’il a imaginé lui-même maintenir et attendre. L’Angleterre a une bien petite politique.
9 h. 1/2 Je vais décidément dîner à Evreux lundi. Si vous deviez être mardi à Rouen, ou à Dieppe, j’irais d’Evreux vous chercher là. Mais si vous êtes encore à Paris mardi j’y serai, moi, dans la journée de mardi et là nous verrons. Cela me paraît l’arrangement le moins compliqué. En tout cas je recevrai encore votre réponse à ceci, et même à ce que je vous écrivais demain car je ne passerai Lundi matin, à Lisieux qu’après l’arrivée de la poste. Adieu. Adieu. Il y a mille à parier contre un, contre la guerre.
Raisonnablement, j’aime mieux que vous restiez à Paris. Cela est plus commode. Je regretterai pourtant la solitude de Dieppe. Il n'y a pas moyen d'accorder tous ses désirs. Mon projet est d’aller dîner lundi à Evreux avec le Duc de Broglie. J'en repartirai dans la nuit et je serai à Paris mardi matin. J'espère que cela ne contrariera pas vos arrangements. Nous chercherons ensemble une maison. Génie m'en indique trois qu’il a visitées. Deux ne me paraissent rien valoir. L’une rue de Grenelle très près de Mad. de Talleyrand en face du passage Ste Marie, dans une maison de Mad. de La Rochejacquelein au rez-de-chaussée avec un jardin, 6000 fr. La vieille Duchesse de La Force demeure au premier. L'autre, rue de Varennes, près de la rue du Bac. C’est un hôtel [?], beaucoup trop loin. 11 000 francs. La troisième me semble meilleure, rue St Dominique entre la rue Belle-Chasse et l’hôtel du Consul d'Etat, presque en face des Brignole. Elle appartient au comte de Schulenbourg. 10 000 francs. Une belle cour des communs assez bien disposée. Un rez-de-chaussée seulement. Deux salons une salle à manger, une salle de billard, quatre chambres à coucher, des dépendances suffisantes. Un petit jardin de forme irrégulière et pas gracieuse resseré entre le Jardin du Conseit d'Etat et celui de Pozzo. Voici l'objection. C’est au Nord. Mais vous devriez le voir.
Le Pacha a bien raison de refuser. Vous voyez que déjà on n'avoue pas la proposition. Si j'étais de ses amis, je lui conseillerais ce qu’il a imaginé lui-même maintenir et attendre. L’Angleterre a une bien petite politique.
9 h. 1/2 Je vais décidément dîner à Evreux lundi. Si vous deviez être mardi à Rouen, ou à Dieppe, j’irais d’Evreux vous chercher là. Mais si vous êtes encore à Paris mardi j’y serai, moi, dans la journée de mardi et là nous verrons. Cela me paraît l’arrangement le moins compliqué. En tout cas je recevrai encore votre réponse à ceci, et même à ce que je vous écrivais demain car je ne passerai Lundi matin, à Lisieux qu’après l’arrivée de la poste. Adieu. Adieu. Il y a mille à parier contre un, contre la guerre.
260. Val-Richer, Samedi 31 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
260 Du Val-Richer, Samedi 31 août 1839 6 heures
Mes nouveaux hôtes me sont arrivés hier. Je les quitterai Lundi matin pour aller dîner à Evreux. De là, je puis faire, dans la journée de mardi ce que vous préférerez, aller vous retrouver à Paris au à Rouen. Mais il faudrait que vous fussiez mardi à Rouen. Voyez ce qui vous convient décidément et dites-le moi en réponse à cette lettre. Je prendrai la vôtre Lundi matin en passant à Lisieux. Si vous préférez Rouen, dites-moi où vous descendrez, car nous pourrions passer plus d’une heure à nous chercher dans cette grande et obscure ville. Il y a sur le port un grand hôtel, fort accrédité qui s’appelle je crois hôtel de France ou de l’Europe. Vous pourriez y descendre. Nous irions de là à Dieppe. Si vous restez à Paris, je serai à La Terrasse mardi dans la journée. Je ne sais pas bien à quelle heure. Il fait très beau depuis deux jours. Paris ou Rouen, je prie pour le soleil. Vous en avez besoin et j'y prends plaisir.
J’entends bien que vous ne voudrez pas la paix à tout prix. Mais il faudrait que vous voulussiez la guerre à tout prix pour qu'elle arrivât. Vous en êtes loin. Je persiste donc, grâce à Dieu. Pourtant Dieu en sait plus que nous et s’il lui plaisait de brouiller, les choses à un certain point, toute notre bonne volonté ne les débrouillerait pas. Ce n'est ni la prévoyance, ni le désir des hommes qui réglera cet avenir-là. C’est le sort commun de l'avenir. On peut y être prêt, et c'est le comble de la sagesse humaine. On ne le fait guère.
9 h. 1/2
Vous voyez que je suis à votre disposition pour Rouen ou pour Paris. Tout à fait à votre disposition. Décidez comme vous préféreriez. Il m’est tout aussi aisé tout aussi agréable d’aller mardi d’Evreux à Rouen que d’Evreux à Paris. Pensez de plus que je n'arriverai à Paris que mardi dans la journée et qu’il m'est impossible de n’y pas rester 48 heures. Enfin, as you please. Pour moi, Rouen et Dieppe me plaisent. Adieu. Adieu.
Mes nouveaux hôtes me sont arrivés hier. Je les quitterai Lundi matin pour aller dîner à Evreux. De là, je puis faire, dans la journée de mardi ce que vous préférerez, aller vous retrouver à Paris au à Rouen. Mais il faudrait que vous fussiez mardi à Rouen. Voyez ce qui vous convient décidément et dites-le moi en réponse à cette lettre. Je prendrai la vôtre Lundi matin en passant à Lisieux. Si vous préférez Rouen, dites-moi où vous descendrez, car nous pourrions passer plus d’une heure à nous chercher dans cette grande et obscure ville. Il y a sur le port un grand hôtel, fort accrédité qui s’appelle je crois hôtel de France ou de l’Europe. Vous pourriez y descendre. Nous irions de là à Dieppe. Si vous restez à Paris, je serai à La Terrasse mardi dans la journée. Je ne sais pas bien à quelle heure. Il fait très beau depuis deux jours. Paris ou Rouen, je prie pour le soleil. Vous en avez besoin et j'y prends plaisir.
J’entends bien que vous ne voudrez pas la paix à tout prix. Mais il faudrait que vous voulussiez la guerre à tout prix pour qu'elle arrivât. Vous en êtes loin. Je persiste donc, grâce à Dieu. Pourtant Dieu en sait plus que nous et s’il lui plaisait de brouiller, les choses à un certain point, toute notre bonne volonté ne les débrouillerait pas. Ce n'est ni la prévoyance, ni le désir des hommes qui réglera cet avenir-là. C’est le sort commun de l'avenir. On peut y être prêt, et c'est le comble de la sagesse humaine. On ne le fait guère.
9 h. 1/2
Vous voyez que je suis à votre disposition pour Rouen ou pour Paris. Tout à fait à votre disposition. Décidez comme vous préféreriez. Il m’est tout aussi aisé tout aussi agréable d’aller mardi d’Evreux à Rouen que d’Evreux à Paris. Pensez de plus que je n'arriverai à Paris que mardi dans la journée et qu’il m'est impossible de n’y pas rester 48 heures. Enfin, as you please. Pour moi, Rouen et Dieppe me plaisent. Adieu. Adieu.
261. Val -Richer, Dimanche 1er septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
261 Du Val-Richer Dim. 11 sept 1839 9 heures 1/2
A mardi donc ; à Paris à moins que vous ne me disiez demain le contraire, ce que je ne présume pas. Nous verrons les maisons ensemble. Je ne vois pas d'objection au N°61 de la rue de Lille, s’il vous convient d'ailleurs. Qu'il y a de temps que nous n'avons rien vu ensemble. Je ne vous parle pas d'autre chose. J'ai deux ou trois billets à écrire. Adieu. Adieu. Je ne sais dire que : Adieu et à mardi. G.
A mardi donc ; à Paris à moins que vous ne me disiez demain le contraire, ce que je ne présume pas. Nous verrons les maisons ensemble. Je ne vois pas d'objection au N°61 de la rue de Lille, s’il vous convient d'ailleurs. Qu'il y a de temps que nous n'avons rien vu ensemble. Je ne vous parle pas d'autre chose. J'ai deux ou trois billets à écrire. Adieu. Adieu. Je ne sais dire que : Adieu et à mardi. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée
262. Val-Richer, Mercredi 11 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
262 Du Val-Richer, Mercredi 11 septembre 1839 9 heures
Vous avez embaumé mon voyage. Le parfum de cette charmante minute dure encore. J’aurais voulu que Génie allât vous voir ce matin. Il ne le pouvait pas. Il avait des rapports à faire à sa cour, ce qui l'oblige à s'y rendre de bonne heure. Je vous le répète ; chargez-le de tout ce qui vous embarrassera ou vous ennuiera. Je réponds qu’il le fera bien et avec plaisir. Je suis arrivé il y a deux heures. J’ai trouvé mes enfants, à merveille, ma mère toujours un peu chancelante.
Il fait un temps admirable. Ce matin, à 5 heures, un brouillard affreux. Le brouillard et le soleil, la tristesse et la joie se touchent, se mêlent presque. Les contrastes de la vie ont bien de la peine à se concilier dans notre cœur. Je n’y prétends pas. Si vous pouviez voir au fond, cela me suffirait, et je suis sûr que cela vous ferait du bien. C’est un si grand repos qu’une sécurité parfaite, même de loin. Vous m’êtes nécessaire, nécessaire comme je le suis pour vous. Mais je suis nécessaire en deux endroits. Que j'aurais à vous dire ! Je ne vous ai rien dit. Adieu. Je n’ai pas dormi cette nuit. Je dormirai peut-être une heure dans la journée.
Adieu Adieu. Non pas farewell for ever, mais ever and ever farewell. G.
Vous avez embaumé mon voyage. Le parfum de cette charmante minute dure encore. J’aurais voulu que Génie allât vous voir ce matin. Il ne le pouvait pas. Il avait des rapports à faire à sa cour, ce qui l'oblige à s'y rendre de bonne heure. Je vous le répète ; chargez-le de tout ce qui vous embarrassera ou vous ennuiera. Je réponds qu’il le fera bien et avec plaisir. Je suis arrivé il y a deux heures. J’ai trouvé mes enfants, à merveille, ma mère toujours un peu chancelante.
Il fait un temps admirable. Ce matin, à 5 heures, un brouillard affreux. Le brouillard et le soleil, la tristesse et la joie se touchent, se mêlent presque. Les contrastes de la vie ont bien de la peine à se concilier dans notre cœur. Je n’y prétends pas. Si vous pouviez voir au fond, cela me suffirait, et je suis sûr que cela vous ferait du bien. C’est un si grand repos qu’une sécurité parfaite, même de loin. Vous m’êtes nécessaire, nécessaire comme je le suis pour vous. Mais je suis nécessaire en deux endroits. Que j'aurais à vous dire ! Je ne vous ai rien dit. Adieu. Je n’ai pas dormi cette nuit. Je dormirai peut-être une heure dans la journée.
Adieu Adieu. Non pas farewell for ever, mais ever and ever farewell. G.
263. Val -Richer, Jeudi 12 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
263 Du Val-Richer Jeudi 12 septembre 1839
J’ai beaucoup dormi. J’étais fatigué. La fatigue, la vraie fatigue corporelle est un moyen de sommeil qui n’est pas à votre usage ; mais c'est le meilleur, peut-être le seul quand on a le cœur triste. Ici vous mêlez un regret profond, et presque un remord à tous les détails de ma vie. Mes enfants ont rempli hier ma journée de tout ce qu’ils avaient fait en pensant à moi, en mon absence des vers français, des vers anglais, appris par cœur, la marche de Moïse sur le piano, des coussins de tapisserie. J'en ai joui avec trouble. Je vous le dis avec trouble. Mais je vous dit tout. Tout est charmant avec vous. Mais j’ai besoin de vous partout. Vous verrez demain demain.
Je n’espère guère que Rothschild soit moins juif que lui et vous donne la maison pour 10 000 fr. Cependant ne vous laissez pas aller, et ne concluez rien avant la réponse de Rothschild. Je suis pressé de savoir quand M. de Jénisson s'en ira. N’ayez pas non plus de laisser-aller quant à ses meubles. Ne prenez que ceux qui vous conviennent vraiment. Démion, qui a envie que vous soyez là, trouvera bien moyen de le débarrasser du reste. Quand vous ferez vos achats pour l’arrangement de la maison, n'oubliez par M. de Valcourt. Il est très entendu et vous épargnera de payer trop cher. C’est le risque que vous courez toujours. Vous ne savez pas le prix des choses, ni vous défendre du savoir faire des Marchands.
Le tournoi de Lord Eglington a parfaitement amusé mes filles. Elles ont lu cela comme un roman et elles vous diraient les noms de tous les chevaliers et de toutes les dames comme si elles y avaient été personnellement intéressées.
9 h. 1/2
Non, je ne doute pas. Je suis sûr et ravi de ma certitude. Je l’avais. J’avais tort quand je ne l’avais pas. Mais vous me la donnez encore. Donnez-la moi toujours. Toujours, elle me sera aussi douce à recevoir que la première fois. Moi aussi, je suis blessé, de cette sotte parole inoculé à sa mère ! Autant qu'on peut être blessé d’une sottise venue d’un sot. Pardonnez-moi ma brutalité. Il ne faut répondre à cela que quand vos affaires seront finies bien finies tout-à-fait réglés. Vous verrez alors qui vous devez remercier, et dans qu’elle mesure. Vous n'avez lu dans tout ceci qu’un seul tort, c’est votre laisser aller dans les premiers moments. si on vous propose d'échanger des capitaux contre une augmentation de pension, je n’en suis pas d’avis. Tout ce qui augmentera votre dépendance ne vaut rien. Moins vous aurez à recevoir des mains d'autrui chaque année, plus vous serez tranquille et dans une situation convenable. Adieu. Adieu. Le facteur attend ma lettre. Je vous écrirai demain avec détail sur tout cela. Adieu. Comme si j'étais monté avant-hier à 6 heures en passant sous vos fenêtres !
Adieu. Il ne faut pas aller au delà des 12 000 fr pour Jenisson. Un appartement meublé ne vous convient plus du tout. J’aimerais mieux retourner à la rue de Lille. Quel ennui de n’être pas là pour vous aider à résoudre toutes choses !
J’ai beaucoup dormi. J’étais fatigué. La fatigue, la vraie fatigue corporelle est un moyen de sommeil qui n’est pas à votre usage ; mais c'est le meilleur, peut-être le seul quand on a le cœur triste. Ici vous mêlez un regret profond, et presque un remord à tous les détails de ma vie. Mes enfants ont rempli hier ma journée de tout ce qu’ils avaient fait en pensant à moi, en mon absence des vers français, des vers anglais, appris par cœur, la marche de Moïse sur le piano, des coussins de tapisserie. J'en ai joui avec trouble. Je vous le dis avec trouble. Mais je vous dit tout. Tout est charmant avec vous. Mais j’ai besoin de vous partout. Vous verrez demain demain.
Je n’espère guère que Rothschild soit moins juif que lui et vous donne la maison pour 10 000 fr. Cependant ne vous laissez pas aller, et ne concluez rien avant la réponse de Rothschild. Je suis pressé de savoir quand M. de Jénisson s'en ira. N’ayez pas non plus de laisser-aller quant à ses meubles. Ne prenez que ceux qui vous conviennent vraiment. Démion, qui a envie que vous soyez là, trouvera bien moyen de le débarrasser du reste. Quand vous ferez vos achats pour l’arrangement de la maison, n'oubliez par M. de Valcourt. Il est très entendu et vous épargnera de payer trop cher. C’est le risque que vous courez toujours. Vous ne savez pas le prix des choses, ni vous défendre du savoir faire des Marchands.
Le tournoi de Lord Eglington a parfaitement amusé mes filles. Elles ont lu cela comme un roman et elles vous diraient les noms de tous les chevaliers et de toutes les dames comme si elles y avaient été personnellement intéressées.
9 h. 1/2
Non, je ne doute pas. Je suis sûr et ravi de ma certitude. Je l’avais. J’avais tort quand je ne l’avais pas. Mais vous me la donnez encore. Donnez-la moi toujours. Toujours, elle me sera aussi douce à recevoir que la première fois. Moi aussi, je suis blessé, de cette sotte parole inoculé à sa mère ! Autant qu'on peut être blessé d’une sottise venue d’un sot. Pardonnez-moi ma brutalité. Il ne faut répondre à cela que quand vos affaires seront finies bien finies tout-à-fait réglés. Vous verrez alors qui vous devez remercier, et dans qu’elle mesure. Vous n'avez lu dans tout ceci qu’un seul tort, c’est votre laisser aller dans les premiers moments. si on vous propose d'échanger des capitaux contre une augmentation de pension, je n’en suis pas d’avis. Tout ce qui augmentera votre dépendance ne vaut rien. Moins vous aurez à recevoir des mains d'autrui chaque année, plus vous serez tranquille et dans une situation convenable. Adieu. Adieu. Le facteur attend ma lettre. Je vous écrirai demain avec détail sur tout cela. Adieu. Comme si j'étais monté avant-hier à 6 heures en passant sous vos fenêtres !
Adieu. Il ne faut pas aller au delà des 12 000 fr pour Jenisson. Un appartement meublé ne vous convient plus du tout. J’aimerais mieux retourner à la rue de Lille. Quel ennui de n’être pas là pour vous aider à résoudre toutes choses !
264. Val -Richer, Jeudi 12 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
264 Du Val Richer, jeudi 12 septembre 1839 Midi et demie
Je rentre pour être avec vous. Vous savez le peu de cas que je fais des fictions. Mais enfin... Je me promenais tout à l’heure avec ma mère et mes enfants. Je ne sais pourquoi j'ai regardé à ma montre. Midi et demie m’a donné l’envie de rentrer, le besoin d'être seul. Vous êtes seule aussi. Je vous ai promis que vous ne le seriez plus. Je ne tiens toute ma promesse qu’au dedans de mon cœur à votre cœur. Au dehors. dans notre vie, je vous laisse encore seule souvent longtemps... Ah que tout est imparfait.
La nouvelle proposition de Jénisson, me contrarie beaucoup. Vous seriez si bien là ! Je me persuade que M. Démion arrangera la chose et vous fera avoir l’appartement sans meubles. M. de Jénisson se trompe s’il espère le louer sur le champ comme il lui convient. Il ne trouvera pas de chalands avant la fin de l’automne, et perdra ainsi ce qu’il se flatte de gagner. Vous aviez bien raison de prévoir que les affaires vous afflueraient quand je serais parti. Vous aurez vu Génie ce matin. Abouchez-le avec Démion ; il traitera mieux que vous. En tout cas la rue de Lille est toujours à votre disposition. Je viens de relire votre frère. C'est bien ce que j’ai entrevu. Pour en finir, pour se débarrasser de toute contrariété en pensant à vous et de toute peine à prendre pour vous, il a besoin de partager les torts entre vous et vos fils. C'est commode, ainsi font les indifférents de peu d’esprit. Il y a bien de quoi vous blesser. Mais ne vous blessez pas, par fierté. Ne voyez là que des affaires. Je vous demande plus qu’il ne se peut, je le sais bien. J’ai peine à croire que l’augmentation de 2000 roubles de pension soit à la place des capitaux. Elle n'y correspond pas. Le capital Anglais n’y peut-être compris. A lui seul, il vaut plus de 13 000 fr de rente. Ce ne pourrait donc être que pour le capital d’une année de revenu de la terre de Courlande. Il vaut mieux que vous le receviez en masse. Votre frère, est-il autorisé par vos pleins pouvoirs à conclure un tel arrangement, sans votre consentement spécial ?
Voici ce que m'écrit Brougham ce matin : " Mon cher M. Guizot, permettez que je vous exprime mon horreur au sujet d’un bruit qui vient de me parvenir de ma belle-fille à la Haye - et qui m’attribue - je dois dire plutôt m'impute une brochure sur la politique de France, et nommément contre le Roi - Notre roi, j’ose l’appeler. Je n'en sais pas même le titre. Encore moins en ai-je lu même une ligne. Jugez de mon étonnement. C'est probablement une ruse de libraire. "
" Encore une justification. L'on m'accuse d'avoir trop parlé du duc de Wellington aux dépens de l’armée française. Au contraire, le comble de mon éloge était qu'au lieu de se battre contre vos troupes, Napoléon les avait commandées tandis que Wellington les avait combattues. Sachant qu’il y avait des respectables Français près de moi, certes j'aurais eu grand soin de ne pas préférer le moindre mot contre vous autres, quand même j'aurais eu une telle opinion, ce que certes, je n’avais point. " Rendez-lui le service de répéter un peu ses démentis. Il faut obliger les gens d’esprit, même fous. Il ne me dit pas un mot d'Angleterre.
8 heures et demie
Je viens à vous à 8 heures et demie comme à midi et demie avec le même désir et le même serrement de cœur. Vous aviez bien raison avant-hier de vous séparer de moi, avec plus de peine que jamais. Je n’ai jamais passé un peu de temps près de vous sans que le plaisir d’y être ne devint plus vif, et la peine de n'y plus être, plus amère. Et cette fois plus encore que jamais. J’ai oublié de vous dire que, si vous vouliez achever l'histoire de la Révolution de Thiers, je l’avais à votre disposition. Dites à Génie de la faire prendre dans la bibliothèque de l’antichambre du salon, au premier étage. Avez-vous lu les mémoires sur le consulat de Thibaudeau ? Ils vous intéresseraient.
Si M. de Jénisson est intraitable tâchons de voir le bon côté de la rue de Lille. Vous payerez 5000 fr de moins & vous aurez sans embarras, sans qu’il y manque rien, le plaisir d’arranger l’appartement à votre gré. Je me dis et redis cela d'avance, pour être moins contrarié pour vous, s’il faut l'être. Au fait, la rue de Lille est très convenable, parfaitement convenable, et nous mettrons dans le jardin tant de fleurs et de si belles fleurs, que nous le rendrons gai et varié. Vous savez que j'ai le département des fleurs. J’apporterai d’ici, dans ce cas de très belles graines qui me viennent du Jardin du Roi. Nous les sèmerons au printemps sur ce gazon que nous métamorphoserons en corbeille. N'a-t-il pas été convenu que décidément on vous donnerait la grande chambre dont vous avez besoin, au haut de l’escalier ?
9 h. 1/2
Si vous m'êtes nécessaire ? Vous aurez beau faire ; vous pouvez me le demander à moi, mais à vous-même, au fond, de votre cœur, je vous en défie. Je suis sûr que vous serez de plus en plus contente de mon génie, et il vous dira beaucoup de petites nouvelles. Je suis fâché que Rothschild attende Démion. C’est Démion qui règne, au gré de Rothschild. Je m’y attendais. Adieu. Adieu. G.
Je rentre pour être avec vous. Vous savez le peu de cas que je fais des fictions. Mais enfin... Je me promenais tout à l’heure avec ma mère et mes enfants. Je ne sais pourquoi j'ai regardé à ma montre. Midi et demie m’a donné l’envie de rentrer, le besoin d'être seul. Vous êtes seule aussi. Je vous ai promis que vous ne le seriez plus. Je ne tiens toute ma promesse qu’au dedans de mon cœur à votre cœur. Au dehors. dans notre vie, je vous laisse encore seule souvent longtemps... Ah que tout est imparfait.
La nouvelle proposition de Jénisson, me contrarie beaucoup. Vous seriez si bien là ! Je me persuade que M. Démion arrangera la chose et vous fera avoir l’appartement sans meubles. M. de Jénisson se trompe s’il espère le louer sur le champ comme il lui convient. Il ne trouvera pas de chalands avant la fin de l’automne, et perdra ainsi ce qu’il se flatte de gagner. Vous aviez bien raison de prévoir que les affaires vous afflueraient quand je serais parti. Vous aurez vu Génie ce matin. Abouchez-le avec Démion ; il traitera mieux que vous. En tout cas la rue de Lille est toujours à votre disposition. Je viens de relire votre frère. C'est bien ce que j’ai entrevu. Pour en finir, pour se débarrasser de toute contrariété en pensant à vous et de toute peine à prendre pour vous, il a besoin de partager les torts entre vous et vos fils. C'est commode, ainsi font les indifférents de peu d’esprit. Il y a bien de quoi vous blesser. Mais ne vous blessez pas, par fierté. Ne voyez là que des affaires. Je vous demande plus qu’il ne se peut, je le sais bien. J’ai peine à croire que l’augmentation de 2000 roubles de pension soit à la place des capitaux. Elle n'y correspond pas. Le capital Anglais n’y peut-être compris. A lui seul, il vaut plus de 13 000 fr de rente. Ce ne pourrait donc être que pour le capital d’une année de revenu de la terre de Courlande. Il vaut mieux que vous le receviez en masse. Votre frère, est-il autorisé par vos pleins pouvoirs à conclure un tel arrangement, sans votre consentement spécial ?
Voici ce que m'écrit Brougham ce matin : " Mon cher M. Guizot, permettez que je vous exprime mon horreur au sujet d’un bruit qui vient de me parvenir de ma belle-fille à la Haye - et qui m’attribue - je dois dire plutôt m'impute une brochure sur la politique de France, et nommément contre le Roi - Notre roi, j’ose l’appeler. Je n'en sais pas même le titre. Encore moins en ai-je lu même une ligne. Jugez de mon étonnement. C'est probablement une ruse de libraire. "
" Encore une justification. L'on m'accuse d'avoir trop parlé du duc de Wellington aux dépens de l’armée française. Au contraire, le comble de mon éloge était qu'au lieu de se battre contre vos troupes, Napoléon les avait commandées tandis que Wellington les avait combattues. Sachant qu’il y avait des respectables Français près de moi, certes j'aurais eu grand soin de ne pas préférer le moindre mot contre vous autres, quand même j'aurais eu une telle opinion, ce que certes, je n’avais point. " Rendez-lui le service de répéter un peu ses démentis. Il faut obliger les gens d’esprit, même fous. Il ne me dit pas un mot d'Angleterre.
8 heures et demie
Je viens à vous à 8 heures et demie comme à midi et demie avec le même désir et le même serrement de cœur. Vous aviez bien raison avant-hier de vous séparer de moi, avec plus de peine que jamais. Je n’ai jamais passé un peu de temps près de vous sans que le plaisir d’y être ne devint plus vif, et la peine de n'y plus être, plus amère. Et cette fois plus encore que jamais. J’ai oublié de vous dire que, si vous vouliez achever l'histoire de la Révolution de Thiers, je l’avais à votre disposition. Dites à Génie de la faire prendre dans la bibliothèque de l’antichambre du salon, au premier étage. Avez-vous lu les mémoires sur le consulat de Thibaudeau ? Ils vous intéresseraient.
Si M. de Jénisson est intraitable tâchons de voir le bon côté de la rue de Lille. Vous payerez 5000 fr de moins & vous aurez sans embarras, sans qu’il y manque rien, le plaisir d’arranger l’appartement à votre gré. Je me dis et redis cela d'avance, pour être moins contrarié pour vous, s’il faut l'être. Au fait, la rue de Lille est très convenable, parfaitement convenable, et nous mettrons dans le jardin tant de fleurs et de si belles fleurs, que nous le rendrons gai et varié. Vous savez que j'ai le département des fleurs. J’apporterai d’ici, dans ce cas de très belles graines qui me viennent du Jardin du Roi. Nous les sèmerons au printemps sur ce gazon que nous métamorphoserons en corbeille. N'a-t-il pas été convenu que décidément on vous donnerait la grande chambre dont vous avez besoin, au haut de l’escalier ?
9 h. 1/2
Si vous m'êtes nécessaire ? Vous aurez beau faire ; vous pouvez me le demander à moi, mais à vous-même, au fond, de votre cœur, je vous en défie. Je suis sûr que vous serez de plus en plus contente de mon génie, et il vous dira beaucoup de petites nouvelles. Je suis fâché que Rothschild attende Démion. C’est Démion qui règne, au gré de Rothschild. Je m’y attendais. Adieu. Adieu. G.
265. Val -Richer, Vendredi 13 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
265 Du Val Richer, Vendredi soir 13 Sept 1839 9 heures
Vous avez bien tort de ne pas savoir dicter. C’est une habitude qu’il faudrait toujours prendre quand on est jeune. Vous pourriez sans fatigue employer une ou deux heures le soir à recueillir vos souvenirs, ce qui vous a occupée ou amusée dans votre vie. Vous vous en amuseriez encore. Je me promets bien de le faire un jour pour mon compte. A défaut de dictée ne vous conviendrait-il pas qu'une personne un peu intelligente, une femme, une jeune fille vint vous lire le soir quand vous êtes seule et que vos yeux sont fatigués ? Je vous trouverais cela, soit par moi-même d’ici, soit par Génie. Votre solitude me pèse inexprimablement. Chagrin même à part, je suis choqué comme d’une absurdité, que vous soyez seule quand il y a dans le monde, et pas au bout du monde, quelqu'un qui se plaît tant à être avec vous.
Samedi matin 6 h et demie
Je me suis couché hier de très bonne heure. La vie que je mène ici est parfaitement calme et très occupée. Je donne à mes enfants presque tout le temps que je ne passe pas dans mon Cabinet dès que je suis seul, je lis ou j'écris. Rarement il fait assez beau pour que je reprenne mes grandes promenades solitaires. Quand le soir arrive, je suis comme mon fermier qui a labouré tout le jour ; j’ai envie de dormir.
Je vois, dans mes nouvelles de l'Intérieur que la conférence sur les affaires d'Orient pourrait se tenir à Constantinople, que la Porte le demande. Je croyais cette idée tout-à-fait abandonnée. Elle avait été d'abord suggérée par vous. En entendez-vous parler de nouveau ? Que dit-on de la déconfiture de D. Carlos? S'achemine-t-on à petit bruit vers la reconnaissance de la Reine Isabelle ? Certainement, il y a là un dernier coup à donner, pas bien fort, et sans guerre aucune, qui terminerait l'affaire d’Espagne comme on a terminé celle de Belgique, et ferait rentrer toute la Péninsule dans l'ordre européen. Mais vous verrez qu'on laissera encore traîner. Les événements n’arrivent plus aujourd'hui qu’à condition d’arriver tout seuls. Les hommes ont abdiqué. Il n'y a plus que Dieu qui gouverne.
Aimez-vous la lecture des voyages ? Vous avez là, je crois, les lettres de Jacquemont sur l’Inde. Mais ce que vous n’avez certainement pas lu, c'est le Journal même de son voyage, qui se publie par livraisons, avec de grandes images et dans un très beau caractère, Ouvrage très spirituel, et plein d’intérêt. Voulez-vous le lire quoiqu'il ne soit pas fini ? On peut très bien faire, cela pour un voyage qui n’a ni commencement ni fin, et où chaque jour se suffit à soi-même. Si vous en avez envie, dites à Génie de le faire prendre chez moi dans ma chambre à coucher, parmi les livraisons non reliées. Les cahiers détachés ne sont pas bien commodes à manier ; mais du moins la lecture ne vous fatiguera pas les yeux. Je voudrais chaque matin, vous envoyer d’ici de quoi remplir votre journée.
9 heures
La lettre de votre frère est très bien. C'est le moins possible. Mais la brièveté douce et froide convient en pareille occasion. Faites la partir tout de suite et dormez. En vérité, je m'indigne de penser qu’il dépend de telles sottises de vous ôter le sommeil. Je suis charmé que M. Jennison, soit plus traitable. Adieu. Adieu. Il n'y a de bon adieu que ceux qui ne finissent pas. G.
Vous avez bien tort de ne pas savoir dicter. C’est une habitude qu’il faudrait toujours prendre quand on est jeune. Vous pourriez sans fatigue employer une ou deux heures le soir à recueillir vos souvenirs, ce qui vous a occupée ou amusée dans votre vie. Vous vous en amuseriez encore. Je me promets bien de le faire un jour pour mon compte. A défaut de dictée ne vous conviendrait-il pas qu'une personne un peu intelligente, une femme, une jeune fille vint vous lire le soir quand vous êtes seule et que vos yeux sont fatigués ? Je vous trouverais cela, soit par moi-même d’ici, soit par Génie. Votre solitude me pèse inexprimablement. Chagrin même à part, je suis choqué comme d’une absurdité, que vous soyez seule quand il y a dans le monde, et pas au bout du monde, quelqu'un qui se plaît tant à être avec vous.
Samedi matin 6 h et demie
Je me suis couché hier de très bonne heure. La vie que je mène ici est parfaitement calme et très occupée. Je donne à mes enfants presque tout le temps que je ne passe pas dans mon Cabinet dès que je suis seul, je lis ou j'écris. Rarement il fait assez beau pour que je reprenne mes grandes promenades solitaires. Quand le soir arrive, je suis comme mon fermier qui a labouré tout le jour ; j’ai envie de dormir.
Je vois, dans mes nouvelles de l'Intérieur que la conférence sur les affaires d'Orient pourrait se tenir à Constantinople, que la Porte le demande. Je croyais cette idée tout-à-fait abandonnée. Elle avait été d'abord suggérée par vous. En entendez-vous parler de nouveau ? Que dit-on de la déconfiture de D. Carlos? S'achemine-t-on à petit bruit vers la reconnaissance de la Reine Isabelle ? Certainement, il y a là un dernier coup à donner, pas bien fort, et sans guerre aucune, qui terminerait l'affaire d’Espagne comme on a terminé celle de Belgique, et ferait rentrer toute la Péninsule dans l'ordre européen. Mais vous verrez qu'on laissera encore traîner. Les événements n’arrivent plus aujourd'hui qu’à condition d’arriver tout seuls. Les hommes ont abdiqué. Il n'y a plus que Dieu qui gouverne.
Aimez-vous la lecture des voyages ? Vous avez là, je crois, les lettres de Jacquemont sur l’Inde. Mais ce que vous n’avez certainement pas lu, c'est le Journal même de son voyage, qui se publie par livraisons, avec de grandes images et dans un très beau caractère, Ouvrage très spirituel, et plein d’intérêt. Voulez-vous le lire quoiqu'il ne soit pas fini ? On peut très bien faire, cela pour un voyage qui n’a ni commencement ni fin, et où chaque jour se suffit à soi-même. Si vous en avez envie, dites à Génie de le faire prendre chez moi dans ma chambre à coucher, parmi les livraisons non reliées. Les cahiers détachés ne sont pas bien commodes à manier ; mais du moins la lecture ne vous fatiguera pas les yeux. Je voudrais chaque matin, vous envoyer d’ici de quoi remplir votre journée.
9 heures
La lettre de votre frère est très bien. C'est le moins possible. Mais la brièveté douce et froide convient en pareille occasion. Faites la partir tout de suite et dormez. En vérité, je m'indigne de penser qu’il dépend de telles sottises de vous ôter le sommeil. Je suis charmé que M. Jennison, soit plus traitable. Adieu. Adieu. Il n'y a de bon adieu que ceux qui ne finissent pas. G.
266. Val -Richer, Samedi 14 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
266 Du Val-Richer, Samedi soir 14 sept. 1839
9 heures
Vous avez bien raison ; un bon confident général épargnerait à tout le monde bien des sottises. Que de fois je l’ai pensé sur l’heure même au milieu des affaires ! Que de fois j'ai désiré que quelqu'un fût là, qui vit les choses comme elles étaient, la vérité, et l'allât redire, à ceux qui auraient été charmés de l'apprendre et ne savaient pas la deviner ! Mais il faudrait que le confident eût bien de l’esprit et bien de l’honneur. Ce serait un rôle charmant, autant qu'utile, et qui vous croit à merveille. Que signifie notre mission en Perse ? Allons-nous là pour nous interposer entre St Pétersbourg et Londres ? Je le croirais au choix de M. de Sercey. Je ne sais qui nous allons envoyer aux Etats-Unis à la place de Pontois. Comment M. de Metternich se fait-il accompagner au Johannisberg par M. de Hügel ? Personne ne me paraît moins propre à égayer un malade. Puisque M. de Jennison s'en va décidément. Sachez-moi, je vous prie, si c'est M. de Lücksbourg qui le remplace. Il m’a paru homme d'esprit. Mais bien des gens paraissent gens d'esprit à la première conversation. Je dis de l’esprit comme Solon de la destinée des hommes. " Il n'en faut jamais juger avant la mort. "
Dimanche 7 heures
Quel temps noir et froid. De tous mes souvenirs d’enfance le plus vif est celui du soleil du midi. Je le cherche toujours au delà de ces brouillards. Un ciel sans soleil, c’est un corps sans âme. Vous m’avez bien manqué hier. J’écrivais, sur Washington une page qui m’a amené à un rapprochement entre lui et Cromwell. Le rapprochement est très piquant ; mais je ne suis pas sûr qu’il vienne à propos. Je ne suis pas très sujet au doute ; que la chose soit petite ou grande, je me décide en général, moi même et promptement. Mais quand il m’arrive d’hésiter, mon embarras est extrême, car je suis horriblement difficile, en fait de conseils. Je crois aux vôtres. Vous avez le jugement très sûr et le goût très exigeant. Et cela d’instinct sans longue méditation. Vous me direz votre avis sur la convenance de mon rapprochement.
J’espérais Lady Granville un peu plutôt, tout vient toujours trop tard. Je regrette qu'elle n'ait pas réussi dans sa négociation. En avez-vous quelque autre en vue ? Vraiment il vous faut quelqu'un. Voulez-vous que je fasse chercher ? J’y serai très difficile, aussi difficile que vous. Puis vous verrez. Votre isolement, dans votre home, pour les soin matériel de la vie, m'est insupportable.
9 heures
Je suis désolé, désolé de toute façon. Mais je ne dirai rien aujourd'hui, je ne pourrais pas. Je vous renverrai demain la lettre du Prince Mestchersky. Je veux la relire. Au nom de Dieu ne soyez pas malade. Soyez injuste tant que vous voudrez, mais non pas malade. G.
9 heures
Vous avez bien raison ; un bon confident général épargnerait à tout le monde bien des sottises. Que de fois je l’ai pensé sur l’heure même au milieu des affaires ! Que de fois j'ai désiré que quelqu'un fût là, qui vit les choses comme elles étaient, la vérité, et l'allât redire, à ceux qui auraient été charmés de l'apprendre et ne savaient pas la deviner ! Mais il faudrait que le confident eût bien de l’esprit et bien de l’honneur. Ce serait un rôle charmant, autant qu'utile, et qui vous croit à merveille. Que signifie notre mission en Perse ? Allons-nous là pour nous interposer entre St Pétersbourg et Londres ? Je le croirais au choix de M. de Sercey. Je ne sais qui nous allons envoyer aux Etats-Unis à la place de Pontois. Comment M. de Metternich se fait-il accompagner au Johannisberg par M. de Hügel ? Personne ne me paraît moins propre à égayer un malade. Puisque M. de Jennison s'en va décidément. Sachez-moi, je vous prie, si c'est M. de Lücksbourg qui le remplace. Il m’a paru homme d'esprit. Mais bien des gens paraissent gens d'esprit à la première conversation. Je dis de l’esprit comme Solon de la destinée des hommes. " Il n'en faut jamais juger avant la mort. "
Dimanche 7 heures
Quel temps noir et froid. De tous mes souvenirs d’enfance le plus vif est celui du soleil du midi. Je le cherche toujours au delà de ces brouillards. Un ciel sans soleil, c’est un corps sans âme. Vous m’avez bien manqué hier. J’écrivais, sur Washington une page qui m’a amené à un rapprochement entre lui et Cromwell. Le rapprochement est très piquant ; mais je ne suis pas sûr qu’il vienne à propos. Je ne suis pas très sujet au doute ; que la chose soit petite ou grande, je me décide en général, moi même et promptement. Mais quand il m’arrive d’hésiter, mon embarras est extrême, car je suis horriblement difficile, en fait de conseils. Je crois aux vôtres. Vous avez le jugement très sûr et le goût très exigeant. Et cela d’instinct sans longue méditation. Vous me direz votre avis sur la convenance de mon rapprochement.
J’espérais Lady Granville un peu plutôt, tout vient toujours trop tard. Je regrette qu'elle n'ait pas réussi dans sa négociation. En avez-vous quelque autre en vue ? Vraiment il vous faut quelqu'un. Voulez-vous que je fasse chercher ? J’y serai très difficile, aussi difficile que vous. Puis vous verrez. Votre isolement, dans votre home, pour les soin matériel de la vie, m'est insupportable.
9 heures
Je suis désolé, désolé de toute façon. Mais je ne dirai rien aujourd'hui, je ne pourrais pas. Je vous renverrai demain la lettre du Prince Mestchersky. Je veux la relire. Au nom de Dieu ne soyez pas malade. Soyez injuste tant que vous voudrez, mais non pas malade. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Discours autobiographique, Portrait (Dorothée)
267. Val -Richer, Lundi 16 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
267 Du Val-Richer Lundi 16 sept. 1839
6 heures et demie
J’aurais le cœur bien blessé si je ne me l’interdisais pas. Blessé à ce point que mon envie était de ne pas vous répondre du tout sur ce que vous me dites. Mais vous êtes souffrante, vous êtes seule. Dites, pensez même (ce qui est bien pis) tout ce que vous voudrez. Je ne vous répondrai jamais qu’une chose. Vous n’aurez jamais plus que moi le sentiment de ce qui manque à notre relation, de ce contraste choquant, douloureux, entre le fond du cœur et la vie extérieure, quotidienne. Si ma vie était à vous aussi bien que mon cœur, vous verriez si je sais tout subordonner à un seul sentiment à une seule affaire si je sais être toujours là et toujours le même. Mais cela n'est pas ; il y a des affections, des devoirs, des intérêts auxquels ma vie appartient, et qui ne sont pas vous. Je ne puis pas la leur ôter. Je ne puis pas me donner ce tort à leurs yeux, à mes yeux, aux yeux du monde, à vos propres yeux. Car je vous connais bien ; vous mépriseriez la faiblesse même dont vous profiteriez. Vous avez l’esprit trop droit et le cœur trop haut pour ne pas avoir besoin, sur toutes choses, d’approuver et de respecter ce que vous aimez. Je vous parle bien sérieusement n’est-ce pas ? Pas si sérieusement que je le sens. Ce qui vous touche est si sérieux pour moi ! Mais assez ; trop peut-être, quoique je vous aie dit bien peu. Comment dire ? Comment dire de loin ? Toutes les paroles me semblent froides et fausses. Voilà plus de deux ans ; et pourtant il faut encore que le temps nous apprenne, l’un sur l'autre, bien des choses.
Que me direz-vous aujourd’hui de vos crampes, et de vôtre nuit ? Je vous renvoie la lettre du Prince Metscherzky. Je voudrais bien ne plus vous parler de Paul. Il me révolte. Et puis je ne comprends pas ces mœurs-là, cette façon de repousser insolemment de faire taire un parent qui vous parle d’une mère, parce qu'il n’a pas des pleins pouvoirs, parce que ce n’est pas un procureur ! Et ce parent se laisse faire ! Il ne trouve pas un mot à répondre, un mot bien simple, bien calme, mais qui remette à sa place tout et chacun ! Le Prince Metscherzky m’a l’air d’un excellent homme, bien zélé pour vous ; mais ne le chargez pas d’affaires difficiles ; ne lui donnez pas à traiter avec un frère puissant ou un cousin arrogant. Ne placez pas non plus comme il semble vous le conseiller, toute votre fortune en Russie. Quelques mille livres de rente de plus ne valent pas beaucoup de sécurité et de facilité de moins. Du reste vous avez déjà fait le contraire pour une partie.
Vous avez bien raison ; on nomme les gens aux emplois diplomatiques, en pensant à ce qu’ils sont là d’où ils partent, point à ce qu’ils seront là où on les envoie. On pense à si peu de choses ! Que les affaires humaines se font grossièrement ! On serait bien étonné si tout à coup, par miracle, elles étaient vraiment bien faites, et par des gens vraiment d’esprit. Savez-vous pourquoi on envoie M. de Pontois à Constantinople ? Parce qu'il est terne et tranquille, ne choque personne et ne fera pas les sottises de l’amiral Roussin. Le grand abaissement de notre temps, c'est de se contenter à bon marché ; le tel quel suffit, pourvu qu'on vive.
9 h. 1/2
Vous avez un peu dormi. Il faut absolument qu’on vous trouve une lectrice. J’en vais parler à ma mère. Adieu. Adieu. J’apprends à l’instant même que D. Carlos est en France avec toute sa famille. Les bataillons navarrois acculés à la frontière ont capitulé. Elio, qui les commandait, avait envoyé d'avance un de ses aides de camp au général Harispe. On ne doute pas que les Cortes ne sanctionnent le traité. Vous savez sûrement tout cela. Adieu. Adieu. G.
6 heures et demie
J’aurais le cœur bien blessé si je ne me l’interdisais pas. Blessé à ce point que mon envie était de ne pas vous répondre du tout sur ce que vous me dites. Mais vous êtes souffrante, vous êtes seule. Dites, pensez même (ce qui est bien pis) tout ce que vous voudrez. Je ne vous répondrai jamais qu’une chose. Vous n’aurez jamais plus que moi le sentiment de ce qui manque à notre relation, de ce contraste choquant, douloureux, entre le fond du cœur et la vie extérieure, quotidienne. Si ma vie était à vous aussi bien que mon cœur, vous verriez si je sais tout subordonner à un seul sentiment à une seule affaire si je sais être toujours là et toujours le même. Mais cela n'est pas ; il y a des affections, des devoirs, des intérêts auxquels ma vie appartient, et qui ne sont pas vous. Je ne puis pas la leur ôter. Je ne puis pas me donner ce tort à leurs yeux, à mes yeux, aux yeux du monde, à vos propres yeux. Car je vous connais bien ; vous mépriseriez la faiblesse même dont vous profiteriez. Vous avez l’esprit trop droit et le cœur trop haut pour ne pas avoir besoin, sur toutes choses, d’approuver et de respecter ce que vous aimez. Je vous parle bien sérieusement n’est-ce pas ? Pas si sérieusement que je le sens. Ce qui vous touche est si sérieux pour moi ! Mais assez ; trop peut-être, quoique je vous aie dit bien peu. Comment dire ? Comment dire de loin ? Toutes les paroles me semblent froides et fausses. Voilà plus de deux ans ; et pourtant il faut encore que le temps nous apprenne, l’un sur l'autre, bien des choses.
Que me direz-vous aujourd’hui de vos crampes, et de vôtre nuit ? Je vous renvoie la lettre du Prince Metscherzky. Je voudrais bien ne plus vous parler de Paul. Il me révolte. Et puis je ne comprends pas ces mœurs-là, cette façon de repousser insolemment de faire taire un parent qui vous parle d’une mère, parce qu'il n’a pas des pleins pouvoirs, parce que ce n’est pas un procureur ! Et ce parent se laisse faire ! Il ne trouve pas un mot à répondre, un mot bien simple, bien calme, mais qui remette à sa place tout et chacun ! Le Prince Metscherzky m’a l’air d’un excellent homme, bien zélé pour vous ; mais ne le chargez pas d’affaires difficiles ; ne lui donnez pas à traiter avec un frère puissant ou un cousin arrogant. Ne placez pas non plus comme il semble vous le conseiller, toute votre fortune en Russie. Quelques mille livres de rente de plus ne valent pas beaucoup de sécurité et de facilité de moins. Du reste vous avez déjà fait le contraire pour une partie.
Vous avez bien raison ; on nomme les gens aux emplois diplomatiques, en pensant à ce qu’ils sont là d’où ils partent, point à ce qu’ils seront là où on les envoie. On pense à si peu de choses ! Que les affaires humaines se font grossièrement ! On serait bien étonné si tout à coup, par miracle, elles étaient vraiment bien faites, et par des gens vraiment d’esprit. Savez-vous pourquoi on envoie M. de Pontois à Constantinople ? Parce qu'il est terne et tranquille, ne choque personne et ne fera pas les sottises de l’amiral Roussin. Le grand abaissement de notre temps, c'est de se contenter à bon marché ; le tel quel suffit, pourvu qu'on vive.
9 h. 1/2
Vous avez un peu dormi. Il faut absolument qu’on vous trouve une lectrice. J’en vais parler à ma mère. Adieu. Adieu. J’apprends à l’instant même que D. Carlos est en France avec toute sa famille. Les bataillons navarrois acculés à la frontière ont capitulé. Elio, qui les commandait, avait envoyé d'avance un de ses aides de camp au général Harispe. On ne doute pas que les Cortes ne sanctionnent le traité. Vous savez sûrement tout cela. Adieu. Adieu. G.
268. Val -Richer, Mardi 17 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
268 Du Val-Richer, mardi 17 sept. 1839-7 heures
Ma mère me parle d’une jeune fille, agréable et bien élevée qui pourrait peut-être vous servir de lectrice. C’est la fille d’un M. Audebez, l’un des Ministres qui prêchent à la chapelle de la rue Taitbout, homme de bien, qui a une famille nombreuse, comme tous les gens qui prêchent, et a fait élever plusieurs de ses enfants en Angleterre. Mais il y aurait peut-être, pour cette jeune fille, quelque difficulté à aller seule dans les rues le soir, tard, car c’est le soir que vous en avez besoin. Il faudrait que Félix ou quelque autre l'accompagnât. Voulez- vous que je fasse demander, s’il y a là quelque chose qui vous convienne ?
Je ne vous conviendrais pas du tout en ce moment pour ce métier-là. Je suis enroué. J’ai suspendu mes lectures du soir et je prends des laits de poule. Nous avons froid, tout à fait froid. depuis deux jours. Avez-vous lu Pepy's Memoirs sur le règne et la cour de Charles 2 ? Ils vous amuseraient à parcourir. Ils sont chez moi dans le corps de bibliothèque de mon Cabinet. Faites les prendre par Génie si vous en avez envie. Le triomphe a ses embarras.
Dites-moi où nous mettrons D. Carlos. Il faut qu’il soit logé convenablement pour lui et surement pour nous. Le Duc de Valençay ne nous rendra pas Valençay. Madame ne nous prêtera pas Randan. J’ai pensé à Amboise, bon château, point prison, et assez possible à bien observer. Mais je doute fort que le Roi veuille avoir D. Carlos dans une maison à lui, une maison du domaine privé. Ce serait bien de l’intimité et de la responsabilité. Et puis notre peuple voudra des précautions plus strictes, plus apparentes. Nous aurons bien du monde à rassurer, des deux côtés des Pyrénées. Cela finira par un château fort à terme. Je ne vois pas bien lequel. Blaye et Hans sont bien petits et bien forts. La citadelle de Lille est un beau logement. Il y a de quoi admirer la bêtise humaine. On criera beaucoup, on demandera toutes sortes de précautions dans le moment-ci quand D. Carlos n’a évidemment aucune envie de recommencer; et dans un an, deux ans, que sais-je ? Quand l'envie et peut-être les moyens lui seront revenus, on n’y pensera plus, et tout sera relâché. Il faut lui faire signer une bonne renonciation et donner par l'Espagne une bonne pension qu’il ira dans quelque temps manger à Rome. Cela se peut quand vous aurez tous reconnu la reine Isabelle. Nous voilà les mains bien libres en occident. Gage de plus de l'immobilité en orient.
9 heures et demie
Pure, pure mégarde, mégarde de tristesse si ma lettre d'avant-hier ne contenait pas d'adieu. J’en suis désolé. Pardonnez-le moi. Je le mérite. Je vous dis adieu si souvent dans le jour, triste ou gai. Et puis dites-moi toujours tout, toute votre disposition, quelle qu’elle soit. Et laissez-moi en faire autant. Et que rien ne soit jamais retenu, caché entre nous. Nous nous affligerons quelquefois. C'est le droit des cœurs qui s’aiment de s'affliger réciproquement quand ils sont tristes. Mais qu'importe ? Le plus vif chagrin vaut mille fois mieux que le moindre silence. Je veux que vous me disiez tout. Je veux vous dire tout. Et adieu est toujours au bout de tout, pour tout réparer tout, charmer. Adieu. Adieu, dearest ever dearest. Adieu. G.
Ma mère me parle d’une jeune fille, agréable et bien élevée qui pourrait peut-être vous servir de lectrice. C’est la fille d’un M. Audebez, l’un des Ministres qui prêchent à la chapelle de la rue Taitbout, homme de bien, qui a une famille nombreuse, comme tous les gens qui prêchent, et a fait élever plusieurs de ses enfants en Angleterre. Mais il y aurait peut-être, pour cette jeune fille, quelque difficulté à aller seule dans les rues le soir, tard, car c’est le soir que vous en avez besoin. Il faudrait que Félix ou quelque autre l'accompagnât. Voulez- vous que je fasse demander, s’il y a là quelque chose qui vous convienne ?
Je ne vous conviendrais pas du tout en ce moment pour ce métier-là. Je suis enroué. J’ai suspendu mes lectures du soir et je prends des laits de poule. Nous avons froid, tout à fait froid. depuis deux jours. Avez-vous lu Pepy's Memoirs sur le règne et la cour de Charles 2 ? Ils vous amuseraient à parcourir. Ils sont chez moi dans le corps de bibliothèque de mon Cabinet. Faites les prendre par Génie si vous en avez envie. Le triomphe a ses embarras.
Dites-moi où nous mettrons D. Carlos. Il faut qu’il soit logé convenablement pour lui et surement pour nous. Le Duc de Valençay ne nous rendra pas Valençay. Madame ne nous prêtera pas Randan. J’ai pensé à Amboise, bon château, point prison, et assez possible à bien observer. Mais je doute fort que le Roi veuille avoir D. Carlos dans une maison à lui, une maison du domaine privé. Ce serait bien de l’intimité et de la responsabilité. Et puis notre peuple voudra des précautions plus strictes, plus apparentes. Nous aurons bien du monde à rassurer, des deux côtés des Pyrénées. Cela finira par un château fort à terme. Je ne vois pas bien lequel. Blaye et Hans sont bien petits et bien forts. La citadelle de Lille est un beau logement. Il y a de quoi admirer la bêtise humaine. On criera beaucoup, on demandera toutes sortes de précautions dans le moment-ci quand D. Carlos n’a évidemment aucune envie de recommencer; et dans un an, deux ans, que sais-je ? Quand l'envie et peut-être les moyens lui seront revenus, on n’y pensera plus, et tout sera relâché. Il faut lui faire signer une bonne renonciation et donner par l'Espagne une bonne pension qu’il ira dans quelque temps manger à Rome. Cela se peut quand vous aurez tous reconnu la reine Isabelle. Nous voilà les mains bien libres en occident. Gage de plus de l'immobilité en orient.
9 heures et demie
Pure, pure mégarde, mégarde de tristesse si ma lettre d'avant-hier ne contenait pas d'adieu. J’en suis désolé. Pardonnez-le moi. Je le mérite. Je vous dis adieu si souvent dans le jour, triste ou gai. Et puis dites-moi toujours tout, toute votre disposition, quelle qu’elle soit. Et laissez-moi en faire autant. Et que rien ne soit jamais retenu, caché entre nous. Nous nous affligerons quelquefois. C'est le droit des cœurs qui s’aiment de s'affliger réciproquement quand ils sont tristes. Mais qu'importe ? Le plus vif chagrin vaut mille fois mieux que le moindre silence. Je veux que vous me disiez tout. Je veux vous dire tout. Et adieu est toujours au bout de tout, pour tout réparer tout, charmer. Adieu. Adieu, dearest ever dearest. Adieu. G.
270. Val -Richer, Jeudi 19 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
270 Du Val Richer jeudi 19 sept 1839 9 heures
Je suis charmé que vous ayez l’entresol. Il se peut que cela ne vous fasse pas plaisir aujourd’hui ; mais vous en jouirez cet hiver, et puis au printemps et puis l'autre hiver. Il n’y aura pas un rayon de soleil qui ne vous arrive, pas une feuille qui ne pousse, pas un oiseau qui ne chante pour vous. J’en suis charmé. Et puis c’est un démenti à ce que vous appelez votre guignon.
A présent ne vous laissez pas imposer par M. de Jennison les meubles qui ne vous conviendront pas, ne prenez que ce que vous voudrez absolument que ce que vous voudrez, et donnez vous de l’espace à remplir, du nouveau à arranger. Tout cela est bien petit, bien petit dearest, mais vous vous en amusez une demi-heure et le temps marche. Je voudrais vous trouver je ne sais quoi à faire jusqu'à mon retour. Je suis en ce qui vous touche, parfaitement désintéressé et orgueilleux.
Vous avez bien fait décrire à Benkhausen pour qu’il prenne en votre nom les letters of administration. Avec Paul, les Affaires faites valent toujours mieux que les affaires à débattre, et celle-là sera ainsi toute simple et sûre en même temps.
Mad. Appony a trouvé moyen de faire à la belle sœur de Bulwer une politesse et de vous tenir sa parole, Bulwer ne rencontrera certainement plus sa belle sœur. Un petit mensonge est bien commode. Du reste, le mensonge suffit.
Je suis toujours enrhumé. J’ai mal dormi cette nuit. J'étais là dans mon lit depuis deux heures, pensant toujours à vous, quelque fois à Washington qui m’occupe et m'intéresse, homme de beaucoup d’esprit, je vous assure et de beaucoup de sens, et point charlatan, point de Humbog. Il ne vous aurait pas charmée, entraînée ; mais vous auriez été tous les jours plus aise de le connaitre. Je suis bien aise que mon Génie vous convienne un peu.
Je comprends votre sentiment sur votre misère. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le monde est bien grand et bien varié ; il faut l'accepter tout entier, et tirer de chacun et de chaque chose tout ce qu’il y a. Vous m’avez dit souvent qu’une fois assise à côté de quelqu'un et forcée de l'avoir pour voisin, vous aviez le talent de le faire parler et de ne pas vous en trop ennuyer. Dans le cours de la vie, on est assis à côté de bien du monde. Ne laissez pas perdre votre talent. Il y a de la coterie partout, en haut, en bas, au milieu. Les petites gens en font, les grands aussi, les Rois eux-mêmes. Tous y perdent. On y perd de la liberté, de la facilité, du mouvement, de l'amusement, de la ressource. On y perd même de l’esprit. Le vôtre est grand, élégant et merveilleuse ment sensé dans son élégance et sa grandeur. Laissez quand l'occasion l'y oblige, se promener en dehors de ses habitudes, ne lui défendez pas, par fierté, d’y prendre intérêt. Soyez tranquille ; vous ne descendrez pas. Cela n’est pas en votre pouvoir. Il s'est fait du vide autour de vous, et c’est là votre misère. Mais elle vous laisse et vous laissera éternellement à votre hauteur, car c’est vous-même qui êtes haute. Plût au Ciel que vous fussiez aussi forte ! Le mal est là. Vous êtes comme mes peupliers de taille superbe et de tige frêle ; la tête s’élève, mais le tronc plié.
9 heures 1/4
Que je voudrais vous envoyer du soleil et autre chose ! Mais je dispose de si peu ! Adieu, adieu. Je vais faire demander ma petite lectrice. Adieu Le plus tendre adieu. G.
Je suis charmé que vous ayez l’entresol. Il se peut que cela ne vous fasse pas plaisir aujourd’hui ; mais vous en jouirez cet hiver, et puis au printemps et puis l'autre hiver. Il n’y aura pas un rayon de soleil qui ne vous arrive, pas une feuille qui ne pousse, pas un oiseau qui ne chante pour vous. J’en suis charmé. Et puis c’est un démenti à ce que vous appelez votre guignon.
A présent ne vous laissez pas imposer par M. de Jennison les meubles qui ne vous conviendront pas, ne prenez que ce que vous voudrez absolument que ce que vous voudrez, et donnez vous de l’espace à remplir, du nouveau à arranger. Tout cela est bien petit, bien petit dearest, mais vous vous en amusez une demi-heure et le temps marche. Je voudrais vous trouver je ne sais quoi à faire jusqu'à mon retour. Je suis en ce qui vous touche, parfaitement désintéressé et orgueilleux.
Vous avez bien fait décrire à Benkhausen pour qu’il prenne en votre nom les letters of administration. Avec Paul, les Affaires faites valent toujours mieux que les affaires à débattre, et celle-là sera ainsi toute simple et sûre en même temps.
Mad. Appony a trouvé moyen de faire à la belle sœur de Bulwer une politesse et de vous tenir sa parole, Bulwer ne rencontrera certainement plus sa belle sœur. Un petit mensonge est bien commode. Du reste, le mensonge suffit.
Je suis toujours enrhumé. J’ai mal dormi cette nuit. J'étais là dans mon lit depuis deux heures, pensant toujours à vous, quelque fois à Washington qui m’occupe et m'intéresse, homme de beaucoup d’esprit, je vous assure et de beaucoup de sens, et point charlatan, point de Humbog. Il ne vous aurait pas charmée, entraînée ; mais vous auriez été tous les jours plus aise de le connaitre. Je suis bien aise que mon Génie vous convienne un peu.
Je comprends votre sentiment sur votre misère. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le monde est bien grand et bien varié ; il faut l'accepter tout entier, et tirer de chacun et de chaque chose tout ce qu’il y a. Vous m’avez dit souvent qu’une fois assise à côté de quelqu'un et forcée de l'avoir pour voisin, vous aviez le talent de le faire parler et de ne pas vous en trop ennuyer. Dans le cours de la vie, on est assis à côté de bien du monde. Ne laissez pas perdre votre talent. Il y a de la coterie partout, en haut, en bas, au milieu. Les petites gens en font, les grands aussi, les Rois eux-mêmes. Tous y perdent. On y perd de la liberté, de la facilité, du mouvement, de l'amusement, de la ressource. On y perd même de l’esprit. Le vôtre est grand, élégant et merveilleuse ment sensé dans son élégance et sa grandeur. Laissez quand l'occasion l'y oblige, se promener en dehors de ses habitudes, ne lui défendez pas, par fierté, d’y prendre intérêt. Soyez tranquille ; vous ne descendrez pas. Cela n’est pas en votre pouvoir. Il s'est fait du vide autour de vous, et c’est là votre misère. Mais elle vous laisse et vous laissera éternellement à votre hauteur, car c’est vous-même qui êtes haute. Plût au Ciel que vous fussiez aussi forte ! Le mal est là. Vous êtes comme mes peupliers de taille superbe et de tige frêle ; la tête s’élève, mais le tronc plié.
9 heures 1/4
Que je voudrais vous envoyer du soleil et autre chose ! Mais je dispose de si peu ! Adieu, adieu. Je vais faire demander ma petite lectrice. Adieu Le plus tendre adieu. G.
271. Val-Richer, Vendredi 20 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
271 Du Val-Richer, Vendredi 20 sept. 1839 7 heures et demie
Ma petite lectrice a beaucoup d'accent gascon. Elle demeure à une lieue de chez vous. L'envoyer chercher, et la ramener prendrait la soirée de vos chevaux. On me propose en échange une Mademoiselle Mallet, fort recommandable de bonnes façons, assez instruite, qui a élevé une jeune fille dans une famille que je connais. Elle demeure près de chez vous rue Godot-Mauroy n°11. Elle a 45 ans. On dit qu’elle n’est pas jolie. On croit qu'en lui donnant 3 fr. par soirée de 60 à 100 fr, par mois, ce serait convenable, et qu’elle vous lirait bien ce que vous voudriez ; pendant, une heure, une heure et demie. Dites-moi si vous voulez que je vous la fasse envoyer, et à quelle heure vous la voudriez chaque soir.
Vous promenez-vous toujours après votre dîner malgré cette horrible pluie ? Ouvrez-vous votre porte, et à quelle heure ? C’est une vraie maladie que le besoin de savoir tous les détails d’une vie qu'on aime. Vous me dîtes tout bien exactement. Il me semble que j'ignore tout. J’ai raison ; on ignore tout quand on n'y est pas.
Je ne m'étonne pas que les apostoliques soient déconcertés du dénouement espagnol. C’est un gros échec pour eux ; un de ces échecs qui révèlent la faiblesse radicale d’un parti et le terrain qu'il a perdu sans retour. La chance était belle contre la révolution d’Espagne, car elle aussi, elle est faible et bien inhabile, et prêtant bien le flanc à ses ennemis. Ils échouent contre elle, bien plus par leur propre misère que par sa force. Au fond, c’est juste, c’est le parti apostolique ses maximes, ses hommes, son gouvernement qui depuis deux siècles ont laissé ou fait déchoir l’Espagne et le Portugal, déchoir comme puissance au dehors, comme prospéré et dedans, déchoir en esprit comme en richesse, en dignité comme en bien-être. Ils sont punis par où ils ont pêché ; ils se trouvent encore plus déchus eux-mêmes que le pays qu'ils ont fait déchoir. Que l’absolutisme autrichien, prussien, russe même se maintienne et batte chez lui les révolutions, je le comprends ; les peuples prospèrent et grandissent sous lui ; il a droit de durer et de vaincre. Les apostoliques, ne sont vraiment bons qu’à mourir.
9 h. 1/2
Essayez de la jeune fille de Génie. Si vous ne vous en servez pas plus de 12 ou 15 fois par mois, 60 francs me paraissent suffisants. Il faut compter entre 3 fr. et 5 fr. par soirée. Je suis toujours enrhumé. Le temps est détestable. Quand je pourrai prendre l’air à mon ordinaire, & un air un peu doux mon rhume s'en ira. Adieu. Adieu. G.
Ma petite lectrice a beaucoup d'accent gascon. Elle demeure à une lieue de chez vous. L'envoyer chercher, et la ramener prendrait la soirée de vos chevaux. On me propose en échange une Mademoiselle Mallet, fort recommandable de bonnes façons, assez instruite, qui a élevé une jeune fille dans une famille que je connais. Elle demeure près de chez vous rue Godot-Mauroy n°11. Elle a 45 ans. On dit qu’elle n’est pas jolie. On croit qu'en lui donnant 3 fr. par soirée de 60 à 100 fr, par mois, ce serait convenable, et qu’elle vous lirait bien ce que vous voudriez ; pendant, une heure, une heure et demie. Dites-moi si vous voulez que je vous la fasse envoyer, et à quelle heure vous la voudriez chaque soir.
Vous promenez-vous toujours après votre dîner malgré cette horrible pluie ? Ouvrez-vous votre porte, et à quelle heure ? C’est une vraie maladie que le besoin de savoir tous les détails d’une vie qu'on aime. Vous me dîtes tout bien exactement. Il me semble que j'ignore tout. J’ai raison ; on ignore tout quand on n'y est pas.
Je ne m'étonne pas que les apostoliques soient déconcertés du dénouement espagnol. C’est un gros échec pour eux ; un de ces échecs qui révèlent la faiblesse radicale d’un parti et le terrain qu'il a perdu sans retour. La chance était belle contre la révolution d’Espagne, car elle aussi, elle est faible et bien inhabile, et prêtant bien le flanc à ses ennemis. Ils échouent contre elle, bien plus par leur propre misère que par sa force. Au fond, c’est juste, c’est le parti apostolique ses maximes, ses hommes, son gouvernement qui depuis deux siècles ont laissé ou fait déchoir l’Espagne et le Portugal, déchoir comme puissance au dehors, comme prospéré et dedans, déchoir en esprit comme en richesse, en dignité comme en bien-être. Ils sont punis par où ils ont pêché ; ils se trouvent encore plus déchus eux-mêmes que le pays qu'ils ont fait déchoir. Que l’absolutisme autrichien, prussien, russe même se maintienne et batte chez lui les révolutions, je le comprends ; les peuples prospèrent et grandissent sous lui ; il a droit de durer et de vaincre. Les apostoliques, ne sont vraiment bons qu’à mourir.
9 h. 1/2
Essayez de la jeune fille de Génie. Si vous ne vous en servez pas plus de 12 ou 15 fois par mois, 60 francs me paraissent suffisants. Il faut compter entre 3 fr. et 5 fr. par soirée. Je suis toujours enrhumé. Le temps est détestable. Quand je pourrai prendre l’air à mon ordinaire, & un air un peu doux mon rhume s'en ira. Adieu. Adieu. G.
272. Val -Richer, Samedi 21 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
272 Du Val-Richer Samedi 21 sept. 1839 7 heures
Mon rhume, va mieux, malgré la pluie. Je n’ai pas toussé cette nuit.
La pluie m'ennuie plus que jamais à cause de mes hôtes. Ils ne savent que faire de leur journée et je ne veux pas leur donner toute la mienne. Je passe toujours ma matinée, d'une à 6 heures dans mon Cabinet. On a pu aller chasser hier quelques heures.
Je ne puis pas être inquiet sur l'Orient. Il me semble que Méhémet met de l'eau dans son vin, et tous les autres n'en ont pas besoin. C’est une question de temps. Nous retrouverons cette affaire-là dans trois ou quatre ans. Elle ne finira pas d'elle-même comme l'Espagne. D. Carlos me paraît bien à Bourges. C'est près de Valencay. Il sera là entre MM. Duvergier de Hauranne et Jaubert, tous deux députés et ce département tous deux habitant d’assez belles terres à quelques lieues de Bourges.
J’ai reçu hier une lettre de M. Duvergier de bien mauvaise humeur il finit en me disant : " Je ne sais quand recommenceront nos tristes séances, mais je désire que ce soit le plus tard possible. Au point où en sont les choses, je ne vois rien de bon à faire et je suis fatigué du mauvais. " Je ne sais si M. Jaubert arrivera plus gracieux de Constantinople. Vous serez la première à en savoir des nouvelles. Quand M. de Jennison quitte-t-il l’entresol ?
Vous ne me l’avez pas dit. Entendez-vous parler des affaires de Suisse ? Je m’y intéresse. Je suis curieux de voir aller jusqu'au bout cette expérience radicale. J’entends dire aux gens sensés que l'impossibilité absolue de gouverner, même un si petit pays à de telles conditions deviendra telle qu’il y faudra renoncer. Tcham est l'homme du monde de qui vous en apprendrez le moins. Il a l’air non pas de cacher les affaires de Suisse, mais de s'en cacher.
9 heures et demie
D. Carlos demande déjà à sortir de France. Il annonce l’intention d’aller vivre avec sa famille à Salzbourg. M. de Metternich aurait une volière de prétendants. Je ne pense pas qu’on se hâte de prendre un parti sur la demande de D. Carlos. Je suis bien aise que Bulwer écrive une vie de Canning puisqu'il a de l’esprit. Mais vous avez toute raison de ne pas lui livrer vos papiers. Soyez assez bonne pour lui demander de ma part l’indication de ce qu’il y a de mieux sur la vie et l'histoire de Lord Chatam, le grand Chatam. Je n’ai rien vu qui me satisfît.
Adieu. Adieu. Que vous faites-vous lire par votre petite fille? Adieu. G.
Mon rhume, va mieux, malgré la pluie. Je n’ai pas toussé cette nuit.
La pluie m'ennuie plus que jamais à cause de mes hôtes. Ils ne savent que faire de leur journée et je ne veux pas leur donner toute la mienne. Je passe toujours ma matinée, d'une à 6 heures dans mon Cabinet. On a pu aller chasser hier quelques heures.
Je ne puis pas être inquiet sur l'Orient. Il me semble que Méhémet met de l'eau dans son vin, et tous les autres n'en ont pas besoin. C’est une question de temps. Nous retrouverons cette affaire-là dans trois ou quatre ans. Elle ne finira pas d'elle-même comme l'Espagne. D. Carlos me paraît bien à Bourges. C'est près de Valencay. Il sera là entre MM. Duvergier de Hauranne et Jaubert, tous deux députés et ce département tous deux habitant d’assez belles terres à quelques lieues de Bourges.
J’ai reçu hier une lettre de M. Duvergier de bien mauvaise humeur il finit en me disant : " Je ne sais quand recommenceront nos tristes séances, mais je désire que ce soit le plus tard possible. Au point où en sont les choses, je ne vois rien de bon à faire et je suis fatigué du mauvais. " Je ne sais si M. Jaubert arrivera plus gracieux de Constantinople. Vous serez la première à en savoir des nouvelles. Quand M. de Jennison quitte-t-il l’entresol ?
Vous ne me l’avez pas dit. Entendez-vous parler des affaires de Suisse ? Je m’y intéresse. Je suis curieux de voir aller jusqu'au bout cette expérience radicale. J’entends dire aux gens sensés que l'impossibilité absolue de gouverner, même un si petit pays à de telles conditions deviendra telle qu’il y faudra renoncer. Tcham est l'homme du monde de qui vous en apprendrez le moins. Il a l’air non pas de cacher les affaires de Suisse, mais de s'en cacher.
9 heures et demie
D. Carlos demande déjà à sortir de France. Il annonce l’intention d’aller vivre avec sa famille à Salzbourg. M. de Metternich aurait une volière de prétendants. Je ne pense pas qu’on se hâte de prendre un parti sur la demande de D. Carlos. Je suis bien aise que Bulwer écrive une vie de Canning puisqu'il a de l’esprit. Mais vous avez toute raison de ne pas lui livrer vos papiers. Soyez assez bonne pour lui demander de ma part l’indication de ce qu’il y a de mieux sur la vie et l'histoire de Lord Chatam, le grand Chatam. Je n’ai rien vu qui me satisfît.
Adieu. Adieu. Que vous faites-vous lire par votre petite fille? Adieu. G.
273. Val-Richer, Dimanche 22 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
273 Du Val-Richer, Dimanche 22 Sept 1839 7 heures
Je viens à vous en me levant. Quand j'ai du monde, je ne dispose pas de ma soirée. Elle n'est pas amusante, savez-vous à quelle condition on supporte le commun des hommes ? à condition d'avoir quelque chose à en faire. Quand on les emploie, quand on va a un but à la bonne heure ; le but anime la route, l'utilité enfante l’intérêt. Mais le vulgaire pour rien, pour s’en amuser, et pour l'amuser ! C’est bien lourd.
J’ai là sous les yeux quelque chose de bien lourd aussi ; un jeune ménage, marié depuis deux mois, une jeune femme de 19 ans, ni laide, ni jolie, ni spirituelle, ni bête, ni glacée, ni animée, parfaitement insignifiante, ordinaire, une jeune femme, rien de moins, rien de plus. Comment se marie-t-on à cela ? Le vulgaire en passant dans un salon, c’est beaucoup ; mais le vulgaire dans l’intimité, pour toujours ! Je n'ai jamais compris qu’on s'y résignât. J’aurais été à ce compte, un bien mauvais mari.
Le Roi des Pays-Bas sera-t-il un bon mari pour Melle d’Outremont ? Il me semble qu’il était, pour la première, assez dur et peu fidèle. celle-ci aura, je pense, les infidélités de moins à subir. Je crois, comme vous, que dans la disposition de tout le monde, peu ou beaucoup de vaisseaux aux Dardanelles, c'est fort la même chose. Pourquoi ne se le dit-on pas, comme nous le disons ? Mais il faut être prêt les uns contre les autres, même quand on marche ensemble. Que sait-on ? Le hasard !
Voici ce que m'écrit hier un ministre. " Le Rois, m’a parlé hier de vous, fortement avec un vif désir de votre appui, et un sentiment très profond de tout ce que vous êtes. Pour moi, mon cher ami, qui n’ai qu'une petite responsabilité & un médiocre souci de moi-même, l’honneur sauf, je n’en attends pas moins la session avec une grave anxiété. L'affaire d’Espagne est un accident heureux et un mérite. Mais la Turquie nous reste avec tous ses hasards ; et il me semble cependant qu'avec cette intention de paix qui est générale et que doit partager un souverain prudent et conséquent, tout absolu qu’il est, une ambassade habile et active serait d’un poids immense, et pourrait prévenir ce qui deviendra peut-être inévitable, sans que personne le veuille, mais parce que personne ne saurait le détourner à temps. Je suis un faible politique, mais je n'ai pas une autre pensée que celle-là dans le temps actuel. "
Vous voyez qu’on a toujours bien envie, de m'avoir et de m'éloigner. On ne fera ni l’un ni l’autre. Lisez, dans le dernier cahier de la Revue des deux mondes (15 septembre) un long article sur le Duc de Wellington, à l'occasion de ses dépêches. Il vous intéressera. C’est un assez curieux spectacle que ce vent d’impartialité qui souffle sur nous et nous fait rendre justice contre le sentiment populaire si cela s'accorde jamais avec un fort esprit national, ce sera très beau.
C’est Pascal, je crois, qui dit : " je n'estime point un homme qui possède une vertu, s’il ne possède en même temps et au même degré, la vertu contraire. " Il a raison. Mais c’est bien de l’exigence. A la vérité on n'obtient rien de bon des hommes qu'à force d’exigence.
9 heures et demie
C’est bien vrai que vos soirées et les miennes, vous chez Armin, moi avec mon jeune ménage, c’est absurde ! Et nous serions si bien ! Il n’y a point de nouvelles. Je vous dis tout ce qu’on m’écrit. On est fort occupé des émeutes du Mans de la réforme du Conseil d'Etat & Tout cela ne vous fait rien. Vous avez raison de bien finir l’affaire de l'entresol. Il n'y a point de sûreté avec ce monde là. Adieu. Adieu. Le plus long adieu possible. Il n'y a de long que ce qui est éternel. G.
Je viens à vous en me levant. Quand j'ai du monde, je ne dispose pas de ma soirée. Elle n'est pas amusante, savez-vous à quelle condition on supporte le commun des hommes ? à condition d'avoir quelque chose à en faire. Quand on les emploie, quand on va a un but à la bonne heure ; le but anime la route, l'utilité enfante l’intérêt. Mais le vulgaire pour rien, pour s’en amuser, et pour l'amuser ! C’est bien lourd.
J’ai là sous les yeux quelque chose de bien lourd aussi ; un jeune ménage, marié depuis deux mois, une jeune femme de 19 ans, ni laide, ni jolie, ni spirituelle, ni bête, ni glacée, ni animée, parfaitement insignifiante, ordinaire, une jeune femme, rien de moins, rien de plus. Comment se marie-t-on à cela ? Le vulgaire en passant dans un salon, c’est beaucoup ; mais le vulgaire dans l’intimité, pour toujours ! Je n'ai jamais compris qu’on s'y résignât. J’aurais été à ce compte, un bien mauvais mari.
Le Roi des Pays-Bas sera-t-il un bon mari pour Melle d’Outremont ? Il me semble qu’il était, pour la première, assez dur et peu fidèle. celle-ci aura, je pense, les infidélités de moins à subir. Je crois, comme vous, que dans la disposition de tout le monde, peu ou beaucoup de vaisseaux aux Dardanelles, c'est fort la même chose. Pourquoi ne se le dit-on pas, comme nous le disons ? Mais il faut être prêt les uns contre les autres, même quand on marche ensemble. Que sait-on ? Le hasard !
Voici ce que m'écrit hier un ministre. " Le Rois, m’a parlé hier de vous, fortement avec un vif désir de votre appui, et un sentiment très profond de tout ce que vous êtes. Pour moi, mon cher ami, qui n’ai qu'une petite responsabilité & un médiocre souci de moi-même, l’honneur sauf, je n’en attends pas moins la session avec une grave anxiété. L'affaire d’Espagne est un accident heureux et un mérite. Mais la Turquie nous reste avec tous ses hasards ; et il me semble cependant qu'avec cette intention de paix qui est générale et que doit partager un souverain prudent et conséquent, tout absolu qu’il est, une ambassade habile et active serait d’un poids immense, et pourrait prévenir ce qui deviendra peut-être inévitable, sans que personne le veuille, mais parce que personne ne saurait le détourner à temps. Je suis un faible politique, mais je n'ai pas une autre pensée que celle-là dans le temps actuel. "
Vous voyez qu’on a toujours bien envie, de m'avoir et de m'éloigner. On ne fera ni l’un ni l’autre. Lisez, dans le dernier cahier de la Revue des deux mondes (15 septembre) un long article sur le Duc de Wellington, à l'occasion de ses dépêches. Il vous intéressera. C’est un assez curieux spectacle que ce vent d’impartialité qui souffle sur nous et nous fait rendre justice contre le sentiment populaire si cela s'accorde jamais avec un fort esprit national, ce sera très beau.
C’est Pascal, je crois, qui dit : " je n'estime point un homme qui possède une vertu, s’il ne possède en même temps et au même degré, la vertu contraire. " Il a raison. Mais c’est bien de l’exigence. A la vérité on n'obtient rien de bon des hommes qu'à force d’exigence.
9 heures et demie
C’est bien vrai que vos soirées et les miennes, vous chez Armin, moi avec mon jeune ménage, c’est absurde ! Et nous serions si bien ! Il n’y a point de nouvelles. Je vous dis tout ce qu’on m’écrit. On est fort occupé des émeutes du Mans de la réforme du Conseil d'Etat & Tout cela ne vous fait rien. Vous avez raison de bien finir l’affaire de l'entresol. Il n'y a point de sûreté avec ce monde là. Adieu. Adieu. Le plus long adieu possible. Il n'y a de long que ce qui est éternel. G.
274. Val-Richer, Lundi 23 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
274 Du Val Richer. Lundi 23 Sept 1839, 8 heures et demie
Je sors tard de mon lit quoique je me sois couché hier de très bonne heure. J'étais fatigué. Au rhume, qui dure encore un peu, s’était jointe la migraine. Le sommeil est ma ressource. Je ne sais si je la conserverai toujours ; mais je l'ai encore. J’ai beaucoup dormi. Je suis bien ce matin. Il fait beau. Le soleil brille. Je me sens en bonne et forte disposition. Quelles mobiles créatures nous sommes, et que les spectateurs qui nous entourent se doutent peu des agitations, des faiblesses, des innombrables vicissitudes, intérieures par lesquelles nous passons !
Si les propositions de D. Carlos sont telles qu’on le dit, elles me paraissent acceptables. Pourvu qu’il ne réserve que ses droits éventuels, en cas d’extinction de la lignée de la Reine Isabelle, masculine et féminine, et que sa renonciation à ses droits actuels, pour lui et les siens, soit bien claires, bien complète. Pourvu aussi que le gouvernement de Madrid y consente, et soit partie contractante dans l’arrangement. A ces conditions l'affaire me paraît finie, autant quelle peut l'être. Et si D. Carlos accepte tout cela, j'ai peine à voir à quel litre et par qu’elle raison on ne le laisserait pas vivre où il voudra même en Autriche, le Capharnaüm, des Prétendants. Nous sommes un grand exemple de l’état ou jettent les grands excès. Il y a cent ans, l’Europe aurait vécu au moins six mois sur un événement comme la chute de D. Carlos. Il y aurait eu là, pendant longtemps, de la pâture pour les esprits, les réflexions, les conversations, les correspondances. Figurez-vous tout ce que M. de St. Simon y aurait vu et fait voir. Aujourd’hui, nous avons tant vu, tant vu que nos yeux sont las et comme hébétés. Nous regardons à peine les plus grosses choses. Je suis sûr que, s’il ne survient point d’incident nouveau dans quinze jours, à Bourges même, D. Carlos vivra sans qu'on pense à lui.
Voilà mon ami, et le vôtre, d’Haubersaert conseiller d'’Etat. Il le désirait beaucoup et on me l’avait promis. Cette nomination de Conseillers d'Etat est une image fidèle du chaos général. On en a donné un à Thiers, un à moi, trois aux 221, trois aux 213. Et tout le monde sera content. Personne n'est difficile. Les troubles pour les grains, sans être sérieux peuvent devenir gaves et embarrassants. Décidément, les récoltes sont insuffisantes ; le pain est déjà cher et renchérira. La crise industrielle se prolonge. L’Angleterre en souffre encore plus que nous. L’hiver s’annonce mal. Si, par dessus le marché, il est froid, la détresse sera réelle.
Le parti radical, devenu parti Buonapartiste, s’agite beaucoup pour remuer le peuple. Il ne peut que cela, mais il peut cela.
9 heures 3/4
Si je commençais, je ne tarirais pas sur votre famille. Je n’ai jamais rien imaginé de pareil. Je vous renverrai demain la lettre de votre sœur. Il me faut bien la journée pour la lire. Je ne comprends pas grand chose, à la lettre de Benkhausen. Je suppose que lorsqu'il aura en main votre signature apposée aux letters of administration, vos plein pouvoirs à votre frère seront considérés comme suffisants, et que celui-ci fera alors toucher, en votre nom, par un délégué de lui, peut-être par Paul lui-même. Il vaudrait beaucoup mieux en effet ne pas faire ce tour du monde, et faire tout simplement toucher, en votre nom, par votre banquier qui remettra à vos fils leur part. Cela est bien plus simple. Vous pourriez, ce me semble, mander cela à Benkhausen. Je ne vois pas quelle objection il y pourrait faire. Vous êtes bien la maîtresse de donner vos pleins, pouvoirs à qui vous voulez, pour cette affaire spéciale ; et il est bien naturel que vous les donniez directement à votre banquier de Londres qui touchera, plutôt qu'à votre père de Pétersbourg qui sera obligé de les déléguer et de faire toucher, par un autre, vous ne savez pas qu' il est évident que vous ne sauriez prendre trop de précautions. Pourquoi, n'aurez-vous pas de vaisselle ? Dans le quart du mobilier qui vous revient de droit vous pouvez toujours prendre ce que vous voulez, au prix d'estimation. Adieu. Adieu. Vous dîtes bien, toutes ces horreurs. Adieu, dearest. G.
Je sors tard de mon lit quoique je me sois couché hier de très bonne heure. J'étais fatigué. Au rhume, qui dure encore un peu, s’était jointe la migraine. Le sommeil est ma ressource. Je ne sais si je la conserverai toujours ; mais je l'ai encore. J’ai beaucoup dormi. Je suis bien ce matin. Il fait beau. Le soleil brille. Je me sens en bonne et forte disposition. Quelles mobiles créatures nous sommes, et que les spectateurs qui nous entourent se doutent peu des agitations, des faiblesses, des innombrables vicissitudes, intérieures par lesquelles nous passons !
Si les propositions de D. Carlos sont telles qu’on le dit, elles me paraissent acceptables. Pourvu qu’il ne réserve que ses droits éventuels, en cas d’extinction de la lignée de la Reine Isabelle, masculine et féminine, et que sa renonciation à ses droits actuels, pour lui et les siens, soit bien claires, bien complète. Pourvu aussi que le gouvernement de Madrid y consente, et soit partie contractante dans l’arrangement. A ces conditions l'affaire me paraît finie, autant quelle peut l'être. Et si D. Carlos accepte tout cela, j'ai peine à voir à quel litre et par qu’elle raison on ne le laisserait pas vivre où il voudra même en Autriche, le Capharnaüm, des Prétendants. Nous sommes un grand exemple de l’état ou jettent les grands excès. Il y a cent ans, l’Europe aurait vécu au moins six mois sur un événement comme la chute de D. Carlos. Il y aurait eu là, pendant longtemps, de la pâture pour les esprits, les réflexions, les conversations, les correspondances. Figurez-vous tout ce que M. de St. Simon y aurait vu et fait voir. Aujourd’hui, nous avons tant vu, tant vu que nos yeux sont las et comme hébétés. Nous regardons à peine les plus grosses choses. Je suis sûr que, s’il ne survient point d’incident nouveau dans quinze jours, à Bourges même, D. Carlos vivra sans qu'on pense à lui.
Voilà mon ami, et le vôtre, d’Haubersaert conseiller d'’Etat. Il le désirait beaucoup et on me l’avait promis. Cette nomination de Conseillers d'Etat est une image fidèle du chaos général. On en a donné un à Thiers, un à moi, trois aux 221, trois aux 213. Et tout le monde sera content. Personne n'est difficile. Les troubles pour les grains, sans être sérieux peuvent devenir gaves et embarrassants. Décidément, les récoltes sont insuffisantes ; le pain est déjà cher et renchérira. La crise industrielle se prolonge. L’Angleterre en souffre encore plus que nous. L’hiver s’annonce mal. Si, par dessus le marché, il est froid, la détresse sera réelle.
Le parti radical, devenu parti Buonapartiste, s’agite beaucoup pour remuer le peuple. Il ne peut que cela, mais il peut cela.
9 heures 3/4
Si je commençais, je ne tarirais pas sur votre famille. Je n’ai jamais rien imaginé de pareil. Je vous renverrai demain la lettre de votre sœur. Il me faut bien la journée pour la lire. Je ne comprends pas grand chose, à la lettre de Benkhausen. Je suppose que lorsqu'il aura en main votre signature apposée aux letters of administration, vos plein pouvoirs à votre frère seront considérés comme suffisants, et que celui-ci fera alors toucher, en votre nom, par un délégué de lui, peut-être par Paul lui-même. Il vaudrait beaucoup mieux en effet ne pas faire ce tour du monde, et faire tout simplement toucher, en votre nom, par votre banquier qui remettra à vos fils leur part. Cela est bien plus simple. Vous pourriez, ce me semble, mander cela à Benkhausen. Je ne vois pas quelle objection il y pourrait faire. Vous êtes bien la maîtresse de donner vos pleins, pouvoirs à qui vous voulez, pour cette affaire spéciale ; et il est bien naturel que vous les donniez directement à votre banquier de Londres qui touchera, plutôt qu'à votre père de Pétersbourg qui sera obligé de les déléguer et de faire toucher, par un autre, vous ne savez pas qu' il est évident que vous ne sauriez prendre trop de précautions. Pourquoi, n'aurez-vous pas de vaisselle ? Dans le quart du mobilier qui vous revient de droit vous pouvez toujours prendre ce que vous voulez, au prix d'estimation. Adieu. Adieu. Vous dîtes bien, toutes ces horreurs. Adieu, dearest. G.
275. Val -Richer, Mardi 24 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
275 Du Val-Richer, mardi 24 Sept. 1839 7 heures
Je croyais avoir le talent de tout lire. Vous me coûtez la perte de cette illusion. En retour vous me faites connaitre un singulier monde. Sous Louis 14 même sous Louis 15 beaucoup de femmes, de très bonne compagnie, ne savaient pas l'Orthographe ; ma belle-mère Mad. de Meulan était encore de ce nombre ; mais elles étaient spirituelles, élégantes ; à travers l’irrégularité de leurs phrases elles avaient le cour d’esprit fois, délicat ; la grande civilisation était partout, excepté dans leur grammaire.
Cuisinière au fond et dans la forme, c’est drôle pour votre sœur ; passez moi la brutalité de l’expression. Du reste, à force d’étude, j’ai tout lu, excepté les mots que j’ai soulignés. Ayez la bonté de m'en envoyer l’interprétation pour que la peine que j’y ai prise ne soit pas tout-à- fait perdue.
Je suis curieux de savoir comment on s'y prendra pour vous empêcher d'avoir l’argenterie qui vous convient, quand vous ne la demandez qu'en en payant la valeur, au taux de l'estimation. Est-ce que Paul veut aussi l'avoir et l'emporter en Angleterre ? Je vois qu’on trouve tout simple, votre frère même, qu’il ait donné sa démission. Je suppose que c’est la nomination de M. de Brünnow qui l'a déterminé et lui sert d'excuse auprès des moins rebelles. Plus j’y pense, plus il me semble que puisque vous avez demandé les letters of adm., ce que vous avez de mieux à faire, c’est de donner vos pleins pouvoirs à Rothschild, et de faire toucher, par lui, le capital, quand vos fils seront arrivés, à Londres, de telle sorte que jusqu'à leur retour l’argent reste où il est, et que vous et eux, vous touchiez chacun votre part au même moment, mais par votre fondé de pouvoirs direct. Il n'y a là, si je ne me trompe, rien à dire pour personne. Et c’est plus sûr.
9h 1/2
Il me paraît impossible que Démion soit menteur à ce point. Il n’a point d’intérêt commun avec M. de Jénnison. Son intérêt à lui, c’est que vous ayez l’appartement. Vous êtes un bon locataire. Vous me direz cela demain. Certainement, si j'étais là, vous auriez l’appartement. Vous auriez tout ce qui vous plairait. Dîtes-le moi toujours. Je suis charmé de le croire.
Adieu. Adieu. J’ai deux lettres d'affaire à répondre sur le champ. Adieu. G.
Je croyais avoir le talent de tout lire. Vous me coûtez la perte de cette illusion. En retour vous me faites connaitre un singulier monde. Sous Louis 14 même sous Louis 15 beaucoup de femmes, de très bonne compagnie, ne savaient pas l'Orthographe ; ma belle-mère Mad. de Meulan était encore de ce nombre ; mais elles étaient spirituelles, élégantes ; à travers l’irrégularité de leurs phrases elles avaient le cour d’esprit fois, délicat ; la grande civilisation était partout, excepté dans leur grammaire.
Cuisinière au fond et dans la forme, c’est drôle pour votre sœur ; passez moi la brutalité de l’expression. Du reste, à force d’étude, j’ai tout lu, excepté les mots que j’ai soulignés. Ayez la bonté de m'en envoyer l’interprétation pour que la peine que j’y ai prise ne soit pas tout-à- fait perdue.
Je suis curieux de savoir comment on s'y prendra pour vous empêcher d'avoir l’argenterie qui vous convient, quand vous ne la demandez qu'en en payant la valeur, au taux de l'estimation. Est-ce que Paul veut aussi l'avoir et l'emporter en Angleterre ? Je vois qu’on trouve tout simple, votre frère même, qu’il ait donné sa démission. Je suppose que c’est la nomination de M. de Brünnow qui l'a déterminé et lui sert d'excuse auprès des moins rebelles. Plus j’y pense, plus il me semble que puisque vous avez demandé les letters of adm., ce que vous avez de mieux à faire, c’est de donner vos pleins pouvoirs à Rothschild, et de faire toucher, par lui, le capital, quand vos fils seront arrivés, à Londres, de telle sorte que jusqu'à leur retour l’argent reste où il est, et que vous et eux, vous touchiez chacun votre part au même moment, mais par votre fondé de pouvoirs direct. Il n'y a là, si je ne me trompe, rien à dire pour personne. Et c’est plus sûr.
9h 1/2
Il me paraît impossible que Démion soit menteur à ce point. Il n’a point d’intérêt commun avec M. de Jénnison. Son intérêt à lui, c’est que vous ayez l’appartement. Vous êtes un bon locataire. Vous me direz cela demain. Certainement, si j'étais là, vous auriez l’appartement. Vous auriez tout ce qui vous plairait. Dîtes-le moi toujours. Je suis charmé de le croire.
Adieu. Adieu. J’ai deux lettres d'affaire à répondre sur le champ. Adieu. G.
276. Val-Richer, Mercredi 25 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
276. Du Val Richer, Mercredi 25 sept. 1839
Mes hôtes me quittent ce matin. J’en suis bien aise. J’aime mieux la solitude que l'ennui des hommes. D'ailleurs, je parle de solitude, bien à mon aise au milieu d’une famille nombreuse, et animée, et qui m’aime. C’est curieux à quel point on se laisse aller à se servir des mots complaisamment pour soi-même et sans prendre la peine de regarder, s’ils sont vraiment vrais.
Je me séparerai aussi cette semaine de Washington. Je vais finir. A regret. C’est une grande âme, et qui a fait bien simplement de grandes choses par de grands motifs. J’ai pris plaisir à vivre en intimité avec lui.
Voici ce que m'écrit de Londres un jeune Dillon, homme d’esprit établi en France par mes soins et qui est allé y passer quinze jours. Il connait bien du monde.
I have been several influential Whigs who are unonimous in regarding their cause as in the atmost peril. The Tories must get into office within a very short space of time. They have been gaining ground slowly but surely within the last twelve monthes. Tthe blunders of L. Palm and the excesses of the Chartists have frightened many among the moderate Whigs into the arms of the Tories. The great and indeed, the only support of the Ministry are the Irish party and the court ; but both are, as you know, far from popular en England. The affair of Lady Flora Hastings, has decidebly brought the Queen into great national disreporter. It is almost needless to speak of the detestation in which O'Connell, the priests and the entire Irish party are held by the great bulk of the English and scotch people. It is a sort of phrenzy, the like of which has not bien witnessed since the days of the League or the Paritans. Really, were it not for a few scattered rays of the philosophy of the 18th century that occasionnally illumine the intellectual gloom ot the British Empire we should witness today scenes that have not been surpassed even by the Inquisition. The fanaticism of the Tories is not one bit greater, than that of their antagonists, tre Papists. Both would burn, main and crucify, il they could, as in the old orthodox times of Bonner or of King Edward. The Tories have great advantage, on their side. They have wealth, talent and political organization. They are, if we forget for a moment, the crudity of some of their political tonets an admirable model as a political party. Still, although, they seem destined to enjoy a passing triumph soon, they will, I feel convinced, be ultimately discomfited. O'Connell is a knotty block. He yields to none of the Tories, in energy, and he has proved himself latterly te be an able statesman. As he is hardened against defeats, 80 he is not likely to be intimidated by that with which he is now menaced. His cause is a good one, and he has behind him seven or eight millions of miserable but resolute zenlots in whose hands the British Constitution has latterly placed a formidable and destructive weapon. O'Connell backed by these will always be able to elog and retard the working of the British constitution. The English people who are not disposed to drive Ireland into open insurrection, will at length grow tired with these and similar embarrassments. They will seek again to remove them by destroying their cause, and a tardy justice will at length be rendered to Ireland.
En voilà bien long. J’ai fini parce que j’avais commencé. Mais pour un jeune Irlandais, ce n'est pas mal de pénétration, et de sens. 9 h. 1/2 Je suis charmé que vous ayez enfin ce bail. Et si Jennison ne veut rien vendre, ce ne sera que mieux. Vous vous meublerez tout-à-fait à votre gré. Plus le Cabinet deviendra radical, plus les Torys acquerront de chances. Adieu. Adieu. Je n’ai pas de soleil aujourd'hui. Mais l'adieu est le même. G.
Mes hôtes me quittent ce matin. J’en suis bien aise. J’aime mieux la solitude que l'ennui des hommes. D'ailleurs, je parle de solitude, bien à mon aise au milieu d’une famille nombreuse, et animée, et qui m’aime. C’est curieux à quel point on se laisse aller à se servir des mots complaisamment pour soi-même et sans prendre la peine de regarder, s’ils sont vraiment vrais.
Je me séparerai aussi cette semaine de Washington. Je vais finir. A regret. C’est une grande âme, et qui a fait bien simplement de grandes choses par de grands motifs. J’ai pris plaisir à vivre en intimité avec lui.
Voici ce que m'écrit de Londres un jeune Dillon, homme d’esprit établi en France par mes soins et qui est allé y passer quinze jours. Il connait bien du monde.
I have been several influential Whigs who are unonimous in regarding their cause as in the atmost peril. The Tories must get into office within a very short space of time. They have been gaining ground slowly but surely within the last twelve monthes. Tthe blunders of L. Palm and the excesses of the Chartists have frightened many among the moderate Whigs into the arms of the Tories. The great and indeed, the only support of the Ministry are the Irish party and the court ; but both are, as you know, far from popular en England. The affair of Lady Flora Hastings, has decidebly brought the Queen into great national disreporter. It is almost needless to speak of the detestation in which O'Connell, the priests and the entire Irish party are held by the great bulk of the English and scotch people. It is a sort of phrenzy, the like of which has not bien witnessed since the days of the League or the Paritans. Really, were it not for a few scattered rays of the philosophy of the 18th century that occasionnally illumine the intellectual gloom ot the British Empire we should witness today scenes that have not been surpassed even by the Inquisition. The fanaticism of the Tories is not one bit greater, than that of their antagonists, tre Papists. Both would burn, main and crucify, il they could, as in the old orthodox times of Bonner or of King Edward. The Tories have great advantage, on their side. They have wealth, talent and political organization. They are, if we forget for a moment, the crudity of some of their political tonets an admirable model as a political party. Still, although, they seem destined to enjoy a passing triumph soon, they will, I feel convinced, be ultimately discomfited. O'Connell is a knotty block. He yields to none of the Tories, in energy, and he has proved himself latterly te be an able statesman. As he is hardened against defeats, 80 he is not likely to be intimidated by that with which he is now menaced. His cause is a good one, and he has behind him seven or eight millions of miserable but resolute zenlots in whose hands the British Constitution has latterly placed a formidable and destructive weapon. O'Connell backed by these will always be able to elog and retard the working of the British constitution. The English people who are not disposed to drive Ireland into open insurrection, will at length grow tired with these and similar embarrassments. They will seek again to remove them by destroying their cause, and a tardy justice will at length be rendered to Ireland.
En voilà bien long. J’ai fini parce que j’avais commencé. Mais pour un jeune Irlandais, ce n'est pas mal de pénétration, et de sens. 9 h. 1/2 Je suis charmé que vous ayez enfin ce bail. Et si Jennison ne veut rien vendre, ce ne sera que mieux. Vous vous meublerez tout-à-fait à votre gré. Plus le Cabinet deviendra radical, plus les Torys acquerront de chances. Adieu. Adieu. Je n’ai pas de soleil aujourd'hui. Mais l'adieu est le même. G.
277. Val-Richer, Jeudi 26 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
277 Du Val-Richer, jeudi 26 sept 1839 9 heures
Je me lève. J’ai eu hier un redoublement de mal de gorge et de toux. Je suis resté tard dans mon lit en moiteur. Je me sens mieux ; mais j'en ai encore pour quelques jours. Il faut bien avoir sa part de mal, en tout genre. Je mange peu, je bois chaud, j'évite l'humidité et je pense à vous.
Vous devez avoir l’entresol au 15 oct. ne le payez à partir de cette époque là que si on vous le remet effectivement. Votre damas rouge trouvera-t-il sa place ? Vous ne devez, pour vos arrangements avoir besoin que du tapissier. Je suppose qu’il n’y a rien à faire du tout dans l’appartement.
On dit que Mlle Rachel a tout-à-fait enlevé le Duc de Noailles, à Mad. de Talleyrand. Voilà Mlle Rachel malade. Il reviendra peut-être.
Mes nouvelles d'Orient sont plus à la paix que jamais. Elles n’ont jamais été ailleurs. Nous cherchons ce que Méhémet Ali peut rendre à la Porte en gardant, héréditairement l’Egypte et la Syrie. Nous voulons qu’il rende quelque chose. Nous trouverons quoi. Nous sommes plus contents de l’Autriche. Que de va et vient inutiles ! Mais il faut bien que les hommes s'amusent, même les Rois.
Champlâtreux vous aura plu. C’est un beau lieu, grand, simple et tranquille. J’y suis allé dîner, il y a quelques onze ou douze ans, avec M. de Talleyrand. C’était trop pauvrement meublé. Mais M. Molé l’a fait arranger, je crois, pour la visite du Roi. Le tableau du Conseil y est-il installé ? Il est bien mauvais.
10 heures
Je ne vous en dis pas davantage aujourd’hui. Le courrier m’apporte trois ou quatre lettres auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Adieu, Adieu. Génie m'écrit une longue lettre. Je suis fort au courant de votre bail. De loin. Mad. de Talleyrand, qui lui fait concurrence à cet égard, me dit-il, lui parait un très habile, clerc de notaire. Adieu Paul a bien fait. C'est inconcevable. G.
Je me lève. J’ai eu hier un redoublement de mal de gorge et de toux. Je suis resté tard dans mon lit en moiteur. Je me sens mieux ; mais j'en ai encore pour quelques jours. Il faut bien avoir sa part de mal, en tout genre. Je mange peu, je bois chaud, j'évite l'humidité et je pense à vous.
Vous devez avoir l’entresol au 15 oct. ne le payez à partir de cette époque là que si on vous le remet effectivement. Votre damas rouge trouvera-t-il sa place ? Vous ne devez, pour vos arrangements avoir besoin que du tapissier. Je suppose qu’il n’y a rien à faire du tout dans l’appartement.
On dit que Mlle Rachel a tout-à-fait enlevé le Duc de Noailles, à Mad. de Talleyrand. Voilà Mlle Rachel malade. Il reviendra peut-être.
Mes nouvelles d'Orient sont plus à la paix que jamais. Elles n’ont jamais été ailleurs. Nous cherchons ce que Méhémet Ali peut rendre à la Porte en gardant, héréditairement l’Egypte et la Syrie. Nous voulons qu’il rende quelque chose. Nous trouverons quoi. Nous sommes plus contents de l’Autriche. Que de va et vient inutiles ! Mais il faut bien que les hommes s'amusent, même les Rois.
Champlâtreux vous aura plu. C’est un beau lieu, grand, simple et tranquille. J’y suis allé dîner, il y a quelques onze ou douze ans, avec M. de Talleyrand. C’était trop pauvrement meublé. Mais M. Molé l’a fait arranger, je crois, pour la visite du Roi. Le tableau du Conseil y est-il installé ? Il est bien mauvais.
10 heures
Je ne vous en dis pas davantage aujourd’hui. Le courrier m’apporte trois ou quatre lettres auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Adieu, Adieu. Génie m'écrit une longue lettre. Je suis fort au courant de votre bail. De loin. Mad. de Talleyrand, qui lui fait concurrence à cet égard, me dit-il, lui parait un très habile, clerc de notaire. Adieu Paul a bien fait. C'est inconcevable. G.
278. Val-Richer, Vendredi 27 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
278 Du Val-Richer, Vendredi 27 sept 1839 8 h 3/4
Je vous écris de mon lit. Non que je sois plus souffrant ; mais hier je me suis trouvé bien d'y être resté quelques heures, et on a voulu que j'en fisse autant aujourd'hui. Je tousse moins et je n’ai presque plus d'oppression. Quand je suis fatigué, mal à l’aise, enfoncé dans mon fauteuil, que vous me seriez douce ! Que votre voix me rafraîchirait la poitrine. Pourtant j’aimerais encore mieux être auprès de vous quand c’est vous qui souffrez.
Génie me mande qu’il vous trouve mieux que les premiers jours où il vous a vue. Il dit que Mad. de Talleyrand vous instruit fort bien sur l'imposition personnelle et mobilière, et qu’il vous a envoyé M. de Valcour dont vous êtes contente. Servez-vous de lui pour que votre tapissier ne vous vole pas trop. Je vous garantis deux choses sur mon monde, leur honnêteté et leur dévouement. J’ai la passion des honnêtes gens et de l'affection, dans tous les états et pour tous les emplois.
Je ne vous parle pas de la pauvre dépêche de Sébastiani. Vous la savez. Le Roi me fait demander où je désire qu’il m'envoie un service de porcelaine qu’il me destine, à Paris ou à la campagne. Je réponds à la campagne. C'est le premier présent que je lui aie vu faire excepté le tableau de Champlâtreux. N'en parlez pas jusqu'à ce qu’il soit arrivé.
Soupçonnez-vous quelque chose du motif de l'Empereur, en rayant votre fils ? Ce ne peut-être à cause de vous. Il l’avait si bien reçu d'abord ! Et puis Paul n’est pas vous aujourd'hui. Il faut qu’il y ait quelque chose de personnel à Paul, quelque propos.
Nous offrons, pour Méhémet, la restitution immédiate du district d'Adana à la Porte et celle de Candie après la mort de Méhémet. Mais nous tenons à la Syrie, et Méhénet me paraît y tenir encore mieux que nous. Il a raison. C’est toujours lui qui a droit de paix et de guerre sur l’Europe.
Vous vous êtes trompé sur le n° de votre lettre de Mercredi. C’est 272 et non 273. Je vais me lever.
10 h. Vos renseignements sur notre pacification d'Orient ne sont pas tout-à-fait d'accord avec les miens. Vous pourriez bien avoir raison. On est sur cette pente là. Rien n'empêche adieu. J’ai le soleil aussi ce matin. Adieu. Adieu.
Je vous écris de mon lit. Non que je sois plus souffrant ; mais hier je me suis trouvé bien d'y être resté quelques heures, et on a voulu que j'en fisse autant aujourd'hui. Je tousse moins et je n’ai presque plus d'oppression. Quand je suis fatigué, mal à l’aise, enfoncé dans mon fauteuil, que vous me seriez douce ! Que votre voix me rafraîchirait la poitrine. Pourtant j’aimerais encore mieux être auprès de vous quand c’est vous qui souffrez.
Génie me mande qu’il vous trouve mieux que les premiers jours où il vous a vue. Il dit que Mad. de Talleyrand vous instruit fort bien sur l'imposition personnelle et mobilière, et qu’il vous a envoyé M. de Valcour dont vous êtes contente. Servez-vous de lui pour que votre tapissier ne vous vole pas trop. Je vous garantis deux choses sur mon monde, leur honnêteté et leur dévouement. J’ai la passion des honnêtes gens et de l'affection, dans tous les états et pour tous les emplois.
Je ne vous parle pas de la pauvre dépêche de Sébastiani. Vous la savez. Le Roi me fait demander où je désire qu’il m'envoie un service de porcelaine qu’il me destine, à Paris ou à la campagne. Je réponds à la campagne. C'est le premier présent que je lui aie vu faire excepté le tableau de Champlâtreux. N'en parlez pas jusqu'à ce qu’il soit arrivé.
Soupçonnez-vous quelque chose du motif de l'Empereur, en rayant votre fils ? Ce ne peut-être à cause de vous. Il l’avait si bien reçu d'abord ! Et puis Paul n’est pas vous aujourd'hui. Il faut qu’il y ait quelque chose de personnel à Paul, quelque propos.
Nous offrons, pour Méhémet, la restitution immédiate du district d'Adana à la Porte et celle de Candie après la mort de Méhémet. Mais nous tenons à la Syrie, et Méhénet me paraît y tenir encore mieux que nous. Il a raison. C’est toujours lui qui a droit de paix et de guerre sur l’Europe.
Vous vous êtes trompé sur le n° de votre lettre de Mercredi. C’est 272 et non 273. Je vais me lever.
10 h. Vos renseignements sur notre pacification d'Orient ne sont pas tout-à-fait d'accord avec les miens. Vous pourriez bien avoir raison. On est sur cette pente là. Rien n'empêche adieu. J’ai le soleil aussi ce matin. Adieu. Adieu.
279. Val-Richer, Samedi 28 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
279 Du Val-Richer, samedi 28 sept 1839 9 heures
e vous écris encore de mon lit, et dans une telle moiteur qu’il n’y a pas moyen de vous écrire plus de quatre lignes. On veut absolument que je rentre mes bras. J’ai très bien dormi. Mes nuits sont fort bonnes. Mais ce matin je tousse et je crois bien que quelques heures de lit feront finir cela plutôt.
J'ai demain une fatigue et un grand ennui ; un déjeuner de vingt leaders électoraux Ils sont invités depuis quinze jours. Il n’y à pas moyen d’y échapper. Je les laisserai se promener, sans moi dans le jardin car il pleut et il pleuvra. Mais dans ce pays-ci on se promène à pied comme vous en calèche sous la pluie. Voilà votre n° 275. Je suis bien aise que vous ayez signé, et que Génie vous ait bien défendue. Démion voulait vous avoir à sa discrétion. Décidément, je rentre mes bras. Je crois très bons les soins que vous me prescrivez pour la gorge, et j'en userai dès que je ne tousserai plus. Adieu. Adieu. G.
e vous écris encore de mon lit, et dans une telle moiteur qu’il n’y a pas moyen de vous écrire plus de quatre lignes. On veut absolument que je rentre mes bras. J’ai très bien dormi. Mes nuits sont fort bonnes. Mais ce matin je tousse et je crois bien que quelques heures de lit feront finir cela plutôt.
J'ai demain une fatigue et un grand ennui ; un déjeuner de vingt leaders électoraux Ils sont invités depuis quinze jours. Il n’y à pas moyen d’y échapper. Je les laisserai se promener, sans moi dans le jardin car il pleut et il pleuvra. Mais dans ce pays-ci on se promène à pied comme vous en calèche sous la pluie. Voilà votre n° 275. Je suis bien aise que vous ayez signé, et que Génie vous ait bien défendue. Démion voulait vous avoir à sa discrétion. Décidément, je rentre mes bras. Je crois très bons les soins que vous me prescrivez pour la gorge, et j'en userai dès que je ne tousserai plus. Adieu. Adieu. G.
280. Val-Richer, Samedi 28 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
280 Du Val Richer, samedi 28 sept 1839 5 heures
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
281. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
281 Du Val Richer. Lundi 30 sept. 1839 9 heures
Je me sens beaucoup mieux ce matin. C’est une singulière chose que la rapidité avec laquelle ce mal de gorge m’envahit s’établit, semble près de devenir une maladie et s'en va. Je suis persuadé qu’en y prenant un peu garde, dans trois ou quatre jours, il n’en sera plus question. Mais c’est bien décidément mon mal.
Je sais peut-être moins de détails que vous sur l'Orient. Quand les affaires ne vont pas à leur satisfaction, ils m'en instruisent plus laconiquement surtout quand l’événement confirme mes avis. J’ai reçu cependant ces jours-ci deux lettres qui sont d'accord avec ce que vous me dites. Mais vous aussi vous êtes trop loin. Deux heures de conversation toutes les semaines nous seraient bien nécessaires. A vous dire vrai, je ne me préoccupe pas beaucoup de cette affaire là quant à présent. Deux choses seules m'importent ; la paix pour le moment, le fond de la question pour l'avenir ; la paix ne sera pas troublée, ni la question au fond résolue. Je tiens l’un et l’autre pour certain. Il ne sortira de tout ceci qu’un ajournement pacifique. Que l’ajournement soit plus ou moins digne, plus ou moins habile, qu’il en résulte plus ou moins de gloire pour les manipulateurs, il m'importe assez peu. Je ne m'étonne pas que Mad. de Castellane vous choque. Elle n'a point de mesure dans la flatterie. Là est la limite de son esprit et le côté subalterne de sa nature. Du reste, rien n'est plus rare aujourd'hui parmi nous que le tact des limites. En toutes choses, nous sommes toujours en deçà ou au delà. C’est le défaut des sociétés renouvelées par les révolutions ; il reste longtemps dans leurs mœurs quelque chose d’informe et de gros, je ne veux pas dire grossier. Il n'y a de fini et d'achevé que ce qui a duré ; ou ce que Dieu lui-même a pris la peine de faire parfait. Mais il ne prend jamais cette peine là pour les peuples.
Voilà votre N°277 et en même temps des détails sur l’orient qui m’arrivent très circonstanciés trop pour la distance où nous sommes.
Vous menez bien votre barque. Vous travaillez à vendre le plus cher possible l'abandon, c’est-à-dire le non renouvellement du traite d'Unkiar-Skelessy. Vous avez tout un plan, dans lequel tout le monde, a son poste assigné contre Méhémet Je ne crois pas à l’exécution. C’est trop artistement arrangé. Je ne suis point invité à Fontainebleau. Je ne sais pas si je le serai. Je suis bien loin. On le sait officiellement. Pour peu qu’on trouve d'embarras à m'inviter moi, et non pas, tel autre, on a prétexte pour s’en dispenser. Adieu. Adieu. Moi aussi, j’attends l'hiver. Je vous en réponds. A propos, je ne sais de quoi, je ferai comme vous avez fait quand j’ai oublié votre commission auprès de Berryer. J’attendrai que je voie Bulwer pour lui demander moi-même des renseignements sur Lord Chatam.
Adieu, quand-même. G.
Je me sens beaucoup mieux ce matin. C’est une singulière chose que la rapidité avec laquelle ce mal de gorge m’envahit s’établit, semble près de devenir une maladie et s'en va. Je suis persuadé qu’en y prenant un peu garde, dans trois ou quatre jours, il n’en sera plus question. Mais c’est bien décidément mon mal.
Je sais peut-être moins de détails que vous sur l'Orient. Quand les affaires ne vont pas à leur satisfaction, ils m'en instruisent plus laconiquement surtout quand l’événement confirme mes avis. J’ai reçu cependant ces jours-ci deux lettres qui sont d'accord avec ce que vous me dites. Mais vous aussi vous êtes trop loin. Deux heures de conversation toutes les semaines nous seraient bien nécessaires. A vous dire vrai, je ne me préoccupe pas beaucoup de cette affaire là quant à présent. Deux choses seules m'importent ; la paix pour le moment, le fond de la question pour l'avenir ; la paix ne sera pas troublée, ni la question au fond résolue. Je tiens l’un et l’autre pour certain. Il ne sortira de tout ceci qu’un ajournement pacifique. Que l’ajournement soit plus ou moins digne, plus ou moins habile, qu’il en résulte plus ou moins de gloire pour les manipulateurs, il m'importe assez peu. Je ne m'étonne pas que Mad. de Castellane vous choque. Elle n'a point de mesure dans la flatterie. Là est la limite de son esprit et le côté subalterne de sa nature. Du reste, rien n'est plus rare aujourd'hui parmi nous que le tact des limites. En toutes choses, nous sommes toujours en deçà ou au delà. C’est le défaut des sociétés renouvelées par les révolutions ; il reste longtemps dans leurs mœurs quelque chose d’informe et de gros, je ne veux pas dire grossier. Il n'y a de fini et d'achevé que ce qui a duré ; ou ce que Dieu lui-même a pris la peine de faire parfait. Mais il ne prend jamais cette peine là pour les peuples.
Voilà votre N°277 et en même temps des détails sur l’orient qui m’arrivent très circonstanciés trop pour la distance où nous sommes.
Vous menez bien votre barque. Vous travaillez à vendre le plus cher possible l'abandon, c’est-à-dire le non renouvellement du traite d'Unkiar-Skelessy. Vous avez tout un plan, dans lequel tout le monde, a son poste assigné contre Méhémet Je ne crois pas à l’exécution. C’est trop artistement arrangé. Je ne suis point invité à Fontainebleau. Je ne sais pas si je le serai. Je suis bien loin. On le sait officiellement. Pour peu qu’on trouve d'embarras à m'inviter moi, et non pas, tel autre, on a prétexte pour s’en dispenser. Adieu. Adieu. Moi aussi, j’attends l'hiver. Je vous en réponds. A propos, je ne sais de quoi, je ferai comme vous avez fait quand j’ai oublié votre commission auprès de Berryer. J’attendrai que je voie Bulwer pour lui demander moi-même des renseignements sur Lord Chatam.
Adieu, quand-même. G.
282. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
282 Du Val Richer, Lundi soir 30 sept. 1839 8 heures et demie
Il n’est bruit que de la nouvelle coalition, votre Empereur, Palmerston et les radicaux. Aurait-elle la majorité à Londres ? On en doute fort. Palmerston trouvant bon que vous entriez, vous dans le Bosphore et l'Asie mineure, tandis qu'il ira lui sans nous à Alexandrie, cela sera-t-il bien reçu du Parlement ? On croit que cela ne s’y présentera pas. Même avec le correctif d'un corps d’armée Autrichien pour faire le siège de St Jean d’Acre, où il n’ira pas. Tout cela a un peu l’air des mille et une nuits. Il n’y a guère, dans chaque affaire, qu’une ou deux grandes politiques. Quand on n'en veut pas, on tombe dans les politiques petites et arbitraires. De celles-là, il y en a mille.
En attendant, vous parait-il vrai, comme on me le dit, que le Cabinet anglais est plus sérieusement menacé que jamais ? On l'a dit si souvent que cela finira pas arriver sans que je le croie. Voilà Zéa décidément rentré en scène. Si les Cortes dont dissoutes comme tout l’annonce, un parti bien voisin de lui dominera dans les nouvelles. J’en suis bien aise, même politique à part. Je lui souhaite du contentement. Je ne sais pourquoi le bruit se répand dans notre Province que Don Carlos doit y venir habiter et qu’on y cherche un château pour lui. Ce qu’il y a de sûr c’est qu’on a fait visiter deux grands châteaux à peu près abandonnés, et très convenables pour un Prince abandonné.
N’allez pas vous ruiner en curiosités. Quand vous aurez vos affaires signées, vous ferez tout ce qui vous plaira. Je n’ai de ma vie été si méfiant.
Mardi, 8 heures 1/2
Avez-vous décidément adopté la bibliothèque de l'entresol pour votre chambre à coucher ? Je suis bien impatient de vous voir là. Où seront nos habitudes? Vous trouverez votre maison peuplée. Jaubert est arrivé ; fort peu préoccupé de la politique de l'Orient, à ce qu'on me dit ; il n'y a pas moyen d’en rien tirer à ce sujet. Ce n'est pas du tout un esprit de politique étrangère. Il a rapporté de Constantinople une grande préoccupation des conspirations de l’extrême gauche. Elles continuent de plus en plus basses, comme on dit les eaux sont basses. Singulière société qui ne veut ni du haut, ni du bas, ni du soleil, ni de la boue ! Comment viendra-t-elle à bout de s'organiser et de suffire à ses affaires ? Je ne pense pas à autre chose, en fait de choses, depuis deux mois que je vis en Amérique.
9 heures et demie
J’attends mon médecin aujourd'hui. Je voudrais bien qu’il fût de votre avis qu’il en fût positivement. Quoique ce qu’on appelle la raison me dise que j’ai tort de désirer cela. Je suis désolé du mariage de votre femme de chambre. Mad. de Mentzingen ne pourrait-elle vous envoyer sa pareille ? Vous avez confiance aux allemandes. Il vous faut une femme de chambre qui vous convienne beaucoup, et vous plaise un peu. La petite lectrice que Génie vous a donnée vous convient-elle, dans son état, et vous en servez-vous ? Adieu. Adieu.
Il n’est bruit que de la nouvelle coalition, votre Empereur, Palmerston et les radicaux. Aurait-elle la majorité à Londres ? On en doute fort. Palmerston trouvant bon que vous entriez, vous dans le Bosphore et l'Asie mineure, tandis qu'il ira lui sans nous à Alexandrie, cela sera-t-il bien reçu du Parlement ? On croit que cela ne s’y présentera pas. Même avec le correctif d'un corps d’armée Autrichien pour faire le siège de St Jean d’Acre, où il n’ira pas. Tout cela a un peu l’air des mille et une nuits. Il n’y a guère, dans chaque affaire, qu’une ou deux grandes politiques. Quand on n'en veut pas, on tombe dans les politiques petites et arbitraires. De celles-là, il y en a mille.
En attendant, vous parait-il vrai, comme on me le dit, que le Cabinet anglais est plus sérieusement menacé que jamais ? On l'a dit si souvent que cela finira pas arriver sans que je le croie. Voilà Zéa décidément rentré en scène. Si les Cortes dont dissoutes comme tout l’annonce, un parti bien voisin de lui dominera dans les nouvelles. J’en suis bien aise, même politique à part. Je lui souhaite du contentement. Je ne sais pourquoi le bruit se répand dans notre Province que Don Carlos doit y venir habiter et qu’on y cherche un château pour lui. Ce qu’il y a de sûr c’est qu’on a fait visiter deux grands châteaux à peu près abandonnés, et très convenables pour un Prince abandonné.
N’allez pas vous ruiner en curiosités. Quand vous aurez vos affaires signées, vous ferez tout ce qui vous plaira. Je n’ai de ma vie été si méfiant.
Mardi, 8 heures 1/2
Avez-vous décidément adopté la bibliothèque de l'entresol pour votre chambre à coucher ? Je suis bien impatient de vous voir là. Où seront nos habitudes? Vous trouverez votre maison peuplée. Jaubert est arrivé ; fort peu préoccupé de la politique de l'Orient, à ce qu'on me dit ; il n'y a pas moyen d’en rien tirer à ce sujet. Ce n'est pas du tout un esprit de politique étrangère. Il a rapporté de Constantinople une grande préoccupation des conspirations de l’extrême gauche. Elles continuent de plus en plus basses, comme on dit les eaux sont basses. Singulière société qui ne veut ni du haut, ni du bas, ni du soleil, ni de la boue ! Comment viendra-t-elle à bout de s'organiser et de suffire à ses affaires ? Je ne pense pas à autre chose, en fait de choses, depuis deux mois que je vis en Amérique.
9 heures et demie
J’attends mon médecin aujourd'hui. Je voudrais bien qu’il fût de votre avis qu’il en fût positivement. Quoique ce qu’on appelle la raison me dise que j’ai tort de désirer cela. Je suis désolé du mariage de votre femme de chambre. Mad. de Mentzingen ne pourrait-elle vous envoyer sa pareille ? Vous avez confiance aux allemandes. Il vous faut une femme de chambre qui vous convienne beaucoup, et vous plaise un peu. La petite lectrice que Génie vous a donnée vous convient-elle, dans son état, et vous en servez-vous ? Adieu. Adieu.
283. Val-Richer, Mardi 1er octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
283 Du Val-Richer, mardi soir 1 octobre 1839 8 heures
Mon médecin me trouve bien. Il a examiné avec grand soin l'état de ma poitrine. Il n’y a rien. C’est un rhume, qui tient bien à une mauvaise disposition des bronches. (c'est le mot savant ) et qu’il faut soigner, mais qui n’a rien du tout de grave. Il pense comme vous, que l’humidité ne me vaut rien et que je ferai bien de ne pas rester ici trop tard. Ma maison n'a pas l'ombre d'humidité ; mais l'atmosphère en a beaucoup, rien n’est plus sûr. Il va passer ici deux jours et me regardera bien. Je me sens beaucoup mieux. J’ai peu toussé aujourd'hui. L’appétit, qui m’avait quitté, me revient.
Pourquoi ne voulez-vous pas que je pense à votre intérêt ? Est ce que ce n’est pas le mien ? Je ne puis m’y donner tout entier à mon regret infini ; mais tout ce que j’y puis donner, j'en jouis autant que vous. D'ailleurs, je ne veux pas arriver enrhumé à la session. Je vais m’arranger en conséquence. Je ne puis vous en dire davantage aujourd'hui. Je tiens trop à la vérité avec vous à la vérité précise. Mais vous pouvez vous fier à moi.
Il y a des gens d’esprit qui ont pensé au troisième parti dont je vous parlais. Ils disent que la coalition de l'Empereur et de Lord Palmerston est très facile à condition que Méhémet ne se défendra pas, car s'il se défend, et fait marcher son fils sur Constantinople jamais Lord Palmerston ne fera trouver bon à l'Angleterre que les Russes soient appelés pour l'arrêter. Du reste le peuple de Paris même celui qui pense à quelque chose, pense bien peu, me dit-on, à l'Orient et au cabinet.
La grande préoccupation, c’est la perspective d’un mauvais hiver, la cherté, la disette, la Banque de Londres chancelante. On dit que la saison vous a maltraités aussi, et que la Russie méridionale est menacée d’une grande disette.
Charlotte me revient à l'esprit. Voulez-vous que je fasse chercher une femme de chambre de Suisse ? Mad. Delessert en a toujours sous la main. Je suis entouré d’un monde très protestant, très pieux, et qui, sous ce rapport là, ne vous donnerait rien que de bon. Ce bon Génie est fort troublé de me craindre malade. Il m'écrit que si je le suis, il viendra s'établir au Val-Richer. Mon médecin lui a écrit ce matin même pour le rassurer.
Mercredi, 9 heures
J’ai très bien dormi. Le sentiment de chaleur et de fatigue que j’avais dans la gorge et la poitrine disparaît dans trois ou quatre jours, il ne restera rien du mal que la nécessité de prévenir ce qui pourrait en amener le retour. Savez-vous si Mad. de Boigne est de retour à Paris, et sinon où elle est ?
9 h. 1/2
Je n’ai pas la moindre rancune de votre oubli de Lord Chatam. J'en avais une vieille à cause de la vôtre pour mon oubli de Berryer. Je me la suis passée dans cette occasion-ci. Et elle est passée. Mon troisième parti vous voyez n’était par aussi terne que celui que vous avez imaginé. Du reste vos présomptions sont justes ; on a beaucoup d'humeur et on espère que les collègues de Lord Palmerston ne seront pas tous de son avis. Adieu. Adieu. Oui au revoir.
Mon médecin me trouve bien. Il a examiné avec grand soin l'état de ma poitrine. Il n’y a rien. C’est un rhume, qui tient bien à une mauvaise disposition des bronches. (c'est le mot savant ) et qu’il faut soigner, mais qui n’a rien du tout de grave. Il pense comme vous, que l’humidité ne me vaut rien et que je ferai bien de ne pas rester ici trop tard. Ma maison n'a pas l'ombre d'humidité ; mais l'atmosphère en a beaucoup, rien n’est plus sûr. Il va passer ici deux jours et me regardera bien. Je me sens beaucoup mieux. J’ai peu toussé aujourd'hui. L’appétit, qui m’avait quitté, me revient.
Pourquoi ne voulez-vous pas que je pense à votre intérêt ? Est ce que ce n’est pas le mien ? Je ne puis m’y donner tout entier à mon regret infini ; mais tout ce que j’y puis donner, j'en jouis autant que vous. D'ailleurs, je ne veux pas arriver enrhumé à la session. Je vais m’arranger en conséquence. Je ne puis vous en dire davantage aujourd'hui. Je tiens trop à la vérité avec vous à la vérité précise. Mais vous pouvez vous fier à moi.
Il y a des gens d’esprit qui ont pensé au troisième parti dont je vous parlais. Ils disent que la coalition de l'Empereur et de Lord Palmerston est très facile à condition que Méhémet ne se défendra pas, car s'il se défend, et fait marcher son fils sur Constantinople jamais Lord Palmerston ne fera trouver bon à l'Angleterre que les Russes soient appelés pour l'arrêter. Du reste le peuple de Paris même celui qui pense à quelque chose, pense bien peu, me dit-on, à l'Orient et au cabinet.
La grande préoccupation, c’est la perspective d’un mauvais hiver, la cherté, la disette, la Banque de Londres chancelante. On dit que la saison vous a maltraités aussi, et que la Russie méridionale est menacée d’une grande disette.
Charlotte me revient à l'esprit. Voulez-vous que je fasse chercher une femme de chambre de Suisse ? Mad. Delessert en a toujours sous la main. Je suis entouré d’un monde très protestant, très pieux, et qui, sous ce rapport là, ne vous donnerait rien que de bon. Ce bon Génie est fort troublé de me craindre malade. Il m'écrit que si je le suis, il viendra s'établir au Val-Richer. Mon médecin lui a écrit ce matin même pour le rassurer.
Mercredi, 9 heures
J’ai très bien dormi. Le sentiment de chaleur et de fatigue que j’avais dans la gorge et la poitrine disparaît dans trois ou quatre jours, il ne restera rien du mal que la nécessité de prévenir ce qui pourrait en amener le retour. Savez-vous si Mad. de Boigne est de retour à Paris, et sinon où elle est ?
9 h. 1/2
Je n’ai pas la moindre rancune de votre oubli de Lord Chatam. J'en avais une vieille à cause de la vôtre pour mon oubli de Berryer. Je me la suis passée dans cette occasion-ci. Et elle est passée. Mon troisième parti vous voyez n’était par aussi terne que celui que vous avez imaginé. Du reste vos présomptions sont justes ; on a beaucoup d'humeur et on espère que les collègues de Lord Palmerston ne seront pas tous de son avis. Adieu. Adieu. Oui au revoir.
284. Val-Richer, Mercredi 2 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
284 Du Val Richer, Mercredi soir 2 oct. 1839 8 heures
Je suis invité à Fontainebleau pour le 7 et le 8. J’aurais mieux aimé que ce fût pour la fin de la semaine. En revanche, si c'eût été cette semaine, il m'aurait été absolument impossible d’y aller. Je tousse encore fort. Mais cela s'en va, et même vite depuis deux jours. J’aurais bien du malheur si samedi matin, je n’étais pas bon pour partir. Mon projet est de partir samedi, dans ma petite calèche avec mon cheval et d’aller coucher à Evreux au Grand cerf. Je ne puis raisonnablement passer la nuit en voiture. Mon rhume y reviendrait à coup sûr. Je partirai d’Evreux le dimanche matin, et je serai à Paris entre 4 et 5 heures.
Donnez-moi à dîner dimanche. Je partirai Lundi à onze heures pour Fontainebleau, et j'en reviendrai Mercredi matin. Il faut que je sois ici Dimanche 13. Je ne jouis qu’en tremblant de cette bonne fortune. Si la fièvre et l’oppression allaient me reprendre d'ici à samedi ! J’espère bien que non.
Mon médecin me trouve bien. Je l’ai mis de mon parti, contre les assistants.
Quel plaisir dimanche ! Je n'y veux pas trop penser. J'en tousserais. J'étais bien ébranlé il y a quatre jours. Votre au revoir aura raison. Je comprends qu'on ait de l'humeur contre Londres. Ce qui est étrange, c’est qu’on ne s’y soit pas attendu. Je n’ai jamais craint que cela. Deux ambitions ennemies peuvent si bien s'entendre pour un ajournement. Je ne sais pourquoi je vous en parle aujourd’hui. Aujourd'hui, je méprise bien les lettres.
Jeudi 9 h. 1/2
Je suis bien ce matin. Je compte sur Dimanche. Pourvu que je ne passe pas de nuit en voiture, je ne crois pas que le voyage me fasse le moindre mal. Mais que je ne vous trouve pas enrhumée à votre tour. Ecrivez-moi un mot en réponse à ceci. Je le prendrai en passant après demain à Lisieux. Adieu. Adieu. Oui adieu en attendant le vrai. G.
Je suis invité à Fontainebleau pour le 7 et le 8. J’aurais mieux aimé que ce fût pour la fin de la semaine. En revanche, si c'eût été cette semaine, il m'aurait été absolument impossible d’y aller. Je tousse encore fort. Mais cela s'en va, et même vite depuis deux jours. J’aurais bien du malheur si samedi matin, je n’étais pas bon pour partir. Mon projet est de partir samedi, dans ma petite calèche avec mon cheval et d’aller coucher à Evreux au Grand cerf. Je ne puis raisonnablement passer la nuit en voiture. Mon rhume y reviendrait à coup sûr. Je partirai d’Evreux le dimanche matin, et je serai à Paris entre 4 et 5 heures.
Donnez-moi à dîner dimanche. Je partirai Lundi à onze heures pour Fontainebleau, et j'en reviendrai Mercredi matin. Il faut que je sois ici Dimanche 13. Je ne jouis qu’en tremblant de cette bonne fortune. Si la fièvre et l’oppression allaient me reprendre d'ici à samedi ! J’espère bien que non.
Mon médecin me trouve bien. Je l’ai mis de mon parti, contre les assistants.
Quel plaisir dimanche ! Je n'y veux pas trop penser. J'en tousserais. J'étais bien ébranlé il y a quatre jours. Votre au revoir aura raison. Je comprends qu'on ait de l'humeur contre Londres. Ce qui est étrange, c’est qu’on ne s’y soit pas attendu. Je n’ai jamais craint que cela. Deux ambitions ennemies peuvent si bien s'entendre pour un ajournement. Je ne sais pourquoi je vous en parle aujourd’hui. Aujourd'hui, je méprise bien les lettres.
Jeudi 9 h. 1/2
Je suis bien ce matin. Je compte sur Dimanche. Pourvu que je ne passe pas de nuit en voiture, je ne crois pas que le voyage me fasse le moindre mal. Mais que je ne vous trouve pas enrhumée à votre tour. Ecrivez-moi un mot en réponse à ceci. Je le prendrai en passant après demain à Lisieux. Adieu. Adieu. Oui adieu en attendant le vrai. G.
Mots-clés : Politique (France), Protestantisme, Santé (François)
285. Val -Richer, Vendredi 4 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
285 Du Val-Richer Vendredi 4 oct. 1839 9 heures
Je sors de mon lit après une longue transpiration. C’est bien ennuyeux. Je suis mieux certainement. Je tousse moins. Mais j'espérais que la journée d’hier emmènerait le rhume plus vite.
Si demain matin à 8 heures, j'étais en nage dans mon lit comme ce matin ce serait une folie de partir. J’espère qu'il n’en sera rien. L’incertitude m'est insupportable, et l'incertitude à côté d’un vif désir ? En êtes-vous bien sûre ? Je crois que j'en viendrai à ne pas vous pardonner le doute.
Voilà le N°281. Et vous aussi Il faudrait je ne sais quoi demain pour que je ne partisse pas. Adieu. Adieu. De quoi vous parlerais-je ? à dimanche. G.
Je sors de mon lit après une longue transpiration. C’est bien ennuyeux. Je suis mieux certainement. Je tousse moins. Mais j'espérais que la journée d’hier emmènerait le rhume plus vite.
Si demain matin à 8 heures, j'étais en nage dans mon lit comme ce matin ce serait une folie de partir. J’espère qu'il n’en sera rien. L’incertitude m'est insupportable, et l'incertitude à côté d’un vif désir ? En êtes-vous bien sûre ? Je crois que j'en viendrai à ne pas vous pardonner le doute.
Voilà le N°281. Et vous aussi Il faudrait je ne sais quoi demain pour que je ne partisse pas. Adieu. Adieu. De quoi vous parlerais-je ? à dimanche. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée, Santé (François)
Paris, Samedi 5 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Voici cette note des questions à adresser et des actes à demander. Elle s'accorde s'il m’en souvient bien avec ce que vous avez demandé, à Bruxner. Adieu.
Ce n'est donc plus à la Terrasse que nous nous reverrons. Je lui ai dit hier soir en passant le seuil de la porte, un adieu bien tendre. Mais tout lieu où vous serez où nous serons aura bientôt ce droit là, sur moi. Adieu. Adieu.
G.
Paris.
Samedi 7 heures
Ce n'est donc plus à la Terrasse que nous nous reverrons. Je lui ai dit hier soir en passant le seuil de la porte, un adieu bien tendre. Mais tout lieu où vous serez où nous serons aura bientôt ce droit là, sur moi. Adieu. Adieu.
G.
Paris.
Samedi 7 heures
223. Val-Richer, Samedi 20 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
223 Du Val Richer, Samedi 20 Juillet 1839 3 heures
J’ai trouvé mes enfants très bien. Cependant Guillaume tousse un peu depuis quinze jours. Il mange et dort parfaitement. Il est très gai. Mon médecin dit que ce n’est rien du tout et que quelques pastilles d’ipécacuanha l’en débarrasseront.
Le Duc de Wellington s’est bien fâché contre Lord Melbourne. J'en ai été un peu surpris. Non qu’il n’eût parfaitement raison ; mais au dire de Pozzo, il y a entre eux la meilleure, intelligence ; et Lord Melbourne ne fait à peu près rien sans s'en être de près ou de loin, entendu avec le duc. Du reste il arrive à Birmingham ce qui arrive dans les grandes villes des Etats Unis d'Amérique, ce qui arrivera partout où la contagion de l'esprit démocratique aura atteint le gouvernement lui-même. On élit des magistrats mais il n’y en a plus. Il n’y a que des adorateurs et des serviteurs de la multitude. Elle est pour eux ce qu’était le Pape au Moyen-Âge pour l’Europe chrétienne. Leur premier mouvement est de la croire infaillible, et ils ne se décident à la réprimer un peu qu’en cas de nécessité absolue et après les derniers excès. Lord John s'est mieux défendu aux Communes que Lord Melbourne chez les Lords. Lord Melbourne a toujours l’air d’un homme qu'on réveille en souriant, et qui dit : " Laissez-moi tranquille. Pourquoi me tracassez-vous ? Croyez-vous que je sois là pour mon plaisir ? J’y suis pour vous empêcher d'être dévorés par cette bête. féroce. " Le Parlement ne sera prorogé que dans la seconde quinzaine d'août.
8 heures
Je rentre de bonne heure quoiqu’il fasse beau. Les soirées normandes sont trop humides pour moi. Je retomberais dans ces éternuements insensés qui m'hébètent et me fatiguent. Décidément, l’atmosphère du midi est la seule agréable la seule ou la chaleur ne soit pas celle d’une étuve et la fraîcheur celle d'une cave. C'est bien dommage que le proverbe ait raison : " Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. " J’aimerais bien à choisir mon herbe. A tout prendre, je me suis assez réglé, dominé, gouverné selon la raison, et je passe pour cela. Mais il me prend quelquefois de furieux accès de fantaisie, un désir passionné de n'en croire que mon goût mon plaisir. Personne ne saura jamais ce qu'il ma fallu d'effort la semaine dernière pour ne pas partir pour Baden dans la journée, et y aller voir moi-même.
Dimanche 6 h. 1/2
Je me lève de bonne heure ici, comme vous à Baden. Le calme du matin est charmant. La nature est animée et il n'y a point de bruit. Je crois que je travaillerai beaucoup, et avec plaisir. Pourvu qu’on ne vienne pas trop me voir. J’attends la semaine prochaine M. et Mad. Lenormant ; puis M. Devaines et son fils, puis M. Rossi. Mad. de Boigne qui ira passer un mois chez Mad. de Chastenay, près Caen, me fera une visite en passant. Ma route n'est pas tout à fait achevée. Cela éloignera quelques personnes.
Ne mettez pas grande importance, à ce que vous lisez dans les journaux sur les dissensions intérieures du Cabinet, sur le travail de M. Dufaure au profit, de la gauche, &. On essaie d’amener cela en le disant ; mais cela n'est point. Il n’y a dans le Cabinet point de dissensions, point de travail de personne au profit de personne. Ils sont tous contents d'être où ils sont, chacun tâche à se maintenir bien avec ses anciens amis pour en tirer quelque appui, M. Dufaure avec la gauche, M. Duchâtel avec le centre ; mais tout cela, sans conséquence. Au fait, ils s'accordent sans peine ; et quand ils différent, chacun dit son avis, le Roi décide, et ils n’y pensent plus.
9 heures
Je suis désolé que le courrier vous ait manqué. J’aime mieux que cela soit tombé sur le jour où vous avez eu Lady Carlisle. Lady Granville m’avait dit qu’elle irait passer une journée avec vous. Merci de ce premier aperçu sur vos arrangements. Ils me conviennent, à présent, il me faut les détails. Adieu. Adieu. Vous aurez été bien rassurés sur Paris. Adieu dearest. G.
J’ai trouvé mes enfants très bien. Cependant Guillaume tousse un peu depuis quinze jours. Il mange et dort parfaitement. Il est très gai. Mon médecin dit que ce n’est rien du tout et que quelques pastilles d’ipécacuanha l’en débarrasseront.
Le Duc de Wellington s’est bien fâché contre Lord Melbourne. J'en ai été un peu surpris. Non qu’il n’eût parfaitement raison ; mais au dire de Pozzo, il y a entre eux la meilleure, intelligence ; et Lord Melbourne ne fait à peu près rien sans s'en être de près ou de loin, entendu avec le duc. Du reste il arrive à Birmingham ce qui arrive dans les grandes villes des Etats Unis d'Amérique, ce qui arrivera partout où la contagion de l'esprit démocratique aura atteint le gouvernement lui-même. On élit des magistrats mais il n’y en a plus. Il n’y a que des adorateurs et des serviteurs de la multitude. Elle est pour eux ce qu’était le Pape au Moyen-Âge pour l’Europe chrétienne. Leur premier mouvement est de la croire infaillible, et ils ne se décident à la réprimer un peu qu’en cas de nécessité absolue et après les derniers excès. Lord John s'est mieux défendu aux Communes que Lord Melbourne chez les Lords. Lord Melbourne a toujours l’air d’un homme qu'on réveille en souriant, et qui dit : " Laissez-moi tranquille. Pourquoi me tracassez-vous ? Croyez-vous que je sois là pour mon plaisir ? J’y suis pour vous empêcher d'être dévorés par cette bête. féroce. " Le Parlement ne sera prorogé que dans la seconde quinzaine d'août.
8 heures
Je rentre de bonne heure quoiqu’il fasse beau. Les soirées normandes sont trop humides pour moi. Je retomberais dans ces éternuements insensés qui m'hébètent et me fatiguent. Décidément, l’atmosphère du midi est la seule agréable la seule ou la chaleur ne soit pas celle d’une étuve et la fraîcheur celle d'une cave. C'est bien dommage que le proverbe ait raison : " Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. " J’aimerais bien à choisir mon herbe. A tout prendre, je me suis assez réglé, dominé, gouverné selon la raison, et je passe pour cela. Mais il me prend quelquefois de furieux accès de fantaisie, un désir passionné de n'en croire que mon goût mon plaisir. Personne ne saura jamais ce qu'il ma fallu d'effort la semaine dernière pour ne pas partir pour Baden dans la journée, et y aller voir moi-même.
Dimanche 6 h. 1/2
Je me lève de bonne heure ici, comme vous à Baden. Le calme du matin est charmant. La nature est animée et il n'y a point de bruit. Je crois que je travaillerai beaucoup, et avec plaisir. Pourvu qu’on ne vienne pas trop me voir. J’attends la semaine prochaine M. et Mad. Lenormant ; puis M. Devaines et son fils, puis M. Rossi. Mad. de Boigne qui ira passer un mois chez Mad. de Chastenay, près Caen, me fera une visite en passant. Ma route n'est pas tout à fait achevée. Cela éloignera quelques personnes.
Ne mettez pas grande importance, à ce que vous lisez dans les journaux sur les dissensions intérieures du Cabinet, sur le travail de M. Dufaure au profit, de la gauche, &. On essaie d’amener cela en le disant ; mais cela n'est point. Il n’y a dans le Cabinet point de dissensions, point de travail de personne au profit de personne. Ils sont tous contents d'être où ils sont, chacun tâche à se maintenir bien avec ses anciens amis pour en tirer quelque appui, M. Dufaure avec la gauche, M. Duchâtel avec le centre ; mais tout cela, sans conséquence. Au fait, ils s'accordent sans peine ; et quand ils différent, chacun dit son avis, le Roi décide, et ils n’y pensent plus.
9 heures
Je suis désolé que le courrier vous ait manqué. J’aime mieux que cela soit tombé sur le jour où vous avez eu Lady Carlisle. Lady Granville m’avait dit qu’elle irait passer une journée avec vous. Merci de ce premier aperçu sur vos arrangements. Ils me conviennent, à présent, il me faut les détails. Adieu. Adieu. Vous aurez été bien rassurés sur Paris. Adieu dearest. G.
286. Evreux, Samedi 12 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
28... (je ne sais pas le dernier chiffre) Evreux, samedi soir 12 Oct.
7 heures
Je ne veux pas que vous soyez plus maltraitée que moi. J’ai le temps de vous dire adieu. Je viens de dîner seul comme vous, au coin de mon feu, pas comme vous. Comment nous arrangerions-nous pour le feu si nous passions notre vie ensemble ? Je crois pourtant que nous nous arrangerions. Il me semble que chaque fois que nous nous retrouvons nous nous trouvons mieux ensemble. Qu'en dites- vous ? Je ne suis point fatigué. Je tousse à peine.
J’ai trouvé dans la diligence un homme de mes amis, M. de Caumont homme d’esprit qui à la passion des vieilleries historiques et qui parcourt sans cesse la France pour voir, tous les endroits ou on s’est battu, où un homme est né ou bien mort. C’est une douce manie, qui l'amuse. J’ai cru en le rencontrant qu’il m'amuserait un peu en route. Pas du tout. Je pensais toujours à autre chose.
Je vous ai envoyé Génie ce matin, avec nos questions. Il me semble que je n’ai rien oublié d'important. Prenez garde seulement que je ne me laisse trop aller à traiter tout cela, en vrai procureur, qui croit tout possible & prend des précautions contre tout. Tous ces gens là sont à mes yeux de purs étrangers pour vous.
Adieu.
Je partirai demain entre sept et huit heures et je serai chez moi pour dîner. Adieu. Je vais lire un peu dans mon lit. Votre pensée interrompra ma lecture. Je m'endormirai. Elle reviendra, sans interrompre mon sommeil. Adieu. Adieu. G.
7 heures
Je ne veux pas que vous soyez plus maltraitée que moi. J’ai le temps de vous dire adieu. Je viens de dîner seul comme vous, au coin de mon feu, pas comme vous. Comment nous arrangerions-nous pour le feu si nous passions notre vie ensemble ? Je crois pourtant que nous nous arrangerions. Il me semble que chaque fois que nous nous retrouvons nous nous trouvons mieux ensemble. Qu'en dites- vous ? Je ne suis point fatigué. Je tousse à peine.
J’ai trouvé dans la diligence un homme de mes amis, M. de Caumont homme d’esprit qui à la passion des vieilleries historiques et qui parcourt sans cesse la France pour voir, tous les endroits ou on s’est battu, où un homme est né ou bien mort. C’est une douce manie, qui l'amuse. J’ai cru en le rencontrant qu’il m'amuserait un peu en route. Pas du tout. Je pensais toujours à autre chose.
Je vous ai envoyé Génie ce matin, avec nos questions. Il me semble que je n’ai rien oublié d'important. Prenez garde seulement que je ne me laisse trop aller à traiter tout cela, en vrai procureur, qui croit tout possible & prend des précautions contre tout. Tous ces gens là sont à mes yeux de purs étrangers pour vous.
Adieu.
Je partirai demain entre sept et huit heures et je serai chez moi pour dîner. Adieu. Je vais lire un peu dans mon lit. Votre pensée interrompra ma lecture. Je m'endormirai. Elle reviendra, sans interrompre mon sommeil. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Portrait, Récit, Relation François-Dorothée, Santé (François)
287. Val-Richer, Lundi 14 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
287 Du Val Richer, Lundi 14 oct. 1839 8 heures
Je ne comprends pas que vous n'eussiez pas vu Génie samedi à une heure et demie. Il m'a quitté à 6 heures emportant une lettre pour vous. Il faut qu’il ait eu quelque affaire obligée. Il vous aura surement vue, dans la journée.
Je suis arrivé hier à 4 heures, point fatigué. Il fait beau, mais je tousse toujours un peu. Je trouve en arrivant quatre invitations à dîner. Je les refuse toutes en disant que mon médecin veut que je me repose pendant le reste de mon séjour à la campagne. Mes enfants sont à merveille. Ma mère pas trop. Rien de grave cependant.
Le procédé de M. Jennison est en effet choquant. Mais il n’y a que lui qui puisse en souffrir. Vous avez votre bail signé. S’il ne voulait vous rien vendre, vous auriez un peu plus d'affaires pour votre arrangement voilà tout. Mais il vous vendra ; ne lui achetez pas plus, et ne le payez pas plus cher que vous ne voulez. Le monde est juif. La dispersion de la race juive a infecté le monde
9 heures et demie
Sans nul doute, les questions à votre fière sont trop péremptoires et il vaut mieux attendre. Quoiqu'il n’y ait rien d’impossible, il me paraît impossible que vous ne receviez pas bientôt la copie textuelle de l’arrangement définitif. Nous verrons alors ce qui manquera. Je vous enverrai demain matin une lettre pour le directeur des Douanes. Vous prierez Génie de la lui porter et de suivre cette petite affaire. Il faut toujours un homme à la suite d’une affaire. Rien ne se fait tout seul. Adieu.
Je trouve ici une foule de petites affaires à régler, et de lettres insignifiantes auxquelles il faut pourtant répondre. Adieu Adieu. G.
Je ne comprends pas que vous n'eussiez pas vu Génie samedi à une heure et demie. Il m'a quitté à 6 heures emportant une lettre pour vous. Il faut qu’il ait eu quelque affaire obligée. Il vous aura surement vue, dans la journée.
Je suis arrivé hier à 4 heures, point fatigué. Il fait beau, mais je tousse toujours un peu. Je trouve en arrivant quatre invitations à dîner. Je les refuse toutes en disant que mon médecin veut que je me repose pendant le reste de mon séjour à la campagne. Mes enfants sont à merveille. Ma mère pas trop. Rien de grave cependant.
Le procédé de M. Jennison est en effet choquant. Mais il n’y a que lui qui puisse en souffrir. Vous avez votre bail signé. S’il ne voulait vous rien vendre, vous auriez un peu plus d'affaires pour votre arrangement voilà tout. Mais il vous vendra ; ne lui achetez pas plus, et ne le payez pas plus cher que vous ne voulez. Le monde est juif. La dispersion de la race juive a infecté le monde
9 heures et demie
Sans nul doute, les questions à votre fière sont trop péremptoires et il vaut mieux attendre. Quoiqu'il n’y ait rien d’impossible, il me paraît impossible que vous ne receviez pas bientôt la copie textuelle de l’arrangement définitif. Nous verrons alors ce qui manquera. Je vous enverrai demain matin une lettre pour le directeur des Douanes. Vous prierez Génie de la lui porter et de suivre cette petite affaire. Il faut toujours un homme à la suite d’une affaire. Rien ne se fait tout seul. Adieu.
Je trouve ici une foule de petites affaires à régler, et de lettres insignifiantes auxquelles il faut pourtant répondre. Adieu Adieu. G.
288. Val-Richer, Lundi 14 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
288 Du Val Richer, Lundi 14 oct 1839 8 heures et demie
Voici une lettre pour M. Gréterin, directeur des douanes. Je la laisse ouverte pour que Génie la lise et sache bien ce que je demande. Priez-le de la porter de ma part à M. Gréterin après l'avoir cachetée, et de demander la réponse. Je crois qu’il faut une décision du Ministre des finances. Mais M. Gréterin la lui demandera. Je ne veux pas qu'on vous brise le vase en vermeil, et encore moins le buste, en marbre. Est-ce que vous ne pouvez-pas garder Pippin jusqu'à ce que vous ayez trouvé un maître d'hôtel qui vous convienne ? Je sais bien que vous en aurez encore plus de peine à lui faire dire une seconde fois qu’il faut qu'il s'en aille. Cependant j'aimerais mieux cet ennui-là que celui de prendre à la hâte le premier venu. Vous avez quelques fois des hésitations, et quelquefois des précipitations singulières. Entendez-vous dire qu’il y ait quelque chose de sérieux, dans la maladie de Méhémet dont parlent les journaux ? Ce serait encore un dénoue. ment inattendu. Je le regretterais. Le monde n'a pas de gens d’esprit à perdre.
Mardi, 7 heures et demie
Dites moi pourquoi je viens de passer une nuit très agitée, de revoir en rêve toute ma vie, ce qu'elle a eu de plus doux et de plus cruel, vingt cinq ans en quelques heures ! La même Puissance dispose donc de nous, sans nous, la nuit comme le jour, et des chimères comme des réalités. Elle devrait bien laisser la nuit au repos. Je suis brisé ce matin. Quelque confiance qu’on ait dans sa propre vie, si on avait dit au général Sébastiani que son maître d’hôtel, que je connais bien et qui le servait depuis très longtemps serait frappé d’apoplexie avant lui dans Hertford-House, on l'aurait, je crois, bien étonné. Je vous voudrais un maître d’hôtel comme celui-là de fort bonne mine, quoique trop petit, très entendu et très attaché.
Est-il vrai que l'Empereur (il ne me plaît pas de dire votre Empereur) entreprend de miner en Pologne la religion catholique, qu’il a déjà enlevé la moitié des Eglises polonaises au culte catholique pour les donner au culte grec &&. La liberté religieuse était la seule en Russie. C’était même un singulier spectacle que de voir deux états nouveaux, aux deux extrémités du monde, le plus despotique et le plus républicain que le monde ait encore vus, la Russie et les Etats-Unis commencent l'un et l'autre leur carrière, par cette tolérance, qu'au bout de six mille ans le monde civilisé a commencé à peine à entrevoir.
9 h. 1/2
J’aime bien le N°285. Il me rend compte des moindres détails de votre vie, personnes et choses. à cette condition seulement, la séparation est supportable ce qu’elle n'est jamais. Je suis charmé que vous ayez un maître d’hôtel. Mais il faut que le hasard couvre le mal de a précipitation. Cela arrive. Adieu.,Adieu. Non pas mille fois, mais mille vies. G.
J'adresse ma lettre rue Florentin, vous m'auriez averti si quelque chose était changé dans vos projets.
Voici une lettre pour M. Gréterin, directeur des douanes. Je la laisse ouverte pour que Génie la lise et sache bien ce que je demande. Priez-le de la porter de ma part à M. Gréterin après l'avoir cachetée, et de demander la réponse. Je crois qu’il faut une décision du Ministre des finances. Mais M. Gréterin la lui demandera. Je ne veux pas qu'on vous brise le vase en vermeil, et encore moins le buste, en marbre. Est-ce que vous ne pouvez-pas garder Pippin jusqu'à ce que vous ayez trouvé un maître d'hôtel qui vous convienne ? Je sais bien que vous en aurez encore plus de peine à lui faire dire une seconde fois qu’il faut qu'il s'en aille. Cependant j'aimerais mieux cet ennui-là que celui de prendre à la hâte le premier venu. Vous avez quelques fois des hésitations, et quelquefois des précipitations singulières. Entendez-vous dire qu’il y ait quelque chose de sérieux, dans la maladie de Méhémet dont parlent les journaux ? Ce serait encore un dénoue. ment inattendu. Je le regretterais. Le monde n'a pas de gens d’esprit à perdre.
Mardi, 7 heures et demie
Dites moi pourquoi je viens de passer une nuit très agitée, de revoir en rêve toute ma vie, ce qu'elle a eu de plus doux et de plus cruel, vingt cinq ans en quelques heures ! La même Puissance dispose donc de nous, sans nous, la nuit comme le jour, et des chimères comme des réalités. Elle devrait bien laisser la nuit au repos. Je suis brisé ce matin. Quelque confiance qu’on ait dans sa propre vie, si on avait dit au général Sébastiani que son maître d’hôtel, que je connais bien et qui le servait depuis très longtemps serait frappé d’apoplexie avant lui dans Hertford-House, on l'aurait, je crois, bien étonné. Je vous voudrais un maître d’hôtel comme celui-là de fort bonne mine, quoique trop petit, très entendu et très attaché.
Est-il vrai que l'Empereur (il ne me plaît pas de dire votre Empereur) entreprend de miner en Pologne la religion catholique, qu’il a déjà enlevé la moitié des Eglises polonaises au culte catholique pour les donner au culte grec &&. La liberté religieuse était la seule en Russie. C’était même un singulier spectacle que de voir deux états nouveaux, aux deux extrémités du monde, le plus despotique et le plus républicain que le monde ait encore vus, la Russie et les Etats-Unis commencent l'un et l'autre leur carrière, par cette tolérance, qu'au bout de six mille ans le monde civilisé a commencé à peine à entrevoir.
9 h. 1/2
J’aime bien le N°285. Il me rend compte des moindres détails de votre vie, personnes et choses. à cette condition seulement, la séparation est supportable ce qu’elle n'est jamais. Je suis charmé que vous ayez un maître d’hôtel. Mais il faut que le hasard couvre le mal de a précipitation. Cela arrive. Adieu.,Adieu. Non pas mille fois, mais mille vies. G.
J'adresse ma lettre rue Florentin, vous m'auriez averti si quelque chose était changé dans vos projets.
289. Val-Richer, Mardi 15 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
289 Du Val Richer, Mardi soir 15 0ct 1839 9 heures
Prenez-vous quelque intérêt à la querelle du Roi de Prusse avec ses sujets catholiques. Je soupçonne l’archevêque de Posen de s'être enfui pour être repris, et pour attiser un peu le feu que le Gouvernement Prussien essayait de calmer. Rome est encore avec les états protestants comme les Princes légitimes avec les sujets rebelles. Ils se croient tout permis et ne se tiennent jamais pour obligés à rien. Et cette perfidie arrogante les perd plus que toute autre cause. On finit par se persuader qu’il n'y a pour en finir avec eux, d'autre moyen que la force et l'extermination. Je ne sais ce que vous aura dit Lord Granville ; mais malgré son aigreur, le Morming Chronicle a bien envie qu’on ne se sépare pas de nous. Je parie toujours que l'affaire s'arrangera du consentement de tout le monde. On veut bien se bouder, se taquiner ; mais personne ne veut se brouiller avec personne.
Dit-on les nouvelles propositions de l'Angleterre comme on me les a dites, la moitié de la Syrie au Pacha, sauf St Jean d’Acre et en cas de besoin, toutes les flottes ensemble à Constantinople ?
Quand vous aurez le Lord Chatam, dites-moi ce que vous pensez de ce caractère-là. J’aime bien mieux votre impression que le livre, que je lirai pourtant à mon retour.
Il me vient des nouvelles de Thiers, toujours plus aigre contre MM. Passy et Dulaure, et de plus en plus embarrassé de la Réforme électorale. Si les affaires d'Orient s’arrangent, il sera en effet fort embarrassé, car il n’y aura point de champ de bataille au dehors ; il faudra en chercher un au dedans, et il n’aime pas, ceux-là.
Du reste plus militaire que jamais ; la tête lui tourne des guerres impériales ; il ne parle que de l’armée de la triste condition de l’armée du peu qu’on fait pour elle qui est pourtant le seul appui du pouvoir. A Lille, il assiste à toutes les revues, et passe sa vie avec les officiers de la garnison. Sa femme est de nouveau fort malade.
Mercredi, 8 heures
Quand vous verrez Tscham soyez assez bonne pour lui demander si M. Eynard et M. Naville de Châteauvieux sont à Genève en ce moment. Il doit le savoir. Hier, je n’ai pas mis le nez hors de la maison. Il a pli tout le jour. Ce matin il fait le plus beau soleil du monde. Beau sans chaleur, ce qui n’est jamais qu'une demi-beauté. La lumière ne suffit. pas ; il faut le feu. Il me semble que ma toux s’en va tout à fait. Mais je sens bien que l’humidité me la rendrait. Il me déplaît que vous vous soyez établie sans moi rue St Florentin. J’aurais voulu assister au début, et le partager. Vous trouvez-vous bien ? Je regarde avec plaisir ce soleil qui brille sur vous. De qui vous vient le maître d’hôtel que vous avez pris ?
9 heures et demie
J'ai besoin de relire la note de Bruxner pour la bien comprendre et vous l'expliquer. Ce n’est pas trop de notre esprit à tous deux. A demain les affaires. Adieu. Adieu. G.
Prenez-vous quelque intérêt à la querelle du Roi de Prusse avec ses sujets catholiques. Je soupçonne l’archevêque de Posen de s'être enfui pour être repris, et pour attiser un peu le feu que le Gouvernement Prussien essayait de calmer. Rome est encore avec les états protestants comme les Princes légitimes avec les sujets rebelles. Ils se croient tout permis et ne se tiennent jamais pour obligés à rien. Et cette perfidie arrogante les perd plus que toute autre cause. On finit par se persuader qu’il n'y a pour en finir avec eux, d'autre moyen que la force et l'extermination. Je ne sais ce que vous aura dit Lord Granville ; mais malgré son aigreur, le Morming Chronicle a bien envie qu’on ne se sépare pas de nous. Je parie toujours que l'affaire s'arrangera du consentement de tout le monde. On veut bien se bouder, se taquiner ; mais personne ne veut se brouiller avec personne.
Dit-on les nouvelles propositions de l'Angleterre comme on me les a dites, la moitié de la Syrie au Pacha, sauf St Jean d’Acre et en cas de besoin, toutes les flottes ensemble à Constantinople ?
Quand vous aurez le Lord Chatam, dites-moi ce que vous pensez de ce caractère-là. J’aime bien mieux votre impression que le livre, que je lirai pourtant à mon retour.
Il me vient des nouvelles de Thiers, toujours plus aigre contre MM. Passy et Dulaure, et de plus en plus embarrassé de la Réforme électorale. Si les affaires d'Orient s’arrangent, il sera en effet fort embarrassé, car il n’y aura point de champ de bataille au dehors ; il faudra en chercher un au dedans, et il n’aime pas, ceux-là.
Du reste plus militaire que jamais ; la tête lui tourne des guerres impériales ; il ne parle que de l’armée de la triste condition de l’armée du peu qu’on fait pour elle qui est pourtant le seul appui du pouvoir. A Lille, il assiste à toutes les revues, et passe sa vie avec les officiers de la garnison. Sa femme est de nouveau fort malade.
Mercredi, 8 heures
Quand vous verrez Tscham soyez assez bonne pour lui demander si M. Eynard et M. Naville de Châteauvieux sont à Genève en ce moment. Il doit le savoir. Hier, je n’ai pas mis le nez hors de la maison. Il a pli tout le jour. Ce matin il fait le plus beau soleil du monde. Beau sans chaleur, ce qui n’est jamais qu'une demi-beauté. La lumière ne suffit. pas ; il faut le feu. Il me semble que ma toux s’en va tout à fait. Mais je sens bien que l’humidité me la rendrait. Il me déplaît que vous vous soyez établie sans moi rue St Florentin. J’aurais voulu assister au début, et le partager. Vous trouvez-vous bien ? Je regarde avec plaisir ce soleil qui brille sur vous. De qui vous vient le maître d’hôtel que vous avez pris ?
9 heures et demie
J'ai besoin de relire la note de Bruxner pour la bien comprendre et vous l'expliquer. Ce n’est pas trop de notre esprit à tous deux. A demain les affaires. Adieu. Adieu. G.
290. Val-Richer, Mercredi 16 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
290 Du Val-Richer, Mercredi soir 16 oct 1839 9 heures
La note de Bruxner est évidemment très obscure. Cependant en voici le sens. Quand il dit : " Nous avons à attendre incessamment l’autorisation nécessaire pour faire payement à M. le Comte du solde stipulé &. " Il veut dire qu’il recevra incessamment de vos fils, l'autorisation de remettre au comte votre frère, comme votre fondé de pouvoirs, le solde stipulé dut, savoir 14 000 roubles argent pour l’année de revenu et 24 000 roubles & &. Il me semble que ces 14 000 roubles argent doivent faire, les 60 et quelques mille francs sur lesquels vous comptiez. Ce que je ne comprends pas, c’est que vous n’ayez pas encore reçu l'acte signé qu’il vous annonce. Votre frère a certainement négligé de vous l'envoyer. Il lui a paru que puisqu'il avait fini, lui, c'était assez pour vous. Il est impossible pourtant que vous ne le receviez pas bientôt.
Puisque, lord Landsdown est à Vienne, vous aviez raison et on était mal informé. Il faudra bien que cela aussi s'éclaircisse comme vos affaires. Je ne m'inquiète pas beaucoup des vicissitudes qu’on traversera. Je crois toujours qu'elles aboutiront au même dénouement. On me mande que Thiers a dû arriver à Paris hier au soir rappelé avec tous les siens par une maladie grave de la mère de Mad. Dodne.
Jeudi 7 heures et demie
L’arrestation de Blanqui, le second ou plutôt le premier de Barbès, fait-elle quelque effet ? Ce sera un grand ennui, et un assez gros embarras pour la Chambre des Pairs. Comment jugera-t-elle autrement qu’elle n'a fait Barbés et comment jugera-t-elle de même. Je suis sûr que le Chancelier en est très préoccupé. On use bien vite les bons instruments dans ce pays-ci. Comme cour de justice, la Chambre des Pairs a fait des miracles depuis 1830. On l’en a dégoûtée. Elle n'en voudra plus faire. Le procès de Blanqui ne sera pas le seul.
Vous n’avez peut-être pas remarqué dans les journaux que Guinard l’un des principaux chefs du procès d'avril est revenu d'Angleterre et s'est constitué prisonnier pour se faire juger. Son père est mort et lui a laissé 40 ou 30 mille livres de rente. On lui a offert sa grâce. Il l'a refusée. Il veut être jugé. Tout cela ne ranimera pas les procès, ni juges, ni accusés. Mais cela fera des embarras, et des embarras ridicules. Du reste le ridicule est mort, comme tant d'autres choses. On ne se moque plus de rien, ni de personne.
9 heures et demie
Je me trompe. Le ridicule n’est pas mort. Ma bonté pour vous le ressuscite. Mais je vous le pardonne. Vous l’avez vu la première. Je rétablis les faits. On n’avait pas, autant qu’il m'en souvient, de nouvelles de Vienne. Mais on avait, de Berlin, une grande approbation, & l’opinion, positivement exprimée, qu’il en serait de même à Vienne. Du reste, vous avez raison, il y a bien du trouble dans les sources les plus pures.
Adieu. Je suis charmé de vous savoir installée, même mal. On est trop heureux quand le bien vient au bout du mal. Le contraire arrive si souvent. Adieu. Adieu. G.
La note de Bruxner est évidemment très obscure. Cependant en voici le sens. Quand il dit : " Nous avons à attendre incessamment l’autorisation nécessaire pour faire payement à M. le Comte du solde stipulé &. " Il veut dire qu’il recevra incessamment de vos fils, l'autorisation de remettre au comte votre frère, comme votre fondé de pouvoirs, le solde stipulé dut, savoir 14 000 roubles argent pour l’année de revenu et 24 000 roubles & &. Il me semble que ces 14 000 roubles argent doivent faire, les 60 et quelques mille francs sur lesquels vous comptiez. Ce que je ne comprends pas, c’est que vous n’ayez pas encore reçu l'acte signé qu’il vous annonce. Votre frère a certainement négligé de vous l'envoyer. Il lui a paru que puisqu'il avait fini, lui, c'était assez pour vous. Il est impossible pourtant que vous ne le receviez pas bientôt.
Puisque, lord Landsdown est à Vienne, vous aviez raison et on était mal informé. Il faudra bien que cela aussi s'éclaircisse comme vos affaires. Je ne m'inquiète pas beaucoup des vicissitudes qu’on traversera. Je crois toujours qu'elles aboutiront au même dénouement. On me mande que Thiers a dû arriver à Paris hier au soir rappelé avec tous les siens par une maladie grave de la mère de Mad. Dodne.
Jeudi 7 heures et demie
L’arrestation de Blanqui, le second ou plutôt le premier de Barbès, fait-elle quelque effet ? Ce sera un grand ennui, et un assez gros embarras pour la Chambre des Pairs. Comment jugera-t-elle autrement qu’elle n'a fait Barbés et comment jugera-t-elle de même. Je suis sûr que le Chancelier en est très préoccupé. On use bien vite les bons instruments dans ce pays-ci. Comme cour de justice, la Chambre des Pairs a fait des miracles depuis 1830. On l’en a dégoûtée. Elle n'en voudra plus faire. Le procès de Blanqui ne sera pas le seul.
Vous n’avez peut-être pas remarqué dans les journaux que Guinard l’un des principaux chefs du procès d'avril est revenu d'Angleterre et s'est constitué prisonnier pour se faire juger. Son père est mort et lui a laissé 40 ou 30 mille livres de rente. On lui a offert sa grâce. Il l'a refusée. Il veut être jugé. Tout cela ne ranimera pas les procès, ni juges, ni accusés. Mais cela fera des embarras, et des embarras ridicules. Du reste le ridicule est mort, comme tant d'autres choses. On ne se moque plus de rien, ni de personne.
9 heures et demie
Je me trompe. Le ridicule n’est pas mort. Ma bonté pour vous le ressuscite. Mais je vous le pardonne. Vous l’avez vu la première. Je rétablis les faits. On n’avait pas, autant qu’il m'en souvient, de nouvelles de Vienne. Mais on avait, de Berlin, une grande approbation, & l’opinion, positivement exprimée, qu’il en serait de même à Vienne. Du reste, vous avez raison, il y a bien du trouble dans les sources les plus pures.
Adieu. Je suis charmé de vous savoir installée, même mal. On est trop heureux quand le bien vient au bout du mal. Le contraire arrive si souvent. Adieu. Adieu. G.
291. Val-Richer, Jeudi 17 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
291 Du Val-Richer, Jeudi soir 17 oct 1839 9 heures
Je me suis promené hier longtemps. Le temps était admirable. Aujourd’hui la pluie a recommencé au moment où j'allais sortir. J’ai pourtant eu quatre visites de Lisieux J'admire les gens qui font cinq lieues par la pluie pour venir passer une demi heure avec moi. Il faut que je sois bien aimable. Je le suis pourtant fort peu cette année pour mes amis de Lisieux et des environs. C’est au mois d'Octobre qu’on me donne à dîner. J’ai déclaré que je n’en accepterais aucun, que j'étais encore enrhumé, que je ne voulais pas l'être pour la session, et que mon médecin m’avait interdit d’ici là toute course, tout dîner. Je suis à mon neuvième refus. On me les pardonnera. Je m'en porterai mieux, et je serai libre plutôt.
Je ferais volontiers cinq lieues pour aller dîner rue St. Florentin et je suis sûr que je ne m’en porterais pas plus mal. Du reste, pour la première fois depuis six semaines presque, j’ai eu aujourd’hui le sentiment de la pleine santé. Je n’ai pas toussé du tout, ni éprouvé la moindre peine à respirer.
Vendredi 7 heures
Comment s’est passé votre dîner Fleischmann ? A-t-il eu l’air aussi ahuri en vous le donnant qu'en vous y priant ? Est-ce que les Granville ne sont pas arrivés ? Vous ne m'en dîtes rien. L’impopularité de la Reine me paraît en progrès. On exploite bien longtemps contre elle cette pauvre Lady Flora Hastings. Il y a des fautes interminables.
Savez-vous si Lord Ponsonby reste décidément à Constantinople ? Il avait été question de le rappeler lorsque nous avons rappelé l’amiral Roussin. Mais on ne paraît pas disposé, pour le moment à faire comme nous. On n’ose pas non plus faire autrement. C’est de la bien petite politique.
4 heures
La poste ne m’arrive qu'à onze heures. Une roue de la voiture s'est brisée à Mantes. Je commençais à m'impatienter. Je vous aime beaucoup. Je vous le dirai à mon aise demain, en attendant mieux. Il faut aujourd’hui que je renvoie promptement le facteur ; sans quoi ma lettre vous manquerait demain. Adieu. Adieu. Je vous en prie, ayez de jolis tapis. Adieu. G.
Je me suis promené hier longtemps. Le temps était admirable. Aujourd’hui la pluie a recommencé au moment où j'allais sortir. J’ai pourtant eu quatre visites de Lisieux J'admire les gens qui font cinq lieues par la pluie pour venir passer une demi heure avec moi. Il faut que je sois bien aimable. Je le suis pourtant fort peu cette année pour mes amis de Lisieux et des environs. C’est au mois d'Octobre qu’on me donne à dîner. J’ai déclaré que je n’en accepterais aucun, que j'étais encore enrhumé, que je ne voulais pas l'être pour la session, et que mon médecin m’avait interdit d’ici là toute course, tout dîner. Je suis à mon neuvième refus. On me les pardonnera. Je m'en porterai mieux, et je serai libre plutôt.
Je ferais volontiers cinq lieues pour aller dîner rue St. Florentin et je suis sûr que je ne m’en porterais pas plus mal. Du reste, pour la première fois depuis six semaines presque, j’ai eu aujourd’hui le sentiment de la pleine santé. Je n’ai pas toussé du tout, ni éprouvé la moindre peine à respirer.
Vendredi 7 heures
Comment s’est passé votre dîner Fleischmann ? A-t-il eu l’air aussi ahuri en vous le donnant qu'en vous y priant ? Est-ce que les Granville ne sont pas arrivés ? Vous ne m'en dîtes rien. L’impopularité de la Reine me paraît en progrès. On exploite bien longtemps contre elle cette pauvre Lady Flora Hastings. Il y a des fautes interminables.
Savez-vous si Lord Ponsonby reste décidément à Constantinople ? Il avait été question de le rappeler lorsque nous avons rappelé l’amiral Roussin. Mais on ne paraît pas disposé, pour le moment à faire comme nous. On n’ose pas non plus faire autrement. C’est de la bien petite politique.
4 heures
La poste ne m’arrive qu'à onze heures. Une roue de la voiture s'est brisée à Mantes. Je commençais à m'impatienter. Je vous aime beaucoup. Je vous le dirai à mon aise demain, en attendant mieux. Il faut aujourd’hui que je renvoie promptement le facteur ; sans quoi ma lettre vous manquerait demain. Adieu. Adieu. Je vous en prie, ayez de jolis tapis. Adieu. G.
292. Val-Richer, Samedi 19 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
292 Du Val Richer, samedi matin 19 Oct. 1839
7 heures et demie
Hier au soir à 9 heures, en traversant la bibliothèque pour rentrer dans mon Cabinet, je me suis arrêté devant le plus beau clair de lune du monde. La bibliothèque en était éclairée. J’ai transporté cette lumière blanche et douce, ces bois, ces prairies, le bruit de l’eau et vous et moi, à deux cents lieues vers le midi, sous un ciel chaud et embaumé. C’était charmant. Gardez, je vous prie votre esprit comme il est fait. Je n'accepte pas en place celui du baron de Krudener. Sa mère était-elle vraiment aussi séduisante, qu’on l'a dit ? Elle a fait un roman qui s’appelle Valérie et qui a charmé ma toute première jeunesse. Mais cela ne prouve rien. Je me fais tort pourtant, tous les romans ne me charmaient pas. Aujourd'hui, je les trouve bons au dessous de ce qui se pourrait et se devrait. L’expérience de la vie, m'a appris qu'un jour une heure d'affection et de bonheur vrai est infiniment au dessus de toute l'éloquence et de toute la passion des plus beaux romans.
Je comprends vos ennuis de meubles, & j'en suis touché. Mais pas outre mesure. Ce que je crains beaucoup pour vous, ce sont les ennuis vides. Les ennuis pleins et pressés sont plus supportables. Je ne comprends pas comment vous mettrez la paix entre vos conseillés avec une tenture de soie dans le premier salon. N'a-t-il pas dû toujours y en avoir une ? N'était-ce pas là la place du meuble rouge à ramages jaunes de M. Jennison ? Puisqu'il n’y a pas réussi ; je suis bien aise qu’il ait essayé de vous duper. Il ne m’a jamais plu.
Je vois qu’en effet vous êtes sur le point de vous brouiller avec le pape. On dit que les évêques de Pologne lui ont écrit que l'Empereur avait formé, et commençait à exécuter le projet de renverser systématiquement toute la constitution religieuse et tous les rapports religieux de leur pays. Vous finirez par fournir un fait de plus à l'argument que M. Fox puisait contre la traite des nègres, dans la démence fréquente des capitaines négriers.
9 h.et demie
Quelle façon de faire les affaires d’une mère et d’une sœur ! Je suis pourtant bien aise que ce soit fini. Je ne crois guère à la possibilité de réclamer pour le mobilier de la terre de Courlande. Les plein- pouvoirs donnés à votre frère comprenait celui de transiger à ce sujet. Il en a usé et abusé, mais c’est fait. D'ailleurs, qui vous représenterait qui vous soutiendrait efficacement dans une contestation ? Vous ne pouvez pas avoir de contestation, à cette distance, dans un pays de loups, pour une affaire de vaches et de moutons. Laissez l'affaire là ; partagez le capital de Londres, et si vous dépensez rue St Florentin un peu plus d'argent que vous n'en avez, vendez quelques diamants. Ils vous donneront plus d'agrément en bons fauteuils et un jolis tapis que dans votre écrin. Adieu. Adieu. Nous trouverions bien assez de temps pour placer un Adieu. G.
7 heures et demie
Hier au soir à 9 heures, en traversant la bibliothèque pour rentrer dans mon Cabinet, je me suis arrêté devant le plus beau clair de lune du monde. La bibliothèque en était éclairée. J’ai transporté cette lumière blanche et douce, ces bois, ces prairies, le bruit de l’eau et vous et moi, à deux cents lieues vers le midi, sous un ciel chaud et embaumé. C’était charmant. Gardez, je vous prie votre esprit comme il est fait. Je n'accepte pas en place celui du baron de Krudener. Sa mère était-elle vraiment aussi séduisante, qu’on l'a dit ? Elle a fait un roman qui s’appelle Valérie et qui a charmé ma toute première jeunesse. Mais cela ne prouve rien. Je me fais tort pourtant, tous les romans ne me charmaient pas. Aujourd'hui, je les trouve bons au dessous de ce qui se pourrait et se devrait. L’expérience de la vie, m'a appris qu'un jour une heure d'affection et de bonheur vrai est infiniment au dessus de toute l'éloquence et de toute la passion des plus beaux romans.
Je comprends vos ennuis de meubles, & j'en suis touché. Mais pas outre mesure. Ce que je crains beaucoup pour vous, ce sont les ennuis vides. Les ennuis pleins et pressés sont plus supportables. Je ne comprends pas comment vous mettrez la paix entre vos conseillés avec une tenture de soie dans le premier salon. N'a-t-il pas dû toujours y en avoir une ? N'était-ce pas là la place du meuble rouge à ramages jaunes de M. Jennison ? Puisqu'il n’y a pas réussi ; je suis bien aise qu’il ait essayé de vous duper. Il ne m’a jamais plu.
Je vois qu’en effet vous êtes sur le point de vous brouiller avec le pape. On dit que les évêques de Pologne lui ont écrit que l'Empereur avait formé, et commençait à exécuter le projet de renverser systématiquement toute la constitution religieuse et tous les rapports religieux de leur pays. Vous finirez par fournir un fait de plus à l'argument que M. Fox puisait contre la traite des nègres, dans la démence fréquente des capitaines négriers.
9 h.et demie
Quelle façon de faire les affaires d’une mère et d’une sœur ! Je suis pourtant bien aise que ce soit fini. Je ne crois guère à la possibilité de réclamer pour le mobilier de la terre de Courlande. Les plein- pouvoirs donnés à votre frère comprenait celui de transiger à ce sujet. Il en a usé et abusé, mais c’est fait. D'ailleurs, qui vous représenterait qui vous soutiendrait efficacement dans une contestation ? Vous ne pouvez pas avoir de contestation, à cette distance, dans un pays de loups, pour une affaire de vaches et de moutons. Laissez l'affaire là ; partagez le capital de Londres, et si vous dépensez rue St Florentin un peu plus d'argent que vous n'en avez, vendez quelques diamants. Ils vous donneront plus d'agrément en bons fauteuils et un jolis tapis que dans votre écrin. Adieu. Adieu. Nous trouverions bien assez de temps pour placer un Adieu. G.
293. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
293 Du Val-Richer, dimanche 20 oct. 1839
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins, tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui. Adieu. Adieu. G.
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins, tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui. Adieu. Adieu. G.
294. Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
294 Du Val-Richer, dimanche soir 20 oct. 1839
9 heures
J’ai eu du monde sans relâche toute la matinée. Parce que je refuse tous les dîners, on se croit obligé de venir me voir deux fois, davantage. J’aimerais mieux discuter avec vos ouvriers. Je ne tousse plus du tout. J’y aurais regret si je n’arrangeais pas déjà mon retour à peu près pour l'époque que je vous ai dite. Il continue pourtant de faire beau.
Vous trouverai-je tout-à-fait arrangée ? Ne vous ruinez pas. Je crains vos goûts de perfection bien naturels et de bien bon goût, Limitez-vous pourtant dans votre perfection. L’appartement est déjà cher pour vous. N'aggravez pas trop le mal. Pippin, vous a-t-il quittée ? Comment Felix prend-il son petit changement de condition. Avez-vous eu le courage de l’en informer ? Je doute que vous eussiez été un bon ministre d’un gouvernement représentatif. Dire oui n’est que la moitié du talent. Non est l’autre moitié. Celle-ci vous eût manqué. Vous ne savez que plaire.
Don Carlos me paraît pressé d'avoir ses passeports. Et le Roi presse de les lui donner. Les Ministres veulent attendre l’issue de l'affaire de Cabrera. Ils ont raison. D’autant plus raison que Don Carlos a donné sous main, ordre à Cabrera de continuer la guerre. Entendez-vous dire quelque chose de Thiers ?
9 heures et demie
Vous avez tout-à-fait le droit, et vous aurez raison avant de faire la partage du capital de Londres, de demander à être informée de ce que vous aurez à toucher en argent et en effets à Pétersbourg. Je ne pense pas que vous puissiez désormais exercer aucun recours légal, ni que vous fissiez bien de le tenter, même indirectement. Mais ce qui se pourra pour embarrasser et pour arracher de la mauvaise honte quelques lumières, et quelques sommes de plus, il faut le faire. J’approuve donc tout-à-fait que vous adressiez à Londres votre question. Parlez aussi à votre frère de l'oubli de vos droits sur le mobilier de Courlande. Il ne faut pas qu’il ignore tout-à-fait sa propre légèreté, ni qu’il croie qu'elle a passé inaperçue. Je suis charmé que ce coup de pierre ne soit rien. J’ai la Reine à cœur. Après les assassins, les fous. Ceux-là aussi passeront.
Adieu. Adieu. J’ai ma petite Pauline un peu indisposée. Ce n’est rien. Adieu G.
9 heures
J’ai eu du monde sans relâche toute la matinée. Parce que je refuse tous les dîners, on se croit obligé de venir me voir deux fois, davantage. J’aimerais mieux discuter avec vos ouvriers. Je ne tousse plus du tout. J’y aurais regret si je n’arrangeais pas déjà mon retour à peu près pour l'époque que je vous ai dite. Il continue pourtant de faire beau.
Vous trouverai-je tout-à-fait arrangée ? Ne vous ruinez pas. Je crains vos goûts de perfection bien naturels et de bien bon goût, Limitez-vous pourtant dans votre perfection. L’appartement est déjà cher pour vous. N'aggravez pas trop le mal. Pippin, vous a-t-il quittée ? Comment Felix prend-il son petit changement de condition. Avez-vous eu le courage de l’en informer ? Je doute que vous eussiez été un bon ministre d’un gouvernement représentatif. Dire oui n’est que la moitié du talent. Non est l’autre moitié. Celle-ci vous eût manqué. Vous ne savez que plaire.
Don Carlos me paraît pressé d'avoir ses passeports. Et le Roi presse de les lui donner. Les Ministres veulent attendre l’issue de l'affaire de Cabrera. Ils ont raison. D’autant plus raison que Don Carlos a donné sous main, ordre à Cabrera de continuer la guerre. Entendez-vous dire quelque chose de Thiers ?
9 heures et demie
Vous avez tout-à-fait le droit, et vous aurez raison avant de faire la partage du capital de Londres, de demander à être informée de ce que vous aurez à toucher en argent et en effets à Pétersbourg. Je ne pense pas que vous puissiez désormais exercer aucun recours légal, ni que vous fissiez bien de le tenter, même indirectement. Mais ce qui se pourra pour embarrasser et pour arracher de la mauvaise honte quelques lumières, et quelques sommes de plus, il faut le faire. J’approuve donc tout-à-fait que vous adressiez à Londres votre question. Parlez aussi à votre frère de l'oubli de vos droits sur le mobilier de Courlande. Il ne faut pas qu’il ignore tout-à-fait sa propre légèreté, ni qu’il croie qu'elle a passé inaperçue. Je suis charmé que ce coup de pierre ne soit rien. J’ai la Reine à cœur. Après les assassins, les fous. Ceux-là aussi passeront.
Adieu. Adieu. J’ai ma petite Pauline un peu indisposée. Ce n’est rien. Adieu G.
295. Val-Richer, Mardi 22 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
295 Du Val-Richer, mardi 22 octobre 1839
7 heures
Pauline va bien. Je sors de sa chambre. Elle a parfaitement dormi. C’est un enfant prodigieusement nerveux, un petit instrument toujours tendu et qui retentit toujours. L’immobilité et le sommeil sont pour elle de vrais remèdes. Je ne sors jamais sans un serrement de cœur de la Chambre de mes filles. Il n'y a point de sécurité où il n'y a pas une mère. La mienne est excellente pour mes enfants, et de la tendresse la plus dévouée. Mais elle a 75 ans.
Votre appartement doit être en effet très bruyant. Mais vous devez pouvoir vous en défendre à force de sourdines. A côté du bruit, il y a de l’espace pour que le bruit s'y répande et s'y perde. Vous jouirez beaucoup du printemps. La verdure, le soleil et les oiseaux reviendront pour vous aux Tuileries plutôt que pour personne.
A propos de retour, les Granville sont-ils revenus ?
Il faut à présent que quelque incident survienne qui fasse faire à la question d'Orient un nouveau pas. Nous sommes tous en Occident arrivés au point où nous resterons sur cette affaire. Je ne vois pas d’où viendraient la concession et le mouvement. Le statu quo indéfini ne se peut pourtant pas. Je compte sur Méhémet. Avez-vous remarqué, dans le Constitutionnel l'humeur de Thiers sur les faveurs de Madrid pour le Maréchal, la toison la grandesse &.. ? Il va, en fait, de jalousie, sur les brisées de M. Molé. On dit que le Maréchal grogne un peu des 30 000 fr que lui coûte le brevet de la Toison. Voici ce qu’on me dit : " Thiers est ici ricanant. beaucoup, mais sans tapage. Ses amis sont très sombres. Ils sont chargés de faire quelques avances aux centres. Mais le mot d’ordre varie tous les jours. Il n’y a qu’un sentiment qui ne change pas, c’est la fureur contre Dufaure et Passy. " M. Passy a gagné quelque chose auprès du Roi. Le Roi le trouve plus intelligent que les autres sur les Affaires étrangères, et aussi plus large, un peu plus aristocratique en fait de Gouvernement. Il a consenti en effet à demander une dotation pour M. le duc de Nemours. Le Roi traitera toujours bien MM. Passy et Dufaure. Il leur sait un gré infini de ce que Thiers ne leur pardonne pas ! M. Dufaure s'affectionne beaucoup au Ministère.
10 heures
Vous m’arrivez à travers un brouillard effroyable. Vous avez le pouvoir de dissiper tous ceux du dedans. Mais ceux du dehors vous résistent. Je suis charmé que Lady Granville, soit de retour. Je reviendrai aussi. Et plus vous me presserez, plus je serai charmé de revenir. La coquetterie est indestructible. N'est-ce pas ? Adieu. Adieu. Ne vous tracassez pas. Adieu.
7 heures
Pauline va bien. Je sors de sa chambre. Elle a parfaitement dormi. C’est un enfant prodigieusement nerveux, un petit instrument toujours tendu et qui retentit toujours. L’immobilité et le sommeil sont pour elle de vrais remèdes. Je ne sors jamais sans un serrement de cœur de la Chambre de mes filles. Il n'y a point de sécurité où il n'y a pas une mère. La mienne est excellente pour mes enfants, et de la tendresse la plus dévouée. Mais elle a 75 ans.
Votre appartement doit être en effet très bruyant. Mais vous devez pouvoir vous en défendre à force de sourdines. A côté du bruit, il y a de l’espace pour que le bruit s'y répande et s'y perde. Vous jouirez beaucoup du printemps. La verdure, le soleil et les oiseaux reviendront pour vous aux Tuileries plutôt que pour personne.
A propos de retour, les Granville sont-ils revenus ?
Il faut à présent que quelque incident survienne qui fasse faire à la question d'Orient un nouveau pas. Nous sommes tous en Occident arrivés au point où nous resterons sur cette affaire. Je ne vois pas d’où viendraient la concession et le mouvement. Le statu quo indéfini ne se peut pourtant pas. Je compte sur Méhémet. Avez-vous remarqué, dans le Constitutionnel l'humeur de Thiers sur les faveurs de Madrid pour le Maréchal, la toison la grandesse &.. ? Il va, en fait, de jalousie, sur les brisées de M. Molé. On dit que le Maréchal grogne un peu des 30 000 fr que lui coûte le brevet de la Toison. Voici ce qu’on me dit : " Thiers est ici ricanant. beaucoup, mais sans tapage. Ses amis sont très sombres. Ils sont chargés de faire quelques avances aux centres. Mais le mot d’ordre varie tous les jours. Il n’y a qu’un sentiment qui ne change pas, c’est la fureur contre Dufaure et Passy. " M. Passy a gagné quelque chose auprès du Roi. Le Roi le trouve plus intelligent que les autres sur les Affaires étrangères, et aussi plus large, un peu plus aristocratique en fait de Gouvernement. Il a consenti en effet à demander une dotation pour M. le duc de Nemours. Le Roi traitera toujours bien MM. Passy et Dufaure. Il leur sait un gré infini de ce que Thiers ne leur pardonne pas ! M. Dufaure s'affectionne beaucoup au Ministère.
10 heures
Vous m’arrivez à travers un brouillard effroyable. Vous avez le pouvoir de dissiper tous ceux du dedans. Mais ceux du dehors vous résistent. Je suis charmé que Lady Granville, soit de retour. Je reviendrai aussi. Et plus vous me presserez, plus je serai charmé de revenir. La coquetterie est indestructible. N'est-ce pas ? Adieu. Adieu. Ne vous tracassez pas. Adieu.
296. Val-Richer, Mercredi 23 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
296 Du Val-Richer, Mercredi 25 oct. 1839
7 heures
Ma journée a été prise hier par M. Hèbert, qui me reste encore aujourd’hui. C’est un homme de quelque importance dans la Chambre. Il a du sens, du courage et de la parole. Il m’a toujours été très fidèle. Mais c'est une terrible chose qu’un brouillard qui rend la promenade impossible, et la conversation permanente. Je ne connais plus que vous au monde avec qui en fait de présence et de conversation, je n’arrive jamais au bout de mon plaisir. Mon hôte ne sait rien. Il vit depuis deux mois à la campagne, en vacances. Sa disposition me paraît être celle des gens sensés du centre, le mécontentement expectant, peu de confiance et peu d’ambition.
Vous verrez que D. Carlos, pour avoir ses passeports, sera obligé de prier sérieusement Cabrera et le comte d’Espagne d'en finir, & qu’ils ne lui obéiront pas. Raison de plus pour ne pas les lui donner de sitôt ; il faut qu’il ait autant d'envie que la reine Christine de voir cesser la guerre civile, et qu’il emploie ce qu’il a d'influence pour nous comme il l'a employée contre nous. Bourges doit être bien ennuyeux, pas plus pourtant qu’Elisando, je pense. Je ne suppose pas que les visiteurs Carlistes suffisent pour charmer le séjour. Quel puérile parti !
Il me paraît que Berryer poursuit sa candidature à l’Académie française car on m'en écrit de nouveau. Parlerait-il du Roi comme il convient dans son discours de réception ? Demandez-le lui tout simplement si vous le voyez. Remarquez-vous, de votre côté un léger, bien léger mouvement pour nous adoucir un peu dans notre refus de faire comme l’Angleterre.
Plus j'y pense, et plus je répète, pour la politique ce que Mirabeau disait pour la morale : " la petite tue la grande. " Et je le répète contre tout le monde.
Pour rien au monde, je ne voudrais épouser la Reine d’Angleterre. Vous n'aviez pas bonne opinion de l'avenir conjugal de la Princesse Charlotte. Je parierais bien plus contre cet avenir-ci. Je ne sais pourquoi, car au fait je n'en sais rien. Mais j’ai cette impression. Peu importe du reste au résultat. Le Prince de Cobourg ne l'en poursuivra pas moins, et ne s'en félicitera pas moins, s’il l'obtient. Puis le temps s’écoulera ; les mécomptes viendront les ennuis, les colères, les regrets peut-être. C'est le train de la vie. Bien peu y échappent, même de ceux qui le prévoient.
9 heures et demie
Je m’attendais, en effet au dénouement de Félix. Vous faites bien de le garder. Moi aussi, j’attends le beau mois de Novembre. Adieu. Adieu. Je vous quitte bien brusquement. Mon hôte entre dans mon Cabinet. Si c'était vous !
7 heures
Ma journée a été prise hier par M. Hèbert, qui me reste encore aujourd’hui. C’est un homme de quelque importance dans la Chambre. Il a du sens, du courage et de la parole. Il m’a toujours été très fidèle. Mais c'est une terrible chose qu’un brouillard qui rend la promenade impossible, et la conversation permanente. Je ne connais plus que vous au monde avec qui en fait de présence et de conversation, je n’arrive jamais au bout de mon plaisir. Mon hôte ne sait rien. Il vit depuis deux mois à la campagne, en vacances. Sa disposition me paraît être celle des gens sensés du centre, le mécontentement expectant, peu de confiance et peu d’ambition.
Vous verrez que D. Carlos, pour avoir ses passeports, sera obligé de prier sérieusement Cabrera et le comte d’Espagne d'en finir, & qu’ils ne lui obéiront pas. Raison de plus pour ne pas les lui donner de sitôt ; il faut qu’il ait autant d'envie que la reine Christine de voir cesser la guerre civile, et qu’il emploie ce qu’il a d'influence pour nous comme il l'a employée contre nous. Bourges doit être bien ennuyeux, pas plus pourtant qu’Elisando, je pense. Je ne suppose pas que les visiteurs Carlistes suffisent pour charmer le séjour. Quel puérile parti !
Il me paraît que Berryer poursuit sa candidature à l’Académie française car on m'en écrit de nouveau. Parlerait-il du Roi comme il convient dans son discours de réception ? Demandez-le lui tout simplement si vous le voyez. Remarquez-vous, de votre côté un léger, bien léger mouvement pour nous adoucir un peu dans notre refus de faire comme l’Angleterre.
Plus j'y pense, et plus je répète, pour la politique ce que Mirabeau disait pour la morale : " la petite tue la grande. " Et je le répète contre tout le monde.
Pour rien au monde, je ne voudrais épouser la Reine d’Angleterre. Vous n'aviez pas bonne opinion de l'avenir conjugal de la Princesse Charlotte. Je parierais bien plus contre cet avenir-ci. Je ne sais pourquoi, car au fait je n'en sais rien. Mais j’ai cette impression. Peu importe du reste au résultat. Le Prince de Cobourg ne l'en poursuivra pas moins, et ne s'en félicitera pas moins, s’il l'obtient. Puis le temps s’écoulera ; les mécomptes viendront les ennuis, les colères, les regrets peut-être. C'est le train de la vie. Bien peu y échappent, même de ceux qui le prévoient.
9 heures et demie
Je m’attendais, en effet au dénouement de Félix. Vous faites bien de le garder. Moi aussi, j’attends le beau mois de Novembre. Adieu. Adieu. Je vous quitte bien brusquement. Mon hôte entre dans mon Cabinet. Si c'était vous !
297. Val-Richer, Jeudi 24 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
297 Du Val-Richer Jeudi 24 Oct 1839
7 heures et demie
Je vois que vous commencez à jouir de votre entresol. Que sera-ce ce printemps ? Les journaux s'amusent à remarquer que vous avez pris l’appartement de M. de Talleyrand. Cette maison et son maître m'ont frappé en 1814, au moment de la Restauration. C’est son grand moment, le seul à vrai dire. Il y a été déployé à ce moment là, un grand savoir-faire sur de grandes choses, et avec infiniment d’aisance, de bon goût, de rapidité, de résolution. A toutes les autres époques, faveur ou disgrâce, je n’ai vu là qu’un homme d’esprit très aimable, gracieux d’un commerce doux d'une conversation agréable, et très habile à plaire, au fait, il avait de grandes habitudes, mais pas de grandeur naturelle, involontaire et permanente. Vous ne m’avez jamais bien dit comment il avait été à Londres en 1830, et qu’elle était vraiment là, sa situation.
Montrond qui est venu me voir la veille de mon départ, m'a parlé de lui une demi-heure, avec le plus singulier mélange d'affection et d'indifférence, un regret très vrai et parfaitement sec. J’aurais été touché et choqué tour à tour si Montrond pouvait me toucher et me choquer. Les journaux reviennent sans cesse sur les embarras du Roi. Guillaume à propos de son projet de mariage. Est-il vrai que ce soit devenu une affaire, et qu’il rencontre de vives résistances dans sa famille ? Je m'intéresse à ce vieux Prince entêté. S'il lui plait de finir sa vie avec une ancienne amie auprès de lui, il fera bien de mettre là aussi, son entêtement.
Je crois comme vous qu'il n'y a point de nouvelles. Il ne m'en est point venu du tout. depuis plusieurs jours. Il serait plaisant que la session s’ouvrit tout simplement, tout paisiblement ; par les seules affaires. C'est peut- être ce qui vaudrait le mieux pour tout le monde.
9 heures et demie
Si vous avez quelque moyen un peu sûr et un peu prompt d'avoir des renseignements sur le mobilier de la terre de Courlande, usez-en ; ne fût-ce que pour savoir ce qu’on a si légèrement jeté à l'eau de votre bagage. Le comte Frédéric de Pahlen est ; il encore en Courlande ? Vous auriez pu vous adresser à lui. Sérieusement je n’espère rien de cette réclamation, avec de tels agents et de tels adversaires. Mais il vaut la peine de savoir au juste ce qui en est, et qui sait peut-être dans l’intervalle, surviendra-t-il quelque moyen de succès. Je m'étonne que vous n'ayez pas reçu les letters of adm. Je crains quelque coup fourré. J’ai ri aussi du Times. Il n’y a pas de mal. Adieu. Adieu. Je me lasse de ceux là. Je vous promets de ne me lasser jamais des autres. Adieu donc. G.
Je vois que vous commencez à jouir de votre entresol. Que sera-ce ce printemps ? Les journaux s'amusent à remarquer que vous avez pris l’appartement de M. de Talleyrand. Cette maison et son maître m'ont frappé en 1814, au moment de la Restauration. C’est son grand moment, le seul à vrai dire. Il y a été déployé à ce moment là, un grand savoir-faire sur de grandes choses, et avec infiniment d’aisance, de bon goût, de rapidité, de résolution. A toutes les autres époques, faveur ou disgrâce, je n’ai vu là qu’un homme d’esprit très aimable, gracieux d’un commerce doux d'une conversation agréable, et très habile à plaire, au fait, il avait de grandes habitudes, mais pas de grandeur naturelle, involontaire et permanente. Vous ne m’avez jamais bien dit comment il avait été à Londres en 1830, et qu’elle était vraiment là, sa situation.
Montrond qui est venu me voir la veille de mon départ, m'a parlé de lui une demi-heure, avec le plus singulier mélange d'affection et d'indifférence, un regret très vrai et parfaitement sec. J’aurais été touché et choqué tour à tour si Montrond pouvait me toucher et me choquer. Les journaux reviennent sans cesse sur les embarras du Roi. Guillaume à propos de son projet de mariage. Est-il vrai que ce soit devenu une affaire, et qu’il rencontre de vives résistances dans sa famille ? Je m'intéresse à ce vieux Prince entêté. S'il lui plait de finir sa vie avec une ancienne amie auprès de lui, il fera bien de mettre là aussi, son entêtement.
Je crois comme vous qu'il n'y a point de nouvelles. Il ne m'en est point venu du tout. depuis plusieurs jours. Il serait plaisant que la session s’ouvrit tout simplement, tout paisiblement ; par les seules affaires. C'est peut- être ce qui vaudrait le mieux pour tout le monde.
9 heures et demie
Si vous avez quelque moyen un peu sûr et un peu prompt d'avoir des renseignements sur le mobilier de la terre de Courlande, usez-en ; ne fût-ce que pour savoir ce qu’on a si légèrement jeté à l'eau de votre bagage. Le comte Frédéric de Pahlen est ; il encore en Courlande ? Vous auriez pu vous adresser à lui. Sérieusement je n’espère rien de cette réclamation, avec de tels agents et de tels adversaires. Mais il vaut la peine de savoir au juste ce qui en est, et qui sait peut-être dans l’intervalle, surviendra-t-il quelque moyen de succès. Je m'étonne que vous n'ayez pas reçu les letters of adm. Je crains quelque coup fourré. J’ai ri aussi du Times. Il n’y a pas de mal. Adieu. Adieu. Je me lasse de ceux là. Je vous promets de ne me lasser jamais des autres. Adieu donc. G.
298. Val-Richer, Vendredi 25 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
298. Du Val Richer Vendredi 25 octobre 1839 7 heures
J’ai remarqué que Médem, quand vous le consultiez ; était toujours de votre avis, entrait dans votre sens ; ce qui n'empêchait pas que, après le conseil, le moment de l'action venu, il ne fit rien pour vous. Lui avez-vous demandé de vous procurer sur la valeur du mobilier de la terre de Courlande, des renseignements un peu précis ? Il me semble qu’il le pourrait. Son père, si je ne me trompe, avait là, ou tout près, une partie de sa fortune. Je me méfie fort des gens qui disent toujours comme moi, et ma confiance comme mon estime, ont besoin qu'on me contrarie souvent.
Je suis charmé que Pahlen revienne ; pour vous d’abord, et aussi pour nos rapports avec vous ; bons ou mauvais, ils seront convenables et tranquilles. A présent que votre tentative sur Londres est manquée, je trouve qu'elle a été faite avec trop d’éclat. L’envoi de M. de Brünnow était une façon de monter à l'assaut ; il fallait emporter, la place. Tout cela du reste est de peu d’importance pour l’événement ; il sera le même. Ce sont de petites vicissitudes de situation et de petites agitations d'amour propre qu’on se donne comme passe-temps.
En fait de passe-temps, j’en ai un depuis deux jours qui m'amuse fort. Je lis ces mémoires de Mirabeau ou plutôt des Mirabeau, que je n’avais jamais fait que regarder. C’est une étrange famille, une fougue de passion, un besoin de suivre sa fantaisie et de faire sa volonté, une mon habitude d’énergie bizarre & d'emportement spirituel, transmis de génération en génération, comme une physionomie et un caractère de caste. Il faudra que vous lisiez cela. Mon libraire me les a envoyés avec d’autres livres, dont j’avais besoin. Je les rapporterai à Paris pour vous. Vos yeux continuent-ils de se trouver un peu mieux ?
Qu'arriverait-il si M. de Metternich refusait à Rodolphe Appony l'autorisation dont il a besoin. ? Irait-il de l'avant dans le mariage ? Mais cela n’arrivera pas.
10 heures
J’espère que la mort de Lord Brougham n’est en effet qu’une étrange mystification. Vous avez mille fois raison. Quand une gloire nationale disparaît, tout le pays s’en ressent et doit s'en affliger. Il a moins de soleil sur son horizon. donne. L'Angleterre sait bien cela. Aussi mérite-t-elle des gloires. Je ne me serais jamais douté du sentiment de Lady Clauricard ! Je ne mets pas, bien ces deux personnes là ensemble. Je suis charmé que vous ayez les letters of adm. Adieu. Adieu. G.
J’ai remarqué que Médem, quand vous le consultiez ; était toujours de votre avis, entrait dans votre sens ; ce qui n'empêchait pas que, après le conseil, le moment de l'action venu, il ne fit rien pour vous. Lui avez-vous demandé de vous procurer sur la valeur du mobilier de la terre de Courlande, des renseignements un peu précis ? Il me semble qu’il le pourrait. Son père, si je ne me trompe, avait là, ou tout près, une partie de sa fortune. Je me méfie fort des gens qui disent toujours comme moi, et ma confiance comme mon estime, ont besoin qu'on me contrarie souvent.
Je suis charmé que Pahlen revienne ; pour vous d’abord, et aussi pour nos rapports avec vous ; bons ou mauvais, ils seront convenables et tranquilles. A présent que votre tentative sur Londres est manquée, je trouve qu'elle a été faite avec trop d’éclat. L’envoi de M. de Brünnow était une façon de monter à l'assaut ; il fallait emporter, la place. Tout cela du reste est de peu d’importance pour l’événement ; il sera le même. Ce sont de petites vicissitudes de situation et de petites agitations d'amour propre qu’on se donne comme passe-temps.
En fait de passe-temps, j’en ai un depuis deux jours qui m'amuse fort. Je lis ces mémoires de Mirabeau ou plutôt des Mirabeau, que je n’avais jamais fait que regarder. C’est une étrange famille, une fougue de passion, un besoin de suivre sa fantaisie et de faire sa volonté, une mon habitude d’énergie bizarre & d'emportement spirituel, transmis de génération en génération, comme une physionomie et un caractère de caste. Il faudra que vous lisiez cela. Mon libraire me les a envoyés avec d’autres livres, dont j’avais besoin. Je les rapporterai à Paris pour vous. Vos yeux continuent-ils de se trouver un peu mieux ?
Qu'arriverait-il si M. de Metternich refusait à Rodolphe Appony l'autorisation dont il a besoin. ? Irait-il de l'avant dans le mariage ? Mais cela n’arrivera pas.
10 heures
J’espère que la mort de Lord Brougham n’est en effet qu’une étrange mystification. Vous avez mille fois raison. Quand une gloire nationale disparaît, tout le pays s’en ressent et doit s'en affliger. Il a moins de soleil sur son horizon. donne. L'Angleterre sait bien cela. Aussi mérite-t-elle des gloires. Je ne me serais jamais douté du sentiment de Lady Clauricard ! Je ne mets pas, bien ces deux personnes là ensemble. Je suis charmé que vous ayez les letters of adm. Adieu. Adieu. G.
299. Val-Richer, Samedi 26 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
299 Du Val Richer Samedi 26 oct. 1839 7 heures et demie
Je répète ce que nous avons dit souvent ; quand on approche du terme la route devient assommante ; quand on est près de se revoir on ne prend plus de plaisir à s’écrire. Il ne s’est rien passé depuis que nous nous sommes quittés. J’ai des milliers de choses à vous dire, et l’insuffisance des lettres me choque plus que jamais. Il fait très beau et très froid ce matin. J’ai été me promener hier sur ma nouvelle route par laquelle je m'en irai, et qui va être achevée enfin. Tout le monde dit qu’elle a été faite avec une rapidité inouïe. Il est vrai qu'on l’a commencée, l’année dernière. Pour moi, il me semble qu’on y travaille depuis un temps infini, et qu’elle s’est fait attendre outre mesure. C’est qu’on m'en a et que j'en ai beaucoup parlé. La parole allonge et use extrêmement les choses. C’est ce qui fait que, de nos jours, tant des gens sont blasés en un clin d’œil, ou même d'avance. On parle trop. Au fait, ma route sera fort jolie.
Je suis charmé que Lord Brougham ne soit pas mort. Je lui ai enfin répondu il y a huit jours. Lady Clauricard me revient beaucoup. Est-ce depuis le mariage du marquis de Dauro, ou auparavant ? Vous avez peut-être vu dans les journaux l'histoire de cette comédie de Mad. de Girardin, qui a été reçue à l'unanimité par les comédiens dont l’autorité hésite à permettre la représentation, et qui excite beaucoup de curiosité me dit-on. C’est une vengeance de femme. Elle s’appelle l’Ecole des Journalistes. C'est l'histoire du Mariage de Thiers et de toute sa vie politique et privée. M. Duchâtel paraît décidé à ne pas permettre et il a raison. Mais ces Girardins ont bec et ongles. Ils feront du bruit.
L'ouverture de la session pour le 16 ou le 20 décembre. On voudrait bien avoir quelque chose de plus à dire sur l'Orient. On espère un peu que d'orient même, il viendra quelque chose qui fera faire un pas. Au fond, je ne suis pas convaincu que le Roi soit pressé. Il aime assez à avoir sur les bras, un embarras dont il n’a pas peur.
9 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez 24 mille francs de plus. Mais j'ai peur d’une femme de chambre qui ne l'a jamais été. Comment ferez -vous cette éducation là ? Par un drôle de hasard, trois ou quatre de mes amis m’écrivent aujourd’hui même qu'ils ont vu Thiers, et leurs dires s'accordent parfaitement avec votre conversation. Je vous en parlerai demain. D'après ce qu’on me mande, l'Orient est tout à fait immobile, et on ne compte plus sûr quelque chose de nouveau avant la session. Adieu.
Si vous étiez ici, vous ne resteriez pas dans votre chambre. Il fait vraiment aujourd’hui un temps admirable pour se promener. Il y a des gens qui aiment passionnément les beaux jours d’automne, parce que ce sont les derniers. J'aime mieux les beaux jours du printemps, parce que ce sont les premiers. J’aime l'avenir, ce que j’aime encore mieux, c'est ce qui est éternel. Adieu. G.
Je répète ce que nous avons dit souvent ; quand on approche du terme la route devient assommante ; quand on est près de se revoir on ne prend plus de plaisir à s’écrire. Il ne s’est rien passé depuis que nous nous sommes quittés. J’ai des milliers de choses à vous dire, et l’insuffisance des lettres me choque plus que jamais. Il fait très beau et très froid ce matin. J’ai été me promener hier sur ma nouvelle route par laquelle je m'en irai, et qui va être achevée enfin. Tout le monde dit qu’elle a été faite avec une rapidité inouïe. Il est vrai qu'on l’a commencée, l’année dernière. Pour moi, il me semble qu’on y travaille depuis un temps infini, et qu’elle s’est fait attendre outre mesure. C’est qu’on m'en a et que j'en ai beaucoup parlé. La parole allonge et use extrêmement les choses. C’est ce qui fait que, de nos jours, tant des gens sont blasés en un clin d’œil, ou même d'avance. On parle trop. Au fait, ma route sera fort jolie.
Je suis charmé que Lord Brougham ne soit pas mort. Je lui ai enfin répondu il y a huit jours. Lady Clauricard me revient beaucoup. Est-ce depuis le mariage du marquis de Dauro, ou auparavant ? Vous avez peut-être vu dans les journaux l'histoire de cette comédie de Mad. de Girardin, qui a été reçue à l'unanimité par les comédiens dont l’autorité hésite à permettre la représentation, et qui excite beaucoup de curiosité me dit-on. C’est une vengeance de femme. Elle s’appelle l’Ecole des Journalistes. C'est l'histoire du Mariage de Thiers et de toute sa vie politique et privée. M. Duchâtel paraît décidé à ne pas permettre et il a raison. Mais ces Girardins ont bec et ongles. Ils feront du bruit.
L'ouverture de la session pour le 16 ou le 20 décembre. On voudrait bien avoir quelque chose de plus à dire sur l'Orient. On espère un peu que d'orient même, il viendra quelque chose qui fera faire un pas. Au fond, je ne suis pas convaincu que le Roi soit pressé. Il aime assez à avoir sur les bras, un embarras dont il n’a pas peur.
9 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez 24 mille francs de plus. Mais j'ai peur d’une femme de chambre qui ne l'a jamais été. Comment ferez -vous cette éducation là ? Par un drôle de hasard, trois ou quatre de mes amis m’écrivent aujourd’hui même qu'ils ont vu Thiers, et leurs dires s'accordent parfaitement avec votre conversation. Je vous en parlerai demain. D'après ce qu’on me mande, l'Orient est tout à fait immobile, et on ne compte plus sûr quelque chose de nouveau avant la session. Adieu.
Si vous étiez ici, vous ne resteriez pas dans votre chambre. Il fait vraiment aujourd’hui un temps admirable pour se promener. Il y a des gens qui aiment passionnément les beaux jours d’automne, parce que ce sont les derniers. J'aime mieux les beaux jours du printemps, parce que ce sont les premiers. J’aime l'avenir, ce que j’aime encore mieux, c'est ce qui est éternel. Adieu. G.
300. Val-Richer, Dimanche 27 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
300 Du val Richer, dimanche 27 oct. 1839
9 heures
Ma mère a été souffrante hier, assez souffrante. Si cela se prolongeait ou se renouvelait d’ici à quatre jours, je presserais mon départ. Son mal, s’il s'aggravait, aurait besoin de secours prompts et décisifs. Je lui en ai dit un mot hier. Cela la contrarie. Mais je n'hésiterai pas. Pauline est parfaitement bien. Mais quelle fièvre que d’aimer des créatures, quand on a tant perdu, quand on a tant éprouvé la fragilité de la vie ! Je ne puis voir malade quelqu'un que j’aime, sans une angoisse, une prévoyance horrible. Je ne vaux plus rien pour un tel fardeau ; mes épaules plient à la moindre apparence qu’il s’appesantisse encore sur moi.
Voici une conversation de Thiers avec un de mes amis ; plus directe que la vôtre mais très analogue, je pense. Thiers : Que pensez-vous du Ministère?
- Qu’il est faible et dans une position fausse.
- Que fera-t-il ?
- Peu de chose sans doute ; ce qu'on peut faire quand on est faible et dans une position fausse.
- Et comment tout cela finira-t-il ?
- Je vous le demanderai à vous- même. "
Ici une pause assez longue. Thiers reprend, et expose ce qu’il pense du Ministère de ses embarras, des difficultés de la session ; la gauche votera contre ; M. Barrot votera contre avec quelques ménagements. Le centre gauche se divisera ; une portion appuiera le Ministère, l'autre votera contre. Et les doctrinaires, que feront-ils ?
- Comme le centre gauche.
- Et M. Guizot, que fera-t-il ? L’avez-vous vu à son dernier passage à Paris ?
- Je l'ai vu ; il agira selon les circonstances sa situation, peut être embarrassante à cause de ceux de ses amis qui sont ministres.
- Autre chose sont ses amis, autre chose est le Ministère."
Thiers revient sur la situation en général, sur l'impossibilité qu’il n’arrive pas quelque chose. On répond que quoi qu’il arrive, il est désormais impossible de parler de coalition. On lui rappelle qu'à la même place, au moment des dernières élections en causant avec lui, en prévoyait la victoire et un grand succès si la conduite était sage et mesurée ; on ajoute que rien n'a été omis de ce qui pouvait et devait tout compromettre. Ceci a paru préoccuper vivement Thiers ; le rouge lui a monté au visage. Après un peu de temps, il a repris :
- Sans se coaliser, on peut tendre au même but. On le peut et on le doit, si en effet on se propose le même but, si on a les mêmes intentions."
Nouvelle pause. Thiers reprend encore pour dire qu’il a pris son parti, qu’il travaille, qu’il veut continuer, qu'il est heureux.
- Vous faites bien. "
10 heures
Lord Brougham n’a pas prolongé assez longtemps sa fantaisie. Il ne faut pas qu’un mort revienne sitôt. Avait-il fait prévenir Lady Clauricard. Vous avez raison de ne pas montrer votre appartement. Mais moi je regrette de ne pas assister à sa création. Vous me parleriez d'autre choses. Vous me permettez cette fatuité. M. Delessert m'écrit que Calamata vient de terminer la gravure de mon portrait. On m'en donnera quelques épreuves quelques unes à Paul Dela Roche ; puis 450 pour les souscripteurs et la planche sera brisée. Voilà des amis jaloux. Adieu. Adieu. G.
9 heures
Ma mère a été souffrante hier, assez souffrante. Si cela se prolongeait ou se renouvelait d’ici à quatre jours, je presserais mon départ. Son mal, s’il s'aggravait, aurait besoin de secours prompts et décisifs. Je lui en ai dit un mot hier. Cela la contrarie. Mais je n'hésiterai pas. Pauline est parfaitement bien. Mais quelle fièvre que d’aimer des créatures, quand on a tant perdu, quand on a tant éprouvé la fragilité de la vie ! Je ne puis voir malade quelqu'un que j’aime, sans une angoisse, une prévoyance horrible. Je ne vaux plus rien pour un tel fardeau ; mes épaules plient à la moindre apparence qu’il s’appesantisse encore sur moi.
Voici une conversation de Thiers avec un de mes amis ; plus directe que la vôtre mais très analogue, je pense. Thiers : Que pensez-vous du Ministère?
- Qu’il est faible et dans une position fausse.
- Que fera-t-il ?
- Peu de chose sans doute ; ce qu'on peut faire quand on est faible et dans une position fausse.
- Et comment tout cela finira-t-il ?
- Je vous le demanderai à vous- même. "
Ici une pause assez longue. Thiers reprend, et expose ce qu’il pense du Ministère de ses embarras, des difficultés de la session ; la gauche votera contre ; M. Barrot votera contre avec quelques ménagements. Le centre gauche se divisera ; une portion appuiera le Ministère, l'autre votera contre. Et les doctrinaires, que feront-ils ?
- Comme le centre gauche.
- Et M. Guizot, que fera-t-il ? L’avez-vous vu à son dernier passage à Paris ?
- Je l'ai vu ; il agira selon les circonstances sa situation, peut être embarrassante à cause de ceux de ses amis qui sont ministres.
- Autre chose sont ses amis, autre chose est le Ministère."
Thiers revient sur la situation en général, sur l'impossibilité qu’il n’arrive pas quelque chose. On répond que quoi qu’il arrive, il est désormais impossible de parler de coalition. On lui rappelle qu'à la même place, au moment des dernières élections en causant avec lui, en prévoyait la victoire et un grand succès si la conduite était sage et mesurée ; on ajoute que rien n'a été omis de ce qui pouvait et devait tout compromettre. Ceci a paru préoccuper vivement Thiers ; le rouge lui a monté au visage. Après un peu de temps, il a repris :
- Sans se coaliser, on peut tendre au même but. On le peut et on le doit, si en effet on se propose le même but, si on a les mêmes intentions."
Nouvelle pause. Thiers reprend encore pour dire qu’il a pris son parti, qu’il travaille, qu’il veut continuer, qu'il est heureux.
- Vous faites bien. "
10 heures
Lord Brougham n’a pas prolongé assez longtemps sa fantaisie. Il ne faut pas qu’un mort revienne sitôt. Avait-il fait prévenir Lady Clauricard. Vous avez raison de ne pas montrer votre appartement. Mais moi je regrette de ne pas assister à sa création. Vous me parleriez d'autre choses. Vous me permettez cette fatuité. M. Delessert m'écrit que Calamata vient de terminer la gravure de mon portrait. On m'en donnera quelques épreuves quelques unes à Paul Dela Roche ; puis 450 pour les souscripteurs et la planche sera brisée. Voilà des amis jaloux. Adieu. Adieu. G.
301. Val-Richer, Lundi 28 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
301 Du Val Richer Lundi 28 octobre 1839
7 heures et demie
Je ne m'étonne pas qu’on soit furieux contre Maroto. Il a bien dérangé le comte de los Valles. Mais j'admire qu'on en veuille. tant au cordon d'Espartero. On tient donc encore plus au respect des cordons qu'au respect des Rois. N'avez-vous pas eu aussi vous-même un peu d'étonnement de ce cordon ? Pour moi, je vous l'avoue, s’il a fait grand plaisir à Espartero, si les Espagnols ont trouvé que c’était là pour lui une récompense, si une aune de ruban rouge, venu de France, a au delà des Pyrénées cette valeur, je trouve qu’on très bien fait. Je fais cas des cordons ; ils plaisent à quelque chose d’indestructible et de puissant dans la nature humaine ; mais je ne les respecte pas ; pas plus que je ne respecte l'argent. Ils sont comme l'argent, très bons à donner à ceux qui les aiment, et il faut savoir, chamarrer les hommes comme les enrichir. Mais je ne connais à l'emploi des cordons, qu'une limite ; c'est de ne pas les user au point qu’on ne les désire plus. Vous voyez qu’on n'en est pas là dans la Péninsule.
Ma mère est mieux. Elle vient de me faire dire qu’elle avait passé une bonne nuit. Je l’ai fait promener hier pendant deux heures au plus petit pas possible sous un ciel sans soleil mais doux et en causant du passé, cette vie des vieillards. Elle était contente, et le contentement est ce qu’il y a de plus sain à tout âge.
J’écris ce matin à Lord Brougham pour lui dire qu’une petite affaire qu’il m’avait recommandée vient d'être faite. J’ai bien envie de lui reprocher d'être revenu trop tôt. Il fallait nous donner trois jours, son expérience est manquée. J'ai peur qu’il ne lui en reste qu’un ridicule de plus. Je suis bien aise que ce mariage Appony soit tout-à-fait arrangé, et que vous ayez votre nièce près de vous. Peut-être en ferez-vous quelque chose ?
Votre anglaise vous plait donc. Est-ce plus qu’une bonne d'enfants ?
Vous devez avoir les Pairs ce matin, au Moniteur. M. Rossi est le seul qui m'intéresse. A sa place, j’aurais mieux aimé attendre qu’une porte s'ouvrit à la Chambre des Députés. Mais qui sait attendre ? Il sera bien partout. Il est du très petit nombre des hommes qui ont assez d’esprit pour que je regrette que vous ne les connaissiez pas.
10 heures
J'ai beau faire, je ne tousse pas. Mais il fait froid. Vous n'êtes pas plus pressée que moi. Je monterai l’escalier de cet entresol avec tant de plaisir ! Je n’ai pas plus de nouvelles que vous. Je vous envoie le peu qui m’arrive. Adieu. Adieu, Adieu. Je suis bien aise que vous vous soyez reposée hier. Vous aviez l'air fatiguée. G.
7 heures et demie
Je ne m'étonne pas qu’on soit furieux contre Maroto. Il a bien dérangé le comte de los Valles. Mais j'admire qu'on en veuille. tant au cordon d'Espartero. On tient donc encore plus au respect des cordons qu'au respect des Rois. N'avez-vous pas eu aussi vous-même un peu d'étonnement de ce cordon ? Pour moi, je vous l'avoue, s’il a fait grand plaisir à Espartero, si les Espagnols ont trouvé que c’était là pour lui une récompense, si une aune de ruban rouge, venu de France, a au delà des Pyrénées cette valeur, je trouve qu’on très bien fait. Je fais cas des cordons ; ils plaisent à quelque chose d’indestructible et de puissant dans la nature humaine ; mais je ne les respecte pas ; pas plus que je ne respecte l'argent. Ils sont comme l'argent, très bons à donner à ceux qui les aiment, et il faut savoir, chamarrer les hommes comme les enrichir. Mais je ne connais à l'emploi des cordons, qu'une limite ; c'est de ne pas les user au point qu’on ne les désire plus. Vous voyez qu’on n'en est pas là dans la Péninsule.
Ma mère est mieux. Elle vient de me faire dire qu’elle avait passé une bonne nuit. Je l’ai fait promener hier pendant deux heures au plus petit pas possible sous un ciel sans soleil mais doux et en causant du passé, cette vie des vieillards. Elle était contente, et le contentement est ce qu’il y a de plus sain à tout âge.
J’écris ce matin à Lord Brougham pour lui dire qu’une petite affaire qu’il m’avait recommandée vient d'être faite. J’ai bien envie de lui reprocher d'être revenu trop tôt. Il fallait nous donner trois jours, son expérience est manquée. J'ai peur qu’il ne lui en reste qu’un ridicule de plus. Je suis bien aise que ce mariage Appony soit tout-à-fait arrangé, et que vous ayez votre nièce près de vous. Peut-être en ferez-vous quelque chose ?
Votre anglaise vous plait donc. Est-ce plus qu’une bonne d'enfants ?
Vous devez avoir les Pairs ce matin, au Moniteur. M. Rossi est le seul qui m'intéresse. A sa place, j’aurais mieux aimé attendre qu’une porte s'ouvrit à la Chambre des Députés. Mais qui sait attendre ? Il sera bien partout. Il est du très petit nombre des hommes qui ont assez d’esprit pour que je regrette que vous ne les connaissiez pas.
10 heures
J'ai beau faire, je ne tousse pas. Mais il fait froid. Vous n'êtes pas plus pressée que moi. Je monterai l’escalier de cet entresol avec tant de plaisir ! Je n’ai pas plus de nouvelles que vous. Je vous envoie le peu qui m’arrive. Adieu. Adieu, Adieu. Je suis bien aise que vous vous soyez reposée hier. Vous aviez l'air fatiguée. G.
302. Val-Richer,Mardi 29 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 12 octobre - 11 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
302 Du Val-Richer, mardi 29 octobre 1839
8 heures
Je me lève tard. Décidément le froid s’établit. Je fais des feux énormes, qui ne me réchauffent pas autant que le plus petit feu au coin de votre cheminée. Votre appartement sera très chaud. Sous le règne de M. de Talleyrand c'était une étuve. Mais vous êtes une Reine du Nord. Vous ouvrez les fenêtres.
Est-ce le frère de Bulwer qui vient à Paris à titre de commissaire pour les négociations commerciales ? Il me semble que toute la famille le pousse. Je n’ai pas lu un seul des romans qu’ils ont faits car ils en ont fait tous deux, si je ne me trompe. Les connaissez-vous ? L'Empereur devrait bien ne pas perdre son argent aux sottises du Capitole. Si peu qu’il en donne, elles ne le valent pas. Il y a une région où les souverains font très bien de semer l'argent ; il y fructifie. Mais trop bas, il ne sert absolument à rien. Que de pauvretés je vous dis là ! J’ai pourtant beaucoup mieux à vous dire.
10 heures
Comment ? Votre aigreur pour votre appartement avait été jusqu'à Lady Granville. Je suis ravi qu’elle soit ravie. Je veux que vous soyez très bien. Je me plais à penser que vous resterez là toujours, que je vous y soignerai toujours, que vous y mènerez une vie douce, agréable. J’arrange l’agrément de cette vie. Je cherche ce qui pourra s’y ajouter. Vous n’avez pas d’idée de l'activité de mon imagination sur les gens que j'aime. J’ai tort de dire sur les gens. Il n'y a pas de pluriel en ceci.
Les mêmes nouvelles que vous avez sur l'Impératrice, me viennent par notre gouvernement. On s'attend à une fin, très prochaine. J’ai une immense pitié pour un tel malheur, n'importe sur quelle tête.
Ma mère est décidément beaucoup mieux. C’est une affaire que de lui faire quitter la campagne où elle se plaît beaucoup, et où elle se persuade qu'elle est mieux pour sa santé parce qu'elle marche et se promène. Cependant il est déjà convenu que nous serons à Paris pour le milieu de Novembre. A présent, je prépare la fixation et l'avancement du jour. Ce que je dis là n’est guère français. Mais peu importe. Vous parlez des tracas de votre intérieur. Ce n’est rien du tout que les tracas de meubles. J’aimerai mieux avoir à arranger trente salons que trois personnes. Henriette m’aide déjà en cela. Elle est pleine de tact sur ce qui peut plaire ou déplaire, embarrasser ou faciliter. Elle a l’instinct de la conciliation.
Adieu. Adieu. Je suis au coin du feu, j’ai les doigt gelés. Mais seulement les doigts. G.
8 heures
Je me lève tard. Décidément le froid s’établit. Je fais des feux énormes, qui ne me réchauffent pas autant que le plus petit feu au coin de votre cheminée. Votre appartement sera très chaud. Sous le règne de M. de Talleyrand c'était une étuve. Mais vous êtes une Reine du Nord. Vous ouvrez les fenêtres.
Est-ce le frère de Bulwer qui vient à Paris à titre de commissaire pour les négociations commerciales ? Il me semble que toute la famille le pousse. Je n’ai pas lu un seul des romans qu’ils ont faits car ils en ont fait tous deux, si je ne me trompe. Les connaissez-vous ? L'Empereur devrait bien ne pas perdre son argent aux sottises du Capitole. Si peu qu’il en donne, elles ne le valent pas. Il y a une région où les souverains font très bien de semer l'argent ; il y fructifie. Mais trop bas, il ne sert absolument à rien. Que de pauvretés je vous dis là ! J’ai pourtant beaucoup mieux à vous dire.
10 heures
Comment ? Votre aigreur pour votre appartement avait été jusqu'à Lady Granville. Je suis ravi qu’elle soit ravie. Je veux que vous soyez très bien. Je me plais à penser que vous resterez là toujours, que je vous y soignerai toujours, que vous y mènerez une vie douce, agréable. J’arrange l’agrément de cette vie. Je cherche ce qui pourra s’y ajouter. Vous n’avez pas d’idée de l'activité de mon imagination sur les gens que j'aime. J’ai tort de dire sur les gens. Il n'y a pas de pluriel en ceci.
Les mêmes nouvelles que vous avez sur l'Impératrice, me viennent par notre gouvernement. On s'attend à une fin, très prochaine. J’ai une immense pitié pour un tel malheur, n'importe sur quelle tête.
Ma mère est décidément beaucoup mieux. C’est une affaire que de lui faire quitter la campagne où elle se plaît beaucoup, et où elle se persuade qu'elle est mieux pour sa santé parce qu'elle marche et se promène. Cependant il est déjà convenu que nous serons à Paris pour le milieu de Novembre. A présent, je prépare la fixation et l'avancement du jour. Ce que je dis là n’est guère français. Mais peu importe. Vous parlez des tracas de votre intérieur. Ce n’est rien du tout que les tracas de meubles. J’aimerai mieux avoir à arranger trente salons que trois personnes. Henriette m’aide déjà en cela. Elle est pleine de tact sur ce qui peut plaire ou déplaire, embarrasser ou faciliter. Elle a l’instinct de la conciliation.
Adieu. Adieu. Je suis au coin du feu, j’ai les doigt gelés. Mais seulement les doigts. G.