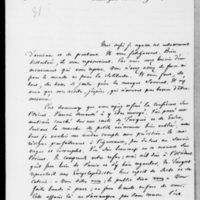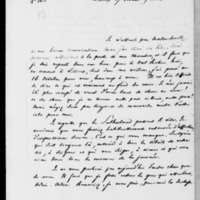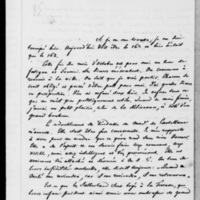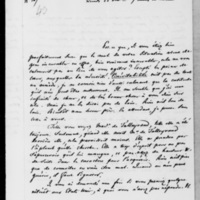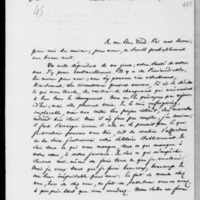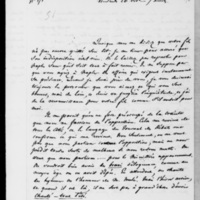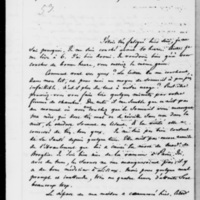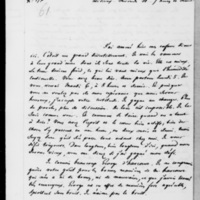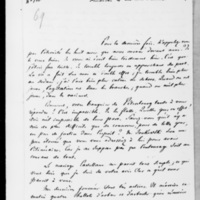Votre recherche dans le corpus : 221 résultats dans 5770 notices du site.Collection : 1838 : Réflexion politique et élaboration historique (1837-1839 : Vacances gouvernementales)
Trier par :
160. Val-Richer, Dimanhe 14 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°160 Dimanche, soir 14 oct. 9 heures
160 est un gros chiffre. Je l’écris avec un sentiment très partagé. Nous nous connaissons déjà depuis longtemps et nous avons été longtemps séparés. Où en serions nous si nous ne nous étions pas quittés un moment ? Bien plus avant que nous ne sommes si je ne me trompe. Le temps seul nous a manqué et nous manquera. Je suis convaincu que nous ne nous connaissons que très imparfaitement. C’est triste. Nous aurons souvent très souvent passé l’un à côté de l’autre, pas grand chose de plus. Nous valons l’un pour l’autre plus que cela beaucoup plus. Il y aura beaucoup à regretter entre nous. Faites-moi le plaisir de me dire, si mes lettres vous arrivent de meilleure heure à la Terrasse qu’aux Champs Elysées.
Si j’étais le Roi, je voudrais bien que le Prince royal de Bavière fût en effet trop laid. Du reste, je sais gré à votre grande Duchesse de l’avoir trouvé laid, s’il l’est réellement et de l’avoir dit. Il n’est pas besoin d’être une grande Duchesse pour se marier comme une sotte. Je serais charmée d’en savoir une qui s’y montrât plus difficile, et plus sensée. Cela ferait aussi honneur à son père.
Lundi 15, 7 heures
J’ai été interrompu hier soir par un petit accident arrivé à Henriette près de se coucher. Elle est tombée en courant dans la galerie et s’est fait mal au menton ; rien du tout, une simple écorchure. Mais le sang coulait ; mon bon Guillaume était au désespoir, et le désespoir le plus tendre, le plus caressant qui se puisse imaginer. J’ai là trois petites créatures qui auront grand besoin de force d’âme et de raison, car elles auront beaucoup d’émotion à porter. L’embarras est grand ; il faut tantôt développer, tantôt contenir ; aujourd’hui on désire, demain on craint la grande activité de l’esprit et du cœur. Je ne puis souffrir les natures obtuses, apathiques ; et les mérites contrariés coûtent si cher ou exigent tant ! C’est un effort bien difficile, et qu’il faut recommencer tous les jours, que d’accepter ce mélange si profond, si inséparable du bien et du mal, en nous-mêmes et dans notre destinée. Parlons de ce qui vous regarde.
Il faudra bien que nous trouvions moyen d’arranger votre soirée comme votre santé, même capricieuse, le voudra. Je regretterais que vous ne pussiez pas conserver l’habitude de rester chez vous tous les soirs, habituellement du moins. Rien ne convient mieux aux hommes et ne les attire davantage que la certitude de trouver toujours. Mais ne pourriez-vous, toutes les fois qu’à six heures, vous aurez envie d’aller vous coucher, le dire tout simplement et renvoyer ceux qui seront- là ? c’est un petit parti à prendre, je le sais et vous n’aimez pas à prendre un parti. Cependant cela vaudrait mieux je crois, que toute autre méthode. Si vous disposiez de vos heures de sommeil, je vous dirais de les placer le matin et de vous lever plus tard. Mais on ne dispose pas de soi, ni de nuit, ni de jour.
10 h.
Il est parfaitement sûr que si cela se pouvait, je vous écrirais plus d’une fois par jour. Je voudrais remplir votre temps, votre cœur, les remplir de moi, de moi seul. J’en dirais trop. Adieu. Adieu. G.
160 est un gros chiffre. Je l’écris avec un sentiment très partagé. Nous nous connaissons déjà depuis longtemps et nous avons été longtemps séparés. Où en serions nous si nous ne nous étions pas quittés un moment ? Bien plus avant que nous ne sommes si je ne me trompe. Le temps seul nous a manqué et nous manquera. Je suis convaincu que nous ne nous connaissons que très imparfaitement. C’est triste. Nous aurons souvent très souvent passé l’un à côté de l’autre, pas grand chose de plus. Nous valons l’un pour l’autre plus que cela beaucoup plus. Il y aura beaucoup à regretter entre nous. Faites-moi le plaisir de me dire, si mes lettres vous arrivent de meilleure heure à la Terrasse qu’aux Champs Elysées.
Si j’étais le Roi, je voudrais bien que le Prince royal de Bavière fût en effet trop laid. Du reste, je sais gré à votre grande Duchesse de l’avoir trouvé laid, s’il l’est réellement et de l’avoir dit. Il n’est pas besoin d’être une grande Duchesse pour se marier comme une sotte. Je serais charmée d’en savoir une qui s’y montrât plus difficile, et plus sensée. Cela ferait aussi honneur à son père.
Lundi 15, 7 heures
J’ai été interrompu hier soir par un petit accident arrivé à Henriette près de se coucher. Elle est tombée en courant dans la galerie et s’est fait mal au menton ; rien du tout, une simple écorchure. Mais le sang coulait ; mon bon Guillaume était au désespoir, et le désespoir le plus tendre, le plus caressant qui se puisse imaginer. J’ai là trois petites créatures qui auront grand besoin de force d’âme et de raison, car elles auront beaucoup d’émotion à porter. L’embarras est grand ; il faut tantôt développer, tantôt contenir ; aujourd’hui on désire, demain on craint la grande activité de l’esprit et du cœur. Je ne puis souffrir les natures obtuses, apathiques ; et les mérites contrariés coûtent si cher ou exigent tant ! C’est un effort bien difficile, et qu’il faut recommencer tous les jours, que d’accepter ce mélange si profond, si inséparable du bien et du mal, en nous-mêmes et dans notre destinée. Parlons de ce qui vous regarde.
Il faudra bien que nous trouvions moyen d’arranger votre soirée comme votre santé, même capricieuse, le voudra. Je regretterais que vous ne pussiez pas conserver l’habitude de rester chez vous tous les soirs, habituellement du moins. Rien ne convient mieux aux hommes et ne les attire davantage que la certitude de trouver toujours. Mais ne pourriez-vous, toutes les fois qu’à six heures, vous aurez envie d’aller vous coucher, le dire tout simplement et renvoyer ceux qui seront- là ? c’est un petit parti à prendre, je le sais et vous n’aimez pas à prendre un parti. Cependant cela vaudrait mieux je crois, que toute autre méthode. Si vous disposiez de vos heures de sommeil, je vous dirais de les placer le matin et de vous lever plus tard. Mais on ne dispose pas de soi, ni de nuit, ni de jour.
10 h.
Il est parfaitement sûr que si cela se pouvait, je vous écrirais plus d’une fois par jour. Je voudrais remplir votre temps, votre cœur, les remplir de moi, de moi seul. J’en dirais trop. Adieu. Adieu. G.
161. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°161 Lundi soir, 15 oct, 9 heures et demie
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
162. Lisieux, Mercredi 17 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°163 Lisieux 17 octobre, 9 heures
Je n’attends pas Matonchewitz, ni une bonne conversation. Mais j’ai dîné ici hier. Trois personnes attendent à la porte de ma chambre et il faut que je sois reparti dans une heure pour le Val Richer. Hier en venant à Lisieux seul dans ma voiture, j’ai pensé au 16 octobre pour vous, beaucoup à vous. Il est bien difficile de dire ce qui est vraiment au fond du cœur. Je n’ai jamais été plus occupé de vous. J’aime tant de choses en vous ! Et des choses que je ne trouve nulle part ailleurs nulle part mais n’ayez donc pas toujours de mauvaises nuits. Faites cela pour moi. Je regrette que les Sutherland passent si vite. Je voudrais que vous fussiez habituellement entourée d’affection d’impressions douces. C’est ce qui vous manque. Quelqu’un qui soit toujours là, associé à tous les détails de votre vie, à soigner et qui vous soigne, à aimer et qui vous aime dans tous les moments de la journée. Je ne vous parlerai pas aujourd’hui d’autre chose que de vous. Il faut que je fasse entrer les gens qui attendent. Adieu. Adieu. Remerciez ; je vous prie, pour moi la Duchesse de Sutherland de son souvenir. J’espère que je serai plus heureux quand elle repassera par Paris pour retourner en Angleterre. Adieu. Adieu. Je voudrais couvrir d’adieux le papier blanc qui me déplaît. G.
Je n’attends pas Matonchewitz, ni une bonne conversation. Mais j’ai dîné ici hier. Trois personnes attendent à la porte de ma chambre et il faut que je sois reparti dans une heure pour le Val Richer. Hier en venant à Lisieux seul dans ma voiture, j’ai pensé au 16 octobre pour vous, beaucoup à vous. Il est bien difficile de dire ce qui est vraiment au fond du cœur. Je n’ai jamais été plus occupé de vous. J’aime tant de choses en vous ! Et des choses que je ne trouve nulle part ailleurs nulle part mais n’ayez donc pas toujours de mauvaises nuits. Faites cela pour moi. Je regrette que les Sutherland passent si vite. Je voudrais que vous fussiez habituellement entourée d’affection d’impressions douces. C’est ce qui vous manque. Quelqu’un qui soit toujours là, associé à tous les détails de votre vie, à soigner et qui vous soigne, à aimer et qui vous aime dans tous les moments de la journée. Je ne vous parlerai pas aujourd’hui d’autre chose que de vous. Il faut que je fasse entrer les gens qui attendent. Adieu. Adieu. Remerciez ; je vous prie, pour moi la Duchesse de Sutherland de son souvenir. J’espère que je serai plus heureux quand elle repassera par Paris pour retourner en Angleterre. Adieu. Adieu. Je voudrais couvrir d’adieux le papier blanc qui me déplaît. G.
Mots-clés : Autoportrait, Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
163. Val-Richer, Jeudi 18 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°163 Jeudi 18 octobre. 6 h et demie
Si je ne me trompe ; je me suis trompé hier. Aujourd’hui doit être le 163 et hier n’était que le 162. Cette fin du mois d’octobre est pour moi, un temps de fatigue et d’ennui. Les dîners m’écrasent. On commence à revenir à la ville. On sait que je vais partir. Chacun se croit obligé et pressé d’être poli pour moi. J’ai quatre dîners, en perspective. J’en ai refusé deux hier. Je refuse tout ce qui ne m’est pas politiquement utile. Quand ce mois finira j’aurai un petit plaisir, celui de la délivrance à côté d’un grand bonheur. Le redoublement de tendresse de Mad. de Castellane m’amuse. Elle sait être fort caressante. Je m’en rapporte à vous pour ne rendre que ce qu’on rend sans rien donner. Elle a de l’esprit et un savoir faire trop remuant, trop visible, mais assez intelligent et très persévérant. Elle est vraiment très attachée et dévouée à M. de L.
Au temps de leurs infidélités naturelles, elle disait toujours : " Quand M. Molé me reviendra, car il me reviendra, il me retrouvera. " Est-ce que les Sutherland sont logés à la Terrasse que leurs enfants puissent ainsi venir vous embrasser de grand matin ? Ce sont d’heureux enfants. On vous fait mal en vous montrant qu’on vous aime. C’est qu’on en vous le montre pas toujours, à tout instant. Il ne faut pas avoir du bonheur à longs intervalles et par accès. Il veut la continuité. Le soleil lève devant moi froid, mais dans un ciel pur, malgré les torrents de pluie d’hier. Je vous désire de tout mon cœur, ici, près de moi ; pour moi d’abord, pour vous ensuite. Je vous ferais du bien. Ce séjour est calme et doux. Une âme fatiguée y peut trouver du repos, et vous y trouveriez aussi de la tendresse. Il n’y a point de repos tout seul. Nous parlerions, nous ne parlerions pas, comme vous voudriez. Vous pleureriez si vous vouliez. Pas trop fort, n’est-ce pas ? Pas ces sanglots où tout votre être semble près de se briser, car je vous demanderais grâce, grâce pour moi-même. J’ai le cœur bien fatigué aussi, plus fatigué que je ne le montre, même à vous. Vous me seriez bonne, vous me feriez du bien aussi. Je veux que vous m’en fassiez. J’en ai besoin et j’y compte. Vous ne viendrez pas ici, mais j’irai vous retrouver.
8 heures
Je rentre. J’ai été me promener vingt minutes dans le jardin. J’y serais resté plus longtemps. Mais les ouvriers m’ont chassé. Quand on est vu, on n’est pas seul. Vous avez raison. Rien n’aide plus à rester ministre que de ne pas vouloir s’en aller. Rois ou Parlement ne chassent guère leurs ministres quand il faut absolument les chasser. Mais les révolutions sont plus brutales, et le Duc de Frias pourrait y être pris. A la vérité, la révolution d’Espagne est une si pâle copie qu’on peut se jouer d’elle sans y risquer comme sans y gagner grand chose. On m’a assuré quand la lettre, pendant je ne sais plus quelles Cortes, on allait voir tous les matins, dans le Moniteur, ce qui s’était fait en France à pareil jour pour savoir comment on remplirait sa journée. M. de Boislecomte est-il encore à Paris ? Si vous le rencontrez, faites-le causer sur le Pacha d’Egypte. Il doit être assez curieux à entendre sur l’état d’esprit où se trouve aujourd’hui cet homme là, et ce qu’on en peut conjecturer. J’admire beaucoup la netteté avec laquelle les Orientaux, quand une situation est une fois décidée en prennent leur parti et s’y accommodent sans cesser au fond, de travailler à la changer si elle leur déplaît. Il n’y a que cela de digne, et j’ajoute d’utile. Dans notre monde, on s’use, en petits efforts contre l’impossible. C’est dommage que Méhemet Ali ne soit pas sur un plus grand théâtre et avec plus d’avenir.
10 h.
Peu m’importe que vous griffonniez pourvu que ce ne soit pas un signe de lassitude. Je suis fort aise que votre fils vous reste quelques jours de plus. Je serais fort aise aussi de le trouver encore à Paris, et de le connaitre. Adieu Adieu. G.
Si je ne me trompe ; je me suis trompé hier. Aujourd’hui doit être le 163 et hier n’était que le 162. Cette fin du mois d’octobre est pour moi, un temps de fatigue et d’ennui. Les dîners m’écrasent. On commence à revenir à la ville. On sait que je vais partir. Chacun se croit obligé et pressé d’être poli pour moi. J’ai quatre dîners, en perspective. J’en ai refusé deux hier. Je refuse tout ce qui ne m’est pas politiquement utile. Quand ce mois finira j’aurai un petit plaisir, celui de la délivrance à côté d’un grand bonheur. Le redoublement de tendresse de Mad. de Castellane m’amuse. Elle sait être fort caressante. Je m’en rapporte à vous pour ne rendre que ce qu’on rend sans rien donner. Elle a de l’esprit et un savoir faire trop remuant, trop visible, mais assez intelligent et très persévérant. Elle est vraiment très attachée et dévouée à M. de L.
Au temps de leurs infidélités naturelles, elle disait toujours : " Quand M. Molé me reviendra, car il me reviendra, il me retrouvera. " Est-ce que les Sutherland sont logés à la Terrasse que leurs enfants puissent ainsi venir vous embrasser de grand matin ? Ce sont d’heureux enfants. On vous fait mal en vous montrant qu’on vous aime. C’est qu’on en vous le montre pas toujours, à tout instant. Il ne faut pas avoir du bonheur à longs intervalles et par accès. Il veut la continuité. Le soleil lève devant moi froid, mais dans un ciel pur, malgré les torrents de pluie d’hier. Je vous désire de tout mon cœur, ici, près de moi ; pour moi d’abord, pour vous ensuite. Je vous ferais du bien. Ce séjour est calme et doux. Une âme fatiguée y peut trouver du repos, et vous y trouveriez aussi de la tendresse. Il n’y a point de repos tout seul. Nous parlerions, nous ne parlerions pas, comme vous voudriez. Vous pleureriez si vous vouliez. Pas trop fort, n’est-ce pas ? Pas ces sanglots où tout votre être semble près de se briser, car je vous demanderais grâce, grâce pour moi-même. J’ai le cœur bien fatigué aussi, plus fatigué que je ne le montre, même à vous. Vous me seriez bonne, vous me feriez du bien aussi. Je veux que vous m’en fassiez. J’en ai besoin et j’y compte. Vous ne viendrez pas ici, mais j’irai vous retrouver.
8 heures
Je rentre. J’ai été me promener vingt minutes dans le jardin. J’y serais resté plus longtemps. Mais les ouvriers m’ont chassé. Quand on est vu, on n’est pas seul. Vous avez raison. Rien n’aide plus à rester ministre que de ne pas vouloir s’en aller. Rois ou Parlement ne chassent guère leurs ministres quand il faut absolument les chasser. Mais les révolutions sont plus brutales, et le Duc de Frias pourrait y être pris. A la vérité, la révolution d’Espagne est une si pâle copie qu’on peut se jouer d’elle sans y risquer comme sans y gagner grand chose. On m’a assuré quand la lettre, pendant je ne sais plus quelles Cortes, on allait voir tous les matins, dans le Moniteur, ce qui s’était fait en France à pareil jour pour savoir comment on remplirait sa journée. M. de Boislecomte est-il encore à Paris ? Si vous le rencontrez, faites-le causer sur le Pacha d’Egypte. Il doit être assez curieux à entendre sur l’état d’esprit où se trouve aujourd’hui cet homme là, et ce qu’on en peut conjecturer. J’admire beaucoup la netteté avec laquelle les Orientaux, quand une situation est une fois décidée en prennent leur parti et s’y accommodent sans cesser au fond, de travailler à la changer si elle leur déplaît. Il n’y a que cela de digne, et j’ajoute d’utile. Dans notre monde, on s’use, en petits efforts contre l’impossible. C’est dommage que Méhemet Ali ne soit pas sur un plus grand théâtre et avec plus d’avenir.
10 h.
Peu m’importe que vous griffonniez pourvu que ce ne soit pas un signe de lassitude. Je suis fort aise que votre fils vous reste quelques jours de plus. Je serais fort aise aussi de le trouver encore à Paris, et de le connaitre. Adieu Adieu. G.
164. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°164 Vendredi 19 octobre 7 heures et demie
Je suis fâché que la duchesse de Sutherland soit engraissée. C’était déjà beaucoup. Quand elle ne sera plus du tout jeune ce sera beaucoup trop. Je m’intéresse à la durée de ce qui m’a plu un moment. Comptent-ils passer tout l’hiver en Italie ? Comment la Reine s’arrange-t-elle de cela ? Il me paraît qu’elle tient fort à garder ce qui lui plait, s’il est vrai qu’elle ait écrit au Roi de Naples pour garder Lablache. Cette jeune fille m’inspire assez de curiosité. Il me semble que personne ne la connait et ne dit ce qu’elle est. Y aura-t-il vraiment quelque chose en elle, ou sera-ce tout bonnement une reine amie sensée, facile, et uniquement occupée de s’amuser convenablement ? Ceci serait peut-être le meilleur pour l’Angleterre ; elle est, je crois dans l’une de ces crises, où ce qu’il y a de mieux pour le pays, c’est un gouvernement qui s’accommode au temps, en y faisant peu et lui demandant encore moins. Un pouvoir fier et exigeant, pour lui-même comme pour les autres, compromettrait là bien des choses. Vous avez raison sur l’Orient. C’était de ma part une pure fantaisie. Ce qui vaut le mieux à présent, c’est que la question en reste où elle est. Personne n’est prêt à lui donner la solution qui convient. L’Empereur à Potsdam était probablement désolé de ce que sa fille trouvait le Prince royal de Bavière, trop laid.
Est-ce Postdam ou Potsdam ? Vous écrivez Potsdam, et moi aussi. J’ai des cartes qui sont de notre avis ; mais la plupart disent Postdam, et il me semble que l’étymologie le voudrait. Décidez. Avez-vous jamais aimé la géographie ? Thiers prétend qu’il n’y a pas de grand homme qui n’ait aimé la géographie. Je l’ai fort bien sue, parce que je n’ai jamais lu une histoire, sans avoir les cartes sous les yeux, et sans suivre pas à pas les événements. Mais la géographie, pour elle- même me touche peu. L’Astronomie encore moins. Je n’ai jamais pu distinguer une étoile d’une autre. Ni le ciel, ni la terre ; c’est dédaigner beaucoup. Au fait, s’il n’y avait pas d’hommes dessus, et dessous, je prendrais du Ciel et à la terre peu d’intérêt.
Entendez-vous parler d’une jeune artiste, Mlle Rachel, qui a, dit-on de grands succès au théâtre français et ramène la foule à Racine et à Corneille ? Si elle fait cela, je lui veux beaucoup de bien, et c’est ce qui fait que je vous en parle. J’admire et j’aime extrêmement la vieille, la vraie littérature française. Et vous lui devez les mêmes sentiments. C’est votre nature qui le fait. Vous voyez que je vous traite là, comme je traiterais Lord Holland.
10 heures
J’avais un vrai remords, avant-hier de ma lettre si courte. J’aurais voulu la charger de toute autre chose, que de paroles. Il y a peu de variété dans ma manière de penser à vous. mais beaucoup de continuité. Je n’ai rien à apprendre sur votre frère et votre mari. Ils seront ce qu’ils sont. Quelque accoutumé que je sois aux incohérences, et aux contradictions de la nature humaine, pourtant il y a telle occasion, et dans cette occasion telle action, telle parole où l’homme se révèle tout entier, et d’après laquelle on peut hardiment le juger, et le prédire. J’ai vu votre mari et votre frère à cette épreuve-là. Adieu. Je vais donner quelques ordres pour des caisses qui doivent partir la semaine prochaine pour Paris. Adieu Bien, adieu. G.
Je suis fâché que la duchesse de Sutherland soit engraissée. C’était déjà beaucoup. Quand elle ne sera plus du tout jeune ce sera beaucoup trop. Je m’intéresse à la durée de ce qui m’a plu un moment. Comptent-ils passer tout l’hiver en Italie ? Comment la Reine s’arrange-t-elle de cela ? Il me paraît qu’elle tient fort à garder ce qui lui plait, s’il est vrai qu’elle ait écrit au Roi de Naples pour garder Lablache. Cette jeune fille m’inspire assez de curiosité. Il me semble que personne ne la connait et ne dit ce qu’elle est. Y aura-t-il vraiment quelque chose en elle, ou sera-ce tout bonnement une reine amie sensée, facile, et uniquement occupée de s’amuser convenablement ? Ceci serait peut-être le meilleur pour l’Angleterre ; elle est, je crois dans l’une de ces crises, où ce qu’il y a de mieux pour le pays, c’est un gouvernement qui s’accommode au temps, en y faisant peu et lui demandant encore moins. Un pouvoir fier et exigeant, pour lui-même comme pour les autres, compromettrait là bien des choses. Vous avez raison sur l’Orient. C’était de ma part une pure fantaisie. Ce qui vaut le mieux à présent, c’est que la question en reste où elle est. Personne n’est prêt à lui donner la solution qui convient. L’Empereur à Potsdam était probablement désolé de ce que sa fille trouvait le Prince royal de Bavière, trop laid.
Est-ce Postdam ou Potsdam ? Vous écrivez Potsdam, et moi aussi. J’ai des cartes qui sont de notre avis ; mais la plupart disent Postdam, et il me semble que l’étymologie le voudrait. Décidez. Avez-vous jamais aimé la géographie ? Thiers prétend qu’il n’y a pas de grand homme qui n’ait aimé la géographie. Je l’ai fort bien sue, parce que je n’ai jamais lu une histoire, sans avoir les cartes sous les yeux, et sans suivre pas à pas les événements. Mais la géographie, pour elle- même me touche peu. L’Astronomie encore moins. Je n’ai jamais pu distinguer une étoile d’une autre. Ni le ciel, ni la terre ; c’est dédaigner beaucoup. Au fait, s’il n’y avait pas d’hommes dessus, et dessous, je prendrais du Ciel et à la terre peu d’intérêt.
Entendez-vous parler d’une jeune artiste, Mlle Rachel, qui a, dit-on de grands succès au théâtre français et ramène la foule à Racine et à Corneille ? Si elle fait cela, je lui veux beaucoup de bien, et c’est ce qui fait que je vous en parle. J’admire et j’aime extrêmement la vieille, la vraie littérature française. Et vous lui devez les mêmes sentiments. C’est votre nature qui le fait. Vous voyez que je vous traite là, comme je traiterais Lord Holland.
10 heures
J’avais un vrai remords, avant-hier de ma lettre si courte. J’aurais voulu la charger de toute autre chose, que de paroles. Il y a peu de variété dans ma manière de penser à vous. mais beaucoup de continuité. Je n’ai rien à apprendre sur votre frère et votre mari. Ils seront ce qu’ils sont. Quelque accoutumé que je sois aux incohérences, et aux contradictions de la nature humaine, pourtant il y a telle occasion, et dans cette occasion telle action, telle parole où l’homme se révèle tout entier, et d’après laquelle on peut hardiment le juger, et le prédire. J’ai vu votre mari et votre frère à cette épreuve-là. Adieu. Je vais donner quelques ordres pour des caisses qui doivent partir la semaine prochaine pour Paris. Adieu Bien, adieu. G.
165. Val-Richer, Samedi 20 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°165 Samedi 20 Oct. 7 heures
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
166. Val-Richer, Dimanche 21 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°166 Dimanche 21 Octobre 7 heures
Je me lève au milieu d’un brouillard incomparable. Je ne vois pas les arbres qui sont devant mes fenêtres. Quand je me reporte en Languedoc, en Provence, sous ce ciel toujours si pur où les regards s’enfoncent sans que rien, les gênes et dont pourtant ils n’atteignent jamais le terme, je ne conçois pas comment je ne suis accoutumé à ces caves du Nord. Et je m’y suis accoutumé et je dis qu’elles sont vertes et fraîches. Il est vrai qu’elles le sont, qu’elles ont leur beauté, et que la sagesse de l’homme consiste à savoir jouir partout de la richesse de Dieu. Je le pense. Je le fais. Et pourtant je regrette, mon soleil. Il sera plaisant en effet que l’Empereur ait fait en Allemagne tout ce chemin et tout ce bruit pour y venir chercher, un Leuchtenberg. Du reste, je ne sais si c’est parce que je demeure loin ; mais il me semble que ce bruit ne retentit plus du tout. Je n’en entends plus rien. Tout passe bien vite de nos jours. Des intérêts, des affaires, qui jadis auraient rempli des mois, obtiennent à peine des heures. Les choses s’en vont comme les personnes en chemin de fer. Je le comprends il y a vingt cinq ans, dans le temps des batailles de Leipzig. Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas si riches, ni si pressés. Au fait, nous avons raison. Il ne faut pas regarder, longtemps, les petites choses, quand on a vécu dans les grandes.
Pour me distraire des petite choses, j’ai lu hier soir à mes enfants le Malade imaginaire. Vous n’avez pas d’idée de leurs transports de rire. Je posais mon livre pour les regarder. Je m’amuse de bon cœur avec mes enfants. Je jouis de leur gaieté. Mais je ne sais plus rire. Vous êtes et vous serez la dernière personne qui m’ait vraiment vu et fait aire. Par exemple je ne rirai pas demain. J’ai vingt personnes à déjeuner qui me prendront toute ma matinée. Je suis charmé que Pozzo vienne passer quelques mois à Paris. Je l’ai vu vous faire rire encore lui et Brougham. Comment a-t-il fait pour que sa maison ne soit pas confortable? Heureusement sa conversation le sera toujours. C’est donc à force d’esprit que Montrond se porte mieux. Il faut qu’il en ait vraiment beaucoup pour en conserver. Je causerai volontiers avec lui. J’ai besoin de causer. J’ai bien des choses à apprendre, et quelques unes à dire. Quoique vous m’ayiez admirablement tenu au courant. Vos lettres sont un miroir d’une vérité parfaite. Je n’ai jamais vu de source plus limpide que votre esprit. Rien ne le trouble et il coule toujours. Nous nous serons beaucoup écrit dans notre vie, beaucoup trop.
Avez-vous remarqué avec quel soin on a fait mettre dans les journaux que ce n’était pas la liste civile, mais l’Etat qui avait loué à M. Appony sa maison ? Il ne faut pas aller si vite au devant des propos. Est-il vrai que les Appony y soient déjà établis ? J’ai peine à le croire. Je suis curieux de voir comment on a arrangé cette maison-là. J’en aurais fait une habitation charmante. Je connais beaucoup l’hôtel Beanay que veut M. de Palhen. J’y ai vu le Président de la Chambre, M. Royer-Collard, et avant lui le directeur général des Ponts et Chaussées, Me Pasquier, je crois. C’est une assez grande maison, c’est-à-dire avec beaucoup de logement, mais rien de très grand, une cour médiocre, et si je ne me trompe une seule sortie. Deux millions me paraissent beaucoup. A la vérité il faut la meubler. Je n’y pensais pas. Ce n’est pas trop.
10 heures
Je suis désolé que vous dormiez toujours si mal. Est-ce que je ne trouverai pas, quand je serai là, des moyen d’y mettre ordre ? Adieu. Adieu. G.
Je me lève au milieu d’un brouillard incomparable. Je ne vois pas les arbres qui sont devant mes fenêtres. Quand je me reporte en Languedoc, en Provence, sous ce ciel toujours si pur où les regards s’enfoncent sans que rien, les gênes et dont pourtant ils n’atteignent jamais le terme, je ne conçois pas comment je ne suis accoutumé à ces caves du Nord. Et je m’y suis accoutumé et je dis qu’elles sont vertes et fraîches. Il est vrai qu’elles le sont, qu’elles ont leur beauté, et que la sagesse de l’homme consiste à savoir jouir partout de la richesse de Dieu. Je le pense. Je le fais. Et pourtant je regrette, mon soleil. Il sera plaisant en effet que l’Empereur ait fait en Allemagne tout ce chemin et tout ce bruit pour y venir chercher, un Leuchtenberg. Du reste, je ne sais si c’est parce que je demeure loin ; mais il me semble que ce bruit ne retentit plus du tout. Je n’en entends plus rien. Tout passe bien vite de nos jours. Des intérêts, des affaires, qui jadis auraient rempli des mois, obtiennent à peine des heures. Les choses s’en vont comme les personnes en chemin de fer. Je le comprends il y a vingt cinq ans, dans le temps des batailles de Leipzig. Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas si riches, ni si pressés. Au fait, nous avons raison. Il ne faut pas regarder, longtemps, les petites choses, quand on a vécu dans les grandes.
Pour me distraire des petite choses, j’ai lu hier soir à mes enfants le Malade imaginaire. Vous n’avez pas d’idée de leurs transports de rire. Je posais mon livre pour les regarder. Je m’amuse de bon cœur avec mes enfants. Je jouis de leur gaieté. Mais je ne sais plus rire. Vous êtes et vous serez la dernière personne qui m’ait vraiment vu et fait aire. Par exemple je ne rirai pas demain. J’ai vingt personnes à déjeuner qui me prendront toute ma matinée. Je suis charmé que Pozzo vienne passer quelques mois à Paris. Je l’ai vu vous faire rire encore lui et Brougham. Comment a-t-il fait pour que sa maison ne soit pas confortable? Heureusement sa conversation le sera toujours. C’est donc à force d’esprit que Montrond se porte mieux. Il faut qu’il en ait vraiment beaucoup pour en conserver. Je causerai volontiers avec lui. J’ai besoin de causer. J’ai bien des choses à apprendre, et quelques unes à dire. Quoique vous m’ayiez admirablement tenu au courant. Vos lettres sont un miroir d’une vérité parfaite. Je n’ai jamais vu de source plus limpide que votre esprit. Rien ne le trouble et il coule toujours. Nous nous serons beaucoup écrit dans notre vie, beaucoup trop.
Avez-vous remarqué avec quel soin on a fait mettre dans les journaux que ce n’était pas la liste civile, mais l’Etat qui avait loué à M. Appony sa maison ? Il ne faut pas aller si vite au devant des propos. Est-il vrai que les Appony y soient déjà établis ? J’ai peine à le croire. Je suis curieux de voir comment on a arrangé cette maison-là. J’en aurais fait une habitation charmante. Je connais beaucoup l’hôtel Beanay que veut M. de Palhen. J’y ai vu le Président de la Chambre, M. Royer-Collard, et avant lui le directeur général des Ponts et Chaussées, Me Pasquier, je crois. C’est une assez grande maison, c’est-à-dire avec beaucoup de logement, mais rien de très grand, une cour médiocre, et si je ne me trompe une seule sortie. Deux millions me paraissent beaucoup. A la vérité il faut la meubler. Je n’y pensais pas. Ce n’est pas trop.
10 heures
Je suis désolé que vous dormiez toujours si mal. Est-ce que je ne trouverai pas, quand je serai là, des moyen d’y mettre ordre ? Adieu. Adieu. G.
167. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Lundi 22 oct. 7 heures et demie N°167
Est-ce que si vous étiez bien parfaitement sûre que le mal de votre situation vient de gens incurables en effet, bien vraiment incurables cela ne vous calmerait pas au lieu de vous agiter ? Excepté les peines de cœur auxquelles la nécessité, l’inévitabilité n’est pas du tout un remède, je ne connais rien d’aussi calmant que la certitude qu’il n’en peut être autrement. Il me semble que j’ai une infinité de choses, et de très bonnes choses à vous dire sur cela. Mais je ne les dirai pas de loin. Rien n’est bon de loin. Bientôt nous serons près. En attendant, je pense sans cesse à vous. Telle vous voyez Mad. de Talleyrand, telle elle a été toujours. Seulement, quand elle avait M. de Talleyrand derrière elle, cela paraissait moins. Elle ne prendra pas l’aplomb qu’elle cherche. Elle a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir qu’il lui manque, et pas assez de hauteur, de de suite dans le caractère pour l’acquérir. Rien n’est pire que de connaitre en vain son mal. Quand on n’en peut guérir, il faut l’ignorer.
Je vous ai demandé une fois, si vous preniez quelque intérêt aux Etats-Unis, à quoi vous n’avez pas répondu. Il faut bien que j’y prenne intérêt puisque je m’en occupe. Mais Washington à part, il m’est arrivé, les jours derniers de Boston une nouvelle et grande quarterly review qui ma fort étonné, tant j’y ai trouvé d’esprit, de bon et presque de grand esprit quoique un peu enthusiantic and unexperienced. C’est très supérieur à tout ce que j’avais vu de là. L’auteur est un M. Greene, jusqu’ici inconnu, pour moi du moins. Je prends un vrai plaisir à découvrir dans le monde un homme de plus. un homme, c’est un monde.
On m’écrit qu’une affaire à laquelle vous n’avez certainement jamais pensé devient pour le Cabinet un assez gros embarras, l’affaire des sucres. Vous ne savez peut-être pas qu’il y a deux sucres, deux sucres en guerre, le sucre de canne et le sucre de betterave. Ils veulent absolument. ou qu’on leur sacrifie leur rival ou qu’on les mette d’accord. Malgré, son talent de conciliation, M. Molé n’en peut venir à bout. Il y a là quelque chose de plus à faire que de donner des paroles à droite et à gauche. Les intérêts sont en présence, très positifs et très animés. Ils exigent qu’on ait un avis, une volonté. M. Duchâtel m’écrit qu’on a trouvé cette exigence par trop forte, et qu’on n’aura, ni volonté, ni avis. Je vous mande tout ce qu’on me mande. A propos de M. Duchâtel, sa femme vient d’accoucher d’un garçon. Il est bien content.
Vous ne vous doutez pas du petit plaisir que j’ai à regarder ce matin par ma fenêtre. Il fait beau, s’il n’avait pas fait beau, j’aurais eu sur les bras, pendant quatre ou cinq heures, entre les quatre murs de mon salon, les vingt hôtes que j’attends de Lisieux à déjeuner. Grace au soleil, je pourrai les mettre dehors, je veux dire les promener.
10 heures
Je ne reçois pas une ligne de vous, je ne pense pas une fois à vous sans que mon désir de me retrouver auprès de vous redouble. Enfin, j’approche. Je vous aime bien tendrement. Je ne puis pas pour vous ce que je voudrais ce que je pourrais pas la millième partie, mais enfin, de près, je puis quelque chose, je fais quelque chose. Votre tristesse me pèse bien plus quand je ne la vois pas. Je serai triste avec vous. Je serai gai pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous faire un peu de bien. Je vous aime trop pour ne pas vous faire du bien. Adieu. Adieu. G.
Est-ce que si vous étiez bien parfaitement sûre que le mal de votre situation vient de gens incurables en effet, bien vraiment incurables cela ne vous calmerait pas au lieu de vous agiter ? Excepté les peines de cœur auxquelles la nécessité, l’inévitabilité n’est pas du tout un remède, je ne connais rien d’aussi calmant que la certitude qu’il n’en peut être autrement. Il me semble que j’ai une infinité de choses, et de très bonnes choses à vous dire sur cela. Mais je ne les dirai pas de loin. Rien n’est bon de loin. Bientôt nous serons près. En attendant, je pense sans cesse à vous. Telle vous voyez Mad. de Talleyrand, telle elle a été toujours. Seulement, quand elle avait M. de Talleyrand derrière elle, cela paraissait moins. Elle ne prendra pas l’aplomb qu’elle cherche. Elle a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir qu’il lui manque, et pas assez de hauteur, de de suite dans le caractère pour l’acquérir. Rien n’est pire que de connaitre en vain son mal. Quand on n’en peut guérir, il faut l’ignorer.
Je vous ai demandé une fois, si vous preniez quelque intérêt aux Etats-Unis, à quoi vous n’avez pas répondu. Il faut bien que j’y prenne intérêt puisque je m’en occupe. Mais Washington à part, il m’est arrivé, les jours derniers de Boston une nouvelle et grande quarterly review qui ma fort étonné, tant j’y ai trouvé d’esprit, de bon et presque de grand esprit quoique un peu enthusiantic and unexperienced. C’est très supérieur à tout ce que j’avais vu de là. L’auteur est un M. Greene, jusqu’ici inconnu, pour moi du moins. Je prends un vrai plaisir à découvrir dans le monde un homme de plus. un homme, c’est un monde.
On m’écrit qu’une affaire à laquelle vous n’avez certainement jamais pensé devient pour le Cabinet un assez gros embarras, l’affaire des sucres. Vous ne savez peut-être pas qu’il y a deux sucres, deux sucres en guerre, le sucre de canne et le sucre de betterave. Ils veulent absolument. ou qu’on leur sacrifie leur rival ou qu’on les mette d’accord. Malgré, son talent de conciliation, M. Molé n’en peut venir à bout. Il y a là quelque chose de plus à faire que de donner des paroles à droite et à gauche. Les intérêts sont en présence, très positifs et très animés. Ils exigent qu’on ait un avis, une volonté. M. Duchâtel m’écrit qu’on a trouvé cette exigence par trop forte, et qu’on n’aura, ni volonté, ni avis. Je vous mande tout ce qu’on me mande. A propos de M. Duchâtel, sa femme vient d’accoucher d’un garçon. Il est bien content.
Vous ne vous doutez pas du petit plaisir que j’ai à regarder ce matin par ma fenêtre. Il fait beau, s’il n’avait pas fait beau, j’aurais eu sur les bras, pendant quatre ou cinq heures, entre les quatre murs de mon salon, les vingt hôtes que j’attends de Lisieux à déjeuner. Grace au soleil, je pourrai les mettre dehors, je veux dire les promener.
10 heures
Je ne reçois pas une ligne de vous, je ne pense pas une fois à vous sans que mon désir de me retrouver auprès de vous redouble. Enfin, j’approche. Je vous aime bien tendrement. Je ne puis pas pour vous ce que je voudrais ce que je pourrais pas la millième partie, mais enfin, de près, je puis quelque chose, je fais quelque chose. Votre tristesse me pèse bien plus quand je ne la vois pas. Je serai triste avec vous. Je serai gai pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous faire un peu de bien. Je vous aime trop pour ne pas vous faire du bien. Adieu. Adieu. G.
168. Val-Richer, Mardi 23 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°168 Mardi 23 Octobre, 8 heures et demie
Je me lève tard. J’ai mal dormi ; pour moi du moins ; pour vous, ce serait probablement une bonne nuit. Vos nuits dépendent de vos jours ; votre santé de votre âme. J’y pense continuellement. Il y a de l’irrémédiable. du moins pour nous ; nous n’y pouvons rien actuellement directement. Les circonstances peuvent amener, là où se décide ce qui vous touche, des raisons de changement qui amèneraient à leur tour le changement. Nous ne les prévoyons pas aujourd’hui ; mais elles peuvent venir. Je le crois unforgiving, implacable, mais non contre son propre intérêt, son moindre intérêt bien clair. Mais il n’y faut pas compter, j’en conviens ; il faut s’arranger comme si cela ne se pouvait pas. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c’est de combien d’affection et de soin j’entourerai, votre solitaire établissement. Je sais tout ce qui vous manque tout ce qui manque à votre cœur, à votre journée. Je sais ce qui m’empêche souvent moi-même de faire tout ce que je voudrais. Mais je veux tant que je ferai beaucoup beaucoup. Je me sens inépuisable pour vous. En fait de monde chez vous, hors de chez vous, en fait de passe-temps vous en aurez à peu près tant que vous voudrez. Votre salon est formé, à présent ; les habitudes sont prises ; la conversation, le petit mouvement social qui vous plaisent ne vous manqueront pas. Voilà pour la surface, au fond dearest, nous comblerons ensemble les vides, nous soignerons ensembles les plaies. Je vous aime tendrement. Le temps, l’absence, la connaissance plus complète de votre caractère, de votre esprit de vous toute entière, tout cela fait que je vous aime toujours autant, plutôt davantage. Vous savez que mes paroles n’exagèrent jamais mes sentiments. Vous savez que je suis doux à vivre. Je le serai pour vous, avec vous, plus que vous ne savez. Il y a bien du vide, bien de l’amertume dans votre situation ; j’y mettrai beaucoup de baume, beaucoup de tendresse. Vous vous souvenez de mon défi, dans nos premiers temps. Vous me direz un jour, si j’avais raison.
J’ai gardé hier mes hôtes jusqu’à cinq heures. Aujourd’hui, je vais dîner à Lisieux, demain aussi. Je mets les morceaux en quatre. Le retour de Lord Durham sera un avènement à Londres. Je ne sais qu’elle position il s’y refera ; mais je comprends que celle de Québec ne lui convienne pas. Revient-il cependant sans attendre son successeur, sans donner à son gouvernement le temps de pourvoir aux affaires du Canada ? Ce serait une boutade d’enfant gâté. Il y est sujet. Les Granville en sont-ils inquiets ? Je crois assez à leur jugement sur la situation, et les chances de leur cabinet. Ils sont éclairés, par une passion, leur désir de rester à Paris. Je la partage pour eux, quoique, non à cause d’eux.
10 heures
Je suis fâché que votre fils vous quitte avant que j’arrive. J’avais espéré qu’il vous resterait encore quelques jours ! Je suis charmé que vous en soyez contente. Ses qualités qu’il a valent mieux plus on en jouit. Je reçois une lettre de M. de Broglie qui me dit qu’en effet il ne vient pas à Broglie. Cela me met à l’aise. Je craignais toujours qu’il ne vint au moment où je veux partir. Il est bien triste, mais il reprend ses occupations intérieures. Il est très content de son fils. Adieu. Je serais en effet très bien aux Tuileries. J’y serai. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
Je me lève tard. J’ai mal dormi ; pour moi du moins ; pour vous, ce serait probablement une bonne nuit. Vos nuits dépendent de vos jours ; votre santé de votre âme. J’y pense continuellement. Il y a de l’irrémédiable. du moins pour nous ; nous n’y pouvons rien actuellement directement. Les circonstances peuvent amener, là où se décide ce qui vous touche, des raisons de changement qui amèneraient à leur tour le changement. Nous ne les prévoyons pas aujourd’hui ; mais elles peuvent venir. Je le crois unforgiving, implacable, mais non contre son propre intérêt, son moindre intérêt bien clair. Mais il n’y faut pas compter, j’en conviens ; il faut s’arranger comme si cela ne se pouvait pas. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c’est de combien d’affection et de soin j’entourerai, votre solitaire établissement. Je sais tout ce qui vous manque tout ce qui manque à votre cœur, à votre journée. Je sais ce qui m’empêche souvent moi-même de faire tout ce que je voudrais. Mais je veux tant que je ferai beaucoup beaucoup. Je me sens inépuisable pour vous. En fait de monde chez vous, hors de chez vous, en fait de passe-temps vous en aurez à peu près tant que vous voudrez. Votre salon est formé, à présent ; les habitudes sont prises ; la conversation, le petit mouvement social qui vous plaisent ne vous manqueront pas. Voilà pour la surface, au fond dearest, nous comblerons ensemble les vides, nous soignerons ensembles les plaies. Je vous aime tendrement. Le temps, l’absence, la connaissance plus complète de votre caractère, de votre esprit de vous toute entière, tout cela fait que je vous aime toujours autant, plutôt davantage. Vous savez que mes paroles n’exagèrent jamais mes sentiments. Vous savez que je suis doux à vivre. Je le serai pour vous, avec vous, plus que vous ne savez. Il y a bien du vide, bien de l’amertume dans votre situation ; j’y mettrai beaucoup de baume, beaucoup de tendresse. Vous vous souvenez de mon défi, dans nos premiers temps. Vous me direz un jour, si j’avais raison.
J’ai gardé hier mes hôtes jusqu’à cinq heures. Aujourd’hui, je vais dîner à Lisieux, demain aussi. Je mets les morceaux en quatre. Le retour de Lord Durham sera un avènement à Londres. Je ne sais qu’elle position il s’y refera ; mais je comprends que celle de Québec ne lui convienne pas. Revient-il cependant sans attendre son successeur, sans donner à son gouvernement le temps de pourvoir aux affaires du Canada ? Ce serait une boutade d’enfant gâté. Il y est sujet. Les Granville en sont-ils inquiets ? Je crois assez à leur jugement sur la situation, et les chances de leur cabinet. Ils sont éclairés, par une passion, leur désir de rester à Paris. Je la partage pour eux, quoique, non à cause d’eux.
10 heures
Je suis fâché que votre fils vous quitte avant que j’arrive. J’avais espéré qu’il vous resterait encore quelques jours ! Je suis charmé que vous en soyez contente. Ses qualités qu’il a valent mieux plus on en jouit. Je reçois une lettre de M. de Broglie qui me dit qu’en effet il ne vient pas à Broglie. Cela me met à l’aise. Je craignais toujours qu’il ne vint au moment où je veux partir. Il est bien triste, mais il reprend ses occupations intérieures. Il est très content de son fils. Adieu. Je serais en effet très bien aux Tuileries. J’y serai. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
169.Lisieux, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°169 Lisieux Mercredi 24 7 heures
Hier au moment où j’allais partir, deux personnes me sont arrivées qui viennent passer deux ou trois jours au Val Richer. Il a bien fallu les y laisser pour venir dîner ici, et je les laisserai encore aujourd’hui. Aussi je retourne, sur le champ pour être poli au moins à déjeuner. Encore aujourd’hui vous n’aurez donc que quelques lignes. Cela me déplaît, je vous assure autant qu’à vous. Il me semble que je vous ai sous ma garde, et que je manque à ma consigne quand je vous quitte. Il faut que vous me plaisiez beaucoup et bien sérieusement pour qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas le goût ni l’habitude, des devoirs factices, et je n’aliène pas aisément une part de ma liberté. Vous avez vécu dans un pays libre, représentatif, électoral. Mais vous n’en avez jamais mené la vie. Vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un grand dîner d’électeurs importants, où viennent s’étaler toutes les importances, toutes les magnificences de l’endroit où il faut passer deux heures à table mangeant et causant, deux heures après la table causant et jouant au trictrac, avec 40 personnes. Voilà ma vie hier et aujourd’hui. Cela aussi, il faut que ce soit bien sérieux pour que je le fasse. Mais c’est un sérieux moins plaisant.
Je crois comme Berryer que la prochaine session sera importante et très animée si chacun consent à prendre sa position simplement, nettement, sans but immédiat et sans combinaison factice. C’est, pour mon compte, ce que je me propose de faire. Adieu. On me dit que ma calèche est prête. La poste n’est pas encore arrivée. J’espérais l’avoir avant de partir. Elle viendra me chercher au Val-Richer. Il a fait un brouillard abominable, cette nuit. Le courrier aura marché plus lentement. Adieu. Adieu. Non pas comme si nous nous promenions, aux Tuileries, mais comme dans notre cabinet. G.
Hier au moment où j’allais partir, deux personnes me sont arrivées qui viennent passer deux ou trois jours au Val Richer. Il a bien fallu les y laisser pour venir dîner ici, et je les laisserai encore aujourd’hui. Aussi je retourne, sur le champ pour être poli au moins à déjeuner. Encore aujourd’hui vous n’aurez donc que quelques lignes. Cela me déplaît, je vous assure autant qu’à vous. Il me semble que je vous ai sous ma garde, et que je manque à ma consigne quand je vous quitte. Il faut que vous me plaisiez beaucoup et bien sérieusement pour qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas le goût ni l’habitude, des devoirs factices, et je n’aliène pas aisément une part de ma liberté. Vous avez vécu dans un pays libre, représentatif, électoral. Mais vous n’en avez jamais mené la vie. Vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un grand dîner d’électeurs importants, où viennent s’étaler toutes les importances, toutes les magnificences de l’endroit où il faut passer deux heures à table mangeant et causant, deux heures après la table causant et jouant au trictrac, avec 40 personnes. Voilà ma vie hier et aujourd’hui. Cela aussi, il faut que ce soit bien sérieux pour que je le fasse. Mais c’est un sérieux moins plaisant.
Je crois comme Berryer que la prochaine session sera importante et très animée si chacun consent à prendre sa position simplement, nettement, sans but immédiat et sans combinaison factice. C’est, pour mon compte, ce que je me propose de faire. Adieu. On me dit que ma calèche est prête. La poste n’est pas encore arrivée. J’espérais l’avoir avant de partir. Elle viendra me chercher au Val-Richer. Il a fait un brouillard abominable, cette nuit. Le courrier aura marché plus lentement. Adieu. Adieu. Non pas comme si nous nous promenions, aux Tuileries, mais comme dans notre cabinet. G.
170. Val-Richer, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N° 170 Mercredi 24, 3 heures
Je commence à vous écrire ici. Ce soir et demain matin à Lisieux, je n’aurai pas plus de temps que ce matin. Je suis désolé de l’état de vos nerfs. J’espère que l’indisposition de votre fils ne sera rien, et n’aura d’autre effet que de vous le laisser quelques jours de plus. Je ne puis partir d’ici que le 5 novembre. J’ai fait et je fais force de voiles pour finir je ne sais combien de petites affaires, qui sont pourtant des affaires, et que je ne puis laisser en arrière. Ma mère de son côté m’a demandé jusqu’au 5 pour ses arrangements de ménage. Ces cinq jours de retard me contrarient vivement. Il n’y avait pas moyen. Nous partirons le 5 au soir. Nous arriverons le 6 pour dîner. Je vous verrai le 6, à 8 heures du soir. Nous voilà au moins à jour fixe. Aurez-vous un bon jour en me revoyant ? Je voudrais bien vous égayer vous distraire. Je ferai de mon mieux. Il y a des choses dont je suis sûr. Il y en a d’autres sur lesquelles notre disposition, n’est pas, la même. Les mêmes remèdes ne nous sont pas bons à l’un et à l’autre. Mais, quoique je n’aie plus vingt-cinq ans je persiste à croire beaucoup qu’on trouve ce qu’on cherche et qu’on peut ce qu’on veut. Je chercherai et je voudrai. Vous avez raison de vouloir de l’éclat, de la grandeur. C’est aussi mon gout, très décidé, et l’un des mérites en effet des monarchie. Cependant je ne puis souscrire absolument à votre arrêt. La République romaine a bien eu quelque éclat, et il n’y a pas beaucoup de plus grandes figures que Scipion et Annibal. Il y a république et république, comme aussi monarchie et monarchie. Il me revient que Thiers est fort triste, fort abattu et assez de l’avis que vous me mandiez de Berryer. La tristesse est en général pour Thiers une source de bonne conduite. Nous verrons. Il revient vers le milieu de novembre.
Lisieux, jeudi 9 heures
J’attends votre lettre. Je n’aime pas à attendre dans les auberges. Nulle part le sentiment de la solitude n’est plus vif. C’est ce qui fait qu’il est charmant de voyager avec quelqu’un qu’on aime. Le monde disparaît. On est vraiment seule. Il y a, dans je ne sais plus quel roman de Mad. de Stael, une page où cela est senti et dit à merveille. A propos de Mad de Stael, j’ai écrit ces jours-ci sur l’état des âmes, dans notre temps, quelques pages qui paraîtront dans la Revue française et où j’ai un peu parlé de Mad. de Broglie. On dit bien peu ce qu’on pense quand on pense vraiment quelque chose sur quelqu’un qui le mérite. Je voudrais avoir réussi cette fois. Vous me le direz.
Voilà 173. Toujours aussi nervons. Il fait pourtant beau. Je ne sais pourquoi je dis pourtant, car décidément je n’aime pas les beaux jours d’automne. Je les accepte, j’en jouis même. Mais on n’aime pas, tout ce dont on jouit. On n’aime que ce qu’on préfère. Adieu. Je remonte en voiture. Les dîners me laissent cinq jours de repos jusqu’à mardi. Je donne cette lettre à la poste avec chagrin. Ces cinq jours de retard vous déplairont, comme à moi. Adieu. Adieu. G.
Je commence à vous écrire ici. Ce soir et demain matin à Lisieux, je n’aurai pas plus de temps que ce matin. Je suis désolé de l’état de vos nerfs. J’espère que l’indisposition de votre fils ne sera rien, et n’aura d’autre effet que de vous le laisser quelques jours de plus. Je ne puis partir d’ici que le 5 novembre. J’ai fait et je fais force de voiles pour finir je ne sais combien de petites affaires, qui sont pourtant des affaires, et que je ne puis laisser en arrière. Ma mère de son côté m’a demandé jusqu’au 5 pour ses arrangements de ménage. Ces cinq jours de retard me contrarient vivement. Il n’y avait pas moyen. Nous partirons le 5 au soir. Nous arriverons le 6 pour dîner. Je vous verrai le 6, à 8 heures du soir. Nous voilà au moins à jour fixe. Aurez-vous un bon jour en me revoyant ? Je voudrais bien vous égayer vous distraire. Je ferai de mon mieux. Il y a des choses dont je suis sûr. Il y en a d’autres sur lesquelles notre disposition, n’est pas, la même. Les mêmes remèdes ne nous sont pas bons à l’un et à l’autre. Mais, quoique je n’aie plus vingt-cinq ans je persiste à croire beaucoup qu’on trouve ce qu’on cherche et qu’on peut ce qu’on veut. Je chercherai et je voudrai. Vous avez raison de vouloir de l’éclat, de la grandeur. C’est aussi mon gout, très décidé, et l’un des mérites en effet des monarchie. Cependant je ne puis souscrire absolument à votre arrêt. La République romaine a bien eu quelque éclat, et il n’y a pas beaucoup de plus grandes figures que Scipion et Annibal. Il y a république et république, comme aussi monarchie et monarchie. Il me revient que Thiers est fort triste, fort abattu et assez de l’avis que vous me mandiez de Berryer. La tristesse est en général pour Thiers une source de bonne conduite. Nous verrons. Il revient vers le milieu de novembre.
Lisieux, jeudi 9 heures
J’attends votre lettre. Je n’aime pas à attendre dans les auberges. Nulle part le sentiment de la solitude n’est plus vif. C’est ce qui fait qu’il est charmant de voyager avec quelqu’un qu’on aime. Le monde disparaît. On est vraiment seule. Il y a, dans je ne sais plus quel roman de Mad. de Stael, une page où cela est senti et dit à merveille. A propos de Mad de Stael, j’ai écrit ces jours-ci sur l’état des âmes, dans notre temps, quelques pages qui paraîtront dans la Revue française et où j’ai un peu parlé de Mad. de Broglie. On dit bien peu ce qu’on pense quand on pense vraiment quelque chose sur quelqu’un qui le mérite. Je voudrais avoir réussi cette fois. Vous me le direz.
Voilà 173. Toujours aussi nervons. Il fait pourtant beau. Je ne sais pourquoi je dis pourtant, car décidément je n’aime pas les beaux jours d’automne. Je les accepte, j’en jouis même. Mais on n’aime pas, tout ce dont on jouit. On n’aime que ce qu’on préfère. Adieu. Je remonte en voiture. Les dîners me laissent cinq jours de repos jusqu’à mardi. Je donne cette lettre à la poste avec chagrin. Ces cinq jours de retard vous déplairont, comme à moi. Adieu. Adieu. G.
171. Val-Richer, Vendredi 26 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°171 Vendredi 26 oct. 7 heures
Quoique vous me disiez que votre fils n’a pas encore quitté son lit je me tiens pour assuré que son indisposition n’est rien. Ne le laissez pas répartir pour Naples sans qu’il soit tout à fait remis. Je ne suppose pas que vous ayez à Naples des affaires qui exigent instamment sa présence. Quand je serai près de vous, je vous désirerai toujours les personnes que vous aimez et qui vous sont bonnes, mais de loin, ce désir va jusqu’à l’inquiétude, et j’ai de la reconnaissance pour votre fils, comme s’il sentait pour moi. Il me paraît qu’on est fort préoccupé de la crainte que nous ne fassions de l’opposition. Cela me revient de tous les côtés et le langage du Journal des Débats me confirme ce qui me revient. Non seulement, on ne veut pas que nous parlions contre l’opposition, mais on nous prédit toutes sorte de malheurs, si nous restons muets. On veut que nous parlions... pour le Ministère apparemment. On voudrait bien avoir des bravi d’éloquence comme au moyen âge on en avait d’épée. En attendant, on chante les hymnes en l’honneur de M. Molé. Mais l’hiver arrive ; et quand il est là, il ne sert pas à grand chose d’avoir chanté, tout l’été. Vous avez bien raison de vous étonner des illusions de M. de Flahaut. Quand il était auprès du Duc d’Orléans, il ferait un peu ses affaires lui-même, et il y avait quelque raison de le ménager. Mais aujourd’hui, qu’a-t-on à espérer ou à craindre de lui ? Et quant au salon de Mad. de Flahaut, on n’est pas assez sûr qu’il fût bon pour désirer réellement qu’il soit ouvert. On ne fera rien pour eux ; et ils font bien de ne pas revenir. Il y a dans les cours, (puisque cour y a) un genre d’hypocrisie qui m’a toujours été insupportable ; c’est la prétention, quand l’occasion s’en présente, à être traité comme s’il y avait de l’affection, quoiqu’on n’y croie point et qu’on n’en ressente point soi-même. On parle d’ingratitude, de froideur, de sécheresse. Les Rois n’aiment qu’eux- mêmes et leur famille. C’est une de leurs grandes infériorités. Mais, pour peu qu’on ait vécu auprès d’eux, cela est si clair ! Savez-vous qu’elle est la situation admirable, qui fait d’un homme tout ce qu’il peut être ? C’est celle d’un Roi légitime qui a été obligé de reconquérir son royaume qui s’assied sur le trône par son droit, et y est monté par son fait, qui est né pour la vie royale et à mené la vie humaine. Gustave Wasa et Henri 4. Ceux-là ont aimé et ont été aimés.
Le Duc de Broglie m’écrit que sa santé est bonne et qu’il va tous les jours, à midi, faire le tour des grandes allées désertes du Champ de Mars. Il a l’air de m’attendre, impatiemment. On me dit d’ailleurs de sa fille : " Mad. d’Haussonville s’apaise un peu. Mais ce pauvre jeune esprit reste sans mouvement, et le moindre effort pour le ranimer lui cause une impression douloureuse. Elle ne sait que trop tout ce qu’elle a perdu. " Je suis bien aise qu’elle le sache, et Je désire pour elle qu’elle le sache toujours. Avec une longue vie devant soi, il n’y a rien de plus salutaire qu’un souvenir respecté et chéri. La voix des morts n’offense jamais et on accepte d’eux des vérités qu’on ne supporterait pas d’une bouche vivante. Sans savoir ce qu’ils sont, on les croit, on les sait parfaitement désintéressés et sincères.
10 heures
Seulement adieu. Je reçois trois ou quatre lettres auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Adieu. Il n’y a plus qu’une semaine entière entre nous. C’est encore bien long. Mais enfin, ce n’est plus que cela. Adieu. Adieu. G.
Quoique vous me disiez que votre fils n’a pas encore quitté son lit je me tiens pour assuré que son indisposition n’est rien. Ne le laissez pas répartir pour Naples sans qu’il soit tout à fait remis. Je ne suppose pas que vous ayez à Naples des affaires qui exigent instamment sa présence. Quand je serai près de vous, je vous désirerai toujours les personnes que vous aimez et qui vous sont bonnes, mais de loin, ce désir va jusqu’à l’inquiétude, et j’ai de la reconnaissance pour votre fils, comme s’il sentait pour moi. Il me paraît qu’on est fort préoccupé de la crainte que nous ne fassions de l’opposition. Cela me revient de tous les côtés et le langage du Journal des Débats me confirme ce qui me revient. Non seulement, on ne veut pas que nous parlions contre l’opposition, mais on nous prédit toutes sorte de malheurs, si nous restons muets. On veut que nous parlions... pour le Ministère apparemment. On voudrait bien avoir des bravi d’éloquence comme au moyen âge on en avait d’épée. En attendant, on chante les hymnes en l’honneur de M. Molé. Mais l’hiver arrive ; et quand il est là, il ne sert pas à grand chose d’avoir chanté, tout l’été. Vous avez bien raison de vous étonner des illusions de M. de Flahaut. Quand il était auprès du Duc d’Orléans, il ferait un peu ses affaires lui-même, et il y avait quelque raison de le ménager. Mais aujourd’hui, qu’a-t-on à espérer ou à craindre de lui ? Et quant au salon de Mad. de Flahaut, on n’est pas assez sûr qu’il fût bon pour désirer réellement qu’il soit ouvert. On ne fera rien pour eux ; et ils font bien de ne pas revenir. Il y a dans les cours, (puisque cour y a) un genre d’hypocrisie qui m’a toujours été insupportable ; c’est la prétention, quand l’occasion s’en présente, à être traité comme s’il y avait de l’affection, quoiqu’on n’y croie point et qu’on n’en ressente point soi-même. On parle d’ingratitude, de froideur, de sécheresse. Les Rois n’aiment qu’eux- mêmes et leur famille. C’est une de leurs grandes infériorités. Mais, pour peu qu’on ait vécu auprès d’eux, cela est si clair ! Savez-vous qu’elle est la situation admirable, qui fait d’un homme tout ce qu’il peut être ? C’est celle d’un Roi légitime qui a été obligé de reconquérir son royaume qui s’assied sur le trône par son droit, et y est monté par son fait, qui est né pour la vie royale et à mené la vie humaine. Gustave Wasa et Henri 4. Ceux-là ont aimé et ont été aimés.
Le Duc de Broglie m’écrit que sa santé est bonne et qu’il va tous les jours, à midi, faire le tour des grandes allées désertes du Champ de Mars. Il a l’air de m’attendre, impatiemment. On me dit d’ailleurs de sa fille : " Mad. d’Haussonville s’apaise un peu. Mais ce pauvre jeune esprit reste sans mouvement, et le moindre effort pour le ranimer lui cause une impression douloureuse. Elle ne sait que trop tout ce qu’elle a perdu. " Je suis bien aise qu’elle le sache, et Je désire pour elle qu’elle le sache toujours. Avec une longue vie devant soi, il n’y a rien de plus salutaire qu’un souvenir respecté et chéri. La voix des morts n’offense jamais et on accepte d’eux des vérités qu’on ne supporterait pas d’une bouche vivante. Sans savoir ce qu’ils sont, on les croit, on les sait parfaitement désintéressés et sincères.
10 heures
Seulement adieu. Je reçois trois ou quatre lettres auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Adieu. Il n’y a plus qu’une semaine entière entre nous. C’est encore bien long. Mais enfin, ce n’est plus que cela. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Politique (France), Réseau social et politique
172. Val-Richer, Samedi 27 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°172 Samedi 27 Oct. 6 heures et demie
J’étais très fatigué hier soir je ne sais pourquoi. Je me suis couché avant 10 heures. Aussi je me lève à 6. J’ai bien dormi. Je voudrais bien qu’à vous coucher de bonne heure, vous eussiez le même gain. Comment vont vos nerfs ? La lecture en me couchant dans mon lit est pour moi, un moyen de sommeil à peu près infaillible. N’est-il plus du tout à votre usage ? Peut-être pourriez-vous vous faire lire quelques minutes par votre femme de chambre. Du reste, il me semble que ce n’est pas au moment où vous vous couchez que le sommeil vous manque. Ma mère, qui dort très mal et se réveille sans cesse dans la nuit, se rendort souvent en lisant. A la vérité elle a conservé de très bons yeux. Je ne suis pas bien content de sa santé depuis quelque temps. Elle n’est pas encore remise de l’ébranlement que lui a causé la mort de Mad. de Broglie. Je suis bien aise de la ramener à Paris. Ici. avec du temps, les sœurs ne me manqueraient pas ; il y a de bons médecins à Lisieux. Mais pour quelque mal prompt et inattendu, trois ou quatre heures d’attente sont beaucoup trop. Le départ de ma maison a commencé hier. Cette amie de ma mère dont je vous ai quelquefois parlé Melle Chabaud nous a quittés. Elle a été pour mes enfants, pendant tout son séjour d’une bonté aussi utile qu’affectueuse. Je ne puis la remplacer pour le piano d’Henriette, mais je me suis chargé de la leçon d’Anglais d’ici au 5 novembre. Nous lisons ce qui se peut lire de Shakespeare. Je ne voudrais pourtant pas nourrir mes enfants de cette lecture-là, même de ce qu’il y a de bon. C’est trop fort et trop brut. Il y a trop d’émotion et pas assez de perfection. Il faut, à de jeunes esprits quelque chose de plus serein et de plus achevé.
Mad. Graham reprend ses raouts de bien bonne heure. Il y a donc déjà beaucoup d’Anglais à Paris. Vous les aimez toujours beaucoup, c’est sûr ; mais si je ne me trompe, ils sont bien vite usés pour vous. Excepté, Lady Granville, s’entend. J’ai peur que Paris ne soit pour vous comme la cour, selon La Bruyère, " pays où l’on n’est pas toujours bien, mais qui empêche qu’on ne se trouve bien ailleurs. " Les journaux démentent la retraite du comte Woronzoff. ont-ils raison ? Il me semble que l’Orient s’apaise. Pourtant la question a fait un pas. L’Angleterre a jeté un grappin de plus & vous êtes mécontents. Qu’y a-t-il de sérieux dans son traité de commerce avec l’Autriche et dans ces bouches du Danube ? Mettez-vous à cela beaucoup d’importance ? Lord Grey a raison de trouver que son gendre a été indignement abandonné. Mais ni Lord Melbourne, ni Lord John ne pourraient faire autrement. C’est leur situation comme celle de notre cabinet, de faire, ce que d’autres ne voudraient pas faire, de supporter ce que d’autres ne voudraient pas supporter. Vous savez le mot du Prince de Talmont aux soldats qui allaient le fusiller : " J’ai fait mon devoir ; faites votre métier. " Il y a des Cabinets qui font leur devoir, d’autres leur métier.
10 heures
Je vous dirai adieu comme à l’ordinaire, à moins que vous ne vouliez pas. Mais aujourd’hui, en ce moment je ne vous dirai pas autre chose. Moi aussi, je vous blesserais, et je ne veux pas. Adieu. Je ne sais pourquoi il convient à M. de Broglie de dire qu’il n’a jamais songé à bouger de Paris. Non seulement il m’en avait parlé, mais il l’a écrit à ma mère.
J’étais très fatigué hier soir je ne sais pourquoi. Je me suis couché avant 10 heures. Aussi je me lève à 6. J’ai bien dormi. Je voudrais bien qu’à vous coucher de bonne heure, vous eussiez le même gain. Comment vont vos nerfs ? La lecture en me couchant dans mon lit est pour moi, un moyen de sommeil à peu près infaillible. N’est-il plus du tout à votre usage ? Peut-être pourriez-vous vous faire lire quelques minutes par votre femme de chambre. Du reste, il me semble que ce n’est pas au moment où vous vous couchez que le sommeil vous manque. Ma mère, qui dort très mal et se réveille sans cesse dans la nuit, se rendort souvent en lisant. A la vérité elle a conservé de très bons yeux. Je ne suis pas bien content de sa santé depuis quelque temps. Elle n’est pas encore remise de l’ébranlement que lui a causé la mort de Mad. de Broglie. Je suis bien aise de la ramener à Paris. Ici. avec du temps, les sœurs ne me manqueraient pas ; il y a de bons médecins à Lisieux. Mais pour quelque mal prompt et inattendu, trois ou quatre heures d’attente sont beaucoup trop. Le départ de ma maison a commencé hier. Cette amie de ma mère dont je vous ai quelquefois parlé Melle Chabaud nous a quittés. Elle a été pour mes enfants, pendant tout son séjour d’une bonté aussi utile qu’affectueuse. Je ne puis la remplacer pour le piano d’Henriette, mais je me suis chargé de la leçon d’Anglais d’ici au 5 novembre. Nous lisons ce qui se peut lire de Shakespeare. Je ne voudrais pourtant pas nourrir mes enfants de cette lecture-là, même de ce qu’il y a de bon. C’est trop fort et trop brut. Il y a trop d’émotion et pas assez de perfection. Il faut, à de jeunes esprits quelque chose de plus serein et de plus achevé.
Mad. Graham reprend ses raouts de bien bonne heure. Il y a donc déjà beaucoup d’Anglais à Paris. Vous les aimez toujours beaucoup, c’est sûr ; mais si je ne me trompe, ils sont bien vite usés pour vous. Excepté, Lady Granville, s’entend. J’ai peur que Paris ne soit pour vous comme la cour, selon La Bruyère, " pays où l’on n’est pas toujours bien, mais qui empêche qu’on ne se trouve bien ailleurs. " Les journaux démentent la retraite du comte Woronzoff. ont-ils raison ? Il me semble que l’Orient s’apaise. Pourtant la question a fait un pas. L’Angleterre a jeté un grappin de plus & vous êtes mécontents. Qu’y a-t-il de sérieux dans son traité de commerce avec l’Autriche et dans ces bouches du Danube ? Mettez-vous à cela beaucoup d’importance ? Lord Grey a raison de trouver que son gendre a été indignement abandonné. Mais ni Lord Melbourne, ni Lord John ne pourraient faire autrement. C’est leur situation comme celle de notre cabinet, de faire, ce que d’autres ne voudraient pas faire, de supporter ce que d’autres ne voudraient pas supporter. Vous savez le mot du Prince de Talmont aux soldats qui allaient le fusiller : " J’ai fait mon devoir ; faites votre métier. " Il y a des Cabinets qui font leur devoir, d’autres leur métier.
10 heures
Je vous dirai adieu comme à l’ordinaire, à moins que vous ne vouliez pas. Mais aujourd’hui, en ce moment je ne vous dirai pas autre chose. Moi aussi, je vous blesserais, et je ne veux pas. Adieu. Je ne sais pourquoi il convient à M. de Broglie de dire qu’il n’a jamais songé à bouger de Paris. Non seulement il m’en avait parlé, mais il l’a écrit à ma mère.
173. Val-Richer, Dimanche 28 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°173 Dimanche 28 oct. 7 heures
Je voudrais que vous pussiez voir, voir dans la réalité et par le menu, les soins que j’ai eu à prendre, et que j’ai pris, dans mon intérieur et dans mes affaires auprès des personnes, et auprès des choses pour retourner à Paris dans les premiers jours de Novembre, au lieu de rester ici jusqu’à l’ouverture de la session. C’est ma seule réponse possible à votre n° 175. Mais vous ne l’avez pas vu, et moi, je ne vous le dirai pas. C’est triste.
Voici ce que je trouve dans une lettre que m’écrivait, le 8 octobre, le Duc de Broglie, à moi et non pas à ma mère : " Je compte toujours aller à Broglie d’ici à quinze jours ; et si j’y vais, j’irai voir vous et votre mère. Dites lui bien des tendresses pour moi ; elle me manque beaucoup. " Ma mère a été très souffrante hier tout le jour de ses pesanteurs de tête et de ses vertiges. Quand elle en convient, il faut que ce soit bien réel, car je n’ai jamais rencontré de personne plus dure à elle-même. Je l’ai tenue dehors presque toute la journée. Ce n’est pas très aise à présent, car on ne peut plus guère s’asseoir dehors.
Mes enfants, en ont profité pour passer aussi toute là journée à l’air. Il y sont beaucoup en général ; mais ma mère à un peu la manie des leçons et quand je puis lui en voler quelques unes ; j’en suis toujours charmé. Du reste, ils ne sont point à plaindre ; ils ont ici un petit cousins qui est venu passer quelques jours au Val Richer, et avec lequel ils s’amusent parfaitement. Le plaisir est encore plus vif pour ce petit garçon que pour mes enfants. Il a été élevé seul. Il éprouve à sortir de sa solitude, à vivre avec ses parents, une joie qui me fait spectacle. C’est une curiosité et une surprise de tous les moments. Il découvre un nouveau monde. C’est du luxe, de la part de M. de Pahlen qui discute si peu, de discuter avec M. de Maussion. L’affaire suisse sera partout une désagréable discussion pour le Ministère. On a bien fait de demander l’expulsion de Louis Buonaparte mais il fallait et on pouvait la demander et l’obtenir tout autrement. Et la façon dont on l’a demandée et obtenue a, pour la France, des inconvénients graves qu’elle rencontrera plus d’une fois sur son chemin, et qui mis au jour, frapperont beaucoup le public, car ils choquent ses passions, bonnes et mauvaises. On me dit qu’il va paraître une brochure du général Bugeaud qui préoccupe beaucoup M. Molé. Le Général Bugeaud, puisqu’il n’a pas répondu au premier moment, ferrait mieux à présent de garder ses explications pour la tribune. C’est une singulière manœuvre que d’avoir retardé le nouveau procès du général Brossard. Il coïncidera avec l’ouverture de la session. Peut-être le retardera-t-on encore jusqu’après les Débat de l’adresse. On n’en évitera pas le retentissement. M. Harcourt est-il revenu avec sa fille Lady Norris ? L’avait-il avec lui quand il a perdu sa femme ? Est-il affligé ? Il me semble qu’il n’y a guère de quoi. Mais l’habitude, même sans être douce est quelquefois puissante.
10 heures 1/2
Le N° 176, commence mieux, que ne finissait le N°175. Mais le cœur m’importe encore plus que les lettres et c’est au fond de votre cœur qu’il faut que j’aille puisque ce qui vient J’espère que nous serons heureux de vous va au fond du mien. quand nous nous serons tout dit. Adieu. Adieu. G. Ma mère est moins souffrante.
Je voudrais que vous pussiez voir, voir dans la réalité et par le menu, les soins que j’ai eu à prendre, et que j’ai pris, dans mon intérieur et dans mes affaires auprès des personnes, et auprès des choses pour retourner à Paris dans les premiers jours de Novembre, au lieu de rester ici jusqu’à l’ouverture de la session. C’est ma seule réponse possible à votre n° 175. Mais vous ne l’avez pas vu, et moi, je ne vous le dirai pas. C’est triste.
Voici ce que je trouve dans une lettre que m’écrivait, le 8 octobre, le Duc de Broglie, à moi et non pas à ma mère : " Je compte toujours aller à Broglie d’ici à quinze jours ; et si j’y vais, j’irai voir vous et votre mère. Dites lui bien des tendresses pour moi ; elle me manque beaucoup. " Ma mère a été très souffrante hier tout le jour de ses pesanteurs de tête et de ses vertiges. Quand elle en convient, il faut que ce soit bien réel, car je n’ai jamais rencontré de personne plus dure à elle-même. Je l’ai tenue dehors presque toute la journée. Ce n’est pas très aise à présent, car on ne peut plus guère s’asseoir dehors.
Mes enfants, en ont profité pour passer aussi toute là journée à l’air. Il y sont beaucoup en général ; mais ma mère à un peu la manie des leçons et quand je puis lui en voler quelques unes ; j’en suis toujours charmé. Du reste, ils ne sont point à plaindre ; ils ont ici un petit cousins qui est venu passer quelques jours au Val Richer, et avec lequel ils s’amusent parfaitement. Le plaisir est encore plus vif pour ce petit garçon que pour mes enfants. Il a été élevé seul. Il éprouve à sortir de sa solitude, à vivre avec ses parents, une joie qui me fait spectacle. C’est une curiosité et une surprise de tous les moments. Il découvre un nouveau monde. C’est du luxe, de la part de M. de Pahlen qui discute si peu, de discuter avec M. de Maussion. L’affaire suisse sera partout une désagréable discussion pour le Ministère. On a bien fait de demander l’expulsion de Louis Buonaparte mais il fallait et on pouvait la demander et l’obtenir tout autrement. Et la façon dont on l’a demandée et obtenue a, pour la France, des inconvénients graves qu’elle rencontrera plus d’une fois sur son chemin, et qui mis au jour, frapperont beaucoup le public, car ils choquent ses passions, bonnes et mauvaises. On me dit qu’il va paraître une brochure du général Bugeaud qui préoccupe beaucoup M. Molé. Le Général Bugeaud, puisqu’il n’a pas répondu au premier moment, ferrait mieux à présent de garder ses explications pour la tribune. C’est une singulière manœuvre que d’avoir retardé le nouveau procès du général Brossard. Il coïncidera avec l’ouverture de la session. Peut-être le retardera-t-on encore jusqu’après les Débat de l’adresse. On n’en évitera pas le retentissement. M. Harcourt est-il revenu avec sa fille Lady Norris ? L’avait-il avec lui quand il a perdu sa femme ? Est-il affligé ? Il me semble qu’il n’y a guère de quoi. Mais l’habitude, même sans être douce est quelquefois puissante.
10 heures 1/2
Le N° 176, commence mieux, que ne finissait le N°175. Mais le cœur m’importe encore plus que les lettres et c’est au fond de votre cœur qu’il faut que j’aille puisque ce qui vient J’espère que nous serons heureux de vous va au fond du mien. quand nous nous serons tout dit. Adieu. Adieu. G. Ma mère est moins souffrante.
174. Val-Richer, Lundi 29 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°174 Lundi 29 Oct., 7 heures
Je suis exactement le contraire de Lord Holland, bien plus hardi dans le Gouvernement que dans l’opposition. Cela prouve qu’il n’est pas trop à sa place en ce moment, ni moi à la mienne. Je crains toujours de faire verser la voiture en querellant le cocher, même quand je n’aime pas le cocher. Et puis, l’opposition déclame beaucoup et je ne peux souffrir la déclamation. Toute parole exagérée tombe sur moi, comme un seau d’eau froide. En revanche, et pour me défendre de ma faiblesse j’ai aversion de celle d’un gouvernement. La colère me prend quand je vois le pouvoir indécis, inerte, abaissé. C’est un son faux à mon oreille, une ligne de travers à mon œil. Je puis me permettre cette colère, car je l’ai dans les affaires comme en dehors. Je n’ai jamais été content de mon propre gouvernement. Voilà les deux sentiments qui me tiennent aujourd’hui. Je navigue de l’un à l’autre.
Hier, pour la première fois depuis que je suis ici, je n’ai pas mis le pied hors de la maison. Je n’ai jamais vu un tel torrent de pluie continue. Je m’en serais consolé en travaillant, si j’avais été en train de travailler ; mais je n’étais pas en train. J’ai beaucoup causé avec Henriette. Cette bonne petite fille m’avait donné le matin, l’air fort troublé, et toute rouge, le billet au crayon que je vous envoie; et qui m’a été au cœur. Pourrez-vous le lire ? Je lui ai promis un mari qui serait charmé de vivre avec moi, et que nous ne nous séparerions jamais. Comment cette petite Duchesse de Wurtemberg s’est-elle détruite si vite ? J’espère que l’Italie la guérira si elle a auprès d’elle quelqu’un qui sache la gouverner, car je doute qu’elle se gouverne bien elle-même. Son mari n’a pas l’air gouvernant du tout.
Qu’est-ce que Fagel entend par le mauvais état des Affaires de son pays ? Croit-il que son Roi, malgré son semblant d’arrangement, s’obstinera toujours et finira par le brouiller avec ses Etats Généraux ? Si la conférence termine l’affaire Belge, je ne vois pas quel embarras il peut y avoir en Hollande. Il me semble que la duchesse de Talleyrand vous donne beaucoup à dîner. Veut-elle comme c’est l’usage de ce temps-ci, suppléer à la qualité par la quantité ? A-t-elle pris des jours ? Essaye-t-elle d’avoir une maison ? Je suis bien questionneur ce matin.
Vous souvenez-vous que vous m’écriviez de Londres, l’an dernier : " Durham a du courage, de l’audace, et surtout de l’ambition. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est Lord Durham qui le créerait. Tout cela est encore à sa naissance ; mais regardez-y bien ; le danger peut surgir tout à coup. Vous avez une sagacité bien rare, et charmante parce qu’elle est si naturelle si prompte ! En passant vous voyez au fond.
10 heures
Je me fâche de ce que vous vous fâchez ; je m’afflige de ce que vous vous affligez. Qu’est-ce que cela prouve ? que dans ma conviction, vous n’avez jamais droit de vous fâcher jamais droit de vous affliger à mon égard. Oui, j’en suis convaincu, j’en suis sûr. Entendez bien ceci, dearest, je suis infaillible envers vous. Et tant que vous ne le croirez pas vous ne me connaîtrez pas, et vous ne saurez pas combien je vous aime. Adieu, adieu toujours le même adieu quand même, et je ne veux pas qu’il y ait de quand même. G.
Je suis exactement le contraire de Lord Holland, bien plus hardi dans le Gouvernement que dans l’opposition. Cela prouve qu’il n’est pas trop à sa place en ce moment, ni moi à la mienne. Je crains toujours de faire verser la voiture en querellant le cocher, même quand je n’aime pas le cocher. Et puis, l’opposition déclame beaucoup et je ne peux souffrir la déclamation. Toute parole exagérée tombe sur moi, comme un seau d’eau froide. En revanche, et pour me défendre de ma faiblesse j’ai aversion de celle d’un gouvernement. La colère me prend quand je vois le pouvoir indécis, inerte, abaissé. C’est un son faux à mon oreille, une ligne de travers à mon œil. Je puis me permettre cette colère, car je l’ai dans les affaires comme en dehors. Je n’ai jamais été content de mon propre gouvernement. Voilà les deux sentiments qui me tiennent aujourd’hui. Je navigue de l’un à l’autre.
Hier, pour la première fois depuis que je suis ici, je n’ai pas mis le pied hors de la maison. Je n’ai jamais vu un tel torrent de pluie continue. Je m’en serais consolé en travaillant, si j’avais été en train de travailler ; mais je n’étais pas en train. J’ai beaucoup causé avec Henriette. Cette bonne petite fille m’avait donné le matin, l’air fort troublé, et toute rouge, le billet au crayon que je vous envoie; et qui m’a été au cœur. Pourrez-vous le lire ? Je lui ai promis un mari qui serait charmé de vivre avec moi, et que nous ne nous séparerions jamais. Comment cette petite Duchesse de Wurtemberg s’est-elle détruite si vite ? J’espère que l’Italie la guérira si elle a auprès d’elle quelqu’un qui sache la gouverner, car je doute qu’elle se gouverne bien elle-même. Son mari n’a pas l’air gouvernant du tout.
Qu’est-ce que Fagel entend par le mauvais état des Affaires de son pays ? Croit-il que son Roi, malgré son semblant d’arrangement, s’obstinera toujours et finira par le brouiller avec ses Etats Généraux ? Si la conférence termine l’affaire Belge, je ne vois pas quel embarras il peut y avoir en Hollande. Il me semble que la duchesse de Talleyrand vous donne beaucoup à dîner. Veut-elle comme c’est l’usage de ce temps-ci, suppléer à la qualité par la quantité ? A-t-elle pris des jours ? Essaye-t-elle d’avoir une maison ? Je suis bien questionneur ce matin.
Vous souvenez-vous que vous m’écriviez de Londres, l’an dernier : " Durham a du courage, de l’audace, et surtout de l’ambition. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est Lord Durham qui le créerait. Tout cela est encore à sa naissance ; mais regardez-y bien ; le danger peut surgir tout à coup. Vous avez une sagacité bien rare, et charmante parce qu’elle est si naturelle si prompte ! En passant vous voyez au fond.
10 heures
Je me fâche de ce que vous vous fâchez ; je m’afflige de ce que vous vous affligez. Qu’est-ce que cela prouve ? que dans ma conviction, vous n’avez jamais droit de vous fâcher jamais droit de vous affliger à mon égard. Oui, j’en suis convaincu, j’en suis sûr. Entendez bien ceci, dearest, je suis infaillible envers vous. Et tant que vous ne le croirez pas vous ne me connaîtrez pas, et vous ne saurez pas combien je vous aime. Adieu, adieu toujours le même adieu quand même, et je ne veux pas qu’il y ait de quand même. G.
175. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°175 Mardi 30 octobre. 6 h. et demie.
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
176. Lisieux, Mercredi 31 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°176 Lisieux, Mercredi 31, 7 heures et demie
J’ai amené hier mes enfants dîner ici. C’était un grand divertissement. Je vais les ramener à leur grand mère dont ils sont toute la vie. Elle est mieux. Le temps devient froid, ce qui lui vaut mieux que l’humidité continuelle. Vous avez beau dire. Nous partons lundi 5. Je vous verrai mardi 6 à 6 heures et demie. Et puisque vous ne voulez pas de mon espérance que nous serons heureux, j'accepte votre certitude. Je gagne au change. Plus de paroles, plus de discussion. De loin, c’est impossible. Je le sais comme vous. Et comment se taire quand on a tant à dire ? Vous avez l’esprit, et le cœur bien actifs, bien des choses s’y passent en une heure, en deux mois et demi. Mais soyez sûre qu’il s'en passe tout autant chez moi. Je vous défie toujours. Dans longtemps, bien longtemps d'ici, quand nous serons vieux vous me direz si j'ai gagné mon défi.
Je connais beaucoup George d'Harcourt. Je ne comprenais guère votre goût pour les bonnes manières de M. Harcourt qui n'en a ni de bonnes, ni de mauvaises et que j’avais trouvé très ennuyeux. George est en effet de manières fort agréables, spirituel sans bruit. Je n’aime pas le bruit.
Non certainement il n'est pas besoin d'être anglais pour être choqué d’une soirée de mariage au Gymnase. C'est le mal de ce pays-ci qu’on veut toujours s'amuser, et qu’on s'amuse de très petits plaisirs. Comme je vois beaucoup de Puritains, je passe ma vie à défendre l'amusement ; mais je vous livre celui-là. Et comme il faut finir par une injure, je vous dirai que la passion du petit amusement possède surtout à Paris, les étrangers. Ils se figurent qu’ils y viennent pour cela. Le Gymnase fait partie du tout.
Vous trouverez bien quelque chose de moi, dans la Revue française, mais rien sur Mad. de Broglie, son mari est occupé à rassembler quelques morceaux qu’elle a publiés. Il veut y joindre des fragments de manuscrits, et il m’a demandé de mettre en tête de ce volume une notice. Je garde pour cette notice ce que je voulais dire d’elle. Ne parlez pas de ce projet de volume. J'étais fort tranquille sur votre discrétion. C’est une de vos petites et charmantes vertus. Mais je tenais à rétablir les faits. Il y avait dans votre lettre un certain où aviez-vous pris plein de doute et d'humeur. Votre doute m'offense, votre humeur me chagrine. Prenez-en votre parti. Rien de vous ne m'est indifférent, & ce qui ne m'est pas indifférent m'est important.
Voilà le N°179 et on me dit que ma voiture est prête. Adieu. Me trouvez-vous fâché ? J’étais sûr que le billet de mon Henriette vous irait au cœur. Certainement, je le garde. Adieu, Adieu. Expliquez-moi comment il se peut que je trouve le temps à la fois lent et rapide d’ici à lundi. Chaque heure qui s’en va est un gain immense. Pourtant il y en a encore beaucoup à gagner. Adieu. Adieu. G.
J’ai amené hier mes enfants dîner ici. C’était un grand divertissement. Je vais les ramener à leur grand mère dont ils sont toute la vie. Elle est mieux. Le temps devient froid, ce qui lui vaut mieux que l’humidité continuelle. Vous avez beau dire. Nous partons lundi 5. Je vous verrai mardi 6 à 6 heures et demie. Et puisque vous ne voulez pas de mon espérance que nous serons heureux, j'accepte votre certitude. Je gagne au change. Plus de paroles, plus de discussion. De loin, c’est impossible. Je le sais comme vous. Et comment se taire quand on a tant à dire ? Vous avez l’esprit, et le cœur bien actifs, bien des choses s’y passent en une heure, en deux mois et demi. Mais soyez sûre qu’il s'en passe tout autant chez moi. Je vous défie toujours. Dans longtemps, bien longtemps d'ici, quand nous serons vieux vous me direz si j'ai gagné mon défi.
Je connais beaucoup George d'Harcourt. Je ne comprenais guère votre goût pour les bonnes manières de M. Harcourt qui n'en a ni de bonnes, ni de mauvaises et que j’avais trouvé très ennuyeux. George est en effet de manières fort agréables, spirituel sans bruit. Je n’aime pas le bruit.
Non certainement il n'est pas besoin d'être anglais pour être choqué d’une soirée de mariage au Gymnase. C'est le mal de ce pays-ci qu’on veut toujours s'amuser, et qu’on s'amuse de très petits plaisirs. Comme je vois beaucoup de Puritains, je passe ma vie à défendre l'amusement ; mais je vous livre celui-là. Et comme il faut finir par une injure, je vous dirai que la passion du petit amusement possède surtout à Paris, les étrangers. Ils se figurent qu’ils y viennent pour cela. Le Gymnase fait partie du tout.
Vous trouverez bien quelque chose de moi, dans la Revue française, mais rien sur Mad. de Broglie, son mari est occupé à rassembler quelques morceaux qu’elle a publiés. Il veut y joindre des fragments de manuscrits, et il m’a demandé de mettre en tête de ce volume une notice. Je garde pour cette notice ce que je voulais dire d’elle. Ne parlez pas de ce projet de volume. J'étais fort tranquille sur votre discrétion. C’est une de vos petites et charmantes vertus. Mais je tenais à rétablir les faits. Il y avait dans votre lettre un certain où aviez-vous pris plein de doute et d'humeur. Votre doute m'offense, votre humeur me chagrine. Prenez-en votre parti. Rien de vous ne m'est indifférent, & ce qui ne m'est pas indifférent m'est important.
Voilà le N°179 et on me dit que ma voiture est prête. Adieu. Me trouvez-vous fâché ? J’étais sûr que le billet de mon Henriette vous irait au cœur. Certainement, je le garde. Adieu, Adieu. Expliquez-moi comment il se peut que je trouve le temps à la fois lent et rapide d’ici à lundi. Chaque heure qui s’en va est un gain immense. Pourtant il y en a encore beaucoup à gagner. Adieu. Adieu. G.
177. Val-Richer, Jeudi 1er novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°177. Jeudi 1er novembre, 7 heures
Nous entrons dans le honey-moon, n’est- ce pas ? C’est charmant de retrouver un honey-moon, toutes les fois qu’on se retrouve, et sans qu’il fasse tort aux moons qui suivent. Je me lève de bonne humeur, par un vent et une pluie épouvantables. Je défie qu’il y ait entre nous de pareils orages. Le soleil est toujours sur notre horizon. Séparés, nous ne le regardons pas toujours ensemble et au même moment, mais il y est toujours. Nous voilà des gens bien heureux, nous avons le soleil et la lune à notre disposition. Il y a deux pays que je voudrais voir avec vous, l'Italie et l’Angleterre, le pays du soleil et celui du brouillard. Je ne sais duquel nous jouirions, le plus vivement. Quel dommage que nous ne voyagions pas ensemble ! Dans la grande voiture de Châtenay. Je ne vous savais pas cette aversion pour les voitures, fermées.
A propos de voyage, lisez-vous dans les journaux les lettres de ces savants que nous avons envoyés chez les Lapons et les Samides ? Ils me paraissent décidés à réhabiliter le Spitzberg, et la bonne compagnie des Esquimaux. A les en croire, ils s'amusent parfaitement. Leurs plaisirs me gèlent. Nous plairions-nous là ? Je dis le Spitzberg nous plairait-il, non pas, nous plairions-nous l'un à l'autre dans le Spitzberg ? Ceci ne fait pas question. Je me suis quelquefois proscrit avec vous en Sibérie. Mais vous la trouviez trop uncomfortable, plus unconfortable que la maison de Pozzo. Vous me livrez la tournure et les manières de Lord Castlereagh et de Lord Jocelyn, et je vous en remercie. Mais quoique vous les avez trouvés très agréables, n’est-ce pas, et vous avez causé avec eux très volontiers, bons ou mauvais principes. Je vous le pardonne. Mon estime pour les Anglais est devenu du goût, un goût sérieux mais affectueux. Obtenez seulement qu’ils ne se donnent pas tant de peine pour être frivoles.
Que cède-t-on aux Belges sur l'argent ? Car je suppose qu’on leur cède quelque chose puisque les cinq Puissances sont d'accord. Je trouve l’adresse des Etats Généraux belle. Cette ferme adhésion d'un peuple à son Roi, dans une question dont pour son compte. le peuple se soucie peu, mais qui est pour le Roi une question d’honneur, me plaît infiniment. Il sert toujours à quelque chose d'avoir été grand. Les Hollandais l’ont été. Depuis longtemps ils sont bien déchus. Dans tout le 18e siècle, leur politique a été pitoyable, sans dessein, sont consistance, sans dignité, sans autorité ; mais de temps en temps Jean de Witt se redresse et élève la tête hors de son tombeau, comme Farinata degl' Uberti dans l'Enfer du Dante.
J’ai fini hier mes plantations. A forces de vouloir m’y intéresser, j'en viens un peu à bout. Je suis pour le bonheur solitaire comme les Anglais pour la frivolité. Pourtant, je me trémousse. moins. Je me persuade quelque fois que je tiens vraiment à ce que je fais avec cette terre et ces arbres. Mais quand je rencontre quelqu’un qui y tient réellement et de cœur, je me reconnais de glace et je m'humilie. Avant-hier, ma mère m'a querellé parce que j’avais laissé mettre où l'on avait voulu des cerisiers qu’elle voulait ailleurs. Un c'est que cela m'est égal à failli m'échapper. Je l’ai retenu à temps. Si Dieu m’avait laissé mon fils, rien ici ne me serait égal. Que de projets j’avais formés, commencés ! Je les discutais avec lui ; puis, je les lui remettais absolument, sans réserve. Il faisait faire seul, à son gré. C'est charmant de se décharger sur son enfant de tout soin, de toute affaire, de se reposer en le voyant agir, décider, ordonner, vivre en maître et pour son compte, comme il vivra quand on n'y sera plus. Mon fils était si libre avec moi, et si tendre ! Il s’appartenait bien tout entier à lui-même, et il venait sans cesse à moi. Pardon, Pardon ce que je me laisse aller à vous dire là, je me permets bien rarement de me le dire à moi-même. Pardon.
9 h. 3/4.
Oui, nous avons abusé de l'adieu. Nous approchons du dernier. Adieu pourtant. J’aime mieux l'autre. G.
Nous entrons dans le honey-moon, n’est- ce pas ? C’est charmant de retrouver un honey-moon, toutes les fois qu’on se retrouve, et sans qu’il fasse tort aux moons qui suivent. Je me lève de bonne humeur, par un vent et une pluie épouvantables. Je défie qu’il y ait entre nous de pareils orages. Le soleil est toujours sur notre horizon. Séparés, nous ne le regardons pas toujours ensemble et au même moment, mais il y est toujours. Nous voilà des gens bien heureux, nous avons le soleil et la lune à notre disposition. Il y a deux pays que je voudrais voir avec vous, l'Italie et l’Angleterre, le pays du soleil et celui du brouillard. Je ne sais duquel nous jouirions, le plus vivement. Quel dommage que nous ne voyagions pas ensemble ! Dans la grande voiture de Châtenay. Je ne vous savais pas cette aversion pour les voitures, fermées.
A propos de voyage, lisez-vous dans les journaux les lettres de ces savants que nous avons envoyés chez les Lapons et les Samides ? Ils me paraissent décidés à réhabiliter le Spitzberg, et la bonne compagnie des Esquimaux. A les en croire, ils s'amusent parfaitement. Leurs plaisirs me gèlent. Nous plairions-nous là ? Je dis le Spitzberg nous plairait-il, non pas, nous plairions-nous l'un à l'autre dans le Spitzberg ? Ceci ne fait pas question. Je me suis quelquefois proscrit avec vous en Sibérie. Mais vous la trouviez trop uncomfortable, plus unconfortable que la maison de Pozzo. Vous me livrez la tournure et les manières de Lord Castlereagh et de Lord Jocelyn, et je vous en remercie. Mais quoique vous les avez trouvés très agréables, n’est-ce pas, et vous avez causé avec eux très volontiers, bons ou mauvais principes. Je vous le pardonne. Mon estime pour les Anglais est devenu du goût, un goût sérieux mais affectueux. Obtenez seulement qu’ils ne se donnent pas tant de peine pour être frivoles.
Que cède-t-on aux Belges sur l'argent ? Car je suppose qu’on leur cède quelque chose puisque les cinq Puissances sont d'accord. Je trouve l’adresse des Etats Généraux belle. Cette ferme adhésion d'un peuple à son Roi, dans une question dont pour son compte. le peuple se soucie peu, mais qui est pour le Roi une question d’honneur, me plaît infiniment. Il sert toujours à quelque chose d'avoir été grand. Les Hollandais l’ont été. Depuis longtemps ils sont bien déchus. Dans tout le 18e siècle, leur politique a été pitoyable, sans dessein, sont consistance, sans dignité, sans autorité ; mais de temps en temps Jean de Witt se redresse et élève la tête hors de son tombeau, comme Farinata degl' Uberti dans l'Enfer du Dante.
J’ai fini hier mes plantations. A forces de vouloir m’y intéresser, j'en viens un peu à bout. Je suis pour le bonheur solitaire comme les Anglais pour la frivolité. Pourtant, je me trémousse. moins. Je me persuade quelque fois que je tiens vraiment à ce que je fais avec cette terre et ces arbres. Mais quand je rencontre quelqu’un qui y tient réellement et de cœur, je me reconnais de glace et je m'humilie. Avant-hier, ma mère m'a querellé parce que j’avais laissé mettre où l'on avait voulu des cerisiers qu’elle voulait ailleurs. Un c'est que cela m'est égal à failli m'échapper. Je l’ai retenu à temps. Si Dieu m’avait laissé mon fils, rien ici ne me serait égal. Que de projets j’avais formés, commencés ! Je les discutais avec lui ; puis, je les lui remettais absolument, sans réserve. Il faisait faire seul, à son gré. C'est charmant de se décharger sur son enfant de tout soin, de toute affaire, de se reposer en le voyant agir, décider, ordonner, vivre en maître et pour son compte, comme il vivra quand on n'y sera plus. Mon fils était si libre avec moi, et si tendre ! Il s’appartenait bien tout entier à lui-même, et il venait sans cesse à moi. Pardon, Pardon ce que je me laisse aller à vous dire là, je me permets bien rarement de me le dire à moi-même. Pardon.
9 h. 3/4.
Oui, nous avons abusé de l'adieu. Nous approchons du dernier. Adieu pourtant. J’aime mieux l'autre. G.
178. Lisieux, Vendredi 2 novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°178. Lisieux vendredi, 2 Novembre 8 heures
Je vous écris debout, auprès de ma fenêtre, avec trois personnes dans ma chambre, certains attendent en bas dans le salon. C'est mon dernier séjour ici : on se presse. Deux choses dominent en province, les intérêts privés et l’ennui. On me trouve bon pour l'un et l'autre mal. Je ne suis bon à présent qu’à une chose, à désirer mardi. L'impatience de vous revoir m'envahit. Ma solitude de deux mois et demi pèsera tout entière sur chaque moment jusqu'à ce que je vous aie retrouvée, vue, entendue, à côté de moi, devant moi, bien près de moi. Si les trois personnes qui sont là, et qui m’interrompent savaient quel sentiment me tient et ce que j'écris, elles seraient bien étonnées. Soyez, soyez impatiente. Soyez-le autant que moi. Il me le faut absolument. Je vous écrirai encore demain et après demain, mais lundi, non, ce sera moi qui partirai. Vous m’écrirez aussi Dimanche pour la dernière fois.
Il a fait cette nuit un temps épouvantable du vent, de la pluie, de la grêle avec fracas. Et au milieu de ce fracas, la sonnerie de toutes les cloches de la ville pour la fête de la Toussaint. Tout cela m'a éveillé, comme de raison. J’ai pensé à vous; je n'ai plus rien entendu. Il y avait une chanson où un pauvre jeune conscrit partant pour l’armée disait à sa maîtresse, Charlotte, je crois. Les cent voix de la renommée de ta voix n'ont pas la douceur. Je dis bien mieux, votre voix, votre seule pensée couvre toutes les voix de la renommée, des cloches, de l'orage. Adieu. Adieu.
Je retourne à mes ennuyés. Adieu. G.
Ma mère était bien hier. Je repars dans une demi-heure pour arriver avant le déjeuner. J’ai Mad. de Meulan avec moi. Elle était invitée à ce dernier dîner. Voilà mon courrier. Pas de lettre. Pourquoi ? J’ai le cœur bien serré. Adieu encore. G.
Je vous écris debout, auprès de ma fenêtre, avec trois personnes dans ma chambre, certains attendent en bas dans le salon. C'est mon dernier séjour ici : on se presse. Deux choses dominent en province, les intérêts privés et l’ennui. On me trouve bon pour l'un et l'autre mal. Je ne suis bon à présent qu’à une chose, à désirer mardi. L'impatience de vous revoir m'envahit. Ma solitude de deux mois et demi pèsera tout entière sur chaque moment jusqu'à ce que je vous aie retrouvée, vue, entendue, à côté de moi, devant moi, bien près de moi. Si les trois personnes qui sont là, et qui m’interrompent savaient quel sentiment me tient et ce que j'écris, elles seraient bien étonnées. Soyez, soyez impatiente. Soyez-le autant que moi. Il me le faut absolument. Je vous écrirai encore demain et après demain, mais lundi, non, ce sera moi qui partirai. Vous m’écrirez aussi Dimanche pour la dernière fois.
Il a fait cette nuit un temps épouvantable du vent, de la pluie, de la grêle avec fracas. Et au milieu de ce fracas, la sonnerie de toutes les cloches de la ville pour la fête de la Toussaint. Tout cela m'a éveillé, comme de raison. J’ai pensé à vous; je n'ai plus rien entendu. Il y avait une chanson où un pauvre jeune conscrit partant pour l’armée disait à sa maîtresse, Charlotte, je crois. Les cent voix de la renommée de ta voix n'ont pas la douceur. Je dis bien mieux, votre voix, votre seule pensée couvre toutes les voix de la renommée, des cloches, de l'orage. Adieu. Adieu.
Je retourne à mes ennuyés. Adieu. G.
Ma mère était bien hier. Je repars dans une demi-heure pour arriver avant le déjeuner. J’ai Mad. de Meulan avec moi. Elle était invitée à ce dernier dîner. Voilà mon courrier. Pas de lettre. Pourquoi ? J’ai le cœur bien serré. Adieu encore. G.
Mots-clés : Autoportrait, Relation François-Dorothée
179. Val-Richer, Samedi 3 novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°179. Samedi 3 Novembre 7 heures
C’est un jour bien triste, un jour étrange qu'un jour sans lettre de vous. Surement vous êtes bien triste aussi, ou bien malade, peut-être l'un et l'autre. Je ne sais pourquoi en me levant, je me mets à vous écrire. Que vous dirai-je ? toutes mes paroles s’arrêtent dans ces ténèbres qui sont entre vous et moi. Dans quelques heures j’espère, il n’y aura plus de ténèbres au moins. Vous m'aurez écrit, ou fait écrire. Quel fardeau, quelle absurdité serait la vie que nous menons ici bas s’il n’y avait qu’ici bas ! Tant d’agitation dans un si court espace ! Des joies et des douleurs si vives pour un jour, pour rien. Cela ne se peut. Il y a de la vie au delà de cette vie-ci. Il y a, à cette vie-ci, un but plus grand qu'elle. Je comprends, j'accepte la souffrance comme préparation, comme épreuve, la souffrance à l'entrée dans un avenir ; mais la souffrance et quelle souffrance ! Sans valeur, sans résultat, étant à elle-même sa propre fin, le terme de tout ! Ma raison tout mon être se révolte. Cela n’est pas. Vous m'en avez été une preuve nouvelle, convaincante. J'ai besoin absolument besoin de l’éternité pour vous. Que de choses je voudrais vous dire, et je ne puis !
9 heures et demie
Il n’y a rien. Point d'accident ; point de mal de plus. Un simple retard. Grondez quelqu'un je vous prie. Votre lettre du jeudi 1er novembre n’est partie de Paris que le vendredi. Elle est timbrée du 2. Grondez, grondez. Certainement mes lettres sont joyeuses, et je pars lundi 5. Vous vous étonnez à ce qu’il me semble que mes lettres soient joyeuses. Ah, que vous avez peu de foi ! Comment avez-vous fait pour ne pas être une incrédule ? J’aurai du chagrin de vous trouver maigrie, autant que je pourrai avoir du chagrin. J’ai peine à y croire.
Adieu, Adieu. Oui vous ne m’écrirez plus qu'aujourd’hui et demain. Adieu. G.
C’est un jour bien triste, un jour étrange qu'un jour sans lettre de vous. Surement vous êtes bien triste aussi, ou bien malade, peut-être l'un et l'autre. Je ne sais pourquoi en me levant, je me mets à vous écrire. Que vous dirai-je ? toutes mes paroles s’arrêtent dans ces ténèbres qui sont entre vous et moi. Dans quelques heures j’espère, il n’y aura plus de ténèbres au moins. Vous m'aurez écrit, ou fait écrire. Quel fardeau, quelle absurdité serait la vie que nous menons ici bas s’il n’y avait qu’ici bas ! Tant d’agitation dans un si court espace ! Des joies et des douleurs si vives pour un jour, pour rien. Cela ne se peut. Il y a de la vie au delà de cette vie-ci. Il y a, à cette vie-ci, un but plus grand qu'elle. Je comprends, j'accepte la souffrance comme préparation, comme épreuve, la souffrance à l'entrée dans un avenir ; mais la souffrance et quelle souffrance ! Sans valeur, sans résultat, étant à elle-même sa propre fin, le terme de tout ! Ma raison tout mon être se révolte. Cela n’est pas. Vous m'en avez été une preuve nouvelle, convaincante. J'ai besoin absolument besoin de l’éternité pour vous. Que de choses je voudrais vous dire, et je ne puis !
9 heures et demie
Il n’y a rien. Point d'accident ; point de mal de plus. Un simple retard. Grondez quelqu'un je vous prie. Votre lettre du jeudi 1er novembre n’est partie de Paris que le vendredi. Elle est timbrée du 2. Grondez, grondez. Certainement mes lettres sont joyeuses, et je pars lundi 5. Vous vous étonnez à ce qu’il me semble que mes lettres soient joyeuses. Ah, que vous avez peu de foi ! Comment avez-vous fait pour ne pas être une incrédule ? J’aurai du chagrin de vous trouver maigrie, autant que je pourrai avoir du chagrin. J’ai peine à y croire.
Adieu, Adieu. Oui vous ne m’écrirez plus qu'aujourd’hui et demain. Adieu. G.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
180. Val-Richer, Dimanche 4 novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°180. Dimanche 4 Nov. 8 heures
Pour la dernière fois. N’appelez-vous pas l’éternité les huit mois que nous aurons devant nous ? Je le veux bien. Je vous ai écrit bien tristement hier. C’est que j'étais fort triste. Je tremble toujours en approchant du port. La vie a fait sur moi ce double effet ; je tremble bien plus au dedans ; j’ai l’air bien plus calme au dehors. Quand on est jeune l’agitation est dans les branches ; quand on n’est plus jeune, dans les racines.
Comment, votre banquier de Pétersbourg tarde à vous répondre ! C'est impossible. Je les flatte. Quelles gens en effet ! Rien n'est impossible de leur part. Savez-vous qu’il n’y a rien de plus difficile que de conserver, pour de telles gens un peu de justice dans l’esprit ? M. Soukowski sera un peu étonné que vous vous adressiez à lui pour avoir l'itinéraire. Car je ne suppose pas que l’entourage soit au courant de tout.
Le Mariage Castellane me parait tout simple ; ce qui veut dire que je suis de votre avis sur ce qu’il vous parait à vous.
Mes dernières journées sont très actives. Il m’arrive ce matin quatre ballots d’arbres et d'arbustes qu’on m’envoie du Jardin des Plantes, toutes sortes de choses belles et rares. Je marque les places où il faut planter tout cela. Mad. de Meulan restera quatre jours après moi pour faire faire les plantations. Il pleut horriblement la nuit ; le jour non ; on n’a d’eau que sous les pieds. Je vous quitte pour aller continuer mon travail commencé hier.
10 h. 1/4
Je rentre pour recevoir votre lettre. Je ne vous parle plus de rien. Je n’ai plus de chagrin de rien. Adieu, Adieu. Quel pauvre adieu ! G.
Pour la dernière fois. N’appelez-vous pas l’éternité les huit mois que nous aurons devant nous ? Je le veux bien. Je vous ai écrit bien tristement hier. C’est que j'étais fort triste. Je tremble toujours en approchant du port. La vie a fait sur moi ce double effet ; je tremble bien plus au dedans ; j’ai l’air bien plus calme au dehors. Quand on est jeune l’agitation est dans les branches ; quand on n’est plus jeune, dans les racines.
Comment, votre banquier de Pétersbourg tarde à vous répondre ! C'est impossible. Je les flatte. Quelles gens en effet ! Rien n'est impossible de leur part. Savez-vous qu’il n’y a rien de plus difficile que de conserver, pour de telles gens un peu de justice dans l’esprit ? M. Soukowski sera un peu étonné que vous vous adressiez à lui pour avoir l'itinéraire. Car je ne suppose pas que l’entourage soit au courant de tout.
Le Mariage Castellane me parait tout simple ; ce qui veut dire que je suis de votre avis sur ce qu’il vous parait à vous.
Mes dernières journées sont très actives. Il m’arrive ce matin quatre ballots d’arbres et d'arbustes qu’on m’envoie du Jardin des Plantes, toutes sortes de choses belles et rares. Je marque les places où il faut planter tout cela. Mad. de Meulan restera quatre jours après moi pour faire faire les plantations. Il pleut horriblement la nuit ; le jour non ; on n’a d’eau que sous les pieds. Je vous quitte pour aller continuer mon travail commencé hier.
10 h. 1/4
Je rentre pour recevoir votre lettre. Je ne vous parle plus de rien. Je n’ai plus de chagrin de rien. Adieu, Adieu. Quel pauvre adieu ! G.
Mots-clés : Réseau social et politique, Vie domestique (François)