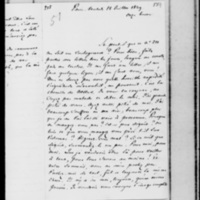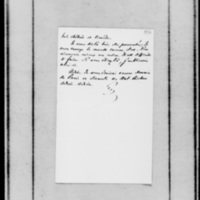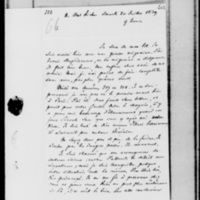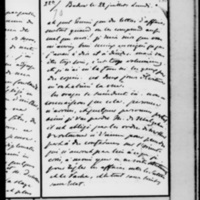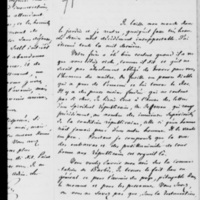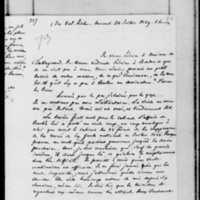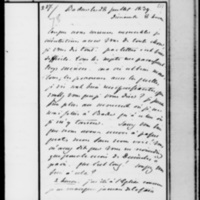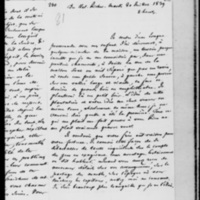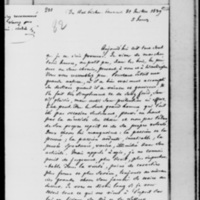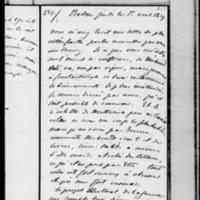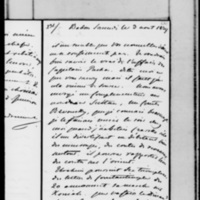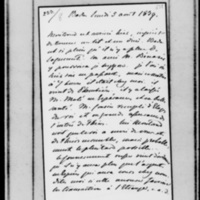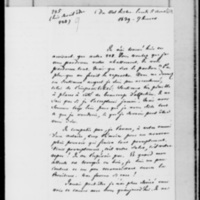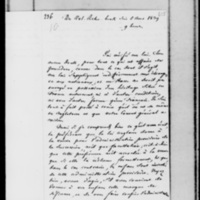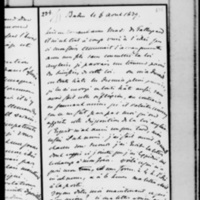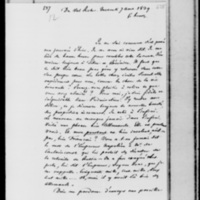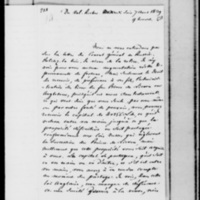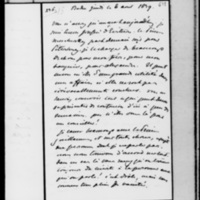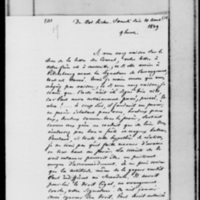Votre recherche dans le corpus : 189 résultats dans 6062 notices du site.Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre ) (1839 : De la Chambre à l'Ambassade)
Trier par :
215. Paris, Vendredi 12 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
215 Paris, Vendredi 12 Juillet 1839 Onze heures
Se peut-il que ce N° 211 me soit un soulagement ? Pour Dieu, faites partir vos lettres tous les jours, longues ou courtes gaies au tristes. Il me faut une lettre ; il me faut quelques lignes ; il me faut vous, vous ! Vous ne savez pas avec qu’elle horrible rapidité l'inquiétude m’envahit, me poursuit. C’est la chemise de Nessus. Je vous en conjure ; ne soyez pas malade et dites-le moi. J'ai grande pitié de vous. Ayez aussi pitié de moi. J’ai beaucoup souffert, en ma vie ; beaucoup plus que je ne l'ai laissé voir à personne. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Est-ce pour dégoût ? Ou bien ce que vous mangez vous pèse-t-il sur l'estomac ? Digérez-vous mal ? Si ce n’est que dégoût, surmontez-le un peu ! Pour moi, pour moi. Que je voudrais être là pour veiller à tout, pour tous savoir au moins. Et votre sommeil vous ne m'en parlez pas. Parlez-moi de tout, fût-ce toujours la même chose. Il n’y a en moi, toujours, qu’une même pensée. Je voudrais vous envoyer l'image complète de mes journées de ce qui les remplit en dedans. Vous verriez. Je devrais peut-être ne pas vous dire tout cela, ne pas ajouter mon inquiétude à votre fatigue. Si vous étiez près de moi, je me tairais mieux. Ne renoncez pas à marcher cela vous est bon. J'ai vu par vos lettres que vous dormiez quelquefois dans le jour. Ne vous en défendez pas.
Je veux parler d'autre chose. Nous sommes assez préoccupés ; agités dirait trop. La Cour rendra son arrêt aujourd’hui. Si Barbès est condamné à mort, le parti fera quelque démonstration, sans espoir, sans dessein sérieux même, par honneur, pour ne pas paraître frappé et mort du même coup. Peut-être quelque tentative sur la prison ; peut-être quelque coup de pistolet sur quelque voiture de Pair.
Paris est fort tranquille. Vous y seriez fort tranquille Je regarde votre lettre. Une chose m’en plait. Votre écriture est bonne et ferme.
J'ai vu Pozzo. Affreusement maigri, rétréci rapetissé, les yeux enfoncés dans un cercle de charbon, la parole chancelante, les épaules voûtées, les jambes ployées, les habits trop larges, l’esprit aussi chancelant que la parole. Nous causions seuls dans le premier petit salon de Mad. de Boigne, Edouard de Lagrange est entré. Il l’a pris pour le Marquis de Dalmatie, lui a parlé du Maréchal ; puis M. de Lagrange passé, il m'a dit tout bas : " C’est bien le marquis de Dalmatie, n’est-ce pas ? " en homme qui doute de lui-même. Pourtant, il m’a parlé longtemps de ses dernières affaires à Londres de ses conversations avec Lord Melbourne et Lord Palmerston de tout ce qu'il leur avait dit sur la nécessité de maintenir la paix sur leurs intérêts et les vôtres dans la paix ; tout cela très nettement, très spirituellement, comme par le passé avec verve dans l'imagination, en même temps qu'avec faiblesse et trouble dans le langage. Puis en finissant : " C'est ma campagne de vétéran. Un autre hiver à Londres me tuerait." Il ne s’est pas pris de goût pour l'Angleterre, en y vivant, Madame de Boigne va mieux, beaucoup mieux. Elle est retournée hier à Châtenay. J’irai y dîner demain.
Connaissez-vous un M. de Lücksbourg, bavarois, qui remplacera probablement ici M. de Jennisson ? Il est venu me voir avant hier. Je l’ai trouvé bien. Si M. de Jennisson s'en va, peut-être son appartement se trouvera-t-il vacant. C’est un peu cher, mais bien gai. A présent tout à côté de la maison est arrangé. Vous n'auriez pas de bruit. Adieu. Je vais à la Chambre. On commence de bonne heure. Pourquoi n’êtes-vous pas à la Terrasse ? Adieu. Adieu. J’aurai de vos nouvelles demain n’est-ce pas ? Ah que la vie est mal arrangée ! Adieu. G.
Se peut-il que ce N° 211 me soit un soulagement ? Pour Dieu, faites partir vos lettres tous les jours, longues ou courtes gaies au tristes. Il me faut une lettre ; il me faut quelques lignes ; il me faut vous, vous ! Vous ne savez pas avec qu’elle horrible rapidité l'inquiétude m’envahit, me poursuit. C’est la chemise de Nessus. Je vous en conjure ; ne soyez pas malade et dites-le moi. J'ai grande pitié de vous. Ayez aussi pitié de moi. J’ai beaucoup souffert, en ma vie ; beaucoup plus que je ne l'ai laissé voir à personne. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Est-ce pour dégoût ? Ou bien ce que vous mangez vous pèse-t-il sur l'estomac ? Digérez-vous mal ? Si ce n’est que dégoût, surmontez-le un peu ! Pour moi, pour moi. Que je voudrais être là pour veiller à tout, pour tous savoir au moins. Et votre sommeil vous ne m'en parlez pas. Parlez-moi de tout, fût-ce toujours la même chose. Il n’y a en moi, toujours, qu’une même pensée. Je voudrais vous envoyer l'image complète de mes journées de ce qui les remplit en dedans. Vous verriez. Je devrais peut-être ne pas vous dire tout cela, ne pas ajouter mon inquiétude à votre fatigue. Si vous étiez près de moi, je me tairais mieux. Ne renoncez pas à marcher cela vous est bon. J'ai vu par vos lettres que vous dormiez quelquefois dans le jour. Ne vous en défendez pas.
Je veux parler d'autre chose. Nous sommes assez préoccupés ; agités dirait trop. La Cour rendra son arrêt aujourd’hui. Si Barbès est condamné à mort, le parti fera quelque démonstration, sans espoir, sans dessein sérieux même, par honneur, pour ne pas paraître frappé et mort du même coup. Peut-être quelque tentative sur la prison ; peut-être quelque coup de pistolet sur quelque voiture de Pair.
Paris est fort tranquille. Vous y seriez fort tranquille Je regarde votre lettre. Une chose m’en plait. Votre écriture est bonne et ferme.
J'ai vu Pozzo. Affreusement maigri, rétréci rapetissé, les yeux enfoncés dans un cercle de charbon, la parole chancelante, les épaules voûtées, les jambes ployées, les habits trop larges, l’esprit aussi chancelant que la parole. Nous causions seuls dans le premier petit salon de Mad. de Boigne, Edouard de Lagrange est entré. Il l’a pris pour le Marquis de Dalmatie, lui a parlé du Maréchal ; puis M. de Lagrange passé, il m'a dit tout bas : " C’est bien le marquis de Dalmatie, n’est-ce pas ? " en homme qui doute de lui-même. Pourtant, il m’a parlé longtemps de ses dernières affaires à Londres de ses conversations avec Lord Melbourne et Lord Palmerston de tout ce qu'il leur avait dit sur la nécessité de maintenir la paix sur leurs intérêts et les vôtres dans la paix ; tout cela très nettement, très spirituellement, comme par le passé avec verve dans l'imagination, en même temps qu'avec faiblesse et trouble dans le langage. Puis en finissant : " C'est ma campagne de vétéran. Un autre hiver à Londres me tuerait." Il ne s’est pas pris de goût pour l'Angleterre, en y vivant, Madame de Boigne va mieux, beaucoup mieux. Elle est retournée hier à Châtenay. J’irai y dîner demain.
Connaissez-vous un M. de Lücksbourg, bavarois, qui remplacera probablement ici M. de Jennisson ? Il est venu me voir avant hier. Je l’ai trouvé bien. Si M. de Jennisson s'en va, peut-être son appartement se trouvera-t-il vacant. C’est un peu cher, mais bien gai. A présent tout à côté de la maison est arrangé. Vous n'auriez pas de bruit. Adieu. Je vais à la Chambre. On commence de bonne heure. Pourquoi n’êtes-vous pas à la Terrasse ? Adieu. Adieu. J’aurai de vos nouvelles demain n’est-ce pas ? Ah que la vie est mal arrangée ! Adieu. G.
214. Baden, Vendredi 12 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
214 Baden Vendredi 12 juillet 1839, 1 heures
Préoccupez-vous beaucoup de ma santé c’est juste mais ne vous préoccupez plus de mon cœur. C'est une injure. Je vous prie, je vous prie, ne pensez plus à lui que pour votre plaisir, soyez sûr de mon cœur comme du vôtre. Soyez sûr que je vous dis vrai. Ma nuit a été mauvaise. J’ai essayé de dormir un peu ce matin, mais cela n'a point réussi. Tout cela vous prépare à un mot, et pas à une lettre. Le médecin cherche à me donner des forces. Il me fait manger beaucoup de racine de gingembre. Je n’ai rien de plus nouveau à vous dire que cela.
5 heures
Votre lettre d'avant hier m'arrive à l’instant. Merci, merci des nouvelles. J'en suis toujours très avide. J'ai toujours des forces pour cela. J'ai essayé de manger, cela ne va pas, je vais essayer de sortir en calèche, cela va toujours. Adieu. Adieu. mille fois.
Préoccupez-vous beaucoup de ma santé c’est juste mais ne vous préoccupez plus de mon cœur. C'est une injure. Je vous prie, je vous prie, ne pensez plus à lui que pour votre plaisir, soyez sûr de mon cœur comme du vôtre. Soyez sûr que je vous dis vrai. Ma nuit a été mauvaise. J’ai essayé de dormir un peu ce matin, mais cela n'a point réussi. Tout cela vous prépare à un mot, et pas à une lettre. Le médecin cherche à me donner des forces. Il me fait manger beaucoup de racine de gingembre. Je n’ai rien de plus nouveau à vous dire que cela.
5 heures
Votre lettre d'avant hier m'arrive à l’instant. Merci, merci des nouvelles. J'en suis toujours très avide. J'ai toujours des forces pour cela. J'ai essayé de manger, cela ne va pas, je vais essayer de sortir en calèche, cela va toujours. Adieu. Adieu. mille fois.
Mots-clés : Santé (Dorothée)
216. Paris, Samedi 13 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
216 Paris Samedi 18 Juillet 1839, 8 heures
J'attends. Je devrais ne rien dire de plus, car d’ici à 10 heures je suis tout là. La Cour des Pairs a rendu hier au soir son arrêt, au milieu d’un calme profond. La délibération intérieure a été solennelle. Les plus difficiles sont contents de sa gravité, de sa liberté, de sa probité. La majorité sur le point capital, Barbès a été grande 133 contre 22. Le parti de l'indulgence a été soutenu par des hommes de tous les partis et surtout par ce motif qu’il fallait craindre d'exciter le fanatisme jusqu'à la rage, et de concentrer cette rage sur une seule tête. M. Cousin a soutenu cela avec beaucoup de talent. M. Molé a bien parlé, brièvement, mais nettement, pour la condamnation à mort. Je n’ai encore vu personne ce matin ; mais rien ne m'indique qu’il y ait eu le moindre bruit cette nuit. On en attendait un peu autour de la prison. En fait de forces et de précautions, il y a du luxe. On a raison. Le Duc de Broglie repart ce matin pour la Suisse. Nous nous sommes dit adieu hier au soir. Pendant son séjour, quelques uns des ministres l’ont pressé d'entrer avec eux aux Affaires étrangères. Je l’en ai pressé moi-même, me mettant, s’il entrait, à sa disposition pour le dehors. Il a positivement refusé.
10 heures
J'attends encore. Montrond sort de chez moi, guéri de son érésipèle. Il part dans deux jours pour Bourhame. Delà à Bade. Je regrette bien qu’il m’y soit pas allé plustôt. Quoique vous l'eussiez probable. ment bientôt aisé. Il est bon à retrouver souvent, mais non pas à garder longtemps. Le Maréchal se trouve fort bien aux Affaires Etrangères, et n'a aucun dessein de les céder à personne. L'Orient va très bien, grâce à lui. Tout s’y arrange, et s’y arrangera encore mieux si le Sultan meurt. Un jeune Prince, un Divan nouveau se hâteront de faire la paix avec le Pacha. La paix donc, le Sultan vivant. Encore plus la paix, le Sultan mort. D'ailleurs, il y aura une conférence, à Vienne, et vous y viendrez. M. de Metternich vous promet. ainsi sera réglée la plus grosse affaire de l’Europe. Rien n’est tel que les petits Ministères pour les grosses affaires.
Voilà le N°212. Les dernières lignes valent Je vois que le bruit d’une conférence à Vienne est Baden, comme à Paris. M. Villemain a défendu hier son budget spirituellement mais trop plaisamment. Notre Chambre n’aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments et M. Villemain en est prodigue. C'est l’usage à l'académie. Entre gens d’esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l’esprit, les uns des autres comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut, devant l'autel. Notre Chambre ne se pique pas d’esprit, et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Adieu. J’y vais à cette Chambre qui ne se pique pas d’esprit. Je verrai aujourd'hui quand nous finirons. Adieu Adieu. Encore une fois des détails.
G.
J’irai voir Pozzo aujourd'hui ou demain à votre intention.
J'attends. Je devrais ne rien dire de plus, car d’ici à 10 heures je suis tout là. La Cour des Pairs a rendu hier au soir son arrêt, au milieu d’un calme profond. La délibération intérieure a été solennelle. Les plus difficiles sont contents de sa gravité, de sa liberté, de sa probité. La majorité sur le point capital, Barbès a été grande 133 contre 22. Le parti de l'indulgence a été soutenu par des hommes de tous les partis et surtout par ce motif qu’il fallait craindre d'exciter le fanatisme jusqu'à la rage, et de concentrer cette rage sur une seule tête. M. Cousin a soutenu cela avec beaucoup de talent. M. Molé a bien parlé, brièvement, mais nettement, pour la condamnation à mort. Je n’ai encore vu personne ce matin ; mais rien ne m'indique qu’il y ait eu le moindre bruit cette nuit. On en attendait un peu autour de la prison. En fait de forces et de précautions, il y a du luxe. On a raison. Le Duc de Broglie repart ce matin pour la Suisse. Nous nous sommes dit adieu hier au soir. Pendant son séjour, quelques uns des ministres l’ont pressé d'entrer avec eux aux Affaires étrangères. Je l’en ai pressé moi-même, me mettant, s’il entrait, à sa disposition pour le dehors. Il a positivement refusé.
10 heures
J'attends encore. Montrond sort de chez moi, guéri de son érésipèle. Il part dans deux jours pour Bourhame. Delà à Bade. Je regrette bien qu’il m’y soit pas allé plustôt. Quoique vous l'eussiez probable. ment bientôt aisé. Il est bon à retrouver souvent, mais non pas à garder longtemps. Le Maréchal se trouve fort bien aux Affaires Etrangères, et n'a aucun dessein de les céder à personne. L'Orient va très bien, grâce à lui. Tout s’y arrange, et s’y arrangera encore mieux si le Sultan meurt. Un jeune Prince, un Divan nouveau se hâteront de faire la paix avec le Pacha. La paix donc, le Sultan vivant. Encore plus la paix, le Sultan mort. D'ailleurs, il y aura une conférence, à Vienne, et vous y viendrez. M. de Metternich vous promet. ainsi sera réglée la plus grosse affaire de l’Europe. Rien n’est tel que les petits Ministères pour les grosses affaires.
Voilà le N°212. Les dernières lignes valent Je vois que le bruit d’une conférence à Vienne est Baden, comme à Paris. M. Villemain a défendu hier son budget spirituellement mais trop plaisamment. Notre Chambre n’aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments et M. Villemain en est prodigue. C'est l’usage à l'académie. Entre gens d’esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l’esprit, les uns des autres comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut, devant l'autel. Notre Chambre ne se pique pas d’esprit, et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Adieu. J’y vais à cette Chambre qui ne se pique pas d’esprit. Je verrai aujourd'hui quand nous finirons. Adieu Adieu. Encore une fois des détails.
G.
J’irai voir Pozzo aujourd'hui ou demain à votre intention.
215. Baden, Samedi 13 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
215 Baden Samedi 13 juillet 1839, 1 heure
Je me sens un peu mieux aujourd’hui et je crains de vous le dire,car cela me porte malheur. J'aimerais bien mieux que vous me permissiez de ne vous parler jamais de ma santé. M. de la Redorte est arrivé, il est venu me voir. Il cause c.a.d. il raconte, et au fond pas grand chose. Voici la réponse de M. de Bacourt. Ces notions lui ont été fournies par M. de Blittersdorff, le Metternich de ce pays-ci. Des lettres de Constantinople du 25 juin disent que le sultan est dans un état désespéré. Il traînera un mois tout au plus.
5 heures
Voici votre N°214 bien tendre, bien bon, je le relirai souvent. Je vous en remercie. Vous voyez que je puis à peine vous écrire, cela me fatigue, le sang me porte à la tête, je ne suis pas bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ecrivez-moi toujours et tout. Adieu. J’ai eu une lettre d'Alexandre, très insignifiante. Il me dit seulement qu’il est très occupé. Mais quand est-ce que quelqu'un prendra la peine de me dire ce qu'on fait ? Adieu. Adieu.
Je me sens un peu mieux aujourd’hui et je crains de vous le dire,car cela me porte malheur. J'aimerais bien mieux que vous me permissiez de ne vous parler jamais de ma santé. M. de la Redorte est arrivé, il est venu me voir. Il cause c.a.d. il raconte, et au fond pas grand chose. Voici la réponse de M. de Bacourt. Ces notions lui ont été fournies par M. de Blittersdorff, le Metternich de ce pays-ci. Des lettres de Constantinople du 25 juin disent que le sultan est dans un état désespéré. Il traînera un mois tout au plus.
5 heures
Voici votre N°214 bien tendre, bien bon, je le relirai souvent. Je vous en remercie. Vous voyez que je puis à peine vous écrire, cela me fatigue, le sang me porte à la tête, je ne suis pas bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ecrivez-moi toujours et tout. Adieu. J’ai eu une lettre d'Alexandre, très insignifiante. Il me dit seulement qu’il est très occupé. Mais quand est-ce que quelqu'un prendra la peine de me dire ce qu'on fait ? Adieu. Adieu.
217. Paris, Dimanche 14 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
217 Paris, Dimanche 14 Juillet 1839 8 h. 3/4
Comme je fermais hier ma lettre on vint m'avertir qu'il y aurait peut-être un peu de mouvement à la Chambre, car une bande assez nombreuse se formait et voulait y porter une pétition pour l'abolition de la peine de mort. Je ne trouvai en arrivant ni mouvement, ni bande mais beaucoup de précautions prises, les grilles fermées, des troupes dans les cours &. Au dedans, de la part de la Chambre, une disposition très sensée et tranquille. S'il y a un progrès depuis quelque temps, c’est que les pouvoirs publics ne sont plus du tout à l'état révolutionnaire. Non qu’il n'y ait là aussi quelques hommes qui sont encore et qui resteront à cet état. Mais ils y sont pour leur propre compte n'oseraient le montrer, et la majorité serait telle qu’on ne lui donnera même pas l'occasion de se manifester. Vers deux heures, pendant qu’on délibérait sur le budget de l’instruction publique, le rassemblement est arrivé sur la place 7 à 800 hommes, la plupart en blouses, quelques étudiants bien vêtus ; de côté hors de la troupe, deux hommes en habit noir, la canne à la main, qui avaient l’air de diriger les mouvements. Au milieu un drapeau portant abolition de la peine de mort, et la pétition roulée autour du bâton. Le commissaire de police les a sommés de se retirer. Sur leur refus, un escadron de la garde municipale s’en avance au grand trot. La dispersion a été générale et soudaine. Un garde municipal a poussé son cheval sur l'homme qui portait le drapeau, l’a pris, l’a jeté sur la croupe de son cheval et l'a ramené au corps de garde de la Chambre, au milieu des hourras de la garde nationale qui voulait le jeter à la rivière. C’est un pauvre ouvrier tailleur, de mine très timide, et qui semblait se croire au moins mort en entrant dans le corps de garde. Nous avons continué notre budget, et je suis parti à 4 heures et demie pour aller dîner à Châtenay. En en revenant, à 10 heures et demie, j’ai traversé tout Paris parfaitement tranquille.
Je n’entends rien dire ce matin. Châtenay était charmant, l’air doux, les arbres, touffus, les gazons frais. Je me suis donné le triste plaisir, bien plaisir et bien triste de refaire seul notre promenade dans le jardin, mêmes alliés, même pas. Ah, que ne peut-on fixer sa vie à un moment de son choix !
Onze heures
Votre N°213 me désespère. Je vous répète, je me répète à moi-même ce que je vous écris tous les jours. Je ne puis pas décider pour vous. J’en suis, dans l’anxiété la plus douloureuse. Je voudrais avoir un avis, une volonté ; je voudrais vous décharger de tout ce qui vous agite et vous pèse, embarras, indécision, solitude. Je retrouve ce que je connais trop bien, cet horrible sentiment d’impuissance contre les choses, les faits tout le monde extérieur, au moment même où la tendresse la plus infinie, la plus souveraine, remplit l'âme et se croirait toute puissante si elle n'écoutait qu'elle-même. Pardon, pardon de vous parler de ma tristesse à moi. De quoi vous parlerais-je ? Ma tristesse, c’est votre mal, c’est votre faiblesse, votre maigreur, votre abattement, votre ennui. Vous m’avez reproché quelquefois de me trop arrêter avec vous sur ce que vous souffriez, et de m'y associer au lieu de vous en distraire. Dearest, je ne puis pas me distraire de vous, encore moins de loin que de près, encore moins de votre santé que de vos chagrins.
Comment, votre médecin vous engage à quitter Baden, ne fût-ce que pour quelques jours ? Je ne comprends pas cela. Je comprendrais qu'il vous en renvoyât. Après tout, je ne sais vous dire qu’une chose. Faites ce dont vous aurez envie. Ne consultez que votre envie et votre force. Allez où elles vous diront, où elles vous mèneront. Ici le beau temps revient, le chaud, le soleil. Est-ce qu'il ne revient pas aussi à Baden ? et ne vous fait-il aucun bien ? Vous avez eu des nouvelles de Pétersbourg puisque vous savez qu’on fera Paul conseiller d'Etat. N’y a-t-il rien sur vos affaires ? J’ai reçu hier une lettre de M. de Barante, sans intérêt. Que je voudrais mettre dans les miennes de quoi remplir votre journée ! Je vous écrirais volontiers des volumes.
J’ai passé auprès de vous tant d'heures de conversation charmante ; pleine des plus douces choses, des seules douces choses de ce monde, de tendresse et de liberté. Vous ne savez pas quelle vive, quelle inépuisable reconnaissance (quand ce ne serait que reconnaissance) me resterait éternellement dans le cœur envers vous pour de tels moments, pour un seul de ces moments. Le monde est si froid, et si faux ! et par dessus cela si médiocre si vulgaire ! L'âme y meurt de faim et de soif, et de dégoût. J’ai trouvé près de vous, en vous, ce que je n'attendais plus ce que je ne demandais plus. Je me suis senti si heureux près de vous, sans contrainte ni privation aucune, aucune, ni de cœur, ni d’esprit, ni de goût, ni de parole, satisfait, pleinement satisfait, plongé dans le sentiment le seul qui épanouisse toute l'âme point de désir parce qu’on a tout. Que de fois, en causant avec vous, au milieu des effusions de notre intimité, j’ai été tout à coup, et pour une seconde rappelé en moi-même par un de ces éclairs intérieurs qui illuminent tout notre bonheur tout notre plaisir ! Je ne vous ai jamais dit, je ne vous dirai jamais à quel point je vous trouve rare et charmante, ni combien je vis seul sans vous, ni ce que sera pour moi, le jour qui vous rendra à moi, fussiez-vous cent fois plus maigre et plus abattue que vous ne me le dites. Adieu. Adieu.
Je ne puis vous parler d'autre chose. Quand j'ai reçu, quand j'ai relu votre lettre, j'attends celle du lendemain. Ne vous fatiguez pas à m’écrire ; mais ne me laissez pas sans nouvelles. Adieu. G.
Comme je fermais hier ma lettre on vint m'avertir qu'il y aurait peut-être un peu de mouvement à la Chambre, car une bande assez nombreuse se formait et voulait y porter une pétition pour l'abolition de la peine de mort. Je ne trouvai en arrivant ni mouvement, ni bande mais beaucoup de précautions prises, les grilles fermées, des troupes dans les cours &. Au dedans, de la part de la Chambre, une disposition très sensée et tranquille. S'il y a un progrès depuis quelque temps, c’est que les pouvoirs publics ne sont plus du tout à l'état révolutionnaire. Non qu’il n'y ait là aussi quelques hommes qui sont encore et qui resteront à cet état. Mais ils y sont pour leur propre compte n'oseraient le montrer, et la majorité serait telle qu’on ne lui donnera même pas l'occasion de se manifester. Vers deux heures, pendant qu’on délibérait sur le budget de l’instruction publique, le rassemblement est arrivé sur la place 7 à 800 hommes, la plupart en blouses, quelques étudiants bien vêtus ; de côté hors de la troupe, deux hommes en habit noir, la canne à la main, qui avaient l’air de diriger les mouvements. Au milieu un drapeau portant abolition de la peine de mort, et la pétition roulée autour du bâton. Le commissaire de police les a sommés de se retirer. Sur leur refus, un escadron de la garde municipale s’en avance au grand trot. La dispersion a été générale et soudaine. Un garde municipal a poussé son cheval sur l'homme qui portait le drapeau, l’a pris, l’a jeté sur la croupe de son cheval et l'a ramené au corps de garde de la Chambre, au milieu des hourras de la garde nationale qui voulait le jeter à la rivière. C’est un pauvre ouvrier tailleur, de mine très timide, et qui semblait se croire au moins mort en entrant dans le corps de garde. Nous avons continué notre budget, et je suis parti à 4 heures et demie pour aller dîner à Châtenay. En en revenant, à 10 heures et demie, j’ai traversé tout Paris parfaitement tranquille.
Je n’entends rien dire ce matin. Châtenay était charmant, l’air doux, les arbres, touffus, les gazons frais. Je me suis donné le triste plaisir, bien plaisir et bien triste de refaire seul notre promenade dans le jardin, mêmes alliés, même pas. Ah, que ne peut-on fixer sa vie à un moment de son choix !
Onze heures
Votre N°213 me désespère. Je vous répète, je me répète à moi-même ce que je vous écris tous les jours. Je ne puis pas décider pour vous. J’en suis, dans l’anxiété la plus douloureuse. Je voudrais avoir un avis, une volonté ; je voudrais vous décharger de tout ce qui vous agite et vous pèse, embarras, indécision, solitude. Je retrouve ce que je connais trop bien, cet horrible sentiment d’impuissance contre les choses, les faits tout le monde extérieur, au moment même où la tendresse la plus infinie, la plus souveraine, remplit l'âme et se croirait toute puissante si elle n'écoutait qu'elle-même. Pardon, pardon de vous parler de ma tristesse à moi. De quoi vous parlerais-je ? Ma tristesse, c’est votre mal, c’est votre faiblesse, votre maigreur, votre abattement, votre ennui. Vous m’avez reproché quelquefois de me trop arrêter avec vous sur ce que vous souffriez, et de m'y associer au lieu de vous en distraire. Dearest, je ne puis pas me distraire de vous, encore moins de loin que de près, encore moins de votre santé que de vos chagrins.
Comment, votre médecin vous engage à quitter Baden, ne fût-ce que pour quelques jours ? Je ne comprends pas cela. Je comprendrais qu'il vous en renvoyât. Après tout, je ne sais vous dire qu’une chose. Faites ce dont vous aurez envie. Ne consultez que votre envie et votre force. Allez où elles vous diront, où elles vous mèneront. Ici le beau temps revient, le chaud, le soleil. Est-ce qu'il ne revient pas aussi à Baden ? et ne vous fait-il aucun bien ? Vous avez eu des nouvelles de Pétersbourg puisque vous savez qu’on fera Paul conseiller d'Etat. N’y a-t-il rien sur vos affaires ? J’ai reçu hier une lettre de M. de Barante, sans intérêt. Que je voudrais mettre dans les miennes de quoi remplir votre journée ! Je vous écrirais volontiers des volumes.
J’ai passé auprès de vous tant d'heures de conversation charmante ; pleine des plus douces choses, des seules douces choses de ce monde, de tendresse et de liberté. Vous ne savez pas quelle vive, quelle inépuisable reconnaissance (quand ce ne serait que reconnaissance) me resterait éternellement dans le cœur envers vous pour de tels moments, pour un seul de ces moments. Le monde est si froid, et si faux ! et par dessus cela si médiocre si vulgaire ! L'âme y meurt de faim et de soif, et de dégoût. J’ai trouvé près de vous, en vous, ce que je n'attendais plus ce que je ne demandais plus. Je me suis senti si heureux près de vous, sans contrainte ni privation aucune, aucune, ni de cœur, ni d’esprit, ni de goût, ni de parole, satisfait, pleinement satisfait, plongé dans le sentiment le seul qui épanouisse toute l'âme point de désir parce qu’on a tout. Que de fois, en causant avec vous, au milieu des effusions de notre intimité, j’ai été tout à coup, et pour une seconde rappelé en moi-même par un de ces éclairs intérieurs qui illuminent tout notre bonheur tout notre plaisir ! Je ne vous ai jamais dit, je ne vous dirai jamais à quel point je vous trouve rare et charmante, ni combien je vis seul sans vous, ni ce que sera pour moi, le jour qui vous rendra à moi, fussiez-vous cent fois plus maigre et plus abattue que vous ne me le dites. Adieu. Adieu.
Je ne puis vous parler d'autre chose. Quand j'ai reçu, quand j'ai relu votre lettre, j'attends celle du lendemain. Ne vous fatiguez pas à m’écrire ; mais ne me laissez pas sans nouvelles. Adieu. G.
216. Baden, Dimanche 14 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
216 Baden le 14 juillet 1839, dimanche 1 heure
Que je vous dis peu en vous écrivant tous les jours, & que de choses j’aurais à vous dire ! Que de choses à répondre à votre lettre de jeudi. Et je le pourrai si j’avais un peu plus de force. Mais vous ne savez pas comme il m’en coûte d'écrire. Comme cela me fatigue ! J’ai passé une mauvaise nuit, je ne vaux rien aujourd’hui, je ne sais que vous dire. J'ai été à l'église je n’y manque jamais. Mad. de Talleyrand ne vous écrit pas probablement parce qu’elle n'a rien de bon à vous dire sur mon compte. Je la vois extrêmement peu. Elle vient tous les deux jours passer avec moi un quart d’heure, voilà tout. C'est à près pour moi comme si elle n’était pas à Baden. Le matin je vois Mad. de Nesselrode assez longtemps. Nous nous rencontrons dans l’allée et nous y restons assises pendant une heure ou plus même. Je vais quelques fois chez elle en rentrant de ma promenade le soir. Je viens quelque fois Mad. Wellesley en calèche. J’y mène aussi Mad. de la Redorte. Le reste du temps. Je me promène avec Marie et la petite Ellice. De une à 2 heures, M. de Malzaden ou quelque autre diplomate vient chez moi me conter les nouvelles. M. de Malzaden a de l'esprit.
Aujourd’hui nous épousons M. de Leuchtenberg, je ne cesse pas d’en être choquée. Vous ai-je dit que Matonchewitz est nommé pour Stockolm, dans son audience de congé l’Empereur lui a rendu ses bonnes grâces, cela me prouve qu’il n’est pas implacable. M. de la Redorte me dit que Thiers retourne à Paris avant la fin du mois. Il me dit aussi ce que vous m’aviez mandé qu'il s’était séparé du roi en très bons termes. Il ajoute que le Roi pense à remanier le ministère. Vous à l’intérieur, Thiers, les affaires étrangères. Le Maréchal la guerre. Que tout cela pourrait se faire bientôt. Y croyez-vous ?
5 heures
Voici votre lettre. Je ne veux pas que vous soyez inquiet. Je ne me porte pas bien, quelques fois je me sens bien mal, et Je vous le dis. Mais c’est une imagination. J’ai l’estomac abîmé, je ne mange pas. Je dors peu et mal, je maigris, tout cela est exact, mais cela ne me fera pas encore mourir. Je suis très impatiente du jugement des Pairs. Je vois dans un journal qu'on chante la Varsovienne dans la rue Rivoli. Cela ne me plaît pas du tout Adieu. Adieu à demain, car vous voulez tous les jours mes pauvres lettres. Dites-moi des nouvelles. Ce pauvre Pozzo, il me parait qu’il restera à Paris. Adieu dearest.
Que je vous dis peu en vous écrivant tous les jours, & que de choses j’aurais à vous dire ! Que de choses à répondre à votre lettre de jeudi. Et je le pourrai si j’avais un peu plus de force. Mais vous ne savez pas comme il m’en coûte d'écrire. Comme cela me fatigue ! J’ai passé une mauvaise nuit, je ne vaux rien aujourd’hui, je ne sais que vous dire. J'ai été à l'église je n’y manque jamais. Mad. de Talleyrand ne vous écrit pas probablement parce qu’elle n'a rien de bon à vous dire sur mon compte. Je la vois extrêmement peu. Elle vient tous les deux jours passer avec moi un quart d’heure, voilà tout. C'est à près pour moi comme si elle n’était pas à Baden. Le matin je vois Mad. de Nesselrode assez longtemps. Nous nous rencontrons dans l’allée et nous y restons assises pendant une heure ou plus même. Je vais quelques fois chez elle en rentrant de ma promenade le soir. Je viens quelque fois Mad. Wellesley en calèche. J’y mène aussi Mad. de la Redorte. Le reste du temps. Je me promène avec Marie et la petite Ellice. De une à 2 heures, M. de Malzaden ou quelque autre diplomate vient chez moi me conter les nouvelles. M. de Malzaden a de l'esprit.
Aujourd’hui nous épousons M. de Leuchtenberg, je ne cesse pas d’en être choquée. Vous ai-je dit que Matonchewitz est nommé pour Stockolm, dans son audience de congé l’Empereur lui a rendu ses bonnes grâces, cela me prouve qu’il n’est pas implacable. M. de la Redorte me dit que Thiers retourne à Paris avant la fin du mois. Il me dit aussi ce que vous m’aviez mandé qu'il s’était séparé du roi en très bons termes. Il ajoute que le Roi pense à remanier le ministère. Vous à l’intérieur, Thiers, les affaires étrangères. Le Maréchal la guerre. Que tout cela pourrait se faire bientôt. Y croyez-vous ?
5 heures
Voici votre lettre. Je ne veux pas que vous soyez inquiet. Je ne me porte pas bien, quelques fois je me sens bien mal, et Je vous le dis. Mais c’est une imagination. J’ai l’estomac abîmé, je ne mange pas. Je dors peu et mal, je maigris, tout cela est exact, mais cela ne me fera pas encore mourir. Je suis très impatiente du jugement des Pairs. Je vois dans un journal qu'on chante la Varsovienne dans la rue Rivoli. Cela ne me plaît pas du tout Adieu. Adieu à demain, car vous voulez tous les jours mes pauvres lettres. Dites-moi des nouvelles. Ce pauvre Pozzo, il me parait qu’il restera à Paris. Adieu dearest.
218. Paris, Dimanche 14 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
218 Paris, dimanche soir 9 heures 14 juillet 1839
Vous vous couchez probablement. Que je voudrais vous envoyer le sommeil, ce sommeil qui fait qu’on se lève le lendemain rafraîchi et fortifié ! La chaleur est accablante ce soir. Encore quelque orage. Cet état de l’atmosphère, n'est-il pas pour quelque chose dans votre extrême malaise ? Tout le monde s'en ressent. On ne craint plus d’émeute pour ce soir. La commutation de peine de Barbès préoccupe beaucoup. On s’y attendait peu. C'est le Roi qui l'a voulue. Le Conseil n’était pas divisé quoiqu'il y ait des indécis. Je voudrais vous raconter quelque chose d’intéressant. Il n’y a rien.
Ce matin, au moment où je sortais pour aller voir Pozzo, le Ministre de l’intérieur est arrivé chez moi et m'a retenu. Je ne puis donc vous rien dire de cette pauvre Lady Flora Hastings. On est convaincu ici que le Cabinet Whig tiendra. Pozzo n’est pas atteint du même mal que vous. Il se tue à force de manger. Le soir après dîner, il a l’esprit bien moins libre que le matin, ses méprises sur les personnes sont continuelles et bien étranges. Il a pris l'autre jour le Maréchal Soult pour M. de Villète.
Lundi matin, 8 heures
Je retourne Jeudi au Val-Richer. Nous finissons à la Chambre ces jours-ci. Adressez-moi donc désormais vos lettres au Val-Richer. Et dites-moi ce que vous aimez le mieux pour notre correspondance tous les jours, où tous les deux jours. Je n'aurai pas au Val-Richer autant de Nouvelles qu'à Paris. Mais j’aime à vous écrire, et encore plus vos lettres. Pauvre ressource pourtant que des lettres ! Vous m’avez grondé une fois de dire cela, et de rabaisser ainsi votre seul plaisir. Et puis, vous avez été de mon avis. Je sais supporter ce qui ne me suffit pas, mais non m'y tromper. Sachez bien seulement, dearest, que pour apporter à vos souffrances quelque distraction, pour jeter un doux moment dans votre solitude, je vous écrirai tous les jours, deux fois par jour, tant que vous voudrez et qu’il se pourra. Et toujours avec un triste plaisir, car c’est bien triste de faire si peu pour qui on aime beaucoup.
Avez-vous vu deux volumes que le comte Appony vient de m'envoyer ? Cezriflan von Gontz c’est un recueil de ses pamphlets politiques. J'en ai parcouru quelques uns qui m’ont intéressé. C'est l’histoire que nous avons vue, et faite. Elle a assez grand air sur le papier. La sœur de Barbès est allée déclarer au Garde des sceaux que cette commutation ne lui convenait pas, et qu'il ne voulait pas des travaux forcés. On le fait partir ce matin. Je doute qu’on l’envoie droit aux galères. Il s’arrêtera dans quelque prison sur la route. Je suis de son avis. Il n'est pas fait pour les galères.
Midi
Votre mot 214 ne me déplaît pas. Il est assez ferme dans sa petite taille. Je n’avais jamais entendu parler de la racine de gingembre. Le monde que j'ai vu ce matin ne m’a rien appris. Je vous quitte pour aller faire ma toilette et de là à la Chambre. Adieu ! J’irai ce soir chez Madame Appony et chez Lady Granville. Mais on n'apprend pas grand chose là. Ils attendent plus qu’ils ne donnent. Adieu. Adieu. G.
Vous vous couchez probablement. Que je voudrais vous envoyer le sommeil, ce sommeil qui fait qu’on se lève le lendemain rafraîchi et fortifié ! La chaleur est accablante ce soir. Encore quelque orage. Cet état de l’atmosphère, n'est-il pas pour quelque chose dans votre extrême malaise ? Tout le monde s'en ressent. On ne craint plus d’émeute pour ce soir. La commutation de peine de Barbès préoccupe beaucoup. On s’y attendait peu. C'est le Roi qui l'a voulue. Le Conseil n’était pas divisé quoiqu'il y ait des indécis. Je voudrais vous raconter quelque chose d’intéressant. Il n’y a rien.
Ce matin, au moment où je sortais pour aller voir Pozzo, le Ministre de l’intérieur est arrivé chez moi et m'a retenu. Je ne puis donc vous rien dire de cette pauvre Lady Flora Hastings. On est convaincu ici que le Cabinet Whig tiendra. Pozzo n’est pas atteint du même mal que vous. Il se tue à force de manger. Le soir après dîner, il a l’esprit bien moins libre que le matin, ses méprises sur les personnes sont continuelles et bien étranges. Il a pris l'autre jour le Maréchal Soult pour M. de Villète.
Lundi matin, 8 heures
Je retourne Jeudi au Val-Richer. Nous finissons à la Chambre ces jours-ci. Adressez-moi donc désormais vos lettres au Val-Richer. Et dites-moi ce que vous aimez le mieux pour notre correspondance tous les jours, où tous les deux jours. Je n'aurai pas au Val-Richer autant de Nouvelles qu'à Paris. Mais j’aime à vous écrire, et encore plus vos lettres. Pauvre ressource pourtant que des lettres ! Vous m’avez grondé une fois de dire cela, et de rabaisser ainsi votre seul plaisir. Et puis, vous avez été de mon avis. Je sais supporter ce qui ne me suffit pas, mais non m'y tromper. Sachez bien seulement, dearest, que pour apporter à vos souffrances quelque distraction, pour jeter un doux moment dans votre solitude, je vous écrirai tous les jours, deux fois par jour, tant que vous voudrez et qu’il se pourra. Et toujours avec un triste plaisir, car c’est bien triste de faire si peu pour qui on aime beaucoup.
Avez-vous vu deux volumes que le comte Appony vient de m'envoyer ? Cezriflan von Gontz c’est un recueil de ses pamphlets politiques. J'en ai parcouru quelques uns qui m’ont intéressé. C'est l’histoire que nous avons vue, et faite. Elle a assez grand air sur le papier. La sœur de Barbès est allée déclarer au Garde des sceaux que cette commutation ne lui convenait pas, et qu'il ne voulait pas des travaux forcés. On le fait partir ce matin. Je doute qu’on l’envoie droit aux galères. Il s’arrêtera dans quelque prison sur la route. Je suis de son avis. Il n'est pas fait pour les galères.
Midi
Votre mot 214 ne me déplaît pas. Il est assez ferme dans sa petite taille. Je n’avais jamais entendu parler de la racine de gingembre. Le monde que j'ai vu ce matin ne m’a rien appris. Je vous quitte pour aller faire ma toilette et de là à la Chambre. Adieu ! J’irai ce soir chez Madame Appony et chez Lady Granville. Mais on n'apprend pas grand chose là. Ils attendent plus qu’ils ne donnent. Adieu. Adieu. G.
217. Baden, Lundi 15 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
217 Baden lundi le 15 juillet 1839, 2 heures
Le télégraphe nous a annoncé hier la condamnation de Barbès, et un peu de tumulte auprès de la Chambre des députés. Je suis impatiente de votre lettre tantôt ; ne vous occupez pas de me parler de ma santé parlez moi de la santé de Paris. Je suis un peu mieux aujourd'hui, et enfin j’ai pu écrire quelques lettres, car depuis assez de temps ce n’est qu’à vous que j’ai écrit. Cela me fatigue la tête. Le temps est à l'orage et j'en suis accablée. J’ai un peu dormi, et même j'ai un peu mangé, ce qui est bien nouveau.
9 heures
J’ai eu une longue visite d'un diplomate qui m’a montré les plus fraîches nouvelles de Constantinople du 28 juin. Le sultan n’avait plus que quelques jours à vivre. La guerre est engagée. J'ai lu tous les récits. Metternich compte sur des conférences. Moi j'en doute encore.
5 heures Voici votre lettre, vous me dites ce que je vous disais tout à l’heure. Je suis curieuse d’apprendre si Petersbourg voudra ce que veut le Prince Metternich vraiment, vraiment je suis mieux aujourd'hui vous savez que je vous dis toujours la vérité. Je regrette même de vous la dire trop ; car vous avez eu de tristes lettres. Tout mon mal vient de ce que j’ai écouté le médecin. Le lait d'ânesse m'a abîmé l'estomac, les bains m’ont affaiblie. Il ne me faut à moi jamais de remèdes. Mais ma vie réglée & l’esprit tranquille. Quand j’aurai cela j'irai mieux. Mais quand ? Voici un gros orage un temps bien lourd. Ecrivez-moi beaucoup, beaucoup. Qu’est-ce que dit Paris de la condamnation de Barbès ? Adieu. Adieu mille fois, adieu.
Le télégraphe nous a annoncé hier la condamnation de Barbès, et un peu de tumulte auprès de la Chambre des députés. Je suis impatiente de votre lettre tantôt ; ne vous occupez pas de me parler de ma santé parlez moi de la santé de Paris. Je suis un peu mieux aujourd'hui, et enfin j’ai pu écrire quelques lettres, car depuis assez de temps ce n’est qu’à vous que j’ai écrit. Cela me fatigue la tête. Le temps est à l'orage et j'en suis accablée. J’ai un peu dormi, et même j'ai un peu mangé, ce qui est bien nouveau.
9 heures
J’ai eu une longue visite d'un diplomate qui m’a montré les plus fraîches nouvelles de Constantinople du 28 juin. Le sultan n’avait plus que quelques jours à vivre. La guerre est engagée. J'ai lu tous les récits. Metternich compte sur des conférences. Moi j'en doute encore.
5 heures Voici votre lettre, vous me dites ce que je vous disais tout à l’heure. Je suis curieuse d’apprendre si Petersbourg voudra ce que veut le Prince Metternich vraiment, vraiment je suis mieux aujourd'hui vous savez que je vous dis toujours la vérité. Je regrette même de vous la dire trop ; car vous avez eu de tristes lettres. Tout mon mal vient de ce que j’ai écouté le médecin. Le lait d'ânesse m'a abîmé l'estomac, les bains m’ont affaiblie. Il ne me faut à moi jamais de remèdes. Mais ma vie réglée & l’esprit tranquille. Quand j’aurai cela j'irai mieux. Mais quand ? Voici un gros orage un temps bien lourd. Ecrivez-moi beaucoup, beaucoup. Qu’est-ce que dit Paris de la condamnation de Barbès ? Adieu. Adieu mille fois, adieu.
219. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
219 Paris, mardi 16 Juillet 1839. Midi.
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
218. Baden, Mardi 16 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
218 Baden Mardi le 16 juillet 1839, 10 heures
Je vous disais hier que le temps était à l’orage. Une heure après un gros nuage noir est descendu sur Bade mais plus particulièrement sur la salle de conversation qui touche à la maison que j'habite. La foudre est tombé dessus, le paratonnerre a écarté le danger mais tout le monde qui était à table dans ce moment a senti le choc électrique, deux dames sont tombées par terre de frayeur. J'étais à la fenêtre, relisant votre lettre. Le coup a été si fort qu'il m’a fait sauter & votre lettre m’est tombée de la main. Je n'ai jamais été si près de la foudre que hier. La nuit a été orageuse aussi & nous n’avons pas fini aujourd'hui.
Voilà donc le Sultan mort, je l’ai appris hier au soir. Le courrier venu de Constantinople traversait Bade le 15 ème jour. C'est vite. Tout peut arriver un bien comme un mal. C’est un moment curieux, mais ce qui m’étonnerait le plus serait que nous prissions part à une conférence à moins qu’elle ne se bornât à établir les nouveaux rapports entre les deux chefs barbares.
5 heures
Je viens de recevoir votre lettre, je viens aussi de recevoir un gros volume de mon frère, avec tout l’arrange ment de me fortune. Je vous manderai demain le détail. Il me parait qu’il n’est pas content de mes fils. La loi rien que la loi, comme elle m’accorde à peu près ce que j’ai à présent, je ne me plains pas, mais je ne suis pas bien orientée encore je vous dirai cela plus exactement demain. Adieu. Adieu. Adieu. J'étais mieux ce matin je ne me sens pas si bien dans ce moment. God bless you.
Je vous disais hier que le temps était à l’orage. Une heure après un gros nuage noir est descendu sur Bade mais plus particulièrement sur la salle de conversation qui touche à la maison que j'habite. La foudre est tombé dessus, le paratonnerre a écarté le danger mais tout le monde qui était à table dans ce moment a senti le choc électrique, deux dames sont tombées par terre de frayeur. J'étais à la fenêtre, relisant votre lettre. Le coup a été si fort qu'il m’a fait sauter & votre lettre m’est tombée de la main. Je n'ai jamais été si près de la foudre que hier. La nuit a été orageuse aussi & nous n’avons pas fini aujourd'hui.
Voilà donc le Sultan mort, je l’ai appris hier au soir. Le courrier venu de Constantinople traversait Bade le 15 ème jour. C'est vite. Tout peut arriver un bien comme un mal. C’est un moment curieux, mais ce qui m’étonnerait le plus serait que nous prissions part à une conférence à moins qu’elle ne se bornât à établir les nouveaux rapports entre les deux chefs barbares.
5 heures
Je viens de recevoir votre lettre, je viens aussi de recevoir un gros volume de mon frère, avec tout l’arrange ment de me fortune. Je vous manderai demain le détail. Il me parait qu’il n’est pas content de mes fils. La loi rien que la loi, comme elle m’accorde à peu près ce que j’ai à présent, je ne me plains pas, mais je ne suis pas bien orientée encore je vous dirai cela plus exactement demain. Adieu. Adieu. Adieu. J'étais mieux ce matin je ne me sens pas si bien dans ce moment. God bless you.
220. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
220 Mardi soir 10 heures-17 Juillet 1839
Je ne trouve sous ma main ce soir que ce ridicule petit papier. Il me plait pourtant. C'est comme si je vous écrivais à la Terrasse. Je viens de dîner à côté d’elle (la Terrasse) chez le Ministre des finances, avec la Sardaigne, la Prusse et la Belgique qui sont maintenant fort bien ensemble. On dit que sur la frontière, les commissaires belges et hollandais s'accablent de politesses. Le Roi Léopold (vous dites comme moi à présent) j’arrive ici vendredi. Le Duc d'Orléans part le 5 août avec sa femme pour Bordeaux, Bayonne et les Pyrénées. Elle l'accompagnera jusqu'à Port-Vendres, en il s'embarquera pour Alger, de là à Constantine et partout où nous sommes en Afrique.
Madame la Duchesse d'Orléans reviendra à Paris avec Monsieur le duc de Nemours. La cour va ces jours-ci s’établir à St Cloud. Nous sommes assez fiers de notre empire en Orient. Les deux aides de camp du Maréchal ont emporté l’un d'Alexandrie, l’autre de Constantinople, des ordres, l'un pour Ibrahimn, l'autre pour Hafiz Pacha, leur enjoignant de s'arrêter partout où ils seraient, selon le vœu de l’Europe exprimé par la France. Nos deux messagers se seront rejoints la Syrie. M. le Ministre de la guerre m'a développé cela à table en prêtant son accent Allemand à notre vanité Gasconne. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Adieu. A demain.
Mercredi, midi
Je regrette bien qu’écrire vous fatigue. Ecrire, c’est tout ce qui nous reste pour cet été. Ne voyez là que ce que j'y mets, un regret, pas du tout un reproche. Je ne crois pas bientôt, aux arrangements dont M. de la Redorte vous a parlé. Le Roi ne songe point à remanier son Cabinet. Personne ni, probablement rien ne l'y obligera d’ici à la session. Donc tout restera. Mais le décri est grand. Lady Sandwich que la Reine vient de prendre pour dame d’honneur, est-ce la nôtre ? Pozzo parle mal de Lady Normanby et d’une ou deux autres des Dames, qui entourent la Reine. Elles lui font, et lui feront, dit-il beaucoup de tort.
J’ai vu Zéa ce matin et son frère Colombie. Il passe encore quelques jours à Paris. Il est assez content de ses nouvelles d’Espagne. Pour lui personnellement, elles sont meilleures qu’avant son voyage en Angleterre. Rumigny lui convient fort. Ils ont passé quatre ans ensemble à Dresde. Je ne m'étonne pas de l’insignifiance des lettres qui vous viennent de Pétersbourg. Je ne m'en étonne pas, le genre admis ; car en soi, tout cela est plus qu'étonnant. A l’ouvrage de l'abbé de La Mennais, j'en ajouterais volontiers un autre : de l'indifférence en matière d'affection. Que j’y dirais de choses. Je mourrai gros de vérités qui seront enfouies avec moi.
Vous savez surement que M. de Castillon est à Pétersbourg à l'heure qu’il est, & probablement sur le point d'en repartir pour Paris. Notre correspondance est très active, et vous paraissez très modérés, très conciliants. On croit en général que la mort du Sultan rendra une conférence Européenne moins urgente, et plus inévitable. La paix faite avec Méhémet Ali, tous les Pachas vont en vouloir autant. Avant un an, l'Empire Ottoman sera sans dessus dessous et il faudra bien y pourvoir. Réchid-Pacha repartira probablement pour Constantinople. On dit que c'est l'homme capable. Je l’ai trouvé homme d’esprit mais d’apparence bien chétive et timide. Je vous dis là bien des pauvretés. Je vous envoie le monde comme il est. J’en aimerais mieux un autre. Il est difficile à faire. Si vous étiez là, j'oublierais celui-ci. Adieu. Je vous écrirai encore demain de Paris et samedi du Val-Richer. Adieu. Adieu. G.
Je ne trouve sous ma main ce soir que ce ridicule petit papier. Il me plait pourtant. C'est comme si je vous écrivais à la Terrasse. Je viens de dîner à côté d’elle (la Terrasse) chez le Ministre des finances, avec la Sardaigne, la Prusse et la Belgique qui sont maintenant fort bien ensemble. On dit que sur la frontière, les commissaires belges et hollandais s'accablent de politesses. Le Roi Léopold (vous dites comme moi à présent) j’arrive ici vendredi. Le Duc d'Orléans part le 5 août avec sa femme pour Bordeaux, Bayonne et les Pyrénées. Elle l'accompagnera jusqu'à Port-Vendres, en il s'embarquera pour Alger, de là à Constantine et partout où nous sommes en Afrique.
Madame la Duchesse d'Orléans reviendra à Paris avec Monsieur le duc de Nemours. La cour va ces jours-ci s’établir à St Cloud. Nous sommes assez fiers de notre empire en Orient. Les deux aides de camp du Maréchal ont emporté l’un d'Alexandrie, l’autre de Constantinople, des ordres, l'un pour Ibrahimn, l'autre pour Hafiz Pacha, leur enjoignant de s'arrêter partout où ils seraient, selon le vœu de l’Europe exprimé par la France. Nos deux messagers se seront rejoints la Syrie. M. le Ministre de la guerre m'a développé cela à table en prêtant son accent Allemand à notre vanité Gasconne. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Adieu. A demain.
Mercredi, midi
Je regrette bien qu’écrire vous fatigue. Ecrire, c’est tout ce qui nous reste pour cet été. Ne voyez là que ce que j'y mets, un regret, pas du tout un reproche. Je ne crois pas bientôt, aux arrangements dont M. de la Redorte vous a parlé. Le Roi ne songe point à remanier son Cabinet. Personne ni, probablement rien ne l'y obligera d’ici à la session. Donc tout restera. Mais le décri est grand. Lady Sandwich que la Reine vient de prendre pour dame d’honneur, est-ce la nôtre ? Pozzo parle mal de Lady Normanby et d’une ou deux autres des Dames, qui entourent la Reine. Elles lui font, et lui feront, dit-il beaucoup de tort.
J’ai vu Zéa ce matin et son frère Colombie. Il passe encore quelques jours à Paris. Il est assez content de ses nouvelles d’Espagne. Pour lui personnellement, elles sont meilleures qu’avant son voyage en Angleterre. Rumigny lui convient fort. Ils ont passé quatre ans ensemble à Dresde. Je ne m'étonne pas de l’insignifiance des lettres qui vous viennent de Pétersbourg. Je ne m'en étonne pas, le genre admis ; car en soi, tout cela est plus qu'étonnant. A l’ouvrage de l'abbé de La Mennais, j'en ajouterais volontiers un autre : de l'indifférence en matière d'affection. Que j’y dirais de choses. Je mourrai gros de vérités qui seront enfouies avec moi.
Vous savez surement que M. de Castillon est à Pétersbourg à l'heure qu’il est, & probablement sur le point d'en repartir pour Paris. Notre correspondance est très active, et vous paraissez très modérés, très conciliants. On croit en général que la mort du Sultan rendra une conférence Européenne moins urgente, et plus inévitable. La paix faite avec Méhémet Ali, tous les Pachas vont en vouloir autant. Avant un an, l'Empire Ottoman sera sans dessus dessous et il faudra bien y pourvoir. Réchid-Pacha repartira probablement pour Constantinople. On dit que c'est l'homme capable. Je l’ai trouvé homme d’esprit mais d’apparence bien chétive et timide. Je vous dis là bien des pauvretés. Je vous envoie le monde comme il est. J’en aimerais mieux un autre. Il est difficile à faire. Si vous étiez là, j'oublierais celui-ci. Adieu. Je vous écrirai encore demain de Paris et samedi du Val-Richer. Adieu. Adieu. G.
219. Baden, Mercredi 17 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
219 Baden le 17 juillet 1839
Vous n'avez qu’un mot, un seul mot, Lady Carlisle vient d’arriver ; elle passe ici la journée, elle est venue pour moi ; je ne puis pas la quitter un seul instant. J’aurais tant de choses à vous dire sur votre lettre d’hier si parfaite, si touchante, si bonne, si douce. Et puis j’ai à vous parler de mes affaires, à vous envoyer copie de tout cela, à vous demander conseil, et je ne puis rien vous dire aujourd’hui. C'est bien ennuyeux. Ce qui l'est bien plus encore c’est que la malle de Paris n’est pas arrivée, qu’elle ne viendra pas. On dit un accident en route. C’est bien suspect. Je crois plutôt quelques malheurs à Paris et je tremble.
Voici vite l’extrait du projet d’arrangement rouble argent 7ème part de Kostroma 2507 roubles argent
7ème part de Courlande 2261
3ème part de Lituanie 548
5316 rb ou 21000 francs
qui me seraient payés comme rente viagère garantie par mes fils mais sans hypothèques Pahlen me le conseille. De plus
1/4 d'arende de Courlande qui court encore 20 ans 1515
1/4 arende qui finit dans 3 ans 2500 rb
4015 ou 16000 francs
Le quart du Capital anglais qui serait je crois 25000 francs. Mon année de revenus de Courlande 15830 rb argent ou 62 000 francs. Il y aurait donc 37 000 francs de revenus et un capital de 312 000 francs. Voilà l'ensemble, cela me fera avec ce que j'ai aux environs de 75 000 francs. Cela est bien. Il n’y a que le droit rigoureusement le droit, et tant mieux. Je ne dois rien à personne. Adieu je suis bien fatiguée. Je suis bien inquiète, pas de malle de Paris c'est incroyable. Mon Dieu que je voudrai votre lettre. Qu’est-il arrivé ? Adieu. Adieu.
God bless and protect you.
Vous n'avez qu’un mot, un seul mot, Lady Carlisle vient d’arriver ; elle passe ici la journée, elle est venue pour moi ; je ne puis pas la quitter un seul instant. J’aurais tant de choses à vous dire sur votre lettre d’hier si parfaite, si touchante, si bonne, si douce. Et puis j’ai à vous parler de mes affaires, à vous envoyer copie de tout cela, à vous demander conseil, et je ne puis rien vous dire aujourd’hui. C'est bien ennuyeux. Ce qui l'est bien plus encore c’est que la malle de Paris n’est pas arrivée, qu’elle ne viendra pas. On dit un accident en route. C’est bien suspect. Je crois plutôt quelques malheurs à Paris et je tremble.
Voici vite l’extrait du projet d’arrangement rouble argent 7ème part de Kostroma 2507 roubles argent
7ème part de Courlande 2261
3ème part de Lituanie 548
5316 rb ou 21000 francs
qui me seraient payés comme rente viagère garantie par mes fils mais sans hypothèques Pahlen me le conseille. De plus
1/4 d'arende de Courlande qui court encore 20 ans 1515
1/4 arende qui finit dans 3 ans 2500 rb
4015 ou 16000 francs
Le quart du Capital anglais qui serait je crois 25000 francs. Mon année de revenus de Courlande 15830 rb argent ou 62 000 francs. Il y aurait donc 37 000 francs de revenus et un capital de 312 000 francs. Voilà l'ensemble, cela me fera avec ce que j'ai aux environs de 75 000 francs. Cela est bien. Il n’y a que le droit rigoureusement le droit, et tant mieux. Je ne dois rien à personne. Adieu je suis bien fatiguée. Je suis bien inquiète, pas de malle de Paris c'est incroyable. Mon Dieu que je voudrai votre lettre. Qu’est-il arrivé ? Adieu. Adieu.
God bless and protect you.
Mots-clés : Finances (Dorothée), Santé (Dorothée)
220. Baden, Jeudi 18 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
220 Baden jeudi le 18 juillet 1839, 2 heures
La poste de lundi de Paris n’est arrivé que tout à l'heure. C'est un accident arrivé à la voiture qui a causé ce retard. J'en ai été très alarmé. Mais voici votre lettre et je suis contente. Savez-vous que vos lettres sont bien prudentes. Vous me laissez beaucoup à deviner, et je ne connais au fond vos opinions sur rien. Ainsi pour parler du plus frais, trouvez-vous bon ou mauvais la commutation de la peine de Barbès ? Comment se porte le ministère ? Ces messieurs font-ils bon ménage ? Cela tiendra-t-il jusq'à la session ? Moi j’entends dire beaucoup que la gauche l'emporte, & que Thiers a des chances.
J'ai donné toute ma journée hier et ma matinée aujourd'hui à Lady Carlisle. C'est une bonne personne, un peu ennuyeuse. Elle vient de repartir. Sir John Couroy est arrivé à Bade. J’ai envie de le voir et de le faire parler, ce qui me réussit assez quand je veux. Voici ce que me dit mon frère : " Paul connait bien les lois. Il ne l’est occupé que de cela depuis son arrivée ici ; et parait très observateur des lois ! " " Voici la calcul de ce que la loi vous assigne. Cela a été discuté avec une précision scrupuleuse ! " Après avoir commenté les articles, mon frère trouvant que je suis riche, & que mes fils sont plus que riches, il poursuit : " Il serait inconvenant dans cette position de solliciter une pension du gouvernement. " Et me cite une grande dame dans ma situation qui l'a fait il y a quelques années et ajoute. " Cela a beaucoup déplu et elle a obtenu 10 000 rouble. Cette somme ne vous rendrait pas plus riche. " La question de déplaire ne me touche pas beaucoup, mais en effet je pense que je ne dirai plus un mot de cela, parce que cela m'ennuie. Ce n’est pas à moi à dire. Ces gens-là devraient faire ce qui est convenable sans que j’en parle. Il y a une chose que je regrette, c’est le plaisir de mettre dans l'embarras ou dans le tort. Voilà du mauvais cœur au fond la question n’est pas de savoir si j'ai besoin de cette pension ou non. Elle devait être donnée sans plus. Après cela savez-vous qu'il y a du plaisir à ne devoir rien à personne. J’aime mieux avoir à me venger d'une injustice. Il me semble que je vous parle un peu trop longuement de moi ; mais pour être franche j’ajouterai encore que j'ai hésité et que j'avais commencé une lettre à Orloff excessivement logique & bonne ; je l’ai laissée là. Mon frère fait des calculs très légers dans ce qu’il m'écrit et comme Pahlen part et que c'est mon frère qui va faire le reste, cela m’inquiète un peu. Ainsi il me parle de 400 mille francs da capital pour moi. Cela n'est pas possible. Ensuite il regarde comme éternels des revenus qui finissent dans 2 ans. Je serai obligée de relever tout cela, & de demander des explications, et puis on veut que je donne 355 paysans pour une rente de 9000 francs. Ils valent le double. Ensuite rien que la parole de mes fils comme garantie que la pension me serait payée. Ceci ne regarde que 21 000 fr par an, mais encore faudrait-il vérité. Enfin je prierai mon fière d’y faire attention et le style de sa lettre me prouve que cette observation ne l'étonnera pas. Mes fils auront à ce qu’ils me parait chacun 100 000 francs de rente. J'en suis bien aise. Ils n’ont pas besoin de moi, et de personne. Et cependant, s'ils avaient eu besoin de moi, j'aurais pu conserver des illusions ! Ah, tout est fini de ce côté !
Adieu, vous qui n'êtes pas une illusion, vous qui êtes ma seule vérité. Vérité que je chéris, que je désirais toute ma vie. Ecrivez-moi tous les jours. Vous allez être bien heureux au Val-Richer.
La poste de lundi de Paris n’est arrivé que tout à l'heure. C'est un accident arrivé à la voiture qui a causé ce retard. J'en ai été très alarmé. Mais voici votre lettre et je suis contente. Savez-vous que vos lettres sont bien prudentes. Vous me laissez beaucoup à deviner, et je ne connais au fond vos opinions sur rien. Ainsi pour parler du plus frais, trouvez-vous bon ou mauvais la commutation de la peine de Barbès ? Comment se porte le ministère ? Ces messieurs font-ils bon ménage ? Cela tiendra-t-il jusq'à la session ? Moi j’entends dire beaucoup que la gauche l'emporte, & que Thiers a des chances.
J'ai donné toute ma journée hier et ma matinée aujourd'hui à Lady Carlisle. C'est une bonne personne, un peu ennuyeuse. Elle vient de repartir. Sir John Couroy est arrivé à Bade. J’ai envie de le voir et de le faire parler, ce qui me réussit assez quand je veux. Voici ce que me dit mon frère : " Paul connait bien les lois. Il ne l’est occupé que de cela depuis son arrivée ici ; et parait très observateur des lois ! " " Voici la calcul de ce que la loi vous assigne. Cela a été discuté avec une précision scrupuleuse ! " Après avoir commenté les articles, mon frère trouvant que je suis riche, & que mes fils sont plus que riches, il poursuit : " Il serait inconvenant dans cette position de solliciter une pension du gouvernement. " Et me cite une grande dame dans ma situation qui l'a fait il y a quelques années et ajoute. " Cela a beaucoup déplu et elle a obtenu 10 000 rouble. Cette somme ne vous rendrait pas plus riche. " La question de déplaire ne me touche pas beaucoup, mais en effet je pense que je ne dirai plus un mot de cela, parce que cela m'ennuie. Ce n’est pas à moi à dire. Ces gens-là devraient faire ce qui est convenable sans que j’en parle. Il y a une chose que je regrette, c’est le plaisir de mettre dans l'embarras ou dans le tort. Voilà du mauvais cœur au fond la question n’est pas de savoir si j'ai besoin de cette pension ou non. Elle devait être donnée sans plus. Après cela savez-vous qu'il y a du plaisir à ne devoir rien à personne. J’aime mieux avoir à me venger d'une injustice. Il me semble que je vous parle un peu trop longuement de moi ; mais pour être franche j’ajouterai encore que j'ai hésité et que j'avais commencé une lettre à Orloff excessivement logique & bonne ; je l’ai laissée là. Mon frère fait des calculs très légers dans ce qu’il m'écrit et comme Pahlen part et que c'est mon frère qui va faire le reste, cela m’inquiète un peu. Ainsi il me parle de 400 mille francs da capital pour moi. Cela n'est pas possible. Ensuite il regarde comme éternels des revenus qui finissent dans 2 ans. Je serai obligée de relever tout cela, & de demander des explications, et puis on veut que je donne 355 paysans pour une rente de 9000 francs. Ils valent le double. Ensuite rien que la parole de mes fils comme garantie que la pension me serait payée. Ceci ne regarde que 21 000 fr par an, mais encore faudrait-il vérité. Enfin je prierai mon fière d’y faire attention et le style de sa lettre me prouve que cette observation ne l'étonnera pas. Mes fils auront à ce qu’ils me parait chacun 100 000 francs de rente. J'en suis bien aise. Ils n’ont pas besoin de moi, et de personne. Et cependant, s'ils avaient eu besoin de moi, j'aurais pu conserver des illusions ! Ah, tout est fini de ce côté !
Adieu, vous qui n'êtes pas une illusion, vous qui êtes ma seule vérité. Vérité que je chéris, que je désirais toute ma vie. Ecrivez-moi tous les jours. Vous allez être bien heureux au Val-Richer.
221. Baden, Vendredi 19 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
221 Baden, Vendredi le 19 juillet, 1839 4 heures
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
221. Paris, Mercredi 17 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
221. Paris, mercredi soir 9 heures-19 Juillet 1839
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
222. Val-Richer, Samedi 20 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
222 Du Val Richer, Samedi 20 Juillet 1839 9 heures
Je sors de mon lit. Je suis arrivé hier avec une grosse migraine. J’ai dormi stupidement et la migraine a disparu. Il fait très beau. Mes enfants sont ravis de me revoir. Mais je n’ai point de joies complètes sans vous, pas plus qu'avec vous. Voilà vos numéros 217 et 218. Je ne sais pourquoi je n’ai pas eu le premier avant-hier à Paris ! J’ai été deux jours sans lettres et point par votre faute. Outre le chagrin, il y a pour moi beaucoup d'étonnement quand un jour s’écoule sans que vous y ayez pris votre place. Je suis lente de dire comme Titus. Certainement, il n’aimait pas autant Bérénice. Ne soyez donc pas si près de la foudre. Je n'aime pas les dangers passés. Ils menacent.
Je suis charmé que vos arrangements de fortune soient conclus. J’attends le détail avec impatience ; mais je suis tranquille, puisque votre situation reste la même. J'en étais très, très préoccupé. Je ne me fie à personne chez vous et pour vous. Rien ne peut plus m'étonner de là, si ce n'est le bien. Que cette conclusion donne au moins à vos nerfs un peu de repos. Vous pourrez à présent régler d’une façon définitive le matériel de votre vie. Est-ce bien conclu ? Y a-t-il quelque chose de réglé pour le partage des meubles, tant ceux de Pétersbourg que le capital de Londres ? Tout sera-t-il bientôt effectivement exécuté ? Je vous demande là ce que vous me direz probablement demain. A demain aussi plusieurs petites choses que j’ai à vous dire. Le facteur me presse pour repartir.
Adieu. Adieu. Vous aurez été deux jours aussi sans lettres et celle-ci n'est rien. Continuez d’être mieux. Je vous le demande. Je vous en conjure et je vous l'ordonne. Adieu. Adieu. G.
Je sors de mon lit. Je suis arrivé hier avec une grosse migraine. J’ai dormi stupidement et la migraine a disparu. Il fait très beau. Mes enfants sont ravis de me revoir. Mais je n’ai point de joies complètes sans vous, pas plus qu'avec vous. Voilà vos numéros 217 et 218. Je ne sais pourquoi je n’ai pas eu le premier avant-hier à Paris ! J’ai été deux jours sans lettres et point par votre faute. Outre le chagrin, il y a pour moi beaucoup d'étonnement quand un jour s’écoule sans que vous y ayez pris votre place. Je suis lente de dire comme Titus. Certainement, il n’aimait pas autant Bérénice. Ne soyez donc pas si près de la foudre. Je n'aime pas les dangers passés. Ils menacent.
Je suis charmé que vos arrangements de fortune soient conclus. J’attends le détail avec impatience ; mais je suis tranquille, puisque votre situation reste la même. J'en étais très, très préoccupé. Je ne me fie à personne chez vous et pour vous. Rien ne peut plus m'étonner de là, si ce n'est le bien. Que cette conclusion donne au moins à vos nerfs un peu de repos. Vous pourrez à présent régler d’une façon définitive le matériel de votre vie. Est-ce bien conclu ? Y a-t-il quelque chose de réglé pour le partage des meubles, tant ceux de Pétersbourg que le capital de Londres ? Tout sera-t-il bientôt effectivement exécuté ? Je vous demande là ce que vous me direz probablement demain. A demain aussi plusieurs petites choses que j’ai à vous dire. Le facteur me presse pour repartir.
Adieu. Adieu. Vous aurez été deux jours aussi sans lettres et celle-ci n'est rien. Continuez d’être mieux. Je vous le demande. Je vous en conjure et je vous l'ordonne. Adieu. Adieu. G.
222. Baden, Samedi 20 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
222 Baden Samedi 20 juillet 1839, 3 heures
Une bien mauvaise nuit. Une bien mauvaise matinée, un mal de tête nerveux abominable, voilà de beaux éléments pour une lettre ! Celle qui m’est venue de vous hier est fort intéressante, je vous en remercie. Vraiment ici à Baden on est étonné de l’affaire Barbés, elle est peut être oubliée à Paris. Mais il me semble que l’effet n'y a pas été bon non plus, car les journaux ministériels se taisent, et les autres ont des articles abominables.
Dimanche 21 5 heures
Vous voyez que j'ai été bien peu capable d'écriture. J'ai souffert de maux de tête horribles. Je suis un peu mieux dans ce moment-ci. On me dit que cela tient au temps qui est à l'orage. C'est des bêtises. J'ai mal parce que je suis malade. J’ai reçu votre dernière lettre de Paris. Dites-moi pourquoi vous n’êtes pas retourné à Neuilly avant votre départ. Je vous remercie beaucoup d’avoir procuré la course du courrier à M. de Castillon.
Je sais de Berlin que la conférence de Vienne n’est pas aussi sûre que le dit M. de Metternich. Il est bien actif dans ce moment. Moi je le suis aussi on du moins j'essaye de l'être, demain j'envoie un gros volume à mon frère. J'aurais voulu vous consulter sur tout. J'ai eu ce matin une longue visite de Sir John Courey, il m’a tout raconté. Savez-vous qui est au fond de tout cela ? Léopold. Depuis l’année 35 il a brouillé la mère et la fille afin de gouverner celle-ci. L'instrument est Letzech. Il n’a réussi qu'à brouiller, mais non à gouverner.
Voyez quel griffonnage, il m’en coûte un peu d'écrire. Et quelle pauvre lettre ! Vous la recevrez bien mal. Il me semble qu’elle n’est là que pour faire acte d'existence. Vous n'en voulez que tous les deux jours vous avez raison, mes lettres sont trop bêtes. J'en ai reçu de Lord Grey ce matin. Il est très anti ministériel et parle des Chartistes avec le plus grand dédain. Il m’invite beaucoup à venir à Hewish, s’il était plus près J’irais. Adieu. Adieu. Que de choses j’ai à vous dire, à vous demander. Ah que nous sommes loin, & que le temps est long encore. Adieu mille fois et bien tendrement.
Une bien mauvaise nuit. Une bien mauvaise matinée, un mal de tête nerveux abominable, voilà de beaux éléments pour une lettre ! Celle qui m’est venue de vous hier est fort intéressante, je vous en remercie. Vraiment ici à Baden on est étonné de l’affaire Barbés, elle est peut être oubliée à Paris. Mais il me semble que l’effet n'y a pas été bon non plus, car les journaux ministériels se taisent, et les autres ont des articles abominables.
Dimanche 21 5 heures
Vous voyez que j'ai été bien peu capable d'écriture. J'ai souffert de maux de tête horribles. Je suis un peu mieux dans ce moment-ci. On me dit que cela tient au temps qui est à l'orage. C'est des bêtises. J'ai mal parce que je suis malade. J’ai reçu votre dernière lettre de Paris. Dites-moi pourquoi vous n’êtes pas retourné à Neuilly avant votre départ. Je vous remercie beaucoup d’avoir procuré la course du courrier à M. de Castillon.
Je sais de Berlin que la conférence de Vienne n’est pas aussi sûre que le dit M. de Metternich. Il est bien actif dans ce moment. Moi je le suis aussi on du moins j'essaye de l'être, demain j'envoie un gros volume à mon frère. J'aurais voulu vous consulter sur tout. J'ai eu ce matin une longue visite de Sir John Courey, il m’a tout raconté. Savez-vous qui est au fond de tout cela ? Léopold. Depuis l’année 35 il a brouillé la mère et la fille afin de gouverner celle-ci. L'instrument est Letzech. Il n’a réussi qu'à brouiller, mais non à gouverner.
Voyez quel griffonnage, il m’en coûte un peu d'écrire. Et quelle pauvre lettre ! Vous la recevrez bien mal. Il me semble qu’elle n’est là que pour faire acte d'existence. Vous n'en voulez que tous les deux jours vous avez raison, mes lettres sont trop bêtes. J'en ai reçu de Lord Grey ce matin. Il est très anti ministériel et parle des Chartistes avec le plus grand dédain. Il m’invite beaucoup à venir à Hewish, s’il était plus près J’irais. Adieu. Adieu. Que de choses j’ai à vous dire, à vous demander. Ah que nous sommes loin, & que le temps est long encore. Adieu mille fois et bien tendrement.
224. Val-Richer, Dimanche 21 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
224 Du Val-Richer, Dimanche 21 Juillet 1839 5 heures
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
223. Baden, Lundi 22 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
223 Baden le 22 Juillet lundi
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
225. Val-Richer, Lundi 22 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
225. Du Val Richer Lundi soir 22 Juillet 1839 7 heures et demie
Je laisse mon monde dans le jardin et je rentre, quoiqu'il fasse très beau. Le serein m’est décidément insupportable. J’ai éternué toute la nuit dernière.
Votre frère a été bien content quand il a vu que vous étiez riche comme il dit, et qu’il ne serait pas absolument obligé de braver pour vous l'humeur du maître. On fusille un pauvre diable qui a peur de l'ennemi, et lui tourne le dos. Il y a des peurs moins fondées qui ne coûtent pas si cher.
Je lisais tout à l'heure des lettres d’un spirituel républicain, M. Jefferson, qui range précisément, au nombre des immenses supériorités de la condition républicaine, celle-ci qu’un homme n'ait jamais peur d’un autre homme. Il se vante un peu ! Pourtant je comprends que la vue des embarras et des pusillanimités de cour donne aux républicains cet orgueil là. Vous voulez savoir mon avis sur la commutation de Barbés. Je trouve le fait bon en général et pour l'avenir du pays, pitoyable dans le moment et pour les personnes.
Vous savez ou vous ne savez pas que, sous la Restauration du milieu des conspirations et des condamnations, j’ai écrit contre l'emploi de la peine de mort en matière politique. Ce petit volume fort modéré et où il y a de belles pages, fit assez de bruit dans le temps et est resté populaire. Lorsque MM. de Lamartine, de Tracy, Arago, Dupont de l'Eure, George de Lafayette & sont allés faire une démarche, auprès du Garde des sceaux pour l'engager à empêcher l'exécution de Barbes, ils m'ont envoyé M. Dupont de l’Eure pour m'inviter à me joindre à eux. Je m'y suis refusé comme de raison, et j’ai prié M. Dupont de l’Eure de relire ce que j’avais écrit en 1821 : " Je viens de le relire moi-même, lui ai-je dit, et loin d'en rien désavouer, j'ai quelque fierté d'avoir écrit cela, il y a 18 ans, car je le pense encore aujourd'hui." Encore aujourd’hui, je désire l'abolition de la peine de mort dans les délits purement politiques. Je la voulais en 1835 quand j’ai fait poser en principe dans les lois de septembre, que les crimes politiques pourraient être punis de la détention dans un lieu de déportation, loin du territoire continental du Royaume. C’était là évidemment la peine qui devait remplacer, et par conséquent abolir la peine de mort. Le côté gauche n’en a pas voulu. Il a fait échouer cette loi là, savez-vous pourquoi ? Parce que ces messieurs, qui ne veulent pas de la peine de mort contre les crimes politiques ne veulent pas non plus d'aucune autre répression vraie, efficace. Point de répression, au fond voilà, leur désir. Et le gouvernement se trouve ainsi place entre la peine de mort et point de répression. Que voulez-vous qu’il fasse ? Pour moi, je désire l'abolition de la peine de mort pour ce genre de délits ; mais je veux à la place une peine réelle, efficace, qui intimide et réprime vraiment. Instituons-la ; je serai des vôtres. " M. Dupont de l’Eure, qui est au fond un homme honnête et sincère n’a su que me répondre, et nous nous sommes séparés bons amis. En voilà bien long ; mais vous voyez où j'en suis. Au fait, et je m'en félicite sans m'en vanter ceci est un pas immense vers l'abolition de la peine de mort en matière politique. Je ne sais comment on trouverait désormais pour l'appliquer, quelqu'un qui en eût fait plus que Barbés. Et quand on ne pourra plus l'appliquer, il faudra bien qu'on en vienne à instituer, une peine moins irréparable et pourtant efficace, car la société, à coup sûr ne consentira pas à rester sans défense contre les faiseurs de conspirations et d’insurrections, fanatiques, ou bandits. Mais en attendant, elle est réellement sans défense ; et les honnêtes gens s'en inquiètent ; et ils accusent de lâcheté le pouvoir qui les laisse sans défense ; et ils disent que c’est dans le seul intérêt de sa sûreté personnelle qu’il abandonne l’intérêt et la sûreté publique. Et de tout cela résulte un affaiblissement, un abaissement dont je ne m'alarme guère parce que j’ai confiance dans l'avenir, mais qui ont grand besoin que l'avenir arrive.
Mardi, 9 heures
Voilà l’armée Turque battue et dispersée. Si j'étais à Paris vous l'apprendriez par moi ; mais les journaux de ce matin vous en auront donné la nouvelle avant que j’arrive. Vous avez raison. Nous sommes plus loin, donc plus séparés. Je vous répète ce que je vous ai dit. Point de joie complète sans vous ; point avec vous. Je ne vous en aime pas moins. Adieu. Adieu. Les bains froids me préoccupent. G.
Je laisse mon monde dans le jardin et je rentre, quoiqu'il fasse très beau. Le serein m’est décidément insupportable. J’ai éternué toute la nuit dernière.
Votre frère a été bien content quand il a vu que vous étiez riche comme il dit, et qu’il ne serait pas absolument obligé de braver pour vous l'humeur du maître. On fusille un pauvre diable qui a peur de l'ennemi, et lui tourne le dos. Il y a des peurs moins fondées qui ne coûtent pas si cher.
Je lisais tout à l'heure des lettres d’un spirituel républicain, M. Jefferson, qui range précisément, au nombre des immenses supériorités de la condition républicaine, celle-ci qu’un homme n'ait jamais peur d’un autre homme. Il se vante un peu ! Pourtant je comprends que la vue des embarras et des pusillanimités de cour donne aux républicains cet orgueil là. Vous voulez savoir mon avis sur la commutation de Barbés. Je trouve le fait bon en général et pour l'avenir du pays, pitoyable dans le moment et pour les personnes.
Vous savez ou vous ne savez pas que, sous la Restauration du milieu des conspirations et des condamnations, j’ai écrit contre l'emploi de la peine de mort en matière politique. Ce petit volume fort modéré et où il y a de belles pages, fit assez de bruit dans le temps et est resté populaire. Lorsque MM. de Lamartine, de Tracy, Arago, Dupont de l'Eure, George de Lafayette & sont allés faire une démarche, auprès du Garde des sceaux pour l'engager à empêcher l'exécution de Barbes, ils m'ont envoyé M. Dupont de l’Eure pour m'inviter à me joindre à eux. Je m'y suis refusé comme de raison, et j’ai prié M. Dupont de l’Eure de relire ce que j’avais écrit en 1821 : " Je viens de le relire moi-même, lui ai-je dit, et loin d'en rien désavouer, j'ai quelque fierté d'avoir écrit cela, il y a 18 ans, car je le pense encore aujourd'hui." Encore aujourd’hui, je désire l'abolition de la peine de mort dans les délits purement politiques. Je la voulais en 1835 quand j’ai fait poser en principe dans les lois de septembre, que les crimes politiques pourraient être punis de la détention dans un lieu de déportation, loin du territoire continental du Royaume. C’était là évidemment la peine qui devait remplacer, et par conséquent abolir la peine de mort. Le côté gauche n’en a pas voulu. Il a fait échouer cette loi là, savez-vous pourquoi ? Parce que ces messieurs, qui ne veulent pas de la peine de mort contre les crimes politiques ne veulent pas non plus d'aucune autre répression vraie, efficace. Point de répression, au fond voilà, leur désir. Et le gouvernement se trouve ainsi place entre la peine de mort et point de répression. Que voulez-vous qu’il fasse ? Pour moi, je désire l'abolition de la peine de mort pour ce genre de délits ; mais je veux à la place une peine réelle, efficace, qui intimide et réprime vraiment. Instituons-la ; je serai des vôtres. " M. Dupont de l’Eure, qui est au fond un homme honnête et sincère n’a su que me répondre, et nous nous sommes séparés bons amis. En voilà bien long ; mais vous voyez où j'en suis. Au fait, et je m'en félicite sans m'en vanter ceci est un pas immense vers l'abolition de la peine de mort en matière politique. Je ne sais comment on trouverait désormais pour l'appliquer, quelqu'un qui en eût fait plus que Barbés. Et quand on ne pourra plus l'appliquer, il faudra bien qu'on en vienne à instituer, une peine moins irréparable et pourtant efficace, car la société, à coup sûr ne consentira pas à rester sans défense contre les faiseurs de conspirations et d’insurrections, fanatiques, ou bandits. Mais en attendant, elle est réellement sans défense ; et les honnêtes gens s'en inquiètent ; et ils accusent de lâcheté le pouvoir qui les laisse sans défense ; et ils disent que c’est dans le seul intérêt de sa sûreté personnelle qu’il abandonne l’intérêt et la sûreté publique. Et de tout cela résulte un affaiblissement, un abaissement dont je ne m'alarme guère parce que j’ai confiance dans l'avenir, mais qui ont grand besoin que l'avenir arrive.
Mardi, 9 heures
Voilà l’armée Turque battue et dispersée. Si j'étais à Paris vous l'apprendriez par moi ; mais les journaux de ce matin vous en auront donné la nouvelle avant que j’arrive. Vous avez raison. Nous sommes plus loin, donc plus séparés. Je vous répète ce que je vous ai dit. Point de joie complète sans vous ; point avec vous. Je ne vous en aime pas moins. Adieu. Adieu. Les bains froids me préoccupent. G.
Mots-clés : Politique, Politique (France), Vie domestique (Dorothée)
226. Val-Richer, Mardi 23 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
226 Du Val-Richer, Mardi 23 Juillet 1839 5 heures
Je viens d'avoir une minute très désagréable. Henriette s'est pincé le doigt dans une porte. Elle criait : " ouvrez-moi, ouvrez-moi !"" J’ai trouvé bien long le temps d’un saut jusqu'à la porte. Ce n’est rien. Elle en sera quitte pour une compresse d’extrait de Saturne pendant quelques heures ce que Madame de Talleyrand vous a fait mettre pour pareil accident. Je lui sais très bon gré de son courage (à Henriette) ; elle n’a pas pleuré du tout.
8 heures
J’ai été interrompu par un homme qui venait de Paris me demander quelques mots de recommandation pour M. Duchâtel. Je les lui ai données. Il a dîné. Il vient de repartir. Il aura fait 90 lieues pour une lettre qui, je crois, ne lui servira pas à grand chose. Je ne m'étonne pas que la conversation de M. Humann vous plaise. Il a assez d’esprit, et ce qu’il en a est bon et net, comme vous dites. Caractère peu élevé d'ailleurs, quoique grave et dont l’honnêteté naturelle a été singulièrement altérée par l’habitude, et le goût de gagner de l’argent. Vrai allemand, susceptible sans être fier ; sentimental et personnel et fort relâché dans la pratique quoique sans corruption. Je suis bien aise que vous l’ayez à Baden ; il vous distraira quelques fois.
La destruction de l'armée Turque préoccupe beaucoup le Cabinet. Non qu’il craigne les folies du vainqueur, tout indique qu'Ibrahim selon les ordres de Méhémet, se conduira, très sagement et attendra. Mais c’est un coup bien rude pour Constantinople ; et si comme on me le mande le Capitan Pacha fait défection avec sa flotte et passe à Méhémet, que deviendra, le jeune Sultan au milieu de ce tremblement de terre ? Les personnes pourraient bien, malgré leur retenue, être encore une fois lancées malgré elles dans de grandes choses. S'il est possible qu’il y ait de grandes choses pour ceux qui n'en veulent pas. Moi aussi je suis très préoccupé de ceci.Toucherions-nous déjà au moment où l’Europe sera remise en question ? Je ne crois pas. Je ne le souhaite pas. Je ne veux, à aucun prix, d'une nouvelle grande lutte révolutionnaire. Je crois que le bonheur de l’Europe des deux Europes, et ce qui me touche bien plus, son honneur, son état moral en seraient profondément altérés, et pour longtemps. Mais s'il se pouvait que les questions fussent grandes, et point révolutionnaires, et que devenues inévitables, elles contraignissent la politique à grandir aussi, ce serait bien heureux, et j'en serais bien heureux. Nous verrons.
Mercredi 24 9 h 1/2
Je n’ai pas de lettres. Cette fois, j’en suis fâché mais non pas inquiet. J’ai peut-être tort. Nous vivons dans les ténèbres. Adieu. Adieu. Vous ne m’avez pas dit à quelle époque l’arrangement de vos affaires serait définitivement conclu et signé. Adieu.
Je viens d'avoir une minute très désagréable. Henriette s'est pincé le doigt dans une porte. Elle criait : " ouvrez-moi, ouvrez-moi !"" J’ai trouvé bien long le temps d’un saut jusqu'à la porte. Ce n’est rien. Elle en sera quitte pour une compresse d’extrait de Saturne pendant quelques heures ce que Madame de Talleyrand vous a fait mettre pour pareil accident. Je lui sais très bon gré de son courage (à Henriette) ; elle n’a pas pleuré du tout.
8 heures
J’ai été interrompu par un homme qui venait de Paris me demander quelques mots de recommandation pour M. Duchâtel. Je les lui ai données. Il a dîné. Il vient de repartir. Il aura fait 90 lieues pour une lettre qui, je crois, ne lui servira pas à grand chose. Je ne m'étonne pas que la conversation de M. Humann vous plaise. Il a assez d’esprit, et ce qu’il en a est bon et net, comme vous dites. Caractère peu élevé d'ailleurs, quoique grave et dont l’honnêteté naturelle a été singulièrement altérée par l’habitude, et le goût de gagner de l’argent. Vrai allemand, susceptible sans être fier ; sentimental et personnel et fort relâché dans la pratique quoique sans corruption. Je suis bien aise que vous l’ayez à Baden ; il vous distraira quelques fois.
La destruction de l'armée Turque préoccupe beaucoup le Cabinet. Non qu’il craigne les folies du vainqueur, tout indique qu'Ibrahim selon les ordres de Méhémet, se conduira, très sagement et attendra. Mais c’est un coup bien rude pour Constantinople ; et si comme on me le mande le Capitan Pacha fait défection avec sa flotte et passe à Méhémet, que deviendra, le jeune Sultan au milieu de ce tremblement de terre ? Les personnes pourraient bien, malgré leur retenue, être encore une fois lancées malgré elles dans de grandes choses. S'il est possible qu’il y ait de grandes choses pour ceux qui n'en veulent pas. Moi aussi je suis très préoccupé de ceci.Toucherions-nous déjà au moment où l’Europe sera remise en question ? Je ne crois pas. Je ne le souhaite pas. Je ne veux, à aucun prix, d'une nouvelle grande lutte révolutionnaire. Je crois que le bonheur de l’Europe des deux Europes, et ce qui me touche bien plus, son honneur, son état moral en seraient profondément altérés, et pour longtemps. Mais s'il se pouvait que les questions fussent grandes, et point révolutionnaires, et que devenues inévitables, elles contraignissent la politique à grandir aussi, ce serait bien heureux, et j'en serais bien heureux. Nous verrons.
Mercredi 24 9 h 1/2
Je n’ai pas de lettres. Cette fois, j’en suis fâché mais non pas inquiet. J’ai peut-être tort. Nous vivons dans les ténèbres. Adieu. Adieu. Vous ne m’avez pas dit à quelle époque l’arrangement de vos affaires serait définitivement conclu et signé. Adieu.
227. Val-Richer, Mercredi 24 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
227 Du Val-Richer, Mercredi 24 Juillet 1839, 5 heures
Je viens d’écrire à Madame de Talleyrand. Je trouve ridicule d’écrire à Baden et que ce ne soit pas à vous. Vous m'aviez promis un petit dessin de votre maison, de ce qui l'environne, de la vue. Est-ce qu’il n'y a pas à Baden un dessinateur ? J’aime les lieux honorés par les pas, éclairés par les yeux... Je ne continue pas avec La Fontaine. La suite ne vous va pas du tout. Mais ceci est vrai, et tendrement dit.
La session finit mal pour le Cabinet. L'affaire de Barbés lui a porté un rude coup, un coup analogue à celui que reçut le Cabinet du 22 février de la suppression de la revue de la garde nationale en juillet 1836. Presque personne ne croit qu'ils puissent gouverner jusqu'à la session prochaine. Moi, je suis convaincu que, sauf de grands incidents, ils iront jusques là, et qu'alors, le remplacement sera très difficile. Je persiste à croire qu'une seule combinaison est efficace. Je ne ferai jamais rien qui la rende impossible, mais j'attendrai qu'elle vienne me chercher. Elle rôde beaucoup autour de moi depuis six semaines, même ici. Je suis sûr que les ministres se regardent eux-mêmes comme très atteints. Deux seulement ont un peu gagné, M. Villemain comme orateur, M. Dufaure comme homme d’affaires et debater. Il me semble que je vous ai déjà dit tout cela. Mais vous vous plaignez que je ne vous parle pas du Cabinet. Savez-vous pourquoi on dit autour de vous que la gauche est en progrès ? Parce qu'on en a peur. Il y a longtemps que les peurs de l’Europe nous font ce mal là Je dis de votre Europe. La gauche lui semble irrésistible et elle se hâte toujours de prédire son triomphe. Ce n'est pas la gauche qui gagne du terrain, c’est la faiblesse universelle. La gauche s'affaiblit et se décolore comme le reste. Pas plus de gouvernement que d'opposition ; pas plus d’opposition que de gouvernement; voilà notre mal. S’il durait une nouvelle gauche apparaîtrait bientôt sur les ruines de l'ancienne, une vraie gauche révolutionnaire. Peut-être faut-il cela pour qu’un gouvernement reparaisse aussi. J’espère que non.
Jeudi 10 heures
Imaginez que tout à l'heure, quand le facteur m'a remis son paquet, j’y ai tout de suite cherché votre lettre. Point de lettre. Il y en avait dix au douze que j'ai jetées là avec une immense humeur. Puis j’ai cherché encore. Votre lettre s’était glissée dans un journal. Quand vous avez mal à la tête, essayez-vous d'aller vous asseoir en plein air, dans quelque coin bien tranquille, et de rester là immobile, les yeux fermés, loin de toute lumière et de tout bruit, & y dormir même ? Ce complet repos, dans un bain d’air a toujours été pour moi le seul remède aux maux de tête, dans un temps où j'en avais beaucoup.
Comment me demandez-vous pourquoi je n’ai pas été à Neuilly ? Vous n'avez donc pas vu dans les journaux, même officiels, que j’y ai été le samedi soir 20. Il est vrai que j'étais ici le vendredi matin 19. Apparemment quelqu'un y été pour moi. J’y serais allé sans l'affaire de Barbés. Je ne voulais pas m'en expliquer, et on m'en aurait certainement parlé. J'ai dit à deux personnes que je n'irais pas, et pourquoi. Elles l’ont sans doute redit et on m'a supplié. Savez-vous ce que fait le rédacteur du nouveau journal qu’on vous attribue, le Capitole ? Il fait auprès de la grille du bois de Vincennes, des discours en l’honneur d’Armand Carrel dont la statue a été inaugurée là hier matin. Il y est enseveli. Il y avait assez de monde, quoique fort paisible. Plusieurs discours ont été prononcés. On n’a remarqué que ceux de M. Arago et de M. Charles Durand, ce rédacteur.
Vendredi, 8 heures
Vous me dites que le chaud vous empêche de sortir. Nous avons froid, depuis mon retour ici. Je n’ai jamais vu si peu d’été. Il y a un grand et bel appartement à louer rue de Lille au coin de la rue de Bourgogne. La position est bonne ; mais pas de jardin. Et puis, cela ne me paraît pas gai. Plus, un joli petit hôtel nue Lascazes entre la rue Belle-Chasse et la place Belle-Chasse. Le Duc de Crussel l’occupait naguère. Un rez-de chaussée et deux étages, et un petit jardin, 5 à 6000 francs. Ceci serait mieux, quoiqu'un peu plus loin. Pour vous, la maison est gaie, la vue gaie, et vous seriez seule chez vous. Pour moi, c’est près de la Chambre. Voulez-vous que je le fasse visiter avec soin et que je vous en envoie la description détaillée ? C'est presque en face les derrières du jardin de l’hôtel Danson, où est M. de Stackelberg. Adieu. Quand nous occuperons-nous ensemble de l’arrangement de votre maison ? Adieu. Adieu. G.
Je viens d’écrire à Madame de Talleyrand. Je trouve ridicule d’écrire à Baden et que ce ne soit pas à vous. Vous m'aviez promis un petit dessin de votre maison, de ce qui l'environne, de la vue. Est-ce qu’il n'y a pas à Baden un dessinateur ? J’aime les lieux honorés par les pas, éclairés par les yeux... Je ne continue pas avec La Fontaine. La suite ne vous va pas du tout. Mais ceci est vrai, et tendrement dit.
La session finit mal pour le Cabinet. L'affaire de Barbés lui a porté un rude coup, un coup analogue à celui que reçut le Cabinet du 22 février de la suppression de la revue de la garde nationale en juillet 1836. Presque personne ne croit qu'ils puissent gouverner jusqu'à la session prochaine. Moi, je suis convaincu que, sauf de grands incidents, ils iront jusques là, et qu'alors, le remplacement sera très difficile. Je persiste à croire qu'une seule combinaison est efficace. Je ne ferai jamais rien qui la rende impossible, mais j'attendrai qu'elle vienne me chercher. Elle rôde beaucoup autour de moi depuis six semaines, même ici. Je suis sûr que les ministres se regardent eux-mêmes comme très atteints. Deux seulement ont un peu gagné, M. Villemain comme orateur, M. Dufaure comme homme d’affaires et debater. Il me semble que je vous ai déjà dit tout cela. Mais vous vous plaignez que je ne vous parle pas du Cabinet. Savez-vous pourquoi on dit autour de vous que la gauche est en progrès ? Parce qu'on en a peur. Il y a longtemps que les peurs de l’Europe nous font ce mal là Je dis de votre Europe. La gauche lui semble irrésistible et elle se hâte toujours de prédire son triomphe. Ce n'est pas la gauche qui gagne du terrain, c’est la faiblesse universelle. La gauche s'affaiblit et se décolore comme le reste. Pas plus de gouvernement que d'opposition ; pas plus d’opposition que de gouvernement; voilà notre mal. S’il durait une nouvelle gauche apparaîtrait bientôt sur les ruines de l'ancienne, une vraie gauche révolutionnaire. Peut-être faut-il cela pour qu’un gouvernement reparaisse aussi. J’espère que non.
Jeudi 10 heures
Imaginez que tout à l'heure, quand le facteur m'a remis son paquet, j’y ai tout de suite cherché votre lettre. Point de lettre. Il y en avait dix au douze que j'ai jetées là avec une immense humeur. Puis j’ai cherché encore. Votre lettre s’était glissée dans un journal. Quand vous avez mal à la tête, essayez-vous d'aller vous asseoir en plein air, dans quelque coin bien tranquille, et de rester là immobile, les yeux fermés, loin de toute lumière et de tout bruit, & y dormir même ? Ce complet repos, dans un bain d’air a toujours été pour moi le seul remède aux maux de tête, dans un temps où j'en avais beaucoup.
Comment me demandez-vous pourquoi je n’ai pas été à Neuilly ? Vous n'avez donc pas vu dans les journaux, même officiels, que j’y ai été le samedi soir 20. Il est vrai que j'étais ici le vendredi matin 19. Apparemment quelqu'un y été pour moi. J’y serais allé sans l'affaire de Barbés. Je ne voulais pas m'en expliquer, et on m'en aurait certainement parlé. J'ai dit à deux personnes que je n'irais pas, et pourquoi. Elles l’ont sans doute redit et on m'a supplié. Savez-vous ce que fait le rédacteur du nouveau journal qu’on vous attribue, le Capitole ? Il fait auprès de la grille du bois de Vincennes, des discours en l’honneur d’Armand Carrel dont la statue a été inaugurée là hier matin. Il y est enseveli. Il y avait assez de monde, quoique fort paisible. Plusieurs discours ont été prononcés. On n’a remarqué que ceux de M. Arago et de M. Charles Durand, ce rédacteur.
Vendredi, 8 heures
Vous me dites que le chaud vous empêche de sortir. Nous avons froid, depuis mon retour ici. Je n’ai jamais vu si peu d’été. Il y a un grand et bel appartement à louer rue de Lille au coin de la rue de Bourgogne. La position est bonne ; mais pas de jardin. Et puis, cela ne me paraît pas gai. Plus, un joli petit hôtel nue Lascazes entre la rue Belle-Chasse et la place Belle-Chasse. Le Duc de Crussel l’occupait naguère. Un rez-de chaussée et deux étages, et un petit jardin, 5 à 6000 francs. Ceci serait mieux, quoiqu'un peu plus loin. Pour vous, la maison est gaie, la vue gaie, et vous seriez seule chez vous. Pour moi, c’est près de la Chambre. Voulez-vous que je le fasse visiter avec soin et que je vous en envoie la description détaillée ? C'est presque en face les derrières du jardin de l’hôtel Danson, où est M. de Stackelberg. Adieu. Quand nous occuperons-nous ensemble de l’arrangement de votre maison ? Adieu. Adieu. G.
224. Baden, Jeudi 25 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
224 Baden le 25 juillet jeudi 1839 8h.
Voici encore votre N°222 vous m’avez envoyé vos lettres deux jours de suite comme je vous l’ai proposé ; et moi attendu que vous me redemandiez l’alternat je ne vous ai pas écrit avant hier. Il y a confusion dans le ménage, mais j’aime mieux ce que vous avez fait que ce que vous avez dit. Et peut-être me rendrez-vous ceci à l’inverse. Je vous écris par un orage effroyable. Il n’y a que cela à Bade. C'est insoutenable. Et je n’aime pas l'orage par dessus la solitude. J'ai cependant quelques petites distractions, mais bien petites. Le Prince Emile de Darmstadt, M. de Blittersdorff qui a de l'esprit et qui sait des nouvelles. Le prince de Montfort fils de Jérôme Bonaparte qui est bête ! Le comte Buol, très agréable. Le prince Emile regarde l’affaire du mariage comme décidée. Il m’a conté beaucoup de détails qui m'ont intéressés. Mon grand Duc était amoureux de l'Angleterre moins la petite Reine qu’il n’aime pas du tout, et il a raison.
Voici la Turquie en train de redevenir plus que jamais la grosse affaire de l'Europe. Outre la destruction de l’armée turque en Syrie, le Capitaine Pacha est parti avec sa flotte en dépit des ordres de Constantinople et attend à Rhodes comment les partis vont se dessiner en Turquie. c.a.d. qu'il donne à tous les autres Pachas l'exemple de l’indépendance. Dans cet état de choses la crise de l’Empire ottoman est imminente et nous ne tarderons pas à reparaître sur la scène. J'ai des lettres de Lady Cowper, de Lady Granville. J'ai peu de forces pour répondre. Je suis toujours fatiguée, sans jamais rien faire pour cela, car je marche fort peu. Mad. de Flahaut m’invite beaucoup à aller la trouver à Wisbade, elle y sera dans huit ou dix jours. Si Bade ne me plaît pas plus qu’il ne m’a plu jusqu'ici, il se peut que j'y aille. Et cependant je suis les déplacements. Tout est pour moi un effort.
5 heures. Voici votre lettre. Décidément tous les jours est une bonne invention et j'y reste pourvu que vous y restiez. Nous faisons un peu comme lorsqu'on marche ensemble. hors de mesure et que chacun de son côté cherche à la rattraper ? Je parie que maintenant vous allez être en défaut. Je me suis séparée de Malzahn aujourd'hui avec regret. Sans avoir beaucoup d'esprit, il en a et du jugement. Il connait bien les affaires. Cela me faisait une ressource. Il vaut mieux qu'Armin, vous l’aimeriez à Paris, et son extérieur est parfaitement bien. Il m’est venu aujourd'hui une nouvelle vieille connaissance le Prince Gustave de Muklembourg Schwerin oncle de la duchesse d’Orléans. C'est un ennuyeux, mais plein d’humilité et bon garçon je crois.
Je vous demande pardon de la mauvaise tournure de me première feuille. J'ai pris la feuille à rebours Il y a de grands commérages et de grands scandales à Bade. Et cette pauvre petite Madame Welleiley fort gentille et innocente petite femme est fort troublée d'un bien vilain article qui a paru dans les journaux Anglais sur son compte. Son mari n’a pas assez d’esprit pour traiter cela comme il convient, et je crains qu’il ne soit cause de plus de publicité qu’il n’est nécessaire. Les procès sont des bêtises.
Adieu Adieu. Voulez-vous avoir un mot de M. Royer Collard à propos de l’effet qu’a produit la commutation de la peine de Barbés " tout n’est pas perdu, quand la lâcheté révolte. " Je vous prie d'oublier que c’est moi qui vous ai dit cela. Adieu encore mille fois de tout mon cœur.
Voici encore votre N°222 vous m’avez envoyé vos lettres deux jours de suite comme je vous l’ai proposé ; et moi attendu que vous me redemandiez l’alternat je ne vous ai pas écrit avant hier. Il y a confusion dans le ménage, mais j’aime mieux ce que vous avez fait que ce que vous avez dit. Et peut-être me rendrez-vous ceci à l’inverse. Je vous écris par un orage effroyable. Il n’y a que cela à Bade. C'est insoutenable. Et je n’aime pas l'orage par dessus la solitude. J'ai cependant quelques petites distractions, mais bien petites. Le Prince Emile de Darmstadt, M. de Blittersdorff qui a de l'esprit et qui sait des nouvelles. Le prince de Montfort fils de Jérôme Bonaparte qui est bête ! Le comte Buol, très agréable. Le prince Emile regarde l’affaire du mariage comme décidée. Il m’a conté beaucoup de détails qui m'ont intéressés. Mon grand Duc était amoureux de l'Angleterre moins la petite Reine qu’il n’aime pas du tout, et il a raison.
Voici la Turquie en train de redevenir plus que jamais la grosse affaire de l'Europe. Outre la destruction de l’armée turque en Syrie, le Capitaine Pacha est parti avec sa flotte en dépit des ordres de Constantinople et attend à Rhodes comment les partis vont se dessiner en Turquie. c.a.d. qu'il donne à tous les autres Pachas l'exemple de l’indépendance. Dans cet état de choses la crise de l’Empire ottoman est imminente et nous ne tarderons pas à reparaître sur la scène. J'ai des lettres de Lady Cowper, de Lady Granville. J'ai peu de forces pour répondre. Je suis toujours fatiguée, sans jamais rien faire pour cela, car je marche fort peu. Mad. de Flahaut m’invite beaucoup à aller la trouver à Wisbade, elle y sera dans huit ou dix jours. Si Bade ne me plaît pas plus qu’il ne m’a plu jusqu'ici, il se peut que j'y aille. Et cependant je suis les déplacements. Tout est pour moi un effort.
5 heures. Voici votre lettre. Décidément tous les jours est une bonne invention et j'y reste pourvu que vous y restiez. Nous faisons un peu comme lorsqu'on marche ensemble. hors de mesure et que chacun de son côté cherche à la rattraper ? Je parie que maintenant vous allez être en défaut. Je me suis séparée de Malzahn aujourd'hui avec regret. Sans avoir beaucoup d'esprit, il en a et du jugement. Il connait bien les affaires. Cela me faisait une ressource. Il vaut mieux qu'Armin, vous l’aimeriez à Paris, et son extérieur est parfaitement bien. Il m’est venu aujourd'hui une nouvelle vieille connaissance le Prince Gustave de Muklembourg Schwerin oncle de la duchesse d’Orléans. C'est un ennuyeux, mais plein d’humilité et bon garçon je crois.
Je vous demande pardon de la mauvaise tournure de me première feuille. J'ai pris la feuille à rebours Il y a de grands commérages et de grands scandales à Bade. Et cette pauvre petite Madame Welleiley fort gentille et innocente petite femme est fort troublée d'un bien vilain article qui a paru dans les journaux Anglais sur son compte. Son mari n’a pas assez d’esprit pour traiter cela comme il convient, et je crains qu’il ne soit cause de plus de publicité qu’il n’est nécessaire. Les procès sont des bêtises.
Adieu Adieu. Voulez-vous avoir un mot de M. Royer Collard à propos de l’effet qu’a produit la commutation de la peine de Barbés " tout n’est pas perdu, quand la lâcheté révolte. " Je vous prie d'oublier que c’est moi qui vous ai dit cela. Adieu encore mille fois de tout mon cœur.
225. Baden, Vendredi 26 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
225. Baden Vendredi 26 juillet 1839 9 heures
J’ai eu une fort mauvaise nuit au fond je ne crois pas qu’il m'arrive de jamais bien dormir ou bien manger à Baden. Je ne sais pas pourquoi j’y reste et j ne sais comment je ferai pour en partir si ma faiblesse augmente. Ensuite l'ennui, la crainte de voyager seule. Car c’est à présent que je vais être bien seule, pas même Marie. Je n’ai aucun projet quelconque ; j’attends. Je vois couler le temps. Je n'ai jamais été si indécise, si flottante qu'aujourd'hui. La seule chose fixe est Paris plutôt ou plus tard c.a. d. Septembre ou Novembre et plutôt le premier.
J’ai trouvé un mot dans votre avant dernière lettre qui m’a fait battre le cœur. Vous avez songé à venir à Baden ! Un seul instant cette idée ou ce désir vous est venu. Et moi je me suis dit. S'il venait, s'il pouvait venir, pourquoi ne pourrait-il pas venir ? Pendant quelques jours je revenais à cela sans cesse. C’est peut être dans le même temps que vous y rêviez aussi. Rêve, rêve, rien que rêve pour tout ce qui est bonheur !
Je suis fâchée de vous avoir remis vos lettres. Il y en a que j'aimerais tant à relire. Celles où vous me parlez de votre foi en Dieu ; de votre foi à l'éternité. Celles où vous me dites que je reverrai ce que j’ai tant aimé ! Ah comme j'y pense, quelle douceur de penser à cela d’y croire. Dites-moi bien d’y croire.
Il a plu hier tout le jour. Cela ne m’a pas empêchée de faire ma promenade. M. de Malzahn est encore venu trois fois prendre congé de moi, j’ai cru que cela irait jusqu'à l’année prochaine. Enfin il est bien parti. C’est dommage, je pouvais causer avec lui.
2 heures
Le médecin a voulu absolument que je recommençasse des bains ; je m’y prête encore plutôt par ennui que par conviction des bains presque froids, ils me plaisent comme sensation, mais nous verrons s'ils me conviennent.
5 heures
Merci de votre lettre 225. Je la reçois dans cet instant. Je viens d'en recevoir une aussi de Pahlen l’ambassadeur. Mon frère lui a dit que j’aurais 90 milles francs de rente avec ce que j'ai d'abord il ne sait pas ce que j’ai et je voudrais bien voir comment il arrivera à cette somme. Savez-vous ce qu’est mon frère, un peu hâbleur. Est-ce un mot dont on ne sert ? et puis c'est un homme qui se débarrasse des questions en brodant. C’est égal. Ce n'est pas ce qu’il a dit à Pahlen mais ce sera ce que moi je vous ai dit 75 mille. Adieu. Adieu.
Je vais à ma promenade du soir. Je vous remercie de vos lettres, elles me font tant de plaisir. Vous voyez que les nouvelles de l’Orient sont plus tôt sues à Baden que chez vous. On a tiré le canon, illuminé à Alexandrie. On dit que Méhémet Ali demande la régence.
J’ai eu une fort mauvaise nuit au fond je ne crois pas qu’il m'arrive de jamais bien dormir ou bien manger à Baden. Je ne sais pas pourquoi j’y reste et j ne sais comment je ferai pour en partir si ma faiblesse augmente. Ensuite l'ennui, la crainte de voyager seule. Car c’est à présent que je vais être bien seule, pas même Marie. Je n’ai aucun projet quelconque ; j’attends. Je vois couler le temps. Je n'ai jamais été si indécise, si flottante qu'aujourd'hui. La seule chose fixe est Paris plutôt ou plus tard c.a. d. Septembre ou Novembre et plutôt le premier.
J’ai trouvé un mot dans votre avant dernière lettre qui m’a fait battre le cœur. Vous avez songé à venir à Baden ! Un seul instant cette idée ou ce désir vous est venu. Et moi je me suis dit. S'il venait, s'il pouvait venir, pourquoi ne pourrait-il pas venir ? Pendant quelques jours je revenais à cela sans cesse. C’est peut être dans le même temps que vous y rêviez aussi. Rêve, rêve, rien que rêve pour tout ce qui est bonheur !
Je suis fâchée de vous avoir remis vos lettres. Il y en a que j'aimerais tant à relire. Celles où vous me parlez de votre foi en Dieu ; de votre foi à l'éternité. Celles où vous me dites que je reverrai ce que j’ai tant aimé ! Ah comme j'y pense, quelle douceur de penser à cela d’y croire. Dites-moi bien d’y croire.
Il a plu hier tout le jour. Cela ne m’a pas empêchée de faire ma promenade. M. de Malzahn est encore venu trois fois prendre congé de moi, j’ai cru que cela irait jusqu'à l’année prochaine. Enfin il est bien parti. C’est dommage, je pouvais causer avec lui.
2 heures
Le médecin a voulu absolument que je recommençasse des bains ; je m’y prête encore plutôt par ennui que par conviction des bains presque froids, ils me plaisent comme sensation, mais nous verrons s'ils me conviennent.
5 heures
Merci de votre lettre 225. Je la reçois dans cet instant. Je viens d'en recevoir une aussi de Pahlen l’ambassadeur. Mon frère lui a dit que j’aurais 90 milles francs de rente avec ce que j'ai d'abord il ne sait pas ce que j’ai et je voudrais bien voir comment il arrivera à cette somme. Savez-vous ce qu’est mon frère, un peu hâbleur. Est-ce un mot dont on ne sert ? et puis c'est un homme qui se débarrasse des questions en brodant. C’est égal. Ce n'est pas ce qu’il a dit à Pahlen mais ce sera ce que moi je vous ai dit 75 mille. Adieu. Adieu.
Je vais à ma promenade du soir. Je vous remercie de vos lettres, elles me font tant de plaisir. Vous voyez que les nouvelles de l’Orient sont plus tôt sues à Baden que chez vous. On a tiré le canon, illuminé à Alexandrie. On dit que Méhémet Ali demande la régence.
228. Val-Richer, Samedi 27 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
228 Du Val-Richer, Samedi 27 Juillet 1839 8 heures
Je suis seul, très seul. Non pas seul comme vous, hélas ! Je suis entouré de gens qui m’aiment, qui s'occupent de moi, qui ont besoin de moi. Mes enfants sont bien gentils bien affectueux. Ma journée est très pleine de personnes et de choses. Mais moi, je vous le répète, moi, je suis très seul. Je suis seul quand je ne me donne pas tout entier. Je suis seul quand je ne trouve pas tout ce qui me plaît, quand je rencontre, non pas des défauts ; que m'importent les défauts ? Mais des lacunes, des impossibilités. On me dit et vous-même me dîtes que je suis orgueilleux. Je ne puis pas être heureux de haut en bas. Je ne puis pas aimer de haut en bas. Je veux que les yeux qui me charment soient là, devant moi, à la hauteur des miens ; et aussi les idées, les instincts, les goûts, les désirs, comme les yeux. Je veux admirer et me soucier qu’on m'admire. Que personne n'entende jamais, ne sache jamais ce que je vous dis là. Pour rien au monde, je ne voudrais affliger ou blesser une affection tendre, un dévouement vrai ; ils sont si rares, & on les mérite si peu quand on ne les rend pas tout entiers ! Je vous dis qu’avant le 15 juin, j'étais seul et m’y étais résigné, qu'aujourd'hui je suis seul et ne m'y résigne pas.
3 heures
Voilà bien du nouveau en Orient. Le protectorat Européen et le Protectorat Russe se disputaient Constantinople. Elle se place sous le protectorat égyptien. A la barbe des Chrétiens divisés, les Musulmans se rallient. Je suppose que cela déplaira beaucoup chez vous. C'est évidemment un tour de M. de Metternich et du Roi Louis- Philippe. Que dira l’Angleterre ? Elle déteste l’Egypte. Serait-ce tout bonnement un coup de tête du jeune Sultan, et de ses Conseillers qui auraient voulu trancher d’un seul coup & eux-mêmes toutes les questions ? Méhémet Ali Généralissime de l'Empire Turc ! Méhémet. Ali à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Si toute l’Europe s'en arrange, il n’y a plus d'affaires-là, pour quelque temps. Si elle ne s'en arrange pas, les grandes affaires commencent. Encore une fois, dites-moi qui a fait cela, M. de Metternich, les Turcs seuls, ou peut-être Méhemet lui-même, par son argent et ses amis à Constantinople. Je ne vois que votre Empereur qui ne puisse pas l'avoir fait. l’acceptera-t-il ?
Il m'est arrivé ce matin bien des nouvelles. Vous savez le dehors ; voici le dedans. Des conférences ont eu lieu ces jours derniers, entre les meneurs de la gauche, députés et journalistes sur la conduite à tenir d’ici à la prochaine session notamment sur la réforme électorale. M. Barrot y présidait. Voici ce qui s’y est passé. La proposition du suffrage universel a été écartée. Il en a été de même de l’élection à deux degrés quoiqu'elle ait été vivement soutenu par quelques personnes. De même aussi de la réunion de tous les électeurs de chaque département en un seul collège siégeant au chef lieu du département, et nommant ensemble tous ses députés.
On a adopté.
1° La suppression de tout cens d'éligibilité. Le premier venu pourra être député sans payer un sou d'impôt.
2° L'admission, comme électeurs de tous les citoyens qui sont admis à être jurés.
3° Une indemnité pour les députés, à raison de 20 francs par jour pendant les sessions.
4° Aucun collège électoral ne pourra être de moins de 600 électeurs, et on admettra pour compléter ce nombre, les citoyens les plus imposés après les électeurs légaux.
5° Les délégués des colonies et les membres de la maison du Roi ne pourront être députés.
6° Les fonctionnaires accusés de corruption dans les élections pourront être poursuivis par qui voudra, et devant les tribunaux ordinaires sans aucune autorisation du Conseil d'Etat.
7° Enfin, il a été question d’interdire à tout député non-fonctionnaire d'accepter une fonction quelconque pendant la durée de la législature même en donnant sa démission. Ceci n'a été ni adopté, ni rejeté. C'est là le thème que les journaux de la gauche vont broder dans l’intervalle des sessions. La personne qui me donne ces détails, venus de source, ajoute : " Je crois cette question de la réforme très importante, en ce qu’elle décidera selon moi, la question ministérielle. Le Ministère actuel n’est assez fort ni pour accepter, ni pour rejeter une réforme électorale. Parmi les amis des Ministres centre gauche quelques uns vont disant que la crise ministérielle va commencer, et que M. Passy, Teste et Dufaure sont déterminés à ne plus souffrir le Maréchal aux Affaires étrangères, et M. Cunin-Gridaine au Commerce. Ce sont là de belles paroles dont les ministres en question bercent leurs amis sans en penser un mot. "
Thiers sera à Paris dans les premiers jours d'août. Il dit beaucoup qu’il n’a d’engagement avec personne et qu’il est parfaitement libre dans ses mouvements. Le journal le Temps vient d'être acheté, dit-on, par M. de Conny, pour les Carlistes. La Presse reste entre les mains de M. Emile de Girardin et devient de plus en plus vive contre le Cabinet. Voilà un vrai Journal. Personne n'a acheté celui-là et il ne se donne qu'à vous.
Dimanche 9 heures
Je vois que les journaux ne donnent pas toutes les nouvelles d'Orient, et que vous ne comprendrez qu’à moitié ce que je vous en dis. La flotte turque est allée. Je mettre sous la protection de Méhémet. Le divan lui a écrit. Le Sultan l’a confirmé dans le gouvernement de l’Egypte et de la Syrie avec l’hérédité pour sa famille. Il l’a nommé Généralissime et soutien de l'Empire Ottoman, et l'a engagé à se rendre à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Il est probable que Méhémet ira, avec les deux flottes réunies. Voilà les faits qui du reste vous sont probablement déjà venus d'ailleurs. Ils ne sont pas officiellement connus, mais presque Certainement. Adieu. Adieu.
Je suis seul, très seul. Non pas seul comme vous, hélas ! Je suis entouré de gens qui m’aiment, qui s'occupent de moi, qui ont besoin de moi. Mes enfants sont bien gentils bien affectueux. Ma journée est très pleine de personnes et de choses. Mais moi, je vous le répète, moi, je suis très seul. Je suis seul quand je ne me donne pas tout entier. Je suis seul quand je ne trouve pas tout ce qui me plaît, quand je rencontre, non pas des défauts ; que m'importent les défauts ? Mais des lacunes, des impossibilités. On me dit et vous-même me dîtes que je suis orgueilleux. Je ne puis pas être heureux de haut en bas. Je ne puis pas aimer de haut en bas. Je veux que les yeux qui me charment soient là, devant moi, à la hauteur des miens ; et aussi les idées, les instincts, les goûts, les désirs, comme les yeux. Je veux admirer et me soucier qu’on m'admire. Que personne n'entende jamais, ne sache jamais ce que je vous dis là. Pour rien au monde, je ne voudrais affliger ou blesser une affection tendre, un dévouement vrai ; ils sont si rares, & on les mérite si peu quand on ne les rend pas tout entiers ! Je vous dis qu’avant le 15 juin, j'étais seul et m’y étais résigné, qu'aujourd'hui je suis seul et ne m'y résigne pas.
3 heures
Voilà bien du nouveau en Orient. Le protectorat Européen et le Protectorat Russe se disputaient Constantinople. Elle se place sous le protectorat égyptien. A la barbe des Chrétiens divisés, les Musulmans se rallient. Je suppose que cela déplaira beaucoup chez vous. C'est évidemment un tour de M. de Metternich et du Roi Louis- Philippe. Que dira l’Angleterre ? Elle déteste l’Egypte. Serait-ce tout bonnement un coup de tête du jeune Sultan, et de ses Conseillers qui auraient voulu trancher d’un seul coup & eux-mêmes toutes les questions ? Méhémet Ali Généralissime de l'Empire Turc ! Méhémet. Ali à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Si toute l’Europe s'en arrange, il n’y a plus d'affaires-là, pour quelque temps. Si elle ne s'en arrange pas, les grandes affaires commencent. Encore une fois, dites-moi qui a fait cela, M. de Metternich, les Turcs seuls, ou peut-être Méhemet lui-même, par son argent et ses amis à Constantinople. Je ne vois que votre Empereur qui ne puisse pas l'avoir fait. l’acceptera-t-il ?
Il m'est arrivé ce matin bien des nouvelles. Vous savez le dehors ; voici le dedans. Des conférences ont eu lieu ces jours derniers, entre les meneurs de la gauche, députés et journalistes sur la conduite à tenir d’ici à la prochaine session notamment sur la réforme électorale. M. Barrot y présidait. Voici ce qui s’y est passé. La proposition du suffrage universel a été écartée. Il en a été de même de l’élection à deux degrés quoiqu'elle ait été vivement soutenu par quelques personnes. De même aussi de la réunion de tous les électeurs de chaque département en un seul collège siégeant au chef lieu du département, et nommant ensemble tous ses députés.
On a adopté.
1° La suppression de tout cens d'éligibilité. Le premier venu pourra être député sans payer un sou d'impôt.
2° L'admission, comme électeurs de tous les citoyens qui sont admis à être jurés.
3° Une indemnité pour les députés, à raison de 20 francs par jour pendant les sessions.
4° Aucun collège électoral ne pourra être de moins de 600 électeurs, et on admettra pour compléter ce nombre, les citoyens les plus imposés après les électeurs légaux.
5° Les délégués des colonies et les membres de la maison du Roi ne pourront être députés.
6° Les fonctionnaires accusés de corruption dans les élections pourront être poursuivis par qui voudra, et devant les tribunaux ordinaires sans aucune autorisation du Conseil d'Etat.
7° Enfin, il a été question d’interdire à tout député non-fonctionnaire d'accepter une fonction quelconque pendant la durée de la législature même en donnant sa démission. Ceci n'a été ni adopté, ni rejeté. C'est là le thème que les journaux de la gauche vont broder dans l’intervalle des sessions. La personne qui me donne ces détails, venus de source, ajoute : " Je crois cette question de la réforme très importante, en ce qu’elle décidera selon moi, la question ministérielle. Le Ministère actuel n’est assez fort ni pour accepter, ni pour rejeter une réforme électorale. Parmi les amis des Ministres centre gauche quelques uns vont disant que la crise ministérielle va commencer, et que M. Passy, Teste et Dufaure sont déterminés à ne plus souffrir le Maréchal aux Affaires étrangères, et M. Cunin-Gridaine au Commerce. Ce sont là de belles paroles dont les ministres en question bercent leurs amis sans en penser un mot. "
Thiers sera à Paris dans les premiers jours d'août. Il dit beaucoup qu’il n’a d’engagement avec personne et qu’il est parfaitement libre dans ses mouvements. Le journal le Temps vient d'être acheté, dit-on, par M. de Conny, pour les Carlistes. La Presse reste entre les mains de M. Emile de Girardin et devient de plus en plus vive contre le Cabinet. Voilà un vrai Journal. Personne n'a acheté celui-là et il ne se donne qu'à vous.
Dimanche 9 heures
Je vois que les journaux ne donnent pas toutes les nouvelles d'Orient, et que vous ne comprendrez qu’à moitié ce que je vous en dis. La flotte turque est allée. Je mettre sous la protection de Méhémet. Le divan lui a écrit. Le Sultan l’a confirmé dans le gouvernement de l’Egypte et de la Syrie avec l’hérédité pour sa famille. Il l’a nommé Généralissime et soutien de l'Empire Ottoman, et l'a engagé à se rendre à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Il est probable que Méhémet ira, avec les deux flottes réunies. Voilà les faits qui du reste vous sont probablement déjà venus d'ailleurs. Ils ne sont pas officiellement connus, mais presque Certainement. Adieu. Adieu.
226. Baden, Samedi 27 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
226 Baden le 27 juillet 1839 9 heures
Je vous écris après une laide et triste promenade car il pleut ; et avant mon bain qui ne sera pas agréable non plus. Le médecin veut que je poursuive. J'obéirai encore jusqu'à ce que cela me rende malade. J’ai écrit à M. Démion et je viens d'écrire à M. de Pogenpohl au sujet de l’appartement qu'occupe le capitaine Jennisson. C'est sans contredit ce qui me conviendrait le mieux. Mais il faut savoir d’abord, s'il part ; et puis si ce n’est pas trop cher. Je ne veux pas donner au delà de 10 mille francs. Mes causeries politiques ont cessé depuis le départ de M. de Malzahn mais les journaux allemands me tiennent assez au courant de ce qui se passe, et le ministre de ce pays-ci M. de Blittersdorff vient me montrer les rapports qu'on lui fait de Vienne. Il a à Vienne un agent fort intelligent que je connais depuis bien longtemps le général Fittenborn partisan dans notre armée l’année 12 et les suivantes.
Le 10 on se flattait à Constantinople que l’armée Turque pourrait s'y rallier et empêcher les progrès d'Ibrahim. Mais on y savait la trahison patente du Capitan Pacha qui avait rallié la flotte égyptienne à Rhodes. Voilà le fait grave 5 heures. Il a plu toute la matinée et depuis mon bain j'ai eu une succession de visites.
Voici votre lettre. Vous me paraissez croire qu'Ibrahim, et le Capitan Pacha vont remuer le monde, c’est possible Mais je crois que la diplomatie fera les derniers efforts pour empêcher cela. Votre cabinet est bien faible pour une semblable crise. Ou pour agir s'il faut agir ! Nous saurons bientôt ce que va devenir l’Empire ottoman. Adieu. Adieu, vos lettres courtes ou longues me font toujours un grand plaisir, mon seul plaisir. Il y a quinze jours que je n’ai rien reçu de mon fils Alexandre. Je l’avais prié de me dire comment se porte Paul rien que cela, est-ce peut être là ce qui l’empêche de me répondre ? Adieu. Adieu mille fois.
Je vous écris après une laide et triste promenade car il pleut ; et avant mon bain qui ne sera pas agréable non plus. Le médecin veut que je poursuive. J'obéirai encore jusqu'à ce que cela me rende malade. J’ai écrit à M. Démion et je viens d'écrire à M. de Pogenpohl au sujet de l’appartement qu'occupe le capitaine Jennisson. C'est sans contredit ce qui me conviendrait le mieux. Mais il faut savoir d’abord, s'il part ; et puis si ce n’est pas trop cher. Je ne veux pas donner au delà de 10 mille francs. Mes causeries politiques ont cessé depuis le départ de M. de Malzahn mais les journaux allemands me tiennent assez au courant de ce qui se passe, et le ministre de ce pays-ci M. de Blittersdorff vient me montrer les rapports qu'on lui fait de Vienne. Il a à Vienne un agent fort intelligent que je connais depuis bien longtemps le général Fittenborn partisan dans notre armée l’année 12 et les suivantes.
Le 10 on se flattait à Constantinople que l’armée Turque pourrait s'y rallier et empêcher les progrès d'Ibrahim. Mais on y savait la trahison patente du Capitan Pacha qui avait rallié la flotte égyptienne à Rhodes. Voilà le fait grave 5 heures. Il a plu toute la matinée et depuis mon bain j'ai eu une succession de visites.
Voici votre lettre. Vous me paraissez croire qu'Ibrahim, et le Capitan Pacha vont remuer le monde, c’est possible Mais je crois que la diplomatie fera les derniers efforts pour empêcher cela. Votre cabinet est bien faible pour une semblable crise. Ou pour agir s'il faut agir ! Nous saurons bientôt ce que va devenir l’Empire ottoman. Adieu. Adieu, vos lettres courtes ou longues me font toujours un grand plaisir, mon seul plaisir. Il y a quinze jours que je n’ai rien reçu de mon fils Alexandre. Je l’avais prié de me dire comment se porte Paul rien que cela, est-ce peut être là ce qui l’empêche de me répondre ? Adieu. Adieu mille fois.
227. Baden, Dimanche 28 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
227 Baden le 24 juillet 1839 dimanche 8 heures
Lorsque nous sommes ensemble, je m'entretiens avec vous de toute chose, je vous dis tout. Par lettres c'est bien difficile. Tous les sujets me paraissent trop minces. Ma vie est bien monotone, les personnes avec lesquelles je vis sont bien insignifiantes ; que voulez-vous que je vous dise ? Je pense bien plus au moment où je ne serai plus à Bade qu'à celui où je m’y trouve. Savez-vous bien que nous avons encore à passer quatre mois sans nous voir ! Vous m'avez dit que vous en reviendriez que pour le mois de décembre à Paris ! Que c'est long ! Songez-vous bien à cela ?
2 heures
J’ai été à l’église comme je ne manque jamais de le faire le dimanche. Nous avons eu un superbe sermon, trop beau, car j'en suis revenue en larmes. Je viens de recevoir une lettre de F. Pahlen de Courlande. Ce n’est que là qu'il a reçu la lettre dans laquelle je lui mandais que mes fils en retenait ma pension. Il me dit qu’il est très fâché de l’avoir ignoré pendant qu'il se trouvait encore à Pétersbourg et qu'il ne doute pas que mon frère y aura une ordre. Mais mon frère n'a jamais répondu à ce que je lui en avais dit vous voyez comme tout se fait légèrement ! Pourvu que cela finisse une bonne fois. Nesselrode écrit à sa femme que mon frère lui a assuré que j’aurais 90 mille francs de rente. Ce drôle de frère Il tranche dans le grand. J’accepte volontiers ses 90 milles francs. Mais je serai curieuse de voir comment il s’y prendra pour me les faire toucher.
5 heures
Vous avez fait ce que je craignais. Je n’ai point de lettres aujourd’hui. Vous voyez bien que si je vous imitais vous n'en auriez pas non plus de moi. Mais je ne vous écris que pour vous dire que vous avez tort et que je ne vous imiterai pas. En attendant voilà un triste dimanche et une forte migraine par dessus cela. Ah que tout m’attriste et m'ennuie ! Je voudrais bien être à l’hiver. Adieu. Je n’ai vraiment pas un mot à vous dire, j’ai eu une lettre du Roi de Hanovre très insignifiante. Ses affaires vont mal à ce qu'on me dit, mais lui ne me le dit pas. Adieu.
Lorsque nous sommes ensemble, je m'entretiens avec vous de toute chose, je vous dis tout. Par lettres c'est bien difficile. Tous les sujets me paraissent trop minces. Ma vie est bien monotone, les personnes avec lesquelles je vis sont bien insignifiantes ; que voulez-vous que je vous dise ? Je pense bien plus au moment où je ne serai plus à Bade qu'à celui où je m’y trouve. Savez-vous bien que nous avons encore à passer quatre mois sans nous voir ! Vous m'avez dit que vous en reviendriez que pour le mois de décembre à Paris ! Que c'est long ! Songez-vous bien à cela ?
2 heures
J’ai été à l’église comme je ne manque jamais de le faire le dimanche. Nous avons eu un superbe sermon, trop beau, car j'en suis revenue en larmes. Je viens de recevoir une lettre de F. Pahlen de Courlande. Ce n’est que là qu'il a reçu la lettre dans laquelle je lui mandais que mes fils en retenait ma pension. Il me dit qu’il est très fâché de l’avoir ignoré pendant qu'il se trouvait encore à Pétersbourg et qu'il ne doute pas que mon frère y aura une ordre. Mais mon frère n'a jamais répondu à ce que je lui en avais dit vous voyez comme tout se fait légèrement ! Pourvu que cela finisse une bonne fois. Nesselrode écrit à sa femme que mon frère lui a assuré que j’aurais 90 mille francs de rente. Ce drôle de frère Il tranche dans le grand. J’accepte volontiers ses 90 milles francs. Mais je serai curieuse de voir comment il s’y prendra pour me les faire toucher.
5 heures
Vous avez fait ce que je craignais. Je n’ai point de lettres aujourd’hui. Vous voyez bien que si je vous imitais vous n'en auriez pas non plus de moi. Mais je ne vous écris que pour vous dire que vous avez tort et que je ne vous imiterai pas. En attendant voilà un triste dimanche et une forte migraine par dessus cela. Ah que tout m’attriste et m'ennuie ! Je voudrais bien être à l’hiver. Adieu. Je n’ai vraiment pas un mot à vous dire, j’ai eu une lettre du Roi de Hanovre très insignifiante. Ses affaires vont mal à ce qu'on me dit, mais lui ne me le dit pas. Adieu.
229. Val-Richer, Lundi 29 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
229 Du Val-Richer, Lundi 29 Juillet 1839 - 3 heures
Je rattraperai aisément la mesure, car l’air me plaît. Je voulais ménager votre force et vos yeux. Donnez m'en tout ce que vous voudrez. J’ai de quoi vous rendre. C'est, je crois le défenseur de l’archevêque Land qui a dit le premier qu'avec cent lapins blancs ou ne fait pas un cheval blanc. Avec cent lettres de Baden et du Val-Richer, on ne fait pas une conversation de la Terrasse. Mais j’aime mieux cent lettres que cinquante. Pourtant je ne redeviendrai quotidien qu’à partir de Jeudi 1er août.
Je mène demain mes deux filles à Caen, chez leur dentiste de province. Il faut leur ôter deux dents de lait que Brewster a voulu ajourner quand elles ont quitté Paris. Il y a un bon dentiste à Caen. J'en reviendrai après demain soir. Cette course me dérange ; mais je suis mère.
J’attends avec grande curiosité la confirmation des nouvelles d'Orient. On dit que le capitan Pacha est un homme à vous, qui avait beaucoup contribué au traité d'Unkiar-Skelessi et vous fut, aussitôt après, envoyé comme Ambassadeur. Les habiles soutiennent que tout cela n’est pas clair. Pour moi, je me suis décidément retranché les prophéties. Je veux voir.
Avez-vous entendu dire que le comte de Pahlen remplacerait Pozzo à Londres ? J’en serais fâché et pour vous et pour nous. A moins qu'on ne nous redonnât Pozzo mourant. Mais cela ne se peut guère. Votre pauvre ami de Hanovre commence à prendre peur. Il s’est chargé de plus qu’il ne peut porter. Ç'a toujours été un grand métier que celui de despote. De nos jours, il y faut Napoléon. Encore s’y est-il cassé le nez. Est-ce qu’il ne vous vient plus de lettres de là ? Du reste, il me semble qu’il vous parle toujours plus des Affaires d’autrui que des siennes. Il me semble que j'ai vu autrefois. M. de Malzahn à Paris, en 1820 et 1821. N’a-t-il pas été Ministre de Prusse à Munich, ou à Stuttgart ? Je le confonds peut-être avec un M. de Maltzen qui était aussi dans la diplomatie Prussienne ; homme d’esprit, un peu solennel.
L'humeur de la Chambre des Pairs porte ses petits fruits. On aurait voulu qu’elle fit sur le champ un second procès, pour en finir de ces gens du 12 mai, comme on en finit. Il n'y a pas du moyen. Les Pairs n’ont pas voulu en entendre parler. Leur commission d’instruction va en mettre en liberté tant qu’elle pourra, et ceux qui resteront attendront en prison que la Chambre ait un peu repris cœur aux procès. C'est encore un excellent instrument de gouvernement qu’on a bien vite usé. Les fêtes ont été on ne peut plus paisibles. Fort tièdes. Les hommes ne se réjouissent pas par commémoration. Il n'y a de solennité durable, en l’honneur d’un grand événement, que celles qui portent un caractère religieux. On ne puise un peu de durée que dans l'éternité. Notre temps a étrangement perdu l’intelligence de la durée et de ses conditions. Jamais les hommes n’ont vécu concentrés à ce point dans le présent. Petite vie, et qui fait toutes choses, à sa mesure. Et pourtant, il y a dans les idées, dans les sentiments, dans les institutions de notre temps, le germe de grandes choses très grandes. Mais pour que les grandes, choses viennent, il faut extirper les petites. On ne peut pas avoir de taillis sous les hautes futaies. Et de notre temps, les petites choses sont innombrables, petits intérêts, petits conforts, petits désirs, petit plaisirs. Il y a des facilités infinies pour dépenser sa vie et son âme en monnaie. C'est mon désespoir de voir de quoi on se contente aujourd'hui. Parmi vos raisons de me plaire, celle-ci m’a beaucoup touché, vous avez l’esprit et le cœur superbe. Cela coûte cher ; mais n’y ayez pas regret. Cela vaut encore davantage, n’est-ce pas ? Adieu pour aujourd’hui. Je vous dirai encore adieu demain avant de partir. J’oubliais de vous dire que Madane d'Haussonville est fort heureusement accouchée d’une fille. C'est ce qu'elle désirait. J’en suis charmé pour son père. Sa première couche avait été fort pénible et le tourmentait.
Mardi 9 heures 1/2
Bonjour et adieu. C'est la même chose, toujours la même et et toujours charmante. Je vous écrirai demain. Je ne vais à Caen que samedi. Encore adieu. G.
Je rattraperai aisément la mesure, car l’air me plaît. Je voulais ménager votre force et vos yeux. Donnez m'en tout ce que vous voudrez. J’ai de quoi vous rendre. C'est, je crois le défenseur de l’archevêque Land qui a dit le premier qu'avec cent lapins blancs ou ne fait pas un cheval blanc. Avec cent lettres de Baden et du Val-Richer, on ne fait pas une conversation de la Terrasse. Mais j’aime mieux cent lettres que cinquante. Pourtant je ne redeviendrai quotidien qu’à partir de Jeudi 1er août.
Je mène demain mes deux filles à Caen, chez leur dentiste de province. Il faut leur ôter deux dents de lait que Brewster a voulu ajourner quand elles ont quitté Paris. Il y a un bon dentiste à Caen. J'en reviendrai après demain soir. Cette course me dérange ; mais je suis mère.
J’attends avec grande curiosité la confirmation des nouvelles d'Orient. On dit que le capitan Pacha est un homme à vous, qui avait beaucoup contribué au traité d'Unkiar-Skelessi et vous fut, aussitôt après, envoyé comme Ambassadeur. Les habiles soutiennent que tout cela n’est pas clair. Pour moi, je me suis décidément retranché les prophéties. Je veux voir.
Avez-vous entendu dire que le comte de Pahlen remplacerait Pozzo à Londres ? J’en serais fâché et pour vous et pour nous. A moins qu'on ne nous redonnât Pozzo mourant. Mais cela ne se peut guère. Votre pauvre ami de Hanovre commence à prendre peur. Il s’est chargé de plus qu’il ne peut porter. Ç'a toujours été un grand métier que celui de despote. De nos jours, il y faut Napoléon. Encore s’y est-il cassé le nez. Est-ce qu’il ne vous vient plus de lettres de là ? Du reste, il me semble qu’il vous parle toujours plus des Affaires d’autrui que des siennes. Il me semble que j'ai vu autrefois. M. de Malzahn à Paris, en 1820 et 1821. N’a-t-il pas été Ministre de Prusse à Munich, ou à Stuttgart ? Je le confonds peut-être avec un M. de Maltzen qui était aussi dans la diplomatie Prussienne ; homme d’esprit, un peu solennel.
L'humeur de la Chambre des Pairs porte ses petits fruits. On aurait voulu qu’elle fit sur le champ un second procès, pour en finir de ces gens du 12 mai, comme on en finit. Il n'y a pas du moyen. Les Pairs n’ont pas voulu en entendre parler. Leur commission d’instruction va en mettre en liberté tant qu’elle pourra, et ceux qui resteront attendront en prison que la Chambre ait un peu repris cœur aux procès. C'est encore un excellent instrument de gouvernement qu’on a bien vite usé. Les fêtes ont été on ne peut plus paisibles. Fort tièdes. Les hommes ne se réjouissent pas par commémoration. Il n'y a de solennité durable, en l’honneur d’un grand événement, que celles qui portent un caractère religieux. On ne puise un peu de durée que dans l'éternité. Notre temps a étrangement perdu l’intelligence de la durée et de ses conditions. Jamais les hommes n’ont vécu concentrés à ce point dans le présent. Petite vie, et qui fait toutes choses, à sa mesure. Et pourtant, il y a dans les idées, dans les sentiments, dans les institutions de notre temps, le germe de grandes choses très grandes. Mais pour que les grandes, choses viennent, il faut extirper les petites. On ne peut pas avoir de taillis sous les hautes futaies. Et de notre temps, les petites choses sont innombrables, petits intérêts, petits conforts, petits désirs, petit plaisirs. Il y a des facilités infinies pour dépenser sa vie et son âme en monnaie. C'est mon désespoir de voir de quoi on se contente aujourd'hui. Parmi vos raisons de me plaire, celle-ci m’a beaucoup touché, vous avez l’esprit et le cœur superbe. Cela coûte cher ; mais n’y ayez pas regret. Cela vaut encore davantage, n’est-ce pas ? Adieu pour aujourd’hui. Je vous dirai encore adieu demain avant de partir. J’oubliais de vous dire que Madane d'Haussonville est fort heureusement accouchée d’une fille. C'est ce qu'elle désirait. J’en suis charmé pour son père. Sa première couche avait été fort pénible et le tourmentait.
Mardi 9 heures 1/2
Bonjour et adieu. C'est la même chose, toujours la même et et toujours charmante. Je vous écrirai demain. Je ne vais à Caen que samedi. Encore adieu. G.
228. Baden, Mardi 30 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
228 Baden 11 heures. Mardi 30 juillet 1839
Imaginez que c'est devant un notaire et deux témoins que je vous écris, et que c’est le seul moment que je trouve pour le faire.
9 heures.
Voyez, je n’en puis plus de fatigue. Pour un pauvre papier de 20 lignes, j’ai été tracassé tout hier et aujourd’hui. On me demande de nouveaux plein pouvoirs pour terminer. Mon frère m'écrit sur cela très simplement et très bien. Matonchewitz pas bien du tout. Il est comme disent les Anglais, lit by Paul. Celui qui parle à toujours l’avantage sur celui qui écrit. Cela m’a tracassée, et vous savez que je n’ai pas besoin de cela de plus. Mon fils Alexandre, une lettre insignifiante comme les autres. Mon frère me mande que mes fils sont pressés de finir et de reprendre leur service. j'imagine donc qu’aussi tôt l’arrivée de mon plein pouvoir tout sera arrangé. Je le saurai dans quatre semaines.
En attendant ma santé ne va pas mieux et ma correspondance avec vous bien mal. Il y a dans tout moi un découragement, une langueur que je ne puis pas vous décrire. Baden a été pour moi très mauvais et j’y reste je ne sais pourquoi ou plutôt je le sais, c’est que je ne sais où aller pour être mieux. Tout est mal pour moi. Il y a de ma faute sans doute et je me prends en grande aversion. Votre lettre hier m'a fait plaisir. Je n'ai rien à vous dire qui puisse vous intéresser. Vous voyez comme j’ai l’esprit occupé de désagréables affaires, c’est si aride, si vous étiez là pour m'aider ; me ranimer ah mon Dieu que je serais une autre personne. Adieu. Adieu et pardonnez-moi. Je suis si fatiguée, si abîmée. Adieu.
Imaginez que c'est devant un notaire et deux témoins que je vous écris, et que c’est le seul moment que je trouve pour le faire.
9 heures.
Voyez, je n’en puis plus de fatigue. Pour un pauvre papier de 20 lignes, j’ai été tracassé tout hier et aujourd’hui. On me demande de nouveaux plein pouvoirs pour terminer. Mon frère m'écrit sur cela très simplement et très bien. Matonchewitz pas bien du tout. Il est comme disent les Anglais, lit by Paul. Celui qui parle à toujours l’avantage sur celui qui écrit. Cela m’a tracassée, et vous savez que je n’ai pas besoin de cela de plus. Mon fils Alexandre, une lettre insignifiante comme les autres. Mon frère me mande que mes fils sont pressés de finir et de reprendre leur service. j'imagine donc qu’aussi tôt l’arrivée de mon plein pouvoir tout sera arrangé. Je le saurai dans quatre semaines.
En attendant ma santé ne va pas mieux et ma correspondance avec vous bien mal. Il y a dans tout moi un découragement, une langueur que je ne puis pas vous décrire. Baden a été pour moi très mauvais et j’y reste je ne sais pourquoi ou plutôt je le sais, c’est que je ne sais où aller pour être mieux. Tout est mal pour moi. Il y a de ma faute sans doute et je me prends en grande aversion. Votre lettre hier m'a fait plaisir. Je n'ai rien à vous dire qui puisse vous intéresser. Vous voyez comme j’ai l’esprit occupé de désagréables affaires, c’est si aride, si vous étiez là pour m'aider ; me ranimer ah mon Dieu que je serais une autre personne. Adieu. Adieu et pardonnez-moi. Je suis si fatiguée, si abîmée. Adieu.
230. Val-Richer, Mardi 30 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
230 Du Val-Richer, Mardi 30 Juillet 1839 2 heures
Je rentre d’une longue promenade avec mes enfants. J'ai découvert, à quelques minutes de la maison, un terrain presque inculte que je ne me connaissais pas dans une position charmante, à droite la vue de la maison dont on n'est séparé que par un ravin où coule une petite source, à gauche, une percée sur une vallée large et riante, en face et derrière de grandes bois en amphithéâtre. Je planterai là un petit bois. L’idée de cette plantation et votre idée me sont venues en même temps absolument en même temps ; je ne saurais dire qu’elle a été le première. Tout ce qui me plaît me fait penser à vous. Rien ne me plaît vraiment qu'avec vous.
Je voudrais que votre frère eût raison pour votre fortune. Je connais cette façon de se débarrasser de toute inquiétude sur le compte des gens en exagérant leurs avantages. Certainement on dit hableur. Quand vous aurez reçu de nouveaux détails sur vos arrangements, sur le partage des meubles sur l'époque où vous toucherez les capitaux, mettez-moi au courant. Je suis beaucoup plus tranquille que je ne l'étais. Je ne le suis pas encore assez pour mon plaisir.
Mes dernières nouvelles d'Orient restent un peu en suspens. Ce qu'on m’avait mandé me paraît plutôt commencé qu'accompli. Si Méhémet trouve moyen de donner satisfaction à l'Angleterre pour l'isthme de Suez, ses affaires seront bonnes. Mais il faut qu’il fasse cela. Je n’ai rien reçu le matin.
9 heures
Vous voulez revoir ce que vous avez aimé. Vous voulez y croire. Vous y croyez bien plus que vous ne pensez. Vous y croyez naturellement, spontanément, par instinct, c’est-à-dire par l'élan primitif et libre de votre âme. Vous croyez à bien plus qu'à la réunion dans l'avenir. Vous vous croyez en rapport avec eux encore à présent, toujours d’un monde à l'autre. Pourquoi les appelez-vous les priez-vous ? Pourquoi levez-vous les yeux, joignez-vous les mains vers eux. Feriez-vous tout cela, la moindre de ces choses-là si réellement, au fond de votre âme, vous les croyiez sourds, insensibles, tout-à-fait étrangers à vous, morts vraiment morts ? Nous portons en nous une foi obscure, mais invincible à une relation inconnue, mais réelle, avec les êtres chéris qui nous ont quittés. Ils ont des droits sur nous, nous avons des devoirs envers eux. En nous acquittant de ces devoirs, nous croyons satisfaire à quelqu'un. Si nous y manquions nous croirions avoir manqué à quelqu'un. A cette croyance se joint même le sentiment que les morts ne pouvant réclamer, ni se faire rendre eux-mêmes, ce qui leur est dû la dette n'en est pour nous que plus sacrée. Qu’est-ce à dire ? Les morts jouissent-ils ou souffrent-ils donc de ce que leur accordent ou leur refusent les vivants ? Je ne puis pas vous répondre. Je ne dois pas toutes de vous répondre. Comment l'être qui n’est plus de ce monde peut-il être encore affecté de ce qui s’y passe ? Quelle société peut l’unir encore à ceux qui y sont restés ? L'homme ne le conçoit pas, et dès qu’il le cherche, il s'égare. Cependant il y croit, et ne peut pas plus échapper à l’instinct de sa nature que dépasser les limites assignées à sa science. Et remarquez que cet instinct n'a point de prétentions scientifiques ; il se suffit à lui-même. Au moment où l'homme, obéissant à cette voix intérieure, s’acquitte envers les morts de quelque devoir pieux, aucune curiosité, aucun doute ne le préoccupe ; il n’a nul besoin de savoir quel est leur mode d'existence ou quel mode de communication est possible entre eux et lui. Il agit en vertu d’une foi irréfléchie dont il se contente, certain, sans s’inquiéter de la route ni du moyen, que son action a un objet, que ses sentiments iront à leur but. C’est seulement lorsque d’acteur l'homme devient spectateur, lors qu’il interroge sa nature au lieu de la suivre et s'examine au lieu de se croire c’est alors que s'élèvent en lui les doutes de l’esprit, les besoins de la science, et qu’il entreprend, pour devenir savant, de franchir des limites au delà desquelles ses croyances instinctives ne le portaient point. Regardez dans l'âme de cette femme, de cette fille qui vont auprès d’un tombeau, offrir à un mari, à un père, tant de marques de tendresse et de respect. Croient-elles savoir, sur son état depuis la mort, sur sa relation avec elles, ce que cherchent les philosophes ? Pas du tout. Les problèmes qu'agitent les philosophes n'existent pas pour elles ; si elles les voyaient, elles seraient, comme les philosophes, tourmentés du besoin et de l’impossibilité de les résoudre. Essayez de soulever ces problèmes dans leur pensée : demandez-leur comment elles se figurent que le parfum de ces fleurs qu'elles cultivent la fraîcheur de cet ombrage qu'elles entretiennent, vont charmer l'être à qui s'adressent leurs soins. Vous les verrez saisies de trouble ; vous n'en recevrez que des réponses timides, contradictoires. Peut-être même leurs paroles démentiront- elles leurs actes ; peut-être s'accuseront-elles de faiblesse et d’erreur avant votre intervention, elles ne croyaient pas en savoir davantage ; elles ignoraient ce qu'elles. ignorent ; mais elles ne le cherchaient point. Elles adhéraient fortement à une foi simple, naturelle ; et jouissaient de ses espérances, et agissaient selon ses inspirations, sans rien demander de plus. C'est le caractère de cette foi qu'elle n’a point de réponse aux doutes, point de solution des problèmes qu’élève la curiosité de l’esprit. Elle n’est point curieuse elle-même ; elle existe ; elle affirme les faits qu'elle entrevoit. Ne lui demandez pas de les démontrer, de les expliquer. Elle est invincible et sans aucune prétention. Ecoutez-la ; elle vous consolera ; ne l’interrogez pas, car elle ne se chargera point de vous instruire, sublime et modeste à la fois, elle révèle l'avenir et ne tente pas de le dévoiler.
Mercredi 10 h.
Ne manquez pas de me répondre sur le petit hôtel de la rue Belle-Chasse, qu’occupait M. de Crussot. Beaucoup de vos convenances m'y paraissent réunies. J’aimerais bien mieux l'entresol de la rue St Florentin. Mais je crains qu'on n'en veuille 12 mille francs. Adieu. Adieu. Pendant une semaine, vous n'aurez eu de lettre que tous les deux jours. Mais nous voilà, au même pas. Encore adieu. G.
Je rentre d’une longue promenade avec mes enfants. J'ai découvert, à quelques minutes de la maison, un terrain presque inculte que je ne me connaissais pas dans une position charmante, à droite la vue de la maison dont on n'est séparé que par un ravin où coule une petite source, à gauche, une percée sur une vallée large et riante, en face et derrière de grandes bois en amphithéâtre. Je planterai là un petit bois. L’idée de cette plantation et votre idée me sont venues en même temps absolument en même temps ; je ne saurais dire qu’elle a été le première. Tout ce qui me plaît me fait penser à vous. Rien ne me plaît vraiment qu'avec vous.
Je voudrais que votre frère eût raison pour votre fortune. Je connais cette façon de se débarrasser de toute inquiétude sur le compte des gens en exagérant leurs avantages. Certainement on dit hableur. Quand vous aurez reçu de nouveaux détails sur vos arrangements, sur le partage des meubles sur l'époque où vous toucherez les capitaux, mettez-moi au courant. Je suis beaucoup plus tranquille que je ne l'étais. Je ne le suis pas encore assez pour mon plaisir.
Mes dernières nouvelles d'Orient restent un peu en suspens. Ce qu'on m’avait mandé me paraît plutôt commencé qu'accompli. Si Méhémet trouve moyen de donner satisfaction à l'Angleterre pour l'isthme de Suez, ses affaires seront bonnes. Mais il faut qu’il fasse cela. Je n’ai rien reçu le matin.
9 heures
Vous voulez revoir ce que vous avez aimé. Vous voulez y croire. Vous y croyez bien plus que vous ne pensez. Vous y croyez naturellement, spontanément, par instinct, c’est-à-dire par l'élan primitif et libre de votre âme. Vous croyez à bien plus qu'à la réunion dans l'avenir. Vous vous croyez en rapport avec eux encore à présent, toujours d’un monde à l'autre. Pourquoi les appelez-vous les priez-vous ? Pourquoi levez-vous les yeux, joignez-vous les mains vers eux. Feriez-vous tout cela, la moindre de ces choses-là si réellement, au fond de votre âme, vous les croyiez sourds, insensibles, tout-à-fait étrangers à vous, morts vraiment morts ? Nous portons en nous une foi obscure, mais invincible à une relation inconnue, mais réelle, avec les êtres chéris qui nous ont quittés. Ils ont des droits sur nous, nous avons des devoirs envers eux. En nous acquittant de ces devoirs, nous croyons satisfaire à quelqu'un. Si nous y manquions nous croirions avoir manqué à quelqu'un. A cette croyance se joint même le sentiment que les morts ne pouvant réclamer, ni se faire rendre eux-mêmes, ce qui leur est dû la dette n'en est pour nous que plus sacrée. Qu’est-ce à dire ? Les morts jouissent-ils ou souffrent-ils donc de ce que leur accordent ou leur refusent les vivants ? Je ne puis pas vous répondre. Je ne dois pas toutes de vous répondre. Comment l'être qui n’est plus de ce monde peut-il être encore affecté de ce qui s’y passe ? Quelle société peut l’unir encore à ceux qui y sont restés ? L'homme ne le conçoit pas, et dès qu’il le cherche, il s'égare. Cependant il y croit, et ne peut pas plus échapper à l’instinct de sa nature que dépasser les limites assignées à sa science. Et remarquez que cet instinct n'a point de prétentions scientifiques ; il se suffit à lui-même. Au moment où l'homme, obéissant à cette voix intérieure, s’acquitte envers les morts de quelque devoir pieux, aucune curiosité, aucun doute ne le préoccupe ; il n’a nul besoin de savoir quel est leur mode d'existence ou quel mode de communication est possible entre eux et lui. Il agit en vertu d’une foi irréfléchie dont il se contente, certain, sans s’inquiéter de la route ni du moyen, que son action a un objet, que ses sentiments iront à leur but. C’est seulement lorsque d’acteur l'homme devient spectateur, lors qu’il interroge sa nature au lieu de la suivre et s'examine au lieu de se croire c’est alors que s'élèvent en lui les doutes de l’esprit, les besoins de la science, et qu’il entreprend, pour devenir savant, de franchir des limites au delà desquelles ses croyances instinctives ne le portaient point. Regardez dans l'âme de cette femme, de cette fille qui vont auprès d’un tombeau, offrir à un mari, à un père, tant de marques de tendresse et de respect. Croient-elles savoir, sur son état depuis la mort, sur sa relation avec elles, ce que cherchent les philosophes ? Pas du tout. Les problèmes qu'agitent les philosophes n'existent pas pour elles ; si elles les voyaient, elles seraient, comme les philosophes, tourmentés du besoin et de l’impossibilité de les résoudre. Essayez de soulever ces problèmes dans leur pensée : demandez-leur comment elles se figurent que le parfum de ces fleurs qu'elles cultivent la fraîcheur de cet ombrage qu'elles entretiennent, vont charmer l'être à qui s'adressent leurs soins. Vous les verrez saisies de trouble ; vous n'en recevrez que des réponses timides, contradictoires. Peut-être même leurs paroles démentiront- elles leurs actes ; peut-être s'accuseront-elles de faiblesse et d’erreur avant votre intervention, elles ne croyaient pas en savoir davantage ; elles ignoraient ce qu'elles. ignorent ; mais elles ne le cherchaient point. Elles adhéraient fortement à une foi simple, naturelle ; et jouissaient de ses espérances, et agissaient selon ses inspirations, sans rien demander de plus. C'est le caractère de cette foi qu'elle n’a point de réponse aux doutes, point de solution des problèmes qu’élève la curiosité de l’esprit. Elle n’est point curieuse elle-même ; elle existe ; elle affirme les faits qu'elle entrevoit. Ne lui demandez pas de les démontrer, de les expliquer. Elle est invincible et sans aucune prétention. Ecoutez-la ; elle vous consolera ; ne l’interrogez pas, car elle ne se chargera point de vous instruire, sublime et modeste à la fois, elle révèle l'avenir et ne tente pas de le dévoiler.
Mercredi 10 h.
Ne manquez pas de me répondre sur le petit hôtel de la rue Belle-Chasse, qu’occupait M. de Crussot. Beaucoup de vos convenances m'y paraissent réunies. J’aimerais bien mieux l'entresol de la rue St Florentin. Mais je crains qu'on n'en veuille 12 mille francs. Adieu. Adieu. Pendant une semaine, vous n'aurez eu de lettre que tous les deux jours. Mais nous voilà, au même pas. Encore adieu. G.
231. Val-Richer, Mercredi 31 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
231 Du Val-Richer. Mercredi 31 Juillet 1839 5 heures
Aujourd'hui c’est tout seul que je me suis promené. Je viens de marcher trois heures, au petit pas, dans les bois, les près avec ou sans chemin, pensant à vous et à Washington. Vous vous ressemblez peu. Pourtant c'était une grande matière, et il a bien vraiment accompli sa destinée quand il a vaincu et gouverné. Il l’a fait très simplement et de sang froid, sans vit plaisir, mais aussi sans prétention ni effort. C’est peut-être le seul grand homme qui l'ait été par occasion seulement, poussé en haut par la nécessité des choses et non par l'élan de son propre esprit et de sa propre volonté. Deux choses lui manquaient : la passion et la pensée ; la passion ardente, insatiable ; la pensée spontanée, variée, illimitée dans son activité. Mais appelé à agir, je ne connais point de jugement, plus droit, plus imperturbable dans la vérité, point de caractère plus ferme et plus serein, toujours au niveau des grandes choses sans jamais se croire au dessus. Je vous en dirais long si je vous disais tout ce qui me vient à l'esprit sur lui en lisant sa vie et ses Lettres. J’ai pensé à vous bien plus qu'à lui. J’aime extrêmement à penser à ce que j’aime. On dit que les avares passent des heures à contempler leur trésor. Je suis un avare. Bien certainement je le suis. Je me comptais à regarder mon trésor, & je veux le garder pour moi seul.
Jeudi 6 heures
Le soleil est admirable ce matin. C’est une rareté. Je voudrais que vous vissiez ma bibliothèque au soleil levant. Il y entre à flots par neuf grandes croisées et se répand sur deux vastes jardinières pleines de fleurs et sur une série de gravures, encadrées le plus simplement du monde, en chêne et en sapin de Suède, comme la bibliothèque, mais toutes fort belles, saintes et profanes des Saintes Familles, la communion de St Jérôme, le spasimo de Raphaël, Napoléon à Eylau à Austertitz, à St Hélène, Henri 4 à Paris, Gustave Wasa à sa dernière diète & Je suis sûr que cela serait de votre goût, la bibliothèque et le soleil. Si le Cardinal Fesch qui répand son argent à tort et à travers, m'en avait laissé un peu je ferais du Val-Richer une habitation charmante. J'ai, pour cela la matière et l’esprit. Rien ne me manque que l’argent. Je comprends que l’Europe s'amuse du spectacle des Buonaparte, se disputant cet argent. Quand Fesch fut fait Cardinal, le maréchal Lefèvre ( duc de Dantzick ) homme d’esprit malicieusement grossier, lui dit avec son accent alsacien : « Sap.. Monseigneur, c'est pien heureux que je ne fous ai pas fait pendre ce chour que fous safez pien, quand fous étiez fournisseur ! " A coup sûr tous les Buonaparte trouvent aujourd'hui comme lui que c’est bien heureux. Chaque pays a ses scandales et ses hontes. L'Angleterre a vu le squelette de Cromwell de l'homme à qui elle avait obéi et qui compte au rang de ses plus grandes gloires, pendu à Tyburn et jeté dans la Tamise. Il n'en arrivera jamais autant à Caradoe. Le voilà Pair d'Angleterre. La Princesse Bagration sera-t-elle Pairesse ?
9 h. 1/2
Comment, quatre mois sans nous voir ? Est-ce que de manière ou d'autre, vous ne reviendrez pas à Paris dans le cours de septembre, soit pour y rester, soit pour y passer en allant en Angleterre ? Dans l'un et l'autre cas, j’irai vous y voir. Vous ne comptez certainement pas rester à Baden jusqu'au mois de Décembre. Dites-moi un peu vos projets. Ayez des projets si j'étais près de vous, je m'en chargerais. Je suis décidé à m'en charger désormais jusqu'à la dernière limite du possible pour moi. Mais à présent, je suis loin. Adieu. Adieu. Voilà quatre jours qui me pèseront jusqu'à ce que vous ayez recommencé à avoir des lettres tous les jours. Vous savez que je ne jouis de rien à moi seul. Adieu. Adieu. G.
Aujourd'hui c’est tout seul que je me suis promené. Je viens de marcher trois heures, au petit pas, dans les bois, les près avec ou sans chemin, pensant à vous et à Washington. Vous vous ressemblez peu. Pourtant c'était une grande matière, et il a bien vraiment accompli sa destinée quand il a vaincu et gouverné. Il l’a fait très simplement et de sang froid, sans vit plaisir, mais aussi sans prétention ni effort. C’est peut-être le seul grand homme qui l'ait été par occasion seulement, poussé en haut par la nécessité des choses et non par l'élan de son propre esprit et de sa propre volonté. Deux choses lui manquaient : la passion et la pensée ; la passion ardente, insatiable ; la pensée spontanée, variée, illimitée dans son activité. Mais appelé à agir, je ne connais point de jugement, plus droit, plus imperturbable dans la vérité, point de caractère plus ferme et plus serein, toujours au niveau des grandes choses sans jamais se croire au dessus. Je vous en dirais long si je vous disais tout ce qui me vient à l'esprit sur lui en lisant sa vie et ses Lettres. J’ai pensé à vous bien plus qu'à lui. J’aime extrêmement à penser à ce que j’aime. On dit que les avares passent des heures à contempler leur trésor. Je suis un avare. Bien certainement je le suis. Je me comptais à regarder mon trésor, & je veux le garder pour moi seul.
Jeudi 6 heures
Le soleil est admirable ce matin. C’est une rareté. Je voudrais que vous vissiez ma bibliothèque au soleil levant. Il y entre à flots par neuf grandes croisées et se répand sur deux vastes jardinières pleines de fleurs et sur une série de gravures, encadrées le plus simplement du monde, en chêne et en sapin de Suède, comme la bibliothèque, mais toutes fort belles, saintes et profanes des Saintes Familles, la communion de St Jérôme, le spasimo de Raphaël, Napoléon à Eylau à Austertitz, à St Hélène, Henri 4 à Paris, Gustave Wasa à sa dernière diète & Je suis sûr que cela serait de votre goût, la bibliothèque et le soleil. Si le Cardinal Fesch qui répand son argent à tort et à travers, m'en avait laissé un peu je ferais du Val-Richer une habitation charmante. J'ai, pour cela la matière et l’esprit. Rien ne me manque que l’argent. Je comprends que l’Europe s'amuse du spectacle des Buonaparte, se disputant cet argent. Quand Fesch fut fait Cardinal, le maréchal Lefèvre ( duc de Dantzick ) homme d’esprit malicieusement grossier, lui dit avec son accent alsacien : « Sap.. Monseigneur, c'est pien heureux que je ne fous ai pas fait pendre ce chour que fous safez pien, quand fous étiez fournisseur ! " A coup sûr tous les Buonaparte trouvent aujourd'hui comme lui que c’est bien heureux. Chaque pays a ses scandales et ses hontes. L'Angleterre a vu le squelette de Cromwell de l'homme à qui elle avait obéi et qui compte au rang de ses plus grandes gloires, pendu à Tyburn et jeté dans la Tamise. Il n'en arrivera jamais autant à Caradoe. Le voilà Pair d'Angleterre. La Princesse Bagration sera-t-elle Pairesse ?
9 h. 1/2
Comment, quatre mois sans nous voir ? Est-ce que de manière ou d'autre, vous ne reviendrez pas à Paris dans le cours de septembre, soit pour y rester, soit pour y passer en allant en Angleterre ? Dans l'un et l'autre cas, j’irai vous y voir. Vous ne comptez certainement pas rester à Baden jusqu'au mois de Décembre. Dites-moi un peu vos projets. Ayez des projets si j'étais près de vous, je m'en chargerais. Je suis décidé à m'en charger désormais jusqu'à la dernière limite du possible pour moi. Mais à présent, je suis loin. Adieu. Adieu. Voilà quatre jours qui me pèseront jusqu'à ce que vous ayez recommencé à avoir des lettres tous les jours. Vous savez que je ne jouis de rien à moi seul. Adieu. Adieu. G.
229. Baden, Jeudi 1er août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
229 Baden jeudi le 1er août 1839
Vous m'avez écrit une lettre des plus intéressantes par les nouvelles que vous me donnez. Si ce que vous me dites sur l'Orient se confirme, si Méhémet Ali va non pas régner, mais gouverner à Constantinople ce sera certainement le dévouement le plus inattendu, le moins désiré par nous, qu'il soit possible de concevoir. Et si c’est M. de Metternich qui a tramé cela et sera son coup le plus habile. Mais je ne crois pas encore. Comment Méhémet irait-il se livrer, livrer sa tête à moins. d’être maître absolu du terrain, ce qu’il ne peut pas être. Tout cela est fort curieux à observer. Et j'en suis fort curieuse. Le projet électoral de la gauche me semble bien démocratique ! Je vous remercie beaucoup de toutes ces notions. Les premières surtout m’intéressent au plus haut degré. Continuez car aujourd’hui que j’ai perdu M. de Malzahn je suis peu informée à moins ce que vous me donnerez.
Ma nièce Meschersky est arrivée pour passer quelques jours avec moi. Il y a d’autres personnes venues aussi mais rien qui me plaise ou me convienne. En Anglais de peines de ménage bien frivoles. La petite Madame Wellesley se retire beaucoup de cela vu les journaux j'y gagne, car je le vois davantage et elle est gentille.
4 heures. Je vous envoie copie d’une partie de la lettre que j'ai reçu hier de notre consul général à Londres, auquel j'avais simplement demandé d’apprendre l’exact montant du capital. Cette réponse m'a beaucoup surprise. Je lui ai écrit de suite pour lui dire que je doutais beau coup que la loi anglaise pût s'appliquer dans ce cas ci à une étrangère et que je ne ferais aucune démarche jusqu’à ce que j'ai acquis la certitude la plus complète que je me trouve sous la régie de cette loi. Qu’en pensez-vous ? Cela me parait bien singulier ! Quelles seraient vos lois en France dans un cas pareil ? Imaginez que j'ai encore eu toute une matinée de notaires. Le premier plein pouvoir n’était pas suffisant ( celui d'avant hier) il a fallu tout recommencer. Je suis excédée de ces affaires. Que j'aime à vous entendre dire que vous êtes seul. Quel égoïsme ! mais cette affection est si égoïste. Il n'y en a qu’une qui ne le soit pas. Mes enfants ! J'étais heureuse de leur bonheur quand même il ne leur venait pas de moi. Mais vous, je veux qu’il vous manque quelque chose, et beaucoup. Adieu. Adieu.
Vous m'avez écrit une lettre des plus intéressantes par les nouvelles que vous me donnez. Si ce que vous me dites sur l'Orient se confirme, si Méhémet Ali va non pas régner, mais gouverner à Constantinople ce sera certainement le dévouement le plus inattendu, le moins désiré par nous, qu'il soit possible de concevoir. Et si c’est M. de Metternich qui a tramé cela et sera son coup le plus habile. Mais je ne crois pas encore. Comment Méhémet irait-il se livrer, livrer sa tête à moins. d’être maître absolu du terrain, ce qu’il ne peut pas être. Tout cela est fort curieux à observer. Et j'en suis fort curieuse. Le projet électoral de la gauche me semble bien démocratique ! Je vous remercie beaucoup de toutes ces notions. Les premières surtout m’intéressent au plus haut degré. Continuez car aujourd’hui que j’ai perdu M. de Malzahn je suis peu informée à moins ce que vous me donnerez.
Ma nièce Meschersky est arrivée pour passer quelques jours avec moi. Il y a d’autres personnes venues aussi mais rien qui me plaise ou me convienne. En Anglais de peines de ménage bien frivoles. La petite Madame Wellesley se retire beaucoup de cela vu les journaux j'y gagne, car je le vois davantage et elle est gentille.
4 heures. Je vous envoie copie d’une partie de la lettre que j'ai reçu hier de notre consul général à Londres, auquel j'avais simplement demandé d’apprendre l’exact montant du capital. Cette réponse m'a beaucoup surprise. Je lui ai écrit de suite pour lui dire que je doutais beau coup que la loi anglaise pût s'appliquer dans ce cas ci à une étrangère et que je ne ferais aucune démarche jusqu’à ce que j'ai acquis la certitude la plus complète que je me trouve sous la régie de cette loi. Qu’en pensez-vous ? Cela me parait bien singulier ! Quelles seraient vos lois en France dans un cas pareil ? Imaginez que j'ai encore eu toute une matinée de notaires. Le premier plein pouvoir n’était pas suffisant ( celui d'avant hier) il a fallu tout recommencer. Je suis excédée de ces affaires. Que j'aime à vous entendre dire que vous êtes seul. Quel égoïsme ! mais cette affection est si égoïste. Il n'y en a qu’une qui ne le soit pas. Mes enfants ! J'étais heureuse de leur bonheur quand même il ne leur venait pas de moi. Mais vous, je veux qu’il vous manque quelque chose, et beaucoup. Adieu. Adieu.
232. Val-Richer, Jeudi 1er août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
232 Du Val Richer, Jeudi 1 Août 1839, 9 h du soir
Vous avez tort de ne pas me dire tout, absolument tout, de loin comme de près, de loin encore plus que de près. Quand je suis près quand je vous vois deux fois par jour, j'ai bien moins besoin que vous me disiez. Je devine, je sais d'avance. Et puis je vous vois ce qui vaut bien des paroles même des vôtres. Essayez de m'en dire autant qu’il en faudra pour me faire oublier un moment que je ne vous vois pas. C'est pourtant là ce que nous nous devrions l'un à l'autre quand nous sommes séparés. Entendez bien qu’il n’y a rien d'insignifiant, ni chose, ni personne, quand elle vous touche. Et puis, ce qui m'importe encore plus que le dehors de votre vue, c'est le dedans. J'aime bien à savoir les incidents de votre journée, encore plus ceux de votre âme. Dites-moi toute votre âme, ce qui l’occupe, ce qui la traverse bon ou mauvais, triste ou gai. J’ai bien envie d’être parfaitement exigeant, et de vous dire que tout ce que vous ne me dites pas, vous me le cachez, car j’ai droit de le savoir. Vous m’avez dit souvent ( quelquefois trop au commencement de notre relation, car cela m'étonnait un peu ) que vous étiez si transparente ! Soyez le de loin comme de près, et toujours, et jusqu'au fond. L’amour, c’est la transparence. L’intimité, c’est la transparence. Et la transparence, c’est que tout paraisse, que tout aille s’offrir de soi-même à des yeux charmés de tout voir. C'est ici, bien plus encore que dans tout ce qui se passe autour de vous, qu’il n’y a rien d’insignifiant pour moi. Savez-vous ce qui vous arrive ? Quand vous êtes fatiguée, ennuyée vous supposez que je le suis aussi. Vous n’avez plus confiance ni en vous, ni en moi, et vous vous laissez retomber même en m'écrivant, dans votre solitude, je veux dire dans votre isolement. Souvenez-vous que la première parole qui nous a vraiment unis a été celle-ci. Vous ne serez plus seule. Qu’elle reste entre nous, éternellement, parfaitement vraie. Ne soyez jamais seule. Je n'admets qu’une raison pour que vos lettres ne m'apportent pas, comme un miroir, toute votre vie, et toute votre âme ; c’est la fatigue physique de tout écrire.
Vendredi 9 heures
Je vois dans quelques journaux que la Belgique demande à entrer dans l’association des douanes allemandes. Je voudrais bien savoir ce qu’il y a de vrai. Je sais bien ce que la Belgique dit et fait dire sur la rive gauche du Rhin, mais je suis curieux de la rive droite. Pouvez-vous en causer avec M. de Blittersdorff, ou quelque autre bien instruit ?
La gauche a nommé un comité chargé de rédiger un projet de réforme électorale d'après les bases que je vous ai dites. Ce sont MM. Barrot, Carnot, Chambolle, Corcelles, Gauthier de Rumilly, de Golbery, Isambert, Larabit, de Sade et de Tocqueville. Il n'y a là de républicain que M. Carnot. Mais il l’est hautement, décidément et a été nommé comme tel par le 6e arrondissement de Paris. C’est à lui que les autres feront des concessions. Jamais assez pour qu'il soit content du projet, mais assez pour qu'il ne le désavoue pas. C’est l’hostilité de M. Garnier Pagès d'avoir mis M. Carnot, dans ce Comité. Il y aura ainsi beaucoup plus d’influence que s’il y était entré lui-même, ce que probablement il n'aurait pas pu.
Je ne suis pas content de la santé de ma mère depuis deux au trois jours. Elle a la tête fort lourde et un petit retour de vertiges. Je crains que le temps orageux et constamment mauvais ne lui fasse mal. Voilà un beau soleil depuis avant-hier. Je mène demain mes filles à Caen. J'en reviendrai après demain. Je m’arrangerai pour que notre quotidienneté n’en soit pas dérangée.
Vous me dîtes que bientôt vous n'aurez même plus Marie. Est-ce qu’elle se marie ? Ou bien avez-vous un parti pris de vous en séparer ? Si vous le faites cherchez quelqu'un pour la remplacer, parmi vos parent on ailleurs. Je sais combien ce choix est difficile et peut devenir ennuyeux. Pourtant il vous faut quelqu'un. Vous ne pouvez rester matériellement seule. Au moins vous faudrait-il une femme de chambre renforcée, de bonnes manières, capable de vous lire. Mais si vous rencontrez quelqu'un ou s’il vous vient quelque idée, ne vous décidez pas tout de suite, et sur votre première impulsion. Cela n’est jamais facile à défaire.
9 h. 1/2
Pourquoi n'ai-je pas de lettre ce matin ? Ceci me déplaît. Vous devez m'avoir écrit. Votre lettre d’hier me le promet. Adieu. Un triste adieu. G.
Vous avez tort de ne pas me dire tout, absolument tout, de loin comme de près, de loin encore plus que de près. Quand je suis près quand je vous vois deux fois par jour, j'ai bien moins besoin que vous me disiez. Je devine, je sais d'avance. Et puis je vous vois ce qui vaut bien des paroles même des vôtres. Essayez de m'en dire autant qu’il en faudra pour me faire oublier un moment que je ne vous vois pas. C'est pourtant là ce que nous nous devrions l'un à l'autre quand nous sommes séparés. Entendez bien qu’il n’y a rien d'insignifiant, ni chose, ni personne, quand elle vous touche. Et puis, ce qui m'importe encore plus que le dehors de votre vue, c'est le dedans. J'aime bien à savoir les incidents de votre journée, encore plus ceux de votre âme. Dites-moi toute votre âme, ce qui l’occupe, ce qui la traverse bon ou mauvais, triste ou gai. J’ai bien envie d’être parfaitement exigeant, et de vous dire que tout ce que vous ne me dites pas, vous me le cachez, car j’ai droit de le savoir. Vous m’avez dit souvent ( quelquefois trop au commencement de notre relation, car cela m'étonnait un peu ) que vous étiez si transparente ! Soyez le de loin comme de près, et toujours, et jusqu'au fond. L’amour, c’est la transparence. L’intimité, c’est la transparence. Et la transparence, c’est que tout paraisse, que tout aille s’offrir de soi-même à des yeux charmés de tout voir. C'est ici, bien plus encore que dans tout ce qui se passe autour de vous, qu’il n’y a rien d’insignifiant pour moi. Savez-vous ce qui vous arrive ? Quand vous êtes fatiguée, ennuyée vous supposez que je le suis aussi. Vous n’avez plus confiance ni en vous, ni en moi, et vous vous laissez retomber même en m'écrivant, dans votre solitude, je veux dire dans votre isolement. Souvenez-vous que la première parole qui nous a vraiment unis a été celle-ci. Vous ne serez plus seule. Qu’elle reste entre nous, éternellement, parfaitement vraie. Ne soyez jamais seule. Je n'admets qu’une raison pour que vos lettres ne m'apportent pas, comme un miroir, toute votre vie, et toute votre âme ; c’est la fatigue physique de tout écrire.
Vendredi 9 heures
Je vois dans quelques journaux que la Belgique demande à entrer dans l’association des douanes allemandes. Je voudrais bien savoir ce qu’il y a de vrai. Je sais bien ce que la Belgique dit et fait dire sur la rive gauche du Rhin, mais je suis curieux de la rive droite. Pouvez-vous en causer avec M. de Blittersdorff, ou quelque autre bien instruit ?
La gauche a nommé un comité chargé de rédiger un projet de réforme électorale d'après les bases que je vous ai dites. Ce sont MM. Barrot, Carnot, Chambolle, Corcelles, Gauthier de Rumilly, de Golbery, Isambert, Larabit, de Sade et de Tocqueville. Il n'y a là de républicain que M. Carnot. Mais il l’est hautement, décidément et a été nommé comme tel par le 6e arrondissement de Paris. C’est à lui que les autres feront des concessions. Jamais assez pour qu'il soit content du projet, mais assez pour qu'il ne le désavoue pas. C’est l’hostilité de M. Garnier Pagès d'avoir mis M. Carnot, dans ce Comité. Il y aura ainsi beaucoup plus d’influence que s’il y était entré lui-même, ce que probablement il n'aurait pas pu.
Je ne suis pas content de la santé de ma mère depuis deux au trois jours. Elle a la tête fort lourde et un petit retour de vertiges. Je crains que le temps orageux et constamment mauvais ne lui fasse mal. Voilà un beau soleil depuis avant-hier. Je mène demain mes filles à Caen. J'en reviendrai après demain. Je m’arrangerai pour que notre quotidienneté n’en soit pas dérangée.
Vous me dîtes que bientôt vous n'aurez même plus Marie. Est-ce qu’elle se marie ? Ou bien avez-vous un parti pris de vous en séparer ? Si vous le faites cherchez quelqu'un pour la remplacer, parmi vos parent on ailleurs. Je sais combien ce choix est difficile et peut devenir ennuyeux. Pourtant il vous faut quelqu'un. Vous ne pouvez rester matériellement seule. Au moins vous faudrait-il une femme de chambre renforcée, de bonnes manières, capable de vous lire. Mais si vous rencontrez quelqu'un ou s’il vous vient quelque idée, ne vous décidez pas tout de suite, et sur votre première impulsion. Cela n’est jamais facile à défaire.
9 h. 1/2
Pourquoi n'ai-je pas de lettre ce matin ? Ceci me déplaît. Vous devez m'avoir écrit. Votre lettre d’hier me le promet. Adieu. Un triste adieu. G.
230. Baden, Vendredi 2 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
230 Baden Vendredi le 2 août 1839, 3 heures
Je m'occupe un peu de ma nièce, et cela m’a pris beaucoup de mon temps hier et ce matin. Sa fille est mal, le médecin craint pour elle l'hydropisie ou l’éthysie, et les parents sont bien alarmés. Je viens de revoir ici le gouverneur du petit grand duc Constantin l'amiral Luthe, vous ne sauriez concevoir comme j’ai été saisie à sa vue. Je le voyais à Pétersbourg tous les jours et il connaissait mieux que personne ce que j’ai perdu parce que ses enfants étaient fort souvent avec les enfants de l'Empereur. J’ai fondu en larmes en le voyant. Il retourne à son poste dans quelques semaines, je l'ai bien fait parler, il vit là dans l’intimité de l'Empereur & de l'Impératrice, et je m’intéresse toujours à cet intérieur. La foule augmente à Baden, je n’y ai gagné que ce que je vous nomme.
J’ai pris maintenant 7 bains froids, ils m’ôtent le sommeil. Je les abandonne. Ne croyez pas les gens qui vous disent que je ne veux pas faire ce qu'on me prescrit. Je fais, mais pas jusqu’au bout lorsque je vois que cela ne me convient pas. Tout ce qu'on a essayé pour moi à Bade est des bêtises. Je suis plus maigre et plus faible. Il est temps de finir, et je vous réponds que je ne suivrai plus que ma fantaisie. Ce qui me fâche est que vous serez fâché de me revoir comme vous m’avez quitté et même plus mal. Mais vous aimez mieux cela que de ne pas me revoir du tout, n’est-ce pas ? Et voilà ce que vous risqueriez si je suivais tout ce que m’ordonne le médecin. Savez-vous que j’ai le plus parfait mépris pour les médecins. Je n'en connais qu’un à Londres auquel je crois un peu.
5 heures Votre 229 vient de m’arriver et en même temps des visites que je mène en calèche. Il faut que je vous quitte. Adieu. Adieu. mille fois et une.
Je m'occupe un peu de ma nièce, et cela m’a pris beaucoup de mon temps hier et ce matin. Sa fille est mal, le médecin craint pour elle l'hydropisie ou l’éthysie, et les parents sont bien alarmés. Je viens de revoir ici le gouverneur du petit grand duc Constantin l'amiral Luthe, vous ne sauriez concevoir comme j’ai été saisie à sa vue. Je le voyais à Pétersbourg tous les jours et il connaissait mieux que personne ce que j’ai perdu parce que ses enfants étaient fort souvent avec les enfants de l'Empereur. J’ai fondu en larmes en le voyant. Il retourne à son poste dans quelques semaines, je l'ai bien fait parler, il vit là dans l’intimité de l'Empereur & de l'Impératrice, et je m’intéresse toujours à cet intérieur. La foule augmente à Baden, je n’y ai gagné que ce que je vous nomme.
J’ai pris maintenant 7 bains froids, ils m’ôtent le sommeil. Je les abandonne. Ne croyez pas les gens qui vous disent que je ne veux pas faire ce qu'on me prescrit. Je fais, mais pas jusqu’au bout lorsque je vois que cela ne me convient pas. Tout ce qu'on a essayé pour moi à Bade est des bêtises. Je suis plus maigre et plus faible. Il est temps de finir, et je vous réponds que je ne suivrai plus que ma fantaisie. Ce qui me fâche est que vous serez fâché de me revoir comme vous m’avez quitté et même plus mal. Mais vous aimez mieux cela que de ne pas me revoir du tout, n’est-ce pas ? Et voilà ce que vous risqueriez si je suivais tout ce que m’ordonne le médecin. Savez-vous que j’ai le plus parfait mépris pour les médecins. Je n'en connais qu’un à Londres auquel je crois un peu.
5 heures Votre 229 vient de m’arriver et en même temps des visites que je mène en calèche. Il faut que je vous quitte. Adieu. Adieu. mille fois et une.
233. Val-Richer,Vendredi 2 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
233. Du Val Richer Vendredi soir 2 Août 1839
Ni moi non plus je n’ai rien à vous dire. Je suis de mauvaise humeur. Je mène demain mes filles à Caen. Il faut que je parte de bonne heure avant l’arrivée de la poste. Je n’ai pas eu de lettre aujourd'hui ; je n'en aurai pas demain, et après-demain à 2 heures seulement à mon retour ici. Je vous répète que je suis de mauvaise humeur si vous ne m’avez pas écrit, pourquoi me disiez- vous la veille que vous ne m'imiteriez pas ? Et si vous m’avez écrit, pourquoi ce matin n’ai-je pas eu votre lettre ?
Voici mes nouvelles de ce matin. La flotte Turque est arrivée le 14 et s'est mise absolument à la disposition de Méhémet. L'amiral Stopford ne l’a pas plus arrêtée que n'avait fait l'amiral Lalande. Ainsi, on ne peut nous imputer un prétendu concert, Méhémet a déclaré qu’il ne rendrait la flotte que lorsque Khosrer Pacha ne serait plus à la tête des affaires et qu'on lui aurait accordé l’hérédité des pays qu'il gouverne. Mais en même temps l’armée égyptienne a reçu ordre de se retirer derrière, l’Euphrate. Ceci est la grande nouvelle, car ceci prouve que l'affaire se dénouera par la Diplomatie, Méhémet ne voulant donner prétexte à personne pour la dénouer autrement. C'est ce qu’on m’écrit avec une vive satisfaction. Vous le savez peut-être déjà.
Avec cette dépêche d'Alexandrie, ce que le courrier m’a apporté ce matin de plus piquant, c’est un petit livre intitulé : L'Almanach des Chasseurs, pour l’année de chasse 1839-1840 et qui débute ainsi : " Les profanes comptent quatre saisons dans l'année ; les chasseurs n'en comptent que deux : 1° Celle où l'on chasse. 2° Celle où l'on ne chasse pas. " Puis viennent toutes sortes de préceptes et de conseils, comme celui-ci : Tuez les geais, les pies, les buses, les oiseaux sont remplis de ruses. "
Rien de tout cela n’est à mon usage, car je ne chasse pas. Vous voyez bien que la poste aurait beaucoup mieux fait de m'apporter votre lettre. Adieu jusqu'à demain matin. Plût à Dieu !
Ni moi non plus je n’ai rien à vous dire. Je suis de mauvaise humeur. Je mène demain mes filles à Caen. Il faut que je parte de bonne heure avant l’arrivée de la poste. Je n’ai pas eu de lettre aujourd'hui ; je n'en aurai pas demain, et après-demain à 2 heures seulement à mon retour ici. Je vous répète que je suis de mauvaise humeur si vous ne m’avez pas écrit, pourquoi me disiez- vous la veille que vous ne m'imiteriez pas ? Et si vous m’avez écrit, pourquoi ce matin n’ai-je pas eu votre lettre ?
Voici mes nouvelles de ce matin. La flotte Turque est arrivée le 14 et s'est mise absolument à la disposition de Méhémet. L'amiral Stopford ne l’a pas plus arrêtée que n'avait fait l'amiral Lalande. Ainsi, on ne peut nous imputer un prétendu concert, Méhémet a déclaré qu’il ne rendrait la flotte que lorsque Khosrer Pacha ne serait plus à la tête des affaires et qu'on lui aurait accordé l’hérédité des pays qu'il gouverne. Mais en même temps l’armée égyptienne a reçu ordre de se retirer derrière, l’Euphrate. Ceci est la grande nouvelle, car ceci prouve que l'affaire se dénouera par la Diplomatie, Méhémet ne voulant donner prétexte à personne pour la dénouer autrement. C'est ce qu’on m’écrit avec une vive satisfaction. Vous le savez peut-être déjà.
Avec cette dépêche d'Alexandrie, ce que le courrier m’a apporté ce matin de plus piquant, c’est un petit livre intitulé : L'Almanach des Chasseurs, pour l’année de chasse 1839-1840 et qui débute ainsi : " Les profanes comptent quatre saisons dans l'année ; les chasseurs n'en comptent que deux : 1° Celle où l'on chasse. 2° Celle où l'on ne chasse pas. " Puis viennent toutes sortes de préceptes et de conseils, comme celui-ci : Tuez les geais, les pies, les buses, les oiseaux sont remplis de ruses. "
Rien de tout cela n’est à mon usage, car je ne chasse pas. Vous voyez bien que la poste aurait beaucoup mieux fait de m'apporter votre lettre. Adieu jusqu'à demain matin. Plût à Dieu !
231. Baden, Samedi 3 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
231. Baden Samedi le 3 août 1839
Il me semble que vos nouvelles d’Orient ne se confirment pas. Je voudrais bien savoir le vrai de l’affaire du Capitaine Pacha. Dites-moi ce que vous saurez, mais il faut que cela vienne de source. Nous avons envoyé un complémentaire au nouveau Sultan, un comte Rzvonsky, que je connais beaucoup. Je le faisais venir le soir chez moi quand j'habitais Czarkoislo il me divertissait en débitant bien des mensonges, des contes de revenants surtout. Il pourra rapporter bien des contes sur l'Orient. Ibrahim poursuit ses triomphes. Des lettres de Constantinople du 20 annoncent sa marche sur Koniah, que va faire le divan ? à qui demandera-t-il secours ? Voici que la confusion commence. un courrier arrivé à Darmstadt porte le consentement de l’Empereur au mariage. On y enverra une ambassade pour la demande formelle. On continue en Allemagne à exprimer le plus grand étonnement de ce choix.
La princesse Meschersky va rester à Bade, j'en suis bien aise ; c’est une ressource lorsqu'il n’y a pas mieux.
5 heures.
Quelle lettre que ce N°230 et combien de fois je vais la relire ! Que je vous en remercie ! Je viens de recevoir une lettre de Bulner de Paris, il me dit que Khosrew Pacha le présent grand vizir est le seul homme habile et ferme en Turquie, qu’il est fort dévoué à la famille du Sultan mais qu'il pourrait bien la vendre aussi si on le payait cher. Méhémet Ali demande le renvoi du grand Vizir et l'hérédité de son gouvernement en Syrie, Egypte et ce troisième nom indéchiffrable. Bulwer croit à la nomination de l'Égyptien. Il connait bien tout cela il y a été longtemps. Le Sultan actuel is devoted to the ladies, a black dwarf and 2 monkeys. The Dwarf being the prime favorite.
Bulwer a écrit à Paul mais il n'a pas eu de réponse, et craint qu’il n’en aura pas. Vous dirai-je ce que je pense ? Si notre consul à Londres a raison, Paul en reviendra, et ce n’est que pour cela que j’aurai quelque plaisir a est accroissement inattendu de fortune. Au reste je n'y compte pas du tout et je fais tous mes calculs sur les lois russes. Il faut que je voie moi-même l'hôtel de la rue Bellechasse. Si je ne me trompe il est rebâti à neuf on n’y a pas habité encore, il y aurait du danger peut-être, je serai à Paris au commencement de septembre au plus tard et je choisirai. J’ai écrit pour l'appartement de Jennison. Je n’ai pas de réponse Adieu. Adieu, bien tendrement.
Il me semble que vos nouvelles d’Orient ne se confirment pas. Je voudrais bien savoir le vrai de l’affaire du Capitaine Pacha. Dites-moi ce que vous saurez, mais il faut que cela vienne de source. Nous avons envoyé un complémentaire au nouveau Sultan, un comte Rzvonsky, que je connais beaucoup. Je le faisais venir le soir chez moi quand j'habitais Czarkoislo il me divertissait en débitant bien des mensonges, des contes de revenants surtout. Il pourra rapporter bien des contes sur l'Orient. Ibrahim poursuit ses triomphes. Des lettres de Constantinople du 20 annoncent sa marche sur Koniah, que va faire le divan ? à qui demandera-t-il secours ? Voici que la confusion commence. un courrier arrivé à Darmstadt porte le consentement de l’Empereur au mariage. On y enverra une ambassade pour la demande formelle. On continue en Allemagne à exprimer le plus grand étonnement de ce choix.
La princesse Meschersky va rester à Bade, j'en suis bien aise ; c’est une ressource lorsqu'il n’y a pas mieux.
5 heures.
Quelle lettre que ce N°230 et combien de fois je vais la relire ! Que je vous en remercie ! Je viens de recevoir une lettre de Bulner de Paris, il me dit que Khosrew Pacha le présent grand vizir est le seul homme habile et ferme en Turquie, qu’il est fort dévoué à la famille du Sultan mais qu'il pourrait bien la vendre aussi si on le payait cher. Méhémet Ali demande le renvoi du grand Vizir et l'hérédité de son gouvernement en Syrie, Egypte et ce troisième nom indéchiffrable. Bulwer croit à la nomination de l'Égyptien. Il connait bien tout cela il y a été longtemps. Le Sultan actuel is devoted to the ladies, a black dwarf and 2 monkeys. The Dwarf being the prime favorite.
Bulwer a écrit à Paul mais il n'a pas eu de réponse, et craint qu’il n’en aura pas. Vous dirai-je ce que je pense ? Si notre consul à Londres a raison, Paul en reviendra, et ce n’est que pour cela que j’aurai quelque plaisir a est accroissement inattendu de fortune. Au reste je n'y compte pas du tout et je fais tous mes calculs sur les lois russes. Il faut que je voie moi-même l'hôtel de la rue Bellechasse. Si je ne me trompe il est rebâti à neuf on n’y a pas habité encore, il y aurait du danger peut-être, je serai à Paris au commencement de septembre au plus tard et je choisirai. J’ai écrit pour l'appartement de Jennison. Je n’ai pas de réponse Adieu. Adieu, bien tendrement.
234 . Caen, Samedi 3 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
233 ( je crois ) Caen. Samedi soir 11 heures 3 Août 1839
Je ne veux pas qu’une lettre vous manque. Mais ce sera à peine une lettre. Je quitte quarante personnes et je repars demain à 6 heures. On a arraché trois dents à mes filles, trois dents de fait destinées à mourir et qui obstruaient le passage. Cela est devenu nécessaire en deux mois, car elles avaient été chez Brewster quelques jours avant leur départ. Elles ont très bien supporté le mal. Et Pauline surtout y a eu du mérite, car elle avait bien le frisson. Ce n'est pas un enfant d’un naturel ferme ; mais elle est capable, pour quelques moments, par affection, par fierté, d’un véritable héroïsme. Si les grandes personnes avaient la moitié des vertus qu'elles demandent aux enfants, le monde serait beau à voir. Mais on fait bien de demander beaucoup aux enfants. Il faut qu’ils acquièrent de quoi perdre.
Je n'ai rien appris ici comme de raison Et je ne vous envoie pas la politique de province. Ce n'est pas la plus intelligente. mais c’est bien souvent, je vous assure, la plus sensée ; non pas plus sensée que vous et moi, mais plus sensée que la plupart des gens avec qui nous passons notre vie et comptons beaucoup. Je reviens toujours de la campagne, avec un grand fond d'estime pour les country gentlemen et les farmers. Adieu. Je compte trouver deux lettres chez moi demain. Adieu. G.
Je ne veux pas qu’une lettre vous manque. Mais ce sera à peine une lettre. Je quitte quarante personnes et je repars demain à 6 heures. On a arraché trois dents à mes filles, trois dents de fait destinées à mourir et qui obstruaient le passage. Cela est devenu nécessaire en deux mois, car elles avaient été chez Brewster quelques jours avant leur départ. Elles ont très bien supporté le mal. Et Pauline surtout y a eu du mérite, car elle avait bien le frisson. Ce n'est pas un enfant d’un naturel ferme ; mais elle est capable, pour quelques moments, par affection, par fierté, d’un véritable héroïsme. Si les grandes personnes avaient la moitié des vertus qu'elles demandent aux enfants, le monde serait beau à voir. Mais on fait bien de demander beaucoup aux enfants. Il faut qu’ils acquièrent de quoi perdre.
Je n'ai rien appris ici comme de raison Et je ne vous envoie pas la politique de province. Ce n'est pas la plus intelligente. mais c’est bien souvent, je vous assure, la plus sensée ; non pas plus sensée que vous et moi, mais plus sensée que la plupart des gens avec qui nous passons notre vie et comptons beaucoup. Je reviens toujours de la campagne, avec un grand fond d'estime pour les country gentlemen et les farmers. Adieu. Je compte trouver deux lettres chez moi demain. Adieu. G.
Mots-clés : Enfants (Guizot), Mandat local, Pédagogie, Santé (enfants Guizot)
232. Baden, Dimanche 4 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
232. Baden Dimanche le 4 août 1839
J'ai fait ma promenade du soir avec ma nièce et mon amiral. Nous avons été au vieux château. Le temps est redevenu charmant ; bien chaud, bien brillant. Quel dommage que je ne sache pas me bien porter ! L'occasion est si belle. Madame de Nesselrode est une étrange personne ! Son goût pour moi lui a passé. Je l'ennuie beaucoup. C’est visible alors je me plais le moins possible sur son chemin. Savez-vous que je suis toujours un peu étonnée de voir que j’inspire de l'ennui. Et puis entre nous soit dit, cela m'est arrivé rarement, et rien qu’avec des Russes.
2 heures
J'ai été à l'église avec ma nièce. Je me sens les nerfs bien agités, certainement l’air de Baden ne vaut rien pour les nerfs. En relisant votre lettre d’hier je vois qu'il s’agit de la rue Bellechasse, je ne m’y retrouve pas. Je croyais rue Las Cases. Bellechasse me parait ne pas avoir de midi, je me reprends, vous dites Bellechasse hier et vous disiez rue Lascases dans le N°227. Ayez la bonté de la faire visiter et de me dire les détails. Mais avant tout voyez si je ne disais pas vrai hier, et si elle n’est pas rebâti à neuf ? Dans ce cas j’en aurai peur. On ne me réponds pas pour la rue St Florentin. La situation est la meilleure de Paris, mais au fond l’appartement. a de petites proportions, pas un salon convenable. J’aime bien le plaisir de la journée mais je voudrais que cela réunisse l’agrément de la soirée. Enfin, je suis un peu difficile.
5 heures
Ecoutez un drôle de dialogue. Félix entre. Princesse je vous demande pardon mais c’est fini. Je m’en vais. Je vous prie de trouver un autre domestique. Qu’est-ce qui vous prend Félix ? Qu’est ce qui vous est arrivé ? Je suis très contente de vous, j’ai cru que vous étiez très content de moi. Oh certainement, je suis très pénétré de votre service. Mais c’est fini. C'est ma fantaisie, c’est ma volonté de partir. Enfin c’est tout à fait fini. Et voilà qui est fini. Imaginez mon désespoir, vous qui connaissez toute ma faiblesse pour Félix ! J’interroge le reste de mon household. Personne n’y comprends rien. Je crains qu’il ne soit devenu fou. Je reçois votre lettre dans cet instant. Je n'ai que le temps de vous le dire et de vous dire adieu. Adieu.
J'ai fait ma promenade du soir avec ma nièce et mon amiral. Nous avons été au vieux château. Le temps est redevenu charmant ; bien chaud, bien brillant. Quel dommage que je ne sache pas me bien porter ! L'occasion est si belle. Madame de Nesselrode est une étrange personne ! Son goût pour moi lui a passé. Je l'ennuie beaucoup. C’est visible alors je me plais le moins possible sur son chemin. Savez-vous que je suis toujours un peu étonnée de voir que j’inspire de l'ennui. Et puis entre nous soit dit, cela m'est arrivé rarement, et rien qu’avec des Russes.
2 heures
J'ai été à l'église avec ma nièce. Je me sens les nerfs bien agités, certainement l’air de Baden ne vaut rien pour les nerfs. En relisant votre lettre d’hier je vois qu'il s’agit de la rue Bellechasse, je ne m’y retrouve pas. Je croyais rue Las Cases. Bellechasse me parait ne pas avoir de midi, je me reprends, vous dites Bellechasse hier et vous disiez rue Lascases dans le N°227. Ayez la bonté de la faire visiter et de me dire les détails. Mais avant tout voyez si je ne disais pas vrai hier, et si elle n’est pas rebâti à neuf ? Dans ce cas j’en aurai peur. On ne me réponds pas pour la rue St Florentin. La situation est la meilleure de Paris, mais au fond l’appartement. a de petites proportions, pas un salon convenable. J’aime bien le plaisir de la journée mais je voudrais que cela réunisse l’agrément de la soirée. Enfin, je suis un peu difficile.
5 heures
Ecoutez un drôle de dialogue. Félix entre. Princesse je vous demande pardon mais c’est fini. Je m’en vais. Je vous prie de trouver un autre domestique. Qu’est-ce qui vous prend Félix ? Qu’est ce qui vous est arrivé ? Je suis très contente de vous, j’ai cru que vous étiez très content de moi. Oh certainement, je suis très pénétré de votre service. Mais c’est fini. C'est ma fantaisie, c’est ma volonté de partir. Enfin c’est tout à fait fini. Et voilà qui est fini. Imaginez mon désespoir, vous qui connaissez toute ma faiblesse pour Félix ! J’interroge le reste de mon household. Personne n’y comprends rien. Je crains qu’il ne soit devenu fou. Je reçois votre lettre dans cet instant. Je n'ai que le temps de vous le dire et de vous dire adieu. Adieu.
Mots-clés : Réseau social et politique, Vie domestique (Dorothée)
233. Baden, Lundi 5 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
233. Baden Lundi 5 août 1839
Montrond est arrivé hier, inquiet de trouver un lit et un dîner. Baden est si plein qu’il n'y a plus de logement. Son ami M. Benazet y pourvoira je suppose. Je l’ai vu hier soir en passant, mais ce matin à 7 heures il était chez moi. Il vient de Plombières. Il y a laissé M. Molé en espérances et sa belle santé. M. Cousin rempli d’éloges du roi et en grande assurance de l'entrée de Thiers. Lui Montrond croit que le Roi a envie de vous et de Thiers ensemble, mais probable ment le plus tard possible. Le gouvernement russe vient d’ordonner qu’il n’y aura plus que l’argent. En espèce qui aura cours chez nous. Dites-moi si cette mesure favorise les transactions à l’étranger, c.a.d. si c’est un bon moment pour faire passer mois argent en France ou en Angleterre. Je voudrais bien vous consulter sur divers choses mais vous êtes trop loin. On est toujours trop loin quand on n’est pas tout près.
Il faut que j’achève aujourd’hui mon roman de Félix. Après m’avoir fait la Déclaration d’hier il est allé se coucher, il n’a reparu que ce matin. Il était parfaitement ivre. Moi qui n’ai aucune connaissance de ces cas là, je croyais le pauvre homme fou. Pépin m’a éclairée. Le coupable est revenu en pénitent. J’ai dit de belles choses bien grave ment, sans rire, car ordinairement sa mine me fait rire, et tout est oublié, mais l’idée de perdre Félix avait gâté ma nuit. Et voilà comment j’ai toujours des soucis. Pardonnez-moi ma distraction des feuilles de cette lettre. Je ne suis pas ivre cependant. Il pleut ce matin ; hier il faisait superbe. J'ai eu hier une longue visite de Lady Chesterfield. Elle est un peu bête, un peu jolie, un peu ruiné. Je la connaissais fort peu en Angleterre, mais il est d'usage pour les Anglais de venir tout de suite chez moi, comme les vrais catholiques vont saluer les images dans les lieux saints
1 heures
Je viens de rencontrer un Rotschild s’en retournant à Paris que j'ai chargé d’arrêter pour moi le premier de l’hôtel Talleyrand. Si le prix n’est pas au dessus de 12 milles francs ou l’entresol pour 8 milles c.a.d. qu'il me rendra compte encore de tout cela et des arrangements à prendre. Au fond c’est la situation la plus agréable . Si le consul général de Londres a raison, le premier ne sera pas trop cher. Et s'il se trompe, j’ai de quoi fournir à l’entresol. Il me survient une affaire importante. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Demain vous serez ce que c’est.
Montrond est arrivé hier, inquiet de trouver un lit et un dîner. Baden est si plein qu’il n'y a plus de logement. Son ami M. Benazet y pourvoira je suppose. Je l’ai vu hier soir en passant, mais ce matin à 7 heures il était chez moi. Il vient de Plombières. Il y a laissé M. Molé en espérances et sa belle santé. M. Cousin rempli d’éloges du roi et en grande assurance de l'entrée de Thiers. Lui Montrond croit que le Roi a envie de vous et de Thiers ensemble, mais probable ment le plus tard possible. Le gouvernement russe vient d’ordonner qu’il n’y aura plus que l’argent. En espèce qui aura cours chez nous. Dites-moi si cette mesure favorise les transactions à l’étranger, c.a.d. si c’est un bon moment pour faire passer mois argent en France ou en Angleterre. Je voudrais bien vous consulter sur divers choses mais vous êtes trop loin. On est toujours trop loin quand on n’est pas tout près.
Il faut que j’achève aujourd’hui mon roman de Félix. Après m’avoir fait la Déclaration d’hier il est allé se coucher, il n’a reparu que ce matin. Il était parfaitement ivre. Moi qui n’ai aucune connaissance de ces cas là, je croyais le pauvre homme fou. Pépin m’a éclairée. Le coupable est revenu en pénitent. J’ai dit de belles choses bien grave ment, sans rire, car ordinairement sa mine me fait rire, et tout est oublié, mais l’idée de perdre Félix avait gâté ma nuit. Et voilà comment j’ai toujours des soucis. Pardonnez-moi ma distraction des feuilles de cette lettre. Je ne suis pas ivre cependant. Il pleut ce matin ; hier il faisait superbe. J'ai eu hier une longue visite de Lady Chesterfield. Elle est un peu bête, un peu jolie, un peu ruiné. Je la connaissais fort peu en Angleterre, mais il est d'usage pour les Anglais de venir tout de suite chez moi, comme les vrais catholiques vont saluer les images dans les lieux saints
1 heures
Je viens de rencontrer un Rotschild s’en retournant à Paris que j'ai chargé d’arrêter pour moi le premier de l’hôtel Talleyrand. Si le prix n’est pas au dessus de 12 milles francs ou l’entresol pour 8 milles c.a.d. qu'il me rendra compte encore de tout cela et des arrangements à prendre. Au fond c’est la situation la plus agréable . Si le consul général de Londres a raison, le premier ne sera pas trop cher. Et s'il se trompe, j’ai de quoi fournir à l’entresol. Il me survient une affaire importante. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Demain vous serez ce que c’est.
235 . Val -Richer, Lundi 5 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
235 (hier devait être 234) Du Val Richer, Lundi 5 août 1839 9 heures
Je n’ai trouvé hier en arrivant que votre 228. Vous voulez que je vous pardonne votre abattement. Je vous pardonne tout. Mais que sert le pardon ? Pas plus que ne ferait le reproche. Vous me donnez un sentiment auquel je suis peu accoutumé, celui de l’impossibilité, sentiment très pénible à placer à côté de beaucoup d'affection. Je ne sais pas si je l’accepterai jamais. Mais nous sommes trop loin pour que je vous dise tout ce que je voudrais ce que je devrais peut être vous dire. Je compatis peu, je l'avoue à votre ennui d’un notaire, deux témoins pour un nouveau plein pouvoir qui finira tout promptement. Finir promptement, c'est votre salut, c'est votre repos ! Je ne l'espérais pas. Et quand mon attente est trompée en bien, je suis un peu content et un peu reconnaissant envers la providence. Une faveur si rare? Jamais peut-être je n'ai plus désiré vous voir et causer avec vous qu'aujourd'hui. Je ne sais si tout ce que je vous dirais vous paraîtrait doux ; mais je suis sûr que ce serait sain pour vous. Car encore une fois, je vous aime trop pour accepter, l'impossibilité.
Parlons d’autre chose. Est-il vrai, comme on me l'écrit, qu'il est question d’un voyage de l'Empereur à Odessa avec le grand duc et M. de Nesselrode ? Personne ne peut prévoir aujourd'hui ce qui arrivera de ce côté. Un enfant Roi, une vieille Sultane-mère, deux jeunes négresses-maitresses, un vieux vizir haineux, un vieux Pacha vainqueur, toutes les habiletés de l’Europe diplomatique ne gouverneront pas cela. Nous sommes au hasard. La discorde est grande dans la gauche. Les projets de réforme électorale déplaisent à la plupart de ceux qui les acceptent, & ne sont pas acceptés de ceux à qui ils voudraient plaire. Ce sera, pour la prochaine session, un grand et bon champ de bataille. Je voudrais que ces deux questions, la réforme électorale et l'Orient restassent un peu longtemps sur le tapis. Nous avons besoin, pour nous former, de questions graves, pressantes, mais suspendues sur nos têtes, qui menacent de devenir, et ne deviennent pas tout à coup de grands événements. J’aurai probablement cette satisfaction.
Ma mère est mieux, et mes filles très bien. C’est demain, 6 août, le jour de naissance d'Henriette. Il y a dix ans. J’étais bien heureux !
9 heures
Voilà le n° 229. Je répondrai demain avec détail sur votre affaire du capital anglais. Je veux revoir le texte des lois. Mais en principe, il ne nous importe pas qu’on soit ou non étranger. Les biens de toute espèce, meubles ou immeubles qui se trouvent sur notre territoire sont régis par nos lois quelle que soit la nationalité du possesseur. Il me manque en effet beaucoup. Vous avez pleine satisfaction. Adieu. Adieu. G.
236 . Val -Richer, Lundi 5 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
236 Du Val-Richer, Lundi soir 5 Août 1839 9 heures
J’ai vérifié nos lois. Sans aucun doute, pour tout ce qui est affaire de procédure, comme dans le cas dont il s’agit, nos lois s'appliquent indifféremment aux étrangers et aux nationaux ; et une Russe ne serait pas envoyée en possession d’un héritage situé en France autrement, ni à d'autres conditions, ni avec d'autres formes qu’un Français. Je suis tout-à-fait porté à croire qu’il en est de même en Angleterre et que votre Conseil général a raison. Mais si je comprends bien ce qu’il vous écrit, la préférence que la loi anglaise donne à la veuve pour l'administration provisoire de la succession, n’est que facultative, c’est-à-dire que cette préférence, n’est accordée à la veuve que si elle la réclame formellement, & que dans le cas contraire les enfants sont investis de cette administration provisoire. Voyez bien, avant d'agir, s’il vous convient de donner à vos enfants cette marque de défiance, et de vous faire confier l'administration de ce capital de 40256 liv. st. sans vous en être entendue avec eux. La défiance est bien justifiée. Cependant ce serait un acte grave, et qui élèverait à coup sûr entre Paul et vous, une nouvelle barrière. J'ai peine à croire qu’il soit indispensable pour la sûreté du quart qui vous revient.
Mardi 7 heures
Je n’ai point de nouvelles. La session finit officiellement après-demain. Le Duc et la Duchesse d'Orléans partent pour Bordeaux. Le Roi reste à St. Cloud jusqu’au retour de sa belle-fille. Ils iront alors passer quelques jours au château d’Eu. Puis au commencement d'octobre, quand M. le Duc d'Orléans sera revenu d'Afrique à Fontainebleau. Voilà les projets de cour. Les Ministres n'en font point. Ils attendent l'Orient et la Chambre. Si j'étais à Paris, je saurais bien Vienne par le gendre de M. de St Aulaire M. de Langsdorff qui vient d’arriver en courrier. C'et un jeune homme d'assez d’esprit.
9 h. 1/2
Nous voilà enfin au même pas. Votre 230 m’arrive. Vous aviez des visites à mener en calèche et moi j'en ai trois à recevoir dans mon jardin. Ce sont des voisins qui viennent me demander. à déjeuner. On se lève de bonne heure en Normandie. A Baden aussi ce me semble. Mais à Paris comme à Baden, vous vous levez de bonne heure. Je serai fâché que vous soyez toujours maigre ; mais j’en prendrai mon parti. Mais plus faible, non ; je ne le prendrai pas. Adieu. Adieu. J’ajoute ce que vous voudrez à mille et une. G.
J’ai vérifié nos lois. Sans aucun doute, pour tout ce qui est affaire de procédure, comme dans le cas dont il s’agit, nos lois s'appliquent indifféremment aux étrangers et aux nationaux ; et une Russe ne serait pas envoyée en possession d’un héritage situé en France autrement, ni à d'autres conditions, ni avec d'autres formes qu’un Français. Je suis tout-à-fait porté à croire qu’il en est de même en Angleterre et que votre Conseil général a raison. Mais si je comprends bien ce qu’il vous écrit, la préférence que la loi anglaise donne à la veuve pour l'administration provisoire de la succession, n’est que facultative, c’est-à-dire que cette préférence, n’est accordée à la veuve que si elle la réclame formellement, & que dans le cas contraire les enfants sont investis de cette administration provisoire. Voyez bien, avant d'agir, s’il vous convient de donner à vos enfants cette marque de défiance, et de vous faire confier l'administration de ce capital de 40256 liv. st. sans vous en être entendue avec eux. La défiance est bien justifiée. Cependant ce serait un acte grave, et qui élèverait à coup sûr entre Paul et vous, une nouvelle barrière. J'ai peine à croire qu’il soit indispensable pour la sûreté du quart qui vous revient.
Mardi 7 heures
Je n’ai point de nouvelles. La session finit officiellement après-demain. Le Duc et la Duchesse d'Orléans partent pour Bordeaux. Le Roi reste à St. Cloud jusqu’au retour de sa belle-fille. Ils iront alors passer quelques jours au château d’Eu. Puis au commencement d'octobre, quand M. le Duc d'Orléans sera revenu d'Afrique à Fontainebleau. Voilà les projets de cour. Les Ministres n'en font point. Ils attendent l'Orient et la Chambre. Si j'étais à Paris, je saurais bien Vienne par le gendre de M. de St Aulaire M. de Langsdorff qui vient d’arriver en courrier. C'et un jeune homme d'assez d’esprit.
9 h. 1/2
Nous voilà enfin au même pas. Votre 230 m’arrive. Vous aviez des visites à mener en calèche et moi j'en ai trois à recevoir dans mon jardin. Ce sont des voisins qui viennent me demander. à déjeuner. On se lève de bonne heure en Normandie. A Baden aussi ce me semble. Mais à Paris comme à Baden, vous vous levez de bonne heure. Je serai fâché que vous soyez toujours maigre ; mais j’en prendrai mon parti. Mais plus faible, non ; je ne le prendrai pas. Adieu. Adieu. J’ajoute ce que vous voudrez à mille et une. G.
234. Baden, Mardi 6 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
234 Baden le 6 août 1839
Hier en causant avec Mad. de Talleyand il m’est tout à coup venu à l’idée que si mon frère terminait l’arrangement avec mes fils sans consulter la loi anglaise. Je pourrais me trouver privée des bénéfices de cette loi. On m’a demandé en toute hâte les derniers pleins pouvoirs, je lui ai envoyé en toute hâte aussi sans avoir fait cette réflexion, au contraire, en pensant même qu'il valait mieux que ce ne fût pas par moi qu’on apprit cette disposition de la loi anglaise. L’Esprit m’est venu un peu tard, mais enfin il est venu. J’ai fait venir Bacourt et avec son secours j’ai écrit la lettre dont copie ci jointe que j'ai expédié sur le champ à mon frère. Voilà ce qui m'a pris mon temps, et mes forces. à 4 h. l'idée m’est venue, & à 6 heures ma lettre était à la poste. Voyons dites-moi maintenant ce qui va en suivre ? Si ma lettre arrive après le conclusion de l'acte, est-il possible de faire valoir une droite à la loi anglaise sans une contestation des plus pénibles avec mes fils ! Vous savez que mon frère a plein pouvoir de tout régler, il aura réglé 4ème part du Capital anglais comme des autres. Une fois signé par lui comment revenir sur cet acte ? Le peut-on ? Et Paul n’a-t-il pas le doit de dire : " ce qui est fait et fait, vous deviez y regarder plus tôt. " Moi, je crois et je suis sûre qu'il connaissait la loi anglaise, et je ne puis pas m’empêcher d' en expliquer par ce fait maintenant sa persistance à vouloir mes pleins pouvoirs. Que pensez-vous de tout cela ? Ma lettre à mon frère est-elle bien ? Dites-moi votre idée sur les conséquences dans le cas de la signature de l’acte avant que mon frère ne reçoive ma lettre d’hier. Il faut convenir que j’ai été bien simple ! J’ai un peu envie de vous demander aussi pourquoi vous ne m'avez pas dit de prendre des informations à Londres. Enfin il n’y a plus rien à faire Mais cela me tracasse, et vous savez comme cela me fait du mal d'être tracassée. Est-il possible que des chiffres m'occupent tellement ! Savez-vous que j’en ai quelque honte. Je vous remercie de votre lettre hier, je voudrais en être digne c.a.d. ; avoir la force d’y répondre. Mais vous voyez que je n’ai pas de forces. Il y a de la force dans mon cœur , il y a là dedans tout ce que vous pouvez aimer à y voir soyez en bien sûr, bien sûr. Mais venez voir à quel point je suis accablée, lasse ! Encore une mauvaise nuit, vraiment cela va bien mal. Toutes mes peines de printemps, toutes ces tracasseries, tout cela se dessine fortement sur mes traits, j'ai l'air bien faible, bien faible, & je le suis.
5 heures l’Empereur a écrit au grand duc de Darmstadt, et lui annoncer que son fils va venir passer l'hiver à Darmstadt. Le mariage est parfaitement décidé. Il ne peut pas être question que la Belgique entre dans l’association des douanes d’Allemagne. Il s’agit d’un traité de commerce avec la Belgique, mais il n'y a que les puissances allemandes que puissent être des Zolleverein. Adieu. Adieu.
Je suis impatiente de votre réponse à ce que je vous écris aujourd'hui. C'est une grande question que ceci, et mon idée est que je ne m’en tirerais pas sans procès, si je voulais maintenir mes droits après l’acte signé. Mais quelles seront nos relations avec mes fils qui qu’auraient dépouillé à bon escient ! Adieu, Adieu.
Hier en causant avec Mad. de Talleyand il m’est tout à coup venu à l’idée que si mon frère terminait l’arrangement avec mes fils sans consulter la loi anglaise. Je pourrais me trouver privée des bénéfices de cette loi. On m’a demandé en toute hâte les derniers pleins pouvoirs, je lui ai envoyé en toute hâte aussi sans avoir fait cette réflexion, au contraire, en pensant même qu'il valait mieux que ce ne fût pas par moi qu’on apprit cette disposition de la loi anglaise. L’Esprit m’est venu un peu tard, mais enfin il est venu. J’ai fait venir Bacourt et avec son secours j’ai écrit la lettre dont copie ci jointe que j'ai expédié sur le champ à mon frère. Voilà ce qui m'a pris mon temps, et mes forces. à 4 h. l'idée m’est venue, & à 6 heures ma lettre était à la poste. Voyons dites-moi maintenant ce qui va en suivre ? Si ma lettre arrive après le conclusion de l'acte, est-il possible de faire valoir une droite à la loi anglaise sans une contestation des plus pénibles avec mes fils ! Vous savez que mon frère a plein pouvoir de tout régler, il aura réglé 4ème part du Capital anglais comme des autres. Une fois signé par lui comment revenir sur cet acte ? Le peut-on ? Et Paul n’a-t-il pas le doit de dire : " ce qui est fait et fait, vous deviez y regarder plus tôt. " Moi, je crois et je suis sûre qu'il connaissait la loi anglaise, et je ne puis pas m’empêcher d' en expliquer par ce fait maintenant sa persistance à vouloir mes pleins pouvoirs. Que pensez-vous de tout cela ? Ma lettre à mon frère est-elle bien ? Dites-moi votre idée sur les conséquences dans le cas de la signature de l’acte avant que mon frère ne reçoive ma lettre d’hier. Il faut convenir que j’ai été bien simple ! J’ai un peu envie de vous demander aussi pourquoi vous ne m'avez pas dit de prendre des informations à Londres. Enfin il n’y a plus rien à faire Mais cela me tracasse, et vous savez comme cela me fait du mal d'être tracassée. Est-il possible que des chiffres m'occupent tellement ! Savez-vous que j’en ai quelque honte. Je vous remercie de votre lettre hier, je voudrais en être digne c.a.d. ; avoir la force d’y répondre. Mais vous voyez que je n’ai pas de forces. Il y a de la force dans mon cœur , il y a là dedans tout ce que vous pouvez aimer à y voir soyez en bien sûr, bien sûr. Mais venez voir à quel point je suis accablée, lasse ! Encore une mauvaise nuit, vraiment cela va bien mal. Toutes mes peines de printemps, toutes ces tracasseries, tout cela se dessine fortement sur mes traits, j'ai l'air bien faible, bien faible, & je le suis.
5 heures l’Empereur a écrit au grand duc de Darmstadt, et lui annoncer que son fils va venir passer l'hiver à Darmstadt. Le mariage est parfaitement décidé. Il ne peut pas être question que la Belgique entre dans l’association des douanes d’Allemagne. Il s’agit d’un traité de commerce avec la Belgique, mais il n'y a que les puissances allemandes que puissent être des Zolleverein. Adieu. Adieu.
Je suis impatiente de votre réponse à ce que je vous écris aujourd'hui. C'est une grande question que ceci, et mon idée est que je ne m’en tirerais pas sans procès, si je voulais maintenir mes droits après l’acte signé. Mais quelles seront nos relations avec mes fils qui qu’auraient dépouillé à bon escient ! Adieu, Adieu.
237. Val-Richer, Mercredi 7 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
237 Du Val-Richer. Mercredi 7 août 1839 6 heures
Je ne sais comment s’est passée ma journée d’hier. Je ne vous ai rien dit. Je me lève de bonne heure pour combler cette lacune. J'en reviens toujours à Titus et Bérénice. Il faut que ce soit bien beau pour qu’on y retrouve sans cesse son propre cœur. Les belles choses écrites s'usent-elles rapidement pour vous, comme les choses de la vie courante ! Prenez-vous plaisir à relire ce que vous avez admiré ? Pour moi, je suis fidèle et inépuisable dans l'admiration. J'y rentre avec délices, et je découvre toujours de nouvelles beautés, des perspectives inconnues. Je relis à l'infini. Le nouveau ne manque jamais dans l'infini. Voilà une phrase bien allemande. Elle est pourtant vraie. Et mon pourtant est bien insolent, n’est-ce pas, bien français ?
Vous a-t-on jamais dit le mot de l'Empereur Napoléon à M. de Caulaincourt qui lui parlait des désastres de la retraite de Russie. " On a fort exagéré les pertes, lui dit l'Empereur ; voyons donc, que je me rappelle. Cinquante mille, cent mille, deux cent mille... Oh mais il y avait là bien des Allemands. "
Dieu me pardonne d'envoyer une pareille anecdote au delà du Rhin ! J’ai tort. Je dois beaucoup à l'Allemagne. D'abord, je lui dois vous, qui n'en êtes guère, d’esprit du moins. Je lui dois une partie du mien. De 20 à 25 ans j'ai beaucoup étudié la littérature allemande et beaucoup appris de cette étude ; appris non seulement, matériellement mais moralement. Il m'est venu de là beaucoup d’idées, des jours nouveaux sur toutes choses, une certaine façon de les considérer qu’on ne trouve point ailleurs, notamment en France. Au fait, c’est une sottise de laisser pénétrer dans son jugement sur un grand peuple le moindre sentiment de dédain, je dirai plus d'orgueil national. Ils ont tous, par cela seul qu’ils ont beaucoup fait et joué un grand rôle en ce monde, de quoi mériter l’attention l'estime, le respect des plus grands esprits. Et il y a toujours dans un tel dédain, infiniment plus d'ignorance & d'irréflexion que de supériorité.
Convenez que Méhémet est un homme supérieur. Je suis charmé de ses notes à nos consuls de la forme comme du fond. Il y a beaucoup de grandeur et de mesure. Belle alliance. Nous verrons comment il dénouera sa situation à Constantinople. Il a bien commencé. Il tient la flotte et parle tout haut à son parti dans tout l'Empire turc. Je me rappelle qu’en 1833 il nous revenait fort d'Orient qu’il avait un grand parti à Constantinople, et que, s’il voulait il y exciterait une sédition très dangereuse pour Mahmoud. Il ne voulut pas. Ménagera-t-il autant Khosrer Pacha ? Avez-vous lu dans le journal des Débats la relation du couronnement du Sultan ? C'est assez intéressant. Elle est d’un M. Herbat, un jeune homme que j’avais près de mois au Ministère de l’Instruction publique et qui m’était si attaché que sous le 14 avril, M. Molé enjoignit à M. de Salvandy de le destituer. Il est parti pour l'Orient avec M. Jaubert à qui je l’ai recommandé. Et pendant qu’il voyait passer Abdul. Medgid dans les rues de Constantinople je lui ai fait rendre à Paris la place qu'on lui avait ôtée. Il la trouvera à son retour. Ce sera quelque jour mon Génie second, ou mon second Génie, comme vous voudrez.
9 heures et demie
Je ne sais pas quelles nouvelles on a d'Orient : mais on en a ! Je ne sais pas, ce que les Ministres ont demandé au Roi ; mais ils lui ont demandé quelque chose que le Roi a refusé Trois consuls ont été tenus dans la journée d’hier. Les ministres ont offert leur démission. Alors le Roi a consenti. Il n’a probablement été demandé et consenti, rien de bien grave. Mais enfin je vous donne ce que je sais. Adieu Adieu. L'heure me presse. G.
Je ne sais comment s’est passée ma journée d’hier. Je ne vous ai rien dit. Je me lève de bonne heure pour combler cette lacune. J'en reviens toujours à Titus et Bérénice. Il faut que ce soit bien beau pour qu’on y retrouve sans cesse son propre cœur. Les belles choses écrites s'usent-elles rapidement pour vous, comme les choses de la vie courante ! Prenez-vous plaisir à relire ce que vous avez admiré ? Pour moi, je suis fidèle et inépuisable dans l'admiration. J'y rentre avec délices, et je découvre toujours de nouvelles beautés, des perspectives inconnues. Je relis à l'infini. Le nouveau ne manque jamais dans l'infini. Voilà une phrase bien allemande. Elle est pourtant vraie. Et mon pourtant est bien insolent, n’est-ce pas, bien français ?
Vous a-t-on jamais dit le mot de l'Empereur Napoléon à M. de Caulaincourt qui lui parlait des désastres de la retraite de Russie. " On a fort exagéré les pertes, lui dit l'Empereur ; voyons donc, que je me rappelle. Cinquante mille, cent mille, deux cent mille... Oh mais il y avait là bien des Allemands. "
Dieu me pardonne d'envoyer une pareille anecdote au delà du Rhin ! J’ai tort. Je dois beaucoup à l'Allemagne. D'abord, je lui dois vous, qui n'en êtes guère, d’esprit du moins. Je lui dois une partie du mien. De 20 à 25 ans j'ai beaucoup étudié la littérature allemande et beaucoup appris de cette étude ; appris non seulement, matériellement mais moralement. Il m'est venu de là beaucoup d’idées, des jours nouveaux sur toutes choses, une certaine façon de les considérer qu’on ne trouve point ailleurs, notamment en France. Au fait, c’est une sottise de laisser pénétrer dans son jugement sur un grand peuple le moindre sentiment de dédain, je dirai plus d'orgueil national. Ils ont tous, par cela seul qu’ils ont beaucoup fait et joué un grand rôle en ce monde, de quoi mériter l’attention l'estime, le respect des plus grands esprits. Et il y a toujours dans un tel dédain, infiniment plus d'ignorance & d'irréflexion que de supériorité.
Convenez que Méhémet est un homme supérieur. Je suis charmé de ses notes à nos consuls de la forme comme du fond. Il y a beaucoup de grandeur et de mesure. Belle alliance. Nous verrons comment il dénouera sa situation à Constantinople. Il a bien commencé. Il tient la flotte et parle tout haut à son parti dans tout l'Empire turc. Je me rappelle qu’en 1833 il nous revenait fort d'Orient qu’il avait un grand parti à Constantinople, et que, s’il voulait il y exciterait une sédition très dangereuse pour Mahmoud. Il ne voulut pas. Ménagera-t-il autant Khosrer Pacha ? Avez-vous lu dans le journal des Débats la relation du couronnement du Sultan ? C'est assez intéressant. Elle est d’un M. Herbat, un jeune homme que j’avais près de mois au Ministère de l’Instruction publique et qui m’était si attaché que sous le 14 avril, M. Molé enjoignit à M. de Salvandy de le destituer. Il est parti pour l'Orient avec M. Jaubert à qui je l’ai recommandé. Et pendant qu’il voyait passer Abdul. Medgid dans les rues de Constantinople je lui ai fait rendre à Paris la place qu'on lui avait ôtée. Il la trouvera à son retour. Ce sera quelque jour mon Génie second, ou mon second Génie, comme vous voudrez.
9 heures et demie
Je ne sais pas quelles nouvelles on a d'Orient : mais on en a ! Je ne sais pas, ce que les Ministres ont demandé au Roi ; mais ils lui ont demandé quelque chose que le Roi a refusé Trois consuls ont été tenus dans la journée d’hier. Les ministres ont offert leur démission. Alors le Roi a consenti. Il n’a probablement été demandé et consenti, rien de bien grave. Mais enfin je vous donne ce que je sais. Adieu Adieu. L'heure me presse. G.
235. Baden, Mercredi 7 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
235 Baden le 7 août 1839
Hier ne m’a pas apporté de lettre de vous. Sans doute c’est le dentiste de Caen qui me l'a enlevée en même temps que les dents de lait de vos filles. Nous avons eu bien froid hier. Ce n’est pas un bel été, et dans le moment je crois que nous sommes entrés en automne. Le prince Guillaume de Prusse fils du Roi, est arrivé hier. C'est le seul de ces princes qui ait de la tenue et un très bon esprit. Il vient de Darmstadt. Il est charmée de Notre future impératrice, mais il critique le choix pour tout ce qui n’est pas sa personne. Il m’a parlé avec peu de goût du mariage Leinchtemberg nous n'avons encore causé que de cela. M. de Jennison sera rappelé pour s’être mêlé de vouloir faire un mariage pour le prince royal avec la princesse Clémentine.
2 heures Le prince Guillaume est venu me faire une longue visite nous avons parlé de choses sérieuses. Il a un très bon esprit qui me plait. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Dites-moi quelles sont les mesures à prendre pour faire entrer en France mes effets. J'espère qu’ils pourront encore m'être expédiés par la présente navigation si le partage est fait. Je n’en ai pas la nouvelle mais je ne puis pas en douter. 5 heures Je reçois en même temps votre N°233 et la lettre de Caen.
Je remarque l’immense différence de l'éducation française et anglaise, à propos des dents de vos enfants. En Angleterre on ôte aux enfants quatre dents par séance, cela n'occupe ni les parents, ni les enfants Ils reviennent bien contents car on leur donne une guinée par dent c’est l'usage. Et tout se passe gaiement et sur tout facilement. Le fait est que les dentistes Anglais sont très habiles et que les vôtres font sans doute de cela une tragédie. Au reste vous devez savoir que ce n’est pas une souffrance pour les enfants. Et moi même en Angleterre. Je me souviens de m'être fait ôter mes dents à ma toilette et d’avoir paru à dîner chez le Roi une heure après sans me trouver un grand mérite à ce fait. Je crois que les sensations se mesurent sur les précédents. Nous sommes excessivement des singes. Ne pensez-vous pas cela un peu ? Quelle longue dissertation sur les dents. Est-ce que nous n’avons rien à nous dire. Voulez-vous encore une observation ? L'anglais en général est plus fort à la douleur qui tout autre nation. Vous seriez fort content d'observer les Anglais sous ce rapport à tous les âges. Leur éducation physique est admirable.
Adieu, Adieu. Voilà de ces lettres (ma lettre) qui me paraissent ne pas valoir la peine d'être envoyées, mais savez-vous pour quoi je l'envoie ? Uniquement pour ceci adieu. P.S. L'écho français dit que vous vouliez épouser Mad. de Stael parce qu’elle est riche, que vous aviez chargé M. de Broglie de votre procuration. Mais qu'il l’épouse pour son compte, & qu’en conséquence vous êtes brouillé avec lui.
Hier ne m’a pas apporté de lettre de vous. Sans doute c’est le dentiste de Caen qui me l'a enlevée en même temps que les dents de lait de vos filles. Nous avons eu bien froid hier. Ce n’est pas un bel été, et dans le moment je crois que nous sommes entrés en automne. Le prince Guillaume de Prusse fils du Roi, est arrivé hier. C'est le seul de ces princes qui ait de la tenue et un très bon esprit. Il vient de Darmstadt. Il est charmée de Notre future impératrice, mais il critique le choix pour tout ce qui n’est pas sa personne. Il m’a parlé avec peu de goût du mariage Leinchtemberg nous n'avons encore causé que de cela. M. de Jennison sera rappelé pour s’être mêlé de vouloir faire un mariage pour le prince royal avec la princesse Clémentine.
2 heures Le prince Guillaume est venu me faire une longue visite nous avons parlé de choses sérieuses. Il a un très bon esprit qui me plait. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Dites-moi quelles sont les mesures à prendre pour faire entrer en France mes effets. J'espère qu’ils pourront encore m'être expédiés par la présente navigation si le partage est fait. Je n’en ai pas la nouvelle mais je ne puis pas en douter. 5 heures Je reçois en même temps votre N°233 et la lettre de Caen.
Je remarque l’immense différence de l'éducation française et anglaise, à propos des dents de vos enfants. En Angleterre on ôte aux enfants quatre dents par séance, cela n'occupe ni les parents, ni les enfants Ils reviennent bien contents car on leur donne une guinée par dent c’est l'usage. Et tout se passe gaiement et sur tout facilement. Le fait est que les dentistes Anglais sont très habiles et que les vôtres font sans doute de cela une tragédie. Au reste vous devez savoir que ce n’est pas une souffrance pour les enfants. Et moi même en Angleterre. Je me souviens de m'être fait ôter mes dents à ma toilette et d’avoir paru à dîner chez le Roi une heure après sans me trouver un grand mérite à ce fait. Je crois que les sensations se mesurent sur les précédents. Nous sommes excessivement des singes. Ne pensez-vous pas cela un peu ? Quelle longue dissertation sur les dents. Est-ce que nous n’avons rien à nous dire. Voulez-vous encore une observation ? L'anglais en général est plus fort à la douleur qui tout autre nation. Vous seriez fort content d'observer les Anglais sous ce rapport à tous les âges. Leur éducation physique est admirable.
Adieu, Adieu. Voilà de ces lettres (ma lettre) qui me paraissent ne pas valoir la peine d'être envoyées, mais savez-vous pour quoi je l'envoie ? Uniquement pour ceci adieu. P.S. L'écho français dit que vous vouliez épouser Mad. de Stael parce qu’elle est riche, que vous aviez chargé M. de Broglie de votre procuration. Mais qu'il l’épouse pour son compte, & qu’en conséquence vous êtes brouillé avec lui.
Mots-clés : Interculturalisme, Pédagogie, Politique (Russie), Santé (enfants Guizot)
238 . Val -Richer, Mercredi 7 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
238 Du Val Richer, Mercredi soir 7 août 1839 9 heures
Nous ne nous entendons pas sur la lettre du Consul général de Russie. Relisez la bien. Je viens de la relire. Je n’y vois pour vous aucune augmentation réelle, et permanente de fortune. Mais seulement le droit de recevoir de préférence à vos fils, l'administration des biens du feu Prince de Lieven en Angleterre, puisqu'il est mort sans testament. Ce qui veut dire que vous seule, par vous-même ou par votre fondé de pouvoir vous pourrez recevoir le capital de 40256 L. St., et qu’il restera entre vos mains jusqu'à ce que la propriété définitive, en soit partagée conformément aux lois Russes qui régleront la succession du Prince de Lieven, mais nullement que cette propriété vous soit acquise à vous. La capital se partagera, qu’il soit en vos mains ou en d'autres, et s’il est entre vos mains vous aurez à en rendre compte au moment du partage. Je vois, dans cette loi Anglaise, une marque de déférence et une sûreté données à la veuve, rien de plus. Il y a peut-être là de ma part quelque grosse ignorance quelque bévue étrange. Je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais je ne découvre pas par où. D'autant que le sens qui m’apparaît dans la lettre du consul est d'accord avec les principes généraux du droit qui veulent que les formes de procéder en matière de succession, comme l'envoi en possession, la régie provisoire en soient réglées par la loi du pays où les biens sont situés et le fond même de la succession, c-à-d le partage des biens et l’attribution définitive de la propriété, par la loi du pays auquel les intéressés appartiennent. Nous avons là vous au moi, quelque chose à éclaircir. Je vous ai dit ce matin l'embryon de nouvelle qui m’arrivait. Je ne vous ai mandé et ne vous mande jamais rien que de source. Mais l’eau est trouble quelques fois même à la source.
Le travail qui se fait sur plusieurs points en occident comme en orient, au profit de l’Egyptien, est empreint dans les nouvelles que je vous avais transmises. Vous voyez que Bulwer aussi croit au succès. Thiers ne passe que peu de jours à Paris et s'en va à Lille pour deux ou trois mois. Il se montre assez dégagé de la politique et sérieusement occupé de son livre, ses ressentiments contre MM. Passy et Dufaure paraissent presque aussi vifs qu’à leur origine. Il est embarrassé et ennuyé de la réforme électorale sans oser se prononcer contre. Il ne croit pas à un changement de Cabinet avant la session. Sa politique pour l'orient est très belliqueuse, et il répète à tout venant que le Cabinet ne peut absolument rien faire dans cette question. Je suis curieux de savoir si les trois conseils d’hier lui donneront un démenti.
Jeudi 9 heures
C'est rue Lascazes et non rue Belle-Chasse qu’est situé le petit hôtel dont je vous ai parlé. Je vais écrire qu’on le visite avec soin. J’ai peine à croire qu’il soit neuf, puisque M. de Crussot l’habitait naguère. Cependant c'est possible et vous aurez grand tort d'entrer dans des plâtres neufs. Il est vrai qu’il n’y a rue St Florentin qu’un bien petit salon. Felix et Mad. de Nesselrode à la fois, c’est beaucoup Fétix s'ennuie peut-être aussi, non pas de vous, mais de Baden, de ce qui n’est pas Paris. Il a l’air d’un garçon, très Parisien. J’en suis fâché. Vous y étiez accoutumée Pas de nouvelles ce matin. Adieu Adieu. G.
Nous ne nous entendons pas sur la lettre du Consul général de Russie. Relisez la bien. Je viens de la relire. Je n’y vois pour vous aucune augmentation réelle, et permanente de fortune. Mais seulement le droit de recevoir de préférence à vos fils, l'administration des biens du feu Prince de Lieven en Angleterre, puisqu'il est mort sans testament. Ce qui veut dire que vous seule, par vous-même ou par votre fondé de pouvoir vous pourrez recevoir le capital de 40256 L. St., et qu’il restera entre vos mains jusqu'à ce que la propriété définitive, en soit partagée conformément aux lois Russes qui régleront la succession du Prince de Lieven, mais nullement que cette propriété vous soit acquise à vous. La capital se partagera, qu’il soit en vos mains ou en d'autres, et s’il est entre vos mains vous aurez à en rendre compte au moment du partage. Je vois, dans cette loi Anglaise, une marque de déférence et une sûreté données à la veuve, rien de plus. Il y a peut-être là de ma part quelque grosse ignorance quelque bévue étrange. Je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais je ne découvre pas par où. D'autant que le sens qui m’apparaît dans la lettre du consul est d'accord avec les principes généraux du droit qui veulent que les formes de procéder en matière de succession, comme l'envoi en possession, la régie provisoire en soient réglées par la loi du pays où les biens sont situés et le fond même de la succession, c-à-d le partage des biens et l’attribution définitive de la propriété, par la loi du pays auquel les intéressés appartiennent. Nous avons là vous au moi, quelque chose à éclaircir. Je vous ai dit ce matin l'embryon de nouvelle qui m’arrivait. Je ne vous ai mandé et ne vous mande jamais rien que de source. Mais l’eau est trouble quelques fois même à la source.
Le travail qui se fait sur plusieurs points en occident comme en orient, au profit de l’Egyptien, est empreint dans les nouvelles que je vous avais transmises. Vous voyez que Bulwer aussi croit au succès. Thiers ne passe que peu de jours à Paris et s'en va à Lille pour deux ou trois mois. Il se montre assez dégagé de la politique et sérieusement occupé de son livre, ses ressentiments contre MM. Passy et Dufaure paraissent presque aussi vifs qu’à leur origine. Il est embarrassé et ennuyé de la réforme électorale sans oser se prononcer contre. Il ne croit pas à un changement de Cabinet avant la session. Sa politique pour l'orient est très belliqueuse, et il répète à tout venant que le Cabinet ne peut absolument rien faire dans cette question. Je suis curieux de savoir si les trois conseils d’hier lui donneront un démenti.
Jeudi 9 heures
C'est rue Lascazes et non rue Belle-Chasse qu’est situé le petit hôtel dont je vous ai parlé. Je vais écrire qu’on le visite avec soin. J’ai peine à croire qu’il soit neuf, puisque M. de Crussot l’habitait naguère. Cependant c'est possible et vous aurez grand tort d'entrer dans des plâtres neufs. Il est vrai qu’il n’y a rue St Florentin qu’un bien petit salon. Felix et Mad. de Nesselrode à la fois, c’est beaucoup Fétix s'ennuie peut-être aussi, non pas de vous, mais de Baden, de ce qui n’est pas Paris. Il a l’air d’un garçon, très Parisien. J’en suis fâché. Vous y étiez accoutumée Pas de nouvelles ce matin. Adieu Adieu. G.
236. Baden, Jeudi 8 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
236 Baden Jeudi le 8 août 1839
Vous n’aurez qu’un mot aujourd’hui. Je suis encore pressée d'écritures. Le Prince Meschersky part demain soir pour Pétersbourg. Je le charge de beaucoup. de choses pour mon frère, pour mon banquier, pour Alexandre. Il peut encore m'être d’une grande utilité dans mes affaires si elles ne sont pas irrévocablement conclues. Vous ne sauriez concevoir tout ce qui peut encore se présenter de confusion d'ici à peu de semaines. Que n’êtes-vous là pour me conseiller ! Je cause beaucoup avec le Prince Guillaume, et sur toutes choses, excepté ma personne dont je ne parle pas. Nous nous trouvons d’accord surtout, dans ces cas-là vous savez qu'on trouve toujours du mérite à la personne avec qui on parle ! C’est drôle, mais nous sommes tous plein de vanité. On dit qu'il y a un tas de Polonais fort, remuant ici. Le Prince Jérôme de Montfort qui est un sot à de mauvaises histoires aussi. On a découvert une certaine lettre adressée à lui par quelques français mécontents. J’espère que ce pauvre petit sot ne va pas faire une seconde édition de Strasbourg.
J’ai vu une lettre de Vienne aujourd'hui qui dit que le Prince Metternich est extrêmement troublé des affaires d’Orient. Il y a des courriers quotidiens presque, entre Vienne & Londres. La déclaration de Méhémet Ali à la Turquie est bien insolemment respectueux. Cet homme doit avoir beaucoup d’esprit. " Je maintiendrai, et j’attendrai " !
5 heures Votre n° 235 est triste, triste pour moi, contre moi ; je ne sais mais il m’afflige, il y a même un mot en seul mot qui me blesse. Je suis bien inquiète, car je suis sûre que je vous ai dit souvent plus que cela, & vous m’avez pardonné. Pardonnez, pardonnez toujours, pardonnez tout, car je suis faible et malheureuse. Je n'ai que vous pour me soutenir. Soutenez-moi et pardonnez-moi tout. Ah si je pouvais vous voir ! Que de fois je profère ce stérile vœu. Adieu. L’Empereur reste à Pétersbourg. Les journaux disent des bêtises. Il ira à la revue de 160 000 hommes à Borodino voilà tout. Il y dépensera 20 millions en fêtes et tuera quelques chevaux de poste en courant. Adieu. Adieu. Adieu.
Vous n’aurez qu’un mot aujourd’hui. Je suis encore pressée d'écritures. Le Prince Meschersky part demain soir pour Pétersbourg. Je le charge de beaucoup. de choses pour mon frère, pour mon banquier, pour Alexandre. Il peut encore m'être d’une grande utilité dans mes affaires si elles ne sont pas irrévocablement conclues. Vous ne sauriez concevoir tout ce qui peut encore se présenter de confusion d'ici à peu de semaines. Que n’êtes-vous là pour me conseiller ! Je cause beaucoup avec le Prince Guillaume, et sur toutes choses, excepté ma personne dont je ne parle pas. Nous nous trouvons d’accord surtout, dans ces cas-là vous savez qu'on trouve toujours du mérite à la personne avec qui on parle ! C’est drôle, mais nous sommes tous plein de vanité. On dit qu'il y a un tas de Polonais fort, remuant ici. Le Prince Jérôme de Montfort qui est un sot à de mauvaises histoires aussi. On a découvert une certaine lettre adressée à lui par quelques français mécontents. J’espère que ce pauvre petit sot ne va pas faire une seconde édition de Strasbourg.
J’ai vu une lettre de Vienne aujourd'hui qui dit que le Prince Metternich est extrêmement troublé des affaires d’Orient. Il y a des courriers quotidiens presque, entre Vienne & Londres. La déclaration de Méhémet Ali à la Turquie est bien insolemment respectueux. Cet homme doit avoir beaucoup d’esprit. " Je maintiendrai, et j’attendrai " !
5 heures Votre n° 235 est triste, triste pour moi, contre moi ; je ne sais mais il m’afflige, il y a même un mot en seul mot qui me blesse. Je suis bien inquiète, car je suis sûre que je vous ai dit souvent plus que cela, & vous m’avez pardonné. Pardonnez, pardonnez toujours, pardonnez tout, car je suis faible et malheureuse. Je n'ai que vous pour me soutenir. Soutenez-moi et pardonnez-moi tout. Ah si je pouvais vous voir ! Que de fois je profère ce stérile vœu. Adieu. L’Empereur reste à Pétersbourg. Les journaux disent des bêtises. Il ira à la revue de 160 000 hommes à Borodino voilà tout. Il y dépensera 20 millions en fêtes et tuera quelques chevaux de poste en courant. Adieu. Adieu. Adieu.
239. Val-Richer, Vendredi 9 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
239 Du Val Richer, vendredi 9 août 1839 7 heures
Il n'y a de repos nulle part. Hier, il a fallu me promener toute la journée avec des visiteurs. Aujourd’hui dès que j'aurai déjeuné, je vais à deux lieues d’ici voir les jardins de deux de mes voisins qui m’ont envoyé je ne sais combien de belles fleurs. Le voisinage et la reconnaissance, deux lourds fardeaux. Hier pourtant, parmi les visites, une était assez agréable, la fille du général Caffarelli qui a épousé le receveur des finances de Lisieux, femme d’esprit et de bonne compagnie, qui s'ennuie beaucoup à Lisieux, et paraissait se plaire fort au Val-Richer. Elle m'a amené ses enfants avec qui les miens se sont parfaitement amusés, son mari est un de mes principaux Leaders d’élections. Tout cela me dérange.
Du déjeuner au dîner, j’aime à passer la matinée enfermé dans mon Cabinet. Je lis beaucoup j'écris. Je descends deux ou trois fois dans le jardin. Je me promène cinq minutes. Je remonte. De la solitude, de la liberté, l’esprit occupé, mes enfants pour société et récréation, la journée s’écoule doucement, comme une eau claire, et peu profonde. Le soir quand je n’ai personne, nous nous réunissons dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode, et de 8 à 9 heures jusqu’à ce que mes enfants se couchent, je leur fais une lecture. Nous achèverons ce soir Ville Hardouin, la conquête de Constantinople par les Français au 13e siècle. Sans allusion ni préméditation de ma part. Nous prendrons demain Joinville, St Louis. Je ferai passer ainsi sous leurs yeux les mémoires originaux et intéressants de l'histoire de France. Je m’arrête en lisant; j'explique je commente, j’écoute. Cela leur plait fort. Et puis, pour grand divertissement, j’interromps quelquefois nos lectures historiques par un roman de Walter-Scott ou une pièce du théâtre Français. En fait de lectures amusantes, je n'en connais point de plus saines pour des enfants et qui leur laissent dans l’âme des impressions plus justes et plus honnêtes que Scott. Racine, Corneille et Molière, un peu choisi. Je n'ai avec mes enfants point d'apprêt, ni de pruderie ; je ne prétends pas arranger toutes choses autour d'eux, de telle sorte qu’ils ignorent le monde et ses imperfections, et ses mélanges jusqu'au moment où ils y seront jetés. Mais je veux que leur esprit se nourrisse d'excellents aliments, comme leur corps de bon pain et de bon bœuf. L’atmosphère et le régime, c'est l’éducation morale comme physique. Je veille beaucoup à cela, et puis de la liberté, beaucoup de liberté. Cela m’avait admirablement réussi.
Il faut en effet que Félix soit fou. Du reste les maîtres n'ont pas le privilège de l’ennui. C’est la seule explication qui me soit venue à l'esprit hier. Elle m’y revient aujourd'hui. Elle vous fait peu d’honneur, et Félix n'est pas Russe. J'espère encore que ce n’est pas fini, et que vous me direz qu’il est resté. Vous dîtes donc que vous serez à Paris en septembre au commencement même. Cela me fait battre le cœur. Pour y rester ou pour aller à Londres ? Si vous le savez, dites le moi.
J’écris aujourd'hui pour faire examiner à fond, la rue Lascazes. Si vos fils sont pressés de retourner à leur poste, Alexandre ne viendrait-il pas vous voir à Baden, selon vos premiers projets ?
9 h. 1/2
Je suis charmé que Félix vous reste. Je n'avais pas pensé à l'ivresse. Et charmé aussi que vous alliez à l'hôtel Talleyrand. Le 1er étage vous convient à merveille. Adieu. Adieu. Quand tout le monde espère toutes les espérances sont des gasconnades. Je n’avais pas naturellement de pente aux gasconnades. Trop encore. On est toujours un peu de son pays. Vous m'en avez guéri tout-à-fait. Je vous en remercie. Adieu. Adieu. G.
Il n'y a de repos nulle part. Hier, il a fallu me promener toute la journée avec des visiteurs. Aujourd’hui dès que j'aurai déjeuné, je vais à deux lieues d’ici voir les jardins de deux de mes voisins qui m’ont envoyé je ne sais combien de belles fleurs. Le voisinage et la reconnaissance, deux lourds fardeaux. Hier pourtant, parmi les visites, une était assez agréable, la fille du général Caffarelli qui a épousé le receveur des finances de Lisieux, femme d’esprit et de bonne compagnie, qui s'ennuie beaucoup à Lisieux, et paraissait se plaire fort au Val-Richer. Elle m'a amené ses enfants avec qui les miens se sont parfaitement amusés, son mari est un de mes principaux Leaders d’élections. Tout cela me dérange.
Du déjeuner au dîner, j’aime à passer la matinée enfermé dans mon Cabinet. Je lis beaucoup j'écris. Je descends deux ou trois fois dans le jardin. Je me promène cinq minutes. Je remonte. De la solitude, de la liberté, l’esprit occupé, mes enfants pour société et récréation, la journée s’écoule doucement, comme une eau claire, et peu profonde. Le soir quand je n’ai personne, nous nous réunissons dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode, et de 8 à 9 heures jusqu’à ce que mes enfants se couchent, je leur fais une lecture. Nous achèverons ce soir Ville Hardouin, la conquête de Constantinople par les Français au 13e siècle. Sans allusion ni préméditation de ma part. Nous prendrons demain Joinville, St Louis. Je ferai passer ainsi sous leurs yeux les mémoires originaux et intéressants de l'histoire de France. Je m’arrête en lisant; j'explique je commente, j’écoute. Cela leur plait fort. Et puis, pour grand divertissement, j’interromps quelquefois nos lectures historiques par un roman de Walter-Scott ou une pièce du théâtre Français. En fait de lectures amusantes, je n'en connais point de plus saines pour des enfants et qui leur laissent dans l’âme des impressions plus justes et plus honnêtes que Scott. Racine, Corneille et Molière, un peu choisi. Je n'ai avec mes enfants point d'apprêt, ni de pruderie ; je ne prétends pas arranger toutes choses autour d'eux, de telle sorte qu’ils ignorent le monde et ses imperfections, et ses mélanges jusqu'au moment où ils y seront jetés. Mais je veux que leur esprit se nourrisse d'excellents aliments, comme leur corps de bon pain et de bon bœuf. L’atmosphère et le régime, c'est l’éducation morale comme physique. Je veille beaucoup à cela, et puis de la liberté, beaucoup de liberté. Cela m’avait admirablement réussi.
Il faut en effet que Félix soit fou. Du reste les maîtres n'ont pas le privilège de l’ennui. C’est la seule explication qui me soit venue à l'esprit hier. Elle m’y revient aujourd'hui. Elle vous fait peu d’honneur, et Félix n'est pas Russe. J'espère encore que ce n’est pas fini, et que vous me direz qu’il est resté. Vous dîtes donc que vous serez à Paris en septembre au commencement même. Cela me fait battre le cœur. Pour y rester ou pour aller à Londres ? Si vous le savez, dites le moi.
J’écris aujourd'hui pour faire examiner à fond, la rue Lascazes. Si vos fils sont pressés de retourner à leur poste, Alexandre ne viendrait-il pas vous voir à Baden, selon vos premiers projets ?
9 h. 1/2
Je suis charmé que Félix vous reste. Je n'avais pas pensé à l'ivresse. Et charmé aussi que vous alliez à l'hôtel Talleyrand. Le 1er étage vous convient à merveille. Adieu. Adieu. Quand tout le monde espère toutes les espérances sont des gasconnades. Je n’avais pas naturellement de pente aux gasconnades. Trop encore. On est toujours un peu de son pays. Vous m'en avez guéri tout-à-fait. Je vous en remercie. Adieu. Adieu. G.
237. Baden, Vendredi 9 août 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
237 Baden le 9 août 1839 5 heures
J’ai passé ma matinée en écritures. Je leur ai même sacrifié mon sommeil de midi et ce n’est que dans ce moment-ci que je pense venir à vous. Montront m'a fait la désagréable surprise de partir ce matin. Il s’est fort ennuyé à Bade. Il dit que moi j’y faire des parties de dormir, que Mad. de Talleyrand qui a un très bon cuisinier s'enferme avec lui à double tour, qu'on mange horriblement ici, que pour voir les gens il faut se lever à 6 heures du matin, tandis que c'est alors ordinairement qu'on les quitte, qu’il y a trop de Princes, et puis qu’on lui vole son argent dans sa poche. C'est vrai, hier en plein salon on y a pris 16 Louis. Tout cela ensemble fait qu'il s'en est allé, il dit qu’il trouvera bien plus de connaissances au café de paris.
L’Autriche et la Prusse donnent raison au roi de Hanovre et lui accordent de retourner à la constitution de l'année 1819. La Diète va aller aux voix, et la majorité pour lui. Les états constitutionnels voteront contre. La lettre de M. St Marc Girardin dans le Journal du Débats du 6 est très bien faite. Je cause beaucoup avec le Prince Guillaume, et il me plait toujours davantage, des lettres de Constantinople du 23 juillet disent que les restes de l’armée Turque se sont débandés. Il n’y a plus de troupes dans l’Empire ottoman que 3 régiments à Constantinople !
Voici votre N°236. Je vous remercie de vos observations sur le Capital. Il me semble que mes interrogations à Bulkhausen sont si précises qui je ne puis pas m’être compromise. Voici la copie, dites-moi si je dois l'envoyer à mon frère. Il est clair que s'il n’y a que moi qui peux lever le Capital, qu'il m’appartient en entier ou qu’il ne m’en revient que le quart l’opération est toujours la même. Adieu. Adieu.
J’ai passé ma matinée en écritures. Je leur ai même sacrifié mon sommeil de midi et ce n’est que dans ce moment-ci que je pense venir à vous. Montront m'a fait la désagréable surprise de partir ce matin. Il s’est fort ennuyé à Bade. Il dit que moi j’y faire des parties de dormir, que Mad. de Talleyrand qui a un très bon cuisinier s'enferme avec lui à double tour, qu'on mange horriblement ici, que pour voir les gens il faut se lever à 6 heures du matin, tandis que c'est alors ordinairement qu'on les quitte, qu’il y a trop de Princes, et puis qu’on lui vole son argent dans sa poche. C'est vrai, hier en plein salon on y a pris 16 Louis. Tout cela ensemble fait qu'il s'en est allé, il dit qu’il trouvera bien plus de connaissances au café de paris.
L’Autriche et la Prusse donnent raison au roi de Hanovre et lui accordent de retourner à la constitution de l'année 1819. La Diète va aller aux voix, et la majorité pour lui. Les états constitutionnels voteront contre. La lettre de M. St Marc Girardin dans le Journal du Débats du 6 est très bien faite. Je cause beaucoup avec le Prince Guillaume, et il me plait toujours davantage, des lettres de Constantinople du 23 juillet disent que les restes de l’armée Turque se sont débandés. Il n’y a plus de troupes dans l’Empire ottoman que 3 régiments à Constantinople !
Voici votre N°236. Je vous remercie de vos observations sur le Capital. Il me semble que mes interrogations à Bulkhausen sont si précises qui je ne puis pas m’être compromise. Voici la copie, dites-moi si je dois l'envoyer à mon frère. Il est clair que s'il n’y a que moi qui peux lever le Capital, qu'il m’appartient en entier ou qu’il ne m’en revient que le quart l’opération est toujours la même. Adieu. Adieu.
240. Val -Richer, Samedi 10 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
240 Du Val Richer, samedi 10 août 1839 6 heures et demie
J’ai fait hier ma visite de jardins, d’un côté que je ne connaissais pas. Le pays est très joli une succession de vallées toujours fraîches et riantes. J’ai admiré les ressources, les expédients de l'activité humaine. Evidemment les deux voisins que j’ai été voir s'ennuient beaucoup ; personne à voir et rien à faire. Ils ont reporté sur les fleurs toutes les passions de la vie. Ils sont ambitieux, avares curieux, jaloux. Il réussissent à remplir leur temps, et je crois, en vérité leur âme. Cependant il y en a un qui emprunte à ma bibliothèque des livres de chimie. Les fleurs ne lui suffisent pas. Il joindra un laboratoire à sa serre
L'Empereur me paraît bien prononcé contre les grands mariages. Au fait, il a raison. C’est encore du pouvoir absolu. Mais si cette petite Princesse a de l’esprit, voilà une seconde grande Duchesse Hélène. Pour vivre là, il faut être Catherine. C’est bien le moins. Est-il vrai que le jour du mariage Leuchtenberg, il y ait eu sur la Baltique une grande tempête ou beaucoup de gens aient péri ?
Il me semble que Baden devient brillant. Je suis bien aise que vous y ayez Montrond. Ce sera bien une demi-heure par jour. Le Roi dit qu’il n’aura jamais Thiers qu'avec moi, pour avoir un contrepoids. Il dit aussi que si jamais il a Thiers aux Affaires étrangères, il l'aura tout seul, pour qu’il soit bien clair qu’il lui est imposé, et pour travailler librement à s'en défaire. Le Roi parle de tout et ne dit rien. Il a raison, comme votre Empereur. Il faut garder le rôle qu’on a pris.
La mesure qu'on vient de prendre à Pétersbourg sur le cours de l'argent me paraît bonne pour vous. Le crédit de la Russie doit y gagner ; donc le cours du rouble doit s'améliorer, et vous ferez venir votre argent, en France ou en Angleterre à de meilleures conditions. Du reste il y a, dans la mesure même, quelque chose que je ne comprends pas bien. Le retrait absolu et soudain d'un papier monnaie est une opération bien difficile et bien longue. Vous auriez dû consulter à ce sujet le Rothschield auquel vous avez donné vos commissions. Il en sait plus que moi.
La bizarre saison ! Quand je me suis levé tout à l'heure, le ciel était pur et le soleil brillant. Voilà un ciel tout noir, et dans cinq minutes la pluie. Avant qu’elle arrive je vais respirer l’air du matin. Quel dommage que nous ne respirions pas le même ? Vous promenez-vous en ce moment ?
9 h 1/2
Je reçois votre n° 234. J'y répondrai demain. Il faut absolument que j'aie mal compris la note du consul car je vois que tous les gens qui vous entourent la comprennent comme vous. Je ne veux pas me résoudre à croire que votre fils savait tout cela. Pourtant ! Adieu Adieu. Je vous dirai demain tout mon avis. G.
J’ai fait hier ma visite de jardins, d’un côté que je ne connaissais pas. Le pays est très joli une succession de vallées toujours fraîches et riantes. J’ai admiré les ressources, les expédients de l'activité humaine. Evidemment les deux voisins que j’ai été voir s'ennuient beaucoup ; personne à voir et rien à faire. Ils ont reporté sur les fleurs toutes les passions de la vie. Ils sont ambitieux, avares curieux, jaloux. Il réussissent à remplir leur temps, et je crois, en vérité leur âme. Cependant il y en a un qui emprunte à ma bibliothèque des livres de chimie. Les fleurs ne lui suffisent pas. Il joindra un laboratoire à sa serre
L'Empereur me paraît bien prononcé contre les grands mariages. Au fait, il a raison. C’est encore du pouvoir absolu. Mais si cette petite Princesse a de l’esprit, voilà une seconde grande Duchesse Hélène. Pour vivre là, il faut être Catherine. C’est bien le moins. Est-il vrai que le jour du mariage Leuchtenberg, il y ait eu sur la Baltique une grande tempête ou beaucoup de gens aient péri ?
Il me semble que Baden devient brillant. Je suis bien aise que vous y ayez Montrond. Ce sera bien une demi-heure par jour. Le Roi dit qu’il n’aura jamais Thiers qu'avec moi, pour avoir un contrepoids. Il dit aussi que si jamais il a Thiers aux Affaires étrangères, il l'aura tout seul, pour qu’il soit bien clair qu’il lui est imposé, et pour travailler librement à s'en défaire. Le Roi parle de tout et ne dit rien. Il a raison, comme votre Empereur. Il faut garder le rôle qu’on a pris.
La mesure qu'on vient de prendre à Pétersbourg sur le cours de l'argent me paraît bonne pour vous. Le crédit de la Russie doit y gagner ; donc le cours du rouble doit s'améliorer, et vous ferez venir votre argent, en France ou en Angleterre à de meilleures conditions. Du reste il y a, dans la mesure même, quelque chose que je ne comprends pas bien. Le retrait absolu et soudain d'un papier monnaie est une opération bien difficile et bien longue. Vous auriez dû consulter à ce sujet le Rothschield auquel vous avez donné vos commissions. Il en sait plus que moi.
La bizarre saison ! Quand je me suis levé tout à l'heure, le ciel était pur et le soleil brillant. Voilà un ciel tout noir, et dans cinq minutes la pluie. Avant qu’elle arrive je vais respirer l’air du matin. Quel dommage que nous ne respirions pas le même ? Vous promenez-vous en ce moment ?
9 h 1/2
Je reçois votre n° 234. J'y répondrai demain. Il faut absolument que j'aie mal compris la note du consul car je vois que tous les gens qui vous entourent la comprennent comme vous. Je ne veux pas me résoudre à croire que votre fils savait tout cela. Pourtant ! Adieu Adieu. Je vous dirai demain tout mon avis. G.
241. Val -Richer, Samedi 10 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
241 Du Val-Richer, Samedi soir 10 août 1839 9 heures
Si vous avez raison sur le sens de la lettre du Consul, votre lettre à votre frère est à merveille ; et si elle arrive à Pétersbourg avant la signature de l’arrangement tout est sauvé. Mais je crains encore que vous n'ayez pas raison ; et si vous avez raison, je crains que l’acte n'ait été signé bien vite, car Paul aura certainement pressé, pressé. Et alors ? A coup sûr il faudrait un procès, un procès éclatant pour vous, honteux pour eux, douteux comme tous les procès, surtout comme ceux qu’on ne conduit que de loin. Vous n'entrerez pas dans ce frêle et orageux bateau. Pourtant, si toute cette hypothèse se réalise, je ne crois pas qu’il faille renoncer d'avance et tout haut au procès. La crainte de le voir entamer pourrait être un puissant moyen d'accommodement. Je ne puis croire que la certitude même de le gagner rendit Paul indifférent au scandale. Il aurait pour lui, le droit légal, un arrangement conclu, votre signature. On n’est jamais sensé ignorer son droit. Paul serait autorisé à vous dire : Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Londres des letters ef administration ? Tout cela est vrai devant les juges. Mais devant le monde, cette vérité là ne suffit pas, et Paul est du monde. Il voudrait donc probablement éviter le procès, et vous pourriez transiger. Voilà, ce me semble le plus probable et le plus raisonnable dans l’hypothèse qu’en effet la propriété de ce capital vous revient. Et si cette hypothèse est fondée, quelle odieuse réticence. qu’elle déplorable complication ! J’en suis depuis deux jours constamment préoccupé. Je ne veux pas écrire tout ce que je vous dirais à ce sujet. Et qui sait si je vous le dirais ? En tout cas soyez sûre que votre lettre à votre frère est très bien. Le rappel que vous y faites des intentions de votre mari à votre égard est frappant. C'est même la circonstance qui me porte le plus à vous donner raison, contre ma raison, dans votre interprétation de la note du Consul ; car c’est celle qui explique le mieux le défaut de testament. Je pense que vous avez écrit sur le champ à Londres pour demander des renseignements plus clairs et plus complets. A la vérité, il ne me parait pas que le sens que moi, j’attribue à la note du consul, vous soit seulement venu à l'esprit.
Dimanche, 8 heures
Vous aviez raison, et M. de Metternich, se flattait ou se vantait. L'Empereur se refuse aux conférences de Vienne. Mais en revanche, l'article qu’il a fait mettre dans la gazette d’Augsbourg est bien fanfaron ; les fanfaronnades, ces gasconnades ces espérances affichées quand on ne les a pas, tout cela, est-il bien nécessaire au Gouvernement du monde ? Ne sont-ce pas plutôt des satisfactions un peu puériles que se donnent les gouvernants eux-mêmes en s'abandonnant à toutes leurs boutades de vanité ou de fantaisie ? C’est bien peu digne et il ne vient point de pouvoir de là. Avez-vous jamais lu les historiens romains Salluste, Tacite, César ? Ce qui m'en plaît surtout, c’est la simplicité, l'absence de charlatanerie et de vanterie. C’est le grand côté du caractère romain. Les Anglais en ont quelque chose. Mais le gouvernement représentatif est très charlatan, très fanfaron à sa manière.
9 h 1/2
Le n° 235 vaut très fort la peine d'être envoyé Vous savez que j'aime tout ce qui vous passe par l'esprit. Vous avez raison sur les dents. Mais ne croyez pas que je fasse de la douleur physique une grande affaire pour mes enfants. Henriette y est assez forte. Sa sœur moins parce qu'elle a les nerfs très irritables. Je crois les douleurs très inégales selon les personnes. Adieu. Adieu. Comme le vôtre souligné ! G.
Si vous avez raison sur le sens de la lettre du Consul, votre lettre à votre frère est à merveille ; et si elle arrive à Pétersbourg avant la signature de l’arrangement tout est sauvé. Mais je crains encore que vous n'ayez pas raison ; et si vous avez raison, je crains que l’acte n'ait été signé bien vite, car Paul aura certainement pressé, pressé. Et alors ? A coup sûr il faudrait un procès, un procès éclatant pour vous, honteux pour eux, douteux comme tous les procès, surtout comme ceux qu’on ne conduit que de loin. Vous n'entrerez pas dans ce frêle et orageux bateau. Pourtant, si toute cette hypothèse se réalise, je ne crois pas qu’il faille renoncer d'avance et tout haut au procès. La crainte de le voir entamer pourrait être un puissant moyen d'accommodement. Je ne puis croire que la certitude même de le gagner rendit Paul indifférent au scandale. Il aurait pour lui, le droit légal, un arrangement conclu, votre signature. On n’est jamais sensé ignorer son droit. Paul serait autorisé à vous dire : Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Londres des letters ef administration ? Tout cela est vrai devant les juges. Mais devant le monde, cette vérité là ne suffit pas, et Paul est du monde. Il voudrait donc probablement éviter le procès, et vous pourriez transiger. Voilà, ce me semble le plus probable et le plus raisonnable dans l’hypothèse qu’en effet la propriété de ce capital vous revient. Et si cette hypothèse est fondée, quelle odieuse réticence. qu’elle déplorable complication ! J’en suis depuis deux jours constamment préoccupé. Je ne veux pas écrire tout ce que je vous dirais à ce sujet. Et qui sait si je vous le dirais ? En tout cas soyez sûre que votre lettre à votre frère est très bien. Le rappel que vous y faites des intentions de votre mari à votre égard est frappant. C'est même la circonstance qui me porte le plus à vous donner raison, contre ma raison, dans votre interprétation de la note du Consul ; car c’est celle qui explique le mieux le défaut de testament. Je pense que vous avez écrit sur le champ à Londres pour demander des renseignements plus clairs et plus complets. A la vérité, il ne me parait pas que le sens que moi, j’attribue à la note du consul, vous soit seulement venu à l'esprit.
Dimanche, 8 heures
Vous aviez raison, et M. de Metternich, se flattait ou se vantait. L'Empereur se refuse aux conférences de Vienne. Mais en revanche, l'article qu’il a fait mettre dans la gazette d’Augsbourg est bien fanfaron ; les fanfaronnades, ces gasconnades ces espérances affichées quand on ne les a pas, tout cela, est-il bien nécessaire au Gouvernement du monde ? Ne sont-ce pas plutôt des satisfactions un peu puériles que se donnent les gouvernants eux-mêmes en s'abandonnant à toutes leurs boutades de vanité ou de fantaisie ? C’est bien peu digne et il ne vient point de pouvoir de là. Avez-vous jamais lu les historiens romains Salluste, Tacite, César ? Ce qui m'en plaît surtout, c’est la simplicité, l'absence de charlatanerie et de vanterie. C’est le grand côté du caractère romain. Les Anglais en ont quelque chose. Mais le gouvernement représentatif est très charlatan, très fanfaron à sa manière.
9 h 1/2
Le n° 235 vaut très fort la peine d'être envoyé Vous savez que j'aime tout ce qui vous passe par l'esprit. Vous avez raison sur les dents. Mais ne croyez pas que je fasse de la douleur physique une grande affaire pour mes enfants. Henriette y est assez forte. Sa sœur moins parce qu'elle a les nerfs très irritables. Je crois les douleurs très inégales selon les personnes. Adieu. Adieu. Comme le vôtre souligné ! G.