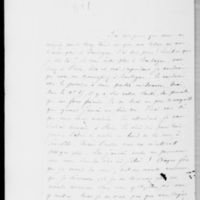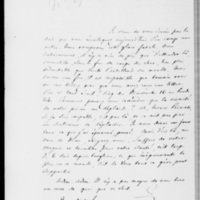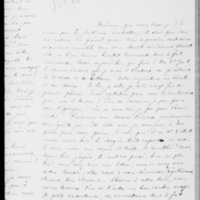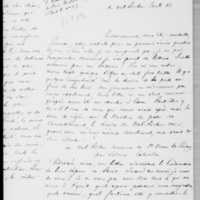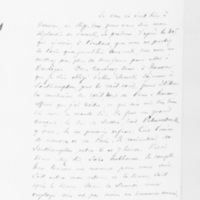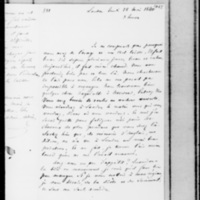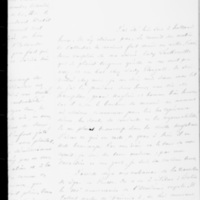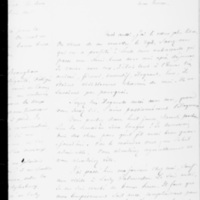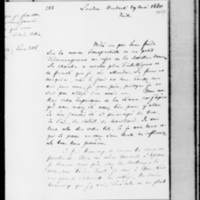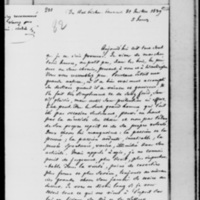Votre recherche dans le corpus : 65 résultats dans 3296 notices du site.
15. Caen, Mardi 1er août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai bien peur que vous ne m’ayez averti trop tard et que ma lettre ne vous trouve plus à Boulogne. J’ai bien peur ! Qu’est- ce que je dis là ? Si vous n’êtes plus à Boulogne, vous serez à Paris. Cela est vrai ; cependant je voudrais que vous me trouvassiez à Boulogne. Je voudrais être le premier à vous parler, en France. Mais dans le n°15, il y a sur votre santé, des paroles qui me font frémir. Je ne serai un peu tranquille que quand j’aurai vu, bien vu. J’irai voir dès que vous serez arrivée. En attendant, je vous écrirai demain à Paris. Je suis ici pour trois jours. J’étais ce matin au bord de la mer à Trouville. Mais l’autre, rive ne m’attirait presque plus. Que j’aurais voulu me promener avec vous sur la rive où j’étais ! Chaque fois que je revois la mer, c’est un monde nouveau que je découvre ; et je ne découvre plus un monde nouveau sans vous y chercher, ou vous y mettre. Mais je ne veux pas que vous soyez malade.
11 h 1/2 du soir J’ai été interrompu par je ne sais combien de visites, et je sors un moment du salon, qui en est encore plein, pour vous dire adieu et donner ma lettre qui partira de grand matin.
Adieu donc. Adieu sur la terre de France. Je vous l’ai déjà dit; il y a des moments en bien comme en mal, où il faut se taire, se taire absolument. L’insuffisance de la parole est trop évidente. G.
11. Duplicata Val-Richer, Mardi 25 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de vous écrire par la voie que vous m’indiquez aujourd’hui. J’en essaie une autre. Nous romprons cette glace fatale. Non certainement, il n’y a rien de pis que d’attendre là, immobile, sous le feu des coup du sort bien plus redoutable que toute l’artillerie du monde. Mais encore une fois, il est impossible que demain vous ne me disiez pas que vous avez reçu une lettre. J’en ai tant écrit ! Cinq du Dimanche 16 au lundi 24. Comment pouvez-vous craindre que la vivacité de votre peine me déplaise ? Ah, dearest Princess, si je suis coupable, c’est par là, et ce n’est pas par un sentiment de déplaisir. Je vous dirai un jour, tout ce que j’ai éprouvé, pensé. Mais d’ici là, au nom de Dieu, soignez-vous. Souffrir de votre chagrin et trembler pour votre santé, c’est trop. Je le sais depuis longtemps, ce qui m’épouvante le plus en ce monde, c’est de voir tout ce qu’on peut supporter.
Adieu. Adieu. Il n’y a pas moyen de vous dire un mot de quoi que ce soit. G.
Mercredi 10 h Enfin, enfin, vous avez une lettre. Votre N°12 me l’annonce. Quelle délivrance, pour moi comme pour vous, oui pour moi comme pour vous. Vous vous trompez sur mes N°. Vous aviez reçu le N°4 et vous me l’aviez dit. Le n° 5 était ce petit billet de Dimanche 9 que j’avais oublie de numéroter. Il ne vous manque que le N° 6 qui vous arrivera certainement. Il était allé par une autre voie qui aura retardé. Adieu, Adieu, dearest. Vous allez être accablée de lettres, accablée. G.
9. Val-Richer, Vendredi 21 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame que vous dirai-je ? Je n’aime pas les sentiments combattus ; ils sont peu dans ma nature. En général, quand deux impressions contraires m’arrivent ensemble, mon cœur choisit décidément choisit et l’une devient bientôt dominante, tout à fait dominante. Mais aujourd’hui que faire ? Vos N°7 et 8, le dernier surtout que je reçois à l’instant, me pénètrent de tristesse et de bonheur. Votre inquiétude me désole et me charme. Je lis, je relis, je relis vingt fois les paroles pleines d’une agitation pour vous si douloureuse, pour moi si tendre ! Que ne donnerais-je par pour vous l’épargner? Que ne vous dois-je pas pour l’avoir sentie? Pardonnez-moi dearest Princess, pardonnez-moi mon égoïste joie ; elle n’ôte rien, je vous jure à ma peine pour votre peine. Je crois que si ce n° 8 était arrivé avant-hier, le chagrin, l’eût emporté en moi. Je vous aurais vue encore si triste, si troublée ! Mais, depuis hier j’espère, le mal est passé ; hier au plus tard, vous avez reçu une lettre; vous en aurez une autre demain ; elles iront à vous désormais régulièrement, souvent, bien souvent. Chacun à notre tour, nous avons traversé l’un et l’autre un bien sombre nuage. De petites circonstances, des circonstances tout-à-fait étrangères à notre volonté, mon déplacement, des adresses inexactes, des postes mal réglées voilà la vraie cause du mal. Il ne se reproduira plus. Nous y veillerons. J’y veillerai comme les Guèbres sur la dernière étincelle du feu sacré, comme une mère sur son enfant malade. Les témoignages de votre affection me sont mille fois plus doux que je ne vous le dirai jamais. Mais je ne veux jamais les devoir à une minute de souffrance de votre cœur.
Et Lord Aberdeen ? Il est donc parti ? Et je puis en toute sûreté, le plaindre, être juste envers lui ? Que je vous remercie de m’avoir ainsi mis à l’aise avec moi-même ! Je ne connais rien de plus pénible que de nourrir en son âme un mauvais sentiment contre un galant homme malheureux. Et pourtant vous êtes une noble créature. Et moi j’ai le cœur bien fier. Je pressentais cela et depuis longtemps. Même avant votre départ, le nom de Lord Aberdeen me frappait plus sérieusement qu’aucun autre. Pauvre homme ! C’est si naturel !
Vous ne savez pas Madame, pour un homme sérieux et malheureux, quel charme il y a en vous, dans votre air, dans votre accent, dans ces entretiens où éclatent, avec tant de dignité et d’abandon, votre esprit si haut si simple, si libre, votre âme si gravement et si finement émue, si sensible aux grandes choses, si indifférente aux petites, pleine de tant de sympathie et de tant de dédain ! Je voudrais avoir quelque occasion d’être en bon rapport avec Lord Aberdeen de lui être agréable en quelque chose. Je me sens comme des devoirs envers lui. Vous me direz s’il vous écrit s’il doit revenir à Londres avant votre départ. Vous me direz tout, comme vous l’avez fait.
Samedi 22 midi. Dearest Princess, il n’y a plus de sentiment combattu. Je n’en ai plus qu’un absolument qu’un. Je suis désespéré de votre inquiétude. Je crains quelle ne vous fasse mal. Je reçois à la fois votre petit billet, sans numéro du lundi 17 qui m’est venu directement, après être encore allé me chercher à Caen et votre N°9, du Mardi 18, qui m’arrive par Paris. J’ai beau me dire qu’à présent, depuis Jeudi vous êtes tranquille, que vous savez combien vos inquiétudes étaient vaines. Je n’en suis pas moins désolé, troublé, inquiet de nouveau moi-même et de la façon la plus douloureuse. Je vous vois, vous êtes là devant mes yeux, impatiente, préoccupée quel charme agitée, triste, attendant, attendant encore. Vous me pardonnez, n’est-ce pas? Je veux que vous me pardonniez, quoique je n’ai point de tort, non certainement point de vrai tort, point de tort devant Dieu; car moi aussi j’ai attendu et bien des jours, et avec une impatience dont j’ai contenu, dont j’ai étouffé l’expression en vous la témoignant. Et si j’avais suivi ma pente, quand vos lettres ne m’arrivaient pas quand mon imagination se lassait, s’épuisait à chercher la cause du retard ou du silence, je vous aurais écrit tous les jours ; tous les jours je vous aurais demandé pourquoi je n’avais pas de lettre. J’aurais mieux fait. Je ne l’ai pas fait à cause de vous, de vous seule. J’ai craint quelque odieuse malice. J’ai voulu y voir clair.
Enfin tout est passé n’est-ce pas, bien passé? Vous ne craignez plus, vous ne souffrez pas, vous n’êtes pas malade ? Que la parole est pitoyable, & que tous mes efforts seraient vains pour vous envoyer sur ce papier, ce que j’ai en ce moment dans le cœur ? Voyez le, devinez-le. Vous le pouvez, j’en suis sûr ; je me confie à vous. C’est ma consolation dirai-je ma joie, mon inexprimable joie de savoir, d’avoir vu, de voir tout ce qu’il y a dans votre cœur de tendresse et de puissance. Ceci encore, cette joie vous me la pardonnez également. Dites-le moi, que j’aie le plaisir de l’entendre, quoique je n’en aie pas besoin. Demain enfin, après demain au plus tard j’aurai une lettre rassurée, et qui me rassurera j’espère. Mais que d’heures encore d’ici à demain ! Aujourd’hui, il me serait impossible de vous parler d’autre chose.
Adieu adieu. Mais, je vous en conjure, soignez-vous ; ne vous livrez pas à des émotions comme celle que ce petit chien a causée. L’absence est déjà assez lourde ; au moins faut-il être tranquille sur votre santé. Je ne serais pas tranquille quand vous vous porteriez toujours le mieux du monde. Comment l’être un moment si des secousses continuelles vous assiègent ? Éloignez-les ; abrégez-les. Vous pouvez avoir de l’empire sur vous? Vous m’avez dit que vous réprimeriez tout ce qui pourrait m’affliger. Pensez à moi. Je suis sûr que vous le ferez comme vous me l’avez dit. G.
6. Val-Richer, Jeudi 13 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement vous êtes malade, Princesse, assez malade pour ne pouvoir écrire quatre lignes. Sans cela, je ne comprends pas, je ne puis comprendre comment je n’ai point de lettres. Quelle ressource pour me rassurer ! J’en ai une autre moins triste quoique l’effet en soit fort triste. Il y a quelque irrégularité dans le service de la poste au fond de mes bois. Mes journaux ne m’arrivent pas encore exactement. Deux lettres ne me sont revenues qu’après avoir été me chercher à Caen. Peut-être y en a-t-il une de vous qui court ainsi après moi. Je viens de régler avec le Directeur des postes de l’arrondissement le service du Val-Richer, voici, quand vous voudrez m’écrire directement, ma vraie et sure adresse. Au Val-Richer, Commune de St Ouen le Paing. par Lisieux. Calvados. Adressées ainsi mes lettres m’arrivent le lendemain de leur départ de Paris. Quand en aurai-je une de vous ?
Je ne veux pas vous dire tout ce qui me vient à l’esprit, quel espace parcourt mon imagination, quels ennemis, quel fantôme elle y rencontre. Je n’ai pas en général l’imagination inquiète et noire : mais quand une fois elle prend ce tour là, elle échappe tout à fait à l’empire de ma raison, tout devient possible, probable, réel. Il faut se taire alors, se taire absolument, ne pas se parler à soi-même. Je vous quitte donc Madame. Pourquoi êtes-vous devenue un si grand intérêt dans ma vie ?
Vendredi 14. Voilà une lettre, une longue, un excellente lettre. Et c’est bien celle que j’attendais. Il n’y en a point de perdue. Celle-ci est allée en effet me chercher à Caen, le service encore mal réglé de la poste a causé le retard. Un nom de village pour un autre, une négligence de commis, cinq minutes de sommeil d’un courrier qui passe, sans s’en apercevoir, devant une route de traverse, qu’il faut peu de chose pour faire beaucoup souffrir ! Enfin, la voilà. Et j’espère que les autres viendront plus régulièrement.
Vous n’êtes point malade. On vous trouve bonne mine. Ne permettez pas à tout ce monde de vous accabler de fatigue ; ils n’ont pas de quoi vous en dédommager. Ils vous aiment pourtant et ils ont raison ; et vous avez bien raison aussi d’accueillir toutes les amitiés, quels que soient leur nom et leur drapeau.
Entre nous, j’ai plus d’une fois regretter de ne pouvoir être avec mes adversaires politiques, aussi cordial aussi, bienveillant que je m’y serais senti enclin. J’en sais plus d’un en qui, politique à part, j’aurais trouvé peut-être un ami du moins une relation facile et douce. Mais le soin de la dignité personnelle, les devoirs envers la cause, les exigences et les méfiances de parti, tout cela jette entre les hommes, une froideur, une hostilité souvent sans motifs individuel et intimes. Il faut s’y résigner ; c’est la loi de cette guerre, car il y a là une guerre.
Mais vous, Madame, profitez, profitez toujours et sans hésiter de votre privilège de femme; soyez juste envers tous, bonne pour tous, amicale pour tous ceux qui le mériteront de vous. C’est quelque chose de si beau et de si rare que l’équité et l’amitié ! Je suis charmé que vous en jouissiez, et plus charmé encore que vous soyez si capable d’en jouir, que vous ayez l’esprit si libre et le cœur si affectueux. Je n’y mets qu’une condition Vous la devinez et elle est bien remplie, n’est-ce pas ? Pendant que vous retrouvez à Londres, vos douleurs, pendant que vous n’y pouvez faire un pas, regarder à rien sans avoir le cœur bouleversé au souvenir de vos fils, moi j’achève ici, dans ma maison, les arrangements que le mien y avait commencés. Je fais descendre dans ma chambre son fusil de chasse, je me promène suivi de son chien.
C’est un lien puissant entre nous, Madame, que cette triste ressemblance de nos destinées, et cette parfaite intelligence que nous avons l’un l’autre de nos peines. Il me semble que j’ai connu vos enfants ; je leur prête les traits, les qualités qui me charmaient dans le mien ; je les unis à lui dans mes regrets. Ne vous défendez pas, Madame, du sentiment qui vient émousser ce que les vôtres ont de plus poignant ; laissez-vous guérir autant que se peut guérir une vraie blessure. A mesure que nous avançons dans la vie, c’est la condition de notre âme d’éprouver et d’associer dans je ne sais qu’elle mystérieuse unité, les émotions les plus contraires, de souffrir et de jouir, de regretter, et de désirer à la fois, et avec la même vérité, la même énergie. Acceptons ces secrets de notre nature. Si vous étiez là, si nous causions en liberté, vous me parleriez de vos fils, je vous parlerais du mien. Nous nous raconterions toute leur vie, toute la nôtre, et un sentiment d’une douceur infinie et souveraine se répandrait sur notre entretien. Que mes lettres vous en apportent l’ombre ; les vôtres ont pour moi tant de charme !
Samedi 15, 9 h 1/2 du matin.
Que je dis vrai dans ces derniers mots, & bien plus vrai que je ne dis ! Voilà, le N° 5 qu’on m’apporte. Dearest Princess, je crains qu’à votre tour vous n’éprouviez quelque retard pour mes lettres, pour celle-ci du moins. Je m’en désole. Pardonnez le moi. J’aurais dû la faire partir avant-hier ; mais j’étais si impatienté de ne voir rien arriver que j’ai attendu. Je vous aurais écrit en trop mauvaise disposition. Aujourd’hui je ferais peut-être mieux d’attendre aussi. Ma disposition est trop bonne.
Tout à l’heure Madame j’irai me promener dans les bois qui m’entourent. Ils sont bien verts, bien frais, bien sombres, quoiqu’un beau soleil brille au dessus et les enveloppe de sa lumière. Ce lieu-ci est très solitaire, très sauvage. Autrefois quelques moines y venaient orner. Aujourd’hui quelques bûcherons y travaillent. J’y serai bien seul. Je n’y entendrai rien. Je n’y verrai personne. Je relirai vos lettres. Je serai charmé. Et pourtant, que le fond du jardin de la Duchesse de Sutherland me fera envie ! Et ma pensée tantôt m’y transportera, tantôt vous amènera vous-même dans les bois du Val-Richer. Et je me laisserai bercer à ces doux rêves jusqu’à ce que j’en sente le mensonge. Je rentrerai alors dans ma maison.
Je suis très préoccupé de ce que vous me dites des projets de M. de Lieven. Vous ne pouvez songer, ce me semble, à aller le rejoindre à Carlsbad. Vous voilà à peine en Angleterre. La saison des eaux serait passée avant que vous arrivassiez, en Bohème. Après les eaux, s’il y va M. de Lieven retournera sans doute auprès du grand duc. Non, Madame, il ne faut pas chercher le bonheur à tout prix ; mais il faut penser sans relâche aux moyens de lever les obstacles. Vous ne pouvez ni vous fier à Pétersbourg, ni errer sans cesse en Europe. Que ces deux points là soient bien arrêtés ; ils feront le reste.
Midi. C’est trop de bien en un jour. Je tremble pour les jours qui vont suivre. Je reçois à l’instant votre N°6. Mon pressentiment ne me trompait pas tout à fait quand je vous craignais malade. Reposez-vous, beaucoup, beaucoup. Je suis charmé que vous n’alliez pas à Howick.
Que je vous remercie d’avoir pensé à me rassurer sur votre mauvaise écriture ! Elle m’eût inquiété en effet. Je vais attendre bien impatiemment vos prochaines lettres. Je les crains pourtant un peu. Vous aurez attendu celle-ci. Vous vous serez, comme moi naguère, impatientée, tourmentée. Vous voyez que j’ai aussi ma fatuité. C’est un lieu commun que je dis là, Madame. Non, je n’ai avec vous, point de fatuité. Ce mot ne convient ni à vous, ni à moi. Mais j’ai confiance, je crois. Et vous aussi, n’est-ce pas ? Nous avons donc bien le droit de nous parler comme gens qui croient, c’est-à-dire tout simplement et en disant les choses comme elles sont, non pas comme on est convenu de les dire quand elles ne sont pas. Il faut pourtant que je finisse si je veux que ma lettre parte !
Il me semble que j’ai à peine commencé que je ne vous ai parlé de rien. Je vais au plus pressé à ce qui me touche vraiment ; et je laisse en arrière (comme je laissais le cahier rouge) la politique anglaise, la politique française, votre jeune Reine, la dissolution de son parlement, celle du nôtre, que sais-je ? Tout cela cependant m’intéresse beaucoup, et je lis très curieusement les détails que vous me donnez, et j’ai sur tout cela, des milliers de choses à vous dire. Et ma prochaine lettre, si dans celle-là encore, j’en trouve le temps. Adieu Madame.
Remerciez, je vous prie, la petite Princesse de son bon souvenir. J’y tiens beaucoup et j’en suis très touché. C’est à vous de lui demander pardon, pour moi d’un langage si familier. Je copie. Je suis bien heureux d’apprendre que Madame la Duchesse de Sutherland veut bien se rappeler mon nom. C’est du luxe en vérité d’être si bonne quand on est si belle. Mais le luxe qui vient de Dieu est charmant ; et il a comblé votre noble hôtesse de tant de dons qu’en effet elle nous doit peut-être à nous autres pauvres mortels de nous traiter avec un peu de bonté. Quelque place qu’elle me donnât à sa table, je serais ravi de m’y asseoir. G.
Mots-clés : Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Deuil, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait (Dorothée), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Séjour à Londres (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
397. Londres, Mercredi 17 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai écrit hier à Douvres au Ship Inn, pour vous dire mon déplaisir de samedi. Je présume d’après le 405 qui m’arrive à l’instant que vous ne partez de Paris qu’aujourd’hui mercredi, car vous ne mettrez pas plus de deux jours pour aller à Boulogne. Vous trouverez donc à Douvres que je suis obligé d’aller samedi déjeuner à Southampton, par le rail-road, pour célébrer la conclusion du rail-road de Paris à Rouen ; affaire que j’ai traitée et qui m’a mis très bien ici avec ce monde là. Ils font un grand banque t; le Duc de Sussex, Lord Palmerston & y vont. Je ne pouvais refuser. C’est l’union de Londres et de Paris. Je reviendrai de Southampton entre 6 et 7 heures. J’irai dîner chez le Sir John Hobhouse. Je compte bien trouver un moment pour vous voir, soit entre mon retour, et le dîner, soit après le dîner. Mais le samedi, ainsi employé n’en est pas, moins un immense ennui. Si donc vous arrivez à Londres le Vendredi, je vous verrai en arrivant de Windsor, et tout le soir. Si vous n’arrivez que le Samedi, je ne vous verrai que tard ce jour là et bien peu. Faites pour le mieux, sans vous harasser de fatigue.
En tout cas, faites-moi dire tout de suite à Hertford House que vous êtes arrivée et où vous êtes. Car je n’en sais rien. Je regarde sans cesse au temps. Il y a eu du vent cette nuit ; il est tombé ce matin. Le saleil est beau.
Adieu. Adieu. Moi aussi, je serai bien content. J’ai souri en lisant: " Que Windsor va vous plaire ! " Croyez-vous que la Reine Victoria sera aussi bonne pour moi que l’était pour vous George IV ? Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Séjour à Londres (Dorothée)
381. Londres, Jeudi 28 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je ne comprends pas pourquoi vous avez de l’orage et un ciel triste. Il fait beau ici depuis plusieurs jours, beau et calme. Aujourd’hui, il fait même chaud. Vous vous porteriez bien par ce temps là. Nous chercherons de l’air pour vous. Cela ne me paraît pas impossible à arranger. Nous trouverons bien quelque chose d’agréable à Norwood. Putney & Vous avez besoin de rouler en voiture ouverte. Vous viendrez à Londres, le matin voir qui vous voudrez, dîner où vous voudrez. Et moi j’en serai quitte pour fatiguer une paire de chevaux de plus pendant que vous serez là. Sachez bien que de mémoire d’anglais, me dit-on, on n’a vu à Londres un aussi beau printemps. Et au fait, je trouve l’air moins lourd qu’on ne me l’avait annoncé. Avez-vous un peu d’appétit ? Quand on a la bile en mouvement, je crois qu’il faut bien peu manger. Si je vous mettais à mon régime, je vous dirais, de la diéte et du sommeil. Ce sont mes seuls remèdes. J’ai vu hier on me promenant, deux ou trois jolies maisons à louer, garnies, à l’extrémité de Regent’s Park du côté de Primerose. Je vous assure que là l’air est agréable. Et vraiment la portion fermée de Regent’s park, le jardin, est charmante. Depuis que Lord Duncannon m’a donné, des clefs, j’y vais quelques fois, m’asseoir seul. C’est bien frais bien tenu, assez grand pour y marcher, pas d’isolement et pas beaucoup de monde. Il me semble que vous seriez bien près de là. Savez-vous décidément dans quel hôtel vous descendrez ?
Le duc de Cambridge, qui ne pouvait venir dîner chez moi le samedi 13, m’a offert le Vendredi, 12 ou le lundi 15. J’ai pris le 12. Je garderai le 15 bien libre. Je viens de déjeuner chez M. Milnes, conservateur modéré de la Chambre des Communes avec quelques radicaux modèrés Charles Buller & et Sir Stratfort. Canning. Conversation assez animée et variée. Il y avait là un homme d’esprit un Rev. M. Thirlwall le premier scholar, dit-on, de l’Angleterre. et prédicateur très éloquent. On voudrait le faire evêque. Mais, lord Melbourne s’y oppose, ne le trouvant pas assez orthodoxe.
Je me suis laissé imposer hier par lord Burghersh une seconde séance de l’ancient concert. C’était la dernière et cela lui faisait tant de plaisir! Au fait, j’aimais autant finir ma soirée là qu’ailleurs. La musique était bonne, très bonne même une ou deux fois. J’ai causé avec lady Burghersh. J’ai trouvé son esprit dont vous m’avez parlé. Bien artiste, fin et sensé. Quand je dis sensé, je ne sais pas, mais clairvoyant.
J’ai arrangé mon petit dîner pour mes Françaises. Elles partent le 3 Juin et je les ai le 2 avec lord Elliot, lord Leveson, lord et lady Lovelace et Sir Robert Cherter que j’ai mis là parce qu’il faut qu’une fois je le mette quelque part. Les invitations me pleuvent. Voilà lord Haddington, le duc de Bucclaugh, le duc d’Argyll. Il faudra rendre tout cela. Il me faudra plus de grands dîners que je ne comptais. Vous me règlerez Point de nouvelles. Chekib. Effendi vient d’arriver.
L’affaire d’Orient remuera de nouveau probablement sans avancer. Entre nous, je crois pouvoir dire que tout le monde ici, corps diplomatique ou Anglais, Whigs ou Torys, est de mon avis dans cette question, comme on est de l’avis d’un autre. On trouve que j’ai raison. On serait bien aise que quelque circonstance rendit ma raison nécessaire. Mais il faut lutter, refuser, dire non. C’est bien difficile. Aussi je ne réponds de rien. Je ne me décourage pas non plus. J’établis chaque jour, un peu plus fortement et dans quelques esprits de plus, que j’ai raison. Je pense des hommes dans les affaires comme des enfants dans l’éducation, il faut faire leur atmosphère et les laisser respirer. Adieu. J’attends la lettre de demain avec une double, une triple impatience. Mais je vous veux point agitée, point abattue. Les vrais adieux veulent la santé. Adieu. Adieu.
396. Londres, Mardi 16 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Vous êtes partie ce matin. Vous marchez en ce moment vers moi. Vous arriverez à Douvres peu après cette lettre. C’est ridicule d’y envoyer un morceau de papier au lieu d’y aller moi-même. Je désire bien vivement que vous arriviez à Londres vendredi, pas tard. Voici pourquoi. Je suis obligé d’aller samedi, par le railroad, déjeuner à Southampton, à un grand banquet donné pour célébrer le chemin de fer de Paris à Rouen. Dire à quel point ceci me déplait c’est impossible. J’avais tant pensé à ce samedi ! Mais il n’y a pas eu moyen de s’y refuser. J’ai négocié ce chemin de fer. Je l’ai fait réussir. C’est la jonction de Londres et de Paris. Le Duc de Sussex y va. Lord Palmerston y va. On tient essentiellement à m’avoir. Je reviendrai le jour même dîner à Londres, chez Sir John Hobhouse et je trouverai bien un moment pour vous voir, entre mon retour et le dîner, ou après le dîner. Mais samedi n’en sera par moins un pauvre jour. Qu’au moins je vous voie bien le vendredi. Je reviendrai de Windsor après le déjeuner. Et puis Dimanche commencera une serie de jours...
Je ne veux pas les qualifier. N’arrivez par trop fatiguée. Le temps est beau. J’épie le soleil. J’épie le vent. Je les interroge. Jusqu’ici, je suis content. Où arrivez-vous ? Vous devriez bien me le dire demain. Car enfin, vous le savez. Vous m’écrirez de Boulogne ou de Douvres.
Adieu. Je ne peux pas, je ne veux pas vous parler d’autre chose, Adieu J’adresse ceci au Ship Inn. Il me semble que vous ne pouvez manquer de l’y recevoir.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Séjour à Londres (Dorothée)
395. Londres, Samedi 13 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici la dernière. Dans sept jours, nous serons ensemble et vous n’aurez plus de tracas. Il est vrai que vous n’y êtes pas propre du tout. Vous ne me dîtes pas si vous avez décidément pris votre compagnon de voyage. C’est un personnage bien mystérieux. Dois-je être inquiet aussi ? Je fais réparation à votre sagacité. Vous avez deviné juste sur Miss Troller ; si juste que l’insinuation m’a été faite, sur la place même. Je voudrais bien savoir ce qui vous inquiète. Vous me le direz, n’est-ce pas, si vous ne l’avez pas oublié, cinq minutes après m’avoir vu.
Je rabâche. Je ne comprends pas les Sutherland. Mais je trouve aussi que puisqu’ils l’ont écrit à Lady Granville, vous auriez pu, et vous pourriez peut-être encore sans atteinte à votre dignité, prier Lady Granville de leur demander, de votre part, si en effet, ils peuvent vous recevoir dans Stafford-House, en leur absence. Savez-vous qui manque dans les relations de cette sociélé-ci, dans les plus amicales ? La simplicité, la facilité, la rondeur. Tous les mouvements sont lents et raides. Les meilleures gens, les meilleurs amis ne savent pas se donner l’agrément de leur bonté et de leur amitié.
Je n’ai pas envie de vous donner des nouvelles. Il n’y en a pas, et je n’en ai pas envie. Je vous en donnerai quand vous serez ici. On ne parle que de l’attentat. Pour dire vrai, d’Oxford plus que de l’attentat. La badanderie est aristocratique aussi bien que démocratique. On est curieux des moindres détails sur ce malheureux. Est-il beau ? A-t-il de l’esprit ? De quelle couleur sont ses yeux ? C’est précisément là ce que veulent ces imaginations perverties, un théatre, un public, grandir et paraître au soleil, eux petits et obscurs. Il faudrait avoir assez de sens et de gravité pour ne pas leur donner ce qu’ils cherchent. Les personnes qui suivent l’affaire disent qu’il n’y a que deux choses sûres, c’est qu’il n’est pas fou, et qu’il n’est pas seul.
On me dit ici, sur le nouveau Roi de Prusse, exactement ce que vous m’avez écrit. Tout le monde, se promet beaucoup de lui ultras et libéraux. Tout le monde, sera déçu. ce qui me paraît clair, c’est qu’il est faiseur et n’aura pas la politique négative, et expectante de son père. Il faut que jeunesse se passe, celle des rois comme toute autre. Adieu. Adieu encore une fois. Je n’ai rien à vous dire. Je dirais trop ou trop peu. Adieu. Enfin.
394. Londres, Vendredi 12 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
J’ai été hier soir à Holland. house. Ils n’y étaient pas. Le conseil du matin et l’attentat les avaient fait venir en ville. J’avais deux emplois de ma soirée Lady Tankerville qui se plaint toujours qu’elle ne me voit pas assez et un bal chez Lady Glengall. Je suis rentré chez moi ; je me suis mis dans mon lit et j’ai lu pendant deux heures une vie de Hampden, grand Anglais, et homme bien hereux car il a eu le bonheur de mourir au moment où allaient commencer pour lui les espérances déçues, les doutes de conduite et la responsabilité. Je me plaît beaucoup dans la vieille Angleterre. J’aime ce qui en reste, et grace à Dieu, il en reste beaucoup. Par mes idées, et le tour de mon esprit, je suis du temps moderne ; par mon caractère et mes goûts, je suis des anciens temps.
J’assiste déjà aux embarras de la transition de règne, en Prusse. On a eu à célébrer à Berlin, le 100e anniversaise de l’Académie royale. Il fallait parler de Frédérie II, du Roi mourant et plaire au Roi qui s’approche. On a chargé M. de Humbolt de cet embarras. Il s’en est tiré, en homme d’esprit, et m’a envoyé son petit discours, car les hommes d’esprit pensent toujours un peu les uns aux autres.
A propos des hommes d’esprit, vous ai-je jamais dit comment m’avait abordé à St Cloud, en se fairant présenter à moi. Reschid. Pacha, qui essaye aujourd’hui de faire de la Turquie quelque chose qui ne soit pas turc? « Moi ausi, dans mon pays, je passe pour un homme d’esprit.» Il vient, dit-on, d’en donner une preuve en se débarrassant de son rival Khosrer-Pacha qu’il a fait remplacer par Ahmed Féthi Pacha, homme insignifiant, sa créature, et ancien ambassadeur à Paris. On dit que cela vous déplaira.
Je rentre à Berlin. Il me paraît que Humboldt, Bülow et toute cette couleur là sont au mieux avec le Prince Royal. Bresson aussi est bien avec lui depuis quelque tour. Bresson est prévoyant et habile. Il n’y a pas de doute sur la retraite de Wittgenstein. On le pressera de rester, sachant qu’il ne restera pas.
2 heures
Je vous ai quittée pour trouver dans le Times, la mort du Rois de Prusse et je n’ai pu vous revenir jusqu’à présent. Lord Palmerston n’a pas pu me rejoindre hier au Foreign office. Il a été retenu à l’home office par le Conseil privé qui interrogeait les témoins sur l’attentat. Il m’a remis à aujourd’hui, et j’attends un mot de lui pour l’aller chercher. Les deux Chambres présentent leur adresse ce matin. Je suppose que la Reine recevra le corps diplomatique demain si le Cabinet trouve bon qu’elle le reçoive. Elle l’a reçu, et ses félicitations en corps, lors de son mariage. Ils sont tous fort contens de la demarche faite, qui acquitte pleinement les convenances. Je les et tous vus ce matin. Dedel est mon meilleur conseiller. Quoique rien n’ait encore transpiré on croit en général que l’assassin est chartiste. Plusieurs propos, recueillis, maintenant indiquent dans ce parti-là, un projet pareil. Ce jeune homme s’exerçait depuis trois semaines à tirer au pistolet.
Le Cabinet a eu encore hier soir un échec aux Communes, toujours sur la même question. Il y a, si je ne me trompe, dans la Chambre un parti pris, pris à une bien petite majorité, mais pris, de mettre en Irlande un temps d’arrêt à l’influence d’Oconnell. Sur les 105 membres Irlandais, il est déjà, dit-on, maître de plus de 60. Avec le systême étectoral actuel, il deviendrait bientôt maître des 40 autres. Et alors on verrait tout autre chose que l’Angleterre obligée de bien gouverner l’Irlande ; on verrait l’Irlande gouverner l’Angleterre. Voilà le gros fait qui frappe, ce me semble, les esprits et décide bien des modérés même.
Vous avez raison d’avoir beaucoup de regret et un peu de remords Windsor est venu bien à propos pour vous. Voici une vérité. Vous êtes si sensible aux petites contrariètés qu’elles peuvent balancer, pour quelque temps, les plus grandes affections. La petite vie, en vous, fait tort à la grande. Cela vient de deux causes. Vous avez été longtemps l’enfant gâté du sort faisant toujours ce qui vous plaisait. Vos déplaisirs sont démesurés, et démesurement puissants sur vous. De plus, il n’y pas en vous une force proportionnée à l’élévation, et à la vivacité de votre âme, vous êtes comme des beaux peupliers, si hauts et si minces, que le moindre vent balance, et fait plier. Vous pliez trop et trop sous les petits fardeaux, comme sous les grands. Je le trouve souvent. Je m’en impatiente quelquefois. Et puis je finis toujours pas me dire que vous connaissant comme je vous connais et vous aimant comme je vous aime, c’est à moi de vous aider à porter tous les fardeaux, petits ou grands. Puisque j’ai plus de force que vous et plus d’indifférence aux choses vraiment indifférentes, il faut bien que vous en profitiez.
Adieu. Je vous écrirai encore demain et je vous verrai vendredi, d’aujourd’hui en huit. Je ne comprends pas que vous n’ayez rien reçu des Sutherland. Charles Gréville ma dit ce que je vous ai mandé, comme une chose arrêtée, convenue. Mais il faut qu’ils vous l’écrivent eux-mênes. Adieu. Adieu.
Je corrige une phrase à ma lettre. Ce que j’avais mis ne rendait pas ma pensée. On dit qu’on a trouvé dans les poches de cet Edward Oxford, un papier qui ferait allusion à quelque relation avec Hanovre. Cela n’est pas croyable.
392. Londres, Mercredi 10 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Ceci doit être ma dernière lettre. Savez vous mon sentiment ? c’est que je ne vous ai rien dit depuis le 25 Février. Je ne vous ai pas plus parlé que je ne vous ai vue. J’ai sur le cœur tout ce que j’ai pensé et senti pendant ce temps là. Quel débordement, comme vous dites ? Le beau temps dure, et par trop étouffant. J’ai été me promener hier au soir dans Regent’s Park jusqu’à 9 heures et demie. L’air était doux, frais, le ciel pur, les eaux pures aussi. Je vous attendais là. Je crois que je suis sorti le dernier. Il me paraît qu’on se bat toujeurs autour du corps de M. de Rumigny. Je suis essez curieux de l’issue. Le Roi en voudra beaucoup à Thiers.
Avez-vous vu Zéa ? Je serais curieux aussi de savoir ce qu’il pense des affaires du moment dans son pays. Il me paraît que les modérés sont dans une grande colère et méfiance, du voyage de la Reine. Ils croyent qu’elle veut les livrer aux exaltés. Je ne comprends pas On dit que Rumigny ne sera pas le seul. Dalmatie et Latour Maubourg sont ménacés. Il faut payer ses dettes. Ste Aulaire et Barrante n’ont rien à craindre. M. de Metternich, et l’Empereur Nicolas, les défendent. Du reste si la diplomatie est traitée comme l’administration, il y aura plus de bruit que d’effet. Que de préfets remués pour en changer un seul ! Je n’aime pas le humbug, même quand il sert à empêcher le mal. Mais il faut bien s’y résigner.
Une heure
Je ne vous dirai pas encore de gros mots. Je ferai plus. Je mettrai votre conscience à l’aise. Je viens de recevoir une invitation de la Reine pour Windsor, dîner le 17, passer la journée du 18, déjeuner le 19. Il n’y a pas moyen de n’y pas aller. Si vous arrivez ici le 15, nous aurons à nous la journée du 16 mais si vous n’arrivez que le 16 au soir ou le 17 matin, nous aurons à peine, le temps de nous entrevoir avant mon départ pour Windsor. Ne vous pressez donc pas de manière à vous troubler ou vous fatiguer. C’est une ennuyeuse parole que je vous dis là. Je suis très pressé. chaque jour plus pressé. Mais puisque ma course de Windsor coïncide avec votre tracas de ménage, faites ce qui vous convient. Je vous donne, pour arriver à Londres latitude jusqu’au 19. Si vous arrivez le 15 ou le 16, je serai parfaitement heureux. En tout cas, je vous écrirai encore à moins que votre lettre de demain ne me dise le contraire. Je vois que l’affaire des ambassadeurs tournera comme celle des prefets. Lord Palmerston ne revient qu’aujourd’hui de Broadlands. Il doit y avoir un conseil de Cabinet ce matin, probablement sur les affaires de l’Orient. Si on voulait m’admettre dans ce conseil, je crois en vérité que je serais tranquille. Cette parole est bien arrogante ; mais j’ai vu tant d’affaires mal conduites uniquement parce qu’on ne savait pas, parce qu’on n’avait pas pensé. Ici surtout on ne pense pas à assez de choses! Et chacun pense à son affaire, et ne sait rien de celles des autres. Evidemment si, dès le premier jour, toutes les faces de cette question d’Orient avaient été présentées à Lord Polmerston, lui-même ne se serait pas engagé comme il l’a fait. Cela perce à chaque instant dans sa conversation.
3 heures et demie
Je viens de faire quelques visites Je ne voulais voir que lady William Russell. Je ne l’ai pas trouvée. Elle m’inspire une estime mêlée de quelque curiosité. On dit que son mari, après avoir débuté par la Juive, fait à présent des sottises avec tout le monde. Est-ce qu’il en est en Angleterre des hommes comme des femmes ? J’entends dire qu’ici c’est à 40 ans quand leurs enfants sont élevés, que les femmes s’émancipent. Et on me cite des exemples. Nous avons ici de très mauvaises nouvelles du Rois de Prusse. Je suppose que vous les avez aussi. Adieu. J’ai été dérangé deux ou trois fois depuis que je suis rentré. Je dine chez Sir Robert Inglis. J’irai de là chez lord Grey. Lady Grey m’a écrit hier pour m’y engager. Je suis très bien avec eux. Adieu Adieu
391. Londres, Mardi 9 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
A mon tour, j’ai une lettre bien courte ce matin. Mais je ne m’en plains pas. Je ne me plaindrai de rien cette semaine, ni la semaine prochaine, à moins que je ne me plaigne de vous ce qui ne sera pas. Je voudrais bien vous trouver quelqu’un pour vous accompagner. Pour calmer votre imagination sur du danger, il n’y en a point ; et la fatigue, un compagnon ne vous l’épargnerait pas. J’espère qu’elle ne sera pas grande. Le temps est beau. Quel dommage que je ne puisse pas aller vous prendre à Boulogne ? Ce serait si facile, si ce n’était pas impossible ? J’ai peine à voir d’où viennent vos pronostics de guerre. Je ne m’attends pas à ce qu’on fasse grand chose ici sur l’Orient. Et quand même on ferait quelque chose, je ne crois pas que la guerre en sortît. Je vous attends pour causer de cela, comme de tout. Quand nous pourrons causer que nous mépriserons ce qui s’écrit. Pendant qu’on hésite en Occident, Méhêmet Ali s’affermit et s’anime en Orient. Il agit partout où il y a des Musulmans ; il les rallie, il les échauffe. Il gagne chaque jour plus de crédit à Constantinople. Si on le pousse à bout nous aurons quelque étrange spectacle. C’est là du moins ce que promettent les apparences. Mais j’ai appris à me méfier des apparences et des promesses. Que la part de la charlatanerie est immense en ce monde ! Il y en a moins ici qu’ailleurs, et pourtant le humbug est grand ici !
Le Prince Esterhazy n’arrive pas. On dit qu’il ne se soucie pas de venir tant que l’affaire d’Orient durera. Et M. de Metternich non plus n’est pas pressé qu’il vienne. Il trouve que Neumann convient mieux à l’insignifiance, et à la tergiversation. Je n’ai point de nouvelles. On est encore aujourd’hui en vacances. Lord Palmerston ne revient que demain de Broadlands.
Le bruit court de nouveau que lady Palmerston est grosse ; bruit très général. On en parlait hier chez les Berry comme d’une chose que tout le monde savait. Il y avait hier chez les Berry, cette grande Miss Trotter qui a failli épouser M. de la Rochéfoucauld et qui ne l’a pas épousé parce qu’il n’a pas voulu lui permettre une femme de chambre protestante. Vrai type anglais grande, blonde, riche, belle avec de grands et gros traits, teint éclatant et sans finesse ; avide d’esprit, prompte à l’enthousiasme ; quelque chose de très sincère, et de très factice, l’air noble sans rien de distingué. En revenant de chez les Berry, j’ai passé un quart d’heure chez lady Jersey qui avait un petit rout. J’y ai vu vingt Miss Troller.
Dites-moi donc ce qui en est de Stafford house, et si on le met réellement à votre disposition. Je le voudrais bien pour que vous n’eussiez, point d’embarras. J’aime bien vos idées d’arrangement. Out pour tout le monde à des heures déterminées. Ne trouvez vous pas que, dans la jeunesse on aime l’imprévu et, quand on n’est plus jeune, le réglé ? Il y aura bien aussi de l’imprévu, et qui sera charmant. Mais le réglé fera le fond. de la vie. Je reçois ce matin une invitation du marquis de Hertford pour dîner à sa villa de Regent’s Park, qui paraît très jolie. Connaissez-vous beaucoup le marquis de Hertford ? Vous devriez dîner là. Adieu.
Je vous quitte pour écrire des dépêches. J’envoie un courrier ce soir. Il me semble que cette manie de voyage de la Reine d’Espagne fait assez de bruit. Le mouvement des journaux est vif pour envoyer M. de la Redorte à Madrid ! Ils montent à l’assaut. On me dit qu’il est bien trist’ le pauvre M. de la Redorte. Il ne se trouve pas tout le crèdit qu’il se croyait. Adieu. Adieu.
389. Londres, Samedi 6 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Moi aussi, j’ai le cœur plus libre. On vient de me remettre le 394. Savez-vous qui en a profité ? Toute mon ambassade qui passé une demi-heure avec moi après déjeuner. Je cause avec eux. J’étais tout à l’heure très animé, fécond, inventif, éloquent. Eux ils étaient visiblement charmés de moi. Ils ne savaient pas pourquoi. Soyez très éloquente aussi avec moi, quand vous serez ici. J’aime passionnément l’éloquence. Vous partez dans huit jours, samedi prochain. Que la semaine sera longue ! Je donnerais bien des choses pour qu’il fit aussi beau qu’au jourd’hui. Pas le moindre vent ; un soleil admirable. Vous viendriez agréablement et vous viendriez vite. J’ai passé hier ma journée chez moi, sauf ma visite à lady Palmerston. Le soir aussi Je me suis couché de bonne heure. Il faut que mon tempérament soit aussi complaisant pour moi que mon caractère l’est pour les autres. ai grand besoin de sommeil. Je n’en ai pas toujours autant que je voudrais. Pourtant cela s’arrange. Quand je peux avoir une longue nuit je la prends, et elle me vaut pour une semaine. Je suis bien aise qu’on écrive d’ici que mon établissement est bon. Je vous attends avec impatience pour les petites choses après les grandes. Je suis sûr, parfaitement sûr que tout n’est pouve pas bien, qu’il y a des manques, que je me trompe quelquefois. Personne ne me reproche rien. Depuis que je suis ici, ni sur ma conduite, ni sur ma maison, je n’ai pas entendu une critique. C’est impossible. C’est absurde. Venez, venez. Apportez-moi de la vérité avec du bonheur.
Voici jusqu’à présent mes dîners du mois. Je ne vous dis pas ceux que j’ai refusés aujourd’hui la Reine. Le 6, les Berry, à Richmond. Le 10, Sir Robert Inglis. Le 14, lady Williams, à Putney-heath. Le 14, lady Lovelace. Le 20, Sir John Hobhouse. Le 22. Rothschild à Gunnersbury. Le 24, lord Abinger. Le 27, lord Monteagle. Il me semble qu’il n’y a rien là que de convenable. A propos de convenable, Mad. Maberly ma envoyé son roman, Emily. Il faut bien que j’écrive un billet poli, n’est-ce pas ? Je n’ai pas lu le roman. On dit qu’il est parfaitement innocent et parfaitement ennuieux. Vous avez cent fois raison, et je suis de votre avis depuis longtemps. Il y a longtemps que je pense et dis que le sénat Romain et le parlement d’ Angleterre sont les deux plus grands gouvernement que le monde ait connus. J’appelle grands gouvernemens ceux qui font de grandes choses par de grands hommes. J’ai peine à croire que la mort du Roi de Prusse soit la révolution. D’après tout ce qui me revient, le successeur sera bien timide. Il a l’esprit plus actif que la volonté. Beaucoup de pojets et de paroles de grandes ardeurs de pensée et de conversation, puis les goûts d’une vie régulière et molle ; voilà notre temps surtout dans le haut de la société. Les gouvernemens sont aujourd’hui des cadres où les Rois viennent se placer et s’emprisonner successivement, comme des images. On a pris avant-hier mes chevaux; on les a mis chacun dans une boite ; sur cette boite on a jeté un filet. La machine a grondé ; le train est parti, et mes chevaux sont arrivés à Eton, sans avoir bougé, malgré qu’ils en eussent. Ce sera le sort de bien des Rois, et de bien des ministres. Voici quatre jours d’immobilité pour les affaires. On va à la campagne. On croit en général que la session finira de bonne heure. Je le voudrais pour nos campagnes.
3 heures
J’ai été interrompu par Lord Brougham changé, triste, fatigue, abattu, dégoûté. Fatigué matériellement ; il a imaginé de venir de Cannes à Calais dans ce que nous appelons, une voiture, un carosse de louage toujours avec les deux mêmes chevaux. Vingt-six jours pour traverser la France. Il a fait la route à pied. Je l’ai revu avec plaisir. J’aime sa conversation c’est-à-dire son monologue. Il est ici un homme très important sans influence, et très considérable sans considération. C’est curieux. Adieu. Je pense au 26 avec un plaisir infini. A ma gauche, n’est-ce pas ? Il me semble que c’est de droit. Il n’y a de femmes outre la duchesse de Cambridge, que lady Aylesbury, lady Jersey, lady Etizabeth Stuart et lady Peel. Adieu. Adieu.
384. Londres, Dimanche 31 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure et demie
Le voilà ce prétendu 388 qui est le 387. Où est-il allé ? Qui l’a arrêté en route? Je n’en sais rien. Je n’y comprends rien. Enfin le voilà, avec le vrai 388. J’ai passé une très mauvaise journée. J’avais l’imagination très noire. J’ai promèné mon mal partout, chez Lady Kinnout à Holland-House, chez Lady Jersey. Vous m’avez suivie partout, malade, mourante, je ne sais quoi. En rentrant, j’ai monté l’escalier quatre à quatre ; j’ai regardé sur ma table, s’il n’y avait pas une lettre quelque oubli de la poste, quelque voyageur. En ne voyant, rien, j’ai eu un mécompte comme si j’avais attendu quelque chose. Par moments, des moments bien courts, je m’en voulais de tant d’anxiète que les spectateurs, s’il y en avait eu, auraient à coup sûr, appelée tant de faiblesse. Ah, que les spectateurs sont sots ! Pour comprendre le chagrin, il faut sentir l’affection ; et l’affection, le chagrin, tout cela est personnel ; on ne le sent que pour soi-même. On passerait pour fou si on laissait entrevoir la millième partie de ces suppositions, de ces émotions innombrables, ingouvernables, qui obsèdent le cœur.
Il y avait dans la lettre du gros Monsieur, 386 une phrase dont je ne pouvais me délivrer : " Je me sens si malade ? " Je lisais cela partout, dans les yeux de mes voisins, dans les journaux du soir. Je n’y veux plus penser. Non, je ne veux pas vous faire courir la poste comme un courrier, ni vous forcer à traverser un jour de gros temps. Mais voulez-vous bien sérieusement que je ne sois pas trop impatient pour le 15 ? Voyons dites ; voulez-vous ? Convenez que j’ai un bon caractère. Rappelez- vous vos colères, vos reproches quand j’ai tardé d’un jour, quand je n’ai pas été parfaitement sûr. J’ai bien envie, pour me venger, de vous conter toutes les coquetteries que m’a faites hier Lady Kinnoul. Je voudrais bien savoir de quel droit lady Kinnoul me fait des coquetteries. Mais droit ou non, elles étaient bien coquettes.
Lord & lady Hatherton, lord et lady Manvers, lord et lady Cadogan, lord et lady Poltiemore, lord Liverpool, M. Leshington. Voilà le dîner. Personne, le soir à Holland house, Si ce n’est au bout de la bibliothèque, lady Essex, l’actrice Miss Stephens, assise au piano et chantant très agréablement pour Lord Holland et M. Allen. 3 heures J’ai été interrompu par la visite de Chekib. Effendi. Celui-là est intelligent. Il est pressant. aussi. Il a raison. Son Empire s’en va. Et si on fait naître là une guerre, quelle qu’elle soit il s’en ira encore plus vite. L’immobilité de l’Orient, l’accord général de l’Occident, à ces deux conditions la Porte peut encore durer. Si l’une ou l’autre manqur, si nous nous divisons ici et si on se bat en Asie, c’est le commencement du grand inconnu. Je dis cela beaucoup, et tout le monde est de mon avis, presque tout le monde. Mais les avis sont peu de chose ; c’est la volonté qui fait.
Ce cabinet-ci est dans une situation bien critique pour élever dans ses chambres et dans le monde, une si grande question. Et je doute que sa situation critique soit de celles dont en sort en élevant une grande question. Je ne crois pas qu’il y ait à s’abstenir définitivement, beaucoup de jugement, ni de prévoyance. Et j’attendrais sans beaucoup de crainte la démonstration des évènements. Votre conversation avecT hiers est charmante. Je suis quelque fois tené de croire qu’il est embarrassé et se déchargerait volontiers de son embarras, pour un temps, sur les épaules d’autrui. Nous verrons jusqu’à quel point la fécondité de l’esprit, la dextérité de la conduite et le talent de la parole suffisent au gouvernemen t! En attendant, il est absurde de se plaindre qu’il ne s’occupe pas des petites affaires. Je suis sûr qu’il s’en occupe plus qu’on n’a le droit de l’exiger dans sa situation. C’est précisément une de ses qualités de pouvoir penser à la fois à beaucoup de choses, grandes et petites, et porter rapidement de l’une sur l’autre son activité et son savoir faire.
Lundi 1 juin
Je trouve en m’éveillant le Roi de Prusse mort de plus grands que lui sont morts. Je le regrette. C’est toujours beaucoup qu’un Roi honnête et sensé. Je me suis intéressé à lui dans ses temps de malheur. La façon dont ils étaient traités lui, sa femme, son pays, m’indignait. Je n‘ai pas à me reprocher d’avoir pris plaisir à à Mexico et à Calcutta comme dans un écho. La place manquera à l’ambition et à la puissance des hommes. Priez Dieu qu’ils ne deviennent pas fous.
2 heures
Je reviens d’un meeting on the slave trade, où le Prince Albert a fait son début in the chair. et je trouve le 389, votre départ pour le 13. Vous ne m’avez jamais donné de si principale nouvelle. J’ai quelques doutes sur un congé à demander à Thiers pour Génie. Sans cela, rien de plus simple que de le faire venir ici pour huit jours en vous accompagnant. Il faut que j’y pense, et que je lui en écrive à lui-même. Cela se pourra peut-être sans inconvénient. Je serais charmé de vous donner ce gardien là. Mais je ne veux pas que Thiers suppose je ne sais quoi. C’est bien intime de faire ainsi passer mon intérêt avant votre agrément. Mais je suis sûr que vous le trouvez bon. Le meeting était très nombreux et intéresant. Le Prince a été fort bien reçu. O’Connell et Sir Robert Peel également bien reçus, également applaudis. Public très impartial, et prenant. plaisir à se séparer de la politique. Grand applaudissement aussi à mon nom et à ma l’arrogance brutale et déréglée que j’ai vu régner. Elle était pleine de grandeur ; mais la grandeur à son tour était pleine de grossiéreté et de folie.
Le rappel de Ste Hélène, c’est juste. Les Invalides c’est juste, St Denis aussi serait juste, quoique moins convenable. L’apothéose serait une impièté. Et aussi une demence. La Prusse elle-même m’intéresse. Il y a en Europe trois pays que j’aime après le mien : l’Angleterre, la Hollande et la Prusse. Je suis très protestant par là. C’est la Réforme qui a fait ces trois pays, qui a fait leur caractère, et en bonne partie leur grandeur. Et l’Europe leur doit une bonne partie de la sienne, sans compter l’avenir. Il n’y en a plus pour la Hollande. Les petits pays sont morts. Deux choses aujourd’hui sont trop grandes pour eux, les idées et les évènements. Ni l’esprit, ni l’activité des hommes ne peut plus se contenir dans un étroit espace sur notre terre, le plus grand espace sera bientôt si étroit ! De Londres à New York, douze jours ; bientôt six jours ; on construit en ce moment à Bristol une machine qui double la force de la vapeur. On se promènera autour du monde. Les paroles dites à Paris retentiront. personne, mentionnés assez éloquemment par le sir Lushington. Mais puisque, vous ne devez ignorer aucune de mes vanités, voici mon plaisir de ce matin. Je suis arrivé un peu tard à Exeter hall. Le Prince était déjà in the chair. On se pressait pour entrer. Sur l’escalier, à la porte de la salle dans la salle, la foule était immense. En abordant la foule, j’ai dit the french ambassador, pour m’aider à avancer. Le premier venu à qui je l’avais dit, a dit à ses voisins. Mr Guizot. Tout le monde, a répété mon nom, personne ma qualité, et tout le monde m’a fait place. Un fils de M. Wilberforce, archidiacre dans l’ile de Wight, a parlé supérieurement avec beaucoup d’éloquence, naturelle et spirituelle. Sir Robert Peel a bien parlé, éternellement bien. Je vous dis que vous ne connaissiez pas M. de Brünnow. Savez-vous comment il était vendredi dernier, à une heure du matin, dans le vestibule de Buckingham Palace, sortant du concert de la Reine et attendant sa voiture au milieu de la très bonne compagnie qui attendait comme lui ? Une sale casquette de voyage sur la tête pour ne pas s’enrhumer. Je suis un peu choqué que vous m’ayez dit que je lui plairais. Du reste, je crois que vous avez eu raison. Il parle très bien de moi Il me semble que l’approche de notre rencontre me rend bien bavard. Vous ne vous plaindrez pas que cette lettre soit courte. J’en ai bien plus long à vous dire. Adieu. Adieu. Quand vous serez ici, il me semble impossible que nous n’arrangions pas tout vous, moi, Londres, et la campagne. Il y a deux choses avec lesquelles on peut tout. La seconde, c’est de l’esprit. Devinez la première. Adieu. Ma mère vous priera peut-être de m’apporter le portrait d’Henriette, dans une boite. J’espère qu’il ne vous embarrassera pas trop. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Progrès, Relation François-Dorothée, Religion, Séjour à Londres (Dorothée)
382. Londres, Vendredi 29 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Voilà un peu d’eau froide sur la mousse Bonapartiste et un petit dédommagement au réjet de la dotation Nemours. La chambre a montré plus d’intelligence et de fermeté que je n’en attendais. La forme est mesquine, mais le fond est bon. Gardez mon avis pour vous, je vous prie, puisque je ne suis pas obligé d’en avoir un. Vous me direz votre impression de la séance car j’espère que vous aurez été assez bien pour y aller.
Je n’ai jamais été si préoccupé du temps, de l’air, du soleil, du brouillard. Je vois tout cela sur votre tête. Et je vois tout ce qui se passe en vous sous toutes ces influences. Le beau temps persevère. Je fais beaucoup de courses la semaine prochaine. Ellice me mène Mercredi à Epsom ; je dînerai tout près, chez M. Motteux. Je reviendrai tard. Jeudi, je vais à Eton. C’est une grande solennité du Collège. On désire beaucoup que j’y sois. Tout cela ne me plaît pas beaucoup ; mais je me prête assez facilement à ce qui ne me plaît pas beaucoup, surtout quand je n’ai rien qui me plaise beaucoup. L’indifférence me rend très complaisant. Je ne le serai pas tant quand vous serez ici. Je deviendrai avare de mes chevaux. Et de mon temps.
J’attends mon gros Monsieur. Je sais qu’il vient d’arriver, et qu’il va venir chez moi. Je sais aussi qu’il vous a laissée mieux et meilleur visage que trois jours avant son départ. Il m’a apporté un très joli petit portrait de Guillaume par Mad. Delessert ; rien, une ébauche à moitié ébauchée, mais parfaitement ressemblant, et gracieux. Ressemblant au modèle et au peintre. C’est ce qui arrive souvent. On met du sien partout. Qu’est-ce qu’un comte Woronzoff qui vient d’arriver et que M. de Brünnow m’a présenté ? Il m’a parlé du comte Michel, comme de son frère ou de son cousin ; je n’ai pas bien entendu. Il y avait hier soir un concert chez la duchesse d’Argyll, un bal chez la duchesse de Montrose. Je n’y ai pas été. Je me retire de la frivolité, comme vous dites. Je ne veux pas qu’on dise que je ne m’en retire qu’à cause de vous. Je vais ce soir au concert de la Cour après le dîner de Lord Haddington.
4 heures
Mon bonheur s’est fait attendre longtemps. Enfin il est venu. Il ne faut pas beaucoup de lettres pour faire beaucoup de bonheur. Vous avez déjà mon impression sur la séance où vous étiez. De loin, j’ai été frappé surtout du fond. Vous de près, surtout de la forme. C’est dans l’ordre. Je persiste dans mon impression. C’est un acte de bon sens et de fermeté contre le brouhaha populaire. Je ne crois à aucun évènement prochain où je puisse être intéressé. Vous savez sur quel terrain je me suis placé, et vous m’y approuvez. La proposition Rémilly pourrait seule murir rapidement la situation. On m’écrit de tous côtés qu’elle sera rapportée peut-être, ce qui ne signifie rien, mais point discutée ce qui serait grave, decisif peut-être. En tout cas, j’y regarde beaucoup ; et si j’y voyais quelque chose, je vous le dirais sur le champ. Certainement, un chassé croisé serait déplorable, ridiculement déplorable. J’ai tant attendu qu’il faut que je finisse. Dans trois semaines, nous ne finirons jamais n’est-ce pas ? Je suis assez d’avis que vous arriviez d’abord près de Londres. Adieu, Adieu. En attendant. Cette fois, l’erreur était double. Pour 386, vous avez mis 287. Adieu.
231. Val-Richer, Mercredi 31 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Aujourd'hui c’est tout seul que je me suis promené. Je viens de marcher trois heures, au petit pas, dans les bois, les près avec ou sans chemin, pensant à vous et à Washington. Vous vous ressemblez peu. Pourtant c'était une grande matière, et il a bien vraiment accompli sa destinée quand il a vaincu et gouverné. Il l’a fait très simplement et de sang froid, sans vit plaisir, mais aussi sans prétention ni effort. C’est peut-être le seul grand homme qui l'ait été par occasion seulement, poussé en haut par la nécessité des choses et non par l'élan de son propre esprit et de sa propre volonté. Deux choses lui manquaient : la passion et la pensée ; la passion ardente, insatiable ; la pensée spontanée, variée, illimitée dans son activité. Mais appelé à agir, je ne connais point de jugement, plus droit, plus imperturbable dans la vérité, point de caractère plus ferme et plus serein, toujours au niveau des grandes choses sans jamais se croire au dessus. Je vous en dirais long si je vous disais tout ce qui me vient à l'esprit sur lui en lisant sa vie et ses Lettres. J’ai pensé à vous bien plus qu'à lui. J’aime extrêmement à penser à ce que j’aime. On dit que les avares passent des heures à contempler leur trésor. Je suis un avare. Bien certainement je le suis. Je me comptais à regarder mon trésor, & je veux le garder pour moi seul.
Jeudi 6 heures
Le soleil est admirable ce matin. C’est une rareté. Je voudrais que vous vissiez ma bibliothèque au soleil levant. Il y entre à flots par neuf grandes croisées et se répand sur deux vastes jardinières pleines de fleurs et sur une série de gravures, encadrées le plus simplement du monde, en chêne et en sapin de Suède, comme la bibliothèque, mais toutes fort belles, saintes et profanes des Saintes Familles, la communion de St Jérôme, le spasimo de Raphaël, Napoléon à Eylau à Austertitz, à St Hélène, Henri 4 à Paris, Gustave Wasa à sa dernière diète & Je suis sûr que cela serait de votre goût, la bibliothèque et le soleil. Si le Cardinal Fesch qui répand son argent à tort et à travers, m'en avait laissé un peu je ferais du Val-Richer une habitation charmante. J'ai, pour cela la matière et l’esprit. Rien ne me manque que l’argent. Je comprends que l’Europe s'amuse du spectacle des Buonaparte, se disputant cet argent. Quand Fesch fut fait Cardinal, le maréchal Lefèvre ( duc de Dantzick ) homme d’esprit malicieusement grossier, lui dit avec son accent alsacien : « Sap.. Monseigneur, c'est pien heureux que je ne fous ai pas fait pendre ce chour que fous safez pien, quand fous étiez fournisseur ! " A coup sûr tous les Buonaparte trouvent aujourd'hui comme lui que c’est bien heureux. Chaque pays a ses scandales et ses hontes. L'Angleterre a vu le squelette de Cromwell de l'homme à qui elle avait obéi et qui compte au rang de ses plus grandes gloires, pendu à Tyburn et jeté dans la Tamise. Il n'en arrivera jamais autant à Caradoe. Le voilà Pair d'Angleterre. La Princesse Bagration sera-t-elle Pairesse ?
9 h. 1/2
Comment, quatre mois sans nous voir ? Est-ce que de manière ou d'autre, vous ne reviendrez pas à Paris dans le cours de septembre, soit pour y rester, soit pour y passer en allant en Angleterre ? Dans l'un et l'autre cas, j’irai vous y voir. Vous ne comptez certainement pas rester à Baden jusqu'au mois de Décembre. Dites-moi un peu vos projets. Ayez des projets si j'étais près de vous, je m'en chargerais. Je suis décidé à m'en charger désormais jusqu'à la dernière limite du possible pour moi. Mais à présent, je suis loin. Adieu. Adieu. Voilà quatre jours qui me pèseront jusqu'à ce que vous ayez recommencé à avoir des lettres tous les jours. Vous savez que je ne jouis de rien à moi seul. Adieu. Adieu. G.