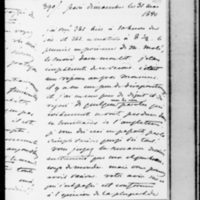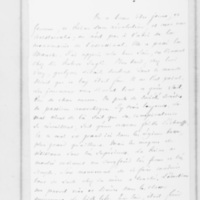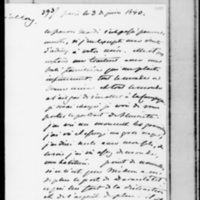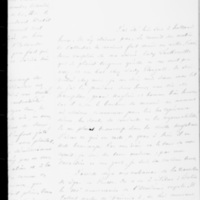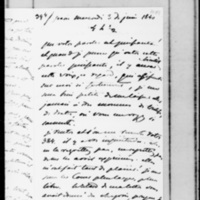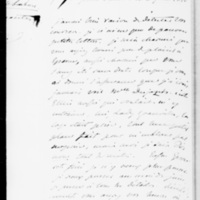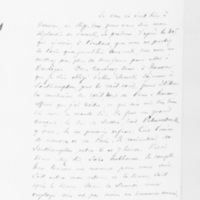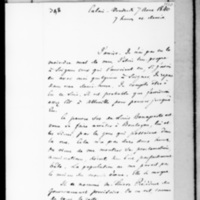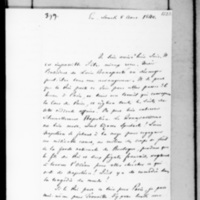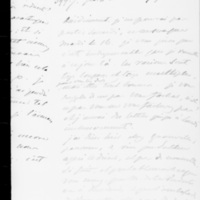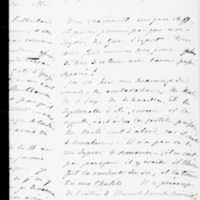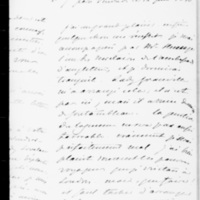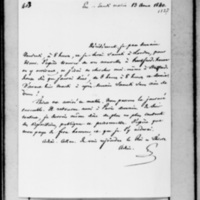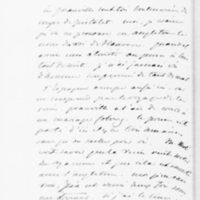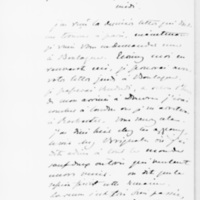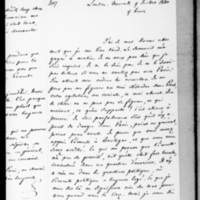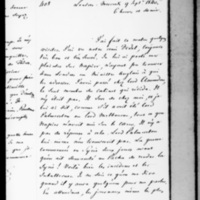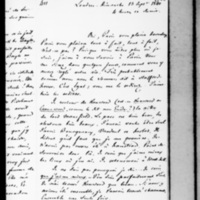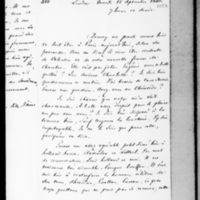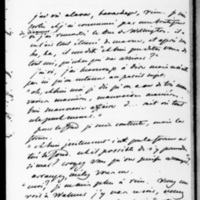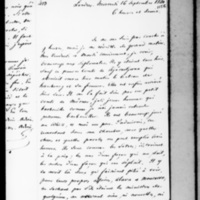Votre recherche dans le corpus : 337 résultats dans 3827 notices du site.
390. Londres, Dimanche 7 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je vous écris avec une pensée charmante, dans le cœur. Plus que trois fois. demain, mardi et mercredi. Car sans doute vous partirez samedi matin. Vous me direz. Ma course à Epsom ne m’a pas paru si drôle qu’à lord Granville. J’ai peu ri. Ce qui me fait sourire, c’est l’importance qu’on attache quelquefois, dans le monde, à certaines choses, et tout ce qu’on y voit. J’ai été à Epsom. Epsoms est frivole. Tous les gens frivoles y vont. Donc, je deviens frivole, donc, je ferai ce que font, les gens frivoles. Donc, donc, .... Il y a bien du factice et bien de la servilité en cela d’agir plus simplement et plus librement. On me dit qu’Epsom est un spectacle curieux. Ellice me propose d’aller dîner à la campagne, tout près, avec sa famille et lord Spencer, et d’aller de là, voir ce spectacle. Je vais dîner avec Ellice et lord Spencer. Je vais avec eux me promener à Epsom. Je trouve que c’est long, et je reviens me coucher à onze heures. Si le monde voit dans ma promenade quelque chose de plus, et s’en promet, sur moi quelque empire de plus, le monde se trompe et le verra bien. Epsom m’a laissé comme il m’a pris, sans embarras d’y aller et sans envie d’y retourner.
Je vous en prie ; ne soyez pas un peu malade, dans vos lettres ni ailleurs, pour ces misères. Ayez foi. Vraiment ceci ne vaut pas la peine de douter. Et dites moi toujours tout à chaque occasion, petite ou grande, je vous en aime davantage. Même quand ce que vous me dîtes, me fait sourire.
J’ai beaucoup causé hier avec la Reine, à dîner surtout, causé de je ne sais quoi mais assez agréablement. Soyez sure qu’elle a de l’esprit, et pas mal de sérieux et de fermeté dans son jeune esprit. Elle est bien jeune. Elle rit toujours. Et on voit qu’elle a envie de rire encore plus qu’elle ne rit. Peu de monde, lord Melbourne et lord Palmerston, le Maréchal Saldanha, le comte de Hartig, M. et Mad. Van de Weyer qui sont revenus de Bruxelles, la maison. J’avais à ma droite lady Mary Howard, fille du comte de Surrey, enfoncée dans sa shyness et ses beaux cheveux blonds. Après le dîner, quelques uns ont joué au Whist, d’autres aux échecs. Nous nous sommes assis, autour d’une table. Conversation froide et languissante. La Reine va à Windsor, dans deux ou trois jours, je crois. La Duchesse de Sutherland est partie ; mais Charles Greville m’a dit qu’elle vous donnait Stafford-House, et que vous seriez là, en son absence. Cela me paraît très bien. Vous ne le saviez donc pas encore. Vous me l’auriez dit.
6 heures
Je viens de faire le tour complet de Regent’s park. J’ai marché une heure et demie, seul, lentement, pensant à vous. Quand vous serez ici, je ne ferai plus guère ces grandes promenades solitaires. Je vous donnerai mon loisir. Le beau temps dure. Je le regarde. Je lui demande, s’il durera dans huit jours. Alava a été assez malade. Il est bien bon enfant et pas mal au courant ; mais personne ne compte avec lui. Est-il vrai que M. Van de Weyer est un peu remuant et commère ? Que de choses j’ai encore à vous demander, quoique je commence à être établi ! N’est-ce pas, vous aurez la bonté avant de partir, de faire demander à Génie s’il n’a rien à m’envoyer. Décidément, il y aurait, à ce qu’il vint dans ce moment, assez d’inconvénients.
Lundi une heure
Je suis charmé que nous ne veniez à Londres qu’à cause de moi, et je veux que vous y trouviez infiniment plus de plaisir que de tracas. Je n’aime pas du tout le tracas. J’ose dire qu’il n’y a personne à la nature de qui il soit plus antipathique qu’à la mienne. Mais quand au bout du tracas, il y a un plaisir, un vrai plaisir, le tracas disparaît, je l’oublie absolument, je le traverse indifféremment. C’est si beau d’être heureux ! Si charmant ! Peu importe le prix du bonheur. Vous n’êtes pas si bien douce que moi. Vous avez le bonheur, très vif, mais la contrariété très-vive aussi, et au moment ou vous payez le bonheur, vous pensez à ce qu’il coûte. Moi, je ne pense jamais qu’à ce qu’il vaut. On m’a apporté hier le petit portrait d’Henriette, très ressemblant et très joli. Je viens de recevoir des nouvelles de leur arrivée à Lisieux. Les voilà établis à la campagne. J’espère qu’ils y seront bien. Vers le 15 suillet. ils iront aux bains de mer, à Trouville sur cette côté où je me suis promené en m’efforçant de traverser des yeux l’Océan pour alles vous chercher en Angleterre où vous étiez alors. C’est moi qui suis en Angleterre, et c’est vous qui venez m’y chercher. Mais pas des yeux seulement.
Adieu. Cet adieu est très à sa place.
Je ne crois pas à la guerre. Vous savez qu’en général je n’y crois pas. Mais pas en particulier non plus. Thiers s’amuse à en parler. cela lui plaît ; et cela lui sert aussi. Un peu de fièvre dans le présent, en perspective d’un peu de bruit dans l’avenir ; sa position s’arrange de cela. Il le croit du moins. Je ne connais personne ici qui accepte la pensée de la guerre. On est déjà assez préoccupé de celle de Chine qui sera probablement plus sérieuse qu’on n’a prévu. Je n’ai pas grande estime pour le nombre ; pourtant c’est quelque chose et en Chine ce quelque chose est immense. Adieu décidément. Plus que deux lettres. Adieu. Adieu. En attendant.
390. Paris, Dimanche le 31 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu 381 hier à 10 heures du soir, et 382 ce matin à 8 1½. Le premier en présence de M. Molé, le second dans mon lit. J’étais impatiente de ce second. C’était une réponse au gros Monsieur. Il y a eu un peu de désapointement. Et j’ai eu un peu de dépit et de regret de quelques unes de mes paroles qui évidemment se sont perdues dans les brouillards de l’Angleterre. Je vous dis ceci en passant, par la simple raison que je dis tout. Vous jugez la semaine dernière autrement que moi et que beau coup de monde. Mais vous pourriez avoir raison. Votre avis sur ce qui s’est passé est conforme à l’opinion de la plupart de un habitué et d’un autre gros Monsieur qu’ils vont voir quelques fois. La suite décidera.
La nouvelle s’est répandue hier que le Roi de Prusse était mort. Le télégraphes de Strasbourg l’a mandé sur un avis de votre ministre à Francfort. Cela me parait un peu sujt à caution, mais en tout cas cet événement ne peut pas tarder à arrivé. C’est une grosse affaire. Il ne résultera que Paris et Pétersbourg seront plus près l’un de l’autre. Deux pièces de porcelaine où on a enlevé le coton.
Vous allez donc voir Epson ! Quand j’étais jeune. J’y ai été une fois, une seule fois mon mari n’a pas voulu y aller, c’est la dernière élégance. Vous y trouverez touta la plus brillante jeunesse de l’Angleterre. C’est un beau coup d’oeil, mais j’en suis revenu plus fatiguée qu’enchantée. Même jeune, le bruit seulement, le bruit ne me plaisait pas. Ensuite, j’ai subi tous les ans les courses d’Ascot à côté de George IV et je puis dire que c’est les moments les plus ennuyeux de ma vie. Il faut êtres fou de chevaux, ou bien oisif pour y aller ; mais je le répète c’est curieux pour une fois, et pour voir tout ce qu’il y a de fous et d’oisif dans le monde ! Vous serez frappé des équipages et des femmes. Je suis charmée que vous voyez Eaton ; je ne l’ai pas vu moi, mais cela a un côté sérieux et important, un peu grotesque aussi.
M. Molé affirme contrairement à mon opinion, que les funérailles de Napoléon ne puissent être faites avec sécurité que par un autre que Thiers. Il est très noir sur tout ce sujet. Son opinion est nécessairement exagérée, cependant aujourd’hui je vous assure que tout le monde est d’accord pour trouver toute l’affaire bien étourdie. Moi, je ne la trouve pas étourdie !! mon fils est vraiment bien. Après Baden, il reviendra à Paris, et compte rester deux ou trois mois auprès de moi. Le nom de son frère n’a pas été prononcé entre nous. Adieu. Je ne trouve pas qu’il y ait une seconde erreur dans nos N°. Je vous ai écrit Mardi 386 selon son tour. J’ai vu hier Montrond fort tranquille aussi, et content : " Tout cela ne sera rien. Il n’y a plus de Bonapartistes en France. " Le Roi a dit aux ambassadeurs : " tout ceci ne me regarde en rien, je ne m en mêle pas."
391. Londres, Mardi 9 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
A mon tour, j’ai une lettre bien courte ce matin. Mais je ne m’en plains pas. Je ne me plaindrai de rien cette semaine, ni la semaine prochaine, à moins que je ne me plaigne de vous ce qui ne sera pas. Je voudrais bien vous trouver quelqu’un pour vous accompagner. Pour calmer votre imagination sur du danger, il n’y en a point ; et la fatigue, un compagnon ne vous l’épargnerait pas. J’espère qu’elle ne sera pas grande. Le temps est beau. Quel dommage que je ne puisse pas aller vous prendre à Boulogne ? Ce serait si facile, si ce n’était pas impossible ? J’ai peine à voir d’où viennent vos pronostics de guerre. Je ne m’attends pas à ce qu’on fasse grand chose ici sur l’Orient. Et quand même on ferait quelque chose, je ne crois pas que la guerre en sortît. Je vous attends pour causer de cela, comme de tout. Quand nous pourrons causer que nous mépriserons ce qui s’écrit. Pendant qu’on hésite en Occident, Méhêmet Ali s’affermit et s’anime en Orient. Il agit partout où il y a des Musulmans ; il les rallie, il les échauffe. Il gagne chaque jour plus de crédit à Constantinople. Si on le pousse à bout nous aurons quelque étrange spectacle. C’est là du moins ce que promettent les apparences. Mais j’ai appris à me méfier des apparences et des promesses. Que la part de la charlatanerie est immense en ce monde ! Il y en a moins ici qu’ailleurs, et pourtant le humbug est grand ici !
Le Prince Esterhazy n’arrive pas. On dit qu’il ne se soucie pas de venir tant que l’affaire d’Orient durera. Et M. de Metternich non plus n’est pas pressé qu’il vienne. Il trouve que Neumann convient mieux à l’insignifiance, et à la tergiversation. Je n’ai point de nouvelles. On est encore aujourd’hui en vacances. Lord Palmerston ne revient que demain de Broadlands.
Le bruit court de nouveau que lady Palmerston est grosse ; bruit très général. On en parlait hier chez les Berry comme d’une chose que tout le monde savait. Il y avait hier chez les Berry, cette grande Miss Trotter qui a failli épouser M. de la Rochéfoucauld et qui ne l’a pas épousé parce qu’il n’a pas voulu lui permettre une femme de chambre protestante. Vrai type anglais grande, blonde, riche, belle avec de grands et gros traits, teint éclatant et sans finesse ; avide d’esprit, prompte à l’enthousiasme ; quelque chose de très sincère, et de très factice, l’air noble sans rien de distingué. En revenant de chez les Berry, j’ai passé un quart d’heure chez lady Jersey qui avait un petit rout. J’y ai vu vingt Miss Troller.
Dites-moi donc ce qui en est de Stafford house, et si on le met réellement à votre disposition. Je le voudrais bien pour que vous n’eussiez, point d’embarras. J’aime bien vos idées d’arrangement. Out pour tout le monde à des heures déterminées. Ne trouvez vous pas que, dans la jeunesse on aime l’imprévu et, quand on n’est plus jeune, le réglé ? Il y aura bien aussi de l’imprévu, et qui sera charmant. Mais le réglé fera le fond. de la vie. Je reçois ce matin une invitation du marquis de Hertford pour dîner à sa villa de Regent’s Park, qui paraît très jolie. Connaissez-vous beaucoup le marquis de Hertford ? Vous devriez dîner là. Adieu.
Je vous quitte pour écrire des dépêches. J’envoie un courrier ce soir. Il me semble que cette manie de voyage de la Reine d’Espagne fait assez de bruit. Le mouvement des journaux est vif pour envoyer M. de la Redorte à Madrid ! Ils montent à l’assaut. On me dit qu’il est bien trist’ le pauvre M. de la Redorte. Il ne se trouve pas tout le crèdit qu’il se croyait. Adieu. Adieu.
391. Paris, Lundi le 1er juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici notre mois, qui redeviendra. nôtre. J’ai vu Granville hier. Vous ne lui avez pas écrit sur M. Rey. Mais il ne s’y attendait nullement il n’y avait pas lieu à une réponse et il sait l’essentiel c’est que vous avez fait bon accueil à son recom mandé. J’ai oublié de vous dire que souvent M. Molé me demande vos opinions sur ce qui se passe ici, les mesures qu’on prend ou qu’on projette. Je réponds invariablement que je n’en sais rien du tout. J’ai été hier au soir chez Mad. de Brignoles. On parle beaucoup du Roi de Prusse. La nouvelle n’était pas confirmée, mais elle est imminente le matin j’ai vu chez moi les Appony et Paulini, qui est très divertissant vrai italien.
1 heure. Je n’ai pas encore votre lettre. J’en ai écrite une longue à mon frère ce matin. Je ne sais où il sera maintenant On ne voudra pas à Berlin que l’Emperatrice y vienne. Elle sera bien accablée de la mort de son père. Qu’en dit Bulow ? Voilà donc la souscription nationale par terre. Quelle inconséquence que toute la marche de cette affaire ! Je crois savoir de bonne source que la session sera terminée avant la fin du mois, qu’on se hâte d’arriver au budget pour noyer ou ajourner toute autre question, Rémilly du nombre. Il fait bien chaud, j’ai mille petites affaires désagréables, et Vous savez que je ne vaux rien pour les petites tracasseries. Elles me font presque l’effet d’un malheur.
Adieu. vous une très pauvre lettre. Mais votre journée mercredi sera bien remplie, et puis vraiment je n’ai rien absolument rien à vous mander. Je trouve qu’Appony a l’air défait et triste, mais il ne dit pas de quoi. On dit que le Roi est de très belle humeur.
Adieu. Adieu. Le comte Woronzoff qui est à Londres, est un grand Seigneur chez nous. Un bon enfant. il était à notre ambassade à Londres et y est resté pendant nos deux premières années. Adieu.
392. Londres, Mercredi 10 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Ceci doit être ma dernière lettre. Savez vous mon sentiment ? c’est que je ne vous ai rien dit depuis le 25 Février. Je ne vous ai pas plus parlé que je ne vous ai vue. J’ai sur le cœur tout ce que j’ai pensé et senti pendant ce temps là. Quel débordement, comme vous dites ? Le beau temps dure, et par trop étouffant. J’ai été me promener hier au soir dans Regent’s Park jusqu’à 9 heures et demie. L’air était doux, frais, le ciel pur, les eaux pures aussi. Je vous attendais là. Je crois que je suis sorti le dernier. Il me paraît qu’on se bat toujeurs autour du corps de M. de Rumigny. Je suis essez curieux de l’issue. Le Roi en voudra beaucoup à Thiers.
Avez-vous vu Zéa ? Je serais curieux aussi de savoir ce qu’il pense des affaires du moment dans son pays. Il me paraît que les modérés sont dans une grande colère et méfiance, du voyage de la Reine. Ils croyent qu’elle veut les livrer aux exaltés. Je ne comprends pas On dit que Rumigny ne sera pas le seul. Dalmatie et Latour Maubourg sont ménacés. Il faut payer ses dettes. Ste Aulaire et Barrante n’ont rien à craindre. M. de Metternich, et l’Empereur Nicolas, les défendent. Du reste si la diplomatie est traitée comme l’administration, il y aura plus de bruit que d’effet. Que de préfets remués pour en changer un seul ! Je n’aime pas le humbug, même quand il sert à empêcher le mal. Mais il faut bien s’y résigner.
Une heure
Je ne vous dirai pas encore de gros mots. Je ferai plus. Je mettrai votre conscience à l’aise. Je viens de recevoir une invitation de la Reine pour Windsor, dîner le 17, passer la journée du 18, déjeuner le 19. Il n’y a pas moyen de n’y pas aller. Si vous arrivez ici le 15, nous aurons à nous la journée du 16 mais si vous n’arrivez que le 16 au soir ou le 17 matin, nous aurons à peine, le temps de nous entrevoir avant mon départ pour Windsor. Ne vous pressez donc pas de manière à vous troubler ou vous fatiguer. C’est une ennuyeuse parole que je vous dis là. Je suis très pressé. chaque jour plus pressé. Mais puisque ma course de Windsor coïncide avec votre tracas de ménage, faites ce qui vous convient. Je vous donne, pour arriver à Londres latitude jusqu’au 19. Si vous arrivez le 15 ou le 16, je serai parfaitement heureux. En tout cas, je vous écrirai encore à moins que votre lettre de demain ne me dise le contraire. Je vois que l’affaire des ambassadeurs tournera comme celle des prefets. Lord Palmerston ne revient qu’aujourd’hui de Broadlands. Il doit y avoir un conseil de Cabinet ce matin, probablement sur les affaires de l’Orient. Si on voulait m’admettre dans ce conseil, je crois en vérité que je serais tranquille. Cette parole est bien arrogante ; mais j’ai vu tant d’affaires mal conduites uniquement parce qu’on ne savait pas, parce qu’on n’avait pas pensé. Ici surtout on ne pense pas à assez de choses! Et chacun pense à son affaire, et ne sait rien de celles des autres. Evidemment si, dès le premier jour, toutes les faces de cette question d’Orient avaient été présentées à Lord Polmerston, lui-même ne se serait pas engagé comme il l’a fait. Cela perce à chaque instant dans sa conversation.
3 heures et demie
Je viens de faire quelques visites Je ne voulais voir que lady William Russell. Je ne l’ai pas trouvée. Elle m’inspire une estime mêlée de quelque curiosité. On dit que son mari, après avoir débuté par la Juive, fait à présent des sottises avec tout le monde. Est-ce qu’il en est en Angleterre des hommes comme des femmes ? J’entends dire qu’ici c’est à 40 ans quand leurs enfants sont élevés, que les femmes s’émancipent. Et on me cite des exemples. Nous avons ici de très mauvaises nouvelles du Rois de Prusse. Je suppose que vous les avez aussi. Adieu. J’ai été dérangé deux ou trois fois depuis que je suis rentré. Je dine chez Sir Robert Inglis. J’irai de là chez lord Grey. Lady Grey m’a écrit hier pour m’y engager. Je suis très bien avec eux. Adieu Adieu
392. Paris, Mardi le 2 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis bien fâchée et même bien inquiète que ma lettre de jeudi ne vous soit pas parvenu samedi. Elle renfermait le récit de mon. dîner chez M. de Pahlen. Elle avait de l’intérêt et je serais tenter de croire que c’est pour cela que vous ne l’aurez pas reçue lorsque vous m’écriviez. Malheureusement aujourd’hui, je ne puis pas être rassurée sur ce point puisque c’est mon mauvais jour. J’ai les nerfs bien mal arrangés. Je suis bien triste sur mon compte. Je ne vois pas comment je pourrai me remettre. Tous les jours je deviens plus poorly. Tout m’agite, tout m’agace. Je suis dans une dipoution bien malheureuse pour moi-même et qui doit me faire hair de tous ceux qui m’approchent. Et peut-être de ceux qui ne m’approchent pas. Ma pauvre tête me semble. bien malade Je ne passe que deux jours sereins. La moindre chose la fait partir. Et alors son vagabondage est extraordinaire.
Lord Harroby ment, vous me trouvez bien changée. Votre ambassade ne m’a pas porté bonheur. Ne serez-vous pas triste de me revoir comme cela ? Ne ferai-je pas une pauvre et ridicule mine à Londres dans cette déplorable disposition à la melancolie. Croyez- vous que vous la dissipiez ? Quelques fois je crois oui bien sincèrement d’autres fois j’ai peur, peur de moi. 2 heures J’ai dîné hier chez les Appony avec mon fils. Ensuite j’ai été marché au bois de Boulogne jusqu’à 10 heures. Et de là chez Mad. de Castellanée où j’avais donné rendez-vous a M. de. Pahlen. il y avait un M. Sue, auteur de romans. Mad. de Castellane ne s’est occupé que du romancier, laissant tout-à-fait du côté l’Ambassadeur, ce que celui-ci m’a fait observer 3 fois en allemand et 3 fois en Russe ! M. Molé causait assez. La lettre de M. Odillon, Barrot occupe. Évidemment Barrot gouverne, mais ici cela a été for the hest.
Qu’entendez-vous dire de Bresson ? Restera-t-il sous le nouveau règne ?
Toujours adieu. Adieu, Adieu. Malgré la mauvaise tête le cœur reste ce que vous connaissez. Adieu. Je m’en vais prendre congès de votre mère.
393_1. Londres, 11 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon cher Vicomte,
Plusieurs membres du Corps diplomatique, entr’autres M. le Baron de Bulow, M. de Hummelaner, et M. le Comte de Pollon qui sont chez moi, et le Général Alava qui vient de m’en écrire, me témoignent un vif désir qu’il y ait pour eux quelque manière d’exprimer à la Reine l’intérêt profond que leur a inspiré le triste événement d’hier, et la part qu’ils prennent à la joie de son peuple. Je viens vous demander ce que nous pouvons faire, et par exemple s’il vous paraîtrait convenable de prendre les ordres de S. M. et de solliciter pour le corps diplomatique, une audience où il pût lui offrir, ainsi qu’à S.A.R. le Prince Albert, l’expression de ses sentiments. Veuillez, mon cher Vicomte, me répondre à ce sujet, car nous serons en attendant votre réponse, dans une immobilité qui nous déplaît.
Vous savez si je suis tout à vous. .
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Politique (Angleterre)
393. Londres 11 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
On a beau être jeune, et femme, et Reine sans révolution, et avec une aristocratie ; on n’est pas à l’abri de la monomanie de l’assassinat. Elle a passé la Manche. J’ai appris cela hier au soir en dinant chez le Sir Robert Inglis. Plus tard, chez lord Grey, quelques détails douteux. Tout le monde disait que ce boy était fou. Il ne l’est point. Les journaux vous diront tout ce qu’on sait. Peu de chose encore. On parle de sociétés secrètes, de passions anarchiques. J’y crois toujours. Le mal vient de là, soit que des conspirateurs se réunnissent, soit qu’un cerveau faible s’échauffe. Et ce mal est grand ici dans les régions basses plus grand qu’ailleurs. Mais les moyens de résistance sont très supérieurs. La Reine a montré vraiment un sangfroid, très ferme et très simple. Son mouvement de se faire conduire tout de suite chez sa mère a touché. L’émotion me paraît vive et sincère dans les classes moyennes. Le High life, hier au soir était froid et lèger, comme partout. On faisait de la musique chez Lord Gey. J’écoutais comme les autres. Et en écoutant, je pensais à ces quelques têtes couronnées, partout le point de mire de ces milliers de prolétaires indignés de n’être pas riches et heureux et à ces passions frénétiques qui fermentent à côté de ces plaisirs frivoles. y aura-t-il dans le monde, assez de sagesse et de courage pour dompter le fléau ? Je le crois. Et le spectacle de cette société-ci me rassure encore plus qu’il ne m’inquiète. Le bien y surpasse le mal, quoique le mal soit grand. Si japprends quelque chore dans la matinée je vous le dirai.
2 heures
Rien de nouveau. On interroge cet homme ; on cherche. Les principaux membres du corps diplo. matique sont venus chez moi. Nous avons cherché, une manière de témoigner à la Reine notre vif sentinent sur ce qui vient d’arriver. De concert avec Bülow, Hummelauer, Pallen, etc J’ai écrit à Lord Palmerston, le billet ci-joint. Il s’en est montré fort touché. Je dois le voir à 4 heures, quand il en aura parlé à ses collègues. N’en parlez pas, car il serait possible qu’il n’y ait point d’audience, point d’expression publique et collective. D’après ce qu’on m’a dit et si je me rappelle bien ce que vous m’avez dit. ceci serait un peu une innovation. Elle est naturelle, vu l’incident, et ces messieurs la désirent tous. Nous avons des usages, nous autres Français, en pareille matière. Je les emporterai peut-être à Londres.
Je m’attendais au retard de ce matin. Je vous ai dit hier pourquoi j’y consentais sans me trop facher. Je n’en dis pas davantage. Je ne veux pas vous donner plus de liberté que je n’en veux prendre pour moi-même en pareil cas. Je me réserve de me fâcher une autre fois, s’il y a lieu et il vous est maintenant interdit de vous fâcher jamais, car il n’y aura jamais lieu. Mais votre curiosité, que je ne comprend pas, sera fort décue, car vous ne trouverez rien de nouveau. De l’inconnu peut-être. que vous prendrez pour du nouveau. Je rabats quelque chose de mon opinion sur votre sagacité. Vous me connaissez bien peu Est-ce que je suis si obscur ?Je vous réponds que tout ce qui y était le 25 février y est encore, y sera toujours. Et rien qui ne soit avec ce qui était le 25 février dans la plus intime harmonie. Mon Dieu, que j’ai de choses à vous dire, et à vous apprendre ? Je ne crois pas du tout à Barrot dans le Cabinet. Et soyez sûre que j’ai raison. Mais si cela était, je n’ai pas la moindre incertitude. Vous avez trouvé cette hypothèse prévue dans ce que vous a montré Génie. Adieu. Vous aurez des lettres jusqu’à lundi inclusivement Adieu. Adieu.
393. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le pauvre mardi s’est passé pauvrement, si j’en excepte une visite d’adieux à votre mère. Elle et vos enfant un traitent, avec une bonté familière qui me plait infiniment, tout le monde a bonne mine et tout le monde a l’air gai de s’en aller à la campagne. Je serai chargée je crois de vous porter le portrait de Henriette.
J’ai vu un moment les Granville. J’ai vu et essuyé un gros orage ; J’ai diné seule avec mon file et le soir j’ai vu assez de monde. Mes habitués. Point de nouvelles, si ce n’est que Médem a eu de plus le poste de Darmstadt, ce qui lui fait de la distraction et de l’argent de plus. Il est fort content. le Duc de Noailles dit qu’on va s’ennuyer, il n’y a plus ni affaire, ni scandale. Les ambassades attendent le mort du Roi de Prusse. La duchesse de Mouchey est accouchée d’un garçon mort. C’est un grand désespoir. Je vais dîner à Boulogne aujourd’hui chez Rothschild, demain chez Brignoles, après demain chez les Granville. Vous avez là mes disssipations. J’attends votre lettre qui me dira j’espère que mon 388 ne s’est pas égaré. Je suis aujourd’hui un peu mieux qu’hier, mais pas assez bien pour aller à Epson. Qui était de votre partie, et à dîner chez Motteux ? Où allez-vous pour le ..... ? Irez-vous à Salhill, avec qui ? Je fais une quantité de questions, toutes petites, et peut-être toutes grandes. Je suis bien loin de vous, je suis bien triste d’être si loin. Serai-je bien heueuse quand je serai près ? Lord Grey m’écrit pour me presser d’arriver ; il part avant la fin du mois. Leveson mande à son père que vous êtes établi parfaitement bien. 1 heure. Pas de lettre encore. Cela est devenu bien singulier depuis le départ du gros Monsieur. 2 1/2 il faut fermer ceci. Fermer sans avoir à répondre. Je ne sais plus de vos nouvelles depuis samedi. Le cinquième jour ! Que c’est long. Adieu, Adieu.
394. Londres, Vendredi 12 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
J’ai été hier soir à Holland. house. Ils n’y étaient pas. Le conseil du matin et l’attentat les avaient fait venir en ville. J’avais deux emplois de ma soirée Lady Tankerville qui se plaint toujours qu’elle ne me voit pas assez et un bal chez Lady Glengall. Je suis rentré chez moi ; je me suis mis dans mon lit et j’ai lu pendant deux heures une vie de Hampden, grand Anglais, et homme bien hereux car il a eu le bonheur de mourir au moment où allaient commencer pour lui les espérances déçues, les doutes de conduite et la responsabilité. Je me plaît beaucoup dans la vieille Angleterre. J’aime ce qui en reste, et grace à Dieu, il en reste beaucoup. Par mes idées, et le tour de mon esprit, je suis du temps moderne ; par mon caractère et mes goûts, je suis des anciens temps.
J’assiste déjà aux embarras de la transition de règne, en Prusse. On a eu à célébrer à Berlin, le 100e anniversaise de l’Académie royale. Il fallait parler de Frédérie II, du Roi mourant et plaire au Roi qui s’approche. On a chargé M. de Humbolt de cet embarras. Il s’en est tiré, en homme d’esprit, et m’a envoyé son petit discours, car les hommes d’esprit pensent toujours un peu les uns aux autres.
A propos des hommes d’esprit, vous ai-je jamais dit comment m’avait abordé à St Cloud, en se fairant présenter à moi. Reschid. Pacha, qui essaye aujourd’hui de faire de la Turquie quelque chose qui ne soit pas turc? « Moi ausi, dans mon pays, je passe pour un homme d’esprit.» Il vient, dit-on, d’en donner une preuve en se débarrassant de son rival Khosrer-Pacha qu’il a fait remplacer par Ahmed Féthi Pacha, homme insignifiant, sa créature, et ancien ambassadeur à Paris. On dit que cela vous déplaira.
Je rentre à Berlin. Il me paraît que Humboldt, Bülow et toute cette couleur là sont au mieux avec le Prince Royal. Bresson aussi est bien avec lui depuis quelque tour. Bresson est prévoyant et habile. Il n’y a pas de doute sur la retraite de Wittgenstein. On le pressera de rester, sachant qu’il ne restera pas.
2 heures
Je vous ai quittée pour trouver dans le Times, la mort du Rois de Prusse et je n’ai pu vous revenir jusqu’à présent. Lord Palmerston n’a pas pu me rejoindre hier au Foreign office. Il a été retenu à l’home office par le Conseil privé qui interrogeait les témoins sur l’attentat. Il m’a remis à aujourd’hui, et j’attends un mot de lui pour l’aller chercher. Les deux Chambres présentent leur adresse ce matin. Je suppose que la Reine recevra le corps diplomatique demain si le Cabinet trouve bon qu’elle le reçoive. Elle l’a reçu, et ses félicitations en corps, lors de son mariage. Ils sont tous fort contens de la demarche faite, qui acquitte pleinement les convenances. Je les et tous vus ce matin. Dedel est mon meilleur conseiller. Quoique rien n’ait encore transpiré on croit en général que l’assassin est chartiste. Plusieurs propos, recueillis, maintenant indiquent dans ce parti-là, un projet pareil. Ce jeune homme s’exerçait depuis trois semaines à tirer au pistolet.
Le Cabinet a eu encore hier soir un échec aux Communes, toujours sur la même question. Il y a, si je ne me trompe, dans la Chambre un parti pris, pris à une bien petite majorité, mais pris, de mettre en Irlande un temps d’arrêt à l’influence d’Oconnell. Sur les 105 membres Irlandais, il est déjà, dit-on, maître de plus de 60. Avec le systême étectoral actuel, il deviendrait bientôt maître des 40 autres. Et alors on verrait tout autre chose que l’Angleterre obligée de bien gouverner l’Irlande ; on verrait l’Irlande gouverner l’Angleterre. Voilà le gros fait qui frappe, ce me semble, les esprits et décide bien des modérés même.
Vous avez raison d’avoir beaucoup de regret et un peu de remords Windsor est venu bien à propos pour vous. Voici une vérité. Vous êtes si sensible aux petites contrariètés qu’elles peuvent balancer, pour quelque temps, les plus grandes affections. La petite vie, en vous, fait tort à la grande. Cela vient de deux causes. Vous avez été longtemps l’enfant gâté du sort faisant toujours ce qui vous plaisait. Vos déplaisirs sont démesurés, et démesurement puissants sur vous. De plus, il n’y pas en vous une force proportionnée à l’élévation, et à la vivacité de votre âme, vous êtes comme des beaux peupliers, si hauts et si minces, que le moindre vent balance, et fait plier. Vous pliez trop et trop sous les petits fardeaux, comme sous les grands. Je le trouve souvent. Je m’en impatiente quelquefois. Et puis je finis toujours pas me dire que vous connaissant comme je vous connais et vous aimant comme je vous aime, c’est à moi de vous aider à porter tous les fardeaux, petits ou grands. Puisque j’ai plus de force que vous et plus d’indifférence aux choses vraiment indifférentes, il faut bien que vous en profitiez.
Adieu. Je vous écrirai encore demain et je vous verrai vendredi, d’aujourd’hui en huit. Je ne comprends pas que vous n’ayez rien reçu des Sutherland. Charles Gréville ma dit ce que je vous ai mandé, comme une chose arrêtée, convenue. Mais il faut qu’ils vous l’écrivent eux-mênes. Adieu. Adieu.
Je corrige une phrase à ma lettre. Ce que j’avais mis ne rendait pas ma pensée. On dit qu’on a trouvé dans les poches de cet Edward Oxford, un papier qui ferait allusion à quelque relation avec Hanovre. Cela n’est pas croyable.
394. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
4h 1/2
Que votre parole est puissante ! Et quand je pense qu’outre cette parole puissante, Il y aura bientôt cette voix, ce regard, qui agissent sur moi si fortement, je me sens bien petite de me laisser aller jamais à des moments de tristesse, de doute, où vous me voyez si souvent. Je rentre et l’on me remet votre 384. Il y a vos inquiétudes. Ah ne les regrettez pas, ne regrettez pas de me les avoir exprimées. Elles m’ont fait tant de plaisir. Je me sens le cœur plus large, plus libre. Le retard de ma lettre vous avait donnée du chagrin, presque l’angoisse. Je suis si contente ! Voyez cet atroce égoïsme. Haïssez-moi bien, car je jouis vivement de vos peines quand c’est à moi qu’elles s’adressent. Nous nous sommes souvent dit que nous ne savions pas rendre tout ce qu’il y a dans notre âme. Jamais je n’ai tant senti l’insuffisance de mes paroles. Mais vous verrez quand vous m’entendrez ! De près, il me semble que je serai bien éloquente Jeudi le 4 de juin.
Voici le 385, et des volumes que j’aurais à répondre, que de choses à vous dire, bien tendres, des reproches, de la reconnaissance. Vous deviez me dire un mot sur le gros Monsieur tout de suite. vous me les dites à présent. Mon cœur allait au devant des paroles de 385. si je les avais trouvées plutôt vous m’auriez épargné quelques jours de peine. Vous avez raison. Il y a bien de la susceptibilité dans l’absence. On remarque tout, cela veut bien dire que nous nous aimons, mais pour cela même il faut que nous nous épargnions mutuellement tous les petites images, car il n’y a rien de petit quand on ne peut que se dire adieu tout de suite après. N’est-ce pas ? Ne faites rien pour Génie si vous y voyiez le moindre inconvénient. Gardez-moi une place à dîner le 26. Cela vous plait, et à moi aussi.
Mes matinées sont très coupées par mon fils et mille bêtises. J’ai à peine le temps d’écrire trois lignes de suite. J’ai dîné hier chez Rothschild à Boulogne. Nous avons beaucoup causé Thiers et moi. Il m’a dit beaucoup de choses qui méritent que je m’en souvienne. Il est très sage, très contenu. La guerre à la toute dernière extrémité, il la reculera plus que ne la reculerait tout autre ! Mais si un jour elle éclate s’il la faut absolument oh alors, par tous les moyens et ravoir ce que la nature indique. Il y a deux forts arguments. L’un pour l’autre contre la guerre. Contre, parce que personne ne la veut. Pour, parce qu’il y a 25 ans qu’on ne l’a faite. Sur l’Orient, sait-on bien, sait-on assez en Europe, que la France sur ce point est in-fle-xible ? Prononçant comme cela et répétant. En Angleterre, il n’y a que Lord Palmerston qui soit de l’avis contraire à tout le monde. La session finit, dans 10 jours tout sera terminé. Odillon Barrot s’est conduit parfaitement. Sa lettre est excellente. On s’est tiré habilement du mauvais pas de la souscription. Les funérailles, qui sait ! Il est vrai que l’épreuve sera forte, car l’émotion sera dans tous les cœurs. Le million de Joseph ? Il na pas voulu me répondre du tout sur cela, il m’a dit simplement : " C’est un vieux fou. C’était une veille créance." Cela confirme sans expliquer ce qu’il veut faire. Je suppose que cela l’embarrasse.
La Prusse. La mort du Roi c’est là révolution. Je suis parfaitement de son avis et vous verrez. Au bout d’une bien longue conversation il me dit que si je ne vais pas en Angleterre, il me jure qu’il viendra deux fois par semaine causer avec moi.
There is a bribe ! I go to England.
Je vois que l’affaire Rémilly est noyée par conséquent rien de grave ou d’immédiat. Il me semble que les rapports de Thiers avec le roi doivent être meilleurs, presque vous. Cela perce dans le paroles respectives. Il me semble que je vous ai tout rapporté. Ah encore, tous les deux lui et moi nous sommes pour une République aristocratique, franchement de tout notre cœur. Je vous assure que nous avons fort bien parlé sur cela, et je crois que vous aurez fait le troisième. Nous nous sommes bien promis de nous garder le secret. Ainsi gardez-le.
Je fais mes préparatifs, et j’ai mille embarras petits et grands, parce que vous savez que je n’ai personne pour me les épargner. Simon m’a dit ce matin qu’il a vu partir toute votre famille en très bonne santé. Il se plaint que la poste lui apporte maintenant les lettres plus tard que de coutume. Je vous en préviens, moi je me plains bien plus que lui. Je suis charmée de ce que vous me dites sur meeting du Slave trade. Vous faites bien de me dire toutes les petites vanités. Cela cela devient bien grand pour moi. de tous côtés j’entends parler de vous, parfaitement J’irez voir. Adieu Adieu, et jamais assez.
395. Londres, Samedi 13 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici la dernière. Dans sept jours, nous serons ensemble et vous n’aurez plus de tracas. Il est vrai que vous n’y êtes pas propre du tout. Vous ne me dîtes pas si vous avez décidément pris votre compagnon de voyage. C’est un personnage bien mystérieux. Dois-je être inquiet aussi ? Je fais réparation à votre sagacité. Vous avez deviné juste sur Miss Troller ; si juste que l’insinuation m’a été faite, sur la place même. Je voudrais bien savoir ce qui vous inquiète. Vous me le direz, n’est-ce pas, si vous ne l’avez pas oublié, cinq minutes après m’avoir vu.
Je rabâche. Je ne comprends pas les Sutherland. Mais je trouve aussi que puisqu’ils l’ont écrit à Lady Granville, vous auriez pu, et vous pourriez peut-être encore sans atteinte à votre dignité, prier Lady Granville de leur demander, de votre part, si en effet, ils peuvent vous recevoir dans Stafford-House, en leur absence. Savez-vous qui manque dans les relations de cette sociélé-ci, dans les plus amicales ? La simplicité, la facilité, la rondeur. Tous les mouvements sont lents et raides. Les meilleures gens, les meilleurs amis ne savent pas se donner l’agrément de leur bonté et de leur amitié.
Je n’ai pas envie de vous donner des nouvelles. Il n’y en a pas, et je n’en ai pas envie. Je vous en donnerai quand vous serez ici. On ne parle que de l’attentat. Pour dire vrai, d’Oxford plus que de l’attentat. La badanderie est aristocratique aussi bien que démocratique. On est curieux des moindres détails sur ce malheureux. Est-il beau ? A-t-il de l’esprit ? De quelle couleur sont ses yeux ? C’est précisément là ce que veulent ces imaginations perverties, un théatre, un public, grandir et paraître au soleil, eux petits et obscurs. Il faudrait avoir assez de sens et de gravité pour ne pas leur donner ce qu’ils cherchent. Les personnes qui suivent l’affaire disent qu’il n’y a que deux choses sûres, c’est qu’il n’est pas fou, et qu’il n’est pas seul.
On me dit ici, sur le nouveau Roi de Prusse, exactement ce que vous m’avez écrit. Tout le monde, se promet beaucoup de lui ultras et libéraux. Tout le monde, sera déçu. ce qui me paraît clair, c’est qu’il est faiseur et n’aura pas la politique négative, et expectante de son père. Il faut que jeunesse se passe, celle des rois comme toute autre. Adieu. Adieu encore une fois. Je n’ai rien à vous dire. Je dirais trop ou trop peu. Adieu. Enfin.
395. Paris, Vendredi 5 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez vu juste en trouvant un peu d’étonnement dans ma lettre. Epsom. J’ai essayé de le laisser percer le moins possible. Je n’étais même pas tout-à-fait d’accord avec moi- même. Frivole oui ; c’est bien frivole, c’est même tout ce qu’il y a de plus frivole en Angleterre, et comme tel cela m’a serré le cœur. Cependant je me suis dit pour un étranger c’est un curieux spectacle. Il a peut être raison. Et avec ce sentiment contraire, j’ai raconté à Lord Granville que vous alliez à Epsom. Il a éctaté de rire ; cela m’a blessé beaucoup. M. Guizot à Epsom ! Et de rire encore. J’ai pris votre défense, j’ai dit ce que je viens de dire plus haut. tout cela ne m’a pas laissé le coeur à l’aise sur Epsom. Voilà exactement la vérité, et vous m’aurez vu un peu malade dans mes lettres les jours suivants. Je vous expliquerai à Londres comme il me semble quo vous pourriez combattre ce que vous appellez votre " laisser aller ". Vous devinez peut-être !
J’ai dîné hier chez M. de Brignole, grand dîner, tout blanc, où il y avait Berryer aussi, tout ronge. Vous ne sauriez croire comme il avait l’air d’un ivrogne. Je n’ai pas causé avec lui, mais le duc de Noailles me dit qu’il est découragé, même mécontent. Il croit que ceci durera. Le soir j’ai vu mon ambassadeur et quelques personnes encore. Le Duc de Noailles part pour Maintenon On part beaucoup. Mon fils part bientôt. Et moi comme, je vous l’ai dit. On attend toujours la mort du Roi de Prusse. J’ai décidé qu’il devait être mort le 31 mai, le siècle revolu ; que l’Impératrice serait arrivé trop tard pour voir. son père, de même qu’elle était arrivée top tard pour voir encore sa mère ; que dans tous les cas L’Empereur sera là, aux funérailles le dernier de la famille. Voilà mon programme. On dit que M. Bresson est assez mal avec M. de Rochow qui va devenir le personnage influent pour le nouveau Roi. Quant au Prince Wittgeinstein, il m’a toujours dit qu’à la mort du Roi il se retirerait pour toujours !
Adieu, Monsieur, J’attendrai vos lettres comme de coutume jusqu’au jour où je vous prierai de ne plus m’écrire. Adieu.
396. Londres, Mardi 16 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Vous êtes partie ce matin. Vous marchez en ce moment vers moi. Vous arriverez à Douvres peu après cette lettre. C’est ridicule d’y envoyer un morceau de papier au lieu d’y aller moi-même. Je désire bien vivement que vous arriviez à Londres vendredi, pas tard. Voici pourquoi. Je suis obligé d’aller samedi, par le railroad, déjeuner à Southampton, à un grand banquet donné pour célébrer le chemin de fer de Paris à Rouen. Dire à quel point ceci me déplait c’est impossible. J’avais tant pensé à ce samedi ! Mais il n’y a pas eu moyen de s’y refuser. J’ai négocié ce chemin de fer. Je l’ai fait réussir. C’est la jonction de Londres et de Paris. Le Duc de Sussex y va. Lord Palmerston y va. On tient essentiellement à m’avoir. Je reviendrai le jour même dîner à Londres, chez Sir John Hobhouse et je trouverai bien un moment pour vous voir, entre mon retour et le dîner, ou après le dîner. Mais samedi n’en sera par moins un pauvre jour. Qu’au moins je vous voie bien le vendredi. Je reviendrai de Windsor après le déjeuner. Et puis Dimanche commencera une serie de jours...
Je ne veux pas les qualifier. N’arrivez par trop fatiguée. Le temps est beau. J’épie le soleil. J’épie le vent. Je les interroge. Jusqu’ici, je suis content. Où arrivez-vous ? Vous devriez bien me le dire demain. Car enfin, vous le savez. Vous m’écrirez de Boulogne ou de Douvres.
Adieu. Je ne peux pas, je ne veux pas vous parler d’autre chose, Adieu J’adresse ceci au Ship Inn. Il me semble que vous ne pouvez manquer de l’y recevoir.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Séjour à Londres (Dorothée)
396. Paris, Samedi le 6 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’avais bien raison de détester vos courses. Je n’ai eu que de pauvres petites lettres. Je suis charmée que vous ayez trouvé peu de plaisir à Epsom, aussi charmée que vous l’ayez été sans doute lorsque je vous ai donné l’assurance que je n’irais jamais voir Melle Dejazet. C’est Ellice aussi qui voulait m’y entraîner, lui Lady Granville, la loge était prise, tout leur petit plan fait pour m’enlever par surprise, mais moi, je sais dire non tout de suite. Enfin Epsom c’est fini je n’y veux plus penser.
Je veux penser au mois de juin. Je pense à tous les détails. Décidément vous aurez vos heures où je serai out pour tous les autres. Nous déciderons cela tout de suite, et nos heures seront réglées selon vos convenances. Mais que Londres va me paraître étouffé, étouffant. Certainement, je ne tiendrai pas longtemps à Londres même quand j’y pense bien, assurément, si ce n’était vous je ne ferais pas ce voyage. J’y vois un peu plus de tracas que de plaisir.
J’ai dîné hier chez les Granville Ils étaient seuls. Le soir, j’ai vu chez moi M. Molé, les ambassadeurs, Armin,& & Les nouvelles de Berlin, sont meilleures vous le savez sans doute/ Ainsi mon programme est faux. M. Molé me dit que la gauche est furieuse contre Barrot. 40 des siens le quittent. Il n’apporte dans le camp ministériel tout au plus que 20 adhérents. Il faudra que Thiers le poste à la présidence et les Conservateurs joints aux extrémités le refuseront. Il nie qu’il puisse y avoir de meilleures relations entre Thiers et Le Roi. On me dit qu’il n’est pas vrai que M. de la Redorte aille à Madrid ; cela s’était établi dans le monde. Je ne sais ce qu’on pense ici du discours de Lord Palmerston. Mais la croyance générale est qu’on est assez près de la guerre. M. Molé a été frappé des paroles dites par Thiers à la chambre des Pairs sur la question de la banque. Il a fait entrevoir la guerre comme probable.
Je suis fatiguée, mais je ne suis pas si malade que je l’étais après que vous m’aviez annoncé Epsom. Adieu. Je ne songe plus qu’à Londres, j’écarte les idées de tracas, je m’attends au bonheur. Oui, un grand bonheur. Ah, que de causeries charmantes, quel débordement, Adieu. Adieu, mille fois.
397. Londres, Mercredi 17 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai écrit hier à Douvres au Ship Inn, pour vous dire mon déplaisir de samedi. Je présume d’après le 405 qui m’arrive à l’instant que vous ne partez de Paris qu’aujourd’hui mercredi, car vous ne mettrez pas plus de deux jours pour aller à Boulogne. Vous trouverez donc à Douvres que je suis obligé d’aller samedi déjeuner à Southampton, par le rail-road, pour célébrer la conclusion du rail-road de Paris à Rouen ; affaire que j’ai traitée et qui m’a mis très bien ici avec ce monde là. Ils font un grand banque t; le Duc de Sussex, Lord Palmerston & y vont. Je ne pouvais refuser. C’est l’union de Londres et de Paris. Je reviendrai de Southampton entre 6 et 7 heures. J’irai dîner chez le Sir John Hobhouse. Je compte bien trouver un moment pour vous voir, soit entre mon retour, et le dîner, soit après le dîner. Mais le samedi, ainsi employé n’en est pas, moins un immense ennui. Si donc vous arrivez à Londres le Vendredi, je vous verrai en arrivant de Windsor, et tout le soir. Si vous n’arrivez que le Samedi, je ne vous verrai que tard ce jour là et bien peu. Faites pour le mieux, sans vous harasser de fatigue.
En tout cas, faites-moi dire tout de suite à Hertford House que vous êtes arrivée et où vous êtes. Car je n’en sais rien. Je regarde sans cesse au temps. Il y a eu du vent cette nuit ; il est tombé ce matin. Le saleil est beau.
Adieu. Adieu. Moi aussi, je serai bien content. J’ai souri en lisant: " Que Windsor va vous plaire ! " Croyez-vous que la Reine Victoria sera aussi bonne pour moi que l’était pour vous George IV ? Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Séjour à Londres (Dorothée)
397. Paris, Dimanche le 7 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon fils vient de me quitter. Il revient à Paris au commencement de Septembre pour y passer alors deux ou trois mois. Il est mieux mais sourd et paralysé du bras gauche.
Je n’ai rien à vous dire d’hier les ambassadeurs et le Duc de Noailles hier au soir ne m’ont pas beaucoup avancée. Thiers d’où on venait est en bonne humeur, et mon monde. le regarde comme établi pour longtemps. Il me semble. qu’Appony commence à en prendre son parti. Moi je trouve que tout prend une mine guerrière, ces messieurs le contentent ; mais infin il faut bien qu’on décide quelque chose à Londres, et quelque chose sera tout. Quoi ? C’est de vous qu’on l’attend.
Je vous remercie de quelques bonnes paroles dans votre lettre ce matin. Les bonnes paroles, c’est comme une caresse à un enfant. Je suis un vrai baby ; si facile à la peine, si facile à la joie. Encore facile à la joie ! Je retombe dans les recherches et les embarras pour trouver quelqu’un qui m’accompagne. Quelle bêtise d’être si poltronne, je le suis devenue. Car jadis je traversais toute l’Europe seule sans un moment de crainte. de Londres à Pétersbourg par terre. Et aujourd’hui Boulogne me parait un tour de force et d’extrême danger.
Adieu. Adieu. Je ne sais pas une nouvelle. On parle même de la sante du Roi de Prusse. Armin croit qu’il s’en tirera. Adieu.
398. Calais, Vendredi 7 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
J’arrive. Je n’ai pas eu le moindre mal de mer. J’étais très propre à soigner ceux qui l’auraient eu si j’avais eu avec moi quelqu’un à soigner. Je repars dans une demi-heure. Je compte être à Eu ce soir. Il est probable que j’arriverai assez tôt à Abbeville pour pousser jusqu’à Eu. Le pauvre sot de Louis Bonaparte est venu se faire arrêter à Boulogne, lui et les siens, par les gens qui passaient dans la rue. Cela n’a pas duré deux heures. On vient de me montrer ses proclamations, nominations, décrets, & & C’est parfaitement bête. La population ne me paraît pas le moins du monde émue. Elle se moque. Il a nommé M. Thiers Président du Gouvernement provisoire. On en rit comme de tout le reste. Pourtant je garde herbet, puisque je l’ai. Il mépargnera toute espère de soins, et ne m’est pas nécessaire à Londres. M. de Bourqueney, vous enverra tous les jours les journaux. Je lui envoie les proclamations Bonaparte. Vous pourrez vous en amuser un moment.
Adieu. Adieu Il me paraît évident que mon voyage ne subira aucun dérangement, et que les choses se passeront comme elles ont été prévues.
398. Paris, Lundi le 8 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu une bonne lettre ce matin, nous nous renvoyons notre plaisir. C’est une charmante marchandise. Il fait beau, j’ai le cœur léger. J’ai fait beaucoup de bois de Boulogne hier, j’ai dîné seule. Seule ! Cela m’a paru de nouveau bien triste !
Le soir j’ai été un moment voir Lady Granville, et puis Mad. de Castellane. M. Molé, M. Salvaudy voilà ce que j’y ai trouvé. Dans la commission de la chambre des Pairs, M. Molé a été tout-à-fait contre les Invalides, il voulait absolument St. Denis. Il me l’a répété lui-même. Je m’étais laissé dire auparavant que le Roi a été très piqué de cela, et qu’il la regardé comme personnel. Tout le monde s’accorde à regarder la session comme fini. M. de la Redorte sera nommé ambassadeur à Bruxelles. On fait de cela une ambassade de famille. aves Mad. Lehon ambassadrice. Cela vient je crois de ce que le Roi n’a pas voulu qu’on touchât aux autres, et que Thiers avait promis à la Redorte. Rien pour M. de Flahaut ! Ils arrivent dans le courant du mois.
Mad. de Talleyrand écrit de Berlin qu’elle est comblée. Toute la famille royale est pleine de politesse pour elle. On fait là comme si le Roi n’était pas malade, il le veut ainsi, les dîners et les réceptions vont donc comme de coutume. Elle parait charmée de mon grand Duc. A moi, elle n’a pas écrit encore. C’est de Mad. de Castellane que je sais tout ceci.
2 heures je suis sortie ; j’ai vu des gens d’affaires, j’ai fait beaucoup de petites affaires, tout cela chez moi au reste, mais on me mange mon temps, mandez-moi encore des nouvelles. J’ai le temps de les recevoir. Je reste fixé à samedi mais j’ai un tracas intérieur qui pourrait cependant me faire remettre mon départ de 2 jours. Imaginez : changer femme de chambre, me livrer à une inconnue, faire sa connaissance.en route, c’est bien désagréable. Je crois que j’en ai le courage, mais je ne suis pas sûre. Tout ceci vous venge bien des querelles que je vous ai faites jadis, aussi ne manquez-vous jamais de me le rappeler. Mais ne me dites pas encore de gros mots, car Samedi est toujours dans ma tête. Ce qu’il y a dans mon cœur je n’ai pas besoin de vous le dire ! Comme le cœur galope quand on approche du moment ! Adieu. Adieu. Les diplomates ici affirment qu’on ne fait et ne fera rien sur l’Orient. J’ai reçu une lettre charmante de Matonchewitz vous l’aurez, car vous les aimez. God bless you. Adieu, adieu.
399. Eu, Samedi 8 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis arrivé hier au soir. Il est impossible d’être mieux reçu. Mais l’incident de Louis Bonaparte va déranger peut-être tous mes arrangements. Il se peut que le Roi, parte ce soir pour aller passer 36 heures à Paris, et tenir un Conseil qui convoquera la cour des Pairs, et règlera toutes les suites de cette ridicule affaire. On peut bien enterrer solennellement Napoléon. Le Bonapartisme est bien mort. Quel bizarre spectacle ! Louis-Napoléon se jetant à la nage pour regagner un misérable canot, au milieu des coups de fusil de la garde nationale de Boulogne, pendant que le fils du Roi et deux frégates françaises voguent à travers l’Océan, pour aller chercher ce qui reste de Napolèon ! Qu’il y a de comédie dans la tragédie du monde ? Si le Roi part ce soir pour Paris, je pars moi-même pour Trouville. J’y passe Lundi avec mes enfants, et je reviens ici, mardi soir pour y passer le Mercedi et me remettre le jeudi en route, pour Londres où j’arriverai toujours vendredi.
J’emploie tout ce que j’ai d’esprit pour que rien ne dérange ce dernier terme qui est mon point fixe. C’est bien bon et bien doux d’avoir un point fixe dans la vie, un point où l’on revient toujours, et où l’on ramène tout. Il y a des biens (j’ai tort de dire des) qu’on n’achète jamais trop cher. Je vis tout le jour, je pourrais dire la nuit avec M. Thiers. Nos appartements se tiennent ; nos chambres à coucher se touchent. Il a ouvert ma porte ce matin à 6 heures à moitié habillé, pour me trouver encore dans mon lit et presque endormi. Nous nous sommes promenés ensemble de 7 heures à 9. Puis, dans le cabinet du Roi, à déjeuner, sur la terrasse après-déjeuner, toujours ensemble jusqu’à midi et demi, heure où je vous écris. L’estafette part à une heure. Je les trouve tous très animés et très calmes, en grande confiance, sur l’avenir, convaincus qu’on s’est fort trompé dans ce qu’on a fait et qu’on le verra bientôt. Le Pacha ne cédera point, et ne fera point de folie. La coërcition maritime ne signifiera rien. La coërcition par terre, ne s’entreprendra pas. Le Roi et son Cabinet, sont très unis. On n’exagère rien dans ce qu’on dit de l’animation du pays. Adieu. J’ai tout juste le temps, de vous dire adieu, ce qui est bien court, trop court, infiniment trop court.
Je m’aperçois que j’ai oublié de vous dire que le Roi reviendrait de Paris à Eu mardi avec M. Thiers. C’est ce qui me fera répasser par Eu. Adieu. Depuis avant-hier je n'ai rien vu, rien entendu de vous. Encore Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Discours du for intérieur, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Turquie)
399. Paris, Mardi le 9 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Décidément,je ne pourrai pas partir samedi, ce ne sera que mardi le 16. Je vous jure que c’est indispensable que je remette à ce jour-là. Les raisons sont longues et trop multiples pour vous les dire mais elles sont bonnes. Je vous supplie de ne pas vous fâcher, n’est -ce pas vous ne vous fâcherez pas et j’aurai des lettres jusqu’à lundi inclusivement.
J’ai dîné hier chez Granville ; personne, et rien que Pahlen après le dîner, et pas de nouvelles. Si fait, et probablement ce que vous savez, que M. de la Redorte va à Madrid, et que l’ambassade est pour M. de Rumigny. Cet arrangement a coûté à Thiers beaucoup d’efforts auprès du Roi. Mais enfin cela s’est fait selon la volonté du ministre; Il est très vraisemblable que M. Barrot entre dans le cabinet sous très peu de temps. Il veut l’intérieur, il est clair que les doctrinaires sortiront dans ce cas. Tout ceci est exactement ce que m’a dit Lord Granville, et je crois qu’il ne dit pas les choses légèrement. Et bien, si cela arrive, qu’arrivera-t-il à Londres ? That is the question !
J’ai été au bois de Boulogne après dix heures du soir, et comme j’avais, peur j’ai pris Fullarton, qui était ravi de la lune, et de l’invention d’une promenade à cette heure-là.
Midi. Un peu de promenade et ma toilette, maintenant les great and little bores d’un départ ; vous ne sauriez croire comme je suis helpless ! Pogenpohl m’aide beaucoup, et puis un homme que m’a donné Génie. Je cherche toujours un compagnon de voyage. Je suis sur la trace. Il faut que je réussisse. Je ne me vanterai que quand il sera vraiment pris. Je vais et viens, je vais à mes paquets, je reviens à vous.
Je suis curieuse de vous revoir. Ne trouvez-vous pas l’expression ridicule ? Mais c’est cela, il me parait que je trouverai du nouveau ; et si même ce nouveau était mieux, voyons.... Si je vous trouvais 25 ans au lien de 50 ! Et bien cela me déplairait beaucoup. Je veux retrouvez ce que j’ai perdu le 25 février, le retrouver tel qu’il était ce jour-là. Je l’aimais tant comme cela !
Adieu. Je vous en dirai encore quelques uns, et puis nous n’aurons plus à les dire. C’est charmant, adieu.
400. Paris, Mercredi 10 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici vraiment, un gros chiffre, et qui ne prouve pas que nous soyons des gens d’esprit. Trois ans font environ 1100 jours. Plus du tiers de ce temps nous l’avons passé séparés !
J’ai vu hier soir beaucoup de monde ; les ambassadeurs, M. Molé, M. de Poix, M. de Noailles et les diplomates d’été comme il les appelle, c’est-à-dire les petites puissances. M. Molé seul d’abord car il vient de bonne heure. Il n’a pas vu le Roi depuis 6 semaines ; il ne voit pas pourquoi il y irait. Il blâme fort la conduite du Roi, il la trouve très malhabile. Il se préoccupe de l’entrée de Barrot dans le ministère il croit qu’on le nomme à la justice. M. Vivien au commerce, et M. Gouin dehors. Si l’entrée de Barrot faisait sortir les doctrinaires, ah, cela serait un gros événement. Alors le ministère ne peut pas tenir, les conservateurs se retrouvent compactes, forts. Cela lui plait beaucoup. Le maréchal Valée aura pour successeur au commandement de l’armée, le général Bugeaud. Dufaure serait nommé gouverneur civil de l’Algérie. Voilà le dire de M. Molé.
Les ambassadeurs étaient occupés de Berlin. Le Roi était à l’agonie. Ils commencent à trouver que ce sera une immense perte. Les derniers 6 mois de l’année 40 peuvent développer beaucoup de mauvais germes. Il y a longtemps qu’on se sent menacé de tous côtés, ne croyez vous pas que le moment est prochain où l’orage doit éclaté ? On dit que Don Carlos est dans la misère. Les légitimistes se cotisent pour le faire vivre.
2 heures
Votre n°390 me laisse un grand remord de ne pas partir Samedi. J’ai tort de dire remord, c’est regret qu’il faut dire, parce qu’il n’y a pas de ma faute à ce retard. Ma seule faute c’est d’avoir du malheur dans les petites choses comme dans les grandes. Je n’en connais qu’une grande qui ne soit pas entachée de cela. Elle couvre tout.
Vous m’apprenez que les Sutherland me donnent Stafford house, et vous concevez que ce n’est pas comme cela que je dois l’apprendre. Assurément ce serait un grand tracas et un bien mauvais gîte d’épargné. Mais encore une fois, ils ne me l’ont pas dit. J’écrirai à Benckhausen. La veille de mon départ pour qu’il me trouve un appartement convenable. dans l’une des auberges de Londres. Je ne partirai pas sans avoir vu Génie. Je serai à Londres jeudi le 18 au soir ou vendredi dans la journée. Cela dépendra du passage. Je vous écrirai de Douvres si je m’y arrête ; si non, comme je devancerai la poste, vous saurez mon arrivée quand je serai arrivée.
N’ayez pas peur que je perde une minute jusqu’à mon départ vous aurez tous les jours une lettre, et une de la route, pour que vous me sachiez vraiment en route. Adieu. Adieu. Je ne pense qu’au bonheur qui m’attend. Adieu.
400. Trouville, Dimanche 9 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Ce qui est vrai, c’est qu’à tout prendre je suis content de ce que j’ai vu à Eu, des deux partis. J’ai vu, d’une part de la révolution, de l’autre, de la modération. Les penchants, les désirs au fond ne sont pas, les mêmes ; mais les conduites pourront fort bien s’accorder. On travaillera sincèrement à maintenir la paix ; on fera hardiment la guerre si l’occasion l’exige. Et on prévoit des occasions qui pourraient l’exiger. On ne provoquera point ; on ne commencera point. Mais on n’éludera point. Le pays est dans la même disposition ; nulle envie de la guerre, tant s’en faut ; mais un grand parti pris de ne pas accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyiez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs. J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs.
J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous serez déjà à la campagne. Je vous écrirai encore 400 demain, à tout hasard. Samedi, en revenant de West, vous trouverez une lettre et moi. Adieu. J’aspire à demain. Trois jours sans un signe de vie ! Cela m’est-il jamais arrivé ? Adieu Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Famille Guizot, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Portrait
401. Paris, Jeudi le 11 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Simon est charmant, il vient toujours de bonne heure. C’est un si doux réveil ! La mort du Roi de Prusse fait beaucoup de sensation. Lady Granville a été hier soir à Neuilly, elle dit qu’on est accablé. On dit : " C’était le seul souverain benveillant pour nous. " Et cela est vrai, j’ai éte chez elle en revenant de Boulogne où j’ai fait ma visite de députion. Il y avait tout le dîner de l’autre jour moins Thiers. (Rothschild est furieux contre Thiers pour cette affaire des juifs de Damas.) Les ambassadeurs en masse. A propos M. Molé et moi nous les trouvons bien bêtes tous. Vous verrez que le nouveau règne en Prusse sera en effet bien du nouveau et cela seul est un mal, car tout était bien sous me vieux roi. Pauvre esprit mais droit et juste. Celui-ci beaucoup d’esprit, l’esprit charmant, mais sans règle.
Je suis sûre que les Berry ont envie de vous faire épouser Miss Trotter, mais cela ne m’enquiète pas du tout. J’irai regarder ce qui m’inquiète, ou plutôt je n’y penserai pas du tout, n’est-ce pas ? Comment faire pour arriver sans partir ? J’ai horreur d’un départ, et quand cela est accompagné de mille tracas et désagréments qui sont pour moi seule je suis sûre, il y a de quoi se fâcher beaucoup contre... Voyons ? Contre celui-qui me fait partir, croyez-vous ? La Stafford house me fâche. Il est très vrai qu’ils ont écrit il y a trois semaines à Lady Granville qu’aussi tôt partis ils mettaient Stafford house à Westhill, leur villa à ma disposition. Mais il fallait me le dire à moi, ce qu’ils n’ont pas fait, et ce qui fait que cela ne veut rien dire du tout. En attendant on me dit que je suis très mal campée, il y a beaucoup d’étrangers arrivés ou arrivant cela me sera odieux. Et à Londres je trouverai cela très inconvenant pour moi.
Voilà pourquoi la fin du season m’eut bien mieux convenu à la veille des campagnes. Il me semble que je suis un peu cross, c’est vrai mais c’est par moment ; le fond est de la joie bien grande, bien intime, bien profonde ; de la joie comme la vôtre tout au moins. Le temps est charmant, j’espère qu’il se soutiendra. On continue à parler beaucoup des mutations prochaines dans la diplomatie. Bresson, Pontois, Latour Maubourg, Rumigny tout cela doit faire la seconde edition des préfets. Adieu. Adieu. Il y en aura encore quatre de Paris? Adieu.
Lady Palmerston m’annonce qu’Esterhazy arrive incessamment à Londres, et lors Beauvale. aussi et qu’on va faire les affaires à Londres. Adieu.
401. Trouville, Lundi 10 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
une heure
Je ne devrais plus vous écrire. Cette lettre-ci sera à Londres, Vendredi. Vous n’y serez pas. Et quand vous y serez, j’y serai. N’importe. Je vous écris. Je viens de recevoir votre lettre 409. J’ai oublié de numéroter les miennes. Il me semble que ceci doit être 405. Il y a trois jours, je ne me résignais pas aux lettres. Aujourd’hui une lettre vient de me charmer. Il fait très chaud, très beau. J’irai tout à l’heure promener ma mère et mes enfants, dans la forêt de Touques ; ma mère en calèche, mes enfants, sur des ânes. Ils sont bien heureux. Je les ai menés à la mer ce matin ; ils se sont baignés devant moi. Mad. de Meulan vient d’arriver. Elle retournera au Val-Richer demain. Ma mère et mes enfants samedi 15.
J’ai déjà parlé à Eu de mon congé en octobre. J’y compte. Toujours subordonné à l’état de cette malheureuse question d’Orient. Mais ou je me trompe fort ou elle sera immobile à cette époque. Le blocus durera sans aboutir. C’est, je vous jure un curieux spectacle que la complète opposition des conjectures sur le Pacha, les uns si sûrs qu’il cédera, les autres qu’il ne cédera pas. Très sincèrement sûrs. Il y a de quoi prendre en grande pitié les convictions diplomatiques. L’erreur sur l’insurrection de Syrie a été grossière ; elle n’a pas été un moment sérieuse, et Lord Alvanley est un badaud. Lord Francis Egerton a donné aux insurgés trois canons rouillés, et 800 fusils hors de service ; par ardeur chrétienne et pour affranchir les frontières de la Terre Sainte. Il n’y a eu personne pour se servir de ses fusils. Méhémet en profiterait s’ils étaient bons à quelque chose. Les Carlistes aussi ont eu la main dans l’insurrection ; par Catholicisme et par Carlisme. Tout cela a abouti à élever un nuage de poussière que Lord Palmerston a pris, pour un orage. De son erreur je conclus qu’il se trompe probablement sur Alexandrie comme sur Beyrout. M. Thiers est infiniment plus sceptique, plus modeste. Pourtant il ne doute pas de la résistance obstinée du Pacha.
Conseillez à Lady Clauricarde de retirer sa joie sur Louis Bonaparte. Elle a des joies un peu légères. Voilà les obsèques de Napoléon accomplies, tranquillement accomplies. Le Roi, ses ministres, le public, tout le monde est charmé. Le Bonapartiosme est tombé plus bas que l’insurrection de Syrie, le pauvre Louis Bonaparte ne voulait pas se coucher dans le château de Boulogne parce qu’il n’avait pas son valet de chambre pour le déshabiller. Et jeudi dernier, quand on l’a retiré de l’eau et conduit en prison, comme il ne voulait pas poser sur la pierre froide ses pieds nus (il venait d’ôter ses bas) un des gardes nationaux qui venaient de lui tirer des coups de fusil, l’a pris dans ses bras, et l’a porté sur son lit.
Vous avez bien fait de m’envoyer la lettre du duc de Poix. Il n’y a en effet rien à faire à présent. On a fait quelque objection à son fils, très haut. Cette nouvelle vilenie de Pétersbourg (pardonnez-le moi) m’a indigné comme si elle m’avait surpris. Je croyois que nous avions atteint le terme. Vous n’avez sans doute plus rien entendu dire de la prochaine arrivée. Vous m’en parleriez. Mais j’oublie que vous m’avez écrit vendredi, vingt, heures après m’avoir vu. Les heures sont bien longues.
Adieu. Ceci est pourtant ma dernière lettre. Mais non pas mon dernier adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Enfants (Guizot), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Russie), Vie familiale (François)
402. Eu, Mercredi 12 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Onze heures et demie
Je suis arrivé il y a deux heures et je n’ai pas trouvé Thiers ici. Il n’y sera que demain matin, et il demande au Roi de me retenir un jour de plus. Il le faut bien. Je ne serais donc à Londres que samedi, au lieu de Vendredi. Ceux qui ne croient pas à mon retour se trompent. Et vous avez raison de croire à une chose. Toujours. J’avais si bien arrangé tout pour partir demain Et d’ici à mon départ, je n’aurai point de lettre. J’ai peu de satisfaction par l’écriture quand je la vois ; mais quand je ne la vois pas, je la désire beaucoup. Je me suis échappé après le déjeuner. Et voilà que le Roi me fait demander. Adieu. J’ai roulé toute cette nuit sans dormir et sans changer de pensée. Adieu
Le discours de Lord Palmerston aux Communes a fait en France beaucoup d’effet et un bon effet. Le mal est grand, mais non incurable.
402. Paris, Vendredi 12 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai un grand plaisir. Enfin quelque chose me réussit. Je serai accompagnée, par M.Heneage l’un des secrétaires de l’ambassade d’Angleterre, et je dormirai tranquille. Lady Granville m’a arrangé cela. Il n’est pas ici, mais il arrive demain de Fontainebleau. La question du logement ne sera pas aussi favorable. Vraiment je serai parfaitement mal. J’ai bien plaint souvent les pauvre voyageurs que je visitais à Londres. Mais que faire ! Il faut tacher d’arranger en campagne au plutôt ; pour cela faites finir le parlement.
J’ai vu hier au soir Berryer il y avait bien deux mois qu’il n’était venu. Il a causé avec esprit mais son humeur est grogneuse. Il avait espère quelque éclat, ceci prend une mine trop solide, qui le deroute. Il me dit : " Thiers pouvait le taire plus fort, il a préféré faire la chambre plus faible. Il doute de l’entrée de Barrot dans le Cabinet ; et il ne compte plus du tout sur la dissolution. La gauche est divisée. Et les conservateurs ne sont pas gouvernés. Voilà à peu près l’essence de ce qu’il m’a dit. Montrond est venu hier soir aussi. Ils ont causé. Mon ambassadeur, les Durazzo d’autres.
J’avais chaud. J’aurais préféré le bois de Boulogne d’où je n’étais revenue qu’à 9 heures. Il y faisait charmant. Je jouis de cet air bien pur ; d’un air qu’on n’a jamais en Angleterre. Je reviens un moment à Berryer. Il est frappé du despotisme complet de Thiers et m’a cité à ce sujet des traits assez curieux. Jaubert est un des plus soumis
A propos mon ambassadeur est maintenant en bonne connaissance avec tous les Ministres. Cela est venu à la suite d’un commérage de ma part. Vous savez mon estime pour les commérages. Adieu Monsieur, je n’aurai plus de réponse à cette lettre Adieu.
2 heures
Je réponds encore à votre lettre. Je suis charmée de Windsor. Votre dîner des 15 chez Lady Lovelace en est dérangé, cela ne me déplait pas trop, elle a un trop joli nom. Je vous dis de loin des bétises. Je suis sûre de n’en point dire de près. Mon départ reste fixé au 16 à moins que Heneage ne me prie de le retarder. Ce ne serait que d’un jour il me ferait arriver le 19. Comme vous le dites. Adieu.
403. Eu, Jeudi 13 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Décidément, je pars demain Vendredi, à 8 heures, et je serai samedi à Londres, pour dîner. J’espère trouver de vos nouvelles à Hertford house en y arrivant, et j’irai, en chercher moi-même à Stafford house dès que j’aurai dîné, de 8 heures à 8 heures et demie. D’avant-hier mardi à après-demain samedi sans rien de Vous ! Thier est arrivé ce matin. Nous passons la journée ensemble. Il retourne ausi à Paris demain. Je suis content, je devrais même dire de plus en plus content des dispositions publiques et personnelles. J’espère que mon pays se fera honneur et que je l’y aiderai.
Adieu. Adieu. Je vais rejoindre, le Roi et Thiers. Adieu.
403. Paris, Samedi le 13 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Les Granville sont très bouleversés du coups de pistolet. Moi, je crains qu’on ne prononce en Angleterre le nom du roi de Hanovre. Quand il arrive une atrocité on pense à lui tout de suite. Je n’ai jamais vu d’homme soupçonné de tant de mal. Espagne occupe aussi ici. On ne comprend pas le voyage de la reine. Granville a l’air de croire à un mariage Cobourg. Le prince est parti d’ici il y a trois semaines sans qu’on sache pour où. M. Molé croit savoir que la Reine veut sortir du royaume et que cela est concerté avec l’Angleterre. Moi je ne sais rien.
Zéa est venue deux fois sans me trouver. Si j’ai le temps je la ferai encore venir avant mon départ.
Thiers a été chez Armin. Il lui a dit que Bresson quitterait Berlin sans lui dire qui serait le successeur mais on pense que ce sera M. Pontois et qu’ils changent de poste. Le duc d’Orléans est allé chez Armin aussi, très sévèrement affligé de la mort du roi. J’ai vu Armin. Il a l’air de craindre pour son compte. Le duc de Nemours est allé chez Granville hier au sujet du coup de pistolet. Granville a pris cela pour une visite de parenté Cobourg, et non de politesse française. Voilà le châpitre fashionable moves. Je n’ai rien fait hier que visites et préparatifs.
M. de Broglie va faire un voyage avec son fils, et puis ils passeront quelques mois en Suisse, il ne retournera à Paris que pour la session prochaine. C’est de Grainville que je tiens cela. Demain revue de la garde nationale. Il me semble que nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Quel plaisir ! Votre lettre ce matin m’a donné deux plaisirs. Je ne puis vous les dire qu’à Londres. Mais soyez sûr que je suis heureuse, heureuse, et joyeuse. Je vous écrirai encore deux fois. J’ai vu Génie hier, je le recevrai Lundi. Adieu, adieu.
404. Du château de Windsor, Mardi 18 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
404 est le vrai numéro de ceci. J’ai refait ma chronologie. Rétablissez la vérité sur mes six dernières lettres de France. Elles sont comprises entre 397 et 404. J’arrive. Le Roi Léopold n’est pas encore rentré de la promenade. Je l’attends et je pense à autre chose. Je suis dans une grande et belle chambre en damas jaune, en face de la grande allée. Je soupçonne que c’est votre chambre. Je soupçonne qu’on me l’a donnée à dessein. J’ai envie de ne pas me tromper. Une alcôve en face de la cheminée, avec une grande glace au fond, recouverte par une tenture flottante. La grande fenêtre en face de la porte. Une petite fenêtre longue dans un enfoncement à côté de la cheminée. Une toilette dans la grande fenêtre. Trois commodes, secrétaires, & l’un en ébène, très doré ! Un joli petit cabinet de toilette à côté. Ai-je raison ? Je suis venu en deux heures. J’ai dormi une heure ; dormi et rêvé. Éveillé l’autre heure en pensant comme j’avais rêvé. Une pensée unique et immuable dans une vie animée et variée.
Que d’espace j’ai parcouru, que de choses j’ai vues, et dites et faites depuis quinze jours ! Deux grands pays, deux châteaux royaux, trois rois dont une reine, la paix ou la guerre en Europe et en Asie. Et tout cela, c’est la surface. Il y a tout autre chose, au fond, une seule chose?
Mercredi 19 août. Midi. J’ai vu deux fois le Roi Léopold hier à 7 heures et tout à l’heure. Je suis content de ma conversation. J’espère qu’il m’aidera bien. Il comprend très bien la situation de la France. Il a plus d’esprit dans les grandes choses que dans les petites. Il devait partir demain 20 ; mais, il restera jusqu’à samedi 28 et plus longtemps s’il le faut. Je le laisse parler et agir. Je lui ai bien expliqué que mon attitude à moi, C’était l’attente, l’attente froide et tranquille. Nous sommes en dehors. Nous restons en dehors, jusqu’à ce qu’en dedans on sente et on nous dise qu’on a besoin de nous. Je ne change donc rien à mes premiers projets. Je retourne à Londres demain matin. L’affaire d’étiquette s’est passée hier comme nous l’avions prévue. On a coupé le différend par la moitié. J’ai donné le bras à la Princesse de Hohenlohe et je me suis placé à la gauche de la Reine, qui avait le Roi, Léopold à sa droite. Le Prince de Hohenlohe qui avait passé avant moi donnant le bras à la duchesse de Kent, était au dessous de moi à table. Mais au retour, j’ai repris la moitié que je n’avais pas eue en allant. Il n’y avait point de femme, personne ne donnait le bras à personne. Je me suis arrêté à la porte de sa salle à manger pour me faire présenter au Prince de Hohenlohe qui y arrivait en même temps que moi, et la présentation faite, j’ai passé devant lui en rentrant dans le salon. J’en ai fait autant en passant d’un salon dans l’autre. Ainse j’ai exercé tout mon droit. A dîner la Reine et la famille royale ont été, pour moi, particulièrement aimables. A glass of wine avec le prince Albert, le roi Léopold et la Reine elle-même, d’une façon marquée. Lord Melbourne et Lord Palmerston comme à l’ordinaire. Lady Palmerston gracieuse avec empressement ; tout à l’heure à déjeuner, elle se désolait du mauvais temps ; elle s’était promis de me faire faire une jolie promenade de me montrer Virginia-water.
- Mais le temps se lèvera, certainement il se levera.
- Prenez garde, Mylady ; je prends les promesses au sérieux. Lord Palmerston intervient, de l’autre côté de la table.
- Je donne ma garantie ; je suis sûr qu’il fera beau. Je me retourne vers sa femme.
- Lord Palmerston est bien heureux ; il est sûr avant. Moi, je ne le suis qu’après.
Adieu. J’attends Herbet, dans trois quarts d’heure. Je vous redirai adieu.
P. S. Voilà votre lettre. Je ne réponds à rien qu’à Adieu. A demain, entre midi et une heure.
404. Paris, Dimanche le 14 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’écris de bonne heure et j’enverrai ma lettre de bonne heure à la poste ! Car voici une grande revue et tout Paris sur pied, car on attend l’Empereur Nicolas ! Imaginez que les Parisiens le croient. J’ai vu hier Montrond, Molé les Appony et Granville le soir. On parle beaucoup de l’Angleterre. Montrond et Molé enchantés que ce soient des sociétés secrètes. Ce sera d’un bon effet ici. Molé dit c’est notre belle révolution qui porte ses fruits. " Je suppose que vous ne prendriez pas la chose ainsi. En attendant c’est vraiment un spectacle fort alarmant.
J’ai vu mon compagnon de voyage; je l’ai bien examiné. Il est tout juste de taille à ne pas encombrer ma voiture. Il a l’air doux et tranquille, et gai, et il est comblé d’être mené aussi commodément.
J’ai eu une longue lettre de William Russell avec des détails intéressants. Nous sommes détestés à Berlin, on a tout fait pour empêcher l’empereur d’arriver. Le Roi de Hanôvre venait aussi. Ces deux ensemble paraissent de mauvais conseiller pour un nouveau roi. On ne sait comment il marchera, on ne connait pas ses idées politiques. On dit maintenant ici que la Redorte pourrait aller à Berlin, ce qui est sûr c’est que sa nomination n’est pas encore au Moniteur.
Je suis bien fatiguée d’hier. Des paquets, des arrangements, des visites, et au matin on va m’envahir pour voir de chez moi la revue. Mon ambassadeur est bien grognon de mon départ. Mad. de Flahaut m’écrit pour s’annoncer pour le 25. Elle a toujours quelque petite tirade contre les doctrinaires. Adieu. Adieu. Encore demain Adieu, et puis, quel plaisir !
On fait à M. de Lamericière des réceptions superbes au château. Molé critique cela et critique tout. Il est de l’opposition la plus violente.
405. Londres, Lundi 7 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Je ne puis pas me rendormir. Je vous écris de mon lit hier en rentrant chez moi, j’ai essayé de travailler. Je n’ai pas réussi. Votre billet m’est arrivé. Que j’aime Guillet ! J’avais envie de le remercier. J’ai encore essayé de travailler. Pas mieux. J’ai pris le parti de sortir, de marcher. J’ai marché deux heures un quart, dans Regent’s Park dedans, à travers, autour. Je me suis arrêté devant trois prédicateurs. L’un prêchait contre le libre arbitre de l’homme. Un autre lisait, dans je ne sais quel voyage, une histoire de Missionnaire pour prouver à ses auditeurs qu’il était plus sage et plus sain de ne boire que de l’eau. Je n’ai pu entendre le troisième. J’ai passé devant une petite porte de Regent’s Park, où est la statue du duc de Kent. Je me suis arrêté. Personne ne parlait là ; mais moi, j’entendais, des choses charmantes Je suis rentré à 6 heures un quart. J’étais las très las. Je me suis endormi dans mon fauteuil, en face de ma fenêtre. Quand je me suis réveillé, j’ai aperçu la lune devant moi, une petite lune claire et douce. Vous l’aurez vue aussi, entre Dartford et Rochester.
A 9 heures et demie j’ai été à Holland house où j’ai mené Bourqueney. Lady Holland est toujours souffrante. Je lui ai remis votre billet. Elle ne voulait pas croire que vous fussiez partie. Il a fallu le lui répéter. Peu de monde. Luttrel, Alava, Moncorvo, Neumann. J’ai demandé à lady Holland quel jour elle voulait venir dîner chez moi en petit comité. Elle craint que sa santé ne le lui permette pas. Ils iront à Brighton pour un peu d’air de mer, mais pas longtemps. Je doute qu’ils y aillent, et je crois qu’ils viendront dîner chez moi la semaine prochaine. J’y dine demain (chez eux) avec lord John Russell. Les nouvelles d’Alexandrie les ont fort troublés. Lady Holland prend le trouble fort au sérieux. Lord Holland dit que le Pacha commence à lui plaire. Il le trouve spirituel et fier. J’étais rentré à onze heures et demie Je suis charmé que votre fils soit venu. Je l’espérais à peine. Et qu’il ait été bien. Puisqu’il a commencé, il continuera. Vous retrouverez quelque chose. Demandez-lui peu. Ne le blessez pas et ne vous blessez pas. Que je voudrais que votre relation redevint convenable et douce.
3 heures
Merci de Rochester comme de Guillet, vous étiez fatiguée. Mais n’est-ce pas que cela ne vous fatigue pas de m’écrire. Il ne fait pas si beau qu’hier ; mais bien doux et pas de vent. J’épie le vent ; je lui parle ; je le prie de se taire. Que de choses je dis et que les paroles qui sortent des lèvres sont peu de chose auprès de celles qui y meurent ? J’ai été obligé de sortir un moment et j’ai manqué George d’Harcourt qui est arrivé hier et repart ce soir. La maladie de son oncle l’a fait venir. Il a causé avec Bourqueney. Il est très frappé de la légèreté des esprits d’ici, qui ne se doutent de rien et se réveilleront un matin tout surpris de trouver le monde en feu et d’apprendre qu’ils y ont eux-mêmes mis le feu pendant leur sommeil. Il y a bien des manières d’être léger. Si tout ceci tourne mal, ce sera la faute des hommes. Les choses ne se portent point d’elles-mêmes à une telle explosion. L’aveuglement et le mismanagement auront leur fait. C’est une de mes raisons d’espérer. J’ai peine à croire que les méprises humaines puissent faire, à ce point violence, à la pente naturelle des choses. G. d’Harcourt dit du reste que, s’il y avait guerre, l’unanimité serait grande en France et qu’on verrait quelle conduite tiendraient les Carlistes eux-mêmes. J’essaie de causer avec vous. J’ai été ce matin savoir des nouvelles de la Princesse Auguste, pour voir Stafford house. Elle était assez tranquille ; mais elle s’affaiblit beaucoup. Adieu. Est-ce vraiment adieu ? J’ai le cœur bien serré. Adieu. Adieu.
405. Paris, Lundi 15 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
midi
J’ai reçu la dernière lettre qui doit me trouver à Paris, maintenant je viens vous en demander une à Boulogne. Ecrivez-moi en recevant ceci, je pourrai avoir votre lettre jeudi à Boulogne. Je passerai vendredi, et selon l’heure de mon arrivée à Douvres j’irai coucher à Londres ou je m’arrêterai à Rochester. Vous saurez cela. J’ai dîné hier chez les Appony, le soir chez Brignoles où j’ai dit adieu à tout le monde sauf deux ou trois qui veulent encore venir. On dit que la session finit cette semaine. La revue s’est très bien passée sauf quelques cris de réforme. L’affaire de Londres occupe beaucoup mais je n’ai pas le temps de vous parler de ces choses-là. Je pense à mon voyage, à ce que je vais trouver, je serai bien contente vendredi ! Si le temps est à l’orage j’ai peur de passer, car je suis faible et je n’échappe jamais au mal de mer. Regardez les nuages. Pensez à moi à Windsor. Il n’y a pas un coin de ce château et de ce parc où je ne me sois arrêté. Si vous avez l’appartement où il y a un salon en haute-lisse faisant face au long walk, c’est le mien. le canapé vert à la gauche de la cheminée dans le salon de la reine est celui où j’ai passé tant de soirées à côté de George IV et de Guillaume IV. Que Windsor va vous plaire ! Mais je ne vous envie pas Ascot, cela me faisait mourir d’ennui.
Adieu. Adieu. Je fais comme si j’étais déjà en Angleterre. J’y suis beaucoup, beaucoup, toujours. Adieu.
406. Boulogne, Jeudi 18 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens d’arriver. Le vent est si fort qui s’il continue à souffler demain avec cette violence. Je n’aurai pas le courage de passer. Cette lettre passerait donc au lieu de moi. Je veux que vous me sachiez partie et près d’arriver, et heureuse de me sentir si près ! Je suis fatiguée, mon dernier jour à Paris a été abominable. Prise par tout le monde, et par mille choses.
Thiers est venu et a causé beaucoup. Rien de nouveau, Je vous conterai. On entre, et on me remet dans ce moment votre lettre de hier. Je vois que Samedi sera mauvais et comme je ne pourrais dans aucun cas arriver à Londres demain il faudra bien attendre dimanche. Le bateau ne part demain qu’à midi, je ne serai à Douvres qu’à 5 heures. J’irai donc coucher en route. Voilà bien du retard.
Dès mon arrivée à Londres j’enverrai chez vous. Je vous verrai peut-être entre le rail road et le dîner voilà tout ce que je puis esperer. Je suis très faliguée mon petit compagnon de voyage est très utile, lui et mon courrier m’enlève tout souci mais ils n’empêchent pas que je trouve l’hôtel Talleyrand plus commode que la voiture et les auberges.
Vendredi 7 heures du matin.
Je n’ai pas décidé encore si je pars ou si j’attends demain. Le vent souffle, on dit le duc de Wellington (paquebot) mauvais. Tout cela avec votre promenade à Southampton fait que je ne vais pas risquer. Je verrai. Je ne suis pas décidée, encore. J’ai dormi presque sans réveil, ce qui est rare. En m’éveillant j’ai pensé avec joie que j’étais bien près. Adieu, adieu. Adieu.
406. Londres, Mardi 8 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
Je crois que c’est une habitude que je prends. Je me réveille à 6 heures et ne me rendors plus. Il fait un temps admirable. Je regarde les arbres de mon square. J’ai un souffle qui remue les feuilles. C’est bien ce qu’il vous faut ; vous êtes aussi délicate qu’une feuille. Point de vent qui vous agite et du soleil qui vous plaise ; je ne ferais pas mieux, si je faisais le temps. Le courrier que j’ai fait partir hier soir m’a dit que la marée était ce matin à 5 heures. Il ne comprenait pas pourquoi je le lui demandais. Vous ne passerez pas, je pense par cette marée là, vous attendrez la seconde. J’ai employé doucement ma soirée d’hier. Seul dans ma chambre, de 5 heures et demie à onze heures, j’ai classé vos lettres par année, par mois, par lieu de séjour, chaque mois dans une grande enveloppe.
A onze heures j’ai eu Charles Greville qui revenait de Holland-House où il avait dîné avec Bourqueney On y était fort agité, fort troublé, comme à la Bourse, comme partout dans Londres hier, c’est-à-dire partout où l’on pense à ce qui se passe. Napier devant Beyrouth, sommant les Egyptiens d’évacuer la Syrie, le 14 août, deux jours avant que Riffat Bey eût notifié à Alexandrie, au Pacha les propositions de la Porte cela paraissait monstrueux, et très alarmant. Les Rothschild étaient inquiets au dernier point, inquiets au point de contremander une partie de chasse qu’ils avaient arrangée pour ce matin, ne voulant pas s’éloigner aujourd’hui de Londres. Mais vous en saurez, sur tout cela, plus que je ne puis vous en mander. Vous aurez le haut du pavé sur moi pour les nouvelles. Elles passeront par vous pour venir à moi. Il me semble que les ouvriers s’apaisent un peu. J’y regarde bien plus attentivement depuis hier. En soi ce n’est rien ; mais, c’est bien assez pour vous agiter. Quand quelque chose de ce genre vous préoccupera, faites venir tout de suite Génie ; il vous dira exactement ce qui en est. Et pour peu que vous en ayez besoin ou envie, M. de Rémusat. S’il peut vous être bon à quelque chose, il en sera charmé.
Moi, je le suis qu’il n’y ait plus rien que de convenable entre vous et Paul. Son voyage à Paris consolidera et améliorera. Il s’y plaira près de vous. Faites avec lui comme il faut faire avec les hommes en général ; attendre peu, et demander moins qu’on n’attend. Quelque douceur rentrera, dans votre relation redevenue convenable.
2 heures
Malgré le retard de ma lettre, je suis bien aise que vous soyez partie ce matin, par ce beau temps. Vous partiez au moment où j’ouvrais ma fenêtre où je saluais le soleil pour vous. Vous êtes depuis longtemps à Boulogne, peut-être déjà repartie pour Paris. Je le voudrais. C’est que la mer ne vous aurait pas fatiguée. Ma pensée vous suit partout. Dieu est bien heureux. Il est toujours à côté de ceux qu’il aime. Je garde ma fleur de Stafford-House morte comme vive. Dimmanche soir, je l’ai serrée dans mon portefeuille, à côté d’un petit sachet noir qui contient autre chose, encore plus précieux qu’elle. Le lierre ira là aussi, quand j’aurai bien joui de ce qu’il m’a apporté. J’écris beaucoup ce matin. Si je puis sortir à temps vous aurez aujourd’hui votre chêne. Sinon demain. Il n’y a point de petit plaisir. Je viens de revoir les Rothschild toujours très inquiets de ce que leur oncle écrit de Paris. Pourtant la partie de chasse se reprend demain. Inquiet ou non, il faut que la vie aille, et qu’on s’amuse. J’attends avec impatience votre impression sur Paris. J’ai presque autant de confiance dans votre jugement que dans autre chose ; presque.
4 heures
J’ai parcouru Regent’s Park, les jardins clos au bout de Portland Place. Pas un chène, ni jeune, ni vieux. Enfin j’en ai trouvé un dans le Regent’s park du public. Voici sa feuille. un peu passée. L’automne approche. Les feuilles passent ; mais tout ne passe pas comme elles, quoiqu’on en dise. C’est la prétention vulgaire que ce qui est rare ne soit pas possible. Il y a un plaisir profond à lui donner un démenti. Adieu. J’ai bien peur de n’avoir rien demain. A présent, je vous veux à Paris, bien reposée. Adieu. Adieu. Infiniment.
407. Boulogne, Vendredi 19 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma lettre ce matin n’est point partie par l’occasion régulière. J’ai donc quelque crainte qu’elle ne vous parvienne pas, ce qui fait que je recommence à vous conter mes doléances. La mer est affreuse je n’ai pas eu le courage de m’embarquer. J’attends du calme demain. S’il ne venait pas il faudrait le prendre, mais j’aime presque cela mieux que le mal de mer. Vos n’avez pas d’idée de l’ennui de ceci. Il fait très froid, très gris. Il pleut à verse ; si je n’avais mon compagnon de voyage deux heures dans la journée ce serait horrible, je lis les journaux de Paris et de Londres, je vous cherche. Ne devrais-je pas vous chercher à Boulogne aussi ? Vous aviez une fois le projet d’y être ? J’attendrais plus patiemment que la tempête se calme.
Je vous écrirai aussi longtemps que durera ma quarantaine. Je regarde les girouettes et les nuages, ils me sont bien hostiles. Adieu monsieur adieu. J’avais bien espéré, ne plus vous dire. Adieu aujourd’hui je comptais vous voir ce soir ! Quel guignon ! Un temps superbe jusqu’au jour où j’ai quitté Paris, et depuis toujours tempête. Adieu. Adieu.
407. Londres, Mercredi 9 [septembre] 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 Heures
J’ai si mal dormi cette nuit que je me lève tard. Le sommeil m’a gagné ce matin. Je ne veux pas dire que je suis inquiet. Je ne le suis pas. Je ne le serais pas du tout, si vous ne rouliez pas vers Paris. J’en attends avec ardeur les nouvelles. Je ne peux pas me figurer un vrai désordre dans Paris, votre agitation, vos craintes, et moi absent. Que de choses on ne peut pas se figurer, et qui arrivent, et qu’on supporte ! C’est odieux à penser. Je suis parlaitement sûr qu’il n’y a point de danger dans Paris, point en général, point pour vous. Je pense que vous aurez appris l’émeute à Boulogne, et que vous vous serez arrêtée. Ce qui me prouve que l’émeute n’a pas de gravité, c’est qu’elle était fort locale, concentrée dans un quartier d’ouvriers. Il n’y a rien eu dans les quartiers politiques, où l’émeute politique à toujours logé. Ce que je vous dis-là, ne signifiera rien du tout pour vous quand vous le lirez. Mais je vous dis ce que je me dis à moi-mêmes. J’essaye en vain de me parler d’autre chose.
J’ai dîné hier à Holland-House, avec Lord John, dont j’ai été content très content. Il commence à entrevoir la gravité de la situation. Il convient qu’on s’est fort trompé, qu’on est déjà au troisième ou quatrième mécompte qu’on ne referait pas ce qu’on a fait si ce n’était pas fait. Mais comment faire? Il cherche et ne trouve pas. Mais il cherche. Et je sais que Lord Melbourne cherche aussi avec plus de care qu’il ne lui appartient. Je ne vois là rien de plus qu’une bonne disposition pour un moment qui peut venir. En attendant qu’il vienne ceci est bien grave. Voilà le traité en cours d’exécution. Et il s’exécute avant d’être non seulement ratifié, mais notifié au Pacha ; on l’attaque en Syrie avant de lui avoir dit qu’on lui demande de rendre la Syrie, quand on lui donne vingt jours, pour répondre à ce qu’on lui aura dit ! C’est là le premier incident. Il en viendra en foule. Et c’est sous ce feu-là, qu’il faut rester immobile jusqu’à ce que le moment se présente , soit pour nous d’agir, soit pour les autres to retrace their Steps ! C’est bien difficile. C’est pourtant la seule bonne conduite, bonne pour maintenir la paix si la paix peut être maintenue, comme j’y crois toujours, bonne si nous sommes obligés à la guerre. Car il faut que nous y soyons bien certainement, bien évidemment obligés, que nous la fassions pour notre compte, pour le compte de notre rang, de notre influence, de notre sureté en Europe, non pour le compte du Pacha et de la Syrie.
Je pense sans cesse à cela, sans cesse en seconde ligne. J’ai tort car tout se tient, la première et la seconde ligne. J’y pense avec cette passion qui pénètre certainement au fond des choses comme on regarde de sa barque à l’horizon, le point d’où peut venir la tempète. Je ne découvre pas autre chose à prévoir, autre chose à faire. Ma conviction sur les chances de l’avenir, sur la route à suivre, est de plus en plus forte. Mais que la barque où nous vivons est fragile, et que toute notre sagesse, toute notre force est peu de chose quand la mer est si grosse et le port si loin ! Je moralise ; j’ai recours à Dieu, je le prie. Je ne puis pas, je ne veux pas m’en défendre. J’ai le cœur trop plein, il s’agit d’intérêts trop chers, pour que les pensées et les ressources humaines me suffisent. Je vais à la sagesse qui sait tout, au pouvoir qui peut tout. Je lui demande d’intervenir.
Une heure
C’est Rothschild qui est intervenu pendant que j’écrivais. Croyez-vous qu’il prie Dieu pour la surété de son argent ? Je ne pense pas que cela soit jamais arrivé à personne. Grande lumière sur la valeur des choses.
Je n’espérais pas de lettre aujourd’hui. Merci mille fois. Vous êtes bien aimable. C’est presque une vertu d’être aimable. Cela me plaît que vous ayez passé par Calais. Je passe toujours par là. Rien de Paris sinon les journaux qui me prouvent que l’émeute n’a pas été grand chose. Le langage du Constitutionnel, sur la dépêche de Lord Palmerston et sur la situation en général est bon. Mais j’aurais dû avoir un courrier. Adieu. Serez-vous ce soir à Paris, ou demain seulement ? Adieu partout. Adieu toujours.
408. Boulogne, Samedi 20 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
La mer est toujours abominable quoique le veut commence à diminuer un peu, la traversée serait encore horrible, il faut attendre à demain. Le ciel n’est plus si chargé, le bateau de demain passe pour avoir le mouvement plus doux, c’est donc demain que je passerai j’espère.
Je veux vous dire ce petit mot par dessus mes deux lettres d’hier. Quel ennui ! Il faut que ma terreur du mal de mer soit bien forte pour me faire me résigner à Boulogne pendant 4 jours. Je marche, je lis, je fais des patiences. Mon compaqnon de voyage va me chercher des nouvelles. Nous mangeons lentement, enfin nous traînons une pitoyable journée. J’ai dejà pris Boulogne en horreur, Boulogne que nous trouvions si charmant en imagination. Il me semble que vous recevrez cette lettre et celle d’hier au soir en même temps demain matin. J’aurais tant aimé passer le dimanche à Londres. C’est un jour tranquille, je l’aurais bien employé. Adieu. Mon impatience est bien grande. Je n’ai jamais été contrariée par les éléments. Ils se mêlent de cela aussi. Mais cela revient à ce que Louis quatorze disait au Maréchal de Villeroi. Adieu. Adieu, Monsieur, adieu.
408. Londres, Mercredi 9 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
J’ai fait ce matin quelques visites. J’ai vu notre amis Dedel, toujours très bon et très sensé. Je lui ai porté mes plaintes sur Napier n’ayant pu trouver dans Londres un ministre anglais à qui les adresser. J’avais passé chez Lord Clarendon le seul membre du Cabinet qui réside. Il n’y était pas. Il sort de chez moi, et je lui ai dit comme s’il avait été Lord Palmerston ou Lord Melbourne tout ce que Napier m’avait mis sur le cœur. Il n’y a pas de réponse à cela. Lord Palmerston lui-même n’en trouverait pas. La guerre commencée en Syrie deux jours avant qu’on ait demandé au Pâcha de rendre la Syrie ! Voilà bien les incidents et les subalternes. Je ne sais ce qu’on me dira quand il y aura quelqu’un pour me parler En attendant les journaux même les plus hostiles au Pacha, le Standard par exemple, se récrient contre une telle légèreté ou un tel manqué de foi. On verra ce que c’est que d’entreprendre à 7ou 800 lieues et par toutes sortes de mains une opération bien plus vaste, bien plus compliquée, bien plur longue que cette expédition de Belgique que nous avons eu tant de peine à conduire à bien, sous nos propres yeux et de nos propres mains.
Jeudi 6 heures et demie
Je m’éveille. Achevez. J’ai eu hier quelques personnes à dîner. Rien. Après dîner, j’ai joué au whist. Quelle décadence. C’est demain que je commence à rester chez moi le soir, mardi et vendredi. J’achète une seconde table de whist, des échecs. Je fais venir du Val-Richer mon tric-trac. On ne trouve pas un tric-trac dans Londres. Je n’aurai pas mes deux soirées par semaine à Holland house. Ils vont décidément à Brighton pour quinze jours. Cependant Lady Holland va mieux. Lord John est retourné à Windsor. La Reine ne voulait pas qu’il en sortit, même pour un jour. Pourtant quand elle a su que c’était pour dîner avec moi, elle a dit : " A la bonne heure. Je crois que la Reine a grande envie de la paix. Lord Clarendon est invité à Windsor pour vendredi, la première fois. Lord Holland n’y a pas encore été invité. On en a de l’humeur. On s’en prend à qui de droit.
Lord Tankerville a été opéré hier matin, avec plein succès, dit-on. On n’en sera tout-à -fait sûr que dans quelques jours. Dites-moi ce qu’il y a de réel dans le succès de l’opération sur les yeux de votre nièce. Je déteste la loucherie. Je penserais avec plaisir qu’on a trouvé un moyen de la chasser de ce monde. Je n’ai pas eu hier de lettre du Val. Richer. Je m’en prends aux désordres des ouvriers dans Paris. Je sais que le service des postes en a été un peu dérangé. J’attends encore plus impatiemment le courrier de ce matin. Je n’ai pas besoin d’un redoubement d’impatience. Qu’a donc été votre si mauvaise nuit à Douvres que vous ayez hésité à partir ? Il ne faut pas dire des choses pareilles, cela donne des pensées abominables. Au moins ne soyez pas malade loin.
Midi
Votre fatigue me préoccupe beaucoup. Je m’y attendais. Mais qu’importe ? Vous ne vous réposerez qu’à Paris. Tout y est tranquille. J’ai reçu ce matin une bonne lettre de Thiers. Il paraît que malgré Napier, les syriens n’ont pas envie de se faire égorger pour faire plaisir à Lord Palmerston. Tout optimiste que je suis, je ne le suis pas tant que d’autres. Je trouve qu’on est déjà bien engagé. Je crains toujours les coups fourrés et soudains. Pourtant il est sûr que jusqu’ici tous les mécomptes ont été d’un seul côté. Où aurez-vous couché hier ? A quelle heure arrivez-vous aujourd’hui à Paris ? Je me fais cent questions; et j’ai beau savoir que je ne trouverai pas la réponse; je recommence toujours. Adieu. Adieu. Adieu.
409. Douvres, Dimanche 21 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
6 heures du soir
Je débarque dans ce moment après une traversée assez bonne. Je suis restée quatre heures comme une morte ; mais me voici, me voici et demain à Londres ! J’espère que j’y serai entre quatre et cinq heures. Je demeure à Dover street 36. C’est ici que je l’apprends. La seule rue de Londres que je fuis à cause de mes souvenirs, c’est là où l’on m’arrête un logement ! Vous ne savez pas ce que cela me fait éprouver. Je changerai mais il faut commcer par y descendre parce qu’il me faut bien un gîte. Ah ! L’Angleterre est triste pour moi, par ce côté-la ! Mais je veux penser à ce qui réjuit mon cœur et non à ce qui l’attriste. Envoyez à 4 heures, un de vos gens savoir si je suis arrivée ; car je n’aurai personne à vous envoyer. Je ne sais cce qu’est cette maison, et moi Je n’ai qu’un courrier. Adieu. Adieu. Il faut que je mange et que je me repose. Adieu pour la dernière fois de cette pauvre façon. Adieu !
409. Londres [Stafford house], Vendredi 7 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
midi
J’ai reçu plusieurs lettres ce matin, d’abord une du duc de Poix que je vous envoie. Une de la petite Princesse au moment de quitter le Havre pour retourner en Allemagne. une de mon banquier de Pétersbourg m’envoyant un compte de pensions, de dettes, & & pour lesquelles je suis taxée au quart, tandis que mes droits de succession l’ont été à la 7ème partie : si c’est la loi je n’ai rien à dire, mais je m’informerai ; si c’est contre la loi, je ne vois pas pourquoi je dois subir cette disposition arbitraire de mon fils aîné. L’affaire de la vaisselle n’est pas terminée et ne le sera que dans 6 mois. Je fais venir Benckausen pour lui parler.
Vous êtes en France. Qu’aurez-vous trouvé là ? Les récits du matin dans les journaux ne sont pas assez clairs. Je ne vois pas assez que cette sotte affaire soit terminée. Où est Louis Bonaparte ? Serait-il possible que lord Palmerston lui eût fait visite ces jours-ci comme le disaient les journaux ? Si vous prenez ce fou, j’espère bien que vous saurez mieux faire que la première fois. N’avez-vous donc pas de conseil de guerre pour un cas pareil ? Et justice immédiate. Cela va bien ajouter encore au clabaudage entre les deux pays ! Je dînerai aujourd’hui chez Lady Clauricarde. Adieu. Adieu, mille fois. J’attendrai vos lettres avec une extrême impatience. Adieu.
410. Londres, Samedi 12 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Voilà deux lettres, Poix et Beauvais. Que j’ai le cœur léger ! Je l’avais bien gros en m’éveillant. Je n’ai pas voulu écrire. Vous êtes fatiguée. Mais vous avez faim et la France vous plaît. J’aime que la France vous plaise ; et je ne suis pas jaloux de la France. Ni de l’Angleterre non plus. L’Angleterre a été charmante. Tout est charmant ce matin. Dieu m’a donné son pouvoir ; je fais le monde à mon image, sombre ou brillant, triste ou gai selon l’état de mon cœur. Demain, j’aurai de vos nouvelles de Paris. Et tous les jours. Et de longues lettres. Demain, je ne vous écrirai pas à mon grand regret. Je suis forcé d’envoyer un courrier aujourd’hui. Il fait beau. J’espère que vous serez entrée à Paris sous un beau soleil, que les fontaines sont pleines d’eau, les Tuileries encore vertes, que vous aurez regardé avec plaisir par votre fenêtre. Regardez. Est-ce que je n’arrive pas ? Ah, j’y suis toujours, sauf le bonheur.
Je parle beaucoup de Napier moi. J’en parle à tout le monde. Quelques uns me répondent comme je parle. Les autres, essayent de ne pas me répondre du tout.Les plus hardis sont embarrassés. Je n’ai pas encore pu joindre lord Palmerston. Toujours à Broadlands pendant qu’on traduit et copie les ratifications turques. Ni Lady Clanricard qui est à la campagne aussi, on n’a pas su me dire où. Elle revient Lundi. Les Palmerstoniens attendent avec passion les insurgés de Syrie, un pauvre petit insurgé ; on n’en demande pas beaucoup. Ils tardent bien. J’ai peur que tôt ou tard, il n’en vienne assez pour faire égorger ceux qui ne seront pas venus. Quels jouets que les hommes ! Il y a là, au fond de je ne sais quelle vallée au sommet de je ne sais quelle montagne du Liban, des maris, des femmes, des enfants qui s’aiment, qui s’amusent, et qui seront massacrés demain parce que Lord Palmerston en roulant, sur le railway de Londres à Southampton, se sera dit : " Il faut que la Syrie, s’insurge; j’ai besoin de l’insurrection de Syrie ; si la série ne s’insurge pas, I’m fool ! "
3 heures
Il me tombe aujourd’hui je ne sais combien de petites affaires, de l’argent à envoyer à Paris pour le railway de Rouen, des quittances à donner, le bail de ma maison, Earthope, Charles Greville. On m’a pris tout mon temps, depuis le déjeuner. Je me loue beaucoup de Charles Greville. C’est dommage qu’il soit si sourd. Il arrive de Windsor où le Conseil privé s’est tenu hier. Il part demain matin pour Doncaster. Moi, j’écris ce matin à Glasgow et à Edimbourg que je nirai pas. Il faut qu’absolument que je sois à Londres pour recevoir l’insur rection de Syrie, si elle arrive. Voilà des grouses d’Ellice. J’aimais mieux les premières. dit-on, les premiers ou les premières ? Je le demanderai à lord Holland qui est mon dictionnaire anglais. Je reçois un billet de ce pauvre comte de Björmtjerna qui devait venir dîner aujourd’hui avec moi. Il est depuis hier matin dans une taverne, à côté de Customs house, attendant le bateau de Hambourg qui porte sa femme et ses enfants, et qui n’arrive pas. Il y a eu une violente tempête mercredi et jeudi. J’ai grande pitié de lui. J’ai eu hier ma première soirée. Dedel, Vans de Weyer, Hummelauer, Moncorvo, Alava Schleinitz, des secrétaires. Ils ont joué au Whist, à l’écarté, aux échecs. Les sandwich excellentes. Je les leur voyais manger avec humeur. Longchamps, Longchamps ! Pas de nouvelles. Neumann était à Broadlands. Il en revient aujourd’hui pour dîner chez moi. Quoiqu’il n’y ait personne ici, il y a des commérages. On dit que j’ai dit que si nous faisions la guerre, ce ne serait pas sur le Rhin, mais sur le Pô que nous la ferions. L’Autriche s’en est émue. Je dis que je ne l’ai pas dit, mais que je n’entends pas dire que nous ne ferions pas la guerre sur le Pô, si nous la faisions.
Adieu. Vous partez pour le bois de Boulogne. Adieu là comme partout, Adieu.
410. Londres, [Stafford house] Samedi 8 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
8 heure du matin
Je ne puis pas dormir, je me lève et j’ai été au jardin. Il y a un brouillard épais et froid un temps anglais bien triste, triste comme moi. J’ai vu hier lord Harry Vane longtemps. Homme sensé voyant les choses comme elles sont sans passion. Il regrette la querelle de personnes et trouve que les journaux français ont été maladroits sur ce rapport. Le discours de lord Palmerston avant-hier a eu du succès à la chambre du commerce. On l’a trouvé clair et satisfaisant. Lady Clauricarde prétend que M. de. Brünnow n’en est pas content quant à la partie qui nous regarde. J’ai vu Munchhausen, des bêtises. Lady Palmerston, très sereine, très contente. Les Russes ne disant et ne sachant rien. J’ai dîné trois avec lord & lady Clauricarde. Le soir la promenade en calèche avec elle, et je me suis couchée à 10 1/2. J’ai pu dormir. J’ai oublié hier, la duchesse de Bedford (régnante) et lady William Russell. La première était évidemment venue pour me sonder et apprendre si je connaissais la Reine des Belges. Ils arrivent ce matin, Il y a une soirée pour eux lundi, et mercredi la cour s’établit à Windsor. Lady William Russell dit qu’on est de bien mauvaise humeur à Holland house. Depuis que je sais Louis Bonaparte arrêté je suis plus tranquille.
Personne ici ne croit à votre retour. Moi je ne crois à rien dans le monde qu’à une seule chose.
Midi. Je me sens bien nervous aujourd’hui, plus que de coutume. Le brouillard est dissipé la chaleur est venue, elle ne me réchauffe pas.
1 heure
Je viens de recevoir votre petit mot de Calais. Je serais bien curieuse, bien anxieuse de celui que vous m’écrirez d’Eu. J’ai eu une longue visite de Benckhausen. Mes fils sont en règle. C’est la loi. Je suis charmée, Benckhausen affirme qu’à la cité personne ne croit à la guerre et qu’on pense que le Général français a fait toutes ces démonstrations pour pouvoir en jouir plus dignement. S’il en était autrement nous avons 28 vaisseaux de ligne à Cronstadt qui peuvent être ici dans 8 jours, et 14 à Sébastopol qui peuvent aller rejoindre la flotte anglaise dans le Levant, voilà les dires de la cité, et on est parfaitement tranquille. Je voudrais être calme et me bien porter, mais cela ne va pas M. de Bourqueney n’est pas venu me voir, je le regrette. Je suis assez seule et cela ne me vaut rien. Adieu. Adieu. J’ai une horreur d’écriture. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Benckendorff), Femme (politique), Femme (portrait), Guerre, Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Russie), Portrait, Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)
411 bis. Wrest Park, Vendredi 14 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens de recevoir votre lettre de Trouville de Dimanche ! Que c’est long ! Mais vous arrivez à Londres aujourd’hui vous me le dites, vous me le promettez. Je me suis ranimée. Je balance, puis-je partir aujourd’hui ? J’en ai si envie, une si grande envie.
3 heures.
Je me décide, je pars, je porte ceci chez vous.
7 heures. Dernier adieu. Je suis à votre porte. Venez me voir à Stafford house après votre dîner. Vous me trouverez malade et heureuse.
411. Londres, Dimanche 13 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures et demie
Oui, Paris, vous plaira davantage. Paris vous plaira tout-à-fait, tout-à-fait, n’est-ce pas ? Puisque vous n’êtes plus où je suis, j’aime à vous savoir à Paris. Vous me direz, dans quelques jours comment vous y aurez réglé votre vie. Très probablement comme nous nous le sommes dit à Stafford. house. C’est égal ; vous me le redirez. J’aime bien les redites. Je reviens de Kenwoood, (est-ce Kenwood ou Caen-Wood, comme le dit mon Guide?) la villa de lord Mansfield. Le parc est bien beau, les alentours bien beaux. J’aurais voulu être seul. J’avais Bourqueney, Vandeul et Herbet. Ils disent qu’il faut que je me promène. Je n’avais pas encore été à Hamstead. Point de souvenirs donc là. Je crois que j’aime mieux les lieux où j’en ai. Je retournerai à West-hill Je ne sais pas pourquoi je dis : " Je crois que j’aime mieux ", j’en suis parfaitement sûr. Je n’ai trouvé Kenwood que beau. Si nous y avions été ensemble, je l’aurais trouvé charmant. Ensemble une seule fois.
Un homme de Holland house, m’a poursuivi à Kenwood pour m’apporter un billet de Lord Holland qui en revenu ce matin de Windrow et me prie d’aller diner aujourd’hui avec lui. J’irai. Ils partent toujours demain pour Brighton. Lady Holland dit qu’elle veut prendre là les eaux de Marienbad, contre la bile. Les Allemands se moquent d’elle. Ils disent qu’on ne prend pas, les eaux de Marienbad avec si peu de façons. Lord Palmerston m’a écrit de Broadlands qu’il revenait demain. Lady Palmerston avec lui, pour quatre ou cinq jours. Ils retourneront à Broadlands.
J’ai écrit décidément à Glasgow et à Edimbourg que je n’irais pas. Il n’y a pas moyen. Je ne puis courir le risque qu’une dépêche m’arrive 48 heures trop tard. On se préparait à me recevoir très bien à Glasgow, bruyamment peut-être. Raison de plus. La parole publique ne me serait pas commode en ce moment. Pour bien parler, il faudrait dire trop. Lundi 14, sept heures et demie Rien que Lord Clarendon et moi à Holland-house. Nous avons l’air de gens qui essayent de se consoler entre eux. Lord Holland plus vif que jamais et Lady Holland encore plus. J’y dine encore aujourd’hui. Ils ne partent pour Brighton que demain.
Rien de nouveau de Windsor, sinon que lord Melbourne dit à tout propos D... et Dev... ce qui fait beaucoup rire la Reine qui n’avait jamais entendu jurer avant lui. Il lui apprendra à jurer et à ne pas se soucier. Drôle d’éducation royale ! Du reste il (lord Melbourne) en souffrant, assez souffrant. Il dit qu’il ne peut ni manger ni dormir. Il rêve à la Syrie. Il y a de quoi. Après Napier, les quatre consuls. On est ici, surtout parmi les Diplomates continentaux, fort troublé de cette pièce qui amène les armées Européennes en Asie et promet la guerre universelle, la guerre à ontrance. Les uns la blâment, les autres la désavouent, les plus hardis, la nient. Neumann est presque de ceux-ci. Il n’a pas attendu que je lui en parlasse pour protester contre avec colère. Quand j’ai parlé des incidents et des subalternes, j’ai eu trop raison. La politique n’a pas tenu grand place hier soir dans notre quatuor. Lord Holland, était tout littéraire et Lady Holland toute mélancolique. Lord Holland m’a montré de ses vers, une longue pièce de vers ; devinez sur quoi sur le dictionnaire de Bayle :
In health or in sickness, as freedom or in jail
Give me one book, but let that book be Bayle.
Je ne suis pas sûr que ma mémoire soit parfaitement correcte ; mais voilà le trait. Bayle ne s’est jamais douté qu’il ferait une telle passion. Pour lady Holland, elle déplorait sa solitude, les longues heures de solitude de ses journées. Elle ne lit tant que parce qu’elle est tant seule ! Nous nous sommes récriés. Personne n’est moins seul qu’elle. Elle a persisté ; elle a parlé de l’isolement de la vieillesse de tous les amis qu’elle avait perdus : " Quand je me sens trop seule, quand la tristesse me gagne, je viens dans cette bibliothèque ; j’y rappelle tous ceux que j’y ai vus ; je remets Romilly sur cette chaise, Mackintosh ici, Horner là, tous mes amis, de bien aimables amis. " Elle était vraiment émue, et presque éloquente, with very few words. Je vous répète que c’est la femme de ce pays-ci qui a le plus d’esprit. Elle m’a répété les déclarations les plus tendres, et demandé de vos nouvelles. Lord Clarendon ne voulait pas croire que vous eussiez été malade. Elle a soutenu que vous l’aviez été, bien réellement.
3 heures
Voilà enfin une vraie lettre. Ne croyez pas que je me plaigne des autres. Votre exactitude, en courant la poste m’a été au cœur. A quelle heure, la plus matinale, peut-on venir chez vous vous remettre une lettre? J’ai en vue, un messager de plus, très bon, très prompt, mais disponible seulement avant 10 heures ou après 4. Peut-il aller avant 10 ? Quant à nos intermédiaires ici, réglez leurs jours, deux jours par semaine pour chacun, pour que je ne sois pas obligé d’envoyer chaque jour partout. Envoyez-moi votre règlement ; tels jours pour le n°1, tels pour le n° 2 && Je sais l’ordre des N°. A demain la conversation. Je retourne aujourd’hui dîner à Holland house. Ils ne partent que demain pour Brighton. Lord Palmerston m’écrit qu’il ne viendra à Londres que demain. Adieu. Adieu. Mille et un.
411 ter. Stafford house [Londres] 15 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis arrivée hier à 8 h. Comme vous le verrez par le billet ci joint. J’ai passé. à votre porte. Vous n’étiez pas arrivé et pas attendu. Je suis rentrée triste à Stafford house. On ne m’y attendait pas. J’ai fait chercher un médecin en toute hâte car je suis très souffrante. On me drogue et on m’a tenue au lit jusque dans ce moment.
Voici votre lettre de jeudi qui vous annonce décidément aujourd’hui. Que Dieu vous entende et m’entende et que vous arrivez vraiment. J’ai bien besoin de vous recevoir ! Je n’ose pas bouger de tout le jour. Avec quelle impatience j’attendrai 8 heures ! Venez venez. Il me manque une lettre de vous qui est allée me chercher à Wrest. Car je me suis décidée très subitement hier à revenir, pour vous voir hier encore. Et je ne vous ai pas vu ?
Adieu. Adieu. Ce soir n’est-ce pas, ce soir ? Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Relation François-Dorothée, Santé (Dorothée)
411. Wrest Park, Jeudi 13 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai quitté Londres hier sans lettre je n’ai eu de vous qu’un mot de Calais, et un mot d’Eu de Samedi matin. Depuis rien du tout. Cela m’inquiète et m’afflige. Je suis venue ici malade. On me drogue ici ; je suis vraiment, souffrante. Des vertiges abominables. Je m’ennuie parfaitement : c’est bien long d’y rester encore aujourd’hui et demain !
Si j’avais une lettre je partirais peut être demain. Dans tous les cas je serai à Stafford house.
Samedi 3 heures. Je vous préviens que j’ai accepté dîner à Holland house dimanche. Lady Palmerston est ici ; elle va à Windsor demain, son mari y est et y reste jusqu’à Mercredi. J’ai eu à me plaindre de la cour et de mes amis ministériels ces derniers jours. J’ai eu une lettre de Mad. de Flahaut. Une lettre de mon frère. La première ne n’envoie pas de copie. L’autre ne me répond pas encore. Il n’avait par reçu Adieu, adieu. Je suis très mécontente de n’avoir pas eu de lettres. Adieu.
412. Londres, Mardi 15 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures et demie
Demay est parti avant-hier et doit être à Paris aujourd’hui selon sa promesse. Vous me direz si vous êtes contente de Valentin et de votre nouvelle, femme de chambre. Elle n’est pas jolie. Eugénie, vous a-t-elle quittée ! Que devient Chartolle ? Je suis bien questionneur ce matin. J’ai besoin de tout savoir. Encore une question. Avez-vous vu Chermside ? Je suis charmé que votre nièce soit charmante. A-t-elle assez d’esprit pour se plaire un peu avec vous ? Je suis très disposé à la trouver bien, sauf toujours la loucherie. J’y suis impitoyable. Je ne le suis que pour cela, quoiqu’on en dise.
Encore un assez agréable petit dîné hier à Holland house. Clarendon et Luttrel. Pas mal de conversation. Lord Holland et moi. Il est vraiment très aimable. Presque bouffon. Il s’est mis hier à contrefaire les hommes célèbres de son temps Sheridan, Graltan, Curran. Ce gros corps goutteux qui ne peut pas se remuer, cette grosse figure, ces gros sourcils de geolier, tout cela devenait souple, gai avec un air de moquerie fine et bienveillante. Lady Holland est plus souffrante. Pas de Brighton aujourd’hui et probablement pas du tout. Je vous raconte tout mon Holland house. C’est mon Angleterre en ce moment. Savez-vous, comment Lady Holland appelle les quatre consuls d’Alerandrie ? Les Proconsuls.
J’ai reçu une longue lettre de lord Grey. Il me prie de faire obtenir à Lady Durham, qui va passer l’hiver à Pau avec ses enfants, l’autorisation d’introduire, en France sa vaisselle. Vous savez que ce n’est pas facile. Il faut pourtant que j’y réussisse. Dites à Thiers, la première fois que vous le verrez, d’en dire un mot au Ministre des finances, de lui dire qu’il le faut.
Politiquement, voici tout Lord Gey. I rend in the papers, my only sources of information, with great anxiety and concern, the continued account ot the dangers, which threaten, the good understanding between this country and France. I cannot bring myself to believe that a rupture can ultimately take place between live countries which have mutually so strong an interest in preserving the relations of peace and amity. But I can not also be without great fears that à state of things may be produced in which some accident or mischance may decide a question which some wisdom and moderation would settle amicably. I feel confident that your feelings are not different from those which I have expressed, and if any thing could induce me again to talk part in public affairs, it would be the hope of being able to assist, in preventing dangers which are much greater than the value of all Syria, past, présent and to come.
Je ne sais pourquoi je vous copie tout cela, qui me prend mon papier et qu’il vous a peut-être écrit aussi. C’est pour la dernière phrase. Et surtout pour vous parler de tout.
3 heures
J’attends bien impatiemment que vous ne soyez plus si fatiguée, si faible. Il me semble que la vie que vous menez doit finir par vous reposer. Je n’en imagine pas de plus tranquille. Continuez à vous coucher de bonne heure. Le bavardage menteur et hostile de Mad. de Flahaut ne métonne pas du tout. Il me devient bien des bavardages. J’écoute tout et ne me préoccupe pas de grand chose. Je me sens très fort, fort comme l’Angleterre avec sa ceinture d’océan comme sera Paris quand son enceinte continue sera faite. Je crois fermement, après y avoir bien regardé, que, depuis mon arrivée à Londres, j’ai bien jugé et bien agi. Rien ne me manque en fait de preuves. Je me tiens et me tiendrai fort tranquille si jamais j’étais attaqué, ouvertement ou sourdement, je me défendrais bien. Et très sérieusement, car ces affaires-ci sont sérieuses. Adieu. Extrêmement comme vous dîtes. J’aime cet adieu-là.
412. Stafford house [Londres Mardi 18 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
le 18 août 1840
J’ai vu Alava, bavardage, rien. Je suis sortie et j’ai commencé pas une boutique de diamant où j’ai rencontré le Duc de Wellington. Il a eu l’air tout étonné de ma vue, et après son ho, ha, il me dit :
" Et bien que dites-vous de tout ceci, qu’est-ce qui va arriver ? " J’ai ri.
- J’ai beaucoup à dire mais ce n’est pas ici qu’on entame au pareil sujet.
- Oh, eh bien moi, je dis qu’on a eu de très mauvaises manières, mauvaises manières. bien mauvaise affaire D... sait où tout cela peut mener.
- Pour le fond je suis contente, mais la forme.
- Et bien justement c’est que la forme a tué le fond. Est-il possible de s’y prendre si mal ? Croyez-vous qu’on puisse arranger ?
- Arrangez mêlez-vous en.
- Moi, Je ne suis plus à rien, venez me voir à Walmer j’y vais ce soir, venez passer quelques jours chez moi."
Et puis nous avions fini le second tour d’un petit couloir qui menait de la boutique à la rue. Nous nous somme séparés. Son ton et son geste était encore plus triste que sa parole. Car il s’est pris par la tête de désespoir. Après ceci une marche à pied et puis...
Mercredi 19 à 10 heures.
Et puis mon dîner, et puis une promenade en calèche. A 9 heures Lady Clauricarde chez moi jusqu’à onze, une nuit passable et me voici. L’interruption hier est venue par deux ou trois petites affaires fort insignifiantes des diamants, des femmes de chambre et encore le médecin.
Lady Clauricarde est curieuse, je n’ai rien à lui dire. Elle est inquiète, je ne me mêle pas de la tranquilliser. Une bonne heure s’est passée à ce petit manège. Enfin elle dit : "J’espère qu’on fera quelque chose pour arranger.
- Il faut beaucoup faire.
- Mais enfin il faudrait des deux côtés.
- Je ne pense pas que ce soit l’offensé qui commence.
- C’est bien embarrassant ! Vous avez l’air tous inquiets.
- Oui et Lord Palmerston plus que tout le monde.
- Ah, ah vous trouviez si drôle et si bête quand je vous disais il y a un mois que je l’étais."
Voilà à peu près. Et puis elle m’a dit que dans les Clubs on parlait toujours beaucoup de moi comme très français et Je lui ai répondu que j’étais fatiguée de tout cela, et que je me moquais de ces clubs et de tous les badauds. Une triste journée aujourd’hui et le ciel triste, du brouillard, une petite pluie fine. Ce sera long, 26 heures encore ! A propos sachez que je vous attendrai demain jusqu’à 3 heures. Si vous venez alors je reste. Mais si à 3 h. vous n’y êtes pas je sortirai pour deux heures et vous me trouverez après cinq heures. Tout cela sont des précautions. Nous n’en aurons pas besoin j’espère. Et je vous verrai à midi et demi. Comme j’y pense !
Malgré la bonne occasion je ne sais pas parler du sujet sur lequel je suis si bavarde. C’est que ce sujet est devenu, si immense, ni intime ; il a pris un tel caractère de sainteté, et de passion, qu’il ne peut plus aller à des lettres. Voilà pourquoi il ne faut plus de lettres n’est-ce pas ? Adieu. Adieu. Adieu bien sérieusement, adieu autrement aussi. Adieu de toutes les manières Adieu.
413. Londres, Mercredi 16 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
Je ne me suis pas conché à 9 heures, mais je me réveille de grand matin. Mes vendredi et mardi conviennent, je crois beaucoup aux diplomates. Ils y étaient tous hier sauf ce pauvre comte de Björnstjerna qui attendait encore hier matin le bateau de Hambourg et sa femme. Elle est enfin arrivée hier soir. Il me l’a fait dire par un petit comte de Mörner, joli jeune homme qui barbouille comme je n’ai jamais entendu personne barbouiller. Ils ont beaucoup joué, au Whist, et moi un peu. J’admirais, en remontant dans ma chambre, avec quelles choses et quelles paroles on peut remplir trois heures. Ils sont comme les vôtres, ils croient à la paix ; les uns d’une façon qui me plaît, les autres d’une façon qui me déplaît. Il y en avait là deux qui faisaient pitié à voir, pour leurs propres affaires, Alava et Moncorvo ; ne sachant pas s’ils étaient les ministres de quelqu’un ne recevant rien, ni nouvelles, ni argent, pas de nouvelles depuis bien des jours, pas d’argent depuis bien des mois. Ils jouaient tout de même au Whist. Lord Palmerston est revenu hier matin. Je l’ai vu à 5 heures et demie au moment où ils venaient d’échanger les ratifications. Les tables étaient encore là, les grands papiers, les bâtons de cire. Neumann, Schleinitz et Brünnow sont sortis devant moi de son Cabinet. Brünnow est très changé, et il a l’air consterné d’être si changé. Il a eu un quasi-choléra. J’ai passé une demi-heure avec Lord Palmerston très doux, ne voulant de querelle sur rien. Il m’a abandonné les consuls tout-à-fait Napier à moitié. Aux autres, il promet toujours un succès certain, prempt, pas le moindre vrai danger. Avec moi il n’argumente plus, il ne prédit plus. Nous avons l’air d’attendre tous deux que Dieu donne raison à l’un des deux. Il reste ici, pour quinze jours au moins. Lady Palmerston est revenue avec lui. Vous a-t-elle écrit ?
2 heures
Je n’ai rien encore ce matin. J’ai encore une chance. Je l’attends. Attendre, et attendre une chance, que cela me déplaît ! Quel ennui de ne pouvoir tout faire tout rondement ? Je suis aujourd’hui comme on était autour de vous samedi dernier, noir et inquiet. Je crains des malheurs et des fautes, les pires des malheurs, car elles en sont et elles en font. Je pense beaucoup dans ma solitude. J’entrevois dans la situation la plus périlleuse, une bonne conduite possible, très bonne, mais si difficile, si difficile ! Et puis, je ne sais pas bien l’état, l’état réel des esprits en France, ce qui est bien quelque chose dans la question. Mon instinct est que le bon parti ne veut pas la guerre. Et qu’il aurait la force de l’empêcher s’il en avait l’esprit et le courage. Je suis très perplexe. Mal double pour moi, car la perplexité, fort pénible en elle-même, est de plus contre ma nature. Je ne reste jamais longtemps perplexe. Je viens de répondre à lord Grey. 3 heures et demie Là voilà. Rien ne manque plus à ma journée de ce quelle peut avoir. Je suis moins noir qu’à 2 heures Je crois moins à la guerre, si elle venait, vous seriez malade, très malade. On est toujours à temps de se mieux porter si cela devient absolument nécessaire. Il faut commencer par être malade. Mais j’espère qu’il ne faudra pas. A présent que je vous ai vue comme je vous vois à présent, je vous quitte. J’envoie un courrier ce soir. Je vais à mes dépêches. Il fait froid aussi à Londres. J’ai du feu. En aurais-je à Paris ? Mad. de Tencin disait que la diversité de goût sur le froid, et le chaud avait brouillé plus de ménages que toute autre passion. Croyez-vous ? En tout cas, ne vous refroidissez pas. Adieu, adieu. J’ai une sottise sur le bout des lèvres. Adieu