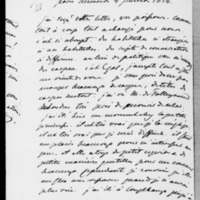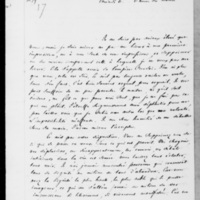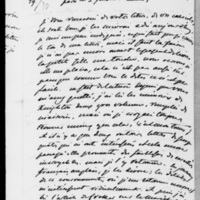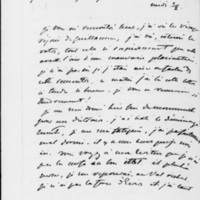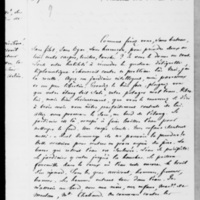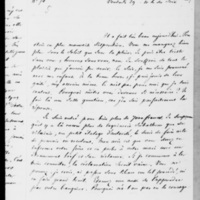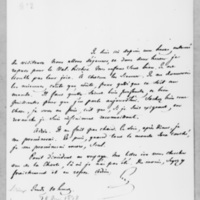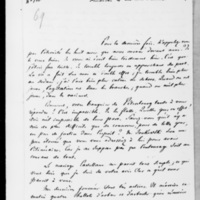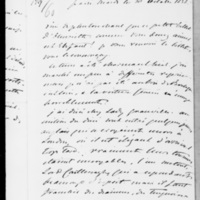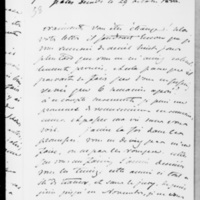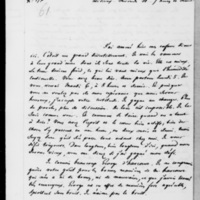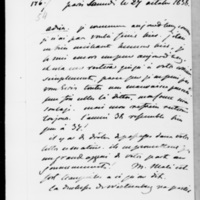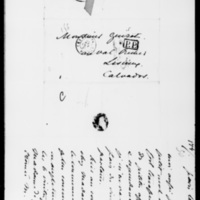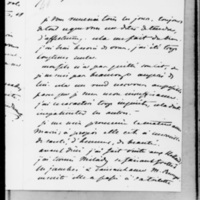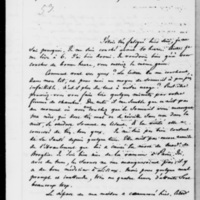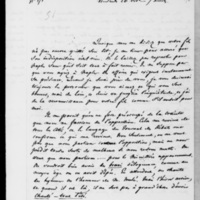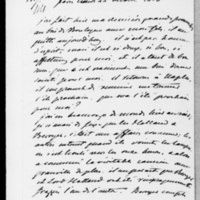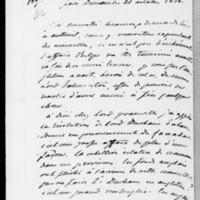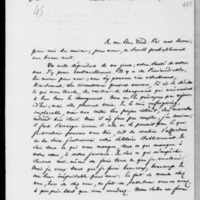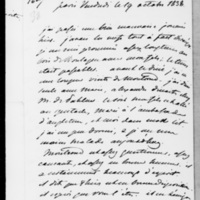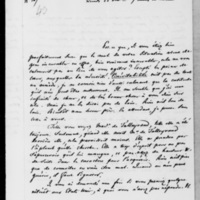Votre recherche dans le corpus : 5493 résultats dans 5493 notices du site.
81. Val-Richer, Dimanche 8 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les mouchoirs blancs et rouges sont tout prêts, rangés dans mon tiroir. Je viens d’en prendre un. Le pauvre roi d’Hanovre me paraît bien accusé. On peut encore exercer le pouvoir absolu là où il existe, encore en s’y prenant bien. Mais le rétablir cela ne se peut plus, surtout en en mettant enseigne. Le principe irrite plus que le fait. Les peuples sont comme les femmes, comme les hommes ; ils aiment mieux être maltraités qu’insultes. Votre Empereur a raison ; le Roi d’Hanovre gâte le métier. Si j’étais M. Molé et que j’eusse envie d’avoir le Maréchal Soult pour ministre de la guerre, son fracas à Londres me déplairait fort. Il reviendra de la plein de prétentions, & probablement ne voulant plus accepter d’autre Présidence que la sienne propre. On me mande qu’il n’y a encore rien de sérieux dans tous les bruits de remaniement de Ministère. Ce qu’on remanie, c’est l’administration d’Alger. On va changer, je crois, l’Intendant civil. M. Bresson payera son discours. Le maréchal Vallée écrit que les affaires militaires sont à peu près arrangées, qu’il lui faut à présent, pour second un administrateur actif et un peu considérable, sans quoi il ne saura que faire de tout l’argent qu’on lui vote. On a fait des propositions à un homme de mes amis. Je l’ai engagé à accepter.
Le dîner de la Reine d’Angleterre aux Ambassadeurs Constitutionnels est une affiche en bien grosses lettres. C’est comme toute la politique extérieure anglaise, un grand tapissage sur la rue. Je ne trouve pas que nos journaux en fassent le bruit convenable. Me voilà au bout de ma politique et de la vôtre. La saison est bien morte. Nous glanons. Si nous étions ensemble, nous moissonnerions toujours. La Fontaine a raison. L’absence est le plus grand des maux. Pourtant je me reproche de dire cela. Nous ne connaissons pas le plus grand des maux. Cela fait trembler. J’oublie les nouvelles de St Ouen. On bâtit le Presbytère.
9 heures
Vous dîtes que je ne vous connais pas tout-à-fait. Tant mieux ; car plus je vous ai connue, plus j’y ai gagné, et vous n’y avez pas perdu. Vous êtes pourtant d’une nature, simple, pas un peu simple, comme votre grand duc, mais très simple. La simplicité riche, c’est la perfection. Votre âme est riche, inépuisable. Je la connais mieux que je ne vous le dirai jamais. Je ne vous dis pas tout de vous surtout. Et de loin, que dit-on?
J’ai repris mer leçons avec mes filles. Je remplace leur maître d’arithmétique! Elles sont bien heureuses. C’est quelque chose de singulier qu’une vie si animée et qui laisse si peu de traces. J’ai probablement été dans mon enfance, aussi heureux, aussi animé que le sont mes filles. Je ne m’en souviens pas du tout. Vous souvenez-vous de votre enfance ? Je suis né vers seize ans. C’est de là que date ma vie, dans ma mémoire à moi. Je vous parlais de mes filles. Un de leurs bonheurs, c’est que je en leur lis le soir. Nous achevons un très joli, roman de Walter Scott, peu vanté : Richard en Palestine. Mais je ne veux pas ne leur lire que des romans même de ceux-là. C’est une lecture trop amusante, un plaisir de paresseux, un aliment qui dégoûte des autres, et ne nourrit pas, les jours derniers, j’ai pris Plutarque, la vie de Thémistocle. C’est charmant ; mais c’est un travail de lire cela à des enfants. Il faut à chaque instant sauter, retrancher, retourner, expliquer. Les faits, les livres, les esprits, le langage tout cela est bien grossier. Il n’y a pas moyen de mettre cela sous les yeux des enfants. Je ne suis pas prude ; mais avec mes filles. je deviens de la susceptibilité la plus ombrageuse. Je ne voudrais pas laisser approcher de leur pensée de leur petite figure, si fraîche et si pure un mot, une ombre, un souffle moins frais et moins pur. Pour les âmes, le mal, c’est la peste contagieuse à faire trembler, contagieuse par un mot, un regard ! J’ai fait en lisant la vie de Thémistocle, des tours de force et d’adresse admirables pour écarter le mal que je rencontrais à chaque pas. Je l’ai écarté hier ; mais demain, mais un jour, il les approchera nécessairement. N’importe, que ce soit tard, le plus tard qu’il se pourra. La longue innocence se répand, sur toute la vie.
10 h. 1/2.
Il paraît que nous parlons l’un et l’autre bien obscurément sur mes carpes. Je ne croyais pas du tout que vous les attendissiez en personne, pas plus que je n’avais pensé à vous les envoyer. Je ne voulais que justifier mon récit de leurs aventures. Mais laissons-le là. C’est plus qu’elles ne méritent. Gardez votre style, anglais ou non. Je ne vous pardonnerais pas d’en changer. Adieu. Adieu. G.
81. Paris, Mercredi 4 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu votre lettre, vos poissons. Comme tout à coup tout a changé pour nous. C’est si abrupt. Des habitudes si étrangères à nos habitudes. Des sujets de conversation se différents. Au lieu de politique vous m’envoyez des carpes. C’est égal, j'accepte tout ce qui me vient de vous. Je vous prie de ne pas manger beaucoup de carpes, de têtes de carpes surtout. J’ai vu M. de Talleyrand à Londres, très près de mourir de cela.
J'ai été hier un moment chez la petite Princesse. Il est très vrai que je la néglige il est très vrai que je suis difficile. Il faut me plaire beaucoup pour m’intéresser un peu, et elle a trop de petit esprit & de petites manières gentilles pour me convenir beaucoup. Cependant, je conviens qu’elle me fera une ressource, quand je n’aurai plus rien. J'ai été à Longchamp jusqu'à cinq heures, & puis un moment à Auteuil. C’était une matinée de réception & il n'y avait à peu près personne. Lady Canterbery qui lorsqu’elle m’a vu venir de loin a vite quitté son siège pour se promener seule dans le jardin. Ici on la comble de politesse & une Anglaise comme moi ne la salue pas, la pauvre femme a erré longtemps et puis elle est partie sans vouloir s'approcher de la maîtresse de la maison.
Je suis rentrée pour mon dîner ; je me suis fait traîner après, & j’ai fini par Lady Granville encore. Ah, pour celle-là, elle me plait.
Les conférences pour la Belgique vont commencer à Londres. Ce ne sera ni une petite, ni une courte besogne. Je ne sais ce que fera Pozzo. Il voulait quitter le 15 pour venir passer 3 mois à Paris ! Si Matonchewitz n’avait pas été déserteur on l'enverrait à la conférence. Je ne sais si l’Empereur voudra se donner cet air de faiblesse.
La petite insurrection à Stockolm qui a misé de si près la visite de l'Empereur me parait un fait curieux. Cette visite n’aurait donc flatté que le Roi. Je ne sais rien de vos affaires ici, et il n’est pas vraisemblable que j'en apprenne rien. Je ne fais attention qu'à ce qui me vient de sources directes et celles-là ne sont pas à ma disposition. M. Molé m'a promis une visite, mais je ne fais pas le moindre cas de ses promesses.
La Reine est dit-on inquiète de la taille énorme de sa fille. Elle accouche dans quinze jours.
Je n’ai pas de lettres de mon mari. J’ai écrit aujourd’hui à mon frère.
Il fait chaud. Et le temps passe bien lentement. Il me semble même qu'il s’arrête. Ah mon Dieu qu'il y a loin jusqu’à de bons moments ! Adieu. Adieu. Est-ce que je ne vous parais pas d’un peu mauvaise humeur ? Je crains que mes lettres ne soient maussades. Je suis si transparente. Et mon chagrin prend quelques fois de si vilaines formes. Vous êtes bien mieux élevé que moi. Adieu adieu.
80. Val-Richer, Vendredi 6 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que vous m’avez manqué aujourd’hui. J’avais commencé ma journée avec vous. On nous a séparés quand nous causions intimément. Je vous ai cherchée tout le jour. Mes regards, mes paroles tout mon être allaient à vous à chaque instant. Nous sommes si bien ensemble. La petite Princesse a raison. Nine fifonne Dorfattais ! Mais quand le Ciel accorde nin fégönnb Banfoittngh, il devrait l’accorder complet, permanent. La perfection est si rare ! C’est un supplice de la rencontrer pour l’entrevoir seulement.
J’étais bien difficile ; vous m’avez rendu plus difficile encore. Je me suis surpris deux ou trois fois près d’avoir de l’humeur, non pas contre vous, mais contre tout ce qui n’est pas vous. J’ai essayé de tout pour me distraire, la promenade, le travail. Rien ne m’a réussi. Tout à l’heure, c’est pour me distraire que je suis rentré dans mon Cabinet que je vous écris. J’avais tant à vous dire ce matin ! Rien ne me revient. Ce papier me déplait. Qu’y puis-je mettre ! C’est encore une manière de me faire sortir ce qui me manque. Je suis en trop mauvaise disposition. Je vous quitte. Si vous étiez là !
Samedi 9 heures
Je me suis levé tard. J’avais mal dormi. Je me suis rendormi ce matin. J’attends que vous me disiez que vos nuits sont meilleures. Fait-il assez beau, assez chaud pour que vous vous promeniez quelques minutes le soir, dans votre jardin, presque en robe de chambre, au moment de vous mettre dans votre lit ? Et votre dîner et votre lunchéon comment se passent-ils ? Êtes-vous toujours contente de votre cuisinier ? Vous donne-t-il souvent du ragoût ? Tout cela me manque. Dites-moi tout cela. Envoyez-moi vos pommes de terre et vos cotelettes. Elles valent bien mes carpes. Soyez tranquille. Je ne me donnerai pas les indigestions de M. de Talleyrand. Voilà votre n° 83, le nouveau facteur est charmant. Mais sa diligence fait qu’il est pressé de repartir. Vous n’aurez donc qu’une courte lettre. J’en suis fâché. Le N°83 me va au cœur, sauf un mot pourtant qui y va ausi, mais tristement, tristement. Je ne sais si vous devinerez lequel. J’aimerais mieux que vous ne le devinassiez pas. Vous l’auriez écrit plus légèrement. Moi aussi, j’ai mes bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Adieu. Adieu. G.
80. Paris, Lundi 2 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma matinée s’est passée hier à Longchamp. Le soir j'ai été faire une visite à Boulogne, et avant 10 heures j’étais à ma toilette pour me mettre dans mon lit. Je ne sais rien , je n'ai rien à vous conter, et je n’ai pas encore votre lettre. Je reviens sur des vieilleries. M. Molé m’a dit qu'à vous la rétractation de M. de Talleyrand n'a pas fait le moindre effet, d’ailleurs on n’a pas trouvé que les termes de cette pièce fussent assez humbles ni assez forte.
On calcule que le jour du couronnement le prix des places payées s’est élevé à 200 m £ c'est-à-dire cinq millions de francs. Cinq cent mille âmes de plus dans la ville, & au moins un million de spectateurs. Je ne puis par digérer encore les applaudissements au Maréchal à l'abbaye. Sébastiani en fait un rapport pompeux qui veut dire qu'il a eu raison de s'opposer à la nomination de Flahaut. Imaginez Marguerite et sa fureur lorsqu’elle a entendu les bravos ! Quand au Maréchal il en reviendra plus glorieux que s'il avait gagné la bataille de Toulouse.
Est-il donc vrai que ce soir il y a huit jours nous étions encore ensemble ? Que vous me donniez le bras sur le trottoir. Ah mon Dieu. Il me paraît qu’il y a quatre mois ; & que vous devez revenir ce soir, si vous voulez tenir votre promesse. " que le jour me dure " & & Je sais très bien cette chanson. Voici votre lettre. Cela me parait si peu de chose. Comprenez-vous bien que ce n’est pas une grossièreté que je vous dis là. Dans quelque temps je trouverai peut être que c’est beaucoup. Aujourd’hui encore cela m'est impossible.
J’ai écrit un peu à tout le monde en Angleterre. J'ai bien plus de temps ici. Je n’attends personne à midi 1/2 Je n’attends personne jamais. Adieu, Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Angleterre)
79. Val-Richer, Vendredi 6 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne suis pas mieux élevé que vous ; mais je sais mieux ne pas me livrer à ma première impression, ou à une seule de mes impressions, et supprimer ou du moins imprimer celle à laquelle je ne veux pas me livrer. Cela s’appelle avoir de l’empire sur soi. J’en ai plus que vous, cela est sûr. Ce n’est pas toujours raison ou vertu, tant s’en faut. C’est bien souvent orgueil, pur orgueil. Je ne puis souffrir de ne pas paraître le maître, ni qu’il soit évident, ne fût-ce que pour moi seul, que je ne fais pas ce qui me plaît. J’étouffe soigneusement mon déplaisir pour ne pas laisser voir que je subis une autre loi que ma volonté. L’impossible m’offense. Je me sens humilié de me débattre sous sa main. J’aime mieux l’accepter. Ce n’est pas votre disposition. Vous ne supprimez rien de ce qui se passe en vous. Tout ce qui est paraît. Vos chagrins, vos déplaisirs, ces désappointements, ces ennuis, ces débats intérieurs dont la vie est semée, vous laisser tout éclater, tout voir. Je n’ai jamais rencontré personne qui conservât tant de dignité au milieu de tant d’abandon. Car vous avez la dignité la plus haute, la plus noble qui se puisse imaginer, et qui ne s’altère jamais au milieu de vos impressions si librement, si vivement manifestés. C’est un des traits les plus originaux de votre caractère, et l’un de ceux qui pour moi, de très bonne heure dans notre relation vous ont le plus mise à part de toutes les femmes. L’abandon, leur est naturel mais il les fait un peu descendre. Vous avez plus d’abandon, plus de transparence, comme vous dîtes, que personne vous restez toujours à votre hauteur. Vous me demandez si je ne vous trouve pas un peu d’humeur. Oui, Madame, quelquefois. J’ai été quelquefois tenté de m’en choquer. Excepté de ma mère, je n’ai jamais supporté l’humeur de personne. Quand la vôtre m’a apparu, je vous aimais déjà beaucoup, beaucoup. L’affection a contenu la surprise. Et puis, j’ai bientôt reconnu la source de votre humeur. Elle ne vient en vous d’aucun défaut, d’aucun désagrément de caractère, ni de susceptibilité, ni de brusquerie, ni d’exigence ni d’attachement aux petites choses. Vous êtes naturellement très douce, très égale, charmante à vivre. Votre humeur ne naît jamais que du chagrin d’un grand, d’un profond chagrin. Il vous indigne, il vous révolte, il s’empare de vous tout entière. Et alors ce qui ne répond pas pleinement à votre chagrin, ce qui n’est pas en harmonie, en parfaite harmonie avec l’état de votre âme, vous donne de l’humeur. L’humeur est pour vous l’une des formes de la douleur. Je vous aime trop, Madame, pour que cette forme là ne s’efface pas devant la profonde sympathie que votre douleur m’inspire. Vous avez cruellement souffert. Mais laissez-moi vous le dire ; je suis plus fait à la douleur que vous, à la douleur morale, comme à la douleur physique. Vos épreuves vous sont venues tard, au milieu d’une vie qui avait été constamment facile, agréable, brillante. Vous n’aviez connu ni le malheur, ni la difficulté, ni la contrariété. Vous n’aviez porté aucun fardeau. Vos émotions même malgré le sérieux de votre naturel, avaient été assez superficielles, et bien loin d’ébranler toute votre âme. Un seul sentiment, le dernier venu, était en vous très puissant et profond. Quand vous avez été frappé, vous avez éprouvé cette immense surprise, cette révolte intérieure qui accompagne, les premiers chagrins, les chagrins de la jeunesse ; et comme vous n’aviez plus, pour y échapper les ressources de la jeunesse, sa mobilité, sa facilité à se distraire, son empressement à jouir de la vie encore inconnue, vous êtes restée sous l’empire de cette impression de surprise et de révolte. La douleur vous a atteinte tard, et trouvée jeune pour souffrir. Et vous avez souffert avec l’impatience avec l’âpreté de la jeunesse. J’ai éprouvé, j’éprouve encore, en vous voyant souffrir, le sentiment d’un vieux soldat couvert de blessures, qui voit les fatigues, les langueurs, les souffrances d’un jeune homme qu’il aime et qu’il soigne...
10 heures
Je m’étais levé de bonne heure pour vous écrire bien à l’aise. J’ai été interrompu par mes enfants, par ma mère, par Mad. de Meulan, par je ne sais quel incidents insignifiants dans la maison. Voilà le facteur, et il faut qu’il reparte. J’en suis très contrarié. J’ai besoin de causer avec vous. J’ai une infinité de choses à vous dire. A demain. Ou plutôt à ce soir. Je me suis couché hier de bonne heure. Je tombais de sommeil, je ne sais pourquoi. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Discours du for intérieur, Portrait (Dorothée)
79. Paris, Lundi 2 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre lettre, de vos conseils, ils sont bons, je les suivrai & dès aujourd’hui. Je suis un peu indignée, ce qui fait que je crains le ton de ma lettre, mais il faut la faire Je n’ai pas encore ouvert le paquet de livres. La petite fille me touche, nous verrons si elle me plaira cela n’est pas aussi sûr parce que comme vous le dites ce n’est pas facile. En fait de lecture depuis que vous m'avez quittée, j'ai lu les Mémoires de Knighton deux gros volumes, remplis de niaiseries, mais où je croyais toujours trouver mieux que cela ; (c’est mon temps) et il n'y a que deux ou trois lettres de George quatre qui m’ont intéressée et cela encore parce qu'elles prouvent des faiblesses de caractère incroyables, mais je l'y retrouve. Les journaux français anglais. je les dévore, les détails de ce couronnement, où je me retrouve encore m’intéressent ridiculement, et puis j’ai lu l’article de Croker sur le Maréchal Soult Il a eu en effet singulier; celui de faire applaudir Le maréchal non seulement dans les rues, mais dans l'abbaye, oui dans l'abbaye, c’est trop, car là il n'y a pas de mots, rien que les hautes classes. Vous jugez comme il en est enflé. Les lettres que j’ai reçues, celles que j'ai lues sont remplies de détails intéressants. La Reine a été vraiment étonnante. Mon fils aussi me mande qu’il n'a rien vu de plus gracieux, de plus digne ; de plus charmant que toute sa tenue, tous ses mouvements, toutes ses inspirations pendant les cinq heures entières qu’elle est restée en scène dans l’église.
La Reine n’est pas contente du duc de Nemours. Il est entré dans sa loge à l'opéra pour lui faire visite. Elle a trouvé cela très familier, et elle a raison. Nous nous sommes communiquées nos lettre & nouvelles hier matin Lady Granville & moi. Nous étions un peu émues l’une & l’autre. Le froid Lord Granville l’était bien aussi. On dit que Melbourne a pleuré comme un enfant à l'église. Le Duc de Wellington aussi. On cite ceux-là, il y aura eu bien d’autres larmes. La reine en a versé un peu pendant le sermon. Elle a été abîmée de fatigue.
J'ai reçu hier au soir. Tout ce qui reste ici est venu. Lord Granville revenait de Neuilly. Il me dit qu'on y est inquiet de l'Egypte. L’affaire devient grave. Je vous ai quitté pour écrire à mon mari, cette lettre m’a été odieuse à écrire. Je l’ai adressée à la reine de H. pour qu’elle la lui remette. J'écrirai à mon frère par un courrier. Me voilà fatiguée, & les nerfs un peu agacés. Je vous quitte. Il me semble que je sais aussi peu vous écrire que vous parler. Je ne puis pas traiter le sujet de notre séparation. Elle m’est insoutenable. J'en ai de l'humeur autant que du chagrin. Il me faut du temps, du temps pour m’accoutumer à cette horreur. Est-ce qu’on s'habitue à cela. Adieu. Le temps est tourd, et je suis si triste !
Mots-clés : histoire, Politique (Angleterre), Vie familiale (Dorothée)
78. Val-Richer, Mercredi 4 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
En effet la colère de Marguerite doit avoir été grande. Il n’y aurait certainement pas eu de bravos pour son mari. Je n’ai nul goût pour le Maréchal, mais je suis bien aise, pour l’Angleterre et pour la France qu’il ait été ainsi accueilli. Je trouve cela un vrai procédé de gentleman ; procédé d’autant meilleur que celui de Croker était plus grossier et subalterne. Les fanfaronnades du Maréchal méritaient la leçon de Croker ; mais, en pareil cas, il y a aussi peu d’honneur à se charger de la leçon qu’à la méditer. La vraie supériorité se montre bien mieux à dédaigner la rivalité et à rendre justice même libérale, à la renommée de son rival. Je voudrais être sûr qu’à pareille épreuve, mon pays se conduirait aussi noblement. Je n’oserais y compter.
Le Duc de Broglie va passer à Paris la journée du lundi 9 ; pour le jugement de la Chambre des Pairs. Il n’a pas voulu prendre part à la question de compétence ; mais la compétence admise, il prendra part au jugement. Il ne veut pas donner à M. Molé un prétexte de dire que lui aussi, il s’est retiré d’un procès. Il a raison. Je lui envie bien cette journée là. C’est du bon bien perdu. Il reviendra à Broglie, le 10, et j’irai le 11 pour y passer 24 heures. Rien ne sera dérangé dans notre correspondance.
Est-ce que Lord et Lady Granville partent décidément le 12 ? J’espère toujours quelque dérangement dans ce voyage. Je comprends qu’on soit préoccupé à Neuilly de l’Affaire d’Egypte. Mais je persiste à penser que même si elle éclate elle avortera ; c’est-à-dire que tout le monde s’entendra pour l’étouffer. Nous protégerons tous à qui mieux mieux la Porte contre cet usurpateur. Et si par hasard l’Angleterre soutenait le Pacha, ce que je ne crois pas du tout cela n’aurait d’autre effet que de resserrer encore notre intimité avec l’Autriche. Nous formerions avec elle un tiers parti qui tiendrait la balance, qui le voudrait du moins et qui y réussirait quelque temps. Il n’y a aujourd’hui que des velléités d’événements qui ne servent qu’à la conversation.
Aujourd’hui, à 3 heures, nous avons eu un assez gros orage. Il marchait rapidement sur la route de Paris. J’ai eu bien envie de le charger d’une commission, qui n’eût pas été un coup de tonnerre. Vous avez, me dîtes-vous, de notre séparation, autant d’humeur que de chagrin. Est-ce qu’on a de l’humeur sans en avoir contre quelqu’un ? Si cela se peut, j’accepte votre humeur comme votre chagrin, car moi aussi je suis horriblement égoïste. Mais si cela ne se pouvait pas contre qui votre humeur ?
10 heures 1/2
Ce ne sont pas mes carpes que je vous envoie, c’est moi-même c’est-à-dire, mon temps et ce qui d’y place comme Mad. de Sévigné envoyait ses soins à sa fille. Je suppose que vous êtes bien aise de tout savoir, petit ou grand. Si j’ai tort, dites. le moi. Adieu Mon facteur est arrivé aujourd’hui une demi-heure plus tard. Je l’ai grondé. Il a paru étonné de la vivacité de mon impatience. Adieu. Adieu.
78. Paris, Dimanche 1er juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici un mois qui ne nous a pas appartenu l’année dernière. Sera-t-il à nous davantage cette année-ci ? J’ai pour lui de mauvais pressentiments.
Je viens de recevoir votre lettre que nous sommes loin ! Comment ce n’est qu’une réponse à ma lettre de jeudi ? Je voudrais un peu plus de civilisation à la France, et ce n’est pas à vous seul que je parle mal d’elle. Hier j'ai blessé M. Molé qui demandait à Lady Granville une cuvette pour y placer des roses coupées très court. Elle n'a jamais pu comprendre ce que c’était qu’une cuvette et elle apportait l'une après l’autre tous les grands bassins de la maison. Enfin j’ai expliqué à chacun d'eux que les Anglais se lavaient les mains jusqu’au poignet, & les français le bout des doigts. M. Molé s’est récrié, et puis il a fini par convenir que les grands bols étaient de toute fraîche date. C’était M. de Decazes qui avait apporté toutes les roses du Luxembourg. Ces deux messieurs Monsieur Maréchal et Tcham, voilà tout le dîner. En sortant de table, M. Molé a pris place sur le petit tabouret et nous avons causé seuls pendant une heure, de tout. Il ne veut pas attacher une grande valeur aux rentes de M. H Vernet. Il dit qu'il y a quelque petits amélioration, mais rien de marquant. Le voyage de Stockolm lui paraît de la folie. Je lui trouve l’air préoccupé, pas de très bonne humeur. Il ne quittera pas Paris : les conférences pour la Belgique le retienne. Il est venu des lettres de Londres. Le couronnement a été superbe, touchant. Il me semble que vos journaux aussi en parlent bien. Je pense beaucoup à Londres. Mais je pense encore plus au Val-Richer. Et puis je pense à moi, si seule, si triste. Je vous remercie d’être triste aussi et de me le dire, cela ne me fait pas de mal. Cela me fait du bien, j’aime votre chagrin. Quel horrible égoïsme !
Je ne vous parlerai plus de mes nuits jusqu'à ce que j'ai à vous les annoncer bonnes. J’ai été à Longchamp, & à Auteuil hier matin. J’avais de l’air tant que je peux, cela m endort de rien. Il faut que ma lettre soit à la poste de bonne heure. Adieu, les choses sont bien mal arrangées dans ce monde, je pousse un gros soupir, il ne me soulage pas. Je sais bien ce qui me soulagerait. Adieu. Adieu.
77. Val-Richer, Mercredi 4 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes-vous jamais levée comme je viens de le faire avant 6 heures ? C’est charmant. Le Ciel est pur comme le regard d’un enfant ; le soleil éclatant comme s’il brillait pour la première fois ; l’air frais sans le moindre vent qui l’agite ; le chant des oiseaux le bourdonnement des insectes, mille bruits, mille mouvements sur les près, dans les bois, sous les feuilles, remplissent, animent l’espace ; et pourtant tout est calme ; toute la nature, s’éveille confiante et gaie. L’homme n’y a pas encore répandu son agitation, et sa fatigue. Vous jouiriez vivement de ce spectacle de jeunesse universelle que la bonté de Dieu renouvelle tous les jours. Moi aussi, j’en jouirais bien autrement que je n’en jouis. Car à chaque impression douce qui m’arrive à chaque mouvement de plaisir qui s’élève en moi, je me tourne vers vous, je vous cherche. Je suis à coup sûr en ce moment dans toute cette étendue que j’ai là devant moi, la seule créature qui désire et cherche, en vain.
N’est-ce pas dans le procès de l’archevêque Land, contre qui on voulait additionner je ne sais combien de petits délits pour en faire un grand crime, qu’il a été dit pour la première fois qu’avec cinquante lapins blancs on ne pouvait faire un cheval blanc ? Je l’apprendrais si j’en avais douté. J’ai bien des choses, & des des choses agréables, à mettre dans ma journée. Mon pays est joli ; mes enfants sont gais. Je me promène et je travaille. Je cause et j’écris. J’ai des ouvriers et des livres. Pas une heure n’est vide. Et elles le sont toutes. Et de tous ces plaisirs, je ne puis pas faire un moment de vrai bonheur. Et il n’y en a pas un qui ne suscite en moi un regret mille fois plus vif que le plaisir ne peut l’être. En vérité, je suis tenté quelques fois de me croire aussi jeune que ce jour qui vient de se lever.
Que mettrez-vous à la place de ce couronnement terminé ? Car il vous a amusée. J’aime en vous cette vivacité cette longue durée de vos souvenirs heureux ou malheureux, doux ou cruels. Vous aussi, vous êtes jeune. Rien n’est usé pour vous ni joie, ni douleur; et tout votre passé vous est cher comme si vous le possédiez encore. Madame, il en coûte beaucoup d’être ainsi fait, de ne pas se mettre en harmonie avec le cours commun des choses de ne pas oublier ce qui s’en va d’avoir le cœur plus constant que n’est le monde, de rester le même quand tout change. Mais quoiqu’il en coûte ne regrettez pas la beauté et le charme de votre nature. C’est ce qui reste éternellement. C’est ce qui détermine notre rang devant Dieu. Et moi, j’ai le droit de demander que vous ne le regrettiez pas.
Je suis charmé que vous ayez trouvé mon conseil bon pour votre lettre à votre mari. J’était très convaincu. Mais de loin, on peut dire si peu de chose ! J’attends impatiemment ce qu’il vous écrira sur l’époque de son arrivée. Je ne sais pourquoi mon impatience, car il n’y aura là rien de bon, sinon le caractère définitif de votre établissement. J’écris ce matin à Broglie pour savoir quel jour j’irai. Il est possible que le Duc de Broglie retourne à Paris pour le jugement de la Chambre des Pairs. Je ne veux pas aller chez lui pendant son absence. Mad. de Staël en part ces jours-ci pour retourner en Suisse.
10 h.
Oui, il y a eu hier huit jours, nous étions encore ensemble. Adieu. G.
77. Paris, Samedi 30 juin 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé ma matinée hier à Longchamps. Avant de m’y rendre j’ai été voir Bagatelle. La plus charmante maison, le plus joli jardin de l'Angleterre ! C’est beaucoup ce que je dis là, et ce n’est pas trop. Il est convenu que vous ne vous offensez pas de mes propos dans ce genre ; mais il n’y a rien qui approche de cela en France. Venez voir Bagatelle transformé par un Anglais. Nous n’avons parlé qu'Angleterre le matin, Angleterre le soir, car je suis retournée à l’Ambassade après dîné. à 9 h 1/2 je suis rentrée pour me coucher. La nuit n’a pas été meilleure c’est pitoyable. Cependant rien ne me manque ici. J’y suis très bien.
Les lettres d'Angleterre sont remplies de petites bêtises. Je n'en ai point reçues. Je vous redis les lettres des autres. Ainsi Madame de Strogonoff avait reçu dans la seule journée de Dimanche mille & 74 visites ou cartes de visite, tous des gens qui veulent être invités à son bal. Des querelles d’étiquette interminables. La procession arrangée ad libitum et sans en donner avis aux diplomates. Pozzo dans tous les embarras, les tracas de toute petites choses. Il ne va pas à cela du tout. Il me semble que je manque beaucoup. Vous ne sauriez croire comme je dépasse vite des embarras de cette espèce, & la grande réputation que j'avais pour cela, on venait toujours me soumettre ces choses et j’éclaircissais tout tout de suite. Au reste aujourd’hui, je mourrais du train et de la fatigue de Londres. On dit que jamais on ne vit pareille chose ; et que c’est en même temps un spectacle fort singulier que l’aspect de tout le monde fou sans savoir pourquoi ?
Pardon de ma demi feuille, je ne m’en étais pas aperçu en commençant. Lord Granville a lu les rapports du ministre anglais à Stockolm. L’empereur a été aimable pour tout le monde, mais cédant toujours le pas à son fils, attendu que lui même n’y était qu'incognito. Le Roi de Suède comblé, flatté. Les Suédois aussi.
Que faites-vous ? Je ne vous demande pas à quoi pensez-vous. J’aurai bien de la peine à m’accoutumer à ma vie présente. J’ai un profond dégoût pour toute chose, et pour tout le monde. Je n’ai pas encore été voir la petite princesse, je n’ai pas reçu une créature vivante. Il n'y a que les Anglais que j’aime à voir. Je suis bien triste, bien triste. C'est si long ! Adieu demain matin j’attendrai un adieu de vous. Cet échange est plus joli de près. Voilà mon expression favorite comme vous dites. God bless you.
Mots-clés : Absence, Réseau social et politique
76. Val-Richer, Lundi 2 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis très touché des détails de ce couronnement. J’aime la piété. J’aime l’antiquité. J’aime l’enthousiasme et l’affection populaire. Je voudrais savoir ce qu’il y a de vrai et de solide dans toutes ces démonstrations. Non que je ne sache que la légèreté et l’inconstance sont de tous les temps, et n’excluent point la sincérité. Mais au moins faut-il qu’au moment où ils éclatent, les sentiments soient sérieux et sincères, que ce peuple assiste avec foi à ces cérémonies religieuses, avec respect à ces anciens usages, qu’il aime vraiment sa Reine en criant. Dieu sauve la Reine ! Qu’en pensez-vous ? Je ne demande pas mieux que d’y croire. J’y crois même. Je trouve que tout cela a l’air vrai. Dites-moi que j’en puis être sûr. Vous me ferez un grand plaisir. C’est un terrible problème que de savoir si la foi, le respect et l’amour se peuvent concilier avec une discussion continuelle, & une liberté immense. C’est le problème de notre temps. Si la solution est bonne, ce sera un honneur infini pour l’humanité. Je l’espère toujours.
Comment donc le Maréchal Soult a-t-il fait pour être le second dans le cortège? Ou bien le Journal des Débats a-t-il effrontément menti ? Je l’en soupçonne un peu, quoique ce fût bien fort. Et ces acclamations, du peuple anglais pour le Maréchal, et pour lui seul, sont-elles vraies aussi ? Est-il vrai du moins que tous les journaux anglais le disent ? Levez tous mes doutes, je vous prie. Vous m’avez donné la passion de l’exactitude. Il faut satisfaire, les passions qu’on donne. Sachez bien seulement que je ne mets de prix à toutes mes questions que parce que je vous les adresse et parce que les réponses me viendront de vous. A cause de cela, vous seriez peut-être tentée de croire que je n’écris qu’à vous. Détrompez-vous. J’ai écrit ce matin à vingt-quatre personnes ; oui, 24. J’ai apporté ici tout mon paquet de lettres non répondues. Il y en a 39 de gens qui m’ont envoyé leurs ouvrages. Il faut bien répondre et répondre avec quelque intelligence, avec un certain air d’avoir lu. J’ai fait 24 fois ce mensonge là aujourd’hui.
Mardi 3 6 h. 1/2.
Je sors de mon lit. Il y avait autrefois, dans cette maison neuf moines qui n’en sortaient pas avant 10 heures. Il y a 600 ans, il y en avait je ne sais combien qui en sortaient à 4 heures du matin. Ceux-là priaient, labouraient, défrichaient, étudiaient. Ils étaient le type de la vie austère et laborieuse. Et le peuple le croyait; et il avait raison de le croire. Naguère, il y a cinquante ans, leurs successeurs étaient le type de la vie oisive, paresseuse licencieuse. Et le peuple le croyait aussi, et il avait raison, quoiqu’il le crût plus que cela n’était. Ainsi va le monde. Mais ce prodigieux contraste des choses, sous les mêmes noms, dans les mêmes lieux, et frappe l’imagination quand elle s’y arrête. Je viens de me promener un quart d’heure. Je regardais cette vallée qui est-ce qu’elle était il y a 600 ans couverte des mêmes bois, éclairée du même soleil, arrosée des mêmes eaux ; puis cette maison, la même aussi au fond, quoique plusieurs fois reconstruite. Les hommes seuls ont changé. Les moines licencieux ont succédé aux moines austères, et moi je succède aux moines licencieux. D’où vient notre plaisir à contempler ce cours des choses humaines, les vies si diverses et toutes si rapides, que le temps remporte toutes également, comme le courant de ma source emporte les feuilles de toute sorte qui y tombent. Homère a pensé et dit tout cela il y a 2700 ans, c’est lui qui compare les générations des hommes aux générations des feuilles. Et moi, je prends le même plaisir à le penser et à le dire comme lui. Mais je vous le redis. C’est là mon vrai plaisir, et celui-là Homère ne l’a pas eu.
10 h.
Voilà, la réponse à mes questions anglaises. J’y comptais presque. Nous pensons, ensemble même à 46 lieues. Que c’est loin pourtant ! Et ces lettres qui vous arrivent ou que vous écrivez sans que je les voie! Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : histoire, Politique (Angleterre), Politique (France)
76. Paris, Vendredi 29 juin 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous ne sauriez concevoir la triste journée que j’ai passée hier. Pour la première fois depuis que j'habite Paris je n’ai pas vu une âme, personne absolument personne. J’étais si lasse et si triste que j’ai fermé ma porte il est venu quelques habitués. Ce soir on les a renvoyés. Je me suis couchée à 10 h. Je n’étais pas sortie du tout. La pluie a été incessante. J’ai dormi jusqu'à 3 heures, alors les oiseaux m'ont réveillée. Ils m’ont parfaitement impatientée. Ils ne chantaient pas en cadence, il n'y avait pas moyen de battre la mesure c’était insupportable. Voilà donc ma nuit finie. Cependant, je suis bien ici, l’air est meilleur que dans la rue Rivoli, les chambres plus hautes, enfin je serai bien je crois, si je n’accoutume à la musique désordonnée des oiseaux.
A 9 heures j'ai eu votre lettre de Lisieux. A thousand thanks ! J’attendrai dimanche et dites-moi bien ce que je dois dire à mon mari. Ma lettre écrite ce jour là le trouvera à Hanovre. C’est étonnant comme un changement d'habitation éloigne les impressions de la veille. Il me semble que je ne suis plus à Paris, je ne sais plus ce qui s'y passe, je ne me rappelle personne. La Normandie à la bonne heure, je m'en suis rapprochée. Comment ai-je pu être accoutumée à vous voir. tous les jours. Deux fois le jour ? Vous ai-je montré assez de joie de cette douce habitude, ne m’est-il pas arrivé quelques fois de ne pas assez l'apprécier. Aujourd’hui si je pouvais me dire à midi 1/2 que je serai heureuse.
Adieu, je ne vous mande par de nouvelles. Je n'en ai point, je ne sais rien. Demain je dîne avec M. Molé chez Lady Granville. Aujourd'hui j’irai chez elle à Longchamps, si la pluie ne vient pas déranger cela. Adieu. Adieu, que de fois nous allons écrire cette triste et charmante Parole !
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
75. Val-Richer, Samedi 30 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis au loin de mon feu. Il a plus presque tout le jour. Je regrette que vous n’aimiez pas le feu. Je vous établirais près du mien, et nous passerions là une soirée charmante. Mais je ne veux pas faire violence, à votre goût, même en pensée.
Savez-vous que Charles 1er n’a point dit en mourant cette belle parole qu’on lui a attribuée. Dites à la Reine que je ne lui ai jamais été infidèle, même en pensée ? Pas plus que l’abbé Edguworth n’a dit à Louis 16, sur l’échafaud : " Fils de St Louis, montez au Ciel." Pas plus que Charles 10, en rentrant à Paris, en 1814, n’a dit : " Messieurs, rien n’est changé ; il n’y a qu’un Français de plus." C’est un journaliste qui le jour même de la mort de Louis 16 dînant avec quelques uns de ses amis, & tout ému de cet effroyable spectacle dit : " En vérité, au moment où il a été frappé, j’ai cru entendre son confesseur s’écrier : " Fils de St Louis, montez au ciel "." Et dès le lendemain en effet, dans je ne sais quelle feuille, ces mots furent mis sur le compte de l’abbé Edguvorth qui plus tard s’en défendait modestement disant qu’il n’avait pas été assez heureux pour les trouver. Quand au mot de Charles 10 en 1814, il est du comte Beugnot qui le lui prêta pour plaire un moment à la vieille Garde impériale. Rien n’est si commun que ces renoms usurpés de belles en spirituelles paroles. En revanche que de mots charmants sont restés inconnus ! J’en ai entendu je ne sais combien qui méritaient de faire le tour du monde et la réputation d’un homme. Et je ne parle que de ceux que j’ai vraiment entendus qui ont été réellement prononcés tout haut. Combien d’autres n’ont été que pensé, sont nés et morts d’ans l’esprit de leur auteur, charmants pour Dieu seul ! Ne croyez-vous, pas qu’on a bien plus d’esprit qu’on n’en montre? Je m’amuserai quelque jour à écrire les Mémoires d’une âme, et je n’y mettrai que ce que cette âme-là, n’a jamais dit. Encore n’y mettrai-je pas tout. Je défie qu’on dise jamais même tout bas, tout ce qu’on a senti ou pensé, qu’on se décide jamais à voir au dehors, ne fût-ce que de ses propres yeux tout ce qui s’est passé au dedans.
Si nous étions toujours ensemble, vous dirais-je vraiment tout ? Tout, c’est beaucoup dire ; à peu près tout. Et si nous passions ensemble je ne sais combien de cent ans, tout peut-être un jour. Il n’y a point d’intimité à laquelle le temps n’ajoute immensément chaque jour. Et l’intimité la plus parfaite n’arrive jamais au terme des choses qui peuvent, qui doivent entrer un jour dans son domaine. Quel dommage ! Il nous faut absolument l’éternité.
Dimanche, 8 heures
Vous me demandez de la force. J’en ai eu beaucoup dans ma vie, jamais avec le sentiment que j’en avais assez. Bien souvent au contraire, je me suis senti sur le point d’en manquer. Je ne puis vous donner que beaucoup, beaucoup d’affection. Faites en de la force, si vous pouvez. Je le voudrais bien. Près de vous, je l’espère. Mais de loin ! Il y en a pourtant à prendre à cette source, même de loin.
J’ irai peut-être à Broglie, vers la fin de la semaine, pour 24 heures seulement, et je m’arrangerai pour que notre correspondance n’en soit pas dérangée. Mon nouveau facteur est jusqu’ici admirablement exact. Il arrive entre 9 et 10 heures. Mes journaux m’ont manqué hier. Dites-moi ce qu’on vous aura dit du procès de la Chambre des Pairs.
10 h.
Merci de vos commérages anglais. De vous, tout m’amuse, même ce qui ne fait que passer par vous. Ne me dîtes pas comment vous étiez, comment vous réussissiez à Londres. Je le sais, je vous y vois moi qui n’ai jamais vu Londres. Je suis sûr que tout était joli. Adieu. Je suis charmé que Bagatelle vous ait plu. Votre n°77 me plaît. Vous y êtes moins abattue. Adieu.
Mots-clés : Discours du for intérieur, histoire, Relation François-Dorothée
75. Champs-Elysées, Jeudi 28 juin 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous ai rencontré hier, j’ai vu le visage réjoui de Guillaume. J’ai vu, entrevu le vôtre, tout cela si rapidement que cela avait l'air d'une mauvaise plaisanterie. Je n'ai pas su si j’étais aise ou fâchée de cette rencontre ; ce matin j'ai lu cette lettre si tendre, si bonne ; je vous en remercie, si tendrement ! Je me suis donnée hier bien du mouvement pour me distraire. J'ai hâté le déménagement. Je me suis fatiguée, j’ai parfaitement mal dormi. Il y a une heure que je suis ici. Vous voyez à mon écriture que je n'ai pas les nerfs en bon état. Il pleut à verse, je me reposerai au Val-Richer. Je n'ai pas la force d'écrire, et j’ai tant tant à vous dire !
Lady Granville est à Versailles. Je ne verrai pas une âme aujourd’hui. Je me caserai. Je crois que je serai bien ici. Je viens de recevoir une lettre de Pétersbourg de mon banquier. Il me dit que mon mari a sanctionné les payements faits & ordonnés pour l’avenir 4000 fr. par mois qui m'a mis à 48 au lieu de 55, qu'il me donnait jusqu’ici. C'est une décision pitoyable. Que me conseillez vous ? Faut-il réclamer auprès de lui ou de mon frère ? Doucement ou fortement ou pas du tout ? Vous voyez que je ne suis rien sans vous.
Ah que le temps va être lourd, insoutenable, j'en suis accablée d’avance. J’ai envie de pleurer vingt fois le jour. Je suis si abandonnée. Il me semble qu'il y a un an que je ne vous ai vu. Où trouver du courage ? Adieu Je vais relire votre lettre, mais la relire, c'est pleurer. Donnez-moi de la force. Adieu. Adieu, que le ciel veille sur vous. Je suis si accablée qu'il faut que vous veniez chercher un adieu, je ne saurais me lever pour vous le donner et j’en ai besoin, bien besoin. Adieu.
75_1. Val-Richer, Dimanche 1er juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Comment feriez-vous, sans bateau, sans filet, sans ligne, sans hameçon, pour prendre deux ou trois cents carpes, truites, tanches ? Je vous le donne en tout. Toute votre habileté à résoudre les questions d’étiquette diplomatique échouerait contre ce problème là. Moi, j’ai la recette. Ayez un jardinier intelligent, mais paresseux et un peu libertin. Grondez le bien fort ; plaignez vous que votre étang soit sale, votre potager mal tenu. Dites lui, mais bien sérieusement que vous le renverrez si d’ici à trois mois, vous n’êtes parfaitement contente de lui. Allez-vous promener le soir, au bord de l’étang. Le jardinier est là, occupé à faire baisser l’eau pour nettoyer le fond. Une carpe saute. Mes enfants sautent aussi : " Quel dommage de ne pouvoir la prendre ! ". Belle occasion pour rentrer en grâce auprès du père. La barre qui retient l’eau est soulevée. L’eau se précipite. Le jardinier y entre jusqu’à la hanche. Le poisson fourmille dans le creux où l’eau reste encore. Le bruit s’en répand. Tous les gens arrivent hommes, femmes, bonnes. Les hommes entrent tous dans l’eau. Je m’assois au bord avec ma mère, mes enfants, Mad. de Meulan, Melle Chabaud. On commence contre les poissons une vraie chasse à courre. On les poursuit ; on les saisit. Les gros se débattent ; les petits glissent entre les doigts; les plus avisés se tapissent dans la vase. Les chasseurs s’animent au jeu ; on se presse, on se pousse ; l’eau rejaillit sons les pieds, sous les mains. La joie de mes enfants, est au comble. Ils bondissent autour de l’étang. Ma mère rit de bon cœur. Je ris aussi. L’espoir revient au cœur du jardinier. Il redouble d’efforts d’adresse. Tous les gens le secondent ; et en moins d’une heure, les deux ou trois cents carpes, truites sont entassés dans des seaux, des arrosoirs et transportés dans un petit vivier où elles resteront jusqu’à ce que l’étang soit bien nettoyé, l’eau bien revenue ; et elles ne sauront jamais que cinq minutes de ma mauvaise humeur et un quart d’heure de gaieté de mes enfants, leur ont seules valu cette aventure. Vous me demandez ce que je fais au Val Richer. Le voilà. Cela vaut bien les mille et 14 visites de Mad. de Strogonoff. Le singulier peuple ! Si sérieux et si frivole ! Si indépendant et si esclave de la mode, d’un jour de mode ! Je ne l’en estime et ne l’en aime pas moins.
J’aime qu’on soit capable des impressions les plus variées, raisonnable trois cents jours au moins, fou les 60 autres. Pourtant 60 c’est trop, n’est-ce pas ? Les Anglais n’en donnent pas tant à la folie. Je soupçonne qu’il y a beaucoup d’ennui dans la leur. C’est la plus mauvaise des raisons de folie. Du reste, on dit que la folie anglaise est grave, symétrique, taciturne. Est-ce vrai ? En ce cas, elle ne ressemble guère à cette de mes enfants et de mes gens ce soir. On ne s’est jamais amusé plus bruyamment. Il est vrai qu’ils ne s’ennuyaient pas du tout auparavant et qu’ils ne s ennuieront pas du tout demain. La gaieté est leur état habituel.
Lundi 8 heures
Pourquoi n’avez-vous pas encore été voir la petite Princesse ? Il me semble qu’elle est sur son déclin. Ne la négligez pas tout-à-fait. C’est votre voisine. Elle vous est plus commode, et à tout prendre, plus agréable que bien d’autres. Ne me dites pas que vous avez le dégoût de toute chose et de tout le monde. C’est une parole corruptrice pour moi si douce à entendre que j’en oublie tout remords. Et pourtant, je veux que, lorsque vous n’avez plus que tout le monde, vous ne soyez pas trop seule, ni trop triste. Oui, je le veux, par vertu, par tendresse, et aussi, et surtout parce que j’ai la confiance que tout le monde ne peut rien me faire perdre, même quand il vous amuse. Pour la première fois depuis que je suis ici, le ciel est parfaitement pur. Le soleil brille. Toute la vallée s’épanouit. Toute sa population, hommes, bêtes, oiseaux, va, vient, vole, travaille, ou broute, ou chante, librement, gaiement. Moi, je regarde. Ma gaieté à moi n’est pas là, ne me vient pas de là. Il y a plus de joie pour moi dans le petit cabinet étouffé, sur la petite chaise basse de la rue de Rivoli qu’au milieu de tout cet éclat, de tout ce sourire de la nature.
10 heures
Voilà le n°78. Je trouve comme vous la poste très peu civilisée. On me fait espérer une amélioration. Le courrier ne partirait plus de Lisieux que vers le soir après le retour du facteur du Val-Richer en sorte que vous auriez toujours mes lettres le lendemain, mais je proteste contre les cuvettes. Je me suis toujours lavé les mains jusqu’au dessus du poignet. Adieu. Mais dormez donc. G.
74. Val-Richer, Vendredi 29 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il a fait très beau aujourd’hui. J’en étais en plus mauvaise disposition. Vous me manquez bien plus sous le soleil que sous la pluie. Je puis être triste sans vous ; heureux sans vous, non. Je souffrais de tout le plaisir que j’aurais pu avoir. Ce soir, je me suis promené avec mes enfants. A la bonne heure ; je puis jouir de leur gaieté, m’y associer même. Ce n’est pas pour moi que je suis content. Pourquoi m’êtes-vous devenue si nécessaire ? Je fais là une sotte question, car j’en sais parfaitement la réponse.
Je suis outré pour bien plus de 7000 francs. Je soupçonne qu’il y a là encore plus de taquinerie subalterne que de vilenie, un petit étalage d’autorité le désir de faire acte de pouvoir en reculant. Mon avis est que vous devez en informer votre frère et en parler à votre mari avec un étonnement bref et sans réclamer. Si je commence à les bien connaître la réclamation serait vaine. Vous ne pouvez, je crois ni passer sous silence un tel procédé, ni en faire grand bruit. Étonnez-vous aussi de l’apprendre par votre banquier. Pourquoi n’a-ton pas eu le courage de le dire soi-même de vous le dire à vous ? Je vous conseille là un langage du haut en bas, le seul qui vous convienne au fond, le seul aussi, j’en ai peur qui vous donne un peu de force. Il faut qu’on sache que vous ne vous générez pas de dire à vos amis la vilenie qu’on vous fait. Un peu de crainte, vous a sauvée. Usez de ce moyen avec les formes les plus douces du monde, mais usez en toujours un peu. Qu’ils aient tous peur du qu’en dira-t-on. Votre sauvegarde est là.
Samedi 8 h.
Vous n’aurez pas de lettre aujourd’hui. Cela me déplaît. Vous a t-on porté un paquet de livres ? Je ne sais si quelque chose là vous amusera. Vous êtes très difficile à amuser. Non que vous soyez blasée, ce qui n’a jamais ni mérite, ni charme, mais parce que vous êtes très difficile et très prompte à mettre de côté ce qui ne vous plait pas du premier coup. Vous ne savez ni attendre, ni chercher. L’imperfection, l’insuffisance, l’ennui vous choquent si vivement que vous détournez sur le champ la tête avec dédain, comme si vous ne pouviez rien avoir à démêler avec tout ce qui n’est pas supérieur et accompli. C’est votre mal, & votre attrait.
Il y a dans ce paquet de livres un roman nouveau intitulé Une destinée qu’on ma apporté la veille de mon départ. Je n’en ai pas lu une ligne et je ne vous réponds pas du tout qu’il vaille le moindre chose. Mais regardez-y cinq minutes. Il est d’une jeune fille à qui je veux du bien. Il y à cinq ans, quelques semaines après le 1 mars 1838 une lettre m’arriva d’une personne inconnue. C’était une longue pièce de vers écrite à mon sujet, sur le coup qui venait de me frapper par une jeune fille de 17 ans, fille d’un pauvre aubergiste dans un pauvre village du fond du Poitou, qui n’avait jamais eu d’autres leçons que celles du maître d’école et du curé de son village, ni lu d’autres livres que quelques volumes incomplets de poésie française et quelques numéros de Journal. Ses vers sans rien de saillant, n’étaient pas dénués de sensibilité et de mouvement. Un me frappe beaucoup. Elle disait, en décrivant celle que je venais de perdre : Ses regards pleins de douceur et d’empire. C’était à croire qu’elle l’avait vue, car ce mélange là, était précisément le caractère original de sa physionomie comme de sa nature. Je fus donc très touché. On l’est toujours d’ailleurs, d’apprendre que votre nom, votre sort ont vivement ému et occupé, à 150 lieues au fond d’un village, une personne inconnue et tant soit peu distinguée. Je répondis affectueusement à cette jeune fille. Je l’encourageai. Je lui envoyai de bon livres. Un an après, je reçus une autre lettre qui m’annonçait que son père avait vendu son auberge, et qu’elle allait venir à Paris, avec son père, et sa mère, dans une charrette traînée par un cheval que son père avait gardé pour ce voyage. J’essayai de l’en détourner. Il n’y eut pas moyen. Elle sentait son génie et voulait tenter sa destinée. Elle arriva. Je devrais dire elle m’arrive, car elle venait sur la foi de ma protection, et je ne pouvais me défendre d’accepter un peu la responsabilité de son sort. Je vis une jeune fille, point jolie de manières très simples, mais convenables, et assez élégantes de l’intelligence, dans le regard de la finesse dans le sourire, point embarrassée, et parfaitement décidée à chercher, par ses vers, la fortune et la gloire. Je lui donnai quelques avis et une petite pension. Depuis elle fait des vers ; elle en a fait d’assez agréables, et qui lui ont valu quelque succès auquel j’ai un peu aidé. Elle a acquis quelques amis de plus, amis-poètes, M. de Lamartine, Mad. Testu, quelques autres que je ne connais pas mais qui ont leur monde, où ils ont leur renommée. Elle vit très modestement, honnêtement, je crois. J’ai fait avoir une petite place à son père. Elle passera sa vie à faire des vers sans jamais monter bien haut ni percer bien loin, pauvre, agitée, jamais sûre de son succès ni de son pain ; mais elle aura obéi à son instinct et coulé selon sa pente. C’est le vrai secret de bien des vies. Je vois que les vers, ne lui suffisent pas, et qu’elle commence à faire des romans. Elle m’a apporté celui-là la veille de mon départ.
10 heures
Voilà votre N°76. Oui, c’est une triste et charmante parole. Adieu. Je vous ai dit ce qu’il me semblait de la réponse à votre mari. J’y pense encore. Il est possible, ce me semble, d’exprimer une surprise très hautaine au fond et très douce dans la forme, une surprise fière et résignée, qui les fasse, non pas rougir, ce qui ne se peut pas, mais s’inquiéter un peu du jugement de cinq ou six personnes, si cela se peut. Adieu encore. G.
73. Val-Richer, Jeudi 28 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis très perplexe. Si je suis ma pente, je serai si triste qui vous le deviendrez encore davantage. Votre tristesse m’est insupportable. Dites moi que vous voulez voir toute la mienne, que vous prendrez plaisir à savoir à quel point vous me manquez, quels efforts j’ai à faire pour comprendre comment il est possible. Que le jour recommence et que le jour finisse Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, Sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Je me rappelle que l’an dernier, dans une de mes courses, après vous avoir quittée en arrivant à Lisieux, je me suis laissé aller à vous montrer toute ma peine ce qui peut se montrer d’une vraie peine, à vous dire combien les lettres, les paroles tout était pour moi insignifiant, misérable, pour moi accoutumé à être près de vous, deux heures, trois heures tous les jours à suivre votre vie minute par minute. Vous m’avez demandé de n’en rien faire, de vous fortifier au lieu de vous affaiblir de vous aider à trouver quelque chose de bon dans les lettres, dans les paroles tendres venues de loin, dans tout ce qu’on appelle les remèdes contre l’absence. Dites-moi ce que vous aimez le mieux. Aujourd’hui dans ce moment ma disposition est de penser à vous plus qu’à moi, d’être plus occupé de votre chagrin que du mien. Je ne vous réponds pas qu’elle dure. Je suis sûr qu’elle ne durera pas. Profitez en pour m’apprendre mon devoir. Je le remplirai comme je pourrai.
Je suis arrivé ici par le temps le plus noir, la pluie la plus épaisse, les plus sales chemins qui se puissent imaginer. La vallée est verte, fraîche, couverte de fleurs, parée pour recevoir le soleil qui ne vient pas. Ainsi va le monde. Le soleil manque à la verdure, et la verdure au soleil. Aussi quel ravissement quand ils se rencontrent ensemble, quelque part, un moment ! En toutes choses, dans la nature, ou dans l’âme, nous ne faisons qu’entrevoir la perfection. Mais, quand on l’a entrevue comment peut-on laisser retomber plus bas sa pensée ? J’ai très peu dormi en voiture. Je prenais quelque plaisir à veiller pendant que tout le monde dormait autour de moi. Comme si j’en avais été un peu moins en voyage, resté un peu plus à Paris ! Que notre cœur est inventif et subtil à se crier des illusions si vaines, si fugitives que la pensée ne peut même les saisir et pourtant elles plaisent !
Mes enfants ont très bien dormi. Ils se réveillaient pour me demander du sucre de cerises. Ils dorment profondément depuis trois quarts d’heure, fatigués du voyage, de leur joie. Ils se réveilleront demain, en chantant, en sautillant comme les oiseaux de ma vallée. Je voudrais vous envoyer leur gaieté. Je voudrais vous envoyer, j’aurais voulu vous laisser un de mes enfants. Ah, que de vains désirs ! Adieu. Je vais me coucher. Je dormirai. Je suis fatigué. Vous vous couchez aussi en ce moment, dans votre nouvelle chambre. Je ne la connais pas. Il est vrai que je ne connais pas non plus l’ancienne. Adieu. Dormez, dormez donc. Adieu
Vendredi, 8 h. 1/4
Je sors de mon lit. J’ai beaucoup dormi, longtemps et profondément. Il fait beau. Le soleil brille. Ma vie sera ici très égale, très dénuée d’événements, de nouvelles. Mais je vous dirai tout, tout ce qui m’aura occupé un moment. Au moins faut-il tout savoir quand on ne voit rien. 9 h. 3/4/ Voilà, mon facteur. J’espère que celui-ci sera diligent. Je suis bien aise que vous soyez établie aux Champs-Elysées. J’ai bien raison de ne pas me laisser aller à vous parler de ma tristesse. Que la vôtre me pèse ! Hélas, il faut payer tous les bonheurs, et les payer cher. Je vous répondrai demain sur cette honteuse, honteuse réduction. Je me lève pour aller chercher mon adieu. Où n’irais-je pas le chercher ? Décidément, j’ai été bien aise de vous rencontrer. Et une demie-heure après, en partant par les Champs Elysées, j’ai vu votre calèche dans la cour de la petite Princesse. Vous savez que j’aime Félix. G.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
72. Lisieux, Jeudi 28 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis ici depuis une heure entouré de visiteurs. Nous allons déjeuner et dans deux heures je repars pour le Val-Richer. Mes enfants sont bien. Je ne trouble pas leur joie. A chacun les siennes. Je ne donnerais les miennes, coûte que coûte, pour quoique ce soit au monde. Il faut qu’elles soient bien profondes, et bien puissantes pour que j’en parle aujourd’hui. Sachez bien une chose, je vous en prie, c’est que si je suis exigent, en revanche je suis infiniment reconnaissant. Adieu. Il ne fait pas chaud. Ce soir après dîner, je me promènerai. Et puis, quand tout le monde sera couché, je me promènerai encore, seul. Point d’incident en voyage. Ma lettre ira vous chercher rue de la Charte, là où je n’ai pas été. Du moins, soyez y fraîchement et en repos.
Adieu. G.
Lisieux jeudi 10 heures.
Mots-clés : Autoportrait, Vie familiale (François)
183. Paris, Samedi 3 novembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous n'avez pas eu de lettre hier ? J'en suis désolée. J’ai bien questionné mon valet de chambre. Il dit que la lettre est partie, mais qu'il avait été trop tard pour l’affranchir. Vous en aurez eu deux ce matin. Mais je suis fâchée d’un petit mouvement de chagrin ; votre lettre était si joyeuse, si bonne jusqu'à ce dernier mot. Soyez sûr que moi aussi j'ai bien de la joie. Il vaut la peine de se réjouir quand on a huit mois devant soi, plus même n'est-ce pas ? Je voudrais me bien porter ou du moins en avoir l'air. Mais que faire !
J’ai fait visite hier à la Duchesse de Talleyrand. Cela ne m’amuse guère elle ne me parle que de ses affaires : il faut aimer beaucoup les gens pour s’intéresser à cela. Je crois que M. de Castellane a du charme. Lady Burghersh m'a fait une longue visite hier matin. Je vous prie de m’en demander des détails, car cela vous intéressera. Elle est full of valuable informations. Vous avez vos paquets à faire ; je ne vous les écris pas.
Le dîner des Granville était complètement anglais, ce qui me plaît. Mais quand le soir j’ai vu venir tous les natifs de Birmingham et de Manchester j’ai fui. J’ai été passer une demi-heure chez Mad. de Castellane et puis to my bed. Je ne rencontre jamais M. Molé chez elle, parce qu’il n’y vient que tard. Lady Granville a dîné avant-hier avec la Reine qui était en larmes en parlant de sa fille. Certainement elle est bien mal. Cette séparation à Fontainebleau sera bien triste !
La conférence ne marche pas. Je crois que les difficultés viennent principalement du côté de Léopold. Les troubles à Cologne lui semblent bons pour soutenir ses prétentions. Le Lenchtemberg a passé à Varsovie où il a été logé dans l’un des palais du Roi. Un aide de camps de l'Empereur l’attendait à la frontière. Cela ne peut se faire que pour un gendre quand on est aussi peu de chose que Lenchtemberg.
M. de Montalivet a causé l’autre jour avec Lord Granville qui l’a trouvé inquiet de la session. Adieu. L’avant dernier adieu. C’est charmant. Adieu.
Voilà les Débats, et voici ce que j’admire par dessus tout. " Et avec les points fixes.... Dieu s'est voilé." Et puis ce dernier paragraphe. " Regardez donc plus haut & &. " Tout cela est superbe. Je veux vous l’avoir dit tout de suite. Adieu.
Mots-clés : Politique (Internationale), Réseau social et politique
182. Paris, Vendredi 2 novembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres sont vraiment joyeuses ; et je crois tout de bon au 6, et je me réjouis comme vous. Mais vous savez j’espère que ma vue ne vous récréera pas. Vous me trouverez changée, maigrie, je vous préviens de tout cela. J'ai beau faire je ne puis pas me remettre. Point d'appétit, un mauvais sommeil. L'esprit constamment inquiet de mes relations avec mon mari. Cela va trop mal.
Après que le monde s’est écouté hier au soir j’ai gardé M. de Pahlen, et nous avons longtemps parlé de mon Empereur. Il n’est plus sous le charme de Toplitz, ce qui fait qu’on peut causer avec lui. L'histoire du mariage Lenchtemberg l’indigne. mais savez-vous qu’ici, outre qu'on en rit, on se fâche. On croit voir de l’intention dans le choix d'un allié des Bonaparte. quelle idée ! En Russie cela fera un vrai mécontentement parmi les gens bonnets. Les petites gens ne sauront pas qui c'est. & les courtisans applaudissent à tout. M. de Pahlen, et moi nous ne sommes pas des courtisans.
Il n’y a pas de nouvelle ; à moins que vous vous intéressiez à M. de Castellane qui dit-on épouse Pauline. Cela me parait pas grand chose. Le Duc de Noailles, est venu causer pendant deux heures chez moi hier matin. Il ne sort pas encore le soir.
J’ai été voir Madame de Boigne. Toute sa maison sent la peinture. Elle m’a reçue au second, bien haut. c’est propre mais très petit. Elle est assez souffrante. Les gens du château disent que la Princesse de Würtemberg n’arrivera pas jusqu’à Gènes. Je ne sais ce qu'il y a de vrai.
Je vais dîner aujourd’hui chez Lady Granville à peu près seule avec l’ambassade, cela me convient parfaitement. Adieu, adieu. Il me semble que je ne vous écrirai plus que deux fois n’est-ce pas ? Il y a une page bien triste et bien touchante dans votre lettre. Vous savez si je vous comprends !
Mots-clés : Réseau social et politique
181. Paris, Jeudi 1er novembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai eu mon monde habituel hier au soir. Humboldt est fort amusant pour moi, il nous déteste (la Russie) et il dit cela au quatrième mot. Or il m’a dit bien des mots ! Le Roi de Prusse serait blessé au vif du mariage Lenchtemberg. En général, le beau-père et le gendre sont parfaitement mal ensemble comme politique.
Je commence à m’inquiéter de ce que je n’ai pas de réponse de mon banquier à Pétersbourg. Le silence complet de mon frère est étrange aussi. Me prépare-t-on une nouvelle surprise ? Quelles gens !
Il pleut, il fait le temps le plus triste du monde, & je suis bien triste. Les troubles à Cologne sont quelque chose. Quelque chose de plus que ce qu’en disent les journaux. Je n'ai rien, rien du tout à vous mander. Je vous dis donc adieu de tout mon cœur.
180. Val-Richer, Dimanche 4 novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pour la dernière fois. N’appelez-vous pas l’éternité les huit mois que nous aurons devant nous ? Je le veux bien. Je vous ai écrit bien tristement hier. C’est que j'étais fort triste. Je tremble toujours en approchant du port. La vie a fait sur moi ce double effet ; je tremble bien plus au dedans ; j’ai l’air bien plus calme au dehors. Quand on est jeune l’agitation est dans les branches ; quand on n’est plus jeune, dans les racines.
Comment, votre banquier de Pétersbourg tarde à vous répondre ! C'est impossible. Je les flatte. Quelles gens en effet ! Rien n'est impossible de leur part. Savez-vous qu’il n’y a rien de plus difficile que de conserver, pour de telles gens un peu de justice dans l’esprit ? M. Soukowski sera un peu étonné que vous vous adressiez à lui pour avoir l'itinéraire. Car je ne suppose pas que l’entourage soit au courant de tout.
Le Mariage Castellane me parait tout simple ; ce qui veut dire que je suis de votre avis sur ce qu’il vous parait à vous.
Mes dernières journées sont très actives. Il m’arrive ce matin quatre ballots d’arbres et d'arbustes qu’on m’envoie du Jardin des Plantes, toutes sortes de choses belles et rares. Je marque les places où il faut planter tout cela. Mad. de Meulan restera quatre jours après moi pour faire faire les plantations. Il pleut horriblement la nuit ; le jour non ; on n’a d’eau que sous les pieds. Je vous quitte pour aller continuer mon travail commencé hier.
10 h. 1/4
Je rentre pour recevoir votre lettre. Je ne vous parle plus de rien. Je n’ai plus de chagrin de rien. Adieu, Adieu. Quel pauvre adieu ! G.
Mots-clés : Réseau social et politique, Vie domestique (François)
180. Paris, Mercredi 31 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
C'est aujourd'hui que je devais vous revoir. J’ai pensé à ce jour depuis le mois de juin ! Hier j’étais bien triste. Je suis restée seule depuis 4 1/2. J'aurais eu tant, tant à vous dire ! Le soir encore nous aurions recommencé. Enfin, il me faut prendre mon parti, comme de tant peines.
J’ai vu chez moi le soir la Duchesse de Talleyrand mon ambassadeur, & Lord Granville rien que cela. On va beaucoup à la Tragédie, & aux Italiens cette année. Tout le monde veut avoir vu Mademoiselle Rachel. Les opinions sont diverses. Mais je crois que vraiment ce n’est pas grand chose, et qu’elle est seulement meilleure, que tous les autres qui ne valent rien.
Ce que vous me dites aujourd’hui de notre situation politique est d'une grande vérité. Je voudrais bien faire voyager cela plus loin. C’est étrange que tandis que vous me parlez des progrès du protestantisme, moi j'en fais la même observation ; et c’est sur moi que je la fais. Et j'ai l'habitude de me prendre en beaucoup de choses comme exemple de la masse. Le juste milieu entre les gens d'esprit, & les gens qui n’en ont pas. Enfin la majorité.
J’ai eu ce matin une longue lettre de la Reine de Hanovre bonne & tendre comme toutes ses lettres. Mais rien de nouveau. Elle n’est pas aussi choquée que moi du mariage Lunchtemberg. On dit beaucoup en Russie que la petite fille de la grande Catherine épouse le petit fils de la maîtresse de Barras.
Je n'ai pas un mot de nouvelle à vous dire ! Je viens de faire une longue promenade aux Tuileries. Il fait froid ; mais un air pur, & du soleil tel quel. Adieu, je suis bien ennuyée de ces adieux là, nous en avons usé et abusé. J’attends le 6, ils vaudront mieux.
179. Val-Richer, Samedi 3 novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est un jour bien triste, un jour étrange qu'un jour sans lettre de vous. Surement vous êtes bien triste aussi, ou bien malade, peut-être l'un et l'autre. Je ne sais pourquoi en me levant, je me mets à vous écrire. Que vous dirai-je ? toutes mes paroles s’arrêtent dans ces ténèbres qui sont entre vous et moi. Dans quelques heures j’espère, il n’y aura plus de ténèbres au moins. Vous m'aurez écrit, ou fait écrire. Quel fardeau, quelle absurdité serait la vie que nous menons ici bas s’il n’y avait qu’ici bas ! Tant d’agitation dans un si court espace ! Des joies et des douleurs si vives pour un jour, pour rien. Cela ne se peut. Il y a de la vie au delà de cette vie-ci. Il y a, à cette vie-ci, un but plus grand qu'elle. Je comprends, j'accepte la souffrance comme préparation, comme épreuve, la souffrance à l'entrée dans un avenir ; mais la souffrance et quelle souffrance ! Sans valeur, sans résultat, étant à elle-même sa propre fin, le terme de tout ! Ma raison tout mon être se révolte. Cela n’est pas. Vous m'en avez été une preuve nouvelle, convaincante. J'ai besoin absolument besoin de l’éternité pour vous. Que de choses je voudrais vous dire, et je ne puis !
9 heures et demie
Il n’y a rien. Point d'accident ; point de mal de plus. Un simple retard. Grondez quelqu'un je vous prie. Votre lettre du jeudi 1er novembre n’est partie de Paris que le vendredi. Elle est timbrée du 2. Grondez, grondez. Certainement mes lettres sont joyeuses, et je pars lundi 5. Vous vous étonnez à ce qu’il me semble que mes lettres soient joyeuses. Ah, que vous avez peu de foi ! Comment avez-vous fait pour ne pas être une incrédule ? J’aurai du chagrin de vous trouver maigrie, autant que je pourrai avoir du chagrin. J’ai peine à y croire.
Adieu, Adieu. Oui vous ne m’écrirez plus qu'aujourd’hui et demain. Adieu. G.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
179. Paris, Mardi 30 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Rien de plus touchant que ce petit billet d’Henriette. Comme vous devez aimer cet enfant. Je vous renvoie le billet, vous le conserverez. Le temps a été charmant hier. J'ai marché un peu à différentes reprises mais je n’ai pas été au bois de Boulogne. C'est loin, & la voiture fermée m'ennuie horriblement.
J'ai dîné chez Lady Granville. Au milieu du dîner sont entrés quelques jeunes anglais qui se croyaient encore à Londres où il est élégant d'arriver trop tard. Vraiment leur tournure étaient incroyables, l’un surtout, Lord Castleragh qui a cependant beaucoup d'esprit mais il faut franchir des diamants, des turquoises des cheveux touchant sur ses épaules, des choses étonnantes, et un peu de folie dans ses propos. L’autre, Lord Jocelyn, je ne le connaissais pas du tout, mais comme je suis anglaise. Il s'est mis tout de suite à son aise avec moi et nous avons parlé bons principes, car toute cette jeunesse, est Tory.
Il parait qu'on ne se pressera pas à Londres de donner un successeur à Lord Durham. Je crois que Lord Glendy va quitter. Il sera sans doute remplacer par Lord Morpette ou M. Baring. On espère que le soutien si unanime que les états généraux accordent à leur roi disposera Léopold à modifier ses prétentions, car il comptait que les Hollandais se montreraient mécontents. Il serait donc possible encore que les chose s’arrangent. Les cinq puissances sont d’accord entre elles & n’attendent plus que les réponses de la Haye & de Bruxelles. Léopold va à Fontainebleau & delà il retournera chez lui. On ne pense pas cependant que la cession territoriale à la Hollande s'opère sans quelque petite tentative de combat.
Que vous êtes patient de relire mes lettres vous m’apprenez que je suis sagace, je ne savais plus du tout ce que je vous avais dit dans le temps sur Lord Durham. Pour moi c’est autre chose, je relis vos lettres comme plaisir, comme étude. Elles sont admirables. Vous serez vous fâchée de celle que je vous ai écrite hier. Je n'en sais rien, mais vous auriez tort, il faut absolument parler de ces choses-là, mais jamais les écrire, je ne devais pas le faire peut-être ; mais ce n’est pas moi qui ai fourni l'occasion Enfin c’est fini ou plutôt ce sera fini le 6.
Voici un beau soleil, il ne faut pas que je le manque. Je m’en vais marcher. 2 heures Je rentre très fatiguée, je ne me sens pas bien, j’ai dormi mal d'abord, et puis ensuite lourdement. Je suis ce qui disent les Anglais out of sorts. Je n'ai jamais su d'où venait cette expression. Je lis toujours Sully avec plaisir. Adieu. Adieu, pas de lettres, pas de nouvelles. Adieu.
178. Lisieux, Vendredi 2 novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous écris debout, auprès de ma fenêtre, avec trois personnes dans ma chambre, certains attendent en bas dans le salon. C'est mon dernier séjour ici : on se presse. Deux choses dominent en province, les intérêts privés et l’ennui. On me trouve bon pour l'un et l'autre mal. Je ne suis bon à présent qu’à une chose, à désirer mardi. L'impatience de vous revoir m'envahit. Ma solitude de deux mois et demi pèsera tout entière sur chaque moment jusqu'à ce que je vous aie retrouvée, vue, entendue, à côté de moi, devant moi, bien près de moi. Si les trois personnes qui sont là, et qui m’interrompent savaient quel sentiment me tient et ce que j'écris, elles seraient bien étonnées. Soyez, soyez impatiente. Soyez-le autant que moi. Il me le faut absolument. Je vous écrirai encore demain et après demain, mais lundi, non, ce sera moi qui partirai. Vous m’écrirez aussi Dimanche pour la dernière fois.
Il a fait cette nuit un temps épouvantable du vent, de la pluie, de la grêle avec fracas. Et au milieu de ce fracas, la sonnerie de toutes les cloches de la ville pour la fête de la Toussaint. Tout cela m'a éveillé, comme de raison. J’ai pensé à vous; je n'ai plus rien entendu. Il y avait une chanson où un pauvre jeune conscrit partant pour l’armée disait à sa maîtresse, Charlotte, je crois. Les cent voix de la renommée de ta voix n'ont pas la douceur. Je dis bien mieux, votre voix, votre seule pensée couvre toutes les voix de la renommée, des cloches, de l'orage. Adieu. Adieu.
Je retourne à mes ennuyés. Adieu. G.
Ma mère était bien hier. Je repars dans une demi-heure pour arriver avant le déjeuner. J’ai Mad. de Meulan avec moi. Elle était invitée à ce dernier dîner. Voilà mon courrier. Pas de lettre. Pourquoi ? J’ai le cœur bien serré. Adieu encore. G.
Mots-clés : Autoportrait, Relation François-Dorothée
178. Paris, Lundi 29 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vraiment vous êtes étrange ! Selon votre lettre, il faudrait encore que je vous remercie de venir huit jours plus tard que vous ne m'aviez solennellement promis, et cela parce que il pouvait se faire que vous ne fussiez venu que 6 semaines après ? à ce compte surement je puis me promener de remerciements en remerciements et passer ma vie sans vous voir. J’aime la foi dans les promesses. Vous ne devez pas m'en faire, ou ne pas les rompre. Celles que vous me faisiez l’année dernière vous les teniez. Cette année ci tout a été de travers et sans le jury. Depuis juin jusqu’en novembre, je ne vous aurais pas vu une fois. et vous verrai je en novembre ? Croyez-vous que j’y crois. Il se peut que je vous dise là une chose dure, mais si vous y pensez bien vous trouverez que je n’ai pas tort. Seulement ce qui vous arrive à vous, c’est de croire que vous avez toujours raison surtout de loin ; ce qui vous arrive encore c’est de ne pas savoir combien je vous aime ! Vous voyez bien, je ne voulais pas entrer en discussion sur ce retard. Et me voilà engouffrée dans des explications sans fin et qui ne mènent à rien, car rien ne mène quand on est loin. Il faut être ensemble. Et voyez encore la différence entre vous et moi. Je vous ai dit, je vous répète. Quand nous nous serons tout dit, nous serons bien heureux. Vous modifiez cela, & vous m'écrivez aujourd'hui j'espère que nous serons heureux. C'est un bien vilain mot que vous avez tracé là Monsieur, et je suis bien aise d'avoir mis Monsieur pour vous le reprocher.
Voilà votre mère souffrante, si elle le devenait davantage n'aurez-vous pas à vous reprocher de ne pas être à Paris avec elle. Je vous prie de m'en parler tous les jours. M. Verny a fait hier un excellent discours, qui m’a fait du bien. Je mènerai Lady Granville à l’église un jour pour l'entendre. Le temps a été affreux. J’ai fait des visites entre autres à Mad. de Stackelberg. Elle avait marié sa fille la veille ; savez-vous ce qu'ils ont fait après la cérémonie ? Les mariés & toute la famille ! Ils sont allés au gymnase voir de méchantes pièces. Sans être Anglais, il me semble qu'on peut être choqué de cela.
J’ai vu beaucoup de monde hier au soir. On est resté dans la mauvaise habitude de l'été, dont je voudrais bien désaccoutumer mes amis, c’est de faire foule le dimanche & le jeudi. je n' y ai aucun plaisir, il n'y a pas de causerie possible. La princesse Schwaremberg qui était chez moi entre autres, est certainement extrêmement jolie ; elle a frappé tout le monde. Avec cela elle est animée, spirituelle. Savez-vous que la petite princesse était de mauvaise humeur ! Car même mon ambassadeur lui a été infidèle. Le George d’Harcourt dont je vous ai parlé est le vôtre. Vous devez l'avoir vu souvent chez Madame de Broglie. C’est lui que je trouve bien, et non le sot mari de Lady Elisabeth qui est le plus ennuyeux personnage du monde.
Avez-vous fait attention à l’adresse des états généraux en Hollande ? Je ne crois pas qu’elle facilite la conclusion de l’affaire belge. Jamais ils ne se sont montrés plus dévoués et plus fiers. Je serai impatiente de la revue française.
A propos, je n’ai point dit à M. de. Broglie que c’était de vous que j’avais appris qu'on l'attendait en Normandie. Jamais je ne cite. C’est mon habitude et une très bonne habitude. Ce qui fait que je n'ai jamais fait un paquet. il n'y a que vous à qui je dise tout, cela va sans dire. La cour toute entière va à Fontainebleau pour conduire jusque là la duchesse de Würtemberg. On y passera quelques jours. J’ai vu hier Mad. la Duchesse d’Orléans à l’église. Elle est selon moi, parfaitement laide.
Adieu, répétez moi, que c’est bien mardi le 6 que je vous verrai afin que j’essaie de me réjouir. J'écris aujourd’hui à Toukowsky pour lui demander l'itinéraire. C’est hopeless de l’attendre de mon mari.
Adieu, adieu, adieu. Dites-moi de bonnes, de douces paroles. Je n’aime pas du tout votre dernière lettre. Adieu.
177. Val-Richer, Jeudi 1er novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous entrons dans le honey-moon, n’est- ce pas ? C’est charmant de retrouver un honey-moon, toutes les fois qu’on se retrouve, et sans qu’il fasse tort aux moons qui suivent. Je me lève de bonne humeur, par un vent et une pluie épouvantables. Je défie qu’il y ait entre nous de pareils orages. Le soleil est toujours sur notre horizon. Séparés, nous ne le regardons pas toujours ensemble et au même moment, mais il y est toujours. Nous voilà des gens bien heureux, nous avons le soleil et la lune à notre disposition. Il y a deux pays que je voudrais voir avec vous, l'Italie et l’Angleterre, le pays du soleil et celui du brouillard. Je ne sais duquel nous jouirions, le plus vivement. Quel dommage que nous ne voyagions pas ensemble ! Dans la grande voiture de Châtenay. Je ne vous savais pas cette aversion pour les voitures, fermées.
A propos de voyage, lisez-vous dans les journaux les lettres de ces savants que nous avons envoyés chez les Lapons et les Samides ? Ils me paraissent décidés à réhabiliter le Spitzberg, et la bonne compagnie des Esquimaux. A les en croire, ils s'amusent parfaitement. Leurs plaisirs me gèlent. Nous plairions-nous là ? Je dis le Spitzberg nous plairait-il, non pas, nous plairions-nous l'un à l'autre dans le Spitzberg ? Ceci ne fait pas question. Je me suis quelquefois proscrit avec vous en Sibérie. Mais vous la trouviez trop uncomfortable, plus unconfortable que la maison de Pozzo. Vous me livrez la tournure et les manières de Lord Castlereagh et de Lord Jocelyn, et je vous en remercie. Mais quoique vous les avez trouvés très agréables, n’est-ce pas, et vous avez causé avec eux très volontiers, bons ou mauvais principes. Je vous le pardonne. Mon estime pour les Anglais est devenu du goût, un goût sérieux mais affectueux. Obtenez seulement qu’ils ne se donnent pas tant de peine pour être frivoles.
Que cède-t-on aux Belges sur l'argent ? Car je suppose qu’on leur cède quelque chose puisque les cinq Puissances sont d'accord. Je trouve l’adresse des Etats Généraux belle. Cette ferme adhésion d'un peuple à son Roi, dans une question dont pour son compte. le peuple se soucie peu, mais qui est pour le Roi une question d’honneur, me plaît infiniment. Il sert toujours à quelque chose d'avoir été grand. Les Hollandais l’ont été. Depuis longtemps ils sont bien déchus. Dans tout le 18e siècle, leur politique a été pitoyable, sans dessein, sont consistance, sans dignité, sans autorité ; mais de temps en temps Jean de Witt se redresse et élève la tête hors de son tombeau, comme Farinata degl' Uberti dans l'Enfer du Dante.
J’ai fini hier mes plantations. A forces de vouloir m’y intéresser, j'en viens un peu à bout. Je suis pour le bonheur solitaire comme les Anglais pour la frivolité. Pourtant, je me trémousse. moins. Je me persuade quelque fois que je tiens vraiment à ce que je fais avec cette terre et ces arbres. Mais quand je rencontre quelqu’un qui y tient réellement et de cœur, je me reconnais de glace et je m'humilie. Avant-hier, ma mère m'a querellé parce que j’avais laissé mettre où l'on avait voulu des cerisiers qu’elle voulait ailleurs. Un c'est que cela m'est égal à failli m'échapper. Je l’ai retenu à temps. Si Dieu m’avait laissé mon fils, rien ici ne me serait égal. Que de projets j’avais formés, commencés ! Je les discutais avec lui ; puis, je les lui remettais absolument, sans réserve. Il faisait faire seul, à son gré. C'est charmant de se décharger sur son enfant de tout soin, de toute affaire, de se reposer en le voyant agir, décider, ordonner, vivre en maître et pour son compte, comme il vivra quand on n'y sera plus. Mon fils était si libre avec moi, et si tendre ! Il s’appartenait bien tout entier à lui-même, et il venait sans cesse à moi. Pardon, Pardon ce que je me laisse aller à vous dire là, je me permets bien rarement de me le dire à moi-même. Pardon.
9 h. 3/4.
Oui, nous avons abusé de l'adieu. Nous approchons du dernier. Adieu pourtant. J’aime mieux l'autre. G.
177. Paris, Dimanche 28 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Certainement vous avez un mauvais caractère ou une mauvaise logique dans l’esprit. Vous vous fâchez de ce que je me fâche, et c'est vous cependant qui avez commencé par m'affliger ! Cela n’a pas le sens commun. Venez et nous raisonnerons sur ce sujet, et je vous prouverai que ce n’est pas moi qui ai tort. Laissons cela maintenant. Ce qu'il y a de plus clair dans notre fait, c'est qu'à distance nous finirions par nous brouiller et que c'est impossible, à jamais impossible, lorsque nous somme ensemble, n’est-ce pas ?
Le traité entre l’Autriche & l'Angleterre ne peut pas nous être agréable, je vous dis cela de mon propre cru. Je n'en ai parlé à personne, et je n’ai personne avec qui causer de ces sujets là. Pahlen n'y entend pas un mot et Médem n’est pas ici. Je trouve en général que notre politique est fort lâchement même depuis quelques temps, aussi nous trouvons nous aujourd’hui dans un parfait isolement.
10 heures. Mon fils vient de me quitter. Je reste affligé, et bien contente de lui. C'est un excellent garçon. Me voilà seule de nouveau sans personne qui m’aime ! Je m'en vais à l'église. Je n’ai rien du tout à vous conter sur ma journée d’hier. Je l'ai passée avec mon fils, avec un peu de mélange de Lady Granville. Adieu. Adieu, & encore adieu et toujours adieu. Si cela ne vous déplaît pas.
Mots-clés : Diplomatie, Relation François-Dorothée (Dispute)
176. Lisieux, Mercredi 31 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai amené hier mes enfants dîner ici. C’était un grand divertissement. Je vais les ramener à leur grand mère dont ils sont toute la vie. Elle est mieux. Le temps devient froid, ce qui lui vaut mieux que l’humidité continuelle. Vous avez beau dire. Nous partons lundi 5. Je vous verrai mardi 6 à 6 heures et demie. Et puisque vous ne voulez pas de mon espérance que nous serons heureux, j'accepte votre certitude. Je gagne au change. Plus de paroles, plus de discussion. De loin, c’est impossible. Je le sais comme vous. Et comment se taire quand on a tant à dire ? Vous avez l’esprit, et le cœur bien actifs, bien des choses s’y passent en une heure, en deux mois et demi. Mais soyez sûre qu’il s'en passe tout autant chez moi. Je vous défie toujours. Dans longtemps, bien longtemps d'ici, quand nous serons vieux vous me direz si j'ai gagné mon défi.
Je connais beaucoup George d'Harcourt. Je ne comprenais guère votre goût pour les bonnes manières de M. Harcourt qui n'en a ni de bonnes, ni de mauvaises et que j’avais trouvé très ennuyeux. George est en effet de manières fort agréables, spirituel sans bruit. Je n’aime pas le bruit.
Non certainement il n'est pas besoin d'être anglais pour être choqué d’une soirée de mariage au Gymnase. C'est le mal de ce pays-ci qu’on veut toujours s'amuser, et qu’on s'amuse de très petits plaisirs. Comme je vois beaucoup de Puritains, je passe ma vie à défendre l'amusement ; mais je vous livre celui-là. Et comme il faut finir par une injure, je vous dirai que la passion du petit amusement possède surtout à Paris, les étrangers. Ils se figurent qu’ils y viennent pour cela. Le Gymnase fait partie du tout.
Vous trouverez bien quelque chose de moi, dans la Revue française, mais rien sur Mad. de Broglie, son mari est occupé à rassembler quelques morceaux qu’elle a publiés. Il veut y joindre des fragments de manuscrits, et il m’a demandé de mettre en tête de ce volume une notice. Je garde pour cette notice ce que je voulais dire d’elle. Ne parlez pas de ce projet de volume. J'étais fort tranquille sur votre discrétion. C’est une de vos petites et charmantes vertus. Mais je tenais à rétablir les faits. Il y avait dans votre lettre un certain où aviez-vous pris plein de doute et d'humeur. Votre doute m'offense, votre humeur me chagrine. Prenez-en votre parti. Rien de vous ne m'est indifférent, & ce qui ne m'est pas indifférent m'est important.
Voilà le N°179 et on me dit que ma voiture est prête. Adieu. Me trouvez-vous fâché ? J’étais sûr que le billet de mon Henriette vous irait au cœur. Certainement, je le garde. Adieu, Adieu. Expliquez-moi comment il se peut que je trouve le temps à la fois lent et rapide d’ici à lundi. Chaque heure qui s’en va est un gain immense. Pourtant il y en a encore beaucoup à gagner. Adieu. Adieu. G.
176. Paris, Samedi 27 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Adieu. Je commence aujourd'hui comme je n’ai pas voulu finir hier. J'étais en bien méchante humeur hier. Je le suis encore un peu aujourd’hui et cela me restera jusqu’à votre arrivée simplement, parce que je ne puis pas vous écrire toutes mes mauvaises pensées. Une fois celles là dites, mon cœur sera soulagé. Mais mon refrain restera toujours. L’année 38 ressemble bien jusqu'à 37 !
Il y a de drôles de passage dans votre lettre ce matin. Ils ne promettent pas un grand appui de votre part au gouvernement ! M. Molé est fort tranquille à ce qu'on dit. La Duchesse de Würtemberg va partir tout de suite pour Gènes où elle passera l'hiver. Elle est dans un état déplorable ! C’est un mélange de poitrine & d’intestins délabrés.
Le Roi est allé voir Mademoiselle Rachel hier. Je vous ai dit je crois, qu’au dire de Mad. de Talleyrand elle est fort médiocre. Lord Holland est venu me faire une longue visite hier matin. Nous avons parlé de toutes les affaires. Il est timide en politique. Il a bien plus de courage quand il est dans l'opposition. Il a été tendre et aimable pour moi et presque tendre en me disant adieu.
J’ai fait une tournée de visites avec Lady Granville. Fagel est venu me voir un moment avant ma toilette. Il a fort mauvaise opinion des affaires de son pays. J’ai dîné chez la Duchesse de Talleyrand avec le duc de Noailles, qui a l’air fort gai. Il reste à Paris ; on y revient. Le soir j’ai été passer une demi- heure chez Lady Granville. Il y avait une nuée d'Anglais dont je ne connaissais pas un. Lady Holland avait encore hier un petit rendez-vous avec M. Molé qui l’a singulièrement soignée. Il a bien fait & fort réussi. Ils partent ce matin et arriveront dans huit jours à Boulogne ! Je viens de faire une promenade aux Tuileries avec Lord Coke. Il me donnait le bras. Cela m’a fait du mal !
Adieu, le temps me paraît bien long !
Mots-clés : Politique (France), Réseau social et politique
175. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
175. Paris, Vendredi 26 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous ferai mon journal comme de coutume, mais je ne répondrai pas à votre lettre, car je sens qu’une réponse pourrait vous déplaire ; et que de mon côté, je ne dirais jamais assez tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je me permettrai un mot cependant, c’est que je n'ai jamais douté que vous me ménagiez une nouvelle surprise.
Après ma promenade ordinaire, j'ai été hier faire visite à M. de Broglie. Je l’ai trouvé un peu maigri et l’air grave et triste mais pas changé comme on me l’avait dit. Nous n’avons pas parlé de sa femme, je ne sais pas parler, mais j'ai senti des larmes dans mes yeux. Il m’a dit qu’il n’avait jamais songé à faire une visite en Normandie ni à bouger de Paris. Où aviez-vous pris qu'il y irait ? Un homme seul me parait une chose bien triste, sans doute je me trompe et un homme doit savoir mieux que nous employer son temps mais son home a un air d’inconfort qui ajoute ce me semble au chagrin.
J’ai eu hier une longue visite des Appony. Ils sont gais, et joyeux d’entrer dans une belle maison toute fraîche. Sûrement cela fait beaucoup à l'humeur, car ce sont des jouissances de tous les instants. Il n’y pas de nouvelles, on espère et on croit toujours que l’affaire Belge s'arrange, mais cependant on n’a pas encore le dernier mot des deux parties intéressées sur l’affaire de la dette.
Lady Carlisle est venue me dire adieu elle part aujourd'hui. C'est une bonne femme et qui est très accoutumé à m’aimer. Le soir j’ai eu du monde. Une querelle entre mon Ambassadeur et M. de Mossion sur l’affaire Suisse. C’est rare que M. de Pahlen discute, mais il a M. Mossion en horreur. George Harcourt et de retour, il est venu. J’aime beaucoup ses manières. J'aime beaucoup les bonnes manières. Le temps est à la pluie, froid et triste, & moi je ne suis pas gaie. Il m’est impossible de vous dire adieu.
Le gouvernement fait des conquêtes. Messieurs de Hautpoul, le marquis d’Oudinot et d’Aligre sont ralliés à la cour.
174. Val-Richer, Lundi 29 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis exactement le contraire de Lord Holland, bien plus hardi dans le Gouvernement que dans l’opposition. Cela prouve qu’il n’est pas trop à sa place en ce moment, ni moi à la mienne. Je crains toujours de faire verser la voiture en querellant le cocher, même quand je n’aime pas le cocher. Et puis, l’opposition déclame beaucoup et je ne peux souffrir la déclamation. Toute parole exagérée tombe sur moi, comme un seau d’eau froide. En revanche, et pour me défendre de ma faiblesse j’ai aversion de celle d’un gouvernement. La colère me prend quand je vois le pouvoir indécis, inerte, abaissé. C’est un son faux à mon oreille, une ligne de travers à mon œil. Je puis me permettre cette colère, car je l’ai dans les affaires comme en dehors. Je n’ai jamais été content de mon propre gouvernement. Voilà les deux sentiments qui me tiennent aujourd’hui. Je navigue de l’un à l’autre.
Hier, pour la première fois depuis que je suis ici, je n’ai pas mis le pied hors de la maison. Je n’ai jamais vu un tel torrent de pluie continue. Je m’en serais consolé en travaillant, si j’avais été en train de travailler ; mais je n’étais pas en train. J’ai beaucoup causé avec Henriette. Cette bonne petite fille m’avait donné le matin, l’air fort troublé, et toute rouge, le billet au crayon que je vous envoie; et qui m’a été au cœur. Pourrez-vous le lire ? Je lui ai promis un mari qui serait charmé de vivre avec moi, et que nous ne nous séparerions jamais. Comment cette petite Duchesse de Wurtemberg s’est-elle détruite si vite ? J’espère que l’Italie la guérira si elle a auprès d’elle quelqu’un qui sache la gouverner, car je doute qu’elle se gouverne bien elle-même. Son mari n’a pas l’air gouvernant du tout.
Qu’est-ce que Fagel entend par le mauvais état des Affaires de son pays ? Croit-il que son Roi, malgré son semblant d’arrangement, s’obstinera toujours et finira par le brouiller avec ses Etats Généraux ? Si la conférence termine l’affaire Belge, je ne vois pas quel embarras il peut y avoir en Hollande. Il me semble que la duchesse de Talleyrand vous donne beaucoup à dîner. Veut-elle comme c’est l’usage de ce temps-ci, suppléer à la qualité par la quantité ? A-t-elle pris des jours ? Essaye-t-elle d’avoir une maison ? Je suis bien questionneur ce matin.
Vous souvenez-vous que vous m’écriviez de Londres, l’an dernier : " Durham a du courage, de l’audace, et surtout de l’ambition. Il me semble qu’il se prépare ici bien de l’embarras. C’est Lord Durham qui le créerait. Tout cela est encore à sa naissance ; mais regardez-y bien ; le danger peut surgir tout à coup. Vous avez une sagacité bien rare, et charmante parce qu’elle est si naturelle si prompte ! En passant vous voyez au fond.
10 heures
Je me fâche de ce que vous vous fâchez ; je m’afflige de ce que vous vous affligez. Qu’est-ce que cela prouve ? que dans ma conviction, vous n’avez jamais droit de vous fâcher jamais droit de vous affliger à mon égard. Oui, j’en suis convaincu, j’en suis sûr. Entendez bien ceci, dearest, je suis infaillible envers vous. Et tant que vous ne le croirez pas vous ne me connaîtrez pas, et vous ne saurez pas combien je vous aime. Adieu, adieu toujours le même adieu quand même, et je ne veux pas qu’il y ait de quand même. G.
174. Paris, Jeudi 25 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Moi aussi je ne vous écrirai qu'un petit mot aujourd’hui. J’ai été fort tracassée toute la matinée par de petites affaires je suis lasser, & cependant il me faut de l'air. Je m’en vais le prendre et puis faire des visites Anglaises à des partants. Hier au soir j’ai été un moment chez Madame Graham où j'ai vu le commencement d'un véritable rout plus communément appelé drum en Angleterre. De là j’ai été rendre les 6 visites que m’avait faites Madame de Castellane. J'y ai trouvé M. Salvandy, je n’ai rien appris de lui, sinon qu’il est très piqué de ce que Lord Holland ne lui a pas rendu sa visite.
Rien d'Angleterre, on ne saura des nouvelles aujourd’hui. Mon fils va mieux ; moi non, je n’ai pas vu mon ambassadeur depuis plusieurs jours. Je ne sais ce qu’il est devenu.
Adieu. Adieu. Voyez comme je disais vrai en commençant cette lettre. Adieu.
173. Val-Richer, Dimanche 28 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais que vous pussiez voir, voir dans la réalité et par le menu, les soins que j’ai eu à prendre, et que j’ai pris, dans mon intérieur et dans mes affaires auprès des personnes, et auprès des choses pour retourner à Paris dans les premiers jours de Novembre, au lieu de rester ici jusqu’à l’ouverture de la session. C’est ma seule réponse possible à votre n° 175. Mais vous ne l’avez pas vu, et moi, je ne vous le dirai pas. C’est triste.
Voici ce que je trouve dans une lettre que m’écrivait, le 8 octobre, le Duc de Broglie, à moi et non pas à ma mère : " Je compte toujours aller à Broglie d’ici à quinze jours ; et si j’y vais, j’irai voir vous et votre mère. Dites lui bien des tendresses pour moi ; elle me manque beaucoup. " Ma mère a été très souffrante hier tout le jour de ses pesanteurs de tête et de ses vertiges. Quand elle en convient, il faut que ce soit bien réel, car je n’ai jamais rencontré de personne plus dure à elle-même. Je l’ai tenue dehors presque toute la journée. Ce n’est pas très aise à présent, car on ne peut plus guère s’asseoir dehors.
Mes enfants, en ont profité pour passer aussi toute là journée à l’air. Il y sont beaucoup en général ; mais ma mère à un peu la manie des leçons et quand je puis lui en voler quelques unes ; j’en suis toujours charmé. Du reste, ils ne sont point à plaindre ; ils ont ici un petit cousins qui est venu passer quelques jours au Val Richer, et avec lequel ils s’amusent parfaitement. Le plaisir est encore plus vif pour ce petit garçon que pour mes enfants. Il a été élevé seul. Il éprouve à sortir de sa solitude, à vivre avec ses parents, une joie qui me fait spectacle. C’est une curiosité et une surprise de tous les moments. Il découvre un nouveau monde. C’est du luxe, de la part de M. de Pahlen qui discute si peu, de discuter avec M. de Maussion. L’affaire suisse sera partout une désagréable discussion pour le Ministère. On a bien fait de demander l’expulsion de Louis Buonaparte mais il fallait et on pouvait la demander et l’obtenir tout autrement. Et la façon dont on l’a demandée et obtenue a, pour la France, des inconvénients graves qu’elle rencontrera plus d’une fois sur son chemin, et qui mis au jour, frapperont beaucoup le public, car ils choquent ses passions, bonnes et mauvaises. On me dit qu’il va paraître une brochure du général Bugeaud qui préoccupe beaucoup M. Molé. Le Général Bugeaud, puisqu’il n’a pas répondu au premier moment, ferrait mieux à présent de garder ses explications pour la tribune. C’est une singulière manœuvre que d’avoir retardé le nouveau procès du général Brossard. Il coïncidera avec l’ouverture de la session. Peut-être le retardera-t-on encore jusqu’après les Débat de l’adresse. On n’en évitera pas le retentissement. M. Harcourt est-il revenu avec sa fille Lady Norris ? L’avait-il avec lui quand il a perdu sa femme ? Est-il affligé ? Il me semble qu’il n’y a guère de quoi. Mais l’habitude, même sans être douce est quelquefois puissante.
10 heures 1/2
Le N° 176, commence mieux, que ne finissait le N°175. Mais le cœur m’importe encore plus que les lettres et c’est au fond de votre cœur qu’il faut que j’aille puisque ce qui vient J’espère que nous serons heureux de vous va au fond du mien. quand nous nous serons tout dit. Adieu. Adieu. G. Ma mère est moins souffrante.
173. Paris, Mercredi 24 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie tous les jours, toujours de tout ce que vous me dites de tendre, d’affectueux. Cela me fait du bien. J'ai bien besoin de vous, j’ai été trop longtemps seule. Mon fils n’a pas quitté son lit, & je ne suis pas beaucoup auprès de lui. Cela me rend nervous au possible parce que je sens mon insuffisance. J’ai ce caractère trop inquiet, cela doit impatienter les autres.
Je me suis promenée le matin avec Marie ; à propos, elle est à merveille de santé, d'humeur, de beauté. Avant dîner, j’ai fait visite aux Holland ; j’ai trouvé Milady se faisant frotter les jambes & causant avec M. Berryer. Ensuite elle a passé à sa toilette et m’a proposé un tête à tête avec son mari. J’ai trouvé, ce que je trouverais en Angleterre c’est qu’il est l’homme le moins propre à une vraie conversation d’affaires, c’est de la politique personnelle et non pas de grands intérêts. Ce soir Marie est allée au spectacle avec les Carlisle, je suis restée avec Armin, Humboldt et M. Mossion. J'ai renvoyé un peu brutalement celui-ci, pour causer avec les autres.
La fièvre jaune s’est déclarée à bord d’un bâtiment de votre flotte au Mexique. On est inquiet du prince de Joinville. Il parait hors de doute que Lord Durham reviendra sans attendre. Sa démission et peut être même sans la demander. Lord Grey m’a écrit sans connaître encore la résolution de son gendre mais il la pressent, & je ne pense pas qu'il en soit très mécontent. Il trouve qu’il a été indignement abandonné par les Ministres. Madame de Flahaut m'écrit aussi. Décidément ils ne reviennent pas. Elle se plaint amèrement de M. Molé. M. de Flahaut s'attendait à l’offre de l'ambassade à Naples, ou en Suisse ou à Turin enfin quelque chose. Je suis étonnée qu'il se soit fait de ces illusions là.
Je ne sais de quelle couleur est M. de Mossion. Il revient de Suisse où il a passé l'été. Il trouve que la France a joué un pitoyable rôle dans l’affaire de Louis Bonaparte, et la Suisse un très beau. J'ai M. Fossin et tout mon écrin à côté de moi au moment où je vous écris. Je fais faire à tout événement l’estimation de mes diamants. On ne sait pas...! Il pleut à verse. J’aurai les arcades pour ressources, et des visites ensuite. Adieu. Adieu comme vous très tendrement.
172. Val-Richer, Samedi 27 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’étais très fatigué hier soir je ne sais pourquoi. Je me suis couché avant 10 heures. Aussi je me lève à 6. J’ai bien dormi. Je voudrais bien qu’à vous coucher de bonne heure, vous eussiez le même gain. Comment vont vos nerfs ? La lecture en me couchant dans mon lit est pour moi, un moyen de sommeil à peu près infaillible. N’est-il plus du tout à votre usage ? Peut-être pourriez-vous vous faire lire quelques minutes par votre femme de chambre. Du reste, il me semble que ce n’est pas au moment où vous vous couchez que le sommeil vous manque. Ma mère, qui dort très mal et se réveille sans cesse dans la nuit, se rendort souvent en lisant. A la vérité elle a conservé de très bons yeux. Je ne suis pas bien content de sa santé depuis quelque temps. Elle n’est pas encore remise de l’ébranlement que lui a causé la mort de Mad. de Broglie. Je suis bien aise de la ramener à Paris. Ici. avec du temps, les sœurs ne me manqueraient pas ; il y a de bons médecins à Lisieux. Mais pour quelque mal prompt et inattendu, trois ou quatre heures d’attente sont beaucoup trop. Le départ de ma maison a commencé hier. Cette amie de ma mère dont je vous ai quelquefois parlé Melle Chabaud nous a quittés. Elle a été pour mes enfants, pendant tout son séjour d’une bonté aussi utile qu’affectueuse. Je ne puis la remplacer pour le piano d’Henriette, mais je me suis chargé de la leçon d’Anglais d’ici au 5 novembre. Nous lisons ce qui se peut lire de Shakespeare. Je ne voudrais pourtant pas nourrir mes enfants de cette lecture-là, même de ce qu’il y a de bon. C’est trop fort et trop brut. Il y a trop d’émotion et pas assez de perfection. Il faut, à de jeunes esprits quelque chose de plus serein et de plus achevé.
Mad. Graham reprend ses raouts de bien bonne heure. Il y a donc déjà beaucoup d’Anglais à Paris. Vous les aimez toujours beaucoup, c’est sûr ; mais si je ne me trompe, ils sont bien vite usés pour vous. Excepté, Lady Granville, s’entend. J’ai peur que Paris ne soit pour vous comme la cour, selon La Bruyère, " pays où l’on n’est pas toujours bien, mais qui empêche qu’on ne se trouve bien ailleurs. " Les journaux démentent la retraite du comte Woronzoff. ont-ils raison ? Il me semble que l’Orient s’apaise. Pourtant la question a fait un pas. L’Angleterre a jeté un grappin de plus & vous êtes mécontents. Qu’y a-t-il de sérieux dans son traité de commerce avec l’Autriche et dans ces bouches du Danube ? Mettez-vous à cela beaucoup d’importance ? Lord Grey a raison de trouver que son gendre a été indignement abandonné. Mais ni Lord Melbourne, ni Lord John ne pourraient faire autrement. C’est leur situation comme celle de notre cabinet, de faire, ce que d’autres ne voudraient pas faire, de supporter ce que d’autres ne voudraient pas supporter. Vous savez le mot du Prince de Talmont aux soldats qui allaient le fusiller : " J’ai fait mon devoir ; faites votre métier. " Il y a des Cabinets qui font leur devoir, d’autres leur métier.
10 heures
Je vous dirai adieu comme à l’ordinaire, à moins que vous ne vouliez pas. Mais aujourd’hui, en ce moment je ne vous dirai pas autre chose. Moi aussi, je vous blesserais, et je ne veux pas. Adieu. Je ne sais pourquoi il convient à M. de Broglie de dire qu’il n’a jamais songé à bouger de Paris. Non seulement il m’en avait parlé, mais il l’a écrit à ma mère.
172. Paris, Mardi 23 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m'écrivez de bonnes, d'aimables lettres ; des paroles bien douces & tendres. Oui, je veux que vous me rendrez un peu de santé, essayez-le je vous en prie. Jusqu’ici vous n'y avez pas réussi par ce que vous n'y avez pas tâché. Vous êtes trop grave pour moi, vous entrez trop dans mes peines, vous ne les combattez jamais, vous ne me montrez pas le moyen de distraire mon esprit je suis avec vous plus triste qu’avec d’autres. Donnez-moi du courage, de la gaieté s'il est possible. Je vous dis cela aujourd’hui au moment où je suis le plus triste du monde, les nerfs dans un état horrible. Irritée, irritable, tremblante quand on sonne, quand on me demande quoi que ce soit, enfin de la plus détestable compagnie.
Au moment où mon fils allait partir hier, il a été saisi d'une fièvre si violente qu'il a été obligé de se mettre au lit. Il y est encore. Le médecin espère que ce ne sera rien, mais moi je m’agite, je m’in quiète ; & dans cet état non seulement je ne suis bonne à rien mais j'impatiente & j'ennuie tout ce qui m’entoure à commencer par mon fils. Voilà mon mauvais caractère ou plutôt mes mauvais nerfs. Je voudrais finir, finir tout le monde, mais surtout me fuir moi.
Non, l’Amérique ne m’intéresse pas du tout. A dire vrai je ne me suis jamais intéressée qu'aux monarchies. Je veux quelque chose qui m’éblouisse ; de l'éclat, de la pompe, de la grandeur. Une république, cela ne me plait pas du tout. Je n’ai rien à vous conter d’hier. J’ai été un moment le soir chez Lady Granville, il y avait du monde, mais tout le monde m'a déplu, ce qui veut dire que de mon côté j’ai été fort peu aimable. Je suis partie au bout d’une demi-heure.
J'ai eu une lettre du Duc de Devonshire de Côme du 15, il venait de dîner entre mon mari, & mon grand duc. Il me dit qu’on reste à Côme un mois, & puis Rome pour l'hiver & Londres au mois de mai. Mon mari ne me dit jamais cela, il ne me dira jamais plus rien. Décidément la correspondance ne reprendra jamais. Et vous avez beau dire, je ne prendrai jamais mon parti des gens incurables. Cela ne m'est pas donné. Je croirai toujours à quelques curieux que je n’atteindrai jamais. Adieu. Adieu. Je vous attends avec bien de l’impatience. Adieu
171. Val-Richer, Vendredi 26 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quoique vous me disiez que votre fils n’a pas encore quitté son lit je me tiens pour assuré que son indisposition n’est rien. Ne le laissez pas répartir pour Naples sans qu’il soit tout à fait remis. Je ne suppose pas que vous ayez à Naples des affaires qui exigent instamment sa présence. Quand je serai près de vous, je vous désirerai toujours les personnes que vous aimez et qui vous sont bonnes, mais de loin, ce désir va jusqu’à l’inquiétude, et j’ai de la reconnaissance pour votre fils, comme s’il sentait pour moi. Il me paraît qu’on est fort préoccupé de la crainte que nous ne fassions de l’opposition. Cela me revient de tous les côtés et le langage du Journal des Débats me confirme ce qui me revient. Non seulement, on ne veut pas que nous parlions contre l’opposition, mais on nous prédit toutes sorte de malheurs, si nous restons muets. On veut que nous parlions... pour le Ministère apparemment. On voudrait bien avoir des bravi d’éloquence comme au moyen âge on en avait d’épée. En attendant, on chante les hymnes en l’honneur de M. Molé. Mais l’hiver arrive ; et quand il est là, il ne sert pas à grand chose d’avoir chanté, tout l’été. Vous avez bien raison de vous étonner des illusions de M. de Flahaut. Quand il était auprès du Duc d’Orléans, il ferait un peu ses affaires lui-même, et il y avait quelque raison de le ménager. Mais aujourd’hui, qu’a-t-on à espérer ou à craindre de lui ? Et quant au salon de Mad. de Flahaut, on n’est pas assez sûr qu’il fût bon pour désirer réellement qu’il soit ouvert. On ne fera rien pour eux ; et ils font bien de ne pas revenir. Il y a dans les cours, (puisque cour y a) un genre d’hypocrisie qui m’a toujours été insupportable ; c’est la prétention, quand l’occasion s’en présente, à être traité comme s’il y avait de l’affection, quoiqu’on n’y croie point et qu’on n’en ressente point soi-même. On parle d’ingratitude, de froideur, de sécheresse. Les Rois n’aiment qu’eux- mêmes et leur famille. C’est une de leurs grandes infériorités. Mais, pour peu qu’on ait vécu auprès d’eux, cela est si clair ! Savez-vous qu’elle est la situation admirable, qui fait d’un homme tout ce qu’il peut être ? C’est celle d’un Roi légitime qui a été obligé de reconquérir son royaume qui s’assied sur le trône par son droit, et y est monté par son fait, qui est né pour la vie royale et à mené la vie humaine. Gustave Wasa et Henri 4. Ceux-là ont aimé et ont été aimés.
Le Duc de Broglie m’écrit que sa santé est bonne et qu’il va tous les jours, à midi, faire le tour des grandes allées désertes du Champ de Mars. Il a l’air de m’attendre, impatiemment. On me dit d’ailleurs de sa fille : " Mad. d’Haussonville s’apaise un peu. Mais ce pauvre jeune esprit reste sans mouvement, et le moindre effort pour le ranimer lui cause une impression douloureuse. Elle ne sait que trop tout ce qu’elle a perdu. " Je suis bien aise qu’elle le sache, et Je désire pour elle qu’elle le sache toujours. Avec une longue vie devant soi, il n’y a rien de plus salutaire qu’un souvenir respecté et chéri. La voix des morts n’offense jamais et on accepte d’eux des vérités qu’on ne supporterait pas d’une bouche vivante. Sans savoir ce qu’ils sont, on les croit, on les sait parfaitement désintéressés et sincères.
10 heures
Seulement adieu. Je reçois trois ou quatre lettres auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Adieu. Il n’y a plus qu’une semaine entière entre nous. C’est encore bien long. Mais enfin, ce n’est plus que cela. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Politique (France), Réseau social et politique
171. Paris, Lundi 22 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai fait hier ma dernière grande promenade au bois de Boulogne avec mon fils. Il me quitte aujourd’hui. Il n’est pas homme d'esprit, mais il est si doux, si bon, si affectueux pour moi et il a tant de bon sens que c’est vraiment une bien douce société pour moi. Il retourne à Naples. Il me promet de revenir me trouver l’été prochain, que sera l’été prochain pour moi ?
J'ai eu beaucoup de monde hier au soir ; je n'avais de fixe que les Holland & Berryer, c’était une affaire commune ; les autres entrent quand ils voient les lampes. On s’est écouté vers les onze heures, & alors a commencé la véritable causerie avec Granville du plus. Il me parait que Berryer et Lord Holland ont été réciproquement frappés l’un de l’autre. Berryer compte sur une session importante ; dont vous & M. Odillon Barrot serez les principales figures. Il trouve Thiers fort effacé dans la chambre, et votre parti fort grandi par la presse. Il est impatient de vous revoir. En attendant il fait à ce qu’il dit le paysan.
Les Holland partent samedi, ils ne peuvent pas vous attendre. Cette affaire du Canada va amener des délibérations du Conseil, & peut être, une convocation du parlement. Cependant, ils ont confiance dans le général Colburne qui garde son commandement, & qu’on dit un homme de guerre & un homme de tête, supérieur. Lady Burgharsh est venue aussi hier au soir. Elle est bien changée. La pauvre femme a perdu il y a deux ans un enfant, une fille de 16 ans, charmante. Mon ambassadeur parle à tout le monde de ses embarras de maison. C'est un peu ennuyeux & on commence à en rire, mais lui en maigrit. Les Appony passeront le 8 Novembre dans leur maison, ils sont enchantés. La Duchesse de Talleyand a donné hier à dîner à M. Molé & Mme de Castellane. Si elle ne les nourrit pas mieux que moi ils seront un peu étonnés. Adieu.
Le temps est ravissant. Je vais m’établir aux Tuileries. Si vous y veniez avec moi, quelle jolie causerie nous aurions dans ce bon air qui est si gai aujourd’hui. Moi, je ne le suis pas. Adieu, adieu.
170. Val-Richer, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je commence à vous écrire ici. Ce soir et demain matin à Lisieux, je n’aurai pas plus de temps que ce matin. Je suis désolé de l’état de vos nerfs. J’espère que l’indisposition de votre fils ne sera rien, et n’aura d’autre effet que de vous le laisser quelques jours de plus. Je ne puis partir d’ici que le 5 novembre. J’ai fait et je fais force de voiles pour finir je ne sais combien de petites affaires, qui sont pourtant des affaires, et que je ne puis laisser en arrière. Ma mère de son côté m’a demandé jusqu’au 5 pour ses arrangements de ménage. Ces cinq jours de retard me contrarient vivement. Il n’y avait pas moyen. Nous partirons le 5 au soir. Nous arriverons le 6 pour dîner. Je vous verrai le 6, à 8 heures du soir. Nous voilà au moins à jour fixe. Aurez-vous un bon jour en me revoyant ? Je voudrais bien vous égayer vous distraire. Je ferai de mon mieux. Il y a des choses dont je suis sûr. Il y en a d’autres sur lesquelles notre disposition, n’est pas, la même. Les mêmes remèdes ne nous sont pas bons à l’un et à l’autre. Mais, quoique je n’aie plus vingt-cinq ans je persiste à croire beaucoup qu’on trouve ce qu’on cherche et qu’on peut ce qu’on veut. Je chercherai et je voudrai. Vous avez raison de vouloir de l’éclat, de la grandeur. C’est aussi mon gout, très décidé, et l’un des mérites en effet des monarchie. Cependant je ne puis souscrire absolument à votre arrêt. La République romaine a bien eu quelque éclat, et il n’y a pas beaucoup de plus grandes figures que Scipion et Annibal. Il y a république et république, comme aussi monarchie et monarchie. Il me revient que Thiers est fort triste, fort abattu et assez de l’avis que vous me mandiez de Berryer. La tristesse est en général pour Thiers une source de bonne conduite. Nous verrons. Il revient vers le milieu de novembre.
Lisieux, jeudi 9 heures
J’attends votre lettre. Je n’aime pas à attendre dans les auberges. Nulle part le sentiment de la solitude n’est plus vif. C’est ce qui fait qu’il est charmant de voyager avec quelqu’un qu’on aime. Le monde disparaît. On est vraiment seule. Il y a, dans je ne sais plus quel roman de Mad. de Stael, une page où cela est senti et dit à merveille. A propos de Mad de Stael, j’ai écrit ces jours-ci sur l’état des âmes, dans notre temps, quelques pages qui paraîtront dans la Revue française et où j’ai un peu parlé de Mad. de Broglie. On dit bien peu ce qu’on pense quand on pense vraiment quelque chose sur quelqu’un qui le mérite. Je voudrais avoir réussi cette fois. Vous me le direz.
Voilà 173. Toujours aussi nervons. Il fait pourtant beau. Je ne sais pourquoi je dis pourtant, car décidément je n’aime pas les beaux jours d’automne. Je les accepte, j’en jouis même. Mais on n’aime pas, tout ce dont on jouit. On n’aime que ce qu’on préfère. Adieu. Je remonte en voiture. Les dîners me laissent cinq jours de repos jusqu’à mardi. Je donne cette lettre à la poste avec chagrin. Ces cinq jours de retard vous déplairont, comme à moi. Adieu. Adieu. G.
170. Paris, Dimanche 21 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai rencontré beaucoup de monde hier à Auteuil, sans y rencontrer cependant des nouvelles, si ce n’est que décidément l’affaire Belge va être terminer avant la fin de ce mois encore. Je crois que l’Angleterre avait besoin de cela, du moins Lord Palmerston, afin de pouvoir se vanter d’avoir mené à fin quelque chose. A dîner chez Lord Granville j’ai appris la résolution de Lord Ducham d'abandonner son gouvernement du Canada. C’est une grosse affaire de plus d'une façon. La rébellion éclatera de nouveau dans ces provinces. Les fonds Anglais ont fléchi à l’arrivée de cette nouvelle. Que va faire Lord Durham en Angleterre ? C'est un grand imbroglio. Les Anglais hier en étaient fort consternés.
Il y a une autre affaire à Madrid qui a aussi son importance. Frias & le chargé d’affaires d'Angleterre se sont brouillés sur une question de journaux, et au point que Lord Wiliam Hervey n’a plus voulu aller à la cour le jour de la fête de la Reine. Cela fait un grand scandale. Villers sera appelé à ajuster cela, probablement en faisant chasser Frias. Le pauvre Alava dit quand on lui demande "comment vont vos affaires ? " au diable."
Il fait chaud ; il fait beau, et je me sens très malade, c’est que je suis bien triste. Vous avez raison dans tout ce que vous me dites sur mon compte. La faveur de la cour me ramènerait mon mari, comme ma disgrâce me l’a aliéné. Est-il possible. Mais vous vous trompez la faveur ne reviendra plus. Il est unforgiving, je ne trouve pas le mot français.
On prétend que la Princesse de Beïra n’est pas en Navarre & que toute la nouvelle était une mystification. Adieu, Adieu. Mon fils me quitte demain. Adieu.
169.Lisieux, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier au moment où j’allais partir, deux personnes me sont arrivées qui viennent passer deux ou trois jours au Val Richer. Il a bien fallu les y laisser pour venir dîner ici, et je les laisserai encore aujourd’hui. Aussi je retourne, sur le champ pour être poli au moins à déjeuner. Encore aujourd’hui vous n’aurez donc que quelques lignes. Cela me déplaît, je vous assure autant qu’à vous. Il me semble que je vous ai sous ma garde, et que je manque à ma consigne quand je vous quitte. Il faut que vous me plaisiez beaucoup et bien sérieusement pour qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas le goût ni l’habitude, des devoirs factices, et je n’aliène pas aisément une part de ma liberté. Vous avez vécu dans un pays libre, représentatif, électoral. Mais vous n’en avez jamais mené la vie. Vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un grand dîner d’électeurs importants, où viennent s’étaler toutes les importances, toutes les magnificences de l’endroit où il faut passer deux heures à table mangeant et causant, deux heures après la table causant et jouant au trictrac, avec 40 personnes. Voilà ma vie hier et aujourd’hui. Cela aussi, il faut que ce soit bien sérieux pour que je le fasse. Mais c’est un sérieux moins plaisant.
Je crois comme Berryer que la prochaine session sera importante et très animée si chacun consent à prendre sa position simplement, nettement, sans but immédiat et sans combinaison factice. C’est, pour mon compte, ce que je me propose de faire. Adieu. On me dit que ma calèche est prête. La poste n’est pas encore arrivée. J’espérais l’avoir avant de partir. Elle viendra me chercher au Val-Richer. Il a fait un brouillard abominable, cette nuit. Le courrier aura marché plus lentement. Adieu. Adieu. Non pas comme si nous nous promenions, aux Tuileries, mais comme dans notre cabinet. G.
169. Paris, Samedi 20 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai pris beaucoup de bois de Boulogne hier, je me suis fatiguée dans l’espoir que cela me profiterait pour la nuit. J'ai été faire visite à la Duchesse de Talleyrand. Je ne puis pas vous dire combien elle & tout son établissement me paraissent unconfortable and unsatisfactory. Je ne sais à quoi cela tient. Elle a un air flottant, indécis, elle flatte tout le monde à droite, à gauche. Et par dessus toute cette incertitude, elle veut se donner de l'aplomb, & répète à tout instant qu’elle est une grande dame. Assurément elle devrait l’être, mais en vérité je ne trouve pas qu’elle en ait l'air, elle n’a pas assez de calme pour cela.
Le soir j’ai été dire adieu à la duchesse de Sutherland chez Lady Granville. J'y ai laissé Marie et je suis revenue me coucher à 10 heures ; cela m’a fait dormir un peu, pas beaucoup. Très décidément on dit Potsdam & je croirais, que cela dérive d’un juron. Il faut le demander à Humboldt. Je suis comme Thiers, j'aime la géographie. Le Duc de Noailles est ici, je ne l’ai pas vu encore. Son père était mourant, et il est mort en effet avant-hier. Ce sera pour lui un deuil et pas autre chose. M. de Barante est arrivé à Pétersbourg. Les affaires en Espagne sont au plus mal pour les Christinos, du moins c'est le ministre de Christine qui le dit !
Il fait doux et charmant aujourd’hui. je devrais me porter bien, & je me porte très mal. Il me semble que jamais mes nerfs n’ont été plus malades. Tout m’agite, tout m'irrite. Je sais bien qu’il n’y a pas de remède, car le mal me vient de gens incurables. Adieu. Adieu. Racontez-moi toujours que vous emballez, que vous envoyez. Il faudra bien finir par vous emballer vous même. Adieu.
168. Val-Richer, Mardi 23 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève tard. J’ai mal dormi ; pour moi du moins ; pour vous, ce serait probablement une bonne nuit. Vos nuits dépendent de vos jours ; votre santé de votre âme. J’y pense continuellement. Il y a de l’irrémédiable. du moins pour nous ; nous n’y pouvons rien actuellement directement. Les circonstances peuvent amener, là où se décide ce qui vous touche, des raisons de changement qui amèneraient à leur tour le changement. Nous ne les prévoyons pas aujourd’hui ; mais elles peuvent venir. Je le crois unforgiving, implacable, mais non contre son propre intérêt, son moindre intérêt bien clair. Mais il n’y faut pas compter, j’en conviens ; il faut s’arranger comme si cela ne se pouvait pas. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c’est de combien d’affection et de soin j’entourerai, votre solitaire établissement. Je sais tout ce qui vous manque tout ce qui manque à votre cœur, à votre journée. Je sais ce qui m’empêche souvent moi-même de faire tout ce que je voudrais. Mais je veux tant que je ferai beaucoup beaucoup. Je me sens inépuisable pour vous. En fait de monde chez vous, hors de chez vous, en fait de passe-temps vous en aurez à peu près tant que vous voudrez. Votre salon est formé, à présent ; les habitudes sont prises ; la conversation, le petit mouvement social qui vous plaisent ne vous manqueront pas. Voilà pour la surface, au fond dearest, nous comblerons ensemble les vides, nous soignerons ensembles les plaies. Je vous aime tendrement. Le temps, l’absence, la connaissance plus complète de votre caractère, de votre esprit de vous toute entière, tout cela fait que je vous aime toujours autant, plutôt davantage. Vous savez que mes paroles n’exagèrent jamais mes sentiments. Vous savez que je suis doux à vivre. Je le serai pour vous, avec vous, plus que vous ne savez. Il y a bien du vide, bien de l’amertume dans votre situation ; j’y mettrai beaucoup de baume, beaucoup de tendresse. Vous vous souvenez de mon défi, dans nos premiers temps. Vous me direz un jour, si j’avais raison.
J’ai gardé hier mes hôtes jusqu’à cinq heures. Aujourd’hui, je vais dîner à Lisieux, demain aussi. Je mets les morceaux en quatre. Le retour de Lord Durham sera un avènement à Londres. Je ne sais qu’elle position il s’y refera ; mais je comprends que celle de Québec ne lui convienne pas. Revient-il cependant sans attendre son successeur, sans donner à son gouvernement le temps de pourvoir aux affaires du Canada ? Ce serait une boutade d’enfant gâté. Il y est sujet. Les Granville en sont-ils inquiets ? Je crois assez à leur jugement sur la situation, et les chances de leur cabinet. Ils sont éclairés, par une passion, leur désir de rester à Paris. Je la partage pour eux, quoique, non à cause d’eux.
10 heures
Je suis fâché que votre fils vous quitte avant que j’arrive. J’avais espéré qu’il vous resterait encore quelques jours ! Je suis charmé que vous en soyez contente. Ses qualités qu’il a valent mieux plus on en jouit. Je reçois une lettre de M. de Broglie qui me dit qu’en effet il ne vient pas à Broglie. Cela me met à l’aise. Je craignais toujours qu’il ne vint au moment où je veux partir. Il est bien triste, mais il reprend ses occupations intérieures. Il est très content de son fils. Adieu. Je serais en effet très bien aux Tuileries. J’y serai. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
168. Paris, Vendredi 19 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé une bien mauvaise journée hier. J’avais les nerfs tout à fait dérangés. Je me suis promenée assez longtemps au Bois de Boulogne avec mon fils ; le temps était passable. Avant le dîner, j’ai eu une longue visite de Montrond. J’ai dîné seule avec Marie, Alexandre dînait chez M. de Pahlen. Le soir, mon fils est allé au spectacle, Marie à l’Ambassade d'Angleterre, et moi dans mon lit. J'ai un peu dormi, & je me sens moins malade aujourd’hui.
Montrond est assez questionneur, assez causant, et assez en bonne humeur. Il a certainement beaucoup d'esprit. Il dit que Thiers est en bonne disposition. Il espère que vous l’êtes. Il ne dénigre personne, mais il exalte le roi. La Duchesse de Talleyrand a vu le Roi hier elle est bien traitée là. Elle essaye d’être bien un peu partout. M. Salvandy va beaucoup chez elle. Ma grande Duchesse Marie épouse vraiment le Lenchtemberg, les Russes jettent les haute cris avec raison, c'est égal, il sera notre gendre. On lui prépare un beau palais à Petersbourg, il doit y arriver dans huit jours. Nous aurons l'honneur d’être cousin de Louis Bonaparte. Il entre au service de Russie, (le gendre par Louis Bonaparte).
Le comte Woronzoff s’est démis de son gouvernement de la mer noire. Il était trop populaire. On a fait sa femme ce que je suis; ou espère par là calmer son mécontentement. Je suis ravie des dîner d'Adieux. Les Adieux de Normandie ne sont pas comme les nôtres.
On s'occupe beaucoup de l’Espagne. Je ne crois pas du tout que le dénoue ment soit prochain mais je crois sûrement au triomphe définitif de Don Carlos. Selon les propos de Montrond je croirais qu'on n’est pas tout-à-fait content du duc d’Orléans, ne savez-vous quelque chose. A propos, la cour désirerait le retour des Flahaut. On trouve qu’il n’y a plus un salon à Paris, & c’est vrai. M. de Talleyrand, Madame de Broglie, Madame de Flahaut de moins, c’est beaucoup. Quelle pauvre ville que votre grande ville, quand on en est réduit à avoir besoin de Marguerite. Adieu. Adieux.
Mots-clés : Politique (France), Politique (Internationale)
167. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Est-ce que si vous étiez bien parfaitement sûre que le mal de votre situation vient de gens incurables en effet, bien vraiment incurables cela ne vous calmerait pas au lieu de vous agiter ? Excepté les peines de cœur auxquelles la nécessité, l’inévitabilité n’est pas du tout un remède, je ne connais rien d’aussi calmant que la certitude qu’il n’en peut être autrement. Il me semble que j’ai une infinité de choses, et de très bonnes choses à vous dire sur cela. Mais je ne les dirai pas de loin. Rien n’est bon de loin. Bientôt nous serons près. En attendant, je pense sans cesse à vous. Telle vous voyez Mad. de Talleyrand, telle elle a été toujours. Seulement, quand elle avait M. de Talleyrand derrière elle, cela paraissait moins. Elle ne prendra pas l’aplomb qu’elle cherche. Elle a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir qu’il lui manque, et pas assez de hauteur, de de suite dans le caractère pour l’acquérir. Rien n’est pire que de connaitre en vain son mal. Quand on n’en peut guérir, il faut l’ignorer.
Je vous ai demandé une fois, si vous preniez quelque intérêt aux Etats-Unis, à quoi vous n’avez pas répondu. Il faut bien que j’y prenne intérêt puisque je m’en occupe. Mais Washington à part, il m’est arrivé, les jours derniers de Boston une nouvelle et grande quarterly review qui ma fort étonné, tant j’y ai trouvé d’esprit, de bon et presque de grand esprit quoique un peu enthusiantic and unexperienced. C’est très supérieur à tout ce que j’avais vu de là. L’auteur est un M. Greene, jusqu’ici inconnu, pour moi du moins. Je prends un vrai plaisir à découvrir dans le monde un homme de plus. un homme, c’est un monde.
On m’écrit qu’une affaire à laquelle vous n’avez certainement jamais pensé devient pour le Cabinet un assez gros embarras, l’affaire des sucres. Vous ne savez peut-être pas qu’il y a deux sucres, deux sucres en guerre, le sucre de canne et le sucre de betterave. Ils veulent absolument. ou qu’on leur sacrifie leur rival ou qu’on les mette d’accord. Malgré, son talent de conciliation, M. Molé n’en peut venir à bout. Il y a là quelque chose de plus à faire que de donner des paroles à droite et à gauche. Les intérêts sont en présence, très positifs et très animés. Ils exigent qu’on ait un avis, une volonté. M. Duchâtel m’écrit qu’on a trouvé cette exigence par trop forte, et qu’on n’aura, ni volonté, ni avis. Je vous mande tout ce qu’on me mande. A propos de M. Duchâtel, sa femme vient d’accoucher d’un garçon. Il est bien content.
Vous ne vous doutez pas du petit plaisir que j’ai à regarder ce matin par ma fenêtre. Il fait beau, s’il n’avait pas fait beau, j’aurais eu sur les bras, pendant quatre ou cinq heures, entre les quatre murs de mon salon, les vingt hôtes que j’attends de Lisieux à déjeuner. Grace au soleil, je pourrai les mettre dehors, je veux dire les promener.
10 heures
Je ne reçois pas une ligne de vous, je ne pense pas une fois à vous sans que mon désir de me retrouver auprès de vous redouble. Enfin, j’approche. Je vous aime bien tendrement. Je ne puis pas pour vous ce que je voudrais ce que je pourrais pas la millième partie, mais enfin, de près, je puis quelque chose, je fais quelque chose. Votre tristesse me pèse bien plus quand je ne la vois pas. Je serai triste avec vous. Je serai gai pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous faire un peu de bien. Je vous aime trop pour ne pas vous faire du bien. Adieu. Adieu. G.
167. Paris, Jeudi 18 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
C’est un bien petit mot que celui que vous m’avez écrit hier ; j'espère mieux pour demain, mais je vous remercie de tout ce que vous me dites. Matonchewitz part aujourd’hui. Je n'ai jamais tant causé avec lui de ma vie que dans ces huit jours, et suis bien contente de lui. J’aurai beau coup de choses à vous dire qui ne s’écrivent pas. Les Sutherland sont venus passer la soirée chez moi hier. Je n'ai reçu à leur donner pour les divertir ; il n’y a vraiment personne à Paris. Quel hasard que Humboldt. Mon ambassadeur se calme, il croit avoir trouvé l'hotel Beauny sur la place Vendôme mais il faut deux millions et il vient de les demander à l'Empereur.
Le discours d'ouverture des états à La Haye annonce comme je crois vous l’avoir dit que la Roi a fait une démocratie conciliante au mois de mars, et que jusqu’ici il n'y a pas obtenu réponse. Il espère cependant arriver à un arrangement définitif et honorable pour la Hollande au sujet des provinces insurgées. On dit maintenant que tout sera terminée cette semaine à Londres & dans une séance de la conférence. Léopold était hier dans le salon du roi, mon ambassadeur et lui ont beaucoup parlé batailles. C’est l’anniversaire de Leipzig, gigantesque combat.
Hier il a plu tout le jour, je n’ai pas pu marcher, aujourd’hui il me faut absolument trouver le moyen de faire de l'exercice. Mes nerfs vont mal. Voilà Matonchewitz qui m’a tenue deux grande heures, & dont je viens de me séparer avec un vrai chagrin. Alava sort d'ici aussi. L'arrivée en Espagne de la Princesse de Keira, aujourd’hui reine, car elle épouse Don Carlos est un grand événement. Votre police est complaisante.
Adieu. Adieu. Je suis plus nervous que jamais, plus triste que jamais. D’après tout ce qui s’est dit entre Matonchewitz et moi, je vois que mon avenir sera affreux, & que je ne puis compter sur rien et sur personne. Quel pays, quelles gens ! Il n’y a rien de plus, rien de nouveau, seulement qu'en y regardant de bien près, nous avons trouvé que mon mari et mon frère ne sont autre chose que des courtisans, & qu’ils le resteront. Adieu. Adieu.
166. Val-Richer, Dimanche 21 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève au milieu d’un brouillard incomparable. Je ne vois pas les arbres qui sont devant mes fenêtres. Quand je me reporte en Languedoc, en Provence, sous ce ciel toujours si pur où les regards s’enfoncent sans que rien, les gênes et dont pourtant ils n’atteignent jamais le terme, je ne conçois pas comment je ne suis accoutumé à ces caves du Nord. Et je m’y suis accoutumé et je dis qu’elles sont vertes et fraîches. Il est vrai qu’elles le sont, qu’elles ont leur beauté, et que la sagesse de l’homme consiste à savoir jouir partout de la richesse de Dieu. Je le pense. Je le fais. Et pourtant je regrette, mon soleil. Il sera plaisant en effet que l’Empereur ait fait en Allemagne tout ce chemin et tout ce bruit pour y venir chercher, un Leuchtenberg. Du reste, je ne sais si c’est parce que je demeure loin ; mais il me semble que ce bruit ne retentit plus du tout. Je n’en entends plus rien. Tout passe bien vite de nos jours. Des intérêts, des affaires, qui jadis auraient rempli des mois, obtiennent à peine des heures. Les choses s’en vont comme les personnes en chemin de fer. Je le comprends il y a vingt cinq ans, dans le temps des batailles de Leipzig. Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas si riches, ni si pressés. Au fait, nous avons raison. Il ne faut pas regarder, longtemps, les petites choses, quand on a vécu dans les grandes.
Pour me distraire des petite choses, j’ai lu hier soir à mes enfants le Malade imaginaire. Vous n’avez pas d’idée de leurs transports de rire. Je posais mon livre pour les regarder. Je m’amuse de bon cœur avec mes enfants. Je jouis de leur gaieté. Mais je ne sais plus rire. Vous êtes et vous serez la dernière personne qui m’ait vraiment vu et fait aire. Par exemple je ne rirai pas demain. J’ai vingt personnes à déjeuner qui me prendront toute ma matinée. Je suis charmé que Pozzo vienne passer quelques mois à Paris. Je l’ai vu vous faire rire encore lui et Brougham. Comment a-t-il fait pour que sa maison ne soit pas confortable? Heureusement sa conversation le sera toujours. C’est donc à force d’esprit que Montrond se porte mieux. Il faut qu’il en ait vraiment beaucoup pour en conserver. Je causerai volontiers avec lui. J’ai besoin de causer. J’ai bien des choses à apprendre, et quelques unes à dire. Quoique vous m’ayiez admirablement tenu au courant. Vos lettres sont un miroir d’une vérité parfaite. Je n’ai jamais vu de source plus limpide que votre esprit. Rien ne le trouble et il coule toujours. Nous nous serons beaucoup écrit dans notre vie, beaucoup trop.
Avez-vous remarqué avec quel soin on a fait mettre dans les journaux que ce n’était pas la liste civile, mais l’Etat qui avait loué à M. Appony sa maison ? Il ne faut pas aller si vite au devant des propos. Est-il vrai que les Appony y soient déjà établis ? J’ai peine à le croire. Je suis curieux de voir comment on a arrangé cette maison-là. J’en aurais fait une habitation charmante. Je connais beaucoup l’hôtel Beanay que veut M. de Palhen. J’y ai vu le Président de la Chambre, M. Royer-Collard, et avant lui le directeur général des Ponts et Chaussées, Me Pasquier, je crois. C’est une assez grande maison, c’est-à-dire avec beaucoup de logement, mais rien de très grand, une cour médiocre, et si je ne me trompe une seule sortie. Deux millions me paraissent beaucoup. A la vérité il faut la meubler. Je n’y pensais pas. Ce n’est pas trop.
10 heures
Je suis désolé que vous dormiez toujours si mal. Est-ce que je ne trouverai pas, quand je serai là, des moyen d’y mettre ordre ? Adieu. Adieu. G.