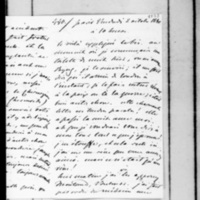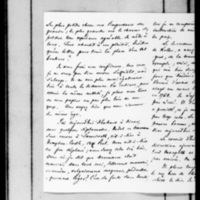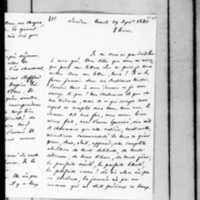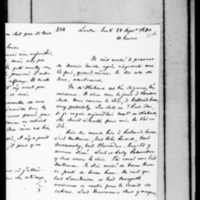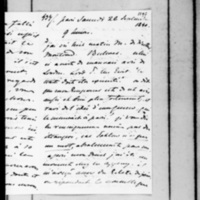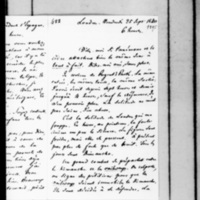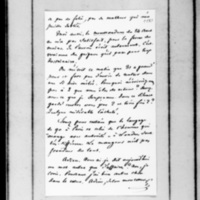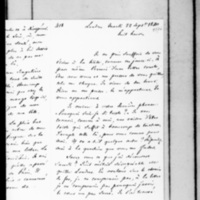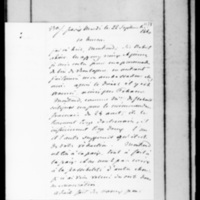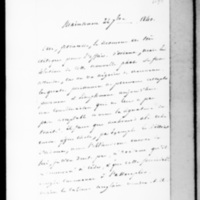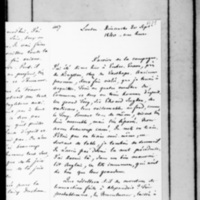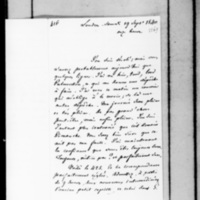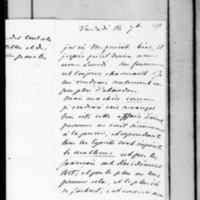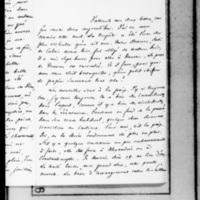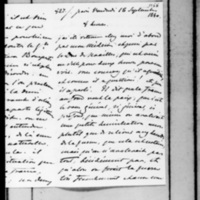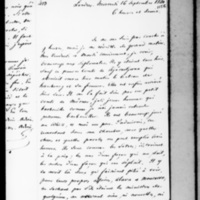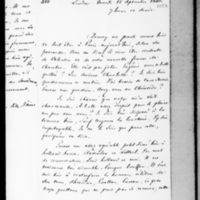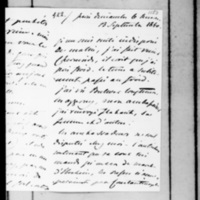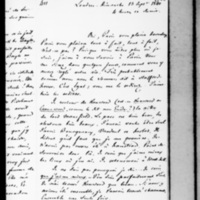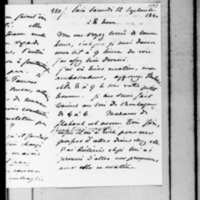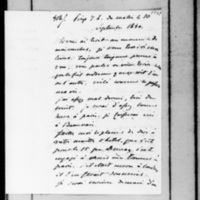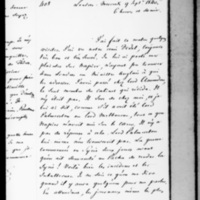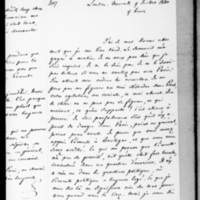Votre recherche dans le corpus : 336 résultats dans 3386 notices du site.
Trier par :
440. Paris, Vendredi 2 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
440. Paris, vendredi 2 octobre 1840,
à 10 heures
Le voilà expliqué le bis, au moment où je commençais une toilette de nuit hier, on m’annonce Byng, je le renvoie ; il me fait dire qu’il arrive de Londres à l’instant ; je le fais entrer rêvant à la paix ou à la guerre ; c’était bien autre chose. Cette charmante lettre en tendres paroles ! Elle a passé la nuit avec moi. Ah que je voudrais vous dire à mon tour tout ce que j’éprouve. J’en étouffe, et cela reste ici. J’ai eu un rêve que vous auriez aimé. Mais ce n’était qu’un rêve !
Hier matin j’ai vu les Appony, Montrond, Bulwer. J’ai fait par ordre du médecin une promenade en voiture fermée. J’ai fait dîner Pogenpohl avec moi pour le voir manger. Ensuite j’ai reçu Tshann, et mon ambassadeur. Mais toujours dans ma chambre à coucher. Le matin j’avais eu une bonne visite de votre plus fidèle. Si la question du dehors s’arrange, savez-vous que celle du dedans sera difficile à arranger. Cela me paraît bien embrouillé, bien compliqué. Le moment des chambres sera des plus curieux. Ma nièce a eu une lettre de son père, il s’annonce positivement pour le mois d’avril, et sa femme dans quinze jours, tout cela est bien pacifique. Il parait qu’on ne rêve pas à la guerre.
Que savez-vous de la disgrâce de Bülow ? Les petits diplomates allemands l’affirment. Vous ne m’étonnez pas par ce que vous me dites de Neumann c’est un gros sot, et fort impertinent ; donnez en de bonnes nouvelles à Paris pour le cas où il y viendrait. A propos les Clauricarde viennent-ils toujours ? Elle ne m’a pas écrit depuis mon départ. Il est vrai que je ne lui ai pas écrit non plus.
J’ai eu un retour de crampes cette nuit et un sot accident après. Je m’étais fait frotter rudement l’épaule et la voilà tout ensanglantée ce matin, et me faisant un mal horrible, comme si j’avais été blessée à la guerre, aussi. ai-je fait chercher le chirurgien du 10ème hussards ! (Chermside)
Midi.
Je viens de recevoir votre lettre d’avant-hier, il y a de l’espoir, il y a de l’inquiétude, un peu de tout. Un peu de gronderie à mon adresse, beaucoup d’autre chose qui n’est pas de la gronderie. J’accepte tout à tort et à travers, mais surtout la dernière partie, toujours désirée, toujours bien venue. Toujours nouvelle quoique si vieille. Voici donc Beyrouth pris. On va crier ici comme si c’était chose inattendue et inouïe. J’en suis effrayée; je suis effrayée de tout, parce qu’il faut si peu pour aller bien mal et bien loin. Vous ne sauriez concevoir le plaisir que j’ai eu à voir Byng. Il avait déjeuné avec vous Samedi. Il été fort pressé de me remettre la lettre. Il était encore en toilette de voyage. J’aime Byng. Adieu, que dois-je penser du conseil de cabinet d’hier ? Je tremble et j’espère. L’article du Times était bon, mais rien ne fait quelque chose à lord Palmerston. Je suis bien aise que vous soyez bien avec Flahaut, je ne sais encore rien de cela pour la femme, je ne l’ai point vue depuis mardi.
Adieu. Adieu, tendrement. Montrond vient souvent sans avoir rien à dire. Il est archi pacifique. Tout le monde l’est je crois, mais n’y a-t-il pas des existences politiques que la paix tuerait. Voilà ce qui m’inquiète. Adieu. Adieu.
2 heures
Dans ce moment, je m’aperçois du vendredi. Je suis enragée contre moi-même, il n’a a pas de remède, ceci ne partira que demain, je vous écris un pauvre mot mais il vous faut la vue de mon écriture, sans cela vous me croiriez morte.
Samedi 3 octobre, 11 heures.
Ma journée s’est passée à Beyrouth c-à-d. que tout le monde est venu chez moi parler de cela et rien que de cela. Le matin, les Granville, Werther, Appony, Pahlen. Le soir M. Molé. Je ne compte pas Adair et autres de cette espèce. Et bien on est bien agité, c’est à dire agité de l’agitation que cela va causé ici, comme si ce n’était pas un événement tout naturel, et très attendu. Thiers a dit hier matin à un diplomate à Auteuil : "Monsieur, c’est la guerre. " On ne le prend pas au mot, parce que vraiment il n’est pas possible qu’elle ressorte de ce fait. le conseil s’était réuni d’abord à Auteuil et puis aux Affaires étrangères. M. Molé me dit que la chambre des pairs était dans un trouble inexprimable. On ne parlait que de cela. On proposait de dresser une pétition à la couronne pour demander la convocation du chambre. M. Molé prétend s’y être opposé. Mais il parle très mal de la situation. Il dit que jamais on n’a si mal gouverné une affaire. Et puis une conduite si lâche à côté de tant de bruit, de si pitoyables réponses au général anglais.
Le dernier factum de lord Palmerston excellent, clair, une vraie pièce de cabinet. Et pas de réponse ? mais c’est incroyable. Enfin vous entendez tout ce qu’il dit. Il voudrait bien savoir bien des choses ; moi, je n’ai rien à lui apprendre. J’ai renvoyé M. Molé avant dix heures pour aller un moment chez Lady Granville. Là j’ai appris l’abdication du roi de Hollande. C’est grave aussi, parce que l’héritier est peu de chose. Tête très légère. Le monde va mal. Mais vous que faites-vous ? L’éclat de Beyrouth devrait faciliter les affaires ; on a meilleure grâce à céder quand ou a un succès. Cependant, je ne sais rien bâtir d’agréable sur ce qui peut venir de Londres. Je suis frappée ce matin du ton de Siècle et du Courrier français. Le Constitutionnel est plus prudent, il est évident qu’il attend vos nouvelles sur le conseil de jeudi. M. Molé prétendait savoir qu’on allait mobiliser la garde nationale, mesure révolutionnaire selon lui. Il croyait aussi que le ministère ne pouvait pas l’empêcher, de convoquer les chambres. Le cri public serait trop fort. Moi, je suis pour la convocation cela va sans dire ! Lord Granville était allé hier soit à St Cloud. L’ambassade anglaise est très agitée. Bulwer excessivement.
1 heure.
J’ai eu votre lettre et un long entretien, avec celui qui me l’a portée. Il vous écrit lui-même. Il voudrait que vous l’instruisiez mieux de votre volonté, de vos idées, pour qu’il puisse faire face aux entretiens qu’il a avec vos amis. Vraiment la situation devient très grave pour les choses comme pour les personnes politiques de toutes les couleurs. C’est bien difficile de deviner le dénouement de tout ceci. On dit qu’ici tout le monde est pacifique au fond, tout le monde, et je le crois mais comment arriver à cette parole décisive " la paix " au milieu de ce qui se passe et peut se passer tous les jours ?
J’approuve tout ce que vous me dites, et comme je comprends ces éclairs d’élan vers une vie tranquille, domestique ! Et moi, que de fois je l’ai souhaitée, et tout juste dans les moments les plus agitées. C’est alors que je rêvais les cottages, que j’enviais le sort des plus humbles de leurs habitants. Ah que je saurais aujourd’hui embellir cette vie là pour vous. Mais vous n’osez pas en vouloir, vous ne le pouvez pas. Je sens tout ; je suis en même temps une créature très passionnée et très sensée.
Je crois l’esprit de 20 très combattu dans ce moment, au fond il n’a pas de l’esprit tout-à-fait Il faut finir, je n’ai encore vu personne aujourd’hui. On dit, c’est votre petit ami qui me l’a dit que les ministres sont un conseil depuis huit heures ce matin. Je crois moi qu’il ne ressortira la convocation des chambres. Encore une fois, il m’est impossible de ne pas la désirer ardemment. J’ai vu chez moi Mad. de Flahaut hier, elle m’a parlé des lettres de son mari, mais elle ne vous a pas nommé. Au reste elle est très douce maintenant, et inquiète comme tout le monde.
Adieu. Adieu. Je ferme de crainte d’interruption et de retard, adieu.
à 10 heures
Le voilà expliqué le bis, au moment où je commençais une toilette de nuit hier, on m’annonce Byng, je le renvoie ; il me fait dire qu’il arrive de Londres à l’instant ; je le fais entrer rêvant à la paix ou à la guerre ; c’était bien autre chose. Cette charmante lettre en tendres paroles ! Elle a passé la nuit avec moi. Ah que je voudrais vous dire à mon tour tout ce que j’éprouve. J’en étouffe, et cela reste ici. J’ai eu un rêve que vous auriez aimé. Mais ce n’était qu’un rêve !
Hier matin j’ai vu les Appony, Montrond, Bulwer. J’ai fait par ordre du médecin une promenade en voiture fermée. J’ai fait dîner Pogenpohl avec moi pour le voir manger. Ensuite j’ai reçu Tshann, et mon ambassadeur. Mais toujours dans ma chambre à coucher. Le matin j’avais eu une bonne visite de votre plus fidèle. Si la question du dehors s’arrange, savez-vous que celle du dedans sera difficile à arranger. Cela me paraît bien embrouillé, bien compliqué. Le moment des chambres sera des plus curieux. Ma nièce a eu une lettre de son père, il s’annonce positivement pour le mois d’avril, et sa femme dans quinze jours, tout cela est bien pacifique. Il parait qu’on ne rêve pas à la guerre.
Que savez-vous de la disgrâce de Bülow ? Les petits diplomates allemands l’affirment. Vous ne m’étonnez pas par ce que vous me dites de Neumann c’est un gros sot, et fort impertinent ; donnez en de bonnes nouvelles à Paris pour le cas où il y viendrait. A propos les Clauricarde viennent-ils toujours ? Elle ne m’a pas écrit depuis mon départ. Il est vrai que je ne lui ai pas écrit non plus.
J’ai eu un retour de crampes cette nuit et un sot accident après. Je m’étais fait frotter rudement l’épaule et la voilà tout ensanglantée ce matin, et me faisant un mal horrible, comme si j’avais été blessée à la guerre, aussi. ai-je fait chercher le chirurgien du 10ème hussards ! (Chermside)
Midi.
Je viens de recevoir votre lettre d’avant-hier, il y a de l’espoir, il y a de l’inquiétude, un peu de tout. Un peu de gronderie à mon adresse, beaucoup d’autre chose qui n’est pas de la gronderie. J’accepte tout à tort et à travers, mais surtout la dernière partie, toujours désirée, toujours bien venue. Toujours nouvelle quoique si vieille. Voici donc Beyrouth pris. On va crier ici comme si c’était chose inattendue et inouïe. J’en suis effrayée; je suis effrayée de tout, parce qu’il faut si peu pour aller bien mal et bien loin. Vous ne sauriez concevoir le plaisir que j’ai eu à voir Byng. Il avait déjeuné avec vous Samedi. Il été fort pressé de me remettre la lettre. Il était encore en toilette de voyage. J’aime Byng. Adieu, que dois-je penser du conseil de cabinet d’hier ? Je tremble et j’espère. L’article du Times était bon, mais rien ne fait quelque chose à lord Palmerston. Je suis bien aise que vous soyez bien avec Flahaut, je ne sais encore rien de cela pour la femme, je ne l’ai point vue depuis mardi.
Adieu. Adieu, tendrement. Montrond vient souvent sans avoir rien à dire. Il est archi pacifique. Tout le monde l’est je crois, mais n’y a-t-il pas des existences politiques que la paix tuerait. Voilà ce qui m’inquiète. Adieu. Adieu.
2 heures
Dans ce moment, je m’aperçois du vendredi. Je suis enragée contre moi-même, il n’a a pas de remède, ceci ne partira que demain, je vous écris un pauvre mot mais il vous faut la vue de mon écriture, sans cela vous me croiriez morte.
Samedi 3 octobre, 11 heures.
Ma journée s’est passée à Beyrouth c-à-d. que tout le monde est venu chez moi parler de cela et rien que de cela. Le matin, les Granville, Werther, Appony, Pahlen. Le soir M. Molé. Je ne compte pas Adair et autres de cette espèce. Et bien on est bien agité, c’est à dire agité de l’agitation que cela va causé ici, comme si ce n’était pas un événement tout naturel, et très attendu. Thiers a dit hier matin à un diplomate à Auteuil : "Monsieur, c’est la guerre. " On ne le prend pas au mot, parce que vraiment il n’est pas possible qu’elle ressorte de ce fait. le conseil s’était réuni d’abord à Auteuil et puis aux Affaires étrangères. M. Molé me dit que la chambre des pairs était dans un trouble inexprimable. On ne parlait que de cela. On proposait de dresser une pétition à la couronne pour demander la convocation du chambre. M. Molé prétend s’y être opposé. Mais il parle très mal de la situation. Il dit que jamais on n’a si mal gouverné une affaire. Et puis une conduite si lâche à côté de tant de bruit, de si pitoyables réponses au général anglais.
Le dernier factum de lord Palmerston excellent, clair, une vraie pièce de cabinet. Et pas de réponse ? mais c’est incroyable. Enfin vous entendez tout ce qu’il dit. Il voudrait bien savoir bien des choses ; moi, je n’ai rien à lui apprendre. J’ai renvoyé M. Molé avant dix heures pour aller un moment chez Lady Granville. Là j’ai appris l’abdication du roi de Hollande. C’est grave aussi, parce que l’héritier est peu de chose. Tête très légère. Le monde va mal. Mais vous que faites-vous ? L’éclat de Beyrouth devrait faciliter les affaires ; on a meilleure grâce à céder quand ou a un succès. Cependant, je ne sais rien bâtir d’agréable sur ce qui peut venir de Londres. Je suis frappée ce matin du ton de Siècle et du Courrier français. Le Constitutionnel est plus prudent, il est évident qu’il attend vos nouvelles sur le conseil de jeudi. M. Molé prétendait savoir qu’on allait mobiliser la garde nationale, mesure révolutionnaire selon lui. Il croyait aussi que le ministère ne pouvait pas l’empêcher, de convoquer les chambres. Le cri public serait trop fort. Moi, je suis pour la convocation cela va sans dire ! Lord Granville était allé hier soit à St Cloud. L’ambassade anglaise est très agitée. Bulwer excessivement.
1 heure.
J’ai eu votre lettre et un long entretien, avec celui qui me l’a portée. Il vous écrit lui-même. Il voudrait que vous l’instruisiez mieux de votre volonté, de vos idées, pour qu’il puisse faire face aux entretiens qu’il a avec vos amis. Vraiment la situation devient très grave pour les choses comme pour les personnes politiques de toutes les couleurs. C’est bien difficile de deviner le dénouement de tout ceci. On dit qu’ici tout le monde est pacifique au fond, tout le monde, et je le crois mais comment arriver à cette parole décisive " la paix " au milieu de ce qui se passe et peut se passer tous les jours ?
J’approuve tout ce que vous me dites, et comme je comprends ces éclairs d’élan vers une vie tranquille, domestique ! Et moi, que de fois je l’ai souhaitée, et tout juste dans les moments les plus agitées. C’est alors que je rêvais les cottages, que j’enviais le sort des plus humbles de leurs habitants. Ah que je saurais aujourd’hui embellir cette vie là pour vous. Mais vous n’osez pas en vouloir, vous ne le pouvez pas. Je sens tout ; je suis en même temps une créature très passionnée et très sensée.
Je crois l’esprit de 20 très combattu dans ce moment, au fond il n’a pas de l’esprit tout-à-fait Il faut finir, je n’ai encore vu personne aujourd’hui. On dit, c’est votre petit ami qui me l’a dit que les ministres sont un conseil depuis huit heures ce matin. Je crois moi qu’il ne ressortira la convocation des chambres. Encore une fois, il m’est impossible de ne pas la désirer ardemment. J’ai vu chez moi Mad. de Flahaut hier, elle m’a parlé des lettres de son mari, mais elle ne vous a pas nommé. Au reste elle est très douce maintenant, et inquiète comme tout le monde.
Adieu. Adieu. Je ferme de crainte d’interruption et de retard, adieu.
427. Londres, Jeudi 1er octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
427. Londres, jeudi 1 Octobre 1840
8 heures
Voilà, le 1er octobre le mois nous a fait de belles promesses. Les tiendra-t-il ! Quand serai-je libre ? Vous voyez bien que je ne le suis pas. Jamais je n’ai été plus avant dans l’affaire, et l’affaire plus avant dans sa crise. Pendant qu’on fait effort ici pour une transaction, on fait effort en Orient pour une prompte exécution. D’ici à quinze jours trois semaines, l’un ou l’autre effort aura atteint un résultat. Votre vie a été comme la mienne, bien engagée dans les affaires publiques, et vous en avez le goût comme moi. Ne vous est-il pas bien souvent arrivé de porter cette chaîne avec une fatigue pleine d’impatience, et de désirer ardemment une vie toute domestique toute simple, parfaitement libre, et calme, s’il y a du calme et de la liberté en ce monde. C’est un lieu commun, bien commun ce que je dis-là, mais par moments bien exactement vrai, bien passionnément senti. Je dis par moments pour ne pas donner à ma vie passée et probablement future, un démenti ridicule, car, si je m’en croyais aujourd’hui, je croirais à la parfaite, à la constante vérité du lieu commun. Et comme vous me croirez contre toutes les apparences, je vous dirai à vous, que pour moi le bonheur domestique est le vrai, le seul bonheur, le bonheur de mon goût, la vie de mon choix, si on choisissait sa vie. Mais on appartient à sa vocation bien plus qu’a soi-même. On obéit à son caractère bien plus qu’à son goût. Je me suis porté, je me porte aux affaires publiques, comme l’eau coule, comme la flamme monte. Quand je vois, l’occasion, quand l’événement m’appelle, je ne délibère pas, je ne choisis pas, je vais à mon poste. Il y a bien de l’orgueil dans ce que je vous dis là, et en même temps, je vous assure, bien de l’humilité. Nous sommes des instruments entre les mains d’une Puissance supérieure qui nous emploie selon ou contre notre goût, à l’usage pour lequel elle nous a faits.
J’ai dîné hier à Holland house. Lord Lansdowne, lord Morpeth, lord John Russell. Les deux premiers arrivent pour le conseil d’aujourd’hui. Ils viennent de loin, et fort contre leur gré. Je suis fâché de ne pas connaitre davantage lord Morpeth. Il me plait. Il a l’air d’un cœur simple, droit et haut. J’étais en train de pénétrer dans l’intérieur de cette famille là quand la mort de Lady Burlington est venue fermer les portes. Je les ai pourtant franchies bien souvent depuis ces portes de Stafford house, et avec quel plaisir !
2 heures
437 en aussi bon que long. Merci de vos détails. Ils m’importent beaucoup. Il n’est pas vrai qu’on s’échauffe ici contre la France. C’est un langage convenu. Je crois plutôt que les idées de transaction, le désir d’une transaction sont en progrès dans le public. Petit progrès pourtant, car le public y pense peu. Il n’y a ici point d’opinion claire, forte, qui impose au gouvernement la paix ou la guerre. Il sera bien responsable de ce qu’il fera, car il fera ce qu’il voudra. La question est entre les mains des hommes qui gouvernent. Leur esprit, ou leurs passions en décideront. Quant à la France, personne n’est plus convaincu que moi, par les raisons que vous me dites et par d’autres encore, qu’elle ne doit point provoquer à la guerre, prendre l’initiative de la guerre. Une politique défensive, une position défensive, c’est ce qui nous convient. Mais défensive pour notre dignité comme pour notre sûreté.
Or il peut se passer en Orient, par suite de la situation qu’on y a faite des événements, des actes qui compromettent notre dignité, et par suite notre sûreté. Nous ne devrions pas les accepter. Nous nous préparons non pour accomplir des desseins, mais pour faire face à des chances. Voilà mon abus, et mon langage. On le croit, si je ne me trompe, sincère et sérieux. Je ne m’étonne pas de l’attitude des légitimistes. Ce qu’il y a de plus incurable dans les partis, c’est l’infatuation de l’espérance. Bien pure infatuation, Soyez en sûre. Je ne me promènerai pas aujourd’hui, pas même seul. Il fait froid et sombre. J’aime mieux rester chez moi, à écrire ou à rêver.
Adieu. Je suppose que vous saurez aujourd’hui le secret du bis. Adieu. Adieu.
8 heures
Voilà, le 1er octobre le mois nous a fait de belles promesses. Les tiendra-t-il ! Quand serai-je libre ? Vous voyez bien que je ne le suis pas. Jamais je n’ai été plus avant dans l’affaire, et l’affaire plus avant dans sa crise. Pendant qu’on fait effort ici pour une transaction, on fait effort en Orient pour une prompte exécution. D’ici à quinze jours trois semaines, l’un ou l’autre effort aura atteint un résultat. Votre vie a été comme la mienne, bien engagée dans les affaires publiques, et vous en avez le goût comme moi. Ne vous est-il pas bien souvent arrivé de porter cette chaîne avec une fatigue pleine d’impatience, et de désirer ardemment une vie toute domestique toute simple, parfaitement libre, et calme, s’il y a du calme et de la liberté en ce monde. C’est un lieu commun, bien commun ce que je dis-là, mais par moments bien exactement vrai, bien passionnément senti. Je dis par moments pour ne pas donner à ma vie passée et probablement future, un démenti ridicule, car, si je m’en croyais aujourd’hui, je croirais à la parfaite, à la constante vérité du lieu commun. Et comme vous me croirez contre toutes les apparences, je vous dirai à vous, que pour moi le bonheur domestique est le vrai, le seul bonheur, le bonheur de mon goût, la vie de mon choix, si on choisissait sa vie. Mais on appartient à sa vocation bien plus qu’a soi-même. On obéit à son caractère bien plus qu’à son goût. Je me suis porté, je me porte aux affaires publiques, comme l’eau coule, comme la flamme monte. Quand je vois, l’occasion, quand l’événement m’appelle, je ne délibère pas, je ne choisis pas, je vais à mon poste. Il y a bien de l’orgueil dans ce que je vous dis là, et en même temps, je vous assure, bien de l’humilité. Nous sommes des instruments entre les mains d’une Puissance supérieure qui nous emploie selon ou contre notre goût, à l’usage pour lequel elle nous a faits.
J’ai dîné hier à Holland house. Lord Lansdowne, lord Morpeth, lord John Russell. Les deux premiers arrivent pour le conseil d’aujourd’hui. Ils viennent de loin, et fort contre leur gré. Je suis fâché de ne pas connaitre davantage lord Morpeth. Il me plait. Il a l’air d’un cœur simple, droit et haut. J’étais en train de pénétrer dans l’intérieur de cette famille là quand la mort de Lady Burlington est venue fermer les portes. Je les ai pourtant franchies bien souvent depuis ces portes de Stafford house, et avec quel plaisir !
2 heures
437 en aussi bon que long. Merci de vos détails. Ils m’importent beaucoup. Il n’est pas vrai qu’on s’échauffe ici contre la France. C’est un langage convenu. Je crois plutôt que les idées de transaction, le désir d’une transaction sont en progrès dans le public. Petit progrès pourtant, car le public y pense peu. Il n’y a ici point d’opinion claire, forte, qui impose au gouvernement la paix ou la guerre. Il sera bien responsable de ce qu’il fera, car il fera ce qu’il voudra. La question est entre les mains des hommes qui gouvernent. Leur esprit, ou leurs passions en décideront. Quant à la France, personne n’est plus convaincu que moi, par les raisons que vous me dites et par d’autres encore, qu’elle ne doit point provoquer à la guerre, prendre l’initiative de la guerre. Une politique défensive, une position défensive, c’est ce qui nous convient. Mais défensive pour notre dignité comme pour notre sûreté.
Or il peut se passer en Orient, par suite de la situation qu’on y a faite des événements, des actes qui compromettent notre dignité, et par suite notre sûreté. Nous ne devrions pas les accepter. Nous nous préparons non pour accomplir des desseins, mais pour faire face à des chances. Voilà mon abus, et mon langage. On le croit, si je ne me trompe, sincère et sérieux. Je ne m’étonne pas de l’attitude des légitimistes. Ce qu’il y a de plus incurable dans les partis, c’est l’infatuation de l’espérance. Bien pure infatuation, Soyez en sûre. Je ne me promènerai pas aujourd’hui, pas même seul. Il fait froid et sombre. J’aime mieux rester chez moi, à écrire ou à rêver.
Adieu. Je suppose que vous saurez aujourd’hui le secret du bis. Adieu. Adieu.
439. Paris, Jeudi 1er octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
439. Paris, Jeudi 1er octobre 1840
9 heures
Vous m’avez promis que le mois serait beau. J’y compte. J’ai bien dormi, les douleurs sont presque passées. Enfin n’y pensez plus, mais comptez. que je suis docile que je me soigne. Votre lettre est venue hier au moment où la mienne partait, elle ne m’a guère éclairée sur la situation, vous ne dites pas un mot qui me guide.
J’ai appris hier soir que le conseil devait être remis à Jeudi, aujourd’hui. Je meurs d’impatience et d’inquiétude. j’ai vu hier mon ambassadeur celui d’Angleterre, trois fois Bulwer, quatre fois M de Pogenpohl. Ces deux là étaient inquiets de moi. Le soir M. Molé. J’étais levé c-à-d couchée sur ma chaise longue. Les ambassadeurs anxieux.
M. Molé est fort maigri. Vous jugez ce qu’a été son langage. S’il était aux affaires, s’il y était resté, tout était autrement? Jamais l’alliance anglaise ne se fût brisé entre ses mains ; on n’a fait que des fautes ; mais il faut que je convienne qu’il attaque le maréchal Soult un peu plus encore que M. Thiers quant à la conduite. Mais de l’affaire d’Orient, il est plus préoccupé de l’intérieur encore que du dehors. La situation des partis, le manque de chef au parti conservateur, l’éparpillement des doctrinaires. L’infatuation du roi pour M. Thiers. Car le roi coule des jours tranquilles, plus d’attentats, plus d’attaque dans les journaux. Son ministre le couvre, le garantit de tout cela. Mais voici l’étrangeté du roi, après avoir passé des années à montrer Thiers aux puissances étrangères comme un révolutionnaire, ennemi de sa personne, ennemi de son trône, de tous les trônes, il s’étonne que les puissances étrangères ne veulent pas. accepter M. Thiers comme un excellent ministre. Il se fâche, il s’importe.
Molé dit comme beaucoup de monde, " Mais si on ne s’arrange pas comment fera-t-on pour avoir la guerre ? Il n’y a ni sens, ni raison à la faire pour la Syrie. Par quel bout commencer ? où, quoi ? Tout ceci est insensé, absurde. Il n’y a plus un homme en Europe. ( Il y a quelques temps déjà que je me permets cette réflexion. ) De vous il dit qu’on a beaucoup répandu que vous avez été pris au dépourvu, mais qu’il n’en croyait rien, et que d’ailleurs, il y avait des preuves.
Je sais par 29 que 62 est très content de 6. 14 parle très bien du cèdre, de ses principes, il les croit inébranlables très dédaigneusement de beaucoup de petits arbrisseaux surtout de 77. Mais il en reste de bons. Il espère beaucoup que le hêtre sera ici quand la compagnie ce ressemble, et regarde même cela comme indispensable La violette a été très réservée malgré beaucoup de tentations, car on revenait toujours sur ce qui la préoccupe le plus. Midi. Voici la lettre de mardi encore pas un mot qui me fasse jusqu’ici vous avez la moindre espérance de transaction. Vous me traitez trop mal, et il y a vraiment trop d’exagération dans votre prudence.
Votre vue s’allonge parce que vous écrivez trop, pas à moi, à d’autres. M. Molé m’a dit que Berryer avait été pitoyable, très au dessus de lui-même. Je viens de lire son discours et je trouve des passages magnifiques, sublimes. Je suis sûr que vous le trouvez aussi, et aux mêmes endroits. Et je comprends un peu que Molé ne les loue pas. M. Molé pour me homme d’esprit dit quelques fois des pauvretés, et compte trop qu’il parle des sots. Hier encore cette réflexion m’a frappée. Il est désintéressé dans son jugement. Il serait très malheureux d’être appelé aux affaires. Il ne sait pas ce qui se passe, il ne cause avec personne." J’avais envie de lui dire : " mais employons donc mieux notre temps car je ne crois pas un mot de ce que vous me dites.
La partie du discours de Berryer que j’admire parfaitement est ce qui commence à : " Le pouvoir en France est aujourd’hui confié, à un ministère dont l’origine est récente" & & & et qui finit à " et quiconque devant dieu devant le pays me dira : "S’il eût réussi je l’aurais nié ce droit. " Celui-là, je l’accepte pour juge. " J’ai été fort contente du leading article des Débats hier. C’est Le langage d’un cabinet bien plutôt que d’un journaliste. Vous savez que j’attends toujours l’explication du bis. On dit dans le monde que vous allez faire partir l’amiral Duperré avec mission d’empêcher la jonction de la flotte russe avec la flotte anglaise. Mais vient elle cette flotte russe ? On dit aussi que vous embarquez des troupes sur vos vaisseaux.
2 heures
Je ne reviens à vous que pour vous dire adieu. Adieu mille fois adieu. Le meilleur, le plus tendre. Voici les Appony. Adieu.
3 h. Sébastiani aura le bâton de Maréchal. Il y a eu quelqu’embarras mais que le roi a surmonté. Montrond sort d’ici.
9 heures
Vous m’avez promis que le mois serait beau. J’y compte. J’ai bien dormi, les douleurs sont presque passées. Enfin n’y pensez plus, mais comptez. que je suis docile que je me soigne. Votre lettre est venue hier au moment où la mienne partait, elle ne m’a guère éclairée sur la situation, vous ne dites pas un mot qui me guide.
J’ai appris hier soir que le conseil devait être remis à Jeudi, aujourd’hui. Je meurs d’impatience et d’inquiétude. j’ai vu hier mon ambassadeur celui d’Angleterre, trois fois Bulwer, quatre fois M de Pogenpohl. Ces deux là étaient inquiets de moi. Le soir M. Molé. J’étais levé c-à-d couchée sur ma chaise longue. Les ambassadeurs anxieux.
M. Molé est fort maigri. Vous jugez ce qu’a été son langage. S’il était aux affaires, s’il y était resté, tout était autrement? Jamais l’alliance anglaise ne se fût brisé entre ses mains ; on n’a fait que des fautes ; mais il faut que je convienne qu’il attaque le maréchal Soult un peu plus encore que M. Thiers quant à la conduite. Mais de l’affaire d’Orient, il est plus préoccupé de l’intérieur encore que du dehors. La situation des partis, le manque de chef au parti conservateur, l’éparpillement des doctrinaires. L’infatuation du roi pour M. Thiers. Car le roi coule des jours tranquilles, plus d’attentats, plus d’attaque dans les journaux. Son ministre le couvre, le garantit de tout cela. Mais voici l’étrangeté du roi, après avoir passé des années à montrer Thiers aux puissances étrangères comme un révolutionnaire, ennemi de sa personne, ennemi de son trône, de tous les trônes, il s’étonne que les puissances étrangères ne veulent pas. accepter M. Thiers comme un excellent ministre. Il se fâche, il s’importe.
Molé dit comme beaucoup de monde, " Mais si on ne s’arrange pas comment fera-t-on pour avoir la guerre ? Il n’y a ni sens, ni raison à la faire pour la Syrie. Par quel bout commencer ? où, quoi ? Tout ceci est insensé, absurde. Il n’y a plus un homme en Europe. ( Il y a quelques temps déjà que je me permets cette réflexion. ) De vous il dit qu’on a beaucoup répandu que vous avez été pris au dépourvu, mais qu’il n’en croyait rien, et que d’ailleurs, il y avait des preuves.
Je sais par 29 que 62 est très content de 6. 14 parle très bien du cèdre, de ses principes, il les croit inébranlables très dédaigneusement de beaucoup de petits arbrisseaux surtout de 77. Mais il en reste de bons. Il espère beaucoup que le hêtre sera ici quand la compagnie ce ressemble, et regarde même cela comme indispensable La violette a été très réservée malgré beaucoup de tentations, car on revenait toujours sur ce qui la préoccupe le plus. Midi. Voici la lettre de mardi encore pas un mot qui me fasse jusqu’ici vous avez la moindre espérance de transaction. Vous me traitez trop mal, et il y a vraiment trop d’exagération dans votre prudence.
Votre vue s’allonge parce que vous écrivez trop, pas à moi, à d’autres. M. Molé m’a dit que Berryer avait été pitoyable, très au dessus de lui-même. Je viens de lire son discours et je trouve des passages magnifiques, sublimes. Je suis sûr que vous le trouvez aussi, et aux mêmes endroits. Et je comprends un peu que Molé ne les loue pas. M. Molé pour me homme d’esprit dit quelques fois des pauvretés, et compte trop qu’il parle des sots. Hier encore cette réflexion m’a frappée. Il est désintéressé dans son jugement. Il serait très malheureux d’être appelé aux affaires. Il ne sait pas ce qui se passe, il ne cause avec personne." J’avais envie de lui dire : " mais employons donc mieux notre temps car je ne crois pas un mot de ce que vous me dites.
La partie du discours de Berryer que j’admire parfaitement est ce qui commence à : " Le pouvoir en France est aujourd’hui confié, à un ministère dont l’origine est récente" & & & et qui finit à " et quiconque devant dieu devant le pays me dira : "S’il eût réussi je l’aurais nié ce droit. " Celui-là, je l’accepte pour juge. " J’ai été fort contente du leading article des Débats hier. C’est Le langage d’un cabinet bien plutôt que d’un journaliste. Vous savez que j’attends toujours l’explication du bis. On dit dans le monde que vous allez faire partir l’amiral Duperré avec mission d’empêcher la jonction de la flotte russe avec la flotte anglaise. Mais vient elle cette flotte russe ? On dit aussi que vous embarquez des troupes sur vos vaisseaux.
2 heures
Je ne reviens à vous que pour vous dire adieu. Adieu mille fois adieu. Le meilleur, le plus tendre. Voici les Appony. Adieu.
3 h. Sébastiani aura le bâton de Maréchal. Il y a eu quelqu’embarras mais que le roi a surmonté. Montrond sort d’ici.
438. Paris, Le 30 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
438. Paris, le 30 septembre 1840
Midi
Je vais vous dire toute la vérité à la condition que vous ne vous inquiéterez point. J’ai été saisie cette nuit de crampes au cœur et à la poitrine assez vives pour m’obliger à faire venir mon médecin il est venu à cinq heures. Il m’a fait faire des frictions, prendre des potions pour me faire transpirer. Cela a réussi, mais le mal est encore là. Je ne puis ni parler, en respirer librement. Je suis levée depuis un quart d’heure, on refait mon lit. Le médecin dit que c’est un cold pas autre chose. Je n’ai pas de fièvre. Eh bien vous savez tout et vous attendrez demain sans la moindre inquiétude. Mais je ne puis pas écrire longtemps.
Et j’avais tant à dire aujourd’hui 30 ! Au milieu de mes douleurs cette nuit, cette date m’est revenue à l’esprit et bien le croiriez-vous ? Je ne sais plus me rappeler ce qui s’est dit, ce qui s’est passé. Pas un détail mais le mot, l’idée, si vifs si profonds dans mon cœur. Je répète les 30 avec tant de passion. J’attends encore l’explication du bis, et j’attends encore la lettre qui doit être venue aujourd’hui. Dimanche il y avait quatre semaines depuis le 30. Dimanche prochain, il y aura quatre semaines de mon départ, je crois qu’il y a quatre ans Dans d’autres moments je crois que c’était hier. nous ne savons rien régler en nous. Nos imperfections sont si de diverses.
Adieu, il faut que je finisse. Je n’ai rien à vous dire. On attend ici avec anxiété. M. de Flahaut a écrit qu’il avait bon espoir à la suite d’un long entretien avec lord Palrmerston. J’espère qu’il n’ajoutera pas à la confusion. Je ne sais si je dois rien espérer du conseil. La seule chose sûre c’est que cet état d’incertitude ne saurait le prolonger, tout est trop tendre.
Fleischmann m’a bien confirmé ce que je vous disais hier je crois. L’Allemagne est très heureuse très peu remuer révolutionnairement parlant Elle sera fort unie pour le défense. Dieu garde que vous l’y forciez. Une longue visite hier du prince Paul de Wurtemberg ; bon a entendre, raisonnant juste, et voyant noir comme tout le monde. comme tout le monde. M. de Broglie repart pour la Suisse tout de suite presque, car le procès va être fini. On dit que c’est pitoyable ce procès.
Adieu, envoyez-moi, la paix, je vous enverrai demain ma convalescence j’espère adieu. Adieu comme le 30 aussi sérieux, aussi éternel.
Midi
Je vais vous dire toute la vérité à la condition que vous ne vous inquiéterez point. J’ai été saisie cette nuit de crampes au cœur et à la poitrine assez vives pour m’obliger à faire venir mon médecin il est venu à cinq heures. Il m’a fait faire des frictions, prendre des potions pour me faire transpirer. Cela a réussi, mais le mal est encore là. Je ne puis ni parler, en respirer librement. Je suis levée depuis un quart d’heure, on refait mon lit. Le médecin dit que c’est un cold pas autre chose. Je n’ai pas de fièvre. Eh bien vous savez tout et vous attendrez demain sans la moindre inquiétude. Mais je ne puis pas écrire longtemps.
Et j’avais tant à dire aujourd’hui 30 ! Au milieu de mes douleurs cette nuit, cette date m’est revenue à l’esprit et bien le croiriez-vous ? Je ne sais plus me rappeler ce qui s’est dit, ce qui s’est passé. Pas un détail mais le mot, l’idée, si vifs si profonds dans mon cœur. Je répète les 30 avec tant de passion. J’attends encore l’explication du bis, et j’attends encore la lettre qui doit être venue aujourd’hui. Dimanche il y avait quatre semaines depuis le 30. Dimanche prochain, il y aura quatre semaines de mon départ, je crois qu’il y a quatre ans Dans d’autres moments je crois que c’était hier. nous ne savons rien régler en nous. Nos imperfections sont si de diverses.
Adieu, il faut que je finisse. Je n’ai rien à vous dire. On attend ici avec anxiété. M. de Flahaut a écrit qu’il avait bon espoir à la suite d’un long entretien avec lord Palrmerston. J’espère qu’il n’ajoutera pas à la confusion. Je ne sais si je dois rien espérer du conseil. La seule chose sûre c’est que cet état d’incertitude ne saurait le prolonger, tout est trop tendre.
Fleischmann m’a bien confirmé ce que je vous disais hier je crois. L’Allemagne est très heureuse très peu remuer révolutionnairement parlant Elle sera fort unie pour le défense. Dieu garde que vous l’y forciez. Une longue visite hier du prince Paul de Wurtemberg ; bon a entendre, raisonnant juste, et voyant noir comme tout le monde. comme tout le monde. M. de Broglie repart pour la Suisse tout de suite presque, car le procès va être fini. On dit que c’est pitoyable ce procès.
Adieu, envoyez-moi, la paix, je vous enverrai demain ma convalescence j’espère adieu. Adieu comme le 30 aussi sérieux, aussi éternel.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Procès, Relation François-Dorothée, Santé (Dorothée)
426. Londres, Mercredi 30 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
426. Londres, Mercredi 30 septembre 1840
Une heure
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levé des ennuyeux et des utiles. Je vois beaucoup de monde depuis quelques jours. Je cause beaucoup. Hier soir j’avais un rout. Et je voudrais bien causer davantage. Si je pouvais passer ma vie pendant quinze jours avec trois ou quatre hommes, avec deux hommes, je ne puis m’empêcher de croire que je persuaderais, que je ferais trouver des moyens de sortir d’embarras, car on se sent dans l’embarras et on a envie d’en sortir. Et selon moi, il y a moyen, sans humiliation pour personne. C’est là le problème. Mais comment en fournir la solution, quelques minutes et avec quelques paroles, à des gens qui ne la trouvent pas eux-mêmes ? qui ne trouvent rien eux-mêmes ?
J’ai rarement vu, si peu d’invention avec tant de bonne volonté. J’ai déjà brusqué bien des choses ces jours-ci troublé bien des indolences, dérangé bien des habitudes. Je continue. Mais les événements continuent aussi, et je crains qu’ils n’aillent plus vite que moi. Je persiste pourtant. Je ne crois pas à la guerre. J’entends à la guerre volontairement choisie et engagée. C’est trop fou. Quant à la guerre forcée, la guerre venue par hasard, commencée sans dessein, c’est celle-la que je redoute. Et c’est de cette crainte là que je m’arme pour pousser à une transaction. Personne n’a de réponse à cela. Je suis convaincu que Flahaut écrira très bien d’ici, c’est-à-dire qu’il voudra avoir écrit très bien. Je suis bien pour lui. Il est fort inquiet, Point belliqueux lui-même.
Le 436 est charmant, la dernière moitié. Je suis désolé de ce jour vide. Je prends mille précautions ; je donne mille instructions. Il n’y a pas moyen de pourvoir à tout. Il n’y a pas moyen d’inspirer aux tiers, mon désir d’arriver, votre désir de recevoir. Personne personne au monde n’a la mesure de ce désir, de ce plaisir. Je n’ai rien à pardonner. Je n’ai pas été fâché du tout. Mon Adieu qui ne ressemble à nul autre, c’est qu’il est plus, non pas autre. Voilà comment j’ai interprète votre special. Jurez que vous ne retomberez pas, et puis retombez tant que vous voudrez. Je ne puis plus prendre vos chutes au sérieux. C’est impossible que vous les preniez vous-même au sérieux. Il y a des régions où le soleil ne se couche plus, où tout est toujours parfaitement clair. Nous y sommes arrivés vous et moi. Nous y sommes établis. Tout-à-fait, c’est tout-à-fait. Et votre oui, c’est tout-à-fait oui. Je le lis de votre main. Je me le redis de ma propre voix, pour l’entendre comme si vous me le disiez. Oui, oui.
3 heures
Je trouve que, pour une personne d’autant d’esprit et d’expérience vous vous laissez trop prendre à deux choses, à la comédie du langage, aux vicissitudes de la situation. On ment immensément ; on change de mensonge tous les jours ; on est doux, on est aigre, on croit à la paix ; à la guerre, selon l’intérêt, la manœuvre, la fantaisie du moment. Intérêt bien petit, manœuvre, fantaisie bien passagère, mais qui n’en fait pas moins dire blanc aujourd’hui noir demain. Et la situation elle-même flotte beaucoup ; elle va en haut, en bas, à droite, à gauche. Il ne faut pas laisser baletter son propre esprit selon le bavardage des hommes et ces ondulations des choses. Il y a un fond de vérité, une pente réelle et définitive des évènements. C’est là ce qu’il faut jeter l’ancre, et s’y tenir, et assister de là au mensonge des paroles et à la fluctuation des incidents quotidiens. Je suppose qu’au fond je vous prêche là assez sottement, et que vous me tenez au courant de tout ce qu’on vous dit, bien plutôt que vous n’y croyez vous-même. Pourtant retenez, je vous prie, quelque chose de mon sermon. Vous vous laissez trop affecter par le petit va-et-vient des conversations et des nouvelles. Et votre disposition à vous, triste ou gaie, confiante ou abattue, a pour moi tant d’importance que dans tout ce que vous me mandez la première chose que je vois et qui m’intéresse, cest l’impression que vous en avez reçue. J’ai de bonnes nouvelles du duc de Broglie. Inquiet, mais pensant sur toutes choses, tout-à-fait comme moi. Cela m’importe toujours, et surtout en ce moment. Adieu. Adieu.
Une heure
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levé des ennuyeux et des utiles. Je vois beaucoup de monde depuis quelques jours. Je cause beaucoup. Hier soir j’avais un rout. Et je voudrais bien causer davantage. Si je pouvais passer ma vie pendant quinze jours avec trois ou quatre hommes, avec deux hommes, je ne puis m’empêcher de croire que je persuaderais, que je ferais trouver des moyens de sortir d’embarras, car on se sent dans l’embarras et on a envie d’en sortir. Et selon moi, il y a moyen, sans humiliation pour personne. C’est là le problème. Mais comment en fournir la solution, quelques minutes et avec quelques paroles, à des gens qui ne la trouvent pas eux-mêmes ? qui ne trouvent rien eux-mêmes ?
J’ai rarement vu, si peu d’invention avec tant de bonne volonté. J’ai déjà brusqué bien des choses ces jours-ci troublé bien des indolences, dérangé bien des habitudes. Je continue. Mais les événements continuent aussi, et je crains qu’ils n’aillent plus vite que moi. Je persiste pourtant. Je ne crois pas à la guerre. J’entends à la guerre volontairement choisie et engagée. C’est trop fou. Quant à la guerre forcée, la guerre venue par hasard, commencée sans dessein, c’est celle-la que je redoute. Et c’est de cette crainte là que je m’arme pour pousser à une transaction. Personne n’a de réponse à cela. Je suis convaincu que Flahaut écrira très bien d’ici, c’est-à-dire qu’il voudra avoir écrit très bien. Je suis bien pour lui. Il est fort inquiet, Point belliqueux lui-même.
Le 436 est charmant, la dernière moitié. Je suis désolé de ce jour vide. Je prends mille précautions ; je donne mille instructions. Il n’y a pas moyen de pourvoir à tout. Il n’y a pas moyen d’inspirer aux tiers, mon désir d’arriver, votre désir de recevoir. Personne personne au monde n’a la mesure de ce désir, de ce plaisir. Je n’ai rien à pardonner. Je n’ai pas été fâché du tout. Mon Adieu qui ne ressemble à nul autre, c’est qu’il est plus, non pas autre. Voilà comment j’ai interprète votre special. Jurez que vous ne retomberez pas, et puis retombez tant que vous voudrez. Je ne puis plus prendre vos chutes au sérieux. C’est impossible que vous les preniez vous-même au sérieux. Il y a des régions où le soleil ne se couche plus, où tout est toujours parfaitement clair. Nous y sommes arrivés vous et moi. Nous y sommes établis. Tout-à-fait, c’est tout-à-fait. Et votre oui, c’est tout-à-fait oui. Je le lis de votre main. Je me le redis de ma propre voix, pour l’entendre comme si vous me le disiez. Oui, oui.
3 heures
Je trouve que, pour une personne d’autant d’esprit et d’expérience vous vous laissez trop prendre à deux choses, à la comédie du langage, aux vicissitudes de la situation. On ment immensément ; on change de mensonge tous les jours ; on est doux, on est aigre, on croit à la paix ; à la guerre, selon l’intérêt, la manœuvre, la fantaisie du moment. Intérêt bien petit, manœuvre, fantaisie bien passagère, mais qui n’en fait pas moins dire blanc aujourd’hui noir demain. Et la situation elle-même flotte beaucoup ; elle va en haut, en bas, à droite, à gauche. Il ne faut pas laisser baletter son propre esprit selon le bavardage des hommes et ces ondulations des choses. Il y a un fond de vérité, une pente réelle et définitive des évènements. C’est là ce qu’il faut jeter l’ancre, et s’y tenir, et assister de là au mensonge des paroles et à la fluctuation des incidents quotidiens. Je suppose qu’au fond je vous prêche là assez sottement, et que vous me tenez au courant de tout ce qu’on vous dit, bien plutôt que vous n’y croyez vous-même. Pourtant retenez, je vous prie, quelque chose de mon sermon. Vous vous laissez trop affecter par le petit va-et-vient des conversations et des nouvelles. Et votre disposition à vous, triste ou gaie, confiante ou abattue, a pour moi tant d’importance que dans tout ce que vous me mandez la première chose que je vois et qui m’intéresse, cest l’impression que vous en avez reçue. J’ai de bonnes nouvelles du duc de Broglie. Inquiet, mais pensant sur toutes choses, tout-à-fait comme moi. Cela m’importe toujours, et surtout en ce moment. Adieu. Adieu.
437. Paris, Mardi 29 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
437. Paris Mardi 29 septembre 1840
9 heures
Cet abominable mardi ; il revient tous les jours ! Pourvu que demain j’aie ma lettre de bonne heure. Je ne vis plus que pour vos lettres. J’ai fait hier ma promenade avec Mad. Durrazo. Vous ne savez pas qu’elle a de l’esprit, beaucoup de finesse, de drôlerie, et qu’elle est le meilleur mime possible. Avant de rentrer, j’ai passé chez Mad. Appony. Hemmelauer qui a passé ici raconte que l’opinion en Angleterre est très vive contre la France et qu’il y a bien peu de vraisemblance à ce que l’affaire puisse s’arranger. Nos pauvres diplomates sont fort tristes et fort tourmentés. Ce sont de très braves gens et qui animent beaucoup Paris !
En traversant la place Louis XV pour rentrer je rencontre Thiers en voiture, qui fait arrêter la voiture et la mienne tout simplement et qui d’un bond s’est trouvé dans ma calèche. Nous sommes restés dix minutes exposés au public. Il m’a dit courtement : " Si le traité s’exécute vous avez la guerre c’est certain." Je lui ai dit que personne de nous en songeait à la lui faire, et que je ne voyais pas comment elle pourrait commencer. " Ah cela, c’est mon affaire. Vous verrez. " Et puis il m’a dit que le roi était furieux, la reine extrêmement, toute la famille. Qu’il était occupé du matin au soir, que tous les jours il veut venir me voir, qu’il viendra, et des tendresses ; personne n’a été nommé. Il m’a demandé ce qu’on me mandait d’Angleterre. Je lui ai dit que les esprits étaient très montés contre la France depuis peu de jours. Il me dit que les rapports sur ce sujet étaient contradictoires. Et nous verrons. Voilà la conversation.
J’ai dîné comme de coutume. Il me semble que je mange ma perdrix mais à me regarder, je croirais plutôt que c’est elle qui me mange. Après le dîner la calèche encore. Je me fais traîner le long du boulevard. C’est si animé, si gai. Je pense à Londres. Je me fâche de regarder quelque chose de gai lorsque vous n’avez que du morne et du triste. Vraiment, je ne conçois pas qu’un français puisse habiter Londres et puis pour tout étranger j’ai toujours pensé qu’on ne peut vivre à Londres que lorsqu’on a un intérieur, des enfants, du bonheur autour de soi, dans sa maison ; alors, et une grande situation pas dessus le marché cela va, surtout. Quand on n’a pas habité Paris. Mais vous, vous ! Vous ne sauriez vous figurer. A quel point je vous plains et je m’en veux de vous avoir quitté. Ah si j’avais pu rester ! Il faut bien que je me répète que c’était impossible. Votre promenade au Regent’s park seul. Cela me fend le cœur, et cet air de Londres si lourd, si gris !
N’est-ce pas que vous comprenez qu’un pauvre diable aille se pendre au mois de novembre ? Mon ambassadeur est venu à 10 heures, il me quitte parce que c’est toujours encore l’heure où je me couche, ma porte est encore fermée à tout le monde. Nous ne parlons que d’une seule et même chose nous ne parlons fort tristement tous les deux. Il admet aujourd’hui la guerre sans la comprendre. Mais enfin la voilà, partant de là il la veut bien forte et bien courte. Encore une fois toute l’Europe, et quelque chose de pire que l’année 15 ? En vérité, c’est très possible. Il y aura bien quelques mauvaises têtes, mais elles sont bien plus rares aujourd’hui qu’elles n’étaient il y a 10 ans
L’exemple de la France n’est par dangereux. Quel degré de plus de liberté y a-t-il que sous les anciens Bourbons. Qu’est-ce que les pays gagnent à se mettre en révolution? Et l’Espagne ! On regarde tout cela, on a réfléchi à tout cela, et vous trouvez peu de sympathies révolutionnaires. C’est sur cela cependant que vous devez compter. Si ce moyen vous manque, et il vous manquera, qui peut douter que l’Europe résolue comme elle l’était alors, ne fasse, comme alors succomber la France ? vraiment la carrière est plus aventureuse pour la France peu pour les autres. S’il y a des gens légers, présomptueux. Autre part, il y en a bien ici aussi. Pensez à tout cela avec votre immense raison et votre impartialité très rare. Est-on engagé assez loin pour ne pas pouvoir trouver des moyens d’éviter un grand fléau ? La situation est mauvaise. Vous faites bien de prendre des mesures à tout événement. Vous avez bien quelque motif de ressentiment quant aux procédés, aux manières, mais de là à faire la guerre, à la provoquer ! Il y a trop loin. Personne ne vous attaquera, tenez cela pour certain ; on vous laissera. à vous tout le tort de la provocation, et il soulèvera contre vous, sincèrement, toute l’Europe. Je pense et repense sans cesse à tout cela.
10 h 1/2
Quelle surprise charmante ! Cher Simon ! J’ai failli l’embrasser. Vos douces paroles me font du bien en effet beaucoup de bien. Je me soigne ; je me soignerai. Je veux que vous me retrouviez mieux. Je suis joyeuse de votre lettre. J’attends avec une vive impatience l’explication du bis, c’est de l’émotion, un intérêt constant pour toute la journée, car vous n’avez pas un confident aussi pressé que Simon. Tout ce qui s’appelle légitimiste s’est abstenu de paraître hier à la Chambre des pairs. C’est une mesure générale convenue avec Berryer. Ceux des légitimistes qui étaient revenus aux idées et au langage le plus raisonnable ont un peu changé de ton depuis les dernières six semaines. Ils prévoient de la confusion, et par conséquent de l’Espérance.
On dit que Molé dit du roi que son esprit a beaucoup baissé. Le roi a été très vif il y a deux jours dans un entretien avec Appony. Après tout ce que j’ai fait, personne n’a pour moi la moindre considération ! Le mot n’est pas heureux. Il a frappé du poing sur le genou d’Appony de façon que le pied d’Appony a rebondi. Je vous raconte tout le bavardage.
Après le beau temps d’hier ; voici la pluie, ma promenade gâtée. Et il me faut de la promenade pour reprendre des forces. Votre lettre toute seule ne m’en donnera pas. Cependant, elle y fait quelque chose. Une de nos plus grandes dames de Russie, la fameuse comteuse Orloff si riche et dernière de son nom (car Orloff est batard) va épouser un jeune officier de 26 ans sans nom et sans renom. Cela fait un immense scandale. Elle est demoiselle et elle a 54 ans. Elle vivait depuis 20 ans dans un couvent avec des moines dont elle balayait la chambre. Elle venait à la cour pendant la semaine, chaque année et y paraissait toujours couverte de diamants, et dans la plus grande pompe. Elle fait maigre toute l’année depuis 20 ans elle n’a mangé que du poisson à la cour comme au couvent. Elle est grande, grasse, un port de reine et des yeux superbes. La colonie russe ici ne parle que de ce mariage. On en est bien plus préoccupé à Pétersbourg que des affaires d’Orient.
Pahlen nie toujours que nous envoyons notre flotte, mais toujours, toujours il est sans la moindre nouvelle.
2h 1/2
Fleischmann revenu depuis 3 jours de Stuttgard a été faire sa cour hier à St Cloud. Il sort de chez moi, le roi l’a étonné, un peu effrayé, des mouvements d’une vivacité inconcevable. Un langage très exagéré. Il se frappait la poitrine. Il poussait Fleischmann contre la muraille. Il le prenait au collet, le secouait. Enfin c’est drôle. Le duc d’Orléans plus calme de gestes, mais aussi vif de paroles à demain car je suis pressée. Adieu. adieu. Mille milles fois adieu.
9 heures
Cet abominable mardi ; il revient tous les jours ! Pourvu que demain j’aie ma lettre de bonne heure. Je ne vis plus que pour vos lettres. J’ai fait hier ma promenade avec Mad. Durrazo. Vous ne savez pas qu’elle a de l’esprit, beaucoup de finesse, de drôlerie, et qu’elle est le meilleur mime possible. Avant de rentrer, j’ai passé chez Mad. Appony. Hemmelauer qui a passé ici raconte que l’opinion en Angleterre est très vive contre la France et qu’il y a bien peu de vraisemblance à ce que l’affaire puisse s’arranger. Nos pauvres diplomates sont fort tristes et fort tourmentés. Ce sont de très braves gens et qui animent beaucoup Paris !
En traversant la place Louis XV pour rentrer je rencontre Thiers en voiture, qui fait arrêter la voiture et la mienne tout simplement et qui d’un bond s’est trouvé dans ma calèche. Nous sommes restés dix minutes exposés au public. Il m’a dit courtement : " Si le traité s’exécute vous avez la guerre c’est certain." Je lui ai dit que personne de nous en songeait à la lui faire, et que je ne voyais pas comment elle pourrait commencer. " Ah cela, c’est mon affaire. Vous verrez. " Et puis il m’a dit que le roi était furieux, la reine extrêmement, toute la famille. Qu’il était occupé du matin au soir, que tous les jours il veut venir me voir, qu’il viendra, et des tendresses ; personne n’a été nommé. Il m’a demandé ce qu’on me mandait d’Angleterre. Je lui ai dit que les esprits étaient très montés contre la France depuis peu de jours. Il me dit que les rapports sur ce sujet étaient contradictoires. Et nous verrons. Voilà la conversation.
J’ai dîné comme de coutume. Il me semble que je mange ma perdrix mais à me regarder, je croirais plutôt que c’est elle qui me mange. Après le dîner la calèche encore. Je me fais traîner le long du boulevard. C’est si animé, si gai. Je pense à Londres. Je me fâche de regarder quelque chose de gai lorsque vous n’avez que du morne et du triste. Vraiment, je ne conçois pas qu’un français puisse habiter Londres et puis pour tout étranger j’ai toujours pensé qu’on ne peut vivre à Londres que lorsqu’on a un intérieur, des enfants, du bonheur autour de soi, dans sa maison ; alors, et une grande situation pas dessus le marché cela va, surtout. Quand on n’a pas habité Paris. Mais vous, vous ! Vous ne sauriez vous figurer. A quel point je vous plains et je m’en veux de vous avoir quitté. Ah si j’avais pu rester ! Il faut bien que je me répète que c’était impossible. Votre promenade au Regent’s park seul. Cela me fend le cœur, et cet air de Londres si lourd, si gris !
N’est-ce pas que vous comprenez qu’un pauvre diable aille se pendre au mois de novembre ? Mon ambassadeur est venu à 10 heures, il me quitte parce que c’est toujours encore l’heure où je me couche, ma porte est encore fermée à tout le monde. Nous ne parlons que d’une seule et même chose nous ne parlons fort tristement tous les deux. Il admet aujourd’hui la guerre sans la comprendre. Mais enfin la voilà, partant de là il la veut bien forte et bien courte. Encore une fois toute l’Europe, et quelque chose de pire que l’année 15 ? En vérité, c’est très possible. Il y aura bien quelques mauvaises têtes, mais elles sont bien plus rares aujourd’hui qu’elles n’étaient il y a 10 ans
L’exemple de la France n’est par dangereux. Quel degré de plus de liberté y a-t-il que sous les anciens Bourbons. Qu’est-ce que les pays gagnent à se mettre en révolution? Et l’Espagne ! On regarde tout cela, on a réfléchi à tout cela, et vous trouvez peu de sympathies révolutionnaires. C’est sur cela cependant que vous devez compter. Si ce moyen vous manque, et il vous manquera, qui peut douter que l’Europe résolue comme elle l’était alors, ne fasse, comme alors succomber la France ? vraiment la carrière est plus aventureuse pour la France peu pour les autres. S’il y a des gens légers, présomptueux. Autre part, il y en a bien ici aussi. Pensez à tout cela avec votre immense raison et votre impartialité très rare. Est-on engagé assez loin pour ne pas pouvoir trouver des moyens d’éviter un grand fléau ? La situation est mauvaise. Vous faites bien de prendre des mesures à tout événement. Vous avez bien quelque motif de ressentiment quant aux procédés, aux manières, mais de là à faire la guerre, à la provoquer ! Il y a trop loin. Personne ne vous attaquera, tenez cela pour certain ; on vous laissera. à vous tout le tort de la provocation, et il soulèvera contre vous, sincèrement, toute l’Europe. Je pense et repense sans cesse à tout cela.
10 h 1/2
Quelle surprise charmante ! Cher Simon ! J’ai failli l’embrasser. Vos douces paroles me font du bien en effet beaucoup de bien. Je me soigne ; je me soignerai. Je veux que vous me retrouviez mieux. Je suis joyeuse de votre lettre. J’attends avec une vive impatience l’explication du bis, c’est de l’émotion, un intérêt constant pour toute la journée, car vous n’avez pas un confident aussi pressé que Simon. Tout ce qui s’appelle légitimiste s’est abstenu de paraître hier à la Chambre des pairs. C’est une mesure générale convenue avec Berryer. Ceux des légitimistes qui étaient revenus aux idées et au langage le plus raisonnable ont un peu changé de ton depuis les dernières six semaines. Ils prévoient de la confusion, et par conséquent de l’Espérance.
On dit que Molé dit du roi que son esprit a beaucoup baissé. Le roi a été très vif il y a deux jours dans un entretien avec Appony. Après tout ce que j’ai fait, personne n’a pour moi la moindre considération ! Le mot n’est pas heureux. Il a frappé du poing sur le genou d’Appony de façon que le pied d’Appony a rebondi. Je vous raconte tout le bavardage.
Après le beau temps d’hier ; voici la pluie, ma promenade gâtée. Et il me faut de la promenade pour reprendre des forces. Votre lettre toute seule ne m’en donnera pas. Cependant, elle y fait quelque chose. Une de nos plus grandes dames de Russie, la fameuse comteuse Orloff si riche et dernière de son nom (car Orloff est batard) va épouser un jeune officier de 26 ans sans nom et sans renom. Cela fait un immense scandale. Elle est demoiselle et elle a 54 ans. Elle vivait depuis 20 ans dans un couvent avec des moines dont elle balayait la chambre. Elle venait à la cour pendant la semaine, chaque année et y paraissait toujours couverte de diamants, et dans la plus grande pompe. Elle fait maigre toute l’année depuis 20 ans elle n’a mangé que du poisson à la cour comme au couvent. Elle est grande, grasse, un port de reine et des yeux superbes. La colonie russe ici ne parle que de ce mariage. On en est bien plus préoccupé à Pétersbourg que des affaires d’Orient.
Pahlen nie toujours que nous envoyons notre flotte, mais toujours, toujours il est sans la moindre nouvelle.
2h 1/2
Fleischmann revenu depuis 3 jours de Stuttgard a été faire sa cour hier à St Cloud. Il sort de chez moi, le roi l’a étonné, un peu effrayé, des mouvements d’une vivacité inconcevable. Un langage très exagéré. Il se frappait la poitrine. Il poussait Fleischmann contre la muraille. Il le prenait au collet, le secouait. Enfin c’est drôle. Le duc d’Orléans plus calme de gestes, mais aussi vif de paroles à demain car je suis pressée. Adieu. adieu. Mille milles fois adieu.
425. Londres, Mardi 29 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
425. Londres, mardi 29 septembre 1840
8 heures
Je ne vous ai pas écrit hier à mon gré. Vous dîtes que vous ne vivez que pour mes lettres. Que ne puis-je tout mettre dans mes lettres, tout ! Je ne les ferme jamais sans un sentiment triste. J’aurais tant à vous donner et je vous envoie si peu ! Non seulement si peu de ma tendresse, mais de ce qui occupe mon esprit et remplit mon temps. Nous nous le sommes dit cent fois, nous avons bien mieux fait, nous l’avons éprouvé ; rien n’est si charmant que cette entière, continuelle, minutieuse communauté de tout ce qu’on pense, sent, sait, apprend ; cette complète abolition de toute solitude, de toute réticence de tout silence, de toute gêne ; la parfaite vérité, la parfaite liberté, la parfaite union. La vie alors n’a pas un incident, la journée n’a pas un moment qui ne soit précieux et doux. Les plus petites choses ont l’importance des grandes ; les plus grandes ont le charme des petites. Une espérance agréable se mêle à tout. Tout aboutit à un plaisir. Qu’est-ce qu’une lettre pour tenir la place d’un tel bonheur ?
Je vous ferai une confidence. Ma vue, je ne veux pas dire encore s’affaiblit, mais s’alonge. Je ne vois plus aussi également bien à toutes les distances. Par instinct, pour obtenir la même netteté, je place mon livre ou mon papier un peu plus loin de mes yeux. Vous voyez bien que nous sommes du même âge.
J’ai aujourd’hui Flahaut à dîner, avec quelques diplomates. Dedel et Neumann sont encore à Tamworth, c’est-à-dire à Drayton-castle, chez Peel. Mon c’est-à dire est fort déplacé ; vous savez cela très bien. Vous ai-je dit que Neumann était mauvais dans tout ceci, sottement mauvais, commère, vulgairement moqueur, pédantesquement léger ? C’est sa faute sans doute, car je ne comprendrais pas qu’il eût pour instruction de nuire à la transaction et à la paix. Le successeur de Hummelauer, le Baron de Keller, a assez bonne mine, l’air intelligent de la tenue. Pas très instruit par exemple ; voici de sa science, un échantillon qui m’a bien surpris. Il m’a dit l’autre jour que Frédéric le grand était mort l’année d’avant la naissance de Napoléon, vingt ans avant la révolution française, en 1768. Je n’ajoute rien. Je me suis un peu récrié. Il s’est troublé un peu, mais il a persisté, et je me suis tu. Ne racontez pas trop cela. Le bruit en reviendrait à ce pauvre homme, et il m’en voudrait. Il dîne aujourd’hui chez moi
Le conseil d’hier a été tenu mais la discussion ajournée à jeudi. Lord Lansddown, lord Morpeth et lord Duncannen n’étaint pas arrivés. On veut qu’ils y soient. Il pleut toujours. Je n’ai pas mis hier le nez hors de chez moi. J’ai joué au Whist, le soir. Je ne saurais vous dire combien cet emploi de mon temps me choque, je dirais presque m’humilie. Et quand je ne m’en ennuie pas, je n’en suis que plus humilié. 4 heures J’ai été à Holland house après-déjeuner. On a bien tort de ne pas aller se promener là plus souvent. C’est charmant. Voilà donc déjà l’amiral Stopford attaqué. C’est un modéré. Napier lui- même est sur le point de l’être. Il fera, tous les coup de tête qu’on voudra. Il aime les coups. Mais sa correspondance ne plaît point. Il parle trop bien du Pacha et trop des difficultés de l’entreprise. Il faudra faire lord Ponsonby amiral, général d’armée. Il n’y a que lui pour instrument comme pour autour à tout ceci Dedel est revenu. J’ai trouvé sa carte en revenant de Holland house. Je le verrai probablement ce soir. Lady Holland va mieux. Elle n’a pas voulu que je vous le dise, il y a deux jours. Cela porte malheurs dit-elle. Ils finiront par aller passer une semaine à Brighton. Elle se persuade que cela lui sera bon, à elle contre la bile, à lord Holland contre un rhume. J’admire cette disposition à croire selon sa fantaisie du moment.
Ne prenez pas cela pour une pierre dans votre iardin. Je n’ai point de pierre pour vous, et votre jardin est le mien. Mais il est vrai que je m’étonne souvent de votre extrême promptitude à prendre sur votre santé une idée une persuasion, une résolution. Et en m’en étonnant, je la deplore. Et certainement si j’étais toujours près de vous, je la combattrais. Pour la santé comme pour toute chose, il faut de l’observation, de l’esprit de suite, un peu de méfiance de soi-même, un peu de patience. Les complaisants, les flatteurs ne valent pas mieux au corps qu’à l’âme. Je vous prêche. Pas autant que je voudrais bien s’en faut. Il y a bien des choses que je ne vous dis pas parce que, pour les dire avec fruit, il faut les dire tout le jour, toujours ce qui est plus que tout le jour. Et je ne me résigne point à ne pas vous les dire, surtout quand elles touchent votre santé.
Adieu. Adieu devant ma gravure mais sans la regarder en lui toumant le dos. Adieu. Quel adieu !
8 heures
Je ne vous ai pas écrit hier à mon gré. Vous dîtes que vous ne vivez que pour mes lettres. Que ne puis-je tout mettre dans mes lettres, tout ! Je ne les ferme jamais sans un sentiment triste. J’aurais tant à vous donner et je vous envoie si peu ! Non seulement si peu de ma tendresse, mais de ce qui occupe mon esprit et remplit mon temps. Nous nous le sommes dit cent fois, nous avons bien mieux fait, nous l’avons éprouvé ; rien n’est si charmant que cette entière, continuelle, minutieuse communauté de tout ce qu’on pense, sent, sait, apprend ; cette complète abolition de toute solitude, de toute réticence de tout silence, de toute gêne ; la parfaite vérité, la parfaite liberté, la parfaite union. La vie alors n’a pas un incident, la journée n’a pas un moment qui ne soit précieux et doux. Les plus petites choses ont l’importance des grandes ; les plus grandes ont le charme des petites. Une espérance agréable se mêle à tout. Tout aboutit à un plaisir. Qu’est-ce qu’une lettre pour tenir la place d’un tel bonheur ?
Je vous ferai une confidence. Ma vue, je ne veux pas dire encore s’affaiblit, mais s’alonge. Je ne vois plus aussi également bien à toutes les distances. Par instinct, pour obtenir la même netteté, je place mon livre ou mon papier un peu plus loin de mes yeux. Vous voyez bien que nous sommes du même âge.
J’ai aujourd’hui Flahaut à dîner, avec quelques diplomates. Dedel et Neumann sont encore à Tamworth, c’est-à-dire à Drayton-castle, chez Peel. Mon c’est-à dire est fort déplacé ; vous savez cela très bien. Vous ai-je dit que Neumann était mauvais dans tout ceci, sottement mauvais, commère, vulgairement moqueur, pédantesquement léger ? C’est sa faute sans doute, car je ne comprendrais pas qu’il eût pour instruction de nuire à la transaction et à la paix. Le successeur de Hummelauer, le Baron de Keller, a assez bonne mine, l’air intelligent de la tenue. Pas très instruit par exemple ; voici de sa science, un échantillon qui m’a bien surpris. Il m’a dit l’autre jour que Frédéric le grand était mort l’année d’avant la naissance de Napoléon, vingt ans avant la révolution française, en 1768. Je n’ajoute rien. Je me suis un peu récrié. Il s’est troublé un peu, mais il a persisté, et je me suis tu. Ne racontez pas trop cela. Le bruit en reviendrait à ce pauvre homme, et il m’en voudrait. Il dîne aujourd’hui chez moi
Le conseil d’hier a été tenu mais la discussion ajournée à jeudi. Lord Lansddown, lord Morpeth et lord Duncannen n’étaint pas arrivés. On veut qu’ils y soient. Il pleut toujours. Je n’ai pas mis hier le nez hors de chez moi. J’ai joué au Whist, le soir. Je ne saurais vous dire combien cet emploi de mon temps me choque, je dirais presque m’humilie. Et quand je ne m’en ennuie pas, je n’en suis que plus humilié. 4 heures J’ai été à Holland house après-déjeuner. On a bien tort de ne pas aller se promener là plus souvent. C’est charmant. Voilà donc déjà l’amiral Stopford attaqué. C’est un modéré. Napier lui- même est sur le point de l’être. Il fera, tous les coup de tête qu’on voudra. Il aime les coups. Mais sa correspondance ne plaît point. Il parle trop bien du Pacha et trop des difficultés de l’entreprise. Il faudra faire lord Ponsonby amiral, général d’armée. Il n’y a que lui pour instrument comme pour autour à tout ceci Dedel est revenu. J’ai trouvé sa carte en revenant de Holland house. Je le verrai probablement ce soir. Lady Holland va mieux. Elle n’a pas voulu que je vous le dise, il y a deux jours. Cela porte malheurs dit-elle. Ils finiront par aller passer une semaine à Brighton. Elle se persuade que cela lui sera bon, à elle contre la bile, à lord Holland contre un rhume. J’admire cette disposition à croire selon sa fantaisie du moment.
Ne prenez pas cela pour une pierre dans votre iardin. Je n’ai point de pierre pour vous, et votre jardin est le mien. Mais il est vrai que je m’étonne souvent de votre extrême promptitude à prendre sur votre santé une idée une persuasion, une résolution. Et en m’en étonnant, je la deplore. Et certainement si j’étais toujours près de vous, je la combattrais. Pour la santé comme pour toute chose, il faut de l’observation, de l’esprit de suite, un peu de méfiance de soi-même, un peu de patience. Les complaisants, les flatteurs ne valent pas mieux au corps qu’à l’âme. Je vous prêche. Pas autant que je voudrais bien s’en faut. Il y a bien des choses que je ne vous dis pas parce que, pour les dire avec fruit, il faut les dire tout le jour, toujours ce qui est plus que tout le jour. Et je ne me résigne point à ne pas vous les dire, surtout quand elles touchent votre santé.
Adieu. Adieu devant ma gravure mais sans la regarder en lui toumant le dos. Adieu. Quel adieu !
436.Paris, Lundi 28 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
436. Paris lundi 22 Septembre 1840
8 heures
Je suis sur pied de bonne heure, je crois qu’en me levant si tôt je rattraperai la lettre perdue. Car vous saurez que hier je n’ai reçu eu, rien du tout. Expliquez cela. S’il y a de votre faute je ne me sens pas le courage de vous pardonner, car vous me faites trop de mal. Mais ce ne peut être vous. Et cependant où est cette lettre ? J’ai bien assez, J’ai bien trop d’un mardi pas semaine, et me voici à deux.
J’ai vu hier matin, Bulwer, Werther, Adair, Montrond, Granville. Bulwer commence à se monter la tête beaucoup. Il veut du décisif, du vigoureux. Il trouve Stopford lâche, il faut le destituer. Il faut finir l’affaire. Schleinitz mande à Werther qu’il a fort peu d’espoir d’accommodement, que l’opinion en Angleterre devient assez générale contre la France, et qu’on ne veut pas lui laisser le triomphe d’avoir fait reculer. Vous êtes tous trop vantards, cela finit par irriter, et vos menaces n’intimident personne. Je crois cela assez vrai et dans le fond il n’y a que la diplomatie à Paris qui soit encore à vous défendre. Le duc de Broglie est arrivé. Il n’avait encore vu ni le roi, ni Thiers. Lord Granville l’a vu très triste, très découragé. Il trouve que la conduite de Thiers a été bonne, mais l’affaire est bien mal engagée. Il est triste et soucieux pour le roi. Il y a bien des gens qui regardent sa situation comme bien mauvaise. Il a épousé le pays ou pour dire plus vrai les journaux. Il sera débordé par eux.
62 dit que la chambre des députés sera toute pour la paix et que par lâcheté elle votera pour la guerre. Or, la guerre, elle sera mauvaise pour toutes les puissances peut-être (sauf l’Angleterre qui n’a qu’à y gagner) mais elle sera surtout mauvaise pour la France, car elle n’y est pas préparée. Cela paraît incontestable. Je suis sûr le ton belliqueux c’est que cela devient le ton de tout le monde. On dit, on répète : " c’est insensé. " Et l’on ajoute toujours, " Mais comment se tirer de là ? "
15 croit que c’est la guerre continentale dont vous avez envie. Il est vrai qu’à l’autre Il n’y aurait que des coups à attraper, et malgré vos promesses malgré vos désires même, ce sera la Prusse qui sera la première victime, car c’est la seule abordable, et le Rhin est ce que l’on comprend le mieux en France. Vraiment nous voilà à la veille d’un beau dénouement, je n’espère pas la moindre chose du conseil de cabinet d’aujourd’hui. Il n’y a aucune vraisemblance à ce que lord Palmerston soit out voted. Thiers a dit à M. de Werther avant hier : " Si les propositions de Méhemet ali ne sont point acceptées, c’est la guerre." J’ai fait mon régime ordinaire hier. Le bois de Boulogne, dîner seule, la perdrix, et le gâteau de semouille, pas autre chose, c’est l’ordonnance. Le soir un moment chez Mad. de Flahaut et un moment chez Lady Granville, dans mon lit à 10 heures. Voici une lettre du duc de Noailles. Elle me frappe un peu. Il est clair que les événements du jour inspirent de l’espérance.
9 heures
Voici la lettre que je devais recevoir hier. Le petit copiste est venu me l’apporter il ne l’a eu hier qu’à 10 heures du soir ; il était reste jusque là à son bureau. Il dit que s’il pouvait être prévenu des jours où on lui adresse des lettres il rentrerait pour les recevoir. Je vous supplie faites quelque chose qui n’épargne la cruelle peine de rester tout un jour sans lire des paroles qui me donnent tant tant de joie ! Car quelle lettre encore que ce 421 ! Ces deux feuilles volantes comme elles vont rester dans ma mémoire dans mon Cœur. C’est un langage du Ciel, vous dites vrai, jamais, jamais oreille de femme ne l’a entendu !J’étais donc destinée à une félicité immense ; et cependant, tout ce qu’il y manque ! Midi Je suis pleine de bonheur et d’orgueil de votre lettre. Mais j’ai le cœur plus triste tous les jours sur les. affaires. Elles vont de mal en pire. Elles vont à la guerre, quelle démence ! J’attend encore votre lettre d’aujourd’hui. La voilà
1 heure
Vous ne m’avez pas entendu sur l’adieu spécial car vous me dites qu’il ne ressemble à nul autre, cela me déplaît beaucoup, les autres ont toujours été si charmants. pour être tout autre il faut qu’il soit bien laid. Je n’en veux pas. Si fait j’en veux, car au moins c’est tout près et s’il commençait mal. Je le forcerais bien à devenir bien mais voyez quelle longue histoire pour si peu de chose. Je suis tout-à-fait enragée contre moi-même. Je vous jure que je ne retomberai plus. Car vous êtes un peu fâché et vous avez raison. Ne m’en parlez plus mais s’il vous plait un adieu qui ressemble à tous les autres. Vraiment, je pense à vous je m’inquiète de vous sur cette maudite affaire d’Orient, sans cesse, sans cesse. Ne vous en tracassez pas trop cependant je vous en prie. L’aventure de votre anneau est arrivée à mon anneau, je suis obligée d’en porter un autre pour le retenir à sa place.
Venez et tout rentrera dans l’ordre. Mon Dieu, si nous étions ensemble ! Vous voulez oui sur tout-à-fait, qu’est-ce qu’était donc tout-à-fait ? J’ai envie de dire oui à tout événement car vous le diriez, et aujourd’hui je me crois obligée à vous obéir, à vous donner toute satisfaction pour vous faire oublier mon iniquité. Oubliez, oubliez, est-il possible que rien puisse m’inquiéter ? Mais c’est si beau, c’est si rare, mon bonheur ; Je ne veux pas que le moindre souffle l’atteigne. Pardonnez pardonnez. Le temps est doux, Paris est charmant. Je suis désolée de penser à toute cette tristesse. Cette solitude de Londres. Je voudrais y retourner. Voilà Mad. Durazzo. Il faut que je vous quitte. Je ne voudrais jamais jamais vous quitter. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon Cœur. Si profond, si fort, si éternel, si tendre si triste. Adieu. Adieu. Adieu. Toute ma vie toujours ! Adieu.
8 heures
Je suis sur pied de bonne heure, je crois qu’en me levant si tôt je rattraperai la lettre perdue. Car vous saurez que hier je n’ai reçu eu, rien du tout. Expliquez cela. S’il y a de votre faute je ne me sens pas le courage de vous pardonner, car vous me faites trop de mal. Mais ce ne peut être vous. Et cependant où est cette lettre ? J’ai bien assez, J’ai bien trop d’un mardi pas semaine, et me voici à deux.
J’ai vu hier matin, Bulwer, Werther, Adair, Montrond, Granville. Bulwer commence à se monter la tête beaucoup. Il veut du décisif, du vigoureux. Il trouve Stopford lâche, il faut le destituer. Il faut finir l’affaire. Schleinitz mande à Werther qu’il a fort peu d’espoir d’accommodement, que l’opinion en Angleterre devient assez générale contre la France, et qu’on ne veut pas lui laisser le triomphe d’avoir fait reculer. Vous êtes tous trop vantards, cela finit par irriter, et vos menaces n’intimident personne. Je crois cela assez vrai et dans le fond il n’y a que la diplomatie à Paris qui soit encore à vous défendre. Le duc de Broglie est arrivé. Il n’avait encore vu ni le roi, ni Thiers. Lord Granville l’a vu très triste, très découragé. Il trouve que la conduite de Thiers a été bonne, mais l’affaire est bien mal engagée. Il est triste et soucieux pour le roi. Il y a bien des gens qui regardent sa situation comme bien mauvaise. Il a épousé le pays ou pour dire plus vrai les journaux. Il sera débordé par eux.
62 dit que la chambre des députés sera toute pour la paix et que par lâcheté elle votera pour la guerre. Or, la guerre, elle sera mauvaise pour toutes les puissances peut-être (sauf l’Angleterre qui n’a qu’à y gagner) mais elle sera surtout mauvaise pour la France, car elle n’y est pas préparée. Cela paraît incontestable. Je suis sûr le ton belliqueux c’est que cela devient le ton de tout le monde. On dit, on répète : " c’est insensé. " Et l’on ajoute toujours, " Mais comment se tirer de là ? "
15 croit que c’est la guerre continentale dont vous avez envie. Il est vrai qu’à l’autre Il n’y aurait que des coups à attraper, et malgré vos promesses malgré vos désires même, ce sera la Prusse qui sera la première victime, car c’est la seule abordable, et le Rhin est ce que l’on comprend le mieux en France. Vraiment nous voilà à la veille d’un beau dénouement, je n’espère pas la moindre chose du conseil de cabinet d’aujourd’hui. Il n’y a aucune vraisemblance à ce que lord Palmerston soit out voted. Thiers a dit à M. de Werther avant hier : " Si les propositions de Méhemet ali ne sont point acceptées, c’est la guerre." J’ai fait mon régime ordinaire hier. Le bois de Boulogne, dîner seule, la perdrix, et le gâteau de semouille, pas autre chose, c’est l’ordonnance. Le soir un moment chez Mad. de Flahaut et un moment chez Lady Granville, dans mon lit à 10 heures. Voici une lettre du duc de Noailles. Elle me frappe un peu. Il est clair que les événements du jour inspirent de l’espérance.
9 heures
Voici la lettre que je devais recevoir hier. Le petit copiste est venu me l’apporter il ne l’a eu hier qu’à 10 heures du soir ; il était reste jusque là à son bureau. Il dit que s’il pouvait être prévenu des jours où on lui adresse des lettres il rentrerait pour les recevoir. Je vous supplie faites quelque chose qui n’épargne la cruelle peine de rester tout un jour sans lire des paroles qui me donnent tant tant de joie ! Car quelle lettre encore que ce 421 ! Ces deux feuilles volantes comme elles vont rester dans ma mémoire dans mon Cœur. C’est un langage du Ciel, vous dites vrai, jamais, jamais oreille de femme ne l’a entendu !J’étais donc destinée à une félicité immense ; et cependant, tout ce qu’il y manque ! Midi Je suis pleine de bonheur et d’orgueil de votre lettre. Mais j’ai le cœur plus triste tous les jours sur les. affaires. Elles vont de mal en pire. Elles vont à la guerre, quelle démence ! J’attend encore votre lettre d’aujourd’hui. La voilà
1 heure
Vous ne m’avez pas entendu sur l’adieu spécial car vous me dites qu’il ne ressemble à nul autre, cela me déplaît beaucoup, les autres ont toujours été si charmants. pour être tout autre il faut qu’il soit bien laid. Je n’en veux pas. Si fait j’en veux, car au moins c’est tout près et s’il commençait mal. Je le forcerais bien à devenir bien mais voyez quelle longue histoire pour si peu de chose. Je suis tout-à-fait enragée contre moi-même. Je vous jure que je ne retomberai plus. Car vous êtes un peu fâché et vous avez raison. Ne m’en parlez plus mais s’il vous plait un adieu qui ressemble à tous les autres. Vraiment, je pense à vous je m’inquiète de vous sur cette maudite affaire d’Orient, sans cesse, sans cesse. Ne vous en tracassez pas trop cependant je vous en prie. L’aventure de votre anneau est arrivée à mon anneau, je suis obligée d’en porter un autre pour le retenir à sa place.
Venez et tout rentrera dans l’ordre. Mon Dieu, si nous étions ensemble ! Vous voulez oui sur tout-à-fait, qu’est-ce qu’était donc tout-à-fait ? J’ai envie de dire oui à tout événement car vous le diriez, et aujourd’hui je me crois obligée à vous obéir, à vous donner toute satisfaction pour vous faire oublier mon iniquité. Oubliez, oubliez, est-il possible que rien puisse m’inquiéter ? Mais c’est si beau, c’est si rare, mon bonheur ; Je ne veux pas que le moindre souffle l’atteigne. Pardonnez pardonnez. Le temps est doux, Paris est charmant. Je suis désolée de penser à toute cette tristesse. Cette solitude de Londres. Je voudrais y retourner. Voilà Mad. Durazzo. Il faut que je vous quitte. Je ne voudrais jamais jamais vous quitter. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon Cœur. Si profond, si fort, si éternel, si tendre si triste. Adieu. Adieu. Adieu. Toute ma vie toujours ! Adieu.
424. Londres, Lundi 28 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
424. Londres, Lundi 28 septembre 1840
10 heures
Il n’est arrivé à personne de devenir louche après, cinquante ans. Et puis quand même. Je dis cela de tout, absolument.
M. de Flahaut est très soigneux, très caressant. Il vient tous les jours à l’Ambassade. Nous causons le soir à Holland house, very privately. Que sait-on ? Peut-être, si je voyais aujourd’hui Mad. de Flahaut, elle serait aimable pour moi. Je l’ai en idée. Bien du monde hier à Holland house. Lord Melbourne, lord John Russell, lord Normanby, lord Clarendon. Ceux-là y avaient dîné. Lord et lady Palmerston y sont venus le soir. J’ai causé avec lord Melbourne. Je suis arrivé de bonne heure et parti de bonne heure. On croit que lord Lansdowne et lord Morpeth arriveront ce matin pour le Conseil de cabinet. Lord Duncannon seul y manquera. J’ai été hier à Carlton-Terrace. Lord Palmerston n’étant pas rentré, je suis monté chez lady Palmerston. Nous avons parlé de vous. Pour la première fois, son accent m’a plu, vraiment plu. Il y avait de l’affection et un sentiment vif de ce que vous êtes. J’ai regretté de couper court à la conversation. Au bout de dix minutes, lord Palmerston est rentré. Je vous remercie de me dire ce que pense le duc de Noailles. Son jugement est excellent. Je regrette toujours que sa position ne soit pas aussi libre que son jugement.
Il a raison dans tout ce qu’il vous dit, excepté sur les firmans exécutoires, en Egypte et en Syrie. Je ne crois pas que le Pacha se préoccupe beaucoup de cet article là.
Une heure
Rien encore. Ces irrégularités ne vous sont pas plus intolérables qu’à moi. Qu’y faire ? Elles ne proviennent ni de vous, ni de moi. Et quand on se sort de plusieurs machines, machines humaines, il n’y a pas moyen de leur imposer à toutes une exactitude mathématique. Vous aurez une lettre demain que vous n’attendez pas. Je m’en réjouis comme si elle venait de vous à moi.
Croyez bien tout ce que je vous dis dans cette lettre là. J’y pense sans cesse. Ma conviction est profonde. De près, elle vous ferait du bien. Ah, pourquoi êtes-vous partie sitôt ? Votre fils n’arrive pas. De petites considérations de petites raisons nous ont décidés. Toutes les grandes, les vraies raisons étaient contre.
Lord Grey, est charmé de moi. Il me remercie avec effusion de ce que j’ai arrangé pour Lady Durham. Elle arrive à Londres ces jours-ci, et elle en repartira presque aussitôt. Lord Tankerville va très bien. Il a vu la main de son médecin. Lady Tankerville ne peut pas partir pour Paris, faute d’argent. Ses fonds étaient chez Hammersley. On parle beaucoup de cette affaire là. On ne sait pas si tout sera payé.
4 heures
Toujours rien. Je n’aurai rien aujourd’hui. Je comprends les retards, mais non pas le manque complet. De quoi voulez-vous que je vous parle ? Je penserai à autre chose. Il fait un temps affreux. Il tombe des torrents. Comme s’il n’y avait pas assez d’eau entre vous et moi. J’ai de bonnes nouvelles de mes enfants. Ils ont eu la jaunisse tous les trois. Elle est parfaitement passée pour mes deux filles. Guillaume en retient encore quelque chose. Ma mère est bien. Adieu. Adieu. De près, il n’y a point d’adieu triste. De loin, il peut y en avoir. Adieu. Elle arrive. Au moment où j’allais cacheter ceci. Le meilleur des adieux.
10 heures
Il n’est arrivé à personne de devenir louche après, cinquante ans. Et puis quand même. Je dis cela de tout, absolument.
M. de Flahaut est très soigneux, très caressant. Il vient tous les jours à l’Ambassade. Nous causons le soir à Holland house, very privately. Que sait-on ? Peut-être, si je voyais aujourd’hui Mad. de Flahaut, elle serait aimable pour moi. Je l’ai en idée. Bien du monde hier à Holland house. Lord Melbourne, lord John Russell, lord Normanby, lord Clarendon. Ceux-là y avaient dîné. Lord et lady Palmerston y sont venus le soir. J’ai causé avec lord Melbourne. Je suis arrivé de bonne heure et parti de bonne heure. On croit que lord Lansdowne et lord Morpeth arriveront ce matin pour le Conseil de cabinet. Lord Duncannon seul y manquera. J’ai été hier à Carlton-Terrace. Lord Palmerston n’étant pas rentré, je suis monté chez lady Palmerston. Nous avons parlé de vous. Pour la première fois, son accent m’a plu, vraiment plu. Il y avait de l’affection et un sentiment vif de ce que vous êtes. J’ai regretté de couper court à la conversation. Au bout de dix minutes, lord Palmerston est rentré. Je vous remercie de me dire ce que pense le duc de Noailles. Son jugement est excellent. Je regrette toujours que sa position ne soit pas aussi libre que son jugement.
Il a raison dans tout ce qu’il vous dit, excepté sur les firmans exécutoires, en Egypte et en Syrie. Je ne crois pas que le Pacha se préoccupe beaucoup de cet article là.
Une heure
Rien encore. Ces irrégularités ne vous sont pas plus intolérables qu’à moi. Qu’y faire ? Elles ne proviennent ni de vous, ni de moi. Et quand on se sort de plusieurs machines, machines humaines, il n’y a pas moyen de leur imposer à toutes une exactitude mathématique. Vous aurez une lettre demain que vous n’attendez pas. Je m’en réjouis comme si elle venait de vous à moi.
Croyez bien tout ce que je vous dis dans cette lettre là. J’y pense sans cesse. Ma conviction est profonde. De près, elle vous ferait du bien. Ah, pourquoi êtes-vous partie sitôt ? Votre fils n’arrive pas. De petites considérations de petites raisons nous ont décidés. Toutes les grandes, les vraies raisons étaient contre.
Lord Grey, est charmé de moi. Il me remercie avec effusion de ce que j’ai arrangé pour Lady Durham. Elle arrive à Londres ces jours-ci, et elle en repartira presque aussitôt. Lord Tankerville va très bien. Il a vu la main de son médecin. Lady Tankerville ne peut pas partir pour Paris, faute d’argent. Ses fonds étaient chez Hammersley. On parle beaucoup de cette affaire là. On ne sait pas si tout sera payé.
4 heures
Toujours rien. Je n’aurai rien aujourd’hui. Je comprends les retards, mais non pas le manque complet. De quoi voulez-vous que je vous parle ? Je penserai à autre chose. Il fait un temps affreux. Il tombe des torrents. Comme s’il n’y avait pas assez d’eau entre vous et moi. J’ai de bonnes nouvelles de mes enfants. Ils ont eu la jaunisse tous les trois. Elle est parfaitement passée pour mes deux filles. Guillaume en retient encore quelque chose. Ma mère est bien. Adieu. Adieu. De près, il n’y a point d’adieu triste. De loin, il peut y en avoir. Adieu. Elle arrive. Au moment où j’allais cacheter ceci. Le meilleur des adieux.
423. Londres, Dimanche 27 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
423. Londres, Dimanche 27 septembre 1840 sept heures
Byng est venu me dire hier qu’il partait aujourd’hui pour l’Italie et qu’il vous verrait en passant par Paris. L’envie m’a pris de vous dire par lui, un adieu plus tendre que de coutume, bien tendre. Je voudrais bien. Mais rien ne contente ma volonté. Vous savez mon mépris pour les illusions. Hier quand l’idée m’en est venue, il me semblait que je serais charmé de vous dire un peu plus, que je vous dirais tant ! Me voici. Je suis dans mon lit. Bien seul. C’est Dimanche. Je n’entends rien. Si vous étiez là ! Vous n’y êtes pas. Et je suis triste ! Et c’est tout ce que je trouve à vous dire Dimanche est un beau jour un saint jour. Je l’aime. Rien ne rafraîchit l’âme comme de se placer ensemble sous l’œil, sous la main, sous la garde de Dieu. C’est de la sécurité, c’est de l’éternité pour l’affection et pour le bonheur. Vous avez le cœur pieux. J’ai été ravi le jour où je m’ens suis aperçu. Je ne vous ai jamais dit, s’en cela, tout ce que je voudrais. Il me semble, en ce moment, que je ne vous ai jamais rien dit. J’ai le cœur si plein de vous, si plein pour vous ! Si vous étiez là, près de moi, je vous prendrais dans mes bras, je vous presserais sur mon cœur. Point de paroles, ma bien aimée. Rien que mes lèvres sur les lèvres, mon cœur sur ton coeur.
Non, il n’y aura pas de guerre. J’ai beau être inquiet ; ma raison ne cède pas devant mon inquiétude. Plus la guerre paraît s’approcher, moins je la trouve probable. Et il me semble que tout le monde est comme moi. On y croit d’autant moins qu’on la craint d’avantage. En ceci encore, que de choses que je ne puis vous dire. Il n’y a pas moyen. L’absence est devenue bien plus amère, bien plus lourde qu’elle n’avait jamais été. Adieu donc, ma bien aimée. Un adieu tendre et triste. Pourtant mille fois plus tendre que triste ! Adieu.
Byng est venu me dire hier qu’il partait aujourd’hui pour l’Italie et qu’il vous verrait en passant par Paris. L’envie m’a pris de vous dire par lui, un adieu plus tendre que de coutume, bien tendre. Je voudrais bien. Mais rien ne contente ma volonté. Vous savez mon mépris pour les illusions. Hier quand l’idée m’en est venue, il me semblait que je serais charmé de vous dire un peu plus, que je vous dirais tant ! Me voici. Je suis dans mon lit. Bien seul. C’est Dimanche. Je n’entends rien. Si vous étiez là ! Vous n’y êtes pas. Et je suis triste ! Et c’est tout ce que je trouve à vous dire Dimanche est un beau jour un saint jour. Je l’aime. Rien ne rafraîchit l’âme comme de se placer ensemble sous l’œil, sous la main, sous la garde de Dieu. C’est de la sécurité, c’est de l’éternité pour l’affection et pour le bonheur. Vous avez le cœur pieux. J’ai été ravi le jour où je m’ens suis aperçu. Je ne vous ai jamais dit, s’en cela, tout ce que je voudrais. Il me semble, en ce moment, que je ne vous ai jamais rien dit. J’ai le cœur si plein de vous, si plein pour vous ! Si vous étiez là, près de moi, je vous prendrais dans mes bras, je vous presserais sur mon cœur. Point de paroles, ma bien aimée. Rien que mes lèvres sur les lèvres, mon cœur sur ton coeur.
Non, il n’y aura pas de guerre. J’ai beau être inquiet ; ma raison ne cède pas devant mon inquiétude. Plus la guerre paraît s’approcher, moins je la trouve probable. Et il me semble que tout le monde est comme moi. On y croit d’autant moins qu’on la craint d’avantage. En ceci encore, que de choses que je ne puis vous dire. Il n’y a pas moyen. L’absence est devenue bien plus amère, bien plus lourde qu’elle n’avait jamais été. Adieu donc, ma bien aimée. Un adieu tendre et triste. Pourtant mille fois plus tendre que triste ! Adieu.
423. bis Londres Dimanche 27 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
423 bis.Londres, Dimanche 27 septembre 1840 4 heures
Quelqu’un part aujourd’hui pour Calais. J’ai quelques minutes. Je vous les donne. Je vous en conjure ; ne soyez pas à ce ce point abattue, découragée. Ne désesperez pas de vous-même, de votre santé, de notre avenir. Jamais, jamais, ne me cachez votre disposition, quelle qu’elle soit ; dites-moi toujours tout, vos plus mauvais comme vos meilleurs moments. J’ai horreur des illusions. Je ne veux pas m’en repaître, même sur ce que j’ai de plus précieux au monde. Ce n’est pas du tout pour me les épargner à moi-même que je combats vos tristes, vos sinistres impressions. C’est parce que je suis sûr, sûr qu’elles sont mal fondées. Votre santé et habituellement bien délicate. Elle a été bien ébranlée par ce mouvement de bile. Mais au fond, elle est saine ; vous n’avez point d’organe malade. Vous supportez bien plus de fatigue qu’on ne le croirait possible quand on vous voit si abattue. Il y a dans votre corps quelque chose de l’élasticité, de la vitalité de votre âme. Ce qui vous rend charmante, vous fera vivre, vivre longtemps.
Dearest, si j’étais près de vous, je vous dirais, j’en suis sûr, des choses qui vous prouveraient que j’ai raison, qui vous feraient retrouver en vous la force qui y est. Car, on ne donne pas de force à qui n’en a pas la tendresse, la plus vive ne possède pas ce beau privilège. Mais vous me l’avez dit, je l’ai vu ; je puis vous animer et vous calmer en même temps ; je puis vous rendre du mouvement du repos. Je suis loin, bien loin, et je m’en désole, et j’en souffre autant que vous. Mais, laissez-moi conserver, exercer de loin un peu de mon pouvoir salutaire, rafraichissant, reconfortant. Que ces paroles, qui tombent de mon coeur sur le papier, aillent au vôtre et y raniment la confiance, l’espérance. L’absence serait aussi trop cruelle si elle nous enlevait tout, absolument tout empire, l’un sur l’autre, si elle nous mettait tout-à-fait hors d’état de nous faire, l’un à l’autre, aucun bien, de nous porter aucun secours. Cela ne se peut pas, cela ne sera pas. Vous vous laisserez soutenir encourager par moi, même absent. Et l’absence passera. Nous nous retrouverons. Je recommencerai à vous soutenir, à vous encourager, à vous animer, à vous calmer de près, bien près. Quel jour ! Quel mouvement et bonheur !
Adieu. Adieu. Mille adieux. Le bis du N° vous sera bientôt expliqué.
Quelqu’un part aujourd’hui pour Calais. J’ai quelques minutes. Je vous les donne. Je vous en conjure ; ne soyez pas à ce ce point abattue, découragée. Ne désesperez pas de vous-même, de votre santé, de notre avenir. Jamais, jamais, ne me cachez votre disposition, quelle qu’elle soit ; dites-moi toujours tout, vos plus mauvais comme vos meilleurs moments. J’ai horreur des illusions. Je ne veux pas m’en repaître, même sur ce que j’ai de plus précieux au monde. Ce n’est pas du tout pour me les épargner à moi-même que je combats vos tristes, vos sinistres impressions. C’est parce que je suis sûr, sûr qu’elles sont mal fondées. Votre santé et habituellement bien délicate. Elle a été bien ébranlée par ce mouvement de bile. Mais au fond, elle est saine ; vous n’avez point d’organe malade. Vous supportez bien plus de fatigue qu’on ne le croirait possible quand on vous voit si abattue. Il y a dans votre corps quelque chose de l’élasticité, de la vitalité de votre âme. Ce qui vous rend charmante, vous fera vivre, vivre longtemps.
Dearest, si j’étais près de vous, je vous dirais, j’en suis sûr, des choses qui vous prouveraient que j’ai raison, qui vous feraient retrouver en vous la force qui y est. Car, on ne donne pas de force à qui n’en a pas la tendresse, la plus vive ne possède pas ce beau privilège. Mais vous me l’avez dit, je l’ai vu ; je puis vous animer et vous calmer en même temps ; je puis vous rendre du mouvement du repos. Je suis loin, bien loin, et je m’en désole, et j’en souffre autant que vous. Mais, laissez-moi conserver, exercer de loin un peu de mon pouvoir salutaire, rafraichissant, reconfortant. Que ces paroles, qui tombent de mon coeur sur le papier, aillent au vôtre et y raniment la confiance, l’espérance. L’absence serait aussi trop cruelle si elle nous enlevait tout, absolument tout empire, l’un sur l’autre, si elle nous mettait tout-à-fait hors d’état de nous faire, l’un à l’autre, aucun bien, de nous porter aucun secours. Cela ne se peut pas, cela ne sera pas. Vous vous laisserez soutenir encourager par moi, même absent. Et l’absence passera. Nous nous retrouverons. Je recommencerai à vous soutenir, à vous encourager, à vous animer, à vous calmer de près, bien près. Quel jour ! Quel mouvement et bonheur !
Adieu. Adieu. Mille adieux. Le bis du N° vous sera bientôt expliqué.
435. Paris, Dimanche 27 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
435. Paris, dimanche 27 septembre 1840 10 heures
J’ai vu hier Appony, Bulwer, les Granville le soir. Le temps était beau, j’ai fait assez de chemin dans le bois de Boulogne. Mon allée favorite est détruite. Elle deviendra une fortification !
Les nouvelles d’avant-hier étaient de l’invention des Rothschild. Le conseil anglais a quitté Alexandrie. La guerre est engagée. Ferez-vous la paix demain à Londres ? Le Roi était vendredi soir de très mauvaise humeur à St Cloud. Très aigre et mécontent vis-avis des puissances. Infiniment plus monté et plus belliqueux que Thiers, et j’ai entendu dire à ma diplomatie qu’il ne valait plus la peine d’aller faire sa cour si on était exposé à entendre tout ce langage. C’est le plus favorisé des diplomates qui disait cela. Eh bien qu’arrivera-t-il donc ? Peut-il arriver autre chose que la guerre, tout insensée qu’elle paraisse ?
Mad. de Boigne est à la Campagne, elle n’a pas été en ville depuis quinze jours. Elle n’y est attendu que dans 15 jours. Je suis restée chez lady Granville hier jusqu’à 10 heures, l’heure de mon coucher. Nous avons bien bavardé et un peu ri à entendre toutes les nouvelles contradictions, à voir toutes ces fluctuations dans cette affaire si grave, on est toujours dans l’embarras de savoir de qui on aura à se moquer le lendemain ! Si le Pacha cède on se moquera de vous. S’il résiste avec succès c’est de nous qu’on rira. Je ris encore, parce que je suis à Paris. Le jour où je n’y serai plus, il en sera autrement.
Midi
On ne m’apporte pas de lettres ; je vais faire un tour aux Tuileries. Vous aimeriez n’est-ce pas à y venir avec moi ? à rentrer avec moi ? à aller regarder votre gravure. Vous ne la regarderiez pas, ni moi non plus. Adieu, c’est le moment de vous le dire. Adieu. Adieu.
J’ai vu hier Appony, Bulwer, les Granville le soir. Le temps était beau, j’ai fait assez de chemin dans le bois de Boulogne. Mon allée favorite est détruite. Elle deviendra une fortification !
Les nouvelles d’avant-hier étaient de l’invention des Rothschild. Le conseil anglais a quitté Alexandrie. La guerre est engagée. Ferez-vous la paix demain à Londres ? Le Roi était vendredi soir de très mauvaise humeur à St Cloud. Très aigre et mécontent vis-avis des puissances. Infiniment plus monté et plus belliqueux que Thiers, et j’ai entendu dire à ma diplomatie qu’il ne valait plus la peine d’aller faire sa cour si on était exposé à entendre tout ce langage. C’est le plus favorisé des diplomates qui disait cela. Eh bien qu’arrivera-t-il donc ? Peut-il arriver autre chose que la guerre, tout insensée qu’elle paraisse ?
Mad. de Boigne est à la Campagne, elle n’a pas été en ville depuis quinze jours. Elle n’y est attendu que dans 15 jours. Je suis restée chez lady Granville hier jusqu’à 10 heures, l’heure de mon coucher. Nous avons bien bavardé et un peu ri à entendre toutes les nouvelles contradictions, à voir toutes ces fluctuations dans cette affaire si grave, on est toujours dans l’embarras de savoir de qui on aura à se moquer le lendemain ! Si le Pacha cède on se moquera de vous. S’il résiste avec succès c’est de nous qu’on rira. Je ris encore, parce que je suis à Paris. Le jour où je n’y serai plus, il en sera autrement.
Midi
On ne m’apporte pas de lettres ; je vais faire un tour aux Tuileries. Vous aimeriez n’est-ce pas à y venir avec moi ? à rentrer avec moi ? à aller regarder votre gravure. Vous ne la regarderiez pas, ni moi non plus. Adieu, c’est le moment de vous le dire. Adieu. Adieu.
436_1 Maintenon 27 sept. 1840, Copie de la lettre du Duc de Noailles à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Mots-clés : Ambassade à Londres
434. Paris, Samedi 26 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
434. Paris Samedi 26 septembre 1840
9 heures
J’ai vu hier matin M. de Werther, Montrond, Bulwer. Celui-ci avait de mauvais avis de Londres. Lord Palmerston écrit : " Le traité doit être exécuté. " On dit que mon Empereur est de cet avis aussi et bien plus fortement ; et ravi de l’idée d’une guerre, qui le mènerait à Paris ! Je vous dis les renseignements venus par des étrangers, car Pahlen n’a pas un mot, absolument pas un. Après mon dîner, j’ai été un moment chez les Appony. Il m’a reçue avec des éclats de joie. On répandait le nouvelle que le pacha avait tout accepté. Est-ce vrai ? Nous verrons dans la journée. Ce serait un effet une bien grande nouvelle. Pas beaucoup de gloire pour le gouvernement français. Grand triomphe pour lord Palmerston, mais enfin, la paix, la paix, à moins que vous ne veuillez la guerre pour rien du tout, et pour le seul plaisir de la faire. Je raisonne et déraisonne, car encore une fois il faut confirmation.
Montrond croit que Flahaut va faire du barbouillage à Londres, que certainement il en ressortira des commérages entre vous et Thiers. Il est fâchée de ce départ. Du reste Montrond est bien à la pais. Il dit qu’il voit Thiers rarement et que quand il le voit il le trouve tellement entouré de journalistes qu’il n’y a pas moyen de causer avec lui. Savez-vous que Bulow a en effet mécontenté sa cour ? Il avait le double ordre de faire comme ses collègues d’Autriche et de Russie, et de ne pas laisser la France en dehors. Il n’y avait pas moyen de concilier cela. Il a fallu choisir, et il a choisi ce qu’il croyait qui flattait le plus les opinions de son nouveau maître. Il s’est trompé, on lui en veut. Cette donnée que je regarde comme très exacte, vous expliquez bien des choses. Lord Palmerston en veut un peu à Bulwer pour avoir tenu un langage trop mou ici. Mon ambassadeur est venu chez moi de 9 à 10 heures. Je lui ai donné la nouvelle d’Appony. Nous avons devisé sur cela. Il doute et écrit tour à tour. Nous verrons votre lettre hier ne m’a été remise qu’à 3 heures, par le petit copiste. C’est vraiement trop tard. Et puis, c’était un pur hasard qu’il m’ait trouvée chez moi.
2 heures
Voici votre lettre tard encore ; les jolis garçons. car Dieu merci j’en ai vu trois maintenant, ne me plaisent pas autant que les vieux et les veilles femmes. Je prie qu’on vienne avant midi mais cela ne fait pas beaucoup d’effet. M. Molé sera ici pourl e procès. Il n’y est pas maintenant ; je suppose qu’il viendra me voir. J’irai demander aujourd’hui où se trouve D. Je ne vous ai pas parlé de votre portrait, je l’ai bien regardé cependant. Il est excellent mais j’aime tant ma gravure, je la regarde tant dans mon cabinet de toilette, j’y suis si habituée, que dans ma préocupation de la gravure et de l’original, je n’ai pas apprécié le portrait autant qu’il le mérite. C’est un intermédiaire dont je n’ai pas besoin les deux autres ont leur place. Je bavarde et je radote. Je rêve de bons temps, bons temps passés, bons temps à venir. Venez. La nouvelle d’Appony est- elle vraie est-elle fausse ? Si elle est fausse, le conseil de Lundi sera-t-il bon, sera-t-il mauvais ? voilà où tournent mes idées. Adieu. Adieu autant de fois et comme il vous plait. Adieu.
9 heures
J’ai vu hier matin M. de Werther, Montrond, Bulwer. Celui-ci avait de mauvais avis de Londres. Lord Palmerston écrit : " Le traité doit être exécuté. " On dit que mon Empereur est de cet avis aussi et bien plus fortement ; et ravi de l’idée d’une guerre, qui le mènerait à Paris ! Je vous dis les renseignements venus par des étrangers, car Pahlen n’a pas un mot, absolument pas un. Après mon dîner, j’ai été un moment chez les Appony. Il m’a reçue avec des éclats de joie. On répandait le nouvelle que le pacha avait tout accepté. Est-ce vrai ? Nous verrons dans la journée. Ce serait un effet une bien grande nouvelle. Pas beaucoup de gloire pour le gouvernement français. Grand triomphe pour lord Palmerston, mais enfin, la paix, la paix, à moins que vous ne veuillez la guerre pour rien du tout, et pour le seul plaisir de la faire. Je raisonne et déraisonne, car encore une fois il faut confirmation.
Montrond croit que Flahaut va faire du barbouillage à Londres, que certainement il en ressortira des commérages entre vous et Thiers. Il est fâchée de ce départ. Du reste Montrond est bien à la pais. Il dit qu’il voit Thiers rarement et que quand il le voit il le trouve tellement entouré de journalistes qu’il n’y a pas moyen de causer avec lui. Savez-vous que Bulow a en effet mécontenté sa cour ? Il avait le double ordre de faire comme ses collègues d’Autriche et de Russie, et de ne pas laisser la France en dehors. Il n’y avait pas moyen de concilier cela. Il a fallu choisir, et il a choisi ce qu’il croyait qui flattait le plus les opinions de son nouveau maître. Il s’est trompé, on lui en veut. Cette donnée que je regarde comme très exacte, vous expliquez bien des choses. Lord Palmerston en veut un peu à Bulwer pour avoir tenu un langage trop mou ici. Mon ambassadeur est venu chez moi de 9 à 10 heures. Je lui ai donné la nouvelle d’Appony. Nous avons devisé sur cela. Il doute et écrit tour à tour. Nous verrons votre lettre hier ne m’a été remise qu’à 3 heures, par le petit copiste. C’est vraiement trop tard. Et puis, c’était un pur hasard qu’il m’ait trouvée chez moi.
2 heures
Voici votre lettre tard encore ; les jolis garçons. car Dieu merci j’en ai vu trois maintenant, ne me plaisent pas autant que les vieux et les veilles femmes. Je prie qu’on vienne avant midi mais cela ne fait pas beaucoup d’effet. M. Molé sera ici pourl e procès. Il n’y est pas maintenant ; je suppose qu’il viendra me voir. J’irai demander aujourd’hui où se trouve D. Je ne vous ai pas parlé de votre portrait, je l’ai bien regardé cependant. Il est excellent mais j’aime tant ma gravure, je la regarde tant dans mon cabinet de toilette, j’y suis si habituée, que dans ma préocupation de la gravure et de l’original, je n’ai pas apprécié le portrait autant qu’il le mérite. C’est un intermédiaire dont je n’ai pas besoin les deux autres ont leur place. Je bavarde et je radote. Je rêve de bons temps, bons temps passés, bons temps à venir. Venez. La nouvelle d’Appony est- elle vraie est-elle fausse ? Si elle est fausse, le conseil de Lundi sera-t-il bon, sera-t-il mauvais ? voilà où tournent mes idées. Adieu. Adieu autant de fois et comme il vous plait. Adieu.
433. Paris, Vendredi 25 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
433. Paris vendredi 25 septembre 1840
9 heures
J’ai vu hier Montrond et les Appony. J’ai fait ma promenade En rentrant, j’ai vu M. de Pahlen. Après mon dîner, j’ai éte un moment chez Mad. de Flahaut avant sa réception et puis chez lady Granville, que je trouve toujours au coin du feu avec son mari. Appony a eu un long entretien, hier matin avec Thiers. M. de Metternich s’emploie à arranger Thiers le trouve long et métaphysique Il voudrait que cela allât plus vite. Il a été un peu menaçant, un peu doux, et toujours un peu drôle. Appony au fond était moins inquiet hier que ces jours derniers. Tout le monde se demande " Mais comment dès qu’on va faire la guerre ! pourquoi ? " Je crois que vraiment quand le moment surprise arrivera, le ridicule pourrait bien tuer le danger. Que Dieu m’entende.
Les petits états envoient des Déclarations de Neutralité, je veux dire Sardaigne, et Suède. Les pauvres allemands n’oseront pas l’être. La Confédération en décidera autrement.
Si je vous écrivais dans mes moments de faiblesse et de tristesse, mes paroles vous feraient de la peine. De la peine et du plaisir. Le matin j’ai un peu de force, vers le milieu du jour elle m’abandonne, le soir je suis tout à fait triste, découragée. Je regarde le fauteuil vert vide, je trouve ma vie si mal arrangée ! Et puis je la crois si courte. Et ce court moment, je le passe seule ! Je ne devrais pas vous dire tout cela. Vous avez assez de votre propre tristesse et puis vendredi, un mauvais jour.
Lady Holland a bien raison de le trouver un très mauvais jour. Je suis fort bien avec Madame de Flahaut. Après la grosse explosion, elle est redevenue charmante. A propos on dit qu’elle ne parle plus dans le monde, qu’elle est d’une réserve, d’une prudence presque outrées.
Je vous envoie une lettre du duc de Noailles, car je n’ai rien à vous dire, et le dimanche vous n’avez rien à lire à Londres. Cette pauvre princesse Augusta je la regrette, car elle était la meilleure personne du monde. Elle louchait cependant , elle ne vous aurait pas plu. J’espère qu’il n’est arrivée a personne de devenir louche après cinquante ans, car après votre déclaration. tout serait donc fini ? Ma nièce plait à tout le monde. On ne peut rien voir de plus gracieux, de plus naturel et de plus élégant. Sa mère sa arriver dans quelques jours what a bore ?
1 heure
Comment se fait-il que je n’ai pas de lettres ? Je vous en prie n’envoyez qu’au gens qui attendent la poste chez eux. Adieu, adieu. Adieu à demain. Je serai bien fâchée contre vous si vous m’envoyez autre chose qu’un tendre adieu après mon explication d’hier. Je sais suffisamment me gronder moi- même et je suis trop malade pour pouvoir supporter d’être grondée. Vous verrez qu’à force de douceur je deviendrai sage tout-à-fait. Adieu. Adieu. Il y aura un Cabinet council lundi. Il sera important. C’est de Londres que je parle.
9 heures
J’ai vu hier Montrond et les Appony. J’ai fait ma promenade En rentrant, j’ai vu M. de Pahlen. Après mon dîner, j’ai éte un moment chez Mad. de Flahaut avant sa réception et puis chez lady Granville, que je trouve toujours au coin du feu avec son mari. Appony a eu un long entretien, hier matin avec Thiers. M. de Metternich s’emploie à arranger Thiers le trouve long et métaphysique Il voudrait que cela allât plus vite. Il a été un peu menaçant, un peu doux, et toujours un peu drôle. Appony au fond était moins inquiet hier que ces jours derniers. Tout le monde se demande " Mais comment dès qu’on va faire la guerre ! pourquoi ? " Je crois que vraiment quand le moment surprise arrivera, le ridicule pourrait bien tuer le danger. Que Dieu m’entende.
Les petits états envoient des Déclarations de Neutralité, je veux dire Sardaigne, et Suède. Les pauvres allemands n’oseront pas l’être. La Confédération en décidera autrement.
Si je vous écrivais dans mes moments de faiblesse et de tristesse, mes paroles vous feraient de la peine. De la peine et du plaisir. Le matin j’ai un peu de force, vers le milieu du jour elle m’abandonne, le soir je suis tout à fait triste, découragée. Je regarde le fauteuil vert vide, je trouve ma vie si mal arrangée ! Et puis je la crois si courte. Et ce court moment, je le passe seule ! Je ne devrais pas vous dire tout cela. Vous avez assez de votre propre tristesse et puis vendredi, un mauvais jour.
Lady Holland a bien raison de le trouver un très mauvais jour. Je suis fort bien avec Madame de Flahaut. Après la grosse explosion, elle est redevenue charmante. A propos on dit qu’elle ne parle plus dans le monde, qu’elle est d’une réserve, d’une prudence presque outrées.
Je vous envoie une lettre du duc de Noailles, car je n’ai rien à vous dire, et le dimanche vous n’avez rien à lire à Londres. Cette pauvre princesse Augusta je la regrette, car elle était la meilleure personne du monde. Elle louchait cependant , elle ne vous aurait pas plu. J’espère qu’il n’est arrivée a personne de devenir louche après cinquante ans, car après votre déclaration. tout serait donc fini ? Ma nièce plait à tout le monde. On ne peut rien voir de plus gracieux, de plus naturel et de plus élégant. Sa mère sa arriver dans quelques jours what a bore ?
1 heure
Comment se fait-il que je n’ai pas de lettres ? Je vous en prie n’envoyez qu’au gens qui attendent la poste chez eux. Adieu, adieu. Adieu à demain. Je serai bien fâchée contre vous si vous m’envoyez autre chose qu’un tendre adieu après mon explication d’hier. Je sais suffisamment me gronder moi- même et je suis trop malade pour pouvoir supporter d’être grondée. Vous verrez qu’à force de douceur je deviendrai sage tout-à-fait. Adieu. Adieu. Il y aura un Cabinet council lundi. Il sera important. C’est de Londres que je parle.
422. Londres, Vendredi 25 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
422. Londres, Vendredi 25 septembre 1840
6 heures
Dites-moi si l’anémone et le cidre attachent bien le même sens à tout-à-fait. Dites-moi oui sans plus. Je reviens de Regent’s Park. La même entrée, les mêmes tours, la même sortie. J’avais écrit depuis sept heures et demie jusqu’à 4 heures, sauf le déjeuner. Je n’en pouvais plus. La solitude ne m’est pas saine. J’en abuse. C’est la solitude de Londres, qui me frappe. En hiver au printemps, la foule anime un peu le silence. Les figures sont froides, mais elles se pressent. A présent pas plus de foule que de bruit. Tous les jours sont dimanche. Un grand combat se prépare entre le Dimanche et les railways. On colporte, on signe des pétitions pour que les railways soient immobiles le Dimanche. Ils sont décidés à se défendre. La question ira au Parlement. Le Cabinet sera un peu embarrassé. Le Dimanche a des amis dans son camp. Cependant, on croit qu’il prendra parti pour les railway.
Samedi 7 heures et demie
Les diplomates me sont arrivés hier soir pleins de paix. Mais elle leur venait d’où vient ordinairement la peste, d’Odessa. Lord Alvanley écrivait de là que tout était arrangé, que le Divan avait accepté les propositions du Pacha. Puis nous avons trouvé que c’était un bruit de bourse, déjà inséré dans le Globe. Les sources, les dates, les vraisemblances morales ôtent à ce bruit, toute valeur. Aujourd’hui ou demain nous aurons des nouvelles sérieuses de Syrie et d’Alexandrie.
Alava, Moncorvo, Schleinitz, Pollon, Van de weyer, Münchhausen, Lisboa et je ne sais combien de secrétaires. Je ne me laisserai point imposer les femmes. Tout en serait changé et gêné ? Leshommes sont là fort librement. On cause, on joue au Whist, à l’écarté, aux êchecs. Tous les journaux anglais et français sur une grande table ronde. Il n’y a rien a changer. On dit qu’Espartero va renvoyer la junte de Madrid et toutes les juntes. Qu’il restera président du Conseil, sans portefeuille et fera un ministère qui ressemblera à tous les autres. Que la nullité du ministère et du Président éclatera bientôt, et que la Reine sortira du défilé en y laissant sur le carreau tous ceux qui l’y ont poussée. Cela se pourrait. Mais au milieu de tous ces gens qui tombent, je cherche quelqu’un qui s’élève. Je ne vois pas. Il ne suffit pas pour gouverner d’user les hommes qui embarrassent. Quelques fois, il est vrai, on n’a rien de mieux à faire. Alors il faut se résigner à n’avoir rien de bien !
Je persiste dans mon jugement. Des maux alternatifs dans une anarchie impuissante. Grand exemple de ce que peuvent faire d’un pays les sottises absolutistes et les absurdités révolutionnaires. Depuis Philippe 2, elles possèdent l’Espagne. Une heure Adieu. L’adieu spécial que vous voulez ; et bien spécial ne ressemblant à aucun autre. Il le faut en vérité, car il y a là un mal qui résiste aux remèdes les plus héroïques. Un seul mot encore. Je n’ai plus entendu parler d’aucune tulipe. Et comme j’évite au lieu de chercher, je n’en entendrai point parler. Vous avez raison. Je ne puis pas m’éloigner. Et juse de cette raison là.
Je ne me plains pas. Soyez contente. Et soyons toujours aussi enfants, tous les deux. Mais ne maigrissez pas ; pour Dieu ne maigrissez pas ; point a cause de la maigreur, mais a cause de la santé. Pour moi, je vous promets de ne pas engraisser. Je vous tiens déjà parole car certainement, j’ai maigri depuis quinze jours. Mon anneau à failli glisser hier. Beaucoup de souci, beaucoup de travail, point. de repos, car point de bonheur. Je ne crois pas à la guerre. Je me le redis, je vous le redis, parce qu’en effet je n’y crois pas. Mais je suis aussi inquiet que si j’y croyais. L’intérêt est si grand que ma prévoyance est sans pouvoir sur ma disposition. Mes relations personnelles avec lord Palmerston sont toujours les mêmes, réellement bonnes. Je crois qu’il aurait vraiment envie d’être d’accord avec moi. Mais qu’importe. Nous verrons ce que rendra le conseil de lundi. Quelle puérilité que tout ce fracas des journaux les plus sérieux à propos de quelques phrases en l’air d’un journal obscur ! Je n’ai pas la moindre relation, avec l’Univers. Je n’ai rien dit, rien fait qui autorise, rien de semblable. Je n’ai pas écrit depuis je ne sais combin de temps à M. Dillon ni a personne qui pût abuser de mes paroles. Je suis réservé, très réservé, aussi réservé que je serais décidé s’il y avait lieu.
Je connais bien les difficultés de ma position. J’y pense sans cesse. C’est la chose à laquelle je pense le plus. Je ne me laisserai point engager au delà de ma propre idée. Ceci est trop grave pour qu’on s’y conduise autrement que selon sa propre idée. Mais je ne me séparerai pas sans motif très grave et je ne désavouerai rien de ce que j’ai accepté jusqu’à présent. Adieu. Adieu. Ne me dites pas que mes lettres sont courtes. Ce n’est pas vrai. Comment le seraient-elles? C’est tout mon plaisir. Adieu.
6 heures
Dites-moi si l’anémone et le cidre attachent bien le même sens à tout-à-fait. Dites-moi oui sans plus. Je reviens de Regent’s Park. La même entrée, les mêmes tours, la même sortie. J’avais écrit depuis sept heures et demie jusqu’à 4 heures, sauf le déjeuner. Je n’en pouvais plus. La solitude ne m’est pas saine. J’en abuse. C’est la solitude de Londres, qui me frappe. En hiver au printemps, la foule anime un peu le silence. Les figures sont froides, mais elles se pressent. A présent pas plus de foule que de bruit. Tous les jours sont dimanche. Un grand combat se prépare entre le Dimanche et les railways. On colporte, on signe des pétitions pour que les railways soient immobiles le Dimanche. Ils sont décidés à se défendre. La question ira au Parlement. Le Cabinet sera un peu embarrassé. Le Dimanche a des amis dans son camp. Cependant, on croit qu’il prendra parti pour les railway.
Samedi 7 heures et demie
Les diplomates me sont arrivés hier soir pleins de paix. Mais elle leur venait d’où vient ordinairement la peste, d’Odessa. Lord Alvanley écrivait de là que tout était arrangé, que le Divan avait accepté les propositions du Pacha. Puis nous avons trouvé que c’était un bruit de bourse, déjà inséré dans le Globe. Les sources, les dates, les vraisemblances morales ôtent à ce bruit, toute valeur. Aujourd’hui ou demain nous aurons des nouvelles sérieuses de Syrie et d’Alexandrie.
Alava, Moncorvo, Schleinitz, Pollon, Van de weyer, Münchhausen, Lisboa et je ne sais combien de secrétaires. Je ne me laisserai point imposer les femmes. Tout en serait changé et gêné ? Leshommes sont là fort librement. On cause, on joue au Whist, à l’écarté, aux êchecs. Tous les journaux anglais et français sur une grande table ronde. Il n’y a rien a changer. On dit qu’Espartero va renvoyer la junte de Madrid et toutes les juntes. Qu’il restera président du Conseil, sans portefeuille et fera un ministère qui ressemblera à tous les autres. Que la nullité du ministère et du Président éclatera bientôt, et que la Reine sortira du défilé en y laissant sur le carreau tous ceux qui l’y ont poussée. Cela se pourrait. Mais au milieu de tous ces gens qui tombent, je cherche quelqu’un qui s’élève. Je ne vois pas. Il ne suffit pas pour gouverner d’user les hommes qui embarrassent. Quelques fois, il est vrai, on n’a rien de mieux à faire. Alors il faut se résigner à n’avoir rien de bien !
Je persiste dans mon jugement. Des maux alternatifs dans une anarchie impuissante. Grand exemple de ce que peuvent faire d’un pays les sottises absolutistes et les absurdités révolutionnaires. Depuis Philippe 2, elles possèdent l’Espagne. Une heure Adieu. L’adieu spécial que vous voulez ; et bien spécial ne ressemblant à aucun autre. Il le faut en vérité, car il y a là un mal qui résiste aux remèdes les plus héroïques. Un seul mot encore. Je n’ai plus entendu parler d’aucune tulipe. Et comme j’évite au lieu de chercher, je n’en entendrai point parler. Vous avez raison. Je ne puis pas m’éloigner. Et juse de cette raison là.
Je ne me plains pas. Soyez contente. Et soyons toujours aussi enfants, tous les deux. Mais ne maigrissez pas ; pour Dieu ne maigrissez pas ; point a cause de la maigreur, mais a cause de la santé. Pour moi, je vous promets de ne pas engraisser. Je vous tiens déjà parole car certainement, j’ai maigri depuis quinze jours. Mon anneau à failli glisser hier. Beaucoup de souci, beaucoup de travail, point. de repos, car point de bonheur. Je ne crois pas à la guerre. Je me le redis, je vous le redis, parce qu’en effet je n’y crois pas. Mais je suis aussi inquiet que si j’y croyais. L’intérêt est si grand que ma prévoyance est sans pouvoir sur ma disposition. Mes relations personnelles avec lord Palmerston sont toujours les mêmes, réellement bonnes. Je crois qu’il aurait vraiment envie d’être d’accord avec moi. Mais qu’importe. Nous verrons ce que rendra le conseil de lundi. Quelle puérilité que tout ce fracas des journaux les plus sérieux à propos de quelques phrases en l’air d’un journal obscur ! Je n’ai pas la moindre relation, avec l’Univers. Je n’ai rien dit, rien fait qui autorise, rien de semblable. Je n’ai pas écrit depuis je ne sais combin de temps à M. Dillon ni a personne qui pût abuser de mes paroles. Je suis réservé, très réservé, aussi réservé que je serais décidé s’il y avait lieu.
Je connais bien les difficultés de ma position. J’y pense sans cesse. C’est la chose à laquelle je pense le plus. Je ne me laisserai point engager au delà de ma propre idée. Ceci est trop grave pour qu’on s’y conduise autrement que selon sa propre idée. Mais je ne me séparerai pas sans motif très grave et je ne désavouerai rien de ce que j’ai accepté jusqu’à présent. Adieu. Adieu. Ne me dites pas que mes lettres sont courtes. Ce n’est pas vrai. Comment le seraient-elles? C’est tout mon plaisir. Adieu.
449_1 Le 25 septembre 1840, copie de la lettre de M. De Benkendorf à la princesse de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benkendorf, M. de
Mots-clés : Ambassade à Londres
421. Londres, Vendredi 25 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
421. Londres Vendredi 25 septembre 1840
7 heures et demie
Vous voyez le travail de Paris et de Londres pour nous brouiller, Thiers et moi. L’animosité personnelle devient très vive ici. On se dit convaincu que Thiers veut la guerre. Je nie, je repousse très haut, très ferme. On persiste. On couvre sous cette conviction, sa propre obstination. Cela fait une situation de plus en plus périlleuse et délicate. Je dis périlleuse quoique le fond de ma pensée ne soit pas changé. Je ne crois pas à la guerre. Je n’y crois guère plus que je ne la veux. Je la trouverais absurde, comme un effet sans cause est absurde. Jamais je ne consentirai à voir dans Beyrouth et Damas une cause suffisante a un si immense effet. Et quoi que l’absurde, ne soit pas banni de ce monde, cependant il n’y est pas puissant à ce point. Mais quand on rase de si près le bord, il est impossible, même en ne croyant pas à la chute de ne pas avoir le sentiment du péril. Et puis les passions des hommes sont à elles seules une cause ; une cause qui dans un moment donné à propos d’un incident imprévu, peut tout emporter soudainement. C’est là le vrai danger ; celui que j’ai constamment mis, que je mets constamment sous les yeux des gens qui ont créé cette situation parce qu’ils n’ont pas voulu y croire. Ils commencent à y croire ; ils commencent à entrevoir la guerre comme possible ; et ne voulant pas s’en pendre à la situation qu’ils ont faite, ils s’en prennent à quelqu’un qui la veut, disent-ils, qui travaille sous main à l’amener. Et je passe mon temps à combattre leurs conjectures sur les intentions et leur sécurité sur la situation. Il y aura toujours un conseil de cabinet lundi, pour reparler de l’affaire Mais lord Lansdowne, lord Duncannon, lord Morpeth sont en Irlande et ne viendront pas. Et aucun de ceux qui viendront n’est encore arrivé, ni lord John Russell, ni lord Melbourne. Ils arriveront dimanche ou lundi, au moment même du conseil. Ils se réuniront sans y avoir pensé, sans en savoir et sans s’en être dit plus qu’ils n’ont encore fait. Ils en parleront une heure ou deux en hésitant beaucoup à se contredire les uns les autres. Ils croiront à peu près ce qu’ils se diront, pour ou pas être forcés de se contredire. Et voilà ce qui peut se cacher de légèreté sous les formes les plus froides et les plus sérieuses. Je n’en pousse pas moins de toutes mes forces à une transaction à une modification des propositions de la Porte au Pacha. Et après bien du temps perdu, il y a bien des chances pour que cela finisse ainsi. Je regarderais ces chances comme extrêmement probables si on croyait ici à une vraie résistance du Pacha. Mais on croit toujours qu’il cèdera.
Une heure
Il n’y a pas moyen, quand on prend le chemin de l’école, d’arriver de très bonne heure, ni toujours à la même heure. Le frêne croit que le petit F. dit vrai sur son compte. Les journaux sont pleins ce matin de mes dissentiments avec Thiers. Je suis de l’avis du Courrier français. Le jour où il y aurait entre Thiers et moi, un vrai dissentiment sur le but et la marche de la politique, nous devrions nous en avertir l’un l’autre. Et nous n’y manquerions certainement pas. Je regarde beaucoup à l’Espagne, et je n’en dis rien parce que je n’en pense rien. La modération sans force, l’anarchie sans force, la folle sans passion, le chaos parodié, quel pitoyable spectacle ! Je mintéresse à la Reine. Je lui trouve de l’esprit et du courage. soit quand elle résiste, soit quand elle cède. Je ne crois pas que, par lui-même, le pauvre pays sorte de son agonie. Mais il n’en mourra pas, et il peut y vivre longtemps sans danger pour personne. A mon avis, c’est l’Europe qui est coupable envers l’Espagne. Et coupable depuis 1833. Après la mort de Ferdinand 7 au premier moment la tutelle européenne proclamée et exercée aurait tout prévenu. On ne veut guères faire, le mal aujourd’hui. On ne sait pas faire le bien. Le bien pourrait se faire, mais à la condition d’être fait grandement. Et on s’effraie de tout ce qui exige de la grandeur. Il y a cinquante ans, l’orgueil des hommes allait à la démence ; ils se croyaient appelés à refaire le monde à la place de Dieu. Aujourd’hui, leur sagesse va jusqu’à l’inertie ; ils laissent Dieu chargé de tout. Voilà du bavardage doctrinaire Vrai pourtant.
Je viens de parcourir ces cinq pages d’écriture. Pas une tendre parole ! Est-ce possible ? Mes paroles vous plaisent. Quel plaisir auriez-vous donc si vous voyez, réellement voir ce qu’elle essayent de peindre ? Vous avez raison ; depuis que le monde existe on a beaucoup dit sur cela ; chacune des mille millions et milliards de créatures, qui ont passé sous notre soleil a élevé la voix et répété la même chose, avec son plus doux accent. Quimporte la répétition ? Tout sentiment vrai est nouveau. Tout ce qui sort réellement du fond du cœur est dit pour la première fois entendu pour la première fois. Et puis vous savez mon orgueil en ceci comme en tout, l’inégalité est immense, la varièté infinie ; les sentiments naturels, universels, que toute créature a connus et racontés à d’autres créatures, ils sont ce que les fait l’âme où ils résident ; toujours beaux et doux car Dieu les a créés tels à l’usage de tous ; mais incomparablement plus beaux, plus doux dans les élus de Dieu, car Dieu a des élus. Ne dites jamais, ne laissez jamais entrevoir ceci à personne, mon amie. Oui, j’ai la prétention de vous dire des choses qu’aucune voix d’homme n’a jamais dites et ne dira jamais qu’aucune oreille de femme n’a jamais entendues et n’entendra jamais. Et que sont les choses que je vous dis auprès de celles que je sens ?
Mon cœur est infiniment plus riche que mon langage, et mes émotions, en pensant à vous infiniment plus nouvelles, plus inouïes que mes paroles. Laissez donc ce papier et entrez dans mon cœur. Lisez ce que je ne vous écris pas. Entendez ce que je ne vous ai jamais dit. Adieu.
7 heures et demie
Vous voyez le travail de Paris et de Londres pour nous brouiller, Thiers et moi. L’animosité personnelle devient très vive ici. On se dit convaincu que Thiers veut la guerre. Je nie, je repousse très haut, très ferme. On persiste. On couvre sous cette conviction, sa propre obstination. Cela fait une situation de plus en plus périlleuse et délicate. Je dis périlleuse quoique le fond de ma pensée ne soit pas changé. Je ne crois pas à la guerre. Je n’y crois guère plus que je ne la veux. Je la trouverais absurde, comme un effet sans cause est absurde. Jamais je ne consentirai à voir dans Beyrouth et Damas une cause suffisante a un si immense effet. Et quoi que l’absurde, ne soit pas banni de ce monde, cependant il n’y est pas puissant à ce point. Mais quand on rase de si près le bord, il est impossible, même en ne croyant pas à la chute de ne pas avoir le sentiment du péril. Et puis les passions des hommes sont à elles seules une cause ; une cause qui dans un moment donné à propos d’un incident imprévu, peut tout emporter soudainement. C’est là le vrai danger ; celui que j’ai constamment mis, que je mets constamment sous les yeux des gens qui ont créé cette situation parce qu’ils n’ont pas voulu y croire. Ils commencent à y croire ; ils commencent à entrevoir la guerre comme possible ; et ne voulant pas s’en pendre à la situation qu’ils ont faite, ils s’en prennent à quelqu’un qui la veut, disent-ils, qui travaille sous main à l’amener. Et je passe mon temps à combattre leurs conjectures sur les intentions et leur sécurité sur la situation. Il y aura toujours un conseil de cabinet lundi, pour reparler de l’affaire Mais lord Lansdowne, lord Duncannon, lord Morpeth sont en Irlande et ne viendront pas. Et aucun de ceux qui viendront n’est encore arrivé, ni lord John Russell, ni lord Melbourne. Ils arriveront dimanche ou lundi, au moment même du conseil. Ils se réuniront sans y avoir pensé, sans en savoir et sans s’en être dit plus qu’ils n’ont encore fait. Ils en parleront une heure ou deux en hésitant beaucoup à se contredire les uns les autres. Ils croiront à peu près ce qu’ils se diront, pour ou pas être forcés de se contredire. Et voilà ce qui peut se cacher de légèreté sous les formes les plus froides et les plus sérieuses. Je n’en pousse pas moins de toutes mes forces à une transaction à une modification des propositions de la Porte au Pacha. Et après bien du temps perdu, il y a bien des chances pour que cela finisse ainsi. Je regarderais ces chances comme extrêmement probables si on croyait ici à une vraie résistance du Pacha. Mais on croit toujours qu’il cèdera.
Une heure
Il n’y a pas moyen, quand on prend le chemin de l’école, d’arriver de très bonne heure, ni toujours à la même heure. Le frêne croit que le petit F. dit vrai sur son compte. Les journaux sont pleins ce matin de mes dissentiments avec Thiers. Je suis de l’avis du Courrier français. Le jour où il y aurait entre Thiers et moi, un vrai dissentiment sur le but et la marche de la politique, nous devrions nous en avertir l’un l’autre. Et nous n’y manquerions certainement pas. Je regarde beaucoup à l’Espagne, et je n’en dis rien parce que je n’en pense rien. La modération sans force, l’anarchie sans force, la folle sans passion, le chaos parodié, quel pitoyable spectacle ! Je mintéresse à la Reine. Je lui trouve de l’esprit et du courage. soit quand elle résiste, soit quand elle cède. Je ne crois pas que, par lui-même, le pauvre pays sorte de son agonie. Mais il n’en mourra pas, et il peut y vivre longtemps sans danger pour personne. A mon avis, c’est l’Europe qui est coupable envers l’Espagne. Et coupable depuis 1833. Après la mort de Ferdinand 7 au premier moment la tutelle européenne proclamée et exercée aurait tout prévenu. On ne veut guères faire, le mal aujourd’hui. On ne sait pas faire le bien. Le bien pourrait se faire, mais à la condition d’être fait grandement. Et on s’effraie de tout ce qui exige de la grandeur. Il y a cinquante ans, l’orgueil des hommes allait à la démence ; ils se croyaient appelés à refaire le monde à la place de Dieu. Aujourd’hui, leur sagesse va jusqu’à l’inertie ; ils laissent Dieu chargé de tout. Voilà du bavardage doctrinaire Vrai pourtant.
Je viens de parcourir ces cinq pages d’écriture. Pas une tendre parole ! Est-ce possible ? Mes paroles vous plaisent. Quel plaisir auriez-vous donc si vous voyez, réellement voir ce qu’elle essayent de peindre ? Vous avez raison ; depuis que le monde existe on a beaucoup dit sur cela ; chacune des mille millions et milliards de créatures, qui ont passé sous notre soleil a élevé la voix et répété la même chose, avec son plus doux accent. Quimporte la répétition ? Tout sentiment vrai est nouveau. Tout ce qui sort réellement du fond du cœur est dit pour la première fois entendu pour la première fois. Et puis vous savez mon orgueil en ceci comme en tout, l’inégalité est immense, la varièté infinie ; les sentiments naturels, universels, que toute créature a connus et racontés à d’autres créatures, ils sont ce que les fait l’âme où ils résident ; toujours beaux et doux car Dieu les a créés tels à l’usage de tous ; mais incomparablement plus beaux, plus doux dans les élus de Dieu, car Dieu a des élus. Ne dites jamais, ne laissez jamais entrevoir ceci à personne, mon amie. Oui, j’ai la prétention de vous dire des choses qu’aucune voix d’homme n’a jamais dites et ne dira jamais qu’aucune oreille de femme n’a jamais entendues et n’entendra jamais. Et que sont les choses que je vous dis auprès de celles que je sens ?
Mon cœur est infiniment plus riche que mon langage, et mes émotions, en pensant à vous infiniment plus nouvelles, plus inouïes que mes paroles. Laissez donc ce papier et entrez dans mon cœur. Lisez ce que je ne vous écris pas. Entendez ce que je ne vous ai jamais dit. Adieu.
432. Paris, Jeudi 24 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
432. Paris, Jeudi 24 Septembre 1840
9 heures
Avant toute chose il faut que je
vous prie de ne plus vous servir de Génie
pour vos lettres. Vous la seconde
fois que pas son entremise je ne
les réçois qu’après 6 heures.
Ce n’est pas sa faute il passe
sa matinée dehors. Il ne rentre
qu’à 5 heures, et c’est alors qu’il
trouve la porte. Il est venu
me porter la lettre avant mon
dîner. Nous avons causé du
sujet dont je vous ai entretenu
hier, il dit qu’il y a longtemps
qu’il le sait et qu’il vous le dit,
il dit aussi que vous écrivez.
trop à M. Dillon. Par là arrivent
des commérages, qui se glissent
dans les journaux. Je vous redis tout.
Votre lettre de jeudi est bien
desponding. Dans un mois
dites-vous la crise doit être
résolu. Mon Dieu qu’arrivera-t-il ?
Ne vous flattez pas
qu’il y ait aucun moyen de
me faire rester à Paris ou en
France. C’est impossible, je
ne puis pas être le seul Russe
qui reste en pays ennemi.
Jugez donc quelle horreur si
la guerre éclate ! Et je la
crois plus probable que le
contraire. Elle est dans la
marche des événements créés
par le 15 juillet et dans l’attitude
que la France a prise en
conséquence.
Elle est surtout dans l’intérêt de Thiers
il est impossible qu’il vive
s’il ne remporte pas un triomphe
moral en faisant modifier
le traité, ou s’il ne fait
pas la guerre. Il n’y point
d’autre alternative. Comment
espérer qu’on lui fournisse
la première ?
Je n’y crois
plus. On est trop engagé
et vous avez trop menacé
et les puissances se diront
qu’il y a bien plus d’avantages
pour elles à commencer
de suite qu’à attendre ;
car aujourd’hui vous n’êtes
pas encore prêts. Dans
6 mois vous le serez trop
tout cela a été horriblement
mal mené. Il y a des torts
de tous les côtés. Mais il ne
s’agit plus de cela.
Cependant est-il possible
de faire la guerre pour quelque
Pachaliks !! Vraiment
c’est fou, mais le monde
est fou.
Ce que je regarde comme
certain, c’est que tout doit
être décidé avant les chambres.
J’ai vu hier matin Bulwer
et Mad. de Flahaut chez
moi.
Je suis sortie pour
aller au bois de Boulogne.
Je fais tristement et tranquillement
et solitairement ma
promenade tous les jours à
moins de pluie. Le médecin
me l’ordonne, mais il m’ordonne
aussi de me coucher à 10
heures, de ne voir que deux
personnes à la fois, de dîner
seule une perdrix ou un
poulet, rien que cela. Enfin,
je suis encore malade. J’ai
été un peu rudement menée
à Londres. Le voyage m’a
beaucoup fatiguée. Je n’ai
jamais été maigre de ma
vie comme je le suis maintenant.
Je tâche de me
calmer, de me reposer, mais
si vous nous donnez la guerre
dites que vais-je devenir ? J’ai vu les Granville hier au
soir. Nous sommes plus
intimes que jamais, car nos
opinions se renontrent parfaitement.
11 heures Voici votre lettre. Les
gros et les vieux sont les meilleures
voies.
Je commence par répondre
à votre question sur ma
question. Tout franchement
j’étais triste d’entendre parler
de séjour chez une tulipe.
Je n’osais pas me l’avouer
à moi même, j’osais encore
moins le dire, et voilà que
Je vous le dis. " Envoyez-moi
un bon adieu pour réponse
car je ne veux pas que vous perdiez votre temps à me dire
ce que je sais, vous avez mieux
à faire que cela. Je suis une
sotte ; vous ne me le direz jamais
aussi énergiquement que je
me le dis à moi-même. Faites
toujours ce que vous croyez
qui est convenable. Moi aujourd’hui
j’aurais cru convenable
de ne pas vous absenter. Si
le moment s’y prète et si
vous ne pouvez pas éviter à
moins d’impolitesse, faites
comme vous l’entendez ; n’en
parlons plus et ne me
parlez pas de ceci, je vous
prie, répondez par un adieu,
un adieu spécial sur ceci, et
dites-moi, dites-moi qu’il n’y aura pas de guerre. Vraiment
chacune de vos lettres est triste
et ce sont des généralités. Vous
ne me dites pas comment vous
êtes avec Lord P.
Dois-je prendre
le Morning chronicle pour la pensée
du gouvernement ? Le Times vous échappe
à ce que je vois. Enfin, enfin
il y a bien de dégringolade.
Le roi de Hollande a fait
venir Fagel, il est parti hier
matin ton subitement.
Dites à Dedel mille souvenirs
de ma part.
le Constitutionnel de ce matin.
vous embarque fort et ferme
dans la galère.
Je vous prie de ne pas tout manquer.
Votre sommeil de l’après dîner vous
vient de là. C’est détestable, je
serais encore plus fâchée de vous
voir engraisser que vous ne pourriez
l’être de me voir maigrir.
Je trouve affreux pour un homme
d’avoir de l’embonpoint. Si jamais
vous deveniez comme lord
Holland. Je ne sais mais il
me semble...
Allons, adieu. Ecrivez-moi davantage
Vous me dites peu, vous
m’écrivez courtement. Je ne vis
que pour vos lettres. Adieu. Adieu.
431. Paris, Mercredi 23 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
431. Paris, Mercredi 23 septembre 1840
9 heures
J’ai vu hier matin, Bulwer, Appony, Granville chez moi. J’ai fait une courte visite à Lady Granville, une plus courte promenade encore en voiture. Il pleuvait à verse après mon dîner j’ai vu les deux Pahlen jusqu’à 10 heures.
Il y avait une soirée chez Lady Granville. Granville a vu longtemps Thiers à Auteuil lundi matin. Ils sont venus ensemble en ville. Granville est retourné dîner à Auteuil. Le soir il a été à St Cloud. Partout reçu et traité avec amitié et un grand empressement. Je crois. que Thiers a perdu tout le goût, qu’il avait pour Bulwer. Thiers est monté sur son cheval de bataille. Il aura neuf cent mille combattants ; il ne craint pas l’Europe réunie. Le protocole de jeudi est à ses yeux une mystification. Le Roi est soucieux depuis deux ou trois jours. Il se loue beaucoup de M. de Pahlen, (c’est de sa personne qu’il s’agit).
Je relève une erreur dans une de vos lettres. Ce n’est pas la grande duchesse Marie seule qui se trouve être maintenant cousine de M. Demidoff. La mère de Mad. Demidoff était sœurs du Roi de Wurtemberg, cousine germaine de l’Empereur Nicolas, par conséquent M. Demidoff devient neveu de l’Empereur à la mode de Bretagne. Voilà mon indiquation. Après cela, savez-vous qui était le le père de M. Demidoff celui que vous avez vu à Paris riche et perclus ? Il était sorti de je ne sais quel gentilhomme russe et potier, C’était son métier. Il a fait cette fortune par son industrie. Vous voilà bien résigné sur mon indication. Il y a beaucoup de symptômes ici qui indiquent que les préparatifs de guerre s’ils ne sont pas employés bientôt le seront plus tard. La France ne voudra pas avoir tant fait, pour ne faire rien ; et M. Thiers surtout voudra faire beaucoup ou au moins quelque chose.
Voilà ce qu’on se dit, et ce qui a beaucoup de vraisemblance. Alors il y a des personnes qui disent qu’il vaudrait mieux lui. adresser dès aujourd’hui, tout de suite, des questions sur ses armements sont-ils défensifs ? Mais personne ne songe à l’attaquer. Sont-ils offensifs, ou enfin destinés à soutenir les prétentions du Pacha ? On dit que plus douce aujourd’hui qu’elle ne le serait peut-être dans quelques mois. Et qu’en tout état de cause on ne peut pas rester longtemps dans cet état actuel de crise et d’incertitude. Je vous dis le bavardage. Les Anglais en déclament beaucoup contre la reine Christine, probablement aussi contre votre influence sur elle. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’elle est dans une pauvre situation.
Le petit F. m’a dit tenir de bonne source que 48 parle fort mal du Frêne, à ses confidents il ajoute qu’il ne fait plus de confidences véritables au peuplier. En savez-vous quelque chose ? On dit qu’au fond Thiers est mécontent de ce que Walesky est allé à Constantinople. Je crois moi que le choix de ce négociateur sera particulièrement désagréable à la Russie et ajoutera par là à l’aigreur à Constantinople.
Il faut que j’aie une lettre aujourd’hui, il m’en faut une et bonne et longue absolument. mon fils m’écrit de Bade qu’il va encore en Angleterre. Il ne sera donc ici que dans le mois d’octobre. Vous faites bien d’avoir vos soirées. Mais je vois d’ici que lady Palmerston sous forcera à recevoir des dames. J’ai trouvé le speech du roi de Prusse de son balcon à Konisberg passablement ridicule, bien Schärmevitch. La dernière phrase inintelligible.
2 heures
Pas de lettre ! C’est abominable après deux jours d’abstinence. Il faudra fermer ceci sans vous rendre un adieu, mais je le donne comme vous pouvez le désirer tout-à-fait ? Adieu. Avez-vous lu le National de ce matin ?
9 heures
J’ai vu hier matin, Bulwer, Appony, Granville chez moi. J’ai fait une courte visite à Lady Granville, une plus courte promenade encore en voiture. Il pleuvait à verse après mon dîner j’ai vu les deux Pahlen jusqu’à 10 heures.
Il y avait une soirée chez Lady Granville. Granville a vu longtemps Thiers à Auteuil lundi matin. Ils sont venus ensemble en ville. Granville est retourné dîner à Auteuil. Le soir il a été à St Cloud. Partout reçu et traité avec amitié et un grand empressement. Je crois. que Thiers a perdu tout le goût, qu’il avait pour Bulwer. Thiers est monté sur son cheval de bataille. Il aura neuf cent mille combattants ; il ne craint pas l’Europe réunie. Le protocole de jeudi est à ses yeux une mystification. Le Roi est soucieux depuis deux ou trois jours. Il se loue beaucoup de M. de Pahlen, (c’est de sa personne qu’il s’agit).
Je relève une erreur dans une de vos lettres. Ce n’est pas la grande duchesse Marie seule qui se trouve être maintenant cousine de M. Demidoff. La mère de Mad. Demidoff était sœurs du Roi de Wurtemberg, cousine germaine de l’Empereur Nicolas, par conséquent M. Demidoff devient neveu de l’Empereur à la mode de Bretagne. Voilà mon indiquation. Après cela, savez-vous qui était le le père de M. Demidoff celui que vous avez vu à Paris riche et perclus ? Il était sorti de je ne sais quel gentilhomme russe et potier, C’était son métier. Il a fait cette fortune par son industrie. Vous voilà bien résigné sur mon indication. Il y a beaucoup de symptômes ici qui indiquent que les préparatifs de guerre s’ils ne sont pas employés bientôt le seront plus tard. La France ne voudra pas avoir tant fait, pour ne faire rien ; et M. Thiers surtout voudra faire beaucoup ou au moins quelque chose.
Voilà ce qu’on se dit, et ce qui a beaucoup de vraisemblance. Alors il y a des personnes qui disent qu’il vaudrait mieux lui. adresser dès aujourd’hui, tout de suite, des questions sur ses armements sont-ils défensifs ? Mais personne ne songe à l’attaquer. Sont-ils offensifs, ou enfin destinés à soutenir les prétentions du Pacha ? On dit que plus douce aujourd’hui qu’elle ne le serait peut-être dans quelques mois. Et qu’en tout état de cause on ne peut pas rester longtemps dans cet état actuel de crise et d’incertitude. Je vous dis le bavardage. Les Anglais en déclament beaucoup contre la reine Christine, probablement aussi contre votre influence sur elle. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’elle est dans une pauvre situation.
Le petit F. m’a dit tenir de bonne source que 48 parle fort mal du Frêne, à ses confidents il ajoute qu’il ne fait plus de confidences véritables au peuplier. En savez-vous quelque chose ? On dit qu’au fond Thiers est mécontent de ce que Walesky est allé à Constantinople. Je crois moi que le choix de ce négociateur sera particulièrement désagréable à la Russie et ajoutera par là à l’aigreur à Constantinople.
Il faut que j’aie une lettre aujourd’hui, il m’en faut une et bonne et longue absolument. mon fils m’écrit de Bade qu’il va encore en Angleterre. Il ne sera donc ici que dans le mois d’octobre. Vous faites bien d’avoir vos soirées. Mais je vois d’ici que lady Palmerston sous forcera à recevoir des dames. J’ai trouvé le speech du roi de Prusse de son balcon à Konisberg passablement ridicule, bien Schärmevitch. La dernière phrase inintelligible.
2 heures
Pas de lettre ! C’est abominable après deux jours d’abstinence. Il faudra fermer ceci sans vous rendre un adieu, mais je le donne comme vous pouvez le désirer tout-à-fait ? Adieu. Avez-vous lu le National de ce matin ?
419. Londres, Mercredi 23 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
419. Londres, Mercredi 23 septembre 1840
7 heures et demie
Pardon d’avoir commencé par cette demi- feuille déchirée. Toujours la tempête. Je suis à écrire, dans mon lit depuis quatre heures du matin. J’écris quelques fois pour me rendre de ce que je pense, un compte bien complet, bien rigoureux. On pense si légèrement ! On fait tant de sottises pour avoir légèrement pensé ! Je trouve les esprits encore plus légers que les cœurs. C’est beaucoup. Mais que m’importe que les cœurs et les esprits soient légers ? Le seul cœur, le seul esprit dont j’aie besoin ne l’est pas. Il est loin de moi ; voilà son seul défaut. Je suis bien vivement ce défaut là. Je voudrais bien causer avec vous. Mon instinct m’a dit que l’affaire est dans sa crise ; crise au dedans, crise au dehors. Moi aussi, je suis condamné à la politique de l’isolement. Elle me déplaît fort. Me voilà tranquille sur la tempête. La malle a passé. Un courrier vient de m’arriver. Il ne m’apporte rien du tout qu’une lettre de cet honnête ministre des finances qui m’écrit : " Je suis bien aise de voir que les circonstances ne détournent pas lady Durham et beaucoup d’autres de venir jouir de notre beau climat, et j’espère que cette confiance ne sera pas trompée. " Je vais faire ma toilette en attendant d’autres lettres.
4 heures
J’ai encore écrit énormément depuis ce matin. Je voulais finir ce que j’avais commencé cette nuit. Vous aussi votre lettre est charmante. Laissez-moi juge de ce que vous méritez. C’est moi que cela regarde. Je vous ai dit bien des vérités, franches. Je peux bien vous dire à mon gré des vérités tendres. Ne dirait-on pas que mes vérités tendres ne seront pas franches ? Je vous aime chez moi. N’y ayez pas de sentiments mêlés. Tout est à vous, tout est à moi ; tout ce dont nous avons pu disposer, l’un et l’autre. Jamais don n’a été plus complet. Moi aussi, j’ai eu mes sentiments mêlés. A présent je ne les ai plus ; je ne les aurai plus jamais. Il me semble. Comment avez-vous trouvé mon portrait ? Votre dîner n’est donc pas autre que celui de Stafford house ? Est-ce faute d’appétit, ou de peur de fatiguer votre estomac? Je suis en général porté à croire qu’on mange trop. Le gâteau de semoule de Valentin vaut-il celui de Guillet ?
Voilà la princesse Augusta morte. Il faudra que j’aille passer sans prétexte devant Stafford house. Vous ne savez pas combien ces plaisirs-là s’usent peu pour moi. Je pourrais me donner le même tous les jours pendant des années. Mes plaisirs sont peu nombreux mais immenses, inépuisables. La transaction est sur le tapis. Elle aurait de bien meilleures chances, si le bruit ne s’était pas répandu ici que le Pacha allait céder tout-à-fait, et que c’est M. Valeski qui l’a empêché. Les adversaires de la transaction exploitent beaucoup cela. Cependant je travaille. On travaille. Il y aura un conseil de cabinet lundi. Certainement la transaction y est en grand majorité. Mais la majorité ne suffit pas. Il faut quelqu’un qui ait le courage de la prendre et de s’en servir contre la minorité.
Je dîne aujourd’hui chez Lord Palmerston. Je le pousserai vivement. Lady Palmerston m’a paru en effet avoir quelque envie de plus d’abandon. Je ne demande pas mieux. Je m’abandonnerai pourvu qu’on me cède. J’aurais vraiment aimé à me trouver de l’avis de lord Palmerston et agissant avec lui. Mais il veut tout, et moi je veux ma part. On me dit que c’est l’heure de la poste. Je trouve toutes les lettres trop courtes, celles que j’écris, celles que je reçois. Tout est trop court. Est-il vrai que vous ayez passé à Londres deux ans et demi ? J’ai peine à y croire. Quel charmant temps ! Un charmé si doux et si solennel ! Y aurait-il mieux ? N’est-ce pas, il y aura mieux ? Est-ce possible ? Oui, c’est possible. Adieu. Adieu. En attendant mieux.
7 heures et demie
Pardon d’avoir commencé par cette demi- feuille déchirée. Toujours la tempête. Je suis à écrire, dans mon lit depuis quatre heures du matin. J’écris quelques fois pour me rendre de ce que je pense, un compte bien complet, bien rigoureux. On pense si légèrement ! On fait tant de sottises pour avoir légèrement pensé ! Je trouve les esprits encore plus légers que les cœurs. C’est beaucoup. Mais que m’importe que les cœurs et les esprits soient légers ? Le seul cœur, le seul esprit dont j’aie besoin ne l’est pas. Il est loin de moi ; voilà son seul défaut. Je suis bien vivement ce défaut là. Je voudrais bien causer avec vous. Mon instinct m’a dit que l’affaire est dans sa crise ; crise au dedans, crise au dehors. Moi aussi, je suis condamné à la politique de l’isolement. Elle me déplaît fort. Me voilà tranquille sur la tempête. La malle a passé. Un courrier vient de m’arriver. Il ne m’apporte rien du tout qu’une lettre de cet honnête ministre des finances qui m’écrit : " Je suis bien aise de voir que les circonstances ne détournent pas lady Durham et beaucoup d’autres de venir jouir de notre beau climat, et j’espère que cette confiance ne sera pas trompée. " Je vais faire ma toilette en attendant d’autres lettres.
4 heures
J’ai encore écrit énormément depuis ce matin. Je voulais finir ce que j’avais commencé cette nuit. Vous aussi votre lettre est charmante. Laissez-moi juge de ce que vous méritez. C’est moi que cela regarde. Je vous ai dit bien des vérités, franches. Je peux bien vous dire à mon gré des vérités tendres. Ne dirait-on pas que mes vérités tendres ne seront pas franches ? Je vous aime chez moi. N’y ayez pas de sentiments mêlés. Tout est à vous, tout est à moi ; tout ce dont nous avons pu disposer, l’un et l’autre. Jamais don n’a été plus complet. Moi aussi, j’ai eu mes sentiments mêlés. A présent je ne les ai plus ; je ne les aurai plus jamais. Il me semble. Comment avez-vous trouvé mon portrait ? Votre dîner n’est donc pas autre que celui de Stafford house ? Est-ce faute d’appétit, ou de peur de fatiguer votre estomac? Je suis en général porté à croire qu’on mange trop. Le gâteau de semoule de Valentin vaut-il celui de Guillet ?
Voilà la princesse Augusta morte. Il faudra que j’aille passer sans prétexte devant Stafford house. Vous ne savez pas combien ces plaisirs-là s’usent peu pour moi. Je pourrais me donner le même tous les jours pendant des années. Mes plaisirs sont peu nombreux mais immenses, inépuisables. La transaction est sur le tapis. Elle aurait de bien meilleures chances, si le bruit ne s’était pas répandu ici que le Pacha allait céder tout-à-fait, et que c’est M. Valeski qui l’a empêché. Les adversaires de la transaction exploitent beaucoup cela. Cependant je travaille. On travaille. Il y aura un conseil de cabinet lundi. Certainement la transaction y est en grand majorité. Mais la majorité ne suffit pas. Il faut quelqu’un qui ait le courage de la prendre et de s’en servir contre la minorité.
Je dîne aujourd’hui chez Lord Palmerston. Je le pousserai vivement. Lady Palmerston m’a paru en effet avoir quelque envie de plus d’abandon. Je ne demande pas mieux. Je m’abandonnerai pourvu qu’on me cède. J’aurais vraiment aimé à me trouver de l’avis de lord Palmerston et agissant avec lui. Mais il veut tout, et moi je veux ma part. On me dit que c’est l’heure de la poste. Je trouve toutes les lettres trop courtes, celles que j’écris, celles que je reçois. Tout est trop court. Est-il vrai que vous ayez passé à Londres deux ans et demi ? J’ai peine à y croire. Quel charmant temps ! Un charmé si doux et si solennel ! Y aurait-il mieux ? N’est-ce pas, il y aura mieux ? Est-ce possible ? Oui, c’est possible. Adieu. Adieu. En attendant mieux.
420. Londres, Mercredi 23 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
420. Londres, Mercredi 23 septembre 1840
six heures et demie
Je vous quitte à peine et je vous reviens. Pourquoi se quitter jamais? Savez-vous que les trois quarts des chagrins qu’on a c’est qu’on le veut. bien ?
Il me semble que 22 s’accroche bien fort aux branches du Chêne. On me dit qu’il y a bien des gens qui voudraient l’y pendre. De loin, 48 a un peu l’air de s’accrocher à tout. Quoique 12 ne soit que le quart de 48, il se flatte bien d’être un chiffre plus fort, et il s’asseoirait volontiers aux pieds du chêne pour qu’il se prétât à l’usage qu’on voudrait faire de lui. Il lui ferait même probablement d’assez grandes concessions de terrain. Est-ce que la grande pensée n’a pas envoyé quelqu’une de ses feuilles à 83 qui aime tant les fleurs ? Si je ne me trompe il se fait en ce moment bien des calculs autour de 34. Le Mélèze serait curieux de savoir si on lui en veut toujours beaucoup de ne pas vouloir épouser 2 en secondes noces et si on espère que 14 refera un grand mariage. Je vous suis à peine revenu et il faut que je vous quitte pour m’habiller. Quand vous étiez ici, j’en voulais à à R. féminin. Depuis que vous n’y êtes plus, je la revois avec plaisir. Elle n’est pas la rose, mais.... Il est convenu que j’aime les redites.
Jeudi 9 heures
A dîner, Lady Clanricard, Lord Minto, M. et Mad. Van de Weyer, Alava, Pollon et Schleinitz, Lady Clanricard en grande coquetterie avec moi, coquetterie non seulement animée et spirituelle, mais presque douce et affectueuse, ce qui est moins dans sa nature. Un lieu banal de conversation, mœurs anglaises ; elle en faisait très bon marché. " Mais nous avons un seul avantage, l’intimité ; nous aimons l’intimité ; nous avons de l’intimité. " Je me suis récrié : " C’est précisément ce que vous n’avez pas. Je ne sais pas comment vous êtes dans vos ménages mais en sortant du ménage de la famille, vous tombez tout de suite dans le raout. Il faut à l’intimité un laisser-aller, un besoin de communication, de sympathie, d’épanchement, qui me semblent inconnus ici. "
Cela ne vaut pas la peine de vous être redit. Son langage était très bienveillant pour la France, pour la vie et la societé française. Point de politique du tout : " Je ne comprends pas comment fait-on Angleterre une femme de moyen-âge qui devient veuve et n’a plus de grande part au monde. Si cela m’arrive j’irai vivre ailleurs, en France peut-être. " Pas plus de politique avec Lord Palmerston qu’avec Lady Clanricard. Un peu avec Lord Minto. Triste de part et d’autre. L’idée de la guerre possible pénètre ici. Il y a huit jours, on n’y croyait pas encore du tout. Je persiste à n’y pas croire. Une transaction sortira de tous ces essais de transaction. Et j’y regarde avec une anxièté qui surmonte, je vous en réponds, ma disposition générale à l’optimisme. Lord et lady Palmerston très empressés pour moi.
Une heure
Vous avez très bien écrit à lady Palmerston Evidemment, évidemment, il est absurde, il est ridicule de faire courir à l’Europe, pour le motif qu’on allègue, les chances qu’on lui ferait courir en repoussant une transaction. " Il faut Beyrout et Damas au Sultan ! " Qui donc savait, qui pensait à savoir en Europe, il y a deux ans si Beyrout et Damas étaient au Sultan, ou au Pacha ? L’Europe, l’Europe saine grande, forte, belle, attachant ses destinées à la question de savoir si ces ruines pestiférées seront au pouvoir d’un vieillard près de mourir ou d’un enfant hors d’état de régner ? Dieu garde le monde de cette alliance : un petit esprit et un caractère fort ! Il n’y a pas de folie, pas de matheur qui n’en puisse sortir. Moi aussi, le memorandum du 24 août ne m’a pas satisfait, pour la forme du moins. Je l’aurais écrit autrement. C’est vraiment du guignon qu’il passe pour trop doctrinaire. On m’écrit ce matin que 31 a grand peur et fort peu d’envie de rentrer dans une si vive mêlée. Pourquoi n’écririez-vous pas à 2 que vous êtes de retour ? Savez vous ce que je soupçonne dans ce silence gardé envers vous par 2 et trois fois 2 ? Quelque misérable lâcheté, tenez pour certain que le langage de 90 à Paris, et celui de l’homme qui " mange avec autorité " à Londres sont très differents. Le mangeur n’est pas frondeur du tout. Adieu.
Vous ai-je dit aujourd’hui un mot autre que d’affaires ? Non, je crois. Pourtant j’ai bien autre chose dans le cœur Adieu, Selon mon cœur.
six heures et demie
Je vous quitte à peine et je vous reviens. Pourquoi se quitter jamais? Savez-vous que les trois quarts des chagrins qu’on a c’est qu’on le veut. bien ?
Il me semble que 22 s’accroche bien fort aux branches du Chêne. On me dit qu’il y a bien des gens qui voudraient l’y pendre. De loin, 48 a un peu l’air de s’accrocher à tout. Quoique 12 ne soit que le quart de 48, il se flatte bien d’être un chiffre plus fort, et il s’asseoirait volontiers aux pieds du chêne pour qu’il se prétât à l’usage qu’on voudrait faire de lui. Il lui ferait même probablement d’assez grandes concessions de terrain. Est-ce que la grande pensée n’a pas envoyé quelqu’une de ses feuilles à 83 qui aime tant les fleurs ? Si je ne me trompe il se fait en ce moment bien des calculs autour de 34. Le Mélèze serait curieux de savoir si on lui en veut toujours beaucoup de ne pas vouloir épouser 2 en secondes noces et si on espère que 14 refera un grand mariage. Je vous suis à peine revenu et il faut que je vous quitte pour m’habiller. Quand vous étiez ici, j’en voulais à à R. féminin. Depuis que vous n’y êtes plus, je la revois avec plaisir. Elle n’est pas la rose, mais.... Il est convenu que j’aime les redites.
Jeudi 9 heures
A dîner, Lady Clanricard, Lord Minto, M. et Mad. Van de Weyer, Alava, Pollon et Schleinitz, Lady Clanricard en grande coquetterie avec moi, coquetterie non seulement animée et spirituelle, mais presque douce et affectueuse, ce qui est moins dans sa nature. Un lieu banal de conversation, mœurs anglaises ; elle en faisait très bon marché. " Mais nous avons un seul avantage, l’intimité ; nous aimons l’intimité ; nous avons de l’intimité. " Je me suis récrié : " C’est précisément ce que vous n’avez pas. Je ne sais pas comment vous êtes dans vos ménages mais en sortant du ménage de la famille, vous tombez tout de suite dans le raout. Il faut à l’intimité un laisser-aller, un besoin de communication, de sympathie, d’épanchement, qui me semblent inconnus ici. "
Cela ne vaut pas la peine de vous être redit. Son langage était très bienveillant pour la France, pour la vie et la societé française. Point de politique du tout : " Je ne comprends pas comment fait-on Angleterre une femme de moyen-âge qui devient veuve et n’a plus de grande part au monde. Si cela m’arrive j’irai vivre ailleurs, en France peut-être. " Pas plus de politique avec Lord Palmerston qu’avec Lady Clanricard. Un peu avec Lord Minto. Triste de part et d’autre. L’idée de la guerre possible pénètre ici. Il y a huit jours, on n’y croyait pas encore du tout. Je persiste à n’y pas croire. Une transaction sortira de tous ces essais de transaction. Et j’y regarde avec une anxièté qui surmonte, je vous en réponds, ma disposition générale à l’optimisme. Lord et lady Palmerston très empressés pour moi.
Une heure
Vous avez très bien écrit à lady Palmerston Evidemment, évidemment, il est absurde, il est ridicule de faire courir à l’Europe, pour le motif qu’on allègue, les chances qu’on lui ferait courir en repoussant une transaction. " Il faut Beyrout et Damas au Sultan ! " Qui donc savait, qui pensait à savoir en Europe, il y a deux ans si Beyrout et Damas étaient au Sultan, ou au Pacha ? L’Europe, l’Europe saine grande, forte, belle, attachant ses destinées à la question de savoir si ces ruines pestiférées seront au pouvoir d’un vieillard près de mourir ou d’un enfant hors d’état de régner ? Dieu garde le monde de cette alliance : un petit esprit et un caractère fort ! Il n’y a pas de folie, pas de matheur qui n’en puisse sortir. Moi aussi, le memorandum du 24 août ne m’a pas satisfait, pour la forme du moins. Je l’aurais écrit autrement. C’est vraiment du guignon qu’il passe pour trop doctrinaire. On m’écrit ce matin que 31 a grand peur et fort peu d’envie de rentrer dans une si vive mêlée. Pourquoi n’écririez-vous pas à 2 que vous êtes de retour ? Savez vous ce que je soupçonne dans ce silence gardé envers vous par 2 et trois fois 2 ? Quelque misérable lâcheté, tenez pour certain que le langage de 90 à Paris, et celui de l’homme qui " mange avec autorité " à Londres sont très differents. Le mangeur n’est pas frondeur du tout. Adieu.
Vous ai-je dit aujourd’hui un mot autre que d’affaires ? Non, je crois. Pourtant j’ai bien autre chose dans le cœur Adieu, Selon mon cœur.
418. Londres, Mardi 22 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
418. Londres, Mardi 22 septembre 1840
huit heures
Je ne puis souffrir de vous écrire à la hâte, comme ces jours-ci. A part même l’ennui d’une lettre courte, être avec vous et me presser de vous quitter, cela me choque. Je viens de me lever. Rien ne me presse. Je m’appartiens. Je vous appartiens. Je reviens à votre dernière phrase.
" Pourquoi suis- je si triste ? " Je vous connais comme à moi, une raison d’être triste qui suffit à beaucoup de tristesse. J’accepte celle-là, pour vous comme pour moi. Y en a-t-il quelque autre ? Répondez- moi à la question que vous me faites. Savez-vous ce que j’ai découvert samedi ? Qu’il m’était désagréable de quitter Londres. En roulant sur le chemin de fer, je ne comprenais pas, à la lettre, je ne comprenais pas pourquoi j’avais le cœur un peu serré. Je l’ai trouvé en y pensant, et cela m’a soulagé de le trouver. J’aime Londres. Londres ou Paris. Quand un sentiment possède le coeur, que de mouvement instinctifs, irréfléchis, obscurs, il y fait naître ! On est triste ou joyeux sans savoir pourquoi. Puis on comprend. N’y a-t-il pas bien des chansons qui ont dit ce que je dis-là ? Voi che sapete & & Les chansons ont raison.
Je suis très préoccupé des affaires. La phase où nous entrons et la manière dont nous y entrons ne me plaît pas. Je suis convainecu qu’en France, comme en Europe on désire la paix, et qu’en France comme en Europe, on n’accepterait franchement, on ne soutiendrait ardemment la guerre qu’autant qu’elle serait née d’elle- même, par un accident imprévu, par une nécessité soudaine inévitable. Il faut ne pas vouloir la guerre, même eût-on la prévoyance qu’elle viendra. Car si le monde, qui n’en veut pas, peut soupçonner qu’elle est venue par la volonté ou par la faute de quelqu’un, ce sera, pour celui-là un affaiblissement immense impossible à mésurer. Vous le savez ; j’ai toujours cru, je crois toujours la guerre évitable ; mais quand je croirais, le contraire, et tout en m’y préparant, je m’appliquerais sans relâche, sérieusement, sincèrement à l’éviter jusqu’au moment où elle viendrait tomber sur moi comme la foudre. Si l’incendie doit éclater, il faut que ce soit par le feu du ciel, non pas d’une main d’homme. Personne hier à Holland house. J’ai tort ; lord Jeffrey, qui arrive d’Edimbourg. Je persiste dans ma première impression ; l’homme le plus spirituel que j’aie vu ici. Un peu d’humeur, et de découragement dans l’esprit ce qui en ôte beaucoup, car cela donne l’air vieux, et la vieillesse ne va pas mieux à l’esprit qu’au corps. Je ne sais ce qui m’arrivera ; jusqu’à présent, l’âge, en m’apportant de l’expérience, m’a paru n’apporter que de la lumière et de la force. J’ai appris à mieux penser et à mieux agir, non à douter et à désespèrer. Un moment viendra, je le sais, où mon esprit conservât-il sa pleine santé, mon corps affaibli ne suffira plus à lui servir d’instrument. Je tâcherai de ne pas me faire illusion sur ce moment là.
Depuis quelques jours une singulière envie de dormir me prend tout de suite après dîner, presque à table. Beaucoup moins quand je dîne chez moi que chez les autres. Je soupçonne qu’on mange trop ici, même moi, et que la fatigue de mon estomac fait la lourdeur de ma tête. Une tempête affrense. La pluie bat mes vitres à les casser. Les arbres de mon square baissent la tête jusque sur la grille qui l’entoure. Je crains bien que ceci ne me coûte demain ma lettre. La poste ne passera pas aujourd’hui. Je vois par les journaux anglais qu’elle a passé hier. Ils ont leur exprès de Paris. Il faisait beau hier. La pluie a commencé le soir, quand je suis revenu de Holland house. une heure Cette irrégularité des lettres me désole autant pour vous que pour moi. Quand aurez-vous eu celle de Dimanche ? Quand c’est-à dire à quelle heure, car certainement vous l’aurez eue. Je regarde au vent ; je le trouve tombé. J’espère que ma lettre à moi, passera aujourd’hui et que je l’aurai demain. Pendant qu’on espère une transaction à Paris, j’y travaille ici de tout mon pouvoir. Travail difficile dans cette saison. Où saisir les gens pour les chauffer ? Et les rapports obscurs, contradictoires, embrouillent tout. On a dévié de cette grande idée qui présidait depuis dix ans à la conduite de l’Europe. Aucune question particulière ne vaut la guerre générale. Le mal est là. On n’a plus de boussole ! Et on a dévié pour la plus petite, la plus lointaine des questions, pour une question que bien peu d’années de patience devaient emporter. Je ramène sans relâche, devant tous les yeux, l’idée grande, l’idée simple qui a tout sauvé. C’est en son nom que je prêche la transaction. L’obstination est grande. Obstination d’aveugle, et d’aveugle piqué qu’on le soupçonne de ne pas voir. Je m’obstine aussi. Vous savez que je suis peu accessible, au découragement. Adieu. Je vous redemande, en finissant la réponse à votre question de samedi. Adieu. Adieu.
huit heures
Je ne puis souffrir de vous écrire à la hâte, comme ces jours-ci. A part même l’ennui d’une lettre courte, être avec vous et me presser de vous quitter, cela me choque. Je viens de me lever. Rien ne me presse. Je m’appartiens. Je vous appartiens. Je reviens à votre dernière phrase.
" Pourquoi suis- je si triste ? " Je vous connais comme à moi, une raison d’être triste qui suffit à beaucoup de tristesse. J’accepte celle-là, pour vous comme pour moi. Y en a-t-il quelque autre ? Répondez- moi à la question que vous me faites. Savez-vous ce que j’ai découvert samedi ? Qu’il m’était désagréable de quitter Londres. En roulant sur le chemin de fer, je ne comprenais pas, à la lettre, je ne comprenais pas pourquoi j’avais le cœur un peu serré. Je l’ai trouvé en y pensant, et cela m’a soulagé de le trouver. J’aime Londres. Londres ou Paris. Quand un sentiment possède le coeur, que de mouvement instinctifs, irréfléchis, obscurs, il y fait naître ! On est triste ou joyeux sans savoir pourquoi. Puis on comprend. N’y a-t-il pas bien des chansons qui ont dit ce que je dis-là ? Voi che sapete & & Les chansons ont raison.
Je suis très préoccupé des affaires. La phase où nous entrons et la manière dont nous y entrons ne me plaît pas. Je suis convainecu qu’en France, comme en Europe on désire la paix, et qu’en France comme en Europe, on n’accepterait franchement, on ne soutiendrait ardemment la guerre qu’autant qu’elle serait née d’elle- même, par un accident imprévu, par une nécessité soudaine inévitable. Il faut ne pas vouloir la guerre, même eût-on la prévoyance qu’elle viendra. Car si le monde, qui n’en veut pas, peut soupçonner qu’elle est venue par la volonté ou par la faute de quelqu’un, ce sera, pour celui-là un affaiblissement immense impossible à mésurer. Vous le savez ; j’ai toujours cru, je crois toujours la guerre évitable ; mais quand je croirais, le contraire, et tout en m’y préparant, je m’appliquerais sans relâche, sérieusement, sincèrement à l’éviter jusqu’au moment où elle viendrait tomber sur moi comme la foudre. Si l’incendie doit éclater, il faut que ce soit par le feu du ciel, non pas d’une main d’homme. Personne hier à Holland house. J’ai tort ; lord Jeffrey, qui arrive d’Edimbourg. Je persiste dans ma première impression ; l’homme le plus spirituel que j’aie vu ici. Un peu d’humeur, et de découragement dans l’esprit ce qui en ôte beaucoup, car cela donne l’air vieux, et la vieillesse ne va pas mieux à l’esprit qu’au corps. Je ne sais ce qui m’arrivera ; jusqu’à présent, l’âge, en m’apportant de l’expérience, m’a paru n’apporter que de la lumière et de la force. J’ai appris à mieux penser et à mieux agir, non à douter et à désespèrer. Un moment viendra, je le sais, où mon esprit conservât-il sa pleine santé, mon corps affaibli ne suffira plus à lui servir d’instrument. Je tâcherai de ne pas me faire illusion sur ce moment là.
Depuis quelques jours une singulière envie de dormir me prend tout de suite après dîner, presque à table. Beaucoup moins quand je dîne chez moi que chez les autres. Je soupçonne qu’on mange trop ici, même moi, et que la fatigue de mon estomac fait la lourdeur de ma tête. Une tempête affrense. La pluie bat mes vitres à les casser. Les arbres de mon square baissent la tête jusque sur la grille qui l’entoure. Je crains bien que ceci ne me coûte demain ma lettre. La poste ne passera pas aujourd’hui. Je vois par les journaux anglais qu’elle a passé hier. Ils ont leur exprès de Paris. Il faisait beau hier. La pluie a commencé le soir, quand je suis revenu de Holland house. une heure Cette irrégularité des lettres me désole autant pour vous que pour moi. Quand aurez-vous eu celle de Dimanche ? Quand c’est-à dire à quelle heure, car certainement vous l’aurez eue. Je regarde au vent ; je le trouve tombé. J’espère que ma lettre à moi, passera aujourd’hui et que je l’aurai demain. Pendant qu’on espère une transaction à Paris, j’y travaille ici de tout mon pouvoir. Travail difficile dans cette saison. Où saisir les gens pour les chauffer ? Et les rapports obscurs, contradictoires, embrouillent tout. On a dévié de cette grande idée qui présidait depuis dix ans à la conduite de l’Europe. Aucune question particulière ne vaut la guerre générale. Le mal est là. On n’a plus de boussole ! Et on a dévié pour la plus petite, la plus lointaine des questions, pour une question que bien peu d’années de patience devaient emporter. Je ramène sans relâche, devant tous les yeux, l’idée grande, l’idée simple qui a tout sauvé. C’est en son nom que je prêche la transaction. L’obstination est grande. Obstination d’aveugle, et d’aveugle piqué qu’on le soupçonne de ne pas voir. Je m’obstine aussi. Vous savez que je suis peu accessible, au découragement. Adieu. Je vous redemande, en finissant la réponse à votre question de samedi. Adieu. Adieu.
430. Paris Mardi 22 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
430. Paris Mardi le 22 septembre 1840
10 heures
J’ai eu hier Montrond, Sir Robert Adair. Les Appony, vieux et jeunes. Je suis sortie pour ma promenade du bois de Boulogne, en rentrant j’ai trouvé mon ambassadeur chez moi. Après le dîner il y ait revenue ainsi que Teham. Montrond comme Mad. de Flahaut critique un peu le mémorandum français du 24 août ; ils le trouvent trop doctrinaire, et infiniment trop doux, l’un et l’autre supposent qu’il est de votre rédaction.
Montrond est très à la paix, tout-à-fait à la paix et ne veut pas croire à la possibilité d’autre chose. Je n’ai rien relevé du reste dans la conversation. Adair fait des vœux pour qu’on s’arrange sur les propositions du Pacha, mais il entend qu’on prenne des sûretés contre les tendances où les armements énormes de la France pourraient la mener. Il les trouve très menaçants. Appony n’avait rien de mal à dire hier. Mon ambassadeur non plus. Seulement lorsque je lui redis l’observation que m’avait faite Granville, que lord Palmerston quand même il pourrait désirer accepter les propositions du Pacha en serait empêché peut être par l’Empereur. Il se récria en répétant mais l’Empereur ne veut pas la guerre, il ne la veut pas. J’ai répondu à lady Palmerston, J’ai pris copie de ce que je lui ai écrit. Le voici. Je suis interrompue par Bulwer & & 22. Impossible de vous dire plus. Adieu Adieu.
J’attends votre lettre avec impatience. Le langage de 6 à 29 hier était très menaçant. Heureusement, l’usage en sera modifié. Adieu.
10 heures
J’ai eu hier Montrond, Sir Robert Adair. Les Appony, vieux et jeunes. Je suis sortie pour ma promenade du bois de Boulogne, en rentrant j’ai trouvé mon ambassadeur chez moi. Après le dîner il y ait revenue ainsi que Teham. Montrond comme Mad. de Flahaut critique un peu le mémorandum français du 24 août ; ils le trouvent trop doctrinaire, et infiniment trop doux, l’un et l’autre supposent qu’il est de votre rédaction.
Montrond est très à la paix, tout-à-fait à la paix et ne veut pas croire à la possibilité d’autre chose. Je n’ai rien relevé du reste dans la conversation. Adair fait des vœux pour qu’on s’arrange sur les propositions du Pacha, mais il entend qu’on prenne des sûretés contre les tendances où les armements énormes de la France pourraient la mener. Il les trouve très menaçants. Appony n’avait rien de mal à dire hier. Mon ambassadeur non plus. Seulement lorsque je lui redis l’observation que m’avait faite Granville, que lord Palmerston quand même il pourrait désirer accepter les propositions du Pacha en serait empêché peut être par l’Empereur. Il se récria en répétant mais l’Empereur ne veut pas la guerre, il ne la veut pas. J’ai répondu à lady Palmerston, J’ai pris copie de ce que je lui ai écrit. Le voici. Je suis interrompue par Bulwer & & 22. Impossible de vous dire plus. Adieu Adieu.
J’attends votre lettre avec impatience. Le langage de 6 à 29 hier était très menaçant. Heureusement, l’usage en sera modifié. Adieu.
Maintenon, le 22 septembre 1840, le Duc de Noailles à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Duc de Noailles
Mots-clés : Ambassade à Londres
430_1. Londres, Le 21 septembre 1840, Dorothée de Lieven à Lady Palmerston
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
à lady Palmerston, le 21 septembre 1840
Je ne voulais plus causer politique, mais vous m’en parlez je réponds, et je réponds pour faire votre écho. " Comme je voudrais voir arranger bien et vite cette affaire d’Orient ! " Vous ne le désirez sûrement pas plus que moi, Voilà notre ressemblance. Mais vous y pouvez quelque chose et moi je n’y peux rien ; voilà notre dissemblance. Eh bien ma chère, faites. Inspirez le désir ; saisissez les moyens. Les moyens y sont dit-on. Le traité a eu pour résultat excellent de faire énoncer des concessions auxquelles ni la France, ni le Pacha ne voulaient se prêter avant. C’est un triomphe très patent. Le jour où lord Palmerston dira : Examinons les propositions du Pacha. " Ce jour là, la paix est sûre. S’il dit : " Le traité doit être accompli." La guerre en ressortira. je dis ici que je n’ai vu ni Thiers, ni Molé pas un français excepté un moment le duc de Noailles, et je rapporte tout ce que je vous ai dit de l’opinion du duc. " Tenez pour certain que la France veut la paix, désire la paix. Mais tenez pour certain aussi qu’elle n’acceptera plus d’humiliation, et qu’elle fera la guerre très résolument, très unanimement, et que nous en serons tous. "
( Je fais un peu le portrait du duc de Noailles après cela je continue.)
Ma chère, vous êtes bien grands à vous tous seuls. Vous êtes immensément grands à quatre ! Les plus forts ne dérogent jamais dans quoi qu’ils fassent. Vous avez fait fléchir une inflexible volonté. Votre traité a beaucoup obtenu déjà. Et bien qu’il pacifie aujourd’hui, tout de suite ; ce sera une belle et bonne veuve. La joie sera partout dans la proposition qu’ont été et qui sont encore les alarmes.
Je ne voulais plus causer politique, mais vous m’en parlez je réponds, et je réponds pour faire votre écho. " Comme je voudrais voir arranger bien et vite cette affaire d’Orient ! " Vous ne le désirez sûrement pas plus que moi, Voilà notre ressemblance. Mais vous y pouvez quelque chose et moi je n’y peux rien ; voilà notre dissemblance. Eh bien ma chère, faites. Inspirez le désir ; saisissez les moyens. Les moyens y sont dit-on. Le traité a eu pour résultat excellent de faire énoncer des concessions auxquelles ni la France, ni le Pacha ne voulaient se prêter avant. C’est un triomphe très patent. Le jour où lord Palmerston dira : Examinons les propositions du Pacha. " Ce jour là, la paix est sûre. S’il dit : " Le traité doit être accompli." La guerre en ressortira. je dis ici que je n’ai vu ni Thiers, ni Molé pas un français excepté un moment le duc de Noailles, et je rapporte tout ce que je vous ai dit de l’opinion du duc. " Tenez pour certain que la France veut la paix, désire la paix. Mais tenez pour certain aussi qu’elle n’acceptera plus d’humiliation, et qu’elle fera la guerre très résolument, très unanimement, et que nous en serons tous. "
( Je fais un peu le portrait du duc de Noailles après cela je continue.)
Ma chère, vous êtes bien grands à vous tous seuls. Vous êtes immensément grands à quatre ! Les plus forts ne dérogent jamais dans quoi qu’ils fassent. Vous avez fait fléchir une inflexible volonté. Votre traité a beaucoup obtenu déjà. Et bien qu’il pacifie aujourd’hui, tout de suite ; ce sera une belle et bonne veuve. La joie sera partout dans la proposition qu’ont été et qui sont encore les alarmes.
428. Paris, Dimanche 20 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
428. Paris, dimanche 20 septembre 1840
10 heures
J’ai un peu dormi cette nuit. Je vais lire dans cette bible où nous vivions ensemble. J’ai le cœur triste et serré. J’ai eu hier une très longue visite de Bulwer, une très longue visite de Paul de Wurtemberg un peu de causerie avec Appony. Et ce soir j’ai revu les Granville qui viennent d’arrivés du Havre. Ceci a été un vrai plaisir pour moi. Eh bien, tout le monde est d’accord pour regarder la proposition égyptienne comme une nouvelle phase de la question, et comme une circonstance qui laisse aux bonnes volontés toute facilité de s’arranger avec convenance. Les Allemands sont d’opinion qu’il faut accepter tout le monde dit que la Turquie laissée à elle même accepterait des deux mains. Nous pensons. même que la Russie accepterait. Reste lord Palmerston ! Vous nous apprendrez s’il veut se servir de ce moyen pour faire sortir l’Europe des dangers qui la menacent où s’il veut à outrance braver ces dangers. Tout est là.
Les ministres anglais sont encore une fois appelés à examiner une grande question. Mais aujourd’hui ils l’examinent avec l’expérience de ce que leur a valu le 15 juillet. Il y a eu pour eux bien des surprises. En veulent-ils encore. 15 est hautement frondeur. Il n’a plus eu une ligne de 79 depuis deux mois. Le petit 29 écrit à 12 de fort bonnes choses, fort sensées. Il dit : " Il est temps encore aujourd’hui , mais ceci est le dernier moment, demain il sera trop tard. Jamais on ne répond à ces exhortations là. " Le Prince Paul a des dires fort étranges, et une vie toute particulière de la situation. Il a beaucoup couru, beaucoup vu ; et même fait. Il affirme que le mépris pour la France est le sentiment dominant partout, dans tous les cabinets. Que les platitudes passées doivent parfaite confiance dans les platitudes futures, et qu’on a beau faire on ne peut persuader à personne que la France fasse la guerre. Aucun cabinet ne veut le croire. Dirait-il vrai ?
On dit que le roi est très convaincu que tout ceci s’arrangera. Arrangez donc, et dites le moi. J’ai essayé de sortir hier mais il faisait laid, j’étais triste et faible. Je suis sortie pour voir lady Granville ; elle est grasse et rose, le mari ditto. Quand est-ce que je serai grasse et rose ?
2 heure. Point de lettres ? D’où vient ? Adieu. Adieu.
10 heures
J’ai un peu dormi cette nuit. Je vais lire dans cette bible où nous vivions ensemble. J’ai le cœur triste et serré. J’ai eu hier une très longue visite de Bulwer, une très longue visite de Paul de Wurtemberg un peu de causerie avec Appony. Et ce soir j’ai revu les Granville qui viennent d’arrivés du Havre. Ceci a été un vrai plaisir pour moi. Eh bien, tout le monde est d’accord pour regarder la proposition égyptienne comme une nouvelle phase de la question, et comme une circonstance qui laisse aux bonnes volontés toute facilité de s’arranger avec convenance. Les Allemands sont d’opinion qu’il faut accepter tout le monde dit que la Turquie laissée à elle même accepterait des deux mains. Nous pensons. même que la Russie accepterait. Reste lord Palmerston ! Vous nous apprendrez s’il veut se servir de ce moyen pour faire sortir l’Europe des dangers qui la menacent où s’il veut à outrance braver ces dangers. Tout est là.
Les ministres anglais sont encore une fois appelés à examiner une grande question. Mais aujourd’hui ils l’examinent avec l’expérience de ce que leur a valu le 15 juillet. Il y a eu pour eux bien des surprises. En veulent-ils encore. 15 est hautement frondeur. Il n’a plus eu une ligne de 79 depuis deux mois. Le petit 29 écrit à 12 de fort bonnes choses, fort sensées. Il dit : " Il est temps encore aujourd’hui , mais ceci est le dernier moment, demain il sera trop tard. Jamais on ne répond à ces exhortations là. " Le Prince Paul a des dires fort étranges, et une vie toute particulière de la situation. Il a beaucoup couru, beaucoup vu ; et même fait. Il affirme que le mépris pour la France est le sentiment dominant partout, dans tous les cabinets. Que les platitudes passées doivent parfaite confiance dans les platitudes futures, et qu’on a beau faire on ne peut persuader à personne que la France fasse la guerre. Aucun cabinet ne veut le croire. Dirait-il vrai ?
On dit que le roi est très convaincu que tout ceci s’arrangera. Arrangez donc, et dites le moi. J’ai essayé de sortir hier mais il faisait laid, j’étais triste et faible. Je suis sortie pour voir lady Granville ; elle est grasse et rose, le mari ditto. Quand est-ce que je serai grasse et rose ?
2 heure. Point de lettres ? D’où vient ? Adieu. Adieu.
417. Londres, Dimanche 20 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
417. Londres, Dimanche 20 septembre 1840
une heure
J’arrive de la campagne. J’ai été dîner hier a Ember-Grave, près de Kingston chez M. Easthope. Ancienne promesse, deux fois violée, que je tenais à acquitter. Trois ou quatre membres des Communes et deux ou trois hommes d’esprit, un grand Tory, Sir Edward Sugden, des radicaux, tous raisonnables au fond, comme le Tory. Pensant tous de même, vivant très bien ensemble, mais très séparés. Nous avons beaucoup causé. Je mets en train. J’étais peu en train moi-même ; en sortant de table, je tombais de sommeil. Je n’avais pas dormi la nuit précédente. J’ai dormi là, dans un bien mauvais lit anglais, ces lits immenses, qui n’ont de bon, que leur grandeur. Que résultera-t-il des ouvertures de transaction faites à Alexandrie ? Très probablement, les Musulmans, laissés à eux-mêmes, en tireraient la paix. Mais les Chrétiens sont là. Y aura-t-il à Vienne et à Berlin, un peu de sagesse active ? On n’aura jamais là, à être sage, plus de profit et moins de danger. Je suis inquiet pourtant. Jamais la situation ne m’a paru plus grave que dans ce moment-ci. La solution, bonne ou mauvaise, peut être accomplie d’ici à un mois. Je sens profondément le mal de ne pas bien connaître, par moi-même, l’état des esprits en France. C’est un élément de la question, et de la conduite, qui me manque beaucoup. La poste n’arrive pas. J’étais arrivé moi, comptant bien la trouver, et heureux d’avance comme tous les jours. On me dit à présent qu’elle pourrait bien ne pas venir. Le vent a encore été mauvais hier, et le samedi la malle. Je décide plus aisément à ne pas passer. La malle ne pense pas à moi.
Vous êtes donc toujours bien fatiguée que vous vous couchiez toujours de si bonne heure. Cela me préoccupe extrêmement, vous dormez pas mal au moins. Car, si vous ne dormiez pas, vous ne pourriez pas, rester si longtemps dans votre lit. Je crois beaucoup, beaucoup au sommeil. Lundi une heure J’ai la lettre que je devais avoir hier mais pas celle de ce matin. J’en suis très contrarié. Pitoyable mot ! Vous me dîtes dans l’autre que vous êtes un peu malade. Il n’y a pas d’un peu pour moi quand je ne sais rien. La voilà. Retardée par la raison la plus insignifiante. Tout ce qui se passe dans une âme, en un quart d’heure, à propos de la raison la plus insignifiante ! Je suis heureux. Oui, heureux, quoi que vous me disiez que vous êtes souffrante et triste. Triste ! Je le crois bien.
M. de Clermont Tonnerre dit un jour à M. de Montlosier, à l’assemblée constituante :
" Vous vous mettez en colère.
- Moi, Monsieur ? Non, certes ; j’y suis toujours ! "
Merci de tout ce que vous me mandez. Je ne puis pas disserter aujourd’hui. J’ai un courrier à expédier Ce soir deux ou trois grandes lettres à écrire. Je vais faire fermer ma porte et travailler toute le matinée. Vous avez mille fois raison. M. de Metternich est mort. Peut-il ressusciter ? Je suis dans un profond, très profond accès d’impatience et d’humeur. Moi aussi, je crois que la France désire la paix et n’accepterait pas tout. C’est la disposition de l’Angleterre aussi si les deux pays ne viennent pas à bout de faire ce qu’ils désirent, ce sera par les deux plus sottes raisons qu’il puisse y avoir en ce monde, faute d’esprit et de courage. On ne comprend pas. On n’ose pas. Je vous dis que j’ai beaucoup d’humeur. Avoir de l’humeur tout seul, c’est presque aussi triste que de le joie tout seul. Il est vrai que de la joie tout seul, c’est impossible. J’ai le permis d’entrée pour la vaisselle et les effets de Lady Durham. Je vais l’envoyer à lord Grey. Je n’ai plus entendu parler de lord Mahon. Je n’irai, certainement pas chercher les tulipes. Je ne demande que la permission d’être poli avec elles, si elles viennent me chercher. Les pauvres tulipes ! C’est à présent la seule fleur que je n’aime pas avec passion. Je dîne aujourd’hui à Holland house. Après-demain chez Lady Palmerston. Adieu. Adieu. Comment peut-on se dire adieu ?
une heure
J’arrive de la campagne. J’ai été dîner hier a Ember-Grave, près de Kingston chez M. Easthope. Ancienne promesse, deux fois violée, que je tenais à acquitter. Trois ou quatre membres des Communes et deux ou trois hommes d’esprit, un grand Tory, Sir Edward Sugden, des radicaux, tous raisonnables au fond, comme le Tory. Pensant tous de même, vivant très bien ensemble, mais très séparés. Nous avons beaucoup causé. Je mets en train. J’étais peu en train moi-même ; en sortant de table, je tombais de sommeil. Je n’avais pas dormi la nuit précédente. J’ai dormi là, dans un bien mauvais lit anglais, ces lits immenses, qui n’ont de bon, que leur grandeur. Que résultera-t-il des ouvertures de transaction faites à Alexandrie ? Très probablement, les Musulmans, laissés à eux-mêmes, en tireraient la paix. Mais les Chrétiens sont là. Y aura-t-il à Vienne et à Berlin, un peu de sagesse active ? On n’aura jamais là, à être sage, plus de profit et moins de danger. Je suis inquiet pourtant. Jamais la situation ne m’a paru plus grave que dans ce moment-ci. La solution, bonne ou mauvaise, peut être accomplie d’ici à un mois. Je sens profondément le mal de ne pas bien connaître, par moi-même, l’état des esprits en France. C’est un élément de la question, et de la conduite, qui me manque beaucoup. La poste n’arrive pas. J’étais arrivé moi, comptant bien la trouver, et heureux d’avance comme tous les jours. On me dit à présent qu’elle pourrait bien ne pas venir. Le vent a encore été mauvais hier, et le samedi la malle. Je décide plus aisément à ne pas passer. La malle ne pense pas à moi.
Vous êtes donc toujours bien fatiguée que vous vous couchiez toujours de si bonne heure. Cela me préoccupe extrêmement, vous dormez pas mal au moins. Car, si vous ne dormiez pas, vous ne pourriez pas, rester si longtemps dans votre lit. Je crois beaucoup, beaucoup au sommeil. Lundi une heure J’ai la lettre que je devais avoir hier mais pas celle de ce matin. J’en suis très contrarié. Pitoyable mot ! Vous me dîtes dans l’autre que vous êtes un peu malade. Il n’y a pas d’un peu pour moi quand je ne sais rien. La voilà. Retardée par la raison la plus insignifiante. Tout ce qui se passe dans une âme, en un quart d’heure, à propos de la raison la plus insignifiante ! Je suis heureux. Oui, heureux, quoi que vous me disiez que vous êtes souffrante et triste. Triste ! Je le crois bien.
M. de Clermont Tonnerre dit un jour à M. de Montlosier, à l’assemblée constituante :
" Vous vous mettez en colère.
- Moi, Monsieur ? Non, certes ; j’y suis toujours ! "
Merci de tout ce que vous me mandez. Je ne puis pas disserter aujourd’hui. J’ai un courrier à expédier Ce soir deux ou trois grandes lettres à écrire. Je vais faire fermer ma porte et travailler toute le matinée. Vous avez mille fois raison. M. de Metternich est mort. Peut-il ressusciter ? Je suis dans un profond, très profond accès d’impatience et d’humeur. Moi aussi, je crois que la France désire la paix et n’accepterait pas tout. C’est la disposition de l’Angleterre aussi si les deux pays ne viennent pas à bout de faire ce qu’ils désirent, ce sera par les deux plus sottes raisons qu’il puisse y avoir en ce monde, faute d’esprit et de courage. On ne comprend pas. On n’ose pas. Je vous dis que j’ai beaucoup d’humeur. Avoir de l’humeur tout seul, c’est presque aussi triste que de le joie tout seul. Il est vrai que de la joie tout seul, c’est impossible. J’ai le permis d’entrée pour la vaisselle et les effets de Lady Durham. Je vais l’envoyer à lord Grey. Je n’ai plus entendu parler de lord Mahon. Je n’irai, certainement pas chercher les tulipes. Je ne demande que la permission d’être poli avec elles, si elles viennent me chercher. Les pauvres tulipes ! C’est à présent la seule fleur que je n’aime pas avec passion. Je dîne aujourd’hui à Holland house. Après-demain chez Lady Palmerston. Adieu. Adieu. Comment peut-on se dire adieu ?
429. Paris, Dimanche 20 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
429. Paris, dimanche 20 septembre 1840
3 heures
Ma lettre est partie, et la vôtre est venue. Quelle charmante page, il y a dans cette lettre. Il n’y a pas un sujet sur lequel on a plus dit depuis que le monde existe que le sujet que traite votre lettre. On n’a jamais dit comme cela, senti comme cela. C’est si beau, si parfait, si charmant que je me demande si je mérite tout cela ? comment il se fait que j’aie mérité tout cela. Je suis fière, je suis humble. Je suis ravie, je suis heureuse, et je suis triste! Je ne devrais pas être loin !
J’ai lu dans la bible, j’ai essayé d’entendre votre voix. J’ai été aux Tuileries, la pluie m’a ramenée plus vite que je ne voulais.
Voici Bulwer. Bulmer bien mélancolique et desponding hier presque joyeux aujourd’hui. Un mot dans le Globe de vendredi que lui semble de bon augure. Mais assez piqué que ce ne soit que jeudi que Thiers lui a parlé de la proposition du Pacha tandis que cette proposition se trouvait livrée à des journalistes anglais depuis la veille. Cela m’est bien égal. Je me sens en train de croire que tout va aller bien, est-ce que je ne crois pas trop vite ? Mais votre lettre m’y encourage un peu.
Lundi 8 heure
J’ai vu un moment mon ambassadeur hier matin ; avant de me rendre au bois de Boulogne j’ai passé chez vous ; je suis entrée sous prétexte de chercher des livres. Je ne les cherchais pas, je n’en ai point pris, j’ai regardé votre portrait, d’autres portraits. Votre fauteuil, votre bureau. Vous ne ne vous doutiez pas que j’étais chez vous. J’y étais avec des sentiments bien mêlés. Le bois de Boulogne un peu, une visite à Mad. Durazzo. Mon dîner qui ne ressemble pas à un dîner, une perdrix. et un gâteau de semouille, je ne sais pas manger encore et puis lady Granville jusqu’à 10 h 1/2.
Le protocole de jeudi est-il ce qui vous faisait me dire vendredi que vous croyiez à la paix ! Il me faudrait plus que cela. Il faut que lord Palmerston dise " Examinons la proposition de M. Ali. " Dès ce moment là je croirai à la paix, avant non. J’ai eu une lettre de lady Palmerston de vendredi, ce même jour je lui écrivais au sujet de la reine de Hanôvre. Une lettre insignifiante pas un mot de politique. elle me provoque à en parler, je verrai si je le ferai. Je vous envoie copie des passages importants de sa lettre.
Midi
Voici votre lettre, courte, et demain je n’aurai rien ! Dites-moi s’il y a espoir que les propositions du Pacha devienne quelque chose. Je suis très flottante. Hier j’espérais, aujourd’hui j’espère peu. Vous m’auriez dit quelque chose, si quelquechose pouvait ressortir du nouvel incident. Cependant vous êtes en pourparler avec lord Palmerston cela laisse du jour. Quand je pense à quel point ma vie, mon bonheur dépendent des paroles qui se disent aujourd’hui à Londres ; je n’ai pas assez de vœux et de soupirs pour tout ce qui agite et remue mon âme. Voici du Soleil ; ce beau soleil de Paris, si brillant, si gai, cet air si pur. Allons nous promener ensemble aux Tuileries. Ensemble ! Ah que ce serait charmant !
Adieu. Adieu bien des fois, et encore. mille fois adieu. Lord Granville verra Thiers ce matin.
A propos Thiers a dit à M. de Pahlen qu’il ignorait qu’on eut permis à Lelevel de revenir. Qu’il allait s’en enquérir auprès de M. de Rémusat. nous verrons. Pahlen redoute tout, s’il revenait prenez garde, Appony ce que je vous dis. Adieu. Lady Palmerston me dit : " Les affaires de ce moment sont trop importantes pour pouvoir espérer de les mener à la distante même de quelques heures. Ainsi, j’ai pris mon parti, et je reste. "
3 heures
Ma lettre est partie, et la vôtre est venue. Quelle charmante page, il y a dans cette lettre. Il n’y a pas un sujet sur lequel on a plus dit depuis que le monde existe que le sujet que traite votre lettre. On n’a jamais dit comme cela, senti comme cela. C’est si beau, si parfait, si charmant que je me demande si je mérite tout cela ? comment il se fait que j’aie mérité tout cela. Je suis fière, je suis humble. Je suis ravie, je suis heureuse, et je suis triste! Je ne devrais pas être loin !
J’ai lu dans la bible, j’ai essayé d’entendre votre voix. J’ai été aux Tuileries, la pluie m’a ramenée plus vite que je ne voulais.
Voici Bulwer. Bulmer bien mélancolique et desponding hier presque joyeux aujourd’hui. Un mot dans le Globe de vendredi que lui semble de bon augure. Mais assez piqué que ce ne soit que jeudi que Thiers lui a parlé de la proposition du Pacha tandis que cette proposition se trouvait livrée à des journalistes anglais depuis la veille. Cela m’est bien égal. Je me sens en train de croire que tout va aller bien, est-ce que je ne crois pas trop vite ? Mais votre lettre m’y encourage un peu.
Lundi 8 heure
J’ai vu un moment mon ambassadeur hier matin ; avant de me rendre au bois de Boulogne j’ai passé chez vous ; je suis entrée sous prétexte de chercher des livres. Je ne les cherchais pas, je n’en ai point pris, j’ai regardé votre portrait, d’autres portraits. Votre fauteuil, votre bureau. Vous ne ne vous doutiez pas que j’étais chez vous. J’y étais avec des sentiments bien mêlés. Le bois de Boulogne un peu, une visite à Mad. Durazzo. Mon dîner qui ne ressemble pas à un dîner, une perdrix. et un gâteau de semouille, je ne sais pas manger encore et puis lady Granville jusqu’à 10 h 1/2.
Le protocole de jeudi est-il ce qui vous faisait me dire vendredi que vous croyiez à la paix ! Il me faudrait plus que cela. Il faut que lord Palmerston dise " Examinons la proposition de M. Ali. " Dès ce moment là je croirai à la paix, avant non. J’ai eu une lettre de lady Palmerston de vendredi, ce même jour je lui écrivais au sujet de la reine de Hanôvre. Une lettre insignifiante pas un mot de politique. elle me provoque à en parler, je verrai si je le ferai. Je vous envoie copie des passages importants de sa lettre.
Midi
Voici votre lettre, courte, et demain je n’aurai rien ! Dites-moi s’il y a espoir que les propositions du Pacha devienne quelque chose. Je suis très flottante. Hier j’espérais, aujourd’hui j’espère peu. Vous m’auriez dit quelque chose, si quelquechose pouvait ressortir du nouvel incident. Cependant vous êtes en pourparler avec lord Palmerston cela laisse du jour. Quand je pense à quel point ma vie, mon bonheur dépendent des paroles qui se disent aujourd’hui à Londres ; je n’ai pas assez de vœux et de soupirs pour tout ce qui agite et remue mon âme. Voici du Soleil ; ce beau soleil de Paris, si brillant, si gai, cet air si pur. Allons nous promener ensemble aux Tuileries. Ensemble ! Ah que ce serait charmant !
Adieu. Adieu bien des fois, et encore. mille fois adieu. Lord Granville verra Thiers ce matin.
A propos Thiers a dit à M. de Pahlen qu’il ignorait qu’on eut permis à Lelevel de revenir. Qu’il allait s’en enquérir auprès de M. de Rémusat. nous verrons. Pahlen redoute tout, s’il revenait prenez garde, Appony ce que je vous dis. Adieu. Lady Palmerston me dit : " Les affaires de ce moment sont trop importantes pour pouvoir espérer de les mener à la distante même de quelques heures. Ainsi, j’ai pris mon parti, et je reste. "
416. Londres, Samedi 19 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
416. Londres, samedi 19 septembre 1840
onze heures
J’en suis désolé ; mais vous n’aurez probablement aujourd’hui que quelques lignes. J’ai vu hier, tard, lord Palmerston ce qui me donne une dépêche à faire. J’ai reçu ce matin un courrier qui m’oblige à le revoir ; de là une autre dépêche. Ma journée sera pleine et très pleine. De pas grand chose peut-être, mais enfin pleine. J’en suis d’autant plus contrarié que c’est demain Dimanche. Vous serez bien sûre que ce n’est pas ma faute. J’ai maintenant la confiance que vous êtes toujours sûre. Toujours, n’est-ce pas ; et parfaitement sûre. Voilà le 425. Et la correspondance parfaitement réglée. Admettez, à partir de 9 heures deux nouveaux intermédiaires l’ancien petit copiste, et celui dont Génie vous a parlé. J’espère qu’il n’y aura plus de retard. Votre inquiétude me charme, à condition qu’elle restera dans votre cœur, et ne passera point dans vos entrailles. Voilà le déjeuner. Je sortirai après. Mais je reviendrai à temps pour vous dire adieu.
Midi et demi
Quelques mots avant de sortir. Merci de votre prudence, car je la prends pour moi. Mais je trouve le silence absolu un parti bien sévère, même chez les Flahaut. Vous ne direz jamais en y pensant, que ce que vous voudrez, et vous êtes bon juge de ce qu’il faut dire. Détendez-vous un peu. Ne vous brouillez point. Il y a de quoi se souvenir, pas de quoi se brouiller. Et puis, je ne veux pas que vous vous isoliez. Pas du tout dans l’intérêt de vos lettres ; je ne les aime jamais mieux que lorsqu’elles me parlent de nous et pas d’autre chose ; mais pour le petit amusement de votre vie. Vous savez que malgré tout ce quelle peut dire et faire, je trouve à Mad. de Flahaut des qualités réelles. Elle a un fond d’amitié sincère pour vous. Il faut respecter cela et en profiter.
Je ne vous ai pas parlé du traité imprimé parce qu’il ne m’a rien appris. Il a éclairci, non changé mes idées. Vous n’y faites certainement pas une grande figure. Le traité crée en Orient un avenir très obscur. Voilà ce qu’il a de grave. De gros nuages à l’Est, et un vieux barbare, et un Commodore Napier, et beaucoup de canons et d’hommes jetés sous les nuages, c’est beaucoup que cela pour une santé convalescente, comme celle de l’Europe. J’écrivais à Lord Grey et je ne me lasse pas de répéter : " La petite politique tue la grande. " Certainement Napier a eu grand tort, et le traité même lui donne tort. On en convient presque ici. Adieu. Adieu. Je sors.
onze heures
J’en suis désolé ; mais vous n’aurez probablement aujourd’hui que quelques lignes. J’ai vu hier, tard, lord Palmerston ce qui me donne une dépêche à faire. J’ai reçu ce matin un courrier qui m’oblige à le revoir ; de là une autre dépêche. Ma journée sera pleine et très pleine. De pas grand chose peut-être, mais enfin pleine. J’en suis d’autant plus contrarié que c’est demain Dimanche. Vous serez bien sûre que ce n’est pas ma faute. J’ai maintenant la confiance que vous êtes toujours sûre. Toujours, n’est-ce pas ; et parfaitement sûre. Voilà le 425. Et la correspondance parfaitement réglée. Admettez, à partir de 9 heures deux nouveaux intermédiaires l’ancien petit copiste, et celui dont Génie vous a parlé. J’espère qu’il n’y aura plus de retard. Votre inquiétude me charme, à condition qu’elle restera dans votre cœur, et ne passera point dans vos entrailles. Voilà le déjeuner. Je sortirai après. Mais je reviendrai à temps pour vous dire adieu.
Midi et demi
Quelques mots avant de sortir. Merci de votre prudence, car je la prends pour moi. Mais je trouve le silence absolu un parti bien sévère, même chez les Flahaut. Vous ne direz jamais en y pensant, que ce que vous voudrez, et vous êtes bon juge de ce qu’il faut dire. Détendez-vous un peu. Ne vous brouillez point. Il y a de quoi se souvenir, pas de quoi se brouiller. Et puis, je ne veux pas que vous vous isoliez. Pas du tout dans l’intérêt de vos lettres ; je ne les aime jamais mieux que lorsqu’elles me parlent de nous et pas d’autre chose ; mais pour le petit amusement de votre vie. Vous savez que malgré tout ce quelle peut dire et faire, je trouve à Mad. de Flahaut des qualités réelles. Elle a un fond d’amitié sincère pour vous. Il faut respecter cela et en profiter.
Je ne vous ai pas parlé du traité imprimé parce qu’il ne m’a rien appris. Il a éclairci, non changé mes idées. Vous n’y faites certainement pas une grande figure. Le traité crée en Orient un avenir très obscur. Voilà ce qu’il a de grave. De gros nuages à l’Est, et un vieux barbare, et un Commodore Napier, et beaucoup de canons et d’hommes jetés sous les nuages, c’est beaucoup que cela pour une santé convalescente, comme celle de l’Europe. J’écrivais à Lord Grey et je ne me lasse pas de répéter : " La petite politique tue la grande. " Certainement Napier a eu grand tort, et le traité même lui donne tort. On en convient presque ici. Adieu. Adieu. Je sors.
429_1 [Londres] Vendredi 18 septembre 1840, Lady Palmerston à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Palmerston,Lady
Mots-clés : Ambassade à Londres
415. Londres, Vendredi 18 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
415. Londres, Vendredi 18 septembre 1840
9 heures
J’attends mes deux lettres car j’en aurai deux aujourd’hui. J’ai eu mon courrier cette nuit. La tempète a été l’une des plus violentes qu’on ait vues. Notre steamer, sorti de Calais avant-hier fut obligé de rentrer. Hier il a mis sept heures pour aller à Douvres. Le port de Douvres est encombré. Et il faut, pour que mon cœur soit tranquille, qu’un petit chiffon de papier surmonté tout cela ! Les nouvelles sont à la paix. J’y ai toujours cru, j’y crois toujours. On a bien des incertitudes, dans l’esprit, comme il y a bien des vicissitudes, dans les événements. Pourtant au fond de la pensée, dans son cours habituel quelque chose domine conviction ou instinct. Pour moi, c’est la paix. Ici, on la désire évidemment de plus en plus. S’il y a quelque concession un peu embarrassante à faire, elle se fera à Alexandrie ou à Constantinople. Je devrais dire et au lieu d’ou. Le traité laisse avec grand soin, cette porte ouverte. Les bases d’arrangement entre le Sultan et le Pacha ne font point partie de la convention des quatre Puissances. C’est une annexe qui vient de la Porte seule et que la Porte peut modifier. Le Pacha de son côté ne me paraît point avoir jeté son bonnet par dessus les moulins. Il n’y a plus que des sages dans le monde. Je prends un singulier moment pour le dire. Pourtant je le crois.
En ma qualité de sage, je vais faire ma toilette pour occuper mon impatience. J’attends très dignement ce que je crains. Mais si on voyait avec quel tumulte intérieur j’attends ce que je désire, on ne me trouverait. pas si sage que je le dis. On aurait tort. La vraie sagesse consiste à ne s’émouvoir que selon l’importance des choses, et je suis bien sûr que j’ai raison dans l’importance que j’attache à celle qui m’émeut en ce moment. Décidément, je vais faire ma toilette.
Une heure
J’ai mes deux lettres, et il vous en a manqué une. Elle ne vous aura pas manqué. On vous l’aura remise plus tard. Je crois même qu’elle était longue, lundi. Je ne vous écris jamais aussi longuement que je le voudrais ! Ni vous non plus à moi. Certainement c’est absurde, absurde et intolérable. Je le sens mieux tous les jours. Mais vous avez tort dans votre égoïsme. Vous ne risquez, vous ne perdez jamais rien dans aucune situation. Partout, toujours mon regret, mon désir est le même. Ceux que j’aime le mieux, je les aime pour eux. Vous, je vous aime pour moi. Est-ce assez ?
Voilà donc la grande duchesse Marie cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue. J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie. Je n’étais pas sorti. J’avais joué au Whist. Je me fais pitié, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ! Bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue.
J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie Je n’étais pas sorti. J’avais joué au whist. Je me fais pitie, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ? bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir, sans y rien mettre qui me satisfasse et qui me plaise. Le temps, ce trésor si grand, qui s’écoule si vite, le dépenser pour rien, avec personne ! Cela me choque. Je rentre dans ma chambre honteux, petit. Quand au contraire mon temps a été bien rempli, rempli au gré de mon âme, quand le chêne a bien ouvert ses feuilles, et bien joui du soleil, je me retire, je me couché, je m’endors content et fier, animé et reposé. Je dis adieu non sans regret, mais sans amertume à ces belles heures passées. C’est toujours triste de belles heures qui ne sont plus. Mais elles ont été belles ; elles ont eu leur part des dons de Dieu, des biens de la vie. Ce quelles deviennent, où elles vont en s’enfuyant, je ne le sais pas ; le passé comme l’avenir est un mystère, un sanctuaire où notre vue ne pénètre point. Mais quand la portion de nous-mêmes qui disparaît dans ce sanctuaire a été charmante, il en reste une ombre charmante qui ne nous quitte plus. Je l’avais près de moi chaque soir cette ombre d’un jour plein, d’un jour heureux. En le regrettant, j’en jouissais encore. Je ne regrette plus rien, et mes journées tombent derrière moi, sans que j’y pense, sans que je tourne une seule fois la tête pour y regarder.
3 heures et demie
Je vous ai quittée. Je vous désirais trop. Je ne vous reviens que pour vous dire adieu avant de sortir. Je vais faire deux ou trois visites. J’irai probablement voir lady Clanricard. Elle m’a dit qu’elle serait chez elle a cinq heures. Ce soir, j’aurai mes diplomates qui joueront au Whist. Lady Palmerston m’a dit que cela leur plaisait fort, mais que c’était bien dommage que je n’y eusse pas quelques femmes. Je ne trouve pas que ce soit dommage. Adieu. Adieu. Adieu, me plaît, mais ne me contente pas. Adieu.
9 heures
J’attends mes deux lettres car j’en aurai deux aujourd’hui. J’ai eu mon courrier cette nuit. La tempète a été l’une des plus violentes qu’on ait vues. Notre steamer, sorti de Calais avant-hier fut obligé de rentrer. Hier il a mis sept heures pour aller à Douvres. Le port de Douvres est encombré. Et il faut, pour que mon cœur soit tranquille, qu’un petit chiffon de papier surmonté tout cela ! Les nouvelles sont à la paix. J’y ai toujours cru, j’y crois toujours. On a bien des incertitudes, dans l’esprit, comme il y a bien des vicissitudes, dans les événements. Pourtant au fond de la pensée, dans son cours habituel quelque chose domine conviction ou instinct. Pour moi, c’est la paix. Ici, on la désire évidemment de plus en plus. S’il y a quelque concession un peu embarrassante à faire, elle se fera à Alexandrie ou à Constantinople. Je devrais dire et au lieu d’ou. Le traité laisse avec grand soin, cette porte ouverte. Les bases d’arrangement entre le Sultan et le Pacha ne font point partie de la convention des quatre Puissances. C’est une annexe qui vient de la Porte seule et que la Porte peut modifier. Le Pacha de son côté ne me paraît point avoir jeté son bonnet par dessus les moulins. Il n’y a plus que des sages dans le monde. Je prends un singulier moment pour le dire. Pourtant je le crois.
En ma qualité de sage, je vais faire ma toilette pour occuper mon impatience. J’attends très dignement ce que je crains. Mais si on voyait avec quel tumulte intérieur j’attends ce que je désire, on ne me trouverait. pas si sage que je le dis. On aurait tort. La vraie sagesse consiste à ne s’émouvoir que selon l’importance des choses, et je suis bien sûr que j’ai raison dans l’importance que j’attache à celle qui m’émeut en ce moment. Décidément, je vais faire ma toilette.
Une heure
J’ai mes deux lettres, et il vous en a manqué une. Elle ne vous aura pas manqué. On vous l’aura remise plus tard. Je crois même qu’elle était longue, lundi. Je ne vous écris jamais aussi longuement que je le voudrais ! Ni vous non plus à moi. Certainement c’est absurde, absurde et intolérable. Je le sens mieux tous les jours. Mais vous avez tort dans votre égoïsme. Vous ne risquez, vous ne perdez jamais rien dans aucune situation. Partout, toujours mon regret, mon désir est le même. Ceux que j’aime le mieux, je les aime pour eux. Vous, je vous aime pour moi. Est-ce assez ?
Voilà donc la grande duchesse Marie cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue. J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie. Je n’étais pas sorti. J’avais joué au Whist. Je me fais pitié, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ! Bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue.
J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie Je n’étais pas sorti. J’avais joué au whist. Je me fais pitie, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ? bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir, sans y rien mettre qui me satisfasse et qui me plaise. Le temps, ce trésor si grand, qui s’écoule si vite, le dépenser pour rien, avec personne ! Cela me choque. Je rentre dans ma chambre honteux, petit. Quand au contraire mon temps a été bien rempli, rempli au gré de mon âme, quand le chêne a bien ouvert ses feuilles, et bien joui du soleil, je me retire, je me couché, je m’endors content et fier, animé et reposé. Je dis adieu non sans regret, mais sans amertume à ces belles heures passées. C’est toujours triste de belles heures qui ne sont plus. Mais elles ont été belles ; elles ont eu leur part des dons de Dieu, des biens de la vie. Ce quelles deviennent, où elles vont en s’enfuyant, je ne le sais pas ; le passé comme l’avenir est un mystère, un sanctuaire où notre vue ne pénètre point. Mais quand la portion de nous-mêmes qui disparaît dans ce sanctuaire a été charmante, il en reste une ombre charmante qui ne nous quitte plus. Je l’avais près de moi chaque soir cette ombre d’un jour plein, d’un jour heureux. En le regrettant, j’en jouissais encore. Je ne regrette plus rien, et mes journées tombent derrière moi, sans que j’y pense, sans que je tourne une seule fois la tête pour y regarder.
3 heures et demie
Je vous ai quittée. Je vous désirais trop. Je ne vous reviens que pour vous dire adieu avant de sortir. Je vais faire deux ou trois visites. J’irai probablement voir lady Clanricard. Elle m’a dit qu’elle serait chez elle a cinq heures. Ce soir, j’aurai mes diplomates qui joueront au Whist. Lady Palmerston m’a dit que cela leur plaisait fort, mais que c’était bien dommage que je n’y eusse pas quelques femmes. Je ne trouve pas que ce soit dommage. Adieu. Adieu. Adieu, me plaît, mais ne me contente pas. Adieu.
427. Paris, Vendredi 18 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
427. Paris, Vendredi 18 septembre 1840
4 heures
J’ai été retenue chez moi d’abord par mon médecin et puis par le duc de Noailles, qui est venu en ville pour deux heures pour me voir. Vous concevez qu’il a questionné et comme il a questionné. Et puis il a parlé. Il dit que la France au fond veut la paix, que c’est le vœu général, si général, si profond, que même on avalerait une petite humiliation encore plutôt que de se livrer aux hasards de la guerre, que cela est certain ; mais qu’on n’avalerait pas tout. Décidément pas et qu’alors on ferait la guerre très franchement et avec une grande unanimité. C’est aussi l’opinion et le dire de Berryer que le duc de Noailles venait de voir. Berryer croit savoir que Thiers est moins pacifique qu’on ne semble le croire. Il veut bien se montrer pacifique encore parce qu’il n’est pas prêt. Mais le jour où il sera prêt il voudra employer ses moyens, et le moment dangereux sera celui-là. Le duc de Noailles se creuse la tête pour trouver ce que les alliés peuvent vouloir tenter ou plutôt ce qu’ils sont convenus de faire pour le cas où l’insurrection de Syrie ne couronnerait pas leurs espérances. Il croit que les Anglais prendraient Caudie par cette position ils tiendraient les Russes aussi en échec, car ils n’en sortiraient que le jour où les Russes sortiraient de Constantinople ; ce serait européennement parlant une bonne affaire, et une bonne affaire pour les anglais dans tous les cas.
Moi - Mais la France avalerait- elle cela ?
Le duc - Je le crois, presque. Voilà à peu près l’Orient expédié ! Venons à Louis Bonaparte. Il paye très cher à Berryer pour le défendre. Et Berryer accepte parce qu’il est bien payé, et puis parce que cette défense tourne pour lui un moyen d’attaque contre le gouvernement ainsi il justifiera Bonaparte sur ce que la France n’est plus qu’un pays de désordres. Un pays où l’on proclame des légitimités à la demi-douzaine. La branche d’Orléans légitime, Bonaparte légitime, le ministère le dit. On ne sait plus auquel entendre. Voyez la confusion, de là une tentative toute naturelle. Il brodera sur cela. Il brodera sur la situation que le gouvernement a faite à la France, répudiée, isolée; ses deux grandes bases d’alliance détruites l’Espagne, l’Angleterre. Belle situation en Europe ! Enfin, enfin Louis Bonaparte a profité de tout cela, il en avait le droit.
Vienne ensuite la Chambre. Oh à la Chambre ! Qu’un orateur habile se lève et toute pacifique que soit cette chambre, cet orateur peut lui faire voter la guerre dans une demi-heure. Si la situation n’est pas. éclaircie d’ici aux chambres. Il sera très difficile d’éviter un éclat. Le duc de Noailles ne sait pas s’il viendra on ne viendra pas au procès. Je l’ai fort engagé à venir. Il m’a dit que Berryer déciderait un peu cela.
Samedi 19 septembre. 9 heures
J’ai été vraiment malade hier très affaibli, très misérable. Je n’ai pas bougé de ma chaise longue. J’ai vu Appony avant dîner, mon ambassadeur le soir. Appony avait vu Thiers. On est comme de raison très très préoccupé de savoir ce que va devenir la proposition de Méhémet Ali. Nécessairement le sultan la référera à la conférence. Voulut-il même l’accepter, Ponsomby aura soin de l’en empêcher, d’abord ce seront des délais de deux mois au moins ; pendant ce temps l’exécution du traité ira toujours. Appony trouve que le conseil donné à Méhémet ali a été bon, très adroit de la part de la France ; il croit que la conférence pourrait accepter, mais si elle n’accepte pas, si on veut à toute outrance le traite ; alors la situation devient bien plus grave qu’avant cette proposition de l’Egypte, parce que la France est compromise, et qu’elle ne peut pas laisser passer cela. Il me semble que pourvu qu’on entre en voie de négociation cela doit s’arranger. Mais les amours propres anglais se soumettront-ils à cela ? Vous me le direz.
Sur le traité, Thiers a dit à Appony : " Vraiment il est pitoyable votre traité ; il est risible, je suis sûr que le prince Metternich doit en rire aussi. " Appony lui a promis de venir l’informer de suite que le prince Metternich en rit, s’il le lui mande. au reste Appony est très frondeur, excessivement frondeur. Il trouve l’oeuvre insensée ; il fait comme moi. Il cherche le prince Métternich. Savez-vous ce que disait Pozzo au mois de juin de l’année dernière, lorsqu’il était encore vivant, et avant la bataille de Nézib ? Il disait " La Russie doit changer sa politique en Orient, c’est avec Méhémet ali qu’elle doit s’allier. " Pozzo vivant, et Metternich pas mort, et tout aurait été autrement. Il n’y a pas un homme aujourd’hui qui sache juger et conduire une affaire. Aussi. voyez le décousu, l’incroyable confusion !
M. de Pahlen était assez noir hier aussi. Il ne fronde pas aussi haut qu’Appony. Mais il n’est pas content. Il ne comprend pas, et tout qu’on ne l’informe pas, il est décidé à ne pas comprendre. Il était inquiet hier de l’information qu’il a eu que votre gouvernement permet à Levewel de revenir à Paris. Il en parlera ce soir à Thier . Si cela était, il craint un gros orage à Pétersbourg Moi je ne crois pas trop à l’orage cependant, je ne sais pas.
Midi. Voici votre lettre. Je suis touchée de ce que vous me demandez 24 heures. Faites ce qui est convenable, mais pouvez-vous vous absenter ? Encore, une fois je suis touchée, et puis je sais bien aujourd’hui que toutes les plus belles tulipes ne valent pas pour vous la plus modeste fleur des champs. Je suis triste, je suis malade Je maigris encore. On ne sait jamais tout ce qu’on a à perdre je m’étonne tous les jours. Adieu. Adieu. Pourquoi suis-je si triste ?
4 heures
J’ai été retenue chez moi d’abord par mon médecin et puis par le duc de Noailles, qui est venu en ville pour deux heures pour me voir. Vous concevez qu’il a questionné et comme il a questionné. Et puis il a parlé. Il dit que la France au fond veut la paix, que c’est le vœu général, si général, si profond, que même on avalerait une petite humiliation encore plutôt que de se livrer aux hasards de la guerre, que cela est certain ; mais qu’on n’avalerait pas tout. Décidément pas et qu’alors on ferait la guerre très franchement et avec une grande unanimité. C’est aussi l’opinion et le dire de Berryer que le duc de Noailles venait de voir. Berryer croit savoir que Thiers est moins pacifique qu’on ne semble le croire. Il veut bien se montrer pacifique encore parce qu’il n’est pas prêt. Mais le jour où il sera prêt il voudra employer ses moyens, et le moment dangereux sera celui-là. Le duc de Noailles se creuse la tête pour trouver ce que les alliés peuvent vouloir tenter ou plutôt ce qu’ils sont convenus de faire pour le cas où l’insurrection de Syrie ne couronnerait pas leurs espérances. Il croit que les Anglais prendraient Caudie par cette position ils tiendraient les Russes aussi en échec, car ils n’en sortiraient que le jour où les Russes sortiraient de Constantinople ; ce serait européennement parlant une bonne affaire, et une bonne affaire pour les anglais dans tous les cas.
Moi - Mais la France avalerait- elle cela ?
Le duc - Je le crois, presque. Voilà à peu près l’Orient expédié ! Venons à Louis Bonaparte. Il paye très cher à Berryer pour le défendre. Et Berryer accepte parce qu’il est bien payé, et puis parce que cette défense tourne pour lui un moyen d’attaque contre le gouvernement ainsi il justifiera Bonaparte sur ce que la France n’est plus qu’un pays de désordres. Un pays où l’on proclame des légitimités à la demi-douzaine. La branche d’Orléans légitime, Bonaparte légitime, le ministère le dit. On ne sait plus auquel entendre. Voyez la confusion, de là une tentative toute naturelle. Il brodera sur cela. Il brodera sur la situation que le gouvernement a faite à la France, répudiée, isolée; ses deux grandes bases d’alliance détruites l’Espagne, l’Angleterre. Belle situation en Europe ! Enfin, enfin Louis Bonaparte a profité de tout cela, il en avait le droit.
Vienne ensuite la Chambre. Oh à la Chambre ! Qu’un orateur habile se lève et toute pacifique que soit cette chambre, cet orateur peut lui faire voter la guerre dans une demi-heure. Si la situation n’est pas. éclaircie d’ici aux chambres. Il sera très difficile d’éviter un éclat. Le duc de Noailles ne sait pas s’il viendra on ne viendra pas au procès. Je l’ai fort engagé à venir. Il m’a dit que Berryer déciderait un peu cela.
Samedi 19 septembre. 9 heures
J’ai été vraiment malade hier très affaibli, très misérable. Je n’ai pas bougé de ma chaise longue. J’ai vu Appony avant dîner, mon ambassadeur le soir. Appony avait vu Thiers. On est comme de raison très très préoccupé de savoir ce que va devenir la proposition de Méhémet Ali. Nécessairement le sultan la référera à la conférence. Voulut-il même l’accepter, Ponsomby aura soin de l’en empêcher, d’abord ce seront des délais de deux mois au moins ; pendant ce temps l’exécution du traité ira toujours. Appony trouve que le conseil donné à Méhémet ali a été bon, très adroit de la part de la France ; il croit que la conférence pourrait accepter, mais si elle n’accepte pas, si on veut à toute outrance le traite ; alors la situation devient bien plus grave qu’avant cette proposition de l’Egypte, parce que la France est compromise, et qu’elle ne peut pas laisser passer cela. Il me semble que pourvu qu’on entre en voie de négociation cela doit s’arranger. Mais les amours propres anglais se soumettront-ils à cela ? Vous me le direz.
Sur le traité, Thiers a dit à Appony : " Vraiment il est pitoyable votre traité ; il est risible, je suis sûr que le prince Metternich doit en rire aussi. " Appony lui a promis de venir l’informer de suite que le prince Metternich en rit, s’il le lui mande. au reste Appony est très frondeur, excessivement frondeur. Il trouve l’oeuvre insensée ; il fait comme moi. Il cherche le prince Métternich. Savez-vous ce que disait Pozzo au mois de juin de l’année dernière, lorsqu’il était encore vivant, et avant la bataille de Nézib ? Il disait " La Russie doit changer sa politique en Orient, c’est avec Méhémet ali qu’elle doit s’allier. " Pozzo vivant, et Metternich pas mort, et tout aurait été autrement. Il n’y a pas un homme aujourd’hui qui sache juger et conduire une affaire. Aussi. voyez le décousu, l’incroyable confusion !
M. de Pahlen était assez noir hier aussi. Il ne fronde pas aussi haut qu’Appony. Mais il n’est pas content. Il ne comprend pas, et tout qu’on ne l’informe pas, il est décidé à ne pas comprendre. Il était inquiet hier de l’information qu’il a eu que votre gouvernement permet à Levewel de revenir à Paris. Il en parlera ce soir à Thier . Si cela était, il craint un gros orage à Pétersbourg Moi je ne crois pas trop à l’orage cependant, je ne sais pas.
Midi. Voici votre lettre. Je suis touchée de ce que vous me demandez 24 heures. Faites ce qui est convenable, mais pouvez-vous vous absenter ? Encore, une fois je suis touchée, et puis je sais bien aujourd’hui que toutes les plus belles tulipes ne valent pas pour vous la plus modeste fleur des champs. Je suis triste, je suis malade Je maigris encore. On ne sait jamais tout ce qu’on a à perdre je m’étonne tous les jours. Adieu. Adieu. Pourquoi suis-je si triste ?
426. Paris, Vendredi 18 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
426. Paris, Vendredi le 18 septembre 1840
10 heures
Je suis un peu malade aujourd’hui, je me fâche contre le médecin, contre moi. Je ne pense qu’à me soigner, me bien porter et rien ne va, rien ne réussit. Vous savez comme le découragement me gagne vite. Hier j’ai fait une longue promenade au bois de Boulogne, le temps était charmant ; en revenant j’ai ramassé Fagel et nous avons recommencé. Fagel est de la bonne espèce droit, franc, sensé. Il a de veilles habitudes de confiance avec moi. En rentrant on m’apprend que ma nièce est malade Je suis allée chez elle ce n’est pas grand chose.
Appony m’a dit les nouvelles d’Egypte. Le Pacha proposant de se contenter de l’Egypte héréditaire et de la Syrie viagère, et ... Le soir j’ai laissé entrer chez moi les Durazzo, et les deux Pahlen. Tout le monde est à la paix ici depuis quatre ou cinq jours. J’espère que tout le monde a raison. Avant mon dîner Mad. de Flahaut est revenue. J’avais bonne envie de la refuser, et puis la curiosité l’a emporté, paix ou guerre, je ne savais pas. Je me croyais en guerre. elle est entrée, douce, caressante, la nuit avait porte conseil et elle s’est résignée à rester comme par le passé, avec soustraction de la politique. Je pense que vous allez voir le père et la fille à Holland. house. La fille est gentille, c’est-ce qu’il y a de mieux dans la famille. Le père est ce qu’il y a de pire.
Mon ambassadeur est vraiment un cher homme il me parait qu’il redouble encore pour moi depuis qu’il sait M. de Brünnow. Il fronde un peu mon cabinet et trouve étrange qu’on le laisse depuis quatre mois sans une ligne d’écriture. Rien Ces gens là ne savent plus écrire, car moi aussi je n’ai rien. Midi. Voici le joli médecin m’apportant un charmant remède. Merci, merci. Denay est arrivé et en fonctions depuis quelques jours. La nouvelle femme de chambre est plus bonne que belle. Eugénie part, et je ne sais comment m’en séparer, mais je le lui avais dit ; je ne puis pas me retarder. Personne ne m’a écrit d’Angleterre depuis mon départ. Il faut que j’écrive aujourd’hui à lady Palmerston pour lui envoyer une lettre de la reine d’Hanôvre qui demande explication. Mon Ambassadeur est excessivement occupé de Mad. Lafarge ; et comme je ne lis pas ce procès, il a le plaisir de me raconter tous les jours ce drame là, cela l’enchante.
Adieu, je comprends la sottise, et même je la partage c’est effroyable ce que je vous dis là. Adieu.
10 heures
Je suis un peu malade aujourd’hui, je me fâche contre le médecin, contre moi. Je ne pense qu’à me soigner, me bien porter et rien ne va, rien ne réussit. Vous savez comme le découragement me gagne vite. Hier j’ai fait une longue promenade au bois de Boulogne, le temps était charmant ; en revenant j’ai ramassé Fagel et nous avons recommencé. Fagel est de la bonne espèce droit, franc, sensé. Il a de veilles habitudes de confiance avec moi. En rentrant on m’apprend que ma nièce est malade Je suis allée chez elle ce n’est pas grand chose.
Appony m’a dit les nouvelles d’Egypte. Le Pacha proposant de se contenter de l’Egypte héréditaire et de la Syrie viagère, et ... Le soir j’ai laissé entrer chez moi les Durazzo, et les deux Pahlen. Tout le monde est à la paix ici depuis quatre ou cinq jours. J’espère que tout le monde a raison. Avant mon dîner Mad. de Flahaut est revenue. J’avais bonne envie de la refuser, et puis la curiosité l’a emporté, paix ou guerre, je ne savais pas. Je me croyais en guerre. elle est entrée, douce, caressante, la nuit avait porte conseil et elle s’est résignée à rester comme par le passé, avec soustraction de la politique. Je pense que vous allez voir le père et la fille à Holland. house. La fille est gentille, c’est-ce qu’il y a de mieux dans la famille. Le père est ce qu’il y a de pire.
Mon ambassadeur est vraiment un cher homme il me parait qu’il redouble encore pour moi depuis qu’il sait M. de Brünnow. Il fronde un peu mon cabinet et trouve étrange qu’on le laisse depuis quatre mois sans une ligne d’écriture. Rien Ces gens là ne savent plus écrire, car moi aussi je n’ai rien. Midi. Voici le joli médecin m’apportant un charmant remède. Merci, merci. Denay est arrivé et en fonctions depuis quelques jours. La nouvelle femme de chambre est plus bonne que belle. Eugénie part, et je ne sais comment m’en séparer, mais je le lui avais dit ; je ne puis pas me retarder. Personne ne m’a écrit d’Angleterre depuis mon départ. Il faut que j’écrive aujourd’hui à lady Palmerston pour lui envoyer une lettre de la reine d’Hanôvre qui demande explication. Mon Ambassadeur est excessivement occupé de Mad. Lafarge ; et comme je ne lis pas ce procès, il a le plaisir de me raconter tous les jours ce drame là, cela l’enchante.
Adieu, je comprends la sottise, et même je la partage c’est effroyable ce que je vous dis là. Adieu.
414. Londres, Jeudi 17 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
414. Londres, Jeudi 17 septembre 1840
sept heures et demie
Hier au soir à Holland house, Lord et lady Palmerston et lady Clanricard qui y avaient dîné. C’est un singulier spectacle que des gens d’esprit qui ne veulent pas parler de ce qui les occupe. Nous nous sommes extenués pendant deux heures à chercher des conversations. Nous en avons trouvé, beaucoup, de toutes sortes ; nous avons parcouru le monde et les siècles. Nous ne pouvions nous arrêter nulle part ; à peine un sujet abordé, nous le quittions. Evidemment notre pensée était ailleurs. Mais nous ne sommes jamais allés là où elle était. Je serais tenté de croire que Lord Palmerston n’est pas content. Je l’ai trouvé encore maigri, vieilli. J’espère que l’Orient ne lui donnera pas de gloire. Mais, à coup sûr, pas de jeunesse. Savez-vous qu’on dit que la Grèce pourrait bien faire la guerre à la Turquie? Elles sont très mal ; les relations des deux peuples ont presque cessé ; le ministre grec est sur le point de quitter Constantinople. Je serais charmé que cette Grèce, que vous avez faite, prit un rôle dans la question d’Orient. Pourvu que ce ne soit pas celui pour lequel vous l’aviez faite.
Lady Holland va mieux. Lady Clanricard part lundi, je ne sais pour où. J’irai la voir demain. Il me prend un scrupule. Lord Mahon à passé chez moi hier. Je recevrai peut-être une seconde invitation à aller passer vingt quatre heures chez eux à vingt milles de Londres. Je voudrais bien ne pas être impoli. Mais je ne veux être poli qu’avec votre permission. 24 heures. Voilà probablement un vif déplaisir. Les journaux anglais disent qu’ils n’ont par reçu leur exprès de Paris. La violence du vent aura empêché la traversée et pour les lettres, comme pour les journaux. On me dit qu’à cette époque vers l’équinoxe, on est quelquefois deux ou trois jours sans que rien puisse passer. Je ne me souviens pas que ce soit jamais arrivé. Il est vrai que je n’y regardais pas de si près. Pourtant j’ai déjà eu ici une équinoxe, en mars. Tout ce que je vous dis là n’avancera pas d’une heure l’arrivée du courrier et n’ôtera rien à mon impatience.
2 heures
La poste n’est pas venue en effet, et l’on doute qu’elle vienne aujourd’hui. Le nord-ouest qui soufflait hier fermait le port de Calais. Ce matin, tout est calme, excepté moi qui m’impatiente beaucoup plus que personne ne s’en doute. Vous récevrez, vous avez déjà reçu la visite, de mon joli médecin. Parlez-lui de votre santé. Permettez-lui d’y bien regarder de vous questionner. Il a de l’esprit, beaucoup de jugement et beaucoup de zèle. C’est quelque chose que le zèle passionné de la jeunesse. Cela vaut bien quelques fois, l’expérience indifférente de l’âge. Saviez-vous que lady Fanny vient d’écarter, le fils du duc de Richmond, lord March ? Elle le trouve trop enfant : " Je veux un mari qui me dise ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire, non pas un qui me le demande. " Ce n’est pas mal. Elle est toujours mal pour lord Palmerston toujours pressée d’aller chez sa soeur pour ne pas rester à Broadlands. Je vous dis tous les bavardages qu’on me dit. Je cherche à passer le temps.
4 heures
Je viens de faire deux visites, lady Palmerston et la princesse Auguste. Je vais souvent savoir des nouvelles de Stafford house, et de la Princesse Auguste. J’ai trouvé Lady Palmerston, très gracieuse. Elle sait plaire. Elle ne m’a point parlé de vous, mais vous êtes revenue deux ou trois fois dans la conversation d’anciennes petites histoires, une dame Russe qui, débarquant à Londres, vous avait priée de venir la voir at the black Bear, Custom’s house, je ne sais quoi encore ; rien, mais vous. Quel sentiment vous font éprouver les personnes qui savent plaire, et ne savent que plaire ? Dites-moi cela. Adieu. Je n’ai pas, le cœur à vous en dire davantage. Ou plutôt j’aurais le cœur à vous en dire trop. Adieu.
sept heures et demie
Hier au soir à Holland house, Lord et lady Palmerston et lady Clanricard qui y avaient dîné. C’est un singulier spectacle que des gens d’esprit qui ne veulent pas parler de ce qui les occupe. Nous nous sommes extenués pendant deux heures à chercher des conversations. Nous en avons trouvé, beaucoup, de toutes sortes ; nous avons parcouru le monde et les siècles. Nous ne pouvions nous arrêter nulle part ; à peine un sujet abordé, nous le quittions. Evidemment notre pensée était ailleurs. Mais nous ne sommes jamais allés là où elle était. Je serais tenté de croire que Lord Palmerston n’est pas content. Je l’ai trouvé encore maigri, vieilli. J’espère que l’Orient ne lui donnera pas de gloire. Mais, à coup sûr, pas de jeunesse. Savez-vous qu’on dit que la Grèce pourrait bien faire la guerre à la Turquie? Elles sont très mal ; les relations des deux peuples ont presque cessé ; le ministre grec est sur le point de quitter Constantinople. Je serais charmé que cette Grèce, que vous avez faite, prit un rôle dans la question d’Orient. Pourvu que ce ne soit pas celui pour lequel vous l’aviez faite.
Lady Holland va mieux. Lady Clanricard part lundi, je ne sais pour où. J’irai la voir demain. Il me prend un scrupule. Lord Mahon à passé chez moi hier. Je recevrai peut-être une seconde invitation à aller passer vingt quatre heures chez eux à vingt milles de Londres. Je voudrais bien ne pas être impoli. Mais je ne veux être poli qu’avec votre permission. 24 heures. Voilà probablement un vif déplaisir. Les journaux anglais disent qu’ils n’ont par reçu leur exprès de Paris. La violence du vent aura empêché la traversée et pour les lettres, comme pour les journaux. On me dit qu’à cette époque vers l’équinoxe, on est quelquefois deux ou trois jours sans que rien puisse passer. Je ne me souviens pas que ce soit jamais arrivé. Il est vrai que je n’y regardais pas de si près. Pourtant j’ai déjà eu ici une équinoxe, en mars. Tout ce que je vous dis là n’avancera pas d’une heure l’arrivée du courrier et n’ôtera rien à mon impatience.
2 heures
La poste n’est pas venue en effet, et l’on doute qu’elle vienne aujourd’hui. Le nord-ouest qui soufflait hier fermait le port de Calais. Ce matin, tout est calme, excepté moi qui m’impatiente beaucoup plus que personne ne s’en doute. Vous récevrez, vous avez déjà reçu la visite, de mon joli médecin. Parlez-lui de votre santé. Permettez-lui d’y bien regarder de vous questionner. Il a de l’esprit, beaucoup de jugement et beaucoup de zèle. C’est quelque chose que le zèle passionné de la jeunesse. Cela vaut bien quelques fois, l’expérience indifférente de l’âge. Saviez-vous que lady Fanny vient d’écarter, le fils du duc de Richmond, lord March ? Elle le trouve trop enfant : " Je veux un mari qui me dise ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire, non pas un qui me le demande. " Ce n’est pas mal. Elle est toujours mal pour lord Palmerston toujours pressée d’aller chez sa soeur pour ne pas rester à Broadlands. Je vous dis tous les bavardages qu’on me dit. Je cherche à passer le temps.
4 heures
Je viens de faire deux visites, lady Palmerston et la princesse Auguste. Je vais souvent savoir des nouvelles de Stafford house, et de la Princesse Auguste. J’ai trouvé Lady Palmerston, très gracieuse. Elle sait plaire. Elle ne m’a point parlé de vous, mais vous êtes revenue deux ou trois fois dans la conversation d’anciennes petites histoires, une dame Russe qui, débarquant à Londres, vous avait priée de venir la voir at the black Bear, Custom’s house, je ne sais quoi encore ; rien, mais vous. Quel sentiment vous font éprouver les personnes qui savent plaire, et ne savent que plaire ? Dites-moi cela. Adieu. Je n’ai pas, le cœur à vous en dire davantage. Ou plutôt j’aurais le cœur à vous en dire trop. Adieu.
425. Paris, Jeudi 17 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
425. Paris Jeudi le 17 septembre 1840
9 heures
Avant toute chose, la question de la correspondance. Ce n’est qu’à huit heures hier au soir que j’ai eu votre lettre de lundi, encore j’ai été la chercher. C’est-à-dire que mourant d’ inquiétude de n’avoir pas eu de lettres j’ai pris le parti d’aller chez Génie pour savoir s’il avait quelque nouvelle, si vous étiez malade. Enfin j’étais moi dans une véritable agonie, et je vous préviens que j’y serai chaque fois qu’il n’arrivera pareille aventure. Mettez y bon ordre, car ces choses me rendent malade et vous savez que je n’ai pas besoin d’agitation ! La preuve que ceci m’avait fait du mal et que j’ai été obligée de faire chercher mon médecin le soir, toute inquiétude se porte sur les entrailles. Et j’avais repris des douleurs. Ensuite on peut me voir toujours de 9 à 10. Et puis, j’écrirai Mercredi et Lundi au N°1. Mardi et Samedi au N°2. Jeudi et Dimanche au 3.
J’ai été à Kenwood bien souvent quand je vous proposai une promenade à Hamstead, c’était là que je voulais vous mener. Pourquoi n’y avons-nous pas été ensemble ? J’ai vu hier matin chez moi Appony, Mad. Durazzo, et Mad. de Flahaut hélas ! Appony venait de prendre lecture rapide du traité dans le journal anglais. Il pensait qu’il n’y avait rien là qui dût irriter la France ou l’inquiéter. Il trouve que la lettre de Königsberg insérée dans le Constitutionnel a un grand fond de vérité ! Mad. Durazzo bonne, douce et pas bête. Brignoles revient dans un mois je crois.
Mad. de Flahaut est venu me faire une scène, une scène. M. de Flahaut et elle sont très offensés de ce que je ne veux pas parler politique en leur présence. Il est évident que je me méfie d’eux, que je ne crois pas un mot de leurs explications sur la lettre. Cela n’est pas tolérable. Et sur ce point là, je ne puis plus être qu’une connaissance et non plus une amie. Voilà littéralement la déclaration. Vraiment c’est trop drôle. J’ai répété que je ne voulais plus entendre parler de la lettre, et qu’assurément je ne parlerais pas politique qu’ils s’arrangent. La colère est grande, il y a eu des insinuations et des paroles, fort étranges, je ne les ai pas relancés. Je veux simplifier les querelles. Vraiment j’ai bien à faire avec mes amies !
C’était bien autre chose encore que lady Palmerston on dirait qu’on s’est donné le mot. Revenez au milieu de la scène, Mad. de Flahaut pleure, moi je n’ai pas eu l’air tendre. Le temps hier était épouvantable. Un vrai hurricane. Le chaos. J’ai eu peur. Plus tard, j’ai été pour une demi-heure au bois de Boulogne.
Après mon dîner, comme je l’ai dit plus haut, chez Génie avec des battements de cœur si forts si forts, il est venu à la portière me remettre la lettre reçue disait-il après 5 heures Mon ambassadeur est venu de 8 1/2 à 9 1/2 et puis mon médecin. Il reviendra ce matin. Et bien le traité ! Vous ne m’en parliez pas Lundi. Il était dans les journaux anglais cependant. Est-ce que par hasard il ne vous aurait pas été communiqué ? Je l’ai lu, je ne trouve pas que nous y jouions un grand rôle. Après cela je ne le trouve en vérité pas incommode pour la France. Et puis l’acte de Napier reste toujours incroyable car l’article qui prescrit les mesures avant la ratification dit nommément que c’est parce que l’insurrection était en train. Or elle se trouvait étouffée.
Le 14, et le 14 était toujours deux jours avant le 1. Effacez vendredi au N°1 car ce jour là j’écris tout droit. Je l’avais oublié et donnez au n°1 Lundi en place de Vendredi. Et ôtez alors le lundi au n°2. Je viens de faire cela à la seconde page. C’est compris maintenant ? 1 heure Pas de lettres, mais la tempête d’hier explique cela, je ne veux donc pas m’inquiéter. Les journaux ministériels ne font pas d’observation sur le traité. J’attends les vôtres. Je me trompais peut-être sur Napier, alors cet article du Protocole réservé est bien étrange. Dites-moi donc ce que vous en pensez.
Voici le 412. Grey a bien du bon sens. J’aime les Holland parce qu’ils vous aiment et parce qu’ils sont aimables. Je ne pourrai rien dire pour la vaisselle de Lady Durham ; vous voyez bien que je ne vois pas Thiers pourquoi ? Je ne le comprends pas et bien vous ne me dites pas un mot du traité. Why ? Chermside sort d’ici, il trouve qu’on m’a fait prendre du quinine trop tôt. J’ai des vertiges, et l’estomac bien affaibli.
2 heures
Il me semble que je vous écris de pauvres lettres, si j’allais dans le monde elles vaudraient mieux mais je n’ai pas la force et vous voulez n’est-ce pas que je me repose. Je pense que Molé ne vient pas parce que je ne lui ai pas envoyé dire que je suis ici. Il est parmi les susceptibles. Mais je vous avoue que je trouve très bon qu’on n’aie pas à citer mes paroles, et le plus sûr alors est de ne pas voir les gens, ou quand on les voit (Flahaut par exemple) de mériter des scènes pour mon silence. C’est une prudence d’enfant, mais je vis au milieu de menteurs.
Adieu. Adieu, beaucoup de fois ou une seule bonne according to your texte. Adieu. Vous avez raison, il faut obtenir la vaisselle pour lady Durham. Lord Grey plus que qui que ce soit arrange ses opinions politiques sur ces petites choses. Et ce qu’il vous mande a de l’importance et beaucoup, il faut l’entretenir dans cette disposition. Je ne puis pas finir sur cela il faut encore adieu. Dites aux Holland mille bons souvenirs de moi, adieu.
9 heures
Avant toute chose, la question de la correspondance. Ce n’est qu’à huit heures hier au soir que j’ai eu votre lettre de lundi, encore j’ai été la chercher. C’est-à-dire que mourant d’ inquiétude de n’avoir pas eu de lettres j’ai pris le parti d’aller chez Génie pour savoir s’il avait quelque nouvelle, si vous étiez malade. Enfin j’étais moi dans une véritable agonie, et je vous préviens que j’y serai chaque fois qu’il n’arrivera pareille aventure. Mettez y bon ordre, car ces choses me rendent malade et vous savez que je n’ai pas besoin d’agitation ! La preuve que ceci m’avait fait du mal et que j’ai été obligée de faire chercher mon médecin le soir, toute inquiétude se porte sur les entrailles. Et j’avais repris des douleurs. Ensuite on peut me voir toujours de 9 à 10. Et puis, j’écrirai Mercredi et Lundi au N°1. Mardi et Samedi au N°2. Jeudi et Dimanche au 3.
J’ai été à Kenwood bien souvent quand je vous proposai une promenade à Hamstead, c’était là que je voulais vous mener. Pourquoi n’y avons-nous pas été ensemble ? J’ai vu hier matin chez moi Appony, Mad. Durazzo, et Mad. de Flahaut hélas ! Appony venait de prendre lecture rapide du traité dans le journal anglais. Il pensait qu’il n’y avait rien là qui dût irriter la France ou l’inquiéter. Il trouve que la lettre de Königsberg insérée dans le Constitutionnel a un grand fond de vérité ! Mad. Durazzo bonne, douce et pas bête. Brignoles revient dans un mois je crois.
Mad. de Flahaut est venu me faire une scène, une scène. M. de Flahaut et elle sont très offensés de ce que je ne veux pas parler politique en leur présence. Il est évident que je me méfie d’eux, que je ne crois pas un mot de leurs explications sur la lettre. Cela n’est pas tolérable. Et sur ce point là, je ne puis plus être qu’une connaissance et non plus une amie. Voilà littéralement la déclaration. Vraiment c’est trop drôle. J’ai répété que je ne voulais plus entendre parler de la lettre, et qu’assurément je ne parlerais pas politique qu’ils s’arrangent. La colère est grande, il y a eu des insinuations et des paroles, fort étranges, je ne les ai pas relancés. Je veux simplifier les querelles. Vraiment j’ai bien à faire avec mes amies !
C’était bien autre chose encore que lady Palmerston on dirait qu’on s’est donné le mot. Revenez au milieu de la scène, Mad. de Flahaut pleure, moi je n’ai pas eu l’air tendre. Le temps hier était épouvantable. Un vrai hurricane. Le chaos. J’ai eu peur. Plus tard, j’ai été pour une demi-heure au bois de Boulogne.
Après mon dîner, comme je l’ai dit plus haut, chez Génie avec des battements de cœur si forts si forts, il est venu à la portière me remettre la lettre reçue disait-il après 5 heures Mon ambassadeur est venu de 8 1/2 à 9 1/2 et puis mon médecin. Il reviendra ce matin. Et bien le traité ! Vous ne m’en parliez pas Lundi. Il était dans les journaux anglais cependant. Est-ce que par hasard il ne vous aurait pas été communiqué ? Je l’ai lu, je ne trouve pas que nous y jouions un grand rôle. Après cela je ne le trouve en vérité pas incommode pour la France. Et puis l’acte de Napier reste toujours incroyable car l’article qui prescrit les mesures avant la ratification dit nommément que c’est parce que l’insurrection était en train. Or elle se trouvait étouffée.
Le 14, et le 14 était toujours deux jours avant le 1. Effacez vendredi au N°1 car ce jour là j’écris tout droit. Je l’avais oublié et donnez au n°1 Lundi en place de Vendredi. Et ôtez alors le lundi au n°2. Je viens de faire cela à la seconde page. C’est compris maintenant ? 1 heure Pas de lettres, mais la tempête d’hier explique cela, je ne veux donc pas m’inquiéter. Les journaux ministériels ne font pas d’observation sur le traité. J’attends les vôtres. Je me trompais peut-être sur Napier, alors cet article du Protocole réservé est bien étrange. Dites-moi donc ce que vous en pensez.
Voici le 412. Grey a bien du bon sens. J’aime les Holland parce qu’ils vous aiment et parce qu’ils sont aimables. Je ne pourrai rien dire pour la vaisselle de Lady Durham ; vous voyez bien que je ne vois pas Thiers pourquoi ? Je ne le comprends pas et bien vous ne me dites pas un mot du traité. Why ? Chermside sort d’ici, il trouve qu’on m’a fait prendre du quinine trop tôt. J’ai des vertiges, et l’estomac bien affaibli.
2 heures
Il me semble que je vous écris de pauvres lettres, si j’allais dans le monde elles vaudraient mieux mais je n’ai pas la force et vous voulez n’est-ce pas que je me repose. Je pense que Molé ne vient pas parce que je ne lui ai pas envoyé dire que je suis ici. Il est parmi les susceptibles. Mais je vous avoue que je trouve très bon qu’on n’aie pas à citer mes paroles, et le plus sûr alors est de ne pas voir les gens, ou quand on les voit (Flahaut par exemple) de mériter des scènes pour mon silence. C’est une prudence d’enfant, mais je vis au milieu de menteurs.
Adieu. Adieu, beaucoup de fois ou une seule bonne according to your texte. Adieu. Vous avez raison, il faut obtenir la vaisselle pour lady Durham. Lord Grey plus que qui que ce soit arrange ses opinions politiques sur ces petites choses. Et ce qu’il vous mande a de l’importance et beaucoup, il faut l’entretenir dans cette disposition. Je ne puis pas finir sur cela il faut encore adieu. Dites aux Holland mille bons souvenirs de moi, adieu.
424. Paris, Mercredi 16 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
424. Paris Mercredi 16 septembre 1840
9 heures
J’ai vraiment des moments de grand mépris pour moi, et pour vous. Je trouve si intolérablement absurde que nous soyons séparés. Vous seul à Londres ; moi seul à Paris, chacun au milieu de millions d’habitants, seuls, bien seuls ! Eh bien voyez-vous cet abominable égoïsme qui fait que je vous aime mieux à Londres qu’au Val-Richer. Je vous veux, comme moi, sans compensation, sans distraction, sans plaisir ; pensant à juin, juillet, août rêvant à octobre. Un doux passé, un charmant avenir, n’est-ce pas ? Mais il faut qu’il vienne cet avenir. Il faut que nous allions à lui bien décider à le conquérir.
J’ai vu hier Bulwer et Adair. J’ai été shopping pour un cadeau à ma nièce. Et j’ai passé chez les Appony que j’avais manqués chez moi décidément on était à la paix hier. Appony avait vu Thiers longtemps ; il avait l’air un peu mystérieux (Appony), mais fort rassuré. Après mon dîner j’ai été chez les Flahaut, il y avait M. de Sercey et M. d’Haubersaert. On a beaucoup, beaucoup parlé politique, je n’ai pas ouvert la bouche. C’est exact ce que je vous dis là, pas ouvert la bouche. On disait beaucoup que le Pacha se modérait. On faisait des paris qu’il n’y aurait aucune tentation sur la côte de Syrie qui puisse réussir. Enfin comme de raison, on était très français. J’étais dans mon lit à 10 heures, avec un gros rhume.
Le temps est abominable. J’aurai une lettre aujourd’hui. Ce pauvre M. de Stackelberg a encore perdu une fille. Mad. de la Rovère. Trois enfants dans dix mois. Je devrais dire cette pauvre Mad. de Stockelberg ! Car c’est elle, elle qui le sent !
1 heure
Comment pas de lettres ! Mais c’est impossible, n’est-ce pas c’est impossible que vous ne m ’ayez pas écrit ?
2 heures
Je vais sortir, comment il faudra fermer ma lettre sans un adieu de vous ? Faut-il que je m’inquiète ? Adieu tristement. Adieu tendrement. Adieu bien longuement.
9 heures
J’ai vraiment des moments de grand mépris pour moi, et pour vous. Je trouve si intolérablement absurde que nous soyons séparés. Vous seul à Londres ; moi seul à Paris, chacun au milieu de millions d’habitants, seuls, bien seuls ! Eh bien voyez-vous cet abominable égoïsme qui fait que je vous aime mieux à Londres qu’au Val-Richer. Je vous veux, comme moi, sans compensation, sans distraction, sans plaisir ; pensant à juin, juillet, août rêvant à octobre. Un doux passé, un charmant avenir, n’est-ce pas ? Mais il faut qu’il vienne cet avenir. Il faut que nous allions à lui bien décider à le conquérir.
J’ai vu hier Bulwer et Adair. J’ai été shopping pour un cadeau à ma nièce. Et j’ai passé chez les Appony que j’avais manqués chez moi décidément on était à la paix hier. Appony avait vu Thiers longtemps ; il avait l’air un peu mystérieux (Appony), mais fort rassuré. Après mon dîner j’ai été chez les Flahaut, il y avait M. de Sercey et M. d’Haubersaert. On a beaucoup, beaucoup parlé politique, je n’ai pas ouvert la bouche. C’est exact ce que je vous dis là, pas ouvert la bouche. On disait beaucoup que le Pacha se modérait. On faisait des paris qu’il n’y aurait aucune tentation sur la côte de Syrie qui puisse réussir. Enfin comme de raison, on était très français. J’étais dans mon lit à 10 heures, avec un gros rhume.
Le temps est abominable. J’aurai une lettre aujourd’hui. Ce pauvre M. de Stackelberg a encore perdu une fille. Mad. de la Rovère. Trois enfants dans dix mois. Je devrais dire cette pauvre Mad. de Stockelberg ! Car c’est elle, elle qui le sent !
1 heure
Comment pas de lettres ! Mais c’est impossible, n’est-ce pas c’est impossible que vous ne m ’ayez pas écrit ?
2 heures
Je vais sortir, comment il faudra fermer ma lettre sans un adieu de vous ? Faut-il que je m’inquiète ? Adieu tristement. Adieu tendrement. Adieu bien longuement.
413. Londres, Mercredi 16 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
413. Londres, Mercredi 16 septembre 1840
6 heures et demie
Je ne me suis pas conché à 9 heures, mais je me réveille de grand matin. Mes vendredi et mardi conviennent, je crois beaucoup aux diplomates. Ils y étaient tous hier sauf ce pauvre comte de Björnstjerna qui attendait encore hier matin le bateau de Hambourg et sa femme. Elle est enfin arrivée hier soir. Il me l’a fait dire par un petit comte de Mörner, joli jeune homme qui barbouille comme je n’ai jamais entendu personne barbouiller. Ils ont beaucoup joué, au Whist, et moi un peu. J’admirais, en remontant dans ma chambre, avec quelles choses et quelles paroles on peut remplir trois heures. Ils sont comme les vôtres, ils croient à la paix ; les uns d’une façon qui me plaît, les autres d’une façon qui me déplaît. Il y en avait là deux qui faisaient pitié à voir, pour leurs propres affaires, Alava et Moncorvo ; ne sachant pas s’ils étaient les ministres de quelqu’un ne recevant rien, ni nouvelles, ni argent, pas de nouvelles depuis bien des jours, pas d’argent depuis bien des mois. Ils jouaient tout de même au Whist. Lord Palmerston est revenu hier matin. Je l’ai vu à 5 heures et demie au moment où ils venaient d’échanger les ratifications. Les tables étaient encore là, les grands papiers, les bâtons de cire. Neumann, Schleinitz et Brünnow sont sortis devant moi de son Cabinet. Brünnow est très changé, et il a l’air consterné d’être si changé. Il a eu un quasi-choléra. J’ai passé une demi-heure avec Lord Palmerston très doux, ne voulant de querelle sur rien. Il m’a abandonné les consuls tout-à-fait Napier à moitié. Aux autres, il promet toujours un succès certain, prempt, pas le moindre vrai danger. Avec moi il n’argumente plus, il ne prédit plus. Nous avons l’air d’attendre tous deux que Dieu donne raison à l’un des deux. Il reste ici, pour quinze jours au moins. Lady Palmerston est revenue avec lui. Vous a-t-elle écrit ?
2 heures
Je n’ai rien encore ce matin. J’ai encore une chance. Je l’attends. Attendre, et attendre une chance, que cela me déplaît ! Quel ennui de ne pouvoir tout faire tout rondement ? Je suis aujourd’hui comme on était autour de vous samedi dernier, noir et inquiet. Je crains des malheurs et des fautes, les pires des malheurs, car elles en sont et elles en font. Je pense beaucoup dans ma solitude. J’entrevois dans la situation la plus périlleuse, une bonne conduite possible, très bonne, mais si difficile, si difficile ! Et puis, je ne sais pas bien l’état, l’état réel des esprits en France, ce qui est bien quelque chose dans la question. Mon instinct est que le bon parti ne veut pas la guerre. Et qu’il aurait la force de l’empêcher s’il en avait l’esprit et le courage. Je suis très perplexe. Mal double pour moi, car la perplexité, fort pénible en elle-même, est de plus contre ma nature. Je ne reste jamais longtemps perplexe. Je viens de répondre à lord Grey. 3 heures et demie Là voilà. Rien ne manque plus à ma journée de ce quelle peut avoir. Je suis moins noir qu’à 2 heures Je crois moins à la guerre, si elle venait, vous seriez malade, très malade. On est toujours à temps de se mieux porter si cela devient absolument nécessaire. Il faut commencer par être malade. Mais j’espère qu’il ne faudra pas. A présent que je vous ai vue comme je vous vois à présent, je vous quitte. J’envoie un courrier ce soir. Je vais à mes dépêches. Il fait froid aussi à Londres. J’ai du feu. En aurais-je à Paris ? Mad. de Tencin disait que la diversité de goût sur le froid, et le chaud avait brouillé plus de ménages que toute autre passion. Croyez-vous ? En tout cas, ne vous refroidissez pas. Adieu, adieu. J’ai une sottise sur le bout des lèvres. Adieu
6 heures et demie
Je ne me suis pas conché à 9 heures, mais je me réveille de grand matin. Mes vendredi et mardi conviennent, je crois beaucoup aux diplomates. Ils y étaient tous hier sauf ce pauvre comte de Björnstjerna qui attendait encore hier matin le bateau de Hambourg et sa femme. Elle est enfin arrivée hier soir. Il me l’a fait dire par un petit comte de Mörner, joli jeune homme qui barbouille comme je n’ai jamais entendu personne barbouiller. Ils ont beaucoup joué, au Whist, et moi un peu. J’admirais, en remontant dans ma chambre, avec quelles choses et quelles paroles on peut remplir trois heures. Ils sont comme les vôtres, ils croient à la paix ; les uns d’une façon qui me plaît, les autres d’une façon qui me déplaît. Il y en avait là deux qui faisaient pitié à voir, pour leurs propres affaires, Alava et Moncorvo ; ne sachant pas s’ils étaient les ministres de quelqu’un ne recevant rien, ni nouvelles, ni argent, pas de nouvelles depuis bien des jours, pas d’argent depuis bien des mois. Ils jouaient tout de même au Whist. Lord Palmerston est revenu hier matin. Je l’ai vu à 5 heures et demie au moment où ils venaient d’échanger les ratifications. Les tables étaient encore là, les grands papiers, les bâtons de cire. Neumann, Schleinitz et Brünnow sont sortis devant moi de son Cabinet. Brünnow est très changé, et il a l’air consterné d’être si changé. Il a eu un quasi-choléra. J’ai passé une demi-heure avec Lord Palmerston très doux, ne voulant de querelle sur rien. Il m’a abandonné les consuls tout-à-fait Napier à moitié. Aux autres, il promet toujours un succès certain, prempt, pas le moindre vrai danger. Avec moi il n’argumente plus, il ne prédit plus. Nous avons l’air d’attendre tous deux que Dieu donne raison à l’un des deux. Il reste ici, pour quinze jours au moins. Lady Palmerston est revenue avec lui. Vous a-t-elle écrit ?
2 heures
Je n’ai rien encore ce matin. J’ai encore une chance. Je l’attends. Attendre, et attendre une chance, que cela me déplaît ! Quel ennui de ne pouvoir tout faire tout rondement ? Je suis aujourd’hui comme on était autour de vous samedi dernier, noir et inquiet. Je crains des malheurs et des fautes, les pires des malheurs, car elles en sont et elles en font. Je pense beaucoup dans ma solitude. J’entrevois dans la situation la plus périlleuse, une bonne conduite possible, très bonne, mais si difficile, si difficile ! Et puis, je ne sais pas bien l’état, l’état réel des esprits en France, ce qui est bien quelque chose dans la question. Mon instinct est que le bon parti ne veut pas la guerre. Et qu’il aurait la force de l’empêcher s’il en avait l’esprit et le courage. Je suis très perplexe. Mal double pour moi, car la perplexité, fort pénible en elle-même, est de plus contre ma nature. Je ne reste jamais longtemps perplexe. Je viens de répondre à lord Grey. 3 heures et demie Là voilà. Rien ne manque plus à ma journée de ce quelle peut avoir. Je suis moins noir qu’à 2 heures Je crois moins à la guerre, si elle venait, vous seriez malade, très malade. On est toujours à temps de se mieux porter si cela devient absolument nécessaire. Il faut commencer par être malade. Mais j’espère qu’il ne faudra pas. A présent que je vous ai vue comme je vous vois à présent, je vous quitte. J’envoie un courrier ce soir. Je vais à mes dépêches. Il fait froid aussi à Londres. J’ai du feu. En aurais-je à Paris ? Mad. de Tencin disait que la diversité de goût sur le froid, et le chaud avait brouillé plus de ménages que toute autre passion. Croyez-vous ? En tout cas, ne vous refroidissez pas. Adieu, adieu. J’ai une sottise sur le bout des lèvres. Adieu
423. Paris, Mardi 15 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
423. Paris Mardi le 15 Septembre 1840
8 heures
J’ai vu hier matin, M. de Werther et Bulwer. Point de nouvelles tout le monde très pacifique. J’ai fait ma promenade au bois avec Emilie. Je n’ai pas vu sa mère, Dieu merci.
Après mon dîner qui n’est pas un dîner, les deux Pahlen sont venus chez moi, du parlage, du rabâchage, car il n’y a rien. M. d’e Pahlen qui connait cependant fort bien l’Orient et parfaitement les Turcs, affirme qu’il est impossible que le traité stipule l’entrée des Russes dans l’Asie mineure, ou que si ce traité le dit c’est une complète absurdité. Car jamais nos troupes en surmonteraient les obstacles matériels et moraux de cette entreprise. Aucune troupe européenne ne le pourrait et nous moins que tout autre, parce que le Russe est détesté par tout musulman ainsi dans son opinion, point de Syrie possible par terre, par mer c’est l’affaire de lord Palmerston voyons s’il en viendra à bout.
Le temps est à la pluie, n’importe Paris est joli. Les fontaines font leur devoir ; les arbres sont un peu gris, C’est vrai ; mais c’est égal. Je n’ai pas vu une âme française depuis mon arrivée ; excepté Montrond. Charles Pozzo vient de se casser une côte. Le vieux est tout-à-fait imbécile, il n’y a plus d’éclaircie. La fille de Jérôme Bonaparte épouse M. Demidoff. J’en suis indignée. Le prince Paul de Wurtemberg est de retour, je pense que je vais bientôt le voir. Il doit être drôle maintenant.
Mon ambassadeur est fort impatient de ce que je n’ouvre. pas encore ma porte. Je l’ai renvoyé avant dix heures. Midi, j’ai vu le petit ami, et il m’a vue dans mon bonnet de nuit. Il est venu trop tôt, ou bien moi, je suis restée trop tard en tenue de nuit.
Il n’y a rien rien. A blank day again. Mais il est impossible qu’il ne survienne pas des événements, les matières remuantes ne manquent pas. Il faut que vous vous contentiez aujourd’hui de ce pauvre chiffon de lettre. Il ne vous en porte pas moins, tout court, qu’il est un bien long, adieu.
8 heures
J’ai vu hier matin, M. de Werther et Bulwer. Point de nouvelles tout le monde très pacifique. J’ai fait ma promenade au bois avec Emilie. Je n’ai pas vu sa mère, Dieu merci.
Après mon dîner qui n’est pas un dîner, les deux Pahlen sont venus chez moi, du parlage, du rabâchage, car il n’y a rien. M. d’e Pahlen qui connait cependant fort bien l’Orient et parfaitement les Turcs, affirme qu’il est impossible que le traité stipule l’entrée des Russes dans l’Asie mineure, ou que si ce traité le dit c’est une complète absurdité. Car jamais nos troupes en surmonteraient les obstacles matériels et moraux de cette entreprise. Aucune troupe européenne ne le pourrait et nous moins que tout autre, parce que le Russe est détesté par tout musulman ainsi dans son opinion, point de Syrie possible par terre, par mer c’est l’affaire de lord Palmerston voyons s’il en viendra à bout.
Le temps est à la pluie, n’importe Paris est joli. Les fontaines font leur devoir ; les arbres sont un peu gris, C’est vrai ; mais c’est égal. Je n’ai pas vu une âme française depuis mon arrivée ; excepté Montrond. Charles Pozzo vient de se casser une côte. Le vieux est tout-à-fait imbécile, il n’y a plus d’éclaircie. La fille de Jérôme Bonaparte épouse M. Demidoff. J’en suis indignée. Le prince Paul de Wurtemberg est de retour, je pense que je vais bientôt le voir. Il doit être drôle maintenant.
Mon ambassadeur est fort impatient de ce que je n’ouvre. pas encore ma porte. Je l’ai renvoyé avant dix heures. Midi, j’ai vu le petit ami, et il m’a vue dans mon bonnet de nuit. Il est venu trop tôt, ou bien moi, je suis restée trop tard en tenue de nuit.
Il n’y a rien rien. A blank day again. Mais il est impossible qu’il ne survienne pas des événements, les matières remuantes ne manquent pas. Il faut que vous vous contentiez aujourd’hui de ce pauvre chiffon de lettre. Il ne vous en porte pas moins, tout court, qu’il est un bien long, adieu.
412. Londres, Mardi 15 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
412. Londres, mardi 15 septembre 1840
7 heures et demie
Demay est parti avant-hier et doit être à Paris aujourd’hui selon sa promesse. Vous me direz si vous êtes contente de Valentin et de votre nouvelle, femme de chambre. Elle n’est pas jolie. Eugénie, vous a-t-elle quittée ! Que devient Chartolle ? Je suis bien questionneur ce matin. J’ai besoin de tout savoir. Encore une question. Avez-vous vu Chermside ? Je suis charmé que votre nièce soit charmante. A-t-elle assez d’esprit pour se plaire un peu avec vous ? Je suis très disposé à la trouver bien, sauf toujours la loucherie. J’y suis impitoyable. Je ne le suis que pour cela, quoiqu’on en dise.
Encore un assez agréable petit dîné hier à Holland house. Clarendon et Luttrel. Pas mal de conversation. Lord Holland et moi. Il est vraiment très aimable. Presque bouffon. Il s’est mis hier à contrefaire les hommes célèbres de son temps Sheridan, Graltan, Curran. Ce gros corps goutteux qui ne peut pas se remuer, cette grosse figure, ces gros sourcils de geolier, tout cela devenait souple, gai avec un air de moquerie fine et bienveillante. Lady Holland est plus souffrante. Pas de Brighton aujourd’hui et probablement pas du tout. Je vous raconte tout mon Holland house. C’est mon Angleterre en ce moment. Savez-vous, comment Lady Holland appelle les quatre consuls d’Alerandrie ? Les Proconsuls.
J’ai reçu une longue lettre de lord Grey. Il me prie de faire obtenir à Lady Durham, qui va passer l’hiver à Pau avec ses enfants, l’autorisation d’introduire, en France sa vaisselle. Vous savez que ce n’est pas facile. Il faut pourtant que j’y réussisse. Dites à Thiers, la première fois que vous le verrez, d’en dire un mot au Ministre des finances, de lui dire qu’il le faut.
Politiquement, voici tout Lord Gey. I rend in the papers, my only sources of information, with great anxiety and concern, the continued account ot the dangers, which threaten, the good understanding between this country and France. I cannot bring myself to believe that a rupture can ultimately take place between live countries which have mutually so strong an interest in preserving the relations of peace and amity. But I can not also be without great fears that à state of things may be produced in which some accident or mischance may decide a question which some wisdom and moderation would settle amicably. I feel confident that your feelings are not different from those which I have expressed, and if any thing could induce me again to talk part in public affairs, it would be the hope of being able to assist, in preventing dangers which are much greater than the value of all Syria, past, présent and to come.
Je ne sais pourquoi je vous copie tout cela, qui me prend mon papier et qu’il vous a peut-être écrit aussi. C’est pour la dernière phrase. Et surtout pour vous parler de tout.
3 heures
J’attends bien impatiemment que vous ne soyez plus si fatiguée, si faible. Il me semble que la vie que vous menez doit finir par vous reposer. Je n’en imagine pas de plus tranquille. Continuez à vous coucher de bonne heure. Le bavardage menteur et hostile de Mad. de Flahaut ne métonne pas du tout. Il me devient bien des bavardages. J’écoute tout et ne me préoccupe pas de grand chose. Je me sens très fort, fort comme l’Angleterre avec sa ceinture d’océan comme sera Paris quand son enceinte continue sera faite. Je crois fermement, après y avoir bien regardé, que, depuis mon arrivée à Londres, j’ai bien jugé et bien agi. Rien ne me manque en fait de preuves. Je me tiens et me tiendrai fort tranquille si jamais j’étais attaqué, ouvertement ou sourdement, je me défendrais bien. Et très sérieusement, car ces affaires-ci sont sérieuses. Adieu. Extrêmement comme vous dîtes. J’aime cet adieu-là.
7 heures et demie
Demay est parti avant-hier et doit être à Paris aujourd’hui selon sa promesse. Vous me direz si vous êtes contente de Valentin et de votre nouvelle, femme de chambre. Elle n’est pas jolie. Eugénie, vous a-t-elle quittée ! Que devient Chartolle ? Je suis bien questionneur ce matin. J’ai besoin de tout savoir. Encore une question. Avez-vous vu Chermside ? Je suis charmé que votre nièce soit charmante. A-t-elle assez d’esprit pour se plaire un peu avec vous ? Je suis très disposé à la trouver bien, sauf toujours la loucherie. J’y suis impitoyable. Je ne le suis que pour cela, quoiqu’on en dise.
Encore un assez agréable petit dîné hier à Holland house. Clarendon et Luttrel. Pas mal de conversation. Lord Holland et moi. Il est vraiment très aimable. Presque bouffon. Il s’est mis hier à contrefaire les hommes célèbres de son temps Sheridan, Graltan, Curran. Ce gros corps goutteux qui ne peut pas se remuer, cette grosse figure, ces gros sourcils de geolier, tout cela devenait souple, gai avec un air de moquerie fine et bienveillante. Lady Holland est plus souffrante. Pas de Brighton aujourd’hui et probablement pas du tout. Je vous raconte tout mon Holland house. C’est mon Angleterre en ce moment. Savez-vous, comment Lady Holland appelle les quatre consuls d’Alerandrie ? Les Proconsuls.
J’ai reçu une longue lettre de lord Grey. Il me prie de faire obtenir à Lady Durham, qui va passer l’hiver à Pau avec ses enfants, l’autorisation d’introduire, en France sa vaisselle. Vous savez que ce n’est pas facile. Il faut pourtant que j’y réussisse. Dites à Thiers, la première fois que vous le verrez, d’en dire un mot au Ministre des finances, de lui dire qu’il le faut.
Politiquement, voici tout Lord Gey. I rend in the papers, my only sources of information, with great anxiety and concern, the continued account ot the dangers, which threaten, the good understanding between this country and France. I cannot bring myself to believe that a rupture can ultimately take place between live countries which have mutually so strong an interest in preserving the relations of peace and amity. But I can not also be without great fears that à state of things may be produced in which some accident or mischance may decide a question which some wisdom and moderation would settle amicably. I feel confident that your feelings are not different from those which I have expressed, and if any thing could induce me again to talk part in public affairs, it would be the hope of being able to assist, in preventing dangers which are much greater than the value of all Syria, past, présent and to come.
Je ne sais pourquoi je vous copie tout cela, qui me prend mon papier et qu’il vous a peut-être écrit aussi. C’est pour la dernière phrase. Et surtout pour vous parler de tout.
3 heures
J’attends bien impatiemment que vous ne soyez plus si fatiguée, si faible. Il me semble que la vie que vous menez doit finir par vous reposer. Je n’en imagine pas de plus tranquille. Continuez à vous coucher de bonne heure. Le bavardage menteur et hostile de Mad. de Flahaut ne métonne pas du tout. Il me devient bien des bavardages. J’écoute tout et ne me préoccupe pas de grand chose. Je me sens très fort, fort comme l’Angleterre avec sa ceinture d’océan comme sera Paris quand son enceinte continue sera faite. Je crois fermement, après y avoir bien regardé, que, depuis mon arrivée à Londres, j’ai bien jugé et bien agi. Rien ne me manque en fait de preuves. Je me tiens et me tiendrai fort tranquille si jamais j’étais attaqué, ouvertement ou sourdement, je me défendrais bien. Et très sérieusement, car ces affaires-ci sont sérieuses. Adieu. Extrêmement comme vous dîtes. J’aime cet adieu-là.
422. Paris, Dimanche 13 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
422. Paris, dimanche 6 heures 13 septembre 1840
Je me suis sentie indisposée ce matin, j’ai fait venir Chermside, il croit que j’ai pris froid. Le temps a subitement passé au froid. J’ai vu Bulwer longtemps les Appony, mon ambassadeur j’ai renvoyé Flahaut, sa femme et d’autres.
Les ambassadeurs se sont disputés chez moi. L’Autrichien soutenant que sa cour lui mande qu’en cas de marche d’Ibrahim, les Russes n’occuperaient pas Constantinople. et le Russe soutenant que nous l’occuperions. Ce discrepancy m’a un peu étonné. Le 29 actuel a vu hier au soir Z et et a obtenu l’assurance positive qu’il ne méditait point de coup de théâtre au loin. Cette idée avait été fort accréditée hier. On dit que l’Angleterre devrait bien souffler au Turc à Londres une proposition d’accommodement avec la France, c’est-à-dire que le Turc offre bénévolement de meilleures conditions au Pacha plutôt que de voir de la désunion entre des puissances qu’elle (la Turquie) regarde comme également bienveillante pour elle, et dont la rupture pourrait avoir des résultats fâcheux pour son existence. Croyez-vous qu’on inspire cela ? Ou qu’on l’ordonne, car on peut ordonner. Ce serait a loop hole.
Les nouvelles d’Espagne sont bien critiquées. Il faudra que la Reine s’humilie ou s’enfuie. Que ferez-vous dans cette affaire ? Un gouvernent qui ne serait pas soutenu par la gauche irait peut-être au secours de la Reine. Mais il est difficile que vous le fassiez. Il y a des gens qui croient que vous le ferez quand même, pour faire aujourd’hui quelque chose. Cela me semble impossible.
Lundi 14. 9 heures
Mon ambassadeur est revenu hier au soir avant de se rendre à deux routs (Appony et Flahaut) il m’a répété qu’il n’a pas eu un mot de Petersbourg, pas un mot depuis le mois de juin. Il en est fort content. Les lettres particulières de là disent qu’on n’y croit pas à la guerre, que personne n’y songe. Lui, Pahlen, la croit très possible , et même très difficile à éviter. Il me demande ce que je ferai ? Je le demande aussi que devenir ? Ah mon Dieu ! J’ai assez bien dormi. Mad. de Talleyrand est à Rochecotte. Elle m’a attendu quelques jours à Paris, à ce qu’elle prétend elle m’engage à aller chez elle ce que je ne ferai pas.
Mad. Appony est moins éprise de sa belle-fille que ne l’est son mari. Elle la trouve bien frivole, et rien que frivole ; toute la journée se passe en toilettes. Elle tremble pour l’avenir lorsque le beau trousseau sera fané ! Lui Appony n’est pas si inquiet ; il est charmé d’une jolie femme dans se maison et me parait tout aussi amoureux que son fils. Midi. J’ai revu le gros Monsieur et quelque chose de mieux que lui. Merci, merci. Demain mardi sera un mauvais jour, je voudrais qu’il fût passé ! Ah je voudrais qu’ils fussent tous passés, tous les jours de séparation ! J’ai écrit à Thiers le lendemain de mon arrivé ; il n’est pas venu, et ne m’a pas répondu. je continue à me coucher à 9 1/2, j’ai bien besoin de repos.
Adieu, adieu. Je ne prévois pas que j’apprenne rien de nouveau d’ici au moment de la poste. Adieu.
Je me suis sentie indisposée ce matin, j’ai fait venir Chermside, il croit que j’ai pris froid. Le temps a subitement passé au froid. J’ai vu Bulwer longtemps les Appony, mon ambassadeur j’ai renvoyé Flahaut, sa femme et d’autres.
Les ambassadeurs se sont disputés chez moi. L’Autrichien soutenant que sa cour lui mande qu’en cas de marche d’Ibrahim, les Russes n’occuperaient pas Constantinople. et le Russe soutenant que nous l’occuperions. Ce discrepancy m’a un peu étonné. Le 29 actuel a vu hier au soir Z et et a obtenu l’assurance positive qu’il ne méditait point de coup de théâtre au loin. Cette idée avait été fort accréditée hier. On dit que l’Angleterre devrait bien souffler au Turc à Londres une proposition d’accommodement avec la France, c’est-à-dire que le Turc offre bénévolement de meilleures conditions au Pacha plutôt que de voir de la désunion entre des puissances qu’elle (la Turquie) regarde comme également bienveillante pour elle, et dont la rupture pourrait avoir des résultats fâcheux pour son existence. Croyez-vous qu’on inspire cela ? Ou qu’on l’ordonne, car on peut ordonner. Ce serait a loop hole.
Les nouvelles d’Espagne sont bien critiquées. Il faudra que la Reine s’humilie ou s’enfuie. Que ferez-vous dans cette affaire ? Un gouvernent qui ne serait pas soutenu par la gauche irait peut-être au secours de la Reine. Mais il est difficile que vous le fassiez. Il y a des gens qui croient que vous le ferez quand même, pour faire aujourd’hui quelque chose. Cela me semble impossible.
Lundi 14. 9 heures
Mon ambassadeur est revenu hier au soir avant de se rendre à deux routs (Appony et Flahaut) il m’a répété qu’il n’a pas eu un mot de Petersbourg, pas un mot depuis le mois de juin. Il en est fort content. Les lettres particulières de là disent qu’on n’y croit pas à la guerre, que personne n’y songe. Lui, Pahlen, la croit très possible , et même très difficile à éviter. Il me demande ce que je ferai ? Je le demande aussi que devenir ? Ah mon Dieu ! J’ai assez bien dormi. Mad. de Talleyrand est à Rochecotte. Elle m’a attendu quelques jours à Paris, à ce qu’elle prétend elle m’engage à aller chez elle ce que je ne ferai pas.
Mad. Appony est moins éprise de sa belle-fille que ne l’est son mari. Elle la trouve bien frivole, et rien que frivole ; toute la journée se passe en toilettes. Elle tremble pour l’avenir lorsque le beau trousseau sera fané ! Lui Appony n’est pas si inquiet ; il est charmé d’une jolie femme dans se maison et me parait tout aussi amoureux que son fils. Midi. J’ai revu le gros Monsieur et quelque chose de mieux que lui. Merci, merci. Demain mardi sera un mauvais jour, je voudrais qu’il fût passé ! Ah je voudrais qu’ils fussent tous passés, tous les jours de séparation ! J’ai écrit à Thiers le lendemain de mon arrivé ; il n’est pas venu, et ne m’a pas répondu. je continue à me coucher à 9 1/2, j’ai bien besoin de repos.
Adieu, adieu. Je ne prévois pas que j’apprenne rien de nouveau d’ici au moment de la poste. Adieu.
411. Londres, Dimanche 13 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
411. Londres, Dimanche 13 Septembre 1840
4 heures et demie
Oui, Paris, vous plaira davantage. Paris vous plaira tout-à-fait, tout-à-fait, n’est-ce pas ? Puisque vous n’êtes plus où je suis, j’aime à vous savoir à Paris. Vous me direz, dans quelques jours comment vous y aurez réglé votre vie. Très probablement comme nous nous le sommes dit à Stafford. house. C’est égal ; vous me le redirez. J’aime bien les redites. Je reviens de Kenwoood, (est-ce Kenwood ou Caen-Wood, comme le dit mon Guide?) la villa de lord Mansfield. Le parc est bien beau, les alentours bien beaux. J’aurais voulu être seul. J’avais Bourqueney, Vandeul et Herbet. Ils disent qu’il faut que je me promène. Je n’avais pas encore été à Hamstead. Point de souvenirs donc là. Je crois que j’aime mieux les lieux où j’en ai. Je retournerai à West-hill Je ne sais pas pourquoi je dis : " Je crois que j’aime mieux ", j’en suis parfaitement sûr. Je n’ai trouvé Kenwood que beau. Si nous y avions été ensemble, je l’aurais trouvé charmant. Ensemble une seule fois.
Un homme de Holland house, m’a poursuivi à Kenwood pour m’apporter un billet de Lord Holland qui en revenu ce matin de Windrow et me prie d’aller diner aujourd’hui avec lui. J’irai. Ils partent toujours demain pour Brighton. Lady Holland dit qu’elle veut prendre là les eaux de Marienbad, contre la bile. Les Allemands se moquent d’elle. Ils disent qu’on ne prend pas, les eaux de Marienbad avec si peu de façons. Lord Palmerston m’a écrit de Broadlands qu’il revenait demain. Lady Palmerston avec lui, pour quatre ou cinq jours. Ils retourneront à Broadlands.
J’ai écrit décidément à Glasgow et à Edimbourg que je n’irais pas. Il n’y a pas moyen. Je ne puis courir le risque qu’une dépêche m’arrive 48 heures trop tard. On se préparait à me recevoir très bien à Glasgow, bruyamment peut-être. Raison de plus. La parole publique ne me serait pas commode en ce moment. Pour bien parler, il faudrait dire trop. Lundi 14, sept heures et demie Rien que Lord Clarendon et moi à Holland-house. Nous avons l’air de gens qui essayent de se consoler entre eux. Lord Holland plus vif que jamais et Lady Holland encore plus. J’y dine encore aujourd’hui. Ils ne partent pour Brighton que demain.
Rien de nouveau de Windsor, sinon que lord Melbourne dit à tout propos D... et Dev... ce qui fait beaucoup rire la Reine qui n’avait jamais entendu jurer avant lui. Il lui apprendra à jurer et à ne pas se soucier. Drôle d’éducation royale ! Du reste il (lord Melbourne) en souffrant, assez souffrant. Il dit qu’il ne peut ni manger ni dormir. Il rêve à la Syrie. Il y a de quoi. Après Napier, les quatre consuls. On est ici, surtout parmi les Diplomates continentaux, fort troublé de cette pièce qui amène les armées Européennes en Asie et promet la guerre universelle, la guerre à ontrance. Les uns la blâment, les autres la désavouent, les plus hardis, la nient. Neumann est presque de ceux-ci. Il n’a pas attendu que je lui en parlasse pour protester contre avec colère. Quand j’ai parlé des incidents et des subalternes, j’ai eu trop raison. La politique n’a pas tenu grand place hier soir dans notre quatuor. Lord Holland, était tout littéraire et Lady Holland toute mélancolique. Lord Holland m’a montré de ses vers, une longue pièce de vers ; devinez sur quoi sur le dictionnaire de Bayle :
In health or in sickness, as freedom or in jail
Give me one book, but let that book be Bayle.
Je ne suis pas sûr que ma mémoire soit parfaitement correcte ; mais voilà le trait. Bayle ne s’est jamais douté qu’il ferait une telle passion. Pour lady Holland, elle déplorait sa solitude, les longues heures de solitude de ses journées. Elle ne lit tant que parce qu’elle est tant seule ! Nous nous sommes récriés. Personne n’est moins seul qu’elle. Elle a persisté ; elle a parlé de l’isolement de la vieillesse de tous les amis qu’elle avait perdus : " Quand je me sens trop seule, quand la tristesse me gagne, je viens dans cette bibliothèque ; j’y rappelle tous ceux que j’y ai vus ; je remets Romilly sur cette chaise, Mackintosh ici, Horner là, tous mes amis, de bien aimables amis. " Elle était vraiment émue, et presque éloquente, with very few words. Je vous répète que c’est la femme de ce pays-ci qui a le plus d’esprit. Elle m’a répété les déclarations les plus tendres, et demandé de vos nouvelles. Lord Clarendon ne voulait pas croire que vous eussiez été malade. Elle a soutenu que vous l’aviez été, bien réellement.
3 heures
Voilà enfin une vraie lettre. Ne croyez pas que je me plaigne des autres. Votre exactitude, en courant la poste m’a été au cœur. A quelle heure, la plus matinale, peut-on venir chez vous vous remettre une lettre? J’ai en vue, un messager de plus, très bon, très prompt, mais disponible seulement avant 10 heures ou après 4. Peut-il aller avant 10 ? Quant à nos intermédiaires ici, réglez leurs jours, deux jours par semaine pour chacun, pour que je ne sois pas obligé d’envoyer chaque jour partout. Envoyez-moi votre règlement ; tels jours pour le n°1, tels pour le n° 2 && Je sais l’ordre des N°. A demain la conversation. Je retourne aujourd’hui dîner à Holland house. Ils ne partent que demain pour Brighton. Lord Palmerston m’écrit qu’il ne viendra à Londres que demain. Adieu. Adieu. Mille et un.
4 heures et demie
Oui, Paris, vous plaira davantage. Paris vous plaira tout-à-fait, tout-à-fait, n’est-ce pas ? Puisque vous n’êtes plus où je suis, j’aime à vous savoir à Paris. Vous me direz, dans quelques jours comment vous y aurez réglé votre vie. Très probablement comme nous nous le sommes dit à Stafford. house. C’est égal ; vous me le redirez. J’aime bien les redites. Je reviens de Kenwoood, (est-ce Kenwood ou Caen-Wood, comme le dit mon Guide?) la villa de lord Mansfield. Le parc est bien beau, les alentours bien beaux. J’aurais voulu être seul. J’avais Bourqueney, Vandeul et Herbet. Ils disent qu’il faut que je me promène. Je n’avais pas encore été à Hamstead. Point de souvenirs donc là. Je crois que j’aime mieux les lieux où j’en ai. Je retournerai à West-hill Je ne sais pas pourquoi je dis : " Je crois que j’aime mieux ", j’en suis parfaitement sûr. Je n’ai trouvé Kenwood que beau. Si nous y avions été ensemble, je l’aurais trouvé charmant. Ensemble une seule fois.
Un homme de Holland house, m’a poursuivi à Kenwood pour m’apporter un billet de Lord Holland qui en revenu ce matin de Windrow et me prie d’aller diner aujourd’hui avec lui. J’irai. Ils partent toujours demain pour Brighton. Lady Holland dit qu’elle veut prendre là les eaux de Marienbad, contre la bile. Les Allemands se moquent d’elle. Ils disent qu’on ne prend pas, les eaux de Marienbad avec si peu de façons. Lord Palmerston m’a écrit de Broadlands qu’il revenait demain. Lady Palmerston avec lui, pour quatre ou cinq jours. Ils retourneront à Broadlands.
J’ai écrit décidément à Glasgow et à Edimbourg que je n’irais pas. Il n’y a pas moyen. Je ne puis courir le risque qu’une dépêche m’arrive 48 heures trop tard. On se préparait à me recevoir très bien à Glasgow, bruyamment peut-être. Raison de plus. La parole publique ne me serait pas commode en ce moment. Pour bien parler, il faudrait dire trop. Lundi 14, sept heures et demie Rien que Lord Clarendon et moi à Holland-house. Nous avons l’air de gens qui essayent de se consoler entre eux. Lord Holland plus vif que jamais et Lady Holland encore plus. J’y dine encore aujourd’hui. Ils ne partent pour Brighton que demain.
Rien de nouveau de Windsor, sinon que lord Melbourne dit à tout propos D... et Dev... ce qui fait beaucoup rire la Reine qui n’avait jamais entendu jurer avant lui. Il lui apprendra à jurer et à ne pas se soucier. Drôle d’éducation royale ! Du reste il (lord Melbourne) en souffrant, assez souffrant. Il dit qu’il ne peut ni manger ni dormir. Il rêve à la Syrie. Il y a de quoi. Après Napier, les quatre consuls. On est ici, surtout parmi les Diplomates continentaux, fort troublé de cette pièce qui amène les armées Européennes en Asie et promet la guerre universelle, la guerre à ontrance. Les uns la blâment, les autres la désavouent, les plus hardis, la nient. Neumann est presque de ceux-ci. Il n’a pas attendu que je lui en parlasse pour protester contre avec colère. Quand j’ai parlé des incidents et des subalternes, j’ai eu trop raison. La politique n’a pas tenu grand place hier soir dans notre quatuor. Lord Holland, était tout littéraire et Lady Holland toute mélancolique. Lord Holland m’a montré de ses vers, une longue pièce de vers ; devinez sur quoi sur le dictionnaire de Bayle :
In health or in sickness, as freedom or in jail
Give me one book, but let that book be Bayle.
Je ne suis pas sûr que ma mémoire soit parfaitement correcte ; mais voilà le trait. Bayle ne s’est jamais douté qu’il ferait une telle passion. Pour lady Holland, elle déplorait sa solitude, les longues heures de solitude de ses journées. Elle ne lit tant que parce qu’elle est tant seule ! Nous nous sommes récriés. Personne n’est moins seul qu’elle. Elle a persisté ; elle a parlé de l’isolement de la vieillesse de tous les amis qu’elle avait perdus : " Quand je me sens trop seule, quand la tristesse me gagne, je viens dans cette bibliothèque ; j’y rappelle tous ceux que j’y ai vus ; je remets Romilly sur cette chaise, Mackintosh ici, Horner là, tous mes amis, de bien aimables amis. " Elle était vraiment émue, et presque éloquente, with very few words. Je vous répète que c’est la femme de ce pays-ci qui a le plus d’esprit. Elle m’a répété les déclarations les plus tendres, et demandé de vos nouvelles. Lord Clarendon ne voulait pas croire que vous eussiez été malade. Elle a soutenu que vous l’aviez été, bien réellement.
3 heures
Voilà enfin une vraie lettre. Ne croyez pas que je me plaigne des autres. Votre exactitude, en courant la poste m’a été au cœur. A quelle heure, la plus matinale, peut-on venir chez vous vous remettre une lettre? J’ai en vue, un messager de plus, très bon, très prompt, mais disponible seulement avant 10 heures ou après 4. Peut-il aller avant 10 ? Quant à nos intermédiaires ici, réglez leurs jours, deux jours par semaine pour chacun, pour que je ne sois pas obligé d’envoyer chaque jour partout. Envoyez-moi votre règlement ; tels jours pour le n°1, tels pour le n° 2 && Je sais l’ordre des N°. A demain la conversation. Je retourne aujourd’hui dîner à Holland house. Ils ne partent que demain pour Brighton. Lord Palmerston m’écrit qu’il ne viendra à Londres que demain. Adieu. Adieu. Mille et un.
421. Paris, Dimanche 13 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
421. Paris, Dimanche 15 septembre 1840
9 heures
Voici trois dimanches bien différents entre eux. Dimanche 30 août, dimanche 6 où je vous voyais pour la dernière fois, et celui-ci que je passe si loin, si loin de vous mais il me semble que je suis chez nous. Et cette pensée est si douce, venez la compléter.
J’ai vu hier matin Bulwer, Montrond, mon ambassadeur. Le premier bien agité, bien inquiet. Il y avait quelque chose ; il venait me le dire, l’arrivée de Montrond nous a dérangés. Montrond inquiet aussi croyant à la guerre, me faisant des questions sur vous, surtout les détails de votre attitude, vos allures, votre maison. J’ai pleinement satisfait à toutes ces questions. Je l’ai trouvé ni bien, ni mal, disant seulement que Flahaut disait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Le roi belliqueux, mais croyait à le paix. Au total pas grand chose. Mon ambassadeur inquiet aussi, la journée semblait mauvaise. Il y avait quelque chose de menaçant dans l’air. Je lui ai conté hier M. de Brünnow, il est parfaitement indiqué et parfaitement sûr que l’Empereur n’y est pour rien, mais il ne devine pas et ne comprend surtout par la bêtise. Je lui ai conté M. de Nesselrode aussi, cela le confond, mais il n’a pas pour lui une grande estime. Il me dit que j’ai très bien fait mais que je les mettrai dans un grand embarras. C’est leur affaire de s’en tirer. M. de Pahlen dit un peu autrement qu’Appony. Il est convaincu qui si Ibrahim passe le Taurus nous irons à Constantinople. Au reste, il n’a pas eu un seul courrier depuis mon départ pour l’Angleterre pas un. Il n’a pas eu un mot même par la poste depuis ce traité, c’est-à-dire qu’on ne lui dit pas un mot du traité. C’est drôle ! L’Empereur sera de retour à Pétersbourg cette semaine.
J’ai fait ma promenade avec Mad. de Flahaut. Je suis avec elle comme avec lady Palmerston bien, et pas comme avant. Elle a recommencé des explications sur la lettre. Je lui ai dit que je n’y pensais plus, elle voulait dire, et elle a dit pendant une demi-heure, trente mille même mensonges je les ai écoutés probablement comme on écoute des mensonges car elle m’a dit : " Je vois que vous ne croyez pas un mot de ce que je vous dis." J’ai souri, et je l’ai assurée que sa réponse écrite m’avait parfaitement suffi. Et voilà qui est fini. Elle a bavardé, bavardé sur les affaires, bien dans le sens raisonnable. Après. cela elle a dit qu’il y avait une question curieuse à éclaircir, que le ministère disait que vous n’aviez pas su un mot du traité et ne lui en avez rien mandé jusqu’après sa conclusion ; que vos amis, c’est-à-dire une petite partie de vos anciens amis disaient que vous avez toujours éte d’opinion qu’il se conclurait que vous en aviez averti et souvent. et elle m’a interrogée. J’ai répondu froidement, que Londres on disait et croyait que vous le saviez et que vous l’aviez dit. Flahaut que je n’ai pas vu part demain pour Londres ou autre part afin de n’être pas ici pendant le procès.
J’ai dîné seule, ou plutôt pas dîné. Après, j’ai été en calèche encore, à droite, à gauche, passer mon temps. J’ai manqué Fagel ce que je regrette. Je me suis couchée à 9 1/2.
Voici votre lettre. Comment êtes-vous resté un jour sans rien de moi ! Vous aurez vu au moins qu’il n’y avait pas de ma faute. Il y a deux pages charmantes dans votre lettre, il y a dans chaque lettre des pensées si douces, si tendres. Ah que j’y réponde doucement, tendrement !
Midi. J’ai fait un tour de promenade au jardin à pied je suis lasse, le plus petit exertion me fatigue. Je ne me plains plus que de cela ; très fatiguée, très faible, très maigre. Il faut que je me relève de ces calamités. Adieu. Adieu extrêmement.
9 heures
Voici trois dimanches bien différents entre eux. Dimanche 30 août, dimanche 6 où je vous voyais pour la dernière fois, et celui-ci que je passe si loin, si loin de vous mais il me semble que je suis chez nous. Et cette pensée est si douce, venez la compléter.
J’ai vu hier matin Bulwer, Montrond, mon ambassadeur. Le premier bien agité, bien inquiet. Il y avait quelque chose ; il venait me le dire, l’arrivée de Montrond nous a dérangés. Montrond inquiet aussi croyant à la guerre, me faisant des questions sur vous, surtout les détails de votre attitude, vos allures, votre maison. J’ai pleinement satisfait à toutes ces questions. Je l’ai trouvé ni bien, ni mal, disant seulement que Flahaut disait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Le roi belliqueux, mais croyait à le paix. Au total pas grand chose. Mon ambassadeur inquiet aussi, la journée semblait mauvaise. Il y avait quelque chose de menaçant dans l’air. Je lui ai conté hier M. de Brünnow, il est parfaitement indiqué et parfaitement sûr que l’Empereur n’y est pour rien, mais il ne devine pas et ne comprend surtout par la bêtise. Je lui ai conté M. de Nesselrode aussi, cela le confond, mais il n’a pas pour lui une grande estime. Il me dit que j’ai très bien fait mais que je les mettrai dans un grand embarras. C’est leur affaire de s’en tirer. M. de Pahlen dit un peu autrement qu’Appony. Il est convaincu qui si Ibrahim passe le Taurus nous irons à Constantinople. Au reste, il n’a pas eu un seul courrier depuis mon départ pour l’Angleterre pas un. Il n’a pas eu un mot même par la poste depuis ce traité, c’est-à-dire qu’on ne lui dit pas un mot du traité. C’est drôle ! L’Empereur sera de retour à Pétersbourg cette semaine.
J’ai fait ma promenade avec Mad. de Flahaut. Je suis avec elle comme avec lady Palmerston bien, et pas comme avant. Elle a recommencé des explications sur la lettre. Je lui ai dit que je n’y pensais plus, elle voulait dire, et elle a dit pendant une demi-heure, trente mille même mensonges je les ai écoutés probablement comme on écoute des mensonges car elle m’a dit : " Je vois que vous ne croyez pas un mot de ce que je vous dis." J’ai souri, et je l’ai assurée que sa réponse écrite m’avait parfaitement suffi. Et voilà qui est fini. Elle a bavardé, bavardé sur les affaires, bien dans le sens raisonnable. Après. cela elle a dit qu’il y avait une question curieuse à éclaircir, que le ministère disait que vous n’aviez pas su un mot du traité et ne lui en avez rien mandé jusqu’après sa conclusion ; que vos amis, c’est-à-dire une petite partie de vos anciens amis disaient que vous avez toujours éte d’opinion qu’il se conclurait que vous en aviez averti et souvent. et elle m’a interrogée. J’ai répondu froidement, que Londres on disait et croyait que vous le saviez et que vous l’aviez dit. Flahaut que je n’ai pas vu part demain pour Londres ou autre part afin de n’être pas ici pendant le procès.
J’ai dîné seule, ou plutôt pas dîné. Après, j’ai été en calèche encore, à droite, à gauche, passer mon temps. J’ai manqué Fagel ce que je regrette. Je me suis couchée à 9 1/2.
Voici votre lettre. Comment êtes-vous resté un jour sans rien de moi ! Vous aurez vu au moins qu’il n’y avait pas de ma faute. Il y a deux pages charmantes dans votre lettre, il y a dans chaque lettre des pensées si douces, si tendres. Ah que j’y réponde doucement, tendrement !
Midi. J’ai fait un tour de promenade au jardin à pied je suis lasse, le plus petit exertion me fatigue. Je ne me plains plus que de cela ; très fatiguée, très faible, très maigre. Il faut que je me relève de ces calamités. Adieu. Adieu extrêmement.
410. Londres, Samedi 12 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
410. Londres, Samedi 12 septembre 1840
10 heures
Voilà deux lettres, Poix et Beauvais. Que j’ai le cœur léger ! Je l’avais bien gros en m’éveillant. Je n’ai pas voulu écrire. Vous êtes fatiguée. Mais vous avez faim et la France vous plaît. J’aime que la France vous plaise ; et je ne suis pas jaloux de la France. Ni de l’Angleterre non plus. L’Angleterre a été charmante. Tout est charmant ce matin. Dieu m’a donné son pouvoir ; je fais le monde à mon image, sombre ou brillant, triste ou gai selon l’état de mon cœur. Demain, j’aurai de vos nouvelles de Paris. Et tous les jours. Et de longues lettres. Demain, je ne vous écrirai pas à mon grand regret. Je suis forcé d’envoyer un courrier aujourd’hui. Il fait beau. J’espère que vous serez entrée à Paris sous un beau soleil, que les fontaines sont pleines d’eau, les Tuileries encore vertes, que vous aurez regardé avec plaisir par votre fenêtre. Regardez. Est-ce que je n’arrive pas ? Ah, j’y suis toujours, sauf le bonheur.
Je parle beaucoup de Napier moi. J’en parle à tout le monde. Quelques uns me répondent comme je parle. Les autres, essayent de ne pas me répondre du tout.Les plus hardis sont embarrassés. Je n’ai pas encore pu joindre lord Palmerston. Toujours à Broadlands pendant qu’on traduit et copie les ratifications turques. Ni Lady Clanricard qui est à la campagne aussi, on n’a pas su me dire où. Elle revient Lundi. Les Palmerstoniens attendent avec passion les insurgés de Syrie, un pauvre petit insurgé ; on n’en demande pas beaucoup. Ils tardent bien. J’ai peur que tôt ou tard, il n’en vienne assez pour faire égorger ceux qui ne seront pas venus. Quels jouets que les hommes ! Il y a là, au fond de je ne sais quelle vallée au sommet de je ne sais quelle montagne du Liban, des maris, des femmes, des enfants qui s’aiment, qui s’amusent, et qui seront massacrés demain parce que Lord Palmerston en roulant, sur le railway de Londres à Southampton, se sera dit : " Il faut que la Syrie, s’insurge; j’ai besoin de l’insurrection de Syrie ; si la série ne s’insurge pas, I’m fool ! "
3 heures
Il me tombe aujourd’hui je ne sais combien de petites affaires, de l’argent à envoyer à Paris pour le railway de Rouen, des quittances à donner, le bail de ma maison, Earthope, Charles Greville. On m’a pris tout mon temps, depuis le déjeuner. Je me loue beaucoup de Charles Greville. C’est dommage qu’il soit si sourd. Il arrive de Windsor où le Conseil privé s’est tenu hier. Il part demain matin pour Doncaster. Moi, j’écris ce matin à Glasgow et à Edimbourg que je nirai pas. Il faut qu’absolument que je sois à Londres pour recevoir l’insur rection de Syrie, si elle arrive. Voilà des grouses d’Ellice. J’aimais mieux les premières. dit-on, les premiers ou les premières ? Je le demanderai à lord Holland qui est mon dictionnaire anglais. Je reçois un billet de ce pauvre comte de Björmtjerna qui devait venir dîner aujourd’hui avec moi. Il est depuis hier matin dans une taverne, à côté de Customs house, attendant le bateau de Hambourg qui porte sa femme et ses enfants, et qui n’arrive pas. Il y a eu une violente tempête mercredi et jeudi. J’ai grande pitié de lui. J’ai eu hier ma première soirée. Dedel, Vans de Weyer, Hummelauer, Moncorvo, Alava Schleinitz, des secrétaires. Ils ont joué au Whist, à l’écarté, aux échecs. Les sandwich excellentes. Je les leur voyais manger avec humeur. Longchamps, Longchamps ! Pas de nouvelles. Neumann était à Broadlands. Il en revient aujourd’hui pour dîner chez moi. Quoiqu’il n’y ait personne ici, il y a des commérages. On dit que j’ai dit que si nous faisions la guerre, ce ne serait pas sur le Rhin, mais sur le Pô que nous la ferions. L’Autriche s’en est émue. Je dis que je ne l’ai pas dit, mais que je n’entends pas dire que nous ne ferions pas la guerre sur le Pô, si nous la faisions.
Adieu. Vous partez pour le bois de Boulogne. Adieu là comme partout, Adieu.
10 heures
Voilà deux lettres, Poix et Beauvais. Que j’ai le cœur léger ! Je l’avais bien gros en m’éveillant. Je n’ai pas voulu écrire. Vous êtes fatiguée. Mais vous avez faim et la France vous plaît. J’aime que la France vous plaise ; et je ne suis pas jaloux de la France. Ni de l’Angleterre non plus. L’Angleterre a été charmante. Tout est charmant ce matin. Dieu m’a donné son pouvoir ; je fais le monde à mon image, sombre ou brillant, triste ou gai selon l’état de mon cœur. Demain, j’aurai de vos nouvelles de Paris. Et tous les jours. Et de longues lettres. Demain, je ne vous écrirai pas à mon grand regret. Je suis forcé d’envoyer un courrier aujourd’hui. Il fait beau. J’espère que vous serez entrée à Paris sous un beau soleil, que les fontaines sont pleines d’eau, les Tuileries encore vertes, que vous aurez regardé avec plaisir par votre fenêtre. Regardez. Est-ce que je n’arrive pas ? Ah, j’y suis toujours, sauf le bonheur.
Je parle beaucoup de Napier moi. J’en parle à tout le monde. Quelques uns me répondent comme je parle. Les autres, essayent de ne pas me répondre du tout.Les plus hardis sont embarrassés. Je n’ai pas encore pu joindre lord Palmerston. Toujours à Broadlands pendant qu’on traduit et copie les ratifications turques. Ni Lady Clanricard qui est à la campagne aussi, on n’a pas su me dire où. Elle revient Lundi. Les Palmerstoniens attendent avec passion les insurgés de Syrie, un pauvre petit insurgé ; on n’en demande pas beaucoup. Ils tardent bien. J’ai peur que tôt ou tard, il n’en vienne assez pour faire égorger ceux qui ne seront pas venus. Quels jouets que les hommes ! Il y a là, au fond de je ne sais quelle vallée au sommet de je ne sais quelle montagne du Liban, des maris, des femmes, des enfants qui s’aiment, qui s’amusent, et qui seront massacrés demain parce que Lord Palmerston en roulant, sur le railway de Londres à Southampton, se sera dit : " Il faut que la Syrie, s’insurge; j’ai besoin de l’insurrection de Syrie ; si la série ne s’insurge pas, I’m fool ! "
3 heures
Il me tombe aujourd’hui je ne sais combien de petites affaires, de l’argent à envoyer à Paris pour le railway de Rouen, des quittances à donner, le bail de ma maison, Earthope, Charles Greville. On m’a pris tout mon temps, depuis le déjeuner. Je me loue beaucoup de Charles Greville. C’est dommage qu’il soit si sourd. Il arrive de Windsor où le Conseil privé s’est tenu hier. Il part demain matin pour Doncaster. Moi, j’écris ce matin à Glasgow et à Edimbourg que je nirai pas. Il faut qu’absolument que je sois à Londres pour recevoir l’insur rection de Syrie, si elle arrive. Voilà des grouses d’Ellice. J’aimais mieux les premières. dit-on, les premiers ou les premières ? Je le demanderai à lord Holland qui est mon dictionnaire anglais. Je reçois un billet de ce pauvre comte de Björmtjerna qui devait venir dîner aujourd’hui avec moi. Il est depuis hier matin dans une taverne, à côté de Customs house, attendant le bateau de Hambourg qui porte sa femme et ses enfants, et qui n’arrive pas. Il y a eu une violente tempête mercredi et jeudi. J’ai grande pitié de lui. J’ai eu hier ma première soirée. Dedel, Vans de Weyer, Hummelauer, Moncorvo, Alava Schleinitz, des secrétaires. Ils ont joué au Whist, à l’écarté, aux échecs. Les sandwich excellentes. Je les leur voyais manger avec humeur. Longchamps, Longchamps ! Pas de nouvelles. Neumann était à Broadlands. Il en revient aujourd’hui pour dîner chez moi. Quoiqu’il n’y ait personne ici, il y a des commérages. On dit que j’ai dit que si nous faisions la guerre, ce ne serait pas sur le Rhin, mais sur le Pô que nous la ferions. L’Autriche s’en est émue. Je dis que je ne l’ai pas dit, mais que je n’entends pas dire que nous ne ferions pas la guerre sur le Pô, si nous la faisions.
Adieu. Vous partez pour le bois de Boulogne. Adieu là comme partout, Adieu.
Paris, le 12 septembre 1840, Général Baudrand à François Guizot
Auteur : Baudrand, Marie-Etienne-François-Henri (1774-1848)
Le général Baudrant m'a remis hier cette lettre dont m'a donné lecture 14 7bre.
420. Paris, Samedi 12 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
420. Paris samedi 12 Septembre 1840 à 8 heures.
Vous me voyez temps de bonne heure, c’est que je suis dans mon lit à 9 heures du soir j’ai assez bien dormi. J’ai vu hier matin mon ambassadeur, Appony, Bulwer et de 8 à 9 le soir votre petit homme. Je me suis fait traîner au bois de Boulogne de 4 à 6. Mad. de Flahaut est venu trois fois, j’avais fermé ma porte. Enfin elle m’a écrit pour me presser d’aller dîner chez elle. J’ai décliné et je lui ai promis d’aller me promener avec elle ce matin. Je verrai ma nièce aussi ce matin.
On ne parle plus d’émeutes du tout Dieu merci. Paris est joli, animé, quelle différence de Londres !
Je trouve ici dans le monde que je vois moins de crainte de la guerre que je ne croyais. Ils la croient possible, tout au plus probable non ; ils croient encore qu’à la dernière heure le Pacha cédera, en se mettant sous la protection de la France et que la France qui promettra ses bons offices obtiendra facilement des alliés St Jean d’Acre qui doit satisfaire le Pacha, et satisfaire la France, car ce serait une concession attendu que par son premier refus le Pacha a perdu ses droits à St Jean d’Acre. Si la guerre éclate, ils n’ont pas la moindre idée que ce puisse être autre chose qu’une guerre maritime. Et voilà pourquoi l’Angleterre y est si indifférents. Elle peut parler légèrement de la guerre, elle y gagne. Ses flottes battront et prendront, et ensuite une guerre continentale ne lui fait aucun mal. Il n’en est pas de même des autres puissances. Non, elles ne veulent pas la guerre. Elles ne comprennent pas pourquoi et comment elle se ferait, car elles ne feront rien pour cela de leur côté. Elles ne rencontreront la France nulle part ? La France regarde comme cas de guerre, l’entrée des Russes en Syrie ou à Constantinople mais ils n’y iront pas. Si Ibrahim franchit le Taurus, les flottes anglaises, russes, autrichiennes entreront dans la rue de mer de Marmara pour couvrir Constantinople. Cela ne constitue pas un cas de guerre ? Pahlen m’assure qu’il faudrait que l’Empereur fut bien changé depuis 6 mois pour en avoir envie. Il n’en veut pas. En recherchant les causes de tout ce mauvais imbroglio on trouve d’abord, une disposition hargneuse à Londres. Ensuite des illusions là comme ici. Là, ignorance volontaire ou réelle de la disposition de la France. Ici, incrédulité sur le vouloir ou le pouvoir de lord Palmerston. Après cela on dit aussi que la France a voulu jouer au plus fin. Qu’elle voulait et croyait escamoter l’arrangement en le faisant conclure d’une manière cachée et abrupte entre les deux parties. Que c’est de Pétersboug qu’on a donné l’éveil à Londres. Que cela y est revenu par d’autres voies ensuite. Que cela a excité non seulement à faire, mais à se cacher aussi pour faire le traité. Voyez ; cela me parait assez bien déduit. Au total, mes ambassadeurs ne croient pas à la guerre. Ils sont très modérés, très calmes, une fort bonne attitude. Ils se louent toujours du Roi. Ils ne se plaignent pas de Thiers, mais Appony dit seulement qu’il a des vivacités étonnantes, et que si on ferait comme lui, on se battrait déjà. Cependant il ne lui attribue pas non plus l’envie de la guerre.
Enfin le langage est concevable. Bulwer a peur, véritablement car je crois qu’il essaie de fréquentes bourrasques. Il cherche à expliquer et justifier Napier. Mes ambassadeurs sont plus francs. Ils disent tout bonnement que c’est une action honteuse.
Ah par exemple ils détestent 46 ! Le petit homme hier au soir m’a fort questionnée ; et cross examined. Cher petit, je l’aime beaucoup ; il a un amour si inquiet ! Je l’ai fort bien renseigné sur les dispositions et les résolutions et il a fini par les trouver bonnes, quoiqu’il penche un peu pour autre chose. Il est dans la plus énorme méfiance de 21. Il parle très mal de lui et de sa femme à l’égard du chêne.
1 heure.
Merci du 408. Je bénis l’invention de la poste puisque je n’ai plus qu’elle ! J’ai été faire visite à ma nièce. Elle est charmante, jolie, une beauté fière, distinguée de la race, blanche, fragile et les yeux à peu près droits, vraiment elle me plaît, elle vous plaira. Appony croit savoir aujoudhui que vous méditez quelque coup de théâtre. Caudie par exemple. Ah cela serait mauvais, car comment éviter alors que la guerre ne s’engage. Mais je pense que vous ne commencez pas. Si personne ne commence elle ne viendra jamais. Cependant comment débrouiller ce brouillamini.
Je suis fatiguée, tout me fatigue, je me soigne bien cependant, je fais ce que je peux, il me faut du temps, des ménagements. Je refuse toute sortie, les Appony, les Flahaut me veulent encore a dîner, je dis non à tout le monde. Je verrai Mad. de Flahaut ce matin. Adieu, Bulwer va venir pour causer. Je vais dîner. Et puis le bois de Boulogne. Adieu, adieu comme toujours comme dans les meilleurs moments. Mille, mille fois adieu.
P.S. les Ambassadeurs ne connaissent pas le traité du 15 juillet. On le leur promet après l’échange de ratification.
Vous me voyez temps de bonne heure, c’est que je suis dans mon lit à 9 heures du soir j’ai assez bien dormi. J’ai vu hier matin mon ambassadeur, Appony, Bulwer et de 8 à 9 le soir votre petit homme. Je me suis fait traîner au bois de Boulogne de 4 à 6. Mad. de Flahaut est venu trois fois, j’avais fermé ma porte. Enfin elle m’a écrit pour me presser d’aller dîner chez elle. J’ai décliné et je lui ai promis d’aller me promener avec elle ce matin. Je verrai ma nièce aussi ce matin.
On ne parle plus d’émeutes du tout Dieu merci. Paris est joli, animé, quelle différence de Londres !
Je trouve ici dans le monde que je vois moins de crainte de la guerre que je ne croyais. Ils la croient possible, tout au plus probable non ; ils croient encore qu’à la dernière heure le Pacha cédera, en se mettant sous la protection de la France et que la France qui promettra ses bons offices obtiendra facilement des alliés St Jean d’Acre qui doit satisfaire le Pacha, et satisfaire la France, car ce serait une concession attendu que par son premier refus le Pacha a perdu ses droits à St Jean d’Acre. Si la guerre éclate, ils n’ont pas la moindre idée que ce puisse être autre chose qu’une guerre maritime. Et voilà pourquoi l’Angleterre y est si indifférents. Elle peut parler légèrement de la guerre, elle y gagne. Ses flottes battront et prendront, et ensuite une guerre continentale ne lui fait aucun mal. Il n’en est pas de même des autres puissances. Non, elles ne veulent pas la guerre. Elles ne comprennent pas pourquoi et comment elle se ferait, car elles ne feront rien pour cela de leur côté. Elles ne rencontreront la France nulle part ? La France regarde comme cas de guerre, l’entrée des Russes en Syrie ou à Constantinople mais ils n’y iront pas. Si Ibrahim franchit le Taurus, les flottes anglaises, russes, autrichiennes entreront dans la rue de mer de Marmara pour couvrir Constantinople. Cela ne constitue pas un cas de guerre ? Pahlen m’assure qu’il faudrait que l’Empereur fut bien changé depuis 6 mois pour en avoir envie. Il n’en veut pas. En recherchant les causes de tout ce mauvais imbroglio on trouve d’abord, une disposition hargneuse à Londres. Ensuite des illusions là comme ici. Là, ignorance volontaire ou réelle de la disposition de la France. Ici, incrédulité sur le vouloir ou le pouvoir de lord Palmerston. Après cela on dit aussi que la France a voulu jouer au plus fin. Qu’elle voulait et croyait escamoter l’arrangement en le faisant conclure d’une manière cachée et abrupte entre les deux parties. Que c’est de Pétersboug qu’on a donné l’éveil à Londres. Que cela y est revenu par d’autres voies ensuite. Que cela a excité non seulement à faire, mais à se cacher aussi pour faire le traité. Voyez ; cela me parait assez bien déduit. Au total, mes ambassadeurs ne croient pas à la guerre. Ils sont très modérés, très calmes, une fort bonne attitude. Ils se louent toujours du Roi. Ils ne se plaignent pas de Thiers, mais Appony dit seulement qu’il a des vivacités étonnantes, et que si on ferait comme lui, on se battrait déjà. Cependant il ne lui attribue pas non plus l’envie de la guerre.
Enfin le langage est concevable. Bulwer a peur, véritablement car je crois qu’il essaie de fréquentes bourrasques. Il cherche à expliquer et justifier Napier. Mes ambassadeurs sont plus francs. Ils disent tout bonnement que c’est une action honteuse.
Ah par exemple ils détestent 46 ! Le petit homme hier au soir m’a fort questionnée ; et cross examined. Cher petit, je l’aime beaucoup ; il a un amour si inquiet ! Je l’ai fort bien renseigné sur les dispositions et les résolutions et il a fini par les trouver bonnes, quoiqu’il penche un peu pour autre chose. Il est dans la plus énorme méfiance de 21. Il parle très mal de lui et de sa femme à l’égard du chêne.
1 heure.
Merci du 408. Je bénis l’invention de la poste puisque je n’ai plus qu’elle ! J’ai été faire visite à ma nièce. Elle est charmante, jolie, une beauté fière, distinguée de la race, blanche, fragile et les yeux à peu près droits, vraiment elle me plaît, elle vous plaira. Appony croit savoir aujoudhui que vous méditez quelque coup de théâtre. Caudie par exemple. Ah cela serait mauvais, car comment éviter alors que la guerre ne s’engage. Mais je pense que vous ne commencez pas. Si personne ne commence elle ne viendra jamais. Cependant comment débrouiller ce brouillamini.
Je suis fatiguée, tout me fatigue, je me soigne bien cependant, je fais ce que je peux, il me faut du temps, des ménagements. Je refuse toute sortie, les Appony, les Flahaut me veulent encore a dîner, je dis non à tout le monde. Je verrai Mad. de Flahaut ce matin. Adieu, Bulwer va venir pour causer. Je vais dîner. Et puis le bois de Boulogne. Adieu, adieu comme toujours comme dans les meilleurs moments. Mille, mille fois adieu.
P.S. les Ambassadeurs ne connaissent pas le traité du 15 juillet. On le leur promet après l’échange de ratification.
419. Paris, Vendredi 11 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
419. Paris, vendredi 9 h. du matin
Le 11 septembre 1840
Je ne suis arrivée qu’à 8 heures, Génie était dans la cour, il avait vu venir le postillon qui me devançait il m’attendait. Il est entré avec moi, il m’a remis. La première impression à Paris a donc été du bonheur. Je vous écris pour être lue un dimanche, j’aimerais mieux un autre jour. Je me suis couchée hier à 9. heures. Je verrai Pogenpolh à midi. Mon ambassadeur plus tard. Je voudrais bien rester ignorée de tous les autres. Mad. de Flahaut, avait déjà passé deux fois ici. M. Thiers y est venu dès mardi, me croyant arrivée.
Il faut que je me repose. Mon appartement me plait. J’espère qu’il me plaira, encore davantage. Paris me plait aussi. N’est-ce pas il me plait davantage ? Je pense à tout ! à tout !
Voici votre 407. C’est presque Londres. Vous, moi, pas autre chose. Je n’ai pas encore. eu une impression, une nouvelle pas un visage étranger. Je suis seule avec deux lettres. C’est une bonne compagnie et douce et tranquille. C’est cela qu’il me faut surtout.
3 heures.
Longtemps Pogenpolh. longtemps mon ambassadeur qui me quitte à l’instant. Bon, excellent homme. Toujours le même : " Madame, je ne sais rien, on ne m’écrit rien de Pétersbourg ! On ne me parle pas ici, je n’ai rien à leur dire ; ich lebe aufoncinem eigenen funde, recht ruhig und recht glücklich. " Et il a l’air de cela. Demain je vous écrirai longuement j’espère.
Adieu. Adieu. Il faut que ma lettre parte si cela peut s’appeler une lettre. Adieu.
Le 11 septembre 1840
Je ne suis arrivée qu’à 8 heures, Génie était dans la cour, il avait vu venir le postillon qui me devançait il m’attendait. Il est entré avec moi, il m’a remis. La première impression à Paris a donc été du bonheur. Je vous écris pour être lue un dimanche, j’aimerais mieux un autre jour. Je me suis couchée hier à 9. heures. Je verrai Pogenpolh à midi. Mon ambassadeur plus tard. Je voudrais bien rester ignorée de tous les autres. Mad. de Flahaut, avait déjà passé deux fois ici. M. Thiers y est venu dès mardi, me croyant arrivée.
Il faut que je me repose. Mon appartement me plait. J’espère qu’il me plaira, encore davantage. Paris me plait aussi. N’est-ce pas il me plait davantage ? Je pense à tout ! à tout !
Voici votre 407. C’est presque Londres. Vous, moi, pas autre chose. Je n’ai pas encore. eu une impression, une nouvelle pas un visage étranger. Je suis seule avec deux lettres. C’est une bonne compagnie et douce et tranquille. C’est cela qu’il me faut surtout.
3 heures.
Longtemps Pogenpolh. longtemps mon ambassadeur qui me quitte à l’instant. Bon, excellent homme. Toujours le même : " Madame, je ne sais rien, on ne m’écrit rien de Pétersbourg ! On ne me parle pas ici, je n’ai rien à leur dire ; ich lebe aufoncinem eigenen funde, recht ruhig und recht glücklich. " Et il a l’air de cela. Demain je vous écrirai longuement j’espère.
Adieu. Adieu. Il faut que ma lettre parte si cela peut s’appeler une lettre. Adieu.
418. Poix, Jeudi 10 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
418. Poix 7 h. du matin le 10 septembre 1840
Je vous ai écrit au moment de mon coucher, je vous écris à mon lever. Toujours toujours penser à vous ; vous parler on vous écrire selon que le ciel ordonne que ce soit l’un ou l’autre. Voilà comme se passera ma vie. J’ai assez mal dormi bien du bruit. Je serai d’assez bonne heure à Paris, je laisserai ceci à Beauvais Faites-moi le plaisir de dire à votre maître d’hôtel, que c’est pour le 15 que Denay s’est engagé à venir me trouver à Paris. S’il était encore à Londres il l’en ferait souvenir.
Je serai curieuse demain d’en tendre du bavardage. Je lis les journaux en route en attendant et je trouve qu’il y a bien de la confusion. C’est probablement là le régime auquel sera livré le monde pour longtemps.
Beauvais midi. N’est-ce pas que vous avez eu une lettre de moi tous les jours ? Je suis à la 6 ème depuis Londres. Je m’arrête ici pour manger et boire de votre vin. Je viens de parcourir le Constitutionnel de hier 9. C’est assez bien répondu aux Débats. Au reste vous n’attendez pas des commentaires politiques de Beauvais ?
Adieu. Adieu. Voilà le couvert mis, c’est important pour un voyageur et j’ai faim. Adieu. Adieu mille fois. God bless you que dit-on à Londres de Napier. Adieu
Je vous ai écrit au moment de mon coucher, je vous écris à mon lever. Toujours toujours penser à vous ; vous parler on vous écrire selon que le ciel ordonne que ce soit l’un ou l’autre. Voilà comme se passera ma vie. J’ai assez mal dormi bien du bruit. Je serai d’assez bonne heure à Paris, je laisserai ceci à Beauvais Faites-moi le plaisir de dire à votre maître d’hôtel, que c’est pour le 15 que Denay s’est engagé à venir me trouver à Paris. S’il était encore à Londres il l’en ferait souvenir.
Je serai curieuse demain d’en tendre du bavardage. Je lis les journaux en route en attendant et je trouve qu’il y a bien de la confusion. C’est probablement là le régime auquel sera livré le monde pour longtemps.
Beauvais midi. N’est-ce pas que vous avez eu une lettre de moi tous les jours ? Je suis à la 6 ème depuis Londres. Je m’arrête ici pour manger et boire de votre vin. Je viens de parcourir le Constitutionnel de hier 9. C’est assez bien répondu aux Débats. Au reste vous n’attendez pas des commentaires politiques de Beauvais ?
Adieu. Adieu. Voilà le couvert mis, c’est important pour un voyageur et j’ai faim. Adieu. Adieu mille fois. God bless you que dit-on à Londres de Napier. Adieu
408. Londres, Mercredi 9 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
408. Londres, Mercredi 9 septembre 1840
6 heures et demie
J’ai fait ce matin quelques visites. J’ai vu notre amis Dedel, toujours très bon et très sensé. Je lui ai porté mes plaintes sur Napier n’ayant pu trouver dans Londres un ministre anglais à qui les adresser. J’avais passé chez Lord Clarendon le seul membre du Cabinet qui réside. Il n’y était pas. Il sort de chez moi, et je lui ai dit comme s’il avait été Lord Palmerston ou Lord Melbourne tout ce que Napier m’avait mis sur le cœur. Il n’y a pas de réponse à cela. Lord Palmerston lui-même n’en trouverait pas. La guerre commencée en Syrie deux jours avant qu’on ait demandé au Pâcha de rendre la Syrie ! Voilà bien les incidents et les subalternes. Je ne sais ce qu’on me dira quand il y aura quelqu’un pour me parler En attendant les journaux même les plus hostiles au Pacha, le Standard par exemple, se récrient contre une telle légèreté ou un tel manqué de foi. On verra ce que c’est que d’entreprendre à 7ou 800 lieues et par toutes sortes de mains une opération bien plus vaste, bien plus compliquée, bien plur longue que cette expédition de Belgique que nous avons eu tant de peine à conduire à bien, sous nos propres yeux et de nos propres mains.
Jeudi 6 heures et demie
Je m’éveille. Achevez. J’ai eu hier quelques personnes à dîner. Rien. Après dîner, j’ai joué au whist. Quelle décadence. C’est demain que je commence à rester chez moi le soir, mardi et vendredi. J’achète une seconde table de whist, des échecs. Je fais venir du Val-Richer mon tric-trac. On ne trouve pas un tric-trac dans Londres. Je n’aurai pas mes deux soirées par semaine à Holland house. Ils vont décidément à Brighton pour quinze jours. Cependant Lady Holland va mieux. Lord John est retourné à Windsor. La Reine ne voulait pas qu’il en sortit, même pour un jour. Pourtant quand elle a su que c’était pour dîner avec moi, elle a dit : " A la bonne heure. Je crois que la Reine a grande envie de la paix. Lord Clarendon est invité à Windsor pour vendredi, la première fois. Lord Holland n’y a pas encore été invité. On en a de l’humeur. On s’en prend à qui de droit.
Lord Tankerville a été opéré hier matin, avec plein succès, dit-on. On n’en sera tout-à -fait sûr que dans quelques jours. Dites-moi ce qu’il y a de réel dans le succès de l’opération sur les yeux de votre nièce. Je déteste la loucherie. Je penserais avec plaisir qu’on a trouvé un moyen de la chasser de ce monde. Je n’ai pas eu hier de lettre du Val. Richer. Je m’en prends aux désordres des ouvriers dans Paris. Je sais que le service des postes en a été un peu dérangé. J’attends encore plus impatiemment le courrier de ce matin. Je n’ai pas besoin d’un redoubement d’impatience. Qu’a donc été votre si mauvaise nuit à Douvres que vous ayez hésité à partir ? Il ne faut pas dire des choses pareilles, cela donne des pensées abominables. Au moins ne soyez pas malade loin.
Midi
Votre fatigue me préoccupe beaucoup. Je m’y attendais. Mais qu’importe ? Vous ne vous réposerez qu’à Paris. Tout y est tranquille. J’ai reçu ce matin une bonne lettre de Thiers. Il paraît que malgré Napier, les syriens n’ont pas envie de se faire égorger pour faire plaisir à Lord Palmerston. Tout optimiste que je suis, je ne le suis pas tant que d’autres. Je trouve qu’on est déjà bien engagé. Je crains toujours les coups fourrés et soudains. Pourtant il est sûr que jusqu’ici tous les mécomptes ont été d’un seul côté. Où aurez-vous couché hier ? A quelle heure arrivez-vous aujourd’hui à Paris ? Je me fais cent questions; et j’ai beau savoir que je ne trouverai pas la réponse; je recommence toujours. Adieu. Adieu. Adieu.
6 heures et demie
J’ai fait ce matin quelques visites. J’ai vu notre amis Dedel, toujours très bon et très sensé. Je lui ai porté mes plaintes sur Napier n’ayant pu trouver dans Londres un ministre anglais à qui les adresser. J’avais passé chez Lord Clarendon le seul membre du Cabinet qui réside. Il n’y était pas. Il sort de chez moi, et je lui ai dit comme s’il avait été Lord Palmerston ou Lord Melbourne tout ce que Napier m’avait mis sur le cœur. Il n’y a pas de réponse à cela. Lord Palmerston lui-même n’en trouverait pas. La guerre commencée en Syrie deux jours avant qu’on ait demandé au Pâcha de rendre la Syrie ! Voilà bien les incidents et les subalternes. Je ne sais ce qu’on me dira quand il y aura quelqu’un pour me parler En attendant les journaux même les plus hostiles au Pacha, le Standard par exemple, se récrient contre une telle légèreté ou un tel manqué de foi. On verra ce que c’est que d’entreprendre à 7ou 800 lieues et par toutes sortes de mains une opération bien plus vaste, bien plus compliquée, bien plur longue que cette expédition de Belgique que nous avons eu tant de peine à conduire à bien, sous nos propres yeux et de nos propres mains.
Jeudi 6 heures et demie
Je m’éveille. Achevez. J’ai eu hier quelques personnes à dîner. Rien. Après dîner, j’ai joué au whist. Quelle décadence. C’est demain que je commence à rester chez moi le soir, mardi et vendredi. J’achète une seconde table de whist, des échecs. Je fais venir du Val-Richer mon tric-trac. On ne trouve pas un tric-trac dans Londres. Je n’aurai pas mes deux soirées par semaine à Holland house. Ils vont décidément à Brighton pour quinze jours. Cependant Lady Holland va mieux. Lord John est retourné à Windsor. La Reine ne voulait pas qu’il en sortit, même pour un jour. Pourtant quand elle a su que c’était pour dîner avec moi, elle a dit : " A la bonne heure. Je crois que la Reine a grande envie de la paix. Lord Clarendon est invité à Windsor pour vendredi, la première fois. Lord Holland n’y a pas encore été invité. On en a de l’humeur. On s’en prend à qui de droit.
Lord Tankerville a été opéré hier matin, avec plein succès, dit-on. On n’en sera tout-à -fait sûr que dans quelques jours. Dites-moi ce qu’il y a de réel dans le succès de l’opération sur les yeux de votre nièce. Je déteste la loucherie. Je penserais avec plaisir qu’on a trouvé un moyen de la chasser de ce monde. Je n’ai pas eu hier de lettre du Val. Richer. Je m’en prends aux désordres des ouvriers dans Paris. Je sais que le service des postes en a été un peu dérangé. J’attends encore plus impatiemment le courrier de ce matin. Je n’ai pas besoin d’un redoubement d’impatience. Qu’a donc été votre si mauvaise nuit à Douvres que vous ayez hésité à partir ? Il ne faut pas dire des choses pareilles, cela donne des pensées abominables. Au moins ne soyez pas malade loin.
Midi
Votre fatigue me préoccupe beaucoup. Je m’y attendais. Mais qu’importe ? Vous ne vous réposerez qu’à Paris. Tout y est tranquille. J’ai reçu ce matin une bonne lettre de Thiers. Il paraît que malgré Napier, les syriens n’ont pas envie de se faire égorger pour faire plaisir à Lord Palmerston. Tout optimiste que je suis, je ne le suis pas tant que d’autres. Je trouve qu’on est déjà bien engagé. Je crains toujours les coups fourrés et soudains. Pourtant il est sûr que jusqu’ici tous les mécomptes ont été d’un seul côté. Où aurez-vous couché hier ? A quelle heure arrivez-vous aujourd’hui à Paris ? Je me fais cent questions; et j’ai beau savoir que je ne trouverai pas la réponse; je recommence toujours. Adieu. Adieu. Adieu.
407. Londres, Mercredi 9 [septembre] 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
407. Londres, Mercredi 9 [septembre] 1840
9 Heures
J’ai si mal dormi cette nuit que je me lève tard. Le sommeil m’a gagné ce matin. Je ne veux pas dire que je suis inquiet. Je ne le suis pas. Je ne le serais pas du tout, si vous ne rouliez pas vers Paris. J’en attends avec ardeur les nouvelles. Je ne peux pas me figurer un vrai désordre dans Paris, votre agitation, vos craintes, et moi absent. Que de choses on ne peut pas se figurer, et qui arrivent, et qu’on supporte ! C’est odieux à penser. Je suis parlaitement sûr qu’il n’y a point de danger dans Paris, point en général, point pour vous. Je pense que vous aurez appris l’émeute à Boulogne, et que vous vous serez arrêtée. Ce qui me prouve que l’émeute n’a pas de gravité, c’est qu’elle était fort locale, concentrée dans un quartier d’ouvriers. Il n’y a rien eu dans les quartiers politiques, où l’émeute politique à toujours logé. Ce que je vous dis-là, ne signifiera rien du tout pour vous quand vous le lirez. Mais je vous dis ce que je me dis à moi-mêmes. J’essaye en vain de me parler d’autre chose.
J’ai dîné hier à Holland-House, avec Lord John, dont j’ai été content très content. Il commence à entrevoir la gravité de la situation. Il convient qu’on s’est fort trompé, qu’on est déjà au troisième ou quatrième mécompte qu’on ne referait pas ce qu’on a fait si ce n’était pas fait. Mais comment faire? Il cherche et ne trouve pas. Mais il cherche. Et je sais que Lord Melbourne cherche aussi avec plus de care qu’il ne lui appartient. Je ne vois là rien de plus qu’une bonne disposition pour un moment qui peut venir. En attendant qu’il vienne ceci est bien grave. Voilà le traité en cours d’exécution. Et il s’exécute avant d’être non seulement ratifié, mais notifié au Pacha ; on l’attaque en Syrie avant de lui avoir dit qu’on lui demande de rendre la Syrie, quand on lui donne vingt jours, pour répondre à ce qu’on lui aura dit ! C’est là le premier incident. Il en viendra en foule. Et c’est sous ce feu-là, qu’il faut rester immobile jusqu’à ce que le moment se présente , soit pour nous d’agir, soit pour les autres to retrace their Steps ! C’est bien difficile. C’est pourtant la seule bonne conduite, bonne pour maintenir la paix si la paix peut être maintenue, comme j’y crois toujours, bonne si nous sommes obligés à la guerre. Car il faut que nous y soyons bien certainement, bien évidemment obligés, que nous la fassions pour notre compte, pour le compte de notre rang, de notre influence, de notre sureté en Europe, non pour le compte du Pacha et de la Syrie.
Je pense sans cesse à cela, sans cesse en seconde ligne. J’ai tort car tout se tient, la première et la seconde ligne. J’y pense avec cette passion qui pénètre certainement au fond des choses comme on regarde de sa barque à l’horizon, le point d’où peut venir la tempète. Je ne découvre pas autre chose à prévoir, autre chose à faire. Ma conviction sur les chances de l’avenir, sur la route à suivre, est de plus en plus forte. Mais que la barque où nous vivons est fragile, et que toute notre sagesse, toute notre force est peu de chose quand la mer est si grosse et le port si loin ! Je moralise ; j’ai recours à Dieu, je le prie. Je ne puis pas, je ne veux pas m’en défendre. J’ai le cœur trop plein, il s’agit d’intérêts trop chers, pour que les pensées et les ressources humaines me suffisent. Je vais à la sagesse qui sait tout, au pouvoir qui peut tout. Je lui demande d’intervenir.
Une heure
C’est Rothschild qui est intervenu pendant que j’écrivais. Croyez-vous qu’il prie Dieu pour la surété de son argent ? Je ne pense pas que cela soit jamais arrivé à personne. Grande lumière sur la valeur des choses.
Je n’espérais pas de lettre aujourd’hui. Merci mille fois. Vous êtes bien aimable. C’est presque une vertu d’être aimable. Cela me plaît que vous ayez passé par Calais. Je passe toujours par là. Rien de Paris sinon les journaux qui me prouvent que l’émeute n’a pas été grand chose. Le langage du Constitutionnel, sur la dépêche de Lord Palmerston et sur la situation en général est bon. Mais j’aurais dû avoir un courrier. Adieu. Serez-vous ce soir à Paris, ou demain seulement ? Adieu partout. Adieu toujours.
9 Heures
J’ai si mal dormi cette nuit que je me lève tard. Le sommeil m’a gagné ce matin. Je ne veux pas dire que je suis inquiet. Je ne le suis pas. Je ne le serais pas du tout, si vous ne rouliez pas vers Paris. J’en attends avec ardeur les nouvelles. Je ne peux pas me figurer un vrai désordre dans Paris, votre agitation, vos craintes, et moi absent. Que de choses on ne peut pas se figurer, et qui arrivent, et qu’on supporte ! C’est odieux à penser. Je suis parlaitement sûr qu’il n’y a point de danger dans Paris, point en général, point pour vous. Je pense que vous aurez appris l’émeute à Boulogne, et que vous vous serez arrêtée. Ce qui me prouve que l’émeute n’a pas de gravité, c’est qu’elle était fort locale, concentrée dans un quartier d’ouvriers. Il n’y a rien eu dans les quartiers politiques, où l’émeute politique à toujours logé. Ce que je vous dis-là, ne signifiera rien du tout pour vous quand vous le lirez. Mais je vous dis ce que je me dis à moi-mêmes. J’essaye en vain de me parler d’autre chose.
J’ai dîné hier à Holland-House, avec Lord John, dont j’ai été content très content. Il commence à entrevoir la gravité de la situation. Il convient qu’on s’est fort trompé, qu’on est déjà au troisième ou quatrième mécompte qu’on ne referait pas ce qu’on a fait si ce n’était pas fait. Mais comment faire? Il cherche et ne trouve pas. Mais il cherche. Et je sais que Lord Melbourne cherche aussi avec plus de care qu’il ne lui appartient. Je ne vois là rien de plus qu’une bonne disposition pour un moment qui peut venir. En attendant qu’il vienne ceci est bien grave. Voilà le traité en cours d’exécution. Et il s’exécute avant d’être non seulement ratifié, mais notifié au Pacha ; on l’attaque en Syrie avant de lui avoir dit qu’on lui demande de rendre la Syrie, quand on lui donne vingt jours, pour répondre à ce qu’on lui aura dit ! C’est là le premier incident. Il en viendra en foule. Et c’est sous ce feu-là, qu’il faut rester immobile jusqu’à ce que le moment se présente , soit pour nous d’agir, soit pour les autres to retrace their Steps ! C’est bien difficile. C’est pourtant la seule bonne conduite, bonne pour maintenir la paix si la paix peut être maintenue, comme j’y crois toujours, bonne si nous sommes obligés à la guerre. Car il faut que nous y soyons bien certainement, bien évidemment obligés, que nous la fassions pour notre compte, pour le compte de notre rang, de notre influence, de notre sureté en Europe, non pour le compte du Pacha et de la Syrie.
Je pense sans cesse à cela, sans cesse en seconde ligne. J’ai tort car tout se tient, la première et la seconde ligne. J’y pense avec cette passion qui pénètre certainement au fond des choses comme on regarde de sa barque à l’horizon, le point d’où peut venir la tempète. Je ne découvre pas autre chose à prévoir, autre chose à faire. Ma conviction sur les chances de l’avenir, sur la route à suivre, est de plus en plus forte. Mais que la barque où nous vivons est fragile, et que toute notre sagesse, toute notre force est peu de chose quand la mer est si grosse et le port si loin ! Je moralise ; j’ai recours à Dieu, je le prie. Je ne puis pas, je ne veux pas m’en défendre. J’ai le cœur trop plein, il s’agit d’intérêts trop chers, pour que les pensées et les ressources humaines me suffisent. Je vais à la sagesse qui sait tout, au pouvoir qui peut tout. Je lui demande d’intervenir.
Une heure
C’est Rothschild qui est intervenu pendant que j’écrivais. Croyez-vous qu’il prie Dieu pour la surété de son argent ? Je ne pense pas que cela soit jamais arrivé à personne. Grande lumière sur la valeur des choses.
Je n’espérais pas de lettre aujourd’hui. Merci mille fois. Vous êtes bien aimable. C’est presque une vertu d’être aimable. Cela me plaît que vous ayez passé par Calais. Je passe toujours par là. Rien de Paris sinon les journaux qui me prouvent que l’émeute n’a pas été grand chose. Le langage du Constitutionnel, sur la dépêche de Lord Palmerston et sur la situation en général est bon. Mais j’aurais dû avoir un courrier. Adieu. Serez-vous ce soir à Paris, ou demain seulement ? Adieu partout. Adieu toujours.