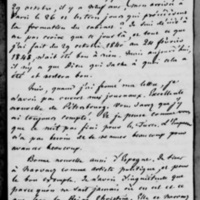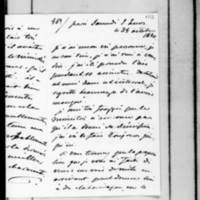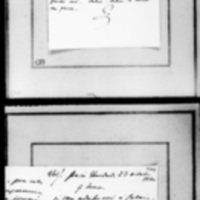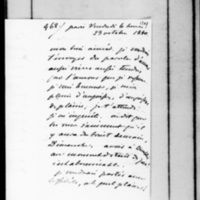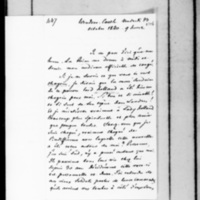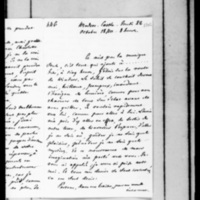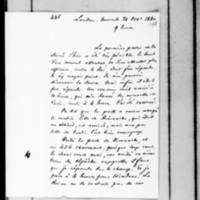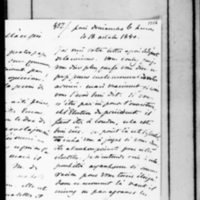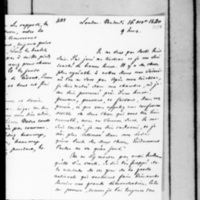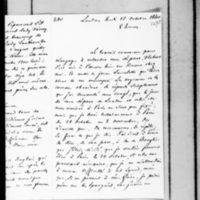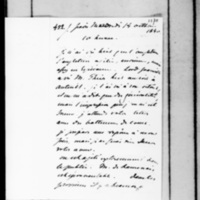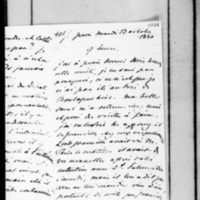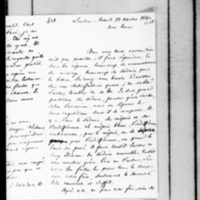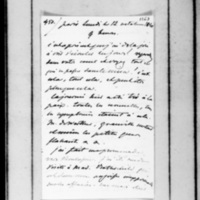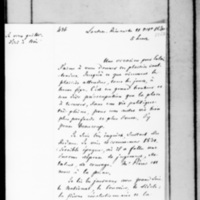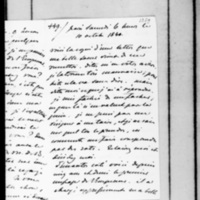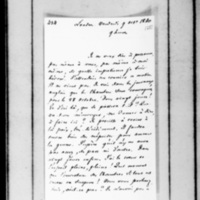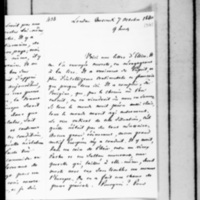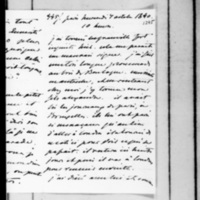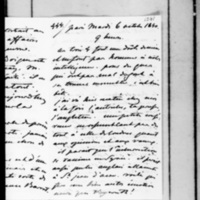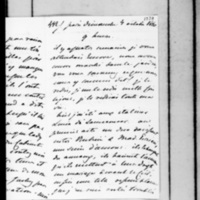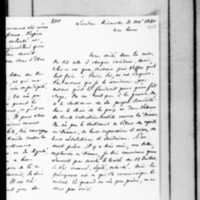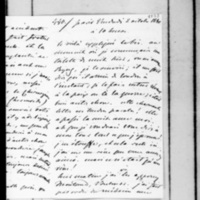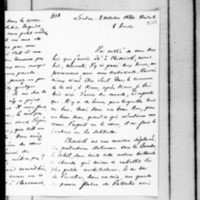Votre recherche dans le corpus : 325 résultats dans 3296 notices du site.
Première de couverture des Lettres de François Guizot et de la princesse de Lieven : 1836-1846, Paris, Mercure de France, 1963, Tome deuxième, 1840.
Ce volume contient 268 lettres.
Mots-clés : Ambassade à Londres
Val-Richer, Lundi 29 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 Heures
Vous rappelez-vous bien le 29 octobre, il y a neuf ans mon arrivée à Paris le 26 et les trois jours qui précédèrent la formation du Cabinet ? Je suis décidé à ne pas croire que ce jour-là, et tout ce que j’ai fait du 29 octobre 1840 au 24 février 1848 m'ait été bon à rien. Mais aujourd’hui il n’y a que Dieu qui sache à qui cela a été et restera bon. Hier quand j’ai fermé ma lettre, je n’avais pas ouvert mes journaux. Excellente nouvelle de Pétersbourg. Vous savez que j'y ai toujours compté. Et je pense comme vous que ce n'est pas fini pour les Turcs. L'Empereur n’a pas besoin de se remuer beaucoup pour avancer beaucoup. Bonne nouvelle aussi d’Espagne. Je tiens à Narvaez comme artiste politique, et pour le bon exemple. Je n’avais d’inquiétude que parce qu’on ne sait jamais où en est et ce que fera la Reine Christine. Elle et Narvaez se détestent et se craignent. Mais la haine et la crainte ne leur enlèvent pas leur bon sens. J’en suis charmé. Tant que ces deux personnages se soutiendront mutuellement, l’Espagne se maintiendra. Je suis assez amusé de la fausse joie qu'aura eue Lord Palmerston. Il n’a depuis longtemps que le plaisir des revers de ses adversaires, pas du tout celui de ses propres succès. Il y a bien à parier que Lord Normanby aura lu votre lettre. N’appartient-il pas plutôt à Lord John qu'à Lord Palmerston ? Malgré cela, s’il vous a lue, il se sera donné probablement le mérite d'en dire quelque chose à son chef direct. Il ne lui aura rien appris, rien sur vos sentiments et rien qui le corrige. Outre M. Moulin, j’ai eu hier un autre ancien député conservateur un brave capitaine, le vaisseau, M. Béchameil qui a été destitué après Février à cause d’une lettre de lui à moi que la Revue rétrospective à publier. Il n'en est pas moins décidé, ni moins dévoué. M. Moulin est tout-à-fait un homme de sens et d’esprit. Je le trouve très inquiet, non seulement, en Général et pour l'avenir, mais prochainement. Persuadé que le Président par détresse d'argent autant que par ambition, cherche à faire et finira par faire le coup d'Etat impérial. Faire, c’est-à-dire tenter. Et cette tentative peut amener quelque grand désordre même un triomphe momentané des rouges. Ceci, je ne vois pas comment, l'assemblée étant là, et le Président ne pouvant pas la chasser, ni se faire Empereur par la grâce des rouges qui eux chasseraient bien l’Assemblée par la violence. Mais peu importe que je voie ou que je ne voie pas comment le désordre peut éclater. Evidemment les hommes les plus sensés et les mieux informés craignent qu’il n'éclate. Ceci me préoccupe. Pour vous d’abord. Il y faut bien regarder. Montebello est très bon pour vous tenir bien au courant. N'hésitez pas, comme renseignement à faire venir aussi mon petit fidèle, et à savoir de lui ce qu’il sait. Il est toujours, bien instruit. Au fond, je ne crois pas à ces crises prochaines. Toute crise qui ne sera pas absolument indispensable, et imposée aux hommes par des nécessités actuelles, sera ajournée. Mais nous sommes tombés à ce point qu’il faut craindre même les maux auxquels on ne croit pas. Je ne suis pas très étonné de la simple carte du Duc de Broglie. Je vous dirai pourquoi. Vous n'avez pas idée de sa disposition d'esprit. On va jusqu'à dire que les affaires d'argent de Morny sont si mauvaises que, pendant son séjour à Londres, son traitement de représentant à été saisi à Paris par des créanciers. Je ne puis pas croire cela.
Midi.
Voilà votre lettre. A demain les réponses. Je n’ai jamais craint la guerre Turque, mais j'ai le cœur bien plus léger depuis que je ne peux plus la craindre. Adieu, adieu, adieu. G.
464. Paris, Dimanche 25 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous écris à tout hasard ; je ne voulais plus le faire, mais votre lettre de vendredi 4 heures où vous ignoriez tout me fait croire qu’il est impossible que vous arriviez aujourd’hui peut-être passerez-vous à Beauvais demain, après l’entrée de la poste. Je n’ai cependant rien du tout à vous dire sinon que les journaux sont les échos fidèles des paroles que prodigue M. de Broglie, et selon lesquelles il est persuadé que vous n’accepterez pas ! Tout le monde me rapporte cela. On vous attend et on ne fait pas autre chose. J’ai pleuré vraiment pleuré en apprenant la mort de lord Holland je vois d’après votre lettre que j’ai fait plus que la plupart de ses intimes. C’est vrai les Anglais sont froids.
J’ai été hier aux Italiens. La Somnambula ravissante musique. Encore une scène d’amour, mais un scène abominable J’ai détourné la tête. Ce matin, il me semblait que vous pouviez arriver à tout instant. J’ai tout hâté, me voilà, mais " le bien aimé ne viendra pas."
2 heures. Montrond sort d’ici. Il dit que Thiers dit beaucoup et Mignet aussi pour lui qu’il vous soutiendra cordialement. Le Roi le croit, pour quelques jours. Le Roi n’est pas inquiet Thiers est gai. Le dire de Montrond est qu’il n’y a encore rien de fait - il m’a même dit que le Maréchal avait envie des Affaires étrangères. Adieu vraiment je n’ai rien à vous dire de plus et puis je ne sais pourquoi votre dernière lettre ne m’inspire pas. Il y a quelque chose de froid, je cherche, j’ai trouvé, et c’est tout bonnement que vous n’avez pas compris quelque chose. Je suis sûre que j’ai raison. Adieu cependant. Adieu, comme si vous m’avez dit adieu bien tendrement.
463. Paris, Samedi 24 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai encore vu personne, je ne sais rien, je n’ai rien à vous dire. J’ai été prendre l’air pendant 10 minutes. Montrond est venu dans cet intervalle, je regrette beaucoup de l’avoir manqué. Je suis très frappée que le ministère n’annonce pas qu’il a donné sa démission J’ai vu le faire toujours jusqu’ici. Si vous trouvez que la proposition que je vous ai faite de venir me voir de suite en arrivant peut donner lieu à des clabaudages, ne le faites pas. Au fond, le motif pour lequel je vous le demande vous sera suffisamment expliqué de vive voix et par ma lettre, et ce n’est vraiment que cela qui me fait désirer la priorité.
Je vous conjure donc de faire autrement pour que que vous voyez de l’inconvénient à ce que je vous demande. Il ne faut rien risquer, rien gâter ; car vous êtes bien en scène et le moment est bien grave ainsi ne faites que ce qui est bien, et prudent, et le plus prudent je crois est de ne pas faire ce que je vous vous me trouvez ai dit. Vous me trouverez bien raisonnable sur toute chose, et bien pénétrée que c’est un grand moment pour vous. J’ai eu votre lettre de vendredi assez prophétique, sentant que l’air était chargé. 20 heures après l’avoir écrite vous aurez, reçu le télégraphe.
2 heures. Werther sort d’ici, il me rapporte que M. de Broglie a dit à plusieurs personnes que vous n’accepteriez pas. Les journaux répètent de lui le même propos. Le Roi a dit hier soir à un diplomate qu’il était très sûr de son fait, qu’il avait toute confiance que le ministère Soult allait se former, qu’il aurait la majorité. Il a ajouté qu’il y aurait bien quelques petites émeutes peut être, mais que cela n’inquiétait nullement. Adieu. Adieu. Le temps me presse. Adieu probablement et j’y compte pour la dernière fois jusqu’à un meilleur adieu, un adieu charmant.
461. Paris, Vendredi 23 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Je vous adresse ceci à Calais. Quel plaisir ! à Calais ! Je vous écris encore ce soir par le fidèle qui ira vous attendre à Beauvais. Et puis plus d’adieu de si loin. Est-il possible que je sois à la veille de tant de bonheur ! Tous ce que j’ai vu hier est profondément troublé de la démission de Thiers. Toute la diplomatie était chez moi hier au soir. C’est unanime ; ils voient ressortir de ce fait la révolution et la ;guerre ; ils ne conçoivent pas que le Roi n’ait pas patienté, fléchi même jusqu’à l’ouverture de la Chambre. La démission donnée après l’ouverture avait une bien autre importance ; elle ne présentait par les même dangers. Aujourd’hui ils sont consternés. D’un autre côté les amis de Thiers, Mad. de Flahaut le prince Paul jettent feu et flamme contre le Roi. Des invectives, des cris ; en vérité c’est furibond. Montrond est venu chez moi, il avait vu le Roi, qui lui a dit que c’était irrévocable, que les Ministres étaient sortis, récemment sortis ; à la mention. de Molé le Roi lui a montré par signe si ce n’est par parole, qu’il n’en pouvait pas être question. Voilà le dire de Montrond. Je calcule quand la dépêche télégraphique a pu vous arriver. Ce que vous allez faire. Il me semble que vous aurez eu la nouvelle cette nuit, qu’à l’heure qu’il est vous demandez à Lord Palmerston une dernière entrevue, que cela et vos autres arrangements vous prendront la journée et que vous partez ce soir.
Demain vous passez de bonne heure, et vous trouverez ma lettre à 10 heures à Calais. Vous pouvez être ici dimanche dans la matinée. Dimanche vous dînerez chez moi c’est convenu, mais voici de quoi je veux convenir par dessus le marché, c’est que vous ne verrez personne avant de m’avoir vu quand ce ne serait que dix minutes ceci n’est pas. pour le plaisir de vous voir une minute plutôt, c’est plus sérieux. Je ne veux pas que vous preniez un parti ou que vous le laissiez seule ment soupçonner avant que je n’aie causé avec vous. Je resterai chez moi tout dimanche ; si je sors ce sera pour marcher au jardin un quart d’heure pour prendre l’air. Vous ne pouvez donc pas me manquer. Quittez votre voiture dans quelque rue et venez-vous en ici en fiacre. Voilà mon prospectus. Je vous supplie de faire comme cela.
1 heure
Votre lettre m’apprend que la dépêche télégraphique vous aura trouvé à Windsor. Comme je pense que lord Palmerston s’y trouve, cela ne peut pas faire une grande différence pour vos mouvements. cependant, il ne vous sera guère possible de partir ce soir. Je n’en serais pas fâchée/ Je n’aime pas ce qu’on entreprend un vendredi. Je suis superstitieuse à l’excès dès que mon cœur s’en mêle. Ainsi vous me ferez bien plaisir en m’apprenant que vous êtes parti après minuit.
3 heures
Voilà le petit qui m’a pris mon temps, mais il a été bien employé. Il s’obstine à partir ce soir, il a tort, il attendra plus de 24 heures. Je vous écrirai encore à Beauvais à l’adresse du fidèle. Adieu. Adieu cent mille fois ou une seule.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique (France)
462. Paris, Vendredi 23 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon bien aimé, je voudrais t’envoyer des paroles d’amour aussi vives aussi tendres que l’amour que je ressens. Je suis heureuse, je suis pleine d’angoisse, d’angoisse de plaisir, je t’attends... je m’inquiète. On dit que les rues s’animent qu’il y aura du bruit demain, Dimanche. Avoir à trembler au moment de tant de joie ! C’est abominable. Je voudrais partir avec le fidèle, ah quel plaisir ! mon ami, tu viendras chez moi tout de suite ; à moins que tu n’arrives avant 10 heures du matin ou après 10 1/2 du soir il faut venir chez moi tout droit. Il faut que je te parle avant que tu n’en vois d’autres. Viendras-tu dimanche ? Je t’ai écrit a Calais que je t’attendrai tout le jour. Ton couvert sera là, ne me laisse pas dîner seule. Mon cher bien aimé, que nous serons heureux, que je t’aime, que je t’aime ! Quelle pauvre affaire que ces paroles là écrites ! Comme je le les dirai ! Viens mon bien aimé. Je ne saurais te parler de rien dans ce moment-ci, je ne veux pas sortir de mon style intime. Le fidèle t’entretiendra de tout. Moi je regarde tes yeux, je touche ta main, tes lèvres. Mon ami, mon bien aimé, ah quel adieu je t’envoie là. Mon cher bien aimé adieu. Je tremble de plaisir adieu.
Vendredi 6h 1/2
Il faut que je vous dise un mot plus grave. Je vous conjure de ne point vous presser d’accepter ; avant de laisser soupçonner votre résolution demandez à tout savoir à tout voir ; la situation est bien difficile, vous ne devez pas reculer s’il faut du courage mais vous ne devez pas non plus aller trop vite et vous donner l’air d’un homme avide d’un portefeuille. Je trouve une situation analogue à celle du duc de Broglie bonne. Du pouvoir sans responsabilité cela n’est peut être pas possible maintenant, je ne sais pas, je ne sais rien, je veux seulement que vous n’agissiez et n’acceptiez qu’avec pleine connaissance de cause. Je vous dis tout cela dans la crainte que votre arrivée ne soit à une heure indue pour moi et que vous vous trouvez envahi par les autres avant de m’avoir vue moi. Je ne sais que désirer ou que craindre, je suis très troublée.
Tout me fait peur, si je ne vous aimais pas, je trouverais ce moment bien intéressant. maintenant, je voudrais la tranquillité, la paix du cottage, votre amour, le mien, rien que cela, ah mon ami c’est là le vrai bonheur ! Et nous n’y arriverons jamais. Adieu. encore mon ami, mon bien aimé, chéri, adoré. Adieu.
Il ne faut pas que j’oublie de vous dire que déjà Appony soutient que les puissances alliées seront très disposées à s’arranger sur des bases plus larges puisque Thiers n’y est plus la diplomatie est cependant, dans un bien grand trouble mon ambassadeur envoie un courrier demain, il ne sait rien ; il ne sait que dire. Sinon que Thiers n’y est plus jamais je n’ai vu de si pauvres diplomates, nous en rirons un peu, quand vous aurez à faire à eux ! Adieu. Adieu mon bien aimé le plus aimé des mortels. Adieu.
Samedi je croyais avoir à remettre ma lettre hier au soir au lieu de cela il ne part que ce matin. Je me lève de meilleure heure pour le recevoir et pour te dire encore deux mots. encore deux mots. Brignoles est venu hier au soir il venait de dîner aux finances avec M. de Broglie, on a beaucoup parlé de vous. Broglie a dit qu’il était certain que vous n’accepteriez pas ! J’ai trouvé moyen de faire redire cela à M. de Brignoles deux fois pour en être plus sûre. Cela ne va pas du tout avec les très bons propos que Broglie a tenu hier au fidèle. Le mauvais propos est de plus fraîche date. M. Pelet de la Lozère a dit qu’il ne voyait aucune raison pour que vous n’accepteriez pas car le Cabinet ne se retirait que pour un fait qui vous est inconnu et étranger, un paragraphe du discours. Vous n’en êtes pas responsable. Tout le monde se demande et tout le monde me demande ce que vous allez faire. J’ai une seule et même réponse pour tous sans exception. Je ne sais pas. Je serais bien aise que vous adoptassiez cela aussi pour les premiers moments avant d’avoir bien reconnu votre terrain. Peut-être poussé- je trop loin la prudence dans des conseils que je vous donne, cependant je ne crois pas, regardez bien et puis décidez.
Le duc de Noailles qui est accouru hier de la campagne et pour quelques heures seulement, affirme que vous accepteriez que vous devez accepter. Le pressentiment est général qu’il y aura une émeute, que Thiers y compte. Il se tient toujours à Auteuil. Le Roi rentre aujourd’hui pour rester aux Tuileries. Le vent a soufflé bien fort cette nuit. Je me suis inquiétée pour la traversée de Douvres à Calais, je n’en ai pas dormi. Vous passez. peut-être dans ce moment. 1 heures. Cher bien aimé demain demain, que le Dimanche est un beau jour. Le 30 août était un dimanche, demain huit semaines révolues, depuis que nous nous sommes donnés bien solennellement l’un à l’autre, pour cette vie, pour l’éternité ! Adieu mon bien aimé chéri. Adieu.
Encore, encore je ne puis pas te quitter, un baisir, mon bien aimé, un baiser. Ah si tu savais ce que j’éprouve en traçant ce mot, mon aimé, mon aimé, je te sens si près de moi, si près. Viens mon bien aimé.
447. Windsor Castle, Vendredi 23 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je ne pars d’ici qu’à une heure. La Reine me donne à midi et demie mon audience officielle de congé. Si je ne savais ce que vaut le mot chagrin, je dirais que la mort soudaine de ce pauvre lord Holland a été hier un chagrin pour moi. Si bon et si aimable ! Et si seul de son espèce dans Londres ! Et je m’intéresse vraiment à lady Holland, beaucoup plus spirituelle, et plus amie que presque toutes. Savez-vous que je suis choqué, vraiment choqué de indifférence avec laquelle cette nouvelle a été reçue autour de moi ? Personne j’en suis sûr, n’y a pensé autant que moi. Ils passaient tous leur vie chez lui depuis 30 ans. Décidément cette race-ci est personnelle et dure. J’ai entendu de nos vieux soldats parler de leurs camarades qu’ils avaient vus tomber à côté d’eux sous le canon, c’était plus tendre.
Et puis il y a dans la froideur forte de ces gens-ci, une certaine acceptation brutale de la nécessité des coups du sort. Ils sont dans la vie comme dans la foule ; ils ne regardent seulement pas celui qui tombe. Ils passent. On dirait qu’ils mettent leur dignité à ne se montrer quoiqu’il arrive, pas plus surpris qu’affligés. Mais leur dignité ne leur coûte. rien du tout. La grande, la belle nature, humaine est plus riche, plus expansive. Elle trouve plus abondamment dans les événements et sur les personnes de quoi penser et s’émouvoir. Et quand elle gouverne ses pensées et ses émotions. On voit qu’elle y prend vraiment quelque peine. Ces gens-ci ont l’air de comprimer ce qu’ils ne sentent pas. Politiquement, je regrette beaucoup lord Holland. Il n’avait pas autant d’influence que j’aurais voulu. Mais il en avait plus qu’on n’en convenait. La désapprobation de Holland house gênait beaucoup, même quand elle n’empêchait pas.
Londres 4 heures et demie
J’arrive. La Reine ne m’a donné mon audience que tard. J’ai à peine le temps de fermer ma lettre. J’en ai plusieurs à fermer, et indispensables. Je pars toujours après-demain. Je serai toujours à Paris, le 28 au soir. Il n’est pas du tout nécessaire d’y être le matin. Je serai à la Chambre le 29. Rien ne commence que le 29. Je ne fais absolument que passer par la Normandie pour y prendre mes enfants. Je ne resterai pas 18 heures chez moi. Cela n’a aucun inconvénient. Si je partais par Douvres des Calais, j’arriverais à Paris 20 heures plutôt. C’est tout-à- fait indifférent....politiquement.
Adieu. Adieu. Il faut absolument que je vous quitte votre grande lettre est très bien. Rien à changer du tout. Adieu. Adieu. Bientôt plus d’adieu.
446. Windsor Castle, Jeudi le 22 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce n’est pas la musique seule, c’est tout qui ajoute à hier à cinq heures, j’étais sur la route de Windsor. Le soleil se couchait devant moi brillant, pompeux, inondant l’horizon de lumière, comme pour nous charmer de tout son éclat avant de nous quitter. Je roulais rapidement vers lui, comme pour aller à lui. L’envie m’a pris d’y aller en effet, de sortir de notre terre, de traverser l’espace, d’aller je ne sais où, goûter je ne sais quels plaisirs, pénétrer je ne sais quels mystères. Et ce mouvement de mon imagination, m’a porté vers vous. Je vous ai appelée ; je vous ai prise avec moi. Et tous mes désirs se sont concentrés en un seul désir : partons, dans un baiser, pour un monde inconnu.
Pendant que je vous proposais de partir le soleil s’est couché. La nuit est venue. Le froid avec la nuit. J’ai fermé, ma calèche. Je m’y suis enfoncé, au lieu de m’élancer dans l’espace. Vous étiez là aussi, encore plus près de moi. Et le fond de ma calèche est devenu plus charmant que le monde inconnu auquel j’aspirais. Et ce matin, dans ce château de Windsor en sortant de mon lit je retrouve en vous écrivant, mes impressions d’hier. Elles me charment encore. Sans vous, si vous n’y aviez pris place, elles se seraient évanouies comme les rayons du soleil, comme les ombres de la nuit. Mais vous les avez transformées en ..... Je ne les oublierai jamais.
Personne ici que lord Melbourne, Lord Palmerston, Lord et Lady Clarendon et moi. On est très aimable pour moi, un peu par estime et par goût, je m’en flatte, un peu aussi parce que je vais à Paris. On désire que j’y sois bien pour ici, que je parle bien des personnes. On me voudrait facile pour les choses. On voit bien que l’avenir, et un avenir prochain est plein de chances. On en est occupé, occupé comme on l’est de tout ce qui n’est pas l’Angleterre elle-même ; assez occupé pourtant. On a traité la France légèrement ; mais sa malveillance importune. On sait que tôt ou tard, pour les affaires son influence pèse ; pour les réputations son opinion compte. On voudrait la calmer, l’amadouer.
Si je pouvais faire comprendre à mon pays ce que je comprends, et lui faire adopter la conduite et le langage. Que je sais bien, je crois qu’il n’aurait pas à s’en repentir. Mais ce serait trop bien pour que ce soit possible. Midi Je reviens de déjeuner. Lady Littleton est la dame in waiting. Elle a assez d’esprit. J’en trouvé bien des gens le premier jour, ou la première heure, comme vous voudrez. Je crois vraiment que bien des gens en ont pour un jour, pour une heure et je m’y laisse prendre encore quelques fois.
La Reine est toute ronde, aussi grasse que grosse. Malgré la princesse Charlotte et la Reine de Portugal, je ne la crois pas inquiète de ses couches. Je ne la crois inquiète de rien. Elle me paraît prendre la vie lestement et sensément, l’esprit gai, le caractère résolu, le cœur pas très vif. Elle reviendra à Londres vers le 15 novembre. Il est décidé qu’elle n’accouchera qu’en décembre.
On chasse ce matin, lord Melbourne et lord Palmerston n’en sont pas plus que moi. Dans la matinée, j’irai causer avec eux.
Comme nous causerons nous ! Quelle profanation de parler de ces conversations. Là à propos d’aucune autre ! Oui, je suis content de votre foi, de votre rire, de vos réponses à mes questions. Mais je prends en grand mépris tous les contentements de loin. Il n’y paraît pas, car je bavarde comme si j’étais prêt comme si je ne songeais à rien de plus. Je songe à beaucoup plus. Je songe à tout. Que c’est beau tout ! Il n’y a que cela de beau. Ne trouvez-vous pas que j’ai un bon caractère ? Trop bon, je trouve. Je suis très ambitieux et très facile, insatiable et prompt à jouir de ce que j’ai malgré ce qui me manque. Il en résulte quelquefois que trop aisément on me croit content et qu’on ne s’inquiète pas assez de me contenter. Il faut qu’on s’inquiète. J’inquiéterai. Certainement pas vous, si je croyais avoir besoin de vous inquiéter, vous ne seriez pas pour moi ce que vous êtes. Je vous dirai mon secret. Avec tout le monde, ma facilité tient à l’insouciance. Avec vous, à la confiance. 2 heures J’attends M. Herbet qui doit m’apporter mes lettres. Il ne vient pas. Je fais partir ceci. Adieu. Adieu. L’heure me presse.
460. Paris, Jeudi le 22 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Le brave homme que Simon ! J’ai votre lettre déjà. Ce que j’ai écrit le 30 août ? J’ai vite ouvert mon livre et j’y trouve ces deux mots rien que cela grand jour (souligné) quelques jours auparavant. Il y avait une autre note (la 25) ; venez la lire, deux mots aussi Je ne veux pas les répéter.
Votre lettre hier m’est arrivée tard. Voilà donc les jours figés. Votre lettre d’hier, celle aujourdhui. Une charmante aujourd’hui si fière, si haute, si décidée. Je vous remercie d’être fier, d’être haut, d’être décidé. Je vous remercie de tout, savez -vous de quoi je ne vous remercie pas ? C’est de vous embarquer à Londres pour le Havre, à la fin d’octobre. Vous n’avez donc jamais eu quelqu’un que vous aimez sur mer ? Vous n’avez jamais su ce que c’est que l’angoisse qu’on éprouve de loin, au moindre souffle. Et bien vous me trouverez malade j’en suis sûre car pendant vingt heures je tremblerai au moindre nuage, et si le vent s’élève mon dieu dans quel état je serai! Ne pourriez-vous pas m’épargner cette angoisse. Pourquoi faut-il ce détour. Et s’il le faut absolument pourquoi ne pas prendre par la terre, aller débarquer à Calais à Boulogne, je n’aurai pas peur, mais 20 heures de mer dans cette mauvaise mer ! Mon Dieu, si vous pouviez me faire ce sacrifice, si je pouvais croire que mes paroles seront entendues ! J’ai vu l’alerte de hier matin, j’ai été bien animée, bien furieuse, le soir le petit est revenu plus rassuré et je l’ai été aussi.
J’ai été chez les Appony c’est leur jour. Lord Granville revenait de St. Cloud ; les ministres y étaient, on allait tenir un conseil important sur le discours de la Couronne, il décidera sans doute. La situation du Cabinet Tout le monde a l’air d’attendre une crise ministérielle. J’ai vu M. Molé aussi hier au soir, le visage allongé, inquiet, préoccupé ; reprenant au moindre petit mot qui pouvait avoir un air d’encouragement Je me suis très certainement divertie à ses dépends, il ne s’en est pas douté. Je lui ai fait quelques questions banales, il n’avait pas encore vu M. de Lamartine. On me dit que le Maréchal Soult était revenu radieux d’un premier entretien avec le Roi.
Je ne sais plus ce que je vous dis tant je suis heureuse, heureuse ! Et inquiète de cette longue navigation. Hier après mon dîner je suis restée trois quatre d’heures. couchée rêvant le bonheur qui m’attend, mais le rêvant si vivement, si vivement ! Non, la réalité ne peut pas être si charmante. Et plus j’y pense, plus je tremble ; je tremble de tout ce qui peut se placer encore entre ici et mercredi. Mercredi est la soirée des Appony, Je ne reçois pas, je serai donc chez moi seule. A quelle heure viendrez-vous ? Ah quelle parole ! J’en frémis de plaisir.
Je viens de recevoir une lettre du Roi de Hanôvre par Kielmansegge il craint la guerre, il donne raison à lord Palmerston, il me recommande un monsieur Stockhausen qu’il nomme son représentant ici. Les Ambassadeurs sont un peu agités et un peu curieux de ce qui va arrivé ici. Aucun d’eux cependant ne croit la retraite de Thiers possible Le Siècle l’annonce aujourd’hui comme imminente. Je vous prie de donner rendez- vous au fidèle quelque part. C’est très nécessaire. ¨Pourquoi ne venez-vous pas droit ? Comme cela eût mieux valu. Mais enfin en venant autrement ne pourriez- vous pas aller débarquer à Calais ? Ah mon Dieu que je serais plus tranquille. J’attends pour fermer ceci quelque nouvelle de la matinée. il est 1 h 1/2.
2 heures. Personne ne vient. Comment il faut finir sans plus et voici ma dernière lettre à Londres ! Quel bonheur, cependant comme le cœur me manque quand je songe à cette longue traversée. Pourquoi me donnez-vous ce chagrin ? Quelle angoisse dimanche, quelle angoisse toute la nuit et lundi encore, et quand saurai-je où vous êtes? Ecrivez-moi un mot par la poste directement à mon adresse en débarquant, je l’aurai mardi à mon réveil, mais d’ici là c’est-à-dire de dimanche à mardi quelles heures d’angoisse. Adieu. Adieu.
Je suis sûre que vous ne souffririez pas que je m’embarque pour le Havre. Pourquoi voulez- vous que je le souffre ? Et votre courage ou le mien ne peuvent rien contre la mer. Ah si j’étais là je me jetterais à vos genoux, pour vous supplier de ne pas vous livrer à cette longue navigation et vous m’écouteriez, et bien écoutez-moi prenez par Calais, de là allez au Val-Richer si vous voulez. Aimez moi même un peu moins si cela vous est possible, Mais ne vous exposez pas, ne me rendez pas malade de terreur. Ah si en réponse à ceci Lundi vous me diriez Je vais par Calais, que je vous aimerais mille fois davantage. Adieu, adieu, adieu. Quel adieu que le premier adieu à Paris !
P. S. Voilà le fidèle. Je sais tout, vous n’irez pas au Havre vous viendrez par Calais, Dieu merci, Dieu merci. Arrivez vite. Pour plus de sûreté Voici les nouvelles. Le ministère a donné sa démission on vous a envoyé chercher par télégraphe, ne perdez pas de temps. Venez, venez. Le fidèle ira demain soir à Beauvais pour vous attendre. Quel bon adieu. Je vous écrirai à Calais à l’hôtel Dessein.
445. Londres, Mercredi 21 oct. 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
La première partie de la soirée d’hier a été très pénible. Ce bruit d’un nouvel attentat et d’un attentat plus efficace, contre le Roi, était fort répondu. Je n’y croyais point. Je n’en pouvais découvrir la source. Mais enfin, il était fort répandu. Un courrier m’est arrivé à 10 heures, qui m’a donné des nouvelles de Paris, lundi à 4 heures. J’ai été rassuré.
On dit que la poste à encore manqué ce matin. Celle de dimanche, qui était en retard est arrivée; mais non pas celle de lundi. C’est bien ennuyeux. Voilà la poste de Dimanche, et un 456, charmant, quoique trop court. Je serai court aussi, car voilà en même temps des dépêches auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Et je pars à 4 heures pour Windsor. La Reine ne se contente pas de me donner une audience de congé. Elle m’a invité pour aujourd’hui et demain. Je reviendrai vendredi matin. C’est une très bonne grâce qui me mettra en grande presse vendredi et samedi. Mais rien à présent ne va aussi vite que je le voudrais.
Je ne crois pas que l’ouverture des Chambres soit retardée quand je n’aurais pas pour aller à Paris, des motifs sans réplique, je pourrais quitter Londres sans inconvénient dans le moment. Rien ne s’y passera jusqu’au retour des réponses de Constantinople, ou jusqu’à l’arrivée des événements en Syrie. Et pour les événements en Syrie, c’est à Paris qu’ils font le grand effet, et qu’il convient d’être pour en diriger l’effet ; si on le peut. Je n’ai donc, quant aux affaires même de ma mission, pas le moindre scrupule. Et j’ai vraiment confiance, dans Bourqueney
3 heures
Mes dépêches sont écrites. Je partirai tout à l’heure. Adieu. Je vous écrirai demain de Windsor. J’attends avec impatience les lettres que vous m’annoncez. Comment puis-je parler d’impatience pour quelque chose. Adieu. Adieu. Plus de lettre à Londres. Ecrivez-moi au Val-Richer. J’y serai lundi matin. Le petit y viendra. Donnez-lui quelque chose pour moi. J’y compte. Et vous dire avec quel sentiment je compte, cela ne se peut pas ; cela ne se dit pas. Adieu. Adieu.
459. Paris, Le 21 octobre mercredi 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Il faut que je commence par vous parler de votre arrivée. j’ignore à quoi vous vous serez décidé pour le jour, mais quel que soit celui-que vous choisir, il me parait impossible que vous ne veniez pas droit à Paris. Votre absence de votre poste dans ce moment pour 24 h. seulement doit avoir un motif impérieux. Ce motif c’est la Chambre. Lors donc que vous quitterez Londres ce doit être pour vous rendre à Paris en droiture. Soyez sûr que j’ai raison la dedans.
Prévenez le fidèle et ordonnez lui d’aller vous trouver à Calais ou plus près sur la route. Donnez lui un rendez-vous précis. Il lui faut quelques heures de conversation avec vous avant que vous tombiez dans cette Babylone. C’est absolument nécessaire. Vous viendrez dîner chez moi le jour de votre arrivée n’est-ce pas ? Concevez-vous le plaisir que j’ai à tracer ces simples mots !
On dit que Thiers a accueilli comme ci, comme ça le communication que Lord Granville lui a faite hier de la réponse anglaise à la note du 8. Il a dit : " On reste toujours dans le même. cercle de difficultés puisque l’Angleterre met pour condition la soumission immédiate du Pacha." Le dire de Thiers aux ambassadeurs est que si la négociation traîne en longueur, on aura la guerre au printemps ; voilà cependant une modification car auparavant on l’avait tout de suite. Il s’était d’abord fâché beaucoup de la défense prussienne pour la sortir des chevaux ; hier il a été plus doux sur cela, et a dit : " Ce n’est pas poli, ce n’est pas amical, mais nous en trouverons ailleurs. "
J’ai vu hier les Granville le matin, Werther ; le soir Appony & mon ambassadeur. Je me couche toujours à 10 heures, je vais prendre de meilleures habitudes. Mad. de Castellane est venue hier s’établir à Paris. On arrive, et vous trouverez Paris plus gai que Londres. Envoyez je vous prie cette lettre. Midi. La vôtre ne vient pas encore. Toujours si tard le mercredi ! Je suis charmée des articles de journaux anglais sur le coup de Carabine, il n’y a pas eu un journal français qui ait parlé avec autant de vérité et de convenance. Ici on ne s’entretient plus du tout de cet événement. Le lendemain on n’en parlait plus.
La saisie d’écrits de M. de Lamenais me fait grand plaisir. Je pense que cela étonnera en bien. C’est un bien grave événement pour vous que l’abdication de Christine. Est-il vrai que votre ambassadeur n’ait été accrédité qu’auprès d’elle ?
2 heures. Pas de lettre et personne, pas même le fidèle. Qu’est-ce que cela veut dire. Et il faut fermer ceci, je suis bien impatiente ; au reste je ne suis plus impatiente que d’émotion ; le jour, le four où je vous reverrai ! Si c’est avant, vous serez surement ici mercredi, si après, ce ne sera qu’en novembre. Je vous ai déjà dit que je trouverai bien choisi ce que vous choisirez. Ce n’est pas moi qui vous appelle un jour plutôt. Il ne faut pas penser à moi du tout. Il faut faire ce qui est bien, ce qui est convenable. Il y a peut-être bien de l’habileté aujourd’hui, et bien de la difficulté à rester dans ces conditions là. Encore une fois je ne sais pas décider, ou si j’y pense c’est presque pour opiner pour le retard. Qu’est-ce qui fait donc que je retombe plus naturelle ment sur ce qui me contrarie la plus ? Serait-ce là le vrai. Je ne sais pas, je suis très combattu. Sans doute vous êtes déjà décidé. Ah que je me résignerai avec transport à avoir tort.
Adieu. Adieu. Je n’aime jamais vous envoyer deux opinions si incohérentes. Aussi n’est-ce pas une opinion. Seulement je bavarde, je bavarde, sur ce qui est toujours dans ma tête. Le fidèle serait bien mécontent de moi s’il savait ce que je vous écris. Il est très brave le fidèle, et il a vraiment beaucoup d’esprit. En définitive pour ces choses là je suis convaincue que son avis vaut mieux que le mien. Adieu. Adieu L’aiguille avance, rien n’arrive. Il faut finir mais par un adieu charmant.
458. Paris, Mardi 20 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
458. Paris mardi 20 octobre 1840,
9 heures
Puisque vous êtes inquiet de ma lettre à mon frère, je vous en envoie copie, et je vous préviens qu’elle ne part que samedi ou dimanche, par conséquent votre réponse à ceci m’arriverez avant. Lisez, je la trouve bien, la trouve absolument nécessaire. Ma belle-sœur m’appuie, l’occasion est bonne, Dites-moi votre avis. J’ai dîné hier chez mon Ambassadeur. Je n’ai pas pu le lui refuser c’était un dîner de famille Appony, & Benckendorff. J’y ai revu Zuglen, il repart et revient bientôt pour résider ici en place de Fagel. C’était très différent de Fagel ! De chez M. de Pahlen, j’ai été chez Lady Granville. M. de Broglie en sortait, il avait dit à Granville que vous serez ici le 26, qu’il regrettait que vous n’eussiez pas remis cela de quelques jours, qu’il aurait mieux valu attendre que l’élection du président fut passée ! J’ai vu le matin Mad. de Flahaut. Elle trouve que le ministère de Thiers est bien orageux, que tous les guignons sont venus l’accabler, elle dit beaucoup cela. Et puis elle s’inquiéte, elle dit que la gauche est impatiente il n’y a pour elle aucune faveur, elle sont toutes aux doctrinaires. Elle parle plutôt avec tristesse qu’avec passion.
Mais elle est venue sur l’Angleterre c’est-à-dire sur la portion du ministère qui a amené la rupture avec la France. J’ai donc lu la note du 8 octobre. Je suis ravie de la trouver si pacifique, mais je ne puis pas ajouter que je la trouve brillante. ni pour la forme, ni pour le fond Je ne le des pas mais je le pense.
Je suis trop heureuse de tout ce qui ajoute aux chances de paix. et généralement ceci est regardé comme rendant la guerre impossible. J’irai peut-être jusqu’à trouver ou jusqu’à dire que la note est très belle ! Savez-vous que je crois que je rêve quand je pense que je suis à si peu de jours de tant de bonheur ! Je ris de plaisir et puis je joins les mains, je remercie Dieu, et je le prie. Vous faites comme moi, j’en suis sûre. M. le conte de Paris est très mal on ne croit pas qu’il en revienne. Je ne vous dirai jamais assez combien j’ai trouvé votre lettre à 62 admirable donnez m’en une copie je vous en prie. Je n’ose pas la demander au fidèle sans votre permission. Permettez-lui. Il y en a deux autres aussi belles, si elles ne le sont pas plus encore, à ce qu’il me dit, que je n’ai point lues. Permettez. La Diplomatie dit beaucoup qu’il y a danger imminent, terrible, si Thiers sort du Ministère. Ils sont effrayés à mort ces pauvres gens. Thiers rentre en ville aujourd’hui. Le Roi pas avant le 26, à ce qu’on dit.
2 heures. Voici le petit auquel je donne ma lettre. Je n’ai rien à ajouter. Certainement la crise y est. Dans la semaine il peut y avoir quelque chose. Etes-vous bien décidé ? Quel jour ? Quel que soit ce jour, il sera beau, il sera ravissant. Adieu. Adieu. Mille fois adieu.
444. Londres, Mardi 20 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
Je ne sais si je vous ai bien dit le motif qui m’avait décidé à être à la chambre le 29. On ne me fait pas faire les choses en me défiant. Mais quand j’ai vu qu’on voulait que je n’y fusse pas pour la présidence, puisque je n’y fusse pas pour l’adresse, puisque j’eusse à enfoncer, mon épée jusqu’à la garde, soit pour, soit contre, je me suis demandé ce que signifiaient toutes ces exigences, et pourquoi j’y céderais. Je ne sais à Paris contre personne. Je ne suis ici et ne serai là dans aucune intrigue. Je ne dirai, je ne ferai rien là qui ne soit en parfaite harmonie avec ce que j’ai dit et fait ici depuis huit mois. J’ai secondé le Cabinet sans me lier à lui Je ferai de même. Je lui ai dit, à son avènement, que je serais avec lui, loyal et libre ! Je serai loyal et libre. Je lui ai dit que je garderais mes amis sans épouser leur humeur. Je le ferai, comme je l’ai fait. J’ai fait, le premier jour, sur mes anciennes amitiés sur notre séparation le jour où notre politique différerait ; toutes les réserves que je pourrais vouloir aujourd’hui. Pourquoi me gênerais-je ? Pourquoi donnerais-je à ma conduite un air d’embarras et d’hésitation ? Je n’en veux point. Il n’y a pas de quoi ni dans le passé, ni dans l’avenir. Je veux prendre ma position simplement, ouvertement, rondement, toute entière. Je suis député avant d’être ambassadeur, et je tiens plus à ce que je suis comme député qu’à ce que je suis comme ambassadeur.
La session s’ouvre. Je demande et on me donne un congé pour l’ouverture de la session. J’y serai de même que je ne machinerai rien, de même je n’éluderai rien. J’agirai comme député selon ma raison, ma position, mon passé. Je parlerai comme ambassadeur, selon ce que j’ai pensé, fait ou accepté depuis que je le suis. Je crois que cela peut très bien se concilier. Si cela ne se peut pas, je m’en apercevrai le premier. Je serai prêt, selon le besoin à seconder ou à me démettre, loyal pendant, libre après. Je serais bien dupe de m’imposer, pour satisfaire aux méfiances ou aux embarras des autres, une contrainte qui n’a en moi-même, pas le moindre fondement. J’accepterai hautement les difficultés de ma propre position. Je n’accepterai aucune des difficultés de la position d’autrui.
Parlons d’autre chose, Je viens de voir lady Palmerston, toujours gracieuse et embarrassée. Je crois qu’elle doit avoir beaucoup plus d’esprit avec son mari qu’avec personne. L’arrangement, le calcul ôte plus d’esprit qu’il n’en donne. Quand on en a, on n’en a jamais autant que dans l’abandon. En revenant de chez lady Palmerston, j’ai fait mes adieux à Stafford house. J’ai été exprès, sur la petite place, devant la porte. Reverrai-je cette maison ? Reverrai-je Londres? L’avenir est bien obscur. Le mien notamment. Quelqu’il soit, j’aimerai Stafford house.
Dites-moi ce que vous avez écrit sur votre long petit livre de Memoranda sous la date du 30 août. La réponse de la Reine pour mon audience de congé n’est pas encore arrivée. Je suppose demain ou après demain. La Reine reçoit, vers 6 heures. On dîne et on couche à Windsor. J’ai bien des petites choses à faire d’ici à dimanche. Qu’il y a de petites choses dans la vie ! Par exemple, je vous quitte pour des comptes. J’ai beaucoup d’ordre. Adieu. J’aime bien adieu. J’aime bien mieux oui.
443. Londres, Lundi 19 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous recevrez ceci Mercredi 21 et le Mercredi suivant 28, dans la soirée, vous me recevrez à mon tour. Je partirai dimanche 25, pour le Havre. J’y arriverai le 26, entre 5 et 8 heures du matin. J’en répartirai sur le champ et j’irai dîner au Val Richer. Je partirai du Val-Richer, le 27, dans l’après-midi avec tous les miens, pour aller coucher à Lisieux ou à Evreux, et le 28 au soir je serai à Paris. Ainsi, le mois d’Octobre n’aura pas menti. Personne, personne pas même vous, pas même moi, ne sait combien, il sera beau. Qu’est-ce que l’attente auprès du bonheur ?
J’ai reçu hier mon congé, dans une lettre particulière de Thiers, de très bonne grâce. Je serai à la Chambre le 29. Je ne manquerai qu’à la séance royale. Je crois que je comprends bien ma situation. et que j’y satisferai pleinement en tous sens. Elle a des embarras, des convenances, des intérêts, des devoirs fort divers. Je n’en éluderai aucun. Pour ma pleine confiance il faut, à mon jugement l’adhésion du vôtre. Que de choses à nous dire ! Ce nouvel assassinat ne m’a pas surpris. Je le pressentais. C’est une rude entreprise que de rétablir de l’ordre et de la raison dans le monde. Aujourd’hui tous les scélérats sont fous et tous les fous sont prêts à devenir des scélérats. Et les honnêtes gens ont à leur tour une folie, c’est d’accepter la démence comme excuse du crime. Il y a une démence qui excuse ; mais ce n’est pas celle de Darmer et de ses pareils. On n’ose pas regarder le mal en face et on dit qu’ils sont fous pour se rassurer. Et pendant que les uns se rassurent lâchement d’autres s’épouvantent lâchement. Tout est perdu ; c’est la fin du monde. Le monde a vu, sous d’autres noms, sous d’autres traits bien des maux et des périls pareils, égaux du moins sinon passifs, pour ne pas dire plus graves. Nous avons besoin aujourd’hui d’un degré de bonheur, et de sécurité dans le bonheur dont le monde autrefois. n’avait pas seulement l’idée. Il a vécu des siècles bien autrement assailli de souffrances, de crimes, de terreurs. Il a prospéré pourtant, il a grandi dans ces siècles là. Nous oublions tout cela. Nous voudrions que tout fût fait. Non certainement tout n’est pas fait ; il y a même beaucoup à faire encore. Mais tout n’est pas perdu non plus. L’expérience, qui m’a beaucoup appris, ne m’a point effrayé ; et moi qui passe pour un juge si sévère de mon temps; moi qui crois son mal bien plus grave que je ne le lui dis, je dis qu’à côté de ce mal, le bien abonde, et qu’à aucune époque on n’a vécu, dans le plus obscur village comme dans la rue St Florentin, au milieu de plus de justice, de douceur, de bien être et de sûreté.
J’écrirai aujourd’hui au Roi. On me dit qu’il a pris ceci avec son sang-froid ordinaire, triste pourtant de voir recommencer ce qu’il croyait fini. Le Morning Chronicle parle de lui ce matin est termes fort convenables. 2 heures Rien encore. J’y compte pourtant toujours. La poste est venue tard. Et vous ne prenez pas le plus court chemin pour venir à moi ; je suis encore plus impatient le lundi qu’un autre jour. Le dimanche est si peu de chose ! Enfin, je n’ai plus qu’un dimanche.
Lord Palmerston a demandé pour moi à la Reine une audience de congé. Je l’aurai Mercredi ou Jeudi Ne dites rien du jour de mon arrivée. Sachez seulement que je viens pour le début de la session.
Adieu. Adieu. 4 heures
Voilà 455. Excellent. Ce que j’aime le mieux ; confiant, comme l’enfance; profond, comme l’expérience. Un sentiment, n’est complet qu’avec ces deux caractères. Et il n’y a de bon, il n’y a même de charmant qu’un sentiment complet. Au début de la vie on peut trouver, on trouve du charmé dans des sentiments auxquels à vrai dire, il manque beaucoup. On sait pas ce qui y manque ; on jouit de ce qui y est sans regretter, sans pressentir ce qui n’y est pas. Quand on a vécu, quand on a mesuré les choses, on veut la perfection ; on ne se contente pas à moindre prix. Et là où on ne trouve pas tout, on ne se donne pas soi-même tout entier. Je n’ai jamais été si difficile et si satisfait.
Je n’ai pas encore les détails de la métamorphose que vous m’indiquez. Ils m’arriveront, je pense dans la journée. Cela, je puis l’attendre patiemment. Je serai fort aise de la métamorphose et pas sûr, après quelques épreuves, je finis par accepter les vicissitudes de certaines relations comme celles des saisons ; en hiver, j’espère l’été ; en été je prévois l’hiver ; le ciel pur ne chasse point le brouillard de ma mémoire, ni le brouillard le ciel pur. Je me résigne à ce mélange imparfait et à ses alternatives. Triste au fond de l’âme, mais sans injustice et sans humeur. Ou plutôt ce qui s’est montré à ce point variable et imparfait ne pénètre plus jusqu’au fond de mon âme. Je le classe dans ce superficiel qui peut être grave comme vous dîtes, et influer beaucoup sur ma destinée mais qui ne décide jamais de ma vie. Adieu. Oui, adieu comme nous le voulons.
456. Paris, Dimanche 18 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Vraiment la musique ajoute bien à... ( Trouvez le mot ) et je crois moi qu’en Italie on doit savoir mieux amer qu’autre part. Hier aux Italiens j’étais comme vous à votre fenêtre, c’était si doux ; si charmant, si enchanteur, mes pensées étaient si tendres. Venez, venez dans ma loge. Serait-il possible que dans quelques jours vous y soyez ? Quel bonheur.
J’ai vu fort peu de monde. hier. Les Granville, ignorants ; Mad. de Flahaut inquiète de la situation du ministère. Disant qu’il faut qu’il se renforcé à droite pour avoir la droite, ou plus sincèrement une portion de la droite. à gauche pour s’affectionner davantage ce parti, et c’est ce qu’elle conseille, car après tout c’est les doctrinaires qui ont les bonnes places, les grandes places et les vrais amis n’ont rien ! Voilà ; et puis les Doctrinaires ne sont pas ralliés. Il pérorent dans les salons, ils frondent & &
Aux Italiens il n’y avaient personne. Toute la diplomatie était à Auteuil. les bruits de retraite de M. Thiers circulent, mais on dit assez généralement dans le monde qu’on les fait circuler, et qu’il n’y a rien de vrai. On dit aussi, c’est 18 qui me le dit que le Roi n’accorderait pas à M. Thiers de se retirer, qu’il le sait positivement ; car il y aurait dans ce fait trop de danger pour le Roi. On dit beaucoup aussi que l’ouverture des Chambres sera retardée. Je crois, que cela ferait un mauvais effet, c’est ce qui me fait en douter.
Midi, à ma toilette, je vous regarde toujours comme vous avez le droit d’attendre que je vous regarde. Voici du nouveau aujourd’hui. Je me suis surprise à rire en vous regardant. Connaissez-vous ce rire, du plaisir, le rire du bonheur ? C’était celui-là ce matin puisque je vous dis des bêtises il est clair que je n’ai rien à vous dire. Je n’ai pas de lettres encore.
Adieu, vous trouverez ceci trop court, je le trouve aussi, mais savez-vous que je suis accouchée d’une grande et d’une petite lettre ce matin à mon frère. Toutes deux le même sujet. Je vous les enverrai. J’attends ma belle sœur pour les lui lire. Adieu. Adieu, le plus charmant adieu.
457. Paris, Dimanche 18 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu votre lettre après le départ de la mienne. Vous voulez que je vous dise plus, que je vous dise ce que je pense sur le moment de votre arrivée. Mais vraiment je crois vous l’avoir bien dit. Si vous n’êtes pas ici pour l’ouverture, et l’élection du président. Il faut être à Londres, cela est bien sûr. Ce point-là est l’essentiel, mais c’est à vous à juger si vous devez être absent ou présent pour cette élection. Je n’entends rien à cela peut-être ayant une si bonne raison pour vous tenir éloigné dans ce moment là vaut-il mieux ne pas aggraver les embarras ; votre absence remplit ce but ; mais il n’y a que vous qui puissiez juger s’il vous convient de faire à vos rapports avec le ministère le sacrifice des exigences de vos amis. Je retourne souvent cela dans ma tête et je pense toujours sauf meilleur avis que vous pouvez vous dispenser de prendre part. à l’élection. Quant à la discussion de l’adresse vous devez y être, c’est clair à moins de l’impossible, c’est-à-dire que dans ce moment-là vous concluiez vraiment quelque chose de bon, d’avantageux à Londres. Il n’y a que cela pour excuser votre absence. Mais aussi cette excuse serait un triomphe.
Vous êtes tenu autant que possible au courant de tout, voilà ce que m’assure la très fidèle, d’après cela vous pensez conclure. Je fais tous les vœux du monde pour que Dieu vous inspire et vous mène bien. Je sens toute l’importance, toute la difficulté du moment. Il ne faut pas faire de faute. Il ne faut pas vous mettre dans votre tort. Et après avoir dit cela, je sais bien cependant que vous y serez toujours aux yeux des uns ou des autres. C’est inévitable et c’est là ce qui me désole. Voyez-vous voilà quatre pages qui n’ont pas le sens commun, et qui ne vous éclairent pas même sur mon opinion ! Cela valait bien la peine de commencer. Toute ma journée a été prise, et le reste va l’être encore. J’ai eu deux-heures le Duc de Noailles, venu pour la journée, seulement. Je l’ai mené au Bois de Boulogne ce qui ne l’a pas trop diverti mais il voulait causer. M. de Werther longtemps. Ma belle sœur très longtemps. Elle est fort contente de ma lettre et elle l’appuiera. Plus tard mon Ambassadeur content de moi aussi, et est parfaitement d’avis de la lettre M. Molé m’a écrit pour demander à me voire, je lui ai fait dire de venir ce soir je l’attends car voici 8 h 1/2.
Le fidèle sort d’ici, il m’a dit tout ce qu’il vous a mandé ce matin. Je n’ai pas de réplique, et dès que vous avez confiance dans l’avis de M. Bertin de Vaux il faut le suivre. D’ailleurs il m’a rapporté des paroles frappantes, des antécédents que j’avais oubliés, et qui vous obligent de faire aujourd’hui ce que vous avez fait après la coalition, c’est évident : d’ailleurs si, comme le pense M. de Vaux, votre opposition à la présidence de M. Barrot doit au moins se manifester par lettre à vos amis, autant vaut, & mieux vaut venir vous-même. Vous voyez bien que dans tout ce que je vous dis je m’efface tout à fait. Je cherche ce qui est bien, ce qui est honorable pour vous, mon plaisir vient après.
Lundi 8 heures. Ma soirée n’a pas été comme je le pensais. Nous ne nous sommes pas dit un mot M. Molé et moi, nous n’avons pas été seuls un moment. M. de Werther mon ambassadeur, Lord Granville, Brignoles, Tschann, le duc de Noaillles. le Duc de Noailles, Lord Granville n’avait pas l’air aussi content que je l’espérais et que me le faisait croire les lettres de Lady Palmerston reçues hier. M. Molé est encore maigri, il est comme moi maintenant il est très triste et très aigre. Il a vu le roi pendant deux heures samedi. A propos il a dit à 55 qu’on vous avait envoyé votre congé, que vous allez venir. Et que Thiers a dit qu’il serait très bien pour vous si vous êtes d’accord dans le langage à tenir ; mais que s’il y avait la plus petite nuance, il avait dans sa poche de quoi vous accabler. Qu’est-ce que cela veut dire ? L’abdication de Christine racontée hier au soir n’a étonné personne, et puis rien ne fait de l’effet que le Canon en Syrie, et celui là retentit rarement. On est étonné de ne rien apprendre. Lady Palmerston me parait bien couronnée de la publication de la dépêche de M. Thiers immédiatement après la communication que vous en avez faits à son mari. Elle dit que vous vous en défendez, que vous défendez Thiers mais elle accuse nécessairement un Français. Du reste sa lettre est dans un ton très pacifique quoiqu’il y perce de la rancune contre Thiers. Quelle déplorable chose que ces personnalités !
1 heure. Je n’ai encore ni lettre, ni fidèle. Savez-vous qu’on me dit que le muguet est un peu inquiet pour son compte de la menace de 6 ? 2 heures. Voilà votre lettre, et voilà le petit qui m’a tout lu. C’est admirable, admirable, je ne trouve que ce mot, et que ce moment. Je sais que 62 n’adopte pas votre point de vue et vous écrit aujourd’hui comme cela. Je crois l’avis des autres amis plus sincères, comme je le trouve au fond plus logique, il me parait. Mon Dieu je ne sais pas ce qu’il me parait. Choisissez. Je suis une femme. Je ne suis pas brave. Vous le serez. Adieu. Adieu. Adieu.
455. Paris, Samedi 17 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
455. Paris, Samedi 11 octobre 1840,
Oui je suis d’accord avec vous sur tout ce que vous me dites. Prenez ce oui aussi largement que vous voudrez pour le moment, je vous parle de quelque chose de sérieux. Londres vaut mieux que Paris dans les derniers jours du mois, à moins comme vous dites qu’il ne vous vienne de nouvelles lumières.
J’approuve complètement votre résolution de rester étranger à toute intrigue ; et votre absence en sera la preuve la plus forte. Mais il ne me parait pas possible de ne pas être ni pour la discussion de l’adresse ? N’est- ce pas ? C’est dans l’intérêt de votre situation politique que je parle. Et puis, si vous ne venez pas alors où serait le prétexte de venir après ? Ce ne serait plus possible. Que vous devez être troublé, agité! Mon Dieu comme je le comprends ! Comme je le suis moi même ! Quelle bagarre où se trouve tout le monde, toute chose !
Thiers a confié à quelques diplomates son envie de se retirer retirer M. Urguhart qui devait être reçu par le roi ne l’a point été. Lord Granville fait ce qu’il peut pour empêcher Thiers de recevoir ; la députation de Birmingham, Attwood & &. Il a dit à Thiers que cela équivaudrait à Palmerston recevant M. de Lamenais avec une députation de républicains. Je ne sais encore ce que fera Thiers sur cela. J’ai vu chez moi hier matin les Appony. Après cela les Granville. Le soir j’ai été chez eux. Je ne suis pas d’avis comme vous de laisser M. de Brünnow tranquille j’écris à mon frère je vous enverrai ma lettre.
11 heures mille bons adieux pour votre lettre. Je l’aime bien. Je suis comme vous quand j’entends de la musique. Et une fois la semaine j’en entends de la bonne. Je choisis votre place, je jouis d’avance. Que de charmants moments. Je ne pense qu’à cela quand je ne pense pas au plus grave ; et le plus grave je n’y pense qu’en ce qu’il a des rapports à vous. C’est bien vrai. ce que je vous dis ! Et vous le croyez bien. Et moi je crois bien tout ce que vous me dites. Ce que j’appelle grave, est votre superficiel, comme vous l’appelez superficiel relativement à ce qu’il y a dans le fond de votre cœur et qui est votre vie, comme la mienne. Et bien êtes-vous content de ma foi ?
J’aime votre résolution pour votre arrivée, j’aime la manière dont vous le dites. Après cela il ne faut rien d’absolu, car les événements peuvent vous mettre dans la nécessité de modifier votre résolution. Jusqu’ici je n’en vois pas l’occasion, mais si elle venait je saurais tout comprendre. En attendant vous avez mille fois raisons de vous poser ainsi, ferme, décidé et droit.
Savez-vous que la situation de Thiers est la plus difficile, la plus critique qu’il soit possible de se figurer ?Je ne comprends pas comment tout celle se débrouillera. on croit beaucoup qu’il nous donnera un coup de théâtre avant l’ouverture des Chambres. On dit ou autre chose.
En attendant le bruit se répand qu’Ibrahim marche sur Constantinople, en ce cas là nous occupons Constantinople et ce cas là est-il pour vous la guerre ? Mon Dieu, la guerre, jugez ce qu’est pour moi, pour nous la guerre !
1 heure. Voici mon visiteur du matin qui me quitte. Je suis fort aise de tout ce qu’il m’a dit et qu’il ne vous mander. Cela se pose bien. Le 62 de Samedi ressemble bien peu au 20 de jeudi. Rien ne me ferait plus de plaisir que de voir 1 revenir à ses bons sentiments. C’est utile. Il me semble que je puis commencer à me réjouir. Et pendant, tout est si mobile ici.
J’ai vu hier des personnes qui dînaient au Club jeudi. Lorsqu’on est venu raconter le coup de carabine. Je ne suis pas contente de la manière dont cela y a été pris : de l’indifférence, la légèreté. Des jeux de mots. c’est le tirant et non le tyran qui a été blessé. Et des éclats de rire. Les journaux sont très bien, et à tout prendre je crois ceci une bonne fortune. Adieu, car j’ai peur d’être interrompue cela m’arrive si souvent. Adieu, adieu.
442. Londres, Samedi 17 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
M. de Brünnow passe sa vie chez moi. Il y a joué hier au whist toute la soirée. Et moi avec lui, non pas toute la soirée pourtant. Et par hasard, toujours contre lui. Rien de nouveau sinon beaucoup de chuchotements, sur ces publications si promptes. J’espère qu’à Paris on en découvrira la source. Si les chambres à Paris ou à Londres avaient demandé ces pièces-là, on les leur aurait refusées, et on aurait eu raison. Les journaux ne les demandent pas ; ils les achètent, ils les volent, ils les prennent. Je ne sais comment, mais enfin ils les ont. C’est un grand ennui. Et je crains que pour cette dernière dépêche, celle du 8, ce ne soit plus qu’un ennui. La publication produira probablement à Paris un mauvais effet. M. de Flahaut ne part que lundi. Lady Holland, toujours souffrante, l’a prié de rester deux jours de plus.
Vous n’avez pas d’idée combien j’ai été contrarié hier de ma lettre qui vous a manqué mardi, de votre lettre à vous si courte. Je suis trop tolérant ; je ne montre pas ce qui se passe en moi quand cela me déplaît à moi-même, et peut déplaire ou affliger. J’ai tort il faut se laisser aller. Je suis encore ce matin sous le poids de ma contrariété d’hier. J’y serai jusqu’à ce que j’aie reçu votre lettre d’aujourd’hui, et que j’y aie trouvé ce qui me plait.
4 heures
Encore une tentative d’assassinat ! Je n’en s’ais rien encore que par les journaux. Pour les faits comme pour les pièces, leur diplomatie est la mieux servie. Il est très vrai : le mal extérieur et le mal intérieur vont toujours ensemble. Cela fait beaucoup de mal. La moitié suffirait. Les vieux pays et les vieux gouvernements sont heureux. J’ai tort de dire cela. Pour rien au monde, je ne voudrais pas, ne pas être de mon pays et de mon temps. Oui, ce qu’on m’écrit est grave. J’en suis peu surpris. Je vois venir depuis assez longtemps cette épreuve là. Elle peut-être fort triste Jusqu’ici, je ne me sens aucune indécision. Je suis très inquiet et très convaincu. Le petit vous parlera de tout. J’attends impatiemment ses réponses. De moment en moment, la conviction m’arrive qu’il faut être là, dans le début. Je ne prendrais mon parti sur rien avant d’avoir vu, entendu, parlé. On ne sait rien de loin. On ne dit rien de loin. J’ai beaucoup à dire et beaucoup à apprendre. Je ne veux encourir aucun reproche de précipitation, ni d’inconséquence. Mais je ne veux pas non plus manquer, sur rien, l’occasion de me décider et d’agir convenablement.
Arriver trop tôt serait d’un étourdi, arriver trop tard d’un poltron. Je ne suis ni l’un, ni l’autre. Je ne suis point de ceux à qui l’on fait faire un coup de tête en les défiant. Je trouve cela puérile. Mais quand on essaie de poser beaucoup sur moi, je me raffermis, d’autant. Je n’ai pas cédé, il y a sept mois, à ceux qui voulaient me bully in une hostilité qui ne me convenait pas. Je ne céderai pas davantage aujourd’hui à ceux qui voudraient me bully in une condescendance qui ne me convient pas davantage. J’attends mon congé. Je persiste à penser qu’on me l’enverra. Il me serait tout-à-fait désagréable d’être obligé de le prendre Adieu.
Le 453 est bien joli à la fin surtout. Je suis très occupé de la lettre que vous avez préparée. Faites bien attention. C’est délicat. Quel mal d’être loin ! Public and private evil. Adieu. Adieu.
458_1. Paris, Le 16 octobre 1840, Dorothée de Lieven à M. de Benckendorff
Paris 16 octobre 1840,
J’ai eu votre lettre du 13 sept. mon cher frère. Je vous remercie sincèrement de la première page. Elle me soulage. L’Empereur est étranger aux procédés de M. de Brünnow. Le reste de votre lettre exige réponse et explication. Lorsque je me suis rendue à Londres, je vous ai promis, & je me promettais à moi-même que de là mes lettres auraient de l’intérêt pour vous. Mes relations à droite et à gauche, me mettaient à même de vous tenir parole. Je l’ai fait et j’ai coutume jusqu’au jour où Lady Palmerston d’un côté, Lady Clauricarde de l’autre, toutes deux mes amies intimes m’ont rapporté ces étonnantes paroles dites par M. de Brünnow à leurs maris respectifs :
" Prenez garde à M de Lieven. Mad. de Lieven ce n’est pas une ruse. Mad. de Lieven est un émissaire de la France. Le moindre mot dit à elle s’en va à l’ambassade de France." Voilà mon cher frère ma réponse à votre question : " Êtes-vous donc bien sûre que M. de Brünnow a tenu sur votre compte des propos favorables ? " Vous voyez que j’en suis bien sûre, et comme pour disculper M. de Brünnow à mes dépends vous ajoutez que mes relations avec M. Guizot sont connues. Je le crois bien ! Je n’ai rien à cacher.
M. Guizot est un homme que son esprit, sa situation, son caractère, sa probité place très haut dans le monde. J’ai du respect pour son caractère et beaucoup de goût pour sa société Je n’imagine pas que vous veuillez insinuer autre chose ? Si je le pensais, je ne vous répondrais pas plus que je n’ai répondu aux journaux. Je reviens à mon texte. J’avais remarqué à mon arrivée à Londres que le corps diplomatique était en grande réserve avec moi, malgré que tous furent mes anciens collègues. Cette circonstance m’avait d’autant plus étonnée qu’à Paris mes relations sont aussi intimes et confiantes que possibles avec tous les représentants des grandes puissances qui sont le fond de ma société. Comme en Angleterre je vis avec les Anglais cela m’importait peu, mais Lady Palmerston le jour même où elle me dénonça les propos de M. de Brünnow à son mari me dit que toute cette diplomatie était ameutée contre moi quelques temps avant mon arrivée et huit jours après cet entretien elle reçut une lettre de son frère Lord Beauvale qui lui mandait de Vienne tout ce que vous me dites, le Prince de Metternich lui avait parlé de ces bruits venus de Londres, et Lord Beauvale ajoute : " Qu’est-ce que veut dire ce bavardage ? " J’ai vu cette lettre.
Devant une intrigue aussi infâme, ourdie avec tant de soin, devant des paroles dites aussi officiellement par le ministre de l’Empereur, à des personnes aussi officielles que lord Palmerston et lord Clauricarde, je n’ai pas pu, je n’ai pas dû me taire. Quelqu’un, quelque chose était cause de la situation bien nouvelle qu’on s’efforçait de me faire à Londres. Comment attribuer à M. de Brünnow la maladresse de faire de moi son ennemi, au lieu de m’avoir pour lui, sur un terrain où tout le bénéfice de bons rapports entre nous, était de son côté ? Comment lui supposer la vilenie, il faut bien me servir de ce terme, et l’audace de venir sans grave raison flétrir par une aussi odieuse calomnie, la veuve de l’homme qu’il appelle son bienfaiteur, une femme de mon rang, placée comme je le suis dans l’opinion et l’affection des personnes les plus élevées et les plus importantes en Angleterre ? Voilà ce que me disaient mes amis en ajoutant que M. de Brünnow connu pour être un grand courtisan s’appuyait peut-être sur ma défaveur auprès de l’Empereur. Or, on la connait à Londres.
Elle a eu là de l’éclat, du retentissement par deux choses surtout ! L’oubli total où l’Empereur m’a laissée à la mort de mon mari ; la quasi défense de venir à Londres lorsque le grand Duc s’y est trouvé. Personne n’avait pu comprendre les motifs d’une d’une semblable rigueur. M. de Brünnow venait de les révéler, ils peuvent même en avoir reçu l’ordre ! Voilà ce que Lady Palmerston me rapportait comme l’opinion des autres et je pouvais même raisonnablement craindre qu’elle même se trouvât dans le doute, car mon expérience du monde m’a assez appris la vérité de cette parole de Beaumarchais : " Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose."
Je vous ai écrit le 5/17 juillet dans la chaleur de la juste indignation que j’ai ressentie ; je vous envoie copie de cet lettre pour mémoire. Je vous ai écrit le 12/24 juillet que, jusqu’à une réponse de vous sur ce point, vous ne deviez pas vous étonner que je suspendisse ma correspondance intime avec vous, et par une autre lettre du 9/21 août j’ai motivé cette résolution. En effet après tant d’années, tant de preuves de dévouement, voir mon dévouement reconnue de cette façon ; voir le ministre de l’Empereur me dénoncer à un gouvernement étranger comme un traître.
Voir cette calomnie faire son chemin auprès de deux autres cabinets étrangers, la voir ébranler la foi de mes plus intimes amis ! C’était trop, et avant que les causes de cette injures fussent éclaircies j’ai dû m’arrêter tout court c’était bien le moins que je pusse faire. Je vous en ai prévenu et vous faites de cela un chef d’accusation contre moi ! Par mon silence, je confirme les soupçons ! Est-ce me juger avec équité, est-ce seulement me juger avec logique. J’en reviens à la confidence qui m’a été faite des propos, de M. de Brünnow. Savez-vous ce que j’ai dit quand lady Palmerston et lady Clauricarde me les ont dénoncés ? J’ai dit, et j’ai dit bien fort. " L’Empereur ne le croit pas, l’Empereur ne le croira jamais car l’Empereur me connait. Mais il ne sera pas loisible à son ministre de m’injurier impunément." Voilà l’écho que je devais trouver à Pétersbourg.
Vous m’accusez au lieu de me défendre. L’Empereur fait mieux que vous. Pour la première fois depuis tant d’années, l’Empereur me fait dire des paroles d’amitié, d’ancienne amitié, par votre femme. L’Empereur sait que je suis un sujet fidèle et c’est le moment où d’autres veulent en douter ; c’est ce moment que l’Empereur choisit pour me faire parvenir un souvenir bienveillant. Dites à l’Empereur que les plus grandes faveurs sont doublées par l’à propos. Mon cœur le remercie de la faveur, mon esprit de l’à propos. Mais si mon cœur est satisfait, mon honneur ne l’est pas, car il n’en reste pas moins constant que M. de Brünnow a jeté une tache sur le noble nom que je porte ; que c’est me déshonorer que de douter que je suis le loyal sujet de l’Empereur, me déshonorer que de le dire ; et que la dame d’honneur de l’Impératrice ne peut pas rester sous le coup d’une semblable calomnie. C’est à ce titre, si ce n’est au mien propre que je demande que M. de Brünnow rétracte ce qu’il a dit là où il l’a dit, parce qu’encore une fois, il me faut cela ou autre chose qui atteste aux yeux des autres que je n’ai jamais mérité de si odieux soupçons. Je vous prie de mettre cette lettre sous les yeux de l’Empereur.
441. Londres, Vendredi 16 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je ne suis pas sorti hier soir. J’ai joué au tric-trac, et je me suis couché de bonne heure. Il y a des choses plus agréables à mettre dans une soirée où l’on ne sort pas. Après mon tric-trac, je suis rentré dans ma chambre, je me suis promené près d’une heure, pensant, pensant et faisant dans mes pensées, ce que vous appelez une confusion visible de deux choses qui vont très bien ensemble, nous en sommes sûrs. Je me suis couché, je me suis endormi, et je n’ai plus retrouvé dans mes rides qu’une seule des deux choses. Evidemment l’autre ne va qu’au jour. Elle ne s’y montre pas aussi hardiment qu’elle s’en vante. Je suis très frappé de la reculade de ces gens de la garde nationale qui voulaient faire dimanche dernier une grande démonstration. Cela me prouve, comme je l’ai toujours cru qu’il y a là plus de bruit que de force et même que de vraie passion. Les factions, les coteries ont aujourd’hui en France très peu de force réelle. Il suffit presque, pour les vaincre, de n’en avoir pas peur. Mais bien des gens en ont peur. Et bien des gens aussi aujourd’hui, très honnêtes, très sensés en général, sont réellement blessés, vivement blessés du procédé anglais. Il y a grande excitation du sentiment national. Elle m’arrive de toutes parts. Comment le contenir sans l’irriter encore ? C’est bien difficile.
Quelles pauvretés je vous dis là ! Ce sont pourtant là, mes pensées habituelles. Et il le faut bien. 2 heures Je suis plus que contrarié. Comment.
Mercredi, à 2 heures et demie, vous n’aviez pas même la lettre que je vous ai écrite dimanche, qui a du être mise lundi à la porte, à Calais et vous arriver mardi ! C’est souverainement déplaisant. Moi qui prends tant de plaisir à faire luire, quand je le peux un doux rayon sur le mardi ! Ne manquez pas de me dire, si cette lettre vous est parvenue, quel jour et à quelle heure. Elle a dû vous être remise par celui que vous appelez mon confident pressé. Je vais attendre votre lettre de demain avec un redoublement d’impatience. Il y a toujours quelque raison pour que mon impatience redouble. J’aurais tant à vous dire, tant à déliberer avec vous !
La grande question pour moi dans ce moment, c’est le jour de mon arrivée à Paris. Traitez la à fond avec le fidèle. Ecoutez bien tout ce qu’il vous dira. Il y a deux jours, j’étais à peu près décidé à n’arriver que le 1er novembre. Il me revient des choses qui méritent qu’on y pense. Pensez donc.
Les amis de la paix sont contents du résultat du Conseil d’hier. On annoncera l’intention de ne pas poursuivre la déchéance du Pacha en Egypte. On conseillera à le Porte d’y renoncer, et de se montrer accessible à un rapprochement avec lui. C’est un commencement qui peut amener une fin. Les rapports, les conversations, les ouvertures, entre la France et les quatre se trouveront rengrénés. En attendant, toujours point de nouvelles de Syrie. Tous les boulets du monde ne portent pas à mille pieds de la côte. Ce n’est pas assez pour chasser les égyptiens du pays. Et les jours s’écoulent. Et les vents se levent. Encore trois semaines pareilles, et tout est fini jusqu’au mois de mai.
4 heures et demie
Des visites. Flahaut. Mac Gregor & &. Je ne vous reviens que pour vous dire adieu. Il faut que j’écrive à Thiers. Votre courte lettre de ce matin ne m’a pas convenue. Je veux que vous me disiez, beaucoup beaucoup en tous genres, beaucoup des deux choses. Adieu pourtant le même, adieu.
454. Paris, Vendredi 16 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le temps hier était charmant. Je suis même restée assise au bois de Boulogne. J’avais vu le matin Bulwer, toujours inquiet comme tout le monde. J’ai vu plus tard Granville qui avait trouvé M. Thiers assez soucieux et de mauvaise humeur. J’ai été porter mes félicitations à Mad. Appony dont c’était la fête. A 6 heures j’étais couchée sur un canapé me reposant de ma promenade lorsque j’ai entendu une grosse explosion. J’ai cru le canon et que la duchesse d’Orléans accouchait quinze jours trop tôt. Comme le coup n’avait pas de camarade, je n’y ai plus pensé et le soir j’apprends qu’on a encore tiré sur le roi. Mon ambassadeur, M. de Bignole et l’internonce sont venus me voir. J’avais enfin ouvert ma porte, mais comme je n’en avais prévenu personne. Je n’ai eu que cela. Nous sommes curieux du parti. que le gouvernement va tirer de ce nouvel attentat.
Midi
Les journaux s’expriment très bien, et si le gouvernement a du courage cet événement peut tourner à bien.
1 1/2
J’ai été interrompue par le petit. J’espère qu’il vous écrit beaucoup, beaucoup. 3 heures. Voici seulement à présent votre lettre. J’en suis très très contente ainsi que d’une autre que j’ai lu aussi. Je n’ai que le temps de vous dire ceci. A demain et comme toujours toujours adieu.
440. Londres, Jeudi 15 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Le travail commence pour m’engager à retarder mon départ. Flahaut s’est mis à l’œuvre hier en dînant chez moi. Et aussi ce jeune Lavalette que Thiers vient de me renvoyer. Les arguments et les caresses abondent. Je réponds simplement que j’ai demandé mon congé, que le jour de mon départ de Londres et celui de mon arrivée à Paris ne sont pas fixés. Mais que je serai certainement à Paris, du 28 octobre au 2 novembre. On n’insiste pas. On recommence. Je répète Je ferai ce que je dis. J’ai écrit à Génie de dire, de ma part à M. de Broglie, que j’étais décidé, que je voulais pouvoir être à Paris, le 28 octobre si cela me paraissait nécessaire ; que je ne m’attendais à aucune difficulté à cet égard mais que, si on pensait à m’en faire, je priais qu’on me les épargnât, car j’avais un un parti pris et je serais certainement à Paris du 28 octobre au 2 novembre. Je suis persuadé que malgré la bonne envie, on ne fera aucune difficulté. Mes amis se sont souvent trompés, je devrais dire que j’ai souvent trompé mes amis à mon égard. J’ai avec eux du laisser aller trop de laisser-aller je n’aime pas les refus, les contradictions, les petites querelles. J’aime la facilité, la complaisance. J’aime à faire plaisir à mes amis. Trop j’en conviens ; ou plutôt je crains trop de les contrarier. Le moment arrivé pourtant où j’ai mon parti pris, je refuse, je refuse péremptoirement. Ils ne s’y attendent pas. Ils s’étonnent un peu de rencontrer la limite de ma facilité. C’est ma faute. Il faut être quelquefois contrariant et raide sans nécessité, pour pouvoir l’être sans exciter de surprise, ni tromper l’attente au moment de la nécessite. Les nouvelles d’Orient sont bien insignifiantes. On commence à craindre ici ce que je vous disais, la longueur du temps, l’hiver, la fièvre. C’est du humbog de dire que la Syrie est soumise. Jamais Gascon n’a dit mieux. Et si elle ne l’est pas dans le cours de ce mois, elle ne le sera pas d’ici au printemps prochain. Et d’ici là, on ne pourra, on ne fera à peu près rien pour la soumettre. La légèreté humaine, la présomption humaine l’imprévoyance humaine, l’insuffisance de l’esprit humain. Je deviendrai un vrai prédicateur. Les sermons ont raison. Lady Holland a été malade, vraiment malade l’autre jour ; une quasi cholérine. Elle s’est trouvée mal ; il a fallu quitter la table, passer la soirée dans sa chambre. Elle était hier au soir fatiguée et changée.
Lord Melbourne et lord Lansdowne. Celui-ci était venu me voir le matin. Très sensé et très impuissant. C’est un exemple frappant de ce que peut et ne peut pas donner une grande situation aristocratique. Il est très instruit, très éclairé, très considéré très riche, très bien établi dans le public et dans le gouvernement. Il n’est rien. M. de Flahaut part samedi. On dit que décidément Emilie épousera lord Ephinstone qui reviendra de l’Inde l’été prochain. On dit que lord Ossulston l’épouserait s’il voulait. On dit qu’il épouserait lady Fanny Cowper, s’il voulait. On dit beaucoup de choses de Lord Ossulston. Lady Tankerville a perdu chez Hammersley l’argent qu’elle destinait à son voyage, en France. Elle n’ira pas. Lady Palmerston a perdu 1200 louis. Lady Fanny 400. Je vous dis ce qu’on me dit. On vous l’a peut-être déjà dit. Je vous l’ai peut-être déjà dit moi-même. Nos bavardages ne porteront guère sur cela. Ils porteront surtout.
3 heures
Je viens de faire le grand tour de Hyde Park seul. Décidément j’aime mieux être seul. Décidément aussi, c’est une supériorité que j’ai sur vous. Je n’ai pas besoin des indifférents. Vous pouvez me la pardonner. Vous n’en souffrez pas. J’ai quatre chanteurs anglais qui viennent souvent, pendant ou après, le dîner, chanter dans ma cour des paroles anglaises sur de l’excellente musique allemande. Trois hommes et une femme, Ils sont venus hier. J’ai soulevé ma fenêtre. Je les ai écoutés une grande demi-heure : c’était triste, c’était gai, c’était grave, c’était tendre. J’ai passé par toutes ces impressions et toutes me portaient à vous. Elles m’y portaient doucement, légèrement, comme on doit être porté sur un nuage. Je ne voyais rien ; je ne pensais à rien ; je flottais dans l’air, bercé de sons charmants qui me parlaient de vous. C’était délicieux, mais si court, comme les beaux rêves. Même au soin des plus beaux, on sent qu’on rêve, on n’a pas de confiance. C’est là que le bonheur est vraiment une ombre. La réalité, la présence, le bonheur éveillé, celui-la seul remplit l’âme et y laisse une trace éternelle. Je suis très contrarié que mardi, à une heure, vous n’eussiez pas encore ma lettre de Dimanche. Je comptais qu’elle vous arriverait de bonne heure. On vous l’aura remise dans la journée ! Ce n’est que la moitié du plaisir que je voulais vous donner et le mien me manque.
Mon jeudi est médiocre. Il y a au moins trois ou quatre choses, que je vous ai demandées depuis huit jour, et auxquelles vous n’avez pas répondu. Rien de grave ; mais enfin des questions sans réponse. On met ma voiture de voyage en ordre. Je recherche les jours de départ des bateaux de Londres au Havre, de Southampton au Havre de Brighton à Dieppe. Adieu. Adieu. Un adieu d’espérance. Ce n’est pas encore le meilleur.
453. Paris, Jeudi 15 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu hier après 3 heures les deux lettres de dimanche et lundi votre bonne intention de dimanche n’a été remplie que tard comme vous voyez. Mais mon cœur la compte, je vous en remercie beaucoup beaucoup. Eh bien je vois qu’on a été content de la note, et je vois cependant que cela va encore traîner. Toujours traîner. Ah mon Dieu ! Il est évident qu’on attend vos réponses.
J’ai beaucoup causé avec ma belle sœur, elle est bien peu de chose, mais enfin elle sait et elle se souvient elle se souvient donc qu’il n’y a pas quelque jours aujourd’hui, on ne rêvait pas à la guerre on ne la voulait pas ; elle est très surprise de tout ce qu’elle entend ici. Le mémorandum de Thiers est fait avec un grand talent. Cela se lit et se comprend parfaitement, et je conçois qu’ici il fasse un excellent effet pour le gouvernement et qu’au delà de la manche il a porte également la conviction dans beaucoup d’esprits. Mais nous autres ses visiteurs d’hier matin nous n’en sommes pas contents. Appony dit que tout ce qu’il dit de l’Autriche est faux. M. de Pahlen dit qu’on est bien près de se battre quand on parle ainsi de la Russie. Et il s’attend a quelque contre coup fâcheux de chez nous. En effet voilà des aveux difficiles. Il y a une forte différence entre penser les choses, et les dire ! Nous savons bien que tout le monde pense cela de nous mais aucun gouvernement n’a encore proclamé cette pensée. La France le fait.
Pensez un peu à cela, ne trouvez-vous pas que M. de Pahlen a raison. J’ai eu un long entretien hier avec ma belle sœur. Elle est d’avis d’une forte démarche de ma part contre M. de Brünnow. Elle est d’avis que je raconte tout en détail ma lettre est faite, j’attends votre conseil. J’insisterai sur une réparation. Elle m’a dit de drôles de chose.
L’empereur a toujours de la colère quand il est obligé de reconnaître que j’ai un peu d’esprit. Cela le dépite. J’ai été à une soirée chez Mad. Appony hier. La diplomatie est triste et inquiète. A propos Appony n’a plus été chez M. Thiers depuis 10 jours, et ne compte y aller que lorsqu’il aura eu un Courrier de Vienne. Mon ambassadeur n’y a pas été non plus depuis tout ce temps. Si bientôt les choses ne prennent pas une bonne tournure, elles ne prendront une bien mauvaise. Appony trouve que la question a fait un progrès sensible en ce qu’elle est très simplifiée mais aussi c’est bien plus grave, et la guerre ou la paix est à la porte, il n’y a plus de faux fuyants possibles. il y a des gens qui disent que s’il faut la guerre au bout de tout cela, il vaut mieux l’accepter tout de suite. Quand la France sera bien en mesure de la faire les alliés pourraient bien n’être plus aussi unis. Aujourd’hui ils tiennent ensemble et la France n’est pas suffisamment préparée.
Cependant il me parait clair aussi que nous (alliés) nous ne la commencerons pas, et que ni d’une part, ni de l’autre il n’y a de véritable bonne raison pour la commencer. Quelle mauvaise bagarre que tout ceci ! Que le ciel nous en tire, car les hommes ne paraissent pas devoir nous en tirer. Quand viendrez-vous quand me pourrez-vous venir ? On dit que tous vos amis sont d’opinion que vos devoirs à Londres sont un prétexte et même une raison suffisante pour vous dispenser de vous trouver ici à l’élection du président.
J’attends avec impatience ce que vous déciderez. Je n’ai point d’opinion là dessus. Je désire que rien n’aggrave l’embarras de la situation que rien ne gâte la vôtre. Je fais des vœux pour l’ensemble, je fais de bons vœux pour vous. Voilà où j’en suis. bien incertaine sur les moyens de concilier tout.
1 heure
Le petit sort d’ici ; tout ce qu’il me dit est bien grand pour le Cèdre. Le cœur me bat bien fort. Qu’est-ce qui ressortira de tout ceci ? L’heure de la décision à prendre va sonner. Ah mon Dieu. Adieu. Adieu. Mon cœur est aussi inquiet qu’il est tendre, qu’il est fidèle, qu’il est passionné. Adieu.
452. Paris, Mercredi 14 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je n’ai vu hier que l’Angleterre. L’Angleterre agitée, curieuse, mais assez en espérance. Lord Granville à vu M. Thiers hier au soir à Auteuil. Je l’ai vu à son retour, il ne m’a dit que des généralités, mais l’impression que j’en ai est bonne. J’attends votre lettre avec des battements de cœur. Je préparé une réponse à mon frère, mais je ne ferai rien sans votre avis. On est agité extrêmement dans le public. M. de Lamenais est épouvantable dans les provinces il y a beaucoup d’exaltation. Le gouvernement aura une rude besogne, car j’espère bien qu’il s’appliquera à apaiser. Je suis inquiète. Les Anglais désertent, ils ont parfaitement peur.
Midi
Point de lettres ? C’est toujours le Mercredi qu’elles m’arrivent le plus tard et c’est précisément. Le jour où elles sont le plus ardemment désirées. Il faudra attendre la soirée. C’est bien long ! 2 heures. Le petit est venu aussi impatient, aussi pauvre que moi. Que faire ? Et par dessus le marché je n’ai rien à vous dire. je m’en vais un mettre à lire ce long memorandum. Je n’ai pas vu mon ambassadeur depuis deux jours, il écrit je crois.
2 1/2
Tous les alliés chez moi grand bavardage dont je n’ai plus le temps de vous dire un mot. Adieu. Adieu. On dit seulement que jamais on ne s’est trouvé plus près du dénouement absolu. Paix ou guerre. Adieu.
Herry, le 14 octobre 1840, Prosper Duvergier de Hauranne à François Guizot
439. Londres, Mercredi 14 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je vous parlais hier matin de M. de Brünnow. Le soir je jouais au Whist avec lui, chez moi. Il est arrivé un des premiers et parti le dernier. Il a amène M. Koudriaffsky, M. Kreptowitch n’est pas venu parce qu’il était à la campagne. Nous sommes au mieux. La grande dépêche paraissait ici, dans le Times quelques heures après que je venais de la lire à Lord Palmerston. Cela à produit un mauvais effet. La Reine, dit Lord Palmerston a dû s’étonner de trouver sur sa table dans un journal une dépêche qu’elle devait recevoir par moi, et que je n’ai pas eu le temps de lui envoyer. Il a le droit de le dire. J’ai écrit sur le champ à Paris, ma surprise et mon regret. Il fallait un intervalle. J’espère qu’on découvrira que quelque correspondant des journaux anglais s’est procuré, je ne sais comment un exemplaire de la dépêche. Brünnnow, Dedel Capellen Moncorvo, Neumann, Björnsterna, Münchhausen. Il y a peu de variété. Ce pauvre Münchhausen est désolé. Il est rappelé, purement et simplement rappelé, sans raison et sans compensation. C’est M. de Kichmansegge qui le remplace. Les diplomates traitent presque aussi mal le Roi de Hanovre que le font les journaux.
2 heures
La vérité de ce que vous me dîtes sur le 28 me frappe beaucoup. Londres ou Paris. A moins qu’il ne me vienne de nouvelles lumières que je ne prévois pas, je choisirai entre les deux sans admettre de tiers parti, comme j’y penchais. Entre les deux, je penche pour Londres. Pensez bien à ceci. Si le cabinet doit tomber, il m’importe beaucoup, beaucoup, d’avoir été parfaitement étranger à sa chute. Je ne puis être fort dans une situation difficile qu’autant que je n’aurai contribue en rien à la créer. Hier, j’ai demandé officiellement mon congé. Je vous répète que 1 ne m’étonne pas. Et il ne faut pas plus lui en vouloir que s’en étonner. Par préoccupation, plus que par tout autre motif, il poursuit son idée sans aucune considération des personnes même amie. Si je suis bien informé, le bouleau et le peuplier son fort décidés, à ne point se laisser faire et à ne se conduire que selon leur propre avis et leur propre situation. Le chêne n’a jamais été plus fortement ému et plus profondément convaincu. L’épreuve sera bien périlleuse... et bien grande. A moins qu’après tant de bruit, il n’y ait pas d’épreuve et que tout ne finisse par une platitude. Je m’étonne qu’il n’arrive rien d’Orient. Il se pourrait bien que l’affaire traînât en longueur les Turcs sur la côte, les Égyptiens dans l’intérieur, une insurrection faiblement soulevée, à moitié réprimée ; l’hiver, les vents, les pluies la fièvre. Les événements aussi ont leurs tergiversations et leurs platitudes.
Je vous quitte. Lord Palmerston vient de Windsor passer deux heures à Londres. Il faut que je le voie. Quelle lettre ! Pas un mot de ce qui me remplit le cœur, quelque pleine que soit d’ailleurs ma vie ! Quand vous me connaîtrez, vous saurez à quel point tout le reste est superficiel, toujours, dans tous les moments. Dites-moi que vous en êtes sûre. Je croirai que vous me connaissez. Adieu.
451. Paris, Mardi 13 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai à peine dormi trois heures cette nuit, je ne sais pas pourquoi, si ce n’est que je n’ai pas été au bois de Boulogne hier. Ma belle sœur m’a retenue chez moi et puis des visites à faire. J’ai vu le soir les Appony et les Granville, chez eux respectivement lord Granville avait vu M. Thiers le matin, il avait de ses nouvelles après votre entretien avec lord Palmerston samedi, mais il lui a dit que vous ne lui mandez rien d’ici pourtant ; de sorte que Granville n’osait rien. Les fonds ont monté beaucoup hier, il faut que ce soit sur des nouvelles. de Londres, mais la diplomatie les ignore tout-à-fait. Le roi a reçu Brignoles dimanche au soir et lui a fait subir le même accueil qu’à Fleishmann c’est-à-dire des tirades violentes contre le traité, violentes de paroles et violentent de gestes de façon à épouvanter l’Italien comme l’avait été l’Allemand.
J’ai vu Brignoles hier qui n’en revenait pas. Le roi lui avait semblé très belliqueux, très irrité, très inquiet et il relevait de son discours que c’était une guerre agressive qu’il se voyait à la veille. d’entreprendre. Montrond est venu chez moi le matin, un peu le contraire, ton à la paix, disant que le roi la croyait sûre. Qu’il était très contente de Thiers. Thiers est très peu accessible depuis une huitaine de jours toujours à Auteuil, il cherche à s’effacer pour le moment.
Mes ambassadeurs n’y ont pas été et par conséquent ils l’ont point vu depuis plus de huit jours. Montrond me disait : " Voilà M. Guizot collé à Londres et collé à Thiers n’est-ce pas ? Je n’ai pas répondu à n’est-ce pas, je ne réponds jamais que de moi-même.
1 heure.
Le journal des Débats est très inquiétant ce matin, et le National très épouvantable. Tout le monde dit : s’il y a guerre, il y a par dessus le marché trouble à l’intérieur. S’il n’y a pas guerre, il y a surement trouble à l’intérieur. Quand ce serait vrai, il vaut mieux le mal simple par le mal double. Mais est-il possible qu’on soit condamné à voir cela ? Je suis mal disposée ce matin, j’ai peur, c’est sans doute parce que Mardi je n’ai rien pour me soutenir. J’attends demain avec grande impatience une grande curiosité. Mon fils est parti pour Londres, ce matin, je ne lui ai pas nommé son frère.
Adieu. Adieu que verrons-nous arriver dans le monde ? Je vois bien noir. On laisse trop aller le mal, pourra-t-on le maîtriser ?
Adieu, toujours le même adieu, à travers la guerre les émeutes. Ah mon Dieu ! Marion est animée, elle est venu me voir ce matin, bien gentille et bonne comme de coutume. Mon fils la trouve charmante mais voilà tout. Adieu. Adieu.
438. Londres, Mardi 13 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Vous avez toute raison ; rien n’est pas possible ; il faut répondre. Et dans la réponse, beaucoup de reconnaissance du message, beaucoup de dédain pour la lettre. Qu’avez-vous besoin d’insister sur une satisfaction quant à M. de Brünnow ? Laissez tomber M. de Brünnow.
Je suis grand partisan du dédain, pourvu qu’on sache selon l’occasion, unir ou séparer les deux ingrédients dont il se compose. Il y a dans le dédain, du mépris et de l’indifférence. Le mépris blesse, l’indifférence embarrasse ; par le mépris, on se sépare par l’indifférence, on prend le haut du pavé. Il faut tantôt laisser ces deux éléments du dédain ensemble, tantôt n’en montrer qu’un, l’un ou l’autre. Sur M. de Brünnow faites les peser tous les deux ; avec votre frère, seulement le dernier. Cela convient et suffit. Après cela, et pour cette fois, rien de plus. D’abord parce que le moment est bien critique et toute parole bien délicate. Ensuite parce qu’il faut se faire désirer et ne pas se montrer pressé. Voilà mon avis, court et clair, n’est-ce pas ? Je vous en dirai bientôt davantage et vous aussi, vous en direz davantage ailleurs.
Quel beau moment ! Je me sens sur une vague propice qui s’enfle sous moi d’heure en heure, et m’élève et me porte à l’objet de mon désir. Votre frère ne trouverait-il pas que c’est là une belle phrase ?
Au fond, je suis bien aise du message et même de la lettre, toute sotte qu’elle est. Elle l’est beaucoup. Renoncez à vous faire comprendre de ce monde là. Acceptez avec eux les inévitables oscillations de relation et de manière. Vous aurez tantôt à vous offenser, tantôt à oublier. Vous suspendrez aujourd’hui, vous reprendrez demain. Ayez du dédain toujours ; montrez-en quelquefois. De la colère, jamais. Pas plus de confiance que de colère. Et le temps se passe dans ce va-et-vient de rapports alternativement bous ou mauvais, toujours supérficiels et qu’il ne faut pas rendre hostiles, un peu par esprit de justice, beaucoup par prudence, et en dernière analyse encore par dédain.
Je n’avais pas attendu votre lettre pour admirer M. Mauguin protégeant Mad. de Benckendorff. Les journaux l’ont affichée. Je n’aurais pourtant pas devinée, la malle poste. J’ai un peu peur pour la paix si M. M. la prend aussi sous sa protection. Dans la Chambre, il a pendant quatre ans porté malheur à la guerre. Il la décriait en la recommandant Mais ne me brouillez pas avec lui en répétant ce que je vous dis là. Il deviendra peut-être, il est peut-être déjà puissant quelque part. C’est un sot avec de l’esprit. Ils n’en manquent pas tous. Vous lirez dans les journaux la grande réponse que j’ai remise hier à lord Palmerston Elle est déjà ce matin dans le Times et le Morning Herald. C’est trop tôt. Ils l’ont eue de Paris, je ne sais comment, ni pourquoi. Elle n’y est pas correcte ; mais enfin, elle y est. Il y a de bonnes parties, concluantes, et spirituellement rédiger. Je regrette qu’elle ne soit pas venue trois semaines plutôt. Ici comme à Paris, on espère un arrangement et on y travaille. Certainement il y a moyen. Je me flatte que cela suffit pour qu’il y ait chance. Je persiste toujours, toujours, dans mon opinion générale.
4 heures
J’ai été dérangé quatre fois en vous écrivant. Pollon, Van de Weyer, Flahaut. Bowring. Je reçois celui-ci parce qu’il me sert. Il a de l’esprit et pas uniquement de l’esprit anglais. Flahaut repart Vendredi pour Paris. Je demande aujourd’hui mon congé. N’en parlez pas, je ne veux pas que ce soit un sujet de conversation. Lord Palmerston va aujourd’hui à Windsor. Il en reviendra après-demain pour le Conseil. Il me semble que Windsor est son cabinet de travail. J’ai vu lord Melbourne. Son lumbago va mieux. Pourtant il marche encore avec une canne dans son salon. J’ai mal dormi depuis deux nuits. J’ai mal à la tête. Un peu de fatigue. Je me défends très bien et très longtemps de l’agitation. Quand elle me gagne, c’est un vrai ravage dans ma nature, qui la repousse. L’agitation me choque et m’humilie, comme l’ennui.
Adieu. Adieu. J’ai énormément à écrire aujourd’hui. Je vous donne tout, mon temps. Je ne vous donne pas tout ce que je voudrais vous donner. Je vous donne adieu, l’adieu que je veux et que vous voulez aussi, n’est-ce pas ? Dites-moi encore, oui.
450. Paris, Lundi 12 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
C’est à présent que j’ai de la joie à voir s’écouler les jours ! Regardez dans votre cœur et voyez tout ce qui se passe dans le mien. C’est cela ; tout cela, et peut être plus que cela. La journée hier a été très à là paix. Toutes les nouvelles, tous les symptômes étaient à cela. M. de Werther, Granville surtout et même les petites gens, Flahaut & &. J’ai fait ma promenade vers Boulogne. J’ai été rendre visite à Mad. Rothschild qui est dans une angoisse inexprimable sur les affaires. Son mari était à Ferrières. J’ai dîné avec mon fils. Le soir j’ai été un moment chez les Granville, un autre moment chez Mad. de Flahaut et à 10h 1/2 dans mon lit.
Je suis de plus en plus mécontente de S.. Il voudrait tout arranger pour la plus grande commodité de M. Il ne s’embarrasse guère dans cet intérêt d’aplatir le bouleau. Tous les propos de F. sont dans ce sens, et si forts qu’on m’a dit que la violette hier était sur le point de se fâcher. D’un autre côté 62 fait tout au monde pour retarder l’arrivée du peuplier.
11 heures
Voici votre lettre. Je suis bien contente de vous voir bien augurer du résultat de la note. Que Dieu vous accorde le bonheur de voir tout ceci s’arranger pacifiquement. Je suis charmée de tout ce que vous me dites sur votre propre compte.
Moi, je n’ai qu’un avis, un avis grave à donner c’est celui-ci. Si vous n’êtes pas à Paris dès le 28, vous ne pouvez être ce jour-là qu’à Londres. J’avais écrit deux longues pages de développement sur cela, j’aime mieux abréger, ceci vous suffit. J’ai vu le petit ce matin, et puis je viens de me rafraîchir sur la place.
Que de choses à dire, à demander, à commenter. Que les heures de bavardage seront charmantes. Elles se présentent tellement comme cela à mon imagination que je me ravis déjà aujourd’hui que vous dire sur ce pauvre papier. Mais dites-moi bien que vous croyez à la paix, qu’elle est sûre.
Depuis hier je commence à y croire, sans oser presque me l’avouer Mardi demain, c’est affreux ; j’ai si besoin de savoir tous les jours un mot consolant.
Je n’ai pas de nouvelles, je ne sais rien, on attend des dépêches télégraphiques sur l’Orient. Elles tardent bien. Le ton des journaux ministériels est bien doux presque timide. Le journal des Débats fait des articles très habiles, c’est qu’il est libre. An fond c’est la condition de pouvoir, de ne pas l’être.
Selon moi il n’y a de Val Richer possible qu’avant le jour de la convocation, pendant ce jour-là impossible. Voilà une et deux interruptions. Pardonnez, pardonnez. Adieu. Adieu. Ecrivez moi. aimez moi (quelle bêtise !) et arrivez. Adieu.
437. Londres, Lundi 12 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
Vous ne serez pas contente de ma lettre d’aujourd’hui. J’ai bien peur qu’elle ne soit courte, et vide aussi. J’ai travaillé toute la matinée. Je viens de chez lord Melbourne. J’irai tout à l’heure chez lord Palmerston. Bien des choses et bien des gens se remuent. Nous verrons le résultat. Je suis las d’attendre et de prédire. D’attendre surtout, car pour prédire, je n’en ai pas abusé. Je parie encore pour beaucoup de longueurs. Comme toujours, on est plein ici de présomption et d’illusion Parce qu’on a bombardé Beyrouth et débarqué 6000 Turcs, on se croit maître de la Syrie. Des renseignements, qui méritent au moins autant de confiance que ceux dont on se prévaut, me donnent lieu de croire qu’eût-on fait partout, sur le littorab, ce qu’on a fait à Beyrouth, on ne serait pas si avancé, tant s’en faut. Ibrahim et Soliman-Pacha se promettent de tenir très ferme dans l’intérieur, et de faire durer la guerre. Napier lui-même dans ses rapports officiels donnés à Ibrahim 120 000 hommes.
En vérité jamais plus de passions, n’ont été excitées, et de hasards courus pour un si mince motif. Hier soir à Holland house. Nous sommes de mieux en mieux. Lady Holland et moi. Il y a quelque temps, elle m’a demandé, la gravure de mon portrait. Je la lui ai envoyée hier. Elle a été charmée. J’ai envie qu’on me mette dans l’escalier au dessus de vous. J’y dîne aujourd’hui. Ils ne retournent pas à Brighton. Il y a conseil de Cabinet Jeudi.
J’ai fait connaissance hier avec lord Ebrington, qui a l’air d’un bien bon et honnête homme. Il arrive d’Irlande et me paraît fort peu préoccupé du bruit pour le repeal. Il y a bien du bruit partout. J’ai de très bonnes nouvelles du Val-Richer. Mes enfants, deux surtout ont été assez longtemps languissants, après la jaunisse. Ils sont très bien à présent. J’espère toujours aller les prendre et les ramener avec moi à Paris. J’aime bien 448.
J’aime bien vos inquiétudes, vos ombrages, vos susceptibilités. Je m’explique bien des choses, quelques unes tristes, toutes bien petites. C’est dommage. Mad. 62 avait plus de grandeur que 20. Il a le cœur élevé rien de grand. Quant à 1, il s’ignore beaucoup lui-même comme il ignore les autres. Je répète à son sujet, ce que je disais l’autre jour, à propos de 99, mais dans un bien moindre degré. Que Dieu me garde quelque chose de complet et d’immuable ! Je supporterai sans la moindre humeur les imperfections et ces vicissitudes, des relations humaines. C’est bien solennel ce langage là ; pas plus solennel que les sentiments qui me fait parler. J’ai vu que votre belle sœur avait fait route de Pétersbourg au Havre avec Mauguin. Il lui aura dit d’étranges choses. Il a assez d’esprit pour faire croire à ceux qui n’en ont pas, qu’il en a beaucoup. J’ai été dérangé deux fois en vous écrivant. Il faut que je sorte. Adieu Votre adieu.
436. Londres, Dimanche 11 oct. 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
5 heures
Une occasion pour Calais. J’aime à vous donner ces plaisirs inattendus. Jusqu’à ce que viennent les plaisirs attendus, tous les jours à heure fixe. C’est un grand bonheur et une vive préoccupation que la place à trouver dans une vie politique tes pleine, pour une autre vie bien plus profonde et plus douce. J’y pense beaucoup. Je suis très inquich surtout du dedans. Je vois recommencer 1831 terrible époque où il a fallu une énorme dépense de jugement, de talent, de courage. M. Périer est mort à la peine. Je lis les journaux avec grand soin le National, le Courrier, le Siècle ; la fièvre révolutionnaire et la complaisance révolutionnaire. Je connais tout cela. Ce sont de vieux revenants mais toujours bien redoutables. Rien ne meurt en ce monde, que les personnes. Quand un grand mal a éclaté, quand un grand combat a commencé, il recommence tous les matins, pendant un siècle, comme le soleil se lève. On croit le soir qu’on pourra se reposer. Il faut être en armes, et rentrer en lutte le lendemain. Je crains la fatigue de beaucoup de vieux soldats.
La note que j’ai remisé hier produit ici, un effet de conciliation. Le Cabinet en a été très content. Lord Palmerston est retourné le soir à Penshänger. Il en revient demain, à ce qu’on m’assure. Je viens de voir le baron de Capellen, arrivé ce matin. J’ai fait vos amitiés à Dedel. Il n’y avait pas hier assez de soins, assez de graces pour moi, chez M. de Brünnow. Il m’a fallu choisir mes compagnons de Whist, un à un. Il ne voulait me donner personne que sûr de me plaire. Mad. de Brünnow en grands frais d’esprit. Mad. Kreptowitch est venue se tenir debout un quart d’heure, à côté de ma chaise, pour me porter bonheur. Rien que le monde diplomatique.
Si ce monde là avait vu en moi, il m’aurait trouvé bien loin de lui. Une pensée ne m’a pas quitte, pas un instant, dans cette maison ; une pensée pleine de tendresse et de tristesse, et de regret, et de désir. Ah, que de temps perdu dans la vie ! J’ai engagé M. de Brünnow à mes mardi et vendredi. J’y engagerai M. Kreptowitch, M. de Brünnow. recevra tour les samedi. L’heure me presse. Je vous quitte Adieu. Adieu. Sans fin d’ici à trois semaines.
435. Londres, Samedi 10 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Il est impossible que je n’aie pas un courrier ce matin. Il m’apportera sans doute la note qui a dû être adoptée dans le conseil de Mercredi. Si elle est rédigée avec mesure et habileté, elle peut ouvrir la porte à un arrangement, car on cherche une porte. Si elle a un caractère de défi et d’intimidation, elle aggravera le mal, car c’est sur ce point que, dans ce moment, les imaginations ici sont excitées et susceptibles. Il y a un an, on se promettait tout haut to bully in la France. Aujourd’hui, ce qu’on craint, c’est d’avoir l’air lo be bullied in par la France.
Que les hommes ont peu d’esprit ! S’ils voyaient les choses, s’ils se voyaient eux-mêmes comme ils sont réellement que de querelles tomberaient avec les méprises ! J’espère que la note sera bien. Je suis certainement très perplexe, mais perplexe sur les événements, pas du tout sur moi- même. Je n’ai pas la moindre hésitation de jugement et de conduite. Mon avis est arrêté, mon chemin tracé, mon parti pris. Jamais ma devise ne m’a paru plus vraie et plus commode. Un brouillard, ce matin comme je n’en ai pas encore vu à Londres. J’aperçois à peine la grille de ma cour. Un brouillard, d’un blanc jaune fade. Un petit soleil rouge-pâle, collé sur le ciel comme un pain à cacheter. Je ne sais comment les gens s’en tirent dans les rues.
A Paris on parle encore, on s’appelle, on s’avertit. Ici toujours le silence dans la foule et le mouvement. Comme je ne vois rien, de même je n’entends personne. Je suppose qu’on se heurte beaucoup et qu’on reprend son chemin, sans se rien dire. Il faut que la vie sociale soit une bien bonne chose pour se maintenir si forte et si active entre des gens qui y prennent si peu de peine et si peu de plaisir. Hier soir Neumann, Pollon, Moncorvo, Celto, Van de Weyer, Schleinitz. Et parmi les petits, s’il y a des grands, tous les secrétaires et attachés de l’Autriche. Koller Esterhazy, Lebzeltern, avec une intention marquée d’empressement.
Ce soir à Ashburnham house, j’engagerai M. de Brünnow à venir. Je ne l’avais pas encore fait. Dedel est venu le matin. Nous avons beaucoup causé. Il regrette son vieux Roi. moi, je trouve sa proclamation (au Roi) admirable. Grave simple et résolue. On n’a jamais abdiqué plus galamment : " Je suis fatigué. Et puis la façon dont on me demande à présent de gouverner ne me convient pas. J’ai consenti à ce qu’on désirait. Mais pour le pratiquer, il faudrait changer mes habitudes. Je suis trop vieux. " On dit qu’il n’épousera pas Melle d’Outremont ; qu’après un voyage à Berlin, il reviendra vivre à Harlem, dans un joli pavillon qui lui appartient. On donne pour preuve du non-mariage, qu’il garde auprès de lui toutes les dames de la feue Reine. Moi, je parie pour le mariage.
Une heure
J’ai eu mon courrier et cette note dont je crois que le résultat, sera pacifique. J’ai écrit sur le champ à lord Palmerston pour lui demander à le voir avant le conseil. Il doit revenir ce matin de Penshänger. Cette absence perpétuelle n’est pas commode. Oui certainement je serai à Paris au début de la session. L’adresse ne peut pas se discuter sans moi. J’ai besoin d’y être, pour mon compte autant. qu’on a besoin que j’y sois pour le compte de la discussion. Je vous ai dit hier mon projet, quelques jours au Val-Richer, puis Paris. Paris ! Je vis depuis le 6 septembre, dans une cruelle anxiété sur le moment où j’irai à Paris.
Vous avez raison ; on devrait ne jamais accepter la moindre illusion. Mais cela ne se peut pas. On ne s’avoue jamais, sur ce qu’on désire ardemment toutes les difficultés, tous les doutes. Je dis les doutes parce que c’est là le vrai. Quand nous nous sommes séparés, le moment possible de mon retour à Paris était douteux, et nous aurions dû nous le dire. Mais nous ne nous serions pas arrêtés dans le doute. Nous aurions tenu le mal pour certain, et nous ne voulions pas. Ne dites rien, je vous prie sur M. O. Barrot. A part moi, je suis très décidé. Mais je ne sais pas à quel moment je placerai la publicité de ma décision, ni quel degré de publicité je lui donnerai. Si le Cabinet doit tomber, je veux être absolument étranger à sa chute aux revers qui amèneront sa chute. Bien rester dans ma ligne à moi, et m’y trouver bien debout si les événements viennent m’y chercher voilà à quoi je m’applique. Je ne veux pas faire les événements qui pourraient venir m’y chercher, ni qu’on puisse seulement supposer que j’ai voulu les faire. Vous avez très bien répondu à Mad.12
Adieu. Adieu. Je tourne le dos à ma gravure. J’en suis même de loin, à l’autre bout du Cabinet. Adieu. Adieu.
448. Paris, Samedi 10 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai déjà votre lettre, c’est qu’elle me vient par le vieux et le moins élégant . Elle est assez bonne votre lettre. Vous avez l’air d’espérer quelque chose. Si l’on veut faire, il est temps de faire ! J’aime votre lettre, j’aimais bien celle d’hier. Je les aime toutes. Vous ne savez pas comme j’aime, comme je pense, comme je rêve, comme j’attends !
Hier mon ambassadeur et Bulwer, tous les Appony. Dîner aves mon fils. Le soir chez les Granville, Granville était un peu blessé d’avoir vu reproduit et perverti comme dit Bulwer, un entretien qu’il a eu avec Thiers. C’est le Courrier français qui répétait et avec des expressions ironiques pour l’Angleterre. Granville continue à être très inquiet, tout le monde le devient beaucoup. Thiers demande souvent à mon ambassadeur des nouvelles de notre flotte. Il lui répond invariablement qu’il saura par Copenhagen quand elle passera, et que lui n’en sait rien.
On parle de convention nationale polonaise qui s’organiserait à Paris. On élira un roi, et l’on ajoute que si la France à besoin de prendre la Belgique elle priera Léopold d’aller trôner à Varsovie. Je vous redis tous les commérages diplomatiques. Je vous assure que l’attitude de Pahlen est parfait, un vrai gentleman au reste ils le sont tous ici dans cette occasion. Que pense Dedel de son nouveau roi ? Moi j’en pense très petitement. De très jolies formes couvrent un très pauvre fond. L’air d’un vieux chevalier et les actions d’un chevalier d’industrie. La mine ouverte, et une grande fausseté. Enfin c’est non seulement peu de chose, mais une mauvaise chose. Voilà mon opinion. Il faut absolument que vous permettiez ou que vous ordonniez au très fidèle d’aller vous trouver à Calais ou sur la route, quand vous reviendrez. Il sera bon que vous causiez à fond avec lui avant de voir personne ici.
Certainement j’ai pris 20 en grande dé plaisance. 29 qui est son reflet parle trop légèrement du Fresnes et puis on dirait qu’il est inutile de compter avec le chêne.Tout cela est traité étrangement. J’ai de la colère intérieure, j’aimerais bien à la montrer.
La petite duchesse de Dino est accouchée bien péniblement et tristement d’un enfant mort. Elle a eu des couches affreuses. Le duc de Mortemart vient de perdre son fils unique à 24 ans, tué par un cheval. Le duc de Wellington a écrit ici une lettre que j’ai lu à me M. Raylkes bien petit personnage. Un ivrogne, et un grand Tory, dans laquelle il lui dit après avoir déplore les circonstances que pourraient mener à une rupture avec la France : " Mais si la guerre a lieu, soyez sûr que nous étonnerons le monde par les efforts gigantesques que nous ferons pour la soutenir. Ils seront tels qu’on n’en a pas vu encore de semblable. " Je vous avoue que toute cette lettre me parait du Stuff. C’est décousu et trivial à l’excès.
Le 28 est proche, le cœur me bat de joie. Vous viendrez, vous viendrez n’est-ce pas ? Si vous pouviez venir avec quelque chose, quelque grande chose ! Il y a dans mon cœur une confusion de politique est d’amour qui est tout à fait risible. La nuit, le jour, je ne pense qu’à cela ; avec passion, avec inquiétude. Ah mon Dieu !
Adieu. Adieu. Comme vous voulez. Adieu. Je vous ai demandé avant hier je crois de nouvelles de Brunow. Vous m’en donnez aujourd’hui, on dirait que nous nous parlons par télégraphe. Je n’attends pas une grande importance à ce que vous me dites des manières nouvelles de nos diplomates. Cependant, je ne sais pas.
Adieu. Adieu. Le leading article du journal des Débats ce matin est admirable. C’est vrai tout cela est bien étrangement même ! Voilà ma belle-sœur arrivée. Adieu. Adieu. Il y m’a beaucoup dans cette lettre. Jamais assez Adieu.
449. Paris, Samedi 10 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici la copie d’une lettre que ma belle sœur vient de me remettre. Dites-m’en votre avis, je la trouve très mauvaise ; pour bête cela va sans dire, mais dites-moi ce que j’ai à répondre. Je suis fâchée de me fâcher ; ces gens-là n’en valent pas la peine. Je ne puis pas me résigner à me taire, et je ne sais sur quel ton le prendre, ni comment me faire comprendre par des sots. Éclairez-moi et décidez-moi.
D’un autre côté voici depuis cinq ans et demi le premier message de l’Empereur. Il a chargé expressément ma belle sœur de me dire " qu’il espère que je ne l’oublie pas lui non plus ancien ami. " Arrangez cela.
Ma belle-sœur est arrivée de Pétersbourg avec M. Mauguin, recommandée par mon frère aux soins de M. Mauguin depuis le Havre, elle a voyagé dans le coupé de la malle-poste avec M. Mauguin. M. Mauguin d’un signe à écarté les embarras de la douane, « il a fait comprendre qu’il fallait. des égards à Mad. de Benckendorff. M. Mauguin a promis sa protection à ma belle-sœur en car d’émeute ou de révolution, et M. Mauguin a assuré ma belle-sœur qu’il s’opposerait de toutes ses forces à la guerre et qu’il n’y aurait pas de guerre. Mon frère a eu de longs entretiens avec M. Mauguin, et lui a fait comprendre toute la politique de l’Empereur dont M. Mauguin est émerveillé et M. Mauguin est converti !
Je viens de vous raconter une demi-heure de ma matinée, après cela le bois de Boulogne, et puis lord Granville chez moi. Appony avant le promenade rien de nouveau une partie du Cabinet très disposée à la guerre. Je vous écris aux bougies c’est mauvais pour mes yeux, je vous quitte.
Dimanche 11 octobre. 9 heures
Je me suis levée avec quelques nouvelles idées. Si je ne prenais acte que du message de l’Empereur et que je traitasse mon frère de sot, qu’en pensez-vous ? Ce qui est bien certain, c’est que l’à propos de ce message n’est pas insignifiant. Dans ma réponse à mon frère je l’exalterai fort, et je rapetisserai, le valet de tout ce que je grandirai le maître. Approuvez-vous. ? Dans tous les cas mon frère aura le détail des vilainies de M. de Brünnow. Mais dois-je insister sur une satisfaction ? Voilà ce que je vous demande.
Je vous demande une autre chose ; dois-je écrire comme ci-devant Savez-vous que je le ferais avec infiniment de plaisir si j’écrivais droit à l’Empereur. C’est mon frère contre qui j’ai de la rancune. Enfin dites-moi, ce que j’ai à faire. Rien du tout, n’est pas possible.
J’ai dîné seule et puis j’ai été aux Italiens. J’avais dans ma loge Mad. de Flahaut, les Pahlen et Hennage. M. de Werther y est venu. Tout le monde hier était à l’espérance tout le monde croyait que dans les deux pays, on désire et on travaille sincèrement à un arrangement. Voilà le vent d’hier ne sera-t-il demain, aujourd’hui ? Certainement la situation de Thiers est pleine de difficultés, moins de périls ; on le pousse, pourra-t-il résister ?
Onze heures.
Voici votre lettre. Vous venez d’apprendre la convocation. Cela vous a écris comme moi. Que des choses réunies dans cette convocation ! Quel moment pour nous ! Vous avez raison, on ne peut pas parler. Il y a trop trop dans ce fait. Il est immense pour nous. Serez-vous content de ce que vous a porté M. de Lavalette ? le public ici est bien curieux de le connaître. Le petit fidèle croit savoir que c’est une platitude. vous prêteriez-vous a une platitude ? Je suis dans une grande anxiété.
Midi.
Je viens de voir le petit. Je l’engage à vous écrire sans cesse la nuit et le jour, il fait que vous soyez informé de tout car tout à de l’importance.
Adieu. Adieu, bientôt quel adieu !
Les diplomates disaient hier que la France veut quelque chose. de plus que le traité, quelque chose de plus grand comme la tête d’une épingle. Mais enfin quelque chose. Cela va peu avec ce que dit le petit mais on vit ici dans un cercle de confusion et de contradictions. Adieu. Adieu.
434. Londres, Vendredi 9 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je ne veux dire à personne, pas même à vous, pas même à moi. même, de quelle impatience je suis dévoré. J’attendais un courrier ce matin. Il ne vient pas. Je vois dans les journaux anglais que les Chambres sont convoquées, pour le 28 octobre. Dans vingt jours ! Et d’ici là, que se passera-t-il ? Que va-t-on m’envoyer, me donner à dire, à faire ici ? Je persiste à croire à la paix très décidément. Il faudra encore bien des méprises pour amener la guerre. J’espère qu’il n’y en aura pas assez, de part ni d’autre. Dans vingt jours enfin. J’ai le cœur et l’esprit pleins, pleins ! Quel moment que l’ouverture des Chambres si tout est encore en suspens ! Vous vous porterez bien, n’est-ce pas ? Je n’aurai pas à m’inquiêter sur vous ? Je vous quitte. Je ne puis pas parler.
3 heures
Ma disposition est toujours la même. Je veux pourtant vous parler. On est inquiet ici. Je ne veux pas dire très inquiet. On n’est jamais très inquiet. On est très brave et très en sureté. C’est heureux d’être une grande nation avec l’Océan pour enceinte continue. Mais on redoute réellement, sinon les périls du moins les maux de la guerre. Et puis, on n’a nul goût pour une rupture avec la France ; on tient vraiment à vivre en paix et en amitié avec la France. Cela est profitable et cela a bon air. Les deux grands pays civilisés ; two gentlemen-countries. Et puis encore, au fond du cœur, on aurait honte d’une guerre si peu motivée, amenée uniquement parce qu’on ne l’aurait pas prévue, parce qu’on ne l’aurait pas crue possible. Car si on l’avait crue possible, on n’aurait certainement pas fait ce qui peut l’amener. Voilà la disposition au vrai. Je ne puis pas ne pas croire qu’on peut encore en tirer parti et sortir de cet abominable défilé. Mais, dans les actes et les paroles, la nuance est délicate et indispensable à saisir. En même temps qu’on a envie d’éviter la guerre et de s’accommoder, on est fier surceptible même. Pour rien au monde, on ne voudrait avoir, l’air de céder à la menace. On est, à cet égard, d’une préoccupation presque maladive. Ma principale inquiétude de ce moment est là. De part et d’autre, on a la peau d’une sensibilité prodigieuse. Il y faut des mains de velours. Mains rares, surtout après tant de révolutions, et de guerres.
Avoir raison au fond, et raison dans la forme, c’est beaucoup exiger. Ce sont des moments bien périlleux que ceux auxquels la perfection seule suffit. Et qui sait si la perfection même suffirait ? Je passe ma journée, en alternatives d’inquiétude et d’espérance, situation fort contraire à ma nature qui est portée à conclure, non à flotter et quand elle a conclu, à marcher ferme selon sa conclusion. Par mon instinct je dirai plus par mon expérience, j’ai confiance, grande confiance dans le courage au service du bon sens. Mais l’épreuve peut être bien rude. Et encore je ne vois les obstacles que de loin.
Je désire beaucoup, en me rendant à la session, pouvoir aller prendre ma mère et mes enfans au Val-Richer et les ramener avec moi à Paris. Je respirerais deux ou trois jours l’air de la campagne. Je ferais ce que vous me conseillez et j’arriverais un peu reposé. Car j’arriverai. C’est encore une chose dont je ne peux pas parler. Je n’ai point de petite nouvelle à vous mander. Je me trompe. M. de Brünnow, vient de m’écrire pour me prier d’aller après-demain prendre du thé et jouer au Whist à Ashburnham house. Je ne suis encore entré qu’une fois dans cette maison Ià, et certes pas avec indifférence. Unir à ce point dans le présent et étrangers, dans le passé, cela ne vous semble-t-il pas impossible ? Le comte de Noé est venu me voir il y a deux jours, m’apportant la nouvelle que Mad. Sébastiani était morte, morte à Richmond, au Star and Garter. C’est Mad. Bathiany qui est morte là. Voilà l’ordonnance de convocation, des chambres dans la seconde édition du Morning Post. C’est bien pour le 28. Adieu. Adieu.
447. Paris, Vendredi 9 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu hier matin mon ambassadeur. Le soir les Granville, où j’ai trouvé Mad. de Flahaut. J’avais fait ma promenade d’habitude dans feu le bois de Boulogne; mon dîner seule, car mon fils dînait dehors.
Je trouve qu’on est généralement rassurer par la convocation des Chambres. C’est quelques semaines de répit. Peut-être pour arriver à pire ! Mais il y a aussi la chance du contraire. Ne faudra-t-il pas la tribune nglaise comme contrepoids ? M. de Broglie est fort consulté et fort occupé. Il s’occcupe toujours avec prédilection d’un ministère qui est son ouvrage, et trouve que la candidature de M. Odilon Barrot pour la présidence est un dévoir de la part du ministère. On dit cependant que M. de Broglie est très inquiet, inquiet de tout, du dehors, du dedans. Il a raison de l’être car tout ceci est bien sérieux. les propos dans le public deviennent atroces. On retourne aux temps où ce n’est pas de l’eau qui coulait sur cette belle place. Vraiment, ma peur vient de bien des côtés maintenant. Je n’ai reçu votre lettre hier qu’à 6 heures.
11. J’ai depuis quelques jours une lecture qui m’amuse beaucoup, c’est mes lettres à mon mari depuis le jour de mon arrivée à Paris. La nouveauté des impressions le jugement quelques fois. correct, d’autre fois un peu léger sur les personnes. Le crescendo, quelques fois le décrescendo de mon goût pour elles, tout cela me divertit à relire. J’essaie de ranger mes papiers, je crois que je n’y réussirai jamais.
Midi
Voici votre lettre qui me plait bien, je suis fâchée de ce mauvais jour qui m’empêche de vous le dire comme je le voudrais. M. de Pahlen a eu un courrier au bout de quatre mois, mais un courrier qui traite de généralités à ce qu’il dit. Il est toujours excellent, sensé, mais bien inquiet. Il pense qu’on va commencer à l’être aussi. Adieu, car je ne vois rien à vous dire ! Comment êtes vous content, ou mécontent de Flahaut ? Adieu très intimement.
433. Londres, Jeudi 8 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Mardi est votre mauvais jour. Jeudi est mon jour médiocre. Le mardi, vous m’écrivez plus brièvement ; vous n’avez pas en m’écrivant, le sentiment d’espérance ou de satisfaction qui anime et prolonge l’entretien. Comme nous regardons à tout ! Il n’y a rien de petit pour nous et entre nous. Je dis nous ; vous avez bien raison, tout est pareil entre nous ; nous n’avons rien à nous demander. Nous nous savons. Décidément les Holland partent aujourd’hui pour Brighton. J’ai été leur faire mes adieux hier au soir. Pour huit ou dix jours. Je dis décidément parce qu’on le disait. Ils pourraient bien être encore retenus ou bientôt rappelés. Il y aura peut-être un nouveau conseil de Cabinet après-demain samedi ou lundi. La gravité de la situation se fait sentir et je la fais valoir. On cherche sérieusement un moyen de calmer la France et de se rapprocher. Les plus raides eux-mêmes le cherchent. Il faut le trouver pendant que le traité s’exécute. Il faut se rapprocher au bruit du canon qui vient frapper les cœurs en France, sinon les corps. C’est difficile. Cependant, pourvu qu’on ne fasse pas de folie à Paris, je crois toujours qu’on finira par là. Moi aussi, j’attends la convocation des Chambres. Il faut au moins vingt jours de délai. Cela porte aux premiers jours de Novembre. Du reste, officiellement je n’en sais absolument rien.
C’est le peintre qui n’a pas voulu que je le regardasse. Car, pour vous regarder vous ; il aurait fallu le regarder lui, et tout le monde, et de la même manière. Il a dit qu’il valait mieux ne regarder personne et penser à quelque chose. Moi, je dis à quelqu’un. Pour être vrai cependant, je crois que c’est à quelque chose que pense mon portrait. Grand défaut de ressemblance. Hier soir en revenant de Holland house, j’ai été passer une demi-heure chez Mad. de Björstierna, soirée invitée. Tout ce qu’il y a ici de diplomates grands ou petits, et quatre ou cinq Anglais. J’ai joué au Whist. M. de Brünnow est toujours assez malade, et vraiment très changé. Je l’ai rencontré, il y a trois jours comme je faisais à pied ; le tour de Hyde park, ce tour que nous avons fait souvent le soir en calèche. Il se promenait aussi à pied. Il s’est joint à moi, avec un grand empressement et n’a pas voulu me quitter qu’il ne m’ait reconduit jusqu’à ma porte. On m’écrit que M. de Tatischeff à Vienne, M. de Meyendorff à Berlin, et même vos plus petits agents, dans les plus petits endroits sont remarquablement polis et soigneux depuis un mois avec les agents français, beaucoup plus qu’avant. En savez-vous quelque chose ? Et qu’est-ce que cela veut dire, si cela veut dire quelque chose, ce que je ne crois pas ?
Lord Melbourne est venu hier à Londres. Mais il n’a pas que dîner à Holland house. Il est retenu chez lui par un fort lumbago.
2 heures
Je reviens de Regent’s park. Je marchais dans Portland Place, les yeux baissés. Je les lève et je vois devant moi, assez loin une femme en noir, grande mince, un chapeau blanc, un petit voile, un mantelet de velours noir. Elle a paru me voir au même moment et doubler le pas. Le cœur m’a battu, mais battu ! Comme le sang vous monte au visage. On parle de l’influence du physique sur le moral. Et du moral, sur le physique, qu’en dire ? Pendant quelques minutes, toute ma personne s’est ressentie de cette idée, cette chimère, qui m’avait traversé l’esprit un quart de seconde. Vous avez très bien fait d’écrire à Paul. Vous le pouviez très convenablement après la façon dont vous vous étiez séparés, et dès lors vous le deviez, car vous devez ne laisser jamais échapper une occasion de lui fournir un moyen de revenir de ses torts. J’avais espéré que votre dernière entrevue, amènerait quelque chose d’un peu mieux que le simple décorum extérieur. Je crains bien qu’il ne veuille que cela. S’il vient à Paris, il faudra lui donner ce qu’il veut, et toutes les fois que vous le pourrez avec dignité, lui laisser entrevoir que, s’il voulait, il pourrait avoir davantage. Une humeur très égale, une douceur un peu triste, mais calme et persévérante, finiront peut-être par réveiller dans ce cœur là quelques uns des sentiments qui devraient y être. Comment ne m’aviez-vous pas dit que vous lui aviez écrit ? Le Chêne et le cèdre sont également sages. Ils écrivent, l’un et l’autre, très rarement à 21, et toujours avec une réserve prévoyante. Ce serait une triste et curieuse histoire que celle des rapports du hêtre avec 99, et qui ferait pénétrer bien avant dans les plus fins et plus profonds replis du cœur humain. Les mêmes passions, les mêmes faiblesses qui dominent sans pudeur comme sans combat, dans les natures grossières et basses, pénètrent souvent, par de très longs détours et après, des transformations infinies, dans les natures hautes et délicates. C’est là, dit-on de quoi dégoûter des hommes. Je ne le trouve pas. J’ai rencontré bien des coeurs légers, mais aussi des cœurs fidèles. J’ai vu tomber bien des gens ; j’en ai vu qui sont restés debout. Un seul bel exemple compense et efface presque à mes yeux, des milliers d’exemples tristes. Et là même où le mal se glisse, tout le bien ne périt pas. L’âme peut accueillir de mauvais et petits sentiments, et pourtant rester noble encore.
L’expérience de la vie m’a appris à beaucoup dédaigner et à rester juste. Je suis devenu plus exigeant à part moi, et plus indulgent dans presque toutes mes relations. Je me donne bien moins et je pardonne bien davantage. Et puis pour croire à la lumière, et pour en jouir, je n’ai pas besoin qu’il y ait au ciel des millions d’étoiles ; mon soleil me suffit. J’ai vu plusieurs personnes ce matin. Il me semble que l’inquiétude est réelle ici et va croissant. Hier soir chez Mad. de Björstierna, Neumann me disait, avec quelque componction, que certainement, si l’on avait prévu tout cela, on aurait fait autrement. Easthope sort d’ici, très inquiet, et répétant qu’il faut qu’on fasse quelque chose pour calmer la France. Nous verrons. Cette situation ne peut plus se prolonger beaucoup. Adieu. Que je passerais doucement de longues heures à causer avec vous ! Et les interruptions mille fois plus douces encore que les causeries. Adieu Adieu.
446. Paris, Jeudi le 8 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai vu hier Montrond, mon ambassadeur, et le reste de la diplomatie le soir chez Appony. La journée toute guerrière, Appony avait été frappé cependant de trouver Thiers la veille plus découragé que vaillant ; l’esprit très préoccupé. Un homme fatigué, abattu. Vraiment on ne sait pas comment tout ceci peut tourner. Le parti de la paix se renforce cependant, mais le parti contraire est bien bruyant, bien pressé. Le roi est toujours très vif avec Appony, infiniment plus doux avec mon ambassadeur.
Il a fait l’éloge de M. Titoff qui s’est refusé à prendre part à Constantinople, à la dépossession du Pacha. J’ai reçu le petit ami dans la journée. Je suis très frappée de voir que dans le récit de ses longs entretiens avec 1, il soit si peu ou point du tout question du chêne.
Décidément S. n’est pas un ami sincère. Il y a quelque ancienne rancune qui perce. Dites au frênes de ne pas s’y fier tout-à-fait.
Les ambassadeurs sont fort disposés à désirer la convocation des chambres, moi aussi. On dirait cependant que hier rien n’était décidé. J’ai eu hier une lettre de M. de Capellan dans laquelle Il me rend compte des événements de La Haye, et où il me dit qu’il part demain pour Londres pour annoncer à la reine l’avènement de son nouveau roi. Je suis désolées que nous perdions Fagel, son successeur Zeeylen est un désagréable homme. Dites toujours je vous prie mes tendresses à Dedel que j’aime beaucoup, est-il confirmé à Londres ? Pourquoi n’est-ce pas lui qu’on nomme à Paris ?
L’arrivée de ma belle-sœur m’ennuie beaucoup. Sa fille me plait davantage tous les jours. Mais elle a peu d’esprit et elle n’a que deux préoccupation sa toilette, et son mari. Et comme cela, dans cet ordre-là.
11 heures
Je suis enchantée voilà la convocation, et plus prochaine que je ne croyais. Moins de trois semaines. Dites- moi bien, répétez-moi bien que vous viendrez. Ah quel beau jour ! Vous ne sauriez imaginer comme mon cœur est joyeux. Si fait vous le savez, et vous répondez à ce transport. Mon fils va lundi à Londres pour revenir la veille de l’ouverture des chambres. Je ne lui ai pas nommé son frère. On a parlé à Baden de M. de Brünnow et moi ; les Russes en ont parlé, car la petit Hesselrode venu de Londres savait tout. Il n’y a eu qu’une opinion, on l’a blâmée de la vilenie, et encore un peu plus de la bêtise. Cependant, cependant, vous voyez qu’on ne me répond pas. Que c’est bête encore !
Vous ne voyez donc pas du tout M. de Brünnow ? Voici ce que je réponds à lady Palmerston. " Il est assez naturel que M. Guizot aime à parler de préférence avec les gens qui sont de son avis ; mais je le crois assez bien orienté en Angleterre pour savoir qu’il n’y a pas d’autre bénéfice pour lui à cela que le plaisir de la conversation. Il sait fort bien que les gens qui parlent la plus ne sont pas ceux qui mènent."
2 heures
Le petit avec ami me quitte ; nous bavardons, nous bavardons ! Voilà donc que M. Barrot sera porté à la présidence. Vous ne jugerez pas possible sans doute de rester neutre ! Je vous fais la question. J’ai donné au petit les noms français Voilà du monde il n’y a pas moyen de continuer. Je n’ai pas eu de lettres encore aujourd’hui. Adieu. Adieu.
Paris, le 7 octobre 1840, Général Baudrand à François Guizot
432. Londres, Mercredi 7 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Voici une lettre d’Ellice. Il me l’a envoyée ouverte en m’engageant à la lire. Il a vraiment de l’esprit et plus d’intelligence continentale et française que presque tous ici. Il a compris, dès l’origine, que, par le chemin où l’on entrait, on en viendrait où nous en sommes. Si tout le monde, avait prévu aussi clair, tout le monde aurait agi autrement. Le vice radical de cette situation, c’est qu’elle n’était pas du tout nécessaire. Aucun grand événement, aucun grand motif européen n’y a conduit. Il y avait, dans un coin de l’Asie, entre un vieux Pacha et un Sultan mourant, une querelle qui laissée à elle-même, serait morte avec eux sans trouble un moment l’Europe. On en a fait une chance de guerre générale. Pourquoi ? Pour satisfaire la passion de lord Ponsomby contre le Pacha et les rêves de Lord Palmerston pour la résurrection de l’Empire Ottoman.
Voilà un courrier. Il ne m’apporte rien, rien du tout. J’en conclus qu’on patauge encore. Le mot est bien à l’image du fait. Je ne veux pas me dire, à moi-même, à quel point je suis impatient. Je vais faire ma toilette, en attendant la poste. 2 heures Certainement non. Jamais trop de feuillets, jamais assez. Vos lettres, c’est mon pain, mon délicieux pain quotidien. J’ai faim avant. Quand elles sont courtes, j’ai faim après. Quand elles sont longues, je suis nourri, point rassasié. Oui nous sommes parfaitement Ninojlubtn, et je sais parfaitement ce que cela veut dire. C’est un mot charmant. Et qui serait encore plus charmant de près que de loin.
La crise de Paris me paraît vive. Je rabâche, car je suis sûr qu’elle est moins vive qu’elle ne paraît. Comme au fond du cœur, presque personne n’a envie de la guerre, pas même les trois quarts de ceux qui la demandent à si grands cris, il est impossible que le fond du cœur n’influe pas sur la réalité de la conduite. On paie les autres d’apparences, et de paroles ; on ne s’en paie pas tout-à-fait aussi aisément soi-même. Cependant un moment peut venir où l’on l’enivre de tant de paroles et si bruyantes. Je n’irai pas avec les gens ivres. La guerre peut sortir de cette situation, et c’est son immense mal. Si elle en sort inopinément, forcément il faudra bien l’accepter, et l’accepter galamment. Mais je crois qu’on peut empêcher qu’elle n’en sorte, et qu’il y faut travailler ardemment. Et toute politique qui poussera, ou se laissera pousser à la guerre ne m’aura pas pour complice.
Probablement, je vous ai déjà dit cela bien des fois. Je rabâche, car je suis très convaincu. Je suis sûr que Thiers se défend contre le vent qui souffle autour de lui si le vent l’emportait, ce ne serait pas une raison pour se laisser emporter soi-même, et pour laisser tout emporter. Il y a encore de la folie révolutionnaire de la folie militaire dans mon pays ; mais aujourd’hui dans cette folie même, il y a plus d’écume que de venin. Et on trouvera toujours, dans le bon sens honnête de pays un point d’appui pour résister. Je pense aujourd’hui, comme en 1831, que pour une guerre juste, inévitable, défensive, la France est très forte, et que l’Europe serait bientôt divisée. Il faut donc que la guerre si elle doit éclater, soit ramenée à ce caractère, et contenue dans ces limites. Et à ces conditions, je suis porté à croire qu’elle n’éclatera pas. Car, malgré la faute très grave que l’Europe a commise en laissant se former, en formant de ses mains, un tel orage pour un si misérable motif, je crois encore au bon sens de l’Europe, et je suis persuadé qu’en Europe comme en France, la bonne politique trouverait de l’appui. Du reste le très fidèle m’écrit ce matin que la bourrasque de dimanche est un peu calmée et que les choses vont moins vite.
Ici, il y a certainement un peu d’inquiétude réelle et un désir sincère de jeter de baume sur les plaies de celte situation, en même temps qu’un parti pris d’exécuter ce qu’on a entrepris, et de ne pas faire acte de faiblesse. On est plus léger avant qu’après. On ne veut pas avoir été léger en paraître intimidé. Mais on n’est pas sans sérieuse appréhension et on a grande hâte d’atteindre le terme du défilé pour se montrer au bout. un peu plus accommodant qu’à l’entrée. Les Ministres se sont dispersés de nouveau. Mais je ne crois pas que lord John Russell, s’éloigne désormais de Londres. J’espère que Berryer et les siens n’espéreront pas trop. Les étrangers, et l’Ancien Régime, la coalition et la contre-révolution, ce sont les deux spectres du pays ; leur vice le pousse à la folie. Adieu. Je ne méprise rien. Je ne me lasse de rien. Je désire tout. Je ne peux me contenter que de tout. Mais j’aime et je goûte toujours avec le même plaisir les moindres portions de ce tout ravissant. Adieu donc aussi tendrement que le jour où adieu fut inventé.
445. Paris, Mercredi 7 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
J’ai trouvé les Granville fort inquiets hier. Cela me parait un mauvais signe. J’ai fait une très longue promenade au bois de Boulogne, une visite en Autriche, et en rentrant chez moi j’y trouve mon fils Alexandre. Il avait lu les journaux de Paris, à Bruxelles. Ils lui ont paru si menaçants qu’au lieu d’aller à Londres il a tourné de ce côté-ci pour voir ce qui se passait. Il restera ici huit jours et puis il va à Londres pour revenir ensuite. J’ai dîné avec lui et comme mon ambassadeur allait à St Cloud et que je n’attends ce soir de visite que la sienne j’ai été passer ma soirée chez Lady Granville.
Je l’ai trouvée seule avec lord et lady Seaford, mariés depuis 6 jours à Londres. Un vieil amour, entre de veilles gens, réchauffé par un mariage fort raisonnable mais pas intéressant lord Seaford était l’une des amies de M. Canning. Il les choisissait tous un peu bêtes. On disait que le conseil hier à St Cloud devait être très important. La bourse s’est encore agitée énormément et les fonds ont éprouvés une hausse de 4 %. On annonçait pour ce matin une espèce de protestation dans le ministère au sujet de la déchéance du pacha.
Appony a couru hier soir à St Cloud pour dire au roi qu’il savait de source certaine sans être encore directe, qui sa cour blâmait hautement la Porte (et infiniment plus haut encore son internonce pour la part ostensible qu’il y a prise) au sujet de cet acte de déchéance. On espère que ce blâme arrêtera votre cour ! Mais tout arrive si tard. En vérité, je crains beaucoup plus que je n’espère, quoique mon refrain, comme celui de tout le monde, soit toujours. " Mais ce serait fou. "
1 heure
Je n’ai vu encore que le petit ami. Son intelligence et la mienne vous sont bien dévoués. J’allais dire son cœur &. Mais là je ne veux pas de cocarde. Et bien nous trouvons, je trouve surtout et mon Dieu je ne sais que dire, on peut si peu dire par lettre. j’espère que si les chambres sont convoquées, vous vous arrangiez de façon à aller avant passer quelques jours dans votre famille, faites y venir le petit ami, ce sera bien utile. Au fond votre situation est bonne. Vous êtes en dehors de toute intrigue. Vous remplissez avec dévouement, fermeté, habileté vos devoirs là où vous êtes, le jour ou il faudra en rendre compte vous saurez le faire à votre plus grande gloire. Jusque là vous êtes tranquille. Si vous écrivez au frêne recommandez lui bien de ne pas dire un mot, pas écrire une ligne qui l’engage à quoi que ce soit Sa couleur on la connait ; il ne peut pas en avoir, on ne doit pas, on ne peut pas lui en prêter un autre. Je reçois votre lettre dans cet instant, que je voudrais être occupée de vous, pour vous.
2 heures
J’ai été interrompue par tant de monde que je n’ai plus qu’un instant. La crise est plus fort que jamais dans ce moment un conseil chez le Roi, très important. On décide la convocation et la protestation. On dit presque l’existence ministérielle. Montrond sort d’ici. Il croit que la chambre sera convoquée pour le 7. Le maréchal Gérard va faire paraître un ordre du jour défendant toute manifestation publique d’origine politique de la garde nationale. Granville a une audience du Roi ce matin. Je suis très très pressée. Vous aurez des lettres aujourd’hui.
Adieu. Adieu mille fois eh tendrement adieu. Quel moment ! Adieu le roi très pacifique.
431. Londres, Mardi 6 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
sept heures et demie
Moi aussi je suis très agité. Tout absolument, tout est engagé, pour moi dans cette question. Mes plus chers intérêts personnels. Les plus grands intérêts politiques de mon pays, et de moi dans mon pays. Et tout cela se décide sans moi, loin de moi, en Syrie par le canon de Napier, à Paris par les conseils d’un Cabinet qui n’est pas le mien.
Ma raison persiste dans sa confiance. Je ne crois pas à la guerre. Mais mon âme est pleine de trouble. Je n’ai jamais été si agité. On se promet ici un succès prompt. On se promet que ce qui s’est passé à Beyrouth se passera, non à Alexandrie, on ne le tentera pas là, mais sur toute la côte de Syrie, à Sidon, à Tripoli, à St Jean d’Acre. On se promet. que, cela fait, le Pacha cédera et qu’on s’arrangera. On est bien léger bien présomptueux bien aveugle. Mais tout le monde l’est. On agit au hasard. On parle au hasard. Vraiment les affaires des hommes sont étrangement faites. S’ils étaient capables de le voir, ils ne le souffriraient certainement pas. Quand on n’est pas content de la politique on fait de la morale.
Hier soir à Holland house. J’étais mécontent, de mauvaise humeur. Je l’ai montré. Ce pauvre lord Holland était troublé, interdit. Il n’est pas fait pour être affligé, seulement contrarié. Il voudrait tout le monde toujours doux, aimable, content. Lady Holland a l’âme plus forte. Elle était extrêmement blessée d’un article de l’Examiner, qui a mis Holland house, en scène. Elle connait l’auteur. Elle l’a bien traité. Je lui conseille, à l’auteur, de ne pas se trouver sur son chemin. Je suis fort en scène aussi dans cet article, très convenablement pour moi, Français. Je gouverne d’un côté les vieux Whigs par Holland house de l’autre les radicaux. J’agite l’intérieur du cabinet. Du reste, l’article n’est pas si mauvais qu’il en veut avoir l’air. Au fond, il conseille une transaction.
Lord et lady Shelburne, Charles Greville, Sir Hussey Vivian, un ou deux inconnus. Lady Clanricard n’est pas à Londres. Lady Shelburne attendait avec quelque impatience que je me fisse présenter à elle. Elle a dit à lady Holland : " J’ai vu bien souvent M. Guizot à Paris, mais je n’étais rien alors. Il ne me connait pas. "
Je me suis fait présenter à présent qu’elle est quelque chose. Lord Shelburne aurait mieux fait d’insister pour Emilie. Elle était là, à côté. Décidément, dit lady Holland, ils partent après-demain pour Brighton. Leurs logements y sont arrêtés. Pour huit jours. Huit jours d’air nouveau et d’eau de Marienbad.
2 heures
Ne me grondez pas, je vous en prie, ne me grondez pas de ma réserve. Elle me déplaît bien autant qu’à vous. Mais soyez sûre que j’ai raison. Dans une situation très difficile, très délicate, il ne faut pas mettre contre soi, ne fût-elle que d’un sur mille, la chance d’une lettre perdue, d’une lettre ouverte, d’un mot échappé. Vous entrevoyez, mais vous ne savez pas à quelles difficultés, à quelles personnes je suis peut-être sur le point d’avoir affaire. Je n’en frémis pas. Je mentirais si je disais que j’en frémis. Mais si cela arrive, ce sera bien grave. Il ne faudra pas faire une faute et on en ferai; pas perdre une force, et on en perdra. Vous en savez sans doute, à l’heure qu’il est bien plus que moi. Mais l’article du Constitutionnel de dimanche me paraît bien clair. C’est la guerre ou la retraite.
J’attends demain. Demain m’apportera certainement quelque chose. Je viens de me promener. Toujours Regent’s Park. Je ne m’en lasse pas. Personne du tout. Un air doux et calme. La nature parfaitement étrangère selon son usage aux agitations des hommes. J’étais plus occupé qu’agité en marchant sans bruit dans ces allées tranquilles. La paix ou la guerre quelle question toujours ! Quelle question aujourd’hui ! Que de questions, et lesquelles, dans celle-là ! J’ai un avis. Je n’ai que cela. Est-ce assez ? Je veux voir Lucia de Lammermoor avec vous. Je ne crois pas que le mois d’octobre se passe sans que nous nous voyions. Adieu. Adieu en attendant.
444. Paris, Mardi 6 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Les trois 4 font une drôle de mine et ne font pas honneur à notre intelligence, pour des gens qui ont pas mal de goût à se trouver ensemble. C’est bien bête. J’ai vu hier matin chez moi à la fois l’Autriche, la Prusse, l’Angleterre. Une petite conférence en ressemblant pas du tout à celle de Londres quant aux opinions et aux vœux. Il parait que l’insurrection se ranime en Syrie. Il paraît aussi que les Anglais allaient à St Jean d’Acre. Voilà qui fera une bien autre émotion encore qui Beyrouth !
On dit donc qu’on travaille ici à une sorte de protestation dans laquelle on établirait le casus belli. Mais tout cela n’est-il pas un peu tard ? On est très révolté ici de voir que l’internonce a assisté à la dépossession du Pacha à Constantinople.
Quant à nous je n’ai rien vu de plus modeste, même de plus effacé. C’est très drôle. Tous les acteurs en scène, le premier amoureux seul, dans les coulisses. Je ne crois pas qu’il perd rien à attendre. Mais la comédie est complète. Le soir je voulais aller chez Lady Granville lorsque est venu encore M. Molé et puis mon ambassadeur et Bulwer. Nous sommes restés à quatre jasant toujours de la même chose, et riant même un peu. C’est toujours encore dans ma chambre à coucher que je reste ; et ma porte fermée à tout ce qui ne m’amuse pas tout-à-fait. M. Molé et très curieux de tout, mais au fond il me parait être au courant de tout.
Il disait et Bulwer disait aussi que M. Barrot entrerait au ministère, si les affaires tournent à la guerre. Mad. de Boigne est toujours à Chatenay. M. Molé me l’a répété. Il ne l’a point vu du tout. Molé repart aujourd’hui ou demain pour la campagne. Personne ne parle du procès de Louis Bonaparte. Jamais il n’y eut quelque chose de plus plat. Le petit Bulwer est d’une activité extraordinaire et une relation avec toute sorte de monde, très lié avec Barrot. Il faut que je vous dise que 10 jours après mon arrivée ici j’ai écrit à Paul une lettre assez indifférente lui parlant de ma santé, un peu des nouvelles du jour, rien du tout. J’ai fait cela pour renouer la correspondance sur le même pied qu’a été notre rencontre. Il ne m’a pas répondu. C’est bien fort je ne crois pas que j’aie à me repentir de cette avancée, c’était un procédé naturel mais son silence me semble prouver qu’il ne veut avec moi que les relations de plus strict décorum rien que ce qu’il faut pour pouvoir décemment habiter la même ville que sa mère. Qu’en pensez-vous ? Est-ce comme cela ? Il écrit à Pogenpohl qu’il viendra passer l’hiver ici, cela ne me promet pas le moindre. agrément. Je le recevrai un peu plus froidement qu’à Londres. Son frère est auprès de lui dans ce moment, je l’attends sous peu de jours. 1 heure. Le petit ami est venu me voir, il est presque convenu que ce sera quotidien. Nous devrions beaucoup sur un même sujet une seule personne. Quelle situation difficile et grave, en tout, en tout.
Le chêne n’écrit-il pas trop à 21 ? Il faut qu’il sache bien que ce 21 est plus l’ami des autres que le sien, et qu’au besoin il livrerait telle phrase imprudente on intime de ses lettres. On parle de la présidence de M. Barrot, s’il n’entre pas dans le ministère. Que pensez-vous de cela ? Dans mon opinion qui sera celle de tout le monde, au premier instant les personnalités doivent s’effacer devant une grande circonstance. En y pensant davantage je ne sais que dire. Je suis très perplexe ; et c’est cela qui me fait dire, que tout, tout sera difficile. Cependant les événements viendront au secours des embarras peut-être. Je finis par crainte d’interruptions.
Adieu. Adieu mille fois adieu, que je voudrais vous parler. Ah mon Dieu que je le voudrais ! Ce ne serait ni de l’Orient, ni de la Chambre, ni du ministère. Adieu, adieu.
443. Paris, Lundi 5 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Hier a été une journée bien active et bien bavarde. D’heure en heure quelque rapportage, et à 5 heures à Tortoni la nouvelle que Thiers avait donné sa démission. On disait qu’il avait résolu de convoquer les chambres, d’y apporter la guerre et d’ordonner en attendant la marche de 200 000 hommes vers le Rhin et l’envoi de votre flotte à Alexandrie pour l’apposer aux alliés. On disait que le roi n’avait point voulu accorder tout cela, ni rien de cela, et que par suite Thiers donnait sa démission. nous verrons aujourd’hui. Berryer est venu chez moi à deux heures. Il ne savait rien de ces bruits, ils n’ont circulé que plus tard mais il me dit qu’une crise ministérielle était arrivée : que Thiers ne pouvait point reculer, qu’évidemment il lui fallait la guerre et que la chambre accueillerait avec transport la guerre, parce que telle était la disposition des esprits maintenant qu’il fallait commencer cependant que Thiers avait fait bien des fautes, qu’il n’avait fait que des fautes mais que pour le moment il ne s’agissait pas de les examiner, qu’il fallait satisfaction à l’amour propre national, et que comme cette satisfaction ne se présentait pas pacifiquement, il fallait la prendre de l’autre manière que ces derniers deux ans avaient fait une grande révolution dans les esprits, qu’il ne pouvait plus y avoir dévouement ou confiance, que les existences avaient été troublées, tout remis en question, et que dès lors, tout pouvait ressortir de cette situation. Que l’Angleterre avait été bien habile, que lord Palmerston était le plus grand homme qui eut paru depuis M. Pitt. Paralyser à la fois la Russie, (je n’ai pas accepté la paralysie) remettre à la tête des grandes puissances, s’emparer de la direction des affaires en Espagne, et rendre ainsi la situation de la France périlleuse de tous les côtés, c’était là un chef d’oeuvre d’habilité, enlevé galamment avec une prestesse admirable. Enfin il grossirait cela de toutes ses forces pour enfler les comparaisons. Il parlait pitoyablement des notes diplomatiques. Il demandait la réponse au factum accablant de Lord Palmerston ? Et puis il a brodé sur les crédits extraordinaires, sur les fortifications de Paris surtout, et de quel droit, sans avoir consulté la Chambre ? Et le bois de Boulogne à qui appartient-il ? Il dit après : le roi a tiré de ce ministère tout ce qu’il lui fallait pour sa propre force. Ce que Thiers préparait pour dehors, le roi se promettait bien de l’employer au dedans et le jour où arrivera la la nécessité d’une révolution extrême, le roi ayant profité habilement de tout ce que la popularité de Thiers a pu lui fournir jusqu’à sa dernière limite, le Roi se passera de lui. Placé entre deux dangers une lutte extérieure, et une lutte intérieure, le roi choisira toujours cette dernière chance. Voilà le dire de Berryer sur la situation en gros ; il n’a point nommé les personnes. Il a seulement dit en passant que vous et Thiers étiez mal ensemble, j’ai dit que ce devait être nouveau parce qu’il me semblait tout le contraire lorsque j’étais à Londres.
Après Berryer, j’ai vu tout mon monde diplomatique les quatre puissances alliées agités, mais point inquiets. Ils ne croient pas sérieusement à la guerre. Sébastiani a dit hier encore à 4 heures de l’un de ces diplomates. Tenez pour certain que le roi n’y consentira pas. Le petit ami est revenu hier une seconde fois très animé, très troublé de tout ce qu’on dit, et de tout ce qu’on lui demande. Je lui ai dit de vous tout dire dans le plus grand détail. Hier soir à 10 heures, M. de Broglie était chez Granville, qui lui a appris tout le tripotage de la journée. M. de Broglie n’en savait pas un mot, et ne voulait pas y croire. Il ne voulait pas croire que le ministère eût pu arriver à ds résolutions aussi excessives. Mais M. de Broglie, me parait être quelque fois un enfant. moi, je suis très très préoccupé de tout ceci pour vous !
Lady Palmerston m’écrit. avec amitié. Sur les affaires elle me dit : " Lord Palmerston désire plus que personne la paix, et je ne puis croire qu’avec ce désir général il y ait crainte de guerre. La conduite de M. Thiers rend toute négociation à présent fort difficile, mais il est clair que l’on serait fort aise de s’accommoder avec la France autant qu’on peut le faire sans déshonneur, et sans abandonner ses alliés. Mon mari est fort raisonnable dans cette affaire et saisirait volontiers tout moyen d’accommodement qui ne porterait point atteinte à l’honneur de son pays, ainsi ne dites pas que c’est de lui que dépend la paix ou la guerre, parce que le résultat est bien plus entre les mains de M. Thiers. Si la France se comporte comme une écervelée ce ne serait point une excuse pour nous d’être lâches ou d’abandonner nos alliés." Elle me dit encore que le duc de Wellington et Peel sont bien plus déterminés encore que son mari, et que Peel a dit : " Si l’on fait des concessions à la France, il n’y aura pas de paix dans trois mois. "
Onze heures
Je reçois votre lettre c’est charmant d’être à Lundi, c’est charmant Mercredi. Mais que faire de l’intermédiaire ? Votre gravure est devant moi dès que je quitte mon lit, tous les jours je trouve la ressemblance admirable. Mais pourquoi ne me regardez-vous pas ? Est-ce le peintre ou vous qui avez voulu cela ? Je ne suis pas sûre que vous ayez eu raison ; c’est parfait comme cela, mais votre regard fixé sur moi, c’eût été mieux encore. Je me repens d’une petite querelle que je vous ai faite hier pour abstenir des nouvelles modernes plutôt que des souvenirs anciens d’Angleterre.
Je me repends de tout ce qui n’est pas des paroles douces tendres ; de loin il ne faut jamais un moment d’impatience même sur ce qu’il y a de plus puéril. compte sur vous. Vous me connaissez un peu pétillante, vive et puis c’est des bêtises.
Mad. 79 se plaint de ce que le bouleau a trop d’intimité avec les personnes qui ne sont pas de l’avis de R. Les journaux ce matin sont bien plats à côté du commérage de la journée d’hier. Le constitutionnel est en bride. L’incertitude ne peut pas durer.
Je ne me porte pas mal, mais je ne suis pas encore assez bien pour voir du monde. Le soir cela me fatiguerait. M. Molé est revenu hier mais je n’y étais pas. Je passe le dimanche à l’ambassade d’Angleterre. Je trouve lord Granville très soucieux. Sa femme est allée avant hier à St Cloud. Elle n’y avait pas été depuis plus de 3 mois. Jamais, elle n’a vu la reine dans l’état d’accablement et de tristesse où elle l’a trouvée.
Samedi 1 heure.
Je n’ai vu personne encore, je viens de marcher sur la place, je rentre pour fermer ni avant les interruptions. Je vous écris des volumes il me semble, mais il me semble aussi que vous les voudriez encore plus gros. Je vous crois insatiable comme moi. Je vous crois comme moi en toute chose, en tout ce qui nous regarde, un peu aussi en ce qui ne nous regarde pas. Enfin je trouve que nous nous sommes tellement eingelebt (Connaissez-vous la nature de ce mot ? ) que nous n’avons plus besoin de nous rien demande,r nous nous devinons. Devinons-nous ce que deviendra ce mois-ci ? Ah pour cela, non !!
Adieu. Adieu. La crise ne peut pas se prolonger. Il faut que la convocation des chambres ressorte de ceci. Adieu. Adieu toujours adieu quoique vous commenciez un peu à le mépriser, et moi peut être aussi. Mais nous sommes trop pauvres pour ne ps accepter les plus petites aumônes. Adieu.
442. Paris, Dimanche 4 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Il y a quatre semaines, je vous attendais encore, nous avons encore marché dans le jardin, vous vous souvenez ce que nous nous y sommes dit ! Je le redis, je me le redis mille fois le jour, je le redirai toute ma vie. Hier j’ai été aux Italiens, Lucia de Lamermoor au premier acte un duo ravissant entre Rubini et Mad. Persiani, une succès d’amour. Ils échangent des anneaux, ils baisent l’anneau qu’ils mettent à leur doigt, un mariage devant le ciel, enfin une telle ressemblance que j’en suis restée troublée toute la soirée.
J’avais dans ma loge Mad. Appony et sa fille. Mon ambassadeur y est venu. J’ai dit un mot à Berryer, il viendra me voir aujourd’hui. Dans la matinée je n’avais vu Appony et manqué beaucoup d’autres : Il ne croit toujours pas à la guerre. Mais il croyait savoir que le roi avait de l’humeur contre ses ministres, ils ont eu trois conseils dans 24 heures sans informer le maître du motif. Ils le contrarient pour se bâton de maréchal à Sébastiani. Le roi très pacifique. On pense que les ministres débattent tant la question de la convocation des Chambres. Il y a toujours bien de l’agitation dans les esprits. On aimerait bien à croire à la nouvelle qu’Ibrahim a forcé les alliés à rentrer dans leurs vaisseaux, mais cette donnée est vague.
Midi.
Votre lettre de vendredi ne me dit rien. Est-ce que les conseil de jeudi n’a donc rien produit du tout ? Mais c’est incroyable. Dites moi donc quelque chose. J’ai besoin d’autres correspondances que vous ! Car par vous je n’apprends rien. Je ne vous donne pas raison pour Chiswick. C’est une très exacte copie des villas près de Padoue, il n’y manque que le soleil. Ce que les hommes ont pu ils l’ont fait ; au lieu de me conter ce que Lady Holland a dit à M. Canning, et ce qu’il lui a répondu et que je sais par cœur, dites-moi ce que lady Holland pense du Cabinet Conseil. Contez-moi l’Angleterre de votre temps et non pas l’Angleterre de mon temps. Il ne vous fâchez pas de cette petite observation, moi Je me députe quand je vous voir employer mal votre papier et votre temps. Je veux de douces paroles d’abord et puis la guerre ou la paix ensuite, je veux aussi tout l’emploi de vos journées. Moi, je vous dis tout.
Hier bois de Boulogne comme de coutume, dîner seule comme de coutume, mon lit à dix heures comme de coutume. J’ai quitté les Italiens à 9 1/2. Je n’ai pas causé avec votre petit Médecin parce que vraiment cela n’aurait pas de sens à moins de me mettre entre les main. Je suis très contente de Chermside. Il me tire vite des petites indispositions qui m’arrivent. Quand vous serez ici, vous ordonnerez et j’obéirai, jusque là à moins de catastrophes j’irai mon train ordinaire. Chermise est prudent, il me traite avec beaucoup de douceur. Ma blessure est presque guérie. Les journaux deviennent incommodes pour M. Thiers. Il n’y a guère qui le journal des Débats que le soutiennes Aujourd’hui, c’est-à-dire il n’y a que le journal des Débats que soit raisonnable car la question de Beyrouth. Le duc de Noailles, m’écrit encore. Il dit qu’il n’y a qu’un gouvernement aristocratique ou un gouvernement populaire qui puisse faire la guerre. Ce gouvernement-ci non mais où est la cause de guerre ? Voilà toujours le puzzle.
1 heure.
Je viens de marcher. Je ne sais pas de nouvelle, je n’aurai vu personne avant de fermer cette lettre. Je pense à la convocation des Chambres. Il me semble qu’il n’y a de salut pour moi que là. Car vous me préparez à un grand désappointement pour octobre. Je n’ai jamais cru sincèrement à octobre, vous n’y avez pas cru non plus. Tout cela était pour acculer deux enfants. Qu’est-ce que c’est que des projets, des volontés. Qu’est- ce que sont les plus ardents désirs ? Eh mon Dieu ; ils ne font pas gagner un jour une heure. Il me semble que je suis de mauvaise humeur aujourd’hui, et je ne vois pas pourquoi. Il n’y a rien de nouveau.
Adieu. Adieu, j’ai ressenti un vrai plaisir hier en prenant possession de ma loge. Est-ce que je me tromperais ? Il me paraissait que je devais y passé de si doux moments croyez-vous que j’aurai de doux moments ?
Adieu. Adieu. Mille fois adieu. dans ce moment une petite visite qui me dit qu’on se plaint de ce que vous n’aviez pas. Cette petite visite visite me dit aussi que 62 dit qu’on a passé toute la journée d’hier à patauger sans rien décider et qu’on attendra encore quelque jours.
430. Londres, Dimanche 4 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Nous voilà dans la crise. On dit cela à chaque incident, mais celui-ci est gros surtout par l’effet qu’il doit faire à Paris. Ici on est inquiet. Pas autant que je le voudrais ; pas autant qu’il le faudrait pour qu’on fût sage. On ne croit pas à la guerre. On a le sentiment de sa propre sincérité dans le désir de la paix et dans l’absence de toute intention hostile envers la France. On n’a pas le sentiment de l’état des esprits en France de leurs impressions si vives, de leurs résolutions si soudaines, si on avait prévu, il y a trois mois une telle explosion en France, je suis convaincu qu’on n’aurait pas conclu le traité du 15 juillet. Je l’ai annoncé, répété, rabâché. Mais la prévoyance est ce qui se communique le moins. Et quand on n’a pas prévu, on ne veut pas voir.
Ma situation ici ne me plaît pas. J’ai beaucoup à attendre et peu à faire. On est à merveille pour moi, même ceux qui ne sont pas de mon avis et ne s’y rendent point. Un moment peut venir où je profiterai de cette bonne disposition ; le moment où, ne réussissant pas, en Syrie par les premiers moyens, employés et ne se souciant pas d’aller plus loin, on sentira, la nécessité d’une transaction. J’attends et je prépare ce moment là, quand viendra-t-il ?
On parle de la convocation de nos chambres. Celle du Parlement suivrait aussitôt. Mais, pour moi comme pour le public ce ne sont là que des bruits. C’est maintenant à Paris que se font les événements. Au moins vous me donnez de bonnes nouvelles de vous. Comment s’y est-on pris pour vous écorcher l’épaule ? Il faut que votre femme de chambre ait la main bien lourde. A quoi lui sert donc d’être laide ?
Lundi 2 heures
Trouvez donc un Byng qui vienne à Londres et que je puisse aimer aussi. Je n’ai point de nouvelles ce matin. La convocation des Chambres ! Je crois bien. Politiquement, je la désire. Je sais bien les entraînements publics, la tribune ; mais je sais aussi les entraînements cachés, insensibles, les journaux, les commérages.
Après tout, depuis dix ans, j’ai toujours vu dans les grandes occasions, les chambres favorables au bon parti ; à la raison, au vrai intérêt du pays, et lui prêtant une force qu’il ne pouvait puiser ailleurs. C’est avec les chambres que nous avons lutté contre l’entrainement révolutionnaire, contre les fatuités anonymes de la presse, contre la politique de café. Nous sommes sur le point de rentrer dans la situation de 1831. Avec plus de péril peut-être, et moins d’excuse. Je sais que, pour que les Chambres se rallient à la raison, et la soutiennent, il faut la leur montrer, la tenir constamment sous leurs yeux, la vouloir fermement soi-même et leur en inspirer la confiance. J’espère que cette lumière et cette volonté ne manqueraient pas plus aujourd’hui qu’en 1831, et que si la raison devait succomber ce ne serait pas sans s’être montrée et défendue.
J’ai reçu une longue lettre du duc de Broglie, très judicieuse, et qui me fait croire qu’on ne fera rien de précipité. Vous avez bien raison ; 20 n’a pas de l’esprit tout à fait ; et quand les grands moments approchent ce qu’il en a se trouble et chancelle. Il peut alors se laisser aveugler et entraîner comme un enfant. De son côté 62, très courageux contre le danger, est très timide contre la responsabilité. Il a naturellement beaucoup indépendance et de dignité, peu de pouvoir. Le frêne a beau chercher ; il n’apprendra pas de là ce qu’il aurait, besoin de savoir. Je suis très préoccupé du frêne. Il est très décidé ; mais il ne voudrait pas se tromper sur le moment où doit se placer sa résolution. Deux choses font le succès d’une conduite, son mérite et son à propos. On ne devine pas l’à propos. Il faut le voir. Je voudrais que ma vue s’alongeât plus encore. Je prêterais mes yeux au frêne. Bien décidément j’envie le cottage, j’aime le cottage. Et parlerions-nous quelquefois de tout cela ? J’ai peur que oui. On n’abdique pas sa nature. On ne se fait pas petit, même pour être heureux. Je voudrais pourtant bien être heureux. Qu’est-ce qui vaut une heure de bonheur ? Et quel bonheur ! C’est bien là l’orgueil humain. Je préfère infiniment le bonheur à tout. Je n’aime, à vrai dire, que le bonheur. Mais pour le bonheur, dans un cottage comme dans un palais, je veux à côté de moi, à moi, un grand coeur, un grand esprit, un grand goût, l’intimité d’une grande pensée. Je ne puis pas être heureux à moins, pas cinq minutes. Mais je serais si heureux ? Adieu. Adieu.
429. Londres, Samedi 3 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
J’attends tous les jours votre lettre avec une vive impatience. Mais aujourd’hui ! Et mon impatience de tous les jours est une impatience de plaisir d’espérance. J’espère bien qu’aujourd’hui aussi j’aurai un immense plaisir. Vous me direz que vous êtes mieux, que ce n’est rien. Que de trouble dans l’âme sous la surface tranquille et monotone de la vie ? J’avais du monde hier soir. J’ai joué au Whist, j’ai causé ; je crois que j’ai ri.
Je faisais cas du Roi de Hollande. Je l’aime. Il a eu deux fois raison, en renonçant à sa volonté, il y a trois mois en la reprenant aujourd’hui. Que dira son peuple ? Son fils est bien loin de le valoir.
Une heure
Me voilà, tranquille ; comme on peut l’être pas inquiet enfin. C’est du bonheur. Comme on en a de loin. S’il était possible. d’avoir plusieurs lettres par jour? Je veux que vous ne mouriez de rien, surtout pas d’impatience et d’inquiétude à cause de ma prudence. Il y a encore eu Conseil hier. Trois dans une semaine, et dans cette saison. Cela seul est quelque chose. Pas de résultat actuel, précis. Un parti de la paix et de l’amitié avec la France, plus nombreux, plus fort, plus déclaré, appuyé par quelques uns ou quelqu’un des hommes, les plus importants du cabinet, ayant soutenu et fait reconnaître la nécessité de saisir, de chercher toutes les occasions de se rapprocher, de transiger. La politique contraire entravée, un peu intimidée. Des choses qu’on regardait comme résolues, remises en question. C’est cela ; ni plus, ni moins.
Je persiste à ne pas croire à la guerre. Je crois à une situation toujours critique, rasant toujours le bord. Pour le moment, la question est en Syrie. Si le Pacha cède ou succombe vite, l’affaire sera finie. Si la résistance en sérieuse et prolongée, la question reviendra en occident, et il y aura transaction. Le Cabinet sort de ces trois conseils profondement agité, divisé, méfiant de part et d’autre, travaillant à se paralyser les uns les autres, ce ne voulant pas de disloquer. Je ne vous répète pas que ceci est entre nous. C’est bien convenu. Il ne m’étonne pas. L’amour pur du mensonge. Mentir sans nécessité et sans succès. Je suis toujours surpris cependant qu’on puisse tant manquer d’esprit en en ayant tant. Ce n’est pas le seul exemple. 14 a raison d’avoir de l’humeur contre 74. Et 2 aussi a raison d’attaquer, le maréchal Soult encore plus que Thiers. Il pressent bien le danger futur. Je viens de lire Berryer. J’en pense comme vous. Il n’y a de bon que ce que vous m’indiquez. Mais cela est beau. J’aime vos impressions si vives dans votre jugement si sûr à coup sûr, M. Molé n’a pas pu être content. Savez-vous ce qui manque à Berryer ? Du sérieux. Il se joue, et cela se sent. Au premier moment cela réussit ; les hommes trouvent bon qu’on leur plaise sans leur rien demander, sans leur demander de croire ou d’agir. A la longue cela décrie. On va le soir, et quelquefois, au spectacle. On ne s’accommode pas du spectacle, même du meilleur, tous les jours et tout le jour. La vie et ses affaires sont sérieuses. Il y faut des personnes, non des acteurs et le public lui-même à ce sentiment , on y revient bientôt. Il ne vient pas de flotte russe. L’Empereur a seulement ordonné qu’elle se mettrait en état de venir. C’est du moins ce qu’on dit ici, et ce qu’on croit, et ce qu’on veut.
Je suis bien aise que Sébastiani soit maréchal. Il n’en aura peut-être pas moins d’humeur contre moi. Mais j’aurai le droit de le trouver mauvais. Quand le Cabinet s’est formé, j’ai fortement insisté auprès de mes amis pour qu’ils le fissent maréchal à la première occasion, et ils me l’ont promis. Depuis que je suis ici, le Roi m’a fait demander d’écrire dans ce sens à le M. de Rémusat, et je l’ai fait. J’aime que justice soit rendu aux bons services. Sébastiani, en a rendu de grands de 1830 à 1832. Je croyais que vous auriez le bis avant-hier. Vous l’aurez eu hier. Je voudrais bien que vous l’eussiez plus souvent. J’ai le cœur bien plus gros depuis le 30, et tout ceci est bien plus insuffisant. Adieu même est insuffisant. Je le prends, mais je ne m’en contente pas. Adieu
440. Paris, Vendredi 2 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
à 10 heures
Le voilà expliqué le bis, au moment où je commençais une toilette de nuit hier, on m’annonce Byng, je le renvoie ; il me fait dire qu’il arrive de Londres à l’instant ; je le fais entrer rêvant à la paix ou à la guerre ; c’était bien autre chose. Cette charmante lettre en tendres paroles ! Elle a passé la nuit avec moi. Ah que je voudrais vous dire à mon tour tout ce que j’éprouve. J’en étouffe, et cela reste ici. J’ai eu un rêve que vous auriez aimé. Mais ce n’était qu’un rêve !
Hier matin j’ai vu les Appony, Montrond, Bulwer. J’ai fait par ordre du médecin une promenade en voiture fermée. J’ai fait dîner Pogenpohl avec moi pour le voir manger. Ensuite j’ai reçu Tshann, et mon ambassadeur. Mais toujours dans ma chambre à coucher. Le matin j’avais eu une bonne visite de votre plus fidèle. Si la question du dehors s’arrange, savez-vous que celle du dedans sera difficile à arranger. Cela me paraît bien embrouillé, bien compliqué. Le moment des chambres sera des plus curieux. Ma nièce a eu une lettre de son père, il s’annonce positivement pour le mois d’avril, et sa femme dans quinze jours, tout cela est bien pacifique. Il parait qu’on ne rêve pas à la guerre.
Que savez-vous de la disgrâce de Bülow ? Les petits diplomates allemands l’affirment. Vous ne m’étonnez pas par ce que vous me dites de Neumann c’est un gros sot, et fort impertinent ; donnez en de bonnes nouvelles à Paris pour le cas où il y viendrait. A propos les Clauricarde viennent-ils toujours ? Elle ne m’a pas écrit depuis mon départ. Il est vrai que je ne lui ai pas écrit non plus.
J’ai eu un retour de crampes cette nuit et un sot accident après. Je m’étais fait frotter rudement l’épaule et la voilà tout ensanglantée ce matin, et me faisant un mal horrible, comme si j’avais été blessée à la guerre, aussi. ai-je fait chercher le chirurgien du 10ème hussards ! (Chermside)
Midi.
Je viens de recevoir votre lettre d’avant-hier, il y a de l’espoir, il y a de l’inquiétude, un peu de tout. Un peu de gronderie à mon adresse, beaucoup d’autre chose qui n’est pas de la gronderie. J’accepte tout à tort et à travers, mais surtout la dernière partie, toujours désirée, toujours bien venue. Toujours nouvelle quoique si vieille. Voici donc Beyrouth pris. On va crier ici comme si c’était chose inattendue et inouïe. J’en suis effrayée; je suis effrayée de tout, parce qu’il faut si peu pour aller bien mal et bien loin. Vous ne sauriez concevoir le plaisir que j’ai eu à voir Byng. Il avait déjeuné avec vous Samedi. Il été fort pressé de me remettre la lettre. Il était encore en toilette de voyage. J’aime Byng. Adieu, que dois-je penser du conseil de cabinet d’hier ? Je tremble et j’espère. L’article du Times était bon, mais rien ne fait quelque chose à lord Palmerston. Je suis bien aise que vous soyez bien avec Flahaut, je ne sais encore rien de cela pour la femme, je ne l’ai point vue depuis mardi.
Adieu. Adieu, tendrement. Montrond vient souvent sans avoir rien à dire. Il est archi pacifique. Tout le monde l’est je crois, mais n’y a-t-il pas des existences politiques que la paix tuerait. Voilà ce qui m’inquiète. Adieu. Adieu.
2 heures
Dans ce moment, je m’aperçois du vendredi. Je suis enragée contre moi-même, il n’a a pas de remède, ceci ne partira que demain, je vous écris un pauvre mot mais il vous faut la vue de mon écriture, sans cela vous me croiriez morte.
Samedi 3 octobre, 11 heures.
Ma journée s’est passée à Beyrouth c-à-d. que tout le monde est venu chez moi parler de cela et rien que de cela. Le matin, les Granville, Werther, Appony, Pahlen. Le soir M. Molé. Je ne compte pas Adair et autres de cette espèce. Et bien on est bien agité, c’est à dire agité de l’agitation que cela va causé ici, comme si ce n’était pas un événement tout naturel, et très attendu. Thiers a dit hier matin à un diplomate à Auteuil : "Monsieur, c’est la guerre. " On ne le prend pas au mot, parce que vraiment il n’est pas possible qu’elle ressorte de ce fait. le conseil s’était réuni d’abord à Auteuil et puis aux Affaires étrangères. M. Molé me dit que la chambre des pairs était dans un trouble inexprimable. On ne parlait que de cela. On proposait de dresser une pétition à la couronne pour demander la convocation du chambre. M. Molé prétend s’y être opposé. Mais il parle très mal de la situation. Il dit que jamais on n’a si mal gouverné une affaire. Et puis une conduite si lâche à côté de tant de bruit, de si pitoyables réponses au général anglais.
Le dernier factum de lord Palmerston excellent, clair, une vraie pièce de cabinet. Et pas de réponse ? mais c’est incroyable. Enfin vous entendez tout ce qu’il dit. Il voudrait bien savoir bien des choses ; moi, je n’ai rien à lui apprendre. J’ai renvoyé M. Molé avant dix heures pour aller un moment chez Lady Granville. Là j’ai appris l’abdication du roi de Hollande. C’est grave aussi, parce que l’héritier est peu de chose. Tête très légère. Le monde va mal. Mais vous que faites-vous ? L’éclat de Beyrouth devrait faciliter les affaires ; on a meilleure grâce à céder quand ou a un succès. Cependant, je ne sais rien bâtir d’agréable sur ce qui peut venir de Londres. Je suis frappée ce matin du ton de Siècle et du Courrier français. Le Constitutionnel est plus prudent, il est évident qu’il attend vos nouvelles sur le conseil de jeudi. M. Molé prétendait savoir qu’on allait mobiliser la garde nationale, mesure révolutionnaire selon lui. Il croyait aussi que le ministère ne pouvait pas l’empêcher, de convoquer les chambres. Le cri public serait trop fort. Moi, je suis pour la convocation cela va sans dire ! Lord Granville était allé hier soit à St Cloud. L’ambassade anglaise est très agitée. Bulwer excessivement.
1 heure.
J’ai eu votre lettre et un long entretien, avec celui qui me l’a portée. Il vous écrit lui-même. Il voudrait que vous l’instruisiez mieux de votre volonté, de vos idées, pour qu’il puisse faire face aux entretiens qu’il a avec vos amis. Vraiment la situation devient très grave pour les choses comme pour les personnes politiques de toutes les couleurs. C’est bien difficile de deviner le dénouement de tout ceci. On dit qu’ici tout le monde est pacifique au fond, tout le monde, et je le crois mais comment arriver à cette parole décisive " la paix " au milieu de ce qui se passe et peut se passer tous les jours ?
J’approuve tout ce que vous me dites, et comme je comprends ces éclairs d’élan vers une vie tranquille, domestique ! Et moi, que de fois je l’ai souhaitée, et tout juste dans les moments les plus agitées. C’est alors que je rêvais les cottages, que j’enviais le sort des plus humbles de leurs habitants. Ah que je saurais aujourd’hui embellir cette vie là pour vous. Mais vous n’osez pas en vouloir, vous ne le pouvez pas. Je sens tout ; je suis en même temps une créature très passionnée et très sensée.
Je crois l’esprit de 20 très combattu dans ce moment, au fond il n’a pas de l’esprit tout-à-fait Il faut finir, je n’ai encore vu personne aujourd’hui. On dit, c’est votre petit ami qui me l’a dit que les ministres sont un conseil depuis huit heures ce matin. Je crois moi qu’il ne ressortira la convocation des chambres. Encore une fois, il m’est impossible de ne pas la désirer ardemment. J’ai vu chez moi Mad. de Flahaut hier, elle m’a parlé des lettres de son mari, mais elle ne vous a pas nommé. Au reste elle est très douce maintenant, et inquiète comme tout le monde.
Adieu. Adieu. Je ferme de crainte d’interruption et de retard, adieu.
441. Paris, Vendredi 2 octobre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
2 heures
Au moment de faire partir mon dernier N° ce matin, il est survenu un accident qui fait qu’il n’ira que demain. J’ai des distractions abominables. J’ai à vous accuser réception d’une lettre venue hier soir tard elle est datée de Dimanche. J’ai reçu celle de Mercredi il y a deux heures. J’apprends dans ce moment la prise de Beyrouth. Je ne sais encore l’effet que cela va produire ici. On attend avec impatience le résultat du conseil de Cabinet d’hier à Londres.
Au fond je ne vous écris ce petit mot que pour vous dire qu’à l’exception d’une écorchure à l’épaule occasionnée par une friction maladroite je me porte assez bien, quoiqu’encore avec quelque souvenir de crampes à la poitrine. Mais je sors pour me promener. J’aurai bien besoin d’une garde malade ou d’une bonne d’enfant qui sût me traiter et me manier avec douceur. Je vous remercie beaucoup beaucoup de votre lettre de dimanche.
J’ai reçu Byng avec un grand plaisir. Je n’ai aucune nouvelle à vous donner. Une grande curiosité, une grande anxiété, un seul et même vœu, la paix. Tout le monde la souhaite ardemment. Mais pourra-t-elle être maintenue ? Adieu mille fois. Un adieu très long par compensation de la courte lettre. Adieu.
428. Londres, Vendredi 2 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures J’ai oublié de vous dire hier que j’avais été à Chiswick, avant hier mercredi. J’y ai passé deux heures, me promenant avec mon ambassade. J’aurais mieux aimé être seul. Dans le commun de la vie, à dîner après dîner, je suis bien aise d’avoir du monde, n’importe qui. Il y a des heures pour lesquelles tout est bon. Mais dans un beau lieu, par un beau temps, quand ce qui m’entoure me remue l’esprit ou le cœur, il me faut le bonheur ou la solitude. Chiswick est une maison déplacée. Les prétentions italiennes sans la Brenta ; le soleil sans toute cette nature brillante et chaude qui anime et embellit la plus petite architecture. Et au bas de l’escalier dans un coin, une grande et pauvre statue de Palladio assis qui a l’air de s’ennuyer et de grelotter. Il n’y a du joli que dans le midi. Le Nord ne peut prétendre qu’au beau. Je reproche à Chiswick de prétendre au joli. Au dedans comme au dehors. C’est trop petit, trop orné.
Les femmes de la Provence se bariolent de rubans de toutes couleurs, de bijoux d’or, d’argent, de pierres de toute espèce. Cela va à leur petite taille lègère, à la vivacité de leurs mouvements, à leur gentillesse d’esprit et de corps. Lady Clanricard était l’autre jour à Holland house, toute enveloppée de mousseline blanche avec une seule pierre au milieu du front. Elle était très belle. Les maisons sont comme les personnes. Chacune selon son climat. Il y a, dans Chiswick, des trèsors de peinture. J’ai beaucoup regardé les tableaux, la plupart d’Italie aussi ; point évidemment sous un autre ciel, pour une autre lumière ; mais beaux partout. Des Papes admirables.
Le parc, voilà l’Angleterre. Que j’aurais pu m’y promener avec délices ! Je n’ai vu nulle part, même ici de tels gazons ; si épais, si fins. C’est du velours qui pousse. Ce serait un meilleur lit que les lits anglais. La serre est charmante. Je crois qu’à tout prendre j’aime mieux Kenwood. C’est plus simple et plus grand.
Lady Holland m’a raconté que M. Canning malade lui ayant dit qu’il allait à Chiswick
" N’allez pas là. Si j’étais votre femme, je ne vous laisserais pas aller là.
- Pourquoi donc ?
- M. Fox y est mort. "
M. Canning sourit. Et une heure après, en quittant Holland house, il revint à Lady Holland, tout bas : " Ne parlez de cela à personne ; on s’en troublerait. "
2 heures
Ne me demandez pas de ne pas m’inquiéter. Résignez-vous à me savoir inquiet, car je ne me résignerai pas à vous savoir malade. Quand nous nous sommes pris for better and for worse, l’inquiétude était dans les worse. Il faut l’accepter et la subir. Inquiet de loin !
Vous avez vu mon petit médecin. Vous ne lui avez pas dit un mot de votre santé. Je ne veux pas vous gronder aujourd’hui. Qui sait si ma hier que j’avais et lettre en arrivant ne vous trouvera pas encoré malade ? Je ne veux vous envoyer que de douces, les plus douces paroles. Mais, je vous en conjure, pensez-un peu à mon inquiétude. Faîtes quelque chose pour ma sécurité. Je me sers de ce mot en tremblant. Il n’y a point de sécurité. Et pourtant il m’en faut. J’en veux avoir sur vous. Ce n’est pas vivre qu’être inquiét pour vous. J’espère que Chemside a raison, que c’est un Cold. Je vous ai vu cela. Vous aviez des crampes dans la région du cœur et de la poitrine. J’aurai des nouvelles demain, bonnes, n’est-ce pas? Il y a eu un second conseil hier. Il y en aura peut-être encore un ce matin. Demain, conseil à Claremont. Mais celui-ci est insignifiant. Les autres le seront peut-être aussi.
Je n’ai jamais été plus actif dans le présent, plus incertain sur l’avenir. Il faut que je vous quitte. J’ai beaucoup à écrire le pour le courrier de ce soir. Adieu. Adieu, comme le 30. Le 30 vous êtiez bien souffrante. Et pourtant quel beau jour ! Mais il n’y a point de beau jour de loin si vous êtes souffrante. Ils sont déjà bien peu beaux quand même vous vous portez bien. Adieu Adieu.