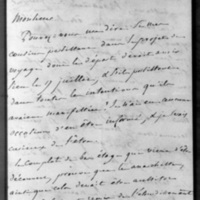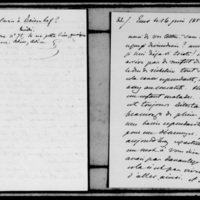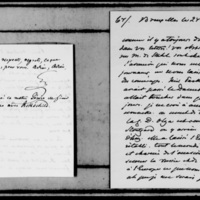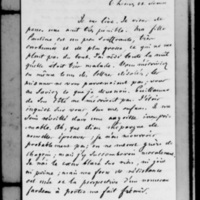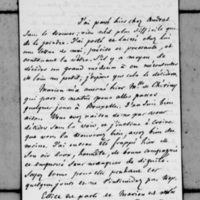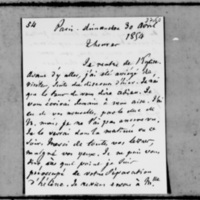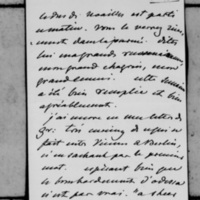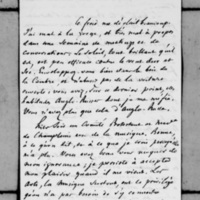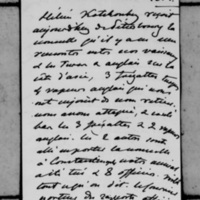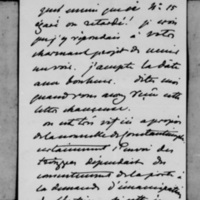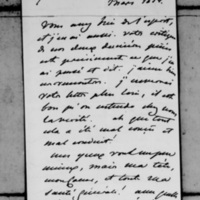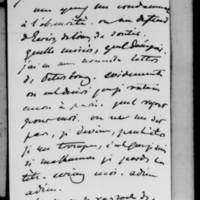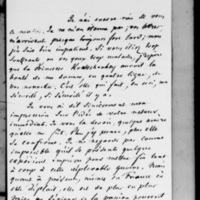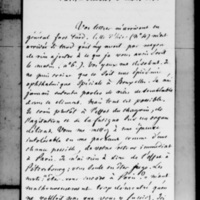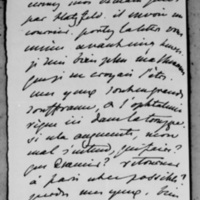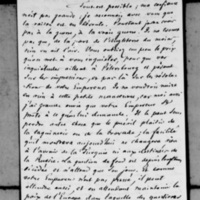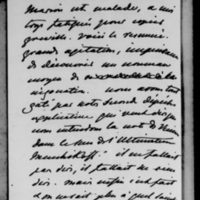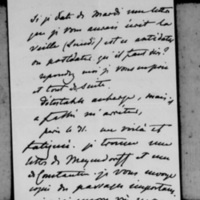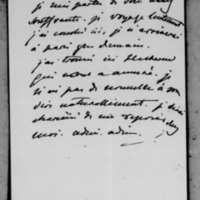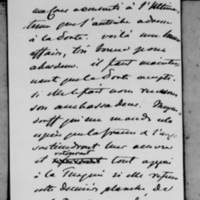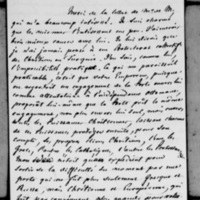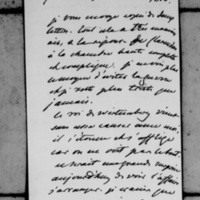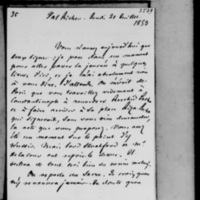Votre recherche dans le corpus : 703 résultats dans 5770 notices du site.
Maintenon, le 5 juillet 1852, le Duc de Noailles à François Guizot
82. Ems, Jeudi 16 juin 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Merci de vos lettres. Sans elles qu’est ce que je deviendrais ? Avec elles je suis déjà si triste ! Il ne nous arrive pas de renfort de société. Le duc de Richelieu tout seul. Cela cause cependant et il est assez au courant. Hélène a un enfant malade. Le temps est toujours détestable. Beaucoup de pluie. Je prends mes bains cependant, plutôt pour me désennuyer.
Je n’ai aujourd’hui exactement pas un mot à vous dire. Je n'en avais pas davantage hier. Cela n'est pas vivre que d’aller ainsi, et il me reste si peu de temps à passer encore dans ce monde que je pleure de désespoir de cette dépense stérile. Dites moi toujours vos nouvelles et vos réflexions. Adieu. Adieu.
79. Ems, Lundi 12 juin 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voilà votre lettre, aussi triste que je le sens moi même. Des âmes en peine, & qui ne prévoient pas quand elles sortiront de cette peine. Vous avez bien de l’esprit dans la manière dont vous me racontez cela, mais ici votre esprit ni celui de personne n’y pourra quelque chose.
On écrit à Hélène de Pétersbourg, la disgrâce de Meyendorff est publique. Il a été trop vif & cassant, il ne fallait pas se brouiller avec son beau frère. Le Maréchal attend et lambine parce qui il veut savoir d’abord s'il a ou non l’Autriche pour ennui. On trouve l’Empereur d’Autriche ingrat et tartuffe. Tout ce que je vous dis là c'est le public de Pétersbourg qui parle. Je ne sais rien de la cour.
Aujourd'hui il fait beau. Si le temps se soutient ainsi je commencerai un bain demain. Pas une âme de plus à Ems. Nous nous sentons bien perdus & ennuyés. Je n’ai pas le courage d'écrire à mes correspondants, je ne sais que leur dire. Nous voilà bien arrangés vous et moi. Union complète. Adieu. Adieu.
87. Val Richer, Mardi 6 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous voilà donc bien plus loin. Au moins j’espère que votre santé s’en trouvera bien. Ems m'a laissé un souvenir très agréable. J’aime extrêmement les bois et les montagnes. Je me suis beaucoup promené seul à Ems, en pensant que, trois ou quatre heures après, je me promènerais avec vous. Rien n’est plus doux que le mélange de la solitude et de la société qu’on aime.
Votre voisin de campagne à Bruxelles a raison. Vous êtes déjà grandement diminués. J’en suis frappé par ce que j'entends dire aux ignorants et aux simples. Les uns comptaient sur vous comme puissance conservatrice ; les autres vous redoutaient comme puissance envahissante. Vous avez perdu la confiance des uns et la peur des autres. Evidemment vous êtes capables d’une grande et longue résistance passive, mais non pas d’un grand et prompt effort actif.
Votre sécurité Russe vous reste ; votre importance Européenne baisse beaucoup. C'est un fait qui se développera de plus en plus si la guerre se prolonge ; on ne vous atteindra pas au coeur, par où vous êtes Russes ; on vous humiliera, on vous mutilera peut-être sur vos frontières, par où vous êtes européens. Je ne sais ce que cela changera à votre avenir lointain, à vos perspectives séculaires, mais votre situation actuelle et votre avenir prochain en souffriront beaucoup. Ce que l'Empereur Napoléon 1er voulait faire contre vous, en même temps qu’il luttait contre l’Angle terre, l'Angleterre, le fera avec l’aide de l'Empereur Napoléon III. Bossuet s'écrierait ; " Ô mystère des plans et des coups de Dieu. Ô vicissitudes étranges et faces imprévues des affaires humaines. " Faites bientôt la paix, c'est votre meilleur, peut-être votre seul moyen de couper court à tous les développements d’une crise que vous n'avez pas su prévoir.
Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que dit la Gazette de Cologne de la disgrâce, où est tombé chez vous M. de Meyendorff ? Il est aisé de briser les hommes d’esprit à qui l’on a commandé des fautes ; il est difficile de les remplacer.
Adieu jusqu'à l’arrivée de mon facteur. Je vous quitte pour aller profiter dans mon jardin d’un rayon de soleil. Hier, nous espérions le beau temps mais le vent du nord ouest lutte encore pour le froid et la pluie.
Onze heures
Je viens de lire les détails et l'affaire de Hango. Petite expérience d’où il paraît résulter que vos artilleurs tirent bien et que les canons Anglais portent plus loin que les vôtres. Viennent les grandes épreuves. Tout indique que l’armée Turque et un corps Anglo-Français se sont mis en mouvement pour vous faire lever le siège de Silistrie. Adieu, adieu. G.
67. Bruxelles, Samedi 27 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Comme il y a toujours de l’esprit dans vos lettres vos observations sur M. de Stahl sont charmantes. L'ascension qui nous relève les journaux ne nous laisse que des commérages. Hier Paskevitch avait passé le Danube. Silistrie allait toucher dans quatre jours. Je ne crois à aucune nouvelle. On ment de tous côtés. La Grande Duchesse Olga est revenue à Stuttgart on y arrive aujourd’hui. Elle a laissé l’Empereur rétabli. Tout le monde confiant et charmé de l’occasion de secouer la Russie et de montrer à l’Europe ce que nous sommes. Ah que je me serais passée de cette exhibition !
Ce qu'il y a de triste dans cette maudite affaire c’est que l’Europe entière ne nous fera pas fléchir. Nous ne sommes pas assez civilisés pour cela.
Greville compte sur des révolutions de palais ou autre. Cela ne sera pas. La force & la puissance de l’Empereur sont dans sa résistance à l'ennemi. Toute la nation l'appuie. Il n’y aurait de danger pour lui que s’il voulait céder quel malheur d’être encore des barbares.
Le temps est affreux, je n'ose pas sortir et j’ai tout le temps imaginable pour m'ennuyer. Si mes yeux me permettaient de lire !
Adieu. Adieu, je n'ai rien à vous envoyer qu’adieu.
Mots-clés : Europe, Guerre de Crimée (1853-1856), Presse, Santé (Dorothée)
77. Paris, Vendredi 26 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quelques mots seulement. aujourd’hui ; j’ai une multitude de visites et de petites affaires et rien à vous dire. Votre N°66 me fait plaisir ; vous êtes mieux. Ne risque jamais ne prendre froid, et faites ce que vous dit votre médecin, même quand il ne vous plait pas. Il en sait plus que vous.
Je n’ai vu personne hier soir. Il n'y a point de journaux ce matin. Dumon sort de chez moi et ne sait rien. Duchâtel est parti hier, et m'a formellement chargé de ses plus affectueux respects, regrets, ce que vous voudrez, pour vous. Adieu, Adieu. G.
Je presserai ce matin Génie de finir votre affaire avec Rothschild.
65. Bruxelles, [Mercredi 24] mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Jeudi
Brockhausen est revenu hier de Paris. Enivré de Paris, malheureux de retrouver Bruxelles. Il dit qu'on sait bien moins là qu'ici. Je suis dans mon lit aujourd’hui c’est bien ennuyeux, j’espère que ce n’est pas dangereux. Redcliffe a fait ses embarras. Il n’a pas voulu aller au dîner donné pour le prince Français, Raglan non plus, c’est drôle. Les spectateurs trouvent cela un singulier début pour l’action commune.
Il y a des gens qui prétendent qu'il y a quelques nuages entre Paris et Londres, c’est des mauvaises langues.
Quelle misère d’aller nous trouver vous en Normandie, moi en Nassau. Ce pauvre Constantin me conseillait l’autre jour de penser comme la Grande Duchesse de Weimar qui dit que le bon Dieu n’aurait pas fait autre ment que l’[Empereur] son frère, j’ai répondu que c’était bon pour un orthodoxe de le croire, mais que moi j’étais Luthérienne, et je crois au bon Dieu plus d'esprit que cela. J'ai été prise d’un accès de sommeil après une nuit blanche, et voilà qu'il est tard. Je suis obligée de fermer ma lettre. Je viens d'en recevoir une de Greville un peu bête. Evidemment l’intéressant il ne veut pas me le dire. Adieu. Adieu.
N'oubliez pas de me donner l’adresse de Génie.
64. Bruxelles, Mardi 23 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mardi
Je vous remercie d’avoir remis mon affaire entre les mains de Génie. Il traitera fort bien avec Rothschild et cela pourra aller vite. Mais reverrai-je jamais mon appartement ? D’abord la paix, quand viendra-t-elle ? & ma santé qui s’en va au grand galop. J’ai tous les jours quelque mal nouveau. Maintenant mal à la poitrine, hier névralgie à la tête. C'est une misère. Je crois le climat de Bruxelles bien mauvais. Quelle est l’adresse de Génie ? J'ai lu des choses curieuses. Il paraît que la faction allemande est débordée à Pétersbourg. Et nos agents diplomatiques sont tous allemands. En Autriche, Prusse, Danemark, Brunnow est à Vienne. Tout cela est pour la paix et la prêche. On dit même que Paskevitch aurait dit : "Je ne sais pas pourquoi je vais faire la guerre." Et bien tout cela n'a pas cours chez nous. Je commence à croire que le petit Grand Duc Constantin gouverne.
Comme vous voyez beaucoup Mad. Mollien depuis quelques temps je suis devenue jalouse et j’ai demandé ce qu’elle était. De bonnes manières, je le sais je la connais, mais après on me dit qu’elle est très ennuyeuse, de la prétention, de l’affectation de la flatterie & des phrases. Cela ne vous va pas il me semble et je me rassure. C'est bien long toute une journée avec elle.
Le ministre Belge chez nous raconte Odessa comme nous l’avons raconté nous-même. Pas une grosse affaire, pas grand dommage à la ville même point, et celui fait à vos vaisseaux c’est les 4 canons de notre petit lieutenant d’artillerie qui l’a causé. Tout cela est donc peu de chose. Les préparatifs à Cronstadt, Sveaborg et surtout Pétersbourg formidables, & même exagérés. La Finlande très dévouée. La Suède pas de danger qu’elle tourne contre nous. Vienne l'hiver & elle aurait tout à craindre de notre part. Elle ne peut pas s'y exposer. Levorin, Courlande, Estonie, les plus affectionnées provinces de l’Empire. Enfin nous sommes en pleine confiance. Ai-je raison de dire que nous sommes très mal à l'aise, mais pas ridicules ?
Comme je suis triste de penser que vous allez être si loin. Et que moi je m'éloignerai à mon tour. Quel espace entre nous ! Adieu. Adieu.
68. Val-Richer, Lundi 15 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
Je me lève. Je viens de passer une nuit très pénible. Ma fille Pauline est un peu souffrante, très enrhumée et de plus grosse, ce qui ne me plait pas du tout. J’ai rêvé toute la nuit qu'elle était très malade. Vous m'écriviez en même temps des lettres désolées ; les miennes ne vous parvenaient pas ; vous ne saviez ce que je devenais. Guillaume de son côté ne m'écrivait pas. J'étais inquiet sur vous, sur mes enfants. Je me suis réveillé dans une angoisse inexprimable. Ah, que Dieu m'épargne de nouvelles épreuves ; je n'en mourrais probablement pas ; on ne meurt guère de chagrin ; mais j'y succomberais moralement. Je n'ai le coeur blasé sur rien, ni joie ni peine ; mais ma force de résistance est née et la perspective d’un nouveau fardeau à porter me fait frémir.
Voilà Baraguay d'Hilliers rappelé. Cela devait être, et je présume que les raisons du rappel sont bonnes. Le spectacle est pourtant singulier. L'Ambassadeur de France est rappelé pour avoir voulu protéger spécialement les grecs Catholiques, et le vaisseaux français sont en train de faire la guerre au Royaume grec que les armes françaises et l’argent français ont fondé. L'évêque d'Evreux avait bien raison, il y a quelques jours dans son mandement pour le succès de nos armes ; il commençait en disant : « Vous vous étonnez probablement, mes Frères, que nous fassions, et que nous vous demandions des prières pour des Musulmans contre des Chrétiens, et je comprends votre étonnement. Mais ne vous scandalisez pas ; la religion n'est pour rien du tout dans cette guerre ; elle est uniquement politique ; et ce n'est point des intérêts de la foi Chrétienne, mais de ceux de l’équilibre Européen qu’il s’agit. »
Je vois dans les journaux, qu’un des principaux chefs de l'insurrection grecque, Karaïskaki est mort. C'est le fils du dernier tué parmi les grands chefs Pallikares de la guerre de l'indépendance. Le tombeau de Karaiskakis la père est sur la route du Pirée à Athènes. Quand Colettis quitta Paris pour aller être premier ministre du Roi Othon, en débarquant du Pirée et en se rendant à Athènes, il s'écarta de la route, et suivi de toute la foule qui était venue l'accueillir à son débarquement, il alla s'agenouiller et prier, avec cette foule, sur le tombeau de Karaïskakis. Il avait le culte de ses anciens compagnons, et il excellait à s'en faire un moyen d'action sur son peuple. Ce qui se passe aujourd’hui doit l'agiter puissamment dans son propre tombeau.
Onze heures
Voilà le N°56. Adieu, Adieu. Mon médecin de Lisieux, est chez Pauline et la trouve bien. Mais ne maigrissez pas. Adieu. G.
56. Bruxelles, Samedi 13 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’avais pas eu de lettre hier, il en est venu deux aujourd’hui. De mon côté, je ne vous ai pas écrit n’ayant vraiment rien à vous dire. De longue lettres de Greville pas grand chose de neuf. Très sûr que l’Autriche marchera avec, & que la Prusse ne le fera pas. Se vantant du forbearance à Odessa. La flotte n’a pas été contente, elle aurait voulu plus Le Havre. Hamelin a été plus que Dundas opposé à ce qu’on devastat la ville. Ici on est très convaincu que l’Autriche marchera avec les alliés. Ce que l’Autriche ne supportera pas c'est la révolution à ses portes, & c’est pour cela qu’elle irait occuper là Bosnie & la Grèce. Montebello m’a écrit il y a huit jours qu’il viendrait après le 15. J’ai donc le droit d’y compter & je viens de m'en rappeler.
Je recommence à maigrir. Cela prouve déclin dans la santé. Le temps est meilleur et le bois de la Cambre charmant, les oiseaux chantent. Mais ce n’est pas vous. [Boldingue] est ici venant de Stuttgart. Le roi de [Wurtemberg]. nous est très fidèle.
Voilà, je n’ai plus rien. Les russes ici m'impatientent un peu. Pleins d’assurance, à la bonne heure, mais je ne sais pas comprendre. Adieu. Adieu.
57. Paris, Mercredi 3 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai passé hier chez Andral sans le trouver ; rien n’est plus difficile que de le joindre. J’ai porté et laissé chez lui une lettre de moi, précise et pressante, et contenant le vôtre. S’il y a moyen de décider un grand médecin à en mécontenter de loin un petit, j'espère que cela le décidera.
Marion m’a amené hier Mlle de Chériny qui part ce matin pour aller passer quelques jours à Bruxelles. J'en suis bien aise. Vous avez raison de ne pas vous décider sans la voir et j'incline à croire que vous la trouverez bien, assez bien du moins. J’ai encore été frappé hier de son air doux, honnête, de bonne compagnie et empressée sans manquer de dignité. Soyez bonne pour elle pendant ces quelques jours et ne l’intimidez pas trop. Ellice est parti et Marion est restée pour huit jours encore chez Charlotte Rothschild. Elle a ici un autre oncle, un M. Finch, qui la ramènera en Angleterre. Je persiste à ne pas bien comprendre l'affaire d'Odessa. Il y a évidemment des choses qu’on ne nous dit pas. Ou bien l’on n’a pas pu faire ce qu’on voulait, ou bien l'on n’a pas voulu faire tout ce qu’on pouvait. En tout, ce n’est pas une grosse affaire.
Ce qui est plus gros, c'est le nombre de tromper qu'on envoie, et le redoublement d'activité qu’on met à les envoyer. Je ne sais ce qu’elles feront cet été ; mais soit pour cet été, soit pour l'été prochain, on semble vouloir faire beaucoup. Je ne vois là point de symptômes de paix.
J'en vois davantage dans les dispositions qui se développent de plus en plus dans le public, non seulement, en France, mais en Angleterre. Si après la campagne de cet été, vaine des deux partis, votre Empereur, je ne sais par quelle voie, propose de nouveau ce qu’il a déjà proposé, l’évacuation simultanée des Principautés, et des deux mers et un congrès à Berlin pour régler Européennement la question, ou je me trompe fort, ou la paix se fera. Les Congrès ont toujours beaucoup de peine à conclure la paix ; mais quand une fois ils sont réunis, ils ne recommencent pas la guerre.
J’ai causé l'autre jour avec Moltke à qui j’ai fait vos amitiés, et que j’ai éclairé sur votre brouillerie avec Kisseleff. On lui avait dit que vous avez d'abord demandé, puis refusé, puis redemandé l'échange ; la versatilité était mise à votre compte. J’ai rétabli les faits. Du reste, je n’en entends plus parler.
10 heures
Voilà votre N°46. Je suis charmé que la question d’Ems soit vidée. Ma lettre à Andral a été remise hier. Il n'y a pas de mal. Adieu, Adieu. G.
46. Bruxelles, Mardi 2 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je commence par reprendre les chevaux blancs et les acclamations à Bourguenay. J'avais la France pour Fiancée c'est un peu différent. Mauvais griffonnage & des mauvais yeux. C’est très ridicule de vous avoir mandé cela & nous en avons bien ri le soir. Ensuite bonne nouvelle pour moi. Le médecin d'ici a de son propre mouvement (pas trop propre soit dit bien entre nous) renoncé complètement à Spa pour sa malade. & c’est à Ems que nous allons tous. Si vous n'avez rien fait ne faites rien. Si c’est fait tant mieux cela confirme. Merci, pardon, & surtout merci.
Sir H. Seymour est ici. Il parle très bien de mon Empereur, très mal de tous ses serviteurs. Pour lui plaire on le trompe, et il ne s’étonne que d'une chose c’est qu’il ne soit pas trompé davantage. Il ne veut voir aucun Russe ici excepté moi. Il y a recrudescence d’irritation. Chez nous l’approche du danger excite à ce sentiment. Meyendorff a demandé à Bual si l'évacuation de la petite Valachie ne produisait pas une bonne impression sur son cabinet. Pas le moins du monde. On ne sera satisfait que de la retraite absolu des [Principautés]. J'ai beaucoup écrit hier à Pétersbourg pour le courrier de Hatzfeld qui devait passer cette nuit. Brockhausen m’a dit que ce ne serait que la nuit prochaine. C’est ennuyeux. Brunnow vient de louer ici une maison, il se lance dans le monde. Hier deux heures de tête-à-tête avec lui. C’est drôle ! Si intime avec Brunnow et brouillé avec [Kisseleff] car c'est fini, il ne revient plus. Adieu. Adieu.
54. Paris, Dimanche 30 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
Je rentre de l'Eglise. Avant d'y aller, j'ai été assiégé de visites, suite du discours d’hier. Je n'ai que le temps de vous dire, adieu. Je vous écrirai demain à mon aise. J’ai eu de vos nouvelles par le duc de N. mais je ne l’ai pas encore vu.
Je le verrai dans la matinée ou ce soir. Merci de toutes vos lettres, malgré vos yeux. Je ne puis vous dire, à quel point je suis préoccupé de votre séparation d'Hélène. Je reviens encore à Mlle de Chériny. Les eaux sont un prétexte convenable pour une expérience. Si elle ne vous va pas, vous vous séparerez après, et on cherchera autre chose. En attendant la paix. Montebello est revenu de Brott après avoir embarqué son fils sur l'Hercule. J'insisterai pour qu’il aille vous voir. Adieu, adieu. G.
44. Bruxelles, Samedi 29 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le duc de Noailles est parti ce matin. Vous le verrez sûrement dans la journée. Dites lui ma grande reconnaissance, mon grand chagrin, mon grand ennui. Cette semaine a été bien remplie et bien agréablement. J'ai encore eu une lettre de [Greville]. Très curieux de ce qui se fait entre Vienne & Berlin, n'en sachant pas le premier mot. Espérant bien que le bombardement d'Odessa n’est pas vrai." A sheer barbarity, without any sort of use."
Je n'ai rien à vous dire de nouveau depuis hier soir. J'écris beaucoup, cela fatigue mes yeux. Ce sera bien pire quand je n’aurai plus Hélène pour venir à mon aide. Ah qu'Andral aurait pu faire une autre réponse ! C'était si simple, répéter ce qu'il avait prescrit, peut être est il blessé de ce qu'on ne s'en soit pas tenu à cela. Si c'était vrai ce serait bien bon à dire, et peut-être à défaire encore le mal. Adieu. Vous voyez ma préoccupation de cette affreuse perspective d'isolement. Adieu.
43. Bruxelles, Vendredi 28 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Grande haine à Pétersbourg contre les Anglais. Des invectives dans les rues aux passants russes qui ont la tournure anglaise. Pas un mot des Français, au contraire bonne amitié pour eux. Le plus gros juron russe est Palmerston. Les cochers disent cela entre eux. Le duc de Noailles vous répètera que l’Empereur Napoléon est rempli de désir de la paix, et de l'horreur de la propagande révolutionnaire. Morny a été bien vif et décidé sur ce chapitre à aucun prix on ne favoriserait ce parti. On se trouve en grande et bonne compagnie, en grand renom. On veut rester comme cela. On y restera. Persigny a tenu le même langage à Marion. (Elle me le mande.) On croit à une campagne stérile, on souhaite ardemment des propositions acceptables. La difficulté sera l'Angleterre mais on pèsera sur elle ; efficacement si on est à trois, et si non on pourrait bien sans elle se décider Morny a trouvé le roi Léopold assez mécontent de l'Angleterre. Il lui a dit de ne pas faire attention à ces bourrades contre les Russes à Bruxelles. Qu'il les garde, qu’il garde son indé pendance. On ne sait trop ce que ferait les Allemands. La Prusse certainement point d’action contre nous, si l’Autriche s'en mêlait ce serait bien douce ment. La neutralité le plus longtemps possible et toujours en position de négocier la paix. Mon empereur la veut ardemment. En consentant à un congrès c'est bien la plus grande preuve. Lui qui s'obstinait au tête-à-tête.
Mes pauvres yeux, je vous renvoye au duc de Noailles, il a tout entendu tout écouté. Sa rencontre si intime avec Morny l’a bien amusé. Du matin au soir avec lui car on déjeunait chez moi, et la nuit au bal dans ma voiture, mariés pour le quart d’heure. Moi aussi cela m'a bien amusée. Voilà que cela finit ! Pourquoi Montebello, Dumon, d'Haubersaert ne viendraient-ils pas ? Toujours mon château. Que je serais aise. Mais concevez-vous le malheur de me séparer d'Hélène. Et pourquoi Andral ne pouvait-il pas avoir un avis, le [?] Politique de confrère. C’est mal. Adieu Adieu.
N'oubliez par le courrier de Hatzfeld le 1er mai Lundi si vous avez de quoi.
42. Bruxelles, Vendredi 28 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le duc de Noailles passe encore la journée ici. Il s’amuse, il y a de la variété & toujours des nouvelles. Il a dîné hier chez Lamoricière avec M. de Rémusat. Avant hier à un bal chez Brockhausen, Morny y a été aussi. Très élégant bal dit-on.
La convention austro prussienne n’est pas tout-à-fait conclue. Le duc George est encore à Berlin. Sebach en arrive, il dit qu'on est peu russe à Berlin et encore moins français.
On écrit ici de Pétersbourg qu'on a fait transporter à Moscou le trésor de la forteresse 400 millions. De tous côtés cependant on doute qu’on puisse attaquer Cronstadt. Lamoricière qui connaît la place a dit au duc de [Noailles] que par mer elle est imprenable, par terre ce serait possible avec un corps de 30 m h. On dit cela aussi de Sevastopol. Mes yeux vont mal depuis hier. Je fais économie et ceci ira par le duc de [Noailles]. Je me ravise. On ne sait pas l’avenir autant vaut vous envoyer toujours ce bout de lettre par la voie ordinaire sauf à écrire encore si je puis. Adieu. Adieu.
51. Paris, Jeudi 27 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier soir Mad. de Boigne. Rien que M. d'Osmond, la duchesse de Maillé, M. et Mad. Duchâtel. Point de politique. En fait de commérages, deux mariages et une fuite. Morny et Mlle de Bonteville, Bondeville ou Bonneville. On en parle sérieusement, si ce mot y va. Elle était chez lui un de ces jours, à un tirage de petite loterie. Elle a gagné un bijou qu’on appelle, je ne sais pourquoi, une rivale. Morny est allé chercher, parmi les fleurs, la plus belle rose, et la lui a apportée, en lui disant : " Je ne vous en connais point d'autre." Elle est très jolie et riche. Le Prince de Montléart est bien plus drôle ; il épouse Mad. Howard. On le dit très mal dans ses affaires depuis la mort de sa femme.
La fugitive est la petite Mad. de Bauffremont ; partie depuis huit jours avec ses diamants et ses dentelles, et accompagnée d’une femme dont on dit beaucoup de mal. On ne savait pas encore hier soir où elle était. Son mari la battait horriblement. Mais elle a eu tort de s'enfuir ; elle pouvait réclamer ouvertement sa séparation. Il l’a battue plusieurs fois devant témoins. J’ai eu bien tort d'envoyer ce petit Moniteur comme attaché à Washington.
Voilà mes histoires d'hier que vous savez peut-être déjà. J'étais rentré à 10 heures. J’ai toujours mal à la gorge. Il fait moins froid pourtant.
Les Anglais partent ; pas le Ellice pourtant ; ils restent encore quelques jours. Rien ne presse au Parlement ; Marion s'amuse et son oncle bavarde. Sir Henry Holland m’écrit : " I see Lord Aberdeen almost every day rather to preserve his health than to relieve him from any actual illness. In truth, he has surprised me by passing through the last twelve months of [?] and painful public business with better health than at any period during the last 15 or 20 years. "
Voilà votre N°39 qui me plait, quoique court. C'était bien la peine de vous envoyer le mariage de Morny. J'attendrai impatiemment demain, ou après demain. Adieu, adieu. G.
40. Bruxelles, Mercredi 26 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voilà Morny arrivé hier soir, il reste ici la journée & me la donne. Complication, car Le duc de Noailles est là. Nous venons de déjeuner à nous trois. Longue et bonne conversation dont moi je suis bien contente. Le roi vient de l'envoyer chercher à Lacken. Moi je viens d'écrire, je suis fatiguée je ne vous dis qu’un mot. Morny me donne le reste. de la journée il part demain matin. Vous aurez demain ou après-demain une longue lettre. Adieu. Adieu.
49. Paris, Mardi 25 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce froid me déplait beaucoup. J’ai mal à la gorge, et très mal à propos dans une semaine de meetings et de conversations. Le soleil tout brillant qu’il est, est peu efficace contre le vent dur et sec. Enveloppez-vous bien dans le bois de La Cambre, et n'abusez pas de la voiture ouverte ; vous avez, sur ce dernier point, des habitudes Anglo-russes dont je me méfie. Vous n’avez plus que cela d' Anglo-Russe.
Hier soir, un Comité Protestant et Mad. de Champlouis avec de la musique. Bonne à ce qu’on dit, et à ce que je crois parce qu'elle m’a plu. Vous avez beau vous moquez de mon ignorance ; je persiste à accepter. mon plaisir quand il me vient. Les arts, la musique surtout ont le privilège qu’on n'a pas besoin de s'y connaître pour en jouir. Ils trouvent toujours, dans les plus inexpérimentés, des fibres qu’ils remuent, et qui à leur tour, remuent toute l'âme.
Le traité de la Prusse et de l’Autriche fait de l'effet. On dit qu’il sera communiqué à la Diète de Francfort qui l’approuvera, et qu'alors, c’est-à-dire vers l'automne, au nom de toute l'Allemagne, on demandera aux Puissances belligérantes de mettre fin, par une transaction, à une situation interminable par la guerre. On parle même déjà des bases de la transaction ; on dirait que votre Empereur a eu tort dans les deux moyens qu’il a pris pour imposer à la Porte ses demandes, sa mission du Prince Mentchikoff et l’occupation des Principautés ; mais il avait réellement quelque chose à demander, et la Porte a eu tort de lui refuser toute satisfaction, et les Puissances occidentales ont eu tort de ne pas engager sérieusement la Porte à lui en accorder une. Tous ces torts admis, on en viendrait à l’évacuation des Principautés, et à un congrès, si mieux n’aimaient votre Empereur et la Porte en finir tout de suite par quelque chose d’analogue à la Note de Vienne un peu modifiée et sans commentaire. Voilà les prédictions. Je n’ai pas trouvé Andral hier quand j’ai passé chez lui. Je lui écrivais ce matin pour le presser, si vous ne me dites pas qu’il a répondu.
Les départs commencent. Henriette part lundi prochain pour le Val Richer, avec son mari et son enfant. Pauline et les siens resteront avec moi jusqu’au 19 Mai. Nous ferons les élections de l' Académie Française le 18, et celles de l'Académie des inscriptions le 19 et le soir même je partirai, à ma grande satisfaction. Les Broglie seront retenus un peu plus longtemps à Paris à cause des couches de la belle-fille qui va très bien. Les Ste Aulaire et les Duchâtel seront partis.
Adieu, Adieu. Avez-vous repensé à Mlle de Chériny ou à quelque autre ? Je dois dire que M. de Chériny n'a pas du tout l’air d’une grande dame Allemande à qui il faut apporter sa chaise. Adieu, G
Mots-clés : Académies, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Femme (maternité), Femme (portrait), Guerre de Crimée (1853-1856), Musique, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Allemagne), Politique (Autriche), Politique (Prusse), Portrait (Dorothée), Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Santé (François)
41. Paris, Lundi 17 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Deux jours sans lettres, ni hier, ni avant hier. Je ne comprends pas. J’ai la confiance que si vous étiez malade et hors d'Etat de m'écrire deux lignes, Hélène me donnerait de vos nouvelles. J'espère donc que vous n'êtes pas malade. Mais le déplaisir est grand.
10 heures et demie
En voilà deux 30 et 31. J’aurais dû avoir le 30 hier. Mon plaisir de ce moment me fait oublier mon ennui de deux jours.
Votre commission pour Andrial sera faite avant 2 heures. Elle est un peu délicate ; mais je m’arrangerai pour la bien faire, et j'espère qu’il pourra persister en conscience dans son propre avis. J'y mets presque autant d'importance que vous-même. La Princesse Kotschoubey auprès de vous m'est une grande sécurité. Au moins faut-il que vous l'ayez tout l'été.
Je vous ai dit mon impuissance auprès de Marion. Soyez sûre de deux choses, que j’ai dit tout ce que je pouvais, tout ce qui se pouvait dire, et qu’il n’y a pas moyen. Toute la famille a un parti pris. Et puis, au fond du cœur, sans me le dire, on vous craint.
Laissez lui prendre un pied chez vous ; elle en aura bientôt pris quatre. Vous avez abusé ; il y a un degré d’exigence qui tue la puissance. Aggy n'était pas en état de se défendre ; mais il lui est resté une grande peur de succomber. Marion sait se défendre ; mais elle n’a pas envie d'y être obligée. Elles se sont jadis très étourdiment engagées ; elles ne veulent plus s’engager du tout. Je vous ai dit, la chance que Marion m’avait laissé entrevoir ; si j’avais voulu amener cette chance à devenir une promesse, j’aurais eu un non positif. Vous connaissez la brutalité des Anglais quand ils sont décidés. Je n’ai pas encore vu Ellice. Je causerai Jeudi avec lui.
Brougham aussi est arrivé. Ils parlent beaucoup l’un et l'autre, des difficultés de la guerre ; ils ne se promettent point de succès prompts et décisifs ; mais ils se montrent et ils disent que leur pays est très résolu à continuer, tant qu’il faudra ; ils indiquent trois ans comme le minimum de la durée. C'est presque aussi ridicule que trois jours ou trois siècles. Personne ne peut rien entrevoir dans l'avenir de cet apathique chaos.
Le Duc de Cambridge s'amuse beaucoup ici. Il a retardé son départ pour un grand bal qu’on lui donne aujourd’hui aux Tuileries.
Le maréchal St Arnaud ne commandera point Lord Raglan. Il y aura concert entre les deux armées, mais non unité. Ainsi ont opéré, le Duc de Marlborough et le Prince Eugène, Wellington, et Blücher. Cela a des inconvénients, mais des inconvénients qui n'empêchent pas les victoires.
Je n’avais pas oublié, le courrier de Brock. Mais je n’avais rien à vous dire qui en valût la peine. Hier matin, Duchâtel longtemps et Molé. Hier soir Broglie et Ste Aulaire. Personne ne sait rien, et tout le monde attend sans grande curiosité. L'indifférence politique a remplacé l'indifférence religieuse, ce qui ne veut pas dire qu’il y ait beaucoup de chaleur religieuse. Adieu, Adieu.
Je vous quitte pour faire ma toilette et m'occuper ensuite d'Andral. Adieu. G.
32. Bruxelles, Lundi 17 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Merci des efforts infructueux au près de Marion. Certes il n’y aura pas ici de votre faute. Cette manière de voir est bien étroite, je dirai bien bourgeoise. J'espère que vous réussirez auprès d'Andral, car je me figure que le changement est une fantaisie des médecins d'ici.
Brunnow a rencontré hier Lord Howard chez moi. Celui-ci a dit entre autres choses qu'il ne à aucune impression. se fierait jamais ou opinion de Seymour. Voilà qui est Drôle. La conversation avait commencé très banale & froide. J'ai chauffé cela et c’est demain piquant & bon du côté anglais. Seymour va venir passer quelque jours ici. le soir Van Praet & Lebeau. [Brackhausen] cela va sans dire. Pas l'ombre d'une nouvelle aujourd’hui. On dit ici que l'accueil du public pour le duc de Cambridge a été froid, et que les Anglais se plaignent des lenteurs des Français. Ah si tout cela pouvait n'être pas nécessaire. Adieu. Adieu.
Mes yeux ont la fièvre intermittente, aujourd’hui le mauvais jour. Adieu.
22. Bruxelles, Jeudi 6 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu du courage tout le jour. La nuit, non, mon chagrin est aussi grand que ma joie avait été grande. Je me retrouve plus seule que jamais, et triste, triste. J’ai vu Brunnow longtemps. Il doute de la nouvelle. On a dit me dit que Kisseleff : " Qu’est-ce que nous font les Chrétiens." C'est à Van Praet qu'il a dit cela. C’est un sot. Brunnow convient que si elle est vraie elle peut & doit mener à tout. Le public de ce pays-ci était hier en extase. Le soir Van Praet & Lebeau, un doctrinaire. Certainement de l'esprit et hier en grande coquetterie. Ils sont drôles ici, ils me prennent pour un bel esprit.
Dites-moi je vous prie vos idées sur la nouvelle de Berlin. Brockhausen m'envoie le journal semi officiel qui la contient. Cela a l’air bien vrai, il me semble impossible que cette avance ne soit pas accueillie avec joie mais que de chemin à faire encore avant que cela aboutisse. J’ai écrit à Ellice ; ignorant. qu’il vienne à Paris, je dis quelques paroles qui pourraient toucher Marion. J’attends quelque chose de votre entrevue avec elle. Au fait vous pourriez bien lui rappeler qu’elle a lutté avec ses parents quand il s’est agi de venir chez moi, pour leur plaisir à elles, qu’elle pourrait bien lutter aussi quand cela devient une charité pour moi, et que je ne mérite pas cet abandon. Enfin, je suis sûre que vous direz ce qu'il faudra. Me voilà à cette même. table où nous étions il y a 24 heures. Mais votre place est vide. Cela me serre le cœur, et je suis prête à pleurer. Ah que votre visite m’a fait de joie et laissé de peine. Adieu. Adieu.
21. Bruxelles, Mercredi 29 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici une commission. Priez votre valet de chambre de la faire et de m’apporter cela & de la payer. Je le rembourserai exactement ici. Qu'il ne prenne pas du carré arrondi ; il faut rond rond. Ma derniers lettre, c’est charmant ! Mais après il faudra recommencer. Ce qui est affreux c’est de n’avoir aucun bonheur tranquille en perspective. Nous ne croyons pas ici au passage du Danube par nos troupes. défensive, défensive, pas autre chose. Brunnow est sur cela très affirmatif. Dieu ! Qu'il est laid. Vous me trouverez mauvaise même. Je suis malade depuis Paris. Ces quelques jours me feront du bien. Adieu. Adieu.
18. Bruxelles, Vendredi 24 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hélène Kotchoubey reçoit aujourd’hui de Pétersbourg la nouvelle qu'il y a eu une rencontre entre nos vaisseaux & les Turcs & Anglais sur la côte d’Asie, 3 frégates turques, 4 vapeurs anglais qui nous ont enjoint de nous retirer nous avons attaqué, & coulé bas les 3 frégates & 2 vapeurs anglais. Les 2 autres sont allés en porter la nouvelle à Constantinople notre amiral a été tué & 8 officiers. Voilà tout ce qu’on dit. Le courrier porteur des rapports officiels n’a fait que traverser Pétersbourg pour aller rejoindre l'Empereur en Finlande. Tout ceci est verbal, sans désignation de lieu ni de date, mais nous allons savoir tout cela officiellement. Voilà donc la guerre commencée ! Les publications anglaises sont inconcevables, et déplorables. Nous ne savions pas ce que nous allions chercher qu’allez-vous me dire de tout cela ? Je grille de ne pouvoir dire à personne tout ce que j'en pense. Je n’ai pas eu un mot de vous du Val Richer.
Vous me direz j’espère si tous mes N° sont en règle, et puis j’attends une réponse. Il n’est peut-être pas trop tard. Je ne vois pas que la nouvelle de Constantinople soit confir mée. Vraiment si les Turcs accordent tout ce qu'on leur demande ils sont bien plus annulés qu'ils ne l'eussent été en cédant à nos demandes. De toute façon je crois que c'est un pays perdu. Je reviens aux publications. Ne vous figurez-vous pas en les lisant que vous êtes la postérité. Dans 60 ans à la bonne heure, mais aujourd’hui. Rien de secret, rien de sacré. Enfin c’est incroyable, je ne sais pas encore l'effet que cela produit. à Paris. Dites le moi je vous en prie. Ici l’effet ne nous est pas favorable. Adieu. Adieu. Le temps est mauvais et mes yeux. vont mal. Dites moi un mot pour Barrot. Adieu.
17. Bruxelles, Mercredi 22 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Quel ennui que ce N°15 égaré ou retardé ! Je crois que j’y répondais à votre charmant projet de me me voir. J’accepte la date avec bonheur. Dites-moi quand vous aurez reçu cette lettre chanceuse. On est très vif ici à propos de la nouvelle de Constantinople. Certainement l'envoi des troupes dépendait des consentements de la porte à la demande d'émancipation des Chrétiens. Si cette émancipation est vraiment obtenue et on y croit, et si mon empereur à la bonne foi & le bon esprit de s'en tenir pour satisfait voilà la guerre évitée, mais c’est trop beau pour croire à ce facile dévouement.
Lord Holland & M. Barrot se sont rencontrés chez moi hier, bien contents & tous deux bien pacifiques. J’ai été très contente du langage de l'Anglais, un grand changement depuis huit jours. Le français avait toujours été convenable et bien. On annonce Brunnow pour aujourd’hui. Quelle curieuse correspondance que celle qu’on vient de produire au parlement. Pauvre dépêche que celle de lord John, mais quel entrain de mon empereur. Dites-moi je vous prie votre avis de tout cela. La publi cation ne me paraît pas une chose bien inventée, pourquoi avons-nous provoqué cela ? à tout instant je me sens le besoin de vous interroger, de vous entendre. Je n’ai pas encore lu cette correspondance jusqu'au bout. Mes yeux sont très capricieux. Je les croyais mieux, ils sont repris. Le temps est froid. Je serai charmée de vous savoir revenu à Paris.
Adieu. Adieu, je suis restée deux jours sans vous écrire à cause de votre absence. J'ai eu peut être tort, mais je croyais que mes lettres reposeraient à Paris. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Conditions matérielles de la correspondance, Femme (politique), Guerre de Crimée (1853-1856), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Russie), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)
12. Bruxelles, Mardi 14 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez bien de l’esprit, et j'en ai aussi. Votre critique de nos deux dernières pièces est précisément ce que j'en ai pensé et dit. J’aime bien ces rencontres. J’enverrai votre lettre plus loin, il est bon qu’on entende chez nous la vérité. Ah que tout cela a été mal conçu et mal conduit.
Mes yeux vont un peu mieux, mais ma tête, mon cœur, et toute ma santé générale ! Avec quelle tristesse je me réveille et je m’endors. Dans une vie si avancée retrancher tant de mois de jouissance, de bonheur ! Meyendorff a dit à Vienne : " Si la porte accorde l'émanci pation des Chrétiens, il n'y a plus de question d’Orient. " That is sensible. Qu'ils accordent donc il paraît trop qu'on s’était pressé ici de croire que c'était fait, ils n'ont obtenu encore que l'égalité devant les tribunaux et encore cela n'est pas tout à fait complet. Morny me mande que St Arnaud va à Vienne. Le sait-on ? On prend à Paris très bien la nouvelle attitude de la Prusse. Elle nous est favorable en tant que tout-à-fait neutre. Le temps ici est magnifique, mais je ne jouis de rien. Comment jouir quand on pleure. Adieu, des lettres, des lettres. Adieu.
11. Bruxelles, Dimanche 12 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous en prie ne m'écrivez pas sur du petit papier. Cela m’attriste. Voilà l’émancipation des Chrétiens consentie par les Turcs, c.a.d. plus que nous n’avions demandé pour les Grecs. Comment mon Empereur laissera-t-il échapper cette occasion de se déclarer content & de finir cette misérable querelle ? Vous devriez bien m'écrire ce que vous pensez de cela. Greville est très animé si le congrès russe de Bruxelles pouvait venir à la paix l'Angleterre seule n’en voudrait pas. Elle veut l'humiliation, l'abaissement de la Russie. Il y a eu une vive scène entre Clarendon & Brusen (ce n’est pas de Gréville que je le tiens) le prussien annonçait la neutralité résolue de la Prusse. On en est venu aux gros mots, il voulait chasser Brusen d'[Angleterre]. Walewski a apaisé l'orage. L’Autriche sans être aussi explicite que la Prusse, ne sera pas non plus féroce. Elle ne nous fera pas la guerre. Je crois, mais je prends cela de ma seule tête que la première opération navale sera une attaque sur l'île d'Aland. Cette position commande Stockholm. Nous y avons fait de grands travaux. Dans huit jours la flotte Anglaise sera dans la Baltique.
Je me sers de mes yeux comme vous voyez, mais j’ai tort. L'ultimatum anglo-français a dû arriver à Pétersbourg hier. Adieu. Adieu. Tâchez de savoir comment Castel bajac a été reçu et s'il a été reçu ? Le premier venu diplomate vous dira cela. J'oublie qu'ils ne se trouvent plus sur votre chemin.
14. Paris, Vendredi 10 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mots-clés : Académies, Guerre de Crimée (1853-1856), Mort, Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)
13. Paris, Jeudi 9 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier soir Mad. de Boigne et Mad. de Ste Aulaire. Chez Mad. de Boigne le service ordinaire ; la petite Duchesse de Maillé y est presque tous les soirs depuis la mort de sa mère ; une jolie souris intelligente et raisonnable. Le Chancelier va toujours. M. Mérimée silencieux, excepté quand on a apporté un grand coffre sculpté en ivoire que Mad. de Menou a légué à M. de Boigne. Est-ce en ivoire ou en os du 15e ou du 13e siècle de Constantinople ou d’Italie ? La conversation s’est animée. Je n'ai point d'opinion ; mais le coffre est joli. Le général d’Arbouville, qui erre de salon en salon comme un soldat en peine, ennuyé et embarrassé de son oisiveté.
Chez Mad. de Ste Aulaire, la famille, qui suffit presque à remplir le salon ; Mad. de Gouchy, la petite Mad. de Barante. Son beau père arrive mercredi, pour deux mois. Il sera aussi de ceux à qui vous manquez.
On disait hier soir que le Maréchal St Arnauld avait définitivement renoncé à commander l’armée. Ce qui l’indique, c’est que ses officiers d’ordonnance qui avaient annoncé et fixé le jour de leur départ, l’ont ajourné. Je trouve la mesure financière propre par Gladstone, très sensée et son discours très honnête. C'est de la bonne administration politique.
M. de Castelbajac est très réservé. Son beau frère, que j'ai vu hier, dit qu’il ne dit rien, sinon que les préparatifs, et l’ardeur sont grands chez vous. Je ne sais rien d'ailleurs. Je ne fermerai ma lettre qu’en sortant pour aller à l'Académie. Je verrai probablement quelques personnes d’ici là ; mais elles ne sauront rien, non plus. Tout le monde devient réservé.
2 heures
Je pourrais dire comme M. de Givré : Rien. rien, rien. Il ne me paraît pas qu’on ait fini avec l’Autriche. Quel article contre vous que celui du Times répété par le Galignani d'hier soir. On vous promet une guerre à mort. Adieu. Adieu.
Quand vous êtes bien, j’attends impatiemment vos lettres pour mon plaisir ; quand vous n'êtes pas bien, presque plus impatiemment. Adieu. G.
9. Bruxelles, Jeudi 9 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Jeudi
Je vous prie écrivez-moi toujours où vous allez le soir. Je pense sans cesse à tout. Voici mes nouvelles. Nous avons envoyé à Vienne des propositions sur lesquelles on délibère là, & qui ont en attendant fait ajourner l’envoi de l’ultimatum anglais français. Vous savez que l’Autriche & la Prusse étaient invitées à s’y joindre. La Prusse ne le fera pas, l’Autriche, oui mais avec des modifications. On n’a donc pas envoyé cet ultimatum encore. Il est venu hier un courrier de [Pétersbourg] : nous désirons fort éviter la guerre. Comment cela sera-t-il possible après tout ce qui s’est fait et dit ?
Je fais mal à mes yeux en vous écrivant. Quel désespoir que mes yeux. Quel horrible climat que ceci, et quel ennui de toutes sortes. Kisseleff a l'ordre de rester indéfiniment ici, & Brunnow d'y venir pour y rester aussi. Nous ne voulons pas encore entendre parler de guerre. Adieu. Adieu.
12. Paris, Mercredi 8 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai reçu votre N°6. Je ne vous ai pas écrit hier. Je n’avais rien à vous dire et j'étais dérangé par toutes sortes de visites. Moins on sait, plus on cherche.
On est toujours un peu perplexe sur l’Autriche. On croit pourtant, et je crois qu’elle signera la convention qui est sur le tapis et qu’on regarde comme suffisante. La Prusse, dit-on. refuse formellement de la signer ; mais elle engage l’Autriche à la signer, lui promettant appui si cela lui attire quelque gros embarras. Le bruit a couru hier que M. de Manteuffel s'était retiré comme trop peu Russe. On n'y croyait pas. Je vous donne le résumé de ce que j'ai entendu dire dans la journée, et le soir chez Molé. Il y avait assez de monde, entr'autres les Cowley. Vous devez du reste savoir les nouvelles Allemandes mieux que nous.
La demande de M. Gladstone pour le doublement de l'Income tax a été assez mal accueillie dans le Parlement. Personne n’aime à payer la guerre, même celle qui plaît. Le corps législatifs d’ici était plus en train. Il voulait voter l'emprunt de 250 millions le jour même où on le lui a présenté. C’est M. Billault qui, par respect pour les formes, a fait retarder d’un jour en disant : " A demain ; cela suffira." Montalembert voulait parler ; point du tout pour combattre l’emprunt, ni la guerre ; il en est tout à fait d’avis, très approbateur de l'alliance Anglo- française et de la résistance à vos prétentions en Orient. L’Assemblée était si pressée qu’il a renoncé. Flavigny, seul, a dit quelques mots convenables et écoutés.
Le Maréchal St Arnauld a eu une nouvelle crise de son mal. Il persiste cependant à vouloir partir. Il dit à l'Empereur : " Vous m'avez donné un bâton de Maréchal ; j’aime mieux mourir en m'en servant que dans mon lit ? " S'il ne peut pas partir, ou s’il meurt après être parti, les gens bien informés croient que le Général. Baraguey d'Hilliers le remplacera. Les badauds disaient hier qu'on avait fait faire des ouvertures au général Changarnier. Les nouvelles levées d'hommes se font sans difficulté et partent sans mauvaise humeur. La longue paix a fait oublier les maux de la guerre. Le goût du mouvement et des aventures s’est ranimé. Cela contrebalance un peu le goût du bien-être et le besoin de la prospérité matérielle.
2 heures
Voilà votre N°8. Que je déplore vos yeux ! On a été bien gauche à Pétersbourg si on avait envie que vous restassiez à Paris. C'était si aisé ! En admettant que vous ne vous trompez pas aujourd’hui, ce ne serait plus si aisé, car il serait plus grave. Il faut que vous sachiez la vérité dans le gouver nement, et aussi un peu dans le public, l’esprit de guerre s'échauffe ; on s'y prépare sérieusement, et pour longtemps. On parle sans sourciller, de ce qu’on fera dans deux ans, dans trois ans, si on ne réussit pas tout de suite, et de toutes les chances en pourraient s'ouvrir alors. Votre Empereur seul peut encore et pourra toujours faire tout finir promptement ; mais s'il ne le fait, les autres accepteront la longue lutte et le grand chaos. Adieu, adieu. Triste adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (France), Politique (Prusse), Salon, Santé (Dorothée)
8. Bruxelles, Mardi 7 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mes yeux me condamnent à l’obscurité. On me défend d'écrire, de lire, de sortir. Quelle misère, quel désespoir. J'ai eu un homme de lettre de Pétersbourg. Evidemment on eût désiré que je restasse encore à Paris. Quel regret pour moi. On ne le dit pas, je devine, peut être je me trompe, c’est que je suis si malheureuse je perds la tête. Ecrivez-moi. Adieu. Adieu.
La Prusse se rapproche de nous.
Mots-clés : Eloignement, Guerre de Crimée (1853-1856), Santé (Dorothée)
8. Paris, Samedi 4 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai encore rien de vous ce matin. Je ne m'en étonne pas ; vos lettres m’arrivent presque toujours fort tard ; mais j'en suis bien impatient. Si vous étiez trop souffrante, ou vos yeux trop malades, j'espère que la Princesse Kotchoubey aurait la bonté de me donner, en quatre lignes, de vos nouvelles. C'est elle qui fait, en ceci, ma sécurité, si sécurité, il y a.
Je vous ai dit sincèrement mon impression sur l’idée de votre retour immédiat. Je vous la devais, quelque amère qu'elle ne fût. Plus j’y pense, plus elle se confirme. Je ne regarde pas comme impossible qu’il se présente quelque expédient imprévu pour mettre fin tout à coup à cette déplorable guerre. Mais quant à présent, même en France, où elle déplait, elle est de plus en plus prise au sérieux, et la passion pourrait bien ne pas tarder à s'y mettre.
M. de Flavigny me disait hier qu'à la séance Impériale, en entendant le discours, le sénat et la magistrature avaient été froids, mais le corps législatif, les gens des provinces, approbateurs et assez animés. Ils ont pris leur parti de la guerre. Ils prennent au pied de la lettre les paroles de paix prochaine et point de conquêtes qui contient le discours. Ils soutiendront sans rien objecter.
Je reçois ce matin une lettre de Piscatory, qui m'écrit : " C'est maintenant le succès qu’il faut souhaiter, et en toute sincérité, je le souhaite ardemment ; le drapeau est engagé ; et puis honneur et intérêt du pays à part, la défaite n'est jamais bonne à rien, ni à personne. Avec de bonnes dispositions, et dans le monde du gouvernement et dans celui de l'opposition la Russie n'est pas populaire.
Je ne me représente pas agréablement vous au milieu de cette atmosphère là ; votre repos et votre dignité en souffriraient également. Restent les maisons de santé, les raisons impérieuses. Celles-là l'emportent surtout.
3 heures
Je rentre et je trouve votre lettre qui me fait grand plaisir parce qu'elle est bien moins abattue. Dieu veuille que vos yeux aillent mieux. Dans le public indifférent, le discours impérial a assez peu de succès. Je ferme ma lettre. J’ai là du monde. Adieu, Adieu. G.
7. Paris, Vendredi 3 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos lettres m’arrivent, en général fort tard. Celle d’hier (N°4) m'est arrivée si tard qu’il n’y avait pas moyen de rien ajouter à ce que je vous avais écrit le matin (N°6).
Vos yeux me désolent. Je ne puis croire que ce soit une épidémie ophtalmique spéciale à Bruxelles. Je n’ai jamais entendu parler de rien de semblable dans le climat. Mais tout est possible. Je crois plutôt à l'effet du chagrin, de l’agitation et de la fatigue sur un organe délicat. Vous me mettez à une épreuve intolérable en me parlant, comme d’une chance possible de votre retour immédiat à Paris. Je n'ai rien à dire de l'effet à Pétersbourg, vous seule en êtes juge. Les mots : " êtes-vous encore à Paris ? " m'ont malheureusement trop démontré qu’on ne voulait pas que vous y fussiez ici. On serait certainement étonné, et comme on ne comprendrait pas, on chercherait, à ce retour, d’autres motifs que le véritable ; on ne croit guère en général aux motifs de santé, quoique ce soient les meilleurs. Trop de gens s'en servent pour me nier.
Quoiqu’on ne soit pas ici, plus en goût de la guerre qu’il y a deux mois, on y croit, et on en prend son parti, et on s'y prépare, et tout le monde règle, sur le fait, ses relations et ses plans. Je vous dis, malgré moi et tristement, mes premières idées ; je n'ai encore causé avec personne ; mais je doute que, parmi vos amis sensés et sincères, il y ait une autre impression que la mienne. Vient toujours, en première ligne votre santé, et dans ce fait là, j’ai tant de peine à voir clair, quand vous êtes ici, qu’il m’est impossible de l’apprécier de loin. Que tout cela est triste !
Demain, plus encore que tout autre jour, je voudrais être avec vous, et vous donner quelques douces distractions. Votre fidélité à de chers souvenirs m'a profondément touché dès le premier jour où je vous ai connue. C'est une vertu qui coûte cher, mais que j’aime et que j'honore infiniment. Les coeurs sont si légers, et tout passe si vite dans ces ombres chinoises de la vie !
Autre tristesse en pensant à vous. Vous avez de la religion, et elle ne vous sert pas à grand chose dans vos épreuves, vous n'y puissiez guère de consolation ni de force. En tout, le mal vous fait plus de mal que le bien ne vous fait du bien, et vous souffrez plus de vos défauts que vous ne profitez de vos qualités. Que de choses il aurait fallu pour mettre en vous l’équilibre et l'harmonie dont vous auriez besoin. Adieu, adieu.
Je ne vous dis rien du discours Impérial. Il ne faisait pas grand effet hier, ni le matin, ni le soir. Il aura le sort de presque tout ce que dit et fait son auteur ; il réussira plus dans les masses que dans les esprits difficiles. Si j'étais allemand, j'en serais mièvrement content. Adieu.
J’ai vu hier Montalembert qui m'a beaucoup parlé de vous, avec un intérêt dont je lui ai su gré.
5. Bruxelles, Vendredi 3 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voilà votre N°6. Je la reçois au moment où il me faut envoyer celle-ci. Mes yeux allaient mieux hier, moins bien aujourd’hui. Le journal de St Pétersbourg. contient la réponse de mon empereur, vous allez la lire à Paris sans doute. Vous m'en direz votre avis. (sans prévention & vous savez bien que je n’en ai pas.) Moi, je la trouve très bien.
Van Praet m’a fait lecture hier soir du discours de l'Empereur Napoléon. J’ai toujours besoin de réflexion, et mes yeux m'ont empêché de le relire moi-même. Il me semble qu'il y a bien à éplucher. L’Allemagne bien engagée, l’intérêt français en relief. Le discours plaira aux masses. Le pain y joue un plus grand rôle que la guerre. Que ne suis-je à Paris pour vous entendre tous sur le discours, sur la lettre, sur toutes choses. Ah que le pluriel me manque ! Je vous laisse à penser si je regrette le singulier !
J’ai vu hier soir le prince de Ligne & M. de Brouckère m'ont empêché de le relire. Il a de l’esprit, et agréable. Van Praet est chez moi tous les soirs. Il me soigne et me plait bien. Le ministre de France est venu sans me trouver, j’ai pris l'air hier quoiqu'il fait bien froid. Lord Howard aime à venir causer avec moi, il est intime et facile. Le ministre de Prusse est ma meilleure pièce. Kisselef est celui de tous que je vois le moins. J'en reste très étonnée. Chreptovich très soigneux mais que d’heures de solitude et d'ennui & de soupirs. Adieu. Adieu. Ecrivez-moi je vous prie, je n’ai de plaisir que vos lettres vous le savez bien. Adieu.
4. Bruxelles, Mercredi 1er mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ecrivez moi demain jeudi par Hatzfeld. Il envoie un courrier. Portez la lettre vous même avant cinq heures. Je suis bien plus malheureuse que je ne croyais l’être. Mes yeux sont en grande souffrance, & l’ophtalmie règne ici dans la troupe. Si cela augmente, mon mal s’entend, que faire ? Retourner ? Que devenir ? à Paris est ce possible ? Perdre mes yeux, bien obligé. Pensez un peu au ridicule de retour à la fâcherie chez nous. Mais d’un autre côté mes yeux ! Je suis dans une grande perplexité. Pensez, consultez. On me défend d'écrire, car j’ai déjà vu un médecin. Je suis plus malheureuse que je ne puis le dire. J'étais si bien à Paris. A mon dieu ! Dites à Duchatel ma connaissance de sa lettre et l'impossibilité où je suis d’y répondre. Je souffre. même en écrivant ce peu de mots. Vous allez bien me plaindre. Je suis triste, à mourir. Adieu. Adieu.. On me dit qu’à Vienne encore on ne veut pas croire à la guerre.
3. Bruxelles, Lundi 27 février 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres sont ma seule joie. Continuez-les je vous en prie. Je n’ai pas bougé depuis mon arrivée, ma toux est beaucoup augmentée, mes yeux aussi me font mal. J’ai beaucoup de courants d'air dans mon appartement. Je ne parviens pas à m'en garer. On vient assez me voir, beaucoup même mais cela ne me plait pas. Montalembert seul me plait & il part ce soir. Van Praet est toujours ma préférence et est vraiment très agréable.
Les nouvelles Allemandes nous sont très défavorable, nous aurons tout le monde contre nous. Je crains qu’au lieu d’intimider cela n’aggrave l’obstination. Clarendon a fait un remar quable discours.
Mardi 28 Le duc de Saxe Cobourg arrive aujourd’hui. Il se rend à Paris où sa visite annoncée fait plaisir. Khiva est décidément pris. Et mon Empereur décidement bien en colère contre les Allemands. Je vous remercie de me dire l'emploi de vos journées. Je veux pour vous de la distraction mais point d'habitude. Mes soirées éparpillées. Ah que je pense à tout cela ! & si on me regrette, jugez comme je regrette à mon tour ! Avant hier je me suis pris à pleurer. J'en ai encore mal aux yeux. aujourd’hui. Quelle chute !
Pourquoi le journal des Débats me fait-il faire des visites à Chreptovich & Kisseleff ? Imaginez, débarquant & courant tout de suite ? Le fait est que je n’ai pas encore bougé de ma chambre et quand je bougerai ce sera pour prendre l’air. S'il y en a jamais de prenable. à Bruxelles, mais certainement je ne ferai visite à personne. Il fait très froid et tout a l’air si triste ! Adieu. Adieu.
2. Bruxelles, Dimanche 26 février 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Merci du triste N°1. Quel brave homme que le duc de Broglie ! Je vois bien que mon chagrin ira en grandissant. Je suis très entourée mais qu’est-ce que c’est ? Et puis si mal arrangée en comparaison de ce que j’étais. Le temps n’est pas froid et cependant ma toux a augmenté beaucoup quoique je ne sois pas sortis du tout depuis mon arrivée. Tout le monde vient, connus et inconnus. Tout le corps diplomatique moins le Français. Lord Howard était en doutes sur l'accueil. Je l'ai fait rassuré. Il est venu avec sa femme, une fille du duc de Portland, très bien & spirituelle, et grande dame. Elle m’a apporté une lettre de Lady Palmerston à moi, très sympathique et bonne. Les Chreptowitch sont toujours là, trop. Le Prussien est excellent. L’Autrichien point d’esprit. Van Praet ma grande ressource. Il veut m'amener M. de Brouckere & le général Chazal. On veut m'amuser. Montalembert a eu l’air bien content de me voir, nous avons causé. Demain il retourne à Paris hélas. Le prince d'Aremberg aussi. Les heureuses gens !
Les nouvelles ici sont que mon Empereur a reçu avec une grande colère les remontrances de l’Autriche & de la Prusse. Qu'à Paris & Londres on presse l’Autriche de telle sorte qu’elle sera obligée de se prononcer & tout de suite, & qu’elle agira. L’enthousiasme en Russie est réel et énorme. Tout le monde veut faire des sacrifices. Un marchand de Moscou nommé Alexis à envoyé à l’Emp. 25 millions la moitié de sa fortune. Hélène va lui donner 300 hommes pour commencer. On dit que nos armées sont immenses. Le 1er avril nous ferons parler de nous. Je ne vois pas ici d’apparence du voyage du duc de Brabant, en tous cas on doute que sa femme l’accompagne. Voilà votre petit billet d’hier continuez, je vous prie. Ce sera mon seul plaisir, mon grand plaisir, ma joie. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Mardi 1er novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Tout est possible ; ma confiance n’est pas grande ; je reconnais avec vous que la raison est en déroute. Pourtant je ne crois pas à la guerre, à la vraie guerre. Je ne trouve pas que de la part de l'Angleterre du moins, rien en ait l’air. Vous oubliez un peu le prix qu’on met à vous inquiéter, pour que vos inquiétudes aillent à Pétersbourg et pèsent sur les impressions, et par là, sur les résolutions de votre Empereur. Je ne voudrais nuire en rien à cette petite manoeuvre, car moi aussi j’ai grande envie que votre Empereur se prête à ce qu’on lui demande. Il le peut sans perdre autre chose que le puéril plaisir de la taquinerie ou de la bravade ; la facilité qu’il montrera aujourd’hui ne changera rien à l'avenir de la Turquie ni aux destinés de la Russie. La question du fond est depuis longtemps décidée, et n'attend que son jour. Et comme votre Empereur n'est pas pressé, il peut attendre aussi, et en attendant maintenir la paix de l'Europe dans laquelle des questions bien plus grandes que la Turquie sont engagées. Si, pour le porter à cela vos inquiétudes sont bonnes à quelque chose, gardez-les. Mais quand je vous en vois réellement tourmentée, je laisse là ma diplomatie, et je les combats comme si elles ne servaient à rien.
Si j’en crois le Moniteur, vous n'êtes pas oisifs en Chine, et vous voir préparez à profiter là de la chute des Tartares. Encore un point sur lequel vous vous trouverez en présence des Anglais et des Américains. Dans un siècle d’ici, il ne restera plus sur ce globe un pays dont la race Européenne ne soit maîtresse. C'est juste.
J’ai bien fait de n'avoir pas à vous écrire hier ; vous m'auriez trouvé une bien mauvaise écriture ; j’avais les épaules tout-à-fait prises de rhumatismes. Les frictions ont fait leur effet. J’ai très bien dormi cette nuit, et je suis dégagé.
Avez-vous lu les Mémoires du comte Mollien et les extraits du Moniteur ne vous en donnent-ils pas quelque envie ? Vous passeriez les dissertations de finances ; il y aurait encore, dans les conversations avec l'Empereur, et les embarras intérieurs de son gouvernement, de quoi vous intéresser. Si vous vouliez les volumes, il sont dans ma bibliothèque à Paris ; mon fils, qui y retourne samedi, vous les ferait remettre.
Onze heures
Le facteur m’arrive au milieu de la toilette. Je suis bien aise que les diplomates ne fassent des notes, et très fâché que vous passiez des nuits blanches. Vraiment, si la guerre devait sortir de tout ceci il y a longtemps qu'elle aurait commencé, tant on a mal conduit les affaires de la paix. Adieu, adieu. G.
66. Paris, Jeudi 29 septembre 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Marion est malade, & moi trop fatiguée pour copier Greville. Voici le résumé grande agitation, impuissance de découvrir un nouveau moyen de négociation. Nous avons tout gâté par notre seconde dépêche explicative qui veut dire que nous entendons la note de Vienne dans le sens de l’Ultimatum Menchikoff. Il ne fallait pas dire, il fallait ne rien dire. Mais enfin c’est fait & on ne sait plus à quel Saint se vouer. Il paraît donc qu'il ne reste que la guerre. cependant la saison fait obstacle aux coups. Mais encore une fois comment renouer ? Voulez-vous bien le dire. Vous vous ferez difficilement une idée de la consternation de Hubner, Hatzfeld & &. Ils nous envoient à tous les D. C’est naturel. Mais nous n'y allons pas. Constantin me mande du 24 que l’Empereur est de très bonne humeur. J’ai vu hier chez moi le soir Molé, Berryer, Brougham, & Fould. Celui-ci très gai. Je n’ai pas pu causer avec lui. Il a dit à Marion que cela s’arrangerait comment ?
L’Empereur revient aujourd’hui. Lansdowne qu'on avait convoqué pour un Cabinet conseil reste pour faire sa cour. Le voyage n’a pas été favorisé par le temps. La reine Amélie renonce à tout. La tempête l’a rejetée à Plymouth, elle est revenue à Clarmont malade. On dit que la Pcesse de Joinville l’est très sérieusement depuis longtemps & qu’elle mourra si elle ne retrouve par le soleil. Le duc de Noailles est venu aussi hier. Il a longuement. vu Fould l’autre jour que lui avait tenu le même langage qu'à moi. Belliqueux & révo lutionnaire par nécessité, parce qu’il ne voyait pas d’autre ressource. Olmentz a dû finir avant hier. Bual y a été mandé. Voilà Hubner plus tranquille au moins sur ce point. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conversation, Diplomatie (Russie), Enfants (Benckendorff), Famille royale (France), Femme (politique), Femme (santé), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Internationale), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)
61. Paris, Lundi 19 septembre 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
La dépêche à M. de Meyendorff par laquelle nous annonçons notre refus aux modifications de la porte est excellentissime. J’espère que cette pièce paraîtra vous en serez content. Elle est une réplique possible. Et très bien faite. Hubner a vu hier l’Empereur, extrêmement pacifique. Hubner lui même conserve des inquiétudes et ne veut pas croire qu'on n’entre pas dans les Dardanelles. J’ai vu Hatzfeld aussi hier, & puis c’est tout. Trois heures de bon air dans le parc de St Cloud et à Meudon. J’étais très lasse hier soir, & je me suis couchée de très bonne heure. J’ai manqué. quelques personnes insignifiantes. Je n’ai vraiment pas une nouvelle à vous dire. Drouin de Lhuys était attendu hier par l’Empereur qui l’avait envoyé chercher. Il a passé ces huit jours à sa terre près de Blois. Je crois que mes fils arrivent aujourd’hui. Adieu. Adieu.
53. Bar le Duc, Mardi 30 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Si je date de Mardi une lettre que je vous aurais écrit la veille (Lundi) est-ce antidater on postdater qu'il faut dire ? Répondez-moi je vous en prie et tout de suite. Détestable auberge, mais il a fallu m’arrêter.
Paris le 31. Me voilà et fatiguée. Je trouve une lettre de Meyendorff et une de Constantin. Je vous envoie copie des passages importants. Je n’ai encore vu personne ici et ma lettre partira avant toute visite, mais ces deux lettres me semblent renfermer ce qui est essentiel. Greville me mandait si les Turcs ne font pas what we prescribe nous ne pouvons plus les soutenir. Voyons comment tout cela ira, maintenant, notre partie est la belle. Heeckeren m’a dit que jamais les vaisseaux. Français ne reculeraient tant que nous resterons dans les principautés. Nous verrons. Comment pourraient-ils entrer dans les Dardanelles sans provoquer le guerre, et ils ne peuvent pas rester à Besika. Adieu. Adieu.
Je copie un autre passage de la lettre de Meyendorff. " je voudrais vous dire tout le plaisir avec un peu d'envie que j’ai éprouvé ici apprenant le beau sens du fils de M. Guizot. Comme j’admire le père d’avoir eu le temps de bien élever ses enfants ! "
53. Strasbourg, Lundi 29 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis partie de Sch. assez souffrante. Je voyage lentement. J’ai couché ici, je n’arriverai à Paris que demain. J’ai trouvé ici Heeckeren qui nous a amusé. Je n’ai pas de nouvelle à vous dire naturellement. Je serai charmée de me reposer chez moi. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Santé (Dorothée), Voyage
48. Val Richer, Mardi 16 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Puisque votre fils trouve Schlangenbad charmant et que votre santé s'en trouve, sinon beaucoup mieux, du moins pas plus mal. Vous avez raison d'y rester encore. Le changement sans rien savoir pourquoi, est un grand ennui. Nous aurons, sans doute avant la clôture, un grand exposé de l'affaire Turque dans le Parlement ; Lord John l’a promis. Il n’y sera pas embarrassé ; le cabinet Anglais a bien conduit sa barque ; il a maintenu la paix, en se montrant prêt à faire la guerre ; il a protégé efficacement la Turquie et rallié à lui la France sans se mettre à leur disposition. C'est de la bonne politique de temporisation et d’ajournement des questions. Personne aujourd’hui n'est en état, ni en goût d'avoir une politique qui les décida. Vous me dites que les Russes de Paris trouvent qu'après tout, et au prix de votre bonne réputation en Europe, vous avez fort avancé vous affaires ; je ne connais pas assez bien les faits pour en bien juger ; mais si cela est, soyez contents aussi ; tout le monde le sera. La Turquie l'est certainement autant que peut l'être un mourant qui n’est n'est pas mort, et pour la France, on dit qu’elle l'est beaucoup. Le public l'est car il voulait la paix, et il sait gré au gouvernement de l'avoir maintenue. Le gouvernement a de quoi l'être, car il a sa part dans le succès pacifique, et il s'est mis fort bien avec l'Angleterre. L’est-il bien réellement, au fond de l'âme ? J'en doute un peu. Mon instinct est que l'Empereur Napoléon aurait préféré l’union belligérante avec l’Angleterre, le Ministère de Lord Palmerston et toutes les chances de cet avenir-là. Je penche à croire que c’est là le but que, de loin et sans bruit, il poursuivait. Mais il ne s'y est pas compromis ; et ce n’est pas un échec pour lui de ne l'avoir pas atteint. Il peut donc se féliciter aussi. J’ai rarement vu une affaire où tout le monde ait été si embarrassé pour être, à la fin, si satisfait.
Je ne pense pas que l'Empereur Napoléon, se soit fait, dans le public, le même bien par le Rapport qu’il s’est fait faire pour montrer en perspective huit ou dix millions à payer en vertu du testament de son oncle. C'est se donner un gros embarras pour une nécessité bien peu pressante. Il y a assez de questions vivantes ; pourquoi exhumer les mortes ?
10 heures
Voilà votre N°46. Je ne partage pas du tout les soupçons de lord Greville à l'endroit des Principautés. Vous êtes entrés nécessairement. pour couvrir vos concessions sur vos premières demandes à Constantinople ; vous vous en irez loyalement. Question d’honneur dans l’un et l'autre cas. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Diplomatie (France-Angleterre), Enfants (Benckendorff), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Opinion publique, Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Politique (Russie), Politique (Turquie), Santé (Dorothée)
44. Schlangenbad, Mardi 9 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma cour a consenti à l’Ultima tum que l’Autriche adresse à la Porte. Voilà une bonne affaire, très bonne pour Aberdeen. Il faut maintenant que la Porte accepte. Si elle le fait nous recevons son ambassadeur. Meyendorff qui me mande cela espère que la France & l'[Angleterre] soutiendront leur oeuvre et retireront tout appui à la Turquie si elle refuse cette dernière planche de salut. Comme démonstration de cette menace il faudrait rappeler les flottes et nous évacuerons les principautés ; il est en bonne espérance et content de lui même car ceci est son œuvre.
Pardonnez moi, mais votre critique des manoeuvres de notre flotte de la Baltique aussi bien que du camps de Chobane est singulière. Mais de tous temps on exerce des troupes. Et depuis que nous avons un vaisseau il fait des promenades. dans la saison d’été pour exercer les matelots à la manœuvre. Est-ce que vous n'envoyez pas les vôtres à droite et à gauche en été pour la même raison ? Nous restons dans notre coin la Baltique ; dans d’autres années ils viennent dans la mer du nord, voilà la différence pour cette année. Et les régimes Anglais ? Mais c’est un camps d’exercices comme Satory, comme St Omer, comme Krasno Selo où mon empereur. fait manoeuvrer tous les ans 100 m hommes. Le chiffre n’y fait rien.
Voilà qui est trop long pour la question militaire. Mon fils n’est pas arrivé encore, ce qui me surprend. Il y a depuis quelques jours un vent glacial, abominable. Mon rhume est plus fort que jamais. La duchesse de Nassau est venue me voir ; bien gentille et bonne. Mes impolitesses sont acceptées, je ne rends visite à personne. Adieu. Adieu.
43. Val Richer, Samedi 6 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de la lettre de M. de [Meyendorff] qui m’a beaucoup intéressée. Je suis charmé que les miennes l’intéressent un peu. J’aimerais bien mieux causer avec lui. Je lui dirais que je n'ai jamais pensé à un protectorat collectif des Chrétiens en Turquie. J'en sais, comme lui, l'impossibilité pratique. Ce qui me paraissait praticable, c'était que votre Empereur, puisque on regardait un engagement de la Porte envers lui comme attentatoire à l’indépendance Ottomane, proposât lui-même que la Porte prit le même engagement, non plus envers lui seul, mais envers toutes les Puissances Chrétiennes, laissant chacune de ces Puissances protéger ensuite, pour son compte, ses propres dieux Chrétiens, l’une les Grecs, l'autre les Catholiques, l'autre les Protestants &
Mon idée n'était qu’un expédient pour sortir de la difficulté du moment par une porte qui ne fût plus seulement Grecque et Russe, mais Chrétienne et Européenne, qui fût par conséquent plus grande pour votre Empereur et unobjectionable pour les autres. Ce sont les situations prises qui décident. des affaires je voyais là une bonne situation à prendre, bonne pour la dignité et pour la solution. Voilà tout. Cela ne signifie plus rien aujourd’hui. Le sultan a beau se griser et traîner. L'affaire finira bientôt puisque tout le monde veut, qu'elle finisse. Les embarras ne sont des périls que lorsqu’il y a des puissants qui veulent en faire des périls.
Vous ne lisez probablement pas les récits de la révolution de Chine. S'ils sont vrais il y aura bientôt là, pour l'Europe, de nouveaux Chrétiens à protéger. Seront-ils Grecs, Catholiques ou Protestants ? Je crois que vous avez une mission religieuse à Pettiny. Du reste, ces Chrétiens chinois, orthodoxes ou non, me paraissent en train de se bien protéger eux-mêmes. Convaincu, comme je le suis, que le monde entier est destiné à devenir Chrétien, je serais bien aise de lui voir faire, de mon vivant, ce grand pas.
Avez-vous des nouvelles de la grande Duchesse Marie ? Le voyage de la grande Duchesse Olga en Angleterre est-il déterminé par la santé de sa sœur ? Dieu veuille épargner à votre Empereur cette affreuse épreuve ! Il m’arrive le contraire de ce qui arrive, dit-on, ordinairement ; je deviens en vieillissant, plus sympathique pour les douleurs des autres ; mes propres souvenirs me font trembler pour eux comme pour moi-même.
Je voudrais vous envoyer un peu du beau temps que nous avons depuis quelques jours ; très beau, mais pas chaud. C'est le vent du Nord avec le soleil. Nous n'aurons décidément point d'été. Vous ne me dites rien de l'effet de vos bains ; mais à en juger par l’air de votre silence, Schlangenbad vaut mieux qu'Ems.
Changarnier parle en effet trop de lui. Mais quand vous n'avez rien à faire des gens, vous ne savez pas assez les prendre par le bon côté, et mettre à profit ce qu’ils ont tout en voyant ce qui leur manque. Vous vous ennuyez trop de l'imperfection dès qu’elle ne vous est bonne à rien.
Adieu, adieu. Je ne fermerai ma lettre que quand mon facteur sera venu ; mais il ne m’apportera probablement rien à y ajouter. Adieu.
Mots-clés : Âge, Aristocratie, Autoportrait, Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Femme (santé), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Internationale), Politique (Russie), Politique (Turquie), Portrait, Portrait (Dorothée), Religion, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
43. Schlangenbad, Samedi 6 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous envoie copie de deux lettres. Tout cela a très mauvais air, & la réponse de Clarendon à la chambre haute complète et compliquée. Je ne vois plus le moyen d'éviter la guerre et je reste plus triste que jamais. Le roi de Wurtemberg vient sans cesse causer avec moi, il s’étonne et s’afflige car on ne voit pas le bout. Ce serait une grande surprise, aujourd’hui de voir l’affaire s’arranger. Je crains que nous ne voyions pas cela.
Ma santé me tracasse, rien de mieux et presque du pire. Je suis cependant si docile. Tous les Croy sont partis ce matin, c’est une petite très petite diminution pour mon salon, car ils n'ont point d’esprit. Je garde deux hommes de la suite de roi de [Wurtemberg]. Et le comte de Brie Belge qui a cloué les princes & qui est très agréable. Jeune et de bonne mine. Ma nièce reste toujours avec moi. Madame Oudinoff est ici. La Princesse Charles de Prusse est la plus ennuyeuse des femmes, Dieu merci elle ne vient pas. Elle avait voulu le faire mais elle a compris que le deuil de son père devait la retenir chez elle. Je n'ai rien à vous dire du tout qu’adieu.
Les lettres de Meyendorff sont pour vous seul.
42. Schlangenbad, Jeudi 4 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Décidement mon voyage ne me profite pas. Je rapporterai à Paris tous mes maux avec & quelques nouveautés p. e. des crampes affreuses dans les jambes. Vous voyez bien que les médecins sont des imbéciles. Le temps est assez beau. Je prends de l’air tout ce que j’en puis prendre. Je ne m'ennuie pas, et quelques fois même je m’amuse. Marion a fait hier chez les vieux Rothschild un dîner impayable. La Princesse Louise de Prusse, Klingworth celui-ci bavardant & mentant, elle idiote. Des Allemands les Croy. Elle est revenue de là impayable de moquerie. Tous les Rotschild sont partis. Les vieux ce matin, Mad. James avant hier rappelée par son mari. Le Général est parti aussi. Tout cela sera rempli par des Biberes, ancien hospoder. C’est une lanterne magique. Nous rions souvent le roi et moi, il a vraiment bien de l’esprit. Le Prince Emile vient aussi me voir de Wisbade, tout autre genre, de la très bonne espèce. L'Empereur Napoléon vient de lui envoyer son grand cordon de la légion d’honneur en souvenir des grandes campagnes. Je ne sais rien de plus sur l'Orient. Cela finira pas la guerre après avoir fait éclater des révolutions à Constantinople le sultan est très menacé.
Je crois que mon fils Alexandre va venir bientôt ici. Je déciderai avec lui de mes mouvements ultérieurs. Je penche un peu pour Paris. Adieu. Adieu.
35. Val Richer, Jeudi 21 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous n'aurez aujourd’hui que deux lignes ; je pars dans un moment pour aller passer la journée à quelques lieues d’ici, et je n'ai absolument rien à vous dire. J'attends. On m’écrit de Paris que vous travaillez vivement à Constantinople à renverser Reschid Pacha et à faire arriver à sa place Riza Pacha qui signerait, sans vous rien demander, la note que vous proposez. Vous avez été un moment sur le point d'y réussir. Mais Lord Stratford et M. Delacour ont repris le dessus. Il restera de tout ceci bien du venin maturé. On reparle du sacre. Je crois qu’on n'y renoncera jamais. Je doute qu’on y arrive.
Savez-vous ce que dit le Pape de votre église ? Quelle se conserve à cause du grand froid. J’ai tort de dire votre Eglise, car vous êtes de la mienne.
Adieu, adieu. J’espère que Schlangenbad fera un peu mieux qu'Ems.
35. Schlangenbad, Jeudi 21 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
D'abord ma santé. Elle est comme vous l'avez vue. Ems m'a laissée comme j'étais. Attendons Schlangenbad.
J'ai eu deux longues lettres de C. Greville la dernière du 18. On avait reçu à Pétersbourg, les propositions de la France, et nous en étions contents. On voulait seulement encore l’aboucher avec l’Autriche, mais cela était fait et convenu avec elle entre temps. La proposition anglaise qu'on dit meilleure encore pour nous aura par conséquent été mieux reçu encore. Les projets pleuvent de tous les côtés. La paix ne peut pas manquer de sortir de tout cela. La réponse de Drouin de Lhuys arrivera après coup et ne dérangera rien. Voilà le point de vue de Londres et je le crois exact. Je trouve cette réponse très bien faite, on ne pouvait pas se dispenser de la faire.
Le roi de [Wurtemberg] m’a fait encore hier une longue visite, trop longue, car même avec beaucoup d’esprit Il ne faut pas me tenir trop longtemps. Je ne puis pas le renvoyer comme un autre et voilà que les impolies angoisses me gagnent. Il y a perdu son dîner et moi ma promenade. Nous arrangerons cela mieux à l'avenir. Il sait beaucoup de choses & moi je lui en apprends quelque unes. Le 22 Constantin m’est arrivé hier inopinément. Il a déserté pour deux jours. Les nouvelles sont bonnes. On va à la paix seulement cette avalanche de projets fait de l'embarras. Il faudra donner la préférence à l’un d’entre eux. Votre Empereur est très bien, tout le monde se loue de lui, Cowley aussi bien que Kisseleff. Menchikoff reste à Sébastopol chef apparent de l’armée de mer & de terre, mais au fond en disgrâce. Il voulait renverser Nesselrode. Beaucoup de petites nouvelles curieuses. Le Prince Emile de Darmstadt est venu de Wisbade hier pour me voir. Toujours charmant le plus charmant Prince que je connaisse.
Adieu. Adieu. Je me baigne tous les jours, malgré ce mauvais temps.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Circulation épistolaire, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Diplomatie (Russie), Empire (France), Enfants (Benckendorff), Femme (diplomatie), Politique (France), Politique (Internationale), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)