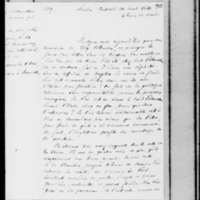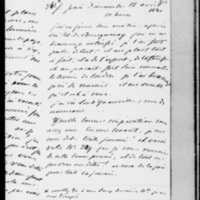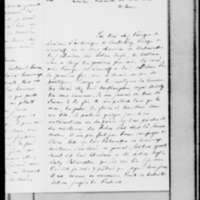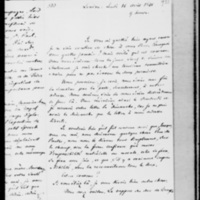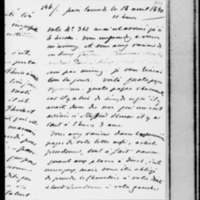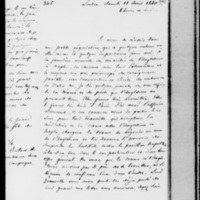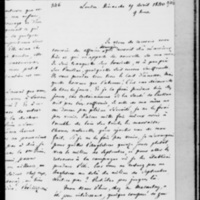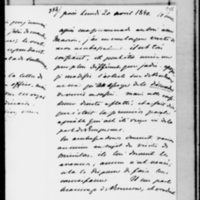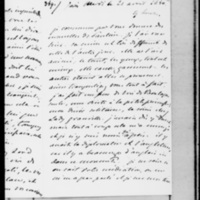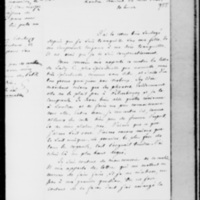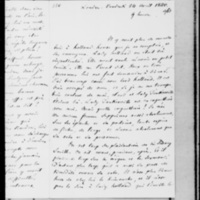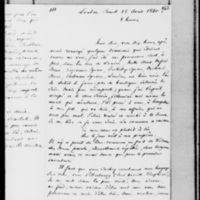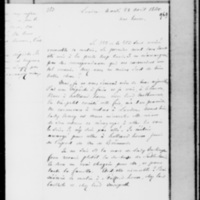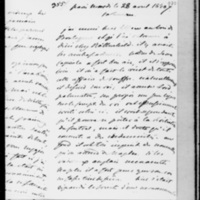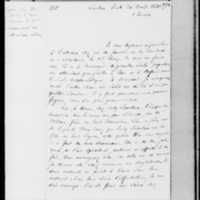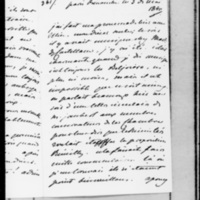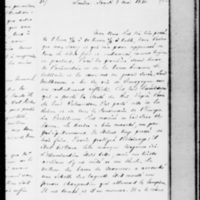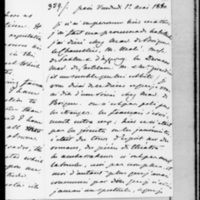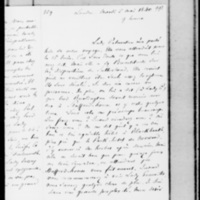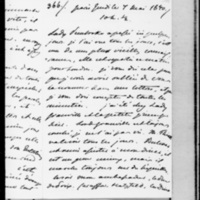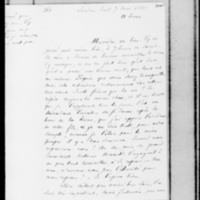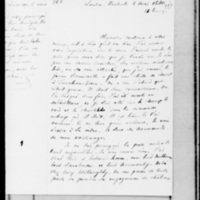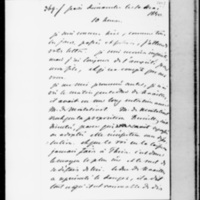Votre recherche dans le corpus : 3330 résultats dans 6062 notices du site.Collection : La correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Lieven : 1836-1856
330. Paris, Mardi 24 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a trente huit ans aujourd’hui de la mort de l’Empereur Paul. Comme toute cette scène est présente à mon esprit. Quelle ivresse à Petersbourg et comme on avait raison d’aimer et de tout attendre de l’Empereur Médem ne sait pas un mot de sa nomination. Je l’ai rencontré chez Lady Granville hier soir. Je l’ai dit à Nicolas Pahlen qui en a été renversé. Il est bien clair aux yeux de tous que c’est une promotion et une punition, je vous l’ai dit dans le temps, on ne laissera pas Médem à Paris. Pahlen voulait le lui annoncer hier j’ai été voir votre mère. elle m’a dit qu’on vous conseillait de rester à Londres, quand même. J’ai donc beau espérer des chaines Il n’y en a plus de bonnes pour moi. Vos filles étaient à leur leçon de piano. Guillaume m’a lu un peu d’Anglais, j’ai demandé la permission de le corriger lorsqu’il prononçait mal votre mère à été très bonne pour moi Je n’ai fait que cette visite hier matin Je ne me sentais pas bien. J’ai dîné chez les Granville avec des Anglais.
à 9 heures je suis allée chez la Maréchal Soult. Elle et son mari ont fait de grands frais de politesse pour moi. Il y avait beaucoup de monde, et pas une figure que je connaisse excepté M. Bandrand. J’ai pris son bras pour sortir; il m’a dit qu’il avait de vos nouvelles, qu’il est charmé que vous soyez à Londres, qu’il faut y rester. Je n’ai rien dit du tout. Je n’ai jamais d’opinion. à dire sur ces choses là. J’ai été faire cette visite parce qu’après tout. Je ni’ai pas de bonne raison de refuser une invitation. S’il redevient ministre, c’est des réceptions, Je n’y vais pas. De là je suis retournée chez Lady Granville où j’avais donné rendez-vous à M. de Noailles et Armin. On disait hier que la combinaison Soult Molé avait manqué par le fait de Duchâtel, dès lors que Thiers avait la majorité, tout cela s’éclaircit aujourd’hui. Thiers ouvrira la séance, je compte y aller. Sa situation me semble bien difficile, car s’il ne parle que comme le Constitutionnel cela ne peut pas être brillant.
Midi. Je viens de marcher sous les arcades, il neige. Mais la privation de mes promenade me fait du mal. Je vais donc chercher le seul point abrité.
Mercredi 25 mars, 9 heures
Vous aurez rien un mot que je vous ai écrit hier en sortant de la Chambre, Je vous l’ai adressé directement par la poste, j’ai été ensuite faire visite à la petite Princesse, M. Molé y est venu. Il était transporté de joie d’apprendre que je venais de la chambre. Racontez, racontez. J’ai raconté le discours de Thiers avec une grande fidélité, sans commentaire, mais peut-être. avec animation car c’est ma manière quand quelque chose me plaît. Vous auriez dû voir la figure de M. Molé s’allonger !!
330_1. Paris, Mardi 24 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je rentre de la Chambre. J’ai entendu Thiers et je ne veux plus rien entendre depuis votre discours du 5 mai 1837. Je n’ai rien entendu de si beau, si élogieux, si puissant. Il a été contenu en même temps qu’animé pas un mot de plus qu’il ne fallait pas un mot de moins. L’effet me parait avoir été très grand, et quand il a terminé en admettant qu’on allait le renverser il me semblait que tout le monde devait se demander : " pourquoi ? ".
Mots-clés : Ambassade à Londres, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique (France)
339. Londres, Vendredi 10 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures et demie
Quelques mots aujourd’hui pour vous remercier du 339 si tendre, et puisque les jours sans lettre sont si tristes. Par malheur j’ai très peu de temps. J’ai été chez Lord Palmerston. En en sortant, j’ai eu à écrire une dépêche sur ces affaires de Naples. Je viens de finir. Que c’est commode d’être dans une île avec l’océan pour frontière ! On fait de la politique, extérieure, sans responsabeilité comme les journaux anonymes. Je l’ai dit en riant à Lord Palmerston. Quand l’Italie sera en feu, pour qui sera l’embarras. Je l’ai trouvé raisonnable, c’est-à-dire ne demandant pas mieux que de l’être pour finir ce qu’il a si vivement commencé. Au fait, l’Angleterre profite des avantages de sa position. Ils étaient hier assez inquiets sur le vote de la Chine. Ils ont eu quatre voix de plus qu’ils n’espéraient une heure avant. Je suis resté à la Chambre jusqu’à 1 heure et demie. J’ai entendu la moitié du discours de Peel. Excellente manière de parler, simple et point familière, naturelle, et point froide ; très bien posé de sa personne ; de l’autorité, comme on en a avec ses égaux quand on leur est supérieur sans être un homme supérieur. J’ai été plus frappé de la forme que du fond. Le début à été très bien. Mais quand il est entreé en Chine, le chemin a été si long que le désespoir m’a pris et je suis sorti. Je regrette de n’avoir pas entendu Lord Palmerston. Mais il n’a pris la parole qu’à 2 heures et demie. Il a eu un vrai succès. Ce qui est excellent, c’est l’énergie et l’intelligence avec lesquelles chaque parti soutient Son chef. Les hear et les loud cheers sont pour moitié dans l’éloquence anglaise. Il n’y a rien de tel pour avancer que d’être ainsi poussé. De quoi vous parle-je là quand votre lettre m’a été si avant-dans le cœur ? Vous avez bien raison de me dire de si douces paroles. N’est-ce pas que c’est charmant ? c’est un droit divin, d’envoyer au delà des mers, dans un petit chiffon de papier du bonheur du vrai bonheur? Mais je vous en veux de votre inquiétude vague, et de votre silence. Sur votre inquiétude vague, vous n’avez droit de rien penser, de me rien dire, en pareil sujet ; mais quand vous avez le tort de penser quelque chose au moins faut-il me le dire. Et que ce soit un dîner chez Mad. Maberly qui ait transformé votre inquiétude vague en une conviction si forte en un chagrin si réel! Cela ne serait pas pardonnable si vous aviez jamais besoin de pardon, et j’en serais très offensé si je ne vous connaissais pas comme je vous aime. Vous me dites d’être fier, très fier. Je le suis mille fois plus que vous ne l’êtes pour moi, car le rouge me monte au visage en pensant à la cause de votre inquiétude. Vous ne savez pas ce qu’est pournmoi que de dire les paroles que je vous dis et à quelle hauteur je cherche et je place celle à qui je les dis.
340. Londres, Samedi 11 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’est pas le moins du monde question de la translation du corps de Napoléon en France. M. Molé me paraît peu au courant des Affaires étrangères. Car ici je ne vois pas pourquoi il mentirait. Du reste je ne suis pas surpris qu’il soit peu au courant. On ne l’aimait pas du tout dans le département, et parmi les gens qui y restent toujours, je n’en sais aucun qui prenne soin de l’instruire.
L’Angleterre a fait le geste pour Naples ; à l’heure qu’il est, l’amiral Stopford doit avoir saisi des bâtimens napolitains et les avoir envoyés à Malte où ils resteront en dépôt jusqu’à l’arrangement. Lord Palmerston est pourtant un peu préoccupé des conséquences possibles du coup. Nous nous emploierons à les prévenir et à amener un accommodement.
J’ai renoncé, bien contre mon goût et mon naturel, à la prétention de tout régler d’avance et pour longtemps. Mais pour ceci et dans les limites que je vous dis c’est parfaitement décidé. Il n’y a donc rien là, absolument rien qui dérange nos projets ni qui puisse nous causer aucun mécompte. Tenez pour certain que sauf les plus grandes affaires du monde ce qui ne se peut pas à Londres à cette époque.
Je serai à Paris d’octobre en Février avec ma mère et mes enfants. Il faudrait donc que je ne les fisse pas venir du tout d’ici là ce qui leur serait et à moi aussi un vif chagrin. Ils viendront donc en Juin, Notre seul dérangement portera, sur nos visites, de châteaux qui en seront, nullement supprimées mais un peu abrégées. Ces visites-là seront pour moi une convenance et presque une affaire. Ma mère le sait déjà et en est parfaitement d’accord. Je ne la laisserai pas seule à Londres. Mlle Chabaud viendra l’y voir au mois d’aout. Je ferai donc des visites, nos visites seulement un peu plus courtes. Il faut bien quelques sacrifices. Je voudrais bien sur cela, n’en faire aucun.
Que signifie cette phrase : "Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi "? Si vous parlez de mes devoirs, de mes premiers devoirs vous avez raison. Est-ce là tout ? Dites-moi. Et puis dites-moi aussi que vous vous associez à mes devoirs, et que vous m’en voudriez de ne pas les remplir parfaitement.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Famille Guizot, Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Protestantisme, Relation François-Dorothée, Religion, Réseau social et politique, Salon, Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)
342. Paris, Dimanche 12 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mettez 40 à mes deux derniers n° je me suis trompée. Je retourne à hier. Thiers m’avait dit la veille mille bien de Lord Granville. Celui-ci est enchanté de Thiers a son tour. certainement l’envie de rester bien, est grande de part & d’autre, & vous par dessus le marché ! Il est difficile de croire que cela puisse s’ébranler. J’ai marché au bois de Boulogne, avec Marion. J’ai eu à dîner M. Pogenpohl. Le soir Appony. Capellen, Berryer, le Duc de Noailles, la Pcesse d’Haubersaert, Soltykoff. Appony m’a raconté la note de l’ambassadeur Turc à Londres et la colère de Thiers en conséquence Berryer nous a un peu dépeint la situation de la Chambre sans y trouver encore aucun élément de vraie force pour le gouvernement il a fort déclamé contre l’Angleterre dans l’affaire des souffres. le Duc de Noailles nous a répété le discours du Duc de Broglie, la majorité de la Commission votant parce qu’elle a confiance, la minorité votant pas prudence. Il ne m’a pas dit assez de bien du discours. Je le trouve très bien à la lecture et je crois que vous devez en être content. Vous savez sans doute qu’il y a eu un délai de 24 heures parce qu’on avait trouvé d’abord le rapport, trop favorable à l’opinion de la minorité. Je vous raconte des choses que vous devez savoir la discussion appellera sans doute tous les hommes importants la Tribune. Le Duc de Noailles, me parait décidé à parler. il dit que son discours qui ne sera que sur l’Orient. doit plaire au ministère et le servir, en ce qu’il mettra bien en lumières l’opinion Égyptienne dans le pays. Il voudrait forcer Thiers à s’expliqué un peu nettement sur ce point. J’ai été si frappée de votre gouvernement représentatif à vous la représentation, aux Anglais le gouvernement » que je l’ai raconté hier au soir, c’est la première fois qu’il m’est arrivé de citer un mot de ce que vous dites. Ai-je fait une grande indiscrétion ? j’en serais désespérée. Ce que c’est la vanité ! J’en ai pour vous extrêmement et quand vous dites bien, j’ai envie de confidence, peut-être ai je eu tort hier ? Cela me tourmente. Je ne crois pas avoir jamais autant vécu hors du lieu où je me trouve qu’à présent. Je vous assure que je crois quelques fois que je suis à Londres, tant je vous suis partout partout, et dans tous les instants de la journée et dans toutes les situations. Merci du drawing room. Vous avez bien choisi les plus belles, surtout bien choisi la plus jolie, car certainement Lady Ashley est ravissante. Mais vous ne me dites pas assez que cette masse de belles personne vous a frappé. Convenez au moins que vous n’avez jamais vu autant de beautés réunies qu’à un drawing room. Je vous attends à Paris. Après un peu de séjour en Angleterre, vous ne trouverez pas une femme jolie. Vous leur trouverez à toutes plus d’élégance, plus de grâce, mais de la beauté non. Il n’y en a vraiment qu’en Angleterre. Enfin une laide est une merveille. Vous savez que M. Etienne Marnier est mort ; cela fait beaucoup de sensation dans le monde élégant de Paris. Je ne me souviens pas de l’avoir jamais vu. Il passait pour le fils de M. Molé, et on a été choqué de le rencontrer le même jour à la musique chez Mad. de Castellane. Cependant il affichait un peu la mère s’il n’y était pas venu.
M de Pahlen arrive ce matin. Le temps se radoucit. J’ai pris la calèche hier, je la prendrai encore aujourd’hui. Ma femme de chambre Charlotte est venue me voir ce matin pour la première fois, elle est bien changé, et encore bien faible. Mais je l’ai bien frappée. Elle m’a trouvé très maigrie et très mauvaise mine; elle ne m’avait pas vue depuis la mi février. Certainement j’ai maigri encore depuis votre départ, et je commence à être en grande défiance de Vérity. Je ne peux plus rien prendre. Connaissez-vous un remède qu’on appelle. Salsaparilla ou quelque chose comme cela. Il me dit ce matin que si j’avale cela, j’engraisserai, je me porterai bien. N’est-ce pas des bêtises. Conseillez moi. A propos, M. de Bourqueney me dit que l’Angleterre convient à votre santé parfaitement et que vous avez bien bonne mine.
Lundi 13, onze heures
Il y a un peu de cela aussi dans le "je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi ?" Mais au fond ; je ne veux pas signifie seulement "Je n’ose pas vouloir, car vous n’accorderiez pas." Et je connais ma place. Elle vient après beaucoup d’autres. Votre mère vos enfants. Vos devoirs publics. Je comprends tout cela, j’approuve tout cela. Ai je répondu? Et bien je suis triste.
Je vous remercie de la promesse de ne plus me tromper. Vous ajoutez "je commence à vous aimer trop pour cela." Ah vous m’aimez donc plus que vous ne m’aimiez. Cela me plaît parfaitement, cela doit être ainsi. Cela est pour mon compte. Le temps compense, ce qu’il emporte Dieu merci. Et comme rien ne reste parfaitement semblable à ce qu’il était si vous ne m’aimiez pas plus, vous m’aimeriez moins. Ainsi plus, plus, tous les jours davantage. Allons voilà votre lettre suffisamment répondue.
Voici ma journée hier, Lady Granville chez moi le matin, en suite promenade en calèche au bois de Boulogne. Après la visite du Duc de Devonshire et du Prince Paul de Wurtemberg. Dîner chez Mad. de Tallyrand avec le duc de Noailles, et le Prince de Chalais. Visite de Pahlen avant dîner que je n’ai pas pu recevoir parce que j’étais à ma toilette.
Au sortir du dîner j’ai été chez lui. Grande joie de nous revoir, grande joie d’être à Paris, de se trouver bien dans une bonne maison. Pas de conversation politique, des amitiés de la famille impériale pour moi, moins l’Empereur. Voilà le premier moment. J’ai passé un instant chez Lady Granville, et une demi-heure pour finir chez Mad. de Castellane. M. Molé fort content du discours de M. de Broglie appuyant beaucoup sur ce que M. de Broglie n’irait jamais à la gauche. Riant un peu de l’embarras que son rapport pouvait donner à Thiers. Voilà le ton. Assez d’abattement et d’aigreur. Je trouve aussi que la gauche pourrait bien n’être pas aussi contente du langage tenu par Thiers dans la Commission. Nous verrons.
Le prince Paul trouve la situation de Thiers très précaire. Le Roi ourdit toujours quelque trame. Il n’y a aucune sécurité de ce coté là. Il n’y en a aucune dans la chambre. Les deux extrémités donnent la majorité voilà tout. Le jours où elles ne la donneront plus, il tombe. M. Molé a dit au duc de Noailles : "Si le ministère tombe par le fait de la Chambre, je suis prêt à le remplacer. Si le roi le renvoie dans l’intervalle des sessions. Je ne me charge pas de prendre le ministère et je l’ai dit au roi. "
J’ai été interrompue par M. de Valcourt. Il est midi. Je n’ai pas fait encore ma toilette. Adieu. Adieu. Adieu. Quel plaisir que des lettres! Quel bonheur que le mois de juin ! Adieu.
Voici la première fois que vous me dites que vous pouvez recevoir de lettres le Dimanche. J’en userai. Il me paraît de cette façon que nous nous écrirons à peu près tous les jours. Adieu.
341. Londres, Dimanche 12 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Lundi, 9 heures
Une heure
Vous avez bien raison de mépriser. Soyez sûre que vous ne méprisez pas assez. Vous avez raison aussi de douter du mariage de la main gauche. Il se traitera longtemps sans se celèbrer, ni se consommer jamais. Mais il faut du temps et des incidents pour se dégager. Des embarras, des coup de bascule, de l’impuissance à droite et à gauche, c’est l’avenir et un avenir peut être assez long. Quoi au bout ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne crois pas du tout que la rivière coule du côté de M. Molé.
342. Londres, Mardi 14 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mes invitations à dîner pour le 1er mai sont parties hier. Le chancelier et le speaker. Melbourne, Lansdowne, Clarendon, Normanby, Palmerston, J Russel, Holland, Minto. 15 Diplomates, y compris Neumann, Le Duc de Wellington. Mon ambassade 8 personnes. En tout 34. C’est le maximum possible de ma salle à manger, et j’espère qu’il m’en manquera, deux ou trois. Déjà le speaker, à son grand regret, m’écrit-il, à cause de la séance de la Chambre. Le duc de Wellington a accepté sur le champ, par un billet de sa main, main tremblante. Lord Melbourne aussi viendra ce qu’il ne faisait guère. Qui dois-je mettre en face de moi comme maîtresse de maison ? Lui à côté de moi? Qui à côté de mon vis-à-vis?
Mercredi 10 heures
La Diplomatie ne m’a pas encore envahi à ce point. Il est bien sûr que j’aime mieux vous écrire tous les jours, et avoir une lettre tous les jours. Nous y avions renoncé par ménagement extérieur de peur qu’ici cela ne parût trop étrange. Nos moyens de correspondance sont maintenant variés, établis.
343. Londres, Jeudi 16 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai quittée hier ayant encore je ne sais combien de choses à vous dire. Pourquoi vous quitter jamais ? Mais voilà qui est convenu. Nous nous écrirons tous les jours, sauf le dimanche.
4 heures
344. Paris, Mercredi 15 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Jeudi le 16. 10 heures
Mardi
345. Paris, Jeudi 16 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai été chez votre mère. J’ai vu Henriette. Elle a le visage bouffi, mais votre mère dit que c’est tout bonnement ses joues, et qu’elle est engraissée. La crainte de la rougeole se dissipe On ne croit pas qu’elle l’aie. Pauline était dans son lit. Je ne l’ai point vue. Guillaume se porte bien votre mère n’a pas l’air inquiet du tout, mais l’idée de votre inquiétude la préoccupe. Voilà exactement ce que j’ai trouvé dans votre maison et dont je vous rend un comple fidèle. J’ai vu Granville. Il a l’air d’être dans la confidence du délai de la reception de Pahlen. Le Serra Capriola attend aussi, parce que lui aussi n’était pas pressé d’arriver.
Vendredi 17, 8 heures
Je viens de parcourir le journaux. Ils disent que M. de Pahlen a eu son audience, par conséquent les Ambassadeurs et moi nous étions mal informés J’ai envoyé à la rue de la Ville l’Evêque. Henriette n’a pas de rougeole, et Pauline a assez bien passé la nuit. Voilà le bulletin. J’ai eu hier une très longue lettre de lady Palmerston. Elle me dit que vous allez demain à Holland House pour deux jours. J’en suis bien aise. Cela vous fera plaisir. Elle parle extremement bien de vous, décidément vous lui plaisez beaucoup. Lord Grey m’écrit avec aigreur sur toute chose et tout le monde. A propos, il me dit qu’Ellice est très peu bienveillant pour les Ministres Je vais voir cela tout à l’heure, il arrive aujourd’hui. Lord Grey me dit qu’il n’a fait que vous entrevoir, qu’il n’a pas d’occasion de causer avec vous. J’en suis fâchée. Je voudrais qu’il vous entendit. Est-ce que vous ne vous êtes point fait visite? Il serait convenable de demander à aller voir lady Grey c’est une très respectable personne. Je vous envoie cette pauvre lettre, elle vous trouvera au milieu de cette belle verdure de Holland House. Il n’y a pas d’arbre que je ne connaisse. J’y venais souvent souvent le matin, lorsque les Holland étaient absents. J’y restais des heures entières. J’écris aujourd’hui à la duchesse de Sutherland ; je parle du mois de Juin sans préciser le moment, car eux-même seront absents la première quinzaine et ne pourraient pas me recevoir alors. J’explique un peu mes jambes. Coucher au second est absolument impossible, il y a 90 marches. S’ils ont encore à me donner l’appartement du rez de chaussée, je serai fort contente d’être chez eux. J’apprends que Paul part à la fin de ce mois-ci pour la Russie. Il n’est donc pas vraisemblable que son frère le voie avant, ce qui pourrait fort bien faire qu’Alexandre ne vint pas du tout ici. Encore ce mécompte.
344. Londres, Vendredi 17 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne vous ai rien dit en me levant. J’étais dans une disposition horriblement triste. Inquiet de ma petite Pauline, me reprochant d’avoir quitté mes enfants, en demandant pardon à leur mère à la mienne. J’ai passé la nuit avec ce cauchemar me reveillant sans cesse, ne me rendormant que pour retrouver mes enfants, ma mère, vous, vos enfants à vous, tout ce que j’aime ce que j’ai perdu, ce qui me reste tous malades, inquiet pour tous. Je suis sorti de mon lit fatigué, agité. Je n’ai rien fait. Je me suis mis tout de suite à ma toilette. Je l’ai fait traîner jusqu’à l’arrivée de la poste. Enfin, elle est mieux ; elle a bien dormi ; elle n’a pas eu de petit retour de fièvre. Ma mère est tranquille. Mon petit médecin veut que je le sois. Je le suis. Je suis plus content que tranquille. On a toujours tort d’être tranquille. Je vous le disais hier. Je le répèterais toujours. Quelle fièvre que la vie ! Je ne suis point d’un naturel agité. J’ai de la sérénité et de la force. Et pourtant
346. Paris, Samedi 18 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre n° 342 ne m’est arrivé qu’à 6 heures. Vous me grondez et vous m’aimez et vous avez raison de ces deux façons. J’enverrai chercher Andral d’ici à deux jours si je ne suis pas mieux. Je vous écrirai tous les jours. Voilà quatre pages répondues. Quatre pages charmantes car il y a bien de l’...., de ce qu’il avait dans des vers qui me sont arrivés à Stafford House il y a tout-à-l’heure 3 ans. Vous avez raison dans les premières pages de votre lettre aussi, article prudence, tout-à-fait raison. Quant aux places à dîner, c’est ennuyeux mais vous êtes obligé de prendre le Chancelier à votre droite et lord Lansdowne à votre gauche. Vous pririez lord Palmerston de se placer vis-à-vis de vous entre le duc de Willingtom et lord Melbourne. Voilà ce qui me semble la règle, mais laissez-moi, encore y penser. D’où vien que vous avez prié le Duc de Wellington ?
345. Londres, Samedi 18 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de réussir dans une petite négociation qui a quelque valeur en elle-même et quelque importance pour moi. A la première nouvelle des vivacités de l’Angleterre à Naples, en causant avec Lord Palmerston et le voyant un peu préoccupé des conséquences possibles, une insurrection en Sicile, des embarras en Italie et, je dis quelques paroles des bons offices de la France et du parti que l’Angleterre en pourrait tirer. Elles furent bien accueillies. Elles le furent très bien à Paris. J’ai mené l’affaire vivement, et un courrier vient de partir hier soir pour Lord Granville qui acceptera la médiation de la France entre l’Angleterre, et Naples chargera la France de négocier au nom de l’Angleterre et lui donnera le pouvoir de suspendre les hostilités contre le pavillon Napolitain. Cela sera bon dans le cas particulier et d’un bon effet général. On verra que la France et l’Angleterre ne sont pas si près de se brouiller, ni si dénuées de confiance l’une dans l’autre. Lord Granville vous aura peut-être déjà parlé de ceci quand ma lettre vous arrivera. Ayez soin seulement de n’en pas parler la première. Du reste, je suppose que l’affaire une fois conclue, on n’aura rien de plus pressé que d’en parler. Je crois avoir bien saisi et bien poussé l’à propos.
3 heures
4 heures 3/4
347. Paris, Samedi 18 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai fait trois heures de bois de Boulogne avant cela j’ai été chez les Granville. Je confirme parfaitement mon conseil de ce matin pour les places à votre dîner, car j’ai consulté Granville. Si vous aviez un collègue ambassadeur, Esterhaz pas exemple vous en auriez fait la maîtresse de la maison. Cela n’étant pas, vous demandez cet office d’amitié à Lord Palmerston comme celui du ministres Anglais avec lequel vous êtes dans les rapports les plus intimes. Comme la hiérarchie anglaise ne permet pas qu’il soit votre voisin ; c’est lui qui doit être placé vis à vis. Et comme je vous l’ai dit le Chancelier à votre droite, le président du Conseil à votre gauche et aux deux côtés de Lord Palmerston, le Duc de Wellington et Lord Melbourne. N’oubliez pas tout ce petit arrangement. C’est Lord Palmerston qui portera la santé du Roi, à quoi vous répondrez un moment après par la sante de la Reine. Le Roi ici se dit très content de son entrevue avec Pahlen, elle a été longue. Ce qui a fait particulièrement plaisir au Roi est l’assurance qu’il lui a portée que le Duc de Bordaux ne viendra pas en Russie. Il a été informé qu’il ne serait pas reçu. Je crois vous avoir constamment donné cette assurance aussi, sans qu’on m’ait chargé de vous l’annoncer. Vous voyez que je sais deviner juste.
Dimanche 11 heures
346. Londres, Dimanche 19 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
348. Paris, Lundi 20 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Après ma promenade au bois avec Marion, j’ai eu une longue visite de mon ambassadeur. Il est très confiant, et peut être même un peu plus defférent que jadis. A propos Je modifie l’article duc de Bordeaux en ceci : qu’on essaye de le dissuader de venir en russie. Mais cette confidence directe a flatté, et a fait dire que c’était la premiere parole agréable qui ait été reçe ici de la part de l’Empereur.
Midi
347. Londres, Mardi 21 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai eu un grand, grand succès at the Mansion house. J’étais seul du corps diplomatique et d’autant mieux reçu. On me dit que M. de Brünnow y serait allé si je n’y étais pas allé. Le Lord Maire ayant porté ma santé et celle des ministres étrangers, voici mon petit speech, un peu prémédité et écrit en rentrant ; vous l’aurez tout entier avec ses fautes : My lord Ladies and Gentlemet I beg yous pardon for my bad very bad English language. I am sure you will show some kindness to a foreigner who likes et better to speak very imperfectly your language than to be imperfectly understood, speaking his own. I am truly happy Gentlemen that it is in this moment my duty to express to you in the name of all the corps diplomatique as in my own name, of Europe as well as of France our warmest feelings of gratitude for your noble and kind hospitality. Your ancestors Gentlemen, I could almost say your fathers should have been very astonished if They have been told that During more than twenty five years, the Ambassadors, the Ministers, the representatives of all the States, all the nations in Europe and in America could every year sit together, with you, in this hall, enjoying the friendship of England and promising to you the friendship, of the civilised world. In times not far from us, war, a war if not general at least partial, if not incessant at least very frequent, rendered such meetings always incomplete and irregular. Peace has made to us that happiness, the consequence and the image of the happiness of the wortd. And pray, gentlemen, remark this : it is not an idle, infertile peace, as it exists sometimes between weak, somnolent and declining nations. It is the most active, the most fruitful peace that was ever seen brought in and maintained by the power of civilisation, labour, justice and liberty.
Une heure
349. Paris, Mardi 21 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je commence par vous donner des nouvelles de Pauline. Je l’ai vue hier. Sa mine est très différente de celle de l’autre jour. elle a l’air animé. Le teint, les yeux, tout est mieux elle cause gaiement. Les autres étaient allés se promener ainsi tranquilisez vous tout-à-fait. J’ai fait un peu de bois de Boulogne seule, une visite à la petite princesse, mon diner solitaire, la soirée chez Lady Granville. J’avais dû y diner mais tout-à-coup cela m’a ennuyé et je n’y suis venu qu’après. Il y avait la diplomatie et l’Angleterre car il y a beaucoup d’Anglais ici dans ce moment. Je ne sais si on sait votre médiation on ne m’en a pas parlé, et je me suis tue. J’ai reçu hier une lettre de mon banquier à Pétersbourg. Mon frère se refuse tout-à-fait à se mêler de la vente de la vaisselle ; cela lui déplait, et il veut que Bruxner ait mes pleins pouvoirs et non pas lui. voilà qui va faire encore un très long delai, d’autant plus que la saison n’est plus favorable à des ventes. Les autres effets ont été vendus, c’est peu de chose, il m’en revient 6000 francs. Je vous dis toutes mes affaires.
10 h 1/2
Mercredi le 22 9 heures
10 heures, Voici votre lettre ; dieu merci vous êtes rassuré pour Pauline et vous avez tout lieu de l’être. Je ne trouve aucun changement dans votre mère. Elle est tout-à-fait comme je l’ai vue à mes autres visites. Et point inquiète. seulement préoccupée de votre inquiétude. Je ne suis point d’avis que vous la laissiez quinze jours, sans lui dire votre résolution. Le vague est toujours ce qui tourmente le plus, ainsi l’idée du voyage, de la traversée, d’un nouveau lieu à habiter tout cela doit lui tourmenter l’esprit. Quand vous lui aurez dit le Val Richer, je suis sûre qu’elle en sera plus tranquille du moins je serais comme cela à sa place, et puis dites lui que vous viendrez la voir en été ; trompez la un peu, ici c’est nécessaire, cela lui ferait peut être du bien.
1 heure
348. Londres, Mercredi 22 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai le cœur bien soulagé depuis que je suis tranquille sur ma fille. Je me surprends toujours à me dire tranquille. Il est vrai que je le suis comparativement. Mon courrier m’a apporté ce matin la lettre de Lady Clanricarde, plus spirituelle que nouvelle mais très spirituelle, comme vous dites et écrite d’un ton ferme quoiqu’un peu verbeux. Ses idées marchent mieux que ses phrases. Evidemment elle ne se plaît pas à Pétersbourg et je le comprends. Je serai bien aise quelle revienne à Londres et de faire un peu connaissance avec elle. Entre nous, je rencontre ici, comme ailleurs du reste bien peu de femmes d’esprit. Je ne m’en plains pas. J’aime que ce que j’aime soit rare. J’aime encore mieux que ce soit unique. Le premier, le plus fort de tous les orgueils, c’est l’orgueil tendre. J’ai celui-là au plus haut degré. Je suis content de mon courrier de ce matin. Il m’a apporté des lettres qui me mettent en mesure de faire faire, si je ne m’abuse un pas à ma grande question. On est fort content de la façon dont j’ai arrangé la médiation de Naples. J’espère que, de son côté, le Roi de Naples entendra raison. J’en serais sûr s’il n’y avait pas là une question d’argent. Son avarice sert merveilleusement sa dignité. En tout cas, les hostilités vont être suspendues ; et j’en suis fort aise. Les mécontents Italiens étaient déjà à l’œuvre. Du reste il n’y a rien à faire pour moi cette semaine. Lord Palmerston est à Broadland et n’en reviendra très probablement que Lundi.
4 heures
350. Paris, Jeudi 23 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai fait ma promenade seule. Pas de visites, dîner chez Lady Sandwich avec les Granville, les Brignoles et quelques autres. Thiers devait en être, il n’est pas venu. Le soir chez moi, M. Molé, Brignoles mon amb., Tcham, les d’Aremberg, Ellice, Heischman, la princesse Rasoumosky point de nouvelles. M. Molé comme de coutume, dénigrant. Les nouvelles de Bruxelles hier ont tout-à-fait rassuré le chateau et on passe à St Cloud ce matin, on raconte que votre médiation est conditionnelle. C’est-à-dire qu’elle prescrit d’alord à Naples de résilier le contrat mais se serait du nonsens et je ne le crois pas. On attend samedi ou dimanche la reponse par télégraphe. M. de Pahlen était vif hier sur la nécessité d’un arrangement quelconque en orient, il dit : si on ne fait pas. il y aura des troubles en Turquie, et alors nous y arrivons infailliblement et puis la guerre générale. L’Empereur est pour qu’on reprenne la Syrie si on le veut ; pourqu’on ne la reprenne pas si on ne veut pas. Enfin cela lui est bien égal mais il veut un arrangement, et il faut que la France et l’Angleterre s’entendent. Voilà le ton d’hier au soir. Il aura une conférence avec Thiers ce matin, et il enverra son courrier samedi. Je voudrais bien pouvoir mander quelque chose.
1 heure.
Voici le 347. Excellent speech, j’en suis aussi contente que l’auditoire, vec quelque chose de plus que lui. Lady Charleville donne des routs et des dîners, depuis 50 ans. Elle m’a constamment prié pendant 22 ans ; j’y ai été une fois, mon mari jamais, parce que c’est a bore. Ne vous en laissez pas incommoder. Il y a quarante vieilles femmes comme cela vous n’êtes pas accrédité auprès d’elles.
349. Londres, Jeudi 23 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
On m’assure qu’en passant à Berlin les comtes Pahlen et Orloff ont tenu, l’un et l’autre, un langage très modéré, et qu’ils ont dit notamment qu’il fallait que les affaires d’Orient fussent reglées de concert entre les cinq cours, et sans se séparer de la France.
3 heures
350. Londres, Vendredi 24 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il y avait plus de monde hier à Holland house que je ne comptais et des ennuyeux. Lady Holland, en était très impatientée. Elle avait voulu m’avoir en petit comité. Elle me l’avait dit. Deux ou trois personnes lui ont fait demander à dîner. J’ai beaucoup causé avec Lord Holland. Il est bien occupé de nous et si je ne me trompe bien content de moi. Lord et Lady Tankerville étaient là. Lady Tankerville est en coquetterie, avec moi. Mais quelle coquetterie ! Je n’ai vu aucune femme supprimer aussi absolument sur ses épaules et sa poitrine, toute espèce de fichu, de linge, et n’avoir absolument que sa robe et sa personne. On rit trop des plaisanteries de M. Sidney Smith. On rit avant, pendant, après. Et il plaisante trop sur les évêques et les sermons. D’autant plus trop qu’il a aussi sa part de timidité envers sa robe. Il n’ose plus dîner hors de chez lui le dimanche, et il n’ose pas le dire à Lady Holland, qui l’invite le Dimanche pour le plaisir de l’embarrasser.
3 heures
351. Londres, Samedi 25 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier soir, vers dix heures, après avoir renvoyé quelques français qui étaient venus me voir, j’ai été me promener seul à pied dans les rues de Londres. Duke street, Oxford Street, Grosvenor-square, Berkeley square, Orchard Street, Postman square. Londres est bien noir. Pas de soleil le jour ; pas de boutiques éclairées le soir. Mais peu m’importe ; quand j’ai l’esprit occupé et le cœur serein j’illumine moi-même le monde qui m’entoure. J’ai pensé à vous à Hampstead à ma fille qui va bien à mes affaires qui ne vont pas mal. J’étais rentré et couché à 11 heures.
Je me lève et je vous écris. La romance a raison.
3 heures
4 heures et demie
352. Paris, Samedi 25 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous écris seulement afin que vous ne me croyiez pas morte. Je me porte même bien. Mais je suis si lasse que je ne puis plus tenir la plume, je l’ai trop fait aller ce matin. J’ai reçu votre 349 dont je vous remercie beaucoup. A demain une grande lettres. Adieu, Adieu.
353. Paris, Dimanche 26 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai été bien fâchée de devoir vous expédier si courtement hier, vous me l’auriez pardonné si vous m’aviez vue. J’étais excedée d’écritures. Aujourd’hui je veux réparer si l’on me laisse, mais mon fils est toujours là. Il part demain pour Londres. D abord je veux vous dire que selon l’avis de Granville vous ferez très bien de parler Anglais aussi au dîner de l’académie samedi. Il dit que dans des occasions publiques, c’est toujours une politesse à faire aux Anglais quelqu’ils soient. Ainsi j’avais tort dans mon premier conseil. Faites votre speech anglais mais très court, c’est encore le conseil de Granville. Il a trouvé celui la Cité fort bien. Je vous dirai qu’assez généralement ici on a trouve la derniere phrase de trop je veux dire la toute dernière qui sentait un peu trop le prédicateur. Et si je dois être franche, et je dois l’être avec vous, je le trouve un peu aussi. Granville pense cependant que cela a dû avoir plutot un bon effet dit là, quoique cela eut été mieux dans la bouche d’un Evêque. Voyez je vous dit la petite critique. Ainsi à l’academie, discours anglais, bref. Chez vous vendredi point de discours, réponse à la santé du Roi par la santé de la Reine, voilà tout. Palmerston portera la santé du Roi. Il me semble que les détails de ménage sont expédiés. J’ai eu un long entretien avec Thiers Vendredi, tout le long du diner, car j’étais sa voisine. Il m’a d’abord raconté toute la séance qui avait été des plus orageuses et importantes comme vous avez vu. Il était parfaitement content, glorieux. Il avait été hardi ; à la tête de la gauche il a enfoncé, écrasé les autres. La confusion a été complète. Sa situation devient tous les jours meilleure quoique toujours difficile, mais il gagnera sans dissolution le temps naturel du renouvellement de la Chambre, le Roi est bien pour lui ; il est bien pour le Roi. Le Roi très belliqueux, lui le moderateur. L’Orient toujours Naples, toujours incertain, toujours menaçant. Cependant il n’y aura pas de guerre. Naples, une bonne affaire quoiqu’il arrive ; car c’est du renouvellement d’intimité avec l’Angleterre. Un grand contentement de vous. Même pensée, même action. Je vous ai donné Thiers, voici Mad. de Boigne hier matin chez moi. La séance de vendredi déplorable, les amis de Thiers, son monde dans le ministère consterné. C’est la gauche, la réforme, tout ce qu’on redoute. Le Roi subit une situation humiliante mais inévitable. Il est très froid pour Thiers. Thiers plus que froid pour le Roi, un peu insolent. Le Roi se tait, la Reine et Madame Adelaide parlent. La dernière surtout et avec beau d’amertume et de véhémence. On ne voit pas le terme du mal. Cette abominable coalition mène l’état où il se trouve aujourd’hui.
352. Londres, Dimanche 26 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’espère que ma lettre vous sera arrivée hier d’assez bonne heure pour vous en servir. Il m’avait été absolument impossible de vous écrire la veille. Les Ministres ne sont pas venus au diner de la Cité parce qu’ils y avaient été très mal reçus la dernière fois, sifflés à la lettre. Lord Melbourne, s’en était très bien tiré, très dignement. Mais ils ne se sont pas souciés de recommencer. Lord Palmerston à qui le matin même, j’avais dit en passant que j’irais, me répondit qu’ils n’iraient pas, et pourquoi. Un motif accidentel de plus. Les Shériffs que la Chambre avait mis en prison, et qui venaient d’être mis en liberté devaient être au dîner, et y étaient en effet. Le Lord Maire a porté leur santé et protesté contre leur emprisonnement. Tout cela faisait bien des petits embarras. Du reste, la santé des ministres a été portée et acceptée avec une froideur décente. Leur absence a été remarquée, mais sans étonnement. Les représentants de la cité au Parlement radicaux n’y étaient pas non plus et n’auraient pas été mieux reçus. La Cité est partagée en Torys en haut, radicaux en bas.
Lundi, 9 heures
Une heure
354. Paris, Lundi 27 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon fils vient de partir pour Londres. Il sera de retour au bout de huit jours J’ai fait des visites hier au soir, entre autres chez Mad. de Castellane. M. Molé a beaucoup causé avec moi, on disait hier que le blocus de Naples était établi ; il voit découler de là une guerre générale, c’est en verite très possible. Personne ne doute que les hostilités de la part de l’Angleterre en deviennent le signal d’un soulevement à Naples, où le Roi est parfaitement détesté et méprisé par tout le monde. Si le reste de l’Italie n’est mal disposé à se remuer aussi, et là se trouveraient au presence, l’Autriche reprimant et vous aidant la révolution. Tout depend de cet imbecile de Roi. Et partout et toujours tout a dépendu d’un fou ou d’un sot.
1 heure.
353. Londres, Mardi 28 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Le 352 et le 353 sont arrivés ensemble ce matin. Le premier avait sans doute été mis à la poste trop tard. Je ne m’arrangerais pas des correspondances qui me causeraient un tel ennui. Avez-vous au moins écrit de bien belles choses ?
Moi, je ne vous écrirai rien de beau aujourd’hui. J’ai une dépêche à faire, et je vais à 6 heures dîner à Holland house, avec Lord Melbourne. En très petit comité cette fois, m’a-t-on promis. On commence à rentrer à Londres. Avant-hier
Lady Jersey, est venue m’avertir elle-même de son retour, et m’engager à aller la voir le soir. Je n’y suis pas allé. Je m’étais
arrangé pour aller à Holland house jouir de l’esprit de M. de Brünnnow.
Je ne sais si la mort de Lady Burlington fera revenir plutôt, la Duchesse de Sutherland. Ce sera un vrai chagrin, pour elle, et pour toute la famille. Etait-elle aimable ? J’irai m’écrire ce matin à Stafford house, chez Lord Carlisle et chez Lord Morpeth.
Je suis tout à fait de l’avis de lord Granville. Le speech at the royal academy très court, un simple remerciement. Mais je suis fâché qu’il soit d’avis de l’Anglais. Le Français me serait là, plus agréable. A la cité, on n’a vu que m’a bonne volonté. Là on verra surtout mon mauvais accent.
Vos deux conversations sur l’état des affaires à Paris m’arrivent de plusieurs côtés ; la seconde surtout. Evidemment les hommes senses sont fâchés et inquiets. Ils ont bien mal mené leur barque depuis quelque temps. Quand pourrons nous causer à notre aise ? Il y a ici des gens qui ont peur d’avoir perdu le Prince de Capoue et qui le cherchent avec anxiété. Il est allé à Brighton avec sa femme, il y a quelques jours. Il y a laissé ses enfants. Puis on l’a vu toujours avec sa femme à Palmouth, à Phymouth, à Portsmouth. Puis on dit qu’on ne le voit plus nulle part. Je crois que s’il va quelque part, les gens chez qui il ira seront
bientôt aussi embarrassés de l’avoir reçu que ceux-ci le sont de l’avoir perdu.
L’Autriche me paraît bien préoccupée de l’affaire de Naples.
de notre médiation que de l’affaire même. Elle a tort. Nous désirons autant qu’elle la paix de l’Italie. Mais si la paix nous présente quelque occasion d’influence, nous la saisissons. Au moins faut-il que notre sagesse soit quelquefois ; un peu récompensée.
Savez-vous quand revient le Duc de Devonshires ? Je donnerai mon second dîner, le dîner Whig le 16 mai, et je désire qu’il y soit. Ma liste est: Sutherland 2 - Devonshire-Palmerston 2 - L.Fanny Cowper - Clarendon 2 - Lansdowne 2 - Minto 2 - Holland 2 - Normanby 2 - Albermarle 2 -Lichfield 2 - Lord Melbourne-Morpeth, Leveson, M. Labour - M. Ellice- Prince Esterhazy s’il est ici. Est-ce bien ? Je n’ai point de devoir, quant aux Albermarle et aux Lichfield. C’est pour la part de la Cour. Vaudrait-il mieux Lord et Lady Carlisle ? Mais la mort de leur fille les empêchera. Et peut-être les Sutherland aussi. Faudrait-il retarder ? Combien de temps? Pourrais-je en ce cas donner le dîner Tory ? Hier et avant-hier, j’ai été me promener seul dans l’intérieur de Regents Park dont Lord Duncannon m’a envoyé les clefs. J’y ai été tristement. Je voyais courir sur ces belles pelouses mes enfants... qui n’y viendront pas. Il faut du reste bien prendre garde aux enfants qu’on mène là. Il y a tant d’eau, et pas le plus petit grillage autour. On a tort. On
devrait aux parents cette sécurité. On leur doit toutes les sécurites qu’on peut donner. C’est si peu? Adieu. Je vous quitte pour ma dépêche. Je ne suis pas sorti hier soir. Le temps est toujours admirable. Je suis fâché que vous n’ayez pas vu M. Andral. S’il revient arrangez mieux les heures. Adieu. Adieu
355. Paris, Mardi 28 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai mené hier Ellice au Bois de Boulogne, et je l’ai retrouvé à dîne chez Rottschild. Il y avait les Ambassadeurs. Le Duc de Serra Capriola a fort bon air et il s’exprime bien. Il m’a fait le recit de toute cette affaire de souffré naturellement il défend son roi. Il accuse Lord palmerston, ses propos un peu légers. sur le compte du Roi ont excessivement irrité celui-ci. Il croit cependant qu’il pourra se prêter à la résiliation du Contrat, mais il doute qu’il consente à des indemnités, au fond, il est très inquiet des nouvell qu’on attend de Naples. Si les vaissaux anglais menacent Naples il a fort peur que son roi se fasse tirer dessus. Hier s’était répandu le bruit d’un mouvement populaire, mais il n’y a encore rien d’officiel. Il y a eu musique chez Rottschild. Mais du Chant allemand qui n’est pas du tout de mon goût ; j’ai quitté à 10 1/2 pour venir me coucher et au moment d’entrer dans mon lit on m’annonce mon Ambassadeur qui me demande un moment seulement. J’ai cru qu’il y avait quelque chose d’incroyable arrivé depuis les dix minutes que je l’avais quitté. Point, il avait envie de parler, à peu près de rien ou du rabachage. Il a Brünnow dans l’esprit. Il se trouve déjà un peu en contradiction avec lui. Brünnow agit selon les paroles venant de haut. Pahlen, selon ses instructions écrites. Ceci est très différent. Cela a été mis en lumière par le dernier courrier envoyé samedi, mon opinion est que le règne de M de Bünnow à Londres ne sera pas long. Tout le monde est ligué contre lui à commencer par lui même ses bouquets, sa danse, le portrait, sa ridicule conduite avec vous, ses flatteries qui fineront par donner des nausées.
354. Londres, Mercredi 29 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Le petit comité de Holland house s’est transformé hier en 14 ou 15 personnes. Toujours au grand déplaisir de Lady Holland dit-elle ! Elle continue de me soigner comme un enfant favori. J’avais Lord Melbourne et Lord John Russell. Nous avons causé. La conversation est difficile avec Lord John ; elle est très courte. Je vois que M. de Metternich est extrêmement préoccupé de Naples de notre médiation autant que de ce qui a fait notre médiation. L’Angleterre et la France sont bien remuantes. Il n’y aura jamais de repos, en Europe tant qu’elles y seront. En sortant de Holland house, j’ai été un moment chez Lady Tankerville. Elle avait déjà vu Lady Palmerston arrivée à 5 heures. Leur intimité est grande. Elle croit au mariage de Lord Leveson et de lady Acton. En savez-vous quelque chose ?
Une heure
356. Paris, Mercredi 29 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Montrond me raconte toujours l’amour du roi pour Thiers, et la nécessite que vous et Thiers restiez bien ensemble, comme un homme qui aurait bien envie que ce fût le contraire, car quand je lui demande pourquoi tant désirer quelque chose qui est, il me répond que les rivalités, les clabaudages peuvent altérer cela ! Moi j’affirme que vous avez tout deux trop d’esprit pour vous brouiller, à moins de très grosses raisons, et que je suis convaincue que vous vous entendez à merveille. Il serait possible que cela déplût au roi. M. Molé est si aigre qu’il trouve même que la duchesse de Nemours n’est pas très jolie. On la dit cependant charmante. Mes diplomates affirment que si une révolution éclate à Naples, l’Autriche doit s’en mêler et s’en mêlera. Je trouve à Appony l’air bien préoccupé et même égarré. Brignole trouve qu’il s’est trop fait l’homme du Roi, que c’est inconvenant et fort compromettant. J’ai causé beaucoup avec lui hier, il était mon voisin à dîner. On raconte dans la diplomatie que Thiers ayant lu dans l’Allgemeine zeitung un article insolent sur lui, a fait venir M. de Luxbourg et lui a très franchement lavé la tête. Il a raison, le journal est censuré, et dès lors le gouvernement bavarois a à en répondre. Luxbourg n’a pas trouvé une parole à répliquer.
1 heure pas de lettre. Fagel me parle toujours beaucoup de vous. Dédel lui rend compte d’un entretien qu’il a eu avec vous avant son départ qui a été pour lui d’un grand intéret.
[Monsieur Guizot
Ambassadeur de France
Manchester Square
Angleterre.
à Londres]
357. Paris, Mercredi 29 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je crois Monsieur que je me suis permis il y a quelques jours de vous dire l’opinion de quelques Anglais ici sur le discours que vous aurez à prononcer samedi au dîner de l’Academie j’y ai bien pensé depuis et je crois que leur avis cependant n’est pas bon. Un discours en français est plus convenable dans
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Interculturalisme
355. Londres, Jeudi 30 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vais déjeuner aujourd’hui à Battertea chez un des favoris de la Duchesse de Sutherland, le Dr. Khay. On veut me faire voir là et à Norwood, de grandes écoles populaires en attendant que j’aille à Eton et à Oxford voir les écoles aristocratiques. A Norwood, je m’enquerrais aussi d’autre chose. Le soleil est décidé à ne pas quitter Londres. Il y fait pourtant une pauvre figure, dans son plus grand éclat. Hier, à dîner, chez Lady Lovelace, l’évêque de Norvich, bon homme un peu ridicule, un M. Villiers, frère de Lord Clarendon. Tous ses frères ont de l’esprit. Vous savez que Lady Lovelace est la fille de Lord Byron, cette petite Oda sur laquelle il a fait des vers charmants. Elle a de très jolis yeux et l’air spirituel naturel et affecté à la fois. Vous arrangerez cela, car cela est, et même, je trouve cela assez comme en Angleterre. Ils sont naturels et point à l’aise dans leur naturel ; d’où leur vient l’affectation. Je me suis ennuyé. J’ai été finir ma soirée chez Mad. Grote au milieu des radicaux. Mad. Grote, devient un personnage. Lady Palmerston l’a invitée à une soirée. J’ai entendu avant-hier Lady Holland faire un petit complot pour l’avoir à dîner la semaine prochaine à Holland, house, et bien recommander à Lord John Russell d’y venir et de plaire à Mad. Grote. Ils ne lui plairont pas, et elle ne leur plaira pas. Elle a de la hauteur et prend de la place. Ils ne lui en feront pas assez ; elle aimera mieux être reçue des radicaux chez elle qu’une étrangère poliment accueillie, à Holland house. Les complaisances aristocratiques ne peuvent plus se mettre au niveau des fiertés démocratiques. Il peut y avoir là des rapprochements sérieux et sincères, par nécessité, par bon sens, par esprit de justice. Tout ce qui est factice, superficiel, momentané ne signifie plus grand chose. On n’aura pas le vote de M. Grote comme Don Juan a eu l’argent de M. Dimanche.
J’ai été voir hier Lady Palmerston, fort contente de son petit séjour à Broadlands, pas rajeunie pourtant ; je lui trouve l’air fatigué. Elle a besoin de toilette. Le négligé du matin ne lui va plus. Elle est préoccupée des Affaires de Naples. A part l’intérêt du moment, cela lui déplaît qu’on dise que les révolutions naissent sous la main de Lord Palmerston et de le craindre elle-même un peu. Nous attendons des nouvelles. Je pense que j’aurai un courrier ce matin. Voilà mon courrier. Il m’apporte : 1° de de longues dépêches sur Naples et l’Orient avec de curieuses conversations de Méhémet Ali ; mais point de réponse encore du Roi de Naples. Cela m’impatiente. 2°des lettres et des livres des Etats-Unis d’Amérique où l’on me reproche d’avoir dit trop de bien de Jefferson. 3° l’ouvrage de M. de Tocqueville sur la démocratie en Amerique. 4° Le grand cordon de la légion d’honneur, pour que je le porte demain.
10 heures et demie
358. Paris, Jeudi 30 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Il y a aujourd’hui 6 ans que mon mari reçut la lettre de l’Empereur lui annonçant sa nouvelle destination lettre qui lui fit lever les mains au ciel de joie, et moi de douleur. J’ai noté ce jour comme un des plus cruels de ma vie. Il y a aujourd’hui un an que mon fils ainé me déclara qu’il ne me reverrait jamais. C’est un triste jour que ce 30 avril. J’aurai de vous une lettre n’est-ce pas ? Deux probablement, car je n’ai rien eu hier. Rien depuis lundi. C’est long. J’étais inquiette hier. Je suis allée chez votre mère pour savoir si elle aussi manquait de lettres elle avait eu la sienne, ainsi vous vous portiez bien. J’ai trouvé tout votre monde en parfaite santé et vous pouvez être bien tranquille Je me suis promenée avec Marion. J’ai dîné chez M. fFeihman. De la diplomatie. On raconte que Thiers dit à propos de l’affaire des soufres : "Si j’avais fait ce que fait Lord Palmerston, qu’aurait dit l’Europe ?" C’est vrai, entendez-vous les cris d’indignation ? Il y a bien de l’injustice dans le monde. Je n’ai vu personne hier au soir. Ces dîners me font veiller tard et je manque tout le monde. Je n’ai vu que M. de Bacourt et Ellice. Je vous enverrai par le courrier des Affaires étrangères une lettre que j’ai reçue hier de Matonchewitz, elle vous intéressera.
11 heures
Midi.
Voici deux lettres l’une par le petit médecin, l’autre par le gros monsieur. Le petit monsieur l’ayant reçu que hier à 2 heures n’a plus osé venir puisque vous lui disiez de la porter avant l heure. Je l’ai renseigné pour l’avenir. Merci de toutes les deux, et de tout. Vraiment Brünnow est trop bête. L’ Europe finira par répéter cet écho. Je vous ai dit hier un mot direct par la poste pas dessus mon autre lettre. Je répete aujourd’hui. Parlez en français à l’academie. C’était mon premier instinct vous vous en souvenez. Granville m’a déroutée, et j’ai assez de confiance dans ses avis, mais cependant je crois que le Français est plus convenable. De toutes les façons, et j’y reviens avec assurance, parce que j’entends dire qu’un ambassadeur Français doit parler sa langue là où il peut être compris et c’est vrai. C’est votre inclination aussi; c’est donc dit samedi à 8 heures je saurai que vous parlez Français. Vous ne savez pas comme je m occupe et m’inquiète de tout ce qui vous regarde. Votre dîner du 16 mai me parait trop short notice pour cette saison d’autant que tout le monde prend le samedi. Il me parait que le 23 est plus sûr. Je pense que ni les Sutherland, ni les Carlisle, ni le Duc de Devonshire, ni Lord Morpeth n’accepteront. Mais cela ne doit pas vous empêcher de donner le diner Whig, il le faut absolument avant celui-pour les Torys. J’ai écrit ce matin à M. Andral. Je ne suis pas bien de nouveau. Vraiment c’est une étrange santé que la mienne, avec mon régime, mon abstinence je ne conçois pas ce qui me dérange, je ne vois plus d’autre parti à prendre que de ne plus manger du tout. On peut s’acoutumer à cela peut être. Vous pourriez prendre M. e Mrs Slanley dans le dîner Whig si vous avez place. Adieu. Adieu.J’ai bién grondé de ce que ma lettre de samedi a été remise trop tard à la poste. Ordinairement, je les porte moi-même. Je ne suis jamais sure que de moi-même. Je viens de relire la lettre de Matonchewitz. Je vous promets qu’elle vous plaira. Vous ne l’aurez pa encore aujourd’hui. Je veux la faire lire à M. de Pahlen.
356. Londres, Vendredi 1er mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
356 et 357 en un jour ! C’est charmant. Et un jour où vous n’aviez rien eu ? Je ne comprends pas cela. Mon troisième commissionnaire n’aura pas reçu la lettre à temps avant de sortir de chez lui. J’espère que vous l’aurez eue plus tard. Vos mécomptes me déplaisent autant que les miens. Je ne peux pas dire mieux, ni plus. Je suis de votre avis sur le speech à l’academie royale. Et je crois que bien décidément j’agirai selon notre avis. Mais quelques phrases seulement; pas un vrai speech. Parlant français surtout, si je parle un peu longuement, il faut que ce soit assez pour faire de l’effet. Et l’effet en pareille occassion dans ma situation d’aujourd’hui, c’est une prétention. J’en ai fait assez depuis quelque temps. Je serai donc très court et très simple. Il y aura quelques personnes attrapées. On est curieux de mon éloquence. On ne l’aura pas là. C’est un peu dommage. Je pourrais dire de bien bonnes choses. Mais j’y ai pensé ; soyez sûre qu’un vrai speech aurait en ce moment un air de prétention et de bruit qui même avec le succès, me diminuerait au lieu de me grandir.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Politique (Internationale)
358. Londres, Dimanche 3 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Lundi une heure
2heures 1/2
Mots-clés : Ambassade à Londres, Aristocratie, Autoportrait, Diplomatie, Interculturalisme, Peinture, Portrait
361. Paris, Dimanche 3 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai fait ma promenade hier avec Ellice, mon dîner seule. Le soir il y avait musique chez Mad. de Castellane ; j’y ai été. C’était charmant. Quand je dis musique c’est toujours les Belgioioso, ni plus, ni moins, mais il est impossible que ce soit mieux. On parlait beaucoup hier au soir d’une lettre circulaire de M. Jaubert aux membres conservateurs de la Chambre pour leur dire que le ministère voulait étouffer la proposition, Rémilly. Cela faisait faire mille commentaires. Là où je me trouvais ils n’’étaient point bienveillant. Appony est toujours d’une humeur de dogue. Mon ambassadeur est silencieux comme de coutume. Appony dit que l’irritation du roi de Naples contre Lord Palmerston est toujours bien vive, et qu’elle rendra l’effet de la médiation bien difficile et bien lent. Mad. la duchesse d’Orléans a la rougeole, mais bénine. On la dit en général cependant dans un triste état. Il y a bien des mois. qu’elle ne prend presque plus d’aliment. Elle dépérit. Le chancelier hier était bien important et Mad.de Boigne très jolie, vraiment jolie, c’est drôle !
10 h. Voici votre lettre. je suis bien aise de vous voir enfin dans de bons rapports avec Brünnow. Je suis sure que vous lui direz des choses utiles, mais je suis tout aussi sure qu’il ne rapportera que ce qui peut flatter. Vous êtes donc entré dans est Ashburnham house, dont le nom seul me cause une émotion de joie et de douleur que je ne saurais décrire. Je crois. que je mourrais en passant le seuil de cette porte. Je pense bien à mon voyage. Mais je suis très peu fixé encore sur la manière dont je serai Londres. Il est convenu que je logerai chez les Sutherland ; s’il y avait un changement il me semble qu’il doit venir de leur part, car je ne saurais leur montrer moins de désir d’être avec eux aujourd’hui qu’ils sont dans l’affliction, au contraire cependant il est très possible. que de leur côté ils préfèrent ne voir personne. Je ne sais vraiment comment arranger cela dans ma tête. J’attendrai un peu, je verrai au bout du compte, où trouver toujours deux chambres dans une auberge. Cela me sera désagréable, mais il n’y aurait pas de choix. Soyez sur que nous serons ensemble Le 15 de juin, mais probablement avant.
midi. Je rentre de ma première promenade. J’en fais trois quand je le peux, à dix heures. Après 4 heures et après mon dîner. Que j’aime vos lettres. Adieu Adieu. Adieu.
360. Paris, Samedi 2 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’ai eu votre lettre après le départ de la mienne. Je suis toujours fâchée quand je ne puis pas répondre de suite. Cela abrège la distance lorsqu’on n’a que quatre jours entre soi. Savez-vous que le télégraphe électrique sort de ma famille. Ce gros M. de Shilling que vous avez vu chez moi en 35 (je ne sais si vous vous souvenez de lui). Il était l’inventeur, il y a quelques quinze ans de cela. Mais je crois que vous vous trompez sur la célérité, il fallait cinq ou 6 secondes entre Pétersbourg et Moscou. Midi Voici votre lettre. Ce que vous dites du melange d’affectation et de naturel dans les Anglaises est très juste. En général elles manquent de grâce, cela est sûr. Et puis elles cherchent à s’en donner; ce qui ne va jamais. Je suis fort aise du grand cordon. Je ne suis pas. tout à fait au dessus de ces petites vanités là. Il y a des choses qu’il faut avoir et puis alors c’est fini des petites vanités. J’ai pensé à votre dîner hier beaucoup. Je penserai à celui d’aujourd’hui.
Le duc de Noailles est venu causer pendant longtemps hier matin, Berryer trouve la chambre très occuppée, très animée, non pas sur quelque chose de spécial, mais enfin une disposition à faire ou à voir faire quelque chose. La séance sur les éligibles a classé les partis, cela a plu, et cela a donné le goût d’arriver à quelque chose de plus clair encore. Berryer croit que la Commission fera éclore cela, et que la discussion se développera plus encore. Enfin il voit ressortir une dissolution de la Chambre par le fait de la Chambre elle-même , et non pas par le ministère ce qui mettra la cour dans l’impossibilité de la refuser. Car si même les pairs rejetaient une loi d’incompatibilité, cela ne rendrait pas de nouvelles élections moins nécessaires, les députés fonctionnaires ne pouvant pas rester sous le coup de précautions. La session ne finira donc pas sans quelque chose d’éclatant. Voilà l’opinion de Berryer. Je n’ai vu hier personne à peu près, la fête absordant tout le monde.
Le soir M. Jaubert est venu pour rencontrer Ellice, mais celui-ci a tardé et jamais ils ne feront connaissance. J’ai lu à Jaubert le passage de la lettre de Lord Aberdeen où il parle de vous. Cela a semblé lui faire un grand plaisir. Nous avons causé assez familièrement ensemble. Il me plait. Il me parait être fort content de Thiers, et de la situation en général. Pahlen est entré, je les ai introduced to each other, mais mon ambassadeur a reçu cela bien froidement, trop froidement. Ellice plus tard, rabâchant sur la Chine.
2 heures
Lady Pembroke est venu m’in terrompre avant ma toilette. me voici bien en retard. Je cherche vite si j’ai quelque chose à vous dire je ne trouve pas. Les fontaines sont admirables, Le soleil va toujours. La chaleur aussi, c’est même ennuyeux.
M. Andral m’a écrit pour me dire qu’il ne pouvait pas venir me voir, parcequ’il est trop occupé. Le Duc de Noailles prétend qu’il n’y a que moi à qui pareille avanie arrive. Sur cela j’ai envoyé cherche Chermeside. Ne pouvant avoir le meilleur, je reviens au plus mauvais médecin, mais c’est que je me souviens que de son temps j’allais mieux, peut être fera-t-il encore ce miracle. Je n’ai pas vu Lady Granville à la façon Anglaise elle ferme sa porte à tout le monde mêne moi puisqu’il y a eu un mort dans la famille. Elle peut le faire elle est entourée. Adieu, adieu. J’aurai une lettre demain, et puis lundi ; mais je ne saurai le dîner de l’Académie que mercredi ; c’est bien long. Adieu mille fois. Le Duc de Noailles trouve que votre position à Londres est superbe et qu’elle vous prépare à tout.
357. Londres, Samedi 2 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon dîner s’est très bien passé. De 8 heures 1/4 à 10 heures à table dans l’ordre que vous savez et qui m’a paru approuvé de tous. Le debut froid et embarrassé comme toujours et partout. Passé la première demi-heure de l’animation et de la bonne humeur. Le cuisinier et la cave ont eu grand succès. Lord Melbourne a bu du vin de Bourgogne avec un contentement réfléchi. C’est Lord Lansdowne qui a porté la santé du Roi, d’après l’avis de Lord Palmerston. J’ai porté celle de la Reine et de tous les souverains de l’Europe. La Parisienne s’est mariée au God save the Queen. Le service a bien marché un peu précipitamment. Ils étaient trop pressés de bien faire. J’avais prodigué l’éclairage ; il était brillant. Cela manque toujours ici. L’illumination était belle, mais un triste accident s’y est mêlé et me désole. La voiture du baron de Moncorvo a accroché une échelle sur laquelle était monté un pauvre charpentier qui allumait les lampions. Il est tombé et il en mourra. Il a le crâne fracassé à la base. Il n’était pas marié, mais il allait se marier. Je lui ai fait donner tous les secours possibles. Mon médecin, qui est allé le voir ce matin à Middlesex-Hospital où je l’ai fait transporter me dit qu’il n’y a pointl’avait fait de chance de guérison. J’avais pris toutes sortes de précautions contre les accidents. Comment prévenir la maladresse d’un cocher? J’ai beaucoup causé avec le duc de Wellington qui y prenait plaisir, quoique la conversation doive lui donner assez de peine. Il cherche ses idées et ses mots comme un aveugle son chemin. Il m’a raconté Charles X, et comment il avait lui toujours prèvu sa fin. Bien aise de me tenir le même langage que Lord Aberdeen qui m’a déjà dit deux fois : " Je me glorifie d’avoir été en Europe le premier ministre qui ait reconnu le Roi Louis-Philippe."
Une heure
359. Paris, Vendredi 1er mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai vu personne hier matin, J’ai fait ma promenade habituelle. J’ai dîné chez mad. de Boigne le chancelier, M. Molé. Mes. de Pahlen, d’Appony, les Durazzo Mad. de Castelane, M. et Mad. Girardin. (Il me semble que lui est bête), je vous dirai de ce dîner ce que je vous ai dit d’une soirée chez Mad. de Boigne. On n’est pas poli pour les étrangers. Les Français s’escriment entre eux ; hier ce n’était pas les jésuites ou les jansénistes C’était des tours d’esprit sur des romans, des pièces de théâtre. Les Ambassadeurs n’ont pas ouvert la bouche, moi pas non plus, et moi d’autant plus que j’avais commencé par dire que je n’allez jamais au spectacle, et que je ne lisais jamais de romans, ce quei réhaussait la politesse de passer tout un dîner sur ce sujet là. Vraiment cela n’est pas des égards, et mes deux collègues et moi /vous voyez que je persiste à me compter dans la diplomatie/ nous en avons très spontanément et simultanément fait l’observation après le diner.
Une fois j’ai essayé de causer avec mon voisin le Chancelier cela a été court mais étrange. " Je regarde le ministère comme très établi." Il me répond : " Jusqu’à la fin de la session." - Cela veut dire jusqu’au commencement de l’autre ? - Non car le Roi a renvoyé M. Thiers, une fois en été. - Mais il me semble difficile qu’il puisse y songer une seconde fois ? - Et pourquoi pas ? Nous verrons." Voilà. Faites-vos commentaires. J’ai été passer une heure chez La Duchesse de Poix, les Belgioioso dont je suis éprise, vraiment C’est ravissant de les entendre chanter. M. Molé était le aussi en grandre chuchoterie avec tous les ultas du Faubourg. Lord William Russell me mande que la santé du Roi de Prusse donne de l’enquiétude. Il est faible sans appétit et l’entourage montre des alarmes.
Lord Aberdeen m’écrit une fort longue lettre. Voici sur vous. " You may be assured that the French minister could not have met with a greater piece of good fortune, than to have M. Guizot here as Ambassador at this time. If is not the talent and reputation of M. Guizot that ensures his influence and succes in this country ; but the respect wich is duc to his character. trusting to your having favorably predisposed him, l have made a greater exertion to obtain his acquaintance than is usual with me, and I have been will repair by all. I have been able to observe, although an Ambassador, the features of his character wich are most impressed upon me are honesty and rectitude."
Savez-vous que tout cela est beaucoup pour Lord Aberdeen. Je voudrais bien que vous fissiez la connaissance de Lord Grey demandez quand on trouve sa femme ; ils réçoivent quelque fois le soir. Ils seraient bien sensibles à une avance, et vous ne dérogez pas en faisant une avance à une femme.
Je viens de lire les journaux, voilà votre médiation acceptée par le Roi de Naples. J’en suis bien aise il est 10 heures. Je m’en vais porter moi-même ceci à la poste, car les bureaux se ferment avant midi. Adieu monsieur. J’espère une lettre ce matin. J’attends M. Andral. Adieu.
363. Paris, Lundi 4 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je viens de vous écrire par Ellice. Vous avez cette lettre là quelques heures après la présente. Les Appony m’ont fait une longue visite hier et puis le prince Paul, et puis Ellice que j’ai mené au bois de Boulogne pour causer. Malgré les assurances d’Appony que Naples restera tranquille on commence à craindre des soulèvements. Quelle énorme complication, si cela arrivait. On dit que vous venez de découvrir un complot trâmé à Bourges. pour empoisonner la petite reine d’Espagne et sa soeur. Quelle horreur ! Le prince Paul croit fermement que la proposition Rémilly sera discutée dans cette session même. L’autre jour chez Mad. de la Redorte où je faisais visite, M. de la Redorte disait non, et M. Piscatory soutenait oui. Vous le saurez mieux. J’ai dîné seule ; après le dîner pluis allée faire ma cour aux Tuileries pour la fête du Roi, mais tout le monde était à Versailles. J’ai été chez Lady Granville que j’ai revue pour la première fois depuis la mort de lady Burlington. Granville est couché, il a la goutte, Ensuite je suis allée courir après les rossignols chez Mad. Locke. Vraiment ces Belgioioso, c’est charmant, et je vais partout où je puis les entendre. Au fond la passion de la musique me revient.
A propos la petite de Contades est fort éprise de l’un de ces rossignols, le plus gros. Elle est une petite personne un peu étrange. à onze heures j’étais dans mon lit, mais la chaleur m’ote le sommeil depuis quelques jours.
2 heures
Vraiment je suis bien fatiguée. Je vous écris, j’éris à mon fils, j’ai eu une longue séance avec votre petit ami. J’ai répondu à Alexandre ceci. " M. de Brünnow ne m’empichèra pas de faire ce qui me plait. Je ne reconnais ce droit à personne." Ma lettre adressée à Ashbrurnham house. Je vois que ceci figurerait mieux dans une lettre que vous porte Ellice. Mais elle est déjà fermée. Je viens de recevoir 357. Cela me servira jusqu’après demain. Si vous saviez l’horreur que j’ai du mardi ! J’ai envie de remplir toute cette page d’adieux. Vous seriez bien content de moi si vous saviez tout ce qui se passe en moi. Adieu. Adieu. Je viens de vous envoyer la lettre de Metternich par votre bureau. Adieu.
362. Paris, Lundi 4 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous envoie copie exacte d’une lettre de Lady Palmerston reçue hier. Je ne lui répondrai que vendredi. Assuré ment vous jugerez cette lettre comme je la juge. Lady Palmerston n’est pas assez fine ! Je ne me dérangerai. pas pour les sots, cela serait trop bête, et je prends acte de ce qu’elle serait très fâchée d’un retard. Mais voyez un peu toutes ces petites gens qui travaillent d’avance, et tout cela sans doute avec des protestations d’amitié et d’intéret pour moi. que j’aurais de choses éloquentes à vous dire sur tout ceci ; et des choses un peu orgueuilleuses. Il vaut bien la peine d’avoir de l’esprit si c’est pour se géner pour les sots. On marche dessus, on ne s’écarte pas pour eux. Tout ce que cela fera de plus, c’est de me faire rire, car leur inquiétude préparatoire est déjà fort drôle. Le reste de la lettre est pour me prier de mettre Thiers en garde contre Ellice ; dont elle me dit beaucoup de mal. En vérité tout cela sont de mauvais tripotages. Ellice est un très bon homme, quand nous en parlons Thiers et moi, c’est pour en dire tous les deux beaucoup de bien. Je garderai mon opinion de lui. C’est lui qui vous porte le présent n° et son annexe. Il sera à Londres, mercredi soir.
Tout le monde diplomatique même Granville a remarqué la hauteur et la froideur avec les quelles le Roi a traité Thiers à la cour le 1er de mai. Décidément le Château trâme contre lui, et ne prend pas la peine de cacher sa haine. Ellice pourra vous conter beaucoup de choses car il a vu Thiers tous les jours et Thiers lui dit tout. Sa situation me parait un vrai tour de force, combien cela pourra-t-il durer ainsi ?
Adieu. Je vous quitte pour vous reprendre sur une autre feuille. Adieu. Adieu.
Midi.
Voici que je reçois une lettre de mon fils Alexandre du 2 de Londres. "J’ai dîné chez Brünnow. Il était très curieux de savoir si votre projet de venir ici était sérieux. Il a fait une mine bien longue en recevant de moi. l’assurance que vous arriviez à Londres au commencement de juin. Il en avait déjà entretenu mon frère et lui en avait signalé tous les inconvénients. Il me parait très préoccupé." Eh bien que dites-vous de tout cela ? moi, voici ce que je dis je vais à Londres.
1 1/2
Génie sort de chez moi. Il m’a tout lu. J’approuve parfaitement. Il faut une énorme raison. Vous avez raison en tout. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Adieu. Adieu. J’ai souligné dans la copie les deux textes à traiter dans ma réponse.
364. Paris, Mardi 5 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je vous prie de me répondre sur le sujet des copies que je vous ai envoyées par Ellice. Je trouve cela parfaitement maladoit dans la forme et pitoyable pour le fond. Encore. une fois, soyez bien sûr que cela ne me dérangera pas, je serais même tentée d’ajouter au contraire, et s’il n’y avait du ridicule, je partirais plutot demain que dans un mois. Mais je vous prie de me parler de cela, je voudrais quelques bonnes petites phrases pour y répondre. J’ai encore vu Ellice hier longuement. J’ai fait ma promenade, mon dîner seule. Le soir les deux Pahlen, Arnim, les Durazzo, les Valambrozo, quelques autres. Mais savez-vous que tout ce monde m’occupe, vous ne savez pas comme le soir m’ennuie depuis le 24 février ! Mon fils me revient à la fin de la semaine et restera avec moi à peu près. jusqu’à mon départ.
1 heure
J’ai fait ma promenade et j’ai vu Chermside. Je suis mieux depuis qu’il m’a reprise. J’ai lu ce matin des vers charmants de Victor Hugo dans le feuilleton du journal des Débats, lisez cela. Il y a une strophe qui m’a beaucoup frappée surtout. Le dernier vers est je crois ceci.
Tout commence ici bas; et tout finit ailleurs.
Je ne vous ai pas assez dit combien je suis contente de ce que m’a montré Génie hier. Je suis contente du présent et contente de l’avenir. Vous avez mille fois raison. Que de choses à nous dire.
J’ai été dire adieu à mad. Talleyrand hier, elle part demain. Elle va droit à Berlin. se plonger dans les royautés Je crois qu’elle y trouvera l’Empératrice aussi. Le Roi de Hanovre m’a mandé que le roi de Prusse est faible et ne veut pas. bouger de Postdam. Toute la Prusse est convaincue qu’il doit mourir cette année. Il me semble que l’affaire Naples va bien, j’en suis charmée. Le temps est convert aujourd’hui. Je voudrais de la pluie, je me sens les poumons desséchés de cette chaleur. Adieu, j’ai écrit une longue lettre à Matonchewitz ce matin. il faut encore expédier le Hanôvre.
On dit que Brougham ne retournera pas en Angleterre, et qu’il ne peut pas y retourner. Adieu. Adieu. As much as you like.
359. Londres, Mardi 5 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
366. Paris, Jeudi 7 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10h 1/2
Lady Pembroke a passé ici quelque jours. Je l’ai vue tous les jours, c’est une de mes plus veilles connaissances. Elle est répartie ce matin, pour Londres. Je vous dis cela parce que je crois avoir oublie de vous la nommer dans mes lettres et Je vous dois compte de toutes les minuties.
J’ai été chez Lady Granville et la petite princesse hier. Lord Granville est toujours couché, je ne l’ai pas vu. M. Thiers va le voir tous les jours. Bulwer, est venu assister à mon dîner, il est un peu mieux, mais il marche toujours sur des béquilles. Le soir mon ambassadeur, le duc de Poix, Caraffa, Hatzfeld, les ducs Kielmansegge. Le Roi de Hanôvre m’écrit, et me demande des lettres.
M. de Pahlen revenait de la cour. Il avait trouvé le roi tout seul, qui l’a retenu pendant plus d’une heure. Point de nouvelles.
Midi.
Voici votre lettre à l’heure où je vous écris, vous avez reçu ce que je vous ai envoyé par Ellice et vous avez l’explication de la sollicitude de Lady Palmerston, et de l’incertitude titude sur Stafford house. Rien ne me serait plus déplaisant (à part vous) que de ne point aller en Angleterre après ce qu’on vient de m’écrire. Faire la volonté, la fantaisie de ces petite diplomate ! Voyez-vous cette idée m’irrite, et me ferait partir demain, comme je crois vous l’avoir déjà dit. Ainsi qu’on trâme pour que les Sutherland ne me reçoivent pas, cela m’est parfaitement indifférent. j’irai à l’auberge à Londres, hors de Londres. C’est égal. Je ne vois qu’une seule raison qui puisse me faire renoncer à y aller, une suule c’est si vous me priez de ne pas venir, si vous y voyez de l’inconvénient pour vous. Répondez- moi à cela. Je m’indigne quand je pense qu’une pitoyable intrigue, de pitoyables gens puissent contrarier une seule des fantaisies de deux êtres comme vous et moi et ici ce n’et pas une fantaisie c’est du bonheur, un immense bonheur ! Répondez-vite, il me semble que je ne puis pas douter de votre réponse. Envoyez regarder à Blackheath, c’est assez bien comme distance. Il ne reste aucun doute dans mon esprit sur l’auteur de toute cette intrigue pour m’empêcher de venir, relisez bien les paroles, que m’écrit alexandre, et voyez les dates. Sa lettre et celle de Lady Palmerston sont du même jour, le 1 mai. Je me trompe celle d’Alexandre est du 2. Son entretien avec Brünnow dont il me rend compte a eu lieu le 29. C’est Brünnow que mon arrivée dérange. C’est Brünnow qui remue tout pour l’empêcher. Ne vous trouveriez vous pas bien sot de faire la volonté de Brünnow.
Je cherche à comprendre, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Ce que je comprends bien moins est comment Lady Palmerston se laisse entraîner. Mais enfin n’y songeons plus. Je suis très résolue et j’irai à moins que vous me disiez non. Je vous prie de ne pas me dire non. Adieu. Adieu.
Il pleut, tout le monde en est réjoui. S’il pleut aussi longtemps qu’il a fait beau. Il y aura de quoi se pendre. Adieu. Adieu. Je suis impatient de votre réponse, Adieu. Kielmansegge disait hier avec autorité : "Il y aura la dissolution" d’un ton sans appel. Adieu.
Je viens de recopier ma lettre à Lady Palmerston afin de pouvoir vous envoyer la minute. Je l’ai écrite telle que vous voyez les corrections. Elle partira demain, elle ne la recevra donc que dimanche ou lundi matin. Vous l’aurez Samedi. Dites-moi si c’est bien. J’ai vouliu dire aussi la vérité sur Ellice, car je trouve qu’on est bien dur pour lui. Granville ne pense pas très bien.
Adieu encore car c’est par ce mot qu’il faut toujours finir. Adieu. Je n’ai pas voulu attendre votre réponse qui ne peut venir que samedi car au fond ce que je dis là, je l’aurais dit dans tous les cas. Adieu.
361. Londres, Jeudi 7 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous quitte pour aller déjeuner chez un chanoine de Westminster Abbey, avec Lord Mahon, Lord Littleton et M. Macaulay. Ils prennent plaisir à me montrer les tombeaux de leurs grands hommes et à m’en parler.
3 heures
Ellice sort d’ici, arrivé tout à l’heure. J’avais deviné juste. Il paraît qu’un grand Empire et trois royaumes ont peur que nous n’ayons, à nous deux, plus d’esprit qu’il ne leur faut. Je ne peux pas imaginer une autre raison.
Vous deviez venir ici bien avant qu’il fût question que j’y vinsse. Vous aviez amorcé votre voyage pour les premiers jours de juin. Vous ne l’avez pas avancé parce que je suis venu ; au contraire, vous le retardez plutôt de quelques jours. Je suis ici depuis trois mois. Ma position est prise avec tout le monde. Elle est aujourd’hui avec M. de Brünnow, ce qu’elle restera, parfaitement convenable, polie, régulière. Quelle différence y aura-t-il entre le mois de Juin et le mois de Juillet ? C’est puérile, si ce n’est pas fin. Et si c’est fin, ce n’est pas assez fin. Je dis donc comme vous, et j’espère que vous ferez comme vous dites. En vérité, les grandes entraves de la vie sont déja bien lourdes ; si on se charge encore des petites, il n’y a pas moyen.
Je viens de causer un moment avec Ellice ; bien court. Bülow est entré. Nous ous reprendrons. Certainement, il est très bon homme et très spirituel ; un peu affairé, un peu important, un peu remuant, comme les oisifs actifs. Mais on n’a qu’à ne pas se laisser faire par lui. J’admire toujours les gens qui ne veulent pas qu’on sente les mérites, et qu’on en profite, et qu’on en jouisse, parce qu’il y a quelques inconvénients dont il faut prendre la peine de se garder.
4 heures 1/4
Encore une interruption de M. Murray pour la cuisine de la Reine. On me porte une grande confiance, en ce genre. J’ai encore deux lettres à écrire. Adieu. Comme dans le 363 ; toute la page. Je suis charmé que vous approuviez ce que vous avez vu. J’y comptais. Mais j’ai bien peur que ma situation ne devienne pressante. Et je n’ai pas envie d’être pressé. Adieu. La page n’est pas pleine.
365. Paris, Mercredi 6 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Dieu merci le mardi est passé. Je le déteste. J’ai eu hier une longue visite de Montrond. Toujours la même chanson, l’amour du Roi pour M. Thiers. Il ne lasse pas, quoique de mon côté je ne me lasse pas non plus de lui dire que je n’en crois pas un mot. J’ai été au bois de Boulogne, mais le froid m’a saisi je suis revenue. J’ai été faire ma cour à Madame. Elle m’a reçue. Le roi y est venu. Il a beaucoup parlé, avec beaucoup d’esprit comme de coutume. Il a parlé de toutes choses, mais il n’a pas promoncé un nom propre. Je lui ai fait compliment sur sa prodigieuse fécondité dans ses réponses le 1er de mai. J’ai pris la liberte d’applaudir à ce qu’il a dit, et à ce qu’il n’a pas dit. Il a paru très sensible à cette dernièrs observation.
"J’ai eu ma satisfaction sur messieurs les députés, je suis charmé que vous l’ayiez remarqué.’ En parlant de toutes choses le seul individu désigné, quoique pas nommé a éte M. Molé. " Ces messieurs après avoir mis tout en œuvre pour tuer la loi de dotation, afin de tuer mon ministère arrivent deux heures après me faire visite et se confondre en regrets de ce qui venait d’arriver." !!
Il s’est dit content pour le moment. Je n’ai vu percer aucune amertume marquée, je n’ai point remarqué en lui l’énorme changement que signalent les diplomates. Il était in spririts, parfois très drôle, content de l’affaire de Naples, très décidé pour la paix de tous côtés, parlant très bien sur l’affaire de l’Orient, relevant avec satisfaction le beau Débat à la Chambre des Pairs, du raisonnement sur la direction des esprits en France. Voilà à peu près comme la demi-heure a été remplie.
J’ai fait une courte visite à Lady Granville. Son mari est souffrant et couché. J’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Appony, Brignoles, mon ambassadeur, Médem, Escham, Carreira, l’internonce, le duc de Noailles. Celui-ci raconte qu’il y a beaucoup d’intrigues ou du moins beaucoup de bavardages ; on fait de nouveaux ministères dont vous êtes, on clabaude. M. de Lamartine a des conciliabules chez lui. C’est le plus animé, et le moins compatible. M. Molé sent que lui, Molé, est hors de question mais il souffle pour qu’on renversa. Le parti conservateur est très raffermi. Le journal des Débats lui donne courage. Le journal des Débats ne serait pas si hostile au ministère, s’il n’avait de bonnes raisons de croire à sa chute prochaine. Voilà le rapport de M. de Noailles, qui finit toujours par "vive Thiers", car il a beaucoup de goût pour lui.
Appony venait de chez le roi. Il était de belle humeur. Le Roi va donner à dîner au corps diplomatique trois diners de suite. Mad. la duchesse d’Orléans tousse beaucoup ; elle est encore au lit. On prend beaucoup de précautions autour du roi qui n’a jamais eu la rougeole. Elle est très générale ici. J’attends votre lettre.
2 heures.
Je l’ai reçue pendant, ma toilette. Le dernier mot de votre speech à l’Académie est charmant. Je vous remercie de me l’avoir envoyé. Au fond vous avez raison d’avoir parlé avec un peu d’étendue surement on eut été désapointé du contraire. Le roi m’a fait des questions sur l’Angleterre, des questions générales sur la disposition des partis. J’ai écrit ce matin à Lady Palmerston, mais ma lettre ne partira que dans deux jours. Adieu. Adieu. Vous ne savez pas combien je pense à vous toujours. Adieu.
362. Londres, Vendredi 8 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai trouvé Ellice assez préoccupé de l’état des affaires à Paris et sans grande confiance, pour le Cabinet. Vous a-t-il tenu le même langage?
2 heures
Voilà le 365. Je suis convaincu que votre impression, sur le Roi est la vraie. Il échappe à la pénétration de vos diplomates. Il a des premiers mouvements très irréfléchis et des profondeurs, incommensurables qui les trompent également.
Ma réponse à vos copies vous sera arrivée trop tard à cause du retard d’Ellice. J’ai relu. Je me répète. C’est bien puérile ou bien maladroit. Je devrais dire et, non pas ou.
Que j’ai à vous dire sur les choses et sur les personnes! Quand vous le dirai-je? Lord Burlington, ne reste pas à Stafford-House. Il est reparti pour la campagne. Je ne vous réparle plus de Blackheath, ni de Norwood. La seule concession qu’il faille faire aux sots, c’est de ne rien faire que bien publiquement à leur barbe ; n’est-ce pas ? Vous devriez bien être déjà ici et m’indiquer quelque chose à envoyer à mes enfants. M. Lenormant part après demain. Je sais pour Guillaume.
Je lui enverrai une toque écossaise, vrai highlander, le bigarrage et la plume. Mais pour mes filles, je cherche sans succès. On donne trop aux enfants; ils ont de tout avant d’en jouir. Pourtant les miens ne sont point blasés, je vous en réponds ; le plus petit et le plus beau présent leur font le même plaisir et un plaisir très vif.
Mon dîner whig sera bien complet. Tout le monde accepte, même Lord Melbourne qui dîne peu en ville, et ne dînait à peu près jamais à Hertford-House. Puisque vous ne m’avez rien dit du dîner du 1er mai, c’est que rien ne vous est revenu, ni sur le cuisinier, ni sur le service.
On me répète que M. de Metternich a un dépit énorme de notre médiation à Naples. Est-ce pour quelque chose dans l’humeur d’Appony ? Je suis fort aise que cette médiation réussisse. Ce sont mes premières armes.
Les Ministres me paraissent ici assez préoccupés du bill de Lord Stanley et de leur budget. Ils ne finiront leur session que fort tard. La mort de ce pauvre Lord William Russel, leur fait perdre huit jours. On dit que Lord John est frappé du malheur des siens. C’est un excellent homme. Il vit beaucoup avec ses enfants et les élève en partie lui-même.
Adieu. La chaleur a cessé, mais la pluie n’est pas venue. Adieu Adieu.
360. Londres, Mercredi 6 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
savoir avec qui. J’étais dans mon lit à minuit et demi.
Lord Aberdeen a eu beaucoup de succès à la Chambre des Lords avec son bill sur l’Eglise d’Ecosse ; a very clever speech. J’en suis bien aise. Si nous vivions longtemps ensemble, vraiment de près nous finirions par de l’intimité. J’aime sa tristesse. Il se prépare à prendre le rôle du Duc de Wellington ; modérateur des Torys. Cela se voit. Il fait bien. Mais il n’empéchera pas une scission dans le parti. Là où elle est la déraison est bien profonde et bien hautaine. On entrevoit, contre Peel, une humeur immense, timide, mais courroucée de sa propre timidité. Le Duc seul contient.
3 heures et demie
Je viens s’apprendre qu’Alexandre a eu hier un accident, rien de grave, il est à merveille ; j’ai de ses nouvelles d’il y a deux heures. Il était en cabriolet; le cheval s’est emporté ; il est tombé. On l’a saigné ; il a parfaitement dormi cette
nuit ; il est fort bien aujourd’hui. Le chirurgien est pleinement rassurant. Dans deux ou trois jours, il n’y paraîtra plus. M. de Brünnow doit vous écrire aujourd’hui pour ne vous laisser aucune inquiétude.
Une horrible affaire s’est passée cetle nuit. Le vieux Lord Willian Russell a été assassiné dans sa maison, dans son lit, égorgé à la lettre, la tête presque tranchée. On a volé quelques bijoux, un peu d’argent. On suppose que ce sont des domestiques, des amants des house-maids. On ne sait encore rien de precis. Le débat sur le bill de Lord Stanley, qui devait avoir lieu ce soir est remis à causé de Lord John. La reine était charmante ce matin à son lever, parfaitement gracieuse et digne. Elle est un peu engraissée. Je lui ai présenté deux Français qui sont ravis de son air et de sa personne. Le lever n’était pas très nombreux. Le Prince de Casteleicala a la plus grossicre et la plus familière tournure provençale qui se puisse voir.
Je n’ai pas encore entendu parler d’Ellice. Je l’attends impatiemment. Que ne donnerais- je pas pour causer deux heures avec vous ! Eh bien en y pensant le plaisir de vous
voir surpasserait à tel point toute autre idée qu’il m’en distrairait absolument, & qu’il me faudrait plus de deux heures pour penser un peu à autre chose. Adieu. Je voudrais vous envoyer à propos de l’accident d’Alexandre, toute la sécurité qu’il y a lieu d’avoir. Adieu. Adieu.
369. Paris, Dimanche 10 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je suis comme hier, comme tous les jours, passés et futurs, j’attends votre lettre. Je suis moins inquiète mais j’ai toujours de l’anxiété pour mon fils, et je ne compte que sur vous.
Je me suis promenée seule, je n’ai vu le matin que le duc de Noailles, il avait eu un long entretien avec M. de Montalivet. M. de Montalivet veut que la proposition Remilly soit discutée, parce que repoussée ou adoptée, elle nécessitera une dissolution Et que le Roi ne la laissera jamais faire à Thiers. C’est donc le moyen le plus sûr, et le seul de se défaire de lui. Le duc de Noailles, a représenté le danger, il a dit tout ce qu’il est raisonnable de dire et de penser, il a fait quelque effet mais il croit le projet très arrêté dans certaines têtes. M. Molé qui est venu hier soir, n’a par l’air aussi sur que la discussion s’engage. Il croit que le ministre, parviendra à faire trainer le rapport ou à ajourner la discussion. J’ai eu de plus que lui, Appony et M. de Pahlen, quelques femmes. Je suis triste, malade J’avais tout le jour hier une migraine à pleurer. Je ne me suis endormie qu’à 3 heures du matin. J’ai été très ébranlée par cette nouvelle avant-hier Le temps est au froid. J’en suis bien aise, cela me va mieux.
Midi
Je viens de faire une vilaine chute dans ma chambre, en m’appuyant conte le dossier d’une chaise. le dossier est parti. je suis tombée rudemen à la renverse. Je viens d’envoyer chercher un chirurgien. Votre lettre m’arrive, Dieu merci vous me rassurez tout-à-fait sur mon fils. Ne croyez jamais que j’aille voir Melle Dejazet. Je n’aime pas le mauvais goût, vous avez bien fait de ne pas croire. Jamais. Jamais. Ellice pensait mal du ministère ici. Adieu ma tête me fait mal, adieu, adieu.