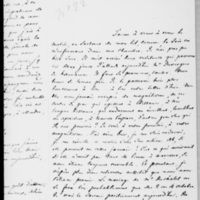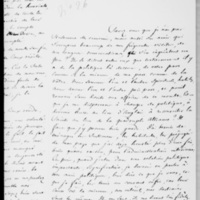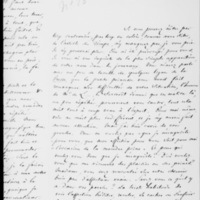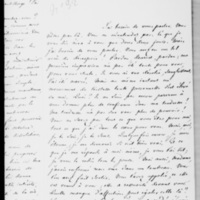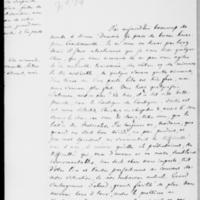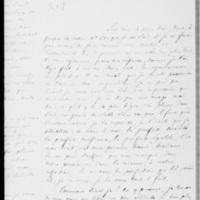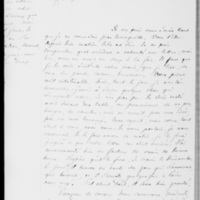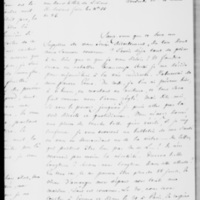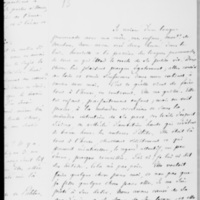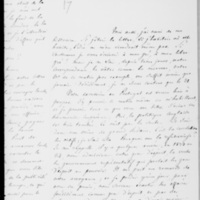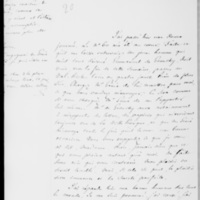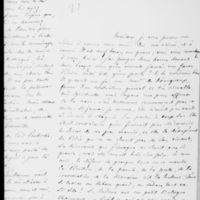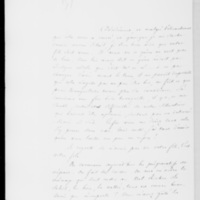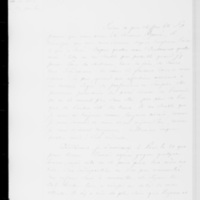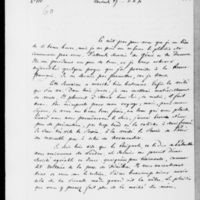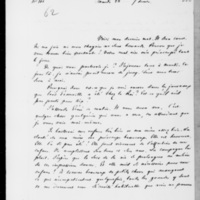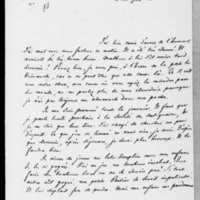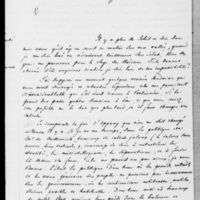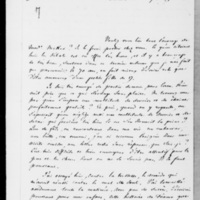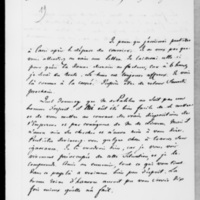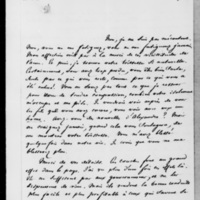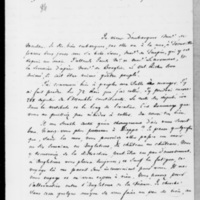Votre recherche dans le corpus : 5770 résultats dans 5770 notices du site.
42. Val-Richer, Jeudi 21 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime à venir à vous le matin, en sortant de mon lit comme le soir en m’enfermant dans ma chambre. Je n’ai pas pu hier soir. Il m’est arrivé deux visiteurs qui passeront ici deux jours. J’attends aujourd’hui M. Duvergier de Hauranne. Il faut se promener, causer. Mon temps se trouve pris. Je le passerais bien plus doucement à lire, à lire votre lettre d’hier. Vous êtes-vous jamais occupée de magnétisme, de ces contes de gens qui agissent à distance, à très longue distance, qui endorment ou éveillent, troublent ou apaisent à travers l’espace, d’autres gens sur qui ils ont pouvoir ? Je crois à votre pouvoir, à votre magnétisme. J’ai vécu hier, je me suis endormi, je me réveille ce matin sous son action. Ah si elle pouvait ne cesser jamais ! C’est ce qui arriverait si elle n’avait pas tant de lieues à traverser, si nous étions toujours ensemble. Et pourtant, je n’espère plus vous retrouver aussitôt que nous nous l’étions promis. Le mariage de M. Duchâtel ne se fera très probablement que du 2 au 4 octobre. Je vais le savoir positivement aujourd’hui.
De plus le mouvement électoral s’anime dans le pays. On vient, de tous les environs, m’en parler, me demander conseil, chercher une direction, une impulsion. J’agis d’ici, par la conversation, par les visites que je reçois, par quelques courses que je ferai, sur toute la Normandie, c’est à dire sur l’élection de 40 députés. C’est une grande affaire. Il faut que je la mette en bon train. La présence réelle, nous le savons trop, ne peut être remplacée. Pour moi-même, j’ai du monde à recevoir, à aller voir. Mon élection est plus sûre qu’aucune autre. Aucun concurrent ne se présente, ne s’annonce. Cependant je ne serais pas surpris, à quelques petits symptômes bien cachés, bien honteux que vers les derniers jours en ameutant les républicains, les carlistes violents, quelques indices, quelques grognons, on fit une tentative, non pour m’empêcher d’être élu on n’y pense pas, mais pour m’enlever quelques voix et rendre mon élection moins brillante en lui donnant quelque apparence de contestation. Il faut que je déjoue d’avance cette malice. Si elle doit se produire. Et pour cela, j’ai besoin précisément au moment où la fièvre électorale se prononce, où les hommes se rallient et s’engagent d’être sur les lieux de voir, de causer, d’animer tous les miens d’affermir les flottants.
Il y a un canton important, car il contient près de 100 électeurs dans lequel je n’ai jamais mis le pied. Je veux y aller un de ces jours. Je crois à peu de pouvoir réel, mais à beaucoup de mauvais vouloir soufflant contre moi d’un certain point, qui n’est pas un des points cardinaux, quoiqu’il en ait l’air. Il faut que j’agisse au grand jour, pendant qu’on travaille sous terre, que je sois aigle pendant qu’on est taupe. Est- ce là de l’orgueil ou de la prudence, dites, le moi? Tous les deux probablement.
Orgueil ou prudence, dearest, cela me coûte cher, et j’ai là, pour ce moment un cruel sacrifice à faire. Le saurez-vous, le croirez-vous tout ce qu’il est ? C’est ma plus vraie, ma plus triste préoccupation. Oui, si j’étais sûr que notre réunion retardée excite en vous les mêmes sentiments, tous les mêmes sentiments qu’en moi, et point d’autres; si j’étais sûr qu’il ne vous vient aucune de ces mauvaises pensées qui me désolent, et comme injustice et comme preuve que vous ne me connaissez pas encore ; si je pouvais vous faire voir, parfaitement voir mon âme, toute mon âme, comme je vous ai fait voir avant-hier une de mes journées, et dissiper ainsi, dissiper sans retour les doutes coupables de la vôtre, à cette condition là, je n’aurais pas moins de chagrin, mais j’aurais un meilleur chagrin, un chagrin parfaitement confiant en vous, sympathique avec vous, et je ne vous parlerais que de notre chagrin. Si vous saviez qu’elle est à ce moment même en vous écrivant, mon impatience de tout ce que je vous dis là, combien, au fond de mon cœur, je me sens étonné, blessé, pour vous et pour moi de vous le dire, de pouvoir croire que j’aie à vous le dire !
Dearest, que la confiance égale la tendresse, que toutes paroles autres que des paroles de tendresse soient inutiles et ne puissent plus nous venir à la pensée ! Il en sera ainsi un jour ; j’y compte. Vous savez que je vous ai ajournée à un an à deux ans à l’époque qui vous voudriez. Que mon ajournement soit sans objet; épargnons-nous l’épreuve du temps ; soyons, dès aujourd’hui aussi surs l’un de l’autre, aussi établis dans notre foi mutuelle, que nous le serions après l’avoir subie. La vie est si courte ! N’en employons rien à essayer, à attendre ; C’est perdre du bonheur pour rien.
10h 1/2
Voilà le N° 43, que j’aime bien quoique j’aime mieux le n° 42. Oui, nous sommes bien loin. Mais vous m’avez envoyé votre Soleil, hier et aujourd’hui, il est très beau. Le petit tableau est de 1835. Gardons notre goût pour Adieu. C’est un goût d’absent mais, dans l’absence, c’est ce qu’il y a de mieux. Adieu donc Adieu, faute de mieux. G.
43. Val-Richer, Vendredi 22 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me réveille bien triste. Je l’étais hier au soir. Je le serai souvent. Hier en vous écrivant, j’étais surtout préoccupé d’une injustice possible de votre part. Aujourd’hui, je le suis bien plus du chagrin même. M. Duvergnier de Hauranne est arrivé. M. Duchâtel ne se marie que le 2 octobre et il se marie sans mariage, absolument sans personne que les parents et les témoins nécessaires. En sortant de l’église, il va passer quelques jours à Meudon, et de là, il part pour Mirembeau, en Saintonge où est sa terre.
Je n’ai donc là, ni motif, ni prétexte. J’en attends un autre. Vous recevrez cette lettre-ci dimanche. Vous attendiez mieux le jour là. Quand vous me partez de vos longues journées, de votre impatience de les voir couler, j’éprouve un sentiment analogue à celui que j’éprouve quand vous m’écriviez d’Angleterre vos inquiétudes, vos douleurs de n’avoir pas de lettre. Pardonnez-moi encore, Madame ; ma première impression est une joie profonde de cette tendresse si vive. La peine ne vient qu’après. Je jouis pour moi avant de souffrir pour vous. Quand vous étiez en Angleterre, quand vos lettres m’arrivaient exactement, et non pas les miennes à vous, je souffrais pour vous. Aujourd’hui, quand je ne pars pas, c’est pour vous et pour moi j’aime mieux dire pour nous, que je souffre.
Quand viendra, la dissolution ? J’établis autour de moi, dans la conversation, qu’elle n’obligera probablement d’aller passer trois au quatre jours à Paris. Mais nous sommes à la merci de l’événement, à la merci des nécessités électorales du pays qui m’entoure. Que de chaines nous portons. J’en ai secoué beaucoup. Il en reste encore énormément.
J’ai ma mère souffrante ce matin. Elle est sujette à des étourdissements, à des vertiges qui pourraient devenir quelque chose de plus grave. On est venu m’avertir au moment où je me levais. Je sors de chez elle. Elle vient de prendre un bain de pieds avec beaucoup de moutarde. Elle est mieux. J’espère que ce ne sera rien du tout. Je lui ai vu plusieurs fois ces petits accidents, et ils ont toujours disparu devant des remèdes, fort simples Mais elle va avoir 73 ans. J’aime beaucoup ma mère. Je lui dois beaucoup. Et personne ne la remplacerait auprès de mes enfants. Elle est avec eux d’une tendresse, d’une assiduité, d’une vigilance inquiète qui fait presque tout ce qui me reste de sécurité. Quand j’avais mon fils, ma sécurité était infiniment plus grande. Tout homme et tout jeune qu’il était, j’étais sur qu’à mon défaut il soignerait, il élèverait ses sœurs et son fière avec une affection, une attention paternelle. Et il était plein d’esprit, de sens, d’activité sérieuse, de tout ce qui fait qu’on peut être à la tête d’une famille. Aujourd’hui moi manquant ma famille, si jeune, resterait comme un faisceau sans lin, un troupeau sans berger. C’est une forte attache que de se sentir nécessaire. Mais c’est aussi un pesant fardeau.
Je vous parle de ma famille. Ne vous arrive-t-il pas quelques fois d’être dans cette disposition où l’on n’ose pas, où l’on ne veut pas ne [?] que sur un seul sujet, sur le sujet intime qui remplit l’âme, et où cependant l’on ne pourrait souffrir de parler de choses indifférentes ? On va alors à ces choses qui sont beaucoup quoiqu’elles ne soient pas tout, à ces intérêts qui tiennent vraiment au cœur quoiqu’ils n’en occupent pas le fond. Ce n’est pas l’intimité personnelle exclusive, c’est encore de l’intimité et qui a quelque douceur.
11 heures
Votre n° 44 m’arrive une demi heure plus tard que de coutume. C’est long, une demi-heure ! Mais le dédommagement est immense, charmant. Ne me gâtez pas trop. J’ai tant de plaisir à croire tout ce que vous me dîtes ! Nous avons besoin pourtant de nous gâter l’un l’autre jusqu’à ce que nous nous retrouvions. Ah, que je voudrais trouver quelque parole qui vous apportât ce que j’ai dans l’âme ! Adieu. Adieu, un adieu triste est au moins aussi tendre qu’un adieu. satisfait. Adieu. G.
44. Val-Richer, Vendredi 22 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Savez-vous que je n’ai pas seulement des ennemis, mais aussi des amis qui s’occupent beaucoup de mes fréquentes visites, de nos longues conversations, et qui s’en inquiètent un peu ! Ils se disent entre eux que certainement il y a de la politique là dessous, de votre part, comme de la mienne, de ma part comme de la vôtre. Nous sommes l’un et l’autre spirituels, habiles ; nous avons l’un et l’autre pris part, et point renoncé sans doute aux affaires de ce monde. Est-ce que je me disposerais à changer de politique à devenir russe au lieu d’anglais à ressusciter la sainte au lieu de la quadruple Alliance ?
Il faut que j’y prenne bien garde. J’ai besoin de ménager les sentiments, les habitudes, les préjugés de mon pays que j’ai déjà heurtés plus d’une fois, bien qu’avec raison, pour l’administration intérieure. Et puis, quand j’entre dans une relation politique importante, significative, je devrais en parler à mes amis politiques, leur dire ce que je veux, ce que je fais, les tenir au courant enfin, car leur cause est la mienne ; nos intérêts, nos destinées sont les mêmes. Ils me sont ; ils me seront très fidèles. Ils voudraient bien être toujours instruits. Cela se dit très doucement très affectueusement. Cela me revient indirectement. J’y réponds et j’y répondrai très simplement souriant un peu, disant de vous un peu de ce que j’en pense, rassurant mes amis sur la fixité de ma politique comme sur l’étendue de ma confiance en eux et gardant bien du reste ma liberté, que je n’ai jamais livrée. J’admire toujours à quel point les hommes, même des hommes distingués, prônent le côté petit et tortueux des choses, au lieu du côté simple et grand et à force de chercher finesse, s’en vont à cent lieues de la vérité.
Samedi matin, 6 heures
Je me lève. Voilà une heure et demie que j’essaie en vain de me rendormir. On dit que la faim empêche de dormir. J’ai faim. Vous me parlez du bonheur qui me reste et m’entoure. Vous me dîtes que j’en sais jouir. Vous avez raison. Je n’ai jamais dans mes plus cruels moments, méconnu le prix de ce qui me restait. Je ne m’y suis jamais senti indifférent. Je ne me suis jamais permis de me dire à moi-même que j’y pouvais être indifférant. Je me serais cru coupable envers Dieu, plus coupable envers ces créatures qui m’aiment, m’aiment beaucoup, & qui ont droit non seulement que je les aime, mais que je me trouve heureux de ce quelles m’aiment. L’affection veut donner du bonheur, et souffre et s’offense quand elle n’en donne pas. Je sais tout cela. Bien plus, je le sens ; et naturellement, sans effort, je jouis en effet de l’affection de mes enfants, de ma mère, de mes amis ; et je leur montre que j’en jouis, et j’espère qu’ils le croient, j’en suis sûr.
Mais laissez- moi, Madame, être avec vous parfaitement sincère, c’est-à-dire vous montrer toute mon âme. C’est en cela, pour moi, que la parfaite, sincérité consiste. Aux autres, je ne mens point, mais je ne dis pas tout. Ces relations, ces affections, ces joies qui me restent, en même temps que je les ai toujours senties, je ne me suis jamais donné, je n’ai jamais pu me donner le change à moi-même sur leur importance pour moi, sur leur place en moi. Je ne voudrais pas même en vous parlant à vous seule, même avec la certitude que nul autre ne verra jamais ce que je vous dis, je ne voudrais pas dire un mot qui fût injuste qui fût offensant pour ces sentiments et ces bonheurs là. Mais il ne leur est pas donné de pénétrer jusqu’au fond de mon âme, de remplir ma vie, d’être mon âme et ma vie. Ils animent, ils embellissent la région où ils se passent, mais cette région est pour moi celle du monde extérieur et non pas la mienne propre ; c’est une région où je me promène, et non pas cette où j’habite.
Voltaire fait quelque part dans La Henriade, je crois la description du système céleste, de toutes les planètes, de tous les astres, de leur hiérarchie, de leur immensité. Il les nomme, il les compte, les compte encore ne parvint pas à les épuiser. Au dessus, au delà de ceux qu’il a nommés, qu’il a comptés.
Sont des soleils sans nombre et des mondes sans fin.
Par delà tous les lieux, le Dieu des lieux réside.
Pardonnez-moi la pompe de cette image. C’est la seule où je reconnaisse vraiment la disposition de mon âme, et ce qui s’y passe. On peut me parler d’une foule de liens, d’affections, de jouissances ; on peut en décrire la force et la douceur. Je le reconnaîtrai, je le sentirai avec ceux qui le diront. Mais par delà tous ces lieux, le Dieu des lieux réside. Et ce n’est point là pour moi, Madame une volonté un parti pris, pas plus qu’une impression de jeunesse une fantaisie d’imagination. C’est le fait, le fait pur et simple, le fait constant pour moi, en moi soit que je l’ai possédé, soit qu’il m’aie manqué un seul sentiment, un seul bonheur, a toujours été pour moi le Dieu des lieux. Je vous le disais avant le 15 Juin, et vous ne vouliez pas me croire. Je vous le redis aujourd’hui. Croyez-moi ; et ne me parlez d’aucune compensation ; et gardons ensemble nos regrets, nos regrets justes & sacrés. Et soyez bien sûre que je sens comme vous les vôtres ; bien sûre que je donnerais je ne sais pas quoi pour vous voir entourée des joies qui me restent. Mais ne mettons rien, joies ou regrets, à côté de ce qui est au delà, et au dessus de tout. Ah, que ne passons-nous notre vie ensemble ! Ce que je vous dis là, je vous le ferai voir.
4 heures Votre lettre m’arrive tard. J’ai là M. Duvergier de Hauranne, dans mon cabinet. La cloche du déjeuner sonne. J’aurais tant de choses à vous dire ! Une seule, une seule aujourd’hui. Au nom de Dieu, ne soyez pas malade. J’ai besoin de votre santé comme de... Adieu. Adieu. Un adieu sans pareil, si cela se peut. G.
Ma mère est un peu mieux ce matin.
45.Val-Richer, Samedi 23 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
46. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est à peine six heures. Le Soleil n’est pas encore au dessus de l’horizon. J’ai mal dormi. Je me lève. Hier en me couchant, à 10 heures et demie, je me suis figuré dans la malle-poste au lieu de mon lit courant vers vous. A peine endormi, j’ai rêvé dans la malle-poste. A quatre heures, je me suis réveillé comme si j’arrivais. Ce devait être aujourd’hui en effet. Vous en avez douté quand je vous l’ai dit. Vous avez prévu que ce ne serait pas. Dearest, voici l’exacte vérité. Je n’en étais pas sûr. Le jour du mariage de M. Duchâtel n’était pas absolument fixé. Il m’avait parlé du 25 septembre au 2 ou 3 octobre. J’ai été faible pour moi, faible pour vous. J’ai pris la supposition favorable sans y compter, pour nous faire plaisir à tous deux, pour ne pas nous donner tout à coup, à vous un chagrin, à moi le vôtre, et le mien. J’ai eu tort. On a toujours tort, avec la personne à qui l’on dit tout, à qui l’on doit tout, de ne pas dire exactement ce qui est ce qu’on croit. Il faudrait toujours braver la peine du moment pour éviter la peine à venir. Pardonnez- moi de ne l’avoir pas fait.
Votre n°46 m’a touché, et me touche profondément ; si triste et si douce ! Si vive et si raisonnable ! Le jour où j’ai un peu causé avec la petite Princesse elle m’a dit deux ou trois fois, en me parlant de vous : « une personne si supérieure, si extraordinaire". A chaque fois ces paroles me pénétraient, me charmaient ; d’orgueil si on veut, mais de ce délicieux orgueil qui naît d’une tendresse infinie, au dessus, bien au dessus duquel cette tendresse plane, dont elle fait le pouvoir et le prix.
Oui, je suis fier, fier de vous, de votre affection pour moi de votre supériorité, de cette supériorité que je connais mille fois mieux que personne dont je jouis comme personne n’en a jamais joui. Et quand je la retrouve dans les plus petits détails de la vie, quand je vois réunies en vous les qualités, les attraits les plus contraires, tant d’abandon et tant de dignité, un cœur si tendre et un esprit si ferme, une imagination si vive et une raison si droite, un caractère si passionné et si doux, une humeur si égale avec des impressions si variées, je suis heureux, heureux, Madame, bien, bien au delà de tout ce que peuvent vous exprimer de loin mes lettres, et même mes adieux.
Maintenant, voici où j’en suis et ce qui sera. Le mariage de M. Duchâtel n’étant plus rien pour moi j’ai pris la dissolution. Elle sera certainement prononcée et publique dans les premiers jours d’Octobre au plus tard. J’ai un dîner chez moi au Val-Richer, demain 26. Après-demain 27 je vais dîner à Croissanville, à 4 lieues d’ici, avec une réunion d’électeurs. Du 27 au 2 octobre, je ferai quelques courses dans l’intérêt des élections voisines. Je recevrai beaucoup de visites. Le 3 octobre encore un dîner pour moi, et une réunion d’électeurs à Mézidon, dans ce canton que je n’ai jamais visité. Le 4 un dîner à Lisieux, point un meeting, un dîner privé, mais avec beaucoup d’électeurs. Le 5 à 1 heure et demie je monte dans la malle-poste, et le 6 à 4 heures du matin, je passe dans la rue de Rivoli, pour faire le même jour, à une heure & demie quelque chose de mieux que d’y passer.
Voilà, d’ici là ma biographie et mon itinéraire. C’est long, bien long. Je ne demande qu’une chose, dearest, une seule chose. Soyez sûre, sûre aujourd’hui comme vous le serez dans deux ans, dans trois ans, que c’est aussi long pour moi que pour vous. Ne dites donc pas que vous me contez trop de petites choses, que vous me donnez trop de détails. Jamais assez. Au milieu du grand bonheur, c’est mon petit, mais très vif plaisir de vous suivre pas à pas dans tout le cours de la journée, d’assister à toutes vos actions, d’heure en heure. Il y en a une que je regrette, qui m’a un peu désagréablement ému le cœur. Vendredi soir vous avez fait de la musique devant votre monde ; et moi, je ne vous ai pas encore entendue. Je ne veux pas, la première fois, vous entendre devant du monde ; mais je voulais avoir votre première musique, à moi seul. Vous ne savez pas à quel point la musique me plaît, m’émeut. Mais c’est pour moi une impression très intime, et qui se lie tout de suite à mes impressions les plus intimes, une de ces impressions dont je n’aime pas à parler excepté à la personne à qui je parle de tout. Je vous aurais si délicieusement écoutée !
J’attends ce matin, M. de Saint-Priest, Alexis, qui vient passer ici 24 heures. Il m’en dira long sur Lisbonne, les Chartistes, Lord Howard de Walden, Saldanha, Sä de Bandeira & & J’ai recommencé hier au soir à lire à mes enfants un romans de Walter Scott. Je vous le dis pour vous montrer que j’ai complètement repris l’usage de ma gorge. Je suis ravi que vous ayez aussi bien retrouvé celui de vos jambes, Certainement c’est une preuve de force.
11 heures Le N° 47 me désole de mille façons, toutes si douloureuses. M. de L., votre chagrin, votre manque de foi, votre santé. Mes lettres suivantes vous auront été un peu meilleures. Celle-ci vous donne une certitude, de voyage, de jour. Si vous saviez que je n’ai pas pensé, que je ne pense pas à autre chose. Croyez-vous donc que je n’ai pas pensé à emmener ma mère à Paris ? Mais elle est mieux et se trouve bien ici. Je vous répondrai demain avec détail. Adieu. Adieu. Soignez-vous, je vous en conjure. Adieu. G.
47. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai besoin de vous parler. Vous n’êtes pas là. Vous ne m’entendez pas. Ce que je vous dis n’ira à vous que dans deux jours. Mais j’ai besoin de vous parler. Vous avez eu un tel accès de désespoir ! Pardon dearest, pardon ; ma première impression n’a pas été toute pour vous, pour vous seule. Je vous ai vue désolée, sanglotant. J’ai été navré. Mais au même instant un mouvement de tristesse toute personnelle s’est élevé en moi. Quoi ? Je ne suis pas encore parvenu à vous donner plus de confiance dans ma tendresse ! Ma tendresse n’a pas sur vous plus de pouvoir ! Vous ne savez pas tout ce que vous êtes pour moi, tout ce que j’ai dans le cœur pour vous. Mais moi je le sais ; je le sens. Quelque fois encore, je m’en étonne ; je me demande si c’est bien vrai. Et ce que je me réponds à moi-même, je vous l’ai dit ; je vous le redis tous les jours. Moi aussi, Madame, j’avais enfermé mon âme dans un tombeau. Vous l’en avez fait sortir. Vous l’avez appelée, et elle est venue à vous ; elle a ressuscité devant vous. Quelle marque d’affection peut égaler celle-là ? Savez-vous quel bonheur j’avais possédé, j’avais perdu ? Savez-vous que si l’on m’eût dit : - Il y a sur la terre une créature, qui peut vous rendre une heure de ce bonheur - j’aurais souri, avec le plus incrédule dédain ? Et que, si l’on m’eût dit aussi : - cherchez dans le monde entier une épingle perdue, si vous la trouvez, vous retrouverez une heure de votre bonheur je serais parti, à l’instant même ; j’aurais cherché toute ma vie pour courir après cette imperceptible chance ? Voilà où j’en étais Madame, avant le 15 Juin. Voilà quel chemin j’ai eu à faire pour arriver à vous, pour vous dire ce que je vous dis aujourd’hui. Est-ce assez pour que j’aie sur vous la puissance d’écarter le désespoir, d’arrêter les sanglots ? Est-ce assez pour que vous ayez foi, en moi ? Et vous croyez que je ne supporterais pas vos sanglots !
Je supporterais tout, tout, Madame pour combattre, pour adoucir un moment votre peine. J’ai bien supporté de voir mourir, mourir lentement les créatures que j’aimais le mieux au monde ; je n’ai pas cessé un instant de les regarder, de leur parler pour que le sentiment de ma tendresse se mêlât à leur angoisse, à leur dernier souffle et qu’elles l’emportassent en me quittant. Et ce qui m’a donné, ce qui je crois me donnerait encore ce courage, c’est que j’ai, de la puissance d’une affection vraie et des souveraines douceurs qui y sont attachées, une si haute idée qu’il me semble que le plus grand bien qu’on puisse faire à une créature désolée à une créature qui souffre, c’est de lui répéter sans cesse. Je l’aime ! Je l’aime ! Pour moi, je ne connais point de douleurs que ces mots d’une bouche chérie n’aient la vertu de calmer.
Mardi 7 h. 1/2 Je ne comprends guère comment, dès le 5 sept., aucun commérage aurait pu parvenir à Carlsbad. Il faudrait qu’on sy fût pris de bien bonne heure. Du reste, je crois à beaucoup de malice et de trahison possible. Les passages que vous me transcrivez me tourmentent beaucoup. Il faut attendre l’effet du comte Orloff. C’est sur cela que vous comptez, que nous comptons une chose me déplaît extrêmement dans tout ceci, c’est de ne pouvoir me faire une idée du pays,des mœurs, de l’état social, des caractères qui le rendent possible. Je me rappelle l’indignation où nous étions de ce que l’Empereur Napoléon ne voulait pas souffrir que Mad. de Stael habitât Paris. Et pourtant quelle différence ! Il y avait pour lui un motif, un motif, sérieux.
La conversation, le salon de Madame de Stael auraient été pour lui un véritable embarras. Mais ici, quel intérêt peut-on avoir à vous faire sortir de France ? Quel inconvénient entraîne votre séjour ? Une pure fantaisie. Cela déplaît. Vous ne faites pas tout ce qui plait. Quel misérable et terrible enfantillage ! J’ai bien envie de crier : vive la Charte !
Je reviens à M. de Lieven. Que lui répondez-vous ? Vous avez, avec lui, comme avec l’Empereur, comme avec tout votre monde, une situation faite, déterminée. Vous vous y êtes bien positivement établie et dans vos entretiens de Londres avec le comte Orloff et dans les lettres à lui et à M. de Lieven que vous m’avez montrées. Vous devez, ce me semble vous y maintenir tout simplement. Les hésitations, les agitations, même purement apparentes de langage seulement rendent tout beaucoup plus difficile. Une résolution simple. claire, clairement exprimée et tranquillement maintenue, coupe court à beaucoup d’embarras, non seulement au fond, mais dans la forme. Car je ne mets pas le fond en doute ; c’est de la forme et des embarras extérieurs qu’il s’agit. C’est à cela qu’il faut pourvoir. Nous en causerons bien complètement le 6 octobre. J’attends de jour en jour l’ordonnance de dissolution.
Ma mère est beaucoup mieux. A moins de nouvel accident, je ne puis penser à lui proposer de revenir plutôt à Paris. Elle se trouve bien ici. Ma mère est à l’age où l’on a un égal besoin de distraction et de repos. La campagne lui donne l’un et l’autre. Il y a une foule de petits intérêts, de petits soins qui l’amusent; et l’égalité de la vie, le silence de l’atmosphère, la paix de tous les aspects qui l’environnent lui assurent cette espèce de quiétude morale qui dépend, pour les vieillards des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés. Si l’indisposition de ma mère reparaissait un peu sérieusement je n’hésiterais cependant pas à la ramener tout de suite à Paris. Mais comme elle en serait, fort contrariée, il y faut une vraie nécessité.
11 heures Voilà le N° 48. Qu’il est triste et si bon, si doux ! Je me console un peu en pensant que vous serez, que vous êtes déjà, un peu consolée. Vous avez une date. Nous avons une date. Il y a encore dans ce n°48, une bien mauvaise, une bien coupable parole. Je n’y reviens pas aujourd’hui. Mais j’y reviendrai. Dearest, ne me mettez rien sur le cœur. Il y a tant de choses dedans ! et toutes pour vous ! Adieu. Adieu. Adieu me plaît, mais ne me suffit pas. G.
48. Val-Richer, Mardi 26 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai aujourd’hui beaucoup de monde à dîner. Demain, je pars de bonne heure pour Croissanville. Je ne vous en dirai pas long. Mais il faut absolument que je vous dise quelque chose, que je vous remercie de ne pas vous agiter de ces misérables tracasseries, des vôtres et des miennes. Je dis misérables de quelque source quelles viennent, d’un trône ou d’un parti. Cela est bien fort ; mais nous sommes plus forts. Vous lisez quelquefois Salomon n’est-ce pas ? Eh bien il a dit cette belle parole, dans le Cantique des cantiques. Fortis est ut mors dilectio. Cherchez au chapitre 8, verset 6. Vous verrez le sens car vous ne savez, dites-vous, que le latin, des Protocoles.
J’ai toujours vu Madame, que quand on était bien décidé, un peu prudent et pas mal spirituel, on surmontait les difficultés une à une à mesure qu’elles se présentaient, des difficultés qui, vues d’avance et en masse, semblent insurmontables. Une seule chose nous importe, c’est d’être l’un et l’autre parfaitement au courant de notre situation, de nos embarras mutuels. Grand soulagement d’abord, grande facilité de plus. Nous unirons tour à tour, contre le problème ou l’embarras du moment nos deux esprits et nos deux volontés. Nous en viendrons à bout, je vous en réponds. J’avais bien un peu prévu ceux qui m’arriveraient du côté de mes amis, mais prévu comme on prévoit, c’est-à-dire vaguement et dans un lointain auquel en regarde à peine. Je suis bien aise de les avoir vus de plus près, et charmé de vous en avoir parlé. Je ne m’en inquiète pas le moins du monde ; bien moins que vous ne devez que nous ne devons nous inquiéter des vôtres. Avec quelques soins, de bonnes conversations, la vérité et la tribune, je dissiperai aisément ces nuages d’intérieur. Ceux de votre horizon à vous, sont plus noirs et plus pesamment chargés. Il faudra que nous y regardions sans cesse que nous nous appliquions, à démêler de loin, à déjouer d’avance les méchancetés, les mensonges. Il y en aura beaucoup. Je vois d’ici comment on les invente, comment on les met en circulation. Je connais ce monde là. Mais, je vous le répète, nous les démêlerons, nous les déjouerons. Ce que je ne connais pas, et à quoi je ne puis pas grand chose, c’est ce qui vient de chez vous ! Vous en serez chargée. Cependant, je vous y aiderai, soyez en sûre. Je vous rendrai, même là, le succès plus facile. Je savais tout ce que vous me dites de votre situation là. Il faut que vous la conserviez cette situation, là et en Europe. Ce n’est pas votre situation, je n’ai pas besoin de vous le dire, qui m’a attiré vers vous, qui m’a attaché à vous. Mais il me plaît que vous l’ayez ; il me plaît qu’elle soit grande, très grande. Il n’y a rien de trop grand pour vous, rien de trop grand selon votre nature et selon mon cœur. Il faut que tout le monde vous voie haut et compte avec vous. Vous serez toujours au dessus de toutes les grandeurs.
Du temps, Madame, du temps et nous : nous arrangerons tout cela. Jamais parfaitement, jamais à notre pleine satisfaction ; jamais assez pour que les ennuis et la nécessité d’y prendre du soin ne recommencent pas sans cesse; c’est la condition de ce monde ; mais assez pour que notre intérêt à nous, notre intérêt si doux et si cher soit assuré et que personne n’ait le pouvoir de nous y déranger.
Mercredi 7 heures
Je partirai, tout à l’heure. J’espère cependant avoir votre lettre auparavant, Un de mes amis de Lisieux, qui vient avec moi à Croissanville, m’a promis de m’apporter ici mon courrier de très bonne heure. Je reviendrai ici ce soir. Oui j’aurais été très étonné de trouver votre salon arrangé comme vous me le dîtes. Peut-être un petit mouvement ... Comment dirai-je ? Je ne sais pas trop je ne me soucie pas d’appeler cela par son nom ...un petit mouvement d’autre chose, se serait mêlé à la surprise. Cependant, dearest continuez, quittez votre place, faites de la musique, cherchez et trouvez un peu de distraction, vous en avez besoin pour votre santé, pour le repos de votre esprit. Je veux que vous en ayez, seulement, quand vous êtes à votre piano, continuez aussi de regarder à la porte pour voir si j’entre.
9 h. 1/2 Je suis obligé de partir sans avoir votre lettre. Cela m’ennuie. J’espère qu’on me l’apportera directement à Croissanville. Adieu donc, cet adieu éternel. Plût à Dieu qu’il fût éternel, mais non pas de loin ! G.
49. Val-Richer, Jeudi 28 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis rentré tard hier. J’étais fatigué. Je me suis couché. Aujourd’hui, je me lève de bonne heure avant le soleil. Le 6 octobre, je ferai le contraire. J’aurai couru toute la nuit. Je me coucherai en arrivant à Paris au moment où le soleil se lèvera. Peu m’importe qu’il y ait un soleil au ciel ce jour-là. Je sais où trouver le mien. Je n’y veux pas trop penser. C’est encore si loin. De demain, vendredi, en huit jours. Y aura-t-il ce jour-là, ou le lendemain un dîner chez Pozzo, ou je ne sais quoi qui vous autorise, à fermer votre porte le soir ? Le lendemain vaudrait mieux peut-être. La dissolution sera au Moniteur le 4. Les élections commenceront le 4 novembre. Je crois mon renseignement positif.
Que de lettres j’écrirai d’ici-là ! On y tient beaucoup. Déjà, il m’arrive des plaintes de ce que je n’écris pas assez. On manque de conseils, d’informations. On veut pouvoir lire à ses amis des passages de mes lettres. J’admire infiniment le proverbe italien : lutto’l mondo e come la nostra famiglia. Il faut vos lettres à Lady Granville pour s’amuser et amuser son mari. Il faut les miennes à mes amis politiques... aussi pour s’amuser eux et leurs amis ; car c’est bien plus de l’amusement, un peu de mouvement moral qu’ils y cherchent, qu’une utilité immédiate et positive. Je leur donnerai satisfaction. Je vais écrire, écrire écrire.
Comment ? Ce pauvre M. de Hügel est fou ? Cela ne m’étonne pas. Il avait depuis quelque temps quelque chose de mystérieux et d’excessivement subtil qui m’étonnait quelques fois. Je l’attribuais à la nature de son esprit. Les Allemands ont de cela. Ils arrivent à la finesse par la subtilité et à la discrétion politique par le mystère. Qui M. de Metternich, enverra-t-il ici à sa place, en l’absence de l’Ambassadeur ? Car je ne suppose pas que les chargés d’affaires aient le privilège des Rois. Ils ne peuvent pas être fous.
Je suis charmé que les Granville soient revenus. C’est une intimité que je vous aime. Quand ils ne seront plus si effarouchés de mes rivalités politiques, j’essaierai d’y entrer un peu.
Que vous revient-il de Londres ? Je ne suppose pas qu’il se passe rien de significatif à la petite session de Novembre. Elle n’aura, je crois, que la liste civile pour objet. Les radicaux me paraissent bien modestes, bien décidés, à accepter qu’on ne leur donne rien pour éviter l’alliance des Whigs et des conservateurs. Mais la nullité et l’inaction ne sont pas, quoiqu’on en dise des éléments de durée.
De quoi je vous parle là ? Il semble que moi aussi, je veux épuiser mes petites nouvelles. J’accueille très bien les vôtres ; mais laissez-les toutes pour me dire, pour me redire toujours comment aime une femme. Le 6 octobre, dearest, dans notre cabinet, je vous dirai, et je suis sûr que vous me croirez, je vous dirai à quel point je vous comprends ? Je vous dirai quelle vie eût été pour moi aussi douce, aussi pleine que pour vous. Je ne veux pas l’écrire. Il y a des choses que je n’aime pas à écrire. Elles sont intimes à ce point qu’il me déplaît de les voir exposées au grand air, exposées à tomber je ne sais sous qu’ils yeux, à provoquer je ne sais quel sourire. Même très sûr que cela n’arrivera pas, l’idée seule de la possibilité me choque et m’arrête. Mais quand je vous aurai dit à quel point je vous comprends vous conviendrez avec moi que femme ou homme, quand on aime, on veut que ce qu’on aime se déploie dans toute sa beauté, s’élève aussi haut qu’il se peut élever. L’amour se passe de tout et prétend à tout. Il se suffit parfaitement à lui-même, et rien ne suffit à son ambition. Je suis sûr que vous pensez, que vous sentez comme moi. Mais encore une fois, je ne veux pas écrire tout ce que j’ai dans le cœur.
J’attends votre lettre de ce matin avec une douce sécurité. Elle répondra à celle où je vous donnais une date. Mais gardez-vous bien de jamais me taire aucune de vos impatiences, de vos injustices. J’ai droit à tout, et je veux tout avoir le worse comme le better. En attendant, je vais écrire à droite & à gauche. Je vous quitte pour je ne sais qui & je ne sais combien.
11 heures
Le courrier m’arrive au milieu de quatre visiteurs. Je viens pourtant de parcourir le N° 50. Que de doutes et tristes choses ! Oui, dearest, comptez sur toujours. Adieu et toujours. Il faudra bien que nous venions à bout de cette situation. Soyez tranquille. Je veillerai sur moi jusqu’au 6. Adieu, adieu. G.
50. Val-Richer, Jeudi 28 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de recevoir trois ou quatre visites d’écrire six lettres. Il me faut du repos, c’est-à-dire du bonheur. Je ne comprends pas d’autre repos. Ce serait vraiment du bonheur, de vous écrire après avoir lu et relu ce que vous m’écrivez si tant d’inquiétude ne se mêlait pas à tant de joie. Je me creuse la tête comme vous pour deviner ce que peut faire, ce que peut méditer M. de Lieven. Je ne veux pas vous en parler. Il me déplairait de dire ce que j’en dirais. Jusqu’à ce que vous ayez des nouvelles de l’intervention du comte Orloff, j’espérerai quelque chose. Vous avez raison décrire avec détail à votre frère, avec grand détail. Il faut que tout ce monde-là, si préoccupé de lui-même et de sa position à la Cour, se sente aussi un peu responsable de votre destinée. Nous causerons de tout cela, le 6 bien bien sérieusement car j’y pense sans cesse. Newton a trouvé le système du monde en y pensant toujours. Il n’en avait pas à coup sûr, autant d’envie que j’en ai de trouver à votre situation une bonne issue. Mais les volontés d’hommes sont plus difficiles, à démêler et n’ont pas des lois aussi fixés que le cours des astres.
10 heures Me voilà enfermé chez moi, enfermé sous clef. Ah, vous auriez bien dû venir à la place de votre lettre comme vous en avez eu l’idée. Vous vous arrêtez en pareil cas, vous ne voulez par dire ce que vous appelez des bêtises. Et moi, que dirais-je ? Je m’arrêterai aussi. Pourtant si vous étiez là près de moi, quelle soirée charmante ! Quel doux entretien ! Vous êtes bien plus heureuse que moi. Vous avez notre Cabinet, Autour de vous, nous avons été, nous sommes partout ensemble. Ici je suis seul. Je parle de vous à tout ; mais rien ne me répond. Aussi je vais à vous bien plus que je ne vous amène à moi. J’aime mieux me souvenir qu’imaginer. Je reprends ma place, mes places. Je refais nos conversations. Je n’ai rien oublié, pas un mot, son lieu, sa date, votre regard, votre accent. J’ai des souvenirs, très préférés ; mais tous me sont présents. Ceux de la table à thé, que cette heure-ci me rappelle, sont au nombre des plus doux ; doux comme un bonheur depuis longtemps, goûté dont on jouit comme de son bien, comme de son droit, avec ravissement mais sans trouble, habitude et prélude d’une intimité parfaite, charmante dans le passé, charmante dans l’avenir ! Adieu, Madame.
Je n’ai pas de thé là ; et quand j’en aurais certainement je n’en prendrais pas. Mais adieu au moins, adieu. Vendredi 6 heures et demie Certainement Pozzo a beaucoup d’esprit, un esprit très étendu, droit, fécond, varié, agréable. A côté de lui à table au coin du feu, j’en jouis infiniment, comme vous. Mais il reste toujours lui au dessous de son esprit. Il n’a jamais l’air d’être tout à fait au niveau, bien établi au niveau de son esprit et de sa situation. Et puis laissez-moi vous dire une impertinence. Pozzo n’a jamais fait que de la politique extérieure de la diplomatie. Il n’a jamais gouverné un pays, traité directement, face à face, avec les idées, les intérêts, les passions de tout un peuple. Métier plus difficile, plus compliqué, plus périlleux, qui met aux prises de bien plus près, bien plus fortement avec les hommes et tout ce qu’il y a dans les hommes, et qui exige, qui provoque, dans celui qui le fait un développement bien plus complet, bien plus énergique de toutes les facultés, du caractère comme de l’intelligence, de la volonté comme de l’habilité. J’ai trouvé, dans les hommes les plus distingués qui ont suivi la même carrière que Pozzo, beaucoup d’étendue, d’élévation de liberté d’esprit, beaucoup de pénétration et de savoir faire dans les relations personnelles, quelques fois de la grandeur et de la hardiesse dans les desseins, dans les combinaisons, jamais cette profonde connaissance de la nature, et de la société humaine cette intelligence de leur vie réelle de leurs besoins ; cette fermeté de pensée et de conduite cette habitude fière de la responsabilité, qui donnent et prouvent la puissance, la grande puissance sur les hommes.
Je ne connais que deux carrières qui placent l’homme, un homme, aussi haut qu’il peut attendre, et le forcent de déployer, pour y monter et pour y rester tout ce qu’il peut être ; c’est la guerre et le gouvernement. Là sont, je crois les conditions, les plus nombreuses, les plus dures et par conséquent, le plus grand exercice de la supériorité. M. de Talleyrand et Pozzo ont beaucoup d’esprit, et ils ont beaucoup fait. Le cardinal de Richelieu et M. Pitt ont fait et prouvé bien davantage. Je ne parle pas de quelques hommes hors ligne qui ont conquis et gouverné. Frédéric 2 ; Napoléon. Pour ceux là c’est trop évident. Je n’ai pas la moindre envie que vous aimiez Alexis de St Priest. Traitez-le comme il vous plaira, quoiqu’il m’ait assez amusé lundi, dans deux heures de conversation. Il allait passer quinze jours près de Caen, chez Madame de Chastenay.
10 heures 3/4
Voilà votre N°51. Je n’en veux rien dire, absolument rien en ce moment. J’en ai le cœur trop plein. Mais j’y répondrai quoique vous ne vouliez pas. Deux mots seulement, vos deux mots. Adieu à toujours. G.
51. Val-Richer, Samedi 30 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai tant à vous dire, tant à propos de votre N°51, que je ne sais si je ne ferais pas mieux de faire comme vous voulez, et d’attendre le 6. Je pourrais même attendre plus loin et vous ajourner, pour ma réponse comme je l’ai déjà fait à un an, deux ans. Les ajournements me plaisent. Il me semble que je prends possession de l’avenir. Mais aujourd’hui ; je ne puis pas. Quand je vous vois une idée, une impression qui met entre nous, je ne dis pas un nuage, mais tout ce qu’il y a de plus léger, une plume dans l’air, un grain de sable. Sans vos pas, il faut qu’à l’instant même je la repousse, je l’écarte que je rétablisse, de vous à moi, la parfaite sérénité, la parfaite confiance, la parfaite égalité. C’est mon droit, c’est mon premier besoin, Madame. Je ne puis souffrir que rien manque, dans votre pensée ou dans la mienne à notre affection. Je ne veux la perfection que là ; mais là, je la veux, je la veux tout à fait.
Comment dirai-je ? En y pensant, je trouve ce que vous me dites un peu ridicule et bien plus ridicule d’y répondre. J’ai eu un moment envie d’y répondre en riant, de vous envoyer la lettre d’un homme de vingt ans, bien jeune, bien ignorant bien ignoré, très épris, ne sachant pourquoi, surpris en effet, comme vous dîtes autant que charmé. A coup sûr, vous me l’auriez renvoyée en me disant que la poste s’était trompée, que ce n’était pas moi qui avais écrit cela. Vous vous seriez chargée de ma réponse Madame. Mais quelque vraie que celle-là eût été, je n’en veux pas. J’en veux une sérieuse, très sérieuse. Je ne sais pas rire si près de votre cœur et du mien.
Nous sommes du même âge, Madame. Je conviens qu’à titre d’homme. je suis un peu plus jeune que vous ; et peut-être y a-t-il des mathématiciens, des Statisticiens qui sauraient évaluer en chiffres la différence. Mais moi madame, je ne suis pas un chiffre. Je suis une créature vivante gouverné par mes impressions, mes idées, mes goûts, parfaitement indifférent aux goûts, aux idées et aux impressions des autres, ne tenant nul compte, pour ma vie intime, ma vraie vie, de ce que pensent, font, aiment ou n’aiment pas les autres, ne songeant seulement pas aux conventions, aux habitudes, aux routines des autres, ne consultant que moi, ne croyant que moi et le plus tranquille, le mieux établi des hommes dans mes sentiments et mes plaisirs, quand ils sont tels que je les veux moi, pour moi. Et je suis très sûr que je suis à cet égard, plus exigeant, et plus ambitieux que qui que ce soit.
J’ai épousé une femme qui avait près de quatorze ans de plus que mois, et puis une femme qui en avait quinze de moins. Ni l’une ni l’autre, je vous en réponds, ne s’est aperçue une minute de la différence. C’est que je les aimais vraiment. C’’est qu’elles répondaient vraiment à tous mes goûts, à tous mes désirs. C’est quelles m’aimaient de toute leur âme. Et leur âme était haute, leur cœur tendre, leur esprit rare. Elles appartenaient l’une et l’autre et par leur nature et par leurs habitudes de toute sorte, à la région la plus élevée. Il me faut tout cela. Tant que j’ai vécu auprès d’elles, j’ai senti mon affection croître comme mon bonheur. Et quand Dieu me les a enlevées, j’ai senti que je perdais, non seulement le bonheur dont j’avais joui, mais, un bonheur inconnu, inépuisable, toujours nouveau qu’elles avaient à me donner et moi à recevoir.
Dieu me traite avec une bonté, une magnificence dont je suis à la fois fier et confondu. Il vous amène vers moi, vous venue de si loin, si étrangère à mon pays, à mon passé, si imprévue, pour moi, et pourtant si sympathique à moi, à mes goûts, à mes désirs, à tout mon être, vous d’une si grande nature, d’un esprit si élevé et si aimable, d’un cœur si vif, d’un caractère si passionné et si doux ! Vous arrivez où je suis en deuil, désolée, ne regardant à rien, ne vous souciant de personne, cherchant à votre peine un peu de soulagement à vos ennuis un peu de distraction que vous n’aviez jamais l’air de trouver, donnant à tout le monde, l’idée d’un mal incurable et d’une créature supérieure à jamais abattue, isolée. Et un jour, vous me laissez voir, vous me dîtes que je vous consolerai, que je vous relèverai, que vous m’aimerez, que vous m’aimez, que nous retrouverons vous en moi, moi en vous cette intimité, ce bonheur qui surpassent, qui dominent tout ce qu’il y a sur cette terre, toutes ses joies et toutes ses douleurs ! Voilà ce qui est Madame. Voilà ce qui nous est arrivé à vous et à moi. Et vous venez me dire que vous êtes de dix mois plus âgée que moi ! Et il vous vient de là un doute qui vous préoccupe, qui vous empêche d’avoir foi, pleine foi en moi, dans mon affection, dans votre bonheur. Et vous me demandez si, moi aussi, je ne m’apercevrai pas un jour que je suis dix mois, plus jeune que vous? Ah Madame, que voulez-vous que je vous dise ? En vérité, vous nous replacez trop l’un et l’autre dans la foule. Je ne suis pas modeste. Je veux être pour vous tout ce que vous êtes pour moi, que vous trouviez en moi tout ce que je trouve en vous. Mais on nous faisant trouver. vous à moi, moi à vous, hors de toute prévoyance, de toute attente, quand notre vie intime à l’un et à l’autre semblait finie. Dieu a fait pour nous un miracle. Il y aurait plus que de l’ingratitude, il y aurait de la folie à n’en pas sentir la merveille, à n’en pas jouir avec une reconnaissance, une confiance un ravissement sans mesure comme le bienfait.
10 heures 1/2
Je ne comprends rien, rien du tout à ce retard qui me désespère. Je vous ai écrit comme à l’ordinaire. Ma lettre a dû partir de Lisieux jeudi avant- hier. Vous en aurez eu deux ce matin. C’est impossible, autrement. Mais je n’en suis pas moins désolé. Adieu, Adieu. Vous avez bien raison. Il faut être ensemble. Adieu. G.
52. Val-Richer, Dimanche 1er octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne puis vous écrire tant. que je ne vous sais pas tranquille. Vous l’êtes depuis hier matin. Cela est sûr. Je ne puis comprendre quel accident a retardé une lettre ; mais hier vous en aurez eu deux à la fois. Il faut que je le voie écrit de votre main, que je lise de vous, des paroles calmées, heureuses. Votre peine m’est intolérable. Hier tout le jour, je voulais travailler ; j’avais à écrire quelque chose qui m’importe assez. Je n’ai pas pu. Je suis resté assis devant ma table, me prescrivant de ne pas bouger, de chercher ; rien ne venait, pas une idée pas un mot heureux. Mon esprit, mon cœur tout était à vous, avec vous. Je vous parlais, je vous rassurais. Je le fais encore ce matin, je le ferai jusqu’à ce que votre lettre me soit arrivée. J’ai recommandé hier au facteur de venir de bonne heure. J’espère qu’il le fera. Je crains le dimanche. Ce jour là, il trouve en route des gens qui s’amusent qui boivent, et il s’arrête quelque fois à boire avec eux. S’il vient tard ; il sera bien grondé.
Essayons de causer. Nous causerons Vendredi, à une heure et demie. Vous trouverai-je bien ? cela devrait être, d’après ce que vous me dites de vos longues promenades et de votre force. J’aurais tant de plaisir à vous voir bien, décidément bien ! Il faut pourtant que vous soyez malade, toujours malade. Je vous dirai que plus j’y pense, plus je suis de l’avis du Comte de Pahlen et du Comte de Médem sur ce qui fait écrire à M. de Lieven de telles lettres. Quelque étrange que ce soit, c’est beaucoup moins étrange que toute autre supposition. Et puis ces messieurs sont plus accoutumés que vous à de telles choses à de telles façons d’agir & pour de tels motifs. Ils ont plus vécu que vous dans cette atmosphère là. Quelle fortune que vous ayez été en Angleterre, que vous ayez passé là tant de temps, au milieu des idées et des sentiments qui sont les nôtres ! Je ne puis me figurer vous Tartare, Scythe vivant de glace & d’obéissance. Vous auriez toujours conservé votre nature, et elle serait toujours devenue quelque chose de grand. Car ne me croyez pas encroûté d’orgueil civilisé ; il y a du grand partout, et j’estime beaucoup de choses chez les peuples débutent. Mais quelle différence ! Et puis pour nous rencontrer, il fallait que vous vinssiez en occident ; je n’entrevois pas comment je serais allé, moi, en Orient. A moins qu’il ne me fût arrivé d’être, un jour ambassadeur à Pétersbourg, et de vous trouver là, vous, bien Russe, J’aurais, bien à côté de l’impératrice. Comment nous sérions nous connus, parlé ? Aurions-nous démêlé quelque chose l’un de l’autre ? Cherchez, vous me direz. Il n’y a pas de risque. Nous pouvons nous en donner le plaisir.
N’est ce pas voilà du vrai bavardage? Comme entre nous pourtant, entre nous seuls. Je vivrais bien dix ans auprès de la Princesse de Poix. (C’est la Princesse et non pas la Duchesse) que je ne bavarderais pas ainsi avec elle. Vous lui trouvez donc de très grandes manières. Je l’ai beaucoup entendu dire, sans jamais en être frappé. Elle a une grosse voix, un gros visage, de gros bras de gros mouvements, du gros tant que vous voudrez mais rien de grand. Pour que les manières soient vraiment grandes, il faut quelque chose dans la personne, si peu que ce soit, quoi que ce soit, mais quelque chose, un peu d’esprit, un peu de beauté, un peu d’âme, quelque fierté de nature, quelque grâce dans la physionomie, quelque élégance dans les gestes, dans le langage. Quand il n’y a rien, absolument rien, les grandes manières ne sont plus que les manières de personnes, bien élevées et sures de leur fait. Je n’aime pas à prodiguer le nom de grand, même dans les plus petites occasions.
10 heures 1/2
Voilà votre N°53. Le facteur n’est pas en retard. Mais je suis encore très ému, très troublé de votre trouble. Ce n’est pas de chez moi, c’est de Lisieux que provient le retard. Je vous dirai comment. Mais soyez tranquille. Je gronderai comme il faut. Je gronde rarement, mais quand je gronde, on s’en souvient. Enfin cela n’arrivera plus. Adieu dearest, Adieu. Soignez-vous bien au moins. Soignez-vous toujours. Toujours. Adieu. Je traite ces deux mots comme vous. G.
53. Val-Richer, Lundi 2 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici, mon avant dernière lettre. Vous l’aurez Mercredi. Je vous écrirai encore demain pour jeudi. Et vendredi, au lieu de lettre ce sera moi. Vous, vous m’écrirez Mercredi pour la dernière fois. Je prendrai votre lettre jeudi à Lisieux, d’où je partirai vers 2 heures. Voilà notre itinéraire lettres et personnes. Comment me plaindrais-je des détails que vous me donnez sur votre triste journée de Vendredi dernier ?
Jamais, dearest, quel qu’en soit le prix pour l’un ou l’autre de nous deux, jamais je ne me plaindrai que vous ayez trop d’affection pour moi, qu’elle soit trop vive, trop tendre, trop inquiète. Je mets l’affection, votre affection, au dessus de tout, même au dessus du bonheur qu’elle donne. Et pourtant il y a, dans l’excès de votre trouble, de votre mal, à la moindre circonstance quelque chose que je voudrais changer, qui pourrait changer sans que nous y perdissions rien. Je voudrais que votre esprit restât plus libres, qu’il vit les choses comme elles sont et mesurât un peu l’abyme où notre cœur se hâte de vous précipiter. Je connais l’empire sur notre imagination, sur Sous vos yeux quand je n’y suis pas moi-même. Il en faut tant, tant pour faire un petit, bien petit effet. Madame, je vous en conjure, restez telle que vous êtes ; n’ôtez rien de ce que vous me donnez de ce que vous me montrez, rien, pas même une crainte, pas même un tourment. Seulement sachez, sachons tous les deux que ces craintes sont folles, & connaissons le mal que nous ne pouvons guérir.
11 h.
J’aime mieux cet indigne procédé que toute autre chose. Je craignais je ne sais pas quoi. Adieu, dearest, ever dearest. Adieu. Il me semble que je ne vous ai rien dit du tout aujourd’hui. Que de choses je vous dirai le 6 ! Adieu. Adieu. G.
54. Val-Richer, Lundi 2 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars demain de bonne heure pour Mézidon. On m’y apportera votre lettre. J’espère que celle-ci n’essuiera pas de retard. Je ne vous en dirai pas long. Je n’ai plus cœur à écrire à la veille de vous retrouver, mon mépris pour l’écriture me reprend. J’ai pourtant sur ce qui vous est arrivé de M. de Lieven bien des choses à vous dire, bien des détails à vous demander. Je me persuade quelques fois que les despotes ont le sort des méchants maris. Tout le monde s’entend pour les tromper. On a l’air de faire tout ce qu’ils veulent ; on ne se refuse à rien ; on va au devant de tout. Et puis rien ne se fait, rien ne s’exécute. Cependant j’ai peur qu’il n’y ait ici un peu de sérieux. Je ne puis m’empêcher de redire, comme ce matin, je craignais davantage. Je craignais quelque chose de plus pénible, de plus embarrassant pour vous. Vous me mettrez bien au courant de votre situation. Nous ferons vos comptes. J’ai besoin d’avoir l’esprit tranquille pour vous à ce sujet.
Quoique ce ne soit pas Dimanche, j’ai eu des visites presque tout le jour. On m’a apporté mes cygnes. Je les ai établis sur la pièce d’eau. Le mâle est très beau, la femelle un peu malade. Elle a les plumes des ailes roses. C’est le sang qui s’y porte, m’a dit le jardinier qui l’a élevée. Il m’assure qu’elle guérira parfaitement & sera aussi belle que le mâle. Ces pauvres oiseaux étaient depuis trois jours hors de leur étang. Quand on les a lancés sur le mien, ils sont partis ensemble côte à côte, parfaitement de front, et sont allés avec la rapidité de la flèche s’enfoncer tout au bout, dans les roseaux du rivage, loin de ceux qui les regardaient. Puis au bout de quelques minutes, ils sont sortis de là, et toujours côte à côte toujours de front s’arrêtant ensemble, repartant ensemble, ils ont fait le tour de la pièce d’eau et l’ont parcourue, en tous sens comme pour prendre ensemble possession de leur demeure. Ils me faisaient envie.
Je ne suis pas surpris que la petite Princesse se soit ennuyée à Maintenon. Le Duc de Noailles tout galant homme qu’il est, a l’air de n’avoir qu’une vie d’emprunt. Quand il est seul, il ne doit pas vivre du tout. Ai- je encore quelque chose d’insignifiant à vous dire ? Je ne cherche que cela. J’ai tout épuisé, ce me semble. A vendredi ce qui est inépuisable.
Adieu. Pour ce soir, cet adieu là. Je vais me coucher. Demain, avant de partir, je vous dirai encore adieu. Je passerai toute la journée hors de chez moi. Le dîner sera long et je vais le chercher loin. Adieu Adieu.
Mardi 8 heures
Je pars tout à l’heure. Il fait un temps admirable. Ma vallée est verte comme il y a trois mois. Pas trace d’automne encore. Si je partais avec vous ce matin, pour aller faire, par ce beau soleil, une longue promenade dans les bois, dans les près, quel charme ! Adieu. Adieu. Vendredi, je ne désirerai rien. Adieu. G.
55. Lisieux, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Un seul mot deux c’est-à-dire, car encore cette fois, il ne faut pas que vous soyez un jour sans lettre. C’est la dernière fois. A partir du 30 octobre, je ne vous écrirai plus, plus du tout. Je ne saurais dire, je n’essaierai pas de dire avec quelle joie je pèse à ce retour là, le seul vrai retour, le seul auquel ne se mêlera aucune arrière pensée. Comme je vais précipiter les jours ! Avec quel plaisir je les verrai tomber ! Et puis, quand je serai revenu, quand je serai rétabli près de vous comme je redeviendrai avare du temps ! Je suis épouvanté de sa fuite si rapide depuis huit jours, Sera-ce ainsi ? Les semaines s’évanouiront-elles comme des heures ? Nous n’en perdrons rien au moins, n’est-ce pas ? Nous ne laisserons à l’étranger, à l’ennemi, rien de ce que nous pourrons lui ôter. Adieu adieu. Voilà des visites qu’on m’annonce. C’est venir bien matin. Il faudra pourtant que je vous écrive encore un mot. Adieu. Demain ce sera mieux. Je veux dire ma lettre, non pas mon adieu. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée
56. Lisieux, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon second mot. Je monte en voiture dans cinq minutes. Il me serait désagréable qu’après demain, vous ne vissiez pas de mon écriture. On devient enfant, et on reste et on restera enfant. Je ne suis point fatigué. Le beau temps continue. Promenez-vous donc longtemps, doucement. Faites provision d’air, de force, d’embonpoint de tout, de tout. Que c’est ridicule d’écrire si peu quand on pourrait tant dire, d’avoir la main si vide et le cœur si plein ! Mais vous savez que je n’aime pas les quasi expressions, le quasi langage. Adieu donc. Je ne veux rien ajouter. Je veux finir par adieu. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée
57. Val-Richer, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vendredi 13. 4 heures
Savez-vous que ce sera un supplice de vous écrire directement, du ton dont nous sommes convenus ? J’avais déjà tant de peine à me dire que ce que je vous disais ! Il faudra encore en rabattre, beaucoup. Aussi, je me décide pour aujourd’hui à la voie indirecte. J’abuserai de mon pauvre Génie. Du reste, je l’en ai prévenu hier à 6 heures en montant en voiture, et tout sera fait comme nous l’avons réglé. Mais dites-moi si vous le pouvez jusqu’où je puis aller par la voie directe et quotidienne. Vous m’avez donné une pierre de touche telle qu’en vérité, si je m’y conforme, je vous enverrai un bulletin de ma santé en vous en demandant un de la vôtre Des lettres qui puissent être lues par M. de Lieven ! Je n’en reconnais pas moins la nécessité. Durera-t-elle longtemps ? Serons-nous longtemps dans cette attente ? En tous cas, ce ne pourra être plus de 18 jours.
Je viens d’arranger mon départ avec toute ma maison. Tout est convenu. Le 30 nous irons coucher à Evreux et dîner le 31 à Paris. Je respire en vous disant cela, et j’en ai besoin, car depuis hier j’étouffe. J’ai étouffé cette nuit ce matin, jusqu’à ce moment. Je suis épouvanté de mon bonheur. Je ne sais plus m’en passer. Quel abyme insatiable que notre cœur! un abyme, comme celui d’un mélodrame que j’ai vu jouer autrefois, qui s’appelait le Précipice, et où l’on précipitait en effet l’innocent dans un abyme de 600 pieds sans fond. Oui, un abyme de 600 pieds sans fond. Voilà ce qu’est devenu pour vous mon cœur. Avant le 15 juin, si l’on m’avait fait entrevoir une correspondance un peu amicale, un peu régulière avec une personne comme vous une personne d’esprit, bien au courant du monde, j’aurais trouvé cela charmant ; je me serais promis au moins un jour très agréable par semaine. Pendant que vous étiez en Angleterre, si l’on m’avait dit que vous reviendriez bientôt en France, et que je ne passerais jamais un mois sans en passer cinq ou six jours avec vous, je me serais cru heureux. Et bien Madame; je ne le suis pas; je ne le suis pas malgré hier, malgré avant-hier, malgré la certitude que dans 18 jours, je retrouverai hier au moins hier, n’est-ce pas ? Je suis devenu insatiable, je resterai insatiable. Vous, vous dont la simple vue fait épanouir tout mon être dont la moindre parole me charme et qui avez pour moi des paroles dont le souvenir, le seul souvenir me plonge dans l’extase, vous ne pouvez pas me rassasier. il n’est pas en votre pouvoir d’apaiser, de combler mon âme. De vous, tout la ravit et rien ne lui suffit. Vous êtes pour moi une source de délices infinies, et moi, j’ai une puissance infinie pour les désirer, pour en jouir; et quelque heureux que je sois par vous, près de vous, je sens que je puis, que je dois l’être encore davantage; et j’aspire avec une ardeur infatigable à ce bonheur inépuisable qui me vient de vous et qui chaque fois qu’il me vient me promet plus encore qu’il ne me donne et m’inspire encore plus de désirs qu’il n’en satisfait, savez-vous ce qui sépuise ce qui se lasse en moi ? La parole. J’arrive d’un coup à ses limites, et là je m’indigne et mon cœur s’élance bien loin au delà. Mais vous n’êtes pas là pour l’entendre sans qu’il parle ; et en même temps que la parole lui manque, le silence lui pèse horriblement.
Samedi 9 heures
J’ai dormi longtemps, en me réveillant souvent. Chaque fois que je me réveillais, je me disais: à une heure et demie. Et il me fallait un réveil complet et une réflexion pour me détromper. On a bien de la peine à apprendre que les choses ne sont pas dans la vie comme dans le cœur. Le premier mouvement est toujours de croire à l’harmonie de ces deux mondes, tant celui du dedans est le monde vrai, le monde souverain. L’autre nuit en roulant dans cette voiture, le ciel était pur, la lune se répandait partout, vous deviez être là comme moi, jouir avec moi de cette lumière si douce et si pénétrante ; vous deviez sortir de ces longues ombres des arbres qui semblaient cacher quelque objet et s’avancer vers moi à mesure que je marchais. Ce matin, je ne marche pas, je suis dans mon cabinet à ma table, près de mon feu. Mais le soleil brille, la vallée où les feuilles commencent à tomber, laisse entrevoir des percées profondes où la lumière entre et se perd ; tout est beau et invitant devant moi, sous mes fenêtres, partout où se porte ma vue. Je vous vois partout, je vous mets partout, partout où quelque chose me plaît et m’attire. Ce matin, comme cette nuit, comme l’autre nuit, la réflexion seule m’apprend que vous n’êtes pas là. Il faut que je le découvre ! D’instinct, je vous crois avec moi, toujours avec moi.
J’ai trouvé tous les miens en bon état. Ma mère est mieux que je ne l’avais laissée ; mes enfants sont à merveille. Savez-vous que je ne jouis de leur présence, de leur joie, qu’avec un peu d’hésitation et de mélange ? Je voudrais vous en envoyer la moitié. Une impression à moi seul un plaisir à moi seul m’étonne presque comme un contresens. N’ayez jamais d’impression, de plaisir à vous seule ! J’en serais plus qu’étonné. Vous pouvez me pardonner cette exigence toutes les exigences. Je les aurai toutes. Mais j’en ai le droit, oui, le plein droit.
11 heures
Voilà votre n° 56. Oui éternellement adieu. C’est là que tous les sentiments s’unissent et se satisfont. Adieu. Adieu.
58. Val-Richer, Samedi 14 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens d’une longue promenade avec ma mère, mes enfants, Mad. de Meulan. Nous avons erré deux heures dans les bois. Henriette, a la passion des longues promenades de tout ce qui étend le cercle de sa petite vie. Deux choses lui plaisent presque également; aller courir au loin, et venir s’enfermer dans mon cabinet à causer avec moi. C’est ce qu’elle vient de faire tout à l’heure en rentrant. Elle me quitte. Elle est enfant, parfaitement enfant ; mais on voit percer, à la moindre occasion et sans la moindre intention de sa part, des traits d’esprit sérieux ces velléités d’ambition haute qui révèlent de bonne heure les natures d’élite. Elle était là, tout à l’heure, cherchant visiblement ce qui pouvait m’intéresser, le regard attentif un peu émue, presque recueillie. J’ai ri ; je lui ai dit des bêtises. Cela n’a pas pris. Elle voulait faire quelque chose pour moi, et non pas que je fisse quelque chose pour elle. Je me suis prêté à son désir. Nous avons causé de sa grand mère, de sa sœur, de ses leçons ; et elle a fini par me demander de lui faire commencer l’hiver prochain à apprendre deux choses, la musique et le dessin : la musique, parce qu’elle m’a entendu dire que je trouvais agréable après le dîner, en sortant de table de rester là, une demi-heure assis près du piano sans rien dire entendant jouer ou chanter ; le dessin, parce qu’elle a envie de faire mon portrait " pour l’avoir à moi " dit-elle. Je ne lui permets pas souvent ces conversation- là, et je ne me laisse point aller au plaisir que j’y pourrais prendre. Je ne fais nul cas des fruits de serre chaude. Je veux que mes enfants croissent en plein air sans provocation factice et en y mettant le temps naturel. C’est déjà une assez forte provocation que notre façon de vivre aujourd’hui, et l’intimité habituelle des enfants avec les grandes personnes. Je suis bien sûr que, s’il y a dans mes enfants quelque heureux don à développer, le développement ne leur manquera pas. Et puis je me défends, je me défendrai toujours d’un certaine tour de leur affection pour moi qui ne convient ni à leur âge, ni à notre relation. Je crois aux lois naturelles des divers liens, des divers sentiments humains, et ne puis souffrir qu’on les confonde. On dit l’amour filial, l’amour paternel, et je ne m’en étonne point. Il est bien simple, bien juste qu’on applique ainsi, à des relations, à des affections, en effet très tendres, & très puissantes, le mot le plus tendre, le plus puissant que connaissent les hommes. Mais il ne faut pas prendre les mots au pied de la lettre, même dans leurs applications les plus douces. Il faut toujours regarder aux choses mêmes.
Eh bien Madame, il n’y a qu’un amour, l’amour tout court. Ce qui le caractérise essentiellement, la passion unique, exclusive, à la fois égoïste et dévoué sans mesure, capable de tout sacrifier et pourtant voulant un retour parfaitement égal, cherchant avant tout son propre bonheur, ce droit absolu qu’un être se sent et s’arroge sur un autre être auquel il se donne, cette complète fusion de deux âmes, de deux vies en une seule vie, en une seule âme ; tout cela, qui est vraiment l’amour, ne se retrouve point ailleurs, ne s’y retrouve du moins ni complètement, ni à sa place et selon l’ordre naturel.
J’espère que mes enfants m’aimeront autant, et avec autant de tendresse, et même avec autant d’exaltation qu’on peut aimer son père. Mais toutes les fois que je verrai pénétrer dans leur sentiment pour moi quelque chose qui naturellement n’en est pas, qui appartient à d’autres relations, qui doit un jour se porter ailleurs, j’écarterai, ce développement irrégulier de l’âme. " Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. "
10 heures et demie
Je ne sais ce que je vous aurais dit ce matin si l’on ne m’avait interrompu. Mais je vous en aurais dit long. Avec vous la conversation sur le sujet le plus indifférent est un charmant plaisir. Quoi donc quand le sujet me tient vraiment au cœur ? Cependant, je ne vous dirai pas grand chose ce soir. J’ai envie de dormir. Il me semble que le besoin de sommeil va croissant en moi. J’en serais contrarié. J’ai toujours disposé de moi-même très librement et sans y regarder, pour toute chose, à toute heure. Il me déplairait de me sentir plus dominé par les habitudes. Comprendrez-vous cette question-là ?
Il y a dans votre numéro 58 page 4, ligne 3, un mot rayé au dessus duquel, vous avez écrit lit en me disant à quelle heure vous êtes allée vous coucher. Le mot rayé a-t-il été mis là à dessein ou par hasard ?
Vous pouvez rassurer le comte de Pahlen, J’ai trouvé sa carte en rentrant chez moi avant de partir, et j’ai eu tous les regrets du monde de n’avoir pas été là quand, il a pris la peine de me venir voir. Nous ne nous connaissons guère quoique nous nous soyons beaucoup vus ; mais il a un air et un ton de galant homme qui me plaît extrêmement.
Dimanche 11 heures
Moi qui oubliais de vous parler de l’éclipse! Tout s’éclipse devant vous. Elle a été parfaitement visible ; et je l’ai bien regardée, et je l’ai oubliée en la regardant. Décidément, je n’irai pas vous chercher dans la Lune. Je vous veux plus près. Adieu, adieu. Est- ce que la lettre ne me fait pas de tort à moi ? Adieu. G.
59. Val-Richer, Dimanche 15 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi, j’ai envie de me distraire. Si j’étais la lettre, si j’habitais où elle habite, l’idée ne m’en viendrait même pas. Si seulement je vous écrivais à mon gré, à mon libre gré ! Mais je ne sais, depuis trois jours, notre correspondance, la vôtre comme la mienne votre N° de ce matin par exemple me suffit moins que jamais. Décidément, je ne serai content que le 31. Votre excursion en Portugal est venue bien à propos. J’y pensais ce matin même en m’habillant, et je pensais tout ce que vous me dites. J’aime ces harmonies imprévues. Oui, la politique Anglaise est bien tombée. Ce n’est pas la seule. Je suis dans une veine de grand dédain. C’est la consolation des oisifs ; je sais cela. Pourquoi me la refuserais-je ?
Je me rappelle il y a quelques années, en 1833 en 34 nous admirions, entre gens d’esprit, la vertu du gouvernement représentatif qui portait les gens d’esprit au pouvoir. Il me prit un remords de notre arrogance ; et je prédis qu’un jour, pour nous en punir, nous serions écartés, des Affaires précisément comme gens d’esprit, et par des adversaires dont le titre serait d’avoir moins d’esprit que nous, moins de talent que nous, moins de courage que nous, d’être des médiocrités enfin, comme dit Lord Aberdeen, la médiocrité a des droits immenses, surtout quand l’esprit démocratique prévaut. Droite précaire pourtant car l’esprit démocratique a beau être petit les affaires des peuples sont grandes, et ne se laissent pas longtemps rabaisser autant que le voudraient ceux à qui toute grandeur déplaît. Et il faut bien que tôt ou tard la taille des hommes se rajuste à la taille des affaires. Au fond Madame, je n’ai pas perdu mon arrogance. Je suis toujours sûr que le pouvoir appartient aux gens d’esprit, aux plus gens d’esprit, et qu’il ne peut manquer de leur revenir. Mais nous passons si vite, gens d’esprit ou non ! Nous avons si peu le temps d’attendre !
Je trouve ceci dans une lettre que je recevais en Octobre 1821, il y a seize ans « J’ai toujours vu tourner à ton profit, les retards même que tu n’aurais pu prévenir. Je te crois du bonheur. Cette croyance serait un enfantillage si elle ne se fondait sur ce que je le crois destiné à quelque chose en ce monde. Je sais bien cependant combien sont vains nos jugements sur les voies de la Providence. Je sais que dans sa terrible magnificence, elle peut créer et faire croître un homme supérieur pour le service d’un dessein, d’une idée destinée après d’infinies transformations à porter son fruit dans quelques milliers d’années. Je sais qu’elle peut fonder l’accomplissement de ses moindres vues sur la destruction de ses plus beaux ouvrages. Et c’est là ce qui m’épouvante sur notre petitesse, bien plus que l’immensité des cieux, le nombre et la grandeur des étoiles. Et pourtant, mon ami, j’ai sur toi, pour toi, de la confiance, beaucoup de confiance. »
Combien il faut que j’en aie en vous, moi, pour vous montrer ainsi toutes choses, tout ce qu’il y a pour moi de plus intime, non seulement dans le présent, mais dans le passé ! Mais, puisque je l’ai cette confiance, pourquoi ne vous la montrerais-je pas ? Pourquoi ne verriez-vous pas vous ce que m’écrivait sur moi-même, il y a seize ans, une âme bien noble et bien tendre ? Eh bien, cette sécurité qu’elle avait sur mon avenir, et qui la rendait patiente, même dans les plus mauvais temps, j’en ai moi-même un peu pour mon propre compte. Je me crois appelé à quelque chose qui en vaut la peine, appelé à relever quelque peu la politique de mon pays à faire rentrer dans des voies un peu régulières, et hautes les esprits et les affaires. Je ne me crois pas au bout de ce que je puis faire en ce sens. Et voulez-vous que je vous dise ? Vous avez beaucoup ajouté à ma tranquillité d’esprit. Vous m’avez donné de quoi attendre. Avant le 15 juin, ma patience était de la philosophie, de la vertu. Aujourd’hui je n’ai nul besoin de vertu, de philosophie. J’ai le fond de la vie. La broderie viendra quand elle voudra. Je la désire. J’y compte. Mais je l’attends et je l’attendrai sans le moindre effort, avec bien moins d’effort qu’il ne m’en faut pour attendre le 31 octobre. Me voilà bien distrait, n’est-ce pas ?
10 heures
Pourquoi enverriez-vous à M. de Lieven votre lettre au comte Orloff ? Pourquoi celle-là et pas les autres ? Il faut, ce me semble les lui envoyer toutes ou aucune. Et je ne vois point de bonne raison de les lui envoyer toutes. Après son procédé vous avez bien le droit de faire vous-même vos affaires sans lui en rendre compte. Si vous deviez gagner quelque chose à lui tout montrer à la bonne heure ; mais vous n’y gagneriez rien. Point de mystère et point de confiance, lui annoncer toutes vos démarches, et ne point lui en raconter les détails, qu’il sache ce que vous faites et demeure pourtant dans l’incertitude sur ce que vous dites qu’il y ait pour lui à votre égard, de la publicité et de l’inconnu, voilà, si je ne me trompe, ce qui vous convient, comme attitude, et aussi pour le succès.
J’ai bien recommandé, et je recommande de nouveau à M. Génie de vous porter lui-même mes lettres ou de vous les faire porter par quelqu’un de très sûr, qui vous les remette tout simplement ou les remporte s’il ne peut vous les remettre. Je n’ose cependant vous garantir toujours l’adresse, le tact. Donnez-moi à cet égard vos dernières instructions. Voulez-vous que j’use souvent ou rarement de ce moyen? J’ai grand peine à croire que M. de Lieven vienne à Paris, sans en avoir reçu l’autorisation formelle et je doute qu’on la lui envoie sitôt. L’affaire traînera davantage. On vous répondra. On disputera. On essaiera quelque nouveau procédé. Du reste, je ne sais ce que je dis. Vous connaissez ce monde là mieux que moi.
11 heures
’aime le N°60. J’aime beaucoup le N°60. J’aimerais encore mieux le pendant de la lettre. Ah ! Si je l’avais ! Si jamais nous nous séparons encore, il faudra que je l’aie. Mais je ne penserai plus, le 31 à aucune séparation. Adieu, Adieu. Adieu comme dans la lettre. G.
60. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai passé hier une douce journée. Le N° 60 m’a été au cœur. Faites ce qu’il me laisse entrevoir. Un jeune homme qui m’est tout dévoué, Emmanuel de Grouchy, doit venir, vers la fin de cette semaine, passer au Val-Richer trois ou quatre jours. Rien de plus sûr. Chargez M. Génie de lui remettre pour moi, ce que vous voudrez m’envoyer. Ce sera comme si vous chargiez, M. Génie de me l’apporter lui-même. M. de Grouchy aura certainement à m’apporter des lettres, des papiers qui m’arrivent toujours rue de la ville l’évêque et que M. Génie m’envoie toutes les fois qu’il trouve une bonne occasion.
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit Madame, rien, jamais rien que ce qui vous plaira autant qu’à moi. Ne faites donc rien qui vous contrarie. Mon plaisir en serait troublé. Mais, si cela se peut, le plaisir sera immense et la sûreté parfaite. J’ai répandu hier ma bonne humeur sur tout le monde.
Je me suis promené, j’ai causé, j’ai bêché le jardin de mes filles, j’ai donné à manger aux cygnes. Le soir, j’ai lu un fragment de voyage dans l’Inde, le récit d’une grande chasse aux tigres et aux bisons. C’étaient des transports de joie. Mais il faut que je prenne garde depuis que je suis au Val-Richer, j’ai lu à mes enfants deux romans de Scott Ivanhoé et L’Officier de fortune, une comédie de Collin d’Harleville, Les châteaux en Espagne, et hier cette aventure de chasse. Vous n’avez pas d’idée de l’état d’excitation où cela les met. Elles bondissent sur leur chaise, elles en rêvent la nuit d’après. Cela ne vaut rien. C’est le mal de notre temps d’avoir l’imagination trop excitée, trop avide d’émotions, d’aventures. Il faut en guérir l’enfance au lieu de l’en nourrir. Je choisirai avec soin mes lectures. J’éviterai celles qui ébranleraient trop fort les petits nerfs. Je veux cependant cultiver, amuser leur esprit. Il n’y a que moi qui puisse mettre dans leurs idées, dans leurs impressions un peu de variété et de liberté. Ma mère, qui les élève très bien les ferait vivre, si je n’étais là dans une sphère trop étroite et monotone. Elles s’en accommoderaient sans grand peine car elles sont naturellement douces et gaies ; et les âmes d’enfant, quand d’ailleurs on les traite fort bien ne sont pas difficiles à contenter. Mais je ne veux pas que rien manque à leur développement. Je veux qu’elles deviennent tout ce que leur nature, les rendra capables d’être que leur esprit soit aussi cultivé, leur vie aussi animée qu’elles le pourront laisser et supporter elles-mêmes. Je ne puis souffrir les tailles comprimées, les fleurs étouffées. Il faut arranger tout cela, et trouver cet éternel juste milieu. C’est mon métier partout.
Vous avez bien raison. Je n’ai pas été chez l’Ambassadeur de Sardaigne depuis son dîner. J’aurais dû y aller à mon dernier voyage. J’en ai oublié bien d’autres, mais je ne le reproche lui plus qu’un autre. Ce sera ma première visite après le 31. Est-ce que vous étiez encore à Pétersbourg quand Mad. de Staël y est arrivée ? Que de choses j’ai à vous demander sur le passé ! Je ne puis souffrir, à ce sujet, la moindre ignorance. Il me semble que c’est une lacune dans ma vie. Mais qu’elle abominable idée ! Vous avoir vue en 1812 pour ne vous revoir qu’en 1837 ! Savez-vous, Madame, que cela fait plus de 18 jours ? Cependant, je suis bien sûr que je vous aurais reconnue.
J’ai achevé hier l’arrangement de ma bibliothèque. Il ne m’y manque plus qu’une chose, c’est que vous l’ayez vue. Quand vous vous y serez promenée à l’heure où le soleil y entre par les onze croisées, et la remplit de lumière, ou bien le soir comme ces jours derniers, à l’heure où la lune y vient et l’éclaire à son tour, je la trouverai charmante, accomplie. Jusques là, je m’y promènerai avec encore plus de désir que de plaisir.
11 heures
Je ferai ce que veut la prudence et j’engagerai M. Génie à avoir plus d’esprit. Mais par cette voie là, je puis écrire un peu à l’aise. Merci, merci de ce n° 61. Si vous ne copiez pas tout mettez quelque chose à la place de ce que vous ne copierez pas. J’aimerais mieux tout. Et puis j’aimerais encore mieux que tout fût de vous. Adieu, adieu. G.
61. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !
Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.
Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.
Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.
Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.
Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.
Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.
11 H.
J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Amour, Discours du for intérieur, histoire, Poésie, Portrait, Protestantisme, Religion
62. Val-Richer, Mercredi 18 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
63. Lisieux, Vendredi 20 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Rue de Rivoli hôtel de la Terrasse
Paris]
N°63. Lisieux, Vendredi 10 h 1/4
J’arrive d’ Osbée et je prends moi-même à la poste, en passant ici, votre n° 64 moi aussi, j’ai poussé intérieurement un cri d’effroi. et la fin, la fin de cette courte lettre me laisse tout mon effroi. Pourquoi étiez-vous à 1 heure, plus malade, plus tremblante qu’à 9 heures ? Que vous a t-on annoncé ? Que vous a-t-on dit ? Comment se fait-il que vous ne m’en disiez pas un mot, un seul mot ? Mon amie, j’ai horreur de l’exagération des paroles ; mais je suis au supplice. Je serai au supplice jusqu’à demain. Et que sais-je ce qui sera après la lettre de demain ? Cependant je suis sûr. C’est impossible. Que c’est long jusqu’à demain ? Si j’étais seul ! Si personne ne me voyait ! Et pourtant, non. J’hésiterais à cause de vous. Il faut attendre. Mais qu’au moins, je sois avec vous, près de vous, dans votre cœur, sur votre cœur. Dearest, le mien est à vous, tout à vous, pour toujours à vous, pour toujours. Et à vous, comme vous ne le savez pas, comme vous ne le saurez jamais ; avec plus de tendresse, d’amour, de désir, d’espérance, de crainte, plus de bonheur ou de malheur possible que je ne le savais moi-même, il y a un quart d’heure. Adieu. Adieu. Cinq ou six personnes m’attendent. Adieu. Quel adieu !
Je n’ai sous ma main ni enveloppe, ni cire noire et je suis très pressé.
Mots-clés : Relation François-Dorothée, Vie familiale (Dorothée)
64. Val-Richer, Samedi 21 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’attends. Vous connaissez cet état où l’âme n’a plus qu’un sentiment, qu’une idée où la vie est suspendue partout, partout excepté sur un point. C’est un état bien pesant. D’autant plus pesant qu’il est plein d’hypocrisie ; on va, on vient, on parle ; on a l’air de penser à tout. J’ai fait recommander hier au facteur de la poste de venir aussi vite qu’il le le pourrait. Mais il ne sera pas ici avant 10 heures et demie.
Cette nuit je me suis réveillé dix fois croyant l’entendre arriver. Ah, dearest, que sert d’avoir vécu d’avoir souffert si l’on n’apprend pas du tout à souffrir si l’on se retrouve, après, tant et tant d’épreuves, aussi impatient à la souffrance, aussi ardent au bonheur, aussi agité, aussi tremblant, aussi avisé. Et pourtant, je m’admire ; je me trouve d’une patience, d’une modération excessive. Si je m’en croyais, si je suivais ma pente, si mes actions étaient l’image fidèle de mes sentiments, où serais-je aujourd’hui ? Je vous l’ai dit souvent : on a mille fois plus de vertu qu’on ne croit. Mais elle ne gouverne que le dehors. Depuis hier, je me raisonne sans relâche ; je me dis tout ce que ce me dirait le plus sensé, le plus bienveillant ami, que rien ne peut être changé dans votre situation, dans notre situation, que votre fils ne peut vous avoir rien amené, rien apporté que nous n’eussions prévu puisque nous avions prévu le pire, que son arrivée vous délivre au contraire d’une crainte plus grave, que vos lettres à tout ce monde-là sont parties &, &. Tout cela est vrai, j’espère, j’en suis sûr. Mais jusqu’à ce que j’aie des nouvelles, des nouvelles comme il me les faut, toutes ces vérités-là sont mortes. Je les vois et elles ne me font rien. Elles passent devant mon esprit & quand elles ont passé, je me retrouve tel que j’étais. Je n’ai pas même la ressource de me blâmer moi-même, de me dire que j’ai tort de vous tant aimer, de mettre ma vie en vous, que j’aurais mieux fait de laisser mon cœur dans son tombeau. Il n’y a pas moyen ; ces idées-là ne peuvent m’approcher. Quand elles essayent d’apparaître de loin, à l’instant je vous vois, vous avec tout ce que vous avez de noble, de vrai, de tendre, de rare, vous excellente et charmante, vous si aimable, si attrayante, si attachante et toujours d’en haut. du plus haut ou puisse habiter une créature ! Comment aurais-je fait vous connaissant, pour ne pas vous aimer comme je vous aime ? Comment ferais-je vous aimant, pour ne pas être inquiet, troublé, impatient, avide, jaloux, insatiable comme je le suis ? Je n’ai qu’à me résigner. Je me résigne. Dans deux heures j’espère, je n’y aurai pas tant de peine.
J’attends toujours. Vous me direz sans doute si je puis continuer à vous écrire comme je ferais, ou s’il faut prendre quelqu’une des précautions que vous m’avez indiquées. En attendant, et pour que rien ne manque à la sûreté, je vous ai écrit hier soir et vous aurez demain une lettre officielle, très officielle. Il n’y a personne qui ne puisse lire celle-là aussi, n’a-t-elle point de Numéro.
11 heures 1/4
Me voilà rassuré. Me voilà heureux. Pourtant, je vous envoie ma folie, car c’est de la folie. Je vous l’envoie même directement. Il n’y a, ce me semble, aucune raison de ne pas le faire. Vous l’aurez trois heures plutôt. Et je ne vous ai pas seulement demandé si vous étiez toujours plus souffrante ! Je n’ai pas songé à votre santé ! Décidément dites-moi si quand je vous écris comme aujourd’hui, vous voulez que ce soit directement, ou directement. Adieu, adieu. Adieu. J’y mets tout. G.
65. Val-Richer, Dimanche 22 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il est très doux de se réveiller quand on a le cœur content. Je ne m’étonne pas que les oiseaux chantent en se réveillant. La vie leur plait, et ils se réjouissent de la retrouver. Je ne chante qu’en dedans ; mais cela me suffit. Je m’entends moi même. Quels enfantillages je vous conte là ! Il faut bien que je vous conte mes enfantillages après mes folies. Une fois ensemble, nous parlerons sérieusement. Nous allons entrer dans la dernière semaine. Il est possible que par des arrangements de voyage j’arrive à Paris, le 31 à 7 heures du matin au lieu de 5 heures du soir. Je vous verrai ainsi quelques heures plutôt. Je vous le dirai positivement d’ici à trois jours. Le réveil du 31 vaudra encore mieux que celui d’aujourd’hui.
En attendant, et dans les moments de liberté qu’on me laisse ; je plante. Mon jardin, n’est pas commencé, mais pour ne pas perdre tout-à-fait cette année, je mets des bouquets d’arbres et d’arbustes là où je suis sûr qu’il en faudra. Il m’est venu hier 76 pins, mélèzes, sapins et arbres verts de toute espèce, déjà un peu grands; et j’ai passé presque toute ma matinée à marquer les places, à faire creuser les trous, tant au bord de la pièce d’eau, tant assez près de la maison autour d’un banc, tant à une place d’où l’en entrevoit une jolie vallée un peu lointaine. N’est-ce pas qu’il faut absolument quelque part une grande allée droite où l’on puisse se promener sans tourner sans cesse, et causer en voyant devant et derrière soi ? J’en aurai une ou plutôt deux tombant l’une sur l’autre à angle droit. La première sera d’arbres ordinaires, tilleuls, marronniers, cerisiers, je ne sais pas bien lesquels ; j’ai envie que la seconde, beaucoup plus courte, soit toute en arbres verts, deux rideaux bien hauts, bien droits, fermant bien les côtés, mais laissant voir le ciel. Qu’en dites-vous ?
Je suis curieux de votre conversation avec Thiers, ce que vous me mandez de lui ne m’étonne pas du tout. Du reste sa conduite dépendra des élections. Si elles lui sont favorables, si la gauche gagne du terrain, il fera de nouveaux pas vers elle, sera exigeant, arrogant, menaçant avec le Ministère. Si l’ancienne majorité revient la même c’est-à-dire affermie, il sera doux, modeste, se fera ministériel soutiendra, promettra. Il y a là cependant pour lui une grosse difficulté. Il ne voudra pas faire ce métier-là gratis ; et on ne pourra lui donner le prix qu’il voudra. J’ai peine à croire qu’il se mette à si bas prix que le marché. soit possible. Nous verrons. Mes nouvelles électorales sont assez bonnes. J’ai grande envie de savoir un peu aussi les projets de Berryer. Je ne crois pas que son bataillon se grossisse autant que quelques personnes l’espèrent ou le craignent. Il n’acquerra pas plus de 15 ou 20 nouveaux membres. Cependant ce sera un petit bataillon et dans une assemblée incertaine, comme le sera encore celle-ci, c’est toujours quelque chose.
On commence donc à vous soutenir un peu. Vous propagez la rébellion. Je suis bien aise que Pozzo s’en mêle. J’ai pour lui un fond de vieux goût. J’en ai toujours pour les hommes dont l’esprit a mis le mien en mouvement et avec qui j’ai causé bien en train, bien à l’aise, n’importe sur quoi. Je vous préviens que je ne vous écrirai cette semaine que des lettres misérables. J’aurai de jour en jour, moins de goût à vous écrire. J’ai une multitude de petites affaires qu’il faut absolument que je règle. On me prend tout mon temps en visites. Je vais trois fois dans la semaine dîner à Lisieux.
Mlle Chabaud, cette amie de ma mère qui était ici et avait bien voulu se charger de la leçon d’anglais de mes filles, est partie hier. Je reprends mon rôle. J’ai déjà lu hier avec Henriette une scène de Shakspeare, Hamlet and the ghost. Elle l’entend assez bien. 11 1/4 Je comprends votre agitation, votre presse. J’ai regret d’y avoir ajouté. Ne m’écrivez que quelques mots si vous êtes fatiguée. Adieu, adieu. Votre N°66 me charme. Adieu.
66. Val-Richer, Lundi 23 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Décidément et malgré l’ébranlement que cela vous a causé, et quoique je ne sache encore aucun détail, je suis bien aise que votre fils soit venu. Il aura vu ce qu’on ne voit pas de loin. Vous lui aurez dit ce qu’on n’écrit pas. Quelque résolu que soit M. de Lieven à ne pas changer d’avis avant le temps il me paraît impossible que cela n’agisse pas un peu sur lui, ne fût-ce que pour tranquilliser encore plus sa conscience. Sa conscience une fois bien tranquille, il y a, ce me semble, certaines difficultés de votre situation qui doivent être aplanies, surtout par un intermédiaire si sûr. Enfin, vous me direz tout cela. J’y pense sans cesse. Moi aussi, j’ai tant d’envie qu’on vous laisse un peu en repos ! Je regrette de n’avoir pas vu votre fils. C’est votre fils.
On commence aujourd’hui les préparatifs de départ. On fait des caisses. On met en ordre le ménage qui doit rester au Val-Richer. Le soleil, les bois, la vallée, tout est encore beau. Mais que m’importe ? Vous m’avez gâté la campagne, gâté de deux façons, parce que j’ai envie d’être ailleurs et parce que je me figure à quel point je serais bien ici, si vous y étiez. Sans vous, tout est incomplet pour moi. Vous manquez au soleil, aux bois, à la vallée. Je ne puis les regarder sans qu’il s’élève aussitôt dans mon cœur un désir et un regret infiniment supérieur à tous les plaisirs qu’ils me peuvent donner. Que c’est dommage ! Ce lieu-ci se prêterait à tout. L’aspect est sauvage et riant calme et animé. On ferait aisément de la maison quelque chose de grand et de simple. J’y arriverai l’année prochaine par un bon chemin.
Je lisais l’autre jour à mes enfants les Châteaux en Espagne. Combien j’en ai fait en lisant, et bien plus beaux que ceux que je lisais ! C’est une singulière impression de se laisser aller ainsi à sa fantaisie. Les premiers moments sont délicieux. On va, on va ; tout arrive, tout s’arrange ; on y est, on le voit, on en jouit. Et puis, tout à coup, tout disparaît, tout tombe ; il n’y a plus rien. Il y a le vide, et la chute dans le vide. Ne vous arrive-t-il jamais, la nuit de rêver que vous prenez votre essor, un grand essor pour monter, pour atteindre à quelque chose qui vous plait, qui vous attire ? Mais l’essor s’arrête soudain, et par un soubresaut très pénible, vous vous retrouvez dans votre lit, seul et rompu, moulu.
M. de Grouchy m’apportera donc quelque chose. Je vous en remercie mille fois. Je me dis tout ; mais j’aime bien mieux votre voix que la mienne. Et puis je suis sûr que je ne me dis pas tout. Vous savez bien combien je vous aime. Eh bien ne vous vient-il par tous les jours de moi, de loin comme de près, quand je vous écris ou quand je vous parle, quelque chose de nouveau, d’inattendu ? C’est le droit, c’est le charme d’une affection comme la nôtre. On croit à tout et on découvre toujours. La confiance est entière, mais le trésor est inépuisable. Rien d’ailleurs, voyez-vous rien, pas même les plus vifs désirs, les plus douces suppositions du cœur, le plus tendre, rien ne vaut la réalité ; et l’amour lui-même ne sait rien inventer d’égal à ce qu’il peut recevoir.
11 heures
Je n’ai jamais qu’une chose à vous dire. J’aime le N°67. J’aurai dans la journée la lettre indirecte, et je suis sûr que je l’aimerai bien davantage. Et puis le 31 encore davantage. Adieu. adieu. Que de choses à nous dire ! Et pour finir toujours par Adieu. G.
67. Val-Richer, Mardi 24 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai tout, tout, plus que je ne demandais, plus que je n’espérais ! Et j’espérais ce que je n’avais demandé. J’ai ces charmantes, ces ravissantes paroles, que depuis si longtemps je n’avais pas entendues. J’ai votre prévoyance, vos soins, vos arrangements. Que je les aime ! Presque autant, pas tout à fait autant, mais presque autant que vos paroles. Tout cela, m’est arrivé hier. La fin de ma journée en a été remplie, embaumée. Je suis monté dix fois dans mon cabinet. J’ai fermé ma porte. Cette nuit, je me suis réveillé, je ne sais combien de fois, pour jouir de mon bien. Aujourd’hui, je l’ai là, à sa place. Certainement non, il ne me quittera pas.
Je n’ai pas voulu vous écrire hier au soir, avant de me coucher. J’en aurais trop dit. Vous, vous ne dites pas trop. Vous ne dites pas tout. J’y compte. Mais au moment où j’entends ce que vous dites, je ne vois rien, je ne désire rien au-delà. Ou plutôt, j’y vois tout ce que je désire. M. de Grouchy, repart demain ou après demain soir. Il vous portera sous le couvert de M. Génie, ma répons ; en attendant, ma vraie réponse, celle que j’apporterai moi-même, le 31 aujourd’hui en huit. Je ne sais pas encore, si ce beau 31, j’arriverai le matin ou pour dîner seulement. Je vous le dirai dans deux jours. Avez-vous décidément choisi l’heure de vos promenades ? Vous n’avez guère de choix, ce me semble. Dans huit jours, il fera froid la nuit à 4 heures.
Que ce que vous me dites de M. de Lieven est étrange ! Comment, il serait possible que tout cela fût de son invention, qu’il n’y eût rien de l’Empereur ! Sérieusement, je ne puis le croire. S’il en était ainsi, vos confidences, vos lettres, l’éclat de l’affaire seraient une bien juste et bien naturelle punition. J’ai grande impatience de savoir tous les détails. Au 31. Je remets tout au 31. Il me semble que la vie recommencera pour moi ce jour- là. En attendant, je fais comme si je vivais. Je plante mes arbres. J’ai eu hier en plantant, un moment délicieux. Je venais de recevoir votre paquet. J’avais tout lu, relu. J’étais retourné à mes ouvriers. J’avais l’air de les regarder. Ils plantaient un mélèze, charmant, haut, droit du feuillage le plus élégant, le plus fin. L’arbre se balançait, s’inclinait. Tout à coup, je l’ai vu se tourner, marcher vers moi. C’était vous que je voyais. Ce mélèze vous ressemblait ; il avait votre port, votre air, la souplesse et la noblesse de votre taille. Enfin je vous voyais là. Quelle folie ! Certains malades ont, à ce qu’on dit des visions, des hallucinations pareilles. Le bonheur a donc aussi les siennes. Nouvelle preuve du dialogue Hindou. à coup sûr, la pensée elle-même est trop lente pour admettre de telles illusions. L’amour seul peut les créer et les voir assez vitre pour y croire. Ce qui est certain, c’est que j’aimerai et soignerai toujours ce mélèze-là. Il est à l’extrémité de la pièce d’eau.
Savez-vous ce qui m’arrive, Madame ? D’instinct sans y penser je vous raconte tout, tous mes enfantillages. La seconde d’après, quand mes yeux retombent sur ce que je viens d’écrire, il me prend un mouvement d’hésitation ; je me dis c’est trop, c’est trop enfant ; si on voyait cela ! Et puis, en dernier ressort, je souris, avec quelque dédain à l’idée de ceux que mes enfantillages feraient sourire et je m’y laisse allez en pleine sérénité. J’ai fait de moi-même et de ma vie un emploi assez sérieux pour être enfant tant qu’il me plait avec vous, vous auprès de qui tout est sérieux pour moi. Vous voulez donc que je regarde que M. de Grouchy est déjà arrivé. Je ne puis pas et pourtant je regrette bien vivement ce que vous lui auriez donné hier; Le 31 je ne regretterai rien. Adieu. Adieu.
La poste est arrivée tard. Je quitte mon déjeuner pour fermer ma lettre. Adieu. Votre adieu.
68. Val-Richer, Mardi 24 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime ce gros chiffre 68. S’il prouve que nous avons été souvent séparés, il témoigne que nous nous écrivons depuis longtemps j’aime ce qui a duré. Depuis quatre mois ! Seulement quatre mois ! Cela ne me semble pas possible quand j’y pense. Tant de sentiments, tant de joies, de désirs, tant d’événement du cœur se pressent dans ce court espace. Et puis, quand nos affections arrivent à un certain degré de profondeur et s’imposent, elles prennent possession du passé comme de l’avenir, on ne se conçoit plus sans elles, pas plus que de l’un que de l’autre côté du temps. Il me semble que je vous ai toujours connue, toujours aimée, comme je vous connais et vous aime aujourd’hui, comme je vous aimerai toujours. Seulement depuis quatre mois ! C’est ridicule.
Décidément, je n’arriverai à Paris le 31 que pour dîner. J’avais espéré gagner quelques heures, mais cela ne se peut pas. Ma mère est bien. Son indisposition ne s’est pas renouvelée. Mes enfants vont à merveille. Le séjour au Val-Richer leur a réussi au delà de mon attente. Il n’y a rien de plus sain que l’espace et la liberté !
Je vous fais aussi, mon journal. J’ai continué hier mes plantations, mais sans hallucination aucune. Puis, j’ai eu dix-huit personnes, à dîner. C’est mon dernier dîner, à donner je veux dire ; j’en ai encore trois à recevoir. Par grande mésaventure, il faisait hier un temps affreux, et mes convives s’en sont allés à 9 heures et demie par la nuit la plus noire et la plus mouillée qui se puisse. Ils n’en étaient pas moins de fort bonne humeur. Je suis sûr qu’ils m’ont trouvé très aimable. Ne vous est-il pas souvent arrivé d’être aimable, de de très bien faire les choses, sans vous y plaire même, en vous en ennuyant ? Tout intérêt & volonté à part quand je suis une fois dans une situation, j’y veux être bien, je fais ce que je fais, ou plutôt cela se fait de soi-même par un certain mouvement intérieur que provoque la nécessité. On cause, on s’anime, on est aimable machinalement.
Voilà donc Constantine pris. Je regrette ce pauvre général Damremont. C’était un homme de sens et un galant homme. J’avais contribué plus que personne à lui faire donner le gouvernement d’Afrique. Il était bien avec M. le Duc d’Orléans et m’apportait plus de force que tout autre pour m’aider à chasser de là le Maréchal Clauzel. Du reste, il le désirait beaucoup lui-même, et n’y avait été envoyé que de son plein gré.
Je suis bien aise que M. de Médem soit bien pour vous. Je lui ai toujours trouvé de l’esprit. Vous serez bien longtemps avant d’avoir aucune réponse à vos grandes lettres. L’Empereur fait décidément son voyage du Caucase, et aucun de vos correspondants ne prendra sur lui de vous répondre avant son retour. Qu’est-ce que cette conciliation de l’Empereur avec le général Yermoloff ? Je croyais que c’était là un des hommes les plus plus indépendants et les plus récalcitrants de la Russie. Est-ce lui ou l’Empereur qui a fait les frais de la réconciliation ? De quoi vous parlé-je là ? Je fais comme si nous en étions ensemble depuis six mois, et que toute conversation nous fût bonne. Du reste, je prends souvent plaisir avec vous à parler des choses les plus indifférentes, les plus insignifiantes, précisément pour jouir du charme qui s’y attache près de vous. C’est un charme doux et qui repose. On a l’air de se distraire, mais il n’en est rien. On ne se distrait pas du bonheur.
11 h. 1/4
Il faut que vous mangiez que vous dormiez. Je suis décidé à vous trouvez bien et à vous bien gouverner pour votre santé. Adieu. M. de Grouchy part ce soir. Vous aurez après-demain matin de mes nouvelles par lui. Adieu. Adieu
69. Val-Richer, Jeudi 26 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis revenu ce matin de Lisieux où j’ai couché. J’y retourne à 4 heures Je fais planter, démeubler, enfermer, emballer. Je ne sais si je viendrai à bout, avant mon départ de faire ce que je veux avoir fait ici. Vous ne savez pas qu’il faut que je regarde à tout, que je sois maître et maîtresse de maison. C’est ennuyeux, et quelques fois plus qu’ennuyeux. Je n’aurai pas ces jours-ci une heure à moi. Notre correspondance s’en ressentira, notre correspondance mon plus vif et plus doux plaisir, ma vie et mon repos, tant que je suis loin de vous ! J’y ai moins de regret ; dans cinq jours, je serai près de vous. Vous avez raison, que de choses possibles dans cinq jours ! Mais il n’en arrivera aucune. Il ne se peut pas qu’un tel bonheur me manque, nous manque.
J’espère que votre indisposition ne se prolongera pas trop. Non, si j’étais là, je ne vous lirais pas les Hindous. Ce n’est pas ce moment. Voilà un mot qui, depuis ce matin, résonne sans cesse dans mes oreilles, et dans mon cœur. Je n’entends que cela, je ne pense qu’à Je reçois le N°71 au moment de monter en voiture pou retourner au Val-Richer. Beaucoup, beaucoup de repos ; un long repos. Êtes-vous aussi malade qu’à Abbeville ? Vous m’écrivez encore dimanche pour lundi. Et puis plus de lettre ! Adieu, adieu. C’est l’avant dernier.
70. Val-Richer, Vendredi 27 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aimerais mieux vous voir que vous savoir faible. Je vous l’ai déjà dit une fois : je crois à la puissance de l’affection pour soulager, même physiquement. N’y eut-il que du mal à partager et ce qui est bien pis, à regarder sans le partager, j’y voudrais encore être. Il faut toujours y être. J’y serai mardi. Ce jour-là j’espère, votre mal sera passé, et pour votre mal je ne vous serai bon à rien. Ce jour là ! Tous les jours qui suivront ce jour-là ! Il y a des joies comme des peines, dont je ne sais pas, dont je ne veux pas parler. Il est impossible de ne pas mépriser la parole quand on la met à côté.
Je comprends que M. Molé soit constant. Constantine, après les deux mariages, cela fait trois bonnes fortunes. Je suis bien aise qu’il soit de bonne humeur. Je n’ai pas l’intention d’être de mauvaise humeur. Il n’y a évidemment, en ce moment, point de question ministérielle, et je ne connais rien de si ridicule que d’en vouloir faire où il n’y en a pas. Il n’y a que des positions à garder ou à prendre, et de nouvelles preuves à faire chaque jour. C’est là mon seul dessein. L’occasion, je crois, ne manquera pas. La Chambre future, si je ne me trompe, ne se donnera à personne. Il faudra la prendre. Nous causerons aussi de tout cela, mais après, bien après. Du reste, il me semble que nous aurons du temps pour tout.
Je reçois ce matin une lettre de Mad. de Dino qui me presse de nouveau pour Rochecotte. Elle y sera établie le 7 ou 8 novembre. Je n’ai pas besoin de vous dire que je n’irai pas. Je lui répondrai demain. Je n’ai du reste nul embarras à n’y pas aller. Je lui avais dit que peut-être en retournant à Paris, il me serait possible de passer de son côté. Mais les élections me rappellent. ll faut que j’aille directement ; et puis que je mette fin à mes courses de cet été. J’en ai tant fait ! Les bonnes raisons ne manquent jamais.
La Duchesse de Broglie m’écrit aussi pour se plaindre un peu que je n’aille pas, avec tous les miens, passer quinze jours à Broglie. Elle y va le 6 novembre jusqu’à l’ouverture de la session. Je la trouverai encore à Péris. J’en suis bien aise. Voilà bien des braves gens qui se sont fait tuer. J’espère que le général, Perregaux guérira. C’est un officier très distingué, un homme d’esprit et d’esprit assez haut, bien plus d’esprit que le général Danrémont qu’il aimait beaucoup. Je connais tous ceux dont je viens de lire le nom dans le bulletin. Chagrin à part, c’est une étrange impression que d’apprendre qu’un homme qu’on a beaucoup vu, qu’on n’a vu et su que plein de vie, a cessé tout à coup de vivre. On a grand peine à y croire. Je ne sais pas si l’Afrique nous servira jamais à grand chose ; mais je suis bien aise que l’esprit militaire conserve quelque part un aliment et un théâtre. Je l’honore beaucoup. Il y a des vertus qui se perdraient en ce monde si la guerre en disparaissait.
Vous voyez bien qu’il faut que je ne vous écrive plus. Je n’y ai plus le cœur. Encore un mot Dimanche et puis ! Adieu. Je repars dans deux heures pour aller dîner à Lisieux. Adieu. Adieu. Lisieux, Samedi 8 heures. Vous auriez dû avoir vendredi, à 11 heures, ma lettre par M. Génie. Vous l’aurez eue à 6 heures. Adieu. Adieu. Comment pouvez-vous imaginer que j’ai regret à quitter la campagne ? Quand j’aimerais extrêmement la campagne, je n’y penserai pas seulement une minute aujourd’hui. Adieu.
71. Lisieux, Samedi 28 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Enfin ! Je laisse ce dernier mot à Lisieux. il sera mis à la poste demain. Vous l’aurez lundi. Je ne puis plus rien dire. C’est bien ennuyeux en effet que vous ne puissiez fermer votre porte mardi soir. Mais il ne le faut pas. Vous avez raison. J’y serai à 8h. 1/4. Je me soignerai d’ici là comme si je vous soignais. Je ne veux pas d’accident. Adieu. Adieu. Quel adieu !
100. Val Richer, Vendredi 27 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce n’est pas pour vous que je me lève de si bonne heure, mais je ne puis me refuser le plaisir de commencer par vous. J’attends demain M. Génie et M. Dumon. Ils me prendront un peu de temps, et je veux achever aujourd’hui quelques pages que j’ai promises à la Revue française. Je ne devrais pas promettre, car je tiens.
Cette semaine a marché bien lentement. Enfin la voilà qui s’en va. Dans trois jours, je me mettrai matériellement en route. Il pleuvait à seaux hier au soir ; ce matin, il fait beau. Peu m’importe pour mon voyage ; mais, pour mon séjour, je veux un beau temps frais, un temps qui vous plaise. Quand nous nous promènerons le soir, j’aurai besoin d’un peu de précaution, pas trop tard ou la calèche à demi fermée. Je sens très vite le serein. à la vérité le serein de Paris ne ressemble pas à celui de Normandie. Je suis bien aise que les Brignole et le duc de Palmella vous reviennent de Londres. Le dernier me paraît d’une société agréable et douce, quoiqu’un peu traînante, comme dit Voltaire de la prose de Fénelon. Ils vous raconteront tout, et vous me le redirez. J’aime beaucoup mieux avoir cela de la seconde main quand c’est la vôtre. Le plaisir que vous y prenez fait plus de la moitié du mien. Vous avez tort de vous obstiner sur la Belgique, car vous céderez. Si vous ne voulez qu’avoir un bon procédé pour le Roi de Hollande, à la bonne heure ; mais comptez que trois mois plutôt ou plus tard, l’affaire s’arrangera. En renonçant à toute prétention territoriale la Belgique à de bonnes raisons quant à la dette ; et ce qui vaut mieux que les raisons, peu lui importe d’attendre. Elle a le provisoire, et le temps ajoute à la bonté de ses raisons. Puis elle fera quelque offre raisonnable, quelque grosse somme payée tout de suite qui videra le différend. Du reste, l’Empereur ne me paraît guère vouloir autre chose que garder sa position et satisfaire son humeur. Il n’y a rien là de bien gênant pour personne. Je vous quitte pour travailler.
9 h. 1/2
Je vous reviens pour rire avec vous de la bêtise des journaux anglais. Est-ce qu’il y en a vraiment un qui ait pris cela au sérieux ? Voilà un beau thème d’éloquence pour le Maréchal Soult. Si vous êtes content de Lord Palmerston, j’ai tort au commencement de cette page. En tout cas ne soyez pas malade. J’y tiens beaucoup plus qu’à la dette belge. J’irai y veiller mardi. Adieu. Adieu.
101_1. Lisieux, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’arrive et je repars à l’instant pour Broglie, où je veux arriver pour déjeuner. J’ai été charmé, toute la nuit de mon apparition en passant. Je l’avais désirée sans l’espérer. C’est bien rare d’avoir plus qu’on n’a espéré. Adieu.
Je suis dans le bureau de poste, entouré de courriers et de commis. J’ai oublié la série des Numéros. Je la retrouverai au Val-Richer. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance
101_2. Broglie, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je tombe de sommeil. J’ai fort peu dormi cette nuit. Ce matin au moment d’arriver, je dormais profondément. Certainement, je dormirais si je ne vous écrivais pas. Mais je ne puis me résoudre à passer toute cette matinée sans vous. A midi et demie en sortant de déjeuner, il m’a pris un vrai mal aise physique. Que le bonheur devient promptement une habitude ! Une heure après vous avoir retrouvée, il me semblait que je ne vous avais jamais quittée ; et pendant bien des jours, à midi et demie, je m’étonnerai tristement de ne pas sortir pour aller vous voir.
Samedi 7 h.1/2
J’ai été interrompu hier par M. de Broglie. Quand on arrive de Paris, il semble toujours qu’on apporte des nouvelles. Il n’y en a point. Je le dis. La conversation languit un moment. Et puis, à défaut de grandes nouvelles, les petites arrivent, abondent, et la conversation se ranime et devient intarissable. J’ai passé hier ma journée à raconter ce que je ne sais plus aujourd’hui ce que je me rappellerais bientôt si j’allais causer ailleurs. Mad. de Broglie vient de partir ce matin avec sa fille. Elle passera deux jours à Paris pour assister au grand concours de l’université où son fils a des prix, et le ramènera, sur le champ ici. Mad d’Haussonville partira du 28 au 30 pour Milan, Rome, Naples et l’hiver en Italie. Mad. de Broglie voulait absolument que nous passassions encore quinze jours ici. J’y serais revenu reprendre ma mère, et mes enfants, à mon retour de Caen. Mais je veux rentrer chez moi. Il faut une raison pour que je me plaise à en sortir longtemps. J’ai trouvé ma mère bien et mes enfants, à merveille. Guillaume est engraissé. Votre petit nécessaire a eu un grand succès. Henriette veut vous écrire. Et Pauline, qui ne sait pas écrire veut vous écrire aussi pour vous remercier avec sa sœur et pour sa sœur. Mes deux filles, sont très unies. Il faut qu’elles fassent toujours la même chose. Tout est commun entre elles. C’est un appui, et un repos dans la vie qu’une vraie intimité fraternelle. Et puis ce spectacle me plaît. Mes filles sont, dans leur famille, la troisième génération qui me le donne. Et toujours l’aînée supérieure à la cadette, et la plus dévouée, la plus prompte, aux sacrifices matériels pour sa sœur.
101. Val Richer, Samedi 28 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon dernier mot. Il sera court. Ni ma joie, ni mon chagrin ne sont bavards. Pourvu que je vous trouve bien portante ! Votre mal aise m’a préoccupé tout le jour. De quoi vous parlerais-je ? J’ajourne tout à mardi. Ce jour là, je n’aurai point encore de jury. Tout mon temps sera à moi. Pourquoi donc, est-ce que je vois encore dans les journaux que Lord Granville a été chez le Roi ? Est-ce qu’il n’est pas parti pour Aix ? J’attends Génie ce matin. Il vous aura vue. C’est quelque chose quelqu’un qui vous a vue, en attendant que je vous voie moi-même. Je laisserai mes enfants très bien et ma mère assez bien. La santé de ma mère, me préoccupe beaucoup. Elle est heureuse. Elle l’a si peu été ! Elle jouit vivement de l’affection de mes enfants. Ils remplissent son temps et son âme. La campagne lui plaît. J’espère que le soir de sa vie se prolongera au milieu de ces impressions douces. Et elle m’est si nécessaire pour mes enfants ! A travers beaucoup de petites choses qui manquent et qui m’impatientent quelquefois, toutes les grandes y sont et me donnent une sécurité habituelle que rien ne pourra remplacer. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu’après l’arrivée du facteur. Mais il sera ici probablement avant M. Génie. Adieu donc. à mardi, midi et demie
9 h. 1/2
Le facteur ne m’apporte pas de lettre. Je suppose que M. Génie me l’apportera dans une heure. Je veux bien de cet échange. Mais sans cela, je serais inquiet. En attendant, adieu, le dernier. G.
104. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi m’êtes-vous devenue nécessaire ? Vous ai-je dit que mon service de poste venait de recevoir un grand perfectionnement ? Mon facteur m’arrivera une heure plutôt et retournera toujours à Lisieux avant le départ du courrier pour Paris. En sorte que vous aurez toujours ma lettre de la veille. M. Conté a arrangé cela, pour moi. Je lui en tiendrai compte quelque jour. L’allocation du Roi sur le parfait accord de sa famille, et de son ministère, est avidemment une réponse au déjeuner de M. le duc d’Orléans chez M. Foule et à mon dîner chez M. le duc d’Orléans. Je n’en reste pas moins convaincu que M. le duc d’Orléans n’a fait cela que d’accord avec le Roi. La part de la comédie est grande, en ce monde. Je trouve le discours de Lord John excellent, un vrai discours de gouvernement, acceptant la responsabilité sans dissimuler le tort, jugeant et agissant d’ensemble et non en détail. C’est le détail qui perd les hommes et les affaires. Lord John a fait de grands progrès. En tout, je trouve la conduite et la situation des Whigs, c’est à dire de Lord Melbourne et de Lord John, meilleures que je n’attendais. Lord Aberdeen se flatte. La clef de l’avenir ministériel est toujours en Irlande. Les Torys ont tort de prolonger indéfiniment les questions irlandaises. Le Gouvernement Tory de l’Irlande est impossible. Les hommes même simples spectateurs ne supportent plus ce degré d’iniquité et de violence. Je regrette la lettre de Lady Clauricard, et celle de Lady Granville, et même celle de Mad. de Flahaut. Si elle a envie de revenir cet hiver, elle reviendra. La mauvaise humeur est une puissance terrible.
9 h. 1/2
Voilà mon facteur et mon N°108. A ce soir. Je trouve ici en arrivant je ne sais combien de petites affaires à régler. Quatre ou cinq personnes sont là qui m’attendent. Nous reprendrons ce soir notre conversation. Car je veux retrouver dans nos lettres notre conversation. Je veux vous dire tout ce qui me traverse l’esprit, tout ... excepté ce qui est tout. à la vérité ceci ne me traverse pas l’esprit. Adieu. Comment voulez-vous qu’on trouve un ventriloque, un homme qui parle là où il n’est pas ? Aussi, qui a jamais cherché un ventriloque ? Je vais pourtant écrire encore pour essayer de trouver le vôtre. Adieu. G.
105. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous lisez très bien les journaux. J’ai envie de m’en fier à vous, et de n’y regarder que ce que vous me recommanderez. D’autant plus que j’avais remarqué tout ce que vous me dites et pas grand chose de plus. Je suis de votre avis sur tout entre autres sur l’article des Débats. Il était si à propos, et si aisé d’écrire sur ce bruit du Times, dix lignes de cœur haut et de bon gout, dix lignes vraiment royales, en réponse aux boutades impériales ! Pour le constitutionnel, je n’y attache aucune importance. Il serait vendu qu’il ne parlerait pas autrement. Raison de plus même. Cependant je ne le crains pas. Mais je crois que M. Molé a une voie que je crois connaitre, pour faire insérer de temps en temps, dans ce Journal, quelque article qui le serve comme il l’a fait pour la visite de Champlatreux. La plupart des journaux sont aujourd’hui des magasins où l’on achète un article. Certains acheteurs payent plus cher que d’autres, et ne peuvent entrer que rarement. Mais pourvu qu’ils en disent tant, et pas trop souvent, on les écoute. Si l’opposition savait son métier comme elle exploiterait l’abandon du procès Chaltas ! Mais elle est bête et subalterne. Elle ne sait pas, et n’ose pas. Je n’en persiste pas moins à penser qu’au dehors, on est embarrassé de cette affaire, & bien aise qu’elle ne soit pas poussée à bout. Je ne trouve pas l’article Hollandais bien fin ni bien fier. Les républiques anciennes auraient mieux répondu. Je ne suis pas républicain, ni vous non plus.
Mais avez-vous lu, vraiment lu Thucydide et Tacite, Démosthène, et Cicéron ? Ce sont les esprits qui vous vont le mieux, hauts et naturels, dignes et dégagés, sensés et élégants, et ce je ne sais quoi d’achevé que la perfection du langage donne à la pensée. Vos grandes pensées vaudront les leurs, mais pas mieux, je vous en prévient. Occupez-vous en un peu quoiqu’on dise. Voulez-vous que je fasse porter chez vous une traduction passable de Tacite. Que je voudrais vous tire tout cela moi-même ! Nous nous sommes rencontrés tard. L’eau court vite. Bien peu de place nous reste pour tout ce que j’y voudrais mettre. Le bonheur possible et point réalisé, vu et point atteint, est un des plus pénibles sentiments que je connaisse. Je vous quitte pour ce soir. Je n’ai pas encore regagné tout mon sommeil.
Lundi 20 8 heures
En rangeant, mes papiers, je viens de relire, le N°104. Je ne suis pas décidé à le bruler. Il y a du bien mauvais. Mais tout n’est pas mauvais ; et dans le mauvais même, il y a du bon, ne pouvant les séparer, j’ai envie de garder tout, pêle- mêle. Je voudrais bien n’avoir pas d’autres papiers à ranger que ces numéros là. J’ai des ennuis d’affaires, des comptes à examiner, un fermier qui ne paye pas. Vous ne savez pas ce que c’est que des affaires, et j’espère que vous ne le saurez jamais quoique je vous aie vue à la veille de le trop bien savoir. Je vais à Caen dimanche 26 de grand matin. Ainsi le samedi 25 adressez-moi votre lettre à Caen, à la Préfecture. Je passerai là cing ou six jours, entre la société des Antiquaires, les courses de chevaux et mes courses à moi dans les environs. Le pays-ci est en grand progrès de civilisation. On y prend tous les goûts élégants et civilisés, les courses, les arts, les Académies, les speeches. Tout cela est amusant, à voir naître, si petit d’abord, si informé, et pourtant si animé, si avidemment destiné à grandir. Mon Lisieux vient de fermer son exposition de tableaux, plus de 250 tableaux, dessins, n’en soit de la province soit d’ailleurs. Le public normand a été très excité et charmé. Les paysans sont venus en foule voir cela. L’expositon a fini par une loterie de tableaux. On en a acheté pas mal, de côté et d’autre. On les méprisera beaucoup un jour. Mais ils auront commencé le goût et le sentiment de l’art dans toute une population.
9 h. 1/2
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. C’est la première fois que cela m’arrive cette année. C’était hier Dimanche. On aura mis votre lettre trop tard à la poste. C’est la seule explication que j’accepte. Adieu. J’aime mieux me taire.
Mots-clés : histoire, Littérature, Politique (France), Portrait (Dorothée), Presse, Progrès
107. Val-Richer, Lundi 20 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai bien envie d’avoir de l’humeur. J’ai mal reçu mon facteur ce matin. Il a été très étonné. Il arrivait de très bonne heure. Malheur à lui s’il arrive tard demain. Pensez bien je vous prie à l’heure de la poste le dimanche, car ce ne peut être que cette cause là. Et si c’est une autre cause, une cause où vous ayez la moindre part du monde, ne me parlez plus de mon étourderie parce que je n’ai pas toujours un almanach dans ma poche. Je me suis promené toute la journée. Il faut que je parle lundi prochain à la société des Antiquaires, et je ne sais que leur dire. J’ai essayé de chercher un peu d’esprit. Ce que j’en ai trouvé ne vaut rien, je crois. J’espère que demain après déjeuner, je serai plus heureux. Il le faudra bien.
Je viens de jouer au loto-dauphin avec mes enfants. Je les ai gagnés. J’ai au jeu un bonheur insolent. Que faire des bonheurs dont on ne se soucie pas. Si tout autre eût gagné, ma petite Pauline se serait impatientée. Il lui déplaît fort de perdre. Mais mes enfants me pardonnent tout. Nous sommes très tendrement ensemble. Je ne les chicane, et ne les gêne pas du tout dans le détail de la vie. J’aime la liberté des gens que j’aime. J’ai du plaisir à les voir s’ébattre librement devant moi d’esprit comme de corps. Avez-vous aussi beau temps que moi ? Du soleil brillant et pas très chaud. Je voudrais arranger le temps de Longchamp l’y envoyer tous les jours, comme vous y envoyez des sandwiches et des fraises. Vient-on vous y voir ? Car vous avez un peu plus de monde à présent. Pahlen vous arrivera dans deux jours. Je vous quitte pour écrire à d’autres personnes de qui je n’attends pas de lettre. Adieu jusqu’à demain.
Mardi, 9 h. 1/2
C’est ce que j’avais pensé. Me voilà délivré pour aujourd’hui de mon chagrin, et pour toujours du reproche d’étourderie deux lettres à la fois, c’est charmant ; mais décidément j’en aime mieux une chaque jour. Ces deux lettres m’arrivent au milieu de la leçon d’arithmétique de mes filles. A ce soir notre conversation. J’aurai le cœur gai aujourd’hui. Adieu. Je suis charmé que vous ayez trouvé le ventriloque. Faites-en mon compliment à M. de Brignolle. Où donc l’a-t-il trouvé ? Adieu. Mille adieux. C’est le moins que vous me deviez.
108. Val-Richer, Mardi 21 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il y a plus de soleil ce soir dans mon cœur qu’il n’y en avait ce matin sur la vallée, quand je me suis levé en admirant tristement son éclat. Bien des gens me prennent pour le sage des Stoïciens. Qu’ils seraient étonnés s’ils voyaient combien je suis loin de son impassibilité? J’ai supposé un moment quelque arrivée soudaine qui vous avait dérangée et retardée. Cependant cela me paraissait si invraisemblable que j’ai écrit comme à l’ordinaire, si le grand Duc passe quatre semaines à Tour ce que vous aviez cru possible ne le sera que plus tard, et il faut changer vos calculs. Je comprends la joie d’Appony que rien ne soit changé ailleurs. Il y a si je ne me trompe, dans la politique de M. de Metternich beaucoup de calculs jaloux (le jaloux sans amour bien entendu), beaucoup de soin à entretenir les rivalités, les misintelligences, les séparations, et à fonder là-dessus sa force. Cela me parait un peu vieux, je vous l’avoue. C’était la politique d’un temps où les grands intérêts et les vœux généraux des peuples ne pesaient pas incessamment sur les gouvernements, où les combinaisons arbitraires, mobiles, étaient possibles et habituelles. D’un temps aussi où beaucoup de petits Etats avaient leur poids dans la balance et pouvaient être assez facilement transportés, dans l’un ou l’autre bassin. Tout cela n’est plus. Il n’y a plus de petits états ; plus de combinaisons arbitraires et variables. Les grands intérêts décident seuls de la conduite ; et les grands intérêts sont connus ne changent pas tous les jours. Et on leur obéit, quels que soient les goûts ou les dégoûts, et les désirs secrets et les variations quotidiennes des cœurs. Toutes ces petites inquiétudes et ces petites joies, toute cette attention aux moindres nuages qui passent, aux plus faibles fils qui se tendent ou se brisent, me paraissent une routine de vieilles gens ou un passe-temps d’oisifs. Qu’on y regarde, et qu’on en tienne compte pour son propre plaisir, pour l’agrément ou le désagrément des relations personnelles, rien de plus simple c’est quelque chose pour la conversation, quelque chose pour l’attitude réciproque des acteurs sur la scène ; mais ce n’est plus de la politique. Les Affaires sont plus haut que cela. Et à la hauteur où elles sont, elles sont écrites, comme disent les musulmans ; il faut des motifs placés aussi haut pour les changer.
Lord Alvanley, vous restera-t-il quelque temps ? Je le voudrais. J’aime que vous vous amusiez loin de moi. Est-ce de la présomption ? Peut-être ; mais à coup sûr c’est de l’affection. Vous croyez qu’il me trouverait bien sérieux. Qui sait ? Je l’amuserais peut-être s’il m’amusait. Mais les indifférents m’amusent difficilement. Je n’accepte les petits plaisirs, la gaieté le rire pour rien, que de la main des gens que j’aime que j’aime beaucoup. malgré votre tranquillité dans le n°110, j’attends demain le comte de Paris. J’ai des nouvelles de chez Mad. la Duchesse d’Orléans, d’hier matin, qui me disent qu’elle commençait à souffrir.
Mercredi 22, 7 heures
Le Prince Paul Wutemberg me paraît du nombre des hommes qui croient aisément ce dont ils ont envie, et en qui le mouvement du sang décidé des idées : à voir cette grande et forte figure, ces traits grossiers, ce teint allumé, je n’ai pas la moindre foi dans l’impartialité de son jugement. Il a de l’esprit, mais encore plus d’égoïsme et de cynisme que d’esprit ; et ni l’égoïsme, ni le cynisme ne font voir clair. Vous savez que je crois encore moins que vous aux ouragans. J’ai de l’humeur pourtant.
Avez-vous lu dans le Journal des débats, un article sur la visite des Bayadères aux Tuileries ? Savez-vous que l’auteur de cet article, qui l’a signé de son nom est le précepteur de M. le Duc d’Aumale ? Un précepteur de Princes parlant de la sorte devant le public, et s’extasiant sur les Bayadères, et se trémoussant pour faire partager son extase et finissant par dire : " Après tout, si vous me demandez ce que sont les Bayadères, je serai fort embarrassé. Ce ne sont pas des danseuses, ce ne sont pas des chanteuses ; les Bayadères sont des Bayadères. " Il y a quelque chose qui est étrangement perdu de notre temps, c’est le tact. Personne n’a le sentiment de sa situation. Vous me direz qu’il n’y a pas de situations. Comment ne fait-on pas, soi-même la sienne ?
Voici de l’écriture et du style d’Henriette. Vous occupez souvent sa petite pensée. Elle voulait absolument mettre une enveloppe, ne trouvant pas ceci assez joli. Je lui ai persuadé qu’une suffirait pour elle et pour moi.
9 h. 1/2 Vous êtes une excellente personne de me dire tout simplement que vous aviez oublié le dimanche. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Politique, Portrait, Presse, Réseau social et politique
109. Val-Richer, Jeudi 23 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais bien voir vos instructions à Lady Clauricard. Est- ce que vous n’en gardez pas une copie ? Dites lui de vous en renvoyer une. C’est bien le moins qu’elle vous doive. Marie ne pourrait-elle pas en faire une ? Si j’étais là, je vous offrirais encore mon copiste, malgré sa bêtise. Soyez sûre qu’au besoin je vous parlerais de mes ennuis intérieurs aussi simplement que vous m’en parlez. Oui croyez hardiment que vous valez Lady Cowper pour moi. Mais malgré la tranquillité du moment je crains aussi toujours des ennuis pour vous-même. Vous m’avez fait connaitre des gens et des façons d’agir que je ne soupçonnais pas. Avec l’Empereur Nicolas et M. de Lieven, tout est possible. Aujourd’hui ne garantit point demain. Un grand géologue français, M. Elie de Beaumont vient de m’envoyer sont voyage à l’Etna. Je lisais cela hier soir. Il s’est promené je ne sais combien de temps, sur une croûte de terre assez mince, au dessous de laquelle sans rien voir, il entendait gronder et bouillonner des flammes, des eaux, des laves des pierres ; le sol pouvait à tout moment éclater sous ses pieds. Vos barbares sont ainsi faits. Il n’y a point de sûreté. Faites vos affaires vous-même. Assurez, ménagez vos moyens d’indépendance. J’y pense plus souvent que je ne vous le dis. Je suis plus tranquille sur l’Angleterre que sur vous. Non que tous les éléments d’explosion n’y soient. Entre la folie de M. Curran et celle de Lord Londonderry, il y en a plus qu’il n’en faut pour mettre le feu à un grand pays. Mais de l’un à l’autre de ces fous, la distance est longue, & remplie d’une foule de sages, très intelligents, et très résolus qui ne permettront pas aux deux petits bataillons de fous d’en venir aux mains. Voilà le résultat d’un bon et long gouvernement libre ; il n’empêche pas le mal ; il le provoque même et le développe ; mais il provoque, et crée un même temps une masse de bien, forte et compacte, qui pèse beaucoup plus dans la balance. Et puis, je vois dans tout cela bien des folies, et des colères simulées, celles de M. O’Connell et de Lord Lyndhurst par exemple. Si le péril devenait pressant, si les paroles entraînaient des actes, leur emportement radical et tory tomberait, je crois, bien vite.
Qu’est-ce que c’est donc que cette capture d’un Schooner anglais dans la mer noire ? Nous finirons par payer en Europe les frais de la rivalité anglaise et russe, en Asie. Car c’est de l’Asie au fond que la Russie, et l’Angleterre sont préoccupées. Du reste, je le veux bien. J’ai envie de voir rentrer l’Asie dans la circulation des événements. Il faut que l’Europe remue et régénère le monde entier. Ne seriez-vous pas curieuse de savoir où en seront les choses, dans 500 ans ? Je vois dans le Constitutionnel qu’il a été question d’un mariage entre le fils du Roi Ernest et une fille de l’Empereur Nicolas. Je n’y puis croire. Et puis le Constitutionnel ignore évidemment que le jeune duc de Cumberland est aveugle. Vous voyez que je lis bien mes journaux.
10 heures
Je n’ai point de nouvelles à vous envoyer. Mais en revanche, je ne vous en demande point. C’est vous que je veux, non pas vos nouvelles. Du reste dans la disette générale, vous glanez à merveille. Vous verrez Pahlen aujourd’hui. Il fournira à quelques heures. Mais vous serez obligée d’employer la méthode socratique. Il ne parle pas tout seul. Plus d’étourderie, je vous prie malgré mon prétendu contentement. J’aime mieux qu’elle soit de Pépin que de vous. Adieu. Tous ces revenants de Londres ont été bien vite usés, à ce qu’il me paraît. Vous avez raison. Pour vous, et malgré votre amour pour Londres, ils ne valent pas plus que cela. Adieu. G.
110. Val-Richer, Vendredi 24 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il fait un temps affreux, et j’ai très mal aux dents. Voilà une mauvaise préparation pour les courses de Caen, et pour la société des Antiquaires. J’ai pourtant un peu plus de foi dans mon éloquence, malgré la douleur, que dans l’agilité des chevaux, malgré la boue. J’ai fait hier une petite répétition de la victoire de Pascal. Je souffrais vraiment beaucoup, l’impatience m’a pris, et je me suis mis à travailler comme si de rien n’était ; en moins d’une heure, l’attention l’a emporté ; je n’ai plus senti la douleur que dans le lointain, comme quelque chose qui pouvait, qui voulait même revenir, mais qui n’était pas là. Je ne l’ai retrouvée qu’à dîner. Cette nuit, j’ai dormi, grâce à un gargarisme de pavot et de fait. Vous voilà parfaitement au courant. Vous a-t-on apporté les Mémoires de Sully ? Avez-vous jété les yeux sur ces dépêches de M. de Fénélon ? Il y a bien des choses ennuyeuses, mais quelques unes vraiment curieuses et amusantes. A la vérité, il faut les chercher dans les ennuyeuses, et vous n’êtes guère propre à ce travail. Votre plus grand défaut est de ne savoir vous plaire qu’à ce qui est parfait. Défaut qui me charme et me désole. Quand je vous vois repousser avec un si fier dédain tout ce qui est médiocre, ou lent, ou froid, ou insuffisant ou mélangé, tout ce qui est entaché, en quelque manière que ce soit de l’imperfection de ce monde, je vous en aime dix fois davantage. Et puis quand je vous vois triste et ennuyée, je vous voudrais plus accommodante moins difficile. Je mens ; restez comme vous êtes, même à condition d’en souffrir. Je le préfère infiniment. Je vous voudrais seulement, pour vous-même, un peu plus de goût pour une occupation quelconque, lecture ou écriture, pour l’exercice solitaire et désintéressé de la pensée. Vous n’y perdriez rien et vous vous en trouveriez mieux. Mais vous n’aimez que les personnes ; il vous faut une âme en face de la vôtre.
Qu’à donc la petite Princesse ? Est-ce qu’elle est malade de la folie de sa femme de chambre ? Pourquoi garde-t-elle cette femme ? Si la folie persiste, il faut la mettre dans une maison de santé. Je parie que l’extrême voisinage de la petite Princesse ne lui vaudra bien auprès de vous. Elle ne supportera pas cette épreuve. Je comprends que le baptême Protestant du petit Duc de Wurtemberg déplaise à l’archevêque ; mais, il devait s’y attendre. On ne s’attend à rien ; on ne renonce à rien ; on ne se résigne point. Il y faut le poids de la nécessité la main de Dieu. Voilà pourquoi nous avons bien fait en 1830. Je pars après demain dimanche à 6 heures du matin, pour être à Caen à 11 heures. J’ai promis d’assister aux courses soleil ou pluie. Elles commencent à midi. Je rentrerai probablement chez moi à la fin de la semaine samedi ou dimanche. La Duchesse de Broglie doit venir nous voir vers cette époque, à partir de demain samedi, adressez-moi donc vos lettres à Caen, à la Préfecture. Du reste, je crois vous l’avoir déjà dit.
10 heure 1/2
Cet horrible temps a retardé mon facteur. Il arrive seulement. Je le sais que vous êtes bien seule, et je m’en désole. A votre mal, je ne sais qu’un soulagement, l’affection, et l’affection de loin, donne si peu ! Tout est bien triste. Votre lettre de ce matin me trouve en grande disposition de le dire avec vous. Adieu. Henriette sera charmée de votre lettre. Adieu. G.
Mots-clés : Littérature, Politique, Portrait (Dorothée), Santé (Dorothée), Santé (François)
111. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voulez-vous lire tout l’ouvrage de Mad. Necker ? Je le ferai porter chez vous. Ce qu’en citaient hier les débats est en effet très beau, et il y a beaucoup de très beau, surtout dans ce denier volume que je n’ai fait que parcourir. A 70 ans, on fait mieux d’écrire cela que d’être amoureux d’une petite fille de 17. Je suis très ennuyé de partir demain pour Caen. Rien n’est pire que ce qui dérange sans plaire. Ne trouvez-vous pas qu’on s’impose une multitude de devoirs et de chaines parfaitement gratuits ? Et puis, quand on y regarde, on s’aperçoit qu’on néglige aussi une multitude de devoir et de soins qui feraient très bien si on s’en donnait la peine. Que de fois, en rencontrant dans ma vie, un embarras, une lutte, un ennemi, j’en ai reconnu l’origine dans une visite omise, une lettre restée sans réponse, que sais je ? C’est bien difficile et bien ennuyeux d’être attentif pour les gens et les choses dont on ne se soucie pas. Il le faut pourtant.
J’ai essayé hier, contre la tristesse le remède qui m’avait réussi contre le mal de dents. J’ai travaillé assidûment toute la matinée. Avec peu de succès. J’écrivais pourtant pour mes enfants, cette histoire de France que je veux leur raconter moi-même. Je le leur ai dit. Ils en ont sauté de joie autour de moi pendant un quart d’heure. Leur joie m’a encore attristé. J’avais eu cette idée il y a quinze ans ; pour mon fils. Je la reprends aujourd’hui pour ces trois petits. Que de choses qu’on reprend, qu’on renoue, qu’on recommence ! Toute ma vie m’est revenue à l’esprit. C’est bien ma vie. C’était bien moi. Et tout cela n’est plus ! Et toute cette immense part de moi-même a disparu ! Et je vais comme si j’étais tout entier ! Et j’ai encore soif de ce vase rempli et brisé tant de fois ! Ah, nous sommes de misérables créatures ? Nous ne pouvons conserver, & nous ne savons pas nous passer. Jeunes, nous nous épuisons à désirer et à espérer. Vieux, nous nous fatiguons à regretter et à désirer encore. Et les joies perdues sont pour nous comme si elles n’avaient jamais été. Et elles nous gâtent celles qui nous restent. Et celles qui nous restent ne nous empêchent pas de rechercher avec passion celles que nous n’avons plus comme si nous n’en avions pas eu notre part. Notre cœur est sans reconnaissance envers Dieu, sans équité envers les autres, insatiable dans son égoïsme. Je donnerais je ne sais quoi pour vous guérir de votre douleur. Et votre douleur me ramène à la mienne. Et la mienne me distrait de la vôtre. Je suis triste et mécontent de moi-même. C’est trop.
J’ai peine à croire que Mad. la Duchesse d’Orléans se soit trompée d’un mois. D’après ce qui me revient de l’intérieur de sa maison, on attend réellement d’un moment à l’autre. Du reste, c’est bien absurde, de moi de vous en parler d’ici. Vous entendez surement rabâcher tout le jour, sur ces pauvres petites nouvelles là Devinez à quoi je passe ma soirée depuis quatre jours. A coller avec de la gomme sur de grands cartons et dans de grands cadres que j’ai fait faire exprès, les portraits de tous les rois de France d’abord, ensuite de tous les députés à l’assemblée constituante. J’ai 72 portraits de Rois et 530 portraits de députés défaiseurs et faiseurs de Rois. Je veux garnir de cette collection, à la fois loyale et insolente, ma salle à manger et mon vestibule. Je fais cela avec l’aide de Mad. de Meulan, et un peu de mes enfants. Cela vaut bien vos grandes pensées.
10 heures
Ma lettre n’est pas propre à changer votre mauvaise disposition. Je voudrais trouver quelque chose à vous dire qui fût bon à écrire à M. de Lieven. Je ne trouve rien. Il y a de l’irrémédiable en ce monde. Quand il en aura fini avec le grand Duc, quand il sera oisif et seul peut-être alors sentira-t-il quelque besoin des autres, de vous, de ses enfants. Et intérêt seul, à ce qu’il me semble, peut agir, sur lui. Adieu. Je suis bien aise que Pahlen soit de retour. Il vous remplira quelques moments. Parlez-moi toujours de vous, toujours. Et toujours adieu. G.
112. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pense que j’arriverai peut-être à Caen après le départ du courrier. Je ne veux pas que vous attendiez en vain une lettre. Je laisserai celle-ci pour qu’on la donne demain au facteur, car à 6 heures je serai en route. Le temps est toujours affreux. Je vais là comme à la corvée. J’espère être de retour samedi prochain. Quel dommage que M. de Pahlen ne soit pas un homme d’esprit ; il lui eût été bien facile de se mettre et de vous mettre au courant des vraies dispositions de l’Empereur et par conséquent de M. de Lieven. Mais il n’aura rien su chercher, et n’aura rien à vous dire. Peut-être devinerez-vous quelque chose à travers son ignorance. Je le voudrais bien, car je vous vois vivement préoccupée de cette situation et je le comprends. Amis ou ennemis, tout ce qui vous tient dans ce pays là, a vraiment bien peu d’esprit. La bonne reine d’Hanovre aurait pu vous servir dix fois mieux qu’elle n’a fait.
Que faites-vous de Marie ? Est-elle toujours aussi gaie et aussi fraîche ? A-t-elle la gaieté plus spirituelle que l’humeur. Dites-m’en quelque chose. Cette jalousie-là m’amuse assez. A présent du moins elle ne vous est pas incommode. Adieu. Je vais passer une semaine en visites, banquets, toasts, speechs. J’espère que les derniers ne seront pas aussi pauvres que cette lettre-ci. Je suis pressé, endormi et triste. Pourtant toujours le même adieu, et du même cœur. Cela est immuable. G.
113. Caen, Lundi 27 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne flatte jamais quand j’aime. Pas un nuage ne passe devant mon soleil que je ne le voie. Mais il n’a pas un rayon qui m’échappe et qui n’illumine tout à mes yeux. On ne sait pas aimer. On ne sait pas admirer. On ne sait pas jouir de ce qu’on aime et de ce qu’on admire. On en laisse perdre des trésors. Et quand on ne perd rien, quand on jouit de tout, pourquoi ne dirait-on pas tout ? Pourquoi ne renverrait-on pas tout son plaisir à sa source. On ne sait pas non plus faire plaisir à qui on aime. On en laisse échapper mille et mille moyens, mille et mille occasions. Je ne veux rien perdre, ni du plaisir que je puis prendre, ni du plaisir que je puis donner. Quel petit mot que celui-là ! J’en sais qui me conviennent bien mieux. Mais ne soyez pas malade. Je ne sais pas de mot pour mon chagrin. Pourquoi cette maigreur soudaine ? Vous êtes vraiment encore plus mobile au physique qu’au moral, pour parler comme les philosophes. N’oubliez pas de me dire ce qui sera parti de cette maigreur, si vite venue.
Je suis arrivé hier ici au milieu des coups de canon, des courses de chevaux et d’un dîner de 40 personnes. Tout cela ne m’a pas empêché de dormir. On m’a reçu à bras ouverts. J’amenais moi d’abord, puis le soleil. On nous attendait tous deux avec grande impatience. J’ai trouvé la population, vraiment la population charmée de son Prince et disant : le bonheur nous en veut. Le mot courait de bouche en bouche, et on disait bien nous. Soyez sûre que ce pays-ci regarde tout-à-fait ce gouvernement comme sien. C’est une force immense. J’écrirai ce matin, à M. le Duc d’Orléans que doit être bien content. Je suis ici jusqu’à samedi. Je passerai mon temps à déjeuner et à dîner dans les environs. Je préside ce soir la société des Antiquaires., Samedi je rentrerai chez moi. Ecrivez-moi donc Vendredi au Val-Richer.
Mon mal de dents est fort diminué. Je le sens mais je n’en souffre plus. Vous me conterez votre dentiste. Du reste, je ne m’étonne pas que le contraste vous ait frappée. Brewster à les meilleures façons du monde. Je trouve la lettre d’Ellice très sensée, car elle est d’accord avec mes conjectures. Ne vous arrive-t-il pas comme à moi, d’être sans cesse étonnée tantôt du beaucoup, tantôt du peu d’esprit que vous avez ? On devine quelques fois merveilleusement de très grandes choses et puis tout à coup on s’aperçoit qu’une petite chose qui se découvre et qu’on ignorait, modifie, immensément ce qu’on croyait très bien savoir. Avez-vous causé avec Pahlen ? Je suis impatient de savoir s’il n’aura rien vu, s’il ne vous aura rien dit qui vous éclaire un peu sur ce qui vous touche.
Adieu. Il faut que j’écrive à M. le Duc d’Orléans et à ma mère. Puis ma toilette. Puis des visites. Puis le déjeuner. Puis les courses. Puis le dîner, la séance, les speechs. Adieu.
Tout cela fait bien du bruit. Mais le moindre grain de mil Ferait bien mieux mon affaire Adieu. Je vous écris dans le même cabinet et de la même table d’où je vous ai écrit l’an dernier, à Boulogne, quand vous êtes revenue de Londres. Toujours.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Mandat local, Portrait (Dorothée)
114. Caen, Mardi 28 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non, je ne suis pas mécontent. Non, vous ne me fatiguez, vous ne me fatiguez jamais. Mon affection n’est pas à la merci de ces vicissitudes de l’âme. Et puis, je trouve votre tristesse si naturelle. Certainement, vous avez trop perdue vous êtes bien seule, seule par ce qui vous reste comme par ce qui vous a été enlevé. Vous ne savez pas tout, ce que je ressens pour vous de tendre compassion, combien votre isolement m’occupe et me pèse. Je voudrais voir auprès de vous les fils que vous avez encore, vous voir avec eux un home. Avez-vous des nouvelles d’Alexandre ? Mais ne craignez jamais, quand cela vous soulagera, de me montrer votre tristesse. Vous m’avez blessé quelques fois dans notre vie. Je crois que vous ne me blesserez plus. Merci de vos détails. Ces couches font un grand effet dans le pays. J’ai vu plus d’une fois ces effets là. Ils ne suffisent pas aux gouvernements, et ne les dispensent de rien. Mais ils rendent la bonne conduite plus facile et plus profitable à ceux qui savent se bien conduire. Nous avons aujourd’hui, une course spéciale, instituée hier en l’honneur du Comte de Paris.
Le soleil est magnifique. Décidément il m’accompagne. J’ai eu hier avec mes Antiquaires, une soirée brillante. 1500 personnes étaient entrées dans une salle qui en contient 1200. On a cassé des carreaux de vitre pour entendre du dehors. Ce que j’ai dit a été bien reçu. La gauche, même la plus vive, avait évidemment pris son parti d’être bien pour moi. Je connais ces alternatives là.
Je regrette que Pahlen ne vous ait rien apporté de plus. J’avais espéré d’un peu meilleures paroles. J’ai tort de dire que j’avais espéré. Mon instinct espérait, ma raison non. Quel monde que le vôtre ! Point d’âme dans les uns, point d’esprit dans les autres. Ceux qui vous ont aimée autre fois ne s’en souviennent pas plus que s’ils ne vous avaient jamais connue. Ceux qui vous aiment ne savent pas vous servir. L’occident a bien ses défauts, et je les lui ai dits souvent ; mais votre Orient ! Je plains le soleil de le trouver le premier sur son chemin. Adieu.
J’ai ma toilette à faire, des visites à recevoir la course à voir. Je vais dîner à la campagne. Je mène ici une vie très active. Je suis fâchée d’abréger mes lettres surtout quand les vôtres sont tristes. Qu’il y ait au moins dans votre cœur un coin tranquille et doux, et point solitaire. Adieu. Adieu. Mon mal de dents est à peu près parti. G.
115. Caen, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars dans une heure pour aller passer la journée à 7 lieues d’ici, chez M. de Tilly. J’y coucherai .Je donnerai demain à deux de ses voisins, M. de Lacour et M. Turgot. Je ne serai de retour à Caen qu’après demain matin. Dans ce vagabondage, je crains de ne pas tomber juste demain, sur l’heure du courrier. Le service des campagnes n’est pas toujours bien exact, et ils n’y mettent pas tous le même intérêt que moi, si une lettre retardait où manquait soyez sûre que je n’ai ni le bras cassé, ni le cœur négligent. J’aurai, moi, votre lettre d’aujourd’hui ; mais celle de demain, je ne la trouverai qu’en revenant. Je ne veux pas qu’elle se perde à courir après moi. Ces courses m’ennuient fort. Enfin, j’en serai quitte samedi.
On m’a mené hier voir un magnifique établissement, créé à force de zèle pieux et d’habileté par un homme qui n’avait pas 500 louis en commençant, et qui y a dépensé près de deux millions. C’est une grande maison de fous, la meilleure œuvre, et le plus triste spectacle du monde. Un édifice immense, un ameublement bien tenu, un ordre parfait, une propreté admirable ; et au milieu de ce chef d’oeuvre de l’intelligence humaine, 5 à 600 fous ou folles errants ou accroupis, criants ou taciturnes ; gardés et soignés par 97 religieuses qu’ils maudissent et injurient sans cesse. Le bien et le mal à cet excès là et se touchant de si près mettent l’âme dans un grand malaise. Notre course en l’honneur du Comte de Paris a eu grand succès malgré l’humeur des Carlistes qui ont fait, dans le Comité des Courses ce qu’ils ont pu pour la faire échouer. Habituellement les deux partis vivent ici en grande paix se rencontrant volontiers sur les terrains neutres et traitant ensemble de bon accord des intérêts ou des plaisirs du pays. Puis survient une circonstance où ils se retrouvent absolument les mêmes. A la vérité cela aboutit à de pures taquineries qui ne dépassent même guère les paroles. Les vieilles passions se payent de bien petites satisfactions. L’archevêque prend le bon parti et ne le soutiendra pas. Celui-là aussi est un petit esprit, décidé chaque jour par de petits motifs, et incapable de résister aux fantaisies qui l’entourent.
Si vous n’avez pas encore écrit à M. Ellice, voulez- vous lui demander s’il pourrait me procurer une lettre de l’écriture de M. Pitt et une de Lord Chatam, son père ? J’en ai envie. Je ne fais pas grand cas des collections d’autographes pèle-mêle. Mais, puisque j’en ai quelques uns je veux y ajouter les noms que j’estime et qui me plaisent. Adieu. Je vis avec votre tristesse. Sans lui rien reprocher ; je la trouve si légitime ! Vous ne me dites pas, dans le N°117, comment vous êtes physiquement. Adieu. J’ai de bonnes nouvelles de mes enfants. G.
116. Lantheuil, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Un seul mot qui, j’espère, vous arrivera à temps. Je me suis échappé du salon où je ne sais combien de personnes sont venues me voir. Je fais le métier de bête curieuse. On vient de m’apporter les N° 118 et 119. Je suis charmé qu’Alexandre vous arrive. Ce sera une douce distraction. Vous avez, je crois, toute raison de préférer l’Angleterre à Baden. Il faut qu’on vienne chez vous, et non pas, vous aller chez les autres. Vous débattrez beaucoup mieux votre avenir à Londres qu’à Baden. En tout cas, je suis bien aise qu’il y ait pour un an du moins, quelque chose de connu, de réglé.
Je serai chez moi après-demain, à ma grande satisfaction. Si ce régime-ci durait, j’aurais le sort de Vert-Vert. Aujourd’hui, je suis chez des gens qui m’aiment vraiment et qui me plaisent, chez les Turgot. Adieu. On vient me chercher. Voici une lettre bien plus misérable que la vôtre. Pardonnez la moi. Je le mérite car mon plus doux temps est celui où je vous écris. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Famille Benckendorff, Mandat local, Vie familiale (Dorothée)
117. Caen, Samedi 1er septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous allons rentrer dans toute la régularité de nos habitudes. Il vous aura manqué une lettre. J’attendais les vôtres sans savoir à quelle heure elles viendraient. Physiquement aussi, je suis bien aise de rentrer chez moi. Cette vie de banquets, de courses, de bavardage incessant, commence à me fatiguer. Elle ne m’a jamais plu. Pour que je m’arrange du monde, il faut que les affaires ou ses agréments vaillent la peine que je prends pour lui. Vous avez votre fils. Je regrette de ne pas le voir. Vous me direz s’il a bien du chagrin de la rupture de son mariage. Mlle de T. ne le désirait donc pas bien vivement. Vous avez, je crois, bien fait d’insister. Il faut beaucoup d’amour et une grande supériorité d’esprit pour que la différence de religion, quand l’un et l’autre y tiennent, ne devienne pas, dans le cours de la vie une vraie peine. A-t-il renoncé à tout espoir ? Il me semble aussi que dans son pays même son père à part, l’abandon de tous ses enfants au catholicisme lui ferait grand tort.
Je compte trouver une lettre au Val Richer. Elle me dira si vous êtes toujours aussi souffrante. Mandez- moi avec détail ce que dit Chemside. Je ne comprends pas votre abominable temps. Ici, il fait très beau, frais, mais point froid. Vous avez bien tort de ne pas venir en Normandie. Où avez-vous logé votre fils ? Se promène-t-il habituellement avec vous ? J’étais sûr que l’archevêque ferait ce qu’il a fait. Je trouve du reste qu’on l’a pris bien vivement. Il y avait des façons moins brutales que l’article des Débats pour lui faire sentir l’inconvenance de son discours. Inconvenance à laquelle on devait s’attendre ; comment veut-on qu’un archevêque, et surtout celui-là, ne laisse pas percer quelque humeur des nouveaux échecs que reçoit de notre temps l’unité de la foi.
M. Molé n’était pas auprès du Roi, aux Tuileries, le jour où il a reçu les députés. Ils en ont été très choqués. On m’écrit que la tête lui tourne un peu. Champlâtreux n’est pourtant pas un bien grand verre de vie. La médaille est de trop. C’est encore plus que le tableau. On ne viendra pas à bout de notre temps, de faire de grands événements avec de petits incidents. Il ne faut pas les traiter de la même façon. M. Dupin n’est pas venu aux couches parce qu’on ne l’avait pas pris pour témoin. Je ne saurais dire combien cet abandon de cette pauvre Princesse tout de suite après ses couches, m’a frappé. Voilà bien les entraînements, les oublis, les distractions des cours. Pour tous ceux qui étaient là, le monde entier avait disparu devant ce petit garçon. Et si elle était morte ! Quel tableau eût fait de cette scène M de St. Simon ! Donnez-moi quelque nouvelle de l’affaire suisse. Il me paraît que Louis Buonaparte ne s’en va pas de lui-même. Cela peut devenir embarrassant. Adieu.
Je vais déjeuner et monter en voiture. Je traverserai une très belle vallée sous un très beau soleil, par une très belle route. Vous me manquerez infiniment. Si je parlais la langue de Pétrarque, je vous dirais que dès qu’il s’élève dans mon âme une impression douce, elle me quitte et va vous chercher Si elle vous trouve elle me revient. si elle ne vous trouve pas, elle me quitte tout-à-fait. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Enfants (Benckendorff), Politique (France), Religion, Vie familiale (Dorothée)
118. Val-Richer, Dimanche 2 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis rentré hier dans mon home en pensant à vous à votre chagrin de n’en point avoir à votre isolement. Je voudrais vous envoyer des paroles capables de dissiper l’isolement et le chagrin. Je les ai en moi, et bien pour vous, pour vous seule. Mais de si loin, leur vertu s’affaiblit si elle ne se perd tout-à-fait. J’ai trouvé mes enfant, à merveille et ma mère aussi. Elle a une vivacité une jeunesse d’âme bien rare et qui la soutient étonnamment. Jamais vu n’a été plus dévoué à un seul sentiment et n’est restée plus accessible à toutes les impressions douces. C’est Rousseau je crois, qui a dit : " Les mœurs sévères conservent les cœurs jeunes. " Il a raison. Je suis bien aise que mon speech, vous ait plu. Il a réussi au milieu d’une assemblée fort mêlée de légitimistes et de radicaux. En tout, j’ai été reçu de tout de monde avec une grande bienveillance. Je n’ai point de pouvoir & je prends quelques soins. On dit de beaux finales.
Pendant que j’étais chez M. Turgot, un légitimiste des environs, qui passe pour très vif M. de Marguerye lui a fait demander si je voudrais aller visiter son château, et un assez grand établissement qu’il a fait à côté pour s’arranger un peu sa fortune. J’y suis allé. Un vieux petit château fort, du 12e siècle avec ses remparts, ses plateformes, ses poternes, ses chemins de ronde, ses mâchicoulis, ses meurtrières, absolument comme si nous devions nous y enfermer aujourd’hui pour y être attaqués demain ; et au dessous sur une jolie rivière, une grande usine, avec toutes les machines de notre temps, un comptoir, des ouvriers, des commis, Tout cela à M. de Marguerye, qui s’en occupe avec le même zèle et prenait le même plaisir à me montrer ses vieilles tours et ses roues hydrauliques. Et dans son Cabinet, toutes les Histoires de Normandie à côté de tous les traités de chimie, sur sa table le anciennes chartes du château pèle-mêle avec les comptes de l’usine. Et par dessus tout, une jeune femme très jolie, très animée, d’un sourire charmant, les meilleures manières du monde, qui m’a accompagné dans toute ma visite, et ne laissait rien oublier à son mari de ce qu’il avait à me montrer. J’ai dit à M. de Marguerye que c’était le problème de notre temps de faire vivre tout cela ensemble et de bon accord. " Je sais, Monsieur, m’a-t-il dit que c’est là votre pensée. J’en ferai volontiers ma devise. " Et nous nous sommes séparés très bons amis, le château de Croully et moi. Le château est célèbre dans les Chroniques Normandes, par les guerres continuelles et ses brigandages. Fort petit du reste, & le maître assez pauvre.
Je vous raconte mes visites. Je regrette de ne pas faire avec vous celle de Versailles. Je vous aurais épargné beaucoup d’ennui. Car vous vous y ennuierez. C’est un chaos de souvenirs d’allusions de noms, de figures. Il faut voir l’ensemble et trois ou quatre choses. Du reste des œuvres du Rois, c’est une de celles qui ont le mieux réussi. Je la trouve connue et populaire partout, dans tous les partis. Tout le monde approuve Versailles, et l’a vu ou se promet de l’aller voir. Si l’affaire Suisse ne s’arrange pas, s’il faut en venir, isolément ou de concert avec l’Autriche et autres, à des menaces mises à effet, ce sera une rude discussion pour le Cabinet à la session prochaine. Il y aura bien compromis, la position de la France et pour de bien mesquines raisons.
10 h.
Le N°116 m’a déplu à vous envoyer. Mais je ne m’amusais certes pas. J’avais dans le salon 28 personnes qui m’attendaient. J’ai passé cette semaine à aller déjeuner et dîner chaque jour dans des lieux différents, à six ou sept lieues de distance les uns des autres. Deux choses étaient difficiles à rencontrer juste, le temps et la poste. Mais d’où vient ce redoublement de faiblesse et de souffrance ? Que je voudrais vous trouver un lieu où aller ? Adieu. Envoyez m’en un meilleur que celui-ci, quoiqu’il soient tous bons. Adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, Mandat parlementaire, Vie familiale (François)
119. Val-Richer, Lundi 3 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens d’embarquer Mad. de Meulan. Je dis bien embarquer car elle va à la mer à Trouville, passer deux jours avec sa belle-sœur Mad.de Turpin, qui y est depuis un mois. J’attends Jeudi, M. et Mad. Lenormant, & la semaine d’après Mad. de Broglie. Le Val Richer sera animé si c’est être animé qu’être peuplé. J’ai commencé hier à peupler ma salle de manger. J’y ai fait pendre les 72 Rois que j’ai collés. J’y pendrai encore 286 députés de l’Assemblée constituante. Le reste des députés ira dans le vestibule et le long de l’escalier. C’est dommage que vous ne puissiez pas m’aider à coller. On cause très bien. Il me semble aussi qu’un changement d’air vous serait bon. N’avez-vous plus personne à Dieppe ? Je pense quelquefois que, sans la mer vous pourriez aller passer un mois ou six semaines, en Angleterre, de château en château. Vous y trouveriez de la distraction, peut-être un peu d’amusement. L’Angleterre vous plaira toujours ; et sauf la fatigue ce voyage-là me paraît sans inconvénient pour vous. Il ne vous engage et ne vous expose à rien. Vous pouvez poser l’alternative entre l’Angleterre et la France.
Je cherche sans cesse quelque moyen de vous faire un peu de bien, au corps et à l’âme. Je trouve et je puis bien peu, et pourtant ! On me conteste l’abandon de Mad. la Duchesse d’Orléans au moment de ses couches, et l’imprudence qui s’en est suivie. On me dit qu’elle a tout simplement été frappée d’une fièvre puerpérale aiguë, comme la Princesse Charlotte. On me donne tous les détails imaginables sur son mal et les remèdes qu’on lui a faits. Elle est devenue froide, violette. On l’a couverte de glace. On lui a fait boire du vin de Constance, manger des citrons. Je crois au mal et aux remèdes. Mais la dénégation de l’abandon m’est suspecte. J’en voudrais savoir le vrai. Cet exemple de plus de l’enivrement factice des cours vaut la peine d’être constaté. Je suis tenté d’être de l’avis de M. Molé. Ce long séjour de votre Empereur en Allemagne, ce vagabondage imprévu, cet argent jeté par les fenêtres, tout cela, annonce un dessein. On dirait qu’il va courant portant après une influence qui lui échappe. Peut-être aussi, n’est-ce qu’une fantaisie, de despote fiévreux et ennuyé. Je ne sais comment se passera le couronnement de Milan. Mais je lis les préparatifs. N’êtes-vous pas frappée de l’extrême différence entre celui-là et celui de Londres ? à Londres, des émotions, des joies publiques, des âmes, un peuple vivant au milieu des fêtes. A Milan, je n’entrevois encore que des cérémonies et des tapisseries. Et il n’y aura certainement pas autre chose au moment même. La curiosité n’est pas la sympathie. Des spectateurs ne sont pas des acteurs. Décidément la vie est du côté de l’occident, dans les vieilles idées et les vieilles mœurs comme dans les nouvelles. Aussi, à part ceux qui y sont qui est-ce qui regarde au couronnement de Milan ? Qui s’en occupe ? Le couronnement de la Reine Victoria a intéressé le monde.
9 h. 1/2
Merci du N° 123. C’est ainsi que je les veux. Je veux être au courant de tout. Tâchez qu’Alexandre ne cède pas sur la religion des garçons, si le mariage se renoue. L’avenir de vos fils, me préoccupe. Leur père ne fera rien pour eux. Leur situation est délicate. Il ne faut pas qu’ils fournissent eux-mêmes des prétextes. Quel pays que celui où des jeunes qui bien nés et capables ne sont préoccupés à 30 ans que de l’envie de quitter le service public ! Je reviens toujours à mon occident.
A coup sûr, vous n’avez de votre vie, entendu chanter une chanson à boire. Voici le refrain d’une des plus jolies. Versez donc mes amis versez.
On n’en peut jamais assez boire.
Versez donc mes amis, versez.
On n’en peut jamais boire assez.
Adieu, adieu, adieu. Adieu. Pas assez. G.
120. Val-Richer, Mardi 4 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mots-clés : Discours du for intérieur, histoire, Vie familiale (François)