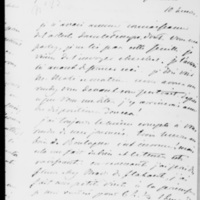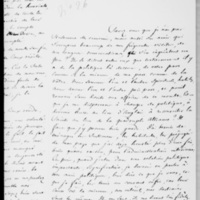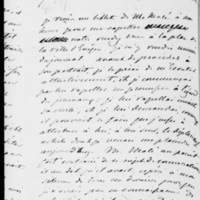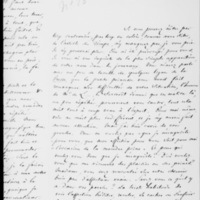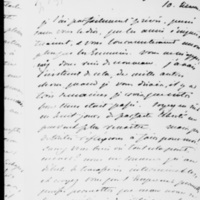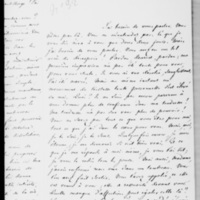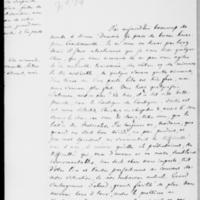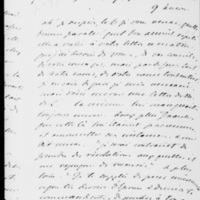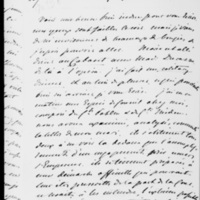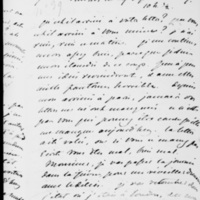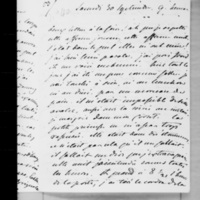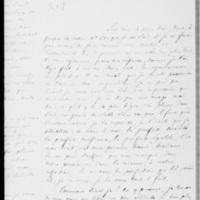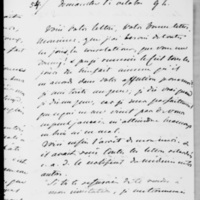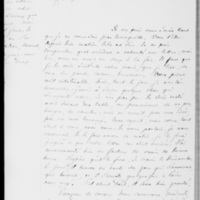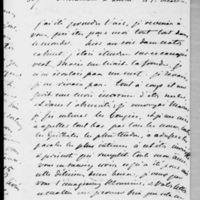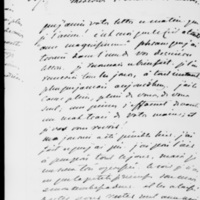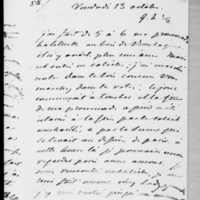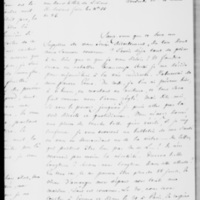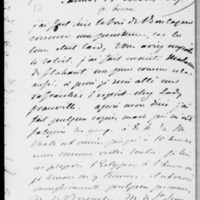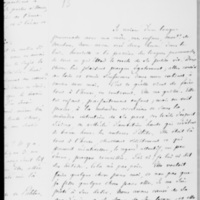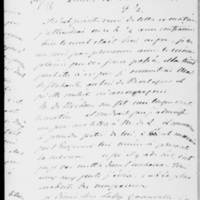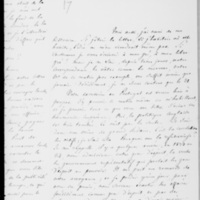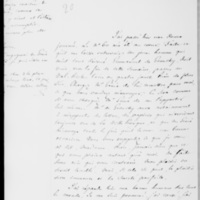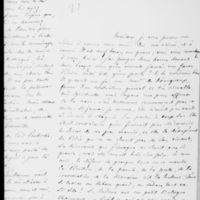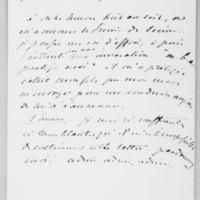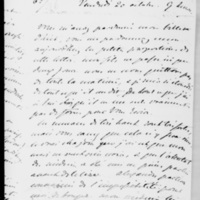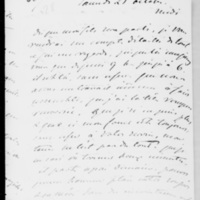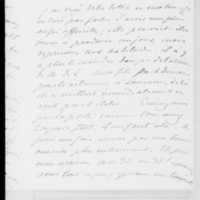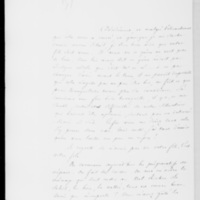Votre recherche dans le corpus : 6062 résultats dans 6062 notices du site.
Trier par :
43. Val-Richer, Vendredi 22 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°43 Vendredi 22. 7 h. 1/2
Je me réveille bien triste. Je l’étais hier au soir. Je le serai souvent. Hier en vous écrivant, j’étais surtout préoccupé d’une injustice possible de votre part. Aujourd’hui, je le suis bien plus du chagrin même. M. Duvergnier de Hauranne est arrivé. M. Duchâtel ne se marie que le 2 octobre et il se marie sans mariage, absolument sans personne que les parents et les témoins nécessaires. En sortant de l’église, il va passer quelques jours à Meudon, et de là, il part pour Mirembeau, en Saintonge où est sa terre.
Je n’ai donc là, ni motif, ni prétexte. J’en attends un autre. Vous recevrez cette lettre-ci dimanche. Vous attendiez mieux le jour là. Quand vous me partez de vos longues journées, de votre impatience de les voir couler, j’éprouve un sentiment analogue à celui que j’éprouve quand vous m’écriviez d’Angleterre vos inquiétudes, vos douleurs de n’avoir pas de lettre. Pardonnez-moi encore, Madame ; ma première impression est une joie profonde de cette tendresse si vive. La peine ne vient qu’après. Je jouis pour moi avant de souffrir pour vous. Quand vous étiez en Angleterre, quand vos lettres m’arrivaient exactement, et non pas les miennes à vous, je souffrais pour vous. Aujourd’hui, quand je ne pars pas, c’est pour vous et pour moi j’aime mieux dire pour nous, que je souffre.
Quand viendra, la dissolution ? J’établis autour de moi, dans la conversation, qu’elle n’obligera probablement d’aller passer trois au quatre jours à Paris. Mais nous sommes à la merci de l’événement, à la merci des nécessités électorales du pays qui m’entoure. Que de chaines nous portons. J’en ai secoué beaucoup. Il en reste encore énormément.
J’ai ma mère souffrante ce matin. Elle est sujette à des étourdissements, à des vertiges qui pourraient devenir quelque chose de plus grave. On est venu m’avertir au moment où je me levais. Je sors de chez elle. Elle vient de prendre un bain de pieds avec beaucoup de moutarde. Elle est mieux. J’espère que ce ne sera rien du tout. Je lui ai vu plusieurs fois ces petits accidents, et ils ont toujours disparu devant des remèdes, fort simples Mais elle va avoir 73 ans. J’aime beaucoup ma mère. Je lui dois beaucoup. Et personne ne la remplacerait auprès de mes enfants. Elle est avec eux d’une tendresse, d’une assiduité, d’une vigilance inquiète qui fait presque tout ce qui me reste de sécurité. Quand j’avais mon fils, ma sécurité était infiniment plus grande. Tout homme et tout jeune qu’il était, j’étais sur qu’à mon défaut il soignerait, il élèverait ses sœurs et son fière avec une affection, une attention paternelle. Et il était plein d’esprit, de sens, d’activité sérieuse, de tout ce qui fait qu’on peut être à la tête d’une famille. Aujourd’hui moi manquant ma famille, si jeune, resterait comme un faisceau sans lin, un troupeau sans berger. C’est une forte attache que de se sentir nécessaire. Mais c’est aussi un pesant fardeau.
Je vous parle de ma famille. Ne vous arrive-t-il pas quelques fois d’être dans cette disposition où l’on n’ose pas, où l’on ne veut pas ne [?] que sur un seul sujet, sur le sujet intime qui remplit l’âme, et où cependant l’on ne pourrait souffrir de parler de choses indifférentes ? On va alors à ces choses qui sont beaucoup quoiqu’elles ne soient pas tout, à ces intérêts qui tiennent vraiment au cœur quoiqu’ils n’en occupent pas le fond. Ce n’est pas l’intimité personnelle exclusive, c’est encore de l’intimité et qui a quelque douceur.
11 heures
Votre n° 44 m’arrive une demi heure plus tard que de coutume. C’est long, une demi-heure ! Mais le dédommagement est immense, charmant. Ne me gâtez pas trop. J’ai tant de plaisir à croire tout ce que vous me dîtes ! Nous avons besoin pourtant de nous gâter l’un l’autre jusqu’à ce que nous nous retrouvions. Ah, que je voudrais trouver quelque parole qui vous apportât ce que j’ai dans l’âme ! Adieu. Adieu, un adieu triste est au moins aussi tendre qu’un adieu. satisfait. Adieu. G.
Je me réveille bien triste. Je l’étais hier au soir. Je le serai souvent. Hier en vous écrivant, j’étais surtout préoccupé d’une injustice possible de votre part. Aujourd’hui, je le suis bien plus du chagrin même. M. Duvergnier de Hauranne est arrivé. M. Duchâtel ne se marie que le 2 octobre et il se marie sans mariage, absolument sans personne que les parents et les témoins nécessaires. En sortant de l’église, il va passer quelques jours à Meudon, et de là, il part pour Mirembeau, en Saintonge où est sa terre.
Je n’ai donc là, ni motif, ni prétexte. J’en attends un autre. Vous recevrez cette lettre-ci dimanche. Vous attendiez mieux le jour là. Quand vous me partez de vos longues journées, de votre impatience de les voir couler, j’éprouve un sentiment analogue à celui que j’éprouve quand vous m’écriviez d’Angleterre vos inquiétudes, vos douleurs de n’avoir pas de lettre. Pardonnez-moi encore, Madame ; ma première impression est une joie profonde de cette tendresse si vive. La peine ne vient qu’après. Je jouis pour moi avant de souffrir pour vous. Quand vous étiez en Angleterre, quand vos lettres m’arrivaient exactement, et non pas les miennes à vous, je souffrais pour vous. Aujourd’hui, quand je ne pars pas, c’est pour vous et pour moi j’aime mieux dire pour nous, que je souffre.
Quand viendra, la dissolution ? J’établis autour de moi, dans la conversation, qu’elle n’obligera probablement d’aller passer trois au quatre jours à Paris. Mais nous sommes à la merci de l’événement, à la merci des nécessités électorales du pays qui m’entoure. Que de chaines nous portons. J’en ai secoué beaucoup. Il en reste encore énormément.
J’ai ma mère souffrante ce matin. Elle est sujette à des étourdissements, à des vertiges qui pourraient devenir quelque chose de plus grave. On est venu m’avertir au moment où je me levais. Je sors de chez elle. Elle vient de prendre un bain de pieds avec beaucoup de moutarde. Elle est mieux. J’espère que ce ne sera rien du tout. Je lui ai vu plusieurs fois ces petits accidents, et ils ont toujours disparu devant des remèdes, fort simples Mais elle va avoir 73 ans. J’aime beaucoup ma mère. Je lui dois beaucoup. Et personne ne la remplacerait auprès de mes enfants. Elle est avec eux d’une tendresse, d’une assiduité, d’une vigilance inquiète qui fait presque tout ce qui me reste de sécurité. Quand j’avais mon fils, ma sécurité était infiniment plus grande. Tout homme et tout jeune qu’il était, j’étais sur qu’à mon défaut il soignerait, il élèverait ses sœurs et son fière avec une affection, une attention paternelle. Et il était plein d’esprit, de sens, d’activité sérieuse, de tout ce qui fait qu’on peut être à la tête d’une famille. Aujourd’hui moi manquant ma famille, si jeune, resterait comme un faisceau sans lin, un troupeau sans berger. C’est une forte attache que de se sentir nécessaire. Mais c’est aussi un pesant fardeau.
Je vous parle de ma famille. Ne vous arrive-t-il pas quelques fois d’être dans cette disposition où l’on n’ose pas, où l’on ne veut pas ne [?] que sur un seul sujet, sur le sujet intime qui remplit l’âme, et où cependant l’on ne pourrait souffrir de parler de choses indifférentes ? On va alors à ces choses qui sont beaucoup quoiqu’elles ne soient pas tout, à ces intérêts qui tiennent vraiment au cœur quoiqu’ils n’en occupent pas le fond. Ce n’est pas l’intimité personnelle exclusive, c’est encore de l’intimité et qui a quelque douceur.
11 heures
Votre n° 44 m’arrive une demi heure plus tard que de coutume. C’est long, une demi-heure ! Mais le dédommagement est immense, charmant. Ne me gâtez pas trop. J’ai tant de plaisir à croire tout ce que vous me dîtes ! Nous avons besoin pourtant de nous gâter l’un l’autre jusqu’à ce que nous nous retrouvions. Ah, que je voudrais trouver quelque parole qui vous apportât ce que j’ai dans l’âme ! Adieu. Adieu, un adieu triste est au moins aussi tendre qu’un adieu. satisfait. Adieu. G.
45. Paris, Vendredi 22 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
45. Vendredi le 22 Septembre.
10 heures
Je n’avais aucune connaissance de l’article dans le Temps dont vous me parlez, je ne lis pas cette feuille. Je viens de l’envoyer chercher. Je l’aurais lu avant de fermer ceci. Je dois voir M. Molé ce matin. Nous avons eu rendez-vous devant son portrait. D’après ce que vous me dites j’y arriverai avec des dispositions douces !
J’ai toujours le même compte à vous rendre de mes journées, trois heures au bois de Boulogne, c’est morne, mais cela me fait du bien et le temps est ravissant. En revenant j’ai pris des fleurs chez Mad. de Flahaut, j’ai fait une petite visite à la princesse. Je suis rentrée pour 6 h 1/2, l’heure de mon dîner. Marie m’a fait lecture après ; moi couchée sur notre canapé vert. C’est là que je passe une heure après mon dîner.
Mon Ambassadeur est venu de bonne heure, il sortait d’un grand dîner chez M. Molé. Après lui Pozzo la petit princesse, Miss. de Hugel, St Simon, l’ambassadeur de Sardaigne, lord Hatturton, M. Sneyd, sir Herbert Taylor. Il n’allait jamais dans le monde à Londres, mais je l’ai beaucoup vu à la cour vous savez le rôle qu’il a joué sous trois règnes. Il n’y a rien qu’il ne sache de ce qui s’est passé de plus important et de plus intime dans le Cabinet et la cour d’Angleterre. Il sait par conséquent que j’en sais beaucoup aussi. Nous nous sommes donc retrouvés comme de très intimes connaissances. Ce qui m’a surpris c’est que Pozzo a semblé faire ici la sienne hier au soir. Il est extrêmement peu orienté en Angleterre. J’ai oublié de vous nommer M. de Mühlinen, ah quel ennuyeux ! Et aujourd’hui il est important par dessus le marché.
On est en négociation avec sa cour pour la religion des enfants à venir. Le reine voudrait au moins que les filles fussent catholiques, mais cela ne s’est jamais vu en Wurtemberg et on dispute. La noce se fera dans le courant d’octobre et ils partent de suite après pour Stuttgart d’abord, & puis le pays de Bayreuth où le prince a un pitoyable château. Ils y passeront l’hiver. On dit que votre princesse est très éprise de son futur mari. Il est parfaitement beau mais de proportions énormes.
A propos & M. Duchâtel ! Comme vous m’annoncez froidement que son mariage est remis aux premiers jours d’octobre ! J’y réponds en ne vous en parlant qu’à la quatrième page. Quoi ? Cela ferait tout une semaine de différence et puis ce sera encore pour me quitter ! Monsieur il me semble que depuis le 15 de juin nous n’avons pas fait autre chose que nous quitter. Enfin il est bien sûr que nous ne pouvons pas. vivre quinze jours ensemble. Cela me nous est au moins pas encore arrivé. C’est un étrange ménage que le nôtre !
Midi. Je viens de lire le Temps de lundi. Je suis parfaitement indignée. Monsieur que de choses je voudrais vous dire, mais vous ne pouver pas venir si ce n’est pour marié M. Duchatel. J’ai passé une bien mauvaise nuit à deux heures j’ai sonné, j’avais le frisson. Je me suis fait brosser, frotter pendant une heure. Je ne sais si c’est mes nerfs où quoi. Je me suis endormie plus tard. Ce temps est charmant, j’en proite. J’ai chaud. Je fais tout pour me bien porter, parce que cela vous fait plaisir.
Adieu Monsieur, j’ai envie de n’être pas en colère de cet article dans le Temps mais je n’y réussis pas beaucoup. Ce qui me frappe c’est que ce n’est peut-être que le commencement d’un nouveau genre de persécution que j’aurai à subir. M. Molé aurait eu envie de me chasser de France. J’ai cependant toujours été bonne pour lui.
Adieu Monsieur, adieu. Vous ne sauriez vous fâcher pour votre compte, vous êtes trop au dessus de cela ; ne vous inquiétez pas pour moi, je ne veux pas que votre affection pour moi soit l’occasion de la moindre peine pour vous. Adieu, quand pourrons-nous nous parler ? J’attends votre lettre demain avec plus d’impatience que jamais.
A propos, j’ai rencontré avant-hier M. Duvergier de Hauranne aux Tuileries. Sa vue m’a fait plaisir, je l’ai salué, il ne m’a pas reconnue, il a eu l’air le plus étonné du monde. Adieu encore. Je ne sais plus le quantième. Je vous en dis trop. Adieu. Adieu.
10 heures
Je n’avais aucune connaissance de l’article dans le Temps dont vous me parlez, je ne lis pas cette feuille. Je viens de l’envoyer chercher. Je l’aurais lu avant de fermer ceci. Je dois voir M. Molé ce matin. Nous avons eu rendez-vous devant son portrait. D’après ce que vous me dites j’y arriverai avec des dispositions douces !
J’ai toujours le même compte à vous rendre de mes journées, trois heures au bois de Boulogne, c’est morne, mais cela me fait du bien et le temps est ravissant. En revenant j’ai pris des fleurs chez Mad. de Flahaut, j’ai fait une petite visite à la princesse. Je suis rentrée pour 6 h 1/2, l’heure de mon dîner. Marie m’a fait lecture après ; moi couchée sur notre canapé vert. C’est là que je passe une heure après mon dîner.
Mon Ambassadeur est venu de bonne heure, il sortait d’un grand dîner chez M. Molé. Après lui Pozzo la petit princesse, Miss. de Hugel, St Simon, l’ambassadeur de Sardaigne, lord Hatturton, M. Sneyd, sir Herbert Taylor. Il n’allait jamais dans le monde à Londres, mais je l’ai beaucoup vu à la cour vous savez le rôle qu’il a joué sous trois règnes. Il n’y a rien qu’il ne sache de ce qui s’est passé de plus important et de plus intime dans le Cabinet et la cour d’Angleterre. Il sait par conséquent que j’en sais beaucoup aussi. Nous nous sommes donc retrouvés comme de très intimes connaissances. Ce qui m’a surpris c’est que Pozzo a semblé faire ici la sienne hier au soir. Il est extrêmement peu orienté en Angleterre. J’ai oublié de vous nommer M. de Mühlinen, ah quel ennuyeux ! Et aujourd’hui il est important par dessus le marché.
On est en négociation avec sa cour pour la religion des enfants à venir. Le reine voudrait au moins que les filles fussent catholiques, mais cela ne s’est jamais vu en Wurtemberg et on dispute. La noce se fera dans le courant d’octobre et ils partent de suite après pour Stuttgart d’abord, & puis le pays de Bayreuth où le prince a un pitoyable château. Ils y passeront l’hiver. On dit que votre princesse est très éprise de son futur mari. Il est parfaitement beau mais de proportions énormes.
A propos & M. Duchâtel ! Comme vous m’annoncez froidement que son mariage est remis aux premiers jours d’octobre ! J’y réponds en ne vous en parlant qu’à la quatrième page. Quoi ? Cela ferait tout une semaine de différence et puis ce sera encore pour me quitter ! Monsieur il me semble que depuis le 15 de juin nous n’avons pas fait autre chose que nous quitter. Enfin il est bien sûr que nous ne pouvons pas. vivre quinze jours ensemble. Cela me nous est au moins pas encore arrivé. C’est un étrange ménage que le nôtre !
Midi. Je viens de lire le Temps de lundi. Je suis parfaitement indignée. Monsieur que de choses je voudrais vous dire, mais vous ne pouver pas venir si ce n’est pour marié M. Duchatel. J’ai passé une bien mauvaise nuit à deux heures j’ai sonné, j’avais le frisson. Je me suis fait brosser, frotter pendant une heure. Je ne sais si c’est mes nerfs où quoi. Je me suis endormie plus tard. Ce temps est charmant, j’en proite. J’ai chaud. Je fais tout pour me bien porter, parce que cela vous fait plaisir.
Adieu Monsieur, j’ai envie de n’être pas en colère de cet article dans le Temps mais je n’y réussis pas beaucoup. Ce qui me frappe c’est que ce n’est peut-être que le commencement d’un nouveau genre de persécution que j’aurai à subir. M. Molé aurait eu envie de me chasser de France. J’ai cependant toujours été bonne pour lui.
Adieu Monsieur, adieu. Vous ne sauriez vous fâcher pour votre compte, vous êtes trop au dessus de cela ; ne vous inquiétez pas pour moi, je ne veux pas que votre affection pour moi soit l’occasion de la moindre peine pour vous. Adieu, quand pourrons-nous nous parler ? J’attends votre lettre demain avec plus d’impatience que jamais.
A propos, j’ai rencontré avant-hier M. Duvergier de Hauranne aux Tuileries. Sa vue m’a fait plaisir, je l’ai salué, il ne m’a pas reconnue, il a eu l’air le plus étonné du monde. Adieu encore. Je ne sais plus le quantième. Je vous en dis trop. Adieu. Adieu.
44. Val-Richer, Vendredi 22 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N° 44 Vendredi 5 heures
Savez-vous que je n’ai pas seulement des ennemis, mais aussi des amis qui s’occupent beaucoup de mes fréquentes visites, de nos longues conversations, et qui s’en inquiètent un peu ! Ils se disent entre eux que certainement il y a de la politique là dessous, de votre part, comme de la mienne, de ma part comme de la vôtre. Nous sommes l’un et l’autre spirituels, habiles ; nous avons l’un et l’autre pris part, et point renoncé sans doute aux affaires de ce monde. Est-ce que je me disposerais à changer de politique à devenir russe au lieu d’anglais à ressusciter la sainte au lieu de la quadruple Alliance ?
Il faut que j’y prenne bien garde. J’ai besoin de ménager les sentiments, les habitudes, les préjugés de mon pays que j’ai déjà heurtés plus d’une fois, bien qu’avec raison, pour l’administration intérieure. Et puis, quand j’entre dans une relation politique importante, significative, je devrais en parler à mes amis politiques, leur dire ce que je veux, ce que je fais, les tenir au courant enfin, car leur cause est la mienne ; nos intérêts, nos destinées sont les mêmes. Ils me sont ; ils me seront très fidèles. Ils voudraient bien être toujours instruits. Cela se dit très doucement très affectueusement. Cela me revient indirectement. J’y réponds et j’y répondrai très simplement souriant un peu, disant de vous un peu de ce que j’en pense, rassurant mes amis sur la fixité de ma politique comme sur l’étendue de ma confiance en eux et gardant bien du reste ma liberté, que je n’ai jamais livrée. J’admire toujours à quel point les hommes, même des hommes distingués, prônent le côté petit et tortueux des choses, au lieu du côté simple et grand et à force de chercher finesse, s’en vont à cent lieues de la vérité.
Samedi matin, 6 heures
Je me lève. Voilà une heure et demie que j’essaie en vain de me rendormir. On dit que la faim empêche de dormir. J’ai faim. Vous me parlez du bonheur qui me reste et m’entoure. Vous me dîtes que j’en sais jouir. Vous avez raison. Je n’ai jamais dans mes plus cruels moments, méconnu le prix de ce qui me restait. Je ne m’y suis jamais senti indifférent. Je ne me suis jamais permis de me dire à moi-même que j’y pouvais être indifférant. Je me serais cru coupable envers Dieu, plus coupable envers ces créatures qui m’aiment, m’aiment beaucoup, & qui ont droit non seulement que je les aime, mais que je me trouve heureux de ce quelles m’aiment. L’affection veut donner du bonheur, et souffre et s’offense quand elle n’en donne pas. Je sais tout cela. Bien plus, je le sens ; et naturellement, sans effort, je jouis en effet de l’affection de mes enfants, de ma mère, de mes amis ; et je leur montre que j’en jouis, et j’espère qu’ils le croient, j’en suis sûr.
Mais laissez- moi, Madame, être avec vous parfaitement sincère, c’est-à-dire vous montrer toute mon âme. C’est en cela, pour moi, que la parfaite, sincérité consiste. Aux autres, je ne mens point, mais je ne dis pas tout. Ces relations, ces affections, ces joies qui me restent, en même temps que je les ai toujours senties, je ne me suis jamais donné, je n’ai jamais pu me donner le change à moi-même sur leur importance pour moi, sur leur place en moi. Je ne voudrais pas même en vous parlant à vous seule, même avec la certitude que nul autre ne verra jamais ce que je vous dis, je ne voudrais pas dire un mot qui fût injuste qui fût offensant pour ces sentiments et ces bonheurs là. Mais il ne leur est pas donné de pénétrer jusqu’au fond de mon âme, de remplir ma vie, d’être mon âme et ma vie. Ils animent, ils embellissent la région où ils se passent, mais cette région est pour moi celle du monde extérieur et non pas la mienne propre ; c’est une région où je me promène, et non pas cette où j’habite.
Voltaire fait quelque part dans La Henriade, je crois la description du système céleste, de toutes les planètes, de tous les astres, de leur hiérarchie, de leur immensité. Il les nomme, il les compte, les compte encore ne parvint pas à les épuiser. Au dessus, au delà de ceux qu’il a nommés, qu’il a comptés.
Sont des soleils sans nombre et des mondes sans fin.
Par delà tous les lieux, le Dieu des lieux réside.
Pardonnez-moi la pompe de cette image. C’est la seule où je reconnaisse vraiment la disposition de mon âme, et ce qui s’y passe. On peut me parler d’une foule de liens, d’affections, de jouissances ; on peut en décrire la force et la douceur. Je le reconnaîtrai, je le sentirai avec ceux qui le diront. Mais par delà tous ces lieux, le Dieu des lieux réside. Et ce n’est point là pour moi, Madame une volonté un parti pris, pas plus qu’une impression de jeunesse une fantaisie d’imagination. C’est le fait, le fait pur et simple, le fait constant pour moi, en moi soit que je l’ai possédé, soit qu’il m’aie manqué un seul sentiment, un seul bonheur, a toujours été pour moi le Dieu des lieux. Je vous le disais avant le 15 Juin, et vous ne vouliez pas me croire. Je vous le redis aujourd’hui. Croyez-moi ; et ne me parlez d’aucune compensation ; et gardons ensemble nos regrets, nos regrets justes & sacrés. Et soyez bien sûre que je sens comme vous les vôtres ; bien sûre que je donnerais je ne sais pas quoi pour vous voir entourée des joies qui me restent. Mais ne mettons rien, joies ou regrets, à côté de ce qui est au delà, et au dessus de tout. Ah, que ne passons-nous notre vie ensemble ! Ce que je vous dis là, je vous le ferai voir.
4 heures Votre lettre m’arrive tard. J’ai là M. Duvergier de Hauranne, dans mon cabinet. La cloche du déjeuner sonne. J’aurais tant de choses à vous dire ! Une seule, une seule aujourd’hui. Au nom de Dieu, ne soyez pas malade. J’ai besoin de votre santé comme de... Adieu. Adieu. Un adieu sans pareil, si cela se peut. G.
Ma mère est un peu mieux ce matin.
Savez-vous que je n’ai pas seulement des ennemis, mais aussi des amis qui s’occupent beaucoup de mes fréquentes visites, de nos longues conversations, et qui s’en inquiètent un peu ! Ils se disent entre eux que certainement il y a de la politique là dessous, de votre part, comme de la mienne, de ma part comme de la vôtre. Nous sommes l’un et l’autre spirituels, habiles ; nous avons l’un et l’autre pris part, et point renoncé sans doute aux affaires de ce monde. Est-ce que je me disposerais à changer de politique à devenir russe au lieu d’anglais à ressusciter la sainte au lieu de la quadruple Alliance ?
Il faut que j’y prenne bien garde. J’ai besoin de ménager les sentiments, les habitudes, les préjugés de mon pays que j’ai déjà heurtés plus d’une fois, bien qu’avec raison, pour l’administration intérieure. Et puis, quand j’entre dans une relation politique importante, significative, je devrais en parler à mes amis politiques, leur dire ce que je veux, ce que je fais, les tenir au courant enfin, car leur cause est la mienne ; nos intérêts, nos destinées sont les mêmes. Ils me sont ; ils me seront très fidèles. Ils voudraient bien être toujours instruits. Cela se dit très doucement très affectueusement. Cela me revient indirectement. J’y réponds et j’y répondrai très simplement souriant un peu, disant de vous un peu de ce que j’en pense, rassurant mes amis sur la fixité de ma politique comme sur l’étendue de ma confiance en eux et gardant bien du reste ma liberté, que je n’ai jamais livrée. J’admire toujours à quel point les hommes, même des hommes distingués, prônent le côté petit et tortueux des choses, au lieu du côté simple et grand et à force de chercher finesse, s’en vont à cent lieues de la vérité.
Samedi matin, 6 heures
Je me lève. Voilà une heure et demie que j’essaie en vain de me rendormir. On dit que la faim empêche de dormir. J’ai faim. Vous me parlez du bonheur qui me reste et m’entoure. Vous me dîtes que j’en sais jouir. Vous avez raison. Je n’ai jamais dans mes plus cruels moments, méconnu le prix de ce qui me restait. Je ne m’y suis jamais senti indifférent. Je ne me suis jamais permis de me dire à moi-même que j’y pouvais être indifférant. Je me serais cru coupable envers Dieu, plus coupable envers ces créatures qui m’aiment, m’aiment beaucoup, & qui ont droit non seulement que je les aime, mais que je me trouve heureux de ce quelles m’aiment. L’affection veut donner du bonheur, et souffre et s’offense quand elle n’en donne pas. Je sais tout cela. Bien plus, je le sens ; et naturellement, sans effort, je jouis en effet de l’affection de mes enfants, de ma mère, de mes amis ; et je leur montre que j’en jouis, et j’espère qu’ils le croient, j’en suis sûr.
Mais laissez- moi, Madame, être avec vous parfaitement sincère, c’est-à-dire vous montrer toute mon âme. C’est en cela, pour moi, que la parfaite, sincérité consiste. Aux autres, je ne mens point, mais je ne dis pas tout. Ces relations, ces affections, ces joies qui me restent, en même temps que je les ai toujours senties, je ne me suis jamais donné, je n’ai jamais pu me donner le change à moi-même sur leur importance pour moi, sur leur place en moi. Je ne voudrais pas même en vous parlant à vous seule, même avec la certitude que nul autre ne verra jamais ce que je vous dis, je ne voudrais pas dire un mot qui fût injuste qui fût offensant pour ces sentiments et ces bonheurs là. Mais il ne leur est pas donné de pénétrer jusqu’au fond de mon âme, de remplir ma vie, d’être mon âme et ma vie. Ils animent, ils embellissent la région où ils se passent, mais cette région est pour moi celle du monde extérieur et non pas la mienne propre ; c’est une région où je me promène, et non pas cette où j’habite.
Voltaire fait quelque part dans La Henriade, je crois la description du système céleste, de toutes les planètes, de tous les astres, de leur hiérarchie, de leur immensité. Il les nomme, il les compte, les compte encore ne parvint pas à les épuiser. Au dessus, au delà de ceux qu’il a nommés, qu’il a comptés.
Sont des soleils sans nombre et des mondes sans fin.
Par delà tous les lieux, le Dieu des lieux réside.
Pardonnez-moi la pompe de cette image. C’est la seule où je reconnaisse vraiment la disposition de mon âme, et ce qui s’y passe. On peut me parler d’une foule de liens, d’affections, de jouissances ; on peut en décrire la force et la douceur. Je le reconnaîtrai, je le sentirai avec ceux qui le diront. Mais par delà tous ces lieux, le Dieu des lieux réside. Et ce n’est point là pour moi, Madame une volonté un parti pris, pas plus qu’une impression de jeunesse une fantaisie d’imagination. C’est le fait, le fait pur et simple, le fait constant pour moi, en moi soit que je l’ai possédé, soit qu’il m’aie manqué un seul sentiment, un seul bonheur, a toujours été pour moi le Dieu des lieux. Je vous le disais avant le 15 Juin, et vous ne vouliez pas me croire. Je vous le redis aujourd’hui. Croyez-moi ; et ne me parlez d’aucune compensation ; et gardons ensemble nos regrets, nos regrets justes & sacrés. Et soyez bien sûre que je sens comme vous les vôtres ; bien sûre que je donnerais je ne sais pas quoi pour vous voir entourée des joies qui me restent. Mais ne mettons rien, joies ou regrets, à côté de ce qui est au delà, et au dessus de tout. Ah, que ne passons-nous notre vie ensemble ! Ce que je vous dis là, je vous le ferai voir.
4 heures Votre lettre m’arrive tard. J’ai là M. Duvergier de Hauranne, dans mon cabinet. La cloche du déjeuner sonne. J’aurais tant de choses à vous dire ! Une seule, une seule aujourd’hui. Au nom de Dieu, ne soyez pas malade. J’ai besoin de votre santé comme de... Adieu. Adieu. Un adieu sans pareil, si cela se peut. G.
Ma mère est un peu mieux ce matin.
46. Paris, Vendredi 22 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
46. Vendredi 22 Septembre. 6 heures
Je reçus un billet de M. Molé à une heure pour me rappeler notre rendez-vous à la place de la ville l’Evêque. Je m’y rendis munie du journal. Avant de procéder à son portrait, je le priai de m’écouter attentivement, et je commençai par lui rappeler ses promesses à l’égard des journaux ; je lui rappelai ensuite sa visite, et je lui demandai, comment il pouvait se faire que j’eusse à attribuer à lui, à lui seul, le déplaisant article dont je venais me plaindre aujourd’hui. M. Molé me parût fort contrarié de ce sujet de conversation. Il me dit qu’il avait espéré à mon silence de tous ces derniers jours que je n’avais pas en connaissance de cet article, qu’il n’en avait pas dormi de 48 heures, qu’il comprenait mes reproches, & qu’il me donnait sa parole d’homme qu’il n’avait rien à se reprocher que d’avoir dit devant Pozzo qu’il m’avait trouvé malade & & qu’il reconnaissait bien à cette indiscrétion, qu’il avait eu parfaitement tort de le dire même à lui, mais qu’il me conjurait de croire qu’il était plus que malheureux de cet abominable article, qu’il lui était défavorable politiquement même, puisqu’il était de nature à vous blesser et de la façon la plus ungentlemanlike qui se puisse, que c’était du plus mauvais goût, de la plus maladroite intuition, enfin il ne tarit pas sur ce sujet. Je lui observai, que ce n’était pas de vous que j’étais venu lui parler ; que j’ignorais ce que vous pourriez penser de cet article, que c’était de moi qu’il s’agissait et qu’au lieu de la protection que j’étais en droit d’attendre de ce qu’il appelle son amitié pour moi, je me plaignais avec raison d’un manque pareil de respect et de convenance. Il protesta qu’il avait de suite enjoint à M. de Montalivet de faire à la presse & au temps, les admonitions. & les menaces nécessaires pour empêcher la répétition d’articles aussi scandaleux. Il me parut être très blessé de la presse surtout (je n’avais pas tenu cette feuille en main. On m’en avait lu seulement un passage.) Il recommença Pozzo, il recommença les insomnies, il me parut sérieusement peiné et fit tout ce qui était en lui pour détruire le mauvais sentiment avec le quel j’étais entrée chez lui. Je fus forcée d’admettre tout ce qu’il me dit, avec mille promesses pour l’avenir, au moins quant à ses efforts pour empêcher que cela se renouvelle. Il m’est impossible. d’entrer par lettres dans plus de détail sur ce sujet. Le Pozzo n’était pas seul, ce que j’ai su depuis, il y avait surtout le jeune homme que nous n’avons pas fort bien traité chez moi au sortir du dîner chez l’ambassadeur de Sardaigne.
Ce qui m’a beaucoup frappé dans cet entretien est la véritable inquiétude qu’il ressent & qu’il montre à votre égard. Je vous réponds que cela est. Je me suis borné à cet égard à des observations très générales. J’ai dit que je comprenais la bonne guerre entre hommes politiques, et que celle-là puisse aller aussi loin que possible, mais que ce genre d’attaque me paraissait tout à fait au dessous de ce qu’on se doit à soi- même et était de la plus mauvaise compagnie. M. Molé renchérit encore là-dessus et revint vingt fois sur ce sujet avec toutes les exclamations convenables. Voilà Monsieur ce que j’ai à vous rapporter sur mon explication de tantôt. Je trouve tout cela une bien mauvaise affaire. & plus j’y pense plus elle me vexe. jugez ce qu’on en dira au loin !
Samedi 23. Je n’ai pas pu continuer hier. Je reprends là où je vous ai laissé. Toute cette explication s’était passée sur un grand divan dans un cabinet vitré donnant sur son jardin. Il avait aussi toute la coquetterie imaginable à préparer son appartement pour me recevoir. Il est bien arrangé. Je passai quelques moments devant son portrait. Plus tard nous nous promenâmes dans le jardin toute cette visite me prit une heure. M. Molé ne me parut pas aussi gai aussi confiant que je l’avais trouvé quelques jours auparavant. Il ne se fit pas très implicitement aux bonnes dispositions que lui témoigne encore M. Thiers. Les deux premiers mois de la session prochaine lui paraissent devoir être très décisifs, & si les doctrinaires entendaient bien leurs intérêts. Ils devraient soutenir le gouvernement !
De la place de la ville de l’Evêque, je me rendis au bois de Boulogne, j’avais besoin de me remettre de cette mauvaise matinée. Je n’y réussis pas, tout ce qui m’agite me porte sur les nerfs & y reste longtemps. Je m’arrêtai chez la petite princesse, je lui parlai de ma matinée, & c’est là-dessus que j’aurais mille détails à vous donner qui ne peuvent pas trouver place dans une lettre. IL faut que je vous dise cependant que le hasard l’avait mis à même d’accepter l’exactitude de chaque chose que M. Molé m’avait dit sur ce sujet.
Ainsi c’est par le Prince Schönburg lundi à dîner chez M. de Pahlen qu’il à appris ce qui avait paru dans le Temps, et il m’a été pétrifié. Le mari l’a conté le soir même à sa femme. Comme un mouvement qui l’avait beaucoup frappé. C’est encore en présence de la petite Princesse que M. Molé avait fait le récit de sa visite chez moi, mais n’appuyant que sur que les vers de Lamartine m’ennuyaient. Pozzo et deux autres hommes étaient présents. Mon Dieu que je vous conte des détails ! J’en ai presque honte.
Je dînai mal, je fus un peu maussade après le dîner. Le soir la petite princesse, les Durazzo, tous les Pahlen & M. de. Médem vinrent chez moi. J’essayai un peu de musique, mais elle ne va pas devant le monde, je me trouble et les idées, les souvenirs ne me viennent pas. Je quittai le piano, je fus toute la soirée un peu fidgetty connaissez vous ce mot ?
J’avais le pressentiment d’un mauvais réveil. Et en effet cette lettre attendue avec tant d’impatience et à laquelle je fais toujours aveuglement un si bon, un si tendre accueil, elle me chagrine bien ! Voulez-vous que je vous le dise, dès la matinée de votre départ j’ai prévu cela. Vous n’aviez pas un air de complète vérité ne m’annonçant le 26 comme le jour de la noce ; et je n’ai pas cessé d’avoir des soupçons depuis le moment où vous m’avez quittée. Ils sont devenus une fort triste certitude. Mais expliquez-moi bien clairement si vos occupations électorales vont remplir l’intervalle entre ceci & la noce ou si elles doivent inquiéter, même sur la noce. Je vous en supplie dite moi quelque chose de fixe, nommez moi une date afin que je sache penser & me réjouir franchement. Ne craignez pas que je vous détourne de vos devoirs par la moindre plainte ; ne craignez pas une mauvaise parole, par une mauvaise pensée.
Ah mon Dieu à qui croire sur la terre si je ne croyais pas en vous. Je serai triste, triste plus constamment triste que vous, car je n’ai rien qui me distraie du seul sentiment du seul intérêt qui occupe mon âme, mais je croirai que la vôtre retourne à moi, à moi toujours dans tous les instants que vous n’êtes pas forcé de consacrer à d’autres soins et je le répète vous êtes heureux bien plus heureux que moi, car vous aviez d’autres soins ! Moi, je n’ai rien ! Vous m’avez dit qu’aussi tôt la dissolution prononcée vous êtes forcé de venir à Paris pour huit jours au moins, afin de voir votre monde, de vous concerter avec lui, votre tournée de province remplace t-elle cela ? Ne serait-elle avant, après ? Enfin je vous en prie soyez clair, bien clair dans ce que vous allez me répondre, moi je je serai bien sage, je vous le promets.
Midi. Les expressions de votre lettre me touchent, je viens de la relire. Oui, je serai tout ce que vous voulez que je sois, comptez là-dessus. Je serai tout bonnement triste, triste, pas autre chose. J’attendrai avec confiance, mais avec impatience. Vous permettez que je sois impatiente, n’est-ce pas ?
La petite princesse est partie ce matin, pour Maintenon avec son fils. C’est une partie d’enfance où elle va passer quelques jours. Ah comme j’acceptais avec transport ces parties là, comme c’étaient mes vraies fêtes ! Mon Dieu, que je suis isolée ! Lady Granville qui devait revenir aujourd’hui se remet à la semaine prochaine. Je n’ai pas de ressources de femmes. Je verrai à passer mon temps comme je pourrai. Quelle longue lettre !
Adieu, que d’adieux nous allons encore nous adresser. Il y en aura tant que je ne les aimerai plus. Ah quel blasphème ! je voulais dire que je serai lasse de les faire voyager toujours. Un peu de repos je vous en prie, du repos dans mon cabinet sur mon canapé vert. Ah mon Dieu ! Adieu.
Je reçus un billet de M. Molé à une heure pour me rappeler notre rendez-vous à la place de la ville l’Evêque. Je m’y rendis munie du journal. Avant de procéder à son portrait, je le priai de m’écouter attentivement, et je commençai par lui rappeler ses promesses à l’égard des journaux ; je lui rappelai ensuite sa visite, et je lui demandai, comment il pouvait se faire que j’eusse à attribuer à lui, à lui seul, le déplaisant article dont je venais me plaindre aujourd’hui. M. Molé me parût fort contrarié de ce sujet de conversation. Il me dit qu’il avait espéré à mon silence de tous ces derniers jours que je n’avais pas en connaissance de cet article, qu’il n’en avait pas dormi de 48 heures, qu’il comprenait mes reproches, & qu’il me donnait sa parole d’homme qu’il n’avait rien à se reprocher que d’avoir dit devant Pozzo qu’il m’avait trouvé malade & & qu’il reconnaissait bien à cette indiscrétion, qu’il avait eu parfaitement tort de le dire même à lui, mais qu’il me conjurait de croire qu’il était plus que malheureux de cet abominable article, qu’il lui était défavorable politiquement même, puisqu’il était de nature à vous blesser et de la façon la plus ungentlemanlike qui se puisse, que c’était du plus mauvais goût, de la plus maladroite intuition, enfin il ne tarit pas sur ce sujet. Je lui observai, que ce n’était pas de vous que j’étais venu lui parler ; que j’ignorais ce que vous pourriez penser de cet article, que c’était de moi qu’il s’agissait et qu’au lieu de la protection que j’étais en droit d’attendre de ce qu’il appelle son amitié pour moi, je me plaignais avec raison d’un manque pareil de respect et de convenance. Il protesta qu’il avait de suite enjoint à M. de Montalivet de faire à la presse & au temps, les admonitions. & les menaces nécessaires pour empêcher la répétition d’articles aussi scandaleux. Il me parut être très blessé de la presse surtout (je n’avais pas tenu cette feuille en main. On m’en avait lu seulement un passage.) Il recommença Pozzo, il recommença les insomnies, il me parut sérieusement peiné et fit tout ce qui était en lui pour détruire le mauvais sentiment avec le quel j’étais entrée chez lui. Je fus forcée d’admettre tout ce qu’il me dit, avec mille promesses pour l’avenir, au moins quant à ses efforts pour empêcher que cela se renouvelle. Il m’est impossible. d’entrer par lettres dans plus de détail sur ce sujet. Le Pozzo n’était pas seul, ce que j’ai su depuis, il y avait surtout le jeune homme que nous n’avons pas fort bien traité chez moi au sortir du dîner chez l’ambassadeur de Sardaigne.
Ce qui m’a beaucoup frappé dans cet entretien est la véritable inquiétude qu’il ressent & qu’il montre à votre égard. Je vous réponds que cela est. Je me suis borné à cet égard à des observations très générales. J’ai dit que je comprenais la bonne guerre entre hommes politiques, et que celle-là puisse aller aussi loin que possible, mais que ce genre d’attaque me paraissait tout à fait au dessous de ce qu’on se doit à soi- même et était de la plus mauvaise compagnie. M. Molé renchérit encore là-dessus et revint vingt fois sur ce sujet avec toutes les exclamations convenables. Voilà Monsieur ce que j’ai à vous rapporter sur mon explication de tantôt. Je trouve tout cela une bien mauvaise affaire. & plus j’y pense plus elle me vexe. jugez ce qu’on en dira au loin !
Samedi 23. Je n’ai pas pu continuer hier. Je reprends là où je vous ai laissé. Toute cette explication s’était passée sur un grand divan dans un cabinet vitré donnant sur son jardin. Il avait aussi toute la coquetterie imaginable à préparer son appartement pour me recevoir. Il est bien arrangé. Je passai quelques moments devant son portrait. Plus tard nous nous promenâmes dans le jardin toute cette visite me prit une heure. M. Molé ne me parut pas aussi gai aussi confiant que je l’avais trouvé quelques jours auparavant. Il ne se fit pas très implicitement aux bonnes dispositions que lui témoigne encore M. Thiers. Les deux premiers mois de la session prochaine lui paraissent devoir être très décisifs, & si les doctrinaires entendaient bien leurs intérêts. Ils devraient soutenir le gouvernement !
De la place de la ville de l’Evêque, je me rendis au bois de Boulogne, j’avais besoin de me remettre de cette mauvaise matinée. Je n’y réussis pas, tout ce qui m’agite me porte sur les nerfs & y reste longtemps. Je m’arrêtai chez la petite princesse, je lui parlai de ma matinée, & c’est là-dessus que j’aurais mille détails à vous donner qui ne peuvent pas trouver place dans une lettre. IL faut que je vous dise cependant que le hasard l’avait mis à même d’accepter l’exactitude de chaque chose que M. Molé m’avait dit sur ce sujet.
Ainsi c’est par le Prince Schönburg lundi à dîner chez M. de Pahlen qu’il à appris ce qui avait paru dans le Temps, et il m’a été pétrifié. Le mari l’a conté le soir même à sa femme. Comme un mouvement qui l’avait beaucoup frappé. C’est encore en présence de la petite Princesse que M. Molé avait fait le récit de sa visite chez moi, mais n’appuyant que sur que les vers de Lamartine m’ennuyaient. Pozzo et deux autres hommes étaient présents. Mon Dieu que je vous conte des détails ! J’en ai presque honte.
Je dînai mal, je fus un peu maussade après le dîner. Le soir la petite princesse, les Durazzo, tous les Pahlen & M. de. Médem vinrent chez moi. J’essayai un peu de musique, mais elle ne va pas devant le monde, je me trouble et les idées, les souvenirs ne me viennent pas. Je quittai le piano, je fus toute la soirée un peu fidgetty connaissez vous ce mot ?
J’avais le pressentiment d’un mauvais réveil. Et en effet cette lettre attendue avec tant d’impatience et à laquelle je fais toujours aveuglement un si bon, un si tendre accueil, elle me chagrine bien ! Voulez-vous que je vous le dise, dès la matinée de votre départ j’ai prévu cela. Vous n’aviez pas un air de complète vérité ne m’annonçant le 26 comme le jour de la noce ; et je n’ai pas cessé d’avoir des soupçons depuis le moment où vous m’avez quittée. Ils sont devenus une fort triste certitude. Mais expliquez-moi bien clairement si vos occupations électorales vont remplir l’intervalle entre ceci & la noce ou si elles doivent inquiéter, même sur la noce. Je vous en supplie dite moi quelque chose de fixe, nommez moi une date afin que je sache penser & me réjouir franchement. Ne craignez pas que je vous détourne de vos devoirs par la moindre plainte ; ne craignez pas une mauvaise parole, par une mauvaise pensée.
Ah mon Dieu à qui croire sur la terre si je ne croyais pas en vous. Je serai triste, triste plus constamment triste que vous, car je n’ai rien qui me distraie du seul sentiment du seul intérêt qui occupe mon âme, mais je croirai que la vôtre retourne à moi, à moi toujours dans tous les instants que vous n’êtes pas forcé de consacrer à d’autres soins et je le répète vous êtes heureux bien plus heureux que moi, car vous aviez d’autres soins ! Moi, je n’ai rien ! Vous m’avez dit qu’aussi tôt la dissolution prononcée vous êtes forcé de venir à Paris pour huit jours au moins, afin de voir votre monde, de vous concerter avec lui, votre tournée de province remplace t-elle cela ? Ne serait-elle avant, après ? Enfin je vous en prie soyez clair, bien clair dans ce que vous allez me répondre, moi je je serai bien sage, je vous le promets.
Midi. Les expressions de votre lettre me touchent, je viens de la relire. Oui, je serai tout ce que vous voulez que je sois, comptez là-dessus. Je serai tout bonnement triste, triste, pas autre chose. J’attendrai avec confiance, mais avec impatience. Vous permettez que je sois impatiente, n’est-ce pas ?
La petite princesse est partie ce matin, pour Maintenon avec son fils. C’est une partie d’enfance où elle va passer quelques jours. Ah comme j’acceptais avec transport ces parties là, comme c’étaient mes vraies fêtes ! Mon Dieu, que je suis isolée ! Lady Granville qui devait revenir aujourd’hui se remet à la semaine prochaine. Je n’ai pas de ressources de femmes. Je verrai à passer mon temps comme je pourrai. Quelle longue lettre !
Adieu, que d’adieux nous allons encore nous adresser. Il y en aura tant que je ne les aimerai plus. Ah quel blasphème ! je voulais dire que je serai lasse de les faire voyager toujours. Un peu de repos je vous en prie, du repos dans mon cabinet sur mon canapé vert. Ah mon Dieu ! Adieu.
45.Val-Richer, Samedi 23 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°45 Samedi 5 heures
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
47. Paris, Dimanche 24 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
47. Paris, dimanche le 21 Septembre 9h1/2
Quel triste réveil. Votre lettre, vous savez ce qu’elle contenait cette lettre ? Point de noce. Votre mère malade. Vos occupations électorales en province, pas la plus légère espérance d’une course à Paris, et tout cela m’arrive le jour où devait tenir pour moi tant de bonheur !
En même temps, je reçois deux lettres de mon mari dont je vous transmets les passages importants dans la première du 5 Sept. il me dit : "Tu me fais de nouvelles propositions sur un voyage de circumnavigation pour te rencontrer au Havre ! S’il n’existait pas des entraves insurmontables à une telle entreprise, j’y aurais pensé à deux fois d’après les allusions qui ont été faites à ce sujet à mon passage par Carlsbad. Ce sont les conséquences nécessaires d’une fausse position trop prolongée. Il est urgent qu’elle subisse une modification d’un côté ou de l’autre."
Dans la seconde lettre du 10 Septembre " Ton N°356 m’est parvenu hier, le précédent n’est point entré encore. C’est pour cela peut-être que celui-ci ne m’est point intelligible. Tu sembles avoir reçu la lettre par laquelle je te demandai de me faire connaître ta détermination. Je suis dans l’obligation d’insister sur une réponse catégorique, car je dois moi-même rendre compte des déterminations que j’aurai à prendre en conséquence. Je t’exhorte donc à me faire connaître sans délai, si tu as intention de venir me rejoindre on non. Je dois dans un délai donné prendre une résolution quelque pénible que puisse m’être une semblable nécessité."
Que direz-vous Monsieur de tout cela ? Il est évident par la première, que des commérages ont voyagé jusqu’à Carlsbad ; & par la seconde qu’il a pris envers l’Empereur l’engagement de me forcer à tout prix à quitter Paris ? Voilà où j’en suis. Savez-vous ce qui arrivera ? L’Empereur lui permettra de venir sous la condition expresse de m’emmener et lui viendra avec empressement, incognito me surprendre. Car voilà sa jalousie éveillée, & je le connais. Il est terrible. Il est clair qu’il ne croira pas un mot des certificat du médecin. Car il me dit dans une autre partie de sa lettre " il est plaisant de remarquer que les médecins de Granville le renvoient de Paris, & que les tiens t’ordonnent d’y rester, ils sont complaisants, avant tout." Si, si ce que je crois arrive, c’est sur la mi octobre que mon mari serait ici. Qui me donnera force & courage ? Je suis bien abandonnée.
Ma journée hier a été plus triste que de coutume. Votre lettre m’avait accablée. J’ai eu de la distraction cependant, le prince Paul de Wurtemberg pendant un temps, qui m’a fait le récit de tous les embarras existants encore pour le mariage. Mon ambassadeur en suite. Ma promenade d ’habitude au bois de Boulogne, mais tout cela n’y a rien fait ; à dîner il m’a pris d’horribles souvenirs. Je n’étais qu’à eux, à eux comme aux premiers temps de mes malheurs. Tout le reste était à la surface tout, oui vous-même. Le fond de mon cœur était le désespoir, je ne trouvais que cela de réel. Je demande pardon à ces créatures chéries d’avoir
été si longtemps détournées de mon chagrin. Je demandais à Dieu comme le premier jour, de me réunir à eux dans la tombe, dans le ciel, tout de suite dans ce tombeau. Je n’entendais & ne voyais rien, Marie parlait je ne l’écoutais pas et tout à coup des sanglots affreux se sont échappés de
mon coeur. Vous ne savez pas comme je sais pleurer. Vous ne pourriez pas écouter mes sanglots, ils vous feraient trop de mal.
J’ai quitté la table, j’ai pleuré, pleuré sur l’épaule de cette pauvre Marie qui pleurait elle-même sans savoir de quoi. J’ai ouvert ma porte à 9 h 1/2. Je n’ai vu que mon ambassadeur & Pozzo.
Ma nuit a été mauvaise, & mon réveil je vous l’ai dit.
Midi
Qu’est-ce que votre mère vous donne de l’inquiétude, puisque le cas de la dissolution échéant vous pourriez être forcé de la quitter pendant quelques jours ne serait-il pas plus prudent, & plus naturel de la ramener à Paris, d’y revenir tous, de vous y établir. Cette question ne vous est-elle pas venue ? L’été est fini, la campagne n’est plus du bénéfice pour la santé.
Un courrier de Stuttgard a posté au prince de Wurtemberg défense de conclure le mariage à moins qu’il ne soit stipulé que tous les enfants seront protestants. La Reine exige qu’ils soient tous catholiques, le prince se conforme à cette volonté qui est celle de la princesse aussi, & il a écrit au roi de Würtemberg en date du 19 par courrier français qu’il passerait outre si même le Roi n’accordait pas son consentement. Dans ce dernier cas cependant il est évident que le ministre de Würtemberg n’assisterait pas à la noce & que cela ferait un petit scandale. Le prince Paul jouit de tout cela. Il abhore son frère. Hier il a dîné à St Cloud
pour la première fois depuis 7 ans.
Je cherche à me distraire en vous contant ce qui ne m’intéresse pas le moins du monde. Adieu Monsieur, dès que je suis triste, je suis malade, j’espère ne pas le dernier trop sérieusement. Je voudrais me distraire, je ne sais comment m’y prendre.
Dites-moi bien exactement des nouvelles de votre mère, & dites-moi surtout, si vous n’auriez pas plus confiance dans le médecin de Paris & les soins qu’elle trouverait ici.
Adieu. Adieu toujours adieu.
Quel triste réveil. Votre lettre, vous savez ce qu’elle contenait cette lettre ? Point de noce. Votre mère malade. Vos occupations électorales en province, pas la plus légère espérance d’une course à Paris, et tout cela m’arrive le jour où devait tenir pour moi tant de bonheur !
En même temps, je reçois deux lettres de mon mari dont je vous transmets les passages importants dans la première du 5 Sept. il me dit : "Tu me fais de nouvelles propositions sur un voyage de circumnavigation pour te rencontrer au Havre ! S’il n’existait pas des entraves insurmontables à une telle entreprise, j’y aurais pensé à deux fois d’après les allusions qui ont été faites à ce sujet à mon passage par Carlsbad. Ce sont les conséquences nécessaires d’une fausse position trop prolongée. Il est urgent qu’elle subisse une modification d’un côté ou de l’autre."
Dans la seconde lettre du 10 Septembre " Ton N°356 m’est parvenu hier, le précédent n’est point entré encore. C’est pour cela peut-être que celui-ci ne m’est point intelligible. Tu sembles avoir reçu la lettre par laquelle je te demandai de me faire connaître ta détermination. Je suis dans l’obligation d’insister sur une réponse catégorique, car je dois moi-même rendre compte des déterminations que j’aurai à prendre en conséquence. Je t’exhorte donc à me faire connaître sans délai, si tu as intention de venir me rejoindre on non. Je dois dans un délai donné prendre une résolution quelque pénible que puisse m’être une semblable nécessité."
Que direz-vous Monsieur de tout cela ? Il est évident par la première, que des commérages ont voyagé jusqu’à Carlsbad ; & par la seconde qu’il a pris envers l’Empereur l’engagement de me forcer à tout prix à quitter Paris ? Voilà où j’en suis. Savez-vous ce qui arrivera ? L’Empereur lui permettra de venir sous la condition expresse de m’emmener et lui viendra avec empressement, incognito me surprendre. Car voilà sa jalousie éveillée, & je le connais. Il est terrible. Il est clair qu’il ne croira pas un mot des certificat du médecin. Car il me dit dans une autre partie de sa lettre " il est plaisant de remarquer que les médecins de Granville le renvoient de Paris, & que les tiens t’ordonnent d’y rester, ils sont complaisants, avant tout." Si, si ce que je crois arrive, c’est sur la mi octobre que mon mari serait ici. Qui me donnera force & courage ? Je suis bien abandonnée.
Ma journée hier a été plus triste que de coutume. Votre lettre m’avait accablée. J’ai eu de la distraction cependant, le prince Paul de Wurtemberg pendant un temps, qui m’a fait le récit de tous les embarras existants encore pour le mariage. Mon ambassadeur en suite. Ma promenade d ’habitude au bois de Boulogne, mais tout cela n’y a rien fait ; à dîner il m’a pris d’horribles souvenirs. Je n’étais qu’à eux, à eux comme aux premiers temps de mes malheurs. Tout le reste était à la surface tout, oui vous-même. Le fond de mon cœur était le désespoir, je ne trouvais que cela de réel. Je demande pardon à ces créatures chéries d’avoir
été si longtemps détournées de mon chagrin. Je demandais à Dieu comme le premier jour, de me réunir à eux dans la tombe, dans le ciel, tout de suite dans ce tombeau. Je n’entendais & ne voyais rien, Marie parlait je ne l’écoutais pas et tout à coup des sanglots affreux se sont échappés de
mon coeur. Vous ne savez pas comme je sais pleurer. Vous ne pourriez pas écouter mes sanglots, ils vous feraient trop de mal.
J’ai quitté la table, j’ai pleuré, pleuré sur l’épaule de cette pauvre Marie qui pleurait elle-même sans savoir de quoi. J’ai ouvert ma porte à 9 h 1/2. Je n’ai vu que mon ambassadeur & Pozzo.
Ma nuit a été mauvaise, & mon réveil je vous l’ai dit.
Midi
Qu’est-ce que votre mère vous donne de l’inquiétude, puisque le cas de la dissolution échéant vous pourriez être forcé de la quitter pendant quelques jours ne serait-il pas plus prudent, & plus naturel de la ramener à Paris, d’y revenir tous, de vous y établir. Cette question ne vous est-elle pas venue ? L’été est fini, la campagne n’est plus du bénéfice pour la santé.
Un courrier de Stuttgard a posté au prince de Wurtemberg défense de conclure le mariage à moins qu’il ne soit stipulé que tous les enfants seront protestants. La Reine exige qu’ils soient tous catholiques, le prince se conforme à cette volonté qui est celle de la princesse aussi, & il a écrit au roi de Würtemberg en date du 19 par courrier français qu’il passerait outre si même le Roi n’accordait pas son consentement. Dans ce dernier cas cependant il est évident que le ministre de Würtemberg n’assisterait pas à la noce & que cela ferait un petit scandale. Le prince Paul jouit de tout cela. Il abhore son frère. Hier il a dîné à St Cloud
pour la première fois depuis 7 ans.
Je cherche à me distraire en vous contant ce qui ne m’intéresse pas le moins du monde. Adieu Monsieur, dès que je suis triste, je suis malade, j’espère ne pas le dernier trop sérieusement. Je voudrais me distraire, je ne sais comment m’y prendre.
Dites-moi bien exactement des nouvelles de votre mère, & dites-moi surtout, si vous n’auriez pas plus confiance dans le médecin de Paris & les soins qu’elle trouverait ici.
Adieu. Adieu toujours adieu.
46. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°46 Lundi 25. 6 heures
Il est à peine six heures. Le Soleil n’est pas encore au dessus de l’horizon. J’ai mal dormi. Je me lève. Hier en me couchant, à 10 heures et demie, je me suis figuré dans la malle-poste au lieu de mon lit courant vers vous. A peine endormi, j’ai rêvé dans la malle-poste. A quatre heures, je me suis réveillé comme si j’arrivais. Ce devait être aujourd’hui en effet. Vous en avez douté quand je vous l’ai dit. Vous avez prévu que ce ne serait pas. Dearest, voici l’exacte vérité. Je n’en étais pas sûr. Le jour du mariage de M. Duchâtel n’était pas absolument fixé. Il m’avait parlé du 25 septembre au 2 ou 3 octobre. J’ai été faible pour moi, faible pour vous. J’ai pris la supposition favorable sans y compter, pour nous faire plaisir à tous deux, pour ne pas nous donner tout à coup, à vous un chagrin, à moi le vôtre, et le mien. J’ai eu tort. On a toujours tort, avec la personne à qui l’on dit tout, à qui l’on doit tout, de ne pas dire exactement ce qui est ce qu’on croit. Il faudrait toujours braver la peine du moment pour éviter la peine à venir. Pardonnez- moi de ne l’avoir pas fait.
Votre n°46 m’a touché, et me touche profondément ; si triste et si douce ! Si vive et si raisonnable ! Le jour où j’ai un peu causé avec la petite Princesse elle m’a dit deux ou trois fois, en me parlant de vous : « une personne si supérieure, si extraordinaire". A chaque fois ces paroles me pénétraient, me charmaient ; d’orgueil si on veut, mais de ce délicieux orgueil qui naît d’une tendresse infinie, au dessus, bien au dessus duquel cette tendresse plane, dont elle fait le pouvoir et le prix.
Oui, je suis fier, fier de vous, de votre affection pour moi de votre supériorité, de cette supériorité que je connais mille fois mieux que personne dont je jouis comme personne n’en a jamais joui. Et quand je la retrouve dans les plus petits détails de la vie, quand je vois réunies en vous les qualités, les attraits les plus contraires, tant d’abandon et tant de dignité, un cœur si tendre et un esprit si ferme, une imagination si vive et une raison si droite, un caractère si passionné et si doux, une humeur si égale avec des impressions si variées, je suis heureux, heureux, Madame, bien, bien au delà de tout ce que peuvent vous exprimer de loin mes lettres, et même mes adieux.
Maintenant, voici où j’en suis et ce qui sera. Le mariage de M. Duchâtel n’étant plus rien pour moi j’ai pris la dissolution. Elle sera certainement prononcée et publique dans les premiers jours d’Octobre au plus tard. J’ai un dîner chez moi au Val-Richer, demain 26. Après-demain 27 je vais dîner à Croissanville, à 4 lieues d’ici, avec une réunion d’électeurs. Du 27 au 2 octobre, je ferai quelques courses dans l’intérêt des élections voisines. Je recevrai beaucoup de visites. Le 3 octobre encore un dîner pour moi, et une réunion d’électeurs à Mézidon, dans ce canton que je n’ai jamais visité. Le 4 un dîner à Lisieux, point un meeting, un dîner privé, mais avec beaucoup d’électeurs. Le 5 à 1 heure et demie je monte dans la malle-poste, et le 6 à 4 heures du matin, je passe dans la rue de Rivoli, pour faire le même jour, à une heure & demie quelque chose de mieux que d’y passer.
Voilà, d’ici là ma biographie et mon itinéraire. C’est long, bien long. Je ne demande qu’une chose, dearest, une seule chose. Soyez sûre, sûre aujourd’hui comme vous le serez dans deux ans, dans trois ans, que c’est aussi long pour moi que pour vous. Ne dites donc pas que vous me contez trop de petites choses, que vous me donnez trop de détails. Jamais assez. Au milieu du grand bonheur, c’est mon petit, mais très vif plaisir de vous suivre pas à pas dans tout le cours de la journée, d’assister à toutes vos actions, d’heure en heure. Il y en a une que je regrette, qui m’a un peu désagréablement ému le cœur. Vendredi soir vous avez fait de la musique devant votre monde ; et moi, je ne vous ai pas encore entendue. Je ne veux pas, la première fois, vous entendre devant du monde ; mais je voulais avoir votre première musique, à moi seul. Vous ne savez pas à quel point la musique me plaît, m’émeut. Mais c’est pour moi une impression très intime, et qui se lie tout de suite à mes impressions les plus intimes, une de ces impressions dont je n’aime pas à parler excepté à la personne à qui je parle de tout. Je vous aurais si délicieusement écoutée !
J’attends ce matin, M. de Saint-Priest, Alexis, qui vient passer ici 24 heures. Il m’en dira long sur Lisbonne, les Chartistes, Lord Howard de Walden, Saldanha, Sä de Bandeira & & J’ai recommencé hier au soir à lire à mes enfants un romans de Walter Scott. Je vous le dis pour vous montrer que j’ai complètement repris l’usage de ma gorge. Je suis ravi que vous ayez aussi bien retrouvé celui de vos jambes, Certainement c’est une preuve de force.
11 heures Le N° 47 me désole de mille façons, toutes si douloureuses. M. de L., votre chagrin, votre manque de foi, votre santé. Mes lettres suivantes vous auront été un peu meilleures. Celle-ci vous donne une certitude, de voyage, de jour. Si vous saviez que je n’ai pas pensé, que je ne pense pas à autre chose. Croyez-vous donc que je n’ai pas pensé à emmener ma mère à Paris ? Mais elle est mieux et se trouve bien ici. Je vous répondrai demain avec détail. Adieu. Adieu. Soignez-vous, je vous en conjure. Adieu. G.
Il est à peine six heures. Le Soleil n’est pas encore au dessus de l’horizon. J’ai mal dormi. Je me lève. Hier en me couchant, à 10 heures et demie, je me suis figuré dans la malle-poste au lieu de mon lit courant vers vous. A peine endormi, j’ai rêvé dans la malle-poste. A quatre heures, je me suis réveillé comme si j’arrivais. Ce devait être aujourd’hui en effet. Vous en avez douté quand je vous l’ai dit. Vous avez prévu que ce ne serait pas. Dearest, voici l’exacte vérité. Je n’en étais pas sûr. Le jour du mariage de M. Duchâtel n’était pas absolument fixé. Il m’avait parlé du 25 septembre au 2 ou 3 octobre. J’ai été faible pour moi, faible pour vous. J’ai pris la supposition favorable sans y compter, pour nous faire plaisir à tous deux, pour ne pas nous donner tout à coup, à vous un chagrin, à moi le vôtre, et le mien. J’ai eu tort. On a toujours tort, avec la personne à qui l’on dit tout, à qui l’on doit tout, de ne pas dire exactement ce qui est ce qu’on croit. Il faudrait toujours braver la peine du moment pour éviter la peine à venir. Pardonnez- moi de ne l’avoir pas fait.
Votre n°46 m’a touché, et me touche profondément ; si triste et si douce ! Si vive et si raisonnable ! Le jour où j’ai un peu causé avec la petite Princesse elle m’a dit deux ou trois fois, en me parlant de vous : « une personne si supérieure, si extraordinaire". A chaque fois ces paroles me pénétraient, me charmaient ; d’orgueil si on veut, mais de ce délicieux orgueil qui naît d’une tendresse infinie, au dessus, bien au dessus duquel cette tendresse plane, dont elle fait le pouvoir et le prix.
Oui, je suis fier, fier de vous, de votre affection pour moi de votre supériorité, de cette supériorité que je connais mille fois mieux que personne dont je jouis comme personne n’en a jamais joui. Et quand je la retrouve dans les plus petits détails de la vie, quand je vois réunies en vous les qualités, les attraits les plus contraires, tant d’abandon et tant de dignité, un cœur si tendre et un esprit si ferme, une imagination si vive et une raison si droite, un caractère si passionné et si doux, une humeur si égale avec des impressions si variées, je suis heureux, heureux, Madame, bien, bien au delà de tout ce que peuvent vous exprimer de loin mes lettres, et même mes adieux.
Maintenant, voici où j’en suis et ce qui sera. Le mariage de M. Duchâtel n’étant plus rien pour moi j’ai pris la dissolution. Elle sera certainement prononcée et publique dans les premiers jours d’Octobre au plus tard. J’ai un dîner chez moi au Val-Richer, demain 26. Après-demain 27 je vais dîner à Croissanville, à 4 lieues d’ici, avec une réunion d’électeurs. Du 27 au 2 octobre, je ferai quelques courses dans l’intérêt des élections voisines. Je recevrai beaucoup de visites. Le 3 octobre encore un dîner pour moi, et une réunion d’électeurs à Mézidon, dans ce canton que je n’ai jamais visité. Le 4 un dîner à Lisieux, point un meeting, un dîner privé, mais avec beaucoup d’électeurs. Le 5 à 1 heure et demie je monte dans la malle-poste, et le 6 à 4 heures du matin, je passe dans la rue de Rivoli, pour faire le même jour, à une heure & demie quelque chose de mieux que d’y passer.
Voilà, d’ici là ma biographie et mon itinéraire. C’est long, bien long. Je ne demande qu’une chose, dearest, une seule chose. Soyez sûre, sûre aujourd’hui comme vous le serez dans deux ans, dans trois ans, que c’est aussi long pour moi que pour vous. Ne dites donc pas que vous me contez trop de petites choses, que vous me donnez trop de détails. Jamais assez. Au milieu du grand bonheur, c’est mon petit, mais très vif plaisir de vous suivre pas à pas dans tout le cours de la journée, d’assister à toutes vos actions, d’heure en heure. Il y en a une que je regrette, qui m’a un peu désagréablement ému le cœur. Vendredi soir vous avez fait de la musique devant votre monde ; et moi, je ne vous ai pas encore entendue. Je ne veux pas, la première fois, vous entendre devant du monde ; mais je voulais avoir votre première musique, à moi seul. Vous ne savez pas à quel point la musique me plaît, m’émeut. Mais c’est pour moi une impression très intime, et qui se lie tout de suite à mes impressions les plus intimes, une de ces impressions dont je n’aime pas à parler excepté à la personne à qui je parle de tout. Je vous aurais si délicieusement écoutée !
J’attends ce matin, M. de Saint-Priest, Alexis, qui vient passer ici 24 heures. Il m’en dira long sur Lisbonne, les Chartistes, Lord Howard de Walden, Saldanha, Sä de Bandeira & & J’ai recommencé hier au soir à lire à mes enfants un romans de Walter Scott. Je vous le dis pour vous montrer que j’ai complètement repris l’usage de ma gorge. Je suis ravi que vous ayez aussi bien retrouvé celui de vos jambes, Certainement c’est une preuve de force.
11 heures Le N° 47 me désole de mille façons, toutes si douloureuses. M. de L., votre chagrin, votre manque de foi, votre santé. Mes lettres suivantes vous auront été un peu meilleures. Celle-ci vous donne une certitude, de voyage, de jour. Si vous saviez que je n’ai pas pensé, que je ne pense pas à autre chose. Croyez-vous donc que je n’ai pas pensé à emmener ma mère à Paris ? Mais elle est mieux et se trouve bien ici. Je vous répondrai demain avec détail. Adieu. Adieu. Soignez-vous, je vous en conjure. Adieu. G.
48. Paris, Lundi 25 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
48. Lundi le 25 Septembre
10 heures
Je l’ai parfaitement prévu, pensé sans vous le dire, que les amis s’inquiéteraient, & vous tourmenteraient encore plus que les ennemis. Vous ne m’apprenez, donc rien de nouveau. J’avais l’instinct de cela de mille autres choses quand je vous disais, il y a trois semaines je crois que notre bon temps était passé. Soyez en sûr ces huit jours de parfaite liberté ne peuvent plus renaître. Mais que de tristes réflexions à faire pour moi ! Savez-vous bien où tout cela peut mener ? Nous ne sommes qu’au début de tracasseries interminables, et croyez-vous que l’Empereur permette, puisse permettre que mon nom se trouve mêlé à des intrigues françaises puis-je m’y exposer moi-même quel air cela a-t-il ?
Dans mon pays Monsieur je suis une très grande dame, la première dame par mon rang, par ma place au Palais et plus encore, parce que je suis la seule dame de l’Empire qui soit comptée comme vivant dans la familiarité de l’Emp. & de l’Impératrice. J’appartiens à la famille voilà ma position sociale à Pétersbourg, et voilà pourquoi la colère de l’Empereur est si grande de voir le pays de révolution honoré de ma présence. Monsieur ne riez pas quoique j’en ai grande envie, c’est du grand sérieux. Avec des idées pareilles imaginez ce qu’il va dire quand lui arriveront les commérages, les petits journaux, les grands peut-être, que sais-je, des tracasseries politiques, et vous Monsieur emmènerez-vous un auditoire pour voir, entendre, ce qui se fait, ce qui se dit dans mon cabinet vert ? Persuaderez-vous des amis méfiants, des ennemies acharnés ? Vous me faites sortir Monsieur d’une position qui était devenue bonne qui serait devenue meilleure. Je suis toujours restée au courant des affaires de l’Europe.
Je n’ai jamais connu les intrigues de partis en France que pour en rire. Je n’ai pas pris plus d’intérêt à un homme politique qu’à un autre. Voilà ce qui était bien, ce qui faisait pour moi, de ce qui se passe ici, un spectacle animé curieux mais rien qu’un spectacle dont je jouissais avec ma petite société en pleine innocence, & pleine insouciance. Déjà cette position commence à s’altérer, je le vois à la mine de la petite diplomatie de petite espèces. Elle est encore un peu ahurie, et je ne manque aucune occasion de la dérouter. Je poursuivais dans cette intention mais cela me réussira-t-il ? Je vous ai montré pour mon compte le très mauvais côté de ma position actuelle. J’ai été chercher le pire parce qu’en fait de mal, j’aime à échapper aux surprises, je veux vous dire cependant que je ne m’agite pas, je ne m’inquiète pas plus qu’il en faut. Je compte un peu sur mon savoir-faire, infiniment sur mon innocence. Nous verrons comment cela pourra aller.
Mais arrivons enfin à ce qui nous importe à nous. Quand vous reverrai- je? Je vous ai écrit une triste lettre hier, n’était-elle pas même un peu brutale Je me sais jamais ce que j’ai écrit, mais j’ai toujours souvenance de l’impression sous laquelle j’ai écrit. Cette impression était bien mauvaise. Elle n’est guère meilleure aujourd’hui. J’ai un chagrin profond. Vous ne sauriez croire tout ce que j’essaye pour me distraire. Ne vous fâchez pas je cherche à me distraire de vous car lorsque je me livre à vous dans ma pensée je me sens toujours prête à fondre en larmes. Je me puis pas vivre comme cela, je ne puis pas me bien porter, vous voulez que je me porte bien. Mais que faire, qu’imaginer ?
Je lis un peu. Je me promène plus longtemps que de coutume. Le soir je quitte ma place, je fais de la musique je dis des bêtises. Enfin je ne me ressemble pas. Hier au soir si vous étiez entré vous ne vous seriez pas reconnu chez moi. Marie occupant mon coin, ce coin encombré de gravures, et garni, par M. Caraffa, dont les yeux noirs trouvent, les yeux bleus de Marie fort beaux. M. Durazzo M. Henage je ne sais quel jeune anglais encore. Moi au piano avec toute la Sardaigne qui chantait on me rappelait des morceaux de Bellini, Adair quelques autres je ne sais plus qui. Le piano est devant une glace. J’y voyais la porte, & je me suis dit vingt fois, cent fois " S’il entrait ! " Et je voyais dans la glace que mes yeux prenaient une autre expression.
En vérité Monsieur je ne conçois pas comment je pourrai aller longtemps comme cela et je frissonne en vous disant cela. Madame de Castellane est venue chez moi hier matin, et en m’attendant nullement à l’objet de cette visite ; elle m’a fort adroitement amenée à ne pas pouvoir lui refuser d’aller dîner chez elle un jour. Cela ne me plait pas cependant. J’ai choisi jeudi. Pendant qu’elle était là je reçu un billet de M. Molé. Un billet de phrases galantes, qui ne demandait pas de réponse. Tout cela veut-il couvrir les pêchés passés, ou servir de masque à de nouveaux ? Ah, j’ai le Temps sur le cœur.
2 heures. Je viens d’écrire une bonne et forte lettre à M. de Lieven. Je crois que vous en sériez très content. Je ne comprends pas ce qu’il pourra y répondre. Mon fils qui est auprès de lui me mande qu’il est comme fou sur le chapitre de mon séjour ici, et qu’il n’y a pas moyen de placer un mot en ma faveur. C’est une vraie démence. Que de tracas de tous les côtés, que des images qui s’amoncellent ! Et les compensations en bonheur que j’ai trouvées, que le ciel a mis sur ma route quand reluira-t-il pour moi ?
M. de Broglie va revenir pour les couches de sa fille. Cela ne peut-il pas faire un petit prétexte ! Mais par dessus tout la santé de votre mère ? L’air n’est-il pas plus froid en Normandie ? Les cheminées ferment ici elle serait mieux. Pourquoi ne pas établir d’avance qu’il faut rentrer plutôt en ville. Vous n’avez pas d’habitudes sur ce chapitre, car vous n’êtes établi chez vous à la campagne que depuis cette année. Et mon dieu que me sert de vous fournir toutes ces raisons, si elles ne vous viennent pas à l’esprit, si elles ne vous viennent pas au cœur (Oh la mauvaise parole).
Je ne pense pas ce que je vous dis, mais permettez-moi d’être triste, extrêmement triste, & de le rester tant que vous ne m’aurez pas fourni une date. Le 25 aujourd’hui m’a fait mal. J’y avais tant compté. Ce salon ce cabinet que je regardais avec tant de complaisance en pensant au 25, auxquels je trouvais un air si gai, si charmant, il me font un effet désagréable aujour’’hui en y entrant j’avais envie de fermer les yeux. Demain je dîne chez Pozzo, j’avais dit d’avance que je ne serais pas chez moi le soir. Je pensais que le 26 vous en revenant de la noce & moi du dîner nous passerions notre soirée dans mon cabinet ; que vous prendriez du thé à la petite table. Je pensais à de si jolies pensées. Cela fait mal aujourd’hui. Adieu Monsieur, adieu, comme toujours plus que jamais adieu.
10 heures
Je l’ai parfaitement prévu, pensé sans vous le dire, que les amis s’inquiéteraient, & vous tourmenteraient encore plus que les ennemis. Vous ne m’apprenez, donc rien de nouveau. J’avais l’instinct de cela de mille autres choses quand je vous disais, il y a trois semaines je crois que notre bon temps était passé. Soyez en sûr ces huit jours de parfaite liberté ne peuvent plus renaître. Mais que de tristes réflexions à faire pour moi ! Savez-vous bien où tout cela peut mener ? Nous ne sommes qu’au début de tracasseries interminables, et croyez-vous que l’Empereur permette, puisse permettre que mon nom se trouve mêlé à des intrigues françaises puis-je m’y exposer moi-même quel air cela a-t-il ?
Dans mon pays Monsieur je suis une très grande dame, la première dame par mon rang, par ma place au Palais et plus encore, parce que je suis la seule dame de l’Empire qui soit comptée comme vivant dans la familiarité de l’Emp. & de l’Impératrice. J’appartiens à la famille voilà ma position sociale à Pétersbourg, et voilà pourquoi la colère de l’Empereur est si grande de voir le pays de révolution honoré de ma présence. Monsieur ne riez pas quoique j’en ai grande envie, c’est du grand sérieux. Avec des idées pareilles imaginez ce qu’il va dire quand lui arriveront les commérages, les petits journaux, les grands peut-être, que sais-je, des tracasseries politiques, et vous Monsieur emmènerez-vous un auditoire pour voir, entendre, ce qui se fait, ce qui se dit dans mon cabinet vert ? Persuaderez-vous des amis méfiants, des ennemies acharnés ? Vous me faites sortir Monsieur d’une position qui était devenue bonne qui serait devenue meilleure. Je suis toujours restée au courant des affaires de l’Europe.
Je n’ai jamais connu les intrigues de partis en France que pour en rire. Je n’ai pas pris plus d’intérêt à un homme politique qu’à un autre. Voilà ce qui était bien, ce qui faisait pour moi, de ce qui se passe ici, un spectacle animé curieux mais rien qu’un spectacle dont je jouissais avec ma petite société en pleine innocence, & pleine insouciance. Déjà cette position commence à s’altérer, je le vois à la mine de la petite diplomatie de petite espèces. Elle est encore un peu ahurie, et je ne manque aucune occasion de la dérouter. Je poursuivais dans cette intention mais cela me réussira-t-il ? Je vous ai montré pour mon compte le très mauvais côté de ma position actuelle. J’ai été chercher le pire parce qu’en fait de mal, j’aime à échapper aux surprises, je veux vous dire cependant que je ne m’agite pas, je ne m’inquiète pas plus qu’il en faut. Je compte un peu sur mon savoir-faire, infiniment sur mon innocence. Nous verrons comment cela pourra aller.
Mais arrivons enfin à ce qui nous importe à nous. Quand vous reverrai- je? Je vous ai écrit une triste lettre hier, n’était-elle pas même un peu brutale Je me sais jamais ce que j’ai écrit, mais j’ai toujours souvenance de l’impression sous laquelle j’ai écrit. Cette impression était bien mauvaise. Elle n’est guère meilleure aujourd’hui. J’ai un chagrin profond. Vous ne sauriez croire tout ce que j’essaye pour me distraire. Ne vous fâchez pas je cherche à me distraire de vous car lorsque je me livre à vous dans ma pensée je me sens toujours prête à fondre en larmes. Je me puis pas vivre comme cela, je ne puis pas me bien porter, vous voulez que je me porte bien. Mais que faire, qu’imaginer ?
Je lis un peu. Je me promène plus longtemps que de coutume. Le soir je quitte ma place, je fais de la musique je dis des bêtises. Enfin je ne me ressemble pas. Hier au soir si vous étiez entré vous ne vous seriez pas reconnu chez moi. Marie occupant mon coin, ce coin encombré de gravures, et garni, par M. Caraffa, dont les yeux noirs trouvent, les yeux bleus de Marie fort beaux. M. Durazzo M. Henage je ne sais quel jeune anglais encore. Moi au piano avec toute la Sardaigne qui chantait on me rappelait des morceaux de Bellini, Adair quelques autres je ne sais plus qui. Le piano est devant une glace. J’y voyais la porte, & je me suis dit vingt fois, cent fois " S’il entrait ! " Et je voyais dans la glace que mes yeux prenaient une autre expression.
En vérité Monsieur je ne conçois pas comment je pourrai aller longtemps comme cela et je frissonne en vous disant cela. Madame de Castellane est venue chez moi hier matin, et en m’attendant nullement à l’objet de cette visite ; elle m’a fort adroitement amenée à ne pas pouvoir lui refuser d’aller dîner chez elle un jour. Cela ne me plait pas cependant. J’ai choisi jeudi. Pendant qu’elle était là je reçu un billet de M. Molé. Un billet de phrases galantes, qui ne demandait pas de réponse. Tout cela veut-il couvrir les pêchés passés, ou servir de masque à de nouveaux ? Ah, j’ai le Temps sur le cœur.
2 heures. Je viens d’écrire une bonne et forte lettre à M. de Lieven. Je crois que vous en sériez très content. Je ne comprends pas ce qu’il pourra y répondre. Mon fils qui est auprès de lui me mande qu’il est comme fou sur le chapitre de mon séjour ici, et qu’il n’y a pas moyen de placer un mot en ma faveur. C’est une vraie démence. Que de tracas de tous les côtés, que des images qui s’amoncellent ! Et les compensations en bonheur que j’ai trouvées, que le ciel a mis sur ma route quand reluira-t-il pour moi ?
M. de Broglie va revenir pour les couches de sa fille. Cela ne peut-il pas faire un petit prétexte ! Mais par dessus tout la santé de votre mère ? L’air n’est-il pas plus froid en Normandie ? Les cheminées ferment ici elle serait mieux. Pourquoi ne pas établir d’avance qu’il faut rentrer plutôt en ville. Vous n’avez pas d’habitudes sur ce chapitre, car vous n’êtes établi chez vous à la campagne que depuis cette année. Et mon dieu que me sert de vous fournir toutes ces raisons, si elles ne vous viennent pas à l’esprit, si elles ne vous viennent pas au cœur (Oh la mauvaise parole).
Je ne pense pas ce que je vous dis, mais permettez-moi d’être triste, extrêmement triste, & de le rester tant que vous ne m’aurez pas fourni une date. Le 25 aujourd’hui m’a fait mal. J’y avais tant compté. Ce salon ce cabinet que je regardais avec tant de complaisance en pensant au 25, auxquels je trouvais un air si gai, si charmant, il me font un effet désagréable aujour’’hui en y entrant j’avais envie de fermer les yeux. Demain je dîne chez Pozzo, j’avais dit d’avance que je ne serais pas chez moi le soir. Je pensais que le 26 vous en revenant de la noce & moi du dîner nous passerions notre soirée dans mon cabinet ; que vous prendriez du thé à la petite table. Je pensais à de si jolies pensées. Cela fait mal aujourd’hui. Adieu Monsieur, adieu, comme toujours plus que jamais adieu.
47. Val-Richer, Lundi 25 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°47 Lundi, 5 heures
J’ai besoin de vous parler. Vous n’êtes pas là. Vous ne m’entendez pas. Ce que je vous dis n’ira à vous que dans deux jours. Mais j’ai besoin de vous parler. Vous avez eu un tel accès de désespoir ! Pardon dearest, pardon ; ma première impression n’a pas été toute pour vous, pour vous seule. Je vous ai vue désolée, sanglotant. J’ai été navré. Mais au même instant un mouvement de tristesse toute personnelle s’est élevé en moi. Quoi ? Je ne suis pas encore parvenu à vous donner plus de confiance dans ma tendresse ! Ma tendresse n’a pas sur vous plus de pouvoir ! Vous ne savez pas tout ce que vous êtes pour moi, tout ce que j’ai dans le cœur pour vous. Mais moi je le sais ; je le sens. Quelque fois encore, je m’en étonne ; je me demande si c’est bien vrai. Et ce que je me réponds à moi-même, je vous l’ai dit ; je vous le redis tous les jours. Moi aussi, Madame, j’avais enfermé mon âme dans un tombeau. Vous l’en avez fait sortir. Vous l’avez appelée, et elle est venue à vous ; elle a ressuscité devant vous. Quelle marque d’affection peut égaler celle-là ? Savez-vous quel bonheur j’avais possédé, j’avais perdu ? Savez-vous que si l’on m’eût dit : - Il y a sur la terre une créature, qui peut vous rendre une heure de ce bonheur - j’aurais souri, avec le plus incrédule dédain ? Et que, si l’on m’eût dit aussi : - cherchez dans le monde entier une épingle perdue, si vous la trouvez, vous retrouverez une heure de votre bonheur je serais parti, à l’instant même ; j’aurais cherché toute ma vie pour courir après cette imperceptible chance ? Voilà où j’en étais Madame, avant le 15 Juin. Voilà quel chemin j’ai eu à faire pour arriver à vous, pour vous dire ce que je vous dis aujourd’hui. Est-ce assez pour que j’aie sur vous la puissance d’écarter le désespoir, d’arrêter les sanglots ? Est-ce assez pour que vous ayez foi, en moi ? Et vous croyez que je ne supporterais pas vos sanglots !
Je supporterais tout, tout, Madame pour combattre, pour adoucir un moment votre peine. J’ai bien supporté de voir mourir, mourir lentement les créatures que j’aimais le mieux au monde ; je n’ai pas cessé un instant de les regarder, de leur parler pour que le sentiment de ma tendresse se mêlât à leur angoisse, à leur dernier souffle et qu’elles l’emportassent en me quittant. Et ce qui m’a donné, ce qui je crois me donnerait encore ce courage, c’est que j’ai, de la puissance d’une affection vraie et des souveraines douceurs qui y sont attachées, une si haute idée qu’il me semble que le plus grand bien qu’on puisse faire à une créature désolée à une créature qui souffre, c’est de lui répéter sans cesse. Je l’aime ! Je l’aime ! Pour moi, je ne connais point de douleurs que ces mots d’une bouche chérie n’aient la vertu de calmer.
Mardi 7 h. 1/2 Je ne comprends guère comment, dès le 5 sept., aucun commérage aurait pu parvenir à Carlsbad. Il faudrait qu’on sy fût pris de bien bonne heure. Du reste, je crois à beaucoup de malice et de trahison possible. Les passages que vous me transcrivez me tourmentent beaucoup. Il faut attendre l’effet du comte Orloff. C’est sur cela que vous comptez, que nous comptons une chose me déplaît extrêmement dans tout ceci, c’est de ne pouvoir me faire une idée du pays,des mœurs, de l’état social, des caractères qui le rendent possible. Je me rappelle l’indignation où nous étions de ce que l’Empereur Napoléon ne voulait pas souffrir que Mad. de Stael habitât Paris. Et pourtant quelle différence ! Il y avait pour lui un motif, un motif, sérieux.
La conversation, le salon de Madame de Stael auraient été pour lui un véritable embarras. Mais ici, quel intérêt peut-on avoir à vous faire sortir de France ? Quel inconvénient entraîne votre séjour ? Une pure fantaisie. Cela déplaît. Vous ne faites pas tout ce qui plait. Quel misérable et terrible enfantillage ! J’ai bien envie de crier : vive la Charte !
Je reviens à M. de Lieven. Que lui répondez-vous ? Vous avez, avec lui, comme avec l’Empereur, comme avec tout votre monde, une situation faite, déterminée. Vous vous y êtes bien positivement établie et dans vos entretiens de Londres avec le comte Orloff et dans les lettres à lui et à M. de Lieven que vous m’avez montrées. Vous devez, ce me semble vous y maintenir tout simplement. Les hésitations, les agitations, même purement apparentes de langage seulement rendent tout beaucoup plus difficile. Une résolution simple. claire, clairement exprimée et tranquillement maintenue, coupe court à beaucoup d’embarras, non seulement au fond, mais dans la forme. Car je ne mets pas le fond en doute ; c’est de la forme et des embarras extérieurs qu’il s’agit. C’est à cela qu’il faut pourvoir. Nous en causerons bien complètement le 6 octobre. J’attends de jour en jour l’ordonnance de dissolution.
Ma mère est beaucoup mieux. A moins de nouvel accident, je ne puis penser à lui proposer de revenir plutôt à Paris. Elle se trouve bien ici. Ma mère est à l’age où l’on a un égal besoin de distraction et de repos. La campagne lui donne l’un et l’autre. Il y a une foule de petits intérêts, de petits soins qui l’amusent; et l’égalité de la vie, le silence de l’atmosphère, la paix de tous les aspects qui l’environnent lui assurent cette espèce de quiétude morale qui dépend, pour les vieillards des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés. Si l’indisposition de ma mère reparaissait un peu sérieusement je n’hésiterais cependant pas à la ramener tout de suite à Paris. Mais comme elle en serait, fort contrariée, il y faut une vraie nécessité.
11 heures Voilà le N° 48. Qu’il est triste et si bon, si doux ! Je me console un peu en pensant que vous serez, que vous êtes déjà, un peu consolée. Vous avez une date. Nous avons une date. Il y a encore dans ce n°48, une bien mauvaise, une bien coupable parole. Je n’y reviens pas aujourd’hui. Mais j’y reviendrai. Dearest, ne me mettez rien sur le cœur. Il y a tant de choses dedans ! et toutes pour vous ! Adieu. Adieu. Adieu me plaît, mais ne me suffit pas. G.
J’ai besoin de vous parler. Vous n’êtes pas là. Vous ne m’entendez pas. Ce que je vous dis n’ira à vous que dans deux jours. Mais j’ai besoin de vous parler. Vous avez eu un tel accès de désespoir ! Pardon dearest, pardon ; ma première impression n’a pas été toute pour vous, pour vous seule. Je vous ai vue désolée, sanglotant. J’ai été navré. Mais au même instant un mouvement de tristesse toute personnelle s’est élevé en moi. Quoi ? Je ne suis pas encore parvenu à vous donner plus de confiance dans ma tendresse ! Ma tendresse n’a pas sur vous plus de pouvoir ! Vous ne savez pas tout ce que vous êtes pour moi, tout ce que j’ai dans le cœur pour vous. Mais moi je le sais ; je le sens. Quelque fois encore, je m’en étonne ; je me demande si c’est bien vrai. Et ce que je me réponds à moi-même, je vous l’ai dit ; je vous le redis tous les jours. Moi aussi, Madame, j’avais enfermé mon âme dans un tombeau. Vous l’en avez fait sortir. Vous l’avez appelée, et elle est venue à vous ; elle a ressuscité devant vous. Quelle marque d’affection peut égaler celle-là ? Savez-vous quel bonheur j’avais possédé, j’avais perdu ? Savez-vous que si l’on m’eût dit : - Il y a sur la terre une créature, qui peut vous rendre une heure de ce bonheur - j’aurais souri, avec le plus incrédule dédain ? Et que, si l’on m’eût dit aussi : - cherchez dans le monde entier une épingle perdue, si vous la trouvez, vous retrouverez une heure de votre bonheur je serais parti, à l’instant même ; j’aurais cherché toute ma vie pour courir après cette imperceptible chance ? Voilà où j’en étais Madame, avant le 15 Juin. Voilà quel chemin j’ai eu à faire pour arriver à vous, pour vous dire ce que je vous dis aujourd’hui. Est-ce assez pour que j’aie sur vous la puissance d’écarter le désespoir, d’arrêter les sanglots ? Est-ce assez pour que vous ayez foi, en moi ? Et vous croyez que je ne supporterais pas vos sanglots !
Je supporterais tout, tout, Madame pour combattre, pour adoucir un moment votre peine. J’ai bien supporté de voir mourir, mourir lentement les créatures que j’aimais le mieux au monde ; je n’ai pas cessé un instant de les regarder, de leur parler pour que le sentiment de ma tendresse se mêlât à leur angoisse, à leur dernier souffle et qu’elles l’emportassent en me quittant. Et ce qui m’a donné, ce qui je crois me donnerait encore ce courage, c’est que j’ai, de la puissance d’une affection vraie et des souveraines douceurs qui y sont attachées, une si haute idée qu’il me semble que le plus grand bien qu’on puisse faire à une créature désolée à une créature qui souffre, c’est de lui répéter sans cesse. Je l’aime ! Je l’aime ! Pour moi, je ne connais point de douleurs que ces mots d’une bouche chérie n’aient la vertu de calmer.
Mardi 7 h. 1/2 Je ne comprends guère comment, dès le 5 sept., aucun commérage aurait pu parvenir à Carlsbad. Il faudrait qu’on sy fût pris de bien bonne heure. Du reste, je crois à beaucoup de malice et de trahison possible. Les passages que vous me transcrivez me tourmentent beaucoup. Il faut attendre l’effet du comte Orloff. C’est sur cela que vous comptez, que nous comptons une chose me déplaît extrêmement dans tout ceci, c’est de ne pouvoir me faire une idée du pays,des mœurs, de l’état social, des caractères qui le rendent possible. Je me rappelle l’indignation où nous étions de ce que l’Empereur Napoléon ne voulait pas souffrir que Mad. de Stael habitât Paris. Et pourtant quelle différence ! Il y avait pour lui un motif, un motif, sérieux.
La conversation, le salon de Madame de Stael auraient été pour lui un véritable embarras. Mais ici, quel intérêt peut-on avoir à vous faire sortir de France ? Quel inconvénient entraîne votre séjour ? Une pure fantaisie. Cela déplaît. Vous ne faites pas tout ce qui plait. Quel misérable et terrible enfantillage ! J’ai bien envie de crier : vive la Charte !
Je reviens à M. de Lieven. Que lui répondez-vous ? Vous avez, avec lui, comme avec l’Empereur, comme avec tout votre monde, une situation faite, déterminée. Vous vous y êtes bien positivement établie et dans vos entretiens de Londres avec le comte Orloff et dans les lettres à lui et à M. de Lieven que vous m’avez montrées. Vous devez, ce me semble vous y maintenir tout simplement. Les hésitations, les agitations, même purement apparentes de langage seulement rendent tout beaucoup plus difficile. Une résolution simple. claire, clairement exprimée et tranquillement maintenue, coupe court à beaucoup d’embarras, non seulement au fond, mais dans la forme. Car je ne mets pas le fond en doute ; c’est de la forme et des embarras extérieurs qu’il s’agit. C’est à cela qu’il faut pourvoir. Nous en causerons bien complètement le 6 octobre. J’attends de jour en jour l’ordonnance de dissolution.
Ma mère est beaucoup mieux. A moins de nouvel accident, je ne puis penser à lui proposer de revenir plutôt à Paris. Elle se trouve bien ici. Ma mère est à l’age où l’on a un égal besoin de distraction et de repos. La campagne lui donne l’un et l’autre. Il y a une foule de petits intérêts, de petits soins qui l’amusent; et l’égalité de la vie, le silence de l’atmosphère, la paix de tous les aspects qui l’environnent lui assurent cette espèce de quiétude morale qui dépend, pour les vieillards des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés. Si l’indisposition de ma mère reparaissait un peu sérieusement je n’hésiterais cependant pas à la ramener tout de suite à Paris. Mais comme elle en serait, fort contrariée, il y faut une vraie nécessité.
11 heures Voilà le N° 48. Qu’il est triste et si bon, si doux ! Je me console un peu en pensant que vous serez, que vous êtes déjà, un peu consolée. Vous avez une date. Nous avons une date. Il y a encore dans ce n°48, une bien mauvaise, une bien coupable parole. Je n’y reviens pas aujourd’hui. Mais j’y reviendrai. Dearest, ne me mettez rien sur le cœur. Il y a tant de choses dedans ! et toutes pour vous ! Adieu. Adieu. Adieu me plaît, mais ne me suffit pas. G.
49. Paris, Mardi 26 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
49. Mardi 9 heures le 26 septembre
Mon Dieu que vous avez raison lorsque vous me dites " Vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies." Que vous avez raison encore quand vous attribuez bien ma méfiance à cette triste habitude de n’avoir jamais trouvé de vrai dévouement. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup de m’expliquer si naturellement cette injustice dans mon caractère. Ce défaut n’était pas dans mon cœur, il y est venu par l’expérience mais Monsieur, cette découverte c’est vous qui me la faites faire ce matin par votre lettre. Je voudrais bien vous dire, vous prouver tout ce que je vous en porte de reconnaissance. Eh bien, je vous entends d’ici vous ne voulez une preuve une seule. Vous l’aurez. Je veux croire croire, tout ce qui me vient de vous, croire en vous, ne croire qu’en vous. Ah si vous saviez comme ces élans de mon âme sont sincères, comme cette promesse vient du fond de mon cœur vous m’aimeriez dans ce moment si vous étiez auprès de moi.
Je suis triste de penser que mes deux dernières lettres vous auront donné de l’humeur, et j’ouvrirai la vôtre demain avec un peu de crainte. J’ai peur de vous Monsieur, oui j’ai peur, quand je sens que j’ai pu vous déplaire, que je vous ai montré de l’impatience, de l’injustice. Pardonnez-moi, pardonnez moi, je vous en prie. Regardez au fond de tout cela, pardonnez-moi la forme. Vous verrez comme bientôt vous n’aurez plus rien à me pardonner & vous serez joyeux de votre ouvrage. Je relis votre lettre & j’y trouve bien quelque chose à redire. En parlant des soucis qui pèsent sur les hommes, de leurs devoirs de tous genres, vous ajoutez : " Si leur situation était un peu abaissée, leur considération tant soit peu diminuée, ils perdraient un peu, beaucoup peut être dans la pensée, dans l’imagination, & quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus." De qui parlez-vous là Monsieur, il n’est pas possible que vous ayez pensé à moi en écrivant cela. J’aime votre gloire, parce que vous l’aimez, j’aime tout ce que vous aimez, mais pour moi pour ma satisfaction ? Ah c’est votre cœur seul qu’il me faut. Vous, un cottage. Vous, toujours, sans cesse, sans autre intérêt sans autre distraction pour vous, comme pour moi. Voilà Monsieur comme aime une femme. Mais vous n’êtes pas femme, vous ne comprenez pas. Je vous demande seulement de ne pas mépriser ce que vous ne comprenez pas.Dans ce moment Monsieur je me sens plus haut que vous.
Me voila donc attendant celle dissolution avec une impatience ! Je crains d’y montrer trop d’intérêt. Hier soir j’ai demandé quand elle aurait lieu. J’ai essayé de donner à mon accent toute l’indifférence possible, je crains que cela ne m’ait pas beaucoup réussi. M. Molé était chez moi, il m’a dit : " ni tout de suite, ni très tard. Un juste milieu." cela ne m’a pas beaucoup avancé. J’ai été un moment seule avec lui, il est venu de bonne heure. Il est plein de recherches, de manières gracieuses. Il va à Compiègne demain. Il veut que je remette à lundi le dîner chez Mad. de Castellane afin qu’il puisse en être. Tout cela ne me plaît pas trop, & il m’est difficile de m’en tirer. L’article du Journal des Débats hier lui a paru être écrit tout à fait dans votre intérêt.
M. de Pahlen, Pozzo, M. de Boigne, Mad. Durazzo et le prince Schenberg passèrent la soirée chez moi. Je la finis tête-à-tête avec Pahlen, c’est toujours de mon mari que nous parlons ensemble, & quoique ce soit triste nous avons fini par rire. J’ai eu une lettre de M. Thiers ce matin de Cauterets encore. Il s’ennuie. Le 1er octobre il le quitte avec sa famille. Ils iront passer quelques jours chez M. de Cases ou chez M. de Talleyrand, et puis il va établir sa famille à Lille & lui-même veut aller en Hollande. Il passera par Paris peut-être, il n’en est pas sûr mais s’il y passe je le verrai.
On m’écrit de Valençay que la visite de M. Salvandy a eu pour objet de faire comprendre que M. de Valençay ne pouvait pas être fait pair à la prochaine nomination. Cela a donné beaucoup d’humeur. Je veux tout de suite avoir expédié toutes mes petites nouvelles. M. de Hugel est fou. Je m’en étais aperçu un peu ; vous ne sauriez croire l’instinct & que j’ai pour cela, & hier au soir M. Molé m’a dit avant que je lui en parlasse qu’il le croyait dérangé. Il vient chez lui à huit heures du matin tous les jours, les larmes aux yeux, lui découvrir une nouvelle conspiration.
Je reviens à vous. Il est dix heures & demi, vous recevez ma lettre ; encore une mauvaise lettre, je suis en grande colère contre moi-même et vous êtes si doux pour moi, si doux, si bon ! Mais, Monsieur l’absence ne vous vaut rien. Vous faites tant de mauvaises découvertes sur mon compte ! Si cela dure encore vous finirez par trouver que vous avez fait un bien mauvais marché, venez prendre tranquille possession de votre bien, & vous penserez autrement. Je suis bien aise des bonnes nouvelles de votre mère & de vos enfants ; mais vraiment établissez les ici, vous serez moins inquiet pour votre mère ; est- ce que vous ne trouvez donc pas cela vous même.
Ce n’est plus de moi que je parle. Je dîne aujourd’hui chez Pozzo. J’irai embrasser Lady Granville avant de m’y rendre. Ils arrivent ce matin, c’est un grand plaisir pour moi. 1 heure M. l’officier de la légion d’honneur est venu m’interrompre ; après lui mon énorme toilette, maintenant je vais faire ma première promenade. Ah ! si je pouvais aller vers vous au lieu de cette lettre ! Si tout à coup je me trouvais dans ce cabinet que vous fermez à clé ! Monsieur, je vais dire mille bêtises. Faites-moi taire. Vous me promettez de me nommer un jour dans la lettre que je reverrai demain ou après-demain. Mais sur cela vous seront arrivées mes mauvaises lettres, vous vous serez fâché, vous n’aurez plus en envie de me donner le moindre plaisir. Monsieur je crois que je me trompe encore, vous aurez eu pitié de moi, vous m’aurez plainte, mais vous ne m’aurez pas punie. Demain à 10 h 1/2, je me dirai que vous n’êtes plus fâché, que vous m’aimez encore, toujours, oui toujours, toujours.
Ah ! Que d’adieux, je vous adresse en répétant un mot toujours. C’est celui-ci qui est le bon aujourd’hui toujours.
Mon Dieu que vous avez raison lorsque vous me dites " Vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies." Que vous avez raison encore quand vous attribuez bien ma méfiance à cette triste habitude de n’avoir jamais trouvé de vrai dévouement. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup de m’expliquer si naturellement cette injustice dans mon caractère. Ce défaut n’était pas dans mon cœur, il y est venu par l’expérience mais Monsieur, cette découverte c’est vous qui me la faites faire ce matin par votre lettre. Je voudrais bien vous dire, vous prouver tout ce que je vous en porte de reconnaissance. Eh bien, je vous entends d’ici vous ne voulez une preuve une seule. Vous l’aurez. Je veux croire croire, tout ce qui me vient de vous, croire en vous, ne croire qu’en vous. Ah si vous saviez comme ces élans de mon âme sont sincères, comme cette promesse vient du fond de mon cœur vous m’aimeriez dans ce moment si vous étiez auprès de moi.
Je suis triste de penser que mes deux dernières lettres vous auront donné de l’humeur, et j’ouvrirai la vôtre demain avec un peu de crainte. J’ai peur de vous Monsieur, oui j’ai peur, quand je sens que j’ai pu vous déplaire, que je vous ai montré de l’impatience, de l’injustice. Pardonnez-moi, pardonnez moi, je vous en prie. Regardez au fond de tout cela, pardonnez-moi la forme. Vous verrez comme bientôt vous n’aurez plus rien à me pardonner & vous serez joyeux de votre ouvrage. Je relis votre lettre & j’y trouve bien quelque chose à redire. En parlant des soucis qui pèsent sur les hommes, de leurs devoirs de tous genres, vous ajoutez : " Si leur situation était un peu abaissée, leur considération tant soit peu diminuée, ils perdraient un peu, beaucoup peut être dans la pensée, dans l’imagination, & quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus." De qui parlez-vous là Monsieur, il n’est pas possible que vous ayez pensé à moi en écrivant cela. J’aime votre gloire, parce que vous l’aimez, j’aime tout ce que vous aimez, mais pour moi pour ma satisfaction ? Ah c’est votre cœur seul qu’il me faut. Vous, un cottage. Vous, toujours, sans cesse, sans autre intérêt sans autre distraction pour vous, comme pour moi. Voilà Monsieur comme aime une femme. Mais vous n’êtes pas femme, vous ne comprenez pas. Je vous demande seulement de ne pas mépriser ce que vous ne comprenez pas.Dans ce moment Monsieur je me sens plus haut que vous.
Me voila donc attendant celle dissolution avec une impatience ! Je crains d’y montrer trop d’intérêt. Hier soir j’ai demandé quand elle aurait lieu. J’ai essayé de donner à mon accent toute l’indifférence possible, je crains que cela ne m’ait pas beaucoup réussi. M. Molé était chez moi, il m’a dit : " ni tout de suite, ni très tard. Un juste milieu." cela ne m’a pas beaucoup avancé. J’ai été un moment seule avec lui, il est venu de bonne heure. Il est plein de recherches, de manières gracieuses. Il va à Compiègne demain. Il veut que je remette à lundi le dîner chez Mad. de Castellane afin qu’il puisse en être. Tout cela ne me plaît pas trop, & il m’est difficile de m’en tirer. L’article du Journal des Débats hier lui a paru être écrit tout à fait dans votre intérêt.
M. de Pahlen, Pozzo, M. de Boigne, Mad. Durazzo et le prince Schenberg passèrent la soirée chez moi. Je la finis tête-à-tête avec Pahlen, c’est toujours de mon mari que nous parlons ensemble, & quoique ce soit triste nous avons fini par rire. J’ai eu une lettre de M. Thiers ce matin de Cauterets encore. Il s’ennuie. Le 1er octobre il le quitte avec sa famille. Ils iront passer quelques jours chez M. de Cases ou chez M. de Talleyrand, et puis il va établir sa famille à Lille & lui-même veut aller en Hollande. Il passera par Paris peut-être, il n’en est pas sûr mais s’il y passe je le verrai.
On m’écrit de Valençay que la visite de M. Salvandy a eu pour objet de faire comprendre que M. de Valençay ne pouvait pas être fait pair à la prochaine nomination. Cela a donné beaucoup d’humeur. Je veux tout de suite avoir expédié toutes mes petites nouvelles. M. de Hugel est fou. Je m’en étais aperçu un peu ; vous ne sauriez croire l’instinct & que j’ai pour cela, & hier au soir M. Molé m’a dit avant que je lui en parlasse qu’il le croyait dérangé. Il vient chez lui à huit heures du matin tous les jours, les larmes aux yeux, lui découvrir une nouvelle conspiration.
Je reviens à vous. Il est dix heures & demi, vous recevez ma lettre ; encore une mauvaise lettre, je suis en grande colère contre moi-même et vous êtes si doux pour moi, si doux, si bon ! Mais, Monsieur l’absence ne vous vaut rien. Vous faites tant de mauvaises découvertes sur mon compte ! Si cela dure encore vous finirez par trouver que vous avez fait un bien mauvais marché, venez prendre tranquille possession de votre bien, & vous penserez autrement. Je suis bien aise des bonnes nouvelles de votre mère & de vos enfants ; mais vraiment établissez les ici, vous serez moins inquiet pour votre mère ; est- ce que vous ne trouvez donc pas cela vous même.
Ce n’est plus de moi que je parle. Je dîne aujourd’hui chez Pozzo. J’irai embrasser Lady Granville avant de m’y rendre. Ils arrivent ce matin, c’est un grand plaisir pour moi. 1 heure M. l’officier de la légion d’honneur est venu m’interrompre ; après lui mon énorme toilette, maintenant je vais faire ma première promenade. Ah ! si je pouvais aller vers vous au lieu de cette lettre ! Si tout à coup je me trouvais dans ce cabinet que vous fermez à clé ! Monsieur, je vais dire mille bêtises. Faites-moi taire. Vous me promettez de me nommer un jour dans la lettre que je reverrai demain ou après-demain. Mais sur cela vous seront arrivées mes mauvaises lettres, vous vous serez fâché, vous n’aurez plus en envie de me donner le moindre plaisir. Monsieur je crois que je me trompe encore, vous aurez eu pitié de moi, vous m’aurez plainte, mais vous ne m’aurez pas punie. Demain à 10 h 1/2, je me dirai que vous n’êtes plus fâché, que vous m’aimez encore, toujours, oui toujours, toujours.
Ah ! Que d’adieux, je vous adresse en répétant un mot toujours. C’est celui-ci qui est le bon aujourd’hui toujours.
48. Val-Richer, Mardi 26 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°48 Mardi 26, 3 heures
J’ai aujourd’hui beaucoup de monde à dîner. Demain, je pars de bonne heure pour Croissanville. Je ne vous en dirai pas long. Mais il faut absolument que je vous dise quelque chose, que je vous remercie de ne pas vous agiter de ces misérables tracasseries, des vôtres et des miennes. Je dis misérables de quelque source quelles viennent, d’un trône ou d’un parti. Cela est bien fort ; mais nous sommes plus forts. Vous lisez quelquefois Salomon n’est-ce pas ? Eh bien il a dit cette belle parole, dans le Cantique des cantiques. Fortis est ut mors dilectio. Cherchez au chapitre 8, verset 6. Vous verrez le sens car vous ne savez, dites-vous, que le latin, des Protocoles.
J’ai toujours vu Madame, que quand on était bien décidé, un peu prudent et pas mal spirituel, on surmontait les difficultés une à une à mesure qu’elles se présentaient, des difficultés qui, vues d’avance et en masse, semblent insurmontables. Une seule chose nous importe, c’est d’être l’un et l’autre parfaitement au courant de notre situation, de nos embarras mutuels. Grand soulagement d’abord, grande facilité de plus. Nous unirons tour à tour, contre le problème ou l’embarras du moment nos deux esprits et nos deux volontés. Nous en viendrons à bout, je vous en réponds. J’avais bien un peu prévu ceux qui m’arriveraient du côté de mes amis, mais prévu comme on prévoit, c’est-à-dire vaguement et dans un lointain auquel en regarde à peine. Je suis bien aise de les avoir vus de plus près, et charmé de vous en avoir parlé. Je ne m’en inquiète pas le moins du monde ; bien moins que vous ne devez que nous ne devons nous inquiéter des vôtres. Avec quelques soins, de bonnes conversations, la vérité et la tribune, je dissiperai aisément ces nuages d’intérieur. Ceux de votre horizon à vous, sont plus noirs et plus pesamment chargés. Il faudra que nous y regardions sans cesse que nous nous appliquions, à démêler de loin, à déjouer d’avance les méchancetés, les mensonges. Il y en aura beaucoup. Je vois d’ici comment on les invente, comment on les met en circulation. Je connais ce monde là. Mais, je vous le répète, nous les démêlerons, nous les déjouerons. Ce que je ne connais pas, et à quoi je ne puis pas grand chose, c’est ce qui vient de chez vous ! Vous en serez chargée. Cependant, je vous y aiderai, soyez en sûre. Je vous rendrai, même là, le succès plus facile. Je savais tout ce que vous me dites de votre situation là. Il faut que vous la conserviez cette situation, là et en Europe. Ce n’est pas votre situation, je n’ai pas besoin de vous le dire, qui m’a attiré vers vous, qui m’a attaché à vous. Mais il me plaît que vous l’ayez ; il me plaît qu’elle soit grande, très grande. Il n’y a rien de trop grand pour vous, rien de trop grand selon votre nature et selon mon cœur. Il faut que tout le monde vous voie haut et compte avec vous. Vous serez toujours au dessus de toutes les grandeurs.
Du temps, Madame, du temps et nous : nous arrangerons tout cela. Jamais parfaitement, jamais à notre pleine satisfaction ; jamais assez pour que les ennuis et la nécessité d’y prendre du soin ne recommencent pas sans cesse; c’est la condition de ce monde ; mais assez pour que notre intérêt à nous, notre intérêt si doux et si cher soit assuré et que personne n’ait le pouvoir de nous y déranger.
Mercredi 7 heures
Je partirai, tout à l’heure. J’espère cependant avoir votre lettre auparavant, Un de mes amis de Lisieux, qui vient avec moi à Croissanville, m’a promis de m’apporter ici mon courrier de très bonne heure. Je reviendrai ici ce soir. Oui j’aurais été très étonné de trouver votre salon arrangé comme vous me le dîtes. Peut-être un petit mouvement ... Comment dirai-je ? Je ne sais pas trop je ne me soucie pas d’appeler cela par son nom ...un petit mouvement d’autre chose, se serait mêlé à la surprise. Cependant, dearest continuez, quittez votre place, faites de la musique, cherchez et trouvez un peu de distraction, vous en avez besoin pour votre santé, pour le repos de votre esprit. Je veux que vous en ayez, seulement, quand vous êtes à votre piano, continuez aussi de regarder à la porte pour voir si j’entre.
9 h. 1/2 Je suis obligé de partir sans avoir votre lettre. Cela m’ennuie. J’espère qu’on me l’apportera directement à Croissanville. Adieu donc, cet adieu éternel. Plût à Dieu qu’il fût éternel, mais non pas de loin ! G.
J’ai aujourd’hui beaucoup de monde à dîner. Demain, je pars de bonne heure pour Croissanville. Je ne vous en dirai pas long. Mais il faut absolument que je vous dise quelque chose, que je vous remercie de ne pas vous agiter de ces misérables tracasseries, des vôtres et des miennes. Je dis misérables de quelque source quelles viennent, d’un trône ou d’un parti. Cela est bien fort ; mais nous sommes plus forts. Vous lisez quelquefois Salomon n’est-ce pas ? Eh bien il a dit cette belle parole, dans le Cantique des cantiques. Fortis est ut mors dilectio. Cherchez au chapitre 8, verset 6. Vous verrez le sens car vous ne savez, dites-vous, que le latin, des Protocoles.
J’ai toujours vu Madame, que quand on était bien décidé, un peu prudent et pas mal spirituel, on surmontait les difficultés une à une à mesure qu’elles se présentaient, des difficultés qui, vues d’avance et en masse, semblent insurmontables. Une seule chose nous importe, c’est d’être l’un et l’autre parfaitement au courant de notre situation, de nos embarras mutuels. Grand soulagement d’abord, grande facilité de plus. Nous unirons tour à tour, contre le problème ou l’embarras du moment nos deux esprits et nos deux volontés. Nous en viendrons à bout, je vous en réponds. J’avais bien un peu prévu ceux qui m’arriveraient du côté de mes amis, mais prévu comme on prévoit, c’est-à-dire vaguement et dans un lointain auquel en regarde à peine. Je suis bien aise de les avoir vus de plus près, et charmé de vous en avoir parlé. Je ne m’en inquiète pas le moins du monde ; bien moins que vous ne devez que nous ne devons nous inquiéter des vôtres. Avec quelques soins, de bonnes conversations, la vérité et la tribune, je dissiperai aisément ces nuages d’intérieur. Ceux de votre horizon à vous, sont plus noirs et plus pesamment chargés. Il faudra que nous y regardions sans cesse que nous nous appliquions, à démêler de loin, à déjouer d’avance les méchancetés, les mensonges. Il y en aura beaucoup. Je vois d’ici comment on les invente, comment on les met en circulation. Je connais ce monde là. Mais, je vous le répète, nous les démêlerons, nous les déjouerons. Ce que je ne connais pas, et à quoi je ne puis pas grand chose, c’est ce qui vient de chez vous ! Vous en serez chargée. Cependant, je vous y aiderai, soyez en sûre. Je vous rendrai, même là, le succès plus facile. Je savais tout ce que vous me dites de votre situation là. Il faut que vous la conserviez cette situation, là et en Europe. Ce n’est pas votre situation, je n’ai pas besoin de vous le dire, qui m’a attiré vers vous, qui m’a attaché à vous. Mais il me plaît que vous l’ayez ; il me plaît qu’elle soit grande, très grande. Il n’y a rien de trop grand pour vous, rien de trop grand selon votre nature et selon mon cœur. Il faut que tout le monde vous voie haut et compte avec vous. Vous serez toujours au dessus de toutes les grandeurs.
Du temps, Madame, du temps et nous : nous arrangerons tout cela. Jamais parfaitement, jamais à notre pleine satisfaction ; jamais assez pour que les ennuis et la nécessité d’y prendre du soin ne recommencent pas sans cesse; c’est la condition de ce monde ; mais assez pour que notre intérêt à nous, notre intérêt si doux et si cher soit assuré et que personne n’ait le pouvoir de nous y déranger.
Mercredi 7 heures
Je partirai, tout à l’heure. J’espère cependant avoir votre lettre auparavant, Un de mes amis de Lisieux, qui vient avec moi à Croissanville, m’a promis de m’apporter ici mon courrier de très bonne heure. Je reviendrai ici ce soir. Oui j’aurais été très étonné de trouver votre salon arrangé comme vous me le dîtes. Peut-être un petit mouvement ... Comment dirai-je ? Je ne sais pas trop je ne me soucie pas d’appeler cela par son nom ...un petit mouvement d’autre chose, se serait mêlé à la surprise. Cependant, dearest continuez, quittez votre place, faites de la musique, cherchez et trouvez un peu de distraction, vous en avez besoin pour votre santé, pour le repos de votre esprit. Je veux que vous en ayez, seulement, quand vous êtes à votre piano, continuez aussi de regarder à la porte pour voir si j’entre.
9 h. 1/2 Je suis obligé de partir sans avoir votre lettre. Cela m’ennuie. J’espère qu’on me l’apportera directement à Croissanville. Adieu donc, cet adieu éternel. Plût à Dieu qu’il fût éternel, mais non pas de loin ! G.
50. Paris, Mercredi 27septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
50. Paris, le 27 septembre Mercredi 9 heures
Ah, je respire, le 6 je vous verrai ; quelle bonne parole ! Quel bon accueil répété elle a valu à votre lettre ce matin. Que j’ai besoin de vous, de vos conseils de votre courage, mais par dessus tout de votre cœur, de votre cœur tout entier. Je ne sais de quoi je suis menacée mais voici encore une lettre de M. de Lieven. La mienne lui manquait toujours encore, deux plus fraîches que celle-là lui étaient parvenues, il renouvelle ses instances, & me dit encore : " Je serai contraint de prendre des résolutions auxquelles il me répugne de recourir." & plus loin " Je te supplie de peser mûrement ce que tes devoirs d’épouses & de mère te commandent de penser à ton avenir comme à ton présent." Mais mon Dieu que veut-il dire ? Serait-ce une séparation qu’il demanderait : Quoi ? Parce que je reste malade à Paris ? Vraiment ma raison se refuse à croire à une pareille barbarie. & cependant que veulent dire ces mots ? Je vais les transcrire en écrivant à mon frère, & me mettre complètement sous sa protection.
Au commencement de l’année 35 à Pétersbourg avec mes deux enfants bien portants, tous les honneurs tous les biens de la terre, moins la faculté physique & morale de m’accoutumer à cet horrible pays, je répétais cent fois à mon mari si cela finira par une catastrophe." C’est moi qui croyais finir. Vous savez les malheurs qui m’ont frappé, & en effet tout a été fini pour moi. Aujourd’hui encore je répète cela finira par une catastrophe, je ne savais laquelle mais il faut un dénouement à une situation aussi menacée et je vis sous le coup de cette attente. Tous les jours je puis voir éclater l’orage. J’ai vous, votre affection pour me soutenir. Ma ferme volonté de tout supporter plutôt que de vous quitter, & cependant Monsieur voyez à quoi je puis être exposée !
C’est vendredi qu’est le 6. Ah comme je l’attendrai ! Hier ma promenade a été courte. Il m’a pris la fantaisie d’aller dans des boutiques de vieilleries après, il était trop tard pour le bois de Boulogne j’ai marché dans les Champs Elysées J’ai été chercher des fleurs chez Mad. de Flahaut. Je suis allée embrasser lady Granville au moment où elle descendait de voiture. J’ai dîné chez Pozzo avec toute l’Europe ce que nous autres orthodoxes appelons la bonne Europe. M. Molé, qui devait y être a écrit pour dire qu’il était malade. J’ai beaucoup joui de l’esprit de Pozzo à dîner. Il en a extrêmement, et la vanité la plus simple du monde. Il croit très naturellement qu’il n’y a pas d’homme qui le vaille et il le dit très naturellement aussi. Cela est si établi dans son esprit, que je me suis surprise à me demander, s’il avait peut-être raison. Il m’a dit cependant une grande sottise. "Je n’ai jamais rien emprunté chez les autres. " Il n’y a que Dieu qui n’ait pas besoin d’autres.
Les tracasseries élevées par le roi de Würtemberg donnent bien de l’humeur et de l’embarras ici. Le mariage se fera quand même. Mais il ne sera pas reconnu en Wûrtemberg, quelle ridicule affaire ! C’est tout bonnement du crû du roi, mais je ne doute pas qu’on ne nous l’attribue encore. Il était dix heures lorsque je suis sortie de chez Pozzo, & j’y laissai tout le monde. J’allai chez lady Granville d’abord un long tête-à-tête avec Mylord dans son Cabinet, & puis elle avec mille questions ; & bien des conseils d’amitié. Les journaux l’ont indiqué, je voudrais pouvoir les oublier.
Je me suis couchée hier vers minuit à 8 1/2 votre lettre était dans mes mains et mieux que cela ! Elle m’a été remise en même temps que celle de mon mari. Hier je l’avais reçu avec celle de Thiers, & du prince Talleyrand. Vous comprenez qu’il n’y en a qu’une que je lie dans mon lit. Et mon Dieu, celles de M. de Lieven je n’en suis jamais pressée ! Je voudrais que vous fussiez là, je vous les remettrais & puis vous me les liriez avec quelques commentaires qui m’adouciraient les expressions ou le sens. Enfin vous me donneriez de la force. Je pleurerais auprès de vous. Ce serait si doux !
Monsieur, je vous ai vu étonné quelques fois de la terreur que m’inspire mon mari. rappelez-vous que j’avais quatorze ans quand je l’ai épousé, qu’il en avait douze de plus que moi, et qu’il est très naturellement devenu mon maître parce que j’étais à peu près un enfant. J’ai senti depuis, & bientôt même l’avantage que j’avais sur lui mais cette première impression est restée, et je tremble, oui je tremble quand je reçois ses lettres. Tenez aujourd’hui j’ai vraiment le frisson. C’est bien mauvais pour mes nerfs. Il ne sait pas le mal qu’il me fait, & s’il le savait peut être s’en réjouirait-il ! Ah Monsieur je n’ose pas vous dire que je suis malheureuse, & cela ne sera même pas exact, parce qu’il y a au fond de mon cœur un sentiment de bonheur, de bonheur du Ciel, mais cependant J’ai un chagrin bien grand, une angoisse de tous les instants qui troublent bien ce bonheur quand vous êtes là, quand vous serez là ah c’est autre chose.
Le 6 viendra-t-il bientôt ? Je vous remercie de m’avoir donné le délai de tous vos dîners, n’allez pas avoir d’accident en allant & venant ; vos routes sont mauvaises, les nuits sombres prenez bien des précautions, je vous en prie. Quel insupportable homme que votre Alexis de St Priest. Il a de l’esprit, mais sa manière est la plus insolente la plus arrogante que j’ai jamais rencontrée. Il était si odieux, à toutes les personnes qui le rencontraient chez moi, qu’il m’a été impossible de l’encourager à y revenir. Et puis c’est une commère ! Si vous voulez que je l’aime cependant Je l’aimerai. Il commence à faire froid. Quand comptez vous établir votre famille à Paris ? Ah revenez tous, il n’y aura que cela de bon.
Adieu Monsieur adieu. il me semble impossible de rien dire qui vaille un adieu quand il est comme les miens, quand j’y appuie avec tant de tendresses. Adieu.
Ah, je respire, le 6 je vous verrai ; quelle bonne parole ! Quel bon accueil répété elle a valu à votre lettre ce matin. Que j’ai besoin de vous, de vos conseils de votre courage, mais par dessus tout de votre cœur, de votre cœur tout entier. Je ne sais de quoi je suis menacée mais voici encore une lettre de M. de Lieven. La mienne lui manquait toujours encore, deux plus fraîches que celle-là lui étaient parvenues, il renouvelle ses instances, & me dit encore : " Je serai contraint de prendre des résolutions auxquelles il me répugne de recourir." & plus loin " Je te supplie de peser mûrement ce que tes devoirs d’épouses & de mère te commandent de penser à ton avenir comme à ton présent." Mais mon Dieu que veut-il dire ? Serait-ce une séparation qu’il demanderait : Quoi ? Parce que je reste malade à Paris ? Vraiment ma raison se refuse à croire à une pareille barbarie. & cependant que veulent dire ces mots ? Je vais les transcrire en écrivant à mon frère, & me mettre complètement sous sa protection.
Au commencement de l’année 35 à Pétersbourg avec mes deux enfants bien portants, tous les honneurs tous les biens de la terre, moins la faculté physique & morale de m’accoutumer à cet horrible pays, je répétais cent fois à mon mari si cela finira par une catastrophe." C’est moi qui croyais finir. Vous savez les malheurs qui m’ont frappé, & en effet tout a été fini pour moi. Aujourd’hui encore je répète cela finira par une catastrophe, je ne savais laquelle mais il faut un dénouement à une situation aussi menacée et je vis sous le coup de cette attente. Tous les jours je puis voir éclater l’orage. J’ai vous, votre affection pour me soutenir. Ma ferme volonté de tout supporter plutôt que de vous quitter, & cependant Monsieur voyez à quoi je puis être exposée !
C’est vendredi qu’est le 6. Ah comme je l’attendrai ! Hier ma promenade a été courte. Il m’a pris la fantaisie d’aller dans des boutiques de vieilleries après, il était trop tard pour le bois de Boulogne j’ai marché dans les Champs Elysées J’ai été chercher des fleurs chez Mad. de Flahaut. Je suis allée embrasser lady Granville au moment où elle descendait de voiture. J’ai dîné chez Pozzo avec toute l’Europe ce que nous autres orthodoxes appelons la bonne Europe. M. Molé, qui devait y être a écrit pour dire qu’il était malade. J’ai beaucoup joui de l’esprit de Pozzo à dîner. Il en a extrêmement, et la vanité la plus simple du monde. Il croit très naturellement qu’il n’y a pas d’homme qui le vaille et il le dit très naturellement aussi. Cela est si établi dans son esprit, que je me suis surprise à me demander, s’il avait peut-être raison. Il m’a dit cependant une grande sottise. "Je n’ai jamais rien emprunté chez les autres. " Il n’y a que Dieu qui n’ait pas besoin d’autres.
Les tracasseries élevées par le roi de Würtemberg donnent bien de l’humeur et de l’embarras ici. Le mariage se fera quand même. Mais il ne sera pas reconnu en Wûrtemberg, quelle ridicule affaire ! C’est tout bonnement du crû du roi, mais je ne doute pas qu’on ne nous l’attribue encore. Il était dix heures lorsque je suis sortie de chez Pozzo, & j’y laissai tout le monde. J’allai chez lady Granville d’abord un long tête-à-tête avec Mylord dans son Cabinet, & puis elle avec mille questions ; & bien des conseils d’amitié. Les journaux l’ont indiqué, je voudrais pouvoir les oublier.
Je me suis couchée hier vers minuit à 8 1/2 votre lettre était dans mes mains et mieux que cela ! Elle m’a été remise en même temps que celle de mon mari. Hier je l’avais reçu avec celle de Thiers, & du prince Talleyrand. Vous comprenez qu’il n’y en a qu’une que je lie dans mon lit. Et mon Dieu, celles de M. de Lieven je n’en suis jamais pressée ! Je voudrais que vous fussiez là, je vous les remettrais & puis vous me les liriez avec quelques commentaires qui m’adouciraient les expressions ou le sens. Enfin vous me donneriez de la force. Je pleurerais auprès de vous. Ce serait si doux !
Monsieur, je vous ai vu étonné quelques fois de la terreur que m’inspire mon mari. rappelez-vous que j’avais quatorze ans quand je l’ai épousé, qu’il en avait douze de plus que moi, et qu’il est très naturellement devenu mon maître parce que j’étais à peu près un enfant. J’ai senti depuis, & bientôt même l’avantage que j’avais sur lui mais cette première impression est restée, et je tremble, oui je tremble quand je reçois ses lettres. Tenez aujourd’hui j’ai vraiment le frisson. C’est bien mauvais pour mes nerfs. Il ne sait pas le mal qu’il me fait, & s’il le savait peut être s’en réjouirait-il ! Ah Monsieur je n’ose pas vous dire que je suis malheureuse, & cela ne sera même pas exact, parce qu’il y a au fond de mon cœur un sentiment de bonheur, de bonheur du Ciel, mais cependant J’ai un chagrin bien grand, une angoisse de tous les instants qui troublent bien ce bonheur quand vous êtes là, quand vous serez là ah c’est autre chose.
Le 6 viendra-t-il bientôt ? Je vous remercie de m’avoir donné le délai de tous vos dîners, n’allez pas avoir d’accident en allant & venant ; vos routes sont mauvaises, les nuits sombres prenez bien des précautions, je vous en prie. Quel insupportable homme que votre Alexis de St Priest. Il a de l’esprit, mais sa manière est la plus insolente la plus arrogante que j’ai jamais rencontrée. Il était si odieux, à toutes les personnes qui le rencontraient chez moi, qu’il m’a été impossible de l’encourager à y revenir. Et puis c’est une commère ! Si vous voulez que je l’aime cependant Je l’aimerai. Il commence à faire froid. Quand comptez vous établir votre famille à Paris ? Ah revenez tous, il n’y aura que cela de bon.
Adieu Monsieur adieu. il me semble impossible de rien dire qui vaille un adieu quand il est comme les miens, quand j’y appuie avec tant de tendresses. Adieu.
51. Paris, Mercredi 27 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
51. Mercredi 27 Septembre 7 1/2
Voici une heure bien indue pour vous écrire mes yeux sont faibles ce soir, mais je viens de m’environner de beaucoup de bougies & j’espère pouvoir aller. Marie est allée dîner au Cabaret avec Mad. Durazzo. De là à l’opéra. J’ai fait un solitary dinner et au lieu de pleurer ce qui pourrait bien m’arriver, je vous écris !
J’ai eu ce matin une espèce de conseil chez moi composé du Comte Pahlen & du Comte Médem. Nous avons examiné, analysé, commenté la lettre de mon mari. Ils s’obstinent tous deux à ne voir la dedans que l’accomplissement d’un engagement pris encore l’Empereur. Ils se tiennent préparés à une démarche officielle qui pourrait leur être prescrite de la part de la cour. Ce serait à les entendre, l’extrême possible et cette démarche resterait parfaitement stérile parce que j’y opposerais constamment l’opinion du médecin. Nous avons prévu tous les cas, & obvié à tout. Mais enfin qui me dit que ces messieurs ont raison & que les lettres de mon mari n’ont pas une portée plus grave ? En attendant je voudrais pouvoir suivre leur conseil, qui est d’attendre tranquillement le dénouement de cette étrange affaire.
J’ai fait ma promenade au bois de Boulogne, par un vent très aigre et qui ne va pas. du tout avec mes nerfs. J’ai été causé, pleurer et rire avec lady Granville. J’ai dîné comme je vous l’ai dit et me voici. Vous ne pensez pas à moi dans ce moment vous êtes à dîner à Croissanville (dis-je bien ?) En rentrant chez vous, vous me retrouverez dans votre chambre, ah si vous pouviez me voir aussi vivement que je vous vois, moi ! Je vous regarde, je vous écoute, je retrouve tant de moments si intimes, si charmants. Je me livre de nouveau à ces rêves depuis que je sais que le 6 ils seront une réalité. Ah que je serai heureuse, & comme je jouirai de mon bonheur. Comme je sais en jouir !
Jeudi 10 heures. Votre lettre est bonne, tendre si tendre ce matin, elle m’a si doucement réchauffé le cœur ! Je l’ai lu trois fois dans mon lit à chaque fois elle me plaisait davantage. Comment ne pas croire tout ce que vous me dites ? Vous le dites avec tant d’effusion, tant de chaleur, tant de vérité. Je crois, je crois donc et puis je ne crois pas. Je crois que vous le pensez parce que vous le dites. Je crois, que mon cœur mérite tout ce que vous pensez de bien de lui, et au delà peut être, et j’aurais cru tout le reste si j’étais jeune. La jeunesse croit parce qu’elle a le droit de croire. Aujourd’hui Monsieur, votre affection pour moi est vive, tendre. Votre cœur a trouvé le cœur qu’il lui fallait mais vous êtes sous le charme de la surprise, vous oubliez mon âge. Vous vous le rappellerez bientôt, & voilà voilà ma crainte voilà ce qui fait que je ne crois pas tout ; ah si je pouvais tout croire ; croire que vous m’aimez que vous pouvez m’aimer comme je croyais être aimée quand... Je ne l’étais pas. Voyez l’étrange sort ! Ah que j’eusse été digne de vous alors ? Et alors vous n’y étiez pas.
Monsieur vous ne pouvez pas vous fâcher de tout ce que je vous dis là. Je voudrais que vos yeux fussent satisfaits comme l’est, comme doit l’être votre cœur comme il le sera toujours. Je voudrais être belle, jeune pour vous, pour vous seul. Non, je voudrais l’être aux yeux de tous, & n’en chercher le prix que dans les vôtres. Je voudrais vous voir envié de tous. Ah Monsieur, que vous êtes aimé ! ne me répondez pas à ceci à moins que ce ne soit pour me dire que vous voulez rester aveugle.
Que j’aime ce que vous me dites sur mes sanglots vous resteriez donc près de moi ? Monsieur, quand je pleurais (& j’ai pleuré dans ma vie !) mon mari sortait de la chambre, quelques fois il fuyait la maison. Je n’ai jamais trouvé une épaule amie sur laquelle reposer ma pauvre tête. Monsieur Je n’ai jamais connu le bonheur. Je n’en ai jamais eu que dans cette affection si entière, si extrême que j’avais pour ces deux enfants qui m’ont été ravis. Et cette affection était accompagnée d’une inquiétude si constante qu’il est difficile d’appeler cela du bonheur. Le bonheur ! Je le trouve auprès de vous mais non pas quand vous êtes au Val Richer. Ici, ici près de moi, bien près.
Après vous avoir quitté hier soir, c.a.d. après avoir cessé de vous écrire. Je me suis reposée pendant une heure, j’ai pensé pensé vous savez à qui, vous savez à quoi ? Plus tard j’ai fait de la musique seule, toute seule jusqu’à 10 heures. Mon jeu m’a plu. Il était comme mes pensées. Ah que je vous désirais là, à côté de piano ! Et si vous y aviez été j’aurais laissé là le piano.
M. Thorn est venu m’interrompre ; après lui la duchesse de Poix et sa fille. Imaginez une heure passée entre ce pauvre Thorn & cette duchesse la plus bête des femmes ! Elle n’a pas une demi-idée elle n’a que de très grandes manières, sa fille m’a fait une vrais ressource dans cette misère. Sabine est charmante, spirituelle, vive, curieuse, fine, caressante, & des façons d’un stable boy. C’est exact ce que je vous dis là. Tout le monde hier était à l’opéra & la petite princesse toujours à Maintenon. Je me suis couchée à onze heures. Mes yeux, mon âme regardaient dans cette chambre inconnue, qu’il me semble que j’habite depuis si longtemps.
Monsieur je suis dans une étrange veine hier & aujourd’hui. Je tourne autour de la même idée. J’y reviens par toutes les routes, et je ne finirais pas, Avec quelle douceur, quelle bonté, vous avez accueilli mes mauvaises lettres ! Monsieur si mon cœur pouvait renfermer encore plus d’amour je vous le donnerais. Je vous somme tout ce qu’il a, tout ce qu’il a jamais eu, plus qu’il n’a jamais eu. Ne répondez pas à cette lettre-ci je vous en prie encore, je me réponds moi-même vieille ou jeune vous m’aimez. Vous ne pouvez aimer que moi, penser qu’à moi. Je n’ai pas d’âge. J’ai votre cœur, tout votre cœur. Toujours, toujours. Ah que j’ai pris goût à ce mot. Je dis toujours, comme je dis adieu.
Voici une heure bien indue pour vous écrire mes yeux sont faibles ce soir, mais je viens de m’environner de beaucoup de bougies & j’espère pouvoir aller. Marie est allée dîner au Cabaret avec Mad. Durazzo. De là à l’opéra. J’ai fait un solitary dinner et au lieu de pleurer ce qui pourrait bien m’arriver, je vous écris !
J’ai eu ce matin une espèce de conseil chez moi composé du Comte Pahlen & du Comte Médem. Nous avons examiné, analysé, commenté la lettre de mon mari. Ils s’obstinent tous deux à ne voir la dedans que l’accomplissement d’un engagement pris encore l’Empereur. Ils se tiennent préparés à une démarche officielle qui pourrait leur être prescrite de la part de la cour. Ce serait à les entendre, l’extrême possible et cette démarche resterait parfaitement stérile parce que j’y opposerais constamment l’opinion du médecin. Nous avons prévu tous les cas, & obvié à tout. Mais enfin qui me dit que ces messieurs ont raison & que les lettres de mon mari n’ont pas une portée plus grave ? En attendant je voudrais pouvoir suivre leur conseil, qui est d’attendre tranquillement le dénouement de cette étrange affaire.
J’ai fait ma promenade au bois de Boulogne, par un vent très aigre et qui ne va pas. du tout avec mes nerfs. J’ai été causé, pleurer et rire avec lady Granville. J’ai dîné comme je vous l’ai dit et me voici. Vous ne pensez pas à moi dans ce moment vous êtes à dîner à Croissanville (dis-je bien ?) En rentrant chez vous, vous me retrouverez dans votre chambre, ah si vous pouviez me voir aussi vivement que je vous vois, moi ! Je vous regarde, je vous écoute, je retrouve tant de moments si intimes, si charmants. Je me livre de nouveau à ces rêves depuis que je sais que le 6 ils seront une réalité. Ah que je serai heureuse, & comme je jouirai de mon bonheur. Comme je sais en jouir !
Jeudi 10 heures. Votre lettre est bonne, tendre si tendre ce matin, elle m’a si doucement réchauffé le cœur ! Je l’ai lu trois fois dans mon lit à chaque fois elle me plaisait davantage. Comment ne pas croire tout ce que vous me dites ? Vous le dites avec tant d’effusion, tant de chaleur, tant de vérité. Je crois, je crois donc et puis je ne crois pas. Je crois que vous le pensez parce que vous le dites. Je crois, que mon cœur mérite tout ce que vous pensez de bien de lui, et au delà peut être, et j’aurais cru tout le reste si j’étais jeune. La jeunesse croit parce qu’elle a le droit de croire. Aujourd’hui Monsieur, votre affection pour moi est vive, tendre. Votre cœur a trouvé le cœur qu’il lui fallait mais vous êtes sous le charme de la surprise, vous oubliez mon âge. Vous vous le rappellerez bientôt, & voilà voilà ma crainte voilà ce qui fait que je ne crois pas tout ; ah si je pouvais tout croire ; croire que vous m’aimez que vous pouvez m’aimer comme je croyais être aimée quand... Je ne l’étais pas. Voyez l’étrange sort ! Ah que j’eusse été digne de vous alors ? Et alors vous n’y étiez pas.
Monsieur vous ne pouvez pas vous fâcher de tout ce que je vous dis là. Je voudrais que vos yeux fussent satisfaits comme l’est, comme doit l’être votre cœur comme il le sera toujours. Je voudrais être belle, jeune pour vous, pour vous seul. Non, je voudrais l’être aux yeux de tous, & n’en chercher le prix que dans les vôtres. Je voudrais vous voir envié de tous. Ah Monsieur, que vous êtes aimé ! ne me répondez pas à ceci à moins que ce ne soit pour me dire que vous voulez rester aveugle.
Que j’aime ce que vous me dites sur mes sanglots vous resteriez donc près de moi ? Monsieur, quand je pleurais (& j’ai pleuré dans ma vie !) mon mari sortait de la chambre, quelques fois il fuyait la maison. Je n’ai jamais trouvé une épaule amie sur laquelle reposer ma pauvre tête. Monsieur Je n’ai jamais connu le bonheur. Je n’en ai jamais eu que dans cette affection si entière, si extrême que j’avais pour ces deux enfants qui m’ont été ravis. Et cette affection était accompagnée d’une inquiétude si constante qu’il est difficile d’appeler cela du bonheur. Le bonheur ! Je le trouve auprès de vous mais non pas quand vous êtes au Val Richer. Ici, ici près de moi, bien près.
Après vous avoir quitté hier soir, c.a.d. après avoir cessé de vous écrire. Je me suis reposée pendant une heure, j’ai pensé pensé vous savez à qui, vous savez à quoi ? Plus tard j’ai fait de la musique seule, toute seule jusqu’à 10 heures. Mon jeu m’a plu. Il était comme mes pensées. Ah que je vous désirais là, à côté de piano ! Et si vous y aviez été j’aurais laissé là le piano.
M. Thorn est venu m’interrompre ; après lui la duchesse de Poix et sa fille. Imaginez une heure passée entre ce pauvre Thorn & cette duchesse la plus bête des femmes ! Elle n’a pas une demi-idée elle n’a que de très grandes manières, sa fille m’a fait une vrais ressource dans cette misère. Sabine est charmante, spirituelle, vive, curieuse, fine, caressante, & des façons d’un stable boy. C’est exact ce que je vous dis là. Tout le monde hier était à l’opéra & la petite princesse toujours à Maintenon. Je me suis couchée à onze heures. Mes yeux, mon âme regardaient dans cette chambre inconnue, qu’il me semble que j’habite depuis si longtemps.
Monsieur je suis dans une étrange veine hier & aujourd’hui. Je tourne autour de la même idée. J’y reviens par toutes les routes, et je ne finirais pas, Avec quelle douceur, quelle bonté, vous avez accueilli mes mauvaises lettres ! Monsieur si mon cœur pouvait renfermer encore plus d’amour je vous le donnerais. Je vous somme tout ce qu’il a, tout ce qu’il a jamais eu, plus qu’il n’a jamais eu. Ne répondez pas à cette lettre-ci je vous en prie encore, je me réponds moi-même vieille ou jeune vous m’aimez. Vous ne pouvez aimer que moi, penser qu’à moi. Je n’ai pas d’âge. J’ai votre cœur, tout votre cœur. Toujours, toujours. Ah que j’ai pris goût à ce mot. Je dis toujours, comme je dis adieu.
49. Val-Richer, Jeudi 28 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°49 Jeudi 28, 6 heures
Je suis rentré tard hier. J’étais fatigué. Je me suis couché. Aujourd’hui, je me lève de bonne heure avant le soleil. Le 6 octobre, je ferai le contraire. J’aurai couru toute la nuit. Je me coucherai en arrivant à Paris au moment où le soleil se lèvera. Peu m’importe qu’il y ait un soleil au ciel ce jour-là. Je sais où trouver le mien. Je n’y veux pas trop penser. C’est encore si loin. De demain, vendredi, en huit jours. Y aura-t-il ce jour-là, ou le lendemain un dîner chez Pozzo, ou je ne sais quoi qui vous autorise, à fermer votre porte le soir ? Le lendemain vaudrait mieux peut-être. La dissolution sera au Moniteur le 4. Les élections commenceront le 4 novembre. Je crois mon renseignement positif.
Que de lettres j’écrirai d’ici-là ! On y tient beaucoup. Déjà, il m’arrive des plaintes de ce que je n’écris pas assez. On manque de conseils, d’informations. On veut pouvoir lire à ses amis des passages de mes lettres. J’admire infiniment le proverbe italien : lutto’l mondo e come la nostra famiglia. Il faut vos lettres à Lady Granville pour s’amuser et amuser son mari. Il faut les miennes à mes amis politiques... aussi pour s’amuser eux et leurs amis ; car c’est bien plus de l’amusement, un peu de mouvement moral qu’ils y cherchent, qu’une utilité immédiate et positive. Je leur donnerai satisfaction. Je vais écrire, écrire écrire.
Comment ? Ce pauvre M. de Hügel est fou ? Cela ne m’étonne pas. Il avait depuis quelque temps quelque chose de mystérieux et d’excessivement subtil qui m’étonnait quelques fois. Je l’attribuais à la nature de son esprit. Les Allemands ont de cela. Ils arrivent à la finesse par la subtilité et à la discrétion politique par le mystère. Qui M. de Metternich, enverra-t-il ici à sa place, en l’absence de l’Ambassadeur ? Car je ne suppose pas que les chargés d’affaires aient le privilège des Rois. Ils ne peuvent pas être fous.
Je suis charmé que les Granville soient revenus. C’est une intimité que je vous aime. Quand ils ne seront plus si effarouchés de mes rivalités politiques, j’essaierai d’y entrer un peu.
Que vous revient-il de Londres ? Je ne suppose pas qu’il se passe rien de significatif à la petite session de Novembre. Elle n’aura, je crois, que la liste civile pour objet. Les radicaux me paraissent bien modestes, bien décidés, à accepter qu’on ne leur donne rien pour éviter l’alliance des Whigs et des conservateurs. Mais la nullité et l’inaction ne sont pas, quoiqu’on en dise des éléments de durée.
De quoi je vous parle là ? Il semble que moi aussi, je veux épuiser mes petites nouvelles. J’accueille très bien les vôtres ; mais laissez-les toutes pour me dire, pour me redire toujours comment aime une femme. Le 6 octobre, dearest, dans notre cabinet, je vous dirai, et je suis sûr que vous me croirez, je vous dirai à quel point je vous comprends ? Je vous dirai quelle vie eût été pour moi aussi douce, aussi pleine que pour vous. Je ne veux pas l’écrire. Il y a des choses que je n’aime pas à écrire. Elles sont intimes à ce point qu’il me déplaît de les voir exposées au grand air, exposées à tomber je ne sais sous qu’ils yeux, à provoquer je ne sais quel sourire. Même très sûr que cela n’arrivera pas, l’idée seule de la possibilité me choque et m’arrête. Mais quand je vous aurai dit à quel point je vous comprends vous conviendrez avec moi que femme ou homme, quand on aime, on veut que ce qu’on aime se déploie dans toute sa beauté, s’élève aussi haut qu’il se peut élever. L’amour se passe de tout et prétend à tout. Il se suffit parfaitement à lui-même, et rien ne suffit à son ambition. Je suis sûr que vous pensez, que vous sentez comme moi. Mais encore une fois, je ne veux pas écrire tout ce que j’ai dans le cœur.
J’attends votre lettre de ce matin avec une douce sécurité. Elle répondra à celle où je vous donnais une date. Mais gardez-vous bien de jamais me taire aucune de vos impatiences, de vos injustices. J’ai droit à tout, et je veux tout avoir le worse comme le better. En attendant, je vais écrire à droite & à gauche. Je vous quitte pour je ne sais qui & je ne sais combien.
11 heures
Le courrier m’arrive au milieu de quatre visiteurs. Je viens pourtant de parcourir le N° 50. Que de doutes et tristes choses ! Oui, dearest, comptez sur toujours. Adieu et toujours. Il faudra bien que nous venions à bout de cette situation. Soyez tranquille. Je veillerai sur moi jusqu’au 6. Adieu, adieu. G.
Je suis rentré tard hier. J’étais fatigué. Je me suis couché. Aujourd’hui, je me lève de bonne heure avant le soleil. Le 6 octobre, je ferai le contraire. J’aurai couru toute la nuit. Je me coucherai en arrivant à Paris au moment où le soleil se lèvera. Peu m’importe qu’il y ait un soleil au ciel ce jour-là. Je sais où trouver le mien. Je n’y veux pas trop penser. C’est encore si loin. De demain, vendredi, en huit jours. Y aura-t-il ce jour-là, ou le lendemain un dîner chez Pozzo, ou je ne sais quoi qui vous autorise, à fermer votre porte le soir ? Le lendemain vaudrait mieux peut-être. La dissolution sera au Moniteur le 4. Les élections commenceront le 4 novembre. Je crois mon renseignement positif.
Que de lettres j’écrirai d’ici-là ! On y tient beaucoup. Déjà, il m’arrive des plaintes de ce que je n’écris pas assez. On manque de conseils, d’informations. On veut pouvoir lire à ses amis des passages de mes lettres. J’admire infiniment le proverbe italien : lutto’l mondo e come la nostra famiglia. Il faut vos lettres à Lady Granville pour s’amuser et amuser son mari. Il faut les miennes à mes amis politiques... aussi pour s’amuser eux et leurs amis ; car c’est bien plus de l’amusement, un peu de mouvement moral qu’ils y cherchent, qu’une utilité immédiate et positive. Je leur donnerai satisfaction. Je vais écrire, écrire écrire.
Comment ? Ce pauvre M. de Hügel est fou ? Cela ne m’étonne pas. Il avait depuis quelque temps quelque chose de mystérieux et d’excessivement subtil qui m’étonnait quelques fois. Je l’attribuais à la nature de son esprit. Les Allemands ont de cela. Ils arrivent à la finesse par la subtilité et à la discrétion politique par le mystère. Qui M. de Metternich, enverra-t-il ici à sa place, en l’absence de l’Ambassadeur ? Car je ne suppose pas que les chargés d’affaires aient le privilège des Rois. Ils ne peuvent pas être fous.
Je suis charmé que les Granville soient revenus. C’est une intimité que je vous aime. Quand ils ne seront plus si effarouchés de mes rivalités politiques, j’essaierai d’y entrer un peu.
Que vous revient-il de Londres ? Je ne suppose pas qu’il se passe rien de significatif à la petite session de Novembre. Elle n’aura, je crois, que la liste civile pour objet. Les radicaux me paraissent bien modestes, bien décidés, à accepter qu’on ne leur donne rien pour éviter l’alliance des Whigs et des conservateurs. Mais la nullité et l’inaction ne sont pas, quoiqu’on en dise des éléments de durée.
De quoi je vous parle là ? Il semble que moi aussi, je veux épuiser mes petites nouvelles. J’accueille très bien les vôtres ; mais laissez-les toutes pour me dire, pour me redire toujours comment aime une femme. Le 6 octobre, dearest, dans notre cabinet, je vous dirai, et je suis sûr que vous me croirez, je vous dirai à quel point je vous comprends ? Je vous dirai quelle vie eût été pour moi aussi douce, aussi pleine que pour vous. Je ne veux pas l’écrire. Il y a des choses que je n’aime pas à écrire. Elles sont intimes à ce point qu’il me déplaît de les voir exposées au grand air, exposées à tomber je ne sais sous qu’ils yeux, à provoquer je ne sais quel sourire. Même très sûr que cela n’arrivera pas, l’idée seule de la possibilité me choque et m’arrête. Mais quand je vous aurai dit à quel point je vous comprends vous conviendrez avec moi que femme ou homme, quand on aime, on veut que ce qu’on aime se déploie dans toute sa beauté, s’élève aussi haut qu’il se peut élever. L’amour se passe de tout et prétend à tout. Il se suffit parfaitement à lui-même, et rien ne suffit à son ambition. Je suis sûr que vous pensez, que vous sentez comme moi. Mais encore une fois, je ne veux pas écrire tout ce que j’ai dans le cœur.
J’attends votre lettre de ce matin avec une douce sécurité. Elle répondra à celle où je vous donnais une date. Mais gardez-vous bien de jamais me taire aucune de vos impatiences, de vos injustices. J’ai droit à tout, et je veux tout avoir le worse comme le better. En attendant, je vais écrire à droite & à gauche. Je vous quitte pour je ne sais qui & je ne sais combien.
11 heures
Le courrier m’arrive au milieu de quatre visiteurs. Je viens pourtant de parcourir le N° 50. Que de doutes et tristes choses ! Oui, dearest, comptez sur toujours. Adieu et toujours. Il faudra bien que nous venions à bout de cette situation. Soyez tranquille. Je veillerai sur moi jusqu’au 6. Adieu, adieu. G.
52. Paris, Vendredi 29 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
52. Vendredi le 29 Septembre 1837 10 h 1/2
Qu’est-il arrivé à votre lettre ? Que vous est-il arrivé à vous même ? Je n’ai rien, rien ce matin. Je me contiens encore assez bien, parce que je suis encore étourdi de ce coup. Peu à peu mes idées reviendront, & avec elles mille fantômes horribles. Depuis mon arrivée à Paris, jamais vos lettres ne m’ont manquées. Ce n’est pas vous qui pouvez être cause qu’elle me manque aujourd’hui. La lettre a été volée, ou si vous n’en avez pas écrite vous êtes mal, bien mal. Monsieur, je vais passer la journée dans la fièvre pour me réveiller demain avec le délire. Je vais retomber dans l’état où j’étais à Londres, & ce sera mille fois pire, pire de tout ce qu’il y a de plus pour vous dans mon cœur.
Ah comme je jurerais volontiers aujourd’hui, que si je vous revois, je ne me sépare plus de vous, que si vous retournez au Val-Richer je vous suis. Ah, pour dire que je vous revoie ! Monsieur, vous ne vous faites aucune idée de mes angoisses. Je ne sais ce que j’ai à vous dire de ma journée d’hier.
Il me semble que ma matinée a ressemblé à toutes les autres. Je me tiens dans mon habitude de n’ouvrir ma porte qu’à mon ambassadeur & de renvoyer tous les autres à la soirée. Je vous conserve vos heures mais vous reverrai-je dans ce cabinet ! Je fis ma promenade au bois de Boulogne. Je dînai chez Lady Granville avec Pozzo les fréres Pahlen et quelques anglais. Chez moi je vis le soir, ce que je viens de vous citer des dîners ; la duchesse de Poix et sa fille, les jeunes Pozzo, le Prince Schonberg, M. de Massion.
J’étais fort triste hier soir, je ne sais de quoi. J’ai passé une fort mauvaise nuit au point de me lever pour me promener dans ma chambre. Cela m’a fait dormir plus tard que de coutume, à 10 heures seulement j’ai sonné ; j’ai souri du bonheur qui allait m’arriver, car ce bonheur de tous les jours, il est toujours nouveau, toujours plus ravissant pour moi. & ces mots : " il n’y a pas de lettres " m’ont fait un mal, un mal affreux. J’ai envoyé deux fois pour bien m’assurer de mon malheur. Ah que ces vingt quatre heures vont être longues ! Que ma nuit sera agitée et comme le cœur va me battre demain matin. Monsieur, est-ce que vous comprenez bien tout cela ? Ah, si vous pouviez pressentir dans ce moment, tout ce que je souffre, que vous seriez peiné, malheureux. Oui Monsieur je le crois. Mais dites-moi ce que je dois penser ? La poste est d’une si grande exactitude !
2 heures J’ai été me promener aux Tuileries. Pas une parole n’est sortie de ma bouche je ne puis pas parler. Dans ce qu’on fait autour de moi tout m’irrite. En traversant à pied la rue, je suis ordinairement d’un prudence qui ressemble beaucoup à de la poltronnerie. Ainsi, j’attends cinq minutes, plutôt que de traverser lorsqu’il y a une voiture en vue de très loin même. Aujourd’hui j’ai pensé me faire rouer. Il m’a semblé si indifférent d’avoir un accident ou de n’en avoir pas. Il me parait si inutile de vivre aujourd’hui. Vous pouvez être sûr que je ne prendrai pas le moindre soin de moi jusqu’à ce que j’aie une lettre. Monsieur vous ne m’avez pas vu avec une grande inquiétude sur le cœur, vous ne me verrez jamais comme cela car quand vous serez près de moi (si jamais vous êtes près de moi !) qu’est-ce qui peut m’inquiéter dans le monde.
Je suis bien misérable, je me fais peine à moi-même. Je pense à tout ce qu’il y a de plus horrible. Mon Dieu Monsieur qu’est devenue votre lettre ? Que faites-vous dans ce moment ? Ah si quelque voix du Ciel m’assurait seulement que vous vous portez bien ! Que vais-je devenir jusqu’à demain ?
La petite princesse est revenue hier au soir je vais lui demander ce matin ce que je lui demandais à Londres, elle va encore m’assurer que vous êtes bien, et comme un enfant, je m’en vais essayer de la croire. Ah Monsieur, le pauvre esprit que le mien. Comme mon cœur envahit tout, tout. Prenez pitié de moi, ne me quittez plus lorsque vous m’aurez retrouvée ; si vous me retrouvez. Je n’ai plus de force pour ces adieux que j’aime tant. Il faut avoir le cœur serré pour cela. Aurez-vous ma lettre ? La comprendrez- vous ? Ah Monsieur, une lettre, une lettre aujourd’hui me parait le comble du bonheur ! Adieu.
Qu’est-il arrivé à votre lettre ? Que vous est-il arrivé à vous même ? Je n’ai rien, rien ce matin. Je me contiens encore assez bien, parce que je suis encore étourdi de ce coup. Peu à peu mes idées reviendront, & avec elles mille fantômes horribles. Depuis mon arrivée à Paris, jamais vos lettres ne m’ont manquées. Ce n’est pas vous qui pouvez être cause qu’elle me manque aujourd’hui. La lettre a été volée, ou si vous n’en avez pas écrite vous êtes mal, bien mal. Monsieur, je vais passer la journée dans la fièvre pour me réveiller demain avec le délire. Je vais retomber dans l’état où j’étais à Londres, & ce sera mille fois pire, pire de tout ce qu’il y a de plus pour vous dans mon cœur.
Ah comme je jurerais volontiers aujourd’hui, que si je vous revois, je ne me sépare plus de vous, que si vous retournez au Val-Richer je vous suis. Ah, pour dire que je vous revoie ! Monsieur, vous ne vous faites aucune idée de mes angoisses. Je ne sais ce que j’ai à vous dire de ma journée d’hier.
Il me semble que ma matinée a ressemblé à toutes les autres. Je me tiens dans mon habitude de n’ouvrir ma porte qu’à mon ambassadeur & de renvoyer tous les autres à la soirée. Je vous conserve vos heures mais vous reverrai-je dans ce cabinet ! Je fis ma promenade au bois de Boulogne. Je dînai chez Lady Granville avec Pozzo les fréres Pahlen et quelques anglais. Chez moi je vis le soir, ce que je viens de vous citer des dîners ; la duchesse de Poix et sa fille, les jeunes Pozzo, le Prince Schonberg, M. de Massion.
J’étais fort triste hier soir, je ne sais de quoi. J’ai passé une fort mauvaise nuit au point de me lever pour me promener dans ma chambre. Cela m’a fait dormir plus tard que de coutume, à 10 heures seulement j’ai sonné ; j’ai souri du bonheur qui allait m’arriver, car ce bonheur de tous les jours, il est toujours nouveau, toujours plus ravissant pour moi. & ces mots : " il n’y a pas de lettres " m’ont fait un mal, un mal affreux. J’ai envoyé deux fois pour bien m’assurer de mon malheur. Ah que ces vingt quatre heures vont être longues ! Que ma nuit sera agitée et comme le cœur va me battre demain matin. Monsieur, est-ce que vous comprenez bien tout cela ? Ah, si vous pouviez pressentir dans ce moment, tout ce que je souffre, que vous seriez peiné, malheureux. Oui Monsieur je le crois. Mais dites-moi ce que je dois penser ? La poste est d’une si grande exactitude !
2 heures J’ai été me promener aux Tuileries. Pas une parole n’est sortie de ma bouche je ne puis pas parler. Dans ce qu’on fait autour de moi tout m’irrite. En traversant à pied la rue, je suis ordinairement d’un prudence qui ressemble beaucoup à de la poltronnerie. Ainsi, j’attends cinq minutes, plutôt que de traverser lorsqu’il y a une voiture en vue de très loin même. Aujourd’hui j’ai pensé me faire rouer. Il m’a semblé si indifférent d’avoir un accident ou de n’en avoir pas. Il me parait si inutile de vivre aujourd’hui. Vous pouvez être sûr que je ne prendrai pas le moindre soin de moi jusqu’à ce que j’aie une lettre. Monsieur vous ne m’avez pas vu avec une grande inquiétude sur le cœur, vous ne me verrez jamais comme cela car quand vous serez près de moi (si jamais vous êtes près de moi !) qu’est-ce qui peut m’inquiéter dans le monde.
Je suis bien misérable, je me fais peine à moi-même. Je pense à tout ce qu’il y a de plus horrible. Mon Dieu Monsieur qu’est devenue votre lettre ? Que faites-vous dans ce moment ? Ah si quelque voix du Ciel m’assurait seulement que vous vous portez bien ! Que vais-je devenir jusqu’à demain ?
La petite princesse est revenue hier au soir je vais lui demander ce matin ce que je lui demandais à Londres, elle va encore m’assurer que vous êtes bien, et comme un enfant, je m’en vais essayer de la croire. Ah Monsieur, le pauvre esprit que le mien. Comme mon cœur envahit tout, tout. Prenez pitié de moi, ne me quittez plus lorsque vous m’aurez retrouvée ; si vous me retrouvez. Je n’ai plus de force pour ces adieux que j’aime tant. Il faut avoir le cœur serré pour cela. Aurez-vous ma lettre ? La comprendrez- vous ? Ah Monsieur, une lettre, une lettre aujourd’hui me parait le comble du bonheur ! Adieu.
53. Paris, Samedi 30 septembre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
53. Samedi 30 septembre. 9 heures
Deux lettres à la fois ! Ah que je regrette cette affreuse journée, cette affreuse nuit l’état dans lequel elles m’ont mise ! J’ai bien tenu parole, j’ai pris froid et me voici enrhumée. Hier tout le jour j’ai été un peu comme folle. Je n’ai touché à rien, ni au lunchon. ni au dîner. Pas un morceau de pain. Il m’était impossible de rien avaler, aussi vers la soirée me sentais-je maigrie dans mon corset. La petite princesse ne m’as pas trop rassurée, elle était dans des étonnements ce n’était pas cela qu’il me fallait. Il fallait me dire que j’extravaguais.
Cette nuit j’ai entendu sonner toutes les heures, et quand à 8 1/2, l’heure de la poste, j’ai tiré la corde de la sonnette, il m’a pris une angoisse horrible. J’ai saisi ma tête dans mes deux mains, j’ai invoqué Dieu, je vous ai appelé vous, la respiration m’a manqué. Ma femme de chambre est entrée, on a ouvert les rideaux les volets, c’est le premier acte, le second est d’aller voir s’il y a des lettres, tout cela ne dure pas une minute 1/2 je n’ai pas fait une question. J’ai attendu le moment de la lettre, avec un frémissement intérieur horrible, & quand enfin la petite porte du couloir s’est ouverte & que j’ai vu ma femme de chambre faire le tour de mon lit pour s’approcher de moi, quand ce mouvement m’a indiqué qu’elle avait quelque chose à me remettre, ah Monsieur avant de saisir les lettres mes mains se sont jointes pour invoquer Dieu, pour le remercier. Et avec quelle ferveur !
Après avoir lu, relu, je me suis sentie mieux sur le champs, mais tellement épuisée que je n’ai pas pu me lever avant d’avoir avalé un bouillon. Voilà Monsieur tout ce que m’a valu la négligence de vos gens, car je vois au contenu de ce N°48 qui devait m’arriver hier que vous étiez parti pour Croissanville avant l’arrivée du facteur, on ne lui aura pas remis votre lettre. J’en ai bien de la colère, je vous assure, car elle m’a fait bien du mal, et n’allez pas croire. que cette expérience me prépare mieux à un autre accident ; pas du tout, je vous croirai mort tout de site. Je suis pour vous comme j’étais pour ces créatures chéries, lorsqu’elles étaient hors de ma vue, je perdais la raison.
Voilà Monsieur le pauvre être que vous avez recueilli, auquel votre cœur promet sincérité & bonheur. Voyez comme il est difficile de me les donner ? Je vous ai tout dit, j’ai voulu tout vous dire vous me pardonnez ces détails si inutiles.
Je viens d’examiner les deux enveloppes, elles portent toutes deux le timbre de Lisieux 29 septembre. Grondez un peu autour de vous, car vous allez être en courses, & vous voulez cependant me retrouver vivante. Je n’en ai pas trop l’air aujourd’hui. Vous ne sauriez croire comme ma soirée m’a pesée hier. Il y avait Pozzo, Pahlen, les Schonberg, les Durazzo, les Brignoles M. de St Simon, je ne sais qui encore. Je ne savais de quoi on me parlait. Je ne comprenais rien. J’ai fait signe à mon ambassadeur, il est parti pour donner le signal aux autres. Ce n’est qu’à onze heures & demi qu’on m’a quittée. M. de Hugel est fort malade. C’est une ossification du cœur. Et toutes les idées sont tournées vers la mort. Il ne parle que de cela. Il ne sort plus le soir. Vous ne sauriez croire comme je le plains. Comme je plains toute créature isolée. Ah Je sais tant ce qu’il y a d’horrible a être seule.
Voyez un peu Monsieur tout ce que j’ai eu de mauvais moments depuis ce vilain 13 septembre où vous m’avez quittée. Les journaux, M. Duchâtel, les lettres de mon mari, maintenant la poste. Je n’ai pas eu deux jours de tranquillité, et vous voulez que je me remette. Monsieur cela na sera possible que lorsque vous serez près de moi tout à fait. Vous m’avez dit que vous rentrerez en ville avec toute votre famille dans la dernière quinzaine d’octobre. Vous m’avez toujours donné cette époque. J’espère que là encore vous ne me trompiez pas ? Cependant depuis la noce de M. Duchâtel, j’ai un peu moins de foi dans vos paroles. Vous ne vous fâchez pas n’est-ce pas ? Et bien Monsieur je vous verrai le 6. Vous resterez surement huit jours à Paris n’est-ce pas ? & puis vous irez au Val Richer chercher votre mère et vos enfants et du 20 au 25 vous serez établi ici, ici près de moi. Toujours près de moi. Promettez le moi, je vous en conjure. Dites moi que vous me le promettez. Je serai si douce si bonne ; si égale ; si heureuse. Vous aurez du plaisir à me voir heureuse ? Je me remettrai alors, j’engraisserai.
Midi. J’ai fait venir mon médecin, il m’a trouvée very low, il me donnera des fortifiants. Je lui ai dit cependant que cela venait d’agitation & de chagrin mais cependant il veut que je prenne ses drogues. Hier de 7 à 8 h du soir on a été à me frotter pour me réchauffer et Marie étouffait dans la chambre.
Le mariage va mal. Il se fera mais le roi de Würtemberg est aussi naughty qu’il est possible, je crois, que le pauvre Mühlinen aura l’ordre de faire un tour un province. Quelles mauvaises manières que tout cela. M. Ellice m’a écrit une lettre énorme et indéchiffrable. Je vous attends pour la comprendre. La petite princesse ne s’est pas amusée à Maintenon. La duchesse de Noailles est fort bête, & son mari un peu pompeux. Le lien est beau. Je suis fort aise de n’y avoir pas été. M. Thiers sera à Valençay le 5.
Vous ne sauriez croire comme je me trouve dans le paradis aujourd’hui en comparaison de ma journée d’hier ! C’était affreux hier ayez soin que cela ne m’arrive plus je vous en conjure.
Adieu, je vais relire vos lettres, & me tenir beaucoup à l’air aujourd’hui. J’ai besoin de me remonter. J’ai une mine bien malade. Adieu. Adieu. & vendredi que ce sera beau ! Adieu. Je crois qu’il me sera plus facile de fermer ma porte vendredi soir que samedi, mais je ferai comme vous voudrez. Ordonnez.
Deux lettres à la fois ! Ah que je regrette cette affreuse journée, cette affreuse nuit l’état dans lequel elles m’ont mise ! J’ai bien tenu parole, j’ai pris froid et me voici enrhumée. Hier tout le jour j’ai été un peu comme folle. Je n’ai touché à rien, ni au lunchon. ni au dîner. Pas un morceau de pain. Il m’était impossible de rien avaler, aussi vers la soirée me sentais-je maigrie dans mon corset. La petite princesse ne m’as pas trop rassurée, elle était dans des étonnements ce n’était pas cela qu’il me fallait. Il fallait me dire que j’extravaguais.
Cette nuit j’ai entendu sonner toutes les heures, et quand à 8 1/2, l’heure de la poste, j’ai tiré la corde de la sonnette, il m’a pris une angoisse horrible. J’ai saisi ma tête dans mes deux mains, j’ai invoqué Dieu, je vous ai appelé vous, la respiration m’a manqué. Ma femme de chambre est entrée, on a ouvert les rideaux les volets, c’est le premier acte, le second est d’aller voir s’il y a des lettres, tout cela ne dure pas une minute 1/2 je n’ai pas fait une question. J’ai attendu le moment de la lettre, avec un frémissement intérieur horrible, & quand enfin la petite porte du couloir s’est ouverte & que j’ai vu ma femme de chambre faire le tour de mon lit pour s’approcher de moi, quand ce mouvement m’a indiqué qu’elle avait quelque chose à me remettre, ah Monsieur avant de saisir les lettres mes mains se sont jointes pour invoquer Dieu, pour le remercier. Et avec quelle ferveur !
Après avoir lu, relu, je me suis sentie mieux sur le champs, mais tellement épuisée que je n’ai pas pu me lever avant d’avoir avalé un bouillon. Voilà Monsieur tout ce que m’a valu la négligence de vos gens, car je vois au contenu de ce N°48 qui devait m’arriver hier que vous étiez parti pour Croissanville avant l’arrivée du facteur, on ne lui aura pas remis votre lettre. J’en ai bien de la colère, je vous assure, car elle m’a fait bien du mal, et n’allez pas croire. que cette expérience me prépare mieux à un autre accident ; pas du tout, je vous croirai mort tout de site. Je suis pour vous comme j’étais pour ces créatures chéries, lorsqu’elles étaient hors de ma vue, je perdais la raison.
Voilà Monsieur le pauvre être que vous avez recueilli, auquel votre cœur promet sincérité & bonheur. Voyez comme il est difficile de me les donner ? Je vous ai tout dit, j’ai voulu tout vous dire vous me pardonnez ces détails si inutiles.
Je viens d’examiner les deux enveloppes, elles portent toutes deux le timbre de Lisieux 29 septembre. Grondez un peu autour de vous, car vous allez être en courses, & vous voulez cependant me retrouver vivante. Je n’en ai pas trop l’air aujourd’hui. Vous ne sauriez croire comme ma soirée m’a pesée hier. Il y avait Pozzo, Pahlen, les Schonberg, les Durazzo, les Brignoles M. de St Simon, je ne sais qui encore. Je ne savais de quoi on me parlait. Je ne comprenais rien. J’ai fait signe à mon ambassadeur, il est parti pour donner le signal aux autres. Ce n’est qu’à onze heures & demi qu’on m’a quittée. M. de Hugel est fort malade. C’est une ossification du cœur. Et toutes les idées sont tournées vers la mort. Il ne parle que de cela. Il ne sort plus le soir. Vous ne sauriez croire comme je le plains. Comme je plains toute créature isolée. Ah Je sais tant ce qu’il y a d’horrible a être seule.
Voyez un peu Monsieur tout ce que j’ai eu de mauvais moments depuis ce vilain 13 septembre où vous m’avez quittée. Les journaux, M. Duchâtel, les lettres de mon mari, maintenant la poste. Je n’ai pas eu deux jours de tranquillité, et vous voulez que je me remette. Monsieur cela na sera possible que lorsque vous serez près de moi tout à fait. Vous m’avez dit que vous rentrerez en ville avec toute votre famille dans la dernière quinzaine d’octobre. Vous m’avez toujours donné cette époque. J’espère que là encore vous ne me trompiez pas ? Cependant depuis la noce de M. Duchâtel, j’ai un peu moins de foi dans vos paroles. Vous ne vous fâchez pas n’est-ce pas ? Et bien Monsieur je vous verrai le 6. Vous resterez surement huit jours à Paris n’est-ce pas ? & puis vous irez au Val Richer chercher votre mère et vos enfants et du 20 au 25 vous serez établi ici, ici près de moi. Toujours près de moi. Promettez le moi, je vous en conjure. Dites moi que vous me le promettez. Je serai si douce si bonne ; si égale ; si heureuse. Vous aurez du plaisir à me voir heureuse ? Je me remettrai alors, j’engraisserai.
Midi. J’ai fait venir mon médecin, il m’a trouvée very low, il me donnera des fortifiants. Je lui ai dit cependant que cela venait d’agitation & de chagrin mais cependant il veut que je prenne ses drogues. Hier de 7 à 8 h du soir on a été à me frotter pour me réchauffer et Marie étouffait dans la chambre.
Le mariage va mal. Il se fera mais le roi de Würtemberg est aussi naughty qu’il est possible, je crois, que le pauvre Mühlinen aura l’ordre de faire un tour un province. Quelles mauvaises manières que tout cela. M. Ellice m’a écrit une lettre énorme et indéchiffrable. Je vous attends pour la comprendre. La petite princesse ne s’est pas amusée à Maintenon. La duchesse de Noailles est fort bête, & son mari un peu pompeux. Le lien est beau. Je suis fort aise de n’y avoir pas été. M. Thiers sera à Valençay le 5.
Vous ne sauriez croire comme je me trouve dans le paradis aujourd’hui en comparaison de ma journée d’hier ! C’était affreux hier ayez soin que cela ne m’arrive plus je vous en conjure.
Adieu, je vais relire vos lettres, & me tenir beaucoup à l’air aujourd’hui. J’ai besoin de me remonter. J’ai une mine bien malade. Adieu. Adieu. & vendredi que ce sera beau ! Adieu. Je crois qu’il me sera plus facile de fermer ma porte vendredi soir que samedi, mais je ferai comme vous voudrez. Ordonnez.
50. Val-Richer, Jeudi 28 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°50 Jeudi 3 heures et demi
Je viens de recevoir trois ou quatre visites d’écrire six lettres. Il me faut du repos, c’est-à-dire du bonheur. Je ne comprends pas d’autre repos. Ce serait vraiment du bonheur, de vous écrire après avoir lu et relu ce que vous m’écrivez si tant d’inquiétude ne se mêlait pas à tant de joie. Je me creuse la tête comme vous pour deviner ce que peut faire, ce que peut méditer M. de Lieven. Je ne veux pas vous en parler. Il me déplairait de dire ce que j’en dirais. Jusqu’à ce que vous ayez des nouvelles de l’intervention du comte Orloff, j’espérerai quelque chose. Vous avez raison décrire avec détail à votre frère, avec grand détail. Il faut que tout ce monde-là, si préoccupé de lui-même et de sa position à la Cour, se sente aussi un peu responsable de votre destinée. Nous causerons de tout cela, le 6 bien bien sérieusement car j’y pense sans cesse. Newton a trouvé le système du monde en y pensant toujours. Il n’en avait pas à coup sûr, autant d’envie que j’en ai de trouver à votre situation une bonne issue. Mais les volontés d’hommes sont plus difficiles, à démêler et n’ont pas des lois aussi fixés que le cours des astres.
10 heures Me voilà enfermé chez moi, enfermé sous clef. Ah, vous auriez bien dû venir à la place de votre lettre comme vous en avez eu l’idée. Vous vous arrêtez en pareil cas, vous ne voulez par dire ce que vous appelez des bêtises. Et moi, que dirais-je ? Je m’arrêterai aussi. Pourtant si vous étiez là près de moi, quelle soirée charmante ! Quel doux entretien ! Vous êtes bien plus heureuse que moi. Vous avez notre Cabinet, Autour de vous, nous avons été, nous sommes partout ensemble. Ici je suis seul. Je parle de vous à tout ; mais rien ne me répond. Aussi je vais à vous bien plus que je ne vous amène à moi. J’aime mieux me souvenir qu’imaginer. Je reprends ma place, mes places. Je refais nos conversations. Je n’ai rien oublié, pas un mot, son lieu, sa date, votre regard, votre accent. J’ai des souvenirs, très préférés ; mais tous me sont présents. Ceux de la table à thé, que cette heure-ci me rappelle, sont au nombre des plus doux ; doux comme un bonheur depuis longtemps, goûté dont on jouit comme de son bien, comme de son droit, avec ravissement mais sans trouble, habitude et prélude d’une intimité parfaite, charmante dans le passé, charmante dans l’avenir ! Adieu, Madame.
Je n’ai pas de thé là ; et quand j’en aurais certainement je n’en prendrais pas. Mais adieu au moins, adieu. Vendredi 6 heures et demie Certainement Pozzo a beaucoup d’esprit, un esprit très étendu, droit, fécond, varié, agréable. A côté de lui à table au coin du feu, j’en jouis infiniment, comme vous. Mais il reste toujours lui au dessous de son esprit. Il n’a jamais l’air d’être tout à fait au niveau, bien établi au niveau de son esprit et de sa situation. Et puis laissez-moi vous dire une impertinence. Pozzo n’a jamais fait que de la politique extérieure de la diplomatie. Il n’a jamais gouverné un pays, traité directement, face à face, avec les idées, les intérêts, les passions de tout un peuple. Métier plus difficile, plus compliqué, plus périlleux, qui met aux prises de bien plus près, bien plus fortement avec les hommes et tout ce qu’il y a dans les hommes, et qui exige, qui provoque, dans celui qui le fait un développement bien plus complet, bien plus énergique de toutes les facultés, du caractère comme de l’intelligence, de la volonté comme de l’habilité. J’ai trouvé, dans les hommes les plus distingués qui ont suivi la même carrière que Pozzo, beaucoup d’étendue, d’élévation de liberté d’esprit, beaucoup de pénétration et de savoir faire dans les relations personnelles, quelques fois de la grandeur et de la hardiesse dans les desseins, dans les combinaisons, jamais cette profonde connaissance de la nature, et de la société humaine cette intelligence de leur vie réelle de leurs besoins ; cette fermeté de pensée et de conduite cette habitude fière de la responsabilité, qui donnent et prouvent la puissance, la grande puissance sur les hommes.
Je ne connais que deux carrières qui placent l’homme, un homme, aussi haut qu’il peut attendre, et le forcent de déployer, pour y monter et pour y rester tout ce qu’il peut être ; c’est la guerre et le gouvernement. Là sont, je crois les conditions, les plus nombreuses, les plus dures et par conséquent, le plus grand exercice de la supériorité. M. de Talleyrand et Pozzo ont beaucoup d’esprit, et ils ont beaucoup fait. Le cardinal de Richelieu et M. Pitt ont fait et prouvé bien davantage. Je ne parle pas de quelques hommes hors ligne qui ont conquis et gouverné. Frédéric 2 ; Napoléon. Pour ceux là c’est trop évident. Je n’ai pas la moindre envie que vous aimiez Alexis de St Priest. Traitez-le comme il vous plaira, quoiqu’il m’ait assez amusé lundi, dans deux heures de conversation. Il allait passer quinze jours près de Caen, chez Madame de Chastenay.
10 heures 3/4
Voilà votre N°51. Je n’en veux rien dire, absolument rien en ce moment. J’en ai le cœur trop plein. Mais j’y répondrai quoique vous ne vouliez pas. Deux mots seulement, vos deux mots. Adieu à toujours. G.
Je viens de recevoir trois ou quatre visites d’écrire six lettres. Il me faut du repos, c’est-à-dire du bonheur. Je ne comprends pas d’autre repos. Ce serait vraiment du bonheur, de vous écrire après avoir lu et relu ce que vous m’écrivez si tant d’inquiétude ne se mêlait pas à tant de joie. Je me creuse la tête comme vous pour deviner ce que peut faire, ce que peut méditer M. de Lieven. Je ne veux pas vous en parler. Il me déplairait de dire ce que j’en dirais. Jusqu’à ce que vous ayez des nouvelles de l’intervention du comte Orloff, j’espérerai quelque chose. Vous avez raison décrire avec détail à votre frère, avec grand détail. Il faut que tout ce monde-là, si préoccupé de lui-même et de sa position à la Cour, se sente aussi un peu responsable de votre destinée. Nous causerons de tout cela, le 6 bien bien sérieusement car j’y pense sans cesse. Newton a trouvé le système du monde en y pensant toujours. Il n’en avait pas à coup sûr, autant d’envie que j’en ai de trouver à votre situation une bonne issue. Mais les volontés d’hommes sont plus difficiles, à démêler et n’ont pas des lois aussi fixés que le cours des astres.
10 heures Me voilà enfermé chez moi, enfermé sous clef. Ah, vous auriez bien dû venir à la place de votre lettre comme vous en avez eu l’idée. Vous vous arrêtez en pareil cas, vous ne voulez par dire ce que vous appelez des bêtises. Et moi, que dirais-je ? Je m’arrêterai aussi. Pourtant si vous étiez là près de moi, quelle soirée charmante ! Quel doux entretien ! Vous êtes bien plus heureuse que moi. Vous avez notre Cabinet, Autour de vous, nous avons été, nous sommes partout ensemble. Ici je suis seul. Je parle de vous à tout ; mais rien ne me répond. Aussi je vais à vous bien plus que je ne vous amène à moi. J’aime mieux me souvenir qu’imaginer. Je reprends ma place, mes places. Je refais nos conversations. Je n’ai rien oublié, pas un mot, son lieu, sa date, votre regard, votre accent. J’ai des souvenirs, très préférés ; mais tous me sont présents. Ceux de la table à thé, que cette heure-ci me rappelle, sont au nombre des plus doux ; doux comme un bonheur depuis longtemps, goûté dont on jouit comme de son bien, comme de son droit, avec ravissement mais sans trouble, habitude et prélude d’une intimité parfaite, charmante dans le passé, charmante dans l’avenir ! Adieu, Madame.
Je n’ai pas de thé là ; et quand j’en aurais certainement je n’en prendrais pas. Mais adieu au moins, adieu. Vendredi 6 heures et demie Certainement Pozzo a beaucoup d’esprit, un esprit très étendu, droit, fécond, varié, agréable. A côté de lui à table au coin du feu, j’en jouis infiniment, comme vous. Mais il reste toujours lui au dessous de son esprit. Il n’a jamais l’air d’être tout à fait au niveau, bien établi au niveau de son esprit et de sa situation. Et puis laissez-moi vous dire une impertinence. Pozzo n’a jamais fait que de la politique extérieure de la diplomatie. Il n’a jamais gouverné un pays, traité directement, face à face, avec les idées, les intérêts, les passions de tout un peuple. Métier plus difficile, plus compliqué, plus périlleux, qui met aux prises de bien plus près, bien plus fortement avec les hommes et tout ce qu’il y a dans les hommes, et qui exige, qui provoque, dans celui qui le fait un développement bien plus complet, bien plus énergique de toutes les facultés, du caractère comme de l’intelligence, de la volonté comme de l’habilité. J’ai trouvé, dans les hommes les plus distingués qui ont suivi la même carrière que Pozzo, beaucoup d’étendue, d’élévation de liberté d’esprit, beaucoup de pénétration et de savoir faire dans les relations personnelles, quelques fois de la grandeur et de la hardiesse dans les desseins, dans les combinaisons, jamais cette profonde connaissance de la nature, et de la société humaine cette intelligence de leur vie réelle de leurs besoins ; cette fermeté de pensée et de conduite cette habitude fière de la responsabilité, qui donnent et prouvent la puissance, la grande puissance sur les hommes.
Je ne connais que deux carrières qui placent l’homme, un homme, aussi haut qu’il peut attendre, et le forcent de déployer, pour y monter et pour y rester tout ce qu’il peut être ; c’est la guerre et le gouvernement. Là sont, je crois les conditions, les plus nombreuses, les plus dures et par conséquent, le plus grand exercice de la supériorité. M. de Talleyrand et Pozzo ont beaucoup d’esprit, et ils ont beaucoup fait. Le cardinal de Richelieu et M. Pitt ont fait et prouvé bien davantage. Je ne parle pas de quelques hommes hors ligne qui ont conquis et gouverné. Frédéric 2 ; Napoléon. Pour ceux là c’est trop évident. Je n’ai pas la moindre envie que vous aimiez Alexis de St Priest. Traitez-le comme il vous plaira, quoiqu’il m’ait assez amusé lundi, dans deux heures de conversation. Il allait passer quinze jours près de Caen, chez Madame de Chastenay.
10 heures 3/4
Voilà votre N°51. Je n’en veux rien dire, absolument rien en ce moment. J’en ai le cœur trop plein. Mais j’y répondrai quoique vous ne vouliez pas. Deux mots seulement, vos deux mots. Adieu à toujours. G.
51. Val-Richer, Samedi 30 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°51 Val-Richer, Samedi 30 6 h. 1/2
J’ai tant à vous dire, tant à propos de votre N°51, que je ne sais si je ne ferais pas mieux de faire comme vous voulez, et d’attendre le 6. Je pourrais même attendre plus loin et vous ajourner, pour ma réponse comme je l’ai déjà fait à un an, deux ans. Les ajournements me plaisent. Il me semble que je prends possession de l’avenir. Mais aujourd’hui ; je ne puis pas. Quand je vous vois une idée, une impression qui met entre nous, je ne dis pas un nuage, mais tout ce qu’il y a de plus léger, une plume dans l’air, un grain de sable. Sans vos pas, il faut qu’à l’instant même je la repousse, je l’écarte que je rétablisse, de vous à moi, la parfaite sérénité, la parfaite confiance, la parfaite égalité. C’est mon droit, c’est mon premier besoin, Madame. Je ne puis souffrir que rien manque, dans votre pensée ou dans la mienne à notre affection. Je ne veux la perfection que là ; mais là, je la veux, je la veux tout à fait.
Comment dirai-je ? En y pensant, je trouve ce que vous me dites un peu ridicule et bien plus ridicule d’y répondre. J’ai eu un moment envie d’y répondre en riant, de vous envoyer la lettre d’un homme de vingt ans, bien jeune, bien ignorant bien ignoré, très épris, ne sachant pourquoi, surpris en effet, comme vous dîtes autant que charmé. A coup sûr, vous me l’auriez renvoyée en me disant que la poste s’était trompée, que ce n’était pas moi qui avais écrit cela. Vous vous seriez chargée de ma réponse Madame. Mais quelque vraie que celle-là eût été, je n’en veux pas. J’en veux une sérieuse, très sérieuse. Je ne sais pas rire si près de votre cœur et du mien.
Nous sommes du même âge, Madame. Je conviens qu’à titre d’homme. je suis un peu plus jeune que vous ; et peut-être y a-t-il des mathématiciens, des Statisticiens qui sauraient évaluer en chiffres la différence. Mais moi madame, je ne suis pas un chiffre. Je suis une créature vivante gouverné par mes impressions, mes idées, mes goûts, parfaitement indifférent aux goûts, aux idées et aux impressions des autres, ne tenant nul compte, pour ma vie intime, ma vraie vie, de ce que pensent, font, aiment ou n’aiment pas les autres, ne songeant seulement pas aux conventions, aux habitudes, aux routines des autres, ne consultant que moi, ne croyant que moi et le plus tranquille, le mieux établi des hommes dans mes sentiments et mes plaisirs, quand ils sont tels que je les veux moi, pour moi. Et je suis très sûr que je suis à cet égard, plus exigeant, et plus ambitieux que qui que ce soit.
J’ai épousé une femme qui avait près de quatorze ans de plus que mois, et puis une femme qui en avait quinze de moins. Ni l’une ni l’autre, je vous en réponds, ne s’est aperçue une minute de la différence. C’est que je les aimais vraiment. C’’est qu’elles répondaient vraiment à tous mes goûts, à tous mes désirs. C’est quelles m’aimaient de toute leur âme. Et leur âme était haute, leur cœur tendre, leur esprit rare. Elles appartenaient l’une et l’autre et par leur nature et par leurs habitudes de toute sorte, à la région la plus élevée. Il me faut tout cela. Tant que j’ai vécu auprès d’elles, j’ai senti mon affection croître comme mon bonheur. Et quand Dieu me les a enlevées, j’ai senti que je perdais, non seulement le bonheur dont j’avais joui, mais, un bonheur inconnu, inépuisable, toujours nouveau qu’elles avaient à me donner et moi à recevoir.
Dieu me traite avec une bonté, une magnificence dont je suis à la fois fier et confondu. Il vous amène vers moi, vous venue de si loin, si étrangère à mon pays, à mon passé, si imprévue, pour moi, et pourtant si sympathique à moi, à mes goûts, à mes désirs, à tout mon être, vous d’une si grande nature, d’un esprit si élevé et si aimable, d’un cœur si vif, d’un caractère si passionné et si doux ! Vous arrivez où je suis en deuil, désolée, ne regardant à rien, ne vous souciant de personne, cherchant à votre peine un peu de soulagement à vos ennuis un peu de distraction que vous n’aviez jamais l’air de trouver, donnant à tout le monde, l’idée d’un mal incurable et d’une créature supérieure à jamais abattue, isolée. Et un jour, vous me laissez voir, vous me dîtes que je vous consolerai, que je vous relèverai, que vous m’aimerez, que vous m’aimez, que nous retrouverons vous en moi, moi en vous cette intimité, ce bonheur qui surpassent, qui dominent tout ce qu’il y a sur cette terre, toutes ses joies et toutes ses douleurs ! Voilà ce qui est Madame. Voilà ce qui nous est arrivé à vous et à moi. Et vous venez me dire que vous êtes de dix mois plus âgée que moi ! Et il vous vient de là un doute qui vous préoccupe, qui vous empêche d’avoir foi, pleine foi en moi, dans mon affection, dans votre bonheur. Et vous me demandez si, moi aussi, je ne m’apercevrai pas un jour que je suis dix mois, plus jeune que vous? Ah Madame, que voulez-vous que je vous dise ? En vérité, vous nous replacez trop l’un et l’autre dans la foule. Je ne suis pas modeste. Je veux être pour vous tout ce que vous êtes pour moi, que vous trouviez en moi tout ce que je trouve en vous. Mais on nous faisant trouver. vous à moi, moi à vous, hors de toute prévoyance, de toute attente, quand notre vie intime à l’un et à l’autre semblait finie. Dieu a fait pour nous un miracle. Il y aurait plus que de l’ingratitude, il y aurait de la folie à n’en pas sentir la merveille, à n’en pas jouir avec une reconnaissance, une confiance un ravissement sans mesure comme le bienfait.
10 heures 1/2
Je ne comprends rien, rien du tout à ce retard qui me désespère. Je vous ai écrit comme à l’ordinaire. Ma lettre a dû partir de Lisieux jeudi avant- hier. Vous en aurez eu deux ce matin. C’est impossible, autrement. Mais je n’en suis pas moins désolé. Adieu, Adieu. Vous avez bien raison. Il faut être ensemble. Adieu. G.
J’ai tant à vous dire, tant à propos de votre N°51, que je ne sais si je ne ferais pas mieux de faire comme vous voulez, et d’attendre le 6. Je pourrais même attendre plus loin et vous ajourner, pour ma réponse comme je l’ai déjà fait à un an, deux ans. Les ajournements me plaisent. Il me semble que je prends possession de l’avenir. Mais aujourd’hui ; je ne puis pas. Quand je vous vois une idée, une impression qui met entre nous, je ne dis pas un nuage, mais tout ce qu’il y a de plus léger, une plume dans l’air, un grain de sable. Sans vos pas, il faut qu’à l’instant même je la repousse, je l’écarte que je rétablisse, de vous à moi, la parfaite sérénité, la parfaite confiance, la parfaite égalité. C’est mon droit, c’est mon premier besoin, Madame. Je ne puis souffrir que rien manque, dans votre pensée ou dans la mienne à notre affection. Je ne veux la perfection que là ; mais là, je la veux, je la veux tout à fait.
Comment dirai-je ? En y pensant, je trouve ce que vous me dites un peu ridicule et bien plus ridicule d’y répondre. J’ai eu un moment envie d’y répondre en riant, de vous envoyer la lettre d’un homme de vingt ans, bien jeune, bien ignorant bien ignoré, très épris, ne sachant pourquoi, surpris en effet, comme vous dîtes autant que charmé. A coup sûr, vous me l’auriez renvoyée en me disant que la poste s’était trompée, que ce n’était pas moi qui avais écrit cela. Vous vous seriez chargée de ma réponse Madame. Mais quelque vraie que celle-là eût été, je n’en veux pas. J’en veux une sérieuse, très sérieuse. Je ne sais pas rire si près de votre cœur et du mien.
Nous sommes du même âge, Madame. Je conviens qu’à titre d’homme. je suis un peu plus jeune que vous ; et peut-être y a-t-il des mathématiciens, des Statisticiens qui sauraient évaluer en chiffres la différence. Mais moi madame, je ne suis pas un chiffre. Je suis une créature vivante gouverné par mes impressions, mes idées, mes goûts, parfaitement indifférent aux goûts, aux idées et aux impressions des autres, ne tenant nul compte, pour ma vie intime, ma vraie vie, de ce que pensent, font, aiment ou n’aiment pas les autres, ne songeant seulement pas aux conventions, aux habitudes, aux routines des autres, ne consultant que moi, ne croyant que moi et le plus tranquille, le mieux établi des hommes dans mes sentiments et mes plaisirs, quand ils sont tels que je les veux moi, pour moi. Et je suis très sûr que je suis à cet égard, plus exigeant, et plus ambitieux que qui que ce soit.
J’ai épousé une femme qui avait près de quatorze ans de plus que mois, et puis une femme qui en avait quinze de moins. Ni l’une ni l’autre, je vous en réponds, ne s’est aperçue une minute de la différence. C’est que je les aimais vraiment. C’’est qu’elles répondaient vraiment à tous mes goûts, à tous mes désirs. C’est quelles m’aimaient de toute leur âme. Et leur âme était haute, leur cœur tendre, leur esprit rare. Elles appartenaient l’une et l’autre et par leur nature et par leurs habitudes de toute sorte, à la région la plus élevée. Il me faut tout cela. Tant que j’ai vécu auprès d’elles, j’ai senti mon affection croître comme mon bonheur. Et quand Dieu me les a enlevées, j’ai senti que je perdais, non seulement le bonheur dont j’avais joui, mais, un bonheur inconnu, inépuisable, toujours nouveau qu’elles avaient à me donner et moi à recevoir.
Dieu me traite avec une bonté, une magnificence dont je suis à la fois fier et confondu. Il vous amène vers moi, vous venue de si loin, si étrangère à mon pays, à mon passé, si imprévue, pour moi, et pourtant si sympathique à moi, à mes goûts, à mes désirs, à tout mon être, vous d’une si grande nature, d’un esprit si élevé et si aimable, d’un cœur si vif, d’un caractère si passionné et si doux ! Vous arrivez où je suis en deuil, désolée, ne regardant à rien, ne vous souciant de personne, cherchant à votre peine un peu de soulagement à vos ennuis un peu de distraction que vous n’aviez jamais l’air de trouver, donnant à tout le monde, l’idée d’un mal incurable et d’une créature supérieure à jamais abattue, isolée. Et un jour, vous me laissez voir, vous me dîtes que je vous consolerai, que je vous relèverai, que vous m’aimerez, que vous m’aimez, que nous retrouverons vous en moi, moi en vous cette intimité, ce bonheur qui surpassent, qui dominent tout ce qu’il y a sur cette terre, toutes ses joies et toutes ses douleurs ! Voilà ce qui est Madame. Voilà ce qui nous est arrivé à vous et à moi. Et vous venez me dire que vous êtes de dix mois plus âgée que moi ! Et il vous vient de là un doute qui vous préoccupe, qui vous empêche d’avoir foi, pleine foi en moi, dans mon affection, dans votre bonheur. Et vous me demandez si, moi aussi, je ne m’apercevrai pas un jour que je suis dix mois, plus jeune que vous? Ah Madame, que voulez-vous que je vous dise ? En vérité, vous nous replacez trop l’un et l’autre dans la foule. Je ne suis pas modeste. Je veux être pour vous tout ce que vous êtes pour moi, que vous trouviez en moi tout ce que je trouve en vous. Mais on nous faisant trouver. vous à moi, moi à vous, hors de toute prévoyance, de toute attente, quand notre vie intime à l’un et à l’autre semblait finie. Dieu a fait pour nous un miracle. Il y aurait plus que de l’ingratitude, il y aurait de la folie à n’en pas sentir la merveille, à n’en pas jouir avec une reconnaissance, une confiance un ravissement sans mesure comme le bienfait.
10 heures 1/2
Je ne comprends rien, rien du tout à ce retard qui me désespère. Je vous ai écrit comme à l’ordinaire. Ma lettre a dû partir de Lisieux jeudi avant- hier. Vous en aurez eu deux ce matin. C’est impossible, autrement. Mais je n’en suis pas moins désolé. Adieu, Adieu. Vous avez bien raison. Il faut être ensemble. Adieu. G.
54. Paris, Dimanche 1er octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
54. Dimanche 1er octobre 9 h.
Voici votre lettre, votre bonne lettre Monsieur, que j’ai besoin de toutes les joies, les consolations que vous me donnez ! & que je remercie le Ciel tous les jours du bienfait immense qu’il m’accorde dans votre affection pour moi ! Je suis triste un peu, je dis vrai quand je dis un peu, car je sens parfaitement que ce qui ne me vient pas de vous ne peut jamais m’atteindre beaucoup ni bien ni en mal. Voici enfin l’arrêt de mon mari. & il avait reçu toutes les lettres retardées c. a. d. le certificat du médecin ente autres.
"Si tu te refusais de te rendre à mon invitation, je me trouverais dans l’obligation de te refuser toute subvention de ma part." "Je dois également prévoir le cas que tu me laisses sans réponse et t’avertir encore, que si dans un délai de trois semaines je ne me trouvais pas en possession de cette réponse, je serais obligé d’agir comme s’il y avait refus de ta part."
Et bien monsieur savez-vous quel est le sentiment qui domine en moi c’est celui d’une grande pitié pour un homme capable d’une action pareille, il est très évident que ce qu’il fait a été concerté avec L’Empereur, promis à l’Empereur. est-il possible ! Mon frère est désormais ma seule protection, j’y vais avoir recours, mais en m’appuyant de quelques conseils que je vais chercher ce matin auprès de mon ambassadeur & du comte Médem.
Nous causerons beaucoup le 6 de tout cela, mais nous causerons beaucoup plus d’autre chose. Monsieur quel bonheur de vous revoir. Quel bonheur ! Je n’ai pas une autre pensée. Hier a été bien mieux que le jour précédent. J’ai mangé, cette nuit j’ai dormi. Je m’étais fait traîner pendant deux heures au bois de Boulogne, je n’ai pas pu marcher mes jambes n’allaient pas. La moindre agitation m’enlève mes forces. Ainsi la veille m’avait fait du mal pour plusieurs jours, mais l’air était ravissant, doux, tranquille, & cette promenade a fait du bien à mes nerfs.
Le soir M. Molé est venu de bonne heure. J’ai passé au delà d’une heure seule avec lui, ensuite sont venus mon ambassadeur, la petite princesse, M. Sneyd, M. Lutrell, c’est un nouvel anglais qui a beaucoup d’esprit. Le pauvre Hugel est dans un très triste état. Je crois que M. Molé a écrit à Vienne pour qu’on se hâte de renvoyer ici M. Appony. C’est mon ami Thorn qui est dans un bel état. Il ne sait que faire, que devenir. Il voit que son principal est fou et il n’ose pas le mander.
Midi. Comme je ne vais pas à l’église, j’ai fait de plus longues lectures pieuses. Je viens d’achever ma longue toilette. Je vais prendre l’air en calèche, oublier s’il se peut mon mari, et comme voici dimanche & que ma lettre doit se trouver de meilleure heure à la poste je la ferme maintenant. Monsieur pensez à mes affaires russes, barbares, mais ne vous en inquiétez pas. Je suis indignée mais inquiète, non. Et dans le pire cas celui où il faisait comme il dit, je puis me tirer d’affaire. Ah mon Dieu, cela est peu de chose à côté des négligences de vos gens, et j’aime cent fois, mille fois mieux qu’on me stop the supplies for ever, que de ce qu’on stop letters for a single day. Je mangerai, je dormirai aujourd’hui ; & avant-hier je n’ai fait ni l’un, ni l’autre. Adieu Monsieur adieu plus que jamais adieu avec tout ce qu’il y a dans mon cœur adieu.
Voici votre lettre, votre bonne lettre Monsieur, que j’ai besoin de toutes les joies, les consolations que vous me donnez ! & que je remercie le Ciel tous les jours du bienfait immense qu’il m’accorde dans votre affection pour moi ! Je suis triste un peu, je dis vrai quand je dis un peu, car je sens parfaitement que ce qui ne me vient pas de vous ne peut jamais m’atteindre beaucoup ni bien ni en mal. Voici enfin l’arrêt de mon mari. & il avait reçu toutes les lettres retardées c. a. d. le certificat du médecin ente autres.
"Si tu te refusais de te rendre à mon invitation, je me trouverais dans l’obligation de te refuser toute subvention de ma part." "Je dois également prévoir le cas que tu me laisses sans réponse et t’avertir encore, que si dans un délai de trois semaines je ne me trouvais pas en possession de cette réponse, je serais obligé d’agir comme s’il y avait refus de ta part."
Et bien monsieur savez-vous quel est le sentiment qui domine en moi c’est celui d’une grande pitié pour un homme capable d’une action pareille, il est très évident que ce qu’il fait a été concerté avec L’Empereur, promis à l’Empereur. est-il possible ! Mon frère est désormais ma seule protection, j’y vais avoir recours, mais en m’appuyant de quelques conseils que je vais chercher ce matin auprès de mon ambassadeur & du comte Médem.
Nous causerons beaucoup le 6 de tout cela, mais nous causerons beaucoup plus d’autre chose. Monsieur quel bonheur de vous revoir. Quel bonheur ! Je n’ai pas une autre pensée. Hier a été bien mieux que le jour précédent. J’ai mangé, cette nuit j’ai dormi. Je m’étais fait traîner pendant deux heures au bois de Boulogne, je n’ai pas pu marcher mes jambes n’allaient pas. La moindre agitation m’enlève mes forces. Ainsi la veille m’avait fait du mal pour plusieurs jours, mais l’air était ravissant, doux, tranquille, & cette promenade a fait du bien à mes nerfs.
Le soir M. Molé est venu de bonne heure. J’ai passé au delà d’une heure seule avec lui, ensuite sont venus mon ambassadeur, la petite princesse, M. Sneyd, M. Lutrell, c’est un nouvel anglais qui a beaucoup d’esprit. Le pauvre Hugel est dans un très triste état. Je crois que M. Molé a écrit à Vienne pour qu’on se hâte de renvoyer ici M. Appony. C’est mon ami Thorn qui est dans un bel état. Il ne sait que faire, que devenir. Il voit que son principal est fou et il n’ose pas le mander.
Midi. Comme je ne vais pas à l’église, j’ai fait de plus longues lectures pieuses. Je viens d’achever ma longue toilette. Je vais prendre l’air en calèche, oublier s’il se peut mon mari, et comme voici dimanche & que ma lettre doit se trouver de meilleure heure à la poste je la ferme maintenant. Monsieur pensez à mes affaires russes, barbares, mais ne vous en inquiétez pas. Je suis indignée mais inquiète, non. Et dans le pire cas celui où il faisait comme il dit, je puis me tirer d’affaire. Ah mon Dieu, cela est peu de chose à côté des négligences de vos gens, et j’aime cent fois, mille fois mieux qu’on me stop the supplies for ever, que de ce qu’on stop letters for a single day. Je mangerai, je dormirai aujourd’hui ; & avant-hier je n’ai fait ni l’un, ni l’autre. Adieu Monsieur adieu plus que jamais adieu avec tout ce qu’il y a dans mon cœur adieu.
52. Val-Richer, Dimanche 1er octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°52 Dimanche 1er Oct. 6h 1/2
Je ne puis vous écrire tant. que je ne vous sais pas tranquille. Vous l’êtes depuis hier matin. Cela est sûr. Je ne puis comprendre quel accident a retardé une lettre ; mais hier vous en aurez eu deux à la fois. Il faut que je le voie écrit de votre main, que je lise de vous, des paroles calmées, heureuses. Votre peine m’est intolérable. Hier tout le jour, je voulais travailler ; j’avais à écrire quelque chose qui m’importe assez. Je n’ai pas pu. Je suis resté assis devant ma table, me prescrivant de ne pas bouger, de chercher ; rien ne venait, pas une idée pas un mot heureux. Mon esprit, mon cœur tout était à vous, avec vous. Je vous parlais, je vous rassurais. Je le fais encore ce matin, je le ferai jusqu’à ce que votre lettre me soit arrivée. J’ai recommandé hier au facteur de venir de bonne heure. J’espère qu’il le fera. Je crains le dimanche. Ce jour là, il trouve en route des gens qui s’amusent qui boivent, et il s’arrête quelque fois à boire avec eux. S’il vient tard ; il sera bien grondé.
Essayons de causer. Nous causerons Vendredi, à une heure et demie. Vous trouverai-je bien ? cela devrait être, d’après ce que vous me dites de vos longues promenades et de votre force. J’aurais tant de plaisir à vous voir bien, décidément bien ! Il faut pourtant que vous soyez malade, toujours malade. Je vous dirai que plus j’y pense, plus je suis de l’avis du Comte de Pahlen et du Comte de Médem sur ce qui fait écrire à M. de Lieven de telles lettres. Quelque étrange que ce soit, c’est beaucoup moins étrange que toute autre supposition. Et puis ces messieurs sont plus accoutumés que vous à de telles choses à de telles façons d’agir & pour de tels motifs. Ils ont plus vécu que vous dans cette atmosphère là. Quelle fortune que vous ayez été en Angleterre, que vous ayez passé là tant de temps, au milieu des idées et des sentiments qui sont les nôtres ! Je ne puis me figurer vous Tartare, Scythe vivant de glace & d’obéissance. Vous auriez toujours conservé votre nature, et elle serait toujours devenue quelque chose de grand. Car ne me croyez pas encroûté d’orgueil civilisé ; il y a du grand partout, et j’estime beaucoup de choses chez les peuples débutent. Mais quelle différence ! Et puis pour nous rencontrer, il fallait que vous vinssiez en occident ; je n’entrevois pas comment je serais allé, moi, en Orient. A moins qu’il ne me fût arrivé d’être, un jour ambassadeur à Pétersbourg, et de vous trouver là, vous, bien Russe, J’aurais, bien à côté de l’impératrice. Comment nous sérions nous connus, parlé ? Aurions-nous démêlé quelque chose l’un de l’autre ? Cherchez, vous me direz. Il n’y a pas de risque. Nous pouvons nous en donner le plaisir.
N’est ce pas voilà du vrai bavardage? Comme entre nous pourtant, entre nous seuls. Je vivrais bien dix ans auprès de la Princesse de Poix. (C’est la Princesse et non pas la Duchesse) que je ne bavarderais pas ainsi avec elle. Vous lui trouvez donc de très grandes manières. Je l’ai beaucoup entendu dire, sans jamais en être frappé. Elle a une grosse voix, un gros visage, de gros bras de gros mouvements, du gros tant que vous voudrez mais rien de grand. Pour que les manières soient vraiment grandes, il faut quelque chose dans la personne, si peu que ce soit, quoi que ce soit, mais quelque chose, un peu d’esprit, un peu de beauté, un peu d’âme, quelque fierté de nature, quelque grâce dans la physionomie, quelque élégance dans les gestes, dans le langage. Quand il n’y a rien, absolument rien, les grandes manières ne sont plus que les manières de personnes, bien élevées et sures de leur fait. Je n’aime pas à prodiguer le nom de grand, même dans les plus petites occasions.
10 heures 1/2
Voilà votre N°53. Le facteur n’est pas en retard. Mais je suis encore très ému, très troublé de votre trouble. Ce n’est pas de chez moi, c’est de Lisieux que provient le retard. Je vous dirai comment. Mais soyez tranquille. Je gronderai comme il faut. Je gronde rarement, mais quand je gronde, on s’en souvient. Enfin cela n’arrivera plus. Adieu dearest, Adieu. Soignez-vous bien au moins. Soignez-vous toujours. Toujours. Adieu. Je traite ces deux mots comme vous. G.
Je ne puis vous écrire tant. que je ne vous sais pas tranquille. Vous l’êtes depuis hier matin. Cela est sûr. Je ne puis comprendre quel accident a retardé une lettre ; mais hier vous en aurez eu deux à la fois. Il faut que je le voie écrit de votre main, que je lise de vous, des paroles calmées, heureuses. Votre peine m’est intolérable. Hier tout le jour, je voulais travailler ; j’avais à écrire quelque chose qui m’importe assez. Je n’ai pas pu. Je suis resté assis devant ma table, me prescrivant de ne pas bouger, de chercher ; rien ne venait, pas une idée pas un mot heureux. Mon esprit, mon cœur tout était à vous, avec vous. Je vous parlais, je vous rassurais. Je le fais encore ce matin, je le ferai jusqu’à ce que votre lettre me soit arrivée. J’ai recommandé hier au facteur de venir de bonne heure. J’espère qu’il le fera. Je crains le dimanche. Ce jour là, il trouve en route des gens qui s’amusent qui boivent, et il s’arrête quelque fois à boire avec eux. S’il vient tard ; il sera bien grondé.
Essayons de causer. Nous causerons Vendredi, à une heure et demie. Vous trouverai-je bien ? cela devrait être, d’après ce que vous me dites de vos longues promenades et de votre force. J’aurais tant de plaisir à vous voir bien, décidément bien ! Il faut pourtant que vous soyez malade, toujours malade. Je vous dirai que plus j’y pense, plus je suis de l’avis du Comte de Pahlen et du Comte de Médem sur ce qui fait écrire à M. de Lieven de telles lettres. Quelque étrange que ce soit, c’est beaucoup moins étrange que toute autre supposition. Et puis ces messieurs sont plus accoutumés que vous à de telles choses à de telles façons d’agir & pour de tels motifs. Ils ont plus vécu que vous dans cette atmosphère là. Quelle fortune que vous ayez été en Angleterre, que vous ayez passé là tant de temps, au milieu des idées et des sentiments qui sont les nôtres ! Je ne puis me figurer vous Tartare, Scythe vivant de glace & d’obéissance. Vous auriez toujours conservé votre nature, et elle serait toujours devenue quelque chose de grand. Car ne me croyez pas encroûté d’orgueil civilisé ; il y a du grand partout, et j’estime beaucoup de choses chez les peuples débutent. Mais quelle différence ! Et puis pour nous rencontrer, il fallait que vous vinssiez en occident ; je n’entrevois pas comment je serais allé, moi, en Orient. A moins qu’il ne me fût arrivé d’être, un jour ambassadeur à Pétersbourg, et de vous trouver là, vous, bien Russe, J’aurais, bien à côté de l’impératrice. Comment nous sérions nous connus, parlé ? Aurions-nous démêlé quelque chose l’un de l’autre ? Cherchez, vous me direz. Il n’y a pas de risque. Nous pouvons nous en donner le plaisir.
N’est ce pas voilà du vrai bavardage? Comme entre nous pourtant, entre nous seuls. Je vivrais bien dix ans auprès de la Princesse de Poix. (C’est la Princesse et non pas la Duchesse) que je ne bavarderais pas ainsi avec elle. Vous lui trouvez donc de très grandes manières. Je l’ai beaucoup entendu dire, sans jamais en être frappé. Elle a une grosse voix, un gros visage, de gros bras de gros mouvements, du gros tant que vous voudrez mais rien de grand. Pour que les manières soient vraiment grandes, il faut quelque chose dans la personne, si peu que ce soit, quoi que ce soit, mais quelque chose, un peu d’esprit, un peu de beauté, un peu d’âme, quelque fierté de nature, quelque grâce dans la physionomie, quelque élégance dans les gestes, dans le langage. Quand il n’y a rien, absolument rien, les grandes manières ne sont plus que les manières de personnes, bien élevées et sures de leur fait. Je n’aime pas à prodiguer le nom de grand, même dans les plus petites occasions.
10 heures 1/2
Voilà votre N°53. Le facteur n’est pas en retard. Mais je suis encore très ému, très troublé de votre trouble. Ce n’est pas de chez moi, c’est de Lisieux que provient le retard. Je vous dirai comment. Mais soyez tranquille. Je gronderai comme il faut. Je gronde rarement, mais quand je gronde, on s’en souvient. Enfin cela n’arrivera plus. Adieu dearest, Adieu. Soignez-vous bien au moins. Soignez-vous toujours. Toujours. Adieu. Je traite ces deux mots comme vous. G.
55. Paris, Dimanche 1er octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
55. Dimanche 2 heures le 1er octobre
J’ai été prendre l’air, je revenais à vous qui êtes pour moi tout tout dans le monde. Hier au soir dans notre cabinet j’étais étendue sur ce canapé vert, Marie me lisait la Fronde. Je n’en écoutais pas un mot. Je rêvais. Je ne rêvais pas. Tout à coup il me prit une envie énorme d’être seule, et dans l’obscurité. Je renvoyai Marie, je fis enlever, les bougies, et je me mis à appeler tout bas par tous les noms, tous les épithètes les plus tendres, à adresser les paroles les plus intimes à cet être invisible & présent qui remplit toute mon âme. Vous ne sauriez croire ce qu’a été pour moi cette délicieuse demi-heure, je veux que vous l’imaginiez Monsieur, & votre lettre ce matin me prouve bien que cela ne vous sera pas difficile. Ah que des moments pareils font oublier de peines ! Eh bien et ce n’était qu’un rêve et ce rêve va devenir une réalité, et j’en ai joui.
Lundi 10 1/2. Je vous envoie le mauvais commencement de lettres, je ne sais plus ce que j’allais dire lorsqu’on m’annoncera M. de Médem. Notre entretien fut long et triste. Il n’a plus eu une parole consolante à me donner. Je ne sais vraiment que faire. Il croit mon frère dans le complot aussi. Alors il ne me resterait vraiment plus de ressource.
Ma journée a été agitée, j’ai mangé cependant, je suis sortie. J’ai vu du monde le soir, mais cette nuit. Cette nuit a été horrible. J’ai entendu sonné toutes les heures & les 1/2 heures. Il y en a une qui m’annonçait du bonheur qui me l’a apporté. Mes yeux se sont remplis de larmes, de larmes de joie, de reconnaissance, de tristesse. Je suis faible Monsieur, plus faible que ne l’ai cru en vous écrivant hier. Tout ceci est affreux, & ce n’est que le commencement. Ce premier moyen ne réussissant pas, on recourra à un autre, le dernier ! Je demande à M. de Médem, si cela est possible, il me répond que tout est possible quand on est autocrate. Monsieur quelle horreur, mon mari se séparerait de moi, il en aurait le puissance ? Vous voyez bien qu’il sera difficile que je vive jusque là.
Ces épreuves sont trop fortes pour moi aujourd’hui j’ai à peine la force de vous écrire deux mots, et c’est contre une faible créature comme moi que s’arme un puissant monarque ! Je ne veux pas parler de M. de Lieven. Il me répugne de dire tout ce que j’en pense. Monsieur c’est bien vous, vous seul sur la terre qui soutenez mon âme. Elle retourne vers vous dans ses angoisses, elle vous trouve toujours, toujours, elle s’attache à vous comme le lierre s’attache au chêne. Ah s’il n’y avait pas eu de 15 juin, où serais-je aujourd’hui ? Livrée à un homme pareil ! Je ne le connaissais pas, tout est nouveau pour moi dans ce qui m’arrive. J’en reste étourdie.
Monsieur vous me trouverez malade & changée vendredi. Je le suis beaucoup aujourd’hui. Dès que vous serez là, je serai mieux. Je le sens. Je suis fâchée de vous avoir mis dans le cas de répondre à ma sotte lettre de jeudi je ne devrais pas vous écrire tout ce qui traverse ma tête. Le dire, oui, c’est plus vite fait, plus vite répondu, plus vite effacé. Voilà pourquoi venez & restez. Oh je vous en conjure restez, ne m’abandonnez plus. Je n’ouvrirai plus une lettre de mon mari, vous les ouvrirez à l’avenir. De votre main j’accepterai les peines, il n’en est point qu’elle n’adoucisse quand j’entendrai le son de votre voix je pourrai tout supporter. Adieu. Adieu J’ai regret à tout ce que je vous dis. Vous aurez du chagrin pour moi, je le vois, je le sens. Je vous en demande pardon à genoux. Je vous en remercie à genoux. Adieu. Adieu.
J’ai été prendre l’air, je revenais à vous qui êtes pour moi tout tout dans le monde. Hier au soir dans notre cabinet j’étais étendue sur ce canapé vert, Marie me lisait la Fronde. Je n’en écoutais pas un mot. Je rêvais. Je ne rêvais pas. Tout à coup il me prit une envie énorme d’être seule, et dans l’obscurité. Je renvoyai Marie, je fis enlever, les bougies, et je me mis à appeler tout bas par tous les noms, tous les épithètes les plus tendres, à adresser les paroles les plus intimes à cet être invisible & présent qui remplit toute mon âme. Vous ne sauriez croire ce qu’a été pour moi cette délicieuse demi-heure, je veux que vous l’imaginiez Monsieur, & votre lettre ce matin me prouve bien que cela ne vous sera pas difficile. Ah que des moments pareils font oublier de peines ! Eh bien et ce n’était qu’un rêve et ce rêve va devenir une réalité, et j’en ai joui.
Lundi 10 1/2. Je vous envoie le mauvais commencement de lettres, je ne sais plus ce que j’allais dire lorsqu’on m’annoncera M. de Médem. Notre entretien fut long et triste. Il n’a plus eu une parole consolante à me donner. Je ne sais vraiment que faire. Il croit mon frère dans le complot aussi. Alors il ne me resterait vraiment plus de ressource.
Ma journée a été agitée, j’ai mangé cependant, je suis sortie. J’ai vu du monde le soir, mais cette nuit. Cette nuit a été horrible. J’ai entendu sonné toutes les heures & les 1/2 heures. Il y en a une qui m’annonçait du bonheur qui me l’a apporté. Mes yeux se sont remplis de larmes, de larmes de joie, de reconnaissance, de tristesse. Je suis faible Monsieur, plus faible que ne l’ai cru en vous écrivant hier. Tout ceci est affreux, & ce n’est que le commencement. Ce premier moyen ne réussissant pas, on recourra à un autre, le dernier ! Je demande à M. de Médem, si cela est possible, il me répond que tout est possible quand on est autocrate. Monsieur quelle horreur, mon mari se séparerait de moi, il en aurait le puissance ? Vous voyez bien qu’il sera difficile que je vive jusque là.
Ces épreuves sont trop fortes pour moi aujourd’hui j’ai à peine la force de vous écrire deux mots, et c’est contre une faible créature comme moi que s’arme un puissant monarque ! Je ne veux pas parler de M. de Lieven. Il me répugne de dire tout ce que j’en pense. Monsieur c’est bien vous, vous seul sur la terre qui soutenez mon âme. Elle retourne vers vous dans ses angoisses, elle vous trouve toujours, toujours, elle s’attache à vous comme le lierre s’attache au chêne. Ah s’il n’y avait pas eu de 15 juin, où serais-je aujourd’hui ? Livrée à un homme pareil ! Je ne le connaissais pas, tout est nouveau pour moi dans ce qui m’arrive. J’en reste étourdie.
Monsieur vous me trouverez malade & changée vendredi. Je le suis beaucoup aujourd’hui. Dès que vous serez là, je serai mieux. Je le sens. Je suis fâchée de vous avoir mis dans le cas de répondre à ma sotte lettre de jeudi je ne devrais pas vous écrire tout ce qui traverse ma tête. Le dire, oui, c’est plus vite fait, plus vite répondu, plus vite effacé. Voilà pourquoi venez & restez. Oh je vous en conjure restez, ne m’abandonnez plus. Je n’ouvrirai plus une lettre de mon mari, vous les ouvrirez à l’avenir. De votre main j’accepterai les peines, il n’en est point qu’elle n’adoucisse quand j’entendrai le son de votre voix je pourrai tout supporter. Adieu. Adieu J’ai regret à tout ce que je vous dis. Vous aurez du chagrin pour moi, je le vois, je le sens. Je vous en demande pardon à genoux. Je vous en remercie à genoux. Adieu. Adieu.
53. Val-Richer, Lundi 2 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°53. Lundi 2 Sept heures
Voici, mon avant dernière lettre. Vous l’aurez Mercredi. Je vous écrirai encore demain pour jeudi. Et vendredi, au lieu de lettre ce sera moi. Vous, vous m’écrirez Mercredi pour la dernière fois. Je prendrai votre lettre jeudi à Lisieux, d’où je partirai vers 2 heures. Voilà notre itinéraire lettres et personnes. Comment me plaindrais-je des détails que vous me donnez sur votre triste journée de Vendredi dernier ?
Jamais, dearest, quel qu’en soit le prix pour l’un ou l’autre de nous deux, jamais je ne me plaindrai que vous ayez trop d’affection pour moi, qu’elle soit trop vive, trop tendre, trop inquiète. Je mets l’affection, votre affection, au dessus de tout, même au dessus du bonheur qu’elle donne. Et pourtant il y a, dans l’excès de votre trouble, de votre mal, à la moindre circonstance quelque chose que je voudrais changer, qui pourrait changer sans que nous y perdissions rien. Je voudrais que votre esprit restât plus libres, qu’il vit les choses comme elles sont et mesurât un peu l’abyme où notre cœur se hâte de vous précipiter. Je connais l’empire sur notre imagination, sur Sous vos yeux quand je n’y suis pas moi-même. Il en faut tant, tant pour faire un petit, bien petit effet. Madame, je vous en conjure, restez telle que vous êtes ; n’ôtez rien de ce que vous me donnez de ce que vous me montrez, rien, pas même une crainte, pas même un tourment. Seulement sachez, sachons tous les deux que ces craintes sont folles, & connaissons le mal que nous ne pouvons guérir.
11 h.
J’aime mieux cet indigne procédé que toute autre chose. Je craignais je ne sais pas quoi. Adieu, dearest, ever dearest. Adieu. Il me semble que je ne vous ai rien dit du tout aujourd’hui. Que de choses je vous dirai le 6 ! Adieu. Adieu. G.
Voici, mon avant dernière lettre. Vous l’aurez Mercredi. Je vous écrirai encore demain pour jeudi. Et vendredi, au lieu de lettre ce sera moi. Vous, vous m’écrirez Mercredi pour la dernière fois. Je prendrai votre lettre jeudi à Lisieux, d’où je partirai vers 2 heures. Voilà notre itinéraire lettres et personnes. Comment me plaindrais-je des détails que vous me donnez sur votre triste journée de Vendredi dernier ?
Jamais, dearest, quel qu’en soit le prix pour l’un ou l’autre de nous deux, jamais je ne me plaindrai que vous ayez trop d’affection pour moi, qu’elle soit trop vive, trop tendre, trop inquiète. Je mets l’affection, votre affection, au dessus de tout, même au dessus du bonheur qu’elle donne. Et pourtant il y a, dans l’excès de votre trouble, de votre mal, à la moindre circonstance quelque chose que je voudrais changer, qui pourrait changer sans que nous y perdissions rien. Je voudrais que votre esprit restât plus libres, qu’il vit les choses comme elles sont et mesurât un peu l’abyme où notre cœur se hâte de vous précipiter. Je connais l’empire sur notre imagination, sur Sous vos yeux quand je n’y suis pas moi-même. Il en faut tant, tant pour faire un petit, bien petit effet. Madame, je vous en conjure, restez telle que vous êtes ; n’ôtez rien de ce que vous me donnez de ce que vous me montrez, rien, pas même une crainte, pas même un tourment. Seulement sachez, sachons tous les deux que ces craintes sont folles, & connaissons le mal que nous ne pouvons guérir.
11 h.
J’aime mieux cet indigne procédé que toute autre chose. Je craignais je ne sais pas quoi. Adieu, dearest, ever dearest. Adieu. Il me semble que je ne vous ai rien dit du tout aujourd’hui. Que de choses je vous dirai le 6 ! Adieu. Adieu. G.
54. Val-Richer, Lundi 2 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°54 Lundi 2 10 h 1/2 du soir
Je pars demain de bonne heure pour Mézidon. On m’y apportera votre lettre. J’espère que celle-ci n’essuiera pas de retard. Je ne vous en dirai pas long. Je n’ai plus cœur à écrire à la veille de vous retrouver, mon mépris pour l’écriture me reprend. J’ai pourtant sur ce qui vous est arrivé de M. de Lieven bien des choses à vous dire, bien des détails à vous demander. Je me persuade quelques fois que les despotes ont le sort des méchants maris. Tout le monde s’entend pour les tromper. On a l’air de faire tout ce qu’ils veulent ; on ne se refuse à rien ; on va au devant de tout. Et puis rien ne se fait, rien ne s’exécute. Cependant j’ai peur qu’il n’y ait ici un peu de sérieux. Je ne puis m’empêcher de redire, comme ce matin, je craignais davantage. Je craignais quelque chose de plus pénible, de plus embarrassant pour vous. Vous me mettrez bien au courant de votre situation. Nous ferons vos comptes. J’ai besoin d’avoir l’esprit tranquille pour vous à ce sujet.
Quoique ce ne soit pas Dimanche, j’ai eu des visites presque tout le jour. On m’a apporté mes cygnes. Je les ai établis sur la pièce d’eau. Le mâle est très beau, la femelle un peu malade. Elle a les plumes des ailes roses. C’est le sang qui s’y porte, m’a dit le jardinier qui l’a élevée. Il m’assure qu’elle guérira parfaitement & sera aussi belle que le mâle. Ces pauvres oiseaux étaient depuis trois jours hors de leur étang. Quand on les a lancés sur le mien, ils sont partis ensemble côte à côte, parfaitement de front, et sont allés avec la rapidité de la flèche s’enfoncer tout au bout, dans les roseaux du rivage, loin de ceux qui les regardaient. Puis au bout de quelques minutes, ils sont sortis de là, et toujours côte à côte toujours de front s’arrêtant ensemble, repartant ensemble, ils ont fait le tour de la pièce d’eau et l’ont parcourue, en tous sens comme pour prendre ensemble possession de leur demeure. Ils me faisaient envie.
Je ne suis pas surpris que la petite Princesse se soit ennuyée à Maintenon. Le Duc de Noailles tout galant homme qu’il est, a l’air de n’avoir qu’une vie d’emprunt. Quand il est seul, il ne doit pas vivre du tout. Ai- je encore quelque chose d’insignifiant à vous dire ? Je ne cherche que cela. J’ai tout épuisé, ce me semble. A vendredi ce qui est inépuisable.
Adieu. Pour ce soir, cet adieu là. Je vais me coucher. Demain, avant de partir, je vous dirai encore adieu. Je passerai toute la journée hors de chez moi. Le dîner sera long et je vais le chercher loin. Adieu Adieu.
Mardi 8 heures
Je pars tout à l’heure. Il fait un temps admirable. Ma vallée est verte comme il y a trois mois. Pas trace d’automne encore. Si je partais avec vous ce matin, pour aller faire, par ce beau soleil, une longue promenade dans les bois, dans les près, quel charme ! Adieu. Adieu. Vendredi, je ne désirerai rien. Adieu. G.
Je pars demain de bonne heure pour Mézidon. On m’y apportera votre lettre. J’espère que celle-ci n’essuiera pas de retard. Je ne vous en dirai pas long. Je n’ai plus cœur à écrire à la veille de vous retrouver, mon mépris pour l’écriture me reprend. J’ai pourtant sur ce qui vous est arrivé de M. de Lieven bien des choses à vous dire, bien des détails à vous demander. Je me persuade quelques fois que les despotes ont le sort des méchants maris. Tout le monde s’entend pour les tromper. On a l’air de faire tout ce qu’ils veulent ; on ne se refuse à rien ; on va au devant de tout. Et puis rien ne se fait, rien ne s’exécute. Cependant j’ai peur qu’il n’y ait ici un peu de sérieux. Je ne puis m’empêcher de redire, comme ce matin, je craignais davantage. Je craignais quelque chose de plus pénible, de plus embarrassant pour vous. Vous me mettrez bien au courant de votre situation. Nous ferons vos comptes. J’ai besoin d’avoir l’esprit tranquille pour vous à ce sujet.
Quoique ce ne soit pas Dimanche, j’ai eu des visites presque tout le jour. On m’a apporté mes cygnes. Je les ai établis sur la pièce d’eau. Le mâle est très beau, la femelle un peu malade. Elle a les plumes des ailes roses. C’est le sang qui s’y porte, m’a dit le jardinier qui l’a élevée. Il m’assure qu’elle guérira parfaitement & sera aussi belle que le mâle. Ces pauvres oiseaux étaient depuis trois jours hors de leur étang. Quand on les a lancés sur le mien, ils sont partis ensemble côte à côte, parfaitement de front, et sont allés avec la rapidité de la flèche s’enfoncer tout au bout, dans les roseaux du rivage, loin de ceux qui les regardaient. Puis au bout de quelques minutes, ils sont sortis de là, et toujours côte à côte toujours de front s’arrêtant ensemble, repartant ensemble, ils ont fait le tour de la pièce d’eau et l’ont parcourue, en tous sens comme pour prendre ensemble possession de leur demeure. Ils me faisaient envie.
Je ne suis pas surpris que la petite Princesse se soit ennuyée à Maintenon. Le Duc de Noailles tout galant homme qu’il est, a l’air de n’avoir qu’une vie d’emprunt. Quand il est seul, il ne doit pas vivre du tout. Ai- je encore quelque chose d’insignifiant à vous dire ? Je ne cherche que cela. J’ai tout épuisé, ce me semble. A vendredi ce qui est inépuisable.
Adieu. Pour ce soir, cet adieu là. Je vais me coucher. Demain, avant de partir, je vous dirai encore adieu. Je passerai toute la journée hors de chez moi. Le dîner sera long et je vais le chercher loin. Adieu Adieu.
Mardi 8 heures
Je pars tout à l’heure. Il fait un temps admirable. Ma vallée est verte comme il y a trois mois. Pas trace d’automne encore. Si je partais avec vous ce matin, pour aller faire, par ce beau soleil, une longue promenade dans les bois, dans les près, quel charme ! Adieu. Adieu. Vendredi, je ne désirerai rien. Adieu. G.
56. Paris, Mardi 3 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
56. Mardi 3 octobre. 9 heures
J’ai dormi cette nuit. Si vous aviez pu me voir hier vous trouverez que c’est la nouvelle la plus importante que je puisse avoir à vous donner. J’ai vu au visage de toutes les personnes que j’ai rencontrées que le mien était effrayant. Maintenant je reprends mon journal. Mon médecin est resté hier longtemps avec moi, il m’a trouvé si agitée, en si pitoyable état que le pauvre homme en était tout troublé & attendri. Il me dit que tout cela me fait bien du mal. Il ne n’apprend rien de nouveau. Je n’ai pas eu la force de marcher hier pas même dans ma chambre. Il m’a recommandé la calèche pour toute la matinée. Et en effet, je m’y suis fait traîner pendant quatre heures. J’y ai dormi même.
J’y ai vu Lady Granville, à elle j’ai tout dit. Vous concevez l’indignation, l’étonnement d’un anglais ! Elle veut que ces sentiments prononcés bien unanimement par tout ce que j’ai d’amis en Angleterre rappellent à l’autocrate ce qu’est l’opinion qu’on porte de lui, et elle sait qu’il en a peur puisqu’il se met à couvert sous l’égide de mon mari. Mais quoi ? Ce sont de belles paroles. Je ne doute pas de mes amis. Mais où sont les marques de manifester cet intérêt ? Ils n’existent pas. It is alltogether a very bad case qui peut devenir pire et dont je dois nécessairement être victime, mais rien ne me forcera à la soumission, vous le savez bien, et ceci est indépendant du 15 juin. Je veux laisser là ce sujet. Vendredi nous en parlerons. En attendant je suis décidée à ne par écrire un mot ni à mon mari, ni à mon frère jusqu’à ce que je vous aie vu. Je veux vos conseils, si je pouvais oublier la Russie jus qu’à ce moment-là.
Savez-vous que c’est possible, car enfin dans trois jours vous serez là, près de moi. Il me parait que je ne saurais penser à autre chose. Ah mon Dieu si on me laissait tranquille ! Que je suis heureuse, heureuse que vos lettres m’en donnent tous les jours davantage la certitude ! Quelle douceur Monsieur quelle félicité d’être aimée comme cela !
Je n’ai quitté ma calèche que pour faire ma toilette pour le dîner de Mad. de Castellane. J’y ai trouvé la petite princesse, M. Molé, Pozzo, & M. Salmandy. Je crois qu’on a été gai, je crois que j’ai essayé de ne pas trop faire contraste avec les autres à 9 heures je suis partie et en rentrant je me suis couchée. ma porte était fermée, Marie était chez lady Granville, & je l’avais prié d’y faire venir également mon ambassadeur & la petite Princesse afin qu’ils ne se trouvassent pas sur le pavé. Je sentais qu’il me fallait du repos, j’ai dormi, pas bien, dormi, mais enfin c’était quelque chose qui ressemblait à du sommeil.
Ce matin dans mon lit, votre lettre que j’aime tant ! Vous étiez troublé du chagrin que m’avait causé le bureau de poste de Lisieux. Vous allez l’être de mes affaires, il me parait que je ne vous donne que du souci, et je vous dis vrai en vous assurant que cela me trouble moi autant que mes propres chagrins. Mais il y a quelque chose qui domine tout cela, qui laisse bien loin en arrière toutes ces misères de la vie, quelque chose qui grandit qui se fortifie à raison même des vicissitudes, des contrariétés qui peuvent se rencontrer sur notre route. Ah, je suis bien riche de cette fortune là.
Monsieur il y a des moments où je suis presque aise des épreuves que j’ai à subir. J’en deviens plus fière, plus grande. Ah qu’ils se trompent lesquels qui croient m’humilier ou me faire fléchir. Midi. Il fait très beau, il me faut de l’air, je vais au bois de Boulogne. Je ne vous quitte que pour cela parce qu’il me faut cela pour essayer de reprendre ce que ces derniers jours m’ont fait perdre. Vous ne sauriez concevoir comme je perds vite & comme je regagne lentement. J’étais mieux bien mieux qu’à votre départ, je me faisais un petit plaisir, un grand plaisir de celui que cela vous donnerait & bien tout est parti. J’en suis désolée.
Le mariage va. Le roi de Würtemberg s’est adouci, les fils seront protestants & on ne parlera pas des filles. Adieu. L’adieu que nous aimons tant.
J’ai dormi cette nuit. Si vous aviez pu me voir hier vous trouverez que c’est la nouvelle la plus importante que je puisse avoir à vous donner. J’ai vu au visage de toutes les personnes que j’ai rencontrées que le mien était effrayant. Maintenant je reprends mon journal. Mon médecin est resté hier longtemps avec moi, il m’a trouvé si agitée, en si pitoyable état que le pauvre homme en était tout troublé & attendri. Il me dit que tout cela me fait bien du mal. Il ne n’apprend rien de nouveau. Je n’ai pas eu la force de marcher hier pas même dans ma chambre. Il m’a recommandé la calèche pour toute la matinée. Et en effet, je m’y suis fait traîner pendant quatre heures. J’y ai dormi même.
J’y ai vu Lady Granville, à elle j’ai tout dit. Vous concevez l’indignation, l’étonnement d’un anglais ! Elle veut que ces sentiments prononcés bien unanimement par tout ce que j’ai d’amis en Angleterre rappellent à l’autocrate ce qu’est l’opinion qu’on porte de lui, et elle sait qu’il en a peur puisqu’il se met à couvert sous l’égide de mon mari. Mais quoi ? Ce sont de belles paroles. Je ne doute pas de mes amis. Mais où sont les marques de manifester cet intérêt ? Ils n’existent pas. It is alltogether a very bad case qui peut devenir pire et dont je dois nécessairement être victime, mais rien ne me forcera à la soumission, vous le savez bien, et ceci est indépendant du 15 juin. Je veux laisser là ce sujet. Vendredi nous en parlerons. En attendant je suis décidée à ne par écrire un mot ni à mon mari, ni à mon frère jusqu’à ce que je vous aie vu. Je veux vos conseils, si je pouvais oublier la Russie jus qu’à ce moment-là.
Savez-vous que c’est possible, car enfin dans trois jours vous serez là, près de moi. Il me parait que je ne saurais penser à autre chose. Ah mon Dieu si on me laissait tranquille ! Que je suis heureuse, heureuse que vos lettres m’en donnent tous les jours davantage la certitude ! Quelle douceur Monsieur quelle félicité d’être aimée comme cela !
Je n’ai quitté ma calèche que pour faire ma toilette pour le dîner de Mad. de Castellane. J’y ai trouvé la petite princesse, M. Molé, Pozzo, & M. Salmandy. Je crois qu’on a été gai, je crois que j’ai essayé de ne pas trop faire contraste avec les autres à 9 heures je suis partie et en rentrant je me suis couchée. ma porte était fermée, Marie était chez lady Granville, & je l’avais prié d’y faire venir également mon ambassadeur & la petite Princesse afin qu’ils ne se trouvassent pas sur le pavé. Je sentais qu’il me fallait du repos, j’ai dormi, pas bien, dormi, mais enfin c’était quelque chose qui ressemblait à du sommeil.
Ce matin dans mon lit, votre lettre que j’aime tant ! Vous étiez troublé du chagrin que m’avait causé le bureau de poste de Lisieux. Vous allez l’être de mes affaires, il me parait que je ne vous donne que du souci, et je vous dis vrai en vous assurant que cela me trouble moi autant que mes propres chagrins. Mais il y a quelque chose qui domine tout cela, qui laisse bien loin en arrière toutes ces misères de la vie, quelque chose qui grandit qui se fortifie à raison même des vicissitudes, des contrariétés qui peuvent se rencontrer sur notre route. Ah, je suis bien riche de cette fortune là.
Monsieur il y a des moments où je suis presque aise des épreuves que j’ai à subir. J’en deviens plus fière, plus grande. Ah qu’ils se trompent lesquels qui croient m’humilier ou me faire fléchir. Midi. Il fait très beau, il me faut de l’air, je vais au bois de Boulogne. Je ne vous quitte que pour cela parce qu’il me faut cela pour essayer de reprendre ce que ces derniers jours m’ont fait perdre. Vous ne sauriez concevoir comme je perds vite & comme je regagne lentement. J’étais mieux bien mieux qu’à votre départ, je me faisais un petit plaisir, un grand plaisir de celui que cela vous donnerait & bien tout est parti. J’en suis désolée.
Le mariage va. Le roi de Würtemberg s’est adouci, les fils seront protestants & on ne parlera pas des filles. Adieu. L’adieu que nous aimons tant.
57. Paris, Mercredi 4 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
57. Mercredi 4 octobre, 11 heures
Que j’aime votre lettre ce matin, que Je l’aime ! C’est moi que le Ciel a traité " avec magnificence." Phrase que j’ai trouvée dans l’une de vos dernières lettres. Je reconnais ce bienfait. Je l’en remercie tous les jours, à tout instant, plus que jamais aujourd’hui. J’ai le cœur plein, plein de vous, de vous seul. Mes peines s’effacent devant un mot tracé de votre main ; et je vais vous revoir !
Ma journée a été pénible hier. J’ai fait ce que j’ai pu. J’ai pris l’air à peu près tout le jour, mais je me sens très oppressée. Le soir je n’ai eu que la petite princesse, son mari, & mon ambassadeur. Il les a laissé partir pour rester seul avec moi. J’ai répété l’entretien que nous avons eu ensemble par l’agitation qu’il m’a laissée et la très mauvaise nuit qui s’en est suivi, mais je suis bien aise d’avoir acquis la certitude que c’est un homme d’honneur & un vrai gentilhomme. Ce n’est pas là les qualités qu’il a reconnues dans le procédé de mon mari. Il l’a qualifié avec une droiture & une rudesse très militaires. Il ne peut pas se persuader qu’il puisse persister dans cette voie, mais il reconnait également qu’il n’y a plus que l’omnipotent Tsar qui puisse le relever du vœu qu’il semble avoir fait dans ce but le seul moyen est mon frère. Mais mon frère vaudra-t-il mieux que mon mari, voilà la question. J’écrirai à mon frère, au comte Orloff. J’ai même commencé mais je vous avoue que le cœur me manque aussi bien que les forces. J’ai tant à dire. Je voudrais que ce fut dit de façon à rendre toute réplique impossible,et à imposer l’obligation de me faire rendre justice sur le champs. Vous m’aiderez à cela & je vous attends. à mon mari, je demanderai seulement s’il croit que je ferai pour de l’argent ce que je n’eusse pas fait par devoir ou par inclination ? à tous les trois je demanderai que l’ambassadeur soit interrogé. Il le désire. Je suis si souffrante que ma pauvre Je voudrais tête ne va plus du tout ! Je voudrais vous écrire des volumes, mais je n’ai plus de forces.
Quel bonheur voici ma dernière lettre. Si je pouvais dormir avant vendredi ; si je pouvais ne pas trop vous effrayer par me pauvre mine. Adieu. Adieu, toujours, toujours adieu.
Que j’aime votre lettre ce matin, que Je l’aime ! C’est moi que le Ciel a traité " avec magnificence." Phrase que j’ai trouvée dans l’une de vos dernières lettres. Je reconnais ce bienfait. Je l’en remercie tous les jours, à tout instant, plus que jamais aujourd’hui. J’ai le cœur plein, plein de vous, de vous seul. Mes peines s’effacent devant un mot tracé de votre main ; et je vais vous revoir !
Ma journée a été pénible hier. J’ai fait ce que j’ai pu. J’ai pris l’air à peu près tout le jour, mais je me sens très oppressée. Le soir je n’ai eu que la petite princesse, son mari, & mon ambassadeur. Il les a laissé partir pour rester seul avec moi. J’ai répété l’entretien que nous avons eu ensemble par l’agitation qu’il m’a laissée et la très mauvaise nuit qui s’en est suivi, mais je suis bien aise d’avoir acquis la certitude que c’est un homme d’honneur & un vrai gentilhomme. Ce n’est pas là les qualités qu’il a reconnues dans le procédé de mon mari. Il l’a qualifié avec une droiture & une rudesse très militaires. Il ne peut pas se persuader qu’il puisse persister dans cette voie, mais il reconnait également qu’il n’y a plus que l’omnipotent Tsar qui puisse le relever du vœu qu’il semble avoir fait dans ce but le seul moyen est mon frère. Mais mon frère vaudra-t-il mieux que mon mari, voilà la question. J’écrirai à mon frère, au comte Orloff. J’ai même commencé mais je vous avoue que le cœur me manque aussi bien que les forces. J’ai tant à dire. Je voudrais que ce fut dit de façon à rendre toute réplique impossible,et à imposer l’obligation de me faire rendre justice sur le champs. Vous m’aiderez à cela & je vous attends. à mon mari, je demanderai seulement s’il croit que je ferai pour de l’argent ce que je n’eusse pas fait par devoir ou par inclination ? à tous les trois je demanderai que l’ambassadeur soit interrogé. Il le désire. Je suis si souffrante que ma pauvre Je voudrais tête ne va plus du tout ! Je voudrais vous écrire des volumes, mais je n’ai plus de forces.
Quel bonheur voici ma dernière lettre. Si je pouvais dormir avant vendredi ; si je pouvais ne pas trop vous effrayer par me pauvre mine. Adieu. Adieu, toujours, toujours adieu.
57_1. Paris Jeudi 5 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (14 septembre - 5 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
9. h du soir jeudi.
Je veux que vous trouviez un mot avant de vous coucher demain matin. Adieu toujours adieu serait le plus naturel à vous dire. Je n’en trouve pas d’autre je ne trouve rien tant je suis heureuse en pensant à demain. 1 h. 1/2. Il me semble que ce petit morceau de papier va reposer avec vous. Je le traite en conséquence. Adieu. Adieu. Adieu.
Je veux que vous trouviez un mot avant de vous coucher demain matin. Adieu toujours adieu serait le plus naturel à vous dire. Je n’en trouve pas d’autre je ne trouve rien tant je suis heureuse en pensant à demain. 1 h. 1/2. Il me semble que ce petit morceau de papier va reposer avec vous. Je le traite en conséquence. Adieu. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Relation François-Dorothée
55. Lisieux, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°55. Lisieux. Vendredi 7 h. 1/2
Un seul mot deux c’est-à-dire, car encore cette fois, il ne faut pas que vous soyez un jour sans lettre. C’est la dernière fois. A partir du 30 octobre, je ne vous écrirai plus, plus du tout. Je ne saurais dire, je n’essaierai pas de dire avec quelle joie je pèse à ce retour là, le seul vrai retour, le seul auquel ne se mêlera aucune arrière pensée. Comme je vais précipiter les jours ! Avec quel plaisir je les verrai tomber ! Et puis, quand je serai revenu, quand je serai rétabli près de vous comme je redeviendrai avare du temps ! Je suis épouvanté de sa fuite si rapide depuis huit jours, Sera-ce ainsi ? Les semaines s’évanouiront-elles comme des heures ? Nous n’en perdrons rien au moins, n’est-ce pas ? Nous ne laisserons à l’étranger, à l’ennemi, rien de ce que nous pourrons lui ôter. Adieu adieu. Voilà des visites qu’on m’annonce. C’est venir bien matin. Il faudra pourtant que je vous écrive encore un mot. Adieu. Demain ce sera mieux. Je veux dire ma lettre, non pas mon adieu. G.
Un seul mot deux c’est-à-dire, car encore cette fois, il ne faut pas que vous soyez un jour sans lettre. C’est la dernière fois. A partir du 30 octobre, je ne vous écrirai plus, plus du tout. Je ne saurais dire, je n’essaierai pas de dire avec quelle joie je pèse à ce retour là, le seul vrai retour, le seul auquel ne se mêlera aucune arrière pensée. Comme je vais précipiter les jours ! Avec quel plaisir je les verrai tomber ! Et puis, quand je serai revenu, quand je serai rétabli près de vous comme je redeviendrai avare du temps ! Je suis épouvanté de sa fuite si rapide depuis huit jours, Sera-ce ainsi ? Les semaines s’évanouiront-elles comme des heures ? Nous n’en perdrons rien au moins, n’est-ce pas ? Nous ne laisserons à l’étranger, à l’ennemi, rien de ce que nous pourrons lui ôter. Adieu adieu. Voilà des visites qu’on m’annonce. C’est venir bien matin. Il faudra pourtant que je vous écrive encore un mot. Adieu. Demain ce sera mieux. Je veux dire ma lettre, non pas mon adieu. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée
56. Lisieux, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°56. Lisieux 8 h. 1/4
Voici mon second mot. Je monte en voiture dans cinq minutes. Il me serait désagréable qu’après demain, vous ne vissiez pas de mon écriture. On devient enfant, et on reste et on restera enfant. Je ne suis point fatigué. Le beau temps continue. Promenez-vous donc longtemps, doucement. Faites provision d’air, de force, d’embonpoint de tout, de tout. Que c’est ridicule d’écrire si peu quand on pourrait tant dire, d’avoir la main si vide et le cœur si plein ! Mais vous savez que je n’aime pas les quasi expressions, le quasi langage. Adieu donc. Je ne veux rien ajouter. Je veux finir par adieu. G.
Voici mon second mot. Je monte en voiture dans cinq minutes. Il me serait désagréable qu’après demain, vous ne vissiez pas de mon écriture. On devient enfant, et on reste et on restera enfant. Je ne suis point fatigué. Le beau temps continue. Promenez-vous donc longtemps, doucement. Faites provision d’air, de force, d’embonpoint de tout, de tout. Que c’est ridicule d’écrire si peu quand on pourrait tant dire, d’avoir la main si vide et le cœur si plein ! Mais vous savez que je n’aime pas les quasi expressions, le quasi langage. Adieu donc. Je ne veux rien ajouter. Je veux finir par adieu. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée
58. Paris, Vendredi 13 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
58. Vendredi 10 octobre 9 h. 1/2
J’ai fait de 5 à 6 ma promenade habituelle au bois de Boulogne. Il n’y avait plus une âme. Marie est restée en calèche, j’ai marché seule dans le bois comme vous marchez dans le vôtre. Le jour commençait à tomber et la fin de ma promenade à pied a été éclairée à la fois par le soleil couchant, & par la lune qui se levait au dessus de Paris à cette heure là je pouvais encore. regarder Paris avec amour. Je suis remontée en calèche, je me suis fait mener chez Lady Granville j’y suis restée jusqu’au moment où j’ai vu à sa pendule que Paris était fini pour moi. En rentrant, j’ai dîné à 7 1/2 je me suis retrouvée dans notre cabinet un frisson m’a saisi en mettant le pied. J’ai tout retrouvé comme je l’avais laissé. Le coussin brodé était foulé, c’est sur lui que je me suis reposée. Je n’ai pas voulu de lecture. Je suis restée silencieuse, immobile rappelant le passé, rêvant l’avenir il n’y a pas de présent pour moi.
Mon ambassadeur a été le premier à venir le soir. Il venait de recevoir une lettre de Genève de son frère que lui dit que mon mari m’attendait sous peu de jours. C’est de sa bouche qu’il le tenait. M. de Pahlen, a exprimé quelques doutes (il m’a quittée il y a quinze jours et je lui ai dit que je ne bougerais pas.) cela n’a pas dérangé mon mari. Il a répété que j’allais arriver. Il ne doutait pas de l’infaillibilité de sa menace !
Pozzo, l’ambassadeur de Sardaigne Madame Durazzo, Madame de Flahaut sont venus. M. de Pahlen était horriblement inquiet de ne pas vous voir. Il vous a fait visite, & vous êtes parti sans le savoir, il ne s’en consolera jamais. Je l’ai rassuré quand il m’a nommé l’heure à laquelle il avait passé chez vous.
à onze h. 1/2 j’étais dans mon lit, j’y avais pris de la lecture pour mon réveil. J’ai entendu sonner deux heures, quatre heures & six heures à chaque fois j’appelais bien bas, la lettre cachetée me répondait et je me rendormais doucement, délicieusement. à 9 heures on a ouvert les volets. J’ai lu, ma vue s’est troublée. Mon cœur a battu bien fort. Ah! Il n’y a plus que la présence qui puisse surpasser, égaler, ce que m’a fait éprouver cette lettre. Et j’ai pu parler dédaigneusement d’une lettre ! Bon Dieu quelle lettre !
Midi. Je l’ai relue ; je la relirai, tous les jours jusqu’à la fin de ma vie, oui tous les jours. Elle occupera une place que rien n’a occupé encore elle sera là toujours, près de moi, sur moi, sur ce cœur auquel elle révèle les joies du paradis. Adieu éternellement adieu.
J’ai fait de 5 à 6 ma promenade habituelle au bois de Boulogne. Il n’y avait plus une âme. Marie est restée en calèche, j’ai marché seule dans le bois comme vous marchez dans le vôtre. Le jour commençait à tomber et la fin de ma promenade à pied a été éclairée à la fois par le soleil couchant, & par la lune qui se levait au dessus de Paris à cette heure là je pouvais encore. regarder Paris avec amour. Je suis remontée en calèche, je me suis fait mener chez Lady Granville j’y suis restée jusqu’au moment où j’ai vu à sa pendule que Paris était fini pour moi. En rentrant, j’ai dîné à 7 1/2 je me suis retrouvée dans notre cabinet un frisson m’a saisi en mettant le pied. J’ai tout retrouvé comme je l’avais laissé. Le coussin brodé était foulé, c’est sur lui que je me suis reposée. Je n’ai pas voulu de lecture. Je suis restée silencieuse, immobile rappelant le passé, rêvant l’avenir il n’y a pas de présent pour moi.
Mon ambassadeur a été le premier à venir le soir. Il venait de recevoir une lettre de Genève de son frère que lui dit que mon mari m’attendait sous peu de jours. C’est de sa bouche qu’il le tenait. M. de Pahlen, a exprimé quelques doutes (il m’a quittée il y a quinze jours et je lui ai dit que je ne bougerais pas.) cela n’a pas dérangé mon mari. Il a répété que j’allais arriver. Il ne doutait pas de l’infaillibilité de sa menace !
Pozzo, l’ambassadeur de Sardaigne Madame Durazzo, Madame de Flahaut sont venus. M. de Pahlen était horriblement inquiet de ne pas vous voir. Il vous a fait visite, & vous êtes parti sans le savoir, il ne s’en consolera jamais. Je l’ai rassuré quand il m’a nommé l’heure à laquelle il avait passé chez vous.
à onze h. 1/2 j’étais dans mon lit, j’y avais pris de la lecture pour mon réveil. J’ai entendu sonner deux heures, quatre heures & six heures à chaque fois j’appelais bien bas, la lettre cachetée me répondait et je me rendormais doucement, délicieusement. à 9 heures on a ouvert les volets. J’ai lu, ma vue s’est troublée. Mon cœur a battu bien fort. Ah! Il n’y a plus que la présence qui puisse surpasser, égaler, ce que m’a fait éprouver cette lettre. Et j’ai pu parler dédaigneusement d’une lettre ! Bon Dieu quelle lettre !
Midi. Je l’ai relue ; je la relirai, tous les jours jusqu’à la fin de ma vie, oui tous les jours. Elle occupera une place que rien n’a occupé encore elle sera là toujours, près de moi, sur moi, sur ce cœur auquel elle révèle les joies du paradis. Adieu éternellement adieu.
57. Val-Richer, Vendredi 13 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°57. J’ai oublié de numéroter mes deux billets de Lisieux. Ils doivent faire les N°55 et 56.
Vendredi 13. 4 heures
Savez-vous que ce sera un supplice de vous écrire directement, du ton dont nous sommes convenus ? J’avais déjà tant de peine à me dire que ce que je vous disais ! Il faudra encore en rabattre, beaucoup. Aussi, je me décide pour aujourd’hui à la voie indirecte. J’abuserai de mon pauvre Génie. Du reste, je l’en ai prévenu hier à 6 heures en montant en voiture, et tout sera fait comme nous l’avons réglé. Mais dites-moi si vous le pouvez jusqu’où je puis aller par la voie directe et quotidienne. Vous m’avez donné une pierre de touche telle qu’en vérité, si je m’y conforme, je vous enverrai un bulletin de ma santé en vous en demandant un de la vôtre Des lettres qui puissent être lues par M. de Lieven ! Je n’en reconnais pas moins la nécessité. Durera-t-elle longtemps ? Serons-nous longtemps dans cette attente ? En tous cas, ce ne pourra être plus de 18 jours.
Je viens d’arranger mon départ avec toute ma maison. Tout est convenu. Le 30 nous irons coucher à Evreux et dîner le 31 à Paris. Je respire en vous disant cela, et j’en ai besoin, car depuis hier j’étouffe. J’ai étouffé cette nuit ce matin, jusqu’à ce moment. Je suis épouvanté de mon bonheur. Je ne sais plus m’en passer. Quel abyme insatiable que notre cœur! un abyme, comme celui d’un mélodrame que j’ai vu jouer autrefois, qui s’appelait le Précipice, et où l’on précipitait en effet l’innocent dans un abyme de 600 pieds sans fond. Oui, un abyme de 600 pieds sans fond. Voilà ce qu’est devenu pour vous mon cœur. Avant le 15 juin, si l’on m’avait fait entrevoir une correspondance un peu amicale, un peu régulière avec une personne comme vous une personne d’esprit, bien au courant du monde, j’aurais trouvé cela charmant ; je me serais promis au moins un jour très agréable par semaine. Pendant que vous étiez en Angleterre, si l’on m’avait dit que vous reviendriez bientôt en France, et que je ne passerais jamais un mois sans en passer cinq ou six jours avec vous, je me serais cru heureux. Et bien Madame; je ne le suis pas; je ne le suis pas malgré hier, malgré avant-hier, malgré la certitude que dans 18 jours, je retrouverai hier au moins hier, n’est-ce pas ? Je suis devenu insatiable, je resterai insatiable. Vous, vous dont la simple vue fait épanouir tout mon être dont la moindre parole me charme et qui avez pour moi des paroles dont le souvenir, le seul souvenir me plonge dans l’extase, vous ne pouvez pas me rassasier. il n’est pas en votre pouvoir d’apaiser, de combler mon âme. De vous, tout la ravit et rien ne lui suffit. Vous êtes pour moi une source de délices infinies, et moi, j’ai une puissance infinie pour les désirer, pour en jouir; et quelque heureux que je sois par vous, près de vous, je sens que je puis, que je dois l’être encore davantage; et j’aspire avec une ardeur infatigable à ce bonheur inépuisable qui me vient de vous et qui chaque fois qu’il me vient me promet plus encore qu’il ne me donne et m’inspire encore plus de désirs qu’il n’en satisfait, savez-vous ce qui sépuise ce qui se lasse en moi ? La parole. J’arrive d’un coup à ses limites, et là je m’indigne et mon cœur s’élance bien loin au delà. Mais vous n’êtes pas là pour l’entendre sans qu’il parle ; et en même temps que la parole lui manque, le silence lui pèse horriblement.
Samedi 9 heures
J’ai dormi longtemps, en me réveillant souvent. Chaque fois que je me réveillais, je me disais: à une heure et demie. Et il me fallait un réveil complet et une réflexion pour me détromper. On a bien de la peine à apprendre que les choses ne sont pas dans la vie comme dans le cœur. Le premier mouvement est toujours de croire à l’harmonie de ces deux mondes, tant celui du dedans est le monde vrai, le monde souverain. L’autre nuit en roulant dans cette voiture, le ciel était pur, la lune se répandait partout, vous deviez être là comme moi, jouir avec moi de cette lumière si douce et si pénétrante ; vous deviez sortir de ces longues ombres des arbres qui semblaient cacher quelque objet et s’avancer vers moi à mesure que je marchais. Ce matin, je ne marche pas, je suis dans mon cabinet à ma table, près de mon feu. Mais le soleil brille, la vallée où les feuilles commencent à tomber, laisse entrevoir des percées profondes où la lumière entre et se perd ; tout est beau et invitant devant moi, sous mes fenêtres, partout où se porte ma vue. Je vous vois partout, je vous mets partout, partout où quelque chose me plaît et m’attire. Ce matin, comme cette nuit, comme l’autre nuit, la réflexion seule m’apprend que vous n’êtes pas là. Il faut que je le découvre ! D’instinct, je vous crois avec moi, toujours avec moi.
J’ai trouvé tous les miens en bon état. Ma mère est mieux que je ne l’avais laissée ; mes enfants sont à merveille. Savez-vous que je ne jouis de leur présence, de leur joie, qu’avec un peu d’hésitation et de mélange ? Je voudrais vous en envoyer la moitié. Une impression à moi seul un plaisir à moi seul m’étonne presque comme un contresens. N’ayez jamais d’impression, de plaisir à vous seule ! J’en serais plus qu’étonné. Vous pouvez me pardonner cette exigence toutes les exigences. Je les aurai toutes. Mais j’en ai le droit, oui, le plein droit.
11 heures
Voilà votre n° 56. Oui éternellement adieu. C’est là que tous les sentiments s’unissent et se satisfont. Adieu. Adieu.
Vendredi 13. 4 heures
Savez-vous que ce sera un supplice de vous écrire directement, du ton dont nous sommes convenus ? J’avais déjà tant de peine à me dire que ce que je vous disais ! Il faudra encore en rabattre, beaucoup. Aussi, je me décide pour aujourd’hui à la voie indirecte. J’abuserai de mon pauvre Génie. Du reste, je l’en ai prévenu hier à 6 heures en montant en voiture, et tout sera fait comme nous l’avons réglé. Mais dites-moi si vous le pouvez jusqu’où je puis aller par la voie directe et quotidienne. Vous m’avez donné une pierre de touche telle qu’en vérité, si je m’y conforme, je vous enverrai un bulletin de ma santé en vous en demandant un de la vôtre Des lettres qui puissent être lues par M. de Lieven ! Je n’en reconnais pas moins la nécessité. Durera-t-elle longtemps ? Serons-nous longtemps dans cette attente ? En tous cas, ce ne pourra être plus de 18 jours.
Je viens d’arranger mon départ avec toute ma maison. Tout est convenu. Le 30 nous irons coucher à Evreux et dîner le 31 à Paris. Je respire en vous disant cela, et j’en ai besoin, car depuis hier j’étouffe. J’ai étouffé cette nuit ce matin, jusqu’à ce moment. Je suis épouvanté de mon bonheur. Je ne sais plus m’en passer. Quel abyme insatiable que notre cœur! un abyme, comme celui d’un mélodrame que j’ai vu jouer autrefois, qui s’appelait le Précipice, et où l’on précipitait en effet l’innocent dans un abyme de 600 pieds sans fond. Oui, un abyme de 600 pieds sans fond. Voilà ce qu’est devenu pour vous mon cœur. Avant le 15 juin, si l’on m’avait fait entrevoir une correspondance un peu amicale, un peu régulière avec une personne comme vous une personne d’esprit, bien au courant du monde, j’aurais trouvé cela charmant ; je me serais promis au moins un jour très agréable par semaine. Pendant que vous étiez en Angleterre, si l’on m’avait dit que vous reviendriez bientôt en France, et que je ne passerais jamais un mois sans en passer cinq ou six jours avec vous, je me serais cru heureux. Et bien Madame; je ne le suis pas; je ne le suis pas malgré hier, malgré avant-hier, malgré la certitude que dans 18 jours, je retrouverai hier au moins hier, n’est-ce pas ? Je suis devenu insatiable, je resterai insatiable. Vous, vous dont la simple vue fait épanouir tout mon être dont la moindre parole me charme et qui avez pour moi des paroles dont le souvenir, le seul souvenir me plonge dans l’extase, vous ne pouvez pas me rassasier. il n’est pas en votre pouvoir d’apaiser, de combler mon âme. De vous, tout la ravit et rien ne lui suffit. Vous êtes pour moi une source de délices infinies, et moi, j’ai une puissance infinie pour les désirer, pour en jouir; et quelque heureux que je sois par vous, près de vous, je sens que je puis, que je dois l’être encore davantage; et j’aspire avec une ardeur infatigable à ce bonheur inépuisable qui me vient de vous et qui chaque fois qu’il me vient me promet plus encore qu’il ne me donne et m’inspire encore plus de désirs qu’il n’en satisfait, savez-vous ce qui sépuise ce qui se lasse en moi ? La parole. J’arrive d’un coup à ses limites, et là je m’indigne et mon cœur s’élance bien loin au delà. Mais vous n’êtes pas là pour l’entendre sans qu’il parle ; et en même temps que la parole lui manque, le silence lui pèse horriblement.
Samedi 9 heures
J’ai dormi longtemps, en me réveillant souvent. Chaque fois que je me réveillais, je me disais: à une heure et demie. Et il me fallait un réveil complet et une réflexion pour me détromper. On a bien de la peine à apprendre que les choses ne sont pas dans la vie comme dans le cœur. Le premier mouvement est toujours de croire à l’harmonie de ces deux mondes, tant celui du dedans est le monde vrai, le monde souverain. L’autre nuit en roulant dans cette voiture, le ciel était pur, la lune se répandait partout, vous deviez être là comme moi, jouir avec moi de cette lumière si douce et si pénétrante ; vous deviez sortir de ces longues ombres des arbres qui semblaient cacher quelque objet et s’avancer vers moi à mesure que je marchais. Ce matin, je ne marche pas, je suis dans mon cabinet à ma table, près de mon feu. Mais le soleil brille, la vallée où les feuilles commencent à tomber, laisse entrevoir des percées profondes où la lumière entre et se perd ; tout est beau et invitant devant moi, sous mes fenêtres, partout où se porte ma vue. Je vous vois partout, je vous mets partout, partout où quelque chose me plaît et m’attire. Ce matin, comme cette nuit, comme l’autre nuit, la réflexion seule m’apprend que vous n’êtes pas là. Il faut que je le découvre ! D’instinct, je vous crois avec moi, toujours avec moi.
J’ai trouvé tous les miens en bon état. Ma mère est mieux que je ne l’avais laissée ; mes enfants sont à merveille. Savez-vous que je ne jouis de leur présence, de leur joie, qu’avec un peu d’hésitation et de mélange ? Je voudrais vous en envoyer la moitié. Une impression à moi seul un plaisir à moi seul m’étonne presque comme un contresens. N’ayez jamais d’impression, de plaisir à vous seule ! J’en serais plus qu’étonné. Vous pouvez me pardonner cette exigence toutes les exigences. Je les aurai toutes. Mais j’en ai le droit, oui, le plein droit.
11 heures
Voilà votre n° 56. Oui éternellement adieu. C’est là que tous les sentiments s’unissent et se satisfont. Adieu. Adieu.
59. Paris, Samedi 14 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
59. Samedi 14 octobre 1837 9. heures
J’ai fait hier le bois de Boulogne comme une pénitence, car le temps était laid, vous aviez emporté le soleil. J’ai fait ensuite Madame de Flahaut un peu comme cela aussi, & puis je suis allée me rafraîchir l’esprit chez lady Granville. Après mon dîner j’ai fait quelques copies mais qui m’ont fatigué les yeux. à 8 h 1/2 M. Molé est venu jusqu’à 10 heures nous sommes restés seuls. Je lui ai proposé l’éclipse à l’heure où je devais m’y trouver. Il est venu, successivement quelques personnes M. de Brignoles, M. de St Simon, M. Sneyd. J’allais et je venais. Je craignais de manquer le véritable moment, & cependant il était impossible de rester plantée sur le balcon en permanence. J’ai été vous chercher bien haut bien haut. Je vous ai trouvé, je vous trouve partout. L’éclipse a été parfaitement visible, pas une image. J’espère qu’il en était de même chez vous.
M. Molé m’a demandé si vous étiez parti. J’ai dit que je le croyais. Il est resté tard, jusqu’à onze heures, fort causant, fort racontant, tout mon autre monde était au grand opéra. Je n’ai par trouvé de N° à votre lettre ce matin, c’est 55 que je viens d’y placer. Voilà donc un grand jour d’écoulé ! Si les autres sont aussi longs qu’hier il me semble que nous n’arriverons jamais au 31. Je viens d’additionner les jours que nous avons passés ensemble depuis le 15 juin. Cela fait juste 40 ainsi le tiers. Mes lettres ne partiront que lundi je ne puis pas achever avant. Il n’y a rien qui presse. Les dramatic personnae ne se trouveront réunies qu’à la fin de ce mois à Moscou. Je ne sais si je ferais bien ou mal d’envoyer à mon mari copie de ma lettre à Orloff qu’en pensez-vous ?
J’ai envie de me distraire, & de vous dire que la bagarre à Lisbonne est vraiment très risible. Quel rôle pour l’Angleterre ? Ce royaume dont l’Europe entière lui abandonnait tacitement la domination, cette domination établie exercée à la satisfaction de tous depuis tant de temps, tout cela lui échappe. Elle est honnie, insultée là où elle régnait si paisiblement. Que de fautes il a fallu commettre pour cela ! C’est un homme, un seul homme, un dandy qui a fait cela. L’Angleterre tenait le Portugal parce que le Portugal était gouverné par les grands, et que les grands étaient dévoués au gouvernement anglais. Depuis que les petits ont chassé les grands ils sont devenus ingouvernables. Que va faire Lord Howard de Walden ?
Midi. Après ma longue toilette, pendant quelques moments de laquelle il faut me séparer de la lettre, je l’ai relue avant de la replacer dans sa demeure. Je l’ai relue avec le même plaisir qu’hier, avec le même ravissement. Il en sera de même tous les jours, tous les jours je vous le promets. Quel trésor vous m’avez donné là ! Il me vient quelques craintes pour les lettres qui pourraient m’être remise de la main à la main. Si c’est un maladroit ce pourrait être pire que les lettres par la poste, et j’ai l’imagination frappée sur l’arrivée de mon mari. Vous verrez qu’il viendra et avant vous. Je voudrais bien me tromper. Adieu. Adieu. Adieu.
J’ai fait hier le bois de Boulogne comme une pénitence, car le temps était laid, vous aviez emporté le soleil. J’ai fait ensuite Madame de Flahaut un peu comme cela aussi, & puis je suis allée me rafraîchir l’esprit chez lady Granville. Après mon dîner j’ai fait quelques copies mais qui m’ont fatigué les yeux. à 8 h 1/2 M. Molé est venu jusqu’à 10 heures nous sommes restés seuls. Je lui ai proposé l’éclipse à l’heure où je devais m’y trouver. Il est venu, successivement quelques personnes M. de Brignoles, M. de St Simon, M. Sneyd. J’allais et je venais. Je craignais de manquer le véritable moment, & cependant il était impossible de rester plantée sur le balcon en permanence. J’ai été vous chercher bien haut bien haut. Je vous ai trouvé, je vous trouve partout. L’éclipse a été parfaitement visible, pas une image. J’espère qu’il en était de même chez vous.
M. Molé m’a demandé si vous étiez parti. J’ai dit que je le croyais. Il est resté tard, jusqu’à onze heures, fort causant, fort racontant, tout mon autre monde était au grand opéra. Je n’ai par trouvé de N° à votre lettre ce matin, c’est 55 que je viens d’y placer. Voilà donc un grand jour d’écoulé ! Si les autres sont aussi longs qu’hier il me semble que nous n’arriverons jamais au 31. Je viens d’additionner les jours que nous avons passés ensemble depuis le 15 juin. Cela fait juste 40 ainsi le tiers. Mes lettres ne partiront que lundi je ne puis pas achever avant. Il n’y a rien qui presse. Les dramatic personnae ne se trouveront réunies qu’à la fin de ce mois à Moscou. Je ne sais si je ferais bien ou mal d’envoyer à mon mari copie de ma lettre à Orloff qu’en pensez-vous ?
J’ai envie de me distraire, & de vous dire que la bagarre à Lisbonne est vraiment très risible. Quel rôle pour l’Angleterre ? Ce royaume dont l’Europe entière lui abandonnait tacitement la domination, cette domination établie exercée à la satisfaction de tous depuis tant de temps, tout cela lui échappe. Elle est honnie, insultée là où elle régnait si paisiblement. Que de fautes il a fallu commettre pour cela ! C’est un homme, un seul homme, un dandy qui a fait cela. L’Angleterre tenait le Portugal parce que le Portugal était gouverné par les grands, et que les grands étaient dévoués au gouvernement anglais. Depuis que les petits ont chassé les grands ils sont devenus ingouvernables. Que va faire Lord Howard de Walden ?
Midi. Après ma longue toilette, pendant quelques moments de laquelle il faut me séparer de la lettre, je l’ai relue avant de la replacer dans sa demeure. Je l’ai relue avec le même plaisir qu’hier, avec le même ravissement. Il en sera de même tous les jours, tous les jours je vous le promets. Quel trésor vous m’avez donné là ! Il me vient quelques craintes pour les lettres qui pourraient m’être remise de la main à la main. Si c’est un maladroit ce pourrait être pire que les lettres par la poste, et j’ai l’imagination frappée sur l’arrivée de mon mari. Vous verrez qu’il viendra et avant vous. Je voudrais bien me tromper. Adieu. Adieu. Adieu.
58. Val-Richer, Samedi 14 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°58. Samedi 14, 3 heures
Je reviens d’une longue promenade avec ma mère, mes enfants, Mad. de Meulan. Nous avons erré deux heures dans les bois. Henriette, a la passion des longues promenades de tout ce qui étend le cercle de sa petite vie. Deux choses lui plaisent presque également; aller courir au loin, et venir s’enfermer dans mon cabinet à causer avec moi. C’est ce qu’elle vient de faire tout à l’heure en rentrant. Elle me quitte. Elle est enfant, parfaitement enfant ; mais on voit percer, à la moindre occasion et sans la moindre intention de sa part, des traits d’esprit sérieux ces velléités d’ambition haute qui révèlent de bonne heure les natures d’élite. Elle était là, tout à l’heure, cherchant visiblement ce qui pouvait m’intéresser, le regard attentif un peu émue, presque recueillie. J’ai ri ; je lui ai dit des bêtises. Cela n’a pas pris. Elle voulait faire quelque chose pour moi, et non pas que je fisse quelque chose pour elle. Je me suis prêté à son désir. Nous avons causé de sa grand mère, de sa sœur, de ses leçons ; et elle a fini par me demander de lui faire commencer l’hiver prochain à apprendre deux choses, la musique et le dessin : la musique, parce qu’elle m’a entendu dire que je trouvais agréable après le dîner, en sortant de table de rester là, une demi-heure assis près du piano sans rien dire entendant jouer ou chanter ; le dessin, parce qu’elle a envie de faire mon portrait " pour l’avoir à moi " dit-elle. Je ne lui permets pas souvent ces conversation- là, et je ne me laisse point aller au plaisir que j’y pourrais prendre. Je ne fais nul cas des fruits de serre chaude. Je veux que mes enfants croissent en plein air sans provocation factice et en y mettant le temps naturel. C’est déjà une assez forte provocation que notre façon de vivre aujourd’hui, et l’intimité habituelle des enfants avec les grandes personnes. Je suis bien sûr que, s’il y a dans mes enfants quelque heureux don à développer, le développement ne leur manquera pas. Et puis je me défends, je me défendrai toujours d’un certaine tour de leur affection pour moi qui ne convient ni à leur âge, ni à notre relation. Je crois aux lois naturelles des divers liens, des divers sentiments humains, et ne puis souffrir qu’on les confonde. On dit l’amour filial, l’amour paternel, et je ne m’en étonne point. Il est bien simple, bien juste qu’on applique ainsi, à des relations, à des affections, en effet très tendres, & très puissantes, le mot le plus tendre, le plus puissant que connaissent les hommes. Mais il ne faut pas prendre les mots au pied de la lettre, même dans leurs applications les plus douces. Il faut toujours regarder aux choses mêmes.
Eh bien Madame, il n’y a qu’un amour, l’amour tout court. Ce qui le caractérise essentiellement, la passion unique, exclusive, à la fois égoïste et dévoué sans mesure, capable de tout sacrifier et pourtant voulant un retour parfaitement égal, cherchant avant tout son propre bonheur, ce droit absolu qu’un être se sent et s’arroge sur un autre être auquel il se donne, cette complète fusion de deux âmes, de deux vies en une seule vie, en une seule âme ; tout cela, qui est vraiment l’amour, ne se retrouve point ailleurs, ne s’y retrouve du moins ni complètement, ni à sa place et selon l’ordre naturel.
J’espère que mes enfants m’aimeront autant, et avec autant de tendresse, et même avec autant d’exaltation qu’on peut aimer son père. Mais toutes les fois que je verrai pénétrer dans leur sentiment pour moi quelque chose qui naturellement n’en est pas, qui appartient à d’autres relations, qui doit un jour se porter ailleurs, j’écarterai, ce développement irrégulier de l’âme. " Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. "
10 heures et demie
Je ne sais ce que je vous aurais dit ce matin si l’on ne m’avait interrompu. Mais je vous en aurais dit long. Avec vous la conversation sur le sujet le plus indifférent est un charmant plaisir. Quoi donc quand le sujet me tient vraiment au cœur ? Cependant, je ne vous dirai pas grand chose ce soir. J’ai envie de dormir. Il me semble que le besoin de sommeil va croissant en moi. J’en serais contrarié. J’ai toujours disposé de moi-même très librement et sans y regarder, pour toute chose, à toute heure. Il me déplairait de me sentir plus dominé par les habitudes. Comprendrez-vous cette question-là ?
Il y a dans votre numéro 58 page 4, ligne 3, un mot rayé au dessus duquel, vous avez écrit lit en me disant à quelle heure vous êtes allée vous coucher. Le mot rayé a-t-il été mis là à dessein ou par hasard ?
Vous pouvez rassurer le comte de Pahlen, J’ai trouvé sa carte en rentrant chez moi avant de partir, et j’ai eu tous les regrets du monde de n’avoir pas été là quand, il a pris la peine de me venir voir. Nous ne nous connaissons guère quoique nous nous soyons beaucoup vus ; mais il a un air et un ton de galant homme qui me plaît extrêmement.
Dimanche 11 heures
Moi qui oubliais de vous parler de l’éclipse! Tout s’éclipse devant vous. Elle a été parfaitement visible ; et je l’ai bien regardée, et je l’ai oubliée en la regardant. Décidément, je n’irai pas vous chercher dans la Lune. Je vous veux plus près. Adieu, adieu. Est- ce que la lettre ne me fait pas de tort à moi ? Adieu. G.
Je reviens d’une longue promenade avec ma mère, mes enfants, Mad. de Meulan. Nous avons erré deux heures dans les bois. Henriette, a la passion des longues promenades de tout ce qui étend le cercle de sa petite vie. Deux choses lui plaisent presque également; aller courir au loin, et venir s’enfermer dans mon cabinet à causer avec moi. C’est ce qu’elle vient de faire tout à l’heure en rentrant. Elle me quitte. Elle est enfant, parfaitement enfant ; mais on voit percer, à la moindre occasion et sans la moindre intention de sa part, des traits d’esprit sérieux ces velléités d’ambition haute qui révèlent de bonne heure les natures d’élite. Elle était là, tout à l’heure, cherchant visiblement ce qui pouvait m’intéresser, le regard attentif un peu émue, presque recueillie. J’ai ri ; je lui ai dit des bêtises. Cela n’a pas pris. Elle voulait faire quelque chose pour moi, et non pas que je fisse quelque chose pour elle. Je me suis prêté à son désir. Nous avons causé de sa grand mère, de sa sœur, de ses leçons ; et elle a fini par me demander de lui faire commencer l’hiver prochain à apprendre deux choses, la musique et le dessin : la musique, parce qu’elle m’a entendu dire que je trouvais agréable après le dîner, en sortant de table de rester là, une demi-heure assis près du piano sans rien dire entendant jouer ou chanter ; le dessin, parce qu’elle a envie de faire mon portrait " pour l’avoir à moi " dit-elle. Je ne lui permets pas souvent ces conversation- là, et je ne me laisse point aller au plaisir que j’y pourrais prendre. Je ne fais nul cas des fruits de serre chaude. Je veux que mes enfants croissent en plein air sans provocation factice et en y mettant le temps naturel. C’est déjà une assez forte provocation que notre façon de vivre aujourd’hui, et l’intimité habituelle des enfants avec les grandes personnes. Je suis bien sûr que, s’il y a dans mes enfants quelque heureux don à développer, le développement ne leur manquera pas. Et puis je me défends, je me défendrai toujours d’un certaine tour de leur affection pour moi qui ne convient ni à leur âge, ni à notre relation. Je crois aux lois naturelles des divers liens, des divers sentiments humains, et ne puis souffrir qu’on les confonde. On dit l’amour filial, l’amour paternel, et je ne m’en étonne point. Il est bien simple, bien juste qu’on applique ainsi, à des relations, à des affections, en effet très tendres, & très puissantes, le mot le plus tendre, le plus puissant que connaissent les hommes. Mais il ne faut pas prendre les mots au pied de la lettre, même dans leurs applications les plus douces. Il faut toujours regarder aux choses mêmes.
Eh bien Madame, il n’y a qu’un amour, l’amour tout court. Ce qui le caractérise essentiellement, la passion unique, exclusive, à la fois égoïste et dévoué sans mesure, capable de tout sacrifier et pourtant voulant un retour parfaitement égal, cherchant avant tout son propre bonheur, ce droit absolu qu’un être se sent et s’arroge sur un autre être auquel il se donne, cette complète fusion de deux âmes, de deux vies en une seule vie, en une seule âme ; tout cela, qui est vraiment l’amour, ne se retrouve point ailleurs, ne s’y retrouve du moins ni complètement, ni à sa place et selon l’ordre naturel.
J’espère que mes enfants m’aimeront autant, et avec autant de tendresse, et même avec autant d’exaltation qu’on peut aimer son père. Mais toutes les fois que je verrai pénétrer dans leur sentiment pour moi quelque chose qui naturellement n’en est pas, qui appartient à d’autres relations, qui doit un jour se porter ailleurs, j’écarterai, ce développement irrégulier de l’âme. " Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. "
10 heures et demie
Je ne sais ce que je vous aurais dit ce matin si l’on ne m’avait interrompu. Mais je vous en aurais dit long. Avec vous la conversation sur le sujet le plus indifférent est un charmant plaisir. Quoi donc quand le sujet me tient vraiment au cœur ? Cependant, je ne vous dirai pas grand chose ce soir. J’ai envie de dormir. Il me semble que le besoin de sommeil va croissant en moi. J’en serais contrarié. J’ai toujours disposé de moi-même très librement et sans y regarder, pour toute chose, à toute heure. Il me déplairait de me sentir plus dominé par les habitudes. Comprendrez-vous cette question-là ?
Il y a dans votre numéro 58 page 4, ligne 3, un mot rayé au dessus duquel, vous avez écrit lit en me disant à quelle heure vous êtes allée vous coucher. Le mot rayé a-t-il été mis là à dessein ou par hasard ?
Vous pouvez rassurer le comte de Pahlen, J’ai trouvé sa carte en rentrant chez moi avant de partir, et j’ai eu tous les regrets du monde de n’avoir pas été là quand, il a pris la peine de me venir voir. Nous ne nous connaissons guère quoique nous nous soyons beaucoup vus ; mais il a un air et un ton de galant homme qui me plaît extrêmement.
Dimanche 11 heures
Moi qui oubliais de vous parler de l’éclipse! Tout s’éclipse devant vous. Elle a été parfaitement visible ; et je l’ai bien regardée, et je l’ai oubliée en la regardant. Décidément, je n’irai pas vous chercher dans la Lune. Je vous veux plus près. Adieu, adieu. Est- ce que la lettre ne me fait pas de tort à moi ? Adieu. G.
60. Paris, Dimanche 15 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
60. Dimanche le 15 octobre 9 heures.
Voilà un gros chiffre, & qui prouve que nous ne sommes pas de fort habiles gens. J’ai reçu ce matin votre second petit mot de Lisieux. C’est moi encore qui y ai placé le 56. Vous ne savez pas que j’aime l’ordre beaucoup. Monsieur les lettres que nous nous écrivons me font pitié. Je ne connais plus qu’une lettre c’est celle que je porte sur moi, que je relis tous les jours, et que je répète après. Je suis fâchée que vous n’ayez pas son pendant. Si je connaissais une bonne occasion de vous écrire. Je copierai cette lettre, les paroles que vous me dites c’est à vous que je les adresserais ; je demanderais pour ma lettre les même localités que j’accorde à la vôtre ; je vous prierais de relire ma lettre tous les jours comme je relis la vôtre, et puis la poste ne nous porterait plus tous les jours que ces mots. "Je me porte bien adieu." Voilà ce que feraient des gens d’esprit. Vous voilà bien étonné monsieur de me trouver tout-à-coup tant de raison, tant de force. Eh bien, oui, il m’en est venu beaucoup. Je ne réponds pas que cela se soutienne, mais ce talisman jusqu’ici a été merveilleux.
J’ai livré hier à Lady Granville toutes les lettres que je vais envoyer. Elle y a fait une seule correction, mais excellente. Outre qu’elle est mon amie et que je me fie à elle, j’ai été bien aise d’initier l’Empire Britannique à mes affaires. J’appartiens à ce pays et à tout événement je garderai ma place dans l’opinion de ces nobles anglais. Elle approuve tout, tout. Son mari a tout lu aussi. J’ai fait deux longues promenades au bois de Boulogne hier. De midi à 2 heures, & de 3 à 5. Je crois que c’est trop. Je me bornerai à une probablement la première. Cela arrangera nos heures.
De cinq à 6 j’ai passé chez lady Granville & puis comme il se trouvait qu’on donnait Norma que toute ma société y allait, que Marie y allait aussi je pris mon parti pour la soirée, j’allais rendre visite d’abord à Mad. de Brignoles où je ne vais jamais, car je ne suis on ne peut plus impolie. En fait de visites c’est une habitude prise, et puis chez Mad. de Castellane. Je les trouvai toutes les deux, chez celle-ci Pozzo qui m’avait cherchée sans me trouver, j’y vais aussi M. Pasquier et M. Decazes, Madame de Castellane voulait absolument me retenir, en me promettant M. Molé (que c’est de bon gout!) " Mais Madame c’est vous que je suis venue voir !" & je la quittai avant onze heures. Voilà Monsieur ma journée. Ah j’ai oublié la visite avant dîner de notre ministre aux Etats-Unis qui arrive de Pétersbourg pour s’y rendre. Ce fut fort drôle. Il ne m’avait pas vu depuis l’année 12 où je le rencontrai à Stockolm en me rendant en Angleterre. Moi je ne le reconnu pas du tout ; je me rappelais à peine son nom. Madame de Staël l’appelait l’élégant Bodisco et se laissait un peu adorer par lui. Je vis qu’il me regarda avec une curiosité et un désappointement extrême. Cela me fit rire, peu à peu je remarquais ce qui arrive toujours c’est qu’on retrouve un visage connu, quelque longtemps qu’on ait passé sans le voir.
Monsieur j’aurais dû vous rencontrer l’an 12, et puis ne plus vous revoir que l’an 37. Dans deux genres différents vous auriez eu ainsi mes deux bons moments. Midi. Avez-vous été rendre visite à l’ambassadeur de Sardaigne après son dîner ? Il me semble que non. Vous ne sauriez concevoir à quel point mes journées me paraissent longues. Comment nous en sommes qu’au 15 ? C’est horrible. Je dîne aujourd’hui chez lady Granville.
Adieu Monsieur, adieu je crois que comme c’est dimanche je pourrai bien me permettre de relire la lettre deux fois. J’ai fait mes lectures pieuse. A présent vient mon holyday. Adieu. Adieu. Adieu.
Voilà un gros chiffre, & qui prouve que nous ne sommes pas de fort habiles gens. J’ai reçu ce matin votre second petit mot de Lisieux. C’est moi encore qui y ai placé le 56. Vous ne savez pas que j’aime l’ordre beaucoup. Monsieur les lettres que nous nous écrivons me font pitié. Je ne connais plus qu’une lettre c’est celle que je porte sur moi, que je relis tous les jours, et que je répète après. Je suis fâchée que vous n’ayez pas son pendant. Si je connaissais une bonne occasion de vous écrire. Je copierai cette lettre, les paroles que vous me dites c’est à vous que je les adresserais ; je demanderais pour ma lettre les même localités que j’accorde à la vôtre ; je vous prierais de relire ma lettre tous les jours comme je relis la vôtre, et puis la poste ne nous porterait plus tous les jours que ces mots. "Je me porte bien adieu." Voilà ce que feraient des gens d’esprit. Vous voilà bien étonné monsieur de me trouver tout-à-coup tant de raison, tant de force. Eh bien, oui, il m’en est venu beaucoup. Je ne réponds pas que cela se soutienne, mais ce talisman jusqu’ici a été merveilleux.
J’ai livré hier à Lady Granville toutes les lettres que je vais envoyer. Elle y a fait une seule correction, mais excellente. Outre qu’elle est mon amie et que je me fie à elle, j’ai été bien aise d’initier l’Empire Britannique à mes affaires. J’appartiens à ce pays et à tout événement je garderai ma place dans l’opinion de ces nobles anglais. Elle approuve tout, tout. Son mari a tout lu aussi. J’ai fait deux longues promenades au bois de Boulogne hier. De midi à 2 heures, & de 3 à 5. Je crois que c’est trop. Je me bornerai à une probablement la première. Cela arrangera nos heures.
De cinq à 6 j’ai passé chez lady Granville & puis comme il se trouvait qu’on donnait Norma que toute ma société y allait, que Marie y allait aussi je pris mon parti pour la soirée, j’allais rendre visite d’abord à Mad. de Brignoles où je ne vais jamais, car je ne suis on ne peut plus impolie. En fait de visites c’est une habitude prise, et puis chez Mad. de Castellane. Je les trouvai toutes les deux, chez celle-ci Pozzo qui m’avait cherchée sans me trouver, j’y vais aussi M. Pasquier et M. Decazes, Madame de Castellane voulait absolument me retenir, en me promettant M. Molé (que c’est de bon gout!) " Mais Madame c’est vous que je suis venue voir !" & je la quittai avant onze heures. Voilà Monsieur ma journée. Ah j’ai oublié la visite avant dîner de notre ministre aux Etats-Unis qui arrive de Pétersbourg pour s’y rendre. Ce fut fort drôle. Il ne m’avait pas vu depuis l’année 12 où je le rencontrai à Stockolm en me rendant en Angleterre. Moi je ne le reconnu pas du tout ; je me rappelais à peine son nom. Madame de Staël l’appelait l’élégant Bodisco et se laissait un peu adorer par lui. Je vis qu’il me regarda avec une curiosité et un désappointement extrême. Cela me fit rire, peu à peu je remarquais ce qui arrive toujours c’est qu’on retrouve un visage connu, quelque longtemps qu’on ait passé sans le voir.
Monsieur j’aurais dû vous rencontrer l’an 12, et puis ne plus vous revoir que l’an 37. Dans deux genres différents vous auriez eu ainsi mes deux bons moments. Midi. Avez-vous été rendre visite à l’ambassadeur de Sardaigne après son dîner ? Il me semble que non. Vous ne sauriez concevoir à quel point mes journées me paraissent longues. Comment nous en sommes qu’au 15 ? C’est horrible. Je dîne aujourd’hui chez lady Granville.
Adieu Monsieur, adieu je crois que comme c’est dimanche je pourrai bien me permettre de relire la lettre deux fois. J’ai fait mes lectures pieuse. A présent vient mon holyday. Adieu. Adieu. Adieu.
61. Paris, Lundi 16 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
61. Lundi 16 octobre 1837 9 1/2
Il n’est point venu de lettre ce matin, j’attendrai onze h. 1 /2 avec confiance. Hier le vent était bien aigre, je ne me suis pas promenée avec le même plaisir que ces jours passés, cela tient peut-être à ce qui je rencontrai Mad. de Flahaut au bois de Boulogne et qu’elle voulut m’accompagner. M. de Médem me fit une longue visite le matin. Il voudrait que j’adoucisse un peu ma lettre à M. de Lieven et commence à prendre pitié de lui, et il est convaincu que l’Empereur lui-même a prescrit la mesure. Ce qu’il y a de sûr, c’est que je vais mettre dans l’embarras tous ceux auxquels j’écris. C’est la plus modeste des vengeances.
Je dînai chez lady Granville. J’y rencontrai M. de Broglie qui vint causer avec moi après le dîner, je le questionnai sur les situations ici. Il m’en fit un tableau fort clair. Il me semble qu’il a beaucoup de netteté dans l’esprit. Je ne sais si je me trompe mais je trouvai en lui plus d’intimité, plus de confiance. Nous parlâmes de tout et de tous, il n’y eut qu’un nom qui ne fut pas prononcé, et comme il appartenait cependant au sujet nous choisîmes d’un commun accord la désignation générale. Je restai tard chez lady Granville & j’allai ensuite pour un quart d’heure chez Mad. de Flahaut où j’avais donné rendez-vous à mon ambassadeur. à onze heures je fus rendue chez moi.
Lord Pumbroke s’est cassé le coude hier aux Champs-Elysées. Les chevaux se sont emportés il a été jeté hors de son phaéton.
J’ai beaucoup connu la Reine de Hollande qui vient de mourir, c’était une excellente femme. Tout-à-fait dans le genre de votre reine. Son mari a été mauvais pour elle pendant bien des années. C’était le plus amoureux des hommes. Je ne sais pourquoi je vous conte tout cela. Je devrais plutôt vous dire que hier j’ai relu quatre fois la lettre, la véritable lettre. Il m’est venu quelque scrupule de m’être offert à la copier. Les deux premières pages, oui la troisième non. c.a.d. la dernière moitié de la troisième. (Voilà déjà que je capitule.) Monsieur je ne copierai cela jamais, & j’y penserai toujours !
11 1/2 la voilà cette lettre, rivale, presque rivale, tout-à-fait rivale de celle dont je vous parle sans cesse. Des lettres comme celles-là jettent le trouble dans tout mon être. C’est trop, c’est trop si loin de vous & cependant que je les aime. C’est un poison si doux?
M. Génie n’est pas fin. Il se fait annoncer de votre part. Voilà qui serait bien adroit si mon mari était ici ! Je voudrais qu’il comprit que Génie tout court, convient tout-à fait à mon Génie. Je ne sais que vous dire sur vos lettres Médem me démontre l’absolue impossibilité que mon mari vienne. Moi, je m’obstine à le voir arriver tous les jours. Faites comme vous pensez la prudence est cependant le meilleur parti à suivre, & vous le savez, je vous promets de relire tous les jours cette lettre, maintenant ces deux lettres, et de penser d’être sure que dans le moment où je les lis vous pensez tout ce que vous me disiez en les écrivant, vous éprouvez tout ce que j’éprouve en les lisant toutes, toutes les mêmes sensations que j’éprouve. Je suis si sûre, si sûre de vous, si sûre de moi. Comment cela m’est-il venu tout-à-coup, si fort ? Mais qu’il y a loin jusqu’au 31 ! De demain en quinze !
Adieu votre lettre m’a donné la fièvre. Il me faut de l’air. Je vais le prendre avec vous. Je marcherai vers le Val Richer. J’irai tant que je pourrai aller, et je reviendrai tristement en voiture. Adieu. Adieu si vous saviez comme je vous dis adieu.
Il n’est point venu de lettre ce matin, j’attendrai onze h. 1 /2 avec confiance. Hier le vent était bien aigre, je ne me suis pas promenée avec le même plaisir que ces jours passés, cela tient peut-être à ce qui je rencontrai Mad. de Flahaut au bois de Boulogne et qu’elle voulut m’accompagner. M. de Médem me fit une longue visite le matin. Il voudrait que j’adoucisse un peu ma lettre à M. de Lieven et commence à prendre pitié de lui, et il est convaincu que l’Empereur lui-même a prescrit la mesure. Ce qu’il y a de sûr, c’est que je vais mettre dans l’embarras tous ceux auxquels j’écris. C’est la plus modeste des vengeances.
Je dînai chez lady Granville. J’y rencontrai M. de Broglie qui vint causer avec moi après le dîner, je le questionnai sur les situations ici. Il m’en fit un tableau fort clair. Il me semble qu’il a beaucoup de netteté dans l’esprit. Je ne sais si je me trompe mais je trouvai en lui plus d’intimité, plus de confiance. Nous parlâmes de tout et de tous, il n’y eut qu’un nom qui ne fut pas prononcé, et comme il appartenait cependant au sujet nous choisîmes d’un commun accord la désignation générale. Je restai tard chez lady Granville & j’allai ensuite pour un quart d’heure chez Mad. de Flahaut où j’avais donné rendez-vous à mon ambassadeur. à onze heures je fus rendue chez moi.
Lord Pumbroke s’est cassé le coude hier aux Champs-Elysées. Les chevaux se sont emportés il a été jeté hors de son phaéton.
J’ai beaucoup connu la Reine de Hollande qui vient de mourir, c’était une excellente femme. Tout-à-fait dans le genre de votre reine. Son mari a été mauvais pour elle pendant bien des années. C’était le plus amoureux des hommes. Je ne sais pourquoi je vous conte tout cela. Je devrais plutôt vous dire que hier j’ai relu quatre fois la lettre, la véritable lettre. Il m’est venu quelque scrupule de m’être offert à la copier. Les deux premières pages, oui la troisième non. c.a.d. la dernière moitié de la troisième. (Voilà déjà que je capitule.) Monsieur je ne copierai cela jamais, & j’y penserai toujours !
11 1/2 la voilà cette lettre, rivale, presque rivale, tout-à-fait rivale de celle dont je vous parle sans cesse. Des lettres comme celles-là jettent le trouble dans tout mon être. C’est trop, c’est trop si loin de vous & cependant que je les aime. C’est un poison si doux?
M. Génie n’est pas fin. Il se fait annoncer de votre part. Voilà qui serait bien adroit si mon mari était ici ! Je voudrais qu’il comprit que Génie tout court, convient tout-à fait à mon Génie. Je ne sais que vous dire sur vos lettres Médem me démontre l’absolue impossibilité que mon mari vienne. Moi, je m’obstine à le voir arriver tous les jours. Faites comme vous pensez la prudence est cependant le meilleur parti à suivre, & vous le savez, je vous promets de relire tous les jours cette lettre, maintenant ces deux lettres, et de penser d’être sure que dans le moment où je les lis vous pensez tout ce que vous me disiez en les écrivant, vous éprouvez tout ce que j’éprouve en les lisant toutes, toutes les mêmes sensations que j’éprouve. Je suis si sûre, si sûre de vous, si sûre de moi. Comment cela m’est-il venu tout-à-coup, si fort ? Mais qu’il y a loin jusqu’au 31 ! De demain en quinze !
Adieu votre lettre m’a donné la fièvre. Il me faut de l’air. Je vais le prendre avec vous. Je marcherai vers le Val Richer. J’irai tant que je pourrai aller, et je reviendrai tristement en voiture. Adieu. Adieu si vous saviez comme je vous dis adieu.
59. Val-Richer, Dimanche 15 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°59. Dimanche 15. 4 heures
Moi aussi, j’ai envie de me distraire. Si j’étais la lettre, si j’habitais où elle habite, l’idée ne m’en viendrait même pas. Si seulement je vous écrivais à mon gré, à mon libre gré ! Mais je ne sais, depuis trois jours, notre correspondance, la vôtre comme la mienne votre N° de ce matin par exemple me suffit moins que jamais. Décidément, je ne serai content que le 31. Votre excursion en Portugal est venue bien à propos. J’y pensais ce matin même en m’habillant, et je pensais tout ce que vous me dites. J’aime ces harmonies imprévues. Oui, la politique Anglaise est bien tombée. Ce n’est pas la seule. Je suis dans une veine de grand dédain. C’est la consolation des oisifs ; je sais cela. Pourquoi me la refuserais-je ?
Je me rappelle il y a quelques années, en 1833 en 34 nous admirions, entre gens d’esprit, la vertu du gouvernement représentatif qui portait les gens d’esprit au pouvoir. Il me prit un remords de notre arrogance ; et je prédis qu’un jour, pour nous en punir, nous serions écartés, des Affaires précisément comme gens d’esprit, et par des adversaires dont le titre serait d’avoir moins d’esprit que nous, moins de talent que nous, moins de courage que nous, d’être des médiocrités enfin, comme dit Lord Aberdeen, la médiocrité a des droits immenses, surtout quand l’esprit démocratique prévaut. Droite précaire pourtant car l’esprit démocratique a beau être petit les affaires des peuples sont grandes, et ne se laissent pas longtemps rabaisser autant que le voudraient ceux à qui toute grandeur déplaît. Et il faut bien que tôt ou tard la taille des hommes se rajuste à la taille des affaires. Au fond Madame, je n’ai pas perdu mon arrogance. Je suis toujours sûr que le pouvoir appartient aux gens d’esprit, aux plus gens d’esprit, et qu’il ne peut manquer de leur revenir. Mais nous passons si vite, gens d’esprit ou non ! Nous avons si peu le temps d’attendre !
Je trouve ceci dans une lettre que je recevais en Octobre 1821, il y a seize ans « J’ai toujours vu tourner à ton profit, les retards même que tu n’aurais pu prévenir. Je te crois du bonheur. Cette croyance serait un enfantillage si elle ne se fondait sur ce que je le crois destiné à quelque chose en ce monde. Je sais bien cependant combien sont vains nos jugements sur les voies de la Providence. Je sais que dans sa terrible magnificence, elle peut créer et faire croître un homme supérieur pour le service d’un dessein, d’une idée destinée après d’infinies transformations à porter son fruit dans quelques milliers d’années. Je sais qu’elle peut fonder l’accomplissement de ses moindres vues sur la destruction de ses plus beaux ouvrages. Et c’est là ce qui m’épouvante sur notre petitesse, bien plus que l’immensité des cieux, le nombre et la grandeur des étoiles. Et pourtant, mon ami, j’ai sur toi, pour toi, de la confiance, beaucoup de confiance. »
Combien il faut que j’en aie en vous, moi, pour vous montrer ainsi toutes choses, tout ce qu’il y a pour moi de plus intime, non seulement dans le présent, mais dans le passé ! Mais, puisque je l’ai cette confiance, pourquoi ne vous la montrerais-je pas ? Pourquoi ne verriez-vous pas vous ce que m’écrivait sur moi-même, il y a seize ans, une âme bien noble et bien tendre ? Eh bien, cette sécurité qu’elle avait sur mon avenir, et qui la rendait patiente, même dans les plus mauvais temps, j’en ai moi-même un peu pour mon propre compte. Je me crois appelé à quelque chose qui en vaut la peine, appelé à relever quelque peu la politique de mon pays à faire rentrer dans des voies un peu régulières, et hautes les esprits et les affaires. Je ne me crois pas au bout de ce que je puis faire en ce sens. Et voulez-vous que je vous dise ? Vous avez beaucoup ajouté à ma tranquillité d’esprit. Vous m’avez donné de quoi attendre. Avant le 15 juin, ma patience était de la philosophie, de la vertu. Aujourd’hui je n’ai nul besoin de vertu, de philosophie. J’ai le fond de la vie. La broderie viendra quand elle voudra. Je la désire. J’y compte. Mais je l’attends et je l’attendrai sans le moindre effort, avec bien moins d’effort qu’il ne m’en faut pour attendre le 31 octobre. Me voilà bien distrait, n’est-ce pas ?
10 heures
Pourquoi enverriez-vous à M. de Lieven votre lettre au comte Orloff ? Pourquoi celle-là et pas les autres ? Il faut, ce me semble les lui envoyer toutes ou aucune. Et je ne vois point de bonne raison de les lui envoyer toutes. Après son procédé vous avez bien le droit de faire vous-même vos affaires sans lui en rendre compte. Si vous deviez gagner quelque chose à lui tout montrer à la bonne heure ; mais vous n’y gagneriez rien. Point de mystère et point de confiance, lui annoncer toutes vos démarches, et ne point lui en raconter les détails, qu’il sache ce que vous faites et demeure pourtant dans l’incertitude sur ce que vous dites qu’il y ait pour lui à votre égard, de la publicité et de l’inconnu, voilà, si je ne me trompe, ce qui vous convient, comme attitude, et aussi pour le succès.
J’ai bien recommandé, et je recommande de nouveau à M. Génie de vous porter lui-même mes lettres ou de vous les faire porter par quelqu’un de très sûr, qui vous les remette tout simplement ou les remporte s’il ne peut vous les remettre. Je n’ose cependant vous garantir toujours l’adresse, le tact. Donnez-moi à cet égard vos dernières instructions. Voulez-vous que j’use souvent ou rarement de ce moyen? J’ai grand peine à croire que M. de Lieven vienne à Paris, sans en avoir reçu l’autorisation formelle et je doute qu’on la lui envoie sitôt. L’affaire traînera davantage. On vous répondra. On disputera. On essaiera quelque nouveau procédé. Du reste, je ne sais ce que je dis. Vous connaissez ce monde là mieux que moi.
11 heures
’aime le N°60. J’aime beaucoup le N°60. J’aimerais encore mieux le pendant de la lettre. Ah ! Si je l’avais ! Si jamais nous nous séparons encore, il faudra que je l’aie. Mais je ne penserai plus, le 31 à aucune séparation. Adieu, Adieu. Adieu comme dans la lettre. G.
Moi aussi, j’ai envie de me distraire. Si j’étais la lettre, si j’habitais où elle habite, l’idée ne m’en viendrait même pas. Si seulement je vous écrivais à mon gré, à mon libre gré ! Mais je ne sais, depuis trois jours, notre correspondance, la vôtre comme la mienne votre N° de ce matin par exemple me suffit moins que jamais. Décidément, je ne serai content que le 31. Votre excursion en Portugal est venue bien à propos. J’y pensais ce matin même en m’habillant, et je pensais tout ce que vous me dites. J’aime ces harmonies imprévues. Oui, la politique Anglaise est bien tombée. Ce n’est pas la seule. Je suis dans une veine de grand dédain. C’est la consolation des oisifs ; je sais cela. Pourquoi me la refuserais-je ?
Je me rappelle il y a quelques années, en 1833 en 34 nous admirions, entre gens d’esprit, la vertu du gouvernement représentatif qui portait les gens d’esprit au pouvoir. Il me prit un remords de notre arrogance ; et je prédis qu’un jour, pour nous en punir, nous serions écartés, des Affaires précisément comme gens d’esprit, et par des adversaires dont le titre serait d’avoir moins d’esprit que nous, moins de talent que nous, moins de courage que nous, d’être des médiocrités enfin, comme dit Lord Aberdeen, la médiocrité a des droits immenses, surtout quand l’esprit démocratique prévaut. Droite précaire pourtant car l’esprit démocratique a beau être petit les affaires des peuples sont grandes, et ne se laissent pas longtemps rabaisser autant que le voudraient ceux à qui toute grandeur déplaît. Et il faut bien que tôt ou tard la taille des hommes se rajuste à la taille des affaires. Au fond Madame, je n’ai pas perdu mon arrogance. Je suis toujours sûr que le pouvoir appartient aux gens d’esprit, aux plus gens d’esprit, et qu’il ne peut manquer de leur revenir. Mais nous passons si vite, gens d’esprit ou non ! Nous avons si peu le temps d’attendre !
Je trouve ceci dans une lettre que je recevais en Octobre 1821, il y a seize ans « J’ai toujours vu tourner à ton profit, les retards même que tu n’aurais pu prévenir. Je te crois du bonheur. Cette croyance serait un enfantillage si elle ne se fondait sur ce que je le crois destiné à quelque chose en ce monde. Je sais bien cependant combien sont vains nos jugements sur les voies de la Providence. Je sais que dans sa terrible magnificence, elle peut créer et faire croître un homme supérieur pour le service d’un dessein, d’une idée destinée après d’infinies transformations à porter son fruit dans quelques milliers d’années. Je sais qu’elle peut fonder l’accomplissement de ses moindres vues sur la destruction de ses plus beaux ouvrages. Et c’est là ce qui m’épouvante sur notre petitesse, bien plus que l’immensité des cieux, le nombre et la grandeur des étoiles. Et pourtant, mon ami, j’ai sur toi, pour toi, de la confiance, beaucoup de confiance. »
Combien il faut que j’en aie en vous, moi, pour vous montrer ainsi toutes choses, tout ce qu’il y a pour moi de plus intime, non seulement dans le présent, mais dans le passé ! Mais, puisque je l’ai cette confiance, pourquoi ne vous la montrerais-je pas ? Pourquoi ne verriez-vous pas vous ce que m’écrivait sur moi-même, il y a seize ans, une âme bien noble et bien tendre ? Eh bien, cette sécurité qu’elle avait sur mon avenir, et qui la rendait patiente, même dans les plus mauvais temps, j’en ai moi-même un peu pour mon propre compte. Je me crois appelé à quelque chose qui en vaut la peine, appelé à relever quelque peu la politique de mon pays à faire rentrer dans des voies un peu régulières, et hautes les esprits et les affaires. Je ne me crois pas au bout de ce que je puis faire en ce sens. Et voulez-vous que je vous dise ? Vous avez beaucoup ajouté à ma tranquillité d’esprit. Vous m’avez donné de quoi attendre. Avant le 15 juin, ma patience était de la philosophie, de la vertu. Aujourd’hui je n’ai nul besoin de vertu, de philosophie. J’ai le fond de la vie. La broderie viendra quand elle voudra. Je la désire. J’y compte. Mais je l’attends et je l’attendrai sans le moindre effort, avec bien moins d’effort qu’il ne m’en faut pour attendre le 31 octobre. Me voilà bien distrait, n’est-ce pas ?
10 heures
Pourquoi enverriez-vous à M. de Lieven votre lettre au comte Orloff ? Pourquoi celle-là et pas les autres ? Il faut, ce me semble les lui envoyer toutes ou aucune. Et je ne vois point de bonne raison de les lui envoyer toutes. Après son procédé vous avez bien le droit de faire vous-même vos affaires sans lui en rendre compte. Si vous deviez gagner quelque chose à lui tout montrer à la bonne heure ; mais vous n’y gagneriez rien. Point de mystère et point de confiance, lui annoncer toutes vos démarches, et ne point lui en raconter les détails, qu’il sache ce que vous faites et demeure pourtant dans l’incertitude sur ce que vous dites qu’il y ait pour lui à votre égard, de la publicité et de l’inconnu, voilà, si je ne me trompe, ce qui vous convient, comme attitude, et aussi pour le succès.
J’ai bien recommandé, et je recommande de nouveau à M. Génie de vous porter lui-même mes lettres ou de vous les faire porter par quelqu’un de très sûr, qui vous les remette tout simplement ou les remporte s’il ne peut vous les remettre. Je n’ose cependant vous garantir toujours l’adresse, le tact. Donnez-moi à cet égard vos dernières instructions. Voulez-vous que j’use souvent ou rarement de ce moyen? J’ai grand peine à croire que M. de Lieven vienne à Paris, sans en avoir reçu l’autorisation formelle et je doute qu’on la lui envoie sitôt. L’affaire traînera davantage. On vous répondra. On disputera. On essaiera quelque nouveau procédé. Du reste, je ne sais ce que je dis. Vous connaissez ce monde là mieux que moi.
11 heures
’aime le N°60. J’aime beaucoup le N°60. J’aimerais encore mieux le pendant de la lettre. Ah ! Si je l’avais ! Si jamais nous nous séparons encore, il faudra que je l’aie. Mais je ne penserai plus, le 31 à aucune séparation. Adieu, Adieu. Adieu comme dans la lettre. G.
62. Paris, Lundi 16 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
62. Lundi 16 octobre 6 heures
Jamais je n’ai marché autant qu’au jour d’hui, les Tuileries d’abord, plus tard le bois de Boulogne. J’y étais & 2 à 4 h 1/2 toujours sur pied. Enfin la fatigue est venue il n’y avait pas de banc, j’ai pris le parti de m’asseoir sur le gazon, j’y suis restée longtemps. J’ai parlé tout bas, tout bas j’ai même fermé les yeux, je dis plus quand j’ai les yeux fermés. Pendant ce temps Emilie faisait répéter à Marie des vers anglais, elles étaient debout derrière moi. La pièce de vers a été longue. Ma poésie valait mieux, elle était charmante. J’ai répété ce que vous me faites répéter quelques fois ce que je répétais après vous le 11. Il faisait beau, charmant, j’ai eu bien de la peine à quitter le bois. J’y ai relu votre lettre de ce matin. je la relierai bien des fois. Quinze jours encore, mon Dieu, que ferai-je de ces quinze jours !
Je voudrais m’étourdir. Non, je veux penser, penser sans cesse au bonheur qui m’attend ; le bien mettre devant moi ce bonheur, le contempler, l’aimer de toutes les forces, de mon âme. Je ne crains pas d’y trop mettre, le 31 effacera toutes les plus charmantes.
Mardi 9 heures
Je me souviens parfaitement du mot rayé dans mon n°58. Et si vous prenez la peine de relire la phrase vous verrez que ce mot placé là, n’avait pas le sens commun. Il s’y est trouvé par hasard c’est parfaitement clair. Mais il m’arrive si souvent de vous appeler de ce mot dans ma pensée, & il m’arrive si souvent de penser à vous, (voilà un belle découverte que je vous fais faire) que ce mot a été tracé sans que je m’en doutasse. Il parait que je n’avais pas pris beaucoup de peine pour l’effacer.
Je vois que notre correspondance de votre côté au moins est une véritable gêne. Je le vois encore à la lettre de ce matin, Cependant je veux savoir tous les jours de vos nouvelles. Voici ce que je vous propose. Ecrivez-moi comme vous avez toujours fait jusqu’à dimanche prochain ; à partir de ce jour vous ne m’écrirez plus que quelques mots très courts et très polis, mettez dans ces lettres là quelque sujet étranger dont nous n’avons pas parlé encore ; d’un côté cela mâtinera la lettre, de l’autre cela m’instruira. Et si cela tombe en d’autres mains c’est à merveille. Mais comme depuis dimanche jusqu’à mardi 31 il y a 9 jours, vous me ferez dans cette intervalle une lettre intime par M. Génie, en lui recommandant de ne pas faire la bêtise de hier. Il me fera dire simplement que quelqu’un demande à me parler, comme ce sera 11 h 1/2 je saurai ce que cela veut dire, & je le recevrai de suite. Mais pour le cas où je ne le reçoive pas, il ne faut pas qu’il se dessaisisse de la lettre. Il ne doit la remettre que dans mes mains et votre nom ne doit être prononcé sous aucun prétexte.
Maintenant voici sur quoi j’ai établi en dates. Ma lettre à M. de Lieven part aujourd’hui. Il l’aura jeudi ou vendredi au plus tard. Il partira samedi & sera ici Mardi prochain. Ce calcul là peut n’avoir pas le sens commun, but wherever there is the least chance of a grand danger it must be avoided. Ainsi votre lettre de dimanche prochain ne sera plus qu’une lettre comme m’en écrirait Müchlinen. Aimez vous la comparaison ? Il est venu hier matin chez M. Molé pour signer le contrat de mariage. Il avait oublié son cachet, il a fallu attendre ce cachet toute une demi-heure. Le roi assure vingt millions de dote à sa fille. On en demandera rien aux chambres.
J’aime bien votre interrogation tout à la fin de votre lettre de ce matin. " Est-ce que la lettre ne me fait pas de tort a moi ? " Ah vous voilà jaloux de votre lettre ? Vous avez mille fois raison et votre jalousie me fait un plaisir infini. Je veux ce sentiment là en vous, l’autre sans cela ne serait pas complet. Et bien oui, je l’aime cette lettre, je l’adore, je ne puis pas m’en séparer, je ne m’en séparerai jamais. Fâchez vous. Lady Granville a repris ses Lundi. J’y passai hier la soirée, il n’y avait cependant que ma société. La petite princesse M. de Pahlen, la Sardaigne & mes anglais. Ce pauvre Hugel va de mal en pire. Il a tout-à-fait abandonner les affaires, il ne s’en fait plus ici avec l’Autriche. M. d’Appony sera ici tout à l’heure. Adieu. Adieu à tout instant, sans cesse. Adieu.
Jamais je n’ai marché autant qu’au jour d’hui, les Tuileries d’abord, plus tard le bois de Boulogne. J’y étais & 2 à 4 h 1/2 toujours sur pied. Enfin la fatigue est venue il n’y avait pas de banc, j’ai pris le parti de m’asseoir sur le gazon, j’y suis restée longtemps. J’ai parlé tout bas, tout bas j’ai même fermé les yeux, je dis plus quand j’ai les yeux fermés. Pendant ce temps Emilie faisait répéter à Marie des vers anglais, elles étaient debout derrière moi. La pièce de vers a été longue. Ma poésie valait mieux, elle était charmante. J’ai répété ce que vous me faites répéter quelques fois ce que je répétais après vous le 11. Il faisait beau, charmant, j’ai eu bien de la peine à quitter le bois. J’y ai relu votre lettre de ce matin. je la relierai bien des fois. Quinze jours encore, mon Dieu, que ferai-je de ces quinze jours !
Je voudrais m’étourdir. Non, je veux penser, penser sans cesse au bonheur qui m’attend ; le bien mettre devant moi ce bonheur, le contempler, l’aimer de toutes les forces, de mon âme. Je ne crains pas d’y trop mettre, le 31 effacera toutes les plus charmantes.
Mardi 9 heures
Je me souviens parfaitement du mot rayé dans mon n°58. Et si vous prenez la peine de relire la phrase vous verrez que ce mot placé là, n’avait pas le sens commun. Il s’y est trouvé par hasard c’est parfaitement clair. Mais il m’arrive si souvent de vous appeler de ce mot dans ma pensée, & il m’arrive si souvent de penser à vous, (voilà un belle découverte que je vous fais faire) que ce mot a été tracé sans que je m’en doutasse. Il parait que je n’avais pas pris beaucoup de peine pour l’effacer.
Je vois que notre correspondance de votre côté au moins est une véritable gêne. Je le vois encore à la lettre de ce matin, Cependant je veux savoir tous les jours de vos nouvelles. Voici ce que je vous propose. Ecrivez-moi comme vous avez toujours fait jusqu’à dimanche prochain ; à partir de ce jour vous ne m’écrirez plus que quelques mots très courts et très polis, mettez dans ces lettres là quelque sujet étranger dont nous n’avons pas parlé encore ; d’un côté cela mâtinera la lettre, de l’autre cela m’instruira. Et si cela tombe en d’autres mains c’est à merveille. Mais comme depuis dimanche jusqu’à mardi 31 il y a 9 jours, vous me ferez dans cette intervalle une lettre intime par M. Génie, en lui recommandant de ne pas faire la bêtise de hier. Il me fera dire simplement que quelqu’un demande à me parler, comme ce sera 11 h 1/2 je saurai ce que cela veut dire, & je le recevrai de suite. Mais pour le cas où je ne le reçoive pas, il ne faut pas qu’il se dessaisisse de la lettre. Il ne doit la remettre que dans mes mains et votre nom ne doit être prononcé sous aucun prétexte.
Maintenant voici sur quoi j’ai établi en dates. Ma lettre à M. de Lieven part aujourd’hui. Il l’aura jeudi ou vendredi au plus tard. Il partira samedi & sera ici Mardi prochain. Ce calcul là peut n’avoir pas le sens commun, but wherever there is the least chance of a grand danger it must be avoided. Ainsi votre lettre de dimanche prochain ne sera plus qu’une lettre comme m’en écrirait Müchlinen. Aimez vous la comparaison ? Il est venu hier matin chez M. Molé pour signer le contrat de mariage. Il avait oublié son cachet, il a fallu attendre ce cachet toute une demi-heure. Le roi assure vingt millions de dote à sa fille. On en demandera rien aux chambres.
J’aime bien votre interrogation tout à la fin de votre lettre de ce matin. " Est-ce que la lettre ne me fait pas de tort a moi ? " Ah vous voilà jaloux de votre lettre ? Vous avez mille fois raison et votre jalousie me fait un plaisir infini. Je veux ce sentiment là en vous, l’autre sans cela ne serait pas complet. Et bien oui, je l’aime cette lettre, je l’adore, je ne puis pas m’en séparer, je ne m’en séparerai jamais. Fâchez vous. Lady Granville a repris ses Lundi. J’y passai hier la soirée, il n’y avait cependant que ma société. La petite princesse M. de Pahlen, la Sardaigne & mes anglais. Ce pauvre Hugel va de mal en pire. Il a tout-à-fait abandonner les affaires, il ne s’en fait plus ici avec l’Autriche. M. d’Appony sera ici tout à l’heure. Adieu. Adieu à tout instant, sans cesse. Adieu.
60. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°60. 9 heures mardi 17
J’ai passé hier une douce journée. Le N° 60 m’a été au cœur. Faites ce qu’il me laisse entrevoir. Un jeune homme qui m’est tout dévoué, Emmanuel de Grouchy, doit venir, vers la fin de cette semaine, passer au Val-Richer trois ou quatre jours. Rien de plus sûr. Chargez M. Génie de lui remettre pour moi, ce que vous voudrez m’envoyer. Ce sera comme si vous chargiez, M. Génie de me l’apporter lui-même. M. de Grouchy aura certainement à m’apporter des lettres, des papiers qui m’arrivent toujours rue de la ville l’évêque et que M. Génie m’envoie toutes les fois qu’il trouve une bonne occasion.
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit Madame, rien, jamais rien que ce qui vous plaira autant qu’à moi. Ne faites donc rien qui vous contrarie. Mon plaisir en serait troublé. Mais, si cela se peut, le plaisir sera immense et la sûreté parfaite. J’ai répandu hier ma bonne humeur sur tout le monde.
Je me suis promené, j’ai causé, j’ai bêché le jardin de mes filles, j’ai donné à manger aux cygnes. Le soir, j’ai lu un fragment de voyage dans l’Inde, le récit d’une grande chasse aux tigres et aux bisons. C’étaient des transports de joie. Mais il faut que je prenne garde depuis que je suis au Val-Richer, j’ai lu à mes enfants deux romans de Scott Ivanhoé et L’Officier de fortune, une comédie de Collin d’Harleville, Les châteaux en Espagne, et hier cette aventure de chasse. Vous n’avez pas d’idée de l’état d’excitation où cela les met. Elles bondissent sur leur chaise, elles en rêvent la nuit d’après. Cela ne vaut rien. C’est le mal de notre temps d’avoir l’imagination trop excitée, trop avide d’émotions, d’aventures. Il faut en guérir l’enfance au lieu de l’en nourrir. Je choisirai avec soin mes lectures. J’éviterai celles qui ébranleraient trop fort les petits nerfs. Je veux cependant cultiver, amuser leur esprit. Il n’y a que moi qui puisse mettre dans leurs idées, dans leurs impressions un peu de variété et de liberté. Ma mère, qui les élève très bien les ferait vivre, si je n’étais là dans une sphère trop étroite et monotone. Elles s’en accommoderaient sans grand peine car elles sont naturellement douces et gaies ; et les âmes d’enfant, quand d’ailleurs on les traite fort bien ne sont pas difficiles à contenter. Mais je ne veux pas que rien manque à leur développement. Je veux qu’elles deviennent tout ce que leur nature, les rendra capables d’être que leur esprit soit aussi cultivé, leur vie aussi animée qu’elles le pourront laisser et supporter elles-mêmes. Je ne puis souffrir les tailles comprimées, les fleurs étouffées. Il faut arranger tout cela, et trouver cet éternel juste milieu. C’est mon métier partout.
Vous avez bien raison. Je n’ai pas été chez l’Ambassadeur de Sardaigne depuis son dîner. J’aurais dû y aller à mon dernier voyage. J’en ai oublié bien d’autres, mais je ne le reproche lui plus qu’un autre. Ce sera ma première visite après le 31. Est-ce que vous étiez encore à Pétersbourg quand Mad. de Staël y est arrivée ? Que de choses j’ai à vous demander sur le passé ! Je ne puis souffrir, à ce sujet, la moindre ignorance. Il me semble que c’est une lacune dans ma vie. Mais qu’elle abominable idée ! Vous avoir vue en 1812 pour ne vous revoir qu’en 1837 ! Savez-vous, Madame, que cela fait plus de 18 jours ? Cependant, je suis bien sûr que je vous aurais reconnue.
J’ai achevé hier l’arrangement de ma bibliothèque. Il ne m’y manque plus qu’une chose, c’est que vous l’ayez vue. Quand vous vous y serez promenée à l’heure où le soleil y entre par les onze croisées, et la remplit de lumière, ou bien le soir comme ces jours derniers, à l’heure où la lune y vient et l’éclaire à son tour, je la trouverai charmante, accomplie. Jusques là, je m’y promènerai avec encore plus de désir que de plaisir.
11 heures
Je ferai ce que veut la prudence et j’engagerai M. Génie à avoir plus d’esprit. Mais par cette voie là, je puis écrire un peu à l’aise. Merci, merci de ce n° 61. Si vous ne copiez pas tout mettez quelque chose à la place de ce que vous ne copierez pas. J’aimerais mieux tout. Et puis j’aimerais encore mieux que tout fût de vous. Adieu, adieu. G.
J’ai passé hier une douce journée. Le N° 60 m’a été au cœur. Faites ce qu’il me laisse entrevoir. Un jeune homme qui m’est tout dévoué, Emmanuel de Grouchy, doit venir, vers la fin de cette semaine, passer au Val-Richer trois ou quatre jours. Rien de plus sûr. Chargez M. Génie de lui remettre pour moi, ce que vous voudrez m’envoyer. Ce sera comme si vous chargiez, M. Génie de me l’apporter lui-même. M. de Grouchy aura certainement à m’apporter des lettres, des papiers qui m’arrivent toujours rue de la ville l’évêque et que M. Génie m’envoie toutes les fois qu’il trouve une bonne occasion.
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit Madame, rien, jamais rien que ce qui vous plaira autant qu’à moi. Ne faites donc rien qui vous contrarie. Mon plaisir en serait troublé. Mais, si cela se peut, le plaisir sera immense et la sûreté parfaite. J’ai répandu hier ma bonne humeur sur tout le monde.
Je me suis promené, j’ai causé, j’ai bêché le jardin de mes filles, j’ai donné à manger aux cygnes. Le soir, j’ai lu un fragment de voyage dans l’Inde, le récit d’une grande chasse aux tigres et aux bisons. C’étaient des transports de joie. Mais il faut que je prenne garde depuis que je suis au Val-Richer, j’ai lu à mes enfants deux romans de Scott Ivanhoé et L’Officier de fortune, une comédie de Collin d’Harleville, Les châteaux en Espagne, et hier cette aventure de chasse. Vous n’avez pas d’idée de l’état d’excitation où cela les met. Elles bondissent sur leur chaise, elles en rêvent la nuit d’après. Cela ne vaut rien. C’est le mal de notre temps d’avoir l’imagination trop excitée, trop avide d’émotions, d’aventures. Il faut en guérir l’enfance au lieu de l’en nourrir. Je choisirai avec soin mes lectures. J’éviterai celles qui ébranleraient trop fort les petits nerfs. Je veux cependant cultiver, amuser leur esprit. Il n’y a que moi qui puisse mettre dans leurs idées, dans leurs impressions un peu de variété et de liberté. Ma mère, qui les élève très bien les ferait vivre, si je n’étais là dans une sphère trop étroite et monotone. Elles s’en accommoderaient sans grand peine car elles sont naturellement douces et gaies ; et les âmes d’enfant, quand d’ailleurs on les traite fort bien ne sont pas difficiles à contenter. Mais je ne veux pas que rien manque à leur développement. Je veux qu’elles deviennent tout ce que leur nature, les rendra capables d’être que leur esprit soit aussi cultivé, leur vie aussi animée qu’elles le pourront laisser et supporter elles-mêmes. Je ne puis souffrir les tailles comprimées, les fleurs étouffées. Il faut arranger tout cela, et trouver cet éternel juste milieu. C’est mon métier partout.
Vous avez bien raison. Je n’ai pas été chez l’Ambassadeur de Sardaigne depuis son dîner. J’aurais dû y aller à mon dernier voyage. J’en ai oublié bien d’autres, mais je ne le reproche lui plus qu’un autre. Ce sera ma première visite après le 31. Est-ce que vous étiez encore à Pétersbourg quand Mad. de Staël y est arrivée ? Que de choses j’ai à vous demander sur le passé ! Je ne puis souffrir, à ce sujet, la moindre ignorance. Il me semble que c’est une lacune dans ma vie. Mais qu’elle abominable idée ! Vous avoir vue en 1812 pour ne vous revoir qu’en 1837 ! Savez-vous, Madame, que cela fait plus de 18 jours ? Cependant, je suis bien sûr que je vous aurais reconnue.
J’ai achevé hier l’arrangement de ma bibliothèque. Il ne m’y manque plus qu’une chose, c’est que vous l’ayez vue. Quand vous vous y serez promenée à l’heure où le soleil y entre par les onze croisées, et la remplit de lumière, ou bien le soir comme ces jours derniers, à l’heure où la lune y vient et l’éclaire à son tour, je la trouverai charmante, accomplie. Jusques là, je m’y promènerai avec encore plus de désir que de plaisir.
11 heures
Je ferai ce que veut la prudence et j’engagerai M. Génie à avoir plus d’esprit. Mais par cette voie là, je puis écrire un peu à l’aise. Merci, merci de ce n° 61. Si vous ne copiez pas tout mettez quelque chose à la place de ce que vous ne copierez pas. J’aimerais mieux tout. Et puis j’aimerais encore mieux que tout fût de vous. Adieu, adieu. G.
63. Paris, Mercredi 18 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
63. le 18 octobre mercredi 9 heures
J’attendrai encore 11 h 1/2 car il n’est rien venu ce matin. Mais comme j’aime la lecture dans mon lit, j’ai lu, relu, je sais par cœur ce que je porte. Comment aujourd’hui nous étions encore ensemble il y a huit jours ? Le soir était le 11 ! Est-il possible ? Jamais, jamais le temps ne m’a paru si long, si lourd à passer. Voici le tiers de surmonté cependant. La semaine prochaine je commencerai à respirer, à compter en avant au lieu de compter en arrière, mais la semaine prochaine sera une semaine d’angoisses. J’attendrai M. de Lieven. Je vous prie de bien observer mes instructions d’hier dans tous les détails.
J’ai marché hier depuis Boulogne, jusqu’à la Muette, est-ce bien ? Et c’était ma seconde promenade à pied. Aussi ai-je mangé avec appétit. Le soir j’ai vu Pozzo, & les petits Pozzo, mon ambassadeur, le Prince d’Aremberg, les Schonberg, Mad. de Flahaut à sa fille, & M. Sneyd. Thiers doit être arrivé, parce que Mad. Dino dans une lettre qu’elle m’écrit, se réfère à tout ce qu’il m’aura déjà conté. J’attends donc sa visite, & puis que là je ne rais pas un mot.
11 h 1/2 me voilà regardant l’aiguille à la pendule, prêtant l’oreille au moindre son dans le salon. J’ai lu les journaux. On a ressenti des secousses de tremblement de terre dans le Calvados. Si la lettre n’arrive pas dans un quart d’heure, je croirai à un tremblement de terre au Val Richer. Vous savez bien Monsieur que je croirai à tout ce qu’il y a d’absurde, et que l’expérience est tout-à-fait perdu pour moi. Voilà qu’on m’annonce quelqu’un de la part de M. Guizot ! C’est trop provoking. Je viens de faire une petite observation toute douce au porteur, mais il faut la vôtre. Car vraiment de cette façon c’est mille fois pire que la poste. C’est proclamer la lettre à son de trompette dans tout l’hôtel. Je ne croyais pas qu’on fut si bête en France. Mais voilà donc ma lettre, mon bien légitime. J’aime parfaitement tout ce que vous me dites sur votre ambition. Gardez-la. Le moment de l’employer arrivera mais attendez qu’il arrive, vous avez de quoi attendre, j’allais presque dire de quoi oublier. Mais oui, vous l’oublierez quelques fois. A propos, si vous ne faites pas un usage plus intime de la voie par laquelle vous m’avez fait passer votre lettre aujourd’hui, il ne vaut guère la peine de me faire attendre trois heures. Il n’y a pas un mot qui ne soit des plus corrects. Je ne vous reproche rien, je ne vous demande rien, j’observe seulement. & puis j’ai des consolations, je les porte sur moi ; ah vous croyez que je vous le rendrai ? Oui, le jour où vous les désavoueriez, pas avant. Adieu, adieu. Le 31 est bien loin, beaucoup trop loin pour le long adieu que je voudrais vous dire.
1h.
Je m’étais trompée, c’est la copie de la lettre que vous voulez si nous nous séparons ; à la bonne heure, vous l’aurez, moins la dernière moitié de la dernière page, mais je vous la redirai, je la répéterai après vous et vous en garderez là si bien le souvenir que ce supplément sera dans votre cœur plus sereinement encore que la lettre ne reposera dessus. Monsieur vous m’avez fourni là un texte inépuisable & depuis le 13 octobre je ne pense qu’à cette lettre. Vous le voyez bien. Il me semble très convenable de vous redire encore adieu ici.
J’attendrai encore 11 h 1/2 car il n’est rien venu ce matin. Mais comme j’aime la lecture dans mon lit, j’ai lu, relu, je sais par cœur ce que je porte. Comment aujourd’hui nous étions encore ensemble il y a huit jours ? Le soir était le 11 ! Est-il possible ? Jamais, jamais le temps ne m’a paru si long, si lourd à passer. Voici le tiers de surmonté cependant. La semaine prochaine je commencerai à respirer, à compter en avant au lieu de compter en arrière, mais la semaine prochaine sera une semaine d’angoisses. J’attendrai M. de Lieven. Je vous prie de bien observer mes instructions d’hier dans tous les détails.
J’ai marché hier depuis Boulogne, jusqu’à la Muette, est-ce bien ? Et c’était ma seconde promenade à pied. Aussi ai-je mangé avec appétit. Le soir j’ai vu Pozzo, & les petits Pozzo, mon ambassadeur, le Prince d’Aremberg, les Schonberg, Mad. de Flahaut à sa fille, & M. Sneyd. Thiers doit être arrivé, parce que Mad. Dino dans une lettre qu’elle m’écrit, se réfère à tout ce qu’il m’aura déjà conté. J’attends donc sa visite, & puis que là je ne rais pas un mot.
11 h 1/2 me voilà regardant l’aiguille à la pendule, prêtant l’oreille au moindre son dans le salon. J’ai lu les journaux. On a ressenti des secousses de tremblement de terre dans le Calvados. Si la lettre n’arrive pas dans un quart d’heure, je croirai à un tremblement de terre au Val Richer. Vous savez bien Monsieur que je croirai à tout ce qu’il y a d’absurde, et que l’expérience est tout-à-fait perdu pour moi. Voilà qu’on m’annonce quelqu’un de la part de M. Guizot ! C’est trop provoking. Je viens de faire une petite observation toute douce au porteur, mais il faut la vôtre. Car vraiment de cette façon c’est mille fois pire que la poste. C’est proclamer la lettre à son de trompette dans tout l’hôtel. Je ne croyais pas qu’on fut si bête en France. Mais voilà donc ma lettre, mon bien légitime. J’aime parfaitement tout ce que vous me dites sur votre ambition. Gardez-la. Le moment de l’employer arrivera mais attendez qu’il arrive, vous avez de quoi attendre, j’allais presque dire de quoi oublier. Mais oui, vous l’oublierez quelques fois. A propos, si vous ne faites pas un usage plus intime de la voie par laquelle vous m’avez fait passer votre lettre aujourd’hui, il ne vaut guère la peine de me faire attendre trois heures. Il n’y a pas un mot qui ne soit des plus corrects. Je ne vous reproche rien, je ne vous demande rien, j’observe seulement. & puis j’ai des consolations, je les porte sur moi ; ah vous croyez que je vous le rendrai ? Oui, le jour où vous les désavoueriez, pas avant. Adieu, adieu. Le 31 est bien loin, beaucoup trop loin pour le long adieu que je voudrais vous dire.
1h.
Je m’étais trompée, c’est la copie de la lettre que vous voulez si nous nous séparons ; à la bonne heure, vous l’aurez, moins la dernière moitié de la dernière page, mais je vous la redirai, je la répéterai après vous et vous en garderez là si bien le souvenir que ce supplément sera dans votre cœur plus sereinement encore que la lettre ne reposera dessus. Monsieur vous m’avez fourni là un texte inépuisable & depuis le 13 octobre je ne pense qu’à cette lettre. Vous le voyez bien. Il me semble très convenable de vous redire encore adieu ici.
61. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°61. Mardi 17 9 heures 1/4
Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !
Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.
Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.
Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.
Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.
Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.
Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.
11 H.
J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.
Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !
Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.
Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.
Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.
Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.
Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.
Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.
11 H.
J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Amour, Discours du for intérieur, histoire, Poésie, Portrait, Protestantisme, Religion
64. Paris, Mercredi 18 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
64. Jeudi 9 heures
à onze heures hier au soir, on m’annonce le Prince de Lieven. Je pousse un cri d’effroi, & puis j’articule bien bas une invocation. " Mon bien aimé protège-moi. " Il m’a protégé. C’était mon fils que mon mari m’envoyer pour me conduire auprès de lui à Lausanne. 1 heure Je suis si souffrante, si tremblante qu’il m’est impossible de continuer cette lettre. Pardonnez moi. Adieu. Adieu. adieu.
à onze heures hier au soir, on m’annonce le Prince de Lieven. Je pousse un cri d’effroi, & puis j’articule bien bas une invocation. " Mon bien aimé protège-moi. " Il m’a protégé. C’était mon fils que mon mari m’envoyer pour me conduire auprès de lui à Lausanne. 1 heure Je suis si souffrante, si tremblante qu’il m’est impossible de continuer cette lettre. Pardonnez moi. Adieu. Adieu. adieu.
Mots-clés : Enfants (Benckendorff), Santé (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
62. Val-Richer, Mercredi 18 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
63. Lisieux, Vendredi 20 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
[Madame la Princesse de Lieven
Rue de Rivoli hôtel de la Terrasse
Paris]
N°63. Lisieux, Vendredi 10 h 1/4
J’arrive d’ Osbée et je prends moi-même à la poste, en passant ici, votre n° 64 moi aussi, j’ai poussé intérieurement un cri d’effroi. et la fin, la fin de cette courte lettre me laisse tout mon effroi. Pourquoi étiez-vous à 1 heure, plus malade, plus tremblante qu’à 9 heures ? Que vous a t-on annoncé ? Que vous a-t-on dit ? Comment se fait-il que vous ne m’en disiez pas un mot, un seul mot ? Mon amie, j’ai horreur de l’exagération des paroles ; mais je suis au supplice. Je serai au supplice jusqu’à demain. Et que sais-je ce qui sera après la lettre de demain ? Cependant je suis sûr. C’est impossible. Que c’est long jusqu’à demain ? Si j’étais seul ! Si personne ne me voyait ! Et pourtant, non. J’hésiterais à cause de vous. Il faut attendre. Mais qu’au moins, je sois avec vous, près de vous, dans votre cœur, sur votre cœur. Dearest, le mien est à vous, tout à vous, pour toujours à vous, pour toujours. Et à vous, comme vous ne le savez pas, comme vous ne le saurez jamais ; avec plus de tendresse, d’amour, de désir, d’espérance, de crainte, plus de bonheur ou de malheur possible que je ne le savais moi-même, il y a un quart d’heure. Adieu. Adieu. Cinq ou six personnes m’attendent. Adieu. Quel adieu !
Je n’ai sous ma main ni enveloppe, ni cire noire et je suis très pressé.
Rue de Rivoli hôtel de la Terrasse
Paris]
N°63. Lisieux, Vendredi 10 h 1/4
J’arrive d’ Osbée et je prends moi-même à la poste, en passant ici, votre n° 64 moi aussi, j’ai poussé intérieurement un cri d’effroi. et la fin, la fin de cette courte lettre me laisse tout mon effroi. Pourquoi étiez-vous à 1 heure, plus malade, plus tremblante qu’à 9 heures ? Que vous a t-on annoncé ? Que vous a-t-on dit ? Comment se fait-il que vous ne m’en disiez pas un mot, un seul mot ? Mon amie, j’ai horreur de l’exagération des paroles ; mais je suis au supplice. Je serai au supplice jusqu’à demain. Et que sais-je ce qui sera après la lettre de demain ? Cependant je suis sûr. C’est impossible. Que c’est long jusqu’à demain ? Si j’étais seul ! Si personne ne me voyait ! Et pourtant, non. J’hésiterais à cause de vous. Il faut attendre. Mais qu’au moins, je sois avec vous, près de vous, dans votre cœur, sur votre cœur. Dearest, le mien est à vous, tout à vous, pour toujours à vous, pour toujours. Et à vous, comme vous ne le savez pas, comme vous ne le saurez jamais ; avec plus de tendresse, d’amour, de désir, d’espérance, de crainte, plus de bonheur ou de malheur possible que je ne le savais moi-même, il y a un quart d’heure. Adieu. Adieu. Cinq ou six personnes m’attendent. Adieu. Quel adieu !
Je n’ai sous ma main ni enveloppe, ni cire noire et je suis très pressé.
Mots-clés : Relation François-Dorothée, Vie familiale (Dorothée)
65. Paris, Vendredi 20 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
65. Vendredi 20 octobre. 9 heures.
Vous m’aurez pardonné mon billet d’hier vous me pardonnerez encore aujourd’hui les petites propositions de cette lettre. Mon fils ne passe ici que deux jours. Nous ne nous quittons pas de toute la matinée, & je suis si étourdie de tout ce qu’il me dit, de tout ce que j’ai à lui dire, qu’il ne me reste vraiment pas de force pour vous écrire. Les menaces de très haut sont très fortes, mais vous savez que cela n’y fera rien. Le vrai chagrin que j’ai est que mon mari ne veut rien croire, & que l’attentat du médecin a été mis en pièce par lui avant de le lire. Alexandre partira convaincu de l’impossibilité pour moi de bouger. Mon médecin lui à a déjà parlé. Mais sa conviction aura beau être intime, il ne pense pas que mon mari la partage avant que l’Empereur ne le lui commande. Mon mari me mande que depuis qu’il m’a fait connaître ces résolutions Il a la conscience tranquille ! Le rôle de l’Empereur va commencer nous verrons comment il pourra le soutenir. On commence autour de moi à se mettre en train de me soutenir, & cela sans aucun effort de ma part. Pozzo même s’en mêle très spontanément, et de sa part j’en suis vraiment touchée car je ne m’y attendais pas. Vous voyez partout ce que je vous dis, que je vis ces jours-ci dans un cercle d’agitations extrêmes.
Ne croyez pas cependant que ma véritable vie y perds rien au contraire, je me replie sur mon cœur, & plus que jamais je le trouve rempli d’amour & de force. Pour que je puisse écrire par M. de Grouchy il faudrait que je remisse de la main à la main ma lettre à M. Génie. Je n’ai pas un moment à moi. Mon fils est là, toujours là. Dites-vous tout ce que je ne vous dis pas. Tout, bien vif, bien intime, je ne désavouerai rien. J’ajouterai peut-être.
A propos j’ai vu ce M. Grouchy, il est assez lié avec ce fils qui est auprès de moi dans ce moment. Hier Berryer est venu le soir un peu maigri de sa maladie. Thiers a passé deux fois sans me trouver, il reviendra aujourd’hui. M. Molé lui a fait une longue visite avant-hier. Il a dîné ce même jour chez M. de Montalivet hier il a été à Trianon. Je sais qu’il va en Angleterre. On me dit aussi qu’il est venu demander aux ministres s’ils voulaient qu’il fût ministériel ? dans ce cas il demande qu’on favorise les élections de ses amis, & que lui même on le laisse être élu dans cinq ou 6 endroits. Voilà les rapportages, mais qui viennent de lieu sûr. J’ai plus écrit que je ne pensais, & même sur plus de sujets qu’il ne me parais sait possible. Que j’aime l’amour hindou ! C’est comme cela que je l’entends aujourd’hui que de choses que je n’ai apprises que depuis trois mois ! Je veux dire quatre mois. Je ne pense qu’au 31, la nuit, le jour. J’étais si bien avant hier. Depuis l’arrivée de mon fils, le sommeil & les forces m’ont de nouveau abandonnée. Adieu. Adieu plus longuement, plus tendrement adieu que jamais.
Vous m’aurez pardonné mon billet d’hier vous me pardonnerez encore aujourd’hui les petites propositions de cette lettre. Mon fils ne passe ici que deux jours. Nous ne nous quittons pas de toute la matinée, & je suis si étourdie de tout ce qu’il me dit, de tout ce que j’ai à lui dire, qu’il ne me reste vraiment pas de force pour vous écrire. Les menaces de très haut sont très fortes, mais vous savez que cela n’y fera rien. Le vrai chagrin que j’ai est que mon mari ne veut rien croire, & que l’attentat du médecin a été mis en pièce par lui avant de le lire. Alexandre partira convaincu de l’impossibilité pour moi de bouger. Mon médecin lui à a déjà parlé. Mais sa conviction aura beau être intime, il ne pense pas que mon mari la partage avant que l’Empereur ne le lui commande. Mon mari me mande que depuis qu’il m’a fait connaître ces résolutions Il a la conscience tranquille ! Le rôle de l’Empereur va commencer nous verrons comment il pourra le soutenir. On commence autour de moi à se mettre en train de me soutenir, & cela sans aucun effort de ma part. Pozzo même s’en mêle très spontanément, et de sa part j’en suis vraiment touchée car je ne m’y attendais pas. Vous voyez partout ce que je vous dis, que je vis ces jours-ci dans un cercle d’agitations extrêmes.
Ne croyez pas cependant que ma véritable vie y perds rien au contraire, je me replie sur mon cœur, & plus que jamais je le trouve rempli d’amour & de force. Pour que je puisse écrire par M. de Grouchy il faudrait que je remisse de la main à la main ma lettre à M. Génie. Je n’ai pas un moment à moi. Mon fils est là, toujours là. Dites-vous tout ce que je ne vous dis pas. Tout, bien vif, bien intime, je ne désavouerai rien. J’ajouterai peut-être.
A propos j’ai vu ce M. Grouchy, il est assez lié avec ce fils qui est auprès de moi dans ce moment. Hier Berryer est venu le soir un peu maigri de sa maladie. Thiers a passé deux fois sans me trouver, il reviendra aujourd’hui. M. Molé lui a fait une longue visite avant-hier. Il a dîné ce même jour chez M. de Montalivet hier il a été à Trianon. Je sais qu’il va en Angleterre. On me dit aussi qu’il est venu demander aux ministres s’ils voulaient qu’il fût ministériel ? dans ce cas il demande qu’on favorise les élections de ses amis, & que lui même on le laisse être élu dans cinq ou 6 endroits. Voilà les rapportages, mais qui viennent de lieu sûr. J’ai plus écrit que je ne pensais, & même sur plus de sujets qu’il ne me parais sait possible. Que j’aime l’amour hindou ! C’est comme cela que je l’entends aujourd’hui que de choses que je n’ai apprises que depuis trois mois ! Je veux dire quatre mois. Je ne pense qu’au 31, la nuit, le jour. J’étais si bien avant hier. Depuis l’arrivée de mon fils, le sommeil & les forces m’ont de nouveau abandonnée. Adieu. Adieu plus longuement, plus tendrement adieu que jamais.
64. Val-Richer, Samedi 21 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°64. Samedi 21 8 heures
J’attends. Vous connaissez cet état où l’âme n’a plus qu’un sentiment, qu’une idée où la vie est suspendue partout, partout excepté sur un point. C’est un état bien pesant. D’autant plus pesant qu’il est plein d’hypocrisie ; on va, on vient, on parle ; on a l’air de penser à tout. J’ai fait recommander hier au facteur de la poste de venir aussi vite qu’il le le pourrait. Mais il ne sera pas ici avant 10 heures et demie.
Cette nuit je me suis réveillé dix fois croyant l’entendre arriver. Ah, dearest, que sert d’avoir vécu d’avoir souffert si l’on n’apprend pas du tout à souffrir si l’on se retrouve, après, tant et tant d’épreuves, aussi impatient à la souffrance, aussi ardent au bonheur, aussi agité, aussi tremblant, aussi avisé. Et pourtant, je m’admire ; je me trouve d’une patience, d’une modération excessive. Si je m’en croyais, si je suivais ma pente, si mes actions étaient l’image fidèle de mes sentiments, où serais-je aujourd’hui ? Je vous l’ai dit souvent : on a mille fois plus de vertu qu’on ne croit. Mais elle ne gouverne que le dehors. Depuis hier, je me raisonne sans relâche ; je me dis tout ce que ce me dirait le plus sensé, le plus bienveillant ami, que rien ne peut être changé dans votre situation, dans notre situation, que votre fils ne peut vous avoir rien amené, rien apporté que nous n’eussions prévu puisque nous avions prévu le pire, que son arrivée vous délivre au contraire d’une crainte plus grave, que vos lettres à tout ce monde-là sont parties &, &. Tout cela est vrai, j’espère, j’en suis sûr. Mais jusqu’à ce que j’aie des nouvelles, des nouvelles comme il me les faut, toutes ces vérités-là sont mortes. Je les vois et elles ne me font rien. Elles passent devant mon esprit & quand elles ont passé, je me retrouve tel que j’étais. Je n’ai pas même la ressource de me blâmer moi-même, de me dire que j’ai tort de vous tant aimer, de mettre ma vie en vous, que j’aurais mieux fait de laisser mon cœur dans son tombeau. Il n’y a pas moyen ; ces idées-là ne peuvent m’approcher. Quand elles essayent d’apparaître de loin, à l’instant je vous vois, vous avec tout ce que vous avez de noble, de vrai, de tendre, de rare, vous excellente et charmante, vous si aimable, si attrayante, si attachante et toujours d’en haut. du plus haut ou puisse habiter une créature ! Comment aurais-je fait vous connaissant, pour ne pas vous aimer comme je vous aime ? Comment ferais-je vous aimant, pour ne pas être inquiet, troublé, impatient, avide, jaloux, insatiable comme je le suis ? Je n’ai qu’à me résigner. Je me résigne. Dans deux heures j’espère, je n’y aurai pas tant de peine.
J’attends toujours. Vous me direz sans doute si je puis continuer à vous écrire comme je ferais, ou s’il faut prendre quelqu’une des précautions que vous m’avez indiquées. En attendant, et pour que rien ne manque à la sûreté, je vous ai écrit hier soir et vous aurez demain une lettre officielle, très officielle. Il n’y a personne qui ne puisse lire celle-là aussi, n’a-t-elle point de Numéro.
11 heures 1/4
Me voilà rassuré. Me voilà heureux. Pourtant, je vous envoie ma folie, car c’est de la folie. Je vous l’envoie même directement. Il n’y a, ce me semble, aucune raison de ne pas le faire. Vous l’aurez trois heures plutôt. Et je ne vous ai pas seulement demandé si vous étiez toujours plus souffrante ! Je n’ai pas songé à votre santé ! Décidément dites-moi si quand je vous écris comme aujourd’hui, vous voulez que ce soit directement, ou directement. Adieu, adieu. Adieu. J’y mets tout. G.
J’attends. Vous connaissez cet état où l’âme n’a plus qu’un sentiment, qu’une idée où la vie est suspendue partout, partout excepté sur un point. C’est un état bien pesant. D’autant plus pesant qu’il est plein d’hypocrisie ; on va, on vient, on parle ; on a l’air de penser à tout. J’ai fait recommander hier au facteur de la poste de venir aussi vite qu’il le le pourrait. Mais il ne sera pas ici avant 10 heures et demie.
Cette nuit je me suis réveillé dix fois croyant l’entendre arriver. Ah, dearest, que sert d’avoir vécu d’avoir souffert si l’on n’apprend pas du tout à souffrir si l’on se retrouve, après, tant et tant d’épreuves, aussi impatient à la souffrance, aussi ardent au bonheur, aussi agité, aussi tremblant, aussi avisé. Et pourtant, je m’admire ; je me trouve d’une patience, d’une modération excessive. Si je m’en croyais, si je suivais ma pente, si mes actions étaient l’image fidèle de mes sentiments, où serais-je aujourd’hui ? Je vous l’ai dit souvent : on a mille fois plus de vertu qu’on ne croit. Mais elle ne gouverne que le dehors. Depuis hier, je me raisonne sans relâche ; je me dis tout ce que ce me dirait le plus sensé, le plus bienveillant ami, que rien ne peut être changé dans votre situation, dans notre situation, que votre fils ne peut vous avoir rien amené, rien apporté que nous n’eussions prévu puisque nous avions prévu le pire, que son arrivée vous délivre au contraire d’une crainte plus grave, que vos lettres à tout ce monde-là sont parties &, &. Tout cela est vrai, j’espère, j’en suis sûr. Mais jusqu’à ce que j’aie des nouvelles, des nouvelles comme il me les faut, toutes ces vérités-là sont mortes. Je les vois et elles ne me font rien. Elles passent devant mon esprit & quand elles ont passé, je me retrouve tel que j’étais. Je n’ai pas même la ressource de me blâmer moi-même, de me dire que j’ai tort de vous tant aimer, de mettre ma vie en vous, que j’aurais mieux fait de laisser mon cœur dans son tombeau. Il n’y a pas moyen ; ces idées-là ne peuvent m’approcher. Quand elles essayent d’apparaître de loin, à l’instant je vous vois, vous avec tout ce que vous avez de noble, de vrai, de tendre, de rare, vous excellente et charmante, vous si aimable, si attrayante, si attachante et toujours d’en haut. du plus haut ou puisse habiter une créature ! Comment aurais-je fait vous connaissant, pour ne pas vous aimer comme je vous aime ? Comment ferais-je vous aimant, pour ne pas être inquiet, troublé, impatient, avide, jaloux, insatiable comme je le suis ? Je n’ai qu’à me résigner. Je me résigne. Dans deux heures j’espère, je n’y aurai pas tant de peine.
J’attends toujours. Vous me direz sans doute si je puis continuer à vous écrire comme je ferais, ou s’il faut prendre quelqu’une des précautions que vous m’avez indiquées. En attendant, et pour que rien ne manque à la sûreté, je vous ai écrit hier soir et vous aurez demain une lettre officielle, très officielle. Il n’y a personne qui ne puisse lire celle-là aussi, n’a-t-elle point de Numéro.
11 heures 1/4
Me voilà rassuré. Me voilà heureux. Pourtant, je vous envoie ma folie, car c’est de la folie. Je vous l’envoie même directement. Il n’y a, ce me semble, aucune raison de ne pas le faire. Vous l’aurez trois heures plutôt. Et je ne vous ai pas seulement demandé si vous étiez toujours plus souffrante ! Je n’ai pas songé à votre santé ! Décidément dites-moi si quand je vous écris comme aujourd’hui, vous voulez que ce soit directement, ou directement. Adieu, adieu. Adieu. J’y mets tout. G.
66. Paris, Samedi 21 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
66. Samedi 21 octobre midi
Dès que mon fils sera parti. Je vous rendrai un compte détaillé de tout ce qui me regarde, jusque là imaginez vous que depuis 9 h jusqu’à 6, il est là, sans cesse. Que nous avons un travail immense à faire ensemble, que j’ai la tête rompue, renversée, que je n’en puis plus & que si mon cœur est toujours, sans cesse à votre service, mon temps ne l’est pas du tout que je ne sais où trouver deux minutes. Il part après demain. Pauvre jeune homme placé entre son père & sa mère dans des circonstances aussi pénibles.
Je n’ai aucun espoir de ramener mon mari, il a perdu la tête. Il faut que je ramène l’Empereur & vous concevez la difficulté si j’échoue, il y aura un éclat terrible, mais rien ne m’ébranlera. Vous savez où je trouve ma force. J’ai vu M. Génie deux fois ce matin. Il m’a porté votre petit billet & demain il viendra prendre un mot de ma part pour vous l’envoyer par M. Grouchy. Vous voulez un mot, vous l’aurez, je le veux aussi, je veux vous donner de la joie. Je sais ce qu’est elle est immense pour moi.
Thiers a passé deux heures chez moi hier. Il est entré boudant, son humeur s’est éclaircie, et il est sorti enchanté. C’est vous qui faisiez sa mauvaise humeur. Il est ministériel ; si les ministres le soutiennent aux élections. Mais au fond de part ni d’autre cela ne me parait encore bien solidement établi. Il est drôle, il est bavard mais comme j’ai été frappée du peu de facilité & d’élégance avec laquelle il s’exprime ! Comme je suis gâtée il est parti ce matin pour Lille il sera ici la première semaine de Nov. Lui et Berryer se trouveront en présence à Aix & à Marseille on les oppose l’un à l’autre dans les deux villes.
Voyez avec quelle hâte je vous écris, voilà une correction plus ridicule encore que celle de l’autre jour.) Ma santé se ressent de toutes les émotions et les tracasseries qu’on me donne, je ne dors pas. Ah quand me laissera-t-on tranquille. Adieu. Adieu. Vos lettres me soutiennent. Je les aime plus que jamais & plus que jamais adieu. Dans mon n°64, j’étais moins agitée à 9h. qu’à 1 h. parce que j’avis prié mon fils de ne me dire que le matin les choses qui pouvaient m’irriter le plus. Voici les paroles de l’Empereur : " Mon honneur et ma dignité sont blessés par votre femme, elle seule a osé jamais mon autorité. Faites vous obéir par elle, si vous n’y réussissez pas, c’est moi qui la réduirez en poussière." Il nous reste à voir comment ?
Dès que mon fils sera parti. Je vous rendrai un compte détaillé de tout ce qui me regarde, jusque là imaginez vous que depuis 9 h jusqu’à 6, il est là, sans cesse. Que nous avons un travail immense à faire ensemble, que j’ai la tête rompue, renversée, que je n’en puis plus & que si mon cœur est toujours, sans cesse à votre service, mon temps ne l’est pas du tout que je ne sais où trouver deux minutes. Il part après demain. Pauvre jeune homme placé entre son père & sa mère dans des circonstances aussi pénibles.
Je n’ai aucun espoir de ramener mon mari, il a perdu la tête. Il faut que je ramène l’Empereur & vous concevez la difficulté si j’échoue, il y aura un éclat terrible, mais rien ne m’ébranlera. Vous savez où je trouve ma force. J’ai vu M. Génie deux fois ce matin. Il m’a porté votre petit billet & demain il viendra prendre un mot de ma part pour vous l’envoyer par M. Grouchy. Vous voulez un mot, vous l’aurez, je le veux aussi, je veux vous donner de la joie. Je sais ce qu’est elle est immense pour moi.
Thiers a passé deux heures chez moi hier. Il est entré boudant, son humeur s’est éclaircie, et il est sorti enchanté. C’est vous qui faisiez sa mauvaise humeur. Il est ministériel ; si les ministres le soutiennent aux élections. Mais au fond de part ni d’autre cela ne me parait encore bien solidement établi. Il est drôle, il est bavard mais comme j’ai été frappée du peu de facilité & d’élégance avec laquelle il s’exprime ! Comme je suis gâtée il est parti ce matin pour Lille il sera ici la première semaine de Nov. Lui et Berryer se trouveront en présence à Aix & à Marseille on les oppose l’un à l’autre dans les deux villes.
Voyez avec quelle hâte je vous écris, voilà une correction plus ridicule encore que celle de l’autre jour.) Ma santé se ressent de toutes les émotions et les tracasseries qu’on me donne, je ne dors pas. Ah quand me laissera-t-on tranquille. Adieu. Adieu. Vos lettres me soutiennent. Je les aime plus que jamais & plus que jamais adieu. Dans mon n°64, j’étais moins agitée à 9h. qu’à 1 h. parce que j’avis prié mon fils de ne me dire que le matin les choses qui pouvaient m’irriter le plus. Voici les paroles de l’Empereur : " Mon honneur et ma dignité sont blessés par votre femme, elle seule a osé jamais mon autorité. Faites vous obéir par elle, si vous n’y réussissez pas, c’est moi qui la réduirez en poussière." Il nous reste à voir comment ?
65. Val-Richer, Dimanche 22 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°65 Dimanche 22 7 heures
Il est très doux de se réveiller quand on a le cœur content. Je ne m’étonne pas que les oiseaux chantent en se réveillant. La vie leur plait, et ils se réjouissent de la retrouver. Je ne chante qu’en dedans ; mais cela me suffit. Je m’entends moi même. Quels enfantillages je vous conte là ! Il faut bien que je vous conte mes enfantillages après mes folies. Une fois ensemble, nous parlerons sérieusement. Nous allons entrer dans la dernière semaine. Il est possible que par des arrangements de voyage j’arrive à Paris, le 31 à 7 heures du matin au lieu de 5 heures du soir. Je vous verrai ainsi quelques heures plutôt. Je vous le dirai positivement d’ici à trois jours. Le réveil du 31 vaudra encore mieux que celui d’aujourd’hui.
En attendant, et dans les moments de liberté qu’on me laisse ; je plante. Mon jardin, n’est pas commencé, mais pour ne pas perdre tout-à-fait cette année, je mets des bouquets d’arbres et d’arbustes là où je suis sûr qu’il en faudra. Il m’est venu hier 76 pins, mélèzes, sapins et arbres verts de toute espèce, déjà un peu grands; et j’ai passé presque toute ma matinée à marquer les places, à faire creuser les trous, tant au bord de la pièce d’eau, tant assez près de la maison autour d’un banc, tant à une place d’où l’en entrevoit une jolie vallée un peu lointaine. N’est-ce pas qu’il faut absolument quelque part une grande allée droite où l’on puisse se promener sans tourner sans cesse, et causer en voyant devant et derrière soi ? J’en aurai une ou plutôt deux tombant l’une sur l’autre à angle droit. La première sera d’arbres ordinaires, tilleuls, marronniers, cerisiers, je ne sais pas bien lesquels ; j’ai envie que la seconde, beaucoup plus courte, soit toute en arbres verts, deux rideaux bien hauts, bien droits, fermant bien les côtés, mais laissant voir le ciel. Qu’en dites-vous ?
Je suis curieux de votre conversation avec Thiers, ce que vous me mandez de lui ne m’étonne pas du tout. Du reste sa conduite dépendra des élections. Si elles lui sont favorables, si la gauche gagne du terrain, il fera de nouveaux pas vers elle, sera exigeant, arrogant, menaçant avec le Ministère. Si l’ancienne majorité revient la même c’est-à-dire affermie, il sera doux, modeste, se fera ministériel soutiendra, promettra. Il y a là cependant pour lui une grosse difficulté. Il ne voudra pas faire ce métier-là gratis ; et on ne pourra lui donner le prix qu’il voudra. J’ai peine à croire qu’il se mette à si bas prix que le marché. soit possible. Nous verrons. Mes nouvelles électorales sont assez bonnes. J’ai grande envie de savoir un peu aussi les projets de Berryer. Je ne crois pas que son bataillon se grossisse autant que quelques personnes l’espèrent ou le craignent. Il n’acquerra pas plus de 15 ou 20 nouveaux membres. Cependant ce sera un petit bataillon et dans une assemblée incertaine, comme le sera encore celle-ci, c’est toujours quelque chose.
On commence donc à vous soutenir un peu. Vous propagez la rébellion. Je suis bien aise que Pozzo s’en mêle. J’ai pour lui un fond de vieux goût. J’en ai toujours pour les hommes dont l’esprit a mis le mien en mouvement et avec qui j’ai causé bien en train, bien à l’aise, n’importe sur quoi. Je vous préviens que je ne vous écrirai cette semaine que des lettres misérables. J’aurai de jour en jour, moins de goût à vous écrire. J’ai une multitude de petites affaires qu’il faut absolument que je règle. On me prend tout mon temps en visites. Je vais trois fois dans la semaine dîner à Lisieux.
Mlle Chabaud, cette amie de ma mère qui était ici et avait bien voulu se charger de la leçon d’anglais de mes filles, est partie hier. Je reprends mon rôle. J’ai déjà lu hier avec Henriette une scène de Shakspeare, Hamlet and the ghost. Elle l’entend assez bien. 11 1/4 Je comprends votre agitation, votre presse. J’ai regret d’y avoir ajouté. Ne m’écrivez que quelques mots si vous êtes fatiguée. Adieu, adieu. Votre N°66 me charme. Adieu.
Il est très doux de se réveiller quand on a le cœur content. Je ne m’étonne pas que les oiseaux chantent en se réveillant. La vie leur plait, et ils se réjouissent de la retrouver. Je ne chante qu’en dedans ; mais cela me suffit. Je m’entends moi même. Quels enfantillages je vous conte là ! Il faut bien que je vous conte mes enfantillages après mes folies. Une fois ensemble, nous parlerons sérieusement. Nous allons entrer dans la dernière semaine. Il est possible que par des arrangements de voyage j’arrive à Paris, le 31 à 7 heures du matin au lieu de 5 heures du soir. Je vous verrai ainsi quelques heures plutôt. Je vous le dirai positivement d’ici à trois jours. Le réveil du 31 vaudra encore mieux que celui d’aujourd’hui.
En attendant, et dans les moments de liberté qu’on me laisse ; je plante. Mon jardin, n’est pas commencé, mais pour ne pas perdre tout-à-fait cette année, je mets des bouquets d’arbres et d’arbustes là où je suis sûr qu’il en faudra. Il m’est venu hier 76 pins, mélèzes, sapins et arbres verts de toute espèce, déjà un peu grands; et j’ai passé presque toute ma matinée à marquer les places, à faire creuser les trous, tant au bord de la pièce d’eau, tant assez près de la maison autour d’un banc, tant à une place d’où l’en entrevoit une jolie vallée un peu lointaine. N’est-ce pas qu’il faut absolument quelque part une grande allée droite où l’on puisse se promener sans tourner sans cesse, et causer en voyant devant et derrière soi ? J’en aurai une ou plutôt deux tombant l’une sur l’autre à angle droit. La première sera d’arbres ordinaires, tilleuls, marronniers, cerisiers, je ne sais pas bien lesquels ; j’ai envie que la seconde, beaucoup plus courte, soit toute en arbres verts, deux rideaux bien hauts, bien droits, fermant bien les côtés, mais laissant voir le ciel. Qu’en dites-vous ?
Je suis curieux de votre conversation avec Thiers, ce que vous me mandez de lui ne m’étonne pas du tout. Du reste sa conduite dépendra des élections. Si elles lui sont favorables, si la gauche gagne du terrain, il fera de nouveaux pas vers elle, sera exigeant, arrogant, menaçant avec le Ministère. Si l’ancienne majorité revient la même c’est-à-dire affermie, il sera doux, modeste, se fera ministériel soutiendra, promettra. Il y a là cependant pour lui une grosse difficulté. Il ne voudra pas faire ce métier-là gratis ; et on ne pourra lui donner le prix qu’il voudra. J’ai peine à croire qu’il se mette à si bas prix que le marché. soit possible. Nous verrons. Mes nouvelles électorales sont assez bonnes. J’ai grande envie de savoir un peu aussi les projets de Berryer. Je ne crois pas que son bataillon se grossisse autant que quelques personnes l’espèrent ou le craignent. Il n’acquerra pas plus de 15 ou 20 nouveaux membres. Cependant ce sera un petit bataillon et dans une assemblée incertaine, comme le sera encore celle-ci, c’est toujours quelque chose.
On commence donc à vous soutenir un peu. Vous propagez la rébellion. Je suis bien aise que Pozzo s’en mêle. J’ai pour lui un fond de vieux goût. J’en ai toujours pour les hommes dont l’esprit a mis le mien en mouvement et avec qui j’ai causé bien en train, bien à l’aise, n’importe sur quoi. Je vous préviens que je ne vous écrirai cette semaine que des lettres misérables. J’aurai de jour en jour, moins de goût à vous écrire. J’ai une multitude de petites affaires qu’il faut absolument que je règle. On me prend tout mon temps en visites. Je vais trois fois dans la semaine dîner à Lisieux.
Mlle Chabaud, cette amie de ma mère qui était ici et avait bien voulu se charger de la leçon d’anglais de mes filles, est partie hier. Je reprends mon rôle. J’ai déjà lu hier avec Henriette une scène de Shakspeare, Hamlet and the ghost. Elle l’entend assez bien. 11 1/4 Je comprends votre agitation, votre presse. J’ai regret d’y avoir ajouté. Ne m’écrivez que quelques mots si vous êtes fatiguée. Adieu, adieu. Votre N°66 me charme. Adieu.
67. Paris, Dimanche 22 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
67. Dimanche le 22 octobre midi.
J’ai reçu votre lettre ce matin, je ne suis pas fâchée d’avoir une pièce aussi officielle ; elle pourrait être bonne à produire un jour, mais reprenons nos habitudes. Il n’y a plus le moindre danger de l’arrivée de M. de Lieven. Mon fils part demain pour le retrouver à Lausanne, delà ils se mettent immédiatement en route pour l’Italie. Ecrivez-moi par la poste comme vous avez toujours fait, il me faut cela. & puis une fois encore par une bonne occasion plus intimement. Et puis nous arrivons au 31, au 31 ! Concevez- vous tout ce que j’éprouve en traçant le chiffre ! Savez-vous que mon affaire avec mon mari est un tel dédale que nous ne nous y retrouvons plus du tout mon fils et moi, & qu’après avoir tout lu, tout examiné de part et d’autre, nous en sommes venus à la conclusion, qu’il est possible, qu’il ait inventé tout ce qu’il prête à l’Empereur ! Alors la confusion est à son comble, car mes lettres sont parties, mes confidences sont faites, & mon mari va l’apprendre. C’est vraiment trop long à vous dire.
Pahlen et moi nous avons regardé cette affaire de tous les côtés hier au soir. On peut lui intimer de me regarder comme rebelle, on peut m’ôter le portrait. Qu’est-ce que cela me fait ? Exactement rien du tout. & on ne peut pas faire plus. et faire cela cependant est hors de toute vraisemblance car tout despote qu’il est, il faut baser cela sur quelque chose. Être à Paris n’est pas suffisant & je demande une enquête. Il faut bien me l’accorder. En vérité, c’est trop bouffon & après avoir un peu gémi, je finis toujours par rire, mais je crois mon mari fou, ni plus, ni moins, & son fils le peine un peu.
Et savez vous que mon frère l’est complètement. Il vient d’embrasser la religion grecque. Allons me voilà dans une belle famille si j’y étais restée ! Mon fils part demain, j’en suis presque impatiente. Nos entretiens perpétuels sur un même sujet si désagréable me font du mal, & puis je ne dors pas la nuit, je ne vous fais plus mon journal. Depuis 9 h. jusqu’à 6 heures, il ne me quitte pas. Le bois de Boulogne nous le faisons ensemble. à 6 1/2 nous dînons encore ensemble jusqu’au moment où j’ouvre ma poste. Après demain j’écrirai avec plus de liberté d’esprit, & du temps.
J’écris des volumes à mon mari, il y a tant à expliquer ; car c’est un enfant. Je serai impatiente que vous m’annonciez la réception de ma lettre pas M. Grouchy. L’aimerez- vous un peu ? Je ne sais plus ce qu’elle contient. Je voudrais m’en rappeler, savoir s’il n’y a pas trop, s’il n’ a pas trop peu. Je flotte entre ces deux craintes. Et au bout de tout cela je suis mécontente. que ce que dans le trouble d’esprit où je vis Je vous aurai dit des bêtises, pas du tout ce que je voulais vous dire, mais je n’ai pas été maîtresse de choisir mon moment. Cela vaudra mieux que toutes les lettres. J’ai eu une excellente lettre de Valençay. Je vous en parlerai. On me dit de vous rappeler Rochecotte en nov : & moi, je vous prie de l’oublier.
Adieu. Adieu, toujours toute notre vie adieu. N’est-ce pas toute notre vit. M. Grouchy doit porter ce soir.
J’ai reçu votre lettre ce matin, je ne suis pas fâchée d’avoir une pièce aussi officielle ; elle pourrait être bonne à produire un jour, mais reprenons nos habitudes. Il n’y a plus le moindre danger de l’arrivée de M. de Lieven. Mon fils part demain pour le retrouver à Lausanne, delà ils se mettent immédiatement en route pour l’Italie. Ecrivez-moi par la poste comme vous avez toujours fait, il me faut cela. & puis une fois encore par une bonne occasion plus intimement. Et puis nous arrivons au 31, au 31 ! Concevez- vous tout ce que j’éprouve en traçant le chiffre ! Savez-vous que mon affaire avec mon mari est un tel dédale que nous ne nous y retrouvons plus du tout mon fils et moi, & qu’après avoir tout lu, tout examiné de part et d’autre, nous en sommes venus à la conclusion, qu’il est possible, qu’il ait inventé tout ce qu’il prête à l’Empereur ! Alors la confusion est à son comble, car mes lettres sont parties, mes confidences sont faites, & mon mari va l’apprendre. C’est vraiment trop long à vous dire.
Pahlen et moi nous avons regardé cette affaire de tous les côtés hier au soir. On peut lui intimer de me regarder comme rebelle, on peut m’ôter le portrait. Qu’est-ce que cela me fait ? Exactement rien du tout. & on ne peut pas faire plus. et faire cela cependant est hors de toute vraisemblance car tout despote qu’il est, il faut baser cela sur quelque chose. Être à Paris n’est pas suffisant & je demande une enquête. Il faut bien me l’accorder. En vérité, c’est trop bouffon & après avoir un peu gémi, je finis toujours par rire, mais je crois mon mari fou, ni plus, ni moins, & son fils le peine un peu.
Et savez vous que mon frère l’est complètement. Il vient d’embrasser la religion grecque. Allons me voilà dans une belle famille si j’y étais restée ! Mon fils part demain, j’en suis presque impatiente. Nos entretiens perpétuels sur un même sujet si désagréable me font du mal, & puis je ne dors pas la nuit, je ne vous fais plus mon journal. Depuis 9 h. jusqu’à 6 heures, il ne me quitte pas. Le bois de Boulogne nous le faisons ensemble. à 6 1/2 nous dînons encore ensemble jusqu’au moment où j’ouvre ma poste. Après demain j’écrirai avec plus de liberté d’esprit, & du temps.
J’écris des volumes à mon mari, il y a tant à expliquer ; car c’est un enfant. Je serai impatiente que vous m’annonciez la réception de ma lettre pas M. Grouchy. L’aimerez- vous un peu ? Je ne sais plus ce qu’elle contient. Je voudrais m’en rappeler, savoir s’il n’y a pas trop, s’il n’ a pas trop peu. Je flotte entre ces deux craintes. Et au bout de tout cela je suis mécontente. que ce que dans le trouble d’esprit où je vis Je vous aurai dit des bêtises, pas du tout ce que je voulais vous dire, mais je n’ai pas été maîtresse de choisir mon moment. Cela vaudra mieux que toutes les lettres. J’ai eu une excellente lettre de Valençay. Je vous en parlerai. On me dit de vous rappeler Rochecotte en nov : & moi, je vous prie de l’oublier.
Adieu. Adieu, toujours toute notre vie adieu. N’est-ce pas toute notre vit. M. Grouchy doit porter ce soir.
66. Val-Richer, Lundi 23 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°66 Lundi 23 7 heures
Décidément et malgré l’ébranlement que cela vous a causé, et quoique je ne sache encore aucun détail, je suis bien aise que votre fils soit venu. Il aura vu ce qu’on ne voit pas de loin. Vous lui aurez dit ce qu’on n’écrit pas. Quelque résolu que soit M. de Lieven à ne pas changer d’avis avant le temps il me paraît impossible que cela n’agisse pas un peu sur lui, ne fût-ce que pour tranquilliser encore plus sa conscience. Sa conscience une fois bien tranquille, il y a, ce me semble, certaines difficultés de votre situation qui doivent être aplanies, surtout par un intermédiaire si sûr. Enfin, vous me direz tout cela. J’y pense sans cesse. Moi aussi, j’ai tant d’envie qu’on vous laisse un peu en repos ! Je regrette de n’avoir pas vu votre fils. C’est votre fils.
On commence aujourd’hui les préparatifs de départ. On fait des caisses. On met en ordre le ménage qui doit rester au Val-Richer. Le soleil, les bois, la vallée, tout est encore beau. Mais que m’importe ? Vous m’avez gâté la campagne, gâté de deux façons, parce que j’ai envie d’être ailleurs et parce que je me figure à quel point je serais bien ici, si vous y étiez. Sans vous, tout est incomplet pour moi. Vous manquez au soleil, aux bois, à la vallée. Je ne puis les regarder sans qu’il s’élève aussitôt dans mon cœur un désir et un regret infiniment supérieur à tous les plaisirs qu’ils me peuvent donner. Que c’est dommage ! Ce lieu-ci se prêterait à tout. L’aspect est sauvage et riant calme et animé. On ferait aisément de la maison quelque chose de grand et de simple. J’y arriverai l’année prochaine par un bon chemin.
Je lisais l’autre jour à mes enfants les Châteaux en Espagne. Combien j’en ai fait en lisant, et bien plus beaux que ceux que je lisais ! C’est une singulière impression de se laisser aller ainsi à sa fantaisie. Les premiers moments sont délicieux. On va, on va ; tout arrive, tout s’arrange ; on y est, on le voit, on en jouit. Et puis, tout à coup, tout disparaît, tout tombe ; il n’y a plus rien. Il y a le vide, et la chute dans le vide. Ne vous arrive-t-il jamais, la nuit de rêver que vous prenez votre essor, un grand essor pour monter, pour atteindre à quelque chose qui vous plait, qui vous attire ? Mais l’essor s’arrête soudain, et par un soubresaut très pénible, vous vous retrouvez dans votre lit, seul et rompu, moulu.
M. de Grouchy m’apportera donc quelque chose. Je vous en remercie mille fois. Je me dis tout ; mais j’aime bien mieux votre voix que la mienne. Et puis je suis sûr que je ne me dis pas tout. Vous savez bien combien je vous aime. Eh bien ne vous vient-il par tous les jours de moi, de loin comme de près, quand je vous écris ou quand je vous parle, quelque chose de nouveau, d’inattendu ? C’est le droit, c’est le charme d’une affection comme la nôtre. On croit à tout et on découvre toujours. La confiance est entière, mais le trésor est inépuisable. Rien d’ailleurs, voyez-vous rien, pas même les plus vifs désirs, les plus douces suppositions du cœur, le plus tendre, rien ne vaut la réalité ; et l’amour lui-même ne sait rien inventer d’égal à ce qu’il peut recevoir.
11 heures
Je n’ai jamais qu’une chose à vous dire. J’aime le N°67. J’aurai dans la journée la lettre indirecte, et je suis sûr que je l’aimerai bien davantage. Et puis le 31 encore davantage. Adieu. adieu. Que de choses à nous dire ! Et pour finir toujours par Adieu. G.
Décidément et malgré l’ébranlement que cela vous a causé, et quoique je ne sache encore aucun détail, je suis bien aise que votre fils soit venu. Il aura vu ce qu’on ne voit pas de loin. Vous lui aurez dit ce qu’on n’écrit pas. Quelque résolu que soit M. de Lieven à ne pas changer d’avis avant le temps il me paraît impossible que cela n’agisse pas un peu sur lui, ne fût-ce que pour tranquilliser encore plus sa conscience. Sa conscience une fois bien tranquille, il y a, ce me semble, certaines difficultés de votre situation qui doivent être aplanies, surtout par un intermédiaire si sûr. Enfin, vous me direz tout cela. J’y pense sans cesse. Moi aussi, j’ai tant d’envie qu’on vous laisse un peu en repos ! Je regrette de n’avoir pas vu votre fils. C’est votre fils.
On commence aujourd’hui les préparatifs de départ. On fait des caisses. On met en ordre le ménage qui doit rester au Val-Richer. Le soleil, les bois, la vallée, tout est encore beau. Mais que m’importe ? Vous m’avez gâté la campagne, gâté de deux façons, parce que j’ai envie d’être ailleurs et parce que je me figure à quel point je serais bien ici, si vous y étiez. Sans vous, tout est incomplet pour moi. Vous manquez au soleil, aux bois, à la vallée. Je ne puis les regarder sans qu’il s’élève aussitôt dans mon cœur un désir et un regret infiniment supérieur à tous les plaisirs qu’ils me peuvent donner. Que c’est dommage ! Ce lieu-ci se prêterait à tout. L’aspect est sauvage et riant calme et animé. On ferait aisément de la maison quelque chose de grand et de simple. J’y arriverai l’année prochaine par un bon chemin.
Je lisais l’autre jour à mes enfants les Châteaux en Espagne. Combien j’en ai fait en lisant, et bien plus beaux que ceux que je lisais ! C’est une singulière impression de se laisser aller ainsi à sa fantaisie. Les premiers moments sont délicieux. On va, on va ; tout arrive, tout s’arrange ; on y est, on le voit, on en jouit. Et puis, tout à coup, tout disparaît, tout tombe ; il n’y a plus rien. Il y a le vide, et la chute dans le vide. Ne vous arrive-t-il jamais, la nuit de rêver que vous prenez votre essor, un grand essor pour monter, pour atteindre à quelque chose qui vous plait, qui vous attire ? Mais l’essor s’arrête soudain, et par un soubresaut très pénible, vous vous retrouvez dans votre lit, seul et rompu, moulu.
M. de Grouchy m’apportera donc quelque chose. Je vous en remercie mille fois. Je me dis tout ; mais j’aime bien mieux votre voix que la mienne. Et puis je suis sûr que je ne me dis pas tout. Vous savez bien combien je vous aime. Eh bien ne vous vient-il par tous les jours de moi, de loin comme de près, quand je vous écris ou quand je vous parle, quelque chose de nouveau, d’inattendu ? C’est le droit, c’est le charme d’une affection comme la nôtre. On croit à tout et on découvre toujours. La confiance est entière, mais le trésor est inépuisable. Rien d’ailleurs, voyez-vous rien, pas même les plus vifs désirs, les plus douces suppositions du cœur, le plus tendre, rien ne vaut la réalité ; et l’amour lui-même ne sait rien inventer d’égal à ce qu’il peut recevoir.
11 heures
Je n’ai jamais qu’une chose à vous dire. J’aime le N°67. J’aurai dans la journée la lettre indirecte, et je suis sûr que je l’aimerai bien davantage. Et puis le 31 encore davantage. Adieu. adieu. Que de choses à nous dire ! Et pour finir toujours par Adieu. G.
68. Paris, Lundi 23 octobre 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
68. Lundi 23 octobre. 9 heures.
Je viens de lire le 64, décidément la folie me touche plus que la raison. Ah si j’avais encore un M. Grouchy à mes ordres aujourd’hui, comme ma petite lettre d’aujourd’hui effacerait ma petite lettre d’hier ! Tout ce que je disais ! J me méprise pour vous avoir dit si peu, si peu. Vous ne savez pas tout ce que je sens ? Vous le saurez, vous le verrez ? Il me semble que je ne vous l’ai jamais dit, que je ne vous l’ai jamais montré.
Il faut cependant que je conserve ma tête encore aujourd’hui. j’ai tant à écrire, à faire. Mon fils part à huit heure ce soir. Quelle excellente & noble créature. Comme il songe à toute, à tout ce qui peut être dans mon intérêt, comme il est heureux de penser que pour la première fois de sa vie il peut servir sa mère !
Je vous ai dit que Médem est parfait pour moi. Il se met dans des colères, et des attitudes de menace qui sont très bouffons. Mais enfin il compte chez nous & pour beaucoup, beaucoup plus que son chef, que Pozzo ou tout autre. Le fait que je lai choisi depuis deux ans pour mon confident & conseiller intime sur place, dans la meilleure position possible. jusqu’ici c’était resté un secret pour tous. Aujourd’hui il le divulguer & moi aussi. Bon Dieu que de commérages on avait fait de ceci. Que de choses j’aurai à vous conter !
Je respirerai demain, je vous écrirai, mais je ne puis pas tout dire, le 31 je vous conterai tout. Non je ne vous conterai rien ; il me semble que ce jour là que bien des jours après, nous ne saurons parler que d’une seule chose ; & en parlerons nous. Ah quelle joie ! Comment demain en huit ? Lundi prochain je ne vous écris plus ? Je ne vous parle pas de ma santé Je n’ai pas le temps de songer à elle. Je me promène tous les jours cependant, tous les jours avec mon fils. Je n’ai vu que lui depuis jeudi, ma porte est fermée le matin. Elle ne s’est ouverte qu’une fois pour Thiers. Le soir j’écoute à peine ce qu’on me dit. Demain je me retrouverai.
Adieu, adieu comme dans la petite lettre, comme dans toutes les lettres, comme toujours, comme toute ma vie. Adieu !
Je viens de lire le 64, décidément la folie me touche plus que la raison. Ah si j’avais encore un M. Grouchy à mes ordres aujourd’hui, comme ma petite lettre d’aujourd’hui effacerait ma petite lettre d’hier ! Tout ce que je disais ! J me méprise pour vous avoir dit si peu, si peu. Vous ne savez pas tout ce que je sens ? Vous le saurez, vous le verrez ? Il me semble que je ne vous l’ai jamais dit, que je ne vous l’ai jamais montré.
Il faut cependant que je conserve ma tête encore aujourd’hui. j’ai tant à écrire, à faire. Mon fils part à huit heure ce soir. Quelle excellente & noble créature. Comme il songe à toute, à tout ce qui peut être dans mon intérêt, comme il est heureux de penser que pour la première fois de sa vie il peut servir sa mère !
Je vous ai dit que Médem est parfait pour moi. Il se met dans des colères, et des attitudes de menace qui sont très bouffons. Mais enfin il compte chez nous & pour beaucoup, beaucoup plus que son chef, que Pozzo ou tout autre. Le fait que je lai choisi depuis deux ans pour mon confident & conseiller intime sur place, dans la meilleure position possible. jusqu’ici c’était resté un secret pour tous. Aujourd’hui il le divulguer & moi aussi. Bon Dieu que de commérages on avait fait de ceci. Que de choses j’aurai à vous conter !
Je respirerai demain, je vous écrirai, mais je ne puis pas tout dire, le 31 je vous conterai tout. Non je ne vous conterai rien ; il me semble que ce jour là que bien des jours après, nous ne saurons parler que d’une seule chose ; & en parlerons nous. Ah quelle joie ! Comment demain en huit ? Lundi prochain je ne vous écris plus ? Je ne vous parle pas de ma santé Je n’ai pas le temps de songer à elle. Je me promène tous les jours cependant, tous les jours avec mon fils. Je n’ai vu que lui depuis jeudi, ma porte est fermée le matin. Elle ne s’est ouverte qu’une fois pour Thiers. Le soir j’écoute à peine ce qu’on me dit. Demain je me retrouverai.
Adieu, adieu comme dans la petite lettre, comme dans toutes les lettres, comme toujours, comme toute ma vie. Adieu !
67. Val-Richer, Mardi 24 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1837 (13 octobre - 29 octobre)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N°67. Mardi 24 Sept heures
J’ai tout, tout, plus que je ne demandais, plus que je n’espérais ! Et j’espérais ce que je n’avais demandé. J’ai ces charmantes, ces ravissantes paroles, que depuis si longtemps je n’avais pas entendues. J’ai votre prévoyance, vos soins, vos arrangements. Que je les aime ! Presque autant, pas tout à fait autant, mais presque autant que vos paroles. Tout cela, m’est arrivé hier. La fin de ma journée en a été remplie, embaumée. Je suis monté dix fois dans mon cabinet. J’ai fermé ma porte. Cette nuit, je me suis réveillé, je ne sais combien de fois, pour jouir de mon bien. Aujourd’hui, je l’ai là, à sa place. Certainement non, il ne me quittera pas.
Je n’ai pas voulu vous écrire hier au soir, avant de me coucher. J’en aurais trop dit. Vous, vous ne dites pas trop. Vous ne dites pas tout. J’y compte. Mais au moment où j’entends ce que vous dites, je ne vois rien, je ne désire rien au-delà. Ou plutôt, j’y vois tout ce que je désire. M. de Grouchy, repart demain ou après demain soir. Il vous portera sous le couvert de M. Génie, ma répons ; en attendant, ma vraie réponse, celle que j’apporterai moi-même, le 31 aujourd’hui en huit. Je ne sais pas encore, si ce beau 31, j’arriverai le matin ou pour dîner seulement. Je vous le dirai dans deux jours. Avez-vous décidément choisi l’heure de vos promenades ? Vous n’avez guère de choix, ce me semble. Dans huit jours, il fera froid la nuit à 4 heures.
Que ce que vous me dites de M. de Lieven est étrange ! Comment, il serait possible que tout cela fût de son invention, qu’il n’y eût rien de l’Empereur ! Sérieusement, je ne puis le croire. S’il en était ainsi, vos confidences, vos lettres, l’éclat de l’affaire seraient une bien juste et bien naturelle punition. J’ai grande impatience de savoir tous les détails. Au 31. Je remets tout au 31. Il me semble que la vie recommencera pour moi ce jour- là. En attendant, je fais comme si je vivais. Je plante mes arbres. J’ai eu hier en plantant, un moment délicieux. Je venais de recevoir votre paquet. J’avais tout lu, relu. J’étais retourné à mes ouvriers. J’avais l’air de les regarder. Ils plantaient un mélèze, charmant, haut, droit du feuillage le plus élégant, le plus fin. L’arbre se balançait, s’inclinait. Tout à coup, je l’ai vu se tourner, marcher vers moi. C’était vous que je voyais. Ce mélèze vous ressemblait ; il avait votre port, votre air, la souplesse et la noblesse de votre taille. Enfin je vous voyais là. Quelle folie ! Certains malades ont, à ce qu’on dit des visions, des hallucinations pareilles. Le bonheur a donc aussi les siennes. Nouvelle preuve du dialogue Hindou. à coup sûr, la pensée elle-même est trop lente pour admettre de telles illusions. L’amour seul peut les créer et les voir assez vitre pour y croire. Ce qui est certain, c’est que j’aimerai et soignerai toujours ce mélèze-là. Il est à l’extrémité de la pièce d’eau.
Savez-vous ce qui m’arrive, Madame ? D’instinct sans y penser je vous raconte tout, tous mes enfantillages. La seconde d’après, quand mes yeux retombent sur ce que je viens d’écrire, il me prend un mouvement d’hésitation ; je me dis c’est trop, c’est trop enfant ; si on voyait cela ! Et puis, en dernier ressort, je souris, avec quelque dédain à l’idée de ceux que mes enfantillages feraient sourire et je m’y laisse allez en pleine sérénité. J’ai fait de moi-même et de ma vie un emploi assez sérieux pour être enfant tant qu’il me plait avec vous, vous auprès de qui tout est sérieux pour moi. Vous voulez donc que je regarde que M. de Grouchy est déjà arrivé. Je ne puis pas et pourtant je regrette bien vivement ce que vous lui auriez donné hier; Le 31 je ne regretterai rien. Adieu. Adieu.
La poste est arrivée tard. Je quitte mon déjeuner pour fermer ma lettre. Adieu. Votre adieu.
J’ai tout, tout, plus que je ne demandais, plus que je n’espérais ! Et j’espérais ce que je n’avais demandé. J’ai ces charmantes, ces ravissantes paroles, que depuis si longtemps je n’avais pas entendues. J’ai votre prévoyance, vos soins, vos arrangements. Que je les aime ! Presque autant, pas tout à fait autant, mais presque autant que vos paroles. Tout cela, m’est arrivé hier. La fin de ma journée en a été remplie, embaumée. Je suis monté dix fois dans mon cabinet. J’ai fermé ma porte. Cette nuit, je me suis réveillé, je ne sais combien de fois, pour jouir de mon bien. Aujourd’hui, je l’ai là, à sa place. Certainement non, il ne me quittera pas.
Je n’ai pas voulu vous écrire hier au soir, avant de me coucher. J’en aurais trop dit. Vous, vous ne dites pas trop. Vous ne dites pas tout. J’y compte. Mais au moment où j’entends ce que vous dites, je ne vois rien, je ne désire rien au-delà. Ou plutôt, j’y vois tout ce que je désire. M. de Grouchy, repart demain ou après demain soir. Il vous portera sous le couvert de M. Génie, ma répons ; en attendant, ma vraie réponse, celle que j’apporterai moi-même, le 31 aujourd’hui en huit. Je ne sais pas encore, si ce beau 31, j’arriverai le matin ou pour dîner seulement. Je vous le dirai dans deux jours. Avez-vous décidément choisi l’heure de vos promenades ? Vous n’avez guère de choix, ce me semble. Dans huit jours, il fera froid la nuit à 4 heures.
Que ce que vous me dites de M. de Lieven est étrange ! Comment, il serait possible que tout cela fût de son invention, qu’il n’y eût rien de l’Empereur ! Sérieusement, je ne puis le croire. S’il en était ainsi, vos confidences, vos lettres, l’éclat de l’affaire seraient une bien juste et bien naturelle punition. J’ai grande impatience de savoir tous les détails. Au 31. Je remets tout au 31. Il me semble que la vie recommencera pour moi ce jour- là. En attendant, je fais comme si je vivais. Je plante mes arbres. J’ai eu hier en plantant, un moment délicieux. Je venais de recevoir votre paquet. J’avais tout lu, relu. J’étais retourné à mes ouvriers. J’avais l’air de les regarder. Ils plantaient un mélèze, charmant, haut, droit du feuillage le plus élégant, le plus fin. L’arbre se balançait, s’inclinait. Tout à coup, je l’ai vu se tourner, marcher vers moi. C’était vous que je voyais. Ce mélèze vous ressemblait ; il avait votre port, votre air, la souplesse et la noblesse de votre taille. Enfin je vous voyais là. Quelle folie ! Certains malades ont, à ce qu’on dit des visions, des hallucinations pareilles. Le bonheur a donc aussi les siennes. Nouvelle preuve du dialogue Hindou. à coup sûr, la pensée elle-même est trop lente pour admettre de telles illusions. L’amour seul peut les créer et les voir assez vitre pour y croire. Ce qui est certain, c’est que j’aimerai et soignerai toujours ce mélèze-là. Il est à l’extrémité de la pièce d’eau.
Savez-vous ce qui m’arrive, Madame ? D’instinct sans y penser je vous raconte tout, tous mes enfantillages. La seconde d’après, quand mes yeux retombent sur ce que je viens d’écrire, il me prend un mouvement d’hésitation ; je me dis c’est trop, c’est trop enfant ; si on voyait cela ! Et puis, en dernier ressort, je souris, avec quelque dédain à l’idée de ceux que mes enfantillages feraient sourire et je m’y laisse allez en pleine sérénité. J’ai fait de moi-même et de ma vie un emploi assez sérieux pour être enfant tant qu’il me plait avec vous, vous auprès de qui tout est sérieux pour moi. Vous voulez donc que je regarde que M. de Grouchy est déjà arrivé. Je ne puis pas et pourtant je regrette bien vivement ce que vous lui auriez donné hier; Le 31 je ne regretterai rien. Adieu. Adieu.
La poste est arrivée tard. Je quitte mon déjeuner pour fermer ma lettre. Adieu. Votre adieu.