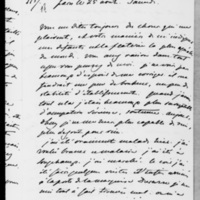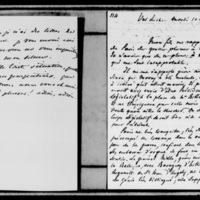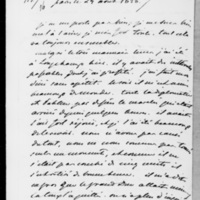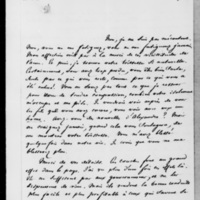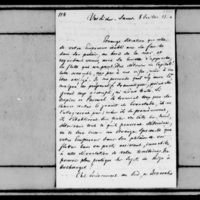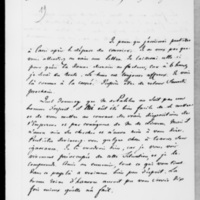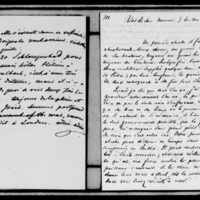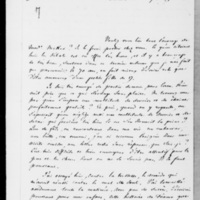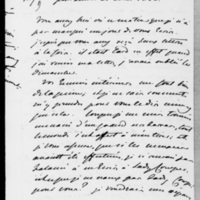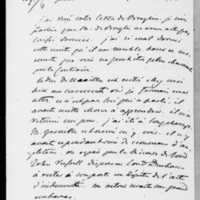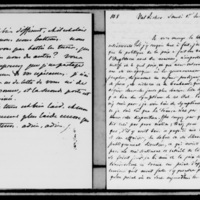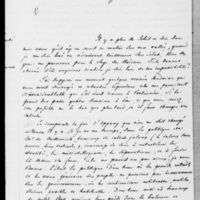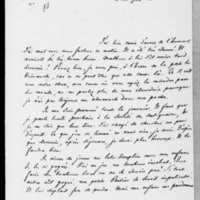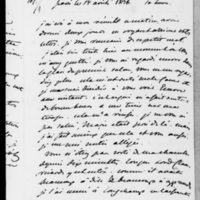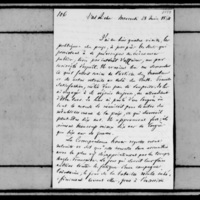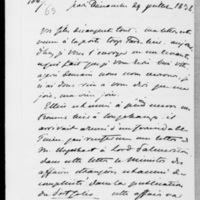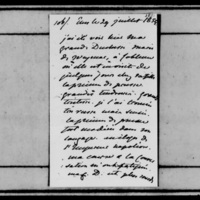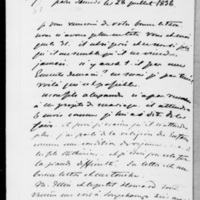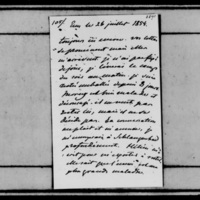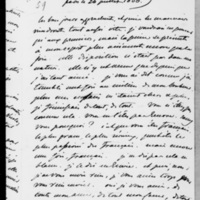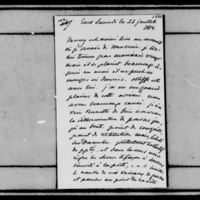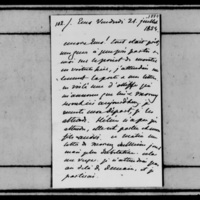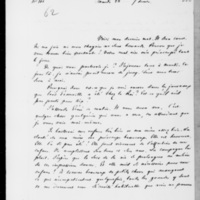Votre recherche dans le corpus : 5493 résultats dans 5493 notices du site.
116. Lantheuil, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Un seul mot qui, j’espère, vous arrivera à temps. Je me suis échappé du salon où je ne sais combien de personnes sont venues me voir. Je fais le métier de bête curieuse. On vient de m’apporter les N° 118 et 119. Je suis charmé qu’Alexandre vous arrive. Ce sera une douce distraction. Vous avez, je crois, toute raison de préférer l’Angleterre à Baden. Il faut qu’on vienne chez vous, et non pas, vous aller chez les autres. Vous débattrez beaucoup mieux votre avenir à Londres qu’à Baden. En tout cas, je suis bien aise qu’il y ait pour un an du moins, quelque chose de connu, de réglé.
Je serai chez moi après-demain, à ma grande satisfaction. Si ce régime-ci durait, j’aurais le sort de Vert-Vert. Aujourd’hui, je suis chez des gens qui m’aiment vraiment et qui me plaisent, chez les Turgot. Adieu. On vient me chercher. Voici une lettre bien plus misérable que la vôtre. Pardonnez la moi. Je le mérite car mon plus doux temps est celui où je vous écris. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Famille Benckendorff, Mandat local, Vie familiale (Dorothée)
115. Paris, Samedi 25 août 1838,Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous me dites toujours des choses qui me plaisent, et votre manière de m'indiquer mes défauts est la flatterie la plus agréable du monde. Vous avez raison dans tout ce que vous pensez de moi. Je ne vois pas beaucoup d'espoir de me corriger. Il me faudrait un peu de bonheur, un peu de stabilité d’établissement. Quand j'avais tout cela j’étais beaucoup plus susceptible d'occupation sérieuse, soutenue. Aujourd’hui je ne me sens plus capable de rien, plus de gout pour rien. J’ai été vraiment malade hier. J’ai voulu braver ce malaise, j’ai été à Longchamp. J'ai marché. Le soir j’ai été faire quelques visites et enfin arrivée à la porte de la marquise Durazzo, je me suis tout-à-fait trouvée mal. On m’a porté chez elle. J’ai eu presque un évanouisse ment. Je suis revenue à l’aide de cela. Je suis un peu mieux ce matin, mais pas bien encore. J'ai beaucoup maigri ces jours derniers. Cela va et vient avec une rapidité extraordinaire. Votre mal de dent me fait beaucoup souffrir, car c’est une horreur. Je suis tourmentée d'une dent aussi, & je vais courir ce matin chez mon dentiste, je l'ai manqué hier. Prenez garde à tout ce que vous allez faire ; des courses, des banquets au milieu d'une rage de dent, c’est affreux.
J’étais à Longchamp hier & javais chez moi M. & Mme Appony lorsque Henri Greville est venue au galop m' annoncer la venue du Comte de Paris, car le canon ne nous arrive pas à Longchamp. Appony est bien vite parti et il est arrivé un peu tard pour la convocation du corps diplomatique. La maréchale Loban a montré l’enfant aux deux mondes rassemblés. On dit qu'il a l’air fort et sain. Il dormait. La Reine avait l'air comblée de bonheur, le duc d’Orléans aussi. Je vous conte ce que disait le ministre du Portugal hier au soir chez Palmella, où je fus faire visite aussi. J'ai oublié de vous dire hier que j’ai reçu une longue lettre & M. Ellice. Je l'ai envoyée à Lady Granville. Cette lettre est intéressante mais il n’y a rien de nouveau. Le ministère très affaibli par les discussions sur le Canada. Lord Durham et son conseil des écoliers en loi ; son ordonnance n'était pas soutenable. Cependant les autres actes de son administration sont excellents. S’il se fâche et il est très populaire. qu'il revienne, le ministère est infailliblement renversé. On espère qu'il restera, mais on sera fort inquiet jus qu'à ce qu'on l’apprenne. Voilà à peu près la longue lettre. Melbourne & John Russell très amis, le reste incapable.
1 heure.
J’ai fait prier M. Génie de passer chez moi ce matin. Il est venu, et il m'a promis tout ce qu'il me fallait. J’ai fait visite à mon dentiste, il est aux eaux. J'ai été chercher un français. Ah comme il est français. Rappelez moi de vous raconter notre dialogue. Vous en rirez. Il fait froid, il fait laid. Soignez-vous, écrivez-moi. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Politique (Angleterre), Politique (France), Santé (Dorothée)
115. Caen, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars dans une heure pour aller passer la journée à 7 lieues d’ici, chez M. de Tilly. J’y coucherai .Je donnerai demain à deux de ses voisins, M. de Lacour et M. Turgot. Je ne serai de retour à Caen qu’après demain matin. Dans ce vagabondage, je crains de ne pas tomber juste demain, sur l’heure du courrier. Le service des campagnes n’est pas toujours bien exact, et ils n’y mettent pas tous le même intérêt que moi, si une lettre retardait où manquait soyez sûre que je n’ai ni le bras cassé, ni le cœur négligent. J’aurai, moi, votre lettre d’aujourd’hui ; mais celle de demain, je ne la trouverai qu’en revenant. Je ne veux pas qu’elle se perde à courir après moi. Ces courses m’ennuient fort. Enfin, j’en serai quitte samedi.
On m’a mené hier voir un magnifique établissement, créé à force de zèle pieux et d’habileté par un homme qui n’avait pas 500 louis en commençant, et qui y a dépensé près de deux millions. C’est une grande maison de fous, la meilleure œuvre, et le plus triste spectacle du monde. Un édifice immense, un ameublement bien tenu, un ordre parfait, une propreté admirable ; et au milieu de ce chef d’oeuvre de l’intelligence humaine, 5 à 600 fous ou folles errants ou accroupis, criants ou taciturnes ; gardés et soignés par 97 religieuses qu’ils maudissent et injurient sans cesse. Le bien et le mal à cet excès là et se touchant de si près mettent l’âme dans un grand malaise. Notre course en l’honneur du Comte de Paris a eu grand succès malgré l’humeur des Carlistes qui ont fait, dans le Comité des Courses ce qu’ils ont pu pour la faire échouer. Habituellement les deux partis vivent ici en grande paix se rencontrant volontiers sur les terrains neutres et traitant ensemble de bon accord des intérêts ou des plaisirs du pays. Puis survient une circonstance où ils se retrouvent absolument les mêmes. A la vérité cela aboutit à de pures taquineries qui ne dépassent même guère les paroles. Les vieilles passions se payent de bien petites satisfactions. L’archevêque prend le bon parti et ne le soutiendra pas. Celui-là aussi est un petit esprit, décidé chaque jour par de petits motifs, et incapable de résister aux fantaisies qui l’entourent.
Si vous n’avez pas encore écrit à M. Ellice, voulez- vous lui demander s’il pourrait me procurer une lettre de l’écriture de M. Pitt et une de Lord Chatam, son père ? J’en ai envie. Je ne fais pas grand cas des collections d’autographes pèle-mêle. Mais, puisque j’en ai quelques uns je veux y ajouter les noms que j’estime et qui me plaisent. Adieu. Je vis avec votre tristesse. Sans lui rien reprocher ; je la trouve si légitime ! Vous ne me dites pas, dans le N°117, comment vous êtes physiquement. Adieu. J’ai de bonnes nouvelles de mes enfants. G.
114. Val Richer, Mardi 10 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon fils me rapporte enfin de Paris des grosses plumes à mon grés. Je n’avais que de ces plumes à bec fin qui me sont insupportables. Il ne me rapporte guère autre chose, sinon que Morny a été malade, à croire qu’il allait mourir. Il paraît qu’il aurait assez envie d'être président du Corps Législatif à la place de M. Billaut ; mais il ne témoignera pas cette envie et je doute qu’on aille le chercher. On dit que le Corps législatif serait bien aise de l'avoir pour Président.
Paris est très tranquille, très désert, très préoccupé des travaux dans les rues et très peu de la guerre, confiant dans le succès. Les embarras d'argent se font un peu sentir. Le général Nielle qu’on envoie dans la Baltique, avec Baraguey d’Hilliers, et Regnaut de St Jean d'Angely est un officier du Génie très distingué ; cela suppose, ou qu’on a de grands sièges à faire en règle, ou qu’on veut s’établir et se fortifier quelque part. C’est une opinion assez générale que la grande guerre contre vous ne se fera que l'année prochaine.
C'est aussi pour l’année prochaine que vous annoncez vos grands armements, et vos grands coups. Je trouve cela, un peu ridicule, de part et d’autre. Je ne trouve pas non plus de bien bon goût la lettre de votre Empereur au Roi de Prusse dont on me donne un résumé qu’on me dit textuel. Le ton en est plus gros qu'au fond la confiance n’y est grande cette dernière phrase : " Quand vos amis deviennent vos ennemis, on ne peut plus se confier qu'à Dieu ; mais soyez en bien persuadé, j’aurai mon tour, et je punirai les Turcs et les autres " est un langage de Sultan à Pacha, non de souverain à souverain.
Il n’est question dans cette lettre que de 500 000 hommes en armes l’année prochaine, non pas de 1. 300 000, comme vous disait le général Offenberg. Grande colère aussi contre le Prince de Metternich : " Il a déjà mis l’Autriche à deux doigts de sa porte ; il va jouer encore une fois son va tout. Et bien, je ne ferai pas la guerre à l'Empereur d’Autriche ; mais j'accepte sa déclaration de guerre. Je ne quitterai pas les principautés ? Je ne sais pourquoi je vous envoie toutes les phrases, vous les avez sûrement. Il pleut à Paris. Un peu de choléra ; rien de grave. Il est grave dans quelques villes du midi ; à Arles, il est mort 80 personnes en un jour. Ville du 10 à 12 000 âmes.
Midi
Voilà votre N°94. Le Constitutionnel me fait croire tout à fait que la lettre qu’on me domme comme de votre Empereur est bien authentique. Il y a, contre l’Autriche, plus d'humeur que vous ne me dites. J’incline assez à penser qu’il y a encore de la part des Allemands, quelque tentative de médiation à votre profit, que du moins ils vous ont présenté sous cet aspect, leurs dernières résolutions, même l’entrée des Autrichiens en Valachie. Je doute que cela réussisse. Les politiques incertaines, et obscures sans être profondes ne réussissent guère aujourd’hui que toute se passe sur une grande échelle et au grand jour. Les événements sont plus sérieux que les hommes. Adieu, Adieu.
114. Paris, Vendredi 24 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne me porte pas bien ; je me sens bien mal à l’aise ; je suis fort triste, tout cela va toujours ensemble. Malgré le très mauvais temps j’ai été à Longchamp hier. Il y avait des intervalles passables dont j’ai profité. J’ai fait mon dîner sans appétit. Le soir il m’est venu, beaucoup de monde. Toute la Diplomatie et Pahlen par dessus le marché qui était arrivé depuis quelques heures. Il avait l’air fort réjoui et je l'ai été beaucoup de le revoir. Nous n’avons pas causé du tout, nous ne nous sommes pas trouvés seuls un moment, et comme il ne s’était pas couché de cinq nuits il s’est retiré de bonne heure. Il m’a dit en gros que le grand duc allait mieux. La toux l'a quitté. On n’a plus d’inquiétude. mais comme les médecins insistent pour que l'hiver soit passé en Italie, il est vraisemblable que l’Empereur y consentira. Lui-même est allé faire une surprise à l’Empereur d'Autriche à Insbruck. L’Impératrice va mieux.
Voilà tout ce que j’ai tiré de Pahlen devant le monde. Il me parait d’après cela que je ne verrai pas mon mari, et cela est très fâcheux. Les mauvaises relations qu'il a établies entre nous se prolongeront indéfiniment. Vous pouvez juger par le passé de ce qui peut encore en advenir. Je suis fort chagrinée de tout cela. J’étais le lien entre le père & les fils. Maintenant cela leur manque. Il oubliera ses fils comme il a oublié sa femme. Et c'est-là ce qui m’afflige beaucoup, beaucoup. Je pourrais sur ce chapitre lui écrire des volumes dont un seul mot attendrirait tout autre homme. Mais que puis je attendre de lui qui n’a pas l'ombre de sensibilité ? Dites-moi. Conseillez-moi ; je suis au bout de mon esprit, et j’ai le cœur tout-à-fait découragé. Je laisserai Pahlen se reposer aujour d’hui mais il me faudra ces jours-ci une bonne causerie avec lui. Je ne vous parle que de moi cela va vous ennuyer. Adieu.
Je suis si mal disposée aujourd’hui que je ne sais vous rien dire qu'Adieu, et toujours adieu.
Mots-clés : Femme (mariage), Santé (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
114. Caen, Mardi 28 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non, je ne suis pas mécontent. Non, vous ne me fatiguez, vous ne me fatiguez jamais. Mon affection n’est pas à la merci de ces vicissitudes de l’âme. Et puis, je trouve votre tristesse si naturelle. Certainement, vous avez trop perdue vous êtes bien seule, seule par ce qui vous reste comme par ce qui vous a été enlevé. Vous ne savez pas tout, ce que je ressens pour vous de tendre compassion, combien votre isolement m’occupe et me pèse. Je voudrais voir auprès de vous les fils que vous avez encore, vous voir avec eux un home. Avez-vous des nouvelles d’Alexandre ? Mais ne craignez jamais, quand cela vous soulagera, de me montrer votre tristesse. Vous m’avez blessé quelques fois dans notre vie. Je crois que vous ne me blesserez plus. Merci de vos détails. Ces couches font un grand effet dans le pays. J’ai vu plus d’une fois ces effets là. Ils ne suffisent pas aux gouvernements, et ne les dispensent de rien. Mais ils rendent la bonne conduite plus facile et plus profitable à ceux qui savent se bien conduire. Nous avons aujourd’hui, une course spéciale, instituée hier en l’honneur du Comte de Paris.
Le soleil est magnifique. Décidément il m’accompagne. J’ai eu hier avec mes Antiquaires, une soirée brillante. 1500 personnes étaient entrées dans une salle qui en contient 1200. On a cassé des carreaux de vitre pour entendre du dehors. Ce que j’ai dit a été bien reçu. La gauche, même la plus vive, avait évidemment pris son parti d’être bien pour moi. Je connais ces alternatives là.
Je regrette que Pahlen ne vous ait rien apporté de plus. J’avais espéré d’un peu meilleures paroles. J’ai tort de dire que j’avais espéré. Mon instinct espérait, ma raison non. Quel monde que le vôtre ! Point d’âme dans les uns, point d’esprit dans les autres. Ceux qui vous ont aimée autre fois ne s’en souviennent pas plus que s’ils ne vous avaient jamais connue. Ceux qui vous aiment ne savent pas vous servir. L’occident a bien ses défauts, et je les lui ai dits souvent ; mais votre Orient ! Je plains le soleil de le trouver le premier sur son chemin. Adieu.
J’ai ma toilette à faire, des visites à recevoir la course à voir. Je vais dîner à la campagne. Je mène ici une vie très active. Je suis fâchée d’abréger mes lettres surtout quand les vôtres sont tristes. Qu’il y ait au moins dans votre cœur un coin tranquille et doux, et point solitaire. Adieu. Adieu. Mon mal de dents est à peu près parti. G.
113. Val Richer, Samedi 8 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Etrange situation que celle de votre Empereur établi avec sa famille dans son palais, au bord de la mer, et regardant venir avec sa lunette d'approche, la flotte qui va peut-être détruire sa capitale ! Cela ressemble, non pas à une ville, mais à un état assiégé. Je me persuade qu’il n’y aura là, malgré ces préparatifs dramatiques, point de grand coup accompli, ni même tenté. Si Napier et Perceval se trouvent trop peu de chance contre le granit de Cronstadt, ils ne l’attaqueront pas ; mais ils se promèneront, ils s’établiront sur toutes vos côtes du Nord, détruisant tout ce qu’ils pourront détruire ; et ce sera encore un étrange spectacle que votre Empereur dans son palais et vos flottes dans vos ports assistant, immobiles, à cette dévastation de votre territoire. Ne pouvoir plus protéger ses sujets de Riga à Archangel !
C'est évidemment au Sud, en Bessarabie et en Crimée, qu’on vous attaquera, sérieusement par terre et par mer. Les journaux indiquent. déjà les trois points sur lesquels vous serez obligés d'avoir de grandes forces et d'attendre le combat. Mais là encore, il se peut que si les alliés ne se jugent pas suffisamment forts, ils remettent les coups décisifs à l’année prochaine. Grande réponse ; attente difficile, mais les gouvernements sont devenus prudents ; il ne veulent se risquer que presque à coup sûr. Ils ont raison. Cependant, je penche à croire que de ce côté, les grandes tentatives se feront bientôt. L’Autriche est moins riche que l’Angleterre et la France, et ne peut guère tenir si longtemps de grandes armées en campagne. Je vous envoie tous mes commentaires comme si nous causions ; quand ils vous arriveront que d'événements seront peut-être accomplis !
Est-ce que le baron de Kömeritz qui va, dit-on, être rappelé de Vienne pour avoir induit son Roi en erreur sur les dispositions de l’Autriche à votre égard, est le même que nous avons eu longtemps à Paris, ou son fils ? M. de Meyendorff retourne-t-il à Pétersbourg ou bien va-t-il à quelques eaux allemandes ? Il devrait venir vous voir sur le Rhin. Ce serait un grand plaisir pour vous, et qu'a-t-il de mieux à faire.
Midi
Rien, que deux versions de votre réponse, entre lesquelles je ne sais pas choisir. Adieu, Adieu. G.
113. Paris, Jeudi 23 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Lisez dans le journal des Débats de ce matin quelques extraits de l’ouvrage de Mlle Necker. Je les trouve admirables. Je ne savais pas en lisant l’autre jour cette description si exaltée & si étrange des Bayadères, que c’était le précepteur d’un jeune prince qui l’avait écrit. Ah, mon Dieu ! On a apporté chez moi hier les Mémoires de Sully. Je vous en remercie beaucoup. Je lis avec plaisir Fénelon l’Ambassadeur. Voilà tout le chapitre du lecture expédié.
Je réponds à Henriette qui m’a écrit une charmante petite lettre. Quelle jolie écriture pour son âge et quel style naturel & aimable.
J’ai vu chez moi hier matin Lord Alvanley. M. & Mme Doucet, & le prince Kotchoubey. Ils m’ont encore retenue ce qui a fait que je ne suis arrivée à Longchamp que pour y essuyer un violent orage. Lord Alvanley est décidément très spirituel malheureusement il part ce soir, tous les autres ce soir aussi. La seule nouveauté d’Angleterre que j’aie apprise est que le duc de Wellington est amoureux de la fille de Lord St Vincent une petite fille de 14 ans. Il rougit quand elle entre dans un salon, et cette petite lui fait faire tout ce qu’elle veut. Voilà qui est drôle.
Le temps était si laid hier soir et moi si désœuvrée que j’ai été chez Madame de Castellane. Je l’ai trouvée et laissée seule. Il me semble que j’ai plus parlé qu’elle. Je n’ai rien à vous en dire. Elle nie qu’on se soit trompée dans le calcul de la Duchesse d’Orléans. Elle dit encore qu’on attend ses couches à tout instant. Ce que je vous disais hier venait de M. Pasquier. Qui est-ce qui a menti ? Je ne sais si mon ambassadeur est arrivé hier. Il n’est pas arrivé, voilà ce qu’on vient de me dire. J’ai été fort triste hier, avant hier. Je le suis aujourd’hui. Il n’y a pas de raison particulières pour cela. Mon cœur se soulève en pensant à mes malheurs. Et comment échapper à ces horribles souvenirs ! Pardonnez-moi de vous dire ces tristes paroles. J’oublie trop souvent qu’il y en a d’autres aussi malheureux que moi. Adieu. Adieu. Je suis bien seule.
113. Caen, Lundi 27 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne flatte jamais quand j’aime. Pas un nuage ne passe devant mon soleil que je ne le voie. Mais il n’a pas un rayon qui m’échappe et qui n’illumine tout à mes yeux. On ne sait pas aimer. On ne sait pas admirer. On ne sait pas jouir de ce qu’on aime et de ce qu’on admire. On en laisse perdre des trésors. Et quand on ne perd rien, quand on jouit de tout, pourquoi ne dirait-on pas tout ? Pourquoi ne renverrait-on pas tout son plaisir à sa source. On ne sait pas non plus faire plaisir à qui on aime. On en laisse échapper mille et mille moyens, mille et mille occasions. Je ne veux rien perdre, ni du plaisir que je puis prendre, ni du plaisir que je puis donner. Quel petit mot que celui-là ! J’en sais qui me conviennent bien mieux. Mais ne soyez pas malade. Je ne sais pas de mot pour mon chagrin. Pourquoi cette maigreur soudaine ? Vous êtes vraiment encore plus mobile au physique qu’au moral, pour parler comme les philosophes. N’oubliez pas de me dire ce qui sera parti de cette maigreur, si vite venue.
Je suis arrivé hier ici au milieu des coups de canon, des courses de chevaux et d’un dîner de 40 personnes. Tout cela ne m’a pas empêché de dormir. On m’a reçu à bras ouverts. J’amenais moi d’abord, puis le soleil. On nous attendait tous deux avec grande impatience. J’ai trouvé la population, vraiment la population charmée de son Prince et disant : le bonheur nous en veut. Le mot courait de bouche en bouche, et on disait bien nous. Soyez sûre que ce pays-ci regarde tout-à-fait ce gouvernement comme sien. C’est une force immense. J’écrirai ce matin, à M. le Duc d’Orléans que doit être bien content. Je suis ici jusqu’à samedi. Je passerai mon temps à déjeuner et à dîner dans les environs. Je préside ce soir la société des Antiquaires., Samedi je rentrerai chez moi. Ecrivez-moi donc Vendredi au Val-Richer.
Mon mal de dents est fort diminué. Je le sens mais je n’en souffre plus. Vous me conterez votre dentiste. Du reste, je ne m’étonne pas que le contraste vous ait frappée. Brewster à les meilleures façons du monde. Je trouve la lettre d’Ellice très sensée, car elle est d’accord avec mes conjectures. Ne vous arrive-t-il pas comme à moi, d’être sans cesse étonnée tantôt du beaucoup, tantôt du peu d’esprit que vous avez ? On devine quelques fois merveilleusement de très grandes choses et puis tout à coup on s’aperçoit qu’une petite chose qui se découvre et qu’on ignorait, modifie, immensément ce qu’on croyait très bien savoir. Avez-vous causé avec Pahlen ? Je suis impatient de savoir s’il n’aura rien vu, s’il ne vous aura rien dit qui vous éclaire un peu sur ce qui vous touche.
Adieu. Il faut que j’écrive à M. le Duc d’Orléans et à ma mère. Puis ma toilette. Puis des visites. Puis le déjeuner. Puis les courses. Puis le dîner, la séance, les speechs. Adieu.
Tout cela fait bien du bruit. Mais le moindre grain de mil Ferait bien mieux mon affaire Adieu. Je vous écris dans le même cabinet et de la même table d’où je vous ai écrit l’an dernier, à Boulogne, quand vous êtes revenue de Londres. Toujours.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Mandat local, Portrait (Dorothée)
112. Val Richer, Jeudi 6 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je trouve le Constitutionnel d’hier curieux et grave ; son leading article sur l’Autriche et le Prince de Metternich la nouvelle escadre Anglaise dans la Manche, la proscription de votre emprunt sur toutes les grandes places de l'Europe, l'adhésion pure et simple des confédérés de Bamberg au traité de Berlin, tout cela porte un caractère d'entente et de résolution européenne qui présage une guerre de vingt ans. Quel revirement de toutes les situations ! Quel renversement de toutes les prévisions ! Ceci est aussi inattendu pour les relations extérieures des états que les Révolutions de 1848 l'ont été pour leur intérieur. Tout ce mouvement militaire et diplomatique avortera-t-il, comme le mouvement libéral de 1848 a avorté ? J’en doute. Les gouvernements engagés dans cette affaire-ci ont plus d’esprit de suite et plus de force que n'en avaient les auteurs des insurrections. Duchâtel qui revient de Vichy, m'écrit qu’il y a trouvé deux récents ambassadeurs à Constantinople, Baraguey d’Hilliers et Lavalette, et qu’il y avait peu à tirer de l’un et de l'autre. Je suis sûr que vous en auriez tiré plus qu’il n’a fait.
" On craignait beaucoup ici, me dit-il, que l'Empereur Nicolas n'opposât pas un refus décidé aux ouvertures de l’Autriche. Il n'est jamais trop tard pour être raisonnable ; j’avoue cependant que, pour l'Empereur Nicolas, se soumettre maintenant au bon sens, ce serait ou trop tôt, ou trop tard. Les résultats militaires ont été trop déplorables pour les Russes pour qu’ils puissent. en rester sur une aussi, fâcheuse impression. Rien n'égale l'incapacité qui a présidé, à l'occupation de la Debrutscha et au siège de Silistrie. On assure que, dans la Dobrudscha plus de 50 000 hommes sont morts de maladie. Cela permet de juger de l'état physique et moral des troupes qui restent. Quant à Silistrie, lever un siège devant les Turcs après avoir fait mettre hors de combat presque tous ses généraux, c’est peu honorable pour le pouvoir absolu qui, jusqu’à présent. avait en au moins le mérite des succès. militaires."
Vous voyez que tout le monde a la même impression. Duchâtel passe le mois de Juillet à Paris ou en excursion aux environs et s'en va à Bordeaux au moins d'août.
Midi
Votre N°91 ne m’apporte que votre tristesse et je n'ai à vous envoyer que la mienne. Adieu, Adieu. G.
112. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pense que j’arriverai peut-être à Caen après le départ du courrier. Je ne veux pas que vous attendiez en vain une lettre. Je laisserai celle-ci pour qu’on la donne demain au facteur, car à 6 heures je serai en route. Le temps est toujours affreux. Je vais là comme à la corvée. J’espère être de retour samedi prochain. Quel dommage que M. de Pahlen ne soit pas un homme d’esprit ; il lui eût été bien facile de se mettre et de vous mettre au courant des vraies dispositions de l’Empereur et par conséquent de M. de Lieven. Mais il n’aura rien su chercher, et n’aura rien à vous dire. Peut-être devinerez-vous quelque chose à travers son ignorance. Je le voudrais bien, car je vous vois vivement préoccupée de cette situation et je le comprends. Amis ou ennemis, tout ce qui vous tient dans ce pays là, a vraiment bien peu d’esprit. La bonne reine d’Hanovre aurait pu vous servir dix fois mieux qu’elle n’a fait.
Que faites-vous de Marie ? Est-elle toujours aussi gaie et aussi fraîche ? A-t-elle la gaieté plus spirituelle que l’humeur. Dites-m’en quelque chose. Cette jalousie-là m’amuse assez. A présent du moins elle ne vous est pas incommode. Adieu. Je vais passer une semaine en visites, banquets, toasts, speechs. J’espère que les derniers ne seront pas aussi pauvres que cette lettre-ci. Je suis pressé, endormi et triste. Pourtant toujours le même adieu, et du même cœur. Cela est immuable. G.
112. Paris,Mercredi 22 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’aimerais bien pour mon divertissement & le vôtre ensuite, des évènements, quelque chose. Mais depuis votre départ il ne se présente rien, du moins j’ignore tout et je n’ai à vous mander que l’ennui que j’éprouve de ma solitude. J’ai vu hier matin la petite princesse, les Appony. J’ai résidé à Longchamp le temps voulu. J’ai dîné seule. J’ai fait la promenade en calèche jusqu’après neuf heures & demi et au moment d’aller me coucher, lorsque j’étais à moitiée déshabillée, Lord Clauricarde demande à me voir un moment. Comme il partait dans la nuit il a bien fallu le recevoir et le moment est devenu une grande heure parce qu’il avait tout à récapituler ou apprendre. Pour mieux faire nous avons mis mes instructions par écrit. J’ai été bien bonne pour lui bien intime. Il m’a juré un secret inviolable. J’ai mal dormi, je ne me porte pas bien, je ne sais ce que c’est. Le temps aussi est bien variable, il ne me convient pas.
Que vous êtes content de pouvoir me dire que je suis étourdie Je suis fâchée de vous déranger, mais après mure investigation, c’est M. Pepin qui l’a été. Il a été à la poste à 3 h. au lieu d’y aller avant 2.
La conférence ne se remet pas encore à Londres. Je ne vois pas beaucoup d’apparence que l’affaire aille. Les représentants de la cour à Londres font beaucoup d’expéditions de courriers à leurs cabinets. On dit que l’archevêque de Paris se montre très mécontent du baptême protestant du prince de Würtemberg. La Duchesse d’Orléans fait attendre tout le monde. Vous voyez que je n’ai rien à vous dire. Racontez-moi quelque chose, n’avez -vous pas quelque petite nouvelle ? Lady Granville m’écrit de Genève, du reste personne ne m’écrit. La petite princesse est malade. Adieu. je suis honteuse de ma lettre vous ne la lirez pas.
On me dit tout à l’heure qu’il y a erreur de tout un mois dans le calcul de la Duchesse d’Orléans. C’est singulier !
111. Val Richer, Mercredi 5 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Au pouvoir absolu, il faut absolument deux choses, un grand homme et du bonheur, toujours un grand homme et toujours du bonheur. Quelquefois, l’une de les deux conditions supplée quelque temps au défaut de l'autre ; pas bien longtemps. Et quand toutes les deux manquent à la fois tout s'en va. Quand je dis que tout s'en va, j’ai tort ; la grandeur certainement s'en va, la puissance au loin et par la seule voie d'influence. Mais il y a des temps et des lieux où le pouvoir absolu est si naturel et si nécessaire, si bien peut-être le seul gouvernement possible, que la grandeur peut lui manquer sans grand péril intérieur. Je crois que c’est votre cas. Votre pouvoir absolu peut déchoir en Europe, sans être compromis en Russie. Il peut rentrer chez lui triste ressource ; ressource réelle pourtant et qui est une force contre les plus puissants ennemis. Si les choses continuent dans leur cours actuel c'est la ressource dont vous serez réduite à user.
Vous n'aurez seulement pas très bonne grace à en user parce que vous avez beaucoup fait blanc de votre épée au dehors. L'Empereur Alexandre pouvait se retirer glorieusement, héroïquement devant l'Empereur Napoléon ; il avait toujours été modeste, en n'était point allé chercher, avec fracas, la guerre qu’on venait lui faire.
Vous ne pouvez faire maintenant aucune concession qui détache l’Autriche de l'alliance ; elle est tiré pour son propre compte ; il lui faut, comme aux deux autres des satisfactions sérieuses, non des palliatifs. A moins que vous ne battiez les armées Autrichiennes, mieux, beaucoup mieux, que vous n’avez battu les armées turques. Ceci serait un gros événement. Qui sait ? Depuis 1848, je ne prédis plus et je ne crois plus qu'à long terme, en prenant du temps, beaucoup de temps ; je ne vois clair que de loin ; de près, je vis dans les ténèbres ; du jour au lendemain, je suis très modeste. Je donne mes conjectures, mais sans y compter. Tout est possible. Vous repasserez peut-être bientôt le Danube. Mais la situation générale n'en serait pas changée. Sans grand homme, l’Angleterre persistera et fera persister les autres. Elle a un grand gouvernement. Je vois avec plaisir que le général Luders n'est pas mort. Je ne le connais pas du tout ; mais la mort prématuré d’un homme distingué me déplait toujours.
La nouvelle insurrection Espagnole ne paraît pas avoir plus de succès que les autres. Quand Mérimée est revenu de Madrid l'hiver dernier, il disait à qui voulait l’entendre que la Reine n'en avait pas six mois et que tout le monde n'en voulait plus qu’à elle. Voilà deux insurrections, depuis, toutes deux sans succès, et toutes deux criant : " Vive la Reine. "
J’attends le texte de votre réponse à la sommation Autrichienne ; je ne puis croire que vous ayez dit : " jusqu'à notre dernier homme et notre dernier rouble. " On ne dit pas cela, même quand on le fait. C’est un lieu commun populaire qui ne vous va pas.
Midi
Rien que des nouvelles d’Espagne, et l'attente de quelque coup dans la Baltique. Adieu, Adieu. G.
111. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voulez-vous lire tout l’ouvrage de Mad. Necker ? Je le ferai porter chez vous. Ce qu’en citaient hier les débats est en effet très beau, et il y a beaucoup de très beau, surtout dans ce denier volume que je n’ai fait que parcourir. A 70 ans, on fait mieux d’écrire cela que d’être amoureux d’une petite fille de 17. Je suis très ennuyé de partir demain pour Caen. Rien n’est pire que ce qui dérange sans plaire. Ne trouvez-vous pas qu’on s’impose une multitude de devoirs et de chaines parfaitement gratuits ? Et puis, quand on y regarde, on s’aperçoit qu’on néglige aussi une multitude de devoir et de soins qui feraient très bien si on s’en donnait la peine. Que de fois, en rencontrant dans ma vie, un embarras, une lutte, un ennemi, j’en ai reconnu l’origine dans une visite omise, une lettre restée sans réponse, que sais je ? C’est bien difficile et bien ennuyeux d’être attentif pour les gens et les choses dont on ne se soucie pas. Il le faut pourtant.
J’ai essayé hier, contre la tristesse le remède qui m’avait réussi contre le mal de dents. J’ai travaillé assidûment toute la matinée. Avec peu de succès. J’écrivais pourtant pour mes enfants, cette histoire de France que je veux leur raconter moi-même. Je le leur ai dit. Ils en ont sauté de joie autour de moi pendant un quart d’heure. Leur joie m’a encore attristé. J’avais eu cette idée il y a quinze ans ; pour mon fils. Je la reprends aujourd’hui pour ces trois petits. Que de choses qu’on reprend, qu’on renoue, qu’on recommence ! Toute ma vie m’est revenue à l’esprit. C’est bien ma vie. C’était bien moi. Et tout cela n’est plus ! Et toute cette immense part de moi-même a disparu ! Et je vais comme si j’étais tout entier ! Et j’ai encore soif de ce vase rempli et brisé tant de fois ! Ah, nous sommes de misérables créatures ? Nous ne pouvons conserver, & nous ne savons pas nous passer. Jeunes, nous nous épuisons à désirer et à espérer. Vieux, nous nous fatiguons à regretter et à désirer encore. Et les joies perdues sont pour nous comme si elles n’avaient jamais été. Et elles nous gâtent celles qui nous restent. Et celles qui nous restent ne nous empêchent pas de rechercher avec passion celles que nous n’avons plus comme si nous n’en avions pas eu notre part. Notre cœur est sans reconnaissance envers Dieu, sans équité envers les autres, insatiable dans son égoïsme. Je donnerais je ne sais quoi pour vous guérir de votre douleur. Et votre douleur me ramène à la mienne. Et la mienne me distrait de la vôtre. Je suis triste et mécontent de moi-même. C’est trop.
J’ai peine à croire que Mad. la Duchesse d’Orléans se soit trompée d’un mois. D’après ce qui me revient de l’intérieur de sa maison, on attend réellement d’un moment à l’autre. Du reste, c’est bien absurde, de moi de vous en parler d’ici. Vous entendez surement rabâcher tout le jour, sur ces pauvres petites nouvelles là Devinez à quoi je passe ma soirée depuis quatre jours. A coller avec de la gomme sur de grands cartons et dans de grands cadres que j’ai fait faire exprès, les portraits de tous les rois de France d’abord, ensuite de tous les députés à l’assemblée constituante. J’ai 72 portraits de Rois et 530 portraits de députés défaiseurs et faiseurs de Rois. Je veux garnir de cette collection, à la fois loyale et insolente, ma salle à manger et mon vestibule. Je fais cela avec l’aide de Mad. de Meulan, et un peu de mes enfants. Cela vaut bien vos grandes pensées.
10 heures
Ma lettre n’est pas propre à changer votre mauvaise disposition. Je voudrais trouver quelque chose à vous dire qui fût bon à écrire à M. de Lieven. Je ne trouve rien. Il y a de l’irrémédiable en ce monde. Quand il en aura fini avec le grand Duc, quand il sera oisif et seul peut-être alors sentira-t-il quelque besoin des autres, de vous, de ses enfants. Et intérêt seul, à ce qu’il me semble, peut agir, sur lui. Adieu. Je suis bien aise que Pahlen soit de retour. Il vous remplira quelques moments. Parlez-moi toujours de vous, toujours. Et toujours adieu. G.
111. Paris, Lundi 20 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous aurez bien vu ce matin que je n’ai pas manqué un jour de vous écrire. J’espère que vous avez reçu deux lettres à la fois. Il était tard en effet quand j’avais oublié. J’ai remis ma lettre, le dimanche. Vos émois intérieurs me font bien de la peine, et je ne sais comment m’y prendre pour vous le dire mieux que cela. Lorsque je me suis trouvée menacée d’un grand embarras, tout le monde s’est offert à m’en tirer ; et je vous assure que si les menaces avaient été effectuées, je n’aurais pas balancé à en écrire à Lady Cowper. Est-ce que je ne vaux pas Lady Cowper pour vous ? Je voudrais une réponse toute simple à ceci, car cela me parait la chose du monde la plus simple.
Le Duc de Devonshire est venu me prendre bonne partie de la matinée hier. Et il est si sourd que je suis sortie parfaitement fatiguée de ce tête à tête. Il ne m’a rien dit de nouveau, mais dans sa qualité de Whig et de patron des gouvernants actuels j’ai été frappée de l’entendre parler avec beaucoup de dégout de la persistance de Lord Melbourne de conserver le pouvoir à des conditions se humiliantes. On est très curieux en Angleterre d savoir ce que va faire lord Durham. Les ministres espérant beaucoup qu’il restera au Canada. Le Duc de Devonshire repart demain pour courir après sa sœur. J’ai dîné hier chez Palmella comme je vous l’ai dit. Lord Alvanley m’a fait rire, & Palmella ne m’a pas ennuyée. J’en suis sortie à 9 1/2 et j’ai été encore me promener sur la route du Val Richer.
J’écris une longue instruction pour Lady Clauricarde. J’aurais bien aimé trouver une Mad. de Lieven il y a 25 ans lorsque je suis allée en Angleterre. Il a fallu que je trouve tout, toute seule. Pour en revenir à Lady Clauricarde. Vous ne sauriez concevoir comme cela est complet j’en suis étonnée moi-même et très fatiguée. Il me semble que je n’ai rien à vous dire de nouveau. Je n’ai reçu de lettres de personne. M. Molé l’autre jour parlait bien mal de la situation de l’Angletere je crois qu’il se trompe, les radicaux y sont faibles en dépits de toutes les sottises qui se disent & s’impriment. Adieu. Adieu.
110. Val Richer, Mardi 4 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Tout confirme notre conjecture ; vous ne faites que vous retirer en Moldavie. Si vous êtes décidés à ne céder jamais et à forcer l'Europe d'aller tous chercher au coeur de la Russie, je comprends cela ; mais si vous devez faire la paix un jour, avant que l'Europe ne soit à Pétersbourg et à Moscou, vous avez tort de ne pas saisir cette dernière ouverture de l’Autriche, et de ne pas rendre vous-même la paix à l’Europe coalisée contre vous. Vous embarrasseriez certainement beaucoup l'Angleterre. et vous auriez chance de regagner du terrain dans les négociations d’un congrès. Mais vous n'aurez pas ce bon sens.
J'explique aussi votre retraite de la Valachie par un autre motif ; vous vous attendez à une grande attaque en Crimée et c’est probable. Vous n’avez pas là une armée suffisante pour résister et vous concentrez vos forces, pour pouvoir vous porter sur le point menacé. Vous n'avez pas des armées partout, et je suis bien tenté de croire que vous aviez sur le Danube ce que vous avez de mieux.
Vous allez avoir dans ou avec le Constitutionnel, un grand pamphlet contre vous, l’histoire de la Turquie de M. de Lamartine. Apothéose des Turcs, dithyrambe contre les Russes ; la fond du livre pris tout entier dans l’histoire de l'Empire Ottoman, par M. de Hamner autrichien. La littérature se fait à l’image de la politique ; l’Autriche vient en aide à la verve de l'Occident.
Je comprends que le dernier discours de Lord Aberdeen et la publication de sa dépêche, après le traité d’Andrinople lui aient fait du bien. D'après ce qui me revient, je crois qu’il n’a pas été fâché que Lord John voulût une place, pour lui-même et pour sir George Grey, et que cela empêchât Lord Palmerston de devenir ministre de la guerre. Cette nomination a été certainement un échec pour Palmerston et les compliments de Lord Dudley Stuart sont une pauvre indemnité. L'inimitié entre Lord John et Palmerston est une grande ressource pour Aberdeen dans les moments d'embarras.
Je vous quitte pour profiter d’un rayon de soleil. La pluie est revenue et gêne mes promenades. Mon Val-Richer va être un peu moins peuplé pendant quelques semaines ; ma fille Henriette vient de partir pour aller faire une visite à sa belle soeur, à Moulin, et Guillaume avait affaire à Paris. Adieu, jusqu'à l’arrivée du facteur.
Onze heures
Voilà votre N°90 et la réponse de votre Empereur à l’Autriche. Malgré mon premier élan d’espérance, je n'attendais pas autre chose. Tristes perspectives. Adieu, Adieu.
Quand vous ne me dites rien de votre santé, j'en conclus que vous n'êtes pas trop mal. Adieu ; mon Journal des Débats et mon Moniteur me manquent ce matin. G.
110. Val-Richer, Vendredi 24 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il fait un temps affreux, et j’ai très mal aux dents. Voilà une mauvaise préparation pour les courses de Caen, et pour la société des Antiquaires. J’ai pourtant un peu plus de foi dans mon éloquence, malgré la douleur, que dans l’agilité des chevaux, malgré la boue. J’ai fait hier une petite répétition de la victoire de Pascal. Je souffrais vraiment beaucoup, l’impatience m’a pris, et je me suis mis à travailler comme si de rien n’était ; en moins d’une heure, l’attention l’a emporté ; je n’ai plus senti la douleur que dans le lointain, comme quelque chose qui pouvait, qui voulait même revenir, mais qui n’était pas là. Je ne l’ai retrouvée qu’à dîner. Cette nuit, j’ai dormi, grâce à un gargarisme de pavot et de fait. Vous voilà parfaitement au courant. Vous a-t-on apporté les Mémoires de Sully ? Avez-vous jété les yeux sur ces dépêches de M. de Fénélon ? Il y a bien des choses ennuyeuses, mais quelques unes vraiment curieuses et amusantes. A la vérité, il faut les chercher dans les ennuyeuses, et vous n’êtes guère propre à ce travail. Votre plus grand défaut est de ne savoir vous plaire qu’à ce qui est parfait. Défaut qui me charme et me désole. Quand je vous vois repousser avec un si fier dédain tout ce qui est médiocre, ou lent, ou froid, ou insuffisant ou mélangé, tout ce qui est entaché, en quelque manière que ce soit de l’imperfection de ce monde, je vous en aime dix fois davantage. Et puis quand je vous vois triste et ennuyée, je vous voudrais plus accommodante moins difficile. Je mens ; restez comme vous êtes, même à condition d’en souffrir. Je le préfère infiniment. Je vous voudrais seulement, pour vous-même, un peu plus de goût pour une occupation quelconque, lecture ou écriture, pour l’exercice solitaire et désintéressé de la pensée. Vous n’y perdriez rien et vous vous en trouveriez mieux. Mais vous n’aimez que les personnes ; il vous faut une âme en face de la vôtre.
Qu’à donc la petite Princesse ? Est-ce qu’elle est malade de la folie de sa femme de chambre ? Pourquoi garde-t-elle cette femme ? Si la folie persiste, il faut la mettre dans une maison de santé. Je parie que l’extrême voisinage de la petite Princesse ne lui vaudra bien auprès de vous. Elle ne supportera pas cette épreuve. Je comprends que le baptême Protestant du petit Duc de Wurtemberg déplaise à l’archevêque ; mais, il devait s’y attendre. On ne s’attend à rien ; on ne renonce à rien ; on ne se résigne point. Il y faut le poids de la nécessité la main de Dieu. Voilà pourquoi nous avons bien fait en 1830. Je pars après demain dimanche à 6 heures du matin, pour être à Caen à 11 heures. J’ai promis d’assister aux courses soleil ou pluie. Elles commencent à midi. Je rentrerai probablement chez moi à la fin de la semaine samedi ou dimanche. La Duchesse de Broglie doit venir nous voir vers cette époque, à partir de demain samedi, adressez-moi donc vos lettres à Caen, à la Préfecture. Du reste, je crois vous l’avoir déjà dit.
10 heure 1/2
Cet horrible temps a retardé mon facteur. Il arrive seulement. Je le sais que vous êtes bien seule, et je m’en désole. A votre mal, je ne sais qu’un soulagement, l’affection, et l’affection de loin, donne si peu ! Tout est bien triste. Votre lettre de ce matin me trouve en grande disposition de le dire avec vous. Adieu. Henriette sera charmée de votre lettre. Adieu. G.
Mots-clés : Littérature, Politique, Portrait (Dorothée), Santé (Dorothée), Santé (François)
110. Paris, Lundi 20 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis enchantée des progrès de votre civilisation. Nous nous parlerons donc plus vite, cela me fait grand plaisir. Le prince Paul de Würtemberg m’a longtemps retenue hier matin. Il vient me questionner sur des choses que j’ignore. La grande préoccupation est ici. Ses idées sont à l’orage, aux ouragans. Je n’y crois pas du tout. Il venait de recevoir une lettre de sa fille la Duchesse de Nassau qui fait les honneurs d’Hesse au grand duc. Elle lui mande qu’il est bien maigre, bien faible, toussant beaucoup enfin dans un état inquiétant. Tous les jours mon mari envoie un courrier à Coblence avec le bulletin de sa santé, lequel bulletin est transmis de nuit pas télégraphe au Roi de Prusse. Ceci indique vraiment un état alarmant. Mon mari porte un chapeau blanc qui fait un grand effet aux eaux. J’ignore pourquoi. Voilà les nouvelles de la Duchesse de Nassau.
Je n’ai passé hier qu’une heure à Longchamp, je me suis rendue de là à Auteuil où j’ai trouvé le duc de Noailles que j’ai ramené chez moi après dîner. Le soir j’ai eu mon monde ordinaire, & M. Molé & Lord Alvanley d’extraordinaires. Celui-ci est rempli d’esprit & de gaieté, je le voyais beaucoup à Londres. Il vous plairait surement, mais vous lui paraitriez bien sérieux. M. Molé était en belle humeur. Il nous a raconté Champlatreux, et ajouté que cette visite lui avait été annoncée déjà depuis trois mois. Il m’a fait une plaisanterie que je relève parce que le Prince Paul m’avait dit la même chose le matin : que l’Emp. Nicolas verrait sans doute Louis Bonaparte sur le lac de Constance. Des personnes qui venaient du salon de la Reine m’ont dit que la duchesse d’Orléans y était et qu’il n’y avait pas encore le moindre indice de l’évènement. Le Duc de Devonshire vient d’arriver. Je dine aujourd’hui chez Palmella avec Lord Alvanley. Enfin le ventriloque est trouvé. Il est venu ce matin chercher la lettre lui-même c’est l’Ambassadeur de Sardaigne qui l’a déterré. Je cherche, il me semble que je vous ai tout dit. Adieu donc.
La lettre de Lisieux devait être 103. Celle de Broglie 104, celle reçue ce matin 105 pas conséquent. Vous n’avez donc pas retrouvé votre compte. Adieu mille fois.
109. Val Richer, Lundi 3 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai peur que vous n'ayez raison et que tout ce mouvement de retraite ne soit qu’une opération de guerre, agressive ou défensive, comme l’Autriche. Je ne vois pas jusqu'ici que vous vous retiriez au delà du Pruth ; c’est seulement au delà du Sereth, vous levez le siège de Silistrie et vous évacuez la Valachie, mais vous vous arrêtez en Moldavie passé devient votre quartier général au lieu de Bucarest. Militaire ou pacifique, la reculade est grande, mais je la voudrais pacifique. Vous ne pouvez plus vous faire illusion sur l’Autriche, sa convention avec la Porte pour l'occupation des principautés est sa manière d'entrer dans l'alliance, et elle s’engage à ne faire aucun arrangement avec vous tant que la Porte ne sera pas rentrée, et garantie dans la plénitude de ses droits et de son indépendance. C'est bien décidément l'Europe entière contre vous et vous n'avez encore eu à faire qu'aux Turcs !
Je penche à croire que nous apprendrons au premier jour que la Suède a fait comme l’Autriche et qu’elle est entrée dans l’Alliance.
L’Europe ainsi unie, vous n'aurez pas même la ressource des insurrections et des révolutions. Vos tentatives en Grèce, et en Bulgarie échouent évidemment ; on dit qu'en vous retirant vous emmenez avec vous 5000 Bulgares qui se trouvent compromis avec les Turcs. C'est de la dépopulation de plus en Turquie, et pour vous les partisans de moins. J’ai rarement vu les fautes porter leurs fruits aussi vite et aussi durement.
J’ai peine à faire attention à l'insurrection de Madrid. Vous savez qu’on vous l'imputera, comme la folie des 50 ou 60 Mazziniens qui ont débarqué sur la côte de Toscane. Je saurai quelques détails sur Madrid ces jours-ci ; le Duc de Glücksburg doit en arriver. Son père est plus malade.
Avez-vous lu dans la Revue des Deux Mondes les articles de Viel Castel sur la Correspondance de Lord Castelreagh ? Ils n’ont rien de remarquable ; mais c’est un résumé clair et complet de la politique Européenne de cette époque, qui nous touche encore, et déjà si loin ! France, Angleterre, Russie, quel changement de principes, de conduite, de langage, de puissance. C’est l’Autriche qui a le moins changé.
Midi
Je n’ai rien de Paris et les journaux ne m’apprennent rien. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, Guerre de Crimée (1853-1856), Lecture
109. Val-Richer, Jeudi 23 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais bien voir vos instructions à Lady Clauricard. Est- ce que vous n’en gardez pas une copie ? Dites lui de vous en renvoyer une. C’est bien le moins qu’elle vous doive. Marie ne pourrait-elle pas en faire une ? Si j’étais là, je vous offrirais encore mon copiste, malgré sa bêtise. Soyez sûre qu’au besoin je vous parlerais de mes ennuis intérieurs aussi simplement que vous m’en parlez. Oui croyez hardiment que vous valez Lady Cowper pour moi. Mais malgré la tranquillité du moment je crains aussi toujours des ennuis pour vous-même. Vous m’avez fait connaitre des gens et des façons d’agir que je ne soupçonnais pas. Avec l’Empereur Nicolas et M. de Lieven, tout est possible. Aujourd’hui ne garantit point demain. Un grand géologue français, M. Elie de Beaumont vient de m’envoyer sont voyage à l’Etna. Je lisais cela hier soir. Il s’est promené je ne sais combien de temps, sur une croûte de terre assez mince, au dessous de laquelle sans rien voir, il entendait gronder et bouillonner des flammes, des eaux, des laves des pierres ; le sol pouvait à tout moment éclater sous ses pieds. Vos barbares sont ainsi faits. Il n’y a point de sûreté. Faites vos affaires vous-même. Assurez, ménagez vos moyens d’indépendance. J’y pense plus souvent que je ne vous le dis. Je suis plus tranquille sur l’Angleterre que sur vous. Non que tous les éléments d’explosion n’y soient. Entre la folie de M. Curran et celle de Lord Londonderry, il y en a plus qu’il n’en faut pour mettre le feu à un grand pays. Mais de l’un à l’autre de ces fous, la distance est longue, & remplie d’une foule de sages, très intelligents, et très résolus qui ne permettront pas aux deux petits bataillons de fous d’en venir aux mains. Voilà le résultat d’un bon et long gouvernement libre ; il n’empêche pas le mal ; il le provoque même et le développe ; mais il provoque, et crée un même temps une masse de bien, forte et compacte, qui pèse beaucoup plus dans la balance. Et puis, je vois dans tout cela bien des folies, et des colères simulées, celles de M. O’Connell et de Lord Lyndhurst par exemple. Si le péril devenait pressant, si les paroles entraînaient des actes, leur emportement radical et tory tomberait, je crois, bien vite.
Qu’est-ce que c’est donc que cette capture d’un Schooner anglais dans la mer noire ? Nous finirons par payer en Europe les frais de la rivalité anglaise et russe, en Asie. Car c’est de l’Asie au fond que la Russie, et l’Angleterre sont préoccupées. Du reste, je le veux bien. J’ai envie de voir rentrer l’Asie dans la circulation des événements. Il faut que l’Europe remue et régénère le monde entier. Ne seriez-vous pas curieuse de savoir où en seront les choses, dans 500 ans ? Je vois dans le Constitutionnel qu’il a été question d’un mariage entre le fils du Roi Ernest et une fille de l’Empereur Nicolas. Je n’y puis croire. Et puis le Constitutionnel ignore évidemment que le jeune duc de Cumberland est aveugle. Vous voyez que je lis bien mes journaux.
10 heures
Je n’ai point de nouvelles à vous envoyer. Mais en revanche, je ne vous en demande point. C’est vous que je veux, non pas vos nouvelles. Du reste dans la disette générale, vous glanez à merveille. Vous verrez Pahlen aujourd’hui. Il fournira à quelques heures. Mais vous serez obligée d’employer la méthode socratique. Il ne parle pas tout seul. Plus d’étourderie, je vous prie malgré mon prétendu contentement. J’aime mieux qu’elle soit de Pépin que de vous. Adieu. Tous ces revenants de Londres ont été bien vite usés, à ce qu’il me paraît. Vous avez raison. Pour vous, et malgré votre amour pour Londres, ils ne valent pas plus que cela. Adieu. G.
109. Paris, Dimanche 19 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu votre lettre de Broglie. Je suis fâchée que M. de Broglie ne vous ait pas laissé dormir. J’ai si mal dormi cette nuit qu’il me semble dans ce moment que rien ne peut être plus charmant que le contraire. Le duc de Noailles est entré chez moi hier au moment où je fermais ma lettre. Ce n’est pas lui qui a parlé. il avait mille choses à apprendre. Il m’a retenue un peu. J’ai été à Longchamp. M. Greville est venu m’y voir. Il n’y avait cependant rien de nouveau d’Angleterre. On espère que le discours de Lord John Russell disposera Lord Durham à rester à son poste en dépit de l’acte d’indemnité. Son retour serait un grand embarras.
J’avais été voir un moment la petite Princesse hier matin. Quel sale ménage ! Je les ai trouvés au déjeuner j’en ai eu mal au cœur. Elle est toujours dans les désespoirs et les terreurs de sa femme de chambre. Cette pauvre folle croit toutes les nuits qu’on attente à son honneur, & le jour elle essaie de se pendre. Cela jouit au perroquet, au chat, au chien, à la nourrice & au prince Schonbery fait un intérieur inconcevable. Je suis allé à Auteuil hier au soir ; j’y ai mené lord Clauricarde et Lord Coke. Il y avait fort peu de monde. Appony m’a dit que selon leurs lettres du prince Metternich le grand duc fera comme il était convenu le voyage d’Italie dans les provinces autrichiennes mais qu’il n’y acceptera pas de fêtes, et ne sera que simple voyageur. L’Empereur Nicolas était attendu sur le lac de Constance le 15. Après, on ne savait pas où il devait se rendre. Le 15 septembre il sera à Berlin aprés les manoeuvres de Magdebourg.
Je vais dîner aujourd’hui à Auteuil avec le Duc de Noailles. Le prince Metternich a été extrêmement content de ses entretiens avec l’Empereur ; Appony a ajouté avec une joie évidente que les récits de Vernet étaient faux, qu’il n’y avait rien de changé. Pahlen reviendra donc comme il était parti. C’est mercredi qu’il arrive. Vous voyez que je cause avec vous comme si vous étiez ici. Mais quelle différence ! Comme je la sens ! Adieu, le dimanche on me demande ma lettre de meilleure heure. Adieu & de tout mon cœur.
Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique
108. Val Richer, Samedi 1er juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous renvoie, la lettre d’Ellice, intéressante si j'y croyais tout à fait, j'en conclurais que la politique de la paix a fait son temps, que l'Angleterre veut du nouveau, n'importe par quels motifs, et à quel prix, et que nous entrons dans une de ces époques où les gouvernements et les peuples dépensent en enfants prodigues, le capital de force, de richesse et de bonheur qu’ils avaient acquis dans ces jours plus sensés. Cela se peut ; il y a bien des symptômes de cet état. Pourtant je n'y crois pas ; je vois bien des symptômes contraires, et je suis sûr que la France n’est pas du tout dans cette disposition.
// Ne croyez pas que je vous dis ceci par pure malice ; tenez pour certain que, s'il y avait dans ce pays-ci une tribune et si ses affaires du dehors, et du dedans, étaient publiquement discutées, ce qui arrive n’arriverait pas. Le vrai sentiment et intérêt de la France se ferait jours et les amis de la paix en Angleterre trouveraient en France un point d’appui. Je conviens qu’il aurait fallu s'y prendre plutôt, et qu’au point où en sont aujourd’hui les choses la paix ne peut se faire que fort à vos dépens.//
Le Duc de Broglie m'écrit : " Voilà l'affaire d'Orient qui entre dans une phase nouvelle ; il me paraît difficile qu’il n’y ait pas, dans tout cela, un dessous de cartes une certaine entente entre la Prusse et l’Autriche et la partie modérée du Ministère anglais. S'il y avait un homme quelque part, les choses étant posées comme elles sont, la paix telle qu’elle s’en suivrait. Mais je n'y crois pas ; je crois que John Bull poussera sa pointe que nous l’y seconderons un peu à contrecoeur, et que l'Allemagne laissera faire. Les événements décideront. "
J’ai aussi des nouvelles de St-Aulaire qui me demande quelques renseignements pour ses Mémoires ; très amical : “ De fréquentes lettres de vous, c’est tout ce que je regrette des ambassades hélas, je serais bien indigne à présent de votre correspondance ; mon esprit s'endort et ma main tremble " Il m’écrit au crayon ; il ne peut plus tenir une plume. C'est ce qui m’arrivera un jour. Sa lettre finit par ceci : " Pauvre Princesse de Lieven ! On croit qu’elle a renouvelé son bail de la rue St Florentin. et j'en augurais bien pour son retour vous me ferez plaisir de mettre, mon nom dans une de vos lettres ; je lui suis bien sincèrement attaché. "
Puisque j'en suis sur les souvenirs, vous vous souvenez de M. Sauzet ; il est à Paris et M. Vitet m’écrit : " C'est à tomber à la renverse ; un spectre, un vrai fantôme. Le pauvre homme m’a donné l'explication de sa maigreur extrême ; c’est son énergie qui l’a dévoré. Par malheur, elle ne lui a pris que son embonpoint et lui a laissé sa faconde, à l’entendre, on le reconnaît." Il paraît qu’il y a eu de vifs débats à l'Académie, à propos des prix Montyon ; les philosophes aux prises avec les dévots ; Cousin et Montalembert se sont querellés vivement. Cousin a été battu. Adieu.
Toujours un temps abominable des torrents de plus depuis trois jours. Si votre Empereur est aussi entêté que mon éternuement, il n’y a guère de chances de paix. Adieu, Adieu. G.
108. Val-Richer, Mardi 21 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il y a plus de soleil ce soir dans mon cœur qu’il n’y en avait ce matin sur la vallée, quand je me suis levé en admirant tristement son éclat. Bien des gens me prennent pour le sage des Stoïciens. Qu’ils seraient étonnés s’ils voyaient combien je suis loin de son impassibilité? J’ai supposé un moment quelque arrivée soudaine qui vous avait dérangée et retardée. Cependant cela me paraissait si invraisemblable que j’ai écrit comme à l’ordinaire, si le grand Duc passe quatre semaines à Tour ce que vous aviez cru possible ne le sera que plus tard, et il faut changer vos calculs. Je comprends la joie d’Appony que rien ne soit changé ailleurs. Il y a si je ne me trompe, dans la politique de M. de Metternich beaucoup de calculs jaloux (le jaloux sans amour bien entendu), beaucoup de soin à entretenir les rivalités, les misintelligences, les séparations, et à fonder là-dessus sa force. Cela me parait un peu vieux, je vous l’avoue. C’était la politique d’un temps où les grands intérêts et les vœux généraux des peuples ne pesaient pas incessamment sur les gouvernements, où les combinaisons arbitraires, mobiles, étaient possibles et habituelles. D’un temps aussi où beaucoup de petits Etats avaient leur poids dans la balance et pouvaient être assez facilement transportés, dans l’un ou l’autre bassin. Tout cela n’est plus. Il n’y a plus de petits états ; plus de combinaisons arbitraires et variables. Les grands intérêts décident seuls de la conduite ; et les grands intérêts sont connus ne changent pas tous les jours. Et on leur obéit, quels que soient les goûts ou les dégoûts, et les désirs secrets et les variations quotidiennes des cœurs. Toutes ces petites inquiétudes et ces petites joies, toute cette attention aux moindres nuages qui passent, aux plus faibles fils qui se tendent ou se brisent, me paraissent une routine de vieilles gens ou un passe-temps d’oisifs. Qu’on y regarde, et qu’on en tienne compte pour son propre plaisir, pour l’agrément ou le désagrément des relations personnelles, rien de plus simple c’est quelque chose pour la conversation, quelque chose pour l’attitude réciproque des acteurs sur la scène ; mais ce n’est plus de la politique. Les Affaires sont plus haut que cela. Et à la hauteur où elles sont, elles sont écrites, comme disent les musulmans ; il faut des motifs placés aussi haut pour les changer.
Lord Alvanley, vous restera-t-il quelque temps ? Je le voudrais. J’aime que vous vous amusiez loin de moi. Est-ce de la présomption ? Peut-être ; mais à coup sûr c’est de l’affection. Vous croyez qu’il me trouverait bien sérieux. Qui sait ? Je l’amuserais peut-être s’il m’amusait. Mais les indifférents m’amusent difficilement. Je n’accepte les petits plaisirs, la gaieté le rire pour rien, que de la main des gens que j’aime que j’aime beaucoup. malgré votre tranquillité dans le n°110, j’attends demain le comte de Paris. J’ai des nouvelles de chez Mad. la Duchesse d’Orléans, d’hier matin, qui me disent qu’elle commençait à souffrir.
Mercredi 22, 7 heures
Le Prince Paul Wutemberg me paraît du nombre des hommes qui croient aisément ce dont ils ont envie, et en qui le mouvement du sang décidé des idées : à voir cette grande et forte figure, ces traits grossiers, ce teint allumé, je n’ai pas la moindre foi dans l’impartialité de son jugement. Il a de l’esprit, mais encore plus d’égoïsme et de cynisme que d’esprit ; et ni l’égoïsme, ni le cynisme ne font voir clair. Vous savez que je crois encore moins que vous aux ouragans. J’ai de l’humeur pourtant.
Avez-vous lu dans le Journal des débats, un article sur la visite des Bayadères aux Tuileries ? Savez-vous que l’auteur de cet article, qui l’a signé de son nom est le précepteur de M. le Duc d’Aumale ? Un précepteur de Princes parlant de la sorte devant le public, et s’extasiant sur les Bayadères, et se trémoussant pour faire partager son extase et finissant par dire : " Après tout, si vous me demandez ce que sont les Bayadères, je serai fort embarrassé. Ce ne sont pas des danseuses, ce ne sont pas des chanteuses ; les Bayadères sont des Bayadères. " Il y a quelque chose qui est étrangement perdu de notre temps, c’est le tact. Personne n’a le sentiment de sa situation. Vous me direz qu’il n’y a pas de situations. Comment ne fait-on pas, soi-même la sienne ?
Voici de l’écriture et du style d’Henriette. Vous occupez souvent sa petite pensée. Elle voulait absolument mettre une enveloppe, ne trouvant pas ceci assez joli. Je lui ai persuadé qu’une suffirait pour elle et pour moi.
9 h. 1/2 Vous êtes une excellente personne de me dire tout simplement que vous aviez oublié le dimanche. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Politique, Portrait, Presse, Réseau social et politique
108. Paris, Samedi 18 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne vous dirai pas quel devait être le N° de votre lettre de Lisieux. Mais j’ai bien envie de vous dire que j’ai plus d’ordre que vous et que je porte toujours en place ou en voyage un calendrier dans lequel je marque cela. C’est que les Français sont étourdis. Fâchez-vous bien je vous en prie. Relisez ma malencontreuse lettre. Regardez y bien. Vous verrez qu’elle n’était pas si mauvaise que vous la faisiez en calèche où vous m’avez inspiré tant de terreur. Mais brûlez la dans tous les cas, car elle vous a donné un mauvais moment et à moi ensuite aussi. J’ai si peu à vous dire de ma journée d’hier que je ferais aussi bien de n’en point parler du tout. Le Duc et la Duchesse de Palmella sont venus me trouver à Longchamp. Avant leur arrivée, j’avais marché seule dans notre allée favorite. Je me suis arrêtée où nous nous arrêtions pour regarder le Mt Calvaire. J’ai pensé à votre bras qui serrait le mien avec compassion à l’endroit où un heureux père appelait son fils d’un nom que je n’ai pas la force de tracer ! Après mon triste dîne j’ai été voir les Brignole. J’ai causé avec eux jusqu’au moment de rentrer pour me mettre au lit.
A propos avant cela, et à la lueur des lanternes, des plus pitoyables lanternes du monde, j’ai été chercher le N°24 de la rue de Sèvres. Imaginez le guignon. Le N°24 est une masure abandonnée. Pas de porte. des affiches placardées partout. Les fenêtres brisées. Enfin une ruine. Vous m’avez mystifiée. Où trouver maintenant le ventriloque ? J’aurais bien des choses à vous dire sur les journaux de ce matin, mais vous n’êtes plus là, vous ne viendrez pas et il faut que je ravale tout. La singulière manière dont le journal des Débats défend le gouvernement Français d’avoir révélé une conspiration formée contre la vie de l’Empereur Nicolas à Varsovie ? On dirait un crime d’empêcher un forfait. Que pensez- vous de cet article ? Que pensez-vous du Constitutionnel de ce matin ? Et de Chaltas, auquel on ne fera pas de procès. Et de l’article inséré dans les journaux hollandais sur cette affaire ? Et les républiques anciennes dont on a tort de trop enseigner l’histoire ? Vous voyez que je lis avec fruit, mais vous voyez aussi que j’ai besoin de vous, ... pour cela seulement ... ?
Marie est d’une gaieté qui m’offense. Elle se porte parfaitement bien. Je n’ai pas de lettres et pas de nouvelles à vous mander. J’ai écrit hier à Lady Cowper, à Mad. de Flahaut. Aujourd’hui à Lady Granville. J’ai fait hier une grande pensée, je compte en faire deux autres aujourd’hui. Maintenant vous savez tout, car je n’ai pas besoin de vous raconter que je suis triste, bien triste. Adieu. adieu.
Mots-clés : Politique (France), Presse, Réseau social et politique
107. Val Richer, Vendredi 30 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai pas reçu hier la confir mation que j’attendais, si impatiemment. Il me paraît clair que vous avez levé le siège de Silistrie, mais non pas que vous vous retirez des Principautés. Je crains que vous ne fassiez dans cette occasion-ci, ce que vous avez fait depuis le commencement de l'affaire, diplomatiquement et militairement, c’est-à-dire quelque chose d’indécis et d’incomplet un certain mélange d’ambition et de modération d'obstination et de concession, d'étalage guerrier et d’esprit non guerrier. Combinaison déplorable pour vous, et aussi pour l'Europe, car elle ne donne, ni à vous la victoire, ni à l’Europe la paix, et elle détruit à la fois l’idée de votre sagesse et celle de votre force. Tout l'orgueil Barbare possible, ne suffit pas pour tenir lieu d'habileté et de vigueur.
Je vous traite, en personne aussi impartiale, que moi je vous dis tout ce que je pense. Je me figure que, si je causais avec elle, je ferais admettre cela, même à la Princesse Kotschoubey qui a l’esprit juste, si elle a le coeur patriote. La vérité peut attrister, mais elle ne blesse pas quand il n’y a rien de blessant dans l’intention de celui qui l'a dit.
J'aime les deux discours d'Aberdeen, et le second au moins autant que le premier, quoique je trouve toujours qu’il ne le prend pas d’assez haut avec les adversaires. Il a beaucoup plus raison qu’il ne dit. Il ne rattache pas assez son bon sens et son honnêteté à la grande morale et à la grande politique. Il ne donne pas grand air à une conduite qui mériterait de l'avoir, et il se donne un air de faiblesse au moment même où il résiste. Il se défend quand il devrait attaquer, et il se défend amèrement et non pas énergiquement. Je le lis avec un mélange de satisfaction et d'impatience, d'approbation et de regret. Et je m'irrite de l'impertinence hautaine avec laquelle, les hommes qui sont à cent piques au-dessous de lui le traitent quelquefois.
Encore un général mort. N'est-ce pas que le général Schilder était un de vos officiers du génie les plus distingués ?
Midi
Votre N°97 est bien triste, et il y a de quoi. J'ai peine à croire pourtant que, de tout ce qui se passe, il ne sorte pas quelque chose de nouveau. Je vais lire la lettre d’Ellice. A demain. Adieu, Adieu. G.
107. Val-Richer, Lundi 20 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai bien envie d’avoir de l’humeur. J’ai mal reçu mon facteur ce matin. Il a été très étonné. Il arrivait de très bonne heure. Malheur à lui s’il arrive tard demain. Pensez bien je vous prie à l’heure de la poste le dimanche, car ce ne peut être que cette cause là. Et si c’est une autre cause, une cause où vous ayez la moindre part du monde, ne me parlez plus de mon étourderie parce que je n’ai pas toujours un almanach dans ma poche. Je me suis promené toute la journée. Il faut que je parle lundi prochain à la société des Antiquaires, et je ne sais que leur dire. J’ai essayé de chercher un peu d’esprit. Ce que j’en ai trouvé ne vaut rien, je crois. J’espère que demain après déjeuner, je serai plus heureux. Il le faudra bien.
Je viens de jouer au loto-dauphin avec mes enfants. Je les ai gagnés. J’ai au jeu un bonheur insolent. Que faire des bonheurs dont on ne se soucie pas. Si tout autre eût gagné, ma petite Pauline se serait impatientée. Il lui déplaît fort de perdre. Mais mes enfants me pardonnent tout. Nous sommes très tendrement ensemble. Je ne les chicane, et ne les gêne pas du tout dans le détail de la vie. J’aime la liberté des gens que j’aime. J’ai du plaisir à les voir s’ébattre librement devant moi d’esprit comme de corps. Avez-vous aussi beau temps que moi ? Du soleil brillant et pas très chaud. Je voudrais arranger le temps de Longchamp l’y envoyer tous les jours, comme vous y envoyez des sandwiches et des fraises. Vient-on vous y voir ? Car vous avez un peu plus de monde à présent. Pahlen vous arrivera dans deux jours. Je vous quitte pour écrire à d’autres personnes de qui je n’attends pas de lettre. Adieu jusqu’à demain.
Mardi, 9 h. 1/2
C’est ce que j’avais pensé. Me voilà délivré pour aujourd’hui de mon chagrin, et pour toujours du reproche d’étourderie deux lettres à la fois, c’est charmant ; mais décidément j’en aime mieux une chaque jour. Ces deux lettres m’arrivent au milieu de la leçon d’arithmétique de mes filles. A ce soir notre conversation. J’aurai le cœur gai aujourd’hui. Adieu. Je suis charmé que vous ayez trouvé le ventriloque. Faites-en mon compliment à M. de Brignolle. Où donc l’a-t-il trouvé ? Adieu. Mille adieux. C’est le moins que vous me deviez.
107. Paris, Vendredi 17 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai cru à mon réveil ce matin avoir dormi deux jours en voyant arriver votre lettre. Je vous remercie de ce petit mot. J’étais bien triste hier au moment où vous m’avez quittée. Je vous ai regardé encore dans la glace du premier salon vous ne me regardiez plus. Cela m’est resté sur le cœur et je me suis décidée à vous voir encore un instant. C’est ce qui m’a fait rentrer de bonne heure & me tenir sur ma terrasse. Cela m’a réussi. Je ne vous ai pas salué, Marie était près de là. Mais j’ai fait mieux que cela et vous aussi. Je me suis sentie allégée.
Vous n’étiez pas sorti de ma chambre depuis dix minutes lorsque Lord Clauricarde y est entré. Comme il avait beaucoup à dire & beaucoup à apprendre, je l’ai mené à Longchamp en laissant Marie à la maison. Il est venu littéralement chercher ses instructions auprès de moi, & sa femme m’écrit même que cela met Lord Palmerston un peu de mauvaise humeur. Elle m’écrit une fort longue lettre, plus intéressante et meilleure que de coutume, et fort intime c’est trop long à vous redire. Il repart après demain. J’ai même lettre fort amusante de Lady Granville et une de Mad. de Flahaut dans laquelle il est évident qu’elle veut revenir à Paris, et que c’est son mari qui ne le veut pas. Je serai pour la femme. Berryer est venu hier au soir, fort désappointé de ne plus vous trouver ; disant beaucoup ce que je disais. Mon discours hier matin, vous en souvenez-vous ? Qu’il n’y aurait pas de N°2.
Médem, Aston, Clauricade, les Brignole, Tcham, Kotchoubey c’est trop long à vous les nommer tous. Mon salon ordinaire. Médem venait du château. Le Roi était soucieux au sujet de l’affaire Belge. Nous ne nous arrangerons pas. Il disait beaucoup aussi qu’on tenait de mauvais propos sur une prétendue mésintelligence entre lui et son fils, entre lui et son ministère. Que tout cela était faux, que jamais il n’y avait eu meilleur accord dans le gouvernement, & que quant à la famille, il n’y en avait pas de plus unie. Le duc d’Orléans contre son ordinaire, était dans le salon du roi. Vous lirez le discours de Lord John au sujet de Lord Durham. Il me paraît excellent. Lisez aussi Lord Brougham sur l’alliance française et les applaudissements de la chambre. Il me semble que pour 20 heures de séparation voilà déjà assez de choses. A propos Marie est venu me dire ce matin que pour la première fois depuis 15 jours elle avait très bien dormi cette nuit. Elle a en effet très bonne mine. C’est trop ridicule.
11 heures
Je viens d’écrire mes deux lettres à mon mari & à mon frère. Elles sont bien. Le grand Duc restera à Lens quatre semaines à ce que prétend Médem. Adieu. Adieu. J’ai encore de grosses lettres à faire pour l’Angleterre. Je suis lasse mais je veux avoir fait cela. Adieu. Je veux faire beaucoup de choses aujourd’hui pour essayer de me distraire. Ah que ce sera long ! que c’est long déjà !
107. Ems, Lundi 31 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
106. Val Richer, Mercredi 28 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai eu hier quatre visites, les politiques du pays, à peu près les seuls qui persistent à se préoccuper des événements publics, trois par intérêt d'affaires, un par curiosité d’esprit. Ils venaient tous me demander ce qu’il fallait croire de l'article du Moniteur et de votre retraite au-delà du Pruth. Grande satisfaction, mêlée d’un peu de surprise. Je les ai engagés à se réjouir toujours, en attendant d'être sûrs. Je leur ai parlé d’un Congrès, où tout le monde se réunirait pour traiter du rétablissement de la paix, et qui durerait peut-être dix ans. Ils approuvent fort ; ils aiment beaucoup mieux dix ans de Congrès que dix ans de guerre.
La correspondance Havas regrette votre retraite, et dit que " cette nouvelle sera accueillie avec le plus vif désappointement par les troupes Anglo-Françaises. Le jour qui devait leur faire oublier toutes les fatigues d’une campagne lointaine, le jour de la bataille recule indéfiniment, avant elles, grâce à l'excessive prudence de la stratégie Moscovite. Mais que nos braves soldats ne perdent pas tout espoir ; cet ennemi qui fait à leur approche n'est pas insaisissable, et on pourra le trouver quelque part, fût-ce sur son propre territoire ?
Nous verrons bientôt si votre retraite n’est en effet qu’une manoeuvre de Stratégie, ou bien la Préface d’un Congrès.
Avez-vous remarqué dans le Times, le rapport des ingénieurs Anglais qui étaient à votre service, et qui s'en sont échappées à grand'peine ? Il est curieux ; mais il ne confirme pas ce qu’on vous dit des compliments qu’on fait chez vous aux Français aux dépens des Anglais. Je suis un peu curieux du commentaire que Lord Aberdeen a dû ajouter avant hier soir à son dernier discours. Mes journaux me l’apporteront ce matin. C'est bien dommage qu’il ne soutienne pas plus hardiment, son propre politique, et en renvoyant à ses adversaires leurs attaques.
Midi
Certainement la nouvelle est vraie ; par considération pour l’Autriche, vous évacuez les principautés. Si cela ne mène pas à la paix, il faut que tout le monde soit fou, ou stupide. Je renais à l’espérance. Grand bonheur. Adieu, adieu. G.
106. Paris, Dimanche 29 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos fêtes dérangent tout. Ma lettre est venue à la poste trop tard hier. Aujourd’hui je vous l’envoie en me levant ce qui fait que je vous écris bien vite. Après demain nous nous verrons je n’ai donc rien à vous dire que ma joie, ma vive joie. Ellice est venu à pied encore me trouver hier à Longchamp. Il arrivait armée d’un formidable Vines qui renferme une lettre de M. Urgethart à Lord Palmerston dans cette lettre le ministre des Affaires étrangères est accusé de complicité dans la publication du Portfolio cette affaire va être grave pour Lord Palmerston. Ellice espère & croit qu’elle lui coutera sa place ; nous verrons. J’ai été hier soir à Auteuil. Il y avait assez de monde, mais pas de conversation. Je voudrais voir cette journée finie. Ce sera un bruit effroyable. Je m’en vais à Longchamp à midi, pour autant de temps que possible, mais il faudra bien finir par revenir. Adieu. Adieu.
Mardi à 4 h. du matin vous passerez devant mes fenêtres. Et j’aurai la bêtise de dormir ! à midi & demi je serai bien éveillée, bien impatiente, bien heureuse. Adieu.
106. Ems, Samedi 29 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai été voir hier ma grande Duchesse Marie de Weimar, à Coblence où elle est en visite de quelques jours chez sa fille la princesse de Prusse. Grandes tendresses. Grande tristesse. Je l’ai trouvé très russe mais sensée. La princesse de Prusse fort modérée dans son langage. Un éloge de l’Empereur Napoléon. Ma course & la Conversation m'ont fatiguée. Ma Grande Duchesse est plus sourde que le Prince Metternich.
Morny va mieux et se décide à rester à Ems. Je voudrais bien amener à Ems Léon de Schlangenbad. J’y resterais bien volontiers mais il n’y a pas moyen comme j'aimerais continuer ces conversations deux fois. le jour. Morny est décidément très agréable, & suis tout à fait fâchée le quitter.
On s’attend à Paris à l'accession de l’Autriche au traité Franco anglo turc, dans 10 jours. St Arnaud, dit on, se prépare à une bataille. rangée sur le Danube. On ne parle plus de la Crimée. Je n’ai pas de nouvelles de Pétersbourg. Voilà bien de la confusion à Madrid. Je pense qu'Espartero gouvernera cette révolution. Greville s'inquiète à l’idée qu'on puisse s'en mêler. Il dit que l'Angleterre n'a plus un soldat, ni un vaisseau à fournir. Il espère que la France verra faire sans prendre la moindre part. Que dites-vous de l'Angleterre prenant à sa solde une armée Turque à laquelle elle fournira ses officiers ? C'est comme les pays. La voilà maîtresse en Turquie comme elle l’est aux Indes, nous avons fait de belles affaires ! Elle a bonne grâce à nous reprocher notre ambition envahissante. Mais sans compter la Turquie que cela fait disparaître, ça peut s' arranger la France & d'autres ? Quels événements !
Metternich n’a pas eu plus de part à la conduite de son gouvernement que vous et moi. Tout cela était inventé de même Aurep. Il écrit à sa femme qu'il se porte très bien. Jusqu’ici la Prusse résiste quand même l’Autriche marcherait. Mais on lui demandera très net de dire oui ou non. Je doute qu’elle ose l'un où l’autre. Alors quoi ? Adieu. Adieu.
J’apprends que l'ordre vient d’arriver de Berlin de mobiliser l’armée. Adieu.
105. Val Richer, Mardi 27 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
M. le Persigny a évidemment de l'humeur ; son départ immédiat pour la Suisse le dit. S'il est encore très amoureux, cela le consolera. Je ne me doutais pas que son long rapport fût un adieu, singulière préface pour congédier un ministre que de mettre au Moniteur le panégyrique de son administration. Les journaux de l'opposition si ce mot existe encore ont mieux parlé hier du ministre en retraite que ceux du gouvernement ; leur ton de regret était plus sincère.
Deux maréchaux en Autriche ! Rien n'indique plus l'approche de la guerre. Ces grands avancements sont toujours, ou un encouragement, ou une récompense. Et chez vous encore un général mort, et l’un de vos plus estimés, si je ne me trompe. Dans le temps de nos grandes guerres, quand nous voyions beaucoup de généraux très, nous disions que les troupes avaient peu d'entrain, et que les officiers étaient obligés de se compromettre pour les enlever. Voilà Napier devant Cronstadt, et avec toutes les forces réunies. Il semble impossible que dans la Baltique et dans la Mer noire, nous n'ayons pas bientôt quelque grosse affaire ; ou bien nous n'en aurons point du tout cette année.
J'avais deviné juste sur la petite duchesse de Melzi. C'est donc dans la jeunesse que les femmes sont folles et les hommes dans la vieillesse. Au reste votre panégyrique des vieilles femmes à propos d’Ellice est mal tombé, et je suis obligé de ne pas l'accepter. Je lisais ces jours-ci qu’entre 60 et 63 ans, la Reine Christine, que le Pape Innocent XI avait d’abord fort bien traité à Rome, est grand peine à obtenir de lui une audience d'un quart d’heure, à cause d’un nouveau galant Français dont elle s'était amourachée. Est-ce qu’il n’en serait pas arrivé autant à votre impératrice Catherine si elle avait eu besoin d’une audience du Pape ?
Nous n'avons pas ici d’aussi fortes variations de température que vous ; il fait beau et chaud depuis quatre jours. Je fais mes foins. A tout prendre les symptômes de la récolte sont bons, et si ce temps-là dure quinze jours, elle sera assurée. En attendant, le pain renchérit toujours, et j’ai eu ce mois-ci, plus de 400 pauvres qui sont venus chercher à ma porte un morceau de pain, et un son ; et je suis dans un des meilleurs pays de France, et mon plus prochain village est à vingt minutes de ma maison.
Onze heures.
Il m'est impossible de ne pas mettre de l'importance à l’annonce du Moniteur que vous avez levé le siège de Silistrie, et que vous vous retirez, au-delà du Pruth. Il n'adopterait pas cette dépêche télégraphique sans en être sûr. Et une foule de détails viennent à l’appui. Si, après cela, vous acceptez un congrès pour traiter du rétablissement de la paix en Europe, sans spécifier à l'avance aucune question, ni aucune solution, les gens qui ne veulent pas de la paix seront bien embarrassés. On peut négocier et disputer des années, dans un Congrès ; on ne recommence pas la guerre. Témoin, le congrès de Münster.
Vous me demandez quand aurons-nous du bon ? En voilà peut-être. Adieu, Adieu, G.
105. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous lisez très bien les journaux. J’ai envie de m’en fier à vous, et de n’y regarder que ce que vous me recommanderez. D’autant plus que j’avais remarqué tout ce que vous me dites et pas grand chose de plus. Je suis de votre avis sur tout entre autres sur l’article des Débats. Il était si à propos, et si aisé d’écrire sur ce bruit du Times, dix lignes de cœur haut et de bon gout, dix lignes vraiment royales, en réponse aux boutades impériales ! Pour le constitutionnel, je n’y attache aucune importance. Il serait vendu qu’il ne parlerait pas autrement. Raison de plus même. Cependant je ne le crains pas. Mais je crois que M. Molé a une voie que je crois connaitre, pour faire insérer de temps en temps, dans ce Journal, quelque article qui le serve comme il l’a fait pour la visite de Champlatreux. La plupart des journaux sont aujourd’hui des magasins où l’on achète un article. Certains acheteurs payent plus cher que d’autres, et ne peuvent entrer que rarement. Mais pourvu qu’ils en disent tant, et pas trop souvent, on les écoute. Si l’opposition savait son métier comme elle exploiterait l’abandon du procès Chaltas ! Mais elle est bête et subalterne. Elle ne sait pas, et n’ose pas. Je n’en persiste pas moins à penser qu’au dehors, on est embarrassé de cette affaire, & bien aise qu’elle ne soit pas poussée à bout. Je ne trouve pas l’article Hollandais bien fin ni bien fier. Les républiques anciennes auraient mieux répondu. Je ne suis pas républicain, ni vous non plus.
Mais avez-vous lu, vraiment lu Thucydide et Tacite, Démosthène, et Cicéron ? Ce sont les esprits qui vous vont le mieux, hauts et naturels, dignes et dégagés, sensés et élégants, et ce je ne sais quoi d’achevé que la perfection du langage donne à la pensée. Vos grandes pensées vaudront les leurs, mais pas mieux, je vous en prévient. Occupez-vous en un peu quoiqu’on dise. Voulez-vous que je fasse porter chez vous une traduction passable de Tacite. Que je voudrais vous tire tout cela moi-même ! Nous nous sommes rencontrés tard. L’eau court vite. Bien peu de place nous reste pour tout ce que j’y voudrais mettre. Le bonheur possible et point réalisé, vu et point atteint, est un des plus pénibles sentiments que je connaisse. Je vous quitte pour ce soir. Je n’ai pas encore regagné tout mon sommeil.
Lundi 20 8 heures
En rangeant, mes papiers, je viens de relire, le N°104. Je ne suis pas décidé à le bruler. Il y a du bien mauvais. Mais tout n’est pas mauvais ; et dans le mauvais même, il y a du bon, ne pouvant les séparer, j’ai envie de garder tout, pêle- mêle. Je voudrais bien n’avoir pas d’autres papiers à ranger que ces numéros là. J’ai des ennuis d’affaires, des comptes à examiner, un fermier qui ne paye pas. Vous ne savez pas ce que c’est que des affaires, et j’espère que vous ne le saurez jamais quoique je vous aie vue à la veille de le trop bien savoir. Je vais à Caen dimanche 26 de grand matin. Ainsi le samedi 25 adressez-moi votre lettre à Caen, à la Préfecture. Je passerai là cing ou six jours, entre la société des Antiquaires, les courses de chevaux et mes courses à moi dans les environs. Le pays-ci est en grand progrès de civilisation. On y prend tous les goûts élégants et civilisés, les courses, les arts, les Académies, les speeches. Tout cela est amusant, à voir naître, si petit d’abord, si informé, et pourtant si animé, si avidemment destiné à grandir. Mon Lisieux vient de fermer son exposition de tableaux, plus de 250 tableaux, dessins, n’en soit de la province soit d’ailleurs. Le public normand a été très excité et charmé. Les paysans sont venus en foule voir cela. L’expositon a fini par une loterie de tableaux. On en a acheté pas mal, de côté et d’autre. On les méprisera beaucoup un jour. Mais ils auront commencé le goût et le sentiment de l’art dans toute une population.
9 h. 1/2
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. C’est la première fois que cela m’arrive cette année. C’était hier Dimanche. On aura mis votre lettre trop tard à la poste. C’est la seule explication que j’accepte. Adieu. J’aime mieux me taire.
Mots-clés : histoire, Littérature, Politique (France), Portrait (Dorothée), Presse, Progrès
105. Paris, Samedi 28 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre bonne lettre nous n’avons plus en tête vous et moi que le 31. Il est si près et ce sera si joli qu’il me semble qu’il ne viendra jamais. N’y aura-t-il pas une émeute demain ? Ne serai je pas tuée ? Voilà qui est possible. Mon fils Alexandre n’a pas renoncé à ces projets de mariage. Il attendra 6 mois comme je lui ai dit de le faire, et puis je crains qu’il n’attendra plus. J’ai parlé de la religion des enfants comme une condition de rigueur, c.a.d. les fils luthériens, et je crois que cela fera la grande difficulté. Sa lettre est une bonne lettre et me touche. M. Ellice et le petit Howard sont venus un voir à Longchamp hier matin. J’ai ramené Ellice qui était venu à pied.
Le soir j’ai fait visite à Madame j ai trouvé M. de la Rovère de Steakelberg un très drôle homme. Quelle idée d’aller épouser Melle de Steakelberg. Ellice m’a lue des lettres de Londres selon lesquelles vraiment le parti libéral (Whigs libéraux) veut absolument une modification dans le ministère. Le Cabinet est fort divisé. Minto et Melbourne, à la Chambre haute, Horwich & John Russell à la Chambre basse se donnent des démentis en pleine séance. Cela a une étrange mine, et ne peut pas durer ainsi. Votre gouvernement ne veut mettre la main à la question Belge que pour la résoudre. Ainsi plus de protocole qui ne soit le dernier. Nous verrons.
105. Ems, Mardi 26 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Toujours ici encore. Vos lettres se promènent mais elles m'arrivent je n’ai pas fixé de jour, je lèverai le camps du soir au matin. Je suis restée emballée depuis 8 jours. Morny est bien malade, et découragé. Il ne veut pas rester ici, mais il ne se décide pas. La conversation me plaît et m’amuse, je m'ennuierais à Schlangenbad profondément. Hélène m'écrit pour m'exhorter à rester. Elle sait que l'ennui est ma plus grande maladie. Enfin je suis encore là, sans savoir si j’y serai demain. Nous avons des chaleurs excessives. On ne peut pas bouger le jour. On ne peut pas dormir la nuit.
Pas de nouvelles. D'Orient rien militairement & politiquement on élabore quelque nouveau protocole qui voudra dire que nos propositions ne sont pas acceptées. Je sais ce pendant qu'on les a trouvé pas sables et que sans y donner suite à présent, on les regarde comme des jalons pour l’avenir. L’Espagne. Que va-t-elle devenir ? Je crois que c'est Espartero qui va reparaître et régner.
Je ne sais sur la mort du général Aurep que ce qu’en disent les journaux. Sa femme avait passé ici il y a une dizaines de jours. Elle ne s’y est arrêté que quelques heures pour me voir. Les journaux sont si menteurs que je ne crois pas encore à cette mort. Si l'Espagne était arrivée dans la belle saison du bavardage de mon salon, que de choses à se dire, et Dumon comme il parlerait ! Adieu. Adieu, que se passera- t-il encore jusqu’au temps où nous nous retrouverons tous ? Ce temps viendra-t-il ? Adieu.
104. Val Richer, Dimanche 25 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Assiégez-vous encore, ou n’assiégez vous plus Silistrie ? Quelles que soient les lois sur la presse, c'est là un fait qui pourrait se dire, et qu’on devrait savoir. Puisqu’on n'affirme rien, j'en conclus que vous assiégez toujours. Mais si le siège continue comme il a commencé, vous y laisserez tous vos généraux.
La nomination du général Hess comme chef de l’armée d'opérations semble dire que le Duc Melzi a raison, et que l’Autriche vous fera la guerre. A ce sujet, je change d’avis tous les jours.
Je suis charmé que le monde vous arrive à Ems. Je vous vois déjà de quoi peupler votre salon le soir. Vous faites, perdez et refaites bien souvent votre fortune de société, petite ou grande. Que devient cette petite Duchesse Melzi ? Est-elle toujours un peu étrange ?
Je ne puis croire que vraiment et d'une façon durable, le beau temps vous vaille moins que le froid. Ici enfin, nous avons beau et chaud depuis deux jours. J'en jouissais pour vous comme pour moi. Ne me gâtez pas mon soleil en vous en plaignant.
Vous n'avez probablement pas lu le grand rapport de M. de Persigny à l'Empereur sur son ministre de l’intérieur. Moi, je l’ai lu et avec intérêt. C'est fait sérieusement, sincèrement et avec une conviction qui ne manque pas de force. Seulement, il y a dans le gouvernement, plus de questions, et les questions sont plus grandes, et plus compliquées que ne le croit M. de Persigny. Il est trop aisément content. Rien ne trompe plus le pouvoir absolu que l'extrême facilité qu’il rencontre d’abord, et quelquefois assez longtemps. On nous rendait, à nous, le Gouvernement trop difficile ; il est, ou plutôt il paraît trop facile aujourd’hui. Autre écueil.
Midi
Je ne m'attendais guère tout à l'heure, en vous parlant de M. de Persigny, que le Moniteur m’apporterait sa retraite. Je n’ai pas un mot de commentaire de Paris ; mais il me paraît impossible que cette retraite n'ait pas un sens politique, et plutôt un sens pacifique qu’un autre. Adieu, Adieu. G.
Je me trompe, on m'écrit que M. de Persigny est remplacé pour deux causes ; comme s'étant expliqué trop durement sur quelques personnes, et comme bouleversant et faisant à la fois languir l'administration. Vraie disgrâce personnelle et purement d’intérieur, dit-on.
104. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi m’êtes-vous devenue nécessaire ? Vous ai-je dit que mon service de poste venait de recevoir un grand perfectionnement ? Mon facteur m’arrivera une heure plutôt et retournera toujours à Lisieux avant le départ du courrier pour Paris. En sorte que vous aurez toujours ma lettre de la veille. M. Conté a arrangé cela, pour moi. Je lui en tiendrai compte quelque jour. L’allocation du Roi sur le parfait accord de sa famille, et de son ministère, est avidemment une réponse au déjeuner de M. le duc d’Orléans chez M. Foule et à mon dîner chez M. le duc d’Orléans. Je n’en reste pas moins convaincu que M. le duc d’Orléans n’a fait cela que d’accord avec le Roi. La part de la comédie est grande, en ce monde. Je trouve le discours de Lord John excellent, un vrai discours de gouvernement, acceptant la responsabilité sans dissimuler le tort, jugeant et agissant d’ensemble et non en détail. C’est le détail qui perd les hommes et les affaires. Lord John a fait de grands progrès. En tout, je trouve la conduite et la situation des Whigs, c’est à dire de Lord Melbourne et de Lord John, meilleures que je n’attendais. Lord Aberdeen se flatte. La clef de l’avenir ministériel est toujours en Irlande. Les Torys ont tort de prolonger indéfiniment les questions irlandaises. Le Gouvernement Tory de l’Irlande est impossible. Les hommes même simples spectateurs ne supportent plus ce degré d’iniquité et de violence. Je regrette la lettre de Lady Clauricard, et celle de Lady Granville, et même celle de Mad. de Flahaut. Si elle a envie de revenir cet hiver, elle reviendra. La mauvaise humeur est une puissance terrible.
9 h. 1/2
Voilà mon facteur et mon N°108. A ce soir. Je trouve ici en arrivant je ne sais combien de petites affaires à régler. Quatre ou cinq personnes sont là qui m’attendent. Nous reprendrons ce soir notre conversation. Car je veux retrouver dans nos lettres notre conversation. Je veux vous dire tout ce qui me traverse l’esprit, tout ... excepté ce qui est tout. à la vérité ceci ne me traverse pas l’esprit. Adieu. Comment voulez-vous qu’on trouve un ventriloque, un homme qui parle là où il n’est pas ? Aussi, qui a jamais cherché un ventriloque ? Je vais pourtant écrire encore pour essayer de trouver le vôtre. Adieu. G.
104. Paris, Jeudi 26 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Longchamp 4 h.
104. Ems, Lundi 24 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Me voilà encore. J’ai du plaisir à la société de Morny. Je ne trouve rien de si agréable à Schlangenbad. D’abord c’est que je n’y trouve rien du tout. La chaleur est excessive. Je recule devant ce voyage. Je reste emballée cependant, mais je lambine. Ici nous causons beaucoup, toute la journée. Morny est bien agréable. Il a de plus un talent de musique charmant. La plus belle voix. Il est bien à son aise, je n’ai plus personne, car le prince de Prusse est absent pour quelques jours.
L'Espagne devient une véritablement grosse affaire. Personne ne s’en mêlera. C’est convenu. B. d'Hilliers va avec ses troupes occuper l'île de Gothland, c. a. d. qu'on l’y reçoit. La Suède se serait donc compromise contre nous. Cela me parait exorbitant mais nous devons nous attendre à tout. Nous avons bien mené nos affaires !
Comme il y a à parler, à penser. Une grande révolution s’opère en Europe. Toutes les situations sont changées. & l'ancien état de choses ne peut plus revenir. J'ai beaucoup à dire, mais Je meurs de chaud, et j’écris un peu loin.
Morny est découragé. Il croit qu’Ems ne lui conviendra pas. Olliffe est d'un avis contraire. Ils vont décider ce soir s’il reste ou s’il va à Plombières. Il a eu aujourd’hui une reprise de ses audiences de Paris. Adieu. Adieu. Je n'ai aucune nouvelle de Russie, & je ne crois pas un mot aux nouvelles des journaux. J’attends les faits. Une bataille. Encore ! Personne n’aura été battu. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Conversation, Musique, Politique (Espagne), Réseau social et politique, Voyage
103. Val Richer, Samedi 24 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà les deux escadres réunies dans la Baltique. Feront-elles quelque chose ? Elles ont l’air d'hésiter beaucoup. C'est là, jusqu'ici, le côté faible des opérations de l'alliance. L'effet est le moindre là où la démonstration a eu le plus d'éclat. Je ne voudrais pas être à la place de Napier, s’il ne fait rien.
Est-il vrai que l'Empereur envoie son ministre de la guerre, le Prince Dolgorouki, sur le Danube ? Vous aurez surement remarqué l’article des Débats d’hier Vendredi sur l’Autriche. Certainement, si l’Autriche réussit à jouer le rôle, elle y grandira beaucoup. Je suppose que les révolu tionnaires Italiens ont une violente humeur de cette importance et presque de cette popularité que l’Autriche a prise dans l’Alliance Anglo française. Les obscurs semblants de tentatives et les coups de poignard qu’ils donnent çà et là, indiquent des gens bien irrités. Pourvu que la duchesse de Parme ne finisse pas par être elle-même comprise dans les coups de poignard.
Je n'ai pas la moindre nouvelle de Paris. Sinon que Montalembert part dans trois jours, non plus pour Vichy, mais pour Contrexeville. Personne ne comprend comment finira son affaire ; on poursuit l’enquête, on épluche ce qu’il a imprimé ; on ne trouve rien, et on ne veut pas se résoudre à une ordonnance de non lieu. C'est assez ridicule.
Onze heures
Est-ce que les eaux que vous buvez ne sont pas pour quelque chose dans cette irritation de l’intérieur de la bouche ? Que votre médecin y fasse bien attention. J’ai vu cela pour des eaux sulfureuses en France. Pauvre Mad. Marischkin ! Elle avait mal à la gorge depuis bien longtemps. Je ne sais pourquoi je crois que nous sommes dans une crise, bonne peut-être. Adieu, Adieu. G.
103. Paris, Jeudi 26 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma bonne matinée de Longchamp a été raccourcie hier par les visites de M. Ellice. M. Villiers, & l’Ambassadeur d’Autriche. Chacun a eu son tête à tête. Villiers a de l’esprit et comme nous en sommes pas sortis des affaires, hier il avait bon ton. Il avait eu la veille une très longue conversation avec le Roi, il en est revenu très frappé de l’habileté, de la plausibilité, (dit-on cela ?) avec les quels le Roi défend ses opinions, car ils n’étaient pas de la même opinion sur l’affaire d’Espagne. La Belgique occupe tous les Cabinets. Le vôtre défend les intérêts de Léopold un peu trop. Celui de Londres reste encore d’accord avec nous. S’il persiste il faudra que la France aussi se range. En général nous sommes fort contents pour le moment de Lord Palmerston dans les deux questions d’Orient et de la Belgique. Je ne sais si cela se soutiendra.
J’ai fait courtement Longchamp par un temps assez froid. Mon dîner solitaire ensuite, et puis un peu de promenade encore en calèche. Marie m’a lu le soir le partage de la France pas l’empereur Nicolas. Vraiment mes Anglais sont trop niais. Comment aller gravement insérer cette bêtise dans les premiers journaux anglais ? Vous avez plus d’esprit ici. J’ai mal dormi, je me sens mal à l’aise ce matin. Je ne sais ce que c’est. En tout cas il n’y a pas de ma faute, car il est impossible de se mettre à un régime plus sain que le mien. Mes Anglais ont dîné hier chez M. Molé.je crois qu’ils dinent chez M. Decary aujourd’hui. Villiers part ce soir. Ellice ne veut partir qu’après vous avoir vu. Voilà une visite un compatriote vite adieu. Adieu.
103. Ems, Samedi 22 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Morny est arrivé hier au moment où je venais de vous écrire. Je ne lui trouve pas mauvais visage mais il se plaint beaucoup de puis un mois il ne peut ni manger ni dormir. Olliffe est avec lui. J’ai eu un grand plaisir de cette arrivée. Nous avons beaucoup causé. Je n’ai rien recueilli de bien nouveau. La détermination de pousser jus qu’au bout. Point de conquête, point de restitution, mais liberté du Danube. Protectorat collectif des pptés, et dans la mer noire régler les choses de façon à donner sécurité à la porte, c.a.d. limiter le nombre de nos vaisseaux de guerre et posséder un point de la côte qui serve d'abri aux vaisseaux anglais & Français. Je crois que ces trois points sont arrêtés & convenus avec l'Angleterre. de plus on parles d'indemnité des frais de la guerre, mais cela ne peut pas être sérieux.
Le plus intime accord avec l'Angleterre et celle dans les plus grande coquetterie pour vous. En vous offrant ses vaisseaux pour le transport de vos troupes dans la Baltique, elle les défraie de tout.
On compte toujours sur l’Autriche et le langage de Hubner y autorise. On est mécontent de la Prusse mais on est convaincu & je le suis aussi, qu’elle sera forcée de faire comme le voisin. On est très préparé a une longue guerre, et comme elle nous ruinera et qu’elle ne ruinera pas la France on compte sur la désaffection qui se produira chez nous, & qui forcera à faire la paix. On se trompe, il n’y aura jamais chez nous ni découragement, ni désaffection et tout cela me paraît éternel. Et je suis parfaitement malheureuse. La cour ne reviendra guère à Paris que pour le [?].
On ne se mêlera pas de l'Espagne. Cependant si le désordre s’établit là, comment laisser faire ? Je trouve toujours que c’est une très grosse question. Il fait une chaleur effroyable. 26 degrés à l'ombre (réaumur) Comment me trainerai-je à Schlangenbad ? Je ne sais encore si j’y vais demain ou après demain. Adieu. Adieu.
102. Val Richer, Vendredi 23 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'avais hier matin, absolu ment rien à vous dire, j’attendais mon facteur et l'explication, ou le désaveu des dépêches télégraphiques de la veille. J’ouvre d'abord votre lettre, et le récit, très curieux, du général Offenburg puis une lettre de Paris, d'un homme d’esprit, en général assez au courant, obligé par état d'être au courant, et qui voit habituellement les gens le mieux au courant. Il m’écrit : " Voilà l’armée Russe au delà du Pruth ; le bruit commence à se répandre que l'Empereur Nicolas est disposé à faire les concessions nécessaires pour désintéresser les Puissances Allemandes, et pour les séparer de la France et de l'Angleterre. On dit même que des concessions seraient de telle nature qu'elles pourraient bien être acceptées, même à Londres. Je ne puis pas croire que l'Empereur Nicolas soit d'humeur à faire une pareille reculade. Cependant ses affaires militaires sont si mal conduites qu’il pourrait bien être condamné aux plus dures et plus humiliantes extrémités."
J’ai souri du contraste. Triste sourire. Que croire ? Je crois tout ce que vous me dites du général Offenberg, mais non pas tout ce qu’il dit. A dessein ou sans dessein, il a évidemment son parti pris d'avoir pleine confiance. J’ai vu, à la fin du règne de l'Empereur Napoléon, des exemples touchants et ridicules de ces illusions du patriotisme et du dévouement passionné. Vous aviez passé le Rhin, vous marchiez sur Paris ; des hommes d’esprit, des généraux distingués disaient sérieusement que vous n'avanciez que parce que l'Empereur vous laissait faire, qu’il était invincible, infaillible, et qu’il retournerait à Vienne et à Berlin quand il voudrait. Je suis décidé à ne croire personne. Je n'ai confiance dans personne. Je ne croirai que les événements. Encore faudra-t-il qu’ils aient parlé bien haut, et plus d’une fois.
// Je trouve seulement bien déplorable que de grands souverains et de grands peuples se fassent la guerre, à si grands frais et avec de si grands risques dans un si grand aveuglement et une si grande ignorance, les uns et les autres, ler leur vraies dispositions et sur leurs vraies forces. Cela fait honte à la civilisation et à l'esprit humain.//
à vous dire vrai, je crois bien plus et j’attache bien plus d'importance au Débat de la Chambre, des Lords lundi dernier qu'à tous les dîners de tous les généraux du monde. J’ai eu attentivement ces trois discours Lyndhurst, Clarendon, Aberdeen. et j’y ai vu ces deux choses-ci ; la paix encore possible, à des conditions modérées pour vous, et un ministre à Londres pour la faire, si vous la voulez ; une guerre de vingt ans et des ministres à Londres pour la faire si vous voulez courir cette chance. Vous n'avez pour vous, dans ce dernier cas, que les divisions des puissances maintenant unies. L'Empereur Napoléon a eu aussi ces divisions là pour lui, et il en a profité, et il a eu, à plusieurs reprises presque tout le continent avec lui, laissant l’Angleterre seule contre lui. L'Angleterre a repris peu à peu toutes les puissances du continent, et les a ralliées contre Napoléon.//
Tout est fort changé, je le sais, les choses et les hommes. Ne vous y fiez pas ; il y a des faits simples et grands, supérieurs à tous les changements d'hommes et de choses, et qui se développent pareillement au milieu des circonstances les plus diverses ; si une fois la politique générale et nationale de l'Angle terre s’engage contre vous, elle marchera à son but, quelle que soit la mobilité des alliances. Ce sera une lutte à mort, dans laquelle, tôt ou tard. Londres ralliera contre vous l’Europe. Le sentiment Européen ne vous est pas favorable ; si vous laissez, à ce sentiment, l’Angleterre pour chef, vous aurez beau être obstinés, aveugles et dévoués ; en définitive, la lutte tournera mal pour vous.
En attendant la question du moment subsiste ; avez-vous cessé le siège de Silistrie, et le grand théâtre de la guerre va-t-il se transporter du Danube en Crimée ?
Midi
Mon facteur ne m’apporte rien aujourd’hui, et je n’ajoute à ceci que adieu et adieu. G.
102. Paris, Mercredi 25 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ellice est entré chez moi hier matin en criant " Vive M. Guizot. Le précepteur est trouvé, une merveille, " et vraiment M. Ellice est d’une joie & d’une reconnaissance sans pareilles. M. Lorain est venu chez moi un moment après, et tous les arrangements ont été faits en ma présence. Je vous remercie beau coup d’avoir si bien arrangé cette affaire. Je n’ai pas vu l’homme mais Ellice le trouve plus gentleman que qui que ce soit.
La petite Princesse et son mari m’ont enlevé un peu de temps hier matin, mais il faisait assez laid et je n’ai pas songé à Longchamp. J’ai fait une visite à Auteuil. Une fort petite promenade après, le dîner ; et puis une heure tout à fait perdue chez moi de 9 à 10. Comme je ne puis ni lire ni travailler. le soir, je vois qu’à moins de très beau temps il me faut un peu de société. Je n’innoverai rien jusqu’à votre arrivée, soyez tranquille. Mais après le honey moon comme vous l’appelez, je reprendrai peu à peu mes anciennes allures. On dit qu’il est sérieusement questions d’appeller le fils du duc d’Orléans, si fils il y a, comte de Paris. On espère qu’il viendra au monde ou le 29, ou le 3 août, ou le 7 ou le 9. En effet voilà plusieurs bonnes occasions. Ce serait maladroit de ne pas en profiter. Londres va finir cette semaine, je me fais fête ds revenants. J’aime votre voisin, ce grand prôneur des mérites de l’Angleterre. Ah quel beau pays. Décidément il faut que nous y allions ensemble, en passant par Boulogne. Que de rêves !
L’Egypte & la Belgique occupent ici le cabinet. Appony était fort interisting & Le comte Pahlen sera de sérieux hier. retour avant le 20 août, je m’en réjouis. Mais nous allons perdre la petite Princesse, quel dommage ! Adieu. Je vous quitte pour aller me réchauffer les pieds au jardin. Voilà où nous en sommes en fait d’été, mais je ne me plains pas, j’aime ceci mille fois mieux que le chaud.
Adieu. Adieu. J’ai des moments de tristesse abominable depuis quelques jours. Vous en sauriez croire tous les efforts que je fais pour combattre cela. Car c’est affreux de me livrer aux souvenirs les plus doux. Je n’ose pas regarder en arrière. Et mon avenir ? Je n’en ai pas. Ah si je n’avais pas votre tendresse, je serais perdue. Ne m’en ôtez rien, jamais, jamais. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Internationale), Réseau social et politique
102. Ems, Vendredi 21 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Encore Ems. Tout était prêt ; mes gens à peu près partis & moi sur le point de monter en voiture hier, j’attendais seulement la poste & mes lettres. En voilà une d’Olliffe qui m'annonce que lui & Morny seront ici aujourd’hui. Je remets mon départ, je les attends. Hélène n’a pas pu attendre, elle est partie et mon fils aussi. Ce matin une lettre de Morny du même jour mais plus dubitative. Cela me vexe. Je n’attendrai pas au delà de demain, et je partirai. Par quoi finira ma tristesse ? Je ne me sens de courage à rien si vous étiez là ! Ah mon Dieu quelle bénédiction, quel bonheur ! Mais personne à qui dire ce que je pense, personne même avec qui causer de ce qui se passe et dans quel moment !
Je ne crois pas du tout à la soit-disant dépêche de Nesselrode à Budbery. C’est trop absurde et d'un ton qui n’est pas à notre usage. Les minoteries à droite et à gauche sont incroyables. Constantin est toujours à Peterhof. La mort du Comte Vorontsov a causé là un vif chagrin. Tout de suite après les couches malheureusement de la Grande Duchesse Catherine, femme du Duc George de Mecklembourg. Elle était très mal et l’enfant mort. On ne parle plus des flottes à Peterhof, ni de la guerre.
Évidemment l’Autriche hésite encore. Cela ne peut cependant pas se prolonger. La Prusse est toujours en grande tendresse pour nous. Les petits allemands attendent avec curiosité. Il me paraît que l’Espagne tout entière à fait son prononciamento. Ce n’est pas mauvais, mais cela peut nous donner du nouveau. L’Europe est bien arrangée ! Adieu & Adieu.
101. Val Richer, Samedi 28 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon dernier mot. Il sera court. Ni ma joie, ni mon chagrin ne sont bavards. Pourvu que je vous trouve bien portante ! Votre mal aise m’a préoccupé tout le jour. De quoi vous parlerais-je ? J’ajourne tout à mardi. Ce jour là, je n’aurai point encore de jury. Tout mon temps sera à moi. Pourquoi donc, est-ce que je vois encore dans les journaux que Lord Granville a été chez le Roi ? Est-ce qu’il n’est pas parti pour Aix ? J’attends Génie ce matin. Il vous aura vue. C’est quelque chose quelqu’un qui vous a vue, en attendant que je vous voie moi-même. Je laisserai mes enfants très bien et ma mère assez bien. La santé de ma mère, me préoccupe beaucoup. Elle est heureuse. Elle l’a si peu été ! Elle jouit vivement de l’affection de mes enfants. Ils remplissent son temps et son âme. La campagne lui plaît. J’espère que le soir de sa vie se prolongera au milieu de ces impressions douces. Et elle m’est si nécessaire pour mes enfants ! A travers beaucoup de petites choses qui manquent et qui m’impatientent quelquefois, toutes les grandes y sont et me donnent une sécurité habituelle que rien ne pourra remplacer. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu’après l’arrivée du facteur. Mais il sera ici probablement avant M. Génie. Adieu donc. à mardi, midi et demie
9 h. 1/2
Le facteur ne m’apporte pas de lettre. Je suppose que M. Génie me l’apportera dans une heure. Je veux bien de cet échange. Mais sans cela, je serais inquiet. En attendant, adieu, le dernier. G.
101. Val Richer, Mercredi 21 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le siège de Silistrie est fatal aux généraux ; Messa Pacha tué et le général Schilder la jambe emportée. La blessure du Maréchal Paskevitch paraît moins grave. Il n’y a pas grand mal à ce que les coups portent un peu haut quelque brave qu’on soit, ces avertissements ont leur effet.
Voilà toutes mes réflexions d'aujourd’hui. Je n'en ai pas plus que de nouvelles. On a beau faire, on a beau écrire tous les jours et n'avoir rien à cacher. Il y a des abymes. entre la correspondance et la conversation. Si nous causions, j’aurais de quoi remplir ces abymes-là.
J’ai eu du regret en vous voyant quitter Bruxelles. Je n’avais pas tort. Vous aviez là du moins des habitués, et des habitués de votre robe. Vous n'aurez à Ems que des rencontres. Le Duc de Richelieu vous restera-t-il un peu longtemps ? C'est à Dieppe qu’il fait ordinairement sa saison d'eaux. Mais pour ce temps-là, les bains de mer ne sont pas encore de saison. Il n’y a encore personne à Trouville. On y attend demain le Chancelier et Mad. de Boigne. Les Broglie y viendront à la fin de Juillet. Assez de monde, dit-on. Cela me dérangera un peu. Le Val Richer est un des délassements de Trouville. Tout le monde n'a pas aussi peur que vous de trois heures de voyage. Vous souvenez-vous comme vous avez été maussade le jour où vous êtes venue ici avec Lady Alice ?
Vous êtes très bonne protestante, mais vous n'êtes ni théologienne, ni philosophe, ni historien ; je ne vous engage donc pas à lire une Défense du protestantisme contre les Ultra Catholiques que M. de Rémusat vient de publier dans la Revue des Deux Mondes. C'est pourtant un écrit très distingué, plein de bon sens et d’esprit, de vérité, et d'à propos. Si nous étions ensemble, je vous le lirais, et je vous le ferais goûter.
Midi
Point de lettre de vous, mais des nouvelles qui seraient bien grosses et bien bonnes, si elles étaient vraies ; le siège de Silistrie suspendu, le maréchal Paskevitch se retirant au delà du Pruth. Il ne manque plus que l'annonce d’un congrès. Je n'ose y croire. En attendant, adieu, Adieu. G.
101. Paris, Mardi 24 juillet 1838 ,Dorothée de Lieven à François Guizot
Quel bonheur quand il n’y aura plus de lettre à écrire ! Voilà une exclamation d’amour et de paresse. Faites les proportions. Ma nuit a été si mauvaise que j’ai dormi jusqu’à dix heures dans le matinée. Il faisait frais cependant, presque froid en vérité. Ma journée hier a été tellement rien du tout que je n’ai pas de compte à vous en rendre. Je n’ai vu personne que Madame Durazzo et Madame Pozzo. A propros le vieux Pozzo est retenu à Londres parler conférences. Il n’a plus de calcul car Dieu sait comme elles iront. On ne s’arrange pas pour le partage de la dette.
Lady Cowper m’a écrit une amusante lettre toute remplie de petites choses. Entre autres, le duc de Sussex qui est un sot comme vous allez voir a donné à dîner au Maréchal Soult en invitant aussi Sébastiani & Flahaut & en portant la santé du Maréchal il a raconté l’histoire de la candidature pour l’ambassade. Lady Cowper ajoute que Flahaut a fait bonne contenance mais que si Marguerite y avait été, on est sûr qu’elle lui aurait jeté un plat au visage. La Reine à son dîner diplomatique a pris le bras de son oncle, de Coburg, ce que les Ambassadeurs ont été obligés de subir ; mais en revanche ils ont pris le pas sur son frère de Linauge, ce qui a déplu à la Reine. Le bruit court à Londres que le grand duc n’y ira pas cette année. J’ai prié la Reine de Hanovre et mon frère de m’apprendre enfin ce qui va devenir mon mari, car toujours encore je n’ai pas un mot de lui.
Savez-vous que je vis exactement comme je ferais à la campagne ? Comme cela me déplairait fort à la campagne, & comme cela me plait parfaitement ici. De l’air, beaucoup d’air, des heures fort bourgeoises, de la solitude ; mais comme elle est volontaire, voilà la différence. Et puis deux fois la semaine du monde, pour me bien prouver que je fais bien de ne pas le recevoir tous les jours, car il ne m’amuse point du tout. Le Pape a de l’Esprit. Comme il y en a peu dans le monde ! Adieu. Mardi prochain à cette heure-ci midi & demi que d’adieux !
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Angleterre), Réseau social et politique
101. Ems, Mardi 18 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mardi
Je n'ai rien. Rien qu'un nouveau rhume que je dois au beau temps. Il fait chaud depuis trois jours et j’ai été assez habile pour en profiter de cette façon. Hier presque tout le jour dans mon lit. Cela ne m'empêchera pas cependant d’aller après demain à Schlangenbad. J’y vais sans plaisir comme tout ce que je fais depuis 6 mois. Je ne sais plus de vos nouvelles depuis Mercredi dernier. C’est bien long.
Voici votre lettre de Vendredi bien courte. Nous ne savons plus que nous dire. Il y a trop pour moi j’étouffe. Une longue lettre de Morny, il a vraiment été bien mal, il l’est encore. On ne sait encore où l'envoyer, Oliffe l’accompagnera. Pas l'ombre d'espérance de la paix. Des bonnes paroles pour moi de St Cloud.
Brockhausen s'écrit ainsi. Il est à Spa avec Hasfeld. Tous deux se lamentent, hopeless case. Au fond j'aimerais aller à Spa. Je suis d’un appétit vorace pour la conversation. L’idée de n'en avoir pas du tout me met dans un vrai désespoir.
Le gros comte Woronov que vous avez vu à Paris le gendre de M. Narchikein vient de mourir subitement du choléra à Peterhof où il était allé pour la fête de l’Empereur. Grande consternation à là cour. Il était fort aimé. Je n'ai rien à vous dire ; tous les jours je suis plus triste. Adieu. Adieu.
101_2. Broglie, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je tombe de sommeil. J’ai fort peu dormi cette nuit. Ce matin au moment d’arriver, je dormais profondément. Certainement, je dormirais si je ne vous écrivais pas. Mais je ne puis me résoudre à passer toute cette matinée sans vous. A midi et demie en sortant de déjeuner, il m’a pris un vrai mal aise physique. Que le bonheur devient promptement une habitude ! Une heure après vous avoir retrouvée, il me semblait que je ne vous avais jamais quittée ; et pendant bien des jours, à midi et demie, je m’étonnerai tristement de ne pas sortir pour aller vous voir.
Samedi 7 h.1/2
J’ai été interrompu hier par M. de Broglie. Quand on arrive de Paris, il semble toujours qu’on apporte des nouvelles. Il n’y en a point. Je le dis. La conversation languit un moment. Et puis, à défaut de grandes nouvelles, les petites arrivent, abondent, et la conversation se ranime et devient intarissable. J’ai passé hier ma journée à raconter ce que je ne sais plus aujourd’hui ce que je me rappellerais bientôt si j’allais causer ailleurs. Mad. de Broglie vient de partir ce matin avec sa fille. Elle passera deux jours à Paris pour assister au grand concours de l’université où son fils a des prix, et le ramènera, sur le champ ici. Mad d’Haussonville partira du 28 au 30 pour Milan, Rome, Naples et l’hiver en Italie. Mad. de Broglie voulait absolument que nous passassions encore quinze jours ici. J’y serais revenu reprendre ma mère, et mes enfants, à mon retour de Caen. Mais je veux rentrer chez moi. Il faut une raison pour que je me plaise à en sortir longtemps. J’ai trouvé ma mère bien et mes enfants, à merveille. Guillaume est engraissé. Votre petit nécessaire a eu un grand succès. Henriette veut vous écrire. Et Pauline, qui ne sait pas écrire veut vous écrire aussi pour vous remercier avec sa sœur et pour sa sœur. Mes deux filles, sont très unies. Il faut qu’elles fassent toujours la même chose. Tout est commun entre elles. C’est un appui, et un repos dans la vie qu’une vraie intimité fraternelle. Et puis ce spectacle me plaît. Mes filles sont, dans leur famille, la troisième génération qui me le donne. Et toujours l’aînée supérieure à la cadette, et la plus dévouée, la plus prompte, aux sacrifices matériels pour sa sœur.