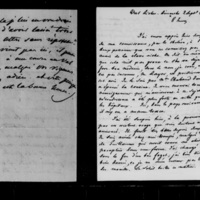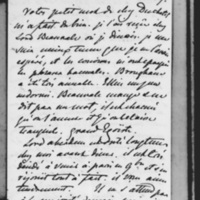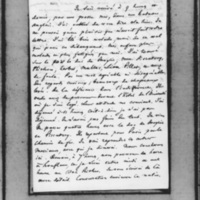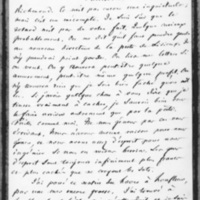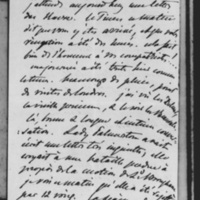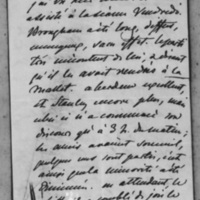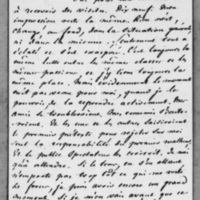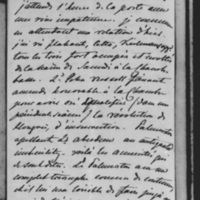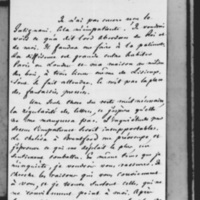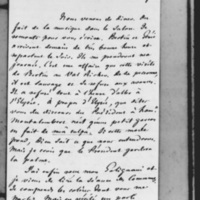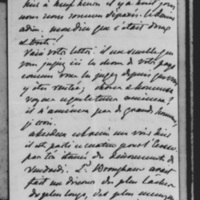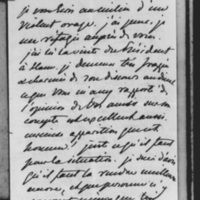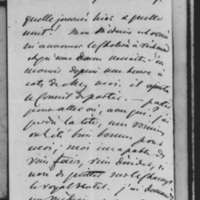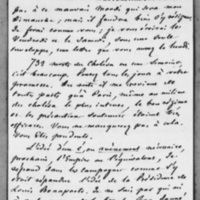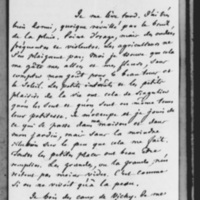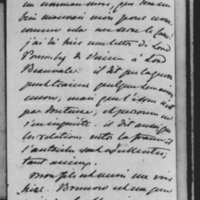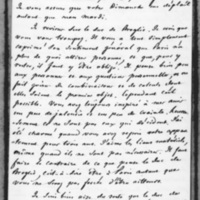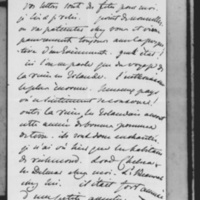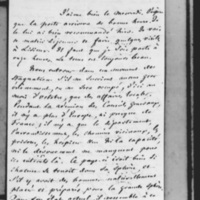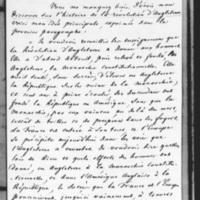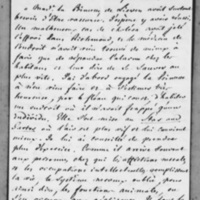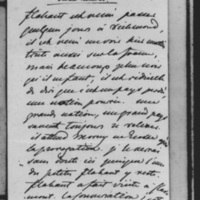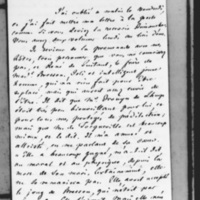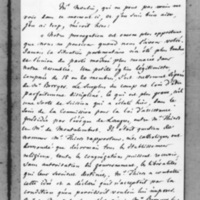Votre recherche dans le corpus : 209 résultats dans 6062 notices du site.Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ? (La correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Lieven : 1836-1856)
Richmond, Samedi 1er septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Richmond, samedi 1er septembre 1849
Un nouveau mois qui commence, nous sera-t-il bon ?
J'ai fait mon luncheon hier chez la duchesse de Gloucester. Je n'en ai pas rapporté des lumières. J'ai dîné chez les Delmas, avec la Colonie. Vieille princesse, & précieuse marquise.
J'ai vu avant-hier Lady John et son frère. Pour la première fois j'ai assez causé avec lui, ou plutôt je l'ai écouté. Il a l'air d'un honnête homme, mais sans esprit, il m'a dit des bêtises sur tout ce qu'il faut faire de libéral. Il n'attache de valeur aux victoires que s'il en ressort partout des constitutions. Au bout de tout cela il perçait cependant de grandes inquiétudes pour l'Angleterre elle-même. Je trouve que ce sentiment gagne.
Le Juius a une tirade aujourd'hui à propos de l'interférence de F.O. dans les affaires de la Hongrie. Cela commence à être su et cru. Assurément cette maladresse couronne toutes les autres.
Le bruit se répand que le G.D. Michel se meurt d'apoplexie. Je le regretterais comme un excellent homme, et qui m'a toujours montré de l'amitié. Cela fera une vraie peine à l'Empereur.
Voici votre lettre, & voici une longue lettre de Montebello, curieuse, animée, voulant absolument qu'on ait du courage dans la timidité même, L. N. promettant qu'on aura cela en se retrouvant à l'assemblée en octobre. Il dit à Lafui [?] dans sa lettre : « Je suis décidé à ne jamais en vouloir à M. Guizot, sans cela je lui en voudrais un peu d'avoir laissé trois & une lettres sans réponse. » Il ne vient par ici, il pense toujours à une course au Val Richer, malgré vos rigueurs.
Adieu, adieu. Et vite puisque l'heure est la bonne heure.
Val Richer, Dimanche 2 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Val Richer, Dimanche 2 sept 1849
8 heures
J'ai encore appris hier deux morts de ma connaissance, par le choléra, à Paris. Deux personnes que vous ne connaissez pas du tout, mais de la classe riche. On dit en même temps que cela n'est pas grave et s'en va déjà. Un fort bon médecin, dont le nom, je crois, ne vous est pas inconnu, M. Rayer, est positivement de cet avis. Je le vois pour Mlle Chabaud, dont il a épousé la cousine. Je vous enverrai tous les renseignements qui m'arriveront à ce sujet. La recrudescence a été plus forte en ville que dans les hôpitaux. Ici, dans le pays environnant, il n'y en a aucune trace.
J'ai été surpris hier, à la promenade, par un violent orage que rien du tout n'avait annoncé. Il faisait très beau depuis deux jours. Je suis arrivé chez moi trempé, malgré les soins de Guillaume qui avait couru me chercher un parapluie dans une ferme. J'ai changé de tout, sous le feu d'un bon fagot ; j'ai bien dîné, très bien dormi, et je ne m'en ressens pas le moins du monde. Le soleil brille ce matin.
Palmerston ruiné m'étonne. Je lui croyais une conduite plus prévoyante et plus réglée. Quoiqu'il reçoive du monde, je ne lui vois pas un établissement ruineux. J'ai entendu dire, il est vrai, que les terres d'Irlande ne lui rapportent plus rien depuis longtemps, car il en employait tout le revenu en secours et en améliorations pour la population.
Je reviens sur une chose que m'a dite Dalmatie, et que je crois vraie. Indépendamment de la question ministérielle, il y aura, au retour de l'Assemblée et pendant sa session d'hiver, deux grosses questions, les deux seules, les finances et les lois sur l'enseignement. En matière de finances, la nécessité de remettre les impôts au niveau des dépenses est l'idée dominante dans le parti modéré ; idée très sensée et très honnête, mais de très difficile et très douloureuse exécution, car le suffrage universel ne permet rien en fait d'impôts, sinon de les réduire. Il y aura là un grand combat entre l'intérêt public et les intérêts privés, entre la nécessité et la timidité devant les électeurs. Les lois sur l'enseignement seront la pierre d'achoppement entre les deux fractions du parti modéré. Les légitimistes et les catholiques veulent avoir plus que le gros du parti modéré ne veut leur donner. La brouillerie qui a recommencé entre Thiers et Montalembert s'aggravera. Ce dont là les deux sources d'où il peut, dans l'intérieur de l'assemblée, découler des événements graves.
Onze heures
Pas de lettre. C'est bien ennuyeux. Heureusement demain n'est pas mardi. Mais c'est bien ennuyeux.Adieu. Adieu quand même. G.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Vie quotidienne (François)
Richmond, Dimanche 2 Septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Richmond, dimanche 2 septembre 1849
Voilà les susceptibilités impériales apostoliques qui s'éveillent. C'est non seulement la phrase malheureuse de Paskévitz, « La Hongrie est aux pieds de Votre Majesté » mais de plus un dîner donné par le général Rüdiger à Görgey et les autres officiers supérieurs de l'armée hongroise. Ils étaient souriants à table, hongrois & russes, lorsqu'arrive un officier d'ordonnance de Haynau porteur d'une dépêche pour Rüdiger. Celui-ci l'invite à s'asseoir, il refuse en apercevant les uniformes hongrois. Rüdiger réplique que là où dîne un général russe, un lieutenant autrichien peut bien dîner. Le lieutenant persiste à ne pas s'asseoir auprès des rebelles, et sort.
Cela fait beaucoup de bruit à Vienne. On dit que Rüdiger a été réprimandé pour avoir été trop courtois. Görgey et tout son monde a été remis aux autorités autrichiennes. Ils sont tous enfermés dans des forteresses & seront jugés. Moi je d[?] Gorgey un peu. Après tout, c'est un vaillant homme, et je ne crois pas que l'Empereur puisse le laisser sacrifier. Beauvale me mande que L'Empereur prêche la clémence, qu'il est sur ce point en correspondance directe avec le jeune Empereur, & qu'il conseille de retirer la constitution de Stadion. Il y a bien à faire encore là !
Comme les radicaux vont faire mousser les petites rixes d'amour propre ! Palmerston sera charmé. Je sais cependant qu'avant-hier, à dîner chez Beauvale il était d'une humeur de dogue. Je ne sais pourquoi.
J'ai vu hier Metternich, il travaille encore à vous répondre. Ah, qu'il m'a ennuyée hier ! Et après bien de ravaudage, il me dit : « Il y a longtemps que je vis, et bien, je me souviens de chaque mot que j'ai dit, ou que j'ai écrit, depuis que je parle & que j'écris. » Ah bon Dieu !
Lundi le 3 septembre.
Voilà votre pauvre hôtesse morte. Cela vous aura fait de la peine. Elle était bien ridicule, mais c'est égal. Je n'ai vu hier que M. de Berg à Londres. (1er secrétaire de notre mission) Il est parfaitement bête. Je n'ai rien pu tirer de lui, sinon qu'il se croit un grand homme parce que son frère est aide de camp de l'Empereur. Je le connais, celui-là a de l'esprit.
J'ai vu la duchesse de Gloucester et toutes mes voisines chez moi le matin. Le soir chez Delmas. C'est de l'exercice de musique. Ce pauvre aveugle n'a peu ce plaisir, & je lui fais de grands plaisirs. Je crois la nouvelle de la mort du G.D Michel fausse.
1.heure. Voici votre lettre. Longue, intéressante. Mauvaise sur le choléra de Paris. Mais il est bien plus fort à Londres. M. de Mussy que j'ai vu hier va à Paris à la fin de ce mois. Ce serait bien là ce qui me conviendrait. Nous verrons.
Montebello est tout aussi vif que Dalmatie sur la nécessité d'une modification. Son Ministère, il l'est extrêmement aussi pour une autre forme de gouvernement, & se promet de faire du tapage en octobre. Nous verrons.
Mad. de Nesselrode avait deux ou 3 ans de moins que moi.
Adieu, adieu, la porte me presse. Adieu.
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849
Sept heures.
On dit que Titus disait, quand il n'avait pas fait au moins un heureux, « J'ai perdu ma journée. » Moi, je crois qu'il disait cela quand il n'avait pas vu Bérénice. Quand votre lettre me manque, ma journée est perdue. J'ai beau faire ; je ne parviens pas à la remplir. J'ai beaucoup travaillé hier ; j'ai lu ; j'ai écrit de mon histoire ; j'ai écrit des lettres. Ma journée est restée vide. Peut-être votre lettre, que j'aurais dû avoir hier, contenait la feuille volante de Metternich, et les curieux auront eu envie de la lire. Je saurai cela ce matin. Ils auraient dû être un peu plus prompts à la lire que lui à l'écrire.
Je pense beaucoup à l'Allemagne, et soit que je veuille arranger l'avenir, ou seulement le prévoir, je ne me satisfais pas. Il y a là des éléments inconciliables entre eux et indestructibles les uns pour les autres, à moins d'un bouleversement général. Des petits États évidemment incapables, soit de contenter, soit de contenir leurs peuples, un grand État qui voudrait dompter les révolutionnaires chez lui, en restant populaire parmi les révolutionnaires du dehors, dont il a besoin pour absorber les petits États, et au moment même où il envoie des troupes pour empêcher ces révolutionnaires là de triompher chez eux. Des peuples qui, petits ou grands, révolutionnaires ou non, veulent jouir de la vie politique dont ils ont commencé à goûter, et se croient humiliés s'ils ne font pas, ou n'entendent pas autant de bruit qu'on en entend et qu'on en fait à Paris et à Londres. Des gouvernements qui ont encore toutes les habitudes du pouvoir absolu, et qui, en quelques mois, ont touché, et vont encore, aux dernières limites du radicalisme, car ils ont accepté le suffrage universel, ou à peu près. Ce sont là des confusions, des ambitions, des contradictions, des nécessités et des impossibilités dont je ne me tire pas. Certainement on ne sortira pas comme on est ; mais je ne crois pas qu'on redevienne purement et simplement comme on était, et je ne vois pas ce qu'on pourra être, ni même ce qu'on voudra essayer d'être.
Attendons. J'attends l'Allemagne et votre lettre. Si j'avais la lettre, je crois que j'arrangerais mieux l'Allemagne.
Onze heures
Voilà mes deux lettres. Et moi bien content. Vous recevrez aujourd'hui celle où je vous parle du choléra. C'est ma préoccupation habituelle pour vous à Paris. On me parle aujourd'hui de nouveaux cas. Je crois décidément qu'il faut attendre un peu.
Je ne comprends rien à ce que vous dit Montebello. Je n'ai pas reçu un mot, un seul mot de lui depuis que je suis ici. Je m'en suis étonné, et je crois vous l'avoir dit. Je vais lui écrire ce matin même.
Adieu, adieu, my dearest. Soignez-vous bien. L'orage ne m'a fait aucun mal. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Politique, Politique (Allemagne), Révolution
Richmond, Jeudi 19 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre petit mot de chez Duchâtel m’a fait du bien. Je l'ai reçu chez lord Beauvale où je dînais. Je me suis mieux tenue que je ne l’avais espéré, et les convives m'ont épargné les phrases banales. Brougham a été très aimable. Ellice un peu endormi. Beauvale mange & ne dit pas un mot, il est charmé qu'on l’amuse et qu’on le laisse tranquille. Grand égoïste. Lord Aberdeen est resté longtemps chez moi avant dîner. Il est très décidé à venir à Paris en 9bre et s'en réjouit tout-à-fait, il vous aime tendrement. Il ne s’attend pas à la majorité demain, mais il voudrait une minorité très respectable.
Ellenborough ne vient pas. Il est malade à la campagne, il a écrit à Lord Brougham ( qui me l’a montré) une lettre très sage très sensée sur la discussion de demain. Lord Aberdeen de son côté a fait part à Lord Brougham de votre recommandation de ne rien dire qui peut gêner les mouvements de la diplomatie française en Italie, & Brougham m’a paru très résolu à observer cette recommandation. Nous verrons car c'est une créature si mobile. Il a vivement regretté de n’avoir pas su le jour de votre départ, il aurait beaucoup désiré causer avec vous avant le débat. Lady Palmerston lui a écrit deux autres lettres, bien aigres & bien inquiètes, il raconte cela fort drôlement.
Je ne suis pas contente de moi. Le malaise continue. Il faut que ce soit dans l'air, car Dieu sait que je me ménage. Le temps est froid. Le vent a soufflé cette nuit. Vous concevez que je n’ai pas dormi, je vous voyais malade en mer.
Midi.
Vous voilà donc en France ! Que c'est loin de moi. Je suis charmée de connaître le Val Richer. Je saurai où vous chercher. Vous aurez un grand plaisir à vous retrouver là, à retrouver vos arbres, votre pelouse, Vos sentiers. Tout cela reposera votre âme. Vous avez là tout le contentement intérieur, de la famille, de la propriété. Je vous manquerai c'est vrai, et je crois que je vous manquerai beaucoup, mais vous avez mille plaisirs que je n’ai pas. Et certes dans cette séparation je suis plus à plaindre que vous. Vous le sentez. Je voudrais me mieux porter et j'y prendrai de la peine, pour vous faire plaisir.
La Reine ayant décidé qu’elle ne viendrait plus à Londres, a reçu hier l’ambassadeur de France à Osborne. Simple présentation, après quoi il est revenu à Londres avec lord Palmerston. La reine a gardé quelques ministres à dîner, elle avait tenu conseil. Elle ne prorogera pas le parlement en personne. Son départ pour l’Irlande est fixé au 2 ou 3 août. Hier encore il m’a été dit de bien bonne source qu’elle est plus que jamais mécontente de Lord Palmerston et qu’elle le lui montre. Adieu. Adieu, mille fois. J’espère une lettre du Havre Samedi. Adieu encore & toujours.
[Le Havre], Jeudi 19 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Je suis arrivé à 9 heures et demie, par une grosse mer, dans un bateau anglais. J’ai oublié de vous dire cela hier. Je ne pensais qu’au plaisir que m’avait fait votre lettre. J’ai été bien malade, mais de ce mal qui passe en débarquant. Mes enfants plus malades et plus fatigués que moi. J’ai trouvé sur le port le duc de Broglie, MM. Piscatory, Plichon, Herbet, Mallac, Léon Pillet, et assez de foule. Pas un mot agréable, ni désagréable. Des regards curieux ; beaucoup de chapeaux levés. De la déférence dans l’indifférence. Il reste assez de personnes devant l'hôtel de l’Amirauté où je suis logé. Leur attitude me convient. J’ai déjeuné à 11 heures, c’est-à-dire, je n’ai pas déjeuné. Je n'avais pas faim du tout. Je viens de passer quatre heures avec le duc de Broglie et Piscatory. Ils repartent pour Paris par le chemin de fer. Je vais reprendre ces autres messieurs avec qui je dinerai. Nous coucherons ici. Demain à 7 heures, nous passerons du Havre à Honfleur, et je serai entre midi et une heure au Val Richer. Je vous écrirai de là avec détail.
Conversation curieuse le matin. Au fond très rassurante pour l’ordre matériel. La prorogation de l’Assemblée, du 17 août à je ne sais quel jour d'octobre, sera votée, plutôt parce que les Montagnards n'en veulent pas que parce que tous les modérés en sont d'accord. Le Ministère ne sera certainement pas renversé avant la prorogation. Peut-être après. J’ai relu bien des fois votre lettre d’hier. Même malade. Grande preuve du plaisir qu’elle m’a fait car c'est un mal bien déplaisant. Adieu. Adieu. Ces messieurs sont là, qui m’attendent. Je leur dois d'être poli pour eux. Adieu. Adieu, mauvais jour aujourd’hui. Je compte trouve une lettre demain en arrivant. Adieu encore. Adieu toujours. G.
Val-Richer, Vendredi 20 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.
J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.
Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.
Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.
J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.
Samedi 21, 9 heures
J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.
Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.
L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.
Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.
Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.
Richmond, Samedi 21 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Midi.
J'attends aujourd’hui une lettre du Havre. Le Times ce matin dit que vous y êtes arrivé, et que votre réception a été des huées. Cela fait bien de l'honneur à vos compatriotes ! Ma journée a été triste hier comme le temps. Beaucoup de pluie, point de visites de Londres. J’ai vu les Delmas la vieille princesse, & le soir les Beauvale. Là, bonne et longue et intime conversation.
Lady Palmerston avait écrit une lettre très inquiète, elle croyait à une bataille perdue à propos de la motion de Lord Brougham. Je vois ce matin qu’elle a été rejetée par 12 voix. La séance a duré jusqu'à 4 h. du matin. Brougham. Carlisle. Hugtesberg. Minto. Aberdeen Lansdown, Stanley. Voilà les orateurs & dans l’ordre que je dis là. On m'apporte votre lettre du Havre. Merci, mais vous ne dites pas comme le Times. J'aime mieux vous croire vous, que lui. (C’était dans les ships news, Southampton.)
Vous voilà donc établi chez vous ! que Dieu vous protège. Comme nous sommes loin ! Les discours hier sont si longs, qu’il m’est impossible de les lire. J'ai choisi celui d'Aberdeen, j’y trouve des paroles honorables & justes pour le roi, Lord Palmerston et pour vous. Je relève cela, parce que les journaux de Paris ne rendront surement pas les discours dans leur étendue. Onze heures de séance. C'est long !
Mon fils est revenu de Londres de sa tournée. J’irai peut être le voir demain, quoique je ne me soucie pas trop de l'air de Londres. Il est vrai que le choléra est bien près d’ici à Brentford vis-à-vis Ken. Peut-être à Richmond, mais on ne me le dit pas. Je n’ai pas de lettres du continent. Demain rien de nulle part, ce sera very dull. Adieu, sotte lettre. Je bavarderais bien cependant si je vous avais là dans ce fauteuil, si bien placé pour un entretien intime comme je regarde ce fauteuil avec tendresse et tristesse ! Adieu. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Dimanche 22 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'aurai le cœur un peu à l'aise que lorsque nous nous serons mutuellement répondu à notre première lettre. Il me semble qu'alors la séparation sera un peu moindre. Vous avez raison ; je suis plus heureux que vous ; j'ai des ressources et des plaisirs qui vous manquent. Aussi je n'en jouis qu'avec un certain sentiment de remords. Mes plaisirs me rappellent à vous comme mes privations. Je viens de me lever. Il fait un temps admirable, l’air est doux et vif, le bleu du ciel aussi pur et aussi brillant que le vert de mes bois. Le climat est réellement bien différent. Je voudrais vous envoyer mon soleil à Richmond. Bien mieux, vous amener, vous, sous mon soleil. Vous y viendrez, soignez-vous bien d’ici là, c'est ma préoccupation de tous les moments.
Les visites commencent bien vite. J’en ai déjà eu quatre hier. De braves gens du pays de ceux qui m’ont été fidèles, et qui restent indignes contre ceux qui ne l'ont pas été. Je leur dis qu’ils ont raison d'être indignes, et je suis plus indulgent qu'eux. Je traiterai mal un très petit nombre d'infidèles, deux ou trois, les plus scandaleux. Amnistie pleine et entière pour tous les autres. La bonne politique est partout la même. Ne trouvez-vous pas que j'ai l’air d’un souverain restauré ? C’est un peu prompt. J'en suis fort loin ; personne n'en est plus convaincu que moi. Mais je suis décidé à prendre mes avantages c'est-a-dire l'attitude d’un homme envers qui on a eu tort, et qui n'a eu tort envers personne. C’est la visite et je crois qu’elle me réussira.
9 heures
Béhier vient de m’arriver. Vous avez lu ses lettres. Il connait bien Paris et comprend bien ma situation. Rien de nouveau dans ce qu’il me dit. Tout confirme ce que nous pensons. Du temps et de l’immobilité, à ces deux conditions, la rivière coule de mon côté. A Paris, impossibilité pour le commerce, et le crédit de se relever. Détresse croissante, après la victoire. On a commencé par s'en étonner. On commence à se l’expliquer. Mais le président est fort loin d'être épuisé comme espérance. On tournera et retournera, en tous sens cette combinaison pour essayer d'en faire sortir un gouvernement. Presque plus de choléra. Moins aujourd’hui qu'à Londres. Il a été affreux pendant cinq jours. La forte chaleur semblait un ennemi acharné à la poursuite de tout le monde. Adieu. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Merci des détails de votre lettre de jeudi. Je sais très bien comment s’est passée votre journée.
Onze heures
Voilà votre lettre de Vendredi. Votre préoccupation du choléra me désole. Non que je vous veuille insouciante à cet égard. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. Béhier me disait tout à l’heure que bien peu de personnes avaient été attaquées sans quelque imprudence positive et constatée. C’est un mal qui atteint rarement, très rarement ceux qui le repoussent d'avance par un régime bon et soutenu et constant. A cela la peur est utile. Gardez donc la vôtre dans cette mesure. Et puis n’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Si le mal s’aggravait à Londres, ou si votre peur devenait un vrai mal, n’hésitez pas, partez. Il n’y a réellement plus rien à Paris. Dans l’hôpital où est Béhier, pas un seul cas depuis plusieurs jours. Je ferme une lettre avant d'avoir ouvert mes journaux. Il m'en est arrivé un paquet. L’article des Débats sur le grand duché de Bade était très bon en effet. Je ne crois pas que la Prusse ose. Adieu. Adieu.
Pas une des minutes que nous avons passées ensemble dans ces derniers jours ne me sort de la mémoire. Toutes charmantes. Adieu. Adieu, demain sera un mauvais jour. Vous aurez été un jour sans lettre de moi. Je n’ai pas pu l’éviter. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Dimanche 22 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Midi
J'ai vu hier Ellice. Il avait assisté à la séance vendredi. Brougham a été long, diffus, ennuyeux, sans effet. Le parti très mécontent de lui & disent qu’il les avait rendus à la Mallet, Aberdeen excellent, et Stanley encore plus, mais celui ci n’a commencé son discours qu’à 3 h. du matin ; les amis avaient sommeil, quelques uns sont partis, c'est ainsi que la minorité a été diminuée. En attendant le chiffre 12 a comblé de joie le ministère. Aberdeen a dit des vérités très dures. En parlant de Palmerston il a dit insanity, de Minto playing antics with [?] & & Je cherche en vain dans le Times ce qu'il a dit de vous. Je l'ai là dans le Chronicle. Ellice m’a dit qu'il a entendu ce passage, grand éloge. Il faut que je le trouve et vous l’envoie. On dit que Minto a été misérable, si misérable qu'on en était honteux pour lui.
Voilà donc le Pape proclamé. Et bien cette expédition tant critiquée et avec quelque raison, a un très beau dénouement. Et Oudinot doit être content. Tous les orateurs à la Chambre haute l'ont comblé de courage. Ce qui viendra après ? Dieu sait.
De Londres je n’ai vu qu’Ellice. Hier Madame Delmas est venue. J’ai été voir Mad. de Metternich. Elle est changée, ses cheveux sont même fort gris, elle est triste, quoique le mari soit très bien ; mais ils ne savent où aller. Ils finissent l’Angleterre, elle est trop chère. Bruxelles, mais c’est bien ennuyeux Je crois presque qu'ils se décident pour Paris au mois d'octobre. Ils essaieront au moins pendant quelques mois. J'ai été le soir chez Beauvale, avec mon Ellice. J’ai joué un peu de piano, et puis un peu Whist. A 10 heures dans mon lit. Voilà ce triste dimanche, sorte d’anticipation du tombeau. Dieu que cela est triste aujourd’hui. Il y a huit jours je vous attendais ! Ah que de bons moments finis ! Je me fais une grande pitié car je suis bien à plaindre.
J'écris aujourd’hui à Albrecht pour quelques arrangements, pas grand chose. Je vous en prie ne vous promener pas seul dans vos bois. J’ai mille terreurs pour vous. Je vous envoie cette lettre aujourd’hui. Vous me direz si elle vous arrive avant celle de Lundi ou en même temps. Dans ce dernier cas je ne ferais qu’une enveloppe pour les deux jours, à l’avenir. Car je vous promets bien une lettre tous les jours. Adieu. Adieu. Toujours ce fauteuil devant moi et vide. Comme c’est plus triste de rester que de partir. Adieu. Adieu mille fois et tendrement adieu.
5 heures dimanche. Flahaut sort de chez moi dans ce moment. Il me dit qu’à Carlton Gardens on est triomphant ; il y avait soirée hier après le dîner pour M. Drouin de Lhuys. Triomphe complet. Lord Palmerston s’était fait interpeller hier à le Chambre des Communes. Il a parlé de tout, de ses vœux pour les Hongrois ! De ses adversaires personnels, il a apellé Lord Aberdeen that antiquated imbecility. Cela vaut les gros mots de Mme de Metternich. J’ajoute ces sottises, pour avoir le prétexte de vous dire encore adieu.
Val-Richer, Lundi 23 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai passé ma matinée hier à recevoir des visites. Dix-neuf. Mon impression reste la même. Rien n’est changé au fond, dans la situation générale, ni dans la mienne. Seulement tout a éclaté et s'est exaspéré. C’est toujours la même lutte entre les mêmes classes et les mêmes passions, et j'y tiens toujours la même place. Mais évidemment le moment n'est pas venu pour moi, quand je le pourrais de la reprendre activement. Mes amis se troubleraient. Mes ennemis s’irriteraient. Et les uns et les autres saisiraient le premier prétexte pour rejeter sur moi seul la responsabilité du premier malheur. Et le public spectateur les croirait. Je n’ai qu'à attendre, si le temps, en s'en allant, n'emporte pas trop tôt ce qui me reste de forces, je puis avoir encore un grand moment. Si je m'en vais avant que ce moment n’arrive, j'ai lieu d'espérer aujourd’hui que justice sera faite à mon nom. Fait général. Les honnêtes gens ont moins peur des coquins que je ne m’y attendais. Ils prévoient de nouvelles luttes, sont très décidés à les soutenir, et comptent sur la victoire. Ceci je le vois. Les coquins que je ne vois pas, sont à ce qu'on me dit, assez découragés et sans confiance dans l'avenir. Ce qui ne les empêchera pas de recommencer. L’esprit manque aux uns et aux autres. Ils sont tous de très petite taille et de vue très courte. C’est une guerre entre des nains aveugles. Il y a dans les deux camps, plus de force et de courage qu’il n'en faut pour se livrer de bien autres combats que ceux qu’ils se livrent des combats au bout desquels viendrait nécessairement la grande défaite ou la grande victoire. Mais ils ont, les uns et les autres, si peu d'intelligence et de portée d'esprit, ils sont tellement au-dessous des questions et des événements qu’ils remuent, qu’il pourra fort bien leur arriver de s’agiter longtemps et misérablement sans rien finir. Il ne serait pas, je crois, bien difficile de faire agir efficacement les honnêtes gens si on pouvait leur faire réellement voir ce dont il s’agit. Ils ne voient pas. Je vous envoie mes réflexions, n'ayant point de faits. La prorogation de l'assemblée sera probablement plus courte qu’on ne l’avait dit. Le sentiment général, dans le parti de l'ordre, est contre. On craint de laisser tout seul un pouvoir si faible et un cabinet si douteux. Ce n'est plus la république seule, c’est la Montagne elle-même qui est l’objet des moqueries populaires. Autrefois, dit-on, la montagne accouchait ; aujourd’hui elle découche.
Onze heures et demie
Je regrette que Brougham et Aberdeen aient perdu leur bataille à 12 voix. Je vais les lire. Je me suis abonné, au Galignani pour rester au courant de l’Angleterre. C'est pourtant le lieu où vous êtes ! Vous ne me dites rien de votre santé. J’en conclus que ce n'est pas mal. Je vous le redemande en grâce ; n'oubliez pas ce que vous m'aurez promis. Adieu, Adieu. Le facteur et le déjeuner m'attendent. G.
Richmond, Lundi 23 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'attends l'heure de la poste avec une vive impatience. Je commence en attendant ma relation d’hier. J’ai vu Flahaut, Cetto, Kielmansegge. Tous les trois fort occupés et révoltés de la séance de Samedi à la Chambre basse. Lord John Russell faisant amende honorable à la Chambre pour avoir osé qualifier (dans une précédente séance) la révolution de Hongrie, d’insurrection. Palmerston appelant Lord Aberdeen an antiquated imbecility. Voilà les aménités qui se sont dites. Lord Palmerston a eu un complet triomphe comme de coutume, & il lui sera loisible de faire jusqu’au mois de février comme il l’entendra : il était en pleine gloire à son Dieu.
Le soir quelques personnes seulement car Lady Palmerston ne sachant pas si son mari serait encore ministre ce jour- là n’avait prié que quelques intimes. C’est ce qu’elle a dit elle-même à Cetto. Votre ambassadeur a fait la connaissance avec quelques diplomates. On ne trouve pas sa femme jolie. De lui, on dit qu'il est assez bien rappelant un peu M. G. de Beaumont. La princesse Metternich et Mad. de Flahaut ont eu hier une vive dispute à propos de la Hongrie. Mad. de Metternich est sortie de son salon et à dit à Flahaut qu’elle n’y rentrerait pas tant que Mad de [?]. y serait. Des témoins de cela ont été fort amusés & sont venus me raconter la scène. Cela a dû être drôle.
J’ai fait ma promenade en calèche avec Kielmansegge. J’ai été dîner chez Mad. Delmas. Madame de Caraman, Richard Metternich & & de la musique après le dîner. Mad. de Caraman joue du piano avec goût. Richard avec force. Le vieux aveugle grogne et voudrait renverser toute les constitutions du monde. Mad. Delmas occupée de mes yeux, de mon poulet. Enfin pleine de bonne grâce. Bonne femme. Voilà hier, et un ciel couvert l’air doux.
4 heures Lady Alice m’a interrompue et voici votre lettre de Lisieux. Vendredi & Samedi. Merci merci de tous les détails. Je n'ai fait encore que parcourir, je vais lire & relire. Paul Tolstoy m'écrit aussi deux mots pour me parler de vous. Comme il vous aime ! Excellent homme, je vais bien le remercier. Votre lettre, vos lettres vont faire mon seul, mon unique plaisir. Je vous en conjure point d’accidents dans notre correspondance. Dieu sait ce que je ne croirais pas si j’en manquais un seul jour. Adieu. Adieu dearest. Adieu. Il pleut, il fait laid mais j’ai votre lettre. Adieu encore, encore.
Val-Richer, Mardi 24 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai pas encore reçu le Galignani. Cela m'impatiente. Je voudrais voir ce qu'a dit Lord Aberdeen du Roi, et de moi. Il faudra me faire à la patience. La différence est grande entre habiter Paris ou Londres et ma maison au milieu des bois, à trois lieues même de Lisieux. Tout se fait attendre. Ce n’est pas la place des fantaisies pressées. Une seule chose du reste m'est nécessaire, la régularité des lettres, et j'espère qu’elle ne me manquera pas. L'inquiétude par dessus l’impatience serait insupportable. Le choléra à Brentford me préoccupe et j’éprouve ce qui me déplait le plus, un sentiment combattu. En même temps que je m'inquiète, je voudrais vous rassurer. Je cherche les raisons qui vous conviennent à vous, et je trouve surtout celles qui ne me conviennent point à moi. Après tout voici ce qui me rassure le plus. Ne vous en inquiétez pas. Il y a eu et il y a encore dans ce pays-ci quelques cas de choléra, épars et rares. Quand l'épidémie n’est pas plus intense, elle n'attaque presque jamais que ceux qui commettent vraiment des excès ou des imprudences. J'ai vu depuis trois jours trois médecins, un de Paris, et deux d'ici, qui me l'ont tous affirmé et prouvé par les exemples. Il en est très probablement de même en Angleterre, et à Richmond comme à Lisieux. Je vous répèterai sans cesse ; point d'imprudence et votre promesse.
Le discours de M. de Montalembert vous aura plu, beaucoup d'esprit, de l’esprit de bonne compagnie, et un cœur chaud et sincère. Jules Favre, un sophiste habile, qui excelle à dire des généralités à peu près vraies et à en faire des applications parfaitement fausses. C'est le grand art des révolutionnaires ; moralistes sur la scène coquins dans la coulisse et glissant très adroitement de l’une dans l'autre. Odilon Barrot a été bien ridicule avec ses prétentions, à la fois pompeuses et embarrassées, à la consistance et à la libéralité imperturbable. C’est toujours le même homme. Le repentir même ne le change pas.
Onze heures
Point de lettre. J’ai envie de dire comme vous ; c’est parce que j'ai parlé de la régularité de notre correspondance ! Toute vanterie porte malheur. J'espère que le dimanche est pour quelque chose dans ce retard. J'attendrai demain avec une double, triple impatience. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Mardi 24 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je découpe du Morning Chronicle le passage (très abrégé à ce qu'on m'a dit) du discours de Lord Aberdeen qui s’adresse au roi et à vous. C'est pour le cas où le Galignani ou les journaux français l’auraient ouïe. Voici donc ce mardi dernier jour où nous nous sommes vus. Comme chaque minute de cette journée reste & reste vive dans mon souvenir jusqu’à ce que votre présence l'efface ou l’adoucisse. Votre présence, quand est ce que le ciel me l’accordera !
J’ai été voir hier Mad. de Metternich enragée plus enragée que jamais contre Lord Palmerston ces deux séances de vendredi et Samedi ont produit un grand effet, mauvais, cela a fait éclater la sympathie de la chambre basse pour les Hongrois, et assuré un grand triomphe à lord Palmerston. Une longue approbation de sa politique ; il fera plus que jamais rien que sa volonté. Il n'a jamais été aussi glorifié et ainsi glorieux, à la suite de cette séance il y a des public meetings pour demander au Gouvernement la reconnaissance de la république de Hongrie. Votre ami Milner s'y distingue. J'ai dîné hier chez Beauvale avec Ellice, il affirme que tout le monde est Hongrois au jourd’hui. Le prince de Canino est arrivé. Lord Palmerston l'a reçu. Il recevra certainement Marrini aussi. Demain & Samedi, lord Palmerston a de grandes soirées. On me dit cependant que Londres est à peu près vide. La peur [des] minorités vendredi à la chambre haute était si grande parmi les Ministres que Lord John lui-même a écrit des lettres de menaces à de vieux Pairs Tories pour les engager à retirer leurs proxies. Il annonce sa démission, une révolution, une république. C’est littéralement vrai ce que je vous dis. Lord Buxley, jadis Vansitart, a reçu une lettre de cette nature qui l'a tant épouvanté qu'il a de suite redemandé à Lord Wynfort le proxy qu'il lui avait confié. Je vous entretiens des petits événements anglais, biens petits en comparaison de tout ce qui se passe hors d'Angleterre.
Dieu veuille qu’il ne se passe rien en France. Il me faut la France tranquille, vous tranquille. Lord Normanby écrit qu'à [?] lorsque le Président y est venu on a crié à bas la république, vive l’Empereur et pas de bêtises. " Je trouve cela charmant, je ne demande pas mieux.
Midi. Voici votre lettre de Dimanche. La correspondance va bien. Gardons ce bien précieux le seul qui nous reste. J'envoie ma lettre à la poste de bonne heure, c'est plus sûr. J’aime ce qui est sûr. Adieu. Adieu. Je suis bien aise que vos amis viennent vous voir n'importe d'où. Je voudrais vous savoir entouré. Je ne veux pas que vous vous promeniez seul. J'ai si peur. Adieu. Adieu dearest. Adieu.
Val-Richer, Mercredi 25 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie du soir.
Nous venons de dîner. On fait de la musique dans le salon. Je remonte pour vous écrire. Bertin et Génie arrivent demain de très bonne heure et repartent le soir. Ils me prendront ma journée. C’est une affaire que cette visite de Bertin au Val Richer.
De sa personne, il est sauvage et se refuse aux avances. Il a refusé tout à l'heure d'aller à l’Elysée. A propos d'’Elysée, que dîtes-vous du discours du Président à Ham ? Montalembert n’est qu'un petit garçon en fait de mea culpa. Si cette mode prend. Dieu sait ce que nous entendrons. Mais je crois que le Président gardera la palme. J'ai enfin reçu mon Galignani et je viens de lire la séance des Communes. Je comprends les colères dont vous me parlez. Mais en vérité un parti conservateur, qui se laisse dire tout cela sans ouvrir la bouche, mérite bien qu’on le lui dise. Il était si aisé de concéder ce que la cause des Hongrois à de juste, et de frapper ensuite d’autant plus fort sur ce qu'elle a de révolutionnaire. L’esprit révolutionnaire est un poison qui infecte et déshonore, et perd de nos jours toutes les bonnes causes. Un rebelle (gardez m'en le secret) ; peut quelques fois avoir raison, un Jacobin jamais Tous les rebelles de notre temps deviennent en huit jours des Jacobins, s'ils ne l’étaient pas le premier jour.
Jeudi matin. 7 heures
Mad de Metternich et Madame de Flahaut m'amusent. Faites exprès pour se quereller. Mad de Mett serait battue. Il y a encore de la femme en elle et beaucoup d'enfant gâté. Ni de l'un ni de l'autre dans Mad. de Flah. Un vieux sergent de mauvais caractère, et toujours de mauvaise humeur. Je sais gré à Mad. Delmas de ses soins. Trouvez, je vous prie l'occasion de leur dire un mot de politesse de ma part. Malgré l'horreur de l'aveugle pour les constitutions.
Je ne me promène seul que dans mon jardin. Soyez tranquille ; je serai attentif. Je suis sûr, et tout me le prouve que la disposition générale du pays est bonne pour moi. Mais, dans la meilleure disposition générale, il y a toujours autant de coquins, et de fous qu’il en faut. Je suis décidé à me préserver pour vous et à me réserver pour je ne sais quoi. Mad. Lenormant m'écrit : " Au nom du ciel et au nom de la France, gardez votre situation hors de tout. Réservez-vous. Le duc de Noailles me charge expressément de vous le dire. " Et elle ajoute : " Je ne puis vous dire assez quel ami admirable, dévoué, courageux, s'est montré, pour la mémoire de ma pauvre tante et pour moi, cet excellent duc de Noailles dans la circonstance de mon triste procès. Il vient de nous quitter, et il était hier à Paris faisant son troisième voyage pour m'aider de ses conseils, de ses démarches et de son affection. Il a fait avec moi les visites aux magistrats. Il a voulu que se femme aussi témoignât dans l'affaire, et il y a une lettre d’elle dans le dossier de Chaix d'Estange. Dans ce temps de mollesse et d’indifférence de semblables témoignages de respects, de souvenir, et d’amitié sont bien rares. Il a bien envie de causer avec vous. Ce serait désirable et nécessaire. Comment cela se pourrait-il ? C’est ce que je ne sais guères, ni l’un ni l'autre de vous ne pouvant en ce moment aller l’un chez l'autre. »
Je suis bien décidé, quant à présent. à ne point sortir de chez moi. Onze heures Bertin est arrivé. Puis Salvandy. Voilà la poste. Je n’ai que le temps de fermer ma lettre. Mes hôtes repartent ce soir. Adieu. Adieu. Que j’aime votre lettre ! Bien moins que vous pourtant. Adieu. G.
Richmond, Mercredi 25 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hier à neuf heures il y a huit jours nous nous sommes séparés. Le dernier adieu. Mon Dieu que c’était doux. & triste. Voici votre lettre. Il me semble que vous jugez ici les choses de votre pays comme vous les jugez depuis que vous y êtes rentré ; choses & hommes. Voyons ce que le temps amènera ? Il n'amènera pas de grands hommes, je crois.
Aberdeen est venu me voir hier. II est parti ce matin pour l’Ecosse. Pas très étonné du dévouement de Vendredi. Lord Brougham avait fait un discours des plus lâches, des plus longs, des plus ennuyeux du monde. Le parti était révolté. Il ménageait lord Palmerston avec une tendresse paternelle. Cela a dégouté beaucoup de monde. Quelques Pairs sont sortis disant qu’ils ne voulaient pas voter pour une motion faite par lord Brougham. Je crois que ceci était un prétexte, et que la vraie raison était la crainte de renverser le Ministère. Quoiqu'il ne soit les Lords Hefford, Pembroke. Tankerville, Cantorbéry, Willougby & & & s’en sont allés. Le duc de Wellington est parti aussi, il est vrai que pour celui-là son vote eût pu être de l’autre côté. On l’accuse fort de désorganiser encore un parti qui l’est déjà beaucoup. Lord Aberdeen a eu hier un dernier entretien très long avec lord Stanly. Ils ne sont venus à reconnaître qu’il n’y avait pour le moment aucun moyen de prendre les affaires ensemble quand bien même les circonstances écarteraient les présents ministres du pouvoir. Aberdeen parle très dédaigneusement de Peel. D'abord comme d'un défunt et puis comme du destructeur du plus grand et respectable parti qu’ait jamais eu l'Angleterre. Moi aussi, mon Peelisme est fini. Lady Alice, parle comme les autres. Aberdeen craint fort les meetings radicaux qui vont se tenir partout en faveur des Hongrois. Il trouve que l’esprit démagogique grandit. Cela l’inquiète.
J’ai oublié de vous dire hier qu' Ellice a reçu une nouvelle lettre de Mad. d'Osne sur le même ton. Thiers et toute la famille sera à Dieppe le 3 août pour y passer quatre semaines. Mon fils est venu me voir hier pour quelques heures. Sa tournée dans le pays lui a profité, il se porte mieux. Brunow envoie des courriers à Varsovie. L’Empereur doit y être revenu hier. J’ai été hier au soir chez Lord Beauvale. Nous sommes une grande ressource l’un pour l’autre Bulwer m'écrit une longue lettre de Francfort, Résumé. L’Allemagne veut l’Unité. La Prusse, si elle ne fait pas de fautes, formera une [?] du Nord. Les petits princes disparaîtront certainement. L'Autriche reprendra sa situation après que la guerre de Hongrie sera terminée. Il n’y a là rien de neuf.
Adieu. Adieu. Je pense à vous tout le jour. Cela n’est pas nouveau non plus, adieu, adieu.
Richmond, Mercredi 25 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
5 heures
Je vous écris au milieu d'un violent orage. J’ai peur. Je me réfugie auprès de vous. J’ai là la visite du Président à Ham. Je demeure très frappée & charmée de son discours au dîner. Ce que vous m’avez rapporté de l’opinion de vos amis sur son compte est excellent aussi. Curieuse apparition que cet homme. Juste ce qu'il faut pour la situation. Je suis d’avis qu'il faut la rendre meilleure encore, et que personne n'y convient mieux que lui.
J’ai lu à Lord Aberdeen ce que vous m'en dites. Cela l'a beaucoup intéressé. Ces visites dans les provinces sont bonnes, utiles, je suis pressée du dénouement. Je ne vous ai pas parlé du discours de M. de Montalembert. Décidément je rechercherai sa connaissance. Beau talent, nature honnête, sincère. C’est très frappant l’un après l'autre on vient se confesser. Tout le monde a eu tort. Je me propose ce texte pour ma première conversation avec le prince Metternich, je suis sûre qu'il me dira : " Oui tout le monde, hors moi. " Je n'ai encore vu personne aujourd’hui, et je ne me suis pas trop ennuyée. Cela m’étonne. Je ne serais pas fâchée que la prorogation de l’Assemblée ne fut pas longue, car Paris vide ne me conviendrait pas du tout.
Jeudi le 26. Onze heures
L'orage a continué presque tout le jour hier, j’ai cependant trouvé moyen de me promener dans les intervalles de pluie mais personne n'est venu de Londres. Lord Beauvale est décidément un grande ressource. J’y vais le soir, et puis les Delmare, gens très faciles à vivre et en grande passion pour moi. On écrit de Paris à Lord Palmerston que tout le monde s’attend à un événement c. a. d. un avènement. Dans les derniers jours le nom de duc d'Aumale est devenu très populaire par suite de ce qu’a dit M. Charras à l'Assemblée. Mais cela n’a pas le sens commun. S’il y a un changement, ce ne peut être que l’Empire. Comment finira l’affaire entre l'Autriche & le Piémont. Cela devient vif. Le choléra a beaucoup augmenté à Londres. 732 morts dans la dernière semaine. C’est beaucoup.
Vous ne sauriez croire tout ce que j’ai d’invention pour me faire passer le temps plus vite. Comme je suis polie pour les ennuyeux, comme Ils m'ennuient moins, depuis que je n’ai plus qu’eux. La veille duchesse me parait avoir un peu d'esprit. Je lui laisse son dire sur les Hongrois en toute liberté, cela l'enchante. A propos, Palkevitch a commencé par un petit échec. Il parait que les Hongrois sont parvenus à couper la ligue. Cependant les récits sont bien confus & contradictoires. Mais tout cela est long, beaucoup plus long que nous ne comptions.
Midi.
Certainement c’est le Dimanche qui a fait votre désappointement. Mardi. Accoutumez-vous à la tristesse du Mardi comme moi à celle du Dimanche. C'est à dire résignez vous. C'est bien triste un jour sur 7. Mauvaise législation Anglaise. Vous voyez que je viens de recevoir votre lettre. Elle me parle de M. de Montalembert. Je vous en ai parlé. J’étais sûr que nous serions d’accord. Je m'en vais lire le discours de Thiers. Adieu. Adieu. Vos lettres font toute ma joie. Adieu mille fois.
Val-Richer, Vendredi 27 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma journée d'hier a été une conversation continue. D’abord avec Salvandy, arrivé à 9 heures et demie, parti à une heure. Puis, avec Bertin et Génie, partis après dîner à 8 heures et demie. Presque toujours dans la maison, à cause de la pluie, vent, orage, grêle. Pourtant quelques intervalles lucides pour se promener en causant. Mon sol est promptement sec.
Salvandy très vieilli. Sa loupe presque doublée. Ses cheveux très longs, pour la couvrir, et très éclaircis, ce qui fait qu’ils la couvrent mal. Toujours en train, mais d’un entrain aussi un peu vieux. Il m'a dit qu’il réimprimait une ancienne brochure de lui, de 1831. Il fait de ses conversations comme de ses brochures. Il est à Paris depuis trois semaines, et y retourne aujourd’hui pour y rester jusqu'aux premiers jours d’août. Après quoi, il revient dans sa terre, à Graveron à 18 lieues de chez moi. Il viendra me voir souvent. A Paris il a vu et il voit tout le monde, excepté Thiers qui ne l'a pas cherché et qu’il n'a pas rencontré. Il raconte Molé, Berryer, Changarnier, le pauvre Bugeaud.
Molé plus animé, plus actif, écrivant plus de billets, faisant plus de visites donnant plus d’aparté que jamais. Président universel et perpétuel, de la réunion du Conseil d'état, de la société pour la propagande, anti-socialiste, de son bureau à l'Assemblée de je ne sais combien de commissions, de tout, excepté de la République. On a fait de lui une caricature très ressemblante, mais où on l'a vieilli de dix ans, avec cette devise : Espoir de notre jeune République.
Il était vendredi dernier à un dîner du Président, faisant les honneurs du salon à MM. S Marc Girardin, Véron, Jules Janin, Janvier & & C'est le dîner où Bertin a refusé d'aller. Le Président, en habit noir cravate blanche, bas de soie, tenue très correcte. M Molé en habit marron, cravate noire, et pantalon gris. Le plus heureux des hommes d’aujourd’hui fort sensé, fort écouté, fort compté, satisfait dans ses prétentions pour lui-même, espérant peu, se contentant de peu, et peu puissant pour le fond des choses. Laissant tomber l'idée de la fusion et s’attachant de plus en plus à la combinaison actuelle n'importe quelle forme nouvelle elle prenne tôt ou tard, car tout le monde croit à une forme nouvelle.
Les voyages du Président préoccupent beaucoup, en espérance ou en crainte. Il est très bien reçu. Il est très vrai qu'on lui crie : Vive l'Empereur et pas de bêtises ! M. Dufaure était un peu troublé à Amiens, et disait : "Je ne croyais pas ce pays-ci tant de goût pour l'autorité. " On se demande ce qui arrivera à Tours, à Angers, à Saumur, à Nantes, surtout à Strasbourg, où il ira ensuite, et qui paraît le principal foyer des espérances impériales. Je suis porté à croire qu’il n’arrivera rien. Tout le monde me paraît s'attendre à un changement et attendre que le voisin prenne l'initiative du mouvement. Point de désir vif, grande défiance du résultat, grande crainte de la responsabilité. Ni fois, ni ambition, ni amour, ni haine. On se trouve mal ; mais on pourrait être plus mal et il faudrait un effort pour être mieux. Et quel mieux ? Un mieux obscur, peut-être pas sûr, qui durerait combien ? Voilà le vrai état des esprits. Le Président ne pousse lui-même à rien. Ceux qui le connaissent le plus le croient ambitieux. Mais personne ne le connait. Il n’a un peu d'abandon. que pour faire sa confession de son passé. Le sang hollandais domine en lui. Il fera comme tout le monde ; il attendra. En attendant ses voyages et ses dîners le ruinent. Il ne peut pas aller. On va redemander de l'argent pour lui. Douze cent mille francs de plus. L'assemblée les donnera. Tristement, car l'état des finances est fort triste. M. Passy tarde à présenter son budget parce qu’il se sent forcé d'avouer, pour 1849, un déficit de 250 millions, & d’en prévoir un de 320 millions pour 1850. On espère ressaisir 90 à 100 millions de l'impôt sur les boissons. Mais comment faire un emprunt pour le reste ? Les habiles sont très perplexes.
La Hongrie n'est pas si populaire à Paris qu'à Londres. Toute l’Europe est impopulaire à Paris les révolutions et les gouvernements. On craint Kessuth et votre Empereur. On croit que c’est l’Autriche qui ne veut pas en finir avec le Piémont afin de tenir en occident une question ouverte qui puisse motiver l’intervention en Italie quand on en aura fini avec la Hongrie.
Il y a eu un temps, déjà ancien de 1789 à 1814, qui était le temps des confiances aveugles. C’est aujourd’hui le temps des méfiances aveugles, suite naturelle de tant de déceptions et de revers. Et la suite naturelle de la méfiance, c'est l'inertie. La France ne demande qu’à se tenir tranquille en Europe. Elle ne se mêlera des affaires de l'Europe qu'à la dernière extrémité, par force et toujours plutôt dans le bon sens, à travers toutes les indécisions et toutes les hypocrisies, comme à Rome. Le gouvernement de Juillet, qui n’a pas su se fonder lui-même, a fondé bien des choses, et on commence à s'en apercevoir. Sa politique extérieure surtout est un fait acquis que tout le monde veut maintenir. Et non seulement on la maintient, mais on en convient et bientôt en s'en vanterai. On m'assure, et je vois bien que comme Ministre des Affaires Etrangères, je suis déjà plus que réhabilité, même auprès des sots. Je vous quitte pour répondre autour Préfet du Havre qui m’a écrit la lettre la plus respectueuse et la plus heureuse que j'aie approuvé sa conduite. Il me dit : " En conformité du désir que vous en avez exprimé, j'ai l’honneur de vous apprendre que les individus qui avaient été arrêtés vendredi dernier ont déjà été relâchés à l'exception de deux que la justice revendique comme habitués de la police correctionnelle, et comme étant d'ailleurs coupables d'avoir joint à leurs cris stupides une tentative d’escroquerie chez un boucher de la rue de Paris. Votre approbation m’a été précieuse et m’a prouvé que j’avais eu raison de ne pas donner à cette ridicule gaminerie les proportions d’une émeute en l’honorant de la présence des baïonnettes citoyennes ou militaires. "
Je reçois beaucoup de lettres, des connus et des inconnus, des fidèles, et des revenants Bourqueney, de qui je n’avais pas entendu parler depuis le 21 février m’écrit avec une tendresse de Marivaux embarrassé : « Dites-vous bien, en recevant cette tardive expression de mon dévouement, que les cœurs les moins pleins ne sont pas ceux dont il n’était encore rien sorti. " Il a voulu dire : " que les cœurs dont il n'était encore rien sorti ne sont pas les moins pleins " Mettez cela à côté de ce billet que m’écrit Aberdeen : " It has been a great satisfaction to me, to see the universal respect and esteem with which you have been regarded in this country. At the same time, it has been to me a cause of sincere regret that I have been so little able to afford you any proofs of m’y cordial friendship during your stay among us. " Je ne le reverrais jamais, je l’aimerai toujours de tout mon cœur.
Merci de m'avoir envoyé le Morning Chronicle J’oublie mon sous Préfet du Havre. Je cause comme si j'étais dans mon fauteuil du Royal Hotel. Pauvre illusion ! Adieu. Adieu. Je vous redirai adieu après la poste. Que de choses j’aurais encore à vous dire.
Onze heures
Voilà votre lettre. Mais mon papier et mon temps sont pleins. Adieu, adieu. à demain. Que l’ancien demain était charmant. Adieu. G.
Richmond, Vendredi 27 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hier nous avons eu le plus violent orage qu’on ait jamais eu en Angleterre. 3 heures de durée, éclairs et tonnerre incessant. L'orage s'acharnait sur le Castel & le royal hôtel. J’ai passé tout ce temps seule, la communication impossible. Le déluge. La pluie a passé le toit & j’ai reçu un vrai bain de douche dans ma chambre à coucher. Plus tard j’ai été voir Metternich il m’a prouvé très longuement que cet orage devait tuer le Choléra. Electricité & & C’était de la sienne. En politique, il est charmé de Montalembert, de Thiers. Il dit que les nouvelles de Hongrie sont excellentes. Je ne vois pas cela encore. Il m'a beaucoup demandé de vos nouvelles. Je l'ai trouvé fort maigre, mais il est bien.
Le soir j’ai vu Beauvale, et puis de la musique chez Delmas. Cela m’a un peu échauffé, & j'ai mal passé la nuit. Hier il est mort 120 personnes du Choléra à Londres, avant-hier 64. Cela augmente beaucoup. J'ai lu ou plutôt parcouru Thiers, il a dit d'excellentes choses, et le ton de ce discours m’a paru bon. Les journaux anglais disent qu'il a produit beaucoup d’effet. Ils le donnent aujourd’hui tout en entier.
Voici votre lettre. Je vais affranchir la mienne, et nous verrons. Comment il n'y a que huit jours aujourd’hui que vous êtes arrivé au Val Richer ? Dieu que cela a été long. Je ne vous parle pas de ma santé par superstition en effet. Quand je serai malade je vous le dirai. Le parlement sera prorogé le 31. Point de séance royale. La reine part d'Osborne le 1er août pour l’Irlande. Adieu. Adieu. Je n’ai pas un mot de nouvelle à vous donner l'orage a intercepté tous les arrivages. La province a vécu sur son propre fond. God bless you dearest.
Val-Richer, Samedi 28 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
D’une heure à cinq hier ma maison n'a pas désempli. Orléanistes, quelques légitimistes quelques quasi républicains honteux. Pour moi de la bienveillance, et de la curiosité. En soi, toujours les mêmes dispositions, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Du bon sens, de l’honnêteté, même du courage ; tout cela trop petit et trop court. C'est la taille qui leur manque à tous. Ils ne sont pas au niveau de leurs affaires. Ils n'atteignent pas ou il faudrait atteindre pour faire quelque chose. Grandiront-ils assez et assez vite ? Mes arbres ont très bien poussé. Je ne suis pas aussi sûr des hommes que des arbres. Je suis content de la visite d’Armand Bertin. Le Journal restera dans une bonne ligne ; impartialement en dehors du présent, fidèle avec indépendance au passé. Et fidèle à moi avec amitié si j'étais à Paris pouvant causer deux ou trois fois par semaine, il ne s’y dirait pas un mot qui ne me convint. Spécialement sur les Affaires Etrangères. D’ici, il n’y a pas moyen d'y regarder de si près. Pourtant on marchera toujours du bon côté.
Des lettres de Barante, de Philippe de Ségur, de Glicksbierg. Barrante affectueux et triste, voyant toutes choses avec la sagacité un peu stérile d’un esprit juste et d’un cœur abattu. Un grand pays à moins qu’il ne soit réellement destiné à périr, n'est jamais si dépourvu de forces et de remèdes qu’il en a l’air. Il supporte et attend deux choses qui nous sont bien difficiles à nous passagers éphémères sur la scène, sans en avoir le projet formel, évidemment Barante finira par venir à Paris. " J’ai un bien vif regret, me dit-il, que mon lieu de retraite, soit si loin du vôtre. Sans cela, je serais allé tout de suite vous revoir. Si quelque circonstance de famille ou d'affaire m'appelle à Paris, je serai bientôt après au Val Richer On fait ce qu’on prévoit si clairement. Ségur très amical, croyant que ma maison à Paris n'est plus à ma disposition, et voulant. que, si j’y vais, j'aille occuper la sienne. Il n’y reviendra que tard, en hiver. Glücksbing est toujours à Madrid. Il m’écrit qu’il va publier quelque chose sur la réforme douanière et financière de l'Espagne, et finit par cette phrase : " M. Mon dit qu’il va vous écrire pour vous engager à venir passer quelques mois en Espagne. A part les bouffées de jalousie entre lui et le général Narvaez, dont il adviendra ce que Dieu voudra, tout marche admira blement ici. Les nouvelles d’Andalousie sont excellentes, et vous aurez remarqué l'accueil que le duc et la duchesse de Montpensier ont reçu à Gibraltar. "
En avez-vous vu quelque chose dans les journaux Anglais ? Si nous étions ensemble, je vous lirais les lettres, et elles vous amuseraient. Elles ne méritent pas d'être envoyées si loin. Je vous donne ce qu’il y a de mieux. Voulez-vous, je vous prie, faire mettre à la poste cette lettre pour Lord Aberdeen, en y ajoutant son adresse actuelle ? Je ne sais où le prendre. Onze heures Votre lettre m’arrive. Et Hébert en même temps. Pour la journée seulement. J’aime assez qu'on prenne cette habitude de venir me voir sans s’établir chez moi pour plusieurs jours. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Samedi 28 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Quelle journée hier, & quelle nuit. Mon Médecin est venu m'annoncer le choléra à Richmond et qu’une dame venait d'en mourir depuis une heure à côté de chez moi. Il ajoute le conseil de partir. Partir pour aller où, avec qui ? J’ai perdu la tête, mes voisines ont été bien bonnes pour moi, moi incapables de rien faire, rien décider, non de quitter sur le champs le royal Hotel. J'ai demandé un Médecin pour me conduire à Brighton. Personne ne veut quitter. J’ai écrit à M. G. de Mussy hors de Londres à St Léonard. Je demande une chambre ici. pas un coin. Me voyez- vous au milieu de tout cela ? Enfin à 10 h. du soir on me procure une chambre et rien de plus. Je n’ai pas fermé l’œil, j’ai l'air d’un revenant ce matin, Ah mon Dieu, que faire ! Horrible isolement, & impuissance de me conduire moi-même. Je vous écris ce peu de mots. Ah que votre amitié est dure dans ce moment & comme je sens que sans vous je n’ai ni protection, ni soutien. Adieu, adieu dearest adieu, quel malheur que ce diner demain, Vous attendez de mes nouvelles & moi-même. Je ne puis rien entreprendre. Adieu. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Dimanche 29 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne m'accoutumerai certainement pas à ce mauvais mardi qui sera mon dimanche ; mais il faudra bien s’y résigner. Je ferai comme vous ; je vous écrirai le vendredi et le samedi, sous une seule enveloppe, une lettre que vous aurez le lundi. 732 morts du Choléra en une semaine, c’est beaucoup. Pensez tous les jours à votre promesse. Du reste il me revient de toutes parts qu’à Paris même au milieu du choléra le plus intense, le bon régime, et les précautions soutenues, étaient très efficaces. Vous ne manquerez pas à cela. vous êtes prudente.
L’idée d'un événement, ou avènement nécessaire, prochain, l’Empire ou l’équivalent se répand dans les campagnes comme s'y était répandue, l'idée de la Présidence de Louis Bonaparte. Je ne sais pas qui, ni à quel moment le branle sera donné, mais il deviendra sur le champ général. On se trouve mal sous ce qui est, et on n’y croit pas. Ni foi, ni santé. On essaiera de tous les remèdes seulement, il y aura, quant au plus prochain remède, sinon lutte au moins dissidence, entre l’Assemblée et la population. Evidemment l’Assemblée ne croit pas à l'empire comme remède, ni à Louis Napoléon connue dynastie. Elle est bien pour lui, et lui donnera volontiers et du pouvoir, et de la durée, mais sans grandes idées ni longues espérances. La population n'en est pas encore là. Et si la population se met en mouvement l'assemblée suivra. J'ai lu le discours de Thiers. Sensé, spirituel et à propos. Petit. Et puis se donnant comme le représentant de tout le Gouvernement passé contre toutes les oppositions. Il a raison, puisque personne ne le contredit et ne lui rappelle ce qu’il a fait. Mais c’est drôle à lire. Toujours grande affluence de visites. Et je n'ai jamais été plus seul. Je ne dis pas deux paroles qui me plaisent à dire. Adieu, adieu jusqu'à la poste.
Onze heures
Voilà votre lettre d'avant hier vendredi. L'affranchissement ne l'a pas retardée. Je voudrais bien que votre grand orage eût tué le choléra à Londres, avez-vous eu peur pendant l'orage ? Que je voudrais avoir été là ! J’espère qu’on a raccommodé le plafond de votre chambre de manière à ce qu’il n’y pleuve plus. Rien d'important de Paris. Un ancien conservateur, membre de l'Assemblée, M. Moulin m'écrit : " Nous allons discuter la prorogation. Je la voterai ; non pour mes affaires et mes plaisirs personnels mais par ce motif, tout puissant à mes yeux qu’au milieu de nos impuissances constitutionnelles et financières, en présence d'un avenir qui n’est plus de trois ans il devient nécessaire que nous puissions porter dans nos départements nos impressions de Paris et rapporter à Paris les impressions des départements. " Adieu. Adieu. La seconde cloche du déjeuner sonne. Adieu, dearest beloved. Adieu. G.
Richmond, Dimanche 29 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma journée a été plus calme hier. Si elle avait continué sur le ton de la veille, je ne crois pas que j'eusse été en état de vous en rendre compte aujourd’hui. Mad. Delmas, [Crasalcowy], les Beauvale, Brougham. Les Collaredo, tout cela m’a aidé à me calmer. Aujourd’hui j’attends M. Guenaud de Mussy. Je ferai ce qu’il me dira. Le choléra avait un peu diminué à Londres avant hier pour ici je n’en sais rien. Personne ne me dira plus la vérité, & je ne croirais pas aux bonnes nouvelles s’il y en avait. J’ai dîné chez Beauvale avec Brougham pas déconcerté du tout. Il m’a donné copie d’une lettre qu'il adresse à la reine. Lettre de remontrance & d'avertissements " Votre ministre tout en protestant qu'il veut l’existence de l'Autriche, prononce des paroles. sympathiques pour les Hongrois. Le lendemain la cité retentit de discours et de vœux pour les rebelles, encouragés par ce qui s’est dit à la chambre des Communes. Rappelez-vous que votre Empire se compose aussi de nationalités diverses que c'est s’attaquer à votre couronne que se liguer avec les Révolutions au dehors. " & & & Tout cela fort bien développé. Extraordinaire créature. & il commence sa lettre en s’appuyant sur son droit de conseiller de la Couronne & son droit d’une audience de la Reine, il préfère lui écrire plutôt que l’incommoder. Tout cela est en règle. J'ai une lettre d’Hélène. La grande Duchesse était retournée à Pétersbourg. Le duc de [Lench] devait la suivre par mer & puis s'embarquer de Peterhoff pour son grand voyage, qui pourrait bien cependant se borner au midi de l'Angleterre. Beaucoup de tendresses impériales pour moi. Votre lettre de jeudi est charmante. Hélas aujourd’hui, rien du tout. Je crois l'air sur la montagne meilleur, & si je reste ici j’ai l’assurance d’un appartement [?] que celui où je suis nichée maintenant. Ellice est parti pour l’Ecosse. Tout le monde quitte Londres. Lady Palmerston a eu hier une dernière soirée. On était curieux de savoir si on y rencontrerait le Prince de Canino. Je ne crois pas, mais Pulsky, bien sûr.
Lundi le 30 juillet
Guenaud de Mussy est venu. Il me plait beaucoup et d’abord il m’a fort rassuré, comme la famille royale arrive demain à Claremont, il a exploré tous les environs pour s'assurer de l’état sanitaire. A Richmond 2 cas. Au surplus toutes les raisons contre la maladie m'ont paru excellentes. Il reviendra me voir jeudi. Enfin! Il m’a calmée. Je me suis prévalue de votre nom. Il me parait qu'il vous est dévoué avec enthousiasme. Kielmansegge est venu hier. Il part pour le Hanovre. Il ne m'a rien dit de nouveau. J’ai vu lord John aussi. Il espérait que la paix allait se conclure avec le Piémont. Il m’a beaucoup parlé de Paris. Il a fort critiqué le discours du président à [?] et s'en est moqué. Moi je l'ai défendu, nous avons eu une petite discussion la dessus. Il est convenu cependant que le discours avait fait un bon effet à Paris. Et bien, c'est tout ce qu'il faut. Lord John est ravi de la fin de Palmerston. A propos, autre discussion sur Palmerston. A mon tour je me suis permis de critiquer et très fort les paroles grossières qu'il a adressées à Lord Aberdeen, et j’ai dit qu’un homme de bonne éducation ne se permettrait pas cela, et que lui Lord John depuis 35 ans qu’il est à la chambre n'a jamais adressé de semblables paroles à ses adversaires. En résumé que cette grossière épithète avait gâté son discours du reste habile. Il m’a donné raison, & sa femme aussi. C'était très drôle cette conversation. Elle vous aurait amusé. J’ai dîné chez Delmas. C'est de la distraction. J'en cherche, j'en ai besoin. Duchâtel vient me voir ce matin. Je crois qu'il part après-demain. Cela me fait de la peine ; mon seul lien avec la France. Je n’en causerai plus avec personne de compétent. Adieu. Adieu. J’essayerai de vous écrire par la poste de 4 heures. Vous me direz si la lettre vous arrive en même temps que celle-ci de 1 heure. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Lundi 30 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je me lève tard. J’ai très bien dormi, quoique réveillé par le bruit de la pluie, point d’orage, mais des ondées fréquentes et violentes. Les agriculteurs ne s'en plaignent pas. Moi je trouve que cela me gâte mes allées et mes fleurs, sans compter mon goût pour le beau temps et le soleil. Les petits intérêts et les petits plaisirs de la vie ont cela de singulier qu'on les sent et qu’on sent en même temps leur petitesse. Je m'occupe et je jouis de ce qui se passe dans ma maison et dans mon jardin, mais sans la moindre illusion sur le peu que cela me fait. Toutes les petites pièces ont beau être remplies. Les grandes, ou la grande, n'en restent pas moins vides. C'est comme si on ne vivait qu'à la peau. Je bois des eaux de Vichy. Je me suis senti quelques velléités de calculs biliaires. Deux verres d’eau de Vichy par jour m’en débarrasseront. C'étaient des velléités lointaines et sourdes. Dans les trois ou quatre premiers jours de mon arrivée, j'ai eu aussi un peu d’émotion dans les entrailles, un certain sentiment d'une influence atmosphérique différente. J'ai été très attentif dans mon régime de nourriture. Il n'en est plus question du tout. Je me porte très bien.
Je suis jour par jour dans le Galignani, la marche du choléra à Londres et en Angleterre. On ne cite jusqu'ici, à peu près point de noms. Je vous demande positivement, instamment en grâce, pour peu que vous vous sentiez indisposée d'envoyer chercher M. Guéneau de Mussy (26 Maddox-Street. Regent street) Vous le croirez ou vous ne le croirez pas vous lui obéirez ou vous ne lui obéirez pas mais voyez-le et entendez le en même temps que vos médecins anglais. Je le crois un excellent médecin, et je suis sûr que l'homme ne vous dégoûtera pas du médecin.
Curieux spectacle que ce mouvement d'opinion en Angleterre, en faveur des Hongrois. Mouvement naturel, car les Anglais, sont toujours portés à prendre intérêt aux causes libérales. Et factice car ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit en Hongrie ni si c’est vraiment une cause libérale ; ils sont remués aveuglément par quelques mots, et par quelques hommes qui n’en savent pas plus qu'eux, ou qui veulent tout autre chose qu'eux. Il y a bien des manières d'être un peuple d’enfant. Et tout cela est l'ouvrage de Lord Palmerston et de la Chambre des communes. Si la politique de Lord Palmerston était bonne ou si la vérité avait été dite dans la Chambre des Communes, la nation anglaise penserait et sentirait autrement. Quand l'Angleterre juge ou agit mal, ce sont toujours les chefs qui sont coupables car elle a assez de bon sens et d’honnêteté pour juger et agir bien si ses chefs lui montraient la voie. Mais elle n’en a pas assez pour trouver à elle seule la vraie voie, et pour y faire marcher ses chefs, surtout en matière d'affaires étrangères, qu’elle voit de si loin et dont au fond, elle se soucie si peu.
Onze heures
Quelle désolation! J'avais le présentiment que la lettre d’aujourd’hui me désolerait. Et je n'en aurais pas demain ! Mais je ne ne pardonne pas de penser à moi. C’est de vous qu’il s’agit, si vous pouviez être un peu moins troublée ! Si je pouvais vous envoyer, vous apporter un peu de calme et de courage ! Je suis disposé à approuver Brighton. Avez-vous quelque nouvelle de ce qui s’y passe en fait de choléra ? Si le mal se répand et augmente, quittez l’Angleterre. Il n’y en a presque plus en France. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il va souvent à St. Léonard, mais il n’y habite point. Il est de bon conseil, et même de ressource au besoin. Que je voudrais être à après-demain. Adieu. Adieu. Dearest, si j'étais là, vous auriez moins peur. G.
Richmond, Lundi 30 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Duchâtel m’a tenu longtemps et mon essai de la poste de 4 heures ne peut pas se faire aujourd’hui. Il part le 4. Il s'embarque à Ostende, le lendemain il dîne à Spa chez sa belle-mère. Il ira ensuite à Paris pour peu de jours & de là chez lui dans le midi. Je crois qu'il préfère ne pas débarquer dans un port français. Son arrivée ne fait pas événement et il aura fait d'une pierre deux coups, la France & Paris. On lui écrit pour lui conseiller cela. Il sera à Paris encore avant la dispersion de l'Assemblée. On lui mande que Morny est un vrai personnage et que c’est lui qui pousse à l’Empire. Duchâtel n’y croit pas. Il ne voit d’où viendrait le courage. En même temps je pense, que si on le tentait cela serait accepté par tous, lui, Duchâtel le premier. Morny a écrit à Duchâtel une lettre très vive d'amitié, de vœux de le voir à Paris, à l’Assemblée, disant que des gens comme lui sont nécessaires & &
Il faut que je vous dise qu'ayant été très inquiétée par suite de ce qui s’est passé au Havre le 19. J’avais écrit au duc de Broglie pour lui demander s’il voyait du danger pour vous au Val-Richer, il me répond et me rassure pleinement, me disant que les quelques cris poussés au Havre n’avaient aucune signification aucune portée mais voici comme il finit sa lettre... " Votre bon souvenir m’est d’autant plus précieux que je n’espère point vous revoir ici. Vous avez vu les derniers beaux jours de la France, ni vous, ni nous ne les reverrons plus. " Il n’espère pas me revoir. Cela veut dire poliment que je ferai grand plaisir en ne [?] pas. C’est clair. Je [?] bien ne pas lui faire ce plaisir. Lettres de vendredi et Samedi très intéressantes. Je vois que vos journées sont bien garnies. J’en [suis] bien aise. J’aime qu’on vienne [vous] voir.
Mardi 31. Onze heures
[?] ce que m'écrit mon fils de [?] en date du 20. [Je] vous ai écrit dans le temps que les français mettaient le maintien [de] la constitution comme prix au [retour] du Pape, ils n’auraient rien [?], & que si le Pape avait la faiblesse d’accepter cette condition [?] serait recommencé. D’après tout ce que j'ai su, le [?] Pape retournerait à Rome les mains libres. Lui de sa personne ne retournera qu’après un an à Rome où il serait représenté par une commission, et toutes les commissions le [?] à une sécularisation partielle de l’administration. En attendant le Pape irait probablement résider dans quelque ville des légations. Rayneval qui c’est conduit dans toute cette affaire avec sagesse et habileté succéderait dit-on à Haverest. Si le pays est tranquille et gouvernement fort. "
Voilà un petit rapport très bien fait. Je lis avec plaisir que mon Empereur a écrit au Président pour lui annoncer, je crois la mort de sa petite-fille. Voilà les relations régulières rétablies. Cela ne fera pas à Claremont autant de plaisir qu'à moi.
Hier M. Fould s’est annoncé chez moi, je l'ai reçu. Quelle figure ! Che bruta facia ! Puisque nous sommes voisins, il a cru devoir venir. Il m’a rassurée sur le choléra de Richmond aussi bien que sur celui de Paris. Il arrivait de là. Il dit que c'est bien vide & bien triste. J'ai fait ma promenade en voiture avec lord Chelsea. Le soir j’ai [?] le piquet à Lord Beauvale. Cela ne lui a pas plu du tout. Je suis un mauvais maitre.
J’ai pris un nouveau médecin à Richmond. J'ai horreur de celui qui m’a tant effrayé l’autre jour. M. G. de Mussy reviendra me voir aussi. Adieu. Adieu. Aujourd’hui Mardi, Il y a quinze jours, je vous ai vu encore. Je ne veux pas me laisser aller à vous dire tout ce que je sens, tout ce que je souffre ! Trouvez un mari, je vous en prie. Travaillez- y. Adieu. Adieu dearest adieu.
Val-Richer, Mardi 31 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Qu'aurez-vous fait ? Où êtes- vous ? Comment êtes-vous ? Je ne puis pas penser à autre chose. J'espère que vous serez allée à Brighton. J'en ai eu hier des nouvelles. Sir John Boileau y est. Il parle du bon état de l’endroit, de la bonne disposition de ceux qui y sont, sans doute le choléra n’y est pas. Et la peur que vous avez du choléra m'inquiète autant que le choléra même. Quand je l’ai eu en 1832. Mes médecins, Andral et Lerminier, ont dit que, si j'en avais eu peur il aurait été bien plus grave. Je n'en avais point peur. Que je voudrais vous envoyer ma disposition ! Et aujourd’hui mardi, je n'aurai même pas de nouvelles de ces nouvelles déjà vieilles de 48 heures. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il me paraît bon pour donner un bon conseil et de l’appui, aussi bien que des soins. Je serais étonné s’il ne s’était pas mis complètement à votre disposition. Demain, demain enfin, je saurai quelque chose. Quoi ?
Dearest, je veux parler d’autre chose. Voilà l'Assemblée prorogée. Avec une bien forte minorité contre la prorogation. Je doute que ce soit une bonne mesure. Dumon, qui va venir me voir, m'écrit : " Vous êtes arrivé au milieu d’une crise avortée. Le Président ne fera pas son 18 Brumaire dans une inauguration de chemin de fer et l’Assemblée n'a d’énergie que pour aller en vacances. Le parti modéré n'a ce me semble, que les inconvénients de sa victoire. A quoi lui serviront les lois qu’il fait si péniblement ! Est-ce le mode pénal qui nous manque ? Mais déjà les dissentiments percent, dans la majorité. Elle se divise comme si elle n’avait plus d'ennemis. Je crains bien que le parti légitimiste ne soit avant longtemps, un obstacle à la formation, si nécessaire du grand parti qui comprendrait les libéraux désabusés, les conservateurs courageux, et les légitimistes raisonnables. Il a bien bonne envie d'exploiter à son seul profit, cet accès de sincérité qui fait faire depuis huit jours tant de confessions publiques, et il semble disposé à marchander l'absolution à tout le monde, sans vouloir l'accepter de personne. Tout ce que je vois, tout ce que j’entends dire me donne une triste idée de la situation du pays. Avec l'économie sociale d’une nation civilisée nous avons l’état politique d’une nation à demi barbare. L'industrie et le crédit ne peuvent s’accommoder de l’instabilité du pouvoir ; la douceur de nos mœurs est incompatible avec sa faiblesse. Nous ne pouvons rester tels que nous sommes ; il faut remonter ou descendre encore. Notre faiblesse s'effraie de remonter ; notre sybaritisme s'effraie de descendre. Il faut bien pourtant ou travailler pour le mieux, ou se résigner au pis : tout avenir me semble possible excepté la durée du présent. Je ne crois pas que la prolongation (je ne dirai pas la durée) du présent soit si impossible. Le pays me paraît précisément avoir assez de bon sens et de courage pour ne pas tomber plus bas, pas assez pour remonter. On compte beaucoup, pour le contraindre à remonter sur l’absolue nécessité où il va être de retrouver un peu de prospérité et de crédit qui ne reviendront qu’avec un meilleur ordre politique. Je compte aussi, sur cette nécessité ; mais je ne la crois pas si urgente qu’on le dit. Nous oublions toujours le mot de Fénelon : " Dieu est patient parce qu'il est éternel. " Nous croyons que tout ira vite parce qu’il nous le faut, à nous qui ne sommes par éternels. Je suis tombé dans cette erreur-là, comme tout le monde. Je veille sans cesse pour m’en défendre. Je conviens qu’il est triste d'y réussir ; on y gagne de ne pas désespérer pour le genre humain ; mais on y perd d’espérer pour soi-même.
Dîtes-moi qu’il n’y a plus de choléra autour de vous et que vous n'en avez plus peur, je serai content, comme si j’espérais beaucoup, et pour demain.
Onze heures Je n'attendais rien de la poste et pourtant. il me semble que c’est un mécompte. Adieu, adieu, adieu, dearest. God bless and preserve you, for me ! Adieu.
Richmond, Mercredi 1er août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Un nouveau mois, qui sera un bien mauvais mois pour nous comme cela me serre le cœur ! J’ai lu hier une lettre de lord Ponsonby de Vienne à lord Beauvale. Il dit que la guerre peut trainer quelques semaines encore, mais que l’issue n'est pas douteuse, et personne ne s'en inquiète. Il dit aussi que les relations entre la France et l’Autriche sont excellentes ; tant mieux.
Mon fils est venu me voir hier. Brünnow est un peu noir sur la Hongrie. Je ne sais pas de nouvelles du reste. Le choléra continue et grandit. 130 morts dans la journée. C'est beaucoup, & ce n'est pas tout ; on avoue cela, mais le vrai chiffre est au-delà de 200. Je reste cependant. Je me soigne. Je me fais beaucoup trainer dans le parc, il n’y a pas de choléra là. Je passe et repasse devant le beau chêne, & vous savez à quoi je pense et repense tous les soirs chez Beauvale et un peu aussi chez Mad. Delmas.
A propos elle a été bien flattée de votre souvenir. Faites dire un mot à la vieille princesse. Le temps est passable. J’occupe dans ce moment-ci l'appartement qu’avait la Reine. Mais c’est un peu bruyant, & j’espère succéder à Mad. Steigley qui part dans peu de jours.
Je suis allée aux informations à propos de la lettre de l’Empereur au Président ; c'est la même formule que pour le Président des Etats-Unis. Mon grand et bon ami. N’importe je suis bien aise qu’il ait écrit. Je ne vois pas cependant que les journaux français le disent. C’est dans le Morning Chronicle que je l’avais trouvé.
J’ai rendu compte à Lord Aberdeen de ma petite discussion avec Lord John à son sujet. Cela l’amusera. Je n’ai pas manqué avant hier de lui faire parvenir votre lettre. Adieu. Adieu dearest, adieu.
Que c’est long déjà, & que ce sera long encore. Les correspondances de Paris dans les journaux anglais disent qu'on est inquiet. On croit à un coup d’état on le craint parce que les trois partis monarchistes sont divisés mais on ne peut pas rester comme on est. Quel puzzle. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Mercredi 1er août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève d'impatience. J’attends la poste. Elle n’arrivera qu'à 10 heures et demie. Que m'apportera- t-elle ? J'ai reçu hier une lettre de Mad. Austin qui me dit que son mari, qui est à Brighton lui écrit que tout le monde s'y porte bien. Je désire beaucoup que vous ayez vu MM. Guéneau de Mussy. Mais que sert tout ce que je puis vous dire de loin ?
Avez-vous remarqué, dans le Times de samedi dernier 28, un excellent article sur l'état de la France que je retrouve dans le Galignani d'avant- hier 30 ? Vraiment excellent. Jamais la conduite de l’ancienne opposition dynastique, et de Thiers en particulier, n’a été mieux peinte et mieux appréciée. Beaucoup de gens en France voient et disent tout cela ; mais ils n'en font ni plus ni moins. Le bon sens porte ses fruits en Angleterre. Là où, il se rencontre en France, c'est une fleur sans fruits. Rien ne se ressemble moins chez les peuples du midi, que la conversation et la conduite ; ce qu’ils pensent et disent ne décide pas du tout de ce qu’ils font. Pleins d’intelligence et de jugement comme spectateurs, quand ils deviennent acteurs il n’y paraît plus. Bresson et Bulwer m’ont souvent dit cela, des Espagnols. Bien pis encore qu'ici, me disaient-ils. Nous n'avons plus le droit d’être sévères pour les Espagnols. Les Hongrois se défendent énergiquement. Je ne sais pas bien cette affaire-là. Je crains que le Cabinet de Vienne par routine ne se soit engagé dans des prétentions et des déclarations excessives non part contre le parti révolutionnaire de Hongrie, mais contre les anciens droits et l’esprit constitutionnel de la nation. On ne saurait séparer avec trop de soin ce qui est national de ce qui est révolutionnaire, ce qui a un fondement en droit et dans les mœurs du pays de ce qui n’est que rêverie et insolence de l’esprit d'anarchie. Le Prince de Schwartzemberg, est-il en état et en disposition de faire ce partage ? Je parle d'autre chose pour me distraire d’une seule chose. Je n'y réussis guères. Adieu. Adieu jusqu'à la poste.
10 heures trois quarts
M. de Lavergne et M. Mallac m’arrivent de Paris, et la poste n'est pas encore là. Parce que j’en suis plus pressé que jamais. Je n'ai pas encore causé du tout avec ces messieurs. Ils sont dans leurs chambres. Je ne pourrai causer avec personne que lorsque j'aurai ma lettre et pourvu qu’elle soit bonne. Voilà ma lettre. Excellente. J’ai le cœur à l'aise. J’étais sûr que M. Gueneau de Mussy vous plairait. Croyez-le et obéissez-lui autant que vous le pourrez faire pour un médecin. Il m’est très dévoué. Il vous soignera bien. Adieu. Adieu. Je vais rejoindre-mes hôtes. Adieu dearest. J’espère que le bien se soutiendra. G.
Richmond, Jeudi 2 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre de Lundi me prouve que ma frayeur vous a bien effrayé aussi. Je me reproche de vous avoir tant dit sur cela. Aujourd’hui je suis très calme sans avoir de bonnes raisons de l’être. J’attends ce matin M. Guenaud de Mussy. Hier j’ai été faire mon luncheon à Ken. Les dames Cambridge toujours fort en train et aimables. Rien de nouveau à apprendre là. Dans le courant de la journée mes visiteurs ordinaires ; Crasalcovy, Delmas, & le soir chez Beauvale. Les Delmas vont s’établir dans 15 jours à Brighton, j'en suis très fâchée. Je crois que Les Metternich finiront par là aussi. & je crains que les Ellice n'imitent tout ce mauvais exemple. On a peur de Paris, d'une nouvelle alerte. On s’ennuie en Angleterre mais on y dort en sécurité. Tout cela est bien vrai & bien raisonable, et je sens que mon inquiétude sera grande à Paris. Cependant vous êtes en France. Je ne veux pas rester en Angleterre.
Il n'y a plus de quoi bavarder ici, calme plat. Plus de Parlement, la Reine en Irlande, la société débordée. Les journaux sont fort insipides. On devient marmotte. Si je ne causais un peu tous les jours avec Lord Beauvale je deviendrais parfaitement bête. Je n’étonne qu'il aie tant d'esprit, car il vit bien seul, et sa femme n'en a pas du tout. Je vous envoie toujours ma lettre avant d’avoir reçu la vôtre, c'est ennuyeux mais c’est plus sûr pour le sort de ma lettre. Ce changement provient du changement de domicile, il y a une grande demi-heure de perdue par la distance. Adieu. Adieu. Je ne vous ai rien dit, je n'ai rien à redire je n’aurais qu’à répéter ce que nous savons si bien par cœur dans le cœur. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Jeudi 2 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
J’ai été bien heureux hier tout le jour. Je crois que mes hôtes m'ont trouvé bien gai. Comme notre âme tombe tout entière sous le joug de son impression du moment. Vous savoir un peu tranquille et être moi-même un peu tranquille, sur votre compte, me suffisait. J'étais presque content comme si vous aviez été là. Ce n’est pas vrai.
J’ai sous les yeux une image de l’extrême éparpillement et dispersion des esprits en France. Mes deux hôtes au fond, pensent et veulent tous deux la même chose; ce sont deux hommes du même parti, et deux hommes d’esprits. L’un croit au retour de la Monarchie pure, l'autre croit au succès définitif tant bien que mal de la République. L'avenir est si obscur et si incertain que des yeux qui y cherchent, et y souhaitent la même chose y voient. des choses contraires. Cela fait peur pour notre destinée et pitié pour l’esprit humain. Tous deux sont fort tristes et inquiets, à cause de la bêtise et de la platitude universelles. Un garde national de Paris disait le 25 février 1848, en criant contre les ouvriers, la populace et l’anarchie : " Puisqu'on leur livre tout, qu’ils nous laissent tranquilles. " Le pays livre soit tout volontiers, l’avenir comme le passé, pourvu qu’on le laissât tranquille. Heureusement que le bon Dieu ne se contente pas à si bon marché que les hommes ; et me permet pas qu’ils soient tranquilles à tout prix. Le Cabinet actuel moins près de tomber qu'on ne le croit. Dufaure et Tocqueville, ses vrais chefs, charmés du régime actuel, comme des acteurs d'une ville de province appelés à jouer sur le théâtre de Paris, et décidés à s'y maintenir. Sincèrement attachés à la République et à la Constitution, et se flattant qu'ils y contiendront le Président. Plus ennemis de Thiers que jamais. Tocqueville a dit à M. de Lavergne : " Il faut que M. Guizot entre dans l'Assemblée ; il n’y a que lui qui puisse nous délivrer de M. Thiers. " M. Molé renonce à l'Empire comme il a renoncé à la fusion. Il renonce même à la Présidence à vie ou décennale. Il faut rester dans la Constitution. Mais quand on en viendra à l'élection d'un président, dans trois ans, il faut que le peuple réélise Louis Napoléon malgré la Constitution qui le défend. Le peuple seul est au-dessus de la Constitution, et peut la violer s'il veut. Tout le monde se soumettra alors. C’est avec cette perspective que M. Molé tâche de calmer un peu les amis impatients du président ; et de gagner du temps, sa seule politique au milieu de toutes les impossibilités d’aujourd’hui.
J'ai vu un Belge intelligent, et fort au courant de son pays et de sa cour. Le Roi Léopold assuré et tranquille mais supportant avec humeur, quoique patiemment, le joug de son cabinet actuel, les Barrot et les Dufaure de Bruxelles, qui ne lui épargnent pas les impertinences et les désagréments. Onze heures Votre lettre confirme celle d’hier. Vous n'êtes pas mal, et vous verrez de temps en temps M. Guéneau de Mussy. Adieu Dearest, à demain la conversation. La cloche du déjeuner sonne. Adieu. Adieu. G. Vous vous trompez sur le sentiment qui fait dire au Duc de Broglie ce qu'il vous dit. Peu importe du reste. Adieu encore et toujours.
Richmond, Vendredi 3 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre me fait rétrograder dans mes espérances. On restera donc comme on est. Si cela pouvait rester ainsi toujours, je n'ai rien à dire mais cela ne se peut pas. Hier un temps charmant aujourd’hui de la pluie. Une longue lettre de Constantin de Berlin. Sa femme n'accouche pas il s’impatiente. Il voudrait aller retrouver ses cosaques. Je crois qu’au fond il les aime mieux que son ménage. Les élections bonnes, pas assez pour défaire tout le mauvais ouvrage, surtout pas assez pour se rapatrier avec l’Autriche. En Autriche on s'en moque de la constitution promulguée à [?], personne n'y pense plus. On est tout militaire. On veut ressaisir tout le pouvoir que donne la force des baïonnettes. Cependant la guerre traine, mais nous écraserons. C’est toujours le langage. On ne sait que faire de Bade. Pays pourri. La famille régnante très déconsidérée. En Bavière l’opposition unitaire gagne. Constantin furieux du discours de Lord Palmerston. Voilà sa lettre. Le duc de Cambridge m’a fait une longue visite. Cela ne m’a pas extraordinairement divertie. Beauvale valait mieux. J’y ai rencontré le L. Holland qui m'a demandé de vos nouvelles avec bien de la tendresse. Le choléra toujours gros à Londres, sans changement. J'ai diné chez Delmars avec Mad. de Caraman. Voici M. Genaud de Mussy. Pardon & Adieu. Adieu.
Val-Richer, Vendredi 3 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Ceci ne partira pas aujourd’hui. Je vous assure que votre Dimanche me déplaît autant que mon mardi. Je reviens sur le Duc de Broglie. Je crois que vous vous trompez. Il vous a tout simplement exprimé son sentiment général que Paris n'a plus de quoi attirer personne, et que pour y rester il faut y être obligé. Il pense bien peu aux personnes et aux questions personnelles, et ne fait guères de combinaisons et de calculs dont elles soient le premier objet. Cependant c’est possible. Vous avez toujours inspiré à mes amis, un peu de jalousie et un peu de crainte. Heureusement ce ne sont pas eux qui décident. J’ai été charmé quand vous avez repris votre appartement pour trois ans. J’aime les liens matériels même quand ils ne sont pas nécessaires. Il faut faire le contraire de ce que pense le duc de Broglie, c'est-à-dire être à Paris autant que vous ne serez pas forcée d’être ailleurs. Je suis bien aise du reste que le duc de Broglie vous ait pleinement rassurée sur ce qui me touche, Croyez bien et que j'y regarde avec soin, et que je vous dirai toujours la vérité. Je veux que vous vous fassiez une affaire de conscience de me tout dire sur vous, et je vous promets d'en faire autant, pour vous, sur moi. C’est le seul moyen d'avoir un peu de sécurité. Sécurité bien imparfaite et moyen quelques fois triste. Mais enfin, c’est le seul.
J’écris aujourd’hui à Guineau de Mussy pour lui demander une ordonnance dont Pauline a besoin contre des douleurs de névralgie dans la tête qu’il a déjà dissipées une fois, à Brompton. Je lui dis en outre : " Je sais que vous avez vu la Princesse de Lieven. J’en suis fort aise. Vous lui donnerez de bons conseils et du courage. Elle est charmée de vous et vous ne la verrez pas longtemps sans prendre intérêt à cette nature, grande et délicate qui a toutes les forces de l’esprit le plus élevé et toutes les agitations d’une femme isolée et souffrante. Je serai reconnaissant de tous les soins que vous prendrez d'elle. " Il m'est en effet très dévoué, et je veux qu’il vous soit dévoué aussi. Je crois au dévouement, et j'en fais grand cas. C'est le service, non seulement le plus doux, mais le plus sûr le seul qui résiste aux épreuves, et aille jusqu'au bout parce qu'il trouve en lui-même son mobile et sa satisfaction. C’est une des sottises de l’égoïsme de ne pas comprendre le dévouement ne sachant pas plus, l’inspirer que le ressentir. J’ai vu des égoïstes très habiles à tirer parti, pour eux-mêmes des personnes qui les entouraient, mais forces d’y prendre une peine extrême et continue, et ne pouvant jamais compter. Avec plus de cœur, ils auraient eu moins de fatigue et plus de sécurité. Il est vrai qu’il faut deux choses avec les personnes dévouées ; il faut leur donner de l'affection et leur passer des défauts. Par goût, j'aime mieux cela, et je crois qu’à tout prendre c’est un bon calcul ! Mais on ne fait pas cela par calcul. Chacun sait sa pente et le dévouement ne va qu'à ceux qui l’inspirent et le méritent réellement.
MM. de Lavergne et Mallac sont partis hier soir. Ils ne m'ont rien dit de plus que ce que je vous ai déjà mandé. J’attends MM. Dumon, Dalmatie, Vitet, Moulin, Coste, Lenormant & & Je me réserve le matin depuis m'en lever jusqu’au déjeuner et dans le cours de l'après-midi au moins trois heures, plus souvent quatre. Je donne à mes hôtes deux heures dans la matinée, et la soirée. D'ici à un mois, je compte bien avoir moins de visites. Elles me dérangeraient trop. On vient toujours beaucoup des environs. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, plus d’une fois peut-être ; bonne population, trop petite, d’esprit et de cœur, pour ce qu’elle a à faire. j'espère qu’elle grandira. Mais je n'en suis point sûr.
5 heures
J’ai reçu une lettre de St Aulaire qui se désole de n'avoir pu venir à ma rencontre au Havre et qui va rejoindre sa femme en Bourgogne, chez Mad d'Esterne. Ils vont tous bien. " J'avais toujours rêvé, me dit-il d'achever ma vie dans le loisir : m’ha troppo ajutato San Antonio. Mais ce n’est pas le mouvement que je regrette. Je travaille à mettre de l'ordre dans mes papiers et mes souvenirs. Mais j'ai commencé par Rome en 1831. J’ai bien du chemin à faire pour arriver à Londres en 1842. Je voudrais que Dieu m’en donnât le temps, car vous m’avez fourni de beaux matériaux à mettre en œuvre pour cette époque. Personne ne lira ce que j'écris avant trente ans. C'est quand on ne se sent plus bon à rien qu’on se rejette ainsi dans l'avenir. J'espère bien que vous nous préparez des enseignements moins tardifs. Que j'aurais envie de causer avec vous mon cher ami ! Vous l'esprit le plus net que j’ai jamais connu débrouillez-vous ce chaos ? Ne comptez pas sur moi pour mettre une idée quelconque dans la conversation. Quelque fois je pense que les socialistes ont à moitié raison, et que la vieille société finit. J'espère seulement ne pas vivre assez pour jouir de celle qu’ils mettront à la place. " Je trouve tout le monde bien découragé. Et les gens d’esprit bien plus que les autres. Et les vieilles. gens d’esprit bien plus que les jeunes. Voici ce que m’écrit Béhier qui ne manque pas d’esprit ; de votre aveu malgré votre première impression : " Nous avons ici un vent singulier qui souffle. On répète partout que le 15 de ce mois Louis Napoléon doit être proclamé Empereur. Personne n’y croit, que Nos Républicains. Ils ont l’air d'en avoir une profonde inquiétude. Ceci n’est probablement pas sérieux. Mais il en résulte ce fait démontré que personne ne croit à la durée de ceci. On parle tout nettement tout bonnement, d’une substitution. Que Dieu la retarde ! Non pas que je me préoccupe des 60 Montagnards qui, pendant les vacances de l'Assemblée vont rester à Paris pour surveiller le pouvoir. Ces vieux roquets fangeux peuvent grogner ; ils ne font plus peur à grand monde : ils ont perdre leurs crocs, et ne sont bons qu'à faire des mannequins de parade. "
C'est là l’impression qui règne autour de moi, parmi les honnêtes gens de bon sens, qui ne cherchent et n'entendent malice à rien. Plus de peur et point d'espérance. Dégoût du présent ; point d’idée ni de désir d'avenir. Le Chancelier et Mad. de Boigne disent à Trouville qu’ils désirent bien que j’y vienne, qu’ils seront bien contents de me revoir & & Je ne leur donnerai pas lieu de croire que je crois ce qu’ils disent. Je n’irai de longtemps à Trouville. Ils ont été mal pour moi. Je suis bien aise qu’ils sachent que je le sais. Adieu. A demain. Je dis cela avec un serrement de cœur. Adieu.
Samedi. 4 août. 7 heures
Je vous dis bonjour en me levant. Je vais travailler. Il faut que j'aie fait deux choses d'ici à la fin de l'automne. Pour les grandes et pour les petites maisons. Le temps est superbe. Je vous aime mille fois mieux que le soleil. Adieu. Adieu. Je dors bien mais toujours en rêvant. Décidemment la révolution de Février m’a enlevé le calme de mes nuits, bien plus que celui de mes jours. Adieu encore. Jusqu'à la poste.
Onze heures Je ne crains pas que vous deveniez bête. Mais j’aimerais infiniment mieux que nous fissions à toute minute, échange de nos esprits. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Vendredi 3 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai sur le cœur d’avoir coupé si court à ma lettre tantôt. M. de Mussy n’avait que 10 minutes à me donner. Jean me pressait pour porter la lettre à la poste. Vous voulez bien que je parlasse à votre médecin. Il me plait beaucoup. Je voudrais l’enrôler pour ma [?] à Paris. Il me dit que je me porte bien. Je le prie de ne pas me tenir ces mauvais propos. Lord John sort d'ici. Si bon, si facile à vivre, bon enfant. On peut tout lui dire. Rien de nouveau cependant. Il espère la paix avec la Sardaigne, il convient avec moi qu’elle n’a pas le droit d'exiger que l'armistice pour les Lombards fasse partie du traité ! Et il m’assure que lord Palmerston a émis cette opinion aussi. Fâché que la guerre de la Hongrie traîne. S'avouant incapable de comprendre la question Hongroise tout entière. Il part le 20 pour rejoindre la reine en Ecosse. Il a trouvé chez moi lady Jersey qui est venue me dire adieu avant son départ pour Vienne, Elle est sortie lorsqu'il est entré. Ils ne se parlent pas. J’ai vu Metternich ce matin, il est mieux et presque remis. Hier il a eu une lettre de son Empereur. Lettre charmante à ce qu'il dit : évidemment cela lui a causé une grande joie. Mais voyez le menteur. Vous vous souvenez que c’est sa fille qui m’a dit combien le silence absolu de l'Empereur le navrait. Je me souviens d’avoir écrit cela à l'Impératrice, il y a quelque 6 semaines (entre nous soit dit je ne serais pas étonnée si cela avait contribué à la lettre actuelle) je dis à Metternich : " Ah, je suis bien aise que votre empereur ait enfin rempli ce devoir. - Comment mais je suis en relation constante avec lui ; et ce n’est pas la relation du souverain avec son ministre. " celle de l'élève avec son maître. Orgueil et mensonge.
Samedi 4 août. Onze heures
Je passe dans une demi-heure dans mon nouvel appartement. Mad. [Steiley] vient de le quitter. Je regrette celui-ci, il était confortable mais on l’avait promis. Le Roi Charles Albert est mort. Samedi dernier à Porto. Je vois que le voyage du Président n’a pas été aussi brillant qu'on l’avait espéré. c. a. d. quant aux conséquences. Je le regrette. Je désire ces conséquences et qu'il y eut quelque chose de fait avant mon retour. Je ne suis pas du tout curieuse d'événements, je veux de la tranquillité une fois que je serai à Paris. Vous, et du repos voilà ce que je demande. Les Metternich iront dans un mois à Brighton. Les Beauvale retourneront à cette époque aussi chez eux, ils voudraient m'y entrainer, mais je n’aime pas faire des visites. Je verrai ce que j'aurai à faire dans un mois. S’il n’y a plus de ressources ici, il faudra bien aller quelque part. Adieu Dearest adieu. Je vous quitte pour déménager. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Dimanche 5 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
J'allume mon feu, en me levant. André le prépare la veille ; un bon petit fagot ; je n'ai qu’une allumette à y mettre. J’ai toujours avec plaisir du feu pendant deux heures le matin pour ma toilette. Il fait très beau, mais point chaud. Décidément du moins jusqu’à ce que l’automne se fasse sentir, je garde l’appartement que j’avais ; je le préfère beaucoup ; il m'est plus commode mes deux cabinets de toilette sont beaucoup plus grands ; j'ai beaucoup plus de place pour mes papiers. Il est plus loin du service de la maison ; c'est de l'autre côté que se font les affaires de ménage, qu'on va et vient. D'ailleurs pas la moindre trace d’humidité pas plus de mon côté que de l'autre. Enfin j'aime mieux, pour moi, rester où je suis si je m’aperçois plus tard que l'exposition à quelque inconvénient ; je changerai. Jusqu'à présent, à mon goûts je perdrais au change.
Vous voyez que les bruits de 18 Brumaire et d'Empire s'en vont en fumée. Je vous l'ai dit ; personne ne croit que la durée du régime actuel sait possible ; mais personne n'a et n'aura le courage de prendre l'initiative d’un changement. La République et la Constitution seront, non pas respectées, mais pas touchées, parce qu'elles sont ce qu'on appelle le fait établi et l’ordre légal et parce que personne n'a bien envie de ni bien confiance sans ce qui viendront après. On attendra la nécessité de changer, la nécessité évidente, urgente, absolue. Et cette nécessité ne viendra si elle vient que lorsqu'on approchera d’une nouvelle élection du président et de l'Assemblée ; jamais une société n'a été plus résignée à l'état horrible et précaire, au pain et à l'eau, ce qu’il faut strictement pour vous aujourd’hui, sans certitude de l'avoir demain. Cela même ne peut pas durer j’en suis bien sûr. Mais combien de jours, de mois, d'années Pour la vie des grands états, nous m'avons pas la mesure du temps. La honte est immense ; le danger matériel et personnel peu de chose. A la condition d'abaisser à ce point leurs prétentions, les honnêtes gens sont les maîtres du terrain. Restent les évènements imprévus, les nécessités inattendues les coups du sort, qui sont les décrets de Dieu. Pour ceci, la France actuelle, n'est pas en état d’y pourvoir, et si elle y est forcée, il faudra bien quelle change. Je n’entrevois, pour le moment, rien de semblable à l'horizon. Il n’y a plus en Italie que des embarras. Le Pape bataillera plus ou moins longtemps pour avoir dans son gouvernement plus ou moins de laïques ; le Roi de Sardaigne luttera comme il pourra contre sa nouvelle chambre quasi-belliqueuse et républicaine mais l’un et l'autre vivront sous la tutelle du trio Français, Autrichien et Anglais qui sera plus ou moins d'accord, mais qui le sera assez pour maintenir ce qui vient de se rétablir. La Hongrie traine, malgré les prédictions de Lord Ponsonby. Les élections Prussiennes, à ce qu’il paraît modérées. L'Allemagne, qui a un avenir bien plus gros que l'Italie, semble faire une halte après une orgie. Les deux états sont Londres et Pétersbourg, ne demandent qu'à se tenir tranquilles en veillant auprès des Etats malades. Mes pronostics sont donc à l'immobilité pour demain, après-demain. Nous verrons plus tard. Je ne vois personne qui ait la moindre inquiétude pour la tranquillité de Paris.
Onze heures
Je suis bien aise que vous ayez revu M. Guéneau de Mussy. Je désire que même bien portante, il vous voie de temps en temps. Adieu. Adieu. J’ai reçu je ne sais combien de lettres insignifiantes deux ou trois exigent une réponse sur le champ. Adieu, dearest. G.
Richmond, Dimanche 5 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mauvais dimanche, qui ne m’apporte rien, c’est si triste. Les Duchâtel sont encore venus me dire Adieu hier. Je me suis presque attendrie en leur disant Adieu. C'est mon dernier lien avec la France dans ce pays-ci et c'est de vos amis. Si nous nous retrouvons à Paris, je me propose bien de continuer cette connaissance. Ils partent ce soir. Samedi 11 ils seront à Paris. Les Paul de Ségur étaient encore venues les voir de Dieppe. Duchâtel avait été à Claremont avant hier. Grande préoccupation là du séjour de la duchesse de Bordeaux à Ems. Evidemment préparatifs de lignée. Cela les trouble beaucoup. La Duchesse d'Orléans veut toujours partir le 15. M. Fould est revenu me voir aussi et m’a gâté ma dernière demi-heure avec Duchâtel. Je ne le trouve pas plus beau à la seconde visite qu'à la première, mais dans ces temps de révolution j'essaie d’être polie. Le soir Beauvale & les Delmas, habitude qui durera tout le mois d'août encore. Après quoi tout le monde part. Je dîne aujourd’hui chez Beauvale avec les Palmerston.
4 heures
J'ai été faire mon luncheon chez La Duchese de Glocester. Bonne. vieille princesse, bien contente de me voir. De là j’ai été faire visite à lady John Russell. Je les trouve toujours seuls, et ayant l’air content de me voir. Nous n’avons guère parlé que de la France. Il désire l’Empire. Il désire quelque chose qui ait l’air de durer. Il dit que Changarmier n’attend qu'un signe & l’armée proclame l’Empereur. Mais ce signe, on ne le donne pas. Il me dit aussi que Molé rêve à la présidence pour lui-même. Cela, je ne l’avais pas encore entendu dire ! Lundi 6 août, onze heures Le dîner chez Beauvale était fort agréable. Lord Palmerston très naturel & amical. Sa femme ni l’un ni l’autre tout-à-fait, quoique elle est l'intention de le paraitre. J’ai fait quelques questions. La paix avec le Piémont n’est pas douteuse quoique pas faite encore. En Hongrie Paskévith a essuyé quelques revers. Georges est meilleur tacticien que lui. En le nommant L. Palmerston disait Gorgy au lieu de Georgy, ce qui m'a fait lui demander qui lui avait enseigné cette prononciation, il m’a répondu. Les Hongrois qui sont ici. Sur la France vif désir d'y voir une forme de gouvernement plus solide. " La constitution est tout ce qu'il y a de plus absurde, c’est comme fait exprès pour rendre tout impossible. On ne peut pas aller comme cela. Il ne dépend que de la volonté de Louis Bonaparte de changer cette situation. Qu'il dise un mot, Changarnier se charge de reste. Cela pouvait se faire le lendemain de la visite à Amiens. Cela peut se faire tous les jours. Une fois fait, la France sera trop contente. "
Enfin, cela est fort désiré ici et moi j'en suis. Avant de venir chez Beauvale les Palmerston avaient passé à Richmond Green. Ils se sont montrés chez Metternich avec Disraeli. Sans doute mutuelle surprise. A propos, Lord Palmerston m’a dit que Disraeli s’est vanté à elle d’avoir été très heureux & glorieux du succès de son mari, parce qu'il avait prédit à ses amis que des attaques sur lui ne pouvaient aboutir qu'à un triomphe. 100 membres de la Chambre des communes ont souscrit pour un portrait de Lord Palmerston qui sera offert à sa femme ! Et voilà ! J'attends la poste avec impatience. A propos serait-il question de vous nommer pour le Conseil général ? Qu'est-ce que cela voudrait dire ? J’ai bien envie que vous n'en soyez pas. Je n’aime pas vous savoir au milieu de ces mauvaises populations. Adieu. Adieu. Dearest Adieu.
Val-Richer, Dimanche 5 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Voici ce que m’écrit M. Piscatory de retour à Paris avec le Président : " Mon métier de représentant m’a mené à Tours, et ma curiosité m’a poussé jusqu'à Angers. J'ai vu qu’il n’y avait rien à voir, rien à conclure de toute cette curiosité de tous ce cri de toutes couleurs. Le héros de la fête est certainement celui qui avait le plus de bon sens et qui conservait le mieux son sang froid. Quel pays, grand Dieu ? " La majorité a été mise hier à sa première épreuve financière, et le grand Passy n’a rien trouvé de mieux que de l’entraîner à frapper de mort lente, un impôt de plus. J’avais bien envie de faire une charge à fond sur ce pauvre Cabinet. Ce n'était pas difficile. Mais je ne sentais pas clairement ce que la situation y aurait gagné. " Nous nous occupons de préparer la liste des 25 personnes qui doivent veiller sur la Constitution en l'absence de l'Assemblée. Je cours grand risque d'être du nombre avec M. Molé qui se dévoue. M. Thiers n'est pas si patriote. M. de Broglie va à son conseil général. M. Berryer représentera avec six autres, son parti. La part faite au centre gauche sera de cinq. Nous n'aurons rien autre chose à faire que de ne pas profiter de la prorogation. " " La maladie des corps et des esprits est toujours la même. Plus il y a de calme apparent, moins on voit l'issue. Comme l'a dit le Président, nous sommes et nous resterons, dans une rade plus ou moins bonne. Remettre du lest et des mâts n’est pas chose facile. " Vous voyez que cela est d'accord avec ce que je vous écris. On me dit d'ailleurs que l'Assemblée n'aura pas fini avant le 20 les lois qu’elle veut absolument avoir faites avant de se proroger. D'autres m'écrivant qu’elle partira bien certainement le 14, le même jour où les écoliers des collèges de Paris prennent leurs vacances. Je crois plutôt à ceux-ci.
Charles Albert n’avait rien de mieux à faire que de mourir. Je trouve le discours de son fils aux chambres Piémontaises bon, assez digne et sensé. Adieu pour aujourd’hui. J’allais dîner avec vous le Dimanche. Adieu. Adieu. Adieu.
Le Général Trezel m’arrive demain. Je n’ai pas entendu parler de Montebello. C’est drôle. Je ne serais pas bien étonné, si le Moniteur me l'apportait ambassadeur à Vienne. En mission temporaire, comme M. Drouyn de Lhuys.
Lundi matin 6 août. 7 heures
Je craignais de m'être enrhumé hier soir, au serein. Les gens d'un village voisins sont venus à 10 heures du soir, et pour me fêter, faire partir un ballon devant ma porte. Il a bien fallu sortir et rester un peu dehors. Le ballon est peu parti ; les paysans Normands ne sont pas de grands physiciens, mais l’intention était amicale. Je ne me suis pas enrhumé. Le soleil est magnifique ce matin. J'espère qu’il durera. Le temps a tourné hier au froid, et au sec. Que je voudrais vous envoyer, ou plutôt vous apporter, la moitié de mon soleil ; ce serait charmant à Richmond. Je pense que la Princesse Chrasalcovitch aussi aime le soleil. Parlez-lui de moi, je vous prie, et de mon respect reconnaissant. Elle me permet, j’en suis sûr d'employer ce mot à cause de ses soins pour vous. Elle a du cœur, et de l’esprit, et de l’indépendance d’esprit, Que faisait-elle de tout cela à Vienne ?
Onze heures Je suis charmé que M. Guéneau de Mussy vous plaise si vous y tenez, je suis sûr qu’il vous conduira à Paris. Je ne connais personne avec qui vous fussiez plus en sûreté. Trezet vient de m’arriver et la cloche du déjeuner sonne. Adieu. Adieu, dearest. Bonne petite lettre ce matin. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 6 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Trezet vient de repartir. J’aime bien les gens qui viennent passer la journée et ne couchent pas. C’est beaucoup plus commode quand on a peu de domestiques. Il ne m’a rien appris et je n'attendais rien de lui. Quelques détails, sur le passé ; quelques souvenirs que je l’ai prié d’écrire. Je veux que chacun de mes collègues me donne son récit du 20 au 24 février. Je m’en servirai un jour. Duchâtel m’a promis le soir qui est le plus important. Il l'a déjà écrit. Il m’a écrit en partant de Londres. Ce qu’il vous avait dit. Il rentrera plus de deux jours à Paris.
La lettre de Morny est assez curieuse. Il en sera pour ses peines d’embauchage impérial. A moins de quelque gros incident nouveau qui le jette de force dans l'Empire, le Président n'ira pas. Personne ne fait plus, et ne veut plus rien faire aujourd’hui que par force. Personne ne veut avoir à répondre de ce qu’il fait " Je n’ai pas pu faire autrement. " C'est l’ambition de tous. Ils ne sont pas fiers. M. de Metternich non plus n'est pas fier. Quand on est petit, je comprends qu’on mente pour se faire croire grand. On a tort ; on est découvert ; on devient ridicule ce qui est un grand obstacle à devenir grand. Pourtant je le comprends. Mais quand on est grand mentir pour faire croire que les Princes sont reconnaissants, et qu'on a encore leur faveur ce n’est pas de l’orgueil quoi que vous lui fassiez l’honneur de ce nom, c’est une vanité d'antichambre. J’en suis fâché. A en croire les apparences, M. de Metternich prend bien sa disgrâce, simplement et fermement. Et il a raison ; un chêne reste chêne, même déraciné, quand il a fallu un tremblement de terre pour le déraciner. Je suis fâché que M. de Metternich soit au fond et dans le secret de la vie intérieure, moins digne qu’il n'en a l’air.
Dearest cette phrase de votre lettre me va au cœur : " Vous, et du repos, voilà ce que je demande. " Je ne voudrais pas vous donner plus de sécurité qu'il n'en faut avoir. Je n’ai que trop eu déjà trop de sécurité (Phrase bizarre que vous comprendrez). Mais vraiment je crois et tout le monde croit qu'il y aura désormais du repos à Paris du repos matériel ; pas de bruit et pas de danger dans les rues. C'est, pour longtemps, le seul repos auquel nous puissions prétendre. J’espère que celui-là vous suffira.
Mardi 7 8 heures
Je reçois beaucoup de lettres dont quelques paragraphes, quelques phrases vous intéresse raient. Je ne puis ni vous tout envoyer ni tout copier. L'absence. L'absence ! Je trouve dans ces lettres des symptômes curieux, des traits de lumière, sur le présent et sur l'avenir. Curieuse société à la fois si inerte et si active, qui se laisse tout faire et ne se laisse définitivement prendre par personne gardant toute l’indépendance de son esprit dans la servilité et l’impuissance de sa conduite ! J’en suis honteux. Mais je n'en désespère pas.
Avez-vous lu l’article de M. Forcade dans la Revue des deux Mondes (N° du 15 Juillet) sur l’histoire de la révolution de Février de M. de Lamartine ? Plein de talent et d'honnêteté. C'est le commencement de la flagellation publique de M. de Lamartine. Et le 5° Numéro qui vient de paraître, du Conseiller du Peuple de M. de Lamartine. Une Philippique contre Thiers. Ces deux choses valent la peine que vous les lisiez.
Onze heures
Je fais toujours la découverte du mardi au moment où la poste arrive. Elle ne m’apporte rien d'ailleurs. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Mardi 7 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres sont des fêtes pour moi. Je lis & relis. Point de nouvelles. On va patienter chez vous et vivre pauvrement toujours avec la perspective d’un événement. Quel état ! Ici l’on ne parle que du voyage de La Reine en Irlande. L’enthousiasme le plus énorme. Heureux pays où ce sentiment se conserve ! Outre la Reine, les Irlandais auront cette année de bonnes pommes de terre. Ils sont donc enchantés.
Je n’ai vu hier que les habitants de Richmond. Lord Chelsea & les Delmas chez moi. Lord Beauvale chez lui. Il était fort amusé d’une petite [?]. Duchâtel a enlevé à Lord Faukerville une belle dame, demoiselle je crois, Miss Mayo nièce d'une Lady Guewood. Fort jolie et fort leste. Elle venait chez les Duchâtel souvent, elle vient de partir avec eux pour Spa et Paris, & peut être Bordeaux. Quelle bonne femme que Mad. Duchâtel.
J'ai eu une longue lettre de Lord Aberdeen. Il s’ennuie à périr en Ecosse, il me le dit. Je crois que nous lui manquons. Je lui avais raconté mon dialogue avec John Russel au sujet du discours de Palmerston. Cela lui a fait plaisir. Beauvale ne croit pas à nos revers en Hongrie. Moi je ne sais [?] que croire. Pourquoi n’y a-t-il pas de bulletin officiel ? Dans tous les cas l’affaire traine beaucoup.
M. de Mussy m’a interrompue. Il m’a dit qu'il avait une lettre de vous. Je ne lui ai pas dit que je le savais. Il est en redoublement de soucis ; je crois bien que c’est lui qui m'accompagnera à Paris ce serait excellent. Le duc de Lenchtenberg est attendu à Londres cette semaine. Les ministres ici s’étonnent beaucoup qu’au milieu des immenses difficultés de vos finances, on ne songe pas à une réduction de l’armée & de la Marine. John Russell & lord Palmerston m'en ont parlé tous deux. Ils disent que très certainement ils vous imiteraient tout de suite pour leur marine, & que vous leur ferez un grand plaisir. L’épouvantail de l'armée russe n’a pas le sens commun. Elle ne veut pas, elle ne peut pas, & personne ne permettrait qu'elle vous attaque. C’est des bêtises. Gardez amplement ce qu'il vous faut pour chez vous & [?] le reste. Adieu, Adieu, que je voudrais jaser, comme nous jaserions. Comme ce serait charmant. Adieu. Adieu dearest. Adieu.
Val-Richer, Mercredi 8 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime bien le Mercredi. J’espère que la poste arrivera de bonne heure je le lui ai bien recommandé hier. Je vais ce matin déjeuner et faire quelques visites à Lisieux. Il faut que je sois parti à onze heures. Le temps est toujours beau. Nous entrons dans un moment de stagnation. S'il ne survient aucun gros évènement, on ne sera occupé, d’ici au mois d'octobre, que des affaires locales. Pendant la réunion des Conseils généraux, il n’y a plus d'Europe, ni presque de France ; il n’y a que le département, l’arrondissement, les chemins vicinaux, les prisons, les hospices, &etc. Ni la capacité ni le dévouement ne manquent pour ces intérêts-là. Ce pays-ci irait bien si chacun se tenait dans sa sphère, et s'il y avait des hommes naturellement placés et préparés, pour la grande sphère. Dans son état actuel il ressemble à ce que serait le système du monde si toutes les planètes voulaient sortir de leur orbite, et devenir le soleil. Les Phaétons sont notre fléau. Pardonnez-moi mon érudition, astronomique et mythologique. Vous avez habituellement la prétention d'être ignorante. Mais j’ai toujours trouvé quand j’y ai regardé de près ; que vous ne l'étiez pas du tout.
J’ai eu hier la visite des deux anciens députés de l’arrondissement de Caen, Mon. de La Cour et Abel Vautier deux bons conservateurs, très braves gens et fidèles pour moi. Bons types de la bonne moyenne, en fait d’honnêteté et d’esprit. Ils ont toutes leurs anciennes idées, leurs anciens sentiments. Ils regrettent ardemment ce qui n’est plus ; ils ne croient pas à la durée de ce qui est. Et pourtant ils s’arrangent et se résignent comme si ce qui est devait durer toujours. On ne voit pas d'issue et on a grand peur des efforts qu’il faudrait faire et de ce qu’il en couterait pour en trouver une. Je ne les trouble point dans leur disposition. Je prends avec tout le monde, mon attitude de tranquillité parfaite.
Un autre de mes anciens amis dont le nom ne vous est pas inconnu, M. Plichon qui était venu m'attendre au Havre, m'écrit de Paris : « Votre retour a fait une sensation réelle dans le pays ; tout le monde, petits et grands, jeunes et vieux, gens de la veille, du jour et du lendemain, cherche à savoir ce que vous pensez et demande ce que vous ferez. Le sentiment public à votre endroit sera d’autant plus vif que votre attitude sera plus réservée. Moins on connaitra votre pensée sur les hommes et sur les choses plus on dérivera la connaitre ; plus vous vous tairez, plus on attachera de prix à vous entendre parler. Ce sentiment grandira dans le pays à mesure que la situation se développera et ce qui n’aura été d’abord que curiosité deviendra une aspiration réelle et profonde. »
Vous voyez qu’un bon bourgeois des environs de Lille peut être tout à fait de votre avis.
10 h. 3/4
Voilà votre longue lettre. Cela m'est bien dû le mardi. Il faut que je parte pour Lisieux. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Mercredi 8 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu hier une longue & bonne lettre de Montebello. A propos de tous les mea culpa exprimés par tous les côtés, il me dit " Thiers a fait le procès du gouvernement provisoire qui est aussi un peu le sien. Si on était logique il faudrait en conclure que celui qui a le moins failli est M. Guizot et se hâter de l’envoyer chercher au Val-Richer, où, tout considéré je suis bien aise de le voir. Il grandit dans sa retraite et son jour viendra. " Il veut vous faire visite. Il veut venir ici aussi. Je le voudrais bien.
J'ai eu aussi une très bonne et affectueuse lettre du grand duc héritier, pleine de respect, de souvenir, & d’amitié. Il m'écrit de Grodus en marche pour Varsovie à la tête de la garde Impériale. La femme de Constantin est accouchée d'un fils. Il en est dans un grand bonheur. Il allait la quitter le 3ème jour pour retourner auprès de l'Empereur à Varsovie. J’ai vu hier lord John Rusell tout rempli du succès de voyage de la Reine. L’enthousiasme est immense. Cela ne peut s’adresser qu'à la durée d'une dynastie, ou à un très grand homme. Il n'y a plus de grands hommes, et une petite fille de mérite très médiocre devient un objet de vénération et d’idolatrie par cela seul que son arrière grand-père, a régné là où elle règne aujourd’hui. Certainement il y a dans cette réflexion de quoi frapper beaucoup aujourd’hui les esprits partout si toutes fois, les esprits du continent sont susceptibles de réflexions sages.
La princesse Crasalcovy à dîner chez moi hier, nous nous sommes fait traîner à nous trois en calèche très découverte jusqu’à 10 heures du soir par le temps le plus beau, le plus chaud du monde. Cette nuit il y a eu de l'orage mais l'air n’en est pas rafraîchi. J’ai fait lire à John Russell la lettre de Montebello qui l'a fort intéressé. Il dit ce que vous me dites. Cela ne peut pas durer comme cela, mais on ne sait comment s'y prendre. Tranquillité assurée pour quelques mois, mais après ? God knows. Tolstoy m'écrit du Havre. Ce pauvre Pogenpohl est en paralysie. Adieu, dearest Adieu. Mille fois.
Val-Richer, Jeudi 9 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Vous me manquez bien. J’écris mon Discours sur l’histoire de la révolution d'Angleterre. Voici mon idée principale exprimée dans le premier paragraphe : « Je voudrais recueillir les enseignements que la Révolution d’Angleterre a donnés aux hommes. Elle a d’abord détruit, puis relevé et fondé en Angleterre la monarchie constitutionnelle. Elle avait tenté sans succès d'élever en Angleterre. La République sur les ruines de la Monarchie ; et cent ans à peine écoulés ses descendants ont fondé la République en Amérique, sans que la monarchie, par eux vaincue au-delà des mers, cessât de briller, et de prospérer dans ses foyers. La France est entrée à son tour, et l’Europe se précipite aujourd’hui dans les voies que l'Angleterre a ouvertes. Je voudrais dire quelles lois de Dieu et quels efforts des hommes ont donné, en Angleterre à la Monarchie constitutionnelle, et dans l’Amérique Anglaise à la République, le succès que la France et l’Europe poursuivent jusqu'ici vainement ,à travers les épreuves mystérieuses des Révolutions qui grandissent ou égarent pour des siècles l'humanité."
Vous entrevoyez ce qui suit : l'exposé à grands traits des causes qui ont fait que la Monarchie constitutionnelle a réussi en Angleterre, et la République aux Etats-Unis d'Amérique, et que ni l’une ni l’autre ne réussit parmi nous. Cela peut être frappant. Mais je n’ai pas une âme avec qui échanger, sur ceci une idée. Vous n'êtes ni bien savante, ni bien littéraire ; mais vous avez l'esprit juste et exigeant dans le grand, soit qu’il s’agisse d’écrits ou d'actions. Vous voyez tout de suite tout l'horizon, et vous n'y voulez pas un nuage. C'est là ce qui est rare et indispensable. Vous m'êtes indispensable. Heureusement nous nous serons rejoints avant que j'aie terminé et publié mon Discours. Ne montrez, je vous prie, à personne ce premier paragraphe.
Voilà la pluie. Savez-vous pourquoi elle me contrarie le plus ; pour mes allées dont elle entraine le sable. J’aime que mes allées soient bien tenues, et je ne peux pas les faire réparer tous les matins. J’ai passé hier ma matinée à Lisieux à faire des visites, très paisiblement dans les rues et très amicalement dans les maisons. Beaucoup d'accueil bienveillant et pas un mot hostile ; sauf cette phrase que j'aie vue écrite au charbon sur un mur : « Peuple, garde-toi de Guizot ; il revient pour être encore le maître. » Il est en effet question de me nommer au conseil général. Par un singulier hasard le membre du Conseil, pour le canton où est situé le Val Richer est mort quelques jours avant mon arrivée. J'ai dit aux personnes qui sont venues m'en parler, que si j'étais nommé spontanément presque unanimement, j'accepterais ; mais que je ne voulais pas être nommé autrement, ni porté si on n’était pas sûr que je le serais ainsi. Je ne pouvais répondre autrement. Je crois que je ne serai ni nommé, ni porté. En tous cas soyez tranquille ; il n’y aurait pas l’ombre de danger pour moi à Caen pas plus qu'à Lisieux. Les dispositions y sont les mêmes. La Normandie est évidemment la province de France la plus sensée.
10 heures et demie
Certainement il faut que M. Guéneau de Mussy vous ramène. Personne ne le vaudra. Il reviendra en septembre. J’ai une longue lettre de lui, il me parle beaucoup de vous, de votre santé. Je vous dirai ce qu’il me dit. Galant homme de l’esprit et du dévouement. Mad. Lenormant a gagné son procès. Elle reste seule et absolue maîtresse des papiers de Mad. Récamier. Défense à Mad. Colet et à tout autre d'en rien publier. C'est un arrêt moral et qui arrêtera bien de petites infamies. Adieu, adieu, dearest, Adieu donc. G.
Richmond, Jeudi 9 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ce que vous mande Piscatory est triste. Comme tout le monde dit de même, ce doit être la vérité attendue. J’ai eu hier quelques visites du voisinage. (à propos la vieille princesse si touchée de ce que vous lui adressez, que vite elle a envoyé chercher des fleurs, bouquets, plantes & & pour orner mon salon) le duc de Cambridge qui part aujourd’hui pour faire visite à son frère à Hanovre. Plus tard j’ai été dîner chez la duchesse de Glocester, rien que la famille royale et moi. J’ai regretté d’avoir accepté, car malgré mes barricades, mes yeux ont souffert de la lumière rien d’intéressant naturellement. A onze heures j'ai été dans mon lit. La duchesse de Cambridge se plaint et avec raison, de la duchesse d’Orléans qui ne lui a pas fait visite quoiqu’elle en ait fait aux autres membres de la famille. Cela fait un petit commérage qui les occupe. Sa fille de Meklembourg me plait chaque fois que je la rencontre. Le vieux Dennison M.P. frère de la. Marquise de Conyngham vient de mourir. Il laisse à lord Albert Conyngham, second fils de sa sœur toute sa fortune en terre et de plus deux millions de Livres, ce qui veut dire deux millions de Francs de rente. Vous avez vu lord Albert chez moi à Paris, pas grand-chose.
Voici votre lettre de Mardi. Toujours un nouveau bonheur quand j'aperçois votre petite lettre dans la grosse main de Jean. Quand aurai-je un autre bonheur que celui-là ? Adieu. Adieu. Je ménage mes yeux aujourd’hui, et je n’ai pas une nouvelle à vous donner ici on ne parle que de la reine et de l'Irlande. Il me semble que nos affaires vont cependant bien en Hongrie, Dieu merci. Adieu dearest Adieu. Comme vous êtes loin ! Adieu.
Val-Richer, Vendredi 10 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 Heures
M. Guéneau de Mussy m'écrit: « Mad. la Princesse de Lieven avait surtout besoin d'être rassurée. J’espère y avoir réussi. Un malheureux cas de choléra avait jeté l'effroi dans Richmond, et le médecin de l'endroit n’avait rien trouvé de mieux à faire que de répandre l'alarme chez les habitants et leur dire de se sauver au plus vite. J’ai d’abord engagé la Princesse à n'en rien faire et à s'estimer très heureuse, par le fléau qui court d'habiter un endroit où il n’avait frappé qu’un individu. Elle s'est mise au Star and Garter où l’air est plus vif et lui convient mieux. Je lui ai conseillé de prendre plus d’exercice. Comme il arrive souvent aux personnes chez qui les affections morales et les occupations intellectuelles remplissent la vie, le système nerveux oublie, pour ainsi dire, les fonctions animales, ou s’en occupe avec négligence. Il faut le rappeler à ses devoirs en exerçant la machine. C’est ce que la Princesse m’a promis de faire. La reconnaissance que je garde de son accueil se porte, Monsieur vers une personne à laquelle je serais trop heureux de témoigner en toute occasion le dévouement entier qu’elle m’inspire. Votre lettre du 3 août, m'est arrivée trop tard pour que ma réponse pût partir hier. Je ne ferme la mienne que ce matin pour vous envoyer des nouvelles toutes fraîches de le Princesse que je quitte et que je laisse en très bonne santé. Vous pouvez compter que mes soins ne lui manqueront pas. "
Il me donne, sur Clarencourt, quelques détails qu’il vous a sans doute dits; et il ajoute : « La famille royale me congédie avec une facilité qui m’attriste et me satisfait plus encore. Elle me donne une dernière marque de confiance en me déclarant qu’elle ne prendra jamais que le successeur de mon choix. Je ne sais si je le trouverai. "
J'ai ri de l’histoire de Duchâtel et j'y crois. J’ai rencontré plusieurs fois chez lui cette Miss Mayo, avec sa tante Lady Gurwood ( Est-ce Lady ou Mistriss ?) veuve du colonel de ce nom qui a publié les dépêches du Duc de Wellington dont il avait été l’aide de camp. Toutes deux jolies, hardies, et vulgaires. A Londres et à Paris. cela peut aller ; la foule couvre tout. Mais il a tort s'il l’emmène à la campagne. Dans l’isolement et l’oisiveté de la campagne les voisins ne passent pas même ce que le ménage tolère.
Lord John n'y pense pas de vouloir que la République réduise son armée. Ce n'est pas contre les Russes qu'elle a besoin de 60 000 hommes à Paris. Les réductions qu’elle pourrait faire seraient financièrement peu importantes, et produiraient moralement un effet qui couterait bientôt beaucoup plus cher. La liberté et l'économie deux choses auxquelles, il faut renoncer aujourd’hui. Et quant à la stabilité, que Lord John se désabuse également ; et peut-être un peu vous aussi ; l'Empire ne la donnerait pas plus, peut-être moins que la République. Ce serait un mot et point un fait. Pas d'Empereur, et pas de dynastie. Avez-vous entendu parler des ouvertures de mariage qui ont été faites de divers côtés ? à Stuttgart, à Stockholm. Partout on a éludé. Son oncle gagnait des batailles, quand on avait éludé avec lui. Je doute qu’il en fasse autant. Et il me paraît avoir le bon sens de ne pas le tenter.
Onze heures
Voilà votre lettre. Montebello prend un long détour pour m’arriver. Adieu. Adieu. Je suis fâché pour ce pauvre Ragenpohl. Il m'écrit pas du tout l'air à la paralysie. Adieu. Adieu. G.
Richmond, Vendredi 10 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Onze heure
Flahaut est venu passer quelques jours à Richmond, il est venu me voir hier matin triste aussi sur la France mais beaucoup plus noir qu’il ne faut. Il est ridicule de dire que c'est un pays perdu, une nation pourrie. Une grande nation, un grand pays savent toujours se relever. Il attend Morny en Écosse après la prorogation. Je le verrai sans doute ici puisque l'une des petites Flahaut y reste. Flahaut a fait visite à Claremont. La conversation s’est engagée sur la Hongrie. La Duchesse d’Orléans espérant bien qu’on ferait grâce à un Bathiany à un Caroby, Flahaut espérant bien qu’ils seraient pendus. La duchesse d’Orléans parlant de nationalité, de leurs droits ; Flahaut décidant que ce ne sont que des révolutionnaires et des rebelles. Enfin la conversation s'est échauffée au point que Flahaut a dit : " Pour moi, j'ai une telle horreur de tout ce qui sent une révolution que je demande pardon à Dieu tous les jours de m'être réjoui de la révolution de juillet. " Grand silence que le roi a rompu en disant : " vous savez bien que ce n’est pas moi qui l'ai faite. " La Duchesse d’Orléans parle de rester jusqu’à la fin du mois.
Grand orage hier qui a un peu rafraîchi l'air, ce qui était nécessaire. J’ai manqué John Russell qui était venu me voir. Beauvale comme de coutume, Lady Alice, les Delmas. Pas de nouvelles. Le cholera continue à Londres. Hier 110 morts. On ne me parle pas de celui de Richmond, & je n'interroge pas. Flahaut m’a interrompue ; il croit qu'il se passera quelque chose à Rouen ou au Havre. Va pour quelque chose. Voici votre lettre d’avant hier. Bonne. Restez comme vous êtes à l’écart, tranquille. Cela a très bon air. Profit tout clair. Soyez en sûr. Adieu. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Vendredi 10 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
J’ai oublié ce matin le vendredi et j’ai fait mettre ma lettre à la poste comme si vous deviez la recevoir Dimanche. Vous aurez deux volumes lundi au lieu d'un. Je reviens de la promenade avec mes hôtes, trois personnes que vous ne connaissez pas et René de Guitaut, le faire de Mad. Bresson. Joli et intelligent jeune homme, qui n’a rien fait pour être replacé, mais qui aurait assez envie de l'être. Il dit que M. Drouyn de Lhuys était très peu bienveillant pour lui, et pour tous mes protégés de prédilection : mais que M. de Tocqueville est beaucoup mieux, et le dit.
Il m'a amusé, et attristé, en me parlant de sa sœur. " Elle a beaucoup gagné, m'a-t-il dit, au moral et au physique, depuis la mort de son mari, Certainement, elle ne se remariera pas. Elle avait accepté le joug de Bresson, qui n’était pas commode. Elle l'aimait. Mais elle n’en acceptera aucun autre. Elle est forte et fière, et jouit beaucoup de son indépendance. " Evidemment le plaisir de la liberté, surpasse dans Mad. Bresson, le regret du bonheur. Bossuet dit quelque part : " Ainsi s’en vont les amitiés de la terre avec les années et les intérêts. " Je reconnais ces vérités communes générales. Je ne les et jamais acceptées, je ne les accepte point comme universelles. Je ne me fais point d'illusions sur le gros de la nature, et de la condition humaine ; mais je crois aux cœurs, comme aux esprits d'élite ; il y a de grandes affections comme de grandes idées, et tout ne se passe pas et ne passe pas pareillement dans toutes les âmes, si je n’avais pas cette confiance et cette expérience là je pourrais cacher, (il le faudrait bien), mon incurable tristesse et mépris de toute personne et de toute chose, mais je vivrais dans un complet isolement intérieur. De toutes les médiocrités, celle des affections est la seule que je ne puisse pas tolérer.
J’ai eu beaucoup de monde toute la matinée ; quatorze gros bonnets d’une petite ville des environs venus en masse, et de Caen le meneur des légitimistes les plus vifs, l’ami intime de Charles de Bourmont, homme d'assez d’esprit et qui a le verbe haut dans le pays. Je suis le même avec tous ; langage très ouvert conduite très réservée ; rien à cacher et rien à faire. L’idée de me nommer au Conseil général court toujours, bien accueillie par la masse de la population repoussée par les gros timides et les rivaux cachés. Anciens rivaux de Paris actifs partout et en toute occasion, quoique affectant une très bonne apparence. Evidemment, ils ne doutent plus que jamais de me revoir sur la scène et feront tout ce qu’ils pourront pour m'en fermer toutes les portes. Je ne me prête point à leurs manœuvres, ni ne m’en défends. Je laisse faire le public et le temps, si je dois revenir, c’est par ces deux forces là seules que je dois et que je puis revenir comme il me convient. Je ne crois pas au Conseil général.
Samedi 7 heures
Voilà M. de Guizard qui m’arrive, l’ami intime de M. de Rémusat. Je sais qu’il voit tous les jours Thiers et sa coterie. Il m'apprendra beaucoup de petites choses. Assez d’esprit et vrai gentleman.
Onze heures Moi aussi, je reçois chaque matin votre lettre avec un plaisir nouveau. Autre chose serait encore plus nouveau et encore mieux. Adieu, Adieu, adieu. Dearest, ever dearest. G.
Richmond, Samedi le 11 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu longtemps Flahaut hier le matin chez moi, le soir chez Beauvale. Il ne sait rien de nouveau de Paris. Il a des lettres de G. Delessert de Naples. Il avait passé à Rouen quelques jours, grande tranquillité, excellente tenue de l'armée, sa population bienveillante pour elle. Quant au Pape la plus complète indifférence à son égard. A Naples tout va bien.
Lady Palmerston est venue me voir, très radicale et parlant toujours de concessions à faire à l’esprit du temps. Ce rabâchage est ennuyeux. Lord Chelsea était présent, il a ri comme moi. Elle ne m’a rien appris de nouveau. Toujours le même vœu pour la France. Ils attendaient hier Le duc de Lenchtemberg à Londres. Le Roi Louis-Philippe la reine et toute la famille sont venues prendre le thé au Star & Garter hier. J’ai rencontré la duchesse d’Orléans marchant sur la terrasse. Lady Alice est venue dîner avec moi. Elle n’a plus de cuisinier du tout. Pourquoi a-t-on rappelé le général Oudinot ? Est-il trop catholique ? M. de Falloux me plait beaucoup. C'est une vraie acquisition pour le gouvernement. Le Times a aujourd’hui à son sujet un long article fort bien fait ou il démontre. Comment Louis Philippe était à tout jamais privé des services des gens de ce parti, tandis que la République peut les réunir tous. Seulement il range M. de Tocqueville parmi les légitimistes. Ceci n’est pas exact je crois. Comme je regrette que vous ne veniez pas dîner chez moi ! Le pain ici est excellent, le dîner fort bon aussi, vous voyez bien que je ne vous regrette que pour cela. Lady Palmerston me disait hier que le Consul Anglais à Yassy annonce l’entrée de 25 m. hommes de troupes hongroises en Moldavie. On n’y comprend rien, & l’étonnement là est extrême. Cela peut forcer la Porte à faire cause commune avec l'Autriche & la Russie.
Voici votre lettre. Il faut causer pour que je comprenne votre préface, & j'espère bien que nous causerons. L’occasion serait excellente pour dire d’excellentes choses. Adieu. Adieu. Demain le mauvais dimanche. Adieu dearest adieu. J'aime mieux que vous ne soyez pas du Conseil général. Flahaut souhaite le contraire. Adieu.
Val-Richer, Samedi 11 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
M. Moulin qui ne peut pas venir me voir dans ce moment-ci et j’en suis bien aise, j'en ai trop, m’écrit hier : " Notre prorogation est encore plus opportune que nous ne pensions quand nous l’avons votée. Jamais la situation parlementaire n’a été plus tendue, et l’union du parti modéré plus menacée dans notre assemblée. Une petite église légitimiste composée de 15 ou 20 membres, s'est nettement séparée de M. Berryer. Le surplus du Camp est loin d'être parfaitement discipliné. Ce qui est plus grave c’est une sorte de scission qui a éclaté hier dans le soin de la Commission pour la loi d'assistance présidée par l’évêque de Langres entre M. Thiers, et M. de Montalembert. Il était question de nommer M. Thiers rapporteur. Les catholiques ont demandé que désormais tous les établissements religieux, toutes les congrégations puissent recevoir sans autorisation du gouvernement les libéralités qui leur seraient destinées. M. Thiers a combattu cette idée, et a déclaré qu’il n'acceptait pas la condition qu'on paraissait vouloir lui imposer. M. de Montalembert s'est aigri, M. Berryer lui-même a soutenu la thèse avec une vivacité contraire à l’attitude conciliante qu’il paraissait avoir adoptée depuis la révolution de Février. En fin de compte, M. Thiers n'a été nommé rapporteur qu'à la plus simple majorité, la moitié plus un. Si l'on n'est pas définitivement brouillé, en est fort refroidi. La constitution d’un Ministère Thiers est de plus en plus difficile pour ne pas dire impossible. Le règne de MM. Barrot et Dufaure n'est pas fini. Les lois fiscales, devenues nécessaires seront très mal accueillies, par nos départements et nous donneraient de tristes élections si le suffrage universel était encore consulté. Tout ordre financier me parait incompatible avec l’institution électorale de Février. "
M. de Guizard me confirme tout cela. Mauvaise situation de Thiers dans l’assemblée, à cause de ses qualités comme de ses défauts. Il est trop franc. Il ne cache aucun de ses dégouts. Il brusque à tout moment les bêtes et les rêveurs. Il n'est le chef du parti modéré que le jour où il a fait un grand discours, et deux jours après, hors de là, c'est Molé, aussi adroit, aussi persévérant aussi agréable courtisan des malotrus que des Rois. Ainsi, est-il heureux de sa situation. Pas grande envie qu’elle change. Pas très pressé que ceci finisse. Hardi dans son langage ; longtemps partisan déclaré des coups d'état conservateurs et impériaux. Beaucoup plus calme aujourd’hui. Décidé à attendre trois ans la réélection du Président, que le peuple réélira alors, en dépit de le constitution. Ceci est également l’avis, même confidentiel et intime, du Président lui-même. Il s'en est expliqué en ce sens dans un petit dîner à quatre, Molé, Thiers, le général Changarnier et lui. " Je désire que personne ne se mêle de mes affaires avec le peuple. Le peuple m'a bien traité. Il me traitera bien encore, si je l'ai bien servi." On doute qu'au fond du cœur, ce soit là son vrai mot. Il cherche évidemment les occasions qui peuvent presser la bonne volonté du peuple. A la vérité ces occasions ne répondent guères quand il les cherche ; et quand même elles répondraient, il hésiterait probablement beaucoup à en profiter. Un coup d'Etat, même pour l'Empire, c’est recommencer Strasbourg et Boulogne. Il est devenu trop sage. Le probabilité est de plus en plus contre les coups d'Etat. Il faudrait que la nécessité les commandât. Ce qui n’est pas probable non plus. Quant au changement de cabinet, le voilà ajourné de six semaines au moins. Thiers toujours décidé à s'efforcer sérieusement d’éviter d'entrer. Molé moins décidé. Moins dynastique, moins fidèle que Thiers. Rémusat, dans la même disposition, que Thiers à cet égard, quoique bien moins intime avec lui. Rémusat aussi noir sur l’avenir que le Duc de Broglie. Plein de regret, et on croit de repentir, quant au passé mais n'en laissant rien percer. M. de Tocqueville presque aussi vif et aussi franc que M. de Montalembert dans un mea culpa, mais me le faisant que pour l'opposition, en général, non pour lui-même, et dans les conversations, non à la tribune. Barrot à l’état de repentir mais toujours aigre contre ses amis eux adversaires, c'est-à-dire contre moi. C'est la compensation qu’il se donne. Du reste chef de parti toujours incapable. Il n’a pas su rallier dans le camp du gouvernement toute l'ancienne gauche qui ne demandait pas mieux. Le plus paresseux des hommes. Ses chefs en service ne peuvent lui arracher des signatures. Il passe son temps à se promener à l'exposition des produits de l'industrie ou des tableaux. Je vous redis tout ce qui me revient ; petit ou gros. Il n’y a pas moyen d'employer le mot grand.
Onze heures
J'ai ri de la boutade de Flahaut. La réponse du Roi est bonne. Je reçois une lettre de Barante qui me dit qu’il va vous écrire. Adieu, adieu, dearest. Il faisait hier un temps admirable. Aujourd’hui il pleut. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 13 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Il y avait hier assez de mouvement à Lisieux et dans le pays ; mouvement très tranquille ; on allait au Havre voir le président et les régates. Une députation de la garde nationale de Lisieux y allait. Elle a pour commandant un vieil officier de l’Empire, en retraite très bon soldat et très brave homme. Il a dit que, si la députation était au moins de 150 hommes il irait lui-même au Havre, avec le drapeau du bataillon. C'est le règlement ; le drapeau ne se déplace pas sans ce nombre. Il ne s’est présenté, pour aller que 78 hommes. Le commandant a déclaré qu’il n'irait. pas. On lui a demandé le drapeau. Il l'a refusé, Ceux qui voulaient aller se sont fâchés, et ont dit qu'ils voulaient le drapeau, qu’ils l'auraient de force. « Venez le prendre chez moi, c’est là qu’il faudra le prendre de force. Ils sont partis sans le drapeau. Ceci m'a assez frappé comme mesure de l’unanimité et de l’enthousiasme. Vous n’avez pas d'idée de l'effet que font dans le public, dans le plus gros public des scènes comme le soufflet de Pierre Bonaparte à M. Gastier. Cela choque bien plus que les plus graves fautes de constitution et de gouvernement. Cela choque une foule de gens qui, s'ils étaient à l'assemblée courraient grand risque d'en faire autant. Ce pays-ci a le goût des formes et la prétention de l'élégance. Il ne pardonne pas ce qui l’humilie sous ce rapport. Si la République et l’Assemblée avaient les belles manières et le beau langage du temps de Louis XIV, il leur passerait presque tout le reste. Cette combinaison là lui plairait beaucoup. Mais il n’a pas, ce plaisir là.
Avez-vous remarqué, il y a quelques jours, la fin du discours de M. de Tocqueville sur l’affaire de Rome ? Il y a été assez dur pour le Pape et en faveur de la politique vaguement libérale. On dit que c’est moins pour plaire à la gauche que pour se préparer une porte de sortie dans le cas, qu’il prévoit où cette politique ne prévaudrait pas à Rome. Il est déjà las du Ministère, et des injures qu’il faut subir, et des luttes qu’il faut soutenir, et des nécessités qu’il faut accepter. Il ne se résigne pas aussi facilement que M. Barrot, à la flagellation publique d’une repentance quotidienne. Et il s’y attend. On m'assure qu’il désire ardemment se retirer. Vous savez qu'on appelle M. Passy le passif des finances de la France. M. Vitet m'écrit qu'il viendra dîner aujourd'hui avec moi. Je suppose que Duchâtel n’arrive à Paris que demain ou après demain. M. et Mad Lenormant me viennent aussi aujourd’hui. Ils me diront les détails et le vrai de la querelle de Thiers et de Montalembert. Si cela est sérieux cela deviendra important. Barante m'écrit ceci : "L'opinion publique commence évidemment à avoir le courage de regretter le passé ; mais elle ne s'émeut pas plus pour le ramener qu’elle ne s’est émue pour le défendre." Rien du reste que des lamentations et des tendresses. Il finit par cette phrase : "Je vais écrire à Madame de Lieven, encore que ma correspondance soit vide et stérile. Autrefois, elle avait la bonté de ne point trop s'ennuyer d'un commerce où j’avais tout à gagner." Adieu. Je vais travailler en attendant la poste. Vous écrire, c'est mon plaisir. Adieu, adieu, dearest.
Onze heures et demie
La poste vient tard. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Adieu. Vous voyez qu’il n’y a rien eu à Rouen. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 13 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
M. et Mad. Lenormant arrivent. Je n'ai pas encore causé avec eux. Ils m'ont dit seulement que dans son voyage à Chartres, le président avait dû aller déjeuner chez le Duc de Noailles, à Maintenon. Il ne l'a pas pu, ou pas voulu ; mais, à l'aller et au retour il a pris dans son wagon, le Duc de Noailles, qui en a été très content, plus content qu’il ne s'y attendait, quoiqu’il s’y attendît. Le voyage de Rouen ressemble aux autres. Convenable et froid. On restera comme on est. Chaque jour me confirme dans cette conviction. Il n’y a plus que Dieu qui ose faire quelque chose. Dimanche ou lundi dernier, MM. Odilon Barrot et Defaure sont allés en personne chez Napoléon Daru ( l’aîné, l’ancien Pair) pour lui offrir le Ministère des Finances. Il a refusé. Ils ont insisté. Il a refusé péremptoirement, disant qu’il ne croyait point à tout ceci et n’y voulait pas prendre plus de part qu’il n'en prenait déjà, comme représentant. Dufaure s'est montré, comme de raison beaucoup plus confiant. La Constitution toute mauvaise qu’elle est, peut bien vivre trois ans. En 1852, on la révisera. Daru a tenu bon, et leur a conseillé de garder M. Passy : " C’est un bon caissier ; contentez vous d’un bon caissier. Il n’y a pas moyen aujourd’hui d'avoir autre chose. " Mardi 14 août 6 heures M. Vitet est arrivé hier, pendant le dîner. Il venait de Rouen et du Havre, où il a tout vu et pris part à tout, comme député du département à Rouen, bonne réception, pas d’enthousiasme mais très bonne réception, public très décidé. Beaucoup de "Viva le Président ", ou Napoléon. Assez de "Vive l'Empereur", non pour avoir l'Empire, mais pour adhérer au neveu de l'Empereur. Très peu de "Vive la République". Au banquet, ovation pour le Président, ovation pour Changarnier, ovation pour Thiers, au Havre, autre chose. Grand concours de population ; 25 ou 30 000 étrangers venus de tout le pays. A l'arrivée du Président, dès le débarcadère, et pendant la revue, une démonstration désagréable, évidemment organisée ; de petits groupes épars criant à tue-tête et sous son nez : "Vive la République, vive la Constitution". Peu de " Vive le Président" en réponse. La masse Froide, étrangère à la démonstration, hostile, mais froide. Il a été reçu au Havre, sauf la grande foule, comme je l'ai été ; peut-être même moins soutenu par les amis contre les ennemis. Au banquet, et au spectacle des régates s’est un peu relevé ; bon accueil, pas mal de Vive le Président mais toujours dans un coin de la salle du banquet et du spectacle, un certain nombre de cris furibonds obstinés : " Vive la République, vive la Constitution". Il a senti le désagrément et témoigne qu’il le sentait. Il était fatigué, souffrant de mauvaise mine ; un peu de cholérine. Il n'a pu ni recevoir solennellement les autorités, ni assister à tout le banquet ; il n’est venu qu’au dessert ; et quand il a répondu au toast, il l’a fait brièvement, sèchement : " Je bois à la santé de la ville du Havre. Je fais des vœux pour sa prospérité. J'espère qu’elle sentira tous les jours davantage que le respect de l'ordre, des autorités qui maintiennent l'ordre, peut seul assurer cette prospérité" ; et quelques phrases, dans ce sens. Voilà le récit d’un observateur très intelligent, très exact, et bien placé pour bien voir. Vous en conclurez comme moi, comme M. Vitet comme tout esprit clairvoyant que ce qui est aujourd’hui a tout juste ce qu’il faut de force pour être, et ne fera rien de plus.
Je ne comprends pas que Madame la Duchesse d'Orléans n'ait pas fait visite à la Duchesse de Cambridge comme aux autres membres de la famille royale d’Angleterre. Peut-être parce qu’elle la croit peu bienveillante. Mais ce n'est pas une raison. Peut-être quelque secrète humeur entre Princesses allemandes. Je ne sais pas. Moi aussi, la Hongrie m'étonne. Je ne puis pas ne pas croire qu'on en finira bientôt. S’il en était autrement, ce serait un grave échec. Peut-être qu'on négocie en même temps qu’on se bat. Il y a là, ce me semble, nécessité et matière à transaction. Nous verrons. C'est le mot qu'on redit à propos de tout.
Onze heures
C'est mardi ! Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Opinion publique, Politique (France), Réseau social et politique
Richmond, Mardi 14 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis mieux aujourd’hui, mais hier je suis restée tout le jour sur mon lit souffrant beaucoup de crampes & d’agression. Le médecin ici m’a fort bien traitée. Tous mes voisins sont accourus, mon fils aussi de sorte que je n’ai pas été seule. Il ne valait pas la peine d'envoyer chercher Mussy qui était à Claremont. Enfin je le répète je suis mieux, je je crois même que je sortirai. Merci merci des deux lettres de Vendredi & Samedi. Je reviens au duc de Lenchtemberg honnête jeune homme, conversation sensée, pleine d’affection, mais reste étranger sous beaucoup d'autres rapports. Du good sense, et bonne vue des choses. Il a vu l’Empereur il y a quinze jours, qui lui a dit que la guerre en Hongrie serait terminée au plus tard en six semaines donc, dans un mois. Qu’aussitôt, cela fait il dirait le bonjour aux Autrichiens &t rentrerait chez lui avec armes & bagages, mais que son armée resterait en Pologne, prête à d’autres éventualités. La totalité de nos forces actuellement en Hongrie & Transylvanie est de 220 mille hommes, 130 mille de réserve en Pologne. En tout 350 m/ sur pied de guerre. On se préparait à recevoir très bien le général Lamoricière. L'empereur lui a assigné un palais à Varsovie (c'est énorme !) Nous allions nommer de suite ses Ministres à Paris. Brunnow affirme que c’est Kisseleff. Le prince a souci & a dit qu’on était mécontent de Kisseleff sans beaucoup de rapports, & qu’il ne croyait pas que ce serait lui, moi, je crois Brunnow mieux renseigné. Après le Prince j’ai eu une longue visite d'un des cavaliers de sa suite, homme d’esprit, français. Il me dit que l’empereur est devenu très serieux, très grave, qu’on a fort peur de lui. Ces propres enfants. Refus absolu de passeport pour l’étranger, pas une exception, personne, personne ; ne peut sortir de Russie. Cela a été provoqué par la conduite de certains Russes à Paris Branitzky entr'autres. Le Prince repart après demain pour Madère. Grande suite 12 ou 14 personnes, toutes grands noms, & des gens comme il faut !
Je n’ai pas de nouvelles à vous mander d’ici. Les Palmerston devaient y venir coucher hier et à côté de moi lorsque tout à coup ils sont partis pour Tunbridge où un autre petit garçon de Ashley est mourant. Lady Holland m'écrit une lettre assez curieuse. Il parait que Thiers a complètement désorganisé le parti conservateur. Brouillé ouvertement avec Montalembert & Barryer. Molé s’en montre fort triste, & dit : " je ne vois plus ce qui peut sauver le pays." Il y a quelque rapprochement entre l’Elysée & les Invalides. Le rappel d’Oudinot n’est pas du tout sûr. Le ministre le rappelle mais le président lui écrit de rester. Cela serait-il possible ? Oudinot a toujours été mal avec Tocqueville et ne lui faisait pas de rapport tandis qu'il écrirait tout confidentiellement mais par intermédiaire au Président. Je vous donne là lady Holland. Son mari est venu pour huit jours. J'espère le voir. Lady Alice est encore ici mais malade. Elle vient de louer Marble Hill. Le temps est à la tempête. Et je suis ici comme dans une cabine de vaisseau. On meurt beaucoup du Choléra à Londres. Adieu. Adieu.
Voici votre lettre d’accord avec lady Holland quant à la scission dans le parti modéré. Si on va de ce train, Ledru Rollin sera président dans 3 ans. Adieu. Adieu. Adieu. Tournez. Vous me faites bien plaisir en continuant votre langage & votre attitude réservée. Persistez, persistez, sans un moment de distraction. Adieu encore.