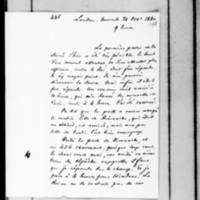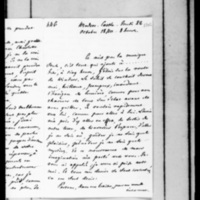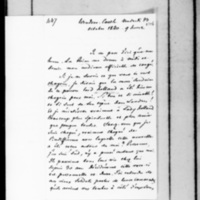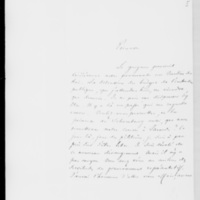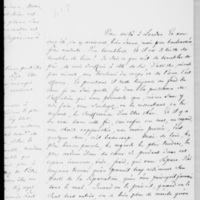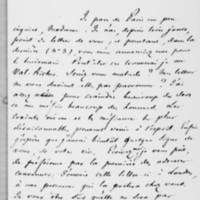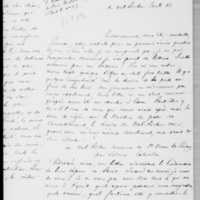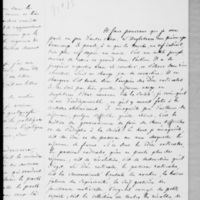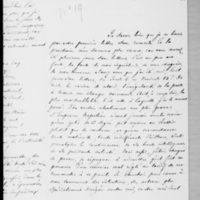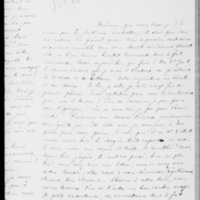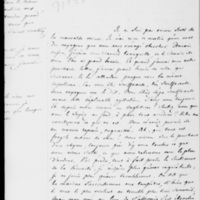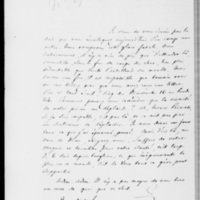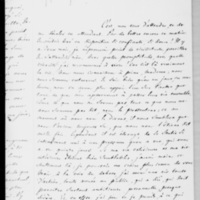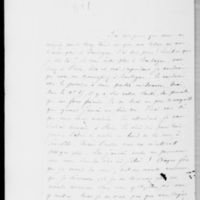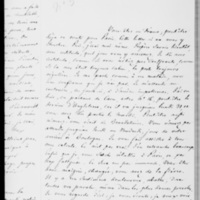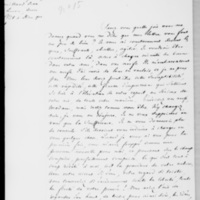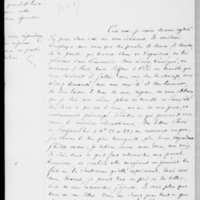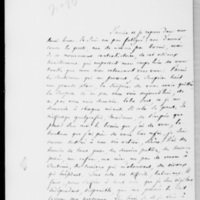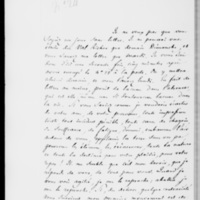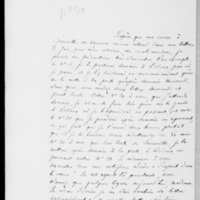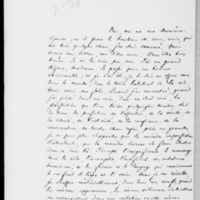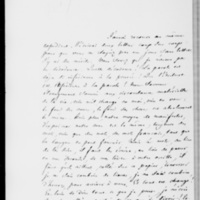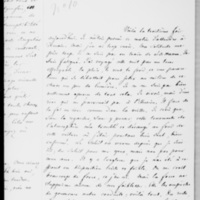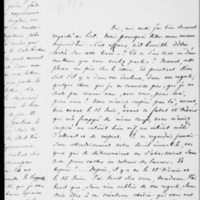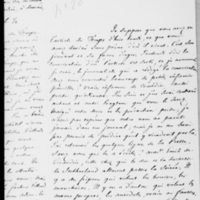Votre recherche dans le corpus : 5770 résultats dans 5770 notices du site.
443. Londres, Lundi 19 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous recevrez ceci Mercredi 21 et le Mercredi suivant 28, dans la soirée, vous me recevrez à mon tour. Je partirai dimanche 25, pour le Havre. J’y arriverai le 26, entre 5 et 8 heures du matin. J’en répartirai sur le champ et j’irai dîner au Val Richer. Je partirai du Val-Richer, le 27, dans l’après-midi avec tous les miens, pour aller coucher à Lisieux ou à Evreux, et le 28 au soir je serai à Paris. Ainsi, le mois d’Octobre n’aura pas menti. Personne, personne pas même vous, pas même moi, ne sait combien, il sera beau. Qu’est-ce que l’attente auprès du bonheur ?
J’ai reçu hier mon congé, dans une lettre particulière de Thiers, de très bonne grâce. Je serai à la Chambre le 29. Je ne manquerai qu’à la séance royale. Je crois que je comprends bien ma situation. et que j’y satisferai pleinement en tous sens. Elle a des embarras, des convenances, des intérêts, des devoirs fort divers. Je n’en éluderai aucun. Pour ma pleine confiance il faut, à mon jugement l’adhésion du vôtre. Que de choses à nous dire ! Ce nouvel assassinat ne m’a pas surpris. Je le pressentais. C’est une rude entreprise que de rétablir de l’ordre et de la raison dans le monde. Aujourd’hui tous les scélérats sont fous et tous les fous sont prêts à devenir des scélérats. Et les honnêtes gens ont à leur tour une folie, c’est d’accepter la démence comme excuse du crime. Il y a une démence qui excuse ; mais ce n’est pas celle de Darmer et de ses pareils. On n’ose pas regarder le mal en face et on dit qu’ils sont fous pour se rassurer. Et pendant que les uns se rassurent lâchement d’autres s’épouvantent lâchement. Tout est perdu ; c’est la fin du monde. Le monde a vu, sous d’autres noms, sous d’autres traits bien des maux et des périls pareils, égaux du moins sinon passifs, pour ne pas dire plus graves. Nous avons besoin aujourd’hui d’un degré de bonheur, et de sécurité dans le bonheur dont le monde autrefois. n’avait pas seulement l’idée. Il a vécu des siècles bien autrement assailli de souffrances, de crimes, de terreurs. Il a prospéré pourtant, il a grandi dans ces siècles là. Nous oublions tout cela. Nous voudrions que tout fût fait. Non certainement tout n’est pas fait ; il y a même beaucoup à faire encore. Mais tout n’est pas perdu non plus. L’expérience, qui m’a beaucoup appris, ne m’a point effrayé ; et moi qui passe pour un juge si sévère de mon temps; moi qui crois son mal bien plus grave que je ne le lui dis, je dis qu’à côté de ce mal, le bien abonde, et qu’à aucune époque on n’a vécu, dans le plus obscur village comme dans la rue St Florentin, au milieu de plus de justice, de douceur, de bien être et de sûreté.
J’écrirai aujourd’hui au Roi. On me dit qu’il a pris ceci avec son sang-froid ordinaire, triste pourtant de voir recommencer ce qu’il croyait fini. Le Morning Chronicle parle de lui ce matin est termes fort convenables. 2 heures Rien encore. J’y compte pourtant toujours. La poste est venue tard. Et vous ne prenez pas le plus court chemin pour venir à moi ; je suis encore plus impatient le lundi qu’un autre jour. Le dimanche est si peu de chose ! Enfin, je n’ai plus qu’un dimanche.
Lord Palmerston a demandé pour moi à la Reine une audience de congé. Je l’aurai Mercredi ou Jeudi Ne dites rien du jour de mon arrivée. Sachez seulement que je viens pour le début de la session.
Adieu. Adieu. 4 heures
Voilà 455. Excellent. Ce que j’aime le mieux ; confiant, comme l’enfance; profond, comme l’expérience. Un sentiment, n’est complet qu’avec ces deux caractères. Et il n’y a de bon, il n’y a même de charmant qu’un sentiment complet. Au début de la vie on peut trouver, on trouve du charmé dans des sentiments auxquels à vrai dire, il manque beaucoup. On sait pas ce qui y manque ; on jouit de ce qui y est sans regretter, sans pressentir ce qui n’y est pas. Quand on a vécu, quand on a mesuré les choses, on veut la perfection ; on ne se contente pas à moindre prix. Et là où on ne trouve pas tout, on ne se donne pas soi-même tout entier. Je n’ai jamais été si difficile et si satisfait.
Je n’ai pas encore les détails de la métamorphose que vous m’indiquez. Ils m’arriveront, je pense dans la journée. Cela, je puis l’attendre patiemment. Je serai fort aise de la métamorphose et pas sûr, après quelques épreuves, je finis par accepter les vicissitudes de certaines relations comme celles des saisons ; en hiver, j’espère l’été ; en été je prévois l’hiver ; le ciel pur ne chasse point le brouillard de ma mémoire, ni le brouillard le ciel pur. Je me résigne à ce mélange imparfait et à ses alternatives. Triste au fond de l’âme, mais sans injustice et sans humeur. Ou plutôt ce qui s’est montré à ce point variable et imparfait ne pénètre plus jusqu’au fond de mon âme. Je le classe dans ce superficiel qui peut être grave comme vous dîtes, et influer beaucoup sur ma destinée mais qui ne décide jamais de ma vie. Adieu. Oui, adieu comme nous le voulons.
444. Londres, Mardi 20 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
Je ne sais si je vous ai bien dit le motif qui m’avait décidé à être à la chambre le 29. On ne me fait pas faire les choses en me défiant. Mais quand j’ai vu qu’on voulait que je n’y fusse pas pour la présidence, puisque je n’y fusse pas pour l’adresse, puisque j’eusse à enfoncer, mon épée jusqu’à la garde, soit pour, soit contre, je me suis demandé ce que signifiaient toutes ces exigences, et pourquoi j’y céderais. Je ne sais à Paris contre personne. Je ne suis ici et ne serai là dans aucune intrigue. Je ne dirai, je ne ferai rien là qui ne soit en parfaite harmonie avec ce que j’ai dit et fait ici depuis huit mois. J’ai secondé le Cabinet sans me lier à lui Je ferai de même. Je lui ai dit, à son avènement, que je serais avec lui, loyal et libre ! Je serai loyal et libre. Je lui ai dit que je garderais mes amis sans épouser leur humeur. Je le ferai, comme je l’ai fait. J’ai fait, le premier jour, sur mes anciennes amitiés sur notre séparation le jour où notre politique différerait ; toutes les réserves que je pourrais vouloir aujourd’hui. Pourquoi me gênerais-je ? Pourquoi donnerais-je à ma conduite un air d’embarras et d’hésitation ? Je n’en veux point. Il n’y a pas de quoi ni dans le passé, ni dans l’avenir. Je veux prendre ma position simplement, ouvertement, rondement, toute entière. Je suis député avant d’être ambassadeur, et je tiens plus à ce que je suis comme député qu’à ce que je suis comme ambassadeur.
La session s’ouvre. Je demande et on me donne un congé pour l’ouverture de la session. J’y serai de même que je ne machinerai rien, de même je n’éluderai rien. J’agirai comme député selon ma raison, ma position, mon passé. Je parlerai comme ambassadeur, selon ce que j’ai pensé, fait ou accepté depuis que je le suis. Je crois que cela peut très bien se concilier. Si cela ne se peut pas, je m’en apercevrai le premier. Je serai prêt, selon le besoin à seconder ou à me démettre, loyal pendant, libre après. Je serais bien dupe de m’imposer, pour satisfaire aux méfiances ou aux embarras des autres, une contrainte qui n’a en moi-même, pas le moindre fondement. J’accepterai hautement les difficultés de ma propre position. Je n’accepterai aucune des difficultés de la position d’autrui.
Parlons d’autre chose, Je viens de voir lady Palmerston, toujours gracieuse et embarrassée. Je crois qu’elle doit avoir beaucoup plus d’esprit avec son mari qu’avec personne. L’arrangement, le calcul ôte plus d’esprit qu’il n’en donne. Quand on en a, on n’en a jamais autant que dans l’abandon. En revenant de chez lady Palmerston, j’ai fait mes adieux à Stafford house. J’ai été exprès, sur la petite place, devant la porte. Reverrai-je cette maison ? Reverrai-je Londres? L’avenir est bien obscur. Le mien notamment. Quelqu’il soit, j’aimerai Stafford house.
Dites-moi ce que vous avez écrit sur votre long petit livre de Memoranda sous la date du 30 août. La réponse de la Reine pour mon audience de congé n’est pas encore arrivée. Je suppose demain ou après demain. La Reine reçoit, vers 6 heures. On dîne et on couche à Windsor. J’ai bien des petites choses à faire d’ici à dimanche. Qu’il y a de petites choses dans la vie ! Par exemple, je vous quitte pour des comptes. J’ai beaucoup d’ordre. Adieu. J’aime bien adieu. J’aime bien mieux oui.
445. Londres, Mercredi 21 oct. 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
La première partie de la soirée d’hier a été très pénible. Ce bruit d’un nouvel attentat et d’un attentat plus efficace, contre le Roi, était fort répondu. Je n’y croyais point. Je n’en pouvais découvrir la source. Mais enfin, il était fort répandu. Un courrier m’est arrivé à 10 heures, qui m’a donné des nouvelles de Paris, lundi à 4 heures. J’ai été rassuré.
On dit que la poste à encore manqué ce matin. Celle de dimanche, qui était en retard est arrivée; mais non pas celle de lundi. C’est bien ennuyeux. Voilà la poste de Dimanche, et un 456, charmant, quoique trop court. Je serai court aussi, car voilà en même temps des dépêches auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Et je pars à 4 heures pour Windsor. La Reine ne se contente pas de me donner une audience de congé. Elle m’a invité pour aujourd’hui et demain. Je reviendrai vendredi matin. C’est une très bonne grâce qui me mettra en grande presse vendredi et samedi. Mais rien à présent ne va aussi vite que je le voudrais.
Je ne crois pas que l’ouverture des Chambres soit retardée quand je n’aurais pas pour aller à Paris, des motifs sans réplique, je pourrais quitter Londres sans inconvénient dans le moment. Rien ne s’y passera jusqu’au retour des réponses de Constantinople, ou jusqu’à l’arrivée des événements en Syrie. Et pour les événements en Syrie, c’est à Paris qu’ils font le grand effet, et qu’il convient d’être pour en diriger l’effet ; si on le peut. Je n’ai donc, quant aux affaires même de ma mission, pas le moindre scrupule. Et j’ai vraiment confiance, dans Bourqueney
3 heures
Mes dépêches sont écrites. Je partirai tout à l’heure. Adieu. Je vous écrirai demain de Windsor. J’attends avec impatience les lettres que vous m’annoncez. Comment puis-je parler d’impatience pour quelque chose. Adieu. Adieu. Plus de lettre à Londres. Ecrivez-moi au Val-Richer. J’y serai lundi matin. Le petit y viendra. Donnez-lui quelque chose pour moi. J’y compte. Et vous dire avec quel sentiment je compte, cela ne se peut pas ; cela ne se dit pas. Adieu. Adieu.
446. Windsor Castle, Jeudi le 22 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce n’est pas la musique seule, c’est tout qui ajoute à ... Hier à cinq heures, j’étais sur la route de Windsor. Le soleil se couchait devant moi brillant, pompeux, inondant l’horizon de lumière, comme pour nous charmer de tout son éclat avant de nous quitter. Je roulais rapidement vers lui, comme pour aller à lui. L’envie m’a pris d’y aller en effet, de sortir de notre terre, de traverser l’espace, d’aller je ne sais où, goûter je ne sais quels plaisirs, pénétrer je ne sais quels mystères. Et ce mouvement de mon imagination, m’a porté vers vous. Je vous ai appelée ; je vous ai prise avec moi. Et tous mes désirs se sont concentrés en un seul désir : partons, dans un baiser, pour un monde inconnu.
Pendant que je vous proposais de partir le soleil s’est couché. La nuit est venue. Le froid avec la nuit. J’ai fermé, ma calèche. Je m’y suis enfoncé, au lieu de m’élancer dans l’espace. Vous étiez là aussi, encore plus près de moi. Et le fond de ma calèche est devenu plus charmant que le monde inconnu auquel j’aspirais. Et ce matin, dans ce château de Windsor en sortant de mon lit je retrouve en vous écrivant, mes impressions d’hier. Elles me charment encore. Sans vous, si vous n’y aviez pris place, elles se seraient évanouies comme les rayons du soleil, comme les ombres de la nuit. Mais vous les avez transformées en ..... Je ne les oublierai jamais.
Personne ici que lord Melbourne, Lord Palmerston, Lord et Lady Clarendon et moi. On est très aimable pour moi, un peu par estime et par goût, je m’en flatte, un peu aussi parce que je vais à Paris. On désire que j’y sois bien pour ici, que je parle bien des personnes. On me voudrait facile pour les choses. On voit bien que l’avenir, et un avenir prochain est plein de chances. On en est occupé, occupé comme on l’est de tout ce qui n’est pas l’Angleterre elle-même ; assez occupé pourtant. On a traité la France légèrement ; mais sa malveillance importune. On sait que tôt ou tard, pour les affaires son influence pèse ; pour les réputations son opinion compte. On voudrait la calmer, l’amadouer.
Si je pouvais faire comprendre à mon pays ce que je comprends, et lui faire adopter la conduite et le langage. Que je sais bien, je crois qu’il n’aurait pas à s’en repentir. Mais ce serait trop bien pour que ce soit possible. Midi Je reviens de déjeuner. Lady Littleton est la dame in waiting. Elle a assez d’esprit. J’en trouvé bien des gens le premier jour, ou la première heure, comme vous voudrez. Je crois vraiment que bien des gens en ont pour un jour, pour une heure et je m’y laisse prendre encore quelques fois.
La Reine est toute ronde, aussi grasse que grosse. Malgré la princesse Charlotte et la Reine de Portugal, je ne la crois pas inquiète de ses couches. Je ne la crois inquiète de rien. Elle me paraît prendre la vie lestement et sensément, l’esprit gai, le caractère résolu, le cœur pas très vif. Elle reviendra à Londres vers le 15 novembre. Il est décidé qu’elle n’accouchera qu’en décembre.
On chasse ce matin, lord Melbourne et lord Palmerston n’en sont pas plus que moi. Dans la matinée, j’irai causer avec eux.
Comme nous causerons nous ! Quelle profanation de parler de ces conversations. Là à propos d’aucune autre ! Oui, je suis content de votre foi, de votre rire, de vos réponses à mes questions. Mais je prends en grand mépris tous les contentements de loin. Il n’y paraît pas, car je bavarde comme si j’étais prêt comme si je ne songeais à rien de plus. Je songe à beaucoup plus. Je songe à tout. Que c’est beau tout ! Il n’y a que cela de beau. Ne trouvez-vous pas que j’ai un bon caractère ? Trop bon, je trouve. Je suis très ambitieux et très facile, insatiable et prompt à jouir de ce que j’ai malgré ce qui me manque. Il en résulte quelquefois que trop aisément on me croit content et qu’on ne s’inquiète pas assez de me contenter. Il faut qu’on s’inquiète. J’inquiéterai. Certainement pas vous, si je croyais avoir besoin de vous inquiéter, vous ne seriez pas pour moi ce que vous êtes. Je vous dirai mon secret. Avec tout le monde, ma facilité tient à l’insouciance. Avec vous, à la confiance. 2 heures J’attends M. Herbet qui doit m’apporter mes lettres. Il ne vient pas. Je fais partir ceci. Adieu. Adieu. L’heure me presse.
447. Windsor Castle, Vendredi 23 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je ne pars d’ici qu’à une heure. La Reine me donne à midi et demie mon audience officielle de congé. Si je ne savais ce que vaut le mot chagrin, je dirais que la mort soudaine de ce pauvre lord Holland a été hier un chagrin pour moi. Si bon et si aimable ! Et si seul de son espèce dans Londres ! Et je m’intéresse vraiment à lady Holland, beaucoup plus spirituelle, et plus amie que presque toutes. Savez-vous que je suis choqué, vraiment choqué de indifférence avec laquelle cette nouvelle a été reçue autour de moi ? Personne j’en suis sûr, n’y a pensé autant que moi. Ils passaient tous leur vie chez lui depuis 30 ans. Décidément cette race-ci est personnelle et dure. J’ai entendu de nos vieux soldats parler de leurs camarades qu’ils avaient vus tomber à côté d’eux sous le canon, c’était plus tendre.
Et puis il y a dans la froideur forte de ces gens-ci, une certaine acceptation brutale de la nécessité des coups du sort. Ils sont dans la vie comme dans la foule ; ils ne regardent seulement pas celui qui tombe. Ils passent. On dirait qu’ils mettent leur dignité à ne se montrer quoiqu’il arrive, pas plus surpris qu’affligés. Mais leur dignité ne leur coûte. rien du tout. La grande, la belle nature, humaine est plus riche, plus expansive. Elle trouve plus abondamment dans les événements et sur les personnes de quoi penser et s’émouvoir. Et quand elle gouverne ses pensées et ses émotions. On voit qu’elle y prend vraiment quelque peine. Ces gens-ci ont l’air de comprimer ce qu’ils ne sentent pas. Politiquement, je regrette beaucoup lord Holland. Il n’avait pas autant d’influence que j’aurais voulu. Mais il en avait plus qu’on n’en convenait. La désapprobation de Holland house gênait beaucoup, même quand elle n’empêchait pas.
Londres 4 heures et demie
J’arrive. La Reine ne m’a donné mon audience que tard. J’ai à peine le temps de fermer ma lettre. J’en ai plusieurs à fermer, et indispensables. Je pars toujours après-demain. Je serai toujours à Paris, le 28 au soir. Il n’est pas du tout nécessaire d’y être le matin. Je serai à la Chambre le 29. Rien ne commence que le 29. Je ne fais absolument que passer par la Normandie pour y prendre mes enfants. Je ne resterai pas 18 heures chez moi. Cela n’a aucun inconvénient. Si je partais par Douvres des Calais, j’arriverais à Paris 20 heures plutôt. C’est tout-à- fait indifférent....politiquement.
Adieu. Adieu. Il faut absolument que je vous quitte votre grande lettre est très bien. Rien à changer du tout. Adieu. Adieu. Bientôt plus d’adieu.
[Paris], Mardi 6 juin 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le guignon poursuit décidément notre promenade au Jardin du Roi. La discussion du budget de l’instruction publique, que j’attendais hier ne viendra que demain. Je ne puis me dispenser d’y être.
Il y a là un passé qui me regarde encore. Voulez-vous permettre et la princesse de Schomberg aussi, que nous remettions notre course à samedi ? Ce jour-là, jour des pétitions, je suis à peu près sûr d’être libre. Je suis désolé de ce nouveau dérangement. Mais il n’y a pas moyen. Vous avez vécu au milieu des servitudes du gouvernement représentatif. J’aurai l’honneur d’aller vous offrir, avant samedi, mes excuses et mes tendres respects.
Guizot
Mardi 6 Je m’aperçois que très étourdiment encore je vous propose samedi qui est le jour de la fête de Versailles. Mille et mille pardons. J’irai vous demander de fixer un autre jour. Décidément cette promenade devient une entreprise dont il faudra venir à bout, à force d’adresse, & d’énergie.
Mots-clés : Jardin des plantes, Politique (France), Relation François-Dorothée
[Paris], Dimanche 18 juin 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mille tendres respects Guizot Dimanche 17. 9 heures.
Mots-clés : Relation François-Dorothée
[Paris], Samedi 24 juin 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me dis que l’un dernier à pareille époque, vous étiez bien plus triste. Vous étiez seule. Mais j’ai beau me dire cela. Je ne m’en contente pas. Je ne me contente de rien pour vous. Peu m’importe que votre fardeau ait été allégé ; tant qu’il pèse encore sur vous, tant que je vois, en vous abordant, en vous quittant une si profonde, tristesse établie dans vos yeux, il me semble que vous n’avez rien gagné, que je n’ai rien fait, que je pourrais que je devrais faire davantage, et votre peine devient presque pour moi un remords.
Je vous l’ai dit: sur un point un seul point, mon ambition est sans limites ; rien ne lui suffit, et tant que quelque chose me manque, tant que je n’ai pas que je ne fais pas tout ce que je voudrais, je ne sais pas me résigner, je suis mécontent et agité. Je l’étais hier je le suis aujourd’hui ; je le serai toutes les fois que je ne verrai pas l’impression douce dominer dans votre âme par dessus les impressions douloureuses, les envelopper, les calmer et sinon les guérir, ce qui ne se peut pas, ce qui ne se doit pas, du moins les couvrir d’un baume rafraîchissant. Vous le savez; j’ai toutes les prétentions du manteau de Raleigh. Mais il faudrait que le manteau de Raleigh fût toujours là, sous vos pieds, sur vos épaules.
C’est trop aussi de vouloir que l’absence fasse ce que la présence continuelle pourrait à peine espérer. Je le veux pourtant et je ne puis pas m’empêcher de le vouloir. Savez-vous pourquoi? c’est que je sens en moi tout ce qu’il faut pour réussir, oui, tout. Il manque beaucoup à ce que je fais mais il n’y manquerait rien, rien si je faisais tout ce que je puis tout ce que je sens. Adieu. Adieu. Samedi 24 10 heures
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
[Paris], Vendredi 30 juin 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Adieu. Je devrais non seulement finir, mais commencer toujours par là. Vendredi 11 h. 1/2
Mots-clés : Relation François-Dorothée
2. Paris, Dimanche 2 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rentre de ma promenade solitaire. Il n’y a presque plus personne à Paris, et je ne vais pas chercher ce qui y reste. Le bonheur, les affaires ou la solitude. C’est un blasphème de placer ces trois mots l’un à côté de l’autre. Le bonheur ne doit jamais être nommé que tout seul ; rien ne lui ressemble. Mais sans bonheur, et à défaut des affaires, j’aime bien mieux la solitude que le bavardage des indifférents. Je sais qu’on ne la supporterait pas longtemps, que l’âme s’userait vite à vivre ainsi à ses propres dépens et de sa seule substance. Mais finir seul sa journée se promener deux heures sans rien regarder, sans rien dire, n’entendant que le bruit de ses pas n’écoutant que cette voix intérieure qui nous entretient de notre passé ou de notre avenir, c’est assez doux. Dans les affaires mêmes, un peu de solitude est bonne ; il faut un moment chaque jour, secouer tous les jougs ne relever que de soi-même, permettre à sa pensée cette liberté insouciante qui lui conserve seule toute son originalité et sa grandeur. Gouverner n’est pas labourer. On s’hébête à avoir toujours la main sur la charrue et l’oeil sur le sillon. C’est un grand vice de notre organisation politique en France que ce travail incessant, ce défaut absolu de loisir auquel nous nous sommes condammés. A faire un tel métier, on se sent devenir machine soi-même et on tombe bientôt au dessous de sa tâche pour n’avoir pas su ou pu, de temps en temps, la laisser là et n’y plus songer. Je vous assure Madame qu’au milieu des plus pressantes affaires, une heure de conversation avec vous n’importe sur quoi serait, tout plaisir à part, le régime le plus sain du monde. à la vérité, ce n’est pas là de la solitude.
Ces chances lointaines, inconnues, tout cela refoule dans le cœur les choses qui auraient le plus envie d’en sortir. Il y a un degré de vérité, de liberté, qui ne souffre aucune entremise. C’est déjà trop quand on est ensemble, que la nécessité de rédiger ses sentiments en phrases et de les envoyer à deux pas en entendant le bruit de sa voix. L’âme ne passe jamais tout entière dans cette manifestation extérieure, et au moment même où elle parle, elle aspire. Surtout à être devinée dans ce qu’elle retient. Je ne sais lequel de nos poètes pour peindre la conversation. intime de deux amants a dit :
Cachés, et se parlant tout bas, quoique tout seuls. Il savait ce que c’est que l’intimité.
A tout prendre cependant, je me sens un peu plus à l’aise par M. Nettement que par la poste. Je lui remets donc cette lettre. Si vous êtes encore à Londres quand il en partira, il ira vous demander vos ordres pour moi. Vous pouvez les lui donner en sûreté. J’étais sûr que les volumes vous plairaient beaucoup. Si je n’en avais été sûr, je ne vous les aurais pas envoyés. Je ne déteste rien tant que la profanation d’un souvenir. A présent, quand vous reviendrez (car vous reviendrez) je vous parlerai librement de ces deux nobles créatures qui ont tenu tant de place dans ma vie. Il n’y a jamais eu, entre elles et moi, cinq minutes de roman. Je m’éprise le roman. Il a la prétention de surpasser la réalité et il lui est bien inférieur. L’amour vrai l’admiration vraie le dévouement vrai sont très rares, c’est pourquoi les gens qui ne s’y connaissent pas les appellent romanesques. Ils ne le sont pas du tout ; ils sont au contraire, quand ils existent tout ce qu’il y a de plus simple de plus positif, de plus pratique. Seulement il ne faut pas s’y tromper et prendre pour les sentiments-là, les fantaisies qui s’en attribuent le nom. Les feux follets qui traversent l’air s’appellent aussi des étoiles ; mais ils n’en ressemblent pas d’avantage aux étoiles véritables, et celles-ci n’en sont pas moins hautes et fixes parce que des traits de flamme apparente courent et brillent un moment dans les régions inférieures de l’atmosphère. Pourquoi vous parlerais-je aujourd’hui d’autre chose? J’ai le cœur joyeux et profondément indifférent à tout ce qui n’est pas ma joie. J’attendais votre première lettre avec une inexprimable impatience. J’avais soif de rentrer par ce simulacre, en possession de nos longs et doux entretiens. Dans une charmante habitude la première interruption a quelque chose de très amer. L’âme se précipite pour ressaisir le fil qui lui a échappé un moment. Adieu, dearest Princess. Soignez-vous comme vous me l’avez promis. Je serai charmé que vous me donniez des nouvelles ; mais sachez bien que j’aime infiniment mieux autre chose.
Adieu. Adieu. Guizot Je suis obligé de rester deux ou trois jours de plus à Paris. Moi aussi, j’ai négligé mes affaires et comme il y en a qui intéressent mes enfants je veux les faire avant de partir. Remarquez mon cachet. C’est celui dont je me servirai habituellement.
3. [Paris], Mardi 4 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Princesse
Ni moi non plus, je n’aime pas les souliers étroits. Vous pouvez vous en apercevoir. à dire vrai, et vous me passerez le terme, ce qu’il y aurait de plus agréable, ce serait de marcher pieds nus. Mais comme cela ne se peut, comme il faut avoir des souliers, je les aime mieux étroits que de ne pas marcher du tout. Y pensez-vous de me demander s’il ne vaudrait pas mieux laisser-là notre correspondance ? Madame on ne laisse pas comme on veut ce qu’on n’a pas pris parce qu’on le voulait. J’ai bien mis quelque chose du mien dans ma propre destinée ; et pourtant ce que j’y ai mis est bien peu à côté de ce qui m’est venu d’en haut... oui d’en haut, sans que je le demandasse et quand je n’y songeais pas. J’ai joui très vivement du bonheur. Le bonheur perdu, le vide est resté tet qu’il s’était fait ; je l’ai senti tous les jours sans chercher à le combler. Quand je l’aurais voulu, je ne l’aurais pas pu. Nous sommes, vis-à-vis de notre cœur malade, comme les Danaïdes vis-à-vis de leur tonneau ; ce que nous y mettons nous-mêmes ne le remplit pas. A une main plus puissante et plus riche il appartient de fermer l’abyme et d’y verser de nouveaux dons. Irons-nous, s’il lui plait de s’étendre avec bonté sur nous, irons-nous retuser son bienfait ou disputer sur le prix ? Non, Madame, non, il faut accepter, et jouir, et payer aussi cher que celui qui donne l’exigera. Vous allez retrouver, vous aurez retrouvé, quand cette lettre vous arrivera, de déchirants souvenirs ; mais tout déchirants qu’ils sont, à coup sûr vous ne voudriez pas les arracher de votre âme, vous ne voudriez pas ne pas avoir possédé les nobles enfants que vous avez perdus.
Un homme qui honorerait, il y a bientôt 200 ans le pays où vous êtes, le Duc d’Ormond, l’ami de Charles 1er disait, à la mort de son fils le comte d’Ossory tué en duel par le Duc de Buckingham. " Jaime mieux, mon fils mort que tout autre fils vivant. " C’est ce que je dis tous les jours du mien, et vous des vôtres; et nous aimons mieux ces maux, ces joies et ces douleurs inséparablement unis et confondus, que toute autre vie qui ne serait pas nous et ceux que nous avons aimés. Et si un beau jour se lève encore sur notre horizon, si une douce musique comme vous dites, vient encore frapper notre oreille, nous l’accueillerons nous en jouirons avec transport, qu’elles que soient les lacunes et les chances que la Providence y voudra attacher. En tout cas je réponds du manteau de Raleigh. C’est à vous, Madame, de me dire si vous croyez à sa puissance. N’ayez du moins à ce sujet que des émotions douces. J’ai le droit de vous le demander. Et puis, ne pensez jamais le moindre mal du 15 juin. Et puis encore écrivez-moi toujours comme vous m’avez écrit d’Abbeville et de Boulogne, dites-moi, taisez-moi tout ce que vous voudrez. Je jouirai des paroles; j’aurai foi au silence. Je vous défie d’inventer dans votre esprit, de trouver dans votre cœur de femme, quelque chose que je ne comprenne pas, si tant est que je ne l’ai pas devancé.
Mercredi 5 Je n’ai pas de lettre aujourd’hui. Je n’en espérais pas. Demain, j’y compterai. Je passe mes matinées d’une façon utile j’espère, mais bien monotone. Tout ce monde qui part, les députés surtout, viennent me dire adieu. Et la même conversation recommence avec chacun. Que le cercle où vivent la plupart des hommes est éteint et pauvre ! J’en suis toujours frappé à la fin d’une session. Ils sont tous épuisés, exténués d’esprit et de cœur. Ils ont évidemment dépensé, et au delà tout ce qu’ils avaient d’idées, de volonté, de force. Ils se traînent, ils baillent ; ils ont hâte d’aller se coucher et dormir. De toutes les conditions de la supériorité et de la puissance, l’activité, l’activité inépuisable est peut-être la première. J’ai beaucoup vécu avec le Maréchal Soult ; nous avons été près de trois ans ministres ensemble ; et pendant ce temps, j’ai vu tomber. l’une après l’autre devant moi toutes les qualités qu’on lui attribue ; il n’a ni esprit de suite, ni jugement sûr, ni vraie finesse d’intelligence, ni capacité efficace, c’est un grossier brouillon, un bizarre mélange du Gascon et du Barbare. Mais il est inventif, actif, infatigablement actif d’esprit, de corps, de volonté ; il projette, il combine, il trame, il pousse, il remue sans relâche. Il est important, il le sera toujours. Je doute qu’il y ait désormais grand chose à tirer de lui, mais son activité encore plus que son nom, lui donne une force avec laquelle tout le monde doit compter. Rien de nouveau d’ailleurs au milieu de ce décampement général. Ce que je sais de plus divertissant à vous mander, c’est la goutte de M. de Salvandy. Il avait l’autre jour un grand dîner, de la bonne compagnie des femmes, M. et Mad. Molé, M. Pasquier, Mad. de Boigne & & La goutte l’a pris : quand on est arrivé pour dîner, il n’avait pu quitter sa chambre ; M. Molé l’a remplacé à table ; et au sortir de table en rentrant dans le salon, tout ce beau monde a trouvé M. de Salvandy étendu sur un canapé, et faisant du soin de son immobilité, les honneurs de sa maison. Les mauvaises langues vont jusqu’à dire qu’il était là, en magnifique robe de chambre, un bonnet grec sur la tête en Sultan malade. Mais je n’en crois rien.
Savez-vous ce que je fais aujourd’hui? Je vais dîner à Chatenay. Cela me plaît-il ? Cela ne me plait-il pas? Je ne sais pas bien. Je vous le dirai après. Mad. de Boigne m’a écrit avant-hier. Enfin j’y vais. Mon départ est encore retardé de trois jours, jusqu’à lundi. L’envoi de 6 ou 7000 volumes à la campagne en est la cause. Adieu, Madame Certainement, j’irai m’asseoir au bord de la mer. Vous voulez que je la regarde. Je crois que je regarderai au delà. G.
4. [Paris], Vendredi 7 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous voilà à Londres. Et vous avez été, en y arrivant bien émue, mais pas bouleversée pas malade. J’en tremblais. Et il est si triste de trembler de loin ! Je sais ce que c’est de trembler de près, de voir souffrir à côté de soi, d’assister minute par minute aux douleurs du corps et de l’âme. C’est affreux. Et pourtant il reste toujours au fond du cœur je ne sais qu’elle foi dans la puissance de l’affection qui vous persuade que, même sans y rien faire, vous soulagez, en les ressentant, en les voyant, les souffrances d’un être chéri. Et il y a du vrai dans cette foi, car enfin, un mot, un regard. une chaise rapprochée, une main pressée, C’est quelque chose, c’est beaucoup. Mais de loin, les plus douces paroles, les regards, les plus tendres, les plus ardents élans du cœur se perdent dans ce espace immense, vide, froid, qui vous sépare. J’ai toujours trouvé qu’on prenait trop aisément son parti de la séparation, qu’on n’en prévoyait jamais tout le mal. Quand on le prévoyait, quand on le sent tout entier, on a bien plus de mérite qu’on ne croit à y consentir, car on fait bien plus de sacrifices qu’il ne paraît. Le pauvre Brutus se trompait beaucoup s’il est vrai qu’il ait dit en mourant : " Ô vertu, tu n’es qu’un vain nom ! " Il faut que la vertu soit au contraire quelque chose de bien réel, car elle impose, et on accepte, pour lui obéir, de bien lourds fardeaux.
J’aime John Bull de vous avoir si bien reçue. Mais une autre fois, ne prenez personne pour votre fils. Comme à vous, les cottages de votre route me paraissent charmants, et j’y vois tout ce que vous avez pu y voir. Cependant. croyez-moi quelque heureuse que vous y fussiez, votre pensée votre caractère, toute votre âme se trouveraient bien à l’étroit dans un cottage. Il faut que le chêne s’étende, que le palmier s’élance, que la rose s’épanouisse. Nul n’est bien que dans un habit à sa taille ; et notre taille, Madame ce n’est ni vous, ni moi qui la réglons ; nous n’y pouvons pas plus retrancher qu’ajouter une coudée. Acceptons donc, quelque lourd qu’il puisse être quelques fois. l’habit qui nous va. Mais sous tous les habits, dans toutes les situations, les sentiments simples naturels, les sentiments primitifs et puissants qui sont le fond de l’âme humaine doivent trouver leur place et garder leur empire. Je ne sais ce qui a pu arriver à d’autres ; pour moi, je n’ai jamais éprouvé que les grands désirs, les grands travaux de la vie publique étouffassent, altérassent le moins du monde en moi, le besoin d’affection bien reçue, passionnée de sympathie intime, les joies du cœur et de la famille, tout ce qui remplit et anime la vie privée des hommes. Plus au contraire mon esprit s’est élevé et ma destinée s’est étendue, plus ces sentiments se sont développés en moi: plus ils me sont devenus chers ; plus même ils ont gagné, je crois en énergie, en fécondité en délicatesse! Il me semble qu’ils ont toujours participé au progrès général de mon être, et qu’en montant un échelon de plus, je n’ai jamais laissé en arrière aucune partie de moi-même. Il est vrai aussi que je suis devenu de plus en plus difficile pour la satisfaction intérieure de ces sentiments si doux de plus en plus exigeant quant aux mérites, aux perfections de leur objet. En ceci comme ailleurs, mon ambition a toujours été croissante, et je n’ai jamais accepté ni mécompte ni décadence. Mais en ceci surtout, ma plus haute ambition est satisfaite, car il a plu à Dieu de placer sur ma route des créatures dont la rencontre est de sa part, un bienfait infiniment supérieur à tous ses autres dons.
Samedi 8. Je n’ai pas eu de lettre hier. Vous l’avez peut-être adressée au Val Richer, m’y supposant déjà. Elle m’y attendra ; mais en attendant elle me manque beaucoup. J’espère que les miennes vous arrivent exactement Je ne sais que vous dire de ma course à Châtenay. J’ai été là dans l’état intérieur le plus mêlé, le plus combattu, tantôt charmé d’y être tantôt m’y trouvant plus seul que partout ailleurs. "Cette fois vous venez pour moi.» m’a dit Mad. de Boigne. Elle m’a parlé de vous, très bien, selon le monde. Le monde vous trouve très aimable Madame mais il vous craint un peu. Il lui semble que vous le regardez d’en haut, vous mettant plus à l’aise avec lui que vous ne lui permettez de l’être avec vous. Il soupçonne qu’au fond vous êtes un peu autre que vous ne lui paraissez. N’y ayez point de regret. La familiarité du monde n’est pas bonne ; il faut toujours se montrer à lui un peu dans le lointain et lui rester un peu inconnu.
Les bruits de dissolution prennent ici depuis deux jours, assez de consistance. Je suis allé avant. hier soir à Neuilly prendre congé du Roi et de la Reine. Le Roi, n’y était pas. Je n’ai donc point eu de conversation sur laquelle je puisse former quelque conjecture. En tout cas, les élections n’auraient probablement lieu qu’au mois d’Octobre. L’indisposition de M. le Duc d’Orléans n’était rien du tout, un pur accès de fièvre éphémère. Il passe demain une revue de la garnison de Paris. Les propos qui couraient sur son désir de commander lui-même, l’expédition de Constantine étant tout à fait tombée. Adieu., Madame. Je vais recommencer à trier dans ma bibliothèque les livres que je veux envoyer à la campagne. C’est un travail presque mécanique qui me convient à merveille. Mon âme pendant ce temps pense à qui elle veut. va où il lui plaît. Adieu. G.
5. Paris, Dimanche 9 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Adieu Madame Ne soyez pas malade et dites, le moi. G.
Paris Dimanche soir 9 juillet
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance
6. Val-Richer, Jeudi 13 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement vous êtes malade, Princesse, assez malade pour ne pouvoir écrire quatre lignes. Sans cela, je ne comprends pas, je ne puis comprendre comment je n’ai point de lettres. Quelle ressource pour me rassurer ! J’en ai une autre moins triste quoique l’effet en soit fort triste. Il y a quelque irrégularité dans le service de la poste au fond de mes bois. Mes journaux ne m’arrivent pas encore exactement. Deux lettres ne me sont revenues qu’après avoir été me chercher à Caen. Peut-être y en a-t-il une de vous qui court ainsi après moi. Je viens de régler avec le Directeur des postes de l’arrondissement le service du Val-Richer, voici, quand vous voudrez m’écrire directement, ma vraie et sure adresse. Au Val-Richer, Commune de St Ouen le Paing. par Lisieux. Calvados. Adressées ainsi mes lettres m’arrivent le lendemain de leur départ de Paris. Quand en aurai-je une de vous ?
Je ne veux pas vous dire tout ce qui me vient à l’esprit, quel espace parcourt mon imagination, quels ennemis, quel fantôme elle y rencontre. Je n’ai pas en général l’imagination inquiète et noire : mais quand une fois elle prend ce tour là, elle échappe tout à fait à l’empire de ma raison, tout devient possible, probable, réel. Il faut se taire alors, se taire absolument, ne pas se parler à soi-même. Je vous quitte donc Madame. Pourquoi êtes-vous devenue un si grand intérêt dans ma vie ?
Vendredi 14. Voilà une lettre, une longue, un excellente lettre. Et c’est bien celle que j’attendais. Il n’y en a point de perdue. Celle-ci est allée en effet me chercher à Caen, le service encore mal réglé de la poste a causé le retard. Un nom de village pour un autre, une négligence de commis, cinq minutes de sommeil d’un courrier qui passe, sans s’en apercevoir, devant une route de traverse, qu’il faut peu de chose pour faire beaucoup souffrir ! Enfin, la voilà. Et j’espère que les autres viendront plus régulièrement.
Vous n’êtes point malade. On vous trouve bonne mine. Ne permettez pas à tout ce monde de vous accabler de fatigue ; ils n’ont pas de quoi vous en dédommager. Ils vous aiment pourtant et ils ont raison ; et vous avez bien raison aussi d’accueillir toutes les amitiés, quels que soient leur nom et leur drapeau.
Entre nous, j’ai plus d’une fois regretter de ne pouvoir être avec mes adversaires politiques, aussi cordial aussi, bienveillant que je m’y serais senti enclin. J’en sais plus d’un en qui, politique à part, j’aurais trouvé peut-être un ami du moins une relation facile et douce. Mais le soin de la dignité personnelle, les devoirs envers la cause, les exigences et les méfiances de parti, tout cela jette entre les hommes, une froideur, une hostilité souvent sans motifs individuel et intimes. Il faut s’y résigner ; c’est la loi de cette guerre, car il y a là une guerre.
Mais vous, Madame, profitez, profitez toujours et sans hésiter de votre privilège de femme; soyez juste envers tous, bonne pour tous, amicale pour tous ceux qui le mériteront de vous. C’est quelque chose de si beau et de si rare que l’équité et l’amitié ! Je suis charmé que vous en jouissiez, et plus charmé encore que vous soyez si capable d’en jouir, que vous ayez l’esprit si libre et le cœur si affectueux. Je n’y mets qu’une condition Vous la devinez et elle est bien remplie, n’est-ce pas ? Pendant que vous retrouvez à Londres, vos douleurs, pendant que vous n’y pouvez faire un pas, regarder à rien sans avoir le cœur bouleversé au souvenir de vos fils, moi j’achève ici, dans ma maison, les arrangements que le mien y avait commencés. Je fais descendre dans ma chambre son fusil de chasse, je me promène suivi de son chien.
C’est un lien puissant entre nous, Madame, que cette triste ressemblance de nos destinées, et cette parfaite intelligence que nous avons l’un l’autre de nos peines. Il me semble que j’ai connu vos enfants ; je leur prête les traits, les qualités qui me charmaient dans le mien ; je les unis à lui dans mes regrets. Ne vous défendez pas, Madame, du sentiment qui vient émousser ce que les vôtres ont de plus poignant ; laissez-vous guérir autant que se peut guérir une vraie blessure. A mesure que nous avançons dans la vie, c’est la condition de notre âme d’éprouver et d’associer dans je ne sais qu’elle mystérieuse unité, les émotions les plus contraires, de souffrir et de jouir, de regretter, et de désirer à la fois, et avec la même vérité, la même énergie. Acceptons ces secrets de notre nature. Si vous étiez là, si nous causions en liberté, vous me parleriez de vos fils, je vous parlerais du mien. Nous nous raconterions toute leur vie, toute la nôtre, et un sentiment d’une douceur infinie et souveraine se répandrait sur notre entretien. Que mes lettres vous en apportent l’ombre ; les vôtres ont pour moi tant de charme !
Samedi 15, 9 h 1/2 du matin.
Que je dis vrai dans ces derniers mots, & bien plus vrai que je ne dis ! Voilà, le N° 5 qu’on m’apporte. Dearest Princess, je crains qu’à votre tour vous n’éprouviez quelque retard pour mes lettres, pour celle-ci du moins. Je m’en désole. Pardonnez le moi. J’aurais dû la faire partir avant-hier ; mais j’étais si impatienté de ne voir rien arriver que j’ai attendu. Je vous aurais écrit en trop mauvaise disposition. Aujourd’hui je ferais peut-être mieux d’attendre aussi. Ma disposition est trop bonne.
Tout à l’heure Madame j’irai me promener dans les bois qui m’entourent. Ils sont bien verts, bien frais, bien sombres, quoiqu’un beau soleil brille au dessus et les enveloppe de sa lumière. Ce lieu-ci est très solitaire, très sauvage. Autrefois quelques moines y venaient orner. Aujourd’hui quelques bûcherons y travaillent. J’y serai bien seul. Je n’y entendrai rien. Je n’y verrai personne. Je relirai vos lettres. Je serai charmé. Et pourtant, que le fond du jardin de la Duchesse de Sutherland me fera envie ! Et ma pensée tantôt m’y transportera, tantôt vous amènera vous-même dans les bois du Val-Richer. Et je me laisserai bercer à ces doux rêves jusqu’à ce que j’en sente le mensonge. Je rentrerai alors dans ma maison.
Je suis très préoccupé de ce que vous me dites des projets de M. de Lieven. Vous ne pouvez songer, ce me semble, à aller le rejoindre à Carlsbad. Vous voilà à peine en Angleterre. La saison des eaux serait passée avant que vous arrivassiez, en Bohème. Après les eaux, s’il y va M. de Lieven retournera sans doute auprès du grand duc. Non, Madame, il ne faut pas chercher le bonheur à tout prix ; mais il faut penser sans relâche aux moyens de lever les obstacles. Vous ne pouvez ni vous fier à Pétersbourg, ni errer sans cesse en Europe. Que ces deux points là soient bien arrêtés ; ils feront le reste.
Midi. C’est trop de bien en un jour. Je tremble pour les jours qui vont suivre. Je reçois à l’instant votre N°6. Mon pressentiment ne me trompait pas tout à fait quand je vous craignais malade. Reposez-vous, beaucoup, beaucoup. Je suis charmé que vous n’alliez pas à Howick.
Que je vous remercie d’avoir pensé à me rassurer sur votre mauvaise écriture ! Elle m’eût inquiété en effet. Je vais attendre bien impatiemment vos prochaines lettres. Je les crains pourtant un peu. Vous aurez attendu celle-ci. Vous vous serez, comme moi naguère, impatientée, tourmentée. Vous voyez que j’ai aussi ma fatuité. C’est un lieu commun que je dis là, Madame. Non, je n’ai avec vous, point de fatuité. Ce mot ne convient ni à vous, ni à moi. Mais j’ai confiance, je crois. Et vous aussi, n’est-ce pas ? Nous avons donc bien le droit de nous parler comme gens qui croient, c’est-à-dire tout simplement et en disant les choses comme elles sont, non pas comme on est convenu de les dire quand elles ne sont pas. Il faut pourtant que je finisse si je veux que ma lettre parte !
Il me semble que j’ai à peine commencé que je ne vous ai parlé de rien. Je vais au plus pressé à ce qui me touche vraiment ; et je laisse en arrière (comme je laissais le cahier rouge) la politique anglaise, la politique française, votre jeune Reine, la dissolution de son parlement, celle du nôtre, que sais-je ? Tout cela cependant m’intéresse beaucoup, et je lis très curieusement les détails que vous me donnez, et j’ai sur tout cela, des milliers de choses à vous dire. Et ma prochaine lettre, si dans celle-là encore, j’en trouve le temps. Adieu Madame.
Remerciez, je vous prie, la petite Princesse de son bon souvenir. J’y tiens beaucoup et j’en suis très touché. C’est à vous de lui demander pardon, pour moi d’un langage si familier. Je copie. Je suis bien heureux d’apprendre que Madame la Duchesse de Sutherland veut bien se rappeler mon nom. C’est du luxe en vérité d’être si bonne quand on est si belle. Mais le luxe qui vient de Dieu est charmant ; et il a comblé votre noble hôtesse de tant de dons qu’en effet elle nous doit peut-être à nous autres pauvres mortels de nous traiter avec un peu de bonté. Quelque place qu’elle me donnât à sa table, je serais ravi de m’y asseoir. G.
Mots-clés : Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Deuil, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait (Dorothée), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Séjour à Londres (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
7. Val-Richer, Dimanche 16 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il faut pourtant que je vous parle un peu d’autre chose. L’Angleterre me préoccupe beaucoup. Je prends à ce qui la touche, un vif intérêt, bien plus vif depuis un mois. C’est un noble peuple moral de cœur et grand dans l’action. Il a su jusqu’ici respecter sans se courber, et s’élever sans rien abaisser. Qu’il ne change pas de caractère. Il en changera, s’il tombe sous l’empire des idées radicales. Je ne sais pas bien quelles réformes exige en Angleterre l’état nouveau de la société. Je crois qu’il en est d’indispensable, et qu’il y aurait folie à les contester obstinément. Je m’inquiète peu d’ailleurs des réformes, quelque difficiles qu’elles soient. C’est le métier des gouvernements de faire des choses difficiles et de s’adapter à la société ! Ce dont je m’inquiète c’est des idées et des passions au nom desquelles les réformes se feront. Si ce sont les idées radicales, les passions radicales, qu’on ne parle plus de réforme; c’est de révolution, c’est de destruction qu’il s’agit. Les idées radicales, les passions radicales c’est la souveraineté brutale du nombre, la haine jalouse des supériorités, la soif grossière des jouissances matérielles, l’orgueil aveugle des petits esprits ; c’est la collection de toutes les révoltes, de toutes les ambitions basses contenues en germe dans toute âme humaine et que l’organisation sociale a précisément pour objet d’y comprimer, d’y refouler incessamment. Ambitions, révoltes dont jamais un gouvernement, quelques réformes qu’il fasse ne doit arborer le drapeau, emprunter le langage, accepter l’impulsion ; car ce jour là, il n’est plus gouvernement ; il abdique sa situation légitime, nécessaire ; il parle d’en bas il est dans la foule, il marche à la queue. Et toutes les idées, tous les sentiments naturels, instinctifs, sur lesquels reposent la force morale du pouvoir et le maintien de la société, s’altèrent, se perdent ; et, spectateurs ou acteurs, les esprits se pervertissent, les imaginations s’égarent, les désirs désordonnés s’éveillent ; et un jour arrive où l’anarchie éclate comme la peste, où non seulement la société mais l’homme lui-même tombe en proie à une effroyable dissolution. Les Whigs, à coup sûr, ne veulent rien de tout cela et très probablement beaucoup de radicaux eux-mêmes n’y pensent point.
Mais tout cela fond des idées et des passions radicales ; tout cela montera peu à peu du fond à la surface, et se fera jour infailliblement si les idées et les passions radicales deviennent de plus en plus le drapeau et l’appui du pouvoir. Les Whigs, en s’en servant, les méprisent ; les Whigs sont éclairés, modérés, raisonnables. Je le crois, j’en suis sûr. Et pourtant quand j’écoute attentivement leur langage, quand j’essaye d’aller découvrir au fond de leur pensée leur credo politique, je les trouve plus radicaux qu’ils ne s’imaginent, je trouve qu’ils prêtent foi, sans s’en bien rendre compte, aux théories radicales, qu’ils n’en mesurent pas du moins avec clarté et certitude, l’erreur et le danger. Leur modération semble tenir à leur situation supérieure, à leur expérience des affaires, plutôt qu’au fond même de leurs idées. Ils ne font pas tout ce que veulent les radicaux ; mais, même quand ils les refusent, ils ont souvent l’air de penser comme eux. Et c’est là ce qui m’inquiète, c’est sur cela que je voudrais les voir inquiets et vigilants eux-mêmes. Car il y a beaucoup de Whigs, et beaucoup de choses dans le parti Whig, que j’honore, que j’aime, que je crois très utiles, nécessaires même à l’Angleterre dans le crise où elle est entrée. J’ai un désir ardent qu’elle sorte bien de cette crise qu’elle en sorte sans bouleversement social, que son noble gouvernement, mis à cette rude épreuve s’y montre capable de se conserver en se modifiant, et de défendre la société moderne contre les malades qui la travaillent en réformant lui-même ses propres abus. Ce serait là, Madame, une belle œuvre, une œuvre de grand et salutaire exemple pour tous les peuples. Mais elle est difficile, très difficile ; et elle ne s’accomplira qu’autant que le venin des idées et des passions radicales, qui s’efforce de pénétrer dans le gouvernement en sera au contraire bien connu et bien combattu. Que Whigs et Tories se disputent ensuite le pouvoir, ou (ce qui serait plus sage) se rapprochent pour l’exercer ensemble, tout sera bon, pourvu que les vieilles dissidences, les vieilles rivalités, les aigreurs & les prétentions purement personnelles se laissent devant le danger commun.
Vous voyez Madame, que moi aussi j’ai mes utopies. Si vous étiez ici je vous les dirais. Vous êtes loin; je vous les écris. Quelle différence ! vos lettres sont charmantes ; mais votre conversation c’est vos lettres plus vous.
Lundi 17. Dix heures du matin.
Je continue, Madame, seulement je reviens d’Angleterre en France. Vous m’avez quelques fois paru étonnée de l’ardeur des animosités politiques dont je suis l’objet. Laissez-moi vous expliquer comme je me l’explique à moi-même, sans détour et sans modestie. Je n’ai jamais été, avec mes adversaires violent, ni dur. A aucun je n’ai fait le moindre mal personnel. Avec aucun je n’ai eu aucune de ces querelles d’homme à homme qui rendent toute bonne relation impossible. Mais le parti révolutionnaire radical, qui s’appelle le parti libéral, avait toujours été traité, par ceux-là même qui le combattaient avec un secret respect. On le taxait, d’exagération, de précipitation ; on lui reprochait d’aller trop, loin trop vite. On ne lui contestait pas la vérité de ses Principes, la beauté de ses sentiments et l’excellence de leurs résultats quand le genre humain serait assez avancé pour les recevoir. Les partisans absolus de l’ancien régime étaient seuls, quant au fond des choses, ses antagonistes déclarés, et ceux-là, il ne s’en souciait guère. Le premier peut-être avec un peu de bruit du moins, j’ai attaqué le parti de front ; j’ai soutenu que presque toutes ses idées étaient fausses, ses passions mauvaises, qu’il manquait de lumières politiques, qu’il était aussi incapable de fonder les libertés publiques que de manier le pouvoir; qu’il n’avait été et ne pouvait être qu’un artisan passager de démolition, que l’avenir ne lui appartenait point ; qu’il était déjà vieux, usé ne savait plus que nuire, et n’avait plus qu’à céder la place à des maîtres plus légitimes de la pensée et de la société humaine. C’était là bien plus que combattre le parti ; c’était le décrier. Je lui contestais bien plus que le pouvoir actuel ; je lui contestais tout droit au pouvoir. Je ne lui demandais pas d’ajourner son empire ; j’entreprenais de le détrôner à toujours.
La question entre le parti et moi, n’a peut-être jamais été posée aussi nettement que je le fais là. Mais il a très bien démêlé la portée de l’attaque. Il s’est senti blessé dans son amour propre menacé dans son avenir; et il m’en a voulu infiniment plus qu’à tous ceux qui demeuraient courbés sous son joug en désertant sa cause et le flattaient en le trahissant. Je ne parle pas des accidents que j’ai essuyés dans cette lutte, ni des rivalités où je me suis trouvé engagé. Ce sont là des causes d’animosité qui se rencontrent à peu près également dans la vie de tout homme politique. Mais s’il y en a une qui me soit particulière et vraiment personnelle, c’est celle que je viens de vous indiquer.
Croyez-moi Madame ; n’ayez nul regret, pour moi à cette situation. Sans doute elle m’a suscité et me suscitera peut-être encore des difficultés graves. Mais elle fait aussi ma force; elle fait s’il m’est permis de le dire, l’originalité et l’énergique vitalité de mon influence. Dans cette guerre raisonnée systématique, que je soutiens contre l’esprit révolutionnaire, les chances, j’en suis convaincu, sont pour moi comme le bon droit.
L’esprit révolutionnaire, nous menacera encore longtemps ; mais il nous menace en reculant, & l’avenir appartient à ceux qui le chasseront en donnant à la société nouvelle satisfaction et sécurité. Et puis vous savez bien que vous m’apprendrez tous les soins, toutes les douceurs par lesquelles on peut prévenir les animosités politiques, ou les atténuer quand elles existent déjà.
2 heures Quelle lettre, bon Dieu ! Un vrai pamphlet politique ! Mais aussi pourquoi m’avoir fait si rapidement contracter l’habitude, et bien plus encore le besoin de penser tout haut avec vous et sur toutes choses ? Pourquoi mon esprit va-t-il à vous des qu’il se met en mouvement ? Je sais bien le parce que de tous ces pourquoi ; mais je ne vous le dirai pas aujourd’hui. Et pourtant c’est ce qui me plairait le plus à vous dire. Mais c’est aussi ce qui m’ entraînerait plus vite & plus loin que toute la politique du monde.
Adieu donc, Madame adieu, quoiqu’en vérité je ne vous aie rien dit aujourd’hui qui réponde à ce qui remplit et occupe réellement mon âme. G.
8. Val-Richer, Mercredi 19 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je savais bien que je ne lirais pas votre première lettre sans remords. Et la prochaine m’en donnera plus encore, car vous aurez été plusieurs jours sans lettres. C’est un peu ma faute, la faute de mon inquiétude, de mon chagrin, de mon humeur. Savez-vous que j’ai été, moi, huit jours sans lettres, du jeudi 6 au vendredi 14 ? De toutes les raisons de retard, l’irrégularité de la poste à travers mes champs normands était à coup sûr, la plus vraisemblable. C’est celle à laquelle j’ai le moins pensé. J’en voulais absolument une plus grave. L’Empereur Napoléon, n’avait jamais voulu croire qu’une gelée de 25 degrés pût arriver en Russie plutôt que de coutume, et qu’une circonstance, toute matérielle, toute indifférente d’ailleurs, vint, paralyser les combinaisons de sa haute intelligence, de sa puissante volonté. Moi aussi, j’étais choqué de penser, je répugnais à admettre qu’il fût au pouvoir d’un courrier mal réglé ou tardif de me tourmenter à ce point. Je cherchais pour cause à mon tourment des intentions, des actions plus spécialement dirigées contre moi, contre moi seul. On ne se rend pas, de tout ce qui se passe dans l’âme ainsi troublée, un compte bien net ; mais que d’idées, que d’émotions la traversent que de conjectures elle invente qui frapperaient d’une surprise infinie si elles paraissaient au jour ! Que la vie extérieure, la vie qui se voit est lente, et froide, et vide, à côté de la vie intérieure, de la vie secrète ! Ce n’est pas là une des moindres causes du charme de l’intimité ; elle soulève aux yeux d’un seul être, le voilà qui couvre ce théâtre si animé, si varié, mais sans spectateurs.
J’ai lu, dans quelque vieille chronique, qu’un roi Barbare, très avisé et qui avait amassé d’immenses trésors, disait à sa femme qu’il l’aimait parce qu’elle était la seule personne à qui il les montrât. On montre son âme à la personne qu’on aime ; et entre mille raisons de l’aimer. On l’aime, en effet pour celle là. On répand devant elle tous ses trésors cachés, et elle les connait, et elle en jouit ; et du moins auprès d’elle tout ce qui est paraît ; le dehors et le dedans se confondent ; la vie éclate avec vérité et liberté.
Malgré mon remords, Madame, votre lettre me charme. Moi aussi, je vous remercie de votre inquiétude, et puis de vos great spirits. et puis encore de votre poésie. Vous avez mille fois raison. Milton a grand tort de dire. "He for God only." C’en un reste d’arrogance puritaine. Et le langage universel du genre humain proteste contre cette arrogance, car de tous temps et en tous pays, hommes et femmes également se sont dit, en s’aimant, je l’adore, ne se faisant pas plus de scrupule les uns que les autres de se parler comme s’ils parlaient à Dieu. J’ai beaucoup de foi à ces instincts spontanés et généraux du langage humain. La vérité s’y révèle presque toujours.
Jeudi 20
Je viens de m’impatienter à chercher mon Milton. Je ne l’ai pas trouvé. Il est dans des caisses de livres, qui ne me sont pas encore arrivées. J’étais pressé de relire les trois vers auxquels vous me renvoyez. Je suis bien sûr que je les aimerai comme vous. Est-il rien de plus doux que cette confiance dans une prompte et complète similitude d’impressions ? Milton est en effet un peu heavy. Cependant si nous le relisions ensemble nous y rencontrerions encore bien des vers qui vous iraient au cœur. La poésie fait bien autre chose que m’élever et me calmer au besoin ; elle m’entretient, dans le plus charmant langage, de tout ce qui a pu de tout ce qui peut charmer ma vie. Elle n’a pas toujours été pour moi ce qu’elle est aujourd’hui. J’ai appris à la comprendre. J’en jouis bien plus que je ne faisais à vingt ans. J’y découvre tous les jours des intentions, des émotions qui avaient passé inaperçues devant moi, et qui maintenant me saisissent car je les reconnais ; c’est mon âme qu’on me raconte. Voici des vers de Moore qui me sont retombés avant hier sous la main. Blessed meetings after many a day
Of widowhood past far away ;
When the loved face againts seen
close, close with not a tear between ;
Confidings frank without controul,
Pour’d mutually from soul to soul ;
As free froms any fear or doubt,
As is that light from chill, or stain
The sun into the Stars Sheds out,
So be by them shed back again !
Faites comprendre tout ce qu’il y a dans ces vers à qui n’a pas goûté tout le charme de l’intimité et senti tout le poids de l’absence ! Les émotions même les plus personnelles, des émotions qu’en les éprouvant on a été tenté soi-même de regarder comme étranges, comme vouées, au plus profond secret, on les retrouve quelquefois dans les poètes et précisément telles qu’on les a éprouvées. Vous m’avez parlé un jour du besoin impérieux qui vous avait quelquefois poussée, quand vous étiez seule, à appeler à haute voix, à bien haute voix, les êtres chéris que vous aviez perdus. Je ne sais quelle réserve, quel embarras m’empêcha de vous dire alors que moi aussi j’avais parlé, et appelé et crié comme vous. Eh bien, Madame, ce que nous avons senti l’un et l’autre, ce que nous ne nous sommes dit qu’à voix basse et en hésitant, le Dante l’a mis en beaux vers dans une canzone sur la mort de sa Beatrix : « Quelquefois, dit-il, mon imagination devient si vive, et en même temps la douleur me presse tellement de toutes parts, que je tressaille, je m’enfuis avec honte loin de toute vue ; et seul, pleurant, gémissant, j’appelle Béatrix, et je lui dis.« Beatrix es-tu morte ? Et quand je l’appelle ainsi, elle me console.»
Poscia, piangendo sol nel mio lamento,
Chiame Beatrice, e dico. Or, sei tu morta ?
E mentre ch’io la chiamo, mi comforla.
Et le Dante a cru peut-être, et nous avons peut-être cru, vous et moi, qu’une telle impression, un tel cri ne pouvaient appartenir qu’à un cœur déchiré. Le Dante s’est trompé, nous nous sommes trompés. Le bonheur aussi, un bonheur profond, saisissant, a produit les mêmes effets. Le méthodiste passionné ce John Newton dont je crois vous avoir parlé, écrit à sa femme :
« It is my frequent custom to vent my dearest
thoughts aloud when I am sure that no one
is within hearing. I have had many a tender
soliloquy concerning you, and in the height
of my enthusiasm, have often repeated your
dear name, merely to hear it returned by
the echo.
N’est-ce pas un plaisir pour vous, Madame, de retrouver ainsi, dans des cœurs si inconnus de vous à des siècles de distance, vos plus chères pensées ; vos émotions les plus intimes ? Et loin d’y rien perdre ne reçoivent-elles pas en quelque sorte par là, à vos propres yeux une nouvelle et puissante sanction. Je crois en vérité Madame, que je me suis persuadé que vous étiez là, car je vous raconte tout ce qui me vient à l’esprit ou à la mémoire, absolument comme si nous causions. Mais mon rêve s’évanouit. Vous me quittez. Adieu. Je n’aurai le cœur à l’aise que lorsque, pour vous comme pour moi, notre correspondance se sera rétablie dans sa douce régularité.
9. Val-Richer, Vendredi 21 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Madame que vous dirai-je ? Je n’aime pas les sentiments combattus ; ils sont peu dans ma nature. En général, quand deux impressions contraires m’arrivent ensemble, mon cœur choisit décidément choisit et l’une devient bientôt dominante, tout à fait dominante. Mais aujourd’hui que faire ? Vos N°7 et 8, le dernier surtout que je reçois à l’instant, me pénètrent de tristesse et de bonheur. Votre inquiétude me désole et me charme. Je lis, je relis, je relis vingt fois les paroles pleines d’une agitation pour vous si douloureuse, pour moi si tendre ! Que ne donnerais-je par pour vous l’épargner? Que ne vous dois-je pas pour l’avoir sentie? Pardonnez-moi dearest Princess, pardonnez-moi mon égoïste joie ; elle n’ôte rien, je vous jure à ma peine pour votre peine. Je crois que si ce n° 8 était arrivé avant-hier, le chagrin, l’eût emporté en moi. Je vous aurais vue encore si triste, si troublée ! Mais, depuis hier j’espère, le mal est passé ; hier au plus tard, vous avez reçu une lettre; vous en aurez une autre demain ; elles iront à vous désormais régulièrement, souvent, bien souvent. Chacun à notre tour, nous avons traversé l’un et l’autre un bien sombre nuage. De petites circonstances, des circonstances tout-à-fait étrangères à notre volonté, mon déplacement, des adresses inexactes, des postes mal réglées voilà la vraie cause du mal. Il ne se reproduira plus. Nous y veillerons. J’y veillerai comme les Guèbres sur la dernière étincelle du feu sacré, comme une mère sur son enfant malade. Les témoignages de votre affection me sont mille fois plus doux que je ne vous le dirai jamais. Mais je ne veux jamais les devoir à une minute de souffrance de votre cœur.
Et Lord Aberdeen ? Il est donc parti ? Et je puis en toute sûreté, le plaindre, être juste envers lui ? Que je vous remercie de m’avoir ainsi mis à l’aise avec moi-même ! Je ne connais rien de plus pénible que de nourrir en son âme un mauvais sentiment contre un galant homme malheureux. Et pourtant vous êtes une noble créature. Et moi j’ai le cœur bien fier. Je pressentais cela et depuis longtemps. Même avant votre départ, le nom de Lord Aberdeen me frappait plus sérieusement qu’aucun autre. Pauvre homme ! C’est si naturel !
Vous ne savez pas Madame, pour un homme sérieux et malheureux, quel charme il y a en vous, dans votre air, dans votre accent, dans ces entretiens où éclatent, avec tant de dignité et d’abandon, votre esprit si haut si simple, si libre, votre âme si gravement et si finement émue, si sensible aux grandes choses, si indifférente aux petites, pleine de tant de sympathie et de tant de dédain ! Je voudrais avoir quelque occasion d’être en bon rapport avec Lord Aberdeen de lui être agréable en quelque chose. Je me sens comme des devoirs envers lui. Vous me direz s’il vous écrit s’il doit revenir à Londres avant votre départ. Vous me direz tout, comme vous l’avez fait.
Samedi 22 midi. Dearest Princess, il n’y a plus de sentiment combattu. Je n’en ai plus qu’un absolument qu’un. Je suis désespéré de votre inquiétude. Je crains quelle ne vous fasse mal. Je reçois à la fois votre petit billet, sans numéro du lundi 17 qui m’est venu directement, après être encore allé me chercher à Caen et votre N°9, du Mardi 18, qui m’arrive par Paris. J’ai beau me dire qu’à présent, depuis Jeudi vous êtes tranquille, que vous savez combien vos inquiétudes étaient vaines. Je n’en suis pas moins désolé, troublé, inquiet de nouveau moi-même et de la façon la plus douloureuse. Je vous vois, vous êtes là devant mes yeux, impatiente, préoccupée quel charme agitée, triste, attendant, attendant encore. Vous me pardonnez, n’est-ce pas? Je veux que vous me pardonniez, quoique je n’ai point de tort, non certainement point de vrai tort, point de tort devant Dieu; car moi aussi j’ai attendu et bien des jours, et avec une impatience dont j’ai contenu, dont j’ai étouffé l’expression en vous la témoignant. Et si j’avais suivi ma pente, quand vos lettres ne m’arrivaient pas quand mon imagination se lassait, s’épuisait à chercher la cause du retard ou du silence, je vous aurais écrit tous les jours ; tous les jours je vous aurais demandé pourquoi je n’avais pas de lettre. J’aurais mieux fait. Je ne l’ai pas fait à cause de vous, de vous seule. J’ai craint quelque odieuse malice. J’ai voulu y voir clair.
Enfin tout est passé n’est-ce pas, bien passé? Vous ne craignez plus, vous ne souffrez pas, vous n’êtes pas malade ? Que la parole est pitoyable, & que tous mes efforts seraient vains pour vous envoyer sur ce papier, ce que j’ai en ce moment dans le cœur ? Voyez le, devinez-le. Vous le pouvez, j’en suis sûr ; je me confie à vous. C’est ma consolation dirai-je ma joie, mon inexprimable joie de savoir, d’avoir vu, de voir tout ce qu’il y a dans votre cœur de tendresse et de puissance. Ceci encore, cette joie vous me la pardonnez également. Dites-le moi, que j’aie le plaisir de l’entendre, quoique je n’en aie pas besoin. Demain enfin, après demain au plus tard j’aurai une lettre rassurée, et qui me rassurera j’espère. Mais que d’heures encore d’ici à demain ! Aujourd’hui, il me serait impossible de vous parler d’autre chose.
Adieu adieu. Mais, je vous en conjure, soignez-vous ; ne vous livrez pas à des émotions comme celle que ce petit chien a causée. L’absence est déjà assez lourde ; au moins faut-il être tranquille sur votre santé. Je ne serais pas tranquille quand vous vous porteriez toujours le mieux du monde. Comment l’être un moment si des secousses continuelles vous assiègent ? Éloignez-les ; abrégez-les. Vous pouvez avoir de l’empire sur vous? Vous m’avez dit que vous réprimeriez tout ce qui pourrait m’affliger. Pensez à moi. Je suis sûr que vous le ferez comme vous me l’avez dit. G.
10. Val-Richer, Dimanche 23 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne suis pas encore sorti de la mauvaise veine. Je n’’ai reçu ce matin qu’un mot du voyageur que vous avez envoyé chercher. Demain enfin, j’espère vous savoir tranquille, et le savoir de vous. J’en ai grand besoin. Et quand j’aurai reçu votre prochaine lettre j’aurai grand besoin de celles qui suivront. Je les attendrai presque avec la même impatience. Car vous êtes souffrante, très souffrante. mon voyageur me le dit. Vous étiez déjà souffrante avant cette déplorable agitation. L’avez-vous toujours été depuis votre arrivée en Angleterre ? Sentez-vous que vous le soyez, au fond, à part tout accident ? Dites-moi exactement ce qui en est. Vous m’aviez promis de me revenir reposée, engraissée.
Ah, que tout est fragile autour de nous ! Nous vivons sur le penchant d’un abyme, toujours près d’y voir tomber ce que nous avons saisi, ce que nous retenons avec le plus d’ardeur. J’ai perdu, tout-à-fait perdu le sentiment de la sécurité ; je n’espère plus qu’avec inquiétude. Je ne jouis plus qu’avec tremblement. On dit que les marins s’accoutument aux tempêtes si bien que le vent le plus violent ne trouble plus leur sommeil ; Mais mon âme au lieu de s’affermir s’est ébranlée par les épreuves, dans le souffle le plus léger, j’entends un affreux orage ; dans le moindre incident, je vois le dernier malheur. Et pourtant mes joies, ces joies si menacées me sont plus chères, plus nécessaires que jamais !
5 heures
J’ai eu des visites toute la matinée, un raout de campagne. Le Dimanche, ma porte est ouverte à tout venant. Je l’ai formellement annoncé pour qu’on me ménageât dans la semaine, et j’espère qu’on me ménagera. un peu en effet. Je vis ici à l’état de bête curieuse, mais de bête curieuse dont on n’approche qu’avec quelque respect. J’ai parcouru aujourd’hui une longue échelle sociale, depuis des laboureurs jusqu’au marquis, moral de Portes, propriétaire du beau château de Fervaques, l’une des terres qu’habitait alternativement Sully, & où l’on conserve encore religieusement la chambre et le lit d’Henri 4.
Je prends, à voir l’homme à tous les étages, un plaisir sérieux et que je rechercherais à dessein, s’il ne me venait pas naturellement. Quand on vit toujours au même niveau dans la même sphère; elle devient comme une prison où l’esprit s’enferme et hors de laquelle il ne sait plus rien voir, ne comprend plus rien. Il faut aller, venir, monter, descendre. Le genre humain est un territoire très varié, très accidenté, comme on dit aujourd’hui. On n’y peut marcher d’un pas ferme, on s’y égare à chaque instant, si on ne l’a pas parcouru en tous sens et vu sous tous les aspects. Par instinct, par goût, je ne suis pas très propre à ces relations, à ces conversations de toute sorte ; mais l’expérience, m’en a démontré la nécessité, et ce que je crois nécessaire me devient bientôt presque naturel. Et puis j’ai pour la créature humaine en général sous quelques traits qu’elle m’apparaisse, un fond de sympathie. Je la considère au premier moment avec curiosité, au second avec un intérêt qui a quelque chose de l’affection. Je me préoccupe de ce qu’elle pense, de ce qu’elle sent de tout son état intellectuel et moral. Je m’inquiète de ses destinées. Il me semble toujours que, si j’essayais, si j’avais le temps, je pourrais quelque chose sur elle, pour elle ; et la communication la plus éphémère m’a quelques fois fait rêver bien des heures à la personne, très insignifiante d’ailleurs, avec qui je l’avais eue.
A la vérité, dans les rapports de ce genre ce n’est jamais à moi que je pense, ni de moi qu’il s’agit. Pour que j’entre moi-même en jeu, pour que je me sente personnellement intéressé dans une relation humaine, il faut qu’elle satisfasse aux conditions les plus élevées, qu’elle réponde à des exigences infinies. Je deviens alors aussi difficile que je suis coulant et complaisant dans le train commun de la vie. Je me prête volontiers aux hommes dans leur intérêt et sans attendre grand chose d’eux. Mais pour me donner, je veux que tous mes désirs, toutes mes ambitions soient comblées, et au delà. Vous voyez, Madame, que moi aussi, je vous parle de moi. Parlez-moi donc toujours de vous et toujours davantage. Vous ne trouverez jamais rien qui me plaise autant.
Lundi midi
Pas de lettre de vous encore ce matin. Je n’ose me plaindre ; mais je vais attendre demain comme je pourrai. Je n’aurai un moment de repos que lorsque je vous saurai calme et moins souffrante.
11. Val-Richer, Mardi 25 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est incompréhensible, c’est impossible. Mes N°6, 7, 8, 9 et 10 sont partis d’ici du Val-Richer, les 16, 18, 21, 23 et 24 Juillet, par des voies différents. Le N°6 devait vous arriver le jeudi 20, au plus tard le 21. Voilà votre lettre du 21, et vous n’avez rien reçu. Vous en recevrez plusieurs coup sur coup à la fois. Mais vous aurez attendu, vous aurez souffert. Dieu sait combien. Je le vois; je le sens, je vous entends. J’assiste à tout ce qui se passe dans votre âme, à tout ce qui la traverse dearest Princess, ever dearest, une seule pensée me fait quelque bien, c’est que ma peine vaut la vôtre ; tout ce que vous avez pu souffrir, je le souffre. Je souffre presque de l’exactitude avec laquelle vos lettres m’arrivent depuis le 14. Je me reproche cette inégalité entre nous, comme si elle était mon ouvrage. Mais il est impossible que le 22 au moins, le N°6 ne vous soit pas parvenu.
Si vous saviez toutes les combinaisons que j’ai faites ! Elles m’ont bien réussi ! Je crois à tout prendre, que le moyen le plus simple est aussi le plus sûr. Cependant, j’envoie ceci à M. Aston. On le lui remettra en mains propres, on lui demandera de vous l’envoyer par le plus prochain courrier. J’écris en même temps par une autre voie. Comment vous parlerais-je d’autre chose? Je ne pense pas à autre chose. Non aujourd’hui, je ne vous reprocherai même pas cette supposition qui a pu, qui n’aurait pas dû, qui n’aurait jamais dû se présenter à vous comme possible. Princesse, il n’y a pas longtemps que nous nous connaissons ; mais que fait le temps ?
Adieu. Adieu. Il faudra bien que nous sortions de cette odieuse impuissance de nous parler et de nous entendre. G.
11. Duplicata Val-Richer, Mardi 25 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de vous écrire par la voie que vous m’indiquez aujourd’hui. J’en essaie une autre. Nous romprons cette glace fatale. Non certainement, il n’y a rien de pis que d’attendre là, immobile, sous le feu des coup du sort bien plus redoutable que toute l’artillerie du monde. Mais encore une fois, il est impossible que demain vous ne me disiez pas que vous avez reçu une lettre. J’en ai tant écrit ! Cinq du Dimanche 16 au lundi 24. Comment pouvez-vous craindre que la vivacité de votre peine me déplaise ? Ah, dearest Princess, si je suis coupable, c’est par là, et ce n’est pas par un sentiment de déplaisir. Je vous dirai un jour, tout ce que j’ai éprouvé, pensé. Mais d’ici là, au nom de Dieu, soignez-vous. Souffrir de votre chagrin et trembler pour votre santé, c’est trop. Je le sais depuis longtemps, ce qui m’épouvante le plus en ce monde, c’est de voir tout ce qu’on peut supporter.
Adieu. Adieu. Il n’y a pas moyen de vous dire un mot de quoi que ce soit. G.
Mercredi 10 h Enfin, enfin, vous avez une lettre. Votre N°12 me l’annonce. Quelle délivrance, pour moi comme pour vous, oui pour moi comme pour vous. Vous vous trompez sur mes N°. Vous aviez reçu le N°4 et vous me l’aviez dit. Le n° 5 était ce petit billet de Dimanche 9 que j’avais oublie de numéroter. Il ne vous manque que le N° 6 qui vous arrivera certainement. Il était allé par une autre voie qui aura retardé. Adieu, Adieu, dearest. Vous allez être accablée de lettres, accablée. G.
12. Val-Richer, Mercredi 26 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Et moi aussi je respire. Quel horrible cauchemar ! et si long ! Depuis deux jours je n’y tenais plus. Dearest, every day dearer Princess, vous avez cependant trouvé le secret de mêler à une peine déchirante une joie ineffable. Ah ne regrettez pas l’abandon de vos sentiments, de vos paroles : j’en ai reçu un bonheur incompréhensible pour moi même au milieu de mon angoisse, et pourtant si réel, si puissant ! Ma raison, ma justice me le reprochaient, mais sans le détruire. Encore une fois, il faut me le pardonner. Vous le savez ; à un seul sentiment l’égoïsme est permis ; mais il lui est bien permis, car c’est le seul où le cœur, la personne, l’être tout entier se donnent vraiment et sans réserve, et avec plein droit par conséquent de tout accepter, de tout attendre. Oui, j’ai plein droit d’être égoïste avec vous. Je ne crains pas de trop recevoir. Je ne compte pas, je ne mesure pas. Donnez, donnez-moi; je m’acquitterai. Mais ce que je vous demande aujourd’hui, ce que je vous conjure de m’envoyer par tous les courriers, c’est la certitude que votre santé n’est pas trop atteinte, que le repos du corps vous revient avec celui du cœur. Là est la préoccupation, la cruelle préoccupation qui me reste.
Déjà, quand j’étais près de vous, j’ai si souvent tremblé en vous voyant, si aisément et si profondément ébranlée en voyant à la moindre émotion un peu vive, même douce, vos nobles traits, toute votre personne près de tomber dans ce frémissement qui fait mal, même quand la joie le cause et dont on ne sait même bientôt plus, quand il vous envahit, s’il vient de la joie ou de la douleur ! Vous ne savez pas quelles inquiétudes vous m’avez déjà causées, quels regards de minutieuse et infatigable inquisition j’ai cent fois porté sur votre physionomie, sur votre maintien, sur votre démarche, pour y découvrir la moindre trace de la moindre altération de la moindre souffrance. Et que faire de telles craintes dans l’absence, quand on ne peut s’assurer à chaque instant, de leur erreur, de leurs limites du moins ?
Vous me connaîtrez un jour, Madame ; vous savez un jour quelles agitations, quelles faiblesses infinies se cachent dans mon cœur, quand une affection vraie le possède, et emploient, à leur triste service dès que l’occasion s’en présente, tout ce que je puis avoir d’imagination, d’esprit d’énergie. Épargnez moi des troubles intérieurs qui atteint le bonheur le plus grand et lassant le plus ferme courage. Veillez sur vous, soignez-vous ; rapportez moi ce teint reposé, ces bras que vous m’avez promis ? Vous aurez des lettres, vous en aurez souvent, exactement. Il est impossible que la cruelle épreuve, par laquelle nous avons passé l’un et l’autre se renouvelle. Je suis enclin à croire qu’elle n’a eu que des causes matérielles, des méprises d’adresse, des ignorances de notre part quant aux arrangements de la poste ; peut-être des combinaisons trop variées et trop savantes. Certainement nous y pourvoirons. Vérifiez, je vous prie, ce que je vous ai dit ce matin sur les numéros de mes lettres. Vous avez eu le N°4. Le N°5 était le petit billet non numéroté, écrit le Dimanche 9. Et quant au retard du N°6, j’en entrevois la raison dans la route particulière qu’il a suivie, si je ne me trompe. Vote prochaine lettre me dira j’espère, qu’il vous est arrivé. Votre N°11 n’était que le n°10. Il commence le mardi 18 à midi, et votre N°9 finissait le mardi au moment de l’arrivée du postman. Votre N°12 que j’ai reçu ce matin, n’est donc que le N°11. J’entre dans ce détail pour qu’il n’y ait point d’erreur entre nous.
Jeudi 10 heure
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’en espérais pas n’importe ; je suis désappointé. Quelle insatiable avidité que celle de notre âme ! Dès qu’elle entrevoit le bonheur elle s’y précipite, elle s’y attache ; elle le vous tout entier à tout moment. A demain mon âme. Je suis charmé de votre conversation avec le comte Orloff. Vous ferez ce que vous voulez. J’attends à présent. vos projets en raison des mouvements de M. de Lieven. Toujours attendre ! Je voudrais connaitre au moins tous les gens à qui vous parlez, de qui vous me parlez. Les noms qui m’arrivent par vous qui sont importants pour vous, et qui ne me représentent ni une figure, ni une voix, ni un caractère cela me déplaît. C’est du vague, de l’obscur, de l’étranger. Je n’en puis souffrir en ce qui vous touche. Ah, notre misère! Que de choses dont nous disons. Je ne puis les souffrir et qu’il faut souffrir pourtant, et que nous souffrons en effet.
2 heures
La proclamation du rois de Hanovre, fera du mal partout. Les conservateurs sont intéressés partout à la bonne conduite du pouvoir. Ceci est vraiment un acte de folie. Je serais bien fâché que les élections anglaises s’en ressentissent profondément. Quant à nous malgré les apparences je doute toujours que nous ayons des élections. Le mieux informé de mes amis m’écrit que jusqu’ici le Roi, qui en décidera seul, y a à peine songé, qu’on se traînera probablement jusqu’au mois de Novembre avec des velléités sans résultat, et qu’alors, quand le vent des Chambres commencera à souffler, s’il secoue un peu fort le roseau ministériel, le Roi préférera un remaniement du Cabinet à une dissolution.
Je ne pense guère à tout cela; d’abord, parce que je pense à autre chose, ensuite, parce que rien ne me déplaît tant que de penser à vide, et quand il n’y a rien à faire. La bavardage vain est la maladie de notre temps et de notre forme de gouvernement. L’esprit s’y hébète et la volonté s’y énerve. Vienne le moment d’agir ; je penserai alors. Jusque là, je veux jouir de ma liberté et n’appartenir qu’à moi-même, pour me donner à mon choix. Mais quand ce choix est fait on ne s’en dédit plus. C’est ce que dit Pompée à Sertorin dans les beaux vers, de Corneille. Je suis de l’avis de Pompée. Adieu dearest Princess. Pour la première fois depuis bien des jours, je vous ai écrit la cœur un peu à l’aise. Mais cette aise a encore besoin de confirmation. G.
Je ne sais ce qu’il y a de vrai dans les bruits de journaux sur l’état grave de M de Talleyrand. Je vais écrire à la duchesse de Dino. Vous pensez bien que je n’ai par remis votre lettre à Mad. de Meulan.)
Vendredi, 10 h. Je n’ai pas de lettre ce matin. J’en attendais pourtant. Jusqu’à ce que je sois pleinement rassuré sur votre santé, je n’aurai aucun repos.
13. Val-Richer, Samedi 29 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est mon tour d’attendre et de me désoler en attendant. Pas de lettre encore ce matin. Je m’étais levé en disposition si confiante, si douce ! Il y a deux mois, je n’éprouvais point de vicissitudes, pareilles. Je n’attendais rien. Avec quelle promptitude, avec qu’elle vivacité j’ai recommencé à vivre ! Car c’est là vraiment la vie. Nous nous connaissons à peine, Madame; nous nous sommes entrevus. Je sais bien qu’en un jour en une heure, nous en avons plus appris l’un sur l’autre que tant de gens n’en apprennent à passer leur vie ensemble. Tout ce que nous ne savons pas, tout ce que nous ne nous sommes pas dit, nous le pressentons ; et au moment où nous nous le dirons, il nous semblera que nous l’avions toujours su, que nous nous l’étions dit mille fois. Cependant il est étrange de se sentir si intimement uni à une personne qu’on a vue, qui vous a vu quinze jours.
Si ma vie extérieure, et ma vie intérieure étaient bien semblables, j’aurais moins ce sentiment là ; je pourrais me croire plus connu de vous. Mais, à la voir du dehors j’ai mené une vie toute d’action, toute vouée au public, qui a dû, qui doit paraître surtout ambitieuse, personnelle, presque sévère. Et en effet j’ai pris et je prends à ce qui m’a occupé aux études, aux Affaires, aux luttes politiques un grand, très grand intérêt. Je m’y suis adonné, je m’y adonne avec grand plaisir comme à un emploi naturel et satisfaisant de moi-même. J’y désire vivement l’éclat et le succès. Et les douloureuses épreuves que Dieu ma fait subir n’ont point changé en cela ma disposition, ni mon goût. Aux jours mêmes de l’épreuve je ne me suis point senti indifférent aux incidents de ma vie publique ; et tout en en portant le poids avec le plus pénible effort, j’y ai toujours trouvé une diversion puissante et librement acceptée. Et pourtant, j’ai le droit de le dire après ce que je dis là et pourtant là n’est point du tout, là n’a jamais été ma véritable vie ; de là je n’ai jamais reçu aucune émotion, aucune satisfaction qui atteignit jusqu’au fond de mon âme ; de là ne m’est jamais venu le sentiment du bonheur. Le bonheur, Madame, le bonheur qui pénètre partout, dans l’âme, qui la remplit et l’assouvit tout entière est quelque chose de bien étranger de bien supérieur à tout ce que la vie publique peut donner. Au delà bien au delà de tous les désirs d’ambition et de gloire, de tous les plaisirs de domination, de lutte, d’amour propre et succès, il y a un désir, il y a un plaisir qui a toujours été pour moi le premier, tellement le premier que j’aurais droit de le dire le seul ; le désir, le plaisir d’une affection infinie, parfaitement égale de cette affection qui unit et confond deux créatures de cœur, d’esprit, de volonté, de goût, qui permet à l’âme de se répandre dans une autre âme comme la lumière dans l’espace, sans obstacle, sans limite, et suscite dans l’une et l’autre toutes les émotions, tous les développements dont elles sont capables, pour leur ouvrir autant de sources de sympathie, et de joie.
Vous êtes-vous jamais figurée, Madame, vous qui sentez si vivement la musique, vous êtes-vous jamais figuré quel serait le ravissement de deux harpes bien harmonieuses & jouant toujours ensemble, si elles avaient la conscience d’elles-mêmes et de leurs accords ? Voilà le bonheur, voilà le seul sentiment, le seul état auquel je donne ce nom. Eh bien madame, j’ai cru entrevoir que vous aussi, vous étiez de même nature, que pour vous aussi, les préoccupations et les intérêts extérieurs, politiques, quelle qu’eût été leur part dans votre vie, ne suffisaient point à votre âme, que vous y trouviez un bel emploi de votre esprit si actif, si élevé, si fin ; mais que vous aviez en vous bien plus de richesses que vous n’en pouviez dépenser là, et des richesses, qui ne se dépensent point à cet emploi-là. En sorte que vous m’avez apparu comme une personne qui comprendrait et accueillerait en moi ce qui se montre et ce qui se cache, ce qui est pour le monde et ce qui est pour une seule personne au monde. Voilà par où Madame vous avez eu pour moi tant d’attrait ; voilà pourquoi d’instinct comme de choix, je me suis engagé si avant et si vite dans une relation si nouvelle. Je ne me suis point trompé, je ne me trompe point n’est-ce pas ? Ni vous non plus ? Nous sommes bien réellement tels que nous nous voyons ? J’en suis sûr, très sûr ; mais à chaque nouveau gage de certitude, à chaque fait, à chaque parole qui vous révèle de nouveau à moi telle que je vous sais à chaque pas de plus que je fais dans un si beau et si doux chemin, je suis ravi comme si je découvrais de nouveau mon trésor. Que vos lettres m’arrivent donc ; il ne m’en est pas venue une seule qui n’ait ajouté à ma foi, et à ma joie. Dimanche, 1 heure. La poste n’arrive pas. D’après les arrangements que j’ai pris elle doit être ici tous les jours, à 10 heures.
Décidément les champs, les bois, les lieux solitaires, tout cela ne vaut rien ; tout cela jette dans les relations une irrégularité, une incertitude que rien ne peut compenser. A Paris tout est ponctuel, assuré. A Paris j’aurais votre lettre depuis plus de trois heures. Car j’en aurai une aujourd’hui. J’y compte. Je vais demain mener ma mère et mes enfants aux bains de mer à Trouville. J’en reviendrai le surlendemain par Caen où l’on veut me donner un banquet. Il y aura encore là des dérangements, des retards.
Quel ennui ! Madame il ne faut par se séparer. Demain, je serai au bord de cette mer qui nous sépare. Mes regards, ma pensée, s’élanceront à l’horizon, vers l’autre bord. C’est là que vous êtes, là que je vous trouverais. Je ne puis m’accoutumer à l’impuissance, humaine, à ce perpétuel et vain effort de la volonté contre des obstacles qu’après tout, si elle voulait bien presque toujours elle pourrait surmonter. Mais les impossibilités morales, les convenances, les liens, les devoirs ! Madame, il me faut une lettre.
4 heures La voilà, et je n’en ai jamais reçu une qui valut celle-là. Vous revenez plutôt, bien plutôt ! Je me tais, je me tais. Mais c’est le N°14 qui vient de m’arriver. Je n’ai pas eu le n° 13. C’est ce qui m’explique le retard. Je l’aurai probablement demain. Je n’en veux perdre aucune. Je vois que vous avez eu mon N°6 car cette lettre-ci porte l’adresse que je vous y donnais.
Adieu adieu. Que l’air est doux et léger ! G.
15. Caen, Mardi 1er août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai bien peur que vous ne m’ayez averti trop tard et que ma lettre ne vous trouve plus à Boulogne. J’ai bien peur ! Qu’est- ce que je dis là ? Si vous n’êtes plus à Boulogne, vous serez à Paris. Cela est vrai ; cependant je voudrais que vous me trouvassiez à Boulogne. Je voudrais être le premier à vous parler, en France. Mais dans le n°15, il y a sur votre santé, des paroles qui me font frémir. Je ne serai un peu tranquille que quand j’aurai vu, bien vu. J’irai voir dès que vous serez arrivée. En attendant, je vous écrirai demain à Paris. Je suis ici pour trois jours. J’étais ce matin au bord de la mer à Trouville. Mais l’autre, rive ne m’attirait presque plus. Que j’aurais voulu me promener avec vous sur la rive où j’étais ! Chaque fois que je revois la mer, c’est un monde nouveau que je découvre ; et je ne découvre plus un monde nouveau sans vous y chercher, ou vous y mettre. Mais je ne veux pas que vous soyez malade.
11 h 1/2 du soir J’ai été interrompu par je ne sais combien de visites, et je sors un moment du salon, qui en est encore plein, pour vous dire adieu et donner ma lettre qui partira de grand matin.
Adieu donc. Adieu sur la terre de France. Je vous l’ai déjà dit; il y a des moments en bien comme en mal, où il faut se taire, se taire absolument. L’insuffisance de la parole est trop évidente. G.
16. Val-Richer, Samedi 5 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.
Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.
J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.
2 heures
Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !
On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.
17. Val-Richer, Lundi 7 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous ne voulez pas que j’aille vous voir tout de suite. Je ne ferai que ce que vous voudrez. Mais le mécompte est grand. Je voulais partir après demain Mercredi soir, pour être à Paris, jeudi matin. J’ai un dîner obligé à Lisieux le Mercredi 16 août. Si je ne vais pas vous voir cette semaine comme je ne veux pas ne rester à Paris que 24 heures, je ne pourrai y aller que vers la fin de la semaine prochaine. Je partirais le jeudi 17 et je vous verrais le 18. Serez-vous reposée? Je trouverais, je vous assure, des conversations qui vous reposeraient mieux que votre solitude. Onze jours encore avant de savoir, de voir par moi-même comment vous êtes que c’est long ! Je sais que je suis ingrat, que c’est déjà un bien immense de vous avoir à 45 lieues, dans ma France, sans abyme ni tempête entre nous. Mais que voulez-vous?
En fait de bonheur, je n’impose point de limite à mes vœux. J’aime mieux souffrir de la privation qu’abaisser mon ambition. Réglons au moins tout de suite mon voyage. Que je puisse penser au jour précis à l’heure. Je n’ai jamais trouvé que l’attente usât la joie ; bien au contraire; le bonheur prévu mesuré, sondé d’avance à toujours surpassé mon espoir. J’entends le vrai bonheur. On parle d’imagination, d’idéal. Sans doute le train ordinaire de la vie est fort au dessous des rêves de l’âme ; mais le vrai bonheur, quand il apparaît, laisse loin, bien loin en arrière toute imagination humaine et il n’y a point de si bel idéal qui approche de la belle réalité. Que si je tarde à vous voir, au moins je vous trouve effectivement reposée. Ce que vous me dîtes pour me rassurer ne me suffit point.
Je n’ai jamais beaucoup compté sur votre séjour en Angleterre pour votre rétablissement. Je savais bien que tant de monde et de bruit vous fatiguerait. Mais ces déplorables agitations ont encore tout empiré, & vous revenez moins bien que vous n’étiez partie. Que je suis pressé d’y aller voir ! Vous ne savez pas à quel point mon imagination est malade sur la santé de ce que j’aime. C’est là le point, le seul peut-être, sur lequel m’a raison soit absolument sans pouvoir. Mon seul remède, c’est que je le sais.
4 heures J’ai fait hier jour de grande fête, et quête religieuse dans mon village un dîner bien différent de votre dîner chez le Duc de Devonshire. J’ai dîné chez mon curé avec un jeune prêtre des environs, le maire, l’adjoint un petit bourgeois, sa femme, sa fille et deux paysans. Ce dîner là était une grande affaire délibérée pendant huit jours et pour laquelle on était venu processionnellement nous inviter. Mad. de Meulan et moi, après s’être assuré de notre consentement. Nous sommes arrivés à travers. champs dans la cour, je devrais dire dans la basse-cour d’un cottage vieux, délabré où loge le curé en attendant la Construction d’un presbytère. Personne pour nous recevoir; on était encore à Vêpres. Mais en revanche, je ne sais combien de chiens, de cochons, de poules, d’oies, de camards, aboyant, grognant, criant, courant, barbotant dans deux ou trois pièces d’eau pleines de de boue ; là et là des charrettes brisées, des fagots déliés, des briques et des pierres entassées pèle-mêle, tout le bagage d’une forme mal tenue par de pauvres laboureurs. Et tout à l’entour le pays le le plus riant qui se puisse voir ; de vastes près bien frais couverts, de ces bœufs énormes, tranquilles, qui semblent le type de la force au repos ; de beaux arbres, des chênes, des hêtres, des pommiers, des pins, des mélèzes mariant leurs formes et leurs teintes si variées ; l’eau de ces marres stagnantes et sales courant à vingt pas de là, claire, pure rapide. Toutes les grâces de la nature, à côté de toutes les grossièretés de l’homme.
On est enfin revenu de Vêpres ; nous avons dîné. Tout ce monde tendu, mal à l’aise, obséquieux, tour à tour silencieux ou bavard, excepté deux, le Curé, bon prêtre sans embarras dans sa gaucherie, et le Maire ancien soldat, huit ans grenadier à cheval et sous officier dans la garde impériale, maintien grave, œil fixe et doux se taisant sans sauvagerie parlant sans vanité. Au bout d’une heure, à la fin du dîner, après quelques verres de vin de champagne car on en boit là, je suis parvenu à les mettre à l’aise et même un peu en train. Tout naturellement le dez de la conversation est tombé aux mains du vieux soldat ; et depuis la campagne de Russie jusqu’à la bataille de Waterloo, il s’est raconté lui-même sans esprit mais non sans intérêt, tour à tour bonhomme et fanatique, intelligent et crédule, enthousiaste et désabusé, ému et apathique, méprisant la paix, mais jouissant beaucoup du repos, ami de l’ordre respectueux, et disant de moi, pour témoigner l’estime qu’il me porte que les mauvais sujets de toute la France me craignent, comme il est craint, lui de ceux de St Ouen. A huit heures et demie, on nous a reconduits jusqu’au Val-Richer. Je donnerai des matériaux pour la construction du presbytère, et je suis très populaire dans St Ouen, dont je vous raconte les histoires. Je voudrais trouver ce qui peut vous divertir et vous reposer.
10 heures du soir.
Je ferme ma lettre pour la donner à un homme à moi qui va demain de grand matin, à Lisieux. Vous l’aurez ainsi un jour plutôt. Les lettres de Paris m’arrivent ici, le lendemain, de 9h. à midi. Celles qui partent du Val-Richer ne sont à Paris que le surlendemain. J’espère que vous m’aurez écrit d’Abbeville ou de Beauvais. Vous devez être à Paris demain. Adieu Adieu, sans aucun doute cet adieu là va moins loin et pèse moins sur le cœur. Il y a quelque chose de mieux pourtant, d’infiniment mieux.
18. Val-Richer, Mardi 8 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous arrivez aujourd’hui à Paris. Peut-être y êtes vous déjà, car de Beauvais à Paris il n’y a que huit postes et demie. Vous y devez trouver je ne sais combien de lettres, les N°11, 12, 13 d’ici, 15 de Caen et 16 d’ici. J’ai reçu ce matin votre dernier mot de Boulogne, N°18.
Je ne vous réponds pas sur le sujet dont vous me parlez. Nous en causerons en pleine liberté. Il n’y a pas un de vos sentiments que je ne comprenne et qui ne me plaise dans le sens le plus intime et le plus sérieux de ce mot, si souvent profané. Gardez-les tous dearest ; ce sont des notes justes, l’harmonie s’y mettra. Que seulement le calme physique vous revienne. Je suis sûr que si vous vous portiez bien vous ne seriez pas en proie à ces troubles dont vous vous plaignez. Vous avez le jugement si droit l’esprit si haut et si fin que certainement, quand l’état de vos nerfs n’y fait pas obstacle vous savez voir toutes choses, choses et personnes, comme elles sont, mettre chacune à sa place, en vous-même comme au dehors, choisir décidément ce qui est vrai, juste, ce qui vous convient, et accepter, dans votre choix, les inconvénients, les difficultés, les peines même la part de mal enfin, inséparables de toute résolution. comme de toute situation humaine. Vous voulez que je vous apprenne à être calme. Je ne sais pas un si beau secret. Mais si j’ai un peu de calme, c’est que pour mes sentiments aussi bien que pour mes actions, dans ma vie intérieure comme dans ma vie extérieure, j’ai assez de prévoyance et peu d’irrésolution. Quand quelque chose commence en moi ou autour de moi, j’en vois promptement et d’un coup d’œil assez libre toutes les faces, toutes les conséquences. Si j’accepte, j’accepte sans hésitation sans retour le bien et le mal, la joie et la peine, l’avantage et l’embarras, le mérite et le tort même, s’il y en a. Et dans la suite, à mesure que les choses se développent et portent leurs fruits, bons ou mauvais, je ne suis pas plus incertain qu’au début. Je ne connais guère le regret ni le repentir. Je veux ce que j’ai voulu ; je me tiens à ce que j’ai fait. Je n’ai point la prétention que ma vie soit sans souffrances et ma conduite sans fautes. Je porte le poids des unes et la responsabilité des autres sans m’en plaindre, sans en déplacer les causes, car ces causes, je les ai en général connues et voulues. En général, dans chacun de mes sentiments, de mes actes, je pressens leur avenir et j’y consens. Et s’il m’arrive, comme il m’arrive en effet de n’avoir pas tout prévu, je ne m’en prends qu’à mon insuffisance et j’y consens encore ; car à tout prendre, en fait d’intelligence et de sagacité, je n’ai point droit de me plaindre de la part que Dieu m’a faite. En tout, je suis soumis, Madame, soumis aux imperfections de la condition humaine à mes propres imperfections aux volontés de Dieu, à mes propres volontés. Je ne me révolte point; je ne me tracasse point ; je ne délibère point à chaque minute, je ne tâtonne point à choque pas. Je veux surtout de l’unité dans mon âme et dans ma vie, et pourvu que l’ensemble me convienne, je ne marchande pas sur les détails. Quelle est, dans cette disposition la part de mon naturel et celle de ma volonté ? Je l’ignore ; mais si j’ai quelque sérénité, voilà à quoi elle tient.
Vous êtes femme, dearest, et par conséquent, un peu plus mobile, un peu plus accessible que moi à l’empire des impressions du moment. Mais vous avez beaucoup d’esprit, de raison, de courage, de dédain. Vous allez naturellement à tout ce qui est grand, simple. Soyez sûre qu’avec un peu de santé et d’habitude, il vous viendrait... laissez-moi dire il vous viendra du calme. J’ai du bien à vous faire, comme du bonheur, à vous donner. Vous me dîtes que je vous ai aidée à supporter vos peines. Je vous aiderai à vous affranchir de ces troubles intérieurs, de ces incertitudes de ces luttes répétées où l’âme se lasse et perd sa force la force dont elle a besoin, et pour résister, et pour jouir. Que je serais heureux de voir la sérénité se répandre sur votre noble physionomie, et de goûter le charme infini de votre affection. sans crainte qu’elle vous fasse mal !
Je voulais vous parler des élections anglaises qui prennent, ce me semble, un tour bien conservateur. Mais je n’y ai plus pensé. A demain les affaires. Adieu. Vous ne vous figurez pas ou plutôt vous vous figurez bien avec quelle impatiente j’attends votre première lettre de Paris. G.
Mercredi 10h.
Je reçois à présent même votre N°19 de Paris. Au nom de Dieu, calmez-vous, soignez vous. Que la fatigue du voyage, de l’absence, de la mer disparaisse. Je me charge du reste. J’attends votre réponse à ma proposition pour la semaine prochaine. Les N°12 et 18 vous ont été adressés à Londres. Le N°15 à Boulogne, porte restante- il était écrit de Caen. Le N°17 vous a été adressé à l’hôtel Bristol.
19. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Comment passerez-vous votre temps ? J’en suis préoccupé. L’ennui vous gagne aisément. Il y a bien peu de monde à Paris. En Angleterre. vous aviez trop d’amis, trop de conversations. Je crains qu’en France il ne vous en manque. Contez-moi en détail votre journée. Quoique j’espère aller bientôt y regarder moi-même, je veux savoir tout de suite ce qui en est. Vous n’avez pas contre l’ennui les ressources d’un homme, des affaires à soigner, le travail, l’étude. Je voudrais vous indiquer quelque chose d’intéressant à lire. Savez-vous lire, lire de manière à remplir quelques heures dans votre journée? J’ai peur que non. Votre vie s’est passée dans les relations de personne à personne, à voir, à causer, à écrire. Les grandes affaires, vous les avez traitées comme on traite les petites en conversation, en visite, en correspondance dans le train ordinaire de la vie. C’est de beaucoup la manière la plus amusante, et aussi la plus naturelle, et peut-être aussi la plus efficace. Vous y avez acquis, c’est-à-dire développé cette admirable intelligence des personnes, des caractères, cette disposition sympathique qui n’enlève point a votre esprit son indépendance, cette pénétration soudaine qui fait qu’avec vous rien ne se perd, que tout a un sens pour vous, que la moindre parole vous dit tout, que les éclairs les plus fugitifs de la physionomie ou de la pensée frappent vos yeux et vous illuminent comme serait le plus grand jour. Tout cela est exquis charmant et quand je suis après de vous, j’en jouis avec délice. Mais quand vous êtes seule que faites-vous de tout cela ? Vous souffrez de vos qualités de votre supériorité. Elles n’ont pas leur emploi accoutumé et il est difficile de leur en trouver un autre. Enfin dites-moi le compte de vos heures. Avez-vous jamais lu mes deux volumes sur l’histoire de la Révolution d’Angleterre jusqu’à la mort de Charles 1er ? Si vous ne les avez pas lus, je vous les ferai porter Je crois que c’est vrai, et assez vivant. J’ai recommencé ici à m’occuper de l’époque qui suit, du gouvernement de Cromwell. Les Anglais à mon avis ne comprennent pas ce temps-là, surtout les hommes, leurs idées, leurs passions, leurs intérêts, et l’amalgame étrange l’action et la réaction continuelle de ces trois causes l’une sur l’autre dans leur conduite et dans leur âme. C’est peut-être une fatuité de ma part ; mais je crois qu’il faut avoir vu & presque fait une révolution pour en comprendre une autre. 10 h. 1/2. Voilà le facteur qui m’apporte votre n° 20 et qui repart sur le champs. Il faut que je lui donne ma lettre. Vous êtes donc un peu mieux, et je vous verrai le 18. Et que votre lettre est bonne, charmante. J’y répondrai demain. Ne vous inquiétez pas de moi. Je me porte et je me porterai à merveille. Soignez- vous, soignez vous. Que je vous trouve un peu moins faible, un peu moins lasse. J’en ai tant d’envie ! Que tous les mots sont faibles ! Adieu. Adieu. Je ne comprends pas que vous n’ayez pas les N°12, 13 et 15. Les deux premiers ont été envoyés à Londres. Le troisième à Boulogne, poste restante. Il faut l’y faire redemander.
20. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.
Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?
Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.
Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.
Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.
Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.
Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.
21. Val-Richer, Vendredi 11 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ne me redites pas, ne me dites jamais ce que vous me dites aujourd’hui ce que Lady Granville vous a dit, ne vous disais-je pas moi, il y a quelques jours, que j’ai l’imagination malade sur la santé de ce que j’aime ? Mon plus jeune enfant ce bon petit garçon, qui un air si doux, si gai, de si beaux yeux bleus, presque les yeux de sa mère, que de temps, il m’a fallu pour le regarder sans le plus douloureux sentiment d’indignation, de révolte contre moi-même ! Voir mourir en couches la femme qu’on aime ! Madame, c’est affreux, c’est abominable ! Comment s’en console-t-on ? Quand j’ai vu ensuite mourir mon fils, si jeune, si beau, si fort, j’ai été saisi d’horreur ; j’ai regardé avec effroi mes autres enfants tout ce que j’aimais au monde ; dix fois, vingt fois, je les ai vus mourir. Vous avez fait rentrer dans mon cœur d’autres impressions, des impressions douces, heureuses, presque confiantes. Et voilà que d’un mot vous touchez à ma plus sécrète, à ma plus cruelle blessure ! Dieu m’aurait destiné à entrevoir sans cesse ses Chefs-d’œuvre, son Paradis, pour les voir, sans cesse disparaître. Il m’aurait choisi pour ce supplice là ! Il ne me donnerait que pour m’ôter ! Cela ne se peut pas. Je n’ai pas mérité cette malédiction.
Au nom de Dieu ne me dites pas cela, ne le pensez pas surtout. Il y a des choses qu’il ne faut pas penser. Mais vous ne le pensez pas. Pourquoi le penseriez- vous ? On vous assure, vous m’assurez qu’il n’y a rien de grave. On ne vous prescrit aucun remède qui indique une vraie maladie. Il vous faut du repos, beaucoup de repos, de l’air, pas de mouvement. On peut s’assurer cela. Enfin, dans huit jours, j’irai y voir. Hélas, je sais trop qu’il ne sert à rien d’y voir ! Mais je compte sur le repos, le repos doux, prolongé de l’âme comme du corps. Il faut que vous l’ayez. Je veux que vous l’ayez. Je ferai ce qu’il faudra pour que vous l’ayez. Je m’en irai, je resterai, je parlerai, je me tairai. Je comprends que ce qui vous émeut, ce qui vous occupe un peu sérieusement ne vous vaille rien. Nous y pourvoirons de près, de loin, dans nos conversations, dans mes lettres, je ne ferai que vous distraire rien que vous distraire, amuser doucement votre imagination, votre esprit. L’ennui ne vous est pas meilleur que l’excitation. Nous les éviterons l’un et l’autre. Dearest, ayez courage, ayez confiance, pour moi comme pour vous. Pensez à l’avenir. Nous avons tant de choses à nous dire, tant de choses à faire l’un pour l’autre, l’un près de l’autre dans l’avenir !
En les attendant ces belles ces bonnes choses-là, savez-vous ce que je fais ici aujourd’hui ? Je fais nettoyer, dégager de roseaux, de plantes aquatiques, de vase, une pièce d’eau qui sera dans mon jardin et sur laquelle je vais établir deux cygnes qu’un de mes voisins à élevés pour moi. Des cygnes ce sont des oiseaux de votre pays, des pays du Nord, s’il est vrai que là soit votre pays. Dans les grands hivers, quand ces beaux oiseaux trouvent en fin leur climat trop froid, ils prennent leur vol, ils viennent chez nous. J’en ai vu arriver ainsi à tire d’aile un peu fatigués, un peu maigris, mais toujours si beaux ! Nous les accueillons nous les attirons ; nous leur arrangeons, des pièces d’eau bien calme, bien pure, sous un ciel bien doux, au milieu de gazons bien verts. Ils s’y trouvent bien ; ils ne s’en vont plus; ils ne volent même jamais bien loin. Ils ont raison; et nous aussi Madame, qui prenons, à les recevoir et à les garder, tant de plaisir. Certainement, je vous écrirai, je vous écris tous les jours.
Rappelez-vous que je vous ai demandé compte de l’emploi de votre journée, un vrai compte pour moi comme celui que je vous ai rendu de la mienne. Il y aura dans le vôtre, sinon plus de visites, du moins plus de conversations que dans le mien. Je ne cause ici avec personne, quoique je parle beaucoup et à beaucoup de gens. Vous me ferez aimer Lady Granville que je connais à peine après l’avoir tant lue. Comment se fait-il qu’on se demeure à ce point étrangers en vivant si près ; tandis qu’ailleurs un moment suffit ? J’ai tort de demander ce pourquoi-là, car je le sais.
Adieu. On vient me chercher pour voir quelque chose au travail de la pièce d’eau. Il est bien convenu que je partirai le 17 pour être à Paris le 18. Vous m’écrirez donc jusqu’au 16 inclusivement, car votre lettre du 16, je l’aurai le 17, avant de partir. G.
22. Val-Richer, Samedi 12 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Savez-vous qu’elle joie vous me donnez quand vous me dîtes que mes lettres vous font un peu de bien ? Je vous ai constamment devant les yeux, souffrante, abattue, agitée. Je voudrais être constamment là, verser à chaque minute du baume dans votre âme, dans vos nerfs. Ils m’embarrassent vos nerfs. J’ai envie de leur en vouloir, et je ne peux pas. Vous leur devez peut-être cette susceptibilité, cette rapidité, cette finesse d’impressions qui s’allient si bien à l’élévation de votre esprit, au sérieux de votre air, de toute votre manière. Guérissez vos nerfs, Madame, mais restez comme vous êtes. N’y changez rien, je vous en conjure. Je ne veux supprimer en vous que la souffrance. Je ne vous donnerais plus de conseils, s’ils devaient vous induire à changer en vous quelque chose.
Quand je vous ai vue pour la première fois, vous m’avez frappé comme une personne nouvelle pour moi, et pourtant sur le champ comprise, parfaitement comprise. Ce qui s’est tout à coup rêvée à moi, c’est la grandeur de votre nature. Avec votre accent si ému, votre regard si triste, vous conserviez si évidemment toute la liberté, toute la fierté de votre pensée. Vous aviez l’air de regarder d’en haut, de toiser pour ainsi dire, les idées les personnes, à mesure qu’elles passaient devant vous. Il y avait dans votre physionomie, dans votre maintien dans votre langage tant de dignité, d’indépendance, et en même temps un tel besoin. D’être soulagée soutenue ! Pendant le dîner, je ne sais ce que je vous disais, vous vous êtes penchée une ou deux fois vers moi, comme entrevoyant et venant chercher dans mes paroles quelque chose qui vous était doux ; et à l’instant même, vous vous êtes relevée et détournée, comme vous repliant sur vous-même et doutant qu’il pût vous venir du dehors, d’un inconnu, quelque distraction. Je crois vous avoir déjà dit qu’il m’était resté de ce premier jour, une impression profonde. Et elle était juste ; ce que je connais en vous aujourd’hui, je l’ai entrevu ce jour là une grande âme qui ne peut vivre seule. Je ne sache rien de comparable à ce double attrait.
5. h. 1/2 Je viens de lire mes journaux. Je trouve le discours de Sir Robert Peel, un peu trop empreint, vers la fin, des habitudes d’opposition. Il reproche bien amèrement aux Ministres, l’emploi qu’ils ont fait du nom de la Reine. Faut-il appliquer le mot impudeur à des hommes dont on est si près de se rapprocher ? Peut-être les mœurs anglaises sont-elles en ce genre moins susceptibles que les nôtres. Du reste le discours est excellent et très frappant. Nous verrons à l’œuvre la Sagesse des deux côtés. Je suis charmé que vous ayez si bien fomenté, celle de Lord Melbourne. Si les conservateurs de France ont autant de persévérance et de zèle que ceux d’Angleterre, la dissolution, nous sera très bonne. Je ne crains, pour eux, que le découragement et le laisser aller. La grande infériorité dès honnêtes gens c’est qu’ils ne savent pas se lever aussi matin que les brouillons. S’ils avaient comme ceux-ci, le Diable au corps, ils gagneraient toutes les batailles.
Dans le n° 15, je crois, je vous avais dit un mot de mon meeting de Caen ; un seul mot, pour vous dire que cela ne valait pas la peine d’en écrire. J’espère que ce N° vous reviendra enfin, et aussi les N°12 et 13 qui sont partis de Lisieux pour Londres le 29 juillet et le 1er août. Vous devriez les avoir depuis longtemps. Dimanche 7 h 1/2 J’ai été interrompu hier par toutes sortes de visites, d’abord je ne sais combien de voisins qui se sont abattus chez moi comme une volée de pigeons, puis le Duc Decazes qui va à Bordeaux, et s’est détourné de 20 ou 30 lieues pour venir me dire pas grand chose.
Ce matin toute ma vallée est enveloppée d’un immense brouillard qui va, vient, monté, descend. Il essaie de se défendre contre le soleil que j’entrevois à l’horizon, en face de moi. Ce n’est encore qu’un point rougeâtre à chaque instant surmonté, voilé par le brouillard. Mais ce point, c’est la chaleur, c’est la lumière. Le brouillard sera vaincu, dispersé, chassé. Dans quelques heures mon ciel sera pur, ma vallée brillante. Plût à Dieu que ce fût toujours là l’image de la vie !
23. Val-Richer, Dimanche 13 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est vrai ; je crains de vous agiter. J’y pense sans cesse en vous écrivant. Je voudrais n’employer avec vous que des paroles, si douces, si douces, de ces paroles qui bercent l’âme et l’apaisent, en lui plaisant sans l’émouvoir. Vous m’avez témoigné, en arrivant à Paris, tant d’effroi à l’idée du trouble qui vous saisirait si j’allais vous voir sur le champ, vous m’avez demandé avec une anxiété si douloureuse, de vous laisser le temps de vous reposer, de vous calmer que je suis moi-même plein de trouble et d’anxiété sur tout ce qui va à vous même de ma part, et constamment préoccupé d’éviter ce qui pourrait vous causer le moindre ébranlement.
Vos lettres d’hier et d’aujourd’hui (N° 22 et 23) me rassurent, un peu. J’en trouve le ton plus tranquille, plus fermé. Cependant j’hésite encore ; je retiens encore mon cœur, ma voix. Je sais tout ce qu’il faut retrancher aux paroles humaines, et combien elles exagèrent en général les faits ou les sentiments qu’elles expriment. Mais avec vous, dearest, je prends tout au pied de la lettre, loin de rien retrancher, j’ajoute. Je crois plus que vous ne me dîtes. Vous ne savez pas tout ce que je vois dans une phrase de vous. J’y vois non seulement ce qu’il y a mais tout ce qu’il y avait en vous au moment où vous l’avez écrite, si votre main tremblait, si votre cœur battait, si vos regards étaient troublés ou sereins, votre contenance animée ou abattue. Et sans y songer, par instinct, je réponds moins à ce que vous me dites qu’à ce que j’ai vu dans votre écriture, dans vos paroles ; en sorte que je réponds peut-être à une impression, très fugitive à un nuage sur votre front à un frisson dans vos nerfs.
Ah l’absence. l’absence ! Madame, la moins lointaine est toujours l’absence avec tous ses vides, tous ses ennuis ! Je vous aime pourtant infiniment mieux à Paris qu’à Londres, Dussé-je ne pas aller vous y voir. Et j’irai cette semaine ; et vendredi, à une heure, je serai hôtel de la Terrasse dans le cabinet devant la fenêtre duquel je me suis tant promène le vendredi soir 30 Juin ! Que vous avez bien fait de vous y rétablir.
10 heures 1/2 du soir
Je vous ai dit que ceci était mon heure mon heure à moi. Tant que le jour dure, quoi qu’on fasse, on appartient un peu aux autres. Les autres dorment. Mes fenêtres sont ouvertes. Il n’y a pas plus de mouvement, pas plus de bruit dans la campagne que dans ma maison. Rien ne vit plus excepté la lune qui regarde tout dormir, et moi qui pense à vous. C’est une étrange impression qu’une joie qui commence et ne s’achève pas, un flot de bonheur qui monte dans l’âme et retombe sur elle ne trouvant pas où se répandre. Le ciel est si pur, l’air si doux, la lune si claire, la vallée si tranquille ! Que je jouirais de tout cela, si vous étiez là ! Mais vous n’y êtes pas. Cet autre soir quand nous sommes revenus de Châtenay, j’étais près de vous ; je vous parlais, vous me parliez. Je n’ai pas regardé le ciel, la lune, la vallée. Je ne leur ai pas demandé de compléter ma joie. Elle était complète, immense. Et tout cela, n’y entrait pour rien, et je n’avais besoin de rien, & cette boite où nous roulions ensemble était pour moi toute la nature. Ne retournerons-nous jamais à Châtenay ?
Lundi 8 heures 1/2
Vous me demandez d’être toujours pour vous ce que j’étais en vous écrivant les N°12 et 13. Dearest, j’ai éprouvé bien rarement en ma vie les sentiments que ces lettres-là vous expriment sans doute, comme toutes les autres ; mais quand ces sentiments sont nés en moi, ils n’ont jamais changé, jamais faiblis. La cause en est si rare, l’effet si puissant et si doux ! Je suis, en fait d’affection et de bonheur mille fois plus difficile que je ne le puis dire. J’y veux, j’y veux instinctivement, absolument des conditions que Dieu ne réunit guère. Et quand il lui a plu, quand il lui plaît de ne traiter avec cette faveur immense, je vivrais mille ans sans épuiser son bienfait. Ceci est la dernière lettre à laquelle vous répondrez. Elle vous arrivera Mercredi, et j’aurai votre réponse. Jeudi à Lisieux où je la prendrai avant de partir pour Paris. Quelle parole! Adieu. Adieu. G.
24. Val-Richer, Lundi 14 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci est mon dernier mot. Vous l’aurez jeudi. Vendredi, j’apporterai moi-même ma lettre. Que celle de ce matin, m'a fait plaisir ! Elle est calme, gaie. Certainement vous êtes mieux. Savez-vous ce qui me trouble avec vous, quant à votre santé ? Vous avez besoin, je crois, d’en être distraite, de porter votre imagination ailleurs. J’hésite donc à vous en parler. Et pourtant ! Et puis à part la contrainte, il y a, dans cette réticence, dans le soin de détourner vos pensées en retenant les miennes, un arrangement une petite supercherie qui me déplaît.
J’ai besoin de laisser librement, aller près de vous mon esprit, mon cœur, ma parole, ma vie. Il m’en coûterait infiniment de vous tromper tant soit peu, même pour vous servir. Je le ferais cependant si votre santé y était intéressée. Qu’elle ne le soit pas Madame; que je puisse vous parler de tout, vous tout montrer, vous tout dire ! Nous nous sommes en effet écrit très peu de nouvelles. Nous les avons peut-être réservées pour le moment où nous serons ensemble.
Y a-t-il des nouvelles aujourd’hui du reste ? Toutes choses sont si prévues qu’on n’en parle plus quand elles arrivent. Savez-vous ce que c’est que l’escompte en fait d’argent ? On escompte tous les événements. Tout se passe tout se fait d’avance. Les élections anglaises finissent à peine. Leurs résultats n’ont pas encore commencé. On n’y pense déjà plus. Les nôtres se préparent. On en a déjà tant parlé, on en parlera tant d’ici à quelques jours, qu’on y arrivera blasé, épuisé. C’est une vraie maladie que ce long bavardage préalable, et une maladie sans remède, car elle est dans nos institutions, dans nos mœurs. Que deviendraient des jeunes gens qui disserteraient, bavarderaient, rêvasseraient, écrivailleraient sur l’amour bien avant de l’éprouver avant de voir une femme ? J’aime que la pensée et l’action, le dire et le faire se suivent de plus près et se lient plus intimement. Je suis sûr que l’un et l’autre s’en trouvent mieux.
Mardi 9 heures
Je me suis levé tard ce matin, et voilà l’homme de la poste qui arrive plutôt. Il faut que je lui donne ma lettre ! J’ai moins de regret qu’elle soit courte. J’y supplierai vendredi. Je lis en courant votre n°25. N’ayez plus de chagrin de mon chagrin. Il est passé puisque vous me rassurez, puisque d’ici déjà je vous vois mieux. Vendredi! Point d’adieu. G.
25. Lisieux, Samedi 26 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’arrive et je repars dans une demi-heure. Je suis un peu fatiguée ; non d’avoir couru la poste, non de n’avoir pas dormi, mais de ce mouvement contradictoire de cet odieux tiraillement qui emportait mon corps loin de vous tandis que mon âme retournait vers vous.
Parmi les sentiments qui me pressent, la surprise tient une grande place, la surprise de vous avoir quittée la surprise de ne pas vous voir aujourd’hui, de ne pas vous voir demain. Cela est, et je me demande à chaque minute si cela se peut. Je m’effraie quelques fois, Madame de l’empire que prend sur moi le besoin que j’ai de vous le bonheur que j’ai près de vous. Car enfin, je suis encore destiné à une vie active, sévère. J’ai des devoirs de tout genre des devoirs publics, des devoirs privés, mes enfants, ma mère un peu de renom à soutenir des curieux qui m’observent des rivaux qui m’épient. Tout cela est difficile laborieux. Il faut, pour suffire à tout cela que je suis vigilant, indépendant, disponible, que m’a poussée le soit comme ma personne. Que ferai-je si je suis à ce point envahi, absorbé, si j’arrache avec effort mon âme à une idée unique pour la lui rendre aussitôt de plus en plus exclusivement possédée ? Et pourtant désormais, il n’en peut être autrement, il n’en sera pas autrement. Je le sais, je le sens ; je ne m’en défends pas ; je repousserais avec aversion, si elle pouvait me venir, toute idée de m’en défendre ; mais elle ne me vient pas, elle ne me viendra pas. Aidez-moi Madame à mettre en harmonie tous mes sentiments, toutes mes volontés. Aidez-moi à ne rien oublier, à ne rien négliger de ce que je dois aux autres, à moi-même, à vous car c’est à vous maintenant que je dois tout, c’est à vous que revient, qu’appartient en définitive tout ce qui me touche, c’est pour vous, pour votre plaisir, pour votre orgueil, qu’il faut que jusqu’au dernier moment de ma vie, je me montre égal, supérieur à toutes les tâches dont il plaira à la providence de me charger. Je me sens si fier ! Que j’en sois toujours digne ! Je ne supporterais pas l’appréhension du moindre déclin dans ce qui m’a valu... Je ne veux pas lui donner de nom. De quoi vous parlé-je là quand mon cœur étouffe d’autre chose? Oui, c’est à dessein. Je cherche depuis que je vous ai quittée, tout ce que je puis avoir en mon âme de plus haut de plus ferme. Ce n’est que là que je puis trouver un peu de force. Je retrouverai assez tôt toute ma faiblesse. Que dis-je retrouver ? Elle est là ; je la sens et elle m’est plus chère que jamais. Here’s the place. G.
26. Lisieux, Samedi 26 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne veux pas que vous soyez un jour, sans lettre. Je ne pourrai vous écrire du Val-Richer que demain dimanche, et vous n’aurez ma lettre que mardi. Je vous écris donc d’ici une seconde fois, cinq minutes après avoir envoyé le n° 25 à la poste. On y mettra celui-ci demain, et vous l’aurez lundi. En fait de lettres au moins, point de lacune dans l’absence qui est elle-même une si douloureuse lacune dans la vie. Si vous saviez comme je voudrais écarter de votre âme, de votre personne toute impression triste tout incident pénible, toute cause de chagrin, de souffrance, de fatigue, d’ennui, embaume l’air autour de vous, aplanir la terre sous vos pas gouverne les éléments, les événements toute la nature et toute la destinée pour votre plaisir, pour votre repos ! Il me semble que c’est mon devoir, que je réponds de vous, de tout pour vous. Quand je vous vois agitée, je me le reproche ; abattue, je me le reproche. Si du dehors, quelque contrariété vous survient, mon premier mouvement est de croire que j’aurais pu prévenir m’interposer. Et cette illusion dissipée, je crois encore que s’il m’était permis de parler d’agir certainement j’amènerais toutes choses, à ce qui peut vous plaire, je convaincrais toutes les personnes qu’elles doivent être et faire tout ce qui vous convient. En tout ce qui se rapporte à vous mon désir est si vif, si profond, que je ne puis me persuader que l’efficacité lui manque. De moi, pour vous l’impossible me semble absurde. C’est une grande vanité, Madame, une vanité que les impitoyables faits ne se chargent que trop de démentir. Et pourtant le sentiment demeure en moi toujours le même ; il résiste aux faits, il survit aux mécomptes. Tant notre cœur est indépendant des chaines mêmes que nous portons ici bas, et son pouvoir d’aimer supérieur à ce monde étroit et dur au sein duquel il se déploie !
Adieu. Promenez-vous aux Tuileries. Promenez vous à pas bien lents. Quand vous rentrerez dans votre Cabinet, asseyez-vous tout de suite sur votre canapé, au milieu. Et le soir ne donnez jamais de thé à personne sur la petite table près de la fenêtre, jamais. Voilà déjà dix-huit heures que je vis des souvenirs de ces huit jours. Adieu. Adieu. G.
27. Val-Richer, Samedi 26 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Me voici rentré dans mon Val-Richer. Le lieu me plaît ; mais qu’importe ? Je vous ai dit, je crois, qu’au milieu des plus grandes scènes politiques en y prenant la part la plus active, l’intérêt le plus vif en y désirant ardemment le succès, jamais je n’avais vu là, jamais je n’avais reçu de là le bonheur, rien qui méritât le nom de bonheur. Il m’est arrivé aussi d’être fatigué, très fatigué de souhaiter le repos, le repos de l’esprit et du corps loin des affaires, loin des hommes, l’oisiveté complète et sinon la complète solitude, du moins sa paix et son silence. Et quand j’ai pu me donner ce repos, j’en ai joui très doucement, presque puérilement. Mais là non plus, je n’ai jamais senti, ni attendu le bonheur. Les hommes se croient heureux à bien bon marché ! Aux uns du pouvoir aux autres du calme ; à ceux-là les applaudissements de la ville à ceux-ci les charmes de la campagne; et ils se disent contents ! Et il y a des philosophes et des poètes pour célébrer l’une ou l’autre de ces situations comme la plus belle ou la plus douce destinée humaine !
Madame, j’ai entendu retentir les applaudissements ; j’ai vu le soleil briller, et la lune dormir sur les plus tranquilles, les plus gracieuses prairies; j’ai connu les joies puissantes du succès et les plaisirs suaves du repos. Tout cela est très superficiel, très incomplet ; tout cela, ne m’a jamais donné que des impressions dont je sentais l’insuffisance en même temps que la douceur. Il n’y a qu’une impression complète, suffisante pour notre âme. Et l’instinct universel, le dit comme moi. Voilà deux créatures qui s’aiment; elles sont ensemble ; elles se partent. Personne ne les a entendues ; elles n’ont parlé à personne. Dites au premier venu qu’elles s’aiment, qu’elles s’aiment vraiment ; et demandez-lui, s’il croit que tant qu’elles s’aiment quelque chose leur manque. Sans hésiter il vous dira non. Allez à elles ; et, si vous avez le courage de les déranger, demandez leur à elles. Même si quelque chose leur manque ; elles vous regarderont en pitié. Prenez toute autre face de la vie, ce qui vous plaira, le pouvoir, la gloire, la science, la retraite, y a-t-il une autre situation à laquelle on puisse adresser la même question et recevoir la même réponse ? Princesse, je dis du repos du Val-Richer comme du bruit de la salle du Palais Bourbon, c’est quelque chose, mais peu bien peu. Je le dis encore bien plus aujourd’hui qu’il y a huit jours.
Quels huit jours ! Les retrouverons-nous ? Nous retrouverons nous jamais à ce point libres et seuls ? C’est là notre plus beau moment m’avez-vous dit une fois ; il est passé ! Dearest, cela n’est pas vrai, quoique vous l’ayez dit. Il y a un genre et un degré de bonheur où il n’y a point de plus beau moment où aucun beau moment ne passe. On ne mesure point ce qui est infini. On ne compare point ce qui est parfait. Il n’en faut croire en de telles choses, ni le raisonnement, ni le langage humain. Le langage est borné et grossier. Le raisonnement est borné et grossier. Il faut s’en rapporter au mouvement instinctif, à la foi intérieure, à la voix inarticulée, de notre cœur. Là, dearest, tout moment près de vous est infiniment doux, parfaitement beau. Et non seulement les plus beaux moments ne sont jamais passés ; mais les moments actuels, les moments qui sont là, sont toujours les plus beaux. Ce qui est vaut toujours mieux que ce qui a été. Ce qui sera au moment où ce sera, vaudra mieux que ce qui est. L’âme ravie et à peine capable de suffire à son ravissement ne conçoit rien de supérieur, rien d’égal. Voilà la vérité, la pure vérité, la vérité de l’amour et du Ciel mille fois plus sûre, plus réelle, que toutes les appréciations, toutes les comparaisons où notre intelligence et notre langage s’épuisent, et s’épuisent sans succès.
Dimanche 9 heures et demie
Je sors de mon lit. J’ai très bien dormi. J’étais fatigué hier au soir. Je me suis couché à 9 heures. Je ne me suis réveillé qu’une fois à 2 heures et pour une demi-heure. Que je voudrais vous savoir un tel sommeil ! J’ai encore un peu d’enrouement bien peu, et de plus en plus en déclin. C’est le seul mal auquel je sois réellement sujet, le seul dont j’aie été une fois assez gravement atteint en 1832, six semaines après mon entrée au Ministère de l’instruction publique. J’ai passé plus d’un mois dans mon lit, complètement dans mon lit. A la vérité je ne m’y étais mis qu’après avoir lutté contre le mal avec une assez sotte obstination, au moins autant par amour propre et pour ne pas céder que par la nécessité des Affaires. J’ai tenu un grand conseil de l’instruction, publique, qui a dure près de deux heures, une demi-heure après m’être fait mettre 40 sangsues et pendant qu’elles coulaient encore. Il y a en nous bien de l’enfantillage. J’ai beaucoup usé de ces organes là ; j’en userai encore beaucoup. Il faut que je le ménage. Il n’est pas du tout affecté en lui-même ; mais toute affection générale s’y porte aussi le repos général me fait-il toujours plus de bien que tout remède particulier.
10 h. Voilà votre N° 28. Moi aussi ce samedi sans lettre me parait horriblement pour vous et pour moi. Mais dormez, dormez ; je vous le demande en grâce. Cela vous va si bien d’avoir bien dormi ! Seulement, dormez dans votre chambre plutôt qu’au bois de Boulogne. Adieu. C’est le vôtre que je vous renvoie avec le mien de plus.
28. Val-Richer, Dimanche 27 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai à écrire ce matin trois ou quatre lettres indispensables ; mais il m’est impossible de ne pas commencer par vous. Un quart d’heure seulement ; puis, je vous quitterai pour aller à mes devoirs. Est-ce sur que je vous quitterai ? Je passerais si doucement ma journée à vous écrire. Au moins, si je vous quitte, vous saurez ce qu’il m’en a coûté, n’est-ce pas ? L’absence qui est toujours intolérable, ne peut être tolérée qu’à une condition, la confiance, la parfaite sécurité du cœur. Le Ciel veut de la foi ; et partout où il y a de la foi, il y a quelque chose du ciel qui adoucit toutes les amertumes de la terre.
2 heures
Voilà les visites du Dimanche qui commencent. Je voudrais bien ne pas être trop interrompu aujourd’hui. Vous avez raison de faire aussi, des visites, outre la distraction vos dettes seront payées. Payez aussi vos dettes de lettres si vous en avez encore. Je vous le recommande comme si cela était nécessaire pour que vous fussiez libre, bien libre la semaine prochaine. Ne trouvez-vous pas qu’on prend plaisir à multiplier les précautions, les arrangements, à entrer, sans la moindre nécessité dans les plus petits détails ? Il y a une importance qui se répand sur toutes choses et leur prête à toute sa grandeur. Moi, j’ai déjà réglé toute ma course de Compiègne. J’irai après demain mardi chercher ma mère et mes enfants à Trouville. Je les ramènerai ici mercredi, à la rigueur, en forçant. personnes et chevaux, je pourrais revenir le mardi soir ; mais je soigne encore mon reste d’enrouement ; et Mad. de Meulan, que j’emmène a quelque envie de se promener un peu au bord de la mer. Il faut penser au plaisir de ceux avec qui l’on vit et qui vous aiment n’est-ce pas ? Je suis sûr que vous y pensez beaucoup que vous êtes très bonne, très attentive pour vos entours.
10 heures et demie
J’ai mal pris mon jour pour désirer de ne pas être interrompu. Comme j’écrivais mes lettres de devoir, deux visiteurs me sont arrivés de treize lieues, un neveu de Mad. Récamier et un de nos plus habiles paysagistes, M. Alligny. Il a pris fantaisie à celui-ci de venir dessiner une vue du Val Richer. Je les ai reçus, promenés, et je viens seulement de les envoyer coucher. Ils répartiront demain, après déjeuner. Savez-vous ce qui m’arrive à chaque, incident de la vie aux plus petits incidents? Je me dis. Cela me plairait si..... Cela m’amuserait si .... Comme le si n’y est pas, cela ne me plaît ni ne m’amuse. Cependant je me plais, je m’amuse, intérieurement à imaginer à me raconter tout bas ce qui serait, ce qui se dirait, comment toutes choses se passeraient si le si était là. C’est ce que j’ai fait depuis 4 heures, en marchant, en causant, en cherchant le plus joli point de vue, pour le paysagiste en prenant du thé ce soir. Ou je me trompe fort ou ces messieurs m’ont trouvé aimable et sont contents de mon accueil. Ils ont vraiment cru qu’en leur parlant c’était à eux que je pensais. Mais j’ai trop parlé. Je suis enroué ce soir. Ce n’était pas la peine. Je vais me coucher. Adieu. Ce n’est pas le vrai adieu. Celui-ci à demain, après avoir reçu votre lettre. Pourquoi pas deux adieu ? Il y en aura deux, Madame et je vous promets que l’on ne nuira point à l’autre.
Lundi 3 heures
Il pleut horriblement. J’attends le facteur depuis dix heures. Enfin le voilà. Comment tant de joie peut-elle en une seconde, succéder à tant d’ennui ? Que de choses je voudrais vous dire ! Mais il faut que le facteur reparte tout de suite. Adieu. Adieu Je crois que le second vaut mieux que le premier. G.
29. Val-Richer, Lundi 28 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’espère que ma course à Trouville ne causera aucun retard dans mes lettres. Je fais, pour m’en assurer des combinaisons, je prends des précautions très savantes. Par exemple, ce N° ci, je le porterai demain à Lisieux par où je passe et je l’y laisserai en recommandant qu’on ne le mette à la poste qu’après demain mercredi sans quoi, vous auriez deux lettres Mercredi, et point jeudi. Votre n°30 à vous, que j’attends demain, je viens de faire dire qu’on me le garde à Lisieux où je le prendrai en passant ; et aussi le n° 31 que je prendrai après demain, en repassant ce qui fait que je l’aurai deux heures plutôt que si je le laissais venir m’attendre ici. Et mon N° 30 à moi, qui sera daté de Trouville, je le mettrai après demain à la poste à Lisieux en prenant votre n° 31. Je m’amuse à vous raconter tous mes artifices. Qu’on a d’esprit dans le cœur ! De cet esprit là pourtant, vous n’aurez que quelques lignes aujourd’hui, Madame.
Je viens d’écrire je ne sais combien de lettres insignifiantes de vieilles dettes ; j’en suis écrasé. Je me lèverai demain à 6 heures. Il faut que je me couche et que je dorme. Je me soigne. Non, je ne me suis jamais endormi en marchant ; Mais je conçois parfaitement que cela arrive; de tous les besoins physiques, le sommeil me paraît le plus irrésistible. N’essayez jamais d’y résister ; Dormez au bois de Boulogne chez Mad. de Castellane, même près de la petite table à thé. Vous avez si bonne grâce à avoir bien dormi ?
Il était dix heures hier et non pas 9 h. 1/2, quand votre N°28 m’est arrivé. Que n’est-il venu un peu plutôt ? Je penserais avec ravissement à la coïncidence. Mais ne me demandez pas de croire jamais que la distance s’évanouisse. Entre la réalité et le rêve il y a toujours pour moi un abyme. Je sais jouir du rêve pourtant sans m’en contenter. Adieu. Adieu.
Mardi 6 h. 1/2 Je me lève. Je ne fermerai certainement pas cette lettre sans vous dire encore adieu. Je pars dans une demi-heure. La pluie a cessé. Je déteste la pluie. Quand je suis triste, peu m’importe la pluie ou le soleil ; il n’est pas au pouvoir de l’atmosphère de changer ma disposition intérieure. Mais quand j’ai le cœur serein, je veux que l’atmosphère le soit aussi. Le contraste me choque. Il me semble que j’ai en moi de quoi dissiper tous les nuages, et que, s’ils demeurent, c’est moi qui suis vaincu. Dans quelques heures, je me promènerai le long de la mer. Elle n’aura plus pour moi deux rives. Tout est sur la même. Qu’il serait charmant de s’y promener avec vous ! Adieu enfin. Adieu pour tout de bon. G.
30. Trouville, Mercredi 30 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous n’aurez qu’un mot, absolument qu’un mot. Je n’ai ici ni temps, ni papier, ni plume ni encre. Je ne trouve dans la maison que ce vieux chiffon de papier rose, pas mal ridicule à vous envoyer. Mais peu importe. Nous partons dans deux heures.
J’ai trouvé mes filles à merveille, grandies, engraissées et d’une vivacité charmante. Mon petit Guillaume est un peu enrhumé. Le temps est très mauvais, grande pluie, grand vent, la marée monte en ce momenl avec une rapidité et une force admirable. Elle fait presque autant de bruit que mes deux filles, qui sautent, rient, crient autour de moi pendant que j’écris, et voudraient bien voir ce que j’écris. J’ai pris à Lisieux votre n° 30. Je prendrai aujourd’hui le 31, tous aussi doux à recevoir, à lire, à relire. Il n’y a pas moyen d’écrire. Voilà Mad. de Meulan, et ma mère qui entrent. Adieu. Adieu, un bon et vrai adieu, mais jamais de dernier. G.
31. Val Richer, Jeudi 31 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Oui ceci est ma dernière réponse ; et à part le bonheur de vous voir qui est bien quelque chose, j’en suis charmé. Vous aimez mes lettres, me dites-vous. Vous êtes bien bonne. Je ne les aime pas moi. J’ai un grand défaut Madame. Je passe pour un homme raisonnable ; et je l’ai été, je le suis en effet avec tout le monde, dans le train habituel de la vie. Mais voici ma folie. Quand j’ai rencontré, quand j’ai goûté dans un coin, dans un seul coin, la perfection que Dieu laisse quelque fois tomber sur la terre la perfection de l’affection, de la vérité, de la liberté de l’intimité, de la confiance, de la conversation, de toutes choses enfin, petites ou grandes, je ne puis plus supporter que la moindre imperfection s’introduire que la moindre lacune se fasse sentir dans ce coin là. J’accepte l’insignifiance, le mensonge, tout le vide, l’incomplet, l’artificiel des relations humaines, et les formes et le langage qui conviennent à un fond si léger et si vain. Mais je me révolte, je souffre matériellement dans tous mes nerfs, quand les mêmes apparences, les mêmes réticences subsistent ou reparaissent dans une relation en elle-même vraie et parfaite. Par ma raison, je reconnais la nécessité et je lui obéis ; par ma folie, je proteste et j’enrage. J’agis, je parle aussi sagement, j’espère aussi convenablement qu’un autre ; mais en agissant, en parlant des pensées autres que celles qu’expriment mes actions assiègent mon esprit ; des paroles autres que celles que je prononce, errent sur mes lèvres. Et de jour en jour le sentiment de ce désaccord monte dans mon cœur ; et l’humeur me gagne ; et je prends tout ce que je dis, tout ce que j’écris, en mépris et en déplaisir. Qu’on se passe du Paradis quand on ne l’a pas ; il le faut bien ; mais l’avoir, l’avoir à soi, et y vivre, s’y promener du même air que sur cette pauvre terre au milieu de la pauvre foule qui la remplit, c’est intolérable.
J’irai vous voir Madame et je perdrai pendant quelques jours ce sentiment. Et puis je le retrouverai. Et puis je retournerai le perdre encore près de vous, et pour bien plus longtemps, l’espère. Et je prie Dieu de ne pas prendre mon humeur au pied de la lettre et de me laisser mon Paradis. J’y compte ; vous m’en avez répété dans le n° 31, et en termes ravissants, la ravissante promesse.
10 heures
Vous avez très bien fait de finir amicalement votre lettre à M. de Lieven. Ce n’est point faiblesse, Madame ; c’est droiture et bonté de cœur, c’est respect pour vous-même, pour vos souvenirs, pour un lien ancien et puissant. Vous devez à la supériorité même qui vous a, si souvent rendu cette relation difficile, de mettre de votre côté tous les bons procédés, toutes les bonnes paroles. Il faut que tout le monde soit dans son tort avec vous. J’espère beaucoup que votre lettre au Comte Orloff et son intervention auprès de M. de Lieven feront finir de triste ennui intérieur. J’en suis très préoccupé pour vous ; j’en suis choqué, j’en suis affligé. Tout cela est bien au dessous de vous, et pourtant cela vous atteint. Nous en reparlerons dimanche. J’ai bien des choses à vous dire à ce sujet. J’en ai infiniment à vous dire sur tous les sujets. Mais il y en a un qui prend tout le temps, et il en a bien le droit, car tout le temps ne lui suffit pas. J’ajourne tout à Dimanche excepté cet adieu toujours si doux, même à la veille de Dimanche. G.
Je serai chez vous à 1 heure et demie
Mots-clés : Autoportrait, Famille Benckendorff, Relation François-Dorothée
Compiègne, Mardi 5 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’arrive après avoir eu une roue brisée en route et deux heures de retard ce qui fait que j’ai tout juste le temps de m’habiller avant dîner. Deux lignes donc seulement à mon grand, grand regret, j’ai le cœur si plein qu’il me paraît ridicule que ma lettre soit si vide. Demain, j’aurai du temps et après-demain, à 2 heures, j’aurai mieux que du temps, car j’espère bien gagner encore la matinée de jeudi. Je suis bien. Mon rhume est fort diminué aujourd’hui. Hier soir, il m’impatientait, pour vous encore plus que pour moi.
Adieu. Adieu. N’est-il pas admirable que nous ayons trouvé le secret de rendre doux ce mot Adieu ? G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée, Vie politique
32. Du château de Compiègne, Mardi 5 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
On vient de se séparer. Je remonte chez moi. Je ne me coucherai pas sans avoir causé un moment avec vous. J’ai eu ce matin un vif déplaisir. Je m’étais promis de vous écrire un mot avant de partir. Il m’est odieux de vous laisser tout un jour sans lettre, sans un signe de vie de moi, quand ce jour-ci comme tous les jours, loin de vous comme près de vous, mon âme est pleine de vous ; quand le sentiment de votre présence ne me quitte pas plus que celui de la vie. Il n’y a pas eu moyen. J’étais à peine levé que deux personnes me sont arrivées, puis deux autres. On m’a tenu jusqu’à 9 h. 1/4. Il a fallu partir. Je suis donc parti. Mais les chevaux ont beau courir, l’espace a beau s’étendre entre vous et moi ; vous êtes là, je vous vois, je vous entends ; je recommence nos charmants entretiens, et quand j’ai fini, je recommence encore. Ce sont là des rêves. Madame, des rêves de malade, car l’absence est le pire des maux. Mais que ce papier vous apporte du moins mes rêves ; qu’aujourd’hui, demain en y regardant, vous aussi vous puissiez rêver que je suis là, que je vous parle. La vie dure si peu et s’en va, si vite, et on en perd tant ! à côté de ces moments si beaux que nous passons ensemble, mettez, comptez, je vous prie, tous ceux que nous donnons à qui ? à quoi ? Cela est-il juste ? Cela est-il raisonnable ? Il faut que la société, ses devoirs, ses convenances, ses arrangements soient bien puissants et bien sacrés pour que nous leur fassions une si large part à nos dépens à nous, à nous mêmes.
Je ne suis pas, vous le savez, de nature rebelle. J’accepte sans murmurer les lois de la destinée et du monde. Et pourtant qu’elles nous coûtent cher ! Que de sacrifices à leur faire, et quels sacrifices ! Allons, allons, je ne veux pas me plaindre ; je n’ai point droit de me plaindre ; hier était trop beau, après-demain sera trop beau. Je demande pardon à Dieu de mes paroles inconsidérées. Je lui demande pardon sans repentir et sans crainte. Je ne crains pas que Dieu regarde, au fond de mon cœur. Il y voit tant de reconnaissance pour Ie nouveau trésor qu’il me donne après m’avoir tant ôté ?
Mercredi 6 7 h.1/2
Je me lève. J’ai assez bien dormi. Nous sommes ici peu de monde. M. le Chancelier, le Général Sebastiani et sa femme, le Duc et la Duchesse de Trévisse, Eugène d’Harcourt, M. Lebrun (de l’Académie française), M. Duchâtel et moi. Puis des officiers du camp. J’ai dîné hier à côté de la grande Duchesse de Mecklembourg, excellente personne, toujours prête à s’émouvoir et aussi à s’amuser, frappée, charmée de l’activité qui règne dans ce pays-ci, mais un peu inquiète de tant de mouvement, inquiète des journaux, inquiète des chemins de fer qui vont chercher, dans les coins les plus reculés, tous les esprits, toutes les existences et ne laissent nulle part ni repos, ni les vertus qui ne fleurissent que dans le repos.
Elle voudrait bien mettre d’accord et voir prospérer ensemble tous les bons et beaux sentiments de toute espèce, ceux de l’ancien état social et ceux du nouveau, la fierté individuelle et la sympathie universelle, la grandeur de quelques-uns et l’égal bonheur de tous, la sérénité pieuse et l’activité puissante des esprits. Toutes les idées tous ces désirs un peu vagues et confus, et amenant un certain mélange d’admiration et de crainte, de curiosité et de timidité, d’attendrissement et de réserve, qui est assez intéressant à regarder.
Mad. la duchesse d’Orléans est engraissée et animée.Je n’ai causé avec elle que deux minutes après dîner. Elle espère que l’air de Compiègne guérira mon rhume. J’ai répondu que malheureusement il n’en aurait pas le temps, car j’étais obligé de demander à M. le Duc d’Orléans la permission de repartir demain. Aujourd’hui le déjeuner à 11 h. 1/2. Après le déjeuner une promenade en calèche, je ne sais où, peut-être aux ruines de Pierrefonds. Nous comptons partir demain matin vers 6 heures et être à Paris vers 1 heure. On a dû aller vous le dire. Nous n’avons fait cet arrangement, M. Duchâtel et moi, qu’au moment où nous montions, en voiture. Imaginez que je n’ai vu encore ni Mad. de Flahaut, ni Emilie et pour les voir, il faudra que j’aille ce matin, chez elles dans la ville. Mad. de Flahaut ne loge point au château. Elle y a passé quatre jours, comme toutes les personnes invitées ; mais ses quatre jours finis, c’est-à-dire hier matin, elle en est sortie pour retourner dans la maison qu’elle a louée. J’irai remettre la lettre de M. de Mentzingen entre le déjeuner et la promenade, mais je ne réponds pas de causer beaucoup avec Emilie.
J’attends une lettre ce matin. Je ne fermerai la mienne qu’après l’avoir reçue. Cependant j’ai bien envie de vous dire un premier adieu, sauf à recommencer. Il fait beau. vous êtes encore dans votre lit. Adieu. Vous vous promenez dans une heure aux Tuileries. Adieu. Adieu 9 heures Voilà votre lettre, votre charmante lettre. Est-elle charmante comme toutes ou plus charmante que toutes ? Je n’en sais rien. Je dirais volontiers l’un et l’autre. Soyez sans inquiétude sur mon rhume. Il serait fini depuis longtemps si je ne l’avais tant secoué, la nuit, le jour, au bord de la mer sur les grands chemins huit jours d’immobilité le dissiperont tout-à- fait. Moi aussi, pendant qu’elle durait, je me suis plaint dans mon âme de la soirée d’avant-hier. Mais j’avais tort. Il ne faut se plaindre de rien quand vous êtes là.
Adieu oui, Adieu, à demain. Vous me conterez en détail votre conversation.
33. Compiègne, Mercredi 6 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi ne vous écrirais-je pas quelques mots avant de m’habiller ? Je ne nous verrai demain qu’à 2 heures. Je ne veux pas que votre réveil se passe sans lettre. Une seule chose ma fait hésiter ; c’est la crainte qu’en voyant arriver une lettre que vous n’attendrez. pas, vous ne disiez avant de la lire - Ah ! Son retour est retardé ! Non, il ne l’est pas, dearest. Je vous verrai demain. J’ai trouvé moyen de vous faire arriver aujourd’hui une longue lettre et celle-ci ira vous chercher demain dans votre lit, quelques heures, avant que je n’entre, moi dans votre cabinet. Ai-je de l’esprit et bien mieux que de l’esprit ?
Je viens de me promener quatre heures, en tête-en-tête avec Mad. le duchesse d’Orléans, M. le Duc d’Orléans et la grande Duchesse de Mecklenbourg. Nous avons beaucoup causé, plus qu’il ne convenait peut-être à mon rhume et à ma distraction. En suivant ces longues allées si couvertes en roulant sur les pelouses si douces, en m’arrêtant devant ces chênes gigantesques, en regardant du haut des collines ces vallées si riantes, je vous cherchais, je vous plaçais partout ; mes vraies pensées, mes paroles intérieures allaient à vous. Et cependant j’écoutais, je parlais. J’en avais l’air au moins. J’espère n’avoir point dit de sottises. Il ne me semble pas que la physionomie de mes interlocuteurs m’en ait reproché aucune. Mon rhume va mieux. Soyez sans inquiétude. Quelques jours de repos absolu le dissiperont tout à fait.
Mais, dearest, il faudra vous accoutumer à me voir quelquefois, ce genre d’indisposition, comme moi à voir vos nerfs aisément ébranlés. Nous nous inquiéterons tous les deux et puis nous nous dirons l’un à l’autre qu’il n’y a rien là de grave ; et sans rien retrancher des préoccupations, des agitations de notre cœur, nous garderons assez de fermeté d’esprit pour voir les choses comme, elles sont, et non pas pires quelles ne sont. Je me prêche moi-même, en vous disant cela je sais que les sermons n’ont pas grande puissance. Il faut pourtant les répéter, et les écouter. Voilà six heures. J’ai tout juste le temps de m’habiller. Je verrai ce soir Mad. de Flahaut et sa fille. Adieu, adieu. Est-ce que je ne pourrais pas remplir d’adieu le reste de cette page? Adieu. G.
34. Lisieux, Jeudi 7 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aurai recours au même expédient. J’écrirai deux lettres coup sur coup pour que vous ne soyez pas un jour sans lettre. J’y ai du mérite. Vous savez que je n’aime pas les décadences. Quelle décadence ! La parole est déjà si inférieure à la pensée! Que l’écriture est inférieure à la parole ! Nous sommes étrangement soumis aux circonstances matérielles de la vie : rien n’est changé en moi, rien en vous ; le fond des âmes, le fond des choses est absolument le même. Bien plus, notre moyen de manifester, d’exprimer notre âme est le même ; toujours des mots, rien que des mots, des mots français tant que la langue en peut fournir. Mais les mots au lieu de les dire, il faut les écrire ; au lieu de passer en une seconde de mes lèvres à votre oreille. Et faut qu’il aillent, collés sur ce papier traverser je ne sais combien de lieues, je ne sais combien d’heures pour arriver à vous. Et tout est changé ! Et loin de dire tout ce que je pense, je n’’écris pas la millième partie de ce que je dirais ! Et les mots que je vous envoie tombent de mon âme lentement, lourdement comme de la glace comme du plomb ! Et dans ce moment même, dans ce que je vous dis là, que fais je? J’observe, je disserte, en moraliste en spectateur, il n’y a là rien de vrai rien de réel; Je sens autre chose, que ce que j’exprime, je pense à autre chose, qu’à ce que je vous dis. Ah, j’ai mille fois raison, Madame, de ne pas aimer les décadences ; mais, sinon les pires, du moins les plus incommodes de toutes sont celles qui ne sont qu’apparentes, et au sein desquelles le fond toujours le même, toujours aussi animé, aussi riche, ne paraît plus que sous une forme misérablement terne, courte, insignifiante. C’est comme si le soleil toujours ardent et brillant à son foyer, ne pouvait plus envoyer sur le monde qu’une lumière pâle et froide. Pour peu qu’il eût conscience de lui-même, il en souffrirait cruellement.
J’en reste là. Je m’ennuie de mes comparaison de mes réflexions. Je me raccoutumerai à écrire, je réapprendrai à oublier les immenses intervalles d’espace, de temps, qui nous séparent et les sacrifices qu’il faut leur faire. Mais aujourd’hui, je ne puis pas. J’ai encore les yeux pleins de ce que je voyais les oreilles charmées de ce que j’entendais il n’y a pas seize heures Vous écrire me distrait de vous. En cessant je vous verrai, je vous entendrai encore. Je l’aime mieux. Permettez-moi de vous dire adieu. C’est en vous disant adieu que je vous retrouve. Adieu donc. G.
35. Lisieux, Jeudi 14 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci est pour le second jour, un morceau de pain, rien qu’un morceau de pain. Je viens de me donner une demi-heure de libre rêverie. J’appelle cela rêverie je ne sais pourquoi. Je ne rêve point ; je vois, j’entends, je sens très distinctement, très positivement. C’est aussi près de la réalité qu’il se peut quand ce n’est pas la réalité. Il est vrai qu’il y a un abyme. Mais en dépit de cet abyme, mon souvenir ne ressemble point à ce qu’on appelle de la rêverie ; il est clair, précis, animé. Il n’y a point de nuage, il n’y a que de la distance entre vous et moi. Cela me vient, je crois de vous et de ce que vous êtes, aussi bien que de moi-même vous êtes une nature, simple vraie à contours grands et nets. Il n’y a en vous rien de vague d’incertain rien qui, vu de loin, s’altère, s’efface, se confonde avec les vapeurs de l’horizon. De loin, ce n’est que votre image, mais une image lumineuse, vivante, comme vous l’êtes de près vous-même ; une image qui est à l’épreuve de l’éloignement comme de l’oubli, et à laquelle l’espace ni le temps ne peuvent rien ôter.
Dearest, je m’épuise en paroles pour vous donner quelque idée de ce que je sens aujourd’hui. Bien vainement à coup sûr. J’aime mieux m’en rapporter à vous. Parlez-vous de ma part ; et quand vous vous serez dit tout ce que vous saurez, ajoutez encore, et puis encore et puis toujours. Vous n’irez jamais au bout de ce que je vous dirais. Je vais monter en calèche pour le Val-Richer. J’y serai dans une heure et demie. C’est dans mon Cabinet seulement, auprès de ma fenêtre, que je puis reprendre avec quelque douceur nos conversations par lettres. Ici je ne sais sentir que la présence d’hier ou la séparation d’aujourd’hui. Adieu. Adieu. Adieu. G.
36. Val-Richer, Jeudi 14 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà la troisième fois aujourd’hui. Je m’étais promis ce matin d’attendre à demain. Mais j’en ai trop envie. Ma solitude me pèse trop. Je ne suis pas en train de résistance. Je suis fatiguée. J’ai voyagé cette nuit par un temps effroyable, la pluie, le vent, le froid, et une pauvre lune qui se débattait pour jeter au milieu de ce chaos un peu de lumière. Je ne me suis pas bien nettement aperçu de tout cela. Je rêvais, mais d’un rêve qui ne parvenait pas à l’illusion. Il faut de la foi en rêve comme dans la veille. Je crois que sans la regarder, sans y penser cette tourmente de l’atmosphère m’a troublé et dérangé au fond de cette voiture où j’étais pourtant bien seul, bien enfermé.
Le soleil est revenu depuis que je suis ici ; du soleil pour mes yeux, mais non pas pour mon âme. Il y a longtemps que je n’ai été à ce point en disposition triste et faible. On me croit beaucoup de force, et j’en ai. Mais la force ne supprime aucune de nos faiblesses. Elle les empêche Es, rien ne de gouverner notre conduite; voilà tout. Du reste je ne sais pourquoi j’appelle cela une faiblesse. Le vide est immense mais pas trop, pas plus que n’était le bonheur. Il est juste d’en sentir l’absence aussi vivement que la possession. Mes enfants, m’ont reçu avec transport. J’en ai été ému jusqu’à la reconnaissance. Je les aurais volontiers remerciés de leur joie. Je désire que vous les connaissiez. Mais vous ne les verrez jamais habituellement. C’est grand dommage. Ils vous aimeraient. Ils ont le cœur très prompt, très développé. Leur affection joyeuse, confiante, caressante, vous ferait du bien. Je voudrais vous voir entourée de sentiments doux, tendrement empressés. Je ne serais point jaloux de ce que vous y pourriez prendre de distraction même de plaisir.
Je vous trouve si seule de cœur ! Cela pèse sur le mien à toutes les heures du jour. Quand je ne suis pas là, vous êtes obligée de tout faire vous-même pour vous. Cependant si je devais perdre quelque chose la moindre chose à ce que vous trouveriez ailleurs aurais-je assez de vertu pour m’y résigner ? Je ne crois pas. Certainement non, je ne crois pas. Et me voudriez-vous cette vertu là ? J’espère bien que non. Imaginez qu’hier en arrivant à l’hôtel des poste pour monter en voiture, la première personne que j’aie aperçue dans la cour, c’est l’ambassadeur de Sardaigne qui venait embarquer, dans la malle poste de Turin, ce savant Prémontais qui a dîné avec nous mardi, et qu’il aime beaucoup. J’ai eu de cette rencontre, une joie d’enfant. Il me semblait qu’à côté de M. Brignole, j’entrevoyais une autre figure, seulement, il était entre elle et moi. C’était autrement mardi. J’aime mieux mardi.
Vendredi, 8 heures
J’ai beaucoup dormi. La pluie est ce matin plus épaisse que jamais. Je n’y ai pas regret. S’il faisait beau, il faudrait se promener, aller, venir être un peu en harmonie avec le soleil. Je resterai beaucoup dans mon cabinet. Mais j’y ai regret pour vous. Vous avez besoin d’air, de promenade moralement comme physiquement. Et puis soit santé, soit caractère, ces contrariétés-là vous atteignent plus que moi. En tout vous êtes sensible aux petites contrariétés. " Je suis un peu enfant gâté. " me disiez-vous l’autre jour. Il y a du vrai. Le cours de votre vie est pour beaucoup en cela. Vous avez été cruellement frappée, peu contrariée. Vos épreuves se sont passées dans la région haute. Au dessous dans celle des petits intérêts, et des petits plaisirs, vous avez eu, vous avez fait tout ce que vous avez voulu. Il en résulte quelques fois. Et vous entre la gravité si égale, si dédaigneuse de votre nature, et votre vivacité, votre susceptibilité sur des choses qui au fond ne vous font rien, et ne vous touchent qu’à la surface un contraste singulier pour qui ne vous connait pas. J’aime ce contraste. Il dit qui vous êtes, d’où vous venez, comment s’est passée votre vie. J’aime que le caractère les impressions, les habitudes, d’une personne, d’une femme surtout soient l’écho vrai, l’image vivante de sa destinée.
Il faut aux hommes plus d’indépendance de disponibilité ; il faut qu’ils soient plus prêts et moins sensibles à toutes choses. Restez comme vous êtes Madame, un peu enfant gâté dans le menu détail de la vie. Cela me plait, et je n’y perdrai rien. Vous voyez où j’aboutis toujours.
11 heures Voilà votre lettre, votre charmante lettre. Vous aimez que le dernier mot soit le plus tendre. Eh bien oui, ce sera le plus tendre, de beaucoup le plus tendre. Quelque mal que vous en disiez quelques fois, rien ne vaut adieu. Adieu, Adieu. G.
37. Val-Richer, Vendredi 15 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Qu’Adam dut avoir de peine à s’accoutumer, à vivre hors du Paradis ! Là, il ne pensait qu’à jouir de la vie. Il n’y pensait même pas. La vie était pour lui parfaitement pleine, et légère, douce et animée. Pas un moment séparé d’Eve. Punit de solitude et toujours seule. Des entretiens charmants, des silences charmants. Un amour serein comme le ciel, chaud comme le soleil, inaltérable et inépuisable. La prière pour repos, comme l’amour pour bonheur. Tout le jour, tous les jours passés à goûter, avec Elle, les dons de Dieu, à remercier, avec Elle, Dieu de ses dons. Quand on a connu un état si beau, comment en supporter un autre ? Pauvre Adam ? Il n’est pas besoin de l’avoir connu ; c’est assez de l’avoir entrevu. Je ne suis pas de ceux, vous le savez qui méprisent la vie réelle et croient qu’il n’y a de vrai bonheur, que dans les rêves de l’imagination. Une heure de bonheur réel, et il y a de telles heures, vaut mille fois mieux que les plus beaux rêves de l’imagination la plus divine. Mais le bonheur se montre en passant ; c’est là son vice. Et quand il s’est montré, quand il s’est laissé saisir un moment, c’est alors que l’imagination est toute puissante à nous enchanter de l’image de sa durée, à le rappeler, à le retenir devant notre âme sous toutes ses formes, avec toutes ses joies, grandes, petites, sérieuses, gaies, innombrables, infinies. Voilà le rêve légitime, le rêve irrésistible Madame. Je pourrais passer des journées des années à m’y livrer, à me figurer, à goûter en idée tous les ravissements d’une vie qui serait tout entière ce qu’a été un jour, une heure. Rien n’égale alors l’allégresse la fertilité de ma pensée. Le monde avec tous ses intérêts la destinée humaine avec toutes ses chances, comparaissent devant moi. J’aborde toutes les situations, toutes les suppositions. Je deviens Roi, obscur, riche, pauvre, puissant, proscrit. Je travaille sans relâche ; la goutte me cloue oisif, sur mon fauteuil. Je mets mon bonheur aux prises avec les fortunes les plus diverses, favorables ou contraires. Et je le contemple avec délice toujours le même au sein de tant de vicissitudes supérieures à tous les triomphes, à toutes les épreuves répandant tantôt son charme sur les plus frivoles incidents. tantôt son baume sur les plus cruelles blessures. Et je contemple avec plus de délice encore la créature, à qui je le dois et mon cœur se gonfle de reconnaissance au moins autant que de plaisir. Et j’ai beaucoup de peine à revenir à moi, à me persuader que tout cela, n’est qu’un rêve ; car en vérité ce bonheur là est si conforme, à ma nature, j’y espère avec tant d’ardeur, je me sens tant de puissance pour en jouir, qu’il me faut tout ce que j’ai dans l’âme de raison et de fermeté pour me résigner à ne le connaitre que par des apparitions, et à l’entrevoir sans le posséder ! Je ne rêve que pour vous Madame.
Je vous conte mes rêves comme toute chose mais à vous seule. Si le monde s’en doutait, il me croirait fou, et ne voudrait plus jamais me confier ses affaires. J’ai pourtant bien raison, et le monde a bien tort quand il ne croit ses affaires bien faites que par ceux qui ne se soucient pas d’autre chose. Je connais les plus habiles en ce genre. Leur habilité est si courte, si légère, elle oublie et laisse en souffrance tant d’instincts puissants, tant de grands intérêts de la nature humaine qu’en vérité, si le monde n’était pas aujourd’hui bien petit d’esprit et de cœur il ne s’en contenterait pas.
Samedi 8 heures
Je suis très fâché du redoublement de froideur dont vous me parlez ; mais je n’en saurais craindre rien de grave. A moins qu’on ne veuille la guerre chez vous ce que je ne crois pas, nous n’aurons point de guerre. Si nous étions très voisins, si nos toits se touchaient, je ne serais pas si sûr de mon fait. Entre un Prince qui fait ce qu’il veut et un peuple qui dit ce qu’il veut, une parole peut amener bien vite un coup de canon. Mais à la distance où nous sommes avec de si épais matelas entre nous, il faut, pour que la guerre commence, ou la folie et la puissance de Napoléon ou de bons et solides motifs. Ni l’une ni l’autre cause n’existe et n’existera de longtemps. Je comprends toutes les préventions, toutes les humeurs. Ce que je ne comprends pas, c’est que lorsqu’on est placé si haut lorsqu’on voit par conséquent, si loin on accorde aux préventions et aux humeurs un tel empire. L’Empereur ne peut avoir que deux pensées politiques, la lutte contre l’esprit révolutionnaire et la grandeur de la Russie. Pour la première, la Russie comme toute l’Europe a besoin, absolument besoin de la France. La France aujourd’hui peut lutter avec plus de crédit et de succès que personne contre l’esprit révolutionnaire, elle l’a éprouvé jusqu’au bout ; elle n’a plus rien à en apprendre et plus rien à en attendre. Mal conseillé, à tout risque elle pourrait le déchaîner encore ; elle sait mieux que tout autre comment on peut le réprimer. Je dis le réprimer, non seulement matériellement, dans les rues, pour un jour, mais moralement dans les esprits, pour l’avenir. L’Europe orientale qui redoute et combat ce mal avec tant d’ardeur ne sait pas Elle même à quel point il est profond, général, là où il se cache comme là où il éclate, et combien notre concours, notre concours sincère et prudent est indispensable pour le guérir partout. Et je n’hésite pas à dire que la France a déjà donné à cet égard, des preuves de savoir faire comme de bon vouloir ; et elle en donnerait bien davantage, si elle recueillait partout, le juste fruit de sa résistance.
Quant à l’avenir diplomatique et territorial de l’Europe, je n’en sais rien, personne n’en sait rien. Je n’y pense pas, personne n’y peut penser activement aujourd’hui. Mais il est évident que des Puissances européennes la France est celle dont les intérêts permanents, les désirs possibles sont le moins opposés, le plus aisément conciliables avec les intérêts et les désirs Russes. Il n’y a point là, dans l’état actuel de l’Europe, de quoi fonder dès aujourd’hui, et pour le présent, un système une politique. Il y a à coup sur motif puissant, motif de rester en mesure pour l’avenir. Rester en mesure, se trouver toujours libre, toujours prêt, ne pas se créer soi-même et d’avance, des embarras, des obstacles, c’est je crois, la première sagesse celle dont on recueille le plus sûrement les fruits, que tôt ou tard on regrette le plus d’avoir oubliée, celle qui convient surtout à un gouvernement qui se vante et avec raison de la persévérance et de l’esprit de suite qu’il apporte dans ses desseins. Voilà de bien sages paroles n’est-ce pas ? Ce n’est pas sur celles-là que je veux rester avec vous. J’attends votre lettre dans deux heures. Je ne vous dirai adieu qu’alors.
10 h. 1/2 Ah, remplissez quatre pages d’Adieu ; il n’y en aura jamais autant que j’en veux. Et vous avez bien raison. Vos paroles valent mille fois mieux que tous mes raisonnements. Mais aussi je m’ennuie infiniment de mes raisonnements. Je les prends quand je n’ose pas me livrer à autre chose. Adieu, adieu. Adieu. G.
38. Val-Richer, Samedi 16 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je le crois bien que vous avez eu peu de plaisir à lire mes lettres de Lisieux. J’en ai eu très peu, moi, à les écrire. Il faut que vous me le pardonniez, Madame. Je viens de passer avec vous des jours ravissants, des jours de confiance si tendre d’abandon, si doux ! A chaque heure, à chaque minute de ces beaux jours, j’ai senti grandir et s’étendre dans mon cœur la confiance l’abandon, la tendresse. Je vous quitte. A l’instant même, je vous écris. Que vous écrirai-je ? Tout ce que je vous disais tout à l’heure, ou tout mon chagrin de ne plus vous le dire ? Ni l’un ni l’autre ne se peut. Et pourtant, je n’ai pas autre chose dans l’âme. J’essaie d’échapper à mon âme. Je me détourne. Je me jette à côté. Ne pouvant aller à vous en liberté, je vous raconte avec effort ma tristesse, ma gène et ses causes, et ses ennuis. Ah ! Vous avez raison, mille fois raison ; votre laisser-aller est bien plus aimable ; mais il n’est pas plus tendre.
Votre lettre m’a charmé ce matin, me charme ce soir, me charmera demain ; mais vos paroles si douces, si pénétrantes, ne m’aiment pas davantage que ne vous aimait avant-hier ma pénible contrainte. Vous le voyez du reste ; elle ne dure pas. C’est le mal du premier jour, c’est l’oppression du poids de l’absence au moment où il tombe sur mon âme. Elle le soulève bientôt ; elle le repousse ; elle reprend avec vous même de loin, ses habitudes de Délicieuse intimité. Oui, vous pouvez bien le dire, c’est le vrai mot ; de loin ou de près, vous embellissez ma vie. Vous avez des paroles charmantes, des joies charmantes à m’envoyer ici, à 45 lieues, comme pour notre Cabinet de la Terrasse. Ne changez rien, ne changez rien, je vous en conjure, à votre manière, à votre nature. Ne vous entravez pas, ne vous étouffez pas. Dites moi toujours tout, tout ce qui traverse votre cœur, ce qui remplit vos journées, les lettres qu’on vous écrit, les visites, qu’on vous fait, les bêtises qu’on vous dit. Tout me plaît, tout m’importe. Vous me permettrez bien, n’est-ce pas de trouver toujours que la présence vaut mieux que l’absence, les conversations mieux que les lettres ? Je vous promets de ne plus m’arrêter, de ne plus vous arrêter avec moi sur la comparaison, de ne dédaigner, de ne laisser perdre aucun petit plaisir, de les trouver tous grands, venant de vous, et de vous en renvoyer de même sorte que vous trouverez grands aussi, n’est-ce pas ? J’ai, du fond de mes bois, du sein de ma famille, mille récits à vous faire, mille détails à vous donner. Vous aurez tout, tout. Mais je persiste. Il n’y a point de détails, point de récits qui puissent valoir une lettre de quatre pages où il y aurait : " adieu, adieu, et rien que cela, bien long et bien serré »
Dimanche 11 heures C’est moi, c’est moi qui serai un enfant gâté si vous continuez. Quel moment ravissant vient de me donner la lettre qui m’arrive ! et que de fois aujourd’hui, demain, ce ravissement recommencera !
Je devrais vous gronder. Il y a bien de quoi. Mais je ne puis, non, je ne puis. Et pourtant vous n’êtes pas pardonnable dearest, ces doutes, ces inquiétudes ne sont pas pardonnables. Si vous me connaissiez mieux, quand vous me connaîtrez tout-à-fait, vous saurez ce qu’il me faut tout ce qu’il me faut pour me faire prononcer une seule fois des paroles, que je voudrais vous redire sans cesse, que je vous redis sans cesse au fond de mon cœur ; que mes lèvres balbutient tout bas, quand je suis seul même quand il y a autour de moi du monde. On n’entend pas, on ne sait pas, mais les paroles que vous aimez, qui vous feraient supprimer la moitié de votre lettre elles sont là, toujours là. Adieu, Adieu. Le facteur me demande ma lettre. Il faut qu’il parte. Adieu. Demain, je vous parlerai de tout. Adieu. G.
39. Val-Richer, Dimanche 17 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous étiez entrée tout à l’heure dans ma cour, vous auriez été un peu surprise. Vingt trois chevaux de selle, deux cabriolets, une calèche. Les principaux électeurs d’un canton voisin sont venus en masse me faire une visite. J’étais à me promener dans les bois avec mes enfants. J’ai entendu la cloche du Val Richer, signe d’un événement. Je ne savais trop lequel. Nous avons doublé le pas, et j’ai trouvé tout ce monde là qui m’attendait. Je viens de causer une heure et demie avec eux de leurs récoltes, de leurs impositions, de leurs chemins, de leurs églises, de leurs écoles. Je sais causer de cela. J’ai beaucoup d’estime et presque de respect pour les intérêts de la vie privée, de la famille, les intérêts sans prétention, sans ambition, qui ne demandent qu’ordre et justice et se chargent de faire eux-mêmes leurs affaires pourvu qu’on ne vienne pas les y troubler. C’est le fond de la société. Ce n’est pas le sel de la terre, comme dit l’Évangile mais c’est la terre même.
Ces hommes que je viens de voir sont des hommes sensés, honnêtes de bonnes mœurs domestiques, qui pensent juste et agissent bien dans une petite sphère et ont en moi, dans une sphère haute assez de confiance pour ne me parler presque jamais de ce que j’y fais et de ce qui s’y passe. Mes racines ici sont profondes dans la population des campagnes, dans l’agricultural interest. J’ai pour moi de plus, dans les villes, tout ce qu’il y a de riche, de considéré, d’un peu élevé. Mes adversaires sont dans la bourgeoisie subalterne & parmi les oisifs de café. Les carlistes sont presque comme des étrangers, vivant chez eux, entre eux et sans rapport avec la population. La plupart d’entre eux ne sont pas violents, et viendraient voter pour moi, si j’avais besoin de leurs suffrages. Du reste, je ne crois pas que mon élection soit contestée. Aucun concurrent ne s’annonce. Ce n’est pas de mon élection que je m’occupe mais de celles qui m’environnent. Je voudrais agir sur quelques arrondissements où la lutte sera assez vive. Je verrai pas mal de monde dans ce dessein. Si la France, toute entière ressemblait à la Normandie, il y aurait entre la Chambre mourante et la Chambre future bien peu de différence ; et j’y gagnerais plutôt que d’y perdre. Mais je ne suis pas encore en mesure de former un pronostic général. Vous voilà au courant de ma préoccupation politique du jour. Je veux que vous soyez au courant de tout.
Lundi 7 h. du matin
Je suis rentré hier chez moi vers 10 heures à notre heure à celle qui me plait le plus pour vous parler de nous. J’ai trouvé mon cabinet et ma chambre pleine d’une horrible fumée. Mes cheminées ne sont pas encore à l’épreuve. Il a fallu je ne sais quel temps pour la dissiper. Je me suis couché après. Aussi je me lève de bonne heure. Laissez-moi vous remercier encore du N°39, si charmant, si charmant ! Qu’il est doux de remplir un si tendre, un si noble cœur! Cette nuit trois ou quatre fois en me réveillant, vos paroles me revenaient tout à coup, presque avant que je me susse reveillé. Je les voyais écrites devant moi. Je les relisais. Adieu n’est pas le seul mot qui ait des droits sur moi.
Je ne vous avais pas parlé de ce petit tableau. J’y avais pensé pourtant, et j’aurais fini par vous en parler. Vous n’en savez pas le sujet. Il est plus lointain, plus indirect que vous ne pensez. En 1833, 34, 35. 36, j’ai relu et relu tous les poètes où je pouvais trouver quelque chose qui me répondit ; qui me fît ... dirai-je peine ou plaisir? Pétrarque surtout m’a été familier. C’est peut-être, en fait d’amour le langage le plus tendre, le plus pieux qui ait été parlé. J’entends parler dans les livres que je méprise infiniment en ce genre, poètes ou autres. Un sonnet me frappa, écrit après la mort de Laure et pour raconter un des rêves de Pétrarque. Je vous le traduis
Ma petite fille aussi est plus jolie que son portrait, des traits plus délicats, une physionomie plus fine. Vous la verrez elle. Je voudrais que vous pussiez la voir souvent, habituellement. Elle est si animée, si vive, toujours si prête à s’intéresser à tout gaiement ou sérieusement ! Elle vous regarderait avec tant d’intelligence. Elle vous écouterait avec tant de curiosité ! Laissons cela. Quand nous aurons trouvé ce que je cherche en Normandie, nous pourrons ne pas le laisser.
Lundi 10 heures 1/2
Voilà le N°40. Je n’ai pas vu cet article de la Presse dont vous me parlez. Je vais le chercher. Je renouvellerai mes recommandations indirectes comme bien vous pensez là du moins mais positives. Ce n’est pas aisé. Mettez sur Adieu tout ce que vous voudrez. Je me charge d’enchérir. Adieu. Adieu. G.
40. Val-Richer, Lundi 18 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Oui, moi aussi j’ai bien souvent regardé au Ciel. Mais pourquoi dites vous encore aujourd’hui : " C’est affreux, c’est horrible d’être restée sur cette terre " ! Est-ce d’un tort ou d’un malheur que vous voulez parler ? Dearest, cette phrase me pèse sur le cœur. Et pourtant Dieu sait s’il y a dans vos douleurs, dans vos regrets ; quelque chose que je ne connaisse pas, que je ne sente pas comme vous, avec vous, pour moi, pour vous ! Vous m’aviez inspiré par là, avant, bien avant le 15 juin avant ce fatal 15 février, qui m’a frappé du même coup, vous m’aviez inspiré un intérêt bien vif, un intérêt mêlé d’attrait et de respect. Je ne regardais jamais sans attendrissement votre deuil immobile, vos yeux qui se détournaient ou s’abaissaient sans cesse pour cacher ou retenir des larmes. Et depuis ! .... Depuis, il y a eu le 15 Février et le 15 juin. J’ai droit sur vous, Madame. J’ai droit que sans rien oublier de vos regrets, sans rien ôter à ces créatures chéries qui vous ont quittée, vous ne disiez plus qu’il est horrible d’être restée sur cette terre. Que dirais-je donc, moi ? N’ai-je pas perdu ce que vous avez perdu ? N’avez-vous pas reçu de moi ce que j’ai reçu de vous ? Ne nous sommes nous pas, tous deux en deuil, tous deux le cœur bien malade, ne nous sommes-nous pas tendu la main avec consolation, avec espérance? Je doutais moi ; j’hésitais. Je ne doute plus. Vous ne m’avez pas ôté mon mal vous ne m’avez pas rendu ce que Dieu m’a retiré. Mais vous m’avez donné un bien immense. Vous avez fait que dans cette balance si incertaine de biens et de maux qui s’appelle la vie, le bon bassin s’est trouvé de nouveau rempli, rempli d’un trésor. Dites-moi aussi cela de vous, Madame. Je le sais, je le crois, j’en suis sûr. Mais dites, redites le moi.
Mardi 7 h. 1/2
Vous voudriez regarder tout un jour dans le Val Richer. Voici un miroir très fidèle où vous verrez tout le jour d’hier, tous les événements, tous les acteurs Il est sept heures. Je suis encore dans mon lit, dans ma petite chambre, après mon cabinet à l’extrémité nord de la galerie. Je n’entends rien, excepté les vaches du fermier qui mugissent en allant paître. Je me lève. Je passe dans mon Cabinet. J’allume moi-même mon feu. Je vous écris. Nous sommes seuls, parfaitement seuls, point de bruit, point de mouvement, ma porte bien fermée. Un peu après huit heures, je l’ouvre. Mon valet de Chambre m’apporte des Eaux Bonnes. J’en bois un grand verre. Je sors à l’autre bout de la galerie, mes enfants, qui ont épié le moment où l’on entrait chez moi, accourent en sautant, criant ; Henriette crie un peu moins fort. Guillaume a un son de voix charmant qu’il défigure affreusement pour étouffer la voix de ses sœurs. Avec eux, je dis bonjour en passant à Mad. de Meulan dont la chambre est la première de ce côté de la galerie. Je vais chez ma mère. J’y passe un quart d’heure. Mes enfants déjeunent dans deux chambres, à côté ; une grande soupe que Mad. de Meulan partage avec eux. Je rentre dans mon cabinet. Je bois un second verre d’Eaux-Bonnes. Je me promène quelques moments dans la galerie, regardant mes livres, mes gravures, arrangement nouveau, encore incomplet, et qui m’amuse. Je rentre décidément. Je fais ma toilette. J’écris des lettres. J’attends la vôtre. Vous ne savez pas, personne n’a jamais su comment j’attends, à quel degré d’impatience intérieure je puis arriver. Pendant que j’attends, tout le monde s’occupe. Mlle Chabaud, cette amie de ma mère dont je vous ai parlé, donne à mes filles une leçon d’anglais. Ma mère fait lire Guillaume. Après leur prière, faite ensemble chez leur grand-mère, mes filles apprennent par cœur des vers français, des dialogues anglais, un peu d’histoire et de géographie. Mad. de Meulan travaille dans sa Chambre, fait de la tapisserie, colle des gravures, coupe et prépare du linge à coudre par me filles et par les femmes, le tout pour le Val Richer. Je suis descendu deux fois pour voir si la poste arrivait. Elle arrive enfin. On m’apporte le paquet dans mon Cabinet. J’y prends mes lettres c’est-à-dire ma lettre. J’envoie à chacun les siennes. Je ferme m’a porte. Je lis, je relis. J’achève et je cachette ma lettre. La poste s’en va.
Il est onze heures. Le déjeuner sonne. Nous descendons tous, moi donnant le bras à ma mère, mes enfants avec des cris de joie. Ils sont très bruyants. A table ils parlent, parlent. Je les arrête un peu. Je dis à Henriette : « Sais-tu que Mad. de Lieven a deviné que tu étais très bavarde ? Elle me regarde, sa physionomie s’altère un peu, bien peu, des larmes tombent sur le petit visage gai, serein, qui ne se décompose jamais. Mais le sont bien des larmes. Elle est affligée, offensée que vous la croyiez bavarde. Je l’appelle. Elle vient à moi. Je la console Je lui dis que je vous ai souvent parlé d’elle, que vous avez bonne opinion d’elle. Elle est consolée et retourne en riant à sa place. Le déjeuner finit. Le temps est passable. Nous allons, nous promener, c’est-à-dire errer ensemble dans le jardin, dans le potager, le long des haies, autour de la pièce d’eau. Mes enfants cueillent des noisettes, ramassent les pommes tombées ! Je cours avec eux sur les gazons car nos près normands sont de vrai gazons de jardin. Guillaume tombe, roule, se plaint, grogne, recommence. On se moque de lui. Il est sensible à la douleur et facile aux larmes. On lui en fait honte. Presque une heure se passe ainsi. Pour me promener loin dans les bois, faire une vraie course, j’aime à être seul ou mieux que seul. La promenade en troupe à la file sans recueillement et sans intimité ne me plaît pas. Je l’évite quand je le puis sans être trop maussade. Nous rentrons. Je place, avec Mad. de Meulan, deux gravures de plus dans la galerie, une belle Ste Famille de M. Ingres et une Lecture de Virgile à Auguste. Nous aurons fait nous-mêmes tout cet arrangement. Les ouvriers d’ici manquent de goût et de patience. Et cela remplit le temps qu’on passe ensemble. Je me rétablis dons mon Cabinet. Je relis plus d’une fois. Je ne compte pas mes plaisirs. Je travaille Je voudrais dire quelque part avec quelque détail ce que je pense de l’état démocratique de la société parmi nous. Je commence à l’écrire. Chacun s’occupe chez soi. Mes filles viennent me voir deux ou trois. fois dans la matinée. Nous causons, un peu d’anglais. un peu d’arithmétique. Un ouvrier me dérange. Il vient poser dans ma chambre un devant de cheminée. Du froid me venait par là. Il ne m’en est plus venu cette nuit. Mad. de Meulan est le grand surveillant, le grand directeur des ouvriers. Ils ont pour elle beaucoup de considération beaucoup plus que pour moi.
Il est six heures un quart. On sonne le dîner. Point d’incident à table. Nous remontons chez ma mère. Grande récréation. On se décide pour le bal. Mes deux filles s’établissent sur des chaises, dans l’embrasure de la fenêtre. Guillaume va leur dire tour à tour : " Mademoiselle voulez-vous me faire l’honneur de danser avec moi la contredanse prochaine ? " La contredanse commence à deux, par un galop. J’interviens. A quatre, on va. Je ne puis venir à bout de leur apprendre à faire la chaîne anglaise. Je me retire du bal. Il finit. On regarde, on arrange de petits plâtres moulés sur des médailles des pierres antiques, et qui doivent prendre place dans des cadres noirs, aux deux bouts de la galerie. Il est neuf heures et demie. Mes enfants vont se coucher. A dix heures, je pars aussi. Je rentre chez moi. Hier, j’étais un peu las. Je me suis couché. J’ai lu une demi-heure dans mon lit, un récit de l’expédition Anglaise de l’Inde en Egypte, en 1800, par un homme de mes amis, M. de Noé, qui servait alors dans le 10e régiment de ligne anglais envoyé contre Tippoo Saïb. Son récit m’endort. J’ai bien dormi.
A quatre heures, j’ai été éveillé. J’ai rêvé éveillé, une demi-heure, si doucement ! Et je vous écris. Est-ce assez complet, assez exact ? Je vous garantis que vous avez tout sauf la présence réelle. Adieu. Un adieu provisoire. Je vais faire ma toilette, en attendant la poste. Il est déjà 9 heures et demie.
10 heures 1/2
Comment avez-vous si chaud ? Ici il pleut toujours. Mais n’importe. Appuyez-vous, sur moi. Je vous soutiendrai longtemps, aussi longtemps que vous voudrez, que vous permettrez adieu. Le véritable adieu. Ils le sont tous. G.
41. Val-Richer, Mardi 19 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suppose que vous avez vu l’article du Temps d’hier lundi, et que vous aurez deviné sans peine d’où il vient. C’est son journal et sa façon d’agir. J’entends d’ici la conversation d’où l’article est sorti, et je nommerais, je crois, le journaliste qui a rédigé la conversation.
Avez-vous rencontré beaucoup de petites infamies pareilles ? Vraies infamies de comédies, aussi petites qu’odieuses. J’en suis et j’en serai contrarié autant et aussi longtemps que vous le serez. Malgré votre désir et les précautions prises, je n’osais pas espérer que votre nom ne parût jamais dans un journal ; mais je ne me serait par la pas permis de prédire qu’il y viendrait par là. J’ai retrouvé les quelques lignes de la Presse. Savez-vous qui les a écrites ? Mad. Emile de Girardin, celle chez qui le Duc et la Duchesse de Sutherland allaient passer la soirée. Il y a des fripons qui volent les bourses, les mouchoirs. Il y en a d’autres qui volent les noms propres, les anecdotes vraies ou fausses. Et Chaque journal a ses coureurs de faits, de nouvelles, qui vont les recueillant et les escamotant dans tout Paris, chacun où il peut, tel dans les rues, tel dans les cafés, tel dans les salons. Et plus le non est illustre, plus le fait se paye cher. Mais ceux-ci ne sont pas des faits payés : ce sont des faits fournis gratis. Quelle honte !
Je suis préoccupé de votre contrariété. Je voudrais tant vous faire vivre dans une atmosphère parfaitement calme et douce ! Connaissez-vous en même temps rien de plus ridicule, si vous lisez ces journaux là, que tout leur ardeur à démontrer pour les matins, qu’il est impossible que M. Molé tombe, impossible que je trouve des alliés pour le renverser impossible que je revienne au pouvoir ?
Je ne pense à rien, je n’essaie rien, je ne parle ministère à personne ; les journaux qui me sont amis ne mettent aucune combinaison en avant, attaquent à peine quelques actes, quelques tendances du Cabinet. n’importe; on se démène, on crie comme des assiégés sous qui une mine va sauter, qui voient commencer un violent assaut. On semble obsédé par un fantôme. Pour les patrons de la conciliation générale, c’est bien peu de sécurité. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. L’article de ce matin, m’a donné de l’humeur et m’a fait penser à tout le reste. Habituellement je n’y pense guère. Rien ne me paraît plus plaisant que l’agitation sans relâche, les machinations continuelles, le tourment d’esprit qu’on m’attribue. J’ai de l’ambition toujours, j’en conviens ; de l’activité au besoin, je l’espère. Mais personne ne se remue moins que moi ; personne ne méprise davantage tout mouvement, petit, impatient, prématuré. Il faut, je crois, dans la vie politique, & sous notre forme de gouvernement, inventer très peu, frapper à très peu de portes, attendre tranquillement et se contenter d’être toujours prêt & à la hauteur de la marée montante, quand elle arrive. C’est mon goût, et je le suivrais n’eussé-je pas d’autre raison. Mais c’est aussi, je crois la vraie habilité. Je n’irai pourtant pas me coucher sur ces idées et ces paroles là.
Qu’est-ce donc que ces étouffements que vous avez eus à l’Eglise ? Certainement, il faut soigner votre santé. à chaque soin que vous prendrez, remerciez vous de ma part. Je vous soignerais si bien si j’étais toujours là ! Adieu, adieu. Il n’est pas onze heures. Vous avez encore du monde. Je vous assure que si j’y étais, je serais très aimable, aimable pour M. de Muhlinen. Adieu à demain.
Mercredi 10 heures ¼
Vous n’avez surement pas vu l’article du Temps. Vous ne m’en dîtes rien. Voyez-le. Il faut savoir où l’on en est. Je ne voudrai jamais que vous ignoriez rien de ce qui vous a touché, de ce qui nous touche de si près. Et pourtant que me fait le Temps, que me font tous les journaux du monde quand je reçois de vous une lettre comme le n° 42 ? Permettez-moi de ne pas vous en parler en ce moment. Vous savez qu’il y a des moments, bonheur ou malheur, où j’ai besoin de me taire, où je ne puis pas, où je ne veux pas parler. Mais vous m’avez ravi. Mais vous venez de me donner une joie incomparable. J’en ai besoin.
On me dit que le mariage de M. Duchâtel n’aura lieu que dans les premiers jours d’octobre. J’attends demain M. Duvergier de Lausanne qui vient passer ici 36 heures et qui m’apportera quelque chose de positif. Je n’ai pas répondu à votre question, je ne vous ai rien dit du tout. Je voulais ; je veux savoir. Je déteste les attentes vaines. Je les déteste pour moi pour vous. Mais, il faut que je donne ma lettre. Le facteur l’attend. Adieu. Adieu. Je ne sais qu’ajouter à mon adieu. Et pourtant, j’y voudrais tant ajouter. Adieu. G.