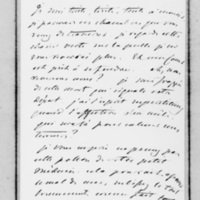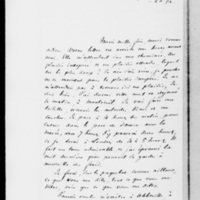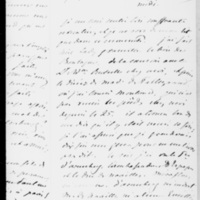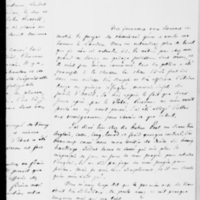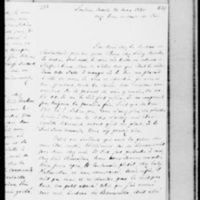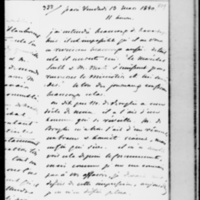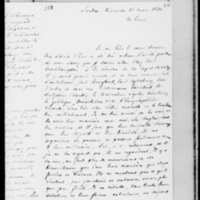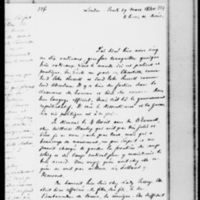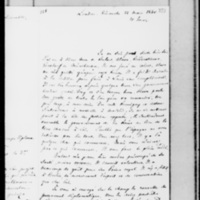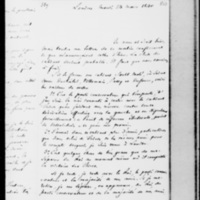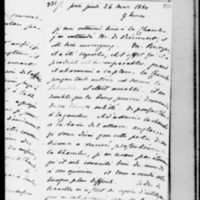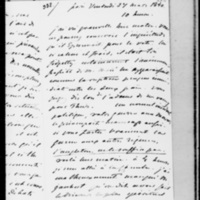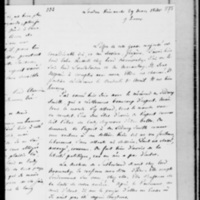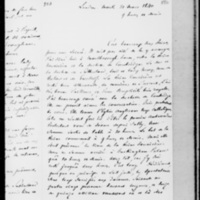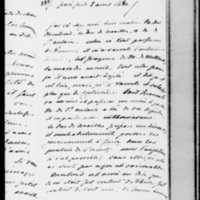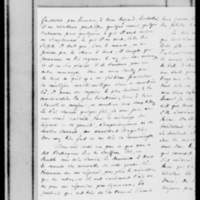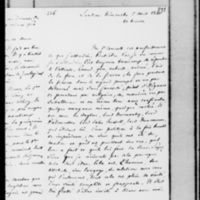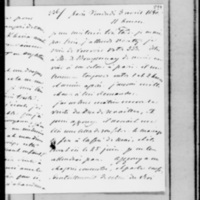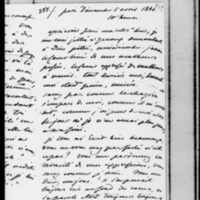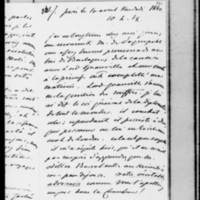Votre recherche dans le corpus : 295 résultats dans 6062 notices du site.Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres (La correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Lieven : 1836-1856)
315. Paris, Mardi 25 février 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mots-clés : Ambassade à Londres, Relation François-Dorothée, Santé (François)
316. Paris, Mercredi 26 février 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
317. Paris, Vendredi 28 février 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre de Calais m’a fait tant de plaisir ! Comme vous avez été vite ! Vous voilà donc vraiment à Londres. Votre chambre à coucher donne-t-elle sur le square ou le jardin ? Vous devriez prendre le square, l’air doit y être meilleur. Comment supportez-vous l’odeur de Londres ? J’ai mille et une question à vous faire ; mais vous me direz tout. J’ai eu longtemps hier matin les Granville et les Appony. En fait de nouvelles ici, ni les uns ni les autres ne savaient la moindre chose. Mais l’un attendait patiemment le dénouement, et l’autre, avec une grande horreur de Thiers, et une presque certitude de retourner au Marechal.
Je ne me suis point promenée il faisait trop froid, je n’ai pas fait d’autres visites, j’ai manqué celle de Mad. Sébastiani dont j’ai trouvé la carte en rentrant ; je vous dis cela comme suite à ce que je vous mandais dans mon dernier n°. J’ai dîné à 6 heures seule, et je suis allée à l’opéra où j’avais donné rendez-vous à M. Molé et le duc de Noailles. Le dernier est venu et Lord Granville nous avons entendu Mozart [ ? ] Les noces de Figaro mais charmant, chanté à ravir. Cela m’a plu j’y retournerai. Medem, [ ? ] et d’autres étaient venus chez moi. Je suis fâchée d’avoir manqué Médem. [Comte Paul] Je vous raconte tout et cela fait peu de choses. Je fus à Paris ce matin chez M. Jaubert, comme de raison j’ai été très effrayée.
Ce soir il y avait [ ?] et [ ? ]. Évidemment Médem serait charmé que le Maréchal n’y fut plus. Il ne voit pas un grand inconvénient à Thiers. Appony et [ ? ] y verraient la guerre. Il n’y a point de nouvelles du dehors, que je sache. Je vous prie de me mander beaucoup de choses. Racontez-moi [ ?], dites-moi tout ce qu’aurait sinon dit Génie, et une autre fois ne vous fier à des Génies. Moi je m’y fiais puisque vous me le disiez - mais il [faut] que j’apprenne à ne pas croire à tout ce que vous me dîtes. Je vous ai dot que j’étais rancunière et je vous le prouve. Cela n’empêche pas autre chose.
M. Molé est venu me chercher hier, mais je n’y étais pas.
316. Calais, Mercredi 26 février 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
317. Londres, Vendredi 28 février 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève. Je suis arrivé hier à 5 heures un quart. J’ai mis un peu plus de huit heures de Douvres à Londres par un beau soleil froid qui est entré avec moi dans le brouillard de la ville et s’y est éteint tout à coup. J’espère que je n’en ferai pas autant.
318. Londres, Samedi 29 février 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
318 Londres Samedi 29 février 1840
9 heures du matin
J’éprouve ici le matin une grande impression de calme. Personne ne vient. Personne ne me parle. Je n’entends point de bruit. C’est le repos de la nuit, sauf les ténèbres. Il me semble que je sors d’un guêpier bruyant, et que je contemple une ruche d’abeilles qui travaillent toutes sans bourdonner. Vous avez raison. Avec du bonheur domestique, la vie peut être ici aussi douce que grande. Il y a en France trop de mouvement extérieur; ici, pas assez de mouvement intérieur. En tout, l’aspect de cette société me plaît; je m’y sens à l’aise et dans un air sain, bien que trop froid.
Voilà du bonheur, le 316. Décidément chaque fois, je vous dirai mille fois merci. Oui, c’est du bonheur, un bonheur charmant quoique triste. Que serait-ce s’il était gai ? Je ne comprends pas Mad. Sébastiani ; malgré tout ce que j’en savais, ceci est plus bête. Mais je comprends encore moins Génie. Je lui ai répété ma recommandation pour tous les jours, cinq minutes avant de monter en voiture. Je n’entrevois qu’un motif, les obsèques de ce pauvre M. Devaines. Elles ont dû avoir lieu avant-hier jeudi, et Génie aura eu toutes sortes de soin à prendre. C’est un travail de mourir, et ceux qui s’en vont lèguent à ceux qui restent l’embarras avec le chagrin. Il est impossible que Génie ne soit pas allé vous voir hier.
4 heures Je viens d’avoir des aventures. Je sors de chez la Reine. Imaginez que je reçois, à une heure dix minutes, un billet de Lord Palmerston qui me dit que la Reine me recevra à une heure. J’envoie sur le champ chez Lord Palmerston pour constater mon innocence. Je m’habille en toute hâte. Je demande mes chevaux. Je pars. J’arrive avant 2 heures, à Buckingham. Comme de raison, on m’attendait. Je monte et trouve Lord Palmerston qui arrivait aussi. Les ordres de la Reine lui étaient parvenus tard. On ne les lui avait pas remis tout de suite. Heureuse-ment la Reine avait d’autres audiences qu’elle avait données en atten-dant. [Point de maître des cérémonies. Sir Robert Chesler, prévenu en même temps que moi, n’avait pas été aussi preste que moi.]
Bref, la Reine m’a reçu avec beaucoup de bonne grâce; sa dignité la grandit; son regard est intelligent et animé. Je lui ai dit en entrant : « J’espère, Madame, que Votre Majesté sait mon excuse, car je serais inexcusable. » Elle m’a répondu en souriant, et j’ai vu que Lord Palmerston était excusé aussi. Mon audience a été courte. Le Roi, la famille Royale, les relations du Roi avec le Duc de Kent son père, la surprise que je ne fusse jamais venu en Angleterre etc, etc. [Je suis sorti. Lors Palmerston est resté un moment après moi. Je m’en allais ; il m’a rejoint en courant : « Vous n’avez pas fini ; je vais vous présenter sur le champs au Prince Albert et à la Duchesse de Kent ; sans cela, vous ne pourriez leur être présenté qu’au prochain lever, le 6 mars ; et il faut qu’au contraire que, ce jour-là, vous soyez de vieux amis. »]
Nous avons été chez le Prince Albert, très beau et agréable jeune homme d’une physionomie douce, ouverte, intelligente, simple et élégant de langage. Il m’a retenu un quart d’heure. Nous avons causé. Il m’a plu tout à fait...
[De là, chez la Duchesse de Kent, au rez de chaussée. Elle était un peu malade de la goutte. Au moment où je traversais le vestibule pour aller reprendre ma voiture, sir Robert Chester est entré descendant de la sienne. Je lui ai fait toutes mes excuses dont je n’avais pas besoin. Je suis rentré chez moi, j’ai quitté mon harnois. J’ai couru une heure et demie pour aller m’écrire chez les Ducs de Sussex & de Cambridge, la duchesse de Glocester, les Princesses Auguste et Sophie-Mathilde, et me voici de retour. Demain les visites du cabinet. Après demain celle du Corps diplomatique. Les cartes pleuvent chez moi ce matin. On me remet à l’instant celle de Lord Aberdeen, Lord Holland et Lord Howe. Je demanderai demain à être reçu par la Reine Douairière.
Je suis allé hier soir chez Lady Holland sans la trouver. Elle était à Covent Garden où la Reine a été fort bien reçue. Les loges en face ont été louées pour 20 £ pour la voir, et les loges à côté 10 liv., pour ne pas la voir.
Dimanche 9 heures.
J’ai été plongé hier en Angleterre ; jusqu’au fond. A dîner le duc de Sussex, le Duc de Norfolk, le Duc de Devonshire, Lord Carlisle, Lord & Lady Albermarle, Lord & Lady Minto, Lord & Lady Elisabeth Howard, Lady Seymour, &, &, tous Whigs sauf un petit Tory dont j’ai oublié le nom. Le soir un rout immense, tout ce qu’il y a de ministres, de corps diplomatique, de membres des deux chambres, Whigs, Torys, radicaux, depuis lors Aberdeen jusqu’à M. Grote ; mais les Whigs souverains, selon leur droit.
J’ai passé ma soirée à être présenté et à accueillir des présentés. On me dit que je dois être content, très content que j’ai été bien lion et bon lion. Il me semble que j’ai rencontré de la curiosité et de la bienveillance. Je suis décidé à y être difficile. Je ne fais nul cas des demi-succès et des succès de début. Il les faut, mais pour commencer, comme il faut un premier échelon à la plus haute échelle. Si je suis bon à quelque chose ici, pour mon pays & pour moi, ce ne peut être qu’en inspirant une estime & un intérêt soutenu & croissants.
Fanny Cowper est charmante ! Elle promène partout, modestement mais sans embarras, un regard si jeune et si indépendant ! Je serais surpris si elle n’avait pas des goûts très décidés, en attendant des volontés.
Lord Aberdeen est venu à moi avec un empressement marqué. Je l’ai trouvé plus vieux et l’air moins sombre que je ne m’y attendais.
Lord Melbourne m’a parlé français de très bonne grace et longtemps. Il n’y a qu’Ellice qui soit décidé à ne pas me dire un mot de français. Il a raison. Je lui ai promis d’aller diner chez lui mercredi, en famille, et vendredi, chez Lord Charendon, en petit comité. Lord Charendon a été très aimable.
Je n’ai pas vu, du Cabinet, Lord John Russel, et du corps diplomatique, le Baron de Brunnow.
Connaissez-vous une Mad. Stanley, jolie, vive, spirituelle, whig très décidée et très active, que Lord Palmerston appelle notre Chef d’Etat major ? Son mari est un whipper-in important.
J’ai trouvé là le Prince de Capoue et sa femme. Il y a plus que l’océan entre les façons anglaises et les façons napolitaines.
Le Duc de Sussex a l’air d’un très bon homme. Il m’a beaucoup parlé de ses voyages sur le continent. Il a vu commencer toutes les révolutions, en France, en Espagne, en Portugal. Il prenait grand plaisir à me raconter Mirabeau. Vous savez que M. Croker m’a dressé à ces leçons-là.
J’étais à table entre Lady Cecilia Underwood (vous savez) et Lady Albermarle qui m’a mis très bonnement, au courant de tout le monde. Lady Palmerston avait à côté d’elle le Duc de Sussex et le duc de Norfolk. C’est la règle, n’est-ce pas ?
J’ai échangé en courant quelques paroles avec Lady Palmerstonn affectueuses pour vous. Elle a l’air très contente, et répand avec beaucoup de grace son contentement tout autour d’elle. Son fils, Lord Cooper m’a paru sprituel.
Si nous étions ensemble, je vous dirais mon compliment de Lady Palmerston à mon sujet, que j’ai entendu en passant. Mais cela ne se dit que tout bas quoique tout seuls.
Vous avez raison ; elle a l’air très fine et voyant tout sans y regarder.
5 heures
J’ai eu toute à l’heure un vrai plaisir. J’ai été à Stafford house. Le Duc et la Duchesse de Sutherland m’ont accueilli presque avec amitié. J’aime Stafford-house. C’est très beau, très beau. Et ce sera encore plus beau, car le premier étage n’est pas fini. J’ai vu ce qui est fait et ce qui se fait. Le Duc m’a promené partout. L’Escalier a vraiment de la grandeur, assez pour que la richesse y soit bien placée. Le comte de Montfort m’y a succédé.
J’apprends que j’ai eu tort de ne pas me mettre à côté de Lady Palmerston. C’est Lady Albermarle qui m’a trompé. Je lui donnais le bras. Je l’ai consultée ; elle m’a dit que je devais me placer à côté de Lady Cécilia Underwood, quasi altesse royale. Je prendrais ma revanche.
J’ai fait ce matin toutes mes visites de cabinet, et Lord Charendon sort d’ici. Il a vraiment de l’esprit, et un esprit gracieux. Nous nous sommes entendus au-delà de mon attente. Je dine chez lui vendredi, samedi chez Lord Lyndhurst, Dimanche chez Lord Landsdown. Il y a aussi un dîner arrangé chez le duc de Devonshire, avec le duc et la duchesse de Cambridge. Je subis cette première bouffée , j’espère qu’elle ne soufflera pas toujours.
Je vous parle de tout, et pas un mot de ce qui se fait à Paris. Que serviraient mes paroles ? Vous en savez plus que moi. J’attends ce que me mandera le duc de Broglie. Il a mes pouvoirs, sauf ratification. Adieu pour Aujourd’hui. Il fait très froid. Mais je n’ai pas l’impression d’un changement de climat.
M. Dedel sort aussi de chez moi, très ouvert et très bienveillant. Je crois que je me trouverai bien de lui et avec lui Lundi.
Lundi 2 mars 9 heures
Je ne compte pas avoir de lettre de vous ce matin, par la poste. Vous aurez attendu le courrier des affaires étrangères. C’est horrible une poste qui arrive et qui ne m’apporte rien de vous. Le Val-Richer, Baden ne m’ont jamais coûté si cher. Je m’y accoutume tous les jours moins. C’est déjà si peu qu’une lettre ! Et pourtant c’est tout.
J’ai passé deux heures et demie hier soir chez Lady Holland, empressée, charmante. J’ai trouvé Lord Holland toujours le même, absolument le même, la seule personne qui ne m paraisse pas vieillie, d’esprit ni de corps. Lord John Russel et Ellice y avaient dîné. Lord & Lady Palmerston y sont venus le soir. J’ai un peu causé avec Lady Palmerston, et j’ai protesté contre l’erreur où m’avait attiré Lady Albermarle avant-hier. Voici mes dîners de la semaine. Mercredi Ellice. Vendredi, Lord Clarendon. Samedi, Sir Robert Peel. Dimanche, Lord Landsdown. Mardi 10, le Duc de Sutherland. Il me semble que je vous en ai dit la moitié plus haut.
10 heures ¼
J’avais tort de ne pas espérer. La poste est charmante. Que de choses à vous répondre ! En attendant vous gagnerez quelque chose à ma joie. Je ferai partir ce volume aujourd’hui. Un autre suivra promptement. Que ne donnerais-je pas en ce moment pour causer une heure avec vous ! Adieu. Adieu.
318. Paris, Dimanche 1er de mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
318. Paris, le 1er mars 1840, dimanche
10 heures
Après avoir fermé ma lettre hier, je suis allée chez votre mère. Le cœur m’a battu en entrant. Elle m’a reçue avec bonté. Vous ne sauriez croire comme elle me plaît. C’est un visage si serein, un regard si intelligent et si doux, et même gai.
Je l’ai beaucoup regardée. Quand je ne la regardais pas, il me semble qu’elle me regardait aussi. Le Duc de Broglie y était, et y est resté. Il a parlé de la situation tout le temps. Pourquoi le Duc de Broglie a-t-il cet air moqueur et désobligeant ? Je conçois qu’il ne plaise pas. Moi, je l’aime assez malgré cela, et malgré autre chose que je déteste et que j’ai découvert en lui hier. Il a commencé par dire qu’il ne savait absolument rien ; que depuis trois jours il n’avait vu personne du tout ; et puis il nous a raconté son entretien avec le Roi, la veille, et un long entretien avec Thiers le soir, et puis, et puis, tout ce qui se passe. Pourquoi commencer par mentir ? Vous savez l’horreur que j’ai de cela. Si jamais je commence, moi, je continuerai. Mais il me semble que je suis trop fière pour commencer. Les Français ont décidément l’habitude du mensonge ; je ne connais pas d’Anglais dans lequel j’aie surpris ce défaut. Voyez bien et vous trouverez si je dis vrai!
Mais je reviens à la rue de la Ville-l’Evêque. Vos enfants ont couru à ma rencontre dans la cour, cela m’a fait plaisir. Ils ont une mine excellente, surtout Henriette. J’ai demandé à votre mère de me les envoyer ce matin pour voir passer le bœuf gras, elle ne le veut pas à cause de leur deuil. Votre mère a été bien polie et affectueuse pour moi.
Delà je fus chez Lady Granville qui est bien malade ; elle n’avait pas dîné ni assisté à la soirée la veille. Nous avons causé pendant une heure, elle et son mari, du nouveau ministère, de votre situation ; il ne sait trop qu’en dire. Moi, je ne me permets pas d’avoir une opinion devant les autres ; j’attends que vous ayez pris votre parti.
J’ai été rendre visite à Mad. Sebastiani sans la trouver. De là chez les Appony qui sont consternés. Appony ne conçoit pas le Roi, et il ajoute qu’il n’aura certainement aucune affaire à traiter avec Thiers, et qu’il entre en conséquence en vacances.
J’ai dîné seule. Le soir la diplomatie est venue. Granville croyait savoir que la nomination du ministère avait été mal accueillie à la Chambre. Médem est enchanté de n’avoir plus Soult et d’avoir Thiers. Il est tout remonté. Brignoles n’a pas d’opinion.
Quand aurai-je mes lettres ? à propos notre correspondance ! Cela ne sera plus très commode. Cela prouve bien votre situation naturelle vis-à-vis de ce ministère.
Bulwer est très malade, je ne puis pas le voir. Il m’écrit ce matin ce matin & me dit qu’Odillon Barot est très piqué contre Thiers qui ne l’aurait pas même consulté pendant la crise. Cela n’est pas trop d’accord avec d’autres avis.
Midi
Génie sort d’ici, il a un peu ébranlé mes opinions d’hier, par les récits qu’il m’a faits de ses entretiens avec vos amis. Il faut attendre ; mais si on tire à gauche, revenir sur le champ : voilà ce qui me paraît ressortir des avis les plus sages. En attendant, la puissance de Thiers me paraît établie dans tous les départements du Ministère.
J’attends votre lettre , car on me dit qu’il y a un gros paquet au bureau de l’hôtel des Capucines.
1 heure
La lettre n’arrive pas. La voilà. Je vous en remercie.
Lundi 2 mars, I heure
Je ne sais pas trop comment vous envoyer cette lettre. Cependant, jusqu’à nouvel avis, je ferai comme vous me l’avez indiqué. Lundi et jeudi au bureau des Affaires étrangères et samedi par la poste.
J’ai été voir hier les trois malades, la petite Princesse, Lady Granville & Mad. Appony. Même fureur chez ceux-ci. Il veut aller au château ce soir.
J’ai eu à dîner M. de Pogenpohl. Ah! mon Dieu, Dimanche passé c’était autre chose! Le soir j’ai été faire visite à Mad. de Castellane; mais quoique j’aie tenu bon jusqu’à onze heures, M. Molé n’y est pas venu, je le regrette. Mad. de Castellane est fort opposition. En bonne catholique, elle a une sainte terreur de M. Vivien. Outre ces faits là, je n’ai rien relevé dans sa conversation.
Lord Palmerston mande à Lord Granville que dimanche il devait avoir un long entretien avec vous. Vous voilà lancé dans les affaires, les dîners et les fêtes. Je crains que, pour commencer, le Duc de Sussex ne vous ait fait longtemps rester à table. Je vois tout cela, et un peu tout ce que vous en pensez. Votre première impression de Londres m’a divertie. Elle est vraie; je n’oublierai pas vos colonnettes et vos figurines.
J’ai fait venir mon petit brigand et l’ai envoyé chez votre mère avec des nappes de Saxe. Elle choisira ; il a tout ce que vous demandez. Les services ordinaires pour 12 personnes, étonnamment bon marché, 129 francs.
Je n’ai de lettres de personne.
Le temps est toujours brillant et froid. Ceci ne me plait pas ? Je crains la grippe des ambassadeurs. Je ne marche pas.Adieu, il me semble que je vous ai tout dit, tout ce que peut porter une lettre. J’aurais mieux dit à la chaise verte. Ah! que cette chambre est vide! Adieu. Adieu.
318. Londres, Mardi 3 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
318 Londres, Mardi 3 mars 1840
6 heures
Je viens de passer ma matinée à écrire une longue dépêche sur la conversation que j’ai eue hier au soir avec Lord Palmerston et où nous n’avons pas encore abordé les affaires d’Orient. Je devais le revoir aujourd’hui à une heure. Mais il m’a prié de remettre à demain. Il était obligé d’employer sa journée à préparer les documents demandés par la Chambre des Communes sur la querelle avec la Chine. Sa vie pendant la session est vraiment très dure. Il travaille beaucoup. Je lui trouve l’esprit net, prompt & pratique. Il doit prendre de l’influence.
Je n’ai encore fait que rencontrer Lord Melbourne. Mais il me plaît. Je lui trouve un certain mélange de bonhomie & de commandement, d’insouciance& d’autorité que je n’ai pas encore vu. Son crédit auprès de la Reine est toujours le même. Les Whigs aiment tendrement la Reine. Ils font remarquer qu’on n’a pas encore cité d’elle un acte, un mot qui manquât de prudence ou de tact.
Elle n’a plus grand goût à la danse. Elle aime mieux son mari.
Je dîne jeudi à Buckingham-Palace. Cela me fait déranger un petit dîner chez moi ave Dedel, Alava et le baron de Blum. Le corps diplomatique me parait très avisé de ces petits dîners & d’une partie de whist après.
M. de Hummelauer a plus d’esprit que vous ne m’aviez dit. Il part au mois de mai, charmé de quitter l’Angleterre, où il s’ennuie, pour aller à Milan épouser une jeune Italienne de 18 ans qu’il ennuiera, je pense. Ellice est venu dîner hier avec moi, très bon et très aimable. Je puis abuser de lui tant que je voudrai. Je lui ferai plaisir.1
J’ai interrompu mes écritures ce matin, pour aller mettre des cartes, chez Lord Lyndhurst, Lord Cowley, et le marquis de Northampton. Voilà qui est bien intéressant , n’est-ce pas ? Je vous dis tout.
Ma chambre donne sur le square. On dit qu’elle est très gaie. Décidément, ici, le ciel et la terre se confondent, gris tous les deux. J’ai regardé hier le soleil bien plus en face que ma lampe. C’est là, jusqu’à présent, le seul fait physique qui me frappe en Angleterre. Je n’ai du reste aucune impression d’un changement de climat, de température et d’habitudes. Si j’avais près de moi ceux que j’aime j’oublierais parfaitement que j’ai changé de lieu. Mon cuisinier a le plus grand succès. Ellice dit qu’il n’a point de pareil. Mon maître d’hôtel est excellent. Je ne suis pas aussi content de mon valet de chambre. Je ne vous dis que des balivernes et j’ai à vous parler de choses si importantes. Je n’ai pas voulu les entamer ce matin. Je me repose avec vous de ma dépêche.
Mercredi, 5 heures
Je voulais vous écrire avec détail sur le parti que je prends, vous dire toutes mes raisons qui me semblent décisives et ne me laissent aucun doute. Je sors de chez Lord Palmerston qui m’a gardé trois heures et demie. J’ai à peine le temps d’envoyer à la poste. A après-demain donc les détails. Mais je veux que vous sachiez au moins l’ensemble. Voici des copies de la lettre que j’ai reçue ce matin du Duc de Broglie, et de celle que j’écris aussi ce matin, à M. Duchâtel. Vous serez au courant. J’y ai bien pensé. Je suis parfaitement convaincu. J’attendrai et je regarderai. Quel douloureux ennui que l’éloignement! Je voudrais vous tout dire et je ne vous dis rien, rien.
Je suis charmé que vous ayez vu ma mère. J’étais sûr qu’elle vous plairait. Adieu, adieu. Quand je cesse de vous écrire, c’est encore une séparation. Adieu au moins.
319. Paris, Mardi 3 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
319 Mardi 3 mars 1840
9 heures
J’attends vos lettres avec une vive impatience. Je suis curieuse de ce que vous me direz de Paris autant et plus que de ce que vous me direz de Londres.
M. d’Appony est venu causer longtemps chez moi hier matin. Plus tard j’ai été causer longtemps chez Lady Granville. M. Thiers quoi venu de bonne heure chez l’Ambassadeur d’Angleterre. L’entretien été fort agréable à Granville. Thiers lui a dit qu’il avait votre promesse de rester avec lui Ministre des Affaires Etrangères. Cette visite s’est faite même avant la notification officielle du changement de Ministère. J’ai dîné seule. Le soir tout le monde était chez Thorn. Il ne m’est venu que Mad. de Boigne et le Duc de Richelieu, trop fier pour faire la connaissance du plébéien de l’autre monde. Mme de Boigne ne sait trop que dire de ceci. Elle trouve à Thiers beaucoup de puissance, mais elle aime Thiers, elle en aime quelques autres dans le nouveau ministère. Somme totale, elle attendra patiemment avec ce ministère ci l’occasion d’aimer beaucoup un ministère prochain. Elle a parlé de vous, espérant fort — que vous resteriez à Londres pour le moment, quoique M. Duchâtel dise que vous n’étiez pas préparé à la combinaison actuelle, telle qu’elle est faite. M. de Broglie se proclame très haut le parrain du Ministère actuel ; il y a des gens que cela étonne beaucoup, car ce Ministère ne peut trouver d’appui que dans la gauche (Boigne). Le Roi a causé avant-hier avec l’Ambassadeur d’Angleterre. Il se dit fort content des explications qu’il a eues avec Thiers. On pense généralement qu’il sera fort doux avec tout le monde, voire même les Appony.
Je suis dans de tristes anniversaires et cette année, pour la première fois, les jours correspondent avec les dates ! Je cherche à me distraire, mais comment ? Ah que vous me manquez, à présent, toujours ! Il y a huit jours je vous attendais encore, je n’attends plus rien, personne.
2 heures Il fait un temps bien froid et avec cela bien gris.
Mercredi, 11 heures
J’ai fait visite hier à Lady Granville, à Pauline et puis à sa mère. L’enfant de Pauline a la ressemblance la plus frappante avec M. de Talleyrand. J’ai trouvé chez la Princesse Mrs de Rambuteau et de Vandoeuvre. Celui-ci ravi et inquiet. Rambuteau disant qu’il faut soutenir parce que les changements sont déplorables. La Duchesse spécule sur la diplomatie française au cas où Londres, Vienne et Petersbourg viendraient à vaquer. Elle doute que Londres vaque.
J’ai dîné hier soir en Autriche. Appony avait été le matin faire visite à Thiers sans le trouver. Une heure après, Thiers est venu chez lui. Il a été très poli, très bien. Il est évident qu’il est décidé à être bien pour tout le monde. Appony avait été au Château avant-hier soir. Il a trouvé le Roi résigné et triste, reconnaissant fort bien que sa situation devait être très abaissée aux yeux de tous. Il s’est dit cependant content de ses entretiens avec Thiers. Les articles d’hier et ce matin dans les Débats font quelque sensation. Mon voisin Jaubert reste mon voisin. J’en suis bien aise. Il est venu me faire visite hier avant que je ne fusse rentrée de chez les Appony. J’étais chez moi à 8 h 1/2. Il n’est venu personne, personne. C’était le mardi-gras, par conséquent mon mardi maigre. Et tout juste hier c’était horrible. Je me suis couchée à 11 heures sans pouvoir m’endormir jusqu’à 6 heures du matin. Cette terrible heure ! Ah quelle nuit !
Il me semble que je suis bien loin de vous, j’ai votre lettre de vendredi & depuis je n’ai rien. Aujourd’hui le Galignani me parlera de vous, voilà tout ce que j’en saurais.
Midi
Voilà M. […] qui m’apporte le 318. Comme j’ai dévoré tout ! Eh bien, je vous dirai que Londres vous plaît beaucoup. Vous êtes content, oui, vous êtes content, même gai. J’ai prévu cela. Et c’est très naturel. La mer nous sépare aujourd’hui, nos sensations seront bien différentes. Je pleure aujourd’hui et vous riez! Quand vous aurez passé par le feu des dîners, dites-moi donc un peu autre chose. Que fait le négociateur Brünnow ? Le petit Nesselrode a dû porter les réponses de Pétersbourg. Mais c’est de Berlin qu’il les a prises au courrier. Quand me direz-vous ce que vous pensez de ceci ? Thiers a dit à Granville qu’il fera une diminution dans les fonds secrets. On dit que cela va être présenté incessamment. Il a reçu hier soir Aston dans la place St Georges ; les zélés y sont allés. Appony s’est abstenu.
1 heure 1/2
Vous voyez comme je reviens à vous souvent! Il me semble que vous m’avez recommandé de vous redire souvent ce que je vous avais dit souvent déjà ici. Eh bien, restez ce que vous êtes, grave, sérieux, naturel. Défendez-vous de l’enivrement de la situation nouvelle où vous vous trouvez. Rappelez-vous que vous vivez dans une maison de verre. Tout sera remarqué. Les Anglais sont infiniment plus fins qu’on ne l’imagine, et singulièrement observateurs et curieux, tout en ayant l’air de n’y pas regarder.
Jeudi 5 mars,
10 heures J’ai été à la Chambre hier. Elle était comble. Thiers est venu prendre sa place sur le banc des Ministres avec un contentement visible. 1 Il s’est assis, pan, pan, pan, comme pour bien en prendre possession. Il a lu un discours d’une voix fort monotone, et pas très haute. Il a été reçu très froidement. J’ai quitté la Chambre tout de suite après, pour le Bois de Boulogne, ensuite chez Lady Granville. M. de Rémusat est venu chez son mari pendant que j’y étais. Il est convenu également qu’ils avaient été accueillis assez tièdement. Il a dit à Granville qu’il ne doutait pas que vous resteriez à Londres.
J’ai dîné seule. Le soir j’ai eu Mad. de Coutades, elle est restée toute la soirée. Appony, Brignoles, le Duc de Noailles, M. Molé, Pahlen, d’Ossuna. Brignoles venait de chez le Roi qui lui a dit : « Je ne suis pas vaincu, mais je suis battu. » M. Molé parle du Ministère comme très transitoire. Il ne fait aucun doute qu’il tombe sur les fonds secrets : tout son monde tient ferme, le vôtre vient à lui. Il n’y a que cinq ou six doctrinaires qui restent avec M. de Rémusat. Les autres 25 passent à l’opposition. Thiers ne peut avoir de soutien qu’à la gauche, et cela ne peut pas suffire. Le Roi affirme qu’il n’accordera jamais la dissolution à Thiers. On a dit : « Et M. Guizot? — M. Guizot? cela ne fait pas une question. Il y a une justice à lui rendre, il n’a jamais cessé de combattre la gauche. » Vous voyez que je vous dis tout. Le Maréchal Soult avait dit aux Ambassadeurs qu’il n’attendait que la fin de la crise pour se rendre dans sa terre en Languedoc, hier il est venu leur faire visite à tous pour les prévenir qu’il les recevra tous les lundis soirs. Cela fait jaser.
Voici une longue lettre, ou plutôt une gazette. Je sais qu’on attend M. d’André en courrier de Pétersbourg ; des lettres venues par la poste annoncent son départ, mandez-moi ce qu’il apporte. M. de Pahlen écrit à son frère toujours la même chose, qu’il n’y a rien. Que pensez-vous que fera Barante de l’ordre qui lui a été envoyé ? Je vous prie de me dire une quantité de choses. Adieu, adieu, adieu.
Lord Granville a été hier à la soirée de la Place St Georges, Mardi. Il y avait une foule de députés, rien que la gauche.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Deuil
320. Londres, Jeudi 5 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Londres, jeudi 5 mars 1840, 8 heures du matin
Je me lève. Comment aurez-vous dormi cette nuit ? Hier était un triste jour. J’ai le coeur plein de remords d’être loin de vous. Je ne vous ai jamais fait le bien que j’aurais voulu. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais tout le bien que je voudrais vous faire, mon ambition infinie, insatiable, avec vous. Je vous aime trop pour me résigner jamais à me sentir impuissant et désarmé quand je vous vois un chagrin, n’importe lequel, n’importe de quelle date. Non, je ne me résignerai jamais à ce que cela soit, jamais à le croire; je m’en prendrai toujours à l’imperfection de notre relation, à la séparation de nos vies, à l’impossibilité où je suis de vous donner tout ce que j’ai en moi pour vous, d’exercer auprès de vous, sur vous, toute cette puissance d’affection et de tendres soins, le seul vrai baume que Dieu ait mis à notre disposition pour les blessures de l’âme. Dearest, vous avez beaucoup souffert, et il vous a toujours manqué du bonheur à côté de la souffrance. Il n’y a pas moyen de supprimer la souffrance dans la vie humaine; elle en est inséparable ; mais le bonheur aussi peut s’y placer; et la destinée le plus rudement frappée, le cœur le plus déchiré peuvent contenir en même temps les joies les plus intimes et les plus douces. C’est ce mélange de bien et de mal, cette compensation de l’un par l’autre que je voudrais du moins vous donner. Près de vous, je faisais déjà si peu! Quoi donc de loin?
6 heures
Vous avez raison. Je suis faible quelquefois avec mes amis. Mais dans cette occasion, ma faiblesse était bien embarrassée, car elle avait à choisir : le Duc de Broglie, MM. de Rémusat et Jaubert d’un côté, MM. Duchâtel et Villemain de l’autre. Evidemment il fallait chercher ailleurs que dans mes amitiés le motif de décision. Je ne vous redirai pas ce que vous aurez vu dans ma lettre à Duchâtel et dans celle du Duc de Broglie. Il ne m’est resté, il ne me reste aucun doute. Je ne sais ce qui arrivera. Je penche à croire qu’au fond ce Ministère fera à peu près comme le précédent. Je suis sûr qu’il le voudra; je présume qu’il le pourra. Je ne lui vois ni des amis bien exigeants, ni des ennemis bien intraitables. S’il en était autretrement, si le pouvoir allait réellement à la gauche, je n’hésiterais pas un instant. Ils le savent. Voici ce que m’a écrit Thiers :
« Mon cher Collègue, je me hâte de vous écrire que le Ministère est constitué. Vous y verrez, parmi les membres qui le composent, deux de vos amis, Jaubert et Rémusat, cl dans tous les autres, des hommes auxquels vous vous seriez volontiers associé. Nos fréquentes communications depuis dix-huit mois nous ont prouvé, à l’un et à l’autre, que nous étions d’accord sur ce qu’il y avait à faire, soit au dedans, soit au dehors. Nous pouvons donc marcher ensemble au même but. Je serais bien heureux si en réussissant tous les deux dans notre tâche, vous à Londres, moi à Paris, nous ajoutions une page à l’histoire de nos anciennes relations. Car aujourd’hui comme au 11 octobre, nous travaillons à tirer le pays d’affreux embarras. Vous trouverez en moi la même confiance, la même amitié qu’à cette époque. Je compte en retour sur les mêmes sentiments. Je ne vous parle pas d’affaires aujourd’hui. Je ne le pourrais pas utilement. J’attends vos prochaines communications et les prochaines délibérations du nouveau Cabinet. Ce n’est qu’un mot d’affection que j’ai voulu vous adresser aujourd’hui, au début de nos relations nouvelles. » Je lui ai répondu ce matin : « Mon cher Collègue, je crois comme vous qu’il y a à tirer le pays de graves embarras. Je vous y aiderai d’ici, loyalement et de mon mieux. Nous avons fait ensemble, de 1832 à 1836, des choses qu’un jour peut-être, je l’espère, on appellera grandes. Recommençons. Nous nous connaissons et nous n’avons pas besoin de beaucoup de paroles. Vous trouverez en moi la même confiance, la même amitié que vous me promettez et que je vous remercie de désirer. Nous nous sommes assurés en effet, dans ces derniers temps, que nous pouvions’ marcher ensemble vers le même but. Rémusat m’écrit que le Ministère s’est formé sur cette idée : Point de réforme, point de dissolution. C’est le seul drapeau sous lequel je puisse agir utilement pour le Cabinet, honorablement pour moi. Si quelque circonstance survenait qui me parût devoir modifier nos relations, je vous le dirais à l’instant et très franchement. Je suis sûr que vous me comprendriez, et même que vous m’approuveriez. » Vous voilà au courant, comme on peut l’être de loin. Misérable communication ! Pendant que je vous écris, mon âme, mes regards, ma voix vous cherchent. Adieu. Je vous quitte pour aller m’habiller et dîner chez la Reine.
Vendredi 6 mars, 5 heures
J’ai diné à la droite de la Reine qui avait son mari à sa gauche. Elle a été très aimable pour moi. Soyez tranquille ; pas la plus petite allusion aux Affaires. La famille Royale, la Princesse Marie, Melle Rachel, Paris, Buckingham-Palace ont défrayé la conversation. La Reine a eu pour moi les mêmes bontés que Mme la Duchesse d’Orléans ; elle a lu mes ouvrages. Elle a un joli regard et un joli son de voix. Dans son intimité elle a supprimé la retraite des femmes avant les hommes. Hier les vieilles mœurs ont prévalu. J’avais à ma droite Lady Palmerston, puis Lord Melbourne, le Marquis de Westminster, Lady Barham etc, 28 en tout.
Après le dîner, on s’est établi autour d’une table ronde, dans un beau salon jaune qui m’a fait frémir tout le cœur en y entrant. C’est presque la même tenture que votre premier salon. Deux ou trois femmes se sont mises à travailler. Nous avons causé, sans trop de langueur, grâce à Lady Palmerston et à moi jusqu’à onze heures un quart que la Reine s’est retirée.
J’ai découvert au-dessus des trois portes de ce salon trois portraits... Je vous donne à deviner lesquels! Fénelon, le Czar Pierre et Anne Hyde, Duchesse d’York. Je me suis étonné de ce rapprochement de trois personnes si parfaitement incohérentes. On ne l’avait pas remarqué. Personne n’a pu en trouver la raison. J’en ai trouvé une. On a choisi ces portraits à la taille. Ils allaient bien aux trois places.
On disait hier matin une nouvelle. La Reine n’avait pas paru la veille à dîner, elle était souffrante ; elle est grosse. Lady Holland a apporté cela le soir chez Ellice où j’avais dîné. Mais la Reine a dîné hier et ce matin elle a tenu un lever qui a duré deux heures. C’est beaucoup si elle est grosse. Cependant on ne retire pas la nouvelle.
Ce lever, m’a ennuyé et intéressé. C’est bien long et bien monotone. Pourtant j’ai regardé avec une émotion pleine d’estime le respect profond de tout ce monde, courtiers, Lawyers, Aldermen, Officers, passant devant la Reine, la plupart mettant un genou en terre pour lui baiser la main, tous parfaitement sérieux, sincères et gauches. Il y faut cette sincérité et ce sérieux pour que tous ces vieux habits, ces perruques, ces bourses, ces costumes que personne, même en Angleterre, ne porte plus que pour venir là, ne fassent pas un effet un peu ridicule. Mais je suis peu sensible au ridicule des dehors quand le dedans ne l’est pas. J’ai vu le Duc de Wellington, triste vue, presqu’aussi triste que celle de Pozzo; rapetissé de trois ou quatre pouces, maigre, chancelant, vous regardant avec ces yeux vagues et éteints où l’âme qui va s’enfuir ne prend plus peine de se montrer, vous parlant de cette voix tremblante dont la faiblesse ressemble à l’émotion d’un dernier adieu. Il n’est point moralement dans l’état de Pozzo, l’intelligence est encore là, mais à force de volonté et avec fatigue. Il s’est excusé de n’être pas ecore venu chez moi : « J’étais à la campagne ». Je crois que je dinerai avec lui chez le Sir Robert Peel.
M. de Brünnow n’est pas encore venu chez moi. C’est le seul. Il était au lever de la Reine, très empressé, auprès des Ministres, busy-body 2 et subalterne dans ses façons.
Lady Palmerston m’a parlé de Paul. Il ne va absolument nulle part, si ce n’est à Crockford à 9 heures pour dîner. Il passe sa journée chez lui, en robe de chambre et à fumer. M. de Brünnow, dans les premiers moments, l’a vu deux ou trois fois et a essayé de le voir davantage. Paul n’a pas voulu. M. de Brünnow ne le voit plus.
Le mariage de Darmstadt n’est point certain. Le Grand Duc y retourne pour voir s’il pourra se décider. On doute qu’il se décide. Il est toujours amoureux en Russie. M. de Brünnow reviendra ensuite ici comme ministre en permanence, en attendant, fort longtemps peut être, un ambassadeur.
Samedi, 8 heures du matin
Hier, à dîner chez Lord Clarendon, M. de Brünnow s’est fait enfin présenter à moi. Il est bien remuant, papillonnant, aimable. Ce dîner m’a plu, Lord Clarendon est plus continental, plus de laisser-aller. Nous avions le Marquis de Douro et sa femme, la plus belle personne de l’Angleterre, dit-on, et vraiment très belle. Point d’esprit du tout. Comme lui. Entre nous il en est étrangement dépourvu. Plus que cela, car il parle beaucoup & se met en avant. Je vous étonnerais en vous répétant les pauvretés qu’il m’a dites. Toujours Lord Melbourne, Lord & Lady Palmerston. Après dîner, j’ai été à Devonshire House, où j’ai trouvé la Duchesse de Cambridge et un très select party, Lady Jersey, La Duchesse de Montrose, &, &. On dansait, le Duc de Devonshire autant que personne. On me parle beaucoup de vous, et je suis sûr que je réponds très bien.
10 heures
Voilà le 319. Mon remords de n’être pas auprès de vous redouble. Je me reproche l’agrément que je trouve ici, le plaisir que je prends à regarder, à être bien reçu. Je ne supporte pas la pensée d’être gai quand vous êtes triste, entouré quand vous êtes seule. Et pourtant cela est et je l’accepte en fait au moment même où mon cœur s’en indigne. Ah !Pardonnez-moi dearest, pardonnez-moi cette faiblesse de notre nature, à laquelle il n’y a peut-être pas moyen d’échapper et qui n’empêche pas que dans toutes les situations, à toutes les heures du jour, je n’aimasse mille fois mieux être auprès de vous que partout ailleurs, et partager votre tristesse plutôt que toutes les joies du monde. N’est-ce pas que vous me le pardonnez? N’est-ce pas que vous savez bien tout ce que vous êtes pour moi? La mer qui nous sépare est bien profonde, mais mon affection pour vous l’est mille fois davantage. Et j’aurais ici tous les succès imaginables que je leur préférerais mille fois le succès de vous donner un jour, une heure de bonheur.
Vous voulez que je vous parle des affaires. M. de Brünnow est évidemment en panne, attendant que les embarras, les obstacles au progrès de la négociation viennent de nous, pour se saisir tout à coup de ce fait, se faire un mérite de l’empressement, de la facilité de son maître, pousser peut-être cette facilité plus loin qu’il ne l’a fait encore, et enlever brusquement le succès. Je tâcherai de ne pas le servir dans cette tactique. Evidemment il y a ici un désir sincère, vif, de ne pas se séparer de nous ; on fera des sacrifices réels à ce désir. Il y a des dissidences marquées, à cet égard, dans le cabinet ; quelques-uns tiennent beaucoup plus à nous que d’autres. Mais tous y tiennent, et je n’entends pas le moins du monde me prévaloir des dissidences, ni chercher seulement à m’en servir. J’ai commencé à traiter et je traiterai jusqu’au bout l’affaire avec la plus entière franchise, m’appliquant uniquement à convaincre tout le monde de l’intérêt supérieur des deux pays au maintien de l’alliance, et de la nécessité d’une transaction, entre le Sultan et le Pacha, qui puisse être acceptée par le Pacha comme par le Sultan, par la France comme par l’Angleterre et qui mette fin à cette question-là en ajournant toutes les autres.
M. d’André n’a apporté de Pétersbourg que des lettres assez vagues, plutôt l’idée que l’affaire ne marchait pas, et un redoublement de colère de l’Empereur qui avait espéré, dit-on, que la dépêche, inspirée par lui, de M. de Nesselrode à Médem, amènerait une réponse qui amènerait une rupture. Je n’en crois rien. Pourtant, je n’en sais rien.
Adieu. Adieu. Continuez de me tout dire. Vos lettres me font un peu vivre à Paris, et cela m’est très utile. Soyez tranquille. Je n’oublierai pas vos recommandations. Mais répétez les moi toujours. Adieu encore.
Continuez de m’écrire les lundi et jeudi par les Affaires Etrangères, et le samedi par la Poste. Et si vous vouliez quelque chose de plus indirect, envoyez votre lettre à Génie.
320. Paris, Vendredi le 6 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Paris, vendredi 6 mars 1840
Il me semble que le courrier de Londres doit être arrivé hier, mais je n’ai pas eu de lettres, et je n’ai pas revu Génie depuis dimanche. Notre correspondance ne me parait pas bien réglée encore, c’est ennuyeux. Hier j’ai envoyé une lettre aux Affaires étrangères. Je me suis promenée seule au bois de Boulogne, j’ai fait ensuite une longue visite à la petite Princesse que j’ai trouvée dans son lit et puis Lady Granville. Elle m’a lu une lettre de son frère qui fait de vous le plus excellent éloge. Vous avez réussi parfaitement, votre air grave, vos bonnes manières and his talk charmed every body. Vous saurez en vivant à Londres que l’opinion du Duc de Devonshire y compte. Et moi, je vous le donne pour très fin. Lady Cowper me parle beaucoup de vous aussi. Elle dit que vous excitez une curiosité générale, que tout le monde veut faire votre connaissance et que tout le monde a été content de vous extrêmement. Elle se réjouit de vous voir plus familièrement. Voilà donc un début excellent; je n’en ai pas douté un instant. Elle aime la distinction de votre air, et votre sérieux, et votre envie de plaire. Je vous redis tout. On dit aussi que la Reine a été très aimable avec vous.
J’ai dîné seule et je suis allée aux Italiens. J’y avais assigné M. de Noailles, mais il m’a écrit pour me dire que Berryer réunissait son parti le soir et qu’on l’invitait à y assister pour délibérer sur la marche à suivre dans les nouvelles circonstances. A son défaut j’ai été prendre M. de Brignole. Lui et Granville ont fait ma soirée avec Rubini dans le Pirate. J’étais dans mon lit à onze heures, et pas très bien portante depuis quelques jours. L’Opéra Italien va finir ici et commencer à Londres. Prenez garde qu’on ne vous entraîne à prendre une loge. Je connais l’indiscrétion des Anglaises. Vous payeriez une loge excessivement cher, et vous n’en serez jamais le maître. En général ne permettez à personne de la familiarité avec vous ; cela ne vous va pas, et cela entraîne beaucoup plus loin que vous n’imaginez. Encore une fois, et toujours, restez là ce que vous êtes. N’est-ce pas?
J’ai envie de vous conter un peu ce qui se passe à Londres. Eh bien, il s’y passe, que la Reine mécontente même le parti whig, et que de grosses défections viendront frapper le gouvernement. Il suffit pour cela de quelques exclusions de ses bals.
Samedi 7 mars, midi
Génie est venu m’interrompre hier. Merci de votre lettre et merci beaucoup des copies. Je suppose que vous avez raison. Je suppose que vous avez raison. Vous saurez mieux que moi si vos idées sur Duchâtel sont exactes. Il me revient à moi tout le contraire de ce que vous pensez et désirez à cet égard. Mais cela ne me regarde pas. Ce qui me regarde c’est vous. Lady Holland écrit que tout le monde est charmé de vous. Et la Reine aussi ; et puis elle ajoute : « The public augurs well from his having placed the celebrated Louis at the head of his kitchen department. Few things tend more to popularity in this town than la bonne chère ; however what is more important is Lord Palmerston appearing really to like him, and confide in his warm expressions in favor of peace and amity with us.»3 Je veux cependant vous dire en passant que vous avez déjà fait des confidences là, qui me paraissent ne pas rentrer dans la résolution que vous aviez prise de ne pas les prodiguer. Cela est revenu ici ; tout y reviendra; et surtout vos opinions sur les personnes. Il ne faut pas trop adorer l’inconnu (ici) et surtout, surtout, il ne faut pas tout dire! Vous voyez que je parle à la chaise verte.
Lord Won Russell est tombé dans une champbre hier au moment où je voulais sortir. Il vous a vu chez Lady Palmerston et chez Lady Holland, mais à la manière des Russell il ne s’est pas fait présenter à vous. Il me dit qu’on est enchanté de vous. Il me dit cela de Lord Palmerston et de la Reine. Il passera ici quelques jours, je le fais dîner chez moi demain. J’ai dîné avec lui chez Lord Granville, aujourd’hui chez la Duchesse de Talleyrand.
Mme Thiers est allé faire visite à la Comtesse Appony, ce qui fait la réconciliation complète. On dit qu’il y a un traité secret entre le Roi et Thiers par lequel celui-ci s’engage à demander à la Chambre 10 millions pour les dettes du Roi. En revanche le Roi le soutiendra pour les fonds secrets. Thiers dit que ceci est la seule question de Cabinet. S’il la traverse, il fera comme les Ministres Anglais, il se moquera de toutes les défaites. Vous comprenez qu’il y a maintenant beaucoup de bavardages. Le corps diplomatique est encore tout ahuri et ne sait trop que penser de ceci ; cependant il est évident qu’ils ont plus confiance dans la durée du Ministère que dans sa chute.
Vous me paraissez bien occupé, car vos lettres à moi sont courtes. Vous vous trompez de N°. Vous m’avez envoyé deux 318. Vous ne me dites pas un moment d’Orient. Voilà un petit paquet de petits griefs.
Je n’ai pas vu un seul personnage politique hier à l’Ambassade. Il y avait des curieux, mais rien pour les satisfaire. Thiers y dine aujourd’hui.
Adieu, je dis adieu, car je n’ai plus rien à dire, et je n’ai guère à répondre. Le temps est toujours froid. Je me suis promenée hier avec Marion. Mais cela ne m’a fait aucun plaisir. Je n’ai plus de plaisir à rien. Adieu. Adieu.
321. Paris, Dimanche 8 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
321. Paris, dimanche 8 mars 1840, midi
Je me suis sentie très souffrante ce matin, et je ne sors de mon lit que dans ce moment. J’ai fait hier Lady Granville, Bois de Boulogne, de la causerie avec Lors Won Russell chez moi, et puis le dîner de Mad. de Taleyrand où j’ai trouvé Montrond qui n’a remis les pieds chez moi depuis le 25. Il a trouvé bon de me dire qu’il y était venu dix fois ; je l’ai assuré que je gronderais dix fois mes gens pour ne me l’avoir pas dit. Le soir j’ai vu le Prince d’Aremberg, l’Ambassadeur d’Espagne & le Duc de Noailles. Miraflors m’ennuie. D’Aremberg m’endort. M. de Noailles m’a tenu éveillée jusqu’à minuit. Il est très préoccupé de la situation. Son parti n’a pas pris de parti encore. Berryer n’a pas grande envie de voter contre Thiers dans les fonds secrets. On ne s’est encore accordé sur rien. Il m’a raconté la séance d’hier dont tout l’honneur appartient à MM. Duchâtel & Teste. Les nouveaux ministres sont très froidement accueillis.
Les 221 s’en vont disant qu’ils voteront les fonds secrets. Dans ce cas là il y aurait presqu’unanimité.
J’ai relu plusieurs fois la plus longue des lettres que vous m’avez envoyées. Elle est d’un fort honnête homme, mais d’une pauvre tête politique. Vraiment, fractionner encore les partis dans un temps où c’est juste leur multiplicité qui fait le danger de la situation et l’impossibilité de gouverner, cela n’a pas le sens commun. C’est de l’homéopathie. Pardonnez-moi, mais mon pauvre esprit se refuse à comprendre. C’est de la dernière page que je parle. Dites-moi quelque chose de MM. de Brünnow et de Bülow. Défiez-vous extrêmement de celui-ci. En général vous ne devez donner votre confiance à personne ; je ne cesserai de vous répéter cela, et d’être bien avare d’opinions tranchées sur quoi que ce soit. En diplomatie, vous ne sauriez croire combien on a moins de regrets à ce qu’on a tu qu’à ce qu’on a dit. Observez un peu les autres, et vous verrez s’ils se hasardent! Ils sont bêtes, mais ils connaissent le métier, et ils sont singulièrement habiles à tirer parti de ceux qui ne les connaissent pas. Et, encore un coup, c’est un métier comme un autre, et qu’on n’apprend qu’en le faisant.
Je vous prie de me dire toujours l’emploi de vos soirées. Je ne sais pas ce que vous avez fait de lundi. Faites comme moi, et comme vous m’aviez promis de faire ; en vous levant, le journal de la veille, les faits matériels, et le remplissage après. Quand me direz-vous un mot de l’Orient, un mot de Pétersbourg? Je ne sais absolument rien, rien du tout. M. d’André est arrivé; qu’apporte-t-il? Je n’ai pas de lettres de mon fils de Naples. Je n’ai de lettres de personne.
Je vous ai dit, je crois, que Paul ne songe pas du tout à venir à Paris ! Il part les premiers jours du mois pour la Russie.
5 heures
Je rentre de la promenade au bois de Boulogne et j’attends la visite du Dimanche. J’ai vu ce matin M. d’Appony et M. d’André. Celui-ci dit que le retour ou non de Pahlen à Paris est regardé en Russie comme très important. Il croit qu’il reviendra. Le discours de Thiers dans la discussion de l’adresse a eu beaucoup de faveur à Pétersbourg. Voilà tout ce que j’ai tiré de sa visite ; vous m’en direz davantage. On disait beaucoup hier que le mariage Nemours ne se faisait plus, que le père était allé à Vienne demander conseil au Prince Metternich. Cela serait une singulière affaire. Vous savez que le duc d’Orléans va décidément à Alger, le Roi le veut aussi.
Lundi 9 mars, 9 heures
Le Prince Paul de Wurtemberg m’a conté quelques commérages de cour sans importance ; il croit savoir que la famille Cobourg demande le Capital qui doit revenir un jour au Duc de Nemours ; et qu’à moins de cela elle ne donne pas sa fille. Je ne sais ce qu’il y a de vrai, mais il y a quelque chose. Il allait diner hier chez Thiers. Il trouve aussi sa situation fragile et très difficile.
Lord Won Russell m’a conté Londres, Berlin ; il m’a quitté à 9 heures. J’ai été faire une courte visite à Mad. Appony et une plus longue à Mad. de Castellane que j’ai trouvée jouant du piano à M. Molé !Il y avait de la bonne humeur dans le salon. M. Molé s’était trouvé la veille chez le Roi avec le Maréchal Soult et M. Thiers. Trois présidents du Conseil en même temps. Il a fort exalté MM. Duchâtel et Teste dans la séance de la veille. Voici onze heures. Je n’ai pas de lettres. N’y a-t-il aucun moyen de faire quelque chose de régulier entre Londres et Paris ? Je ne me porte pas bien ; le vent d’Est ne me va pas. Ma solitude m’accable. J’ai des moments d’affreuses tristesses. Adieu. Adieu.
P.S. J’avais déjà fermé ma lettre lorsque m’arrive le 320; si bon, si tendre, et si long! Je veux tout cela. Songez que je n’ai que cela pour vivre! J’ai reçu une longue lettre du Roi de Hanovre toute remplie de commérages de gazettes sur mon compte. Ces bombes me viendront de Pétersbourg. Aussi, j’ai envie de faire comme j’ai fait pour les gazettes, je ne répondrai pas. Je suis bien lasse d’être tracassée sur toute chose.
Je n’ai plus vu Médem deppuis longtemps. Dans huit jours le cœur lui battra, car les réponses de Pétersbourg lui arriveront alors. M. Molé croit que Pahlen reviendra, mais c’est d’instinct ; car à la réflexion il ne le croit pas. Nous allons voir. Lisez le Constitutionnel de ce matin. On disait hier que le minsitère avait remis de huit jours la présentation des fonds secrets. Lord Granville a donné à diner samedi à Mrs Thiers, Rémusat, Broglie, la Redorte, d’autres encore. On m’a dit que le diner était bien froid ; Lord Won Russell disait des gens qui ont peur les uns des autres, ou qui n’ont pas fait connaissance. Rémusat très abattu, il venait de la séance. Demain Thiers donne un grand diner diplomatique.
Adieu, merci de tous les détails. Adieu encore, Merci de tout.
3 heures Encore! Voici Montrond qui vient me raconter très longuement que Thiers a été délecté à la lecture de votre dépêche ; qu’il est enchanté de tout ce que vous faites ; qu’il le dit à tout le monde ; et Montrond, doutant que j’aie l’esprit de deviner qu’il n’était venu chez moi que pour me dire cela et pour que je vous le redise, me prie en finissant de vous raconter un peu cela, ainsi que son dévouement pour vous.
L’affaire Nemours est comme je vous ai dit plus haut. On négocie. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres
321. Londres, Dimanche 8 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Londres, dimanche 8 mars 1840,
une heure
Nos journaux vous donnent ce matin le projet de charivari qu’on a voulu me donner à Londres. Vous en entendrez plus de bruit que je n’en ai entendu ici. Je n’étais pas chez moi quand ces douze ou quinze polissons sont venus, et ils n’ont pas même commencé, tant la police a été prompte à les chasser. Ces choses-là se font ici avec une rudesse très simple et très efficace. C’était douze ou quinze réfugiés, mauvais sujets du procès d’avril. Je n’ai appris le fait que deux jours après, par le Globe. Personne ne m’en avait parlé et n’y avait pensé. J’ai été obligé d’aller aux renseignements pour savoir ce que c’était.
J’ai dîné hier avec Sir Robert Peel, un dîner bien anglais, cossu, long, lourd et froid, quoique cordial. J'ai beaucoup causé avec mon voisin de droite Sir Henry Hardinge, soldat brave et sensé qui m’a plu. Je m’aperçois de jour en jour de mon progrès pour parler. Mais je vais tout simplement, et il me semble qu’on m’en sait gré.
Vous m’avez trop dit que le premier acte du dîner était très silencieux. On parle assez et c’est presque toujours moi qui me tais.
Lord Aberdeen, qui n’avait pas pu venir dîner parce qu’il était engagé chez Lady Holland, est venu le soir, et nous avons beaucoup causé. Il est très instruit et d’une conversation très variée. Je vous répète tout ce que vous m’avez dit. Cela me plaît de découvrir à chaque instant que vous aviez raison.
Les Tories sont en effet très aimables pour moi. Ils viennent tous me chercher. Lord Londonderry est presque le seul qui ne soit pas encore venu. Aussi, quoique Lady Londonderry m’ait écrit un petit billet bien doré pour m’engager à aller passer la soirée chez elle après-demain mercredi, je m’en excuserai sur quelque prétexte. Le Général Sébastiani, ni personne de l’Ambassade n’allait jamais là. Le langage était trop violent contre nous, trop tendre pour vous. Si Lord Londonderry vient me voir, je verrai ce que j’ai à faire. Autant que j’en puis juger, il ne me sera pas difficile de vivre en bons rapports avec les Tories sans donner aux Whigs aucun ombrage. Je dirai ce que je pense et je serai ce que je suis. La vérité est ici fort bien acceptée. Vous avez bien raison, c’est un mérite immense.
Lady Palmerston chez qui je suis allée hier au soir en sortant de dîner, m’a demandé en passant : « Connaissez-vous depuis longtemps Sir Robert Peel ? ». Ce n’était plus un rout chez elle, mais une petite soirée assez agréable.
4 heures
Je viens de chez Lord Melbourne. Nous avons causé une heure et demie. Il me plaît beaucoup, beaucoup; sa figure, son esprit, ses manières. Il s’est étendu dans son fauteuil, à côté du mien, détournant la tête et tournant l’oreille; il a parlé anglais, moi, français, dialogue très régulier, chacun à son tour, interrompu seulement par ses rires. On dirait qu’il vit pour rire. Je traiterai volontiers d’affaires avec lui. Il comprend à merveille, avec élévation dans les idées, et point préoccupé de son propre sens. J’ai peu à vous dire des affaires mêmes. Elles sont stationnaires. On attend le plénipotentiaire Turc, Ie nouveau cabinet français. On s’observe. Personne ne voudrait être le premier à avoir une résolution. On croit assez ici qu’au fond vous êtes embarrassés du Traité d’Unkiar-Skelessi, que si les circonstances, vous obligeaient à l’exécuter, si la Porte vous le demandait, vous le feriez, par honneur ; mais que cette chance vous déplaît, que vous en craignez les conséquences, et que vous saisiriez volontiers quelque manière d’échapper aux charges de ce protectorat exclusif et compromettant.
Je crois vous avoir déjà dit qu’on avait grande envie de faire quelque chose avec nous et grand embarras à faire quelque chose sans nous. Il me semble que je vois cette disposition en progrès.
M. de Werther part demain pour Berlin. Il passera quelques jours à Paris.
Lundi, 9 heures
J’ai dîné hier à Landsdown-House, un dîner plus agréable et plus causant que de coutume, Lord & Lady Holland, Lord & Lady Clarendon, le Duc et la Duchesse de Sutherland, Lord John Russel, M. Charles Greville et moi. Je vous ai placée au milieu de cette conversation. Elle serait devenue charmante.
De là chez Lady Jersey où j’ai trouvé Lord Aberdeen, Lord Stuart et Lord Elliot, l’homme de Londres qui parle le mieux français. Il y a, chez Lady Jersey, plus de liberté, d’abandon, et de façons sociables qu’ailleurs. Mais quelle inépuisable parole que la sienne ! et quel infatigable mouvement ! Elle a, sur toutes choses, des phrases, des désirs, des fantaisies, des volontés. C’est là, je crois, ce qui lui donne cette puissance dont vous vous étonniez.
Lord Leveson me paraît très occupé de Fanny Cowper. On croit qu’il l’épousera, et même que la Charge de Sous-Secrétaire d’Etat a été donnée dans cette idée. Lord Levenson est fort à la mode, me dit-on.
L’affaire du privilège des Chambres va finir par le bill de John Russell. Il paraît que la Chambre des Lords l’adoptera. L’affaire des corporations municipales d’Irlande finira aussi dans cette session. Il y aura transaction entre le Gouvernement et l’opposition, et la Chambre des Lords adoptera. Le Ministère paraît très solide, malgré les échecs passés et futurs. Au fond, tout le monde croit à sa durée. J’ai à dîner aujourd’hui M. Dedel, M. de Blum, M. de Werther et de M. de Hummelauer.
Une heure
Merci de tout ce que vous me renvoyez à Londres. Je suis bien aise de le savoir. J’accepte le reproche d’avoir un peu manifesté mon opinion sur les personnes. Je me souviens en effet de deux occasions où j’aurais mieux fait de ne rien dire. Mais je proteste contre ce qui me revient par Génie du ravissement que j’ai témoigné, et de ce que j’ai trouvé excellent. Ceci m’apprend qu’à Londres comme à Paris on peut broder, exagérer ; soit par goût, soit par dessein. Je suis sûr d’avoir été dans mon langage à ce sujet, très réservé, ne manifestant ni inquiétude, ni confiance, espérant plutôt que craignant, comme c’est mon rôle, mais rien de plus. J’y avais pensé, et je n’ai rien dit de cela sans y avoir pensé. Je ne vais guère, dans ce cas, plus loin que je ne devrais.
Soyez tranquille, je n’aurai point de loge à l’Opéra! Je n’irai même pas à l’Opéra. Je ne vois pas pourquoi je changerais à cet égard mon habitude qui est aussi mon goût. Je suis sûr que le spectacle me causerait une impression pénible. Je vous l’ai dit souvent ; je n’ai jamais su m’amuser seul ; j’ai besoin, absolument besoin de partager tout plaisir vif, toute émotion douce et un peu saisissante. L’autre jour, après dîner, chez Ellice, sa belle-fille et M. Dundas ont chanté, chanté presque toute la soirée pour me faire plaisir. J’avais fini par avoir le coeur tout-à-fait mal à l’aise.
Adieu. Il fait beau et doux aujourd’hui. Je me promènerais bien volontiers. Mais je ne me promènerai pas. Adieu, Adieu.
322. Paris, Mardi 10 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
322. Paris, Mardi 10 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Paris, mardi 10 mars 1840,
Lord John Russell a été ma seule visite du matin hier. J’en ai fait une à Mad. de la Redorte qui est bien malade. Elle est inquiète pour le ministère. On jase beaucoup, il y a assurément une grande incertitude dans les esprits et la situation du nouveau ministère n’est pas triomphante. Cependant on croit qu’il aura les fonds secrets. Je me suis promenée avec Marion au bois de Boulogne, j’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Lady Granville et sa fille, la famille Poix, les Durazzo, Brignole, Aston, M. d’André, le hanôvre. Je ne sais ce qui prend à Modem, mais il ne vient plus. Lady Granville sortait du salon du Maréchal Soult où la diplomatie s’était donné rendez-vous. Aujourd’hui sera le tour de M. Molé. J’ai fort mal dormi encore. Je ne me porte pas bien, sans être absolument malade ; si ce malaise dure cependant il me faudra M. Verity. Le vent d’Est ne me va pas du tout.
Il me semble que vous dînez chez le duc de Sutherland aujourd’hui. On ne sera plus embarrassé où vous placer à table. Je vous vois à côté de la Duchesse tournant le dos au jardin ; moi je serais à l’autre extrémité bien loin de vous ; mais dans la même chambre ; aujourd’hui dans un autre pays !
6 heures
Lord John Russel et Appony sont venus me voir. Le premier a tout bêtement de l’esprit et une bonté de cœur parfaite. Il me raconte peu à peu tout, avec beaucoup de finesse, de vie. A propos, il vous conseille de vous défier de notre ami Ellice ; la plus grande commère de Londres. C’est bon pour dîner et mille petits services, mais pas bon pour des confidences ; au reste celles-là, vous aurez soin de n’en faire à personne. Il me semble d’après votre lettre que M. de Brünnow se met en grande froideur avec vous. A propos, Appony me dit qu’on a envoyé l’ordre à Barante de rester à Pétersbourg jusqu’à la dernière extrémité. C’est drôle!
J’ai vu Granville chez sa femme. Il croit que le ministère tiendra. Au moins cela n’a pas encore grand air. Médem se donne les apparences d’être moins lié avec Thiers qu’il ne l’est en effet. Voilà les observations de la diplomatie. Tout ceci aujourd’hui fait un spectacle curieux à observer. Granville aussi m’a parlé du grand succès de votre dernière dépêche. A propos il dit que les difficultés du mariage Nemours sont aplanies et qu’il se fera après Pâques. Il me semble que je vous raconte tout ce que vous devez savoir par d’autres.
Mercredi 11 –
M. Jaubert est venu me voir hier un moment avant mon dîner ; il est très poli, et n’a pas l’air très soucieux. Il parle de vous avez grand respect. M. de Pogenpohl a dîné avec moi ; mon monde m’est venu de bonne heure. Pahlen, Médem, Caraffa, Brignole, le Duc de Noailles, Bacourt, Mad. de Contades. Cette petite femme me plait tout à fait. Je n’ai pas causé avec le duc de Noailles. Médem est resté tard. Il m’a répété que Barante restera à Pétersbourg, quand même. L’Empereur regardait à sa montre pour calculer l’arrivée des réponses de Paris aux gesticulations. Médem est le seul diplomate qui n’ait point dîné hier chez Thiers, il dinait avec M. Molé chez M. Greffulhe. Il y a été le soir. Un monde énorme. Rien des 221 que le Gal Bugeaud. M. de .Broglie y était, Odillon, Barôt. Voilà !
Ce que vous me dites du lever de la Reine est très original et très vrai. Je suis curieuse de l’effet que vous aura fait le Drawing room, et de ce que vous mettez comme pendant à : Sérieux, sincère et gauche.
J’ai fait venir Verity hier au soir. Je ne suis pas bien, et je ne sais pas dire ce que j’ai . J’ai de l’ennui, de la tristesse, un gros gros poids sur le cœur, et je me sens malade.
1 heure. Voici le 321 que je vous remercie du plaisir que vous me faites ! Car vous ne savez pas avec quel plaisir je reçois, je lis vos lettres ! Je suis charmée que Lord Melbourne vous plaise, parce que je suis sûre alors que vous lui plaisez aussi. Il me semble que Londres vous plait en général beaucoup. En tous cas votre journée est bien remplie, vous êtes bien heureux.
Jeudi 12 mars, 9 heures
L’infaillible Lord William est encore venu hier pendant mon luncheon. C’est une excellente et douce créature, avec un esprit d’observation très fin. En général vous ne concevez pas combien les Anglais ont de cela, rien ne leur échappe. Il pense que vous vous arrangerez mieux de Lord Melbourne ou d’autres que de Lord Palmerston, mais il ajoute que celui-ci est assez jaloux des relations des Ambassadeurs avec ses collègues. Cela n’est cependant pas une raison pour n’en pas avoir, car en définitive, s’il s’agit d’une résolution à prendre, c’est le Cabinet et non Lord Palmerston qui décide. Que je voudrais causer avec vous! Car vous m’écrivez beaucoup, mais vous ne dites pas tout. Il n’y a de vraie confiance que dans la parole.
J’ai fait visite à votre mère. Je l’ai trouvée seule. Je ne sais pourquoi cela m’a saisie, et dès le premier moment la disposition a tourné à l’attendrissement. Je sentais tellement les larmes me monter aux yeux que pour échapper au ridicule, j’ai dit quelques paroles qui pouvaient les légitimer ; cela est venu naturellement après qu’elle m’eût dit qu’hier était un triste anniversaire pour vous. Ah, il y en a pour d’autres de plus cruels encore ; j’ai fondu en larmes. Votre mère m’a regardé avec plus d’étonnement que d’intérêt ; du moins c’est ce qui m’a semblé. En général je ne suis pas sûre que je lui plaise. Pour elle, elle me plait beaucoup ; si simple dans tout ce qu’elle dit et tout ce qu’elle fait ! Elle donnait quelques ordres pour des chemises ; elle a tiré de son armoire des gâteaux pour les enfants ; tout cela s’est fait comme si je n’y étais pas. J’ai été charmée de me trouver tout à coup initié aux détails du ménage. Je suis restée une demi-heure. Vos enfants vont à merveille, et très aimables pour moi. De là, j’ai fait la visite à Mad. Durazzo, et la petite princesse. J’ai dîné seule. Le soir la princesse Lebkowitz est venue jouer chez moi avec M. Durazzo, Fullarton et Greville. Moi, j’ai causé avec le Duc de Noailles, lord Granville & Arnim. Granville croit plus fermement tous les jours que le vote sera en faveur du nouveau ministère. Décidément toute la gauche est venue au premier mardi. M. de Broglie y avait dîné. Les légitimistes n’ont pas encore décidé ce qu’ils feront ; ils se réuniront samedi pour cela. Thiers est inquiet de l’apprendre. J’ai eu ce matin une lettre de mon fils de Naples. Il sera ici à la fin d’avril. Lord Brougham m’écrit de Cannes. Il ne parle pas de revenir. Les Clanricarde seront en Angleterre au mois de mai.
Le mariage Darmstadt se fait décidément.
Verity vient, mais mon mal ne s’en va pas.
Adieu, adieu. Ecrivez-moi beaucoup. J’aime tant vos douces paroles ! Adieu.
Génie est chez moi dans ce moment et m’assure que je fais mieux de lui remettre ma lettre.
322. Londres Mardi 10 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Londres, mardi 10 mars 1840, 11 h 1/2 du soir
J’ai dîné chez la Duchesse de Sutherland, puis un quart d’heure chez Lady Minto. Je rentre. Moi aussi, le coeur m’a battu en entrant à Stafford house, dans ce salon vert qui était le vôtre, dans cette salle à manger où le Duc me plaçait à côté de vous. Je vous ai cherchée, je vous ai vue, partout, toute la soirée. Cette maison vous convient. On se promet de vous y revoir. On me l’a dit. Je me le suis fait redire. Je ne comprends pas toujours la première fois. Qu’il y a de temps d’ici là! n’est-ce pas, vous n’avez plus de plaisir à rien? vous me le dites. Laissez-moi être égoïste librement, autant qu’il me plaît. Je le suis sans remords. Vous n’y perdez rien. Voici un incident qui vaut la peine de vous être conté. Décidément M. de Brünnow1 n’est pas venu chez moi. Il s’est fait présenter à moi chez Lord Clarendon. Nous nous sommes rencontrés deux jours après, le lendemain plutôt, chez Lady Palmerston et nous avons causé. Mais enfin, il n’est pas venu et ne viendra pas. Ce n’est pas tout. Un petit attaché, celui que j’ai amené avec moi, Gustave de Banneville, était allé porter à Ashburnham-House, qui est toujours le quartier général de l’Ambassade Russe, sa carte pour M. de Kisselef qui n’y demeure plus. Au lieu de porter cette carte à M. de Kisselef, on l’a portée à M. de Brünnow qui demeure Mywart’s Hotel. M. de Brünnow est venu en hâte ce matin, à ma grille, sans entrer dans la cour, porter une carte de lui sur laquelle il avait écrit au crayon, pour M. Gustave de Banneville. Je me suis fait expliquer la méprise, et quelques heures après, j’ai envoyé M. de Banneville porter sa carte chez M. de Brünnow, en écrivant aussi au-dessus, au crayon, pour M. le Baron de Brünnow. Il se trouve ainsi que M. de Brünnow a fait la première visite au dernier attaché qui s’est empressé de la lui rendre. Nous en avons un peu ri.
Evidemment M. de Brünnow a des instructions spéciales à mon égard. Il a l’air d’être, et on me dit qu’il est le plus poli, le plus obséquieux des hommes. Il l’a été beaucoup dans nos deux rencontres chez autrui. A la première, je passerai devant lui sans le voir. Il paraît qu’on a été très fâché de ma mission ici. J’espère qu’on aura raison. Convenez que cela est drôle, et qu’en fait de mes dispositions envers la Russie, me voilà bien loin de mon point de départ. J’ai attendu très tranquillement et avec réserve avant de parler à personne de cette boutade de mauvaise éducation officielle. Mais cela commence à circuler, à la grande surprise et moquerie de tout le monde. N’en parlez pas du tout avant deux ou trois jours, je vous en prie, à qui que ce soit. J’en rendrai compte après-demain.
[Neumann part dans les premiers jours d’avril , aussi tôt après le lever que la Reine tiendra le 1er. Il l’annonce lui-même, sans dire si c’est un départ temporaire ou définitif. Brünnow part toujours aussi à la fin du mois. Le champ de bataille me restera, en attendant le combat.
On attendra aussi le plénipotentiaire turc. L’officier qui en a porté la demande à Constantinople doit y arriver en ce moment. Il n’y allait pas exprès pour cela. Il passait par Constantinople en retournant aux Indes.
Adieu pour ce soir. Je vais me coucher. Je me suis couché fort tard tous ces jours-ci, et je n’ai pas assez dormi. Adieu
Mercredi, 9 heures
J’espérais une lettre ce matin. J’y compte pour demain. Je n’ai pas été content du N° 320, venu lundi, non parce qu’il portait un petit paquet de petits griefs, mais parce qu’il y avait, ou je me trompe fort, des réticences. La dernière que vous veniez de recevoir de moi, était courte. Je vous disais ma résolution de rester ici, sans vous rien dire de la joie que m’aurait value la résolution contraire. Enfin, elle était écrite un triste jour, et je ne vous en parlais pas2. Vous avez pensé à tout cela, et vous ne m’en avez rien dit. Dites-moi si je me trompe. Et si je ne me trompe pas, une autre fois dites-moi tout ; point de réticence, en fait de griefs surtout. Presque toujours, j’aurai raison, et je me sens en état d’avoir un tort... que vous me pardonnerez.
Une heure
Je viens de faire un déjeuner savant chez M. Hallam, avec Lord Landsdowne, Lord Mahon, Lord Southampton, Sir Francis Palgrave, et M. Milman, Chanoine de Westminster. Vrai intérieur de savant Anglais. On m’a reçu dans la bibliothèque de M. Hallam. Puis nous avons passé dans la salle à manger, où nous avons trouvé Misstriss Hallam et sa fille, debout à nous attendre. Une salle à manger très nue, quasi sans meubles, mais de petites colonnes et un grand portrait sur la cheminée. [Du café d’abord, avec de la cassonade grise. Puis des côtelettes chaudes, une volaille froide. Puis du fromage rapé, du caviar. Puis des œufs, du beurre, toutes sortes de pain grillé. Enfin du thé. Et tout au travers une très bonne conversation, point politique du tout mais bien substantielle et variée dans l’ordre scientifique. Il m’a paru que les convives s’y plaisaient, et j’ai bien peur qu’une nouvelle porte ne se soit ouverte là aux invitations. En voilà une qui m’arrive de Lord Mahon pour déjeuner Mercredi prochain.]
Miss Hallam jolie, de 25 à 30 ans, peu d’espoir de se marier, parfaitement silencieuse, le regard très modeste, mais doucement animé, et se soulevant quelquefois avec une curiosité très intelligente, pour se rabaisser aussitôt. Tout cela était très Anglais, et pas du monde anglais que je vois tous les jours.
Jeudi midi
Pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. Comment ne m’avez-vous pas écrit par la poste après avoir manqué lundi le courrier des Affaires Etrangères? Est-ce que je suis destiné à subir le même chagrin que vous avez eu ici en 1837 ? Ce qui me rassure un peu, c’est que j’ai ce matin des nouvelles de Génie qui ne me dit pas un mot de vous. Le mal se sait si vite ! Mais c’est une triste sécurité que le silence. Adieu. Je vais attendre jusqu’à demain matin.
Pour Dieu, convenons bien de nos faits : le lundi et le jeudi, écrivez-moi par le courrier des Affaires Etrangères et le samedi par la poste. Et si le lundi ou le samedi le courrier des Affaires Etrangères ne partait pas, écrivez-moi par la poste, ne fût-ce que quelques lignes pour que je ne sois pas inquiet. Je cherche un moyen de me faire arriver ici les lettres que vous ne voudrez m’envoyer ni par les Affaires Etrangères, ni directement par la poste. Je n’ai encore rien qui me satisfasse pleinement. Adieu. Je suis dans une triste et déplaisante disposition.
323. Paris, Vendredi 13 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
323. Londres, Vendredi 13 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
323 Londres Vendredi 13 mars 1840
Une heure
Pas plus de lettre aujourd’hui qu’hier, qu’avant-hier. Je m’y perds si c’est votre faute, c’est bien mal. Mais ce ne peut être votre faute. Je suppose que vous aurez posté une lettre Lundi aux Affaires Etranges trop tard ; elle ne sera pas partie ; et une hier, pour le courrier qui m’arrivera demain matin. J’aurais donc deux lettres demain. Je suppose cela parce qu’il faut bien supposer quelque chose. Quel amer déplaisir ! Car je ne veux pas aborder l’idée de l’inquiétude. Ma mère me dit aujourd’hui qu’elle vous enverra mes enfants. Il me semble que si vous étiez malade, elle le saurait. Il me semble à tort ; le contraire se pourrait fort bien.
De quoi voulez-vous que je vous parle ? J’ai été hier voir le Royal Coronation picture, un détestable tableau où beaucoup de portraits sont ressemblants, surtout la Duchesse de Sutherland et Fanny Cowper. Puis j’ai fait neuf visites. Puis je suis rentré chez moi. J’y ai dîné et je ne suis sorti qu’à dix heures et demie pour aller passer une heure chez Lady Holland. J’y ai trouvé le révérant M. Sidney Smith, the most witty man, dit-on, in the three kingdoms. Je n’étais en train ni de l’esprit des autres, ni du mien propre. Lady Holland se désole de ne m’avoir pas encore donné à dîner. Elle trouve sa maison de South street trop petite. Son cuisinier vient de mourir. Son maître d’hôtel vient de partir pour aller passer quinze jours dans sa famille, sur le continent. Tout est en désarroi chez elle.
On remarque depuis quelques jours un changement sensible dans les manières de la Reine avec les Torys. Elle les traite mieux. Plusieurs ont été invités aux derniers bals. Elle a été très aimable pour le Duc de Wellington Lundi dernier, à dîner. Il me semble que cela veut dire simplement que les Whigs sont sans inquiétude.
Une heure après minuit.
Je reviens de chez Lady Palmerston. Quelle odieuse journée ! Personne n’a jamais su ce que je puis souffrir. Je n’ai pas naturellement l’imagination noire ni agitée ; mais quand le trouble entre en moi, il m’ébranle jusqu’au fond de l’âme. Je ne voudrais pour rien au monde, laisser voir à qui que ce soit au monde ce qui s’est passé en moi, depuis 48 heures, ce que j’ai pensé, senti, imaginé, dit et contredit, accepté et repoussé intérieurement. Et tout cela tomberait, tout cela s’évanouirait devant quelques lignes de vous ! Il se mêle un peu de colère à mon chagrin. Vous ne vous en doutez pas ; vous êtes bien tranquille. Quelque arrangement insignifiant, la lenteur d’un domestique, une visite prolongée, je ne sais quelle pauvreté a causé tout cela. J’espère qu’il n’y a pas d’autre cause, que vous n’êtes pas malade. Je vais me coucher. Adieu.
Londres, samedi 14 [mars 1840], 10 heures
Dieu soit loué ! Ce n’est rien. Il n’y a que mon mal à moi, mon mal passé. Voilà 321 et 322. L’une par le portefeuille, l’autre par la poste. J’avais deviné juste. Le 321 avait été remis trop tard aux Affaires étrangères. Je joins ici le bout de l’enveloppe sur lequel on l’a écrit, si on a écrit vrai. Vous avez très bien fait de remettre le 322 à Génie. Je suis occupée à trouver ici une bonne adresse sous laquelle vous puissiez, au moins une fois par semaine, m’écrire sûrement par la poste. Vous m’écririez une fois par le portefeuille, une fois sous cette adresse et le samedi directement. Mais en attendant, servez vous souvent de Génie, et quand vous vous serez du Portefeuille, arrivez à tems rue des Capucines. Quel brouillard vient de se dissiper autour de moi ! Pour la première fois, j’ai vu du soleil à Londres.
Du reste soyez tranquille. Il n’y a rien, dans le 321, qui valut le retard à la rue des Capucines, si le retard est de leur fait.
Je reprends mes récits. Il me semble que je n’ai rien oublié, ni matin, ni soir. J’ai passé hier toute la journée chez moi. J’ai été à onze heures chez Lady Palmerston. Très joli bal plein et point étouffé. La Duchesse de Cambridge y était. Sa fille ne quitte pas la place. Elle serait jolie si elle n’était pas énorme. J’ai causé avec Lord Landsdowne, Lord Aberdeen, Lord Stuart, Lord Wilton, le Duc et la Duchesse de Somerset, &. On dit qu’il faut biens e défendre de la dernière, qu’elle s’attache à sa proie. Son mari a l’air d’un bon homme, un savant Seigneur. Il m’a fait toutes les caresses qu’un Anglais peut faire. Nous commençons à causer presque avec confiance Lord Aberdeen et moi. De la confiance et nulle confidence, n’est-ce pas cela? Vous avez raison. Il y a un métier qu’il faut apprendre. Je m’y applique. Je sais me taire tout à fait, sans peine même. J’espère que j’apprendrai à me taire en parlant.
Nous sommes fort en coquetterie réciproque, Lady Palmerston et moi. Coquetterie encore sans liberté, ni vérité. Elle m’a dit que je la trouverais tous les matins, d’une heure à trois. J’irai. Je ne me suis empressé vers personne.
J’ai ce soir lord Northampton, lady Cottenham et Mistriss Stanley. Celle-ci est vraiment agréable. Personne ici excepté Lord Eliot ne parle français aussi bien qu’elle, et l’esprit français comme la langue.
Lundi soir chez Lady Lyndhust. Mardi matin, le musée britannique ; dîner cez lady Aylesbury, Mercredi, déjeuner chez Lord Manon ; dîner chez Mad. Grote ; le soir chez Lady Jersey. La fin de ma semaine est plu libre. La première moitié de l’autre est déjà prise. Je trouve que c’est trop et je commence à refuser. M. De Bourqueney me sert beaucoup dans toutes ces questions là. Il connait bien le monde anglais, et il y est bien posé. Je crois qu’il a bien envie de retourner à Paris le plus tôt possible. Je le traite très bien et je le crois très content de moi. Mais il était l’ambassade.
Hier, dans la soirée, j’ai passé trois fois devant. M. de Brünnow sans le voir. Quant au fond des affaires, tout trainera. Décidément on attendra le Plénipotentiaire de Constantinople. En attendant, le Pacha se fortifie chez lui. Il évacue de lui-même les villes saintes et en rappelle ses troupes. La guerre avec la Chine coûtera cher. Les bulletins de Pékin ne ressembleront pas à ceux de Londres. L’Empereur (de Pékin) a félicité ses braves marins de l’éclatante victoire remportée sur les barbares Etrangers. Il a pourtant dégradé son Amiral de deux boutons. Prenez-vous quelque intérêt à la Chine? Lord Lyndhurst en est très occupé. Il dit qu’il y a une question Constitutionnelle dans la manière dont cette guerre a été déclarée, et que le Cabinet sera fort attaqué sur ce point.
M. de Bülow ne pense guère à moi, ni à personne. Il est uniquement occupé de sa santé, encore plus préoccupé qu’occupé. Le vent, le brouillard, le soleil, le froid, le chaud, le monde, la solitude, tout lui fait mal, tout l’agite. Il est évidemment dans un triste état nerveux, qui pourrait devenir beaucoup plus triste. On en est très frappé.
Je reçois ce matin du Maréchal Soult une lettre très tendre. Je lui ai écrit très poliment à propos de sa retraite. Il espère que je lui écrirai quelques fois. On m’écrit très diversement sur la situation du Ministère, les uns à peu près comme vous, les autres sûrs de sa chute prochaine. Je crois que les premiers ont raison. Certainement , il n’y a et il n’y aura rien de triomphal. On emploiera à vivre tout ce qu’on a d’esprit. Il me semble qu’on doit y réussir. On me comble de compliments et de tendresses.
Vous avez raison aux trois quarts sur la dernière page de la longue lettre ; pas tout à fait. Il fallait prendre soi-même le pouvoir, ou du moins la présidence d’un grand Cabinet dans lequel nous aurions tous été. C’était la bonne conduite, et la victoire complète de notre parti qui adhérait tout entier à cette combinaison, et marchait en tête de tous les ralliés de toute origine. On a manqué à cette fortune, qui était obvious et pouvait être grande. Il n’est plus resté à tenir que des conduites incertaines et d’un succès douteux. J’ai une longue lettre de M. Duchâtel, fort amicale, plus calme et d’un ;bon jugement.
Ma Mère m’écrit qu’elle a reçu de vous une nouvelle, longue et bonne visite. Elle ne me dit rien de plus. Sous sa gravité et son autorité, ma mère est très timide, surtout avec moi. Et toujours un peu jalouse. Je ne m’étonne pas de son silence, et il ne signifie pas du tout que vous ne lui ayez pas plu. Je parierais du contraire ; mais elle ne me le dira pas d’elle-même. Je suis tout à fait de votre avis sur les commérages de gazettes. Qu’ils viennent de Hanovre, ou de Pétersbourg, ou d’ailleurs, n’y répondez pas plus dans vos correspondances que dans les gazettes mêmes. Il ne faut pas se laisser tracasser. Et il ne faut faire et dire que ce qu’on veut. Adieu. Un tout autre adieu que celui d’avant-hier quoique le fond soit toujours le même. Je voudrais bien que Vérity ait le pouvoir de vous débarrasser de votre malaise. Je ne l’espère guères ; mais vous faites bien de le voir. Il vous calme un peu, et s’il y avait quelque mal réel, il le verrait. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres
324. Paris, Dimanche 15 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
324. Paris, dimanche 15 mars 1840,
10 h 1/2
J’ai été hier au Bois avec Marion, j’ai fait une longue visite à Lady Granville. J’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Lord Granville, W. Russell, les Brignole, les Capellen. Le matin j’avais eu une longue visite de M. de Werther, que j’ai beaucoup questionné sur Londres, sur le bal de la Reine dont vous ne m’avez rien dit. Je lui ai demandé ce que vous faisiez dans cette longue soirée ; « La cour aux dames. » En rentrant chez moi, avant dîner, j’ai trouvé Nicolas Pahlen qui m’attendait depuis une demi-heure. Il venait m’annoncer qu’enfin son frère devait quitter Pétersbourg le 10 mars. Cette décision a été Irise après l’arrivée des réponses de Medem, et avant encore l’arrivée du courrier à Barante. Je suis fort contente. Mais j’aimerais encore mieux le savoir vraiment en route. Ma manière est de douter toujours des choses qui me font plaisir. Je crois vite celles qui m’affligent. Vous vous arrangez autrement.
La journée d’hier semble bonne et très bonne aux partisans des Ministres. J’ai eu une lettre de Lord Aberdeen dans laquelle il me dit qu’il vous voit fort peu, qu’il ne vous avait rencontré qu’une fois encore, et qu’il y a beaucoup de regret. Je ne suis pas bien, toujours pas bien. C’est un véritable spleen. Et je crois que je prierai Vérity de ne plus revenir, parce qu’il ne peut rien du tout. J’ai perdu mon cher William Russel. Il est parti hier pour Berlin.
1 heure
Je suis si triste, si triste ! J’aurais tant besoin d’ouvrir mon cœur. Je ne puis pas.
Lundi le 16.
9 heures
Mon médecin m’a interrompue hier, et m’a défendu d’écrire, de lire, de rien faire. Je suis restée couchée sur un canapé. Mad. Appony est venu me lire des lettres de son fils. Le mariage est retardé de quelques jours, ils ne quitteront Pétersbourg que le 1er de Juin pour être ici le 15 ou à la fin du mois. Je ne suis sortie qu’un moment pour prendre l’air en voiture. En rentrant j’ai trouvé le Prince Paul qui m’attendait. Il avait vu le Roi la veille. Son impression est que le Roi attend avec certitude la chute de Thiers. Il avait causé avec Thiers aussi qui n’a aucun doute sur l’action du Roi contre lui. J’ai dîné chez Mad. De Talleyran, rien de nouveau de là. Le même bavardage qu’on retrouve partout sur ce qui se passe en ce moment ; la même incertitude sur le dénouement.
De là j’ai été chez Lady Granville et à 10 heures chez Mme de Castellane. J’ai passé une grande heure seule avec elle et M. Molé. M. Molé dit que son parti est ferme, fort, numériquement plus nombreux que Thiers et la gauche réunis ; que Duchâtel et 22 doctrinaires ont passé de son côté. Teste est plus douteux. Duchâtel sera de son Ministère ; il serait insensé de rien entreprendre sans lui et ses amis. Le Roi est parfaitement neutre dans la lutte, mais le Roi est l’homme le plus triste et le plus inquiet de toute la France. M. de Broglie est un enfant, ce qu’il a fait est trot naïf. M. de Broglie soutiendra tous les Ministères moins un, celui de M. Molé. M. de Rémusat est enragé pour la gauche. Jaubert, tout le contraire, il ne tiendra pas longtemps. Le mot de M. Thiers dans le bureau : « Si l’on me renverse, gouverne --qui-pourra»-a fait grand scandale. Je cherche, il me semble que je vous ai tout dit. En somme M. Molé a l’air d’un homme qui s’attend à être Ministre la semaine prochaine. J’ai très mal dormi. J’ai tout le côté gauche engourdi, j’ai de la peine à marcher, mais mon cœur est encore plus malade que mes jambes. J’attends Génie ce matin. Il est allé faire des enquêtes sur certaine lettre remise lundi aux Affaires étrangères et qui n’étaient pas arrivé à Londres jeudi.
Midi
Voici le 323, long et bon. Je vous remercie d’avoir été inquiet et triste. Vous ne savez pas le plaisir que me cause votre peine. Est-ce que vous me comprenez bien ? Vous ne vous fâchez pas je suis sûre. Vous me pardonnez ; nous sommes si loin ; je suis si seule, je n’ai au monde que vous! Songez à cela toujours, dans tous les instants. Ne vous inquiétez jamais de moi que comme santé, moi je m’inquiète de beaucoup d’autres façons. Je suis faite comme cela, c’est pourquoi une séparation est une si odieuse chose. Votre foreign office a menti, ou bien vous vous trompiez en me disant d’y remettre une lettre avant 5 heures. J’avais porté la mienne Lundi à 4 heures moins ¼. Je vous prie bien de croire, qu’il ne s’agira jamais de visite prolongée, de négligence d’un domestique. Je n’ai pas de ces négligences quand il s’agit de vous. Je me suis arrêtée moi-même à la porte quand il s’est agi des affaires étrangères, et j’ai moi-même mis ma lettres aux finances, pour la poste. Maintenant je crois que Génie, Génie for ever, est ce qu’il y aura de mieux. Il me dit qu’il vous tient bien au courant de la situation. Je doute que les lettres apprennent suffisamment. Il ne vous restera probablement que confusion de tout cela. Moi je suis parfaitement ahurie, mais si vous étiez ici vous comprendriez. Moi je ne recueille que les commérages. Je vous les redis comme on me les donne. Si je devais juger sur la Diplomatie, je dirais que Thiers tombera. ; car Appony est content aussi mais par raison contraire, c’est qu’il ne croit pas qu’on ait le courage de renverser Thiers. Il voit trop de danger à cela. C’est bien un peu l’opinion de beaucoup de monde.
Je ne connais pas du tout Mrs Stanley dont vous me parlez tant. Je l’ai vue mais elle ne m’a pas paru assez jolie pour la regarder ,et je ne lui ai jamais parlé ; elle n’était pas du cercle dans lequel je vivais. C’était des fonctionnaires subalternes. Dites-moi toujours tout ce que vous faites et avec qui vous causez dans les soirées. Moi je vous raconte minutieusement toute. Aujourd’hui je vais dîner chez Mad. Salomon si Vérity me le permet. M. de Bacourt est allé prendre congé du Roi ier, il part dans huit jours. Walesky dit qu’il est désigné pour aller à Constantinople et Alexandrie terminer la grande affaire. Le Maréchal Soult m’invite à ses lundis. Vous savez que j’ai pour règle de n’aller dans aucun salon politique, et je crois que celui-ci a cette couleur. Ma belle-sœur arrivera en Septe pour passer huit mois à Paris ! Jugez comme cela m’amusera. Est-il vrai que la duchesse de Kent va mourir ? Où en êtes-vous avec M. de Kisselef ? Celui-là au moins est-il allé vous faire visite ? Car pour tous les autres j’ai la réponse ; M. de Werther m’a dit que tous les diplomates étaient allés se présenter chez vous. La Duchesse de Sutherland écrit de vous mille biens. Je finis, et je voudrais ne finir jamais. Je vais convenir avec Génie du départ de mes lettres. De votre côté je voudrais bien que vous prissiez pour règle de m’en envoyer tous les deux jours bien régulièrement. N’est-ce pas ? Adieu. Adieu, vous savez tout ce que je ne vous dis pas, vous voyez que toutes, toutes mes pensées sont à Londres. Adieu.
324. Londres, Dimanche 15 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
325. Paris, Mardi 17 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai été positivement malade et très malade hier. J’avais à peine fermé ma lettre que j’ai été saisie de violentes douleurs, accompagnées de fièvre et d’une prostration de forces telle que j’avais peine à parler. J’ai envoyé chercher Marion d’abord et puis le médecin. Marion est venue. Le Médecin était introuvable, mais au bout de quatre heures il est venu. Il proclame la bile ; il a peut être raison. Je me susi couchée, j’ai dormi, vers neuf je me suis levée, et me sentant mieux j’ai ouvert ma porte. Mad. de Contades, les d’Arenberg, Mad. de Soltykoff, Lady Granville, Pahlen, Médem, le duc de Noailles, Escham. Lady Granville venait d’apprendre au grand dîner Rothschild que j’étais malade, elle accourait pour me soigner ; elle fut un peu étonnée de me trouver gaiement entourée. Je suis un peu mieux ce matin, mais il me faudra beaucoup de Vérity.
Les Ministres ont beaucoup repris courage. Ils se tiennent assurés que M. Molé ne peut pas faire de Ministère. Dès lors ils n’ont rien à craindre, car les 221 eux-mêmes ne voudront pas les renverser pour retomber dans une crise.
Voici du soleil, mais il me parait si triste depuis votre départ. J’ai eu hier la nouvelle de la mort de la Princesse Jean de Lieven. Il n’y a plus de dame Lieven au monde que moi. On dit que c’était une femme d’un très grand mérite. Je ne la connaissais pas. Vous savez pourquoi son mari m’intéresse. C’est qu’ils reposent chez lui.
Mercredi 18, 9 heures
J’apprends que Rothschild part aujourd’hui pour Londres ; vous le verrez. Si j’avais pu dîner chez lui avant-hier ça vous aurait plu. J’ai passé une journée sans bouger. On est venu me voir un peu le matin, un peu le soir. M. de Pogenpohl, M. Werther, les Appony, Mad. de Courval, Marion, Miraflores, les Brignoles, Arnim, Montrond. Je ne l’ai pas vu seul, il avait l’air aigre. Personne aujourd’hui ne doute que les fonds secrets seront votés ; dès lors, Thiers sera bien puissant et il peut aller longtemps. On rit un peu de la circulaire de M. de Rémusat où il dit que la Monarchie de Juillet est moins faible qu’on ne le croit.
Midi
Voici le N°324. Certainement vous avez raison de me gronder, bien raison. Vous me l’avez dit une fois, mon chagrin se traduit toujours en injustice. Quand je suis triste je vous accuse, je ne sais de quoi ; je vous cherche des torts, et vous, vous m’excusez toujours! Restez comme cela, bon, indulgent. Laissez-moi comme je suis ; regardez-y bien, avec ces yeux qui savent si bien regarder, et vous trouverez ce qu’il y a ; ce que je ne puis pas écrire ; ce que vous m’écriviez à Londres l’année 37 au bout d’une longue tirade de vers ; oui, il y a cela, il n’y a que cela, beaucoup, beaucoup plus que vous ne croyez, beaucoup plus que je n’ai jamais dit ou montré. Eh bien, m’avez-vous pardonné Lady Antrobus, ou Mrs Stanley, ou toutes les ladies du monde ? Vous me faites une description admirable des Anglais. C’est bien cela. Vous avez raison aussi pour les femmes. Point de bienveillance entre elles, et celles que j’aime le plus, toujours un petit coup de patte après l’éloge. J’ai oublié le Duc de Noailles qui est venu passer deux heures chez moi hier matin. Il y a eu réunion chez Berryer hier au soir. M. de Noailles y était appelé. Il a de grands soupçons contre Berryer. Il le croit à Thiers tout à fait. Le parti veut voter contre les fonds secrets. Berryer ne voudrait pas. Le parti veut qu’il parle, et je crois savoir qu’il a promis à Thiers de ne pas parler. Enfin la désunion est là aussi comme elle est partout. Il me semble évident, par le ton des journaux depuis hier, que les 221 ne Sont pas aussi féroces que M. Molé le proclame. Le ton de Thiers hier au soir était à la confiance et tout le monde a l’instinct de sa durée ? Ne lui restera-t-il pas beaucoup sur le cœur contre le château ? Si vous pouviez voir mon visage rayonner lorsqu’on m’annonce « Ce gros Monsieur qui vient quelques fois le matin. » Comme je cours vite dans le salon pour prendre mon butin ! Je m’établis ensuite sur la chaise verte et je lis, et je savoure, et je recommence. Ecrivez. Ecrivez.
Je me sens mieux ce matin, mais j’attends Vérity pour savoir si c’est vrai. Je voudrais qu’il me permît de sortir. Je vous enverrai cette lettre tout bonnement par la poste, car j’ai envie que vous l’ayez vite. Il me semble que vous me pardonnerez celle qui vous a fâché. Ne vous fâchez jamais, je vous en prie. Ecrivez-moi beaucoup. Dites-moi tout ce que vous faites comme moi je vous dis tout. J’ai oublié que hier je n’ai pris qu’un bouillon, dans ma chambre à coucher. Il me semble que je vous dois compte de tout absolument. Faites de même. Adieu. Adieu. Je me sens en train de vous dire adieu si souvent que je pourrais vous ennuyer. Croyez-vous ? Adieu.
1 heure.
Il faut que je vous redise que toutes les lettres qui viennent de Londres sont remplies d’éloges de vous. Cela m’est redit de tous côtés.
Mots-clés : Ambassade à Londres
325. Londres, Mardi 17 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
325 Londres, mardi 17 mars 1840,
9 h 1/2
J’ai fait hier soir un grand plaisir à deux pauvres personnes bien vieilles, bien changées, aux Berry. Elles ont été parfaitement heureuses de me voir entrer. J’y ai passé trois quarts d’heure. Elles ne sortent jamais le soir. Six ou sept personnes y viennent habituellement. J’ai promis d’y diner un jour avec M. Macaulay. Ne croyez pas que j’accepte toutes les petites invitations. J’en ai déjà refusé beaucoup, et j’en refuserai davantage. Il y a une comtesse de Salis qui a imaginé d’écrire à sa cousine à Paris, que je connais assez, pour que celle-ci m’écrivît et me conjurât d’aller chez elle. J’ai reçu à la fois les deux lettres et une invitation à dîner. Je refuse. Mad. de Salis a ici une grande fortune, une bonne maison et vit dans le meilleur monde. Mais on me dit que c’est one of the greatest bores de Londres. De chez Miss Berry, chez Lady Lyndhouse, a dancing party ; toute la plus haute aristocratie Tory, la Duchesse de Cambridge, le Duc de Wellington, le marquis de Londonderry ; et au milieu de tout cela, Lady Lyndhurst sémillante dans sa petite et maigre stature, décolletée jusque sous les bras, et dansant, m’a-t-elle dit, pour mettre tout le monde en train. Elle était ravie de se montrer dans sa grandeur à l’ambassadeur de France. En rentrant chez moi à minuit et demi, j’ai trouvé un courrier qui arrivait de Paris dont il était parti avant-hier à 7 heures du soir (29 heures c’est admirable !) ; il m’apportait une lettre du Ministre de l’Intérieur que je vous envoie. Vous y verrez l’idée qu’ils se forment eux-mêmes de la situation après le vote des bureaux de samedi pour la commission des fonds secrets. Vous n’entendez guères que l’autre cloche. M. de Rémusat est un homme d’esprit et sans humbug, plutôt despending que sanguine. Gardez cette lettre pour vous ; non qu’il y ait la moindre chose à taire, mais pour la convenance. J’ai le cerveau encore pris . Si j’avais pu rester chez moi encore hier au soir et me coucher de bonne heure, ce serait fini. Mais il n’y avait pas moyen de ne pas allez chez Lord Lyndhurst où déjà j’avais refusé une invitation à dîner. Vous n’avez aucune idée de la chaleur qu’il faisait là, certainement 28 à 30 degrés. Vous n’y seriez pas restée dix minutes. J’en avais très mal à la tête. Aujourd’hui, je ne sortirai que pour aller diner chez Lady Aylesbury. J’ai des dépêches à faire.
4 heures
Pour la première fois, ce matin, j’ai été me promener à pied une heure et demie, dans Regent’s Park. En été ce doit être très beau et charmant. Il y a là réunies deux choses qui vont rarement ensemble, la grâce et l’étendue. C’est le double mérite que me paraît avoir ici la nature, arrangée par l’homme. Je ne l’ai pourtant vue encore qu’à demi gelée. Voilà le Plénipotentiaire Turc qui va recevoir ses pouvoirs. Il viendra ici sans retard. Et vous, vous n’avez d’objection à rien. Soyez sûre que je vous ai donné la vraie raison. Personne aujourd’hui en Europe ne veut être engagé dans une situation difficile et en courir les chances. Rois, Empereurs, Ministres, absolus ou constitutionnels, tous se trouvent compromis par leur métier et cherchent à s’affranchir des grandes affaires...
De Brünnow achète toute la cave de Pozzo. Dix mille bouteilles de vin, dit-on. A coup sûr, il compte rester ici. J’ai eu hier la visite du speaker de la Chambre des Communes. Il est très populaire ici, dans tous les partis. Je trouve Lord Aberdeen beaucoup plus impartial que je ne m’y attendais. Il m’a fait le plus grand éloge du speaker whig et du Chancelier Whig « Le meilleur Chancelier , m’a-t-il dit, que nous ayons eu depuis bien longtemps. Mais il ne faut pas dire cela trop haut ici. » Nous étions chez Lord Lyndhurst.
Mercredi 9 heures
Eh bien, Les Aylesbury, qui n’ont pas d’esprit, en ont eu assez pour m’arranger hier un dîner agréable, Lord et Lady Burghersh, Lord et Lady Wilton, Lady Palmerston et sa fille, Lady Lichfieldn Lady Seymour et son mari, enfin Lord Claude Hamilton qui revient d’Egypte et est amoureux du Pacha. Je l’enverrai à Lord Palmerston qui devait aussi venir dîner mais qui a été retenu à al chambre. Assez de conversation à dîner, et beaucoup, et très bonne, après dîner, avec Lady Palmerston. Lady Wilton aussi a beaucoup d’esprit. On me dit ici qu’à tout prendre c’est la plus aimable personne de la société. Lady Burghersh me traite bien. Lord Burghersh veut me rendre musicien. Mais décidément c’est Lord Aylesbury que j’ai le plus charmé. Il m’épouserait.
Voilà le courrier des Affaires Etrangères qui ne m’apporte rien de vous. Je m’y attendais. Rien du ministère non plus. La politique et …. Me manque également. Mais je compte retrouver le second ailleurs.
10 heures
Je pars pour aller déjeuner chez Lord Mahon. La poste est venue aussi et ne m’a rien apporté. Mais je suis décidé à compter que j’aurai quelque chose, indirectement. L’ennui, c’est d’aller déjeuner sans l’avoir reçu. Les voies les plus sûres sont les plus lentes. Que ce monde est imparfait.
Midi et demi
J’avais bien raison de compter. Voilà le 324, bien doux et bien bon. Mes chevaux sont revenus de chez Lord Mahon plus vite qu’ils n’y étaient allés. J’avais à déjeuner Lord Ellenborough et Sir James Graham. Après-déjeuner, Lady Mahon, vraiment jolie et aimable, plus de facilité et de laisser aller que je n’en ai vu à personne ici, et parlant français à merveille. Il faut que je m’habille pour le lever de la Reine. Je trouve que cela revient souvent. Ma curiosité n’y suffit pas. Il n’y aura pas de Drawing-room que le 9 avril. Pourquoi avez-vous le côté gauche engourdi ? Cela me déplait. Ce qui me déplairait au moins autant, (je n’ose pas dire plus) ce serait que le retard de l’arrivée de votre nièce retardât votre voyage ici. Il me semble que cela devrait produire l’effet contraire. Vous ne pouvez l’attendre indéfiniment. Vous la trouverez à Paris avec votre belle-sœur ?
4 heures et demie
Je rentre et la poste me presse. Oui, tous les deux jours. Je comptais ne faire partir ce ci que demain. Mais j’aime mieux l’abréger et que vous ne l’attendiez pas en vain. C’est si dur d’attendre ce qui ne vient pas ! Je renvoie bien des choses à l’ordinaire prochain. De Brünnow m’a présenté à St James le fils de Kesselrode. C’est drôle l’impolitesse commandée à côté de la politesse empressée. Certainement M. de Kisselef est venu le premier chez moi, comme tous les autres. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres
326. Paris, Mercredi 18 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai eu une longue visite d’Appony. Il a été hier au Château. Il ne devine pas,à la physionomie et au langage du Roi ce qu’il croit de la semaine prochaine. Il pense que le Roi s’est trompé en nommant Thiers, s’il a cru que tout serait dit au bout de quinze jours et que c’est la conviction contraire qui le frappe aujourd’hui et imprime de l’embarras à son langage. Cependant, il pense encore qu’il ne faut rien préguger. Le Maréchal à été une heure en conférence avec le Roi hier au soir. On dit toujours que s’il s’arrangeait avec Molé tout s’arrangerait. Mais tout cela à un air de complot et de tripotage qui me parait mauvais, pour tous ceux qui s’en mêlent le Prince Metternich écrit à Appony au moment où il venait de recevoir la nouvelle de l’avénement de Thiers. Il lui dit simplement son profond étonnement et qu’il attendra le manifeste du nouveau ministère; jusque là il n’a rien à dire ou à communiquer à ce nouveau gouvernement.
5 heures
Jeudi 10 heures.
2 heures
Mots-clés : Ambassade à Londres, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique (France)
326. Londres, Jeudi 19 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
327. Paris, Vendredi 20 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
De là j’ai été faire une visite que vous ne divinerez pas. Rue de la Borde 21, la plus misérable chaumière sale délabrée. Là demeure une Anglaise avec quatre enfants tout en haillons. Ils ont de la viande deux fois la semaine. La femme n’a pas l’air triste comme moi, les enfants sont joyeux. Tout cela ne parle qu’Anglais. Ma visite leur a fait du plaisir et du bien. J’y retournerai. C’est Marion qui m’a envoyée là; je l’ai chargée de me faire de ces découvertes. J’ai rendu à Mad. d’Armmberg ses nombreuses visites. J’y ai trouvé quelques Carlistes, grands noms et sottes gens. De là, la petite Princesse.
1 heure
5 heures
Samedi, 11 heures
Le vent d’Est et du Nord continue. Je n’ose pas m’y exposer. Cela fait que ne faisant pas d’exercice. Je passe de mauvaises nuits. Je dine demain chez le duc de Noailles à moins que je ne fasse comme au dîner Rothschild Je ne suis plus sûre du tout de ma santé.
Je mets cette lettre-ci sous une nouvelle adresse, mandez-moi si je fais bien. C’est Génie qui me donne tous ces conseils. Je crois voir ou deviner, dans les propos des anglais ici que vous devez rencontrer des obstacles dans le quartier principal. Je connais la tenacités de ces idées. Il peut en changer brusquement. Mais les adoucir, c’est difficile. Au reste, vous avez, dit-on, tout le reste de la boutigue pour vous.
Adieu. Adieu. Il me semble que je vous dis tout. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Gouvernement Adolphe Thiers
327. Londres, Samedi 21 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
3 heures
4 heures ¾
328. Paris, Dimanche 22 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai vu personne chez moi hier, matin. J’ai été chez Lady Granville je devrais dire plutôt chez son mari car c’est lui qui prend tout le temps. de ma visite. Il sait bien peu ; il faut bien que cela soit, parce qu’il trouve intérêt à ce que j’ai à lui dire mais je suis frappée de l’entêtement des gens qui ne veulent jamais croire ce qui les contrarie. D’abord M. de Broglie est infaillible; et puis, M. Thiers est impérissable. Il faudra bien cependant que Granville se détache de ces deux idées. j’ai été ensuite voir Mad. de Talleyrand, M. de Vandoeuvre y est venu. Il parlait assez mal pour le Ministère de l’effet du rapport de M. Barville. J’ai fait encore visite à la petite Princesse, Médem y était. Nous ne lui trouvons pas l’air très joyeux du retour de Pahlen. Il est évident qu’il ne s’y attendait pas, et qu’il ne le désirait pas. Il dinait lui chez Thiers. J’ai dîné seule. Berryer est revu de bonne heure. Je suis restée seul avec lui une heure au moins. Il m’a beaucoup raconté et avec sa clarté et son animation ordinaire. il trouve la journée d’hier bien mauvaise pour les Ministres il n’a presque pas de doute qu’ils seront remaniés sur les fonds secrets. C’est à dire qu’on proposera un amendement de rien du tout. (100/m francs) sur lequel il tombera la situation est trop périlleuse. la partie est trop bien liée entre les conservateurs. Voici les chiffres qu’il donne, 180, des 221 plus une quinzaine de voix de sassesz plus une 20 aine. de voix avec Duchâtel, plus 30 voix de l’extrème gauche; 245 voix contre M. Thiers. Lui même Berryer et son parti ne veulent se décider que pendant la discussion Il me parait évident dès à présent qu’il votera pour Thiers toujours it tomberait. Il croit cependant impossible que tout ce parti d’opposition s’engage sans savoir ce que vous ferez en cas de nomination de M. Molé il dit qu’on a envoyé à Londres, et qu’on attend la réponse. Mais quand je lui demandé s’il sait, il répond ; mais il est évident qu’on ne peut rien faire sans lui. En parlant de la situation en général, il dit "cela craque., voilà ce qu’il y a de plus sûr" ; aussi a-t-il l’air content. Je vous ai redit tout Berryer. Les journaux de toutes couleurs ce matin ne le démentaient pas. Evidemment le danger est là et mardi sera très curieux. Le gros Monsieur est venu m’in terrompre. J’avais cru prudent jusqu’ici de ne lui dire qu’un boujour et un merci des plus polis mais sans aucun conver sation. Je ferai plus la première fois. Merci à vous bien autre ment qu’avec politesse ! Mais oui, oui, vous êtes pour nas tout, tout. Vous le voyez bien Je ne sais pas le dire mais est-ce qu’il est besoin que je le dise ? Je n’ai pas une autre peine; un autre souci, une autre joie que vous ! J’ai envie de vous envoyer ceci aujour d’hui même quoique je vous aie écrit hier, Il me semble que le bavardage de Berryer pourra vous amuser. vraiment je vous redis tout. Ce que je ne dis pas est mes commentaires, mes spéculations ; pour cela il faut le tête à tête, et puis mon opinion. n’est guère comptée, je n’entends rien sans doute aux situations, je ne m’en mélerai pas. Les emprunts et la danse de Brünnow m’ont royalement amusée. Et votre journal m’entéresse au dernier point, continuez, continuez, tout.
Je dîne aujourd’hui chez M. de Noailles je crois que je vous l’ai dit. J’irai le soir entendre les Deljouse chez la Desse de Poux. Je ne me promenerai pas. Le vent d’est me crispe. Ce vilain vent qui vous a emporté si vite en Angleterre il n’a pas cessé de souffler depuis ce triste 25 février. Je vous ai écrit deux jours de suite Mercredi et jeudi, parce que les lettres de vendredi ne sont pas remises à Londres Comme le dimanche le Dimanche. Aussi les lettres ne partent pas de Londres j’espère que vous aurez fait le même arrangement ; si non, je resterai deux jours sans lettre, et alors j’aurai plus le droit de défier que vous Je vous écrirai toujours lundi, Mercredi Jeudi, et Samedi. Sauf les extraordi naires comme aujourd’hui. Dites-moi si tout a été bien dans l’arrangement des adresses aujourd’hui. On me dit d’omettre sentaire ?????? & c’est mon bon génie qui m’inspire toujours des précautions. Il trouve que vous n’en avez pas assez. Adieu, adieu. Vous devez être très préoccupé de ce qui se passe ici. Il est évident qu’à moins de miracle Thiers tombera. Mais que ferait-t après? C’est ce que je demandais à Berryer. Il dit que naturellement la gauche toute entière se rangèra sous lui, qu’il peut devenir très redoutable, que si contre toute attente, le vote de la semaine était pour lui, il est impossible qu’il ne recourre pas à la dissolution. parce qu’il rencontrerait des chevaux de frise. à chaque pas. Enfin Berryer ne comprend pas qu’il soit possible de gouverner dans l’état actuel de les chambres à moins que le parti. Soult Molé et doctrinaire ne soit tout à fait uni. Et encore !! Adieu, adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, de toutes les prochaines lettres. Je n’en ai jamais assez, jamais d’assez longues, jamais assez d’adieux.
Mots-clés : Ambassade à Londres
328. Londres, Dimanche 22 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je ne suis pas sorti hier soir. J’ai eu à dîner MM. de Bülow, Alava, Biörnstierna, Gersdorf et Münchausen. Ils ont joué au whist. Alava ne m’a quitté qu’après onze heures. Il a failli descendre à la cuisine pour faire à Louis son compliment. Il est très heureux depuis quelque tems. Son gouvernement devient quasi-tory et s’en trouve bien. Alava parle con gusto de toutes les lois qu’on va remanier. Un peu trop à mon avis. Du reste Rumigny et Aston s’entendront à merveille à Madrid ; ils ne se mettront point à la tête des factions opposées ; ils soutiendront ensemble le gouvernement de la Reine au lieu de tirer chacun à soi. J’oublie que l’Espagne ne vous intéresse pas du tout. Vous avez tort. Il y a là quelque chose qui commence. Mais vous n’aimez pas ce qui commence. Il vous faut du plein midi. Bülow m’a paru hier moins préoccupé de sa santé, moins nervous. Il causait volontiers. Il a beaucoup de goût pour son Prince royal. Il n’y a, dit-il, à Berlin de mouvement d’esprit et de conversation que chez lui. Je vous ai envoyé sur le champ les nouvelles du corps diplomatique. Vous les ,aviez peut-être déjà. Médem ira-t-il à Stuttgart ? J’en doute. N’a-t-il pas refusé Stockholm il y a un an ? S’il part, j’en suis fâché pour lui, et même un peu pour vous. Sa conversation vous plaisait assez.
Je vous consulte et bien à l’avance, sur une grave question. Je donnerai mon premier grand dîner le 1er mai. Autrefois, c’était un dîner français. Sébastiani a changé cela et en a fait un dîner du Corps Diplomatique, plus les principaux membres du Cabinet. On me propose ou de faire comme Sébastiani, ou de donner un dîner tout anglais, sauf les deux ou trois principaux du Corps Diplomatique et composé ainsi qu’il suit :
Le Cabinet tout entier... 14 les hommes seulement
Les lords Leveson à cause de son père Uxbridge pour la Cour Albermarle Hill Pour l’armée Tankerville il y a toujours été Somerset Devonshire Pour le monde Sutherland Anglesey M Elllice Esterhazy Bülow Pour le Corps Diplomatique Alava de famille.
Il y aurait, dans ce nombre, plusieurs refus. On me propose, comme remplaçants Les Lords Carlisle, Breadalbane, Skrewsbury Dites-moi votre avis.
Le dîner tout anglais, ou à peu près, est peut-être plus utile. Mais il me semble que le dîner au Corps Diplomatique est plus convenable. Ne criera-t-on pas beaucoup si j’abandonne la tradition ? Puisque nous sommes à table, je poursuis. Voici deux autres dîners qui viendront à leur tour. Pesez-les bien. 1° Le dîner Tory
Les Cambridge…. 6 personnes, le fils, la fille, la dame d’honneur
Les lords Wellington 1 Peel 2 Lord et Lady Aberdeen 1 Lyndhurst 2 Lord et Lady Stanley 2 Lord et Lady Jersey 3 Sa fille pour la fille de la duchesse de Cambridge Witton 2 Cowley 2 Les lords Stuart de Rothsay 2 Londonderry 2 s’ils viennet tout sera fini Hertford 1 Howe 1 Et pour suppléants aux refus Les lords Douro 2 Aylesbury 2 Fitz Roy Somerset Sir Charles Bagot
3°) Le dîner de fantaisie, purement fashionable Les Sutherland 2 Palmerston 3 Clarendon 2 Tankerville 2 Aylesbury 2 Lichfield 2 Mahon 2 Anson 2 Douro 2 Leveson Douglas Foley Kisselef Cooper Et pour suppléants Chesterfield 2 Cadogan 2 Si le premier dîner était donné au Corps diplomatique, cela modifierait les deux autres. Je compte que vous serez ici avant le 3ème. Voilà de quoi méditer. Je n’ai pas fini Bourqueney m’apporte son projet pour le 1er dîner, en remplacement de celui qui précède. Il ne prend dans son cabinet que les Lords Melbourne-Landsdowne-Clarendon-Normansby-Palmerston-John Russell-Minto et Holland. Plus quinze ministres étrangers. Plus les Ducs de Somerset et Sutherland et Lord Uxbridge. Il me semble que pour le 1er mai, ceci serait plus correct. C’est bien je crois la première fois qu’on fait passer la mer à des listes d’invitation à dîner. Faut-il que je vous envoie aussi le menu ?
5 heures
Je n’ai rien ce matin. Mais au fait, je ne peux rien avoir. Quand même quelque chose serait arrivé pour moi dans Londres on ne le distribuerait que demain. J’ai passé ma matinée à écrire toutes sortes de lettres insignifiantes. Hummelauer m’a pris une heure. Je crois que ma conversation lui plait. Il a beaucoup plus d’esprit que Neumann qui ressemble à un père noble de comédie. d’Haubersaert m’a écrit comme vous : « Le résultat du vote sur les fonds secrets n’est plus douteux pour personne. « Il me dit qu’on écrit d’ici beaucoup de bien de moi à Lady Sandwich. J’ai après-demain, à l’Athénaeum, un dîner où il faudra un speech, me dit-on, mais un speech en français. Je fais, pour comprendre l’anglais, des progrès considérables. Je triomphe dans le duo. Je suffis au trio ou au quatuor, et même les morceaux d’ensemble m’effrayent peu. Mais j’ai en idée que pour parler, je ne saisirai jamais l’accent. Vous savez que je dîne aujourd’hui chez Lady Palmerston, en petit comité. Je finirai ma soirée Chez Lady Jersey. Elle a de drôle d’artifices. Elle m’a dit l’autre jour, devant plusieurs personnes, qu’elle était désolée de m’avoir manqué le matin, qu’elle ne rentrait ordinairement qu’à 5 heures. Je n’y étais pas allé. J’irai un jour à 5 heures. Lundi, 9 heures Lord et Lady Holland, Lord Normanby, Lord John Russel, M. Macaulay, M. Allen, M. et Mme Stanley, voilà le dîner. Assez languissant. Toujours la Chine. Lady Holland lit beaucoup sur la Chine. L’amirauté vient d’en publier une carte. On aura, au mois de novembre prochain des nouvelles de ce qui s’y passera d’après ce qu’on a décidé ces jours ci. Après le dîner, pour nous délasser de la Chine, j’ai expliqué l’Algérie. Il m’a paru qu’Abel-Kader était un peu moins ennuyeux que l’Empereur de Pékin. Je suis sorti à 11 heures un quart. Lady Jersey n’était pas chez elle. J’étais dans mon lit à minuit. Lord Lyndhurst est très malade, d’un inflammation de poitrine devenue presque générale. Il était mieux avant-hier, mais hier, il est retombé. Savez-vous qu’il a 70 ans ? Lady Holland m’a invité à dîner pour Mercredi. J’étais engagé. Pour dimanche. J’étais engagé. Je crois qu’il faudra attendre leur retour à Kensington. Ils iront bientôt.
Lord Holland en meurt d’envie. Il n’a point de chambre ici. Il fait sa toilette dans la salle à manger. Et pas un coin pour mettre des livres, des papiers. Il a tout son bagage dans un petit coffre qu’il transporte dans la salle à manger, dans le salon, partout avec lui. Lady Holland tient absolument à cette petite maison. Lady Cecilia Underwood va donc devenir Duchesse de Sussex. L’attaque du Morning Post est bien violente. Le Morning Chronicle, ce matin, annonce que le Cabinet est résolu d’approuver la déclaration du mariage et de demander les 6000 Livres. Je n’en ai encore entendu parler que par des ennemis. Que signifie ce procès de Lady Bulwer où le pauvre Bulwer est ramené sur la scène ? Il me semble qu’il avait raison de la craindre à Paris. Comment va-t-il ? Donnez-moi de ses nouvelles.
Une heure
Je viens d’envoyer chercher le 327. Je suis charmé que vous n’ayez plus besoin de Verity. Mais faites le toujours venir à la moindre envie. C’est un peu de repos et surtout un peu de distraction pour votre imagination. Je pense beaucoup à tout ce que vous me mandez, vous et Génie. Personne ne peut savoir ce qui peut commencer là. Mais je n’aime pas les paroles inutiles, je dis comme vous : Nous verrons. En attendant, pensez-y bien de votre côté, je vous prie. Un moment peut venir où tout notre esprit ne sera pas de trop.
2 heures
Rothschild sort de chez moi et ne m’a rien appris. Il voulait savoir quelque chose, mais je suis bien sûr que je ne lui ai rien appris non plus. Certainement j’aurais été charmé qu’il me dit que vous aviez dîné chez lui ces jours derniers. Comment ce pauvre Bulwer, avec son genou, est-il en état de se battre avec Berryer ? Le cartel m’avait échappé ce matin en lisant les journaux. C’est Bourqueney que me l’a fait remarquer. Adieu. Je vais faire des visites. Je dîne aujourd’hui au Raleigh Club. Que de dîners je donnerais pour un autre ! C’était charmant. Adieu encore. Madame la Princesse de Lieven St Florentin 2 Paris Voici des nouvelles que j’ai tout juste le temps d’ajouter. M. de Brünnow a reçu ce matin ses lettres de Ministre extraordinaire à Londres. Il n’en ira pas moins à Darmstadt. M. de Kisselef est nommé à Paris, à la place de Médem qu’on envoie à Stuttgart. Le gendre de M. de Nesselrode, M. Miloradowisch vient à Londres à la place de Kisselef. 5 heures 1/4
329. Londres, Mardi 24 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai écrit hier. mais toutes mes lettres de ce matin confirment ce que m’annonçaient celles d’hier. La chute du Cabinet devient probable. Il faut que nous causions à fond. S’il se forme un Cabinet Soult Molé où soient MM. Duchâtel Villemain Gassy et Dufaure, voici les raisons de rester.
1. C’est le parti conservateur qui l’importe, et j’en suis. Je n’ai consenti a rester avec le Cabinet Thiers qu’en faisant mes réserves contre toute dérivation effective vers la gauche et en stipulant formellement : "Point de reforme électorale, point de dissolution" ce qu’on m’a promis.
2. J’aurai dans ce cabinet plus d’amis particuliers que dans celui de Thiers, et les mêmes amis pour le compte desquels je suis venu à Londres.
3. C’est quelque chose de très grave que de me séparer du Roi au moment même, où il remporte la victoire sur Thiers. Si je reste, je reste avec le Roi, le parti conservateur et la majorité de mes amis. Si je me retire, je me sépare, en apparence du Roi du parti conservateur et de la majorité de mes amis pour me trouver seul entre les deux camps car je ne serai jamais de l’autre.
Voici les raisons de me retirer.
1. Mes relations personnelles avec M. Mole. Elles ne sont pas changées. J’ai été dans des relations analogues avec Thiers ; mais la coalition nous a rapproches ; nous avons sans nous confondre parlé et agi en commun. J’ai pu sans le moindre sacrifice de dignité personnelle rester Ambassadeur de son cabinet. Avec M. Molé ma situation est tout autre. Rien ne nous a rapprochés. Nous sommes au lendemain de la coalition.
2. La politique générale de M. Molé au dehors. Elle est plus faible, plus vacillante qu’il ne me convient. Les formes sont dignes ; le fond ne l’est pas. La gravité couvre mal la légèreté. De plus il est particulièrement désagréable et suspect à ce gouvernement-ci. Son avènement, causera, entre les deux Cabinets de la froideur, et pour l’ambassadeur de France, une mauvaise situation générale J’userai ma faveur personnelle à compenser sa défaveur.
3. Le mal éclatera surtout dans l’affaire d’Orient. En soi, il est difficile d’amener le Cabinet, Anglais à l’arrangement qui nous convient. La difficulté croîtra sera peut-être insurmontable. si je ne la surmonte pas, en rejettera sur moi la responsabilité du mauvais succès. M. Molé excelle dans cette manœuvre. Je serai resté, pour ne pas réussir avec le Cabinet dont la présence m’aura empêché de réussir. Voilà bien je crois, les deux faces de la question. Voyons maintenant, si je me retire dans quelle situation je me trouverai ce que je ferai et qu’il sera l’avenir probable. Je me retirerai en disant, très haut que je me retire à cause :
1. de mes relations personnelles avec M. Molé
2. de la faiblesse de sa politique extérieure,
3. de sa mauvaise position avec le Cabinet, britannique de qui on me demande d’obtenir beaucoup d’obtenir ce qu’il ne fera pas pour M. Molé Le Roi le parti conservateur et mes amis ministres, m’en voudront beaucoup de ce langage ; il n’y a pas moyen d’en tenir un autre.
Arrivé à Paris, rentré dans la Chambre loin de combattre, le Ministère, je l’appuierai dans toutes les affaires intérieures. Je soutiendrai la lutte contre la gauche, qui deviendra très vive. Je la soutiendrai avec grand avantage a cause de ma position indépendante et digne. J’y apporterai toute l’impartialité qui me conviendra. Thiers et la gauche, qui m’auront loue beaucoup de ma retraite me ménageront toujours. Sur les affaires extérieures, je parlerai peu ; à moins que la paix générale, et ma politique personnelle Vis à vis de ce pays-ci ne soient en jeu. Je parlerais alors avec beaucoup d’autorité. Dans cette hypothèse ma mauvaise chance, c’est de demeurer déclassé, isolé en dehors de mon vrai. parti séparé de mes deux points d’appui naturel la couronne et les conservateurs. Ma bonne chance c’est de reprendre peu à peu le Gouvernement du parti conservateur, en le soutenant dans la lutte où il va être engagé, sans répondre des fautes qu’il a faites ni de celles qu’il fera. Il y a beaucoup de mal au début, dans cette situation. Il y a beaucoup d’avenir. En restant, j’échappe aux difficultés du premier moment. Je m’en prépare, dans l’avenir de plus graves peut-être, et sans gagner de la force pour les surmonter. En restant, je reste étranger comme je le suis depuis un mois aux manœuvres aux oscillations ou s’usent, si vite ceux qui y entrent. Je reste en dehors d’une pauvre chambre et d’un pauvre gouvernement.
Si j’ai ici des succès les succès seront pour moi seul. J’agis prudemment. Et pour parler en anglais, je cargue les voiles et je reste en panne, en attendant qu’un bon vent revienne En me retirant, j’agis avec éclat. J’entre par mon propre choix dans une situation, très difficile très périlleuse, qui peut avoir de la grandeur. Je pourrais tout résumer en deux noms propres. Me retirer avec M. Thiers. Rester avec M. Molé. Lequel des deux bassins contient le moins inconvénients. Pensez-y bien, je vous prie. Causez-en avec Génie qui vous dira les petites choses. Il vous mettra au courant de ce que je ne puis bien savoir. L’état d’esprit de mes amis ascendants et de mes amis descendants. Adieu. Je ne vous parle pas d’autre chose aujourd’hui. Ceci peut devenir, très grave. J’en suis frappé Que ne donnerais-je pas pour une matinée avec vous! Peut-être vaut-il mieux que j’aie mon parti à prendre ici hors du brouhaha seul entre vous et moi, car vous me direz tout. Je n’écris sur ce sujet absolument à personne. Je ne m’engage avec personne. Je garde toute ma liberté. Adieu, adieu. A demain.
330. Londres, Mercredi 25 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Le 328 m’est arrivé tard hier. Mon homme avait été le matin hors de Londres. Il n’y a pas moyen d’éviter ces petits ennuis là. Je dis petit, par acte de raison. Je le dis plus facilement aujourd’hui. Ce 325 m’a été si doux ! Les œuvres de surérogation sont toujours charmantes. On me l’a apporté en venant me chercher au club de l’Athénoeun où l’on m’avait donné à dîner ; Lord Landsdowne, Aberdeen, Northampton, Mahon, Montègle, Sir Francis Palgrave MM. Milmes, Holland, Hallam, Milman &etc un diner agréable et assez bon en dédommagement de celui du Raleigh Club vrai dîner Anglais, plus ardent que le charbon le plus ardent. Vous ai je dit que j’avais fait là mon début de speech, en Anglais, à la grande joie de mes auditeurs ? Joie morale plus que littéraire, je pense. Mais n’importe ; ni embarras, ni prétention ; n’est ce pas ce qu’il faut ?
Sur la proposition du Chairman appuyée par Lord Prudhor on m’a élu membre honoraire du Raleigh Club, the only Honorary member in the wortd, m’a-t-on dit. De là on m’a mené, à la Royal geographical society, nombreux meeting où nous avons été en exhibition, moi et trois sauvages des bords de l’Orénoque, tatoués et emplumés comme je ne le serai jamais. Pourtant et sans vanité, j’excitais plus de curiosité qu’eux.
Une heure
Jeudi, 9 heures
Une heure
331. Paris, Jeudi 26 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Je suis retourné hier à la Chambre. J’ai entendu M. de Rémusat, il est bien ennuyeux. M. Berryer, il a été superbe et l’effet qu’il a produit est incomparable. Quand il est revenu à sa place, la Chambre presque toute entière est venue, le féliciter. Il était accablé. Il me semble que les deux pensées dominantes de son discours ont été : de pousser Thiers à la gauche, et d’associer la chambre à sa haine de l’alliance Anglaise. Je vous dirai que cette partie de son discours a remué profondement la Chambre ; je ne serais pas étonnée qu’il ait converti bien du monde à son opinion. Il vous a rendu votre besogne plus difficile.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Doctrinaires, Gouvernement Adolphe Thiers, Progrès
331. Londres, Vendredi 27 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je me lève de bonne heure. Je me suis couché de bonne heure hier, quoique j’aie dîné chez Lady Jersey où l’on dîne plus tard que partout ailleurs. J’en suis sorti à 10 heures trois quarts, et j’ai été passer un quart d’heure chez Lady Landsdowne. J’étais rentré à 11 heures et demie Lady Jersey a vraiment trop peu d’esprit pour tant d’activite et de paroles. Elle me lasse sans m’animer. J’ai revu hier chez elle la petite Lady Alice Peel toujours aussi vive et aussi bizarre, dans son parfait naturel. Elle était enfermée dans une petite robe de soie bariolée sans rien sur son cou, rien dans ses cheveux, pas le plus petit ornement, non absolument qu’elle et sa robe. Cela lui allait bien.
332. Paris, Vendredi 27 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Samedi 28. à 10 heures
J’ai dîné chez Lord Granville, il m’a raconté assez. Le Duc de Broglie est dans la joie de tous les triomphes du vote. Mais il se moque de la Chambre et condamne hautement l’élan d’enthousiasme auquel elle s’est livrée pour ce comedien Berryer. Ah par exemple ! Quand un comédien joue aussi bien que cela, il est fort naturel de l’applaudir.
332. Londres, Dimanche 29 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
L’effet de cette grosse majorité est considérable ici, et me servira, j’espère. J’avais hier Lord John Russel chez Lord Normanby. J’ai vu le soir lord Landsdowne et M. Macaulay. Ils sont disposés à compter avec nous. Ellice est charmé. Il partira décidément le vendredi 10 avril. Il est bien heureux. J’ai causé hier soir avec le revérend M Sidney Smith, qui a réellement beaucoup d’esprit. Mais tout le monde s’y attend, tout le monde vous en avertit. C’est son état d’avoir de l’esprit comme c’est l’état de Lady Seymour d’être belle. On demande de l’esprit à M. Sidney Smith, comme une voiture à un sellier. Rien ici ne va facilement librement, sans attente, ni dessein. Tout est classé, arrangé, convenu. On fait bien d’avoir de la liberté politique, car on n’en a pas d’autre.
3 heures
6 heures
Lundi, 9 heures et demie
2 heures
3 heures
333. Paris, Dimanche 29 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Pour le 1er de mai. Melbourne, Landsdowne, Clarendon, Palmerston, Normanby, John Russell, Minto, Holland, lord Leveson, Hill, Huxbridge, Albermarle, Erroll s il est comme je crois grand maitre de la cour (Lord Stewart), le Duc de Somerset, Sutherland, Anglesea, Devonshire, s’il y est, mais je ne crois pas. Ellice non, il n’y a pas de raison, c’est un dîner d’étiquette, et puis les chefs de mission. Laissez moi penser encore au dîner Tory. Votre discription de l’ancient Musique est excellente. En général vous excellez dans la description. Mais que vous êtes faible de vous laisser entraîner à de parails ennuis! Au reste je me souviens que dans le temps de mon innocence, la 2ème année de mon sejour en Angleterre, j’y ai été une fois, en jurant, par trop tard, qu’on ne m’y prendrait plus, car il faut avoir vu ces choses nationales une fois. C’est comme je vous conseillerais d’aller au diner de Pâques à la Cité, si vous n’avez pas des raisons politiques de vous abstenir. J’ai été voir hier mes pauvres et puis Madame de Talleyrand. J’y ai trouvé le Duc de Broglie. Décidément nous n’avons pas de goût l’un pour l’autre. Il ne me regarde pas, et moi je lui trouve l’air si dédaigeux, si satisfait et si gauche, ou du moins si disgracieux, et puis cet air de moquerie insolente que je déteste. J’ai parlé avec une grande admiration du discours de Berryer, j’esperais qu’il me dirait ce qu’il a dit à Granville et je préparais ma réplique ; il n’a rien dit, il ne m’a absolument pas adressé la parole ni directement ni indirectement. Restée seule, avec Mad. de Talleyrand elle m’a dit qu’elle venait de chez Madame qui était consternée, accablée, elle disait, " le Roi est étonnant tant de courages, tant de résignation dans une situation si terrible. " Voilà le dire de Madame.
Le duc d’Orléans a la grippe. Son voyage est toujours à l’ordre du jour mais pas absolument fixé. La noce Nemours aura lieu le 23 avril. Jai reçu hier une lettre de Pahlen du 17. Il quittait Pétersbourg le lendemain 18, il sera ici le 10 avril sürement. Maintenant Je me réjouis tout de bon. A propos, il me dit que Lady Palmerston mande à Lady Clauricarde que je serai à Londres en avril, il se désole de ne plus me trouver ici. J’ai dîné seule, et le soir j’ai vu Mad de Contades, Mad. de Courval, Brignoles, d’Haubersaert, la Redorte. Celui-ci a un air bien triste ; de quoi ? On sortait de chez M. Thiers, un salon bien rempli ; il a pris les Samedi comme les Mardi.
Midi. Je reviens à vous après ma toilette. M. Royer Collard a voté pour Thiers avec ostentation et parlait tout à fait dans le sens de le soutenir, c’est de Mad. de Talleyrand que je le sais. A propos quelqu’un qui est de l’avis de M. de Broglie sur Berryer a dit de lui, c’est Talma et Rubini, mais ce n’est ni Corneille ni Rossini. Et bien à la bonne heure mais comme on applaudit Rubini ! Ce qui est très vrai, c’est que ses discours perdent à être lus.
On dit que M. de Ste Aulaire est sûr de conserver son poste de Vienne. M. de Barante est-il aussi sûr de Petersbourg ?Dites-moi des nouvelles de là.
Lundi le 30, 10 heures
Médem a enfin reçu de Pétersbourg une lettre qui lui annonce sa nomination. Il n’a pas assez de tenue dans cette circonstance, car il dit après beaucoup d’autres choses, qu’il avait réfusé le poste de Londres ! On peut bien se fâcher, mais il ne faut pas mentir. Au reste il se défâchera aussi, et il faudra bien qu’il aille. Je trouve au fond que Médem avait besoin d’une petite leçon de modestie, il était trop arrogant. Au surplus il passera encore quelques mois à Paris parce que Kisselef va d’abord à Pétersbourg. Je viens de parcourir les journaux dans la séance du 27 aux Communes je lis de très bonnes parole de Lord Palmerston sur la Russie. John Russell, un peu, sur la France. Au total il est évident que vous n’avez pas Lord Palmerston.
J’oublie, et je vous demande pardon de cet oubli mille fois, que j’ai été hier chez votre mère. Mais je l’ai peu vue ou plutôt nous avons peu causé ensemble ; il y avant M. Priscatory ; je lui ai parlé des discussions de la semaine passée. Il m’a assez plus il était moins arrogant dans ses paroles que dans son air.
Votre mère a bonne mine et l’air toujours si serein et si doux ! j’aime extrémement l’expression de sa physionomie. Vos enfants se portent à merveille. Il y avait bal chez eux, et ils faisaient. bien du tapage, mais cela m’a fait plaisir ! M. de Rémusat s’est trouvé hier au soir fort longtemps auprès de moi. Je trouve qu’il ressemble en colossal à Bulwer. Il n’est pas beau.
1 h 1/2
Il faut donc que je ferme cette lettre seule et sans vous remercier de la votre, cela me choque. Adieu. Adieu. Mille fois.
2 heures
Je n’ai lu votre lettre que très rapidement encore, je vais bien la relire Adieu. Adieu.
Où en êtes vous avec Brünnow ? Lord Holland se moque de lui dans une lettre à Granville. Toutes les lettres parlent de vous avec enthousiasme. Je me crois toujours obligée après vous avoir dit cela d’ajouter, restez ce que vous êtes. J’ai rencontré dans le monde des gens de beaucoup d’esprit qui oubliaient cela. Mais moi j’oublie que vous ne ressemblez à personne. Adieu.
333. Londres, Mardi 31 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures et demie
C’est beaucoup deux Reines pour une soirée. Il n’est pas aisé de les y arranger. J’ai dîné hier à Marlborough House entre la Reine douairière et la Duchesse de Cambridge. Le Duc et la Duchesse de Sutherland, Lord et Lady Jersey, Mm. de Bülow et de Gersdorf. La Reine douainière est restée bien allemande de manières et d’accent. L’air très bonne d’ailleurs et d’une simplicité bien royale. J’ai beaucoup causé avec la Duchesse de Cambridge. Elle me paraît aîmer la conversation. Bien protestante de cœur. Elle trouve l’Eglise Anglicane trop catholique. Cela me réussit fort ici d’être le premier Ambassadeur protestant venu de France depuis Sully. Nous sommes sortis de table à 10 heures. Le bal de la Reine commençait à 9 heures et demie. Mais elle était prévenue du dîner de la Reine douairière. Nous ne sommes arrivés à Buckingham-Palace qu’à 10 heures et demie. Assez tôt, car j’y suis resté jusqu’à deux heures. C’est long. Décidément quoique en principe ce soit juste, les spectateurs sont trop sacrifiés aux danseurs. Soixante ou quatre vingt personnes dansant toujours, et douze ou quinze assistants ramassant çà et là des lambeaux de conversation décousue. Lord Clarendon a été m’a principale ressource. Un peu Lady Palmerston, Lady Normanby, Lady Fitz-Harris. Je trouve la manière de Lady Palmerston avec son mari et sa fille très aimable. Elle est sans cesse occupée d’eux, et visiblement. Elle doit leur plaire beaucoup. J’ai eu hier une longue visite de M. de Kissélef, évidemment charmé d’aller à Paris, quoiqu’il y aille par Pétersbourg. Je lui ai parlé de bien des choses et bien. De deux surtout, votre conduite envers la France et notre coalition de l’an dernier. Je crois qu’il a été assez frappé. J’étais en veine de paroles très libres et point amères, comme le jour où j’ai parlé chez vous devant la Princesse Soltykoff et Nicolas Pahlen de la façon dont vous récompensiez Pozzo. Vous vous rappelez. 3 heures Il n’est bruit ici que du mauvais succès de votre expédition de Khiva. J’ai tort de dire votre et cela me déplait. Eh bien, vous savez surement que l’expédition de Khiva, n’a pas réussi. Le corps expéditionnaire est rentré dans les frontières russes après avoir perdu la moitié de ses hommes et presque tous ses moyens de transport, chameaux, charrettes etc. Je ne vois que des gens à qui cela fait plaisir. M. de Brünnow a du malheur. Invité à dîner chez la Reine, il a répondu pour dire qu’il acceptait. Du reste, depuis quelques jours il s’excuse de n’être pas venu chez moi. Il n’avait, dit-il, point de caractère bien règlé, il était si peu de chose ; il a cru qu’il devait se conduire sans prétentions. Dès qu’il aura présenté ses lettres de créance demain au lever, il viendra mettre sa carte chez moi, et il m’expliquera pourquoi il n’est pas venu plutôt. Il a tenu ce langage à plusieurs personnes entr’autre à M. de Bülow qui me l’a dit, et ne doute pas qu’il ne vienne. Je l’attends. N’en parlez à personne jusqu’à ce qu’il soit venu. Le corps Diplomatique de Londres va se renouveler beaucoup. M. de Blome retourne en Danemark. M. de Hummelauer à Vienne, quand il se sera marié à Milan ce qu’il fait par ordonnance de son médecin. Bourquenoy me quitte la sémaine prochaine. Je le regretterai. Il est de très bon conseil et d’un aimable caractére ; vraiment estimé ici. Mon ambassade vous plairait à voir. Les deux secretaires, les deux attachés et mon petit herber vivent dans la meilleure intelligence, et tous de fort bon air. L’un des attachés, M. de Vandeul est un jeune homme distingué. Je ne sais pourquoi ceci me revient à l’esprit, Lord Douro, était hier au soir au bal. Oh vraiment vraiment! J’aime mieux Lord Brougham.
Mercredi, 9 heures
J’ai causé longtemps hier après dîner avec Lady Carlisle qui m’a parlé de vous simplement; affectueusement, comme il me convient. Il y avait à dîner dix du douze personnes invitées, pour me voir. Un M. Grenville, de 84 ans frère ainé du feu lord Grenville, homme fort, lettré, dit-on et qui a l’une des plus belles, bibliothèques de l’Angleterre. Je lui ai promis d’aller la voir. Je suis d’une coquetterie infatigable. Ne croyez pas pourtant que je prodigue mes promesses. J’oublie les noms des autres. On a ici une façon de prononcer les noms propres qui les rend très difficiles à comprendre et à retenir. C’est un de mo ennuis. On me présente les gens, J’entends mal ou je n’entends pas leur nom. Et quand je les retrouve je ne m’en souviens pas. Le vieux poète Rogers est un de mes proneurs. Je le soigne. Au moment du dîner, la Duchesse de Sutherland à reçu l’avis que le lèver, qui devait avoir lieu ce matin était remis. Je viens de le recevoir aussi de Sir Robert Chester. La Reine est un peu souffrante. Elle a pourtant dansé avant-hier jusqu’à une heure et demie. On se demande toujours, si elle a raison ou tort de danser. Personne ne répond positivement. si elle a tort elle a grand tort, car elle danse beaucoup, et personne, en dansant ne saute si vivement et ne parcourt autant d’espace qu’elle J’ai fini chez Lady Minto. J’y ai découvert un parent de bien loin, un M. Boileau de Castelnau issu d’une famille de refugiés protestans Geva une branche existe encore à Rismes, et tient à la mienne. Il est beau frère de Lord Minto et a été charmé de la découverte. Précisément, par grand hazard ma mère venait de m’annoncer, le mariage d’une jeune fille de la branche Nimoise, qui a épousé à Paris un anglais un M. Grant. De là des conversations, très amicales un nouveau gage de l’alliance anglaise. J’étais rentré à minuit. C’est ma limite ordinaire.
2 heures
J’ai le 333. Au moment où je revenais à vous on est venu m’annoncer le rev. M. Sidney smith. Je l’ai reçu. Il vante fort Lord John Russell et le regarde comme l’âme du Cabinet. Il dit que Lord Melbourne est un homme de beaucoup d’esprit et un beau garçon, beaucoup plutôt qu’un politician. Mais bien moins insouciant qu’il n’en a l’air Les radicaux sont en déclin dans la Chambre deCommunes, décourages et ne comptant plus sur lEur avenir ; ils s’étaient figurés qu’ils changeraient toutes choses. Le bon sens public les paralyse. La plupart se fondront dans les Whigs. S’il y avait une de dissolution. Peel aurait, six à sept voix de majorité. Voilà notre conversation. Conversation où j’ai beaucoup plus écouté que dit ; comme je fais toujours quand je suis avec un homme qui à une reputation d’homme d’esprit un peu littéraire. Il y a des gens à qui on plaît en leur parlant ; à d’autres, en les écoutant. On distingue bien vite. Je crois tout à fait que Barante restera à Pétersbourg comme Ste Aulaire à Vienne Soyez sûre que Thiers remuera peu, le moins possible M. de Rémusat est des amis particuliers de M. de Barante et le défendra. Il y aura beaucoup de petits combats intérieurs sur les personnes Quelques nominations feront du bruit. Mais en somme, la conservation prévaudra. Je suis charmé que Pahlen revienne et vous revienne. De part et d’autre on n’est pas si méchant qu’on se fait Voilà qui est dit : le 1er juin, car bien certainement votre nièce tardera. On part toujours plus tard qu’on ne dit, excepté.... Je ne comprends pas comment Lady Palmerston a parlé d’avril, à Lady Clauricard. Juin est établi. Votre description du Duc de Br. est très vraie mais l’intérieur est très supérieur à l’extérieur. Vous trouveriez la même chose pour plusieurs de mes amis M. Piscatory et M. de Rémusat par exemple. Les défauts sont très apparens; les qualités sont essentielles et quelquefois des plus rares. Je dis cela de l’esprit comme du caractére. J’ai fort appris et j’apprends tous les jours à suspendre beaucoup mon jugement. Je crois à mon premier instinct et à ma longue réflexion. Mais cette vue superficielle, passagére qui n’est ni de l’instinet, ni de la réflexion, je m’en méfie beaucoup ; rien n’est plus trompeur. Voilà un billet de Lord Palmerston qui me dit qu’il sera au Foreign, office à 4 heures. J’ai encore deux ou trois lettres à écrire dont ma mère est une. Adieu. Je ne puis pas me plaindre de la prudence, de mes gens. Je l’ai recommandée. Adieu, adieu
334. Paris, Mardi 31 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez bien raison, M. Molé ne peut pas être votre rival. De plus j’ajouterai, que je ne vous ai jamais trouvé inquiet à son égard. Je cherche si vous l’avez jamais été pour quelqu’un, je ne trouve pas. Vos lettres sont charmantes vous ne sauriez croire comme elles m font rire quelque fois, tant les portraits sont ressemblants. M. de Neumann qui mange avec autorité ! Comme je le vois d’ici !
Lord Holland mande à lord Granville que vous plaisez extrémement à lord et Lady Palmerston et que la danse du Russian bear n’enlève, rien à vos succès. Au fait que dit-on de M. de Brünnow ? Est-ce qu’on ne le trouve pas un peu ridicule. J’ai été enfin au Bois de Boulogne hier, mais pour un moment il faisait encore froid ; j’ai fait une courte visite à Lady Granville et voilà tout. J’ai dîné chez les Appony avec Médem. Il ne quittera Paris qu’en été. Il ira à son poste, il y passera l’hiver, il prend son parti, il n’y a pas autre chose à faire. J’ai vu le soir Madame de Boigne, Fagel, Arnim, Esham, le duc de Noailles, les Poix. Fagel est ravi que son maître ne se marie plus. Madame de Boigne est excessivement officielle d’ailleurs il y avait du monde. Le Duc d’Orléans va toujours en afrigue. J’ai eu une lettre de mon frère pour m’annoncer que Pahlen venait de se mettre en voiture le 18. il me remercie beaucoup de mes intéressantes lettres. Il parle du changement de Ministère ici comme de nouveaux visages, sans dire ni mal ni bien. Voilà la lettre, rien du tout. Il m’annonce sa femme pour l’hiver prochain. Je me réjouis beaucoup de voir Ellice. Lord Brougham s’annonce aussi pour le 1 avril. Pahlen sera ici le 10. Voilà bien des ressources à la fois. Je crois que Lady William Russel vient. Au fond vous avez raison dans ce que vous dites d’elle, mais si vous y regardiez de plus près vous seriez frappée de son instruction. Lady Jersey a une querelle de robe avec Madame Appony qui est pour mourir de rire. Celle ci croit bien faire de lui envoyer des couleurs de son âge, l’autre est furieuse, elle renvoye et prétend qu’on reprenne, Palmyre ne veut pas reprendre. la Robe pensée reste flottante entre Douvres et Boulogne, Lady Jersey jure qu’elle ne payera pas ; Mad. Appony pleure, c’est vrai elle pleure. Elle a écrit à lady Jersey une lettre vive pour l’assurer qu’elle ne ferait plus ses commissions. Quelle idée d’en faire jamais.
Mercredi 1er avril. 9 heures
J’ai vu le soir chez moi, le petit Graham, le plus glorieux des hommes de la grossesse de sa femme. L’Internonce, très longtemps seul et Brignoles, voilà tout. Le dernier opéra avait enlevé tout le monde. L’internonce a de l’esprit, on peut causer avec lui. Il m’a raconté des souffres. Il m’a un peu raconté les embarras d’archevêque. J’ai mal dormi, j’ai le rhumatisme au bras gauche.
10h 1/2
Adieu. Il me semble que je n’ai plus rien à vous conter, mais j’attendrai deux heures. Adieu. Adieu.
J’ai lu à Lady Granville la lettre de la Duchesse. Elle m’a avoué qu’elle n’avait pas cru que les Sutherland m’attendirent chez eux, parce que le duc est toujours un peu nervous et qu’un nouveau visage, quoique le mien soit bien vieux, pouvait peut être le géner. Cependant la lettre de la duchesse l’ébranle, sans tout-à-fait la convaincre. Pour éclaircir cela elle va écrire à sa sœur Lady Carlisle? J’attendrai la réponse. Madame de Tumilhac est morte à Rome, le Duc de Richelieu vient de partir pour ramener le corps.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
334. Londres, Jeudi 2 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
J’ai dîné hier chez le colonel Maberly dans la petite maison de Londres la plus magnifiquement arrangée ; un luxe prodigieux en dorures, vieux sèvres, laque & On dit que lord Lichfield est pour beaucoup dans cette magnificence là ! Mad. Maberly est une grande femme, un beau teint, des yeux très animés du mouvement d’esprit, qui a été fraiche et qui passe pour belle. Le premier jockey de l’Angleterre and an author of novels. A dîner, Sir John Shelley, un ancien ami de George 4, lady Shelley, Lord Cantalupe, l’un des rivaux de Lord Chesterfield (à propos, lundi dernier pour le bal de la Reine, Lord Chesterfield a mis sept heures à sa toilette ; il a fait son luncheon dans l’intervalle) Lord Burghersh, Sir Hussey Vivian et sa femme. Après dîner, un improvisateur Anglais M. Hook, qui avait dîné aussi, s’est mis au piano, et cherchant ça et là quelques accords, a emprovisé sur tous les sujets qu’il a plu de lui donner. Je ne sais combien de chansons en vers, rimées, quelquefois assez originales et pleines de humour. Vous n’avez pas d’idée des rires; ils sont rares ici ; on rit les dents serrées. Mais hier ils étaient tous charmés; les corn laws et Lady Kinnoul, les deux affaires de la soirée revenaient à chaque instant dans les chansons et à chaque fois les rires redoublaient. L’improvisation a fini par une chanson en mon honneur, et nous nous sommes séparés à 11 heures pour aller en effet, les uns au débat des Corn laws, les autres au bal de Lady Kinnoul. J’ai été de ceux-ci, quoiqu’infiniment plus propre au débat qu’au bal.
Office (épicerie &) 90
Gages des gens 100
Mes chevaux 20, (ils sont beaux)
3 heures
4 heures
335. Paris, Jeudi 2 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu chez moi hier matin M de Montrond, le Duc de Noailles, & M. de St Aulaire. Celui-ci tout parfumé de Vienne; il m’a raconté l’automne dernier, les frayeurs de M. de Metternich, sa malade ensuite, tout cela parce qu’il nous avait déplu. Il dit qu’il est bien mais qu’il raconte et rabache plus que de coutume. Lord Beauvale va arriver et passera un mois à paris ! M. de St Aulaire a lu de vos dépêches. Il en parle avec enthousiasme. Le Duc de Noailles prépare un discours, il veut absolument pousser le gouverment à faire dans la question de l’orient ; avec l’Angleterre si c’est possible; sans elle si elle ne veut pas ce qui est raisonable. Montrond est venu me dire que le roi était fort content de Thiers, fort content de tout ceci, de bonne humeur. quand il a eu fini. Je lui ai dit qu’on n’en croyait pas un mot. Il ne s’est pas fâché, et il s’est tu sur le chapitre de la satisfaction. Il a entonné vos louanges aussi. Il parait que Thiers parle beaucoup de vos dépêches. Je voudrais être Thiers pour les lire. Il m’a dit qu’on s’entretient beaucoup de Mad. de Meulan qui veut absolument aller à Londres, et que vos amis craignent qu’à force d’importunités elle y parvienne. Or, ils sentent tous que cela gâterait parfaitement votre maison. Avez-vous quelque tracasserie sur ce sujet ?
Hier, le conseil a dû décider sur M. le Duc d’Orléans. Je crois que c’est pour lui permettre de partir. Lui même n’en a pas la moindre envie, c’est une question d’honneur et de parole engagée, pas autre chose. Je me suis promenée au Bois de Boulogne par vertu, sans aucun plaisir. C’est si triste d’être seule ! Je me fatique tout de suite. J’ai eu la Princesse Wolkonsky à dîner, et puis j’ai été un quart d’heure chez Mad. Appony; grand raout insupportable, et une demi-heure chez Mad. de Castellane, M. Molé et quelques personnes y étaient, conversation générales ; rien à vous rapporter. J’étais bien lasse hier, et tout le monde m’a trouvé mauvais visage. Je suis très poorly sans savoir dire exactement ce que j’ai.
Midi
Au fond, il faut absolument que vous ayez un dîner d’essai avant votre grand dîner du 1er de Mai, car le service ne peut pas aller tout-à-fait bien du premier coup. Et comme essai, le corps diplomatique est une très bonne chose. Prenez les tous, femmes et hommes, faites un dîner de 20 ou 24 personnes huit jours avant. Et laissez la liste que je vous envoie pour après le 1er de mai. Nous ne nous génions pas beaucoup pour le corps diplomatique, ainsi comme dépense; cela n’ allait pas aussi loin que pour les autres dîners. On ne leur donne pas a eux absolument toutes les primeurs. Dites cela à votre chef de cuisine. Vous voyez que je me mêle de tout. Mais croyez moi, essayez votre maison sur le corps diplomatique. J’ai rayé sur l’autre page parce que décidément vous ferez comme je vous conseille tout à l’heure. Et puis après le 1er de mai viendra ce que je vous ai dit plus haut, et ensuite seulement le diner Tory. Vous pourrez faire cela deux jours de suite c’est l’usage, samedi et dimanche parce que ce sont les seuls jours libres.
Voici deux heures. Il faut finir. Je n’ai rien à vous dire du tout. Je me sens si malade, je crains une grosse maladie, et je ne sais que faire. adieu
335. Londres, Vendredi 3 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
5 heures
Je n’ai pu vous écrire ce matin. J’avais une longue dépêche à faire. J’ai passé avant-hier une heure avec Lord Palmerston au Foreign office pour la première fois. Je n’ai pas encore attendu. Je suis charmé de lui plaire extrêmement. J’ai été très content de ma dernière conversation. Je mets fort en pratique le système de la franchise, de la franchise la plus exacte ; ne dire ni plus ni moins, et dire au commencement ce qu’on dira a la fin. Que je voudrais causer de tout cela avec vous. Pour mon plaisir d’abord, et aussi pour mon profit. Vous ne savez pas quelle confiance j’ai dans votre jugement. Elle était grande en quittant Paris. Elle est plus grande depuis que j’ai vu Londres. Vous aviez raison en tout. Je rencontre à chaque pas les vérités que vous m’avez apprises.
Il y a des mensonges que vous rencontrerez à chaque pas, qui dépasseront toujours votre attente. Celui que vous me mandez est inconcévable, et ne m’étonne pas. Il ment par légérète et par calcul. Il ment selon sa fantaisie, par humeur à tout hazard. Que sait-on ? Il en résultera peut-être quelque ennui, quelque embarras pour quelqu’un à qui il veut nuire ou simplement à qui il en veut. Cela lui suffit. Il sait que, dans le monde, on ne pousse pas les choses à bout ; il compte que personne ne lui cognera le nez sur son mensonge. Et si on s’en plaint, il se sauvera par un autre mensonge. Vous ne vous doutez pas de tout ce qu’il y a de faiblesse féminine et d’artifice machiavilique dans ce caractère-là. Il passe du caprice le plus soudain à la machination la plus lointaine, tour à tour étourdi et profond, et menteur aux deux titres. Je l’ai observé quelque fois, je vous jure avec une vraie curiosité, tant ce mélange de légérété et de gravité, d’imprevoyance, et de malice savante me paraissait singulier.
Vous avez bien fait de me dire ce commérage. Dites-moi aussi un peu ce que vous a dit l’internonce sur les souffres. Ici, on semble n’en rien savoir. Je demande à tout le monde des nouvelles de cette guerre-là. Personne ne me répond, pas plus les ministres que les autres ; et ils ont vraiment l’air de ne pas me répondre par ignorance. Je prétends que c’est bien de ce tems-ci d’avoir deux guerres sur les bras, l’une à la Chine pour quelques pilules, l’autre à Naples pour des allumettes.
Je les regardais alternativement. Lord Grey m’a accueilli avec un empressement marqué. Nous avons causé, un moment, et nous ne nous sommes pas rejoints. Il m’a dit qu’il ne resterait à Londres que jusqu’à la fin de Juin. Lady Landsdowne avait invité le moins de monde possible. Les mères à plusieurs filles étaient priées de n’en amener qu’une. Fanny Cowper était très jolie. Je la trouve trop jolie. Ne me trahissez pas. Je vous dis sur les personnes toute mon impression. J’ai autant de confiance dans votre discrétion que dans votre jugement.
Lundi, 10 heures
Hier soir chez les Berry, que je n’ai pas trouvées ; elles étaient malades ; chez Lady Holland, qui était au spectacle; chez Lady Cadogan qui avait une petite soirée assez agréable à cause du peu de monde. J’ai causé longtemps avec Lady William Russell. J’ai vu sa science. Elle y est simple. Il y a dans tout son air et toutes ses paroles, quelque chose de très honnête et sincère.
Lady Jersey était là. Vous ne vous doutez pas qu’elle ma raconté sa robe et Mad. Appony. Elle m’avait prié de me charger d’un petit paquet. Le paquet n’est pas venu. Je lui ai demandé pourquoi. C’était la robe qui en effet reste en suspens. Et Lady Jersey n’aura pas, pour le drawing-room, la robe quelle voulait. Elle s’en désole et s’en prend au goût de Mad. Appony. Je dîne aujourd’hui chez Mistress Stanley avec M. O’Connell.
4 heures
Adieu. Adieu. Il ma manqué hier une lettre de ma mère. Mais j’en ai aujourd’hui. Tout va bien chez moi. Adieu! Que personne ne vous plaise à la bonne heure ; mais rien c’est trop. Je ne suis pas égoïste à ce point.
336. Londres, Dimanche 5 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je lui ai dit quand on me l’a présenté : "Il y a ici, Monsieur deux choses presque également singulières, un Ambassadeur de France Protestant, un membre catholique de la Chambre des communes d’Angleterre. Nous sommes vous et moi deux grandes preuves du progrès de la justice et du bon sens." Ceci m’a gagné son cœur. Il n’y avait à dîner que Lord J. Russell, Lord Duncanmon, Edward Ellice et sa femme, M. Charles Buller et M. Austin. Mistress Stanley hésitait à inviter quelques personnes pour le soir. Elle s’est décidée et a envoyé ses petites circulaires. Sont arrivés avec empressement Lord et Lady Palmerston, Lord Normanby, Lord Clarendon, l’évêque de Norwich, Lady William Russel, etc, etc.
En sortant de table, un accès de modestie a pris à M. O’Connell ; il a voulu s’en aller.
-Oui, mais restez, restez. Nous y comptons."
-Non, je sais bien.
-Restez, je vous prie." Et il est resté avec une satisfaction visible mais sans bassesse. Lady William Russell qui ne l’avait jamais vu, m’a demandé en me le montrant. - C’est donc là M. O’Connell, et je lui ai dit "Oui"en souriant d’être venu de Paris pour le lui apprendre.
-Vous croyez peut
être, m’a-t-elle dit, que nous passions notre vie avec lui.
- Je vois bien que non."
4 heures et demie
Vous avez raison pour les dîners. Le 1er Mai ne compte pas, et le dîner Tory ne peut venir qu’après un pur dîner whig. Je rétablirai cet ordre. Mais il n’y a pas moyen de donner aucun dîner un peu nombreux avant le 1er mai. On entre dans la quinzaine de Pâques. Beaucoup de gens s’en vont. Je n’aurais pas qui je voudrais même dans le corps diplomatique. D’ailleurs, pour le 1er Mai le corps diplomatique me convient, huit ministres, et trois ou quatre grands seigneurs. J’espère que le service ira assez bien. Mon maître d’hôtel est excellent.
3 heures 1/2
J’avais vu souvent le colonel Maberly en France chez Mad. de Broglie. Il me connait ; il m’invite à dîner, je venais d’avoir quelque affaire avec lui pour les Postes des deux pays. Personne ne m’avait jamais parlé de Mad. Maberly. Vous ne m’aviez point dit la prophètie de M. Pahlen. J’ai dîné chez un anglais de ma connaissance, chez un membre du Parlement, chez le Secrétaire des postes anglaises sans me douter de l’inconvenance. Une fois là, le ton de la maîtresse de la maison ne m’a pas plu. Mais cela m’arrive quelquefois, même en très bonne compagnie. J’ai du regret de ma bèvue, mais point de remords. Je regarderai de plus près à mes acceptations ; mais je n’ose pas répondre de ma parfaite science. Venez. J’ajoute que si je ne me trompe cela a été à peine su, point ou fort peu remarqué. Rien ne m’est revenu. Soyez donc, je vous prie, moins troublée du passé. Et bien tranquille, sur l’avenir du moins quant à moi-même. Je reprends ma phrase. Je suis ce que j’étais et je resterai ce que je suis. Et je suis charmé que cela vous plaise. C’est une immense raison pour que j’y tienne. Mais en honneur comment voulez-vous que ces blunders-là ne m’arrivent jamais ?
J’ai bien envie de me plaindre à Lady Palmerston de ce qu’elle ne m’a pas empêché de dîner chez Mad. Maberly. Elle me répondra que je ne lui avais pas dit que Mad. Maberly m’avait invité. Croyez-moi, j’ai quelque fois un peu de laisser-aller ; mais il n’est pas aisé de me plaire, ni de m’attirer deux fois de suite chez soi. Et je suis plus difficile en femmes qu’en hommes. Et toutes les prophéties, que vous auriez mieux fait de me dire seront des prophèties d’Almanach. I will not be caught. Mais regardez-y toujours bien je vous prie, S’il m’arrive malheur, je m’en prends à vous. Et n’ayez jamais peur de me tout dire. Votre colère est vive, mais charmante. Je ne sais pourquoi je vous ai parlé de cela d’abord. C’est une nouvelle preuve de notre incurable égoïsme.
J’ai commencé par moi. J’aurais dû commencer par vous, par ce triste jour. Samedi en vous écrivant, je voulais vous en parler ; et le cœur m’a failli. De loin, avec vous sur ce sujet-là, celui-là seul, je crains mes paroles, je crains vos impressions. Je n’aurais confiance que si j’étais là, si je vous voyais, si je livrais ou retenais mon âme selon ce que j’apercevrais de la vôtre. Je me suis tu samedi, ne sachant pas, dans quelle disposition vous trouverait ce que j’aurais dit craignant le défaut d’accord entre vous et moi. Tout ce qui va de vous à moi m’importe, me préoccupe. Dearest, je vous ai vue bien triste près de moi. Ne le soyez pas, laissez la moi ; ne le soyez du moins que parce que je ne suis pas là. C’est là ce que je ne voudrais. Et cela ne se peut pas. Et dans ce moment, je ne vous dis pas la centième partie de ce que je voudrais dire.
336. Paris, Vendredi 3 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
2 heures
6 heures. J’ai été faire visite à Lady Granville. J’ai causé avec le mari, il est bien d’avis que si M. Thiers est sage il n’abandonnera pas une de ses idées sur la question de l’Orient, parce que sa chute serait inévitable. Il pense, et il sait que vous soutenez cette opinion aussi qu’il ne serait possible à aucun homme d’Etat en France d’abandonner le Pacha. Enfin il me parait être aussi bien disposé que vous pouvez le désirer, et il gémit un peu de ce que d’autres en Angleterre pensent diffèrement. Il a eu hier pour voisin à dîner chez M. Gonin, M. Odillon, Barot. Il lui a laissé l’impression d’un homme qui protège le ministère ; et de plus, d’un homme qui compte être ministre lui même. On dit que la commission de la chambre des pairs est assez animée, et que la discussion le sera certainement. M de Broglie compte parler. J’ai été au bois de Boulogne un peu. Le vent d’est était bien élevé et bien aigre. En revenant j’ai passé chez Mad. de Talleyrand, M. Sallandy y était. Il disait que M. Molé parlerait aussi. C’est probablement le 13 que commence la discussion.
samedi 4
à 9 heures
Midi.
1 heure
Paris samedi le 4 avril 1840,
3 heures
Je viens de vous écrire et je recommence. Vous ne savez pas le chagrin que vous m’avez fait, chagrin de toutes les façons. Vous êtes descendu dans mon opinion, voilà ce qui me fait mal. Je vous proteste qu’un homme de ma connaissance qui m’aurait dit à Londres, j’ai dîné chez Mad. Maberly ; cet homme-là je l’aurais tout de suite classé un élégant, parmi les élégants de mauvais genre. il faut bien que je me serve de cette expression. Si un homme sérieux ; ah là je n’ose pas dire sans vous offenser. Enfin, ce qui est bien sûr c’est que personne ne m’a jamais dit y avoir dîné. Le duc de Wellington peut être mais aussi le Duc de W. figure dans les mémoires de... le nom m’échappe, une demoiselle de Londres. Tenez pour certain que vous avez fait là quelque chose de très inconvenant, demandez la réputation de la dame, et la réputation des convives. Votre position exige un peu plus de prudence. Il est très naturel que vous ignoriez la qualité sociale ou morale des gens qui vous invitent. Il faut demander et si vous n’avez à qui, écrivez-moi, nous en étions convenus. Je suis parfaitement sûre que j’entendrai parler de ce dîner avec beaucoup d’étonnement. Ce n’est pas de cette manière là qu’il vous convient d’étonner les gens. A ce compte je conçois que vous dîniez souvent dehors. Mais vous n’avez pas la prétention de Neuman qui avait compté 60 invitations dans un hiver, il peut accepter la quantité, mais vous devez regarder à la qualité. Je crois qu’en fait d’Ambassadeur Estrhazi peut avoir dîné chez Mad. Maberly. Mais il fait pire assurément. Il ne sera venu en tête à aucun de vos devanciers d’accepter cela. Quel plaisir de pouvoir se divertir d’un philosophe ! Et moi comme j’aurais aimé à m’entendre dire que tout tout était digne de vous ! Ceci fait un petit dérangement. Croyez vous que qui [que] ce soit au monde vous dise la vérite excepté moi. Eh bien si vous aimez encore la vérité écoutez moi. Ces allures ne vous vont pas. Elles vous donneront du ridicule, j’en suis parfaitement sûre. Et le dire de bien sottes gens ici, avant votre départ encore, se trouvera vèrifier. Je ne vous ai pas dit ce que j’ai entendu alors, je n’osais pas, vous auriez pris cela pour une injure. N. Pablen disait : " Il est capable d’aller dîner chez Madame Maberly." Cela faisait suite à Mad.Durazzo : "all these pretty women will make up to him, and he will be caught." Eh bien, je ne vous l’ai pas redit. J’ai eu tort; cela eut mieux valu. Aujourd’hui, j’aurais tort de ne pas vous dire tout, tout ce que je pense. Si vous vous fâchez. Je me tairai, mais je ne me repentirais pas. Cela me prouvera seulement que Londres, vous a déjà gaté. Ah que ne restez-vous ce que vous êtes. M. de Sully serait il allé dîner là ? Un ambassadeur doit tenir plus haut sa personne. Vous ne pouvez pas accepter indistinctement les invitations de tout le monde. Sans compter les espèces conme Mad. Maberly vous ne devez aller chez de petits gens que si une grande célébrité se rettache à leur nom. Votre dîner chez Grote a paru singulier aux Granville. Mais j’ai expliqué que vous aviez dîné chez eux à Paris ; je vous cite cela pour vous montrer ce qu’on peut penser à Londres. Il arrive parfois qu’on peut être obligé de dévier : par exemple, j’ai dîné chez certains Mitchell à Londres, mais c’était le plus gros individu commerçant de nos proviences de la Baltique. Son argent avait poussé sa femme respectable et ses filles à être admises à Almacks, à Devonshire house enfin partout. Et bien alors pour m’avoir,
337. Paris, Dimanche 5 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Après avoir fermé ma lettre hier, je me suis jetée à genoux demandant à Dieu pitié, miséricorde. J’avais le cœur brisé de mes malheurs passés, le cœur oppressé des malheurs à venir, tout derrière moi, devant moi était peine, misère. Vous ne savez pas comme le chagrin s’empare de moi, comme il m’envahit. Comme j’ai peur de moi alors, le joir où je n’en aurai plus que ce sera fini. Je vous ai écrit hier beaucoup, vous ne vous serez pas fâché n’est-ce pas ? Vous me pardonnez la vivacité de mes expressions vous savez comme je suis. Vous me disiez un jour : "Si l’on pouvait toujours lire au fond du cœur, si la parole était toujours toujours la vérité." Ma parole à moi, quand c’est à vous que je parle est bien ce qu’il y a dans mon cœur! Laissez moi ce privilège. Je n’ai fait que penser au sujet de votre dernière lettre. Je vous ai peut être dit directement ce que j’en ressentais, la forme eut été autre aujourd’hui que dans le premier moment, mais le fond n’eut pas varié ; je penserai toujours sur ce sujet comme hier. Si j’étais auprés de vous je suis sûre que je vous ferais convenir que j’ai raison mais je suis loin, si loin ! Vous me dites ce que vous avez fait, pourquoi ne pas me dire ce que vous ferez, ce qu’on vous propose ? Là où il y a doute, je le resoudrai. restez donc bien fier bien haut, comme il vous convient de l’être, à vous ; comme il convient de l’être dans le poste que vous occupez. Il y a quelques fois en vous une distraction d’esprit qui vous fait ne pas juger de suite les choses ce qu’elles sont ; je dirais d’un autre français que c’est de la légèreté, chez vous il n’y a pas moyen d’appliquer ce mot, il faut en trouver un autre.
Envoyez- moi, je vous prie votre programme d’engagements pris ou à prendre. Vous aurez trois invitations par jour si vous donnez dans du Maberly ! Il est impossible qu’un étranger sache classer la société de Londres, et depuis que M. de Bourqueney vous a passé les Maberly son expérience m’est très suspecte. Excepté les toutes nouvelles gens / les radicaux/ Il n’y a personne dont je ne connaisse la position sociale à Londres. Vous pouvez être pris à des noms, à des relations, cela ne veut rien dire.
Ainsi, Sir John Shelley, ami de George 4 oui surement et je l’ai vu là, toujours, ainsi que sa femme. Mais jamais je n’ai imaginé de prier chez moi ni le mari, ni la femme. A propos de celle ci, elle racontait qu’à Vienne où elle a été pendant le congrès, M. de Metternich, très amoureux d’elle avait été un jour très pressant et qu’elle lui avait dit : "une femme qui a refusé au duc de Wellington n’accordera pas au Prince de Metternich." Wellington à qui cela fut redit s’écria : "D... m’emporte si je lui ai jamais rien demandé."
Je cois que personne ne connait mieux que moi la société à Londres, les petits embarras d’invitation dans une ville où tous les invités ont de quoi inviter à leur tour. C’est là justement ce qui fait qu’il faut regarder de si prés à ce qu’on acceppte. Ainsi les Shelley, tenant par quelques petits bouts à un peu de l’élégance des Jokeys, vous demanderont de dîner chez eux, et n’auront rien de plus pressé que d’inviter les Maberly parce que vous avez eu l’air de rire et de vous plaire dans cette société. En même temps vous verrez chez eux quelque chose de mieux que chez ceux-ci, ce mieux jugera tout de suite que vous appartenez à ce set et vous voilà classé dans leur opinion avec des gens auxquels vous n’auriez pas même du rendre de carte de visite. Je vous dis l’exacte vérité. Ensuite laissez-moi- vous dire encore, ne laissez pas envahir votre temps par des visiteurs tels que Sidney Smith le prêtre bouffon. C’est bon à rencontrer à dîner, et encore il ne m’a jamais plu je vous l’avoue et c’est plutôt un homme méprisé que le contraire, parce que le genre de son esprit va mal avec son état mais vraiment on n’imagine pas de le recevoir le matin. Un ambassadeur qui ne passe pas pour un désoeuvré ne reçoit chez lui que des gens qui lui parlent affaires. Vous n’avez rien à apprendre avec M. Smith. Croker c’est autre chose de temps en temps, il a, ou du moins, il a eu une grande expérience des affaires de son pays. Il est bon à entendre quelquefois. Je vous trouve trop poli pour commencer. Il est impossible que vous souteniez cela, il aurait mieux valu vous faire plus rare. Nous avons beaucoup causé Angleterre pendant un mois. Et tous les jours je m’aperçois davantage, que je ne vous ai rien dit. Je reviens à moi.
J’ai été au bois de Boulogne un moment. Il faisait détestable. J’ai été chez la petite Princesse, M. de Ste Aulaire y est venu. Galant, épris de la petite Princesse, lui parlant de la couleur de sa robe, lui débitant des vers sur la couleur de ses yeux. Imaginez que je suis partie d’un éclat de rire. C’était parfaitement grossier, mais je n’avais rien entendu de pareil depuis le marquis de Mascarille. Je suis partie le laissant un peu étonné de mon rire. J’ai diné chez Appony avec le duc de Noailles. Appony est bien monté aussi contre Lord Palmerston et sa russomanie. Il me semble que cela devient un morceau d’ensemble. Comment cela finira-t-il ? Le Duc de Noailles persiste à vouloir presser Thiers à la Chambre des Pairs à dire quelque chose de trancher sur l’Egypte. Berryer est reçu chez moi le soir. Il dit que l’esprit de la chambre est bien vif sur ce point, que Thiers ni personne ne pourrait faire autrement que suivre la pente égyptienne. Il y a des prétentions de places qui commencent à incommoder le ministère. Les rédacteurs sont exigeants. M. Verou veut la direction générale des beaux arts ; Walesky une Ambassade ; la gauche entrer dans le ministère. Il faudra bien que tout cela se fasse après la session.
Vous aurez cette lettre par la poste d’aujourd’hui. Il me semble que celle d’hier ne doit pas rester deux jours sans successeur. Je voudrais vous parler à tout instant. Croyez-vous que je vous aime ? Ah mon dieu ! Adieu. Adieu.
Berryer soutient que Thiers ferait bien de prendre Barrot dans le ministère parce que là il s’annulerait tout-à-fait.
338. Paris, Lundi 6 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
J’avais oublié de vous dire que samedi 4 j’ai été chez mes pauvres. Eh bien, là même, mon guignon me poursuit. Je m’étais attachée à eux, à ces quatre petits enfants. La mère vient à moi bien joyeuse me dire qu’elle part elle et tous les enfants après demain pour l’amérique. Je ne puis pas me chagriner de ce qu’elle regarde comme un bouheur, mais moi, je perds encore cet intérêt au moment où je commençais à m’y attacher. Et voilà comment tout m’échappe. Je vous ai écrit hier, je ne dérange pas pour cela notre ordre établi. M. de Pogenpohl est venu me voir un moment avant ma sortie. Je ne me suis point promenée, le vent était très aigre. Je suis allée chez Mad. de Talleyrand qui m’avait mandé qu’elle était malade dans son lit. J’y ai trouvé ses enfants. Elle me demande si je suis d’un diner chez la Redorte et si je sais qui y dîne. Je dis : "Mad. la duchesse de Talleyrand et M. Thiers. " "M. Thiers !!!! est-il possible êtes-vous bien sûre ? Comment ? M. Thiers, me faire rencontrer Mr Thiers mais c’est trop fort. " Enfin toute la comédie. Comme elle a vu à mon regard que je ne croyais ni à son étonnement ni à son désespoir, elle m’a confié après les enfants partis, qu’elle le savait en effet ; mais qu’on ne l’en avait prevenue qu’après lui avoir fait prendre l’engagement d’y venir. J’ai dit : "Mais c’est bien perfide ou bien sot à votre amie Mad. d’Albufera.
- J’ai cru que vous l’étiez depuis deux ans ?
- C’est vrai nous ne nous sommes plus vus depuis la mort de M. de Talleyrand. Mais la Duchesse d’Albufera m’a dit
que vraiment maintenant qu’il est un homme si important. Elle trouvait qu’il valait beaucoup mieux que je saisisse une occasion de me rapprocher de lui. Que lui d’ailleurs le désire vivement. Il a demandé à M. de Bacourt de mes nouvelles enfin il fait toutes les avances & & "
Enfin je ne lui ai pas laissé la plus légère espérance de m’avoir donné le change après cela, elle me confia qu’après
J’ai eu à dîner hier la Princesse Wolkowsy pour la dernière fois car elle part pour la Suisse. J’ai été ensuite chez les Appony qui m’avaient beaucoup prié de venir à la suite d’un dîner intime qu’ils donnaient à Thiers, l’idée de lui donner un dîner intime. J’avais dit, mais donnez donc grand dîner officiel, c’est bien plus convenable et commode : [de vibur est loflet éutd]. Vraiment ce sont de droles d’Ambassadeurs
- Le fait sans la menace ?
- C’est cela. "
Adieu, j’attends une lettre. J’attends aussi Verity, je vous l’ai dit, je ne suis pas bien. Ecrivez-moi de douces lettres, cela me vaudra, encore mieux que Verity.
Votre déjeuner de cuisine me parait un peu fort, et quand viendront les grands dîners ce sera bien autre chose. Pourquoi donnez-vous d’emblée un dîner aux Cambridge, avez-vous dîné chez eux ? Je ne me rapelle pas. Les Londonderry ne me paraissent pas devoir y figurer, ce serait bien plus que d’aller chez eux à un bal et puisque vous ne croyez pas devoir faire cela comment les inviter chez vous à dîner, cela est trop fort. Il me semble que vous n’êtes pas encore assez orienté sur la valeur morale d’un diner en Angleterre. Et savez-vous qu’en général il faut une longue pratique de ce pays pour se retrouver dans toutes les nuances des usages, des personnes, apprécier toute la portée et les conséquences de choses qui paraissent très peu importantes au premier coup d’oeil. Je vous aurais été utile pour cela ; Je voudrais bien que vous [m’usiez] à mieux de l’être d’ici ; et c’est facile, quatre jours pour question et réponse. Vous vouliez le faire, vous avez oublié.
Fini à l’heure. La lettre n’est pas venue.
337. Londres, Mardi 7 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je reviens à votre colère. Je suis très perplexe. J’ai envie d’être content et faché, de vous remercier et de me plaindre. C’est bien tendre, mais bien injuste. Comment ? parce que dans mon ignorance fort naturelle sur trente dîners, j’en aurai accepté un à tort. Londres m’a déjà gâté, je suis descendu dans votre opinion, Dieu sait si je ne reviendrai pas à Paris un mauvais sujet ! Non. Dieu ne le sait pas et bien certainement il ne le croit pas ; il n’est pas si pressé que vous de mal penser de moi. Tenez, je me fâcherais si vous n’aviez pas mis à côté de cela des paroles excellentes, charmantes. Mais, je vous en prie gardez-moi avec la même sollicitude, sans me croire si facile à la chute. Je vous dirai nullement pour l’intérêt de la comparaison, mais pour celui de la vérité que Sully était un fort mauvais sujet, fort grossièrement mauvais sujet et que si les Miss Harriet Wilson de son temps avaient fait des mémoires, il y aurait figuré.
J’ai été hier soir chez les Berry. Ceci est convenable, j’espère. Je ne les avais pas trouvées l’autre jour et elles m’avaient écrit une lettre désolée. Il y a toujours quelques personnes. Elles partent, le 1er mai pour la campagne Richmond où elles m’ont fait promettre d’aller dîner. Je veux y aller une fois tout seul, et voir votre maison. Bourqueney est parti ce matin, par la Tamise. Il va lentement et ne sera guère à Paris que vendredi. Il ira vous voir d’1à 2. Il est très intelligent et très sûr. On l’aime ici. Je ne sais pas encore comment je le remplacerai par interim. Peut-être par Casimir Périer. Peut-être simplement par Philippe de Chabot qui est ici, bien établi dans la société et qui me plait.
4 heures et demie
Et je sais dans quel état vous êtes quand ces paroles là, viennent sur vos lèvres; je vous y ai vue. Vous me devez, oui vous me devez deux choses plus de confiance et moins de tristesse. Vous me devez qu’à côté de vos alarmes se place toujours une certaine sécurité, à côté de vos peines un certain baume doux et fortifiant. Je ne prétends pas vous faire rien oublier ; je ne prétends pas bannir toute crainte de votre âme si ébranlée. Mais je vous aime trop vous le savez trop bien, et vous devez me trop bien connaitre pour que le doute et le désespoir entrassent jamais dans votre cœur. C’est là ce qui me désole, c’est là ce qui m’offense. Que vous ayiez de bien mauvais de bien amers momens hélas, je ne puis l’empêcher et de loin bien moins encore. Mais que ma pensée, était toujours là ; appelez la comme vous m’appelleriez. Dearest je ne vous dis rien, rien en ce moment de ce que je voudrais vous dire. Mais si vous saviez comme mon cœur est plein de vous et quelle place vous tenez dans ma vie ! Voici mes engagements du moment; ils sont peu nombreux, à cause des vacances de Pâques qui suspendent tout. Je ne vois que des gens qui vont partir pour la campagne. Aujourd’hui, la Duchesse de Sutherland. Demain, Lord Clarendon. Jeudi, M. Hallam. Samedi, à déjeuner M. Senior, membre des Communes avec l’archevêque de Dublin. Dîner, chez l’évêque de Londres, Dimanche, dîner chez Ellice. Il n’y a dans tout cela, ce me semble rien que de très orthodoxe. Ellice ne part que le 15.
J’ai le mercredi 15 chez moi un dîner savant les lords Landsdowne, Aberdeen, Northampton, Mahon,MM. Macalllay, Hallam, Milman, Reeves, Sir Robert Inglis, Sir Francis Palgrave, Sir Henry Ellis, le poète Rogers, MM. Senior, Milnes. Je rends les politesses littéraires.
Soyez tranquille sur mes réceptions du matin. Très peu. J’ai reçu M. Sidney Smith, d’abord parce que je lui croyais un peu d’importance dans le monde, ensuite à cause de Lady Holland qui m’en avait beaucoup parlé. Mais mon instinct m’avait dit de lui ce que vous me dites. Rien ne me plaît moins que les prêtres bouffons. Je vais à la Chambre des Communes, pour la première fois. C’est la Chine. Adieu jusqu’à demain. Oui jusqu’à demain sans interruption.
Mercredi 9 heures
J’irai encore aujourd’hui. J’espère entendre Lord Palmerston et Sir Robert Peel. J’ai écouté bien plus attentivement que personne. On écoute bien peu. Et Lord John Russell, qui dînait à Stafford house, prétend que depuis longtemps, il n’avait pas vu la Chambre si attentive.
2 heures
339. Paris, Mardi 7 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 h 1/2
Mad. de Castellane m’a fait une longue visite hier matin, toute remplie de papillonage, assurément elle gazouille très agréablement, mais elle ne me plaît pas du tout. Je n’aime pas ce qui n’est pas réel. Et puis, je m’en vais vous dire ce qui est bien présomptieux de ma part. Je ne lui trouve pas assez d’esprit ; je vous le prouverais si je vous racontais hier. Elle s’est coupée, elle a dit des bétises, des mensonges, le tout par embarras, je suppose. Enfin, elle me parait en cela ressembler beaucoup au portrait que vous me traciez hier de M Molé et qui est admirable, je supprime les bétises dans la ressemblance, car il n’en dit pas. J’ai vu Lord Granville hier matin. Il avait été chez le Roi la veille. Il a été frappé de son changement, courbé, abattu, le son de voix faible ; il est évidemment très affecté de sa situation. Lord Granville ne sait pas un mot des souffres, on ne lui en a pas dit un mot de Londres. Il s’étonne de ce qui se passe à Naples si ce qu’on raconte est correct ; mais il est convaincu que M. Temple ne peut pas avoir fait de sa tête et que cela doit lui avoir été prescrit par son frère. En même temps c’est bien singulier ! Thiers a dit à Granville, en plaisantant je suppose : " Et bien, prenez la Sicile, nous prendrons Naples, on peut s’arranger."
Voilà Samedi !
Mercredi 8
1 heure
338. Londres, Jeudi 9 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Hier, à dîner chez Lord Clarendon, Lord et Lady Landsdowne, Lord et Lady Holland, Lord et Lady Tankerville, Lord John Russell, Ellice, deux ou trois inconnus. Nous avons eu une petite scène. Lord Clarendon a fait monter dans le salon un tableau qui lui arrivait de Madrid et dans lequel une figure de Moine ressemblait vraiment beaucoup à Lord Holland, à ce point qu’à Madrid Charles Fox s’était recrié en la voyant. Lady Holland s’est fâchée, d’abord tout haut, puis tout bas avec Lord Clarendon. "I’m angry, truly angry take away that picture so ugly, so disgusting a friar."
Midi et demie
Voilà une Hypothése. L’autre, celle d’un accommodement entre les cinq, par des concessions réciproques du Sultan et du Pacha me paraît toujours la plus probable. Mais la solution n’est pas mûre. Le temps y conduit. J’aime donc le temps. Je ne fais rien cependant pour le gagner. Je le laisse venir. J’ai vu aussi entrer hier Charles de Mornay qui passe par Londres en retournant à Stockholm. Il est devenu bien lourd. Je le mènerai demain à Lord Palmerston. Je suis dans une grande incertitude. Il faut que je vous quitte pour faire ma toilette. Fermerai-je ma lettre et la donnerai-je à M. Herbet pour la poste avant de monter, en voiture ? Ou bien attendrai-je que je sois revenu du Drawing- room. On me parle de trois grandes heures. Je ne serais donc ici qu’à 5 heures et demie. C’est trop tard. Je ne veux pas risquer qu’une lettre attendue vous manque.
Adieu. Adieu. Vérity a-t-il vraiment commencé à vous droguer ? J’espère que non. Je déteste les drogues. On ne sait jamais ce quelles feront. Adieu.
340. Paris, Jeudi 9 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Appony m’a fait une longue visite hiers la dépêche télégraphique annonçant que M. Temple avait envoyé des ordres à l’amiral Stopford préocupait beaucoup l’ambassadeur. Cependant je l’ai trouvé plutôt joyeux. Il m’a fait l’éloge de M. Thiers, il le loue de sa politesse, ce qui ne l’empéchait pas de faire quelque voeux contre M. Berger. M. Molé ameutait beaucoup son monde dans ce vote. Je vois cependant que les moutons sont remis à ce berger.
Midi
341. Paris, Vendredi 10 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 h 1/2
2 heures
Ce que vous au dites de l’impression que vous a faite la chambre des Communes me plait parfaitement, car c’est celle que j’ai reçue moi même. J’ai chargé Marion de la découverte de nouveaux pauvres. Anglais, et enfants ; c’est les deux conditions. On dit que le Roi, qui s’était mis sur le ton de la résignation a passé maintenant à l’état de plainte et de propos très amers contre son Ministère. Il se plaint aussi que son salon est désert ; on ne vient plus ! Vraiment il y a peu de dignité à ce langage.
Je vous dis à tort et à travers tout ce qui me revient, mais toujours de bonne source.
Samedi le 11 avril 10 heures
343. Paris, Mardi 14 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai fait visite à Lady Granville hier matin, et une très longue promenade avec Marion. Je me suis même fatiguée, je suis rentreée pour me reposer. J’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Mad. de Boigne, Razonmowsky & Lobkowitz, quelques petits hommes et mon Ambassadeur nous sommes restés seuls après onze heures. Il est très difficile de tirer de Pahlen quelque chose, cependant cela est venu. Et bien il n’y a rien de nouveau. L’Empereur est ce qu’il était, toujours la même hostilité personnelle toujours la même passion. M. de Pahlen a toujours combattu sans gagner un pouce de terrain. Il n’est chargé d’aucune parole aimable, de rien du tout. Il a vu Thiers. Ils ont un peu causé. Il lui a dit que favoriser le Pacha, c’est affaiblir la porte & que puisqu’on veut l’intégrité de l’Empereur ottoman, puisqu’on le dit, il faut lui rendre la Syrie. The Old story again and again. Voilà tout. On pense mal de tout ceci. il est bien égal qui gouverne ici Thiers ou tout autre. Cela s’en va. Je crois que je vous ai donné l’essence. Pahlen a fort bonne mine ; il est content d’être ici et de n’être plus là. Il ne parle pas très bien de M. de Brünnow, un plat courtisan dont les longues et habiles dépêches sont lardées de flatteries pour l’Empereur. On le croit un grand homme. Sa nomination a fort mécontenté en Russie. Lady Clanricarde me le mande aussi. A propos, elle m’a écrit une lettre fort spirituelle. Je vous l’enverrai, par courrier Français car elle est volumineuse. Il n’y a rien de pressé, car il n’y a rien de nouveau, mais vous la lirez avec plaisir. Le temps est doux et charmant aujourd’hui. J’ai déjà marché. Et puis j’ai fait ma longue toilette et je ne viens à vous qu’à une heure. Aujourd’hui vous dînez chez les Berry. Je suis sûre qu’elles vous donneront lady William Russell et que sans jamaisvous plaire beaucoup elle vous paraîtra une bonne ressource de conversation. L’impératrice vient en Allemagne à Erns. La grande duchesse Hélène aussi.
Mercredi 15 avril 1 heure
Je suis tellement occupée de cette idée que je ne vois que cela dans votre lettre par le premier moment des pars. Est-ce que rien ne m’avertissait que vous seriez à Richmond un jour ? Voilà que je bavarde et je veux parler.
329. Paris, Dimanche 22 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
4 1/2 h.
Je viens de voir Mad. de Boigne, elle me parait croire que la combinaison Soult Molé est parfaitement sûre M. Molé n’y fera pas faute. Il accepte moins qu’il n’a en suivant l’exemple de Thiers, qui aussi avait consenti à la présidence de Broglie, de Soult & & ce précédent met à couvert l’amour propre de Molé. Il parait que le Maréchal a plus de regret de se séparer des aff. Etrangères. Cependant cela est convenu 801 et Dufauré c’est fait aussi. Duchatel n’est pas tout à fait aussi avancé mais on a peu de doute. En tout on regarde l’affaire à peu près comme consommée tant on croit ici facilement, aussi les vraisemblances sont bien pour cela. M. de Broglie à qui Mad. de Boigne demandait avant-hier ce qu’il pensait du ministère, a dit qu’il donnerait un an. M. de Broglie est un grand baby. M. de Rémusat dînait hier chez Mad. de Boigne, à elle il n’a pas dit tout ce qu’il pensait de la journée, mais à un autre dans son salon ; il a dit, le rapport est déplorable, C’est une mauvaise situation. Madame de Boigne ne doute pas, si le changement arrive que Messieurs de Broglie, Rémusat, Dumerger d’Hausaine vous somment de revenir. Elle ne doute également pas que M. Molé ne vous demande de rester. Elle ajoute Si M. G. me faisait l’honneur de me consulter ce qu’il ne fera assurement pas, je lui dirai de rester. En revenant il ne mettrait à la suite de Thiers avec trois ou quatre homme de feu son parti. Ce n’est vraiment pas une situation qu’il puisse accepter. Et venir le mettre à la tête du parti Duchâtel pour donner son appui au Ministère, c’est se déclarer trop brusquement l’ennemi de l’homme qu’il vient de servir. Si M. Thiers passe à l’état d’opposition s’y montre dangereux pour le pouvoir du roi alors sera le moment pour M. Guizot de venir le combattre. Aujourd’hui ce qu’il a de mieux à faire est de rester où il est." On dira donc que M. Guizot accepte tout le monde. " C’est ce que diront quatre ou cinq hommes M. de Broglie à la tête ; et voilà tout, et M de Broglie a de la passion contre M. Molé." Mad. de Boigne ne vous acorde de motifs de revenir que si M. Duchatel n’était pas du Ministère. Je crois que je vous ai raconté toute ma visite. Je vous raconterai tout. et je me garderai bien de vous rien dire pour mon compte. Vous n’avez pas besoin de mon opinion d’ailleurs. L’affaire n’est pas faite.
Je passe à autre chose. Voici ce que m’écrit Lady Palmerston en date d’avant-hier . " Je crois vraiment que M. Guizot se plait ici, tout est nouveau pour lui et il regarde à la scène en philosophe. Ce qui est sûr c’est que lui plaît beaucoup. On trouve ses manières très agréables et douces et sa conversation intéressante et instructive. Lord Palmerston l’aime beaucoup, et croit qu’ils feront très bon ménage ensemble. Ses manières tiennent beaucoup plus de l’ancien régime que du nouveau, ce qui est un grand mérite à mes yeux. "
Lundi 11 heures
Je suis arrivée hier chez le Duc de Noailles une heure plus tard qu’il ne fallait. J’ai donc trouvé la compagnie de bien mauvaise humeur. J’avais eu chez moi dabord. le prince Paul et celui-là est vraiment amusant dans ce moment la plus violente fureur, les invectives, les épithètes. C’est M. Molé surtout qui est sa bête noire. Il prétendait savoir que M. Passi ne se joignait pas à lui. Au bout de la crise s’il y a crise. Il croit à un grand ébranlement pour tout ceci, et il ne manquera pas de la prêcher à M. Thiers, selon son dire, s’il tombait, la guerre au roi serait à mort. Après lui, Lord Granville que j’avais vu cependant chez sa femme est venu encore causer. avec moi, on n’apprend jamais de lui grand chose, mais c’est long de causer avec lui. Il m’a retenue pour me dire ses inquiétudes, presque sa certitude. que le ministère tombera. L’attitude, la Chambre, les journaux. l’alliance Soult et Molé, tout l’indigne. A 6 1/2 j’ai commencé ma toilette et je suis arrivée à 7 1/4 au milieu du noble faubourg un peu fâchée. Cela n’empêche pas que l’hôte n’a fait que causer et d’une seule chose avec moi pendant le dîner. Il avait vu M. Molé la veille. Il a cherché à le detourner de porter le coup si tot, vu que cela rendrait Thiers trop redoutable. M. Molé réplique toujours "cela est possible ; mais si on ne le tue pas de suite il est sûr qu’on ne les tuera plus, et voilà pourquoi il faut se presser. " Il a conté à M. de Noailles l’affaire Bugeaud telle que la dit le Journal des Débats, et que cela a fait un effet prodigieux sur la droite Les légitimistes se sont réunis hier matin chez le Duc de Noailles. Il est possible encore qu’ils votent pour Thiers Berryer parlera, ce sera assez curieux de voir comme il s’en tirera. Au reste on ne prendra de parti positif que selon la discussion. Appony était du diner bien content. Brignole ditto, mais avec plus de réserve les dames du fauboug parlaient de toute autre chose. De là j’ai passé chez la Duchesse de Poix, de la musique chermante M. Molé y était. Nous avons causé. Il est préoccupé et content. Il rit de la résultante. Il dit que Thiers a fait une grande faute en prenant le ministère comme cela. Il compte son monde exactement comme me l’a compté Berryer. Il dit " j’aurais une rude tâche, et les affaires extérieures vont prendre, tout-à-l’heure une grande importante Il y a des partis à prendre. au fond il eut été plus commode de laisser ce premier feu sur le épaules de Thiers, mais il n’y a pas à reculer. " Il a parlé de vous en termes généraux : "jamais on ne me fera croire que M. Guizot puisse, aller à la gauche jamais je ne croirai qu’il a connu ceci au moment de son départ. " C’est le lieu de vous dire qu’on dispute beaucoup sur ce point. Duchatel soutient que vous l’ignoriez, tous les autres affirment le contraire. Il n’y a que Duchâtel qui dise vrai. Il va sans dire que moi je ne m’en mêle point. Je dis seulement que comme vous n’êtes pas olbligé de me tout dire j’ignorais ce que vous saviez ou ne saviez pas.
Voici le 324. Autant de prevenances autant d’.... que moi. Mais merci d’avoir songé au dimanche. Il me semble que ce bon dimanche nous met à la ration de 4 lettres par semaine. Tant mieux. Vous m’apprenez l’affaire de Médem. Il me semble qu’on a pris à Pétersbourg, un très sage parti pour ceci. Envoyer Pahlen et renvoyer Médem, vraiment il est trop cassant ; il a trop de présomption. Pour Londres, je regrette l’atitude que Brünnow a pris vis-à-vis de vous et qu’on le comprends pas trop Le chreptovitz, gendre de Nesselrode, qu’on lui donne n’est rien du tout ; et sa femme est parfaitement ridicule, avec un peu d’esprit, bonne personne au fond quant à Mad. Brünnow, je ne sais ce qu’elle est, si non qu’elle a été belle. Il est clair que lui n’a jamais été beau. Je voudrais bien entendre ce que vous pensez de tout ceci. Quelle bagarre ! Moi, ma crainte c’est la rue. Je crois savoir que M. Sacy, l’un des redacteurs des Débats ne veut pas qu’on renverse Thiers sur les fonds secrets. L’autre rédacteur le veut. M. Molé m’a confirmé l’autre jour ce que me disait Berryer, qu’on proposera un amendement & 100 francs. Adieu. Adieu. N’est-ce pas que je vous dis tout ?
2h1/2 Voici Appony qui sort d’ici. il doute encore de la chute immédiate cependant il est convaincu que le Roi la veut. Il est enchanté d’avoir Molé, mais il ne pense pas que la question orientale y gagne comme solution pacifique, Il sera beaucop plus égyptien que Thiers, dès lors il s’entendra moins avec l’Angleterre.