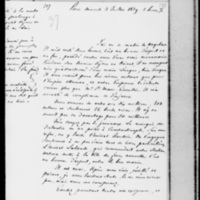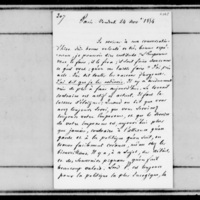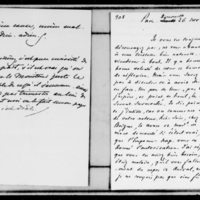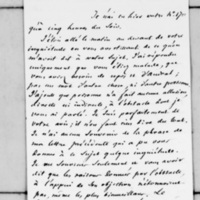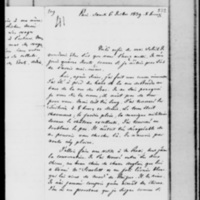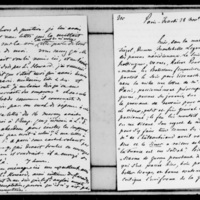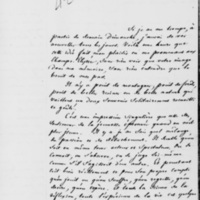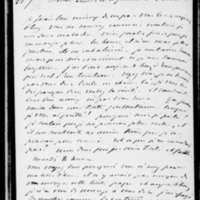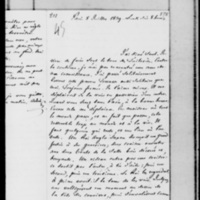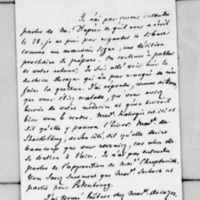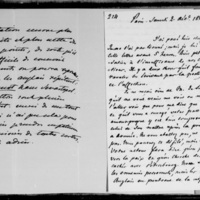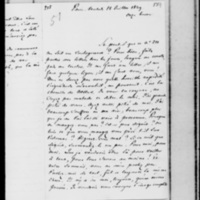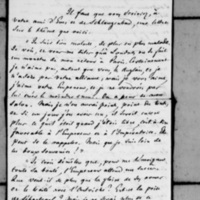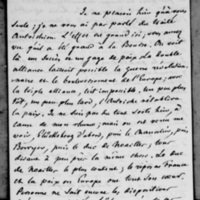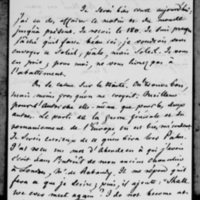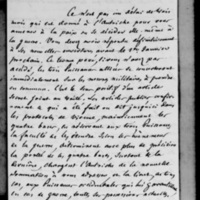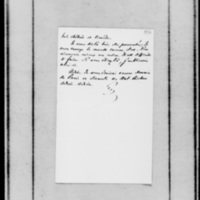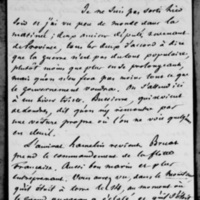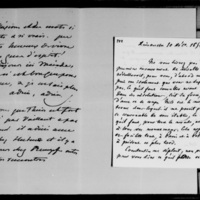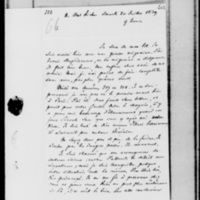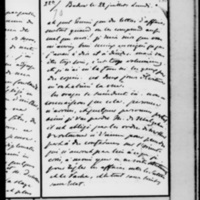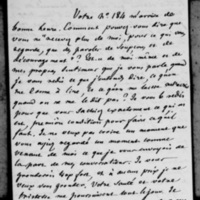Votre recherche dans le corpus : 5770 résultats dans 5770 notices du site.
207. Paris, Mercredi 3 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'ai vu ce matin, M. Urquhart. Il m'est resté deux heures. C’est un homme d’esprit et un fou, possédé contre vous d'une vrai monomanie. Pendant son dernier séjour en Orient, il ne mangeait rien qu'assaisonné d’une main Turque, bien Turque, Il vous craint pour lui-même autant que pour l'Empire Ottoman et votre Empereur le déteste encore plus que M. Marc Girardin. Il m'a accablé de compliments et d'injures. Nous venons de voter nos dix millions. 313 votants et seulement 21 boules noires. Il n’y en aurait pas eu d'avantage pour 10 millions. N'en croyez pas les journaux. Le marquis de Dalmatie ne va point à Constantinople. Sur mon refus, on y laisse l’amiral Roussin. On l’engagera seulement à ne pas écrire tant de lettres particulières. L’Amiral Lalande, qui commandait notre station, restera aussi à la tête des forces nouvelles. C’est un homme d’esprit, outre le bon marin. Il est vrai.
Après mon rêve éveillé et priant, je vous laissais seule. Je ne m'en excuse pas, mais vous me comprenez. Gardez pourtant toutes vos exigences, et repoussez toutes vos défiances. Celles ci n'auront jamais raison et les autres jamais tort. Un moment j’ai espéré suffire à votre âme à votre vie. Je n'y compte guère plus. Mais vous ne désirerez jamais rien de moi que je ne sois prêt à vous donner, et au delà. Adieu jusqu'à demain. Je vais dîner chez Madame Eynard.
Onze heures
Je rentre. Adieu encore avant de me coucher. La Grèce était là, bien contente de moi. Pauvre Grèce ! J’ai soutenu votre ouvrage. Vous auriez souri d'entendre ce matin, M. Urquhart me raconter toutes vos perfidies, quel immense et imperceptible filet vous aviez jeté sur M. Canning pour l'amener à vous, et comment il était déplorable qu’il fût mort, car il commençait à se reconnaître et à se débattre; il vous aurait échappé ; il se serait vengé ; il aurait vengé et sauvé l'Empire Ottoman. Heureusement pour vous, il est mort. Et pour la Grèce aussi, car, selon, M. Urquhart, il l’aurait défaite. Un jour aussi, vous voudrez la défaire, et c’est encore une des terreurs de M. Urquhart. Je l'ai rassuré. Je ne sais ce qui arrivera en Orient. Mais à coup sûr bien des prévisions y seront déjouées, et beaucoup de choses que nous y aurons faites, vous ou nous, pour notre compte et en passant, subsisteront et prendront une place et joueront un rôle que nous ne leur destinions pas.
Jeudi, 8 heures et demie Les amis de Thiers se désespèrent qu’il n'ait pas été ici pour cette discussion. Si vous lisez ses journaux, vous y verrez qu’'ils ont grand peur que l'envie ne me prenne d'être ministre des Affaires Etrangères. Ils m'attaquent à ce titre comme si je l'étais. A propos de Thiers, un homme de ma connaissance qui arrive de Lombardie me contait l'autre jour qu’en se promenant sur le lac de Côme le batelier qui le conduisait lui avait dit en lui montrant une villa : " C’est là que demeurait ce fameux ministre de France, avec Sa femme et sa fille. "
9 h 3/4
Je suis sans cesse interrompu. Je voudrais vous renvoyer tous les doutes, toutes les inquiétudes que suscite mon discours. Suis- je Anglais ? Suis-je Russe ? Pourquoi ai-je dit que l'Angleterre se trompait quelquefois ? Pourquoi ai-je fait tant de compliments à l'Empereur ? J'admire les badauds et les malices qu’ils voient partout.
Vous avez bien raison sur Lady Jersey. Mais ce n’est pas la persévérance de sa volonté qui fait faire ici attention à elle. Elle a été à la mode à Londres, et la mode de Londres se prolonge à Paris. Elle est partie contente de son petit séjour et un peu malade ; chargée d’emplettes. Je ne sais combien de caisses elle a emportées. Soyez tranquille sur Paris. Je n'aurai pas à faire le curieux. Le procès devient tous les jours plus petit et les précautions plus grandes. Je ne cours pas le moindre risque et la terrasse encore un peu moins que moi. Adieu. Adieu.
Nous avons froid comme, vous ; mais je fais du feu. Adieu. Pas froid. G. Ce pauvre Montrond m'écrit qu'il est malade retenu dans son lit à Versailles, par un érésipèle à la tête et des remèdes assez violents. Il me dit qu’il en a encore pour quelques jours. Si ça va bien.
207. Paris, Vendredi 24 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens à ma conversation d’hier. Très bonne volonté et très bonne espérance, je pourrais dire certitude. "L'Empereur veut le faire ; il le fera ; il sait faire doucement ce qu’il veut qu’on me laisse faire. " J’ai pris acte. J’ai dit toutes les raisons d’urgence. J’ai dit que je les redirais. Il n’y a évidemment rien de plus à faire aujourd’hui. Le travail contraire est actif et actuel. Il faut le laisser s'éloigner. Quand on dit que vous avez toujours servi, que vous servirez toujours votre Empereur, et que le service de votre Empereur est aujourd’hui plus que jamais, contraire à l'Alliance qu’on garde et à la politique qu’on suit, on trouve facilement créance, même chez les bienveillants. Il y a à ce sujet, des détails et des souvenirs piquants, qu’on fait beaucoup valoir. Lord P. est toujours pour la politique la plus énergique, la plus soutenue la plus étendue. On se prépare à reprendre en Crimée l'offensive, et à porter la guerre au delà des murs de Sébastopol. Les derniers rapports disent que vos troupes ne font point de quartier, qu'elles égorgent les blessés l’histoire du major Russe qui a, dit-on, fait massacrer le colonel Camas tombé sur le champ de bataille, et qui a ensuite été lui-même pris et pendu, fait beaucoup d'effet. La guerre, qui avait commencé courtoisement et chrétiennement, prend un caractère violent et féroce. On s'en irrite de plus en plus. Certainement l'aspect général est sombre.
J’ai vu hier M. de Sacy, l'Académie, Mad. Lenormant, M. Bocher, et le soir le Duc de Broglie qui m'est fidèle tous les jours. Il part demain pour Broglie d’où il reviendra après Noël. Il avait été le matin à Etioles. Cette pauvre famille est comme elle peut être Mad. de Ste Aulaire courageuse et vivante ; M. de Langsdorff, très abattu, le plus malheureux. Après le jour de l’an ils viendront tous s'enfermer dans leur maison de Paris. Peu de monde à l'Académie. Le Duc de Noailles est revenu de Maintenon ; mais il n’y était pas. Le Duc de Mouchy est mourant.
10 heures
La poste ni les journaux ne m’apportent rien. Le Times n’a pas été distribué hier ici. On dit qu’il contenait un article vif sur le Prince Napoléon et sa santé.
2 h.
Le N°168 m’arrive. C'est charmant en effet d'être un peu plus près. Mais c’est toujours bien loin.
Je viens de voir Dumon Calmon, Plichon, M. de Bonnechose &. Personne ne sait rien de plus. Dumon parle seulement de l’inquiétude. des gens d'affaires qui commence à devenir sérieuse. Bineau veut bien aller en Italie pour se soigner ; mais il veut rester ministre et demande un intérimaire. On lui en a proposé un dont il n’a pas voulu (M. de Vitry), parce que c’est un ami de Fould. On lui a dit alors qu’on la remplacerait définitivement. Ce n’est pas encore fait. Baroche veut bien de l’interim des finances, mais à condition qu'au sortir de là, on lui donnera le ministère de l'intérieur où Billaut ne réussit pas. Voilà les commérages ministériels. Adieu, Adieu. G.
208. Bade, Vendredi 5 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je cherche ce que j’ai à vous conter. Il a gelé cette nuit positivement gelé. Ce matin il y a un beau magnifique soleil du mois de janvier voilà le beau pays que je suis venu chercher ! Personne ne se baigne, personne ne boit, tout est suspendu. J’ai mal dormi, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Cela fait une intéressante 2 lettre n'est-ce pas ? Que je voudrais voir ces deux mois écoulés, car enfin je me crois obligée de rester puisque j’ai dit que je resterai, et je suis cependant que ceci ne convient pas à ma santé. Les bains de mer me feraient du bien, ils m’en ont toujours fait, mais où les chercher ? Ah s je n’étais pas seule, tout serait facile. Mais seule, seule, voilà ma vraie maladie. J’attends avec impatience votre discours. Je n’ai pas lu encore la séance de lundi.
1 heures
Je viens de lire. M. de la Lamartine a dû être très brillant. M. Villemain a eu un grand mérite à savoir si bien lui répondra. Je suis curieuse de la suite du Débat. Il n’en ressortira cependant rien de pratique. Cela est évident. C'est une question sur laquelle on peut parler, mais on ne peut pas faire. Personne ne veut faire. le médecin n’est pas content de moi, et je le suis très peu de lui. Il va changer les bains. Demain on y mettra du houblon au lieu d’aromates et toujours du sel. Tout cela sont des bêtises, rien ne me fera du bien. Dites-moi si je dois continuer à faire la volonté du médecin. J'ai bien envie de ne plus rien faire. Mon pouls est fort affaibli. Vous voulez la vérité et je vous la dis. Mad. de Talleyrand me conseille de partir. Elle a bien raison. Ma vue seule est de l'ennui pour tout le monde.
5 heures
Voici le N°206. C'est le premier c’est le seul bon moment de ma triste journée. Je vous remercie de me le donner. Je serai bien avide de lire votre discours demain matin ; ce n’est que le matin qu'on me l'apporte. Adieu. Adieu mille tendres adieux.
208. Paris, Dimanche 26 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous en conjure ne vous découragez pas ne vous abandonnez pas à une tristesse bien naturelle. Nous en viendrons à bout. Il y a bonne volonté. Bonne volonté de cœur et bonne volonté de réflexion. Mais vous savez qu’on n'aime pas à discuter et à avoir des embarras en face. Un peu de temps, pas beaucoup j'espère, et point de bruit ; les obstacles seront surmontés. Je dis point de bruit et j'insiste, car on commence à parler de votre retour. Hier soir, chez Mad. de Boigne, le nonce et Mad. de Boigne. m'ont demandé si c'était vrai ajoutant que l'Empereur Napoléon vous en avait donné l'autorisation. J’ai répondu que vous en aviez bien besoin, que vous étiez malade, qu’il vous fallait absolu ment du repos et Andral, mais que je ne croyais pas que rien fût fait. On trouve très simple que l'Empereur Nap vous autorise, et personne n'en doute. On demande ce qu'en pensera votre Empereur. Mad. de Boigne m’a dit en se penchant vers moi. " Sa position ici sera délicate." à quoi j’ai répondu : " Elle verra certainement très peu de monde si elle revient ; seulement ses amis particuliers. Je ne sais qui a mis ce bruit dans l’air. Je n'ai ouvert la bouche à personne. Est-ce un bien ou un mal ? Je ne vois pas bien. Mais Morny m’a paru désirer qu’on n'en parlât pas. Faites lui savoir qu’on en parle un peu, et que cela ne vient ni de vous, ni de vos amis. Les ennemis parleraient-ils dans l'espoir de nuire, c’est possible.
J’ai trouvé là hier soir le Chancelier. Le nonce, le général de la Rue, les Salvo, Boislecomte & &. On ne savait rien, sinon le départ de renforts vraiment considérables. Les deux divisions Dulac et de Salles forment 20 000 hommes. Avant ce gros envois, il est parti 10 ou 12 000 hommes en petits paquets, entre autres 3000 zouaves pris encore en Algérie. On est certainement décidé à prendre Sébastopol et à faire là une campagne d’hiver. Les militaires, en parlant avec une vive admiration de la bravoure indomptable des Anglais, se désolent qu’ils sachent si peu faire la guerre ; il ne se gardent pas ; ils se mettent dans de mauvaise situations ; il faut toujours venir les en tirer." Ce n’est pas le général Canrobert, c'est le général d'Alconville qui disait, à propos de la charge de cavalerie de Lord Cardigan : " C'est magnifique, mais ce n’est pas là la guerre."
Le matin, l'Académie des sciences morales, et politiques, François Delessert et d'Haubersaert. Le premier avait reçu votre chèque et en était très reconnaissant. Il m’a demandé votre adresse pour vous en remercier au nom de la famille et de la commission. On aura à 60 mille francs de souscription d'Haubersaert m’a demandé de le rappeler à votre souvenir. Toujours très sensé et très hardi dans son bon sens. C'est probablement le Duc de Broglie. qui sera nommé à l'Académie Française, en remplacement de Ste Aulaire. Il consent à être porté et il a grande faveur dans l'Académie.
2 heures
Je viens de voir quelques personnes ; mais je n’ai rien appris. On va décidément envoyer 20 000 hommes sur le Danube, pour exciter et soutenir Omer Pacha dans une campagne agressive. On avait dit que Lord Palmerston repartait demain ; mais on assure que la revue de la Garde impériale aura lieu demain et qu’il reste pour y assister. Adieu, adieu. Je n'ai rien de vous ce matin. Adieu. G.
208. Paris, Vendredi 5 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Je me suis levé tard ce matin. Je dormais. Je dors assez mal, je ne sais pourquoi, car je me porte bien. Je pense beaucoup la nuit et le jour. J’ai rarement vécu aussi seul. Le monde que je vois ne rompt pas ma solitude. Le Duc de Broglie est tenu toute la journée à la Chambre des Pairs. Nous ne voyons guère qu'en dînant ensemble. Plus je suis seul, plus je vis avec vous seule. Mais je passe décidément à la présence réelle. Il n’y a que cela de vrai. Le procès ennuie tout le monde, juges et accusés. Les Pairs déclarent qu’ils n'en veulent plus de semblable. Les accusés sauf un seul ont l’attitude de gens qui ne recommenceront pas. C'est l’impression générale. Les avocats eux-mêmes sont polis. Cela finira dans huit jours. Il en reste encore près de 200 en prison. On en mettra quelques uns en liberté. Les autres attendront jusqu'au mois de novembre, au plus tard encore, pour être jugés, je ne sais pas bien par qui. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde que cette échauffourée-ci soit la dernière ; mais certainement c'est une folie, en déclin. Le Chancelier aussi est en grand Déclin out le monde en est frappé. Je n’ai pas encore été dîner à Châtenay. Cela ne me plaît pas.
Madame de Boigne va mieux. Je suis très ennuyé que vos Affaires de Pétersbourg ne marchent pas plus vite, et bien aise que votre fils Paul soit si réservé. Donc il croit sa cause mauvaise. Dans cet état des choses, il me paraît impossible que les lettres de Madame de Nesselrode. Ne vous fassent pas faire un pas. Mais il y a bien des pas à faire avant que vous soyez au terme. Vous avez beaucoup d'expérience des personnes, aucune des choses. Elles sont toutes lentes, difficiles, embrouillées. Elles ne vont que lorsqu'une volonté, active et obstinée s'en mêle. Et cette volonté pour vous. Je ne la vois pas à Pétersbourg. Il y a des Abymes de la bienveillance à la volonté. Je suis donc tourmenté, et pourtant je voudrais que vous le fussiez un peu moins. Je vous voudrais moins confiante et moins impatiente. Si vous vous laissiez complètement gouverner par moi, que vous vous en trouveriez bien !
Mon discours devient très populaire. Tout le monde s’y range. Mais tout le monde est persuadé que je veux être Ministre des Affaires étrangères, et que je n’ai parlé que pour cela. J’admire tout ce qu’on suppose et tout ce qu’on ignore en fait d’intentions. J'ai dîné hier chez le Ministre de l’instruction publique avec trente personnes que vous ne connaissez pas et M. d’Arnim qui m’a demandé de vos nouvelles. De là chez le Ministre de l’Intérieur. Peu de monde partout. Je n’ai trouvé à causer chez M. Duchâtel, qu'avec un officier de marine, homme d’esprit, autrefois aide de camp de l'amiral Rigny, le capitaine Leray. Je l’ai emmené dans un coin, et j'en ai extrait tout ce qu’il a vu de l'Orient. Nous croyons de plus en plus à la sagesse du Pacha. Mais si le Sultan lui déclare une guerre à mort, l’embarras peut commencer.
La Chambre a abrégé hier la session de huit jours. Elle a décidé qu’elle ne s’occuperait pas cette année de la loi des sucres. Votre protégé M. Dufaure, n'a pas de succès dans la discussion des chemins de fer. Plusieurs de ses projets seront rejetés et il ne les défend pas bien. Vous savez surement que Lady Granville ne va pas à Kitzingen. Elle parlait de Dieppe, du Havre. Je crois qu'elle n'ira nulle part, & que Constantinople les retiendra à Paris. Nous sommes très contents de l'Angleterre, et elle de nous. Je suis charmé que Bulwer revienne à Paris. Il a vraiment de l’esprit. On dit qu'il en a eu trop quelquefois jusqu'à la fièvre. Est-ce vrai ? Adieu. Je vais à la Chambre. Que m'importe à présent que La Terrasse soit sur mon chemin ? G.
209. Bade, Samedi 6 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai lu et relu votre discours. Relu surtout le passage sur l’Empereur dans l’intention de bien me rendre compte de l’effet qu'il peut produire chez nous. Le personnage principal ne peut pas en méconnaître la vérité, mais elle ne lui plaira pas. Ceux qui après lui comprennent seront contents. Moi je suis très contente de tout votre discours et soyez sûr que je suis difficile. J’ai voulu commencer ma lettre par vous dire cela.
J'ai mal dormi, mes forces m’ont manqué pour la promenade du matin, j’ai pris mon bain de houblon quelle idée ! J’ai dormi depuis il me semble que je suis un peu mieux que ce matin. Vous voyez que je vous dis minutieusement tout. Le temps redevient beau mais je crains que cela ne dure pas.
5 heures
Votre lettre m’attriste, j'y répondrai demain. Je vaux mieux que je ne parais. Je vous aime plus, mille fois plus que vous le pensez. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon cœur ! Mais on ne voit jamais la dedans. Ah mon Dieu que vous aimeriez y regarder. A présent dans ce moment. Et ce moment, et sera toujours. Adieu. Je ne me sens pas bien, je ne puis pas continuer. Adieu.
209. Paris, Lundi 27 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
209. Paris, Samedi 6 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà enfin du vrai soleil. Je voudrais être sûr que vous l’avez aussi. Je n'en joui qu'avec doute comme si je n'étais pas sûr de l'avoir moi-même.
Hier après dîner, j’ai fait une course immense. J’ai été à pied du haut de la rue de Breda au bout de la rue du Bac. Je ne sais pourquoi je vous dis les noms ; ils n'ont pas de sens pour vous. Mais c’est très long. J’ai traversé les Tuileries à 8 heures et demie. Le temps était charmant; le jardin plein, la musique militaire devant le chateau excellente. J’ai traversé en doublant le pas. Il m’était très désagréable de ne pouvoir vous chercher là. Je n’aurais pas voulu m’y plaire.
J’allais faire une visite à M. Rossi dont j'aime la conversation. Je l’ai trouvé entre ses deux chiens, un beau chien de chasse anglais que lui a donné M. Scarlett et un joli lévrier blanc qui lui vient de Mad. de Boigne. Il les aime. Je n’ai jamais compris qu'on aimât des chiens. J'en ai un pourtant que je soigne comme si je l’aimais. Mon fils me l'a laissé.
10 heures
Je viens de voir le Duc de Broglie, très frappé du discours du Procureur Général, hier à la cour des Pairs, M. Frank Carré. Il a parlé deux heures avec un grand talent et un grand effet en grand magistrat, refusant, enlevant aux accusés toute grandeur de parti ou de passion politique, et au nom du plus simple bon sens de la plus vulgaire morale les réduisant à n'être que des bandits ou des fous de bas étage. Ils en ont été eux-mêmes troublés consternés, atterés. Prévenus et avocats écoutaient silencieusement, les yeux baissés, l’air humilié et contrit. C'était une scène très imposante. Si l'on eût été aux voix sur le champ, les conclusiens du Procureur général auraient été adoptées à l’umanimité. On dit que son discours sera inséré, par ordre et aux termes des lois de septembre, dans tous les journaux sans exception, y compris les journaux républicains afin qu’il arrive à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Les avocats commencent aujourd’hui et finiront Lundi. L’arrêt sera rendu probablement Jeudi prochain. On croit à deux condamnations à mort, et à plusieurs condamnations aux travaux forcés. L’idée qui paraît dominante, c'est de les traiter comme des accusés ordinaires, abstraction faite de toute considération politique, et de leur appliquer purement et simplement le code pénal. Un peu d’agitation recommence. Il y a eu hier, rue St Denis une légère ombre de rassemblement. Je vous le dis pour que vous sachiez tout, et parce que vous êtes encore plus curieuse que craintive. Mais ce n'est, et ne sera rien. Ils sont matériellement impuissants, et moralement très intimidés quoique furieux.
Midi
J’ai un mouvement d’impatience de revenir à vous deux ou trois fois par jour sans jamais vous voir en effet, et par pure fiction. Les fictions s’usent vite. Je vous reviens pourtant. J'ai là, dans la pièce à côté un peintre qui copie, mon portrait pour je ne sais quelle collection. C’est la quatrième ou cinquieme fois depuis deux ans. Je méprise beaucoup les petits plaisirs d'amour-propre, et pourtant je les sens. Bien passagèrement, il est vrai ; mais enfin, je les sens et si je ne les sentais pas, je ne vous dirais pas ce que je vous dis là. Je ne le dis qu'à vous. Ne le redites à personne. Au fait, j'ai droit qu’on ignore que ces plaisirs là me touchent. un peu, car je les méprise infiniment. Adieu.
Je vous quitte pour écrire à ma mère. Tout le monde va bien au Val-Richer. Mais on s’y ennuie un peu sans moi. Les orages ont fait beaucoup de mal tout à l'entour. Vous ne savez pas ce que c’est que le mal des orages Vous ne savez rien. Vous avez vécu dans votre Ambassade comme un moine dans sa cellule, étrangère à tout excepté au sort des Etats. Adieu Adieu.
210. Baden, Dimanche 7 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il faut convenir que vous prenez bien mal votre temps pour douter de mon cœur, pour douter que mon cœur ma vie sont à vous, pour croire que vous ne suffisez pas à mon âme. Et mon Dieu qu’est ce qui occupe mon âme ? Où trouve-t-elle du repos, de la douceur, si ce n’est en vous. Je suis bien accablée de mes malheurs passés, de mes peines présentes, je le suis plus ici que lorsque j’étais auprès de vous, et cependant avec quel bonheur je pense à vous, comme je retrouve de la joie de la sérénité dans le fond de mon âme en arrangeant le reste de ma vie pour vous, avec vous ! Vous êtes bien le reste de ma vie. Si je ne vous avais pas, je n’aurais plus rien. Dites-vous cela, dites-vous que je le pense sans cesse, sans cesse, et voyez si je ne vous aime pas plus que vous ne pouvez m'aimer ? Car vous, vous avez du bonheur sans moi. Et moi je n’ai plus rien sans vous.
Dites-moi si je dois me baigner ; si je dois rester à Baden. J'ai besoin qu'on me dirige. Je ne sais pas me décider. Je suis certainement plus malade qu’en arrivant, faut-il que j’attribue cela au temps ou aux remèdes. Jamais je n’ai été accoutumée aux bains, ils m'ont toujours affaiblie. Il n’y a que les bains de mer qui me conviennent. Dois-je faire à ma fantaisie c.a.d. ne plus rien faire. J'ai si besoin de vos conseils. Et après tout, ce que je fais ou ne fais pas, c'est pour vous. Il m'importe peu d’engraisser, de maigrir. Mais vous voulez me revoir autre que vous ne m'avez quittée, et je n'oserais pas revenir à Paris si je n’ai fait votre volonté.
J’ai été interrompue par Mad. de Nesselrode. Elle vient quelque fois causer de mes affaires. C’est de la bonté, mais il n'y a rien à dire il faut attendre. Paul va se trouver dans un grand embarras. On ne doute pas là-bas qu’il ne fasse un arrangement convenable, car le droit serait trop peu, et jamais on ne s’en est tenu au droit. Lorsqu'il s’est agi d'une mère. Voilà ce que Mad. de Nesselrode crie sur les toits en vantant à cet égard la supériorité des Russes sur tous les autres. Si elle a raison, encore une fois, le dilemme sera grand pour Paul. Que fera-t-il ? Et moi dites-moi ce que je ferai ? Puis-je accepter son au delà du droit après ce qui s’est passé ! Mon instinct me dit que non. Aidez-moi. Je vois votre réponse ; " Votre fils ne vous mettra pas dans cet embarras." Cependant répondez comme s'il m'y plaçait. Si je mettais mon acceptation au prix d’un retour de sa part, il n’aurait garde de revenir à moi. Répondez, répondez.
11 heures
Je pense beaucoup à votre discours c'est au fond le vrai discours politique dans cette discussion. Il est fort remarqué. Et en général on pense que l’Empereur doit être content de ce que vous avez dit de lui. Je le pense aussi sauf un point, le véritable, et que vous avez traité avec une grande habilité, ne lui imposant des devoirs qui pourraient ne pas rencontrer ses intérêts. Somme toute vous avez fait un beau discours et qui sera fort remarqué chez nous. On me dit que le mariage Dormstadt n'aura pas lieu. On ignorait la naissance lorsqu'on s'est embarqué si étourdiment dans cette affaire. C’est une grande étourderie d’Orloff. Mon mari en eut été incapable. Il est vrai que la bâtardise ne pouvait pas être un grand pêché aux yeux d’Orloff. A Berlin on s’est fort ému de ce choix et on a éclaté. Je ne sais au reste ceci que par des voies détournées. Voici votre lettre, je n'ai plus que le temps de vous le dire, et de vous dire adieu, et bien des adieux.
210. Paris, Mardi 28 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier, dans la matiné, le Gal Trezel, Dumon, Montebello Legouvé Liadières, des parents méridionaux. Le soir, Delessert, Hottinguen, Vernes, Robert Pourtale, Oppermann les Protestants financiers. Trezel partait le soir pour Eisenach. Il avait reçu la veille une lettre de M. le comte de Paris, passionnément préoccupé de la guerre, passant ses journées sur des cartes & le pressant de revenir pour en causer. Le vieux, petit et fier général est tout aussi passionné ; le feu lui montait au visage en me disant son regret de n'être pas là pour s’y faire tuer comme ses camarades. M. de Châteaubriand avait raison de le dire et le Times a raison de le répéter : " la France est un soldat. Point d'enthousiasme de guerre pourtant à la revue qui s'est passée hier, bien passé d'ailleurs ; belles troupes et bonne contenance. On critique l’uniforme de la garde impériale, surtout des cent gardes. On dit qu’il y a trop de rose. Mes rapporteurs n'ont pas vu Lord Palmerston. On dit qu’il est parti dimanche, comme on l’avait annoncé. Je le saurai positivement ce matin.
Montebello revenait de Cherbourg où il était allé chercher son fils. Il le garde ici quelques semaines ; après quoi, ce jeune homme s’embarque sur la Virginie, avec l’amiral Guérin qui va prendre le commandement de la station de Chine. On peut se faire tuer là comme ailleurs témoin l'absurde débarquement tente au Kamchatka. L’amiral Price s'est brûlé la cervelle de chagrin de ne pas mieux réussir. Notre amiral à nous, Ferrier. Despointes, n'était point d’avis du débarquement ; mais il n’a pas su se refuser aux bravades du commodore anglais qui succédait à Price. Il a eu tort. Montebello est fort aise, après tout, que son fils aille là le danger est moindre qu’en Crimée, moins quotidien. Il ne reverra pas son fils de trois ans. Nous avons parlé de vous c’est-à-dire de votre santé et de votre tristesse. Il a vraiment de l’amitié pour vous, quoiqu’il ne soit pas allé vous voir. Il dit toujours qu’il ira.
L'Empereur est allé voir sa belle-sœur, la Duchesse d'Albe qui est malade. Elle a voulu lui parler des affaires d’Espagne dont elle est fort inquiète. Il lui a refusé la conversation ne me parlez pas de cela ; je ne veux pas entendre parler d'autre chose. que de la seule chose à laquelle je pense, les affaires d'Orient. La nomination projetée d’Espartero à la Présidence des Cortés constituantes est une manœuvre des démocrates pour le séparer de la Reine et le poser en face du trône, sur le fauteuil de la souveraineté nationale. Vieille pratique révolutionnaire. La Reine sera personnelle ment attaquée, dans sa vie, ses favoris comment sera-t-elle défendue ?
Plus j’y pense, plus l'accord rétabli en Allemagne me paraît une grosse affaire. Je ne puis pas ne pas croire que, si on sait en tirer parti, le rétablissement de la paix peut en sortir. L'Allemagne unie sur le terrain des quatre conditions que la France et l'Angleterre ont demandées, et la Russie les acceptant ; si la paix ne sort pas de là, c’est que décidément, il n’y a plus en Europe que des fous et des sots.
2 heures
Point de lettre de vous. J'espère qu'elle viendra ce soir. Je vois que les Palin ne sont point partis. Adieu, Adieu. G.
210. Paris, Samedi 6 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si je ne me trompe, à partir de demain Dimanche, j’aurai de vos nouvelles tous les jours. Voilà une heure que cette idée fait mon plaisir en me promenant aux Champs-Elysées, sans rien voir que votre image dans ma mémoire, sans rien entendre que le bruit de mes pas. Il n’y a point de montagnes, point de forêts, point de belles ruines ou de belle nature qui vaillent un doux souvenir solitairement recueilli et goûté. C'est une impression singulière que celle des sentiments de la jeunesse éprouvée quand on n’est plur jeune. Il y a je ne sais quel mélange de passion et de détachement. Il semble qu’on soit en même temps acteur et spectateur. On se connait on s'observe, on se juge soi-même comme s’il s’agissait d'un autre. Et pourtant c’est bien réellement et pour son propre compte qu'on jouit ou qu’on souffre, qu’on regrette, qu’on désire, qu'on espère. Et toute la science de la réflexion, toute l'expérience de la vie, est quelque chose de bien superficiel et de bien peu puissant à côté d’une émotion vraie qui remplit le cœur et ne s’inquiète de rien.
Dimanche 8 heures
M. de Bacourt vient quelque fois vous voir à Baden, n'est-ce pas ? Seriez-vous assez bonne pour lui demander ce que c’est qu’un M. Buss membre de la seconde Chambre des Etats de Bade, qui vient de m'écrire en m'envoyant un livre de politique ? Je voudrais savoir ce que c’est avant de lui répondre. Je passerai probablement aujourd’hui toute ma matinée chez moi. Mes visites reçues, je mettrai en ordre mes papiers et ma correspondance. Je suis prodigieusement en arrière. J’aime assez à rester tout un jour sans sortir. J’irai dîner chez Madame d’Haussonville. Point de nouvelles.
En nommant M. de Rumigny à Madrid le Roi lui a dit de bien prendre garde, que s’il prenait la moindre initiative, s’il s’écartait en rien de la ligne, de conduite de son prédécesseur, il aurait affaire à lui. Rumigny appartient tout à fait air Roi. Mais le Roi se souvient qu’en suisse il était assez bien avec les radicaux. Du reste je ne sais ce qui arrive en Espagne. Personne ici n’y pense plus guère. Qu'on en fasse autant ailleurs. Je suppose que Zéa est encore à Londres. Je ne l’ai pas revu.
Onze heures
Zéa sort de chez moi, arrivé de Londres avant hier, hier soir à Neuilly, ce matin ici. Content de son voyage, des dispositions de Lord Palmerston avec qui il a fait sa paix ; encore plus de celles de Lord Melbourne ; encore plus du Duc de Wellington, et de Lord Aberdeen. Il a trouvé le Duc de Wellington, très, très changé physiquement, & moralement plus actif que jamais. L'envoi d'Aston à Madrid lui convient fort ; le départ de Lord Clarendon au moins autant. Il va passer quinze jours ici, puis il ira vous retrouver à Baden. C’est vraiment un loyal homme, et la vivacité de ses émotions me touche. On lui promet d’Espagne que la dissolution des Cortes, qu'il ne voulait pas, donnera une assemblée encore plus modérée. Je ne sais si on l’appelle optimiste ; mais à coup sûr il est bien plus sanguine in his hope que moi.
Voilà votre N°207. Ainsi, à partir de demain nous nous parlerons tous les jours. Je suis charmé que vous ayez retrouvé du sommeil. C’est bien quelque chose, en attendant les bras. C’est la préface des bras. Ne vous découragez pas; ne jetez pas votre médecin par la fenêtre. Adieu. Adieu
211. Baden, Lundi 8 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ferais bien mieux de ne pas vous écrire aujourd'hui. Vous ne sauriez concevoir combien je me sens malade. Voici quatre jours que je ne mange plus. Les bains il n'en sera plus question, ils m'ont abîmé. Je me traîne encore mais je ne sais vraiment si je me traînerai longtemps. J’ai l’air aujourd’hui d’une personne qui sort d’un tombeau. Voyez vous je ne devrais pas vous dire toutes ces choses là, je vous les dis parce que vous voulez la vérité. Il vaudrait donc bien mieux ne pas vous écrire. Que j'avais raison dans un triste pressentiment lorsque je vous ai quitté ! Pourquoi suis-je partie ? Je sentais que je ne pouvais plus rester, et il me semblait en même temps que je ne pouvais plus revenir. Est-ce que je ne reviendrai pas ? Mon dieu que je suis triste et faible.
Mardi 8 heures
Vous voyez bien pourquoi vous n'avez pas eu ma lettre d’hier. Il n’y avait pas moyen de vous envoyer cette triste page. Et aujourd’hui je n'ai rien de mieux à vous dire. J’ai essayé de marcher comme de coutume, mais mes jambes se refusent . Si je pouvais manger je me soutiendrais, mais je ne puis rien prendre. J'ai du dégoût pour tout. votre lettre à fait l’événement et le plaisir de mes journées. J’ai mené Madame de la Redorte en calèche le soir ; je ne suis pas difficile, il me faut quelqu'un. La pluie nous a surpris. J’ai passé un moment chez Mad. de Nesselrode ; nous avons causé jusqu'à neuf heures. C’est l'heure où je vais me coucher. Je mène une bien triste vie. Je maigris de cela autant que du bains.
Vous ne me dites pas si vous avez vu Pozzo. Comment le trouvez-vous ? Malgré ce que je vous ai mandé l’aube jour et qui est vrai, je vois que le mariage à Darstadt se fera. Le grand duc est épris et a pleuré en se séparant de la petite princesse. Cela suffit, l’Empereur fera sur cela la volonté de son fils. Il sera absolu dans tout le reste mais dès qu'il s’agit d'inclination, de bonheur de ménage, il fléchit.
Adieu, quelle lettre ! Comment vous envoyer cela ? Ah que je voudrais vous en écrire de meilleures, me sentir un peu de force, un peu de courage, mais tout me manque. Ne m’abandonnez pas. Adieu. Adieu.
211. Paris, Lundi 8 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai pu lire ceci sans sourire. Je ne savais pas que vous attendiez mes lettres comme moi j’attends les vôtres. Si j’allais vous ennuyer : " Vous êtes, dirai-je incorrigible, ou incurable ? Ce n'est pas parce que vos lettres m'amusent que je les attends impatiemment ; quand elles m’attristent, je les attends plus impatiemment encore. Je vous aime. Voilà ma raison, qui dispense de toutes les autres. Il y a dans l’évangile une admirable parole : " Cherchez premièrement la sagesse ; tout le reste vous sera donné par dessous. " La tendresse a le même privilège que la sagesse ; là où elle est tout le reste vient par dessus.
Vous avez bien fait de mettre le comte Frédéric Pahlen et Matonchewitz un peu en garde. Je ne doute guère des retards factices, par humeur et vengeance. Mais puisqu'il se sent obligé à la réserve, cela ne peut aller très loin, pourvu que, de leur côté, vos fondés de pouvoir pressent au lieu de tolérer la langueur. C’est donc sur eux qu’il faut agir. M. Sampayo, qui arrive de Lisbonne dit sur l’Espagne des choses curieuses. L’anarchie y est plus grande, et le gouvernement plus impuissant que jamais. Mais à travers l’anarchie, l'activité est grande aussi dans le pays et la prospérité croissante. Il y a beaucoup plus de terres cultivées, de maisons neuves. Le commerce se répand ; des établissements de tout genre se forment ; le luxe augmente. Bref, c’est un pays qui se développe du lieu de se détruire. Et l’idée que Don Carlos ne peut rien, que le gouvernement de la Reine, bon ou mauvais, est, après tout, celui qui subsistera, cette idée devient générale. M. Sampayo ajoute que les partisans de la non-intervention ont eu raison, qu'évidemment on aurait eu tort d'intervenir, et que l’Espagne s'en tirera dans cela. Voilà qui fera bien plaisir à Zéa. M. Sampayo n’est pas content de sa campagne contre le duc de Palmella. Il s’en venge en retenant, je ne sais sous quel prétexte légal, la plus grande partie de la fortune jusqu’à ce que la marquise de Fayal ait 24 ans. Pure vengeance, car il n'en joint point ; tout s'accumule et il faudra tout rendre. Mais enfin plaisir de vengeance.
Il n'y a personne de votre connaissance à Dieppe. Vous serez partout plus seule qu’à Baden, excepté en Angleterre. Est-ce que ce sommeil que vous avez un peu retrouvé ne vous repose pas ? Comment va l'appétit ? Je fais des questions et je sais les réponses. Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir vous envoyer autre chose que des paroles. Je me suis heurté plus d’une fois en ma vie contre les limites de notre puissance, quel que soit le désir. C’est un sentiment très amer. Adieu Adieu G.
211. Paris, Mercredi 29 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai eu votre grand 172 hier soir. J'en ferai usage aujourd’hui. L'effet ne peut qu'être bon. Il ne faut négliger aucune occasion de presser en montrant que c’est pressant. Mais évidemment il faut que l'obstacle se soit éloigné. Et probablement quelques jours encore après qu’il se sera éloigné, pour que la convenance y soit et pour que l'impression actuelle y soit moins. Je vous dis les choses comme elles sont. Quand elle n’est pas désespérante, la vérité est calmante. Elle n’a rien ici de désespérant, quoiqu’elle soit triste. Le passé a laissé, dans ces esprits-là, des traces bien profondes. Avez-vous jamais inspiré autant de confiance que de méfiance ? Sur la question que vous me faites, j’ai un avis décidé. Si vous avez à écrire en Angleterre ne parlez pas du tout de l'obstacle qui a agi et parlé ici. Ne faites pas de ceci une question personnelle.
Parlez uniquement de votre mauvaise santé qui vous rend Paris nécessaire et de la vie retirée et profondément tranquille que vous y mènerez. Il ne faut que faire valoir votre motif et répondre à l'objection, sans la mettre sur le compte d'aucune personne spécialement. Je suis très frappé du silence qu’elle a gardé sur ce point en vous pas. C'est ce qu’on a fait, depuis l'origine ; répondant.
N'écrivez pas à Londres sans avoir demandé à M. S'il en est d’avis. Il a beaucoup redit : " Qu'on me laisse faire et qu’on s'en rapporte à mon amitié." C'est beaucoup que le gouvernement Anglais accepte votre acceptation des quatre points. Il ne paraît pas qu'ici on soit aussi avancé. On m’a dit hier qu’un projet d'alliance offensive et défensive, rédigé à Vienne et envoyé naguère ici venait d'être écarté comme liant trop absolument les puissances occidentales aux quatre points. Je crains aujourd’hui deux choses, le coup de fouet que donnera probablement le Parlement anglais, et les petites réserves, les petites piques qui se mêleront de l’un et de l'autre côté, à la négociation des quatre points quand on les aura acceptés en principe. Il y a peu d’esprits qui sachent marcher droit, même au but qu’ils veulent. On s'embarrasse en route dans une foule, de questions et d’intérêts secondaires qu’il spécialement. Je suis très frappé du silence faudrait mettre sous ses pieds et on n’arrive pas. C'est ce qu’on a fait, depuis l'origine ; dans cette malheureuse question, et ce qui nous a mené où nous sommes. Je crains qu’on n'en fasse encore autant et qu’on s'en rapporte à mon amitié." On n'est occupé ici que de l'envoi des renforts qu’on augmente tous les jours. Quoique le pays soit sans passion pour la guerre, l’armée ne demande pas mieux, et il y a grand empressement dans tous les régimes auxquels on demande des hommes. Le Roi de Naples prête ses bateaux à vapeur pour les transports.
2 heures
Je ne comprends pas le retard de ma lettre de Mardi. Je vous ai écrit tous les jours, et j’ai mis moi-même mes lettres à la poste, à la rue Tronchet, samedi est le seul jour où je ne vous ai pas écrit, et je l’ai regretté. Si vous n'étiez pas triste et malade, je me fâcherais qu’il puisse vous passer par l’esprit que vous êtes moins pour moi dans un lieu que dans un autre. Adieu, adieu. Je n'aurai le cœur un peu en repos que lorsque je saurai mes lettres arrivées. Qu'on les lise si on veut, mais qu’on ne les retarde pas. Adieu.
Je reviens des obsèques d’une pauvre jeune femme de 29 ans la fille de Mad. de Champloin, nièce de Salvandy, très heureuse et vertueuse. Morte des suites d’une fausse couche. Famille désolée. Adieu. G.
C'est curieux Mad. Chreptovitch, mais tant mieux. Mad. Kalergis y est aussi. Elle était du moins à la réception de l'Evêque d'Orléans.
212. Baden, Mercredi 10 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
La mort de cette pauvre Lady Flora Hastings me parait un bien mauvais événement. Si vous causez avec Pozzo demandez lui ce qu'il pense de l’impression que cela fera sur l'opinion. En général Pozzo doit être curieux à questionner et à entendre. Je regrette de ne pas le voir. Vous me faites plaisir en m’annonçant Zéa. Mais il est bien sourd et je suis bien faible.
J'entends beaucoup dire que Bade est bien mauvais pour les personnes qui souffrent des nerfs, et maintenant je me souviens que je l'ai éprouvé moi-même les deux fois que j’y suis venue. Vous m’avez dit et même écrit je crois, que j'oubliais trop facilement tout ; vous avez raison, non pas pour tout, mais pour la plupart des choses qui me touchent. Je ne profite pas de l’expérience, il faut convenir que l’affaire de Bade est une pauvre bêtise de ma part, maintenant dites-moi où il faut que j’aille ! Et voyez un peu tous les inconvénients matériels et moraux qu'il y a pour moi à un déplacement. Je vous assure que j'en suis toute consternée et surement il faut prendre un parti car tous les jours je suis plus mal, & c’est visible. M. de Bacourt va prendre des renseignements sur M. Buss et vous les aurez dans peu de jours. Tout ce qu’il en sait c’est qu’il est professeur de l’université de Fribourg.
D’après les dernières nouvelles de Vienne, l’état du Sultan est désespéré ; cela va faire une grosse complication. Je vous remercie de vous promener aux Champs Elysées en pensant à moi. Je me trouve un si pitoyable objet que j’ai peine à comprendre qu'on y pense. Mon Dieu que je suis découragée ! Voilà le médecin qui sort de chez moi, et qui me conseille d’aller chercher les bains de mer. Mon pouls l'inquiète et il veut je crois se débarrasser d'un malade compromettant. Mais avec qui aller, où aller ?
5 heures
J’ai vu une lettre de Vienne dans laquelle il est dit que le Cabinet est consterné de la nouvelle de Constantinople. Le Prince de Metternich se flatte d’établir une conférence à Vienne sur les affaires de l’Orient. J"en serais fort étonnée. Voici votre lettre. Que vous êtes bon de m’écrire si assidûment que vous me faites plaisir. Je n'ai plus que ce plaisir. Je n’attends que cela, je n’aime que cela. Adieu dans ce moment je me sens un peu mieux. Vous voyez que j'ai hâte de vous le dire. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
212. Paris, Lundi 8 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'ai dîné seul. Je viens de faire seul le tour des Tuileries. Contre la coutume, je n’ai pas rencontré une âme de ma connaissance. J’ai passé solitairement devant cette pauvre Terrasse aussi solitaire que moi. Toujours fermée. Je l’aime mieux. Il me déplairait de la voir en possession d'un autre. Quand vous serez dans Paris, à la bonne heure. Encore cela me déplaira. Ces maisons où tout le monde passe et ne fait que passer cela ressemble trop au monde et à la vie. Il faut quelqu'un qui reste et un lieu où l'on reste. Un Roi anglo-saxon donnait un grand festin à ses guerriers ; deux croisées ouvertes aux deux bouts de la salle bien décorée et bruyante. Un oiseau entra par une croisée et sortit par l'autre, à tire d'aile ; puis un second, puis un troisième. Le Roi les regardait, à peine avait-il le temps de les voir. Quelques uns voltigèrent un moment au dessus de la tête des convives, puis s’envolèrent comme les autres. Un seul vint se poser sur l’épaule du Roi. Le Roi fit fermer les croisées et le garda. Le lendemain, le Roi aimait l'aisance, et l'oiseau le Roi. On rouvrit les croisées. L'oiseau ne s’en alla point.
J’ai eu ce matin une visite qui ne m'a pas donné la moindre envie de la garder. Un prêtre entre dans mon Cabinet, une figure honnête et animée. Il me raconte qu’il est Espagnol, mais depuis quelque temps employé par M. l'archevêque de Paris. Il avait été placé auprès du curé de S. Nicolas des Champs. Le Curé lui a dit du mal du Roi Louis Philippe et a voulu qu’il prêchât contre les Protestants. Cela l’a choqué. Il me demande de le tirer d'embarras. Puis tout-à-coup il se lève me saisit par les deux bouts du collet de mon habit en me disant : " Je vais vous dire la messe ; il faut que je vous dise la messe. " Prenez garde, lui ai-je dit ; ce serait une profanation ; je suis Protestant." Il a été confondu, a pris son chapeau et s’en est allé. Je crois que j’ai de l’attrait pour les fous. J'ai reçu plusieurs visites pareilles depuis quelques années.
Notre séance a été parfaitement insignifiante : des colères contre le chemin de fer de Paris à Versailles par la rive gauche ; très légitimes. Les Pairs ont fini d’entendre les plaidoiries. Ils entreront demain en délibération pour l’arrêt. Ils avaient eu quelque envie d'entrer en séance à 8 heures du matin et de n’en sortir qu'après avoir fini, tout fini. Mais ce serait trop long ; probablement 10 ou onze heures du soir. Ils y mettront deux jours. Le premier jour, ils voteront sur la culpabilité de tous les accusés ; le second, sur la pénalité.
Mardi 10 h. et demie
Je ne sais pourquoi les bains de Houblon vous choquent. Je les ai vu employer avec succès. Ne vous en découragez pas. Je suis du parti de votre médecin. Je n'ai aucune confiance en vous pour le management de votre santé. Il faut écouter avec grand soin tout ce que vous en dîtes, car vous avez des impressions très vives et probable ment très justes, qui doivent fournir des indications précieuses. Mais il ne faut pas vous croire sur ce qu’il y a à faire ou à ne pas faire, car vous n'en croyez jamais, vous que votre impression du moment, moyen très trompeur de gouvernement. Il faut consulter sans cesse le baromètre pour comprendre le temps qu’il fera. Mais Dieu ne règle pas le temps selon les variations du baromètre.
Deux choses me préoccupent sans cesse, votre santé et votre cœur. Je ne demande pas mieux que de regarder dans celui-ci tout au fond. Mais aussi, je suis difficile très difficile. Je suis charmé que vous approuviez mon discours. Vous avez mille fois raison. On ne peut pas faire sur cette question là. Personne ne veut faire, Tant mieux. Le moment n’est pas venu. Adieu. Adieu. Il faut que je vous quitte. J’ai cinq ou six lettres à écrire ce matin. Adieu. G.
213. Baden, Jeudi 11 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé une bien mauvaise nuit ce qui m’affaiblit encore. Je reprends tout à fait ma nouvelle sur le mariage Darmstadt. Il se fera. Le grand duc est décidément épris. Il reviendra à Darmstatd peut être même avant la fin de l’année. Mon fils aîné sera nommé conseiller d’état, quand on est cela chez nous on ira à tout. Je suis charmée ; cela le figera dans la carrière. Il parait qu’il a du succès à Pétersbourg, & que l’Empereur et tout le reste veulent conserver un Lieven pour de hauts emplois. S'il le veut il ira loin et je crois qu'il voudra.
5 heures
Je me sens bien malade, j’ai de la peine à vous écrire, et puis je m'en vais vous en causer de la peine, vraiment je ne sais que dirait le médecin me prie de quitter Bade au moins pour quelques jours. Je n'y puis pas m’y décider parce que dans cet état de souffrance il est absurde de m’en aller courir seule, toute seule ! Je ne sais où. Ah c'est d’être seule qui est affreux ! Jamais je ne l’ai autant senti qu’à présent. Pardonnez-moi mes lettres, vous voyez que je n’ai pas ma tête à moi. Et si je ne vous écris pas. Vous me croirez morte. Je vous écris donc & je vous dis tout. Je ne mange plus depuis huit jours mes forces diminuent beaucoup. Je dors encore mal, mais je dois. Mon pouls est bien faible, ma mine affreuse, ma maigreur plus grande qu’a Paris ; vous savez tout. Mais vous ne saurez pas me dire ce que je dois faire. Retourner à Paris serait absurde, enfin tout est absurde. Adieu. Adieu. Je n'ai que vos lettres pour me soutenir.
213. Paris, Mardi 9 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens de la Chambre. On a saisi cette nuit la presse clandestine du Moniteur républican, et l’un des principaux auteurs, meneurs. La police est fort active depuis quelque temps, et M. Delessert n’a pas manqué de bonheur. Il a un coup de collier à donner. L’arrêt sera rendu demain. Le parti de loin comme de près. Je remue beaucoup pour sauver Barbès M. Laffitte avait déposé ce matin une proposition contre la peine de mort. On l’a décidé à la retirer, M. Garnier-Pages a fait demander aux archives de la Chambre copie des pétitions présentées en 1830 par les blessés de Juillet pour l'abolition de la peine de mort en matière politique, dans tout cela, rien que du mouvement mais du mouvement. La session va finir. On commence demain la discussion du budget. Elle ne durera pas plus de dix ou douze jours.
Le débat sur l'Orient n'a été bon dans le Cabinet, qu'à M. Villemain. Il disait à un homme de ma connaissance « J’ai sauvé le Ministère. - Sauve qui peut." lui a-t-on répondu. Du reste le Roi est fort tranquille, sur l'Orient. Il est parfaitement d'accord avec Vienne, et d'accord avec Londres. A propos de Vienne, j'ai vu ce matin quelqu'un qui en arrive et qui dit que M. de Metternich est bien fatigué, bien cassé, que sa mémoire faiblit beaucoup sur les choses récentes, qu’il devient dévôt & &. Il est venu de lui, naguères, sur l'Orient une grande dépêche très pompeuse, très métaphysique, parfaitement doctrinaire, mais fort semblable à beaucoup d’autres que j’ai vues autrefois ; ni moins bonne au fond, ni meilleure dans la forme.
Madame de Boigne, vient demain passer la soirée à Paris, et j’irai samedi dîner à Châtenay. Voilà mes nouvelles de ce matin. Si vous en voulez de hors Paris, je vous dirai que le Val-Richer a été grêlé et que mon fermier prétend que sa récolte de blé est perdue. Mercredi, Midi. Je ne sais pourquoi le courrier est arrivé plus tard ce matin. Et comme la séance commence plutôt, je suis pressé. On veut mettre les morceaux en quatre. Notre Chambre finira avec la semaine prochaine.
J’ai dîné hier chez le Garde des sceaux avec tout ce qu’il y a ici d’ambassadeurs, c’est-à-dire tous, sauf le vôtre. Même le Turc, qui a assisté, avec toute son Ambassade, à notre débat sur l'Orient. De choquante pour nous, comme nos paroles l’étaient pour lui. Nous avions l’air de faire une autopsie devant la famille. Un de ses secrétaires n'a pu y tenir et a quitté un jour la séance, très ému et irrité. Lord Granville ne quittera pas Paris, quoique son médécin l’engage à changer d’air, s’il veut n'avoir pas de goutte l’hiver prochain. Le Duc de Devonshire vient d’arriver.
Je ne vous parle que de choses insignifiantes. Il faut que je sorte. Je garde vos affaires, votre santé et nous pour ce soir. J’ai tant à vous dire ! Et je vous dirais si peu ! Adieu. Adieu G.
213. Paris, Vendredi 1er décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
214. Baden, Vendredi 12 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Préoccupez-vous beaucoup de ma santé c’est juste mais ne vous préoccupez plus de mon cœur. C'est une injure. Je vous prie, je vous prie, ne pensez plus à lui que pour votre plaisir, soyez sûr de mon cœur comme du vôtre. Soyez sûr que je vous dis vrai. Ma nuit a été mauvaise. J’ai essayé de dormir un peu ce matin, mais cela n'a point réussi. Tout cela vous prépare à un mot, et pas à une lettre. Le médecin cherche à me donner des forces. Il me fait manger beaucoup de racine de gingembre. Je n’ai rien de plus nouveau à vous dire que cela.
5 heures
Votre lettre d'avant hier m'arrive à l’instant. Merci, merci des nouvelles. J'en suis toujours très avide. J'ai toujours des forces pour cela. J'ai essayé de manger, cela ne va pas, je vais essayer de sortir en calèche, cela va toujours. Adieu. Adieu. mille fois.
Mots-clés : Santé (Dorothée)
214. Paris, Mercredi 10 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Votre santé d'abord. Vous me mettez au supplice en me demandant de la gouverner. Je connais ce mal-là. Je frissonne encore en y pensant. Au bord du précipice dans les ténèbres, pousser ou retenir, on ne sait lequel, ce qu'on aime le mieux au monde ! Si vous étiez là, si j’avais là vos médecins, si je ne vous quittais pas un instant, si je voyais, si j’entendais tout mon anxiété serait affreuse. Et de loin, quand je ne sais rien, rien, quand vous me dîtes hier que vous dormez, aujourd'hui que vous ne dormez pas, tantôt que vous faites de longues promenades, tantôt que vous ne pouvez plus marcher. C'est impossible. Je vois bien que Baden ne vous fait pas le bien que vous en espériez. Ne vous en fait-il aucun ? Vous y êtes bien seule. Ou irez-vous ? à Paris quand je vais le quitter. Aux bains de mer ? Où ? En France, vous y serez plus seule que partout ailleurs. En Angleterre ? Dans cette terre de Lady Cowper dont j'ai oublié le nom, près de Douvres, Broadstairs, n'est-ce pas? Je l’aimerais mieux. Si cela se peut je l'approuverais. Cela se peut-il ? Si le cabinet reste, comme tout l’indique Lady Cowper ne viendra pas sur le continent. Tout à l'heure, je crois, elle vous a de nouveau pressée d’aller la voir.
Jusqu'au moment qui nous réunira à Paris, je ne vois que l'Angleterre qui vous convienne un peu, un peu. Et j'y crains pour vous le manque de repos, les obligations gênantes, le climat triste, les souvenirs. Je ne m’arrêterais pas si je disais tout ce qui me vient à l’esprit sur un tel intérêt, dans un tel doute. Ecoutez ; il y a des choses qu'on peut faire, des résolutions qu'on peut prendre quand la nécessité est là, la nécessitée actuelle pratique, quand l'action suivra immédiatement la résolution, quand on est là soi-même pour agir comme pour parler. Mais décider sans agir, par voie de conseil, envoyer par la poste une décision pareille. Cela ne se peut pas vous ne me le demandez pas. Madame de Talleyrand m’avait promis de me donner de vos nouvelles. Pourquoi ne le fait-elle pas ?
Jeudi 7 heures
Après votre santé, vos reproches. Je les accepte et je les repousse. Moi aussi, j’ai été gâté. Je n’ai pas prodigué mon affection ; et j'ai vu, jai toujours vu celle que j’aimais heureuse, très heureuse. Je l'ai vue heureuse à travers les épreuves, sous le poids des peines de la vie. J’ai toujours eu le pouvoir de la soulever au dessus des vagues, de rappeler le soleil devant ses yeux, le sourire sur ses lèvres, de placer pour elle, au fond de toutes choses ce bien suprême qui dissipe ou rend supportables tous les maux. De quel droit me plaindrais-je que, sur vous, le pouvoir me manque souvent ? Qu’est-ce que je fais, qu'est-ce que je puis pour vous ? Une heure, où une lettre tous les jours. C'est pitoyable. Parce que je suis avec vous ambitieux, exigeant, ne me croyez pas injuste où aveugle. Vos douleurs passées, vos ennemis présents, ce qui vous a brisée, et ce qui vous pèse, je sens tout cela ; je le sens comme, vous-même, oui comme vous- même ; et je sais le peu, le très peu de baume que je verse dans ces plaies qui auraient besoin que la main la plus tendre fût toujours là, toujours. Je sais de quoi se fait le bonheur ; je sais ce qu’il y faut, et à tout instant. Vous ne l’avez pas même par moi. Ma tendresse s’en désole ; mon orgueil s'en révolte ; mais je ne m’abuse point et ne vous reproche rien. Pourtant ne me demandez pas de changer. Je ne changerai pas. Je ne me contenterai pas pour vous, à meilleur marché que je n'ai toujours fait. Je ne prendrai pas mon parti qu’il y ait entre nous tant d'insuffisance et d’imperfection. Ce temps que je ne vous donne pas, il est plein de vous. Ce bien que je ne vous fais pas, je m’en sens le pouvoir. Ce qui manque à votre bonheur ne manque pas à ma tendresse. Ce contraste est poignant. N'importe. Je garderai avec vous mon ambition infinie, insatiable, souvent mécontente ; et je vous la montrerai, comme vous me montrez ce mal que je ne puis guérir. Voilà la vanité. Déplorons la ensemble. Pour tous deux cela vaut mieux que de s'y résigner.
Je viens à vos affaires. Ceci est plus aisé et sur ceci, j’ai un parti pris. J’ignore si votre fils fera ce qu’il doit. Mais, s’il le fait, je suis d’avis que vous mettiez de coté tout fâcheux souvenir, & que vous acceptiez de bonne grâce ce qu’il fera pour vous au delà de votre droit. Vous n’avez point cédé à sa fantaisie, à sa colère. Votre dignité est à couvert. Vous pouvez, vous devez vous montrer facile avec lui, quant à la réparation. Et s'il agit convenablement, s’il met votre droit de côté pour faire son devoir, il y a réparation de sa part. Le fait suffit pour que vous présumiez l’intention. Saisissez la et reprenez votre fils dès qu’il reprendra lui la physionomie filiale. Je n'hésite pas dans mon conseil et je souhaite beaucoup que cela finisse ainsi. Onze heures Voilà mes lettres. Point de vous. Pour le coup, ceci m'inquiète. Je ne vois point d'explication. Peut-être quelque orage. Mais la poste est arrivée. Il faut attendre à demain. Adieu. Un tendre et triste Adieu. G.
214. Paris, Samedi 2 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai passé hier chez Hatzfeldt. Je ne l’ai pas trouvé ; mais je lui enverrai cette lettre avant 5 heures. Bien petite compensation à l'insuffisance de nos communications. Il y a deux choses qu’il faut sans cesse ravaler en écrivant par la poste, la vérité et l'affection.
Je ne reçois rien de M. Je suis convaincu qu’il ne veut venir me voir ou m’engagera l'aller voir que pour me dire que c’est fait et qu’il vous a envoyé votre passeport. Son amour propre y est bien compromis, et aussi celui de son maître après la promesse qu’il a donnée. Ne vous abattez pas, ne vous irritez pas. Vous passerez ce défilé, mais il est difficile. Votre retour fera dire qu’on penche ici vers la paix, et qu’on cherche des liens cachés avec Pétersbourg. Non seulement les ennemis personnels, mais les badauds Anglais en prendront de la méfiance. Non seulement dans les journaux, mais peut-être aussi dans le Parlement. Souvenez-vous de Nicolas Pahlen. Je vous dis tout cela, non pour vous faire perdre l'espérance, car je crois fermement que la chose se fera, mais pour vous faire prendre patience, et comme je le dis à moi-même par le même motif. Je ne crois pas devoir retourner chez M. avant d'avoir reçu de lui quelque avis. Il ne faut pas le fatiguer. Il est toujours souffrant. On dit qu’il se croit très malade. Je ne l’ai pas trouvé changé. J’ai beau chercher ; je ne trouve personne qui croie à la paix prochaine, qui parle sérieusement de votre acceptation des quatre points. Ceux qui ne le disent pas comme ceux qui le disent, sont également convaincus que vous n'en voulez pas sérieusement. Qu’est ce que la révision du traité du 13 Juillet 1841, le seul dont vous parliez ? Celle-là va sans dire. C'est la révision de tous vos anciens traités avec la Porte qu’on demande et celle-là, vous êtes bien loin de la promettre. Il n’y a rien à faire d'ailleurs, tant que Sébastopol n’est pas pris. Plus c'est difficile, plus c’est nécessaire. Si on ne le prend pas cette année on recommencera le printemps prochain, avec des forces doubles, triples de terre et de mer. Toute cette affaire a été un chef d'œuvre d'imprévoyance. J’ai peur qu’elle ne devienne aussi un chef d'ouvre d’entêtement. Je suis bien noir. Il faut que Sébastopol soit pris. C'est, quant à présent. la seule chance sérieuse de paix. On s'en irait de Crimée et on recommencerait à négocier sérieusement. J'en reviens toujours à ce que nous nous sommes dit avec Lord Lansdowne il y a six semaines.
Vous ne vous figurez pas l'effet qu'a produit le prince Napoléon quittant l’armée. Personne ne s'en gêne. On dit que son père a dit : " S'il ne se fait pas tuer, je ne consentirai jamais à le revoir. " Le Moniteur a ajouté à l'effet en disant, un jour, qu’il était rétabli, et deux jours après, qu’il restait à Constantinople. La nomination de Morny comme Président du Corps législatif a beaucoup déplu au Palais-Royal.
Midi
Je sors de bonne heure ce matin, quoique enrhumé. L’Académie des sciences morales et politiques, siège à midi et demi et je la préside. On m’apporte le 176. Guillaume revient du Moniteur ; il coûte 80 fr. par en et 20 fr par trimestre à l'étranger. C'est en France seulement qu’on en a réduit le prix à 40 et 10 fr pour faire concurrence aux autres journaux. Les 2 fr 45 c. sont le résultat d’une nouvelle convention postale avec la Belgique. Ainsi, on ne vous vole pas. Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Académie des sciences morales et politiques, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (Russie), Enfants (Guizot), Femme (diplomatie), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (France), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé, Santé (Dorothée)
215. Baden, Samedi 13 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je me sens un peu mieux aujourd’hui et je crains de vous le dire,car cela me porte malheur. J'aimerais bien mieux que vous me permissiez de ne vous parler jamais de ma santé. M. de la Redorte est arrivé, il est venu me voir. Il cause c.a.d. il raconte, et au fond pas grand chose. Voici la réponse de M. de Bacourt. Ces notions lui ont été fournies par M. de Blittersdorff, le Metternich de ce pays-ci. Des lettres de Constantinople du 25 juin disent que le sultan est dans un état désespéré. Il traînera un mois tout au plus.
5 heures
Voici votre N°214 bien tendre, bien bon, je le relirai souvent. Je vous en remercie. Vous voyez que je puis à peine vous écrire, cela me fatigue, le sang me porte à la tête, je ne suis pas bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ecrivez-moi toujours et tout. Adieu. J’ai eu une lettre d'Alexandre, très insignifiante. Il me dit seulement qu’il est très occupé. Mais quand est-ce que quelqu'un prendra la peine de me dire ce qu'on fait ? Adieu. Adieu.
215. Paris, Dimanche 3 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc le traité d'alliance avec l’Autriche signé. Quels en sont les termes ? Nous verrons. Mais le fait seul est capital. On s'efforce souvent d'éluder ce qu’on fait par les paroles dont on se sert ; mais on n'y réussit que bien peu. C'est le fond des actions que décide de leurs conséquences. Mon ami Bourqueney ne fait pas mal ses affaires. Sa femme doit être bien contente. Elle était beaucoup moins perplexe que lui.
Ce traité facilitera beaucoup à Aberdeen la session qui va s'ouvrir. Ne vous attendez pas à sa retraite. En faisant la guerre, il se promet toujours de faire la paix, et la Reine veut qu’il reste pour la faire en effet le jour où elle sera possible sans un grand effort d’énergie et de courage. Je ne crois pas au succès de l’intrigue Palmerstonienne ; elle est trop publique, et elle mènerait trop évidemment à la guerre révolutionnaire. Si ce que vous dit Ch. Greville est vrai, il n’y a pas là grand danger.
Les marins n'auront plus d'humeur. Ils en avaient un peu et trouvaient qu’on exigeait d'eux ce qu’ils ne pouvaient pas faire, et qu’on ne leur rendait pas justice pour ce qu’ils faisaient. M. Ducos avait plus d’une fois, porté les plaintes à l'Empereur. Les décrets du Moniteur de ce matin y mettront fin. Hamelin a bien gagné son bâton d’Amiral et Parseval Deschênes, qui ne l’a pas autant gagné, le mérite autant. Je connais la plupart des officiers qui reçoivent de l'avancement. Ce sont des hommes vraiment distingués. On ne sait pas assez à quel point le corps d’officiers de notre marine est bien composé.
A tout prendre, je trouve le discours du Roi de Prusse bon. Avec des paroles entortillées il dit franchement sa politique. Ses Chambres, le pousseront un peu, mais pas bien vivement je crois, ni de manière à l'embarrasser. Elles lui savent gré de sa loyauté envers elle-même, et elles ne veulent pas faire grand bruit.
Hier l’Académie des sciences morales et Mad. Mollien en en revenant. Longue conversation sur Claremont intéressante pour moi. La Reine ne tarit pas en éloges sur sa belle fille l'Infante Fernande vertueuse, sérieuse, pieuse, occupée de son mari, de ses enfants, de sa dévotion et de bonnes œuvres, respectée et aimée de tous. Quand faisaient. M. Ducos avait plus d’une fois, le Roi Léopold a été de Calais, il y a eu, dans la famille, un vif mouvement d'humeur ; on a eu quelque envie de quitter Claremont ; les trois Princes se sont réunis pour en délibérer. Mais le bon sens, la justice et l'opinion de la Reine ont prévalu. La Reine Victoire est toujours extrêmement bien pour eux, soigneuse avec affection. Le soir, j’ai dîné chez ma fille Henriette, et je suis rentré à 9 heures et demie pour me coucher. Je suis très enrhumé ; je tousse beaucoup. Mais j’ai bien dormi cette nuit, et j'espère qu’en restant deux jours sans sortir, je m'en débarrasserai. Quand donc vous soignerai-je aussi ?
1 heure
J’ai peine à croire au mot brute. On peut et il faut, en pareil cas, être très sûr ; mais à quoi bon être grossier ? Je vous ai envoyé hier par la voie indiquée, les livres que vous désirez. On est très content de Bourqueney pas précisément dans le cabinet des affaires étrangères, où l’on n'est jamais content que quelqu’un réussisse, mais plus haut. Je viens d'en avoir des nouvelles. Rien de précis sur le traité ; seulement, qu’il est surtout conçu dans la prévision d’une campagne des alliés. sur le Bas Danube. Adieu, Adieu. G.
Mad. Kalergis part des quelques jours ; elle avait annoncé qu’elle passerait l'hiver à Paris ; mois elle y renonce.
Mots-clés : Académie des sciences morales et politiques, Armée, Diplomatie (Angleterre), Diplomatie (France), Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), Marine, Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (Espagne), Politique (Prusse), Salon, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
215. Paris, Vendredi 12 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Se peut-il que ce N° 211 me soit un soulagement ? Pour Dieu, faites partir vos lettres tous les jours, longues ou courtes gaies au tristes. Il me faut une lettre ; il me faut quelques lignes ; il me faut vous, vous ! Vous ne savez pas avec qu’elle horrible rapidité l'inquiétude m’envahit, me poursuit. C’est la chemise de Nessus. Je vous en conjure ; ne soyez pas malade et dites-le moi. J'ai grande pitié de vous. Ayez aussi pitié de moi. J’ai beaucoup souffert, en ma vie ; beaucoup plus que je ne l'ai laissé voir à personne. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Est-ce pour dégoût ? Ou bien ce que vous mangez vous pèse-t-il sur l'estomac ? Digérez-vous mal ? Si ce n’est que dégoût, surmontez-le un peu ! Pour moi, pour moi. Que je voudrais être là pour veiller à tout, pour tous savoir au moins. Et votre sommeil vous ne m'en parlez pas. Parlez-moi de tout, fût-ce toujours la même chose. Il n’y a en moi, toujours, qu’une même pensée. Je voudrais vous envoyer l'image complète de mes journées de ce qui les remplit en dedans. Vous verriez. Je devrais peut-être ne pas vous dire tout cela, ne pas ajouter mon inquiétude à votre fatigue. Si vous étiez près de moi, je me tairais mieux. Ne renoncez pas à marcher cela vous est bon. J'ai vu par vos lettres que vous dormiez quelquefois dans le jour. Ne vous en défendez pas.
Je veux parler d'autre chose. Nous sommes assez préoccupés ; agités dirait trop. La Cour rendra son arrêt aujourd’hui. Si Barbès est condamné à mort, le parti fera quelque démonstration, sans espoir, sans dessein sérieux même, par honneur, pour ne pas paraître frappé et mort du même coup. Peut-être quelque tentative sur la prison ; peut-être quelque coup de pistolet sur quelque voiture de Pair.
Paris est fort tranquille. Vous y seriez fort tranquille Je regarde votre lettre. Une chose m’en plait. Votre écriture est bonne et ferme.
J'ai vu Pozzo. Affreusement maigri, rétréci rapetissé, les yeux enfoncés dans un cercle de charbon, la parole chancelante, les épaules voûtées, les jambes ployées, les habits trop larges, l’esprit aussi chancelant que la parole. Nous causions seuls dans le premier petit salon de Mad. de Boigne, Edouard de Lagrange est entré. Il l’a pris pour le Marquis de Dalmatie, lui a parlé du Maréchal ; puis M. de Lagrange passé, il m'a dit tout bas : " C’est bien le marquis de Dalmatie, n’est-ce pas ? " en homme qui doute de lui-même. Pourtant, il m’a parlé longtemps de ses dernières affaires à Londres de ses conversations avec Lord Melbourne et Lord Palmerston de tout ce qu'il leur avait dit sur la nécessité de maintenir la paix sur leurs intérêts et les vôtres dans la paix ; tout cela très nettement, très spirituellement, comme par le passé avec verve dans l'imagination, en même temps qu'avec faiblesse et trouble dans le langage. Puis en finissant : " C'est ma campagne de vétéran. Un autre hiver à Londres me tuerait." Il ne s’est pas pris de goût pour l'Angleterre, en y vivant, Madame de Boigne va mieux, beaucoup mieux. Elle est retournée hier à Châtenay. J’irai y dîner demain.
Connaissez-vous un M. de Lücksbourg, bavarois, qui remplacera probablement ici M. de Jennisson ? Il est venu me voir avant hier. Je l’ai trouvé bien. Si M. de Jennisson s'en va, peut-être son appartement se trouvera-t-il vacant. C’est un peu cher, mais bien gai. A présent tout à côté de la maison est arrangé. Vous n'auriez pas de bruit. Adieu. Je vais à la Chambre. On commence de bonne heure. Pourquoi n’êtes-vous pas à la Terrasse ? Adieu. Adieu. J’aurai de vos nouvelles demain n’est-ce pas ? Ah que la vie est mal arrangée ! Adieu. G.
216. Baden, Dimanche 14 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Que je vous dis peu en vous écrivant tous les jours, & que de choses j’aurais à vous dire ! Que de choses à répondre à votre lettre de jeudi. Et je le pourrai si j’avais un peu plus de force. Mais vous ne savez pas comme il m’en coûte d'écrire. Comme cela me fatigue ! J’ai passé une mauvaise nuit, je ne vaux rien aujourd’hui, je ne sais que vous dire. J'ai été à l'église je n’y manque jamais. Mad. de Talleyrand ne vous écrit pas probablement parce qu’elle n'a rien de bon à vous dire sur mon compte. Je la vois extrêmement peu. Elle vient tous les deux jours passer avec moi un quart d’heure, voilà tout. C'est à près pour moi comme si elle n’était pas à Baden. Le matin je vois Mad. de Nesselrode assez longtemps. Nous nous rencontrons dans l’allée et nous y restons assises pendant une heure ou plus même. Je vais quelques fois chez elle en rentrant de ma promenade le soir. Je viens quelque fois Mad. Wellesley en calèche. J’y mène aussi Mad. de la Redorte. Le reste du temps. Je me promène avec Marie et la petite Ellice. De une à 2 heures, M. de Malzaden ou quelque autre diplomate vient chez moi me conter les nouvelles. M. de Malzaden a de l'esprit.
Aujourd’hui nous épousons M. de Leuchtenberg, je ne cesse pas d’en être choquée. Vous ai-je dit que Matonchewitz est nommé pour Stockolm, dans son audience de congé l’Empereur lui a rendu ses bonnes grâces, cela me prouve qu’il n’est pas implacable. M. de la Redorte me dit que Thiers retourne à Paris avant la fin du mois. Il me dit aussi ce que vous m’aviez mandé qu'il s’était séparé du roi en très bons termes. Il ajoute que le Roi pense à remanier le ministère. Vous à l’intérieur, Thiers, les affaires étrangères. Le Maréchal la guerre. Que tout cela pourrait se faire bientôt. Y croyez-vous ?
5 heures
Voici votre lettre. Je ne veux pas que vous soyez inquiet. Je ne me porte pas bien, quelques fois je me sens bien mal, et Je vous le dis. Mais c’est une imagination. J’ai l’estomac abîmé, je ne mange pas. Je dors peu et mal, je maigris, tout cela est exact, mais cela ne me fera pas encore mourir. Je suis très impatiente du jugement des Pairs. Je vois dans un journal qu'on chante la Varsovienne dans la rue Rivoli. Cela ne me plaît pas du tout Adieu. Adieu à demain, car vous voulez tous les jours mes pauvres lettres. Dites-moi des nouvelles. Ce pauvre Pozzo, il me parait qu’il restera à Paris. Adieu dearest.
216. Paris, Lundi 4 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il faut que vous écriviez, à votre ami d'Ems et de Schlangenbad, une lettre sur le thème que voici :
" Je suis bien malade de plus en plus malade. Je vois, et vous me dites qu'à Londres, on se fait un monstre de mon retour à Paris. Certainement je n’aime pas autant que vous les Anglais et je n'adore pas votre alliance ; mais je vous aime, j’aime votre Empereur, et je ne voudrais pas lui créer le moindre ennui. On a peur de mon salon. Mais je n'en aurai point point du tout ; et si un jour j'en avais un, il serait encore plus ce qu’il était quand j'étais libre, c’est-à-dire favorable à l'Empereur et à l'Impératrice. Elle peut se le rappeler. Mais que je suis loin de les doux souvenirs ! "
" Je crois démêler que pour me témoigner toute sa bonté, l'Empereur attend un succès. Que veut-il de plus que la gloire de ses armes et le traité avec l’Autriche ? Est-ce la prise de Sébastopol. Mais je ne serai plus de ce monde ; déjà j’ai à peine la force de sortir de mon lit, de me lever de mon fauteuil ; je crache le sang && J’aspire avec passion et souffrance à mon appartement de Paris, à mon médecin, à l’air doux et à l’aspect gai qui me viennent par mes fenêtres, à des portes qui ferment et que je ferai fermer à tout le monde, s'il le faut. Et puis, si je retourne à Paris, maintenant, on en pensera ailleurs ce qu’on voudra ; l'escapade sera faite ; mais si on apprend à Pétersbourg, ma démarche et qu’on me défende d'aller à Paris, alors j’entre en état de vraie révolte et pour moi, pour ma famille, la situation est tout-à-fait changée. Hélas, je ne tarirais pas sur les motifs de mon ardent désir. "
Je suis un interprète parfaitement fidèle. M. est venu me voir hier ; très heureux du traité autrichien disant qu’il est complet, qu’on vous fera probablement une nouvelle et dernière sommation, et que si votre réponse n’est pas pleinement satisfaisante, les ambassadeurs seront aussitôt retirés, et l’Autriche entrera en campagne avec ses alliés. Il regarde ceci comme très favorable à la paix. On se loue infiniment de Bourqueney, de sa prudence, de sa patience et de son savoir-faire.
Conseil général. Quand vous écrivez à M. prenez soin que vos lettres puissent être montrées plus haut, et ne donnent pas lieu de croire à un concert habituel entre vous et lui. J’ai entrevu que cela pouvait le gêner et l'affaiblir.
Vous ne savez pas à quel point le travail contre vous est actif et sérieux. Il y a là une méfiance incurable, une conviction de marbre que vous ne sauriez vous tenir tranquille, ne pas travailler contre l'alliance, ne pas servir, à tout prix, votre Empereur qui à son tour, se sert et se servira de vous, par toutes les voies et dans toutes les situations. Certainement, dans le temps de votre grande activité il vous a manqué une habileté, celle de faire penser que vous pouviez être autrement que vous n'étiez, vous soucier d'autre chose que de politique, vous décider par d'autres motifs que le service de votre maître, vivre en dehors de la diplomatie, et des affaires Russes comme hors de la Russie elle-même. Vous êtes, aux yeux des Anglais, la diplomatie Russe incarnée, infatigable, insaisissable. Il n’y a pas moyens de leur persuader qu’il puisse y avoir, pour vous d'autres intérêts, d'autres sentiments, d'autres intentions, d'autres occupations. Un homme peut porter le poids de cette situation exclusive, absolue immuable. Elle ne convient pas à une femme ; il faut qu’elle puisse se retrouver purement et simplement une femme, renfermé dans la vie privée, et que tout le monde puisse le croire.
Ne dites pas trop comme vous me l'écrivez souvent, qu’on fait chez vous, entre les Anglais et les Français, une grande différence, très doux pour les uns, très rude pour les autres. Cela est pris comme une preuve de votre travail contre l'alliance. Et puis, personne ne prend au sérieux cette distinction de votre part. Votre Empereur, dans sa conduite et dans ses conversations avec Seymour, a traité trop légèrement la France et l'Empereur Napoléon pour qu’on voie là autre chose qu’une manœuvre, et une manœuvre trop transparente.
J’aurais bien des choses à ajouter. Mais en voilà déjà bien long et l'heure me presse. Adieu. Adieu. Le bon vouloir est toujours le même. G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Correspondance, Diplomatie (Russie), Femme (diplomatie), Femme (santé), France (1852-1870, Second Empire), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Autriche), Politique (Russie), Portrait (Dorothée), Relation François-Dorothée, Santé (Dorothée), Vie domestique (Dorothée)
216. Paris, Samedi 13 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'attends. Je devrais ne rien dire de plus, car d’ici à 10 heures je suis tout là. La Cour des Pairs a rendu hier au soir son arrêt, au milieu d’un calme profond. La délibération intérieure a été solennelle. Les plus difficiles sont contents de sa gravité, de sa liberté, de sa probité. La majorité sur le point capital, Barbès a été grande 133 contre 22. Le parti de l'indulgence a été soutenu par des hommes de tous les partis et surtout par ce motif qu’il fallait craindre d'exciter le fanatisme jusqu'à la rage, et de concentrer cette rage sur une seule tête. M. Cousin a soutenu cela avec beaucoup de talent. M. Molé a bien parlé, brièvement, mais nettement, pour la condamnation à mort. Je n’ai encore vu personne ce matin ; mais rien ne m'indique qu’il y ait eu le moindre bruit cette nuit. On en attendait un peu autour de la prison. En fait de forces et de précautions, il y a du luxe. On a raison. Le Duc de Broglie repart ce matin pour la Suisse. Nous nous sommes dit adieu hier au soir. Pendant son séjour, quelques uns des ministres l’ont pressé d'entrer avec eux aux Affaires étrangères. Je l’en ai pressé moi-même, me mettant, s’il entrait, à sa disposition pour le dehors. Il a positivement refusé.
10 heures
J'attends encore. Montrond sort de chez moi, guéri de son érésipèle. Il part dans deux jours pour Bourhame. Delà à Bade. Je regrette bien qu’il m’y soit pas allé plustôt. Quoique vous l'eussiez probable. ment bientôt aisé. Il est bon à retrouver souvent, mais non pas à garder longtemps. Le Maréchal se trouve fort bien aux Affaires Etrangères, et n'a aucun dessein de les céder à personne. L'Orient va très bien, grâce à lui. Tout s’y arrange, et s’y arrangera encore mieux si le Sultan meurt. Un jeune Prince, un Divan nouveau se hâteront de faire la paix avec le Pacha. La paix donc, le Sultan vivant. Encore plus la paix, le Sultan mort. D'ailleurs, il y aura une conférence, à Vienne, et vous y viendrez. M. de Metternich vous promet. ainsi sera réglée la plus grosse affaire de l’Europe. Rien n’est tel que les petits Ministères pour les grosses affaires.
Voilà le N°212. Les dernières lignes valent Je vois que le bruit d’une conférence à Vienne est Baden, comme à Paris. M. Villemain a défendu hier son budget spirituellement mais trop plaisamment. Notre Chambre n’aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments et M. Villemain en est prodigue. C'est l’usage à l'académie. Entre gens d’esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l’esprit, les uns des autres comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut, devant l'autel. Notre Chambre ne se pique pas d’esprit, et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Adieu. J’y vais à cette Chambre qui ne se pique pas d’esprit. Je verrai aujourd'hui quand nous finirons. Adieu Adieu. Encore une fois des détails.
G.
J’irai voir Pozzo aujourd'hui ou demain à votre intention.
217. Baden, Lundi 15 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le télégraphe nous a annoncé hier la condamnation de Barbès, et un peu de tumulte auprès de la Chambre des députés. Je suis impatiente de votre lettre tantôt ; ne vous occupez pas de me parler de ma santé parlez moi de la santé de Paris. Je suis un peu mieux aujourd'hui, et enfin j’ai pu écrire quelques lettres, car depuis assez de temps ce n’est qu’à vous que j’ai écrit. Cela me fatigue la tête. Le temps est à l'orage et j'en suis accablée. J’ai un peu dormi, et même j'ai un peu mangé, ce qui est bien nouveau.
9 heures
J’ai eu une longue visite d'un diplomate qui m’a montré les plus fraîches nouvelles de Constantinople du 28 juin. Le sultan n’avait plus que quelques jours à vivre. La guerre est engagée. J'ai lu tous les récits. Metternich compte sur des conférences. Moi j'en doute encore.
5 heures Voici votre lettre, vous me dites ce que je vous disais tout à l’heure. Je suis curieuse d’apprendre si Petersbourg voudra ce que veut le Prince Metternich vraiment, vraiment je suis mieux aujourd'hui vous savez que je vous dis toujours la vérité. Je regrette même de vous la dire trop ; car vous avez eu de tristes lettres. Tout mon mal vient de ce que j’ai écouté le médecin. Le lait d'ânesse m'a abîmé l'estomac, les bains m’ont affaiblie. Il ne me faut à moi jamais de remèdes. Mais ma vie réglée & l’esprit tranquille. Quand j’aurai cela j'irai mieux. Mais quand ? Voici un gros orage un temps bien lourd. Ecrivez-moi beaucoup, beaucoup. Qu’est-ce que dit Paris de la condamnation de Barbès ? Adieu. Adieu mille fois, adieu.
217. Paris, Dimanche 14 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Comme je fermais hier ma lettre on vint m'avertir qu'il y aurait peut-être un peu de mouvement à la Chambre, car une bande assez nombreuse se formait et voulait y porter une pétition pour l'abolition de la peine de mort. Je ne trouvai en arrivant ni mouvement, ni bande mais beaucoup de précautions prises, les grilles fermées, des troupes dans les cours &. Au dedans, de la part de la Chambre, une disposition très sensée et tranquille. S'il y a un progrès depuis quelque temps, c’est que les pouvoirs publics ne sont plus du tout à l'état révolutionnaire. Non qu’il n'y ait là aussi quelques hommes qui sont encore et qui resteront à cet état. Mais ils y sont pour leur propre compte n'oseraient le montrer, et la majorité serait telle qu’on ne lui donnera même pas l'occasion de se manifester. Vers deux heures, pendant qu’on délibérait sur le budget de l’instruction publique, le rassemblement est arrivé sur la place 7 à 800 hommes, la plupart en blouses, quelques étudiants bien vêtus ; de côté hors de la troupe, deux hommes en habit noir, la canne à la main, qui avaient l’air de diriger les mouvements. Au milieu un drapeau portant abolition de la peine de mort, et la pétition roulée autour du bâton. Le commissaire de police les a sommés de se retirer. Sur leur refus, un escadron de la garde municipale s’en avance au grand trot. La dispersion a été générale et soudaine. Un garde municipal a poussé son cheval sur l'homme qui portait le drapeau, l’a pris, l’a jeté sur la croupe de son cheval et l'a ramené au corps de garde de la Chambre, au milieu des hourras de la garde nationale qui voulait le jeter à la rivière. C’est un pauvre ouvrier tailleur, de mine très timide, et qui semblait se croire au moins mort en entrant dans le corps de garde. Nous avons continué notre budget, et je suis parti à 4 heures et demie pour aller dîner à Châtenay. En en revenant, à 10 heures et demie, j’ai traversé tout Paris parfaitement tranquille.
Je n’entends rien dire ce matin. Châtenay était charmant, l’air doux, les arbres, touffus, les gazons frais. Je me suis donné le triste plaisir, bien plaisir et bien triste de refaire seul notre promenade dans le jardin, mêmes alliés, même pas. Ah, que ne peut-on fixer sa vie à un moment de son choix !
Onze heures
Votre N°213 me désespère. Je vous répète, je me répète à moi-même ce que je vous écris tous les jours. Je ne puis pas décider pour vous. J’en suis, dans l’anxiété la plus douloureuse. Je voudrais avoir un avis, une volonté ; je voudrais vous décharger de tout ce qui vous agite et vous pèse, embarras, indécision, solitude. Je retrouve ce que je connais trop bien, cet horrible sentiment d’impuissance contre les choses, les faits tout le monde extérieur, au moment même où la tendresse la plus infinie, la plus souveraine, remplit l'âme et se croirait toute puissante si elle n'écoutait qu'elle-même. Pardon, pardon de vous parler de ma tristesse à moi. De quoi vous parlerais-je ? Ma tristesse, c’est votre mal, c’est votre faiblesse, votre maigreur, votre abattement, votre ennui. Vous m’avez reproché quelquefois de me trop arrêter avec vous sur ce que vous souffriez, et de m'y associer au lieu de vous en distraire. Dearest, je ne puis pas me distraire de vous, encore moins de loin que de près, encore moins de votre santé que de vos chagrins.
Comment, votre médecin vous engage à quitter Baden, ne fût-ce que pour quelques jours ? Je ne comprends pas cela. Je comprendrais qu'il vous en renvoyât. Après tout, je ne sais vous dire qu’une chose. Faites ce dont vous aurez envie. Ne consultez que votre envie et votre force. Allez où elles vous diront, où elles vous mèneront. Ici le beau temps revient, le chaud, le soleil. Est-ce qu'il ne revient pas aussi à Baden ? et ne vous fait-il aucun bien ? Vous avez eu des nouvelles de Pétersbourg puisque vous savez qu’on fera Paul conseiller d'Etat. N’y a-t-il rien sur vos affaires ? J’ai reçu hier une lettre de M. de Barante, sans intérêt. Que je voudrais mettre dans les miennes de quoi remplir votre journée ! Je vous écrirais volontiers des volumes.
J’ai passé auprès de vous tant d'heures de conversation charmante ; pleine des plus douces choses, des seules douces choses de ce monde, de tendresse et de liberté. Vous ne savez pas quelle vive, quelle inépuisable reconnaissance (quand ce ne serait que reconnaissance) me resterait éternellement dans le cœur envers vous pour de tels moments, pour un seul de ces moments. Le monde est si froid, et si faux ! et par dessus cela si médiocre si vulgaire ! L'âme y meurt de faim et de soif, et de dégoût. J’ai trouvé près de vous, en vous, ce que je n'attendais plus ce que je ne demandais plus. Je me suis senti si heureux près de vous, sans contrainte ni privation aucune, aucune, ni de cœur, ni d’esprit, ni de goût, ni de parole, satisfait, pleinement satisfait, plongé dans le sentiment le seul qui épanouisse toute l'âme point de désir parce qu’on a tout. Que de fois, en causant avec vous, au milieu des effusions de notre intimité, j’ai été tout à coup, et pour une seconde rappelé en moi-même par un de ces éclairs intérieurs qui illuminent tout notre bonheur tout notre plaisir ! Je ne vous ai jamais dit, je ne vous dirai jamais à quel point je vous trouve rare et charmante, ni combien je vis seul sans vous, ni ce que sera pour moi, le jour qui vous rendra à moi, fussiez-vous cent fois plus maigre et plus abattue que vous ne me le dites. Adieu. Adieu.
Je ne puis vous parler d'autre chose. Quand j'ai reçu, quand j'ai relu votre lettre, j'attends celle du lendemain. Ne vous fatiguez pas à m’écrire ; mais ne me laissez pas sans nouvelles. Adieu. G.
217. Paris, Mardi 5 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne pensais hier qu'à vous seule ; je ne vous ai pas parlé du traité Autrichien. L'effet est grand ici ; vous aurez vu qu’il a été grand à la Bourse. On voit là un succès et un gage de paix. La double alliance laissait possible, la guerre révolution naire et le bouleversement de l'Europe ; avec la triple alliance, c’est impossible. Un peu plus tôt, un peu plus tard, l’Autriche rétablira la paix. Je ne suis pas du tout sorti hier, à cause de mon rhume ; mais on est venu me voir, Glücksberg d’abord, puis le chancelier, puis Berryer, puis le Duc de Noailles ; tous disant à peu près la même chose. Le Duc de Noailles, le plus content ; le repos en France et la paix en Europe ont tout son cœur. Personne ne sait encore les dispositions précises du traité. Hübner qu’un de ces messieurs (je ne me rappelle pas si c’est Berryer ou Noailles avait rencontré hier, lui a dit que c’était le plus grand événement qui se fût passé en Europe depuis 1815. Il était radieux. Je le comprends. La Russie affaiblie, l'Allemagne affranchie et unie, l’Autriche rassurée contre la révolution et contre vous à la fois, et médiatrice entre l'Occident et l'Orient, il y a là de quoi charmer les cœurs Autrichiens. Quand la paix sortira-t-elle de là ? Ceux qui y comptent ne l'attendent pas très prochaine, ils doutent que vous accédiez à la nouvelle sommation qui va vous être adressée et alors il faut une nouvelle campagne. Rien n’est à prévoir avec quelque certitude jusqu'à ce que nous avons vu le Parlement anglais.
Le Duc de Noailles veut aller vous voir à la fin du mois. Il m’a dit qu’il serait déjà allé sans la mort du Duc de Mouchy. Il s'occupe des affaires de sa cousine. Mais il affirme qu’il ira. Berryer aussi veut aller vous voir, et je ne serais pas surpris quand il serait le premier. Il se plaint de sa santé, et je l’ai trouvé en effet fatigué et vieilli. Il ne pense pas, ni moi non plus que sa réception à l’Académie ait lieu avant le milieu de Janvier.
Glücksberg m’a intéressé sur l’Espagne d'où il vient et où il va retourner. Il n’a pas maintenant grande inquiétude sur la Reine Isabelle ; il dit qu'à travers ses désordres et son décri qui sont tout ce qu’on en dit, elle ne manque ni d’esprit, ni de courage, et qu’en se mettant pleinement, comme elle l’a fait, entre les mains d’Espartero et de ses amis, elle leur a été toute possibilité de l'attaquer ; l’un deux disait ces jours derniers : " Elle nous force à la défendre jusqu'à ce qu’elle puisse nous faire pendre." Cette réaction arrivera, et c’est Narvaez qui la fera ; mais pas de sitôt. En attendant, il vit à Orléans. On l’a prié de ne pas venir à Paris, et lui-même ne veut pas être où est la reine Christine. Celle-ci est la personne qui a le plus perdu en Espagne dans ces derniers temps ; il paraît qu’elle a tout-à-fait manqué de jugement, et de tact, pleine de prétentions et de tracas sur de petites choses. Son attitude à Paris, il y a deux ans, a déplu en Espagne.
Mon médecin a lu une lettre d’un chirurgien Français devant Sébastopol qui raconte qu'après la bataille du 5 on a surpris un chirurgien Russe errant sur le champ de bataille, et ouvrant les veines aux blessés anglais et français. On l’a pris et fusillé sur place.
2 heures
J’ai eu bien du monde, et des gens qui devraient savoir précisément ce qu’est le traité Autrichien. Personne n'en connait, ou n'en veut dire les dispositions ; mais il fait, sur tout le monde, l'impression d’une garantie future de la paix. Adieu, Adieu. J'attendrai impatiemment demain votre lettre. Adieu. G.
Mots-clés : Académie des sciences morales et politiques, Affaire d'Orient, Diplomatie, Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Allemagne), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (Espagne), Politique (Russie), Réseau social et politique
218. Baden, Mardi 16 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous disais hier que le temps était à l’orage. Une heure après un gros nuage noir est descendu sur Bade mais plus particulièrement sur la salle de conversation qui touche à la maison que j'habite. La foudre est tombé dessus, le paratonnerre a écarté le danger mais tout le monde qui était à table dans ce moment a senti le choc électrique, deux dames sont tombées par terre de frayeur. J'étais à la fenêtre, relisant votre lettre. Le coup a été si fort qu'il m’a fait sauter & votre lettre m’est tombée de la main. Je n'ai jamais été si près de la foudre que hier. La nuit a été orageuse aussi & nous n’avons pas fini aujourd'hui.
Voilà donc le Sultan mort, je l’ai appris hier au soir. Le courrier venu de Constantinople traversait Bade le 15 ème jour. C'est vite. Tout peut arriver un bien comme un mal. C’est un moment curieux, mais ce qui m’étonnerait le plus serait que nous prissions part à une conférence à moins qu’elle ne se bornât à établir les nouveaux rapports entre les deux chefs barbares.
5 heures
Je viens de recevoir votre lettre, je viens aussi de recevoir un gros volume de mon frère, avec tout l’arrange ment de me fortune. Je vous manderai demain le détail. Il me parait qu’il n’est pas content de mes fils. La loi rien que la loi, comme elle m’accorde à peu près ce que j’ai à présent, je ne me plains pas, mais je ne suis pas bien orientée encore je vous dirai cela plus exactement demain. Adieu. Adieu. Adieu. J'étais mieux ce matin je ne me sens pas si bien dans ce moment. God bless you.
218. Paris, Dimanche 14 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous vous couchez probablement. Que je voudrais vous envoyer le sommeil, ce sommeil qui fait qu’on se lève le lendemain rafraîchi et fortifié ! La chaleur est accablante ce soir. Encore quelque orage. Cet état de l’atmosphère, n'est-il pas pour quelque chose dans votre extrême malaise ? Tout le monde s'en ressent. On ne craint plus d’émeute pour ce soir. La commutation de peine de Barbès préoccupe beaucoup. On s’y attendait peu. C'est le Roi qui l'a voulue. Le Conseil n’était pas divisé quoiqu'il y ait des indécis. Je voudrais vous raconter quelque chose d’intéressant. Il n’y a rien.
Ce matin, au moment où je sortais pour aller voir Pozzo, le Ministre de l’intérieur est arrivé chez moi et m'a retenu. Je ne puis donc vous rien dire de cette pauvre Lady Flora Hastings. On est convaincu ici que le Cabinet Whig tiendra. Pozzo n’est pas atteint du même mal que vous. Il se tue à force de manger. Le soir après dîner, il a l’esprit bien moins libre que le matin, ses méprises sur les personnes sont continuelles et bien étranges. Il a pris l'autre jour le Maréchal Soult pour M. de Villète.
Lundi matin, 8 heures
Je retourne Jeudi au Val-Richer. Nous finissons à la Chambre ces jours-ci. Adressez-moi donc désormais vos lettres au Val-Richer. Et dites-moi ce que vous aimez le mieux pour notre correspondance tous les jours, où tous les deux jours. Je n'aurai pas au Val-Richer autant de Nouvelles qu'à Paris. Mais j’aime à vous écrire, et encore plus vos lettres. Pauvre ressource pourtant que des lettres ! Vous m’avez grondé une fois de dire cela, et de rabaisser ainsi votre seul plaisir. Et puis, vous avez été de mon avis. Je sais supporter ce qui ne me suffit pas, mais non m'y tromper. Sachez bien seulement, dearest, que pour apporter à vos souffrances quelque distraction, pour jeter un doux moment dans votre solitude, je vous écrirai tous les jours, deux fois par jour, tant que vous voudrez et qu’il se pourra. Et toujours avec un triste plaisir, car c’est bien triste de faire si peu pour qui on aime beaucoup.
Avez-vous vu deux volumes que le comte Appony vient de m'envoyer ? Cezriflan von Gontz c’est un recueil de ses pamphlets politiques. J'en ai parcouru quelques uns qui m’ont intéressé. C'est l’histoire que nous avons vue, et faite. Elle a assez grand air sur le papier. La sœur de Barbès est allée déclarer au Garde des sceaux que cette commutation ne lui convenait pas, et qu'il ne voulait pas des travaux forcés. On le fait partir ce matin. Je doute qu’on l’envoie droit aux galères. Il s’arrêtera dans quelque prison sur la route. Je suis de son avis. Il n'est pas fait pour les galères.
Midi
Votre mot 214 ne me déplaît pas. Il est assez ferme dans sa petite taille. Je n’avais jamais entendu parler de la racine de gingembre. Le monde que j'ai vu ce matin ne m’a rien appris. Je vous quitte pour aller faire ma toilette et de là à la Chambre. Adieu ! J’irai ce soir chez Madame Appony et chez Lady Granville. Mais on n'apprend pas grand chose là. Ils attendent plus qu’ils ne donnent. Adieu. Adieu. G.
218. Paris, Mercredi 6 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je serai bien court aujourd’hui.
J’ai eu des affaires ce matin et du monde jusqu'à présent. Je reçois le 180. Je suis presque fâché qu’il fasse beau ici ; je voudrais vous envoyer ce soleil ; pâle, mais soleil. Je vous en prie, pour moi, ne vous livrez pas à l'abattement.
On se calme sur le traité. On le trouve bon, mais moins gros qu’on ne croyait. Meilleur pour l’Autriche elle-même que pour les deux autres. Le parti de la guerre générale et du remaniement de l'Europe, on est très mécontent. Je serais curieux de ce qu’en dira Lord Palm. J’ai reçu un mot d'Aberdeen à qui j’avais écrit dans l’intérêt de mon ancien chancelier à Londres, M. de Rabaudy. Il me répond qu’il fera ce que je désire, puis, il ajoute : " Shall we ever met again ? I do not become at all more reconciled to this long suspension of interecourse, but I Know not how, it is to be avoided. Doubtless, there is much to be said, and I would give a great deal for an hours conversation with you. But these are vain désires. " Ce n’est pas d’un homme près de quitter le pouvoir.
Le langage de Hatzfeld est amer sur un traite signé si promptement et si incognito.
3 heures
J’ai été encore dérangé pour ne rien apprendre. Tout le monde dit qu’au mois d'avril, la France et l'Angleterre auront en Crimée, 250 000 hommes. Adieu, adieu. Il faut que je ferme ma lettre. G.
219. Baden, Mercredi 17 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous n'avez qu’un mot, un seul mot, Lady Carlisle vient d’arriver ; elle passe ici la journée, elle est venue pour moi ; je ne puis pas la quitter un seul instant. J’aurais tant de choses à vous dire sur votre lettre d’hier si parfaite, si touchante, si bonne, si douce. Et puis j’ai à vous parler de mes affaires, à vous envoyer copie de tout cela, à vous demander conseil, et je ne puis rien vous dire aujourd’hui. C'est bien ennuyeux. Ce qui l'est bien plus encore c’est que la malle de Paris n’est pas arrivée, qu’elle ne viendra pas. On dit un accident en route. C’est bien suspect. Je crois plutôt quelques malheurs à Paris et je tremble.
Voici vite l’extrait du projet d’arrangement rouble argent 7ème part de Kostroma 2507 roubles argent
7ème part de Courlande 2261
3ème part de Lituanie 548
5316 rb ou 21000 francs
qui me seraient payés comme rente viagère garantie par mes fils mais sans hypothèques Pahlen me le conseille. De plus
1/4 d'arende de Courlande qui court encore 20 ans 1515
1/4 arende qui finit dans 3 ans 2500 rb
4015 ou 16000 francs
Le quart du Capital anglais qui serait je crois 25000 francs. Mon année de revenus de Courlande 15830 rb argent ou 62 000 francs. Il y aurait donc 37 000 francs de revenus et un capital de 312 000 francs. Voilà l'ensemble, cela me fera avec ce que j'ai aux environs de 75 000 francs. Cela est bien. Il n’y a que le droit rigoureusement le droit, et tant mieux. Je ne dois rien à personne. Adieu je suis bien fatiguée. Je suis bien inquiète, pas de malle de Paris c'est incroyable. Mon Dieu que je voudrai votre lettre. Qu’est-il arrivé ? Adieu. Adieu.
God bless and protect you.
Mots-clés : Finances (Dorothée), Santé (Dorothée)
219. Paris, Jeudi 7 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce n’est pas un délai de trois mois qui est donné à l’Autriche pour vous amener à la paix, ou se décider elle-même à la guerre. Vous devez avoir répondu définitivement à ses nouvelles ouvertures, avant le 1er Janvier prochain. Ce terme passé, si vous n'avez pas accédé, les trois puissances alliées se concerteront immédiatement, sur les mesures militaires à prendre en commun. C'est le sens positif d’un article secret joint au traité. Les articles publics confirment ce qui a été fait ou dit jusqu'ici dans les protocoles de Vienne maintiennent les quatre bases, en réservant aux trois Puissances. La faculté de les étendre selon les événements de la guerre, déterminent avec plus de précision la portée de ces quatre bases, surtout de la dernière, chargent l’Autriche de la nouvelle sommation à vous adresser, et la lient en tous cas, aux puissances occidentales qui lui garantissent en cas de guerre, toutes ses possessions actuelles. On ne doute pas ici, dans le gouvernement que si votre réponse n’est pas favorable, l’Autriche n'entre en campagne contre vous sur le Danube, aussitôt que la France et l'Angleterre y entreront elles-mêmes.
Le délai du 1er Janvier a été assez brusquement substitué à celui de trois mois qui avait d'abord été à peu près convenu.
On a donné de Vienne à Berlin, avis de ce qu’on faisait, 48 heures avant la signature, assez tard pour qu’on n’est pas le temps de faire des objections.
La Prusse s'était décidé à se mettre d'accord avec l’Autriche parce qu’elle avait vu qu’elle serait en grande minorité dans la Diète.
Les dernières nouvelles de l’armée alliée en Crimée sont bonnes, les lettres particulières voudraient bien se combattre sans se brouiller. comme les rapports officiels. L’arrivée des renforts a rendu à nos troupes leur entrain. On s’arrange pour l'hiver. La gaieté des Français gagne et soutient les Anglais. Le Duc de Cambridge est réellement malade, malade du cerveau ; il s’est très bravement. conduit dans la journée du 5 ; mais le spectacle de la lutte et du carnage lui a frappé l’esprit au point de le déranger. Il a absolument besoin de repos.
Mon rhume va mieux, sans être tout-à-fait fini. J’ai recommencé hier à sortir. J’ai rendu une visite au Ministre des Etats-Unis d’Amérique, homme de sens qui m’a paru bien convaincu que son pays ne se mêlerait d'aucune façon, des affaires de l'Europe. Bien pour vous et décidé à être bien, sans sympathie. Le soir chez Mad. de Boigne, le chancelier, le général de la Rue, les Salvo, Mad. Mollien, Viel Castel. J’y dîne dimanche.
J’ai eu hier une longue lettre de Molé, sur les élections de l'Académie. Il appartient, corps et âme à M. de Falloux. L’intervention du nom du Duc de Broglie l’embarrasse fort. Grande confusion dans cette affaire. Les hommes voudraient bien se combattre sans se brouiller. Si le Duc de Broglie ne dit pas formellement qu’il n'en veut pas, c’est lui qui sera nommé. Molé me demande beaucoup de vos nouvelles. Une heure. J’approuve tout-à-fait votre idée. Vous venez consulter votre médecin pour aller ensuite à Nice s’il le juge nécessaire et si vous en avez la force. Cela est bon à dire partout, et ici encore plus qu'ailleurs. L’autorisation en sera plus facile à donner et à justifier auprès de ceux qui en prendront de l’humeur. Il y aurait de la barbarie à vous la refuser.
Vous me direz positivement si vous voulez qu’on réponde dans ce sens, aux questions faites à votre sujet.
Adieu, adieu. Dumon sort d’ici et me demander de vous présenter ses respects vraiment affectueux. Duchâtel arrive demain ou après-demain, pour cinq ou six jours. Adieu. G.
219. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis levé tard. J'avais mal dormi. Cinq au six personnes m'attendaient. Je n’ai pas encore pu vous dire un mot. Soyez donc toujours, un peu mieux comme le N°215 me le promet. Comment voulez-vous que je ne m’inquiète pas de votre santé ? Lady Granville dit pourtant comme vous et ne veut pas que je m'en inquiète. Elle est bien plus préoccupée de votre solitude. Elle dit que, si vous ne lui aviez pas caché votre voyage, si elle ne l’avait pas appris quand vos paquets étaient faits, elle vous en aurait détournée ; que vous êtes allée chercher ce qui vous déplaît le plus de l’ennui, à travers ce qui vous convient le moins de la fatigue ; que vous auriez vécu ici depuis six semaines assez doucement et agréablement, que j’y suis, que bien des Anglais de votre connaissance y ont passé, que le Duc de Devonshire vient d'y arriver. Elle parle très bien sur vous. Ils sont encore ici pour quelque temps si tant est qu’ils puissent s'en éloigner.
La mort du Sultan hâtera peut-être la conclusion des affaires d'Orient sauf à les embrouiller plus tard. Nous l'avons apprise hier par une dépêche de M. de Bacourt. Soyez assez bonne pour le remercier des renseignements qu’il a bien voulu me transmettre. Je répondrai en conséquence.
On avait le cœur fort oppressé à Neuilly. A présent on y respire à l'aise. Cela fait deux familles contentes. Ailleurs, on grogne, dans les Chambres, dans la garde nationale, dans l’armée. Et à part, dans les coins, il y a des gens qui sourient. Barbès ne va point aux galères, comme je vous le disais. On le laissera au Mont Saint-Michel, belle et pittoresque prison, au milieu de la mer où l'on retient les condamnés à la déportation, en attendant qu’il y ait un lieu de déportation. Hier, plusieurs officiers de la garde nationale s’étaient réunis, parlant de donner leur démission. Il n'en sera rien.
J'ai vu Pozzo deux fois hier le matin chez lui, le soir chez Mad. Appony. Chez lui, nous avons très bien causé, lentement, sans bruit ; il ne faut pas que le vent souffle et que le feuillage tremble ; mais à la condition du calme et du silence autour de lui, le rossignol chante encore. Chez Mad. Appony, il avait dîné, il était fatigué ; on remuait dans le salon, la mémoire lui manquait comme la parole. On doit lui mettre aujourd'hui un vésicatoire et des ventouses. Je lui ai demandé qui était son médecin. Il m’a dit Lerminier qui est mort depuis trois ans. Au fond, il a la conscience de son état. " J’ai donné dix ans de ma vie, à l'Empereur en passant dix hivers en Angleterre. Je ne puis faire plus. Je ne sais comment l'Empereur me remplacera. Mais c’est assez." Voilà ce qu’il m'a dit hier matin. Lady Flora Hastings, vivante et morte, l'a peu frappé. Il croit la Reine plus whig qu’aucun Whig et plus hardie que les Whigs les plus hardis. Mais il espère qu'après tout, les Whigs mêmes lui donneront plus de bons que de mauvais conseils. Il est très content de Lord Melbourne.
Adieu. Je pars toujours après-demain. Le beau temps est décidément revenu. Quand mariez-vous Marie ? Adieu. Adieu. G.
220. Baden, Jeudi 18 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
La poste de lundi de Paris n’est arrivé que tout à l'heure. C'est un accident arrivé à la voiture qui a causé ce retard. J'en ai été très alarmé. Mais voici votre lettre et je suis contente. Savez-vous que vos lettres sont bien prudentes. Vous me laissez beaucoup à deviner, et je ne connais au fond vos opinions sur rien. Ainsi pour parler du plus frais, trouvez-vous bon ou mauvais la commutation de la peine de Barbès ? Comment se porte le ministère ? Ces messieurs font-ils bon ménage ? Cela tiendra-t-il jusq'à la session ? Moi j’entends dire beaucoup que la gauche l'emporte, & que Thiers a des chances.
J'ai donné toute ma journée hier et ma matinée aujourd'hui à Lady Carlisle. C'est une bonne personne, un peu ennuyeuse. Elle vient de repartir. Sir John Couroy est arrivé à Bade. J’ai envie de le voir et de le faire parler, ce qui me réussit assez quand je veux. Voici ce que me dit mon frère : " Paul connait bien les lois. Il ne l’est occupé que de cela depuis son arrivée ici ; et parait très observateur des lois ! " " Voici la calcul de ce que la loi vous assigne. Cela a été discuté avec une précision scrupuleuse ! " Après avoir commenté les articles, mon frère trouvant que je suis riche, & que mes fils sont plus que riches, il poursuit : " Il serait inconvenant dans cette position de solliciter une pension du gouvernement. " Et me cite une grande dame dans ma situation qui l'a fait il y a quelques années et ajoute. " Cela a beaucoup déplu et elle a obtenu 10 000 rouble. Cette somme ne vous rendrait pas plus riche. " La question de déplaire ne me touche pas beaucoup, mais en effet je pense que je ne dirai plus un mot de cela, parce que cela m'ennuie. Ce n’est pas à moi à dire. Ces gens-là devraient faire ce qui est convenable sans que j’en parle. Il y a une chose que je regrette, c’est le plaisir de mettre dans l'embarras ou dans le tort. Voilà du mauvais cœur au fond la question n’est pas de savoir si j'ai besoin de cette pension ou non. Elle devait être donnée sans plus. Après cela savez-vous qu'il y a du plaisir à ne devoir rien à personne. J’aime mieux avoir à me venger d'une injustice. Il me semble que je vous parle un peu trop longuement de moi ; mais pour être franche j’ajouterai encore que j'ai hésité et que j'avais commencé une lettre à Orloff excessivement logique & bonne ; je l’ai laissée là. Mon frère fait des calculs très légers dans ce qu’il m'écrit et comme Pahlen part et que c'est mon frère qui va faire le reste, cela m’inquiète un peu. Ainsi il me parle de 400 mille francs da capital pour moi. Cela n'est pas possible. Ensuite il regarde comme éternels des revenus qui finissent dans 2 ans. Je serai obligée de relever tout cela, & de demander des explications, et puis on veut que je donne 355 paysans pour une rente de 9000 francs. Ils valent le double. Ensuite rien que la parole de mes fils comme garantie que la pension me serait payée. Ceci ne regarde que 21 000 fr par an, mais encore faudrait-il vérité. Enfin je prierai mon fière d’y faire attention et le style de sa lettre me prouve que cette observation ne l'étonnera pas. Mes fils auront à ce qu’ils me parait chacun 100 000 francs de rente. J'en suis bien aise. Ils n’ont pas besoin de moi, et de personne. Et cependant, s'ils avaient eu besoin de moi, j'aurais pu conserver des illusions ! Ah, tout est fini de ce côté !
Adieu, vous qui n'êtes pas une illusion, vous qui êtes ma seule vérité. Vérité que je chéris, que je désirais toute ma vie. Ecrivez-moi tous les jours. Vous allez être bien heureux au Val-Richer.
220. Paris, Mardi 16 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne trouve sous ma main ce soir que ce ridicule petit papier. Il me plait pourtant. C'est comme si je vous écrivais à la Terrasse. Je viens de dîner à côté d’elle (la Terrasse) chez le Ministre des finances, avec la Sardaigne, la Prusse et la Belgique qui sont maintenant fort bien ensemble. On dit que sur la frontière, les commissaires belges et hollandais s'accablent de politesses. Le Roi Léopold (vous dites comme moi à présent) j’arrive ici vendredi. Le Duc d'Orléans part le 5 août avec sa femme pour Bordeaux, Bayonne et les Pyrénées. Elle l'accompagnera jusqu'à Port-Vendres, en il s'embarquera pour Alger, de là à Constantine et partout où nous sommes en Afrique.
Madame la Duchesse d'Orléans reviendra à Paris avec Monsieur le duc de Nemours. La cour va ces jours-ci s’établir à St Cloud. Nous sommes assez fiers de notre empire en Orient. Les deux aides de camp du Maréchal ont emporté l’un d'Alexandrie, l’autre de Constantinople, des ordres, l'un pour Ibrahimn, l'autre pour Hafiz Pacha, leur enjoignant de s'arrêter partout où ils seraient, selon le vœu de l’Europe exprimé par la France. Nos deux messagers se seront rejoints la Syrie. M. le Ministre de la guerre m'a développé cela à table en prêtant son accent Allemand à notre vanité Gasconne. Je vais me coucher. Je tombe de sommeil. Adieu. A demain.
Mercredi, midi
Je regrette bien qu’écrire vous fatigue. Ecrire, c’est tout ce qui nous reste pour cet été. Ne voyez là que ce que j'y mets, un regret, pas du tout un reproche. Je ne crois pas bientôt, aux arrangements dont M. de la Redorte vous a parlé. Le Roi ne songe point à remanier son Cabinet. Personne ni, probablement rien ne l'y obligera d’ici à la session. Donc tout restera. Mais le décri est grand. Lady Sandwich que la Reine vient de prendre pour dame d’honneur, est-ce la nôtre ? Pozzo parle mal de Lady Normanby et d’une ou deux autres des Dames, qui entourent la Reine. Elles lui font, et lui feront, dit-il beaucoup de tort.
J’ai vu Zéa ce matin et son frère Colombie. Il passe encore quelques jours à Paris. Il est assez content de ses nouvelles d’Espagne. Pour lui personnellement, elles sont meilleures qu’avant son voyage en Angleterre. Rumigny lui convient fort. Ils ont passé quatre ans ensemble à Dresde. Je ne m'étonne pas de l’insignifiance des lettres qui vous viennent de Pétersbourg. Je ne m'en étonne pas, le genre admis ; car en soi, tout cela est plus qu'étonnant. A l’ouvrage de l'abbé de La Mennais, j'en ajouterais volontiers un autre : de l'indifférence en matière d'affection. Que j’y dirais de choses. Je mourrai gros de vérités qui seront enfouies avec moi.
Vous savez surement que M. de Castillon est à Pétersbourg à l'heure qu’il est, & probablement sur le point d'en repartir pour Paris. Notre correspondance est très active, et vous paraissez très modérés, très conciliants. On croit en général que la mort du Sultan rendra une conférence Européenne moins urgente, et plus inévitable. La paix faite avec Méhémet Ali, tous les Pachas vont en vouloir autant. Avant un an, l'Empire Ottoman sera sans dessus dessous et il faudra bien y pourvoir. Réchid-Pacha repartira probablement pour Constantinople. On dit que c'est l'homme capable. Je l’ai trouvé homme d’esprit mais d’apparence bien chétive et timide. Je vous dis là bien des pauvretés. Je vous envoie le monde comme il est. J’en aimerais mieux un autre. Il est difficile à faire. Si vous étiez là, j'oublierais celui-ci. Adieu. Je vous écrirai encore demain de Paris et samedi du Val-Richer. Adieu. Adieu. G.
220. Paris, Vendredi 8 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai eu quelques personnes hier soir. Tout le monde a, du traité autrichien, la même impression, une impression favorable à la paix ; mais on doute de deux choses, l’une que vous acceptiez purement et simplement, et immédiatement, ce qu’on vous propose ; l'autre que l'Angleterre veuille sérieusement la paix tant que Sébastopol ne sera pas pris et détruit. J’ai aussi les deux doutes. Quand Sébastopol sera-t-il pris ? Pour le moment, je vois là trois assiégés, Sébastopol Canrobert à Mentchikoff. Tous les trois se retranchent dans leurs lignes pour se prémunir contre les attaques imprévues. On peut passer ainsi tout l’hiver. Sébastopol ne tomberait alors que l'été prochain, devant une campagne encore bien plus grande et plus rude que celle-ci. Tenez pour certain que si vous ne faites pas la paix à présent, vous aurez la guerre au printemps sur une bien autre échelle ; après quoi vous ferez une plus mauvaise paix. Si vous êtes décidés à ne pas la faire de 15 ou 20 ans à perdre vos provinces frontières, à vous retirer de plus en plus loin de l'Europe, peut-être aurez-vous le dernier ; il y a, dans cette hypothèse, quelques chances pour vous, mais dans cette hypothèse seulement. Je ne pense pas que même dans cette hypothèse, le succès valût, pour vous, ce qu’il vous aurait couté.
J’ai fait deux ou trois visites hier en revenant de l’Académie. Mad. de Staël est de retour. Montebello est venu me voir comme je rentrais, très préoccupé du traité. Son frère doit arriver en ce moment même, à Balaklava ; il en reviendra promptement. Il n’est allé que porter des récompenses et des encouragements et chercher des renseignements précis sur les besoins. Dumon, qui est venu aussi, avait rencontré Morny au Club des chemins de fer et l’avait trouvé très convaincu de la paix.
Avez-vous lu les discours des généraux San Miguel et Bonnell sur la reine Isabelle, et n’avais-je pas raison de vous dire qu’elle survivrait à cette secousse ? L’esprit monarchique et l’esprit révolutionnaire existent en Espagne ; lequel des deux étouffera l'autre ? Je n'en sais rien ; mais il faudra bien des années, des siècles peut-être, pour l’une ou l'autre victoire.
2 heures
Pas de lettre ce matin. Je n’ai rien à ajouter à celle-ci. Adieu, Adieu. G.
221. Baden, Vendredi 19 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai pas eu un moment à moi depuis que je suis levée. Je m’occupe des réponses à mon frère. Je ne veux rien oublier afin que là on n'oublie rien, c’est long, c'est ennuyeux, mais c’est nécessaire. Et puis j’ai eu une longue visite de M. Humann. Il me plait. Il a l’esprit fort net, et il s’exprime bien. On m'a toujours dit que je sais faire causer les gens. En effet je l'ai beaucoup fait parler, et il n’y a pas une de ses opinions sur les choses et les personnes que je n'ai fait sortir de lui ce matin. Il n’applaudit pas trop à ce qui se passe à Paris. Il voudrait vous et Thiers aux affaires. Le 11 octobre lui parait le bon temps. Le seul bon temps depuis l’année 30.
J’ai passé une mauvaise nuit et comme il fait très chaud aujourd'hui je ne suis pas sortie comme santé je suis plutôt mieux que plus mal. Le médecin veut que je reprenne les bains cela me parait absurde. Il est parfaitement clair qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont affaibli, ils m’ont fait maigrir. Il les veut froid maintenant, mais ai-je assez de forces pour tous ces essais ?
5 heures Voici votre n° 220. Je suis triste de penser que vous allez vous éloigner de moi, et il faut que je songe à toute la joie que vous m'aurez. (C'est mal tourné, c’est égal) pour me combler un peu. Dans ce moment vous êtes bien content, & moi je suis bien seule, toute seule avec un gros orage sur ma tête. L’allocution du Pape sur l'affaire des Évêques en Prusse est une pièce très remarquable. La brèche est sans remède. C'est à l’Autriche que le roi de Prusse doit cela. Elle se venge par Rome des traités de commerce. Adieu. Adieu, cet adieu vous arrive un jour plus tard, et moi comme je vais être retardée ! Que cela me déplaît. Il me semble que c'est aujourd'hui que nous nous séparons vraiment. Adieu. Adieu.
221. Paris, Mercredi 17 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous ne savez certainement pas qu'elle est la famille, la plus populaire de Paris, une famille que tout le peuple de Paris aime et admire. une famille de singes au Jardin du Roi ; vraie famille, père, mère, petits. L'autre jour, un passant leur a jeté un gâteau. Le père a voulu le prendre ; mais le grillage était trop serré ; sa patte n'a pu y passer. Il est allé chercher un de ses petits et l'a amené sur le lieu. Le petit a passé sa patte et pris le gâteau. Mais il l’a mangé. Le père a battu le petit, très battu. Le petit est allé rejoindre sa mère qui l’a consolé, caressé, amadoué, baigné dans leur petit bassin. Puis tout à coup elle a accouru vers le père, s'est ruée sur lui et l'abattu à son tour sans qu’il essayât de se défendre ; au grand applaudissement des spectateurs. Voilà l'histoire dont on vient d'amuser mon dîner. Vous voyez que je vous dis tout.
Je viens de voir, mon pauvre ami Baudrand encore repris d’un accès de rhumatisme goutteux. Il est dans son lit, très souffrant et tout aussi patient quoique fort impatienté. Dès qu’il en pourra sortir, on l'envoie aux eaux de Néris. Tout le monde va aux eaux. M. Molé est parti ce matin. Vous ai-je dit qu'il m'emmène mon petit médecin, celui que j'aime et qui vient voir mes enfants tous les deux jours ? Ce bon jeune homme, qui m'est très attaché, ne savait pas s’il pouvait décemment accepter cette mission. Il était tout près de s'y refuser. Je lui ai vivement recommandé la santé de M. Molé. Il ne peut pas lui souffrir la plus légère indisposition. M. de Montalivet va aussi à Plombières, pour la santé de sa femme qui est fort malade. M. Cousin aussi. Plombières aura son Cabinet.
Jeudi 9 heures
Je relis votre n° 216. Je ne veux de vos pauvres lettres tous les jours qu’autant que cela ne vous coûte pas, & ne vous fatigue pas. Ne faisons rien avec effort. Ainsi vous ne m'écrirez plus que tous les deux jours. J'en ferai autant. Et quand j'aurai quelque vraie nouvelle à vous dire ou quelque envie particulière de vous écrire, je ne me l’interdirais pas. Tous les deux jours, sera l'habitude. Et il y aura des œuvres de surérogation. J’ai mal dormi. Un gros orage est dans l’air. J'aimerais mieux qu’il tombât avant mon départ que pendant la route. L’atmosphère est aussi agitée que la politique est plate.
Midi
Pas de lettre de vous. Cela m'ennuie. D'autant que celle qui viendra demain ne me rejoindra qu'après demain au Val-Richer. J'en ai une de Madame de Talleyrand. Je n'admets pas la compensation. Pourtant elle me tranquillise sur le fond de votre santé de l'avis de votre médecin. Ce n’est pas tout pour moi, bien s'en faut ; je ne me contente pas de ce qui ne vous fait pas encore mourir, comme vous dîtes ; mais c’est le sine qua non. Malheureusement, pour le reste, je ne puis rien de loin.
Le Sultan est mort le 27 juin et non pas le 30. On a caché sa mort pendant trois jours. Nous croyons de plus en plus sinon à un Congrès ou à une conférence du moins à un concert Européen, dont Vienne serait le centre. Vous vous montrez moins éloignés de vous y prêter. On avait eu quelque envie d'avoir pour les fêtes de Juillet une grande revue de la garde nationale. On y renonce. Le goût de l’amnistie est moins répandu qu’en 1837. En 1836, on a supprimé, la revue de peur des assassins. Aujourd’hui autre cause même effet. Cela se dit en latin : similia e contrario. Mais ce n’est pas du latin diplomatique.
Pozzo est venu me voir hier. Je n’y étais pas. Je le regrette. Je ne sais comment je le retrouverai à mon retour. S'il ne met pas son estomac à un régime plus sévère, sa tête ne résistera pas. Savez-vous que l'Angleterre avait demandé l’occupation de Bassora par un corps de troupes anglaises, comme garantie de sa sûreté dans l’Inde ? La proposition a été écartée à Constantinople. Adieu.
Dans quelques heures, je serai sur la grande route, mais vers l'ouest et non vers l'est. Vous auriez beaucoup de choses à me dire que vous ne me dîtes pas. Et moi aussi. Adieu. Adieu G.
221. Paris, Vendredi 8 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
L’amiral Hamelin revient Bruat prend le commandement de la flotte Française. Aussi bon marin, et plus entreprenant. Vous aurez vu, dans le Moniteur, qu’il était à terre le 14, au moment où le grand ouragan a éclaté, et qu’il s'était sur le champ mis à la mer, dans un canot, pour aller rejoindre son vaisseau, ce qu’il a fait avec la plus grande peine et le plus grand péril. Le récit de cet ouragan, par un officier à bord du Napoléon, est très dramatique. Vous ne l'aurez peut-être pas remarqué.
On raconte que la Princesse Mathilde passant sur le quai des Tuileries, et apercevant un homme de sa connaissance, le duc Blanchot à qui elle avait quelque chose à dire, a fait arrêter sa voiture. Elle avait à la main en lui parlant, un petit portefeuille, et elle lui a dit : " Vous ne devineriez pas ce que j’ai là dedans ? - Quoi donc ? - Vingt cinq mille francs que l'Empereur vient de me payer. - Et pourquoi ? - J’avais parié contre lui que, quand on se battrait à l’armée, mon frère n'y resterait pas. Il a reconnu que j’avais gagné et il m’a payé."
On raconte aussi beaucoup de paroles, de colère de votre Empereur contre l'Empereur d’Autriche ; trop violentes pour que je vous les redise.
2 heures
Je reçois votre lettre trop tard pour y répondre. aujourd’hui comme vous le désirez. Je le ferai demain. Il y faut le ton et la mesure, justes. Vous avez trop d’esprit pour croire que les foudres de Constantin, quand elles éclateraient, dissiperaient les préventions dont vous êtes l'objet, les préventions résisteraient à de bien autres témoignages. Ce ne serait pas le premier exemple d’un souverain se brouillant. avec son serviteur et le maltraitant pour le mieux accréditer. Tenez pour certain que ce serait là ce qu’on dirait et ce qu’on croirait. Il faut toujours voir les choses comme elles sont Adieu, Adieu.
222. Baden, Samedi 20 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Une bien mauvaise nuit. Une bien mauvaise matinée, un mal de tête nerveux abominable, voilà de beaux éléments pour une lettre ! Celle qui m’est venue de vous hier est fort intéressante, je vous en remercie. Vraiment ici à Baden on est étonné de l’affaire Barbés, elle est peut être oubliée à Paris. Mais il me semble que l’effet n'y a pas été bon non plus, car les journaux ministériels se taisent, et les autres ont des articles abominables.
Dimanche 21 5 heures
Vous voyez que j'ai été bien peu capable d'écriture. J'ai souffert de maux de tête horribles. Je suis un peu mieux dans ce moment-ci. On me dit que cela tient au temps qui est à l'orage. C'est des bêtises. J'ai mal parce que je suis malade. J’ai reçu votre dernière lettre de Paris. Dites-moi pourquoi vous n’êtes pas retourné à Neuilly avant votre départ. Je vous remercie beaucoup d’avoir procuré la course du courrier à M. de Castillon.
Je sais de Berlin que la conférence de Vienne n’est pas aussi sûre que le dit M. de Metternich. Il est bien actif dans ce moment. Moi je le suis aussi on du moins j'essaye de l'être, demain j'envoie un gros volume à mon frère. J'aurais voulu vous consulter sur tout. J'ai eu ce matin une longue visite de Sir John Courey, il m’a tout raconté. Savez-vous qui est au fond de tout cela ? Léopold. Depuis l’année 35 il a brouillé la mère et la fille afin de gouverner celle-ci. L'instrument est Letzech. Il n’a réussi qu'à brouiller, mais non à gouverner.
Voyez quel griffonnage, il m’en coûte un peu d'écrire. Et quelle pauvre lettre ! Vous la recevrez bien mal. Il me semble qu’elle n’est là que pour faire acte d'existence. Vous n'en voulez que tous les deux jours vous avez raison, mes lettres sont trop bêtes. J'en ai reçu de Lord Grey ce matin. Il est très anti ministériel et parle des Chartistes avec le plus grand dédain. Il m’invite beaucoup à venir à Hewish, s’il était plus près J’irais. Adieu. Adieu. Que de choses j’ai à vous dire, à vous demander. Ah que nous sommes loin, & que le temps est long encore. Adieu mille fois et bien tendrement.
222. [Paris], Dimanche 10 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ne vous livrez pas à votre premier mouvement de révolte. Il en résulterait, pour vous d'abord une lutte puis un isolement que vous ne supporteriez pas. Ce qu’il faut consulter avant tout, dans ses résolutions, c’est sa force, force d'âme et de corps. Nice est le moyen terme dans lequel il me paraît possible et convenable de vous établir, le but qu’il faut pour tout le monde, assigner. à tous vos mouvements. Cela explique et facilite tout, à Paris et à Pétersbourg, à présent, et plus tard.
Constantin me déplait ; non pas pour vous dire ce qu’il pense et vous blâmer de ce qu’il suppose, mais pour vouloir se brouiller avec vous. Il y a des liens que rien ne peut rompre & des amitiés qui doivent survivre à toutes les dissidences. Je ne puis croire que les projets de brouillerie aillent jusqu’à ne pas vous payer ce qu’on vous doit. Ceci dépasserait toute permission. Les dettes d’affaires sont indépendantes des peines de cœur. Il serait trop commode de s’acquitter avec du chagrin.
Voilà deux visites qui m’arrivent. Je n’ai pas le temps de vous dire plus, adieu, adieu. G.
222. Val-Richer, Samedi 20 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je sors de mon lit. Je suis arrivé hier avec une grosse migraine. J’ai dormi stupidement et la migraine a disparu. Il fait très beau. Mes enfants sont ravis de me revoir. Mais je n’ai point de joies complètes sans vous, pas plus qu'avec vous. Voilà vos numéros 217 et 218. Je ne sais pourquoi je n’ai pas eu le premier avant-hier à Paris ! J’ai été deux jours sans lettres et point par votre faute. Outre le chagrin, il y a pour moi beaucoup d'étonnement quand un jour s’écoule sans que vous y ayez pris votre place. Je suis lente de dire comme Titus. Certainement, il n’aimait pas autant Bérénice. Ne soyez donc pas si près de la foudre. Je n'aime pas les dangers passés. Ils menacent.
Je suis charmé que vos arrangements de fortune soient conclus. J’attends le détail avec impatience ; mais je suis tranquille, puisque votre situation reste la même. J'en étais très, très préoccupé. Je ne me fie à personne chez vous et pour vous. Rien ne peut plus m'étonner de là, si ce n'est le bien. Que cette conclusion donne au moins à vos nerfs un peu de repos. Vous pourrez à présent régler d’une façon définitive le matériel de votre vie. Est-ce bien conclu ? Y a-t-il quelque chose de réglé pour le partage des meubles, tant ceux de Pétersbourg que le capital de Londres ? Tout sera-t-il bientôt effectivement exécuté ? Je vous demande là ce que vous me direz probablement demain. A demain aussi plusieurs petites choses que j’ai à vous dire. Le facteur me presse pour repartir.
Adieu. Adieu. Vous aurez été deux jours aussi sans lettres et celle-ci n'est rien. Continuez d’être mieux. Je vous le demande. Je vous en conjure et je vous l'ordonne. Adieu. Adieu. G.
223. Baden, Lundi 22 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah quel ennui que des lettres d’affaires surtout quand on les comprend aussi mal que moi. Je suis sûre que vous m'auriez bien mieux enseigné ce que j'avais à dire et à décider. Mais vous êtes trop loin, c’est trop volumineux et je n'ai eu la force ni les yeux pour des copies. Ces deux jours d'écriture m'ont abîmé la vue. Les orages se succèdent ici. Nous ne connaissons que cela. Personne n’arrive, et quelques personnes partent ainsi je vais perdre M. de Malzahen. Il est obligé par les ordres de Werther de retourner à Vienne pour prendre part à des conférences sur l'Orient qui n’auront pas lieu à ce que je crois à moins que ce ne soit strictement pour régler les affaires entre le Sultan et le Pacha, et le tout sans bruit, sans éclat.
Mardi 8 heures
Voici deux grands jours passés sans lettre. Cela m’attriste. J’espère qu'aujourd'hui j’en aurai M. Hummann est venu hier encore il quitte Baden demain. Je lui ai trouvé hier moins d’esprit. Il me faut beaucoup pour se soutenir auprès de moi. J'aime la société des gens qui me font faire de nouvelles découvertes mais je suis bientôt ennuyée quand toute la dépense s’est fait le premier jour. Et deux représentations de la même pièce c’est trop. Voilà ce qui fait que je suis si peu accusable, et que Baden m’est odieux. Je n’aime que la Terrasse à midi et demi ! c’est toujours nouveau, toujours charmant.
5 heures
J'ai eu une lettre de Mad. de Flahaut de Londres dans laquelle elle me mande que la Duchesse de Kent menace de quitter l'Angleterre. le Duc de Willegton s’emploie pour l’en empêcher, mais on doute qu'il réussisse. Je suppose que Conroy attend ici le dénouement. Mad. de Flahaut me dit aussi que Lady Cowper allait épouser Lord Palmerston. J’attends qu’elle me le dise elle-même.
Voici votre 222. Je ne sais si je vous ai dit en détail mes affaires, dans ce que j’ai écrit hier à mon frère j’ai accepté le projet de rente payée par mes fils sans hypothèques ; 21 000 francs. J'ai demandé qu'on m'envoie le tableau des capitaux et de l’époque où j’aurai à les toucher... De même où et par quelle main je toucherai le revenu des arendes, l’une pour 20 ans des 6000 fr ; l’autre pour 2 de 10 000. J’ai prié qu'on procède de suite au partage du mobilier. J'ai fait observer que la loi m'adjuge une part égale à celle de mes fils dans le mobilier en Courlande enfin je n’ai rien négligé en fait d’interrogations ou d’instructions, mais tout cela va tomber au milieu des fêtes, des départs, des manœuvres. Ce sera miracle si on y pense.
Je viens de voir deux diplomates le comte Buol qui est venu ici de Stuttgart pour passer quelque jours avec moi. Et M. Desbrown ministre d'Angleterre à La Haye. Il vient de Londres, il est plus Tory que Whig. Il croit que Peel va arriver ici. L'autre Buol a beaucoup d’Esprit, et d’indépendance dans l’esprit. Il me plaît beaucoup. Le Prince Emile de Hesse est arrivé ce matin, je ne l’ai pas vu encore. Je suis plus souffrante aujourd'hui que je ne l'avais été ces derniers jours. Le médecin me trouve le pouls bien nerveux. Je n’ai pas de raison à donner pour cela. Adieu. Adieu. Je suis impatiente de votre prochaine lettre, et ce sera toujours ainsi. Adieu.
223. Paris, Lundi 11 décembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Votre N°184 m’arrive de bonne heure. Comment pouvez-vous dire que vous ne “ recevez plus de moi, pour ce qui vous regarde, que des paroles de soupçons et de découragement. " Est-ce de moi-même et de mes propres sentiments que je vous parle quand je vous redis ce que j'entends dire, ce qu’on me donne à lire, et ce qu’on me laisse entrevoir quand on ne me le dit pas. Je vous le redis pour que vous sachiez exactement ce qui en est, première condition pour faire ce qu’il faut. Je ne veux pas croire un moment que vous ayez regardé un moment comme venant de moi ce que je vous envoyais de la part de mes conversations. Je vous gronderais trop fort, et à aucun prix, je ne veux vous gronder. Votre santé et votre tristesse me poursuivent tout le jour. Je cherche tout le jour quelque moyen de presser. la solution que nous désirons. Malheureusement je n'en trouve guère, et je crains que si nous voulions trop presser, nous ne fissions que nuire. Je suis charmé que vous ayez renoncé de vous-même à l’idée d’écrire à l'Emp. Nap. ; je trouvais cela peu convenable. En tout cas, il n’eût fallu le faire que de l’avis et de l'aveu de Morny. C'est lui que vous avez chargé de votre affaire là. Il est, sans comparaison, le plus capable de réussir et le mieux disposé. Je ne suis pas d'avis que vous écriviez à Fould sans avoir demandé à M. s'il le croit utile. Fould vous a écrit plusieurs fois ; vous lui avez écrit ; il est naturel que vous lui parliez de ce qui vous intéresse si fort, et peut-être étant toujours là, pourrait-il trouver le moment de vous servir. Mais ne le faites que M prévenu et consentant. Vous avez ce me semble, une très bonne et très naturelle raison de réécrire à M. sans attendre sa réponse à votre dernière lettre. Parlez-lui, de l’idée de Nice ; mettez-vous sur ce terrain là qui facilite tout pour lui et pour l'Empereur lui-même. Je l'éprouve dans la conversation ; hier à dîner chez Mad. de Boigne, elle m’a parlé de vous, de vos projets. J’ai répondu par votre santé, Andral et Nice. Non seulement à elle, mais au chancelier, à Dumon, à Viel Castel qui étaient là, cela a paru naturel et faisable. Si vous écrivez sans retard à M. sur ce thème, avertissez-moi ; j’irai le voir pour en causer avec lui. J'hésite à aller le voir uniquement pour le presser, sans rien de nouveau à lui demander ou à lui dire. Je sais que c’est très triste et très dur de vous prêcher la patience quand vous êtes dans l'impatience et la souffrance ; mais avant tout et par-dessus tout je ne veux ni vous conseiller, ni faire pour vous que ce qui peut réellement vous servir.
Il court ici toute sorte de bruits. Mad. Kal. a dit à celui de qui je le tiens qu’elle tenait de Mad Chreptovitch. qui sans doute a passé par Paris en revenant de Stuttgart comme en y allant, que le Prince Gortschakoff avait écrit de Vienne à la grande Duchesse Olga qu’il avait porté au comte Bual l'acceptation pure et simple des quatre points par votre Empereur, sur quoi Bual s'était grandement réjoui, disant : " Nous ne vous battrons donc plus qu'autour de ce tapis vert." Mad. Kal. a dit en outre que son père lui écrivait de Varsovie qu'au tour que prenaient les choses, elle pourrait passer tranquillement l’hiver à Paris, ce qu’il ne croyait pas du tout quelques jours auparavant. Qu’il y a loin de ces perspectives là aux derniers articles du Times répétés par le Moniteur ? Je reçois à l’instant une lettre de Duchâtel qui me dit : " Il n’y aurait que la paix de sensée pour tout le monde, si toutefois l'Emp. Nicolas comprend sa position et consent à des conditions raisonnables. Je doute qu’il le fasse. Ces concessions jusqu'à présent n’ont été que des ruses diplomatiques, et il agit toujours, en vrai grec, retenant par dessous main, ce qu’il semble donner et cherchant, sans cesse à filouter ses adversaires. Pardon des expressions ; mais voilà l'impression actuelle des spectateurs intelligents et pas malveillants.
Duchâtel me demande de vos nouvelles en ajoutant : " Voudriez-vous lui offrir l'hommage de mon respectueux, et triste attachement ? " Il arrive aussi ce matin, dans ma maison, une lettre de Sébastopol d’un petit soldat au 20e d'infanterie légère qui écrit à sa mère. nourrice de ma fille Pauline, qu’il a été blessé d’un coup de baïonnette à la main, dans la dernière sortie des Russes et qu’il a tué de la sienne, le Russe qui l’avait blessé : " C'est le premier que je tue avec ma baïonnette ; j’aime mieux les tuer avec des balles ; c’est moins triste. Au moment où je t'écris le 22 Nov.) le canon gronde toujours ; nos tranchées ne sont pas à 200 mètres de la ville. Ils établissent des batteries jusques dans les maisons, ce qui fait qu’elle sera un peu abimée. On attend de nouveaux renforts pour donner l’assaut, car il fait froid. On nous a donné des capotes à capuchon, ainsi que des paletots en peau de mouton, ce qui est très chaud, et on doit nous donner aussi des guêtres fourrées." Voilà le dire des soldats. La lettre n’offre aucune trace de découragement.
Adieu, Adieu. Du courage, je vous en conjure. Adieu. G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Correspondance, Femme (diplomatie), Femme (politique), Femme (statut social), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Russie), Relation François-Dorothée (Dispute), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)
223. Val-Richer, Samedi 20 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai trouvé mes enfants très bien. Cependant Guillaume tousse un peu depuis quinze jours. Il mange et dort parfaitement. Il est très gai. Mon médecin dit que ce n’est rien du tout et que quelques pastilles d’ipécacuanha l’en débarrasseront.
Le Duc de Wellington s’est bien fâché contre Lord Melbourne. J'en ai été un peu surpris. Non qu’il n’eût parfaitement raison ; mais au dire de Pozzo, il y a entre eux la meilleure, intelligence ; et Lord Melbourne ne fait à peu près rien sans s'en être de près ou de loin, entendu avec le duc. Du reste il arrive à Birmingham ce qui arrive dans les grandes villes des Etats Unis d'Amérique, ce qui arrivera partout où la contagion de l'esprit démocratique aura atteint le gouvernement lui-même. On élit des magistrats mais il n’y en a plus. Il n’y a que des adorateurs et des serviteurs de la multitude. Elle est pour eux ce qu’était le Pape au Moyen-Âge pour l’Europe chrétienne. Leur premier mouvement est de la croire infaillible, et ils ne se décident à la réprimer un peu qu’en cas de nécessité absolue et après les derniers excès. Lord John s'est mieux défendu aux Communes que Lord Melbourne chez les Lords. Lord Melbourne a toujours l’air d’un homme qu'on réveille en souriant, et qui dit : " Laissez-moi tranquille. Pourquoi me tracassez-vous ? Croyez-vous que je sois là pour mon plaisir ? J’y suis pour vous empêcher d'être dévorés par cette bête. féroce. " Le Parlement ne sera prorogé que dans la seconde quinzaine d'août.
8 heures
Je rentre de bonne heure quoiqu’il fasse beau. Les soirées normandes sont trop humides pour moi. Je retomberais dans ces éternuements insensés qui m'hébètent et me fatiguent. Décidément, l’atmosphère du midi est la seule agréable la seule ou la chaleur ne soit pas celle d’une étuve et la fraîcheur celle d'une cave. C'est bien dommage que le proverbe ait raison : " Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. " J’aimerais bien à choisir mon herbe. A tout prendre, je me suis assez réglé, dominé, gouverné selon la raison, et je passe pour cela. Mais il me prend quelquefois de furieux accès de fantaisie, un désir passionné de n'en croire que mon goût mon plaisir. Personne ne saura jamais ce qu'il ma fallu d'effort la semaine dernière pour ne pas partir pour Baden dans la journée, et y aller voir moi-même.
Dimanche 6 h. 1/2
Je me lève de bonne heure ici, comme vous à Baden. Le calme du matin est charmant. La nature est animée et il n'y a point de bruit. Je crois que je travaillerai beaucoup, et avec plaisir. Pourvu qu’on ne vienne pas trop me voir. J’attends la semaine prochaine M. et Mad. Lenormant ; puis M. Devaines et son fils, puis M. Rossi. Mad. de Boigne qui ira passer un mois chez Mad. de Chastenay, près Caen, me fera une visite en passant. Ma route n'est pas tout à fait achevée. Cela éloignera quelques personnes.
Ne mettez pas grande importance, à ce que vous lisez dans les journaux sur les dissensions intérieures du Cabinet, sur le travail de M. Dufaure au profit, de la gauche, &. On essaie d’amener cela en le disant ; mais cela n'est point. Il n’y a dans le Cabinet point de dissensions, point de travail de personne au profit de personne. Ils sont tous contents d'être où ils sont, chacun tâche à se maintenir bien avec ses anciens amis pour en tirer quelque appui, M. Dufaure avec la gauche, M. Duchâtel avec le centre ; mais tout cela, sans conséquence. Au fait, ils s'accordent sans peine ; et quand ils différent, chacun dit son avis, le Roi décide, et ils n’y pensent plus.
9 heures
Je suis désolé que le courrier vous ait manqué. J’aime mieux que cela soit tombé sur le jour où vous avez eu Lady Carlisle. Lady Granville m’avait dit qu’elle irait passer une journée avec vous. Merci de ce premier aperçu sur vos arrangements. Ils me conviennent, à présent, il me faut les détails. Adieu. Adieu. Vous aurez été bien rassurés sur Paris. Adieu dearest. G.
224. Baden, Jeudi 25 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici encore votre N°222 vous m’avez envoyé vos lettres deux jours de suite comme je vous l’ai proposé ; et moi attendu que vous me redemandiez l’alternat je ne vous ai pas écrit avant hier. Il y a confusion dans le ménage, mais j’aime mieux ce que vous avez fait que ce que vous avez dit. Et peut-être me rendrez-vous ceci à l’inverse. Je vous écris par un orage effroyable. Il n’y a que cela à Bade. C'est insoutenable. Et je n’aime pas l'orage par dessus la solitude. J'ai cependant quelques petites distractions, mais bien petites. Le Prince Emile de Darmstadt, M. de Blittersdorff qui a de l'esprit et qui sait des nouvelles. Le prince de Montfort fils de Jérôme Bonaparte qui est bête ! Le comte Buol, très agréable. Le prince Emile regarde l’affaire du mariage comme décidée. Il m’a conté beaucoup de détails qui m'ont intéressés. Mon grand Duc était amoureux de l'Angleterre moins la petite Reine qu’il n’aime pas du tout, et il a raison.
Voici la Turquie en train de redevenir plus que jamais la grosse affaire de l'Europe. Outre la destruction de l’armée turque en Syrie, le Capitaine Pacha est parti avec sa flotte en dépit des ordres de Constantinople et attend à Rhodes comment les partis vont se dessiner en Turquie. c.a.d. qu'il donne à tous les autres Pachas l'exemple de l’indépendance. Dans cet état de choses la crise de l’Empire ottoman est imminente et nous ne tarderons pas à reparaître sur la scène. J'ai des lettres de Lady Cowper, de Lady Granville. J'ai peu de forces pour répondre. Je suis toujours fatiguée, sans jamais rien faire pour cela, car je marche fort peu. Mad. de Flahaut m’invite beaucoup à aller la trouver à Wisbade, elle y sera dans huit ou dix jours. Si Bade ne me plaît pas plus qu’il ne m’a plu jusqu'ici, il se peut que j'y aille. Et cependant je suis les déplacements. Tout est pour moi un effort.
5 heures. Voici votre lettre. Décidément tous les jours est une bonne invention et j'y reste pourvu que vous y restiez. Nous faisons un peu comme lorsqu'on marche ensemble. hors de mesure et que chacun de son côté cherche à la rattraper ? Je parie que maintenant vous allez être en défaut. Je me suis séparée de Malzahn aujourd'hui avec regret. Sans avoir beaucoup d'esprit, il en a et du jugement. Il connait bien les affaires. Cela me faisait une ressource. Il vaut mieux qu'Armin, vous l’aimeriez à Paris, et son extérieur est parfaitement bien. Il m’est venu aujourd'hui une nouvelle vieille connaissance le Prince Gustave de Muklembourg Schwerin oncle de la duchesse d’Orléans. C'est un ennuyeux, mais plein d’humilité et bon garçon je crois.
Je vous demande pardon de la mauvaise tournure de me première feuille. J'ai pris la feuille à rebours Il y a de grands commérages et de grands scandales à Bade. Et cette pauvre petite Madame Welleiley fort gentille et innocente petite femme est fort troublée d'un bien vilain article qui a paru dans les journaux Anglais sur son compte. Son mari n’a pas assez d’esprit pour traiter cela comme il convient, et je crains qu’il ne soit cause de plus de publicité qu’il n’est nécessaire. Les procès sont des bêtises.
Adieu Adieu. Voulez-vous avoir un mot de M. Royer Collard à propos de l’effet qu’a produit la commutation de la peine de Barbés " tout n’est pas perdu, quand la lâcheté révolte. " Je vous prie d'oublier que c’est moi qui vous ai dit cela. Adieu encore mille fois de tout mon cœur.