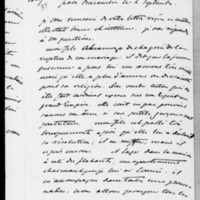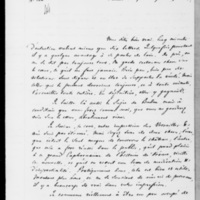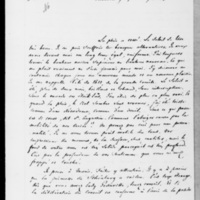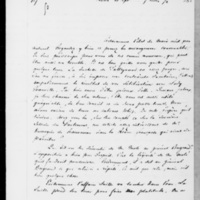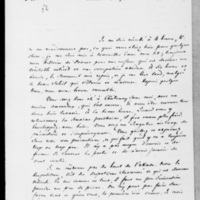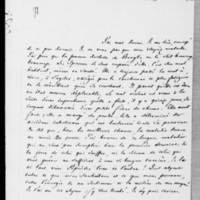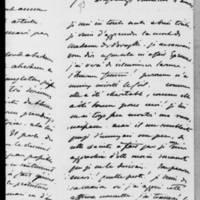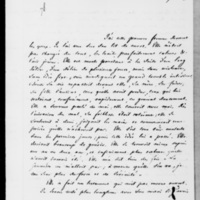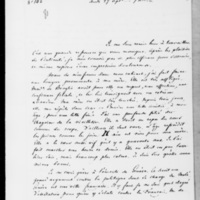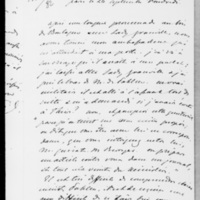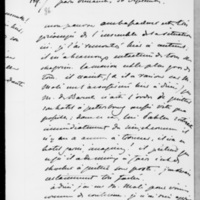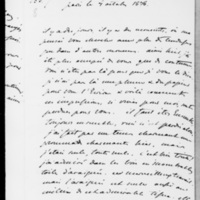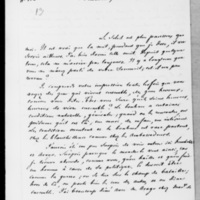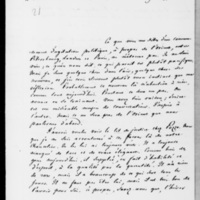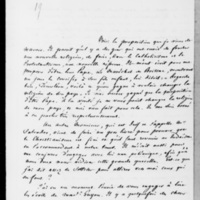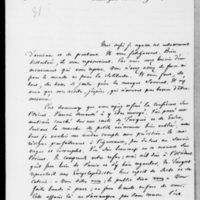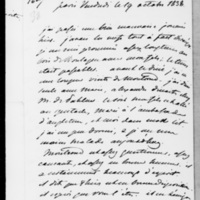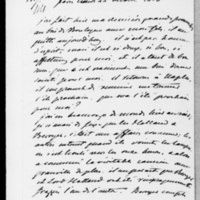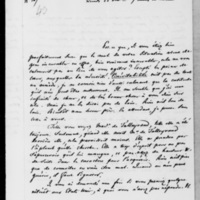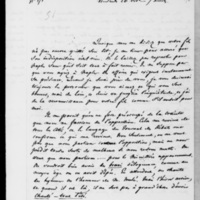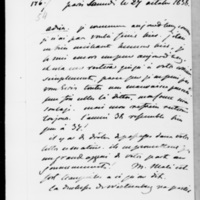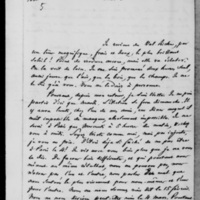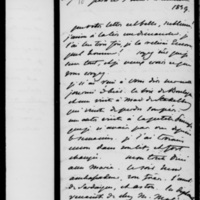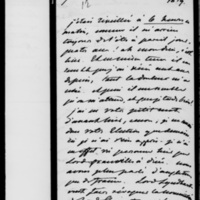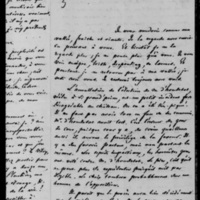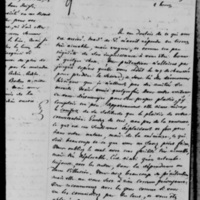Votre recherche dans le corpus : 1712 résultats dans 3515 notices du site.
117. Caen, Samedi 1er septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous allons rentrer dans toute la régularité de nos habitudes. Il vous aura manqué une lettre. J’attendais les vôtres sans savoir à quelle heure elles viendraient. Physiquement aussi, je suis bien aise de rentrer chez moi. Cette vie de banquets, de courses, de bavardage incessant, commence à me fatiguer. Elle ne m’a jamais plu. Pour que je m’arrange du monde, il faut que les affaires ou ses agréments vaillent la peine que je prends pour lui. Vous avez votre fils. Je regrette de ne pas le voir. Vous me direz s’il a bien du chagrin de la rupture de son mariage. Mlle de T. ne le désirait donc pas bien vivement. Vous avez, je crois, bien fait d’insister. Il faut beaucoup d’amour et une grande supériorité d’esprit pour que la différence de religion, quand l’un et l’autre y tiennent, ne devienne pas, dans le cours de la vie une vraie peine. A-t-il renoncé à tout espoir ? Il me semble aussi que dans son pays même son père à part, l’abandon de tous ses enfants au catholicisme lui ferait grand tort.
Je compte trouver une lettre au Val Richer. Elle me dira si vous êtes toujours aussi souffrante. Mandez- moi avec détail ce que dit Chemside. Je ne comprends pas votre abominable temps. Ici, il fait très beau, frais, mais point froid. Vous avez bien tort de ne pas venir en Normandie. Où avez-vous logé votre fils ? Se promène-t-il habituellement avec vous ? J’étais sûr que l’archevêque ferait ce qu’il a fait. Je trouve du reste qu’on l’a pris bien vivement. Il y avait des façons moins brutales que l’article des Débats pour lui faire sentir l’inconvenance de son discours. Inconvenance à laquelle on devait s’attendre ; comment veut-on qu’un archevêque, et surtout celui-là, ne laisse pas percer quelque humeur des nouveaux échecs que reçoit de notre temps l’unité de la foi.
M. Molé n’était pas auprès du Roi, aux Tuileries, le jour où il a reçu les députés. Ils en ont été très choqués. On m’écrit que la tête lui tourne un peu. Champlâtreux n’est pourtant pas un bien grand verre de vie. La médaille est de trop. C’est encore plus que le tableau. On ne viendra pas à bout de notre temps, de faire de grands événements avec de petits incidents. Il ne faut pas les traiter de la même façon. M. Dupin n’est pas venu aux couches parce qu’on ne l’avait pas pris pour témoin. Je ne saurais dire combien cet abandon de cette pauvre Princesse tout de suite après ses couches, m’a frappé. Voilà bien les entraînements, les oublis, les distractions des cours. Pour tous ceux qui étaient là, le monde entier avait disparu devant ce petit garçon. Et si elle était morte ! Quel tableau eût fait de cette scène M de St. Simon ! Donnez-moi quelque nouvelle de l’affaire suisse. Il me paraît que Louis Buonaparte ne s’en va pas de lui-même. Cela peut devenir embarrassant. Adieu.
Je vais déjeuner et monter en voiture. Je traverserai une très belle vallée sous un très beau soleil, par une très belle route. Vous me manquerez infiniment. Si je parlais la langue de Pétrarque, je vous dirais que dès qu’il s’élève dans mon âme une impression douce, elle me quitte et va vous chercher Si elle vous trouve elle me revient. si elle ne vous trouve pas, elle me quitte tout-à-fait. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Enfants (Benckendorff), Politique (France), Religion, Vie familiale (Dorothée)
123. Paris, Dimanche 2 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre lettre reçue ce matin ; elle était bonne et intime. Je vais répondre à vos questions. Mon fils a beaucoup de chagrin de la rupture de son mariage. Il dit que la jeune personne a pour lui un amour très visible mais qu’elle a plus d’amour ou de crainte pour sa religion. Son oncle Acton qui va être fait cardinal exerce sur son esprit un grand empire. Elle croit ne pas pouvoir sauver son âme si ses petits garçons sont protestants. Mon fils est parti très brusquement après qu’elle lui a déclaré sa résolution ; il ne souffre, mais il espère encore. Il loge dans la maison à côté de Flahaut un appartement charmant que je lui ai trouvé. Il m’accompagne dans toutes mes promenades. Nous allons presque tous les jours à St Cloud. Longchamp depuis votre départ m’a paru bien ennuyeux.
Tout le monde parle de l’affaire de la Suisse sans comprendre comment elle finira. Louis Bonaparte y reste, cela est sûr. Pour le moment je pense que le rappel de l'Ambassadeur sera la seule mesure qu'on prendra, mais c’est peu de chose. Nous nous retirerons peut-être aussi tous les trois, mais les Suisses s’en consoleront. On s’étonne un peu que la Russie ait si vite et si fermement soutenue là dedans votre gouvernement. Mais c’est que, à part les caresses, vous nous trouverez peut-être meilleurs collègues que tous les autres. L’Empereur évite tout ce qui peut vous donner ombrage. Par exemple il n'a jamais reçu chez lui à Toplitz La Feronnays ou Marmont. Il ne les a vus qu'à leur promenade publique. Il a toujours beaucoup aimé M. de La Ferronays. M de Stakelberg a donné hier à dîner à mon fils qui a longtemps servi sous ses ordres. J’y ai dîné aussi & mon Ambassadeur & Médem. De là j'ai été à Auteuil. J’y ai trouvé M. Molé très entouré de la diplomatie. Il me dit qu’il est plus que jamais accablé de travail. Il a pris l’intérieur dans l'absence de M. de Montalivet. Il y avait hier plus de monde que de coutume à Auteuil. On ne sait pas où est l’Empereur de Russie dans ce moment. Il est attendu partout, et il ne parait nulle part. Le 15 Septembre lui & l’Impératrice seront. à Berlin.
Les derniers mots de votre lettre me plaisent et me font du bien. J'ai l’âme un peu moins triste depuis l'arrivée de mon fils, mais toujours ce silence inexpliqué de mon mari me donne beaucoup de chagrin. Je ne sais que penser, et l’avenir me parait abominable. Mon fils aîné me mande que si sa situation secondaire doit se prolonger il quittera le service, & pour ce cas l'idée de venir vivre auprès de moi est ce qui la donne le plus de plaisir. Adieu. Adieu. Adieu, trouvez-vous que c'est assez ? Par moi.
124. Val-Richer, Samedi 8 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous dites bien vrai. Cinq minutes d’entretien valent mieux que dix lettres. Quelque fois pourtant il y a quelque avantage à se parler de loin de près, on ne se dit pas toujours tout. On garde certaines choses sur le cœur, ce qu’il ne faut jamais. Bien peu, bien peu de relations sont dignes et en état de supporter la vérité. Mais celles qui le peuvent devraient toujours, et à toute minute, l’accueillir toute entière. En définitive elles y gagnent. Je laisse la aussi, le sujet de Baden, mais à condition que vous ferez comme moi, que vous ne garderez rien, sur le cœur absolument, rien.
Je devine je crois votre impression sur Versailles et n’en suis pas étonné. Mais soyez sûre de deux choses, l’une que c’était le seul moyen de conserver le château, l’autre, que cela a fort réussi dans le public, qu’il prend plaisir à ce grand Capharnaüm de l’histoire de France, vieille et nouvelle, et qu’il en reçoit une leçon de modération et d’impartialité. Pratiquement donc cela est bien et utile. Montant plus haut, et ne se souciant de rien ni de personne, il y a beaucoup de vrai dans votre impression.
Je commence réellement à être un peu occupé de l’affaire de Suisse. Cependant je crois comme vous, qu’il n’en sortira rien que du ridicule. Rien, c’est la passion du temps. Mais si l’affaire n’est pas finie au moment de la session de manière ou d’autre, la discussion sera désagréable pour le Cabinet.
J’ai M. et Mad. Lenormant depuis deux jours. Ils partent aujourd’hui. Ils ont amené leurs trois enfants qui joints aux trois miens, font un grand bruit dans le tranquille Val-Richer. J’ai été consterné hier matin, en voyant tomber des torrents de pluie noire. La journée est longue quand on ne peut pas promener ses hôtes. Mais à midi, il ne pleuvait plus. J’ai conseillé de braver les nuages et notre courage a été récompensé. Le soleil est venu. Le terrain que j’ai choisi n’était pas trop mouillé. Nous avons fait une agréable promenade. Il n’y a rien eu ici avant- hier qui ressemble à votre orage.
On me dit que M. de Châteaubriand est revenu très frappé de l’état du midi de la décadence du Carlisme, et des progrès de l’esprit nouveau. Il vient d’écrire à Melle de Fontanes, une longue lettre très agréable, dit-on, sur le souvenir et le talent de son père. Cette lettre doit servir de Préface aux œuvres de M. de Fontanes que sa fille va publier. Je n’accepte pas votre envie. Oui, nous sommes des êtres, horriblement jaloux, mais non pour toutes choses, ni de tous. Je ne porte pas, la moindre envie aux possesseurs de parcs et de châteaux qui ne sont pas à moi. Je suis charmé qu’ils les aient et qu’ils en jouissent, et il ne m’est jamais entré, dans l’âme, à leur sujet, le plus léger sentiment d’amertume ou de tristesse. Seulement le plaisir d’y regarder s’use vite pour moi, parce que je n’y porte pas non plus cet inépuisable intérêt très naturel et très légitime, qui s’attache, pour chacun de nous à notre propre existence et à tout ce qui y tient de près ou de loin. Il y a, dans l’égoïsme, comme dans tous les sentiments naturels et universels, une part très légitime, juste en soi et nécessaire à la marche du monde. Il faut accepter hautement cette part là en lui assignant sa limite.
La Duchesse de Talleyrand revient-elle décidément ? Je suppose que le Duc de Noailles est retourné à Maintenon. Pour vous, vous y avez tout à fait renoncé, n’est-ce pas ? On me dit que Mad. Pasquier va tout à fait mourir. Je penche fort à croire que le Chancelier finira par épouser Mad. de Boigne ; et à mon avis, ils auront raison tous les deux. Ils finiront doucement leur vie ensemble sans avoir la peine d’aller se chercher deux ou trois fois, par jour. 10 h. Adieu. Adieu. Et ni Madame, ni morale. Adieu. J’avais eu la même idée sur Marie. Elle n’avait fait que me traverser l’esprit ; mais je l’avais eue, tant je trouvais cela fou. Adieu. G.
125. Val-Richer Dimanche, 9 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
La pluie a cessé. Le soleil se lève très beau. Je ne puis souffrir ces brusques alternatives. Je veux avoir devant moi un long temps égal, uniforme. J’ai toujours trouvé le bonheur ancien supérieur, au bonheur nouveau. Ce qui me plaît vraiment ne s’use jamais pour moi. J’y découvre au contraire chaque jour un nouveau mérite et un nouveau plaisir. Je me rappelle l’été de 1811 de la grande comète. Le soleil a été plus de deux mois brillant et chaud, sans interruption. Tout le monde en était las. J’en étais de plus en plus ravi. Et quand la pluie, le ciel sombre sont revenus, j’ai été triste comme d’une décadence, comme d’un deuil. Tout ce qui passe est si court, dit St Augustin. Comment l’abréger encore par la mobilité de nos désirs ?
Ne prenez pas ceci pour une personnalité. Je ne vous trouve point mobile du tout. Vos impressions du moment de la surface sont mobiles ; mais le fond de votre âme est très solide parce qu’il est très profond. C’est par la profondeur de vos sentiments que vous m’avez frappé et touché. Je pense à Marie. Faites y attention. Il y a à parier que la princesse de Schönburg a raison. C’est trop étrange. dès que vous aurez Lady Granville, tenez conseil. Et si la délibération du conseil est conforme à l’avis de la petite Princesse ayez sans doute tous les ménagements possibles ; mais ne tardez pas trop à prendre une résolution. Vous ne pouvez en conscience charger de plus votre vie d’une folle. Pauvre enfant ! J’espère encore qu’il n’en sera rien. Mais s’il y a quelque chose, ce n’est pas près de vous qu’elle se guérira. Elle y manque à la fois de sérénité et de mouvement. Elle s’agite et s’ennuie. Mauvaise condition à tout âge, encore plus dans la jeunesse.
Je suis charmé que Lady Holland, Lady Granville. et tout ce monde dont vous me parlez reviennent. Cela vous distraira l’une et l’autre, et l’une de l’autre. Que devient l’affaire du Roi de Hanovre ? Est-ce que celle-là s’en ira aussi en fumée comme les autres ? Que veut dire cette apathie, cette impuissance universelle ! Est-ce un monde fatigué qui se remet, ou un monde usé qui s’affaisse ? J’ai cru. je crois toujours à la première explication. Mais il faut de temps en temps quelque grand événement, quelque voix bien haute pour secouer cette torpeur, et interrompre la prescription de la vie. Rien ne paraît.
Je ris de moi-même en écrivant cela. Que la préoccupation de l’égoïsme est forte ! Il y a à peine huit ans que nous avons ébranlé le monde. Il n’y a pas trois ans que nous sommes sortis, nous autres Français d’une lutte intérieure terrible qui a duré cinq ans. Et nous nous plaignons de l’apathie ! Nous trouvons l’entracte bien long ? S’il m’arrive d’oublier ainsi les choses, à cause de moi, de ne pas juger mes impressions et mes désirs personnels, rappelez-moi à l’ordre, je vous prie. Je veux surtout être juste et sensé.
9. 1/2
Cela ne se peut pas. Il ne peut pas y avoir une phrase froide, ni à la fin, ni au commencement, ni nulle part. Je vous ai écrit très triste, très jaloux, mais triste, mais jaloux par une tendresse infinie, insatiable, désolée de ne pas tout pouvoir, de ne pas tout avoir. Que mes paroles sentissent l’effort ; qu’elles fussent pénibles, raides, cela se peut ; mais ce que vous dites est impossible. Je veux savoir qu’elle est cette phrase. Je suis sûr que vous vous êtes trompée. Je ne l’en efface pas moins puisqu’elle vous a affligée. Il m’arrivera peut-être encore de vous affliger. Quand il m’en viendra du chagrin de vous, je ne vous promets pas de ne pas vous en rendre. Mais jamais ce chagrin-là, jamais. N’est-ce pas que vous ne l’avez plus, que vous n’y pensez plus, que vous n’avez plus froid ? Dites-le moi ; redites. le moi. Que d’Adieux. Je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant, cette lettre. Adieu dearest, adieu. G.
Quand je dis que je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant cette lettre ce n’est pas de celle-ci, c’est de l’autre que je parle, de celle où vous dites qu’il y a une mauvaise phrase. Renvoyez-moi la phrase. Je l’ai sur le cœur, mais je n’y crois pas.
127. Val-Richer, Mardi 11 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement l’état de Marie n’est pas naturel. Regardez-y bien et prenez les arrangements, convenables. Je suis préoccupé pour vous de cet ennui nouveau, qui peut- être aussi un trouble. Il est bon qu’elle vous quitte pour quelque temps. La Duchesse de Talleyrand est assez propre, avec son air féroce, à lui imposer une contrainte sanitaire. J’attends impatiemment le résultat de vos délibérations avec Lady Granville. J’ai bien envie d’être jaloux d’elle. Quoique jaloux, je suis charmé de son retour. Elle vous est aussi utile qu’agréable, de bon conseil et de doux passe-temps. Nous avons raison de tenir au Cabinet Whig. Du reste, j’espère qu’il tiendra. Avez-vous lu sur son compte et sur la dernière session du Parlement, un article assez intéressant de M. Duvergier de Hauranne dans la Revue française qui vient de paraître ? Qui dit-on des démentis de M. Molé au général Bugrand ? L’opposition a bien peu d’esprit. C’est la légèreté de M. Molé qu’il faudrait poursuivre. Evidemment, il a dit au général Bugrand ce que celui-ci a répété. Ce n’est que cela ; mais c’est bien quelque chose. Evidemment l’affaire suisse va tomber dans l’eau. La suisse prend son temps pour faire une platitude. On a fait de tous temps des platitudes, mais autrefois, elles n’étaient pas précédées de ces éclats publics de ces fanfaronnades qui sans les empêcher aujourd’hui, les rendent parfaitement ridicules. A la vérité, il n’y a plus de ridicule ; nous en avons perdu la liberté et presque le sentiment. Depuis que le genre humain tout entier est en scène, on n’ose plus se moquer de personne.
Vous vous seriez moquée de moi hier si vous aviez eu avec quelle prolixité, quelle gravité je discutais avec les autorités de St Ouen, la question d’un bout de chemin vicinal que je veux échanger contre un autre. Vous vous sentez un peu jalouse du Val Richer. Vous avez bien tort. Je fais de mon mieux pour prendre intérêt à tout cela. J’y donne du temps, de l’attention. Je m’occupe sérieusement d’une plantation, d’un vase, d’un meuble d’une gravure. Je n’y ai point mauvaise grâce, je vous assure, et les assistants me savent, je crois, très bon gré de mon empressement et de mon plaisir.
Mais au fait tout cela est parfaitement superficiel tout cela ne m’occupe, ni ne m’amuse ; mon temps est plein mais rien que mon temps ; et quand je rentre dans mon Cabinet, je ne retrouve dans ma pensée à peu près rien de ce qui a rempli ma journée. Je ne puis me soucier vraiment et m’occuper sérieusement que de trois choses, les gens que j’aime, les affaires publiques, et les questions religieuses. Je comprends qu’on se donne tout entier à une personne, à la politique, ou à Dieu. Le reste n’en vaut pas la peine.
Je suis bien aise que vous ayez causé à fond avec Médem. Il faut qu’une fois au moins un homme d’esprit dise votre position ici et comment vous vivez. Si de l’autre côté, il y avait aussi un vrai homme d’esprit, rien de tout ce qui vous arrive, n’arriverait. Vous avez bien raison. Toutes les fois que deux hommes d’esprit se voient, ils se séparent contents l’un de l’autre. M. de Metternich et Thiers ont dû s’amuser beaucoup. Thiers fait profession d’être absorbé dans l’histoire de Florence.
10 heures
La phrase me déplaît aussi. Merci de me la pardonner. Un seul mot pourtant, pour excuser. Je ne veux, je ne puis penser à moi, à mon bonheur, à mon plaisir et y subordonner toutes choses, que si je suis pour vous tout ce que je veux être. A cette seule condition, je vous garde à tout prix. Si cela n’était pas, je ne penserais plus qu’à vous, aux intérêts et aux convenances de votre avenir, de votre avenir à vous seule. Voilà mon sentiment quand j’ai écrit cette phrase. Pardonnez-la moi encore ; mais ne dites pas qu’il y a de la glace dessous. G.
128. Val-Richer, Mercredi 12 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis réveillé à 4 heures, et ne me rendormant pas, en quoi vous étiez bien pour quelque chose, je me suis mis à travailler dans mon lit ; toujours mon histoire de France pour mes enfants qui est devenue un véritable intérêt et une occupation assidue. A six heures et demie, le sommeil m’a repris, et je me lève tard, malgré ce beau soleil qui s’étonne et m’accuse. Depuis quelque temps, nous nous levons ensemble.
Vous avez donc été à Châtenay sans moi, avec un ancien amoureux, qui l’est encore. Et vous êtes revenus tous deux bien transis. A la bonne heure. Quand vous y retournerez, la semaine prochaine, il fera encore plus froid. Enveloppez-vous bien. Vous avez un singulier mélange de précaution et d’imprévoyance. Vous quittez et reprenez sans cesse vos précautions, ce qui fait qu’il y en a toujours trop ou trop peu. Il n’y a pas moyen d’ouvrir et de fermer si souvent les portes et de n’avoir jamais de vent coulis. Je ne m’étonne pas du bruit de l’ukase. Outre le despotisme, c’est du despotisme suranné et qui est devenu ridicule. En ceci comme en tout, il faut un peu d’invention, prendre un peu de peine. On n’y peut pas faire sans façon tout ce qu’on veut, la première idée venue.
Je crois que M. de Pahlen aurait tort de démentir sans être bien sûr de son fait. Il est lui un galant homme et qui se respecte. Il ne lui serait pas indifférent de n’avoir pas dit vrai, ou de n’avoir pas su ce qui était vrai. Et puis c’est une étrange manière de gouverner que de n’informer de rien les agents, de ne pas plus compter avec eux, qu’avec ses sujets. Comment veut-on qu’ils fassent et qu’ils servent surtout dans les pays où on parle de tout, et où il faut avoir au moins l’air de tout savoir ?
Sur le procès du général Brossard, j’ai deux visages, l’un qui pleure, l’autre qui rit. Mon pauvre ami Bugeaud s’est conduit là, avec son esprit grossier et sa probité plus vraie que délicate. Je l’y reconnais bien et j’en suis fâché. Je vous ai dit hier mon impression quant à M. Molé. Je m’afflige moins de ce qui la prouve et la répand. A la légèreté j’ajoute la promptitude à abandonner ses agents. Singulier homme de gouvernement ! Incapable de suffire à la moindre difficulté sérieuse, mais très propre à pallier l’étourderie et la faiblesse ; frivole et poltron en fait, mais grave et digne en apparence. Il a son moment.
Vous voulez que je vous dise souvent que je vous aime. Je voudrais vous le lire toujours. C’est mon chagrin de ne pas le pouvoir. Je mourrai avec l’amer regret de ne vous avoir pas donné, montré toute ma tendresse, de n’avoir pas rempli toute votre âme, embaume toute votre vie de cette joie profonde et douce, solide et charmante que répand incessamment un amour vrai, le vrai amour. Je l’ai en moi pour vous. Je vous crois, je vous sais capable et d’en jouir et de le sentir. Je crois qu’il y a en vous des trésors à vous-même inconnus de bonheur et de tendresse. Je suis sûr que j’ai en moi de quoi vous plaire et vous rendre heureuse bien au delà de notre imagination à tous les deux, car la réalité, quand elle est belle, est supérieure à notre imagination de toute la supériorité de l’œuvre divine sur la pensée humaine. Je sais tout cela, et cela n’est pas, cela ne sera pas. J’aurai, pour vous des joies que je ne vous donnerai pas ; j’en attendrai de vous que je ne recevrai par. Je vous verrai des peines que je ne guérirai pas. Je tiendrai dans mes mains le manteau de Raleigh, et je ne pourrai pas l’étendre toujours devant vos pas. J’ai accepté, j’accepte de bonne grâce l’imperfection la médiocrité, la pauvreté de la vie et des relations humaines. Avec vous je ne l’accepterai jamais.
10 heures
Vous avez raison. Voilà un Numéro 132 bien shabby. J’avais envie de toute autre chose aujourd’hui. Adieu pourtant. Je vous rends votre adieu. C’est ce qu’il y a de mieux dans la lettre. Si Marie n’est pas folle, cela ne vaut pas mieux pour vous et au lien d’avoir pitié d’elle, je suis tenté d’en avoir pour vous.
130. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de votre Gazette. Je vous aime mieux vous que les nouvelles. Mais j’aime les nouvelles. Quand elles remplissent vos lettre, il me semble qu’elles ont rempli aussi votre temps. Je me trompe. Il faudrait des tas de nouvelles et des plus grandes, pour remplir le temps quand le cœur est triste ! Et encore ! Mais n’importe ; cela me semble ainsi, et ce semblant me plaît. Nous sommes si disposés à nous payer d’apparences. Ne tenez pourtant pas à votre projet de ne me parler que de nouvelles. Je veux savoir ce qui se passe ailleurs que dans le monde. Ne craignez pas les malentendus les mauvaises phrases. Entre nous, les réticences seraient bien pires. Il n’en faut point, même de loin.
A propos de nouvelles donnez-m’en du petit Lord Coke. Je m’intéresse à cet enfant. Il avait l’air si isolé avec une figure si ouverte et si gaie ! J’espère qu’il va bien. Le précepteur s’est-il animé un peu ? Si l’affaire du roi de Hanovre finit comme vous le dîtes, les Allemands diètes et peuples, baisseront beaucoup dans mon esprit. Ils n’auront que ce qu’ils méritent. Il ne faut pas vouloir, ce qu’on ne sait pas défendre. C’est sans doute l’influence de l’Autriche et de le Prusse qui a retourné la Diète, car elle était disposée à reconnaître sa compétence. Pour ce qui se fait en Espagne, Frias vaut Ofalie. Singulier temps que celui où les révolutions elles-mêmes sont apathiques, et vivent sans faire un pas. Que votre Empereur s’en aille d’Allemagne en emportant pour tout résultat, un Leuchtonberg pour gendre, peuples et Princes pourront adopter la même devise ; Much ade about nothing.
Je lève la tête en ce moment. Vous avez parfaitement raison. J’ai devant moi ce soleil froid, qui s’épuise à chasser du Ciel le brouillard, et n’a plus rien pour échauffer la terre. C’est du pur humbog. Pourtant je l’aime mieux que la pluie. J’assiste chaque jour à toute la vie du soleil. Je me couche et me lève de très bonne heure. Physiquement, je m’en trouve bien. Je voudrais vous envoyer un peu de mon sommeil.
Ce qui me fait grand plaisir à voir, c’est la santé de mes enfants. Ils sont à merveille, et d’un mouvement, d’un entrain d’esprit et de corps inimaginable. M. de Metternich n’a pas trouvé Thiers plus animé, que ne l’est ma petite Henriette. Je leur lis le soir l’histoire des croisades de Guillaume de Tyr. Nous venons de passer trois jours à assiéger, et à prendre Antioche. Au moment où nous y sommes entrés Henriette a jeté sa tapisserie, & ils se sont mis à courir et à sauter dans la Chambre avec des cris de joie, comme les Croisés eux-mêmes. Ce sera bien pis quand nous prendrons Jérusalem.
10 heures ¼
Le facteur arrive tard. Vous êtes bien triste. Il y a une chose que je ne vous pardonne pas, c’est de croire que vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez. Que de choses j’ai à vous dire ? Et je vous ai écrit hier que je n’irais pas à Paris ! Adieu. Ce soir, je vous écrirai longuement. J’ai là du monde. Prenez garde à Marie, je vous en conjure. Les folles qu’on ne croit pas folles me font trembler. Adieu. Adieu. J’ai le cœur plein !
138. Val-Richer, Dimanche 23 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai mal dormi. Je me lève ennuyé de ne pas dormir. Je ne veux pas que vous soyez malade. J’ai peur que la pauvre Duchesse de Broglie ne le soit beaucoup, beaucoup. Les spasmes se sont emparés d’elle. C’est son mal habituel même en santé. Elle a toujours passé la nuit à rêver, à s’agiter, assiégée par le cauchemar, et plus fatiguée, en se réveillant qu’en se couchant. Il parait qu’elle est dans un état nerveux déplorable. Le mal violent est venu à la suite d’une imprudence qu’elle a faite, il y a quinze jours se croyant débarrassée d’une petite fièvre de rhume. Elle avait faim ; elle a mangé du poulet. Cela a déterminé des accidents intestinaux qui ont bouleversé toute sa personne. On dit que, dans les meilleures chances la maladie durera au moins 40 jours. J’ai horreur de ces longues maladies, qui ne sont pas domptées dans la première semaine. Ni la force de celui qui souffre, ni la science de celui qui veut guérir, ne suffisent à une si longue carrière. Je les ai tant vues s’épuiser l’une et l’autre !
Quel abyme entre ce que nous souhaitons, et ce que nous pouvons entre l’énergie de nos sentiments et la misère de nos moyens. Je l’ai vu cet abyme ; j’y suis tombé. Je n’y puis croire. Il me semble impossible, absolument impossible que des affections si profondes, des vœux si ardents, toute l’âme attachée à une seule pensée à un seul effort, n’aient qu’une si pauvre puissance. Toute ma nature se refuse à cette cruelle conviction. Et quand je la sens venir, quand je me vois au terme du savoir et du pouvoir humain, je fais comme les plus simples, je me réfugie dans la prière, cette tentative d’attirer, par un désir immense et vrai, la force de Dieu au secours de notre faiblesse. Je ne sais ce que peut la prière ; je ne prétends pas entendre la réponse de Dieu à ce cri de l’homme. Mais que Dieu n’écoute pas, que le cri de l’homme se perde dans l’air comme le bruit du vent, que notre âme ne puisse, en faveur de ceux qu’elle aime infiniment, rien de plus que ce qui se voit ici bas, je ne le crois point, je ne le croirai jamais. Et je prierai toujours, dût ma prière échouer toujours. Je puis me soumettre aux plus terribles volontés de Dieu, non à la certitude de mon impuissance après de lui, et j’aime bien marcher dans les plus épaisses ténèbres que rester immobile avec désespoir, sûr qu’il n’y a aucun moyen d’arriver.
9 heures
Je vous ai quittée. J’étais trop triste. Avec vous, je me défends de ma tristesse. Je crains pour vous la contagion. Pardonnez moi quand je me laisse aller. Je vous aime beaucoup, & je le sens au moins autant quand je suis triste que dans mes meilleurs moments. Votre grand Duc va-t-il décidément mieux ? N’a-t-on plus de crainte ? Savez-vous qu’il est fort connu que c’est la brutale imprévoyance de son père qui a failli le tuer ? Les hôtes que j’ai ici me le disaient hier ; et ils ne le tenaient pas du tout de moi. Ils me quittent aujourd’hui, M. Duvergier de Hauranne ce matin. M. Rossi ce soir. Mes nouvelles sont que le Ministère est de nouveau sérieusement inquiet de la Suisse. Louis Buonaparte ne s’en ira pas. Le parti radical suisse et Français, avec lequel, il est en intelligence, lui défend de s’en aller. Et puis, il est sot au-delà de tout ce qui se peut imaginer. Il y a quelques année, à Florence, il envoya chercher en toute hâte un homme d’esprit que je connais voulant de lui un conseil. Il lui montra une lettre de Corse où on lui promettait 1500 hommes, s’il voulait aller les chercher, et débarquer avec eux en France. Son conseiller l’en détourna, l’assurant qu’il ne réussirait pas. " Mais pourquoi donc ? Mon oncle l’a bien fait avec la moitié. " L’avis de M. Hess de Zurich, qui veut qu’on demande à Louis B. de s’expliquer catégoriquement et de déclarer s’il est français ou suisse, pourrait bien offrir une issue. Il sera peut-être difficile à L. B. de dire officiellement et décidément qu’il n’est plus français. Je sais qu’on attend quelque chose de là. Probablement on a tort. En telle situation, le plus grossier mensonge ne coûte rien et ne fait pas grand chose, car il ne trompe personne.
9 h. 1/2
Elle est morte. Je viens de recevoir un mot de son mari. Je pars pour Broglie dans deux heures. Adieu. Adieu. G.
143. Longchamp, Dimanche 23 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis ici toute seule et bien triste. Je viens d’apprendre la mort de Mad. de Broglie. Je ne saurais vous dire ce que cela m’a fait éprouver. J’ai versé de silencieuses larmes. L'heureuse femme ! Personne n’a mieux mérité le ciel. Comme elle a été charitable, comme elle a été bonne pour moi. Je lui en ai trop peu montré ma reconnaissance. Mais il me semblait que je l'ennuyais un peu, & cette crainte a fait que je me suis approchée d’elle moins souvent que je ne le désirais. Son pauvre mari ! Quelle perte ! Je viens de sa maison où j’ai appris cette affreuse nouvelle. J’ai traversé le bois de Boulogne en pleurant. J'arrive ici je pleure, et je vous écris parce que j'ai besoin de pleurer auprès de vous.
Lundi
Je vous demande pardon de cette feuille de papier, je n’ai pas trouvé autre chose à Longchamp. Je continue. Votre lettre ce matin est aussi triste que moi. Je pensais bien hier en pleurant, que dans ce même moment vous pleuriez, et à Broglie. Restez y. Dites-moi comment est ce pauvre duc, dites-moi des détails. Je ne pense pas à autre chose. J'ai les yeux bien rouges ce matin. Hier j'ai été obligé de faire les honneurs d’un grand dîner chez M. de Pahlen. J’étais si triste que j'ai bien mal rempli mes devoirs. Le soir il m’a fallu aussi recevoir mon monde habituel. Mais à onze heures j'ai levé la séance, car je n'en pouvais plus. Il m’était venu beaucoup de monde. Ce que j’ai appris de plus nouveau c’est les dernières nouvelles que votre gouvernement a reçu sur Louis Bonaparte. Si la diète lui demande d’opter entre sa qualité de Français & de Suisse, il répondra qu’il est français, et il sortira immédiatement & spontanément de Suisse. Si cette question ne lui est pas posé, il ira établir son quartier général à Genèves. L’affaire Belge est dit-on rompue par le fait du Roi des Pays-Bas c-a-d qu’il ne veut aucune modification aux 24 articles. Ceci était un on-dit mais pas encore officiel. J'ai eu des lettres de Lord Aberdeen, & de M. Ellice. Lord Aberdeen ne comprend pas que l'Angleterre puisse éviter des discussions très sérieux avec la France au sujet du blocus en Amérique, and some procedings au the coast of Africa. Cela lui semble très grave.
Il parle du ministère anglais avec le dernier mépris et il ne croit pas possible qu'il résiste vu de que ce sentiment de mépris devient tout à fait général. Il dit aussi que depuis le protecteur Sommerset il n'y a jamais eu d'homme dans une situation pareille à celle de Lord Melbourne et que son pouvoir sur la Reine est absolu. Ellice n'attend les réponses de Lord Durham que le 8 du mois prochain. Il est d’opinion que Durham restera au Canada j'ai essayé hier de marcher, j'essaierai. encore aujourd’hui.
Mon fils Alexandre ne me reviendra que dans les premiers jours d'octobre. Marie le 7. Je passerai à la Terrasse probablement avant. Le grand duc est à Berlin. Je ne sais que ce fait. Je n’ai pas un mot de mon frère, ni de mon mari. Adieu. Je suis si accablée de cette mort. Je pense tant à cette angélique femme, à son pauvre mari, à votre chagrin car vous en avez beaucoup. Je vous aime, je vous aime de tout mon cœur. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Politique (Europe), Politique (France)
142. Paris, Dimanche 23 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ne vous inquiétez pas de moi. Je suis très faible, voilà tout. Je viens d'envoyer chercher Cheremside. Je voudrais qu’il me redonnât des forces. C'est singulier comme tout à coup elles m'ont abandonnée. M. Molé était fort tendre hier, et moi aussi. Il me reproche d'être prise & conquise, mais il s’y accoutume. Il soigne beaucoup Lord & Lady Holland. Il a pris goût à Sir George Villers qui est en effet un très aimable homme. Il n’y avait hier que mon Ambassacleur du corps diplomatique. Messieurs Pasquier, Decazes, Salvandy. Jeudi M. Molé reçoit chez lui les Holland. On s'occupait beaucoup hier de cette pauvre Duchesse de Broglie. On la dit ici plus mal que vous ne dites.
Je suis parfaitement ignorante de mon mari, les journaux allemands prétendent que mon frère n’est resté que deux heures à Weymar. Que l’Empereur l’a fait partir immédiatement en mission secrète. Cela parait incroyable à Pahlen & à moi. Il n’est pas des gens qu'on envoie, il est de ceux qui envoient les autres. Cependant son silence me ferait croire qu'il n’a pas résidé à Weymar. Et je reste sans nouvelles. On a fait venir les grandes Duchesses aînées pour les faire voir à leur grand père. Il n’y a pas une autre raison. On ne les avait pas prises dans le voyage en Allemagne tout juste pour ne point faire penser qu'on les promenait pour chercher des maris.
Je ferai votre message à Lady Holland. Ils restent ici jusqu'au commencement de Novembre. Vous pourrez donc encore les voir. Je n’ai point de nouvelles à vous dire et il me semble en même temps que je trouverais à causer avec vous aussi longuement que cause M. de Humbold vraiment les lettres sont un pitoyable moyen d'entretien. Mille petits symptômes peuvent être relevés en conversation, & ne sauraient l’être en s’écrivant, je trouve cela plus vrai tous les jours.
On croit assez généralement que Louis Bonaparte va quitter la Suisse. M Molé n’a pas l'air d'avoir le moindre souci. Il n'oublie pas qu’il est premier ministre depuis plus de deux ans. & il pense que ce qui a duré si long temps a par la même acquis des chances de plus de durer encore. Voilà Cheremside qui me quitte ; il me dit que ce n’est rien, que cela tient à mon état général, et qu’il ne veut y faire attention que si cela augmente. Vous voyez que je vous dis tout.
Adieu. Adieu. Je pense à vous sans cesse croyez le bien. Je dîne aujourd’hui chez M. de Pahlen avec toute l’Autriche, mais je veux prendre beaucoup de bois de Boulogne avant car le temps est beau. Adieu encore mille fois.
Mots-clés : Politique (France), Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
144. Paris Mardi 25 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m'avez écrit une bien courte lettre de Broglie, j’attendrai mieux demain. Nous nous sommes promenées Lady Granville et moi hier au bois de Boulogne. Elle est très affectée de la mort de Madame de Broglie, comme l’est sincèrement tout le monde. C’était une personne bien aimée, bien admirée. J’ai été passer une heure de la soirée chez Lady Granville. On y recevait lors que j'en suis partie. Je me sens si lasse que je suis toujours pressée d’aller trouver mon lit.
Louis Bonaparte a demandé au ministre d'Angleterre en Suisse si gouvernement anglais lui permettrait de résider en Angleterre. Cela ne peut pas se défendre. Il est décidé à y aller. Cette nouvelle a fait grande joie à M. Molé. Je crois qu’elle n’est pas connue encore. Une dépêche télégraphique annonçant hier une émeute à Genève, & cette émeute dirigée contre les Français. On avait fermé les portes de la ville; Je ne vois pas cette dépêche dans les journaux de ce matin. Quand vous m'écrivez peu il me semble que je ne sais pas vous écrire du tout. Et puis je ne me sens pas bien sans cependant que je sois malade. Aussi je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter mais pour excuser mes pauvres lettres.
Je crois que le temps est malsain, l'air ne me rafraîchit pas, & je reviens de ma promenade toujours fatiguée quoique je ne marche point. On annonce quelques anglaises ici ; l’une Lady Burghersh, est une femme d'esprit & qui a une grâce infinie. Je crois qu’elle vous plaira. Je suis bien aise quand il arrive des femmes agréables. Il en manque bien ici. Adieu, adieu.
Mots-clés : Décès, Politique (France), Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
141. Val-Richer, Mercredi 26 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai cette pauvre femme devant les yeux. Je l’ai vue sur son lit de mort. Elle n’était pas changée du tout, les traits parfaitement calmes et l’air jeune. Elle est morte pourtant à la suite d’un long délire, d’un délire de plusieurs jours, mais sans violence, sans idée fixe ; rien n’indiquait un grand trouble intérieur. Toute sa vie repassait devant elle, sa mère, ses frères, sa fille Pauline, ceux qu’elle avait perdus, ceux qui lui restaient confusément, rapidement, en général doucement. Elle a souvent parlé de moi ; elle causait avec moi. Dès l’invasion du mal, sa faiblesse était extrême ; elle se soulevait à demi, joignait les mains et commençait une prière qu’elle n’achevait pas. Elle s’est crue très malade dans les premiers jours ; puis cette idée lui a passé. Elle désirait beaucoup de guérir. Elle se trouvait mieux depuis un an ou deux ans, et infiniment plus calmes qu’elle n’avait jamais été. Elle ma dit bien des fois : " La jeunesse ne m’allait pas ; à mesure qu’elle s’en va, je me sens plus de force et de sérénité. " Elle a fait un testament qui n’est pas encore ouvert. Je serais resté plus longtemps avec son mari si j’avais dû le laisser seul. Mais sa belle sœur est arrivée et il attendait son fils hier soir ou ce matin. Il sera à Paris dans quatre on cinq jours, et n’ira pas à plus de 20 ou 30 lieues au devant de sa fille. Il est calme.
Il m’a beaucoup touché hier matin. Tous les jours, avant le déjeuner, la famille faisait la prière dans la bibliothèque. On lisait un chapitre de l’évangile, une ou deux pages de méditations pieuses et l’oraison dominicale. C’était mad. de Broglie, qui lisait. Il a fait recommencer hier et l’a remplacée. J’espère que sa fille viendra vivre avec lui. Cependant il y a des obstacles. M. d’Haussonville, a aussi son père et sa mère qui sont vieux et sourds. Albert de Broglie sera beaucoup pour son père. Il est distingué et affectueux.
Vous vouliez des détails. Je me repose ici. J’ai le cœur fatigué. Vos lettres sont bien bonnes. Mais ne vous laissez pas aller à pleurer. Vos pauvres yeux n’en ont pas besoin.
9 heures.
Je viens de passer une demi heure, avec mes enfants dans mon cabinet. Il m’aiment beaucoup. Je mentirais si je disais que votre pensée me les gâte ; non, je jouis beaucoup de leur présence, de leur affection. Mais votre pensée est toujours là, toujours. Je vous aime beaucoup. J’ai besoin de tout ce qui vous manque. Que ne puis je vous faire jouir de mon bien comme je souffre de votre mal ? Mon petit Guillaume à le meilleur cœur du monde. Quand il me voit triste, il redouble autour de moi de gaieté et de caresses. Et s’il ne réussit pas à me distraire, il s’arrête tout à coup, un peu confus, comme s’il avait fait une sottise.
Je vois que j’ai deviné juste, sur l’expédient que la suisse prendra envers Louis Buonaparte. On lui posera la question. Elle a été inventée dans le dessein. Si on ne la lui pose pas, il aura tort de transporter son quartier général à Genève. Genève n’est pas un canton radical malgré le vote de son député à la Diète. Thurgovie au Bâle campagne lui conviennent mieux. Je ne crois à aucune querelle sérieuse, pas même par lettres, pour le blocus mexicain ou la côte d’Afrique. Ni l’un ni l’autre Cabinet ne veut se quereller. Ils ont bien assez de peine à vivre. Cependant je ne crois guère non plus aux pronostics de Lord Aberdeen. L’Irlande ! L’Irlande tant que cette question-là ne sera pas vidée, les Whigs et les radicaux tiendront ensemble.
10 heures
Adieu. Le temps est mauvais en effet. Nous n’avons pas eu d’été. Pardonnez-moi la tache qui vient de se faire, je ne sais comment, sur cette lettre. Je serai bien aise de vous savoir à Le Terrasse. Adieu. Adieu. G.
142. Val-Richer, Jeudi 27 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis remis hier à travailler. C’est une grande ressource qui vous manque. Après les plaisirs de l’intimité, je n’en connais pas de plus efficace pour distraire, et même reposer d’une impression douloureuse. Avant de m’enfermer dans mon cabinet, j’ai fait faire une longue promenade à ma mère. Elle est très affligée. Mad. de Broglie avait pour elle un respect, une affection, une confiance filiale, et les lui témoignait avec un extrême abandon. Ma mère en était très touchée depuis trois jours elle me répète sans cesse : " Prendre une telle amitié à mon âge, pour une cette fin ! "
J’ai une profonde pitié des chagrins de la vieillesse. Elle a droit au repos du cœur comme du corps. D’ailleurs ils sont rares. L’âge refroidit les peines comme les joies. Il n’en est rien pour ma mère. Elle a le cœur aussi vif qu’il y a quarante ans. Je l’ai fait marcher une heure et demie. Elle en était un peu lasse hier soir, mais beaucoup plus calme. Je suis sûr qu’elle aura mieux dormi.
Je ne crois guère à l’émeute de Genève. Ce serait un grand argument contre la politique dont se charge M. Molé ; Genève est une ville française. Il y faut je ne sais quel degré d’irritation pour qu’on y éclate contre les Français. M. de Metternich doit sourire, un peu. Thiers travaille aussi. Mais au fond, d’après ce qui me revient, il est très animé et se propose de le témoigner à la prochaine session. Nous verrons bien. Il restera en Italie jusqu’au mois de novembre. Ce sera le moment du retour universel.
Je serai bien aise de retrouver les Holland à Paris autant qu’un plaisir peut être quelque chose à côté d’un bonheur. Vous devriez bien d’ici là rassembler tout ce qui vous reste de ce que vous avez écrit sur tout ce que vous avez fait ou vu. Je suis sûr qu’il y a je ne sais combien de choses, petites ou grandes, que je ne connais pas. J’ai envie de toutes. Le papier sur la mort de Lord Castlereagh est-il décidément perdu ? Faites cela en rentrant à la Terrasse. Là où je suis indifférent, je ne suis pas curieux. Mais où est mon affection, ma curiosité est insatiable. J’ai beaucoup plus envie du moindre petit papier que de Lady Burgherch. Les femmes distinguées manquent partout. L’Angleterre ne m’a encore montré que Lady Granville, et si vous voulez, Lady Clanricard. A propos, vous ne m’avez pas envoyé sa lettre.
10 h. ¼
Mon facteur arrive tard ce matin. Je n’ai pas de nouvelles de Broglie, ce qui me prouve qu’Albert n’est pas arrivé. Je suis impatient qu’il ait rejoint son père. J’avais pensé à votre prédiction. Je vous remercie de vous ménager. La fatigue ne vous vaut. rien. Soignez-vous pour le mois de novembre. Je ne comprends pas qu’on se laisse mal traiter par Lady Holland. Passe pour son mari, s’il l’aime. Car il faut aimer pour supporter. Du reste les impertinents ont raison puisqu’on les supporte. Je vous conseille d’écrire à votre mari. Toutes les fois qu’il renoue le fil, n’importe pourquoi vous devez le ressaisir. Vous l’avez dispensé d’explication. Cela vous dispense de reproche. Les confidences de Mlle Henriette ne tracassent donc plus Marie. Adieu. Tout à l’heure, en lisant votre adresse en Courlande, j’ai eu envie de vous répondre par la première phrase de mon testament. Je ne le ferai pas. Adieu. G.
147. Paris, Vendredi 28 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Après une longue promenade au bois de Boulogne avec Lady Granville, nous avons trouvé mon Ambassadeur qui m’attendait à ma porte. J’ai vu à son visage qu'il avait à me parler ; j’ai laissé aller Lady Granville et j’ai pris le bras de M. de Pahlen. Un vrai militaire il est allé à l’assaut tout de suite et m’a demandé si j’avais écrit à Thiers ? Non, et pourquoi cette question. " parce qu’on tient sur vous mille propos ; on dit que vous êtes avec lui en correspondance, que vous intriguez entre lui, M. Guizot, M. Berryer. On prépare un article contre vous dans un journal, et tout cela vient du ministère. " Il est très difficile de comprendre clairement Pahlen, il est de même un peu difficile de se faire bien comprendre de lui. D'ailleurs, il avait mille réticences, et à tout instant, " un nom de Dieu, ne parlez de ceci à personne " ; je l’ai calmé, rassuré, cela me parait très facile, car rien n’est plus inoffensif que ma conduite, mais cependant je ne saurais être indifférente à l'usage qu'on peut faire de mauvais commérages sur mon compte, et je viens d'écrire à M. Molé pour le prier de me donner un moment d'entretien.
J’ai voulu vous dire tout cela puisque je vous dis tout. Serait-ce une intrigue Cosaque pour me faire fuir Paris ? Il faut que l’invention vienne de loin puis que c’est tellement invention qu'il n'y a pas le premier mot de vrai. J’avais eu un moment l'envie de demander à Thiers de ses nouvelles, tout bêtement. Je ne l’ai pas fait, et j'en suis bien aise Il y a 6 semaines que je n’ai vu Berryer. Je suis très curieuse de savoir sur quoi on peut bâtir sur mon compte quelque chose qui sorte de la routine la plus innocente. J’ai vu beaucoup de monde hier au soir, cela devient un peu trop nombreux. Il faudra reprendre mon ancienne manière. Le duc de Noailles est venu. C’était comme il dit, le seul étranger, parce que le rôle était tout le reste de l’Europe.
J'ai reçu ce matin une lettre de mon mari de Potsdam ; je n’ai à relever dans cette lettre que les deux choses-ci. N°2 placé en haut, ce qui veut dire qu’une nouvelle ère a commencé à Weymar, & l’indication de Munich pour ma première lettre après quoi il veut me donner un nouvel avis. Le reste est des détails sur la famille impériale. Les grandes duchesses embellies. Les cantonnements à Potsdam des bêtises. Voici cette lettre de Lady Clauricarde que vous voulez absolument. Voici aussi celle de Lord Aberdeen. Brûlez la première et renvoyez moi la seconde, parce qu'il faut que j’y réponde. Adieu. Adieu, je suis un peu pressée. J’ai quelques courses à faire, & encore. à écrire. Adieu bien tendrement.
144. Val-Richer, Vendredi 28 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir parlé de ma mère. Elle a été un peu souffrante. Elle est bien aujourd’hui, quoique très, très affligée. Mad. de Broglie était avec elle filialement. Mais je suis sûr que je vous en ai parlé. Ma mère d’ailleurs a une attitude admirable envers la douleur ; elle la supporte sans s’en défendre. Je n’ai jamais vu personne qui l’acceptât plus complètement sans s’y abandonner, qui en parût plus rempli et moins abattu. Elle y est comme dans son état naturel. Il n’y survient rien de nouveau pour elle et le plus ou le moins ne change pas grand chose à sa disposition, toujours triste mais toujours forte. Je l’ai fait beaucoup promener ces jours-ci. Je l’ai fatiguée. Et puis mes enfants ne la quittent guère. J’ai beaucoup travaillé ce matin. J’avais besoin aussi de me fatiguer. J’en suis convaincu comme vous. On ne comprend que les maux qu’on a soufferts. A ce titre, j’ai bien quelque droit à vous comprendre, pas assez peut-être. Il est vrai que je suis moins isolé. Que ne puis- je vous guérir au moins de ce mal-là ! L’autre resterait. Je l’ai vu rester. Mais ce serait celui-là de moins. Je ferai mieux de ne pas vous écrire ce soir. Je suis si triste moi-même que je ne dois rien valoir pour consoler personne, pas même vous que je voudrais tant consoler, un peu !
Samedi 7 heures
Je suis frappé du peu que nous pouvons, du peu que nous faisons pour les autres, et pour nous-mêmes. Dieu m’a traité plusieurs fois avec une grande faveur. Il m’a beaucoup ôté mais il m’avait beaucoup donné et souvent il m’a beaucoup rendu. J’ai reçu le bien, j’ai subi le mal. J’ai très peu fait moi-même dans ma propre destinée. Nous ne réglons pas les événements. Nous sommes pris dans les liens de notre situation. Nous oublions cela sans cesse. Nous nous promettons sans cesse que nous pourrons, que nous ferons. C’est notre plus grande erreur que l’orgueil de nos espérances. Voilà Louis Buonaparte éloigné. C’est une grande épine de moins dans le pied de M. Molé. La marque, en restera, mais pour le moment, il n’en sent plus la piqûre. Entendez-vous dire que la session soit toujours pour le 15 Décembre ?
Vous êtes bien bonne d’attendre mes lettres avec impatience. Qu’ai je à vous mander ? Point de nouvelles. Mon affection n’en est pas une. De près, tout est bon, la conversation donne une valeur à tout. De loin, si peu de choses valent la peine d’être envoyées !
9. 1/2
Je ne comprends, rien à cette incartade. Est-ce en effet une intrigue cosaque ou bien seulement quelque commérage subalterne qui sera monté haut, comme il arrive souvent aujourd’hui ? Je penche pour cette dernière conjecture. En tout cas, vous avez très bien fait d’aller droit à M. Molé. Il est impossible qu’il ne comprenne pas l’absurdité de tout cela et n’empêche pas toute sottise, au moins de ses propres journaux. Ne manquez pas de me dire la suite, s’il y en a une. Quelles
pauvretés !
Je suis bien aise que vous ayez un N°2. Je vous renverrai demain la lettre de Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Je reçois je ne sais combien de lettres qui me demandent des détails sur cette pauvre Mad. de Broglie. Est-il possible qu’on soit contraint de rabâcher, sur un vrai chagrin. Adieu. G.
148. Paris, Samedi 29 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Comment, on n’a pas eu le temps ? ou bien, on n’y a pas pensé. Quand il s'agit d'une dernière prière sur la tombe d'un chrétien, & d’une femme qu'on aime ! Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais il n'y a que des Français capables de cela. Et vous, vous-même c’est bien légèrement que vous me donnez ces excuses. Savez-vous que cela me blesse, savez-vous que moi, moi étrangère, arrivée, là à la dernière heure j’aurais demandé à M. de Broglie à genoux d’attendre qu’un ministre de Dieu vient bénir la dépouille de sa pauvre femme. Ah dans mon froid pays, dans ce pays barbare, c’est un prêtre qui recevra tout ce qui reste de moi. Est-ce que je vous dis des choses dures ? Pardonnez moi, pardonnez ce que Lady Granville appelle vingt fois le jour, ma funeste franchise. Vous ne me referez pas. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Comment M. de Broglie pourra-t-il jamais avoir un moment de tranquillité ?
M. Molé est venu hier chez moi en sortant du Conseil. Il est convenu qu’il y avait sur mon compte mille mauvais rapportages. Berryer était sur le premier plan de la Reine ! Imaginez ! Vous qui savez ce que j’en fais. Le gros de l’affaire est que mon salon est le rendez-vous des adversaires du gouvernement. Enfin on veut me faire passer pour une archi intrigante. Vraiment c’est trop absurde. M. Molé a été parfait, il dit que lui et le Roi me défendent, mais qu’on est très exalté contre la Russie, & qu'il n’y a pas moyen de faire comprendre que moi je ne suis pas un émissaire chargé de susciter d'embarras au pouvoir existant. Voilà qui est trop fort. Je voudrais en rire, mais c’est difficile. M. Molé dit qu'il a arrêté déjà des articles qui devaient paraître contre moi qu'il y veillera encore, mais il ne répond de rien cependant. J’ai dit tout ce qui était convenable et tout ce qui était vrai. Je n'ai à m’amuser que d'une intimité ; c'est avec vous. Alors il y a eu une grande exclamation. " Oh pour celui-là. c’est tout autre chose, un homme que nous estimons & respectons tous. " Il a dit de vous mille biens et dans le meilleur langage. Mais excepté vous je voudrais bien savoir quels sont donc les Français avec lesquels je conspire ? La police du gouvernement est bien mal informée, et les fonds secrets devraient mieux servir que cela. Au total je ne comprends pas bien sur quoi repose tout ce tripotage, ni de qui j'ai à me garder, mais il me semble que M. Molé est sérieusement désireux de m’épargner tout espèce d'embarras.
Vraiment il ne me manquait plus que cela. Il me parait que l’exaspération contre l’Empereur est arrivée à un haut degré. Il y a quelque chose de nouveau à ce sujet que M. Molé n’a pas voulu me dire, et qui surpasse tout ce qui est jamais venu de mon maître. C'est fort triste. J'ai dîné hier chez Madame Graham avec les Holland, mon ambassadeur M. d’Armin, Fagel, & Villers. Celui-ci est un homme charmant. J’ai peu rencontré d’homme qui m’aient si vite plu. Je cherche à lui faire faire des conquêtes parmi mon entourage, et il faut revenir de tous, car il est en horreur à la sainte alliance.
Hier matin j’ai promené Madame Appony. Le tête à tête n’est pas aussi animé qu’avec Lady Granville. Ce matin votre lettre n'était pas sur la nappe à mon déjeuner, voilà qu’une violente agitation s’est emparée de moi. J’ai vu toutes les catastrophes imaginables et la plus naturelle s'est rencontrée dans un article de journal que j'ai pris en main et où j’ai trouvé qu'il y avait beaucoup de loups aux environs de Caen. Vous aviez été attaquée par un loup, cela ne me sortait pas de la tête, dix minutes après la lettre est venue et j’ai respiré comme si le loup venait de vous lâcher. Ah quelle pauvre tête que la mienne. Mais convenez-vous bien de cela. Un jour passé sans lettre, j'en prendrai la fièvre. Adieu, adieu. Adieu autant d’adieux que vous voudrez.
149. Paris, Dimanche 30 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon pauvre Ambassadeur est très préoccupé de l'ensemble de la situation ici. Je l’ai rencontré hier à Auteuil ; il m'a beaucoup entretenu de tous ses chagrins. La maison est le plus gros de tous. Il craint, (& il a raison car M. Molé me l’a confirmé hier à dîner) que M. de Barante n’ait l’ordre de quitter son hôtel à Pétersbourg aussi vite que possible ; dans ce cas, lui Pahlen sortirait immédiatement du sien, et comme il n'y en a aucun à trouver, il ira en hôtel garni, imaginez ! Il prétend que ce qu'il a de mieux à faire c'est de chercher à quitter son poste. J’en serai certainement très fâchée.
A dîner, j’ai eu M. Molé pour voisin comme de coutume. Je n'ai rien appris de nouveau. Il me semble que c’est pour le 20 décembre qu'est fixée l’ouverture des Chambres. Il n’a pas l'air soucieux. Il ne pense pas que la partie raisonnable de l'opposition puisse se montrer hostile, c'est vous sans doute, et en effet sur quoi le seriez-vous ? L'attitude que vous aviez l’année passée à l’époque de l'ouverture sera difficile à reprendre vu ce qui s’est dit à l'occasion des fonds secrets. Mais cependant ce qu'il y aurait de mieux à faire serait de se rapprocher de cette première position plutôt que de continuer dans la seconde. Thiers s'est assez bien tiré de la session, il a senti que la situation était mauvaise. Il s’est effacé ; après en avoir compromis d'autres. Voilà à peu près.
La dépêche télégraphique sur Genève a été démentie par une autre dépêche le lendemain. C’était un faux bruit de voyageur. Le dîner hier était pour Holland, toute l'Angleterre. Je suis restée la dernière jusqu'à 10 heures. Demain je dîne à Suresnes chez les Salomon Rotschild. Jeudi chez Lady Sandwich, vendredi chez Mad. de Castellane. & puis chez les petits Pozzo. Me voilà fort dissipée. Lady Granville est malade ; je ne l’ai pas vu depuis jeudi. Son mari a la goutte. C’est là ce qu’on rapporte des Eaux. Les Palmella me pressent fort d'aller à Versailles, les Holland y vont aussi. Mais je crains la fatigue de voyage ; car c’est une fatigue. Je vous vois triste dans vos lettres, est- ce que moi j'y ajoute ! Il me semble que oui.
Eh quand serons-nous ensemble ! J'ai eu un mot de M. de Broglie hier ; je lui avais écrit le lendemain de son malheur. Adieu. Adieu. Votre pauvre reine me fait bien de la peine ; mais elle a bien dû jouir sur cette terre cependant. Adieu, encore adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Réseau social et politique
150. Paris, Lundi 1er octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai eu une longue visite hier du C. Appony et une autre longue de mon ambassadeur. Le premier que j’avais beaucoup engagé à s’approcher de Villiers a fait comme je lui ai dit et était fort content de son entretien avec lui. Il l’a trouvé moins révolutionnaire qu’il ne pensait. De son côté Villers m’a dit qu'il trouvait Appony beaucoup moins carliste qu'on ne lui avait dit. Voilà pour commencer les Anglais me savent gré de la toute petite peine que je prends à rapprocher les gens, je ne le ferais pas si je n’avais vraiment le cœur anglais. Au surplus ceci est du bien pour tout le monde. Je suis fâchée que vous ne connaissiez pas Villiers, il vous plairait surement. M. Molé est enchanté de lui. M. de Pahlen était venu pour déverser encore son spleen. Nous avons regardé sa situation sous toutes ses faces. Nul doute qu’elle ne soit mauvaise. Nous finirons par n’avoir que des chargés d’affaires.
Après ma promenade au bois de Boulogne, j’ai été voir Lord Granville qui est couché sur son canapé en très mauvais état. Sa femme est dans son lit sans voir âme qui vive. Granville était bien content d'un petit moment de causerie avec moi. J’ai dîné seule et le soir mon salon a été rempli de monde, beaucoup trop c’est décidément ennuyeux. La France tout changera tout cela. Mais je n’y passerai que le 10, j’attendrai Marie. A propos, elle ne m écrit pas, je commence à être inquiète. Je lui écris cependant souvent.
On est fort fâché ici, & nous le sommes aussi du traité de commerce conclu entre la Porte et l'Angleterre. Cela va déterminer l'indépendance de l’Egypte et nous regardons cela comme la guerre en Orient. Nous verrons. Voici le mois d'octobre ; c’est-à-dire 6 semaines d’écoulées depuis que je ne vous ai vus. Combien ne passera-t-il encore ? Adieu, adieu. Pensez à moi beaucoup toujours, & tendrement
152. Paris, Mercredi 3 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'écris aujourd’hui à mon frère par un courrier de Pahlen. Votre gouvernement en a envoyé un à M. de Barante avant- hier, je crois entre autre pour lui prescrire de sortir de l'hôtel aussi tôt que possible. Cela sera le signal de la sortie de Pahlen, de la maison qu'il occupe, il s’en va contant à tout le monde ces douleurs, & dans un désespoir comique.
J’ai fait visite à Auteuil hier matin ; on dit qu'on ne sait pas encore le départ de Louis Bonaparte de Suisse et que cela tracasse un peu ici. Le soir, j’ai été voir les Granville malades. Il est couché, immobile. Elle va un peu mieux tous les jours.
Il arrive de normaux anglais qui passent. Je les vois, je ne vous les nomme pas, vous ne les connaissez pas du tout. Alava est venu me voir aussi, il a bonne mine. Il va à Londres dans quinze jours. Les Holland sont à Versailles, ils y ont mené aussi le poète Rogers. Vous le connaissez sans doute ?
Le soleil est superbe, je ne me lasse pas de profiter de ces derniers beaux jours. Je me promène encore le soir en voiture ouverte. Je m’enrhume, je me dé-rhume tout cela est égal, il me faut de l'air. Le petit Sneyd va partir pour l’Italie j'en suis très fâchée, car je l’ai fort à mes ordres. Ainsi quand il n'y a rien de mieux, je le prends dans ma calèche et il se laisse toujours prendre.
Marie m’a enfin écrit. Elle se dit parfaitement remise, & arrive samedi. Nous verrons. L’Empereur le prolonge un peu à Berlin. Il veut retourner chez lui par mer. Quelle idée dans cette saison et après que ses filles ont failli périr. Je suis bien aise d’apprendre que votre mère est bien. Adieu, je cherche si j’ai quelque chose à vous dire. Je ne trouve rien qu'une quantité d’adieux.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Réseau social et politique
153. Paris, Jeudi 4 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a des jours, il y a des moments, où ma pensée vous cherche avec plus de tendresse que dans d’autres moments. Ainsi hier, j’ai été plus occupée de vous que de coutume. Vous n'êtes pas là pour que je vous le dise. Je n’ai pas là une plume & du papier pour vous l’écrire & voilà comment ces impressions si vives pour moi sont perdues pour vous. Il faut être ensemble, toujours ensemble, rien n’est perdu alors. J'ai fait par un temps charmant une promenade charmante hier, mais j’étais seule, toute seule. C’est bien triste !
J’ai admiré dans les bois ces innombrables toiles d'araignée, ce merveilleux travail. Mais l’araignée est seule aussi au milieu de cet admirable tissus. Elle me parait bien égoïste, et bien orgueilleuse, c’est qu’il lui plait d'être seule. Moi cela ne me plaît pas du tout, aussi n'ai-je aucun de ces sentiments. Que je serais heureuse d'habiter la campagne. Je l’ai désiré toute ma vie. La plus imperceptible des merveilles de la nature est pour moi un sujet inépuisable d’admiration & de ravissement, mais il me faut à qui le dire. Avec vous quel bonheur que la campagne !
J’ai dîné hier chez Lady Granville, avec mes Anglais bonnes gens mais que vous ne connaissez pas. Lord Granville n’a pas dîné avec nous. Je l'ai vu après. Il est faible & malade. Je le crois en mauvais état. J’ai fait plus tard une courte visite à Madame de Castellane. J’y ai trouvé M. et Mme Deleferst. M. Molé y est venu plus tard. Il destine l'hôtel de Pahlen au Turc qui vient d'arriver. Il a mandé à M. de Barante comme avis privé, qu’il serait de bon goût qu'il quittât l’hôtel de l’ambassade immédiatement fût ce pour aller provisoirement dans une auberge. Je ne puis pas m’empêcher de trouver que M. Molé a raison.
Le 28 sept. Louis Bonaparte n’avait pas encore quitter Aremberg. Il ne parvient pas à avoir de passeport. Le ministre de Prusse les lui a refusés parce qu’il ne dit pas par où il passe. Cela me parait une querelle d’Allemand. On espère que c’est en Toscane qu'il va se rendre. En attendant l’affaire Suisse n’est pas fini.
Je griffonne horriblement aujourd’hui. C'est que j’ai les nerfs bien mal arrangés & les genoux tremblants. Je ne sais de quoi ma vue est trouble aussi. Je lis Sully et je l'aime comme vous. J’ai toujours eu une vraie passion pour Henry IV. L’espèce est perdue.
Adieu, car je n’ai pas la forme de continuer. Je ne sais ce que j'ai. Mais je vous aime bien, comme hier. Adieu.
150. Val-Richer, Vendredi 5 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai mené hier ma mère et mes enfants faire une grande promenade. Nous avons été à St Ouen, ce fameux St Ouen le Paing, dont le nom vous fatiguait tant à écrire. Je ne comprends pas que je ne vous l’aie pas épargné plutôt. Mais notre correspondance essuyait tant d’échecs que je voulais prendre toutes les sûretés possibles. St Ouen est à un quart d’heure du Val- Richer. Mais ma mère marche si lentement que nous avons mis trois quarts d’heure. Mes enfants étaient parfaitement heureux. La joie des enfants est charmante à regarder ; d’autant qu’elle ne fait point d’envie à moi du moins. C’est un bonheur bien complet, bien exempt de regret, d’inquiétude. Mais je n’en voudrais pas, et je ne le regrette pas. Nous faisons comme vous. Nous jouissons avidement des derniers beaux jours. Hier était peut-être le dernier. Ce matin, le vent souffle, le ciel est noir, la pluie va venir. J’entends pourtant des paysans qui chantent à pleine gorge dans la vallée en récoltant leurs pommes. Encore des joies dont je ne voudrais pas.
Ce pauvre, M. de Barante sera presque aussi contrarié que M. de Pahlen. Il le racontera moins. Je comprends toutes les malveillances, toutes les hostilités, pas du tout les maussaderies. On peut se détester et se combattre mais on se salue et on se parle comme si de rien n’était. Viendra-t-il un temps où les gouvernements vivront entr’eux tout à fait en gentlemen, polis et pleins d’égards dans les choses extérieures, et indifférentes, quoiqu’il en soit du fond des choses ? J’en doute : il faudrait supprimer le caprice et l’humeur. La nature humaine ne voudra pas. Vous n’entendez surement pas parler de l’élection du Général Jacqueminot qui doit se faire demain. Ce ne sont pas les affaires de votre monde. Il me revient qu’on en est assez préoccupé. Non qu’on ne la regarde comme assurée, mais l’opposition sera forte, plus forte qu’elle n’ait jamais été. A cette occasion on m’écrit de plusieurs côtés qu’on est frappé du terrain que gagne la gauche, et qu’il se dit assez que, si le Ministère durait, il finirait par lui livrer les affaires.
Je viens de recevoir une lettre de Mad. de Rémusat qui m’a touché. Elle est désolée vraiment désolée de la mort de Mad. de Broglie, avec une vivacité, un abandon d’admiration et de chagrin qui sont rares dans le monde. Il est si froid et si sec ! Il est juste en général, mais de cette justice superficielle et indifférente qui est presque une offense pour des cœurs bien émus. C’est une des choses auxquelles j’ai eu le plus de peine à m’accoutumer. Je l’ai fait pourtant. Je ne puis souffrir de laisser aux indifférents le moindre pouvoir de m’atteindre. M. de Turpin, écrit de Venise à Mad. de Meulan que l’effet de l’armistice est vraiment très grand et que l’Empereur sera vraiment bien reçu. Du reste, Venise se relève, dit-il, non pas seulement pour un jour et par artifice, mais réellement et d’une façon durable. Le port se ranime ; les palais se réparent. Avez-vous jamais lu un peu attentivement l’histoire de Venise ? C’est un gouvernement qui a admirablement compris et exploite deux grands mobiles de ce monde, le secret et le plaisir. On n’a jamais si bien su se taire et s’amuser.
10h
Moi aussi, j’ai mes moments où je vous cherche plus encore que de coutume. Ils reviennent souvent. Vous me manquez immensément. Enfin, nous avançons. N’ayez mal aux nerfs que pour me chercher. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Absence, Décès, Diplomatie, Enfants (Guizot), Politique (France), Vie familiale (François)
152. Val-Richer, Dimanche 7 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le soleil est plus paresseux que moi. Il est vrai que la nuit, pendant que je dors, il va servir ailleurs. J’ai bien dormi cette nuit. Depuis quelque temps, cela ne m’arrive pas toujours. Il y a longtemps que vous ne m’avez parlé de votre sommeil ; est-il un peu revenu ?
Je comprends votre impression toutes les fois que vous voyez des gens qui vivent ensemble, des gens heureux. comme vous dîtes. Etes-vous sûre qu’ils soient heureux, heureux de vivre ensemble ? Le bonheur à certaines conditions naturelles, générales ; quand on les rencontre on présume qu’il est là ; un mari, des enfants, un intérieur. Les conditions mentent et le bonheur est rare partout, chez les blanchisseurs comme chez les Ambassadeurs. J’aurais été un peu surpris de voir entrer ici Humboldt et Arago. Surpris parce que le monde le veut ainsi, car je trouve absurde, comme vous, qu’on haïsse et qu’on fuie un homme à cause de sa politique. Ce devrait être comme la guerre ; on se tue sur le champ de bataille ; hors de là, on parle bien les uns des autres, et on dîne ensemble. J’ai beaucoup dîné avec M. Arago chez Mad de Rumford. Il a de l’esprit, un esprit actif et brutal, et le plus vaniteux des hommes. Il avait une femme aimable et sensée qui contenait ses défauts et adoucissait son humeur. Depuis qu’il l’a perdue, il a fait et dit beaucoup de sottises.
On me dit qu’on est fort occupé dans le Cabinet et au dessus, de ce que fera le Duc de Broglie. Son malheur l’éloignera-t-il des affaires ? On assure que oui qu’il ne se souciera plus de rien, que c’est une retraite morale. On le plaint beaucoup, mais on l’approuve. Vous est-il revenu quelque chose de ces prédictions-là ? Elles diffèrent beaucoup de la vôtre. Vous y êtes moins intéressée.
Prenez-vous quelque intérêt à la politique des Etats-Unis ? J’y pense beaucoup. Je lis Washington. J’ai promis de surveiller la publication de ses écrits en France. Je ferai son portrait comme Brougham, probablement un peu moins vite. A cette occasion on m’écrit et on me parle souvent de ce monde-là, qui deviendra grand quoiqu’il arrive. Vous avez bien raison, en Russie de vous soigner de ce côté. La bonne politique, s’y relève un peu. Du moins la mauvaise s’y décrie. On s’aperçoit que le suffrage universel n’est pas le remède universel. L’aristocratie revient sur l’eau. Elle aura bien de la peine à s’y tenir. Tout le monde a peine à s’y tenir aujourd’hui. C’est le mal du temps. Je serais assez aise de savoir ce que pensera de l’Amérique le ministre Autrichien, M. Marchal. C’est un homme d’esprit.
9 h. 1/2
Ma lettre aussi sera courte. Le Dimanche est mon jour de visites. On me dit qu’il y en a déjà deux qui m’attendent dans le salon. C’est de bonne heure. Adieu. Je suis bien aise de vous savoir à la Terrasse. Mais dormez-y. Adieu. Adieu en attendant. G.
153. Val-Richer, Lundi 8 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me souviens qu’hier, étourdiment je vous ai encore adressé ma lettre aux Champs Elysées. Elle vous sera peut-être arrivée quelques heures plus tard.
Je suis fâché de ce que mande M. de Médem, plus fâché que surpris. Il m’a toujours paru, par ses lettres que votre frère était réellement blessé de votre peu de goût pour la Russie. C’est bien lui qui sincèrement ne conçoit pas que vous ne préfériez pas à tout, votre état de grande Dame auprès du grand Empereur dans le grand pays. M. de Lieven est encore plus soumis, pour parler convenablement mais moins russe et vous comprend mieux. Rien n’est pire que l’humeur sincère d’un honnête homme de peu d’esprit. Il se croit fondé en raison, et ce qu’il y a de plus intraitable, c’est la conviction qu’on a raison. M. de Médem aura peut-être choqué encore votre frère en lui répétant que, bien réellement, avec votre santé, vos habitudes, vos goûts, vous ne pouviez vivre ailleurs qu’à Londres ou à Paris. Les gens d’esprit vont quelque fois trop brutalement au fait. Enfin je raisonne, je cherche, je voudrais tout savoir et tout expliquer, tant cela intéresse. Je voudrais surtout que vous eussiez auprès de l’Empereur quelqu’un de bienveillant et d’intelligent, qui vous comprît, et vous fît comprendre. Je crois toujours qu’avec de l’esprit de la bonne volonté et du temps on peut beaucoup, quand on est toujours là. M. de Nesselrode et Matonchewitz, à ce qu’il me semble y seraient seuls propres. Mais l’un est trop affairé, l’autre trop petit, et ni l’un ni l’autre ne s’en soucie assez. Je suppose que vous avez répondu à votre mari.
Montrond a passé en effet son temps chez Thiers. Je suis curieux de ce qu’il y a porté et de ce qu’il en a rapporté, au moins de ce qu’il en dit. Je le verrai à mon retour. Il a vraiment de l’esprit, de l’esprit efficace. Il faut beaucoup pour qu’il rajeunisse un peu. Il était cruellement cassé.
8 h 1/2
Je viens de sortir pour aller voir mes ouvriers. Je plante des arbres. Nous avons depuis huit jours un temps admirable. Ma mère et mes enfants en profitent beaucoup dix fois dans le jour, je les envoie, au grand air, comme on envoie les chevaux à l’herbe. Nous nous promenons ensemble après déjeuner. Le matin, tout à l’heure j’assiste au premier déjeuner de mes enfants, chez ma mère. Trois fois par semaine ; ils viennent chez moi tout de suite après prendre une leçon d’arithmétique. Le soir de 9 heures et demie à 8h 1/2, je leur lis de vieilles Chroniques sur les croisades, qui les amusent extrêmement. Le reste du temps, je suis dans mon cabinet ou je me promène pour mon compte.
Quel est donc le mal de la Princesse Marie ? Quel qu’il soit, j’en suis fâché, et j’espère que ce n’est pas vraiment grave. Elle a de l’esprit. J’ai quelque fois causé avec elle tout -à-fait agréablement. Je m’intéresse à elle comme à une personne en qui on a entrevu en passant plus que le monde n’y verra, et qu’elle-même ne saura très probablement.
J’ai eu hier beaucoup de visites. On se hâte de venir me voir. J’aurai d’ici à quinze jours, quelques dîners à Lisieux private dinners, pas de banquet. Je n’en veux pas cette année Je l’ai dit à mes amis et ils l’ont fort bien compris. Je ne veux pas parler politique avant la Chambre.
10 h.
Le facteur m’arrive au milieu de ma leçon d’arithmétique. Je reçois des nouvelles de l’arrivée de Mad. d’Haussonville. Je veux écrire un mot à M. de Broglie. Adieu. Adieu, comme à la Terrasse, dans ses meilleurs jours. G.
156. Val-Richer, Mercredi 10 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce que vous me dîtes d’un commencement d’agitation politique à propos de l’Orient, entre Pétersbourg, Londres et Paris ne m’étonne pas. Je ne sais rien ; ce qu’on nous dit, ce qui paraît est plutôt pacifique. Mais je sens quelque chose dans l’air, quelque chose de nouveau et j’en crois souvent plutôt mon instinct que ma réflexion. Probablement ce nouveau-là, n’aboutira à rien comme tout aujourd’hui. Pourtant ce sera un pas. On avance en se traînant. Vous avez bien raison, écrire est un misérable moyen de conversation. J’espère à l’autre. Mais ce ne sera pas de l’Orient que nous parlerons d’abord.
J’aurais voulu voir le lit de justice chez Pozzo. Non que je ne sois accoutumé à ces façons-là de notre Chancelier. Je les lui ai toujours vues. Il a toujours manqué de tact et de vraie élégance. Comme bien des gens aujourd’hui, il supplée en fait d’habilité et d’esprit, à la qualité par la quantité. Il n’a rien de rare, mais, il a beaucoup de ce qui sert tous les jours. Il ne faut pas être lui, mais il est très bon de l’avoir pour soi. A propos, savez-vous que l’hiver dernier, il était jaloux de M. Piscatory auprès de Mad. de Boigne ? Je ne sais si cela recommencera cet hiver.
Jeudi 7 heures
Vous tenez un véritable congrès, Matonchavitz, Alexandre, des arrivants de Naples, de Londres, de Pétersbourg. Quand les fabricants de commérages sur vos grandes intrigues sauront tout cela, ils se croiront bien sûrs de leur fait. Moi, je passe mon temps à intriguer avec Marius, Sylla et César. Et nous nous amusons parfaitement mes enfants, et moi, de l’esprit et des actions de ces intrigants-là. On peut vraiment mettre les plus grandes choses et les plus grands hommes à la portée d’enfants intelligents et accoutumés à entendre parler de tout. M. de Broglie me mande qu’il sera obligé de venir à Broglie du 20 au 25 de ce mois, pour affaires, et qu’il viendra passer 29 heures ici. Il ne voit en effet personne. Mais sa lettre ne porte aucun caractère d’abattement qui est la disposition que je craindrais le plus pour lui. Il ne doit rester à Broglie que trois ou quatre jours. Que les impressions sont diverses ! Il m’a paru pressé de quitter Broglie, et effrayé d’y revenir. J’aurais voulu rester toujours aux mêmes lieux, entouré des mêmes objets, menant la même vie. C’est le changement qui me navre et me révolte après la mort.
Ma mère était un peu souffrante hier, toujours de cette même disposition au mal de tête et au vertige. Je lui ai fait faire une longue promenade dans ces bois, sous ce soleil dont je vous parlais le matin. Elle s’en est bien trouvée. Elle a une merveilleuse disposition à se distraire et à se reposer des émotions fortes par les plaisirs simples. Je fais planter des arbres ; elle regarde, elle conseille ; et cet intérêt qu’elle y prend lui fait plus de bien que toutes les tisanes du monde.
Lady Granville a t-elle fait sa déclaration à Marie. Vous savez que j’en suis curieux. Je ne doute guère de la soumission au premier moment. C’est l’exécution qu’il faut voir. Vous arrive-t-il comme à moi ? Il y a deux époques où je ne me plais guère à vous écrire, et suis en un moment au bout de ce que j’ai à vous dire; c’est quand je viens de vous quitter, et quand j’approche de vous revoir. Entre deux je me résigne, je m’établis. Mais les premiers et les derniers temps sont durs.
10 heures 1/4
Vous aimez les petits mots. J’en ai le cœur plein. Je ne peux pas, vous les envoyer tous. Je vous les apporterai. Adieu, Adieu Moi, j’aime la visite de Mad. de Talleyrand. G.
155. Val-Richer, Mercredi 10 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici la proposition que je viens de recevoir. Il paraît qu’il y a des gens qui ont envie de fonder une nouvelle religion, de faire, dans le catholicisme et le Protestantisme, une nouvelle réforme. Ils m’ont écrit pour me proposer d’être leur Pape. Le Maréchal de Brissac, montrant un jour le crucifix à son fils enfant lui disait : " Regarde bien Timoléon, voilà ce qu’on gagne à vouloir changer la religion de son pays. Je n’ai encore gagné que la proposition d’être Pape. A la vérité je ne veux point changer la religion de mon pays, et n’ai rien fait pour cela. Je me suis borné à en parler très respectueusement. " Un autre Monsieur, qui est Juif et s’appelle M. Salvador vient de faire un gros livre pour prouver que le Christianisme est fini, et qu’il faut revenir au Judaïsme en l’accommodant à notre temps. Il m’écrit aussi pour me conjurer d’engager avec lui une polémique, afin qu’à nous deux nous vidions cette grande querelle. Est-ce que j’ai dit assez de sottises pour attirer vers moi ceux qui en font ?
J’ai eu un moment l’envie de vous engager à lire les écrits de Mad. Guyon. Il y a quelquefois des choses très touchantes, très pénétrantes, très belles, qui auraient bien été à la disposition de votre âme. Mais j’ai rouvert le livre, et je ne vous en ai pas parlé C’est trop fou. Vous avez la combinaison la plus difficile à satisfaire, beaucoup d’imagination et beaucoup de bon sens, l’âme tendre et l’esprit positif, ce qui met sur le chemin de la folie et ce qui en écarte. Et puis les livres n’ont pas grand pouvoir sur vous. Il vous faut des actions et non pas des paroles. J’ai pensé à tout cela cette nuit, ne dormant pas. C’est pourquoi je vous parle.
Je viens de me lever. Le temps est admirable. Le soleil achève de dissiper un brouillard qui roule en s’en allant, sur les bois et sur les prairies. L’air et ma vallée sont pleins de mouvement, et d’un mouvement où la bonne cause triomphe. Dans une heure tout sera charmant autour de moi. Une longue promenade ensemble sous ce soleil brillant, dans cet air frais, nous ferait plus de bien à tous deux que tous les livres du monde. On dit que Louis Buonaparte est parti de Suisse. Convenez qu’il est difficile de faire plus ridiculement sa volonté et de moins bien finir une affaire qu’on finit. Si nous vivions dans un temps où les esprits fussent un peu exigeants, un peu hauts, il y aurait là de quoi perdre un Cabinet. Mais nous sommes à une époque de bon marché, comme on dit. On veut un gouvernement bon marché. on s’en contente à bon marché. Le salon de la Terrasse est-il bien arrangé ? On n’a rien changé dans le petit cabinet, n’est-ce pas ? Verrez-vous beaucoup les Holland ? Sont-ils à l’hôtel de Bath ? Que c’est ennuyeux de vous faire des questions ! Quand je serai là, je saurai tout.
10 h.
Je suis charmé que votre monde vous soit arrivé. Nous causerons ce soir. Adieu. On m’attend en bas pour je ne sais combien de petites affaires. Adieu Adieu. Dormez donc. G.
157. Val-Richer, Vendredi 12 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait comme vous. Je me suis couché hier à 9 heures et demie. J’avais beaucoup travaillé dans mon Cabinet et beaucoup couru dans mes champs ; deux choses que je puis très bien faire séparément mais pas bien ensemble. J’ai toujours éprouvé cela ; de l’activité d’esprit ou de corps, tant qu’on voudra ; mais l’une ou l’autre. Dans mes moments de grande préoccupation morale une course à pied d’une demi heure me fatiguait.
Vous verrez que Mad. de Talleyrand viendra chez vous cet hiver chercher des nouvelles. Je ne lui vois que M. Royer-Collard qui puisse lui en apporter un peu. Encore est-il lui-même fort en dehors de tout. Mais il vit à la Chambre et il voit quelque fois les Ministres. Je trouve ce que vous me dîtes à propos de sa visite fort naturel. Vous réagissez, et elle non. Elle a l’air embarrassé et vous non. Cela est dans l’ordre.
L’article des Débats d’hier sur l’Angleterre, l’Inde et la Russie est curieux. Est-ce qu’il y a vraiment chez vous quelque projet semblable ? Je ne dis pas projet lointain. général, politique d’ensemble; rien de plus simple, mais projet prochain, actuel. Ce serait étrange. Du reste cela s’est vu : beaucoup de prudence, de timidité même pour ce qu’on a sous la main à sa porte ; et des intentions, des combinaisons, même des préparatifs gigantesques pour ce qui est loin, bien loin. On satisfait ainsi, à la fois son imagination et sa raison. Et l’imagination se passe d’apparences et de paroles. à la bonne heure.
Lisez vous quelques fois le petit journal de Thiers, le Nouvelliste? Il est bien vif contre le Cabinet. Thiers n’a plus tout le Constitutionnel. M. Molé s’y est glissé ; non pas de manière à l’ôter à d’autres, mais pour y avoir; un petit coin à lui. C’est sa façon de procéder. Il n’en est pas d’un journal comme d’un cœur ; on n’est pas obligé à tout ou rien. Je vous quitte pour aller voir si on plante mes arbres. Vous ne savez pas et vous ne saurez jamais ce que c’est que de surveiller des ouvriers. Mais pardonnez moi de vous trouver, quant à la température, un peu inconséquente. Vous me dites, page 1, Il fait très froid. et page 2, Comment, vous avez du feu dans votre chambre ! Cela me paraît incroyable. Quand Dieu fait très froid, moi, je fais du feu. Vous êtes à ce qu’il me semble, beaucoup plus résignée.
9 heures
Mes plantations se font bien. Je me prête, je crois, de très bonne grâce aux affaires et aux plaisirs de la Campagne. Et j’en jouirais très vivement si je les partageais. Mais je ne les partage pas. Aussi ne fais-je que m’y prêter. Voilà le facteur et une bonne lettre. N’oubliez rien, je vous prie de ce que vous avez eu une fois et un moment le projet de me dire. C’est là le mal cruel de l’absence entre tant d’autres ; on perd une infinité de choses, qui étaient bonnes, charmantes, mais qui passent avant qu’on se retrouve. Même quand je vous aurai retrouvée j’aurai beaucoup, beaucoup à regretter. N’oubliez donc pas. Je ne sais ce que feront mes amis, rien de déplacé j’espère. Pour moi, je n’irai certainement pas ailleurs que la où j’ai toujours été, depuis huit ans entr’autres. Je suis plus que jamais convaincu que c’est d’idées et de pratiques gouvernementales que la France a besoin. Et ce qui me fâche c’est qu’on l’en éloigne au lieu de l’y conduire. Si je me plains, ce sera de ce qu’on pousse ce pays-ci vers M. Odilon Barrot. Adieu. Adieu. Que c’est long ? G.
163. Paris, Dimanche 14 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai mal dormi ; je me suis levée très tard. J’attends Matonchewitz tout à l'heure, & je n’ai pas encore fait ma grande toilette. Voyez comme tout cela est enrageant. Et puis dimanche par dessus le marché ! Hier il a fait si froid que j'ai du prendre la voiture fermée. J'ai été à Auteuil où j’ai trouvé beaucoup trop de monde je n’y suis restée que cinq minutes. J'ai dîné chez la D. de Talleyrand avec Alava de là j’ai été de bonne heure chez Lady Holland. M. Molé y dînait. Mad. de Castellane y est venue après, et tout mon monde.
M. Molé a envoyé l’ordre que le corps d'observation reste sur la frontière, attendu que Louis Bonaparte n’a pas quitté encore son château. C’et décidément en Angleterre qu'il doit se rendre & de là aux Etats-Unis/ M. Molé n’avait pas l'air de bien bonne humeur. Il est parti aussi tôt que Mad. de Castellane est entrée.
Le Roi ne rentre en ville que mardi ce jour là aussi on attend Léopold. La conférence ira à ce qu’on croit & dans notre sens, parce que l'Angleterre se joint à nous. a propos Lord Palmerston a proposé d’établir à Londres une conférence pour régler les Affaires de l’Orient Nous avons décliné péremptoirement. Ce sont nos affaires. Demain sera vraiment la moitié du mois d'octobre !
Adieu. Cette semaine sera bien remplie pour moi. Mon fils, Matonchewitz, les Sutherland. Tout cela me quitte avant vendredi. Les derniers arrivent ce soir ! Ils me prendront beaucoup de mon temps aussi. Je voudrais partager toutes ces ressources, tous ces plaisirs, et tout cela vient à la fois ! Ecrivez-moi ; il est bien vrai que j'ai de vous une lettre tous les jours, mais cela ne me parait pas assez. Adieu. Adieu. Je suis bien casée & j'aime bien notre cabinet. Adieu encore.
164. Paris, Lundi 15 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Trois heures de causerie avec Matonchewitz, et puis une promenade bien froide en calèche avec mon fils, ensuite le Prince Paul de W. et au moment de ma toilette Lady Granville Voilà ma matinée hier. J’ai dîné chez le duc de Palmella, où je me suis ennuyée ; je suis rentrée chez moi au sortir de table ; j’ai eu beaucoup de monde que j’ai chassé à onze heures. Ma journée a été remplie c'est à dire dissipée. Cependant les visites de Motonchewitz comptent. J'aimerais bien le garder ici, & il en a une grande envie, mais au bout du compte, il en sera encore plus profitable à Pétersbourg. Il part jeudi. Lady Clauricarde va demeurer dans ma maison, dans ce Palais si beau, si horrible pour moi. J’ai été saisie hier quand on me l’a annoncé.
Pozzo a une ample permission de venir à Paris et d’y rester jus qu’au mois de février. Il en est enchanté et moi aussi. Tcham est tout ahuri de ce que l’affaire suisse n’est pas finie tant que Louis Bonaparte y reste vous continuez votre attitude guerrière. Il a déposé cependant entre les mains du Gouvernement de Thurgovie une déclaration dans laquelle il se dit français. Mais ces gens sont un peu à sa dévotion, et ils ne donnent pas de publicité à cette déclaration.
Je vous remercie de me parler de nos habitudes d’hiver. J'y pense bien moi. J’arrange aussi, quel plaisir que tout cela ! J’ai fait la paix entre la Duchesse de Talleyrand et Lord Holland. Elle était désirée des deux partis. Ils se verront aujourd’hui. Je voudrais bien parvenir à montrer Berryer aux Holland, mais il n’est pas ici ; et ils partent le 25, encore une fois quel dommage que vous ne les voyez pas ! Ils en sont très contrariés. Ne me trouvez-vous pas bien égoïste dans ce que je vous dis sur Matonchewitz ? Un grand défaut est de ne jamais prendre le temps et la peine d’expliquer ma pensée. Ainsi ce que je vous dis à son égard qui me regarde, le regarde lui bien davantage encore. Il faut qu'il parte, car sa carrière est finie, s'il reste à Paris. Pour mon plaisir, pour le profit de ma curiosité, il me serait bien agréable ici. Il sait tout. Il est au courant de tout. Il est discret, prudent; sûr. C’est bien rare.
Voilà un temps doux & mou. Le même degré hier au thermomètre, et une sensation charmante au lieu de la plus désagréable. Madame de Castelane m'accable d’attention et de cadeaux. Il faut que je rende, les cadeaux s'entend. Je viens de m'arranger pour cela avec Fossin. Vous doutiez-vous en me faisant l’éloge de Lord Halland dans votre dernière lettre que vous faisiez un peu, non pas un peu, tout-à-fait ma critique ? Je vous en remercie, cela me fait toujours du bien, quoique je ne réponds pas que je me change. Je suis bien vieille pour changer. Il y a vingt ans de cela que je devais faire votre connaissance, comme je serais autre, comme je vaudrais mieux !
Adieu. Adieu. J'écris toujours à mon mari, mais vous verrez qu'il va reprendre son silence. Celui de mon frère me surprend. Adieu de tout mon cœur.
Mots-clés : Autoportrait, Politique (France), Vie familiale (Dorothée)
161. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
166. Paris, Mercredi 17 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez bien raison, et je suis très fatiguée, et je suis très maigrie, c’est trop pour moi, et je ne me résigne parce que cela va cesser. J’ai passé presque ma journée entière hier avec les Sutherland ; aujourd’hui encore. Après demain ils partent. Je vois même très peu mon fils, heureusement il reste quelque jours de plus. Le Roi de Hanovre me mande que l’Empereur était très triste et a battu à Postdam, on ne sait de quoi. Du reste, il est en santé parfaite.
Je ne m’accorde pas du tout avec vous sur l’Orient. Je ne vois pas à quelle bonne fin, nous perdrions l'Angleterre dans nos conseils sur cette question. Ce n’est pas avec elle qu’elle s’arrangera jamais, ce sera contre elle. Il y a d'autres puissances qui feraient meilleur ménage avec nous sur ce point & vous les connaissez. Mais en attendant que cette affaire arrive au point où il faudra la résoudre. Il est bon qu’elle reste comme elle est. Miraflores vient d'être nommé ambassadeur ici, ce qui le comble de joie. Il n'y avait rien de nouveau hier de Madrid.
Vous savez qu’on a reçu hier la nouvelle que Louis Bonaparte est parti le 14 & qu'il sera le 19 à Londres. C’est donc vraiment fini. Lord Granville a vu le Duc de Broglie hier. Il l’a trouvé extrêmement abattu & changé. Il lui a dit qu'il ne songeait pas à aller à Broglie. Il ne quittera pas Paris. J'ai dîné hier chez Lady Granville ; rien qu'Angleterre, 20 anglais. Je n’ai pas fermé l’œil cette nuit. C'est déplorable. Lady Jersey me mande qu'elle a vu mon mari à Munich, à Innsbruck, et que le grand Duc a parfaitement bonne mine. Adieu, je vous écris en me levant dans la crainte que plus tard je ne trouverai plus un moment. Voyez aussi comme je griffonne. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Politique (France), Politique (Internationale)
168. Paris, Vendredi 19 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé une bien mauvaise journée hier. J’avais les nerfs tout à fait dérangés. Je me suis promenée assez longtemps au Bois de Boulogne avec mon fils ; le temps était passable. Avant le dîner, j’ai eu une longue visite de Montrond. J’ai dîné seule avec Marie, Alexandre dînait chez M. de Pahlen. Le soir, mon fils est allé au spectacle, Marie à l’Ambassade d'Angleterre, et moi dans mon lit. J'ai un peu dormi, & je me sens moins malade aujourd’hui.
Montrond est assez questionneur, assez causant, et assez en bonne humeur. Il a certainement beaucoup d'esprit. Il dit que Thiers est en bonne disposition. Il espère que vous l’êtes. Il ne dénigre personne, mais il exalte le roi. La Duchesse de Talleyrand a vu le Roi hier elle est bien traitée là. Elle essaye d’être bien un peu partout. M. Salvandy va beaucoup chez elle. Ma grande Duchesse Marie épouse vraiment le Lenchtemberg, les Russes jettent les haute cris avec raison, c'est égal, il sera notre gendre. On lui prépare un beau palais à Petersbourg, il doit y arriver dans huit jours. Nous aurons l'honneur d’être cousin de Louis Bonaparte. Il entre au service de Russie, (le gendre par Louis Bonaparte).
Le comte Woronzoff s’est démis de son gouvernement de la mer noire. Il était trop populaire. On a fait sa femme ce que je suis; ou espère par là calmer son mécontentement. Je suis ravie des dîner d'Adieux. Les Adieux de Normandie ne sont pas comme les nôtres.
On s'occupe beaucoup de l’Espagne. Je ne crois pas du tout que le dénoue ment soit prochain mais je crois sûrement au triomphe définitif de Don Carlos. Selon les propos de Montrond je croirais qu'on n’est pas tout-à-fait content du duc d’Orléans, ne savez-vous quelque chose. A propos, la cour désirerait le retour des Flahaut. On trouve qu’il n’y a plus un salon à Paris, & c’est vrai. M. de Talleyrand, Madame de Broglie, Madame de Flahaut de moins, c’est beaucoup. Quelle pauvre ville que votre grande ville, quand on en est réduit à avoir besoin de Marguerite. Adieu. Adieux.
Mots-clés : Politique (France), Politique (Internationale)
Laffitte, le 21 octobre 1838, Eloi Mallac à François Guizot
171. Paris, Lundi 22 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai fait hier ma dernière grande promenade au bois de Boulogne avec mon fils. Il me quitte aujourd’hui. Il n’est pas homme d'esprit, mais il est si doux, si bon, si affectueux pour moi et il a tant de bon sens que c’est vraiment une bien douce société pour moi. Il retourne à Naples. Il me promet de revenir me trouver l’été prochain, que sera l’été prochain pour moi ?
J'ai eu beaucoup de monde hier au soir ; je n'avais de fixe que les Holland & Berryer, c’était une affaire commune ; les autres entrent quand ils voient les lampes. On s’est écouté vers les onze heures, & alors a commencé la véritable causerie avec Granville du plus. Il me parait que Berryer et Lord Holland ont été réciproquement frappés l’un de l’autre. Berryer compte sur une session importante ; dont vous & M. Odillon Barrot serez les principales figures. Il trouve Thiers fort effacé dans la chambre, et votre parti fort grandi par la presse. Il est impatient de vous revoir. En attendant il fait à ce qu’il dit le paysan.
Les Holland partent samedi, ils ne peuvent pas vous attendre. Cette affaire du Canada va amener des délibérations du Conseil, & peut être, une convocation du parlement. Cependant, ils ont confiance dans le général Colburne qui garde son commandement, & qu’on dit un homme de guerre & un homme de tête, supérieur. Lady Burgharsh est venue aussi hier au soir. Elle est bien changée. La pauvre femme a perdu il y a deux ans un enfant, une fille de 16 ans, charmante. Mon ambassadeur parle à tout le monde de ses embarras de maison. C'est un peu ennuyeux & on commence à en rire, mais lui en maigrit. Les Appony passeront le 8 Novembre dans leur maison, ils sont enchantés. La Duchesse de Talleyand a donné hier à dîner à M. Molé & Mme de Castellane. Si elle ne les nourrit pas mieux que moi ils seront un peu étonnés. Adieu.
Le temps est ravissant. Je vais m’établir aux Tuileries. Si vous y veniez avec moi, quelle jolie causerie nous aurions dans ce bon air qui est si gai aujourd’hui. Moi, je ne le suis pas. Adieu, adieu.
167. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Est-ce que si vous étiez bien parfaitement sûre que le mal de votre situation vient de gens incurables en effet, bien vraiment incurables cela ne vous calmerait pas au lieu de vous agiter ? Excepté les peines de cœur auxquelles la nécessité, l’inévitabilité n’est pas du tout un remède, je ne connais rien d’aussi calmant que la certitude qu’il n’en peut être autrement. Il me semble que j’ai une infinité de choses, et de très bonnes choses à vous dire sur cela. Mais je ne les dirai pas de loin. Rien n’est bon de loin. Bientôt nous serons près. En attendant, je pense sans cesse à vous. Telle vous voyez Mad. de Talleyrand, telle elle a été toujours. Seulement, quand elle avait M. de Talleyrand derrière elle, cela paraissait moins. Elle ne prendra pas l’aplomb qu’elle cherche. Elle a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir qu’il lui manque, et pas assez de hauteur, de de suite dans le caractère pour l’acquérir. Rien n’est pire que de connaitre en vain son mal. Quand on n’en peut guérir, il faut l’ignorer.
Je vous ai demandé une fois, si vous preniez quelque intérêt aux Etats-Unis, à quoi vous n’avez pas répondu. Il faut bien que j’y prenne intérêt puisque je m’en occupe. Mais Washington à part, il m’est arrivé, les jours derniers de Boston une nouvelle et grande quarterly review qui ma fort étonné, tant j’y ai trouvé d’esprit, de bon et presque de grand esprit quoique un peu enthusiantic and unexperienced. C’est très supérieur à tout ce que j’avais vu de là. L’auteur est un M. Greene, jusqu’ici inconnu, pour moi du moins. Je prends un vrai plaisir à découvrir dans le monde un homme de plus. un homme, c’est un monde.
On m’écrit qu’une affaire à laquelle vous n’avez certainement jamais pensé devient pour le Cabinet un assez gros embarras, l’affaire des sucres. Vous ne savez peut-être pas qu’il y a deux sucres, deux sucres en guerre, le sucre de canne et le sucre de betterave. Ils veulent absolument. ou qu’on leur sacrifie leur rival ou qu’on les mette d’accord. Malgré, son talent de conciliation, M. Molé n’en peut venir à bout. Il y a là quelque chose de plus à faire que de donner des paroles à droite et à gauche. Les intérêts sont en présence, très positifs et très animés. Ils exigent qu’on ait un avis, une volonté. M. Duchâtel m’écrit qu’on a trouvé cette exigence par trop forte, et qu’on n’aura, ni volonté, ni avis. Je vous mande tout ce qu’on me mande. A propos de M. Duchâtel, sa femme vient d’accoucher d’un garçon. Il est bien content.
Vous ne vous doutez pas du petit plaisir que j’ai à regarder ce matin par ma fenêtre. Il fait beau, s’il n’avait pas fait beau, j’aurais eu sur les bras, pendant quatre ou cinq heures, entre les quatre murs de mon salon, les vingt hôtes que j’attends de Lisieux à déjeuner. Grace au soleil, je pourrai les mettre dehors, je veux dire les promener.
10 heures
Je ne reçois pas une ligne de vous, je ne pense pas une fois à vous sans que mon désir de me retrouver auprès de vous redouble. Enfin, j’approche. Je vous aime bien tendrement. Je ne puis pas pour vous ce que je voudrais ce que je pourrais pas la millième partie, mais enfin, de près, je puis quelque chose, je fais quelque chose. Votre tristesse me pèse bien plus quand je ne la vois pas. Je serai triste avec vous. Je serai gai pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous faire un peu de bien. Je vous aime trop pour ne pas vous faire du bien. Adieu. Adieu. G.
170. Val-Richer, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je commence à vous écrire ici. Ce soir et demain matin à Lisieux, je n’aurai pas plus de temps que ce matin. Je suis désolé de l’état de vos nerfs. J’espère que l’indisposition de votre fils ne sera rien, et n’aura d’autre effet que de vous le laisser quelques jours de plus. Je ne puis partir d’ici que le 5 novembre. J’ai fait et je fais force de voiles pour finir je ne sais combien de petites affaires, qui sont pourtant des affaires, et que je ne puis laisser en arrière. Ma mère de son côté m’a demandé jusqu’au 5 pour ses arrangements de ménage. Ces cinq jours de retard me contrarient vivement. Il n’y avait pas moyen. Nous partirons le 5 au soir. Nous arriverons le 6 pour dîner. Je vous verrai le 6, à 8 heures du soir. Nous voilà au moins à jour fixe. Aurez-vous un bon jour en me revoyant ? Je voudrais bien vous égayer vous distraire. Je ferai de mon mieux. Il y a des choses dont je suis sûr. Il y en a d’autres sur lesquelles notre disposition, n’est pas, la même. Les mêmes remèdes ne nous sont pas bons à l’un et à l’autre. Mais, quoique je n’aie plus vingt-cinq ans je persiste à croire beaucoup qu’on trouve ce qu’on cherche et qu’on peut ce qu’on veut. Je chercherai et je voudrai. Vous avez raison de vouloir de l’éclat, de la grandeur. C’est aussi mon gout, très décidé, et l’un des mérites en effet des monarchie. Cependant je ne puis souscrire absolument à votre arrêt. La République romaine a bien eu quelque éclat, et il n’y a pas beaucoup de plus grandes figures que Scipion et Annibal. Il y a république et république, comme aussi monarchie et monarchie. Il me revient que Thiers est fort triste, fort abattu et assez de l’avis que vous me mandiez de Berryer. La tristesse est en général pour Thiers une source de bonne conduite. Nous verrons. Il revient vers le milieu de novembre.
Lisieux, jeudi 9 heures
J’attends votre lettre. Je n’aime pas à attendre dans les auberges. Nulle part le sentiment de la solitude n’est plus vif. C’est ce qui fait qu’il est charmant de voyager avec quelqu’un qu’on aime. Le monde disparaît. On est vraiment seule. Il y a, dans je ne sais plus quel roman de Mad. de Stael, une page où cela est senti et dit à merveille. A propos de Mad de Stael, j’ai écrit ces jours-ci sur l’état des âmes, dans notre temps, quelques pages qui paraîtront dans la Revue française et où j’ai un peu parlé de Mad. de Broglie. On dit bien peu ce qu’on pense quand on pense vraiment quelque chose sur quelqu’un qui le mérite. Je voudrais avoir réussi cette fois. Vous me le direz.
Voilà 173. Toujours aussi nervons. Il fait pourtant beau. Je ne sais pourquoi je dis pourtant, car décidément je n’aime pas les beaux jours d’automne. Je les accepte, j’en jouis même. Mais on n’aime pas, tout ce dont on jouit. On n’aime que ce qu’on préfère. Adieu. Je remonte en voiture. Les dîners me laissent cinq jours de repos jusqu’à mardi. Je donne cette lettre à la poste avec chagrin. Ces cinq jours de retard vous déplairont, comme à moi. Adieu. Adieu. G.
169.Lisieux, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier au moment où j’allais partir, deux personnes me sont arrivées qui viennent passer deux ou trois jours au Val Richer. Il a bien fallu les y laisser pour venir dîner ici, et je les laisserai encore aujourd’hui. Aussi je retourne, sur le champ pour être poli au moins à déjeuner. Encore aujourd’hui vous n’aurez donc que quelques lignes. Cela me déplaît, je vous assure autant qu’à vous. Il me semble que je vous ai sous ma garde, et que je manque à ma consigne quand je vous quitte. Il faut que vous me plaisiez beaucoup et bien sérieusement pour qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas le goût ni l’habitude, des devoirs factices, et je n’aliène pas aisément une part de ma liberté. Vous avez vécu dans un pays libre, représentatif, électoral. Mais vous n’en avez jamais mené la vie. Vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un grand dîner d’électeurs importants, où viennent s’étaler toutes les importances, toutes les magnificences de l’endroit où il faut passer deux heures à table mangeant et causant, deux heures après la table causant et jouant au trictrac, avec 40 personnes. Voilà ma vie hier et aujourd’hui. Cela aussi, il faut que ce soit bien sérieux pour que je le fasse. Mais c’est un sérieux moins plaisant.
Je crois comme Berryer que la prochaine session sera importante et très animée si chacun consent à prendre sa position simplement, nettement, sans but immédiat et sans combinaison factice. C’est, pour mon compte, ce que je me propose de faire. Adieu. On me dit que ma calèche est prête. La poste n’est pas encore arrivée. J’espérais l’avoir avant de partir. Elle viendra me chercher au Val-Richer. Il a fait un brouillard abominable, cette nuit. Le courrier aura marché plus lentement. Adieu. Adieu. Non pas comme si nous nous promenions, aux Tuileries, mais comme dans notre cabinet. G.
171. Val-Richer, Vendredi 26 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quoique vous me disiez que votre fils n’a pas encore quitté son lit je me tiens pour assuré que son indisposition n’est rien. Ne le laissez pas répartir pour Naples sans qu’il soit tout à fait remis. Je ne suppose pas que vous ayez à Naples des affaires qui exigent instamment sa présence. Quand je serai près de vous, je vous désirerai toujours les personnes que vous aimez et qui vous sont bonnes, mais de loin, ce désir va jusqu’à l’inquiétude, et j’ai de la reconnaissance pour votre fils, comme s’il sentait pour moi. Il me paraît qu’on est fort préoccupé de la crainte que nous ne fassions de l’opposition. Cela me revient de tous les côtés et le langage du Journal des Débats me confirme ce qui me revient. Non seulement, on ne veut pas que nous parlions contre l’opposition, mais on nous prédit toutes sorte de malheurs, si nous restons muets. On veut que nous parlions... pour le Ministère apparemment. On voudrait bien avoir des bravi d’éloquence comme au moyen âge on en avait d’épée. En attendant, on chante les hymnes en l’honneur de M. Molé. Mais l’hiver arrive ; et quand il est là, il ne sert pas à grand chose d’avoir chanté, tout l’été. Vous avez bien raison de vous étonner des illusions de M. de Flahaut. Quand il était auprès du Duc d’Orléans, il ferait un peu ses affaires lui-même, et il y avait quelque raison de le ménager. Mais aujourd’hui, qu’a-t-on à espérer ou à craindre de lui ? Et quant au salon de Mad. de Flahaut, on n’est pas assez sûr qu’il fût bon pour désirer réellement qu’il soit ouvert. On ne fera rien pour eux ; et ils font bien de ne pas revenir. Il y a dans les cours, (puisque cour y a) un genre d’hypocrisie qui m’a toujours été insupportable ; c’est la prétention, quand l’occasion s’en présente, à être traité comme s’il y avait de l’affection, quoiqu’on n’y croie point et qu’on n’en ressente point soi-même. On parle d’ingratitude, de froideur, de sécheresse. Les Rois n’aiment qu’eux- mêmes et leur famille. C’est une de leurs grandes infériorités. Mais, pour peu qu’on ait vécu auprès d’eux, cela est si clair ! Savez-vous qu’elle est la situation admirable, qui fait d’un homme tout ce qu’il peut être ? C’est celle d’un Roi légitime qui a été obligé de reconquérir son royaume qui s’assied sur le trône par son droit, et y est monté par son fait, qui est né pour la vie royale et à mené la vie humaine. Gustave Wasa et Henri 4. Ceux-là ont aimé et ont été aimés.
Le Duc de Broglie m’écrit que sa santé est bonne et qu’il va tous les jours, à midi, faire le tour des grandes allées désertes du Champ de Mars. Il a l’air de m’attendre, impatiemment. On me dit d’ailleurs de sa fille : " Mad. d’Haussonville s’apaise un peu. Mais ce pauvre jeune esprit reste sans mouvement, et le moindre effort pour le ranimer lui cause une impression douloureuse. Elle ne sait que trop tout ce qu’elle a perdu. " Je suis bien aise qu’elle le sache, et Je désire pour elle qu’elle le sache toujours. Avec une longue vie devant soi, il n’y a rien de plus salutaire qu’un souvenir respecté et chéri. La voix des morts n’offense jamais et on accepte d’eux des vérités qu’on ne supporterait pas d’une bouche vivante. Sans savoir ce qu’ils sont, on les croit, on les sait parfaitement désintéressés et sincères.
10 heures
Seulement adieu. Je reçois trois ou quatre lettres auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Adieu. Il n’y a plus qu’une semaine entière entre nous. C’est encore bien long. Mais enfin, ce n’est plus que cela. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Politique (France), Réseau social et politique
175. Paris, Vendredi 26 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous ferai mon journal comme de coutume, mais je ne répondrai pas à votre lettre, car je sens qu’une réponse pourrait vous déplaire ; et que de mon côté, je ne dirais jamais assez tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je me permettrai un mot cependant, c’est que je n'ai jamais douté que vous me ménagiez une nouvelle surprise.
Après ma promenade ordinaire, j'ai été hier faire visite à M. de Broglie. Je l’ai trouvé un peu maigri et l’air grave et triste mais pas changé comme on me l’avait dit. Nous n’avons pas parlé de sa femme, je ne sais pas parler, mais j'ai senti des larmes dans mes yeux. Il m’a dit qu’il n’avait jamais songé à faire une visite en Normandie ni à bouger de Paris. Où aviez-vous pris qu'il y irait ? Un homme seul me parait une chose bien triste, sans doute je me trompe et un homme doit savoir mieux que nous employer son temps mais son home a un air d’inconfort qui ajoute ce me semble au chagrin.
J’ai eu hier une longue visite des Appony. Ils sont gais, et joyeux d’entrer dans une belle maison toute fraîche. Sûrement cela fait beaucoup à l'humeur, car ce sont des jouissances de tous les instants. Il n’y pas de nouvelles, on espère et on croit toujours que l’affaire Belge s'arrange, mais cependant on n’a pas encore le dernier mot des deux parties intéressées sur l’affaire de la dette.
Lady Carlisle est venue me dire adieu elle part aujourd'hui. C'est une bonne femme et qui est très accoutumé à m’aimer. Le soir j’ai eu du monde. Une querelle entre mon Ambassadeur et M. de Mossion sur l’affaire Suisse. C’est rare que M. de Pahlen discute, mais il a M. Mossion en horreur. George Harcourt et de retour, il est venu. J’aime beaucoup ses manières. J'aime beaucoup les bonnes manières. Le temps est à la pluie, froid et triste, & moi je ne suis pas gaie. Il m’est impossible de vous dire adieu.
Le gouvernement fait des conquêtes. Messieurs de Hautpoul, le marquis d’Oudinot et d’Aligre sont ralliés à la cour.
176. Paris, Samedi 27 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Adieu. Je commence aujourd'hui comme je n’ai pas voulu finir hier. J'étais en bien méchante humeur hier. Je le suis encore un peu aujourd’hui et cela me restera jusqu’à votre arrivée simplement, parce que je ne puis pas vous écrire toutes mes mauvaises pensées. Une fois celles là dites, mon cœur sera soulagé. Mais mon refrain restera toujours. L’année 38 ressemble bien jusqu'à 37 !
Il y a de drôles de passage dans votre lettre ce matin. Ils ne promettent pas un grand appui de votre part au gouvernement ! M. Molé est fort tranquille à ce qu'on dit. La Duchesse de Würtemberg va partir tout de suite pour Gènes où elle passera l'hiver. Elle est dans un état déplorable ! C’est un mélange de poitrine & d’intestins délabrés.
Le Roi est allé voir Mademoiselle Rachel hier. Je vous ai dit je crois, qu’au dire de Mad. de Talleyrand elle est fort médiocre. Lord Holland est venu me faire une longue visite hier matin. Nous avons parlé de toutes les affaires. Il est timide en politique. Il a bien plus de courage quand il est dans l'opposition. Il a été tendre et aimable pour moi et presque tendre en me disant adieu.
J’ai fait une tournée de visites avec Lady Granville. Fagel est venu me voir un moment avant ma toilette. Il a fort mauvaise opinion des affaires de son pays. J’ai dîné chez la Duchesse de Talleyrand avec le duc de Noailles, qui a l’air fort gai. Il reste à Paris ; on y revient. Le soir j’ai été passer une demi- heure chez Lady Granville. Il y avait une nuée d'Anglais dont je ne connaissais pas un. Lady Holland avait encore hier un petit rendez-vous avec M. Molé qui l’a singulièrement soignée. Il a bien fait & fort réussi. Ils partent ce matin et arriveront dans huit jours à Boulogne ! Je viens de faire une promenade aux Tuileries avec Lord Coke. Il me donnait le bras. Cela m’a fait du mal !
Adieu, le temps me paraît bien long !
Mots-clés : Politique (France), Réseau social et politique
173. Val-Richer, Dimanche 28 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais que vous pussiez voir, voir dans la réalité et par le menu, les soins que j’ai eu à prendre, et que j’ai pris, dans mon intérieur et dans mes affaires auprès des personnes, et auprès des choses pour retourner à Paris dans les premiers jours de Novembre, au lieu de rester ici jusqu’à l’ouverture de la session. C’est ma seule réponse possible à votre n° 175. Mais vous ne l’avez pas vu, et moi, je ne vous le dirai pas. C’est triste.
Voici ce que je trouve dans une lettre que m’écrivait, le 8 octobre, le Duc de Broglie, à moi et non pas à ma mère : " Je compte toujours aller à Broglie d’ici à quinze jours ; et si j’y vais, j’irai voir vous et votre mère. Dites lui bien des tendresses pour moi ; elle me manque beaucoup. " Ma mère a été très souffrante hier tout le jour de ses pesanteurs de tête et de ses vertiges. Quand elle en convient, il faut que ce soit bien réel, car je n’ai jamais rencontré de personne plus dure à elle-même. Je l’ai tenue dehors presque toute la journée. Ce n’est pas très aise à présent, car on ne peut plus guère s’asseoir dehors.
Mes enfants, en ont profité pour passer aussi toute là journée à l’air. Il y sont beaucoup en général ; mais ma mère à un peu la manie des leçons et quand je puis lui en voler quelques unes ; j’en suis toujours charmé. Du reste, ils ne sont point à plaindre ; ils ont ici un petit cousins qui est venu passer quelques jours au Val Richer, et avec lequel ils s’amusent parfaitement. Le plaisir est encore plus vif pour ce petit garçon que pour mes enfants. Il a été élevé seul. Il éprouve à sortir de sa solitude, à vivre avec ses parents, une joie qui me fait spectacle. C’est une curiosité et une surprise de tous les moments. Il découvre un nouveau monde. C’est du luxe, de la part de M. de Pahlen qui discute si peu, de discuter avec M. de Maussion. L’affaire suisse sera partout une désagréable discussion pour le Ministère. On a bien fait de demander l’expulsion de Louis Buonaparte mais il fallait et on pouvait la demander et l’obtenir tout autrement. Et la façon dont on l’a demandée et obtenue a, pour la France, des inconvénients graves qu’elle rencontrera plus d’une fois sur son chemin, et qui mis au jour, frapperont beaucoup le public, car ils choquent ses passions, bonnes et mauvaises. On me dit qu’il va paraître une brochure du général Bugeaud qui préoccupe beaucoup M. Molé. Le Général Bugeaud, puisqu’il n’a pas répondu au premier moment, ferrait mieux à présent de garder ses explications pour la tribune. C’est une singulière manœuvre que d’avoir retardé le nouveau procès du général Brossard. Il coïncidera avec l’ouverture de la session. Peut-être le retardera-t-on encore jusqu’après les Débat de l’adresse. On n’en évitera pas le retentissement. M. Harcourt est-il revenu avec sa fille Lady Norris ? L’avait-il avec lui quand il a perdu sa femme ? Est-il affligé ? Il me semble qu’il n’y a guère de quoi. Mais l’habitude, même sans être douce est quelquefois puissante.
10 heures 1/2
Le N° 176, commence mieux, que ne finissait le N°175. Mais le cœur m’importe encore plus que les lettres et c’est au fond de votre cœur qu’il faut que j’aille puisque ce qui vient J’espère que nous serons heureux de vous va au fond du mien. quand nous nous serons tout dit. Adieu. Adieu. G. Ma mère est moins souffrante.
Nîmes, le 16 février 1839, Paradès de Daunant à François Guizot à François Guizot
184. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens du Val Richer, par un temps magnifique, frais et doux ; le plus brillant soleil ! Point de verdure encore, mais elle va éclater. On la voit de loin. Je me suis promené deux heures seul, aussi jeune que l’air, que les bois, que les champs. Je ne le dis qu'à vous. Vous ne le direz à personne. Pourtant depuis mon retour, je suis triste. Je ne puis partir d’ici que mardi. L’élection se fera dimanche. Il y aura lundi chez l’un de mes amis, un dîner auquel il m'est impossible de manquer absolument impossible. Je ne serai à Paris que Mercredi à 5 heures du matin, & chez vous à midi. Soyez triste comme moi, mais pas injuste, je vous en prie. J'étais déjà si fâché de ne pas être à Paris, le 4. Je vis avec vous bien plus que je ne vous le dis. De façons bien différentes et qui pourtant nous mènent au même résultat, nous ne pouvons pas, nous n'osons pas l’un et l'autre, nous parler du mal que nous sentons le plus vivement pour nous-mêmes et l'un pour l'autre. Nous ne nous sommes rien dit le 15 février. Nous ne nous dirions peut-être rien le 4 mars. Pourtant je voudrais être là ; je voudrais vous voir. En vérité, il y a des tendresses, auxquelles Dieu devrait accorder de paraître telles qu’elles sont et de donner tout ce qu’elles ont, sans démonstration extérieure, sans parole. Dearest for ever dearest !
Vendredi 7 heures et demie
J’ai été réveillé cette nuit à une heure du matin, par un singulier message. Des électeurs de Rouen m’ont envoyé l'un d'entre eux pour me conjurer, c’est bien le mot d'aller passer quelques heures à Rouen et de prendre la parole dans un grand meeting où il s’agit d'assurer le succès des candidats de l'opposition entr'autres de M. Duvergier de Hauranne qu'on veut porter à Rouen. Il leur faut un virtuose pour porter le dernier coup. Avec un virtuose ils se tiennent pour vainqueurs. Je me suis excusé, comme vous pensez bien. J’ai à faire ici. J’ai donné une belle lettre au lieu de ma personne. On la lira dans le meeting. Mais vous savez le peu qu’est une lettre. En voilà pourtant une qu’on m’apporte, et qui est beaucoup. Certainement, Lady William Bentinck est une bonne femme. Je le savais. A présent, je lui en sais gré. A-t-elle été jusqu'à vous offrir son perroquet, ce perroquet favori qui va se promener avec elle ? Je suis bien aise que le Duc de Wellington, n'ait pas notre rhumatisme. Je dis notre, car décidément j'ai les épaules un peu entreprises. Je n’ai pas même le temps de lire les journaux. J'ai laissé les miens à Paris. Il faudrait ici aller Ies chercher au Club. On me les raconte. Et je n’ai pas besoin qu’on me les raconte. Je les fais bien tout seul, amis ou ennemis. Le rabâchage règne et gouverne dans le monde. J’ai bien remarqué l'âpreté anglaise dans cette affaire du Pilote. Il y a quelque chose de plus que l'humeur de l'affaire même. C’est une humeur générale, et qui prend plaisir à se faire sentir, les plus simples en sont frappés, et frappés aussi de la chose même, de l'étourderie de ce jeune Prince, et de l’inconvénient des étourderies princières. On va de là aux faiblesses royales. Et de là on vient à moi, pour me donner raison. Le Duc d'Orléans a passé ici, cette nuit. Il va sans doute au devant du Prince de Joinville. Nous sommes sur la route de Brest.
Adieu. A mercredi. J’ai ces 24 heures là bien lourdes, sur le cœur. Il n'y a pas moyen. Adieu.
186. Paris, Vendredi 1er Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé une nuit affreuse. de l’insomnie, & des rêves l'un plus hideux que l’autre. Des meurtres et rien que des morts autour de moi. Des morts chéris, d'autres indifférents, mais enfin je n'étais pas de ce monde. Et je me suis tout-à-fait brisée ce matin. Votre lettre m’a remise un peu, je vous en remercie. Je vous vois content et je le suis.
Les journaux disent que M. Duvergier de Hauranne n’est pas aussi content que vous et qu'il va perdre son élection, ah cela par exemple fera un grand plaisir dans le camp ministériel. M. Appony m'a fait une longue visite hier matin. Il n’est pas tranquille. L'avènement possible de M. Thiers le trouble à un degré un peu excessif. Il y a là quelque mystère, quelque personnalité dont je n’ai pas la clé. La discussion à Bruxelles est remise à la semaine prochaine. Les troupes prussiennes sont en force sur la frontière. Partout on s’émeut fort de la situation des affaires en France. Vous êtes de grands perturbateurs.
J'ai vu longtemps hier matin Lady Granville et son mari. J'ai fait une longue promenade au bois de Boulogne par un temps. charmant. Le soir j’ai reçu mon ambassadeur, la Sardaigne, Naples, la Suisse, et le Duc de Richelieu. Le faubourg St Germain a une grande admiration pour le duc de Joinville. Messieurs ses frères sont partis hier pour aller à sa rencontre. Ils le ramènent aujourd’hui à Paris. Voilà toutes mes nouvelles.
J'écris aujourd’hui à mes deux fils, et à la Duchesse de Sutherland. Elle prolongera son séjour en Italie, ce dont je suis fâchée. M. Ellice sera ici le 20, il est dans une fort grande admiration de la coalition ! Adieu vous ne concevez pas comme je me sens souffrante. C’est peut être le temps. Je n’en sais rien, mais je ne vaux rien. Adieu. Adieu.
186. Lisieux, Samedi 2 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le soleil a beau briller la rivière, a beau couler gaiement devant ma fenêtre ; tout ce qui m'entoure a beau prendre soin de m'animer et de me plaire. Je pense tristement à vous, si triste ! Je me sens seul loin de vous, si seul !
Je vous l'ai dit bien souvent; je puis me répandre au dehors ; je puis paraître, je puis être très occupé, très actif, et que tout cela soit point un mensonge, point un effort, mais très superficiel, très indifférent pour moi, pour ce qui est vraiment moi. Moi, c’est ce qui m’aime et ce que j'aime. Moi, c’est vous, vous de loin vu de près, triste ou gaie, pleurant ou souriant, juste ou injuste même. Mais ne soyez pas injuste ; ne le soyez jamais !
J'ai bien raison d'être triste avec vous. Voilà votre pauvre lettre. C’est bien assez du mal des jours ; les mots devraient être un repos. Je regrette quelque fois que vous ne soyez pas en état et aussi en nécessité absolue de vous fatiguer physiquement. Je l’ai éprouvé ; l'extrême fatigue endort la douleur ; quand le corps s'affaisse, l’âme s’apaise. Paix stérile, paix sans joie, mais qui donne quelque relâche et rend quelque force. Et puis, quand de cruelles images vous assiègent, quand vous n'êtes entourée que de morts, faites un effort, prenez votre élan ; sortez de ces tombeaux. Ils en sont sortis ; ils sont ailleurs. Nous serons où ils sont. Je me suis longtemps épuisé à chercher où ils sont et comment ils y sont. Je ne recueillais de mon travail que ténèbres et anxiété. C’est qu’il ne nous est pas donné, il ne nous est pas permis de voir clair d’une rive à l'autre. Si nous y voyions clair, s'ils étaient là devant nos yeux, nous appelant, nous attendant, supporterions-nous de rester où nous sommes aussi longtemps que Dieu l’ordonne ? Ferions-nous jusqu'au bout notre tâche ? Nous nous refuserions à tout, nous abandonnerions tout ; nous jetterions là notre fardeau, notre devoir, et nous nous précipiterions vers cette rive où nous les verrions clairement. Dieu ne le veut pas, mon amie. Dieu veut que nous restions où il nous a mis, tant qu’il nous y laisse. C'est pourquoi, il nous refuse cette lumière certaine, vive qui nous attirerait invinciblement ailleurs ; c'est pourquoi il couvre d'obscurité ce séjour inconnu où ceux qui nous sont chers emporteraient toute notre âme. Mais l’obscurité ne détruit pas ce qu’elle cache ; mais cette autre rêve où ils nous ont devancés, n'en existe pas moins parce qu'un nuage s'étend sur le fleuve qui nous en sépare. Il faut renoncer à voir dearest, il faut renoncer à comprendre. Il faut croire en Dieu. Depuis que je me suis renfermé dans la foi en Dieu, depuis que j’ai jeté à ses pieds toutes les prétentions de mon intelligence, et même les ambitions prématurées de mon âme, j'avance en paix quoique dans la nuit, et j'ai atteint la certitude, en acceptant mon ignorance. Que je voudrais vous donner la même sécurité la même paix ! Je ne renonce pas, je ne veux pas renoncer à l’espérer.
Midi
Je vais aller voter pour la formation du bureau. Demain, je serai retenu toute la journée, car on veut me nommer Président du Collège. Je ne pourrai probablement vous écrire que quelques lignes. Je les retarderai jusqu’au dernier moment ; il est possible que le scrutin soit dépouillé avant le départ du courrier. Je vous en dirais le résultat. Moi aussi, j’attends. Je viens de recevoir une lettre de M. Jaubert qui me rassure tout à fait sur l’élection de M. Duvergier. D'autant que Jaubert est disposé à voir en noir. Je suis préoccupé de celle de M. Joseph Poirier. J'y tiens et j'en ai toujours été un peu inquiet. Nous verrons. Je ne crains pas grand chose du résultat définitif, quel qu’il soit. Si la victoire ne nous est pas donnée du premier coup, nous aurons certainement de quoi la prendre. Peut-être cela vaudrait-il mieux. En tous cas, je suis résigné et prêt. Adieu. Ne soyez pas trop souffrante, je vous en prie. Mon ambition est bien modeste. Adieu. G.
187. Paris, Samedi 2 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mercredi seulement. Que c’est long ! je m'afflige, mais je ne me plains pas. Je ne suis pas inquiète comme vous le dites. Mais cela me fait beaucoup de peine. Cela vous ne vous en plaindrez pas ? Oui le 4 ! C’est horrible, mais je ne puis ni en parler ni en écrire.
J’ai eu une lettre de Paul hier. L’Empereur a envoyé de suite à Londres le comte Strogonnoff pour remplacer mon fils pendant le voyage qu'il va faire en Russie. Il lui enjoint de venir de suite attendu qu’'il désire le voir. Paul ne veut pas aller dans ce moment, sa santé ne va pas à un voyage rapide dans la rude saison. Il ira dans quatre semaines on trouvera cela étrange, il fallait courir ventre à terre dès le lendemain ! Voilà comme on est chez nous. J’ai eu ma lettre de mon frère ce matin ; il avait reçu mes deux lettres. Celle de reproche et l’autre écrite après la mort de mon mari. La sienne contient que des hélas et des reproches sur ce que je ne veux pas vivre en Russie. Voici le lieu de lui dire une fois pour toutes pourquoi je n’y veux pas vivre et que je n’y retournerai jamais. Je vous montrerai cette lettre, je ne l’enverrai qu'après vous l’avoir lue.
J’ai vu hier matin chez moi la comtesse Appony. J’ai fait le plus agréable dîner possible chez Lady William Bentinck, elle, son mari et Lord Harry Vane, voilà tout. Très anglais, très confortable, j’ai eu presque de la gaieté. Le soir chez moi, mon ambassadeur, celui d’Autriche, Fagel, M. de Stackelberg & le Prince Waisensky. Don Carlos a retiré sa proclamation contre Maroto. Après l’avoir déclaré traître, il approuve tous ses actes, lui rend le commandement. Enfin, c’est une confusion plus grande que jamais, et mes ambassadeurs disent que ce qu'il y a de mieux à faire est d’abandonner complètement Don Carlos et le principe. Les princes gâtent le principe.
Lord Everington vient d'être nommé vice roi d’Irlande, c'est un très grand radical, un homme d’esprit, membre distingué de la chambre basse, et très grand seigneur quand son père Lord Forteseme mourra. Je vous conterai comment un jour il est resté caché pendant deux heures dans les rideaux de mon lit ! J’ajoute, puisque vous êtes si loin ; que c’est mon mari qui l'y avait caché. Vous feriez d’étranges spéculations si je ne vous disais pas cela. Et ce n’était pas cache cache.
Le petit copiste est venu. Il a commencé aujourd’hui. Cela va très bien. Les ambassadeurs avaient vu M. Molé hier. Les nouvelles sur les élections sont d’heure en heure meilleures pour les ministres. Vous avez bien fait de n'être pas allé à Rouen, mais vous faites très mal d'avoir du rhumatisme. Je vous le disais lorsque vous êtes parti, j’étais sure que vous alliez prendre froid. Faites-vous bien frotter au moins Adieu. Adieu, il faut donc encore écrire demain et lundi. What a bore ! Adieu. Adieu.
188. Paris, Dimanche 3 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
189. Paris, Lundi 4 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
191. Val-Richer, Mardi 4 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous voudrais comme ma vallée, fraiche et riante. Je la regarde avec envie en pensant à vous. Et bientôt je ne la regarde plus ; je ne pense plus qu'à vous. Je vous vois maigre, triste, desponding, en larmes. Et pourtant je ne retourne pas à ma vallée ; je reste avec vous. Je resterai toujours avec vous.
L’annulation de l'élection de M. d’Houdetot, réélu à si grand'peine, est un petit incident fort désagréable au château. On en a été très piqué. Il ne faut pas avoir tort en face de ses ennemis Mr d’Houdetot avait tort. C’est l'erreur des gens de cour, puisque cour y a, de croire qu'ailleurs aussi, ils auront le privilège de la faveur. Il y a des favoris partout, mais non partout les mêmes. Les esprits impartiaux, les honnêtes gens ont voté contre M. d’Houderot. Le pire, c’est qu’il ne peut plus se représenter puisqu’il n’est pas éligible. Le choix tombera probablement sur un homme de l'opposition.
Il paraît que le procès aura lieu décidément vers le milieu de Juin. On le presse ; on ne veut pas que, s’il doit y avoir des exécutions, elles soient trop voisines des fêtes de Juillet ; et très probablement il y en aura. L'assassinat est prouvé, dit-on, contre deux des accusés, et des principaux. L’un, le nommé Barbès a tué de sa main l'officier qui commandait le poste du Palais de justice, l'autre Milon, Miron, je ne sais pas bien, a fait fusiller trois soldats, après avoir enlevé un corps de garde. Plusieurs témoins les reconnaissent.
Après les fêtes de Juillet, le Roi veut aller à Bordeaux. Il a formé plusieurs fois ce projet. Je doute qu'il l'exécute encore. Cependant il le promet. Bordeaux le demande beaucoup, et comme une réparation. Ils disent que jamais Roi ou Empereur ne les a laissés neuf ans sans aller les voir. Le Maréchal Vallée avait demandé plusieurs fois à être rappelé. On s'est montré disposé à le lui accorder. On lui aurait donné le Général Cubieres pour successeur. Il ne s'en est plus soucié, et il reste. J’en suis bien aise. A travers toutes les manies d’un esprit systématique et d’un caractère insociable, c’est un homme honnête, capable et prudent. Qualités dont notre établissement d'Afrique à grand besoin. Je m'intéresse à cet établissement. Je m’en suis beaucoup mêlé.
Mon sac est vidé, madame. Bien petit sac cette fois, et probablement souvent jusqu'à ce que je retourne à Paris. On ne m'écrit guères les petites choses, et il n’y en a pas de grandes. Vous n’avez probablement jamais ouvert un livre intitulé : Historiettes de Tallemant des Réaux. C'était un abbé du 17e siècle qui écrivait tous les soirs tout ce qu’il avait entendu dire sur toutes les personnes dont tout le monde parlait. Il a écrit ainsi six gros volumes curieux et amusants, quoique pleins d'énormes sottises. Quelqu'un de votre connaissance, mon Génie, se donne le même plaisir sur notre temps. Il laissera des volumes beaucoup plus convenables, j’en suis sûr que ceux de l'abbé Tallemant, et peut-être assez piquants. On oublie beaucoup trop en ce monde. En attendant de vraies nouvelles d'Orient, j’ai apporté ici et je lisais tout à l'heure l'ouvrage de M. Urquhart de la Turquie et de ses ressources. Savez-vous au juste quel cas on fait à Londres de l'auteur ? Le livre me semble bien vide, avec de grandes prétentions.
Adieu pour aujourd'hui. Je vous quitte pour aller assister à des plantations de fleurs ; je devrais dire coopérer. Je transporte le jardin du Roi au Val-Richer. Je mentirais si je disais que cela ne m'amuse pas du tout ; et je mentirais bien davantage si je disais que cela m'intéresse vraiment. On peut vivre superficiellement ; mais il n'y a pas moyen de s’y tromper. Pour moi, je n'y prétends pas.
Mercredi 7 heures Depuis que je ne vous vois plus, ma perplexité est extrême. Je suis bien plus inquiet ; j'ai besoin que vous me rassuriez, et j'hésite à vous le demander, à vous occuper de votre santé. Convenons d'une chose ; c’est que vous me direz tout, absolument tout ; je n'ignorerai aucun détail, ni aucune de vos inquiétudes. Ce sera comme si je vous voyais, sauf le plaisir de vous voir. A cette condition, je ne vous agiterai pas, de mon tourment. J’attends presque avec humeur le moment où j’attendrai vos lettres à jour fixe. En aurai-je ? N'en aurai-je pas ? Cette ignorance m'est insupportable. J’en ai encore pour huit jours avant que vous vous soyiez posée, que je le sache du moins et que jen éprouve l'effet. Où êtes-vous en ce moment ? à Vitry, je pense. Vous vous levez. Vous allez partir pour Nancy. J’ai fait cette route-là, il y a douze ans, le cœur bien déchiré. Je conduisais à Plombières ma femme mourante.
Que notre âme est étrange, & tout ce qui s’y passe dans le cours de la vie ! Quels contrastes, quels désaccords, impossibles à concevoir ensemble, et qui coexistent pourtant & s'effacent et disparaissent dans cette mer du temps qui couvre de son uniformité tout ce qu'elle engloutit Adieu. Adieu.
9 heures. Voilà le facteur, et deux lettres de Paris qui ne m’apportent rien à vous envoyer. Adieu encore.
192. Val-Richer, Jeudi 6 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
193. Val-Richer, Samedi 8 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.