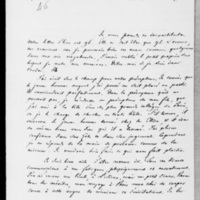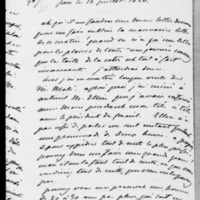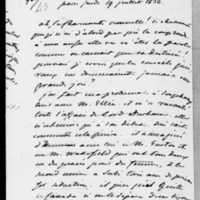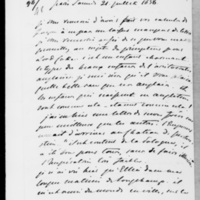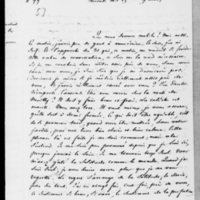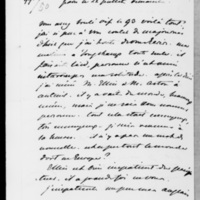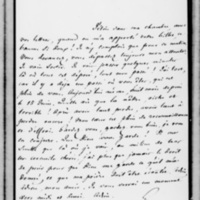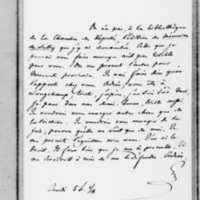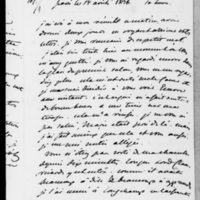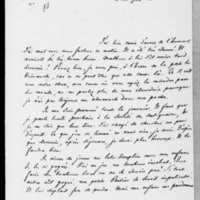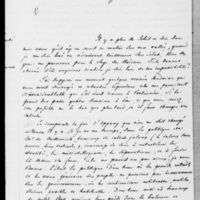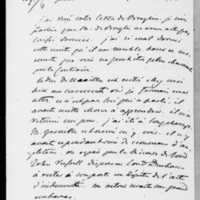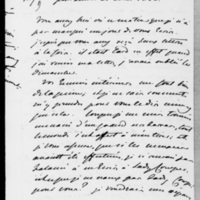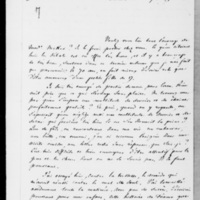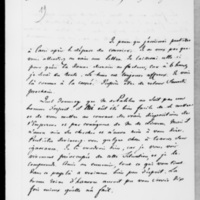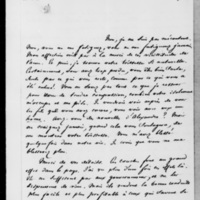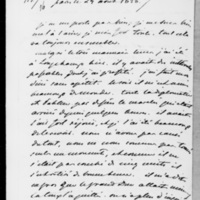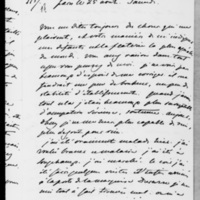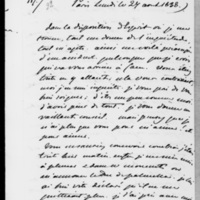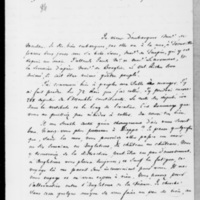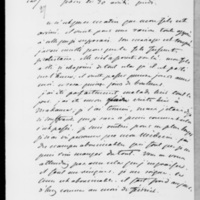Votre recherche dans le corpus : 221 résultats dans 5770 notices du site.Collection : 1838 : Réflexion politique et élaboration historique (1837-1839 : Vacances gouvernementales)
94. Paris, Mardi 17 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre programme de dîners me déroute mais Lisieux me parait nous rapprocher et j’y gagne je crois. Lady Granville est vraiment partie ce matin, je l’ai encore vue deux fois hier et j’ai revu M. Ellice ce qui me fait un gros plaisir. Je vais le faire bien parler en attendant j’ai eu une énorme lettre de Mad. de Flahaut pas mal amusante, mais plus remplie de petites tracasseries que d’autre chose. Les diplomates se font la petite guerre. L’Orient ne veut pas inviter l’Occident, ni aller. chez cet accident. Il y en a même qui ne se calment pas. La guerre de principes a commencé. Cela doit être fort ridicules. nous soutenons les mêmes principes lorsque j’étais à Londres, mais les représentants constitutionnels trouvaient à manger et à danser chez moi comme les autres. Le bal du Maréchal Soult a été fort ridicule il avait invité le Lord Maire et sa femme, gens qui ne passent jamais le Temple-Bar. Et il a été plein d’attentions pour la Lady Mairesse. Vous ne sauriez croire comme cela est drôle en Angleterre. On a trouvé sa maison fort mesquine ; le seul luxe remarqué a été des bouquets offerts aux femmes et on a dit qu’il avait mis quatre cent mille francs en bouquets. Ni lui, ni les Sébastiani n’ont invité une seule fois M. de Flahaut a dîné vous concevez la fureur de Marguerite. Le Duc de Nemours a déplu généralement, à tout le monde. On le trouve mal élevé et sot. Ceci ne vient pas de Marguerite. M. de Fabricius m’a fait savoir hier que le grand Duc avait renoncé à visiter la Hollande. Son indisposition se prolonge à Copenhague, et l’Empereur veut qu’il se trouve demain à Toeplitz ! Je n’ai rien de direct.
J’écris aujourd’hui à mon mari en adressant ma lettre à mon frère. Ce voyage manqué ou tronqué est une fort désagréable affaire pour mon mari. On dira que c’est maladroit et qu’un vrai Russe n’aurait par été aussi gauche. Quelque absurde que ceci vous paraisse, je vous dis vrai. Nous verrons les conséquences. J’attends M. Molé ce matin, et puis j’irai à Auteuil si j’en ai le temps. Voici qu’on m’interrompt. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique
94. Val Richer, Vendredi 20 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous prends en inexactitude. Votre lettre d’hier est 96. Elle ne doit être que 95. L’erreur me convient car je pourrais bien en avoir commis quelqu’une dans ma vie vagabonde. J’avais oublié le petit papier sur lequel je note mes numéros. Dites-moi si je suis dans l’ordre 96. J’ai écrit sur le champ pour votre précepteur. Je crains que le jeune homme auquel j’ai pensé ne soit placé ou parti. Ill conviendrait parfaitement. Dans la prévoyance qu’il ne pourrait pas, je m’adresse au précepteur de mon fils, que j’ai mis à la tête d’un des plus grands collèges de Paris, et je le charge de chercher en toute hâte. S’il trouve, il enverra, le jeune homme trouvé chez M. Ellice, & il ira en même temps vous dire qui il a trouvé. J’ai pleine confiance dans son zèle et dans son jugement. Cependant je ne réponds de la main de personne comme de la mienne. Je voudrais bien faire ce qui vous fait plaisir.
Je suis bien aise d’être revenu ici. Tous ces dîners commençaient à me fatiguer, physiquement et moralement. J’en ai encore un lundi à Lisieux mais un petit dîner. Parmi tous ses mérites, mon voyage à Paris aura celui de couper cours à cette vogue de réunions et d’invitations. Je les voyais pleuvoir. On sera forcé de s’interrompre, & après on n’y pensera plus. La modification Tory du Cabinet anglais, me paraît toujours bien. Le renversement complet me semble pas possible, et pour la transaction, je ne la comprends guère avant que les questions d’Irlande soient vidées. Du reste, M. Ellice en sait plus que moi. Je ne crois pas tout ce que disent les gens qui savent ; mais je n’ai pas la prétention de savoir mieux qu’eux. M. de Stackelberg ne m’étonne pas du tout. Il y a certainement un tel intermédiaire, & je lui ai trouvé deux ou trois fois le ton d’un homme, qui n’est pas étranger à toute importance pratique. Si cela est, il n’a pas encore fait une bonne campagne cette année. Je ne sais si les affaires d’Isabelle avancent ; mais celles de Don Carlos reculent évidemment.
Faites votre course à Versailles, la semaine prochaine. Je ne pourrais probablement pas la faire avec vous. Le jury me retiendra souvent toute la matinée. Mais nous aurons toujours la soirée. Je suis bien aise que M. Molé soit venu vous voir. Je m’en fie à vous pour le faire revenir. Vous êtes habile pour plaire. Il me semble que voilà votre Grand Duc guéri. Les journaux le remettent en voyage. Je le plains d’avoir peur de son père. Ce qu’on vous dit de l’Empereur m’est revenu encore de plusieurs côtés. La prédiction du duc de Mortemart se vérifiera. Si votre Impératrice mourrait l’agitation serait grande parmi les Princesses à marier. L’Empereur chercherait-il bientôt.
10 heures
Voilà le vrai n° 96. Vous vous êtes corrigée, vous-même. Il est charmant ce N° là, charmant par votre joie. C’est le sort qui m’a mis du jury. Je suis sur la liste générale comme tous les électeurs. On en tire au sort un certain nombre. Le sort vient de me désigner. Il est plein d’intelligence. Soyez tranquille ; une fois à Paris, je ne vous parlerai pas de constitution. Adieu. Adieu. G.
95. Paris, Mercredi 18 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah qu’il me faudra une bonne lettre demain pour me faire oublier la mauvaise lettre de ce matin ! Quand on n’a qu’une lettre pour le plaisir de toute une journée convenez que la taille de la vôtre est tout à fait J’attendrai donc. inconvenante Hier j’ai eu matin longue visite de M. Molé. Après quoi j’ai mené à Auteuil M. Ellice que j’avais enfermé avec Marie pendant mon tête à tête avec le président du conseil. Ellice n’a pas cessé de parler un seul instant pendant une promenade de deux heures. A propos & pour expédier tout de suite le plus pressé, pouvez-vous me faire une grande grâce ? Mais il me le faut tout de suite, ou que vous me disiez tout de suite que vous ne le pouvez pas. Pouvez-vous me procurer un homme de 20 à 30 ans pas plus, qui soit en même temps instituteur & même (tutor and companion) d’un garçon de 15 ans. Qui ne sache pas un mot d’Anglais, qui enseigne à cet enfant, la langue française à l’entretienne d’histoire, qui ne le quitte pas un instant, qui fasse au besoin avec lui quelques courses aux environs de Paris ? Enfin un homme actif, gai & sûr. Cette tutelle ne doit durer que quatre mois, peut être un peu plus. Le petit garçon Lord Coke fils du Earl of Leicester sera établie aux environs de Paris dans une famille française, tout cela est déjà réglé, il ne manque donc que ce précepteur. Nous ne le voulons pas pédant, pas trop doctrinaire. Le but du séjour de cet enfant ici est tout simplement d’apprendre bien le français et de savoir quelque chose de plus que faire des latin verses. Si M. l’instituteur peut par dessus le marché l’entretenir dans l’habitude du Latin il n’y aurait mais cela n’est pas essentiel pas de mal, l’essentiel est le français, la surveillance et l’entrain. Si vous connaissez une espèce qui répond à ces exigence. Ayez la bonté de lui écrire pour qu’il se rende de suite à l’hôtel Bristol place Vendôme chez M. Ellice de votre part. La question pécuniaire sera largement réglée, le jeune homme est héritier d’une fortune de 50 m £ de rente ! Vous savez ce que vent dire £ ? Des guinées. Vous me ferez un grand grand plaisir. Mandez-moi aussi l’adresse du précepteur. Je me suis chargée de cette affaire croyant que par vous tout se pouvait
Il m’est impossible de vous redire tout ce que m’a dit Ellice. C’est trop. Le plus important, est le remaniement positif, selon lui, du ministère, dans quel sens ? C’est ce qui restera à voir vraisemblablement plus Torry que Whig. Il déteste Palmerston et dit que Lord Melbourne le déteste aussi. M. Molé ne l’aime pas trop. M. Molé m’a conté bien des choses qui m’intéressent. Une conspiration avortée à Varsovie. Défaites de nos troupes dans l’Abazie. L’Empereur, d’une activité qu’ on qualifie étrangement. Et puis une drôle de chose, M. de Stackelberg intermetteur des secours aux Carlistes d’Espagne. Cela quoique il l’affirme, je ne puis pas le croire. Il a l’air d’en être bien sûr. Nous avons causé de tout. Il n’a pas d’inquiétude pour l’Orient du moins pas pour le moment. Il est content de l’Angleterre sur ce point. il me semble que je vous ai redit en gros, tout ce que je sais. Je m’en vais dîner aujourd’hui à Auteuil, je médite une fuite à Varsailles avec Ellice & Aston. Ce sera dans la semaine prochaine. pour y passer trois jours. Le Maréchal sera ici je crois le 25. Le duc de Nemours demain.
Adieu. Je voudrais bien vous faire comprendre combien vous me manquez. Combien j’ai des moments de tristesse de mélancolie affreuse, mais il ne faut pas trop vous le dire. Adieu. Adieu.
J’ai eu une lettre encore de la Duchesse de Talleyrand. Elle est insatiable. Elle veut des nouvelles et m’en donne de son côté de tout à fait saugrenues, sa meilleure source est M. Jennison. Imaginez. Quelle chute !
Mots-clés : Diplomatie, Pédagogie, Politique (Angleterre)
95. Val Richer, Vendredi 20 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne commençais jamais à vous écrire qu’avec un sentiment triste. Il diminuait en vous écrivant ; mais au premier moment, je sentais si amèrement la séparation ! Aujourd’hui, j’ai le cœur joyeux. Et je l’aurai plus joyeux à chaque lettre. Je suis en voyage. Je marche vers vous. La malle poste a fait, dans son itinéraire, un changement qui me plaît fort. Elle partait de Lisieux à 2 heures et s’arrêtait une heure en route à Evreux. Cette heure là m’était insupportable. Maintenant elle part à 4 heures et ne s’arrête plus du tout. Une fois monté en voiture le 30, je n’en descendrai que le 31, dix minutes après avoir passé sous vos fenêtres, dans les Champs Elysées. J’aime que vous soyez toujours sur mon chemin. Il fait beau ; mais le chaud n’est pas revenu. Je ne veux pas qu’il revienne. Je ne veux pas que vous vous pâmiez de fatigue pendant que je serai à Paris. Vous est-il resté de cette chaleur encore un peu plus de faiblesse ? J’espère que non.
Avez-vous recommencé à manger ? Si vous saviez quels appétits je vois en Normandie ! C’est grand dommage que je ne dîne pas avec vous. Je suis sûr que je vous ferais manger le double. Le Ministère anglais a raison de ne pas vouloir que Lord Durham étale à Quebec ses bijoux. On est trop heureux d’avoir de pareils préjugés populaires à ménager. Mais convenez qu’il n’y a qu’heur et malheur. Je ne sais ce qu’a été le procès de ce M. Turton ; mais je doute qu’il ait pu être plus scandaleux que celui de Lord Melbourne contre M. Norton. Et Lord Melbourne chassera M. Turton à cause de son procès. A la vérité Lord Melbourne a gagné le sien. A propos, quel est le Hügel qui s’est battu à Stuttgart avec Mühlinen ? Est-ce le diplomate ou le voyageur ? Voici la filiation de mon à propos. Un procès scandaleux ; un scandale sans procès ; Lady Elizabeth Harcourt ; Hügel, le voyageur Adieu pour ce soir. Je vais me coucher. Je suis encore enrhumé du cerveau. C’est un grand ennui. Adieu pourtant.
Samedi 7 h. 1/2
Pourquoi M. Ellice vient-il à Paris en ce moment où il n’y a personne ? Je ne lui vois aucune raison d’amusement, de société. Y en a-t-il quelqu’une d’affaire ? Tient-il plutôt à telle ou telle partie du Cabinet qu’à telle autre ? Je ne sais pourquoi je vous fais ces questions. Je ne veux plus vous faire de questions ! Dans dix jours, vos réponses me viendront bien plus agréablement. Oui, dans dix jours. Que nous sommes de chétives créatures, à la merci de nos impressions. Ces dix jours ne me paraissent rien du tout. Et pourtant Dieu sait si je les vois s’écouler impatiemment. Mais il y a une impatience joyeuse qui abrège le temps. C’est la mienne aujourd’hui. En conscience, vous ne pouvez exiger d’Appony qu’il aime les Russes. L’Autriche me paraît dans cette désagréable position d’être essentiellement gouvernée dans sa politique par la crainte, crainte russe, crainte française, crainte pour l’Orient, crainte pour l’Italie ; en Allemagne même, un peu de crainte Prussienne. Le mouvement ascendant n’est pas de son côté. Mais que tout est lent pour les grandes choses ! Depuis le 17e siècle, l’Autriche décline. Elle en a pour longtemps à décliner de la sorte.
10 h.
J’ai tort. C’est vrai. Vous avez eu bien des représentants constitutionnels à faire danser. Et Léopold a tort aussi, et bien plus tort de ne pas revenir vous voir. Je suis charmé que M. Ellice reste jusqu’à mon arrivée. Il m’enseignera notre Ministère, comme M. Croker notre révolution. Adieu. Nous irons prendre de l’air ensemble à Longchamp.
96. Paris, Jeudi 19 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah la Charmante nouvelle ! Si charmante que je n’ai d’abord pas pu la comprendre. à moi aussi elle va m’ôter la parole. Comme on connait peu sa destinée ! Pouvais-je croire que les conseils généraux me donneraient jamais une grande joie ? J’ai fait ma promenade à Longchamp hier avec M. Ellice. Il m’a raconté toute l’affaire de Lord Durham. Elle n’est encore qu’à son début. Dieu sait comment cela finira. Il a imaginé d’emmener avec lui ce M. Turton et un M. Wakefield qui ont tous deux eu des procès pour des femmes, & le second même à subi trois ans de prison for seduction. Il jure qu’il quitte le Canada si on le sépare de ces bijoux et les ministres sont résolus à ne pas permettre qu’ils y restent officiellement. Or Lord Durham n’a eu rien de plus pressé que de leur donner des emplois & de le publier dans les journaux de Quebec. Ce sont tous deux des hommes de beaucoup d’esprit et de mérite, mais le préjugé anglais ne permet pas qu’ils aient jamais d’emploi publié. C’est une difficile affaire entre le gouvernement & l’autocrate du Canada.
J’ai été dîner à Auteuil. Il n’y avait que M. Armin. Je me suis trouvé parfaitement at home. De l’Allemand, de la diplomatie, cela m’a convenu tout à fait. Je suis restée jusqu’à neuf heures & demi et je ne suis rentrée que pour me coucher. Appony est très peu avec des Russes, cela perce dans chaque parole M. de Metternich n’a vu dans le voyage à Stockholm qu’un caprice du moment. Il cherche à faire partager cette conviction. ici où l’on a été un peu effarouchée de la fantaisie impériale. Je relis votre lettre, cette jolie lettre. Ce n’est pas les conseils généraux ; c’est le jury qui vous amène. Comment êtes-vous de cela aussi ? Quelle drôle de chose. Vous m’expliquerez cela ; par lettre je vous prie, car depuis nous aurons mieux à nous dire. Je suis déjà jalouse de tous les moments pendant ces quinze jours et je ne veux pas me perdre à m’instruire en matière de constitution. Je voudrais vous dire quelque chose, et je ne pense qu’au 31 juillet. C’est si inattendu, si ravissant. Quel plaisir ! J’attends aujourd’hui des nouvelles anglaises. Quelques petits attachés des Ambassadeurs extraordinaires arrivés à Paris racontent que tous les ambassadeurs sont mécontents du peu de politesses qu’on leur témoigne à la cour. J’attends avec impatience le retour de Palmella & de Brignoles, je me trompe, je n’attends plus avec impatience que le juré.
Adieu. Adieu que ce sera charmant !
Mots-clés : Réseau social et politique
96. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon rhume de cerveau s’en va. Je ne vous éternuerai pas au nez en arrivant. Le serein, dans ce pays-ci est une véritable pluie. Je le dédaignais trop. Depuis deux jours, j’y ai pris garde, je suis rentré de bonne heure et je m’en trouve très bien. Mes enfants y ont gagné une plus longue lecture, des Tales of the Crusaders de Walter Scott. C’est leur grand plaisir du soir. Plaisir d’une vivacité singulière. Les impressions vives, des hommes causent toujours un peu d’inquiétude. Elles auront des conséquences. Celles des enfants n’en ont point. Le plaisir passé, tout est fini. Aussi le spectacle en est très agréable. Hier soit le charme du sujet, soit vraiment le mérite du lecteur, ma petite Pauline s’est écriée tout à coup avec ravissement : " Mon père, que tu lis bien." Et je l’ai embrassée de tout mon cœur. C’est charmant d’être loué par ses enfants.
Je suis bien aise que M. Ellice reste à Paris jusqu’à mon arrivée. J’aurai peut-être aujourd’hui ou demain une réponse sur sa commission. Vous ai-je dit que j’avais dit à M. Lorain, proviseur du Collège St Louis et mon délégué pour cette affaire de passer chez vous, dès qu’il aurait trouvé quelqu’un pour vous donner l’adresse du précepteur et quelques renseignements à son sujet ? Savez-vous les détails de la conclusion ou à peu près du différend entre Berlin et Rome ? La Cour de Rome s’est conduite avec une Sagesse et une habileté consommée. Après avoir publiquement donné sur les doigts au Roi de Prusse, qu’elle prenait en flagrant délit de mensonge et de violence, elle a, sans la moindre humeur, engagé M. de Buntzen à aller un peu se promener un peu loin. Puis elle a vertement tancé l’archevêque de Posen, lui a demandé de quoi il le mêlait de vouloir imiter l’archevêque de Cologne, & lui a ordonné de se tenir tranquille et d’obéir au Roi, comme par le passé. Puis elle a reconnu l’administration provisoire du Diocèse de Cologne nécessaire à défaut de l’archevêque absent en voyage, n’importe où. Puis enfin, elle a dit au Roi qu’elle avait pourvu à tout, qu’il pouvait garder l’archevêque en prison tant qu’il voudrait, qu’elle n’en parlerait plus, que le jour où il ne se soucierait plus de garder l’archevêque, elle l’en débarrasserait en le faisant Cardinal. Voilà le bruit fini, la contagion arrêté, & le Roi de Prusse obligé d’être content, quoique déjoué dans ses petits arrangements secrets avec quelques uns de ses Évêques et fort embarrassé de son prisonnier. Rome n’eût pas mieux fait, il y a cinq cents ans. A la vérité, elle ne se se serait probablement pas contentée à si bon marché.
10 h. ¼
Le N°98 m’arrive entre une visite qui s’en va et une visite qui vient. Vous savez que le Dimanche est mon jour de corvée. J’aurai beaucoup de monde aujourd’hui, à cause de mon prochain départ. Car je pars le 30 et je serai rue de la Charte, le 31. Je devais en effet prendre le 5 août la société des Antiquaires, mais sa séance est remise à le fin d’août, toujours à cause de mon départ. Il a dérangé beaucoup de choses et de gens. Mais ce qu’il arrange, choses et gens, vaut mieux que ce qu’il dérange. Je vois à ma visite. Adieu. Here’s the place exactly. G.
97. Paris, Vendredi 20 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne fais que penser à votre belle institution du jury. J’ai pour elle un grand respect. J’ai passé ma matinée hier à Longchamp. M. Ellice, M Granville et le petit Howard sont venus m’y trouver, j’ai ramené Ellice à Paris, il est revenu chez moi le soir ainsi que la petite princesse, les Durazzo & &. Lorsque j’ai dit à Ellice que vous serez ici le 31 il a décidé de remettre son départ pour vous attendre en vérité il est très curieux à écouter sur toute chose, et il bavarde comme je n’ai jamais entendu bavarder, on tire de lui tout ce qu’on veut. Ne croyez pas que le duc de Sussex sont ici comme le racontent vos journaux. Il ne bouge pas de Londres et il boude les ministres parcequ’ils ne veulent pas lui donner d’argent. Sir George Villers est arrivé hier de Madrid.
Pourquoi croyez-vous que je vous ai dit une bêtise en vous disant que je recevrais les représentants constitutionnels ? Vous oubliez que mon temps à été longtemps, et que je suis restée jusqu’en 34. En 34 donc j’ai fait dîner Miraflores, ambassadeur de Christine, & danser Van de Weyer, ministre de la révolution Belge. J’espère que c’est du libéralisme, nous avons cru que ce serait le pousser trop loin de faire manger le petit van de Weyer. Et puisque je parle de la Belgique, quand je me suis plaint que Léopold ne venait pas chez moi, c’est qu’il y est venu jus qu’à présent lorsqu’il était à Paris. Il cesse tout bonnement parce qu’il sait que j’ai perdu mon importance, jusqu’à l’année dernière il s’imaginait que je l’avais conservée. Pas de nouvelle de mon mari, rien du tout. Rien sur les mouvements du grand duc rien de nulle part le monde est fort ennuyeux. Je vous quitte pour Longchamp. J’y prends du bon air. Adieu. Adieu. dans onze jours !
Mots-clés : Diplomatie, Discours autobiographique
97. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma corvée est finie. Ce n’est certes pas la solitude que je suis venu chercher ici. Je suis charmé de la vôtre. J’en profiterai. Je fais de charmants projets. Je fais des vœux pour que le temps se maintienne tel qu’il est aujourd’hui beau et pas chaud. Un de mes voisins de ce matin me l’a promis. " C’est, dit-il, le combat de la lune." Ce sera la lune de miel.
Je regrette que vous n’ayez pas vu M. Villers. Il aime à parler et il doit être curieux à entendre sur l’Espagne. Il a joué là un jeu bien brouillé. Quel triste sort que celui des pays faibles ! Le théâtre des intrigues rivales des grands pays quand ils ne sent pas celui de leurs guerres : jouet ou champ de bataille et toujours victime. Il ne faut pas être petit, et il faut être bon pour les petits. Je crois que c’est pour vous que M. Ellice est venu à Paris. Il me semble qu’il passe sa vie chez vous. Il a de l’esprit et il est très au courant. Comment un homme d’esprit comme lui ne s’aperçoit-il pas que tout en causant, & vous plaisant avec lui, vous ne lui portez pas grande considération ? Et s’il s’en aperçoit, comment s’en arrange-t-il ? Mais il est de ceux qui s’arrangent de tout ce qui les sert ou les amuse. Vous avez un grand talent pour traiter avec ces hommes-là. Vous les attirez sans les laisser tout à fait approcher. Vous leur plaisez et vous leur donnez le plaisir de vous plaire, mais toujours d’un peu loin. C’est votre histoire avec Thiers. En entendez-vous dire quelque chose? Ne trouvez-vous pas que le Maréchal Soult abuse de sa fortune ? Ces visites partout, ces acclamations de tous les jours, cette perpétuelle exhibition, combien de temps cela peut-il durer en Angleterre ? Chez nous, ce serait déjà fini usé. Et vous qui n’aimez pas les répétitions et les longues choses vous n’êtes donc pas Anglaise par là ? Il y a bien des côtés par où vous ne l’êtes pas. Vous avez le cœur plus anglais que l’esprit.
Du reste j’ai un de mes voisins qui arrivait d’Angleterre et qui vous charmerait à entendre, cinq minutes je veux dire car vous ne vous en accommoderiez pas plus longtemps. C’est le plus grand manufacturier du pays ; il est allé parcourir l’Angleterre pour ses affaires ; et malgré les rivalités d’argent, il en est dans un enthousiasme inépuisable ; il professe, il prêche la richesse, la propreté, l’élégance, la grandeur, l’esprit d’ordre, le bon jugement, les bonnes auberges. Je l’écoutais l’autre jour avec le plaisir de vous entendre donner raison. C’est lui qui m’a donné à dîner à Combrée avec 80 amis. Et son toast et son speech en mon honneur valaient son admiration pour l’Angleterre.
9 heures 1/2
93 méritait d’être brûlé vif. Je n’ai fait que mon devoir. Je trouve comme vous, que nous nous adressons de sottes lettres. Si elles pouvaient ressembler à nos conversations, elles seraient charmantes. Ah, nos conversations ? Nous les retrouverons de demain, en huit, pour quinze jours. Que ce sera court, & immense ! Vous y pensez, dites-vous, plus que moi. Je le veux bien, mais je le nie. J’y pense toujours. Ajoutez quelque chose à cela. Je vous en prie ; ayez des caprices ; ne vous laissez gouverner par personne en mon absence. Je ne vous le pardonnerais pas. C’est peut-être un des signes les plus assurés de l’affection que de se laisser gouverner. On ne remet sa liberté qu’à celui qu’on aime plus que soi-même, en qui on se confie plus qu’en soi-même. Redites-moi de vous gouverner.
Je n’ai pas encore de réponse pour le précepteur, vous l’aurez probablement avant moi. Vous ne savez pas combien je voudrais faire, à l’instant même ce que vous désirez. Si je pouvais le faire toujours moi-même, j’en serais sûr. Mais de loin, mais forcé de mettre un esprit au bout de mon esprit, des mains au bout de mes mains, tout est long, & je m’impatiente autant que vous. Adieu. Comment va Marie ? Dites-lui au moins une fois avant mon arrivée que je vous ai demandé de ses nouvelles. Adieu. Lundi prochain, je serai sur la route de Paris. Je vous porterai moi-même mon adieu. G.
98_1. Val Richer, Mercredi 25 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais vous envoyer de mon sommeil. Je suis sûr qu’il vous ferait grand bien. Pour moi, c’est ma vie, sauf les journées, vous devez avoir moins de bruit rue de la Charte que rue de Rivoli. A quelle époque comptez-vous retourner à la Terrasse ? Ne me répondez pas. Vous me direz tout le 31. Que de choses pour le 31 ! C’est un grand pouvoir Madame, que de répandre, sur un petit point du temps, tant d’espérance et de charme. Le monde entier se cotiserait en vain pour me donner, en bien des années, ce que j’attends, ce que j’aurai de vous ce jour-là. Et ce jour-là ne sera pas le seul. Le jury, qui nous vaut ces excellents moments nous en ôtera bien quelques uns. On tire au sort chaque matin les jurés qui doivent siéger dans la journée. Quand le sort me désignera, toute ma matinée pourra bien être prise. Mais, alors même, nous aurons la soirée ! Et le sort ne me désignera pas toujours. Et quelquefois, je me ferai récuser. Je vous parle là comme si vous étiez versée dans la procédure criminelle. Mon plaisir à part, je fais bien d’aller au Jury. L’amiral Duperré, qui avait été appelé il y a trois semaines, s’est excusé pour cause ou sous prétexte de santé, et comme Pair. Les Magistrats et les autres jurés ont trouvé cela mauvais, et je sais qu’on a dit : " Nous verrons si M. Guizot en fera autant." Je n’en ferai pas autant.
Je ne m’étonne pas que vous vous ennuyiez à Auteuil. Quels que soient les visiteurs, on s’ennuie partout où les maîtres de la maison sont ennuyeux. Ce qui fait l’agrément ou l’ennui d’une maison c’est bien moins ceux qui l’ont, que ceux qui l’habitent et y reçoivent. On m’écrit aussi que les Ministres ne savent comment tenir leur parole au comité Appony pour l’hôtel de la rue de Grenelle. Cela commence à se savoir et on en parle. Vous pourriez bien un de ces jours le trouver dans les petits journaux. Puisque, au pied du mur, vous n’avez pas plus d’envie de voir Versailles, je ne regrette pas que vous n’y alliez pas. Non que la chose ne soit belle et digne de vos yeux ; mais malgré les petites voitures, c’est très fatigant, & vous seriez bientôt excédée. Ma présomption est grande. Si j’y étais avec vous, je ne craindrais pas votre fatigue. Vous me direz si j’ai tort.
10 heures
Le N° 101 m’arrive par un grand orage. Il n’est pourtant pas orageux du tout. Quand votre nuit est mauvaise, vous faites fort bien de dormir tard. Cependant, je suis décidé à faire la part de la paresse très petite. Je ne suis point paresseux ; mais je m’écrie aussi, quel bonheur ! Il est sûr que la perspective du 31 fait aux lettres un peu de tort. Vous avez raison. Le Duc de Sussex a peu d’esprit, moins esprit que le Pape. Certainement l’esprit est rare en ce monde. Et il me semble qu’il s’en en va plus qu’il n’y en vient. J’en serais fâché. Je n’ai nulle envie de laisser le monde en déclin après moi. Adieu. Mercredi prochain, je serai établi dans mon bonheur. Adieu. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée, Réseau social et politique
98. Lisieux, Mardi 24 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je persiste dans mon erreur. Je mets 98 comme si 93 avait été à sa place. Je suis encore venu dîner ici. C’est une singulière chose, qu’un pays démocratique. Tout le monde est shy avec un Ministre et shy avec humeur. Je ne suis plus ministre, mais je l’ai été et on croit que je le serai encore. Tout le monde veut être et avoir été bien pour moi, et avec moi, et croit pouvoir l’être sans embarras. Je n’ai jamais été plus entouré. Hier, à dîner, tout-à-coup, au milieu des 24 personnes qui étaient à table avec moi, comme je m’ennuyais fort l’idée m’est venu du plaisir que j’aurais si j’étais seul à table avec vous, à dîner je ne sais où. Le rouge m’a monté au visage. Ma voisine, la maîtresse de la maison l’a remarqué : " Est-ce que vous êtes souffrant ? Vous avez trop chaud. " J’ai eu beau dire que non. On a ouvert toutes les fenêtres. On m’a demandé dix fois, si j’étais encore incommodé, si j’allais mieux &, Dans huit jours, mon plaisir ne sera pas en idée. Je crois en vérité que le rouge me gagne encore en y pensant. M. Génie vient en effet passer avec moi Samedi et Dimanche. J’espère qu’il m’apportera quelque chose de vous. Je suis avide et toujours avide, en dépit du 31. Je serai très avide le 31 et tous les jours suivants. Je ne m’étonne pas que M. Villers ait mauvais ton. Il a mené à Madrid une vie fort légère, et les galanteries espagnoles n’ont bon ton, je crois, que dans les romances du Cid. Avez-vous jamais lu ces vieilles romances du Cid et de tous les héros Espagnols de son temps ? C’est très joli d’une élégance et d’une simplicité charmante. Il y a quelque chose de très agréable, de mon avis, dans une grande élégance d’esprit et de cœur une à une grande simplicité de vie matérielle. C’est souvent le mérite de l’antiquité grecque et de l’Europe du moyen-âge.
Je persiste à croire qu’Ellice est venu à Paris pour autre chose encore que pour vous et pour ne pas voter sur Lord Durham. Si vous avez quelque bon endroit où il vous plaise d’aller passer les trois journées, faites le, sauf cela, vous pouvez, ce me semble rester chez vous sans autre inconvénient que le bruit. A la vérité, il sera grand là où vous êtes. La poussière vous incommode-t-elle ? Je ne pensais pas qu’on arrose. Vous vous promenez donc toujours le soir sur la route de Neuilly.
J’y vais tous les soirs. Adieu. Je repars pour le Val-Richer, & ; je n’en sortirai plus que lundi prochain. Mon rhume n’est rien. Et je n’en aurai pas la moindre trace mardi. Adieu. G.
98. Paris, Samedi 21 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie d’avoir fait vos calculs de façon à ne pas me laisser manquer de lettre. Je vous remercie aussi de ce que vous me permettez au sujet du précepteur pour Lord Coke. C’est un enfant charmant. Le type des beaux enfants de l’aristocratie anglaise. Je suis sûre qu’il vous plaira. Quelle belle race que ces Anglais ! Et les enfants qui naissent en Angleterre sont comme cela, étaient comme cela ! J’ai eu hier une lettre de mon frère un peu meilleure que les autres. L’Empereur venait d’arriver au château de Furtustein " il est content de la Pologne, il a été bon pour tous sans se faire illusion." L’Impératrice très faible. Je n’ai vu hier qu’Ellice dans ma longue matinée de Longchamp. Il m’est venu du monde en ville, sur lequel je ne regrette que M. Villers. M. Molé me mande que le grand Duc est arrivé à Lubeck très souffrant et faible. Du reste, no new whatever.
Je mène une vie très solitaire depuis que je ne reçois plus le soir et que ma matinée se passe hors de Paris. Je me couche à 10 heures après une promenade en calèche et cette promenade je la fais invariablement sur la route de Neuilly, la seule praticable puisqu’elle est arrosée ! J’ai lu dans les journaux ce matin, que la réunion de savants à Caen est fixée au 8 août & que vous devez la présider. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous m’avez juré que vous étiez du jury. Je suis extrêmement refroidie sur la partie à Versailles. Vous ne sauriez croire comme je déteste de me déplacer, comme je crains l’inconnu, un mauvais lit. Je ne suis pas difficile, mais mes conforts me sont nécessaires. Je m’engage très lestement pour ce qui est dans l’avenir, mais quand le moment de l’exécution arrive cela me devient insupportable. Je crois que cela s’appelle de la vieillesse.
Adieu, je suis enchantée de vous savoir sorti de vos dîners, il m’en revenait de pauvres lettres. Au reste depuis que j’ai le 31 devant moi, je suis devenue fort accommodante ! Adieu. Adieu. Je ne pense qu’à mardi 31.
99. Val Richer, Mercredi 25 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que nous sommes mobiles ! Moi aussi. Ce matin, j’avais peu de goût à vous écrire. Ce soir j’en ai soif. Et l’approche du 31 qui, ce matin me rendait si froide cette ombre de conversation, ce soir me la rend nécessaire. Si je me couchais sans m’être assis près de vous, sans avoir causé avec vous, je suis sûr que je ne dormirais pas. Dormirais-je mieux si je m’étais réellement assis près de vous. Si j’avais réellement causé avec vous ? J’en doute. N’importe. Causons. Êtes-vous encore sur la route de Neuilly ? Il doit y faire beau et frais. La calèche est ouverte. Vous avez tort. Il vaut mieux, je vous assure qu’elle soit à demi-fermée. Ce qui doit être agréable, c’est de se promener tard, quand vous êtes rentrés dans votre jardin, par une lune bien claire et bien calme. Cette phrase-là est faite je ne sais comment ; mais cela s’entend. Je me suis peu promené depuis que je suis ici, presque jamais le soir. Je me trouvais trop seul. Vous m’avez gâté la solitude comme le monde. Quand je suis seul, je vous désire encore plus que je ne vous regrette. Le regret s’arrange de la solitude, le désir, pas du tout. J’ai eu vingt fois, cent fois, près de vous, le sentiment si beau, si rare, le sentiment de la perfection d’un état auquel rien ne manque et qu’on accepterait avec ravissement comme sort éternel. Loin de vous, le souvenir de ces heures-là me revient sans cesse, tout à coup, au milieu d’une conversation ; et mon âme s’en va ; elle va vers vous. Vous me rendrez ces heures charmantes, n’est-ce pas ? Je les retrouverai près de vous. L’été à Paris est une très douce saison. On est bien plus libre. L’été, le monde n’a point de droits ; on ne lui donne que ce qu’on veut. Mes quinze jours seront à moi, bien à moi. Ils passeront si vite ! Que faites-vous de Marie, le soir. Mad. Durazzo s’en charge-t-elle quelques fois ?
Décidément ma mère et tous les miens vont passer à Broglie, le temps de mon absence. J’en suis charmé. Ils y seront bien et moins impatients. Ils n’iront que le 4 août. Mad. de Broglie m’écrit ce matin qu’elle ne sera libre que le 4 de quelques hôtes qu’elle a dans ce moment. Avez-vous eu des nouvelles d’Alexandre ? A-t-il bien abandonné ses idées de mariage ? Je ne puis me déshabituer des questions. Ne répondez qu’à celles dont vous voudrez débarrasser d’avance nos quinze jours. Le mois de Juillet, sur lequel vous aviez de si mauvais pressentiments, il ne se passera pas tout entier sans nous. A la vérité ce sera tout juste. L’année dernière, il a été tout à fait perdu. Vous le dirai-je cependant ? Il n’a pas été, il n’est pas encore en mon pouvoir d’y avoir tout le regret que je devrais. Votre voyage en Angleterre, votre impatience, votre chagrin, vos lettres si tendres, votre retour si soudain, c’est là ce qui m’a donné confiance. J’ai vu là une preuve, cette épreuve par laquelle tout nœud doit passer avant d’être vraiment serré. Mais à présent, nul voyage, nulle absence n’est plus bonne à rien. C’est du chagrin en pure perte. Et le temps qui s’en va, la vie qui passe ! Qui me rendra les jours que vous auriez pu remplir ? Je n’y veux pas penser à présent, si près du 31. J’aurai bien assez de temps plus tard pour les réflexions mélancoliques. Adieu. Je vais me coucher pourtant. Probablement vous vous couchez aussi, à cette heure, même. Adieu, adieu.
Jeudi 7 h 1/4
J’ai bien dormi ; mais d’un sommeil chargé de rêves, tristes et doux, incohérents au delà de toute expression comme la vie. J’hésite beaucoup dans ce que je pense de la vie. J’y connais de si beaux jours, et des temps si sombres ! Il faut que je sois particulièrement né pour le bonheur, car il me laisse une impression si vive qu’elle résiste au malheur même. Un moment de vrai bonheur me paraît digne d’être acheté au prix de toutes les peines. On dit cela dans la jeunesse, avant l’épreuve. Je le dis après. Après cette lettre-ci, je ne vous écrirai plus que deux fois. Mais écrivez-moi encore Dimanche matin. Je ne partirai d’ici lundi qu’à 2 heures 10 h. Je suis charmé que vous soyez contente de ce qu’Ellice est content. Vous savez que j’ai entrepris, non pas de guérir votre tristesse, les vraies tristesses ne se guérissent pas, mais de mettre à côté du bonheur, du vrai bonheur. Soyez tranquille. Je réussirai. Je vous aime trop pour ne pas réussir. Adieu. Adieu.
99. Paris, Dimanche 22 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez brûlé vif le 93 voilà tout. J’ai si peu à vous conter de ma journée d’hier que j’ai honte de vous écrire. Ma matinée à Longchamp toute seule. Il faisait laid personne n’est venu interrompre ma solitude. Après le dîner j’ai mené M. Ellce et M. Aston à Auteuil. Il y avait du monde, beaucoup même, mais je ne vais vous nommer personne. Tout cela était ennuyeux, très ennuyeux. Je suis revenue à 10 heures. Il n’y a pas un mot de nouvelle. Est-ce que tout le monde dort en Europe. Ellice est bien impatient du précepteur. Il a grande foi en vous. J’impatiente un peu mes Anglais de hier au soir. Je n’ai plus la plus petite envie de Versailles. Je me sens fort sotte d’en avoir jamais témoigné. Cela a l’air d’un caprice. Ah que j’aurais besoin d’être gouvernée. Pourquoi ne me gouvernez-vous pas ? Rien ne me plait que ce qui plait à un autre. Mais l’autre il faut que je l’aime ; que je l’aime bien, et je n’aime pas assez M. Ellice, ni M. Aston ; ici personne. Personne que la Normandie. Quelle belle manière d’échapper à la personnalité ! Monsieur, je deviens bête, je crois même que vous le trouvez un peu depuis le 27 juin.
Nous nous adressons de sottes lettres. Vous ne me dites rien, vous ne m’avez écrit que deux lettres charmantes même le n°87. " de douces paroles !", l’autre le jury. J’attends tout du jury. Dans 9 jours. J’y pense je crois plus que vous Adieu. Adieu.
[Paris], Jeudi 15 février 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Adieu. Adieu, mon amie. Je vous verrai un moment vers midi et demi. Adieu.
Jeudi 8 h. 1/2.
[Paris], Jeudi 15 février 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Adieu. G.
Jeudi 5 h. 1/4.
[Paris], Mercredi 18 mai 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est le sentiment qui m’a accompagné hier toute la soirée, et quand je suis entré dans mon lit et jusqu’au moment où je me suis évanoui dans le sommeil. Je pensais à vous, à ma mère, à mes enfants. Je pouvais mourir. Je n’étais pas seul. Dites-le moi comme je vous l’ai dit, comme je vous le redis. Nous avons été l’un et l’autre bien battus, bien chargés. Nous avons eu et nous aurons jusqu’au bout le cœur bien malade. Mais dans notre mal, c’est un bien immense de nous être rencontrés, et de faire ensemble, hand in hand, ce qui nous reste de chemin. Vous êtes fatiguée, très fatiguée. Appuyez-vous sur moi. Moi aussi, je suis souvent fatigué, plus souvent que je ne le dis ; et j’ai besoin de m’appuyer sur vous, besoin du moins d’être sûr que je le puis si la fatigue me presse trop. Oui, j’ai besoin de vous. Adieu. Farwell. Gots sey mit ihnen. N’y a-t-il pas encore quelque autre manière de vous dire adieu ? Je vous ai beaucoup dit depuis le 15 juin, bien peu pourtant, infiniment peu auprès de ce que j’aurais à vous dire. Chaque jour, à chaque occasion douce ou pénible triste ou gaie, je me sens le cœur plus rempli que jamais. Mais le temps manque, les paroles manquent. Tout manque, excepté le cœur même. Adieu. G.
Ma petite Pauline a fort bien dormi. Elle est mieux ce matin. Ce ne sera rien. Mercredi, 9 heures
Mots-clés : Deuil, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Relation François-Dorothée
101_1. Lisieux, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’arrive et je repars à l’instant pour Broglie, où je veux arriver pour déjeuner. J’ai été charmé, toute la nuit de mon apparition en passant. Je l’avais désirée sans l’espérer. C’est bien rare d’avoir plus qu’on n’a espéré. Adieu.
Je suis dans le bureau de poste, entouré de courriers et de commis. J’ai oublié la série des Numéros. Je la retrouverai au Val-Richer. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance
101_2. Broglie, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je tombe de sommeil. J’ai fort peu dormi cette nuit. Ce matin au moment d’arriver, je dormais profondément. Certainement, je dormirais si je ne vous écrivais pas. Mais je ne puis me résoudre à passer toute cette matinée sans vous. A midi et demie en sortant de déjeuner, il m’a pris un vrai mal aise physique. Que le bonheur devient promptement une habitude ! Une heure après vous avoir retrouvée, il me semblait que je ne vous avais jamais quittée ; et pendant bien des jours, à midi et demie, je m’étonnerai tristement de ne pas sortir pour aller vous voir.
Samedi 7 h.1/2
J’ai été interrompu hier par M. de Broglie. Quand on arrive de Paris, il semble toujours qu’on apporte des nouvelles. Il n’y en a point. Je le dis. La conversation languit un moment. Et puis, à défaut de grandes nouvelles, les petites arrivent, abondent, et la conversation se ranime et devient intarissable. J’ai passé hier ma journée à raconter ce que je ne sais plus aujourd’hui ce que je me rappellerais bientôt si j’allais causer ailleurs. Mad. de Broglie vient de partir ce matin avec sa fille. Elle passera deux jours à Paris pour assister au grand concours de l’université où son fils a des prix, et le ramènera, sur le champ ici. Mad d’Haussonville partira du 28 au 30 pour Milan, Rome, Naples et l’hiver en Italie. Mad. de Broglie voulait absolument que nous passassions encore quinze jours ici. J’y serais revenu reprendre ma mère, et mes enfants, à mon retour de Caen. Mais je veux rentrer chez moi. Il faut une raison pour que je me plaise à en sortir longtemps. J’ai trouvé ma mère bien et mes enfants, à merveille. Guillaume est engraissé. Votre petit nécessaire a eu un grand succès. Henriette veut vous écrire. Et Pauline, qui ne sait pas écrire veut vous écrire aussi pour vous remercier avec sa sœur et pour sa sœur. Mes deux filles, sont très unies. Il faut qu’elles fassent toujours la même chose. Tout est commun entre elles. C’est un appui, et un repos dans la vie qu’une vraie intimité fraternelle. Et puis ce spectacle me plaît. Mes filles sont, dans leur famille, la troisième génération qui me le donne. Et toujours l’aînée supérieure à la cadette, et la plus dévouée, la plus prompte, aux sacrifices matériels pour sa sœur.
104. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi m’êtes-vous devenue nécessaire ? Vous ai-je dit que mon service de poste venait de recevoir un grand perfectionnement ? Mon facteur m’arrivera une heure plutôt et retournera toujours à Lisieux avant le départ du courrier pour Paris. En sorte que vous aurez toujours ma lettre de la veille. M. Conté a arrangé cela, pour moi. Je lui en tiendrai compte quelque jour. L’allocation du Roi sur le parfait accord de sa famille, et de son ministère, est avidemment une réponse au déjeuner de M. le duc d’Orléans chez M. Foule et à mon dîner chez M. le duc d’Orléans. Je n’en reste pas moins convaincu que M. le duc d’Orléans n’a fait cela que d’accord avec le Roi. La part de la comédie est grande, en ce monde. Je trouve le discours de Lord John excellent, un vrai discours de gouvernement, acceptant la responsabilité sans dissimuler le tort, jugeant et agissant d’ensemble et non en détail. C’est le détail qui perd les hommes et les affaires. Lord John a fait de grands progrès. En tout, je trouve la conduite et la situation des Whigs, c’est à dire de Lord Melbourne et de Lord John, meilleures que je n’attendais. Lord Aberdeen se flatte. La clef de l’avenir ministériel est toujours en Irlande. Les Torys ont tort de prolonger indéfiniment les questions irlandaises. Le Gouvernement Tory de l’Irlande est impossible. Les hommes même simples spectateurs ne supportent plus ce degré d’iniquité et de violence. Je regrette la lettre de Lady Clauricard, et celle de Lady Granville, et même celle de Mad. de Flahaut. Si elle a envie de revenir cet hiver, elle reviendra. La mauvaise humeur est une puissance terrible.
9 h. 1/2
Voilà mon facteur et mon N°108. A ce soir. Je trouve ici en arrivant je ne sais combien de petites affaires à régler. Quatre ou cinq personnes sont là qui m’attendent. Nous reprendrons ce soir notre conversation. Car je veux retrouver dans nos lettres notre conversation. Je veux vous dire tout ce qui me traverse l’esprit, tout ... excepté ce qui est tout. à la vérité ceci ne me traverse pas l’esprit. Adieu. Comment voulez-vous qu’on trouve un ventriloque, un homme qui parle là où il n’est pas ? Aussi, qui a jamais cherché un ventriloque ? Je vais pourtant écrire encore pour essayer de trouver le vôtre. Adieu. G.
105. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous lisez très bien les journaux. J’ai envie de m’en fier à vous, et de n’y regarder que ce que vous me recommanderez. D’autant plus que j’avais remarqué tout ce que vous me dites et pas grand chose de plus. Je suis de votre avis sur tout entre autres sur l’article des Débats. Il était si à propos, et si aisé d’écrire sur ce bruit du Times, dix lignes de cœur haut et de bon gout, dix lignes vraiment royales, en réponse aux boutades impériales ! Pour le constitutionnel, je n’y attache aucune importance. Il serait vendu qu’il ne parlerait pas autrement. Raison de plus même. Cependant je ne le crains pas. Mais je crois que M. Molé a une voie que je crois connaitre, pour faire insérer de temps en temps, dans ce Journal, quelque article qui le serve comme il l’a fait pour la visite de Champlatreux. La plupart des journaux sont aujourd’hui des magasins où l’on achète un article. Certains acheteurs payent plus cher que d’autres, et ne peuvent entrer que rarement. Mais pourvu qu’ils en disent tant, et pas trop souvent, on les écoute. Si l’opposition savait son métier comme elle exploiterait l’abandon du procès Chaltas ! Mais elle est bête et subalterne. Elle ne sait pas, et n’ose pas. Je n’en persiste pas moins à penser qu’au dehors, on est embarrassé de cette affaire, & bien aise qu’elle ne soit pas poussée à bout. Je ne trouve pas l’article Hollandais bien fin ni bien fier. Les républiques anciennes auraient mieux répondu. Je ne suis pas républicain, ni vous non plus.
Mais avez-vous lu, vraiment lu Thucydide et Tacite, Démosthène, et Cicéron ? Ce sont les esprits qui vous vont le mieux, hauts et naturels, dignes et dégagés, sensés et élégants, et ce je ne sais quoi d’achevé que la perfection du langage donne à la pensée. Vos grandes pensées vaudront les leurs, mais pas mieux, je vous en prévient. Occupez-vous en un peu quoiqu’on dise. Voulez-vous que je fasse porter chez vous une traduction passable de Tacite. Que je voudrais vous tire tout cela moi-même ! Nous nous sommes rencontrés tard. L’eau court vite. Bien peu de place nous reste pour tout ce que j’y voudrais mettre. Le bonheur possible et point réalisé, vu et point atteint, est un des plus pénibles sentiments que je connaisse. Je vous quitte pour ce soir. Je n’ai pas encore regagné tout mon sommeil.
Lundi 20 8 heures
En rangeant, mes papiers, je viens de relire, le N°104. Je ne suis pas décidé à le bruler. Il y a du bien mauvais. Mais tout n’est pas mauvais ; et dans le mauvais même, il y a du bon, ne pouvant les séparer, j’ai envie de garder tout, pêle- mêle. Je voudrais bien n’avoir pas d’autres papiers à ranger que ces numéros là. J’ai des ennuis d’affaires, des comptes à examiner, un fermier qui ne paye pas. Vous ne savez pas ce que c’est que des affaires, et j’espère que vous ne le saurez jamais quoique je vous aie vue à la veille de le trop bien savoir. Je vais à Caen dimanche 26 de grand matin. Ainsi le samedi 25 adressez-moi votre lettre à Caen, à la Préfecture. Je passerai là cing ou six jours, entre la société des Antiquaires, les courses de chevaux et mes courses à moi dans les environs. Le pays-ci est en grand progrès de civilisation. On y prend tous les goûts élégants et civilisés, les courses, les arts, les Académies, les speeches. Tout cela est amusant, à voir naître, si petit d’abord, si informé, et pourtant si animé, si avidemment destiné à grandir. Mon Lisieux vient de fermer son exposition de tableaux, plus de 250 tableaux, dessins, n’en soit de la province soit d’ailleurs. Le public normand a été très excité et charmé. Les paysans sont venus en foule voir cela. L’expositon a fini par une loterie de tableaux. On en a acheté pas mal, de côté et d’autre. On les méprisera beaucoup un jour. Mais ils auront commencé le goût et le sentiment de l’art dans toute une population.
9 h. 1/2
Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. C’est la première fois que cela m’arrive cette année. C’était hier Dimanche. On aura mis votre lettre trop tard à la poste. C’est la seule explication que j’accepte. Adieu. J’aime mieux me taire.
Mots-clés : histoire, Littérature, Politique (France), Portrait (Dorothée), Presse, Progrès
107. Paris, Vendredi 17 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai cru à mon réveil ce matin avoir dormi deux jours en voyant arriver votre lettre. Je vous remercie de ce petit mot. J’étais bien triste hier au moment où vous m’avez quittée. Je vous ai regardé encore dans la glace du premier salon vous ne me regardiez plus. Cela m’est resté sur le cœur et je me suis décidée à vous voir encore un instant. C’est ce qui m’a fait rentrer de bonne heure & me tenir sur ma terrasse. Cela m’a réussi. Je ne vous ai pas salué, Marie était près de là. Mais j’ai fait mieux que cela et vous aussi. Je me suis sentie allégée.
Vous n’étiez pas sorti de ma chambre depuis dix minutes lorsque Lord Clauricarde y est entré. Comme il avait beaucoup à dire & beaucoup à apprendre, je l’ai mené à Longchamp en laissant Marie à la maison. Il est venu littéralement chercher ses instructions auprès de moi, & sa femme m’écrit même que cela met Lord Palmerston un peu de mauvaise humeur. Elle m’écrit une fort longue lettre, plus intéressante et meilleure que de coutume, et fort intime c’est trop long à vous redire. Il repart après demain. J’ai même lettre fort amusante de Lady Granville et une de Mad. de Flahaut dans laquelle il est évident qu’elle veut revenir à Paris, et que c’est son mari qui ne le veut pas. Je serai pour la femme. Berryer est venu hier au soir, fort désappointé de ne plus vous trouver ; disant beaucoup ce que je disais. Mon discours hier matin, vous en souvenez-vous ? Qu’il n’y aurait pas de N°2.
Médem, Aston, Clauricade, les Brignole, Tcham, Kotchoubey c’est trop long à vous les nommer tous. Mon salon ordinaire. Médem venait du château. Le Roi était soucieux au sujet de l’affaire Belge. Nous ne nous arrangerons pas. Il disait beaucoup aussi qu’on tenait de mauvais propos sur une prétendue mésintelligence entre lui et son fils, entre lui et son ministère. Que tout cela était faux, que jamais il n’y avait eu meilleur accord dans le gouvernement, & que quant à la famille, il n’y en avait pas de plus unie. Le duc d’Orléans contre son ordinaire, était dans le salon du roi. Vous lirez le discours de Lord John au sujet de Lord Durham. Il me paraît excellent. Lisez aussi Lord Brougham sur l’alliance française et les applaudissements de la chambre. Il me semble que pour 20 heures de séparation voilà déjà assez de choses. A propos Marie est venu me dire ce matin que pour la première fois depuis 15 jours elle avait très bien dormi cette nuit. Elle a en effet très bonne mine. C’est trop ridicule.
11 heures
Je viens d’écrire mes deux lettres à mon mari & à mon frère. Elles sont bien. Le grand Duc restera à Lens quatre semaines à ce que prétend Médem. Adieu. Adieu. J’ai encore de grosses lettres à faire pour l’Angleterre. Je suis lasse mais je veux avoir fait cela. Adieu. Je veux faire beaucoup de choses aujourd’hui pour essayer de me distraire. Ah que ce sera long ! que c’est long déjà !
107. Val-Richer, Lundi 20 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai bien envie d’avoir de l’humeur. J’ai mal reçu mon facteur ce matin. Il a été très étonné. Il arrivait de très bonne heure. Malheur à lui s’il arrive tard demain. Pensez bien je vous prie à l’heure de la poste le dimanche, car ce ne peut être que cette cause là. Et si c’est une autre cause, une cause où vous ayez la moindre part du monde, ne me parlez plus de mon étourderie parce que je n’ai pas toujours un almanach dans ma poche. Je me suis promené toute la journée. Il faut que je parle lundi prochain à la société des Antiquaires, et je ne sais que leur dire. J’ai essayé de chercher un peu d’esprit. Ce que j’en ai trouvé ne vaut rien, je crois. J’espère que demain après déjeuner, je serai plus heureux. Il le faudra bien.
Je viens de jouer au loto-dauphin avec mes enfants. Je les ai gagnés. J’ai au jeu un bonheur insolent. Que faire des bonheurs dont on ne se soucie pas. Si tout autre eût gagné, ma petite Pauline se serait impatientée. Il lui déplaît fort de perdre. Mais mes enfants me pardonnent tout. Nous sommes très tendrement ensemble. Je ne les chicane, et ne les gêne pas du tout dans le détail de la vie. J’aime la liberté des gens que j’aime. J’ai du plaisir à les voir s’ébattre librement devant moi d’esprit comme de corps. Avez-vous aussi beau temps que moi ? Du soleil brillant et pas très chaud. Je voudrais arranger le temps de Longchamp l’y envoyer tous les jours, comme vous y envoyez des sandwiches et des fraises. Vient-on vous y voir ? Car vous avez un peu plus de monde à présent. Pahlen vous arrivera dans deux jours. Je vous quitte pour écrire à d’autres personnes de qui je n’attends pas de lettre. Adieu jusqu’à demain.
Mardi, 9 h. 1/2
C’est ce que j’avais pensé. Me voilà délivré pour aujourd’hui de mon chagrin, et pour toujours du reproche d’étourderie deux lettres à la fois, c’est charmant ; mais décidément j’en aime mieux une chaque jour. Ces deux lettres m’arrivent au milieu de la leçon d’arithmétique de mes filles. A ce soir notre conversation. J’aurai le cœur gai aujourd’hui. Adieu. Je suis charmé que vous ayez trouvé le ventriloque. Faites-en mon compliment à M. de Brignolle. Où donc l’a-t-il trouvé ? Adieu. Mille adieux. C’est le moins que vous me deviez.
108. Paris, Samedi 18 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne vous dirai pas quel devait être le N° de votre lettre de Lisieux. Mais j’ai bien envie de vous dire que j’ai plus d’ordre que vous et que je porte toujours en place ou en voyage un calendrier dans lequel je marque cela. C’est que les Français sont étourdis. Fâchez-vous bien je vous en prie. Relisez ma malencontreuse lettre. Regardez y bien. Vous verrez qu’elle n’était pas si mauvaise que vous la faisiez en calèche où vous m’avez inspiré tant de terreur. Mais brûlez la dans tous les cas, car elle vous a donné un mauvais moment et à moi ensuite aussi. J’ai si peu à vous dire de ma journée d’hier que je ferais aussi bien de n’en point parler du tout. Le Duc et la Duchesse de Palmella sont venus me trouver à Longchamp. Avant leur arrivée, j’avais marché seule dans notre allée favorite. Je me suis arrêtée où nous nous arrêtions pour regarder le Mt Calvaire. J’ai pensé à votre bras qui serrait le mien avec compassion à l’endroit où un heureux père appelait son fils d’un nom que je n’ai pas la force de tracer ! Après mon triste dîne j’ai été voir les Brignole. J’ai causé avec eux jusqu’au moment de rentrer pour me mettre au lit.
A propos avant cela, et à la lueur des lanternes, des plus pitoyables lanternes du monde, j’ai été chercher le N°24 de la rue de Sèvres. Imaginez le guignon. Le N°24 est une masure abandonnée. Pas de porte. des affiches placardées partout. Les fenêtres brisées. Enfin une ruine. Vous m’avez mystifiée. Où trouver maintenant le ventriloque ? J’aurais bien des choses à vous dire sur les journaux de ce matin, mais vous n’êtes plus là, vous ne viendrez pas et il faut que je ravale tout. La singulière manière dont le journal des Débats défend le gouvernement Français d’avoir révélé une conspiration formée contre la vie de l’Empereur Nicolas à Varsovie ? On dirait un crime d’empêcher un forfait. Que pensez- vous de cet article ? Que pensez-vous du Constitutionnel de ce matin ? Et de Chaltas, auquel on ne fera pas de procès. Et de l’article inséré dans les journaux hollandais sur cette affaire ? Et les républiques anciennes dont on a tort de trop enseigner l’histoire ? Vous voyez que je lis avec fruit, mais vous voyez aussi que j’ai besoin de vous, ... pour cela seulement ... ?
Marie est d’une gaieté qui m’offense. Elle se porte parfaitement bien. Je n’ai pas de lettres et pas de nouvelles à vous mander. J’ai écrit hier à Lady Cowper, à Mad. de Flahaut. Aujourd’hui à Lady Granville. J’ai fait hier une grande pensée, je compte en faire deux autres aujourd’hui. Maintenant vous savez tout, car je n’ai pas besoin de vous raconter que je suis triste, bien triste. Adieu. adieu.
Mots-clés : Politique (France), Presse, Réseau social et politique
108. Val-Richer, Mardi 21 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il y a plus de soleil ce soir dans mon cœur qu’il n’y en avait ce matin sur la vallée, quand je me suis levé en admirant tristement son éclat. Bien des gens me prennent pour le sage des Stoïciens. Qu’ils seraient étonnés s’ils voyaient combien je suis loin de son impassibilité? J’ai supposé un moment quelque arrivée soudaine qui vous avait dérangée et retardée. Cependant cela me paraissait si invraisemblable que j’ai écrit comme à l’ordinaire, si le grand Duc passe quatre semaines à Tour ce que vous aviez cru possible ne le sera que plus tard, et il faut changer vos calculs. Je comprends la joie d’Appony que rien ne soit changé ailleurs. Il y a si je ne me trompe, dans la politique de M. de Metternich beaucoup de calculs jaloux (le jaloux sans amour bien entendu), beaucoup de soin à entretenir les rivalités, les misintelligences, les séparations, et à fonder là-dessus sa force. Cela me parait un peu vieux, je vous l’avoue. C’était la politique d’un temps où les grands intérêts et les vœux généraux des peuples ne pesaient pas incessamment sur les gouvernements, où les combinaisons arbitraires, mobiles, étaient possibles et habituelles. D’un temps aussi où beaucoup de petits Etats avaient leur poids dans la balance et pouvaient être assez facilement transportés, dans l’un ou l’autre bassin. Tout cela n’est plus. Il n’y a plus de petits états ; plus de combinaisons arbitraires et variables. Les grands intérêts décident seuls de la conduite ; et les grands intérêts sont connus ne changent pas tous les jours. Et on leur obéit, quels que soient les goûts ou les dégoûts, et les désirs secrets et les variations quotidiennes des cœurs. Toutes ces petites inquiétudes et ces petites joies, toute cette attention aux moindres nuages qui passent, aux plus faibles fils qui se tendent ou se brisent, me paraissent une routine de vieilles gens ou un passe-temps d’oisifs. Qu’on y regarde, et qu’on en tienne compte pour son propre plaisir, pour l’agrément ou le désagrément des relations personnelles, rien de plus simple c’est quelque chose pour la conversation, quelque chose pour l’attitude réciproque des acteurs sur la scène ; mais ce n’est plus de la politique. Les Affaires sont plus haut que cela. Et à la hauteur où elles sont, elles sont écrites, comme disent les musulmans ; il faut des motifs placés aussi haut pour les changer.
Lord Alvanley, vous restera-t-il quelque temps ? Je le voudrais. J’aime que vous vous amusiez loin de moi. Est-ce de la présomption ? Peut-être ; mais à coup sûr c’est de l’affection. Vous croyez qu’il me trouverait bien sérieux. Qui sait ? Je l’amuserais peut-être s’il m’amusait. Mais les indifférents m’amusent difficilement. Je n’accepte les petits plaisirs, la gaieté le rire pour rien, que de la main des gens que j’aime que j’aime beaucoup. malgré votre tranquillité dans le n°110, j’attends demain le comte de Paris. J’ai des nouvelles de chez Mad. la Duchesse d’Orléans, d’hier matin, qui me disent qu’elle commençait à souffrir.
Mercredi 22, 7 heures
Le Prince Paul Wutemberg me paraît du nombre des hommes qui croient aisément ce dont ils ont envie, et en qui le mouvement du sang décidé des idées : à voir cette grande et forte figure, ces traits grossiers, ce teint allumé, je n’ai pas la moindre foi dans l’impartialité de son jugement. Il a de l’esprit, mais encore plus d’égoïsme et de cynisme que d’esprit ; et ni l’égoïsme, ni le cynisme ne font voir clair. Vous savez que je crois encore moins que vous aux ouragans. J’ai de l’humeur pourtant.
Avez-vous lu dans le Journal des débats, un article sur la visite des Bayadères aux Tuileries ? Savez-vous que l’auteur de cet article, qui l’a signé de son nom est le précepteur de M. le Duc d’Aumale ? Un précepteur de Princes parlant de la sorte devant le public, et s’extasiant sur les Bayadères, et se trémoussant pour faire partager son extase et finissant par dire : " Après tout, si vous me demandez ce que sont les Bayadères, je serai fort embarrassé. Ce ne sont pas des danseuses, ce ne sont pas des chanteuses ; les Bayadères sont des Bayadères. " Il y a quelque chose qui est étrangement perdu de notre temps, c’est le tact. Personne n’a le sentiment de sa situation. Vous me direz qu’il n’y a pas de situations. Comment ne fait-on pas, soi-même la sienne ?
Voici de l’écriture et du style d’Henriette. Vous occupez souvent sa petite pensée. Elle voulait absolument mettre une enveloppe, ne trouvant pas ceci assez joli. Je lui ai persuadé qu’une suffirait pour elle et pour moi.
9 h. 1/2 Vous êtes une excellente personne de me dire tout simplement que vous aviez oublié le dimanche. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Politique, Portrait, Presse, Réseau social et politique
109. Paris, Dimanche 19 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu votre lettre de Broglie. Je suis fâchée que M. de Broglie ne vous ait pas laissé dormir. J’ai si mal dormi cette nuit qu’il me semble dans ce moment que rien ne peut être plus charmant que le contraire. Le duc de Noailles est entré chez moi hier au moment où je fermais ma lettre. Ce n’est pas lui qui a parlé. il avait mille choses à apprendre. Il m’a retenue un peu. J’ai été à Longchamp. M. Greville est venu m’y voir. Il n’y avait cependant rien de nouveau d’Angleterre. On espère que le discours de Lord John Russell disposera Lord Durham à rester à son poste en dépit de l’acte d’indemnité. Son retour serait un grand embarras.
J’avais été voir un moment la petite Princesse hier matin. Quel sale ménage ! Je les ai trouvés au déjeuner j’en ai eu mal au cœur. Elle est toujours dans les désespoirs et les terreurs de sa femme de chambre. Cette pauvre folle croit toutes les nuits qu’on attente à son honneur, & le jour elle essaie de se pendre. Cela jouit au perroquet, au chat, au chien, à la nourrice & au prince Schonbery fait un intérieur inconcevable. Je suis allé à Auteuil hier au soir ; j’y ai mené lord Clauricarde et Lord Coke. Il y avait fort peu de monde. Appony m’a dit que selon leurs lettres du prince Metternich le grand duc fera comme il était convenu le voyage d’Italie dans les provinces autrichiennes mais qu’il n’y acceptera pas de fêtes, et ne sera que simple voyageur. L’Empereur Nicolas était attendu sur le lac de Constance le 15. Après, on ne savait pas où il devait se rendre. Le 15 septembre il sera à Berlin aprés les manoeuvres de Magdebourg.
Je vais dîner aujourd’hui à Auteuil avec le Duc de Noailles. Le prince Metternich a été extrêmement content de ses entretiens avec l’Empereur ; Appony a ajouté avec une joie évidente que les récits de Vernet étaient faux, qu’il n’y avait rien de changé. Pahlen reviendra donc comme il était parti. C’est mercredi qu’il arrive. Vous voyez que je cause avec vous comme si vous étiez ici. Mais quelle différence ! Comme je la sens ! Adieu, le dimanche on me demande ma lettre de meilleure heure. Adieu & de tout mon cœur.
Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique
109. Val-Richer, Jeudi 23 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais bien voir vos instructions à Lady Clauricard. Est- ce que vous n’en gardez pas une copie ? Dites lui de vous en renvoyer une. C’est bien le moins qu’elle vous doive. Marie ne pourrait-elle pas en faire une ? Si j’étais là, je vous offrirais encore mon copiste, malgré sa bêtise. Soyez sûre qu’au besoin je vous parlerais de mes ennuis intérieurs aussi simplement que vous m’en parlez. Oui croyez hardiment que vous valez Lady Cowper pour moi. Mais malgré la tranquillité du moment je crains aussi toujours des ennuis pour vous-même. Vous m’avez fait connaitre des gens et des façons d’agir que je ne soupçonnais pas. Avec l’Empereur Nicolas et M. de Lieven, tout est possible. Aujourd’hui ne garantit point demain. Un grand géologue français, M. Elie de Beaumont vient de m’envoyer sont voyage à l’Etna. Je lisais cela hier soir. Il s’est promené je ne sais combien de temps, sur une croûte de terre assez mince, au dessous de laquelle sans rien voir, il entendait gronder et bouillonner des flammes, des eaux, des laves des pierres ; le sol pouvait à tout moment éclater sous ses pieds. Vos barbares sont ainsi faits. Il n’y a point de sûreté. Faites vos affaires vous-même. Assurez, ménagez vos moyens d’indépendance. J’y pense plus souvent que je ne vous le dis. Je suis plus tranquille sur l’Angleterre que sur vous. Non que tous les éléments d’explosion n’y soient. Entre la folie de M. Curran et celle de Lord Londonderry, il y en a plus qu’il n’en faut pour mettre le feu à un grand pays. Mais de l’un à l’autre de ces fous, la distance est longue, & remplie d’une foule de sages, très intelligents, et très résolus qui ne permettront pas aux deux petits bataillons de fous d’en venir aux mains. Voilà le résultat d’un bon et long gouvernement libre ; il n’empêche pas le mal ; il le provoque même et le développe ; mais il provoque, et crée un même temps une masse de bien, forte et compacte, qui pèse beaucoup plus dans la balance. Et puis, je vois dans tout cela bien des folies, et des colères simulées, celles de M. O’Connell et de Lord Lyndhurst par exemple. Si le péril devenait pressant, si les paroles entraînaient des actes, leur emportement radical et tory tomberait, je crois, bien vite.
Qu’est-ce que c’est donc que cette capture d’un Schooner anglais dans la mer noire ? Nous finirons par payer en Europe les frais de la rivalité anglaise et russe, en Asie. Car c’est de l’Asie au fond que la Russie, et l’Angleterre sont préoccupées. Du reste, je le veux bien. J’ai envie de voir rentrer l’Asie dans la circulation des événements. Il faut que l’Europe remue et régénère le monde entier. Ne seriez-vous pas curieuse de savoir où en seront les choses, dans 500 ans ? Je vois dans le Constitutionnel qu’il a été question d’un mariage entre le fils du Roi Ernest et une fille de l’Empereur Nicolas. Je n’y puis croire. Et puis le Constitutionnel ignore évidemment que le jeune duc de Cumberland est aveugle. Vous voyez que je lis bien mes journaux.
10 heures
Je n’ai point de nouvelles à vous envoyer. Mais en revanche, je ne vous en demande point. C’est vous que je veux, non pas vos nouvelles. Du reste dans la disette générale, vous glanez à merveille. Vous verrez Pahlen aujourd’hui. Il fournira à quelques heures. Mais vous serez obligée d’employer la méthode socratique. Il ne parle pas tout seul. Plus d’étourderie, je vous prie malgré mon prétendu contentement. J’aime mieux qu’elle soit de Pépin que de vous. Adieu. Tous ces revenants de Londres ont été bien vite usés, à ce qu’il me paraît. Vous avez raison. Pour vous, et malgré votre amour pour Londres, ils ne valent pas plus que cela. Adieu. G.
110. Paris, Lundi 20 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis enchantée des progrès de votre civilisation. Nous nous parlerons donc plus vite, cela me fait grand plaisir. Le prince Paul de Würtemberg m’a longtemps retenue hier matin. Il vient me questionner sur des choses que j’ignore. La grande préoccupation est ici. Ses idées sont à l’orage, aux ouragans. Je n’y crois pas du tout. Il venait de recevoir une lettre de sa fille la Duchesse de Nassau qui fait les honneurs d’Hesse au grand duc. Elle lui mande qu’il est bien maigre, bien faible, toussant beaucoup enfin dans un état inquiétant. Tous les jours mon mari envoie un courrier à Coblence avec le bulletin de sa santé, lequel bulletin est transmis de nuit pas télégraphe au Roi de Prusse. Ceci indique vraiment un état alarmant. Mon mari porte un chapeau blanc qui fait un grand effet aux eaux. J’ignore pourquoi. Voilà les nouvelles de la Duchesse de Nassau.
Je n’ai passé hier qu’une heure à Longchamp, je me suis rendue de là à Auteuil où j’ai trouvé le duc de Noailles que j’ai ramené chez moi après dîner. Le soir j’ai eu mon monde ordinaire, & M. Molé & Lord Alvanley d’extraordinaires. Celui-ci est rempli d’esprit & de gaieté, je le voyais beaucoup à Londres. Il vous plairait surement, mais vous lui paraitriez bien sérieux. M. Molé était en belle humeur. Il nous a raconté Champlatreux, et ajouté que cette visite lui avait été annoncée déjà depuis trois mois. Il m’a fait une plaisanterie que je relève parce que le Prince Paul m’avait dit la même chose le matin : que l’Emp. Nicolas verrait sans doute Louis Bonaparte sur le lac de Constance. Des personnes qui venaient du salon de la Reine m’ont dit que la duchesse d’Orléans y était et qu’il n’y avait pas encore le moindre indice de l’évènement. Le Duc de Devonshire vient d’arriver. Je dine aujourd’hui chez Palmella avec Lord Alvanley. Enfin le ventriloque est trouvé. Il est venu ce matin chercher la lettre lui-même c’est l’Ambassadeur de Sardaigne qui l’a déterré. Je cherche, il me semble que je vous ai tout dit. Adieu donc.
La lettre de Lisieux devait être 103. Celle de Broglie 104, celle reçue ce matin 105 pas conséquent. Vous n’avez donc pas retrouvé votre compte. Adieu mille fois.
110. Val-Richer, Vendredi 24 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il fait un temps affreux, et j’ai très mal aux dents. Voilà une mauvaise préparation pour les courses de Caen, et pour la société des Antiquaires. J’ai pourtant un peu plus de foi dans mon éloquence, malgré la douleur, que dans l’agilité des chevaux, malgré la boue. J’ai fait hier une petite répétition de la victoire de Pascal. Je souffrais vraiment beaucoup, l’impatience m’a pris, et je me suis mis à travailler comme si de rien n’était ; en moins d’une heure, l’attention l’a emporté ; je n’ai plus senti la douleur que dans le lointain, comme quelque chose qui pouvait, qui voulait même revenir, mais qui n’était pas là. Je ne l’ai retrouvée qu’à dîner. Cette nuit, j’ai dormi, grâce à un gargarisme de pavot et de fait. Vous voilà parfaitement au courant. Vous a-t-on apporté les Mémoires de Sully ? Avez-vous jété les yeux sur ces dépêches de M. de Fénélon ? Il y a bien des choses ennuyeuses, mais quelques unes vraiment curieuses et amusantes. A la vérité, il faut les chercher dans les ennuyeuses, et vous n’êtes guère propre à ce travail. Votre plus grand défaut est de ne savoir vous plaire qu’à ce qui est parfait. Défaut qui me charme et me désole. Quand je vous vois repousser avec un si fier dédain tout ce qui est médiocre, ou lent, ou froid, ou insuffisant ou mélangé, tout ce qui est entaché, en quelque manière que ce soit de l’imperfection de ce monde, je vous en aime dix fois davantage. Et puis quand je vous vois triste et ennuyée, je vous voudrais plus accommodante moins difficile. Je mens ; restez comme vous êtes, même à condition d’en souffrir. Je le préfère infiniment. Je vous voudrais seulement, pour vous-même, un peu plus de goût pour une occupation quelconque, lecture ou écriture, pour l’exercice solitaire et désintéressé de la pensée. Vous n’y perdriez rien et vous vous en trouveriez mieux. Mais vous n’aimez que les personnes ; il vous faut une âme en face de la vôtre.
Qu’à donc la petite Princesse ? Est-ce qu’elle est malade de la folie de sa femme de chambre ? Pourquoi garde-t-elle cette femme ? Si la folie persiste, il faut la mettre dans une maison de santé. Je parie que l’extrême voisinage de la petite Princesse ne lui vaudra bien auprès de vous. Elle ne supportera pas cette épreuve. Je comprends que le baptême Protestant du petit Duc de Wurtemberg déplaise à l’archevêque ; mais, il devait s’y attendre. On ne s’attend à rien ; on ne renonce à rien ; on ne se résigne point. Il y faut le poids de la nécessité la main de Dieu. Voilà pourquoi nous avons bien fait en 1830. Je pars après demain dimanche à 6 heures du matin, pour être à Caen à 11 heures. J’ai promis d’assister aux courses soleil ou pluie. Elles commencent à midi. Je rentrerai probablement chez moi à la fin de la semaine samedi ou dimanche. La Duchesse de Broglie doit venir nous voir vers cette époque, à partir de demain samedi, adressez-moi donc vos lettres à Caen, à la Préfecture. Du reste, je crois vous l’avoir déjà dit.
10 heure 1/2
Cet horrible temps a retardé mon facteur. Il arrive seulement. Je le sais que vous êtes bien seule, et je m’en désole. A votre mal, je ne sais qu’un soulagement, l’affection, et l’affection de loin, donne si peu ! Tout est bien triste. Votre lettre de ce matin me trouve en grande disposition de le dire avec vous. Adieu. Henriette sera charmée de votre lettre. Adieu. G.
Mots-clés : Littérature, Politique, Portrait (Dorothée), Santé (Dorothée), Santé (François)
111. Paris, Lundi 20 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous aurez bien vu ce matin que je n’ai pas manqué un jour de vous écrire. J’espère que vous avez reçu deux lettres à la fois. Il était tard en effet quand j’avais oublié. J’ai remis ma lettre, le dimanche. Vos émois intérieurs me font bien de la peine, et je ne sais comment m’y prendre pour vous le dire mieux que cela. Lorsque je me suis trouvée menacée d’un grand embarras, tout le monde s’est offert à m’en tirer ; et je vous assure que si les menaces avaient été effectuées, je n’aurais pas balancé à en écrire à Lady Cowper. Est-ce que je ne vaux pas Lady Cowper pour vous ? Je voudrais une réponse toute simple à ceci, car cela me parait la chose du monde la plus simple.
Le Duc de Devonshire est venu me prendre bonne partie de la matinée hier. Et il est si sourd que je suis sortie parfaitement fatiguée de ce tête à tête. Il ne m’a rien dit de nouveau, mais dans sa qualité de Whig et de patron des gouvernants actuels j’ai été frappée de l’entendre parler avec beaucoup de dégout de la persistance de Lord Melbourne de conserver le pouvoir à des conditions se humiliantes. On est très curieux en Angleterre d savoir ce que va faire lord Durham. Les ministres espérant beaucoup qu’il restera au Canada. Le Duc de Devonshire repart demain pour courir après sa sœur. J’ai dîné hier chez Palmella comme je vous l’ai dit. Lord Alvanley m’a fait rire, & Palmella ne m’a pas ennuyée. J’en suis sortie à 9 1/2 et j’ai été encore me promener sur la route du Val Richer.
J’écris une longue instruction pour Lady Clauricarde. J’aurais bien aimé trouver une Mad. de Lieven il y a 25 ans lorsque je suis allée en Angleterre. Il a fallu que je trouve tout, toute seule. Pour en revenir à Lady Clauricarde. Vous ne sauriez concevoir comme cela est complet j’en suis étonnée moi-même et très fatiguée. Il me semble que je n’ai rien à vous dire de nouveau. Je n’ai reçu de lettres de personne. M. Molé l’autre jour parlait bien mal de la situation de l’Angletere je crois qu’il se trompe, les radicaux y sont faibles en dépits de toutes les sottises qui se disent & s’impriment. Adieu. Adieu.
111. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voulez-vous lire tout l’ouvrage de Mad. Necker ? Je le ferai porter chez vous. Ce qu’en citaient hier les débats est en effet très beau, et il y a beaucoup de très beau, surtout dans ce denier volume que je n’ai fait que parcourir. A 70 ans, on fait mieux d’écrire cela que d’être amoureux d’une petite fille de 17. Je suis très ennuyé de partir demain pour Caen. Rien n’est pire que ce qui dérange sans plaire. Ne trouvez-vous pas qu’on s’impose une multitude de devoirs et de chaines parfaitement gratuits ? Et puis, quand on y regarde, on s’aperçoit qu’on néglige aussi une multitude de devoir et de soins qui feraient très bien si on s’en donnait la peine. Que de fois, en rencontrant dans ma vie, un embarras, une lutte, un ennemi, j’en ai reconnu l’origine dans une visite omise, une lettre restée sans réponse, que sais je ? C’est bien difficile et bien ennuyeux d’être attentif pour les gens et les choses dont on ne se soucie pas. Il le faut pourtant.
J’ai essayé hier, contre la tristesse le remède qui m’avait réussi contre le mal de dents. J’ai travaillé assidûment toute la matinée. Avec peu de succès. J’écrivais pourtant pour mes enfants, cette histoire de France que je veux leur raconter moi-même. Je le leur ai dit. Ils en ont sauté de joie autour de moi pendant un quart d’heure. Leur joie m’a encore attristé. J’avais eu cette idée il y a quinze ans ; pour mon fils. Je la reprends aujourd’hui pour ces trois petits. Que de choses qu’on reprend, qu’on renoue, qu’on recommence ! Toute ma vie m’est revenue à l’esprit. C’est bien ma vie. C’était bien moi. Et tout cela n’est plus ! Et toute cette immense part de moi-même a disparu ! Et je vais comme si j’étais tout entier ! Et j’ai encore soif de ce vase rempli et brisé tant de fois ! Ah, nous sommes de misérables créatures ? Nous ne pouvons conserver, & nous ne savons pas nous passer. Jeunes, nous nous épuisons à désirer et à espérer. Vieux, nous nous fatiguons à regretter et à désirer encore. Et les joies perdues sont pour nous comme si elles n’avaient jamais été. Et elles nous gâtent celles qui nous restent. Et celles qui nous restent ne nous empêchent pas de rechercher avec passion celles que nous n’avons plus comme si nous n’en avions pas eu notre part. Notre cœur est sans reconnaissance envers Dieu, sans équité envers les autres, insatiable dans son égoïsme. Je donnerais je ne sais quoi pour vous guérir de votre douleur. Et votre douleur me ramène à la mienne. Et la mienne me distrait de la vôtre. Je suis triste et mécontent de moi-même. C’est trop.
J’ai peine à croire que Mad. la Duchesse d’Orléans se soit trompée d’un mois. D’après ce qui me revient de l’intérieur de sa maison, on attend réellement d’un moment à l’autre. Du reste, c’est bien absurde, de moi de vous en parler d’ici. Vous entendez surement rabâcher tout le jour, sur ces pauvres petites nouvelles là Devinez à quoi je passe ma soirée depuis quatre jours. A coller avec de la gomme sur de grands cartons et dans de grands cadres que j’ai fait faire exprès, les portraits de tous les rois de France d’abord, ensuite de tous les députés à l’assemblée constituante. J’ai 72 portraits de Rois et 530 portraits de députés défaiseurs et faiseurs de Rois. Je veux garnir de cette collection, à la fois loyale et insolente, ma salle à manger et mon vestibule. Je fais cela avec l’aide de Mad. de Meulan, et un peu de mes enfants. Cela vaut bien vos grandes pensées.
10 heures
Ma lettre n’est pas propre à changer votre mauvaise disposition. Je voudrais trouver quelque chose à vous dire qui fût bon à écrire à M. de Lieven. Je ne trouve rien. Il y a de l’irrémédiable en ce monde. Quand il en aura fini avec le grand Duc, quand il sera oisif et seul peut-être alors sentira-t-il quelque besoin des autres, de vous, de ses enfants. Et intérêt seul, à ce qu’il me semble, peut agir, sur lui. Adieu. Je suis bien aise que Pahlen soit de retour. Il vous remplira quelques moments. Parlez-moi toujours de vous, toujours. Et toujours adieu. G.
112. Paris,Mercredi 22 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’aimerais bien pour mon divertissement & le vôtre ensuite, des évènements, quelque chose. Mais depuis votre départ il ne se présente rien, du moins j’ignore tout et je n’ai à vous mander que l’ennui que j’éprouve de ma solitude. J’ai vu hier matin la petite princesse, les Appony. J’ai résidé à Longchamp le temps voulu. J’ai dîné seule. J’ai fait la promenade en calèche jusqu’après neuf heures & demi et au moment d’aller me coucher, lorsque j’étais à moitiée déshabillée, Lord Clauricarde demande à me voir un moment. Comme il partait dans la nuit il a bien fallu le recevoir et le moment est devenu une grande heure parce qu’il avait tout à récapituler ou apprendre. Pour mieux faire nous avons mis mes instructions par écrit. J’ai été bien bonne pour lui bien intime. Il m’a juré un secret inviolable. J’ai mal dormi, je ne me porte pas bien, je ne sais ce que c’est. Le temps aussi est bien variable, il ne me convient pas.
Que vous êtes content de pouvoir me dire que je suis étourdie Je suis fâchée de vous déranger, mais après mure investigation, c’est M. Pepin qui l’a été. Il a été à la poste à 3 h. au lieu d’y aller avant 2.
La conférence ne se remet pas encore à Londres. Je ne vois pas beaucoup d’apparence que l’affaire aille. Les représentants de la cour à Londres font beaucoup d’expéditions de courriers à leurs cabinets. On dit que l’archevêque de Paris se montre très mécontent du baptême protestant du prince de Würtemberg. La Duchesse d’Orléans fait attendre tout le monde. Vous voyez que je n’ai rien à vous dire. Racontez-moi quelque chose, n’avez -vous pas quelque petite nouvelle ? Lady Granville m’écrit de Genève, du reste personne ne m’écrit. La petite princesse est malade. Adieu. je suis honteuse de ma lettre vous ne la lirez pas.
On me dit tout à l’heure qu’il y a erreur de tout un mois dans le calcul de la Duchesse d’Orléans. C’est singulier !
112. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pense que j’arriverai peut-être à Caen après le départ du courrier. Je ne veux pas que vous attendiez en vain une lettre. Je laisserai celle-ci pour qu’on la donne demain au facteur, car à 6 heures je serai en route. Le temps est toujours affreux. Je vais là comme à la corvée. J’espère être de retour samedi prochain. Quel dommage que M. de Pahlen ne soit pas un homme d’esprit ; il lui eût été bien facile de se mettre et de vous mettre au courant des vraies dispositions de l’Empereur et par conséquent de M. de Lieven. Mais il n’aura rien su chercher, et n’aura rien à vous dire. Peut-être devinerez-vous quelque chose à travers son ignorance. Je le voudrais bien, car je vous vois vivement préoccupée de cette situation et je le comprends. Amis ou ennemis, tout ce qui vous tient dans ce pays là, a vraiment bien peu d’esprit. La bonne reine d’Hanovre aurait pu vous servir dix fois mieux qu’elle n’a fait.
Que faites-vous de Marie ? Est-elle toujours aussi gaie et aussi fraîche ? A-t-elle la gaieté plus spirituelle que l’humeur. Dites-m’en quelque chose. Cette jalousie-là m’amuse assez. A présent du moins elle ne vous est pas incommode. Adieu. Je vais passer une semaine en visites, banquets, toasts, speechs. J’espère que les derniers ne seront pas aussi pauvres que cette lettre-ci. Je suis pressé, endormi et triste. Pourtant toujours le même adieu, et du même cœur. Cela est immuable. G.
113. Caen, Lundi 27 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne flatte jamais quand j’aime. Pas un nuage ne passe devant mon soleil que je ne le voie. Mais il n’a pas un rayon qui m’échappe et qui n’illumine tout à mes yeux. On ne sait pas aimer. On ne sait pas admirer. On ne sait pas jouir de ce qu’on aime et de ce qu’on admire. On en laisse perdre des trésors. Et quand on ne perd rien, quand on jouit de tout, pourquoi ne dirait-on pas tout ? Pourquoi ne renverrait-on pas tout son plaisir à sa source. On ne sait pas non plus faire plaisir à qui on aime. On en laisse échapper mille et mille moyens, mille et mille occasions. Je ne veux rien perdre, ni du plaisir que je puis prendre, ni du plaisir que je puis donner. Quel petit mot que celui-là ! J’en sais qui me conviennent bien mieux. Mais ne soyez pas malade. Je ne sais pas de mot pour mon chagrin. Pourquoi cette maigreur soudaine ? Vous êtes vraiment encore plus mobile au physique qu’au moral, pour parler comme les philosophes. N’oubliez pas de me dire ce qui sera parti de cette maigreur, si vite venue.
Je suis arrivé hier ici au milieu des coups de canon, des courses de chevaux et d’un dîner de 40 personnes. Tout cela ne m’a pas empêché de dormir. On m’a reçu à bras ouverts. J’amenais moi d’abord, puis le soleil. On nous attendait tous deux avec grande impatience. J’ai trouvé la population, vraiment la population charmée de son Prince et disant : le bonheur nous en veut. Le mot courait de bouche en bouche, et on disait bien nous. Soyez sûre que ce pays-ci regarde tout-à-fait ce gouvernement comme sien. C’est une force immense. J’écrirai ce matin, à M. le Duc d’Orléans que doit être bien content. Je suis ici jusqu’à samedi. Je passerai mon temps à déjeuner et à dîner dans les environs. Je préside ce soir la société des Antiquaires., Samedi je rentrerai chez moi. Ecrivez-moi donc Vendredi au Val-Richer.
Mon mal de dents est fort diminué. Je le sens mais je n’en souffre plus. Vous me conterez votre dentiste. Du reste, je ne m’étonne pas que le contraste vous ait frappée. Brewster à les meilleures façons du monde. Je trouve la lettre d’Ellice très sensée, car elle est d’accord avec mes conjectures. Ne vous arrive-t-il pas comme à moi, d’être sans cesse étonnée tantôt du beaucoup, tantôt du peu d’esprit que vous avez ? On devine quelques fois merveilleusement de très grandes choses et puis tout à coup on s’aperçoit qu’une petite chose qui se découvre et qu’on ignorait, modifie, immensément ce qu’on croyait très bien savoir. Avez-vous causé avec Pahlen ? Je suis impatient de savoir s’il n’aura rien vu, s’il ne vous aura rien dit qui vous éclaire un peu sur ce qui vous touche.
Adieu. Il faut que j’écrive à M. le Duc d’Orléans et à ma mère. Puis ma toilette. Puis des visites. Puis le déjeuner. Puis les courses. Puis le dîner, la séance, les speechs. Adieu.
Tout cela fait bien du bruit. Mais le moindre grain de mil Ferait bien mieux mon affaire Adieu. Je vous écris dans le même cabinet et de la même table d’où je vous ai écrit l’an dernier, à Boulogne, quand vous êtes revenue de Londres. Toujours.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Mandat local, Portrait (Dorothée)
113. Paris, Jeudi 23 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Lisez dans le journal des Débats de ce matin quelques extraits de l’ouvrage de Mlle Necker. Je les trouve admirables. Je ne savais pas en lisant l’autre jour cette description si exaltée & si étrange des Bayadères, que c’était le précepteur d’un jeune prince qui l’avait écrit. Ah, mon Dieu ! On a apporté chez moi hier les Mémoires de Sully. Je vous en remercie beaucoup. Je lis avec plaisir Fénelon l’Ambassadeur. Voilà tout le chapitre du lecture expédié.
Je réponds à Henriette qui m’a écrit une charmante petite lettre. Quelle jolie écriture pour son âge et quel style naturel & aimable.
J’ai vu chez moi hier matin Lord Alvanley. M. & Mme Doucet, & le prince Kotchoubey. Ils m’ont encore retenue ce qui a fait que je ne suis arrivée à Longchamp que pour y essuyer un violent orage. Lord Alvanley est décidément très spirituel malheureusement il part ce soir, tous les autres ce soir aussi. La seule nouveauté d’Angleterre que j’aie apprise est que le duc de Wellington est amoureux de la fille de Lord St Vincent une petite fille de 14 ans. Il rougit quand elle entre dans un salon, et cette petite lui fait faire tout ce qu’elle veut. Voilà qui est drôle.
Le temps était si laid hier soir et moi si désœuvrée que j’ai été chez Madame de Castellane. Je l’ai trouvée et laissée seule. Il me semble que j’ai plus parlé qu’elle. Je n’ai rien à vous en dire. Elle nie qu’on se soit trompée dans le calcul de la Duchesse d’Orléans. Elle dit encore qu’on attend ses couches à tout instant. Ce que je vous disais hier venait de M. Pasquier. Qui est-ce qui a menti ? Je ne sais si mon ambassadeur est arrivé hier. Il n’est pas arrivé, voilà ce qu’on vient de me dire. J’ai été fort triste hier, avant hier. Je le suis aujourd’hui. Il n’y a pas de raison particulières pour cela. Mon cœur se soulève en pensant à mes malheurs. Et comment échapper à ces horribles souvenirs ! Pardonnez-moi de vous dire ces tristes paroles. J’oublie trop souvent qu’il y en a d’autres aussi malheureux que moi. Adieu. Adieu. Je suis bien seule.
114. Caen, Mardi 28 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non, je ne suis pas mécontent. Non, vous ne me fatiguez, vous ne me fatiguez jamais. Mon affection n’est pas à la merci de ces vicissitudes de l’âme. Et puis, je trouve votre tristesse si naturelle. Certainement, vous avez trop perdue vous êtes bien seule, seule par ce qui vous reste comme par ce qui vous a été enlevé. Vous ne savez pas tout, ce que je ressens pour vous de tendre compassion, combien votre isolement m’occupe et me pèse. Je voudrais voir auprès de vous les fils que vous avez encore, vous voir avec eux un home. Avez-vous des nouvelles d’Alexandre ? Mais ne craignez jamais, quand cela vous soulagera, de me montrer votre tristesse. Vous m’avez blessé quelques fois dans notre vie. Je crois que vous ne me blesserez plus. Merci de vos détails. Ces couches font un grand effet dans le pays. J’ai vu plus d’une fois ces effets là. Ils ne suffisent pas aux gouvernements, et ne les dispensent de rien. Mais ils rendent la bonne conduite plus facile et plus profitable à ceux qui savent se bien conduire. Nous avons aujourd’hui, une course spéciale, instituée hier en l’honneur du Comte de Paris.
Le soleil est magnifique. Décidément il m’accompagne. J’ai eu hier avec mes Antiquaires, une soirée brillante. 1500 personnes étaient entrées dans une salle qui en contient 1200. On a cassé des carreaux de vitre pour entendre du dehors. Ce que j’ai dit a été bien reçu. La gauche, même la plus vive, avait évidemment pris son parti d’être bien pour moi. Je connais ces alternatives là.
Je regrette que Pahlen ne vous ait rien apporté de plus. J’avais espéré d’un peu meilleures paroles. J’ai tort de dire que j’avais espéré. Mon instinct espérait, ma raison non. Quel monde que le vôtre ! Point d’âme dans les uns, point d’esprit dans les autres. Ceux qui vous ont aimée autre fois ne s’en souviennent pas plus que s’ils ne vous avaient jamais connue. Ceux qui vous aiment ne savent pas vous servir. L’occident a bien ses défauts, et je les lui ai dits souvent ; mais votre Orient ! Je plains le soleil de le trouver le premier sur son chemin. Adieu.
J’ai ma toilette à faire, des visites à recevoir la course à voir. Je vais dîner à la campagne. Je mène ici une vie très active. Je suis fâchée d’abréger mes lettres surtout quand les vôtres sont tristes. Qu’il y ait au moins dans votre cœur un coin tranquille et doux, et point solitaire. Adieu. Adieu. Mon mal de dents est à peu près parti. G.
114. Paris, Vendredi 24 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne me porte pas bien ; je me sens bien mal à l’aise ; je suis fort triste, tout cela va toujours ensemble. Malgré le très mauvais temps j’ai été à Longchamp hier. Il y avait des intervalles passables dont j’ai profité. J’ai fait mon dîner sans appétit. Le soir il m’est venu, beaucoup de monde. Toute la Diplomatie et Pahlen par dessus le marché qui était arrivé depuis quelques heures. Il avait l’air fort réjoui et je l'ai été beaucoup de le revoir. Nous n’avons pas causé du tout, nous ne nous sommes pas trouvés seuls un moment, et comme il ne s’était pas couché de cinq nuits il s’est retiré de bonne heure. Il m’a dit en gros que le grand duc allait mieux. La toux l'a quitté. On n’a plus d’inquiétude. mais comme les médecins insistent pour que l'hiver soit passé en Italie, il est vraisemblable que l’Empereur y consentira. Lui-même est allé faire une surprise à l’Empereur d'Autriche à Insbruck. L’Impératrice va mieux.
Voilà tout ce que j’ai tiré de Pahlen devant le monde. Il me parait d’après cela que je ne verrai pas mon mari, et cela est très fâcheux. Les mauvaises relations qu'il a établies entre nous se prolongeront indéfiniment. Vous pouvez juger par le passé de ce qui peut encore en advenir. Je suis fort chagrinée de tout cela. J’étais le lien entre le père & les fils. Maintenant cela leur manque. Il oubliera ses fils comme il a oublié sa femme. Et c'est-là ce qui m’afflige beaucoup, beaucoup. Je pourrais sur ce chapitre lui écrire des volumes dont un seul mot attendrirait tout autre homme. Mais que puis je attendre de lui qui n’a pas l'ombre de sensibilité ? Dites-moi. Conseillez-moi ; je suis au bout de mon esprit, et j’ai le cœur tout-à-fait découragé. Je laisserai Pahlen se reposer aujour d’hui mais il me faudra ces jours-ci une bonne causerie avec lui. Je ne vous parle que de moi cela va vous ennuyer. Adieu.
Je suis si mal disposée aujourd’hui que je ne sais vous rien dire qu'Adieu, et toujours adieu.
Mots-clés : Femme (mariage), Santé (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
115. Caen, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars dans une heure pour aller passer la journée à 7 lieues d’ici, chez M. de Tilly. J’y coucherai .Je donnerai demain à deux de ses voisins, M. de Lacour et M. Turgot. Je ne serai de retour à Caen qu’après demain matin. Dans ce vagabondage, je crains de ne pas tomber juste demain, sur l’heure du courrier. Le service des campagnes n’est pas toujours bien exact, et ils n’y mettent pas tous le même intérêt que moi, si une lettre retardait où manquait soyez sûre que je n’ai ni le bras cassé, ni le cœur négligent. J’aurai, moi, votre lettre d’aujourd’hui ; mais celle de demain, je ne la trouverai qu’en revenant. Je ne veux pas qu’elle se perde à courir après moi. Ces courses m’ennuient fort. Enfin, j’en serai quitte samedi.
On m’a mené hier voir un magnifique établissement, créé à force de zèle pieux et d’habileté par un homme qui n’avait pas 500 louis en commençant, et qui y a dépensé près de deux millions. C’est une grande maison de fous, la meilleure œuvre, et le plus triste spectacle du monde. Un édifice immense, un ameublement bien tenu, un ordre parfait, une propreté admirable ; et au milieu de ce chef d’oeuvre de l’intelligence humaine, 5 à 600 fous ou folles errants ou accroupis, criants ou taciturnes ; gardés et soignés par 97 religieuses qu’ils maudissent et injurient sans cesse. Le bien et le mal à cet excès là et se touchant de si près mettent l’âme dans un grand malaise. Notre course en l’honneur du Comte de Paris a eu grand succès malgré l’humeur des Carlistes qui ont fait, dans le Comité des Courses ce qu’ils ont pu pour la faire échouer. Habituellement les deux partis vivent ici en grande paix se rencontrant volontiers sur les terrains neutres et traitant ensemble de bon accord des intérêts ou des plaisirs du pays. Puis survient une circonstance où ils se retrouvent absolument les mêmes. A la vérité cela aboutit à de pures taquineries qui ne dépassent même guère les paroles. Les vieilles passions se payent de bien petites satisfactions. L’archevêque prend le bon parti et ne le soutiendra pas. Celui-là aussi est un petit esprit, décidé chaque jour par de petits motifs, et incapable de résister aux fantaisies qui l’entourent.
Si vous n’avez pas encore écrit à M. Ellice, voulez- vous lui demander s’il pourrait me procurer une lettre de l’écriture de M. Pitt et une de Lord Chatam, son père ? J’en ai envie. Je ne fais pas grand cas des collections d’autographes pèle-mêle. Mais, puisque j’en ai quelques uns je veux y ajouter les noms que j’estime et qui me plaisent. Adieu. Je vis avec votre tristesse. Sans lui rien reprocher ; je la trouve si légitime ! Vous ne me dites pas, dans le N°117, comment vous êtes physiquement. Adieu. J’ai de bonnes nouvelles de mes enfants. G.
115. Paris, Samedi 25 août 1838,Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous me dites toujours des choses qui me plaisent, et votre manière de m'indiquer mes défauts est la flatterie la plus agréable du monde. Vous avez raison dans tout ce que vous pensez de moi. Je ne vois pas beaucoup d'espoir de me corriger. Il me faudrait un peu de bonheur, un peu de stabilité d’établissement. Quand j'avais tout cela j’étais beaucoup plus susceptible d'occupation sérieuse, soutenue. Aujourd’hui je ne me sens plus capable de rien, plus de gout pour rien. J’ai été vraiment malade hier. J’ai voulu braver ce malaise, j’ai été à Longchamp. J'ai marché. Le soir j’ai été faire quelques visites et enfin arrivée à la porte de la marquise Durazzo, je me suis tout-à-fait trouvée mal. On m’a porté chez elle. J’ai eu presque un évanouisse ment. Je suis revenue à l’aide de cela. Je suis un peu mieux ce matin, mais pas bien encore. J'ai beaucoup maigri ces jours derniers. Cela va et vient avec une rapidité extraordinaire. Votre mal de dent me fait beaucoup souffrir, car c’est une horreur. Je suis tourmentée d'une dent aussi, & je vais courir ce matin chez mon dentiste, je l'ai manqué hier. Prenez garde à tout ce que vous allez faire ; des courses, des banquets au milieu d'une rage de dent, c’est affreux.
J’étais à Longchamp hier & javais chez moi M. & Mme Appony lorsque Henri Greville est venue au galop m' annoncer la venue du Comte de Paris, car le canon ne nous arrive pas à Longchamp. Appony est bien vite parti et il est arrivé un peu tard pour la convocation du corps diplomatique. La maréchale Loban a montré l’enfant aux deux mondes rassemblés. On dit qu'il a l’air fort et sain. Il dormait. La Reine avait l'air comblée de bonheur, le duc d’Orléans aussi. Je vous conte ce que disait le ministre du Portugal hier au soir chez Palmella, où je fus faire visite aussi. J'ai oublié de vous dire hier que j’ai reçu une longue lettre & M. Ellice. Je l'ai envoyée à Lady Granville. Cette lettre est intéressante mais il n’y a rien de nouveau. Le ministère très affaibli par les discussions sur le Canada. Lord Durham et son conseil des écoliers en loi ; son ordonnance n'était pas soutenable. Cependant les autres actes de son administration sont excellents. S’il se fâche et il est très populaire. qu'il revienne, le ministère est infailliblement renversé. On espère qu'il restera, mais on sera fort inquiet jus qu'à ce qu'on l’apprenne. Voilà à peu près la longue lettre. Melbourne & John Russell très amis, le reste incapable.
1 heure.
J’ai fait prier M. Génie de passer chez moi ce matin. Il est venu, et il m'a promis tout ce qu'il me fallait. J’ai fait visite à mon dentiste, il est aux eaux. J'ai été chercher un français. Ah comme il est français. Rappelez moi de vous raconter notre dialogue. Vous en rirez. Il fait froid, il fait laid. Soignez-vous, écrivez-moi. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Politique (Angleterre), Politique (France), Santé (Dorothée)
116. Lantheuil, Mercredi 29 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Un seul mot qui, j’espère, vous arrivera à temps. Je me suis échappé du salon où je ne sais combien de personnes sont venues me voir. Je fais le métier de bête curieuse. On vient de m’apporter les N° 118 et 119. Je suis charmé qu’Alexandre vous arrive. Ce sera une douce distraction. Vous avez, je crois, toute raison de préférer l’Angleterre à Baden. Il faut qu’on vienne chez vous, et non pas, vous aller chez les autres. Vous débattrez beaucoup mieux votre avenir à Londres qu’à Baden. En tout cas, je suis bien aise qu’il y ait pour un an du moins, quelque chose de connu, de réglé.
Je serai chez moi après-demain, à ma grande satisfaction. Si ce régime-ci durait, j’aurais le sort de Vert-Vert. Aujourd’hui, je suis chez des gens qui m’aiment vraiment et qui me plaisent, chez les Turgot. Adieu. On vient me chercher. Voici une lettre bien plus misérable que la vôtre. Pardonnez la moi. Je le mérite car mon plus doux temps est celui où je vous écris. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Famille Benckendorff, Mandat local, Vie familiale (Dorothée)
116. Paris, Dimanche 26 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre d'hier m'a fait pleurer. Oui nous sommes malheureux tous les deux, bien malheureux. Mais je le suis bien plus que vous. Vous avez des enfants à élever, vous avez une patrie, vous avez des devoirs publics, une belle carrière à soutenir, vous avez un home. qu’est-ce que j'ai ? Pensez à tout ce que j’ai perdu. Pensez à ce qui me reste et ne soyez pas mécontent. Lorsque je vous montre de la tristesse, beaucoup de tristesse. J'en ai moins auprès de vous. Quelque fois même j'oublie auprès de vous mes chagrins mais lorsque je me retrouve en face de moi-même, rien que moi ! Ah c’est affreux, tous les jours je le suis parce que je ne vois davantage aucun terme à cette dure situation. Je la vois au contraire s'empirer tous les jours ; j'ennuie ou je mécontente ceux auxquels j’en parle. Vous même je vous ennuie peut être je vous mécontente peut-être. Vous trouvez que je n’apprécis pas assez la seule consolation que le ciel m’a envoyée. Vous vous trompez, mon cœur est plein de reconnaissance, d’affection. Mais encore une fois j’ai trop perdu, trop, et je rencontre de la froideur de la sûreté là où je devais attendre du soutien de la consolation. Et plus cela se prolonge plus mon cœur se révolte. Vraiment quelques fois il est prêt à la briser. Je ne me sens de courage pour rien. Il me semble que jamais je n’ai été si triste Je ne devrais pas vous dire tout cela, mais songez qu’il n’y a plus que vous à qui je le dise. Pardonnez-moi, ne vous fâchez pas. Ayez pitié de moi !
J’ai passé la matinée seule à Longchamp, et par un mauvais temps. Cela ne me vaut rien ; je me sens trop isolée. Que je serais heureuse si j'avais des gravures à côté sur du carton ; si j’étais entourée, aidée, comme vous l’êtes !
J’ai été le soir chez Mad. Appony. Elle revenait de la cour. On y est dans la plus grande joie. Vous savez que l’archevêque est tout à fait reconquis. Il sera aussi assidu qu'il a été jusqu'ici éloigné. On dit qu’il ne reproche le baptême. protestant du petit prince de Würtemberg qu’il croit que s'il y avait regardé de plus près, il en aurait fait un catholique. Qu’il veut aujourd'hui la conversion de la Duchesse d'Orléans & que par ce regret, & par cette espérance ; il est décidé à bien vivre avec la cour. Le Roi lui a pris cordialement, la main. La Reine a baisé son étole. La Duchesse d’Orléans a été fort mal une heure après ses couches. Elle va bien maintenant. L'enfant est fort grand. Et il était blanc et rose deux heures après sa naissance. Tout le monde en a été frappé.
J'ai eu hier un long entretien. Pahlen. Il était venu chez moi le matin sans me trouver. Nous nous sommes vengés le soir. Tout ce qu’il me dit m’intéresse mais il n’y a rien de nouveau à vous redire ! Tout le monde y compris le maître a été révolté du procédé de l’année à mon égard dernière et assuré ment ce n’est qu’à cela que je suis redevable du rétablissement, incomplet de l’ancien état de choses. C'est la seule chose qu'il ait eu à me rapporter sur mon compte, et je n’ai pas voulu lui faire d’interrogation. s'il avait un quelque chose d’agréable à me dire, le brave homme n’attendait pas mes questions. Quant à son affaire à lui, comme Je vous l'ai déjà dit ; il n’y a rien de changé. Le temps adoucira peut être, mais voilà tout.
Adieu, voici dimanche j’ai peur que la lettre n'arrive trop tard. J'ai mal dormi, je me suis levée tard et il est 1 heure. Adieu. Adieu.
117. Caen, Samedi 1er septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous allons rentrer dans toute la régularité de nos habitudes. Il vous aura manqué une lettre. J’attendais les vôtres sans savoir à quelle heure elles viendraient. Physiquement aussi, je suis bien aise de rentrer chez moi. Cette vie de banquets, de courses, de bavardage incessant, commence à me fatiguer. Elle ne m’a jamais plu. Pour que je m’arrange du monde, il faut que les affaires ou ses agréments vaillent la peine que je prends pour lui. Vous avez votre fils. Je regrette de ne pas le voir. Vous me direz s’il a bien du chagrin de la rupture de son mariage. Mlle de T. ne le désirait donc pas bien vivement. Vous avez, je crois, bien fait d’insister. Il faut beaucoup d’amour et une grande supériorité d’esprit pour que la différence de religion, quand l’un et l’autre y tiennent, ne devienne pas, dans le cours de la vie une vraie peine. A-t-il renoncé à tout espoir ? Il me semble aussi que dans son pays même son père à part, l’abandon de tous ses enfants au catholicisme lui ferait grand tort.
Je compte trouver une lettre au Val Richer. Elle me dira si vous êtes toujours aussi souffrante. Mandez- moi avec détail ce que dit Chemside. Je ne comprends pas votre abominable temps. Ici, il fait très beau, frais, mais point froid. Vous avez bien tort de ne pas venir en Normandie. Où avez-vous logé votre fils ? Se promène-t-il habituellement avec vous ? J’étais sûr que l’archevêque ferait ce qu’il a fait. Je trouve du reste qu’on l’a pris bien vivement. Il y avait des façons moins brutales que l’article des Débats pour lui faire sentir l’inconvenance de son discours. Inconvenance à laquelle on devait s’attendre ; comment veut-on qu’un archevêque, et surtout celui-là, ne laisse pas percer quelque humeur des nouveaux échecs que reçoit de notre temps l’unité de la foi.
M. Molé n’était pas auprès du Roi, aux Tuileries, le jour où il a reçu les députés. Ils en ont été très choqués. On m’écrit que la tête lui tourne un peu. Champlâtreux n’est pourtant pas un bien grand verre de vie. La médaille est de trop. C’est encore plus que le tableau. On ne viendra pas à bout de notre temps, de faire de grands événements avec de petits incidents. Il ne faut pas les traiter de la même façon. M. Dupin n’est pas venu aux couches parce qu’on ne l’avait pas pris pour témoin. Je ne saurais dire combien cet abandon de cette pauvre Princesse tout de suite après ses couches, m’a frappé. Voilà bien les entraînements, les oublis, les distractions des cours. Pour tous ceux qui étaient là, le monde entier avait disparu devant ce petit garçon. Et si elle était morte ! Quel tableau eût fait de cette scène M de St. Simon ! Donnez-moi quelque nouvelle de l’affaire suisse. Il me paraît que Louis Buonaparte ne s’en va pas de lui-même. Cela peut devenir embarrassant. Adieu.
Je vais déjeuner et monter en voiture. Je traverserai une très belle vallée sous un très beau soleil, par une très belle route. Vous me manquerez infiniment. Si je parlais la langue de Pétrarque, je vous dirais que dès qu’il s’élève dans mon âme une impression douce, elle me quitte et va vous chercher Si elle vous trouve elle me revient. si elle ne vous trouve pas, elle me quitte tout-à-fait. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Enfants (Benckendorff), Politique (France), Religion, Vie familiale (Dorothée)
117. Paris, Lundi 27 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Dans la disposition d’esprit où je me trouve, tout me donne de l’inquiétude, Tout m'agite. Ainsi me voilà préoccupée d’un accident quelconque que je crois qui va vous arriver à Caen. Vous étiez triste en y allant ; cela vous contrariait ; moi, j’en suis inquiète. Je vous prie de vous bien soigner ; d’être un peu comme moi, d’avoir peur de tout. Je vous donne un vaillant conseil. Mais pensez que je n’ai plus que vous pour m’aimer. Et pour aimer. Vous ne sauriez concevoir combien j’étais triste hier matin. Enfin je me suis mise a pleurer & dans ce moment on m'annonce le Duc de Palmella. Je lui ai bien vite déclaré qu'il ne me quitterait plus. Je l’ai pris avec moi nous avons été à St Cloud où il m’a fait promener, et puis à Suresne. Enfin à 6 heures il m’a ramené chez moi, mais bien faible quoique ma tête fait mieux. Le soir il est revenu, & beaucoup de monde. Les dames revenaient du Château. J’y vais faire ma cour aujourd'hui on y est dans une joie éclatante.
L’affaire de l’archevêque fait grand plaisir aussi. Que dira le faubourg St Germain ? Vous avez bien raison de dire pour ce qui me regarde, qu’amis & ennemis tout le monde est bête chez moi. C'est sans réponse. Mais vraiment que penser de mon mari ? Serait il possible qu’il vienne ? Cette idée me revient toujours, et puis je la rejette et je ne comprends pas quand ce silence cessera enfin. J'écris beaucoup de lettres aujourd’hui à Lord Aberdeen (enfin !) au duc de Sutherland, Lady Chauricarde qui me fait toujours du nouvelles questions, la Duchesse de Bedford, qui m’a annoncé les couches de Lady Abercom. Je n’ai pas fini. Il me reste Lord Grey qui m’ennuie ahh ! Et Ellice. Lady Granville m’écrit des énigmes dans une écriture indéchiffrable. Mais quand cette difficulté est surmontée l’autre est bien grande. Je l’attends toujours du 10 au 12 Septembre.
Ecrivez-moi bien de Caen ; ne vous fatiguez pas, ne prenez pas froid. Adieu. Adieu. Toujours adieu. & comme toujours ! J'ai oublié de vous dire hier que le chargé d'affaires de Muklembourg est le seul diplomate qui ne se soit pas rendre à la convocation au château. Il avait ordre de son maître de quitter Paris pour l’époque des couches. C'est trop absurde !
Mots-clés : Diplomatie, Relation François-Dorothée, Vie familiale (Dorothée)
118. Paris, Mardi 28 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu en même temps que votre lettre ce matin, une lettre de mon frère & une de mon fils Alexandre qui s'annonce pour ce soir. Cela me fait grande joie. Mon frère me mande que l’Empereur vient de décider l’affaire de son fils. Il passera l’automne dans le nord de l’Italie, l’hiver à Naples, le printemps en Hollande, l'été prochain en Angleterre. Pour retourner par mer en Russie au mois d’août 1839. Il m’exhorte beaucoup à profiter de cet itinéraire pour aller trouver mon mari. Pour le moment, il ira avec le grand duc à Baden où il passera le mois de Septembre. Vous savez maintenant tout ce que je sais J’ai pensé un moment à Baden. Mais je crois qu’il est plus prudent d'y renoncer. J’irai l’année prochaine en Angleterre. C'est là, sur mon terrain, que je reverrai mon mari. Ne pensez vous que c’est là ce que je dois faire, & que je ferai même bien de l'écrire ? Quant à Alexandre j’imagine qu'il arrive pour arranger avec moi son mariage. Ah mon dieu, s’il n’y avait que moi à consulter, cela ne serait pas bien difficile.
J’ai été au Château hier au soir. Un cercle de femmes énorme, pas une de ma connaissance. Je n’ai pas vu le Roi. La joie me parait calmée. Je crois qu’on est fatigué de s’être tant réjoui. J’ai passé de là chez Mad. de Castellane j'y ai trouvé M. Molé seul. & puis chez Mad. de Boigne où était le chancelier, seul. Il parait que les couches de Mad. la Duchesse d’Orléans ont ressemblé de tout point à celles de Mad. la Duchesse de Berry. Je parle des témoins. Il ne leur reste aucun doute. Mais imaginez que le Duchesse a pensé mourir parce que tout le monde l’avait quittée pour s’occuper de l’enfant & de sa toilette, et que pendant ce temps elle a changé de lit en prenant soin de le faire bien bassiner . Pas un médecin, pas un garde, personne que deux filles de chambre. On l’a crue morte pendant une demi-heure, et c’est miracle qu'on soit parvenu à la faire revivre.
M. Molé m’a donné beaucoup de détails sur l’Empereur. Il dit qu’il prodigue les largesses & les magnificences de la manière la plus extraordinaire. Il a l’air d'y voir un plan. Votre lettre est bien aimable et bonne. Vous êtes si doux, si bon pour moi, vous avez l'air de vous être chargé de m’aimer de me gâter, pour tous ceux qui ne me gâtent ni ne m'aiment plus. M. de Pahlen n’est pas parvenu à voir M. Molé depuis son arrivée. Adieu. Adieu. Si vous étiez ici, que de choses à vous dire, que de conseils à vous demander. Ever ever yours.
118. Val-Richer, Dimanche 2 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis rentré hier dans mon home en pensant à vous à votre chagrin de n’en point avoir à votre isolement. Je voudrais vous envoyer des paroles capables de dissiper l’isolement et le chagrin. Je les ai en moi, et bien pour vous, pour vous seule. Mais de si loin, leur vertu s’affaiblit si elle ne se perd tout-à-fait. J’ai trouvé mes enfant, à merveille et ma mère aussi. Elle a une vivacité une jeunesse d’âme bien rare et qui la soutient étonnamment. Jamais vu n’a été plus dévoué à un seul sentiment et n’est restée plus accessible à toutes les impressions douces. C’est Rousseau je crois, qui a dit : " Les mœurs sévères conservent les cœurs jeunes. " Il a raison. Je suis bien aise que mon speech, vous ait plu. Il a réussi au milieu d’une assemblée fort mêlée de légitimistes et de radicaux. En tout, j’ai été reçu de tout de monde avec une grande bienveillance. Je n’ai point de pouvoir & je prends quelques soins. On dit de beaux finales.
Pendant que j’étais chez M. Turgot, un légitimiste des environs, qui passe pour très vif M. de Marguerye lui a fait demander si je voudrais aller visiter son château, et un assez grand établissement qu’il a fait à côté pour s’arranger un peu sa fortune. J’y suis allé. Un vieux petit château fort, du 12e siècle avec ses remparts, ses plateformes, ses poternes, ses chemins de ronde, ses mâchicoulis, ses meurtrières, absolument comme si nous devions nous y enfermer aujourd’hui pour y être attaqués demain ; et au dessous sur une jolie rivière, une grande usine, avec toutes les machines de notre temps, un comptoir, des ouvriers, des commis, Tout cela à M. de Marguerye, qui s’en occupe avec le même zèle et prenait le même plaisir à me montrer ses vieilles tours et ses roues hydrauliques. Et dans son Cabinet, toutes les Histoires de Normandie à côté de tous les traités de chimie, sur sa table le anciennes chartes du château pèle-mêle avec les comptes de l’usine. Et par dessus tout, une jeune femme très jolie, très animée, d’un sourire charmant, les meilleures manières du monde, qui m’a accompagné dans toute ma visite, et ne laissait rien oublier à son mari de ce qu’il avait à me montrer. J’ai dit à M. de Marguerye que c’était le problème de notre temps de faire vivre tout cela ensemble et de bon accord. " Je sais, Monsieur, m’a-t-il dit que c’est là votre pensée. J’en ferai volontiers ma devise. " Et nous nous sommes séparés très bons amis, le château de Croully et moi. Le château est célèbre dans les Chroniques Normandes, par les guerres continuelles et ses brigandages. Fort petit du reste, & le maître assez pauvre.
Je vous raconte mes visites. Je regrette de ne pas faire avec vous celle de Versailles. Je vous aurais épargné beaucoup d’ennui. Car vous vous y ennuierez. C’est un chaos de souvenirs d’allusions de noms, de figures. Il faut voir l’ensemble et trois ou quatre choses. Du reste des œuvres du Rois, c’est une de celles qui ont le mieux réussi. Je la trouve connue et populaire partout, dans tous les partis. Tout le monde approuve Versailles, et l’a vu ou se promet de l’aller voir. Si l’affaire Suisse ne s’arrange pas, s’il faut en venir, isolément ou de concert avec l’Autriche et autres, à des menaces mises à effet, ce sera une rude discussion pour le Cabinet à la session prochaine. Il y aura bien compromis, la position de la France et pour de bien mesquines raisons.
10 h.
Le N°116 m’a déplu à vous envoyer. Mais je ne m’amusais certes pas. J’avais dans le salon 28 personnes qui m’attendaient. J’ai passé cette semaine à aller déjeuner et dîner chaque jour dans des lieux différents, à six ou sept lieues de distance les uns des autres. Deux choses étaient difficiles à rencontrer juste, le temps et la poste. Mais d’où vient ce redoublement de faiblesse et de souffrance ? Que je voudrais vous trouver un lieu où aller ? Adieu. Envoyez m’en un meilleur que celui-ci, quoiqu’il soient tous bons. Adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, Mandat parlementaire, Vie familiale (François)
119. Paris, Mercredi 29 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Les journaux que je viens de lire à ma toilette m’annoncent qu'il faut vous écrire de très bonne heure aujourd’hui. Je me presse donc de vous dire deux mots car voici le moment où ma lettre doit partir, midi, je vous remercie de la vôtre. Vous ne m'avez jamais donné un mauvais moment. Tout ce que vous me dites est si bon si affectueux, si tendre. Je veux le mériter, je le mérite car j’ai le cœur si reconnaissant, si plus d’affection. Mon fils n’est pas venu encore. Il m'écrivait cependant de Marseille du 24. Il ne peut par tarder. Je n’ai vu hier qu'Appony revenant de notre danse. Il m’a dit que le Roi en entrant était pâle, ému ou en colère. Il opinait pour la colère. et je vois dans le journal des Débats de ce matin que ce pouvait bien être du discours de l’archevêque. Du reste tout s’est bien passé ; mais mon Ambassadeur seul n’a pas voulu se mettre à genoux. Cela me surprend, parce qui cela ne lui ressemble pas. Je parie qu’étant fort serré en uniforme il aura craint quelque accident de toilette. Il est venu hier deux fois chez moi sans me trouver. Je me suis fait traîner en calèche, pas de Longchamp. Il m'ennuie. Tout m’ennuie, & je suis souffrante. Je ne mange pas. Je dors mal, j’étouffe de je ne sais quoi. Lady Granville m’écrit maintenant tous les deux jours, des lettres impayables. Je ne suis pas si gaie qu’elle ! Adieu. Voici une misérable lettre, mais vous sériez fâchée j’espère si elle ne venait pas ? Adieu. Adieu mille fois.
119. Val-Richer, Lundi 3 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens d’embarquer Mad. de Meulan. Je dis bien embarquer car elle va à la mer à Trouville, passer deux jours avec sa belle-sœur Mad.de Turpin, qui y est depuis un mois. J’attends Jeudi, M. et Mad. Lenormant, & la semaine d’après Mad. de Broglie. Le Val Richer sera animé si c’est être animé qu’être peuplé. J’ai commencé hier à peupler ma salle de manger. J’y ai fait pendre les 72 Rois que j’ai collés. J’y pendrai encore 286 députés de l’Assemblée constituante. Le reste des députés ira dans le vestibule et le long de l’escalier. C’est dommage que vous ne puissiez pas m’aider à coller. On cause très bien. Il me semble aussi qu’un changement d’air vous serait bon. N’avez-vous plus personne à Dieppe ? Je pense quelquefois que, sans la mer vous pourriez aller passer un mois ou six semaines, en Angleterre, de château en château. Vous y trouveriez de la distraction, peut-être un peu d’amusement. L’Angleterre vous plaira toujours ; et sauf la fatigue ce voyage-là me paraît sans inconvénient pour vous. Il ne vous engage et ne vous expose à rien. Vous pouvez poser l’alternative entre l’Angleterre et la France.
Je cherche sans cesse quelque moyen de vous faire un peu de bien, au corps et à l’âme. Je trouve et je puis bien peu, et pourtant ! On me conteste l’abandon de Mad. la Duchesse d’Orléans au moment de ses couches, et l’imprudence qui s’en est suivie. On me dit qu’elle a tout simplement été frappée d’une fièvre puerpérale aiguë, comme la Princesse Charlotte. On me donne tous les détails imaginables sur son mal et les remèdes qu’on lui a faits. Elle est devenue froide, violette. On l’a couverte de glace. On lui a fait boire du vin de Constance, manger des citrons. Je crois au mal et aux remèdes. Mais la dénégation de l’abandon m’est suspecte. J’en voudrais savoir le vrai. Cet exemple de plus de l’enivrement factice des cours vaut la peine d’être constaté. Je suis tenté d’être de l’avis de M. Molé. Ce long séjour de votre Empereur en Allemagne, ce vagabondage imprévu, cet argent jeté par les fenêtres, tout cela, annonce un dessein. On dirait qu’il va courant portant après une influence qui lui échappe. Peut-être aussi, n’est-ce qu’une fantaisie, de despote fiévreux et ennuyé. Je ne sais comment se passera le couronnement de Milan. Mais je lis les préparatifs. N’êtes-vous pas frappée de l’extrême différence entre celui-là et celui de Londres ? à Londres, des émotions, des joies publiques, des âmes, un peuple vivant au milieu des fêtes. A Milan, je n’entrevois encore que des cérémonies et des tapisseries. Et il n’y aura certainement pas autre chose au moment même. La curiosité n’est pas la sympathie. Des spectateurs ne sont pas des acteurs. Décidément la vie est du côté de l’occident, dans les vieilles idées et les vieilles mœurs comme dans les nouvelles. Aussi, à part ceux qui y sont qui est-ce qui regarde au couronnement de Milan ? Qui s’en occupe ? Le couronnement de la Reine Victoria a intéressé le monde.
9 h. 1/2
Merci du N° 123. C’est ainsi que je les veux. Je veux être au courant de tout. Tâchez qu’Alexandre ne cède pas sur la religion des garçons, si le mariage se renoue. L’avenir de vos fils, me préoccupe. Leur père ne fera rien pour eux. Leur situation est délicate. Il ne faut pas qu’ils fournissent eux-mêmes des prétextes. Quel pays que celui où des jeunes qui bien nés et capables ne sont préoccupés à 30 ans que de l’envie de quitter le service public ! Je reviens toujours à mon occident.
A coup sûr, vous n’avez de votre vie, entendu chanter une chanson à boire. Voici le refrain d’une des plus jolies. Versez donc mes amis versez.
On n’en peut jamais assez boire.
Versez donc mes amis, versez.
On n’en peut jamais boire assez.
Adieu, adieu, adieu. Adieu. Pas assez. G.
120. Paris, Jeudi 30 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ce n’est que ce matin que mon fils est arrivé. Il vient pour une raison toute opposée à celle que je supposais. Son mariage est rompu. J’avais insisté pour que les fils fussent protestants. Elle ne l’a point voulu. Mon fils a été si chagriné de tout cela qu'il est parti sur l’heure ; il vient passer quinze jours avec moi. Ce sera quinze jours de bonheur. J’ai été parfaitement malade hier tout le jour. J’ai été encore faire visite hier à Madame, je l’ai trouvée mais j’étais déjà si souffrante que je sais à peine comment cela s’est passé. Je suis rentrée pour ne plus bouger. Je n’ai vu personne que mon médecin. J'ai des crampes abominables qui font que je ne puis rien manger du tout. Vous ne vous attendrez pas avec cela que j’engraisse. Il faut me résigner. Je me soigne. Le temps est abominable. Il fait froid aujourd’hui comme au mois de février.
La Duchesse de Talleyrand arrive demain, à ce que m’a dit Madame. Elle a des affaires pressantes importantes. On dit que son mari lui dispute la tutelle de sa fille, & qu'aux termes de la loi il a raison. Vous voyez que vous jugez bien en me parlant de l’archevêque. Son discours au Roi n'était pas du tout ce qu’il devait être. Je pense qu’on est très fâchée contre lui. J'écris à mon mari et à mon frère. A l’un et à l’autre je promets d’aller en Angleterre en juin. Pardonnez-moi si je vous quitte, je vous assure que je suis tout à fait malade. Je n'ai la force de rien faire. Adieu. Adieu. Avez-vous lu le discours de Berryer à des écoliers je ne sais où ? Il leur recommande beaucoup le latin & le grec. Adieu.
Remerciez je vous en prie M. Génie, on n’a pas dit un mot de moi.
Mots-clés : Politique (France), Santé (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
120. Val-Richer, Mardi 4 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mots-clés : Discours du for intérieur, histoire, Vie familiale (François)
121. Paris, Vendredi 31 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
En effet il ne m’est point venu de lettre ce matin. Cela me parait singulier et cela me parait triste. La journée sera lorsque. Au lieu d'une lettre de vous j'ai lu votre discours à la société des antiquaires. C’est beau et les dernières sentences. sont admirables. Vous produisez toujours de grands effets. Et j'aime les beaux finales (dit-on beaux ou belles ?) dans les morceaux d'éloquence comme en musique.
Je vais mal, toujours mal. Hier au soir il a fallu me faire frotter pendant plus d’une heure dans mon lit et me couvrir de trois grands châles avant de pouvoir me réchauffer. J’étais comme une glace. Je ne mange rien. Je ne sais ce que j'ai. Le médecin dit que c’est le temps. Je suis beaucoup maigrie. Tout mon monde ordinaire est venu hier au soir. Mon fils me dit que Naples vous envoie enfin un ambassadeur. Le vieux comte Ludolf père de Mad. de Stakelberg, il y a 25 ans qu'ils sont à Londres. Le mari et la femme sont des ennuyeux que j’ai toujours bien mal traités. Ah que j’étais difficile à Londres ! La cour part demain. Le Roi a eu la bonté de faire donner des ordres à Versailles pour moi. Je crois que j’y irai cette semaine avec mon fils ; mais rien que pour une matinée. No ever whatever. and no letters. Adieu. Je pense beaucoup à vous beaucoup. Adieu.
Si la Suisse refuse votre demande. L'Autriche rappellera son ministre.
Mots-clés : Diplomatie, Enfants (Benckendorff), Mandat parlementaire, Santé (Dorothée)
121. Val-Richer, Mercredi 5 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Plus j’y pense, plus je suis d’avis que vous alliez à Baden. Evidemment vous ne sortirez de cette mauvaise position que par vous-même en voyant et causant. Et M. de Lieven ne vous fournira pas l’occasion de voir et de causer, car il ne viendra pas vous chercher. Médem a raison. Il faut que l’Empereur lui ait prescrit le silence. Le retrait des subsides ayant échoué, on veut essayer l’abandon de la personne. Vous romprez toutes ces combinaisons-là en marchant dessus, comme on dit à la guerre. La circonstance est favorable. Le grand Duc et M. de Lieven doivent passer à Baden quelques semaines. Vous aurez du temps pour tout expliquer, tout arranger. Vous ferez rentrer le grand Duc dans votre intimité. Vous avez Alexandre qui pourra, je pense, vous accompagner. Le voyage n’est pas long. La saison est encore bonne. Il ne se présentera peut-être de longtemps une occasion de tous points aussi propice pour mettre fin à une situation si pénible. Et après tout, Baden n’est pas un pays barbare. Il a fallu l’Empereur Napoléon pour y enlever le duc d’Enghien. L’Empereur Nicolas ne vous y traitera pas de cette sorte. On vous pressera d’aller en Italie, de retourner en Russie, que sais-je ? Mais en définitive, vous ne ferez que ce que vous voudrez. Et peut-être, le changement de lieu, la nouveauté de la situation, la nécessité de la résistance, vous rendront quelque chose de cette animation de cette énergie intérieure que vous ne pouvez retrouver. Cela vaut la peine d’être tenté et il y a bien des chances de succès. Et enfin vous passerez avec un peu de mouvement un mois, deux mois. Le temps vous pèse. Il est si lourd quand il est vide !
Si la situation actuelle devait se prolonger jusque l’été prochain jusqu’à votre voyage annoncé en Angleterre, je ne sais comment, vous la supporteriez. J’ai cherché, je cherche comme vous me le demandez. Je n’ai pas plus d’invention. J’arrive toujours à reconnaître que vous n’avez, auprès de l’Empereur, ni auprès de votre mari, personne qui sache vous servir et que vous seule pouvez quelque chose pour vous-même. Vous avez fait tout ce qui se pouvait faire de loin et par écrit. Cela ne suffit pas. Il faut aller à l’assaut. Êtes-vous en état ? Le voyage ne vous fatiguera-t-il pas trop ? Soutiendrez-vous les agitations de la lutte corps à corps ? Voilà mon inquiétude. J’espère pourtant. On est toujours plus fort quand on agit que lorsqu’on attend. Enfin, pensez-y et dites-moi ce que vous pensez.
M. Molé, qui ne faisait aucun cas des dires d’Horace Vernet, ne devait pas attendre grand chose du retour de M. de Pahlen. Je ne comprends pas qu’on se préoccupe de cette situation. Elle n’a point de danger, et elle cessera le jour où le moindre intérêt sérieux conseillera à l’Empereur de cesser. Il n’y a point là de passion vraie et entreprenante. On joue son rôle. Il y en a un à jouer de ce côté-ci, tout aussi fier et plus commode. Et en le jouant, on peut attendre à l’aise que le jamais s’évanouisse. Mais M. Molé ne le jouera pas.
10 h.
Il faut que la course de Versailles ne vous fatigue pas du tout pour que je lui pardonne si une lettre me manque. J’avais un peu prévu votre réponse sur l’Angleterre, car j’avais pensé aux absents. Je pense à tout ce qui vous touche. Adieu. Je ne sais pas, vous parler d’autre chose aujourd’hui. Adieu. G.