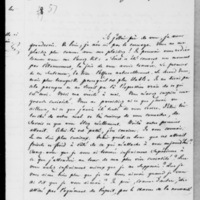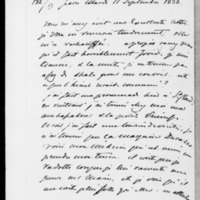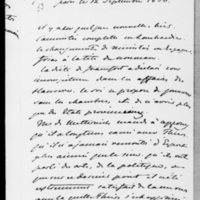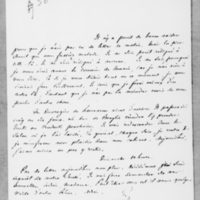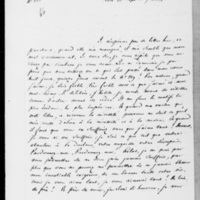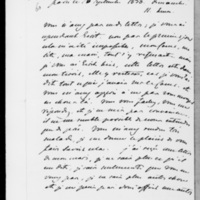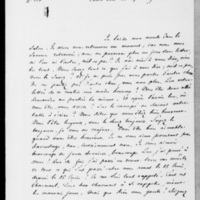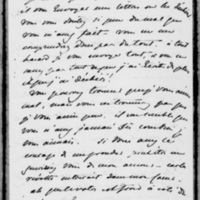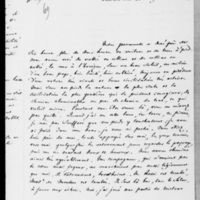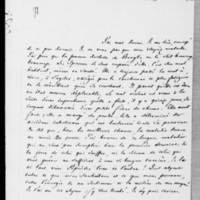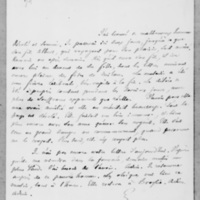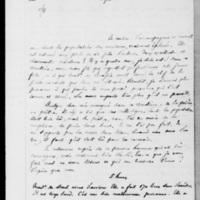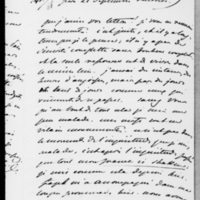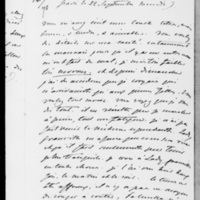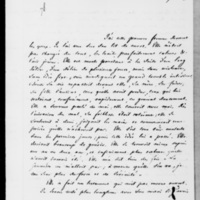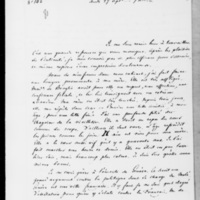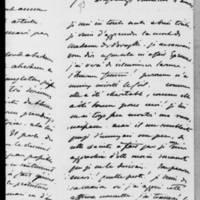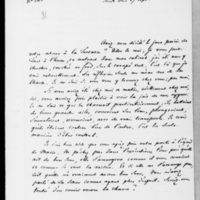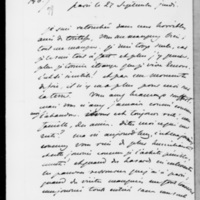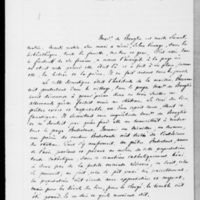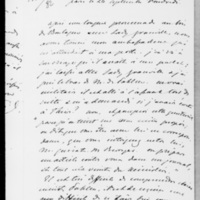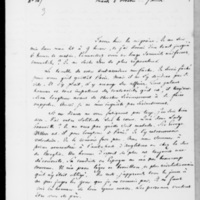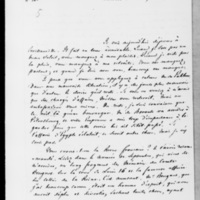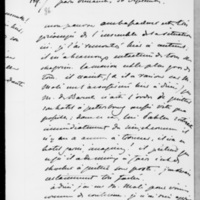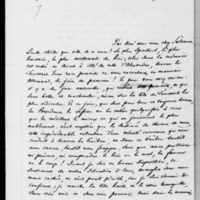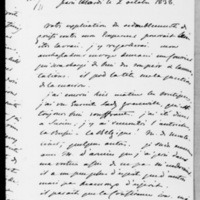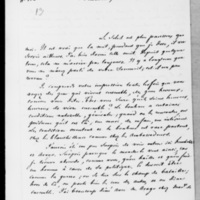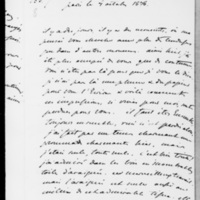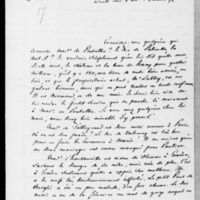Votre recherche dans le corpus : 155 résultats dans 5770 notices du site.Collection : 1838 (4 août - 4 novembre) (1838 : Réflexion politique et élaboration historique)
130. Paris, Dimanche 9 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre ce matin me fait un peu oublier celle d’hier. Je suis en meilleure humeur et j’ai hâté à vous le dire. Mon fils est parti. Marie s’est tout de suite remise, comme lorsque vous êtes parti. Ses variations sont si subtiles, si étranges, toute sa manière est si singulière qu'il faut absolument finir cela. Comme préface, je m'en vais l'envoyer à Rochecotte avec Mad. de Talleyrand, qui me l'a beaucoup demandé. Pauline en est transportée de joie, & Marie après m’avoir déclaré hier qu'elle détestait Mad. de Talleyrand et qu’elle n’irait chez elle pour rien dans le monde, vient de me supplier ce matin de l’y laisser aller. Ce sera une absence de 15 jours au moins. Je m’en vais donc rester parfaitement seule et ce sera pour moi abominable.
Hier j’ai eu en entretien de deux heures avec Médem, il part aujourd’hui pour Berlin & de là pour la Russie. Il verra tout le monde dans huit jours. Je lui a demandé ce qu’il dirait de moi. J’ai été parfaitement contente de la réponse. S’il tient parole, j'aurai eu pour la première fois un avocat homme d’esprit. Et je crois qu’il fera comme il m’a dit. Il m’a retenue fort longtemps, je n'ai plus attrapé qu’un bout de promenade avant mon dîné. Le soir j’ai été à Auteuil et je n'en ai rien rapporté. Une peu de causerie avec Pahlen à Armin. Fagel était attendu hier. Marguerite m'écrit une longue lettre remplie d’amitié. La question de l'hiver n’est pas décidée encore. Elle a bien envie de revenir à Paris, mais M. de Flahaut fait des chutes d’eau, une espèce de Niagara qui l’occupe beaucoup. Mon frère & mon mari et l’Empereur se sont trouvés réunis à Weimar avant hier. Certainement il y est question de moi, on y reste jusqu'au 11 ou 12, et de là je recevrai au moins une lettre de mon frère qui m’arrivera à la fin de la semaine. Adieu, que j'aimerais un adieu de plus près ! Je n'ai rien d’agréable à vous dire sur ma santé et ma mine. C’est pourquoi je ne vous en parle pas Adieu. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique, Vie familiale (Dorothée)
130. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de votre Gazette. Je vous aime mieux vous que les nouvelles. Mais j’aime les nouvelles. Quand elles remplissent vos lettre, il me semble qu’elles ont rempli aussi votre temps. Je me trompe. Il faudrait des tas de nouvelles et des plus grandes, pour remplir le temps quand le cœur est triste ! Et encore ! Mais n’importe ; cela me semble ainsi, et ce semblant me plaît. Nous sommes si disposés à nous payer d’apparences. Ne tenez pourtant pas à votre projet de ne me parler que de nouvelles. Je veux savoir ce qui se passe ailleurs que dans le monde. Ne craignez pas les malentendus les mauvaises phrases. Entre nous, les réticences seraient bien pires. Il n’en faut point, même de loin.
A propos de nouvelles donnez-m’en du petit Lord Coke. Je m’intéresse à cet enfant. Il avait l’air si isolé avec une figure si ouverte et si gaie ! J’espère qu’il va bien. Le précepteur s’est-il animé un peu ? Si l’affaire du roi de Hanovre finit comme vous le dîtes, les Allemands diètes et peuples, baisseront beaucoup dans mon esprit. Ils n’auront que ce qu’ils méritent. Il ne faut pas vouloir, ce qu’on ne sait pas défendre. C’est sans doute l’influence de l’Autriche et de le Prusse qui a retourné la Diète, car elle était disposée à reconnaître sa compétence. Pour ce qui se fait en Espagne, Frias vaut Ofalie. Singulier temps que celui où les révolutions elles-mêmes sont apathiques, et vivent sans faire un pas. Que votre Empereur s’en aille d’Allemagne en emportant pour tout résultat, un Leuchtonberg pour gendre, peuples et Princes pourront adopter la même devise ; Much ade about nothing.
Je lève la tête en ce moment. Vous avez parfaitement raison. J’ai devant moi ce soleil froid, qui s’épuise à chasser du Ciel le brouillard, et n’a plus rien pour échauffer la terre. C’est du pur humbog. Pourtant je l’aime mieux que la pluie. J’assiste chaque jour à toute la vie du soleil. Je me couche et me lève de très bonne heure. Physiquement, je m’en trouve bien. Je voudrais vous envoyer un peu de mon sommeil.
Ce qui me fait grand plaisir à voir, c’est la santé de mes enfants. Ils sont à merveille, et d’un mouvement, d’un entrain d’esprit et de corps inimaginable. M. de Metternich n’a pas trouvé Thiers plus animé, que ne l’est ma petite Henriette. Je leur lis le soir l’histoire des croisades de Guillaume de Tyr. Nous venons de passer trois jours à assiéger, et à prendre Antioche. Au moment où nous y sommes entrés Henriette a jeté sa tapisserie, & ils se sont mis à courir et à sauter dans la Chambre avec des cris de joie, comme les Croisés eux-mêmes. Ce sera bien pis quand nous prendrons Jérusalem.
10 heures ¼
Le facteur arrive tard. Vous êtes bien triste. Il y a une chose que je ne vous pardonne pas, c’est de croire que vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez. Que de choses j’ai à vous dire ? Et je vous ai écrit hier que je n’irais pas à Paris ! Adieu. Ce soir, je vous écrirai longuement. J’ai là du monde. Prenez garde à Marie, je vous en conjure. Les folles qu’on ne croit pas folles me font trembler. Adieu. Adieu. J’ai le cœur plein !
131. Paris, Lundi 10 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
C’est tout simplement pour vous obéir que je transcris la mauvaise phrase.
" Je vous ai conseillé d’aller à Baden croyant deux choses. L’une, que, si je suis pour vous ce que je veux être vous sauriez bien revenir en France ; l’autre que si je ne suis pas cela, il vous importe par dessus tout d’arranger votre vie avec ceux qui en disposent matériellement. "
Et je suis très fâchée de vous avoir obéi, car ma main redevient froide. N’allez pas commenter, expliquer ; l'impression a été, & reste mauvaise. C'est froid, bien froid. Mais tout ce qui est venu depuis a été bon, bien bon. Ainsi, c’est de tout mon cœur que je vous promets de n’y plus penser.
J'ai été faire visite hier matin à Mad. de Boigne, j’ai pris Palmella, avec moi. Nous avons eu si froid que vraiment lui et moi nous en étions violets ; nous avons marché au pas de charge en revenant. Quel temps abominable ! Nous avons trouvé le chantier à Chatenay. Il en fait les honneurs. Il était élégant frais, vraiment il est fort ridicule. On ne disait rien là, je n’ai donc rien à vous redire J'ai promis d’y aller dîner la semaine prochaine. Le soir j’ai vu du monde, la Duchesse de Talleyrand et M. de Humboldt comme extraordinaires. La Duchesse est embellie, blanchie. M. de Humboldt est plus bavard que jamais il m'a beaucoup parlé de mon mari qu'il rencontrait tous les jours à dîner chez le Roi de Prusse. Il l’a trouvé plus triste qu’il ne l’avait vu en Angleterre. Vous ne dites rien du prince Bugeaud qu’en pensez-vous ? Pahlen est fort en colère de l’article des Débats sur la Pologne. Je lui propose de démentir l’Ukase sur l'habillement ; mais voilà l'embarras. Il peut y avoir du vrai. Cependant vraiment nous ne croyons pas que ce soit tel que le disent les journaux. J'imagine que le démenti paraîtra dans quelque journal allemand. Le mal dans nos Affaires, c’est qu’on croit de nous tout ce qu’on invente, et pour cause ; Tcham avait l’air plus content hier ; l’affaire suisse s'arrangera.
Marie frappe tout le monde pas l’étrangeté de son regard. Demain je parlerai. médecin, et la semaine prochaine. Elle ira je crois à Rochecotte. Elle parait le désirer elle-même. Elle partira le 18 et reviendra le 7 octobre. Dites-moi que vous m'aimez, dites le moi souvent. Il y aura jeudi quatre semaines que vous m'avez quittée. J’ai mal employé ce temps-là. Je devais engraisser. J’ai maigri. Cela m’afflige extrêmement. Je ne vois pas que mes tracasseries présentes puissent me remettre. Adieu. Adieu. Adieu.
131. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si j’étais près de vous, je vous gronderais. De loin, je n’en ai pas le courage. Vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez ! Je pourrais vous redire comme vous me l’avez dit : " Tout a été couvert un moment par l’étonnement, la joie de vous avoir trouvée. Le premier de ces sentiments, le temps l’efface naturellement. Le second dure mais plus tranquille parce qu’il est plus établi. Je ne dirai pas cela parce que ce ne serait pas là l’expression vraie de ce qui est en moi. Voici ma vérité à moi. Vous m’avez inspiré une grande curiosité. Vous ne paraissiez ni ce que j’avais vu ailleurs, ni ce que j’avais été tenté de vous croire. J’étais très touché de votre mal et très curieux de vous connaitre, de savoir ce que vous étiez réellement. Voilà votre premier attrait. Celui-là est passé, j’en conviens. Je vous connais. Je ne suis plus curieux. Mais qu’est-ce donc que cet attrait frivole et froid, à côté de ce qui m’attache à vous aujourd’hui ? Savez-vous que je vous ai trouvée infiniment supérieure à ce que j’attendais au temps de ma plus vive curiosité ? Que vous valez infiniment mieux que je ne supposais ? Que je vous aime bien plus que je ne vous aimais quand je vous ai dit que je vous aimais ? Je puis, comme d’autres, être attiré par l’agrément de l’esprit, par le charme de la nouveauté et donner à ce plaisir plus de place qu’il ne lui en est dû et me laisser aller à l’exprimer plus vivement que ne le voudrait l’exacte vérité. Tout cela, c’est de la vie superficielle, qui a son prix, que je ne dédaigne pas.
Mais ce n’est plus de cela qu’il s’agit entre nous ; ce n’est plus dans cette sphère là que nous vivons. Vous avez pénétré au fond de mon âme, dans ma vraie vie, dans ce qu’il y a en moi de plus sérieux, dans ce qui est vraiment moi. Et vous n’y avez pénétré que lentement. Je suis très accessible à la surface très peu au fond. J’ai beaucoup douté. J’entendais beaucoup parler de vous. J’ai tout écouté. Je ne vous ai pas dit le quart de tout ce que j’ai pensé, cherché, sondé, supposé. Je vous ai trouvé des défauts, des torts. Je les ai tournés et retournés en tous sens pour en découvrir l’origine, pour en mesurer la portée possible. Je vous ai traitée sans faveur. Et plus j’ai regardé à vous, plus vous avez grandi et brillé à mes yeux, plus je me suis senti pénétré et d’estime et de goût, et de tendresse pour vous, pour votre nature, votre nature primitive et essentielle telle que Dieu l’a faite. Je n’y regarde plus à présent. Peu m’importent vos défauts ; peu m’importe ce que vous pourriez avoir fait, ce que vous pourriez faire encore. Il y a en vous quelque chose qui est indépendant de tout supérieur à tout, qui domine et efface tout pour moi. Ce quelque chose, c’est le fond de votre être, c’est vous même. comme disent les dévots vous êtes pour moi, en état de grâce. Rien ne peut plus vous en faire sortir. Est-ce là me plaire assez ? Manque-t-il quelque chose à cette affection-là? Et ne croyez pas que, depuis le 15 Juin, elle n’ait pas subi plus d’une épreuve venant de vous ou d’ailleurs. Je vous dirai quelque jour toutes celles qu’elle a surmontées. Vous me direz si j’ai tort de vouloir que vous ayez foi. Mais laissez-moi vous demander une chose.
Soyez fière avec la destinée comme vous l’avez été avec votre Empereur. Ne parlez pas de la décadence qui vous entoure. Ne vous en parlez pas à vous-même. Il y a des impressions très naturelles, presque inévitables, mais qui ne méritent pas de séjourner dans l’âme. Ne leur permettez pas de faire plus que traverser la vôtre. Elle est si grande ! Rien ne lui manquerait si elle était aussi forte. Mais le sort vous a d’abord gâtée, et puis frappée immensément. Il faudrait une force immense pour suffire toujours à cette double épreuve. Je ne vous parle pas trop sérieusement, n’est-ce pas ? J’espère que non. Dites-le moi pourtant. Et chargez-moi de vous apprendre à vous aimer. Ce qui est très sérieux aussi, croyez-moi, c’est Marie. Ce que vous m’en dîtes à propos de l’enfant de la petite Princesse me trouble beaucoup. Je sais de déplorables aberrations qui ont commencé ainsi. Votre médecin est un sot. Que le mal soit déjà réel ou non, de tels symptômes méritent qu’on y regarde J’aurais bien des choses à vous dire à ce sujet. Mais je ne puis les écrire. 10 h. Je n’ai point de lettre aujourd’hui. Je laisse partir celle-ci comme elle est. Je n’y ajoute et n’en ôte rien. Adieu. Adieu. G.
132. Paris, Mardi 11 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m'avez écrit une excellente lettre. Je vous en remercie tendrement. Elle à propos savez-vous m’a réchauffée qu'il fait horriblement froid. Je suis transie & la nuit je ne trouve pas assez de châle pour me couvrir. Est ce que l’hiver serait commencé ? J'ai fait ma promenade hier à St. Cloud ; en rentrant j’ai trouvé chez moi mon Ambassadeur & la petite princesse. Le soir j'ai fait une tournée de visites, je n’ai trouvé que la marquise Durazzo. Voici mon médecin qui est venu me prendre mon temps. Il croit que je radote lorsque je lui raconte mes peurs sur Marie, et je vois qu'il me croit plus folle qu’elle. En attendant, il est enchanté que je l'envoie à Rochecotte. Mais il me faudra plus que ce remède, je crois, parce qu'il faut absolument rompre, ces caprices sans cela nous ne pourrons pas continuer à vivre ensemble. Il lui suffit que j’aime quelqu'un pour qu’elle le déteste. Ce pauvre Alexandre si doux et si poli pour elle, et qu’elle a traité avec la même férocité que vous !
M. Aston est venu me voir aussi hier matin. Nous avons à nous occuper ensemble du petit Coke qui nous a donné de l'inquiétude. On a craint un moment pour lui la fièvre scarlatine. Il va mieux.
Point de nouvelles politiques du tout. Je ne sais rien du Hanovre. Le monde dort.
Adieu ma lettre est un peu shabby mais je me suis levé tard. J'ai été interrompue. J’attends la petite princesse et il faut que ma lettre soit remise avant qu’elle ne vienne. Adieu. adieu. Aussi vivement que si vous étiez ici.
Mots-clés : Réseau social et politique
133. Paris,Mercredi 12 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a eu quelques nouvelles hier. L'armistice complète en Lombardie. Le changement de ministère en Espagne. Frias à la tête du nouveau. La diète de Francfort a déclaré son incompétence dans les affaires des Hanovre. Le Roi se propose de gouverner sans les chambres, et de n’avoir plus que des états provinciaux. M. de Metternich mande à Appony qu'il a longtemps causé avec Thiers, qu'il n'a jamais rencontré d’esprit plus animé que que le sien, qu’ils ont parlé des arts, de la politique, & que sur ce dernier point il a été extrêmement satisfait de la mesure avec laquelle Thiers s’est exprimée Le Roi revient vendredi. M. le Duc d’Orléans part le 15 et fera une absence de quatre semaines ; en attendant sa femme n’a pas encore bougé de son lit et sa faiblesse est telle qu’elle ne peut pas lever la tête. Je suis étonnée qu'il la quitte. Madame partira pour son château de Randon avec la princesse Clémentine et les petits princes. Elle ne reviendra qu'au bout d’un mois. La cour rentre aux Tuileries for good. Plus tard il y aura un petit séjour à Trianon, et un autre à Fontainebleau mais private. Je crois que voilà assez de commérage.
J'ai été hier matin à Auteuil. J'y dîne aujourd'hui. Le soir j’ai vu chez moi quelques personnes car je commence J’ai donc fait venir à m’ennuyer. mon Ambassadeur, son frère, la petite Princesse, Armin, & quelques autres. Le temps est froid quoique gai. Un beau soleil, et un vent glacé. Je n’aime pas cela. C’est du humbug. Je viens d'écrire une longue lettre à Marguerite. Je dois bien des lettres à bien du monde. Mon humeur est si chagrine que je n’ai pas le courage de me mettre à l’oeuvre. J'attends maintenant ce qui ressortira de Weymar, et au fond je n’attends pas grand chose. Je vous remercie de la lettre reçue ce matin. Le mauvais moment est passé n’est-ce pas ? Je suis presque impatiente de voir Marie partir, et cependant je serai bien seule. Je n’attends mon fils que vers le 22 pour quatre ou cinq jours. Lady Granville demain. Adieu, with all my heart.
Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique
132. Val-Richer, Samedi 15 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’y a point de bonne raison pour que je n’aie pas eu de lettre ce matin. Mais la pire serait que vous fussiez malade. Je ne suis point résigné à celle-là. Je ne suis résigné à aucune. Je ne sais pourquoi je vous écris avant le courrier de demain, car je n’ai rien à vous dire. Et si je vous disais tout en ce moment, je vous écrirais fort tristement. Je crois que je ferai mieux d’en rester là, d’autant que je n’ai pas la moindre envie de vous parler d’autre chose.
M. Duvergier de Hauranne vient d’arriver. Il passera ici cinq ou six jours. Le Duc de Broglie viendra l’y prendre jeudi ou vendredi prochain. Je vais redescendre dans le salon où je l’ai laissé. En général, chaque soir je rentre et je m’enferme avec plaisir dans mon cabinet. Aujourd’hui, j’aime mieux ne pas y rester. Dimanche 10 heures Pas de lettre aujourd’hui, non plus. Décidément je suis inquiet de votre santé. Je vais faire demander de vos nouvelles.
Adieu Madame. Peut-être vous est-il venu quelque visite d’Outre-Rhin. Adieu. G.
134. Paris, Jeudi 13 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous êtes toujours égal, toujours bon pour moi. Votre lettre ce matin me fait plaisir à relire. Mais au milieu de vos plus douces paroles je vois bien que je ne vous plais plus comme je vous plaisais et me je prends moi en véritable horreur. Il n’y a pas de sentiment plus pénible que celui-là. Je ne m’aime pas, voilà ce qui fait mon humeur. Du reste j'ai bien de quoi en avoir et de la très mauvaise. Il me semble que tout, en grand, en détail tout est en décadence pour moi, de temps en temps il s’offre à mon imagination quelque lueur, mais elle n’a pas de duré. Vous seul vous êtes pour moi une réalité, je le sens mille fois le jour, & je ne vous le dis jamais comme je le sens, parce qu'il me parait que je n’en ai pas le droit, que mon humeur mobile me porterait le lendemain à vous dire des paroles, plus tièdes, que tout cela n’est pas. digne de vous. Ah mon Dieu quelle confusion dans mon cœur ! Ma destinée est si triste que mon pauvre esprit succombe et quand vous n'êtes pas auprès de moi, il ne me reste pas un brin de courage, pas un brin de raison.
Le temps froid me tient loin du bois de Boulogne, j'ai été du côté de la ville hier, dans quelques boutiques. C’est des meubles que je vais voir. Quelques fois l’envie de m’arranger me prend, et puis, je trouve si pitoyable de m’arranger à la Terrasse. J’attends un bel hôtel ; le luxe, le confort dans lesquels j'ai vécu toute ma vie, et mon bivouac actuel me parait insoutenable. C’était drôle en commençant, cela ne me parait plus drôle du tout. J'en suis excédée. La petite princesse a tous les jours quelque nouveau récit à me faire sur Marie ; elle me démontre claire ment que Marie me déteste et qu’elle parle mal de moi. Cela ne me fâche pas, mais cela m’afflige. Comment pas un peu de reconnaissance pour tout ce que j'ai fait pour elle. Je ne sais par quoi nous finirons.
A propos Marie hait les petits enfants de la petite princesse. et a proposé un jour à sa nourrice de lui jeter une pensée à la tête ; une autre fois de l’étouffer. Eh bien & le médecin dit qu’il n’y a pas l'ombre de folie en elle ! Sneyd est arrivé & m’a fait une longue visite hier matin. Il m’a apporté une lettre de Lady Clauricarde que je vous enverrai. J’ai été dîner à Auteuil, j'y ai rencontré Fagel que j'aime beaucoup. Nous nous sommes arrangés pour un long tête à tête Samedi. Pas de lettre pas la moindre nouvelle de mon mari. Adieu. Adieu. Pourquoi ne suis-je pas née en province, d'une famille amie de la vôtre. Vous auriez pris soin de me former, plus tard de m’aimer, & puis. Adieu, adieu.
133. Val-Richer, Mardi 18 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Oui, je vous aime, je vous aime, plus que je ne vous ai jamais aimée, plus que vous ne le croirez jamais. Vous êtes malade depuis trois jours. On peut être bien malheureux sans être malade. Que n’ai-je pas pensé, que n’ai-je pas senti depuis trois jours ?
Laissez-moi être heureux de toutes ces lettres d’aujourd’hui ; heureux, oui heureux, laissez-moi être heureux de tout ce que je lis là. Je ne l’espérais pas. Je ne l’espérais plus. Dearest ever dearest, je vois ce que vous avez souffert. Pardon, pardon, laissez-moi être heureux. J’en ai un remord immense ; mais je suis si heureux. Trois jours sans lettres et en supposant toutes les causes, des causes bien pires que de vous savoir malade ! Ce que je dis là est affreux. Mais pardon encore pour cela. Adieu Adieu. Je vous aime. Ce soir, je vous dirai tout. Je vous aime.
134. Val-Richer, Mardi 18 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pardonnez-moi ce que je vous ai dit ce matin, ce que je vous redirai. J’étais si heureux ! Je suis si heureux ! Je n’ai pas pu, je ne puis pas, je ne veux pas vous le faire. Il faut que vous me le pardonniez. Oui vous m’aimez, vous m’aimez beaucoup. J’en ai douté. Moi aussi j’ai souffert, depuis plus de trois jours. J’ai cru depuis plus de trois jours, non pas que vous ne m’aimiez plus, non pas que vous m’aimiez moins mais que vous ne m’aviez jamais assez aimé que nous nous étions trompés tous deux, vous sur ce que j’étais moi, sur ce que je pouvais être pour vous. Que me fait l’étonnement ? Que me fait la nouveauté ? Moi, je vous aime plus, oui, beaucoup plus que le premier jour, que le premier mois. Je suis bien plus à vous. J’ai bien plus besoin de vous.
A Paris, quand je vais vous voir, le second quart d’heure vaut mieux que le premier, le troisième mieux que le second ; de moment en moment, près de vous, je me sens plus animé, plus reposé, plus confiant, plus heureux, plus avide. My beloved il en est des jours comme des heures, des mois comme des jours ; il en sera des années comme des mois. Le temps, loin de rien user, apporte à vous de l’attrait pour moi, à moi de l’amour pour vous. Je sais cela ; j’en suis sûr je l’éprouve. J’ai cru qu’il en était autrement pour vous, que ce même temps qui, pour moi, augmentait le charme et l’empire de notre lien, pour vous l’affaiblissait et le décolorait un peu. Et un peu, c’est tout. Je l’ai cru. Et au milieu de cette crainte, je suis trois jours sans lettre de vous ! J’ai tout supposé, tout m’a paru possible, des choses absurdes, folles, odieuses criminelles. Votre chagrin, votre violent chagrin de ce que je ne pouvais aller vous voir, était pour moi une explication inespérée, ravissante. Et c’est la vraie ! Et vous m’aimez comme je le veux, vous me le dites comme je le veux ! Encore une fois, pardonnez-moi mon bonheur. Vous grondez ! Non, dearest non ; je vous rends grâces, je vous aime. Vous ne savez pas combien je vous aime. Oui, je puis contenir, je puis taire ce que je sens. Je le contiens toujours. Je ne vous ai jamais exprimé ma tendresse sans me sentir le cœur plein d’une tendresse inexprimable, qui montait, montait en moi, et s’efforçait en vain de passer de moi à vous, et retombait en moi, sans que vous l’eussiez vue, sans que vous en eussiez joui. Désirez, mon amie, imaginez, inventez, rêvez tout ce qu’il vous plaira, je vous défie. Vous le savez ; je vous ai défiée une fois. Je vous défie toujours. Et laissez-moi vous tout dire.
Quand j’ai cru ce que je vous disais tout à l’heure, je ne m’en suis point pris à vous ; je ne vous l’ai point imputé à mobilité, à Caprice. J’ai tout attribué à la force d’un autre sentiment, un moment contenu et distrait, mais redevenu tout puissant dans votre cœur. Dearest, je puis tout accepter de la créature, que j’aime, tout, excepté l’inégalité, la moindre inégalité en fait de tendresse. Être pour elle moins qu’elle n’est pour moi, je ne puis pas, je ne veux pas. Il ne croyez pas que ce soit fierté seulement, pur orgueil. Non, non. Mais je vous aime de cet amour au delà duquel il n’y a rien et qui ne veut rien voir au delà, qui ne veut pas avoir un regret à sentir, un désir à former, que rien ne peut contenter si ce n’est le même amour. Je puis tout sacrifier, tout, même le bonheur que j’attends de vous, même le bonheur que j’ai à vous donner ; mais renoncer à la moindre part de votre cœur, de mon ambition sur votre cœur, jamais. Le jour où je le pourrais vous n’auriez pas tout mon cœur à moi.
Mercredi matin, 3 heures
Je vous ai quittée hier au soir pour redescendre dans le salon. J’attendais un messager que j’avais envoyé le matin à Broglie. La Duchesse de Broglie est malade, très malade ; une fièvre catarrhale aiguë, compliquée d’une inflammation d’entrailles, & de graves accidents spasmodiques. M. Chomel a quitté Paris pour venir passer quelques heures à Broglie. Il est reparti inquiet. L’état était le même hier. Dans tous les cas, ce sera très long. Son pauvre mari me fait une pitié profonde. Il l’aime autant qu’il peut aimer. Il serait très malheureux. J’espère cependant, et on espère. Je vous donnerai de ses nouvelles. J’en ai tous les jours. Je me suis couché tard et je me lève tard ce matin. J’étais fatigué. Depuis trois jours, j’ai fait de très longues courses, un peu pour promener mes hôtes, beaucoup pour me distraire. J’ai chassé même, ce qui ne m’était pas arrivé depuis plus de treize ans. Vous me parlez de lettres froides, de lettres bien écrites, bien raisonnées. C’est impossible. Vous me dîtes que je ne vous comprends pas. Vous ne m’avez pas compris non plus. Ah comprenons, nous toujours. Il y a trop à souffrir autrement.
10 h. 1/2
Je n’ai rien de vous ce matin, un seul mot de Génie que j’avais chargé d’aller savoir si vous étiez malade. Demain j’aurai une lettre de vous. Vous ai-je bien dit que je vous aime ? Vous ai-je dit quelque chose ? Je n’en sais rien. J’ai tant à vous dire. Je recommencerai. Adieu, adieu. Jamais tant d’adieux. G.
135. Paris, Samedi 15 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne vous ai pas écrit hier. Aujourd’hui j'essaie de le faire mais je ne crois pas que Vous me dites je vous envoie ma lettre aujourd’hui il faut tout se dire, même de loin. Cela me semble impossible si je vous disais tout, tout ce que j’ai sur le cœur. Ah que je vous blesserais. Et en ne vous le disant pas, je ne sais de quoi vous parler, car je n’ai plus qu'une idée, une seule. Vous m'avez fait bien du mal. Et vous voulez que je croie, vous voulez de la foi. Et tous les jours vous prenez soin de m’en enlever. En me quittant le 16 août vous étiez décidé à ne pas revenir. Je l’ai vu, je l’ai senti. Je me suis fait effort pour en douter. Votre proposition de Baden m'a rendu mon soupçon. Je ne vous ai pas aidé à vous débarrasser de moi, M. Duvergier de Hauranne, M. le préfet, Madame sa femme, sont venus à votre aide. Convenez que ce sont de pauvres raisons ! Les autres valent mieux ; et cependant l’année dernière elles n’étaient pas suffisantes pour vous retenir ? Vous êtes venu me voir deux fois, cela ne vous a pas semblé difficile. C’est que vous m’aimiez bien alors. Non, je ne suis pas injuste je ne suis pas défiante, je vois les choses comme elles sont. Je mérite tout ce qui m'arrive, c’est moi, toujours moi que j’accuse. Je vous l’ai dit, je ne m’aime pas, et je trouve que les autres ont raison de ne pas m’aimer. Je sens ce malheur profondément. J’ai cru que vous m'aimeriez beaucoup, beaucoup, j’avais repris confiance en moi-même, je l’ai perdue, tout à fait perdu, et je me retrouve plus isolée, plus malheureuse que je ne l'ai jamais été. Mon âme est tout à fait abîmée, flétrie. Je n'ai courage à rien. Je ne sais que vous dire. Je ne vous dis pas tout encore. Je ne vous crois plus, et le 31 octobre ! Vous reverrai-je le 31 octobre. Vous me l'avez promis, mais est-ce une raison pour que j'y crois maintenant ?
Dans ce moment il passe un convoi sous mes fenêtres. Le cercueil est tout blanc tout est recouvert de blanc. Qu’est-ce que c'est que le blanc pour les morts ? Dimanche 16 Sept. 8 h 1/2 Vous voyez bien que je ne puis pas vous envoyer ma lettre, Et j'ai besoin de vous écrire, de vous parler à tout instant. Je vous aime, je vous aime beaucoup. Pourquoi m'aimez-vous si peu ? Vos lettres sont bien écrites mais elles me semblent si froides ! Je me couvre beaucoup. Je ne parviens pas à me réchauffer.
135. Val-Richer, Jeudi 20 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’espérais pas de lettre hier ; et pourtant, quand elle m’a manqué, il m’a semblé que mon mal recommençait. Je vous dis, je vous répète que vous ne savez pas combien je vous aime. Que ne donnerais- je pas pour que vous eussiez vu ce qui s’est passé dans mon cœur huit jours, quinze jours avant le n°127 ? Par nature, quand j’aime je suis faible, très faible avec ce que j’aime et avec moi-même. Je délibère, j’hésite, je recule avant de résister comme d’autres avant de céder. Il me faut les motifs les plus évidents, les plus impérieux. Et quand ma raison, qui reste libre, a reconnu la nécessité, personne ne sait ce qu’il m’en coûte d’obéir à la nécessité et à la raison. Et quand il faut que vous en souffriez, vous que j’aime tant ! Dearest, je vous ai vu souffrir ; je sais ce que c’est que votre abandon à la douleur, votre angoisse, votre désespoir. Pardonnez-moi, Pardonnez-moi. Hélas, je ne puis pas vous promettre de ne vous faire jamais souffrir, pas plus que vous ne pouvez me promettre de ne jamais blesser mon insatiable exigence, de me donner toute votre vie. Mais je vous aime tant, je vous aimerai tant ! De loin, de près ! Et près de vous, je serai si heureux, je vous rendrai si heureuse. Vous vous en souvenez, n’est-ce pas de ces heures charmantes que nous avons si souvent passées ensemble si animées et si douces, si confiantes, rapides à ce point que nous ne les voyons pas passer et pourtant pleines comme une vie, et laissant des traces si profondes ! Vous me les rendrez, je vous les rendrai ; et quand nous les aurons retrouvées, quand je vous aurai là, devant moi, près de vous, il n’y aura plus pour nous de chagrin passé, ni de chagrin à venir. Nous n’aurons ni mémoire, ni prévoyance, comme des enfants, de vrais enfants, car le mal reviendra ; ce qui nous manque, nous manquera encore souvent. Il n’est que trop vrai qu’il nous manque beaucoup, beaucoup ?
10 heures
Oui, oui, je vous aimerai toujours, immensément, à combler, à dépasser votre plus insatiable ambition. Moi aussi, en ouvrant votre lettre excellente, charmante, j’ai poussé un soupir de délivrance. Moi aussi, je suis heureux bien heureux. Dearest, je l’ai été avant vous ; j’ai été soulagé avant vous. C’est là mon remord. Vous me pardonnez, n’est-ce pas ? Non, nous ne nous connaissions pas ; nous ne nous connaîtrons jamais, jamais assez pour que notre sécurité soit complète. Il n’y a de sécurité complète que dans un bonheur complet. Comment n’aurions-nous jamais un mauvais jour, une pensée triste une inquiétude amère ? Sommes-nous toujours ensemble ? Pouvons-nous à chaque instant, sur la moindre occasion, nous délivrer l’un l’autre, par un mot, par un regard, de ces nuages qui passent, de ces poids secrets qui tombent tout à coup sur le cœur ? Mais n’importe ; nous sommes, bien heureux ; nous serons bien heureux. Nous nous aimerons encore plus que nous ne serons heureux. Adieu. Adieu. Que de choses, j’ai encore à vous dire ! Oui, c’est une longue, longue histoire. Adieu. Je vous aime ; je vous aime comme le dit le petit papier dans le petit sachet noir. Adieu. G. Mad de Broglie est un peu mieux, c’est-à-dire un peu moins mal. Je viens de recevoir des nouvelles jusqu’à hier midi. Ils sont toujours bien inquiets. Cependant il y a plutôt du mieux. On me dit : " La nuit a été plus tranquille qu’aucune des précédentes depuis que la maladie a pris un caractère de gravité. La matinée commence bien. "
136. Paris, Dimanche 16 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous n'avez pas eu de lettre ; cependant je vous ai écrit. Non pas le premier jour cela m’a été impossible, mon cœur, ma tête, ma main, tout s’y refusait. Mais je vous ai écrit hier, cette lettre est dans mon tiroir, elle y restera, car je vous ai dit tout ce que j’avais sur le cœur. Et vous m’avez appris à ne pas vous envoyer ces choses-là. Vous vous fâchez, vous me répondez, et je ne suis pas convaincue. Il ne me semble possible de nous entendre que de près. Vous m'avez rendue très malade, je me donne le plaisir de vous faire savoir cela. J'ai reçu une lettre de mon mari, je ne sais plus ce qu’il me dit, je sais seulement que vous ne venez pas, je ne sais plus autre chose et je ne pense pas vous offrir une autre manière de vous aimer que de perdre la tête de ce que cette année présente un tel contraste avec l’année dernière.
2 heures
Je rentre de l’église, je suis mieux. Un peu plus calme. J’y ai pensé à vous. Il m’a semblé que je devais tout vous dire, et je suis bien convaincue que je ne puis vous écrire qu'à cette condition. J'ai le cœur si plein, si plein, & vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez. pas le mal que m'a fait votre N°129. Je l'ai lue, relue, étudiée, encore une fois, toutes ces pauvres raisons. La seule, pratique est celle que vous regardez comme la plus faible. J’ai disposé du préfet & de M. Duvergier de Hauranne. Votre mère, vos enfants sûrement ils n’aiment pas à vous voir partir, mais quelques jours ! Vous l'avez bien fait l’année dernière. Et puis vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi vous venez, vous m’avez souvent répété que vous conserviez votre parfaite liberté d’actions. Je ne me range qu'à la dernière raison et celle-là m’afflige au delà de ce que je puis vous exprimer. Je ne puis donc rien. Est-ce les moyens de venir ? Le temps que cela vous prend et que vous enlèveriez à votre travail ? Mais ce temps pourrait être abrégée. Je vous aurais vu ; et vous voir, vous entendre, me faire entendre de vous, voilà ce qui m’eût comblée, voilà ce que j’attendais, et il m’est impossible de vous rendre l’impression qu'a fait sur moi l’annonce que je ne vous verrais pas. Il m’a semblé que le monde finissait pour moi. J’ai pleuré, je pleure encore, je pleurerai toujours.
Dimanche midi
Je vais à l’église demander à Dieu de remettre ma pauvre tête ! Je vous écris tous les jours, mais je ne vous enverrai ma lettre que si vous me l’ordonnez et n’ordonnez pas légèrement car mon cœur est tout entier dans cette lettre. Je vous en ai écrit trois ce matin que j'ai déchirées. Peut être ferai je le même usage de ce billet. Je n'en sais rien. Je ne sais plus rien, sinon que vous ne venez pas.
136. Val-Richer, Jeudi 20 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je laisse mon monde dans le salon. Je viens vous retrouver un moment ; car nous nous sommes retrouvés ; nous ne passerons plus un jour sans lettre, ni l’un, ni l’autre n’est-ce pas ? Je n’ai rien à vous dire, rien du tout. Vous savez tout ce que j’ai à vous dire ; n’est-ce pas, vous le savez ? Et je ne puis pas vous parler d’autre chose. Ne me parlez pas d’autre chose, vous non plus.
Que votre lettre de ce matin, m’a rendu heureux ! Vous êtes donc allée demander au portier la mienne. Et après l’avoir lue, où vous êtes-vous assise ? Sur le canapé ou devant votre table à écrire ? Vous dîtes que vous étiez bien heureuse. Vous l’êtes toujours, vous le serez toujours. Soyez le toujours, je vous en conjure. Vous êtes bien aimable quand vous êtes heureuse. Je ne vous aime pourtant pas davantage non, certainement non. Je vous aimais beaucoup ces jours derniers, beaucoup. Que j’ai pensé à vous ! Que de fois j’ai passé en revue, tous vos mérites et tout ce qui s’est passé entre nous avant le 15, puis depuis le 15 Juin ! Je me suis tout rappelé. Tout est charmant. Tout sera charmant à se rappeler, même les mauvais jours. Mais que Dieu vous garde. Soignez vous bien ne soyez pas malade. Génie n’a donné hier de vos nouvelles. Dites-moi comment vous êtes bien exactement.
Vendredi 10 heures
Je me suis encore levé tard. Je n’ai pas eu un quart d’heure à moi. Je mène mes hôtes faire une grande promenade à quatre lieues d’ici. Nous déjeunons plutôt. Voilà une sorte lettre. Je ne puis souffrir de vous écrire ainsi. Aujourd’hui surtout. Je prendrais ma revanche ce soir. La lettre de votre mari ne me laisse pas un doute. Lady Granville a raison. L’Empereur a commandé la lettre comme le silence. M. de Lieven vous le dit en propres termes. Ils ont peur de vous. Il n’y a pas de mal. Amour ou crainte, il faut inspirer l’un des deux. L’état de Mad. de Broglie est le même. On m’écrit ce matin que le mal violent n’est pas revenu, mais le mieux a fait peu de progrès. Il est clair qu’on espère un peu plus seulement un peu ! J’en suis très préoccupé. J’ai une vraie amitié pour elle. Les personnes rares, sont très rares. Je vous tiendrai exactement au courant. L’an dernier, ma mère et mes enfants étaient à Trouville. L’an dernier je ne travaillais pas. Je vous aime plus que l’an dernier. Adieu dearest. Le meilleur adieu possible. Ce possible est bien peu. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
137. Paris, Lundi 17 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne sais quel parti prendre, faut il vous envoyer mes lettres ou les déchirer. Vous vous doutez si peu du mal que vous m’avez fait. Vous ne me comprendrez donc pas du tout. A tout hasard je vous envoyé tout, & vous ne savez pas tout ce que j’ai écrit de plus et que j'ai déchiré ! Vous pourrez trouver que je vous aime mal, mais vous ne trouverez pas que je vous aime peu. Il me semble que vous n'avez jamais su combien je vous aimais. Si vous avez le courage de me gronder peut-être me guérissez vous de mon amour. Car la révolte entrerait dans mon cœur. Ah que le vôtre est froid à côté du mien.
Midi
Je suis si triste, si triste. Quand me viendra la réponse à ceci, quelle sera cette réponse ? N’aurais-je pas mieux fait de dissimuler ? De faire une réponse convenable à votre 129. Une réponse aussi raisonnée aussi froide que l’était cette lettre ? Savez-vous cacher ce que vous sentez vivement. Moi, je ne le peux pas. Ainsi dans ce moment, si vous étiez ici. (ah quelle parole !) Je me jetterais à vos genoux, je vous demanderais de m’aimer, de m’aimer comme vous m’aimiez, de prendre pitié d’un pauvre cœur abattu, délaissé, malheureux, tout rempli de vous, qui n’a plus que vous, qui croyait en vous, qui voudrait y croire encore et qui ne le peut pas. Dites-moi, dites-moi si vous m’aimez. Dites le moi, vite un mot, un seul mot. Ne raisonnez pas avec moi, c'est si froid de raisonner. Cela me glace. Réchauffez mon pauvre cœur, j'y ai froid, bien froid.
1 heure. Lundi.
Encore un mot, encore. Aimez-moi, aimez moi je vous en conjure. Je pleure, je ne vois pas ce que j'écris. Dites-moi bien vite que vous m'aimez. Adieu. Adieu Adieu, toujours adieu, n’est ce pas ? Comme j’attendrai après demain matin ! si vous voyiez l'état où je suis, je vous ferai pitié.
137. Val-Richer Vendredi 21 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Notre promenade a duré près de six heures, plus de deux heures en voiture, et de trois à pied. Nous avons été de vallée en colline et de colline en vallée, la mer à l’horizon, sous un beau soleil, au milieu d’un beau pays bien boisé, bien cultivé, toujours en présence d’une nature très riante et d’une civilisation très active. Mais sous nos pieds la nature la plus sale et la civilisation la plus grossière qui se puissent imaginer ; des chemins abominables, ou pas de chemin du tout, ce qui valait mieux. Pourtant vous êtes venue là, vous ne m’avez pas quitté ? Quand j’ai vu cette boue, ces trous, ces pierres, je n’ai pas souffert que vos pieds y touchassent ; je vous ai prise dans mes bras, je vous ai portée. Vous étiez bien près de moi, toute appuyée sur moi, les yeux tournés vers moi quelque fois les retournant pour regarder le paysage, puis me les rendant doux et heureux.
Nous avons cheminé, ainsi très agréablement. Mes compagnons, qui n’avaient pas le cœur aussi joyeux, ne marchaient pas aussi légèrement que moi ; ils tâtonnaient, bronchaient. M. Rossi est tombé, Mad. de Meulan est tombée. Ils sont là bas, dans le salon à jouer aux échecs. Moi, j’ai joué une partie de trictrac avec M. Duvergier de Hauranne et je vous reviens, car vous ne jouez pas au trictrac. Je vous répète que Lady Granville a raison, et que M. de Lieven a reçu permission ou plutôt ordre de vous écrire. Pour combien de temps, combien de fois ? Je n’en sais rien.
Avez-vous lu les romans d’Anne Radcliff, les statues immobiles, inanimées, qui sont sur votre chemin et vous empêchent absolument de passer ? Tout à coup vous découvrez un bouton, vous le pressez, la statue se meut, vous ouvre le chemin vous transporte même et vous sert. Il y a un bouton à presser. Vous le savez.
Que signifie, cette arrivée à Weimar des Grandes Duchesses aînées ? Est-ce qu’il y a un ou deux mariages arrangés, à Munich ou ailleurs ? On me disait ces jours-ci que le Prince royal de Bavière était marié en secret, qu’il se défendait par là contre tout ce qu’on voulait faire de lui. Y a-t-il quelque chose de vrai ? Je suis charmé que Marie soit partie. Le conseil de vos amies est bon. Cette manière envers vous n’est pas tenable. Si elle en peut changer, il faut qu’elle en change. Si elle ne peut pas, à plus forte raison. J’ai une vraie pitié de cette jeune fille. Si elle eût eu de l’esprit, et le cœur à la fois un peu vif et sensé, elle se fût si bien trouvée de vous et près de vous ! Elle se fût trouvée trop bien. Quand vous l’auriez mariée, il lui aurait fallu descendre. Décidément sa position est triste. Ce qu’elle aurait de mieux à faire, ce serait de retourner dans son pays, d’épouser un bon gros gentilhomme Allemand et de ne plus penser à tout ce qu’elle a vu et entendu sous votre toit.
Je n’avais plus pensé que les Holland étaient à Paris. Parlez- leur de moi, je vous prie. Lady Holland a été très bonne pour moi. Dites-lui que je regrette beaucoup de ne pas la voir et que je la prie de me garder, malgré cela ses bontés. Partent-ils, bientôt ? Vous m’avez dit que vous m’enverriez une lettre de Lady Clanricarde. Que devient M. Ellice ? Est-il vrai, comme je le vois dans les journaux, que Lord Durham ait déclaré qu’il resterait au Canada. J’ai peine à me figurer que je ne reverrai pas Lady Elisabeth Harcourt. Il faut que je redescende. La partie d’échec doit être finie.
Samedi 7 heures et demie
J’ai ici un petit jeune homme de 16 ou 17 ans du midi, un peu de mes parents, qui achève ses études au Collège Louis le Grand et que j’ai fait venir pour ses vacances. Henriette l’a pris sous sa protection. Hier deux heures avant que nous ne montassions en voiture pour notre promenade, elle est venue me dire tout bas : " Mon père, j’ai engagé Favié à aller à la promenade avec vous. Il dit que cela lui fera plaisir. " Je lui ai représenté qu’il fallait songer au plaisir de tout le monde, que Favié était un enfant dont la société amuserait peu les grandes personnes pour qui la promenade, se ferait qu’elle avait eu tort de l’engager sans m’en parler et Favié n’est pas venue. Mais je l’ai embrassée de bon cœur. J’aime des créatures qui s’occupent des autres et ne craignent pas d’agir par elles-mêmes, de prendre sous leur responsabilité pour obliger ou faire plaisir. Henriette sera une maîtresse de maison très attentive et très aimable et très décidée. Du reste, elle m’a fort bien compris.
10 heures
Pour Dieu, ne soyez pas malade. La lettre de ce matin me laisse tout à fait triste. Voici un triste bulletin de Mad de Broglie : " L’Etat ne s’est point amélioré. La journée d’hier avait été moins agitée ; mais la nuit l’a été davantage. La fièvre est forte. Les médecins ne voient point de nouveaux symptômes ; mais ceux qui s’étaient déjà montrés ne cèdent point. Onze heures. Le calme se rétablit." Adieu. Adieu. Soignez-vous. Il faut que je mette une enveloppe sous l’enveloppe. On ne fait plus que du papier transparent. Je ne crois pas que le principe de la publicité doit aller jusque là. G.
138. Paris, Mardi 18 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Que pensez-vous de moi et qu’allez-vous me répondre ? Depuis que je vous ai écrit hier je n’ai pas cessé de tourner et retourner dans ma misérable tête votre lettre et ma réponse et plus j'y pense et plus je me repends. J'excuse tout ce que vous me dites. Je me veux du mal de tout ce que je vous ai dit. Il me reste bien ce froid. " Il fait moins pour moi cette année ci que l’année dernière", mais je n’ajoute pas " il m’aime moins " ; je ne le crois pas, et toutes ces réflexions me ramènent à vous avec moins de chagrin que je n’en éprouvais hier ; et bientôt, bientôt au bout de tous les dialogues que j’établis entre vous et moi, j'arriverai à vous demandez pardon de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que j’ai pensé surtout, car j’ai encore plus pensé que je n’ai dit et mon imagination me sert si bien que d'ici à demain matin je croirai que tout est effacé, oublié, pardonné et que je sors seulement d'un mauvais rêve. Mais encore une fois que penserez-vous de moi, qu’allez-vous me dire? Je n'ai rien reçu ce matin, je l'ai bien mérité.
Mercredi 11 heures
Ma nuit a été bien agitée. J’ai reçu cette nuit vingt lettres, elles étaient toutes mauvaises. Je me réveillais entre chaque mauvaise lettre, pour me dire, " c'est bon signe " ; " c'est mauvais signe." Et quand le matin est venu, quand je suis entrée dans le salon où je déjeune, & que je n’ai point vu de lettre auprès de mon couvert, mon cœur s’est serré. Je suis descendue dans le jardin j’ai appelé le portier, il tenait à la main une lettre. Je ne savais si je devais l’ouvrir. J’espérais plus que je ne craignais, mais je craignais un peu et le cœur me battait bien fort. Enfin je l’ai ouverte et j’ai poussé un de ces longs soupir, de ces soupirs qui vous soulagent après une grande fatigue. Vous m’avez dit tout ce qu'il me fallait ; vous me l’avez dit comme je le voulais, et il me semble que nous nous aimions mille fois mieux depuis ces terribles quatre jours. Et je crois que j'ai bien fait d’avoir perdu la tête parce que je me retrouve si bien, si bien aujourd’hui. J'aurais pour un mois de récit à vous faire sur l’histoire de ces quatre jours. Ces récits seraient interrompues pas mille adieux. Que d'émotions j’ai éprouvées ! Et cependant c'est une histoire si simple, une seule pensée. Enfin, enfin tout est fini. Mais que j'aimerais à vous le dire de près !
Dites-moi, dites-moi tout. Vous avez douté de moi, je le vois. Nous étions des personnes bien éclairées sur le compte l’un de l’autre, il faut en convenir ! Et vous vous vantez de me si bien connaître ! Moi je ne me vante de rien, je n’ai pas une prétention, mais une ambition de cœur immense. Je suis insatiable. Je veux que vous m’aimiez. Dans tous les instants, toujours. Aujourd’hui je suis si contente. Et j’ai été si malheureuse. Je ne le serai plus n'est-ce pas ? Je ne puis rien vous dire encore aujourd’hui qui sorte de mon seul et unique sujet de préoccupation. Tantôt je reviendrai à vous pour vous parler d’autre chose, car bien des choses m’ont passé, sous les yeux depuis vendredi ; je vous enverrai copie de la lettre de mon mari. Pour aujourd'hui vous n'aurez que moi, moi toute seule, avec tout ce que j’ai pour vous d'amour, d’amour éternel. Adieu.
138. Val-Richer, Dimanche 23 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai mal dormi. Je me lève ennuyé de ne pas dormir. Je ne veux pas que vous soyez malade. J’ai peur que la pauvre Duchesse de Broglie ne le soit beaucoup, beaucoup. Les spasmes se sont emparés d’elle. C’est son mal habituel même en santé. Elle a toujours passé la nuit à rêver, à s’agiter, assiégée par le cauchemar, et plus fatiguée, en se réveillant qu’en se couchant. Il parait qu’elle est dans un état nerveux déplorable. Le mal violent est venu à la suite d’une imprudence qu’elle a faite, il y a quinze jours se croyant débarrassée d’une petite fièvre de rhume. Elle avait faim ; elle a mangé du poulet. Cela a déterminé des accidents intestinaux qui ont bouleversé toute sa personne. On dit que, dans les meilleures chances la maladie durera au moins 40 jours. J’ai horreur de ces longues maladies, qui ne sont pas domptées dans la première semaine. Ni la force de celui qui souffre, ni la science de celui qui veut guérir, ne suffisent à une si longue carrière. Je les ai tant vues s’épuiser l’une et l’autre !
Quel abyme entre ce que nous souhaitons, et ce que nous pouvons entre l’énergie de nos sentiments et la misère de nos moyens. Je l’ai vu cet abyme ; j’y suis tombé. Je n’y puis croire. Il me semble impossible, absolument impossible que des affections si profondes, des vœux si ardents, toute l’âme attachée à une seule pensée à un seul effort, n’aient qu’une si pauvre puissance. Toute ma nature se refuse à cette cruelle conviction. Et quand je la sens venir, quand je me vois au terme du savoir et du pouvoir humain, je fais comme les plus simples, je me réfugie dans la prière, cette tentative d’attirer, par un désir immense et vrai, la force de Dieu au secours de notre faiblesse. Je ne sais ce que peut la prière ; je ne prétends pas entendre la réponse de Dieu à ce cri de l’homme. Mais que Dieu n’écoute pas, que le cri de l’homme se perde dans l’air comme le bruit du vent, que notre âme ne puisse, en faveur de ceux qu’elle aime infiniment, rien de plus que ce qui se voit ici bas, je ne le crois point, je ne le croirai jamais. Et je prierai toujours, dût ma prière échouer toujours. Je puis me soumettre aux plus terribles volontés de Dieu, non à la certitude de mon impuissance après de lui, et j’aime bien marcher dans les plus épaisses ténèbres que rester immobile avec désespoir, sûr qu’il n’y a aucun moyen d’arriver.
9 heures
Je vous ai quittée. J’étais trop triste. Avec vous, je me défends de ma tristesse. Je crains pour vous la contagion. Pardonnez moi quand je me laisse aller. Je vous aime beaucoup, & je le sens au moins autant quand je suis triste que dans mes meilleurs moments. Votre grand Duc va-t-il décidément mieux ? N’a-t-on plus de crainte ? Savez-vous qu’il est fort connu que c’est la brutale imprévoyance de son père qui a failli le tuer ? Les hôtes que j’ai ici me le disaient hier ; et ils ne le tenaient pas du tout de moi. Ils me quittent aujourd’hui, M. Duvergier de Hauranne ce matin. M. Rossi ce soir. Mes nouvelles sont que le Ministère est de nouveau sérieusement inquiet de la Suisse. Louis Buonaparte ne s’en ira pas. Le parti radical suisse et Français, avec lequel, il est en intelligence, lui défend de s’en aller. Et puis, il est sot au-delà de tout ce qui se peut imaginer. Il y a quelques année, à Florence, il envoya chercher en toute hâte un homme d’esprit que je connais voulant de lui un conseil. Il lui montra une lettre de Corse où on lui promettait 1500 hommes, s’il voulait aller les chercher, et débarquer avec eux en France. Son conseiller l’en détourna, l’assurant qu’il ne réussirait pas. " Mais pourquoi donc ? Mon oncle l’a bien fait avec la moitié. " L’avis de M. Hess de Zurich, qui veut qu’on demande à Louis B. de s’expliquer catégoriquement et de déclarer s’il est français ou suisse, pourrait bien offrir une issue. Il sera peut-être difficile à L. B. de dire officiellement et décidément qu’il n’est plus français. Je sais qu’on attend quelque chose de là. Probablement on a tort. En telle situation, le plus grossier mensonge ne coûte rien et ne fait pas grand chose, car il ne trompe personne.
9 h. 1/2
Elle est morte. Je viens de recevoir un mot de son mari. Je pars pour Broglie dans deux heures. Adieu. Adieu. G.
139. Broglie, Lundi 24 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai trouvé ce malheureux homme désolé et soumis. Je passerai ici deux jours jusqu’à ce que son fils Albert, qui voyageait pour son plaisir soit arrivé demain, ou après-demain. Dès qu’il aura son fils, il ira avec lui au devant de sa fille, dont les lettres arrivent encore pleines des fêtes de Milan. Le maladie a été une fièvre cérébrale, très rapide à la fin. Le délire a été à peu près constant pendant les derniers jours avec plus de souffrance apparente que réelle. J’avais pour elle une vrai amitié et elle en méritait beaucoup. Tout le pays est désolé. Elle faisait un bien immense, & bien plus encore avec son âme qu’avec son argent. Elle s’est crue en grand danger au commencement, quand personne ne le croyait. Plus tard ; elle n’y croyait plus. Je n’ai pas encore votre lettre d’aujourd’hui. J’espère qu’elle me viendra dans la journée, demain matin au plus tard. J’ai besoin de l’avoir. Adieu. Je retourne auprès de ce pauvre homme. Les obsèques ont lieu ce matin, tout à l’heure. Elle restera à Broglie.
Adieu Adieu.
Mots-clés : Deuil
139. Paris, Jeudi 20 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Quelle lettre charmante ! Que je vous aime ! Voilà de mauvaises journées excellentes, elles ont tout ramené, rétabli. Et je me sens heureuse ! Maintenant reprenons un peu l'arriéré. Je veux vous parler de mon mari. Voici la copie textuelle de sa lettre. Lady Granville jure encore que le silence était commandé par l'Empereur mais que voyant que j’étais prête à l’accuser haut & ferme comme j’avais fait sur la question de l’argent, il a commandé à mon mari de m'écrire. C’est un peu for fetched je crois, cependant il faut convenir que mon mari n’explique rien. Mon frère n’arrivait que le lendemain. J'attends ce qu'il me mandera sur ses entretiens avec mon mari. Je viens d’adresser une lettre à Bâle, sans récrimination, & reprenant le ton du journal.
Marie est partie. Le conseil de mes amis Granville (car elles ont tenu conseil. Lady Granville, Mad. Appony & la petite Princesse) est qu'à son retour on exige d'elle un changement total de manières envers moi ; ou bien que je la renvoie à ses parents.
Lady Granville est pour moi plus charmante que jamais. Les Holland sont désolés de ne pas trouver un seul grand homme à Paris. Je ne leur laisse pas le moindre espoir. Enfin ils se rabattent sur Berryer que je promets un jour. Je vais lui écrire. Lord Holland a eu un long tête-à-tête avec le roi hier. Mylady ne peut pas être reçue à la cour ne l’étant pas à la cour d'Angleterre. Je crois que le Roi se propose de la surprendre le jour où elle ira visiter Versailles. J’ai dîné chez Lady Granville. Avant-hier à Chatenay, hier chez la petite Princesse.
Je devais aller à Chatenay en tête-à-tête avec Humboldt. Palmella est venu le rompre, nous y avons été à trois. Humboldt plus bavard qu’il n’est possible d'imaginer même après l’avoir entendu, et d'une indiscrétion complète. Je vous manderai un autre jour toutes les curieuses confidences qu'il m’a faites. Nous avons trouvé à Chatenay mon ambassadeur qui était fort chagrin que je n'y fusse pas venue avec lui, mais il aime la voiture fermée que je déteste. Le chancelier impayable. Je n’ai rien vu qui ressemble plus à la province. M. Salvandy un peu rêveur, mais se posant toujours, Madame de Castellane agaçant Palmella. M. & Mad. Ducazes, lui, qu'il m’est impossible de comprendre ; & elle impossible de regarder le baptême est décidément remis au 1er de mai.
Les chambres se réuniront le 15 Décembre. Voilà les nouvelles qu'on y disait.
Lady Elisabeth Harcourt vient de mourir subitement à Milan, deux jours seulement de maladie. Une inflammation d’entrailles. C’est très frappant cette mort. Elle avait l’air si vivante, si animée. Je suis très inquiète de ce que vous me dites de Mad. de Broglie. Ne manquez pas de me dire tout ce que vous en savez. J’ai les nerfs très mauvais aujourd’hui. Je ne puis rien faire posément. Je me hâte. Je griffonne. Connaissez-vous cela ? Comme il y a longtemps que nous ne sous sommes écrit tout ! Il me parait que j'ai un arriéré d’un an.
Le Roi de Bavière est tombé malade de la fatigue que lui a donné l’Empereur. Il l’a tenu 7 heures à cheval, & qu’il n’avait jamais fait de sa vie. Partout on est bien aise de voir finir en visite. Les Affaires vont mal en Suède. Tout le nord de l'Europe est en assez mauvaise disposition. L'armistice de Milan est superbe. C'est l’Empereur tout seul qui l’a voulu. M. de Metternich n'y a pas la moindre part. N’est-ce pas étrange. Ce pauvre imbécile n’a eu qu’une seule volonté, et celle-là et le plus grand, le plus généreux acte la plus habile coup d’état. On parle beaucoup des tendresses entre M. de Metternich & Thiers. M. de Ste Aulaire le mande à M. Ducazes avec détail. Les Anglais sont très fâchés du change ment de ministère en Espagne. Les Affaires y vont très mal pour la reine. Mais vous verrez que don Carlos ne saura pas en tirer parti du tout.
Adieu. Adieu. Nous nous aimons beaucoup, beaucoup. C'est charmant ! Vous ne manquez pas de continuer n'est-ce pas ? C’est-si joli d'être bien aimée. Adieu.
140. Broglie, Lundi 24 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens d’accompagner le cercueil avec toute la population des environs vraiment éplorée. Elle est enterrée aux pieds de sa fille Pauline. Deux excellentes et charmantes créatures ! Il y a quatre ans, je suis entré dans ce cimetière, avec mon fils qui regrettait profondément cette jeune fille, et à qui Mad. de Broglie, avait donné la clef de la petite enceinte qui leur est réservée.
Bientôt, je n’aurai plus personne à qui parler de mon passé personne qui l’ait connu et aimé. La mort emporte bien plus qu’il ne paraît. Quelque chose m’a manqué dans ce cimetière, de la prière, un prêtre. Il n’y a ici que des catholiques. Toute la population était bien là, mais des prêtres, non. J’ai eu envie de les remplacer, de prier tout haut. Je ne l’ai pas fait. Je ne supporte pas la mort sans Dieu. Quand une âme s’en va, il faut qu’il soit là pour la recevoir. Je retourne auprès de ce pauvre homme qui est très courageux, mais vraiment bien désolé. Est-ce que je vous fais mal en vous disant ce qui me traverse l’âme ? J’espère que non.
5 heures
Mad. de Stael vient d’arriver. Elle a fait 170 lieues sans s’arrêter. Il est trop tard. C’est une bien malheureuse personne. Elle a tout entrevu, mari, enfants, sœur, bonheur intime, bonheur extérieure, et n’a rien entrevu que pour le perdre ! Je retourne demain chez moi. Je partirai après déjeuner. Je n’ai pas eu votre lettre aujourd’hui. Je l’aurai demain matin, et j’en trouverai une autre en passant à Lisieux. Si les accidents n’ont pas cessé, tenez-vous bien bien tranquille. Lady Granville a encore raison. L’immobilité est le vrai remède. Je lui sais gré d’être toujours aussi aimable pour moi. Elle vous le doit bien. Vous lui êtes de si bon secours pour amuser son mari !
Mardi 7 heures
Je n’ai jamais vu un tel rideau de pluie, si épais qu’il cache absolument la campagne. Peu importe du reste dans ce lieu-ci. Le soleil n’y égaierait personne. Le soleil reviendra. Ceux qui sont tristes s’en iront. Et un jour, je ne sais quand, mais pas loin, car rien n’est loin, tout passe si vite, on se plaira, on sera gai, dans ce lieu-ci comme ailleurs.. J’ai horreur de cette brièveté de toutes choses. Pas toutes n’est-ce pas ? Albert arrive aujourd’hui. Le pauvre enfant sait à peine le danger. Il aimait tendrement sa mère. Dès qu’il sera arrivé ils partiront tous pour Paris, et de là le Duc de son fils iront au devant de Mad. d’Haussonville. Je vais me retrouver seul chez moi. J’en suis bien aise. J’ai vu assez de monde. Trois ou quatre personnes doivent encore venir, mais dans huit ou dix jours seulement.
Adieu.
J’ai besoin de vos lettres. Comment former une conjecture sur ce que fera ou ne fera pas M. de Lieven ? Ses liens avec vous, sa qualité de mari, de père, de gentleman, tout cela n’entre pour rien dans sa conduite. Un autre décide de tout ; et cet autre qui peut deviner sa fantaisie, son humeur du moment. Il y a deux vices radicaux dans la nature humaine, la légèreté et l’arrogance. La situation despotique les développe l’un et l’autre au delà de que ce qui se peut imaginer. On ne vous écrira pas. Et puis on vous écrira. Il n’y a à compter sur rien. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
Mots-clés : Deuil, Discours du for intérieur, Vie familiale (Dorothée)
140. Paris, Vendredi 21 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Que j'aime vos lettres ! Je vous en remercie tendrement. C’est juste, et il y a long temps que je le pense, il n’y a pas de sécurité complète sans bonheur complet. Et la seule ressource est de vivre dans le même lieu. J’aurai des instants, des heures d'angoisses, mais pas des jours. et tant de jours comme ceux qui viennent de se passer. Savez-vous qu'au bout de tout cela je suis un peu malade. Mes nerfs sont un vilain mouvement. Ce n’est pas dans le moment de l'inquiétude que je suis malade ; c’est après l’inquiétude passée que tout mon frame is shaken. Je suis comme cela depuis hier.
Fagel m’a accompagnée dans ma longue promenade hier. Nous avons été à St Cloud par un temps charmant. La pluie nous a reconduit à la maison. J’ai dîné seule et vite, ce qui est très malsain. Le soir on est venu. Sir George Villers & sa sœur qui est une personne charmante. Lui me plait comme il m’a toujours plu. De bien bonnes manières, une conversation. charmante, et de l’élégance dans sa figure. Pahlen et Armin le regardaient avec horreur. Je me suis empressée de le leur présenter pour forcer à un peu de politesse. Quelle idée de haïr quelqu'un pour sa politique ! Le prince Schevaremberg ne manque pas de venir chez moi. Il a un laisser aller qui serait de la très mauvaise compagnie s’il n’était un très grand seigneur. Au reste avec ses étranges façons il a toujours un air très respectueux ce qui appartient au grand seigneur. Il me rappelle beaucoup lord Melbourne un gentleman farmer avec beaucoup de bonhomie.
La reine d'Angleterre est tombée de cheval l’autre jour. Melbourne montait à côté d’elle, il ne s’en est pas douté. Il avançait toujours. Mon grand Duc ne va plus à Baden, je suis tout-à-fait déroutée, j’attends avec impatience ce que me dira mon frère. Si l’Empereur imaginait de le ramener en Russie. Mon mari pourrait venir me voir. Enfin nous verrons. Je devais aller dîner à Versailles aujourd’hui chez Palmella. Mais je viens de lui écrire pour m'en excuser. Les temps n’est pas beau, et surtout je ne me sens pas bien, il faut que je me ménage. L’affaire Belge n’ira pas et le roi des Pays- Bas pourra dire à ses états que le 22 mars il a proposé de reconnaître les 24 articles, et qu'au mois de Septembre encore la conférence n’a fait aucune réponse à cette proposition, et les états voteront le budget. Vraiment je me sens malade, je ne puis pas continuer ma lettre, je vais essayer de me coucher, mais c’est si ennuyeux.
Adieu. Adieu, je relirai votre lettre, je la répéterai, car je vous adresse tout ce que vous m’adressez. Adieu encore with all my heart.
141. Paris, Samedi 22 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m'avez écrit une courte lettre, mais bonne, & tendre et aimable. Vous voulez des détails sur ma santé. Certainement les mauvais jours qu'il y a eu entre nous m'ont fait du mal ; je suis très faible, très nervous, et depuis dimanche J’ai des accidents que je croyais qui n’arrivaient qu'aux jeunes filles. Vous voulez tout savoir. Vous voyez que je vous dis tout. Il en résulte que je marche à peine tout me fatigue. Je n’ai pas fait venir le médecin cependant. Lady Granville m’assure que ce ne sera rien et qu'il faut seulement me tenir plus tranquille. Je crois à Lady Granville en toutes choses. Je l'ai vue hier deux fois le matin et le soir. Le temps a été affreux, il n'y a pas un moyen de songer à sortir. Palmella m’aura attendue à Versailles.
J’ai dîné seule, très seule ; je me suis bien ennuyée après car je ne puis pas lire et mon ouvrage est une pauvre ressource. Eh bien, si vous avez raison de dire que la lettre comme le silence sont du fait de l’Empereur, que croyez-vous donc qui s’en suive ? Mon mari continuera-t-il à m'écrire ? Je suis extrêmement curieuse de la première lettre de mon frère et je suis fort étonnée de ne pas l'avoir reçue encore. A propos, mon mari avait menti, il n’a point changé de religion, les journaux allemands disent qu’arrivé à Bayreuth, où il avait fait sa première communion, il est allé droit à la même église et y a commencé après avoir été visiter la veuve d’un vieux précepteur allemand chez lequel il a passé quelques années de son enfance. Tout ceci me fait grand plaisir, et je m'en vais le lui dire.
Il n'y a pas une pauvre nouvelle ici, et je suis peu en train d'écrire, même de vous écrire, c’est beaucoup ! Je suis si lasse, si faible, mes genoux sont si faibles. Marie m'écrit de Rochecotte, Melle Henriette lui fait des confidences sur Mad. de Dino qui font, que Marie aurait grande envie de prendre la diligence et de revenir. J'espère que mon fils Alexandre sera ici à la fin de la semaine prochaine, cela me fera un bon moment, mais il sera court. Je suis bien inquiète de Mad. de Broglie. Hier M. Chomel et le général Lascours sont partis pour Broglie. On disait beaucoup qu'il y avait peu d’espoir. Quelle triste chose ! Adieu. Adieu. Je vais dîner aujourd’hui chez Lady Granville, je croise que c’est un dîner officiel pour Lord Holland. Il a eu deux heures d’entretien avec le roi. Lorsqu’il en est sorti, il a dit a damne fellow. Adieu comment faire pour reprendre des forces. C’est si bête d'être faible adieu.
Mots-clés : Décès, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
141. Val-Richer, Mercredi 26 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai cette pauvre femme devant les yeux. Je l’ai vue sur son lit de mort. Elle n’était pas changée du tout, les traits parfaitement calmes et l’air jeune. Elle est morte pourtant à la suite d’un long délire, d’un délire de plusieurs jours, mais sans violence, sans idée fixe ; rien n’indiquait un grand trouble intérieur. Toute sa vie repassait devant elle, sa mère, ses frères, sa fille Pauline, ceux qu’elle avait perdus, ceux qui lui restaient confusément, rapidement, en général doucement. Elle a souvent parlé de moi ; elle causait avec moi. Dès l’invasion du mal, sa faiblesse était extrême ; elle se soulevait à demi, joignait les mains et commençait une prière qu’elle n’achevait pas. Elle s’est crue très malade dans les premiers jours ; puis cette idée lui a passé. Elle désirait beaucoup de guérir. Elle se trouvait mieux depuis un an ou deux ans, et infiniment plus calmes qu’elle n’avait jamais été. Elle ma dit bien des fois : " La jeunesse ne m’allait pas ; à mesure qu’elle s’en va, je me sens plus de force et de sérénité. " Elle a fait un testament qui n’est pas encore ouvert. Je serais resté plus longtemps avec son mari si j’avais dû le laisser seul. Mais sa belle sœur est arrivée et il attendait son fils hier soir ou ce matin. Il sera à Paris dans quatre on cinq jours, et n’ira pas à plus de 20 ou 30 lieues au devant de sa fille. Il est calme.
Il m’a beaucoup touché hier matin. Tous les jours, avant le déjeuner, la famille faisait la prière dans la bibliothèque. On lisait un chapitre de l’évangile, une ou deux pages de méditations pieuses et l’oraison dominicale. C’était mad. de Broglie, qui lisait. Il a fait recommencer hier et l’a remplacée. J’espère que sa fille viendra vivre avec lui. Cependant il y a des obstacles. M. d’Haussonville, a aussi son père et sa mère qui sont vieux et sourds. Albert de Broglie sera beaucoup pour son père. Il est distingué et affectueux.
Vous vouliez des détails. Je me repose ici. J’ai le cœur fatigué. Vos lettres sont bien bonnes. Mais ne vous laissez pas aller à pleurer. Vos pauvres yeux n’en ont pas besoin.
9 heures.
Je viens de passer une demi heure, avec mes enfants dans mon cabinet. Il m’aiment beaucoup. Je mentirais si je disais que votre pensée me les gâte ; non, je jouis beaucoup de leur présence, de leur affection. Mais votre pensée est toujours là, toujours. Je vous aime beaucoup. J’ai besoin de tout ce qui vous manque. Que ne puis je vous faire jouir de mon bien comme je souffre de votre mal ? Mon petit Guillaume à le meilleur cœur du monde. Quand il me voit triste, il redouble autour de moi de gaieté et de caresses. Et s’il ne réussit pas à me distraire, il s’arrête tout à coup, un peu confus, comme s’il avait fait une sottise.
Je vois que j’ai deviné juste, sur l’expédient que la suisse prendra envers Louis Buonaparte. On lui posera la question. Elle a été inventée dans le dessein. Si on ne la lui pose pas, il aura tort de transporter son quartier général à Genève. Genève n’est pas un canton radical malgré le vote de son député à la Diète. Thurgovie au Bâle campagne lui conviennent mieux. Je ne crois à aucune querelle sérieuse, pas même par lettres, pour le blocus mexicain ou la côte d’Afrique. Ni l’un ni l’autre Cabinet ne veut se quereller. Ils ont bien assez de peine à vivre. Cependant je ne crois guère non plus aux pronostics de Lord Aberdeen. L’Irlande ! L’Irlande tant que cette question-là ne sera pas vidée, les Whigs et les radicaux tiendront ensemble.
10 heures
Adieu. Le temps est mauvais en effet. Nous n’avons pas eu d’été. Pardonnez-moi la tache qui vient de se faire, je ne sais comment, sur cette lettre. Je serai bien aise de vous savoir à Le Terrasse. Adieu. Adieu. G.
142. Paris, Dimanche 23 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ne vous inquiétez pas de moi. Je suis très faible, voilà tout. Je viens d'envoyer chercher Cheremside. Je voudrais qu’il me redonnât des forces. C'est singulier comme tout à coup elles m'ont abandonnée. M. Molé était fort tendre hier, et moi aussi. Il me reproche d'être prise & conquise, mais il s’y accoutume. Il soigne beaucoup Lord & Lady Holland. Il a pris goût à Sir George Villers qui est en effet un très aimable homme. Il n’y avait hier que mon Ambassacleur du corps diplomatique. Messieurs Pasquier, Decazes, Salvandy. Jeudi M. Molé reçoit chez lui les Holland. On s'occupait beaucoup hier de cette pauvre Duchesse de Broglie. On la dit ici plus mal que vous ne dites.
Je suis parfaitement ignorante de mon mari, les journaux allemands prétendent que mon frère n’est resté que deux heures à Weymar. Que l’Empereur l’a fait partir immédiatement en mission secrète. Cela parait incroyable à Pahlen & à moi. Il n’est pas des gens qu'on envoie, il est de ceux qui envoient les autres. Cependant son silence me ferait croire qu'il n’a pas résidé à Weymar. Et je reste sans nouvelles. On a fait venir les grandes Duchesses aînées pour les faire voir à leur grand père. Il n’y a pas une autre raison. On ne les avait pas prises dans le voyage en Allemagne tout juste pour ne point faire penser qu'on les promenait pour chercher des maris.
Je ferai votre message à Lady Holland. Ils restent ici jusqu'au commencement de Novembre. Vous pourrez donc encore les voir. Je n’ai point de nouvelles à vous dire et il me semble en même temps que je trouverais à causer avec vous aussi longuement que cause M. de Humboldt. Vraiment les lettres sont un pitoyable moyen d'entretien. Mille petits symptômes peuvent être relevés en conversation, & ne sauraient l’être en s’écrivant, je trouve cela plus vrai tous les jours.
On croit assez généralement que Louis Bonaparte va quitter la Suisse. M Molé n’a pas l'air d'avoir le moindre souci. Il n'oublie pas qu’il est premier ministre depuis plus de deux ans. & il pense que ce qui a duré si long temps a par la même acquis des chances de plus de durer encore. Voilà Cheremside qui me quitte ; il me dit que ce n’est rien, que cela tient à mon état général, et qu’il ne veut y faire attention que si cela augmente. Vous voyez que je vous dis tout.
Adieu. Adieu. Je pense à vous sans cesse croyez le bien. Je dîne aujourd’hui chez M. de Pahlen avec toute l’Autriche, mais je veux prendre beaucoup de bois de Boulogne avant car le temps est beau. Adieu encore mille fois.
142. Val-Richer, Jeudi 27 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis remis hier à travailler. C’est une grande ressource qui vous manque. Après les plaisirs de l’intimité, je n’en connais pas de plus efficace pour distraire, et même reposer d’une impression douloureuse. Avant de m’enfermer dans mon cabinet, j’ai fait faire une longue promenade à ma mère. Elle est très affligée. Mad. de Broglie avait pour elle un respect, une affection, une confiance filiale, et les lui témoignait avec un extrême abandon. Ma mère en était très touchée depuis trois jours elle me répète sans cesse : " Prendre une telle amitié à mon âge, pour une cette fin ! "
J’ai une profonde pitié des chagrins de la vieillesse. Elle a droit au repos du cœur comme du corps. D’ailleurs ils sont rares. L’âge refroidit les peines comme les joies. Il n’en est rien pour ma mère. Elle a le cœur aussi vif qu’il y a quarante ans. Je l’ai fait marcher une heure et demie. Elle en était un peu lasse hier soir, mais beaucoup plus calme. Je suis sûr qu’elle aura mieux dormi.
Je ne crois guère à l’émeute de Genève. Ce serait un grand argument contre la politique dont se charge M. Molé ; Genève est une ville française. Il y faut je ne sais quel degré d’irritation pour qu’on y éclate contre les Français. M. de Metternich doit sourire, un peu. Thiers travaille aussi. Mais au fond, d’après ce qui me revient, il est très animé et se propose de le témoigner à la prochaine session. Nous verrons bien. Il restera en Italie jusqu’au mois de novembre. Ce sera le moment du retour universel.
Je serai bien aise de retrouver les Holland à Paris autant qu’un plaisir peut être quelque chose à côté d’un bonheur. Vous devriez bien d’ici là rassembler tout ce qui vous reste de ce que vous avez écrit sur tout ce que vous avez fait ou vu. Je suis sûr qu’il y a je ne sais combien de choses, petites ou grandes, que je ne connais pas. J’ai envie de toutes. Le papier sur la mort de Lord Castlereagh est-il décidément perdu ? Faites cela en rentrant à la Terrasse. Là où je suis indifférent, je ne suis pas curieux. Mais où est mon affection, ma curiosité est insatiable. J’ai beaucoup plus envie du moindre petit papier que de Lady Burgherch. Les femmes distinguées manquent partout. L’Angleterre ne m’a encore montré que Lady Granville, et si vous voulez, Lady Clanricard. A propos, vous ne m’avez pas envoyé sa lettre.
10 h. ¼
Mon facteur arrive tard ce matin. Je n’ai pas de nouvelles de Broglie, ce qui me prouve qu’Albert n’est pas arrivé. Je suis impatient qu’il ait rejoint son père. J’avais pensé à votre prédiction. Je vous remercie de vous ménager. La fatigue ne vous vaut. rien. Soignez-vous pour le mois de novembre. Je ne comprends pas qu’on se laisse mal traiter par Lady Holland. Passe pour son mari, s’il l’aime. Car il faut aimer pour supporter. Du reste les impertinents ont raison puisqu’on les supporte. Je vous conseille d’écrire à votre mari. Toutes les fois qu’il renoue le fil, n’importe pourquoi vous devez le ressaisir. Vous l’avez dispensé d’explication. Cela vous dispense de reproche. Les confidences de Mlle Henriette ne tracassent donc plus Marie. Adieu. Tout à l’heure, en lisant votre adresse en Courlande, j’ai eu envie de vous répondre par la première phrase de mon testament. Je ne le ferai pas. Adieu. G.
143. Longchamp, Dimanche 23 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis ici toute seule et bien triste. Je viens d’apprendre la mort de Mad. de Broglie. Je ne saurais vous dire ce que cela m’a fait éprouver. J’ai versé de silencieuses larmes. L'heureuse femme ! Personne n’a mieux mérité le ciel. Comme elle a été charitable, comme elle a été bonne pour moi. Je lui en ai trop peu montré ma reconnaissance. Mais il me semblait que je l'ennuyais un peu, & cette crainte a fait que je me suis approchée d’elle moins souvent que je ne le désirais. Son pauvre mari ! Quelle perte ! Je viens de sa maison où j’ai appris cette affreuse nouvelle. J’ai traversé le bois de Boulogne en pleurant. J'arrive ici je pleure, et je vous écris parce que j'ai besoin de pleurer auprès de vous.
Lundi
Je vous demande pardon de cette feuille de papier, je n’ai pas trouvé autre chose à Longchamp. Je continue. Votre lettre ce matin est aussi triste que moi. Je pensais bien hier en pleurant, que dans ce même moment vous pleuriez, et à Broglie. Restez y. Dites-moi comment est ce pauvre duc, dites-moi des détails. Je ne pense pas à autre chose. J'ai les yeux bien rouges ce matin. Hier j'ai été obligé de faire les honneurs d’un grand dîner chez M. de Pahlen. J’étais si triste que j'ai bien mal rempli mes devoirs. Le soir il m’a fallu aussi recevoir mon monde habituel. Mais à onze heures j'ai levé la séance, car je n'en pouvais plus. Il m’était venu beaucoup de monde. Ce que j’ai appris de plus nouveau c’est les dernières nouvelles que votre gouvernement a reçu sur Louis Bonaparte. Si la diète lui demande d’opter entre sa qualité de Français & de Suisse, il répondra qu’il est français, et il sortira immédiatement & spontanément de Suisse. Si cette question ne lui est pas posé, il ira établir son quartier général à Genèves. L’affaire Belge est dit-on rompue par le fait du Roi des Pays-Bas c-a-d qu’il ne veut aucune modification aux 24 articles. Ceci était un on-dit mais pas encore officiel. J'ai eu des lettres de Lord Aberdeen, & de M. Ellice. Lord Aberdeen ne comprend pas que l'Angleterre puisse éviter des discussions très sérieux avec la France au sujet du blocus en Amérique, and some procedings au the coast of Africa. Cela lui semble très grave.
Il parle du ministère anglais avec le dernier mépris et il ne croit pas possible qu'il résiste vu de que ce sentiment de mépris devient tout à fait général. Il dit aussi que depuis le protecteur Sommerset il n'y a jamais eu d'homme dans une situation pareille à celle de Lord Melbourne et que son pouvoir sur la Reine est absolu. Ellice n'attend les réponses de Lord Durham que le 8 du mois prochain. Il est d’opinion que Durham restera au Canada j'ai essayé hier de marcher, j'essaierai. encore aujourd’hui.
Mon fils Alexandre ne me reviendra que dans les premiers jours d'octobre. Marie le 7. Je passerai à la Terrasse probablement avant. Le grand duc est à Berlin. Je ne sais que ce fait. Je n’ai pas un mot de mon frère, ni de mon mari. Adieu. Je suis si accablée de cette mort. Je pense tant à cette angélique femme, à son pauvre mari, à votre chagrin car vous en avez beaucoup. Je vous aime, je vous aime de tout mon cœur. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Politique (Europe), Politique (France)
143. Val-Richer, Jeudi 27 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avez-vous décidé le jour précis de votre retour à la Terrasse ? Dites-le moi, je vous prie. Tout à l’heure, en rentrant dans mon cabinet, j’ai été vous y chercher, couchée au fond, sur le canapé vert. C’est là que je vais naturellement. La réflexion seule me mène rue de la Charte. Je ne sais si vous vous y trouvez chez vous ; pas moi. Si vous aviez été chez moi ce matin, réellement chez moi, ici, vous auriez pris plaisir à voir la joie de mes cygnes. Je ne sais ce qui les charmait particulièrement; ils battaient de leurs grandes ailes, couraient sur l’eau, plongeaient, s’envolaient, revenaient avec de vrais transports. Je crois qu’ils étaient contents l’un de l’autre. C’est la seule manière d’être content.
Je suis bien aise que vous ayez pris votre parti a l’égard de Marie. Ne pêchez pas dans l’exécution. Pour peu quelle ait de bon sens, elle s’arrangera comme il vous convient et comme le veut la raison. Et si elle ne s’arrange pas, c’est qu’elle n’a vraiment aucun bon sens. Vous m’avez parlé de sa sœur comme ayant plus d’esprit. Seriez-vous tenté d’en courir encore la chance ?
On fait réellement un armement sur la frontière de Suisse. Trois brigades, de six bataillons chacune, environ 15000 hommes , si c’était sérieux, ce serait trop peu. Le Roi a eu querelle avec les gens de la guerre. Il a voulu dix batteries d’artillerie. Ils n’en voulaient que quatre. On a querelle aussi avec le maréchal Vallée. Il veut plus que le budget en fait de troupes et on ne lui donne pas tout le budget. Je n’entends rien dire du procès Brossard qui va recommencer.
Vendredi 7 h. 1/2
Vous avez bien raison. Les lettres sont un pauvre moyen d’entretien. Nous nous disons plus en une heure que nous ne savons nous écrire en huit jours. Je ne connais rien de plus charmant qu’une conversation intime. Et on peut avoir tous les mérites du monde, et point ce charme-là.
Mad. de Broglie l’avait, surtout à cause du grand mouvement de son âme. Autrefois, au moindre prétexte, dès qu’elle se sentait atteinte par quelque côté, elle se mettait elle-même et toute entière dans l’enjeu de la conversation. Dans tout ce qu’elle disait quelque fois très loin, mais très clairement, on voyait la personne, une personne, très vivante, très intelligente, qui démêlait et saisissait sur le champ, partout, ce qui pouvait l’intéresser directement, intimement. On na jamais été plus femme qu’elle ne l’était par là. Depuis quelques années, elle avait réussi à s’oublier ou à à se cacher mieux elle-même, et à causer avec plus de désintéressement ou d’indifférence. Elle a laissé deux manuscrits intéressants, l’un est une espèce d’exposé de sa foi religieuse. J’ai lu celui-là. L’autre, un projet d’ouvrage sur la condition des femmes dans l’état actuel de le société. Elle m’en avait plusieurs fois parlé mais je n’en ai rien lu.. Ce n’est qu’un projet, mais long et le développé dans quelques parties. C’était une imagination prodigieusement active, et qui souffrait intérieurement de sous activité.
10 h. 1/2
Une pluie énorme a encore retardé mon facteur. Vous êtes bien triste. Hélas, je voudrais vous envoyer autre chose que de la tristesse. Quand je serai là, je tâcherai de vous apporter autre chose. De loin, aujourd’hui, je n’ai que cela, et mon affection, qui ne peut pas grand chose. Je le vois bien. Albert est arrivé à Broglie, avant-hier au soir. Ils vont à Paris aujourd’hui. La raison que vous supposez au défaut de prêtre n’a aucun fondement. C’est le temps qui a manqué. Peut-être aussi n’y a-t-on pas pensé. Pour moi, je suis arrivé le dimanche à 4 heures et les obsèques ont eu lieu le lendemain à 10 heures du matin. Il n’y avait pas moyen d’y faire penser. Aussi tendrement que tristement. Adieu. Adieu. Ma mère est assez bien.
144. Paris Mardi 25 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m'avez écrit une bien courte lettre de Broglie, j’attendrai mieux demain. Nous nous sommes promenées Lady Granville et moi hier au bois de Boulogne. Elle est très affectée de la mort de Madame de Broglie, comme l’est sincèrement tout le monde. C’était une personne bien aimée, bien admirée. J’ai été passer une heure de la soirée chez Lady Granville. On y recevait lors que j'en suis partie. Je me sens si lasse que je suis toujours pressée d’aller trouver mon lit.
Louis Bonaparte a demandé au ministre d'Angleterre en Suisse si gouvernement anglais lui permettrait de résider en Angleterre. Cela ne peut pas se défendre. Il est décidé à y aller. Cette nouvelle a fait grande joie à M. Molé. Je crois qu’elle n’est pas connue encore. Une dépêche télégraphique annonçant hier une émeute à Genève, & cette émeute dirigée contre les Français. On avait fermé les portes de la ville; Je ne vois pas cette dépêche dans les journaux de ce matin. Quand vous m'écrivez peu il me semble que je ne sais pas vous écrire du tout. Et puis je ne me sens pas bien sans cependant que je sois malade. Aussi je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter mais pour excuser mes pauvres lettres.
Je crois que le temps est malsain, l'air ne me rafraîchit pas, & je reviens de ma promenade toujours fatiguée quoique je ne marche point. On annonce quelques anglaises ici ; l’une Lady Burghersh, est une femme d'esprit & qui a une grâce infinie. Je crois qu’elle vous plaira. Je suis bien aise quand il arrive des femmes agréables. Il en manque bien ici. Adieu, adieu.
Mots-clés : Décès, Politique (France), Réseau social et politique, Santé (Dorothée)
144. Val-Richer, Vendredi 28 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir parlé de ma mère. Elle a été un peu souffrante. Elle est bien aujourd’hui, quoique très, très affligée. Mad. de Broglie était avec elle filialement. Mais je suis sûr que je vous en ai parlé. Ma mère d’ailleurs a une attitude admirable envers la douleur ; elle la supporte sans s’en défendre. Je n’ai jamais vu personne qui l’acceptât plus complètement sans s’y abandonner, qui en parût plus rempli et moins abattu. Elle y est comme dans son état naturel. Il n’y survient rien de nouveau pour elle et le plus ou le moins ne change pas grand chose à sa disposition, toujours triste mais toujours forte. Je l’ai fait beaucoup promener ces jours-ci. Je l’ai fatiguée. Et puis mes enfants ne la quittent guère. J’ai beaucoup travaillé ce matin. J’avais besoin aussi de me fatiguer. J’en suis convaincu comme vous. On ne comprend que les maux qu’on a soufferts. A ce titre, j’ai bien quelque droit à vous comprendre, pas assez peut-être. Il est vrai que je suis moins isolé. Que ne puis- je vous guérir au moins de ce mal-là ! L’autre resterait. Je l’ai vu rester. Mais ce serait celui-là de moins. Je ferai mieux de ne pas vous écrire ce soir. Je suis si triste moi-même que je ne dois rien valoir pour consoler personne, pas même vous que je voudrais tant consoler, un peu !
Samedi 7 heures
Je suis frappé du peu que nous pouvons, du peu que nous faisons pour les autres, et pour nous-mêmes. Dieu m’a traité plusieurs fois avec une grande faveur. Il m’a beaucoup ôté mais il m’avait beaucoup donné et souvent il m’a beaucoup rendu. J’ai reçu le bien, j’ai subi le mal. J’ai très peu fait moi-même dans ma propre destinée. Nous ne réglons pas les événements. Nous sommes pris dans les liens de notre situation. Nous oublions cela sans cesse. Nous nous promettons sans cesse que nous pourrons, que nous ferons. C’est notre plus grande erreur que l’orgueil de nos espérances. Voilà Louis Buonaparte éloigné. C’est une grande épine de moins dans le pied de M. Molé. La marque, en restera, mais pour le moment, il n’en sent plus la piqûre. Entendez-vous dire que la session soit toujours pour le 15 Décembre ?
Vous êtes bien bonne d’attendre mes lettres avec impatience. Qu’ai je à vous mander ? Point de nouvelles. Mon affection n’en est pas une. De près, tout est bon, la conversation donne une valeur à tout. De loin, si peu de choses valent la peine d’être envoyées !
9. 1/2
Je ne comprends, rien à cette incartade. Est-ce en effet une intrigue cosaque ou bien seulement quelque commérage subalterne qui sera monté haut, comme il arrive souvent aujourd’hui ? Je penche pour cette dernière conjecture. En tout cas, vous avez très bien fait d’aller droit à M. Molé. Il est impossible qu’il ne comprenne pas l’absurdité de tout cela et n’empêche pas toute sottise, au moins de ses propres journaux. Ne manquez pas de me dire la suite, s’il y en a une. Quelles
pauvretés !
Je suis bien aise que vous ayez un N°2. Je vous renverrai demain la lettre de Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Je reçois je ne sais combien de lettres qui me demandent des détails sur cette pauvre Mad. de Broglie. Est-il possible qu’on soit contraint de rabâcher, sur un vrai chagrin. Adieu. G.
145. Paris, Mercredi 26 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai reçu votre triste lettre de Broglie comment, pas de prêtre ? pourquoi ? Pourquoi n’avez-vous pas dit quelques paroles sur cette tombe ? Elles eussent été se belles, mais encore une fois, comment M. de Broglie n'a-t-il pas fait venir de Paris quelqu'un ? J’ai peine à lui pardonner cela, et je me sens cependant le cœur si attendri pour son malheur. Mad. de Broglie est placée comme j’ai demandé à l’être un jour. à leurs pieds. Informez vous bien alors si on a fait comme je le demande. Et d’avance voici mon adresse. Au Château du Prince Jean de Lieven, Mesotten près de Mitten en Courlande. N'oubliez pas cela.
Je disais hier à Lady Granville que dans un an Madame de Stael aura épousé le Duc de Broglie. Cela me semble une continuation si naturelle du passé. Ne le croyez-vous pas aussi ? Le Duc de Palmella est venu hier matin m’inviter beaucoup à venir à Versailles ; je le lui ai promis, & ce matin je viens de me dédire ; c’est trop loin, cela me fatiguerait, & il ne faut pas que je me fatigue. J’ai été à Auteuil avant le dîner ; & chez Lady Granville après. Il n'y avait que des Anglais. Lady Holland était en train de dire à chaque personne ce qui pouvait la blesser, ou la chagriner le plus. C’est sa manière. Aussi Lady Granville mourait-elle d'envie de prendre toutes ses roses & de les lui jeter à la figure. Elle déteste les roses et on les avait emportés par égard pour cette aversion.
Lord Holland parlait beaucoup du jugement porté contre les témoins d’un duel qui vient d'avoir lieu près de Londres. Les témoins sont condamnés à mort ! Il croit que le gouvernement éprouvera de l'embarras dans la commutation de la peine. La nation anglaise à une horreur invincible des duels. Aussi un Anglais supporte- t-il beaucoup avant d'arriver à cette extrémité. Marie est charmée de Rochecotte. Elle me témoigne un peu d'inquiétude dans sa lettre de ce que j’apprendrai à me passer d'elle. Nous avons tout concerté avec Lady Granville. Il y aura de sa part un changement total, ou bien nous nous séparerons.
Je n’ai rien à vous annoncer, pas de lettres d'Allemagne, que me conseillez- vous ? Dois-je écrire à mon mari à tout événement dans le nord de l'Italie, car je puis toujours adresser mes lettres à nos ministres. Ou bien dois-je attendre qu'il me dise où les lui adresser ? Vous avez copie de ce qu' il m’a écrit de Weymar. Regardez y, & dites-moi ce que je dois faire. Adieu. Adieu, très tendrement aussi comme vous me disiez adieu dans votre dernière lettre ?
Mots-clés : Réseau social et politique, Vie familiale (Dorothée)
145. Val-Richer, Dimanche 30 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens à M. de Pahlen. Ce qu’il vous à dit me paraît singulier à force d’être absurde. Que de tels propos fussent tenus en hiver, quand il m’arrive de rencontrer quelques fois chez vous Thiers le matin ; Berryer le soir, je le concevrais ; il ne faut pas aux commérages un meilleur prétexte. Mais à présent en l’absence de tout prétexte une correspondance quand vous n’avez pas écrit du tout, cela ne peut venir que de très loin, comme vous dîtes ou de très bas. Ce ne peut être qu’un retentissement des rencontres de l’hiver dernier, qui revient du bout du monde, ou un propos d’antichambre. Il est impossible que le Ministère quelque susceptible, quelque ombrageux que je le sache, quelque goût que je lui connaisse pour les rapports et les tracasseries de polices soit pour quelque chose là dedans. M. Molé vous aura, je n’en doute pas, édifiée de ce côté. Reste la supposition lointaine. Nous verrons. Il n’y a pas moyen de la vérifier sur le champ. Cependant elle me paraît bien invraisemblable. Je persiste à croire à des bavardages subalternes qui auront étouffé votre Ambassadeur. En tout cas, je lui sais gré de vous avoir avertie.
Je vous renvoie la lettre de Lord Aberdeen. Celle de Lady Clanricard est intéressante. J’en ai reçu une qui l’est assez ; de M. de Barante, d’Odessas, pleine de la Grèce et de la Turquie. Athènes et Constantinople. Deux choses surtout l’ont frappé. Colocotroni et Nicitas, les noms qui ont retenti héroïquement en Europe s’épuisant en intrigues et en humilités pour un traitement de 1500 fr. ; les Turcs qui ne sont plus Turcs ne disent plus Chiens de Chrétiens, confessent à tout propos leur infériorité et s’efforcent de nous imiter sans espérer d’y réussir. Il me dit en finissant : " Si les grandes puissances le veulent, s’il s’établissait quelque concert dans le patronage qu’elles exercent, le rajeunissement d’Eson ne serait pas impossible. La Turquie se transformerait peu à peu en un état subalterne qui prospérerait plus ou moins. Il se placerait au même rang que la Moldavie le Valachie ou la Grêce. Mais si la bonne volonté de chaque Cabinet demeure isolée et méfiante, le cadavre de l’Empire Ottoman tout en demeurant debout avancera chaque jour dans sa dissolution, et au premier incident il tombera en poudre. Le premier soin à prendre serait de faire cesser cet état provisoire et menaçant d’hostilité entre l’Egypte et Constantinople. Autrement nulle sécurité, nul progrès dans l’Orient. Je ne réponds pas qu’une telle résolution, soit possible à décider et à exécuter ; mais il m’a paru quelle était nécessaire. "
Je vous enverrais la lettre même, si elle n’était pas très longue et écrite si fin que vos pauvres yeux se perdraient à la lire. Vous avez la substance. Lord Aberdeen attache trop d’importance au Mexique et à la côte d’Afrique. C’est un reste de la vieille politique Torry, que cette disposition hargneuse à notre égard sur les petites choses, ne pouvant et ne voulant rien autre que les Whigs sur les grandes. Grandes et petites choses se tiennent. On se fait petit soi-même à retenir les secondes quand on abandonne les premières. Lord Aberdeen devrait porter dans sa politique extérieure, sa nouvelle disposition dont il vous parle pour ses relations privées. Party violence convient encore, moins aujourd’hui au dehors qu’au dedans, et national animosity doit être entirely subdued aussi bien que personal animosity. Du reste la simplicité tranquille et haute de son ton et de son caractère me plaît toujours beaucoup.
10 h.
Non je ne veux pas vous refaire ; n’on, je ne vous reproche pas votre franchise ; bien au contraire, je vous en aime. Et vous voyez bien que votre impression ne peut me déplaire puisque je l’ai eue avant vous, puisque c’est moi qui l’ai suscitée en vous. Mais vous ne connaissez pas ce pays-ci. Vous ne savez pas ce que c’est qu’un village tout catholique, et les habitudes qui en résultent dans la famille Protestante la plus pieuse. A demain les détails, car je veux vous répondre avec détail. Je ne veux pas qu’il vous reste sur le cœur autre chose, qu’un regret. Adieu Adieu. Je suis fort aise de votre conversation avec M. Molé. Cela empêchera toujours quelque chose. Adieu. Calmez-vous au moins sur les loups. Un long adieu. G.
146. Paris, Jeudi 27 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis retombée dans ces horribles accès de tristesse, vous me manquez bien ; tout me manque. Je suis trop seule, car je le suis tout-à-fait. Et plus j’y pense, plus je trouve étrange que je vive encore. C'est si inutile. Et pas un moment de joie, il n’y en a plus pour moi sur la terre. Vous avez beaucoup souffert mais vous n'avez jamais connu comme moi l'abandon. Il vous est toujours resté une famille, des amis. Dites-moi ce qui me reste ? Ma vie aujourd'hui, c'est ma journée Concevez-vous rien de plus humiliant ? Et cette journée comme je l'achète pénible ment. Et quand des hasards m'enlèvent les pauvres ressources que j’ai à Paris ; quand des visites manquées me font trouver une journée toute entière, sans une seule distraction d’esprit, alors cette cause, si insignifiante en elle-même me semble combler la mesure de mes infortunes, et je suis si près , si près du désespoir ! Croyez-moi, on ne sait bien juger une situation que lorsque on l'a éprouvée soi- même. Vous ne savez donc pas tout ce que je souffre, tout ce que je pense.
Vous ne me parlez pas de votre mère. Elle a dû être bien affectée de la mort de madame de Broglie. Encore une fois dites-moi, dites-moi comment il n’y a pas eu de prêtre. Savez-vous que cela me parait horrible. Et l'horrible idée d’économie qui se présente naturellement me fait frémir. Est-il possible ? Et cependant, quelle autre raison ? Comment avez-vous laissé faire cela ?
Le temps est charmant, cela ne me fait rien du tout. Je suis faible, mes jambes le sont surtout. On me défend de monter les escaliers. Quand je sors, je suis bien longtemps à remonter le mien qui est bien raide. Je ne veux pas me pousser cependant de retourner à la Terrasse. Le jardin est une ressource ; il y a plus d'air ici. Le bois de Boulogne est plus près. Enfin l'habitude est prise, & j'aime assez faire comme la veille, quand même la veille ne m'offre rien. Adieu. Adieu, j’attends toujours vos lettres avec une vive impatience. Adieu.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Santé (Dorothée)
146. Val-Richer, Lundi 1er octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mad. de Broglie est morte samedi matin. Mardi matin son mari a réuni, selon l’usage, dans la bibliothèque, toute la famille, maîtres et gens, s’est assis dans le fauteuil de sa femme, a ouvert l’évangile à la page où on était resté quand elle était là, et a fait à sa place, comme elle, la lecture et la prière. Il en fait autant tous les jours. Le culte domestique était l’habitude de le maison. Personne n’est protestant dans le village dans le pays. Mad. de Broglie, avait découvert à grand peine deux ou trois suisses ou allemands qu’elle faisait venir au château. Le curé du lieu, prêtre exact et respectable est d’un esprit court, étroit et fanatique. Il surveillait avec inquiétude Mad. de Broglie, et ne doutait pas qu’au fond, elle ne travaillât à rendre tout le pays protestant. Jamais un Ministre, un sermon, une prière de couleur protestante n’est sortie de l’intérieur du château. Tout s’y renfermait. Un prêtre protestant venu de Paris, parlant et priant au milieu de cette population toute catholique, dans ce cimetière catholiquement béni à deux pas de la petite enceinte réservée, en droit cela se pouvait; en fait cela se fût passé très paisiblement ; la population eût écouté avec approbation et respect, mais pour les dévots du lieu, pour le clergé, le trouble eût été grand. Je ne sais ce qu’ils auraient dit. On n’a pas pensé à tout cela, pas du tout. Mais on a agi sous l’influence de ces faits là. On s’est conduit selon les habitudes. La religion s’est renfermée dans la maison. On a prié, en famille, auprès du lit de mort; on a prié pour elle comme elle eût prié elle-même, comme si elle eût pu entendre. Je suis persuadée que l’idée n’est pas venue de faire autrement. Elle m’est venue à moi, et je vous l’ai dit. Mais je me suis expliqué qu’elle ne fût pas venue aux autres, et je vous l’explique comme à moi-même. Soyez sûre que c’est la vérité, et que le duc a le cœur parfaitement tranquille, qu’il croit sa femme bien et dûment reçue au sein de Dieu qu’il n’a pas cessé un instant d’être en rapport pieux avec elle. Il n’est pas léger du tout, ni d’esprit, ni de cœur.
Je ne veux pas que vous soyez blessée. Je veux que vous compreniez ce qui mérite d’être compris de vous. Mais je vous aime de votre impression, de votre colère, de votre franchise. Restez comme vous êtes et dites-moi toujours tout. Même vos intrigues politiques, quand vous en ferez. Je serais très choqué que vous en fissiez sans moi. Je vous dirai les deux ou trois petites choses qui, peut-être ont pu donner prétexte à ces ridicules commérages. A force de regarder où il n’y a rien, on finit par découvrir je ne sais qu’elle ombre qu’avec beaucoup de bonne volonté quelque passant curieux, léger, malveillant, bête, a pu transformer en un corps. Je suis persuadé qu’il n’y a rien de plus.
Je parie que le redoublement d’humeur contre l’Empereur vient de Munich. Il y est resté longtemps. Les grandes Duchesses aînées sont venues à Weymar, de là à Berlin. Le Prince Royal de Bavière y va. Il y aura là une entrevue, puis un mariage. Celui qu’on recherchait d’ici est manqué. L’Empereur aura dit et fait, à ce sujet, beaucoup de choses désagréables, offensantes. Voilà, ma conjecture. Je n’ai jamais cru que les grandes Duchesses fussent sérieusement laissées à Pétersbourg. On n’a pas voulu qu’elles vinssent, du premier saut chercher elles-mêmes des maris. On a ménagé les convenances. Mais on a cherché, les maris pour elles. Et puis elles sont venues. Et puis, et puis... Je suis fâché de deux choses ; que notre mariage soit manqué, s’il l’est et qu’il vous vienne de là quelque ennui. Mais j’espère que ce ne sera rien.
9 h. 1/2.
Ma mère est bien depuis deux jours. Elle m’appelle pour aller voir je ne sais quoi dans le jardin. Je sors avec elle autant que cela lui plait, Adieu. Adieu. Les Débats que je viens d’ouvrir ne guériront pas le chagrin de M. de Pahlen. Adieu. G.
147. Paris, Vendredi 28 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Après une longue promenade au bois de Boulogne avec Lady Granville, nous avons trouvé mon Ambassadeur qui m’attendait à ma porte. J’ai vu à son visage qu'il avait à me parler ; j’ai laissé aller Lady Granville et j’ai pris le bras de M. de Pahlen. Un vrai militaire il est allé à l’assaut tout de suite et m’a demandé si j’avais écrit à Thiers ? Non, et pourquoi cette question. " parce qu’on tient sur vous mille propos ; on dit que vous êtes avec lui en correspondance, que vous intriguez entre lui, M. Guizot, M. Berryer. On prépare un article contre vous dans un journal, et tout cela vient du ministère. " Il est très difficile de comprendre clairement Pahlen, il est de même un peu difficile de se faire bien comprendre de lui. D'ailleurs, il avait mille réticences, et à tout instant, " un nom de Dieu, ne parlez de ceci à personne " ; je l’ai calmé, rassuré, cela me parait très facile, car rien n’est plus inoffensif que ma conduite, mais cependant je ne saurais être indifférente à l'usage qu'on peut faire de mauvais commérages sur mon compte, et je viens d'écrire à M. Molé pour le prier de me donner un moment d'entretien.
J’ai voulu vous dire tout cela puisque je vous dis tout. Serait-ce une intrigue Cosaque pour me faire fuir Paris ? Il faut que l’invention vienne de loin puis que c’est tellement invention qu'il n'y a pas le premier mot de vrai. J’avais eu un moment l'envie de demander à Thiers de ses nouvelles, tout bêtement. Je ne l’ai pas fait, et j'en suis bien aise Il y a 6 semaines que je n’ai vu Berryer. Je suis très curieuse de savoir sur quoi on peut bâtir sur mon compte quelque chose qui sorte de la routine la plus innocente. J’ai vu beaucoup de monde hier au soir, cela devient un peu trop nombreux. Il faudra reprendre mon ancienne manière. Le duc de Noailles est venu. C’était comme il dit, le seul étranger, parce que le rôle était tout le reste de l’Europe.
J'ai reçu ce matin une lettre de mon mari de Potsdam ; je n’ai à relever dans cette lettre que les deux choses-ci. N°2 placé en haut, ce qui veut dire qu’une nouvelle ère a commencé à Weymar, & l’indication de Munich pour ma première lettre après quoi il veut me donner un nouvel avis. Le reste est des détails sur la famille impériale. Les grandes duchesses embellies. Les cantonnements à Potsdam des bêtises. Voici cette lettre de Lady Clauricarde que vous voulez absolument. Voici aussi celle de Lord Aberdeen. Brûlez la première et renvoyez moi la seconde, parce qu'il faut que j’y réponde. Adieu. Adieu, je suis un peu pressée. J’ai quelques courses à faire, & encore. à écrire. Adieu bien tendrement.
147. Val-Richer, Mardi 2 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’avais hier la migraine. Je me suis mis dans mon lit à 9 heures, et j’ai dormi d’un trait jusqu’à 6 heures ce matin. Connaissez-vous les longs sommeils uniformes immobiles ? Je ne sache rien de plus réparateur. Le trouble de votre Ambassadeur me fâche. Je serais fâché pour vous qu’il quittât Paris. Mais il ne s’y décidera pas si vite. Il s’y plait, il y arrangé ses affaires. Tout galant homme et tout impatient des contrariétés qu’il est, il tergiversera longtemps avant de chercher sérieusement à se faire rappeler. Aussi, je ne m’en inquiète pas sérieusement. Si ces dîners ne vous fatiguent pas trop j’en suis bien aise. J’ai votre solitude sur le cœur. Qu’à donc Lady Granville ! Je ne veux pas qu’elle soit malade. Sir George Villers est-il pour longtemps à Paris ? Je l’y retrouverais volontiers. Je le connais fort peu. Nous nous sommes à peine rencontrés à l’ambassade d’Angleterre ou chez le Duc de Broglie. Un homme d’esprit de plus est toujours une découverte. Sa conduite en Espagne ne m’a pas beaucoup convenu. Il m’a paru léger et brouillon et plus révolutionnaire qu’il n’y était obligé. Du reste, j’apprends tous les jours à ne pas juger les gens que je ne connais pas. Il ne faut voir les hommes de loin qu’en masse. Les personnes veulent être vues de près.
Avez-vous jamais entendu dire que Lord Holland, l’ancien, le père du grand M. Fox mettait son fils petit garçon sur une table et lui disait : " Allons, tu vas être pendu. Le peuple est là, furieux autour de toi. Parle-lui ; défends-toi, c’est à toi de sauver ta vie. " Et il écoutait les discours de l’enfant au peuple.
J’apprends aussi à mes enfants à faire des discours, mais moins tragiques. Le jeu du soir depuis trois jours est de donner un mot. Celui à qui on le donne est obligé de le placer dans un speech, un récit, et il faut que les autres, le devinent. Ce qu’il y a de plaisant, c’est que les improvisations des plus petits de Guillaume entre autres, sont les meilleures. Henriette veut faire trop bien. Cette pauvre Mad. de Broglie avait un grand talent pour amuser les enfants, le soir à des bêtises. Elle y apportait toute sorte de bonté d’invention et de grâce.
9 heures
Vous me demandez, si vous ajoutez à ma tristesse. J’ai un grand défaut. Je ne sais pas me figurer ceux que j’aime autrement que je ne les vois au moment où je les vois. Leur disposition, leur impression actuelle a pour moi tant d’importance, me préoccupe si vivement que j’oublie absolument qu’elle peut changer, quelle changera. Elle m’apparaît permanente, unique, et j’en ressens l’effet en conséquence. Vous m’avez écrit N° 146 une lettre si triste que j’en ai eu le cœur navré, abattu. Je vous ai vue toujours dans cet état et toutes choses vaines, et moi-même impuissant pour vous en tirer de là mon redoublement de tristesse. Et quand vous êtes mieux, quand vos lettres sont plus sereines, plus animées, la même chose m’arrive ; j’en jouis avec un abandon d’enfant ; je ne vous vois plus qu’avec cette physionomie si vivante, si simplement, allègrement, si profondément vivante, qui m’a si souvent charmé’en vous. Et j’oublie que le mal peut revenir, qu’il reviendra. Et quand il me revient, il m’étonne, il me consterne comme si j’en faisais la découverte. Ainsi nous avons l’un et l’autre notre façon de préoccupation imprévoyante exclusive. Tâchons de nous y accoutumer, l’un et l’autre. dans une telle intimité d’ailleurs, il faut tout accepter, se faire et même se plaire à tout, les bons et les mauvais moments, les qualités et les défauts, in health and in sickness, for better and for worse, n’est-ce pas ?
10 h. 1/2
Je suis bien aise de savoir quel jour vous retournez à la Terrasse. Adieu., Adieu. Vous avez raison de mettre bien les un avec les autres. Vous avez le génie des bons commérages. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Discours du for intérieur, Vie familiale (François)
148. Paris, Samedi 29 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Comment, on n’a pas eu le temps ? ou bien, on n’y a pas pensé. Quand il s'agit d'une dernière prière sur la tombe d'un chrétien, & d’une femme qu'on aime ! Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais il n'y a que des Français capables de cela. Et vous, vous-même c’est bien légèrement que vous me donnez ces excuses. Savez-vous que cela me blesse, savez-vous que moi, moi étrangère, arrivée, là à la dernière heure j’aurais demandé à M. de Broglie à genoux d’attendre qu’un ministre de Dieu vient bénir la dépouille de sa pauvre femme. Ah dans mon froid pays, dans ce pays barbare, c’est un prêtre qui recevra tout ce qui reste de moi. Est-ce que je vous dis des choses dures ? Pardonnez moi, pardonnez ce que Lady Granville appelle vingt fois le jour, ma funeste franchise. Vous ne me referez pas. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Comment M. de Broglie pourra-t-il jamais avoir un moment de tranquillité ?
M. Molé est venu hier chez moi en sortant du Conseil. Il est convenu qu’il y avait sur mon compte mille mauvais rapportages. Berryer était sur le premier plan de la Reine ! Imaginez ! Vous qui savez ce que j’en fais. Le gros de l’affaire est que mon salon est le rendez-vous des adversaires du gouvernement. Enfin on veut me faire passer pour une archi intrigante. Vraiment c’est trop absurde. M. Molé a été parfait, il dit que lui et le Roi me défendent, mais qu’on est très exalté contre la Russie, & qu'il n’y a pas moyen de faire comprendre que moi je ne suis pas un émissaire chargé de susciter d'embarras au pouvoir existant. Voilà qui est trop fort. Je voudrais en rire, mais c’est difficile. M. Molé dit qu'il a arrêté déjà des articles qui devaient paraître contre moi qu'il y veillera encore, mais il ne répond de rien cependant. J’ai dit tout ce qui était convenable et tout ce qui était vrai. Je n'ai à m’amuser que d'une intimité ; c'est avec vous. Alors il y a eu une grande exclamation. " Oh pour celui-là. c’est tout autre chose, un homme que nous estimons & respectons tous. " Il a dit de vous mille biens et dans le meilleur langage. Mais excepté vous je voudrais bien savoir quels sont donc les Français avec lesquels je conspire ? La police du gouvernement est bien mal informée, et les fonds secrets devraient mieux servir que cela. Au total je ne comprends pas bien sur quoi repose tout ce tripotage, ni de qui j'ai à me garder, mais il me semble que M. Molé est sérieusement désireux de m’épargner tout espèce d'embarras.
Vraiment il ne me manquait plus que cela. Il me parait que l’exaspération contre l’Empereur est arrivée à un haut degré. Il y a quelque chose de nouveau à ce sujet que M. Molé n’a pas voulu me dire, et qui surpasse tout ce qui est jamais venu de mon maître. C'est fort triste. J'ai dîné hier chez Madame Graham avec les Holland, mon ambassadeur M. d’Armin, Fagel, & Villers. Celui-ci est un homme charmant. J’ai peu rencontré d’homme qui m’aient si vite plu. Je cherche à lui faire faire des conquêtes parmi mon entourage, et il faut revenir de tous, car il est en horreur à la sainte alliance.
Hier matin j’ai promené Madame Appony. Le tête à tête n’est pas aussi animé qu’avec Lady Granville. Ce matin votre lettre n'était pas sur la nappe à mon déjeuner, voilà qu’une violente agitation s’est emparée de moi. J’ai vu toutes les catastrophes imaginables et la plus naturelle s'est rencontrée dans un article de journal que j'ai pris en main et où j’ai trouvé qu'il y avait beaucoup de loups aux environs de Caen. Vous aviez été attaquée par un loup, cela ne me sortait pas de la tête, dix minutes après la lettre est venue et j’ai respiré comme si le loup venait de vous lâcher. Ah quelle pauvre tête que la mienne. Mais convenez-vous bien de cela. Un jour passé sans lettre, j'en prendrai la fièvre. Adieu, adieu. Adieu autant d’adieux que vous voudrez.
148. Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.
A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.
J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.
9 heures
Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.
149. Paris, Dimanche 30 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon pauvre Ambassadeur est très préoccupé de l'ensemble de la situation ici. Je l’ai rencontré hier à Auteuil ; il m'a beaucoup entretenu de tous ses chagrins. La maison est le plus gros de tous. Il craint, (& il a raison car M. Molé me l’a confirmé hier à dîner) que M. de Barante n’ait l’ordre de quitter son hôtel à Pétersbourg aussi vite que possible ; dans ce cas, lui Pahlen sortirait immédiatement du sien, et comme il n'y en a aucun à trouver, il ira en hôtel garni, imaginez ! Il prétend que ce qu'il a de mieux à faire c'est de chercher à quitter son poste. J’en serai certainement très fâchée.
A dîner, j’ai eu M. Molé pour voisin comme de coutume. Je n'ai rien appris de nouveau. Il me semble que c’est pour le 20 décembre qu'est fixée l’ouverture des Chambres. Il n’a pas l'air soucieux. Il ne pense pas que la partie raisonnable de l'opposition puisse se montrer hostile, c'est vous sans doute, et en effet sur quoi le seriez-vous ? L'attitude que vous aviez l’année passée à l’époque de l'ouverture sera difficile à reprendre vu ce qui s’est dit à l'occasion des fonds secrets. Mais cependant ce qu'il y aurait de mieux à faire serait de se rapprocher de cette première position plutôt que de continuer dans la seconde. Thiers s'est assez bien tiré de la session, il a senti que la situation était mauvaise. Il s’est effacé ; après en avoir compromis d'autres. Voilà à peu près.
La dépêche télégraphique sur Genève a été démentie par une autre dépêche le lendemain. C’était un faux bruit de voyageur. Le dîner hier était pour Holland, toute l'Angleterre. Je suis restée la dernière jusqu'à 10 heures. Demain je dîne à Suresnes chez les Salomon Rotschild. Jeudi chez Lady Sandwich, vendredi chez Mad. de Castellane. & puis chez les petits Pozzo. Me voilà fort dissipée. Lady Granville est malade ; je ne l’ai pas vu depuis jeudi. Son mari a la goutte. C’est là ce qu’on rapporte des Eaux. Les Palmella me pressent fort d'aller à Versailles, les Holland y vont aussi. Mais je crains la fatigue de voyage ; car c’est une fatigue. Je vous vois triste dans vos lettres, est- ce que moi j'y ajoute ! Il me semble que oui.
Eh quand serons-nous ensemble ! J'ai eu un mot de M. de Broglie hier ; je lui avais écrit le lendemain de son malheur. Adieu. Adieu. Votre pauvre reine me fait bien de la peine ; mais elle a bien dû jouir sur cette terre cependant. Adieu, encore adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Réseau social et politique
149. Val-Richer, Jeudi 4 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai dîné avec vous chez Salomon. Quelle chute que celle de ce nom ? Le plus spirituel, le plus hautain, le plus aristocrate des Rois, celui dont la mémoire est restée en orient à côté de celle d’Alexandre devenu le Turcaret d’une race proscrite et vous racontant, en mauvais allemand, ses joies de parvenu ! Et puis vous avez raison : il y a des joies naturelles, qui restent aux proscrits et qui sont belles et touchantes, même sur la tête des Turcarets les plus ridicules. Et ces joies, qui sont pour tous et toujours bonnes, la Providence les refuse ou les enlève quelques fois à ceux qui les méritent le mieux et qui en jouiraient le plus noblement. Quel mystère que la destinée de chacun de nous, cette impénétrable intention d’une volonté inconnue qui nous conduit à travers les ténèbres, et dans ces ténèbres tantôt nous caresse, tantôt nous frappe, sans que nous puissions ni prévoir ni comprendre le bien ou le mal, la faveur ou le coup ! Quand je suis en bonne disposition, ce sentiment de notre situation à tous, aveugles sous une main cachée, ne m’est point pénible, car je suis soumis et confiant ; je marche la tête haute et le cœur tranquille sans rien voir et sans rien pouvoir. Mais dans les mauvais jours, dans les heures faibles, soit pour moi-même, soit pour ceux que j’aime, je succombe sous ce fardeau sans limite comme je ferme les yeux, je prends ma tête dans mes mains, comme pour me cacher et me soustraire à cette mystérieuse et irrésistible Puissance. Oui vous dites vrai, vous êtes bien seule. Vous êtes faite pour n’être pas seule ; vous avez le cœur très ouvert, très vif pour ces affections et ces joies intimes, de tous les moments, Gnimhich und Gnimhich, qui sont le vrai, le seul bonheur. Et vous êtes bien seule. J’y pense sans cesse.
Laissez-moi vous dire tout ce que je pense. Pour ce bonheur-là comme en toute chose, vous êtes délicate, difficile ; vous ne savez vous contenter de rien de médiocre. Si le médiocre, le commun pouvait vous suffire vous l’auriez, vous l’avez. Il vous reste un mari, des enfants. Vous pourriez, avec ces liens tels quels, avoir un intérieur tel quel, comme tant d’autres. Mais vous n’acceptez pas ce que d’autres acceptent ; vous ne supportez pas ce que d’autres supportent. Vous répudiez ce que d’autres gardent. Vous résistez quand d’autres cèdent. Vous ne consentez jamais à descendre, à vous abaisser à vous mutiler ni dans vos instincts, ni dans vos jugements ni dans vos désirs, ni dans vos plaisirs, ni dans vos douleurs. Ne soyez pas autrement ; n’essayez jamais d’être autrement. C’est votre nature, c’est votre supériorité, si rare et si charmante. Quand vous le voudriez, vous n’y pourriez pas renoncer. Ne le veuillez jamais. Ce serait une abdication, une profanation. Mais c’est là ce qui fait que vous êtes seule. Dites-moi que vous n’êtes pas seule quand vous êtes avec moi. Vous vous le rappelez ; c’est ce que je vous ai promis.
9 h 1/2
J’ai aussi un soleil superbe. Réunissons-nous dans ce soleil qui brille sur tous deux. Je me suis promené hier toute la matinée. J’en ferai autant aujourd’hui, mais à pied et avec mes enfants. J’ai vu Rogers une fois ; mais je ne le connais pas. J’ai vu beaucoup de gens que je ne connais pas. Vous savez que je ne suis pas curieux. Le curiosité ne me vient qu’après autre chose. Je suis curieux de savoir comment sera Marie. Je voudrais bien que vous n’eussiez pas là une tracasserie de plus. Adieu. Le temps marche et me pousse vers vous. Adieu. Adieu. Si je m’en croyais, je ne finirais pas. G.
150. Paris, Lundi 1er octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai eu une longue visite hier du C. Appony et une autre longue de mon ambassadeur. Le premier que j’avais beaucoup engagé à s’approcher de Villiers a fait comme je lui ai dit et était fort content de son entretien avec lui. Il l’a trouvé moins révolutionnaire qu’il ne pensait. De son côté Villers m’a dit qu'il trouvait Appony beaucoup moins carliste qu'on ne lui avait dit. Voilà pour commencer les Anglais me savent gré de la toute petite peine que je prends à rapprocher les gens, je ne le ferais pas si je n’avais vraiment le cœur anglais. Au surplus ceci est du bien pour tout le monde. Je suis fâchée que vous ne connaissiez pas Villiers, il vous plairait surement. M. Molé est enchanté de lui. M. de Pahlen était venu pour déverser encore son spleen. Nous avons regardé sa situation sous toutes ses faces. Nul doute qu’elle ne soit mauvaise. Nous finirons par n’avoir que des chargés d’affaires.
Après ma promenade au bois de Boulogne, j’ai été voir Lord Granville qui est couché sur son canapé en très mauvais état. Sa femme est dans son lit sans voir âme qui vive. Granville était bien content d'un petit moment de causerie avec moi. J’ai dîné seule et le soir mon salon a été rempli de monde, beaucoup trop c’est décidément ennuyeux. La France tout changera tout cela. Mais je n’y passerai que le 10, j’attendrai Marie. A propos, elle ne m écrit pas, je commence à être inquiète. Je lui écris cependant souvent.
On est fort fâché ici, & nous le sommes aussi du traité de commerce conclu entre la Porte et l'Angleterre. Cela va déterminer l'indépendance de l’Egypte et nous regardons cela comme la guerre en Orient. Nous verrons. Voici le mois d'octobre ; c’est-à-dire 6 semaines d’écoulées depuis que je ne vous ai vus. Combien ne passera-t-il encore ? Adieu, adieu. Pensez à moi beaucoup toujours, & tendrement
150. Val-Richer, Vendredi 5 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai mené hier ma mère et mes enfants faire une grande promenade. Nous avons été à St Ouen, ce fameux St Ouen le Paing, dont le nom vous fatiguait tant à écrire. Je ne comprends pas que je ne vous l’aie pas épargné plutôt. Mais notre correspondance essuyait tant d’échecs que je voulais prendre toutes les sûretés possibles. St Ouen est à un quart d’heure du Val- Richer. Mais ma mère marche si lentement que nous avons mis trois quarts d’heure. Mes enfants étaient parfaitement heureux. La joie des enfants est charmante à regarder ; d’autant qu’elle ne fait point d’envie à moi du moins. C’est un bonheur bien complet, bien exempt de regret, d’inquiétude. Mais je n’en voudrais pas, et je ne le regrette pas. Nous faisons comme vous. Nous jouissons avidement des derniers beaux jours. Hier était peut-être le dernier. Ce matin, le vent souffle, le ciel est noir, la pluie va venir. J’entends pourtant des paysans qui chantent à pleine gorge dans la vallée en récoltant leurs pommes. Encore des joies dont je ne voudrais pas.
Ce pauvre, M. de Barante sera presque aussi contrarié que M. de Pahlen. Il le racontera moins. Je comprends toutes les malveillances, toutes les hostilités, pas du tout les maussaderies. On peut se détester et se combattre mais on se salue et on se parle comme si de rien n’était. Viendra-t-il un temps où les gouvernements vivront entr’eux tout à fait en gentlemen, polis et pleins d’égards dans les choses extérieures, et indifférentes, quoiqu’il en soit du fond des choses ? J’en doute : il faudrait supprimer le caprice et l’humeur. La nature humaine ne voudra pas. Vous n’entendez surement pas parler de l’élection du Général Jacqueminot qui doit se faire demain. Ce ne sont pas les affaires de votre monde. Il me revient qu’on en est assez préoccupé. Non qu’on ne la regarde comme assurée, mais l’opposition sera forte, plus forte qu’elle n’ait jamais été. A cette occasion on m’écrit de plusieurs côtés qu’on est frappé du terrain que gagne la gauche, et qu’il se dit assez que, si le Ministère durait, il finirait par lui livrer les affaires.
Je viens de recevoir une lettre de Mad. de Rémusat qui m’a touché. Elle est désolée vraiment désolée de la mort de Mad. de Broglie, avec une vivacité, un abandon d’admiration et de chagrin qui sont rares dans le monde. Il est si froid et si sec ! Il est juste en général, mais de cette justice superficielle et indifférente qui est presque une offense pour des cœurs bien émus. C’est une des choses auxquelles j’ai eu le plus de peine à m’accoutumer. Je l’ai fait pourtant. Je ne puis souffrir de laisser aux indifférents le moindre pouvoir de m’atteindre. M. de Turpin, écrit de Venise à Mad. de Meulan que l’effet de l’armistice est vraiment très grand et que l’Empereur sera vraiment bien reçu. Du reste, Venise se relève, dit-il, non pas seulement pour un jour et par artifice, mais réellement et d’une façon durable. Le port se ranime ; les palais se réparent. Avez-vous jamais lu un peu attentivement l’histoire de Venise ? C’est un gouvernement qui a admirablement compris et exploite deux grands mobiles de ce monde, le secret et le plaisir. On n’a jamais si bien su se taire et s’amuser.
10h
Moi aussi, j’ai mes moments où je vous cherche plus encore que de coutume. Ils reviennent souvent. Vous me manquez immensément. Enfin, nous avançons. N’ayez mal aux nerfs que pour me chercher. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Absence, Décès, Diplomatie, Enfants (Guizot), Politique (France), Vie familiale (François)
151. Paris, Mardi 2 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre explication du redoublement de griefs contre mon Empereur pourrait bien être la vraie. J’y regarderai. Mon Ambassadeur envoie demain un courrier qui sera chargé de bien de soupirs & lamentations. Il perd la tête sur la question de la maison. J’ai couru hier matin les boutiques, j’ai vu ensuite Lady Granville, qui est toujours bien souffrante. J’ai été dîner à Suresnes, j’y ai rencontré l’Autriche, la Russie. La Belgique. M. de Montalivet, quelques autres. Je suis revenue avec M. d’Armin que j’ai pris dans ma voiture afin de ne pas m’endormir. Il a un peu plus d’esprit que d’autres mais pas beaucoup d’esprit. Il parait que la conférence ira. Mais Lord Palmerston n’a pas tout-à-fait satisfait Léopold. M. Molé qui devait être du dîner hier s'est fait excuser à la dernière heure. Mon voisin le maître de la maison m'a beaucoup divertie. D'abord nous avons parlé allemand, et quand un Allemand n’est pas schwarmerische, il est bouffon. Celui-ci est parfaitement, simple, naïf, rond. Il raconte sa misère passée comme sa richesse présente et il tire même un peu plus variété de la première que de la seconde. Et puis il rit de ce que n’étant pas né pour approcher de la société, il y est gauche. Il remarque de ses officiers de maison qui bâtissent les mets : ainsi quand on lui offre des boudins à la Richelieu. " Was ? Der ist ja schon lange todt. " En parlant le français il me dit : le Ministre des intérêts. Et il se reprend, le Ministre des intérieurs. Enfin il m'a fait rire tout le long du dîner, et puis il m’a attendri, en me disant comme il aimait sa femme, comme c’était une brave femme, comment ils passaient leurs soirées ensemble, tête-à-tête jouant à l’écarté jusqu'à 10 heures, & puis ils vont se coucher, à 6 heures il est à son travail. Tout ce tableau d’intérieur, & liebe goth qui arrivait vingt fois au milieu de tout cela m’a fait plaisir, & puis m’a fait soupirer.
Tout le monde est heureux, tout le monde a un intérieur. Moi seule, je n'ai rien. Le dîner au reste m’a rappelé beaucoup de dîners Anglais, où en prenant place, flanquée à droite et à gauche par des ennuyeux, je finissais cependant, par m'accommoder de mon sort, & même par le trouver profitable. Ainsi hier entre Rotschild & Löwenkielm, J’ai su tiré parti de l’un & de l’autre. Le Suédois m’a raconté l’arrivée, & tout le séjour de l'Empereur à Stokholm, et ensuite tout est intérieur de la cour de Suède qui est assez étrange. N’ayant plus rien à tirer de lui je l’ai fait taire. Savez- vous que j'ai l’une et l’autre capacité à me degré très convenable, c'est de faire parler, & de faire taire. Il est vrai que le métier de femme y aide. Les Sutherland arrivent lundi, & mon fils, & Marie & beaucoup d’autres. c’est trop à la fois, la Duchesse de Talleyrand me mande que Marie se porte très bien, qu’elle s’amuse. Elle ne m’écrit pas, elle ne répond pas même à mes lettres, c'est mal. Le temps se soutient, charmant. Adieu, adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Portrait, Réseau social et politique
151. Val-Richer, Samedi 6 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avez-vous eu une raison pour me chercher avant-hier avec plus de tendresse que de coutume ? Avez-vous pensé que j’étais né ce jour-là, il y a 51 ans ? Car nous sommes du même âge. Quand mes enfants sont venus m’embrasser avec leurs gros bouquets et leurs petits ouvrages, vous m’avez manqué, je vous ai cherchée aussi. Nous sommes-nous rencontrés à ce moment ? Je ne suis pas [?] du tout, et je n’aime pas les gens qui le sont, je ne puis souffrir qu’il entre dans le cœur ou qu’il en sorte quelque chose d’affecté et de ridicule. Mais je trouve le monde si froid, si sec ! Vous avez bien raison ; il n’y a point de joie solitaire. Ces mêmes émotions qui, partagées, seraient douces et charmantes retombent sur le cœur isolé et l’oppressent. N’ayez pas mal aux nerfs deares ; que vos genoux ne tremblent pas, que votre vue ne se trouble pas ; mais aimez-moi toujours comme hier et avant-hier.
C’est par courtoisie sans doute que M. Molé destine au Turc, l’hôtel de Pahlen. Il veut que cette maison soit encore un peu Russe. Vous la reprendrez avec Constantinople. Pourquoi M. de Pahlen n’achèterait-il pas l’hôtel d’Hauré ou de Lille ! C’est grand et beau, & toujours à vendre, si je ne me trompe. Quand le comte Appony sera-t-il établi dans sa nouvelle maison ? Voilà une affaire traitée de bonne grâce. A partir de ce matin, je suis tout à fait seul. Mon dernier cousin s’en va et je n’attends plus personne, M. et Mad. Villemain devaient venir, mais ils ne viendront par.
Lisez donc la Littérature de M. Villemain. Il y a vraiment beaucoup d’esprit, de l’esprit sensé et gracieux, ce qui prouve bien, à coup sûr, la distinction de l’âme et du corps. Mais j’oublie que vous n’aimez guère la littérature, même spirituelle. Il vous faut la vie réelle, les personnes. Moi aussi, j’aime infiniment mieux les personnes qui me plaisent que les livres qui me plaisent. Mais beaucoup de personnes ne me plaisent pas, et les livres me distraient de celles-là. Henriette aime beaucoup les livres et j’en suis charmé. C’est une immense ressource pour une femme que le goût de l’étude. Elle lit avec le même ravissement le Voyage du jeune Anacharsis et Macbeth. C’est un esprit bien sain, en qui toutes les facultés, tous les goûts se développent dans une rare harmonie. Si vous aviez été ici à la campagne, avec moi, en mesure de jouir ensemble des œuvres de l’art comme de celles de la nature, je vous aurais montré avant-hier sa traduction, à elle seule, bien réellement seule, d’un fragment du Lay of the last Minstrel, et vous auriez trouvé que pour un enfant de neuf ans, l’intelligence était assez vive et l’expression heureuse. A propos de mes enfants, je vous conte mes propres enfantillages. Je ne les conte à nul autre.
M. de Broglie était encore avant-hier sans nouvelles de sa fille. Je suis impatient qu’elle l’ait rejoint. Il ne faut pas toucher souvent aux plaies. Dites-moi, s’il a vu les Granville. Je suppose que non, puisque Lord Granville ne peut pas sortir. Il me tarde que vous soyez rentrée en possession de Lady Granville. Sans elle vous me faites l’effet d’une personne à qui son dîner manque. J’espère que vous garderez Alexandre au moins quelques jours. 9 h. 1/2 Non, vous ne serez plus seule. J’en ai besoin pour moi, encore plus que pour vous. Adieu, adieu. Je vais marquer des place où je veux plantés des arbres. Le mélèze que vous savez, qui voulait me suivre, se porte à merveille. J’en vais planter d’autres. Aucun ne le vaudra. Adieu. Adieu. G.
152. Paris, Mercredi 3 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'écris aujourd’hui à mon frère par un courrier de Pahlen. Votre gouvernement en a envoyé un à M. de Barante avant- hier, je crois entre autre pour lui prescrire de sortir de l'hôtel aussi tôt que possible. Cela sera le signal de la sortie de Pahlen, de la maison qu'il occupe, il s’en va contant à tout le monde ces douleurs, & dans un désespoir comique.
J’ai fait visite à Auteuil hier matin ; on dit qu'on ne sait pas encore le départ de Louis Bonaparte de Suisse et que cela tracasse un peu ici. Le soir, j’ai été voir les Granville malades. Il est couché, immobile. Elle va un peu mieux tous les jours.
Il arrive de normaux anglais qui passent. Je les vois, je ne vous les nomme pas, vous ne les connaissez pas du tout. Alava est venu me voir aussi, il a bonne mine. Il va à Londres dans quinze jours. Les Holland sont à Versailles, ils y ont mené aussi le poète Rogers. Vous le connaissez sans doute ?
Le soleil est superbe, je ne me lasse pas de profiter de ces derniers beaux jours. Je me promène encore le soir en voiture ouverte. Je m’enrhume, je me dé-rhume tout cela est égal, il me faut de l'air. Le petit Sneyd va partir pour l’Italie j'en suis très fâchée, car je l’ai fort à mes ordres. Ainsi quand il n'y a rien de mieux, je le prends dans ma calèche et il se laisse toujours prendre.
Marie m’a enfin écrit. Elle se dit parfaitement remise, & arrive samedi. Nous verrons. L’Empereur le prolonge un peu à Berlin. Il veut retourner chez lui par mer. Quelle idée dans cette saison et après que ses filles ont failli périr. Je suis bien aise d’apprendre que votre mère est bien. Adieu, je cherche si j’ai quelque chose à vous dire. Je ne trouve rien qu'une quantité d’adieux.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Réseau social et politique
152. Val-Richer, Dimanche 7 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le soleil est plus paresseux que moi. Il est vrai que la nuit, pendant que je dors, il va servir ailleurs. J’ai bien dormi cette nuit. Depuis quelque temps, cela ne m’arrive pas toujours. Il y a longtemps que vous ne m’avez parlé de votre sommeil ; est-il un peu revenu ?
Je comprends votre impression toutes les fois que vous voyez des gens qui vivent ensemble, des gens heureux. comme vous dîtes. Etes-vous sûre qu’ils soient heureux, heureux de vivre ensemble ? Le bonheur à certaines conditions naturelles, générales ; quand on les rencontre on présume qu’il est là ; un mari, des enfants, un intérieur. Les conditions mentent et le bonheur est rare partout, chez les blanchisseurs comme chez les Ambassadeurs. J’aurais été un peu surpris de voir entrer ici Humboldt et Arago. Surpris parce que le monde le veut ainsi, car je trouve absurde, comme vous, qu’on haïsse et qu’on fuie un homme à cause de sa politique. Ce devrait être comme la guerre ; on se tue sur le champ de bataille ; hors de là, on parle bien les uns des autres, et on dîne ensemble. J’ai beaucoup dîné avec M. Arago chez Mad de Rumford. Il a de l’esprit, un esprit actif et brutal, et le plus vaniteux des hommes. Il avait une femme aimable et sensée qui contenait ses défauts et adoucissait son humeur. Depuis qu’il l’a perdue, il a fait et dit beaucoup de sottises.
On me dit qu’on est fort occupé dans le Cabinet et au dessus, de ce que fera le Duc de Broglie. Son malheur l’éloignera-t-il des affaires ? On assure que oui qu’il ne se souciera plus de rien, que c’est une retraite morale. On le plaint beaucoup, mais on l’approuve. Vous est-il revenu quelque chose de ces prédictions-là ? Elles diffèrent beaucoup de la vôtre. Vous y êtes moins intéressée.
Prenez-vous quelque intérêt à la politique des Etats-Unis ? J’y pense beaucoup. Je lis Washington. J’ai promis de surveiller la publication de ses écrits en France. Je ferai son portrait comme Brougham, probablement un peu moins vite. A cette occasion on m’écrit et on me parle souvent de ce monde-là, qui deviendra grand quoiqu’il arrive. Vous avez bien raison, en Russie de vous soigner de ce côté. La bonne politique, s’y relève un peu. Du moins la mauvaise s’y décrie. On s’aperçoit que le suffrage universel n’est pas le remède universel. L’aristocratie revient sur l’eau. Elle aura bien de la peine à s’y tenir. Tout le monde a peine à s’y tenir aujourd’hui. C’est le mal du temps. Je serais assez aise de savoir ce que pensera de l’Amérique le ministre Autrichien, M. Marchal. C’est un homme d’esprit.
9 h. 1/2
Ma lettre aussi sera courte. Le Dimanche est mon jour de visites. On me dit qu’il y en a déjà deux qui m’attendent dans le salon. C’est de bonne heure. Adieu. Je suis bien aise de vous savoir à la Terrasse. Mais dormez-y. Adieu. Adieu en attendant. G.
153. Paris, Jeudi 4 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a des jours, il y a des moments, où ma pensée vous cherche avec plus de tendresse que dans d’autres moments. Ainsi hier, j’ai été plus occupée de vous que de coutume. Vous n'êtes pas là pour que je vous le dise. Je n’ai pas là une plume & du papier pour vous l’écrire & voilà comment ces impressions si vives pour moi sont perdues pour vous. Il faut être ensemble, toujours ensemble, rien n’est perdu alors. J'ai fait par un temps charmant une promenade charmante hier, mais j’étais seule, toute seule. C’est bien triste !
J’ai admiré dans les bois ces innombrables toiles d'araignée, ce merveilleux travail. Mais l’araignée est seule aussi au milieu de cet admirable tissus. Elle me parait bien égoïste, et bien orgueilleuse, c’est qu’il lui plait d'être seule. Moi cela ne me plaît pas du tout, aussi n'ai-je aucun de ces sentiments. Que je serais heureuse d'habiter la campagne. Je l’ai désiré toute ma vie. La plus imperceptible des merveilles de la nature est pour moi un sujet inépuisable d’admiration & de ravissement, mais il me faut à qui le dire. Avec vous quel bonheur que la campagne !
J’ai dîné hier chez Lady Granville, avec mes Anglais bonnes gens mais que vous ne connaissez pas. Lord Granville n’a pas dîné avec nous. Je l'ai vu après. Il est faible & malade. Je le crois en mauvais état. J’ai fait plus tard une courte visite à Madame de Castellane. J’y ai trouvé M. et Mme Deleferst. M. Molé y est venu plus tard. Il destine l'hôtel de Pahlen au Turc qui vient d'arriver. Il a mandé à M. de Barante comme avis privé, qu’il serait de bon goût qu'il quittât l’hôtel de l’ambassade immédiatement fût ce pour aller provisoirement dans une auberge. Je ne puis pas m’empêcher de trouver que M. Molé a raison.
Le 28 sept. Louis Bonaparte n’avait pas encore quitter Aremberg. Il ne parvient pas à avoir de passeport. Le ministre de Prusse les lui a refusés parce qu’il ne dit pas par où il passe. Cela me parait une querelle d’Allemand. On espère que c’est en Toscane qu'il va se rendre. En attendant l’affaire Suisse n’est pas fini.
Je griffonne horriblement aujourd’hui. C'est que j’ai les nerfs bien mal arrangés & les genoux tremblants. Je ne sais de quoi ma vue est trouble aussi. Je lis Sully et je l'aime comme vous. J’ai toujours eu une vraie passion pour Henry IV. L’espèce est perdue.
Adieu, car je n’ai pas la forme de continuer. Je ne sais ce que j'ai. Mais je vous aime bien, comme hier. Adieu.
153. Val-Richer, Lundi 8 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me souviens qu’hier, étourdiment je vous ai encore adressé ma lettre aux Champs Elysées. Elle vous sera peut-être arrivée quelques heures plus tard.
Je suis fâché de ce que mande M. de Médem, plus fâché que surpris. Il m’a toujours paru, par ses lettres que votre frère était réellement blessé de votre peu de goût pour la Russie. C’est bien lui qui sincèrement ne conçoit pas que vous ne préfériez pas à tout, votre état de grande Dame auprès du grand Empereur dans le grand pays. M. de Lieven est encore plus soumis, pour parler convenablement mais moins russe et vous comprend mieux. Rien n’est pire que l’humeur sincère d’un honnête homme de peu d’esprit. Il se croit fondé en raison, et ce qu’il y a de plus intraitable, c’est la conviction qu’on a raison. M. de Médem aura peut-être choqué encore votre frère en lui répétant que, bien réellement, avec votre santé, vos habitudes, vos goûts, vous ne pouviez vivre ailleurs qu’à Londres ou à Paris. Les gens d’esprit vont quelque fois trop brutalement au fait. Enfin je raisonne, je cherche, je voudrais tout savoir et tout expliquer, tant cela intéresse. Je voudrais surtout que vous eussiez auprès de l’Empereur quelqu’un de bienveillant et d’intelligent, qui vous comprît, et vous fît comprendre. Je crois toujours qu’avec de l’esprit de la bonne volonté et du temps on peut beaucoup, quand on est toujours là. M. de Nesselrode et Matonchewitz, à ce qu’il me semble y seraient seuls propres. Mais l’un est trop affairé, l’autre trop petit, et ni l’un ni l’autre ne s’en soucie assez. Je suppose que vous avez répondu à votre mari.
Montrond a passé en effet son temps chez Thiers. Je suis curieux de ce qu’il y a porté et de ce qu’il en a rapporté, au moins de ce qu’il en dit. Je le verrai à mon retour. Il a vraiment de l’esprit, de l’esprit efficace. Il faut beaucoup pour qu’il rajeunisse un peu. Il était cruellement cassé.
8 h 1/2
Je viens de sortir pour aller voir mes ouvriers. Je plante des arbres. Nous avons depuis huit jours un temps admirable. Ma mère et mes enfants en profitent beaucoup dix fois dans le jour, je les envoie, au grand air, comme on envoie les chevaux à l’herbe. Nous nous promenons ensemble après déjeuner. Le matin, tout à l’heure j’assiste au premier déjeuner de mes enfants, chez ma mère. Trois fois par semaine ; ils viennent chez moi tout de suite après prendre une leçon d’arithmétique. Le soir de 9 heures et demie à 8h 1/2, je leur lis de vieilles Chroniques sur les croisades, qui les amusent extrêmement. Le reste du temps, je suis dans mon cabinet ou je me promène pour mon compte.
Quel est donc le mal de la Princesse Marie ? Quel qu’il soit, j’en suis fâché, et j’espère que ce n’est pas vraiment grave. Elle a de l’esprit. J’ai quelque fois causé avec elle tout -à-fait agréablement. Je m’intéresse à elle comme à une personne en qui on a entrevu en passant plus que le monde n’y verra, et qu’elle-même ne saura très probablement.
J’ai eu hier beaucoup de visites. On se hâte de venir me voir. J’aurai d’ici à quinze jours, quelques dîners à Lisieux private dinners, pas de banquet. Je n’en veux pas cette année Je l’ai dit à mes amis et ils l’ont fort bien compris. Je ne veux pas parler politique avant la Chambre.
10 h.
Le facteur m’arrive au milieu de ma leçon d’arithmétique. Je reçois des nouvelles de l’arrivée de Mad. d’Haussonville. Je veux écrire un mot à M. de Broglie. Adieu. Adieu, comme à la Terrasse, dans ses meilleurs jours. G.
154. Paris, Vendredi 5 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Oui, vous avez-raison, je sais trop peu accepter ce que la Providence me destine seulement quand je vois des gens heureux qui souvent le sentent si peu ; quand je sens qu’avec cela, justement cela, je jouirais si intimement si profondément de mon bonheur. Quand l’aspect du ménage le plus obscur. Tenez hier, de pauvres gens, un mari, une femme, cette femme portant son enfant sur les bras, & le mari portant un panier recouvert d'une toile, je crois que c’était une blanchisseuse, quand cela frappe ma vue, quand partout je vois des êtres vivant ensemble, et que je me regarde et que je suis seule, moi qui ai si besoin d'être aimée, d'être soutenue. Je sens mon cœur se briser. Je n’offense pas Dieu en l’accusant. Je m’accuse moi, je m’accuse beaucoup, de tout, même de mes malheurs. Ah si vous saviez tout ce qu’il y a dans mon âme ! Mais je vous en parle trop. Venez, je ne vous en parlerai plus ; & comme vous dites, & comme je le sens, oui je ne serai plus seule.
J’ai vu Lady Granville longtemps hier matin. Après elle, j’ai vu le bois de Boulogne, et puis un dîner fort gai et agréable chez Lady Sandwich mais que nous avons attendu jusqu'à près de huit heures. C’est trop anglais ! Il y avait la petite princesse, les Holland, mon Ambassadeur. Il est tous les jours plus malheureux, & je crois que cela va devenir de la folie. En sortant de table, je suis rentrée chez moi. Il m’est venu beaucoup de monde, surtout des Anglais, entre autres Lady Browlon qui sous le dernier règne avait assez d’influence. Le Roi et la Reine l’aimaient fort.
Humboldt serait allé vous voir au Val-Richer, s’il n'avait eu M. Arago pour compagnon de voyage. Alava a bavardé sans que personne ne l’écoute. Villers me plaît parfaitement, mais il part après demain. Le soleil est parti, & je sens que la Terrasse vaudra mieux que ceci. J’y serai surement la semaine prochaine. Lady Holland en est très pressée, parce que ni elle, ni son mari ne peuvent monter mon escalier ici. Ils ont été à Versailles & ils en sont revenus ravis. Mais ils avaient bien autant, d'injures à dire sur l'Auberge où on leur a donné deux fois de suite la même nappe à dîner, que d'éloges à faire des galeries. Il est bien vrai que pour des Anglais les habitudes ici sont intolérables. Le petit Suisse part la semaine prochaine et j’en suis fâchée. Adieu. Adieu, comme vous me le dites. Adieu
154. Val-Richer, Lundi 8 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Connaissez-vous quelqu’un qui connaisse Mad. de Pontalba ? Le Duc de Palmella la voit-il ? Je voudrais simplement qu’on lui dit qu’elle aura si elle veut le château et la terre de Rosny pour quatre millions, qu’il y a 120, 000 livres de rente bien assurés, en bois, et que le propriétaire actuel. M. Labbey, est un galant homme avec qui on peut traiter en toute confiance. Il est normand et de mes amis. Je serais bien aise de lui rendre le petit service que ces paroles là revinssent à Mad. de Pontalba. Si vous avez quelqu’un sous la main, vous serez bien aimable d’y penser.
Mad. de Talleyrand est donc aussi revenue à Paris. Où en est son procès ? Le Duc de Valencay est très bon pour en faire les honneurs à Marie ! Il me revient qu’un ou deux mariages ont encore manqué pour Pauline. Mad. d’Haussonville est venue de Florence à Genève sachant le danger de sa mère, mais rien de plus. C’est à Genève seulement quelle a appris son malheur. Elle a les nerfs très douloureusement affectés. Le petit Paul de Broglie a été un peu malade, d’un fort rhume. Le Duc aussi a eu de la fièvre et un mal de gorge auquel on a fait quelque attention. Il est bien physiquement. Je suis rentré dans mon cabinet pour être avec vous. J’avais besoin de vous. Mais cette façon d’être avec vous me contente si peu que je vous quitte. Il est huit heures et demie. A cette heure-là, j’irai à la Terrasse. Cela vaudra infiniment mieux.
10 heures
Je reviens de chez ma mère. Je veux vous dire adieu avant de me coucher. Êtes-vous longtemps à vous coucher ? Quand j’ai le cœur bien disposé, quand mes pensées me plaisent je suis fort longtemps ; je m’assois devant mon feu, je me promène dans ma Chambre ; j’y jouis d’être seul, bien seul, distrait par rien. Quand je ne me plais pas, je suis déshabillé et couché en cinq minutes. Au fait, c’est une vie beaucoup plus saine de se coucher et de se lever de bonne heure. Je crois aux harmonies naturelles. Certainement la nuit a été faite pour dormir. Oui, vous jouiriez beaucoup de la campagne. Vous êtes faites pour jouir de tout, mais surtout de ce qui est simple et grand à la fois. Il n’y a guère que deux choses où ces deux mérites-là se réunissent, la belle nature, et une belle âme. Adieu. Je vais dire bonsoir à M. Saint et me coucher. Adieu.
Mardi, 9 h. 1/2
Oui sans doute de 10 heures à 3 c’est trop peu. N’avez-vous jamais essayé de boire le soir en vous couchant quelque chose de calmant ? Je n’ai jamais vu personne qu’il fût plus difficile de faire un peu sortir de ses habitudes. Ce que vous n’avez pas fait autrefois vous semble impossible, presque étrange. Vous dormiez autrefois. Vos nouvelles du Duc de Broglie sont d’accord avec les miennes. Pauvre homme ! Mais M. Decazes aime les commérages enflés. C’est de son cabinet qu’il ne sort pas. L’arrivée de sa fille lui sera bonne. Il l’attendait avec une grande anxiété. Je suis curieux de la visite de Matonchewitz. Je ne me doutais pas qu’il fût, si près quand je vous parlais hier de lui. Puisque le Pacha d’Egypte s’est soumis, il n’aura à vous parler que de vos propres affaires. Votre diplomatie de second rang me parait bien voyageante, comme votre Empereur. Adieu. Je m’impatiente beaucoup. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Décès, Discours du for intérieur, Réseau social et politique, Santé (Dorothée)